 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004
George SOROS,
ou la "conscience" du Monde
Par Heather Cottin
(http://www.artel.co.yu)
« OUI, J’AI UNE POLITIQUE ETRANGERE : MON OBJECTIF EST DE DEVENIR LA CONSCIENCE DU MONDE. »
Il ne s’agit nullement d’un cas de trouble narcissique de la personnalité; voici, en fait, comment George Soros applique aujourd’hui le pouvoir de l’hégémonie des Etats-Unis dans le monde. Les institutions de Soros et ses machinations financières sont en partie responsables de la destruction du socialisme en Europe de l’Est et dans l’ancienne URSS. Il a également jeté son dévolu sur la Chine. Il a également fait partie de toute cette entreprise d’opérations en tous genres qui ont abouti au démantèlement de la Yougoslavie. Alors qu’il se donne du philanthrope, le rôle du milliardaire George Soros consiste à resserrer la mainmise idéologique de la globalisation et du nouvel ordre mondial tout en assurant la promotion de son propre profit financier. Les opérations commerciales et « philanthropiques » de Soros sont clandestines, contradictoires et coactives. Et, pour ce qui est de ses activités économiques, lui-même admet qu’il n’a pas de conscience, en capitaliste fonctionnant avec une amoralité absolue.
SON GOUROU ? SIR KARL POPPER, THéORICIEN DE LA “SOCIéTé OUVERTE”
En maître d’œuvre du nouveau secteur de la corruption qui trompe systématiquement le monde, il se fraie un chemin jusqu’aux hommes d’Etat planétaires et ils lui répondent. Il a été proche de Henry Kissinger, de Vaclav Havel et du général polonais Wojciech Jaruzelski.(2) Il soutient le dalaï-lama, dont l’institut est installé au Presidio, à San Francisco, lequel Presidio héberge également, entre autres, la fondation dirigée par l’ami de Soros, l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev.(3) Soros est une figure de pointe du Conseil des Relations extérieures, du Forum économique mondial et de Human Rights Watch (HRW). En 1994, après une rencontre avec son gourou philosophique, Sir Karl Popper, Soros ordonnait à ses sociétés de se mettre à investir dans les communications en Europe centrale et de l’Est.
L’administration fédérale de la radio et télévision de la République tchèque a accepté son offre de eprendre et de financer les archives de Radio Free Europe. Soros a transféré ces archives à Prague et a dépensé plus de 15 millions de dollars pour leur entretien.(4)
Conjointement avec les Etats-Unis, une fondation Soros dirige aujourd’hui Radio Free Europe/Radio Liberty, laquelle a étendu ses ramifications au Caucase et en Asie.(5) Soros est le fondateur et le financier de l’Open Society Institute. Il a créé et entretient le Groupe international de Crise (GIC) qui, entre autres choses, est actif dans les Balkans depuis le démantèlement de la Yougoslavie. Soros travaille ouvertement avec l’Institut américain pour la Paix – un organe officiellement reconnu de la CIA.
Lorsque les forces hostiles à la globalisation battaient de la semelle dans les rues entourant le Waldorf-Astoria, à New York, en février 2002, George Soros était à l’intérieur et tenait un discours devant le Forum économique mondial. Quand la police entassa les manifestants dans des cages métalliques à Park Avenue, Soros vantait les vertus d’une « société ouverte » et rejoignait ainsi Zbigniew Brzezinski, Samuel Huntington, Francis Fukuyama et d’autres.
QUI EST CE TYPE ?
George Soros est né en Hongrie en 1930 de parents juifs si éloignés de leurs racines qu’ils passèrent même une fois leurs vacances en Allemagne nazie.(6) Soros vécut sous le régime nazi mais, au moment du triomphe des communistes, il alla s’installer en Angleterre en 1947.
Là, à la London School of Economics, il subit l’influence du philosophe Karl Popper, un idéologue anticommuniste adulé dont l’enseignement constitua la base des tendances politiques de Soros. Il est malaisé de trouver un discours, un ouvrage ou un article de la plume de Soros qui n’obéisse à l’influence de Popper.
Anobli en 1965, Popper inventa le slogan de « Société ouverte », qu’on allait retrouver plus tard dans l’Open Society Fund and Institute de Soros. Les disciples de Popper répètent ses mots comme de véritables fidèles. La philosophie de Popper incarne parfaitement l’individualisme occidental. Soros quitta l’Angleterre en 1956 et trouva du travail à Wall Street où, dans les années 60, il inventa le « fonds de couverture » : « (…) les fonds de couverture satisfaisaient les individus très riches (…) Les fonds en grande partie secrets, servant habituellement à faire des affaires en des lieux lointains (…) produisaient des retours astronomiquement supérieurs. Le montant des ‘enjeux’ se muaient souvent en prophéties qui se réalisaient d’elles-mêmes : ‘les rumeurs circulant à propos d’une situation acquise grâce aux énormes fonds de couverture incitaient d’autres investisseurs à se hâter de faire pareil’, ce qui, à son tour, augmentait les mises de départ des opérateurs en couverture. »(7)
Soros met sur pied le Quantum Fund en 1969 et se met à boursicoter dans la manipulation des devises. Dans les années 70, ses activités financières glissent vers « l’alternance entre les situations à long et à court terme (…) Soros se mit à gagner gros à la fois sur la montée des trusts d’investissement dans l’immobilier et sur leur effondrement ultérieur. Durant ses vingt années de gestion, Quantum offrit des returns étonnants de 34,5% en moyenne par an. Soros est particulièrement connu (et craint) pour sa spéculation sur les devises.
(…) En 1997, il se vit décerner une distinction rare en se faisant traiter de scélérat par un chef d’Etat, Mahathir Mohamad, de Malaisie, pour avoir participé à un raid particulièrement rentable sur la monnaie de ce pays. »(8)
C’est via de telles martingales financières clandestines que Soros va devenir multimilliardaire. Ses sociétés contrôlent l’immobilier en Argentine, au Brésil et au Mexique, la banque au Venezuela et elles figurent au nombre des commerces de devises les plus rentables au monde, donnant naissance à la croyance générale que ses amis très haut placés l’ont aidé dans ses aventures financières, et ce pour des raisons tant politiques que liées à l’appât du gain.(9)
SOROS ? UN DRACULA QUI SUCE LE SANG DU PEUPLE !
George Soros a été blâmé pour avoir fait sombrer l’économie thaïlandaise en 1997.(10) Un activiste thaï a même déclaré : « Nous considérons George Soros comme une sorte de Dracula. Il suce le sang du peuple. »(11) Les Chinois l’appellent « le crocodile » du fait que ses efforts économiques et idéologiques en Chine n’étaient jamais satisfaits et parce que ses spéculations financières ont engendré des millions de dollars de profit lorsqu’il a mis le grappin sur l’économie thaï et sur celle de la Malaisie.(12)
Un jour, Soros s’est fait un milliard de dollars en un jour en spéculant (un mot qu’il déteste) sur la livre britannique. Accusé de prendre « de l’argent à chaque contribuable britannique lorsqu’il spéculait contre le sterling », il avait répondu : « Lorsque vous spéculez sur les marchés financiers, vous ne vous embarrassez pas de la plupart des préoccupations morales auxquelles est confronté un homme d’affaires ordinaire. (…) Je n’avais pas non plus à m’embarrasser de questions de morale sur les marchés financiers. »(13)
Soros est schizophréniquement insatiable quand il s’agit de s’enrichir personnellement de façon illimitée et il éprouve un perpétuel désir d’être bien considéré par autrui : « Les commerçants en devises assis à leurs bureaux achètent et vendent des devises de pays de tiers monde en grande quantités. L’effet des fluctuations des cours sur les personnes qui vivent dans ces pays n’effleure même pas leurs esprits.
Il ne devrait pas le faire non plus : ils ont un travail à faire. Si nous nous arrêtons pour réfléchir, nous devons nous poser la question de savoir si les commerçants en devises (…) devraient contrôler la vie de millions de personnes. »(14)
C’est George Soros qui a sauvé la peau de George W. Bush lorsque la gestion par celui-ci d’une société de prospection pétrolière était sur le point de se solder par un échec. Soros était le propriétaire de la Harken Energy Corporation et c’est lui qui avait racheté le stock des actions en baisse rapide juste avant que la société ne s’effondre. Le futur président liquida a presque un million de dollars. Soros déclara qu’il avait agi de la sorte pour acheter de « l’influence politique ».(15) Soros est également un partenaire du tristement célèbre Carlyle Group. Officiellement fondée en 1987, la « plus importante société privée par actions du monde », qui gère plus de 12 milliards de dollars, est dirigée par « un véritable bottin mondain d’anciens dirigeants républicains », depuis l’ancien membre de la CIA, Frank Carlucci, jusqu’à l’ancien chef de la CIA et ancien président George Bush père. Le Carlyle Group tire la majeure partie de ses rentrées des exportations d’armes.
L’ESPION PHILANTHROPE
En 1980, Soros commence à utiliser ses millions pour s’en prendre au socialisme en Europe de l’Est. Il finance des individus susceptibles de coopérer avec lui. Son premier succès, c’est en Hongrie qu’il l’obtient. Il reprend le système éducatif et culturel hongrois, mettant hors d’état de fonctionnement les institutions socialistes partout dans le pays. Il se fraie directement un chemin à l’intérieur du gouvernement hongrois. Ensuite, Soros se tourne vers la Pologne, contribuant à l’opération Solidarité, financée par la CIA, et, la même année, il étend également ses activités à la Chine. L’URSS vient ensuite.
Ce n’est nullement une coïncidence si la CIA a mené des opérations dans tous ces pays. Son objectif était également le même que celui de l’Open Society Fund : démanteler le socialisme. En Afrique du Sud, la CIA dénichait des dissidents anticommunistes. En Hongrie, en Pologne et en URSS, via une intervention non dissimulée menée à partir de la Fondation nationale pour la Démocratie, l’AFL-CIO, l’USAID et d’autres institutions, la CIA soutenait et organisait les anticommunistes, le type même d’individus recrutés par l’Open Society Fund de Soros. La CIA allait les appeler ses « atouts ». Comme le dit Soros : « Dans chaque pays, j’ai identifié un groupe de personnes – certaines sont des personnalités de premier plan, d’autres sont moins connues – qui partageaient ma foi… »(16)
L’Open Society de Soros organisait des conférences avec des anticommunistes tchèques, serbes, roumains, hongrois, croates, bosniaques, kosovares.(17) Son influence sans cesse croissante le fit soupçonner d’opérer en tant que partie du complexe des renseignements américains. En 1989, le Washington Post se faisait l’écho d’accusations d’abord émises en 1987 par des officiels du gouvernement chinois et prétendant que le Fonds de Soros pour la Réforme et l’Ouverture de la Chine avait des connexions avec la CIA.(18)
AU TOUR DE LA RUSSIE
Après 1990, les fonds de Soros visent le système éducatif russe et fournissent des manuels à toute la nation.(19) En effet, Soros se sert de la propagande de l’OSI pour endoctriner toute une génération de la jeunesse russe. Les fondations de Soros ont été accusées d’avoir orchestré une stratégie visant à s’assurer le contrôle du système financier russe, des plans de privatisation et du processus des investissements étrangers dans ce pays. Les Russes réagissent avec colère aux ingérences de Soros dans les législations. Les critiques de Soros et d’autres fondations américaines ont affirmé que l’objectif de ces manœuvres était de « faire échouer la Russie en tant qu’Etat ayant le potentiel de rivaliser avec la seule superpuissance mondiale ».(20)
Les Russes se mettent à soupçonner que Soros et la CIA sont interconnectés. Le magnat des affaires, Boris Berezovsky, allait même déclarer : « J’ai presque tourné de l’œil en apprenant, il y a quelques années, que George Soros était un agent de la CIA. »(21) L’opinion de Berezovsky était que Soros, de même que l’Occident, « craignaient que le capitalisme russe ne devînt trop puissant ».
Si l’establishment économique et politique des Etats-Unis craint la concurrence économique de la Russie, quelle meilleure façon y a-t-il de la contrôler que de dominer les médias, l’éducation, les centres de recherche et le secteur scientifique de la Russie ? Après avoir dépensé 250 millions de dollars pour « la transformation de l’éducation des sciences humaines et de l’économie au niveau des écoles supérieures et des universités », Soros injecte 100 millions de dollars de plus dans la création de la Fondation scientifique internationale.(22) Les Services fédéraux russes de contre-espionnage (FSK) accusent les fondations de Soros en Russie d’« espionnage ». Ils font remarquer que Soros n’opère pas seul ; il fait partie de tout un rouleau compresseur recourant, entre autres, à des financements de la part de Ford et des Heritage Foundations, des universités de Harvard, Duke et Columbia, et à l’assistance du Pentagone et ses services de renseignements américains.(23) Le FSK s’indigne de ce que Soros a graissé la patte à quelque 50.000 scientifiques russes et prétend que Soros a cultivé avant tout ses propres intérêts en s’assurant le contrôle de milliers de découvertes scientifiques et nouvelles technologies russes et en s’appropriant ainsi des secrets d’Etats et des secrets commerciaux.(24)
CUNY, AGENT DE LA CIA EN TCHéTCHéNIE?
En 1995, les Russes avaient été très en colère suite aux ingérences de l’agent du Département d’Etat, Fred Cuny, dans le conflit tchétchène. Cuny se servait du secours aux sinistrés comme de couverture, mais l’histoire de ses activités dans les zones de conflit internationales intéressant les Etats-Unis, auxquelles venaient s’ajouter les opérations d’investigations du FBI et de la CIA, rendaient manifestes ses connexions avec le gouvernement américain. A l’époque de sa disparition, Cuny travaillait sous contrat pour une fondation de Soros.(25) On se sait pas assez aux Etats-Unis que la violence en Tchétchénie, une province située au cœur de la Russie, est généralement perçue comme étant le résultat d’une campagne de déstabilisation politique que Washington voit d’un très bon œil et, en fait, orchestre probablement. Cette façon de présenter la situation est suffisamment claire aux yeux de l’écrivain Tom Clancy, au point qu’il s’est senti libre d’en faire une affirmation de fait dans son best-seller, La somme de toutes les peurs. Les Russes ont accusé Cuny d’être un agent de la CIA et d’être l’un des rouages d’une opération de renseignements destinée à soutenir l’insurrection tchétchène.(26) L’Open Society Institute de Soros est toujours actif en Tchétchénie, comme le sont également d’autres organisations sponsorisées par le même Soros.
La Russie a été le théâtre d’au moins une tentative commune de faire grimper le bilan de Soros, tentative orchestrée avec l’aide diplomatique de l’administration Clinton. En 1999, la secrétaire d’Etat Madeleine Albright avait bloqué une garantie de prêt de 500 millions de dollars par l’U.S. Export-Import Bank à la société russe, Tyumen Oil, en prétendant que cela s’opposait aux intérêts nationaux américains. La Tyumen voulait acheter des équipements pétroliers de fabrication américaine, ainsi que des services, auprès de la société Halliburton de Dick Cheney et de l’ABB Lummus Global de Bloomfield, New Jersey.(27) George Soros était investisseur dans une société que la Tyumen avait essayé d’acquérir. Tant Soros que BP Amoco avaient exercé des pressions afin d’empêcher cette transaction, et Albright leur rendit ce service.(28)
L’ENTRETIEN D’UN ANTISOCIALISME DE GAUCHE
L’Open Society Institute de Soros trempe les doigts dans toutes les casseroles. Son comité de directeurs est un véritable « Who's Who » de la guerre froide et des pontifes du nouvel ordre mondial. Paul Goble est directeur des communications : « Il a été le principal commentateur politique de Radio Free Europ ». Herbert Okun a servi dans le département d’Etat de Nixon en tant que conseiller en renseignements auprès de Henry Kissinger. Kati Marton est l’épouse de Richard Holbrooke, l’ancien ambassadeur aux Nations unies et envoyé en Yougoslavie de l’administration Clinton. Marton a exercé des pressions en faveur de la station de radio B-92, financée par Soror, et elle a également beaucoup œuvré en faveur d’un projet de la Fondation nationale pour la démocratie (une autre antenne officielle de la CIA) qui a collaboré au renversement du gouvernement yougoslave.
Lorsque Soros fonde l’Open Society Fund, il va chercher le grand pontife libéral Aryeh Neier pour la diriger. A l’époque, Neier dirige Helsinki Watch, une prétendue organisation des droits de l’homme de tendance nettement anticommuniste. En 1993, l’Open Society Fund devient l’Open Society Institute.
Helsinki Watch s’est mué en Human Rights Watch en 1975. A l’époque, Soros fait partie de sa Commission consultative, à la fois pour le comité des Amériques et pour ceux de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale, et sa nébuleuse Open Society Fund/Soros/OSI est renseignée comme bailleuse de fonds.(29) Soros a des relations étroites avec Human Rights Watch (HRW) et Neier écrits des articles pour le magazine The Nation sans mentionné le moins du monde qu’il figure sur les fiches de paie de Soros.(30)
Soros est donc étroitement lié à HRW, bien qu’il fasse de son mieux pour le dissimuler.(31) Il déclare qu’il se contente de bailler des fonds, de mettre les programmes au point et de laisser les choses aller d’elles-mêmes. Mais les actions de HRW ne s’écartent en aucune façon de la philosophie de son bailleur de fonds. HRW et OSI sont très proches l’un de l’autre. Leurs vues ne divergent pas. Naturellement, d’autres fondations financent également ces deux institutions, mais il n’empêche que l’influence de Soros domine leur idéologie.
Les activités de George Soros s’inscrivent dans le schéma de construction développé en 1983 et tel qu’il est énoncé par Allen Weinstein, fondateur de la Fondation nationale pour la démocratie. Wainstein déclare ceci : «Une grande partie de ce que nous faisons aujourd’hui était réalisée en secret par la CIA voici 25 ans. »(32)
LéGITIMER LES STRATéGIES AMéRICAINES
 Soros opère exactement dans les limites du complexe de renseignements. Il diffère peu des trafiquants de drogue de la CIA au Laos, dans les années 60, ou des moudjahidine qui tiraient profit du trafic de l’opium tout en menant des opérations pour le compte de la CIA contre l’Afghanistan socialiste des années 80. Il canalise tout simplement (et ramasse) beaucoup plus d’argent que ces marionnettes et une partie bien plus importante de ses affaires se font au grand jour. Sa franchise, dans la mesure où il en fait preuve, réside dans un contrôle factice des dégâts, lequel sert à légitimer les stratégies de la politique étrangère américaine.
Soros opère exactement dans les limites du complexe de renseignements. Il diffère peu des trafiquants de drogue de la CIA au Laos, dans les années 60, ou des moudjahidine qui tiraient profit du trafic de l’opium tout en menant des opérations pour le compte de la CIA contre l’Afghanistan socialiste des années 80. Il canalise tout simplement (et ramasse) beaucoup plus d’argent que ces marionnettes et une partie bien plus importante de ses affaires se font au grand jour. Sa franchise, dans la mesure où il en fait preuve, réside dans un contrôle factice des dégâts, lequel sert à légitimer les stratégies de la politique étrangère américaine.
La majorité des Américains qui, aujourd’hui, se considèrent politiquement au centre-gauche, sont sans aucun doute pessimistes à propos des chances d’assister un jour à une transformation socialiste de la société. Par conséquent, le modèle de « décentralisation » à la Soros, ou l’approche « fragmentée » de «l’utilitarisme négatif, la tentative de réduire au minimum la quantité de misère », qui constituait la philosophie de Popper, tout cela leur plaît, en gros.(33) Soros a financé une étude de HRW qui a été utilisée pour soutenir l’assouplissement de la législation en matière de drogue dans les Etats de Californie et d’Arizona.(34) Soros est favorable à une législation sur les drogues – une manière de réduire provisoirement la conscience de sa propre misère. Soros est un corrupteur qui tutoie le concept de l’égalité des chances. A un échelon plus élevé de l’échelle socio-économique, on trouve les social-démocrates qui acceptent d’être financés par Soros et qui croient aux libertés civiques dans le contexte même du capitalisme.(35) Pour ces personnes, les conséquences néfastes des activités commerciales de Soros (lesquelles appauvrissent des gens partout dans le monde) sont édulcorées par ses activités philanthropiques. De la même manière, les intellectuels libéraux de gauche, tant à l’étranger qu’aux Etats-Unis, ont été séduits par la philosophie de l’« Open Society », sans parler de l’attrait que représentait ses donations.
La Nouvelle Gauche américaine était un mouvement social-démocratique. Elle était résolument antisoviétique et, lorsque l’Europe de l’Est et l’Union soviétique se sont effondrées, peu de gens au sein de cette Nouvelle Gauche se sont opposés à la destruction des systèmes socialistes. La Nouvelle Gauche n’a ni gémi ni protesté lorsque les centaines de millions d’habitants de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale ont perdu leur droit au travail, au logement à loyer décent et protégé par la loi, à l’éducation gratuite dans des écoles supérieures, à la gratuité des soins de santé et de l’épanouissement culturel. La plupart ont minimisé les suggestions prétendant que la CIA et certaines ONG – telles la Fondation nationale pour la Démocratie ou l’Open Society Fund – avaient activement participé à la destruction du socialisme. Ces personnes avaient l’impression que la détermination occidentale à vouloir détruire l’URSS depuis 1917 avait vraiment peu de chose à voir avec la chute de l’URSS. Pour ces personnes, le socialisme a disparu de son plein gré, du fait de ses défauts et lacunes.
LA “NOUVELLE GAUCHE” IGNORE TOUJOURS LES MACHINATIONS AMéRICAINES
Quant aux révolutions, comme celles d’un Mozambique, de l’Angola, du Nicaragua ou du Salvador, annihilées par des forces agissant sous procuration ou retardées par des « élections » très démonstratives, les pragmatistes de la Nouvelle Gauche n’en ont eu que faire et ont tourné les talons. Parfois même, la Nouvelle Gauche a semblé ignorer délibérément les machinations post-soviétiques de la politique étrangère américaine.
Bogdan Denitch, qui nourrissait des aspirations politiques en Croatie, a été actif au sein de l’Open Society Institute et a reçu des fonds de ce même OSI.(36) Denitch était favorable à l’épuration ethnique des Serbes en Croatie, aux bombardements par l’Otan de la Bosnie et de la Yougoslavie et même à une invasion terrestre de la Yougoslavie.(37) Denitch a été l’un des fondateurs et le président des Socialistes démocratiques des Etats-Unis, un groupe prépondérant de la gauche libérale aux Etats-Unis. Il a également présidé longtemps la prestigieuse Conférence des Universitaires socialistes, par le biais de laquelle il pouvait aisément manipuler les sympathies de beaucoup et les faire pencher du côté du soutien à l’expansion de l’Otan.(38) D’autres cibles du soutien de Soros comprennent Refuse and Resist the American Civil Liberties Union (refus et résistance à l’Union américaine de défense des libertés civiques), et toute une panoplie d’autres causes libérales.(39) Soros allait acquérir un autre trophée invraisemblable en s’engageant dans la Nouvelle Ecole de Recherches Sociales de New York, qui avait été longtemps une académie de choix pour les intellectuels de gauche. Aujourd’hui, il y sponsorise le Programme pour l’Europe de l’est et l’Europe centrale.(40)
MICHEL KOZAK : INSTALLER DES “DIRIGEANTS SYMPATHIQUES”
Bien des gens de gauche inspirés par la révolution nicaraguayenne ont accepté avec tristesse l’élection de Violetta Chamorro et la défaite des sandinistes en 1990. La quasi-totalité du réseau de soutien au Nicaragua a cessé ses activités par la suite. Peut-être la Nouvelle Gauche aurait-elle pu tirer quelque enseignement de l’étoile montante qu’était Michel Kozak. L’homme était un vétéran des campagnes de Washington visant à installer des dirigeants sympathiques au Nicaragua, à Panama et à Haïti, et de saper Cuba – il dirigeait la Section des Intérêts américains à La Havane.
Après avoir organisé la victoire de Chamorro au Nicaragua, Kozak a poursuivi son chemin pour devenir ambassadeur des Etats-Unis en Biélorussie, tout en collaborant à l’Internet Access and Training Program (IATP – Progr. d’accès et d’initiation au net), sponsorisé par Soros et qui œuvrait à la « fabrication de futurs dirigeants » en Biélorussie.(41) Dans le même temps, ce programme était imposé à l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. L’IATP opère à visière relevée avec le soutien du département d’Etat américain. Au crédit de la Biélorussie, il faut ajouter qu’elle a fini par expulser Kozak et toute la clique de l’Open Society de Soros et du département d’Etat américain. Le gouvernement d’Aleksandr Lukachenko a en effet découvert que, quatre ans avant de s’installer à Minsk, Kozak organisait la ventilation des dizaines de millions de dollars destinés à alimenter l’opposition biélorusse. Kozak travaillait à l’unification du coalition d’opposition, il créait des sites web, des journaux et des pôles d’opinion, et il supervisait un mouvement de résistance estudiantine semblable à l’Otpor en Yougoslavie. Kozak fit même venir des dirigeants de l’Otpor pour former des dissidents en Biélorussie.(42) Juste à la veille du 11 septembre 2001, les Etats-Unis relançaient une campagne de diabolisation contre le président Aleksandr Lukachenko. Cette campagne allait toutefois être remise sur feu doux pour donner la priorité à la « guerre contre le terrorisme ».
Par l’entremise de l’OSI et du HRW, Soros était l’un des principaux sponsors de la station de radio B-92 à Belgrade. Il fonda l’Otpor, l’organisation qui recevait ces « valises d’argent » afin de soutenir le coup d’Etat du 5 octobre 2000 qui allait renverser le gouvernement yougoslave.(43) Un peu plus tard, Human Rights Watch aidait à légitimer l’enlèvement et la médiatisation du procès de Slobodan Milosevic à La Haye sans aucunement faire état de ses droits.(44)
Louise Arbour, qui a œuvré comme juge au sein de ce tribunal illégal, siège actuellement au conseil du Groupe international de crise de Soros.(45) Le gang de l’Open Society et de Human Rights Watch a travaillé en Macédoine, disant que cela faisait partie de sa « mission civilisatrice ».(46) Il faut donc s’attendre à ce qu’on « sauve » un jour cette république et que s’achève ainsi la désintégration de l’ancienne Yougoslavie.
DES MANDATAIRES DU POUVOIR
En fait, Soros a déclaré qu’il considérait sa philanthropie comme morale et ses affaires de gestion d’argent comme amorales.(47) Pourtant, les responsables des ONG financées par Soros ont un agenda clair et permanent. L’une des institutions les plus influentes de Soros n’est autre que le Groupe international de Crise, fondé en 1986.
Le GIC est dirigé par des individus issus du centre même du pouvoir politique et du monde des entreprises. Son conseil d’administration compte entre autres en ses rangs Zbigniew Brzezinski, Morton Abramowitz, ancien secrétaire d’Etat adjoint aux Etats-Unis; Wesley Clark, ancien chef suprême des alliés de l’Otan pour l’Europe; Richard Allen, ancien conseiller national à la sécurité des Etats-Unis. Il vaut la peine de citer Allen : l’homme a quitté le Conseil national de la sécurité sous Nixon parce qu’il était dégoûté des tendances libérales de Henry Kissinger; c’est encore lui qui a recruté Oliver North pour le Conseil national de la sécurité sous Reagan, et qui a négocié l’échange missiles-otages dans le scandale des contras iraniens. Pour ces quelques individus, « contenir des conflits » équivaut à assurer le contrôle américain sur les peuples et ressources du monde entier.
Dans les années 1980 et 1990, sous l’égide de la doctrine reaganienne, les opérations secrètes ou à ciel ouvert des Etats-Unis battaient leur plein en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie. Soros était ouvertement actif dans la plupart de ces endroits, oeuvrant à corrompre d’éventuels révolutionnaires en devenir, à sponsoriser des hommes politiques, des intellectuels et toute autre personne susceptible d’arriver au pouvoir lorsque l’agitation révolutionnaire serait retombée. Selon James Petras : « A la fin des années 1980, les secteurs les plus perspicaces des classes néo-libérales au pouvoir comprirent que leurs menées politiques polarisaient la société et suscitaient un ample mécontentement social.
UNE STRATéGIE PARALLèLE “à PARTIR DE LA BASE”
Les politiciens néo-libéraux se sont mis à financer et à promouvoir une stratégie parallèle ‘à partir de la base ‘, la promotion d’organisations en quelque sorte ‘tirées du sol’, à l’idéologie ‘anti-étatique’ et censées intervenir parmi les classes potentiellement conflictuelles, afin de créer un ‘tampon social’. Ces organisations dépendaient financièrement de ressources néo-libérales et étaient directement engagées dans la concurrence avec des mouvements socio-politiques pour la fidélité des dirigeants locaux et des communautés militantes. Dans les années 1990, ces organisations, décrites comme ‘non gouvernementales’, se comptaient par milliers et recevaient quelque 4 milliards de dollars pour l’ensemble de la planète. »(48)
Dans Underwriting Democracy (Garantir la démocratie), Soros se vante de « l’américanisation de l’Europe de l’Est ». Selon ses propres dires, grâce à ses programmes d’éducation, il a commencé à mettre en place tout un encadrement de jeunes dirigeants « sorosiens ». Ces jeunes hommes et femmes issus du moule éducatif de la Fondation Soros sont préparés à remplir des fonctions de ce qu’on appelle communément des « personnes d’influence ». Grâce à leur connaissance pratique des langues et à leur insertion dans les bureaucraties naissantes des pays ciblés, ces recrues sont censées faciliter, sur le plan philosophique, l’accès à ces pays des sociétés multinationales occidentales. Le diplomate de carrière Herbert Okun, qui siège en compagnie de George Soros au Comité européen de Human Rights Watch, entretient d’étroites relations avec toute une série d’institutions liées au département d’Etat, allant de l’USAID à la Commission trilatérale financée par Rockefeller. De 1990 à 1997, Okun a été directeur exécutif d’une organisation appelée le Corps des bénévoles des Sercvices financiers, qui faisait partie de l’USAID, « afin d’aider à établir des systèmes financiers de marché libre dans les anciens pays communistes ».(49) George Soros est en complet accord avec les capitalistes occupés à prendre le contrôle de l’économie mondiale.
LA RENTABILITE DU NON-MARCHAND
Soros prétend qu’il ne fait pas de philanthropie dans les pays où il pratique le commerce des devises.(50) Mais Soros a souvent tiré avantage de ses relations pour réaliser des investissements clés. Armé d’une étude de l’ICC et bénéficiant du soutien de Bernard Kouchner, chef de l’UNMIK (Administration intérimaire des Nations unies au Kosovo), Soros a tenté de s’approprier le complexe minier le plus rentable des Balkans.
En septembre 2000, dans sa hâte de s’emparer des mines de Trepca avant les élections en Yougoslavie, Kouchner déclarait que la pollution dégagée par le complexe minier faisait grimper les taux de plomb dans l’environnement.(51) C’est incroyable, d’entendre une chose pareille, quand on sait que l’homme a applaudi lorsque les bombardements de l’Otan, en 1999, ont déversé de l’uranium appauvri sur le pays et ont libéré plus de 100.000 tonnes de produits cancérigènes dans l’air, l’eau et le sol.(52) Mais Kouchner a fini par obtenir gain de cause et les mines ont été fermées pour des « raisons de santé ». Soros a investi 150 millions de dollars dans un effort pour obtenir le contrôle de l’or, l’argent, le plomb, le zinc et le cadmium de Trepca, lesquels confèrent à cette propriété une valeur de 5 milliards de dollars.(53)
Au moment où la Bulgarie implosait dans le chaos du « libre marché », Soros s’acharnait à récupérer ce qu’il pouvait dans les décombres, comme Reuters l’a rapporté au début 2001 : « La Banque européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) a investi 3 millions de dollars chez RILA [une société bulgare spécialisée dans les technologies de pointe], la première société à bénéficier d’un nouveau crédit de 30 millions de dollars fixé par la BERD pour soutenir les firmes de high-tech en Europe centrale et de l’Est. (…) Trois autres millions de dollars venaient du fonds américain d’investissements privés Argus Capital Partners, sponsorisé par la Prudential Insurance Company of America et opérant en Europe centrale et de l’Est. (…) Soros, qui avait investi quelque 3 millions de dollars chez RILA et un autre million de 2001 (…) demeurait le détenteur majoritaire. »(54)
CERNER LES PROBLEMES
Ses prétentions à la philanthropie confèrent à Soros le pouvoir de modeler l’opinion publique internationale lorsqu’un conflit social soulève la question de savoir qui sont les victimes et qui sont les coupables. A l’instar d’autres ONG, Human Rights Watch, le porte-voix de Soros sur le plan des droits de l’homme, évite ou ignore la plupart des luttes de classes ouvrières organisées et indépendantes.
En Colombia, des dirigeants ouvriers sont très fréquemment assassinés par des paramilitaires opérant de concert avec le gouvernement sponsorisé par les Etats-Unis. Du fait que ces syndicats s’opposent à l’économie néo-libérale, HRW garde à propos de ces assassinats un relatif silence. En avril dernier, José Vivanco, de HRW, a témoigné en faveur du Plan Colombia devant le Sénat américain (55) : « Les Colombiens restent dévoués aux droits de l’homme et à la démocratie. Ils ont besoin d’aide. Human Rights Watch ne voit pas d’inconvénient fondamental à ce que ce soient les Etats-Unis qui fournissent cette aide. »(56)
HRW met les actions des combattants de la guérilla colombienne, qui luttent pour se libérer de l’oppression de la terreur d’Etat, de la pauvreté et de l’exploitation, sur le même pied que la répression des forces armées financées par les Etats-Unis et celle des escadrons paramilitaires de la mort, les AUC (Forces colombiennes unies d’autodéfense). HRW a reconnu le gouvernement de Pastrana et de ses militaires, dont le rôle était de protéger les droits à la propriété et de maintenir le statu quo économique et politique. Selon HRW, 50% des morts de civils sont l’œuvre des escadrons de la mort tolérés par le gouvernement.(57). Le pourcentage exact, en fait, est de 80%.(58)
HRW a validé les élections dans leur ensemble et l’accession au pouvoir du gouvernement Uribe, en 2002. Uribe est un parfait héritier des dictateurs latino-américains que les Etats-Unis ont soutenu dans le passé, bien qu’il ait été « élu ». HRW n’a pas eu de commentaire à propos du fait que la majorité des habitants ont boycotté les élections.(59)
CUBA DéMONISé PAR “HUMAN RIGHTS WATCH”
Dans le bassin caraïbe, Cuba est un autre opposant au néo-libéralisme à avoir été diabolisé par Human Rights Watch. Dans l’Etat voisin de Haïti, les activités financées par Soros ont opéré de façon à venir à bout des aspirations populaires qui ont suivi la fin de la dictature des Duvalier, et ce, en torpillant le premier dirigeant haïtien, démocratiquement élu, Jean-Bertrand Aristide. Ken Roth, de HRW, a abondé utilement dans le sens des accusations américaines reprochant à Aristide d’être « antidémocratique ». Pour étayer son idée de la « démocratie », les fondations de Soros ont entamé à Haïti des opérations complémentaires de celles si inconvenantes des Etats-Unis, telles la promotion par USAID de personnes associées aux FRAPH, les fameux escadrons de la mort sponsorisés par la CIA et qui ont terrorisé le pays depuis la chute de « Baby Doc » Duvalier.(60)
Sur le site de HRW, le directeur Roth a critiqué les Etats-Unis de ne pas s’être opposés à la Chine avec plus de véhémence. Les activités de Roth comprennent la création du Tibetan Freedom Concert (Concert pour la liberté du Tibet), un projet itinérant de propagande qui a effectué une tournée aux Etats-Unis avec d’importants musiciens de rock pressant les jeunes à soutenir le Tibet contre la Chine.(61) Le Tibet est un projet de prédilection de la CIA depuis de nombreuses années.(62)
Récemment, Roth a réclamé avec insistance que l’on s’oppose au contrôle de la Chine sur sa province riche en pétrole du Xinjiang. Avec l’approche colonialiste du « diviser pour conquérir », Roth a essayé de convaincre certaines membres de la minorité religieuse des Ouïgours au Xinjiang que l’intervention des Américains et de l’Otan au Kosovo contenait une promesse en tant que modèle pour eux-mêmes. Déjà en août 2002, le gouvernement américain avait soutenu quelque peu cette tentative également.
Les intentions américaines à propos de cette région sont apparues clairement lorsqu’un article du New York Times sur la province de Xinjiang, en Chine occidentale, décrivait les Ouïgours comme une « majorité musulmane vivant nerveusement sous domination chinoise. Ils « sont bien au courant des bombardements de la Yougoslavie par l’Otan, l’an dernier, et certains les encensent pour avoir libéré les musulmans du Kosovo; ils s’imaginent pouvoir être libérés de la même manière ici ».(63) Le New York Times Magazine, de son côté, notait que « de récentes découvertes de pétrole ont rendu le Xinjiang particulièrement attrayant au yeux du commerce international » et, en même temps, comparaît les conditions de la population indigène à celles du Tibet.(64)
DES DEFICIENCES EN CALCUL
Lorsque les organisations sorosiennes comptent, elles semblent perdre toute notion de vérité. Human Rights Watch affirmait que 500 personnes, et non pas plus de 2.000, avaient été tuées par les bombardiers de l’Otan au cours de la guerre de Yougoslavie, en 1999.(65) Elles prétendent que 350 personnes seulement, et non pas plus de 4.000, étaient mortes suite aux attaques américaines en Afghanistan.(66) Lorsque les Américains ont bombardé Panama en 1989, HRW a préfacé son rapport en disant que « l’éviction de Manuel Noriega (…) et l’installation du gouvernement démocratiquement élu du président Guillermo Endara amenait de grands espoirs au Panama (…) ». Le rapport omettait de mentionner le nombre de victimes.
Human Rights Watch a préparé le travail de terrain pour l’attaque de l’Otan contre la Bosnie, en 1993, avec de fausses allégations de « génocide » et de viols par milliers.(67) Cette tactique consistant à susciter une hystérie politique était nécessaire pour que les Etats-Unis puissent mener à bien leur politique dans les Balkans. Elle a été réutilisée en 1999 lorsque HRW a fonctionné en qualité de troupes de choc de l’endoctrinement pour l’attaque de la Yougoslavie par l’Otan. Tout le bla-bla de Soros à propos du règne de la loi a été oublié d’un seul coup. Les Etats-Unis et l’Otan ont imposé leurs propres lois et les institutions de Soros étaient derrière pour les soutenir.
Le fait de trafiquer des chiffres afin d’engendrer une réaction a été une composante importante de la campagne du Conseil des relations étrangères après le 11 septembre 2001. Cette fois, il s’agissait des 2.801 personnes tuées au World Trade Center. Le Conseil des relations étrangères (CRE) se réunit le 6 novembre 2001 afin de planifier une « grande campagne diplomatique publique ». Le CRE créa une « Cellule de crise indépendante sur la réponse de l’Amérique au terrorisme ». Soros rejoignit Richard C. Holbrooke, Newton L. Gingrich, John M. Shalikashvili (ancien président des chefs d’état-major réunis) et d’autres individus influents dans une campagne visant à faire des morts du WTC des outils de la politique étrangère américaine. Le rapport du CRE mit tout en œuvre pour faciliter une guerre contre le terrorisme.
VANTER ET DéFENDRE LA POLITIQUE éTRANGèRE AMéRICAINE
On peut retrouver les empreintes de George Soros un peu partout, dans cette campagne : « Il faut que les hauts fonctionnaires américains pressent amicalement les Arabes amis et autres gouvernements musulmans non seulement de condamner publiquement les attentats du 11 septembre, mais également de soutenir les raisons et les objectifs de la campagne antiterroriste américaine. Nous n’allons jamais convaincre les peuples du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud de la légitimité de notre cause si leurs gouvernements restent silencieux. Il nous faut les aider à éviter tout retour de flamme pouvant émaner de telles déclarations, mais il faut que nous les convainquions de s’exprimer de vive voix. (…) Encouragez les musulmans bosniaques, albanais et turcs à apprendre à des auditoires étrangers à considérer le rôle des Américains dans le sauvetage des musulmans de Bosnie et du Kosovo en 1995-1999 ainsi que nos liens étroits et de longue durée avec les musulmans dans le monde entier. Engagez les intellectuels et les journalistes du pays à prendre la parole également, quels que soient leurs points de vue. Informez régulièrement la presse régionale en temps réel pour encourager des réponses rapides. (…) Insistez sur la nécessité de faire référence aux victimes (et citez ces dernières nommément afin de mieux les personnaliser) chaque fois que nous discutons de nos motifs et de nos objectifs.»(68)
Bref, les déficiences sorosiennes en calcul servent à vanter et à défendre la politique étrangère américaine.
Soros est très ennuyé par le déclin du système capitaliste mondial et il veut faire quelque chose à ce propos, et maintenant, encore. Récemment, il déclarait : « Je puis déjà discerner les préparatifs de la crise finale. (…) Des mouvements politiques indigènes sont susceptibles d’apparaître qui chercheront à exproprier les sociétés multinationales et à reprendre possession des richesses ‘nationales’. »(69)
Soros suggère le plus sérieusement du monde un plan pour contourner les Nations unies. Il propose que les « démocraties du monde devraient prendre les rênes et constituer un réseau mondial d’alliances qui pourraient travailler avec ou sans les Nations unies ». Si l’homme était psychotique, on pourrait penser qu’il était en crise, à ce moment précis. Mais le fait est que l’affirmation de Soros : « les Nations unies sont constitutionnellement incapables de remplir les promesses contenues dans le préambule de leur Charte » reflète la pensée des institutions réactionnaires du genre de l’American Enterprise Institute.(70) Bien que maints conservateurs font référence au réseau de Soros comme étant de gauche, si l’on aborde la question de l’affiliation des Etats-Unis aux Nations unies, Soros est exactement sur la même longueur d’onde que les semblables de John R. Bolton, sous-secrétaire d’Etat pour le Contrôle des Armes et les Affaires de Sécurité internationale qui, en même temps que « de nombreux républicains du Congrès, croient qu’il ne faut pas accorder davantage de crédit au système des Nations unies ».(71) La droite a mené une campagne de plusieurs décennies contre l’ONU. Aujourd’hui, c’est Soros qui l’orchestre. Sur divers sites web de Soros, on peut lire des critiques des Nations unies disant qu’elles sont trop riches, qu’elles ne sont guère désireuses de partager leurs informations, ou qu’elles se sont affaiblies dans des proportions qui les rendent impropres à la manière dont le monde devrait tourner, selon George Soros, du moins.
LES “PROGRESSISTES” OCCIDENTAUX ONT DONNé UN BLANC-SEING à SOROS
Même les auteurs écrivant dans The Nation, des auteurs censés en savoir beaucoup plus, ont été influencés par les idées de Soros. William Greider, par exemple, a récemment découvert quelque pertinence dans la critique de Soros disant que les Nations unies ne devrait pas « accueillir les dictateurs de pacotille et les totalitaristes ni les traiter en partenaires égaux ».(72) Ce genre de racisme eurocentrique constitue le noyau de l’orgueil démesuré de Soros. Quand il affirme que les Etats-Unis peuvent et devraient diriger le monde, c’est un plaidoyer pour le fascisme à l’échelle mondiale. Pendant bien trop longtemps, les « progressistes » occidentaux ont donné un blanc-seing à Soros. Il est probable que Greider et les autres trouvent que l’allusion au fascisme est excessive, injustifiée et même insultante.
Mais écoutez plutôt, et d’une oreille attentive, ce que Soros lui-même a à dire : « Dans la Rome ancienne, seuls les Romains votaient. Sous le capitalisme mondial moderne, seuls les Américains votent. Les Brésiliens, eux, ne votent pas. »
Heather COTTIN.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
.jpg)
.jpg) Zwischenzeitlich rumort es auch in der EU-Kommission. Sie hatte die Regierung in Dublin erst vor wenigen Tagen aufgefordert, ihren derzeitigen Sparkurs noch einmal »drastisch« zu verschärfen, weil nur so das Staatsdefizit von derzeit 14,3 Prozent des BIP bis zum Jahr 2014 unter den EU-Grenzwert von drei Prozent gedrückt werden könne.
Zwischenzeitlich rumort es auch in der EU-Kommission. Sie hatte die Regierung in Dublin erst vor wenigen Tagen aufgefordert, ihren derzeitigen Sparkurs noch einmal »drastisch« zu verschärfen, weil nur so das Staatsdefizit von derzeit 14,3 Prozent des BIP bis zum Jahr 2014 unter den EU-Grenzwert von drei Prozent gedrückt werden könne.




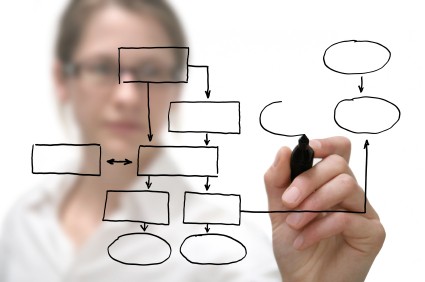
 La tâche du FMI est d’empêcher ou, du moins, de limiter l’effet des crises financières qui affectent les Etats et qui pourraient avoir des répercussions sur l’économie mondiale. Les esprits critiques nous disent que ce système fait tomber les gouvernements et les banques dans la tentation de faire des affaires risquées car, de fait, le FMI, en cas d’échec, vole à leur secours. Le FMI est alimenté par des cotisations payées par les grands Etats industrialisés. Les Etats-Unis sont l’Etat qui, en réalité, profite pleinement de l’institution qu’est le FMI, parce que Washington use de son influence prépondérante pour dire quels Etats doivent recevoir une aide et quels Etats doivent en être privés, et sous quelles conditions.
La tâche du FMI est d’empêcher ou, du moins, de limiter l’effet des crises financières qui affectent les Etats et qui pourraient avoir des répercussions sur l’économie mondiale. Les esprits critiques nous disent que ce système fait tomber les gouvernements et les banques dans la tentation de faire des affaires risquées car, de fait, le FMI, en cas d’échec, vole à leur secours. Le FMI est alimenté par des cotisations payées par les grands Etats industrialisés. Les Etats-Unis sont l’Etat qui, en réalité, profite pleinement de l’institution qu’est le FMI, parce que Washington use de son influence prépondérante pour dire quels Etats doivent recevoir une aide et quels Etats doivent en être privés, et sous quelles conditions. 
 Das bedeutet, dass die US-Regierung die Investoren – vor allem ausländische Zentralbanken wie die japanische und chinesische – davon überzeugen muss, in nie dagewesener Höhe neue US-Staatspapiere zu kaufen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem diese Länder bereits an der Stabilität des Dollars zu zweifeln beginnen. Nur wegen der Griechenland-Krise und der inszenierten Panik über die Zukunft des Euro konnte eine volle Dollar-Krise bisher abgewendet werden. Derzeit kann niemand sagen, wie lange dies noch möglich sein wird. Klar ist hingegen: Ohne eine wie auch immer geartete neue Kriegssituation lässt sich die Stabilität des Dollar nicht aufrecht erhalten.
Das bedeutet, dass die US-Regierung die Investoren – vor allem ausländische Zentralbanken wie die japanische und chinesische – davon überzeugen muss, in nie dagewesener Höhe neue US-Staatspapiere zu kaufen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem diese Länder bereits an der Stabilität des Dollars zu zweifeln beginnen. Nur wegen der Griechenland-Krise und der inszenierten Panik über die Zukunft des Euro konnte eine volle Dollar-Krise bisher abgewendet werden. Derzeit kann niemand sagen, wie lange dies noch möglich sein wird. Klar ist hingegen: Ohne eine wie auch immer geartete neue Kriegssituation lässt sich die Stabilität des Dollar nicht aufrecht erhalten. Le système économique dominant est actuellement du type transnational: des groupes privés ont des stratégies mondiales. Ce type d'organisation est renforcé depuis les années soixante par une conquête des esprits à travers les thèmes de propagande américains: culture de masse, droits de l'homme, etc…, et trouve un appui au sein des bureaucraties publiques des Etats européens où se conjuguent sécurité de l'emploi et avantages de la richesse. Ce n'est toutefois qu'une modalité possible d'organisation. Notre réflexion sur l'Empire suggère trois paradigmes alternatifs, dont l'ensemble forme système. Un paradigme politico-économique: le circuit européen, moyen de puissance de l'Empire; un paradigme socio-économique: le travailleur, mobilisateur de la technique; un paradigme éthique: le service social avec plus de réciprocité. Ces trois paradigmes favoriseraient l'émergence de structures européennes qui permettraient d'entretenir notre foyer de civilisation.
Le système économique dominant est actuellement du type transnational: des groupes privés ont des stratégies mondiales. Ce type d'organisation est renforcé depuis les années soixante par une conquête des esprits à travers les thèmes de propagande américains: culture de masse, droits de l'homme, etc…, et trouve un appui au sein des bureaucraties publiques des Etats européens où se conjuguent sécurité de l'emploi et avantages de la richesse. Ce n'est toutefois qu'une modalité possible d'organisation. Notre réflexion sur l'Empire suggère trois paradigmes alternatifs, dont l'ensemble forme système. Un paradigme politico-économique: le circuit européen, moyen de puissance de l'Empire; un paradigme socio-économique: le travailleur, mobilisateur de la technique; un paradigme éthique: le service social avec plus de réciprocité. Ces trois paradigmes favoriseraient l'émergence de structures européennes qui permettraient d'entretenir notre foyer de civilisation.
 Tôt ou tard – mais nous n’en sommes pas encore là – il faudra l’admettre, afin de chercher à poser le problème autrement pour parvenir à le résoudre. Car, pour la seconde fois après l’épisode de la chute libre initiée par la faillite de Lehman Brothers, les gouvernements et les autorités financières tentent de régler un problème d’insolvabilité par le déversement de liquidités, renflouant les dettes en créant de nouvelles dettes.
Tôt ou tard – mais nous n’en sommes pas encore là – il faudra l’admettre, afin de chercher à poser le problème autrement pour parvenir à le résoudre. Car, pour la seconde fois après l’épisode de la chute libre initiée par la faillite de Lehman Brothers, les gouvernements et les autorités financières tentent de régler un problème d’insolvabilité par le déversement de liquidités, renflouant les dettes en créant de nouvelles dettes.




.jpg)

 Soros opère exactement dans les limites du complexe de renseignements. Il diffère peu des trafiquants de drogue de la CIA au Laos, dans les années 60, ou des moudjahidine qui tiraient profit du trafic de l’opium tout en menant des opérations pour le compte de la CIA contre l’Afghanistan socialiste des années 80. Il canalise tout simplement (et ramasse) beaucoup plus d’argent que ces marionnettes et une partie bien plus importante de ses affaires se font au grand jour. Sa franchise, dans la mesure où il en fait preuve, réside dans un contrôle factice des dégâts, lequel sert à légitimer les stratégies de la politique étrangère américaine.
Soros opère exactement dans les limites du complexe de renseignements. Il diffère peu des trafiquants de drogue de la CIA au Laos, dans les années 60, ou des moudjahidine qui tiraient profit du trafic de l’opium tout en menant des opérations pour le compte de la CIA contre l’Afghanistan socialiste des années 80. Il canalise tout simplement (et ramasse) beaucoup plus d’argent que ces marionnettes et une partie bien plus importante de ses affaires se font au grand jour. Sa franchise, dans la mesure où il en fait preuve, réside dans un contrôle factice des dégâts, lequel sert à légitimer les stratégies de la politique étrangère américaine. L’économiste Jacques Delpla, reprenant une étude d’Olivier Blanchard, du FMI, propose une mise en œuvre à marche forcée de ce programme. Les États du sud, propose-t-il, devraient imposer une réduction coordonnée des salaires et des prix, de l’ordre de 10 à 30%. Jean Claude Werrebrouck s’inquiète des conséquences de cette mesure « abracadabrantesque », aux effets de bord imprévisibles, et qui de plus aurait pour conséquence remarquable d’être favorable aux rentiers. Face à la grande crise qui menace, le temps n’est plus aux bricolages, juge-t-il : il convient de « rétablir la souveraineté monétaire ».
L’économiste Jacques Delpla, reprenant une étude d’Olivier Blanchard, du FMI, propose une mise en œuvre à marche forcée de ce programme. Les États du sud, propose-t-il, devraient imposer une réduction coordonnée des salaires et des prix, de l’ordre de 10 à 30%. Jean Claude Werrebrouck s’inquiète des conséquences de cette mesure « abracadabrantesque », aux effets de bord imprévisibles, et qui de plus aurait pour conséquence remarquable d’être favorable aux rentiers. Face à la grande crise qui menace, le temps n’est plus aux bricolages, juge-t-il : il convient de « rétablir la souveraineté monétaire ». Jour après jour, il apparaît de plus en plus clair que des banques et des fonds spéculatifs américains jouent l’éclatement de la zone euro : d’abord la Grèce avant le Portugal, l’Espagne, etc.
Jour après jour, il apparaît de plus en plus clair que des banques et des fonds spéculatifs américains jouent l’éclatement de la zone euro : d’abord la Grèce avant le Portugal, l’Espagne, etc. Après avoir lu beaucoup de livres de penseurs alternatifs (…),
Après avoir lu beaucoup de livres de penseurs alternatifs (…), Jean de Maillard, 58 ans, vice-président au tribunal de grande instance d’Orléans, s’intéresse aux mutations économiques, financières et sociales nées de la mondialisation. Dans « Le Rapport censuré » (Flammarion), publié en 2004, il a repris un travail « trappé » sur les menaces engendrées par les circuits de l’argent sale, réalisé pour le ministère des Affaires étrangères.
Jean de Maillard, 58 ans, vice-président au tribunal de grande instance d’Orléans, s’intéresse aux mutations économiques, financières et sociales nées de la mondialisation. Dans « Le Rapport censuré » (Flammarion), publié en 2004, il a repris un travail « trappé » sur les menaces engendrées par les circuits de l’argent sale, réalisé pour le ministère des Affaires étrangères. Les profits du capital financier reposent sur l’endettement, et sur une création illimitée de dettes, au niveau des sociétés, des ménages et du gouvernement, qui grossissent à une vitesse bien plus grande que le produit national brut mondial ou le commerce mondial. Comment espérer, dans ces conditions, atteindre à la stabilité de l’ordre monétaire international ou à l’efficacité du système ? Sa remise en ordre serait-elle compatible avec les intérêts en jeu et avec la libéralisation tous azimuts de l’économie ?
Les profits du capital financier reposent sur l’endettement, et sur une création illimitée de dettes, au niveau des sociétés, des ménages et du gouvernement, qui grossissent à une vitesse bien plus grande que le produit national brut mondial ou le commerce mondial. Comment espérer, dans ces conditions, atteindre à la stabilité de l’ordre monétaire international ou à l’efficacité du système ? Sa remise en ordre serait-elle compatible avec les intérêts en jeu et avec la libéralisation tous azimuts de l’économie ?