Par Frédéric Lordon
Ex: http://fortune.fdesouche.com/
Il faut peut-être prendre un ou deux pas de recul pour admirer l’édifice dans toute sa splendeur : non seulement les marchés de capitaux libéralisés, quoique les fabricateurs de la crise dite des dettes souveraines (voir « Crise : la croisée des chemins »), demeurent le principe directeur de toutes les politiques publiques, mais les institutions bancaires qui en sont le plus bel ornement sont devenues l’unique objet des attentions gouvernementales.

- Albrecht Dürer – Némésis ou La grande fortune (1501)
Les amis du « oui » au Traité constitutionnel de 2005 trouvaient à l’époque trop peu déliées à leur goût les dénonciations de « L’Europe de la finance » mais si le slogan ne sonne en effet pas très raffiné, c’est que la réalité elle-même est grossière à ce point.
L’entêtement à soumettre les politiques économiques aux injonctions folles des créanciers internationaux, telles qu’elles s’apprêtent à nous jeter dans la récession, trouve ainsi son parfait écho dans la décision, qui ne prend même plus la peine de se voiler, de mobiliser le surplus d’emprunt européen de l’EFSF (1)… pour le sauvetage des banques irlandaises bien méritantes d’avoir savamment ruiné les finances publiques du pays (2).
Le cas de l’Irlande a ceci d’intéressant que la connexion entre finances bancaires privées et finances publiques y est plus directe et plus visible qu’ailleurs, mais il ne faut pas s’y tromper : pour la Grèce déjà, et pour tous les autres candidats au sauvetage qui suivront, il s’agit toujours in fine moins de sauver des États que d’éviter un nouvel effondrement de la finance – et l’on attend plus que le barde européen de service qui viendra célébrer l’Europe en marche d’après ses plus hautes valeurs : solidarité et humanisme, car après tout c’est vrai : nous voilà, contribuables citoyens européens (3), solidaires des banques de tous les pays, et les banquiers sont des hommes comme les autres.
Il y a pourtant quelque part un point de réalité où les fables déraillent et les voiles se déchirent. Manifestement nous nous en approchons. Et, Némésis incompréhensible de tous ceux qui, l’ayant voulue ainsi, l’ont défendue envers et contre tout, l’Europe commise à la finance contre ces citoyens mêmes est sur le point de périr par la finance.
La croyance financière à la dérive
En univers financiarisé, il n’y a pas de signe de crise plus caractéristique et plus inquiétant que la perte des ancrages cognitifs collectifs qui, en temps ordinaires, régularisaient les jugements et les comportements des investisseurs. Or tout vole en éclat et la croyance financière n’est plus que dérive erratique.
Inutile de le dire, la perte de toute régularité interprétative et comportementale rend impossible la conduite des politiques économiques toujours exposées au risque d’être reçues à l’envers des effets qu’elles pensaient produire, et même d’être systématiquement rejetées puisque, quelle que soit la proposition, les jugements de la finance sont écrasés par un affect directeur de panique et que, littéralement parlant, plus rien ne va – énoncé qu’il faudrait d’ailleurs lire en remettant les mots dans leur ordre adéquat : rien ne va plus.
Ainsi le 30 septembre l’agence Moody’s a-t-elle le front de dégrader la note souveraine espagnole au motif… d’une insuffisante croissance, alors même qu’elle a si bien concouru au printemps à faire adopter les politiques de rigueur… qui tuent la croissance.
L’opinion financière, agence et opérateurs ici confondus, réclament donc à cors et à cris la rigueur, et vendront les dettes publiques s’ils ne l’ont pas. Mais ils ne veulent pas des conséquences de la rigueur et vendront la dette publique s’ils les ont.
Sans même en venir à des considérations de principe tenant pour une espèce de crime contre la souveraineté démocratique (4) que l’on évince les réquisits des citoyens par ceux des créanciers, sorte d’effet d’éviction (5) qui incidemment n’a jamais empêché les économistes standard de dormir, n’importe quel décideur politique tant soit peu rationnel arrêterait qu’il est simplement inenvisageable de se soumettre à une tutelle aussi désarticulée, qui lui fera faire tout en lui demandant au surplus son contraire.
Mais quelqu’un a-t-il entendu le moindre commencement de l’évocation d’un éventuel projet d’émancipation européenne en cette matière ?
L’union monétaire est donc vouée à dévaler, avec les investisseurs auxquels elle a lié son sort, la pente du chaos cognitif collectif, et il n’y aura plus qu’à s’étonner de l’étonnement de ceux qui découvrent affolés que « plus rien ne marche » : car en effet les conditions sont maintenant en place pour que rien ne marche plus.
Dans une tentative héroïque de réplication d’une opération-vérité à la suédoise, la banque centrale irlandaise a décidé d’annoncer en mars les besoins « véritables » (6) – colossaux (7) – de recapitalisation d’un système bancaire privé dont la taille relativement au PIB du pays était déjà en soi un signe de déraison manifeste (8) (proposée à la réparation de l’Europe entière…).
Las, les autorités irlandaises qui escomptaient les profits d’admiration généralement accordés au stoïcisme et le prix de son « courage » sous forme de détente des taux d’intérêt, n’ont reçu qu’un surplus de panique et la mise en cause de leurs finances publiques devenues solidaires des finances privées pour des montants il est vrai affolants.
Ceux qui espéraient le retour au calme du sauvetage de l’Irlande ont vite compris à quoi s’en tenir : dès lundi matin sitôt l’annonce faite, les taux d’intérêt irlandais se détendaient très légèrement sur les échéances inférieures à deux ans… et se tendaient à dix ans, attestation indirecte de ce que l’EFSF n’est vu que comme une parenthèse sans pouvoir de résolution durable ; lundi soir c’était la débâcle obligataire.
Et l’on tiendra pour un symptôme très caractéristique de la destruction des repères cognitifs de la finance le fait que quelques jours avant l’annonce du plan de sauvetage irlandais, 35 milliards d’euros étaient jugés par les analystes comme un volume tout à fait à la hauteur des besoins de recapitalisation bancaire alors que dès l’après midi de son annonce il était trouvé notoirement insuffisant…
L’Union dans son ensemble est logée à la même enseigne. Elle croyait le sauvetage de la Grèce et la constitution de l’EFSF propres à impressionner l’opinion financière et à la raisonner pour de bon. Il n’en a rien été comme l’atteste la recherche frénétique par la finance du nouveau maillon faible sitôt le précédent réparé.
Formellement semblable en cela à la séquence qui à partir du printemps 2008 avait vu l’inanité des sauvetages ponctuels, Bear Stearns, Fannie, Freddie, jusqu’au point de bascule Lehman, la succession des bail-outs européens n’arrête plus rien mais a l’effet exactement opposé d’allonger sans fin la liste des suspects – la seule chose dont débat maintenant la finance étant l’ordre dans lequel il faut les « prendre ».
On pourrait être tenté de filer le parallèle avec l’automne 2008 pour en tirer la conclusion que, la formule des sauvetages ponctuels épuisée, seule une solution globale frappant fort un grand coup a quelque chance de produire l’effet de choc propre à modifier brutalement la configuration des anticipations collectives de la finance.
La menue différence, trois fois rien, tient au fait qu’à l’époque les finances publiques étaient fraîches et disponibles pour tirer d’affaire ces messieurs de la banque. Or, le sauvetage de la finance privée et les coûts de récession sur le dos, les budgets sont désormais aux abonnés absents, la situation ayant d’ailleurs si mal tourné que les finances publiques sont passées du côté du problème et ne font décidément plus partie des solutions.
Misère du fonds de secours européen
C’est cet état de fait que l’EFSF s’emploie à masquer autant qu’il le peut. Mais l’illusion qu’il avait congénitalement vocation à produire, et celles qu’il entretient sur son propre compte, finiront bientôt par craquer. Il y a d’abord qu’on n’est pas très au clair sur l’extension véritable des sollicitations dont il peut faire l’objet, et il reste comme une incertitude sur la nature de la « facilité » qu’il est censé apporter.
Est-il simple « facilité intermédiaire » destinée à faire d’ici 2013 les soudures de trésorerie des Etats temporairement en délicatesse avec les marchés ? Si tel est le cas, la force de frappe du fonds s’apprécie d’après les besoins de financement des États, c’est-à-dire la somme des déficits courants et des échéances de dette arrivant à maturité sur la période.
L’Irlande et le Portugal à eux deux devront trouver 60 milliards en 2011 et 40 pour 2012. L’Espagne à elle seule aura besoin de 190 milliards d’euros pour 2011 et 140 autres milliards pour 2012 (9) – 330 milliards et encore : un an en avance de l’échéance de l’EFSF, plus les 100 des deux précédents, 430 milliards à eux trois… pour une enveloppe globale de l’EFSF de 440 milliards (10) – et plaise au ciel que tout aille bien pour l’Italie et la France, les deux têtes de turc d’ores et déjà inscrites dans la file.
Il y a ensuite que l’EFSF n’a pas exactement les moyens qu’il dit avoir. Car pour obtenir la notation triple-A qui lui permet de lever des fonds à coût moindre que les États en difficultés, l’EFSF a été contraint de sur-collatéraliser à 120% ses actifs (11).
La chose signifie que tout euro prêté doit être adossé à 1,2 euros de fonds levé par l’EFSF (en fait par les Etats contributeurs) – et sur les 440 milliards nominaux seuls donc 366 sont réellement disponibles. La logique de la sur-collatéralisation n’est pas autre chose que celle de la garantie que l’EFSF prétend apporter et du coût de défaut qu’il prendrait à sa charge puisqu’il en soulage les créanciers internationaux.
Mais l’enveloppe est en fait bien plus petite encore.
Car d’une part disparaissent (assez logiquement) de la liste des Etats contributeurs au fonds les Etats devenus suppliants du fonds – on peut sans doute tenir le manque pour surmontable quand il s’agit des 12 milliards d’euros d’apport de la Grèce et des 7 de l’Irlande, mais le trou commencera à se voir si jamais il faut se passer d’un coup des 52 de l’Espagne…
Et s’y ajoute d’autre part que l’EFSF pour conserver son triple-A devra n’être abondé que par des États eux-mêmes triple-A, avec risque de casse majeur si d’aventure l’un des « gros » se trouvait être dégradé – vienne la France, au hasard, à perdre son sésame, l’EFSF trépasserait vraisemblablement dans l’instant.
Il y a enfin que l’EFSF n’a été dimensionné que dans la logique des sauvetages ponctuels (au surplus en petit nombre) et qu’il serait strictement incapable de faire face à un épisode de défauts souverains simultanés par contagion foudroyante – ce ne serait plus les besoins de financement publics à deux ou trois ans qu’il faudrait regarder mais les encours mêmes de dette, et l’ordre de grandeur change d’un coup du tout au tout.
Affolés par ces perspectives qu’ils ont eux-mêmes si bien contribué à créer, les investisseurs sont maintenant obsédés par une quête de la sécurité parfaite que, curieusement ils ne leur viendraient pas à l’idée d’exiger d’un débiteur privé, et dans le monde particulier des sovereigns (12), « senior » est implicitement tenu pour synonyme de « garanti » (13) ! (comme l’atteste le plan irlandais qui a pris grand soin d’épargner ces créanciers-là).
Or ce n’est pas du côté de l’augmentation des moyens du fonds que viendra la solution parce que régler les problèmes des plus endettés en surendettant ceux qui le sont moins finira par se voir.
Il est utile de redire que la solution du bootstrapping par laquelle le baron de Münchausen s’extrait de la boue en se tirant lui-même par les cheveux ne fonctionne que dans les contes. Dans la réalité européenne présente, plus il y a de secourus moins il y a de secouristes, et plus ces derniers se préparent à rejoindre les précédents dans leur catégorie.
Le syllo de Canto
A la question de savoir comment tout ceci peut se finir, la réponse est donc : mal. Et ceci d’autant plus que les corps sociaux commencent à sérieusement renauder.
Sans doute l’enchaînement des faits est-il compliqué à suivre dans son détail technique mais le tableau d’ensemble lui est des plus clairs, et tout le monde en voit maintenant parfaitement les couleurs dégueulasses :
1) la finance privée est l’auteur de la plus gigantesque crise de l’histoire du capitalisme ;
2) les banques ne doivent d’avoir forcé les pouvoirs publics à les secourir qu’au fait d’occuper cette place névralgique dans la structure d’ensemble du capitalisme qui leur permet d’enchaîner le corps social tout entier à leurs intérêts particuliers ;
3) cette situation qui a tout de la parfaite prise d’otage aurait dû conduire sitôt le sauvetage de 2008, non seulement à fermer largement le jeu de la finance de marché (14), mais à recommunaliser le système bancaire en tant précisément qu’il est de fait le dépositaire de biens communs vitaux (15) à savoir : la sûreté des encaisses monétaires du public et les conditions générales du crédit à l’économie réelle ;
4) infestés par les représentants des puissances d’argent, les États n’en ont rien fait et donné le secours pour rien, ou plutôt pour un double bras d’honneur, qui a d’abord pris la forme du maintien des rémunérations exorbitantes et surtout, plus grave, celle de l’application de la férule des marchés aux finances publiques, saignées soit d’avoir sauvé directement les banques, soit de faire face aux coûts de la récession ;
5) les splendides mécanismes des marchés de capitaux concourent avec une rare élégance à l’organisation du pire en rendant insoluble la crise des dettes qu’ils ont eux-mêmes fait naître ;
6) et ceci jusqu’à ce que cette crise-là devienne irrémédiablement la leur à nouveau, menaçant d’un deuxième effondrement du calibre de 2008 ;
7) pendant quoi l’Europe invente à la hâte de nouvelles institutions supposées venir en aide « aux États » là où tous voient bien qu’il s’agit de sauver les banques pour la deuxième fois. Or, pour ainsi dire, c’est la deuxième fois de trop – car on se demande encore comment la première a été avalée si facilement par les corps sociaux décidément d’un calme olympien. Jusqu’ici.
Jusqu’ici, car maintenant ça commence à glouglouter méchamment dans la marmite et les populations hors de leurs gonds cherchent légitimement de quoi se passer les nerfs sur les banques.
Le succès de la vidéo Cantona n’a pas d’autre origine, et il faudrait le fin fond de l’ineptie politique pour n’en pas saisir le sens réel qui dit l’arrivée aux limites de ce que les populations sont prêtes à tolérer de scandale.
Pour tout le bien-fondé de la colère qu’il exprime, il y a pourtant de quoi s’effrayer de son implacable syllogisme qui dit en gros : « les banques et les banquiers sont la cause de tous nos maux » – schématique mais vrai –, « or les banques ne vivent que de nos dépôts » – partiellement vrai encore –, « par conséquent, pour abattre les banques et se débarrasser du fléau il suffit de leur retirer nos dépôts » – techniquement vrai… mais in fine catastrophiquement faux.
Bank run : il n’y en aura pas pour tout le monde !
Parce que Canto, tu retires tes économies et puis tu en fais quoi ? Matelas ? Lessiveuse ? Tâche aussi de te présenter au guichet parmi les tout premiers car il n’y en aura pas pour tout le monde. À chaque instant, en effet, les banques sont strictement incapables de faire face à l’exercice généralisé de la convertibilité inconditionnelle des dépôts à vue en espèces.
Sur leurs larges populations de déposants, la loi des grands nombres leur assure en temps ordinaires une régularité statistique des comportements de retrait dont la moyenne globale ne représente qu’une fraction minime des dépôts réels, et n’appelle donc qu’un taux de couverture équivalent – bas.
Évidemment tout change lorsque des circonstances exceptionnelles modifient brutalement les comportements de retrait, en les corrélant intensément, par exemple sous l’effet d’une panique collective qui conduit à la ruée des déposants. Planifiant sa propre détention d’espèces sur la base des comportements moyens ordinaires, la banque se retrouve incapable de faire face à des demandes de retrait brutalement modifiées.
De là le ravissant spectacle des files de déposants, éclusées délibérément au compte-goutte pour donner le temps à la banque de s’alimenter en liquidités – quand elle le peut. Le rationnement, pour dire les choses en termes pudiques, fait donc nécessairement partie d’un bank run, c’est pourquoi il arrive que la queue au guichet soit un peu tassée, parfois même qu’on s’y marche légèrement dessus, car d’emblée on sait que tous ne récupéreront pas leurs billes.
Lessiveuses et patates
Mais les vraies joyeusetés commencent après. Car, les banques mises au tapis dans un bel ensemble, il faut tâcher de se figurer de la plus concrète des manières ce à quoi peut bien ressembler la vie matérielle. Manger par exemple. C’est-à-dire aller acheter à manger. Payer par chèque ? Plus possible : plus de banques. Tirer de l’argent au distributeur ? Plus possible : plus de banques. Obtenir un crédit ? Plaisanterie ! Plus de banques. Reste l’argent liquide au fond des poches. Canto qui se sera présenté parmi les premiers aura sa lessiveuse pour tenir. Mais pour les 90% rationnés, ça leur fera quatre à cinq jours d’horizon, en forçant plutôt sur les pâtes, et juste le temps de se mettre à l’art du jardin potager, car après…
Parce qu’il détruit instantanément le système des paiements et du crédit, l’effondrement bancaire général est l’événement extrême en économie capitaliste, arrêt des productions incapables de financer leurs avances, impossibilité même des échanges puisque la circulation monétaire a perdu ses infrastructures, une sorte de comble du chaos matériel, et le monde social n’a pas belle allure lorsque les individus en sont réduits à lutter pour leur survie matérielle quotidienne.
Le syllo de Canto commet donc ce qu’on pourrait appeler une erreur de métonymie : il prend l’accident pour la substance, ou la réalisation particulière pour la généralité.
La vérité, si elle manque sans doute de poésie, est que nous avons besoin de banques, nous en avons même un besoin vital.
Mais dire que nous avons besoin de banques est une chose, et la question de savoir de quelles banques nous avons besoin en est une autre. Car des systèmes bancaires il en existe de toutes sortes, des pires et des meilleurs. Et l’on pourrait en dire ce qu’on dit déjà de cet autre générique inconsistant, « L’Europe » : ce ne sont pas les banques, c’est cette forme de banque qu’il faut détruire.
On trouvera la nuance bien mince et de peu d’implications concrètes. Elle signifie pourtant que la ruine totale n’est pas une option attrayante, encore moins la ruine organisée de propos délibéré.
Dans les banques, il y a les infrastructures des systèmes de paiement et de tenue des comptes, c’est-à-dire les prérequis à tout échange possible dans une économie monétaire à travail divisé. Il y a aussi des gens (plus ou moins) capables de prendre des décisions de crédit, pour les ménages, les entreprises, et puis quelques autres choses encore que nous avons sacrément intérêt à garder.
Faire tomber les banques, mais par le défaut souverain…
Il faut bien reconnaître cependant qu’il n’est pas facile de décourager les plans naufrageurs du public en colère quand le système bancaire lui-même travaille si bien à son propre effondrement… Car voilà où en est la magnifique Europe des traités, celle-là même qui voulait tant qu’on ne l’appelle pas « L’Europe de la finance », et voilà ce qui lui pend au nez comme un sifflet de deux ronds : le défaut généralisé.
Désormais les uns entraînent les autres sans qu’on n’ait plus idée ni de la cause ni de l’effet. Dans l’atmosphère de panique qui emporte les marchés obligataires, le fait marquant est en effet la solidarité (dans la déveine) des financials et des sovereigns, c’est-à-dire des titres bancaires et des titres publics.
La corrélation de leurs primes de CDS (16) et de leurs spreads (17) respectifs donne une idée du degré auquel les destins des finances publiques et des finances bancaires privées sont désormais intriqués puisque sauver les banques ruine les Etats et que le possible défaut des Etats ruinera les banques.
C’est l’emballement collectif des investisseurs qui se charge de déployer cette dynamique fatale, la croyance financière au défaut souverain faisant advenir le défaut souverain – et puis juste après le défaut bancaire ! Et la synergie des faillites combinées s’annonce d’une telle magnitude que tous les EFSF de la terre peuvent d’ores et déjà aller se rhabiller.
Entre faire tomber les banques par un run de déposants en colère et les voir tomber d’elles-mêmes sous l’effet de leurs propres turpitudes, la différence, à résultat concret équivalent, est celle qui laisse au capitalisme financier et à ses « élites » l’entière responsabilité historique de la ruine finale.
Et si vraiment, plutôt que de simplement regarder tomber les banques, on voulait activement les faire tomber, la meilleure option à tout prendre consisterait bien plutôt à ce que, par inversion des rôles dans la comédie du bras d’honneur, ce soit l’État qui s’en charge en déclarant souverainement le défaut sur sa dette publique.
Car pour produire tous ses effets, le défaut « nu », celui du simple bank run citoyen, ne suffit pas, et la manœuvre ne prend tout son sens politique possible que :
1. de signifier par un geste unilatéral de souveraineté à qui revient le pouvoir en dernière analyse : aux peuples, pas à la finance ;
2. par répudiation de tout ou partie de la dette publique, de soulager aussitôt les populations de la contrainte d’austérité et de récupérer des marges pour des politiques de croissance ;
3. de s’armer d’une politique publique de transformation radicale, prolongement nécessaire du simple défaut, visant, d’une part, l’affranchissement du financement des déficits publics des marchés de capitaux (18) (seul moyen que le défaut maintenant ne vaille pas sur-pénalisation par les marchés plus tard), et, d’autre part, la refonte complète des structures bancaires (de toute façon mises à bas par le défaut même)
Il y a fort à parier que, parmi les gouvernements commis d’aujourd’hui, il ne s’en trouvera aucun capable de l’insolence affirmative qui est la marque de la souveraineté, et de revendiquer par le défaut l’état de guerre ouverte avec la finance – car après tout le problème est bien plus symétrique qu’on ne croit : la finance peut sans doute nous prendre en otages mais, dès lors qu’il est suffisamment débiteur, l’Etat a aussi les moyens de la ruiner, avec au surplus, derrière, le pouvoir de la ramasser à la petite cuillère et à sa façon.
Qu’à cela ne tienne : c’est le développement endogène de la dynamique financière présente qui se chargera de faire le travail, et le défaut que les Etats pourraient endosser dans un geste de rupture délibéré s’imposera à eux comme à des boutiquiers déconfits.
Nous n’avons de toute façon plus le choix que de penser sous l’hypothèse de l’effondrement bancaire consécutif à des dénonciations souveraines, revendiquées ou subies, c’est-à-dire sous l’hypothèse resurgie de « l’automne 2008 » – mais avec cette différence par rapport à 2008 que la solution par le sauvetage d’Etat est désormais barrée.
… et les saisir !
A l’honneur (ou au déshonneur) près, toutes les possibilités ouvertes par le défaut combiné des Etats et des banques restent offertes.
Car pour tous ses dangers réels, la faillite technique des banques a au moins un effet intéressant : elle permet de leur mettre la main dessus. Et à pas cher en plus. Les arguments de principe pour une recommunalisation du système du crédit abondent ; la situation de faillite leur offre leurs conditions de réalisation – et même de réalisation modique.
Car si la nationalisation intégrale est la première étape du processus de recommunalisation du bien commun bancaire, avant la mutation ultérieure en système socialisé du crédit (19), la situation critique de la faillite générale offre la possibilité d’opérer cette nationalisation par simple saisie.
A l’inverse des pratiques ordinaires du redressement des entreprises en difficulté, il n’y a pas de solution privée à l’effondrement global des institutions bancaires qui condamne dès lors irrémédiablement leurs actionnaires à la vitrification.
Le sauvetage public, quelle qu’en soit la modalité, n’a donc aucun compte à tenir de cette population spéciale qu’on peut d’ores et déjà tenir pour annihilée, conformément d’ailleurs à l’esprit même du capitalisme des sociétés par actions : les apports en fonds propres ne sont pas récupérables et les actionnaires n’acquièrent leur part de propriété (et les droits afférents aux dividendes) qu’en contrepartie d’accepter une perte définitive en cas de faillite – nous y sommes.
Saisir les banques faillies n’a donc aucun caractère d’attentat à la propriété puisque la propriété a été anéantie par la faillite même, la faillite étant de ce point de vue l’équivalent capitaliste de la bombe à neutrons qui tue les droits de propriété en laissant intacts les bâtiments, les équipements et même, quoique pendant un temps relativement court, les humains salariés capables de les faire marcher. C’est tout cela qu’il faut récupérer.
À l’instant tau plus upsilon qui suit le passage des neutrons, les pouvoirs publics ne se penchent sur le cas des banques à terre que parce qu’il y va d’un bien commun vital pour la société et pour cette raison seule.
Le jeu normal du marché anéantit les actionnaires et cette partie-là du jeu ne sera pas modifiée. Le sauvetage public n’a aucune vocation à les ressusciter, il n’a pas d’autre finalité que de nous éviter le désastre collectif qui suit particulièrement d’une faillite bancaire.
L’alternative qui naît de cet événement est alors des plus simples et, selon que l’État fait ou ne fait pas, ne laisse le choix qu’entre, d’une part, des banques à terre, des actionnaires morts et nous morts avec très peu de temps après, ou bien d’autre part, des banques redressées, des actionnaires laissés morts mais nous vivants par le fait même de la saisie-redressement.
On constatera que dans ces deux états du monde possibles les actionnaires meurent identiquement, et que la différence notable tient au seul fait que dans l’un nous mourrons avec eux, dans l’autre pas, raison pour quoi il ne devrait pas y avoir à réfléchir trop longtemps avant de choisir la bonne solution.
La banque centrale, ultime recours
Mais une faillite ne laisse pas que des actionnaires sur le carreau : des créditeurs aussi. Le droit ordinaire des faillites et ses résolutions concordataires offrent cependant à ces derniers une chance de récupérer une partie de leur mise. Mais ce droit-là est privé et la logique du défaut souverain lui est hétérogène.
Mis à part les dettes souveraines, le gros du problème tient dans le réseau des dettes-créances interbancaires. On peut imaginer leur partiel netting (20) sur le territoire pertinent – dont on réserve de dire quelle doit être la circonscription (voir infra).
Ce netting « interne » peut s’accompagner d’un défaut sur les engagements « externes » (i. e. avec les institutions financières situées hors du « territoire pertinent »), à la façon dont les banques islandaises se sont remises bien plus vite que prévu du fait de n’avoir pas hésité à dénoncer les passifs non-résidents (21) – et mieux encore d’avoir fait valider ce geste de dénonciation par un référendum populaire !
Au rang des créditeurs internes, il faut compter également tous les épargnants individuels, détenteurs de titres publics par assurances-vie et Sicav interposées. Disons tout de suite que le défaut souverain a spontanément de bonnes propriétés de justice sociale puisqu’il frappe proportionnellement les plus gros épargnants qui sont aussi les plus riches, même si l’on peut envisager de garantir ces créditeurs-là à hauteur d’un certain plafond qui ne ferait plonger que les plus fortunés.
En remontant l’ordre de séniorité, viennent enfin les déposants dont il est assez évident que les dépôts à vue et à terme doivent être garantis – hors de quoi le sauvetage des banques est simplement privé de sens.
Mais dans tous les cas de figure il y aura des pertes colossales à prendre et des recapitalisations tout aussi importantes à opérer du fait de la prévisible destruction des bases de fonds propres.
C’est bien pourquoi les plans de 2008 étaient à double détente : concours de la banque centrale pour assurer la liquidité vitale des banques et permettre au moins la continuité d’opération du système des paiements, « plans de redressement » à la façon du TARP des Etats-Unis, de la NAMA irlandaise, de la SFEF française, etc. Ces volets « redressement » étaient indispensables pour, au-delà de la simple survie, remettre le système bancaire en état de reprendre ses activités de crédit.
À ceci près qu’ils ont été assurés sur les finances publiques et que maintenant c’est fini. Le redressement peut être amorcé par cessions massives d’actifs (quoique dans la situation envisagée, on se demande bien qui pourrait en être preneur…), ou à tout le moins voir son ampleur diminuée par une réduction brutale des périmètres d’activité : les banques en saisie-redressement abandonneront tout ou partie de leurs activités de marché et seront priées de se reconcentrer sur ce qui est historiquement leur métier, à savoir le crédit à l’économie et l’offre de formules d’épargne simples – l’une des opportunités offertes par la faillite étant donc de permettre de médiocriser la finance (22).
À ce stade critique cependant, c’est-à-dire quand les possibilités financières d’intervention de l’Etat ont été épuisées, il ne reste de toute façon plus qu’un seul instrument significatif mobilisable : la banque centrale.
Ça n’est pas la peine de commencer à hurler à l’inflation, car, en cette situation-là, il n’y a plus qu’à choisir entre le risque de l’inflation future et la certitude de la mort matérielle tout de suite – alternative qui normalement ne laisse pas le loisir d’hésiter très longtemps. À court terme au moins les fonds de reconstruction d’un système bancaire ne pourront donc plus venir que de la création monétaire.
Quant à ceux qui pousseront de grands cris à l’idée que la banque centrale pourrait abonder de cette manière le capital des banques à reconstruire, on leur fera observer qu’ils ont gardé un délicat silence lorsque la Réserve Fédérale s’est transformée en gigantesque hedge fund [pour] racheter tous les actifs pourris des banques privées en pleine déconfiture – ceci dit au moment précis où la Fed révèle la liste des récipiendaires des 3300 milliards de dollars de concours variés qu’elle a mis à leur disposition, comme quoi, dirait l’adage populaire, pas faux en l’occurrence, quand on veut, on peut…
Salut, souveraineté, territoire
Et voilà où se pose pour de bon la question du « territoire pertinent ». Est pertinent le territoire sur lequel existe une banque centrale décidée à accomplir toutes ces actions. Il y a malheureusement toutes les raisons de redouter que ce ne soit pas la zone euro. Jamais ni les représentants allemands à la BCE, ni le gouvernement de Bonn ni la cour constitutionnelle de Karlsruhe ne consentiraient la chose qui leur apparaît comme le comble de l’horreur.
Il est vrai que sauf les mythologies du « couple franco-allemand », faire une Europe monétaire avec l’Allemagne était d’emblée une entreprise impossible (23) – et en même temps, dans l’hypothèse retenue, les banques privées allemandes seraient au tapis comme les autres et il faudra bien que l’Allemagne invente quelque chose…
L’Allemagne mise à part, on peut craindre également que la BCE elle-même se refuserait à une intervention massive de cette sorte, en effet en violation flagrante de tous les textes qui encadrent son action.
On dira qu’on reconnaît précisément ces moment de souveraineté pure à l’envoi au bain des textes, encre sur du papier susceptible d’être rayée par une autre encre derrière laquelle de toute façon il n’y a jamais que de la force, la force politique du corps social souverain, en dernière analyse l’unique force motrice de tout l’univers politique.
Les Argentins, au cœur de la crise de 2001-2002, ne se sont-ils pas débarrassés en une nuit du currency board dont ils avaient pourtant gravé les termes dans le marbre de la constitution ?
Mais ces reprises de souveraineté supposent des conditions d’unité politique qui n’existent pas dans le cas européen où les traités demandent deux ans pour être modifiés là où il s’agit d’agir en deux jours, quand ça n’est pas en deux heures – et les pétaudières de l’intergouvernemental à 27 ne sont pas exactement ce qu’on appelle une force de réaction rapide….
On peut être tout à fait sûr que si besoin était vraiment, le gouvernement des Etats-Unis n’hésiterait pas un instant à envoyer valser le Reserve Federal Act pour reprendre en mains les contrôles et les latitudes qu’appelle impérieusement la situation d’exception.
Cette possibilité n’existe même pas dans la navrante construction européenne dont on sait bien qu’elle est un barbarisme au regard de la grammaire fondamentale de la souveraineté – et seule la mauvaise foi européiste, cette dégénérescence de l’idée européenne, comprendra ici que souveraineté ne rime qu’avec « nation », au sens des nations présentes, là où il s’agissait d’envisager les conditions de possibilité d’un véritable redéploiement de souveraineté à une nouvelle échelle : pour ainsi dire de refaire nation mais « à l’étage supérieur ».
Aussi, et comme le salut impose impérieusement ses réquisits, on peut imaginer que la zone euro se fracturerait selon une ligne de découpe séparant ceux qui s’accorderont à l’exercice d’une souveraineté commune dictée par la nécessité du geste monétaire massif et ceux qui ne le voudront pas.
Ou bien qu’elle céderait à de très fortes pressions à la « renationalisation » de l’action publique, c’est-à-dire à un retour à l’échelle territoriale où, pour l’heure, en existe en fait les réels moyens de souveraineté.
Réapparition de banques centrales nationales ou bien de sous-blocs monétaires, à partir de l’euro et avec les problèmes transitoires de double circulation, inutile de dire qu’on sera là entré dans un monde non-standard…
Notre heure
Mais quels choix reste-t-il vraiment quand les marchés auxquels les États se sont livrés gaiement s’apprêtent à faire leur ruine ?
Quand la collusion des élites politiques et économiques a atteint le degré que nous lui connaissons, quand le gouvernement est devenu le fourrier du capital à un point de caricature qui ferait rougir Marx (jusqu’à faire nommer sans discontinuer des chefs d’entreprise ministre des finances depuis dix ans…), quand l’asservissement des politiques publiques aux intérêts de la finance est tel que même la plus grande crise à l’échelle d’une génération ne parvient pas à obtenir le moindre commencement de régulation, quand tous les mécanismes institutionnels du présido-parlementarisme organisent la parfaite coupure d’avec le peuple et la capture de fait du pouvoir par une oligarchie séparée qui ne répond plus de rien ni à personne – comme l’attestent à propos des retraites une désapprobation de masse balayée d’un revers de main –, quand n’existe plus nulle part aucun mécanisme institutionnel de réelle représentation, aucune force de rappel politique, alors il est avéré qu’il n’est plus de solution de transformation à froid de l’ordre social – à l’encontre même de la (fausse) promesse « démocratique » (24) d’ingénierie politique ordonnée du changement.
Ce sera donc à chaud.
La question est alors celle de savoir en quels lieux précisément faire monter la température – en ne cachant pas que « température augmentée » signifie qu’il y a aura des bris de quelque chose quelque part. Marx en son temps avait parfaitement perçu que la convulsion est la modalité privilégiée par l’histoire de dépassement des contradictions.
Le nexus présent des contradictions de ce qu’il faut bien appeler avec Badiou le capitalo-parlementarisme, contradictions mêlées d’un système économique conduit au désastre par la finance libéralisée et d’un système politique institutionnel qui, en tous les sens du terme, ne répond plus, et n’est donc plus l’instance possible de transformation du premier, ce nexus a épuisé le spectre de ses solutions internes.
Si vraiment on en arrive en ce point où, les possibilités d’accommodation « régulière » du système évanouies, ne reste plus que le choix de son renversement, alors il y a cependant quelques raisons de préférer le soulèvement politique à l’insurrection bancaire.
Car la seconde nous abat nous-mêmes dans le même mouvement où elle abat ses ennemis, alors que le premier conserve la Banque comme principe mais nous rend les moyens de lui donner la forme que nous voulons – et dont nous avons besoin.
Cantona pense faire la révolution sans violence en effondrant les banques. Mais c’est qu’il n’a pas idée des violences du chaos matériel qui suivrait. Si le blocage institutionnel et le verrouillage par le bloc hégémonique rendent chaque jour un peu plus probable l’issue qu’un « bon » système politique a normalement pour vocation de tenir aussi éloignée que possible, à savoir le débordement insurrectionnel, toutes les insurrections ne se valent pas.
Et si vraiment violence il devait y avoir, plutôt celle qui permet de reprendre les institutions confisquées (ou d’inventer de nouvelles institutions) que celle qui nous jetterait les uns contre les autres dans des luttes pour la survie matérielle.
Qu’elle le dise de travers n’empêche pourtant pas la sortie de Cantona d’avoir son fond de justesse : les tyrannies ont rarement le bon goût de quitter d’elles-mêmes la scène de l’histoire et seuls des rassemblements de force adéquats peuvent les en expulser. La finance a régné 25 ans, c’est plus qu’il n’en faut pour dresser un bilan, et le bilan dit : c’est assez.
La particularité de l’époque réside en ceci que la tyrannie impersonnelle de la finance collabore activement à son propre renversement puisque, par une sorte de nécessité interne qui confirme, en la poussant à son comble, sa vocation à la destruction sociale, elle est sur le point de tout engloutir et paradoxalement jusqu’à elle-même.
Les Romains disaient que « ceux que Jupiter veut perdre, il commence par les rendre fous » – nous y voilà. La perspective de chocs immenses n’est pas gaie, mais qu’à la face de l’histoire il revienne entièrement aux fous de l’avoir fait advenir.
Et que les autres en tirent le meilleur parti, celui du moment décisif où leur joug se lève, éventuellement de s’être autodétruit, et où ils peuvent enfin se dire que « c’est notre heure ».
—————-
Notes :
(1) European Financial Stability Facility, le fonds de secours établi lors du sommet de Bruxelles du 9 mai 2010 à la suite du plan de sauvetage de la Grèce.
(2) Sur les 85 milliards d’euros du « paquet irlandais », 35 sont explicitement destinés aux banques.
(3) Sur qui reposeront in fine les éventuelles pertes de l’EFSF.
(4) Pour un développement de cet argument, voir « Le point de fusion des retraites », 23 octobre 2010, et « Crise européenne, deuxième service (partie 1) », 8 novembre 2010.
(5) Car les économistes standard sont surtout très préoccupés de cet effet d’éviction par lequel les emprunts d’Etat assèchent les marchés obligataires au détriment des émetteurs privés.
(6) Dont on découvre d’ailleurs aujourd’hui qu’ils sont encore un peu sous-estimés : Sharlene Goff et Patrick Jenkins, « Irish banks remain on a tightrope », Financial Times, 29 novembre 2010 ; mais seul le mensonge grec sur le déficit public est haïssable, le mensonge permanent des banques privées, lui, est véniel.
(7) 28,5 milliards d’euros au moment de l’annonce de mars.
(8) Le total des passifs bancaires irlandais est de 360% du PIB – le modèle-frère anglais faisant d’ailleurs encore mieux : 450%… voir « The real lesson about Ireland’s austerity plan », e21 Economic Policies for the 21st Century.
(9) Données Bloomberg, FMI, The Economist.
(10) Il est vrai compte non tenu des 60 milliards d’euros de l’EFSM (European Financial Stability Mechanism) et des 250 milliards d’euros apportés par le FMI lors du sommet du 9 mai 2010.
(11) Voir sur ce point Wolfgang Münchau, « Could any country risk a eurozone bail-out ? », Financial Times, 26 septembre 2010.
(12) Les titres obligataires souverains.
(13) La séniorité désigne l’ordre de priorité des créanciers à être servis en cas de défaut. Plus un titre est senior plus il vient haut dans cet ordre et plus ses créanciers seront remboursés prioritairement. Mais il se peut très bien que le défaut soit tel que même les créanciers seniors prennent des pertes, comme l’a montré le cas des tranches seniors des CDO et des MBS de subprimes.
(14) Voir « Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières », 23 avril 2008, et « Si le G20 voulait… », 18 septembre 2009.
(15) Cette recommunalisation prenant la forme d’urgence de la nationalisation puis, à terme, de la mutation en un système socialisé du crédit, voir « Pour un système socialisé du crédit », 5 janvier 2009.
(16) C’est-à-dire ce qu’il en coûte de faire assurer un titre obligataire contre d’éventuelles dévalorisations liées à un « événement de crédit ».
(17) C’est-à-dire l’écart de taux qui les sépare d’une obligation de référence jugée sans risque, en Europe le Bund allemand pour les titres souverains.
(18) Voir « Commencer la démondialisation financière », Le Monde diplomatique, mai 2010 ; « Crise européenne, deuxième service (partie 2) », 15 novembre 2010.
(19) « Pour un système socialisé du crédit », 5 janvier 2009.
[20] C’est-à-dire la compensation mutuelle des dettes croisées à des taux évidemment à définir en fonction de leurs taux d’intérêt facials, de leur maturité, etc.
(21) Et ceci même s’il est exact qu’à moyen terme, les banques islandaises, et l’Etat qui les a couvertes, se retrouveront engagés dans de nombreuses procédures judiciaires aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays Bas, etc.
(22) Voir « Si le G20 voulait… », 18 septembre 2009.
(23) Voir « Ce n’est pas la Grèce qu’il faut exclure, c’est l’Allemagne ! », 29 mars 2010.
(24) On veut dire : dans les formes présentes de la « démocratie ».
La pompe à phynance








 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg.jpg)


![OneDollar_NovusOrdoSeclorum[1].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/00/3044936868.jpg)






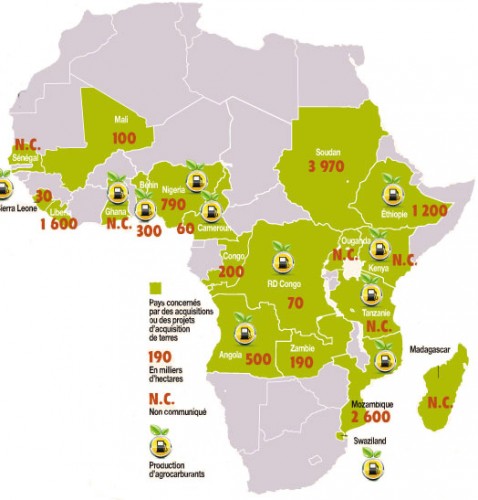

 Les Etats-Unis planifient l’intégration de l’Union Européenne dans leur propre espace économique et juridique, en accord avec les législateurs de Bruxelles et de Strasbourg. Washington espère ainsi construire un marché puissant de 800 millions de citoyens sous le régime normatif et hégémonique du seul droit américain.
Les Etats-Unis planifient l’intégration de l’Union Européenne dans leur propre espace économique et juridique, en accord avec les législateurs de Bruxelles et de Strasbourg. Washington espère ainsi construire un marché puissant de 800 millions de citoyens sous le régime normatif et hégémonique du seul droit américain.
 La noticia del apresurado y dichoso financiero yanqui, nos trae al recuerdo la figura del gran economista alemán profesor Werner Sombart, que ejerció docencia, justamente sonada, como profesor de Economía Política, en la Universidad de Berlín, y cuya obra es una verdadera pena que aun no haya sido traducida —que sepamos— al castellano.
La noticia del apresurado y dichoso financiero yanqui, nos trae al recuerdo la figura del gran economista alemán profesor Werner Sombart, que ejerció docencia, justamente sonada, como profesor de Economía Política, en la Universidad de Berlín, y cuya obra es una verdadera pena que aun no haya sido traducida —que sepamos— al castellano. Aan het kapitalisme, liever: aan het liberalisme, gaan de volkeren ten onder, schreef de grote Duitse conservatieve auteur Arthur Moeller van den Bruck al. Dat het kapitalisme in zijn meest primitieve vorm inderdaad moordend is geweest voor heel wat originele culturen, wordt sinds decennia door niemand meer in twijfel getrokken. Het volstaat de wereld rond te trekken om er hier en daar bewijzen van te ontdekken.
Aan het kapitalisme, liever: aan het liberalisme, gaan de volkeren ten onder, schreef de grote Duitse conservatieve auteur Arthur Moeller van den Bruck al. Dat het kapitalisme in zijn meest primitieve vorm inderdaad moordend is geweest voor heel wat originele culturen, wordt sinds decennia door niemand meer in twijfel getrokken. Het volstaat de wereld rond te trekken om er hier en daar bewijzen van te ontdekken.







