 Ex: http://eisernekrone.blogspot.com/
Ex: http://eisernekrone.blogspot.com/vendredi, 26 juin 2009
G. Maschke: "Die Genusssucht wird mit Zerknirschung bezahlt"
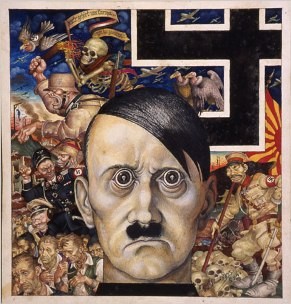
Dossier "Günter Maschke"
Vergangenheitsbewältigung als Staatsräson: Günter Maschke über die Auflösung der deutschen Nation und die íntellektuelle Lage der politischen Rechte
"Die Genußsucht wird mit Zerknirschung bezahlt"
von Dieter Stein /Hans B. von Sothen - http://www.jungefreiheit.de
Herr Maschke, Sie haben vor fast sechs Jahren in einem Interview mit dieser Zeitung gesagt, in Deutschland wäre der Raum geistiger Freiheit nahezu verdampft. Die Lage wird sich wohl kaum gebessert haben?
MASCHKE: Nein, die Lage hat sich keineswegs verbessert, weil die Vergangenheitsbewältigung sich sogar noch verschärft hat. Ihre eigentliche Krux ist nicht die ständige hysterische Abgrenzung von Hitler und angeblichen faschistischen oder neofaschistischen Gefahren, sondern daß sie ausgeweitet wird auf die fernsten Zonen und Zeiten. Wenn ich heute über – sagen wir mal – den Minnegesang etwas schreibe, so muß ich dabei die Degradierung der Frau durch ein autoritäres Patriarchat beklagen und darauf hinweisen, daß schon hier die Schrecken der dunkelsten Jahre zu ahnen sind oder ähnliches und wenn ich die Bürgerkriege zwischen den antiken griechischen Staaten behandle, so komme ich um ein spruchkammerhaftes Moralisieren nicht herum. Das ist etwas karikierend, aber die Tendenz geht in diese Richtung. Ich darf praktisch keine Epoche mehr aus sich selbst heraus sehen, aus dem Imperativ Rankes, daß alle Epochen gleich stehen zu Gott, – ich muß über alles die Sauce dieser diffusen, suggestiven, erpresserischen Moral gießen. Das Problem der Vergangenheitsbewältigung ist weniger, daß ich bei gewissen Namen, Daten, Tatsachen oder Tatsachenbehauptungen den Kopf einziehen muß und die gewünschte Meinung zu äußern habe,– sondern daß ich tendenziell alle geschichtlichen Ereignisse unter dem Aspekt vermeintlicher Emanzipation, von Schuld und Vorläuferei betrachten muß. Die Vergangenheitsbewältigung durchdringt und verpestet die Geistes- und Geschichtswissenschaften und zerstört die Fähigkeit zu geschichtlichem, psychologischem Denken und so weiter. Dieses Nichtwahrnehmenkönnen der jeweils eigenen gesellschaftlichen und geschichtlichen Bedingungen, diese damit in Gang gesetzte Verdummung ist vielleicht schwerwiegender als eine punktuelle Political correctness gegenüber dem Nationalsozialismus.
Wie erklären Sie sich, daß sich die Vergangenheitsbewältigung derart verselbständigt hat, daß die Kampagnen wie Fieberanfälle uns in immer kürzeren Intervallen schütteln?
MASCHKE: Ich glaube, es gibt wenig Dinge, die ein derart gutes Karriere- und Machtmittel sind wie die Vergangenheitsbewältigung, weil ich durch sie natürlich überall irgendwelche Spuren des Unheils oder Vorahnungen oder Anfänge sehen und unbegrenzt alle und alles verdächtigen kann. Wenn Sie an der Frauenemanzipation die leisesten Zweifel äußern, wird Ihnen in jedem Parteivorstand die Rübe abgemacht. Die bis in die fernsten Regionen gehende Vergangenheitsbewältigung kann überall eingesetzt werden, um den Gegner als reaktionär, gefährliche Tendenzen hegend und so weiter, zu diffamieren. Die normale Pluralität eines Gemeinwesens wird sofort aggressiv in Frage gestellt, und das ist natürlich ein großartiges Mittel im Machtkampf. Die Vergangenheitsbewältigung spielt zwar insgesamt eine bedeutende Rolle bei der Selbstverohnmachtung Deutschlands, doch im innerpolitischen und -parteilichen Machtkampf bietet sie unzählige Instrumente, um dem Gegner eins überzuziehen. Der große Machiavellismus wird getötet, der kleine so richtig in Schwung gebracht.
Ist das der Grund, warum diese Art der Machtausübung jetzt auch exportiert wird, etwa auch nach Frankreich oder in die Schweiz?
MASCHKE: Ich glaube, daß es ein allgemeines Dekadenzphänomen einer Gesellschaft ist, die sich nicht mehr selbst will, dieweil sie unfähig ist, zu kämpfen, ihre Genußsucht mit Zerknirschung bezahlen muß, – das ist endlos… Das Hauptproblem scheint zu sein, daß diese Phänomene, immer Zeichen für Dekadenz sind ,– und da sind wir natürlich auch wieder führend. In Frankreich gab es einmal eine gesunde Schizophrenie, man sprach von Menschenrechten, orientierte sich aber an der Staatsräson und so weiter. Jetzt hat Frankreich nicht mehr die Kraft, an dieser "Schizophrenie" festzuhalten, man hat jetzt diese neue Machtquelle entdeckt und da jeder ältere Politiker irgendwann einmal gelebt hat und damals irgendetwas passiert ist, wird man immer etwas finden… Im Falle der Schweiz ist es gelenkt, weil es darum geht, den Finanzplatz Schweiz zu schwächen. Das ist ein ganz klares Motiv.
Wie erklären Sie sich, daß es nach der Wiedervereinigung nicht zu einem Erlahmen der Vergangenheitsbewältigung gekommen ist?
MASCHKE: Je größer Deutschland ist, desto mehr wird die Vergangenheitsbewältigung zunehmen. Die Gefahr bestand, daß man sich zu einer anderen Politik entschließt, einer Politik der Wir-Findung, einer Machtpolitik… diese Gefahr bestand ja, wenn auch eher in den Augen des Auslands, dessen Ängste bei uns kniefälligst zur politischen Leitlinie erklärt wurden. Man gestattete sich dann die Wiedervereinigung als Einpassung in Europa, sie wurde zum hinzunehmenden Nebenprodukt der Vereinigung Europas erklärt. Letztlich beruht die Vergangenheitsbewältigung darauf, daß Deutschland nie wieder eine starke, eigenständige Macht sein darf, das ist ja der Konsens. Das ist das, was ich einmal die Verschwörung der Flakhelfer genannt habe. In dem Moment, wo auch nur entferntest die Gefahr droht, daß sich hier etwas tut, muß die Vergangenheitsbewältigung intensiviert werden. Das gelang vor sieben Jahren aber auch nur deshalb, weil die Ideologie der DDR, beseitigt man nur etwas den SED-Aufputz, so verschieden von der der BRD nicht war…
Wer ist Träger dieses antinationalen Konsenses?
MASCHKE: Der Träger ist die politische Klasse selbst, die ihre Macht daraus zieht, daß Deutschland keine Macht hat oder nur eine sehr begrenzte; dabei wird unter dem Beifall dieser Klasse sogar die letzte deutsche Machtressource aufgelöst, die D-Mark! Wenn dies geschehen ist, werden aber die anderen größeren Länder ihre nationalen Prärogative wahren, wir aber buchstäblich nichts mehr in Händen halten. Wenn wir dann kein Geld mehr haben, wenn sich unsere Krise verschärfen wird, wenn wir Europa nicht mehr finanzieren können, dann werden wir die größten Schweine in Europa sein und dann wird es wieder riesige Kampagnen wegen der Vergangenheit geben. Darauf sollten wir vorbereitet sein.
Klingt unlogisch: Die politische Klasse strebt doch normalerweise nach immer mehr Macht!
MASCHKE: Sie gewinnt, sie verstärkt und verbessert ihre Macht im Inneren durch den Verzicht nach außen. Der Verzicht nach außen verstärkt die totalitäre Formen annehmende Herrschaft im Inneren. Der Verzicht auf eine Verfolgung deutscher Interessen innerhalb Europas beinhaltet einen Machtgewinn, der sicher und kalkulierbar ist, zumal die intellektuellen Mittelschichten ähnlich denken und sich nach Entnationalisierung sehnen: sie wollen sich nicht einbringen in Europa, sie wollen sich dort auflösen. Wenn der Deutsche stolz sagen wird, daß er Europäer sei, wird ihm der Brite oder Franzose sagen, nein, du bist ein Deutscher, du Ferkel! Und da wird dieser Europäer Augen machen! Hinzu kommt ja noch, daß die offizielle Politik Kohls die eines neuen cauchemar des coalitions ist, also der Alptraum der Koalitionen, die der neuen Einkreisung. Bismarck hatte diesen Alptraum auch – und deswegen wird ja Herr Kohl seltsamerweise als Fortsetzer Bismarcks betrachtet…
…mit gegenteiligem Ergebnis…
MASCHKE: Ja, weil Kohl daraus nicht die Frage ableitet: Wie halten wir uns durch auf diesem gefährlichen Terrain, wie gewinnen wir die notwendige Stärke, sondern Kohl propagiert die deutsche Selbstfesselung, verspricht die deutsche Selbstfesselung. Im Grunde betreibt er Selbstmord aus Angst vorm Tode. Mir fällt dazu nur Clausewitz ein: "Zum Sterben ist immer noch Zeit". Das ist keine Politik, die von anderen geglaubt werden kann und das ist auch keine, die uns zu einem respektierten Mitglied in Europa macht. Im Gegenteil, wegen dieser Politik und dieser Mentalität, wegen dieser Reue- und Machtverzichtspolitik werden wir im Ausland verachtet und – sogar verschärft – beargwöhnt.
Wie erklären Sie sich, daß beim Thema Globalisierung in Deutschland die Linke zu den Hauptbefürwortern gehört, obwohl es klar sein dürfte, daß im Zuge dessen die Arbeitnehmer die Zeche zahlen werden – wie etwa beim Euro?
MASCHKE: Die Linke hofft auf die Auflösung des deutschen Volkes, sie ist darin noch radikaler als das Volk selbst – wenn dies auch nur ein gradueller Unterschied ist. Aber man muß sehen, daß die Globalisierung von Teilen der Linken auch scharf kritisiert wird, zum Beispiel in dem Buch von Elmar Altvater und einer Frau Birgit Mahnkopf "Grenzen der Globalisierung", erschienen im Verlag Westfälisches Dampfboot. Sieht man von den etwas biederen Lösungsvorschlägen ab, so sind wohl nirgends so eindringlich die katastrophalen ökonomischen, ökologischen und auch seelischen Folgen der Globalisierung, die entsetzliche Entwurzelung der Menschen, geschildert worden. Von der rechten Seite aus, von uns aus, gibt es leider keine auch nur annähernd so gute Analyse!
Woran liegt die desolate Lage der intellektuellen Rechten in Deutschland?
MASCHKE: Die Rechte ist ein rein mikroskopisches Phänomen, man muß sich sogar fragen, ob es überhaupt noch eine Rechte gibt. Ich glaube, Ernst Jünger hat einmal gesagt, daß es seit der Affäre Dreyfus keine Rechte mehr gibt. Auch die Rechte glaubt heute an die Volkssouveränität und sie ist sogar vulgär-rousseauistisch: das Volk ist gut. Bei ihr ist aber nicht der Kapitalismus schuld, sondern die Vergangenheitsbewältigungsindustrie oder die Alliierten oder das korrupte Fernsehen. Doch muß man wohl zugeben, daß das deutsche Volk seelisch und intellektuell völlig verkrüppelt und heruntergekommen ist; es ist um keinen Deut in einem besseren Zustand als die politische Klasse. Das wagt die Rechte auch nicht zu sagen. Viele Dinge, die als rechts gelten, sind es keineswegs – man denke nur an die seltsame Liebe vieler Rechter zu unserem Grundgesetz, an die Fata Morgana eines rechten Verfassungspatriotismus! Die Rechte bei uns spricht gerne über Metapolitik, landet aber nur in einer sehr kurzatmigen Bildungshuberei. Man begnügt sich mit einer Collage des rechten und konservativen Bildungsgutes der Vergangenheit – aber zu Discountpreisen. Drei Seiten hierüber, zwei Seiten darüber, da ist eine wirkliche rechte Häppchenkultur entstanden. Man sieht nicht den Sinn ambitiöser, strenger theoretischer Arbeit, man will rasch zu Potte kommen und wird es nicht, weil keine Ausmessung der Krise, der wahrhaft furchtbaren seelischen und spirituellen Situation des modernen Menschen geleistet wird, die alles Politische übersteigt.
In letzter Zeit ist es in Mode gekommen, zu behaupten, daß immer mehr Linke angeblich nach rechts gewandert wären, zum Beispiel – um mal Namen zu nennen – Klaus Rainer Röhl. Kann man davon überhaupt reden?
MASCHKE: Bei Röhl sehe ich, daß er antikommunistisch wurde, antitotalitär, aber als Rechten würde ich ihn nicht bezeichnen. Im Gegenteil, bei ihm gibt es eine Identifikation mit dem bestehenden System. Diese Art von Rechtsliberalen, von Nationalliberalen glaubt ja, daß diese Republik im Grunde gut wäre, daß man selbst diese Republik verteidigen müsse gegen links. In Wirklichkeit würden sie eher von diesen Linken depossediert als umgekehrt. Ein führender rechter Intellektueller, dessen Namen ich jetzt mal nicht nennen will, der regte sich einmal über Joschka Fischer auf, und ich sagte ihm, daß dies eher der Staat Joschka Fischers sei als der seine. Es gibt genügend Etablierte, die noch nicht begriffen haben, daß sie nur noch geduldet werden. Sie appellieren an eine bundesdeutsche Substanz, die sich längst in anderen Händen befindet.
Sie haben sich eine Weile stärker publizistisch auf der Rechten geäußert. Jetzt haben wir den Eindruck, Sie hätten sich mehr auf die wissenschaftliche Arbeit zurückgezogen. Hängt das auch mit Frusterlebnissen zusammen, daß sie nicht sehen, daß sich rechts etwas bewegt?
MASCHKE: Man soll das machen, von dem man glaubt, daß man es am besten kann, das ist abendfüllend genug. Und wie schon gesagt: Ich glaube, daß die Rechte es lernen muß, dickere Bretter zu bohren. Ich halte das nicht für Resignation. Ich kann nicht auf zwei oder drei Hochzeiten tanzen.
Sehen Sie in Deutschland oder seinen Nachbarländern jemanden, der dazu in der Lage wäre, diese theoretische Arbeit von rechts zu leisten?
MASCHKE: Ja, ich kenne einige Leute, auch Dreißigjährige, denen ich viel zutraue; bei uns, auch in Belgien, Frankreich, Spanien Italien. Das Problem wird von manchen gesehen, sicher… doch wenn man hier und anderswo gewisse Bücherschränke betrachtet, gewisse rechte Bücherschränke, so findet sich darin nur Publizistik, Zeitgeschichte und dergleichen. Natürlich, auch das muß man lesen. Aber ich kenne relativ bekannte Autoren der Rechten, die noch nie ein klassisches Werk der Politikwissenschaft im weitesten Sinne, sei es nun Tacitus, Tocqueville oder Carl Schmitt, gelesen haben, die aus zweiter oder gar dritter Hand leben. Das ist einfach die wahrhaft erschütternde Situation. Man muß sehen, daß mehr getan wird und auch, daß ein jahrzehntelang umkonditioniertes Volk mit einem völlig verschütteten Bewußtsein nicht durch ein paar witzige Formulierungen oder ein paar flotte Phrasen kuriert werden kann. Die Rechte muß intellektuell und wissenschaftlich ernsthafter werden, wozu es auch Ansätze gibt.
Sie muß also ihr Handwerk neu lernen?
MASCHKE: Ja, weil wir fast keine Ressourcen mehr haben. Wir sind intellektuell in einer viel schlechteren Lage als in den fünfziger Jahren, wo gewisse große Autoren noch meinungsbildend sein konnten, zum Beispiel Arnold Gehlen. Man muß sozusagen erst einmal wieder auf diesen Erkenntnis- und Bewußtseinsstand kommen, weil wir uns heute unter diesem Niveau befinden. Denken Sie einmal an den Parlamentarismus! Obgleich der Parlamentarismus der heutigen Republik viel katastrophaler, viel niveauloser ist als der von 1955, liegen fast alle Rechten heute, was die Einsicht in den Wert und Unwert des Parlamentarismus angeht, unter dem Niveau eines Winfried Martini von 1955 mit seinem Buch "Das Ende der Sicherheit". Wir sind in einer unendlich schwachen Position, und wenn der Feind zu wer weiß was dämonisiert, dann nur deshalb, weil er wirklich totalitär ist, weil er eine ganz und gar minoritäre Sache im Keim ersticken will. Die Political Correctness ist eben totalitär und vor allem ist sie analog zum faschistischen Autoritätssyndrom. Gemäß diesem ist der Feind winzig, lächerlich, dumm, historisch widerlegt, schmutzig, erbärmlich – und zugleich ungeheuer gefährlich! So werden wir behandelt. Daraus dürfen wir aber nicht schließen, daß wir wirklich gefährlich sind, sondern nur, daß der Feind die bescheidensten Ansätze mit gutem Instinkt sofort ersticken will. Zweitens aber dürfen wir daraus schließen, daß dieser Feind die höchsten Werte auf der F-Skala der Frankfurter Schule erreichen würde, nicht wir!
Die politische Entwicklung läuft momentan rasant in Richtung Auflösung der Nationalstaaten. Ist es überhaupt sinnvoll und realistisch, dagegen Widerstand zu leisten? Oder ist es konsequent, daß es zu größeren staatlichen Gebilden und Großräumen kommt?
MASCHKE: Der Trend dahin ist sicher zwangsläufig, nur ist das, was hier entstehen soll oder entstehen wird, kein Großraum: dieses Gebilde hat weder einen Hegemon, noch besteht Einigkeit über den Feind, noch besteht eine Homogenität der Mitglieder des Bundes, noch eine von allen bejahte politische Idee und deshalb auch keine gemeinsame Metaphysik, noch gibt es ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Was vermutlich herauskommt, ist eine Lateinamerikanisierung Europas, eine erleichterte Penetration Europas durch die Vereinigten Staaten. Im Grunde geht es heute ja nicht mehr um ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte, sondern um ein Penetrationsverbot – ein zwar wünschenswerter, aber nur schwer vorstellbarer Prozeß, da man die Vereinigten Staaten der Europäischen Union aus den Ganglien reißen müßte. Im übrigen wird die Europäische Union vermutlich scheitern, weil nach der monetären Einheit die politischen Differenzen zwischen den einzelnen Staaten anwachsen werden, weil jeder im anderen den Schuldigen suchen und finden wird. Die Krisen werden sofort kontinentalisiert, ohne daß man einen klaren Adressaten fände, ohne daß man sich einig werden könnte über "den Schuldigen" und die ganze Relation von Schutz und Gehorsam, die ohne klare Autoritäten und Verantwortlichkeiten nicht funktionieren kann, wird in diesem Pseudo-Großraum zusammenbrechen. Die Völker werden sich entzweien und die hohe Zeit der – sogar nationalistisch verschärften – Demagogie wird das sich ver-uneinigende Europa heimsuchen. Der Prozeß wird sozial – im weitesten Sinne sozial – zerstörerisch sein, ohne daß ein politisches Konzept und ein wirklich eiserner Rahmen da ist. Man könnte der ganzen Sache zustimmen, wenn die Ausschließung der Vereinigten Staaten angestrebt würde und wenn eine gemeinsame politische Idee vorhanden wäre – ja, wenn…
Könnte es nicht sein, daß Europa auch für Deutschland von Interesse ist?
MASCHKE: Nur wenn man ein Interesse daran hat, sich in irgendeiner Form durchzusetzen. Dann muß man sagen: Wir wollen, zu einem gewissen Grade, ein deutsches Europa. Jetzt aber will man, auch bei uns, Deutschland einbinden, sprich fesseln; das deutsche Verhalten in Sachen Maastricht zeigt das ja. Übrigens: den Hegemon im neuen Europa zu spielen fiele auch dann schwer, wenn wir die Vergangenheitsbewältigung abschütteln könnten.
Aber ist nicht gerade die Vergangenheitsbewältigung auf eine eigenartige Weise zu einem ganz neuen nationalen Rückgrat der Deutschen geworden? Wurzelt die Aufforderung grüner Politiker für deutsche Beteiligung an militärischen Interventionen nicht darin? Dahinter steht doch die hybride Vorstellung, daß die Deutschen regelrecht historisch auserwählt sind, nicht wie vor 50 Jahren in nationalistischem Sinne, sondern im umgekehrten Sinne, allen zu sagen, was moralisch gut ist ...
MASCHKE: Das mag mitspielen, aber es ist mehr ein völliges Sich-Überlassen der US-amerikanischen Missionsideologie. Theodore Roosevelt sagte 1909, daß die Deutschen an ihrer Geographie ersticken würden und danach den US-Amerikanern ein nützliches Hilfsvolk sein könnten. Ist ein Engagement für die "Hilfsvolk"-Rolle nationalistisch? Jetzt lassen wir uns von der inzwischen wieder US-amerikanisch kontrollierten UNO instrumentalisieren ohne dieser irgendwelche Bedingungen zu stellen, sieht man einmal von den albernen Forderungen nach einem Sitz im Sicherheitsrat ab. Wir nehmen die offiziellen humanitaristischen Schwungradvorstellungen ernst, unsere Politiker glauben ihren eigenen Lügen und so geraten wir in die Gefahr, die dummen Jungs eines Bündnisses zu werden, das gegen uns errichtet wurde. Ein Deutscher saniert die Finanzen der UNO, die Deutschen wollen oder sollen militärische Aktionen der UNO durchführen – und fordern nicht einmal die Beseitigung der Feindstaatenklauseln!
Haben Sie nicht den Eindruck, daß man den Deutschen von 1997 am stärksten irritieren kann, wenn man ihm seine historische Täterrolle nimmt?
MASCHKE: Ja, natürlich, weil man ihm ja auch nur die gelassen hat. Das geht so weit, daß man fordert, daß Menschen anderer Nationen, die bei uns eingebürgert werden, an dieser Schuld teilhaben sollen. Also zum Beispiel Türken, die Deutsche werden. Die werden aber dann sagen: "Großvater damals nix dabei gewesen". Aber immerhin wird es von ihnen erwartet, immerhin mutet man ihnen diese Ersatzidentität zu. Hier ist die deutsche Politik extrem widersprüchlich: Wenn wir ewig bereuen sollen, wenn wir uns ewig unserer furchtbaren, unvergleichlichen Schuld bewußt bleiben sollen, muß man dann das deutsche Volk nicht intakt halten, muß man dann nicht verhindern, daß das deutsche Volk durch den Massenimport von Fremden biologisch und gesellschaftlich aufgelöst wird? Damit das deutsche Volk dem Schuldmessianismus weiterhin frönen kann, muß es in seiner ethnischen Substanz erhalten werden und darf nicht durch Multikulti und Masseneinwanderung geschädigt werden. Diese Behauptung ist nur für den absurd, der nicht bemerkt, in welchem Absurdistan er lebt.
Kommt die Forderung nach Normalisierung Deutschlands nicht schon stärker vom Ausland?
MASCHKE: Ja, aber das Ausland versteht unter Normalisierung, daß wir an seinen Schweinereien, daß wir an dieser imperialistischen westlichen Konstellation gleichberechtigt teilnehmen, vor allem finanziell. Das kann nicht unser Interesse sein. Zum Beispiel lag es nicht in unserem Interesse, das Techno-Massaker der Vereinigten Staaten am Irak mitzubezahlen, einem Land, das uns nie bedrohte; in einem noch viel geringeren Interesse läge es, in Zukunft an solchen Interventionen, die zunehmen werden, sich aktiv zu beteiligen. Eine Verschärfung unserer Dienstfertigkeit gegenüber den Siegermächten darf man nicht Normalisierung taufen oder gar zur nationalen Pflicht proklamieren.
00:10 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, nationalisme, droite, droite politique, conservatisme, national-conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 juin 2009
R. Badinand: Requiem pour la contre-révolution

Daniel Cologne - http://www.alexipharmaque.net/
Rodolphe Badinand:
Requiem pour la Contre-Révolution
Ainsi s’achève Requiem pour la Contre-Révolution, dont l’auteur Rodolphe Badinand me fait l’honneur d’être le co-dédicataire. Il ne m’en voudra donc pas si j’inverse l’adjectif indéfini et l’adjectif démonstratif. L’appel clôturant ce remarquable recueil d’ ‘’essais impérieux’’ est en réalité rédigé comme suit :
‘’Pour le Système et ses sbires, nous incarnons le plus grand des périls parce que nous croyons en nos rêves’’. Rodolphe Badinand cite alors Thomas Edgar Lawrence : ‘’Les rêveurs de jour sont des hommes dangereux, car ils peuvent jouer leur rêve les yeux ouverts et le rendre possible’’. L’auteur conclut : ‘’Soyons ces rêveurs éveillés…’’ (p.163).
Qui sommes nous donc et quel est ce ‘’Système’’ que Rodolphe Badinand nous invite à faire trembler ? Disons d’abord ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des ‘’anti-Lumières’’, comme nous désignent nos ennemis. Nous ne sommes pas les nostalgiques d’un temps révolu, les passéistes assoupis dans la langueur des regrets éternels. Nous coupons le cordon ombilical avec la Contre-Révolution, dont nous saluons néanmoins le double mérite : son courage d’être entré en résistance contre des ‘’valeurs mortifères’’, et notamment les ‘’idéologies égalitaires’’, mais aussi la ‘’valeur didactique’’ de ‘’son échec’’ (p.42).
Nous sommes les partisans d’une recomposition du monde fondée, non sur l’abstraction droit-de-l’hommiste, mais sur le socle concret du ‘’droit des hommes (c’est moi qui souligne) à s’enraciner dans leur terroir et leurs communautés d’appartenance multiples et variées’’ (p.163).
Cette refondation planétaire postule une reconstruction de l’Europe selon un ‘’principe fédérateur d’essence supérieure’’ (p.162), dont l’absence pertinemment épinglée par un monarque polynésien fut le cause de la Première Guerre Mondiale. En citant Tupon IV, roi des Tonga, Rodolphe Badinand témoigne de ce qu’est la véritable ouverture à l’Autre, la capacité d’être authentiquement à l’écoute de la sagesse, d’où qu’elle vienne : tout le contraire de la mensongère ‘’tolérance’’ du Système, où l’égalitarisme de façade masque l’impitoyable volonté d’épuiser les hommes et les peuples dans une course infernale le long de ‘’la ligne droite individu-Etat jacobin-Etat mondial-humanité’’ (p.163).
Un exemple de ‘’principe fédérateur’’ est l’idée impériale telle que la concrétise l’institution pluriséculaire du Saint Empire romain germanique. ‘’Au Moyen Age, l’empire sacré et sanctifié ne pouvait que promouvoir l’idéal chrétien. Il aurait été inconcevable qu’il s’édifiât contre la majorité religieuse du moment’’ (p.119). A notre époque de déchristianisation, il ne faut évidemment pas aspirer à reproduire la structure médiévale, mais il convient de lui substituer un symbolisme cosmique où l’Empire serait une image du Soleil central autour duquel tourneraient, à des vitesses différentes, comme les planètes du système solaire astronomique, les nations (patries historiques) et les régions (patries charnelles). Ainsi l’Europe pourrait-elle revendiquer le titre de ‘’patrie idéale’’, répondre à l’exigence d’universalité inscrite au cœur de toute pensée métapolitique.
Rodolphe Badinand distingue judicieusement l’impérialité et les impérialismes. ‘’Contrairement au Saint Empire, les Premier et Second Empires français n’ont reposé que sur les épaules d’une personnalité charismatique’’ (p.116). Son procès des bonapartistes n’a d’égal que son rejet de l’hitlérisme, ‘’version teutonne du jacobinisme français’’ (p.121).
Dans la ligne d’Alain de Benoist, Rodophe Badinand considère aussi comme de ‘’faux empires’’ les empires coloniaux anglais, français, hollandais, portugais ou espagnol. Il tient ‘’le mal colonial’’ (p.127) pour une des étapes importantes de la ‘’décomposition de la France’’ (p.125).
Erudit français, Rodophe Badinand consacre tout naturellement de nombreuses pages à l’histoire de son pays. Recensant l’ouvrage d’un historien de l’Université de Jérusalem, il rappelle ‘’les prétentions capétiennes à la Couronne du Saint Empire romain germanique’’ (p.95), qui aurait pu devenir, entre les règnes de François Ier et Louis XIV, un ‘’Saint Empire romain de la Nation Française’’ (p.96). C’est l’un des textes courts du recueil, qui alternent avec des essais plus longs, de même que se succèdent, dans un ensemble ipso facto de lecture agréable, de brefs comptes-rendus de livres, de vigoureuses interventions conférencières et de profonds essais où la réflexion toujours nuancée se déploie dans un style souvent chatoyant.
La coutume gastronomique encadre le plat de résistance de hors-d’œuvre et de desserts. Ici, l’essai le plus consistant, qui donne d’ailleurs son titre au florilège, est opportunément placé en tête. Une quarantaine de pages d’une rare densité intellectuelle nous convie ainsi à réfléchir sur la Contre-Révolution ‘’impasse intellectuelle majeure’’ (p.13).
L’Eglise catholique fut la première à s’opposer à la révolution de 1789 et elle le fit avec d’autant plus de force qu’un an à peine après la prise de la Bastille, fut votée la Constitution civile du clergé (1790), la ‘’plus grave erreur’’ (p.19) de la révolution suivant l’auteur.
Celui-ci examine, tout au long des deux siècles écoulés, la ‘’lente translation vers la Modernité’’(p.24) qui affecte la catholicisme et dont Jacques Maritain (1882-1973) offre un exemple symbolique.
Le royalisme également a succombé, au fil des décennies, à la contagion de l’esprit moderniste. Ce dernier ‘’contamina les doctrines monarchiques avec la même vigueur qu’il se développait au sein du catholicisme’’ (p.28). Des mouvements royalistes de gauche naquirent ainsi dans toute l’Europe méridionale : le Parti populaire monarchique portugais, le carlisme espagnol qui ‘’se transforma en un mouvement socialiste autogestionnaire’’ (p.30), et en France les ‘’’maurrassiens’’ de la Nouvelle Action Française de Bertrand Renouvin.
‘’Avec ces trois exemples’’, écrit Rodolphe Badinand, ’’nous devons nous interroger si la Contre-Révolution et la Révolution ne seraient pas l’avers et le revers d’une même médaille appelée la Modernité’’ (Ibid).
Avant de revenir sur cette importante citation, où l’on voit émerger sous la plume de l’auteur le questionnement fondamental, épinglons encore cette vision non conformiste des régimes de Salazar, Franco et Pétain, où Rodolphe Badinand voit les germes de l’élan économique-industriel d’après-guerre, via l’arrivée au pouvoir des technocrates. Le phénomène lui semble particulièrement sensible dans la France de Vichy, après ‘’la nomination de l’amiral Darlan à la vice-présidence du Conseil des ministres’’ (p.31).
Y aurait-il eu donc un ‘’apport contre-révolutionnaire au libéralisme’’ (p.32) ? Oui, répond sans hésitation l’auteur qui va jusqu’à établir un parallélisme entre la ’’main invisible’’ du marché et les ’’voies insondables’’ de la Providence. Les fondements chrétiens de la Contre-Révolution sont ici mis en cause et il en découle que la dérive potentielle des contre-révolutionnaires était prévisible dès la fin du XVIIIème siècle.
Rodolphe Badinand rappelle opportunément que ’’les trois futures sommités de la contre-révolution intellectuelle étaient vus par leurs contemporains comme des libéraux : Edmund Burke était un parlementaire whig, défenseur des droits du Parlement anglais et de la Révolution américaine ; Joseph de Maistre était, à la cour de Savoie, jugé comme un franc-maçon francophile et Louis de Bonald fut, en 1789-1790, le maire libéral de Millau’’ (p.41).
Quant à la Révolution conservatrice, que ses adversaires ont baptisée ’’Nouvelle Droite’’, elle intègre certes un héritage contre-révolutionnaire, mais elle se réfère aussi au socialisme proudhonien, aux non-conformistes des années trente si bien étudiés par Pierre Loubet del Bayle, et au situationnisme de Guy Debord dénonçant ’’la société du spectacle’’. Rodophe Badinand conclut son analyse de ce courant par cette hypothèse de recherche que les historiens des idées politiques devraient creuser ; ’’Ce syncrétisme semblerait marquer la fin historique de la Contre-Révolution en tant que mouvement de pensée’’ (p.36).
Rodolphe Badinand s’interroge de manière inattendue : ‘’L’écologie : le dernier surgeon contre-révolutionnaire ?’’ (p.38). L’auteur fait un rapprochement insoupçonné entre, d’une part les écrits d’un Edouard Goldsmith ou d’un Bernard Charbonneau, et d’autre part, le roman balzacien Le Médecin de Campagne, sorte d’Arcadie où «’’chacun mène une existence équilibrée’’ et où ‘’la nature maîtrisée, mais non agressée par le machinisme, donne des fruits à tous les villageois’’ (p.39). Au même titre que la Nouvelle Droite et la Révolution Conservatrice, l’écologie dépasse ‘’les vieux clivages, devenus obsolètes’’ (voir le slogan ‘’Ni Droite ni Gauche’ d’Antoine Waechter) et ne se laisse pas enfermer dans le binôme Révolution - Contre Révolution. Sa vision du monde dynamique rompt avec le passéisme ruraliste exaltant une société champêtre ‘’stable, immuable et édénique’’ (Ibid)
Partageant avec les écologistes certaines légitimes préoccupations environnementales, Rodolphe Badinand avertit : ‘’Si le réchauffement planétaire se poursuit et s’accentue, dans quelques centaines d’années, la banquise aura peut-être disparu, faisant de l’océan polaire un domaine
maritime de première importance’’ (p.123). La maîtrise de l’Arctique s’impose à l’auteur comme une des plus impérieuses nécessités pour le futur Empire européen. Cet enjeu tant stratégique que symbolique est d’autant moins négligeable que les anciennes mythologies indo-européennes, y compris celle de l’Hellade méditerranéenne et celle de l’Inde védique, mentionnent le Septentrion comme l’origine, sinon de l’humanité, du moins d’une de ses plus importants rameaux. L’Europe se devra donc d’être présente sur tout le pourtour de l’Océan Arctique comportant aussi des rivages asiatiques et nord-américains.
‘’Face à la marée montante des peuples du Sud, le regroupement intercontinental des descendants de Boréens ne se justifie que par le désir de survivre au XXIème siècle. Cela mérite au moins un débat que seul l’avenir tranchera’’ (p.73).
Rodolphe Badinand nous convie à effectuer deux démarches simultanées : retrouver le chemin de notre ‘’plus longue mémoire’’ et imaginer notre futur lointain.
‘’Les contre-révolutionnaires souhaitaient conserver intact le passé. Leur démarche les obligea souvent à faire de l’avenir table rase. Entre la négation du passé, propagée par la Modernité, et le refus du futur, pratiqué par la Contre-Révolution, existe une troisième voie : l’archéo-futurisme’’ (p.44). L’auteur se réfère à Guillaume Faye, qui a longtemps partagé avec Alain de Benoist, quoique dans un autre registre, le magistère intellectuel de notre famille de pensée. Né vers 1972, issu de la génération suivante, Rodolphe Badinand peut prétendre à la succession de ces deux maîtres à penser, selon l’expression consacrée et en l’occurrence toute relative si l’on pense à ces figures hors normes que sont René Guénon (1886-1951) et Julius Evola (1898-1974).
A propos de ces deux immenses éveilleurs, il est temps de se demander dans quelle mesure ils ont été piégés par le binôme Révolution-Contre Révolution. C’est à force de critiquer le progressisme moderne rectilinéaire que l’on dérive peu à peu, au départ d’une conception cyclique de l’histoire, vers un décadentisme ‘’traditionnel’’ tout aussi rectilinéaire.
Progressisme et décadentisme apparaissent alors comme les deux faces de la même médaille, de même que s’impose la nécessité, pour la Nouvelle Droite et la Révolution Conservatrice, de faire venir leurs adversaires sur leur terrain (c’est Rodolphe Badinand qui souligne). ‘’Qu’elles cessent donc de débattre des idées adverses pour imposer la discussion sur leurs idées’’ (p.43). Qu’elles arrêtent de disserter sur les inconvénients du progressisme et sur l’absurdité d’un ‘’sens de l’Histoire’’, et qu’elles valorisent les avantages et la solidité de leur conception cyclique du devenir humain, qui est une respiration à plusieurs vitesses, et qui ne peut en aucun cas dégénérer en un décadentisme vertigineux.
Osons nous dresser avec Rodolphe Badinand contre l’exorbitante prétention de la démocratie moderne à être le point oméga de l’aventure humaine. Adoptée le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comporte en son Article XI une restriction à la liberté d’expression que l’auteur reprend in extenso : ‘’sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ‘’ (p.18).Rodolphe Badinand commente : il s’agit d’ ‘’une phrase si vague qu’elle permet toutes les interprétations possibles et justifie toutes les polices de la pensée. Or le totalitarisme commence quand on empêche certaines opinions de s’exprimer sur la place publique…(Ibid.). La Modernité est donc bien la ‘’matrice des totalitarismes » ». Sous le couvert de la démocratie et du ‘’droit-de-l’hommisme’’ sévit un terrorisme intellectuel s’appuyant sur des lois liberticides et rétablissant le délit d’opinion, dont sont passibles tous ceux qui contestent les fondements du Système. Un de ces fondements concerne les origines de l’espèce humaine. C’est la thèse africano-centriste selon laquelle l’Afrique serait l’unique berceau de l’humanité, le seul foyer primordial à partir duquel le primate se serait transformé en homo sapiens.
En optant pour une vision ‘’boréocentrique’’ de l’histoire, Rodolphe Badinand ne craint pas de s’exposer à la vindicte de la ‘’bien-pensance’’ qui pourrait lui faire grief ‘’d’une supercherie scientifique à relent raciste’’ (p.69).
Pourtant, ses ‘’Notes dissidentes sur la nation de tradition Primordiale’’, autre chapitre très fouillé et hyper-documenté, révèle une approche pluraliste du problème. Logique et conséquent, Rodolphe Badinand se refuse à trancher la question de l’antériorité en faveur de l’un ou l’autre ‘’ensemble ethnique’’. ‘’N’y aurait-il pas finalement une succession aléatoire de Traditions primordiales pour chaque entité ethnique matricielle ? Et si c’était le cas, qui bénéficierait de l’antériorité ? On le voit : ce type de questionnement débouche sur une absence de réponse d’ordre humain. Cependant, s’interroger sans cesse est le meilleur moyen de maintenir son esprit libre et éveillé. L’interrogation permanente produit des antidotes aux toxines du conformisme médiatique’’ (p.71).
Nous voici aux antipodes du dogmatisme des traditionalistes qui, même lorsqu’ils se définissent comme ‘’intégraux’’ et se réclament d’Evola ou de Guénon, demeurent fréquemment incapables d’auto-critique, inaptes à soulever eux-mêmes des objections à leur discours, fascinés par ‘’le pessimisme foncier de la doctrine des âges, souvent porteur de désespoir ou d’inaction totale’’ (p.59).
Rodolphe Badinand est un authentique ‘’penseur libre’’ aussi éloigné de la fallacieuse ‘’libre-pensée’’ que de son primaire retournement traditionaliste, aussi étranger à la linéarité évolutive qu’à la descente sans frein de l’âge d’or à l’âge de fer. La ‘’spiritualité primordiale’’ ne serait-elle pas plutôt d’inspiration astrologique, c’est-à-dire fondée sur l’alternance de courbes ascendantes et descendantes, tributaires des angles tantôt harmonieux tantôt dissonants formés entre eux par les astres ?
Diverses formes d’astrologie caractérisent en tout cas les aires culturelles où Rodolphe Badinand discerne, en s’appuyant sur de récentes recherches anthropologiques, paléontologiques et archéologiques, l’empreinte des Boréens, ancêtres des Indo-Européens, grand peuple migrateur de la plus haute préhistoire ‘’ne rechignant jamais les rencontres avec les tribus indigènes’’ (p.68).
Celles-ci possèdent peut-être leur propre foyer d’irradiation culturelle, leur ‘’tradition primordiale’’ indissociable de leur ‘’’spécificités ethno-spirituelles » » (p.71). Dans la Grèce antique, parallèlement à l’exaltation mythologique du ‘’séjour des dieux’’ localisé au Nord et gardé à l’Occident par les Hespérides, à l’entrée du fameux jardin aux ‘’pommes d’or’’ que cueillit Héraklès et qui subjuguèrent la farouche Atalante, le scrupuleux Hérodote évoquait la possibilité de l’existence d’Hypernotiens, équivalents de nos Hyperboréens, matrice des peuple du Sud avec lesquelles nous sommes appelés à fonder une ‘’fraternité qualitative’’ (p.60).
En effet, ‘’la tradition risque d’avoir sa signification détournée et de devenir à son corps défendant un auxiliaire du fraternitarisme mondial’’ (c’est Rodolphe Badinand qui souligne) assimilable à ‘’un oecuménisme pervers ‘’ (Ibid). Sous le couvert de celui-ci peut de développer une forme spirituelle d’impérialisme et de domination mondiale à laquelle les Boréens étaient totalement réfractaires lorsqu’ils quittèrent leurs terres arctiques d’origine pour essaimer sur d’autres continents et fonder peut-être les cultures méso-américaines, l’Egypte pharaonique, la Chine du Céleste Empire.
Les historiens de notre famille de pensée saluent en Dominique Venner un guide incontournable dont Rodolphe Badinand se solidarise dans la critique de ‘’la conception guénonienne d’une seule tradition hermétique et universelle, qui serait commune à tous les peuples et à tous les temps, ayant pour origine une révélation provenant d’un ‘’ultramonde’’ non identifié’’ (p.60). A la suite du directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, l’auteur subodore dans le ‘’traditionalisme intégral’’ un ‘’syncrétisme équivoque’’ et une critique de la modernité ne débouchant ‘’que sur un constat d’impuissance’’ (Ibid.), ‘’l’attente millénariste de la catastrophe’’ (p.61).
Par delà les fausses alternatives Tradition-Modernité et Révolution-Contre-Révolution, la brillante anthologie de Rodophe Badinand, compilant des textes écrits ces dix dernières années dans L’Atre, Cartouches, Roquefavour, Eléments et L’Esprit européen, suggère de remonter aux sources vives de cet ‘’esprit européen’’ et de réfléchir à son adaptation au monde de demain et d’après-demain. ‘’Il y a du travail pour cent ans’’, écrivit un jour Robert Steuckers. Rodolphe Badinand est un des pionniers de ce siècle de renouveau de l’intelligence européenne, de cette ère de rayonnement retrouvé et de renaissance métapolitique, de cette nouvelle étape de l’aventure humaine où les Européens et fiers de l’être sauront être à l’écoute des sagesses fleuries sous d’autres latitudes, pour construire enfin une Terre harmonieuse et pacifiée.
Le Coin Littéraire - (novembre 2008) - Ex: http://www.alexipharmaque.nat/
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, contre-révolution, théorie politique, conservatisme, droites, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 juin 2009
La révolution conservatrice en Allemagne (1918-1932)
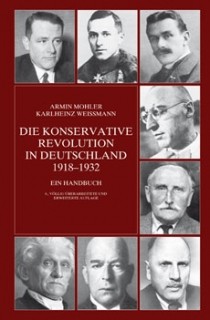
SYNERGIES EUROPÉENNES - Novembre 1989
La "Révolution Conservatrice" en Allemagne (1918-1932)
A propos de la réédition tant attendue du célèbre manuel d'Armin Mohler
par Robert STEUCKERS
L'ouvrage d'Armin Mohler sur la "Konservative Revolution" (KR) a été si souvent cité, qu'il est de-venu, dans l'espace linguistique francophone, chez ceux qui cultivent une sorte d'adhésion affective aux idées vitalistes allemandes déri-vées de Nietzsche, une sorte de mythe, de ré-férence mythique très mal connue mais souvent évoquée. Cette année, une réédition a enfin vu le jour, flanquée d'un volume complémen-taire où sont consignés les commentaires de l'auteur sur l'état actuel de la recherche, sur les nou-veaux ou-vrages d'approfondissement et surtout sur les re-cherches de Sternhell (1).
Comment se présente-t-il, finalement, cet ou-vrage de base, ce manuel si fondamental? Il se compose d'abord d'un texte d'initiation, com-mençant à la page 3 de l'ouvrage et s'achevant à la page 169; ensuite d'une bibliographie ex-haustive, recensant tous les ouvrages des au-teurs cités et tous les ouvrages pa-noramiques sur la KR: elle débute à la page 173 pour se ter-miner à la page 483. Suivent alors les annexes, avec la liste des abréviations utilisées pour les lieux d'édition et les maisons d'édition, puis les registres des personnes, des périodiques et des organisations.
Un ouvrage destiné à la recherche
L'ouvrage est donc de prime abord destiné à la re-cherche. Mais comme la thématique englobe des idées, des leitmotive, des affirmations poli-tiques qui ont enthousiasmé de larges strates de l'intelligentsia alle-mande voire une partie des masses, il est évident qu'aujourd'hui encore elle enregistrera des retentis-sements divers en de-hors des cénacles académiques. A Bruxelles, à Genève, à Paris ou à Québec, il n'y a pas que des professeurs qui lisent Ernst Jünger ou Tho-mas Mann... La recension qui suit s'adressera dès lors essentiellement à ce public extra-aca-démique et se con-centrera sur la première partie de l'ouvrage, le texte d'initiation, avec ses défini-tions de concepts, sa clas-sification des diverses strates du phénomène que fut la KR. Mohler, dans ces chapitres d'une densité inouïe, définit très méticuleusement des mouvements politico-idéologiques aussi marginaux que fascinants: les "trots-kystes du national-socialisme", la "Deutsche Be-wegung" (DB), le national-bolché-visme, le "Troi-sième Front" (Dritte Front, en abrégé DF), les Völkischen, les Jungkonser-vativen, les nationaux-révolutionnaires, les Bündischen, etc. ainsi que des concepts comme Weltanschauung, nihilisme, Umschlag, "Grand Midi", réalisme héroïque, etc.
"Konservative Revolution" et national-socialisme
Le premier souci de Mohler, c'est de distinguer la KR du national-socialisme. Pour la tradition antifasciste, souvent imprégnée des démon-strations du marxisme vulgaire, le national-so-cialisme est la continuation politique de la KR. De fait, le national-socialisme a affirmé pour-suivre dans les faits ce que la KR (ou la "Deutsche Bewegung") avait esquissé en esprit. Mais nonobstant cette revendication nationale-socialiste, on est bien obligé de constater, avec Mohler, que la KR d'avant 1933 recelait bien d'autres possibles. Le national-socialisme a constitué un grand mouvement de masse, impres-sionnant dans ses dimensions et affublé de toutes les lourdeurs propres aux appareils de ce type. Face à lui, foisonnaient des petits cercles où l'esprit s'épanouissait indépendamment des vicis-situdes politiques du temps. Ces cénacles d'intel-lec-tuels n'eurent que peu d'influence sur les masses. Le grand parti, en revanche, écrit Mohler, "gardait les masses sous son égide par le biais des liens orga-ni-sationnels et d'une doctrine adaptée à la moyenne et limitée à des slogans; il n'offrait aux têtes supérieures que peu d'espace et seulement dans la mesure où elles voulaient bien participer au travail d'enré-gimentement des masses et limitaient l'exercice de leurs facultés intellectuelles à un quelconque petit domaine ésotérique" (p.4).
Peu d'intellectuels se satisferont de ce rôle de "garde-chiourme de luxe" et préfèreront rester dans cette cha-leur du nid qu'offraient leurs petits cénacles élitaires, où, pensaient-ils, l'"idée vraie" était conservée intacte, tandis que les partis de masse la caricaturaient et la tra-his-saient. Ce réflexe déclencha une cascade de rup-tures, de sécessions, d'excommunications, de conju-ra-tions avec des éléments exclus du parti, si bien que plus aucune équation entre la NSDAP et la KR ne peut honnêtement être posée. Bon nombre de figures de la KR de-vinrent ainsi les "trotskystes du national-so-cialisme", les hérétiques de la "Deutsche Be-wegung", qui seront poursuivis par le régime ou opteront pour l'"émigration intérieure" ou s'insinueront dans cer-taines instances de l'Etat car le degré de la mise au pas totalitaire fut nettement moindre en Allemagne qu'en Union Soviétique. Des représentants éminents de la KR, comme Hans Grimm, Oswald Spengler et Ernst Jünger purent compter sur l'appui de la Reichswehr, des cercles diplomatiques "vieux-conservateurs" ou de cénacles liés à l'industrie. Ne choisissent l'émi-gration que les figures de proue des groupes sociaux-révolutionnaires (Ot-to Strasser, Paetel, Ebeling) ou certains natio-naux-socialistes dissidents comme Rausch-ning. La plupart restent toutefois en Alle-magne, en es-pérant que surviendra une "seconde ré-volution" entièrement conforme à l'"Idée". D'autres se taisent définitivement (Blüher, Hielscher), se ré-fugient dans des préoccupations totalement a-politi-ques ou dans la poésie (Winnig) ou se tournent vers la phi-losophie religieuse (Esch-mann). Très rares seront ceux qui passeront carrément au national-socialisme comme Bäum-ler, spécialiste de Bachofen.
La thèse qui cherche à prouver la "culpabilité an-ticipative" de la KR ne tient pas. En effet, les idées de la KR se retrouvent, sous des formes chaque fois spé-cifiquement nationales, dans tous les pays d'Eu-rope depuis la moitié du XIXième siècle. Si l'on re-trouve des traces de ces idées dans le national-so-cia-lisme allemand, celui-ci, comme nous venons de le voir, n'est qu'une manifestation très partielle et in-com-plète de la KR, et n'a été qu'une tentative parmi des dizaines d'autres possibles. Raisonner en termes de causalité (diabolique) constitue donc, expli-que Moh-ler, un raccourci trop facile, occultant par exemple le fait patent que les conjurés du 20 juillet 1944 ou que Schulze-Boysen, agent so-viétique pendu en 1942, avaient été influencés par les idées de la KR.
L'origine du terme "Konservative Revolution"
Pour éviter toutes les confusions et les amalgames, Mohler pose au préalable quelques définitions: celle de la KR proprement dite, celle de la "Deutsche Be-wegung", celle de la "Weltanschauung" en tant que véhicule pédago-gique des idées nouvelles. Les termes "konser-vativ" et "revolutionär" apparaissent accolés l'un à l'autre pour la première fois dans le journal berlinois Die Volksstimme du 24 mai 1848: le po-lémiste qui les unissait était mani-festement mu par l'intention de persifler, de se gausser de ceux qui agitaient les émotions du public en affirmant tout et le contraire de tout (le conservatisme et la révolution), l'esprit troublé par les excès de bière blanche. En 1851, le couple de vocables réapparait —cette fois dans un sens non polémique— dans un ouvrage sur la Russie attribué à Theobald Buddeus. En 1875, Youri Sa-marine donne pour titre "Re-volyoutsionnyi konser-vatizm" à une plaquette qu'il a rédigée avec F. Dmi-triev. Par la suite, Dostoïevski l'utilisera à son tour. En 1900, Charles Maurras l'emploie dans son Enquête sur la Monarchie. En 1921, Thomas Mann l'utilise dans un article sur la Russie. En Allemagne, le terme "Konservative Revolution" acquiert une vaste no-to-riété quand Hugo von Hoffmannsthal le prononce dans l'un de ses célèbres discours (Das Schriftum als geistiger Raum der Nation — La littérature comme espace spirituel de la nation; 1927). Von Hoff-manns-thal désigne un processus de maturation intellectuel caractérisé par la recherche de "liens", prenant le relais de la recherche de "liberté", et par la recherche de "totalité", d'"unité" pour échapper aux divi-sions et aux discordes, produits de l'ère libérale.
Chez Hoffmannsthal, le concept n'a pas encore d'im-plication politique directe. Mais dans les quelques ti-mi-des essais de politisation de ce concept, dans le con-texte de la République de Weimar agonisante, on per-çoit très nettement une volonté de mettre à l'avant-plan les ca-ractéristiques immuables de l'âme humaine, en réaction contre les idées de 1789 qui pariaient sur la perfectibilité infinie de l'homme. Mais tous les cou-rants qui s'opposèrent jadis à la Révolution Française ne débouchent pas sur la KR. Bon nombre d'entre eux restent simplement partisans de la Restauration, de la Réaction, sont des conservateurs de la vieille école (Altkonservativen).
"Konservative Revolution" et "Deutsche Bewegung"
Donc si la KR est un refus des idées de 1789, elle n'est pas nostalgie de l'Ancien Régime: elle opte con-fusément, parfois plus clairement, pour une "troisième voie", où seraient absentes l'anarchie, l'absence de valeurs, la fascination du laissez-faire propres au li-béralisme, l'immoralité fondamentale du règne de l'ar-gent, les rigidités de l'Ancien Régime et des abso-lutismes royaux, les platitudes des socialismes et com-munismes d'essence marxiste, les stratégies d'a-ra-sement du passé ("Du passé, faisons table rase..."). A l'aube du XIXième siècle, entre la Révolution et la Restauration, surgit, sur la scène philoso-phique euro-péenne, l'idéalisme allemand, réponse au rationalisme français et à l'empirisme anglais. Parallèlement à cet idéalisme, le roman-tisme secoue les âmes. Sur le ter-rain, comme dans le Tiers-Monde aujourd'hui, les Al-le-mands, exaltés par Fichte, Arndt, Jahn, etc., pren-nent les armes contre Napoléon, incarnation d'un co-lo-nialisme "occidental". Ce mélange de guerre de li-bé-ration, de révolution sociale et de retour sur soi-même, sur sa propre identité, constitue une sorte de préfiguration de la KR, laquelle serait alors le stade atteint par la "Deutsche Bewegung" dans les années 20.
Pour en résumer l'esprit, explique Mohler, il faut mé-diter une citation tirée du célébrissime roman de D.H. Lawrence, The plumed Serpent (= Le serpent à plu-mes, 1926). Ecoutons-la: "Lorsque les Mexicains apprennent le nom de Quetzalcoatl, ils ne devraient le prononcer qu'avec la langue de leur propre sang. Je voudrais que le monde teutonique se mette à repenser dans l'esprit de Thor, de Wotan et d'Yggdrasil, le frêne qui est axe du monde, que les pays druidiques comprennent que leur mystère se trouve dans le gui, qu'ils sont eux-mêmes le Tuatha de Danaan, qu'ils sont ce peuple toujours en vie même s'il a un jour sombré. Les peuples méditerranéens devraient se réapproprier leur Hermès et Tunis son Astharoth; en Perse, c'est Mithra qui devrait ressusciter, en Inde Brahma et en Chine le plus vieux des dragons".
Avec Herder, les Allemands ont élaboré et conservé une philosophie qui cherche, elle aussi, à renouer avec les essences intimes des peuples; de cette philosophie sont issus les nationalismes germaniques et slaves. Dans le sens où elle recherche les essences (tout en les préservant et en en conservant les virtualités) et veut les poser comme socles d'un avenir radicalement neuf (donc révolutionnaire), la KR se rapproche du na-tionalisme allemand mais acquiert simultanément une valeur universelle (et non universaliste) dans le sens où la diversité des modes de vie, des pensées, des âmes et des corps, est un fait universel, tandis que l'univer-salisme, sous quelque forme qu'il se présente, cherche à biffer cette prolixité au profit d'un schéma équarisseur qui n'a rien d'universel mais tout de l'ab-straction.
La notion de "Weltanschauung"
La KR, à défaut d'être une philosophie rigoureuse de type universitaire, est un éventail de Weltan-schau-ungen. Tandis que la philoso-phie fait partie intégrante de la pensée du vieil Occident, la Weltanschauung apparaît au moment où l'édifice occidental s'effondre. Jadis, les catégories étaient bien contingentées: la pensée, les sentiments, la volonté ne se mêlaient pas en des flux désordonnés comme aujour-d'hui. Mais désormais, dans notre "interrègne", qui succède à l'ef-fondrement du christianisme, les Weltan-schau-ungen mêlent pensées, senti-ments et volontés au sein d'une tension perpé-tuelle et dynamisante. La pensée, soutenue par des Weltanschauungen, détient désor-mais un caractère instrumental: on sollicite une mul-titu-de de disciplines pour illustrer des idées déjà pré-alablement conçues, acceptées, choisies. Et ces idées servent à atteindre des objectifs dans la réalité elle-même. La nature particulière (et non plus universelle) de toute pensée nous révèle un monde bigarré, un chaos dynamique, en mutation perpétuelle. Selon Mohler, les Weltanschauungen ne sont plus véhicu-lées par de purs philosophes ou de purs poètes mais par des êtres hybrides, mi-penseurs, mi-poètes, qui savent conjuguer habilement —et avec une cer-taine cohérence— concepts et images. Les gestes de l'existence concrète jouent un rôle primordial chez ces penseurs-poètes: songeons à T.E. Lawrence (d'Ara-bie), Malraux et Ernst Jünger. Leurs existences enga-gées leur ont fait touché du doigt les nerfs de la vie, leur a communiqué une expérience des choses bien plus vive et forte que celle des philosophes et des théologiens, même les plus audacieux.
L'opposition concept/image
Les mots et les concepts sont donc insuffisants pour cerner la réalité dans toute sa multiplicité. La parole du poète, l'image, leur sont de loin supérieures. L'ère nouvelle se reflète dès lors davantage dans les travaux des "intellectuels anti-intellectuels", de ceux qui peu-vent, avec génie, manier les images. Un passage du journal de Gerhard Nebel, daté du 19 novembre 1943, illustre parfaitement les positions de Mohler quand il sou-ligne l'importance de la Weltanschauung par rap-port à la philosophie classique et surtout quand il en-tonne son plaidoyer pour l'intensité de l'existence contre la grisaille des théories, plaidoyer qu'il a ré-sumé dans le concept de "nominalisme" et qui a eu le reten-tissement que l'on sait dans la maturation intel-lectuelle de la "Nouvelle Droite" française (3).
Ecoutons donc les paroles de Gerhard Nebel: "Le rap-port entre les deux instruments méta-physiques de l'homme, le concept et l'image, livre à ceux qui veu-lent s'exercer à la com-paraison une matière inépui-sable. On peut dire, ainsi, que le concept est impro-ductif, dans la mesure où il ne fait qu'ordonner ce qui nous tombe sous le sens, ce que nous avons déjà dé-couvert, ce qui est à notre disposition, tandis que l'image génère de la réalité spirituelle et ramène à la surface des éléments jusqu'alors cachés de l'Etre. Le concept opère prudemment des distinctions et des re-groupements dans le cadre strict des faits sûrs; l'image saisit les choses, avec l'impétuosité de l'aventurier et son absence de tout scrupule, et les lance vers le large et l'infini. Le concept vit de peurs; l'image vit du faste triomphant de la découverte. Le concept doit tuer sa proie (s'il n'a pas déjà ramassé rien qu'un cadavre), tandis que l'image fait apparaître une vie toute pétil-lante. Le concept, en tant que concept, exclut tout mys-tère; l'image est une unité paradoxale de contraires, qui nous éclaire tout en honorant l'obscur. Le concept est vieillot; l'image est toujours fraîche et jeune. Le concept est la victime du temps et vieillit vite; l'image est toujours au-delà du temps. Le concept est subor-donné au progrès, tout comme les sciences, elles aussi, appartiennent à la caté-gorie du progrès, tandis que l'image relève de l'instant. Le concept est écono-mie; l'image est gaspillage. Le concept est ce qu'il est; l'image est toujours davantage que ce qu'elle semble être. Le concept sollicite le cerveau mais l'image solli-cite le cœur. Le concept ne meut qu'une périphérie de l'existen-ce; l'image, elle, agit sur l'ensemble de l'existence, sur son noyau. Le concept est fini; l'image, infinie. Le concept simplifie; l'image honore la diversité. Le concept prend parti; l'image s'abstient de juger. Le concept est gé-néral; l'image est avant tout individuelle et, même là où l'on peut faire de l'image une image générale et où l'on peut lui subordonner des phénomènes, cette action de subordonnance rap-pelle des chasses passionnantes; l'ennui que suscite l'inclusion, l'enfermement de faits de monde dans des concepts, reste étranger à l'image...".
Les idées véhiculées par les Weltanschauungen s'incarnent dans le réel arbitrairement, de façon impré-visible, discontinue. En effet, ces idées ne sont plus des idées pures, elles n'ont plus une place fixe et immuable dans une quelconque empyrée, au-delà de la réalité. Elles sont bien au contraire imbriquées, pri-sonnières des aléas du réel, soumises à ses mutations, aux conflits qui forment sa trame. Etudier l'impact des Weltan-schauungen, dont celles de la KR, c'est poser une topographie de courants souterrains, qui ne sau-tent pas directement aux yeux de l'obser-vateur.
Une exigence de la KR: dépasser le wilhelminisme
Quand Arthur Moeller van den Bruck parle d'un "Troisième Reich" en 1923 (4), il ne songe évidem-ment pas à l'Etat hitlérien, dont rien ne laisse alors prévoir l'avènement, mais d'un système politique qui succéderait au IIième Reich bismarcko-wilhelminien et où les oppo-sitions entre le socialisme et le nationa-lisme, en-tre la gauche et la droite seraient sublimées en une synthèse nouvelle. De plus, cette idée d'un "troisième" Empire, ajoute Mohler, renoue avec toute une spéculation philosophique christiano-européenne très ancienne, qui parlait d'un troisième règne comme du règne de l'esprit (saint). Dès le IIième siècle, les montanistes, secte chrétienne, évoquent l'avènement d'un règne de l'esprit saint, successeur des règnes de Dieu le Père (ancien testament) et de Dieu le Fils (nouveau testament et incarnation), qui serait la syn-thèse parfaite des contraires. Dans le cadre de l'histoire allemande, on repère une longue aspiration à la syn-thèse, à la conciliation de l'inconciliable: par exemple, entre les Habs-bourg et les Hohenzollern. Après la Grande Guer-re, après la réconciliation nationale dans le sang et les tranchées, Moeller van den Bruck est l'un de ces hommes qui espèrent une synthèse entre la gauche et la droite par le truchement d'un "troisième parti". Evidemment, les hitlé-riens, en fondant leur "troisième Reich", prétendront transposer dans le réel toutes ses vieilles aspirations pour les asseoir définiti-ve-ment dans l'histoire. La KR et/ou la "Deutsche Be-wegung" se scinde alors en deux groupes: ceux qui estiment que le IIIième Reich de Hitler est une falsifi-cation et entrent en dissidence, et ceux qui pensent que c'est une première étape vers le but ultime et acceptent le fait accompli.
Sous le IIième Reich historique, existait une "opposition de droite", mécontente du caractère libé-ral/darwiniste de la révolution industrielle allemande, du rôle de l'industrie et du grand capital, de l'étroitesse d'esprit bourgeoise, du façadisme pompeux, avec ses stucs et son tape-à-l'oeil. Le "conservatisme" officiel de l'époque n'est plus qu'un décor, que poses mata-mores-ques, tandis que l'économie devient le destin. Ce bourgeoisisme à colifichets militaires suscite des réactions. Les unes sont réformistes; les autres exigent une rupture radicale. Parmi les réfor-mistes, il faut compter le mouvement chrétien-social du Pasteur Adolf Stoecker, luttant pour un "Empire social", pour une "voie caritative" vers la justice sociale. Les élé-ments les plus dynami-ques du mouvement finiront par adhérer à la sociale-démocratie. Quant au "Mouvement Pan-Ger-maniste" (Alldeutscher Verband), il sombre-ra dans un impérialisme utopique, sur fond de roman-tisme niais et de cliquetis de sabre. Les autres mouve-ments restent périphériques: les mouvements "artistiques" de masse, les mar-xistes qui veulent une voie nationale, les pre-miers "Völkischen", etc.
A l'ombre de Nietzsche...
Face à ces réformateurs qui ne débouchent sur rien ou disparaissent parce que récupérés, se trouvent d'abord quelques isolés. Des isolés qui mûrissent et agissent à l'ombre de Nietzsche, ce penseur qui ne peut être classé parmi les prota-gonistes de la "Deutsche Bewe-gung" ni parmi les précurseurs de la KR, bien que, sans lui et sans son œuvre, cette dernière n'aurait pas été telle qu'elle fut. Mais comme les isolés qu'a-limente la pensée de Nietzsche sont nombreux, très différents les uns des autres, il s'en trouve quelques-uns qui amorcent véritablement le processus de maturation de la KR. Mohler en cite deux, très importants: Paul de Lagarde et Julius Langbehn. L'orientaliste Paul de La-garde voulait fonder une religion allemande, appelée à remplacer et à renforcer le message des christia-nismes protestants et catholiques en pariant sur la veine mys-tique, notamment celle de Meister Eckhart le Rhénan et de Ruusbroeck le Bra-bançon (5). Julius Langbehn est surtout l'homme d'un livre, Rembrandt als Erzieher (1890; = Rembrandt éducateur) (6). A partir de la person-nalité de Rembrandt, Langbehn chante la mysti-que profonde du Nord-Ouest européen et sug-gère une synthèse entre la rudesse froide mais vertueuse du Nord et l'enthousiasme du Sud.
Mouvement völkisch et mouvement de jeunesse
En marge de ses deux isolés, qui connurent un succès retentissant, deux courants sociaux contri-buent à briser les hypocrisies et le matérialisme de l'ère wilhelmi-nienne: le mouvement völkisch et le mouvement de jeunesse (Jugendbewe-gung). Par völkisch, nous ex-plique Mohler, l'on entend les groupes animés par une philosophie qui pose l'homme comme essentiellement dépen-dant de ses origines, que celles-ci proviennent d'une matière informelle, la race, ou du travail de l'histoire (le peuple ou la tribu étant, dans cette op-tique, forgé par une histoire longue et com-mune). Proches de l'idéologie völkische sont les doctrines qui posent l'homme comme déterminé par un "paysage spirituel" ou par la langue qu'il parle. Dans les années 1880, le mouvement völkisch se constitue en un front du refus assez catégorique: il est surtout antisémite et remplace l'ancien antisémitisme confessionnel par un antisémitisme "raciste" et déterministe, lequel prétend que le Juif reste juif en dépit de ses options person-nelles réelles ou affectées. Le mouvement völkisch se divise en deux tendan-ces, l'une aristocratique, dirigée par Max Lieber-mann von Sonnenberg, qui cherche à rapprocher certaines catégories du peuple de l'aristocratie conservatrice; l'autre est radicale, démo-cratique et issue de la base. C'est en Hesse que cette pre-mière radicalité völkische se hissera au niveau d'un parti de masse, sous l'impulsion d'Otto Böckel, le "roi des paysans hessois", qui renoue avec les souvenirs de la grande guerre des paysans du XVIième siècle et rêve d'un soulève-ment généralisé contre les grands capitalistes (dont les Juifs) et les Junker, alliés objectifs des premiers.
Le mouvement de jeunesse est une révolte des jeunes contre les pères, contre l'artificialité du wilhelminisme, contre les conventions qui étouf-fent les cœurs. Créé par Karl Fischer en 1896, devenu le "Wandervogel" (= "oiseau migra-teur") en 1901, le mouvement connait des dé-buts anarchisants et romantiques, avec des éco-liers et lycéens, coiffés de bérets fantaisistes et la gui-tare en bandoulière, qui partent en randon-née, pour quitter les villes et découvrir la beauté des paysages (7). A partir de 1910-1913, le mou-vement de jeunesse acquerra une forme plus stricte et plus disciplinée: la principale organisation porteuse de ce renouveau fut la Frei-deutsche Jugend (8).
Le choc de 1914
Quand éclate la guerre de 1914, les peuples croient à une ultime épreuve purgative qui pulvérisera les bar-rières de partis, de classes, de confessions, etc. et conduira à la "totalité" espé-rée. Thomas Mann, dans les premières semaines de la guerre, parle de "purification", de grand nettoyage par le vide qui ba-laiera le bric-à-brac wilhelminien. Peu importaient la victoire, les motifs, les intérêts: seule comptait la guerre comme hygiène, aux yeux des peuples lassés par les artifices bourgeois. Mais les enthousiasmes du début s'enliseront, après la bataille de la Marne, dans la guerre des tranchées et dans l'implacable choc mé-canique des matériels. "Toute finesse a été broyée, piétinée", écrit Ernst Jünger. Le XIXième siècle périt dans ce maelstrom de fer et de feu, les façades rhéto-riques s'écroulent pulvérisées, les contingente-ments proprets perdent tout crédit et deviennent ridicules.
De cette tourmente, surgit, discrète, une nouvelle "totalité", une "totalité" spartiate, une "totalité" de souffrances, avec des alternances de joies et de morts. Une chose apparaît certai-ne, écrit encore Ernst Jünger, c'est "que la vie, dans son noyau le plus intime, est indestructi-ble". Un philosophe ami d'Ernst Jünger, Hugo Fischer, décrit cet avènement de la totalité nou-velle, dans un essai de guerre paru dans la revue "nationale-bolchévique" Widerstand (Janvier 1934; "Der deutsche Infanterist von 1917"): "Le culte des grands mots n'a plus de raison d'être aujourd'hui... La guerre mondiale a été le dai-mon qui a fracassé et pulvérisé le pathétisme. La guerre n'a plus de com-mencement ni de fin, le fantassin gris se trouve quelque part au mi-lieu des masses de terre boueuse qui s'étendent à perte de vue; il est dans son trou sale, prêt à bondir; il est un rien au sein d'une monotonie grise et désolée, qui a toujours été telle et sera toujours telle mais, en même temps, il est le point focal d'une nou-velle souveraineté. Là-bas, quelque part, il y avait ja-dis de beaux systèmes, scrupuleusement construits, des systèmes de tran--chées et d'abris; ces systèmes ne l'intéres-sent plus; il reste là, debout, ou s'accroupit, à moitié mort de soif, quelque part dans la campagne libre et ouverte; l'opposition entre la vie et la mort est repoussée à la lisière de ses souvenirs. Il n'est ni un individu ni une com-munauté, il est une particule d'une force élé-mentaire, planant au-dessus des champs rava-gés. Les concepts ont été bouleversés dans sa tête. Les vieux concepts. Les écailles lui tombent des yeux. Dans le brouillard infini, que scrutent les yeux de son esprit, l'aube semble se lever et il commence, sans sa-voir ce qu'il fait, à penser dans les catégories du siècle prochain. Les ca-nons balayent cette mer de saletés et de pourriture, qui avait été le domaine de son exis-tence, et les entonnoirs qu'ont creusés les obus sont sa demeure (...) Il a survécu à toutes les formes de guerre; le voilà, incorruptible et immortel, et il ne sait plus ce qui est beau, ce qui est laid. Son regard pénètre les choses avec la tranquillité d'un jet de flamme. Avec ou sans mérite, il est resté, a survécu (...) L'"intériorité" s'est projetée vers l'extérieur, s'est transformée de fond en comble, et cette extériorité est devenue totale; intériorité et extériorité fusion-nent; (...) On ne peut plus distinguer quand l'extériorité s'arrête et quand l'homme com-mence; celui-ci ne laisse plus rien derrière lui qui pourrait être réservée à une sphère privée".
La défaite de 1918: une nécessité
En novembre 1918, l'Etat allemand wilhelminien a cessé d'exister: la vieille droite parle du "coup de cou-teau dans le dos", œuvre des gau-ches qui ont trahi une armée sur le point de vaincre. Dans cette perspective, la défaite n'est qu'un hasard. Mais pour les tenants de la KR, la défaite est une nécessité et il convient main-tenant de déchiffrer le sens de cette défaite. Franz Schauwecker, figure de la mouvance na-tio-nale-révolu-tionnaire, écrit: "Nous devions perdre la guerre pour gagner la Nation". Car une victoire de l'Allemagne wilhelminienne aurait été une défaite de l'"Allemagne secrète". L'écrivain Edwin Erich Dwin-ger, de père nord-allemand et de mère russe, engagé à 17 ans dans un régiment de dragons, prisonnier en Si-bérie, combattant enrôlé de force dans les armées rouge et blanche, revenu en Allemagne en 1920, met cette idée dans la bouche d'un pope russe, personnage de sa trilogie romanesque consacrée à la Russie (9): "Vous l'avez perdue la grande Guerre, c'est sûr... Mais qui sait, cela vaut peut-être mieux ainsi? Car si vous l'aviez gagnée, Dieu vous aurait quitté... L'orgueil et l'oppres-sion [du wilhelminisme, ndt] se seraient multi-pliées par cent; une jouissance vide de sens aurait tué toute étincelle divine en vous... Un pourrissement rapide vous aurait frappé; vous n'auriez pas connu de véritable ascension... Si vous aviez ga-gné, vous seriez en fin de course... Mais maintenant vous êtes face à une nouvelle aurore...".
Après la guerre vient la République de Weimar, mal aimée parce qu'elle perpétue, sous des ori-peaux répu-blicains, le style de vie bourgeois, celui du parvenu. Cette situation est inaccepta-ble pour les guerriers reve-nus des tranchées: dans cette république bourgeoise, qui a troqué les uniformes chamarrés et les casques à pointe contre les fracs des notaires et des banquiers, ils "bivouaquent dans les appartements bourgeois, ne pouvant plus renoncer à la simplicité virile de la vie militaire", comme le disait l'un d'eux. Ils seront les recrues idéales des partis extrémistes, communiste ou national-socialiste. La Républi-que de Weimar se dé-ploiera en trois phases: une phase tumultueuse, s'étendant de novembre 1918, avec la proclamation de la République, à la fin de 1923, quand les Français quittent la Ruhr et que le putsch Hitler/Ludendorff est maté à Munich; une phase de calme, qui durera jus-qu'à la crise de 1929, où la République, sous l'impulsion de Stresemann, jugule l'inflation et où les passions semblent s'apaiser. A partir de la crise, l'édifice répu-blicain vole en éclats et les nationaux-socialistes sortent vainqueurs de l'arène.
Le débourgeoisement total
La République de Weimar a connu des débuts très dif-ficiles: elle a dû mater dix-huit coups de force de la gauche et trois coups de force de la droite, sans compter les manœuvres séparatistes en Rhénanie, fo-mentées par la France. Dans cette tourmente, on en est arrivé à une situation (apparemment) absurde: un gou-vernement en majorité socialiste appelle les ouvriers à la grève générale pour bloquer le putsch d'extrême-droite de Kapp; cette grève générale est l'étincelle qui déclenche l'insurrection communiste de la Ruhr et, pour étrangler celle-ci, le gouvernement ap-pel-le les sympathisants des putschistes de Kapp à la rescousse! La situation était telle que l'esprit public, secoué, pre-nait une cure sévère de dé-bourgeoisement.
Bien sûr, le débourgeoisement total n'affectaient qu'une infime minorité, mais cette minorité était quand même assez nombreuse pour que ses attitudes et son esprit déteignent quelque peu sur l'opinion publique et sur la mentalité générale de l'époque. La guerre avait arraché plusieurs clas-ses d'âge au confort bourgeois, lequel n'exerçait plus le moindre attrait sur elles. Pour ces hommes jeunes, la vie active du guerrier était qua-litativement supérieure à celle du bourgeois et ils haïs-saient l'idée de se morfondre dans des fauteuils mous, les pantoufles aux pieds. C'est pourquoi l'ardeur de la guerre, ils allaient la rechercher et la retrouver dans les "Corps Francs", ceux de l'intérieur et ceux de l'ex-térieur. Ceux de l'intérieur se moulaient dans les structures d'auto-défense locales (Einwohner-wehr) et permettaient, en fin de compte, un retour progressif à la vie civile, assorti quand même d'une promptitude à reprendre l'assaut dans les rangs communistes ou, surtout, na-tionaux-socialistes. Ceux de l'extérieur, qui combattaient les Polonais en Haute-Silésie et avaient arraché l'Annaberg de haute lutte, ou affrontaient les armées bolchéviques dans le Baltikum, regroupaient des soldats perdus, de nouveaux lansquenets, des irré-cupérables pour la vie bourgeoise, des pélérins de l'absolu, des vagabonds spartiates en prise directe avec l'élé-mentaire. Dans leurs âmes sauvages, l'esprit de la KR s'incrustera dans sa plus pure quin-tessence.
Parallèlement aux Corps Francs, d'autres structures d'accueil existaient pour les jeunes et les soldats fa-rouches: les Bünde du mouvement de jeunesse, lequel, avec la guerre, avait perdu toutes ses fantaisies anar-chistes et abandonné toutes ses rêveries philoso-phiques et idéalistes. Ensuite les partis de toutes obé-diences recru-taient ces ensauvagés, ces inquiets, ces cheva-liers de l'élémentaire pour les engager dans leurs formations de combat, leurs services d'ordre. Avant le choc de la guerre, le révolutionnaire typique ne renon-çait par radicalement aux for-mes de l'existence bour-geoise: il contestait simplement le fait que ces formes, assorties de richesses et de positions sociales avanta-geuses, étaient réservées à une petite minorité. L'engage-ment du révolutionnaire d'avant 1914 visait à généraliser ces formes bourgeoises d'existence, à les étendre à l'ensemble de la société, classe ouvrière comprise. Le révolutionnaire de type nou-veau, en re-vanche, ne partage pas cet uto-pisme eudémoniste: il veut éradiquer toute référence à ces valeurs bour-geoises haïes, tout sentiment positif envers elles. Pour le bourgeois frileux, convaincu de détenir la vérité, la formule de toute civilisation, le révolutionnaire nouveau est un "nihiliste", un dangereux mar-ginal, un personnage inquiétant.
Les lansquenets modernes
Mais les partis bourgeois, battus en brèche, incapables de faire face aux aléas qu'étaient les exigences des Al-liés et les dérèglements de l'économie mondiale, la violence de la rue et la famine des classes défavori-sées, ont été obligés de recourir à la force pour se maintenir en selle et de faire appel à ces lansquenets modernes pour encadrer leurs militants. Ces cadres issus des Corps Francs se rendent alors incontour-nables au sein des partis qui les utilisent, mais conservent toujours une certaine distance, en marge du gros des militants.
Ce processus n'est pas seulement vrai pour le national-socialisme, avec ses turbulents SA. Chez les commu-nistes, des bandes de solides bagarreurs adhèrent au Roter Kampfbund. Cer-taines organisations restent in-dépendantes for-mellement, comme le Kampfbund Wi-king du Capitaine Hermann Ehrhardt, le Bund Ober-land du Capitaine Beppo Römer et du Dr. Friedrich Weber, le Wehrwolf de Fritz Kloppe et la Reichs-flagge du Capitaine Adolf Heiß. Le Stahl-helm, orga-nisation paramilitaire d'anciens com-battants, dirigée par Seldte et Duesterberg, est proche des Deutschna-tionalen (DNVP). Le Jungdeutscher Orde (Jungdo) de Mahraun sert de service d'ordre à la Demokratische Partei. Quant aux sociaux-démocrates (SPD), leur or-ganisation paramilitaire s'appelait le Reichs-ban-ner Schwarz-Rot-Gold, dont les chefs étaient Hörsing et Höltermann.
La quasi similitude entre toutes ses formations faisait que l'on passait allègrement de l'une à l'autre, au gré des conflits personnels. Beppo Römer quittera ainsi l'Oberland pour passer à la KPD communiste. Bodo Uhse (10) fera exacte-ment le même itinéraire, mais en passant par la NSDAP et le mouvement révolution-naire pay-san, la Landvolkbewegung. Giesecke passera de la KPD à la NSDAP. Contre les Français dans la Ruhr, les militants communistes sabotent instal-lations et voies ferrées sous la conduite d'of-ficiers prussiens; SA et Roter Kampfbund colla-borent contre le gouver-nement à Berlin en 1930-31.
Dans ce contexte, Mohler souligne surtout l'apparition et la maturation de deux mouve-ments d'idées, le fa-meux "national-bolché-visme" et le "Troisième Front" (Dritte Front). Si l'on analyse de façon dualiste l'affrontement majeur de l'époque, entre nationaux-so-cialistes et communistes, l'on dira que l'idéologie des forces communistes dérive des idées de 1789, tan-dis que celles du national-socialisme de cel-les de 1813, de la Deutsche Bewegung. Il n'em-pêche que, dans une plage d'intersection réduite, des contacts fructueux entre les deux mondes se sont produits. Dans quelques cerveaux perti-nents, un socialisme ra-dical fusionne avec un nationalisme tout aussi radical, afin de sceller l'alliance des deux nations "prolétariennes", l'Allemagne et la Russie, contre l'Occident capitaliste.
Trois vagues de national-bolchévisme
Trois vagues de "national-bolchévisme" se suc-céde-ront. La première date de 1919/1920. Elle est une ré-action directe contre Versailles et atteint son apogée lors de la guerre russo-polonaise de 1920. La section de Hambourg de la KPD, dirigée par Heinrich Lauf-fenberg et Fritz Wolffheim, appelle à la guerre popu-laire et nationale contre l'Occident (11). Rapidement, des contacts sont pris avec des nationalistes de pure eau comme le Comte Ernst zu Reventlow. Quand la cavalerie de Boudienny se rapproche du Corridor de Dantzig, un espoir fou germe: foncer vers l'Ouest avec l'Armée Rouge et réduire à néant le nouvel ordre de Versailles. Weygand, en réorganisant l'armée polo-naise en août 1920, brise l'élan russe et annihile les espoirs allemands. Lauffenberg et Wolffheim sont ex-communiés par le Komintern et leur nouvelle organi-sation, la KAPD (Kommunisti-sche Arbeiterpartei Deutschlands), se mue en une secte insignifiante.
La seconde vague date de 1923, quand l'occupation de la Ruhr et l'inflation obligent une nouvelle fois natio-nalisme et communisme à fusionner. Radek, fonction-naire du Komintern, rend un vibrant hommage à Schlageter, fusillé par les Français. Moeller van den Bruck répond. Un dialogue voit le jour. Dans le jour-nal Die Rote Fahne, on peut lire les lignes suivantes, parfaitement à même de satisfaire et les natio-nalistes et les communistes: "La Nation s'effrite. L'héritage du prolétariat allemand, créé par les peines de générations d'ouvriers est menacé par la botte des militaristes fran-çais et par la faiblesse et la lâcheté de la bourgeoi-sie alle-mande, fébrile à l'idée de récolter ses petits pro-fits. Seule la classe ouvrière peut désormais sauver la Nation". Mais cette seconde vague natio-nale-bol-chéviste n'est restée qu'un symptôme de fièvre: d'un côté comme de l'autre, on s'est contenté de formuler de belles proclamations.
Plus sérieuse sera la troisième vague nationale-bolchéviste, explique Mohler. Elle s'amorce dès 1930. A la crise économique mondiale et à ses effets sociaux, s'ajoute le Plan de réparations de l'Américain Young qui réduit encore les maigres ressources des Alle-mands. Une fois de plus, les questions nationale et so-ciale se mêlent étroite-ment. Gregor Strasser, chef de l'aile gauche de la NSDAP, et Heinz Neumann, tacti-cien commu-niste du rapprochement avec les natio-naux, parlent abondamment de l'aspiration anti-capita-liste du peuple allemand. Des officiers natio-nalistes, aristocratiques voire nationaux-socia-listes, passent à la KPD comme le célèbre Lieutenant Scheringer, Ludwig Renn, le Comte Alexander Stenbock-Fermor, les chefs de la Landvolkbewegung comme Bodo Uhse ou Bruno von Salomon, le Capitaine des Corps Francs Beppo Römer, héros de l'épisode de l'Annaberg. Dans la pratique, la KPD soutient l'initiative du Stahl-helm contre le gouvernement prussien en août 1931; communistes et natio-naux-socialistes organisent de concert la grève des transports en commun berlinois de novem-bre 1932. Toutes ces alliances demeurent ponc-tuel-les et strictement tactiques, donc sans lendemain.
La tendance anti-russe de la NSDAP munichoise (Hitler et Rosenberg) réduit à néant le tandem KPD/NSDAP, particulièrement bien rodé à Berlin. L'URSS signe des pactes de non-agression avec la Pologne (25.1.1932) et avec la France (29.11.1932). Au sein de la KPD, la tendance Thälmann, internatio-naliste et anti-fas-ciste, l'emporte sur la tendance Neu-mann, socia-liste et nationale.
Mais ce national-bolchévisme idéologique et militant, présent dans de larges couches de la population, du moins dans les plus turbulentes, a son pendant dans certains cercles très influents de la diplomatie, regrou-pés autour du "Comte rouge", Ulrich von Brockdorff-Rantzau, et du Baron von Maltzan. La position de Brockdorff-Rantzau était en fait plus nuancée qu'on ne l'a cru. Quoi qu'il en soit, leur optique était de se dé-gager des exigences françaises en jouant la carte russe, exactement dans le même esprit de la politique prussienne russophile de 1813 (les "Accords de Taurog-gen"), tout en voulant reconstituer un équilibre euro-péen à la Bis-marck.
Le "troisième front" (Dritte Front)
Pour distinguer clairement la KR du national-socia-lisme, il faut savoir, explique Mohler, qu'avant la "Nuit des Longs Couteaux" du 30 juin 1934, où Hit-ler élimine quelques adversai-res et concurrents, inté-rieurs et extérieurs, le national-socialisme est une idéologie floue, re-celant virtuellement plusieurs pos-sibles. Ce fut, selon les circonstances, à la fois sa force et sa faiblesse face à un communisme à la doc-trine claire, nette mais trop souvent rigide. Mohler énumère quelques types humains rassemblés sous la bannière hitlérienne: des ouvriers re-belles, des resca-pés de l'aventure des Corps Francs de la Baltique, des boutiquiers en colère qui veulent faire supprimer les magasins à rayons multiples, des entrepreneurs qui veulent la paix sociale et des débouchés extérieurs nouveaux. Sur le plan de la politique étrangère, les options sont également diverses: alliance avec l'Italie fasciste contre le bolchévisme; al-lian-ce de tous les pays germaniques avec mini-misation des rapports avec les peuples du Sud, décrétés "fellahisés"; alliance avec une Russie redevenue plus nationale et débarrassée de ses velléités communistes et internationalistes, afin de forger un pacte indéfectible des "have-nots" con-tre les nations capitalistes. De plus, la NSDAP des premières années du pouvoir, compte dans ses rangs des fédéra-listes bavarois et des centralistes prussiens, des catho-liques et des protestants convaincus, et, enfin, des mi-litants farouchement hostiles à toutes les formes de christianisme.
Cette panade idéologique complexe est le propre des partis de masse et Hitler, pour des raisons pratiques et tactiques, tenait à ce que le flou soit conservé, afin de garder un maximum de militants et d'électeurs. Avant la prise du pou-voir, plusieurs tenants de la KR avaient constaté que cette démagogie contribuerait tôt ou tard à falsifier et à galvauder l'idée précise, tranchée et argu-mentée qu'ils se faisaient de la nation. Pour éviter l'avènement de la falsification nationale-socialiste et/ou communiste, il fallait à leurs yeux créer un "troisième front" (Dritte Front), basé sur une synthèse cohérente et destiné à remplacer le système de Weimar. Entre le drapeau rouge de la KPD et les chemises brunes de la NSDAP, les dissidents optent pour le drapeau noir de la révolte paysanne, hissé par les révoltés du XVIième siècle et par les amis de Claus Heim (12). Le drapeau noir est "le dra-peau de la terre et de la misère, de la nuit allemande et de l'état d'alerte".
Le rôle de Hans Zehrer
L'un des partisans les plus chaleureux de ce "troisième front" fut Hans Zehrer, éditeur de la revue Die Tat d'octobre 1931 à 1933. Dans un article intitulé signifi-cativement Rechts oder Links? (Die Tat, 23. Jg., H.7, Okt. 1931), Zehrer explique que l'anti-libéralisme en Allemagne s'est scindé en deux ailes, une aile droite et une aile gauche. L'aile droite puise dans le réservoir des sentiments nationaux mais fait passer les questions sociales au second plan. L'aile gauche, elle, accorde le primat aux questions sociales et tente de gagner du ter-rain en matière de nationalisme. Le camp des anti-libéraux est donc partagé entre deux pôles: le national et le social. Cette opposition risque à moyen ou long terme d'épuiser les combattants, de lasser les masses et de n'aboutir à rien. En fin de course, les appareils dirigeants des partis communiste et national-socialiste ne défendent pas les intérêts fondamentaux de la po-pulation, mais exclusive-ment leurs propres intérêts. Les bases des deux partis devraient, écrit Zehrer, se détourner de leurs chefs et se regrouper en une "troisième communauté", qui serait la synthèse parfaite des pôles social et national, antagonisés à mau-vais escient.
Derrière Zehrer se profilait l'ombre du Général von Schleicher qui, lui, cherchait à sauver Weimar en atti-rant dans un "troisième front" les groupes socialisants internes à la NSDAP (Gre-gor Strasser), quelques syn-dicalistes sociaux-dé-mocrates, etc. Mais l'assem-bla-ge était trop hétéroclite: KPD et NSDAP ré-sistent à l'entre-prise de fractionnement. Le "troisième front" ne sera qu'un rassemblement de groupes situés "entre deux chaises", sans force motrice dé-cisive.
Robert STEUCKERS.
(La suite de cette recension, rendant compte d'un ouvrage abso-lument capital pour comprendre le mouvement des idées poli-tiques de notre siècle, paraîtra dans nos éditions ultérieures. Nous mettrons l'accent sur les fondements philosophiques de la KR et sur ses principaux groupes).
Armin MOHLER, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch (Dritte, um einen Ergänzungsband erweiterte Auflage 1989), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-stadt, 1989, I-XXX + 567 S., Ergänzungsband, I-VIII + 131 S., DM 89 (beide zusammen); DM 37 (Ergänzungsband einzeln).
00:09 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, weimar, années 20, années 30, conservatisme, droite, national-bolchevisme, national-communisme, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 mai 2009
Erik von Kuehnelt-Leddihn (1909-1999), der liberalkonservative Monarchist
Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn (1909-1999), der liberalkonservative Monarchist
Auch Julius Evola, ein brillanter, wenn auch perverser Denker der heidnischen Rechten, betrachtete den Faschismus als eine Bewegung der Linken, die nichts mit der wahren Rechten zu tun hatte.
(Eine Sprachregulierung: Was ist „faschistisch“?)
Allerdings hatte vieles was Kuehnelt-Leddihn in seiner persönlichen Gleichung lieb und rechts war, auch nichts mit der wahren Rechten zu tun. Dies gilt an erster Stelle für seinen ultrakapitalistischen Wirtschaftsliberalismus (der Freund Hayeks war auch in der Mont Pèlerin Society), der gerade die bürgerlichen Zerstörer der alten aristokratischen Ordnung abfeierte und den er gegen links verteidigte, nicht verstehend oder akzeptierend, daß die stets beklagte Proletarisierung und Egalitarisierung eben die Konsequenz dieser Freihandelsvergötzung war. Aber er war auch der Auffassung, die Monarchie würde den wirklichen Liberalismus (englisch und nicht französisch verstanden, empiristisch und nicht rationalistisch) schützen. Dazu kam sein Unverständnis für alle Konservative, die nicht katholisch sind. Wobei sein Katholizismus andererseits wiederum - entgegen gerade wieder verbreiteten Gerüchten - sehr liberal war (sein Verlag wirbt wohl zurecht mit einem Zitat des liberalkonservativen Paradetheologen Hans Urs von Balthasar), der Ökumene zugewandt, insbesondere philojudaistisch, nur nicht linkskatholisch (Befreiungstheologie, feministische Theologie, usw.), aber ganz gegen die "Traditionalisten" wie Marcel Lefebvre gerichtet, den er mit Martin Luther verglichen hat und dies nicht nur wegen des Ungehorsams, sondern auch weil er ihn als mittelalterlich empfand. (Tatsächlich war Kuehnelt-Leddihn ja wie die meisten "Konservativen" sehr fortschrittlich, er nannte dies "additiv"; siehe auch: Konservativismus und Subversion) Die "Tradition" in einem übergeordneten, integralen Sinne hat er wohl trotz seiner Begegnung(en) mit Evola nicht verstanden. Für ihn war nur ein christlicher Staat als Pyramide gedacht - entgegen dem ja gerade dem Christentum entstammenden Gleichheitsprinzip - akzeptabel, nicht-christliche "Pyramiden"-Gesellschaft, was wir als Kastensystem bezeichnen würden, waren für ihn so unakzeptabel wie egalisierte Gesellschaften:
Und ein heidnischer Vertikalismus kann furchtbar sein. Corruptio optimi pessima, hatte uns schon der Aquinate gewarnt. Das fühlte ich schon einmal in der Anwesenheit vom Baron Giulio Evola, der einer der brillantesten Verteidiger der atheistischen oder agnostischen Rechten war. Dieser Mann, der durch die Rachebombardierung der Alliierten auf Wien im März 1945 querschnittgelähmt war, redete zu mir in kalter Verachtung wie ein amerikanischer College-Professor zu einem Dshu-Dshu Praktiker am oberen Ubangi.
(Weltweite Kirche. Begegnungen und Erfahrungen in sechs Kontinenten 1909-1999; Stein am Rhein 2000; S. 502)
Das Bonmot, den adeligen Dandy mit einem US-College-Professor zu vergleichen, ist wieder Erik von Kuehnelt-Leddihn in einer Nußschale: so originell wie schief. Bei aller, kaum verdeckten Boshaftigkeit ("perverser Denker", "agnostische Rechte") war der Ritter, der im Juli vor 100 Jahren in Tobelbad geboren wurde und im Mai vor 10 Jahren in Lans gestorben ist, persönlich wohl liebenswert wie eine Figur aus einem Roman des Co-Wahltirolers Ritter Fritz von Herzmanovsky-Orlando: ein Dshu-Dshu Praktiker am oberen Ubangi der Tarockei.
15:04 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politique, théorie politique, conservatisme, droite, monarchisme, hommage, biographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 mai 2009
Ernesto Guevara mito e simbolo della destra militante?
|
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, mythe politique, che guevara, amérique latine, amérique du sud, anti-impérialisme, gauchisme, gauche, droite, droite militante |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 mai 2009
Karl Ludwig von Haller en de restauratie gedachte
KARL LUDWIG VON HALLER EN DE RESTAURATIE GEDACHTE
door Willem van der Burcht - http://bitterlemon.eu/
De Zwitserse conservatieve staatstheoreticus en publicist Karl Ludwig von Haller werd op 1 augustus 1778 te Bern geboren in één van de voornaamste patriciërsfamilie van de trotse stadrepubliek. Hij was de kleinzoon van de grote natuurwetenschapper, arts, dichter en botanicus Albrecht von Haller (1708-1777) en de tweede zoon van de bekende staatsman, historicus, numismaticus en heruitgever van de “Bibliothek der Schweizergeschichte”, Gottlieb Emanuel von Haller (1735-1786). Hij liep school in de Academie van zijn geboortestad, maar de vroege dood van zijn vader en financiële problemen lieten universitaire studies niet toe, zodat hij op wetenschappelijk gebied geheel autodidact is gebleven.
Op amper zestienjarige leeftijd trad hij in dienst van de stad Bern – toen de grootste stadsstaat benoorden de Alpen – en maakte snel carrière door zijn bekende naam en zijn capaciteiten. Hij had goede vooruitzichten op een mooie loopbaan in dienst van de stad. Als twintigjarige was hij reeds Secretaris van de Commissie en politiek heel erg actief via politieke geschriften.
In juli 1790 maakte hij tijdens een reis naar Parijs persoonlijk kennis met de Franse revolutie. Hij zetelde in talrijke commissies en genootschappen en zijn toespraken en denkbeelden vielen bij velen in de smaak. Tussendoor schreef hij nog ontelbare verhandelingen, memoranda, tijdschrift- en krantenartikelen, enz.
Als delegatiesecretaris en in zijn talrijke publicaties, bemoeide hij zich ook met de Bernse buitenlandse politiek. Zo nam hij deel aan diplomatieke zendingen naar Genève (1792), Ulm (1795), Noord Italië -waar hij Napoleon ontmoette - en Parijs (1797); hij was aanwezig op het Congres van Rastatt (1797/1798) en in 1798 waarschijnlijk ook betrokken bij de onderhandelingen met de Franse generaal Brune, die met zijn revolutionaire troepen op het punt stond het Zwitserse Eedgenootschap binnen te trekken. Er werd nog voorgesteld dat de stad zelf met een progressief en liberaal “Projekt einer Constitution für die Schweizerische Republik Bern” op de proppen zou komen (maart 1798), maar het voorstel kwam te laat. Op 6 maart 1798 trokken de Fransen Bern binnen, wat het einde was van het oude Bern en ook van het oude Zwitserland dat, onder de benaming “Helvetische Republiek”, een Franse satellietstaat werd.
Anti-revolutionair verzet en eerste ballingschap
Albrecht Ludwig von Haller werd uit overheidsdienst ontslagen en met zijn tijdschrift Helvetische Annalen zette hij het verzet tegen het revolutionaire systeem voort. Algauw veroorzaakte hij een groot schandaal in de pers en ontkwam ter nauwer dood aan arrestatie vanwege de autoriteiten door naar Zuid-Duitsland te vluchten, waar hij zich aansloot bij de Zwitserse emigranten rond Nikolaus Friedrich von Steiger, de laatste verdedigers van een onafhankelijk Bern. Ondanks het feit dat ze ten gevolge van de krijgsgebeurtenissen niet lang op eenzelfde plaats konden blijven, spreidde hij een indrukwekkende literaire en propagandistische productiviteit ten toon.
In maart 1799 vond hij onderdak in het hoofdkwartier van het leger van Aartshertog Karel en in juni, tijdens de Eerste Slag van Zürich, was hij getuige van de eerste geallieerde zege op Napoleon, die echter algauw weer verloren ging door de Tweede Slag, die de Oostenrijkers ook dwong de terugtocht te aanvaarden. Vervolgens hield hij zich weer op in kringen van Zwitserse emigranten tot hij in juni 1801 als Hofkriegskonzipist in de Präsidialkanzlei van Aartshertog Karel in Wenen werd aangesteld.
De in 1803 tot Hofkriegssekretär bevorderde vluchteling werd – na de herinvoering van de kantonale soevereiniteit door de Mediatie Akte van Napoleon - in 1805 als professor in het staatsrecht aan de nieuw opgerichte Academie van Bern aangesteld. Hij moest echter alweer snel de benen nemen voor de oprukkende Franse troepen en hij vluchtte naar Agram in Kroatië.
Terug in Bern; academische loopbaan
Eind februari 1806 nam hij ontslag uit Oostenrijkse staatsdienst en keerde terug naar Bern om er zijn professoraat weer op te nemen. In hetzelfde jaar huwde hij de patriciërsdochter Katharina von Wattenwyl en bekleedde –naast talrijke andere ambten- de functies van Censor en Prorector aan de Academie van Bern. Hij begon zijn universitaire carrière met zijn openingsrede “Über die Notwendigkeit einer andern obersten Begründiging des allgemeinen Staatsrechts” (vert.: Over de noodzakelijkheid van een andere fundamentele grondslag van het algemene staatsrecht); het volgende jaar hield hij een rede “Über den wahren Sinn des Naturgesetzes, daß der Mächtige herrsche” (vert.: Over de ware betekenis van de natuurwet, dat de machtige heerse). In 1808 publiceerde hij zijn Handbuch der allgemeinen Staatenkunde [vert.: Handboek der algemene staatskunde], dat de basis vormde voor zijn lessen. Daarin worden zijn opvattingen over de staat - en in het bijzonder over het wezen en het ontstaan van de staatsgemeenschap - voor het eerst systematisch uiteengezet, en zodoende geldt het als voorloper van zijn grote werk, de Restauration der Staatswissenschaft (vert.: Restauratie der Staatswetenschap). Het Handbuch leverde hem roem en erkenning op, maar ook hoon en vijandschap.
Het "enfant terrible" van Bern
Von Haller kwam al gauw in conflict met zijn grote concurrent op de universiteit, Samuel Schnell. Nadat von Haller zijn ambt als Censor misbruikt had om zijn concurrent te benadelen, werd hij in 1809 verplicht zijn mandaat neer te leggen.
Dit verhinderde echter niet dat hij het jaar daarop lid van de Grote Stadsraad van Bern werd en in 1810 in de Kleine Stadsraad werd gekozen. In zijn opmerkelijke werk uit 1811: Politische Religion oder biblische Lehre über die Staaten (vert.: Politieke religie of Bijbelse leer over de staten) trachtte hij aan te tonen dat zijn nieuwe staatspolitieke opvattingen in alle opzichten in overeenstemming waren met wat de Bijbel daarover zegt. Hij bleek onvermoeibaar als politieke stokebrand, verklikker en intrigant in de Bernse stadspolitiek, en hij raakte betrokken bij enkele schandalen die een smet op zijn reputatie wierpen. Zo was hij de auteur van een (anonieme) recensie in de Göttingischen gelehrten Anzeigen waarin hij op een perfide wijze van leer trok tegen het levenswerk van Pestalozzi, waarmee hij de ongemeen harde hetze die tegen deze laatste gevoerd werd, nog aanwakkerde. Hij liet zich evenmin onbetuigd in de zogenaamde “Kreis der Berner Unbedingten” terwijl zijn rol in het “Waldshuter Komitee” nog steeds niet helemaal opgehelderd is. Voor zijn verantwoordelijkheid bij de onlusten in Nidwalden werd hij tot een celstraf veroordeeld, maar snel begenadigd. Wel leverde dit incident hem een blaam op vanwege de voorzitter van de Kleine Raad.
De door von Haller bejubelde doortocht van de geallieerde legers door Bern op 23 december 1813 en een algemene staking bij de overheid, leidden tot de val van de Mediatieregering, die werd opgevolgd door de Restauratieregering. Hij stelde zich kandidaat voor de verkiezingen voor de Grote (of “Soevereine”) Raad van de Republiek Bern, die op 12 januari 1814 gehouden werden, met een programma dat hij in twee propagandabrochures neerschreef: Was sind Untertanenverhältnisse? (vert.: Wat zijn onderdanenverhoudingen?) en Was ist die Alte Ordnung? (vert.: Wat is de oude orde?)
Zijn hoofdwerk: "Restauration der Staatswissenschaft"
Von Haller was co-auteur van de nieuwe Bernse grondwet van 1815 en lid van de commissie die de grondwet diende te herzien ten gevolge van de aansluiting van de Jura. In 1816 werd hij tot lid van de Geheime Raad gekozen, waar hij echter met zijn reactionaire voorstellen op niet veel steun kon rekenen.
Op de derde verjaardag van de Slag bij Leipzig voltooide hij het eerste deel van zijn magnum opus dat zijn naam zou geven aan een heel tijdperk: Restauration der Staatswissenchaft (vert.: Restauratie der Staatswetenschap). Dag op dag een jaar later, op 18 oktober 1817, werd het boek tijdens het Wartburgfest openbaar verbrand omdat het een Duitse grondwet niet genegen was.
De volgende delen van het monumentale werk (2: 1817; 3: 1818; 4: 1820; 5: 1834; 6:1825) kenden niet meer dezelfde weerklank als het eerste deel, ondanks de vele (negatieve) publiciteit die von Haller te beurt viel: in 1817 werd hij gedwongen “in allen Ehren” (sic) ontslag te nemen als professor aan de Bernse universiteit, en hoewel hij nog tal van ambten beklede, bleef hij vooral op een negatieve wijze in de belangstelling komen.
In zijn Über die Constitution der spanischen Cortes (vert.: Over de Constitutie van de Spaanse Cortes), betoonde hij zich een hartstochtelijke verdediger van de koninklijke rechten, tegen de usurpatoren van de Cortes-grondwet in. Het geschrift werd aanvankelijk door de bevriende censor toegelaten, maar kort daarop door de Kleine Raad van Bern verboden.
Karl-Ludwig von Haller -“cet extravagant”, zoals hij genoemd werd- maakte zich alsmaar minder en minder geliefd. Het enfant terrible van de Bernse politiek gold in die dagen niet alleen in Bern maar in heel Zwitserland als ultrareactionair. Die reputatie had hij ook te danken aan zijn engagement in wat de “Olry-Hallerschen Clique” werd geheten. Het grootste schandaal, dat de emmer ten slotte deed overlopen, stond echter nog te gebeuren.
Bekering tot het katholicisme en tweede ballingschap
Op 17 oktober 1820 legde de protestantse patriciër uit Bern – die later bekende “… in zijn hart reeds sedert 1808 katholiek te zijn geweest …” - op het landgoed van de familie de Boccard in Jetschwil (Freiburg), in het geheim de Katholieke Geloofsbelijdenis af. Tijdens een oponthoud op weg naar Parijs raakte zijn bekering echter bekend. Hij koos voor de vlucht naar voren en kondigde in een brief aan zijn familie zijn overstap naar het Katholieke geloof aan. Deze apologie, die meer dan 70 herdrukken beleefde en in vele talen werd vertaald, lokte een stortvloed aan reacties pro en contra uit! Zijn bekering zond een schokgolf doorheen Europa en ontketende een storm in de pers. Op voorstel van de Kleine Raad en na stormachtige debatten werd Von Haller door een overweldigende meerderheid in de Grote Raad uit al zijn ambten ontzet en voor immer en altijd van lidmaatschap van datzelfde orgaan uitgesloten.
Von Haller werd nu voor de tweede maal – en deze keer definitief – weggejaagd. Tevergeefs verzocht hij in Oostenrijkse, Pruisische of Spaanse dienst te kunnen treden; na afscheidsbezoeken aan Freiburg, Bern, Genève en Erlach te hebben gebracht, trok hij in mei 1822 met zijn familie – zonder zijn beide zonen, die tot 1823 hun studies in Gottstadt verderzetten – naar Parijs. Daar werd hij snel opgenomen in het gezelschap van gelijkgezinden, waaronder de Bonald, de Lamennais en anderen, en leverde hij talrijke bijdragen aan Franse ultraroyalistische en Duitse conservatieve bladen. In juli 1824, na het terugtreden van Chateaubriand, kreeg hij een aanstelling als “publiciste” verbonden aan het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
In Parijs vond hij ook de tijd en de energie om zijn familieleden tot het katholicisme te bekeren, achtereenvolgens de groep rond zijn dochter Cecilia, de bij hem inwonende Julie Mathilde von Erlach, zijn tweede zoon Albrecht (die later hulpbisschop van Chur zou worden), zijn oudste zoon Karl Ludwig (later publicist en politicus in Solothurn) en uiteindelijk ook zijn echtgenote.
Reeds in 1828 kocht von Haller in Solothurn het huidige bisschoppelijke paleis en in 1829 verwierf hij het burgerschap van deze stad. Kort na de Julirevolutie van 1830 trok hij weg uit Parijs om zich definitief in Solothurn te vestigen.
Voorvechter van de Restauratie tot het einde
In Solothurn stelde hij zich aan het hoofd van de ultraconservatieven en was vanaf 1834 drie jaar lang lid van de Grote Raad; in 1837 werd hij niet meer herkozen.
Koortsachtig richtte de reeds op pensioenleeftijd gekomen pamflettist zijn pijlen op de rampzalige tendensen van zijn tijd. In 1833 ontwierp hij het programma voor een “Bund der Getreuen zum Schutz der Religion, der Gerechtigkeit, und der wahren Freiheit” (vert.: Bond der getrouwen ter bescherming van de Godsdienst, de Gerechtigheid en de Ware Vrijheid), die zou uitgroeien tot een internationale strijdgroep tegen liberalisme, de vrijmetselarij en het revolutionaire systeem überhaupt. Met Satan und die Revolution (vert.: Satan en de revolutie) uit 1834 toonde hij aan dat de drijvende krachten achter de revolutie voortsproten uit het Kwade. In zijn Geschichte der Kirklichen Revolution oder protestantischen Reform (vert.: Geschiedenis van de kerkelijke revolutie of protestantse hervorming, 1836) ontmaskerde hij de reformatie als een tweede zondeval, en duidde haar als diepere oorzaak van en voorloper van de grote revolutie.
Met zijn geschriften tegen de vrijmetselarij (1840/41) wilde hij de “oerleugen” blootleggen die volgens hem aan de basis lag van de valse leerstellingen van die verderfelijke “sekte” en antistoffen aanreiken ter bestrijding ervan. Achter alle revolutionaire stromingen in Zwitserland vermoedde hij de hand van geheime genootschappen en hun ideeën van “gleichmacherei” (lett. vert.: “gelijkmakerij” of egalitarisme), van “onverschilligheid ten aanzien van iedere vorm van religiositeit”, van “exclusieve haat jegens de katholieke godsdienst en kerk”, van “afschaffing van iedere gedachte van een opperheerschappij” en van een “bevrijding van iedere hogere macht”. In zijn strijd tegen de revolutie, die bij wijlen extreme en obsessieve vormen aan nam, schreef hij ontelbare journalistieke bijdragen voor kranten en tijdschriften .
Hij ondernam ook nog meerdere reizen: in 1840 verbleef hij een tijdje in het Zuiden van Duitsland, meerbepaald in München; ook Freiburg, Luzern, Schwyz en Kienzheim in de Elzas deed hij aan. Op zijn reizen legde hij veel contacten en ook door middel van een uitgebreide correspondentie met iedereen van naam en faam in Europa, onderhield hij contacten met katholieken, bekeerlingen, ultramontanen, conservatieven en reactionairen.
Von Hallers werk gaf, samen met de activiteiten van de Jezuïeten, voedsel aan een antiprotestantse, traditionalistische en legitimistische politieke cultuur in Zwitserland, wat de spanningen aan de vooravond van de Sonderbundskrieg van 1847 aanzienlijk deed toenemen. De katholieke, conservatieve en overwegend landelijke kantons moesten het echter afleggen tegen de protestantse, liberale stadskantons; deze nederlaag én de revolutie die in 1848 door gans Europa trok, ervoer de bejaarde voorvechter als een persoonlijke nederlaag. Tijdens de laatste jaren van zijn leven zag hij zijn levenswerk instorten.
In hetzelfde jaar als de revolutie overleed zijn echtgenote, die al lange tijd zwaar ziek was. Op 20 mei 1854 volgde hij haar in het graf ten gevolge van een longontsteking. Drie dagen later werd hij op het kerkhof van Sint-Katharina van Solothurn bijgezet. Het kerkhof werd echter onder het radicale regime met de grond gelijk gemaakt, zodat er niets meer overblijft dat herinnert aan deze onvermoeibare strijder, wiens levenswerk gericht was tegen zijn eigen tijd.
Von Hallers reactionaire staatstheorie
Albrecht Ludwig von Haller was zijn hele leven lang vervuld van het profetisch zendingsbewustzijn, de kop van de slang van het jacobinisme te moeten verpletteren. Daarvoor ontwikkelde hij een restauratieve staatstheorie gebaseerd op de “natuurlijke gemeenschap”, als tegenpool voor Rousseau’s “kunstmatig-burgerlijke” leer van het “sociaal contract”. Tegenover deze zuiver speculatieve drogbeelden wilde hij een uit de Schepping en uit de Openbaring gedestilleerde, wetenschappelijk onderbouwde Waarheid plaatsen die universeel en absoluut geldig was.
Von Haller zag de basis van de maatschappelijke verhoudingen in de Natuurwet, waarbij de sterkere heerst en de zwakkere dient: “De machtige heerst, of hij wil of niet, terwijl de zwakke dient, of hij wil of niet”.
Tegenover de geconstrueerde, egaliserende filosofie van de revolutie, plaatste hij de door hem opnieuw naar voor gebrachte principes van de “eeuwige en onveranderlijke Goddelijke Ordening”: de fundamentele ongelijkheid, de “weldadige verscheidenheid” der “krachten en noden” en de superioriteit van de sterksten. Macht en heerschappij komen voort uit het Natuurrecht, het Goddelijke recht en het positieve recht.
Von Hallers doctrine wordt daarom vaak voor brutaal, materialistisch en utilitaristisch aanzien. Daar zijn leer ook de triomf van de sterke over de zwakke bejubelt en soms geweld verheerlijkt, wordt eveneens beweerd dat zijn ideeën op de “Uebermensch” van Nietzsche vooruitliepen of zelfs dat zijn stellingen – indien consequent doorgedacht – tot een toestand van anarchie zouden leiden.
De Staat als huishouding
De Staat is voor von Haller een oneindig uitgestrekte familie, één reusachtige huishouding. De heerschappijverhoudingen zijn over elkaar heen geordend en van een zuiver privaatrechterlijk karakter.
Zo wil hij dat het Staatsrecht, de opperste bekroning van de natuurlijke dienst- en maatschappelijke verhoudingen, wordt vervangen door een aggregaat van oneindig verschillende, vrije, private verdragen. Met andere woorden: staatsrecht en privaatrecht zijn voor hem identiek. Bijgevolg bestaat er binnen een staat ook geen gemeenschappelijk doel, maar is hij slechts een mengeling van talrijke verschillende private doelen. Dus dient de Staat uitsluitend de door God gewilde verhoudingen en toestanden te bewaren en garandeert hij zo de ware Vrijheid, de vrijheid der voorrechten en de natuurlijke ongelijkheid.
Deze opvatting die – consequent doorgedacht – de staat ontbindt tot op het niveau van de enkele individu, staat in schril contrast tot de ideeën over Staat en Natie die in die periode overal in Europa opgang maakten.
De Staat als patrimonium
De natuurlijke basis voor het uitoefenen van macht en heerschappij is grondbezit. De landsheer is niets anders dan de grootste eigenaar en de Staat is zijn patrimonium. In deze “Patrimonialstaat” (lett. vert.: patrimoniumstaat) – een uitvinding en woordkeuze van von Haller waarmee hij een soort van feodale standenstaat voor ogen had – is de vorst enkel tegenover God verantwoording verschuldigd. Zijn gezag wordt slechts beperkt door verdragen en het recht, door de eigendom en de autonomie van zijn onderdanen en door de uit de Natuur afgeleide morele wetten. Gerechtigheid moet het Kwade verhinderen terwijl Liefde het Goede moet bevorderen. De concrete vrijheid die ieder individu toekomt, wordt gemeten naar de relatieve macht die iemand op grond van zijn sociale positie binnen het kader van heerschappij en dienstbaarheid, toekomt.
Onafhankelijkheid zonder dienstbaarheid behoort tot de soevereiniteit van de vorst en staat op de hoogste spurt van het menselijke geluk. Dit voorrecht verplicht de vorst tot rechtvaardigheid en tot het goede. Deze premisse, dat slechts de zwakke misbruik zou maken van zijn macht en niet de sterke, heeft hem het verwijt opgeleverd op moreel vlak naïef te zijn.
Invloed en nawerking
Von Hallers ambitieuze voornemen om een totaalverklaring voor de gehele werkelijkheid te geven, kan gezien worden als een – enigszins laattijdige - poging om het Ancien Régime op rationalistische basis te legitimeren. Tegelijkertijd heeft hij echter een gefundeerde contrarevolutionaire doctrine en een monumentale uitdaging aan het adres van de moderniteit nagelaten!
Ondanks de vaak starre systematiek, de ongegeneerde wereldvreemdheid en de reeds in zijn tijd opgemerkte anachronismen, heeft von Hallers “politieke theologie” – hoewel slechts voor een korte tijd – een enorme weerklank in Europa gekend. Von Haller werd alom bewonderd (bijvoorbeeld door de jonge Achim von Arnim) en zijn Restauration der Staatswissenschaft verdrong Adam Müllers Elementen der Staatskunst als hoogste autoriteit op het gebied van de staatswetenschappen. Daarnaast was von Hallers denken – naast dat van de Maistre en de Bonald - van groot belang voor de ontwikkeling van de staatsleer van het politieke katholicisme.
Zijn onhistorische, rationalistische opvattingen over de staat werden in kringen van Pruisische Junkers hartstochtelijk verwelkomd en ze oefenden een grote invloed uit op de conservatieven van het laatromantische Berlijn, zoals op de Christelijk-germaanse kring rond de gebroeders Gerlch.
Voor de Pruisische koning Frederik Willem IV dan weer, was von Hallers idee van een op religieuze grondslagen gevestigde “patrimoniale standenstaat”, tot in de jaren vijftig van de 19de eeuw het te verwezenlijken ideaal. De invloed die von Haller op het Pruisische conservatisme uitoefende, werd slechts overtroffen door die van Friedrich Julius Stahl (1802-1861).
Ook in Wenen kon von Hallers Restauratie-idee op grote instemming rekenen. In Zwitserland zelf bleef zijn invloed eerder gering, hoewel toch enkele aanhangers in zijn voetsporen verder werkten. In Frankrijk, in Nederland, in Italië (en in het bijzonder in de Kerkelijke Staten) en in Spanje bekenden prominente geestelijken en politici zich tot von Hallers systeem. Dit uitte zich niet alleen in publieke stellingnamen, maar ook in de talrijke orden en onderscheidingen die hem verleend werden, alsook in zijn indrukwekkende briefwisseling.
De nawerking van von Hallers poging om de geestelijke premissen van de revolutie door een antitheorie in de kiem te smoren om zo de tijd terug te kunnen draaien, was echter van korte duur. De democratische, liberale en nationale krachten stormden over hem heen en bepaalden het verdere verloop van de geschiedenis tot in de 21ste eeuw.
"Restauratie” verwerd van een strijdkreet tot een scheldwoord, de reactionair werd ideologisch geïsoleerd en als verliezer van de geschiedenis uit het collectieve geheugen verbannen. Niettegenstaande, blijft deze eens zo toonaangevende “politieke Luther” of “Helvetische Bonald”, zoals hij wel eens genoemd werd, één der belangrijkste en eigenzinnigste conservatieve denkers van de 19de eeuw. Geen enkele zichzelf respecterende conservatief kan het zich veroorloven rond deze Zwitserse persoonlijkheid van Europees formaat heen te lopen.
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, restauration, droite, conservatisme, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 02 mai 2009
Portret C. S. Lewis (1898-1963)
Portret C.S. Lewis (1898-1963)
C.S. LEWIS
door Bart Jan Spruyt - http://bitterlemon.eu/
"Do not be scared by the word authority. Believing things on authority only means believing them because you have been told by someone you think trustworthy. Ninety-nine per cent of the things you believe are believed on authority. I believe there is such a place as New York. I have not seen it myself. I could not prove by abstract reasoning that there must be a place. I believe it because reliable people have told me so. The ordinary man believes in the Solar System, atoms, evolution, and the circulation of the blood on authority – because the scientists say so. (...) A man who jibbed at authority in other things as some people do in religion would have to be content to know nothing all his life."
Clive Staples Lewis werd op 29 november 1898 in Belfast geboren uit ouders die nominaal lid waren van de Anglicaanse Kerk. Zijn vader, waarmee Lewis een groot deel van zijn leven een problematische verhouding had, was advocaat en stamde uit een sociaal geëmancipeerd Engels arbeidersmilieu. Zijn moeder was van vaders kant afkomstig uit een Schots-Iers predikantengezin en van moeders kant stamde zij uit een oud Anglo-Normandisch geslacht dat zich onder Hendrik II in Ierland gevestigd had. Op dat laatste was Lewis als jongeman erg trots.
Samen met zijn drie jaar oudere broer Warren beleefde hij een gelukkige kindertijd. Centraal in hun bestaan stond een fantasiewereld, uitgedrukt in zelf geschreven sprookjes, tekeningen en sILLEtjes, al snel mede gevoed uit de omvangrijke ouderlijke boekerij waar de kinderen onbeperkte toegang toe hadden. Zo vermeldde Lewis als tienjarige in zijn dagboek: “Paradise Lost gelezen, erover nagedacht.” Daar is hij nog vele jaren mee doorgegaan, getuige het in 1942 verschenen A Preface to Paradise Lost. Aan deze gelukkige periode kwam abrupt een einde door de vroege dood van zijn moeder. Vervolgens bracht hij enkele jaren door op twee Engelse kostscholen die hem tot laat in zijn leven depressief makende herinneringen opleverden. In zijn autobiografie Surprised by Joy (1955) heeft hij maar liefst zeven hoofdstukken nodig om dit liefdeloze en intellectueel afstompende milieu te beschrijven.
In 1916 won Lewis een beurs voor University College in Oxford, maar moest al spoedig zijn studie afbreken om als negentienjarige officier zijn land te dienen in de Noord-Franse loopgraven. In april 1918 kwam er een eind aan zijn oorlogservaringen door een ernstige granaatwond die hij opliep tijdens de Slag bij Arras. Na de oorlog hervatte hij zijn studie in Oxford. Hij studeerde er cum laude af in de klassieke talen, in de klassieke filosofie en in de Engelse taal- en letterkunde. Vanaf 1925 was hij als fellow in de Engelse taal- en leterkunde verbonden aan Magdalen College. Nadat hij gedurende zijn jeugd langere tijd van het christendom vervreemd was geraakt, begon rond die tijd ook een proces van religieuze heroriëntatie. Onder andere onder invloed van de dood van zijn vader en als gevolg van gesprekken met gelovige collega's als J.R.R. Tolkien en Hugo Dyson bekeerde hij zich tot het christendom. Zoals hij later in Surprised by Joy zou beschrijven vond de eigenlijke bekering plaats op 22 september 1931 tijdens een tochtje in de zijspan van de motorfiets van zijn broer. Als eerste literaire neerslag van zijn bekering publiceerde hij The Pilgrim's Regress (1932), een geestrijke allegorie naar het model van John Bunyan's boek.
Een nationaal bekend figuur zou Lewis pas tijdens de Tweede Wereldoorlog worden. Die bekendheid kreeg hij enerzijds door een aantal druk beluisterde lezingen over filosofische en religieuze onderwerpen voor de BBC-microfoon. Een aantal van die lezingen werden later gebundeld onder de titel Mere Christianity (1952), nog steeds een van zijn meest gelezen boeken. Daarnaast verscheen in 1942 het eerste publiekssucces, The Screwtape Letters, dat in het eerste jaar negen drukken kende en een jaar later eenzelfde succes kende in de Verenigde Staten.
Tot 1954 werkte hij onafgebroken in Oxford. In dat jaar werd hij in Cambridge benoemd op een speciaal voor hem ingestelde leerstoel voor letterkunde. In 1956 trouwde hij met de Amerikaanse Joy Davidham Gresham, een gescheiden voormalige communiste die zich onder invloed van Lewis’ boeken tot het christendom bekeerd had. Vier jaar later al stierf zij. In een van zijn laatste boeken, A Grief Observed (1961), dat onder het pseudoniem N.W. Clerk verscheen, probeerde hij verslag te doen van dit verschrikkelijke verlies. C.S. Lewis stierf op 22 november 1963, de dag dat John F. Kennedy in Dallas werd neergeschoten. Hij ligt begraven op het kerkhof van de Holy Trinity Church in Headington, Oxford.
Volgens zijn levenslange vriend Owen Barfield zijn er in zekere zin drie “C.S. Lewissen” geweest. Tijdens zijn leven heeft Lewis aan drie verschillende roepingen succesvol beantwoord. Op de eerste plaats was daar de gerespecteerde Oxford-docent, literatuurgeleerde en literair criticus. Daarnaast de schrijver van romans en kinderboeken. En ten slotte was er de populaire en invloedrijke apologeet, filosoof en volkstheoloog die veel lezers (opnieuw) op een verfrissende wijze het christendom binnen leidde. Daarbij geldt echter ook dat in veel van zijn werk filosofie, theologie, literatuur en fictie niet scherp te scheiden zijn.
In 1936 publiceerde Lewis zijn baanbrekende The Allegory of Love. Lewis beschrijft in dit boek hoe in de vroege middeleeuwen de klassieke goden in allegorische vorm weer het christelijk denken binnenkomen. Streden de goden vroeger tegen elkaar, nu worden het personificaties van krachten in de mens zelf. In de loop van de eeuwen begint de kracht van de allegorie echter te verzwakken. Dit wordt veroorzaakt door het verzwakkende besef dat de stoffelijke wereld primair een afspiegeling is van de bovennatuur. Steeds meer gaan elementen als satire, alledaagsheid en liefdesperikelen overheersen en daarmee verdwijnt de kracht van de allegorie in de westerse literatuur. Een ander levenswerk op het gebied van de literatuurgeschiedenis was zijn English Literature in the Sixteenth Century (1954) dat als deel III verscheen van The Oxford History of English Literature.
In zijn zeven kinderboeken (The Chronicles of Narmia) en drie science fiction romans verwerkte Lewis ook tal van theologische en filosofische ideeën. Zo vindt men in de roman That Hideous Strength talloze ideeën in literaire vorm die men in The Abolition of Man (1943) in filosofische vorm uitgewerkt vindt. Zijn beroemdste literaire werk is ongetwijfeld het al eerder genoemde The Screwtape Letters. In dit boek schrijft een oudere duivel eenendertig brieven aan een jongere collega met talloze adviezen hoe een jonge gelovige het best verleid kan worden. Het boek weerspreekt het binnen de hedendaagse Nederlandse intelligentsia wijd verbreide vooroordeel dat christendom en humor elkaar niet verdragen.
C.S. Lewis vormde de belichaming van een natuurlijk soort conservatisme. In zijn levensstijl (zo weigerde hij pubs te betreden waar de radio aan stond), in zijn literaire opvattingen (pas heel laat kwam hij tot waardering voor het werk van T.S. Eliot) en in zijn politieke opvattingen was Lewis een conservatief pur sang. Voor wat betreft de politiek moet daarbij wel vermeld worden dat Lewis een groot scepticus was ten aanzien van politici en partijpolitiek. Winston Churchill bewonderde hij overigens zeer, maar dat verhinderde hem in 1951 niet de minister-president te laten weten dat hij afzag van een hem aangeboden titel. Lewis was bang dat zijn critici zo'n adellijke titel als bewijs zouden opvatten dat zijn religieus werk slechts verholen anti-progressieve propaganda was. Zijn onverschilligheid inzake de dagelijkse politiek weerhield hem er niet van over een breed scala aan politieke onderwerpen te schrijven: misdaad, censuur, pacifisme, doodstraf, dienstplicht, vivisectie enzovoorts. Ook over de verzorgingsstaat had hij uitgesproken opvattingen. In een artikel in The Observer schreef hij in 1958:
"The modern State exists not to protect our rights, but to do us good or make us good — anyway, to do something to us or to make us something. Hence the new name ‘leaders’ for those who were once ‘rulers’. We are less their subjects than their wards, pupils, or domestic animals. There is nothing left of which we can say to them, ‘mind your own business.’ Our whole lives are their business."
De staat kan ervoor zorgen dat mensen zich gedragen, maar uiteindelijk kan hij de mens niet goed maken. Deugd veronderstelt vrije keuze. Lewis was er vooral bang voor dat de verzorgingsstaat zich verder zou ontwikkelen tot een technocratie van het soort dat hij al in romanvorm had beschreven in That Hideous Strength.
Veel conservatieven zien in The Abolition of Man zijn belangrijkste filosofische werk. In dit werk geeft Lewis een zeer originele verdediging van de natuurrechtsleer. De meeste beschavingen, religies en denksystemen gingen in het verleden van dezelfde morele codex uit. Wanneer men die codex analyseert komt men vanzelf uit bij de bekende deugden als Rechtvaardigheid, Eerlijkheid, Bramhartigheid en Voorzichtigheid. Hij laat zien wat de consequenties zijn wanneer de moderne cultuur het idee van een objectieve morele orde verwerpt.
Lewis is in Nederland een bekend auteur. Een aantal belangrijke boeken van hem is vertaald en leverbaar.
Literatuur
Er is zoveel over Lewis geschreven dat het hier slechts mogelijk is een bescheiden selectie te geven.
Een mooie biografie werd geschreven door Roger Lancelyn Green en Walter Hooper: C.S. Lewis: A Biography (A Harvest Book).
De biografie Jack: A Life of C.S. Lewis van George Sayer werd ook in het Nederlands vertaald (Crossway Books).
In de bundel Ontijdige bespiegelingen van Robert Lemm is een korte lezenswaardige inleiding in het werk van Lewis opgenomen (Kok Agora).
Een interessante visie op het conservatieve mens- en geschiedbeeld van Lewis vindt men in het door Peter Kreeft geschreven C.S. Lewis for the Third Millennium. Six essays on the Abolition of Man (Ignatius Press).
Een kort essay over de politieke opvatingen van Lewis werd geschreven door John G. West, Jr.: Public Life in the Shadowlands. What C.S. Lewis Teach Us About Politics (Acton Institute), met een geannoteerde bibliografie van de boeken en essays van Lewis die handelen over politieke thema's.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres anglaises, littérature anglaise, conservatisme, droite, grande-bretagne, angleterre, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 avril 2009
Terre & Peuple Magazine n°39
Terre et Peuple Magazine n°39 - Printemps 2009
| ||||||||
00:30 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, nouvelle droite, géopolitique, identité, droite, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
An Interview with Dominique Venner
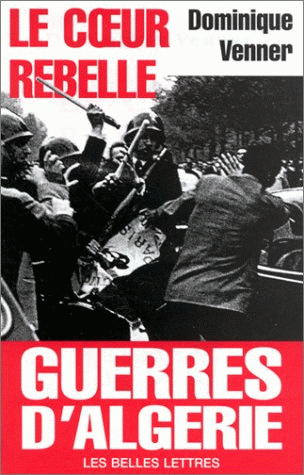
An Interview with Dominique Venner
by Michael O'Meara
TRANSLATOR’S NOTE: It’s testament to the abysmal state of our culture that hardly one of Dominique Venner’s more than forty books have been translated into English. But everything he writes bears directly on us — “us” here referring not specifically to the anglophone world, but to the European world that exists wherever white men still carry on in any of the old ways.
Venner is more than a gifted historian who has made major contributions to the most important chapters of modern, especially 20th-century European history. He has played a key role in both the development of the European New Right and the “Europeanization” of continental nationalionalism.
It is his “rebel heart” that explains his engagement in these great struggles, as well as his interests in the Russian Revolution, German fascism, French national socialism, the U.S. Civil War, and the two world wars. The universe I’ve discovered in his works is one that reminds me of Ernst von Salomon’s “Die Geächteten” — one of the Homeric epics of our age.
The following interview is about the rebel. Unlike the racial conservatives dominant in U. S. white nationalist ranks, European nationalism still bears traces of its revolutionary heritage — opposed as it is not merely to the alien, anti-national forces, but to the entire liberal modernist subversion, of which the United States has been the foremost exemplar. -Michael O’Meara
Question: What is a rebel? Is one born a rebel, or just happens to become one? Are there different types of rebels?
Dominique Venner: It’s possible to be intellectually rebellious, an irritant to the herd, without actually being a rebel. Paul Morand [a diplomat and novelist noted for his anti-Semitism and collaborationism under Vichy] is a good example of this. In his youth, he was something of a free spirit blessed by fortune. His novels were favored with success. But there was nothing rebellious or even defiant in this. It was for having chosen the side of the National Revolution between 1940 and 1944, for persisting in his opposition to the postwar regime, and for feeling like an outsider that made him the rebellious figure we have come to know from his “Journals.”
Another, though different example of this type is Ernst Jünger. Although the author of an important rebel treatise on the Cold War, Jünger was never actually a rebel. A nationalist in a period of nationalism; an outsider, like much of polite society, during the Third Reich; linked to the July 20 conspirators, though on principle opposed to assassinating Hitler. Basically for ethical reasons. His itinerary on the margins of fashion made him an anarch, this figure he invented and of which after 1932 he was the perfect representative. The anarch is not a rebel. He’s a spectator whose perch is high above the mud below.
Just the opposite of Morand and Jünger, the Irish poet Patrick Pearse was an authentic rebel. He might even be described as a born rebel. When a child, he was drawn to Erin’s long history of rebellion. Later, he associated with the Gaelic Revival, which laid the basis of the armed insurrection. A founding member of the first IRA, he was the real leader of the Easter Uprising in Dublin in 1916. This was why he was shot. He died without knowing that his sacrifice would spur the triumph of his cause.
A fourth, again very different example is Alexander Solzhenitsyn. Up until his arrest in 1945, he had been a loyal Soviet, having rarely questioned the system into which he was born and having dutifully done his duty during the war as a reserve officer in the Red Army. His arrest, his subsequent discovery of the Gulag and of the horrors that occurred after 1917, provoked a total reversal, forcing him to challenging a system which he once blindly accepted. This is when he became a rebel — not only against Communist, but capitalist society, both of which he saw as destructive of tradition and opposed to superior life forms.
The reasons that made Pearse a rebel were not the same that made Solzhenitsyn a rebel. It was the shock of certain events, followed by a heroic internal struggle, that made the latter a rebel. What they both have in common, what they discovered through different ways, was the utter incompatibility between their being and the world in which they were thrown. This is the first trait of the rebel. The second is the rejection of fatalism.
Q: What is the difference between rebellion, revolt, dissent, and resistance?
DV: Revolt is a spontaneous movement provoked by an injustice, an ignominy, or a scandal. Child of indignation, revolt is rarely sustained. Dissent, like heresy, is a breaking with a community, whether it be a political, social, religious, or intellectual community. Its motives are often circumstantial and don’t necessarily imply struggle. As to resistance, other than the mythic sense it acquired during the war, it signifies one’s opposition, even passive opposition, to a particular force or system, nothing more. To be a rebel is something else.
Q: What, then, is the essence of a rebel?
DV: A rebel revolts against whatever appears to him illegitimate, fraudulent, or sacrilegious. The rebel is his own law. This is what distinguishes him. His second distinguishing trait is his willingness to engage in struggle, even when there is no hope of success. If he fights a power, it is because he rejects its legitimacy, because he appeals to another legitimacy, to that of soul or spirit.
Q: What historical or literary models of the rebel would you offer?
DV: Sophocles’ Antigone comes first to mind. With her, we enter a space of sacred legitimacy. She is a rebel out of loyalty. She defies Creon’s decrees because of her respect for tradition and the divine law (to bury the dead), which Creon violates. It didn’t mater that Creon had his reasons; their price was sacrilege. Antigone saw herself as justified in her rebellion.
It’s difficult to choose among the many other examples. . . . During the War of Succession, the Yankees designated their Confederate adversaries as rebels: “rebs.” This was good propaganda, but it wasn’t true. The American Constitution implicitly recognized the right of member states to succeed. Constitutional forms had been much respected in the South. Robert E. Lee never saw himself as a rebel. After his surrender in April 1865, he sought to reconcile North and South. At this moment, the true rebels emerged, who continued the struggle against the Northern army of occupation and its collaborators.
Certain of these rebels succumbed to banditry, like Jesse James. Others transmitted to their children a tradition that has had a great literary posterity. In the “Vanquished,” one of William Faulkner’s most beautiful novels, there is, for example a fascinating portrait of a young Confederate rebel, Drusilla, who never doubts the justice of his cause or the illegitimacy of the victors.
Q: How can one be a rebel today?
DV: How can one not! To exist is to defy all that threatens you. To be a rebel is not to accumulate a library of subversive books or to dream of fantastic conspiracies or of taking to the hills. It is to make yourself your own law. To find in yourself what counts. To make sure that you’re never “cured” of your youth. To prefer to put everyone up against the wall rather than to remain supine. To pillage in this age whatever can be converted to your law, without concern for appearance.
By contrast, I would never dream of questioning the futility of seemingly lost struggles. Think of Patrick Pearse. I’ve also spoken of Solzhenitsyn, who personifies the magic sword of which Jünger speaks, “the magic sword that makes tyrants tremble.” In this Solzhenitsyn is unique and inimitable. But he owed this power to someone who was less great than himself. To someone who should gives us cause to reflect. In “The Gulag Archipelago,” he tells the story of his “revelation.”
In 1945, he was in a cell at Boutyrki Prison in Moscow, along with a dozen other prisoners, whose faces were emaciated and whose bodies broken. One of the prisoners, though, was different. He was an old White Guard colonel, Constantin Iassevitch. He had been imprisoned for his role in the Civil War. Solzhenitsyn says the colonel never spoke of his past, but in every facet of his attitude and behavior it was obvious that the struggle had never ended for him. Despite the chaos that reigned in the spirits of the other prisoners, he retained a clear, decisive view of the world around him. This disposition gave his body a presence, a flexibility, an energy that defied its years. He washed himself in freezing cold water each morning, while the other prisoners grew foul in their filth and lament.
A year later, after being transferred to another Moscow prison, Solzhenitsyn learned that the colonel had been executed. “He had seen through the prison walls with eyes that remained perpetually young. . . . This indomitable loyalty to the cause he had fought had given him a very uncommon power.” In thinking of this episode, I tell myself that we can never be another Solzhenitsyn, but it’s within the reach of each of us to emulate the old White colonel.
French Original
“Aujourd’hui, comment ne pas être rebelle?”
http://www.jisequanie.com/blogs/index.php?2006/06/18/13-entretien
avec-dominique-venner-comment-peut-on-ne-pas-etre-rebelle
On Venner
“From Nihilism to Tradition”
http://www.theoccidentalquarterly.com/vol4no2/mm-venner.html
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, nationalisme révolutionnaire, rébellion, coeur rebelle, droite, france, histoire, entretiens, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 avril 2009
Chi era Giano Accame
Chi era Giano Accame
L'intellettuale "eretico" di destra
Pensatore eretico della destra, fascista di sinistra, uno degli intellettuali storici della destra italiana, l'intellettuale che voleva unire destra e sinistra sull'idea di patria, il pioniere del dibattito sulla repubblica presidenziale, il primo intellettuale di destra ad avere posizioni filoisraeliane, pensatore "scomodo" grande studioso del poeta americano Ezra Pound: sono solo alcune delle definizioni date ad Giano Accame, il giornalista, saggista e scrittore scomparso a Roma a 81 anni.
Da vero "irregolare" del panorama politico e culturale di destra, Giano Accame ha ricoperto ruoli diversi nella sua lunga vita: dalla sua collaborazione con Tabula Rasa, fucina di pensatori della destra, a inviato del settimanale Il Borghese dal 1958 al 1968; per sedici anni direttore del settimanale Nuova Repubblica, che faceva capo al repubblicano Randolfo Pacciardi, e direttore del quotidiano Il Secolo d'Italia, organo del Msi, tra il 1988 e il '91. Ha pubblicato diversi libri che hanno sempre suscitato dibattito a destra e letti con attenzione a sinistra: Socialismo tricolore (1983) con Editoriale Nuova, poi con Settimo Sigillo Il fascismo immenso e rosso (1990), Ezra Pound economista, Contro l'usura (1995), La destra sociale (1996), Il potere del denaro svuota le democrazie (1998). Nel 2000 con Rizzoli Accame ha pubblicato Una storia della Repubblica: un'opera, avvertiva l'editore, non basata sul conformismo e sul politicamente corretto, ma raccontata con un'interpretazione fuori dai vecchi schemi, spesso critica ma sempre obiettiva e rigorosamente documentata. In pochi mesi il volume fu ristampato più volte e poi apparve anche in edizione tascabile Bur Rizzoli. Alla presentazione ufficiale del libro a Roma esponenti di destra e di sinistra cercarono di far "pace" sul dopoguerra: intervennero, tra gli altri, Gianni Borgna, Marco Minniti, Gianni Alemanno e Francesco Storace.
Giano Accame nasce a Stoccarda il 30 luglio 1928 da madre tedesca, Elisabeth von Hofenfels, mentre il padre e il nonno furono ammiragli e gli antenati piccoli armatori di Loano (Savona). Il 25 aprile 1945, giorno della Liberazione, ad appena 17 anni, Accame si arruolò nella marina militare della Repubblica sociale italiana, ammirando la Decima Mas. La sua adesione alla Rsi durò lo spazio di un mattino, perché alla sera fu catturato dai partigiani a Brescia. Nel 1946 si iscrisse a Genova al Fronte degli Italiani, organismo poi confluito nel Msi, di cui creò le prime sezioni nella riviera ligure ed è stato dirigente regionale e nazionale. Nel 1956 lasciò il Movimento sociale italiano, stanco di polemiche interne e per impegnarsi di più con il giornalismo, sua futura professione, nelle polemiche culturali.
Da qui la collaborazione, con altri intellettuali già stanchi del partito, con Tabula Rasa. Nel 1956 iniziò la professione come capo della redazione toscana del settimanale Cronaca italiana. Nel 1958 passò a Il Borghese, da cui si dimise nel 1968 per contrasti sulla contestazione giovanile. Segretario del Centro di vita italiana presiedutoda Ernesto De Marzio, organizzò a Roma due incontri internazionali di scrittori di destra. Nel1964 dirisse il settimanale Folla, poi, Nuova Repubblica, organo del movimento presidenzialista del repubblicano Randolfo Pacciardi, l'Unione democratica per la nuova Repubblica, di cui divenne segretario nazionale. Come stretto collaboratore di Pacciardi, Accame fu anticipatore, durante gli anni Sessanta, del dibattito sulla repubblica presidenziale.
Dal 1969, come inviato ed editorialista de Il Fiorino, Giano Accame si specializzò in giornalismo economico e collaborò agli Annali dell'economia italiana di Epicarmo Corbino. Tra la fine del 1988 e il 1991 ricoprì l'incarico di direttore del Secolo d'Italia. Ha collaborato con diverse riviste, tra le quali L'Italia settimanale, Il Sabato, Lo Stato, Pagine Libere, Letteratura - Tradizione, La Meta Sociale e Area, ma anche con diversi quotidiani come Il Tempo, Lo Specchio e Vita.
Giano Accame è stato considerato, insieme a Piero Buscaroli, Fausto Gianfranceschi, Franco Cardini, Gianfranco de Turris e Marcello Veneziani, uno degli intellettuali storici della destra italiana. Accame non si ritenne mai un "fascista di sinistra", come il suo grande amico Beppe Niccolai, né tantomeno un "Bertinotti della destra", come fu definito da alcuni giornali per le sue posizioni "eretiche" e "scomode", considerandolo una perniciosa macchietta. Accame ha sempre pensato che tradizione e patria non dovessero essere pretesti, ma ideali veri da rendere concreti con l'azione politica. Quando vennero fuori i documenti del "golpe bianco" del partigiano liberale Edgardo Sogno, alla metà degli anni Settanta, Accame risultava in predicato come ministro della Pubblica istruzione. "Vanterie di una persona anziana che voleva stupire. Sogno era intelligente, simpatico, coraggioso. Ma era il birichino di mamma"', dichiarò Accame nel 2004 in un'intervista a Claudio Sabelli Fioretti per Sette del Corriere della Sera. Allo stesso giornalista che gli ricordava le definizioni date di lui come "terzomondista, anticapitalista, antiamericano", Accame rispose: "Sono solo venature".
Il sindaco di Roma Alemanno:
''Per me è veramente una scomparsa gravissima perché è stato un maestro''. ''E' stato un intellettuale di grandissimo spessore che ha attraversato tutta la storia del dopoguerra con posizioni sempre molto ricche e significative, uno dei grandi maestri della cultura di destra''.
La camera ardente, allestita presso la sua casa-studio in Lungotevere dei Mellini 10 a Roma, verrà aperta questo pomeriggio a partire dalle 15. I funerali si svolgeranno sabato.
00:40 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, politique, politologie, sciences politiques, théorie politique, non conformisme, pensée rebelle, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Giano Accame : pensiero scomodo

Giano Accame, pensiero scomodo
14 maggio 2001
Puntata realizzata con gli studenti del Liceo Classico "Umberto I" di Napoli"
STUDENTESSA: Ringraziamo Giano Accame per essere qui con noi. Prima di dare avvio alla discussione guardiamo la scheda filmata.
Pensieri scomodi, pensieri inquietanti, pensieri di difficile collocazione, attraversano, come ombre, il corso del secolo che è appena trascorso. Un secolo dove la massa si è fatta protagonista e il conformismo, l'automatismo mentale, l'inerzia, il torpore, sono diventati condotta comune, norma di comportamento. Il secolo dei grandi totalitarismi sicuramente è anche il secolo dell'indottrinamento di massa, ma, paradossalmente, è anche il secolo degli antagonismi, delle ribellioni, è il secolo in cui scrittori e pensatori, spesso solitari, emarginati, talvolta sconfitti dalla storia, conducono "esperimenti temerari" o semplicemente portano il peso di una "intelligenza scomoda", refrattaria a ogni conformismo. È il caso, ad esempio, dello scrittore tedesco Ernst Junger, una delle grandi figure della letteratura del Novecento. In età più che matura, all'inizio degli anni Cinquanta, Junger teorizza il comportamento del ribelle, al quale, "per sapere che cosa sia giusto, non servono teorie o leggi escogitate da qualche giurista di partito". Il ribelle "attinge alle fonti della moralità ancora non disperse nei canali delle istituzioni". Il ribelle rifugge da ogni ordine costituito, non appartiene più a niente, ha varcato una volta per tutte il meridiano delle opinioni comuni. Pensatore scomodo è dunque Junger, come d'altra parte scrittore scomodo è stato Louis-Ferdinand Céline, definito "veggente del tramonto dell'Occidente". Poeta scomodo è Ezra Pound, una delle voci più alte della poesia del Novecento e uno dei critici più feroci della vita degradata, misurata dal denaro e dalla prestazione. E scrittore scomodo Yukio Mishima, la cui "intelligenza scomoda" si esprime nella ricerca della bellezza e nella fedeltà alla propria tradizione. Ma ogni ricerca ha il suo prezzo: Mishima muore suicida nel 1970.
STUDENTESSA: Possiamo arrivare a definire una "intelligenza scomoda"? Cioè quali sono i suoi tratti distintivi?
ACCAME: Questa espressione, "intelligenze scomode", viene da una trasmissione di Rai Educational dedicata a scrittori, intellettuali e artisti di destra, ma più che di destra, o fascisti, o accusati di fascismo, persone che sono state una parte ineliminabile, importante, del pensiero del Novecento; e che appartengono ormai non solo a una parte, ma al genere umano. Non si potrebbe fare a meno, nella letteratura italiana, di Gabriele D'Annunzio, anche se a Fiume ha creato la ritualità del fascismo, i saluti, il discorso dal balcone. La filosofia italiana non potrebbe fare a meno del più grande filosofo accademico del Novecento, Giovanni Gentile. L'arte italiana non potrebbe fare a meno del futurismo, anche se Marinetti è stato fascista. Il futurismo è stato, dopo il Barocco, la prima volta che l'arte italiana ha avuto di nuovo una dimensione universale. E così la cultura del mondo non potrebbe più rinunciare a Ezra Pound, che è stato il grande innovatore del modo di fare poesia in lingua inglese, o di Céline, che ha cambiato completamente, rinnovato, il modo di fare prosa narrativa, o di Carl Schmitt, che è stato il più grande politologo del secolo scorso.
STUDENTESSA: Secondo Lei, quali sono i rischi, i pericoli, che una "intelligenza scomoda" corre al giorno d'oggi, e quali sono stati quelli dell'anticonformismo nel secolo appena passato?
ACCAME: Ad esempio, tra i rischi dell'anticonformismo, è esemplare la vita tormentata di Ezra Pound, che per essere stato vicino al fascismo e soprattutto alla repubblica sociale italiana, fu poi chiuso dai suoi concittadini americani in una gabbia, come una bestia, in un campo di concentramento a Pisa e poi confinato per tredici anni in un manicomio criminale negli Stati Uniti. Questa idea di curare le dissidenze come una forma di disturbo mentale non è stata adottata prima nell'Unione Sovietica, ma per prima in America. Non accettandosi l'idea che il più grande poeta americano fosse simpatizzante del fascismo, lo si è fatto passare per matto.
STUDENTE: Al di là del nostro secolo, come può manifestarsi oggi una "intelligenza scomoda"? E cosa vuol dire, nella nostra società, andare contro l'opinione comune?
ACCAME: È sempre una posizione rischiosa e naturalmente scomoda. Non lo è stata nella prima metà del secolo, dove il pensiero fascista è stato dominante in quasi tutta l'Europa, ma nella seconda metà del secolo queste forme di cultura sono state emarginate e quindi, tra l'altro, si sono rarefatti gli intellettuali che vi hanno aderito. Il massimo della scomodità oggi è nel ribellarsi alla pretesa del denaro, dei poteri finanziari, e di porsi come elemento principale della scelta politica. Oggi viene teorizzato dalla migliore cultura economica, quella che viene dalla Banca d'Italia in Italia, la compresenza di due elettorati: uno siamo noi, sarete Voi, quando ci arrivate, a diciotto anni, il popolo sovrano, quello che vota per dei deputati e dei senatori, che contano sempre di meno. E l'altro invece è il grande elettorato del mercato finanziario, che, si dice, ormai vota tutti i giorni in casa nostra, facendo salire o scendere le quotazioni della lira e della borsa, a seconda che il Parlamento e i governi si comportino bene, cioè secondo le indicazioni del mercato finanziario, oppure si comportino male. Se spendono troppo per i pensionati o gli ammalati, la lira cade. Ecco, ribellarsi a questo grande potere internazionale è certamente scomodo, perché la maggior parte degli organi di informazione importanti sono nelle mai del potere finanziario, e quindi liberissimi nel criticare i poteri politici, molto meno nel criticare i poteri economici. I grandi giornali, le televisioni, sono un po' delle pistole puntate alla tempia dei poteri politici, che devono adeguarvisi.
STUDENTE: Non pensa che sia il pericolo ad impedire l'esercizio dell'anticonformismo? E ancora: è forse per paura che ci si adegua all'opinione comune?
ACCAME: Per la verità l'anticonformismo oggi non viene impedito. Viviamo in un periodo di piena libertà, soltanto che nessuno gli dà poi retta. Diceva Ezra Pound che la libertà di parola, senza la libertà di esprimersi via radio, non vale nulla. Questo lo diceva quando non esisteva ancora la televisione. Se uno scrive, ma non arriva a esprimersi attraverso il nuovo grande mezzo di comunicazione, parla a vuoto, o parla a delle piccole minoranze. Non credo che oggi vi siano motivi di paura. Il grande vantaggio di essere usciti dai due secoli di cultura delle rivoluzioni, con la caduta del Muro di Berlino, che nessuno ha più legittimo motivo di avere paura per la vita, per la libertà, per i beni, di fronte a qualunque scelta politica. Il potere non fa paura. Il potere però può emarginare, è naturale insomma. Quindi esiste, è legittimo, anche per gli intellettuali, il timore, la paura di essere isolati, di essere emarginati, di non contare niente, quindi di non guadagnare. Ecco, questo è. Ridimensionando il timore, è lì oggi il vero nemico dell'anticonformismo, quello che spesso vengono reclamizzate sono forme di anticonformismo banale, ma quello più serio viene ancora ghettizzato.
STUDENTESSA: Recentemente ho visto un film, L'ultimo bacio, di Gabriele Muccino, e uno dei personaggi dice: "La normalità è la vera rivoluzione". Lei cosa ne pensa?
ACCAME: La rivoluzione è cambiamento, mentre la normalità è stabilizzazione. La grossa difficoltà nel rapporto tra gli intellettuali e la politica è che, soprattutto in periodo democratico di elezioni, la politica si muove appunto sulla normalità. La politica deve usare argomenti accessibili al grande pubblico, quindi argomenti ormai banalizzati. Mentre il compito dell'intellettuale è quello di spingersi oltre, di dire delle novità; il compito più difficile, insomma. Ma la normalità non è la vera rivoluzione. La vera rivoluzione è il cambiamento. La vera rivoluzione è stata - adesso ormai questo periodo di due secoli è finito - l'ambizione delle filosofie a inverarsi nella storia. Un tempo ci si accontentava che le filosofie spiegassero il mondo. Da Marx a Gentile, che ha ripreso questa filosofia della prassi di Marx, invece si aggiunge o si era aggiunta una nuova pretesa, che la filosofia non solo spiegasse il mondo, ma che lo cambiasse. Ecco, la normalità non ha questa pretesa di cambiamento. La normalità di solito si adegua e non penso che possa essere rivoluzionaria.
STUDENTESSA: Nella scheda filmata abbiamo visto che gli scrittori e i pensatori citati sono tutti critici della democrazia occidentale. Ora l'atteggiamento antidemocratico può identificarsi con l'anticonformismo?
ACCAME: Certamente! Perché quelli anticonformisti sono atteggiamenti di minoranza, che quindi spesso si rivoltano, o si sono rivoltati in passato contro la democrazia. In realtà né Pound né Junger si sono particolarmente rivoltati contro la democrazia. Se mai solo Mishima, che è un curioso esempio di fascismo di ritorno, o di tradizionalismo di ritorno. Durante la guerra Mishima fu scartato alla leva e ne fu contentissimo perché si risparmiava la vita. Diventò lo scrittore giapponese più noto in Occidente, e di solito in Italia tutti i suoi primi libri sono stati pubblicati da Feltrinelli, quindi anche molto gradito alla sinistra. Omosessuale, o almeno bisessuale, quindi trasgressivo, su un piano che il pensiero conservatore è meno orientato a accettare. E tuttavia, dopo aver riscosso successo internazionale e in Giappone naturalmente, a un certo punto ha sentito la vanità di questo successo e ha avuto un ritorno di pensiero conservatore, tradizionale ed è ritornato all'antica etica dei Samurai, sino a compiere il sacrificio rituale in una caserma giapponese, per protestare contro l'occidentalizzazione del Giappone e soprattutto contro l'asservimento dell'attuale classe politica giapponese agli americani. Ecco, quindi è l'unico, se mai, che si è ribellato a quel tipo di democrazia asservita. In realtà tutti poi dopo hanno fatto riferimento al popolo. In particolare Ezra Pound era fortemente critico del sistema politico americano, ma non perché fosse antidemocratico. Lui seguiva le idee di Jefferson, che è tra i creatori della democrazia americana, ma accusava la classe dirigente democratica americana di essersi asservita ai banchieri, di essersi asservita al grande capitale finanziario e di aver quindi tradito la stessa Costituzione degli Stati Uniti, che riservava al Congresso la sovranità monetaria e invece questa sovranità era stata trasferita ai banchieri. Questo era più legato alla vera idea dei pionieri americani. Si considerava infatti un vero patriota americano, in rivolta contro il tradimento della democrazia fatta delegando troppi problemi e troppi poteri alla finanza.
STUDENTE: Non crede che l'anticonformismo sia possibile solo in democrazia, e che invece il totalitarismo non sopporti le intelligenze scomode?
ACCAME: Certamente è più facile in democrazia che nei totalitarismi. E tuttavia anche nei sistemi totalitari ci sono stati esempi di rivolta, di ribellione, che naturalmente sono costati di più. Io, come scrittore di destra, la libertà in questo mezzo secolo ho dovuto più faticosamente conquistarmela, giorno per giorno. A me non l'hanno regalata gli americani, insomma, non mi è stata importata. L'ho dovuta conquistare vincendo pregiudizi, difficoltà, tentativi di discriminazione. E quindi qualche difficoltà la si incontra anche in un sistema di piena libertà.
STUDENTE: Si può, paradossalmente, seguire la legge ed essere comunque scomodi? Pensavo, ad esempio, al Giudice Falcone.
ACCAME: Certamente! Ma il Giudice Falcone era scomodo per la delinquenza, per la grande criminalità organizzata. Non direi che sia un esempio di anticonformismo. È un esempio di eroismo, come quello del Giudice Borsellino, come quello delle forze dell'ordine quotidianamente impegnate nella difesa delle persone per bene, degli onesti, contro la grande criminalità. Ma non direi che questo sia un esempio di anticonformismo. Per quanto, lì dove la società è addormentata, dove esistono complicità tra poteri politici e grandi organizzazioni mafiose, anche questo, il coraggio di rivoltarsi, rischiando la pelle, può, a suo modo, essere interpretato come un anticonformismo. L'egoismo, il rischiare la vita, è sempre impresa di pochi. L'eroe è di per sé uno che si stacca dalla media, dalla normalità, e in questo si può considerare non perfettamente conformista. Non è uno che si fa i fatti suoi e pensa solo alla famiglia. Pensa alla Patria, alla generalità dei cittadini.
STUDENTESSA: Secondo Lei l'intelligenza scomoda è capace solo di demolire e criticare, o è in grado anche di costruire e affermare?
ACCAME: L'intelligenza scomoda vorrebbe anche costruire e affermare. In realtà, dalla lezione dei fascismi è venuto qualcosa che oggi, a livello debole, è estremamente diffuso. Cosa ha fatto il successo politico di Mussolini, ad esempio? È stato il ribellarsi a quella spaccatura, che è nel cuore dell'uomo e della società europea, che aveva provocato la presunzione illuministica, contrapponendo alla tradizione il progresso, contrapponendo alla fede la ragione e la scienza, e, poi il socialismo, contrapponendo alla aspirazione e alla giustizia sociale l'idea di Dio e della Patria. Il successo di Mussolini è stato quello di risaldare queste spaccature e legando e rendendo compatibile, con un'aspirazione alla giustizia sociale, l'idea di Dio e della Patria. Naturalmente poi gli errori hanno compromesso questo tentativo, che aveva suscitato tanti entusiasmi, aprendo nuovi conflitti: conflitto razziale, la discriminazione degli ebrei, e aprendo un conflitto sui temi della libertà. Ma questa idea di risaldare, di non spaccare le masse, sui temi di Dio e della Patria, e spingere il progresso delle masse, unificando questi sentimenti forti, oggi è condivisa da tutti. Nel socialismo italiano è stato Bettino Craxi che ha cercato di sanare queste imprudenti e stupide spaccature, queste fratture. Ha fatto un nuovo Concordato con la Chiesa, ha riscoperto il socialismo tricolore. Ma non c'è forza politica importante, sono solo marginali quelle che non abbiano il pieno rispetto del sentimento religioso e che rinneghino l'aspirazione, oggi più debole, all'identità nazionale. Questo è ormai da destra a sinistra. Tutte le volte che un'idea si affaccia, si affaccia di solito con violenza e con forza, mentre adesso, anche a livello di pensiero debole, tutti condividono questa aspirazione unificante di quelle che sono le grandi tendenze dell'uomo.
STUDENTESSA: Noi finora abbiamo parlato solo di anticonformismo. Ma cosa si intende e come si esprime il conformismo oggi?
ACCAME: Il conformismo, secondo me, si esprime soprattutto nell'economicismo, nell'assegnare, come obiettivo esistenziale e principale, l'idea dell'arricchimento. E questo porta a delle gare che possono essere addirittura distruttive per il genere umano, perché è probabile che l'assetto ecologico della terra non possa resistere a ulteriori progressi, a ulteriori escalation in questa ricerca del benessere e dello spreco. Un tempo ci si accontentava più facilmente della propria condizione economica e si cercava la gratificazione nel far bene certe cose. Il medico condotto non voleva arricchirsi, ma curare, il professore era completamente dedito al proprio lavoro di educatore e non era scontento, i servitori dello Stato e gli ufficiali peroravano la grandezza della nazione. E, comunque, chiunque faceva la propria professione, o il proprio lavoro, o il proprio mestiere di artigiano, di operaio, tendeva a trovare la gratificazione nell'esistenza e in altri valori oltre che quelli monetari. Oggi la ricerca dell'arricchimento, l'economicismo, spegnendo altre aspirazioni dell'uomo, altre tendenze, esprime una forma di conformismo che considero pericolosa.
STUDENTE: Non pensa che il prezzo da pagare all'anticonformismo sia l'individualismo?
ACCAME: No, se mai proprio il conformismo di oggi è l'individualismo. Ci si lamenta, dopo la caduta del Muro di Berlino, della affermazione planetaria della formazione di un pensiero unico, che è il pensiero liberale individualista. E c'è addirittura una forma quasi di intolleranza liberal-liberista. Se mai, l'anticonformismo oggi si dovrebbe manifestare in un ritorno al pensiero comunitario, all'idea di sentirsi insieme, all'idea della società a cui aderire e da servire.
STUDENTESSA: Secondo Lei, si può essere anticonformisti nel rispetto dell'opinione comune?
ACCAME: L'anticonformismo e l'opinione comune di solito sono in conflitto. L'anticonformista è proprio contro l'opinione comune. Però ci può essere una forma di anticonformismo del conformismo, nel senso che spesso gli intellettuali ostentano forme di disprezzo del senso comune. E allora aderire al senso comune rappresenta in qualche modo una forma di anticonformismo. Il coraggio di pensarla un po' come tutti, perché questo tipo di pensiero viene snobbato.
Puntata registrata il 21 febbraio 2001
00:35 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, droite, politique, politologie, sciences politiques, théorie politique, non conformisme, pensée rebelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 mars 2009
Twee handen op een buik
Twee handen op een buik
 De ultraliberale extremist Dedecker die - zoals algemeen bekend - een hevig tegenstander is van het communisme en het socialisme, heeft in het tv-programma Phara, waar hij in een panel zat met Peter Mertens (de voorzitter van de PVDA), onthuld dat zijn partij LDD de lijstvoordracht van de PVDA met twee handtekeningen van parlementsleden steunt. Dit betekent dat de PVDA (Partij van de Arbeid) zich geen zorgen of moeite moet getroosten om op straat duizenden handtekeningen op te halen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen van juni. Velen zullen verrast zijn door de houding van Dedecker, maar voor ons van het N-SA is het helemaal niet verwonderlijk dat zoiets gebeurt.
De ultraliberale extremist Dedecker die - zoals algemeen bekend - een hevig tegenstander is van het communisme en het socialisme, heeft in het tv-programma Phara, waar hij in een panel zat met Peter Mertens (de voorzitter van de PVDA), onthuld dat zijn partij LDD de lijstvoordracht van de PVDA met twee handtekeningen van parlementsleden steunt. Dit betekent dat de PVDA (Partij van de Arbeid) zich geen zorgen of moeite moet getroosten om op straat duizenden handtekeningen op te halen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen van juni. Velen zullen verrast zijn door de houding van Dedecker, maar voor ons van het N-SA is het helemaal niet verwonderlijk dat zoiets gebeurt.
Het kapitalisme spreekt altijd in tongen. Soms met een links geluid en andere keren weer met een meer rechts. Maar die tong zit altijd in dezelfde mond, die van de politieke en de kapitaalselites. Als er een boost is in de winstmaximalisatie en de markt boomt, dan roept ze uit het rechterkeelgat dat er nu geen obstructie van de markt mag zijn. De markt is van heilig karakter: de geldgoden beschikken, de gelovigen schikken zich ernaar. En wie niet in de geldgod gelooft, moet zwijgen of verketterd worden. In tijden van economische boom rochelt de linkse tong dat er toch voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd, want dat er anders misschien ongelukjes van komen. Maar de rechtse tong sust het geweten van zijn linkerhelft door met een paar fooien te smijten.
Als dan de onvermijdelijke crash volgt, neemt de linkse tong het deuntje over. Alleen gorgelt die tong nu ineens dat de staat met oplossingen moet komen. Dat kreeg die rechtse tong eerst jaren niet over de lippen. Maar kijk, nu is er symbiose: de linkse tong van het kapitaal heeft zich verzoend met de rechtse tong van het kapitaal om zo hun gezamenlijke slokdarm te redden. Ze maken deel uit van hetzelfde orgaan. Het ene stuk is ervoor te vinden dat de staat alles beheerst (staatskapitalisme zoals in China) en het andere stuk wil de kosten van de crisis liefst rechtstreeks door de gemeenschap laten betalen. De droom van elke maoïst én elke kapitalist! De staat beheert het kapitalisme en zorgt er zo voor dat het onaangetast blijft.
Dedecker zei tijdens een debat dat hij veel bewondering had voor China en we geloven hem op zijn woord (voor deze ene keer dan). Dat systeem is dan ook het systeem bij uitstek waar elke monopoliekapitalist van droomt. Volk onderdrukt, organisaties en instellingen onder rechtstreekse controle van de staat, afdankingen met behulp van staat en politie, onderdrukking voor iedereen die zijn mening durft te spreken en het belangrijkste: er is een ongecontroleerde en ongehoorde winstmaximalisatie van het kapitaal. De monopolies worden gevormd en beschermd door de maoïstische elite die zelf een deel is geworden van dat kapitalisme. De droom voor elke kapitalist: of het nu een rooie van de PVDA of een blauwe van LDD is. Daarom dat de beide woordvoerders van zowel LDD als PVDA hun partij 'de partij van de kleine man' noemen. Maar eigenlijk bedoelen zij daarmee dat hun beide partijen het perfecte onderdrukkingsapparaat van de kleine man zouden zijn. Dat is waarschijnlijk bedoeld als advertentie naar de grote kapitaalgroepen toe. "Kijk hoe wij de kleine man klein houden, steun ons alstublieft, heren kapitalisten!"
Ook op het vlak van migratie zijn beide partijen zo liberaal als de multiculturele pest. Beiden verdedigen dat iedereen hier mag komen als ze maar willen werken. De PVDA heeft dat deuntje geleerd bij de Nederlandse SP van Marijnissen. Dedecker zingt dat liedje al lang, net zoals Wilders in Nederland. Ze moeten zich wel aanpassen, die vreemdelingen, zeggen de beide tongen van het kapitalisme. Met aanpassen bedoelen ze alleen maar dat de vreemdelingen zich moeten aanpassen aan de kapitalistische maatschappij en niks anders. Zo hebben PVDA en LDD alweer een gezamenlijk doel. Nog meer invoeren van vreemdelingen dus, want die vreemdelingen worden gekoesterd als waren ze pareltjes.
Natuurlijk moet de rechtertong van het kapitaal soms eens stoer doen. Dan roept het met een krakerig geluid dat er moet worden optreden tegen die vreemde mannen die niet braaf naar de fabriek gaan en die hun vrouwen niet laten werken uit religieus principe. Ze mogen dan ook die islam op hun buik schrijven wat betreft mensen als Dedecker, Wilders en copycat Dewinter. Moslimvrouwen aan de slag, dat bedoelen ze bijvoorbeeld met hun Europese vorm van islam. Veel is dat toch niet gevraagd, wel? Maar de linkerhelft sust dan de boel: de immigrant moet tijd krijgen en - wat belangrijker is - de immigrant moet een groot deel van de jobs krijgen van de autochtone kleine man. Eigen volk discrimineren als wapen tegen discriminatie. Ja, zot zijn doet geen pijn, zeggen ze. Alhoewel, als je die beide heren hun tronie bekijkt, zou je soms gaan twijfelen. Arbeidsverdeling noemen ze dat. Niet van hun arbeid en inkomen natuurlijk, maar van het uwe en het mijne.
De conclusie is dus duidelijk: het kapitaal schrikt in deze crisisperiode werkelijk voor niks terug. De meest fanatieke vrije-marktaanhanger steunt de communistische partij van België. Zo hebben ze de taken reeds verdeeld: rechts houdt de poen op zijn plaats, links misleidt het volk zodat er geen protest van komt. De linkse liberalen van de PVDA zijn het schaamlapje (of beter: de schotelvod) van het kapitaal. Om die taak naar behoren te kunnen vervullen krijgt ze steun bij de verkiezingen en mag ze op TV haar gekwijl komen verkondigen. Ze hebben voor deze gelegenheid dan ook een gezamenlijk deuntje ingestudeerd. Elke vorm van nationalisme is uit den boze, laat staan protectionisme, zingen ze in koor. Maar nationalisme betekent zorgen voor het eigen volk en protectionisme betekent werk voor het eigen volk. Wij van het N-SA zijn dan ook de echte beweging van de kleine man: we zijn een beweging van en voor de kleine man.
De LDD en de PVDA zijn alleen maar de parasieten die de kleine man kapotmaken.
Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA
00:48 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, flandre, wallonie, actualité, politique, gauche, droite, ultra-libéralisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 mars 2009
Revolutionary Conservative: Interview with Jonathan Bowden

REVOLUTIONARY CONSERVATIVE:
INTERVIEW WITH JONATHAN BOWDEN
Interviewed by Troy Southgate - http://www.rosenoire.org/
REVOLUTIONARY CONSERVATIVE: INTERVIEW WITH JONATHAN BOWDEN As conducted by Troy Southgate
Jonathan Bowden is the Chairman of the New Right and a man I am proud to regard both as a like-minded spirit and a friend. The following interview was conducted in the summer of 2007.
Q1: Your family background is a heady mix of Irish and Mancunian and you were brought up in rural Kent. Would you say that any of this helped to shape your intellectual development in any significant way?
JB: One’s origins obviously influence the way everything turns out in the end. I actually spent many of my formative years in the south Oxfordshire countryside, but I do admit that the Kent coast offers a certain draw. I was born in Pembury maternity hospital in mid-Kent in 1962 and the family later branched out into Bearstead after that. I remember a blue Volkswagen beetle, an extremely low-lying bungalow, roundabouts, that sort of thing… it was all very middle-class. I especially recall a Gothic moment from my own childhood; it concerned a mad woman or witch who lived up the way. She seemed to be a sort of Grendel’s mother – you know the kind. Anyway, rumour had it that she used to sit stark naked behind her letter box, dressed only in a black balaclava helmet, and any woman passing by would then be subjected to ferocious abuse. Scatology wasn’t the word for it, if you take my drift. Then, after a certain time had elapsed, the police would be called and she’d be sat there, dressed up to the nines, with cream teas and all the rest of it. It was essentially an elaborate attempt to flirt with, seduce or just fraternise with the local policemen. Then, as soon as they’d departed and she’d promised to behave, our wired sister would be back at the letter box fulminating. All other women were the object of her hate. No feminist sisterhood in evidence there, then. Its sexual hysteria and related screamings – I remember it all as if it were yesterday. My mother was terrified of her. We always had to go round the other way. Gothic or macabre things like that have always intrigued me – it’s the hint of chaos underneath bourgeois suburban conformism, you see. Life – when you stop to consider it – is really a painting through which people articulate their own death. What interests me is the artistry to it; it’s what our forebears, the Elizabethans, used to call the skull beneath the skin.
Q2: A few years ago now, you published a series of books under a different name. Tell us more about the themes involved and what you were trying to achieve at the time.
JB: Yes, I admit that your question is along the right lines. I’ve written a great deal down in the years and under various names – one of them happened to be John Michael McCloughlin, as I recall. I’ve certainly written between thirty and fifty books – depending on how you choose to look at it. At one level I’ve composed purely for myself – fiction, plays, non-fiction, memoirs, belle lettres, higher journalism, lyrics, prosody, experimental or stream-of-consciousness work, you name it. At present it’s all beginning to appear on the internet. My website – www.jonathanbowden.co.uk – contains one full manuscript. It’s an e-Book in PDF format. It’s entitled Apocalypse TV and consists of at least 100,000 words. It’s approximately 240 pages. A Platonic dialogue between a Christian and a pagan voice, it deals with Turner Prize art or the “Sensation” exhibition, criminology and the murders of Fred and Rose West, the concept of Political Correctness, all sorts of things. A short story, A Ballet of Wasps , also exists on the site. Hopefully – and before too long – a great deal of material will appear in this way. It’s essentially got to be scanned, edited, converted to PDF and then uploaded. A play which you have read, Troy, called Lilith Before Eve , has recently been added to the site. The following three short stories, Golgotha’s Centurion, Wilderness’ Ape and Sixty-foot Dolls , will appear relatively soon. There are also four more plays known as Glock’s Abattoir, We are Wrath’s Children!, Evolution X and ,i>Stinging Beetles, for example. Ultimately, one of my life tasks is to put all of it online and then see if publishers, small outfits, that sort of thing, would be willing to do hard copy versions. One point of interest: the publisher Integral Tradition Publishing has expressed an interest in possibly treating Apocalypse TV in the way I describe – although whether this will ever extend to a desire to publish full novels of mine, such as Al-Qa’eda Moth or The Fanatical Pursuit of Purity, is altogether another issue. But, rest assured, I will bring out everything I’ve ever done over time, even if it’s only in e-Book form on the internet. Politics is just a side-line, you see; artistic activity is what really matters. The one alters effects; the other changes the world. As Bill Hopkins once told me, one man sat writing alone in a room can alter the entire cosmos. It’s the ability – through a type-writer or whatever else – to radically transform the consciousness of one’s time. Cultural struggle is the most interesting diversion of all. There’s a Lancastrian truism that my mother retailed to me: “truth is a knife passing through meat”. Well, in this particular freeway one special coda stands out – you must become your own comet streaking across the heavens – all else is just a matter of flame, spent filament, rock or tissue, en passant, which slopes off to the side. Avoid those stray meteor shoals casting off to one’s left; they are just the abandoned waifs and strays of a spent becoming. Let your life resemble a bullet passing through screens: everything extraneous to one’s task recalls such osmotic filters. (I’d especially like to thank Daniel Smalley and Sharon Ebanks for their manifold assistance with these websites. Sharon’s earlier contribution was the following: www.jonathanbowdenart.co.uk). Do you wish to survey something I’ve just written? It’s a bit of a prosody based on a Futurist painting by Fortunato Depero called Skyscrapers & Tunnel (1930).
Do they make the most Of a tubular scene-scape Designed without cost And collapsing into date Crepe rape spate fate constant ingrate?
Q3: Please tell us how you came to be involved in the Western Goals Institute, a vociferously anti-liberal and anti-communist tendency which originated in 1989 as an offshoot of the American ultra-conservative group of the same name.
JB: Yes, the organisation known as Western Goals was a bit of a shape-shifting entity – it began as Western Goals UK and then transformed itself, eventually, into the Western Goals Institute. Later still it recomposed itself into the British chapter of the World League for Freedom and Democracy; a group which, as it didn’t believe in either freedom or democracy, was rather amusing. I gave them my support – I was actually deputy chairman for a while – because I agreed with a merciless prosecution of the Cold War. Right-wingers of every type and race aligned across the globe against communism. The war had to be fought tooth and branch. I essentially concurred with Louis Ferdinand C’eline’s mea culpa about Marxist-Leninism – after having toured the Soviet Union on the proceeds of Journey to the End of the Night and Death on Credit. Don’t forget that the third world war, to use a different nomenclature for the Cold War, proved to be an alliance between Western hawks or rightist liberals and neo-fascism across the Third World. Groups like Unita, Renamo, Broad National Front (FAN), the Triple A, the United Social Forces, The Konservative Party and HNP, the Contras and Arena – never mind Ba’athism… all of these tendencies were Ultra in character. Had they all been Caucasian in profile, such groups would have seemed indistinguishable from the OAS or VMO. It was vitally necessary to delouse those “communist peons of dust”… to adopt a line from a stanza by Robinson Jeffers. I have always believed with Mephistopheles in Goethe’s Faust, whether paraphrased by Sir Oswald Mosley or not, that in the beginning there is an action.
Q4: Shortly afterwards you founded the Revolutionary Conservative Caucus with Stuart Millson. What were the reasons behind the establishing of this group and, realistically, how much do you think it managed to achieve?
JB: Ah yes, the Revolutionary Conservative Caucus and all that jazz. Where have one’s salad days gone? Anyway, the RCC was set up by Millson and myself as a cultural struggle tendency. Never really conservative, except metaphysically, it wanted to introduce abstract thought into the nether reaches of the Conservative and Unionist party – an area habitually immune to abstract thought, possibly any thought at all. There have always been such ginger groups – Rising, National Democrat and later Scorpion, Nationalism Today, Perspectives, the European Books Society, the Spinning Top Club, the Bloomsbury Forum and now the New Right. The important thing to remember is that these groups are fundamentally similar – irrespective of distinct semiotics. The system of signs may jar, but, in truth, all of them are advocating radical inequality and meaning through transcendence… that’s the key. As to accomplishments or achievements… well, they were really twofold: first, the mixing together of ultra-conservative and neo-fascist ideas; second, a belief in the importance of meta-politics or cultural struggle. By dint of a third or more casual reading, various publications like Standardbearers , Oswald Spengler’s essay Man & Technics , the ‘Revolutionary Conservative Review’, a brief and intermediate magazine called Resolution and the ultra-conservative journal Right Now… all of these formulations came out of this nexus. It’s a creative vortex, you see? Let’s take one example: my interview with Bill Hopkins in Standardbearers… this links right back to the fifties Angry Young Men and to Stuart Holroyd’s productions in Northern World, the journal of the Northern League. This interconnects – like Colin Wilson writing for Jeffrey Hamm’s Lodestar – with not only Roger Pearson but also the fact that members of the SS were in the Northern League.
Sic cum transierint mei Nullo cum strepitu dies Plebeius moriar senex. Illi mors gravis incubat Qui notus nimis omnibus Ignotus moritur sibi.
It’s this which has to be avoided.
Q5: Your first association with the New Right was as a guest speaker at the very first meeting in January 2005. What made you want to become more involved with the group and what role do you think it can play in the future?
JB: I became involved because of a residual respect for what the New Right and GRECE were trying to achieve. For my own part, this has something to do with the fact that the New Right wishes to bring back past verities in new guises. It ultimately recognises an inner salience; whence the Old Right enjoyed a Janus-faced discourse: whether esoteric or exoteric in character. Do you follow? Because the outer manifestation tended to be conspiratorial, however defined. Whereas the innermost locution rebelled against old forms, postulated a Nietzschean outlook and adopted a pitiless attitude towards weakness in all its forms. Irrespective of this, the New Right recognises that fascism and national-socialism were populist or mass expressions of revolutionary conservative doctrines. Indeed, the Conservative Revolution is tantamount to Marxism on the other side: the truth of the matter is that Evola, Junger, Spengler, Pound, Moeller van den Bruck, Bardeche, Revillo P. Oliver, Rebatet, Brasillach, Jung, Celine, Wyndham Lewis, Yockey, Bill Hopkins and Arthur Raven Thompson, say, are actually to the right of their respective political movements. It’s the same with the extreme left on the other side – whether we’re talking about Adorno, Horkheimer or Althusser. Who’s ever really read Sartre’s The Dialectic of Critical Reason? As to any influence our group might have… well, perhaps it would be best to put it in this manner. I think that the New Right can prove to be a nucleus for illiberal thinking, albeit of a revolutionary and conservative character. Take, for example, Tomislav Sunic’s thesis, Against Democracy; Against Equality – a History of the European New Right. In this purview it becomes obvious that the Conservative Revolution was the seed-bed or think tank for fascism and national-socialism, much in the manner that theoretical Marxism was for communism. In the latter’s case, one only has to think of Adorno and Horkheimer’s The Dialectic of Enlightenment as the forcing house for ‘sixties revolutionism – far more, say, than Marcuse or the Situationists. Percy Bysshe Shelley, in Paul Foot’s terms Red Shelley, once described poets as the unacknowledged legislators of mankind. But, in all honesty, if we were to substitute the word intellectual or philosopher for poet then you might be nearer the mark. (All of which isn’t to take away for a moment the impact of poets like Kipling, Robinson Jeffers or the blind and recently deceased bard John Heath Stubbs, for example). Yet, I say again, one thing that we must deliberate upon is the power of conception. A man who possesses an idea or a spiritual truth is the equivalent of fifty men. Every pundit, tame journalist, academic or mainstream politician is mouthing hand-me-down ideas from a philosopher of yesteryear. At one level artists and intellectuals have no power whatsoever; undertake a parallax view or examine it in a reverse mirror, then you will see that they are matters of the universe. For those who have heard of Mosley, Degrelle, Jose Antonio Primo de Riveria, Mussolini, even at a push Julius Caesar; figures of Bardeche, Thomas Carlyle, Spengler and Lawrence R. Brown will remain forever arcane and mysterious. But fate’s mysterious witching hour knows that you can never have one without the other.
Q6: How did you reconcile your role as Chairman of the New Right, a self-proclaimed elitist and anti-democratic group, with your former position as Cultural Officer of the British National Party (BNP)?
JB: I feel that there was no great contradiction between the New Right and the British National Party. It’s a conundrum that revolves around the exoteric-esoteric fissure mentioned before. The British National Party is a populist or nativist group – it currently has about fifteen percent electoral support across Britain. No campaign and one leaflet garners a tenth of votes. Any sort of campaign nets 15%+; whereas a full-on methodology, Eddy Butler style, can get up to a fifth or a quarter of the vote. Bearing in mind that England is now fifteen per cent non-white then these margins represent an even higher proportion of Caucasia. Given this, the party represents a plebiscitary wing, the organisation’s inner spine are (for the most part) traditional nationalists; whereas their mental fodder needs to be provided by groupings like the New Right. Hierarchically speaking, the new reformats the old, albeit with a new cloak. Let’s put it this way: New Right sensibility sublimates Julius Evola’s The Metaphysics of War into Nietzsche’s The Will to Power. You have to understand that on the doorstep a small proportion of electors can vaguely recollect what country they’re living in… never mind anything else. Philosophy blinds them to a dance of sharp-toothed wolves. My, what large teeth you have, Granny – said little Red Riding Hood. Never mind: the real point is to achieve transcendence or becoming. Let’s begin with Voice of Freedom turning into Identity, inter alia, which leaps upwards to New Imperium – a step to the side of which might really be Bill Hopkins’ essay, Ways Without Precedent, in the volume of essays which served as the Angry Young Men’s manifesto. It was called Declarations. Yet perhaps even a step beyond this actually exists. Doesn’t one of Elisabeth Frink’s sculptures of a Soldier’s massive cranium – or one of her Goggle-heads, perchance – indicate a move ahead into aesthetic puissance? Everything that exists is about to transmute into a superior variant, an intellectual and spiritual speck of light which exists over it. As a BNP activist who’d been electioneering in the streets of East London once told a journalist; “If there’s nothing above you then there’s nothing to aspire to”.
Q7: Is there any real difference between the natural ascendancy of the strong over the weak – a recurring theme in your speeches – and the ruthlessness of capitalist economics?
JB: Again, as before, my answer has to begin and end with a postulation of hierarchy tout court. Do you see? It all has to do with the fact that economics is the lowest level of social reality. It remains purely material. Despising it is no good; what you have to do must be to effectively transcend it. The neo-utilitarian economist, Arthur Marshall, who was active at the turn of the twentieth century once famously described his subject as the dismal science. Just so… literary-minded types have always preferred belletrists of finance, whether J.K. Galbraith or Hilaire Belloc’s Economics for Helen. What you need to do is accept the market as the basis for a national economy that will be mainly privately owned, as Tyndall advocated in the Eleventh Hour, and then impose implacable political ethos on it from above. Politics must master economics; businessmen must be made to be spiritually subordinate to spiritual verities: the supreme expression of which is Art. Money then serves higher interests to which it is beholden – not the other way around. In all vaguely autocratic systems the economy operates in the way I’ve described. Ultimately you have to teach people not that money is the root of all evil – that’s purblind Biblical moralising – but that capital proves to be little more than fuel. To start up your car you need to put the key in the slot. Economic activity then has to serve the national community – not the reverse. As to the alleged ruthlessness of capitalist economics – that’s largely Darwinian romanticism. Does an eagle suffer from pity as it tears its prey to pieces in the stump of a tree? Anyway, do you really suppose that we have an unfettered market after over a century of state intervention or social democratic manipulation of its mechanisms? The only real success the far-left’s ever had was to provide shot-gun marriages for statist institutions in the West. New liberals designed pension, health, credit, insurance and social housing schemes in order to buy off proletarian rebellion from below. It owed as much to the far-right as the accredited Left – hence Skidelsky’s hero-worshipping of Mosley in his biography of that name. (This author moved from being right social democrat to a left conservative at a later date). Likewise, Sir Oswald Mosley’s New Party contained Marxian economists and social commentators like John Strachey – later to be Minister of Food in the post-war Labour government. The real point has to be the metaphysical guiding post behind Mosley’s post-war treatise, The Alternative. Subordinate economics to the meaning of politics not its management. The whole point of a political class is to impose a morality on the market – as Heseltine, of all people, once said, market economics has no ethical system otherwise. Von Hayek’s methodology of the implicit moral goodness of markets (because self-correcting) is flawed. But de Benoist’s attack on an advocacy of jungle law – whether directed at von Mises, Hayek, Friedman, etc… falls sheer. Why so? Because all that’s wrong with primitivism, brutalism and what Ragnar Redbeard called Might is Right has to be an absence of culture. That’s the salient point to remember. No Sistine chapel ceilings would ever have been painted without a systematic metaphysic to master gold. Put it in its proper place, why don’t you? Yet you can only do so after its creation. In this custodianship Sir Digby Jones, the former director general of the CBI, has to find himself subordinated to the manifestation of those eight symphonies by Sir Peter Maxwell Davies.
Q8: How ‘new’ is the New Right?
JB: It is clear to me that the New Right is diverse and diachronic in form. Like the refracted sides of a cerulean gem it casts many different slants afoot. All of these shimmer and break against a dark glass. To be truthful, the biggest disjunctions between old and new have to do with reductionism, conspiracy and revisionism. The old accepts the first two categories and could be said to have reformulated itself by virtue of the third. Perhaps we could go as far as to say that Revisionism is the reworking of the Old Right in modern guise – revisionist literature could then be considered to be the Old Right’s research and development. Just so… maybe Butz, Samning, Steiglitz, Baron, Berg, Harry Elmer Barnes, Rudolf, Mattogno, Graf, Faurisson, Zundel, Rassinger, Joachim Hoffmann, Heddessheimer, et al, are really Maurras, Weininger, Brasillach, Drieu la Rochelle, Celine, Barres, Revilo P. Oliver, Yackey, Ezra Pound, Jack London and Rossenberg… all come round again. I think, in these circumstances, that the New Right is a differentiated codex or semiotic – it enables a great deal of radical conservative material to return, maybe in a new guise. Although another point should be made, in that ultra-Right movements tend to have an occult trajectory. They manifest two sides: the esoteric and the exoteric. This can be considered to be a polarity between internal and external. For the masses Jean Respail’s Camp of the Saints or Christopher Priest’s Fugue for a Darkening Island; for the elite Count Arthur de Gobineau’s Essay on the Inequality of the Human Races . To quote yet another example – for mass taste Kolberg or Der Ewige Jude; for elitist consumption Leni Riefenstahl’s Olympia or the Italian film industry’s version of Ayn Rand’s We the Living. Even Hans Jurgen Syberberg’s seven hour epic, Hitler: a Film from Germany, strives for neutrality in an area where only negative partisanship is allowed. In this context Steukers, Sunic, Gottfried, De Benoist, Walker, Lawson, Krebs and so forth, are the inner elitism or vertical dimension amidst a general carnival. They are less the meat in the sandwich than the inner pagan and non-humanist core to ideas which the residuum cannot grasp unless they are put in a more basic form. It must only be true the less it is understood, in other words… By virtue of our silk-screening, reductive and metaphysical conspiracies are materialisms. They are explanations on a physical level. New Right discourse internalises and sublimates this doxa; it circulates it as spiritual velocity. Aesthetically speaking, what can be transmuted – for a philistine or mass public – as Max Nordau’s Degeneration becomes Ortega Y Gasset’s The De-humanisation of Art at a more advanced illustrative push. Perhaps, even as a reverse dialectic, Wyndham Lewis’ The Demon of Progress in the Arts provides an overlapping negation to Y Gasset’s thesis – all prior to a new or renewed synthesis. Ethnically speaking, one might aver that The Turner Diaries amount to the outside face of the Bell Curve’s Junction. Artistically again, doesn’t Ayn Rand’s The Fountainhead provide a fusion, in mock-libertarian guise, of internal and external messages in a bottle? Whereby the heroic modernist Roark – based loosely on the living example of Mies van der Rohe – overlaps with the neo-classical sculptor ‘Steve’. A character which was loosely based on Gustav Thorak, an artist who’s heroic figurine, Atlas, outside the grand central station in Chicago influenced Ayn Rand’s last right-anarchist novel, Atlas Shrugged. I would go so far as to say that the New Right is a toxic cerebration to the Old Right’s fist: in musical terms it’s Screwdriver becoming Laibach and then morphing into Carl Orff. But isn’t Verese’s noise brought back into focus by Igor Stravinsky’s The Right of Spring? After the performance of which – the master Stravinsky had to be guarded at his concerts, like a prize fighter. Diaghilev strove to remain highly jealous throughout.
Q9: You have a keen interest in Modernism. Why does this form of artistic expression appeal to you most and what, in your opinion, makes Modernism so superior to Modern Art?
JB: Ah yes, the issue of Modernism… I’m an ultra-rightwing modernist, let’s make that clear. Even though some of my work is traditional, restorationist, historical and semi-classic in spirit… nonetheless, I’m a modernist, even on some occasions an Ultra-modernist. Let’s be definite about this: some of my pictures do relate to Bosch, Redon, Klimt, Bacon, Pacher, ancient Greek sculpture and so on, but primarily I wish to create new and ferocious forms. They must come from within; what you really require is an image the like of which no-one has ever seen before, even dreamt of prior to your conception. Bacon always declared that he wanted to paint the perfect cry, after the fashion of the nurse on the steps facing the White Guards in Battleship Potemkin. I never wished to paint the greatest scream a la Poussin’s Massacre of the Innocents. No. For my part, I wanted to paint the most ferocious image of my time – these works are not neurotic, paranoid, schizoid, disturbed or mentally ill, as some might suggest… they are passionate integers of fury. The effort is to project strength and power. One cares nothing for the aesthetic standards of the masses; they are children who only like what they know or feel comfortable with. What really matters has to be the ecstasy of becoming – early or classic modernism happened to be exactly that. It was an attack on sentimentality; it proved to be an art purely for intellectuals. It was anti-humanist, elitist, inegalitarian, vanguardist, misanthropic, sexist, racist and homophobic – all good things. It gave witness to the neo-classic bias within the Modern that related to the theories of T.E. Hulme, a revolutionary conservative, and Ortega Y Gasset, a mild fascist. In the latter’s Dehumanisation of Art he preaches a new style against the Mass – that notion has always intoxicated me; to trample upon the masses and synthesise them into a new evolutionary surge has to be our object. The failure of extremist conservatism, fascism and national-socialism was material; revolutionary right-wing ideas may only really flourish spiritually: art has to be its vehicle; the stars its limit… homo stultus, the putty. Early modernism found itself penetrated by these ideas… only much later did it become a vehicle for liberal humanism. A move which in and itself related to the academic, restorative and conservative aesthetic tendencies in Soviet and Nazi art. One of the ironies is that revolutionary art becomes liberal wall-paper; while revolutionary movements adopted philistinism as their watchword. Their anti-formalism became a rigid fear of upsetting the majority. Art partly exists to disturb expectations, but liberal anti-objectivism has gradually dissolved this influence. An image like Tato’s March on Rome becomes more and more diffuse… until you end up with a David Hockney sketch, a Yorkshire scene bathed in light, and adorning a corporate office anywhere in the world. But let’s not fall into the trap of talking about the revolution betrayed – that’s such a bore. Also, revolutions are always betrayed; that’s their purpose. It’s only then that we recognise the salient truth: namely, they are part of life’s warp and weft. They have to be taken - to use Truman Capote’s axiom – in Cold Blood. A dilemma which brings us to the exposed issue of post-modernism, I dare say.
Q10: A talented and accomplished artist, you have produced over 200 paintings of your own. What first motivated you to take up painting, and how would you describe your own inimitable style?
JB: Unlucky for some, eh? Well, let’s look at it in this way… between around six or thirteen years of age I used to draw comics or graphic novels. They were my first form. Around two thousand images definitely came into the world as a consequence of these endeavours. They were my first love, I suppose – primarily due to their combination of words and images. A factor which also accounts for my interest in the graphic, the horrific or Gothic, the linear and the pre-formed. Contrary to the desiderata of pure modernism, in graphic work you always know where you’re going but not necessarily where you intend to end up. After a brief gap – grammar school and so on – I started to produce images again. Yet now a subtle change had taken place. The pictures underwent a metamorphosis into full-scale paintings and over around thirty years have mounted up to at least 215 works. Some of the early ones are framed; others not. Around 175 or 177 (depending) are available for viewing on my website (www.jonathanbowden.co.uk), sundry sketches and preliminaries will follow… and the coup de gras shall be those graphic novels which await scanning and upload at a later date. Personally speaking, I find them to be captivating in their allure. They are extremely varied in their focus – some are ferocious, savage and expressionist; others are erotic, playful and sensual; still more have a classic, restorationist or historical bias; while the remainder embody autobiographical and ideological themes. Some pertain to child art or the ramifications of Art Brut: that is, a willing or known primitivism in terms of artistic silence. Certain other paintings are literally portraits of people known to me; whilst early on I experimented with the psycho-portrait – here you illuminate a person’s nature and not their looks. Although eschewing abstraction – unlike Norman Lowell – I’ve never been interested in pure representationality after the invention of photography to do it for you. Do you recall those nineteenth century series of photographs by the master Edward Muybridge? He was one of the great pioneers of slow-motion, frame by frame photography when this art or science was in its infancy. A sequential art motif featuring two men engaged in Graeco-Roman wrestling has to be an early classic. These images in particular had profound influence on Francis Bacon’s oeuvre. Anyway, if we examine it closely then this tradition splits several ways. It leads to the strip cartoon, the cartoon or funny, comics and the story board – a development that prepares the ground for early silent cinema. So inter alia, the fantastical and linear presentation of action becomes art’s necessity. All of which involves going inside the mind so as to furnish provender – imagination then facilitates change, transmutation, forays from within and the custody of inner space. An eventuality which portends Modernism – why don’t you think of me as a heterosexual version of Francis Bacon? Maybe you could construe yourself, Troy, as the famous critic David Sylvester with whom Bacon had a well-known artistic dialogue in Plato’s tradition. Thames and Hudson published it years ago.
Q11: In his recent book, Homo Americanus, the Croatian author Tomislav Sunic notes that “postmodernity is hypermodernity insofar as the means of communication render all political signs disfigured and out of proportion.” (p.150)? What is your view on post-modernism and hyper-modernism?
JB: I actually question whether the concept of hyper-modernity actually exists, but we don’t want to end up in a cul-de-sac of meaning and response. By no means… Do you happen to recall that story by H.P. Lovecraft, Pickman’s Model, where the artist’s baying creature at the end of various Old Bostonian tunnels was taken from life? That’s the point… Anyway, in Tomislav Sunic’s Homo Americanus, which I have to admit that I had a hand in editing, he makes a situational point about post-modernism. Note: Situationism was a literary theory of excess, somewhat ‘terrorist’ in spirit, which grew out of a fragment of late surrealism. Its chief text was Guy Debord’s The Society of the Spectacle. Certainly the notion of a twenty-four hour media circus which penetrates everything, cyclonically, has come to be seen as a cliché. Nowadays , a thinker like Jean Baudrillard just tidied up post-modern excess and evinced an ironic distance over any attachment to left radicalism. Post-modernity is really about patterning. It’s an Asiatic or Oriental deportment; one in which displaced tarot cards are endlessly displaced and new meanings then become attached to them. It self-consciously adopts a mosaic’s inflexions, but variously complex or contradictory currents enter into the mixture here. Yet misnomers abound: Stravinsky’s neo-classicism early on in the twentieth century is definitely post-modern in feel… yet historically it can hardly be described as such. Whereas an extremist modernist text written after the Second European Civil War by Samuel Beckett, Comment C’est (How It Is), could be delineated as a post-modern elixir. In it two forms – vaguely reminiscent of the actors Patrick Magee and Max Wall – drag themselves across plateaus of mud towards an uncertain future, mouthing imprecations all the while. Also, there is a complicated interaction between post-modernist diction and historical revisionism over the Shoah. Its extreme relativism, metaphysical subjectivism and heuristic bias lend itself to micrological analysis, rather like Kracuer’s estimation of the German film industry. Nonetheless, the hermeneutical pea-souper which clings to Paul de Mann’s Blindness & Insight definitely has something to do with his own partiality for writing on behalf of Leon Degrelle-like journals during that conflict. Paradoxically though, deep textual analysis or criminological fare, rather like Faurisson’s exegesis, can quite easily dovetail itself with Thion’s post-structuralism, whereby all media certainties become questionable. As to hyper-modernity, what can one say? Perhaps it relates to the mass media’s electronic self-consciousness – the self-consciousness of its own self-consciousness, if you like. Now post-modernism truly behaves like a serpent devouring its tail, or the Worm Ouroborous. It also betokens those cinema audiences in the ‘fifties, metaphorically, who sat in darkened flea-pits watching in X-Ray specs. Possibly hyper dims post-modernity, if only to provide its apotheosis and defeat. A chimpanzee sits before a Sony Playstation playing a Gulf War game with News 24 alive in the background… maybe the latter scenes in Pierre Boulle’s novel, Monkey Planet, have a certain salience. Particularly when these gestures are interestingly spliced with Christopher Priest’s racialist science-fiction novel, Fugue for a Darkening Island… the one with a piece of Ploog-like fantasy art on the cover. A neglected work – it nevertheless intones values similar to those of a British Camp of the Saints. The point to make throughout all of this, however, is that culture cannot just elicit a significatory response. It must entertain an essentialist or organic bias (even in its existential mists) – otherwise it’s meaningless. One can then look forward to conceptual art replacing an art of concepts; wherein Stewart Home’s interpretation of Manzoni’s cube smears over Kipling’s The Stranger.
Jonathan Bowden may be contacted in writing via BCM Refine, London WC1N 3XX, England.
| Home | Articles | Essays | Interviews | Poetry | Miscellany | Reviews | Books | Archives | Links |
00:23 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, conservatisme, conservatisme révolutionnaire, droite, angleterre, théorie politique, esthétique politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 mars 2009
R. Scruton : Waarom cultuur belangrijk is
Boekbespreking
Roger Scruton - Waarom cultuur belangrijk is
Ex: http://onsverbond.wordpress.com/
Het is een open deur intrappen als we stellen dat de conservatieve maatschappijvisie in het publieke debat slechts een minderwaardige positie krijgt toegemeten. Doch - eerlijkheidshalve - is deze op dit moment nog onvoldoende georganiseerd. Buiten enkele zeldzame initiatieven zoals de Iskander-rondzendlijst van Vbr. prof. dr. Matthias Storme en bladen zoals Nucleus en TeKoS blijft het in Vlaanderen nagenoeg windstil.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hongerige lezers hun nectar vaak over de grens halen. Zo beweegt boven de Moerdijk heel wat meer. Het initiatief rond het Bitter Lemon, de uitgeverij Aspekt en auteurs als Andries Kinneging en Ad Verbrugge zijn alvast talrijker en ook beter gewapend om het debat te voeden. Daarom achtten wij de kans klein om een nochtans bekende Engelse conservatief als Roger Scruton ooit in Vlaanderen vertaald te zien. Zijn nieuwste boek ‘Culture Counts’ lag daarom bij ons bezoek aan een New Yorkse boekhandel meteen in het winkelmandje. Groot was onze verbazing toen wij enkele maanden geleden dit werk alsnog in een Nederlandse uitgave zagen verschijnen. Erop vertrouwend dat de vertalers zich nauwgezet aan de tekst hielden, wagen wij het erop hier de Engelse versie te bespreken.
Reeds in de inleiding formuleert de schrijver duidelijk het opzet van dit boek: de verdediging van de Westerse cultuur. Hierbij positioneert Scruton zich uitdrukkelijk tegenover zowel haar innerlijke als externe vijanden, resp. de ‘postmodernisten’ en de ‘humorloze islam’. En omdat jarenlange indoctrinatie en inbreuken op onze Europese cultuur hun tol hebben geëist, voelt hij zich niet te goed om terug te grijpen naar de basis en te vertrekken vanuit het definiëren van het begrip ‘cultuur’. Deze dient men te zien als “de kunst en de literatuur waardoor de beschaving tot bewustzijn van zichzelf komt en haar visie op de wereld definieert”. Of het nu de Griekse, Romeinse of Egyptische beschaving betreft, elk heeft daaraan in de geschiedenis zijn eigen invulling gegeven. Men moet werkelijk ziende blind te zijn om te ontkennen dat Europa sinds 1500 jaar met zijn kathedralen, schilderwerken, beeldhouwkunst en architectuur ook een dergelijke beschaving rijk is.
| Kathedraal van Chartres, gebouwd tussen 1194 en ca. 1220. |
In een tweede fase wenst Roger Scruton antwoord te vinden op volgende twee vragen: hoe kunnen we in deze samenleving ware cultuur (h)erkennen en hoe kan deze worden doorgegeven opdat ze niet verloren gaat. De nieuw-rechtse filosoof Alain de Benoist stelde in dat verband al eerder dat er twee types conservatieven zijn: “zij die de vlam brandend houden en zij die de as koesteren”. Beide pistes krijgen de nodige aandacht bij de Engelse filosoof.
Is cultuur er enkel voor de elite, voor een selecte groep van al dan niet zelfverklaarde intellectuelen? Ja en neen. Neen, omdat ze de overdracht van morele en emotionele kennis betreft en dit zou in principe voor iedereen beschikbaar dienen te zijn en aangeleerd te worden. Ja, omdat het inspanning vergt. De schrijver haalt daarbij uit naar onder meer het medium televisie, dat hij eerder ziet als een verstrooiing. Door het gebruik van snelle beelden en het gebruik van actie en sterke emoties amputeert het de verbeeldingskracht van de Europeaan.
Liefhebbers van poprock zullen het misschien niet graag lezen, maar Scruton vindt deze vorm van muziek ook niet echt cultuur, gezien de focus te veel op ritme en minder op tonaliteit ligt. Hoeft het gezegd dat klassieke muziek wel die harmonie en melodie in zich draagt en daarom de tand des tijds zo makkelijk doorstaat? Samen met bijvoorbeeld een schilderij van Rembrandt of de kathedraal van Chartres slaagt Beethoven erin zijn publiek te imponeren, te laten meeleven. Zonder nochtans te shockeren via obsceniteiten of overdreven sentimentaliteit, waarvan moderne ‘kunst’ vaak doorwrochten is. Neen, ware kunst kenmerkt zich door zijn focus op zijn intrinsieke waarde: l’art pour l’art en geen politieke, economische of zelfs emotionele motieven. Kunst staat op zichzelf en geniet precies daarom aandacht. Het zet aan tot denken, tot reflectie, tot het formuleren van een visie op deze wereld.
Na de lezer vertrouwd te hebben gemaakt met het begrip cultuur en hoe deze op te sporen, rest nog de vraag hoe deze waarde(n)volle cultuur aan onze volgende generaties door te geven, hoe hen te overtuigen van haar rijkdom. Hoeft het gezegd dat de Engelse auteur weinig vertrouwen heeft in de filosofie van scholen zoals Freinet en Steiner? Onderwijs moet kennisgericht zijn, niet kindgericht. Hoe kan het kind immers uit zichzelf weten wat goed, slecht, mooi, lelijk is?
Onze cultuur is boven alles de moeite waard te worden overgedragen en verspreid. Nochtans staan adepten van de Frankfurter Schule klaar om de cultuur van de zogenaamde ‘Dead white men’ neer te sabelen en te brandmerken als seksistisch, racistisch en dies meer. Ook heel wat moslims springen op de kar en zien de kans schoon om met de christelijke concurrent af te rekenen. Edward Saïd is misschien de bekendste telg van deze strekking met zijn boek ‘Orientalism’.
Scruton toont echter aan dat er geen reden is waarom onze Europese cultuur zich zou moeten schamen voor haar verleden. Evenmin zou deze minder aandacht of respect tonen voor vreemde invloeden dan bijvoorbeeld in islamitische landen het geval is. Anderzijds stelt de schrijver terecht dat precies ‘verlichte’ academici, actief in bijvoorbeeld vrouwenstudies, vaak wetenschappelijke kritiek ter zijde schuiven als deze indruist tegen hun politieke overtuiging. Indien de Europese cultuur het vrije woord, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek niet had gekoesterd in haar schoot, zouden we nooit op bijvoorbeeld technologisch vlak zo’n grote sprongen voorwaarts hebben gemaakt. Wetenschap en cultuur of in extenso wetenschap en christelijke religie vormen geen tegenspraak.[1] Zou het kunnen dat onder zogenaamde intellectuelen ‘geestelijke vadermoord’ gemeengoed is geworden?
Met dit boek heeft Scruton als specialist inzake esthetica en filosofie opnieuw een interessant werk afgeleverd. Akkoord, het boek is niet altijd even toegankelijk en verdient daarom af en toe de nodige reflectie en bezinning. Maar wie de boodschap heeft gevat, beseft meer dan ooit dat onze Europese cultuur meer dan de moeite waard is te worden beleefd en overgedragen. Uit respect voor het verleden, met een blik op de toekomst.
Vbr. OS lic. rer. oec. et merc. Pieter Vandermoere
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, conservatisme, angleterre, culture, théorie politique, métapolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 mars 2009
Götz KUbitschek - Provokation

Götz Kubitschek - Provokation
“Unsere Hoffnung ruht in den jungen Leuten, die an Temperaturerhöhung leiden”, sagte Ernst Jünger, und das gilt heute wieder. Kubitscheks Aufruf zur Provokation ist das Manifest des rechten, politischen Existentialismus: Immer dann, wenn einer entschieden etwas tut, vergewissert er sich seiner selbst und gewinnt für sich und seine Überzeugung Strahlkraft und Deutungsmacht. www.edition-antaios.de
00:29 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, conservatisme, existentialisme, allemagne, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 mars 2009
A propos du décisionnisme
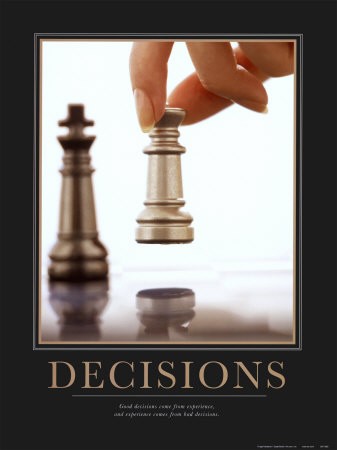
ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
A propos du décisionnisme
Le décisionnisme est, comme son nom l'indique, une pensée en termes de décision. Le décisionniste est l'homme politique qui veut décider, aboutir à une décision, c'est-à-dire à un acte de volonté qui a ses ressorts en lui-même et qui est vierge de toute compromission. Le décisionniste, en conséquence, s'oppose à toutes les formes de compromis que permet le libéralisme. Carl Schmitt, catholique et conservateur, est sans nul doute celui qui, parmi les tenants de la “révolution conservatrice”, a pensé le décisionnisme de la manière la plus conséquante. Chez les penseurs nationaux-révolutionnaires de la même époque, on trouve également des décisionnistes.
Pour Carl Schmitt, ce qui est important, c'est «que dans la simple existence d'une autorité réellement autoritaire, il y ait de la décision, et que toute décision soit valable et valide, car dans les choses les plus essentielles [du politique], il est plus imoportant de savoir que quelqu'un décide, que de savoir comment cette décision est décidée» (1). Il s'agit donc de poser une “décision” en soi, en pleine souveraineté. L'Etat, à l'époque de Carl Schmitt, du moins dans le domaine du politique, est le moyen le plus approprié pour poser de telles décisions; c'est lui qui incarne la souveraineté qui est, en fait, rien d'autre que le “monopole de la décision” (2). Il s'agit de reconnaître le bien-fondé, l'utilité pratique, l'excellence, de la décision absolue, c'est-à-dire de la décision pure, non raisonnée, qui n'est pas le produit d'une discussion, qui n'a nul besoin de se justifier, qui jaillit du néant (3). L'essence de l'Etat apparaît ici clairement, parce qu'il est le vecteur premier de la décision, devient de la sorte le moyen le plus précieux pour contrer, à l'intérieur, la guerre civile que déclenchent les idéologies et les intérêts contradictoires. «L'essence de l'Etat réside en ceci, qu'il y ait [par lui] une décision» (4).
La particularité de Carl Schmitt, dans le cadre de cette “révolution conservatrice” mise en exergue par Armin Mohler, c'est, qu'en tant que penseur catholique, il voit toujours Dieu trôner au-dessus de tout. D'où son constat: «Tous les concepts prégnants des doctrines modernes de l'Etat sont des concepts théologiques sécularisés» (5). Toutefois, le Règne de Dieu n'est pas de ce monde, où c'est l'homme qui gouverne, où c'est l'homme qui est le fondateur des valeurs. Mais comment réalise-t-on concrètement les valeurs, comment établit-on les lois? Schmitt ne cesse de citer l'Anglais Thomas Hobbes, en acceptant ses théorèmes: «Auctoritas, non veritas facit legem» (6). L'autorité est la source des lois, car le pouvoir lui en donne la force, c'est elle qui pose les décisions qui génèrent les lois. C'est au départ de cette conception de Hobbes, que la “révolution conservatrice” allemande a opté pour les systèmes autoritaires, parce qu'ils éliminent les querelles intérieures et les bannissent de la “communauté organique”.
Chez les nationaux-révolutionnaires, que Mohler classe aussi dans la “révolution conservatrice”, il y a donc aussi des décisionnistes. Le concept de décision a fasciné cette gauche non-conformiste, si bien que l'hebdomadaire du mouvement “Widerstand” (= Résistance) d'Ernst Niekisch portait le titre d'Entscheidung (= Décision). Ce n'est pas un hasard. Chez Niekisch, par d'arrière-plan théologique, au contraire de Schmitt. Le décisionnisme de Niekisch découle d'une position fondamentaliste absolue. Niekisch exige la “décision permanente”, car l'“idéologie de Widerstand” équivaut à une “protestation allemande” contre le “romanisme”, à une option pour l'Est contre l'Ouest, pour l'éthique prussienne du service contre le libéralisme (7). Cette protestation tous azimuts, incessante, permanente, exige, selon Niekisch, une “nouvelle attitude humaine”, une promptitude à accepter et à supporter un “destin héroïque”. Pour généraliser cette attitude contestatrice permanente, il faut recruter des hommes qui soient “déjà saisis par l'esprit du futur” (8). Niekisch accuse et brocarde l'éternelle indécision allemande: «Il existe une lenteur, une lourdeur, une faiblesse typiquement allemandes, qui, sans cesse, cherche, en louvoyant, à échapper à la décision nécessaire» (9). Mais le devoir éthique de trancher, donc de décider, de prendre littéralement le taureau par les cornes, personne ne peut l'éviter, le refuser.
Sur le plan littéraire, l'exigence de décision se retrouve, à un degré de radicalité encore plus élevé, chez Ernst Jünger, qui, à cette époque, appartenait encore aux cercles nationaux-révolutionnaires, et était une figure de proue du “nouveau nationalisme”. Il écrivait: «C'est pourquoi cette époque exige une vertu entre toutes: celle du décisionnisme. Il s'agit de pouvoir vouloir et de pouvoir croire, sans se référer au contenu que cette volonté et cette foi se donnent» (10). Cet appel de Jünger est un appel à la “décision en soi”. Chez Jünger, la décision est couplée à un désir ardent de nouveauté, au désir d'une révolution, d'où les éléments de nihilisme ne sont pas totalement absents. Chez lui, la décision est toute imprégnée de l'esprit des “orages d'acier”: elle est quasi synonyme de “mobilisation totale”. «Notre espoir repose sur les hommes jeunes, qui souffre de fièvre, parce qu'ils sont dévorés par le pus verdâtre du dégoût, notre espoir repose dans les âmes saisies par la grandezza, dans les âmes que nous voyons errer dans les sinuosités de l'ordre des auges. Notre espoir repose en une révolution qui s'opposerait à la domination du confort, en une révolution visant à détruire le monde des formes, en une révolution qui a besoin d'explosifs pour nettoyer et vider notre espace vital, afin qu'il y ait la place pour une nouvelle hiérarchie» (11).
Le décisionnisme est en tant que tel une méthode, plus exactement une méthode de critique sociale, une méthode finalement assez proche de la théorie critique utilisée par les gauches nouvelles. Mais il peut bien entendu étoffer l'arsenal d'une nouvelle droite, qui devrait en être l'héritière et la continuatrice, car de larges segments de la “neue Rechte” allemande sont d'ores et déjà influencés par Carl Schmitt. En effet, la critique du déclin du politique à l'ère du libéralisme, formulée par Carl Schmitt en 1922, reste d'une étonnante actualité: «Aujourd'hui rien n'est plus moderne que la lutte contre le politique. Les financiers américains, les techniciens de l'industrie, les socialistes marxistes, les révolutionnaires anarcho-syndicalistes, s'unissent pour exiger que soit éliminée la domination immatérielle du politique sur la matérialité de la vie économique. Il ne devrait plus y avoir que des tâches organisationnelles, techniques, économiques et sociologiques, mais il ne pourrait plus y avoir de problèmes politiques. Le mode aujourd'hui dominant de la pensée économico-technique n'est déjà plus capable de percevoir la pertinence d'une idée politique. L'Etat moderne semble être vraiment devenu ce que Max Weber voyait se dégager de lui: une grande entreprise. En général, [dans ce contexte libéral], on ne comprend une idée politique que lorsque ses tenants sont parvenus à prouver à une certaine catégorie de personnes qu'elles ont un intérêt économique direct et tangible à l'instrumentaliser à leur profit. Si, dans ce cas d'instrumentalisation, le politique disparaît et sombre dans l'économique, ou dans le technique ou l'organisationnel, par ailleurs, il s'épuise dans les intarissables discours ressassant à l'envi les banales généralités que l'on ne cesse d'ânonner sur la “culture” ou sur la “philosophie de l'histoire”, discours définissant au nom de critères esthétiques l'air du temps tantôt comme classique, tantôt comme romantique ou comme baroque, en hypnotisant les “beaux esprits”. Ce basculement dans l'économique ou ce discours [“cultureux”], passe à côté du noyau réalitaire de toute idée politique, de toute décision qui, en tant que décision, est toujours d'une plus haute élévation morale. La signification réelle que revêtent en fait les philosophes de l'Etat contre-révolutionnaires, réside entièrement dans la dimension conséquente de leur démarche, laquelle repose sur la décision, [baigne dans l'incandescance de la décision]. Ces philosophes contre-révolutionnaires mettent si fort l'accent sur l'instant intense de la décision qu'ils annulent finalement l'idée de légitimité, à partir de laquelle, pourtant, ils avaient amorcé leurs réflexions» (12).
Le déclin du politique découle de l'évitement systématique des décisions. La modernité passe de fait à côté de la décision essentielle, de la décision qui fonde le concept du politique, c'est-à-dire de la décision qui aboutit à la désignation de l'ami et de l'ennemi. «C'est ainsi que Carl Schmitt définit la modernité: elle est oublieuse du politique. Dans cette perspective, le communisme et le capitalisme apparaissent pour ce qu'ils sont: les deux pôles complémentaires d'une même positivité impolitique, qui constitue le terminus ad quem d'une objectivisation mécaniciste du social, à l'œuvre depuis le XVIIième siècle» (13).
Jürgen HATZENBICHLER.
(traduction française: Robert STEUCKERS).
Notes:
(1) Carl SCHMITT, Politische Theologie, Berlin, 1990, p. 20.
(2) Ibid., p.71.
(3) Ibid., p.83.
(4) Ibid., p.71.
(5) Ibid., p.49.
(6) Ibid., p.44.
(7) Ce nom dérive de celui du mensuel Widerstand, dirigé par Niekisch.
(8) cf. Uwe SAUERMANN, Ernst Niekisch und der revolutinäre Nationalismus, München, 1985, pp. 173 & ss.
(9) Ernst NIEKISCH, cité par Friedrich KABERMANN, Widerstand und Entscheidung eines deutschen Revolutionärs, Köln, 1973, p. 165.
(10) Ernst NIEKISCH, Widerstand, Krefeld, 1982, p. 164.
(11) Ernst JÜNGER, Das abenteurliche Herz - Erste Fassung, Stuttgart, 1987, p. 110.
(12) E. JÜNGER, ibid., pp. 113 & ss.
(13) C. SCHMITT, ibid., pp. 82 & ss.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, carl schmitt, conservatisme, droite, nouvelle droite, synergies européennes, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 mars 2009
Guerre d'Espagne: mémoire historique ou mémoire hystérique?
Guerre d'Espagne : mémoire historique ou mémoire hystérique ?
Présenté sous un tel titre, l’article de Arnaud Imatz ne cache rien de son objet. On voit immédiatement où l’auteur veut en venir et c’est probablement une des raisons pour lesquelles la « Nouvelle Revue d’Histoire », dirigée par Dominique Venner, l’a publié.
Cette publication bimestrielle, taxée par la vulgate médiatique de non-conformisme au sens du politiquement correct historique, a déjà presque sept ans d’âge et recueille des signatures prestigieuses, plumes de marque, historiens et chercheurs de talent.
Dans la dernière livraison, Arnaud Imatz revient sur la toujours très controversée Guerre civile espagnole de 1936-1939, dont les plaies sont rouvertes périodiquement, et il nous fait découvrir comment les politiques de gauche espagnols se sont emparés de l’histoire, très exactement comme nos politiques, hélas de toute tendance à de rares exceptions près, l’ont si bien fait en France en 1990 avec la loi Gayssot. Les Espagnols se trouvent donc, eux aussi, affublés d’une loi outrageusement partisane dont on ne sera pas étonné de lire qu’elle trouve son origine dans une proposition du Parti communiste. Cette loi de « Mémoire historique » a été adoptée par les députés espagnols le 26 décembre 2007. Le lecteur ne sera pas surpris de trouver au détour de cette loi le célèbre juge Garzon, connu même sur le plan international puisqu’il a été l’initiateur du mandat d’arrêt lancé contre le général Pinochet : ce juge se consacre à corps perdu à la recherche des « criminels du camp national ». Enfin, là aussi, on assiste à une bataille de chiffres des victimes, décidément pomme de discorde éternelle et arme suprême de la propagande idéologique.
Cet article historico-politique est passionnant et il montre qu’en Espagne, tout comme dans une grande partie des pays appartenant à l’Union européenne, l’histoire est aujourd’hui confisquée par le pouvoir politique relayé par la justice, et donne lieu à l’intauration de « lois mémorielles » et à la judiciarisation du fait historique.
Polémia
Tous les historiens reconnaissent l’impressionnant développement économique et social de l’Espagne après la mort de Franco. Tous admirent l’exemple de transition démocratique pacifique et tolérante donné au monde par le peuple espagnol. Bien sûr, selon leurs convictions, les analystes s’affrontent : certains considèrent que ce processus s’étend de 1966 à 2004, d’autres soulignent l’importance de l’approbation de la Constitution de 1978, d’autres encore mettent en valeur l’arrivée au pouvoir de Felipe Gonzalez et du PSOE (1982), d’autres enfin insistent sur le retour de la droite de José Manuel Aznar (1996), mais tous reconnaissent la formidable et spectaculaire transformation du pays. Pendant près de trois décennies, deux principes ont animé « l’esprit de la transition » : le pardon réciproque et la concertation entre gouvernement et opposition. Il ne s’agissait pas d’oublier le passé (la conscience de l’histoire est au contraire une des conditions pour éviter de répéter les erreurs), mais de le surmonter, de regarder résolument vers l’avenir. On aurait pu penser qu’au fil des ans le calme et la sérénité se seraient imposés, que soixante dix ans après la fin de la Guerre civile les historiens se seraient adonnés enfin librement aux plaisirs tranquilles du champ de leur connaissance, mais il n’en est rien.
Depuis son accession au pouvoir, en 2004, plutôt que de contribuer à effacer les rancœurs, José Luis Rodriguez Zapatero, a délibérément choisi de raviver la bataille culturelle et de rouvrir les blessures du passé. Zapatero a expliqué en de nombreuses occasions comment la mémoire de son grand père, Juan Rodriguez Lozano, fusillé par les franquistes, a motivé ses convictions politiques. Une explication tronquée, quand on sait que son grand-père, qui fut exécuté par les troupes nationales, en 1936, pour avoir franchi leurs lignes dans un but d’espionnage, avait été aussi décoré, en 1934, pour avoir contribué à restaurer la légalité républicaine sous les ordres du général Franco et participé à cette occasion à la répression des mineurs d’Asturies. Mais le caractère monstrueusement fratricide de la guerre civile semble évacué par Monsieur Zapatero et son gouvernement.
On pourrait rappeler quelques exemples frappants et cruels comme celui des prestigieux écrivains, Antonio et Manuel Machado, qui se trouvaient chacun dans des camps différents, ou celui du dirigeant anarchiste Buenaventura Durruti dont les deux frères étaient phalangistes, ou encore celui de Constancia de la Mora, l’épouse communiste du général de l’aviation républicaine Hidalgo de Cisneros, dont la sœur Marichu était une journaliste phalangiste. Il serait inutile de s’acharner à répéter que la plupart des ministres de la démocratie espagnole, qu’ils soient de gauche ou de droite, ont des pères, des oncles et des grands-parents qui ont soutenu le régime franquiste. Tout cela, Monsieur Zapatero le sait. Le grand-père de son épouse, Sonsoles Espinosa, n’était-il pas lui aussi franquiste ? Mais le chef du gouvernement espagnol et son équipe n’en ont cure. La politique n’est pas le terrain de la morale, pas plus qu’il n’ait celui du droit ou de l’histoire.
Les raisons de la pugnacité du gouvernement socialiste espagnol sont essentiellement politiques. Il s’agit de donner quelques gages au parti communiste et à l’extrême gauche qui, depuis des décennies, cherchent invariablement à imposer leur vision unilatérale de l’histoire, et, par la même occasion, à condamner moralement la droite conservatrice pour l’écarter durablement du pouvoir.
Avec l’aide du député travailliste maltais, Léo Brincat, le 17 mars 2006, Zapatero a d’abord fait adopter par la commission permanente, agissant au nom de l’assemblée du Conseil de l’Europe, une recommandation sur « la nécessité de condamner le franquisme au niveau international ». Par la suite, il n’a eu de cesse de faire voter par le parlement espagnol une loi de « Mémoire historique » dont l’origine se trouve dans une proposition du Parti communiste (Izquierda Unida).
L’expression « mémoire historique » est devenue le lieu commun de la culture espagnole. L’effort de récupération de la mémoire historique n’est évidemment pas un mal en soi, mais encore faut-il qu’il ne soit pas un prétexte pour que les plus sectaires s’arrogent le droit de séquestrer l’histoire ou de la manipuler. On ne peut pas, en effet, comparer la récupération de la mémoire pour ressusciter la haine de l’autre avec la récupération de la mémoire pour rénover la fraternité et la concorde. Or, si la « loi de Mémoire historique », du 26 décembre 2007, reconnait et amplifie justement les droits en faveur de ceux qui ont pâti des persécutions ou de la violence pendant la Guerre civile et la dictature, elle accrédite une vision manichéenne de l’histoire et contrevient à l’éthique la plus élémentaire. « Le pire de la prétendue “mémoire historique”, déclare le prestigieux hispaniste américain Stanley Payne, ce n’est pas la falsification de l’histoire, sinon l’intention politique qu’elle renferme, sa prétention à fomenter l’agitation sociale. » (Congrès universitaire de Madrid du 5.11.2008).
Une des idées fondamentales de la « loi de Mémoire historique » est que la démocratie espagnole est l’héritage de la Seconde République. Un point de vue d’autant plus discutable que le processus de transition fut mené conformément aux mécanismes prévus par le régime de Franco et qu’il fut dirigé à la fois par un roi désigné par le généralissime et son premier ministre qui était l’ancien secrétaire général du Movimiento. Selon le raisonnement de la « mémoire historique », la Seconde République, mythe fondateur de la démocratie espagnole, aurait été un régime presque parfait dans lequel l’ensemble des partis de gauche auraient eu une action irréprochable. Pour couronner le tout, mettre en cause cette absurdité ne saurait être qu’une apologie exprès ou déguisée du fascisme.
Les anomalies de cette loi ne se comptent plus. Elle effectue un amalgame stupide entre le soulèvement militaire, la guerre civile et le régime de Franco qui sont autant de faits distincts relevant d’interprétations et de jugements différents. Elle exalte les victimes et les assassins, les innocents et les coupables lorsqu’ils sont dans le camp du Front populaire et uniquement parce qu’ils sont de gauche. Elle confond les morts en action de guerre et les victimes de la répression. Elle jette le voile de l’oubli sur toutes les victimes « républicaines » qui moururent aux mains de leurs frères ennemis de gauche. Elle encourage et justifie tout travail visant à démontrer que Franco à mener délibérément et systématiquement une répression sanglante pendant et après la guerre civile. Elle reconnait, enfin, le légitime désir de beaucoup de personnes de pouvoir localiser le corps de leur ancêtre, mais refuse ce droit à ceux qui étaient dans le camp national sous le prétexte fallacieux qu’ils ont eu tout le temps de le faire à l’époque du franquisme.
Après l’adoption de la loi de « mémoire historique » et les débats qui l’ont précédée, fin 2007, la boîte de Pandore est ouverte. Dès le 15 décembre 2006, diverses associations « pour la récupération de la mémoire », avaient déposé des plaintes auprès du Juge d'instruction de l’Audience nationale, Baltasar Garzón « pour détention illégale en vertu d'un plan systématique d'élimination physique de l'adversaire pendant la guerre civile (1936-1939) et les années de l'après-guerre, méritant le qualificatif juridique de génocide et de crime contre l'humanité ». L’Audience nationale est l’héritière directe du Tribunal de l'ordre public de la dictature franquiste qui fut supprimé en 1977. Le juge Garzón est un magistrat instructeur connu internationalement pour avoir lancé un mandat d’arrêt contre Augusto Pinochet. Il avait effectué une brève incursion dans la vie politique comme second sur la liste du parti socialiste de Madrid derrière Felipe Gonzalez. Dans une ordonnance, qui échappe à la logique de la procédure judiciaire et ne suit aucune méthodologie historique, Baltasar Garzón s’est déclaré compétent. Un magistrat instructeur se doit de diligenter une affaire à charge et à décharge. Lui, soutient une thèse. Lorsque les faits le gênent, il les écarte. La responsabilité et la cruauté de la guerre civile et des exactions retombent, selon lui, entièrement sur un seul camp. L’affaire est donc entendue ! Il n’y a pas à prendre en compte les crimes survenus pendant la IIème République, ni les crimes du Front Populaire. Et qu’on ne lui reproche pas d’avoir rejeté une plainte contre le communiste, Santiago Carrillo, un des principaux responsables du massacre de Paracuellos, en se fondant sur des arguments et une jurisprudence exactement inverses. La plainte contre le « prétendu » crime de Paracuellos (plus de 4000 morts) était, dit-il, « inconsistante » : les faits, avaient été jugés, les victimes avaient été identifiées (quand ?, où ?, comment ? il ne le précise évidemment pas !), en outre, ajoute-t-il, « ces faits n’attentaient en rien aux hautes autorités de la nation » !
Enfermé dans sa logique sectaire, Garzón n’a pas l’ombre d’une hésitation. Les vainqueurs, selon lui, ont porté atteinte à la légalité en s’insurgeant contre le Gouvernement de la République et ont eu le temps d’identifier leurs victimes et de demander réparations. Les vaincus, en revanche, n’ont jamais pu le faire et en conséquence le délit perdure aujourd’hui. Mieux, les « rebelles » voulaient exterminer leur opposant de façon systématique et donc « le caractère de crime contre l’humanité imprescriptible tel qu’il est défini par les normes du droit pénal international ne fait pas de doute ». Frisant le grotesque, Garzón demande les certificats de décès de Franco et de 34 dignitaires franquistes « pénalement responsables ». Il autorise les exhumations de corps des fosses contenant des républicains dans les délais les plus urgents et demande la formation de groupes d’experts et l’utilisation de tous les moyens techniques et scientifiques à cet effet. Ultime incongruité, Garzón réclame la liste des principaux dirigeants de la Phalange Espagnole entre le 17 juillet 1936 et décembre 1951, ignorant sans doute que la Phalange de José Antonio, très divisée à l’heure de se joindre aux forces de droite insurgées, en juillet 1936, fut dissoute le 19 avril 1937 et que le second chef de la Phalange fut condamné à mort par un tribunal militaire franquiste.
Le recours immédiat contre cette décision de justice intenté devant la salle pénale de l’Audience nationale par l’Avocat général, Javier-Alberto Zaragoza Aguado, a fait beaucoup moins de bruit. Dommage ! car ce texte qui est celui d’un professionnel du droit est une véritable leçon, un camouflet pour le juge Garzón. « Dans un état de droit, écrit Javier Zaragoza, le procès pénal est sujet à des règles et des limites de procédure qui en aucun cas ne peuvent être violées ». L’Avocat général blâme le juge pour avoir contourné la loi d’amnistie votée par les premières Cortès démocratiques en 1977. « Questionner la légitimité d'origine de cette loi, écrit-il, et pire la stigmatiser comme loi d'impunité serait la sottise juridique absolue ». Il reproche encore au juge Garzón : d’ignorer les règles de compétence territoriale des tribunaux, d’utiliser une habile « couverture » pour qualifier les actes de crimes contre l’humanité et de construire un « échafaudage juridique singulier » qui lui permet de lier les délits de détentions illégales avec un délit contre les hautes autorités de l'État, alors que non seulement les responsables théoriques de ces délits sont morts mais que, en raison de leur condition et responsabilité, la compétence de l'instruction revient au Tribunal suprême. « En résumé, écrit Zaragoza, on peut affirmer que la prétention de tout connaître et sur tous en une seule procédure rompt les plus élémentaires règles du procès pénal et débouche inévitablement sur une inquisition générale interdite par notre Constitution ».
En ce qui concerne la qualification de génocide ou de lèse humanité des faits dénoncés, l’Avocat général explique pourquoi celle-ci n’est juridiquement pas applicable dans ce cas. Le corpus de normes qui conforme la légalité pénale internationale n'existait pas à l'époque ou les actes ont été commis ; cette qualification juridique ne peut donc s'appliquer rétroactivement sans attenter à la légalité pénale dans toute sa dimension ; enfin, l'exécution des faits est antérieure à leur qualification dans le droit pénal international.
Mais le juge Garzón n’est pas du genre à faire amende honorable. Le 18 novembre, coup de théâtre ! Alors que la Salle pénale de l’Audience nationale est sur le point de se réunir pour prendre sa décision, afin d’éviter de courir le risque d’être désavoué par ses pairs et, vraisemblablement, sous la pression de certains de ses amis politiques qui jugent qu’il en faisait trop, Garzón a édicté une nouvelle ordonnance. Dans un texte interminable, saturé de faits incertains, de semi-vérités et d’interprétations contestables, le juge prétendait se justifier et « ratifier avec force tous les motifs qui l’ont amené à considérer cette instruction nécessaire ». Mais après 148 pages de cette eau, il déclarait que la responsabilité pénale du dictateur Franco et des dignitaires franquistes était éteinte en raison de leurs morts et, simultanément, que l’instruction des disparitions était désormais de la compétence des juges de provinces où se trouvent les fosses qu’il avait ordonné d’ouvrir.
Nouvelle contradiction juridique de Garzón, soulignée immédiatement par les présidents de plusieurs tribunaux supérieurs de province : on ne voit pas comment des auteurs de crimes seraient décédés pour Madrid sans l’être pour d’autres villes. Deux jours plus tôt, le Professeur Stanley Payne, célèbre spécialiste américain de la guerre-civile espagnole, prononçait sa propre sentence devant la presse : « L’idée qu’un juge puisse se déclarer en faveur de l’annulation de la transition et de la loi est parfaitement grotesque ».
Critiquables sur le plan juridique, les ordonnances de Garzón ne le sont pas moins au niveau historique (1). Tout d’abord - est-il besoin de le rappeler ? - les historiens ne reconnaissent ni aux politiciens, ni aux juristes la moindre autorité pour venir leur dire comment il faut écrire les faits et interpréter le passé ? Quant aux objections de fond, elles sont multiples.
Ce n’est pas le soulèvement militaire de juillet 1936 qui est à l’origine de la destruction de la démocratie. C’est parce que la légalité démocratique avait été est détruite par le Front populaire que le soulèvement s'est produit. En 1936, personne ne croyait en la démocratie libérale telle qu’elle existe aujourd’hui en Espagne. Le mythe révolutionnaire partagé par toute la gauche était celui de la lutte armée. Les anarchistes et le parti communiste, un parti stalinien, ne croyaient certainement pas en la démocratie. L’immense majorité des socialistes et, notamment leur leader le plus significatif, Largo Caballero, le « Lénine espagnol », qui préconisait la dictature du prolétariat et le rapprochement avec les communistes, n’y croyait pas davantage. Les gauches républicaines du jacobin Azaña, qui s’étaient compromises dans le soulèvement socialiste de 1934, n’y croyaient pas plus. Quant aux monarchistes de Rénovation espagnole, aux carlistes, aux phalangistes et à la majorité de la CEDA (Confédération espagnole des droites autonomes), ils n’y croyaient pas non plus.
Les anarchistes se révoltèrent en 1931, en 1932 et en 1933. Les socialistes se soulevèrent contre le gouvernement de la République, du radical Alejandro Lerroux, en octobre 1934. Appuyé par toutes les gauches, ce soulèvement fut planifié par les socialistes comme une guerre civile pour instaurer la dictature du prolétariat. Dès son arrivée au pouvoir, le Front populaire ne cessa d'attaquer la légalité démocratique. Le résultat des élections de février 1936 ne fut jamais publié officiellement. Plus de 30 sièges de droite furent invalidés. Le président de la République, Niceto Alcalá Zamora fut destitué de manière illégale. La terreur s'imposa dans la rue, faisant plus de 300 morts en trois mois.
On aimerait bien que les nombreux « écrivains d’histoires », défenseurs des vieux mythes du Komintern, nous expliquent la réflexion lapidaire du libéral antifranquiste, Salvador de Madariaga, tant de fois reprise par les auteurs les plus divers : « Avec la rébellion de 1934, la gauche espagnole perdit jusqu’à l’ombre d’autorité morale pour condamner la rébellion de 1936 ». On aimerait qu’ils nous disent pourquoi, à l’exclusion de la Gauche républicaine et de l’Union républicaine, les militants et sympathisants de toutes les autres tendances, depuis les partis républicains de Lerroux, Martinez Velasco, et Melquiadez Alvarez, jusqu’aux traditionalistes carlistes, furent tous considérés en territoire front populiste comme des ennemis à extirper. Pourquoi les ministres démocrates du parti radical Salazar Alonso, Abad Conde, Rafael Guerra del Rio furent condamnés à mort et assassinés. Pourquoi des libéraux comme José Ortega y Gasset, Perez de Ayala, Gregorio Marañon, qui étaient alors « les pères fondateurs de la République », ou encore des démocrates et républicains comme le Président du parti radical, ex-chef du gouvernement de la République, Alejandro Lerroux ou le philosophe catholique-libéral, ami de Croce et d’Amendola, Miguel de Unamuno, choisirent le camp national ? Pourquoi les nationalistes basques ont préféré négocier leur reddition avec le Vatican, les italiens et leurs frères carlistes-requetes (Pacte de Santoña, 24 août 1937) plutôt que de poursuivre la lutte aux côtés de révolutionnaires « persécuteurs et athées ». Pourquoi l’assassinat du député Calvo Sotelo, menacé de mort au Parlement par le ministre de l’intérieur socialiste, Angel Galarza, et liquidé par des militants du PSOE qui furent aidé dans leur crime par les forces de l’ordre, puis protégés par les députés socialistes Vidarte, Zugazagoitia, Nelken et Prieto, n’a-t-il jamais été condamné par les Cortès démocratiques de l’après-franquisme ?
Le caractère partisan de l’action de Baltasar Garzón est flagrant. Mais imaginons que le juge médiatique fasse des émules à droite. Au nom de quels principes pourrait-on alors leur empêcher d’instruire des plaintes contre les responsables : des 200 tchekas qui fonctionnaient à Madrid ; des fosses nationales de Paracuellos (plus de 4000 morts), Torrejón de Ardoz et Usera ; de l’assassinat de García Lorca (cf. notre article dans ce numéro) par les uns et des assassinats de Muñoz Seca, Maeztu, Ledesma et Pradera par les autres ; des massacres républicains de Malaga et de la prison Modèle de Madrid ; de l’extermination de près de 7000 religieux et de 12 évêques ; du bombardement de Cabra (plus de 100 morts et 200 blessés civils) dans des conditions aussi barbares que Guernica (126 à 1635 morts selon les sources) ; de la détention illégale de José Antonio Primo de Rivera quatre mois avant le soulèvement et de son assassinat, en novembre 1936, après une parodie de procès ; des réglements de compte de Marty le boucher d’Albacete, responsable de la mort de plus de 500 brigadistes internationaux ; de l’assassinat du dirigeant anarchiste, Buenaventura Durruti, par les communistes ; de la disparition d’Andreu Nin, le dirigeant du POUM torturé à mort par les staliniens ; des purges de mai 1937 à Barcelone, contre les dissidents de l’orthodoxie stalinienne traités au préalable de trotskistes et d’agents fascistes ; des exécutions sommaires à l’issue de la petite guerre civile qui se déroula à l’intérieur de la guerre civile dans le camp Front populiste, à Madrid, en mars 1939 ; de la spoliation par Moscou des réserves d’or de la Banque d’Espagne ; des milliers d’enfants évacués de force par les autorités républicaines vers l’URSS et qui perdirent ainsi à jamais leur identité … et de tant d’autres exemples polémiques ?
Venons-en enfin au nœud de la controverse : les chiffres de la répression et l’existence de fosses aux victimes non identifiées. Depuis la fin du conflit, de part et d’autre, les protagonistes et leurs descendants les plus enragés n’ont cessé de se jeter des cadavres à la face. Pendant près de 70 ans les chiffres sur les répressions ont oscillé de façon inconsidérée et absurde. Les auteurs favorables au Front populaire, ont cité tour à tour 500 000, 250 000, 192 548 (selon les prétendus propos d’un fonctionnaire franquiste jamais identifié), 140 000, 100 000 (selon Tamames, qui était alors communiste), et, finalement, « plusieurs dizaine de milliers » (selon Hugh Thomas). Par ailleurs, ils ont toujours assuré que les quelques milliers, voire dizaine de milliers de franquistes victimes de la répression l’avaient été parce que le gouvernement de la République était débordé par des groupes incontrôlés alors que dans la zone nationale l’action répressive était préméditée et avait pris l’allure d’une extermination.
En revanche, pour les franquistes qui se fondaient sur les investigations du Ministère public menées dans le cadre de la « Causa general » (procès instruit contre « la domination rouge », au début des années 40, dont l’énorme documentation est conservée, depuis 1980, à l’Archivo Histórico Nacional de España de Madrid et qui n’a jamais été publiée intégralement), il était avéré que les front-populistes avaient commis 86 000 assassinats et les nationaux entre 35 et 40 000. Pour les besoins de sa cause, Baltasar Garzón retient aujourd’hui le chiffre de 114 266 républicains disparus « un chiffre qui, dit-il, pourrait être révisé par un groupe d’experts ». Il prétend nous faire croire qu’ils seront identifiés grâce aux techniques modernes sans préciser bien entendu que la constitution d’une banque d’ADN et l’utilisation systématique de tests constituerait une dépense colossale pour l’État espagnol. Mais peut-on accorder quelque crédit à un juge qui ne cite jamais un expert ou historien adverse ? En fait, dans la majorité des publications que manie Garzón, le préjugé des auteurs se fonde souvent sur des estimations approximatives et des témoignages relevant de l'imagination. Enfin, lorsque ces publications présentent des relations nominales, elles attribuent fréquemment à la répression franquiste des victimes qui, en réalité, sont mortes en action de guerre ou mortes en combattant pour le camp national. Il en résulte que le bilan final est inacceptable sur le triple plan moral, juridique et historique.
Un seul exemple suffit à illustrer l’ampleur des passions dangereuses que l’imprudence des autorités et des médias déchainent dans l’opinion publique. Le 5 mars 2008, l’information de la découverte de nouvelles fosses à Alcala de Henares circulait dans toutes les agences de presse. Immédiatement, le gouvernement espagnol insinua qu’il s’agissait de nouvelles victimes du franquisme, puis, lorsque quelques spécialistes firent remarquer que cette ville étant restée sous contrôle du Front Populaire jusqu’à la fin du conflit, il était peu probable qu’il s’agisse de victimes du camp républicain, le silence se fit et l’affaire fut étouffée.
Même s’il reste à déterminer de façon rigoureuse les morts irrégulières qui, de part et d’autre, n’ont pas encore été inscrites dans les registres d’état civil, on peut considérer que les chiffres pratiquement définitifs des deux répressions sont les suivants : 60 000 victimes chez les nationaux et 80 000 victimes chez les républicains (50 000 pendant la guerre et 30 000 exécutés après la fin du conflit). Des chiffres si lourds n’ont pas besoin d’être exagérés pour rendre compte de l'intensité des passions et l’étendue des massacres qui ont affecté les deux camps.
Plus de trente ans après l’instauration de la démocratie en Espagne, on ne peut toutefois manquer de s’interroger sur un fait étrange. Alors que les publications plus ou moins sérieuses sur la répression se succèdent à bon rythme, personne ne semble avoir eu l’idée de réunir les très nombreux témoignages de tous ceux qui, dans un camp comme dans l’autre, ont essayé en pleine guerre civile de sauver quelqu’un dans le camp ennemi. Ce sont pourtant ces personnes qui sont les plus méritantes, les seules dignes de figurer au tableau d’honneur d’une guerre civile. Mais ne rêvons pas, car parmi ces hommes d’exception devraient figurer en bonne place : Julian Besteiro, le social-démocrate qui s’opposa à la ligne bolchévique de son parti et mourut, en 1939, dans les geôles franquistes ; Melchor Rodriguez García, l’anarchiste de la CNT, délégué général des prisons, qui s’opposa au communiste-stalinien Santiago Carrillo et sauva des centaines de vie humaines, en novembre et décembre 1936, ou José Antonio Primo de Rivera, le chef de la Phalange, assassiné par les front-populistes puis instrumentalisé par les franquistes, qui proposa sa médiation avec insistance au Président des Cortes, Diego Martinez Barrio, en août 1936… et la guerre idéologique, fomentée par tant de politiciens irresponsables, risquerait de s’éteindre.
Arnaud Imatz
Nouvelle revue d’Histoire, janvier/février 2009 n°40
Polémia
28/02/09
Note :
(1) Les origines et les causes de la guerre civile espagnole et la nouvelle historiographie du conflit ont fait l’objet d’un dossier publié dans le numéro 25 de la NRH: 1936-2006 : la guerre d’Espagne.
Arnaud Imatz, docteur d’état ès sciences politiques, diplômé d’études supérieures en droit, ancien fonctionnaire international à l’OCDE, a publié sur la Guerre d’Espagne : « La guerre d’Espagne revisitée », Paris, Economica, 1993, « José Antonio, la Phalange Espagnole et le national-syndicalisme », Paris, Godefroy de Bouillon, 2000 et, plus récemment, « José Antonio : entre odio y amor. Su historia como fue », Barcelone, Áltera.
Arnaud Imatz
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, gauche, droite, guerre d'espagne, histoire, années 30, guerre civile, historiographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 février 2009
Freiheitskonservativismus is overleden
 De publicist Caspar von Schrenck-Notzing is overleden. Meer dan wie ook blijft zijn naam verbonden met hét Europese conservatieve tijdschrift bij uitstek Criticon. Het niveau was jarenlang toonaangevend voor zovele andere Europese tijdschriften.
De publicist Caspar von Schrenck-Notzing is overleden. Meer dan wie ook blijft zijn naam verbonden met hét Europese conservatieve tijdschrift bij uitstek Criticon. Het niveau was jarenlang toonaangevend voor zovele andere Europese tijdschriften. De taak van een rechtse, conservatieve beweging was in die jaren (jaren 50 en 60 van de vorige eeuw) niet gemakkelijk en totaal anders dan 30 jaar geleden. Kon ze in een vroeger tijdsgewricht de staat, het leger, het gerecht en de kerk als traditiegebonden instellingen verdedigen, schragen en uitdragen, dan bleken ze in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw steeds meer aangetast door het liberalisme en het egalitarisme. Zo schreef Caspar von Schrenck-Notzing: “We leven in een tijdperk van een wereldwijd ineenstorten van alle Europese posities”.
De taak van een rechtse, conservatieve beweging was in die jaren (jaren 50 en 60 van de vorige eeuw) niet gemakkelijk en totaal anders dan 30 jaar geleden. Kon ze in een vroeger tijdsgewricht de staat, het leger, het gerecht en de kerk als traditiegebonden instellingen verdedigen, schragen en uitdragen, dan bleken ze in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw steeds meer aangetast door het liberalisme en het egalitarisme. Zo schreef Caspar von Schrenck-Notzing: “We leven in een tijdperk van een wereldwijd ineenstorten van alle Europese posities”.
13:42 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, bavière, conservatisme, revue, droite, politique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
In Memoriam: Caspar von Schrenck-Notzing und "Criticon"
Caspar von Schrenck-Notzing und Criticón
von Karlheinz Weißmann am 4. Februar 2009 - http://www.sezession.de/
[1]Heute wird Caspar von Schrenck-Notzing in München zu Grabe getragen. Damit geht auch ein Abschnitt in der Geschichte des deutschen Nachkriegskonservatismus zu Ende. In allen Würdigungen und Nachrufen wurde darauf hingewiesen, daß Schrenck-Notzing mit der Gründung der Zeitschrift Criticón die Tribüne für die rechte Intelligenz der siebziger und achtziger Jahre geschaffen hatte: von den katholischen Traditionalisten über die Adenauer-Fraktion und die Klassisch-Liberalen bis zu den Nominalisten und Nationalrevolutionären.
Geplant war das ursprünglich nicht. Datiert auf „Ammerland, im Mai 1970″ ging ein hektographierter Rundbrief ins Land, der das Erscheinen der ersten Ausgabe von Criticón ankündigte. Einleitend hieß es: „Bei dem Schwimmen gegen den Strom fällt es immer schwerer, aus der Sturzflut des Gedruckten jene Publikationen herauszufinden, die für die grundlegende und laufende Orientierung über Zeitfragen wesentlich sind.“ Deshalb sei es nötig, eine „Sammelstelle“ zu schaffen, die das Material sichte und den Leser auch auf das hinweise, was eventuell am Rande stehe. Die Nummer 1 war denn auch ein gerade zwölf Seiten umfassendes Heft ohne Umschlag im Format DIN A 4, dessen Schwerpunktthema das Denken Arnold Gehlens bildete (einleitender Text über Moral und Hypermoral von Armin Mohler, Autorenportrait von Gehlens Schüler Hanno Kesting), während man ansonsten nur Rezensionen und kurze Hinweise auf Organisationen, Veranstaltungen oder andere Zeitschriften fand.
Seine spätere Gestalt mit den auffallend farbigen Umschlägen, auf denen eben kein deutscher Adler, sondern ein Hahn in gallischer Manier prangte, nahm Criticón allerdings schon im Laufe des zweiten Erscheinungsjahrs an. Auch die Gliederung der einzelnen Nummer ergab sich frühzeitig. Die Autorenportraits bildeten über die Zeit hinweg eine Art Enzyklopädie der konservativen Meisterdenker, wobei Schrenck-Notzing großzügig jede Fraktion der geistigen Rechten zur Geltung kommen ließ, außerdem gab es theoretische wie aktuelle Aufsätze deutscher und ausländischer Autoren, sowie ein politisch-metapolitisches Editorial, das Schrenck-Notzing unter dem Pseudonym „Critilo“ – der „Kritische“ verfaßte.
[2]Critilo gehörte zu den Figuren des allegorischen Romans El Criticón des spanischen Jesuiten Baltasar Gracián, nach dem Schrenck-Notzing seine Zeitschrift benannt hatte. Gracián war einer jener „Machiavellisten“, die die Freiheit liebten und deshalb die Macht der Gegen-Aufklärung einsetzten, um sich Einsicht in die tatsächlichen Weltzusammenhänge zu verschaffen. Das erklärt etwas von dem hohen analytischen und prognostischen Wert, den viele der in Criticón veröffentlichten Texte hatten. Zusammenfassend schrieb Schrenck-Notzing dazu: „Schwerpunkte von Criticón waren das russische Dissidententum (vor dem Nobelpreis für Solschenizyn), der amerikanische Konservatismus (vor der Wahl Reagans), der britische Konservatismus (vor der Wahl von Mrs. Thatcher), die Emigrationen der Ostblockstaaten (vor deren Zusammenbruch), die deutsche Identität (vor der Wiedervereinigung), Parteien und Medien (vor dem Ausufern des Parteien- und Medienstaates).“
Man muß sich dabei vergegenwärtigen, daß Criticón trotz oder gerade wegen dieser Qualität isoliert in der deutschen Zeitschriftenlandschaft stand. Selbst die Springer-Presse hatte kaum mehr als Häme für die „konservativen Standartenträger“ (Die Welt) übrig. Ein Sachverhalt, der auch durch vermehrte Anstrengungen nicht zu ändern war. Das ließ sich vor allem an den Überlegungen Schrenck-Notzings in den achtziger Jahren ablesen, mit Criticón aktuell einen eigenen, alle drei Wochen erscheinenden Nachrichtendienst herauszubringen. Ein Versuch, der bereits im Ansatz scheiterte. Kurze Zeit später mußte auch die Erscheinungsweise Criticóns von zweimonatlich auf vierteljährlich umgestellt werden.
[3]Der Einsatzbereitschaft von Schrenck-Notzing ist es zu verdanken, daß Criticón trotzdem die damalige Krise des konservativen Zeitschriftensegments überstand, dessen Publikationen nach und nach verschwanden, weil die Verlegerpersönlichkeit, die sie getragen hatte, nicht mehr da war (Herderbücherei Initiative), aufgab (Mut), sich von der CSU umarmen ließ (Zeitbühne, Epoche) oder ihr Milieu verlor (Konservativ heute). Es war deshalb tragisch, daß die Auswahl eines Nachfolgers zu einem immer drängenderen Problem wurde und Schrenck-Notzings Wahl – Gunnar Sohn, ein langjähriger Mitarbeiter von Criticón – sich als Fehlentscheidung erwies. Die gewisse Häme, mit der die Neue Zürcher Zeitung im Frühjahr 2000 einen Artikel über das „neue Criticón“ betitelte mit „Kapitulation vor dem bösen alten Feind“ war ein Signal dafür, daß Sohn nach kurzem Lavieren, das Erbe, das er angetreten hatte, verriet. Das hatte auch mit objektiven Schwierigkeiten zu tun, die Zeitschrift wie bisher fortzuführen, hing aber vor allem mit der Inkompetenz Sohns zusammen.
Und das ist das erstaunliche: Criticón ist eine konservative Zweimonatsschrift, ein Blatt der rechten Intelligenz, sowohl nach seinem Selbstverständnis wie im Urteil der Kritiker. – Claus Leggewie 1987
Schrenck-Notzing wird diese Entwicklung mit Bitterkeit verfolgt haben, wenngleich er sich das niemals anmerken ließ. Durch die Zeitschrift Agenda, die seine Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung (FKBF) mit einigen Nummern erscheinen ließ, versuchte er noch einmal zu den Anfängen von Criticón zurückzukehren und ein konservatives Rezensionsorgan zu schaffen. Geglückt ist das nur im Ansatz. Es war offenbar Zeit für etwas Anderes, und das Erscheinen der Sezession ist von Freund wie Feind als Versuch betrachtet worden, die Linie Schrenck-Notzings unter den gegebenen Umständen fortzusetzen.
Artikel ausgedruckt von Sezession im Netz: http://www.sezession.de
Adresse zum Artikel: http://www.sezession.de/caspar-von-schrenck-notzing-und-criticon.html
Adressen in diesem Beitrag:
[1] Bild: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/02/schrenck.jpg
[2] Bild: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/02/img4881.jpg
[3] Bild: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/02/img4891.jpg
13:41 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, conservatisme, droite, philosophie, revue, politique, bavière |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 décembre 2008
'68: "Contestazione controluce"/A. Romualdi
'68: "Contestazione controluce" - di Adriano Romualdi
[…]
“Potere studentesco” è la parola d’ordine con cui i comunisti e i loro utili idioti hanno cominciato a occupare le università italiane al principio del ’68. Uno slogan chiaramente ricalcato su “ potere negro” , e, infatti, uno dei contro-corsi verteva appunto sul black power, mentre altri ne seguivano sulla rivoluzione culturale cinese […], sui benefici della droga e sui rapporti tra repressione sessuale e autoritarismo. […] “Potere studentesco” è una grossolana formula demagogica con cui i comunisti tentano di speculare sui gravi scompensi che affliggono le università italiane. […] Vogliono il “potere studentesco” , ossia la dittatura di quell’esigua frangia di studenti rosi dal marxismo che introduce nelle università la demagogia permanente e impedisce quella selezione dei quadri, quell’approfondimento degli studi, che sono garanzia di maggior serietà nella vita pubblica e di una maggiore efficienza nazionale. […] “Potere studentesco” è una formula mitica che s’inserisce in un certo mito generale della vita, un mito di cui fan parte il “potere negro” e la LSD, Fidel Castro e la pillola, Ché Guevara, Marcuse e la zazzera.
[…]
Gli occupanti pretendono di lottare contro la società, ma i loro miti, il loro costume, il loro conformismo sono precisamente quelli di questa società contro cui dicono di battersi. Dicono di essere contro lo stato, e la televisione di stato gli adula e li vezzeggia, dicono d’ essere contro il governo, e i socialisti al governo li proteggono, dicono di costituire un’alternativa ai tempi, ma le loro chiome, gli abiti, gli atteggiamenti, i loro folk-songs, le loro donnine beat, sono quanto di più consono allo spirito dei tempi si possa immaginare. Si atteggino ad “antiamericani” , ma sono marci di americanismo fino al midollo: le loro giacche, i loro calzoni, i loro berretti, sono quelli dei beatniks di San Francisco, il loro profeta è Allen Ginsberg, la loro bandiera la LSD, il loro folk-songs quelli dei negri del Mississipi, la loro patria spirituale il Greewich-Village. Sono marxisti, ma non alla maniera barbarica dei russi o dei cinesi ma in quella particolare maniera in cui è marxista un certo tipo di giovane americano frollo di civiltà. Proclamano il “collegamento con la classe operaia” , la “giuntura tra la semantica della rivendicazione studentesca e la dialettica del mondo operaio” , ma nulla più del loro snobismo è remoto dall’animo dei veri operai e contadini, nessuno più di questi pulcini usciti dall’uovo d’una borghesia marcia è lontano dalla mentalità di chi deve lottare con le più elementari esigenze. Il loro problema è la droga; quello degli operai il pane.
[…]
È piuttosto la sommossa d’una minoranza d’intellettuali da salotto, di giovani e ricchi borghesi che rompon la noia di un’esistenza troppo facile giocando ai cinesi o ai castristi. Le roccaforti della rivolta studentesca sono state proprio le facoltà snob, come la facoltà di architettura di Roma dove - di fronte ai muri su cui era scritto “guerriglia cittadina” – stazionavano in doppia fila le eleganti auto sportive degli occupanti. [… ] È la rivolta di una minoranza di borghesi comunisti allevati nelle serre calde di alcune facoltà tradizionalmente rosse come Lettere, Fisica, Architettura. È la rivolta dei capelloni, degli zozzoni, dei bolscevichi da salotto, di una gioventù che, più che bruciata, si potrebbe chiamare stravaccata. [… ] Ecco che all’operaio, integrato nella società borghese e indisponibile per le chiassate marxiste, si sostituisce il giovane blasé, il figlio di papà con la spider e il ritratto del Ché sul comodino.
[…]
Per un colmo di ironia, la rivolta studentesca, che ha il marxismo scritto sulle sue bandiere, smentisce proprio la teoria marxista del fondamento economico d’ogni moto politico. La rivolta studentesca è una tipica sommossa ideologica, libresca, sfornata dalle riviste impegnate, dalla libreria Feltrinelli, come i distintivi di protesta e i ritratti del Ché venduti nei grandi magazzini come tappezzeria. Questa rivolta che polemizza con la civiltà dei consumi, è una tipica espressione del “consumo culturale” , di un boom librario impiantato sul sesso e sul marxismo, sulla droga e Ché Guevara, su Fidel Castro e sulle donne nude. Da un punto di vista di mercato, il militante del “movimento studentesco” è il tipo medio del consumatore della cultura di protesta, che trangugia ogni giorno la sua razione di quella letteratura marxista, sessuomane, negrafila, che le grandi case editrici gettano sul mercato in quantità sempre maggiori. Il consumatore culturale è progressista, cinese, antirazzista, per lo stesso motivo per cui indossa i blue-jeans e beve Coca-Cola, consuma il romanzo cochon o il diario di Che Guevara come si “consuma” una scatola di fagioli o un rotolo di carta igienica, consuma la rivolta giovanile che oramai si fabbrica e si vende come una qualunque merce.
[…]
Il problema che si pone a questo punto è il seguente: come mai una “ rivoluzione” così sfacciatamente inautentica è riuscita a imporsi alla gioventù, e non solo a quella più conformista, ma anche a quella più energica e fantasiosa? La risposta è semplice: perché dall’altra parte non esisteva più nulla. Seppellita sotto un cumulo di qualunquismo borghese e patriottardo – sotto il perbenismo imbecille della garanzia “sicuramente nazionale, sicuramente cattolica, sicuramente antimarxista” – la destra non aveva più una parola d’ordine da dare alla gioventù. [… ] In un’epoca di crescente eccitazione dei giovani, essa diceva loro “statevi buoni”; in un’epoca di offensive e confronti ideologici, essa dormiva tranquilla perché le percentuali FUAN nei “parlamentini” restavano stazionarie. Fossilizzata nelle trincee di retroguardia del patriottismo borghese, incapace di agitare il grande mito di domani, il mito dell’Europa, le organizzazioni giovanili ufficiali vegetavano senza più contatto alcuno col mondo delle idee, della cultura, della storia.È bastato un soffio di vento a spazzare questo immobilismo che voleva essere furbesco, ma era soltanto cretino. Bastarono le prime occupazioni per comprendere che dall’altra parte - quella della destra - non c’era più nulla. La cosiddetta classe giovanile si lasciò sommergere in pochi giorni, senza fantasia e senza gloria. Quando le bandiere rosse sventolarono in quelle università che avevano costituito fino a pochi anni prima le roccaforti della destra nazionale, molti guardarono a destra, attesero un segno. Ma il segno non venne: mancarono, più che il coraggio, e i giovani che erano pronti, l’iniziativa e le idee. Maturata nei corridoi di partito, in un clima furbesco e procacciatore, questa cosiddetta classe dirigente giovanile ormai rarefatta a tre o quattro nomi non aveva assolutamente niente da dire di fronte alla formidabile offensiva ideologica delle sinistre. Ne era semplicemente spazzata via. Si riuscì a farsi rinchiudere nel ghetto della banalità più retriva.
[…]
Mentre le sinistre, con tutta una rete di circoli politici e culturali, agitavano, con sempre maggiore fantasia, tutta una serie di temi rivoluzionari, la gioventù di destra era castigata a montar la guardia al “dio-patria-famiglia” . Si parlava un po’ di Gentile, il cui patriottismo generico era abbastanza scolorito e tranquillizzante, ma si evitavano con gran cura le tesi antiborghesi d’uno Julius Evola. La parola d’ ordine era di amare la patria e la conciliazione, di odiare il divorzio, il cinema pornografico e la Süd TirolerVolkspartei . Fascisti si, ma con moderazione; dei nazisti, neppure parlarne. Ci si deve meravigliare se molti dei migliori giovani di destra siano diventati “cinesi”? Per un giovane di temperamento veramente fascista, le parole estreme, la violenza, le bandiere dei “cinesi” venivano a surrogare quel che la destra ufficiale, tiepida e invecchiata, non poteva più dare. Ci si può meravigliare se per reazione, sorse il fenomeno dei nazimaoisti? [… ] Molti di questi nazi-maoisti erano soltanto dei signorini che cercavano di tenersi alla moda. Ma anche quelli che sinceramente speravano di creare un nuovo fronte rivoluzionario, disparvero nella selva di bandiere rosse dei loro “alleati” . La loro incerta tematica fu risucchiata dal gergo marxista. Crearon dei dubbi, di cui solo il comunismo si avvantaggiò. [… ] Esso sta a dimostrare come una visione di destra rivoluzionaria e antiborghese avrebbe per lo meno disorientato i contestatori, e come la contestazione avrebbe potuto essere loro strappata di mano se solo si fosse avute alle spalle una tematica meno bolsa e convenzionale. Ciò che non ha compreso la destra, la necessità di ringiovanire la sua tematica, lo ha ben compreso il PCI.
[…]
Il PCI ha coscientemente coltivato tutta una certa mitologia mediante associazioni culturali, politiche, artistiche, alle quali vien garantita la massima libertà critica nei confronti del partito, ma che portano avanti un certo di discorso atto a condurre i giovani nell’area del comunismo. [… ] Il PCI ha compreso anche che un certo comunismo da cellula, alla russa, è ormai qualcosa di troppo austero coi tempi che corrono, e ha puntato le sue carte sui comunismi esotici, romantici, tropicali, sui poteri negri e gialli, sui comunismi barbutelli, pidocchiosi, fantasiosi, il comunismo del Ché e del cha-cha-cha, di Luther King e di Halleluja. E’ questo il comunismo alla moda, il comunismo che piace ad una gioventù sempre più sbracata. Il centro d’infezione di questo nuovo comunismo è la casa editrice del miliardario comunista Giangiacomo Feltrinelli (per gli amici “Giangi” ), il Giangiacomo Rousseau della nuova rivoluzione. [… ] È dalle librerie di Feltrinelli che escono a migliaia i libri sulla droga e sulla Bolivia, sui negri e su Fidel Castro, è là che si possono comprare i distintivi di protesta, è là che fu tenuta a battesimo la rivista «Quindici», organo del “movimento studentesco” . Poco importa che le avanguardie cinesi e castriste snobbino il PCI. Esse seminano pur sempre un grano che non sarà mietuto nelle lontane Avana e Pechino, ma dal comunismo nostrano. Il “movimento studentesco” attira i giovani in un ordine d’idee che – placatisi i giovani bollori - farà di loro dei bravi elettori comunisti. Il PCI ha sempre controllato l’agitazione studentesca. Nessuno crederà che le occupazioni di facoltà protrattesi per mesi interi siano state possibili senza l’apparato logistico del partito comunista, senza i rifornimenti della FGC. I pacchi-viveri che furono distribuiti a Roma nella facoltà di Lettere occupata, erano involti in carta elettorale del PCI. I professori alla testa della rivolta erano i soliti Chiarini, Amaldi, Asor-Rosa. I parlamentari alla testa dei cortei del “movimento studentesco” erano parlamentari comunisti.
[…]
Quali risultati politici si aspetta il partito comunista da quest’agitazione? Innanzi tutto, creare un clima di frontismo giovanile, un fronte comune di giovani cattolici e giovani comunisti contro il governo e, chissà, domani, utili idioti “nazionali” e giovani comunisti contro la NATO. Logorando la preclusione anticomunista nei giovani democristiani, esso pone le premesse per il superamento dell’anticomunismo DC. In secondo luogo, esso ricatta i socialisti, costringendoli ad una “corsa a sinistra” all’interno del centro-sinistra. In terzo luogo, esso pone la sua candidatura alla partecipazione al governo, della quale - a parte l’alleanza atlantica - esistono già tutte le premesse. Di fronte a questo lucido disegno del PCI, che si serve della gioventù universitaria come d’una forza d’urto, sta l’inettitudine dell’attuale classe dirigente della destra giovanile a dire una parola nuova alla gioventù. È quest’inettitudine che ha condotto a quelle defezioni e a quelle confusioni che si sarebbero potute evitare.
[…]
[… ] Questa mitologia d’una borghesia putrefatta che spera nella “rivoluzione”, per conquistare sempre nuovi paradisi di libertà e sudiciume, non è in nessun modo un’antitesi al sistema, ma solo l’evoluzione interna del sistema verso la sua inevitabile conclusione: la putrefazione dei popoli di razza bianca e il tramonto dell’occidente. […] Il fatto è che il partito comunista ha compreso da anni una verità che nel nostro ambiente non è ancora entrata in testa a nessuno, e cioè che un partito estremista, in un momento non rivoluzionario, con una situazione internazionale statica e un certo sonnacchioso benessere all’interno, può portare avanti solo un’offensiva ideologica, appoggiata a minoranze imbevute di un certo mito della vita e che vengon gettate avanti per conseguire effetti psicologici. [… ] Perché è chiaro che si può respingere un certo trito linguaggio benpensante senza cadere per questo nella retorica viet-cong o guevarista. Che si può alzar la bandiera del nazionalismo europeo senza dimenticare le garanzie necessarie alla sicurezza dell’Europa. Che ci si può battere nelle università contro “l’ordine costituito” ma, contemporaneamente contro i comunisti. Poiché la destra, il fascismo, pur nella loro crisi attuale, rappresentano pur sempre l’unica alternativa rivoluzionaria per la gioventù.
* * *
Brani tratti da Contestazione Controluce, in «Ordine Nuovo», a. I, n. s. 1, marzo-aprile 1970.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mai 68, contestation, italie, droite, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 04 décembre 2008
L'anarchisme de droite dans la littérature contemporaine

L'anarchisme de droite dans la littérature contemporaine
par Jacques d'ARRIBEHAUDE
A l'origine d'un esprit de révolte qu'il analyse ici re-marquablement, François Richard évoque les baro-ques et les libertins du XVIème et du XVIIème sièc-les, diversement suspects aux pouvoirs en place et dé-jà "non conformes". Il signale à juste titre la "Sa-ti-re Ménippée", mais, très vite, en vient à son vrai sujet, qui tient à l'esprit et au rôle de ceux qu'il ran-ge parmi les anarchistes de droite de la fin du siècle dernier à nos jours. "En fait, écrit-il, l'anarcho-droi-tis-me se révolte contre la montée et la tentative d'in-car-nation des idéaux démocratiques, mais cette op-po-sition n'englobe pas sa pensée dans son entier. El-le n'en est qu'un des aspects: sur cette humeur ré-tive, ce refus viscéral, croît et se développe une atti-tude philosophique globale qui, dans sa lucidité, sa vio-lence et son appétit de liberté, a engendré l'un des flamboiements littéraires les plus contestés et les plus impressionnants de ce temps".
Soutenu par un excellent choix de citations, le livre s'ar-ticule en six chapîtres de lecture aisée et capti-van-te, qui vont du "refus de la démocratie" à la "chas-se à l'absolu". Il est évident que la révolution de 89, dont les masses se voient sommées, à leurs pro-pres frais de contribuables, de célébrer le bicente-naire, est ici une charnière, un point de rupture fon-damental. Parmi beaucoup d'autres, on peut retenir cette appréciation de Léautaud: "Au total, une bande de coquins et d'imbéciles sans en excepter un seul... Voilà pourtant ce qu'on glorifie, voilà les créateurs de la France, de la France d'aujourd'hui, les précur-seurs des bavards et des sots qui nous gouver-nent...". Drumont avait déjà parfaitement constaté que "la Société fonctionnant en mode subversif, tout ce qui semblerait devoir protéger les honnêtes gens concourait en réalité à assurer aux gros voleurs le succès d'abord, l'impunité ensuite". La caractéristi-que de tous ces hommes que leur forte individualité sé-pare et rend parfois hostiles les uns aux autres, c'est le refus des mots creux, des abstractions gro-tes-ques imposées comme valeurs suprêmes du Pro-grès à majuscule et d'une république considérée par Léon Bloy comme "le droit divin de la médiocrité absolue". C'est aussi, dans un siècle où l'idéal se ré-duit de plus en plus à "la même chose pour tout le monde", l'appel spontané à la contradiction et la vo-lonté farouche de rejeter les crédos de plus en plus suspects, les vulgates les plus agressivement niaises d'une intelligentsia aussi sotte que perverse en ses pe-sants rabâchages. On conçoit dans ces conditions le cri de Nimier et de quelques autres, qui eurent vingt ans en 45. "Plus l'Apocalypse s'est rappro-chée de l'Allemagne et plus elle est devenue ma pa-trie". On conçoit aussi que, dans l'asphyxie du confor-misme ambiant, étayé d'un appareil judiciaire et po-licier parfaitement au point, appuyé à tous les cré-neaux possibles par des aboyeurs médiatiques, des enseignants abrutis et l'armée socialisante d'une plé-tho-rique fonction publique où nul ne semble avoir jamais vu l'ombre d'un prolétaire, le moindre pro-pos d'un Drumont, d'un Céline, d'un Rebatet, et, plus près de nous, d'un Nabe ou d'un Micberth, soit aussitôt perçu comme une menace intolérable. A l'Est, il y a pour ces criminels les fameux "asiles psy-chiatriques". Dans nos démocraties de progrès, de tolérance et de droits de l'homme, c'est tout simplement l'assassinat par étouffement, piqures d'é-pin-gle, inquisition fiscale, persécutions admi-nistra-tives, incarcération sur motifs fabriqués, le tout dans "ce grand silence de l'Abjection" si bien évoqué ja-dis par Châteaubriand.
De Gobineau à Micberth en passant par Drumont, Bloy, Darien, Léautaud, Daudet, Céline, Rebatet, Mar-cel Aymé, Bernanos et bien d'autres, François Ri-chard éclaire à merveille le talent, la vigueur po-lé-mique et la fécondité d'un courant qui, en dépit de toutes les censures, de tous les éteignoirs, et de l'im-mense peur des bien-pensants de tous bords, appa-raît "comme l'une des tendances politiques, morales et intellectuelles les plus stimulantes de notre moder-ni-té".
Où l'auteur de cette excellente étude s'égare un peu, me semble-t-il, c'est lorsqu'il cite Louis Pauwels en bonne place parmi ces irréductibles briseurs de ta-bous dont il souligne pourtant bien, par ailleurs, le ca-ractère irrécupérable. Certes Pauwels est honni et abreuvé d'injures par les tout puissants foutriquets de ce qu'il nomme si justement la "gauche caviar", qui ne sauraient lui pardonner ses ricanements à pro-pos du "sida mental" dont il les voit atteints. Mais Pauwels est une institution qui se recommande, tout comme ses adversaires et détracteurs, de la démo-cra-tie, de la République, et de l'épilepsie moralisante de nos cardinaux judéo-chrétiens. Je distingue mal le rap-port avec Barbey d'Aurevilly, Léon Bloy, Da-rien, Rebatet, Micberth, etc. Je regrette, en revan-che, que François Richard ait omis de citer Brigneau, Gripari, Marc-Edouard Nabe, Willy de Spens, d'autres peut-être, qui appartiennent, sans conteste, par l'éclat, le talent et le caractère, à cette flamboyante aristocratie de réprouvés qu'il s'est atta-ché à dépeindre. Mais ne boudons pas notre satis-faction dès lors qu'il s'agit là du premier ouvrage sérieux sur un sujet pratiquement tabou jusqu'à ce jour.
Jacques d'ARRIBEHAUDE.
François RICHARD, L'anarchisme de droite dans la littérature contemporaine, PUF (coll. "Littératures mo-dernes"), Paris, 1988, 244 pages, 130 FF.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, anarchisme, anarchisme de droite, droite, conservatisme, lettres françaises, littérature françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 23 novembre 2008
Hommage à Giorgio Locchi (1923-1992)
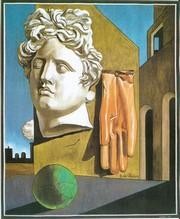
Hommage à Giorgio Locchi (1923-1992)
par Gennaro MALGIERI
Giorgio Locchi est mort de la seule façon qu'il aurait jugée acceptable: de manière imprévue, presque sans avertir personne, alors qu'il voulait écrire un essai sur Martin Heidegger. Sans doute, a-t-il eu une lueur de conscience, entre le moment où la mort s'est annoncée et celui où elle l'a frappé, quelques minutes plus tard, et il a très certainement remercié les dieux de lui offrir une sortie de scène aussi soudaine, car l'idée de rester longtemps malade ou diminué le faisait immensément souffrir. A la fin du mois de juin 92, lors de son dernier séjour à Rome, il m'a parlé du mal qui l'avait frappé deux années plus tôt et qu'il avait vaincu. Il me disait que la perspective de devenir un tronc inerte le faisait frémir parce qu'avec le temps qui passe, on s'accroche plus étroitement, plus profondément, plus égoïstement à la vie. Paroles de Locchi qui ne m'ont pas surpris. Aujourd'hui, j'y repense, comme si elles avaient été un présage.
Pour quelqu'un qui comme moi était de ses amis, ce n'est pas facile de rendre hommage à Giorgio Locchi, de récapituler tout ce qu'il nous a légué. Je pourrais tenter de tracer un profil du journaliste, correspondant à Paris du Tempo pendant plus de trente ans. Et de raconter une infinité d'anecdotes sur ses rapports avec Renato Angiolillo. Ou encore de souligner l'importance de tous les services qu'il a rendu à l'information en Italie: sur les événements d'Algérie, sur la naissance de l'existentialisme, sur le mai 68 parisien. Ses vues étaient portées par un anti-conformisme extraordinairement courageux et intelligent. Je voudrais aussi souligner le rôle capital qu'a joué Giorgio Locchi dans l'évolution de la droite française, insister sur le bout de chemin qu'il a fait avec Alain de Benoist, sur la passion qu'il éprouvait à former des jeunes intellectuels, sur ses activités au sein du GRECE et sur ses contributions à la revue Nouvelle Ecole. Je voudrais aussi pouvoir rassembler ici tous les éléments de la vaste mosaïque qu'était sa personnalité, rendre compte de son amour pour la musique et le cinéma, de sa maîtrise des choses physiques et scientifiques. Et je pourrais aussi raconter l'histoire de notre amitié et relater celle de son refuge parisien qui m'a été si cher, ainsi qu'à une poignée d'autres Italiens, où nous nous retrouvions pour évoquer le passé ou pour manifester notre hostilité au système ambiant. Mieux: nous y venions pour écouter Locchi qui nous évoquait Nietzsche ou Wagner, Heidegger ou la Révolution Conservatrice, ses expériences en Allemagne ou les moments cruciaux de la seconde guerre mondiale qu'il a vécue comme acteur du «front intérieur». Il nous parlait aussi de la «droite impossible» et d'une Europe tout aussi impossible. Et il nous faisait part de ses projets, commentait les revues auxquelles il collaborait, évoquait les articles qu'il voulait écrire et les livres qu'il voulait publier. Nous voyions peu de choses de Paris quand nous allions chez «Meister Locchi» et Saint-Cloud, où il vivait pratiquement en reclus, fut, pendant de nombreuses années, le point de rencontre de beaucoup d'entre nous.
Le journaliste, l'ami, l'organisateur de manifestations culturelles, l'agitateur d'idées vivent et vivront toujours dans le cœur de ceux qui ont connu Giorgio Locchi et ont été ses amis. Ses livres, ses idées, ses essais dispersés dans Nouvelle Ecole, La Destra, L'Uomo Libero et Elementi, ses articles du Tempo et du Secolo d'Italia resteront les témoignages écrits d'un engagement intellectuel et politique au sens le plus noble du terme, mais qu'il a ressenti comme le fardeau d'une défaite européenne pendant plus de quarante ans. Nous avons d'abord vu Giorgio sceptique et méfiant, puis la confiance ne lui est revenue qu'au moment où on a parlé de la réunification allemande. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu être à Berlin quand l'Allemagne s'est remembrée: c'était pour lui, me disait-il, un rêve qui se réalisait, un événement qui se déroulait sous ses yeux et qu'il n'avait pas imaginé voir se réaliser, même s'il n'avait jamais cessé de croire au-delà des limites qu'impose le pessimisme, attitude justifiée s'il en est.
Les idées de Locchi étaient les idées d'une Europe qui n'existe plus: mais cette inexistence n'était pas pour lui une raison pour ne pas en défendre ou en illustrer les principes. Mais quand on lui en faisait le reproche, il rétorquait: ses idées étaient les idées de l'Europe éternelle que cette Europe conjoncturelle de notre après-guerre ne voulait pas, momentanément, reconnaître.
Son attitude à l'égard du fascisme, par exemple, était loin d'être simplement revendicative voire revencharde. Giorgio Locchi voulait, dans le bouillonnement culturel de la parenthèse fasciste, recueillir tous les éléments qui n'étaient pas caducs. Il nous a fait part de ses réflexions à ce sujet dans son opuscule intitulé L'essenza del fascismo (Il Tridente, 1981). Il s'y réfère à la vision du monde qui fut l'inspiratrice du fascisme historique mais qui n'a nullement disparu avec la défaite de ce dernier. Cet ouvrage constitue aujourd'hui encore un prodigieux «discours de vérité», au sens grec, qui cherche à soustraire le fascisme de toutes ces explications fragmentaires qui ont cours actuellement et à toutes les formes de démonologie générant préjugés sur préjugés. Locchi, en fait, a développé une réflexion historique propre selon un schéma philosophique cohérent, appuyé sur une option interdisciplinaire, elle-même prélude à une théorie synthétique de l'essence du fascisme.
Dans son enquête, Locchi soutenait qu'il n'était pas possible de comprendre le fascisme si l'on ne se rendait pas compte qu'il était la première manifestation politique d'un phénomène spirituel et culturel plus vaste, dont l'origine remonte à la seconde moitié du XIXième siècle et qu'il appelait le «surhumanisme». Les pôles de ce phénomène, qui ressemble à un énorme champ magnétique, sont Richard Wagner et Frédéric Nietzsche qui, par leurs œuvres, ont «agité» le «principe nouveau» et l'ont diffusé et dilué dans la culture européenne entre la fin du XIXième et le début du XXième siècle.
Ce principe est le «sentiment de l'homme» comme volonté de puissance et système de valeur. Dans ce sens, le principe surhumaniste, avec lequel le fascisme est en rapport «génétique/spirituel», s'articule comme le rejet absolu du «principe égalitaire» qui lui est opposé et qui informe le monde d'aujourd'hui, toile de fond de nos circonstances.
Locchi avançait la thèse suivante: «Si les mouvements fascistes ont désigné l'ennemi spirituel avant de désigner l'ennemi politique, s'ils ont dénoncé les idéologies démocratiques —libéralisme, parlementarisme, socialisme, communisme, anarcho-communisme— c'est bien parce que dans la prospective historique instituée par le principe surhumaniste, ces idéologies s'articulent comme autant de manifestations du principe égalitaire antithétique, apparues successivement dans l'histoire mais toujours présentes; toutes tendent, en définitive, vers le même but mais avec un degré de conscience différent; toutes ensemble, elles sont la cause de la décadence spirituelle et matérielle de l'Europe, de l'“avilissement progressif” de l'homme européen, de la désagrégation des sociétés occidentales».
Reliant ces considérations à la prospective historique dans laquelle opère le fascisme, à l'unisson avec les autres fascismes européens, Locchi pose une thèse du plus haut intérêt qui contribue au «dés-occultement» du fascisme, en mettant en lumière son essence même.
Ces thématiques, Locchi les a développées dans son ouvrage Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista (Akropolis, 1982; il s'agit partiellement d'une remise en forme de ses articles de musicologie parus en français dans Nouvelle Ecole, n°30 et 31/32; ndlr). Dans sa brillante préface, Paolo Isotta précise, avec minutie, quelles sont les tendances égalitaires et quelles sont les tendances surhumanistes qui entrent en jeu et les posent comme deux conceptions du monde antithétiques et irréconciliables. C'est un livre très dense, particulièrement difficile, parfois rébarbatif dans certains de ses chapitres; il n'empêche que lorsqu'Isotta et moi-même l'avons présenté devant un auditoire comble d'étudiants napolitains, en décembre 1982, il semblait véritablement captiver ces jeunes qui sont restés pendant deux heures rivés sur leurs sièges puis ont harcelé Locchi de questions pertinentes, qui n'avaient vraiment rien de banal. L'auteur n'en a pas paru surpris.
Outre ce livre, j'ai de Locchi un autre grand souvenir: celui de son ouvrage polémique Il male americano (Lede, 1979), auquel Alain de Benoist a apporté quelques petites notes complémentaires (en français, ce texte est paru dans Nouvelle Ecole n°27-28, sous le pseudonyme de Hans-Jürgen Nigra, également repris pour l'édition allemande; ndlr). Ce texte est capital à mon sens car il démonte la mécanique du colonialisme culturel américain et nous permet de jeter un autre regard sur l'Amérique. Locchi, en revanche, n'aimait pas trop ce texte, estimant qu'il relevait davantage du combat que de la formation, qu'il était plus polémique que philosophique.
Dans les tiroirs du bureau de Giorgio Locchi, se trouvent de nombreux projets, des ébauches de textes, le schéma d'un livre sur Heidegger et d'un autre sur la conception du temps chez les Indo-Européens. Ils resteront certainement tels que Giorgio les a laissés parce qu'avant toutes choses, il était un perfectionniste et ne voulait rien publier sans être pleinement convaincu que cela en valait la peine.
Il reste encore, parmi les innombrables lettres qui constituent sa correspondance, un splendide roman qui a pour héros un Italien qui combat en Allemagne une guerre désespérée pour défendre l'Europe. Je ne saurais jamais si c'est par pudeur ou par orgueil que Giorgio Locchi a toujours refusé de le présenter à un éditeur.
Gennaro MALGIERI.
(traduction française: Robert Steuckers).
00:15 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, italie, nécrologie, fascisme, droite, biographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 18 novembre 2008
L'impact de Nietzsche dans les milieux de gauche et de droite
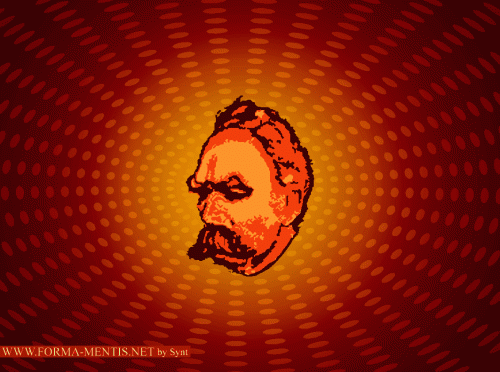
L'impact de Nietzsche dans les milieux politiques de gauche et de droite
par Robert STEUCKERS
Intervention lors de la 3ième Université d'été de la FACE, Provence, juillet 1995
Analyse:
-Steven E. ASCHHEIM, The Nietzsche Legacy in Germany. 1890-1990, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1992, 337 p., ill., ISBN 0-520-07805-5.
- Giorgio PENZO, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987, 359 p., 25.000 Lire.
L'objet de mon exposé n'est pas de faire de la philosophie, d'entrer dans un débat philosophique, de chercher quelle critique adresse Nietzsche, par le biais d'un aphorisme cinglant ou subtil, à Aristote, à Descartes ou à Kant, mais de faire beaucoup plus simplement de l'histoire des idées, de constater qu'il n'existe pas seulement une droite ou un pré-fascisme ou un fascisme tout court qui dérivent de Nietzsche, mais que celui-ci a fécondé tout le discours de la sociale-démocratie allemande, puis des radicaux issus de cette gauche et, enfin, des animateurs de l'Ecole de Francfort. De nos jours, c'est la “political correctness” qui opère par dichotomies simplètes, cherche à cisailler à l'intérieur même des discours pour trier ce qu'il est licite de penser pour le séparer pudiquement, bigotement, de ce qui serait illicite pour nos cerveaux. C'est à notre sens peine perdue: Nietzsche est présent partout, dans tous les corpus, chez les socialistes, les communistes, les fascistes et les nationaux-socialistes, et, même, certains arguments nietzschéens se retrouvent simultanément sous une forme dans les théories communistes et sous une autre dans les théories fascistes.
La “political correctness”, dans sa mesquinerie, cherche justement à morceler le nietzschéisme, à opposer ses morceaux les uns aux autres, alors que la fusion de toutes les contestations à assises nietzschéennes est un impératif pour le XXIième siècle. La fusion de tous les nietzschéismes est déjà là, dans quelques cerveaux non encore politisés: elle attend son heure pour balayer les résidus d'un monde vétuste et sans foi. Mais pour balayer aussi ceux qui sont incapables de penser, à gauche comme à droite, sans ces vilaines béquilles conventionnelles que sont les manichéismes et les dualismes, opposant binairement, répétitivement, une droite figée à une gauche toute aussi figée.
La caractéristique majeure de cet impact ubiquitaire du nietzschéisme est justement d'être extrêmement diversifiée, très plurielle. L'œuvre de Nietzsche a tout compénétré. Méthodologiquement, l'impact de la pensée de Nietzsche n'est donc pas simple à étudier, car il faut connaître à fond l'histoire culturelle de l'Allemagne en ce XXième siècle; il faut cesser de parler d'un impact au singulier mais plutôt d'une immense variété d'impulsions nietzschéennes. D'abord Nietzsche lui-même est un personnage qui a évolué, changé, de multiples strates se superposent dans son œuvre et en sa personne même. Le Dr. Christian Lannoy, philosophe néerlandais d'avant-guerre, a énuméré les différents stades de la pensée nietzschéenne:
1er stade: Le pessimisme esthétique, comprenant quatre phases qui sont autant de passages: a) du piétisme (familial) au modernisme d'Emerson; b) du modernisme à Schopenhauer; c) de Schopenhauer au pessimisme esthétique proprement dit; d) du pessimisme esthétique à l'humanisme athée (tragédies grecques + Wagner).
2ième stade: Le positivisme intellectuel, comprenant deux phases: a) le rejet du pessimisme esthétique et de Wagner; b) l'adhésion au positivisme intellectuel (phase d'égocentrisme).
3ième stade: Le positivisme anti-intellectuel, comprenant trois phases: a) la phase poétique (Zarathoustra); b) la phase consistant à démasquer l'égocentrisme; c) la phase de la Volonté de Puissance (consistant à se soustraire aux limites des constructions et des constats intellectuels).
4ième stade: Le stade de l'Antéchrist qui est purement existentiel, selon la terminologie catholique de Lannoy; cette phase terminale consiste à se jeter dans le fleuve de la Vie, en abandonnant toute référence à des arrière-mondes, en abandonnant tous les discours consolateurs, en délaissant tout Code (moral, intellectuel, etc.).
Plus récemment, le philosophe allemand Kaulbach, exégète de Nietzsche, voit six types de langage différents se succéder dans l'œuvre de Nietzsche: 1. Le langage de la puissance plastique; 2. Le langage de la critique démasquante; 3. Le style du langage expérimental; 4. L'autarcie de la raison perspectiviste; 5. La conjugaison de ces quatre premiers langages nietzschéens (1+2+3+4), contribuant à forger l'instrument pour dépasser le nihilisme (soit le fixisme ou le psittacisme) pour affronter les multiples facettes, surprises, imprévus et impondérables du devenir; 6. L'insistance sur le rôle du Maître et sur le langage dionysiaque.
Ces classifications valent ce qu'elles valent. D'autres philosophes pourront déceler d'autres étapes ou d'autres strates mais les classifications de Lannoy et Kaulbach ont le mérite de la clarté, d'orienter l'étudiant qui fait face à la complexité de l'œuvre de Nietzsche. L'intérêt didactique de telles classifications est de montrer que chacune de ces strates a pu influencer une école, un philosophe particulier, etc. De par la multiplicité des approches nietzschéennes, de multiples catégories d'individus vont recevoir l'influence de Nietzsche ou d'une partie seulement de Nietzsche (au détriment de tous les autres possibles). Aujourd'hui, on constate en effet que la philosophie, la philologie, les sciences sociales, les idéologies politiques ont receptionné des bribes ou des pans entiers de l'œuvre nietzschéenne, ce qui oblige les chercheurs contemporains à dresser une taxinomie des influences et à écrire une histoire des réceptions, comme l'affirme, à juste titre, Steven E. Aschheim, un historien américain des idées européennes.
Nietzsche: mauvais génie ou héraut impavide?
Aschheim énumère les erreurs de l'historiographie des idées jusqu'à présent:
- Ou bien cette historiographie est moraliste et considère Nietzsche comme le “mauvais génie” de l'Allemagne et de l'Europe, “mauvais génie” qui est tour à tour “athée” pour les catholiques ou les chrétiens, “pré-fasciste ou pré-nazi” pour les marxistes, etc.
- Ou bien cette historiographie est statique, dans ses variantes apologétiques (où Nietzsche apparaît comme le “héraut” du national-socialisme ou du fascisme ou du germanisme) comme dans ses variantes démonisantes (où Nietzsche reste constamment le mauvais génie, sans qu'il ne soit tenu compte des variations dans son œuvre ou de la diversité de ses réceptions).
Or pour juger la dissémination de Nietzsche dans la culture allemande et européenne, il faut: 1. Saisir des processus donc 2. avoir une approche dynamique de son œuvre.
Le bilan de cette historiographie figée, dit Aschheim, se résume parfaitement dans les travaux de Walter Kaufmann et d'Arno J. Mayer. Walter Kaufmann démontre que Nietzsche a été mésinterprété à droite par sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche, par Stefan George, par Ernst Bertram et Karl Jaspers. Mais aussi dans le camp marxiste après 1945, notamment par Georg Lukacs, communiste hongrois, qui a dressé un tableau général de ce qu'il faut abroger dans la pensée européenne, ce qui revient à rédiger un manuel d'inquisition, dont s'inspirent certains tenants actuels de la “political correctness”. Lukacs accuse Nietzsche d'irrationalité et affirme que toute forme d'irrationalité conduit inéluctablement au nazisme, d'où tout retour à Nietzsche équivaut à recommencer un processus “dangereux”. L'erreur de cette interprétation c'est de dire que Nietzsche ne suscite qu'une seule trajectoire et qu'elle est dangereuse. Cette vision est strictement linéaire et refuse de dresser une cartographie des innombrables influences de Nietzsche.
Arno J. Mayer rappelle que Nietzsche a été considéré par certains exégètes marxisants comme le héraut des classes aristocratiques dominantes en Allemagne à la fin du XIXième siècle. L'insolence de Nietzsche aurait séduit les plus turbulents représentants de cette classe sociale. Aschheim estime que cette thèse est une erreur d'ordre historique. En effet, l'aristocratie dominante, à cette époque-là en Allemagne, est un milieu plutôt hostile à Nietzsche. Pourquoi? Parce que l'anti-christianisme de Nietzsche sape les assises de la société qu'elle domine. L'“éthique aristocratique” de Nietzsche est fondamentalement différente de celle des classes dominantes de la noblesse allemande du temps de Bismarck. Par conséquent, Nietzsche est jugé “subversif, pathologique et dangereux”. La “droite” (en l'occurrence la “révolution conservatrice”) ne l'utilisera surtout qu'après 1918.
Les “transvaluateurs”
Hinton Thomas, historien anglais des idées européennes, constate effectivement que Nietzsche est réceptionné essentiellement par des dissidents, des radicaux, des partisans de toutes les formes d'émancipation, des socialistes (actifs dans la social-démocratie), des anarchistes et des libertaires, par certaines féministes. Thomas nomme ces dissidents des “transvaluateurs”. La droite révolutionnaire allemande, post-conservatrice, se posera elle aussi comme “transvaluatrice” des idéaux bourgeois, présents dans l'Allemagne wilhelmienne et dans la République de Weimar. Hinton Thomas concentre l'essentiel de son étude aux gauches nietzschéennes, en n'oubliant toutefois pas complètement les droites. Son interprétation n'est pas unilatérale, dans le sens où il explore deux filons de droite où Nietzsche n'a peut-être joué qu'un rôle mineur ou, au moins, un rôle de repoussoir: l'Alldeutscher Verband (la Ligue Pangermaniste) et l'univers social-darwiniste, plus particulièrement le groupe des “eugénistes”.
En somme, on peut dire que Nietzsche rejette les systèmes, son anti-socialisme est un anti-grégarisme mais qui est ignoré, n'est pas pris au tragique, par les militants les plus originaux du socialisme allemand de l'époque. Les intellectuels sociaux-démocrates s'enthousiasment au départ pour Nietzsche mais dès qu'ils établissent dans la société allemande leurs structures de pouvoir, ils se détachent de l'anarchisme, du criticisme et de la veine libertaire qu'introduit Nietzsche dans la pensée européenne. La social-démocratie cesse d'être pleinement contestatrice pour participer au pouvoir. Roberto Michels appelera ce glissement dans les conventions la Verbonzung, la “bonzification”, où les chefs socialistes perdent leur charisme révolutionnaire pour devenir les fonctionnaires d'une mécanique partitocratique, d'une structure sociale participant en marge au pouvoir. Seuls les libertaires comme Landauer et Mühsam demeurent fidèles au message nietzschéen. Enfin, au-delà des clivages politiques usuels, Nietzsche introduit dans la pensée européenne un “style” (qui peut toujours s'exprimer de plusieurs façons possibles) et une notion d'“ouverture”, impliquant, pour ceux qui savent reconnaître cette ouverture-au-monde et en tirer profit, une dynamique permanente d'auto-réalisation. L'homme devient ce qu'il est au fond de lui-même dans cette tension constante qui le porte à aller au-devant des défis et des mutations, sans frilosité rédhibitoire, sans nostalgies incapacitantes, sans rêves irréels.
Enfin, Nietzsche a été lu majoritairement par les socialistes avant 1914, par les “révolutionnaires-conservateurs” (et éventuellement par les fascistes et les nationaux-socialistes) après 1918. Aujourd'hui, il revient à un niveau non politique, notamment dans le “nietzschéisme français” d'après 1945.
L'impact de Nietzsche sur le discours socialiste avant 1914 en Allemagne
En Allemagne, mais aussi ailleurs, notamment en Italie avec Mussolini, alors fougueux militant socialiste, ou en France, avec Charles Andler, Daniel Halévy et Georges Sorel, la philosophie de Nietzsche séduit principalement les militants de gauche. Mais non ceux qui sont strictement orthodoxes, comme Franz Mehring, que les nietzschéens socialistes considèrent comme le théoricien d'un socialisme craintif et procédurier, fort éloigné de ses tumultueuses origines révolutionnaires. Franz Mehring, gardien à l'époque de l'orthodoxie figée, évoque une stricte filiation philosophie —en dehors de laquelle il n'y a point de salut!— partant de Hegel pour aboutir à Marx et à la pratique routinière, sociale et parlementariste, de la sociale-démocratie wilhelminienne. Face à ce marxisme conventionnel et frileux, les gauches dissidentes opposent Nietzsche ou l'un ou l'autre linéament de sa philosophie. Ces gauches dissidentes conduisent à un anarchisme (plus ou moins dionysiaque), à l'anarcho-syndicalisme (un des filons du futur fascisme) ou au communisme. Ainsi, Isadora Duncan, une journaliste anglaise qui couvre, avec sympathie, les événements de la Révolution Russe pour L'Humanité, écrit en 1921: «Les prophéties de Beethoven, de Nietzsche, de Walt Whitman sont en train de se réaliser. Tous les hommes seront frères, emportés par la grande vague de libération qui vient de naître en Russie». On remarquera que la journaliste anglaise ne cite aucun grand nom du socialisme ou du marxisme! La gauche radicale voit dans la Révolution Russe la réalisation des idées de Beethoven, de Nietzsche ou de Whitman et non celles de Marx, Engels, Liebknecht (père), Plekhanov, Lénine, etc.
Pourquoi cet engouement? Selon Steven Aschheim, les radicaux maximalistes dans le camp des socialistes se réfèrent plus volontiers à la critique dévastatrice du bourgeoisisme (plus exactement: du philistinisme) de Nietzsche, car cette critique permet de déployer un “contre-langage”, dissolvant pour toutes les conventions sociales et intellectuelles établies, qui permettent aux bourgeoisies de se maintenir à la barre. Ensuite, l'idée de “devenir” séduit les révolutionnaires permanents, pour qui aucune “superstructure” ne peut demeurer longtemps en place, pour dominer durablement les forces vives qui jaillissent sans cesse du “fond-du-peuple”.
En fait, dès la fin de la première décennie du XXième siècle, la sociale-démocratie allemande et européenne subit une mutation en profondeur: les radicaux abandonnent les conventions qui se sont incrustées dans la pratique quotidienne du socialisme: en Allemagne, pendant la première guerre mondiale, les militants les plus décidés quittent la SPD pour former d'abord l'USPD puis la KPD (avec Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht); en Italie, une aile anarcho-syndicaliste se détache des socialistes pour fusionner ultérieurement avec les futuristes de Marinetti et les arditi revenus des tranchées, ce qui donne, sous l'impulsion de la personnalité de Mussolini, le syncrétisme fasciste; etc.
le socialisme: une révolte permanente contre les superstructures
Par ailleurs, dès 1926, l'Ecole de Francfort commence à déployer son influence: elle ne rejette pas l'apport de Nietzsche; après les vicissitudes de l'histoire allemande, du nazisme et de l'exil américain de ses principaux protagonistes, cette Ecole de Francfort est à l'origine de l'effervescence de mai 68. Dans toutes ces optiques, le socialisme est avant toutes choses une révolte contre les superstructures, jugées dépassées et archaïques, mais une révolte chaque fois différente dans ses démarches et dans son langage selon le pays où elle explose. A cette révolte socialiste contre les superstructures (y compris les nouvelles superstructures rationnelles et trop figées installées par la sociale-démocratie), s'ajoute toute une série de thématiques, comme celles de l'“énergie” (selon Schiller et surtout Bergson; ce dernier influençant considérablement Mussolini), de la volonté (que l'on oppose chez les dissidents radicaux du socialisme à la doctrine sociale-démocrate et marxiste du déterminisme) et la vitalité (thématique issue de la “philosophie de la Vie”, tant dans ses interprétations laïques que catholiques).
Une question nous semble dès lors légitime: cette évolution est-elle 1) marginale, réduite à des théoriciens ou à des cénacles intellectuels, ou bien 2) est-elle vraiment bien capillarisée dans le parti? Steven Aschheim, en concluant son enquête minutieuse, répond: oui. Il étaye son affirmation sur les résultats d'une enquête ancienne, qu'il a analysée méticuleusement, celle d'Adolf Levenstein en 1914. Levenstein avait procédé en son temps à une étude statistique des livres empruntés aux bibliothèques ouvrières de Leipzig entre 1897 et 1914. Levenstein avait constaté que les livres de Nietzsche étaient beaucoup plus lus que ceux de Marx, Lassalle ou Bebel, figures de proue de la sociale-démocratie officielle. Cette étude prouve que le nietzschéisme socialiste était une réalité dans le cœur des ouvriers allemands.
«Die Jungen» de Bruno Wille, «Der Sozialist» de Gustav Landauer
En Allemagne, la première organisation socialiste/nietzschéenne était Die Jungen (Les Jeunes) de Bruno Wille. Celui-ci entendait combattre l'“accomodationnisme” de la sociale-démocratie, son embourgeoisement (rejoignant par là Roberto Michels, analyste de l'oligarchisation des partis), le culte du parlementarisme (rejoignant Sorel et anticipant les deux plus célèbres soréliens allemands d'après 1918: Ernst Jünger et Carl Schmitt), l'ossification du parti et sa bureaucratisation (Michels). Plus précisément, Wille déplore la disparition de tous les réflexes créatifs dans le parti; l'imagination n'est plus au pouvoir dans la sociale-démocratie allemande du début de notre siècle, tout comme aujourd'hui, avec l'accession au pouvoir des anciens soixante-huitards, l'imagination, pourtant bruyamment promise, n'a plus du tout droit au chapitre, “political correctness” oblige. Ensuite, autre contestataire fondamental dans les rangs socialistes allemands, Gustav Landauer (1870-1919), qui tombera les armes à la main dans Munich investie par les Corps Francs de von Epp, fonde une revue libertaire, socialiste et nietzschéenne, qu'il baptise Der Sozialist. Chose remarquable, son interprétation de Nietzsche ignore le culte nietzschéen de l'égoïté, l'absence de toute forme de solidarité ou de communauté chez le philosophe de Sils-Maria, pour privilégier très fortement sa fantaisie créatrice et sa critique de toutes les pétrifications à l'œuvre dans les sociétés et les civilisations modernes et bourgeoises.
Max Maurenbrecher et Lily Braun
Max Maurenbrecher (1874-1930), est un pasteur protestant socialiste qui a foi dans le mouvement ouvrier tout en se référant constamment à Nietzsche et à sa critique du christianisme. La première intention de Maurenbrecher a été justement de fusionner socialisme, nietzschéisme et anti-christianisme. Son premier engagement a lieu dans le Nationalsozialer Verein de Naumann en 1903. Son deuxième engagement le conduit dans les rangs de la sociale-démocratie en 1907, au moment où il quitte aussi l'église protestante et s'engage dans le “mouvement religieux libre”. Son troisième engagement est un retour vers son église, un abandon de toute référence à Marx et à la sociale-démocratie, assortis d'une adhésion au message des Deutschnationalen. Maurenbrecher incarne donc un parcours qui va du socialisme au nationalisme.
Lily Braun, dans l'univers des intellectuels socialistes du début du siècle, est une militante féministe, socialiste et nietzschéenne. Elle s'engage dans les rangs sociaux-démocrates, où elle plaide la cause des femmes, réclame leur émancipation et leur droit au suffrage universel. Ce féminisme est complété par une critique systématique de tous les dogmes et par une esthétique nouvelle. Son apport philosophique est d'avoir défendu l'“esprit de négation” (Geist der Verneinung), dans le sens où elle entendait par “négation”, la négation de toute superstructure, des ossifications repérables dans les superstructures sociales. En ce sens, elle annonce certaines démarches de l'Ecole de Francfort. Lily Braun plaidait en faveur d'une juvénilisation permanente de la société et du socialisme. Elle s'opposait aux formes démobilisantes du moralisme kantien. Pendant la première guerre mondiale, elle développe un “socialisme patriotique” en arguant que l'Allemagne est la patrie de la sociale-démocratie, et qu'en tant que telle, elle lutte contre la France bourgeoise, l'Angleterre capitaliste et marchande et la Russie obscurantiste. Son néo-nationalisme est une sociale-démocratie nietzschéanisée perçue comme nouvelle idéologie allemande. La constante du message de Lily Braun est un anti-christianisme conséquent, dans le sens où l'idéologie chrétienne est le fondement métaphysique des superstructures en Europe et que toute forme de fidélité figée aux idéologèmes chrétiens sert les classes dirigeantes fossilisées à maintenir des superstructures obsolètes.
Contre le socialisme nietzschéen, la riposte des “bonzes”
Avec Max Maurenbrecher et Lily Braun, nous avons donc deux figures maximalistes du socialisme allemand qui évoluent vers le nationalisme, par nietzschéanisation. Cette évolution, les “bonzes” du parti l'observent avec grande méfiance. Ils perçoivent le danger d'une mutation du socialisme en un nationalisme populaire et ouvrier, qui rejette les avocats, les intellectuels et les nouveaux prêtres du positivisme sociologique. Les “bonzes” organisent donc leur riposte intellectuelle, qui sera une réaction anti-nietzschéenne. Le parallèle est facile à tracer avec la France actuelle, où Luc Ferry et Alain Renaut critiquent l'héritage de mai 68 et du nietzschéisme français des Deleuze, Guattari, Foucault, etc. Le mitterrandisme tardif, très “occidentaliste” dans ses orientations (géo)politiques, s'alignent sur la contre-révolution moraliste américaine et sur ses avatars de droite (Buchanan, Nozick) ou de gauche, en s'attaquant à des linéaments philosophiques capables de ruiner en profondeur —et définitivement— les assises d'une civilisation moribonde, qui crève de sa superstition idéologique et de son adhésion inconditionnelle aux idéaux fluets et chétifs de l'Aufklärung. L'intention de Ferry et Renaut est sans doute de bloquer le nietzschéisme français, afin qu'il ne se mette pas au service du lepénisme ou d'un nationalisme post-lepéniste. Démarche bizarre. Curieux exercice. Plus politicien-policier que philosophique...
Kurt Eisner: nietzschéen repenti
L'exemple historique le plus significatif de ce type de réaction, nous le trouvons chez Kurt Eisner, Président de cette République des Soviets de Bavière (Räterepublik), qui sera balayée par les Corps Francs en 1919. Avant de connaître cette aventure politique tragique et d'y laisser la vie, Eisner avait écrit un ouvrage orthodoxe et anti-nietzschéen, intitulé Psychopathia Spiritualis, qui a comme plus remarquable caractéristique d'être l'œuvre d'un ancien nietzschéen repenti! Quels ont été les arguments d'Eisner? Le socialisme est rationnel et pratique, disait-il, tandis que Nietzsche est rêveur, onirique. Il est donc impossible de construire une idéologie socialiste cohérente sur l'égocentrisme de Nietzsche et sur son absence de compassion (ce type d'argument sera plus tard repris par certains nationaux-socialistes!). Ensuite, Eisner constate que l'“impératif nietzschéen” conduit à la dégénérescence des mœurs et de la politique (même argument que le “conservateur” Steding). A l'injonction “devenir dur!” de Nietzsche, Eisner oppose un “devenir tendre!”, pratiquant de la sorte un exorcisme sur lui-même. Eisner dans son texte avoue avoir succombé au “langage intoxicateur” et au “style narcotique” de Nietzsche. Contrairement à Lily Braun et polémiquant sans doute avec elle, Eisner s'affirme kantien et explique que son kantisme est paradoxalement ce qui l'a conduit à admirer Nietzsche, car, pour Eisner, Kant, tout comme Nietzsche, met l'accent sur le développement libre et maximal de l'individu, mais, ajoute-t-il, l'impératif nietzschéen doit être collectivisé, de façon à susciter dans la société et la classe ouvrière un pan-aristocratisme (Heinrich Härtle, ancien secrétaire d'Alfred Rosenberg, développera un argumentaire similaire, en décrivant l'idéologie nationale-socialiste comme un mixte d'impératif éthique kantien et d'éthique du surpassement nietzschéenne, le tout dans une perspective non individualiste!).
Si Eisner est le premier nietzschéen à faire machine arrière, à amorcer dans le camp socialiste une critique finalement “réactionnaire” et “figeante” de Nietzsche et du socialisme nietzschéen, si Ferry et Renaut sont ses héritiers dans la triste France du mitterrandisme tardif, Georg Lukacs, avec une trilogie inquisitoriale fulminant contre les mutliples formes d'“irrationalisme” conduisant au “fascisme”, demeure la référence la plus classique de cette manie obsessionnelle et récurrente de biffer les innombrables strates de nietzschéisme. Pourtant, Lukacs était vitaliste dans sa jeunesse et cultivait une vision tragique de l'homme, de la vie et de l'histoire inspirée de Nietzsche; après 1945, il rédige cette trilogie contre les irrationalismes qui deviendra la bible de la “political correctness” de Staline à Andropov et Tchernenko dans les pays du COMECON, chez les marxistes qui se voulaient orthodoxes. Pourtant, les traces du nietzschéisme sont patentes dans la gauche nietzschéenne, chez Bloch et dans l'Ecole de Francfort.
Les gauchistes nietzschéens
Par gauchisme nietzschéen, Aschheim entend l'héritage d'Ernst Bloch et d'une partie de l'Ecole de Francfort. Ernst Bloch a eu une grande influence sur le mouvement étudiant allemand qui a précédé l'effervescence de mai 68. Une amitié fidèle et sincère le liait au leader de ces étudiants contestataires, Rudy Dutschke, apôtre protestant d'un socialisme gauchiste et national. Bloch opère une distinction fondamentale entre “marxisme froid” et “marxisme chaud”. Ce dernier postule un retour à la religion, ou, plus exactement, à l'utopisme religieux des anabaptistes, mus par le “principe espérance”. Lukacs ne ménagera pas ses critiques, et s'opposera à Bloch, jugeant son œuvre comme “un mélange d'éthique de gauche avec une épistémologie de droite”. Bloch est toutefois très critique à l'égard de la vision de Nietzsche qu'avait répandue Ludwig Klages. Bloch la qualifiera de “dionysisme passéiste”, en ajoutant que Nietzsche devait être utilisé dans une perspective “futuriste”, afin de “modeler l'avenir”. Bloch rejette toutefois la notion d'éternel retour car toute idée de “retour” est profondément statique: Bloch parle d'“archaïsme castrateur”. Le dionysisme que Bloch oppose à celui de Klages est un dionysisme de la “nature inachevée”, c'est-à-dire un dionysisme qui doit travailler à l'achèvement de la nature.
Bloch n'appartient pas à l'Ecole de Francfort; il en est proche; il l'a influencée mais ses idées religieuses et son “principe espérance” l'éloignent des deux chefs de file principaux de cette école, Horkheimer et Adorno. Les puristes de l'Ecole de Francfort ne croient pas à la rédemption par le principe espérance, car, disent-il, ce sont là des affirmations para-religieuses et a-critiques. Dans leurs critiques des idéologies (y compris des idéologies post-marxistes), les principaux protagonistes de l'Ecole de Francfort se réfèrent surtout au “Nietzsche démasquant”, dont ils utilisent les ressources pour démasquer les formes d'oppression dans la modernité tardive. Leur but est de sauver la théorie critique, et même toute critique, pour exercer une action dissolvante sur toutes les superstructures léguées par le passé et jugées obsolètes. Dans ce sens, Nietzsche est celui qui défie au mieux toutes les orthodoxies, celui dont le “langage démasquant” est le plus caustique; Adorno justifiait ses références à Nietzsche en disant: «Il n'est jamais complice avec le monde». A méditer si l'on ne veut pas être le complice du “Nouvel Ordre Mondial”...
Marcuse: un nietzschéisme de libération
Quant à Marcuse, souvent associé à l'Ecole de Francfort, que retient-il de Nietzsche? L'historiographie des idées retient souvent deux Marcuse: un Marcuse pessimiste, celui de L'homme unidimensionnel, et un Marcuse optimiste, celui d'Eros et civilisation. Pour Steven Aschheim, c'est ce Marcuse optimiste —il met beaucoup d'espoir dans son discours— qui est peut-être le plus “nietzschéen”. Son nietzschéisme est dès lors un nietzschéisme de libération, teinté de freudisme, dans le sens où Marcuse développe, au départ de sa double lecture de Nietzsche et de Freud, l'idée d'un “pouvoir libérateur du souvenir”. Jadis, la mémoire servait à se souvenir de devoirs, d'autant de “tu dois”, suscitant tout à la fois l'esprit de péché, la mauvaise conscience, le sens de la culpabilité, sur lesquels le christianisme s'est arcbouté et a imprégné notre civilisation. Cette mémoire-là “transforme des faits en essences”, fige des bribes d'histoire peut-être encore féconds pour en faire des absolus métaphysiques pétrifiés et fermés, qu'on ne peut plus remettre en question; pour Nietzsche, comme pour le Marcuse optimiste d'Eros et civilisation, il faut évacuer les brimades et les idoles qu'a imposées cette mémoire-là, car les instincts de vie (pour Freud: l'aspiration au bonheur total, entravée par la répression et les refoulements), doivent toujours, finalement, avoir le dessus, en rejettant sans hésiter toutes les formes d'“escapismes” et de négation. Pour Marcuse, en cela élève de Nietzsche, la civilisation occidentale et son pendant socialiste soviétique (Nietzsche aurait plutôt parlé du christianisme) sont fondamentalement fallacieux (parce que sur-répressifs) (*) car ils conservent trop d'essences, d'interdits, et étouffent les créativités, l'Eros. On retrouve là les mêmes mécanismes de pensée que chez un Landauer.
La “science mélancolique” d'Adorno
Adorno, dans Minima Moralia, se réfère à la dialectique négative de Nietzsche et se félicite du fait que cette négation nietzschéenne permanente ne conduit à l'affirmation d'aucune positivité qui, le cas échéant, pourrait se transformer en une nouvelle grande idole figée. Mais, Adorno, contrairement à Nietzsche, ne prône pas l'avènement d'un “gai savoir” ou d'une “gaie science”, mais espère l'avènement d'une “science mélancolique”, sorte de scepticisme méfiant à l'endroit de toute forme d'affirmation joyeuse. Adorno se démarque ainsi du “panisme” de Bloch, des idées claires et tranchées d'un Wille ou d'une Lily Braun, du communautarisme socialiste d'un Landauer ou, anticipativement, du “gai savoir” d'un philosophe nietzschéen français comme Gilles Deleuze. Pour Adorno, la joie ne doit pas tout surplomber.
Pour Aschheim, l'Ecole de Francfort adopte alternativement deux attitudes face à ce que Lukacs, dans sa célèbre polémique pro-rationaliste, a qualifié d'“irrationalisme”. Selon les circonstances, l'Ecole de Francfort distingue entre, d'une part, les irrationalismes féconds, qui permettent la critique des superstructures (dans ce qu'elles ont de figé) et/ou des institutions (dans ce qu'elles ont de rigide) et, d'autre part, les irrationalismes réactionnaires qui affirment brutalement des valeurs en dépit de leur obsolescence et de leur fonction au service du maintien de hiérarchies désuètes.
A quoi sert la “political correctness”?
Aschheim constate que l'idéologie des Lumières introduit et généralise dans la pensée européenne le relativisme, le subjectivisme, etc. qui développent, dans un premier temps, une dynamique critique, puis retournent cette dynamique contre le sujet érigé comme absolu dans la civilisation occidentale par les tenants de l'Aufklärung eux-mêmes. Ce que Ferry a appelé la “pensée-68” est justement cette idéologie des Lumières qui devient justement sans cesse plus intéressante, en ses stades ultimes, parce qu'elle retourne sa dynamique relativiste et perspectiviste contre l'idole-sujet. Ferry estime que ce retournement est allé trop loin, dans les œuvres de philosophes français tels Deleuze, Guattari, Foucault,... La “pensée-68” sort donc de l'Aufklärung stricto sensu et travaille à dissoudre le sacro-saint sujet, pierre angulaire des régimes libéraux, pseudo-démocratiques, nomocratiques et/ou ploutocratiques, axés sur l'individualisme juridique, sur la méthodologie individualiste en économie et en sociologie. Par conséquent, contre l'avancée de l'Aufklärung jusqu'à ses conséquences ultimes, avancée qui risque de faire voler en éclat des cadres institutionnels vermoulus qui ne peuvent plus se justifier philosophiquement, un personnel composite de journalistes, de censeurs médiatiques, de fonctionnaires, de juristes et de philosophes-mercenaires doit imposer une “correction politique”, afin de restituer le sujet dans sa plénitude et sa “magnificence” d'idole, afin de promouvoir et de consolider une restauration néo-libérale.
Revenons toutefois à Aschheim, qui cherche à remettre clairement en évidence les linéaments de nietzschéisme dans l'Ecole de Francfort, tout en montrant par quelles portes entrouvertes la correction politique, sur le modèle des Mehring, Eisner, Lukacs, Ferry, etc., peut simultanément s'insinuer dans ce discours. Horkheimer, chef de file de cette Ecole de Francfort et philosophe quasi officiel de la première décennie de la RFA, juge Nietzsche comme suit: le philosophe de Sils-Maria est incapable de reconnaître l'importance de la “société concrète” (**) dans ses analyses, mais, en dépit de cette lacune, inacceptable pour ceux qui ont été séduits, d'une façon ou d'une autre, par le matérialisme historique de la tradition marxiste, Nietzsche demeure toujours libre de toute illusion et voit et sent parfaitement quand un fait de vie se fige en “essence” (pour reprendre le vocabulaire de Marcuse). Horkheimer ajoute que Nietzsche “ne voit pas les origines sociales des déclins”. Position évidemment ambivalente, où admiration et crainte se mêlent indissolublement.
Nietzsche, le maître en “misologie”
En 1969, J. G. Merquior, dans Western Marxism, ouvrage qui analyse les ressorts du “marxisme occidental”, rappelle le rôle joué par les diverses lectures de Nietzsche dans l'émergence de ce phénomène un peu paradoxal de l'histoire des idées; Nietzsche, disait Merquior, est un “maître en misologie” (néologisme désignant l'opposition radicale des irrationalistes à l'endroit de la raison voire de la logique). Cette misologie transparaît le plus clairement dans la Généalogie de la morale (1887), où Nietzsche dit que “n'est définissable que ce qui n'a pas d'histoire”; en effet, on ne peut enfermer dans des concepts durables que ce qui n'a plus de potentialités en jachère, car des potentialités insoupçonnées peuvent à tout moment surgir et faire éclater le cadre définitionnel comme une écorce devenue trop étroite.
Notre point de vue dans ce débat sur l'Ecole de Francfort: cette école critique à juste titre l'étroitesse des vieilles institutions, lois, superstructures, qui se maintiennent envers et contre les mouvements de la vie, mais, dans la foulée de sa critique, elle heurte et tente d'effacer des legs de l'histoire qui gardent en jachère des potentialités réelles, en les jugeant a priori obsolètes. Elle n'utilise qu'une panoplie d'armes, celles de la seule critique, en omettant systématiquement de retourner les forces vives et potentielles des héritages historiques contre les fixations superstructurelles, les manifestations institutionnelles reflètant dans toutes leurs rigidités les épuisements vitaux, et les processus de dévitalisation (ou de désenchantement). Bloch, en dépit de ses références aux théologies de libération et aux messianismes révolutionnaires, abandonne au fond lui aussi l'histoire politique, militaire et non religieuse —c'est du moins le risque qu'il court délibérément en déployant sa critique contre Klages— pour construire dans ses anticipations quasi oniriques un futur somme toute bien artificiel voire fragile. Son recours aux luttes est à l'évidence pleinement acceptable, mais ce recours ne doit pas se limiter aux seules révoltes motivées par des messianismes religieux, il doit s'insinuer dans des combats pluriséculaires à motivations multiples. Adorno et Horkheimer abandonnent eux aussi l'histoire, la notion d'une continuité vitale et historique, au profit du magma informe et purement “présent”, sans profondeur temporelle, de la “société” (erreur que l'on a vu se répéter récemment au sein de la fameuse “nouvelle droite” parisienne, où l'histoire est étrangement absente et le pilpoul sociologisant, nettement omniprésent). Le risque de ce saltus pericolosus, d'Adorno et Horkheimer, dit Siegfried Kracauer (in: History: The Last Things Before the Last, New York, OUP, 1969), est de perdre tout point d'appui solide pour capter les plus fortes concrétions en devenir qui seront marquées de durée; pour Kracauer la “dialectique négative” des deux principaux parrains de l'Ecole de Francfort “manque de direction et de contenu”. Tout comme les ratiocinations jargonnantes et sociologisantes d'Alain de Benoist et de sa bande de jeunes perroquets.
L'entreprise de “dé-nietzschéanisation” de Habermas
Si Nietzsche a été bel et bien présent, et solidement, dans le corpus de l'Ecole de Francfort, il en a été expulsé par une deuxième vague de “dialecticiens négatifs” et d'apôtres, sur le tard, de l'idéologie des Lumières. Le chef de file de cette deuxième vague, celle des émules, a été sans conteste Jürgen Habermas. Aschheim résume les objectifs de Habermas dans son travail de “dé-nietzschéanisation”: a) œuvrer pour expurger les legs de l'Ecole de Francfort de tout nietzschéisme; b) rétablir une cohérence rationnelle; c) re-coder (!) (Deleuze et Foucault avaient dissous les codes); d) reconstruire une “correction politique”; e) réexaminer l'héritage de mai 68, où, pour notre regard, il y a quelques éléments très positifs et féconds, surtout au niveau de ce que Ferry et Renaut appelerons la “pensée-68”; dans ce réexamen, Habermas part du principe que la critique de la critique de l'Aufklärung, risque fortement de déboucher sur un “néo-conservatisme”; de ce fait, il entend militer pour le rétablissement de la “dialectique de l'Aufklärung” dans sa “pureté” (ou dans ce qu'il veut bien désigner sous ce terme). Pour Habermas, le nietzschéisme français, le néo-heideggerisme, le post-structuralisme de Foucault, le déconstructivisme de Derrida, sont autant de filons de 68 qui ont chaviré dans “l'irrationalisme bourgeois tardif”. Or ces démarches philosophiques non-politiques, ou très peu politisables, ne se posent nullement comme des options militantes en faveur d'un conservatisme ou d'une restauration “bourgeoise”, bien au contraire, on peut conclure que Habermas déclenche une guerre civile à l'intérieur même de la gauche et cherche à émasculer celle-ci, à la repeindre en gris. Dans son combat, Habermas s'attaque explicitement aux notions d'hétérogénité (de pluralité), de jeu (de tragique, de kaïros tel que l'imaginait un Henri Lefebvre), de rire, de contradiction (implicite et incontournable), de désir, de différence. Selon Habermas, toutes ces notions conduisent soit au “gauchisme radical” soit à l'“anarchisme nihiliste” soit au “quiétisme conservateur”. De telles attitudes, prétend Habermas, sont incapables d'envisager un changement chargé de sens (i. e. un sens progressiste et modéré, évolutionnaire et calculant). D'où Habermas, et à sa suite Ferry et Renaut, estiment être les seuls habilités à énoncer le sens, lequel est alors posé a priori, imposé d'autorité. Le libéralisme ou le démocratisme que habermas, Ferry et Renaut entendent représenter sont dès lors les produits d'une autorité, en l'occurence la leur et celle de ceux qui les relaient dans les médias.
Le libéralisme et le démocratisme autoritaires (sur le plan intellectuel), mais en apparence tolérants sur le plan pratique, constituent en fait le fondement de notre actuelle “political correctness” qui se marie très bien avec le pouvoir des “socialistes établis”, héritiers du social-démocratisme à la Mehring, et flanqués des orthodoxes marxistes dévitalisés à la Lukacs. Cette alliance vise à remplacer un autoritarisme par un autre, une superstructure par une autre, qui serait le réseau des notables, des mafieux et des fonctionnaires socialistes. Une telle constellation idéologique renonce à émanciper continuellement les masses, les citoyens, les esprits mais entend installer un appareil inamovible (au besoin en noyautant les services de police, comme c'est le cas des socialistes en Belgique qui transforment la gendarmerie, déjà Etat dans l'Etat, en une armée au service du ministère de l'intérieur socialiste, tenu par un ancien gauchiste adepte de la marijuana). Cette constellation idéologique et politique refuse de réceptionner l'innovation, de quelqu'ordre qu'elle soit, et les rénégats de 68, les repentis à la façon d'Eisner, trahissent les intellectuels féconds de leur propre camp de départ, pour déboucher sur un discours sans relief, sans sel.
Donc l'aventure commencée par Die Jungen autour de Wille est un échec au sein de la sociale-démocratie. Ses forces dynamiques vont-elles aller vers un nouveau fascisme? Il semble que la sociale-démocratie n'écoute pas les leçons de l'histoire et qu'en alignant à l'université des Habermas, des Ferry et des Renaut, ou en manipulant des groupes de choc violents, ou en animant des cercles conspirationnistes parallèles comme le CRIDA de “René Monzat”, elle prépare un nouvel autoritarisme, qu'en d'autres temps elle n'aurait pas hésiter à qualifier de “fascisme”. Dans toute tradition politico-intellectuelle, il faut laisser la porte ouverte au dynamisme juvénile, immédiatement réceptif aux innovations. Une telle ouverture est une nécessité voire un impératif de survie. Dans le cas de la sociale-démocratie, si ce dynamisme juvénile ne peut s'exprimer dans des revues, des cercles, des associations, des mouvements de jeunesse liés au parti, il passera forcément “à droite” (ce qui n'est jamais qu'une convention de langage), parce que la gauche-appareil ne cesse de demeurer sourde à ses revendications légitimes. Aujourd'hui, ce passage “à droite” est possible dans la mesure où la “droite” est démonisée au même titre que l'anarchisme au début du siècle. Et les démonisations fascinent les incompris.
Nietzsche et la “droite”
Avant 1914, la droite allemande la plus bruyante est celle des pangermanistes, qui ne se réfèrent pas à Nietzsche, parce que celui-ci n'évoque ni la race ni la germanité. Lehmann pensait que Nietzsche restait en dehors de la politique et qu'il était dès lors inutile de se préoccuper de sa philosophie. Paul de Lagarde ne marque pas davantage d'intérêt. Quant à Lange, il est férocement anti-nietzschéen, dans la mesure où il affirme que la philosophie de Nietzsche est juste bonne “pour les névrosés et les littérateurs”, “les artistes et les femmes hystériques”. A Nietzsche, il convient d'opposer Gobineau et de parier ainsi pour le sang, valeur sûre et stable, contre l'imagination, valeur déstabilisante et volatile. Otto Bonhard, pour sa part, réfute l'“anarchisme nietzschéen”.
C'est sous l'impulsion d'Arthur Moeller van den Bruck que Nietzsche fera son entrée dans les idéologies de la droite allemande. Moeller van den Bruck part d'un premier constat: le défaut majeur du marxisme (i. e. l'appareil social-démocrate) est de ne se référer qu'à un rationalisme abstrait, comme le libéralisme. De ce fait, il est incapable de capter les véritables “sources de la vie”. En 1919, la superstructure officielle de l'empire allemand s'effondre, non pas tant par la révolution, comme en Russie, mais par la défaite et par les réparations imposées par les Alliés occidentaux. L'Armée est hors jeu. Inutile donc de défendre des structures politiques qui n'existent plus. La droite doit entrer dans l'ère des “re-définitions”, estime Moeller van den Bruck, et à sa suite on parlera de “néo-nationalisme”.
Si tout doit être redéfini, le socialisme doit l'être aussi, aux yeux de Moeller. Celui-ci ne saurait plus être une “analyse objective des rapports entre la superstructure et la base”, comme le voulait l'idéologie positiviste de la sociale-démocratie d'après le programme du Gotha, mais une “volonté d'affirmer la vie”. En disant cela, Moeller ne se contente pas d'une déclamation grandiloquente sur la “vie”, de proclamer un slogan vitaliste, mais dévoile les aspects très concrets de cette volonté de vie: une juste redistribution permet un essor démographique. La vie triomphe alors de la récession. Dès lors, ajoute Moeller, les clivages sociaux ne devraient plus passer entre des riches qui dominent et des masses de pauvres. Au contraire, le peuple doit être dirigé par une élite frugale, apte à diriger des masses dont les besoins élémentaires et vitaux sont bien satisfaits. Ce processus doit se dérouler dans des cadres nationaux visibles, assurant une transparence, et, bien entendu, clairement circonscrits dans le temps et l'espace pour que le principe “nul n'est censé ignorer la loi” soit en vigueur sans contestation ni coercition.
Même raisonnement chez Werner Sombart: le nouveau socialisme s'oppose avec véhémence à l'hédonisme occidental, au progressisme, à l'utilitarisme. Le nouveau socialisme accepte le tragique, il est non-téléologique, il ne s'inscrit pas dans une histoire linéaire, mais fonde un nouvel “organon”, où fusionnent une vox dei et une vox populi, comme au moyen-âge, mais sans féodalisme ni hiérarchie rigide.
Spengler et Shaw
Pour Spengler, on doit évaluer positiviement le socialisme dans la mesure où il est avant toute chose une “énergie” et, accessoirement, le “stade ultime du faustisme déclinant”. Spengler estime que Nietzsche n'a pas été jusqu'au bout de ses idées sur le plan politique. Ce sera Georges Bernard Shaw, notamment dans Man and Superman et Major Barbara, qui énoncera les méthodes pratiques pour asseoir le socialisme nietzschéen dans les sociétés européennes: mélange d'éducation sans moralisme hypocrite, de darwinisme tourné vers la solidarité (où les communautés les plus solidaires gagnent la compétition), d'ironie et de distance par rapport aux engouements et aux propagandes. Shaw, en annexe de son drame Man and Superman, publie ses Maxims for Revolutionists, rappelle que la “démocratie remplace la désignation d'une minorité corrompue par l'élection d'un grand nombre d'incompétents”, que la “liberté ne signifie [pas autre chose] que la responsabilité et que, pour cette raison, la plupart des hommes la craignent”; enfin: “l'homme raisonnable est celui qui s'adapte au monde; l'hommer irraisonnable est celui qui persiste à essayer d'adapter le monde à lui-même. C'est pourquoi le progrès dépend tout entier de l'homme raisonnable. L'homme qui écoute la Raison est perdu: le Raison transforme en esclaves tous ceux dont l'esprit n'est pas assez fort pour la maîtriser”. “Le droit de vivre est une escroquerie chaque fois qu'il n'y a pas de défis constants”. “La civilisation est une maladie provoquée par la pratique de construire des sociétés avec du matériel pourri”. “La décadence ne trouvera ses agents que si elle porte le masque du progrès”.
Le socialisme doit donc être forgé par des esprits clairs, dépourvus de tous réflexes hypocrites, de tout ballast moralisant, de toutes ces craintes “humaines trop humaines”. Dans ce cas, conclut Spengler à la suite de sa lecture de Shaw, le “socialisme ne saurait être un système de compassion, d'humanité, de paix, de petits soins, mais un système de volonté-de-puissance”. Toute autre lecture du socialisme serait illusion. Il faut donner à l'homme énergique (celui qui fait passer ses volontés de la puissance à l'acte), la liberté qui lui permettra d'agir, au-delà de tous les obstacles que pourraient constituer la richesse, la naissance ou la tradition. Dans cette optique, liberté et volonté de puissance sont synonymes: en français, le terme “puissance” ne signifie pas seulement la volonté d'exercer un pouvoir, mais aussi la volonté de faire passer mes potentialités dans le réel, de faire passer à l'acte, ce qui est en puissance en moi. Définition de la puissance qu'il convient de méditer, —et pourquoi pas à l'aide des textes ironiques de Shaw?— à l'heure où la “correction politique” constitue un retour des hypocrisies et des moralismes et un verrouillage des énergies innovantes.
Aschheim montre dans son livre le lien direct qui a existé entre la tradition socialiste anglaise, en l'occurence la Fabian Society animée par Shaw, et la redéfinition du socialisme par les premiers tenants de la “révolution conservatrice” allemande. Dénominateur commun: le refus de conventions stérilisantes qui bloquent l'avancée des hommes “énergiques”.
Nietzsche et le national-socialisme
Au départ, Nietzsche n'avait pas bonne presse dans les milieux proches de la NSDAP, qui reprend à son compte les critiques anti-nietzschéennes des pangermanistes, des eugénistes et des idéologues racialistes. Les intellectuels de la NSDAP poursuivent de préférence les spéculations raciales de Lehmann et se désintéressent de Nietzsche, plus en vogue dans les gauches, chez les littéraires, les féministes et dans les mouvements de jeunesse non politisés. Ainsi, au tout début de l'aventure hitlérienne, Dietrich Eckart, le philosophe folciste (= völkisch) de Schwabing, rejette explicitement et systématiquement Nietzsche, qui est “un malade par hérédité”, qui a médit sans arrêt du peuple allemand; pour Eckart, la légende d'un Nietzsche qui vitupère contre l'Allemagne parce qu'il l'aime au fond passionément est une escroquerie intellectuelle. Enfin, constate-t-il, l'individualisme égoïste de Nietzsche est totalement incompatible avec l'idéal communautaire des nationaux-socialistes. Après avoir édité des exégèses de Nietzsche pourtant bien plus fines, Arthur Drews, théologien folciste inféodé à la NSDAP, s'insurge en 1934 dans Nordische Stimme (n°4/34), contre la thèse d'un Nietzsche qui aime son pays malgré ses vitupérations anti-germaniques et affirme —ce qui peut paraître paradoxal— que le jeune poète juif Heinrich Heine, lui, critiquait l'Allemagne parce qu'il l'aimait réellement. Nietzsche est ensuite accusé de “philo-sémitisme”: pour Aschheim et, avant lui, pour Kaufmann, le texte le plus significatif de l'ère nazie en ce sens est celui de Curt von Westernhagen, Nietzsche, Juden, Antijuden (Weimar, Duncker, 1936). Alfred von Martin, critique protestant, revalorise l'humaniste Burckhardt et rejette le négativisme nietzschéen, plus pour son manque d'engagement nationaliste que pour son anti-christianisme (Nietzsche und Burckhardt, Munich, 1941)! Finalement, les deux auteurs pro-nietzschéens sous le Troisième Reich, outre Bäumler que nous analyserons plus en détail, sont Edgar Salin (Jacob Burckhardt und Nietzsche, Bâle, 1938), qui prend le contre-pied des thèses de von Martin, et le nationaliste allemand, liguiste (= bündisch) et juif, Hans-Joachim Schoeps (Gestalten an der Zeitwende: Burckhardt, Nietzsche, Kafka, Berlin, Vortrupp Verlag, 1936). Quant au critique littéraire Kurt Hildebrandt, favorable au national-socialisme, il critique l'interprétation de Nietzsche par Karl Jaspers, comme le feront bon nombre d'exilés politiques et Walter Kaufmann. Jaspers aurait développé un existentialisme sur base des aspects les moins existentialistes de Nietzsche. Tandis que Nietzsche s'opposait à toute transcendance, Jaspers tentait de revenir à une “transcendance douce”, en négligant le Zarathoustra et la Généalogie de la morale. Enfin, plus important, l'apologie de la créativité chez Nietzsche et sa volonté de transvaluer les valeurs en place, de faire éclore une nouvelle table des valeurs, font de lui un philosophe de combat qui vise à normer une nouvelle époque émergeante. Dans ce sens, Nietzsche n'est pas un intellectuel virevoltant (freischwebend) au gré de ses humeurs ou de ses caprices, mais celui qui jette les bases d'un système normatif et d'une communauté positive, dont les assises ne sont plus un ensemble fixe de dogmes ou de commandements (de “tu dois”), mais un dynamisme bouillonant et effervescent qu'il faut chevaucher et guider en permanence (Kurt Hildebrandt, «Über Deutung und Einordnung von Nietzsches System», Kant-Studien, vol. 41, Nr. 3/4, 1936, pp. 221-293). Ce chevauchement et ce guidage nécessitent une éducation nouvelle, plus attentive aux forces en puissance, prêtes à faire irruption dans la trame du monde.
Plus explicite sur les variations innombrables et contradictoires des interprétations de Nietzsche sous le Troisième Reich, est le livre du philosophe italien Giorgio Penzo (cf. supra), pour qui l'époque nationale-socialiste procède plus généralement à une dé-mythisation de Nietzsche. On ne sollicite plus tant son œuvre pour bouleverser des conventions, pour ébranler les assises d'une morale sociale étriquée, mais pour la réinsérer dans l'histoire du droit, ou, plus partiellement, pour faire du surhomme nietzschéen un simple équivalent de l'homme faustien ou, chez Kriek, l'horizon de l'éducation. On assiste également à des démythisations plus totales, où l'on souligne l'infécondité fondamentale de l'anarchisme nietzschéen, dans lequel on décèle une “pathologie de la culture qui conduit à la dépolitisation”. Ce reproche de “dépolitisation” trouve son apothéose chez Steding. D'autres font du surhomme l'expression d'une simple nostalgie du divin. L'époque connaît bien sûr ses “lectures fanatiques”, dit Penzo, où l'incarnation du surhomme est tout bonnement Hitler (Scheuffler, Oehler, Spethmann, Müller-Rathenow). Seule notable exception, dans ce magma somme toute asses confus, le philosophe Alfred Bäumler.
Bäumler: héroïsme réaliste et héraclitéen
La seule approche féconde de Nietzsche à l'ère nationale-socialiste est donc celle de Bäumler. Pour Bäumler, par ailleurs pétri des thèses de Bachofen, Nietzsche est un “penseur existentiel”, soit un philosophe qui nous invite à nous plonger dans la concrétude sociale, politique et historique. Bäumler ne retient donc pas le reproche de “dépolitiseur”, que d'aucuns, dont Steding, avaient adressé à Nietzsche. Bäumler définit l'“existentialité” comme un “réalisme héroïque” ou un “réalisme héraclitéen”; l'homme et le monde, dans cette perspective, l'homme dans le monde et le monde dans l'homme, sont en devenir perpétuel, soumis à un mouvement continu, qui ne connaît ni repos ni quiétude. Le surhomme est dès lors une métaphore pour désigner tout ce qui est héroïque, c'est-à-dire tout ce qui lutte dans la trame en devenir de l'existence terrestre.
On constate que Bäumler donne la priorité au “Nietzsche agonal” plutôt qu'au “Nietzsche dionysiaque”, qui hérissait Steding, parce qu'il était le principal responsable du refus des formes et des structures politiques. Bäumler estime que Nietzsche inaugure l'ère de la “Grande Raison des Corps”, où la Gebildetheit, ne s'adressant qu'au pur intellect en négligeant les corps, est inauthentique, tandis que la Bildung, reposant sur l'intuition, l'intelligence intuitive, et une valorisation des corps, est la clef de toute véritable authenticité. Notons au passage que Heidegger, ennemi de Bäumler, parlait aussi d'“authenticité” à cette époque. La logique du Corps, qui est une logique esthétique, sauve la pensée, pense Bäumler, car toute la culture occidentale s'est refermée sur un système conceptuel froid qui ne mène plusà rien, système dont la trajectoire a été jalonnée par le christianisme, l'humanisme (basé sur une fausee interprétation, édulcorée et falsifiée, de la civilisation gréco-romaine), le rationalisme scientiste. La notion de Corps (Leib), plus le recours à ce que Bäumler appelle la “grécité véritable”, soit une grécité pré-socratique, de même qu'à une germanité véritable, soit une germanité pré-chrétienne, conduisent à un retour à l'authentique, comme le prouvent, à l'époque, les innovations de la philologie classique. Cette mise en équation entre grécité pré-socratique, germanité pré-chrétienne et authenticité, constitue le saltus periculosus de Bäumler: dénier toute authenticité à ce qui sortait du champs de cette grécité et de cette germanité, a valu à Bäumler d'être ostracisé pendant longtemps, avant d'être timidement réhabilité.
Les impasses philosophiques de la bourgeoisie allemande
Dans un second temps, Bäumler politise cette définition de l'authenticité, en affirmant que le national-socialisme, en tant que Weltanschauung, représente “une conception de l'Etat gréco-germanique”. Bäumler ne se livre pas trop à des rapprochements hasardeux, ni à des sollicitations outrancières. Pourquoi affirme-t-il que l'Etat national-socialiste est grèco-germanique au sens où Nietzsche a défini la corporéité grecque et accepté la valorisation grecque des corps? Pour pouvoir affirmer cela, Bäumler procède à une inteprétation de l'histoire culturelle de la “bourgeoisie allemande”, dont tous les modèles ont été en faillite sous la République de Weimar. L'Aufklärung, première grande idéologie bourgeoise allemande, est une idéologie négative car elle est individualiste, abstraite et ne permet pas de forger des politiques cohérentes. Le romantisme, deuxième grande idéologie de la bourgeoisie allemande, est une tradition positive. Le piétisme, troisième grande idéologie bourgeoise en Allemagne, est rejeté pour les mêmes motifs que l'Aufklärung. Le romantisme est positif parce qu'il permet une ouverture au Volk, au mythe et au passé, donc de dépasser l'individualisme, le positivisme étriqué et la fascination inféconde pour le progrès. Cependant, en gros, la bourgeoisie n'a pas tiré les leçons pratiques qu'il aurait fallu tirer au départ du romantisme. Bäumler reproche à la bourgeoisie allemande d'avoir été “paresseuse” et d'avoir choisi un expédiant; elle a imité et importé des modèles étrangers (anglais ou français), qu'elle a plaqué sur la réalité allemande.
Parmi les bricolages idéologiques bourgeois, le plus important a été le “classicisme allemand”, sorte de mixte artificiel d'Aufklärung et de romantisme, incapable, selon Bäumler, de générer des institutions, un droit et une constitution authentiquement allemands. En rejetant l'Aufklärung et le piétisme, en renouant avec le filon romantique en jachère, explique et espère Bäumler, le national-socialisme pourra “travailler à élaborer des institutions et un droit allemands”. Mais le nouveau régime n'aura jamais le temps de parfaire cette tâche.
Action, destin et décision
Dans l'interprétation bäumlerienne de Nietzsche, la mort de Dieu est synonyme de mort du Dieu médiéval. Dieu en soi ne peut mourir car il n'est rien d'autre qu'une personnification du Destin (Schicksal). Celui-ci suscite, par le biais de fortes personnalités, des formes politiques plus ou moins éphémères. Ces personnalités ne théorisent pas, elles agissent, le destin parle par elles. L'Action détruit ce qui existe et s'est encroûté. La Décision, c'est l'existence même, parce que décider, c'est être, c'est se muer en une porte qu'enfonce le Destin pour se ruer dans la réalité. Ernst Jünger aurait parlé de l'“irruption de l'élémentaire”. Pour Bäumler, le “sujet” a peu de valeur en soi, il n'en acquiert que par son Action et par ses Décisions historiques. Ce déni de la “valeur-en-soi” du sujet fonde l'anti-humanisme de Bäumler, que l'on retrouve, finalement, sous une autre forme et dans un langage marxisé, chez Althusser, par exemple, où la “fonction pratique-sociale” de l'idéologie prend le pas sur la connaissance pure (comme, dans la conception de Bäumler, le plongeon dans la vie réelle se voyait octroyer une bien plus grande importance que la culture livresque de l'idéologie des Lumières ou du classicisme allemand). Pour Althusser, dont la pensée est arrivée à maturité dans un camp de prisonniers en Allemagne pendant la 2ième Guerre mondiale, l'idéologie (la Weltanschauung?), était une instance mouvante, portée par des penseurs en prise sur les concrétudes, qui permettait de mettre en exergue les rapports de l'homme avec les conditions de son existence, de l'aider dans un combat contre les “autorités figées”, qui l'obligeaient à répéter sans cesse, —“sisyphiquement” serait-on tenter de dire—, les mêmes gestes en dépit des mutations s'opérant dans le réel. Pour Althusser, l'idéologie ne peut donc jamais se muer en une science rigide et fermée, ne peut devenir pur discours de représentation, et, en tant que conceptualisation permanente et dynamique des faits concrets, elle conteste toujours le primat de l'autorité politique ou politico-économique installée et établie, tout comme l'“anarchisme” gauchiste et nietzschéen de Landauer refusait les rigidifications conventionnelles, car elles étaient autant de barrages à l'irruption des potentialités en germe dans les communautés concrètes. Enfin, il ne nous paraît pas illégitime de comparer les notions d'“authenticité” chez Bäumler (et Heidegger) et de “concrétude” chez Althusser, et de procéder à une “fertilisation croisée” entre elles.
L'anti-humanisme de Bäumler repose, quant à lui, sur trois piliers, sur trois œuvres: celles de Winckelmann, de Hölderlin et de Nietzsche. Winckelmann a brisé l'image toute faite que les “humanités” avaient donné de l'antiquité grecque à des générations et des générations d'Européens. Winckelmann a revalorisé Homère et Eschyle plutôt que Virgile et Sénèque. Hölderlin a souligné le rapport entre la grécité fondamentale et la germanité. Mais l'anti-humanisme de Bäumler est une “révolution tranquille”, plutôt “métapolitique”, elle avance silencieusement, à pas de colombe, au fur et à mesure que croulent et s'effondrent dogmes, certitudes et représentations figées, notamment celles de l'humanisme, ennemi commun de Bäumler et d'Althusser. Althusser a recours, lui, à la traditionnelle lutte des classes marxistes, mais avec un politburo contrôlé par un “comité scientifique”, capable de déceler les changements, les fulgurances du devenir, dès qu'ils se pointent, même timidement.
Conclusion
Il nous a semblé nécessaire de revenir à ce foisonnement d'interprétations diverses de la philosophie de Nietzsche, qui surgit ou court transversalement à travers tous les champs politico-idéologiques du siècle, pour tenter de répondre à la critique qu'adressent Ferry et Renaut à l'encontre du “nietzschéisme français”, pour nous obliger à revenir à des stabilités politiques jugées “correctes”. Lukacs les avait précédés dans un travail similaire. Tout recours à Nietzsche dans une perspective “révolutionnante”, de facture socialiste-gauchiste ou révolutionnaire-conservatrice, devient aujourd'hui suspect. En Allemagne, ce fut le cas entre 1945 et la moitié des années 80. En France, le recours à Nietzsche, ou le recours simultané à Marx et à Nietzsche, voire à Nietzsche, Marx et Freud, n'a pas été interdit ou boycotté. Un anti-humanisme, une philosophie du soupçon à l'endroit des représentations humanistes, a pu fermement s'installer jusqu'il y a peu de temps en France. C'est contre cet héritage, aujourd'hui oublié à l'ère du prêt-à-penser et des ultra-simplifications télévisées, où l'on est prié de tout dire en quelques secondes, que luttent Renaut et Ferry. Mais Nietzsche est revenu en Allemagne par le biais d'une “gauche nietzschéenne” française qui a séduit une petite phalange de brillants esprits, sur lesquels Habermas a tiré à boulets rouges. Des disciples de Habermas parlaient de “Lacan-can” et de “Derrida-da”, pour laisser sous-entendre que les travaux de ces deux philosophes n'étaient que cancans et dadas. Sur le modèle de la réaction de Franz Mehring ou des reniements de Kurt Eisner, une nouvelle inquisition anti-nietzschéenne se déploie de part et d'autre du Rhin où sévissent, avec un empressement à la fois triste et comique, les “anti-fascistes” habermassiens, mués en défenseurs de bien glauques établissements, et le duo Ferry-Renaut, appuyés par quelques terribles simplificateurs postés dans des officines para-policières. Les cas du philosophe vitaliste Gerd Bergfleth, agressé en ma présence à Francfort par des vitupérateurs délirants, —rapidement remis à leur place par la tchatche et le rire homérique de Günther Maschke (***)— ou de l'éditeur Axel Matthes, qui propose au public allemand d'excellentes traductions de Baudrillard, Artaud, Bataille, etc., sont révélateurs de la violence et de l'hystérie de cette nouvelle inquisition.
Que conclure de cette fresque fort longue mais très incomplète? Que la culture est un tout. Que les interpénétrations et les compénétrations idéologiques, politiques et culturelles sont omniprésentes. Il est en effet impossible de démêler l'écheveau, sans opérer de dangereuses mutilations. Les synthèses sublimes et même les bricolages idéologiques un peu boîteux n'échappent pas à la règle. Nous avons aujourd'hui une gauche qui joue aux inquisiteurs contre les idéologèmes qu'elle étiquette de “droite”, sans se rendre compte, car elle a la mémoire fort courte, que ces mêmes idéologèmes ont été forgés au départ par des hommes de la gauche la plus pure et la plus sublime, que toutes les gauches ont hissés dans leurs propres panthéons! Habermas en Allemagne, ses imitateurs français à Paris, sont en train de castrer les gauches allemande et française, tout en se déclarant de “gauche”, mais d'une gauche bourgeoise, humaniste, illuministe. Nous vivons donc le règne d'une inquisition, d'une prohibition. Mais c'est une gesticulation inutile.
Robert STEUCKERS.
Notes:
(*) Par sur-répression, Marcuse entend l'ensemble des mécanismes et des discours qui permettent aux dominants d'une société d'imposer pour leur seul bénéfice de cruelles contraintes à ceux qu'ils exploitent, dans le désordre et le gaspillage, en imposant aux dominés un “sur-travail”. Cette logique nietzschéo-marcusienne pourrait servir à juger les dominants actuels, jonglant avec les mécanismes de la partitocratie, qui excluent de larges strates de leurs concitoyens du marché de l'emploi pour s'approprier les fonds qui pourraient le relancer ou qui imposent une fiscalité telle que la vie des indépendants devient une prison.
(**) Le nietzschéisme caricatural de certaines droites politiques ou métapolitiques est à la fois le refus de prendre en compte la “société concrète” mais aussi le refus de reprendre en compte le combat à la fois conservateur, romantique, démocratique et populiste, pour la “societas civilis”. Panajotis Kondylis reproche notament aux droites “révolutionnaires-conservatrices” du temps de Weimar d'avoir dévié dans l'esthétisme révolutionnaire, sans plus chercher à reconstituer une “societas civilis”, où les ressorts des différentes communautés composant la nation sont entretenus, harmonisés et perpétués. Un même reproche peut être adressé aux “nouvelles droites”, surtout celles qui ont sévi à Paris.
(***) Lors d'une Foire de Francfort, fin des années 80, Gerd Bergfleth devait présenter son dernier livre, critique à l'égard de cette “raison palabrante” qui s'était emparée de la philosophie allemande au détriment de tous les linéaments de vitalisme. Cette présentation a eu lieu dans une librairie de la ville, où plusieurs furieux, alternant colères et larmes (Lothar Baier!), ont injurié le conférencier, l'ont menacé, l'ont accusé de ressusciter l'“inressuscitable”, le tout sous les sarcasmes, les rires tonitruants et les moqueries de Günter Maschke, spécialiste de Donoso Cortès et de Carl Schmitt, et ancien agitateur du SDS gauchiste à l'époque des révoltes étudiantes de 1967/68. Parmi les auditeurs, Karlheinz Weißmann, Axel Matthes et Robert Steuckers. Soirée grandiose! Ou le ridicule des inquisiteurs a parfaitement transparu.
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : philosophie, nietzsche, gauche, droite, révolution conservatrice, allemagne, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 novembre 2008
Le clivage gauche/droite dans l'histoire politique belge (1830-1900)

Frédéric KISTERS:
Le clivage Gauche/Droite dans l'histoire politique belge (1830-1900).
"La distinction entre gauche et droite est d'ordre polémique et électoral, elle ne détermine pas des catégories politiques essentielles. En effet, la classification en droite et gauche est assez récente, contemporaine de l'apparition de la conscience idéologique au siècle dernier. En plus, elle est essentiellement européenne et même localisée aux pays latins, bien qu'elle ait été reprise, il y a quelques temps par les pays anglo-saxon (...)
En effet, les notions de gauche comme de droite sont des agrégats de logique et de sophismes volontiers dogmatiques, qui servent de raisonnement à ceux qui ne raisonnent pas. En effet, une fois que l'on a choisi le camps de la droite ou de la gauche, on se trouve "casé ' dans une routine qui fait que l'on ne sera plus sensible qu'aux arguments de sa famille."
FREUND (Julien), L'essence du politique, 3e éd., Paris, Sirey, 1986 (ler éd. 1965), p. 825.
L'UNIONISME
Comme le lecteur l'aura subodoré en lisant l'exergue, notre propos sera de montrer, au travars de l'exemple belge, l'ineptie du classement gauche/droite, qui doit sans doute son succès séculaire à sa simplicité.
La distinction entre droite et gauche remonte aux assemblées d'Etats de l'Ancien Régime, dans lesquelles les ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, siégeaient à la droite du souverain, tandis que les représentants du Tiers Etat s'asseyaient à sa gauche. Le 28 août 1789, les députés de la Convention qui se prononçaient sur la question du veto royal des lois se répartirent en deux groupes afin de faciliter le décompte des voix: à droite se positionnèrent les partisans d'un veto absolu (les conservateurs); à gauche, se placèrent les adeptes du veto suspensif (les progressistes). Depuis, cette répartition spatiale est devenue un concept politique... dont il semble impossible de donner un définition satisfaisante, universelle et intemporelle, car le classement gauche/droite varie d'un pays ou d'une époque à l'autre.
En 1795, la France avait annexé les Pays-Bas autrichiens, l'évêché de Liège, le duché de Bouillon et le comté de Chiny. Nous demeurâmes français jusqu'en 1814. Après, les grandes puissances qui avaient vaincu Napoléon, désireuses d'affaiblir la France, offrirent nos neuf départements au roi des Pays-Bas, Guillaume d'Orange, créant ainsi un glaci entre le royaume recouvré par Louis XVIII et les Allemagnes. Quinze ans plus tard, les Belges chassèrent manu militari leur nouveau maître. Pour la première fois, l'on put écrire le nom "Belgique" sur les cartes de géographiel.
Or les vieilles monarchies ne craignaient rien moins qu'une nouvelle révolution. Elles voulaient préserver l'ordre établi en 1815 après la défaite de Napoléon Ier. Quelques régiments eussent balayé nos brouillons bourgeois révolutionnaires, mais aucune des grandes puissances ne voulaient compromettre la paix et l'équilibre de l'Europe. La Belgique existerait donc, n'en déplaise à Guillaume d'Orange. Néanmoins, l'apparition au milieu de l'Europe d'une petite république leur répugnaient. Ils n'avaient pas écrasé l'Ogre pour laisser la place à un Petit Poucet ! Il fallait donc un roi pour ce nouveau trône, n'importe lequel pourvu qu'il régnât, fût-ce sans gouverner. Après quelques tergiversations, le consensus se fit autour de la personne du prince Léopold de Saxe Cobourg Gotha.
La révolution belge avait été rendue possible par une convergence des oppositions au roi Guillaume Ier: les libéraux aspiraient à un gouvernement constitutionnel plus libre, basé sur le suffrage censitaire; les catholiques ne se reconnaissaient pas dans un roi qui menait une politique de centralisation et de laicisation. Les catholiques, autrefois farouchement opposés au libéralisme, évoluèrent vers une attitude plus pragmatique et conciliante. En concédant le principe de constitutionalité, ils consentirent à un grand sacrifice.
Notre Constitution était un amalgame original de la "Grondwet" néerlandaise (40%), de la Charte constitutionnelle de la France (35%), de droit constitutionnel anglais (5%), additionné de quelques éléments nouveaux (10%: le Sénat non héréditaire, la liberté de l'enseignement, les rapports de l'Eglise et de l'Etat, la liberté d'association).
Dans son encyclique "Mirari Vos", le pape Grégoire XVI condamna le modèle belge. Il ne s'attaquait pas au principe d'Etat constitutionnel, qui relevait du temporel, mais au contenu de la Constitution qui instaurait la séparation de l'Eglise et de l'Etat, garantissait les libertés de conscience, de presse et d'opinion, principes qui se conciliaient difficilement avec le dogme et l'Index. Les différents courants catholiques réagirent de manière variable, mais aucune des attitudes adoptées ne menaçait le concensus:
- les ultras rejetèrent l'unionisme, mails obéirent à la Constitution puisqu'en bons traditionalistes ils devaient respecter l'autorité et la loi, même en maugréant;
- les catholiques libéraux ne croyaient pas ou ne voulaient pas croire que la condamnation papale les touchât puisque les résultats de l'unionisme étaient favorables à l'Eglise.
Quant aux libéraux, ils étaient presque comblés par le nouveau régime.
Peu apres l'indépendance de la Belgique, il n'existait pas encore de partis organisés, mais l'on distinguait deux grands groupes de députés aux contours fort imprécis il est vrai, les catholiques (les "conservateurs") et les libéraux (la "gauche progressiste"). Toutefois, aucune ligne de fracture nette et profonde ne séparait les deux mouvances.
Du fait du régime électoral censitaire2, la composition du Parlement était remarquablement homogène, les représentants de la nation étaient issus de la classe la plus aisée de la population belge. Au Sénat, presque tous les élus, dont une large majorité était noble, se déclaraient favorables aux intérêts de l'Eglise et de la grande propriété foncière3. A la Chambre, le nombre de propriétaires fonciers et de représentants de l'industrie domestique excédaient largement celui des membres de la nouvelle bourgeoisie industrielle. La bourgeoisie intellectuelle (professions libérales) s'était introduite en nombre dans l'assemblée. La présence de nombreux hauts fonctionnaires et magistrats dans l'hémicycle renforçait encore la cohésion.
Non seulement les parlementaires appartenaient à la même classe sociale et partageaient des intérêts économiques communs, mais, de plus, ils s'exprimaient tous en français, et, de ce fait, baignaient dans une culture commune.
Quant à la religion, elle ne constituait pas encore un facteur de division, car les radicaux anticléricaux ne formaient qu'une infime minorité. Les libéraux avaient adopté à l'égard de l'Eglise une attitude très conciliante; la plupart d'entre-eux, qu'ils fussent croyants, déistes ou athées, reconnaissaient l'utilité sociale d'une religion qui était un facteur d'ordre: elle apaisait les pauvres et leur inculquait le respect de l'autorité et de la morale.
Un dernier facteur parfaisait la cohésion de l'ensemble: l'existence d'un ennemi commun, les orangistes, partisans du roi Guillaume d'Orange et du rattachement de la Belgique aux Pays-Bas, qui se recrutaient dans la bourgeoisie industrielle des grandes villes comme Anvers et Gand. La menace hollandaise incitait les députés à maintenir leur rangs serrés. L'ennemi nous unit.
Le roi Léopold Ier, qui par son éducation et ses idées demeurait un roi d'Ancien Régime, abhorrait la Constitution qu'on lui avait imposée. Il favorisa la formation de gouvernement d'union alliant catholiques et libéraux modérés. Les gouvernements unionistes qui se succédèrent de 18~1 à 1847 se préoccupèrent surtout d'asseoir et de consolider le nouvel ordre établi. Il s'agissait d'un gouvernement de notables.
Parler de gauche et droite à propos de cette période n'a donc guère de sens. Les événements de 1839 montre qu'un classement pro et anti-gouvernement serait plus adéquat.
Lors des élections de 1839, les orangistes, les catholiques progressistes et les radicaux s'allièrent contre les catholiques conservateurs et les libéraux doctrinaires. Les progressistes, orangistes ou non, provenaient surtout de la bourgeoisie industrielle, financière ou intellectuelle, tandis que la plupart des unionistes jouissaient d'importants revenus fonciers. La coalition anti-gouvernementale fut laminée.
La reconnaissance de l'Etat belge par Guillaume enleva aux orangistes toute raison et moyen de poursuivre leur lutte; la plupart rejoignirent la mouvance libérale dont ils partageaient, entre-autre, l'anti-cléricalisme. Mais l'opposition progressiste fut muselée durant des lustres.
La disparition de l'ennemi orangiste et le peu de succès des radicaux permit une bipolarisation de la vie politique belge entre catholiques et libéraux.
LA NOUVELLE GENERATION LIBERALE
L'unionisme portait en lui-même les germes de sa destruction; l'antagonisme entre libéraux et cléricaux se révéla fatal. En effet, la montée en puissance de l'Eglise provoqua l'appréhension de certains bourgeois et le parti libéral s'érigea alors en défenseur du Tiers Etat contre le clergé et la noblesse. Profitant des mesures favorables à son essor prises par les gouvernements unionistes, l'Eglise avait rapidement accru son patrimoine et le nombre d'écclésiastiques était passé de 4791 à 11 968 de 1829 à 1846. La presque entièreté de l'enseignement était sous sa coupe.
Au début des années 1840, émergea une nouvelle génération de politiciens libéraux, moins conservateurs que leurs aînés. Nouvelle par l'âge d'abord: la plupart de leurs représentants n'avaient pas trente ans, ils avaient donc peu ou pas connu le régime hollandais. Ils étaient issus de la petite bourgeoisie, des classes moyennes et appartenaient à l'élite intellectuelle: la plupart, contrairement aux premiers conventionnels, avaient accompli des études secondaires ou universitaires. Beaucoup exerçaient une profession libérale (avocat, médecin), d'autres étaient ingénieurs, journalistes, professeurs, négociants, petits industriels ou fonctionnaires subalternes. Ils étaient animés par un optimisme irrésistible; ils croyaient au progrès et à la perfectibilité de l'homme. Démocrates, ils prônaient le suffrage universel ou du moins l'extension du droit de vote. D e par leur position sociale, ils étaient plus proches du peuple et de ses problèmes. Certains d'entre-eux ne jouissaient pas du droit de vote, car leur revenus n'atteignaient pas le cens.
Mais, les réformes qu'ils proposaient paraissent aujourd'hui bien timides au regard de la condition ouvrière du l9è siècle. Pour l'améliorer, ils réclamaient la réglementation du travail des femmes et des enfants, l'impôt progressif, la suppression du livret d'ouvrier, la liberté de coalition, le développement de sociétés d'épargne, coopératives et assurances. En effet, ils ne désiraient aucunement bouleverser les structures établies; ils croyaient aux vertus du capitalisme et du libre-échange. Pour eux, c'était l'ignorance et non les structures sociales ou économiques, qui était la cause de la pauvreté des masses. Quant à la moralité, elle était liée au niveau d'éducation, ce qui était raisonnable était nécessairement moral. Donc, il ne fallait pas modifier la société mais éduquer le peuple. En conséquence, ils voulaient établir un enseignement obligatoire, gratuit et laic. Cette volonté, alliée à la conviction que sciences modernes et dogme de l'Eglise s'excluaient, engendra la "Guerre scolaire".
LA NAISSANCE DU PREMIER PARTI
Le 14 juin 1846, sous la présidence de DEFACQZ, conseiller à la Cour de Cassation et grand maître du Grand Orient de Belgique, les libéraux fondèrent le premier parti de l'histoire de Belgique. Il regroupait aussi bien des doctrinaires que des radicaux ou d'anciens orangistes. Il se posait comme le parti de gauche, réformateur, soutenu par la bourgeoisie anti-cléricale, l'adversaire de la droite catholique.
Toutefois, il ne faut pas oublier que, malgré les dissensions entre catholiques et laics, la classe politique demeurait solidaire au niveau de la politique économique: le libéralisme dominait sans partage.
La formation du parti libéral n'excluait pas l'existence en son sein d'une tendance "doctrinaire" et d'une tendance "radicale" qui mettait l'accent sur l'idéal égalitaire hérité des Lumières mais ne renonçait pas pour autant aux valeurs liée à la propriété.Les élections de 1847 ouvrirent la longue ère de domination libérale (1847-1874). Notons qu'à cette époque, nombre de députés dits "libéraux" n'étaient pas affiliés au parti.
Durant cette période, le classement gauche/droite, selon un axe allant du plus réformateur au plus conservateur, se justifie. D'un côté à l'autre de l'hémicycle, nous pouvons aligner les radicaux, les libéraux modérés, les libéraux doctrinaires, les catholiques libéraux, les catholiques conservateurs et les ultramontains.
Le gouvernement Rogier-Frère Orban, formé le 12 août 1847, se composait entièrement de d'élus libéraux4.
LES TROUBLES DE 1848.
Vers 1848, un nouvelle vague révolutionnaire agita l'Europe. Afin que les troubles ne s'étendissent pas dans notre paisible royaume, le nouveau gouvernement libéral abaissa le cens électoral à son minimum constitutionnel, de ce fait le nombre d'électeurs passa ainsi de 47 000 à 79 000 pour une population d'environ 4 500 000 habitants et le cens différentiel entre les campagnes et les villes disparaissait. Dans la foulée, les fontionnaires furent rendus inéligibles. Sous la pression conjuguée de la vague révolutionnaire et de la crise économique, il étendit le champ d'action de l'Etat au domaine économique, ce qui allait pourtant à l'encontre du credo libéral; le Parlement vota des "crédits pour la subsistance" et "pour le maintien du travail", créa la Banque Nationale de Belgique (1850). La loi du 3 avril 1851 définit le cadre légal dans lequel les sociétés de secours mutuels pouvaient oeuvrer.
Vraisemblablement suite aux troubles révolutionnaires et à l'inquiétude qu'ils avaient engendrés, les catholiques bénéficièrent d'un certain regain aux élections partielles de 1850 et 1852 (à l'époque on renouvelait les députés par moitié tous les deux ans). Le roi profita de l'occasion pour appuyer une demière tentative de constitution d'un gouvernement unioniste qui échoua. La bipolarisation de la vie politique était confirmée.
GUERRE SCOLAIRE
La constitution belge contenait deux principes apparemment contradictoires et ne prévoyait aucune hiérarchie entre ces deux valeurs: la liberté de culte et la liberté de conscience. L'Eglise belge avait toléré les libertés constitutionnelles tant que le gouvernement avait favorisé son culte. Avec l'accession au pouvoir des libéraux, la période d'entente s'achevait. Le laicisme de plus en plus intransigeant des libéraux effraya les catholiques, comme la morgue des ultramontains alarma les libéraux. Le fossé s'approfondissait. Peu à peu, sous l'effet des attaques laiques, nombre de catholiques rejetèrent le principe d'un Etat constitutionnel et aspirèrent à un retour aux valeurs de l'Ancien Régime.
De leur c8té, les libres-exaministes, malgré leur maître-mot "tolérance", admettaient difficilement l'adhésion à une religion. Selon eux, les religions niaient le principe supérieur de la liberté de conscience puisqu'elles imposaient des dogmes exclusifs. En fait, les libéraux doctrinaires défendaient le principe de tolérance dans la mesure où les critiques de l'adversaire se basait sur la Raison et la Science et ne remettait pas en cause les fondements éthico-politiques de la société libérale.
Le laicisme pouvait être plus ou moins virulents, les plus durs voulant exclure tous les prêtres de l'enseignement, les modérés désirant en conserver quelques uns comme professeurs de religion. La lutte se concentra autour de l'enseignement.
Durant l'ère libérale, la tension entre les deux p81e politique alla crescendo. En 1842, une loi sur l'enseignement avait imposé à chaque commune l'entretien d'une ou plusieurs écoles primaire, mais elle leur avait laissé la faculté d'adopter une école privée, et donc le plus souvent catholique. Un autre texte créa, en 1850, 50 écoles moyennes et 10 athénées, mettant ainsi fin, du moins ~n théori, au quasi-monopole de l'Eglise sur l'enseignement moyen. Enfin, la loi VAN HUMBEECK (1879), qui avait pour objectif la laicisation de l'enseignement, engendra ce que l'on a nommé "la guerre scolaire". Les catholiques usèrent de moyens de pression religieux: les sacrements étaient refusés au professeurs des écoles officielles, aux élèves et à leurs parents, les curés haranguaient les paroissiens du haut de leurs chaires... Ils créèrent de nombreuses nouvelles écoles grâce au fonds récolté lors de quêtes. Par contre, le financement de la politique libérale nécessita la levée de nouveaux imp8ts, ce qui forcément fit des mécontents. En 1884, les catholiques remportèrent les élections. Cette victoire marqua une rupture entre l'Eglise et la bourgeoisie libérale qui cessa de fréquenter les lieux de culte.
FIN DE SIECLE TROUBLEE POUR LES IDEES SIMPLES
Dans la seconde moitié du l9e siècle, trois mouvements, minoritaires mais très actifs, troublèrent l'impeccable ordonnancement gauche/droite.
a) Entre 1875 et 1884, les ultramontains constituèrent le principal groupe de pression catholique. Ils voulaient transformer le mouvement catholique en un parti confessionnel, organisé et centralisé, alors que les catholiques libéraux rejetaient l'idée de parti et refusaient le mandat impératif, c'est-à-dire la soumission des élus à un pacte, au contraire des libéraux dont les élus étaient tenus de respecter le programme commun. Leur idéal était un retour à la société d'Ancien Régime; les plus extrémistes voulaient créer un Etat catholique dans lequel le Parlement aurait fait place à une représentation par ordre.
Les ultramontains déployaient une grande activité dans le domaine de la charité patronale, ainsi naquit, en 1867, la "Fédération des sociétés ouvrières catholiques belges" qui rassemblait les oeuvres de charité ouvrière catholique. Les ultramontains voulaient créer à l'aide de cette fédération, une organisation hiérarchisée d'ordres ou corporation qui aurait barré la route à la progression de l'individualisme libéral, la hiérarchie des ordres transcendants les oppositions de classes et de partis.
La guerre scolaire (1879-1884) et l'accession de Léon XIII à la dignité papale facilitèrent le rapprochement des ultramontains et des catholiques-libéraux, qui fondèrent ensemble un parti confessionnel capable de contrebalancer la formation laique. Après 1885, les ultramontains, naguère élément moteur du renouveau catholique, disparurent presque entièrement de la vie politique belge. Ils conservèrent néanmoins une certaine influence au sein des organisations caritatives ouvrières.
Par de nombreux aspects de leur idéologie, les ultramontains peuvent être classés à l'extrêmedroite, mais d'après leurs activités sociales et leur volonté de transformation de la société, même si cette mutation est un retour à d'anciennes valeurs, il faudrait les classer à gauche.
b) L'extension progressive du droit de vote amena au flamingantisme des électeurs non francisés issus de la classe moyenne. Peu après 1860, le mouvement flamand, jusqu'alors essentiellement intellectuel et littéraire, trouva sa première expression politique dans le Meetingspartij, une dissidence de la mouvance radicale qui s'implanta surtout à Anvers dont la classe moyenne était restée majoritairement néerlandophone. Le parti se disloqua en 1868, victime de la bipolarisation croissante de la politique belge entre libéraux et catholiques. La scission consommée, plus aucun parti ne représentait le flamingantisme, mais on trouvait de ses adeptes aussi bien au sein du parti libéral qu'au parti catholique. Les flamingants "libéraux" rendaient l'Eglise responsable de l'infériorité culturelle flamande et désiraient émanciper la Flandre grâce à la libre-pensée et à l'enseignement; tandis que les flamingants "catholiques", souvent moins virulents, estimaient au contraire que la religion catholique faisait partie intégrante de la culture flamande, au même titre que sa langue. Il fallut attendre l'entre-deux-guerres pour que le nationalisme flamand retrouvât une concrétisation sous forme de parti. Mais, entre-temps, il avait remporté quelques succès notables5.
c) Le troisième trouble-fête allait mettre fin au bipolarisme. Au départ, les revendications ouvrières furent surtout relayées par les radicaux. En effet, la première génération d'ouvriers était constituée de ruraux déracinés, de travailleurs non-qualifiés, le plus souvent illettrés. Le prolétariat de 1840 était atomisé; il fallut quelques décennies pour qu'il se structure.
Entre 1850 et 1880, les conditions de vie de la classe ouvrière se dégradèrent. Les industriels disposaient d'une main d'oeuvre abondante et peu qualifiée; ils répondaient à chaque baisse de la demande par des licenciements ou des baisses de salaire, celui-ci pouvant descendre endessous du minimum vital. Les journées duraient de 12 à 14 heures. Le travail des femmes et des enfants se généralisa, on les employait jusque dans les mines, pour un salaire équivalent au tiers de celui des hommes. Vu la modestie de leurs revenus, les familles de travailleurs avaient besoin de ce maigre appoint pour survivre, mais l'extension de l'emploi des femmes et des enfants favorisait la baisse des gages alloués aux adultes mâles. Grâce au "truck System", les patrons récupéraient une bonne part des salaires octroyés aux familles ouvrières, qui dépensaient environ 80 % de leurs revenus à la nourriture et vivaient entassés dans des logements exigus, sans la moindre notion d'hygiène. L'homme ne fut jamais autant exploité qu'au siècle du Progrès; les serfs et esclaves des époques précédentes jouissaient d'un niveau de vie plus élevé.
Vers 1880, la population ouvrière dépassa la population occupée dans l'agriculture. Entre 1873 et 1895, l'économie capitaliste connu une longue crise, l'amélioration de l'équipement industriel se poursuivait, la production de certains produits augmentait, mais les profits, les prix et les salaires stagnaient ou baissaient. Le chômage crût, ce qui accentua les tensions sociales.
En 1884, deux phénomènes favorisèrent l'émergence d'un parti socialiste en Belgique:
- la victoire catholique aux législatives provoqua en réaction une agitation anti-cléricale;
- les grèves de l'hiver 1884-1885 virent naître un ensemble d'associations de solidarité (syndicats, coopératives d'achat, caisses de soutien, mutualités...).
Les 5 et 6 avril 1885, 59 organisations ouvrières fusionnèrent avec le parti ouvrier socialiste belge (principalement implanté en Flandre) pour former le Parti ouvrier de Belgique (POB).
La bipolarisation catholiques/libéraux prenait fin. En effet, le POB était bien un parti anticlérical, mais il ne s'adressait pas au même public, il s'opposait aux conceptions économiques et sociales des deux autres partis bourgeois et, surtout, avait des visées révolutionnaires.
RECOMPOSITION DU PAYSAGE POLITIQUE A LA FIN DU SIECLE
1894 est une année charnière sous plus d'un aspect. C'est l'année de la rédaction de la Charte de Quaregnon6 (5/26 mars) et de l'instauration du suffrage universel tempéré par le vote plural7.
Après la publication de l'encyclique Rerum Novarum et l'adoption du suffrage universel tempéré par le vote plural (1894), le parti catholique devint peu à peu un parti oeucuménique. Rejetant le l'individualisme libéral comme la lutte des classes, il développa une théorie corporatiste. Les corporations, inspirées du système d'Ancien Régime, devaient regrouper ouvriers et patrons au sein d'un même corps, sous le patronage de l'Eglise et des notables. Soucieux de maintenir sous sa coupe un maximum d'ouvriers, devenus électeurs, il développa un ensemble d'oeuvres sociales, mutuelles, caisses de crédit et de syndicats pour concurrencer le POB.
Chacun des trois partis, quoique les libéraux dans une moindre mesure, avaient développé un ensemble d'associations permettant d'encadrer ses sympathisants dans tous les aspects vie quotidienne (loisirs, travail, éducation...). En ce sens, le système belge est totalitaire. Comme l'objectif de ces trois piliers de la société est sa pérennisation, les politiciens éludent les véritables problèmes, ils les écartent par des compromis provisoires, renoncent à toute adaptation structurelle. Ils distraient l'électorat en créant de fausses problématiques ou en grossissant des problèmes secondaires.
A la fin du siècle, un parti confessionnel inter-classe faisait donc face à deux formations laiques chacun défenseur d'une classe sociale; en même temps, un parti prolétarien combattaient les deux mouvements bourgeois.
En 1884, le nouveau-venu, le POB se classa naturellement à l'extrême-gauche; le parti libéral devenait de ce fait un mouvement de centre-gauche... Après la Première Guerre mondiale, le il se mua en un mouvement social-démocrate qui n'avait plus rien de révolutionnaire; ses revendications s'atténuèrent jusqu'à l'atonie. Une guerre plus tard, le parti catholique prit le nom de "Parti Social Chrétien" signifiant ainsi son recentrage, un centre que l'on situe d'ailleurs assez difficilement puisque l'on trouve dans cette formation des membres du Mouvement Ouvrier chrétien aussi rouges que nos socialistes comtemporains, aux côtés d'hyper-libéraux néanmoins catholiques. Les partis catholiques belges possèdent le don d'ubiquité. Enfin, le Parti Réformateur Libéral, qui a glissé à droite au cours du siècle, demeure le dernier parti de classe comme le démontre l'étude de son électorat.
Ce repositionnement s'explique par le changement du référent qui sous-tend le classement gauche/droite. Depuis la Révolution française, les analystes politiques opposaient les progressistes, réformateurs ou révolutionnaires (la gauche) aux conservateurs (la droite). En 1886, les révolutionnaires du POB furent rangés suivant cet axiome à l'extrême-gauche. Suivant un principe identique, on plaça les ultramontains à l'extrême-droite malgré que leurs actions sociales allassent plus loin que celles des radicaux puisqu'ils appelaient à un changement de la structure de la société.
Actuellement, le référent qui détermine la distinction entre gauche et droite est le niveau d'intervention de l'Etat dans l'économique; ainsi retrouvons nous à droite les libéraux partisans du retrait plus ou moins prononcé de l'Etat et à gauche les socialistes soi-disant protecteurs des acquis sociaux (à nouveau nous constatons une inversion de valeurs, voilà un parti de renouveau qui vire au conservatisme). En ce sens le terme d'extrême-gauche s'appliquerait aux tenants de vastes nationalisations ou d'une économie dirigiste, tandis que "extreme-droite" dé~ignerait les hypers-libéraux. Dans ce cas, le Front National (belge) mériterait son qualificatif d'extrême-droite, mais il faudrait verser le Parti Communautaire National-Européen (PCN) dans la catégorie extrême-gauche, quoique les journalistes et les "anti-fascistes" fissent fi de la différence.
La confusion naît du fait que l'on utilise un critère économique pour distinguer des attitudes politiques.
D'autres référents interviennent sur un mode mineur. L'autoritarisme est habituellement attribué à la droite qui a peu confiance en a nature humaine et désire donc l'encadrer. La gauche qui croit en la "bonté naturelle " ou la perfectibilité de l'homme, s'affirme plus libertaire. Pourtant, il existe encore des libéraux qui défendent ces valeurs. Si l'on donnait une importance primordiale à ce référant, les communistes deviendraient des extrémistes de droite! Enfin, la dextre postule le primat de l'individu sur le collectif, contre les hommes de gauche qui parlent plus souvent qu'à leur tour de "solidarité" et "d'intérêt général". Pourtant, peu d'auteurs classent les fascistes, grand défenseurs des valeurs communautaires, à l'extrêmegauche...
Il appert que le classement gauche/droite n'est pertinent que dans une société où il n'existe pas d'opposi~ion fondamentale au régime. Il ne s'applique qu'aux partis gouvemementaux à l'intérieur du syst~me. C'est un concept endogène. La seule discrimination valable semble celle qui sépare les ennemis d'un système de ceux qui en vivent. Toutefois, il existe une position intermédiaire, ou plutôt de transition, entre ces deux attitudes: telles formations, comme le Vlaams Blok ou, jadis, les écolos, s'institu~ionalisent peu à peu; en sens conaaire, d'au~es mouvements quittent l'orbe du système dont ils sont issus (Rex, par exemple, provient du parti catholique).
L'histoire politique belge a débuté par une période d'indifférenciation de 17 ans: l'unionisme. De 1846 à 1860, la bipolarisation entre conservateurs catholiques et réformateurs libéraux atteignit sa perfection, nonobstant quelques mouvements, tels que les orangistes, le Meetingspartij, ou les ul~amontains qui brisaient la perspective classique. Nous vivons depuis 1945 une sorte d'unionisme: les partis gouvernementaux, ainsi que d'autres plus petits comme la VU et les écologistes qui pa~icipent déjà aux pouvoirs locaux, partagent une pensée commune (le libéralisme au sens large, le primat de l'économie sur le politique, les DH, le renoncement au projet à long terme) et des intérets et objectifs communs
(maintenir le statu quo). Chacun constate une convergence programmatique de la droite et de la gauche, les socialistes appliquent des recettes libérales, dénationalisent, et les partis de droite, en France corr~ne en Wallonie (Gol singe Chirac), adoptent un discours social et mettent en avant leur "volonté de changement" (thème de gauche). Pa~allèlement, de nombreux partis ou mouvements actuels nient l'essence du politique en défendant les intérêts particuliers de classes d'âge (WOW, Plus ou Jeunes), de classe économique (PIB, libéraux), ou régionaux (Happart, VU...) contre ceux de la Cité.
Ces deux tendances ne sont qu'apparemment contradictoires; elles révèlent l'ambiguité du système: d'une part, nous voyons une classe dirigeante de plus en plus fermée, solidaire mais égoïste, d'autre part se développent des discours qui émiettent les oppositions potentielles en multiples courants rivaux: jeunes contre vieux, ouvriers con~e patrons, Flamands contre Wallons... Rema~q~z que chacun de ces antagonismes est fondé sur une revendication commune ~ Janus sème la zizanie, le citoyen élit son ennemi, l'ennemi le domine.
OUVRAGES UTILISES
MAsLLE (Xavier), Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, sruxelles~ CRISP, 1992 (édition complétée), 428 p.
wrrTE (E.), cRAEYsEcKx (F.), La Belgique politique de 1830 d nos jours, sruxelles~ Labor, 1987 (ler éd. en néerlandais 1985), XIII-639 p.
LORY (J.), Libéralisme et instruction primaire 1842-1879. Introduction d l'étude de la lutte scolaire en Belgique, Louvain, 1979, 2 t. LXXXI-839 p. (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et philologie, 6e série, fascicules 17-18)
HAAG (H.), Les origines du catholicisme libéral, sruxelles~ 1950, 300 p.
GILISSEN (J.), Le régime représentatif en Belgique,
ERsA
PIRENNE (H.), Histoire de Belgique, sruxelles~ (1950), t. IV
1 Jusqu'au début du l9e siècle, le mot "belgique" fut employé comme adjectif. On parlait de "Gaule belgique", "provinces belgiques"...
2 Le cens était, en 1831, de 20 à 30 florins d'impôts directs pour les campagnes et de 50 à 80 pour les villes. Il n'y avait que 55 000 électeurs pour 4 079 000 habitants, c est-adire proportionnellement plus que dans les autres Etats européens.
3 Pour être éligibles au Sénat, il fallait payer 1000 florins d'impôts directs. De ce fait, le nombre d'éligibles se réduisait à six ou sept cents grands propriétaires, presque tous nobles.
4 En 1847, la Chambre comptait 55 libéraux et 53 catholiques, en 1848, 85 libéraux
5 1873: le néerlandais est accepté en droit pénal; 1878: usage du néerlandais dans l'administration flamande; 1880; le néerlandais devient la langue de l'enseignement moyen officiel et de quelques disciplines; 1898: une loi établit l'équivalence des deux langues sur le plan juridique.
6 Ce texte très court était la base idéologique dans laquelle tous les socialistes de l'époque se reconnaissaient. Il comprenait quatre points:
- la source des richesses est le travail;
- la richesse doit être équitablement partagée selon l'utilité sociale;
- la société ne doit plus être partagée entre une classe de propriétaires oisifs et une classe de travailleurs obligé de céder à la première une partie du fruit de son travail;
- il faut assurer l'usage libre et gratuit des moyens de production.
7 Les socialistes avaient provoqué une série de grèves pour forcer le Parlement, dans lequel ils n'avaient aucun représentant, de voter le suffrage universel. Après de longs débats et tergiversations, les parlementaires adoptèrent un système hybride:
- tous les citoyens mâles, âgé de 25 ans, domiciliés depuis un an dans une commune, obtenait le droit de vote;
- une deuxième voix était accordée aux pères de famille de 35 ans occupant un habitation représentant 5 francs d'impôts; aux propriétaires d'un immeuble de 2000 F ou d'une rente de 1000 francs;
- deux voix supplémentaires étaient octroyées aux "capacitaires", détenteurs d'un diplôme d'humanité ou universitaire.
Le maximum de voix par électeurs fut fixé à trois (il eût été possible de jouir de 5 voix).
Le nombre des électeurs passait de 136 775 à 1370 687 dont 850 000 électeurs à une voix, 290 000 à deux voix, et 220 000 à trois voix (dont 40 000 capacitaires, parmi lesquels 20 000 ecclésiastiques) pour une population 6 342 000.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, dix-neuvième siècle, gauche, droite, socialisme, unionisme, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 02 novembre 2008
Misère des intellectuels de "droite"

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Misère des intellectuels de “droite”
L'option métapolitique de la “nouvelle droite” est, dans l'espace culturel germanique, une importation française. La ND, regroupée autour d'Alain de Benoist, a tenté d'adapter à la droite la théorie du communiste italien Antonio Gramsci, à un moment de l'évolution de cette droite, moment où elle se demandait quels étaient les véritables ressorts de la société. Point de départ de Gramsci: la société n'est mue que partiellement par les groupes politiques visibles, c'est-à-dire les partis. Plus essentielle est la superstructure idéelle de la société, où sont façonnées valeurs, morale et idées. La tâche des “intellectuels organiques” serait alors de mener un combat culturel au sein même de cette superstructure, combat dont le but ultime ne peut être que la révolution. D'après Gramsci, on ne peut donc révolutionner une société que si l'hégémonie culturelle qui la régente est brisée, c'est-à-dire quand les tenants de cette hégémonie ne croient plus en eux-mêmes. C'est alors que les valeurs révolutionnaires prennent le pas sur les valeurs dominantes fragilisées et deviennent graduellement hégémoniques. Le combat culturel mené par les intellectuels devient dans une telle optique la stratégie principale du “révolutionnement” politique de la société.
Dieter Stein, le directeur de l'hebdomadaire néo-conservateur berlinois Junge Freiheit, a analysé très justement cette vision gramscienne de la révolution, qui ne survient que par le biais de la culture; au bout de son analyse, il lance un avertissement: une telle vision de la révolution culturelle pourrait déboucher sur une “political correctness” de droite (cf. JF n°8/97). Si je trouve la critique de Stein pertinente, cela ne veut pas dire que je juge le point de vue de Gramsci incorrect. C'est aujourd'hui précisément que nous constatons que la “superstructure intellectuelle”, c'est-à-dire les médias, a acquis une puissance bien trop considérable, tant et si bien que les hommes politiques ne sont plus que des figurants pour les émissions d'actualité. La puissance qu'ont acquises les émissions de “talkshows” est emblématique et révèle un phénomène inhabituel, soit la “pluralisation totale” de la société mais avec pour corollaire paradoxal la réduction de tout aux idéaux du plus grand nombre, du “brave quidam”, du “Gutmensch” (ndt: ce terme est ironique; il a été forgé par les critiques allemands de la “PC”). C'est cette contradiction qui produit la “political correctness” (PC), qui, lorsqu'elle aura atteint son stade idéal, sera une censure bien installée dans l'intériorité même des citoyens. Cette nouvelle intériorité auto-contrôlée produit un discours mortifère, un discours assassin, qui frapperait abruptement toute personne qui, pour une raison ou une autre, serait déclarée non “politiquement correcte”. Tous ceux qui entendent ignorer les gestes symboliques et rituels de la PC, tous ceux qui ne se sentiraient pas “concernés” par ses gestes et ses agitations, tous ceux qui avanceraient un certain type d'arguments non conventionnels seraient purement et simplement “morts”, du moins au sens figuré.
Pourtant, à droite, beaucoup de militants souhaiteraient, eux aussi, l'avènement d'une telle “censure intérieure”. Mais qui serait tout simplement de signe opposé. Ceux qui ne détiennent aucune puissance politique développent souvent des fantasmes de toute-puissance, mais d'une toute-puissance basée sur d'autres critères que ceux maniés par la toute-puissance en place. Quoi d'étonnant, dès lors, que le concept narcotique d'“hégémomie culturelle” ait été importé de France en Allemagne par des groupuscules qui ont voulu, dans un premier temps, divulguer les aspects intéressants de la nouvelle droite française, mais se sont enlisés, finalement, dans la prédication d'une “stratégie rédemptrice” et, pire, ont fini par aller faire de la formation dans des groupuscules néo-nazis interdits.
La trajectoire du néo-droitisme gramscien est triste, mais cette tristesse provient de plusieurs causes:
1. Il n'existe pas de “nouvelle droite” unitaire.
2. Si, au départ, les intellectuels de droite se voulant gramsciens ont souhaité l'émergence d'un débat, ils se sont rapidement enlisés dans la recherche d'une “Weltanschauung” idéale.
3. La “Révolution conservatrice” n'est pas pour eux une mine de concepts intéressants pour affronter le monde actuel, mais, plus prosaïquement, l'occasion de répéter à satiété un discours invariable, fait d'invocations stériles.
4. Ces intellectuels de droite se sont créé un petit monde, hermétiquement protégé de l'effervescence du réel.
Il n'existe pas “UNE” nouvelle droite. C'est pourtant clair: il suffit de comptabiliser tout ce que l'on vend au public sous cette appelation. Dans ce bric-à-brac, il y a toujours quelque chose de “plus neuf”. Dans les années 60, on disait des nationaux-révolutionnaires allemands qu'ils étaient la “nouvelle droite”. Mais, il n'est pratiquement rien resté de cette école nationale-révolutionnaire. Son espace idéologique était à l'intersection de la gauche et de la droite. Les nationaux-révolutionnaires affirmaient qu'ils n'étaient ni de droite ni de gauche: ils n'ont pas survécu sur la scène politique. Hennig Eichberg, qui, à cette époque, était la tête pensante de cette “nouvelle droite”, se considère aujourd'hui comme un homme de gauche. Beaucoup de nationaux-révolutionnaires de ces années 60 se retrouvent aujourd'hui chez les Republikaner.
Quant à la “nouvelle droite” la plus récente, elle a fini par démontrer qu'elle était au fond “conservatrice”, mais elle s'adresse à de plus larges catégories sociales que ses ancêtres de la nouvelle droite de 1968 qui tentaient d'apporter une réponse aux intellectuels de gauche et à la sottise de la vieille droite. Plus typés étaient les néo-droitistes —quelques personnes et quelques journaux— qui voulaient et veulent faire de leur nouvelle droite un projet de modernisation de l'extrême-droite. Cette catégorie de “néo-droitistes” reste la plus problématique, car, au fond, elle se borne à sortir de la naphtaline la “pensée anti-démocratique” de l'époque de Weimar (telle que l'a définie Kurt Sontheimer). Par cet exercice, elle veut hisser la pensée de l'extrême-droite à l'excellent niveau et à la belle forme, acquis par la “révolution conservatrice” sous Weimar.
A côté de ces “requinqueurs” de vieux corpus, s'est regroupée une autre “nouvelle droite”, composée pour l'essentiel de conservateurs (en Allemagne) ou de nationaux-libéraux et de conservateurs (en Allemagne et en Autriche). Ils ont abordé sans complexe la pensée moderne, ils ont, en ce sens, été conséquents, ont modulé leur action sur ce choix et ont investi les territoires politiques assignés par convention sociale à ces idéologies bourgeoises, bien ancrées et établies. Ces entristes, qui ont pénétré dans les rouages de la CDU, de la CSU ou de l'ÖVP, voire de la FDP ou de la FPÖ, sont de braves citoyens, ils sont tout simplement un petit peu à droite que les autres.
Si l'on mélange ces deux courants sous l'appelation commune de “nouvelle droite”, on débouche évidemment dans un beau désordre, sinon dans une aporie intellectuelle. Les “nouvelles droites” ancrées dans les diverses formes d'extrémismes droitiers confondent la volonté de débattre intellectuellement avec la proclamation impavide d'une Weltanschaunng ancienne, dont elles ont la nostalgie. Pour sortir de cette impasse, on recourt généralement à deux stratagèmes, dont on use et on abuse:
- soit on recommence à se référer directement aux racines théologiques du politique, en tentant de formuler un nouveau projet de “théologie politique”, dans le sens où l'entendait Carl Schmitt,
- soit on s'efforce de séculariser ce besoin d'absolu.
Dans ce cas, on se tourne vers d'autres certitudes, des certitudes immanentes, comme le “peuple” (Volk), des certitudes idéalistes, comme cette “science des citoyens d'Empire” de facture hégélienne, plus exactement mi-hégélienne-de-gauche, mi-hégélienne-de-droite, à l'usage de citoyens qui ne vivent plus dans un Reich et ne souhaitent certainement pas y revivre, les plages de Torremolinos ou des Baléares ayant pour eux plus d'attraits... Les multiples expressions de ces exercices para-théologiques ou “hégélisants” varient considérablement: les plus “sortables” ne sont “que” autoritaires, mais, dans la plupart des cas, le mode totalitaire est bien vite accepté, illustré et défendu...
C'est dans ces recherches et ces tâtonnements qu'il faut replacer l'engouement pour la “révolution conservatrice” de l'entre-deux-guerres. Soyons clairs et honnêtes: cette “révolution conservatrice” est une mine d'or, elle ne cesse de susciter les intérêts des philosophes et des politologues, à juste titre; il est intéressant d'en étudier tous les aspects si l'on veut connaître l'archéologie de certaines pensées aujourd'hui classées à “droite”, si l'on veut se plonger dans des corpus entièrement différents de l'idéologie dominante actuelle, si l'on veut lire de “mauvais livres” au regard des catégories politiques contemporaines. En pratiquant ainsi une forme de transversalité, indubitablement, on se forme l'esprit, on acquiert un sens critique, on aiguise ses intuitions. La “révolution conservatrice” nous apprend que les hommes de droite n'ont pas toujours été bêtes. Mais, en réceptionnant la “révolution conservatrice” de cette sorte, on ne doit pas non plus oublier qu'elle fut un échec. Ni oublier qu'elle fut, en bon nombre de ses aspects, antidémocratique et partiellement extrémiste. Aujourd'hui, notre regard doit se porter sur elle avec le même sens critique que sur les corpus de gauche de la même époque. Malheureusement, pour beaucoup d'hommes de droite actuels, de militants, cette “révolution conservatrice”, dans ses innombrables variantes, n'est que prétexte à répétitions, à dévotions naïves et bigotes, répétitions et dévotions qui remplacent toute intellectualité autonome ou permettent des exercices pénibles comme réitérer une attitude antidémocratique classique en citant des extraits d'auteurs “révolutionnaires-conservateurs”, pour faire intelligent ou pour donner le change.
Le résultat de tout cela est lamentable, car une telle nouvelle droite paraît toujours bien vieille, elle parait truffée de science, elle se gargarise de sa belle Weltanschauung prête-à-porter, mais elle n'est quasi pas branchée sur la réalité. Car la belle Weltanschauung néo-droitiste n'est qu'une construction intellectuelle consolatrice pour tous ceux qui sont laissés-pour-compte dans la société réellement existante. Les plus lucides d'entre eux savent certes que le “peuple” (Volk) de leur idéologie n'est pas le peuple réel qui circule dans les rues d'Allemagne. Mais ce sont les “autres” qui sont coupables de cette inadéquation. Le peuple devrait correspondre à leur image du peuple: nous n'avons plus affaire là à de la nostalgie, à la nostalgie d'une “hégémonie culturelle” de droite, conservatrice, mais la rage de voir partout l'inadéquation génère subtilement une sorte de totalitarisme, camouflé derrière un verbiage conservateur, qui se veut apaisant, moral et “traditionnel”.
Au bout du compte, nos intellectuels de la “nouvelle droite” sont soit des modernisateurs de l'extrémisme, soit des bourgeois à un âge où il n'y a plus de bourgeois classiques, cultivés et conventionnels. Cette alternative, dont les deux termes sont également figés, est le résultat de la ghettoïsation des droites. Elles marinent dans leur jus. Alors que reste-t-il de la “nouvelle droite”?
Il reste sans doute quelques intellectuels de droite, qui se posent en anarchistes pour ne pas sombrer dans le dogmatisme, pour ne pas se laisser aveugler par les illusions. La réalité prosaïque, c'est qu'il n'y a dans le monde ni consolation ni rédemption. Mais, justement, ce n'est pas la tâche des intellectuels de droite de proposer de la consolation et d'annoncer une rédemption: au contraire, ils devraient se donner pour seule mission de déconstruire systématiquement toute idéologie de la consolation et de la rédemption. Travail difficile: en effet, c'est la meilleure façon de se faire mal aimer de tous; les uns détestent le “déconstructiviste” parce qu'il ne partage par leur illusion et n'apporte donc pas de quoi l'alimenter, de quoi entretenir la consolation; les autres le détestent tout autant parce qu'ils sont de gauche ou libéraux, qu'ils appartiennent à des espaces politico-philosophiques dans lesquels, forcément, le déconstructiviste n'aimera pas aller mariner: au contraire, il aimera les détricoter avec une égale délectation. Le véritable intellectuel de la nouvelle droite devrait être celui qui d'emblée se définit comme l'homme sans aucune illusion.
Nos sociétés souffrent d'une absence de créneau critique. Pourtant, aujourd'hui plus qu'auparavant, le terme “critique” est le vocable le plus prisé des hommes de gauche, au point qu'ils identifient les mots “gauche” et “critique”. L'école de Francfort, réservoir idéologique de la gauche, s'est effectivement auto-dénommée “critique”. Mais la gauche ne critique plus, elle accepte le statu quo et gère la crise. Automatiquement, dans un tel contexte, la pratique de la critique incombe alors à la droite. Pire, si un homme de gauche pratique encore la critique, il sera désormais traité de “fasciste” ou de “crypto-fasciste” par ses coreligionnaires (Botho Strauss, même Peter Handke, le cinéaste Fassbinder, le dramaturge Heiner Müller, héritier du théâtre de Brecht).
Pour nous, la démarche “critique”, c'est d'affronter les aléas du réel sans s'embarresser de tabous. L'actuelle “political correctness” instaure de nouveaux tabous et aboie son hostilité à l'égard de tout discours, de tout débat, et justifie ces tabous et ces aboiements au nom d'idées de gauche. Forcément, l'homme de droite sera celui qui s'opposera avec énergie à ces tabous et à ces aboiements: il se dira de droite parce que ces tabous et ces aboiements se disent de gauche. Il rejettera la “political correctness” parce qu'elle refuse tout discours et tout débat. Il restaurera le débat par le simple fait de prendre la parole de force, en avançant des arguments de signes nouveaux ou de signes contraires. Cet acte de prise de parole constitue une pluralisation volontaire du discours et place l'homme de droite —nouveau contestataire radical— au centre même de la vie sociale en danger de rigidification définitive. Il reconnaît alors que la confrontation des idées n'est possible que dans une société marquée du sceau du pluriel. L'intellectuel de droite prend dès lors position pour un ordre social où règne la liberté et où s'épanouit la diversité. Il défend cette liberté précisément parce que ses idées sont bannies et ostracisées dans une société qui devient de moins en moins plurielle et différenciée. Sa tâche consiste à réfléchir et à chercher. Car celui qui connaît les réponses avant de formuler ses questions, tombe dans le piège du totalitarisme.
Que reste-t-il de la “nouvelle droite”? Sans doute un homme de droite qui n'est plus un homme de droite au sens conventionnel du terme. Un homme qui part à l'aventure dans la vie ou dans les épaisses forêts de la pensée, car il sait que rien n'est définitivement sûr, que ce savoir de l'incertitude universelle fait de lui le meilleur critique des conventions figées de la société, mais d'une société dont il connaît les ressorts (organiques), parce qu'il en est issu.
Jürgen HATZENBICHLER.
(Correspondant de “Synergies Européennes” en Carinthie, responsable de la chronique politique de Junge Freiheit/Autriche; article paru dans Junge Freiheit, n°16/97; traduction et adaptation françaises de Robert Steuckers).
00:10 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, conservatisme, critique, philosophie, théorie politique, politique, gauche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook











