 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
L'instant brûlant
Quand meurt un homme, le chant de sa vie est joué dans l'éther. Il a le droit d'écouter jusqu'à ce qu'il passe au silence. Il prête alors une oreille si attentive au milieu des souffrances, de l'inquiétude. En tout cas, celui qui imagina le chant était un grand maître. Cependant, le chant ne peut être perçu dans la pureté du son que là où disparaît la volonté, là où elle cède à l'abnégation (1).
Ernst Jünger s'est avancé, ce 17 février 1998, vers des régions où les ciseaux de la Parque ne tranchent pas.
Les réactions lorsque fut annoncé ce deuil dans le monde des Lettres et de la pensée furent tristement coutumières. En ces temps où prévaut le “politiquement conforme”, certains critiques se sont distingués par des analyses sinon élogieuses (comme l'excellent article de Dominique Venner paru dans Enquête sur l'Histoire) du moins pertinentes (dans un magazine allemand inattendu, Focus). D'autres, zélés contempteurs inféodés à une idéologie qu'ils servent dans les organes de la presse française et allemande, se sont empressés de diffamer une œuvre qu'ils ne se sont jamais donnés la peine de lire et l'avouent parfois. Diable! Le personnage est agaçant: doté tout à la fois d'un esprit d'une rare fécondité et d'une vigueur physique non moins surprenante qui lui a permis de traverser la presque totalité du XX° siècle, ce plus que centenaire n'a eu de cesse d'aimer son pays, de ne se rétracter en rien: écrits bellicistes à l'issue de la Première Guerre mondiale, vision élitiste, contemplation douloureuse lors de l'entre-deux guerres... Il n'a rien renié; seul parfois l'angle de la perspective devait changer, mais faut-il forcer un homme à n'être qu'un bloc monolithique? Toutefois, est-il décent, en cette période, de s'irriter des réactions coutumières quand on prononce le nom de Jünger, de dresser dès à présent le bilan de l'œuvre? Les lecteurs fidèles préféreront encore se tourner vers cet Eveilleur qui a su nous offrir une élégante méditation philosophique et poétique sur les maux qui rongent notre civilisation.
Les ciseaux de la Parque... Par respect pour ce “passage” qui intriguait tant Ernst Jünger, nous évoquerons dans ces colonnes sa métaphysique de la mort, qui apparaît dès 1928 dans la première version du Cœur aventureux. Car à force d'avoir voulu préciser les choix politiques souvent au sens large de Jünger, on a souvent oublié que cet auteur, s'il avait voulu agir sur l'histoire, ne s'intéressait pas moins aux questions d'ordre spirituel. Or, parler de la mort consiste justement à se plonger dans les eaux régénératrices de la spiritualité. Reportons-nous à un texte révélateur de 1928
La vie est un nœud qui se noue et se dénoue dans l'obscurité. Peut-être la mort sera-t-elle notre plus grande et plus dangereuse aventure, car ce n'est pas sans raison que l'aventurier recherche ses bords enflammés (2).
Le symbole de l'entortillement
Procréation et mort marquent la fin du lacet, de ce noeud coulant qui, relié à son principe du domaine éternel, pénètre dans le règne terrestre. Pour Jünger, vie et mort sont intimement liées. Dans sa seconde version du Cœur aventureux qui paraît en 1938, Jünger recourt une nouvelle fois au symbole de l'entortillement. La théorie du lacet fait alors partie intégrante de l'initiation de Nigromontanus, maître mystérieux et charismatique. Le principe qu'il explique suppose une manière supérieure de se soustraire aux circonstances empiriques.
Il [Nigromontanus] nommait la mort le plus étrange voyage que l'homme puisse faire, un véritable tour de passe, la capuche de camouflage par excellence, aussi la plus ironique réplique dans l'éternelle controverse, l'ultime et l'imprenable citadelle de tous les êtres libres et vaillants (3).
Cet aspect nous ramène aux liens qu'entretiennent la mort et la liberté pour Jünger. Qui craint la mort doit renoncer à sa liberté. Le renforcement puissant de cette dernière n'est possible que si l'on part de la certitude que l'homme, en mourant, ne disparaît pas dans le néant, mais se voit élevé dans un être éternel. Aussi la pensée de Jünger tourne-t-elle sans cesse autour de la mort, parce qu'il veut infiniment fortifier la position de la liberté et assurer l'essence éternelle de l'homme. Ces idées acquises sur les champs de bataille, il les émet encore dans Heliopolis en 1949 et dans l'essai Le Mur du Temps, paru en 1959.
Celui qui ne connaît pas la crainte de la mort est l'égal des dieux (4).
Une conception grecque et platonicienne de la mort
La conception jüngerienne de la mort, en rien chrétienne, est influencée par la pensée grecque, notamment platonicienne. Les lectures attentives des dialogues Phédon, Gorgias, La République (notamment le X° chapitre) ont laissé leur trace dans l'œuvre jüngerienne. L'anamnèse platonicienne, nous la retrouvons formulée dans la deuxième version du Cœur aventureux et plus précisément dans “La mouche phosphorescente”. Jünger rapporte de la conversation de deux enfants qu'il surprit un jour cette phrase qui fusa, telle une illumination intellectuelle:
Et sais-tu ce que je crois? Que ce que nous vivons ici, nous le rêvons seulement; mais quand nous serons morts, nous vivrons la même chose en réalité (5).
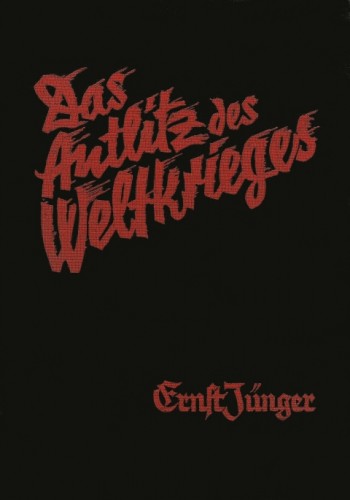 La vie semble se réduire à n'être que le reflet de cette vie véritable, impérissable, qui ne jaillit qu'au-delà de la mort. Voyons-y une fois encore le triomphe de l'être intemporel sur l'existence terrestre, qui est déterminée par le temps qui s'écoule perpétuellement!
La vie semble se réduire à n'être que le reflet de cette vie véritable, impérissable, qui ne jaillit qu'au-delà de la mort. Voyons-y une fois encore le triomphe de l'être intemporel sur l'existence terrestre, qui est déterminée par le temps qui s'écoule perpétuellement!
Nous trouvons chez Jünger une inversion de la mort, comme si cette dernière signifiait en fait le réveil d'un rêve étrange, peut-être même mauvais. Cela n'est pas sans évoquer la métaphysique de la mort, telle que l'avait formulée le romantique Novalis dans les Hymnes à la Nuit et le roman Heinrich von Ofterdingen.
Le monde devient rêve, le rêve devient monde [...]
Mélancolie et volupté, mort et vie
Sont ici en intime sympathie (6)
Idéalisation de la nuit et goût de l'outre-tombe
L'idéalisation de la nuit qui apparaît au cours du XIX° siècle dans le culte lamartinien de l'automne, le goût de l'outre-tombe, l'attraction de la mort sur Goethe, sur Novalis et sur Nodier, la nécrophilie de Baudelaire, jette encore des feux de vie dans la pensée de Jünger. Le procès intenté à la raison comme nous l'avons perçu au XIX° siècle se poursuit au XX° siècle contre l'idéologie positiviste; cette véritable offensive vient des horizons les plus variés: citons R. von Hartmann et sa Métaphysique de l'Inconscient, Barrès et le Culte du Moi, Bergson et l'Evolution créatrice ou l'Essai sur les données immédiates de la conscience. La redécouverte de l'inconscient des psychanalystes est aussi certainement liée à cette révolte.
La mort apparaît comme l'ultime libération de l'esprit du monde de la matière. A cet égard, la nouvelle “Liebe und Wiederkunft” —“amour et retour”—, très révélatrice, traduit une philosophie de l'histoire où des événements similaires se produisent sans cesse dans le même ordre, un retour de l'identique sous des formes différentes. L'histoire déjà parue dans la première version du Cœur aventureux localise à Leisnig le passage à l'écriture et se voit dotée d'un titre une décennie plus tard. Jünger s'est alors contenté de préciser ici une image, d'affiner une idée ou de changer là l'emploi d'un temps verbal; il n'a en rien touché le contenu de l'histoire.
La trame est simple. Le narrateur, un officier, est tout d'abord naufragé sur une île de l'Océan Atlantique. Recueilli par une vertueuse femme qui prit le voile, il se rend peu à peu à l'évidence qu'une relation séculaire les lie l'un à l'autre. La fonction de cette femme consiste à soigner et à veiller les hommes qui, pour avoir goûté une belle plante narcotique, dorment le lourd sommeil du coma. Malgré les injonctions de la religieuse, le narrateur n'y résiste pas non plus et devient lui-même la proie du sommeil et du rêve. Pourtant, le voilà de nouveau sur l'île, menacée cette fois par l'inimitié d'une flotte espagnole! Hôte d'une généreuse famille pirate, amoureux de la fille de la maison, le narrateur se prépare, chevaleresque, à livrer combat. Or, n'aperçoit-il pas soudain une fleur merveilleuse, ne succombe-t-il pas encore à l'impérieux désir de la goûter?
Dans la dernière lueur du crépuscule, j'eus le temps encore de pressentir que je vivrais d'innombrables fois pour rencontrer cette même jeune fille, pour manger cette même fleur, pour m'abîmer de cette même manière, tout comme d'innombrables fois déjà ces choses avaient été mon lot (7).
Une fleur aux couleurs du danger: le rouge, le jaune
Cette singulière histoire nous permet de mieux cerner la double nature de l'homme, ce qui fonde son originalité et son drame: son âme est immortelle et son corps périssable. Il est certain que la présence de cette fleur ne peut qu'évoquer le symbole le plus connu de toute l'œuvre de Novalis, la fleur bleue qui enchante le roman Heinrich von Ofterdingen et qui marque, de par ses racines et la couleur céleste de ses pétales, l'union de la terre et du ciel. La fleur jüngerienne n'est pas parée du bleu spirituel et bienfaisant. Ses pétales arborent les teintes de la vie et du danger, le jaune et le rouge (8); tout comme Goethe, rappelons-le, Jünger devait conférer une signification particulière aux couleurs. La fleur, belle et menaçante, figure l'instabilité essentielle de l'être , qui est voué à une évolution perpétuelle. Ernst Jünger semble admettre que la mort n'est pas un fait définitif, mais une simple étape de la série des transformations auxquelles tout être est soumis. La réminiscence d'un état antérieur, telle qu'elle semble affecter l'imagination nocturne de Jünger et que nous venons d'évoquer, soulève le délicat problème de l'incarnation successive des âmes et dramatise ainsi la notion d'un éternel retour. Ne soyons donc pas surpris de trouver dans Le Cœur aventureux les très célèbres vers de Goethe:
Ah, tu étais ma sœur ou ma femme, en des temps révolus (9).
Ces vers impliquent la reconnaissance des choses entre elles, de leurs liens, une conscience de leur parenté qui peut dépasser le cadre restreint de l'espèce humaine; d'ailleurs Jünger, dans le même passage, se fait écho de Byron:
Les monts, les vagues, le ciel ne font-ils partie de moi et de mon âme, et moi-même d'eux? (10).
La mort est le “souvenir le plus fort”
Finalement, la mort est pour Jünger un souvenir enfoui au plus profond de la mémoire, “le souvenir le plus fort” “der Tod ist unsere stärkste Erinnerung” (aHl, 75). L'homme qui, pour Jünger, représente infiniment plus que le corps physique, est doté d'une mémoire qui semble survivre à la destruction de la matière. Le dualisme de la vision anthropologique que nous décelons ici évoque celui de Platon, qui stipula la primauté de l'âme sur le corps. Fidèle à ses influences pythagoriciennes, Platon reprit à son compte l'idée de l'immortalité de l'âme; dans sa préexistence ou postexistence, l'âme voit les idées, mais en s'incarnant dans sa prison de chair, elle les oublie. Rappelons-nous que celui qui, chez Hadès, conserve la mémoire transcende la condition mortelle, échappe au cycle des générations. D'après Platon, les âmes assoiffées doivent éviter de boire l'eau du Léthé car l'oubli, qui constitue pour l'âme sa maladie propre, est tout simplement l'ignorance. Voilà peut-être la raison pour laquelle les Grecs prêtaient à Mnémosyne “mémoire”, la mère des Muses, de grandes vertus! L'histoire que chante la Titanide est déchiffrement de l'Invisible; la mémoire est fontaine d'immortalité. Nous pensons trouver ici un lointain écho de cette sagesse antique chez Jünger car, dans son œuvre, le contact avec l'autre monde est permis grâce à la mémoire. Celle-ci joue donc un rôle fondamental dans l'affirmation de l'identité personnelle et nous ne pouvons que souligner cette faveur qu'elle trouve auprès de Jünger, si l'on se réfère à ses journaux intimes, ces voyages entrepris dans les profondeurs du moi et d'où surgissent à la conscience des aspects nouveaux de l'être, mêlé parfois à toute une tonalité poétique.
L'aspect orphique de Jünger
Le roman philosophique Eumeswil (1977), à cet égard très révélateur, montre l'aspect orphique de Jünger. La mémoire, par l'intermédiaire du Luminar, fait tomber la barrière qui sépare le présent du passé. Que ce soit par le biais du Luminar ou par l'évocation des morts dans le jardin de Vigo, un pont est jeté entre le monde des vivants, au-delà duquel retourne tout ce qui a quitté la lumière du soleil. Cette évocation des morts n'est pas sans éveiller à notre mémoire le rituel homérique, qui connaît deux temps forts: d'une part, l'appel chez les vivants et, d'autre part, la venue au jour, pour un bref moment, d'un défunt remonté du monde infernal. Le voyage d'un vivant au pays des morts semble également possible, ainsi le chamane Attila qui s'aventura dans les forêts.
La place centrale que les mythes de type eschatologique accordèrent à la mémoire indique l'attitude de refus à l'existence temporelle. Si Jünger exalte autant la mémoire, nous pouvons nous demander s'il n'est pas mû par la tentation d'en faire une puissance qui lui permette de réaliser la sortie du Temps et le retour du divin.
Qu'en est-il du vieil homme? Dans l'attente de l'ultime rendez-vous, habitué à la mort pour l'avoir côtoyée sur les fronts, dans les deuils et les déchirements qu'elle causa, il ne peut abandonner une inquiétude, qu'il exprime Deux fois Halley:
Au contraire, ce qui me préoccupe depuis longtemps, c'est la question du franchissement; une coupe en terre est transformée en or, puis en lumière. A cela une seule chose m'inquiète: c'est de savoir si l'on prend encore connaissance de cette élévation, si l'on s'en rend encore compte (11).
Parques, Moires, Nornes
Quelques années plus tard paraît le journal Les Ciseaux, que Jünger écrivit de 1987 à 1989. L'outil bien anodin dont il est ici question appartient aux sœurs filandières des Enfers qui filent et tranchent le fil de nos destinées. Etrangères au monde olympien, ces Parques ou Moires du monde hellénique sont les déesses de la Loi. Lachésis tourne le fuseau et enroule le fil de l'existence, Clotho, la fileuse, tient la quenouille et file la destinée au moment de la naissance. La fatale Atropos coupe le fil et détermine la mort. La représentation ternaire des fileuses, également présente dans le religieux germanique où les Nornes filent la destinée des dieux et celle des hommes, évoque la trinité passé, présent et futur et nous permet d'entrer dans la temporalité. Ce fil est le lien qui nous attache à notre destinée humaine, nous lie à notre mort. Ce qui importe ici, c'est que, d'une part, l'outil retenu par Jünger ne soit ni le fuseau ni la quenouille mais bien les ciseaux de la divinité morticole et que, d'autre part, Jünger valorise non le fil ou le tissage mais la coupure par les ciseaux.
Le titre de l'essai et les discrètes allusions aux Moires, à ces divinités du destin, intègrent l'écrit dans l'ensemble de la réflexion jüngerienne sur le temps et la temporalité. Quoi d'étonnant à ce qu'il établisse des correspondances secrètes avec ses écrits antérieurs et jongle avec des idées abondamment traitées dans le passé! Les allusions au Travailleur, au Mur du temps sont nombreuses; sans grande peine, nous retrouvons Le Traité du Sablier, Le Problème d'Aladin, Eumeswil et même la théorie du “lacet” propre au Cœur aventureux. Cette œuvre de continuité qui n'est certes pas l'écrit le plus original de Jünger, prend l'aspect d'une récapitulation. Dans cet écrit tout en nuances, à défaut d'avoir énoncé des théories véritablement nouvelles, Jünger a composé une série d'accords d'accompagnements, s'attaquant à des problèmes essentiels de notre temps. Les Ciseaux sont en cela une méditation sur les aventures de notre siècle qu'ils posent, sur un fond de dualisme entre races divines, le problème crucial de l'éthique dans un monde où la science et le progrès technique repoussent les frontières d'une science morale désormais dépassée. Nous reconnaissons cette volonté d'ordonner le monde à d'autres fins que matérialistes.
Jünger considère le Temps sous la loi de deux règnes, d'une part celle du temporel où les ciseaux d'Atropos ne coupent pas et annoncent cet infini comme nous pouvons déjà le percevoir dans les rêves et l'extase. L'essai parle donc de la conscience jüngerienne de la mort et de cette douloureuse et inquiétante question du passage, de l'ultime franchissement.
Du comportement psychologique des agonisants
Cette curiosité incite l'auteur à s'interroger sur l'état de mort temporelle et sur les souvenirs des rares patients qui, rappelés à la vie, reprochent à leur médecin de les avoir empêchés de passer le tunnel de la mort (Schere, 73 sq). Sensible peut-être à cette vague déferlante de littérature occultiste qui aborde depuis quelques années la vie postmortelle, (est-là un présage de l'ère du Verseau?) ne va-t-il pas jusqu'à citer Elisabeth Kübler-Ross (12), cette femme d'origine suisse alémanique, installée aux Etats-Unis d'Amérique? En sa qualité de médecin, elle édita de nombreux ouvrages portant sur le comportement psychologique des agonisants; elle examina les récits des patients qu'avaient ressuscités les nouvelles techniques médicales de la réanimation, c'est-à-dire des injections d'adrénaline dans le cœur ou des électrochocs. Certains “revenants” que la médecine avait considérés cliniquement morts après avoir préalablement constaté un arrêt cardiaque, une absence de respiration et d'activité cérébrale, confièrent les expériences étranges qui leur étaient alors advenues pendant ces instants.
Or, la similitude des descriptions, l'exactitude des récits excluaient tout rêve ou toute hallucination. C'est ce qui incita le médecin à voir là une preuve d'existence post-mortelle. Voilà un sujet épineux où l'on se heurte tant aux théologiens horrifiés à l'idée d'un éventuel blasphème qu'aux doctes gardiens de la Science! Le raisonnement scientifique ne saurait rien admettre qui ne soit entièrement évident et ne forme un tout cohérent; la pensée qui en résulte, disciplinée par la rigoureuse volonté d'ordonner selon une méthode la plupart du temps linéaire et déductive, va par étapes successives de la simplicité à la complexité dans un ordre logique et chronologique. Or, dans le présent cas, la finalité du témoignage peut être sujette au même doute que son contenu. Il est donc bien évident que les thèses alléguées par E. Kübler-Ross ne peuvent, dans le meilleur des cas, remporter l'unanimité du monde scientifique et, dans le pire, ne peuvent qu'être rejetées car la science accueille avec méfiance des assertions qu'elle juge a priori insanes.
Toutefois, comme si Jünger voulait imposer le silence aux contempteurs de théories qu'il semble lui partager, comme s'il doutait aussi de cette méthode scientifique dont on aperçoit les limites, il cite des autorités médicales, aussi ambiguës soient-elles, ou nous livre les réflexions d'un ami, Hartmut Blersch, médecin lui aussi de son état. Ce dernier, traitant des personnes âgées, a écrit une étude non éditée: “Die Verwandlung des Sterbens durch den Descensus ad infernos” [La transformation de l'agonie par la Descente aux Enfers] (13) et a permis à Jünger d'en inclure quelques extraits dans Les Ciseaux. Jünger a tourné le dos à l'intelligence rationnelle du discours et à certaines acquisitions du savoir scientifique il y a longtemps déjà. De nos jours, une telle approche, qualifiée d'irrationnelle invite ses représentants à douter de la validité, du sérieux que l'on pourrait accorder à une telle pensée, à voir dans cette réaction antimatérialiste une régression vers un nouvel obscurantisme. Il n'en est pas moins vrai que Jünger, s'inscrivant déjà dans toute une tradition, reflète les angoisses qui oppressent son temps. Car cette mythologie d'une vie post-mortelle exerce sur nos contemporains une fascination qui dépasse le simple divertissement.
Placidité et sagesse où la mort devient conquête
Les conceptions irrationnelles de Jünger ont toujours damé le pion à la divine raison. Ainsi avait-il conclu son ouvrage Approches, drogues et ivresse:
L'approche est confirmée par ce qui survient, ce qui est présent est complété par ce qui est absent. Ils se rencontrent dans le miroir qui efface temps et malaise. Jamais le miroir ne fut aussi vide, dépourvu ainsi de poussière et d'image —deux siècles se sont chargé de cela. En plus, le cognement dans l'atelier —le rideau devient transparent; la scène est libre (14).
C'est peut-être justement dans cette irrationalité que Jünger puise cette placidité et cette sagesse où la mort elle-même devient conquête. Esprit téméraire, Jünger s'est avancé, vigilant, vers ces régions où les ciseaux de la Parque ne tranchent pas.
Tout comme jadis où, jeune héros incontesté, il glorifiait l'instant dangereux, le vieil homme avait renoncé à l'histoire, à percevoir le temps de manière continue; il est demeuré fasciné par cette seconde brûlante où tout se joue, ce duel sans merci où la vie et la mort s'affrontent:
L'histoire n'a pas de but; elle est. La voie est plus importante que le but dans la mesure où elle peut, à tout instant, en particulier à celui de la mort devenir le but (15).
Isabelle FOURNIER.
Notes:
(1) Sgraffitti, [première parution, Antaios, 1960, Stuttgart] in Jüngers Werke, Bd. VII, Essays III, p. 354: «Wenn ein Mensch stirbt, wird sein Lebenslied im Äther gespielt. Er darf es mithören, bis er ins Schweigen übergeht. Er lauscht dann so aufmerksam inmitten der Qualen, der Unruhe. In jedem Fall war es ein großer Meister, der das Lied ersann. Doch kann es in seinem reinen Klange nur vernommen werden, wo der Wille erlischt, wo er der Hingabe weicht».
(2) Das abenteurliche Herz 1, Berlin, 1928 [1929], p. 76: «Das Leben ist eine Schleife, die sich im Dunkeln schürzt und löst. Vielleicht wird der Tod unser größtes und gefährlichstes Abenteuer sein, denn nicht ohne Grund sucht der Abenteurer immer wieder seine flammenden Ränder auf».
(3) Das abenteurliche Herz 2, Berlin, 1938 [1942], p. 38: «Er nannte den Tod die wundersamste Reise, die der Mensch vermöchte, ein wahres Zauberstück, die Tarnkappe aller Tarnkappen, auch die ironische Replik im ewigen Streit, die letzte und ungreifbare Burg aller Freien und Tapferen».
(4) An der Zeitmauer, [première parution Antaios, 1, 209-226], Stuttgart, 1959, p. 159: «Wer keine Todesfurcht kennt, steht mit Göttern auf vertrautem Fuß».
(5) Das abenteureliche Herz 2, ibid., p. 102: «[...] und weißt du, was ich glaube? Was wir hier leben, ist nur geträumt; wir erleben aber nach dem Tode dasselbe in Wirklichkeit».
(6) Novalis, Hymnen an die Nacht, Heinrich von Ofterdingen. Goldmann Verlag, Stuttgart, 1979, p. 161-162: «Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt[...]/Wehmuth und Wollust, Tod und Leben/ Sind hier in innigster Sympathie».
(7) Das abenteureliche Herz 2, ibid. p. 83: «Im letzten Schimmer des Lichtes ahnte ich noch: Ich würde unzählige Male leben, demselben Mädchen begegnen, dieselbe Blume essen und daran zugrunde gehen, ebenso wie dies bereits unzählige Male geschehen war».
(8) voir à ce propos le symbolisme des couleurs dans le Cœur aventureux.
(9) Das abenteurliche Herz 1, ibid., p. 74: «Ach, du warst in abgebten Zeiten/ Meine Schwester oder meine Frau».
(10) Das abenteurliche Herz 1, ibid., p. 74: «Sind Berge, Wellen, Himmel nicht ein Teil von mir und meiner Seele, ich von ihnen?».
(11) Zwei Mal Halley, Stuttgart, 1987, p. 33: «Mich beschäftigt vielmehr seit langem die Frage des Überganges; ein irdener Becher wird in Gold verwandelt und dann in Licht. Daran beunruhigt nur eines: ob diese Erhöhung noch zur Kenntnis genommen wird, noch ins Bewußtsein fällt».
(12) Die Schere, Stuttgart, 1989, p. 173 sq.
(13)Schere, p. 173.
(14) Annäherungen, Drogen und Rausch, Stuttgart, 1970, [Ullstein, 1980], p. 348: «Annäherung wird durch Eintretendes bestätigt, Anwesendes durch Abwesendes ergänzt. Sie trefen sich im Spiegel, der Zeit und Unbehagen löscht. Nie war der Spiegel so leer, so ohne Staub und bildlos —dafür haben zwei Jahrhunderte gesorgt. Dazu das Klopfen in der Werkstatt— der Vorhang wird durchsichtig; die Bühne ist frei».
(15) Die Schere, ibid., p. 120: «Die Geschichte hat kein Ziel; sie existiert. Der Weg ist wichtiger als das Ziel, insofern, als er in jedem Augenblick vor allem in dem des Todes Ziel werden kann».
 Dans son Ouverture de la Chasse publiée en 1968, Dominique de Roux évoque la spécificité géopolitique et eschatologique de la Roumanie en ces termes : "Comme le Tibet, la Roumanie est un pays circulaire, un pays central - une Fondation du Milieu - qui tourne catastrophiquement sur lui-même, de gauche à droite dans ses périodes amères ou fastueuses, de droite à gauche dans les Temps de ses ordalies. Evidemment, les notions eidétiques de gauche, de droite, se trouvent utilisées, là, dans leur sens le plus intérieur, le plus interdit". Et puis, plus loin : "Bucarest c'est l'Assomption de l'Europe comme le dirait Raymond Abellio, une latinité antérieure, innocente ou peut-être pure, dans ses profondeurs interdites, et choisir l'Europe n'est-ce pas choisir cette plus grande latinité".
Dans son Ouverture de la Chasse publiée en 1968, Dominique de Roux évoque la spécificité géopolitique et eschatologique de la Roumanie en ces termes : "Comme le Tibet, la Roumanie est un pays circulaire, un pays central - une Fondation du Milieu - qui tourne catastrophiquement sur lui-même, de gauche à droite dans ses périodes amères ou fastueuses, de droite à gauche dans les Temps de ses ordalies. Evidemment, les notions eidétiques de gauche, de droite, se trouvent utilisées, là, dans leur sens le plus intérieur, le plus interdit". Et puis, plus loin : "Bucarest c'est l'Assomption de l'Europe comme le dirait Raymond Abellio, une latinité antérieure, innocente ou peut-être pure, dans ses profondeurs interdites, et choisir l'Europe n'est-ce pas choisir cette plus grande latinité".



 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg « Devenir immortel… et puis mourir ». C’était la grande ambition que lui confiait Jean-Luc Godard dans À bout de souffle, qui lui prêtait les traits de Jean-Pierre Melville. L’écrivain d’origine roumaine, Jean Parvulesco s’est éteint le 21 novembre à l’âge de 81 ans. Entre littérature, cinéma, et engagement politique, sa trajectoire artistique se distingue par sa singularité. Il n’a pas 20 ans lorsqu’il fuit le régime communiste de son pays et réussit à rejoindre Paris. Il y fréquente différents milieux artistiques, dont celui de la Nouvelle Vague. Son personnage apparaît dans À bout de souffle, et il a un petit rôle dans un film d’Éric Rohmer. En politique, Parvulesco est proche de la Nouvelle Droite, lié à certains gaullistes, ainsi qu’à l’Organisation de l’Armée secrète (OAS). Il commence à écrire dans les années 1960 et entame une carrière de journaliste. De nombreux articles sont publiés notamment dans le quotidien Combat. Son entrée en littérature ne s’effectue qu’à la fin des années 1970. Le recueils de poèmes, Traité de la chasse au faucon (L'Herne, 1978), est très remarqué. Une dizaine d’essais et une trentaine de romans, dont La servante portugaise (éd. L’âge d’homme), suivront. Un retour en Colchide, son dernier roman, est paru en 2010 chez Guy Trédaniel.
« Devenir immortel… et puis mourir ». C’était la grande ambition que lui confiait Jean-Luc Godard dans À bout de souffle, qui lui prêtait les traits de Jean-Pierre Melville. L’écrivain d’origine roumaine, Jean Parvulesco s’est éteint le 21 novembre à l’âge de 81 ans. Entre littérature, cinéma, et engagement politique, sa trajectoire artistique se distingue par sa singularité. Il n’a pas 20 ans lorsqu’il fuit le régime communiste de son pays et réussit à rejoindre Paris. Il y fréquente différents milieux artistiques, dont celui de la Nouvelle Vague. Son personnage apparaît dans À bout de souffle, et il a un petit rôle dans un film d’Éric Rohmer. En politique, Parvulesco est proche de la Nouvelle Droite, lié à certains gaullistes, ainsi qu’à l’Organisation de l’Armée secrète (OAS). Il commence à écrire dans les années 1960 et entame une carrière de journaliste. De nombreux articles sont publiés notamment dans le quotidien Combat. Son entrée en littérature ne s’effectue qu’à la fin des années 1970. Le recueils de poèmes, Traité de la chasse au faucon (L'Herne, 1978), est très remarqué. Une dizaine d’essais et une trentaine de romans, dont La servante portugaise (éd. L’âge d’homme), suivront. Un retour en Colchide, son dernier roman, est paru en 2010 chez Guy Trédaniel.


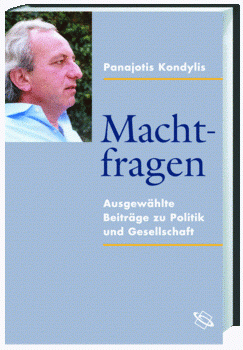



 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998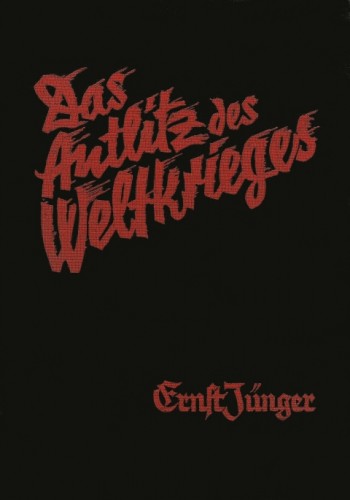 La vie semble se réduire à n'être que le reflet de cette vie véritable, impérissable, qui ne jaillit qu'au-delà de la mort. Voyons-y une fois encore le triomphe de l'être intemporel sur l'existence terrestre, qui est déterminée par le temps qui s'écoule perpétuellement!
La vie semble se réduire à n'être que le reflet de cette vie véritable, impérissable, qui ne jaillit qu'au-delà de la mort. Voyons-y une fois encore le triomphe de l'être intemporel sur l'existence terrestre, qui est déterminée par le temps qui s'écoule perpétuellement!


 Marxiste, révolutionnaire, syndicaliste et Irlandais. C’est ainsi que l’on peut définir James Connolly (1868-1916). S’il fut un infatigable rédacteur d’articles et auteur d’essais, il fut aussi un militant proche des ouvriers dont il défendait la cause que ce soit en Écosse, aux États-Unis ou en Irlande. Il est l’un des dirigeants de l’insurrection de Pâques 1916, les « Pâques sanglantes ».
Marxiste, révolutionnaire, syndicaliste et Irlandais. C’est ainsi que l’on peut définir James Connolly (1868-1916). S’il fut un infatigable rédacteur d’articles et auteur d’essais, il fut aussi un militant proche des ouvriers dont il défendait la cause que ce soit en Écosse, aux États-Unis ou en Irlande. Il est l’un des dirigeants de l’insurrection de Pâques 1916, les « Pâques sanglantes ».



