vendredi, 12 février 2010
Participation gaullienne et "ergonisme": deux corpus d'idées pour la société de demain
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Participation gaullienne et «ergonisme»:
deux corpus d'idées pour la société de demain
par Robert Steuckers
Beaucoup de livres, d'essais et d'articles ont été écrits sur l'idée de participation dans le gaullisme des années 60. Mais de toute cette masse de textes, bien peu de choses sont passées dans l'esprit public, dans les mentalités. En France, une parcelle de l'intelligentsia fit preuve d'innovation dans le domaine des projets sociaux quand le monde industrialisé tout entier se contentait de reproduire les vieilles formules libérales ou keynésiennes. Mais l'opinion publique française n'a pas retenu leur message ou n'a pas voulu le faire fructifier.
 On ne parle plus, dans les salons parisiens, de la participation suggérée par De Gaulle, ni de l'idée séduisante d'«intéressement» des travailleurs aux bénéfices des entreprises, ni des projets «pancapitalistes» d'un Marcel Loichot ou d'un René Capitant. Lors des commémorations à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Charles De Gaulle, ces projets, pourtant très intéressants et, aujourd'hui encore, riches de possibles multiples, n'ont guère été évoqués. Couve de Murville, sur le petit écran, a simplement rappelé la diplomatie de «troisième voie» amorcée par De Gaulle en Amérique latine, au Québec et à Phnom Penh (1966). Si la «troisième voie» en politique extérieure suscite encore de l'intérêt, en revanche, la «troisième voie» envisagée pour la politique intérieure est bel et bien oubliée.
On ne parle plus, dans les salons parisiens, de la participation suggérée par De Gaulle, ni de l'idée séduisante d'«intéressement» des travailleurs aux bénéfices des entreprises, ni des projets «pancapitalistes» d'un Marcel Loichot ou d'un René Capitant. Lors des commémorations à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Charles De Gaulle, ces projets, pourtant très intéressants et, aujourd'hui encore, riches de possibles multiples, n'ont guère été évoqués. Couve de Murville, sur le petit écran, a simplement rappelé la diplomatie de «troisième voie» amorcée par De Gaulle en Amérique latine, au Québec et à Phnom Penh (1966). Si la «troisième voie» en politique extérieure suscite encore de l'intérêt, en revanche, la «troisième voie» envisagée pour la politique intérieure est bel et bien oubliée.
Outre les textes de René Capitant ou l'étude de M. Desvignes sur la participation (1), il nous semble opportun de rappeler, notamment dans le cadre du «Club Nationalisme et République», un texte bref, dense et chaleureux de Marcel Loichot, écrit en collaboration avec le célèbre et étonnant Raymond Abellio en 1966, Le cathéchisme pancapitaliste. Loichot et Abellio constataient la faiblesse de la France en biens d'équipement par rapport à ses concurrents allemands et japonais (déjà!). Pour combler ce retard —que l'on comparera utilement aujourd'hui aux retards de l'Europe en matières d'électronique, d'informatique, de création de logiciels, en avionique, etc…— nos deux auteurs suggéraient une sorte de nouveau contrat social où capitalistes et salariés se partageraient la charge des auto-financements dans les entreprises. Ce partage, ils l'appelaient «pancapitaliste», car la possession des richesses nationales se répartissait entre toutes les strates sociales, entre les propriétaires, les patrons et les salariés. Cette diffusion de la richesse, expliquent Loichot et Abellio (2), brise les reins de l'oligo-capitalisme, système où les biens de production sont concentrés entre les mains d'une petite minorité (oligo en grec) de détenteurs de capitaux à qui la masse des travailleurs «aliène», c'est-à-dire vend, sa capacité de travail. Par opposition, le pancapitalisme, ne s'adressant plus à un petit nombre mais à tous, entend «désaliéner» les salariés en les rendant propriétaires de ces mêmes biens, grâce à une juste et précise répartition des dividendes, s'effectuant par des procédés techniques dûment élaborés (condensés dans l'article 33 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises si celles-ci attribuent à leur personnel des actions ou parts sociales).
L'objectif de ce projet «pancapitaliste» est de responsabiliser le salarié au même titre que le patron. Si le petit catéchisme pancapitaliste de Loichot et Abellio, ou le conte de Futhé et Nigo, deux pêcheurs japonais, dont l'histoire retrace l'évolution des pratiques économiques (3), peuvent nous sembler refléter un engouement utopique, parler le langage du désir, les théoriciens de la participation à l'ère gaullienne ne se sont pas contentés de populariser outrancièrement leurs projets: ils ont su manier les méthodes mathématiques et rationnelles de l'économétrie. Mais là n'est pas notre propos. Nous voudrions souligner ici que le projet gaullien global de participation s'est heurté à des volontés négatives, les mêmes volontés qui, aujourd'hui encore, bloquent l'évolution de notre société et provoquent, en bon nombre de points, son implosion. Loichot pourfendait le conservatisme du patronat, responsable du recul de la France en certains secteurs de la production, responsable du mauvais climat social qui y règnait et qui décourageait les salariés.
Deuxième remarque: qui dit participation dit automatiquement responsabilité. Le fait de participer à la croissance de son entreprise implique, de la part du salarié, une attention constante à la bonne ou la mauvaise marche des affaires. Donc un rapport plus immédiat aux choses de sa vie quotidienne, donc un ancrage de sa pensée pratique dans le monde qui l'entoure. Cette attention, toujours soutenue et nécessaire, immunise le salarié contre toutes les séductions clinquantes des idéologies vagues, grandiloquentes, qui prétendent abolir les pesanteurs qu'impliquent nécessairement les ancrages dans la vie. Jamais les modes universalistes, jamais les slogans de leurs relais associatifs (comme SOS-Racisme par exemple), n'auraient pu avoir autant d'influence, si les projets de Loichot, Capitant, Abellio, Vallon s'étaient ancrés dans la pratique sociale quotidienne des Français. Ceux-ci, déjà victimes des lois de la Révolution, qui ont réduit en poussière les structures professionnelles de type corporatif, victimes une nouvelle fois de l'inadaptation des lois sociales de la IIIième République, victimes de la mauvaise volonté du patronat qui saborde les projets gaulliens de participation, se trouvent systématiquement en porte-à-faux, davantage encore que les autres Européens et les Japonais, avec la réalité concrète, dure et exigeante, et sont consolés par un opium idéologique généralement universaliste, comme le sans-culottisme de la Révolution, la gloire de l'Empire qui n'apporte aucune amélioration des systèmes sociaux, les discours creux de la IIIième bourgeoise ou, aujourd'hui, les navets pseudo-philosophiques, soft-idéologiques, de la médiacratie de l'ère mitterandienne. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, les Allemagnes restauraient leurs associations professionnelles ou les maintenaient en les adaptant, Bismarck faisait voter des lois de protection de la classe ouvrière, les fascismes italiens ou allemands peaufinaient son œuvre et imposaient une législation et une sécurité sociales très avancées, la RFA savait maintenir dans son système social ce qui avait été innovateur pendant l'entre-deux-guerres (Weimar et période NS confondues), le Japon conservait ses réflexes que les esprits chagrins décrètent «féodaux»... Toutes mesures en rupture avec l'esprit niveleur, hostile à tout réflexe associatif de nature communautaire, qui afflige la France depuis l'émergence, déjà sous l'ancien régime, de la modernité individualiste.
 L'idée de participation est un impératif de survie nationale, identitaire et économique, parce qu'elle implique un projet collectif et non une déliquescence individualiste, parce qu'elle force les camarades de travail d'une entreprise à se concerter et à discuter de leurs vrais problèmes, sans être doublement «aliénés»: et par les mécanismes économiques du salariat et par les discours abrutissants des médias qui remplacent désormais largement l'opium religieux, comme l'entendaient Feuerbach, Marx et Engels, dont les idées sont trahies allègrement aujourd'hui par ceux qui s'en revendiquent tout en les figeant et les dénaturant. La réalité, qui n'est pas soft mais hard, contrairement à ce qu'affirment les faux prophètes, a déjà dû s'adapter à cette nécessité de lier le travailleur immédiatement à sa production: l'éléphantiasis tant des appareils administratifs étatisés de type post-keynésiens que des énormes firmes transnationales ont généré, à partir de la première crise pétrolières de 1973, une inertie et une irresponsabilité croissantes de la part des salariés, donc une perte de substance humaine considérable. Il a fallu trancher stupidement, avec gâchis, au nom de chimères opposées, en l'occurrence celles du néo-libéralisme reaganien ou thatchérien. Renvoyer des salariés sans préparation au travail indépendant. Résultat, dans les années 80: accroissement exponentiel du chômage, avec des masses démobilisées n'osant pas franchir ce pas, vu que les législations de l'ère keynésienne (qui trahissaient Keynes) avaient pénalisé le travail indépendant. Autre résultat, au seuil des années 90: une inadaptation des structures d'enseignement aux besoins réels de la société, avec répétition sociale-démocrate des vieux poncifs usés, avec hystérie néo-libérale destructrice des secteurs universitaires jugés non rentables, alors qu'ils explorent, souvent en pionniers, des pans entiers mais refoulés du réel; et produisent, du coup, des recherches qui peuvent s'avérer fructueuses sur le long terme.
L'idée de participation est un impératif de survie nationale, identitaire et économique, parce qu'elle implique un projet collectif et non une déliquescence individualiste, parce qu'elle force les camarades de travail d'une entreprise à se concerter et à discuter de leurs vrais problèmes, sans être doublement «aliénés»: et par les mécanismes économiques du salariat et par les discours abrutissants des médias qui remplacent désormais largement l'opium religieux, comme l'entendaient Feuerbach, Marx et Engels, dont les idées sont trahies allègrement aujourd'hui par ceux qui s'en revendiquent tout en les figeant et les dénaturant. La réalité, qui n'est pas soft mais hard, contrairement à ce qu'affirment les faux prophètes, a déjà dû s'adapter à cette nécessité de lier le travailleur immédiatement à sa production: l'éléphantiasis tant des appareils administratifs étatisés de type post-keynésiens que des énormes firmes transnationales ont généré, à partir de la première crise pétrolières de 1973, une inertie et une irresponsabilité croissantes de la part des salariés, donc une perte de substance humaine considérable. Il a fallu trancher stupidement, avec gâchis, au nom de chimères opposées, en l'occurrence celles du néo-libéralisme reaganien ou thatchérien. Renvoyer des salariés sans préparation au travail indépendant. Résultat, dans les années 80: accroissement exponentiel du chômage, avec des masses démobilisées n'osant pas franchir ce pas, vu que les législations de l'ère keynésienne (qui trahissaient Keynes) avaient pénalisé le travail indépendant. Autre résultat, au seuil des années 90: une inadaptation des structures d'enseignement aux besoins réels de la société, avec répétition sociale-démocrate des vieux poncifs usés, avec hystérie néo-libérale destructrice des secteurs universitaires jugés non rentables, alors qu'ils explorent, souvent en pionniers, des pans entiers mais refoulés du réel; et produisent, du coup, des recherches qui peuvent s'avérer fructueuses sur le long terme.
Les vicissitudes et les dysfonctionnements que nous observons dans notre société contemporaine proviennent de ce désancrage permanent qu'imposent les idéologies dominantes, privilégiant toutes sortes de chimères idéologiques, transformant la société en un cirque où des milliers de clowns ânonnent des paroles creuses, sans rien résoudre. La participation et l'intéressement sont les aspects lucratifs d'une vision du monde qui privilégie le concret, soit le travail, la créativité humaine et la chaîne des générations. Ce recours au concret est l'essence même de notre démarche. Au-delà de tous les discours et de toutes les abstractions monétaires, de l'étalon-or ou du dollar-roi, le moteur de l'économie, donc de notre survie la plus élémentaire, reste le travail. Définir en termes politiques notre option est assez malaisé: nous ne pouvons pas nous définir comme des «identitaires-travaillistes», puisque le mot «travailliste» désigne les sociaux-démocrates anglais ou israëliens, alliés aux socialistes de nos pays qui claudiquent de compromissions en compromissions, depuis le programme de Gotha jusqu'à celui de Bad Godesberg (4), depuis les mesures libérales du gouvernement Mitterand jusqu'à son alliance avec Bernard Tapie ou son alignement inconditionnel sur les positions américaines dans le Golfe.
Jacob Sher, économiste qui a enseigné à l'Institut polytechnique de Léningrad avant de passer à l'Ouest, participationniste sur base d'autres corpus que ceux explorés par les gaulliens Loichot, Vallon ou Capitant, a forgé les mots qu'il faut —ergonisme, ergonat, ergonaire (du grec ergon, travail)— pour désigner sa troisième voie basée sur le Travail. Issu de la communauté juive de Vilnius en Lithuanie, Jacob Sher partage le sort de ces Israëlites oubliés par nos bateleurs médiatiques, pourtant si soucieux d'affirmer et d'exhiber un philosémitisme tapageur. Oublié parce qu'il pense juste, Sher nous explique (5) très précisément la nature éminement démocratique et préservatrice d'identité de son projet, qu'il appelle l'ergonisme. Il est démocratique car la richesse, donc le pouvoir, est répartie dans l'ensemble du corps social. Il préserve l'identité car il n'aliène ni les masses de salariés ni les minorités patronales et fixe les attentions des uns et des autres sur leur tâche concrète sans générer d'opium idéologique, dissolvant toutes les formes d'ancrage professionnel ou identitaire.
La participation gaullienne et l'ergonat sherien: deux corpus doctrinaux à réexplorer à fond pour surmonter les dysfonctionnements de plus en plus patents de nos sociétés gouvernées par l'idéologie libérale saupoudrée de quelques tirades socialistes, de plus en plus rares depuis l'effondrement définitif des modèles communistes est-européens. Pour ceux qui sont encore tentés de raisonner en termes reagano-thatchériens ou de resasser les formules anti-communistes nées de la guerre froide des années 50, citons la conclusion du livre de Jacob Sher: «Et ce n'est pas la droite qui triomphe et occupe le terrain abandonné par la gauche, malgré les apparences électorales. Certes, la droite profite de la croissance du nombre des voix anti-gauche, mais ces voix ne sont pas pro-droite, elle ne s'enrichit pas d'adhésions à ses idées. Car la droite aussi est en déroute, son principe de société a aussi échoué. Ce sont les nouvelles forces qui montent, les nouvelles idées qui progressent, une nouvelle société qui se dessine. Non pas une société s'inscrivant entre les deux anciennes sociétés, à gauche ou à droite de l'une ou de l'autre, mais CONTRE elles, EN FACE d'elles, DIFFERENTE d'elles. TROISIEME tout simplement. Comme un troisième angle d'un triangle».
Robert Steuckers.
Notes
(1) Cf. M. Desvignes, Demain, la participation. Au-delà du capitalisme et du marxisme, Plon, Paris, 1978; René Capitant, La réforme pancapitaliste, Flammarion, Paris, 1971; Ecrits politiques, Flammarion, 1971; Démocratie et participation politique, Bordas, 1972.
(2) «Le catéchisme pancapitaliste» a été reproduit dans une anthologie de textes de Marcel Loichot intitulée La mutation ou l'aurore du pancapitalisme, Tchou, Paris, 1970.
(3) Le conte de Futhé et Nigo se trouve également dans Marcel Loichot, La mutation..., op. cit., pp. 615-621.
(4) Au programme de Gotha en 1875, les socialistes allemands acceptent les compromissions avec le régime impérial-libéral. A Bad Godesberg en 1959, ils renoncent au révolutionnarisme marxiste, donc à changer la société capitaliste. Le marxisme apparaît comme un compromis permanent face aux dysfonctionnements du système capitaliste.
(5) Jacob Sher, Changer les idées. Ergonisme contre socialisme et capitalisme, Nouvelles éditions Rupture, 1982.
00:08 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : théorie politique, politique, france, sciences politique, politologie, histoire, gaullisme, de gaulle, sociologie, économie, participation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 février 2010
Sousl l'oeil de Big Brother: une société sous surveillance?
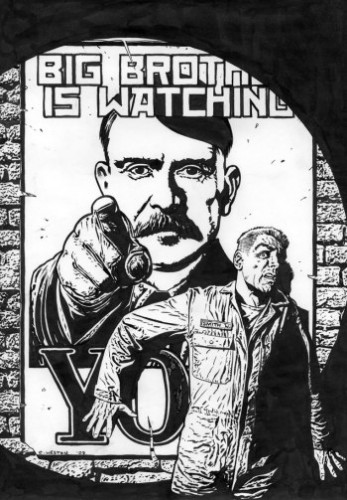 Sous l’œil de Big Brother : Une société sous surveillance ?
Sous l’œil de Big Brother : Une société sous surveillance ?
PARU DANS LE CHOC DU MOIS n°35 - Ex: http://www.lechocdumois.com/
Le pouvoir de l’Etat est-il devenu « absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux », selon les termes de Tocqueville ? Si tel est le cas, quelle saveur ont encore concrètement les libertés ? Faut-il encourager passivement ce « pouvoir immense et tutélaire », dont le même auteur prévoyait l’avènement avec quelque inquiétude ? Grave question que les criminalités émergentes font ressurgir avec d’autant plus d’acuité qu’elles nécessitent une surveillance accrue des services publics. Souvent au détriment des honnêtes gens.
L’efficacité avec laquelle les nouvelles menaces doivent être combattues ne saurait tout justifier. La question est politique. On ne perdra pas de vue que la sécurité est l’impératif catégorique des Etats modernes. Le prétexte de leurs secrètes tentations. Aussi, prudentia oblige, cette efficacité n’implique pas que les citoyens, auxquels l’administration moderne épargne le souci de songer à leur défense personnelle, s’en remettent à l’Etat les yeux fermés. La lâcheté d’une société civile qui s’est historiquement laissé désarmer peut avoir un coût redoutable. A fortiori dans un contexte globalisé, où prolifèrent parallèlement menaces et techniques complexes de collecte de l’information. La distance cri?tique du citoyen isolé s’y réduit comme une peau de chagrin. Ignorant la réalité des menaces qui l’environnent, celui-ci tend à s’en remettre au discours officiel. Telle menace extérieure, à l’ampleur imprécise, qu’elle soit d’ordre terroriste, mafieuse ou relevant de la délinquance financière, lui en impose plus que le pouvoir immédiat, aussi prégnant que ce der?nier puisse s’affirmer dans la vie quotidienne. On le sait, l’épouvantail effraie plus les moineaux que le filet.
Ainsi, plus se développe le souci légitime de faire face aux agressions les plus diverses et les plus inédites, plus se pose le problème de la gestion des risques dans les sociétés contemporaines. Là est le lieu de toutes les illusions d’optique quant à la perception des nuisances réelles. A ce titre, les risques pesant sur la santé constituent un révélateur formidable. Le phénomène des vaccinés contre le virus de la grippe A illustre cette porosité des populations aux slogans alarmistes. Aussi, dans le cas de menaces portant sur la sécurité, autrement angoissantes, mais éventuellement surévaluées au nom de ces « sciences du danger », qui prétendent éclairer les administrations en matière de précautions, beaucoup de conditionnements sont possibles, de dérives envisageables. Un carcan de normes inédites, asphyxiant les libertés, peut alors être imposé. Un exemple extrême : le Patriot Act de 2001, arguant des nouvelles menaces terroristes pour étendre brutalement les prérogatives de l’Etat américain en matière d’investigation.
Souriez, vous êtes filmé !
Au-delà de ce cas de démesure flagrante, remis en cause de?puis, c’est le quadrillage discret de nombreux pans de la vie sociale, par les administrations du monde occidental, qui doit attirer notre attention. De la gestion des entreprises à la vie privée, en passant par le patrimoine et les déplacements des personnes et des biens. En effet, les services publics de sécurité doivent aujourd’hui s’adapter à un contexte sans précédent. Dans le monde joliment bigarré du XXIe siècle, toutes sortes d’opportunités s’offrent désormais aux cerveaux délinquants qui pensent la criminalité, l’imaginent, et plus encore la calculent mathématiquement, selon un type d’analyses parfois peu éloignées de celles des grands prédateurs légaux de l’ordre libéral. Cette criminalité déterritorialisée, dématérialisée quand elle exploite les circuits d’Internet, s’organise en réseaux structurés. Au maillage que réalisent alors certains groupes délinquants sur un espace mondialisé, et donc sur une population ciblée à l’assiette infiniment plus large, répond le maillage que mettent en place peu à peu les administrations.
On connaissait jusqu’ici le tropisme tentaculaire de ces dernières. S’y ajoute désormais, pour compléter la panoplie du monstre, la propension à se doter d’une multitude d’yeux, sans oublier les grandes oreilles. Les réseaux d’écoute et de surveillance visuelle par satellite, déployés à une échelle très vaste et d’autant moins transparente, l’illustrent avec force. Nés en 1948 du contexte de la Guerre froide, avec les cinq pays anglos-saxons du pacte UKUSA, ces réseaux se sont de?puis étendus à d’autres Etats. Mais d’une manière générale, au-delà de tels systèmes, ce que peut redouter une société un tant soit peu soucieuse de ses libertés, c’est la mémoire colossale que les administrations tentent obstinément de se greffer à coups de logiciels toujours plus puissants.
Petit coup de projecteur en France. Le 1er octobre dernier, le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux indiquait à tous les préfets, réunis à Paris pour la circonstance, ses quatre priorités concernant les moyens de la police. Outre « le développement de la police scientifique et technique de masse », était affirmée la priorité du « déploiement des outils vidéo » avec un effort particulier pour les caméras embarquées, beaucoup plus efficaces. Le même Hortefeux ouvrait ensuite en novembre la 25e édition de Milipol, le salon mondial consacré à la sécurité des Etats. 900 exposants aux techniques de pointe pour ce marché – du flicage ? – en pleine croissance (8,4 % en 2008). Véritable Eldorado pour la vidéosurveillance. Minicaméras dissimulées dans une plaque d’immatriculation, drones filmant les foules, caméras-projectiles dotées d’un angle de 360°. Les hors-la-loi n’ont qu’à bien se tenir ! Les citoyens aussi.
C’est bien le nœud du problème. L’escalade technologique, qui entraîne les délinquants et les services de sécurité dans le même vertige, a des conséquences nouvelles. La frontière entre prévention et contrôle s’amenuise. Ainsi le veut la raison technocratique sur laquelle se greffe cette logique technicienne. N’est en effet nullement en cause une improbable volonté autoritaire des gouvernements. L’air du temps n’est plus aux Etats policiers, en dépit des fantasmes de l’extrême-gauche, qui focalise grossièrement ses critiques sur de prétendues intentions répressives. Curieusement, ses membres ignorent le passage des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle, qu’ont montré les analyses des philosophes Gilles Deleuze et Michel Foucault.
Le monde d’Orwell en version numérique
Fondamentalement, sont en cause les mécanismes de con?trôle induits par le système global, condamné à miser sur un optimisme technologique. Ceci afin de concilier la marchandisation du monde et la sécurité de cette universalité errante des individus qui la mettent en œuvre. D’où la dimension planétaire du phénomène et sa logique d’intégration toujours plus étroite. On observe d’abord cette logique à travers la collaboration croissante des services administratifs à l’intérieur d’un même Etat. A ce titre, les services fiscaux, par exemple, deviennent des partenaires de choix pour les services publics de sécurité. L’information est moins cloisonnée, mise en commun. Concertation et collaboration par le rapprochement des fichiers respectifs se généralisent. Aussi voit-on les lignes traditionnelles de l’investigation ordinaire se déplacer. Au-delà, s’impose, sur un mode semblable, la coopération plus étroite entre Etats et entre organisations internationales.
Cependant, le point le plus avancé de cette intégration réside dans le transfert de plus en plus fréquent d’informations du secteur privé vers le public. Et inversement. Les perspectives ouvertes par le numérique ont fait passer la surveillance au stade d’une industrie. Au détriment de toute légitimité. La « Commission nationale de l’informatique et des libertés » (CNIL) n’a pas fini d’être dépassée. C’est l’impératif d’une véritable chaîne de la sécurité, au-delà du champ traditionnel du bien commun, qui a fait naître cette logique marchande. Quand la sécurité devient un bien commercial, on assiste alors à des liens auparavant inconcevables. Ainsi des relations privilégiées entre la National Science Agency (NSA) américaine et Microsoft. Ou de la vente d’images par Spot Image, filiale du CNES français, à Google Earth. Par ail?leurs, d’autres acteurs deviennent décisifs, comme les compagnies d’assurances, qui contrôlent désormais nombre de sociétés privées de télésurveillance.
Est-ce la préfiguration d’une ère nouvelle ? C’est, en tout cas, la rançon d’une longue fuite en avant. Sans doute la con?séquence lointaine d’un consentement séculaire, celui de la prise en charge du vivre-ensemble par une providence séculière, un Léviathan. La surveillance comme nouveau mode de régulation sociale, voilà ce qu’avait bien saisi Orwell. Ses intuitions restent valables. Seulement, aujourd’hui, Big Brother n’est plus moustachu. Dépersonnalisé, il est également dématérialisé. C’est une puissance anonyme, tapie dans les circuits de notre quotidien numérique.
Vincent Villemont
A lire :
Patrick Le Guyader, Les systèmes électroniques et informatiques de surveillance : contrôle de la vie privée des personnes et des biens,
Hermès science publications-Lavoisier, 2 008.
Frédéric Ocqueteau, Les défis de la sécurité privée. Protection et surveillance dans la France d’aujourd’hui, L’Harmattan, 1 997.
00:28 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, etat policier, totalitarisme, big brother, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, médias |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 février 2010
Neue Formen der Weltpolitik
 Neue Formen der Weltpolitik
Neue Formen der Weltpolitik
machen.
Oswald Spengler, Aus einem Vortrage "Neue Formen der Weltpolitik", gehalten am 28. April 1924 im Überseeclub zu Hamburg.
http://www.ueberseeclub.de/vortrag/v...1924-04-28.pdf
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, années 20, weimar, oswald spengler, révolution conservatrice, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 février 2010
Piet Tommissen: een krasse tachtiger
Piet Tommissen : Een krasse tachtiger
Peter Logghe - http://www.peterlogghe.be/
Professor dr. Em. Piet Tommissen staat helemaal achter het principe dat men nooit te oud is om actief te blijven, ook intellectueel. Op zijn 82ste presteert deze oud-academicus het om een bundeling bijdragen te publiceren. Bedenkingen en interessante achtergrondinformatie onder andere bij het ontstaan en de evolutie van een tijdschrift als Golfslag, een kort essay over Wies Moens als heraut van de ‘konservatieve revolutie’ in Vlaanderen. Een bedrage over de zogenaamde Politieke Academie als tussenoorlogs conservatief vormingsinstituut, en over ‘De Gemeenschap’ van pater Bonifaas Luykx tot de wet van Brück.
 Voor wie professor Tommissen niet zou kennen, hij gaat de wereld rond als dé Carl Schmitt-kenner bij uitstek, die gans Europa ons trouwens benijdt. Derhalve kunnen we niet om de vaststelling heen dat zowat elke grote natie zijn Schmitt-renaissance heeft gekend, met uitzondering van dit dwergenlandje België. Terwijl juist hier…inderdaad!
Voor wie professor Tommissen niet zou kennen, hij gaat de wereld rond als dé Carl Schmitt-kenner bij uitstek, die gans Europa ons trouwens benijdt. Derhalve kunnen we niet om de vaststelling heen dat zowat elke grote natie zijn Schmitt-renaissance heeft gekend, met uitzondering van dit dwergenlandje België. Terwijl juist hier…inderdaad!
Maar niet alleen de jurist Carl Schmitt behoort tot de geprefereerde onderzoeksdomeinen van Piet Tommissen. Zo behoren ook de Italiaanse topintellectueel Vilfredo Pareto tot zijn lezerslijstje. Professor Tommisssen moet trouwens ook een van de eersten zijn geweest die het Mohleriaans begrip ‘konservatieve revolutie’ in de Lage Landen binnenbracht en enkele Vlaamse en Nederlandse jongeren een fascinatie voor het onderwerp zou meegeven dat een leven lang zou blijven duren.
Op 82-jarige leeftijd publiceren en dat dan de titel “Buitenissigheden” als titel meegeven: prachtig gewoon. Met bijzondere interesse heb ik kennis genomen van de wet van Brück – waarbij het aardmagnetisme als verklaringsgrond wordt gebruikt voor het cyclische geschiedenisverloop – en van de studie over Wies Moens, die ik in een Duitse versie ook al ergens kon lezen. Vooral boeide mij zijn studie over het ontstaan van het Vlaamse tijdschrift Golfslag. Dit kwam tot stand uit de vruchtbare samenkomsten van jongeren tijdens en na de jongste Wereldoorlog. Bijeenkomsten in Knokke-Heist en later in Antwerpen en waarbij steeds dezelfde namen terugkomen: Manu Ruys, Ivo Michiels, Adriaan De Roover, Hugo en Arnold Van der Hallen. Volgens historicus Etienne Verhoeyen een “extreem rechts tijdschrift”, maar het onderzoek van professor Piet Tommissen legt toch heel wat andere accenten bloot. De doelstelling van Golfslag bijvoorbeeld had weinig of geen extreem rechtse kleur: het wilde ‘jong, durvend en gelovend’ zijn. En een van de initiatiefnemer, Hugo Van der Hallen, verwoordde het bijvoorbeeld zo: “Golfslag wilde provoceren, uitdagen, progressief, niet conservatief, niet berustend maar durvend”. Of iets verder in het gesprek liet Van der Hallen zich ontvallen: “Golfslag was dus niet een project van jongeren die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog van de officiële VNV-koers hadden gedistanciëerd. Ik was bij mijn weten de enige van het groepje die zich tijdens de oorlog enigszins politiek had geëngageerd. Het was in eerste instantie ene project van katholieke studenten die in het achterhoofd meer aan een soort heropbloei van het AKVS dachten”.
Een oplage van ongeveer 2.000 exemplaren: niet mis voor een blad dat in de moeilijke en zware naoorlogse repressietoestand verscheen; Professor Tommissen kon meticuleus een lijst van medewerkers, losse en vaste, bijeenbrengen en daar zitten veel interessante namen bij, dat moet gezegd. Golfslag zou uiteindelijk ten onder gaan onder invloed van verschillende factoren. Verschillende kernmedewerkers werden voor opslorpende professionele taken geplaatst, de tijdsgeest verplaatste zich gedeeltelijk naar andere interessedomeinen en een louter cultureel tijdschrift bleek minder aan een behoefte te beantwoorden. In 1949 stopte de redactie er mee, maar andere initiatieven waren ondertussen al opgestart en zagen op een andere plaats het levenslicht.
Deze “Buitenissigheden” geven de geïnteresseerde zeer aangename leesmomenten, vooral omdat de stijl van professor em. Piet Tommissen zeer soepel gebleven is, ondanks (of juist door) de hoge leeftijd van de auteur. Piet Tommissen publiceerde in 2007 al over Georges Sorel en zou dit jaar een werk over Hugo Ball op de markt brengen. Nouvelle Ecole, het Franse tijdschrift (of jaarboek) van Alain de Benoist, brengt in november een speciaal nummer uit over Georges Sorel, met daarin een tekst van de onvermoeibare Piet Tommissen. Wij kijken alvast met veel interesse uit naar volgende buitenissigheden en roepen de auteur toe: ad multos annos!
Tommissen, P., “Nieuwe Buitenissigheden”, 2007, Apsis S.A., La Hulpe, 188 pag.
ISBN 2 – 9600590 – 3 – 4.
(P.L.)
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politique, théorie politique, flandre, carl schmitt, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 février 2010
Wessen Gegner?
 Wessen Gegner?
Wessen Gegner?
Doch diese Begriffe sind so mit Gefühlen, mit dem Lebenssinn wie mit der Feindschaft von Millionen berknüpft, dass es schon deshalb für den einzelnen, der aus der Phrase zur Einsicht in die Tatsachen zu gelangen sucht, ungeheuer schwer ist, sich hindurchzukämpfen.
Im Kampf gegen die Unklarheiten des Denkens und die Unaufrichtigkeit des Wollens will der "Gegner" den einzelnen helfen, zu weitsichtigeren übergeordneten Meinungen zu gelangen. Er bekämpft ebenso die falschen Hoffnungen der Schlagwort-Idealisten wie die Hoffnungslosigkeit, d. h. Trägheit und Müdigkeit derer, die keinen Boden mehr unter den Füssen fühlen.
In allen Lagern mehren sich die Menschen, die sich auf der Suche nach Erkenntnis der wirklichen Zusammenhänge in dem heutigen Geschehen nicht mehr mit den Parteischlagworten und der Schuld der anderen begnügen können. Der "Gegner" stellt sich denen, die auf neuen und vergessenen Wegen den Sinn dieser Zeit und die Lösung der uns brennenden Fragen zur erfahren streben, zur Verfügung.
Vielleicht sind manche Perspektiven irrig, manche Anschauungen sogar falsch. Wem schadet das?
Wir sammeln die Fragestellungen in den Bewusstsein, dass überall unter dem Chaos der Meinungen das Wissen um die Zeit, das Bewusstsein für das, was im Grunde vor sich geht, zu wachsen und zu reifen beginnt.
Man möge sich darüber beruhigen, dass der "Gegner" kein "Programm" habe, es gibt heute Wichtigeres zu entwickeln als Programme. Es gilt die Konzeption einer neuen einheitlichen Weltanschauung, die hier und dort bereits sichtbar wird. Denn erst eine neue an dem riesenhaften Wissen früherer Kulturen geschulte Sinngebung wird die bedeutenden Teilergebnisse der heutigen offiziellen Wissenschaften und die ungeheuren Wirtschaftskräfte, die diese jetzt vergehende Epoche herausgebildet hat, für Deutschland, für Europa, für alle Länder der Erde fruchtbar machen können.
Bewusst oder unbewusst - der Mythos der Zeit bildet uns bereits, und wir ihn.
Erst grosse, aus tiefen Erkenntnissen stammende Gedanken und Aufgaben werden die von den verschiedenen Grundeinstellungen zum gemeinsamen Werk vordringenden Gegner wirklich verbinden können - hierzu ist der "Gegner" eine Vorarbeit.
Der Gegner, Heft 1/2, 1932.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, années 30, antagonisme, idéologie, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 février 2010
Le bourgeois selon Sombart
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979
Le bourgeois selon Sombart
par Guillaume Faye
Dans Le Bourgeois, paru en France pour la première fois en 1926, Werner Sombart, une des figures les plus marquantes de l'école économique "historique" allemande, analyse la bourgeoisie comme l'effet d'une rencontre entre un phénomène de "psychologie historique" et des faits proprement économiques. Cette analyse le sépare de la pensée libérale comme des idées marxistes.
Comme pour Groethuysen, le bourgeois représente d'après Sombart, "l'homme de notre temps". "Le bourgeois", écrit-il, représente la forme la plus typique de l'esprit de notre temps". Le bourgeois n'est pas seulement un type économique, mais "un type social et psychologique".
Sombart accorde au bourgeois l'"esprit d'entreprise"; et c'est, effectivement, de notre point de vue, une de ses caractéristiques jusqu'au milieu du XXème siècle. Mais Sombart prophétise qu'à la fin du XXème siècle, la bourgeoisie, largement "fonctionnarisée" et créatrice de l'Etat-Providence aura perdu cet esprit d'entreprise au profit de la "mentalité du rentier".
Cependant, elle a conservé ce que décelait Sombart à l'origine de sa puissance: "la passion de l'or et l'amour de l'argent ainsi que l'esprit de calcul", comme le note également d'ailleurs Gehlen.
"Il semblerait, écrit Sombart, que l'âpreté au gain (lucri rabies) ait fait sa première apparition dans les rangs du clergé. Le bourgeois en héritera directement".
Sombart, décelant le "démarrage" de l'esprit bourgeois au Moyen Age, en relève une spécificité fondamentale: l'esprit d'épargne et de rationalité économique (1), caractère qui n'est pas critiquable en soi, à notre avis, mais qui le devient dès lors que, comme de nos jours, il est imposé comme norme à toutes les activités de la société (réductionnisme).
Il ne faut donc pas soutenir que l'esprit bourgeois ne fait pas partie de notre tradition culturelle; de même, Sombart remarque que le mythe de l'or était présent dans les Eddas et que les peuples européens ont toujours été attachés à la "possession des richesses" comme "symboles de puissance".
Dans notre analyse "antibourgeoise" de la civilisation contemporaine, ce n'est pas cet esprit économique que nous critiquons "en soi", c'est sa généralisation. De même l'appât des richesses ne peut être honni "dans l'absolu", mais seulement lorsqu'il ne sert qu'à l'esprit de consommation et de jouissance passive.
Au contraire, le goût de la richesse (cf. les mythes européens du "Trésor à conquérir ou à trouver"), lorsqu'il se conjugue avec une volonté de puissance et une entreprise de domination des éléments s'inscrit dans nos traditions ancestrales.
La figure mythique -ou idéaltypique- de l'Harpagon de Molière définit admirablement cette "réduction de tous les points de vues à la possession et au gain", caractéristiques de l'esprit bourgeois.
Pour Sombart, le "bourgeois vieux style" est caractérisé entre autres par l'amour du travail et la confiance dans la technique. Le bourgeois "moderne" est devenu décadent: le style de vie l'emporte sur le travail et l'esprit de bien-être et de consommation sur le sens de l'action. En utilisant les "catégories" de W. Sombart, nous pourrions dire, d'un point de vue anti-réductionniste, que nous nous opposons au "bourgeois en tant que tel" et que nous admettons le "bourgeois entrepreneur" qui doit avoir sa place organique (3ème fonction) dans les "communautés de mentalité et de tradition européennes", comme les nomme Sombart.
L'entrepreneur est "l'artiste" et le "guerrier" de la troisième fonction. Il doit posséder des qualités de volonté et de perspicacité; c'est malheureusement ce type de "bourgeois" que l'univers psychologique de notre société rejette. Par contre, le "bourgeois en tant que tel" de Sombart correspond bien à ce que nous nommons le bourgeoisisme -c'est-à-dire la systématisation dans la société contemporaine de traits de comportements qualifiés par W. Sombart d'"économiques" par opposition aux attitudes "érotiques". Sombart veut dire par là que la "principale valeur de la vie" est, chez le bourgeois, d'en profiter matériellement, de manière "économique". La vie est assimilée à un bien consommable dont les "parties", les unités, sont les phases de temps successives. Le temps "bourgeois" est, on le voit, linéaire, et donc consommable. Il ne faut pas le "perdre"; il faut en retirer le maximum d'avantages matériels.
Par opposition, la conception érotique de la vie -au sens étymologique- ne considère pas celle-ci comme un bien économique rare à ne pas gaspiller. L'esprit "aristocratique" reste, pour Sombart, "érotique" parce qu'il ne calcule pas le profit à tirer de son existence. Il donne, il se donne, selon une démarche amoureuse. "Vivre pour l'économie, c'est épargner; vivre pour l'amour, c'est dépenser", écrit Sombart. On pourrait dire, en reprenant les concepts de Sombart, que le "bourgeoisisme" serait la perte, dans la bourgeoisie, de la composante constituée par l'esprit d'entrepreneur; seul reste "l'esprit bourgeois proprement dit".
Au début du siècle par contre, Sombart décèle comme "esprit capitaliste" l'addition de ces deux composantes: esprit bourgeois et esprit d'entreprise.
L'esprit bourgeois, livré à lui-même, systématisé et massifié, autrement dit le bourgeoisisme contemporain, peut répondre à cette description de Sombart: "Type d'homme fermé (...) qui ne s'attache qu'aux valeurs objectives de ce qu'il peut posséder, de ce qui est utile, de ce qu'il thésaurise. Grégaire et accumulateur, le bourgeois s'oppose à la mentalité seigneuriale, qui dépense, jouit, combat. (...) Le Seigneur est esthète, le bourgeois moraliste".
 Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.
Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.
Avec un trait de génie, Werner Sombart prédit cette décadence de la bourgeoisie qui est aussi son apogée; décadence provoquée, entre autres causes, par la fin de l'esprit d'entreprise, mais également par cet esprit de "bien-être matériel" qui asservit et domestique les Cultures comme l'ont vu, après Sombart, K. Lorenz et A. Gehlen. Le génie de Sombart aura été de prévoir le phénomène en un temps où il était peu visible encore.
Le Bourgeois, livre remarquable, devenu grand classique de la sociologie contemporaine, se conclut par cet avertissement, dont les dernières lignes décrivent parfaitement une de nos principales ambitions: "Ce qui a toujours été fatal à l'esprit d'entreprise, sans lequel l'esprit capitaliste ne peut se maintenir, c'est l'enlisement dans la vie de rentier, ou l'adoption d'allures seigneuriales. Le bourgeois engraisse à mesure qu'il s'enrichit et il s'habitue à jouir de ses richesses sous la forme de rentes, en même temps qu'il s'adonne au luxe et croit de bon ton de mener une vie de gentilhomme campagnard (...).
Mais un autre danger menace encore l'esprit capitaliste de nos jours: c'est la bureaucratisation croissante de nos entreprises. Ce que le rentier garde encore de l'esprit capitaliste est supprimé par la bureaucratie. Car dans une industrie gigantesque, fondée sur l'organisation bureaucratique, sur la mécanisation non seulement du rationalisme économique, mais aussi de l'esprit d'entreprise, il ne reste que peu de place pour l'esprit capitaliste.
La question de savoir ce qui arrivera le jour où l'esprit capitaliste aura perdu le degré de tension qu'il présente aujourd'hui, ne nous intéresse pas ici. Le géant, devenu aveugle, sera peut-être condamné à traîner le char de la civilisation démocratique. Peut-être assisterons-nous aussi au crépuscule des dieux et l'or sera-t-il rejeté dans les eaux du Rhin.
"Qui saurait le dire?"
Guillaume FAYE.
(janvier-février 1979).
(1) La vie aristocratique et seigneuriale était plus orientée vers la "dépense".
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques, nouvelle droite, économie, révolution conservatrice, allemagne, weimar, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 janvier 2010
Nation et nationalisme, Empire et impérialisme, dévolution et grand espace

Communication de Robert Steuckers
au XXIVième Colloque du GRECE, Paris, le 24 mars 1991
Nation et nationalisme, Empire et impérialisme, dévolution et grand espace
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et camarades,
Le thème de notre colloque d'aujourd'hui est à la fois intemporel et actuel.
Actuel parce que le monde est toujours, envers et contre les espoirs des utopistes cosmopolites, un pluriversum de nations, et parce que nous replongerons tout à l'heure à pieds joints dans l'actualité internationale, marquée par le conflit, donc par la pluralité antagonistes des valeurs et des faits nationaux.
Intemporel parce que nous abordons des questions que toutes les générations, les unes après les autres, remettent inlassablement sur le tapis. En traitant de la nation et du nationalisme, de l'Empire et de l'impérialisme, nous touchons aux questions essentielles du politique, donc aux questions essentielles de l'être-homme, puisqu'Aristote déjà définissait l'homme comme un zoon politikon, comme un être ancré dans une polis, dans une cité, dans une nation. Ancrage nécessaire, ancrage incontournable mais ancrage risqué car précisément il accorde tout à la fois profondeur, sens de la durée et équilibre mais provoque aussi l'enfermement, l'auto-satisfaction, l'installation, la stérilité.
Devant le retour en Europe de l'Est et de l'Ouest d'un discours se proclamant nationaliste, il est impératif de comprendre ce double visage que peut prendre le nationalisme, de voir en lui cet avantage et ce risque, cette assurance que procure l'enracinement et ce dérapage qui le fait chavirer dans l'enfermement. Quant à la notion d'empire, elle a désigné au Moyen Age le Reich centre-européen, sorte d'agence qui apaisait les conflits entre les diverses ethnies et les multiples corps qui le composait; puis elle a désigné, sous Bonaparte, le militarisme qui tentait d'imposer partout en Europe des modèles constitutionnels marqués par l'individualisme bourgeois, qui méconnaissaient les logiques agrégatrices et communautaires des corps de métier, des «républiques villageoises» et des pays charnels; ensuite, elle a désigné l'impérialisme marchand et thalassocratique de l'Angleterre, qui visait l'exploitation de colonies par des groupes d'actionnaires, refusant le travail parce que, lecteurs de la Bible, ils voyaient en lui une malédiction divine; leur aisance, leur oisivité, ils la tiraient des spéculations boursières.
Cette confusion sémantique, qui vaut pour le terme «nation» comme pour le terme «empire», il importe que nous la dissipions. Que nous clarifions le débat. C'est notre tâche car, volontairement, nous parions pour le long terme et nous refusons de descendre directement dans l'arène politicienne qui nous force toujours aux pires compromis. Si nous ne redéfinissons pas nous-mêmes les concepts, si nous ne diffusons pas nos redéfinitions par le biais de nos stratégies éditoriales, personne ne le fera à notre place. Et la confusion qui règne aujourd'hui persistera. Elle persistera dans le chaos et de ce chaos rien de cohérent ne sortira.
Commençons par définir la nation, en nous rappelant ce qu'Aristote nous enseignait à propos du zoon politikon ancré dans sa cité. Le politique, qui est l'activité théorique surplombant toutes les autres activités de l'homme en leur conférant un sens, prend toujours et partout son envol au départ d'un lieu qui est destin. A partir de ce lieu se crée une socialité particulière, étayée par des institutions bien adaptées à ce paysage précis, forcément différentes des institutions en vigueur dans d'autres lieux. Nous avons donc affaire à une socialité institutionnalisée qui procure à sa communauté porteuse autonomie et équilibre, lui assure un fonctionnement optimal et un rayonnement maximal dans son environnement. Le rayonnement élargit l'assise de la socialité, crée le peuple, puis la nation. Mais cette nation, produit d'une évolution partie de l'ethnos originel, se diversifie à outrance au cours de l'évolution historique. En bout de course, nous avons toujours affaire à des nations à dimensions multiples, qui se déploient sur un fond historique soumis à tous les aléas du temps. Toute conception valide de la nation passe par une prise en compte de cette multidimensionalité et de ce devenir. Le peuple est donc une diversité sociologique qu'il faut organiser, notamment par le truchement de l'Etat.
L'Etat organise un peuple et le hisse au rang de nation. L'Etat est projet, plan: il est, vis-à-vis de la concrétude nation, comme l'ébauche de l'architecte par rapport au bâtiment construit, comme la forme par rapport à la matière travaillée. Ce qui implique que l'Etat n'a pas d'objet s'il n'y a pas, au préalable, la concrétude nation. Toutes les idéologies statolâtriques qui prétendent exclure, amoindrir, juguler, réduire la concrétude, la matière qu'est la nation, sont des sottises théoriques. Le peuple précède l'Etat mais sans la forme Etat, il ne devient pas nation, il n'est pas organisé et sombre rapidement dans l'inexistence historique, avant de disparaître de la scène de l'histoire. L'Etat au service de la concrétude peuple, de la populité génératrice d'institutions spécifiques, n'est pas un concept abstrait mais un concept nécessaire, un concept qui est projet et plan, un projet grâce auquel les élites du peuple affrontent les nécessités vitales. L'Etat —avec majuscule— organise la totalité du peuple comme l'état —sans majuscule— organise telle ou telle strate de la société et lui confère du sens.
Mais il est des Etats qui ne sont pas a priori au service du peuple: Dans son célèbre ouvrage sur la définition du peuple (Das eigentliche Volk, 1932), Max Hildebert Boehm nous a parlé des approches monistes du concept Etat, des approches monistes qui refusent de tenir compte de l'autonomie nécessaires des sphères sociales. Ces Etats capotent rapidement dans l'abstraction et la coercition stérile parce qu'ils refusent de se ressourcer en permanence dans la socialité populaire, dans la «populité» (= Volkheit), de se moduler sur les nécessités rencontrées par les corps sociaux. Cette forme d'Etat coupée du peuple apparaît vers la fin du Moyen Age. Elle provoque une rupture catastrophique. L'Etat se renforce et la socialité se recroqueville. L'Etat veut se hisser au-dessus du temps et de l'espace. Le projet d'Etat absolu s'accompagne d'une contestation qui ébauche des utopies, situées généralement sur des îles, elles aussi en dehors du temps et de l'espace. Dès que l'Etat s'isole de la socialité, il ne l'organise plus, il ne la met plus en forme. Il réprime des autonomies et s'appauvrit du même coup. Quand éclate la révolution, comme en France en 1789, nous n'assistons pas à un retour aux autonomies sociales dynamisantes mais à un simple changement de personnel à la direction de la machine Etat. Les parvenus remplacent les faisandés au gouvernail du bateau.
C'est à ce moment historique-là, quand la nation concrète a périclité, que nous voyons émerger le nationalisme pervers que nous dénonçons. Le discours des parvenus est nationaliste mais leur but n'est pas la sauvegarde ou la restauration de la nation et de ses autonomies nécessaires, de ses autonomies qui lui permettent de rayonner et de briller de mille feux, de ses autonomies qui ont une dynamique propre qu'aucun décret ne peut régenter sans la meurtrir dangereusement. L'objectif du pouvoir est désormais de faire triompher une idéologie qui refuse de reconnaître les limites spatio-temporelles inhérentes à tout fait de monde, donc à toute nation. Une nation est par définition limitée à un cadre précis. Vouloir agir en dehors de ce cadre est une prétention vouée à l'échec ou génératrice de chaos et d'horreurs, de guerres interminables, de guerre civile universelle. Les révolutionnaires français se sont servis de la nation française pour faire triompher les préceptes de l'idéologie des Lumières. Ce fut l'échec. Les nationaux-socialistes allemands se sont servis de la nation allemande pour faire triompher l'idéal racial nordiciste, alors que les individus de race nordique sont éparpillés sur l'ensemble de la planète et ne constituent donc pas une concrétude pratique car toute concrétude pratique, organisable, est concentrée sur un espace restreint. Les ultramontains espagnols se sont servis des peuples ibériques pour faire triompher les actions du Vatican sur la planète. Les banquiers britanniques se sont servis des énergies des peuples anglais, écossais, gallois et irlandais pour faire triompher le libre-échangisme et permettre aux boursicotiers de vivre sans travailler et sans agir concrètement en s'abstrayant de toutes les limites propres aux choses de ce monde. Les jésuites polonais ont utilisé les énergies de leur peuple pour faire triompher un messianisme qui servait les desseins de l'Eglise.
Ce dérapage de l'étatisme, puis du nationalisme qui est un étatisme au service d'une abstraction philosophique, d'une philosophade désincarnée, a conduit aux affrontements et aux horreurs de la guerre de Crimée, de la guerre de 1870, de la guerre des Boers, des guerres balkaniques et de la guerre de 1914. Résultat qui condamne les nationalismes qui n'ont pas organisé leur peuple au plein sens du terme et n'ont fait que les mobiliser pour des chimères idéologiques ou des aventures colonialistes. Inversément, cet échec des nationalismes du discours et non de l'action concrète réhabilite les idéaux nationaux qui ont choisi l'auto-centrage, qui ont choisi de peaufiner une socialité adaptée à son cadre spatio-temporel, qui ont privilégié la rentabilisation de ce cadre en refusant le recours facile au lointain qu'était le colonialisme.
Pour sortir de l'impasse où nous ont conduit les folies nationalistes bellogènes, il faut opérer à la fois un retour aux socialités spatio-temporellement déterminées et il faut penser un englobant plus vaste, un conteneur plus spacieux de socialités diverses.
Le Saint-Empire du Moyen Age a été un conteneur de ce type. En langage moderne, on peut dire qu'il a été, avant son déclin, fédératif et agrégateur, qu'il a empêché que des corps étatiques fermés ne s'installent au cœur de notre continent. La disparition de cette instance politique et sacrée à la suite de la fatale calamité des guerres de religion a provoqué le chaos en Europe, a éclaté l'œkoumène européen médiéval. Sa restauration est donc un postulat de la raison pratique. A la suite des discours nationalistes fallacieux, il faut réorganiser le système des Etats européens en évitant justement que les peuples soient mobilisés pour des projets utopiques irréalisables, qu'ils soient isolés du contexte continental pour être mieux préparés par leurs fausses élites aux affrontements avec leurs voisins. Il faut donc réorganiser le continent en ramenant les peuples à leurs justes mesures. Ce retour des limites incontournables doit s'accompagner d'une déconstruction des enfermements stato-nationaux, où les peuples ont été précisément enfermés pour y être éduqués selon les principes de telle ou telle chimère universaliste.
Le retour d'une instance comparable au Saint-Empire mais répondant aux impératifs de notre siècle est un vieux souhait. Constantin Frantz, le célèbre philosophe et politologue allemand du XIXième siècle, parlait d'une «communauté des peuples du couchant», organisée selon un fédéralisme agrégateur, reposant sur des principes diamétralement différent de ceux de la révolution française, destructrice des tissus sociaux concrets par excès de libéralisme économique et de militarisme bonapartiste.
Guillaume de Molinari, économiste français, réclamait à la fin du XIXième siècle la construction d'un «marché commun» incluant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Hollande, la Belgique, le Danemark et la Suisse. Il a soumis ses projets aux autorités françaises et à Bismarck. Lujo Brentano envisage à la même époque une union économique entre l'Autriche-Hongrie et les nouveaux Etats balkaniques. L'industriel autrichien Alexander von Peez, par un projet d'unification organique de l'Europe, entend répondre aux projets américains de construire l'Union panaméricaine, qui évincera l'Europe d'Amérique latine et amorcera un processus d'«américanisation universelle». Gustav Schmoller affirme que toute politique économique européenne sainement comprise ne peut en aucun cas s'enliser dans les aventures coloniales, qui dispersent les énergies, mais doit se replier sur sa base continentale et procéder à grande échelle à une «colonisation intérieure». Jäckh et Rohrbach théorisent enfin un projet de grande envergure: l'organisation économique de l'Europe selon un axe diagonal Mer du Nord/Golfe Persique. L'objectif de la théorie et de la pratique économiques devait être, pour ces deux économistes des vingt premières années de notre siècle, d'organiser cette ligne, partant de l'embouchure du Rhin à Rotterdam pour s'élancer, via le Main et le Danube, vers la Mer Noire et le Bosphore, puis, par chemin de fer, à travers l'Anatolie et la Syrie, la Mésopotamie et le villayat de Bassorah, aboutir au Golfe Persique. Vous le constatez, on retombe à pieds joints dans l'actualité. Mais, ce projet de Jäckh et de Rohrbach, qu'a-t-il à voir avec le thème de notre colloque? Que nous enseigne-t-il quant au nationalisme ou à l'impérialisme?
Beaucoup de choses. En élaborant leurs projets d'organisation continentale en zones germanique, balkanique et turque, les puissances centrales de 1914 réévaluaient le rôle de l'Etat agrégateur et annonçaient, par la voix du philosophe Meinecke, que l'ère des spéculations politiques racisantes était terminée et qu'il convenait désormais de faire la synthèse entre le cosmopolitisme du XVIIIième siècle et le nationalisme du XIXième siècle dans une nouvelle forme d'Etat qui serait simultanément supranationale et attentive aux ethnies qu'elle englobe. L'Entente, porteuse des idéaux progressistes de l'ère des Lumières, veut, elle, refaire la carte de l'Europe sur base des nationalités, ce qui a fait surgir, après Versailles, une «zone critique» entre les frontières linguistiques allemande et russe. Nous découvrons là la clef du problème qui nous préoccupe aujourd'hui: les puissances porteuses des idéaux des Lumières sont précisément celles qui ont encouragé l'apparition de petits Etats nationaux fermés sur eux-mêmes, agressifs et jaloux de leurs prérogatives. Universalisme et petit-nationalisme marchent la main dans la main. Pourquoi? Parce que l'entité politique impérialiste par excellence, l'Angleterre, a intérêt à fragmenter la diagonale qui s'élance de Rotterdam aux plages du Koweit. En fragmentant cette diagonale, l'Angleterre et les Etats-Unis de Wilson brisent la synergie grande-continentale européenne et ottomane de Vienne au Bosphore et de la frontière turque aux rives du Golfe Persique.
Or depuis la chute de Ceaucescu en décembre 1989, tout le cours du Danube est libre, déverrouillé. En 1992, les autorités allemandes inaugureront enfin le canal Main-Danube, permettant aux pousseurs d'emmener leurs cargaisons lourdes de Constantza, port roumain de la Mer Noire, à Rotterdam. Un oléoduc suivant le même tracé va permettre d'acheminer du pétrole irakien jusqu'au cœur industriel de la vieille Europe. Voilà les raisons géopolitiques réelles de la guerre déclenchée par Bush en janvier dernier. Car voici ce que se sont très probablement dit les stratèges des hautes sphères de Washington: «Si l'Europe est reconstituée dans son axe central Rhin-Main-Danube, elle aura très bientôt la possibilité de reprendre pied en Turquie, où la présence américaine s'avèrera de moins en moins nécessaire vu la déliquescence du bloc soviétique et les troubles qui secouent le Caucase; si l'Europe reprend pied en Turquie, elle reprendra pied en Mésopotamie. Elle organisera l'Irak laïque et bénéficiera de son pétrole. Si l'Irak s'empare du Koweit et le garde, c'est l'Europe qui finira par en tirer profit. La diagonale sera reconstituée non plus seulement de Rotterdam à Constantza mais du Bosphore à Koweit-City. La Turquie, avec l'appui européen, redeviendra avec l'Irak, pôle arabe, la gardienne du bon ordre au Proche-Orient. Les Etats-Unis, en phase de récession, seront exclus de cette synergie, qui débordera rapidement en URSS, surtout en Ukraine, pays capable de redevenir, avec un petit coup de pouce, un grenier à blé européen auto-suffisant. Alors, adieu les achats massifs de blé et de céréales aux Etats-Unis! Cette synergie débordera jusqu'en Inde et en Indonésie, marchés de 800 millions et de 120 millions d'âmes, pour aboutir en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un grand mouvement d'unification eurasienne verrait le jour, faisant du même coup déchoir les Etats-Unis, en mauvaise posture financière, au rang d'une puissance de second rang, condamnée au déclin. Les Etats-Unis ne seraient plus un pôle d'attraction pour les cerveaux du monde et on risquerait bien de voir s'effectuer une migration en sens inverse: les Asiatiques d'Amérique, qui sont les meilleurs étudiants d'Outre-Atlantique, retourneraient au Japon ou en Chine; les Euro-Américains s'en iraient faire carrière en Allemagne ou en Italie du Nord ou en Suède. Comment éviter cela? En reprenant à notre compte la vieille stratégie britannique de fragmentation de la diagonale! Et où faut-il la fragmenter à moindres frais? En Irak, pays affaibli par sa longue guerre contre l'Iran, pays détenteur de réserves pétrolières utiles à l'Europe».
La stratégie anglo-américaine de 1919, visant la fragmentation des Balkans et du Proche-Orient arabe et projetant la partition de la Turquie en plusieurs lambeaux, et la stratégie de Bush qui entend diviser l'Irak en trois républiques distinctes et antagonistes, sont rigoureusement de même essence. L'universalisme libéral-capitaliste, avatar des Lumières, instrumentalise le petit-nationalisme de fermeture pour arriver à asseoir son hégémonie.
Au seuil du XXième siècle comme au seuil du XXIième, la necessité d'élargir les horizons politiques aux dimensions continentales ont été et demeurent nécessaires. Au début de notre siècle, l'impératif d'élargissement était dicté par l'économie. Il était quantitatif. Aujourd'hui, il est encore dicté par l'économie et par les techniques de communications mais il est dicté aussi par l'écologie, par la nécessité d'un mieux-vivre. Il est donc aussi qualitatif. L'irruption au cours de la dernière décennie des coopérations interrégionales non seulement dans le cadre de la CEE mais entre des Etats appartenant à des regroupements différents ou régis par des systèmes socio-économiques antagonistes, ont signifié l'obsolescence des frontières stato-nationales actuelles. Les énergies irradiées à partir de diverses régions débordent le cadre désormais exigu des Etats-Nations. Les pays riverains de l'Adriatique et ceux qui forment, derrière la belle ville de Trieste, leur hinterland traditionnel, ont organisé de concert les synergies qu'ils suscitent. En effet, l'Italie, au nom de la structure stato-nationale née par la double action de Cavour et de Garibaldi, doit-elle renoncé aux possibles qu'avaient jadis concrétisé l'élan vénitien vers la Méditerranée orientale? La Sarre, la Lorraine et le Luxembourg coopèrent à l'échelon régional. Demain, l'axe Barcelone-Marseille-Turin-Milan fédèrera les énergies des Catalans, des Languedociens, des Provençaux, des Piémontais et des Lombards, en dépit des derniers nostalgiques qui veulent tout régenter au départ de Madrid, Paris ou Rome. Ces coopérations interrégionales sont inéluctables. Sur le plan de la politologie, Carl Schmitt nous a expliqué que le Grand Espace, la dimension continentale, allait devenir l'instance qui remplacera l'«ordre concret» établi par l'Etat depuis Philippe le Bel, Philippe II d'Espagne, François I, Richelieu ou Louis XIV. Ce remplacement est inévitable après les gigantesques mutations de l'ère techno-industrielle. Schmitt constate que l'économie a changé d'échelle et que dans le cadre de l'Etat, figure politique de la modernité, les explosions synergétiques vers la puissance ou la créativité ne sont plus possibles. Le maintien de l'Etat, de l'Etat-Nation replié sur lui-même, vidé de l'intérieur par tout un éventail de tiraillements de nature polycratique, ne permet plus une mobilisation holarchique du peuple qu'il n'administre plus que comme un appareil purement instrumental. Sa décadence et son exigüité appellent une autre dimension, non obsolète celle-là: celle du Grand Espace.
Si le Grand Espace est la seule figure viable de la post-modernité, c'est parce qu'on ne peut plus se contenter de l'horizon régional de la patrie charnelle ou de l'horizon supra-régional de l'Etat-Nation moderne. L'horizon de l'avenir est continental mais diversifié. Pour pouvoir survivre, le Grand Espace doit être innervé par plusieurs logiques de fonctionnement, pensées simultanément, et être animé par plusieurs stratégies vitales concomitantes. Cette pluralité, qui n'exclut nullement la conflictualité, l'agonalité, est précisément ce que veulent mettre en exergue les différentes écoles de la post-modernité.
Cette post-modernité du Grand Espace, animé par une pluralité de logiques de fonctionnement, condamne du même coup les monologiques du passé moderne, les monologiques de ce passatisme qu'est devenue la modernité. Mais elle condamne aussi la logique homogénéisante de l'impérialisme commercial et gangstériste des Etats-Unis et la monologique frileuse des gardiens du vieil ordre stato-national.
Pour organiser le Grand Espace, de Rotterdam à Constantza ou le long de toute la diagonale qui traverse l'Europe et le Proche-Orient de la Mer du Nord au Koweit, il faut au moins une double logique. D'abord une logique dont un volet réclame la dévolution, le recentrage des énergies populaires européennes sur des territoires plus réduits, parce que ces territoires ne seront alors plus contraints de ne dialoguer qu'avec une seule capitale mais auront la possibilité de multiplier leurs relations interrégionales. Ensuite une logique qui vise l'addition maximale d'énergies en Europe, sur le pourtour de la Méditerranée et au Proche-Orient.
L'adhésion à la nation, en tant qu'ethnie, demeure possible. Le dépassement de cet horizon restreint aussi, dans des limites élargies, celles du Grand Espace. L'ennemi est désigné: il a deux visages selon les circonstances; il est tantôt universaliste/mondialiste, tantôt petit-nationaliste. Il est toujours l'ennemi de l'instance que Carl Schmitt appelait de ses vœux.
Que faire? Eh bien, il faut 1) Encourager les logiques de dévolution au sein des Etats-Nations; 2) Accepter la pluralité des modes d'organisation sociale en Europe et refuser la mise au pas généralisée que veut nous imposer l'Europe de 1993; 3) Recomposer la diagonale brisée par les Américains; 4) Organiser nos sociétés de façons à ce que nos énergies et nos capitaux soient toujours auto-centrés, à quelqu'échelon du territoire que ce soit; 5) Poursuivre la lutte sur le terrain métapolitique en s'attaquant aux logiques de la désincarnation, avatars de l'idéologie des Lumières.
Pour conclure, je lance mon appel traditionnel aux cerveaux hardis et audacieux, à ceux qui se sentent capables de s'arracher aux torpeurs de la soft-idéologie, aux séductions des pensées abstraites qui méconnaissent limites et enracinements. A tous ceux-là, notre mouvement de pensée ne demande qu'une chose: travailler à la diffusion de toutes les idées qui transgressent les enfermements intellectuels, le prêt-à-penser.
Je vous remercie.
Robert Steuckers.
00:05 Publié dans Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, histoire, europe, nationalisme, empire, impérialisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, fédéralisme, saint empire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 janvier 2010
G. Faye: L'Essai sur la violence de M. Maffesoli
 Archives « Guillaume Faye » - 1985
Archives « Guillaume Faye » - 1985
Guillaume FAYE:
L’ “Essai sur la violence” de Michel Maffesoli
Michel Maffesoli n’aime pas le “devoir-être”; la sociologie qu’il a fondée, orientée vers l’analyse de la “socialité” quotidienne et imprégnée de paganisme dionysiaque, échappe autant à l’énoncé de solutions historiques et politiques pour notre temps qu’à l’alignement sur les prêts-à-penser idéologiques. “Laissant à d’autres le soin d’être utiles, note-t-il dans la préface de la deuxième édition de ses “Essais sur la violence”, il me semble possible d’envisager les problèmes sociaux sous l’angle métaphorique (…). On est loin de ce qu’il est convenu d’appeler la demande sociale ou autres fariboles de la même eau. C’est de l’esthétisme. Peut-être faut-il en accepter le risque”. Cet esthétisme donne lieu en tous cas à un travail très complet et fort sérieux: la réédition des “essais sur la violence”, publiés en 1978 dans un ouvrage maintenant épuisé (« La violence fondatrice », Ed. du Champs Urbain, Paris, avec une préface de Julien Freund) offre à la réflexion l’une des meilleurs approches sur le statut et la fonction sociale de « cette mystérieuse violence » qui est, dit l’auteur, « peut-être préférable à l’ennui mortifère d’une vie sociale aseptisée ».
Prenant le contre-pied de l’humanisme chrétien qui, comme la plupart des idéologies contemporaines qu’il a innervées, considère la violence —sociale ou politique— comme une anomalie anthropologique. Maffesoli, dans la lignée de Max Weber et de Carl Schmitt, voit dans la violence, la lutte et l’hostilité, « les moteurs principaux du dynamisme des sociétés » (p. 13). A une société « monothéiste » qui prétendrait éliminer toute violence pour uniformiser les valeurs, Maffesoli voit dans la reconnaissance de la violence comme trame du social, la marque d’un esprit polythéiste et antitotalitaire. Analysant la « dynamique » de la violence, son « invariance », son caractère « dionysiaque » et expliquant comment une violence ritualisée et intégrée par la société civile —par le peuple— peut constituer un moyen de défense de la communauté organique contre les impératifs et les normes (autrement violents) de l’Etat égalitaire. Maffesoli met en lumière l’ « ambivalence » de la violence : elle est à la fois structurante —si elle s’avère ritualisée et organique— et déstructurante —si elle s’éprouve comme délinquance chaotique dans une société policée et sécurisée—, libératrice et totalitaire, créatrice et destructrice à l’image du Scorpion, le signe zodiacal de Maffesoli lui-même !
S’appuyant parfois sur les travaux des éthologistes, Maffesoli qui échappe —chose rare aujourd’hui— aux angélismes et aux utopies du siècle, souligne le caractère fondateur de la violence dans la dynamique des rapports sociaux, qu’ils soient institutionnels ou privés, exceptionnels (le « débridement passionnel orgiastique ») ou ressortissant de la banalité de la vie de tous les jours.
 Mais, quoiqu’il prétende ne pas toucher à l’idéologie politique, Maffesoli donne tout de même en cette matière une importante leçon. En refusant de légitimer ou de ritualiser la violence, en s’en arrogeant aussi le monopole sous une forme « rationnelle » et « neutre », l’Etat égalitaire moderne fonde paradoxalement « la violence totalitaire, l’abstraction du pouvoir par rapport à la socialité », comme la définit Maffesoli, qui ajoute : « ce qui se dessine (…), c’est que la maîtrise de cette menace organisée, en étant déliée d’un enracinement social, devienne le lot d’un Big Brother anonyme, contrôleur et constructeur de la réalité » (p. 17). Dès lors que la violence est « décommunalisée », abstraitement et légalement détenue par une technocratie et qu’elle n’est plus légitime au sein de la société civile qui savait la ritualiser, dès lors donc que la société est sécurisée par l’Etat, on assiste paradoxalement à l’émergence de la violence irrationnelle, « terrifiante et angoissante », celle de l’insécurité d’aujourd’hui : « La mise en spectacle rituelle de la violence permettrait que celle-ci fût en quelque sorte extériorisée. Sa monopolisation, son devenir rationnel tend au contraire à l’intérioriser » (p. 18).
Mais, quoiqu’il prétende ne pas toucher à l’idéologie politique, Maffesoli donne tout de même en cette matière une importante leçon. En refusant de légitimer ou de ritualiser la violence, en s’en arrogeant aussi le monopole sous une forme « rationnelle » et « neutre », l’Etat égalitaire moderne fonde paradoxalement « la violence totalitaire, l’abstraction du pouvoir par rapport à la socialité », comme la définit Maffesoli, qui ajoute : « ce qui se dessine (…), c’est que la maîtrise de cette menace organisée, en étant déliée d’un enracinement social, devienne le lot d’un Big Brother anonyme, contrôleur et constructeur de la réalité » (p. 17). Dès lors que la violence est « décommunalisée », abstraitement et légalement détenue par une technocratie et qu’elle n’est plus légitime au sein de la société civile qui savait la ritualiser, dès lors donc que la société est sécurisée par l’Etat, on assiste paradoxalement à l’émergence de la violence irrationnelle, « terrifiante et angoissante », celle de l’insécurité d’aujourd’hui : « La mise en spectacle rituelle de la violence permettrait que celle-ci fût en quelque sorte extériorisée. Sa monopolisation, son devenir rationnel tend au contraire à l’intérioriser » (p. 18).
Guillaume FAYE.
(recension parue dans « Panorama des idées actuelles », mars 1985 ; cette revue des livres et des idées était dirigée par le grand indianiste français Jean Varenne, disparu prématurément en 1997 ; avec l’aimable autorisation de l’auteur).
Michel MAFFESOLI, Essai sur la violence banale et fondatrice, Librairie des Méridiens, paris, 1984, 174 pages.
00:15 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, violence, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Carlo Gambescia - Metapolitica e potere
Carlo Gambescia. Metapolitica e potere
Intervista Carlo Gambescia - Ex: http://www.mirorenzaglia.org/
È di pochi giorni fa la pubblicazione del suo nuovo volume, Metapolitica. L’altro sguardo sul potere (Il Foglio Letterario Edizioni, 2009) e suo un sito web ben articolato”Carlogambesciametapolitica“ (incipit: “Senza ‘metapolitica’ si finisce sempre per fare cattiva ‘politica’ “). Lui viene definito «studioso di sociologia, propugnatore di un approccio basato sulla “metapolitica”, ovvero capace di andare al di là della dicotomie destra-sinistra e del giudizio politico, affrontando i fatti sociali attraverso una modalità esente da strumentalizzazioni ed etichettature. Il [suo] blog si propone di offrire qualche elemento di riflessione “metapolitica”, cercando di ricondurre il “particolare” (quel che accade) all’ “universale” (le costanti sociali)». Ed ancora: «La metapolitica non è una disciplina accademica. Senza ombra di dubbio il suo campo di studio rinvia alla filosofia politica. Tuttavia di rado se ne parla in enciclopedie e manuali di storia del pensiero politico. Probabilmente perché su di essa pesa tuttora l’accusa di pericoloso dilettantismo romantico dalle tentacolari propaggini totalitarie. Il che per certi versi è vero. Ma è soltanto una parte della storia. Ed è ciò che si propone di mostrare Carlo Gambescia. Per il quale la metapolitica, come altro sguardo sul potere, può rappresentare, oggigiorno, la classica boccata di aria fresca e pulita: un’analisi razionale di quel che viene “dopo” e “oltre” la politica, imperniata sulle scienze sociali e non sull’astratta ricerca dell’ “Ottimo Stato” o sulla sua abolizione rivoluzionaria». “Dove va la politica?” (Edizioni Settimo Sigillo, 2008) è il suo volume-risposta appassionante ed incalzante al disfacimento dell’appunto politica nel puzzle dell’essere degli stati che non sa più né ragionare né avere preciso potere decisionale. Una crisi di valori che rischia un irrimediabile punto di non ritorno. Contattato per un’intervista, il nostro si è subito reso disponibile a confrontarsi sulle pagine de Il Fondo con tematiche e realtà sociopolitiche spesso scomode ai più. Lo ringraziamo per questa sua squisita presenza pensando sempre alle parole di Ezra Pound «Non puoi fare una buona economia con una cattiva etica».
Di Carlo Gambescia [nella foto] si dice (fonte: archivio900.it): ‘Italia, Sociologo, ha scritto diversi libri. Collabora a un discreto numero di riviste italiane e non. Critico di quella che definisce la «vulgata sviluppista e utilitarista, che ci presenta questo come “il migliore dei mondi possibili”», politicamente trasversale, è sostanzialmente un osservatore, un libero studioso e ricercatore’. Praticamente scomodo a “sinistra” (viene considerato un fascista) ed a “destra ed oltre” (viene considerato un antifascista), Lei non è fascista né tradizionalista. Insomma chi è?
Sono un libertario. Nel senso che se lei all’improvviso mi imponesse di scegliere tra il massimo della libertà senza alcun ordine e il massimo dell’ordine senza alcuna libertà, sceglierei, senza esitare, la libertà senza ordine. O se vuole sconfinante nel disordine. Ma non è tutto. E qui viene il bello, anzi il brutto. Perché, come sociologo, ritengo sia irrealistico parlare di libertà assoluta: l’uomo vive “in società”; agisce in un mondo che in buona parte non ha creato, fatto di istituzioni, se vuole, valori, idee, norme, “solidificati” in comportamenti strutturati; istituzioni che l’uomo trova quando nasce, e che continueranno a esistere dopo la sua morte. Certo, assumendo significati storici diversi. Ma il punto è che, pur mutando il contenuto storico, come ogni buon sociologo sa, la forma-istituzione permane, limitando oggettivamente, nei fatti, la libertà dell’uomo. Pertanto, dentro di me si scontrano due figure: l’uomo che aspira al massimo di libertà e il sociologo che frena… E non è un bel vivere.
Per quale ragione?
Perché spesso chi ti legge e frettolosamente, come capita soprattutto in Rete, non percepisce il “dramma”. O meglio forse non vuole percepire la combattuta onestà di chi scrive… Per dirla tutta, se mi passa l’espressione, sotto questo profilo la Rete - non mi faccia fare nomi - è il peggio del peggio… Presenta gli stessi vizi (invidia, perfidia, conformismo, cordate, guerra per bande, eccetera) della cosiddetta “società letteraria”, che, pure scrivendo professionalmente, conosco molto bene. Senza però godere della qualità e della professionalità, che tutto sommato, distingue, la “società letteraria”. Con un’altra differenza, ovvero che “quelli” della Rete si ritengono “gli ultimi puri”. Roba da piangere o ridere. Faccia lei. Spesso penso veramente di essere un masochista perché mi ostino a tenere ancora “acceso” il mio blog.
Oltre all’economia anche la sociologia. Finalmente sorella tra le per me arti conoscitive o ancora brutto anatroccolo degli studi di questo mondo?
“Arte conoscitiva”… Bellissima espressione, complimenti. Ricordo un prezioso libro di Robert Nisbet dove più o meno si sosteneva il valore dell’intuizione artistica anche nell’ambito dell’analisi sociologia. Da una parte i dati empirici e le costanti interpretative nel senso di quel che si ripete nel sociale: la “forma” sempre uguale a se stessa. Dall’altra l’intuizione bruciante, sempre diversa come capacità di vedere nell’effervescenza dei “contenuti”, ciò che sia sfuggito agli altri scienziati sociali quali politologi, economisti, eccetera. Guardi, il più bel complimento, me lo fece qualche anno fa un amico filosofo, un appuntito “marxologo”, che a cena mi disse: “Carlo, nei tuoi libri, si ritrova sempre quell’immaginazione sociologica, teorizzata, da Charles Wright Mills, che va oltre i fatti sociali, pur partendo da essi”… E, purtroppo, oggi la sociologia ha rinunciato all’immaginazione, per “certificare” il presente, indossando abiti notarili. Come trent’anni fa, invece, si baloccava in eskimo con l’idea di “rivoluzione”. Resta ancora tanta strada da fare.
Quanti libri al suo attivo?
Non mi piace fare della pubblica contabilità librario-culturale… Chi mi apprezza, già sa. O comunque sia, la faranno i posteri… Se ne avranno voglia… Ricordo un collega trombone, ancora in circolazione, che molti anni fa, in treno, ammaestrava noi giovani leve sul fatto, che lui aveva scritto venti libri bla bla, e che dunque era il più grande sociologo, eccetera, eccetera. Ecco, pensai: un comportamento, in futuro, da evitare…
Come non detto. Quali allora gli argomenti trattati?
La mia ricerca, si muove lungo due filoni principali. Il primo riguarda la sociologia della cultura, con particolare riferimento all’economia come processo culturale. Il secondo concerne le relazioni, sempre sociologiche, tra economia, cultura e politica, ricerca che dovrebbe sfociare, più avanti, in una vera e propria teoria complessiva del politico. Ne potrei aggiungere un terzo, carsico: quello dello studio storico-critico di alcune figure di sociologi e filosofi aperti al sociale che possono aiutarci ad affinare i concetti sociologici, come dire ” di pronto impiego”, per la ricerca. E qui penso, tra gli altri, a Sorokin, Polanyi, Del Noce.
E a quale volume tiene di più?
Non ne ho uno in particolare. Diciamo che mi muovo “metodicamente” - e chi mi segue se ne sarà accorto – nell’alveo dei tre filoni indicati. Poi, guardi, io prima che “scrittore”, sono “lettore” accanito. Di qui una grande umiltà… Non pretendo di dire nulla di definitivo… E conosco i miei limiti. A differenza di altri…
“Metapolitica. L’altro sguardo sul potere”, Il Foglio Letterario edizioni. Questa la sua nuova fatica letteraria. Ce ne vuole parlare?
Diciamo subito che il libro è uno “spicchio” di quella teoria generale del politico, verso la quale in prospettiva dovrebbero confluire i diversi filoni della mia ricerca. Ma il libro è nato anche da una constatazione: in certi ambienti non conformisti, soprattutto a destra, da decenni si parla di metapolitica, senza aver mai dato prima alcuna definizione… E soprattutto senza aver mai imparato a distinguere tra metapolitica, come ricerca filosofica o ideologica intorno allo stato ottimo, e metapolitica, come studio positivo della politica, basato sulle scienze sociali e sull’individuazione e l’uso di alcune fondamentali regolarità sociologiche. O peggio ancora: senza distinguere, tra metapolitica, come teoria (dal punto di vista chi osserva), e metapolitica come azione (dal punto di vista di chi la pratica). Ecco il mio libro si muove intorno a queste intuizioni.
Politica e Metapolitica, per capire. Dove vanno da sole od insieme?
Dopo quanto ho detto, dovrebbe essere chiaro, per dirla telegraficamente – e come del resto lei stessa ha fatto notare nella sua introduzione – che senza metapolitica si rischia sempre di fare cattiva politica.
Lancio dei sassi nello stagno dell’attualità italiana:
Nel 2008 ed a seguire in questo anno, il 20% delle famiglie si trovano sotto la soglia della povertà; stipendi bassi, salari da fame. L’Italia si attesta dopo la Grecia e la Spagna; da poco la decisione delle banche di bloccare i mutui per un anno alle categorie sociali in difficoltà; dubbio amletico nel lavoro: posto fisso o mobilità di assunzione; ancora la crisi economica è nera o si intravede un pur minimo spiraglio di fiduciosa ripresa?
Domande interessanti. Se però mi consente preferisco dare una risposta di metodo. Lasciando a lei e ai lettori la possibilità poi di “rispondersi da soli”. Anche questa è metapolitica… La forza del capitalismo è nel fatto che si fa al tempo stesso odiare e amare. È una via di mezzo tra il Dio dell’Antico e del Nuovo Testamento: atterrisce e consola al tempo stesso… Pertanto quei dati che lei ricorda, sono sempre suscettibili di peggiorare (il Dio che atterrisce), ma anche di migliorare (il Dio che consola). A differenza di altri sistemi storici a economia centralizzata o autarchica, il capitalismo ha una capacità di autoriformarsi, finora sconosciuta. Ma anche una capacità economica e politico-militare considerevole. Pensi, per così dire, alle battute finali dei totalitarismi, dei diversi totalitarismi che pur con sfumature diverse atterrivano senza consolare… Quelli nazionalsocialista e fascista sconfitti dal capitalismo sul campo, con la forza delle armi. E quello comunista, come qualcuno all’epoca scrisse, schierando invece stereo e frigoriferi… Si tratta di una plasticità, dalla forza pressoché sconosciuta, che ripeto atterrisce e consola al tempo stesso, con la quale ogni serio studioso dei sistemi socio-economici in generale, e del capitalismo in particolare, deve fare i conti.
D’accordo, ma sull’immediato?
Credo che per ora la forza sistemica del capitalismo sia tale che, anche questa volta, ce la farà… Tuttavia nessun sistema è eterno. E i due punti deboli del capitalismo attuale sono nella possibile crescita delle distanze sociali e nel degrado ambientale del pianeta. Al primo problema, si può rispondere con il welfare. Al secondo, puntando su uno sviluppo più attento all’ambiente. Tuttavia il problema è che la sicurezza sociale costa e richiede una crescita economica progressiva, in grado di garantire un altrettanto costante prelievo fiscale per coprire le finalità sociali del sistema. Ma la crescita progressiva – ecco il punto – non può andare tanto per il sottile. Di qui la possibilità, per alcuni la certezza, di sempre più gravi problemi ambientali.
Alcuni sostengono che la decrescita risolverebbe tutto…
Può darsi. Il vero problema resta però quello di trovare come conciliare la decrescita con la democrazia, in un mondo che temporalmente non potrà mai trasformarsi, tutto insieme e nello stesso momento, da capitalista in “decrescista”. Detto in altri termini: come convincere razionalmente e pacificamente i possibili refrattari interni ed esterni alla nazione o al “blocco di nazioni” decresciste ? La tragica esperienza dei socialismi reali dovrebbe aver insegnato, una volta per tutte, che una “riconversione economica” non può essere una passeggiata, soprattutto in un mondo ostile. Pensi, ad esempio, alla necessità di difendersi, dagli eventuali “nemici esterni” della decrescita… E allora che fare? Applicare la decrescita anche all’industria bellica? Un punto questo, che i “decrescisti”, almeno, a parole, pacifisti convinti, sembrano purtroppo sottovalutare.
Capisco benissimo che l’attualità italiana le interessa fino a un certo punto… Ma Bruno Tremonti e Mario Draghi. Maestri, allievi o discoli?
No. Direi mestieranti… Ben pagati, però.
Confindustria e sindacati del lavoro. Pensano ai lavoratori ed al bene socialmente inteso o discettano del nulla?
Come sopra… Scherzo…Mi offre invece l’opportunità di spiegare come “funziona” la logica sociale delle istituzioni. Dal punto di vista sociologico la storia del sindacato può essere riletta come un continuo alternarsi tra movimento e istituzione. Nel XIX il sindacato era un movimento. Nel XX si è trasformato in istituzione. Di qui quel comportamento da routinier che oggi distingue il sindacato. Ma fino alla prossima “scossa” storica e sociale. Chissà il XXI secolo potrebbe essere quello del ritorno a un comportamento movimentista. Tenga infine presente che la costante o regolarità “movimento-istituzione” contraddistingue l’agire sociale dei gruppi più diversi: dalle chiese ai partiti, dai sindacati alla coppia. Sotto questo aspetto Trotsky aveva torto marcio: non esistono rivoluzioni permanenti. Anche il potere rivoluzionario, proprio per un umano e innato bisogno di sicurezza, tende a istituzionalizzarsi. Il che non significa che gli uomini non si ribellino mai. E che l’istituzionalizzazione possa andare, anche qui, oltre quel limite rappresentato dall’umana sopportazione delle ingiustizie. Insomma, neppure Stalin, teorico del socialismo in un solo paese, aveva ragione… Ma solo che, una volta raggiunta la vittoria, gli uomini si siedono e chiedono “normalità”… E il gioco ricomincia.
Destra e Sinistra? Destra o Sinistra? Destra vs Sinistra? Altro ed ulteriore? “Dove vanno le ideologie”, citando Enzo Erra ed Enzo Cipriano?
Destra e sinistra parlamentari possono essere anche superate. È un secolo che se ne parla… Ma il vero problema è quello di trovare un forma di rappresentanza alternativa. Come rappresentare gli interessi e i valori? Come fare in modo che tutte le posizioni vengano rappresentate? E democraticamente? Mi permetto sommessamente di ricordare che, nonostante alcuni ritengano – ed a ragione – “politicamente” sorpassate le ideologie di destra e sinistra scaturite dalla Rivoluzione Francese, in realtà all’interno di tutti i gruppi sociali tendono sempre a riproporsi “psicologicamente” e “socialmente”, le divisioni tra coloro che difendono lo status quo e quelli che vogliono cambiarlo. E infine tra questi ultimi e quelli che vogliono il ritorno allo status quo ante… Nell’ ordine: conservatori, progressisti e reazionari. Quindi, sì, fine delle dicotomie “classiche” o quasi, ma con juicio…
A conclusione, qualche formula magica da proporre? Riti sciamanici? Profezie maya o curandere?
No. Per quel che mi riguarda cercherò di “applicarmi di più”. Insomma: studiare, studiare, studiare. Tutto qui.
00:12 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sociologie, métapolitique, sciences politiques, italie, pouvoir |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Contre l'intégration mondialiste, pour un développement auto-centré
Archives de Synergies Européennes - 1985
Contre l'intégration mondialiste, pour un développement auto-centré
par Stefan Fadinger
L'héritage de Fichte
_____________________________________________________________
 Johann Gottlieb FICHTE, dans son "Geschlossener Handelsstaat " ("L'Etat commercial fermé"), propose à son peuple, le peuple allemand, un modèle d'économie socialiste et nationale voire communiste et nationale. Ce modèle est inspiré des idées de Jean-Jacques ROUSSEAU, qui avait déjà influencé FICHTE pour la rédaction du "Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien des Wissenschaftlehre " de 1796. Dans ces deux ouvrages, FICHTE pose le "commun" (c'est-à-dire la "Nation") comme l'idéal, comme une société gérée par les principes de la "raison pure" et basée sur l'égalité en droit de tous les citoyens. Et comme le fondement de la propriété humaine est le travail, chaque citoyen détient un "droit à l'activité (Tätigkeit)" et l'Etat doit veiller à ce que chacun puisse vivre du produit de son travail (FICHTE se fait ici l'avocat d'une sorte de subvention officielle pour ceux qui sont réduits au chômage). Le philosophe manifeste également son souci de créer une morale socialiste du travail. Pour lui, le travail possède une valeur morale et religieuse. L'Etat ne doit pas seulement protéger les droits de l'homme mais doit aussi veiller à encourager le libre déploiement des facultés morales et techniques des citoyens rangés sous sa protection. FICHTE, en outre, constate que vendeurs et acheteurs se livrent mutuellement une guerre incessante, guerre qui devient plus âpre, plus injuste, plus dangereuse en ses conséquences au fur et à mesure que le monde se peuple. Cette guerre commerciale, générée par l'égoïsme, l'Etat doit l'éliminer par des moyens légaux. Le gouvernement a le devoir de veiller à ce que l'économie soit correctement régulée. Il doit prendre en charge le commerce extérieur, calculer le volume global des échanges commerciaux, équilibrer la production selon les lois de l'offre et de la demande et réglementer la division du travail. Tous les capitaux doivent se trouver dans les mains de l'Etat. FICHTE, socialiste-national, exige que l'Etat se ferme totalement à tout commerce avec l'étranger, sauf pour l'échange de biens et de marchandises absolument indispensables. La condition sine qua non pour pratiquer une telle politique, c'est que les citoyens renoncent progressivement à toute espèce de besoin de consommation qui ne contribue pas réellement à leur "bien-être" (Wohlsein). En langage moderne, nous traduirions par: couverture des besoins plutôt qu'éveil de besoins. Donc: renoncer aux biens superflus ou nuisibles!
Johann Gottlieb FICHTE, dans son "Geschlossener Handelsstaat " ("L'Etat commercial fermé"), propose à son peuple, le peuple allemand, un modèle d'économie socialiste et nationale voire communiste et nationale. Ce modèle est inspiré des idées de Jean-Jacques ROUSSEAU, qui avait déjà influencé FICHTE pour la rédaction du "Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien des Wissenschaftlehre " de 1796. Dans ces deux ouvrages, FICHTE pose le "commun" (c'est-à-dire la "Nation") comme l'idéal, comme une société gérée par les principes de la "raison pure" et basée sur l'égalité en droit de tous les citoyens. Et comme le fondement de la propriété humaine est le travail, chaque citoyen détient un "droit à l'activité (Tätigkeit)" et l'Etat doit veiller à ce que chacun puisse vivre du produit de son travail (FICHTE se fait ici l'avocat d'une sorte de subvention officielle pour ceux qui sont réduits au chômage). Le philosophe manifeste également son souci de créer une morale socialiste du travail. Pour lui, le travail possède une valeur morale et religieuse. L'Etat ne doit pas seulement protéger les droits de l'homme mais doit aussi veiller à encourager le libre déploiement des facultés morales et techniques des citoyens rangés sous sa protection. FICHTE, en outre, constate que vendeurs et acheteurs se livrent mutuellement une guerre incessante, guerre qui devient plus âpre, plus injuste, plus dangereuse en ses conséquences au fur et à mesure que le monde se peuple. Cette guerre commerciale, générée par l'égoïsme, l'Etat doit l'éliminer par des moyens légaux. Le gouvernement a le devoir de veiller à ce que l'économie soit correctement régulée. Il doit prendre en charge le commerce extérieur, calculer le volume global des échanges commerciaux, équilibrer la production selon les lois de l'offre et de la demande et réglementer la division du travail. Tous les capitaux doivent se trouver dans les mains de l'Etat. FICHTE, socialiste-national, exige que l'Etat se ferme totalement à tout commerce avec l'étranger, sauf pour l'échange de biens et de marchandises absolument indispensables. La condition sine qua non pour pratiquer une telle politique, c'est que les citoyens renoncent progressivement à toute espèce de besoin de consommation qui ne contribue pas réellement à leur "bien-être" (Wohlsein). En langage moderne, nous traduirions par: couverture des besoins plutôt qu'éveil de besoins. Donc: renoncer aux biens superflus ou nuisibles!
l'héritage de Friedrich List
_____________________________________________________________
Friedrich LIST est considéré également, avec raison, comme l'un des principaux fondateurs de la théorie nationaliste de l'économie. Démocrate militant du "Vormärz" (1), il a lutté pour l'unité politique et économique de l'Allemagne, pour la suppression des barrières douanières internes et pour une politique nationale des chemins de fer. Le titre de son maître-ouvrage est, significativement: Das Nationale System der Politischen Ökonomie (Système national d'économie politique). Dans ce livre, LIST formule une découverte révolutionnaire: tout le bla-bla à propos de l'Homme (au singulier) et de son économie (encore au singulier) qui sert d'assise à la praxis de l'économie mondialiste n'est qu'abstraction et pilpoul intellectualiste; l'économiste doit davantage se montrer attentif au niveau intermédiaire de la réalité économique, situé entre celui de l'individu et celui des lois économiques générales. Ce niveau intermédiaire, c'est le niveau national. Et quand LIST déclare que l'arrière-plan de ses travaux, c'est la volonté de construire l'Allemagne, il exprime une perspective nouvelle qui postule qu'il n'existe aucune économie générale mondiale, mais seulement des économies nationales.
 Selon LIST, au cours de l'histoire, les structures économiques se sont développées par paliers. Ainsi, l'Etat agraire pur se mue en Etat productiviste agricole et, finalement, quand les économies politiques atteignent un stade "supérieur", les Etats agricoles deviennent productivistes et commerciaux. Nous dirions aujourd'hui qu'ils sont des Etats industriels et agricoles modernes. Cette évolution globale doit être dirigée par l'Etat, selon les critères d'une économie politique sainement comprise. Ce qui signifie que l'agriculture et l'industrie doivent toujours s'équilibrer à tous les niveaux.
Selon LIST, au cours de l'histoire, les structures économiques se sont développées par paliers. Ainsi, l'Etat agraire pur se mue en Etat productiviste agricole et, finalement, quand les économies politiques atteignent un stade "supérieur", les Etats agricoles deviennent productivistes et commerciaux. Nous dirions aujourd'hui qu'ils sont des Etats industriels et agricoles modernes. Cette évolution globale doit être dirigée par l'Etat, selon les critères d'une économie politique sainement comprise. Ce qui signifie que l'agriculture et l'industrie doivent toujours s'équilibrer à tous les niveaux.
Lorsque LIST s'insurge contre le processus d'intégration multinational, il s'insurge principalement contre la doctrine anglaise du libre-échange, contre le libéralisme économique préconisé par Adam SMITH, idéologie qui camoufle la conquête impérialiste des marchés/débouchés sous le slogan de la "liberté" (liberté du commerce, s'entend). A cette "science" de camouflage propagée par les économistes libéraux, LIST oppose le primat de l'industrie nationale et, au niveau politique, la création de barrières douanières protectrices (les Erziehungszölle ). Ces barrières, conçues comme des mesures temporaires limitées, doivent servir à élaborer une branche économique déterminée, à la rendre indépendante et rentable, de manière à ce qu'elle contribue à assurer la bonne marche de la Nation dans l'histoire.
Contrairement à ce qu'affirme la doctrine de SMITH, LIST ne reconnaît aucune autonomie à l'économie. Celle-ci a pour mission de servir les hommes et les peuples, sinon ce qui constitue la "liberté" pour les uns, ne signifie que l'exploitation pour les autres. Comparées à ces assertions sur l'économie politique, les thèses de Karl MARX à propos de cette thématique demeurent abstraites et universalistes, c'est-à-dire encore curieusement empreintes du libéralisme smithien.
Dieter Senghaas, avocat de la "dissociation"
_____________________________________________________________
Dans l'univers des pensées étiquettées de "gauche", aujourd'hui, Dieter SENGHAAS, professeur de sciences politiques, renoue avec cette théorie économique nationale de LIST. En effet, dans son livre Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik. Plädoyer für Dissoziation, SENGHAAS traite en long et en large de la science économique nationaliste de LIST et la déclare largement "positive".
Pour SENGHAAS, les idéologies dominantes en matière économique préconisent globalement une politique de libre-échange qui conduit obligatoirement à l'inclusion de l'Amérique Latine, de l'Afrique et de l'Asie dans le mode de division du travail (DIT) imposé par les métropoles. Derrière les mots "liberté" (c'est-à-dire liberté de commerce), "intégration" et "coopération", derrière cet écran de belles paroles, le capital multinational construit son One World. De la complexité des économies nationales, on passe alors, sous la pression de ces doctrines économiques fortement idéologisées, à des monocultures déformées, incapables d'auto-approvisionner leurs propres peuples, dépendantes des diktats imposés par les QG des consortiums, caractérisées par des "déformations structurelles" et des "circuits économiques défaillants". Tous les reproches que peuvent adresser les forces de gauche ou les pays en voie de développement à cette économie "one-worldiste" restent nuls et non avenus tant que l'on ne s'attaque pas au fond du problème, tant que l'on ne rejette pas le principe de l'imbrication économique multinationale, tant que l'on ne refuse pas l'intégration dans le système du One World.
Contre cet engouement planétaire, SENGHAAS suggère une alternative: prôner la dissociation plutôt que l'intégration, déconnecter les sociétés périphériques du système économique mondialiste/capitaliste (dans une perspective nationale), favoriser la création d'espace de développement auto-centrés plutôt que d'accepter les main-mises étrangères. L'économie contribue ainsi à asseoir la conception "nationale-révolutionnaire" du socialisme, c'est-à-dire celle du socialisme selon la voie nationale.
La contradiction qui oppose la "libre-économie" impérialiste aux voies nationales de développement n'a pas été levée. Au contraire, elle s'est accentuée. Le conflit entre la cause du capital multinational et la cause des peuples, entre la stratégie de l'aliénation et l'idéal d'identité culturelle et nationale, est le conflit majeur, essentiel, de notre temps. Et SENGHAAS écrit: "L'option cosmopolite de la doctrine des avantages comparés et le plaidoyer pour le libre-échange sont pareils aujourd'hui à ce qu'ils étaient du temps de LIST. Il s'agit tout simplement de l'argumentaire des profiteurs d'une division internationale du travail inégale... Sans aucun doute, la théorie de Friedrich LIST (notamment la perspective analytique et pragmatique qu'il ouvre) est tout à fait actuelle, dans la mesure où les masses des sociétés périphériques se dressent contre le système, contre l'ordre économique international que leurs "élites" contribuent à renforcer".
La déconnexion par rapport au marché mondial a pour objectif de mettre sur pied une économie et une société autonomes et viables, basées sur leurs propres ressources et sur leurs propres besoins. Il suffit de se rappeler les modèles historiques qu'a connus l'Europe, aux différentes stades de son développement industriel, et le développement de certains pays socialistes (La Chine de MAO ZEDONG, la République Populaire de Corée, l'Albanie) et de les imiter, dans la mesure du possible et dans le respect des identités, dans les pays du Tiers-Monde. Les critiques actuels des idéologies économiques dominantes (les "dissociationnistes") mettent avec raison en exergue les points suivants en matière de politique de développement:
- Rupture avec la division internationale du travail et rejet des modèles basés sur l'exportation et caractérisés par les monocultures;
- Rupture avec le type d'industrialisation qui fonctionne selon les substitutions à l'importation.
Cette double rupture devra simplement être temporaire. Jusqu'au moment où les lacunes structurelles contemporaines des économies politiques des pays en voie de développement (chômage, inégalités criantes dans la redistribution des revenus, pauvreté, endettements, etc.) soient éliminées grâce à une stratégie de développement auto-centré. A ce moment, les économies nationales pourront prendre, sur le marché mondial, une place équivalente à celle des pays plus développés et participer efficacement à la concurrence, selon les critères de la doctrine des coûts comparatifs. Ainsi, le modèle de la déconnexion se pose comme contre-modèle à l'endroit de la praxis dominante actuelle en matière de développement; la déconnexion rompt les ponts avec le modèle du développement associatif (connecté) qui, dans le langage journalistique, s'impose aux mentalités grâce aux vocables sloganiques de One World et d'intégration sur le marché mondial.
Les "théories de la dépendance" démontrent que le développement dans la périphérie est impossible dans les conditions que dictent les dépendances à l'égard des métropoles. Ces théories analysent les formes "dépendantes" de développement, telles qu'elles sont mises en pratique dans certains pays. Elles mettent par ailleurs l'accent sur le fait que le sous-développement ne constitue pas un stade en soi, que les PVD (pays en voie de développement) doivent traverser, mais est bien plutôt une "structure". Poursuivant leur raisonnement, ces théories affirment que les économies politiques déformées des PVD ne pourront sortir de leurs impasses que si elles acquièrent un certain degré d'indépendance, de libre compétence nationale dans les questions de production, de diversification, de distribution et de consommation. Dieter NOHLEN et Franz NUSCHELER ont ainsi mis en exergue les complémentarités qui pourraient résoudre les problèmes des économies des PVD: travail/emploi, croissance économique, justice sociale/modification structurelle, participation, indépendance politique et économique (in Handbuch Dritte Welt, Hamburg, 1982).
Kwame Nkrumah contre le néo-colonialisme,
John Galtung, économiste de la "self-reliance"
_____________________________________________________________
 Dans le Tiers-Monde lui-même, ces complémentarités ont été entrevues pour la première fois par le socialiste panafricain Kwame NKRUMAH dans son livre Neo-Colonialism. The Last Stage of Imperialism. L'essence du néo-colonialisme, selon NKRUMAH, consiste en ceci: l'Etat dominé par le néo-colonialisme possède théoriquement tous les attributs d'un Etat souverain, tandis qu'en réalité, son système économique et sa politique sont déterminés par l'extérieur. NKRUMAH constate de ce fait l'émergence d'une nouvelle lutte des classes, dont les "fronts" ne traversent plus les nations industrielles mais opposent les pays riches aux pays pauvres (puisque les travailleurs des pays riches profitent eux aussi du néo-colonialisme).
Dans le Tiers-Monde lui-même, ces complémentarités ont été entrevues pour la première fois par le socialiste panafricain Kwame NKRUMAH dans son livre Neo-Colonialism. The Last Stage of Imperialism. L'essence du néo-colonialisme, selon NKRUMAH, consiste en ceci: l'Etat dominé par le néo-colonialisme possède théoriquement tous les attributs d'un Etat souverain, tandis qu'en réalité, son système économique et sa politique sont déterminés par l'extérieur. NKRUMAH constate de ce fait l'émergence d'une nouvelle lutte des classes, dont les "fronts" ne traversent plus les nations industrielles mais opposent les pays riches aux pays pauvres (puisque les travailleurs des pays riches profitent eux aussi du néo-colonialisme).
Le concept de self-reliance (c'est-à-dire le développement selon ses propres forces) a été découvert, cerné et systématisé par John GALTUNG dans un ouvrage intitulé précisément Self-Reliance. Ce concept, né dans les polémiques adressées à l'encontre des modèles occidentaux/capitalistes de développement, sert à déterminer une économie basée sur la confiance que déployerait une nation pour ses propres forces. Une telle économie utiliserait ses propres ressources pour satisfaire les besoins fondamentaux de sa population et chercherait à atteindre cet équilibre intérieur par la mobilisation des masses, par la concentration des forces économiques sur le marché intérieur et par la participation globale de la population aux décisions politiques et ce, aux différents niveaux hiérarchiques et territoriaux. La self-reliance est liée à la recherche des traditions autochtones, des valeurs culturelles enracinées, adaptées à la voie propre de développement choisie par le pays concerné. La self-reliance peut ainsi constituer une alternative sérieuse aux stratégies de développement orientées selon les logiques de la croissance et de la mondialisation du marché. Les modèles les plus réussis d'un tel développement autonome des forces productives sont les économies de la Tanzanie, du Zimbabwe, de la Guinée-Bissau et surtout de la République Populaire de Corée.
Mais ces modèles "déconnectés", illustrant la théorie "dissociationniste", ne sont que des premiers pas. Il faut aller plus loin. Et il ne faut pas qu'ils ne restent qu'à la périphérie du monde. L'intégration des peuples européens dans un réseau de dépendances et de déformations structurelles (GATT, CEE, etc.) doit être arrêtée.Car cette intégration ne signifie pas seulement une mutilation économique dangereuse mais aussi et surtout une "déformation" globale de la société. Ce ne sont pas que les nations périphériques qui souffrent de ces mutilations. Nos identités européennes, nos héritages culturels risquent également d'être totalement arasés. Le développement auto-centré est aujourd'hui une tâche révolutionnaire, pour le salut de toutes les nations du globe. Et ici aussi, en Allemagne, en Europe.
Stefan FADINGER.
(traduit de l'allemand par R. Steuckers; texte paru dans Aufbruch 4/1985)
00:05 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, théorie politique, sciences politiques, politologie, autocentrage, développement, mondialisme, antimondialisme, altermondialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 janvier 2010
Kapital als Aberglaube
Kapital als Aberglaube
 Das Kapital ist ein Glaube, und das Schlimme an diesem Glauben ist, dass es ein unethischer Glaube ist, - dass es ein Glaube ist, der nur regiert wird von einem einzigen Instinkt des Menschen, von seinem unmittelbaren, atavistischen, vom Egoismus, und dass dieser Egoismus nur gehemmt wird durch die Furcht vor dem Egoismus der anderen. Wie ein wildes Tier arbeitet eine Firma gegen die andere, rücksichtslos bedrängt der Fiskus den Bürger, und verschlagen und rücksichtslos versucht der Bürger, der Steuer zu entgehen. Wunderschöne Namen sind dafür erfunden worden. Eine ganze Wissenschaft hat sich aufgebaut aus dem Wunsch des Bürgers, dem Staat nur so wenig Steuern bezahlen zu müssen, als es irgendwie geht, und grosse Büros mit vornehm klingenden Namen leben von diesem Wunsch. Ein Spiel um Worte, denn dass der Staat Geld braucht, das ist ja klar, und dass er eigentlich gerecht besteuern müsste, müssten wir nach allem, was wir in der Schule von Ethik gelernt haben, wohl voraussetzen. Die Praxis beweist das Gegenteil. Der Staat wird als Feind betrachtet, und der Staat betrachtet seinen Bürger, der ihm Steuern zahlt, zunächst als Betrüger.
Das Kapital ist ein Glaube, und das Schlimme an diesem Glauben ist, dass es ein unethischer Glaube ist, - dass es ein Glaube ist, der nur regiert wird von einem einzigen Instinkt des Menschen, von seinem unmittelbaren, atavistischen, vom Egoismus, und dass dieser Egoismus nur gehemmt wird durch die Furcht vor dem Egoismus der anderen. Wie ein wildes Tier arbeitet eine Firma gegen die andere, rücksichtslos bedrängt der Fiskus den Bürger, und verschlagen und rücksichtslos versucht der Bürger, der Steuer zu entgehen. Wunderschöne Namen sind dafür erfunden worden. Eine ganze Wissenschaft hat sich aufgebaut aus dem Wunsch des Bürgers, dem Staat nur so wenig Steuern bezahlen zu müssen, als es irgendwie geht, und grosse Büros mit vornehm klingenden Namen leben von diesem Wunsch. Ein Spiel um Worte, denn dass der Staat Geld braucht, das ist ja klar, und dass er eigentlich gerecht besteuern müsste, müssten wir nach allem, was wir in der Schule von Ethik gelernt haben, wohl voraussetzen. Die Praxis beweist das Gegenteil. Der Staat wird als Feind betrachtet, und der Staat betrachtet seinen Bürger, der ihm Steuern zahlt, zunächst als Betrüger.Der Kapitalismus ist ein unmoralischer Glaube, besser gesagt, er ist ein amoralischer. Aber der erste Schritt ist bereits getan, wenn man weiss, dass der Kapitalismus eigentlich ein Aberglaube ist, ein Aberglaube, wie die Astrologie, die ja auch amoralisch ist und sich jetzt mit einem Mäntelchen der Moral umkleidet.
Der Kapitalismus ähnelt überhaupt sehr stark der Astrologie. Denn ebenso blind, wie diese Pseudowissenschaft, begünstigt und vernichtet er die Individualität des einzelnen.
Wolfgang Forell, Kapital als Aberglaube. Betrachtung über einige aktuelle Fragen in der heutigen Zeit. In: Gegner, Heft 3, 15. August 1931, S. 15-17.
00:17 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, théorie politique, politologie, économie, sciences politiques, politique, capitalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'itinéraire d'Edgar Julius Jung
 Archives de Synergies Européennes - 1992
Archives de Synergies Européennes - 1992
L'itinéraire d'Edgar Julius Jung
par Robert Steuckers
Né le 6 mars 1894 à Ludwigshafen, fils d'un professeur de Gymnasium, Edgar Julius Jung entame, à la veille de la première guerre mondiale, des études de droit à Lausanne, où il suit les cours de Vilfredo Pareto. Quand la guerre éclate, Jung se porte volontaire dans les armées impériales et acquiert le grade de lieutenant. A sa démobilisation, il reprend ses études de droit à Heidelberg et à Würzburg mais participe néanmoins aux combats de la guerre civile allemande de 1918-19. Engagé dans le corps franc du Colonel Chevalier von Epp, il participe à la reconquête de Munich, gouvernée par les «conseils» rouges. Jung organise ensuite la résistance allemande contre la présence française dans le Palatinat. En 1923, il doit quitter précipitamment les zones occidentales occupées pour avoir trempé dans le complot qui a abouti à l'assassinat du leader séparatiste francophile Heinz Orbis. C'est de cette époque que date son aversion pour la personne de Hitler: ce dernier, sollicité par Jung envoyé par Brüning, avait refusé de rejoindre le front commun des nationaux et des conservateurs contre l'occupation française, estimant que le «danger juif» primait le «danger français». Pour Jung, ce refus donnait la preuve de l'immaturité politique de celui qui allait devenir le chef du IIIième Reich. En 1925, Jung ouvre un cabinet d'avocat à Munich. Il renonce à l'activisme politique et rejoint la DVP nationale-libérale, un parti toléré par les Français dans le Palatinat et qui rassemblait, là-bas, tous les adversaires du détachement de cette province allemande. Quand Stresemann opte pour une politique de réconciliation avec la France, dans la foulée du Pacte de Locarno (1925), Jung se distancie de ce parti, mais en reste formellement membre jusqu'en 1930. Il consacre ses énergies à toutes sortes d'entreprises «métapolitiques» et d'activités «clubistes». En effet, entre 1925 et 1933, la République de Weimar voit se constituer un véritable réseau de clubs conservateurs qui organisent des conférences, publient des revues intellectuelles, cherchent des contacts avec des personnalités importantes du monde de l'économie ou de la politique. Après avoir eu quelques contacts avec le Juniklub et le Herren-Klub de Heinrich von Gleichen et Max Hildebert Boehm (dont il retiendra la définition du Volk), Jung adhère et participe successivement aux activités du Volksdeutsches Klub (de Karl Christian von Loesch), de la Nationalpolitische Vereinigung (à Dortmund) et du Jungakademisches Klub de Munich, dont il est le fondateur. L'objectif de cette stratégie métapolitique est de créer une nouvelle conscience politique chez les étudiants, de manier l'arme de la science contre les libéraux et les gauches et de fonder une éthique pour les temps nouveaux. En 1927, paraît la première édition de son livre Die Herrschaft der Minderwertigen (= La domination des hommes de moindre valeur), véritable vade-mecum de la révolution conservatrice d'inspiration traditionaliste ou jungkonservative (que nous distinguons de ses inspirations nihiliste, nationale-révolutionnaire, soldatique comme chez les frères Jünger, nationale-bolchévique, völkische, etc.). Entre 1929 et 1932, paraissent plusieurs éditions d'une nouvelle version, comptant deux fois plus de pages, et approfondissant considérablement l'idéologie jungkonservative. Petit à petit, pense Jung, une idéologie conservatrice et traditionaliste, puisant dans les racines religieuses de l'Europe, remplacera la «domination des hommes de moindre valeur», établie depuis 1789. Mais, secouée par la crise, l'Allemagne n'emprunte pas cette voie conservatrice: le parlementarisme libéral s'effondre, plus tôt que Jung ne l'avait prévu, mais pour laisser le chemin libre aux communistes ou aux nationaux-socialistes. Jung constate avec amertume que le noyau conservateur qu'il avait formé dans ses clubs ne fait pas le poids devant les masses enrégimentées. Pour gagner du temps et barrer la route au mouvement hitlérien, Jung estime qu'il faut soutenir le gouvernement de Brüning. Ce gouvernement prolongerait la vie de la démocratie libérale pendant le temps nécessaire pour former une élite conservatrice, capable de passer aux affaires et de construire l'«Etat organique et corporatif» dont rêvaient les droites catholiques. Pour Jung, l'avènement du national-socialisme totalitaire serait la conséquence logique de 1789 et non son éradication définitive par une «éthique de plus haute valeur». En 1930-31, il rejoint les rangs de la Volkskonservative Vereinigung, qui soutient Brüning, et cherche à la rebaptiser Revolutionär-konservative Vereinigung pour séduire une partie de l'électorat national-socialiste. En mai 1932, Brüning tombe. Jung décide de soutenir son successeur Papen, qu'il juge aussi falot que lui. Jung devient toutefois son conseiller. Quand Hitler accède au pouvoir en janvier 1933, Jung prépare aussitôt les élections de mars 1933 en organisant la campagne électorale du Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, visant à soutenir l'aile conservatrice du nouveau gouvernement et à transformer la révolution nationale de Hitler, marquée par une démagogie tapageuse, en une révolution conservatrice, chrétienne, tranquille, sérieuse, décidée. Cette ultime tentative connaît l'échec. Jung continue cependant à écrire les discours de von Papen. Le 17 juin 1934, ce dernier, lors d'un rassemblement universitaire à Marbourg, prononce un discours écrit par Jung, où celui-ci dénonce le «byzantinisme du national-socialisme», ses prétentions totalitaires contre-nature, ses polémiques contre l'esprit et la raison et réclame le retour d'une «humanité véritable» qui inaugurera l'«apogée de la culture antique et chrétienne». Le régime réagit en interdisant la radiodiffusion du discours et la circulation de sa version imprimée. Papen démissionne mais cède ensuite aux pressions de la police. Jung est arrêté le 25 juin et, cinq jours plus tard, on retrouve son cadavre criblé de balles dans un petit bois près d'Oranienburg. Le destin de Jung montre l'impossiblité de mener à bien une révolution conservatrice/traditionaliste à l'âge des masses.
La domination des hommes de moindre valeur. Son effondrement et sa dissolution par un Règne nouveau (Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung durch ein neues Reich), 1929
Jung a voulu faire de cet ouvrage une sorte de «bible» de la «révolution conservatrice», une révolution qu'il voulait culturelle et annonciatrice d'un grand bouleversement politique. S'adressant aux jeunes et aux étudiants, Jung veut donner à son conservatisme —son Jungkonservativismus— une dimension «révolutionnaire». Il explique que l'idéologie progressiste a eu son sens et son utilité historique; il fallait qu'elle brise l'hégémonie de formes mortes. Mais depuis que celles-ci ont disparu de la scène politique, l'attitude progressiste n'a plus raison d'être. L'idéologie du progrès n'est plus qu'une machine qui tourne à vide. Pire, quand elle reste sur sa lancée, elle peut s'avérer suicidaire. A la suite de la parenthèse progressiste, doit s'ouvrir une ère de «maintien», de conservation. Le Jungkonservativismus ne cherche donc pas à perpétuer des formes politiques dépassées. Quant aux formes sociales et politiques actuelles, pense Jung, elles ne sont plus des formes au sens propre du mot, mais des résidus évidés, balottés dans le chaos de l'histoire. Jung définit ensuite son conservatisme comme «évolutionnaire»: il vise le dépassement d'un monde vermoulu, l'inversion radicale et positive de ses fausses valeurs. Ce travail d'inversion/restauration est, aux yeux de Jung, proprement révolutionnaire.
La période qui suit la Grande Guerre est caractérisée par la crise épocale des valeurs individualistes et bourgeoises en pleine décadence. Pour les relayer, le Jungkonservativismus jungien propose un recours à Dilthey et à Bergson, à Spengler, Tönnies, Roberto Michels, Vilfredo Pareto et Nicolas Berdiaev. La crise s'explique, en langage spenglérien, par le passage au stade de «civilisation» qui est le couronnement de l'esprit libéral. Les liens sociaux sont détruits et les peuples tombent sous la coupe d'une démocratie inorganique, gérée par les «hommes de moindre valeur». Tel est le diagnostic. Pour sortir de cette impasse, il faut restaurer les vertus religieuses. Abandonnant ses positions initiales, lesquelles reposaient sur une philosophie des valeurs tirée du néo-kantisme, Jung veut désormais ancrer son «axiome de l'immuabilité de la pulsion métaphysique» dans un discours théologisé. Deux philosophes de la religion contribuent à le faire passer du néo-kantisme au néo-théologisme: Nicolas Berdiaev et Leopold Ziegler (qui deviendra son ami personnel). Jung embraye sur l'idée de Berdiaev qui évoque le fin imminente de l'époque moderne qui a vu le triomphe de l'irreligion. Pour Jung comme pour Berdiaev ou Ziegler, l'époque qui succèdera au libéralisme moderne sera un «nouveau Moyen Age» pétri de religion, réchristianisé. Eliminant les catastrophes de l'individualisme, ce nouveau «Moyen Age» restaure une holicité (Ganzheit), un universalisme dans le sens où l'entendait Othmar Spann, un «organicisme» historique et non biologique. Cette dernière position distingue Jung des nationalistes de toutes catégories. En effet, il rejette le concept de «nation» comme «occidental», c'est-à-dire «français» et révolutionnaire, libéral et atomiste. Dans ce concept de «nation», domine le rationalisme raisonneur de l'idéologie des Lumières. Les «nations», dans ce sens, sont les peuples malades ou morts. Les peuples qui n'ont pas subi l'emprise de l'idéologie nationale, qui est d'essence révolutionnaire et est donc perverse, sont vivants, conservent au fond d'eux-mêmes des énergies intactes et demeurent les «porteurs de l'histoire». Jung relativise ainsi au maximum la valeur attribuée à l'Etat national, fermé sur lui-même. Les concepts-clé sont pour lui ceux de peuple (Volk) et de Reich. Cette dernière instance, supra-nationale et incarnation politique du divin sur la Terre, est une idée d'ordre fédérative, tout à fait adaptée à l'espace centre-européen. De là, elle devra être étendue à l'ensemble du continent européen, de façon à instaurer un europäischer Staatenbund (une fédération des Etats européens). Sur le plan spirituel, l'idée de Reich est le seul barrage possible contre le processus de morcellement rationaliste et nationaliste. Les Etats-Nations reposent sur un fait figé rendu immuable par coercition, tandis que le Reich est un mouvement perpétuel dynamique qui travaille sans interruption les matières «peuples». Pour Jung, né protestant mais devenu catholique de fait, l'idée nationale est une tradition protestante en Allemagne, tandis que l'idée dynamique de Reich est une idée catholique. Sur le plan intérieur, ce Reich fédératif est organisé corporativement. A la place du Parlement et du suffrage universel, Jung suggère l'introduction d'une représentation populaire corporative et d'un droit de vote échelonné et différencié. L'organisation intérieure de son Reich idéal, Jung la calque sur les idées du sociologue et philosophe autrichien Othmar Spann. C'est le talon d'Achille de son idéologie: cette organisation corporative ne peut s'appliquer dans un Etat moderne et industriel. Son appel à l'ascèse et au sacrifice ne pouvait nullement mobiliser les Allemands de son époque, durement frappés par l'inflation, la crise de 29, la famine du blocus et les dettes de Versailles.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie: Die geistige Krise des jungen Deutschland, 1926 (discours, 20 p.); Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung, 1927 (XIV + 341 pages); Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung durch ein neues Reich, 1929 (2ième éd.), 1930 (3ième éd.) (692 pages); Föderalismus aus Weltanschauung, 1931; Sinndeutung der deutschen Revolution, 1933; une copie du mémoire rédigé par E.J. Jung à l'adresse de Papen en avril 1934 se trouve à l'Institut für Zeitgeschichte de Munich, archives photocopiées 98, 2375/59 et chez Edmund Forschbach, ami et biographe d'E.J. Jung (cf. infra); d'après Karlheinz Weißmann (cf. infra), Jung serait l'auteur de la plupart des textes contenus dans le recueil de discours de Franz von Papen intitulé Apell an das deutsche Gewissen. Reden zur nationalen Revolution. Schriften an die Nation, Bd. 32/33, Oldenburg i.O., 1933.
- Principaux articles de philosophie politique: 1) Dans la revue Deutsche Rundschau: «Reichsreform» (nov. 1928); «Der Volksrechtsgedanke und die Rechtsvorstellungen von Versailles» (oct. 1929); «Volkserhaltung» (mars 1930); «Aufstand der Rechten» (1931, pp.81-88); «Neubelebung von Weimar?» (juin 1932); «Revolutionäre Staatsführung» (oct. 1932); «Deutsche Unzulänglichkeit» (nov. 1932); «Verlustbilanz der Rechten» (1/1933); «Die christiliche Revolution» (sept. 1933, pp. 142-147); «Einsatz der Nation» (1933, pp. 155-160); 2) Dans les Schweizer Monatshefte: 1930/31: Heft 1, p. 37, Heft 7, p. 321; 1932/33: Heft 5/6, p. 275; 3) Dans la Rheinisch- Westfälische Zeitung, où Jung utilisait le pseudonyme de Tyll, voir les dates suivantes: 1/1/1930; 5/3/1930; 5/4/1930; 24/4/1930; 2/5/1930; 31/5/1930; 12/10/1930; 8/11/1930; 30/12/1930; 28/1/1931; 7/2/1931; 4/3/1931; 1/4/1931; 10/4/1931; 1/8/1931; été 1931; 15/3/1932; 4) Dans les Münchner Neueste Nachrichten, voir les dates suivantes: 20/3/1925; 28/1/1930; 23/11/1930; 3/1/1931; 25/7/1931; 4/7/1931; 5) Dans les Süddeutsche Monatshefte: «Die Tragik der Kriegsgeneration», mai 1930, pp. 511-534; 6) Dans Die Laterne: «Was ist liberal?», Folge 6, 6/5/1931.
- Participation à des ouvrages collectifs: «Deutschland und die konservative Revolution», in E.J. Jung, Deutsche über Deutschland. Die Stimme des unbekannten Politikers, Munich, 1932, pp. 369-383; on signale également une contribution d'E.J. Jung («Die deutsche Staatskrise als Ausdruck der abandländischen Kulturkrise») dans Karl Haushofer et Kurt Trampler (éd.), Deutschlands Weg an der Zeitenwende, Munich, 1931; le livre signé par Leopold Ziegler, Fünfundzwanzig Sätze vom Deutschen Staat (Berlin, 1931) serait en fait dû à la plume de Jung.
- Sur Edgar Julius Jung: Leopold Ziegler, Edgar Julius Jung. Denkmal und Vermächtnis, Salzbourg, 1955; «Edgar Jung und der Widerstand» in Civis 59, Bonn, Nov. 1959; Friedrich Grass, «Edgar Julius Jung (1894-1934)», in Kurt Baumann (éd.), Pfälzer Lebensbilder, Bd. 1, Spire, 1964; Karl Martin Grass, Edgar Julius Jung, Papenkreis und Röhmkrise 1933-1934, dissertation phil., Heidelberg, 1966; Bernhard Jenschke, Zur Kritik der konservativ-revolutionäre Ideologie in der Weimarer Republik. Weltanschauung und Politik bei Edgar Julius Jung, Munich, 1971 (avec une bibliographie reprenant 79 articles importants d'E.J. Jung); Karl-Martin Grass, «Edgar J. Jung», in Neue Deutsche Biographie, 10. Bd., Berlin, 1974; Joachim Kaiser, Konservative Opposition gegen Hitler 1933/34. Edgar Julius Jung und Ewald von Kleist-Schmenzin, Texte non publié d'un séminaire de l'Université d'Aix-la-Chapelle, 1984; Edmund Forschbach, Edgar J. Jung, ein konservativer Revolutionär 30. Juni 1934, Pfullingen, 1984; Gilbert Merlio, «Edgar Julius Jung ou l'illusion de la "Révolution Conservatrice"», in Revue d'Allemagne, tome XVI, n°3, 1984; Karlheinz Weißmann, «Edgar J. Jung» in Criticón, 104, 1987, pp. 245-249; Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, 3ième éd., Darmstadt, 1989.
- Pour comprendre le contexte historique: Klemens von Klemperer, Konservative Bewegungen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, Munich/Vienne, 1957; Erasmus Jonas, Die Volkskonservativen 1928-1933, Düsseldorf, 1965; Theodor Eschenburg, «Hindenburg, Brüning, Groener, Schleicher», in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 9. Jg. 1961, 1; Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, Munich 1962; Franz von Papen, Vom Scheitern einer Demokratie 1930-1933, Mayence, 1968; Klaus Breuning, Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und Diktatur, Munich, 1969; Volker Mauersberger, Rudolf Pechel und die «Deutsche Rundschau» 1919-1933. Eine Studie zur konservativ-revolutionären Publizistik in der Weimarer Republik, Brème, 1971; Jean-Pierre Faye, Langages totalitaires, Paris, 1972; Martin Greiffenhagen, Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland, Munich, 1977.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, philosophie, théorie politique, années 20, années 30, allemagne, sciences politiques, politologie, weimar, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 janvier 2010
Les néo-socialistes au-delà de la gauche et de la droite
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
Les néo-socialistes au-delà de la gauche et de la droite
par Pierre-Jean Bernard
1) Les néo-socialistes: "ni droite, ni gauche", "néos" et perspectives socialistes.
Si la guerre de 14/18 sonne le glas du vieux monde, des vieilles choses, des idées reçues et de la morale bourgeoise, force est de constater les mutations qu'elle entraîne dans les divers courants politiques. Mutations qui s'opèrent parallèlement à l'avènement du monde moderne. Il en est ainsi du "mouvement socialiste", nous devrions plutôt dire des socialismes qui vont éclore et parfois s'affronter. Certes le public retiendra longtemps l'impact du dernier avatar du marxisme, à savoir le bolchévisme et l'élan que suscita la Révolution d'Octobre 1917. En France, les conséquences en sont l'apparition du PCF et la scission dans le mouvement syndical de la CGT, consécutive à la déchirante révision idéologique née du congrès "historique" de Tours. Mais finalement la conception bolchévique n'est que la "radicalisation" du courant marxiste, accompagnée d'un rejet du jeu parlementaire et légaliste.
Or que sait-on des courants néos opposés aux vieilles barbes de la SFIO? Que sait-on des idées de ces militants que le conflit mondial -et donc l'avènement brutal de la "modernité"- a rendu visionnaires, alors que d'autres, atteints de cécité politique, veulent absolument faire croire au public à la réalité éternelle de l'affrontement droite/gauche, hypothétiques blocs hermétiques qui symboliseraient deux conceptions du monde. L'une serait celle d'une gauche porteuse d'espérance et de générosité (mythes qui recouvrent en partie les sentiments de la classe ouvrière européenne dans ces années de capitalisme en plein essor), et l'autre celle d'une droite "fascisante et réactionnaire, ennemie de la démocratie (ce qui est vrai) et bras armé du capital, celui des deux cents familles! Ce qui est aussi partiellement vrai.
Mais, en réalité, qui sont donc les hommes qui refusent ce schéma trop simpliste? Leurs noms sont Georges Gressent, dit Valois, Marcel Déat, Henri De Man ou encore Marquet, Lefranc, Albertini, etc. L'absurde chaos de la "Grande Guerre", où ils se sont battus courageusement, parfois comme officiers, parfois comme simples soldats (le cas d'un Drieu la Rochelle), "les joies (sic) des tranchées" et le brassage des classes jeunes (ouvrières, paysannes, bourgeoises) dans les champs sanglants de l'Est et du Nord de la France, les ont enfin décillés. Avec l'absurdité et l'horreur, ils ont aussi connu le sens du sacrifice -car le mot "devoir" est bien trop faible pour évoquer leur cas- le sens également de la solidarité, de la camaraderie, rendant ineptes ou dépassés les vieux termes de droite ou de gauche, sanctionnant de manière désormais si désuète les clivages de classe. Et s'ils désapprouvent "la guerre civile européenne", selon le mot fameux de Valery, ils ont gardé au fond de leur cœur cette mystique de l'"Union sacrée" (mais pas au sens où l'entendaient les minables politiciens bourgeois de la future chambre bleue horizon). "Ni droite, ni gauche" crie le socialiste Albertini, auquel fait écho le "droitiste" Bucard. D'où une volonté de sortir du moule trop bien huilé des partis et des "systèmes", et d'essayer autre chose...
Georges Valois
 G. Valois est chronologiquement le premier dans cette série de pionniers. S'il reprend du service à l'Action Française, c'est bien dans l'espoir de voir se perpétuer et s'approfondir le rapprochement des Camelots du Roy avec les cercles proud'honiens et soréliens d'avant-guerre, bref de réconcilier la monarchie des humbles, celle de la justice des peuples, avec l'anarcho-syndicalisme révolutionnaire (cf l'œuvre de Sorel, en particulier ses réflexions sur la violence, et ses matériaux d'une théorie du prolétariat). Mais l'AF, où il occupe dans le journal la place de l'économiste, est un mouvement qui, soit dit en passant, ne "croit" pas à l'économie... (l'"économie politique" est refusée au nom du célèbre postulat maurrassien du "politique d'abord"). Le "vieux maître" de Martigues est maintenant enfermé dans son système d'idées préconçues et confond par trop la "défense" (intellectuelle et morale) de la "monarchie nationale" avec les impératifs tactiques de l'Action française, au point de courtiser la vieille droite "cléricale" et sclérosée, étouffant l'idée royaliste sous un ordre moral "macmahonien", irrespirable pour un bon nombre de jeunes intellectuels (Bernanos en est le plus célèbre, avec Maulnier, Drieu...). Très rapidement, c'est la rupture et la création, par certains anciens militants, du "faisceau" (préfiguration du fascisme français) et vite rebaptisé "fesso" pour la circonstance par le talentueux polémiste L.Daudet, fils du célèbre écrivain Alphonse Daudet, tant les haines et les agressions des fidèles de Maurras et de la tendance réactionnaire du mouvement monarchiste seront virulentes.
G. Valois est chronologiquement le premier dans cette série de pionniers. S'il reprend du service à l'Action Française, c'est bien dans l'espoir de voir se perpétuer et s'approfondir le rapprochement des Camelots du Roy avec les cercles proud'honiens et soréliens d'avant-guerre, bref de réconcilier la monarchie des humbles, celle de la justice des peuples, avec l'anarcho-syndicalisme révolutionnaire (cf l'œuvre de Sorel, en particulier ses réflexions sur la violence, et ses matériaux d'une théorie du prolétariat). Mais l'AF, où il occupe dans le journal la place de l'économiste, est un mouvement qui, soit dit en passant, ne "croit" pas à l'économie... (l'"économie politique" est refusée au nom du célèbre postulat maurrassien du "politique d'abord"). Le "vieux maître" de Martigues est maintenant enfermé dans son système d'idées préconçues et confond par trop la "défense" (intellectuelle et morale) de la "monarchie nationale" avec les impératifs tactiques de l'Action française, au point de courtiser la vieille droite "cléricale" et sclérosée, étouffant l'idée royaliste sous un ordre moral "macmahonien", irrespirable pour un bon nombre de jeunes intellectuels (Bernanos en est le plus célèbre, avec Maulnier, Drieu...). Très rapidement, c'est la rupture et la création, par certains anciens militants, du "faisceau" (préfiguration du fascisme français) et vite rebaptisé "fesso" pour la circonstance par le talentueux polémiste L.Daudet, fils du célèbre écrivain Alphonse Daudet, tant les haines et les agressions des fidèles de Maurras et de la tendance réactionnaire du mouvement monarchiste seront virulentes.
Mais G. Valois, s'il se réfère au départ à la pensée mussolinienne (celle de la première période), s'écartera assez vite du "modèle" italien (la critique d'un "modèle" de régime ne date pas de l'eurocomunisme...), modèle auquel il reproche son aspect plus "nationaliste" (puis impérialiste) que "socialiste". Le "fascisme" valoisien est précisément l'union de l'"idée nationale" -réalité née de la guerre et des hécatombes meurtrières- et du courant socialiste français, socialisme non matérialiste, mais d'une inspiration spiritualitste et volontariste, qui doit autant à Charles Péguy qu'à l'idéologie sorélienne. Le socialisme valoisien, qui ne rejette pas les notions "économiques" de profit et de propriété, s'appuie sur une vision organiciste et non-mécaniciste (à rebours du libéralisme) de la société contemporaine. Il ajoute en outre une vériatble "mystique" du travail teintée de christianisme (cf la place qu'il accorde à l'idée de rédemption) dans un culte englobant des valeurs communautaires et "viriles" (le sport comme "pratique politique").
Mais la lutte que mènent désormais les partisans de l'Action Française, avec l'appui sans faille des groupes financiers catholiques qui soutiennent parallèlement les ligues d'extrême-droite et les partis droitistes, ne laissera aucun répit ni à Valois, bassement calomnié et injurié par la presse royaliste, selon une technique éprouvée qui fera "florès" lors de l'affaire Salengro, ni à ses troupes isolées. Les "chemises bleues" disparaîtront vite à la fin des années 20, et Valois ira rejoindre les rangs de la SFIO, en attendant de mourir pendant le second conflit mondial dans le camp de Bergen-Belsen, condamné à la déportation par les autorités allemandes pour fait de résistance. Là aussi, dans ce "grand dégoût collecteur", la voix de Valois rejoindra celle d'un Bernanos, celui des "grands cimetières sous la lune"...
Henri De Man
L'autre personnalité marquante du néo-socialisme est celle du Belge Henri De Man, connu internationalement pour ses critiques originales des théories marxistes, idéologie qu'il connait à fond pour y avoir adhéré dans ses premières années de militantisme. La fin de la première guerre mondiale est, pour De Man, la période des remises en question et des grandes découvertes. En s'initiant aux théories psychanalytiques de Freud et aux travaux du professeur Adler sur la volonté et le "complexe d'infériorité", il fait pour la première fois le lien entre les sciences humaines, donnant une signification de type psychologique, et bientôt éthique, à l'idéologie socialiste. Il s'agit d'une tentative remarquable de dépassement du marxisme et du libéralisme, qui est à l'opposé des élucubrations d'un W. Reich ou d'un H. Marcuse!!
Mais dans sa volonté de dépasser le marxisme, De Man en viendra inéluctablement à un dépassement de la "gauche" et s'intéressera aux théories néo-corporatistes et à l'organisation du "Front du Travail" national-socialiste. Cela dit, De Man préconise le recours au pouvoir d'Etat dans le but d'une meilleure régularisation de la vie économique et sociale, des rapports au sein de la société moderne industrielle, et cela grâce à un outil nouveau: le PLAN.
 Le "planisme" connaîtra longtemps les faveurs des milieux syndicalistes belges et néerlandais et une audience plus militée en France. Il est alors intéressant de noter que De Man prévoit dans ce but l'apparition d'une nouvelle "caste" de techniciens, ayant pour tâche essentielle d'orienter cette planification. Vision prémonitoire d'une société "technocratique" dans laquelle les "néos" ne perçoivent pas les futurs blocages que l'expérience des quarante dernières années nous a enseignés. On peut également signaler l'importance, à la même époque, des idées appliquées par un certain J.M. Keynes qui verra, dans les années 30, le triomphe de ses théories économiques. Enfin, le planisme de De Man prévoit une application de type corporatiste.
Le "planisme" connaîtra longtemps les faveurs des milieux syndicalistes belges et néerlandais et une audience plus militée en France. Il est alors intéressant de noter que De Man prévoit dans ce but l'apparition d'une nouvelle "caste" de techniciens, ayant pour tâche essentielle d'orienter cette planification. Vision prémonitoire d'une société "technocratique" dans laquelle les "néos" ne perçoivent pas les futurs blocages que l'expérience des quarante dernières années nous a enseignés. On peut également signaler l'importance, à la même époque, des idées appliquées par un certain J.M. Keynes qui verra, dans les années 30, le triomphe de ses théories économiques. Enfin, le planisme de De Man prévoit une application de type corporatiste.
En France, à la même époque, des hommes comme Marcel Déat, H. Marquet, M. Albertini, ou encore Lefranc, se situeront résolument dans cette mouvance. Leur insistance à refuser la "traditionnelle" dichotomie entre prolétariat et bourgeoisie (N'y a-t-il pas là une préfiguration de la critique plus récente contre la "société salariale" que Marx, Proudhon et d'autres encore, avaient déjà ébauché...) les place sans aucun doute dans ce courant des néos dont nous parlons ici. Cette division est pour eux d'autant plus dépassée que le prolétariat ne joue plus que partiellement le rôle de "moteur révolutionnaire". L'évolution de la société a enfanté de nouvelles forces, en particulier les "classes moyennes" dont la plupart sont issus. Leur confiance se reportant alors sur ces dernières qui sont les victimes de la société capitaliste cosmopolite. Le "système" rejette les classes moyenes par un mouvement puissant de nivellement des conditions et de rationalisation parcellaire du travail. Taylor est alors le nouveau messie du productivisme industrialiste... Le progrès est un révélateur de ces nouvelles forces, qui participent dorénavant de gré ou de force au mouvement révolutionnaire.
Désormais, au sein de la vieille SFIO, déjà ébranlée par la rupture fracassante des militants favorables au mouvement bolchévique, on assiste à une lutte d'influences entre "néos" et guesdistes; parmi ces derniers apparaissent certaines figures de proue: ainsi celle de Léon Blum. Là aussi, comme dans le cas du Faisceau de Georges Valois, les "néos" sont combattus avec violence et hargne par une "vieille garde" socialiste, qui réussit à étouffer le nouveau courant en expulsant ses partisans hors des structures décisionnaires du parti. L'avènement du front populaire sonnera le glas de leur espoir: réunir autour de leur drapeau les forces vives et jeunes du socialisme français. Certains d'entre eux, et non des moindres, se tourneront alors vers les "modèles" étrangers totalitaires: fascisme et national-socialisme allemand. De leur dépit naîtront des formations "fascisantes" ou nationales, et, pour beaucoup, la collaboration active avec la puissance occupante pendant les années 40 (Remarquons au passage que de nombreux militants "néos" rejoindront la résistance, représentant au sein de cette dernière un fort courant de réflexion politique qui jouera son jeu dans les grandes réformes de la libération).
En effet, si la grande tourmente de 1945 sera la fin de beaucoup d'espoirs dans les deux camps, celui de la collaboration et celui de la résistance intérieure, le rôle intellectuel des néos n'est pas pour autant définitivement terminé. Sinon, comment expliquer l'idéologie moderniste de la planification "à la française", à la fois "souple et incitative", où collaborent les divers représentants de ce qu'il est convenu d'appeler les "partenaires sociaux"? (cf. le rôle essentiel accordé par les rédacteurs de la constitution de 1958 à un organe comme le "Conseil économique et social", même si la pratique est en décalage évident avec le discours). On peut aussi expliquer pour une bonne part les idées nouvelles des milieux néo-gaullistes. Celles des idéologies de la "participation" ou celle des partisans de la "nouvelle société". La recherche d'une troisième voie est l'objectif souvent non-avoué de ces milieux. Une voie originale tout aussi éloignée des groupes de la "gauche alimentaire" que de la "droite affairiste", et appuyée davantage sur un appel au "cœur" des hommes plutôt qu'à leur "ventre".
2) L'après-guerre: néosocialisme et planification "à la française".
La grande crise des années 30 marque dans l'histoire économique mondiale la fin du sacro-saint crédo libéral du libre-échangisme, du "laisser faire, laisser passer", caractérisant ainsi le passage de l'Etat-gendarme à l'Etat-providence, en termes économistes. Et ceci, grâce en partie aux "bonnes vieilles recettes" du docteur Keynes...
L'Etat, nouveau Mammon des temps modernes, est investi d'une tâche délicate: faire pleuvoir une manne providentielle sous les auspices de la déesse Egalité... L'empirisme du "New Deal" rooseveltien fera école. En France, une partie du courant socialiste entrevoit le rôle étatique au travers d'administrations spécialisées et de fonctionnaires zélés (cf. les théories du Groupe X), en fait simple réactualisation d'un saint-simonisme latent chez ces pères spirituels de la moderne "technocratie".
On trouve l'amorce de cette évolution dans les cénacles intellectuels qui gravitent autour du "conseil national de la résistance". L'idée se fait jour d'une possible gestion technique et étatique de l'économie dans le cadre d'un plan général de reconstruction du pays en partie ruiné par le conflit. L'idée ne se réfère pas à un modèle quelconque (comme, par exemple, l'URSS dans les milieux du PCF), c'est-à-dire d'un dirigisme autoritaire pesant sur une société collectiviste, mais plutôt à un instrument permettant à l'Etat une "régulation" de l'économie -dans un système démeuré globalement attaché aux principes de l'économie libérale- grâce notamment à une planification "incitative", souple, concertée et enfin empirique. De quoi s'agit-il?
Pour les générations de la guerre, le traumatisme de la violence -et des régimes dictatoriaux qui l'ont symbolisée après la défaite des fascismes- est souvent lié à la grande dépression des années 30. L'objectif est donc de permettre au pouvoir politique, en l'occurence l'Etat comme instance dirigeante, de régulariser les flux et les rapports économiques, donc de contrôler pour une part ses évolutions, afin de favoriser un équilibre nécessaire à une plus forte croissance, mais aussi une plus juste croissance (hausse des revenus les plus défavorisés). Un indice est la création, dès la libération, des premières grandes institutions de Sécurité Sociale. La Constitution française de 1946 intègre officiellement ce souci du "social", où domine de plus en plus l'idée de redistribution égalitaire des revenus. Dans le même temps, les responsables du pays sont confrontés à la tâche écrasante de reconstruire la nation, de moderniser l'outil industriel frappé certes par la guerre, mais aussi par l'obsolescence.
facteurs démographiques, commissariat au plan, ENA
Cette tâche apparaît difficile si on tient compte que la population française vieillit. Heureusement, ce dernier point sera éliminé dans les années 50, grâce à une vitalité du peuple français assez inattendue (phénomène connu sous le nom de "baby boom"). Cette renaissance démographique aura deux effets directs positifs d'un point de vue économique: augmentation de la demande globale, qui favorise l'écoulement de la production, et croissance de la population active que les entreprises pourront embaucher grâce à la croissance du marché potentiel et réel. Sur cette même scène, s'impose le "géant américain", en tant que vainqueur du conflit (non seulement militaire mais aussi politique et surtout économique) qui se décrète seul rempart face à l'Union Soviétique. Un oubli tout de même dans cette analyse des esprits simples: le monde dit "libre" était déjà né, non pas de l'agression totalitaire des "rouges", mais de l'accord signé à Yalta par les deux (futurs) grands. Les dirigeants français doivent justifier l'aumône "généreusement" octroyée par les accords Blum-Byrnes, et surtout le plan Marshall.
C'est donc dans un climat politique gagné pour l'essentiel aux idéaux socialistes (pour le moins dans ses composantes "tripartite", exception faite de quelques conservateurs trop compromis dans les actes du régime de Vichy et qui vont se rassembler autour de A.Pinay), que l'idée de la planification aboutira. Il faut souligner le rôle majeur d'un Jean Monnet, créateur du "commissariat au plan", structure nouvelle composée de techniciens de l'économie, et qui fourniront aux pouvoirs publics le maximum des données indicielles nécessaires aux choix essentiels. On peut en outre noter à la même époque la création par Debré de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), pépinière des futurs "technocrates" et point de départ d'une carrière qui ne passera plus exclusivement par les cursus des élections locales. La carrière de l'énarchie est celle des grands corps de l'Etat.
On assiste par ailleurs à la nationalisation des secteurs vitaux de l'économie française (chemins de fer, charbonnage, etc...), qui doivent être le soutien principal d'une politique économique nationale (à l'exception de Renault, nationalisée en régie d'Etat à cause de l'attitude "incivique" de son fondateur pendant l'occupation). Ce mouvement inspirera toutes les lois de nationalisation en France jusqu'en 81.
Planification certes, mais fondée sur la souplesse et l'incitation, qui exprime la volonté des pouvoirs publics de rendre plus cohérent le développement économique du pays. Cette volonté est claire: assurer les grands équilibres financiers et physiques, rechercher l'optimum économique qui ne soit pas simplement un assemblage de diverses prévisions dans les secteurs publics et privés. De plus, l'aspect humain n'est pas négligé, loin de là. Plus tard, passé le cap de la reconstruction proprement dite, les secondes étapes seront celles de l'aménagement du territoire et de la régionalisation (à la fin des années 60). Seront ensuite abordés les thèmes essentiels du chômage et de l'inflation. Priorité étant donnée aux thèmes les plus brûlants. Les administrations s'appuieront sur les services de l'INSEE, utilisant un nouvel "outil" privilégié: la comptabilité nationale réactualisée en 1976, puis les moyens plus récents que sont l'informatique et les techniques économétriques (plan FIFI (physio-financier), 6° Plan).
Planification concertée et empirique enfin, où les divers partenaires sociaux jouent un rôle non-négligeable au travers d'institutions spéciales telles le "Conseil économique et social". Le plan se veut une "étude de marché" -sous l'impulsion d'un homme comme P.Massé- à l'échelle nationale, imposant un axe de développement conjoncturel, éventuellement corrigé par des "indicateurs d'alerte", ou des clignotants (ex: les hausses de prix) dans un but de compétitivité internationale.
les risques du néo-saint-simonisme
Conclusion. On constate indubitablement une étatisation progressive de l'économie. Mais "étatisation" ne signifie pas obligatoirement, dans l'esprit des réformateurs et dans les faits, "nationalisation" de la production. La bureaucratisation est plutôt le phénomène majeur de cette étatitation. Relire à ce sujet l'ouvrage de Michel Crozier: La société bloquée. Cette "étatisation" se traduit en effet par la lutte de nouveaux groupes de pression: côteries politico-administratives, financières, patronales, syndicales enfin. Chacun de ces groupes étant axés sur la défense d'intérêts "corporatistes" plus que sur le souci d'intérêt national. Le jeu particulier de firmes "nationales" préférant traiter avec des multinationales, relève de cette philosophie de la rentabilité qui rejette le principe précédent.
La contestation de Mai 68 a pu jouer le rôle de révélateur de cette réalité. La société française, troublée par une urbanisation anarchique, une pollution croissante, a pris alors conscience de la perte d'une "qualité de vie". Enfin, au plan international, l'interdépendance croissante des économies, la dématérialisation progressive des relations financières victimes du dollar, ont pu montrer la relativité des objectifs poursuivis par les planificateurs français. Aidée en France par un courant saint-simonien de plus en plus puissant, cette évolution a précipité la dilution politique du pays; la collaboration entre les nouveaux gestionnaires et les puissances financières a aggravé incontestablement cette situation. N'y aurait-il pas alors une "divine surprise " des années 80: celle du rapprochement entre les derniers néosocialistes et les nationalistes conséquents (éloignés du pseudo-nationalisme mis en exergue récemment par les média) sous le signe du "Politique d'abord" ...
Pierre-Jean BERNARD.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, théorie politique, sciences politiques, politologie, socialisme, idéologie, néo-socialisme, france, belgique, gauche, droite, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 janvier 2010
Capitalisme libéral et socialisme, les deux faces de Janus
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
CAPITALISME LIBERAL ET SOCIALISME,
LES DEUX FACES DE JANUS
par Pierre Maugué
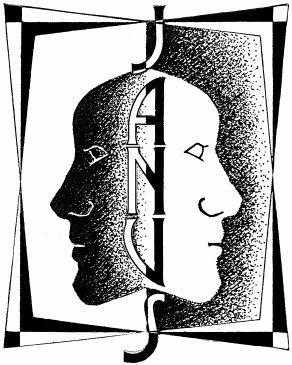 L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies deux conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les deux systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences?
L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies deux conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les deux systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences?
En 1952, dans son "Introduction à la métaphysique" , Heidegger écrivait : "L'Europe se trouve dans un étau entre la Russie et l'Amérique, qui reviennent métaphysiquement au même quant à leur appartenance au monde et à leur rapport à l'esprit". Si, pour lui, notre époque se caractérisait par un "obscurcissement du monde" marqué par "la fuite des dieux, la destruction de la terre, la grégarisation de l'homme, la prépondérance du médiocre", et si cet obscurcissement du monde provenait de l'Europe elle-même et avait commencé par "l'effondrement de l'idéalisme allemand", ce n'en est pas moins en Amérique et en Russie qu'il avait atteint son paroxysme.
L'affirmation de Heidegger, qui pose comme équivalentes, au plan de leur rapport à l'être, deux nations porteuses d'idéologies généralement pensées comme antinomiques peut paraître provocatrice. Elle ne fait pourtant que reconnaître, au plan métaphysique, la parenté certaine qui existe, au plan historique, entre capitalisme et socialisme (dont le marxisme n'est que la forme la plus élaborée et la plus absolue).
Capitalisme et socialisme sont aussi intimement liés que les deux faces de Janus. Tous deux sont issus de la philosophie du XVIIIe siècle, marguée par la trilogie : raison, égalité, progrès, et de la Révolution industrielle du XIXe siècle, caractérisée par le culte de la technique, du productivisme et du profit, et s'ils s'opposent, c'est beaucoup plus sur les méthodes que sur les objectifs.
L'émergence du socialisme moderne tient au fait gue non seulement la proclamation de l'égalité des droits par la Révolution de 1789 laissa subsister les inégalités sociales, mais que furent supprimées toutes les institutions communautaires (gérées par l'Eglise, les corporations, les communes) gui créaient un réseau de solidarité entre les différents ordres de la société, Quant à la Révolution industrielle, si elle marqua un prodigieux essor économique, elle provoqua également une détérioration considérable des conditions de vie des classes populaires, de sorte que ce qui avait été théoriquement gagné sur le plan politique fut perdu sur le plan social, La protestation socialiste tendit alors à démontrer qu'une centralisation et une planification de la production des richesses était tout-à-fait capable de remplacer la libre initiative des entrepreneurs et de parvenir, au plan économique, à l'égalité qui avait été conquise au plan juridique.
Bien que divergeant sur les méthodes (économie de libre entreprise ou économie dirigée), libéraux et socialistes n'en continuaient pas moins à s'accorder sur la primauté des valeurs économiques, et partageaient la même foi dans le progrès technique, le développement industriel illimité, et l'avènement d'un homme nouveau, libéré du poids des traditions. En fait, tant les libéraux que les socialistes pouvaient se reconnaître dans les idées des Saints-Simoniens, qui ne voyaient dans la politique que la science de la production, et pour lesquels la société nouvelle n'aurait pas besoin d'être gouvernée, mais seulement d'être administrée.
La même négation de l'autonomie du politique se retrouve ainsi chez les libéraux et les socialites de toute obédience. A l'anti-étatisme des libéraux, qui ne concèdent à l'Etat qu'un pouvoir de police propre à protéger leurs intérêts économiques, et la mission de créer les infrastructures nécessaires au développement de la libre entreprise, répond, chez les sociaux-démocrates, le rêve d'un Etat qui aurait abandonné toute prérogative régalienne et dont le rôle essentiel serait celui de dispensateur d'avantages sociaux. On trouve même chez les socialistes proudhoniens un attrait non dissimulé pour un certaine forme d'anarchie. Quant aux marxistes, bien qu'ils préconisent un renforcement du pouvoir étatique dans la phase de dictature du prolétariat, leur objectif final demeure, du moins en théorie, le dépérissement de l'Etat. Le totalitarisme vers lequel ont en fait évolué les régimes mar~istes constitue d'ailleurs aussi, à sa manière, une négation de l'autonomie du politique.
La pensée de Marx, nourrie de la doctrine des théoriciens de l'économie classique, Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill et Jean-Baptiste Say, est toujours restée tributaire de l'idéologie qui domine depuis les débuts de l'ère industrielle . Le matérialisme bourgeois, l'économisme w lgaire se retrouvent ainsi dans le socialisme marxiste. Marx rêve en effet d'une société assurant l'abondance de biens matériels et, négligeant les autres facteurs socio-historiques, il voit dans l'économie le seul destin véritable de l'homme et l'unique possibilité de réalisation sociale.
Mais ce qui crée les liens les plus forts est l'existence d'ennemis communs. Or, depuis l'origine, libéraux et marxistes partagent la même hostilité à l'égard des civilisations traditionnelles fondées sur des valeurs spirituelles, aristocratiques et communautaires.
Le Manifeste communiste de 1868 est à cet égard révélateur. Loin de stigmatiser l'oeuvre de la bourgeoisie (c'est-à-dire, au sens marxiste du terme, le grand capital), il fait en quelque sorte l'éloge du rôle éminemment révolutionnaire qu'elle a joué. "Partout où elle (la bourgeoisie) est parvenue à dominer", écrit Marx, "elle a détruit toutes les conditions féodales, patriarcales, idylliques. Impitoyable, elle a déchiré les liens multicolores qui attachaient l'homme à son supérieur naturel, pour ne laisser subsister entre l'homme et l'homme que l'intérêt tout nu, le froid 'paiement comptant'... Elle a dissous la dignité de la personne dans la valeur d'échange, et aux innombrables franchises garanties et bien acquises, elle a substitué une liberté unique et sans vergogne : le libre-échange".
Prenant acte de cette destruction des valeurs traditionnelles opérée par la bourgeoisie capitaliste, Marx se félicite que celle-ci ait "dépouillé de leur sainte auréole toutes les activités jusque là vénérables et considérées avec un pieux respect" et qu'elle ait "changé en salariés à ses gages le médecin, le juriste, le prêtre, le poête, l'homme de science".
La haine du monde rural et l'apologie des mégapoles s'expriment également sans détours chez Marx, qui juge positifs les effets démographiques du développement capitaliste. "La bourgeoisie", écrit-il, "a soumis la campagne à la domination de la ville. Elle a fait surgir d'immenses cités, elle a prodigieusement augmenté la population des villes aux dépens des campagnes, arrachant ainsi une importante partie de la population à l'abrutissement de l'existence campagnarde". Il n'hésite pas non plus à faire l'éloge du colonialisme, se félicitant que "la bourgeoisie, de même qu'elle a subordonné la campagne à la ville ... a assujetti les pays barbares et demi-barbares aux pays civilisés, les nations paysannes aux nations bourgeoises, l'Orient à l'Occident". Cette domination sans partage de la fonction économique est magnifiée par Marx, de même que l'instabilité qui en résulte. C'est en effet avec satisfaction qu'il constate que "ce qui distingue l'époque bourgeoise de toutes les précédentes, c'est le bouleversement incessant de la production, l'ébranlement continuel de toutes les institutions sociales, bref la permanence de l'instabilité et du mouvement... Tout ce qui était établi se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané".
Mais la bourgeoisie capitaliste n'en a pas moins souvent cherché à faire croire qu'elle défendait les valeurs traditionnelles contre les marxistes et autres socialistes, ce qui amène Marx à rappeler, non sans une certaine ironie, que les marsistes ne peuvent être accusés de détruire des valeurs que le capitalisme a déjà détruit ou est en voie de détruire. Vous nous reprochez, dit Mars, de détruire la propriété, la liberté, la culture, le droit, l'individualité, la famille, la patrie, la morale, la religion, comme si les développements du capitalisme ne l'avait pas déjà accompli.
«Détruire la propriété?" "Mais" dit Mars, "s'il s'agit de la propriété du petit-bourgeois, du petit paysan, nous n'avons pas à l'abolir, le développement de l'industrie l'a abolie et l'abolit tous les jours". "Détruire la liberté, l'individualité?" "Mais l'individu qui travaille dans la société bourgeoise n'a ni indépendance, ni personnalité". "Détruire la famille?" "Mais par suite de la grande industrie, tous les liens de famille sont déchirés de plus en plus".
Tous ces arguments de Marx ne relèvent pas seulement de la polémique. En effet, les sociétés capitalistes présentent bien des traits conformes aux idéaux marxistes. Ainsi, à l'athéisme doctrinal professé par les marxistes répond le matérialisme de fait des sociétés capitalistes, où toute religion structurée a tendance à disparaître pour faire place à un athéisme pratique ou à une vague religiosité qui, sous l'influence du protestantisme, tend à se réduire à un simple moralisme aux contours indécis, dont tout aspect métaphysique, tout symbolisme, tout rite, toute autorité traditionnelle est banni.
De même, au collectivisme tant reproché à l'idéologie marxiste (collectivisme qui ne se réduit pas à l'appropriation par l'Etat des moyens de production, mais consiste également en une forme de vie sociale où la personne est soumise à la masse) répond le grégarisme des sociétés capitalistes. Comme le note André Siegfried, c'est aux Etats-Unis qu'est né le grégarisme qui tend aujourd'hui à gagner l'Europe. "L'être humain, devenu moyen plutôt que but accepte ce rôle de rouage dans l'immense machine, sans penser un instant qu'il puisse en être diminué", "d'où un collectivisme de fait, voulu des élites et allègrement accepté de la masse, qui, subrepticement, mine la liberté de l'homme et canalise si étroitement son action que, sans en souffrir et sans même le savoir, il confirme lui-même son abdication". Curieusement, marxisme et libéralisme produisent ainsi des phénomèmes sociaux de même nature, qui sont incompatibles avec toute conception organique et communautaire de la société.
L'idéologie mondialiste est également commune au marxisme et au capitalisme libéral. Pour Lénine, qui soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la libération complète de toutes les nations opprimées n'est en effet qu'un instrument au service de la Révolution et ne peut constituer qu'une "phase de transition", la finalité étant "la fusion de toutes les nations". Or, cette fusion de toutes les nations est également l'objectif du capitalisme libéral qui, tout en ayant utilisé les nationalismes des peuples de l'Est pour détruire l'Union soviétique, vise en fait à établir un marché mondial dans lequel toutes les nations sont appelées finalement à se dissoudre. Toutes les identités nationales sont ainsi destinées à disparaître pour être remplacées par un modèle uniforme, américanomorphe, au service duquel une intense propagande est organisée, modèle dont les traits caractéristiques sont le métissage, la culture rock, les jeans, le coca-cola, les chaînes de restaurant fast-food et le "basic English", le tout étant couronné par l'idéologie des droits de l'homme dont les articles de foi sont dogmatiquement décrétés par les grands-prêtres d'une intelligentsia qui n'a d'autre légitimité que celle qu'elle s'est elle-même octroyée.
En fait, tant le marxisme que le capitalisme libéral approuvent sans réserves toutes les conséquences économiques et sociales de la Révolution industrielle, qui se traduisent par la destruction de tous les liens communautaires, familiaux ou nationaux, le déracinement et la grégarisation. Une telle évolution est en effet nécessaire aussi bien à l'établissement d'un véritable marché mondial, rêve ultime du capitalisme libéral, qu'à l'avènement de l'homme nouveau, libéré de toute aliénation, qui constitue l'objectif du marxisme. Pour ce dernier, le prolétariat était d'ailleurs appelé à jouer un rôle messianique et à porter plus loin le flambeau de la Révolution, afin de mener à son terme la destruction de toutes les valeurs traditionnelles.
Pour le philosophe chrétien et traditionnaliste Berdiaev, capitalisme libéral et marxisme ne sont pas seulement liés au plan des sources idéologiques, mais ils sont également les agents d'une véritable subversion. "Tant la bourgeoisie que le prolétariat", écrit Berdiaev, "représentent une trahison et un rejet des fondements spirituels de la vie. La bourgeoisie a été la première à trahir et à abdiquer le sacré, le prolétariat lui a emboîté le pas." Soulignant les affinités qui existent entre la mentalité du bourgeois et celle du prolétaire, il déclare : "Le socialisme est bourgeois jusque dans sa profondeur et il ne s'élève jamais au-dessus du sentiment des idéaux bourgeois de l'existence. Il veut seulement que l'esprit bourgeois soit étendu à tous, qu'il devienne universel, et fixé dans les siècles des siècles, définitivement rationalisé, stabilisé, guéri des maladies qui la minent."
Si, pour Berdiaev, l'avènement de la bourgeoisie en tant gue classe dominante a correspondu à un rejet des fondements spirituels de la vie, Max Weber voit, pour sa part, une relation étroite entre l'éthique protestante et le développement du capitalisme moderne. Ces deux points de vue ne sont pas aussi contradictoires qu'ils peuvent paraître de prime abord. En effet, outre que la spiritualité ne se réduit pas à l'éthique, l'éthique protestante a tendu à devenir une simple morale utilitariste qui s'apparente en fait à la morale laïgue, et qui n'est plus sous-tendue par une vision spirituelle du monde. Max Weber relève d'ailleurs que "l'élimination radicale du problème de la théodicée et de toute espèce de questions sur le sens de l'univers et de l'existence, sur quoi tant d'hommes avaient peiné, cette élimination allait de soi pour les puritains ..." °
L'utilitarisme de l'éthique protestante apparaît d'ailleurs clairement dans sa conception de l'amour du prochain. En effet, selon celle-ci, comme le rappelle Max Weber, "Dieu veut l'efficacite sociale du chrétien" et "l'amour du prochain ... s'exprime en premier lieu dans l'accomplissement des tâches professionnelles données par la "lex naturae" revêtant ainsi "l'aspect proprement objectif et impersonnel d'un service effectué dans l'organisation rationnelle de l'univers social qui nous entoure." C'est d'ailleurs par la promotion de cette conception éthique dans le monde chrétien que le protestantisme a pu créer un contexte favorable au développement du capitalisme moderne.
Mais l'état d'esprit qui en est résulté, et qui s'est développé sans entraves aux Etats-Unis d'Amérique, paraît bien éloigné de toute sorte d'éthique. Comme l'a relevé Karl Marx à propos des "habitants religieux et politiquement libres de la Nouvelle Angleterre", "Mammon est leur idole qu'ils adorent non seulement des lèvres, mais de toutes les forces de leur corps et de leur esprit. La terre n'est à leurs yeux qu'une Bourse, et ils sont persuadés qu'il n'est ici-bas d'autre destinée que de devenir plus riches que leurs vo;sins".
Etudiant les liens qui existent entre l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante, Max Weber avait souligné la "bibliocratie" du calvinisme, qui tenait les principes moraux de l'Ancien Testament dans la même estime que ceux du Nouveau, l'utilitarisme de l'éthique protestante rejoignant l'utilitarisme du judaïsme. Avant lui, Marx avait d'ailleurs déjà relevé les affinités qui existent entre l'esprit du capitalisme et le judaïsme même si cette analyse était peu conforme aux principes du matérialisme historique. Considérant que "le fond profane du judaïsme" c'est "le besoin pratique, l'utilité personnelle", Marx estimait ainsi que, grâce aux Juifs et par les Juifs, "l'argent est devenu une puissance mondiale et l'esprit pratique des Juifs, l'esprit pratique des peuples chrétiens", concluant que "les Juifs se sont émancipés dans la mesure même où les chrétiens sont devenus Juifs".
Ignorant délibérément la complexité des origines de l'idéologie socialiste, Berdiaev privilégiait quant à lui les affinités entre socialisme et judaïsme. Selon Berdiaev, le socialisme constitue en effet une "manifestation du judaïsme en terreau chrétien", et "la confusion et l'identification du christianisme avec le socialisme, avec le royaume et le confort terrestre sont dues à une flambée d'apocalyptique hébraïque", au "chiliasme hébreu, qui espère le Royaume de Dieu ici-bas" et "il n'était pas fortuit que Marx fût juif" . Cioran rejoint sur ce point Berdiaev lorsqu'il écrit : "Quand le Christ assurait que le "royaume de Dieu" n'était ni "ici ni "là", mais au-dedans de nous, il condamnait d'avance les constructions utopiques pour lesquelles tout "royaume" est nécessairement extérieur, sans rapport aucun avec notre moi profond ou notre salut individuel. 5
De différents points de vue, capitalisme libéral et socialisme moderne paraissent ainsi liés, non seulement au plan historique, mais également par leurs racines idéologiques, et ce n'est probablement pas un hasard si leur émergence a coïncidé avec l'effondrement du système de valeurs qui, pendant des siècles, avait prévalu en Europe, et qui affirmait, du moins dans son principe originel, la primauté de l'autorité spirituelle sur le pouvoir temporel, et la subordination de la fonction économique au pouvoir temporel.
L'écroulement des régimes marxistes, incapables d'atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, n'aura donc pas changé fondamentalement le cours de l'Histoire, puisque la "Weltanschauung" commune au marxisme et au capitalisme continue toujours à constituer le point de référence de nos sociétés. Se trouvent en effet toujours mis au premier plan : le matérialisme philosophique et pratique, le règne sans partage de l'économie, l'égalitarisme idéologique (qui se conjugue curieusement avec l'extension des inégalités sociales), la destruction des valeurs familiales et communautaires, la collectivisation des modes de vie et le mondialisme. C'est peut-être d'ailleurs ce qui permet d'expliquer pourquoi les socialistes occidentaux et la majeure partie des marxistes de l'Est se sont aussi facilement convertis au capitalisme libéral, qui paraît aujourd'hui le mieux à même de réaliser leur idéal.
Mais la chute des régimes marxistes a l'Est nombre de valeurs qui, bien qu'ayant été niées pendant des décennies, n'avaient pu être détruites. On voit ainsi, dans des sociétés en pleine décomposition qui redécouvrent les réalités d'un capitalisme sauvage, s'affirmer à nouveau religions, nations et traditions.
Toutes ces valeurs qui refont surface, et dont l'affirmation avait été jugée utile par les Etats occidentaux, dans la mesure où elle pouvait contribuer au renversement des régimes marxistes, sont toutefois loin d'être vues avec la même complaisance dès lors que cet objectif a été atteint.
L'idéologie matérialiste des sociétés occidentales s'accommode en effet assez mal de tout système de valeurs qui met en question sa prétention à l'universalité et qui n'est pas inconditionnellement soumis aux impératifs du marché mondial. Tout véritable réveil religieux, toute affirmation nationale ou communautaire, ou toute revendication écologiste ne peuvent ainsi être perc,us que comme autant d'obstacles à la domination sans partage des valeurs marchandes, obstacles qu'il s'agit d'abattre ou de contourner.
Ainsi, l'établissement d'un véritable marché mondial qui puisse permettre aux stratégies des multinationales de se développer sans entraves étant devenu l'objectif prioritaire, des pressions sont exercées au sein du GATT - par le lobby américain - pour que les pays d'Europe acceptent le démantèlement de leur agriculture, quelles que puissent en être les conséquences sur l'équilibre démographique et social de ces pays, sur l'enracinement de leur identité nationale et sur leur équilibre écologique.
De même, les cultures et les langues nationales doivent de plus en plus se plier aux lois du marché mondial et céder le pas à des "produits culturels" standardisés de niveau médiocre, utilisant le "basic English" comme langue véhiculaire, et aptes ainsi à satisfaire le plus grand nombre de consommateurs du plus grand nombre de pays. Quant aux religions, elles ne sont tolérées gue dans la mesure où elles délivrent un message compatible avec l'idéologie du capitalisme libéral, et si elles s'accommodent avec les orientations fondamentales de la société permissive, qui ne sont en fait que l'application, au domaine des moeurs, des principes du libre-échange.
L'écologie, enfin, n'est prise en compte que si elle ne s'affirme pas comme une idéologie ayant la prétention d'imposer des limites à la libre entreprise. Les valeurs néo-païennes qu'elle véhicule (que le veuillent ou non ses adeptes) sont par ailleurs vivement dénoncées. Ainsi, Alfred Grosser se plaît à relever que "ce n'est pas un hasard si l'écologie a démarré si fort en Allemagne où la nature ("die Natur") tient une place tout autre qu'en France. La forêt ("der Wald") y est fortement chargée de symbole. La tradition allemande ... c'est l'homme mêlé, confondu à la nature". Ne reculant pas devant les amalgames les plus grossiers, il n'hésite pas à écrire : "La liaison entre les hommes et la nature, le sol et le sang, cette solide tradition conservatrice allemande a été reprise récemment par Valéry Giscard d'Estaing à propos des immigrés. C'était la théorie d'Hitler;". Et Grosser de conclure avec autant de naïveté que de grandiloquence : "La grandeur de la civilisation judéo-chrétienne est d'avoir forgé un homme non soumis à la nature".
L'idéologie capitaliste libérale, actuellement dominante, entre ainsi en conflit avec d'autres ordres de valeur, et ces nouveau~ conflits, dont nous ne voyons que les prémisses, pourraient bien reléguer au rang des utopies la croyance en une "fin de l'histoire". En effet, ces conflits n'opposent plus, comme c'était le cas depuis deux siècles, deux idéologies jumelles qui, tout en se combattant, partaqeaient pour l'essentiel les mêmes idéaux fondamentaux et ne s'opposaient que sur les moyens de les réaliser. Les sociétés fondées sur le capitalisme libéral vont en effet avoir désormais à affronter des adversaires dont l'idéologie est irréductible à une vision purement économiste du monde. L'antithèse fondamentale ne se situe pas en effet entre capitalisme et marxisme, mais entre un système où l'économie est souveraine, quelle que soit sa forme, et un système où elle se trouve subordonnée à des facteurs extra-économiques.
On voit ainsi reparaître l'idée d'une hiérarchie des valeurs qui n'est pas sans analogies avec l'idéologie des peuples indo-européens et celle de l'Europe médiévale, où la fonction économique, et notamment les valeurs marchandes, occupait un rang subordonné aux valeurs spirituelles et au pouvoir politique (au sens originel de pouvoir régulateur de la vie sociale et des fonctions économiques). Bien que, dans cet ordre ancien, la dignité de la fonction de production des biens matériels fût généralement reconnue , il était toutefois exclu que les détenteurs de cette fonction puissent usurper des compétences pour l'exercice desquelles ils n'avaient aucune qualification. L'économie se trouvait ainsi incorporée dans un système qui ne considérait pas l'homme uniquement comme producteur ou consommateur, et l'organisation corporative des professions mettait beaucoup plus l'accent sur l'aspect qualitatif du travail que sur l'aspect quantitatif de la production, donnant une dimension spirituelle à l'accomplissement de toutes les tâches, même des plus humbles. Quant à la spéculation, au profit détaché de tout travail productif, ils n'étaient non seulement pas valorisés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils étaient profondément méprisés, tant par la noblesse que par le peuple, et ceux qui s'y adonnaient étaient généralement considérés comme des parias.
Ce n'est en fait que depuis deux siècles que les valeurs marchandes ont pris une place prépondérante dans la société occidentale, et que s'est instituée cette véritable subversion que Roger Garaudy qualifie de "monothéisme du marché, c'est-à-dire de l'argent, inhérent à toute société dont le seul régulateur est la concurrence, une guerre de tous contre tous". Un champion de l'ultra-libéralisme, comme Hayek, reconnaît d'ailleurs lui-même que "le concept de justice sociale est totalement vide de sens dans une économie de marché".
Cette subversion des valeurs est particulièrement sensible dans le capitalisme de type anglo-saxon que Michel Albert oppose au capitalisme de type rhénan ou nippon : le premier pariant sur le profit à court terme, négligeant outrancièrement les secteurs non-marchands de la société, l'éducation et la formation des hommes, et préférant les spéculations en bourse à la patience du capitaine d'industrie ou de l'ingénieur qui construisent et consolident jour après jour une structure industrielle; le second planifiant à long terme, respectant davantage les secteurs non-marchands, accordant de l'importance à l'éducation et à la formation et se fondant sur le développement des structures industrielles plutôt que sur les spéculations boursières.
Il est d'ailleurs intéressant de relever gue c'est le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui conserve un certain nombre de valeurs des sociétés pré-industrielles et s'enracine dans une communauté ethno-culturelle, qui se révèle être plus performant que le capitalisme de type anglo-saxon, qui ne reconnaît pas d'autres valeurs que les valeurs marchandes, même s'il aime souvent se draper dans les plis de la morale et de la religion.
Mais le meileur équilibre auquel sont parvenues les sociétés où règne un capitalisme de type rhénan ou nippon n'en demeure pas moins fragile, et ces sociétés sont loin d'être exemptes des tares inhérentes à toutes les formes de capitalisme libéral. On peut d'ailleurs se demander si le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui s'appuie sur les restes de structures traditionnelles, n'est pas condamné à disparaître par la logique même du capitalisme libéral qui finira par en détruire les fondements dans le cadre d'un marché mondial.
Par delà ces oppositions de nature éphémère qui existent au sein du capitalisme libéral, la question est finalement de savoir si celui-ci parviendra à établir de manière durable son pouvoir absolu et universel, marquant ainsi en quelque sorte la fin de l'histoire, ou s'il subira, à plus ou moins longue échéance, un sort analogue à celui de marxisme. En d'autres termes, une société ne se rattachant plus à aucun principe d'ordre supérieur et dénuée de tout lien communautaire est-elle viable, ou cette tentative de réduire l'homme aux simples fonctions de producteur et de consommateur, sans dimension spirituelle et sans racines, est-elle condamnée à l'échec, disqualifiant par là-même l'idéologie (ou plutôt l'anti-idéologie) sur laquelle elle était fondée?
Pierre Maugué
Novembre 1992
NOTES
1) Cf. Martin Heideqger, "Introduction à la métaphysique", page 56, Gallimard, Paris 1967.
2) Cf. Werner Sombart, "Le Socialisme allemand", Editions Pardès, 45390 Puiseaux.
3) Cf. Karl Marx, "Le manifeste communiste" in "oeuvres complètes", La Pléïade, Gallimard, Paris 1963.
4) René Guénon fait la même constatation gue Rarl Marx, mais, loin d'y voir l'annonce d'un monde nouveau, supérieur à l'ancien, il y voit au contraire une déchéance, la fin d'un cycle. Il relève ainsi que "partout dans le monde occidental, la bourgeoisie est parvenue à s'emparer du pouvoir", que le résultat en est "le triomphe de l'économique, sa suprématie proclamée ouvertement" et qu'"à mesure qu'on s'enfonce dans la matérialité, l'instabilité s'accroît, les changements se produisent de plus en plus rapidement". Cf. René Guénon, "Autorité spirituelle et pouvoir temporel", page 91, Les Editions Vega, Paris, 1964.
5) Cf. André Siegfried, "Les Etats-Unis d'aujourd'hui", pages 346, 349
et 350, Paris 1927.
6) Cf. Lénine, "Oeuvres", tome 22, page 159, Editions sociales, Paris 1960.
7) Comme le relève Régis Debray, "Nous avions eu Dieu, la Raison, la Nation, le Progrès, le Prolétariat. Il fallait aux sauveteurs un radeau de sauvetage. Voilà donc pour les aventuriers de l'Arche Perdue, les Droits de l'Homme come progressisme de substitution. Cf. Régis Debray, "Que vive la République", Editions Odile Jacob, Paris 1989.
8) Cf. Nicolas Berdiaev, "De l'inégalité", pages 150 et 152, Editions l'Age
d'Homme, Genève 1976.
9) Cf. Nicolas Berdiaev, op. cité, page 150. Dans le style qui lui est propre, Louis-Ferdinand Céline avait relevé la même analogie entre esprit bourgeois et esprit prolétaire. "Vous ne rêvez que d'être lui, à sa place, rien d'autre, être lui, le Bourgeois! encore plus que lui, toujours plus bourgeois! C'est tout. L'idéal ouvrier c'est deux fois plus de jouissances bourgeoises pur lui tout seul. Une super bourgeoisie encore plus tripailleuse, plus motorisée, beaucoup plus avantageuse, plus dédaigneuse, plus conservatrice, plus idiote, plus hypocrite, plus stérile que l'espèce actuelle". Cf. Louis-Ferdinand-Céline, "L'école des cadavres", Editions Denoël, Paris.
10) Cf. Max Weber, "L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme", page 129, Librairie Plon, Paris 1964.
11) Cf. Max Weber, op cité, pages 128 et 129.
12) Cf. Rarl Marx, "La question juive", pages 50 et 55, collection 10/18, Union générale d'éditions, Paris 1968.
13) Cf. Karl Marx, op cité, pages 49 et 50.
14) Cf. Nicolas Berdiaev, op cité, page 154
15) Cf. Cioran, "Histoire et Utopie", Gallimard, Paris 1960.
16) C'est ainsi que le modèle de la société libérale avancée, qui s'est imposé en Occident, correspond parfaitement à certains objectifs qu'Engels avait fixés au 21e point de son avant-projet pour le Manifeste du Parti communiste. Il écrivait ainsi : "(L'avènement du communisme) transformera les rapports entre les sexes en rapport purement privés, ne concernant que les personnes qui y participent et où la société n'aura pas à intervenir. Cette transformation sera possible du moment que ... les enfants seront élevés en commun, et que seront détruites les deux bases principales du mariage actuel, à savoir la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme, et celle des enfants vis-à-vis des parents".
17) Cf. Alfred Grosser, interview paru dans "Le Nouveau Quotidien" (Lausanne) du vendredi 24 janvier 1992 sous le titre : "Après le dieu Lénine des communistes, voici la déesse Gaia des écologistes".
18) Dans l'Inde traditionnelle, les "vaishya", représentants de la troisième fonction, ont la qualité d'"arya". Toutefois, dans le monde méditerranéen, chez les Romains et les Grecs de l'époque classique, on constate une dépréciation du travail manuel, qui n'existe pas en revanche dans les sociétés celtiques et germaniques, où l'esclavage tenait une place beaucoup moins importante.
19) Cf. Roger Garaudy "Algérie, un nouvel avertissement pour l'Europe", in "Nationalisme et République", No 7.
20) Cf. Michel Albert, "Capitalisme contre capitalisme", Editions du Seuil, collection "L'histoire immédiate", Paris 1991.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philosophie, socialisme, libéralisme, capitalisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 janvier 2010
Entretien avec Günter Maschke
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
 Entretien avec Günter Maschke
Entretien avec Günter Maschke
propos recueillis par Dieter STEIN et Jürgen LANTER
Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA?
Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA?
GM: Oui. Car cette loi fondamentale (Grundgesetz) est pour une moitié un octroi, pour une autre moitié la production juridique de ceux qui collaborent avec les vainqueurs. On pourrait dire que cette constitution est un octroi que nous nous sommes donné à nous-mêmes. Les meilleurs liens qui entravent l'Allemagne sont ceux que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes.
Q.: Mais dans le débat qui a lieu aujourd'hui à propos de cette constitution, vous la défendez...
GM: Oui, nous devons défendre la loi fondamentale, la constitution existante car s'il fallait en créer une nouvelle, elle serait pire, du fait que notre peuple est complètement «rééduqué» et de ce fait, choisirait le pire. Toute nouvelle constitution, surtout si le peuple en débat, comme le souhaitent aussi bon nombre d'hommes de droite, connaîtrait une inflation de droits sociaux, un gonflement purement quantitatif des droits fondamentaux, et conduirait à la destruction des prérogatives minimales qui reviennent normalement à l'Etat national.
Q.: Donc, quelque chose de fondamental a changé depuis 1986, où vous écriviez dans votre article «Die Verschwörung des Flakhelfer» (= La conjuration des auxiliaires de la DCA; ndlr: mobilisés à partir de 1944, les jeunes hommes de 14 à 17 ans devaient servir les batteries de DCA dans les villes allemandes; c'est au sein de cette classe d'âge que se sont développées, pour la première fois en Allemagne, certaines modes américaines de nature individualiste, telles que l'engouement pour le jazz, pour les mouvements swing et zazou; c'est évidemment cette classe d'âge-là qui tient les rênes du pouvoir dans la RFA actuelle; en parlant de conjuration des auxiliaires de la DCA, G. Maschke entendait stigmatiser la propension à aduler tout ce qui est américain de même que la rupture avec toutes les traditions politiques et culturelles européennes). Dans cet article aux accents pamphlétaires, vous écriviez que la Constitution était une prison de laquelle il fallait s'échapper...
GM: Vu la dégénérescence du peuple allemand, nous devons partir du principe que toute nouvelle constitution serait pire que celle qui existe actuellement. Les rapports de force sont clairs et le resteraient: nous devrions donc nous débarrasser d'abord de cette nouvelle constitution, si elle en venait à exister. En disant cela, je me doute bien que j'étonne les «nationaux»...
Q.: Depuis le 9 novembre 1989, jour où le Mur est tombé, et depuis le 3 octobre 1990, jour officiel de la réunification, dans quelle mesure la situation a-t-elle changé?
GM: D'abord, je dirais que la servilité des Allemands à l'égard des puissances étrangères s'est encore accrue. Ma thèse a toujours été la suivante: rien, dans cette réunification, ne pouvait effrayer la France ou l'Angleterre. Comme nous sommes devenus terriblement grands, nous sommes bien décidés, désormais, à prouver, par tous les moyens et dans des circonstances plus critiques, notre bonne nature bien inoffensive. L'argumentaire développé par le camp national ou par les établis qui ont encore un petit sens de la Nation s'est estompé; il ne s'est nullement renforcé. Nous tranquilisons le monde entier, en lui disant qu'il s'agit du processus d'unification européenne qui est en cours et que l'unité allemande n'en est qu'une facette, une étape. Si d'aventure on rendait aux Allemands les territoires de l'Est (englobés dans la Pologne ou l'URSS), l'Autriche ou le Tyrol du Sud, ces braves Teutons n'oseraient même plus respirer; ainsi, à la joie du monde entier, la question allemande serait enfin réglée. Mais trêve de plaisanterie... L'enjeu, la Guerre du Golfe nous l'a montré. Le gouvernement fédéral a payé vite, sans sourciller, pour la guerre des Alliés qui, soit dit en passant, a eu pour résultat de maintenir leur domination sur l'Allemagne. Ce gouvernement n'a pas osé exiger une augmentation des impôts pour améliorer le sort de nos propres compatriotes de l'ex-RDA, mais lorsqu'a éclaté la guerre du Golfe, il a immédiatement imposé une augmentation et a soutenu une action militaire qui a fait passer un peu plus de 100.000 Irakiens de vie à trépas. Admettons que la guerre du Golfe a servi de prétexte pour faire passer une nécessaire augmentation des impôts. Il n'empêche que le procédé, que ce type de justification, dévoile la déchéance morale de nos milieux officiels. Pas d'augmentation des impôts pour l'Allemagne centrale, mais une augmentation pour permettre aux Américains de massacrer les Irakiens qui ne nous menaçaient nullement. Je ne trouve pas de mots assez durs pour dénoncer cette aberration, même si je stigmatise très souvent les hypocrisies à connotations humanistes qui conduisent à l'inhumanité. Je préfère les discours non humanistes qui ne conduisent pas à l'inhumanité.
Q.: Comment le gouvernement fédéral aurait-il dû agir?
GM: Il avait deux possibilités, qui peuvent sembler contradictoires à première vue. J'aime toujours paraphraser Charles Maurras et dire «La nation d'abord!». Première possibilité: nous aurions dû participer à la guerre avec un fort contingent, si possible un contingent quantitativement supérieur à celui des Britanniques, mais exclusivement avec des troupes terrestres, car, nous Allemands, savons trop bien ce qu'est la guerre aérienne. Nous aurions alors dû lier cet engagement à plusieurs conditions: avoir un siège dans le Conseil de Sécurité, faire supprimer les clauses des Nations Unies qui font toujours de nous «une nation ennemie», faire en sorte que le traité nous interdisant de posséder des armes nucléaires soit rendu caduc. Il y a au moins certains indices qui nous font croire que les Etats-Unis auraient accepté ces conditions. Deuxième possibilité: nous aurions dû refuser catégoriquement de nous impliquer dans cette guerre, de quelque façon que ce soit; nous aurions dû agir au sein de l'ONU, surtout au moment où elle était encore réticente, et faire avancer les choses de façon telle, que nous aurions déclenché un conflit de grande envergure avec les Etats-Unis. Ces deux scénarios n'apparaissent fantasques que parce que notre dégénérescence nationale et politique est désormais sans limites.
Q.: Mais la bombe atomique ne jette-t-elle pas un discrédit définitif sur le phénomène de la guerre?
GM: Non. Le vrai problème est celui de sa localisation. Nous n'allons pas revenir, bien sûr, à une conception merveilleuse de la guerre limitée, de la guerre sur mesure. Il n'empêche que le phénomène de la guerre doit être accepté en tant que régulateur de tout statu quo devenu inacceptable. Sinon, devant toute crise semblable à celle du Koweit, nous devrons nous poser la question: devons-nous répéter ou non l'action que nous avons entreprise dans le Golfe? Alors, si nous la répétons effectivement, nous créons de facto une situation où plus aucun droit des gens n'est en vigueur, c'est-à-dire où seule une grande puissance exécute ses plans de guerre sans égard pour personne et impose au reste du monde ses intérêts particuliers. Or comme toute action contre une grande puissance s'avère impossible, nous aurions en effet un nouvel ordre mondial, centré sur la grande puissance dominante. Et si nous ne répétons pas l'action ou si nous introduisons dans la pratique politique un «double critère» (nous intervenons contre l'Irak mais non contre Israël), alors le nouveau droit des gens, expression du nouvel ordre envisagé, échouera comme a échoué le droit des gens imposé par Genève jadis. S'il n'y a plus assez de possibilités pour faire accepter une mutation pacifique, pour amorcer une révision générale des traités, alors nous devons accepter la guerre, par nécessité. J'ajouterais en passant que toute la Guerre du Golfe a été une provocation, car, depuis 1988, le Koweit menait une guerre froide et une guerre économique contre l'Irak, avec l'encouragement des Américains.
Q.: L'Allemagne est-elle incapable, aujourd'hui, de mener une politique extérieure cohérente?
GM: A chaque occasion qui se présentera sur la scène de la grande politique, on verra que non seulement nous sommes incapables de mener une opération, quelle qu'elle soit, mais, pire, que nous ne le voulons pas.
Q.: Pourquoi?
GM: Parce qu'il y a le problème de la culpabilité, et celui du refoulement: nous avons refoulé nos instincts politiques profonds et naturels. Tant que ce refoulement et cette culpabilité seront là, tant que leurs retombées concrètes ne seront pas définitivement éliminées, il ne pourra pas y avoir de politique allemande.
Q.: Donc l'Allemagne ne cesse de capituler sur tous les fronts...
GM: Oui. Et cela appelle une autre question: sur les monuments aux morts de l'avenir, inscrira-t-on «ils sont tombés pour que soit imposée la résolution 1786 de l'ONU»? Au printemps de cette année 1991, on pouvait repérer deux formes de lâcheté en Allemagne. Il y avait la lâcheté de ceux qui, en toutes circonstances, hissent toujours le drapeau blanc. Et il y avait aussi la servilité de la CSU qui disait: «nous devons combattre aux côtés de nos amis!». C'était une servilité machiste qui, inconditionnellement, voulait que nous exécutions les caprices de nos pseudo-amis.
Q.: Sur le plan de la politique intérieure, qui sont les vainqueurs et qui sont les perdants du débat sur la Guerre du Golfe?
GM: Le vainqueur est inconstestablement la gauche, style UNESCO. Celle qui n'a que les droits de l'homme à la bouche, etc. et estime que ce discours exprime les plus hautes valeurs de l'humanité. Mais il est une question que ces braves gens ne se posent pas: QUI décide de l'interprétation de ces droits et de ces valeurs? QUI va les imposer au monde? La réponse est simple: dans le doute, ce sera toujours la puissance la plus puissante. Alors, bonjour le droit du plus fort! Les droits de l'homme, récemment, ont servi de levier pour faire basculer le socialisme. A ce moment-là, la gauche protestait encore. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme servent à fractionner, à diviser les grands espaces qui recherchent leur unité, où à détruire des Etats qui refusent l'alignement, où, plus simplement, pour empêcher certains Etats de fonctionner normalement.
Q.: Que pensez-vous du pluralisme?
GM: Chez nous, on entend, par «pluralisme», un mode de fonctionnement politique qui subsiste encore ci et là à grand peine. On prétend que le pluralisme, ce sont des camps politiques, opposés sur le plan de leurs Weltanschauungen, qui règlent leurs différends en négociant des compromis. Or la RFA, si l'on fait abstraction des nouveaux Länder d'Allemagne centrale, est un pays idéologiquement arasé. Les oppositions d'ordre confessionnel ne constituent plus un facteur; les partis ne sont plus des «armées» et n'exigent plus de leurs membres qu'ils s'engagent totalement, comme du temps de la République de Weimar. A cette époque, comme nous l'enseigne Carl Schmitt, les «totalités parcellisées» se juxtaposaient. On naissait quasiment communiste, catholique du Zentrum, social-démocrate, etc. On passait sa jeunesse dans le mouvement de jeunesse du parti, on s'affiliait à son association sportive et, au bout du rouleau, on était enterré grâce à la caisse d'allocation-décès que les coreligionnaires avaient fondée... Ce pluralisme, qui méritait bien son nom, n'existe plus. Chez nous, aujourd'hui, ce qui domine, c'est une mise-au-pas intérieure complète, où, pour faire bonne mesure, on laisse subsister de petites différences mineures. Les bonnes consciences se réjouissent de cette situation: elles estiment que la RFA a résolu l'énigme de l'histoire. C'est là notre nouveau wilhelminisme: «on y est arrivé, hourra!»; nous avons tiré les leçons des erreurs de nos grands-pères. Voilà le consensus et nous, qui étions, paraît-il, un peuple de héros (Helden), sommes devenus de véritables marchands (Händler), pacifiques, amoureux de l'argent et roublards. Qui plus est, la fourchette de ce qui peut être dit et pensé sans encourir de sanctions s'est réduite continuellement depuis les années 50. Je vous rappellerais qu'en 1955 paraissait, dans une grande maison d'édition, la Deutsche Verlags-Anstalt, un livre de Wilfried Martini, Das Ende aller Sicherheit, l'une des critiques les plus pertinentes de la démocratie parlementaire. Ce livre, aujourd'hui, ne pourrait plus paraître que chez un éditeur ultra-snob ou dans une maison minuscule d'obédience extrême-droitiste. Cela prouve bien que l'espace de liberté intellectuelle qui nous reste se rétrécit comme une peau de chagrin. Les critiques du système, de la trempe d'un Martini, ont été sans cesse refoulés, houspillés dans les feuilles les plus obscures ou les cénacles les plus sombres: une fatalité pour l'intelligence! L'Allemagne centrale, l'ex-RDA, ne nous apportera aucun renouveau spirituel. Les intellectuels de ces provinces-là sont en grande majorité des adeptes extatiques de l'idéologie libérale de gauche, du pacifisme et de la panacée «droit-de-l'hommarde». Ils n'ont conservé de l'idéologie officielle de la SED (le parti au pouvoir) que le miel humaniste: ils ne veulent plus entendre parler d'inimitié (au sens schmittien), de conflit, d'agonalité, et fourrent leur nez dans les bouquins indigestes et abscons de Sternberger et de Habermas. Mesurez le désastre: les 40 ans d'oppression SED n'ont même pas eu l'effet d'accroître l'intelligence des oppressés!
Q.: Mais les Allemands des Länder centraux vont-ils comprendre le langage de la rééducation que nous maîtrisons si bien?
GM: Ils sont déjà en train de l'apprendre! Mais ce qui est important, c'est de savoir repérer ce qui se passe derrière les affects qu'ils veulent bien montrer. Savoir si quelque chose changera grâce au nouveau mélange inter-allemand. Bien peu de choses se dessinent à l'horizon. Mais c'est également une question qui relève de l'achèvement du processus de réunification, de l'harmonisation économique, de savoir quand et comment elle réussira. A ce moment-là, l'Allemagne pourra vraiment se demander si elle pourra jouer un rôle politique et non plus se borner à suivre les Alliés comme un toutou. Quant à la classe politique de Bonn, elle espère pouvoir échapper au destin grâce à l'unification européenne. L'absorption de l'Allemagne dans le tout européen: voilà ce qui devrait nous libérer de la grande politique. Mais cette Europe ne fonctionnera pas car tout ce qui était «faisable» au niveau européen a déjà été fait depuis longtemps. La construction du marché intérieur est un bricolage qui n'a ni queue ni tête. Prenons un exemple: qui décidera demain s'il faut ou non proclamer l'état d'urgence en Grèce? Une majorité rendue possible par les voix de quelques députés écossais ou belges? Vouloir mener une politique supra-nationale en conservant des Etats nationaux consolidés est une impossibilité qui divisera les Européens plutôt que de les unir.
Q.: Comment jugez-vous le monde du conservatisme, de la droite, en Allemagne? Sont-ils les moteurs des processus dominants ou ne sont-ils que des romantiques qui claudiquent derrière les événements?
GM: Depuis 1789, le monde évolue vers la gauche, c'est la force des choses. Le national-socialisme et le fascisme étaient, eux aussi, des mouvements de gauche (j'émets là une idée qui n'est pas originale du tout). Le conservateur, le droitier —je joue ici au terrible simplificateur— est l'homme du moindre mal. Il suit Bismarck, Hitler, puis Adenauer, puis Kohl. Et ainsi de suite, usque ad finem. Je ne suis pas un conservateur, un homme de droite. Car le problème est ailleurs: il importe bien plutôt de savoir comment, à quel moment et qui l'on «maintient». Ce qui m'intéresse, c'est le «mainteneur», l'Aufhalter, le Cat-echon dont parlait si souvent Carl Schmitt. Hegel et Savigny étaient des Aufhalter de ce type; en politique, nous avons eu Napoléon III et Bismarck. L'idée de maintenir, de contenir le flot révolutionnaire/dissolutif, m'apparait bien plus intéressante que toutes les belles idées de nos braves conservateurs droitiers, si soucieux de leur Bildung. L'Aufhalter est un pessimiste qui passe à l'action. Lui, au moins, veut agir. Le conservateur droitier ouest-allemand, veut-il agir? Moi, je dis que non!
Q.: Quelles sont les principales erreurs des hommes de droite allemands?
GM: Leur grande erreur, c'est leur rousseauisme, qui, finalement, n'est pas tellement éloigné du rousseauisme de la gauche. C'est la croyance que le peuple est naturellement bon et que le magistrat est corruptible. C'est le discours qui veut que le peuple soit manipulé par les politiciens qui l'oppressent. En vérité, nous avons la démocratie totale: voilà notre misère! Nous avons aujourd'hui, en Allemagne, un système où, en haut, règne la même morale ou a-morale qu'en bas. Seule différence: la place de la virgule sur le compte en banque; un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Pour tout ordre politique qui mérite d'être qualifié d'«ordre», il est normal qu'en haut, on puisse faire certaines choses qu'il n'est pas permis de faire en bas. Et inversément: ceux qui sont en haut ne peuvent pas faire certaines choses que peuvent faire ceux qui sont en bas. On s'insurge contre le financement des partis, les mensonges des politiciens, leur corruption, etc. Mais le mensonge et la corruption, c'est désormais un sport que pratique tout le peuple. Pas à pas, la RFA devient un pays orientalisé, parce que les structures de l'Etat fonctionnent de moins en moins correctement, parce qu'il n'y a plus d'éthique politique, de Staatsethos, y compris dans les hautes sphères de la bureaucratie. La démocratie accomplie, c'est l'universalisation de l'esprit du p'tit cochon roublard, le règne universel des petits malins. C'est précisément ce que nous subissons aujourd'hui. C'est pourquoi le mécontentement à l'égard de la classe politicienne s'estompe toujours aussi rapidement: les gens devinent qu'ils agiraient exactement de la même façon. Pourquoi, dès lors, les politiciens seraient-ils meilleurs qu'eux-mêmes? Il faudrait un jour examiner dans quelle mesure le mépris à l'égard du politicien n'est pas l'envers d'un mépris que l'on cultive trop souvent à l'égard de soi-même et qui s'accommode parfaitement de toutes nos petites prétentions, de notre volonté générale à vouloir rouler autrui dans la farine, etc.
Q.: Et le libéralisme?
GM: Dans les années qui arrivent, des crises toujours plus importantes secoueront la planète, le pays et le concert international. Le libéralisme y rencontrera ses limites. La prochaine grande crise sera celle du libéralisme. Aujourd'hui, il triomphe, se croit invincible, mais demain, soyez en sûr, il tombera dans la boue pour ne plus se relever.
Q.: Pourquoi?
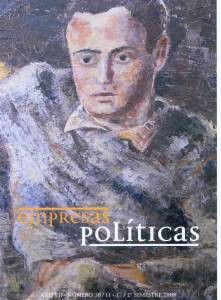 GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs... Et le libéralisme échouera parce qu'il ne pourra plus satisfaire les besoins économiques qui se font de plus en plus pressants, notamment en Europe orientale.
GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs... Et le libéralisme échouera parce qu'il ne pourra plus satisfaire les besoins économiques qui se font de plus en plus pressants, notamment en Europe orientale.
Q.: Vous croyez donc que les choses ne changent qu'à coup de catastrophes?
GM: C'est exact. Seules les catastrophes font que le monde change. Ceci dit, les catastrophes ne garantissent pas pour autant que les peuples modifient de fond en comble leurs modes de penser déficitaires. Depuis des années, nous savions, ou du moins nous étions en mesure de savoir, ce qui allait se passer si l'Europe continuait à être envahie en masse par des individus étrangers à notre espace, provenant de cultures radicalement autres par rapport aux nôtres. Le problème devient particulièrement aigu en Allemagne et en France. Quand nous aurons le «marché intérieur», il deviendra plus aigu encore. Or à toute politique rationnelle, on met des bâtons dans les roues en invoquant les droits de l'homme, etc. Ceci n'est qu'un exemple pour montrer que le fossé se creusera toujours davantage entre la capacité des uns à prévoir et la promptitude des autres à agir en conséquence.
Q.: Ne vous faites-vous pas d'illusions sur la durée que peuvent prendre de tels processus? Au début des années 70, on a pronostiqué la fin de l'ère industrielle; or, des catastrophes comme celles de Tchernobyl n'ont eu pour conséquence qu'un accroissement générale de l'efficience industrielle. Même les Verts pratiquent aujourd'hui une politique industrielle. Ne croyez-vous pas que le libéralisme s'est montré plus résistant et innovateur qu'on ne l'avait cru?
GM: «Libéralisme» est un mot qui recouvre beaucoup de choses et dont la signification ne s'étend pas à la seule politique industrielle. Mais, même en restant à ce niveau de politique industrielle, je resterai critique à l'égard du libéralisme. Partout, on cherche le salut dans la «dé-régulation». Quelles en sont les conséquences? Elles sont patentes dans le tiers-monde. Pour passer à un autre plan, je m'étonne toujours que la droite reproche au libéralisme d'être inoffensif et inefficace, alors qu'elle est toujours vaincue par lui. On oublie trop souvent que le libéralisme est aussi ou peut être un système de domination qui fonctionne très bien, à la condition, bien sûr, que l'on ne prenne pas ses impératifs au sérieux. C'est très clair dans les pays anglo-saxons, où l'on parle sans cesse de democracy ou de freedom, tout en pensant God's own country ou Britannia rules the waves. En Allemagne, le libéralisme a d'emblée des effets destructeurs et dissolutifs parce que nous prenons les idéologies au sérieux, nous en faisons les impératifs catégoriques de notre agir. C'est la raison pour laquelle les Alliés nous ont octroyé ce système après 1945: pour nous neutraliser.
Q.: Etes-vous un anti-démocrate,
Monsieur Maschke?
GM: Si l'on entend par «démocratie» la partitocratie existente, alors, oui, je suis anti-démocrate. Il n'y a aucun doute: ce système promeut l'ascension sociale de types humains de basse qualité, des types humains médiocres. A la rigueur, nous pourrions vivre sous ce système si, à l'instar des Anglo-Saxons ou, partiellement, des Français, nous l'appliquions ou l'instrumentalisions avec les réserves nécessaires, s'il y avait en Allemagne un «bloc d'idées incontestables», imperméable aux effets délétères du libéralisme idéologique et pratique, un «bloc» selon la définition du juriste français Maurice Hauriou. Evidemment, si l'on veut, les Allemands ont aujourd'hui un «bloc d'idées incontestables»: ce sont celles de la culpabilité, de la rééducation, du refoulement des acquis du passé. Mais contrairement au «bloc» défini par Hauriou, notre «bloc» est un «bloc» de faiblesses, d'éléments affaiblissants, incapacitants. La «raison d'Etat» réside chez nous dans ces faiblesses que nous cultivons jalousement, que nous conservons comme s'il s'agissait d'un Graal. Mais cette omniprésence de Hitler, cette fois comme croquemitaine, signifie que Hitler règne toujours sur l'Allemagne, parce que c'est lui, en tant que contre-exemple, qui détermine les règles de la politique. Je suis, moi, pour la suppression définitive du pouvoir hitlérien.
Q.: Vous êtes donc le seul véritable
anti-fasciste?
GM: Oui. Chez nous, la police ne peut pas être une police, l'armée ne peut pas être une armée, le supérieur hiérarchique ne peut pas être un supérieur hiérarchique, un Etat ne peut pas être un Etat, un ordre ne peut pas être un ordre, etc. Car tous les chemins mènent à Hitler. Cette obsession prend les formes les plus folles qui soient. Les spéculations des «rééducateurs» ont pris l'ampleur qu'elles ont parce qu'ils ont affirmé avec succès que Hitler résumait en sa personne tout ce qui relevait de l'Etat, de la Nation et de l'Autorité. Les conséquences, Arnold Gehlen les a résumées en une seule phrase: «A tout ce qui est encore debout, on extirpe la moëlle des os». Or, en réalité, le système mis sur pied par Hitler n'était pas un Etat mais une «anarchie autoritaire», une alliance de groupes ou de bandes qui n'ont jamais cessé de se combattre les uns les autres pendant les douze ans qu'a duré le national-socialisme. Hitler n'était pas un nationaliste, mais un impérialiste racialiste. Pour lui, la nation allemande était un instrument, un réservoir de chair à canon, comme le prouve son comportement du printemps 1945. Mais cette vision-là, bien réelle, de l'hitlérisme n'a pas la cote; c'est l'interprétation sélectivement colorée qui s'est imposée dans nos esprits; résultat: les notions d'Etat et de Nation peuvent être dénoncées de manière ininterrompue, détruites au nom de l'émancipation.
Q.: Voyez-vous un avenir pour la droite en Allemagne?
GM: Pas pour le moment.
Q.: A quoi cela est-il dû?
GM: Notamment parce que le niveau intellectuel de la droite allemande est misérable. Je n'ai jamais cessé de le constater. Avant, je prononçais souvent des conférences pour ce public; je voyais arriver 30 bonshommes, parmi lesquels un seul était lucide et les 29 autres, idiots. La plupart étaient tenaillés par des fantasmes ou des ressentiments. Ce public des cénacles de droite vous coupe tous vos effets. Ce ne sont pas des assemblées, soudées par une volonté commune, mais des poulaillers où s'agitent des individus qui se prétendent favorables à l'autorité mais qui, en réalité, sont des produits de l'éducation anti-autoritaire.
Q.: L'Amérique est-elle la cible principale
de l'anti-libéralisme?
GM: Deux fois en ce siècle, l'Amérique s'est dressée contre nous, a voulu détruire nos œuvres politiques, deux fois, elle nous a déclaré la guerre, nous a occupés et nous a rééduqués.
Q.: Mais l'anti-américanisme ne se déploie-t-il pas essentiellement au niveau «impolitique» des sentiments?
GM: L'Amérique est une puissance étrangère à notre espace, qui occupe l'Europe. Je suis insensible à ses séductions. Sa culture de masse a des effets désorientants. Certes, d'aucuns minimisent les effets de cette culture de masse, en croyant que tout style de vie n'est que convention, n'est qu'extériorité. Beaucoup le croient, ce qui prouve que le problème de la forme, problème essentiel, n'est plus compris. Et pas seulement en Allemagne.
Q.: Comment expliquez-vous la montée du néo-paganisme, au sein des droites, spécialement en Allemagne et en France?
GM: Cette montée s'explique par la crise du christianisme. En Allemagne, après 1918, le protestantisme s'est dissous; plus tard, à la suite de Vatican II dans les années 60, ça a été au tour du catholicisme. On interprète le problème du christianisme au départ du concept d'«humanité». Or le christianisme ne repose pas sur l'humanité mais sur l'amour de Dieu, l'amour porté à Dieu. Aujourd'hui, les théologiens progressistes attribuent au christianisme tout ce qu'il a jadis combattu: les droits de l'homme, la démocratie, l'amour du lointain (de l'exotique), l'affaiblissement de la nation. Pourtant, du christianisme véritable, on ne peut même pas déduire un refus de la politique de puissance. Il suffit de penser à l'époque baroque. De nos jours, nous trouvons des chrétiens qui jugent qu'il est très chrétien de rejetter la distinction entre l'ami et l'ennemi, alors qu'elle est induite par le péché originel, que les théologiens actuels cherchent à minimiser dans leurs interprétations. Mais seul Dieu peut lever cette distinction. Hernán Cortés et Francisco Pizarro savaient encore que c'était impossible, contrairement à nos évêques d'aujourd'hui, Lehmann et Kruse. Cortés et Pizarro étaient de meilleurs chrétiens que ces deux évêques. Le néo-paganisme a le vent en poupe à notre époque où la sécularisation s'accélére et où les églises elles-mêmes favorisent la dé-spiritualisation. Mais être païen, cela signifie aussi prier. Demandez donc à l'un ou l'autre de ces néo-païens s'il prie ou s'il croit à l'un ou l'autre dieu païen. Au fond, le néo-paganisme n'est qu'un travestissement actualisé de l'athéisme et de l'anticléricalisme. Pour moi, le néo-paganisme qui prétend revenir à nos racines est absurde. Nos racines se situent dans le christianisme et nous ne pouvons pas revenir 2000 ans en arrière.
Q.: Alors, le néo-paganisme,
de quoi est-il l'indice?
GM: Il est l'indice que nous vivons en décadence. Pour stigmatiser la décadence, notre époque a besoin d'un coupable et elle l'a trouvé dans le christianisme. Et cela dans un monde où les chrétiens sont devenus rarissimes! Le christianisme est coupable de la décadence, pensait Nietzsche, ce «fanfaron de l'intemporel» comme aimait à l'appeler Carl Schmitt. Nietzsche est bel et bien l'ancêtre spirituel de ces gens-là. Mais qu'entendait Nietzsche par christianisme? Le protestantisme culturel libéral, prusso-allemand. C'est-à-dire une idéologie qui n'existait pas en Italie et en France; aussi je ne saisis pas pourquoi tant de Français et d'Italiens se réclament de Nietzsche quand ils s'attaquent au christianisme.
Q.: Monsieur Maschke, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.
(une version abrégée de cet entretien est parue dans Junge Freiheit n°6/91; adresse: JF, Postfach 147, D-7801 Stegen/Freiburg).
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, entretien, réflexions personnelles, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 janvier 2010
Der absolute Krieg
 Der absolute Krieg
Der absolute Krieg
Da man den unabhängigen Willen des Gegners sich gegenüber hat, so gilt es, diesen Willen zu brechen. Dies geschieht mit Hilfe der eigenen Machtmittel und der eigenen Willenskraft. Wenn sich die eigenen Machtmittel als unzureichend erweisen oder die eigene Willenskraft der des Gegners nachsteht, müssen daraus gewissen Gegengewichte erwachsen. Diese beiden Faktoren sind daher von geradezu entscheidender Bedeutung. Jeder Kriegführende wird folgerichtig bestrebt sein, sie zu möglichst grosser Wirkung zu bringen, d. h. die "äusserste Anstrengung der Kräfte" vorzubereiten und in die Tat umzusetzen.
Theoretisch betrachtet, müsste man nun zu einem Maximum an personeller, materieller, wirtschaftlicher und willensmässiger Anstrengung gelangen können, aus dem sich ein völlig ungehemmter Krieg ergeben würde, den Clausewitz mit dem Begriff "Absoluter Krieg" umfasst. Aber das ist nur höchst selten der Fall. Vielmehr ist "die Gestalt, die der Krieg gewinnt, abhängig von allem Fremdartigen, was sich darin einmischt und daran ansetzt..., von aller natürlichen Schwere und Reibung der Teile, der ganzen Inkonsequenz, Unklarheit und Verzagtheit des menschlichen Geistes".
Der "absolute" oder, wie ihn Clausewitz gelegentlich auch nennt, der "abstrakte" Krieg hat also mit dem Krieg, wie er sich in der Wirklichkeit abspielt, nur wenig zu tun. Wenn auch gerade in neuester Zeit seit dem Zeitalter Napoleons das offensichtliche Bestreben zutage tritt, dem Kriege auch in der Wirklichkeit eine absolute Gestalt zu verleihen, so wurde dies doch noch nie in der letzten Vollkommenheit erreicht. Selbst die glänzendsten Feldzüge weisen hier und da, wenn auch kleinere, Lücken auf, die z. B. durch unvermeidliche Fehler von Unterführerm hervorgerufen worden sind.
Friedrich von Cochenhausen, Der Wille zum Sieg. Clausewitz´ Lehre von den dem Kriege innewohnenden Gegengewichten und ihrer Überwindung, erläutert am Feldzug 1814 in Frankreich, Berlin 1943.
00:10 Publié dans Polémologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, guerre, sociologie, théorie politique, sciences politiques, politologie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 janvier 2010
Slavoj Zizek, un fascista di sinistra dei nostri giorni
Slavoj Zizek, un fascista di sinistra dei nostri giorni
di Luciano Lanna
Ex: http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/
 Luciano Lanna, laureato in filosofia, giornalista professionista dal 1992 e scrittore (autore, con Filippo Rossi, del saggio dizionario Fascisti immaginari. Tutto quello che c'è da sapere sulla destra, Vallecchi 2004), oltre ad aver lavorato in quotidiani e riviste, si è occupato di comunicazione politica e ha collaborato con trasmissioni radiofoniche e televisive della Rai. Già caporedattore del bimestrale di cultura politica Ideazione e vice direttore del quotidiano L'Indipendente, è direttore responsabile del Secolo d'Italia.
Luciano Lanna, laureato in filosofia, giornalista professionista dal 1992 e scrittore (autore, con Filippo Rossi, del saggio dizionario Fascisti immaginari. Tutto quello che c'è da sapere sulla destra, Vallecchi 2004), oltre ad aver lavorato in quotidiani e riviste, si è occupato di comunicazione politica e ha collaborato con trasmissioni radiofoniche e televisive della Rai. Già caporedattore del bimestrale di cultura politica Ideazione e vice direttore del quotidiano L'Indipendente, è direttore responsabile del Secolo d'Italia.L'articolo è anche sul sito web del Secolo d'Italia: QUI
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, slovénie, théorie politique, politologie, sciences politiques, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le monde comme système
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Le Monde comme Système
par Louis SOREL
Si le substantif de géopolitique n'est pas la simple contraction de «géographie politique», cette méthode d'approche des phénomènes politiques s'enracine dans la géographie; elle ne peut donc se désintéresser de l'évolution. Réputée inutile et bonasse (1), la géographie est un savoir fondamentalement politique et un outil stratégique. Confrontée à la recomposition politique du monde, elle ne peut plus se limiter à la description et la mise en carte des lieux et se définit comme science des types d'organisation de l'espace terrestre. Le premier tome de la nouvelle géographie universelle, dirigée par R. Brunet, a l'ambition d'être une représentation de l'état du Monde et de l'état d'une science. La partie de l'ouvrage dirigée par O. Dollfuss y étudie le Monde comme étant un système, parcouru de flux et structuré par quelques grands pôles de puissance.
O. Dollfuss, universitaire (il participe à la formation doctorale de géopolitique de Paris 8) et collaborateur de la revue Hérodote, prend le Monde comme objet propre d'analyses géographiques; le Monde conçu comme totalité ou système. Qu'est-ce qu'un système? «Un système est un ensemble d'éléments interdépendants, c'est-à-dire liés entre eux par des relations telles que si l'une est modifiée, les autres le sont aussi et par conséquent tout l'ensemble est transformé» (J. Rosnay).
Nombre de sciences emploient aujourd'hui une méthode systémique, les sciences physiques et biologiques créatrices du concept, l'économie, la sociologie, les sciences politiques… mais la démarche est innovante en géographie.
Le Monde fait donc système. Ses éléments en interaction sont les Etats territoriaux dont le maillage couvre la totalité de la surface terrestre (plus de 240 Etats et Territoires), les firmes multinationales, les aires de marché (le marché mondial n'existe pas), les aires culturelles définies comme espaces caractérisés par des manières communes de penser, de sentir, de se comporter, de vivre. Les relations entre Etats nourrissent le champ de l'international (interétatique serait plus adéquat) et les relations entre acteurs privés le champ du transnational: par exemple, les flux intra-firmes qui représentent le tiers du commerce mondial. Ces différents éléments du système Monde sont donc «unis» par des flux tels qu'aucune région du monde n'est aujourd'hui à l'abri de décisions prises ailleurs. On parle alors d'interdépendance, terme impropre puisque l'asymétrie est la règle.
L'émergence et la construction du système Monde couvrent les trois derniers siècles. Longtemps, le Monde a été constitué de «grains» (sociétés humaines) et d'«agrégats» (sociétés humaines regroupées sous la direction d'une autorité unique, par exemple l'Empire romain) dont les relations, quand elles existaient, étaient trop ténues pour modifier en profondeur les comportements. A partir du XVIième siècle, le désenclavement des Européens, qui ont connaissance de la rotondité de la Terre, va mettre en relation toutes les parties du Monde. Naissent alors les premièrs «économies-mondes» décrites par Immanuel Wallerstein et Fernand Braudel et lorsque toutes les terres ont été connues, délimitées et appropriées (la Conférence de Berlin en 1885 achève la répartition des terres africaines entre Etats européens), le Monde fonctionne comme système (2). La «guerre de trente ans» (1914-1945) accélèrera le processus: toutes les humanités sont désormais en interaction spatiale.
L'espace mondial qui en résulte est profondément différencié et inégal. Il est le produit de la combinaison des données du milieu naturel et de l'action passée et présente des sociéts humaines; nature et culture. En effet, le potentiel écologique (ensemble des éléments physiques et biologiques à la disposition d'un groupe social) ne vaut que par les moyens techniques mis en œuvre par une société culturellement définie; il n'existe pas à proprement parler de «ressources naturelles», toute ressource est «produite».
Et c'est parce que l'espace mondial est hétérogène, parce que le Monde est un assemblage de potentiels différents, qu'il y a des échanges à la surface de la Terre, que l'espace mondial est parcouru et organisé par d'innombrables flux. Flux d'hommes, de matières premières, de produits manufacturés, de virus… reliant les différents compartiments du Monde. Ils sont mis en mouvement, commandés par la circulation des capitaux et de l'information, flux moteurs invisibles que l'on nomme influx. Aussi le fonctionnement des interactions spatiales est conditionné par le quadrillage de réseaux (systèmes de routes, voies d'eau et voies ferrées, télécommunications et flux qu'ils supportent) drainant et irriguant les différents territoires du Monde. Inégalement réparti, cet ensemble hiérarchisé d'arcs, d'axes et de nœuds, qui contracte l'espace terrestre, forme un vaste et invisible anneau entre les 30° et 60° parallèles de l'hémisphère Nord. S'y localisent Etats-Unis, Europe occidentale et Japon reliés par leur conflit-coopération. Enjambés, les espaces intercalaires sont des angles-morts dont nul ne se préoccupe.
L'espace mondial n'est donc pas homogène et les sommaires divisions en points cardinaux (Est/Ouest et Nord/sud), surimposés à la trame des grandes régions mondiales ne sont plus opératoires (l'ont-elles été?). On sait la coupure Est-Ouest en cours de cicatrisation et il est tentant de se «rabattre» sur le modèle «Centre-Périphérie» de l'économiste égyptien Samir Amin: un centre dynamique et dominateur vivrait de l'exploitation d'une périphérie extra-déterminée. La vision est par trop sommaire et O. Dollfuss propose un modèle explicatif plus efficient, l'«oligopole géographique mondial». Cet oligopole est formé par les puissances territoriales dont les politiques et les stratégies exercent des effets dans le Monde entier. Partenaires rivaux (R. Aron aurait dit adversaires-partenaires), ces pôles de commandement et de convergence des flux, reliés par l'anneau invisible, sont les centres d'impulsion du système Monde. Ils organisent en auréoles leurs périphéries (voir les Etats-Unis avec dans le premier cercle le Canada et le Mexique, au-delà les Caraïbes et l'Amérique Latine; ou encore le Japon en Asie), se combattent, négocient et s'allient. Leurs pouvoirs se concentrent dans quelques grandes métropoles (New-York, Tokyo, Londres, Paris, Francfort…), les «îles» de l'«archipel métropolitain mondial». Sont membres du club les superpuissances (Etats-Unis et URSS, pôle incomplet), les moyennes puissances mondiales (anciennes puissances impériales comme le Royaume-Uni et la France) et les puissances économiques comme le Japon et l'Allemagne (3); dans la mouvance, de petites puissances mondiales telles que la Suisse et la Suède. Viennent ensuite des «puissances par anticipation» (Chine, Inde) et des pôles régionaux (Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Nigéria…). Enfin, le système monde a ses «arrières-cours», ses «chaos bornés» où règnent la violence et l'anomie (Ethiopie, Soudan…).
La puissance des «oligopoleurs» vit de la combinatoire du capital naturel (étendue, position, ressources), du capital humain (nombre des hommes, niveau de formation, degré de cohésion culturelle) et de la force armée. Elle ne saurait être la résultante d'un seul de ces facteurs et ne peut faire l'économie d'un projet politique (donc d'une volonté). A juste titre, l'auteur insiste sur l'importance de la gouvernance ou aptitude des appareils gouvernants à assurer le contrôle, la conduite et l'orientation des populations qu'ils encadrent. Par ailleurs, l'objet de la puissance est moins le contrôle direct de vastes espaces que la maîtrise des flux (grâce à un système de surveillance satellitaire et de missiles circumterrestres) par le contrôle des espaces de communication ou synapses (détroits, isthmes…) et le traitement massif de l'information (4).
Ce premier tome de la géographie universelle atteste du renouvellement de la géographie, de ses méthodes et de son appareil conceptuel. On remarquera l'extension du champ de la géographicité (de ce que l'on estime relever de la discipline) aux rapports de puissance entre unités politiques et espaces. Fait notoire en France, où la géographie a longtemps prétendu fonder sa scientificité sur l'exclusion des phénomènes politiques de son domaine d'étude. Michel Serres affirme préférer «la géographie, si sereine, à l'histoire, chaotique». R. Brunet lui répond: «Nous n'avons pas la géographie bucolique, et la paix des frondaisons n'est pas notre refuge». Pas de géographie sans drame!
Louis SOREL.
Sous la direction de Roger Brunet, Géographie universelle, tome I, Hachette/Reclus, 1990; Olivier Dollfuss, Le système Monde, livre II, Hachette Reclus, 1990.
(1) Cf. Yves Lacoste, La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, petite collection Maspero, 1976.
(2) Cf. I. Wallerstein, The Capitalist World Economy, Cambridge University Press, 1979 (traduction française chez Flammarion) et F. Braudel, Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, Armand Colin, 1979. Du même auteur, La dynamique du capitalisme (Champs Flammarion, 1985) constitue une utile introduction (à un prix "poche").
(3) I. Ramonet, directeur du Monde diplomatique, qualifie le Japon et l'Allemagne de «puissances grises» (au sens d'éminence…). Cf. «Allemagne, Japon. Les deux titans», Manières de voir n°12, édition Le Monde diplomatique. A la recherche des ressorts communs des deux pays du «modèle industrialiste», les auteurs se déplacent du champ économique au champ politique et du champ politique au champ culturel tant l'économique plonge ses racines dans le culturel. Ph. Lorino (Le Monde diplomatique, juin 1991, p.2) estime ce recueil révélateur des ambiguïtés françaises à l'égard de l'Allemagne, mise sur le même plan que le Japon, en dépit d'un processus d'intégration régionale déjà avancé.
(4) Les «îles» de «l'archipel-monde» (le terme rend compte tout à la fois de la globalité croissante des flux et des interconnexions et de la fragmentation politico-stratégique de la planète) étant reliée par des mots et des images, Michel Foucher affirme que l'instance culturelle devient le champ majeur de la confrontation (Cf. «La nouvelle planète», n°hors série de Libération, [ou du Soir en Belgique, ndlr], déc. 1990). Dans le même recueil, Zbigniew Brzezinski, ancien «sherpa» de J. Carter, fait de la domination américaine du marché mondial des télécommunications la base de la puissance de son pays; 80% des mots et des images qui circulent dans le monde proviennent des Etats-Unis.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, philosophie, géopolitique, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 janvier 2010
Armin Mohler et la révolution conservatrice
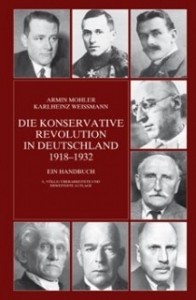 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Armin Mohler et la «Révolution Conservatrice»
(2ième partie)
par Luc PAUWELS
Dans notre numéro 59/60 de novembre-décembre 1989, Robert Steuckers avait analysé la première partie de l'introduction théorique d'Armin Mohler. Au même moment, Luc Pauwels, directeur de la revue Teksten, Kommentaren en Studies (in nr. 55, 2de trimester 1989), se penchait sur le même maître-ouvrage de Mohler et mettait l'accent sur la seconde partie théorique, notamment sur la classification des différentes écoles de ce mouvement aux strates multiples. Nous ne reproduisons pas ci-dessous l'entrée en matière de Pauwels, car ce serait répéter en d'autres mots les propos de Steuckers. En revanche, le reste de sa démonstration constitue presque une sorte de suite logique à l'analyse parue dans notre n°59/60.
Débuts et contenu
Les premiers balbutiements de la Révolution Conservatrice, écrit Mohler, ont lieu lors de la Révolution française: «Toute révolution suscite en même temps qu'elle la contre-révolution qui tente de l'annihiler. Avec la Révolution française, advient victorieusement le monde qui, pour la Révolution Conservatrice représente l'adversaire par excellence. Définissons provisoirement ce monde comme celui qui refuse de mettre l'immuable de la nature humaine au centre de tout et croit que l'essence de l'homme peut être changée. La Révolution française annonce ainsi la possibilité d'un progrès graduel et estime que toutes les choses, relations et événements sont explicables rationnellement; de ce fait, elle essaie d'isoler chaque chose de son contexte et de la comprendre ainsi pour soi».
Mohler nous rappelle ensuite un malentendu tenace, que l'on rencontre très souvent lorsque l'on évoque la Révolution Conservatrice. Un malentendu qui, outre la confusion avec le fascisme et le national-socialisme, lui a infligé beaucoup de tort: c'est l'idée erronée qui veut que tout ce qui est (ou a été) fait et dit contre la Révolution française, son idéologie et ses conséquences, relève de la Révolution Conservatrice.
La Révolution de 1789 a dû faire face, à ses débuts, à deux types d'ennemis qui ne sont en aucune manière des précurseurs de la Révolution Conservatrice. D'abord, il y avait ses adversaires intérieurs, qui estimaient que les résultats de la Révolution française et/ou de son idéologie égalitaire étaient insuffisants. Cette opposition interne a commencé avec Gracchus Babeuf (1760-1797), adepte d'«Egalité parfaite» (la majuscule est de lui), qui voulait supprimer toutes les formes de propriété privée et espérait atteindre l'«Egalité des jouissances». Sa tentative de coup d'Etat, appelée la «Conjuration des Egaux», fut tué dans l'œuf et l'aventure se termina en parfaite égalité le 27 mai 1797... sous le couperet de la guillotine.
Toutes les tendances qui puisent leur inspiration dans l'égalitarisme de Babeuf et qui, sur base de ces idées, critiquent la Révolution française, n'ont rien à voir, bien entendu, avec la Révolution Conservatrice (RC). Elles appartiennent, pour être plus précis, aux traditions du marxisme et de l'anarchisme de gauche.
Ensuite, la Révolution française, dès ses débuts, a eu affaire à des groupes qui la combattaient pour maintenir ou récupérer leurs positions sociales (matérielles ou non), que les Jacobins menaçaient de leur ôter ou avaient détruites. Les adeptes de la RC ont toujours eu le souci de faire la différence entre leur propre attitude et cette position; ils ont qualifié l'action qui en découlait, écrit Mohler, de «restauratrice», de «réactionnaire», d'«altkonservativ» («vieille-conservatrice»), etc. Mais, au cours du XIXième siècle, les tenants de la RC (qui ne porte pas encore son nom, ndt) et les «Altkonservativen» font face à un ennemi commun, ce qui les force trop souvent à forger des alliances tactiques avec les réactionnaires, à se retrouver dans le même camp politique. Ainsi, la différence essentielle qui sépare les uns des autres devient moins perceptible pour les observateurs extérieurs. Dans les rangs mêmes de la RC, on s'aperçoit des ambiguïtés et le discours s'anémie. Pour les RC de pure eau, ces alliances et ces ambiguïtés auront trop souvent des conséquences fatales. Mohler nous l'explique: «Car, à la RC, n'appartiennent —comme le couplage paradoxal des deux mots l'indique— que ceux qui s'attaquent aux fondements du siècle du progrès sans simplement vouloir une restauration de l'Ancien Régime».
Sous sa forme pure, la RC est toujours restée au stade de la formulation théorique. Rauschning, lui aussi, décrit ce caractère composite dans son ouvrage intitulé précisément Die Konservative Revolution: «Le mouvement opposé, qui se dresse contre le développement des idées révolutionnaires, a amorcé sa croissance au départ de stades initiaux embrouillés et semi-conscients, pour atteindre ce que nous nommons, avec Hugo von Hoffmannstahl, la RC. Elle représente le renversement complet de la tendance politique actuelle. Mais ce contre-mouvement n'a pas encore trouvé d'incarnation pure, adaptée à lui-même. Il participe aux tentatives d'instaurer des modèles d'ordre totalitaire et césariste ou à des essais plattement réactionnaires. C'est pour toutes ces raisons, précisément, qu'il reste confus et brouillon...».
Sur base de cette constatation, Mohler observe que toute description cohérente du processus de maturation de la RC se mue automatiquement en une véritable histoire des idées. Si on cherche à la décrire comme une partie intégrante de la réalité politique, elle déchoit en un événement subalterne ou marginal. De ce fait, il ne faut pas donner des limites trop exiguës à la RC: elle déborde en effet sur d'autres mouvements, d'autres courants de pensée. Et vu le flou de ces limites, flou dû à la très grande hétérogénéité des choses que la RC embrasse, des choses qui font irruption dans son champs, Mohler est obligé de tracer une démarcation arbitraire afin de bien circonscrire son sujet. Il s'explique: «Au sens large, le terme "Révolution Conservatrice" englobe un ensemble de transformations s'appuyant sur un fondement commun, des transformations qui se sont accomplies ou qui s'annoncent, et qui concerne tous les domaines de l'existence, la théologie comme par exemple les sciences naturelles, la musique comme l'urbanisme, les relations interfamiliales comme les soins du coprs ou la façon de construire une machine. Dans notre étude, nous nous bornerons à donner une définition exclusivement politique au terme; notre étude se limitant à l'histoire des idées, nous désignons par "Révolution Conservatrice" une certaine pensée politique».
Les pères fondateurs, les précurseurs et les parrains
Une pensée politique, une Weltanschauung, implique qu'il y ait des penseurs. Mohler les appelle les Leitfiguren, les figures de proue, que nous nommerions par commodité les «précurseurs». Mohler souligne, dans la seconde partie de son ouvrage, inédite dans les premières éditions, que l'intérêt pour les précurseurs s'est considérablement amplifié. Les figures qui ont donné à la RC sa plus haute intensité spirituelle et psychique, ses penseurs les plus convaincants et aussi ses incarnations humaines les plus irritantes ont désormais trouvé leurs biographes et leurs analystes».
Si l'on parle de «père fondateur», il faut évidemment citer Friedrich Nietzsche (1844-1900), reconnu par les amis et les ennemis comme l'initiateur véritable du phénomène intellectuel et spirituel de la RC. A côté de lui, le penseur français, moins universellement connu, Georges Sorel (1847-1922)... Nous reviendrons tout à l'heure sur ces deux personnages centraux.
Au second rang, une génération plus tard, nous trouvons le «trio» (ainsi que le nomme Mohler): Carl Schmitt (1888-1985), Ernst Jünger (°1895) et Martin Heidegger (1889-1976). Mohler cite ensuite toute une série de penseurs dont l'influence sur la RC est sans doute moins directe mais non moins intense. Les parrains non-allemands sont essentiellement des sociologues et des historiens du début de notre siècle qui, très tôt, avaient annoncé le crise du libéralisme bourgeois: les Italiens Vilfredo Pareto (1848-1923) et Gaëtano Mosca (1858-1941), l'Allemand Robert(o) Michels (1876-1936), installé en Italie, l'Américain d'origine norvégienne Thorstein Veblen (1857-1929). L'Espagne nous a donné Miguel de Unamuno (1864-1936) puis, une génération plus tard, José Ortega y Gasset (1883-1956). La France, elle, a donné le jour à Maurice Barrès (1862-1923).
Quelques-uns de ces penseurs revêtent une double signification pour notre propos: ils sont à la fois «parrains» de la RC en Allemagne et partie intégrante dans les initiatives conservatrices-révolutionnaires qui ont animé la scène politico-idéologiques dans nos propres provinces.
Parmi les «parrains» allemands de la RC, Mohler compte le compositeur Richard Wagner (1813-1883), les poètes Gerhart Hauptmann (1862-1946) et Stefan George (1868-1933), le psychologue Ludwig Klages (1872-1956) et, bien sûr, Thomas Mann (1875-1955), Gottfried Benn (1896-1956) et Freidrich-Georg Jünger (1898-1977), le frère d'Ernst.
D'autres parrains allemands sont à peine connus dans nos provinces; Mohler les cite: les poètes Konrad Weiss (1880-1940) et Alfred Schuler (1865-1923), les écrivains Rudolf Borchardt (1877-1945) et Léopold Ziegler (1881-1958), un ami d'Edgar J. Jung, connu surtout pour son livre Volk, Staat und Persönlichkeit («Peuple, Etat et personnalité»; 1917). Enfin, il y a Max Weber (1864-1920), le plus grand sociologue que l'Allemagne ait connu, célèbre dans le monde entier mais pas assez pratiqué dans nos cercles non-conformistes.
La RC dans
d'autres pays
Pour Mohler, la RC est «un phénomène politique qui embrasse toute l'Europe et qui n'est pas encore arrivé au bout de sa course». Dans la préface à la première édition de son ouvrage, nous lisons que la RC est «ce mouvement de rénovation intellectuelle qui tente de remettre de l'ordre dans le champs de ruines laissé par le XIXième siècle et cherche à créer un nouvel ordre de la vie. Mais si nous ne sélectionnons que la période qui va de 1918 à 1932, nous pouvons quand même affirmer que la RC commence déjà au temps de Goethe et qu'elle s'est déployée sans interruption depuis lors et qu'elle poursuit sa trajectoire aujourd'hui sur des voies très diverses. Et si nous ne présentons ici que la partie allemande du phénomène, nous n'oublions pas que la RC a touché la plupart des autres pays européens, voire certains pays extra-européens».
Mohler réfute la thèse qui prétend que la RC est un phénomène exclusivement allemand. Il suffit de nommer quelques auteurs pour ruiner cet opinion, explique Mohler. Quelques exemples: en Russie, Dostoievski (1821-1881), le grand écrivain, chaleureux nationaliste et populiste russe; les frères Konstantin (1917-1860) et Ivan S. Axakov (1823-1886). En France, Georges Sorel (1847-1922), le social-révolutionnaire le plus original qui soit, et Maurice Barrès (1862-1923). Ensuite, le philosophe, homme politique et écrivain espagnol Miguel de Unamuno (1864-1936), l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto (1848-1923), célèbre pour sa théorie sur l'émergence et la dissolution des élites. En Angleterre, citons David Herbert Lawrence (1885-1930) et Thomas Edward Lawrence (1888-1935), qui fut non seulement le mystérieux «Lawrence d'Arabie» mais aussi l'auteur des Seven Pillars of Wisdom, de The Mint, etc.
Cette liste pourrait être complétée ad infinitum. Bornons-nous à nommer encore T.S. Eliot et le grand Chesterton pour la Grande-Bretagne et Jabotinski pour la diaspora juive. Tous ces noms ne sont choisis qu'au hasard, dit Mohler, parmi d'autres possibles.
Dans les Bas Pays de l'actuel Bénélux, on observe un contre-mouvement contre les effets de la Révolution française dès le début du XIXième siècle. En Hollande, les conservateurs protestants se donnèrent le nom d'«antirévolutionnaires», ce qui est très significatif. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) et Abraham Kuyper (1837-1920) donnèrent au mouvement antirévolutionnaire et au parti du même nom (ARP, depuis 1879) une idéologie corporatiste et organique de facture nettement populiste-conservatrice (volkskonservatief). Conrad Busken Huet (1826-1886), prédicateur, journaliste et romancier, infléchit son mouvement, Nationale Vertoogen, contre le libéralisme, héritier de la Révolution française. Son ami Evert-Jan Potgieter (1808-1875) qui, en tant qu'auteur et co-auteur de De Gids, avait beaucoup de lecteurs, évolua, lui aussi, dans sa critique de la société, vers des positions conservatrices-révolutionnaires; il décrivait ses idées comme participant d'un «radicalisme conservateur» (konservatief radikalisme).
Après la première guerre mondiale, aux Pays-Bas, les idéaux conservateurs-révolutionnaires avaient bel et bien pignon sur rue et se distinguaient nettement du conservatisme confessionnel. Ainsi, le Dr. Emile Verviers, qui enseignait l'économie politique à l'Université de Leiden, adressa une lettre ouverte à la Reine, contenant un programme assez rudimentaire d'inspiration conservatrice-révolutionnaire. Sur base de ce programme rudimentaire, une revue vit le jour, Opbouwende Staatkunde (Politologie en marche). Le philosophe et professeur Gerard Bolland (1854-1922) prononça le 28 septembre 1921 un discours inaugural à l'Université de Leiden, tiré de son ouvrage De Tekenen des Tijds (Les signes du temps), qui lança véritablement le mouvement conservateur-révolutionnaire aux Pays-Bas et en Flandre.
Dans les lettres néerlandaises, dans la vie intellectuelle des années 20 et 30, les tonalités et influences conservatrices-révolutionnaires étaient partout présentes: citons d'abord la figure très contestée d'Erich Wichman sans oublier Anton van Duinkerken, Gerard Knuvelder, Menno ter Braak, Hendrik Marsman et bien d'autres. En Flandre, la tendance conservatrice-révolutionnaire ne se distingue pas facilement du Mouvement Flamand, du nationalisme flamand et du courant Grand-Néerlandais: la composante national(ist)e de la RC domine et refoule facilement les autres. Hugo Verriest et Cyriel Verschaeve, deux prêtres, doivent être mentionnés ici (1), de même qu'Odiel Spruytte (1891-1940), un autre prêtre peu connu mais qui fut très influent, surtout parce qu'il était un brillant connaisseur de l'œuvre de Nietzsche (2). En dehors du mouvement flamand, il convient de mentionner le leader socialiste Henri De Man (3), le Professeur Léon van der Essen (4) et Robert Poulet, récemment décédé et auteur, entre autres, de La Révolution est à droite (5). Sans oublier le Baron Pierre Nothomb (6), chef des Jeunesses Nationales et Charles Anciaux de l'Institut de l'Ordre Corporatif (7).
Les noms de Lothrop Stoddard et de Madison Grant, défenseurs soucieux de l'identité de la race blanche, de James Burnham, théoricien de The Managerial Revolution, mais aussi auteur du The Suicide of the West et de The War we are in, montrent que les Etats-Unis aussi ont contribué à la RC. Dans les grands bouleversements qui affectent depuis quelques dizaines d'années l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine, on peut, explique Mohler, trouver des phénomènes apparentés: «Notamment le mélange, caractéristique de la RC, de lutte pour la libération nationale, de révolution sociale et de rédécouverte de sa propre identité».
Le mouvement ouvrier péroniste en Argentine, avec Juan et Evita Perón, constitue, sur ce chapitre, un exemple d'école. Plus nettement marquée encore est l'œuvre du révolutionnaire chinois, le Dr. Sun Ya-Tsen (1866-1925), fondateur du Kuo-Min-Tang, qui, dans son livre Les trois principes du peuple (8), prêche explicitement pour le nationalisme, la révolution sociale et la voie chinoise vers la démocratie.
Mohler pose un constat: le fait que la Révolution française a mis en branle un contre-mouvement conservateur dont le point focal a été l'Allemagne, indique clairement que nous avons affaire à un phénomène de dimensions au moins européennes; «L'accent mis sur l'élément allemand dans la RC mondiale se justifie sur certains plans. Mêmes les expressions non allemandes de cette révolution intellectuelle contre les idées de 1789 s'enracinent dans ce chapitre de l'histoire des idées en Allemagne, qui s'étend de Herder au Romantisme. En Allemagne même, cette révolte a connu sa plus forte intensité».
L'un des facteurs qui a le plus contribué à l'européanisation générale de la RC est sans conteste la large diffusion des œuvres et des idées de Nietzsche. Armin Mohler tente de ne pas englober Nietzsche dans la RC, mais démontre de façon convaincante que sans Nietzsche, le mouvement n'aurait pas acquis ses Leitbilder («images directrices») typiques et communes. Son influence s'est faite sentir dans les Bas Pays, notamment chez le jeune August Vermeylen (9) et, d'après H.J. Elias (10), sur toute une génération d'étudiants de l'Athenée d'Anvers, parmi lesquels nous découvrons Herman van den Reeck, Max Rooses, Lode Claes et d'autres figures célèbres. La philosophie de Nietzsche a permis qu'éclosent dans toute l'Europe des courants d'inspiration conservatrice-révolutionnaire.
Le Normand Georges Sorel, le second «père fondateur» de la RC selon Mohler (11), est toutefois resté inconnu dans nos régions. Cet ingénieur et philosophe n'a pratiquement jamais été évoqué dans notre entre-deux-guerres (12). A notre connaissance, la seule publication néerlandaise qui parle de lui est l'étude de J. de Kadt sur le fascisme italien; elle date de 1937 (13). On dit qu'il aurait exercé une influence discrète sur Joris van Severen (14) mais son meilleur biographe, Arthur de Bruyne (15), dont le travail est pourtant très fouillé, ne mentionne rien.
Les groupes «völkisch»
Nous ne devons pas concevoir la RC comme un ensemble monolithique. Elle a toujours été plurielle, contradictoire, partagée en de nombreuses tendances, mouvements et mentalités souvent antagonistes. Mohler distingue cinq groupes au sein de la RC; leurs noms allemands sont: les Völkischen, les Jungkonservativen et les Nationalrevolutionäre, dont les tendances idéologiques sont précises et distinctes. Ensuite, il y a les Bündischen et la Landvolkbewegung, que Mohler décrit comme des dissidences historiques concrètes qui n'ont produit des idéologies spécifiques que par la suite. Cette classification en cinq groupes de la RC allemande n'est pas aisément transposable dans les autres pays. Partout, on trouve certes les mêmes ingrédients mais en doses et mixages chaque fois différents. Cette prolixité rend évidemment l'étude de la RC très passionnante.
Le premier groupe, celui des Völkischen, met l'idée de l'«origine» au centre de ses préoccupations. Les mots-clefs sont alors, très souvent, le peuple (Volk), la race, la souche (Stamm) ou la communauté linguistique. Et chacun de ces mots-clefs conduit à l'éclosion de tendances völkische très différentes les unes des autres. Dans la foule des auteurs allemands de tendance völkische, signalons-en quelques-uns qui ont été lus et appréciés à titres divers chez nous, de manière à ce que le lecteur puisse discerner plus aisément la nature du groupe que par l'intermédiaire d'une longue démonstration théorique: Houston Stewart Chamberlain, Adolf Bartels, Hans F.K. Günther, Ernst Bergmann, Erich et Mathilde Ludendorff, Herman Wirth et Erwin Guido Kolbenheyer.
Chez nous, quand la tendance völkische est évoquée, l'on songe tout de suite à Cyriel Verschaeve qui y a indubitablement sa place. Les mots-clefs volk (peuple) et taal (langue) peuvent toutefois nous induire en erreur car l'ensemble du mouvement flamand a pris pour axes ces deux vocables. Une fraction seulement de ce mouvement peut être considérée comme appartenant à la tendance völkische, notamment une partie de l'orientation grande-néerlandaise qui, explicitement, plaçait le «principe organique de peuple» (organische volksbeginsel), théorisé par Wies Moens (16), ou le «principe national-populaire», au-dessus de toutes autres considérations politiques et/ou philosophiques. Nous songeons à Wies Moens lui-même et à la revue Dietbrand, à Ferdinand Vercnocke, à Robrecht de Smet et sa Jong-Nederlandse Gemeenschap (Communauté Jeune-Néerlandaise), à l'aile dite Jong-Vlaanderen (Jeune-Flandre) de l'activisme (17), à l'anthropologue Dr. Gustaaf Schamelhout (18), etc.
Au sein de la tendance völkische a toujours coexisté, chez nous, une tradition basse-allemande (nederduits), à laquelle appartenaient Victor Delecourt et Lodewijk Vlesschouwer (qui participait, e.a., à la revue De Broederhand), le Aldietscher (Pan-Thiois) Constant Jacob Hansen (1833-1910) (19) et le germanisant plus radical encore Pol de Mont (1857-1931), qui déjà avant la première guerre mondiale avait développé son propre corpus völkisch.
Le groupe des Jungkonservativen
A rebours de volks (völkisch), le terme de jungkonservativ (jongkonservatief) n'a jamais, à ma connaissance, été utilisé dans nos provinces. En Allemagne, démontre Mohler, le terme jungkonservativ est le vocable classique qu'ont utilisé les fractions du mouvement conservateur qui, par l'adjonction de l'adjectif «jeune» (jung), voulaient se démarquer du conservatisme antérieur, purement «conservant» et réactionnaire, l'Altkonservativismus. Les Jungkonservativen s'opposent, en esprit et sur la scène politique, au monde légué par 1789 et tirent de cette opposition des conséquences résolument révolutionnaires. Les grandes figures du Jungkonservativismus, également connue hors d'Allemagne, sont notamment Oswald Spengler (20), Arthur Moeller van den Bruck (21), Othmar Spann, Hans Grimm et Edgar J. Jung.
Le peuple et la langue, concepts-clefs des Völkischen, ne sont certes pas niés par les Jungkonservativen, encore moins méprisés. Mais pour eux, ces concepts ne sont pas pertinents si l'on veut construire un ordre: ils conduisent à la constitution d'Etats nationaux fermés, monotone, comparables aux Etats d'inspiration jacobine. De plus, ces Etats précipitent l'Europe, continent qui n'a que peu de frontières linguistiques et ethniques précises, dans des conflits frontaliers incessants, dans des querelles d'irrédentisme, des guerres balkaniques. En pervertissant le principe völkisch, ils provoquent une extrême intolérance à l'encontre des minorités ethniques et linguistiques à l'intérieur de leurs propres frontières. De tels débordements, l'histoire en a déjà assez connus.
Le mot-clef pour les Jungkonservativen est dès lors le Reich. L'idée de Reich, prisée également dans les Bas Pays, n'implique pas un Etat fermé à peuple unique ni un Etat créé par un peuple conquérant sachant manier l'épée. Le Reich est une forme de vivre-en-commun propre à l'Europe, né de son histoire, qui laisse aux souches ethniques et aux peuples, aux langues et aux régions, leurs propres identités et leurs propres rythmes de développement, mais les rassemble dans une structure hiérarchiquement supérieure. Dans ce sens, explique Mohler, l'Etat de Bismarck et celui de Hitler ne peuvent être considérés comme des avatars de l'idée de Reich. Ce sont des formes étatiques qui oscillent entre l'Etat-Nation de type jacobin et l'Etat-conquérant impérialiste à la Gengis Khan.
En langue néerlandaise, Reich peut parfaitement se traduire par rijk. Dans d'autres langues, le mot allemand est souvent traduit à la hâte par des mots qui n'ont pas le même sens: «Empire» suggère trop la présence d'un empereur; «Imperium» fait trop «impérialiste»; «Commonwealth» suggère une association de peuples beaucoup plus lâche.
Mentionnons encore trois particularités qui nous donnerons une image plus complète du groupe jungkonservativ. D'abord, l'influence chrétienne est la plus prononcée dans ce groupe. L'idée médiévale de Reich est perçue par quelques-uns de ces penseurs jungkonservativ comme essentiellement chrétienne, qualité qui demeurera telle, affirment-ils, même si l'idée doit connaître encore des avatars historiques. Les Jungkonservativen chrétiens perçoivent la catholitas comme une force fédératrice des peuples, comme une sorte de ciment historique. Pour eux, cette catholitas ne semble donc pas un but en soi mais un instrument au service de l'idée de Reich.
Ensuite, ces Jungkonservativen cutlivent une nette tendance à peaufiner leur pensée juridique, à ébaucher des structures et des ordres juridiques idéaux. C'est en tenant compte de cet arrière-plan que le deuxième concept-clef de la sphère jungkonservative, en l'occurrence l'idée d'ordre, prend tout son sens. En dehors de l'Allemagne, c'est incontestablement ce concept-là qui a été le plus typique. Mohler écrit, à ce propos: «L'unité, à laquelle songent les Jungkonservativen (...) englobe une telle prolixité d'éléments, qu'elle exige une mise en ordre juridique».
 Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.
Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.
Dans les Bas Pays, plusieurs figures de la vie intellectuelle étaient apparentées au courant jungkonservativ. Songeons à Odiel Spruytte qui, malgré son ancrage profond dans le Mouvement Flamand, restait un défenseur typique de l'«universalisme» d'Othmar Spann (22). Aux Pays-Bas, citons Frederik Carel Gerretsen, historien, poète (sous le pseudonyme de Geerten Gossaert) et homme politique (actif, entre autres, dans la Nationale Unie).
Lorque l'on recherche les traces de l'idéologie jungkonservative dans nos pays, il faut analyser et étudier les concepts de solidarisme et de personnalisme: les tenants de cette orientation doctrinale appartenaient très souvent à la démocratie chrétienne. Les «navetteurs» qui oscillaient entre la démocratie chrétienne et la RC, version jungkonservative, étaient légion.
Le Jungkonservativ le plus typé, le seul à peu près qui ait vraiment fait école chez nous, c'est Joris van Severen. Chez lui, les concepts-clefs d'«ordre» et d'«élite» sont omniprésents; sa pensée est juridico-structurante, ce qui le distingue nettement des nationalistes flamands aux démarches protestataires et friands de manifestations populaires. Autre affinité avec les Jungkonservativen: sa tendance à chercher des interlocuteurs dans l'aile droite de l'établissement... Mais ce qui est le plus étonnant, c'est la similitude entre sa pensée de l'ordre et l'idée de Reich des Jungkonservativen de l'ère weimarienne: Joris van Severen refuse la thèse «une langue, un peuple, un Etat» et part en quête d'un modèle historique plus qualitatif, reflet d'un ordre supérieur, mais très éloigné de l'Etat belge de type jacobin, qui, pour lui, était aussi inacceptable. Dans cette optique, ce n'est pas un hasard qu'il se soit référé aux anciens Pays-Bas, dans leur forme la plus traditionnelle, celle du «Cercle de Bourgogne» du Reich de Charles-Quint. Jacques van Artevelde (23) en avait lancé l'idée au Moyen Age et elle avait tenu jusqu'en 1795. L'argumentation qu'a développé Joris van Severen pour étayer son idéal grand-néerlandais dans le sens des Dix-Sept Provinces historiques (24), et contre toutes les tentatives de créer un Etat sur une base exclusivement linguistique, est au fond très semblable à celle qu'avait déployé Edgar J. Jung lorsqu'il polémiquait avec les Völkischen pour défendre l'idée de Reich. A la fin des années 30, van Severen parlait de plus en plus souvent du «Dietse Rijk» (de l'Etat thiois; du Regnum thiois), utilisant dans la foulée le vieux terme de Dietsland (Pays Thiois) (25) pour bien marquer la différence qui l'opposait aux «nationalistes linguistiques» (26).
Les nationaux-révolutionnaires
Le troisième groupe, celui des nationaux-révolutionnaires, est un produit typique de la «génération du front» en Allemagne. Il est plus difficile à cerner pour nous, dans les Bas Pays. De plus, la plupart des auteurs nationaux-révolutionnaires sont peu connus chez nous. Friedrich Hielscher, Karl O. Paetel, Arthur Mahraun, pour ne nommer que les plus connus d'entre eux, sont très souvent ignorés, même par les politologues les plus chevronnés. D'autres, en revanche, sont beaucoup plus célèbres. Mais cette célébrité, ils l'ont acquise pendant une autre période et pour d'autres activités que leur engagement national-révolutionnaire. Ainsi, Ernst von Salomon acquit sa grande notoriété pour ses romans à succès. Otto et Gregor Strasser, à la fin de leur carrière, ont été connus du monde entier parce qu'ils ont été les compagnons de route de Hitler, avant de s'opposer violemment à lui et, pour Gregor, de devenir sa victime. Ernst Niekisch, lui, est souvent considéré à tort comme un communiste parce qu'après la guerre il a enseigné à Berlin-Est (27). Mais cette notoriété, due à des faits et gestes posés en dehors de l'engagement politique, fait que les nationaux-révolutionnaires sont en général très mal situés. On les considère comme des «nazis de gauche», ce qui est inexact dans la plupart des cas, sauf peut-être pour Gregor Strasser, assassiné sur ordre de Hitler en 1934. Ou bien on les considère comme des communistes sans carte du parti, ce qui n'est vrai que pour quelques-uns d'entre eux.
En réalité, l'attitude nationale-révolutionnaire est le fruit d'une étincelle jaillie du choc entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Les étincelles ne meurent pas si l'on parvient, grâce à elles, à allumer un foyer: ce que voulaient les nationaux-révolutionnaires. Ils considéraient plus ou moins les Völkischen comme des romantiques et des «archéologues» et les Jungkonservativen comme des individus qui voulaient construire du neuf avant que les ruines n'aient été balayées. Evacuer les ruines, mieux, contribuer énergiquement au déclin rapide du monde bourgeois, dénoncer la décadence capitaliste: voilà ce que les nationaux-révolutionnaires comprenaient comme leur tâche. Pour la mener à bien, ils présentait un curieux cocktail de passion sauvage et de froideur sans illusions, produit de leur expérience du front.
Mohler cite une phrase typique de Franz Schauwecker, figure de proue du «nationalisme soldatique»: «L'Allemand se réjouit de ses déclins parce qu'ils sont le rajeunissement». La gauche comme la droite sont dépassées pour les nationaux-révolutionnaires. Ils voulaient dépasser la gauche sur sa gauche et la droite sur sa droite. Pour eux, Staline était un conservateur et Hitler un libéral. Ce que les temps nouveaux apporteront, ils ne le savent pas trop: «mouvement», tel est le premier mot-clef. Le deuxième, c'est la «nation», celle qui est née dans les tranchées. Schauwecker décrit comment la réalité et la foi, comment l'instinct et la profondeur de la pensée, la nature et l'esprit ont fusionné. «Dans cette unité, la nation était soudainement présente». C'est cela pour eux, le nationalisme: la société allemande sans classes.
Au Pays-Bas, il y a eu une figure nationale-révolutionnaire bien typée: Erich Wichman (1890-1929), surnommé souvent avec mépris le «premier fasciste néerlandais», alors qu'il est très difficile de coller l'étiquette de fasciste (si l'on entend par fasciste, cette sorte de militaires d'opérette chaussés de belles bottes bien cirées) sur ce représentant impétueux de la bohème hollandaise, au visage déformé par un oeil de verre. Les noms des groupuscules qu'il a fondé De Rebelse Patriotten (Les Patriotes Rebelles), De Anderen (Les Autres), De Rapaljepartij (Le Parti de la Racaille) trahissent tous l'élan oppositionnel et le défi adressé à «tout ce qui est d'hier», assortis d'un résidu de foi nationale. A son ami, le Dr. Hans Bruch, il écrivit ces phrases révélatrices: «Je n'ai pas besoin de vous dire que, moi comme vous, nous souhaitons que les Pays-Bas et Orange soient au-dessus de tout! Mais... ce cri de guerre ne peut plus être un cri de guerre parce qu'il a été répété a satiété, éculé, galvaudé et usé par les nationalistes de vieille mouture; par de gros bonshommes tout gras affublés de moustaches tombantes, qui remplissent des salles de réunion pour se plaindre, se lamenter et se consumer en jérémiades parce que notre nation, hélas, n'a jamais eu assez de sentiment national. (...) Et nous, les combatifs, nous ne pouvons rien avoir en commun avec eux! Car, nous, nous ne voulons pas nous plaindre, mais agir. Mais nous ne voulons pas non plus pousser des cris de joie, car nous savons qu'en tant que peuple nous n'avons encore rien - nous avons la ferme volonté de mettre un terme définitif à notre misère!» (28).
La prose de Wichman, en violence et en radicalisme, ne cède en rien devant les phrases de Franz Schauwecker ou d'autres nationaux-révolutionnaires: «Tout, aujourd'hui, est cérébralisé et calculé. Il n'y a plus place en ce monde pour l'aventure, l'imprévu, l'élasticité, la fantaisie et la «démonie». La raison raisonnante la plus bête garde seule droit au chapitre. Dieu s'est mis à vivre peinard. Cette époque est morte, sans âme, sans foi, sans art, sans amour. (...) Ce n'est plus une époque, c'est une phase de transition mais qui peut nous dire vers où elle nous mène? Si tout devient autrement que nous le voulons — et pourquoi cela ne deviendrait-il pas autrement? On pourra une fois de plus nous appeler "les fous". Tout acte peut être folie, est en un certain sens une folie. Et celui qui craint d'être appelé un "fou", d'être un "fou", celui qui craint d'être une part vivante d'un tout vivant, celui qui ne veut pas "servir", celui qui ne veut pas être "facteur" en invoquant sa précieuse "personnalité" et ainsi faire en sorte qu'advienne un monde contraire à ses pensées, celui qui a peur d'être un «lépreux de l'esprit», qui ne veut être "particule", qui ne veut être ni une feuille dans le vent ni un animal soumis à la nécessité ni un soldat dans une tranchée ni un homme armé d'un gourdin et d'un revolver sur la Piazza del Duomo (ou sur le Dam); celui qui ne commence rien sans apercevoir déjà la fin, qui ne fait rien pour ne pas commettre de sottise: voilà le véritable âne! On ne possède rien que l'on ne puisse jeter, y compris soi-même et sa propre vie. C'est pourquoi, il serait peut-être bon de nous débarrasser maintenant de cette "République des Camarades", de cette étable de "mauvais bergers". Oui, avec violence, oui, avec des "moyens illégaux"! C'est par des phrases que le peuple a été perverti, ce n'est pas par des phrases qu'il guérira (Multatuli) (29). Donc, répétons-le: aux armes!».
Le type du national-révolutionnaire a également fait irruption sur la scène politique flamande, surtout dans les tumultueuses années 20. Notamment dans le groupe Clarté et dans sa nébuleuse, qui voulaient forger un front unitaire révolutionnaire regroupant les frontistes flamands (30), les communistes, les anarchistes et les socialistes minoritaires. On hésite toutefois à ranger des individus dans cette catégorie car l'engagement proprement national-révolutionnaire n'a quasi jamais été qu'une phase de transition: quelques flamingants radicaux ont tenté de trouver une synthèse personnelle entre, d'une part, un engagement nationaliste flamand et, d'autre part, une volonté de lutte sociale-révolutionnaire. Après une hésitation, longue ou courte selon les individualités, cette synthèse a débouché sur un national-socialisme plus proche du sens étymologique du mot que de la NSDAP, encore peu connue à l'époque. Chez d'autres, la synthèse conduisit à un engagement résolument à gauche, à un socialisme voire un communisme teinté de nationalisme flamand.
Boudewijn Maes (1873-1946) est sans doute l'une des figures les plus hautes en couleurs du microcosme «national-révolutionnaire» flamand. Ce nationaliste flamand libre-penseur (vrijzinnig) avait lutté contre les activistes pendant la première guerre mondiale parce qu'ils étaient trop bourgeois à son goût. Après 1918, il les défendit parce qu'il était animé d'un sens aigu de la justice et parce qu'il s'estimait solidaire du combat national flamand. Aussi parce qu'il voyait en eux des victimes de l'«Etat bourgeois» belge et donc des révolutionnaires potentiels. En 1919, il est élu au Parlement belge sur les listes du Frontpartij. Il y restera seulement deux ans. Dans des groupuscules toujours plus petits, notamment au sein d'un Vlaams-nationaal Volksfront, il illustra un radicalisme pur, dont il ne faut pas exagérer la portée, et par lequel il voulait dépasser les socialistes et les communistes sur leur gauche. Plus tard, il passa au socialisme et mourut communiste flamand.
A propos des deux derniers groupes de la RC allemande, nous pouvons être brefs. Les Bündischen, héritiers des célèbres Wandervögel, constituent un phénomène typique dans l'histoire du mouvement de jeunesse allemand, lequel a véritablement alimenté tous les cénacles de la RC. Notre mouvement de jeunesse flamand, depuis Rodenbach (31), en passant par l'Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS) (32), jusqu'au Diets Jeugdverbond, n'est pas comparable aux Bündischen sur le plan idéologique: la majeure partie des affiliés à l'AKVS, à ses successeurs et à ses émules, est restée, des années durant, fidèle à une sorte de tradition völkische catholisante. D'autres noyauteront l'aile droite de la démocratie chrétienne flamande. Cette communauté de tradition forme aujourd'hui encore le lien entre les groupes nationalistes flamands et certains cénacles du parti catholique. C'est l'idéologie de base que partagent notamment un journal comme De Standaard et les animateurs du pélérinage annuel à la Tour de l'Yser (IJzerbedevaart).
La Landvolkbewegung fut une révolte paysanne, brève mais violente, qui secoua le Slesvig-Holstein entre 1928 et 1932. On peut tracer des parallèles entre des événements analogues qui se sont produits au Danemark et en France mais, dans nos régions, nous n'apercevons aucun phénomène de même nature. Mohler lui-même, dans son Ergänzungsband (cf. références infra) de 1989, revient sur sa classification antérieure des strates de la RC en cinq groupes: la Landvolkbewegung a été de trop courte durée, trop peu chargée d'idéologie et trop dépendante d'orateurs issus d'autres groupes de la RC (surtout des nationaux-révolutionnaires) pour constituer à égalité un cinquième groupe.
Le fascisme défini
par les Staliniens
Mohler note que la littérature secondaire concernant la RC parue depuis 1972 (année de parution de la seconde édition de son maître-ouvrage) est devenue de plus en plus abondante et imprécise. La raison de cet état de choses: la propagation de la conception stalinienne du fascisme, y compris dans les milieux universitaires. «Cette conception, qui a l'élasticité du caoutchouc, est en fait un concept de combat, contenant tout ce que le stalinisme perçoit comme ennemi de ses desseins, jusque et y compris les sociaux-démocrates. Lorsque l'on parlait jadis du national-socialisme de Hitler ou du fascisme de Mussolini, on savait de quoi il était question. Mais le «fascisme allemand» peut tout désigner: la NSDAP, les Deutsch-Nationalen, la CDU, le capitalisme, Strauß comme Helmut Schmidt - et c'est précisément cette confusion qui est le but. Et bien sûr, la RC, elle aussi, aboutit dans cette énorme marmite».
Cette confusion a débouché d'abord sur une littérature tertiaire traitant du fascisme et dépourvue de toute valeur historique, ensuite sur des petits opuscules apologétiques qui «désinforment» en toute conscience. Prenons un exemple pour montrer comment le concept illimité de fascisme, propre au vocabulaire stalinien, s'est répandu dans le langage courant au cours des années 70 et 80: l'écrivain néerlandais Wim Zaal écrit un livre qui connaitra deux éditions, avec un titre chaque fois différent pour un contenu grosso modo identique. Ce changement de titre est révélateur. En 1966, l'ouvrage est titré De Herstellers (Les Restaurateurs). Il traite de plusieurs aspects de l'idéologie conservatrice-révolutionnaire aux Pays-Bas. La définition qu'il donne de cette idéologie n'est pas tout à fait juste mais elle a le mérite de ne pas être ambiguë et parfaitement concise; nous lui reprocherions de réduire l'univers conservateur-révolutionnaire à celui des adeptes de l'«ordre naturel», ce qui n'est pas le cas car d'autres traditions intellectuelles l'ont alimenté. Ecoutons sa définition: «Ce que visait le mouvement restaurateur, c'était précisément de restaurer l'ordre naturel du vivre-en-commun et de le débarrasser des maux que lui avait infligés les forces révolutionnaires à partir de 1780. Toutes les conséquences de ces révolutions n'étaient pas perverses mais leurs principes l'étaient». La seconde édition (remaniée) du livre paraît en 1973: elle traite du même sujet mais change de titre: De Nederlandse fascisten (Les fascistes néerlandais).
De Gorbatchev au Pape Jean-Paul II, de Reagan à Khomeiny, y a-t-il une figure de proue du monde politique ou de l'innovation idéologique qui n'ait jamais été traité de «fasciste» par l'un ou l'autre de ses adversaires? Dans de telles conditions, ne doit-on pas considérer que le mot est désormais vide de toute signification, du moins pour ce qui concerne le récepteur. En revanche, dans le chef de l'émetteur, le message est très clair; celui qui traite un autre de «fasciste», veut dire: «J'entends vous discriminer sur le plan intellectuel»; en d'autres mots: «Je refuse tout dialogue».
Ni dans cet article ni dans le travail de Mohler, le fait de dénoncer cet usage élastique du terme «fascisme» ne constitue pas une tentative d'évacuer du débat les rapports historiques réels qui ont existé entre, d'une part, la RC et, d'autre part, le fascisme ou le national-socialisme. La pensée révolutionnaire-conservatrice ne peut être purement et simplement réduite au rôle de «précurseur» de l'idéologie fasciste. ce serait trop facile et grotesque. A ce propos, Mohler écrit: «Tous ceux qui critiquent les idées de 1789 courent le risque de se voir étiquettés par les protagonistes de ces idées révolutionnaires de "pères fondateurs du fascisme" (ou du "nazisme") (...) D'Héraclite à Maître Eckehart, en passant par Paracelse et Luther, Frédéric le Grand, Hamann et Zinzendorf, pour aboutir à Schopenhauer et Kierkegaard, on peut, dans la foulée, construire les arbres généalogiques du fascisme les plus fantasmagoriques».
En réalité, parmi les protagonistes des idées conservatrices-révolutionnaires, on trouvera les appréciations et les attitudes les plus diverses vis-à-vis du fascisme, tant en Allemagne que dans nos pays. La prudence et la précision s'imposent. Quelques figures de la RC se sont en effet converties très vite et avec beaucoup d'enthousiasme au nazisme, comme, par exemple, un Alfred Bäumler ou un Ernst Kriek, ou, chez nous, un Herman van Puymbroeck (33), futur rédacteur-en-chef de Volk en Staat. D'autres ont vu leur enthousiasme s'évanouir rapidement, mais trop tard pour échapper à la mort: l'exemple de Gregor Strasser, assassiné le 30 juin 1934, un jour avant Edgar J. Jung, qui avait, lui, combattu le national-socialisme dès le début et avec la plus grande énergie. Thomas Mann et Karl Otto Paetel choisirent d'émigrer, tout comme Otto Strasser et Hermann Rauschning. Le national-révolutionnaire dur et pur, ennemi de Hitler, Hartmut Plaas, mourra en 1944 dans un camp de concentration tout comme l'avocat liégeois Paul Hoornaert, grand admirateur de Mussolini et chef de la Légion Nationale.
Pour d'autres encore, la collaboration mena à un ultime engagement dans la Waffen-SS, dont ils ne revinrent jamais; pour citer deux exemples, l'un flamand, l'autre néerlandais: Reimond Tollenaere (1909-1942) et Hugo Sinclair de Rochemont (1901-1942). Au cours de cette même année 1942, la collaboration était déjà un passé bien révolu pour un Henri De Man ou un Arnold Meijer, ex-chef du Zwart Front néerlandais. Quant à Tony Herbert, jadis figure symbolique de tout ce qui comptait à droite en Flandre dans les années 30, il était déjà entré de plein pied dans la résistance. Dans la véritable résistance à Hitler, derrière l'attentat du 20 juillet 1944, se profile une quantité de figures issues de la RC, notamment de la Brigade Ehrhardt, comme l'Amiral Wilhelm Canaris, le Général Hans Oster voire l'écrivain Ernst Jünger. Quant à l'homme qui, en 1945, dans le tout dernier numéro de Signal, la revue de propagande allemande qui paraissait dans la plupart des langues européennes pendant la guerre, publia un article pathétique pour marquer la fin du IIIième Reich, était une figure de la RC: Giselher Wirsing, issu du Tat-Kreis (34). En 1948, il participera à la fondation du journal Christ und Welt, dont il deviendra le rédacteur en chef en 1954 et le restera jusqu'à sa mort en 1975 (35).
Les noms que nous venons de citer ne constituent pas des exceptions. Loin de là. Tous répondent en quelque sorte à la règle. Mais comment expliquer à quelqu'un qui a été élevé sous l'égide du concept stalinien de fascisme, ou a reçu un enseignement universitaire marqué par ce concept, que c'est un fait historiquement attesté que dès le début de l'année 1933, le citoyen néerlandais Jan Baars (36), chef de l'Algemene Nederlandse Fascistenbond (ANFB; = Ligue Générale des Fascistes Néerlandais), envoie un télégramme à Hitler pour protester contre la persécution des Juifs (37). Le 30 janvier 1933, le jour où Hitler arriva au pouvoir, un autre télégramme partit de Hollande. Non pas envoyé par Jan Baars mais par l'association des étudiants catholiques d'Amsterdam, le cercle Thomas Aquinas. C'était un télégramme de félicitations. Précisons-le. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné.
Luc PAUWELS.
(texte paru dans la revue anversoise Teksten, Kommentaren en Studies, nr. 55, 2de Trimester 1989; adresse: DELTAPERS v.z.w., Postbus 4, B-2110 Wijnegem).
(1) cfr. Arthur De Bruyne, Cyriel Verschaeve - Hendrik De Man, West-Pocket, 4-5, De Panne, 1969.
Jos Vinks, Cyriel Verschaeve, de Vlaming, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1977.
Hugo Verriest (1840-1922) fut l'élève de Guido Gezelle au couvent théologique de Roeselare (Roulers). Nommé prêtre en 1864. Enseigne à Bruges, Roeselare, Ypres, Heule. Curé à Wakken, commune de la famille de Joris van Severen en 1888. Exerça une influence prépondérante sur le mouvement étudiant nationaliste d'Albrecht Rodenbach (la fameuse Blauwvoeterij).
A son sujet, lire: Luc Delafortrie, Reinoud D'Haese, Noël Dobbelaere, Antoon Van Severen, Rudy Pauwels, Dr. R. Bekaert, Hugo Verriest - Joris Van Severen, Komitee Wakken, Wakken, 1984.
(2) Frank Goovaerts, «Odiel Spruytte. Een vergeten konservatief-revolutionnair denker in Vlaanderen», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 55/1989.
(3) Sur De Man en français: André Philip, Henri De Man et la crise doctrinale du socialisme, Librairie universitaire J. Gambier, Paris, 1928.
Revue européenne des sciences sociales, Cahiers Vilfredo Pareto, Tome XII, 1974, n°31 («Sur l'œuvre de Henri De Man»).
Michel Brelaz, Henri De Man. Une autre idée du socialisme, Ed. des Antipodes, Genève, 1985.
En guise d'introduction générale: Robert Steuckers, «Henri De Man», in Etudes et Recherches, GRECE, Paris, n°3, 1984.
En anglais: Peter Dodge, Beyond Marxism. The Faith and Works of Hendrik De Man, M. Nijhoff, The Hague (NL), 1966.
(4) Léon van der Essen, Pages d'histoire nationale et européenne, Les Œuvres/Goemare, Bruxelles, 1942.
Léon van der Essen, Alexandre Farnèse et les origines de la Belgique moderne, 1545-1592, Office de publicité, Bruxelles, 1943.
Léon van der Essen, Pour mieux comprendre notre histoire nationale, Charles Dessart éd., s.d.
(5) Robert Poulet, La Révolution est à droite. Pamphlet, Denoël et Steele, Paris, 1934.
(6) Frederic Kiesel, Pierre Nothomb, Pierre de Meyere éd., Paris/Bruxelles, 1965.
(7) Charles Anciaux, L'Etat corporatif. Lois et conditions d'un régime corporatif en Belgique, ESPES, Bruxelles, 1942.
(8) Dr. Sun Ya-Tsen, The Three Principles of the People, China Publishing Company, Taipei R.O.C., 1981.
(9) August Vermeylen, écrivain flamand, né à Bruxelles en 1872 et mort à Uccle en 1945. Etudie à Bruxelles, Berlin et Vienne. Il enseignera à Bruxelles et à Gand. Sera démis de ses fonctions par les autorités allemandes en 1940. Influence de Baudelaire et du mouvement décadent français mais défenseur de la langue néerlandaise. Co-fondateur de la revue littéraire Van Nu en Straks. Individualiste anarchisant à ses débuts, il évoluera vers un socialisme communautaire, justifié par un panthéisme dynamique. Son œuvre la plus célèbre est De wandelende Jood (Le Juif errant), illustrant la quête de la vérité en trois phases: la jouissance sensuelle, l'ascèse et le travail.
(10) Hendrik J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, 4 delen, Uitg. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1971. Ces quatre volumes retracent l'histoire intellectuelle du mouvement flamand et recense minutieusement les influences diverses qu'il a subies, notamment celles venues des Pays-Bas, d'Allemagne et de Scandinavie. Ces ouvrages sont indispensables pour comprendre les lames de fond non seulement de l'histoire flamande mais aussi de l'histoire belge.
(11) Mohler se réfère surtout au livre de Michael Freund, Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus (V. Klostermann, Frankfurt a.M., 1972). De même qu'aux passage que consacre Carl Schmitt à Sorel dans Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1926), aujourd'hui disponible en français sous le titre de Démocratie et Parlementarisme (Seuil, 1988).
(12) Sorel a exercé une incontestable influence sur le philosophe martyr José Streel (1910-1946), idéologue du rexisme et auteur, entre autres, de La Révolution du XXième siècle (Nouvelle Société d'Edition, Bruxelles, 1942). Dans cet ouvrage concis, on repère aussi l'influence prépondérante de Péguy, Maurras et De Man. Sur José Streel, lire ce qu'en écrit Bernard Delcord, «A propos de quelques "chapelles" politico-littéraires en Belgique (1919-1945)», in Cahiers du Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale/Bijdragen van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Bruxelles, Ministère de l'Education nationale/Ministerie van Onderwijs, Archives Générales du Royaume - Algemeen Rijksarchief, Place de Louvain 4 (b.19), Bruxelles, 1986. On lira de même toutes les remarques que formule à son sujet le Prof. Jacques Willequet dans La Belgique sous la botte, résistances et collaborations, 1940-1945, Ed. Universitaires, Paris, 1986. Signalons aussi que José Streel fut l'un des artisans de l'accord Rex-VNV, règlant, dans le cadre de la collaboration, le problème linguistique belge.
(13) J. De Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid, N.V. Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, 1939.
(14) Sur Joris Van Severen, lire: L. Delafortrie, Joris Van Severen en de Nederlanden, Oranje-Uitgaven, Zulte, 1963.
Jan Creve, Recht en Trouw. De Geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Soethoudt, Antwerpen, 1987.
(15) Arthur De Bruyne, Joris Van Severen, droom en daad, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1961-63.
(16) Le poète Wies Moens (1898-1982) fut un activiste (un «collaborateur») pendant la première guerre mondiale. Il étudia à l'Université de Gand de 1916 à 1918. Il purgera quatre ans de prison pour ses sympathies nationalistes. Il fondera les revues Pogen (1923-25) et Dietbrand (1933-40). En 1945, il est condamné à mort mais trouve refuge aux Pays-Bas pour échapper à ses bourreaux. Il fut le principal représentant de l'expressionnisme flamand et entretint des liens avec Joris Van Severen, avant de rompre avec lui.
Cfr. Erik Verstraete, Wies Moens, Orion, Brugge, 1973.
(17) L'activisme est la collaboration germano-flamande pendant la première guerre mondiale. A ce propos, lire: Maurits van Haegendoren, Het aktivisme op de kentering der tijden, Uitgeverij De Nederlanden, Antwerpen, 1984.
(18) Frank Goovarts, «Dr. G. Schamelhout, antropologie en Vlaamse Beweging», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 42, 1985. Le Dr. G. Schamelhout peut être considéré comme un élève de Georges Vacher de Lapouge. Il s'est intéressé également aux ethnies européennes.
(19) Le mouvement pan-thiois (Alldietscher Beweging) visait à unir toutes les «tribus» basses-allemandes, soit néerlandaises et allemandes du nord, en forgeant un Etat qui aurait rassemblé les Pays-Bas, la Belgique (avec les départements français du Nord et du Pas-de-Calais), la Prusse, le Hanovre, le Oldenbourg, etc. La langue de cet Etat aurait été une synthèse entre le néerlandais actuel et les dialectes bas-allemands. A ce sujet, lire: Ludo Simons, Van Duinkerke tot Königsberg. Geschiedenis van de Alldietsche Beweging, Orion, Brugge, 1980.
(20) Sur Spengler, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Gilbert Merlio, Oswald Spengler, témoin de son temps, Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, Stuttgart, 1982 (deux volumes).
(21) Sur Arthur Moeller van den Bruck, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Denis Goeldel, Moeller van den Bruck (1876-1925), un nationaliste contre la révolution, Peter Lang, Frankfurt a.M./Bern, 1984.
(22) Deux livres récents sur Spann: Walter Becher, Der Blick aufs Ganze. Das Weltbild Othmar Spanns, Universitas, München, 1985.
J. Hanns Pichler (Hg.), Othmar Spann oder die Welt als Ganzes, Böhlau, Wien, 1988.
(23) Pour comprendre le mouvement d'unité dans les Bas Pays au Moyen Age, lire Léon Vanderkinderen, Le siècle des Artevelde. Etudes sur la civilisation morale et politique de la Flandre et du Brabant, J. Lebègue & Cie, Bruxelles, 1907.
(24) Les dix-sept provinces regroupent les pays suivants dans l'optique de Joris Van Severen et de ses adeptes de jadis et d'aujourd'hui: la Frise, le Groningue, la Drenthe, l'Overijssel, le Pays de Gueldre, le Pays d'Utrecht, la Hollande, la Zélande, le Brabant, le Limbourg (Limbourg historique, Limbourg belge, soit l'ex-Comté de Looz, Limbourg néerlandais contemporain), le Pays de Liège, le Pays de Namur, le Luxembourg (Grand-Duché, Luxembourg belge et Pays de Thionville/Diedenhofen), le Hainaut, la Flandre, l'Artois et la Picardie.
(25) Le terme néerlandais de «Dietsland» se traduit en français par «Pays Thiois». Le long de la frontière linguistique, en Pays de Liège, on trouve également la forme «tixhe», typique de l'ancienne graphie liégeoise. On parle également de «Lorraine thioise» pour désigner la partie allemande de la Lorraine.
(26) Van Severen semble être le seule représentant de la RC dans nos pays à avoir utiliser et revendiquer le terme de «conservateur-révolutionnaire». C'était dans un article du 23 juillet 1932, paru dans De West-Vlaming. Cité par Arthur De Bruyne, op. cit., p. 140.
Rappelons qu'une querelle demeure sous-jacente entre, d'une part, le nationalisme à base exclusivement linguistique, rêvant d'un Etat néerlandais unissant la Flandre et les Pays-Bas, et, d'autre part, les adeptes des Dix-Sept Provinces Unies, regroupant les régions néerlandophones, wallonophones, picardophones et germanophones de l'ancien «Cercle de Bourgogne».
(27) Pour comprendre l'itinéraire d'Ernst Niekisch, lire Uwe Sauermann, Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus, Bibliothekdienst Angerer, München, 1985.
(28) Cité par Wim Zaal dans De Nederlandse Fascisten, Wetenschapelijke Uigeverij, Amsterdam, 1973.
(29) Multatuli est le pseudonyme d'Eduard Douwes Dekker (1820-1887), écrivain néerlandais, pionnier de la colonisation de l'Indonésie. Lecteur de Nietzsche, il se posera en partisan d'une monarchie éclairée et d'un système d'éducation non étouffant. Son roman le plus célèbre est Max Havelaer, une chronique assez satirique de la colonie néerlandaise en Indonésie.
(30) Le frontisme est le mouvement politique des années 20 en Flandre, porté par les soldats revenus du front. Sur la scène électorale, il se présentait sous la dénomination de Frontpartij. Ce mouvement d'anciens soldats du contingent était pacifiste et soucieux de ne plus verser une seule goutte de sang flamand pour la France, considérée comme ennemie mortelle des peuples germaniques et du catholicisme populaire.
(31) Albrecht Rodenbach (1856-1880), jeune poète flamand, formé au séminaire de Roeselare (Roulers), élève de Hugo Verriest (cf. supra), fonde, en entrant à la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, le mouvement étudiant flamand, la Blauwvoeterij. Ses poèmes mêlent un catholicisme charnel et sensuel, typiquement flamand, à un paganisme wagnérien, nourri de l'épopée des Nibelungen: un contraste étonnant et explosif...
A son sujet, lire: Cyriel Verschaeve, Albrecht Rodenbach. De Dichter, Zeemeeuw, Brugge, 1937.
(32) L'AKVS publie toujours une revue, AKVS-Schriften. Adresse: AKVS-Schriften, c/o Paul Meulemans, Kruisdagenlaan 75, B-1040 Brussel. Tél.: 02/734.25.52.
(33) La radicalité des positions de H. Van Puymbrouck transparaît dans le texte d'une brochure publiée à Berlin en 1941 et intitulée Flandern in der neuen Weltordnung (Verlag Grenze und Ausland, Berlin, 1941) et rééditée en 1985 par Hagal-Boeken, Speelhof 10, B-3840 Borgloon.
(34) Sur le Tat-Kreis, cfr.: Klaus Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution, Fluchtwege in der Krise der bürgerlichen Gesellschaft: Das Beispiel des «Tat-Kreises», edition Suhrkamp, es 778, Frankfurt a.M., 1976. Ouvrage très critique mais qui révèle les grandes lignes de l'idéologie du Tat-Kreis.
(35) A propos de Giselher Wirsing, on lira avec profit le texte que lui a consacré Armin Mohler au moment de sa mort en 1975 («Der Fall Giselher Wirsing») et repris dans son recueil intitulé Tendenzwende für Fortgeschrittene, Criticón Verlag, München, 1978.
(36) Jan Baars, né le 30 juin 1903, fit partie de la résistance néerlandaise pendant la guerre. Il est décédé le 24 avril 1989.
(37) Wim Zaal, op. cit., p.119.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, années 20, années 30, révolution conservatrice, droite, conservatisme, nouvelle droite, idéologie, sciences politiques, politologie, philosophie, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 janvier 2010
La excepcion en Carl Schmitt - Una exposicion introductoria
La excepción en Carl Schmitt
Una exposición introductoria
Christian Reátegui / Ex: http://la-coalicion.blogspot.com/

La previsión de una dictadura comisarial en los dos últimos textos constitucionales peruanos ha pasado inadvertida. Para comenzar, la positivización del concepto jurídico de medida en dichos textos constitucionales ha pasado sin mayores comentarios. Tanto en la Constitución peruana de 1979 como en la de 1993 podemos leer textos similares:
Constitución de 1979“Artículo 211º.- Son obligaciones y atribuciones del Presidente de la República:
...
18.- Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y la soberanía en caso de agresión.”
Constitución de 1993
"Artículo 118º.- Corresponde al Presidente de la República:
...
15.- Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado".
Se ha dicho que los constituyentes peruanos de 1979 adoptaron la fórmula de la empleada en el artículo 16 de la Constitución francesa de 1958, que fue a su vez recogida del texto del famoso artículo 48 de la Constitución de Weimar (1919). Lo que es menos conocido es que este artículo 48 fue el centro de un debate jurídico rico e intenso en la Alemania de esos años acerca de sus alcances y, en última instancia, acerca del concepto de Constitución, debate en el que el concepto de medida (maßnahme) desempeñó un papel central. Para el jurista alemán Carl Schmitt dicho artículo sustentaba la posibilidad de una Dictadura del Presidente del Reich. Es más, dicho artículo devenía en el referente interpretativo de toda la Constitución:
“Artículo 48. Si un Land no cumpliese con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en la Constitución o en una Ley del Reich, el Presidente del Reich podrá hacérselas cumplir con ayuda de las Fuerzas Armadas.
Si la seguridad y el orden públicos se viesen gravemente alterados o amenazados, el Presidente del Reich podrá adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de la seguridad y orden públicos, utilizando incluso las Fuerzas Armadas si fuera necesario. A tal fin puede suspender temporalmente el disfrute total o parcial de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153.
El Presidente del Reich está obligado a informar inmediatamente al Reichstag de la adopción de todas las medidas tomadas conforme a los párrafos 1º y 2º de este artículo. Las medidas deberán ser derogadas a petición del Reichstag.
En caso de peligro por demora, el Gobierno de cualquier Land podrá aplicar provisionalmente medidas de carácter similar a las referidas en el párrafo 2º de este artículo. Las medidas deberán ser derogadas a petición del Reichstag o del Presidente del Reich.
Una ley del Reich desarrollará el resto"
Para Schmitt el párrafo 2º, primera parte, de este artículo contiene el fundamento constitucional de un apoderamiento para una comisión de acción ilimitada, en términos precisos, una dictadura comisarial. Sobre la verificación o no del presupuesto (alteración o amenaza de la seguridad y del orden públicos) para dicho apoderamiento, decide de por sí el Presidente. De acuerdo a Schmitt, el párrafo 2º, en su parte primera, constituía derecho vigente y no requería la ley que desarrollara el estado de excepción que preveía el 5º párrafo. Ante el acaecimiento de alteración o amenaza de la seguridad y del orden públicos, el Presidente podía adoptar todas las medidas necesarias (nötigen Maßnahmen), cuya necesidad era evaluada de acuerdo a las circunstancias y al solo arbitrio del propio Presidente. En consecuencia la dictadura Presidencial cuya posibilidad preveía la Constitución de Weimar, se concretizaba en la adopción de medidas.
Para Schmitt una medida era una acción individualizada o una disposición general, adoptada frente a una situación concreta que se considera anormal, y que es, por lo tanto, superable, con una pretensión de vigencia por tiempo no indefinido. Una medida se caracteriza por su dependencia de la situación objetiva concreta. Ello supone que la magnitud de la medida, su procedimiento y su eficacia jurídica dependen de la naturaleza de las circunstancias. El aforismo latino rebus sic stantibus preside su adopción y ejecución. Ahora bien, la dictadura comisarial desarrollada por Schmitt no significaba la disolución del orden jurídico existente ni que el Presidente deviniese en soberano, ya que las medidas era sólo de naturaleza fáctica y no podían ser equiparadas con actos de legislación ni de administración de justicia, sin que ello significase que no se pudiesen tomar medidas que se aproximaran por sus resultados y consecuencias prácticas a fallos judiciales, decisiones administrativas conseguidas tras un procedimiento previamente establecido o a normas generales (leyes y/o reglamentos), pero que jurídicamente no serían equiparables en significado ni en eficacia jurídicas. Esto porque una medida no podía reformar, derogar o suspender preceptos constitucionales, pero sí podía desconocerlos, separándose de ellos para un caso concreto o una generalidad de casos concretos, en lo que Schmitt llamaba “quebrantamiento” (durchbrechung) de la Constitución. Hay que apuntar que, de acuerdo a Schmitt, hay que distinguir entre Constitución y leyes constitucionales. La Constitución sería la decisión de conjunto de un pueblo acerca de la forma y modo de su unidad política, mientras que las leyes constitucionales serían los preceptos o normas que, por una razón u otra, han sido recogidas en el texto constitucional. Entonces para nuestro autor la Constitución es intangible, mientras que las leyes constitucionales (preceptos o normas) no, por lo que pueden ser “quebrantadas” por las medidas para un caso determinado o casos determinados, y ello sólo en defensa de la propia Constitución en estados de excepción. Hay que precisar que cualquier ley constitucional podría ser desconocida puntualmente por las medidas (o “quebrantada”) y no sólo las que contienen derechos fundamentales, como sucede con lo permitido por la norma de la segunda parte del párrafo 2º como más adelante veremos.
Un ejemplo para clarificar la diferencia entre medida y decisión administrativa, sería la que da el propio Schmitt a propósito de lo establecido en el artículo 129º de la Constitución de Weimar. Este artículo preveía una serie de garantías a favor de los funcionarios, así, sólo podrían ser privados de su cargo mediante un procedimiento conforme a Derecho, tenían la posibilidad de interponer recursos impugnatorios, el respeto a sus derechos adquiridos, etc. A pesar de ello, a través de una medida se podría suspender a determinados funcionarios y confiar su cargo a otras personas. Tales medidas tendrían efectos o resultados jurídicos, pero no la eficacia de una decisión adoptada tras un proceso disciplinario que concluyese con la separación definitiva del cargo del funcionario. Esto significa que el funcionario suspendido continuaría disfrutando (jurídicamente) de su status de funcionario, situación que no se daría con el separado jurídicamente del servicio. Asimismo, la persona encargada, mediante una medida, del cargo y de sus tareas públicas no conseguiría, por ello, alcanzar la situación jurídica de funcionario.
Para Schmitt no escapó que esta comisión para una dictadura presidencial, entraba en contradicción con lo establecido en la segunda parte de ese mismo 2º párrafo, que para él contenía otra norma que, junto al apoderamiento general de su primera parte, determinaba que para conseguir el restablecimiento de la seguridad y el orden públicos, el Presidente del Reich también podía suspender (suspension), es decir, poner temporalmente fuera de vigencia, en todo o en parte, a los derechos fundamentales contenidos en las leyes constitucionales de los artículos 114º (libertad personal), 115º (inviolabilidad del domicilio), 117º (secreto de la correspondencia y de correo), 118º (libertad de prensa), 123º (libertad de reunión), 124º (libertad de asociación) y 153º (propiedad privada). Esta contradicción, que, por un lado, permitía suspender toda el ordenamiento jurídico existente y, por otro, sólo permitía suspender una serie de derechos enumerados taxativamente, se debía, según Schmitt, a la confusión entre dictadura soberana y comisarial, que supone el considerar que el Presidente del Reich podía emitir ordenanzas con fuerza de ley sin considerar la distinción entre ley y medida y la asignación de competencias que conformaba la Constitución del Reich, y a la creencia ingenua que, en el Estado de Derecho burgués, la seguridad sólo podría ser puesto en peligro por individuos o grupos de individuos en tumultos y motines, no por organizaciones políticas, colectivos o agrupaciones solidarias, ya que los grupos intermedios y gremios de este tipo habían desaparecido.
Esta misma contradicción, entre la existencia del establecimiento de una dictadura presidencial (artículos 211 numeral 18 de la Constitución de 1979, y 118 numeral 15 de la Constitución de 1993) con la de un régimen de excepción limitado (artículos 231 de la Constitución de 1979, y 137 de la Constitución de 1993) se ha dado, a nuestro entender, tanto en la Constitución peruana anterior como en la actual. Basta con leer el artículo 231º de la Constitución de 1979 y el 137º de la que nos rige actualmente:
Constitución de 1979
"Artículo 231.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, decreta, por plazo determinado, en todo o parte del territorio y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
a.- Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede suspender las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, que se contemplan en los incisos 7, 9 y 10 del artículo 2º y en el inciso 20-g del mismo artículo 2º. En ninguna circunstancia se puede imponer la pena de destierro. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. La prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando lo dispone el Presidente de la República.
b.- Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, o guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con especificación de las garantías personales que continúan en vigor. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso”
Constitución de 1993
“Artículo 137.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
1.- Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2º y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
El plazo de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
2.- Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso".
El que el artículo 55 de la Constitución actual, que prescribe que los tratados celebrados por el Estado, y que se encuentren en vigor, forman parte del derecho nacional, y la 4º Disposición Final y Transitoria que dispone que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre dichas materias ratificadas por el Perú, pueden dar la impresión que el problema jurídico se ha zanjado. Ello puede ser considerado efectivamente así, pero pasa por alto que toda disciplina jurídica que pretende tener vigencia en el tiempo, es decir, eficacia social, no puede responder a autoengaños a partir de visiones ideologizadas de experiencias pasadas. Sobre ello queda mucho por abundar aún.
00:16 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, révolution conservatrice, sciences politiques, philosophie, politologie, droit, décisionnisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 janvier 2010
Démocratie américaine et dialectique de la liberté
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Démocratie américaine et dialectique
de la liberté
à propos d'un livre de Gottfried Dietze
par Hans-Dietrich SANDER
Parmi les livres dignes d'intérêt récemment parus, et soumis à la conspiration du silence, il y a l'ouvrage sur l'Amérique de Gottfried Dietze:
Gottfried Dietze, Amerikanische Demokratie — Wesen des praktischen Liberalismus, Olzog Verlag, München, 1988, 297 S., DM 42.
Depuis longtemps déjà, l'auteur n'avait plus publié d'articles dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung et dans Die Welt (Bonn). Il n'est plus membre de la Mount Pelerin Society. Il s'en est retiré, parce qu'il ne lui a pas été permis de prononcer son discours sur Kant en langue allemande lors d'une diète de la dite société à Berlin! Mais personne en revanche n'a pu le traiter de «terroriste intellectuel». Gottfried Dietze est professeur ordinaire de «théorie comparée des pouvoirs» à la John Hopkins University de Baltimore, l'une des cinq universités les plus cotées aux Etats-Unis (sa faculté occupe d'ailleurs la première place en son domaine). Ses travaux, il les publie en Allemagne chez J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) et chez Duncker & Humblot, c'est-à-dire chez les meilleurs éditeurs de matières politologiques. La maison Olzog, qu'il a choisie pour éditer son livre sur l'Amérique, ouvrage destiné à un public plus vaste, ne suscite pas davantage les colères des professionnels hystériques qui entendent façonner l'opinion publique selon leurs seuls critères. La démocratie ouest-allemande vient manifestement d'atteindre un seuil critique, où, désormais, ceux qui prononcent des paroles libres, claires, transparentes, passent pour des excentriques. Et, «notre démocratie», pour reprendre les mots de son Président Richard v. Weizsäcker, ne peut pas se permettre des excentriques politiques.
Critique du libéralisme pur et réminiscences tocquevilliennes
Dietze passe depuis longtemps déjà pour un excentrique dans notre bonne république. Pour être exact, depuis que le Spiegel a découvert, jadis, qu'il servait de conseiller au candidat à la Présidence américaine Barry Goldwater, et cela, au moment où la guerre du Vietnam atteignait son point culminant. Toute évocation de son nom, à l'époque, suscitait la suspicion. Il a tenté de revenir en Allemagne, en y postulant un poste universitaire. Sans succès. Le dernier des grands théoriciens du libéralisme politique n'est pas le bienvenu dans la République fédérale, acquise pourtant aux principes du libéralisme. Cette situation n'est pas incompréhensible. Elle découle, d'une part, du rapport même que Dietze entretient avec l'idéologie libérale et, d'autre part, de son engagement politique aux côtés de Goldwater. La modestie de Dietze est telle, qu'il n'a pas osé paraphraser Kant dans les sous-titres de ses ouvrages majeurs, Reiner Liberalismus (Le libéralisme pur) et Amerikanische Demokratie (La démocratie américaine). Au premier, il aurait parfaitement pu donner le titre de Kritik des reinen Liberalismus (Critique du libéralisme pur); au second, Kritik des praktischen Liberalismus (Critique du libéralisme pratique). Il aurait ainsi imité le grand penseur de Königsberg, avec sa Critique de la raison pure et sa Critique de la raison pratique.
Le titre du livre qui me préoccupe ici, Amerikanische Demokratie, paraphrase pourtant un autre grand théoricien politique, Alexis de Tocqueville, auteur de La démocratie en Amérique. Mais Dietze adopte une perspective critique à l'endroit des idées de Tocqueville. Il cherche à donner d'autres définitions aux concepts. Contrairement à Tocqueville, qui, il y a 150 ans, voulait explorer l'essence de la démocratie à la lumière de la démocratie américaine, Dietze cerne la démocratie américaine en soi, qui, dans la forme qu'elle connaît aujourd'hui, n'existait pas encore vers 1830-40, sa transformation radicale par Andrew Jackson n'en étant qu'à ses premiers balbutiements. La démocratie américaine, explique Dietze, est fondamentalement différente des autres démocraties, ce qui la rend précaire quand elle est imposée à d'autres pays.
La néomanie américaine
Dietze approche son sujet en analysant les phénomènes et les discours de la quotidienneté américaine, de la banalité quotidienne de l'American Way of Life, qui, soutenu par cette bonne conscience typique du «Nouveau Monde», se présente comme une poussée incessante vers la nouveauté (Drang nach dem Neuen), vers tout ce qui est nouveau. Le concept américain de liberté repose sur un fondement problématique: en l'occurrence sur la volonté d'être toujours prêt à réceptionner cette nouveauté. Ensuite, ce concept trouve son apogée dans la notion de Manifest Destiny, du destin et de la mission de l'Amérique, qui est d'apporter cette liberté à tous les autres peuples. Dans la foulée de ses possibilités illimitées, la démocratie américaine n'a pas créé une forme spécifique de libéralisme politique mais des variations libérales toujours changeantes.
Ce type de démocratie a très fortement marqué le peuple américain et, à l'inverse, le peuple a marqué la démocratie américaine. Les origines des Etats-Unis, faites d'émigrations et d'immigrations, se sont transformées en migrations et en vagabondages, en manifestations et en agitations. Le résultat: une absence permanente de racines, qui trouve un parallèle saisissant dans le monde juif toujours dé-localisé (ent-ortet). Cette absence de racines est la condition première de la symbiose actuellement dominante. Contrairement aux symbioses d'antan, cette symbiose actuelle ne présente pas une panoplie de négations qui se combinent utilement à des positions données, mais une gamme de négations qui s'imposent sur la scène publique en se créant du tort les unes aux autres.
Une pulsion jamais assouvie de liberté jouissive
Le pouvoir du peuple en Amérique oscille ainsi de la démocratie élitaire à la démocratie égalitaire, de la démocratie représentative à la démocratie directe, de la démocratie limitée à la démocratie illimitée. Quelle vue d'ensemble cela donne-t-il? Celle d'un «pot-pourri dans le melting pot»; par «melting pot», nous n'entendons pas, ici, le seul mélange des races et des ethnies. Ce jeu chaotique dérive précisément de cette pulsion incessante vers la nouveauté et se maintient par la force intrinsèque dégagée par cette pulsion. Il dérive des droits inaliénables à jouir de la triade life, liberty and pursuit of happiness, d'une liberté toujours plus grande qui se mesure surtout à la possession de biens matériels et à leur jouissance. Dans une telle optique, le pays n'est rien, l'individu est tout.
Ce serait bien là le perpetuum mobile d'un monde totalement immanent, si la pulsion de liberté n'était pas pluri-signifiante et à strates multiples. Dans son analyse, Gottfried Dietze déploie une dialectique de la liberté, où sa position vis-à-vis du libéralisme prend des formes socratiques. En effet, le livre, en de longs passages, se lit comme un dialogue, où chaque facette est opposée à son contraire (son négatif), si bien qu'à la fin, on débouche sur des questions ouvertes.
La pulsion de liberté du libéralisme pur n'est pas seulement dirigée contre les tyrans: elle s'épuise dans la lutte interne de concurrences diverses aux frais des autres. Cela ne nous mène pas seulement à la lutte hobbesienne de tous contre tous, lutte où apparaîtrait juste la crainte de Hegel de voir l'homme considérer qu'une telle liberté autorise et prône le vol, le meurtre et le désordre, mais aussi à une exploitation despotique de la minorité par la majorité, ce qui serait parfaitement conciliable avec le libéralisme, parce qu'il exige plus de liberté pour l'individu sans regard pour les autres.
La transposition de cette émancipation dans le domaine de la libido, comme on a pu l'observer au cours de ces dernières décennies en Amérique, fait que cette pulsion, sans regard pour autrui, qui poursuit sa quête insatiable de bonheur conduit à une «jungle sexuelle» que Hobbes n'avait pas pu imaginer.
Une symbiose entre
Jefferson et Freund
La permissivité engendrée par la lutte concurrentielle outrancière et la multiplication des contacts sexuels, où la question du bien et du mal n'est plus posée, a forgé une symbiose entre Jefferson et Freud, dont les conséquences excessives ne peuvent surgir qu'en Amérique: «Les idées de Freud, telles qu'elles ont été prises en compte et perçues par les Américains, ont complété celles de Jefferson —du moins dans les interprétations qu'elles avaient acquises au cours du temps; elles les ont complétées de façon telle que le pensée libérale ancrée dans ce peuple s'est vue considérablement élargie, s'est apurée à l'extrême et s'est détachée de tout contexte axiologique».
Sur le plan de la liberté, nous apercevons très vite la différence essentielle entre Tocqueville et Dietze. Tocqueville voyait une démocratie américaine liée à l'idée d'égalité, suscitant une tendance générale et progressive à expulser toute notion de liberté. Dietze, au contraire, voit dans la liberté le pôle adverse de la démocratie et de l'égalité; et, pour lui, la liberté est tout aussi illusoire que la démocratie et l'égalité. Ce que Tocqueville craignait jadis, soit de voir advenir une dictature égalitaire de la démocratie, n'a pas eu lieu: la pulsion de liberté s'y est sans cesse heurtée et en a émoussé les contours.
La pulsion de liberté, en tant que fondement ultime du libéralisme à l'américaine, s'est toujours mise en travers de toutes les mesures de contrôle, d'équilibrage et de conservation. Sans ces mesures, le libéralisme devient un mouvement anti-autoritaire. De ce fait, le despotisme de la majorité et le mouvement anti-autoritaire sont les extrêmes du libéralisme pratique, extrêmes qui se rejoignent dans le libéralisme pur. Prenons deux exemples.
Une presse libre qui censure
ce qui ne lui plaît pas
Le premier montre comment l'expression «presse populaire» a acquis un sens ambigu. La presse, qui, à l'origine, était un instrument servant à presser des lettres sur du papier, a fini très vite par presser ses vues dans les cerveaux du peuple, à la manière la plus libérale qui soit: «L'ancienne liberté de presse, soit la liberté de la presse vis-à-vis de toute censure étatique, s'est transformée radicalement: elle est devenue liberté pour la presse de censurer, dénoncer et vilipender l'Etat, des citoyens individuels et des groupes précis de la société d'une manière éhontée, nuisant aux cibles infortunées et profitant à ceux qui usent et abusent de cette liberté. Cette situation s'observe dans tous les pays où la presse est libre mais elle est plus frappante encore aux Etats-Unis, écrit Dietze, le plus libéral des pays».
Le deuxième exemple nous montre les possibilités illimitées que laisse entrevoir le jeu de mot democracy/democrazy, où le «pouvoir du peuple» apparaît comme l'«enfollement du peuple». Dietze souligne à plusieurs reprises que la quintessence de la démocratie américaine ne permet pas de percevoir cet «enfollement» comme une dégénérescence. Car la quintessence de la démocratie américaine, c'est que son libéralisme est réellement sans principes, dépourvu de tout point de référence éthique et de toute forme de responsabilité.
Les déceptions des Européens face à l'extrême versatilité américaine ne sont dès lors pas convaincantes: «Vu d'Amérique, vu du lieu où se bousculent toutes les variantes et variations du libéralisme, il ne peut guère y avoir de déceptions nées du spectacle et du constat de comportements instables, du va-et-vient de la politique américaine. On ne peut être déçu que lorsque quelque chose évolue d'une façon autre, pire, que ce que l'on avait prévu. Mais, dans la démocratie américaine, qui se rapproche plus du libéralisme pur que n'importe quelle autre démocratie, on ne doit guère s'attendre à une politique constante. Toute constance y disparaît sous la pression des souhaits et des désirs des individus et du peuple, mus par l'humeur du moment».
Anarchie et volonté de simplification outrancière
Au point culminant de ses analyses enjouées et sans pitié, qui rappellent celles de Machiavel, Dietze cite le poète irlandais William Butler Yeats: «Things fall apart; the center cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world» («Les choses se disloquent; le centre ne maintient plus rien; une anarchie brute envahit le monde»). Pour Dietze, Yeats, dans cette phrase résume l'essence du libéralisme pur. Quand cette situation d'anarchie est atteinte, toute dialectique de liberté prend fin.
Dietze explique ensuite le processus dans son moteur intime et profond: «Bien des signes nous l'indiquent: la complexité croissante de la vie a éveillé une nostalgie du simple, du pur, avec des simplifications outrancières, si bien que la démocratie n'apparaît même plus comme une forme politique dans le sens où l'entendaient Locke ou Rousseau mais bien plutôt comme l'entendait Bakounine». La démocratie à l'américaine est le catalyseur de ce courant sous-jacent fondamental: «Sans doute, très probablement, les évolutions du Nouveau Monde, avec la pulsion constante de changement qui règne là-bas, ont accéléré le processus. Car l'américanisation du monde est un fait que l'on ne saurait ignorer en ce siècle, que les Américains déclarent être le leur, même si le rêve d'une pax americana est passé depuis longtemps».
La question finale que pose le livre de Dietze est la suivante: «Qu'adviendra-t-il de l'Amérique et de l'américanisme? Il faut attendre. L'avenir nous le dira». Question rhétorique ou question macabre? Dietze prononce des vérités que l'on n'aime guère entendre dans la République de Bonn, où l'on considère la démocratie à l'américaine comme une sotériologie, pour ne pas dire comme une vache sacrée, alors que cette démocratie a été instaurée en RFA comme un système provisoire mais qu'on s'est habitué à considérer comme définitif. Ce sont des vérités que l'on n'aime guère entendre parce qu'elles sonnent justes. On préfère se boucher les oreilles.
Après la révolution populaire allemande de RDA, qui fait apparaître la démocratie de Bonn pour ce qu'elle est vraiment, soit un système provisoire, et la remet en question, il n'est pourtant plus possible de se boucher les oreilles. Les Allemands devront, en opérant la synthèse de leurs divers systèmes politiques actuels, trouver une réponse adéquate, adaptée à leur histoire, pour dépasser le système de la démocratie à l'américaine.
Hans-Dietrich SANDER.
(recension parue dans Staatsbriefe 1/1990; adresse: Castel del Monte Verlag, Türkenstr. 57, D-8000 München 40).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, liberté, théorie politique, sciences politiques, politologie, histoire, etats-unis, amérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 27 décembre 2009
La fallacieuse théorie du libre échange et la diabolisation du protectionnisme
 La fallacieuse théorie du libre échange et la diabolisation du protectionnisme
La fallacieuse théorie du libre échange et la diabolisation du protectionnisme
Avec l’aimable autorisation de Polémia [1].
Le modèle de la théorie des coûts comparés de Ricardo, décrit en 1817, dans son ouvrage On the principles of Political Economy repose sur une hypothèse essentielle, à savoir que la structure des coûts comparatifs dans les divers pays reste invariable au cours du temps. Or, il n’en est ainsi que dans le cas des ressources naturelles. Ainsi, par rapport à l’Europe occidentale, les pays producteurs de pétrole disposent d’un avantage comparatif qui restera le même dans un avenir prévisible. De même, les produits tropicaux ont un avantage comparatif qui ne saurait disparaître.
La théorie des coûts comparés est fondée sur l’immobilité des facteurs de production
En revanche, dans le domaine industriel, aucun avantage comparatif ne saurait être considéré comme permanent. Chaque pays aspire légitimement à rendre ses industries plus efficaces et il est souhaitable qu’il puisse y réussir. Il résulte de là que l’arrêt de certaines activités dans un pays développé, en raison des désavantages relatifs d’aujourd’hui, pourra se révéler demain complètement stupide, dès lors que ces désavantages relatifs disparaîtront. Il faudrait alors rétablir ces industries, mais entre-temps on aura perdu le savoir-faire.
Voir : Les théories de la mondialité par Gérard Dussouy
http://www.polemia.com/article.php?id=2347 [2]
La théorie de Ricardo ne vaut que dans un monde stable et figé. Elle n’est pas valable dans un monde dynamique, où les fonctions de production et les salaires évoluent au cours du temps, où les capitaux peuvent se déplacer librement et où les industries peuvent être délocalisées.
Selon la théorie de Ricardo, le libre échange n’est justifié que si les taux de change correspondent à l’équilibre des balances commerciales. Or, c’est l’importance des flux financiers spéculatifs et des mouvements de capitaux qui expliquent l’extraordinaire instabilité des cours du dollar, du yen ou de l’euro. La prétendue régulation par les taux de change flottants des balances commerciales n’a donc aucune signification aujourd’hui.
Or capital et main d’œuvre sont de plus en plus mobiles
De tous les dogmes économiques, le libre-échange est celui sur lequel les néo-libéraux sont le plus intraitables. Formulé il y a presque deux siècles dans le contexte théorique de l’immobilité des facteurs de production (capital et travail) et de la division internationale du travail, il est toujours présenté comme le nec plus ultra de la modernité, et comme la recette du développement et de la croissance. Ses hérauts ont réussi le tour de force de le pérenniser dans un contexte exactement contraire à celui de sa conception : aujourd’hui, le capital ne connaît plus aucune entrave à sa circulation internationale et la main d’œuvre devient, elle aussi, de plus en plus mobile. Quant à la division internationale du travail, elle appartient au passé, avec la multiplication des entreprises mettant en œuvre des technologies de pointe dans les pays à bas salaires. L’économie mondiale est devenue un bateau ivre, sans gouvernail.
La réalité disqualifie intellectuellement le libre-échangisme
Voilà qui devrait disqualifier intellectuellement le libre-échangisme. Il n’en est rien. Il constitue, bien au contraire, le soubassement même de l’Union européenne, qui fait de la libre circulation des capitaux, des biens et des services trois de ses libertés fondamentales, la quatrième étant celle de la circulation des personnes.
Il est assez cocasse de remarquer que les Américains eux-mêmes, en la personne de Paul Volcker, ancien Président de la Federal Reserve Bank, dans un livre commun avec Toyoo Gyothen, ancien Ministre des Finances au Japon, ont reconnu que la théorie des avantages comparatifs perdait toute signification lorsque les taux de change pouvaient varier de 50% ou même davantage (1). Une forte dévaluation du dollar de 20% ou plus qui équivaut à une barrière douanière protectrice pour les pays qui appartiennent à la zone dollar est un énorme coup de canif aux principes du libre échange..
Friedrich List (1789 - 1846) économiste et théoricien du protectionnisme
De Friedrich List à Paul Bairoch
Friedrich List, en 1840, expliqua qu’il fallait protéger les industries naissantes en Allemagne face à la concurrence sans merci des pays industriels les plus avancés : « Toute nation qui, par des tarifs douaniers protecteurs et des restrictions sur la navigation, a élevé sa puissance manufacturière et navale à un degré de développement tel qu’aucune autre nation n’est en mesure de soutenir une concurrence libre avec elle ne peut rien faire de plus judicieux que de larguer ces échelles qui ont fait sa grandeur, de prêcher aux autres nations les bénéfices du libre échange, et de déclarer sur le ton d’un pénitent qu’elle s’était jusqu’alors fourvoyée dans les chemins de l’erreur et qu’elle a maintenant, pour la première fois réussi à dénouer la vérité ».
Paul Bairoch, professeur à l’Université de Genève, a également montré que la croissance économique dans la période 1870-1940, fut largement liée au protectionnisme. Paul Bairoch a publié, en 1994, une étude sur les Mythes et Paradoxes de l’histoire économique (2). Il écrit : « On aurait du mal à trouver des exemples de faits en contradiction plus flagrante avec la théorie dominante qui veut que le protectionnisme ait un impact négatif, tout au moins dans l’histoire économique du XIXe siècle. Le protectionnisme a toujours coïncidé dans le temps avec l’industrialisation et le développement économique, s’il n’en est pas à l’origine. » Bairoch montre notamment que le protectionnisme ne fut pas la cause, mais bien la conséquence du krach de Wall Street en octobre 1929. A partir de séries statistiques s’étalant de 1800 à 1990, il explique que le monde développé du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, à l’exception de quelques brèves périodes, tira son expansion économique de politiques très majoritairement protectionnistes, mais que, en revanche, il imposa le libéralisme aux pays qui allaient devenir le tiers monde, à l’Inde en particulier. Ni le Royaume-Uni, ni la France, ni la Corée, ni le Japon, ni la Prusse n’ont acquis leur puissance industrielle en respectant la loi des avantages comparatifs de David Ricardo.
La croissance dopée par les droits de douane
Cette approche a même donné naissance au « paradoxe de la croissance dopée par les droits de douane » (Tariff-growth paradox). Il est en effet établi, pour le XIXe siècle comme pour une bonne partie du XXe siècle, que la croissance est en relation inverse avec le degré d’ouverture du commerce international (3).
Les « nouveaux pays industrialisés » d’Asie démontrent également l’importance du protectionnisme. Une étude, publiée par l’université Harvard, souligne qu’il peut, tout autant que le libre-échange, générer une forte croissance économique (4). Ainsi, alors que le discours dominant du journalisme économique proclame depuis deux décennies que le protectionnisme est le mal absolu, les travaux scientifiques les plus récents aboutissent à un résultat inverse. Il y a donc discordance entre les discours économiques médiatiques et le discours scientifique.
Droits de douane et protection de l’environnement
Par ailleurs la libéralisation des échanges est loin de produire les gains espérés (5). Elle engendre des coûts qui ne sont pas pris en compte dans les modèles utilisés par les organisations internationales. Son bilan économique, hors même tout jugement social, est bien plus sombre qu’on ne l’affirme. Les droits de douane par exemple contribuent à défendre l’environnement en diminuant les quantités de CO2 engendrées par les périples de la mondialisation. Avant de venir garnir les linéaires des grandes surfaces en Écosse, les crevettes « pêchées in Scotland » de la société Young’s Sea Food effectuent 27000 km aller retour avec le Bengla Desh pour être simplement décortiquées dans ce pays à bas coût de main d’œuvre ! (6)
Les États-Unis, une nation longtemps protectionniste…
Si l’on regarde l’histoire économique des États-Unis, depuis leur création, il n’y a pas eu de nation plus protectionniste que les États-Unis ! On a dit d’Alexander Hamilton, dès la création des États-Unis, qu’il était un autre Colbert. La guerre de sécession opposait le Nord industriel protectionniste au Sud agricole libre-échangiste (7). Le paroxysme du protectionnisme fut atteint en 1930 avec la loi Smoot-Hawley qui imposait des droits de douane record aux importations. De leur origine jusqu’aux années 1930, les États-Unis pratiquèrent donc un protectionnisme virulent avec des tarifs douaniers de l’ordre de 50% ; c’est avec cette stratégie qu’ils connurent le taux de croissance le plus élevé du monde et accédèrent au leadership mondial.
…Devenue libre-échangiste en 1945
Ce n’est que depuis 1945, sous la pression des Etats-Unis y trouvant leur intérêt, qu’une véritable pensée unique s’est mise en place : seul le libre échange absolu serait conforme à la rationalité économique. Toute autre analyse relève d’une pensée pré-scientifique et ne peut que susciter la commisération des gens compétents (8). Par ailleurs le pays qui s’est fait le soudain héraut du libre-échange le bafoue sans vergogne s’il n’y trouve plus avantage. Il y a fort à parier, avec une balance commerciale déjà déficitaire en 2006 de 763 milliards de dollars dont 232 milliards de dollars avec la Chine, que les mesures protectionnistes du Congrès américain vis-à-vis des importations chinoises vont se multiplier et prendre de plus en plus d’ampleur, malgré les digues de l’OMC.
Les Européens, en tant que consommateurs, peuvent acheter des produits de Chine ou d’Inde meilleur marché. Mais pour ces consommateurs, la contrepartie réelle de ces importations à bas prix est finalement la perte et la précarité de leur emploi ou la baisse de leurs salaires, ainsi que des prélèvements accrus pour couvrir le coût social du chômage. Les importations de biens de consommation en Europe augmentent d’une façon structurelle plus vite que les productions nationales menant le plus souvent à leur disparition.
Vers un protectionnisme européen ?
Emmanuel Todd a donc entièrement raison lorsqu’il a pu dire en décembre 2006 : « Je suis arrivé à la conclusion, il y a quelques années, que le protectionnisme était la seule conception possible et, dans un second temps, que la seule bonne échelle d’application du protectionnisme était l’Europe ». Mais là encore les médias et les moutons de panurge européens attendent que les États-Unis virent de bord à nouveau vers le protectionnisme, pour avoir enfin bonne conscience, voir les réalités en face et proclamer avec force leurs nouvelles certitudes d’une préférence communautaire qu’ils n’osent même pas évoquer à l’heure actuelle ! La forteresse Europe ne semble pouvoir être construite qu’à la remorque de « Fortress USA ». Ulysses Grant, Président des États-Unis de 1868 à 1876, a pu dire, avec un grand sentiment prémonitoire : « Pendant des siècles, l’Angleterre s’est appuyée sur la protection, l’a pratiquée jusqu’à ses plus extrêmes limites et en a obtenu des résultats satisfaisants. Après deux siècles, elle a jugé commode d’adopter le libre échange, car elle pense que la protection n’a plus rien à lui offrir. Eh bien, Messieurs, la connaissance que j’ai de notre pays me conduit à penser que dans moins de deux cent ans, lorsque l’Amérique aura tiré de la protection tout ce qu’elle a à offrir, elle adoptera le libre échange ».
En finir avec les bobards libre-échangistes !
Alors que cela est inexact, un très grand nombre d’Européens, crétinisés par les lieux communs médiatiques, établissent très souvent la comparaison avec la ligne Maginot, croyant ainsi mettre brillamment et très rapidement un terme aux discussions avec leur interlocuteur, essayant de lui faire comprendre que la messe est dite ! Or, à la réflexion, la ligne Maginot en mai 1940 a parfaitement joué son rôle, car la seule véritable erreur a été de faire sur le plan militaire le même pêché de naïveté qu’aujourd’hui sur le plan économique, à savoir de respecter la neutralité de la Belgique, tout comme l’on respecte aujourd’hui les bobards libre-échangistes, et de ne pas en achever la construction jusqu’à Dunkerque, dont l’équivalent économique actuel serait le rétablissement de la préférence communautaire ! L’Allemagne avait aussi sa ligne Maginot, la ligne Siegfried, qui a parfaitement joué son rôle fin 1944- début 1945 !
Marc Rousset – 15/12/2009 – Auteur de la Nouvelle Europe Paris Berlin Moscou, Godefroy de Bouillon, 538 p., 2009
Notes :
1) Paul Volcker et Toyoo Gyohten – Changing Fortunes – NY, Random House-1992-p293
2) Paul Bairoch – Mythes et Paradoxes de l’histoire économique – Editions La découverte, 1994, p.80
3) Kevin H. O’Rourke – Tariffs and growth in the late 19th century – Economic Journal, vol.110, n°3, Londres, avril 2000
4) Michael A. Clemens et Jeffrey G. Williamson – A tariff-growth paradox ? Protection’s impact in the world around 1875-1997 – Center for International Development – Université Harvard- Cambridge-Mass-août 2001
5) Franck Ackerman – The shrinking gains from trade : a critical assessment of Doha round projections – Global Development and Environment Institute – document de travail n° 05-01, Université Tufts-Medford (Mass)- octobre 2005
6) Thierry Fabre – L’incroyable parcours des produits « made in monde » – Capital – Mars 2007, pp 76-79
7) André Philip – Histoire des faits économiques et sociaux – Aubier-1963 – pp 142 – 146
8) Marc Rousset – Les Euroricains – Chapitre XX – Non au libre échange mondialiste – Godefroy de Bouillon -2001- pp.186 – 199
Article printed from :: Novopress.info France: http://fr.novopress.info
URL to article: http://fr.novopress.info/43356/la-fallacieuse-theorie-du-libre-echange-et-la-diabolisation-du-protectionnisme/
URLs in this post:
[1] Polémia: http://www.polemia.com/
[2] http://www.polemia.com/article.php?id=2347: http://www.polemia.com/article.php?id=2347
00:30 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, libre échange, protectionnisme, théorie politique, économie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 décembre 2009
Annotation sur le "Travailleur"
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Annotation sur le «Travailleur»
Dr. Karlheinz WEISSMANN
Ernst Jünger a toujours voulu que l'on inclue son Travailleur dans l'édition de ses œuvres complètes, surtout contre les “bien-pensants” qui l'exhortaient à prendre distance à l'endroit de ce “faux-pas” littéraire. Déjà dans une “Troisième lettres aux amis”, datée du 1er septembre 1946, Jünger insistait: il ne reniait rien de son œuvre, celle-ci devait être considérée comme un tout; il ne prenait ses distances d'aucun fragment de ce travail. Le rapport qui existe entre des écrits tels La mobilisation totale ou Le Travailleur, d'une part, et d'autres tels Jardins et Routes, est comparable à celui qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Plus tard, il a répété cette formule de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais cela ne nous dit rien de clair, finalement, sur la valeur qu'il faut attribuer actuellement aux premiers écrits de Jünger. La seconde version du Cœur aventureux déjà, la décision de publier en 1934 une édition des œuvres complètes mais sans les textes nationalistes du début des années 20 ensuite, signale la volonté de Jünger de marquer une césure entre la partie purement politique de ses premiers écrits et ses livres ultérieurs. Mais il fit tout de même une exception de taille: les deux ouvrages que nous venons de mentionner, La Mobilisation totale et Le Travailleur. Mais au prix d'une interprétation qui rend presque méconnaissable l'intention initiale. Voilà pourquoi il m'apparaît opportun de poser une nouvelle fois la question: quelle est l'“assise dans la vie” que possèdent ces textes? Ce qui doit nous permettre de tourner notre regard vers un fragment de l'histoire des impacts obtenus par ses livres-clefs, histoire au demeurant peu connue, mais ô combien instructive et éclairante.
La Mobilisation totale et Le Travailleur étaient tous deux des livres apocalyptiques. Depuis le début des années 30 la crise s'accentuait considérablement en Allemagne; simultanément augmentait le besoin de “grandes solutions”. Les modèles technocratiques, les “Plans” de réorganisation de l'Etat et de la société bénéficiait d'une incontestable conjoncture, puisque le jeu libre des libéraux, en politique comme en économie, avait incontestablement failli. Pour les extrémistes de gauche, le modèle était les plans quinquennaux soviétiques, tandis qu'une fraction des économistes professionnels autour de John M. Keynes imaginait une politique interventionniste du plein-emploi. Enfin, des cercles de non-conformistes, où se rencontraient, pour échanger des idées, hommes de gauche et de droite, libéraux, sociaux-démocrates, des banquiers, des conservateurs et des nationaux-socialistes. Ces idées ont trouvé une écho dans le fameux “Plan WTB” (d'après les noms de ses inventeurs: Wladimir Woytinski, Karl Baade et Fritz Tarnow), édité par la fédération des syndicats (Gewerkschaftsbund), de même que dans le Wirtschaftliches Sofortprogramm der NSDAP (= “Programme économique tout-de-suite de la NSDAP”) de Gregor Strasser ou dans le Sofortprogramm de Günther Gereke qui devint par la suite Commissaire du Reich pour la politique de l'emploi dans le Cabinet von Schleicher. En lançant son appel à la “nostalgie anti-capitaliste”, Strasser a pu transformer en triomphe pour la NSDAP les élections de juillet 1932; ailleurs, le Président de l'ADGB, Theodor Leipart, tentait de rassembler tous les partisans de l'autarcie nationale, qui voulaient délivrer les syndicats libres du carcan de la SPD. Dans son célèbre discours de Bernau, le 14 octobre 1932, Leipart expliquait que la tâche du travailleur était de se mettre au service de son peuple; il évoquait l'«esprit soldatique de l'imbrication dans le Tout et du don de soi au Tout», qui devait animer le prolétariat dans l'avenir.
On peut avancer la thèse que Leipart a été inspiré par Le Travailleur de Jünger. A une époque aussi chaotique, les ennemis d'hier se rassemblent dans de nouveaux groupements: Le Travailleur avait incontestablement touché une corde sensible dans l'air du temps. Mais ce livre mythique et apocalyptique a également suscité une série d'incompréhensions. Les uns considéraient Le Travailleur comme un ouvrage “bolchévique”, d'autres y voyaient le résultat d'un culte impolitique de la technique, d'autres encore en interprétaient le contenu comme l'expression d'une philosophie nihiliste, née sous la pression des faits. Ce sont précisément les admirateurs de Jünger dans les ligues de jeunesse nationales-révolutionnaires et le mouvement Widerstand d'Ernst Niekisch qui se sont sentis interpellés et irrités. Une irritation qui s'est encore accrue quand Jünger, sans ambages, accepte la modernité et insiste sur le rapport unissant la “mobilisation allemande” et la “domination planétaire du Travailleur”. Si Jünger a voulu faire du Travailleur un écrit programmatique du “nouveau nationalisme”, alors il n'a pas été compris de son public ou n'a été accepté qu'avec réserve. En 1933, les dernières possibilités d'organiser des discussions fructueuses disparaissent.
 Mais, dans l'Allemagne nationale-socialiste, on comptait un petit nombre d'admirateurs de Jünger qui considéraient toujours que Le Travailleur était un manifeste et, en même temps, un manuel de politique pratique. Ce groupe se rassemble dans les années 30 autour de Meinhard Sild et Edgar Traugott. Tous deux appartenaient à la NSDAP clandestine d'Autriche et sont passés à la SS après l'Anschluß. Pourtant leurs idées étaient en ultime analyse bien différentes des directives principales qu'énonçaient les idéologues officiels de la NSDAP. Ils s'étaient doter d'un petit forum dans la revue Zeitgeschichte. La couverture de cette publication présentait un aigle et un serpent, les animaux du Zarathoustra de Nietzsche; la tonalité des articles et des poèmes publiés était franchement nietzschéenne. Ensuite, les jeunes hommes rassemblés autour de Sild et de Traugott se sentaient fidèles à un “socialisme” qui, tout-à-fait dans le sens du Travailleur de Jünger, voulait organiser la “mise au travail totale” et élever l'Allemagne au rang d'une puissance capable “d'intervenir de la façon la plus vigoureuse qui soit dans les rapports de force régissant le monde”. Pour eux, il ne s'agissait nullement de “totalitarisme” ou d'une justification folciste (= völkisch) des guerres pour l'espace vital: mais bien plutôt des effets de cette logique froide qui a tant fasciné Jünger lui-même. Traugott et Sild, à leur façon, tirent les leçons du “réalisme héroïque”, dont ils attendent qu'il “compénètre totalement le monde d'esprit guerrier, de réalisme et de paganisme”. Dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas affirmer exactement quelle a été la nature du rapport entre Jünger, d'une part, et Traugott et Sild, d'autre part. Quoi qu'il en soit, leurs idées se sont différenciés dès que la guerre a éclaté. Sild a encore patronné l'édition de campagne de Feuer und Blut en 1941, mais déjà dans un article de juin 1939 pour les Nationalsozialistische Monatshefte, il exprime ses réserves quant à l'amitié qui lie Jünger au dessinateur Alfred Kubin, qui plonge son regard dans les abîmes les plus glauques de l'âme humaine et que Jünger considérait comme un “frère en esprit”. Cette amitié ne correspondait pas à ce que l'on attendait de Jünger, en qui on voyait, à l'époque, le “type même de l'activiste technique et le chef efficace”. La version finale des Falaises de marbre était, elle aussi, en contradiction avec cette image que l'on se faisait de Jünger. Traugott a consacré une longue recension à ce livre, dès sa parution, dans les colonnes de Zeitgeschichte: il y louait les qualités littéraires, tout en indiquant clairement ce qui le séparait de l'auteur. L'essai de Traugott, paru en 1941, Von der Führung (= Du Commandement) ne contient plus aucune allusion à Jünger; le contenu de cet ouvrage s'aligne largement sur l'orthodoxie nationale-socialiste.
Mais, dans l'Allemagne nationale-socialiste, on comptait un petit nombre d'admirateurs de Jünger qui considéraient toujours que Le Travailleur était un manifeste et, en même temps, un manuel de politique pratique. Ce groupe se rassemble dans les années 30 autour de Meinhard Sild et Edgar Traugott. Tous deux appartenaient à la NSDAP clandestine d'Autriche et sont passés à la SS après l'Anschluß. Pourtant leurs idées étaient en ultime analyse bien différentes des directives principales qu'énonçaient les idéologues officiels de la NSDAP. Ils s'étaient doter d'un petit forum dans la revue Zeitgeschichte. La couverture de cette publication présentait un aigle et un serpent, les animaux du Zarathoustra de Nietzsche; la tonalité des articles et des poèmes publiés était franchement nietzschéenne. Ensuite, les jeunes hommes rassemblés autour de Sild et de Traugott se sentaient fidèles à un “socialisme” qui, tout-à-fait dans le sens du Travailleur de Jünger, voulait organiser la “mise au travail totale” et élever l'Allemagne au rang d'une puissance capable “d'intervenir de la façon la plus vigoureuse qui soit dans les rapports de force régissant le monde”. Pour eux, il ne s'agissait nullement de “totalitarisme” ou d'une justification folciste (= völkisch) des guerres pour l'espace vital: mais bien plutôt des effets de cette logique froide qui a tant fasciné Jünger lui-même. Traugott et Sild, à leur façon, tirent les leçons du “réalisme héroïque”, dont ils attendent qu'il “compénètre totalement le monde d'esprit guerrier, de réalisme et de paganisme”. Dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas affirmer exactement quelle a été la nature du rapport entre Jünger, d'une part, et Traugott et Sild, d'autre part. Quoi qu'il en soit, leurs idées se sont différenciés dès que la guerre a éclaté. Sild a encore patronné l'édition de campagne de Feuer und Blut en 1941, mais déjà dans un article de juin 1939 pour les Nationalsozialistische Monatshefte, il exprime ses réserves quant à l'amitié qui lie Jünger au dessinateur Alfred Kubin, qui plonge son regard dans les abîmes les plus glauques de l'âme humaine et que Jünger considérait comme un “frère en esprit”. Cette amitié ne correspondait pas à ce que l'on attendait de Jünger, en qui on voyait, à l'époque, le “type même de l'activiste technique et le chef efficace”. La version finale des Falaises de marbre était, elle aussi, en contradiction avec cette image que l'on se faisait de Jünger. Traugott a consacré une longue recension à ce livre, dès sa parution, dans les colonnes de Zeitgeschichte: il y louait les qualités littéraires, tout en indiquant clairement ce qui le séparait de l'auteur. L'essai de Traugott, paru en 1941, Von der Führung (= Du Commandement) ne contient plus aucune allusion à Jünger; le contenu de cet ouvrage s'aligne largement sur l'orthodoxie nationale-socialiste.
Tout ce que je viens d'écrire sur le groupe rassemblé autour de Traugott et Sild permet de comprendre le Jünger “politique”. L'engagement de Jünger dans les années 20 n'a pas été une marotte: sans aucun doute, il a appartenu aux têtes pensantes de la droite révolutionnaire allemande. Mais sa participation au débat politique n'autorise aucune simplification extrême, comme celles de l'historiographie boîteuse qui se pare du label d'“antifascisme”, en répétant ses arguments à satiété. Jünger était un nationaliste à l'époque mais il a toujours été plus que cela. Mais, après avoir écrit Le Travailleur, il tire une conclusion: la politique n'est qu'un phénomène superficiel qui n'influe en rien sur les processus titaniques à l'œuvre dans notre monde; Jünger n'a pas voulu s'exposer aux coups de cette “titanisation”, parce qu'il la croyait inévitable. Cette attitude est sans doute le résultat d'un moment de faiblesse, mais elle est aussi empreinte de sagesse. Car l'un des messages les plus forts de Jünger demeure le suivant: il est bon “de deviner que derrière les excès de dynamisme de notre temps se trouve caché un centre immobile”.
Dr. Karlheinz WEISSMANN.
(article paru dans Junge Freiheit, n°12/95; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, ernst jünger, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 décembre 2009
Les thèses de Zeev Sternhell sur le fascisme français
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985
Les thèses de Zeev Sternhell sur le fascisme français
par Robert STEUCKERS
Qui est Zeev Sternhell? Un historien israëlien, membre du Parti Travailliste de son pays et partisan du dialogue avec les Palestiniens. Son œuvre, constituée jusqu'ici de trois ouvrages majeurs (1), a pris pour thème principal l'histoire du fascisme français, perçue essentiellement sous l'angle de l'évolution des idées. Pour Sternhell, le fascisme français est un fascisme plus pur que ses équivalents italien ou allemand, pour ne parler que des "fascismes" (mes guillemets ne sont pas innocents, ici) les plus notoires. Il est plus pur car ses diverses composantes se distinguent bien clairement du reste des idéologies politiques du XIXème et du XXème siècles. Un autre grand explorateur du fascisme, l'Allemand Ernst Nolte, avait pris pour objets de ses investigations, le national-socialisme hitlérien, le fascisme mussolinien et l'Action Française de Maurras. Ce n'est pas cette dernière que Sternhell examine. Il ne réduit pas le phénomène fasciste français à la geste de Maurras, de son groupe et de son quotidien. Le phénomène est beaucoup plus complexe que cela. Beaucoup plus diversifié aussi. Certes, les interprétations de Sternhell ne sont pas exemptes de défauts et nous reviendrons, en fin d'exposé, sur quelques lacunes ou quelques omissions.
Je crois que l'œuvre de Sternhell doit ici être placée dans le contexte du XIXème siècle, qu'elle expose par ailleurs si brillament. Nous vivons aujourd'hui la fin des grandes idéologies. Peu nombreux sont ceux qui croient encore au démocratisme chrétien ou au traditionalisme catholique des ultramontains du siècle dernier, au libéralisme manchesterien qui revient un peu à la mode, au socialisme caricaturé par les médiocrités sociales-démocrates qui sont au marxisme ce qu'un misérable journaliste d'une quelconque feuille démocrate-chrétienne est à Thomas d'Aquin. Personne, en tout cas, n'est prêt à sacrifier sa vie, à donner des heures, des jours voire des semaines de militantisme pour ces vieilleries poussiéreuses.
Nous n'avons pas réalisé les espoirs du XIXème siècle, ce siècle où les idées ont fusé, où elles ont mobilisé savants et militants, où on est mort pour elles. Il faut se replonger dans ce XIXème siècle où l'on a jeté les bases des sciences humaines ou exactes les plus diverses. Sans son avidité pour le savoir humain, pas de sociologie, sans un Darwin, pas de biologie moderne, sans une myriade de savants, pas de psychologie, sans Mendeleïev, pas de chimie, sans Bopp, pas de linguistique moderne. La liste est longue. Ce que nous n'avons pas réussi, c'est à créer une nouvelle politique, tenant compte de ces acquis scientifiques, de ces connaissances nouvelles. Le XXème siècle reste, politiquement parlant, en-deçà des connaissances globales que nous possédons depuis une centaine d'années. Il n'est parvenu qu'à neutraliser les défis contenus dans les sciences humaines et exactes nées au cours du XIXème. Nous vivons aujourd'hui cette cassure, ce chiasme qui nous conduit chaque jour davantage sur la piste du déclin. Quelles que soient d'ailleurs nos options, révolutionnaires ou conservatrices. Les conservateurs peuvent puiser des arguments terriblement efficaces dans les découvertes des archéologues ou des linguistes, des philologues ou des historiens du XIXème. Les révolutionnaires tout autant. Un Julius Evola ne serait pas arrivé à ses conclusions sans les travaux d'un Bachofen ou d'un Fustel de Coulanges, sans un Cumont ou un Rohde, sans les acquis de la philologie latine. Marx, et surtout Engels, sont, eux aussi, les fils spirituels de ce XIXème. L'héritage darwinien est présent chez eux. Toute leur critique dirigée contre le phénomène religieux dérive des historiens des religions du XIXème. Toute la théorie d'Engels sur les origines de la famille et de l'Etat provient d'une lecture plus qu'attentive de Bachofen et de Morgan.
Mais nous, nous sommes les enfants de l'oubli; les enfants adoptés par une Amérique sans histoire mais affligée de beaucoup de vices. Celui de la gaminerie en tête. Celui de la haine de l'intellect, de la haine des souvenirs ensuite. Le personnel politique dont nous subissons la médiocrité intellectuelle et la vulgarité est aussi un résultat, navrant, de cet oubli.
Mais revenons à Sternhell.
Une question essentielle doit être posée et c'est celle que nous pose son œuvre: quels sont les fondements du fascisme français, quelles sont les racines, au XIXème siècle, de ces fondements?
C'est la question centrale à laquelle son livre La Droite révolutionnaire tente de répondre. Sternhell voit cinq composantes dans le fascisme français. Passons-les en revue.
1. Le Boulangisme:
Le substantif "boulangisme" dérive du nom du Général Boulanger. Ce personnage de la vie politique française émerge après les événements tragiques de 1871, la défaite de l'Empire de Napoléon III sous les coups de la nouvelle Allemagne de Bismarck et les tueries sanglantes de la Commune. La gauche parisienne, la plus combative d'antan, a été écrasée sous la mitraille des Versaillais. Les partis de gauche ont perdu leurs meilleurs hommes dans cette effroyable tourmente. Les réparations exigées par l'Allemagne sont énormes. L'économie française ne s'en porte forcément pas bien. Une agitation sociale voit le jour; des grèves éclatent. Boulanger apparaît comme une figure salvatrice. Ce général, non issu des milieux de gauche par la force des choses, attire à lui un très grand nombre d'électeurs socialistes. Son programme de justice sociale, couplé à un charisme évident et à un nationalisme qui réclame le retour de l'Alsace à la "patrie française", lui assure un inconstestable succès électoral. Ces succès, il les enregistre précisément dans les cantons où la gauche, traditionnellement, encaissait le plus de suffrages.
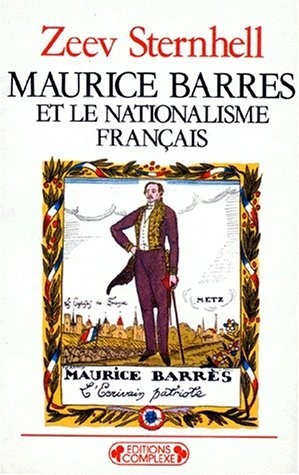 De cette aventure boulangiste, Sternhell retient surtout que les masses sont friandes de deux choses: un socialisme concret, pas trop abstrait, pas trop bavard, pas trop théorique et un nationalisme volontaire car elles savent instinctivement, qu'au fond, société et nation sont quasi identiques. Que ce sont des valeurs collectives et non individualistes.L'ennemi, pour ces masses parisiennes, c'est la classe qui a pour philosophie le libéralisme et l'individualisme, donc l'égoïsme, et qui met cette philosophie en pratique, avec, pour corollaire, les résultats sociaux désastreux dont la classe ouvrière se souvient encore.
De cette aventure boulangiste, Sternhell retient surtout que les masses sont friandes de deux choses: un socialisme concret, pas trop abstrait, pas trop bavard, pas trop théorique et un nationalisme volontaire car elles savent instinctivement, qu'au fond, société et nation sont quasi identiques. Que ce sont des valeurs collectives et non individualistes.L'ennemi, pour ces masses parisiennes, c'est la classe qui a pour philosophie le libéralisme et l'individualisme, donc l'égoïsme, et qui met cette philosophie en pratique, avec, pour corollaire, les résultats sociaux désastreux dont la classe ouvrière se souvient encore.
2. L'antisémitisme de gauche et le "racisme":
Qu'est-ce que l'antisémitisme de gauche? Il est, à mes yeux, difficile à cerner pour la simple et bonne raison qu'il participe de la lutte contre les religions qu'ont décrétée les libertaires, les socialistes et les révolutionnaires depuis la fin du XVIIIème siècle. La religion chrétienne d'Europe dérivant d'une matrice proche-orientale, on rejettera tout ce qui procède de cette matrice pour renouer avec un héritage refoulé, que redécouvre la philologie en plein essor. Cet héritage, ce sont les antiquités grecque et latine, les patrimoines celte, germanique et slave dans les pays qui n’ont jamais été soumis aux aigles romaines. Les socialistes danois et allemands du Nord redécouvrent ainsi les traditions vikings. Ce recours aux racines a également une fonction politique indéniable: celle d'arracher au clergé le monopole de la culture, puisque le clergé, surtout dans les pays catholiques, constitue le bouclier intellectuel des classes dominantes.
a) Blanqui, Toussenel, Tridon:
Dans cet univers très diversifié à l'échelle européenne, une figure sort des rangs en France: celle d'Auguste Blanqui.Fondateur du cercle "Les Amis du Peuple", Auguste Blanqui incarne ce que l'on pourrait appeller un "élitisme révolutionnaire". Il a presque passé la moitié de sa vie en prison et tirait de cette expérience une fierté, un orgueil indéniables. Proches de lui, évoluaient deux antisémites: Toussenel et Tridon. Ces écrivains parlaient du "molochisme juif" et expliquaient que la religion biblique dérivait du culte de Baal-Moloch et que Yahvé en était un avatar ultérieur. L'Allemand Georg Friedrich Daumer, un grand oublié du XIXème (2), avait élaboré cette théorie du "molochisme juif" dès 1842. Marx a lu cet ouvrage, dérivé des découvertes philologiques de l'orientaliste Johann Arnold Kanne. Klages en a retenu l'essentiel et Ludwig Feuerbach comptait Daumer parmi ses amis. Le socialiste belge Edmond Picard en reparlera dans un pamphlet antisémite (3), distribué par la social-démocratie en Belgique.
La gauche la plus radicale de cette époque reproche dès lors aux religions orientales, et donc au christianisme qui a fait souche en Europe, de dériver d'un culte dont l'axe central est le sacrifice humain. Ce faisant, cette gauche révolutionnaire procède à une analogie entre le capitalisme, assimilé au fait juif chez Toussenel et Tridon, et le Baal-Moloch dévoreur de chair humaine (4). Le capitalisme, comme l'idole proche-orientale, dévore des énergies avant que celles-ci ne puissent donner la pleine mesure de leurs potentialités. Tel est donc le mécanisme de pensée que la théorie, purement philologique de Daumer, injecte volens nolens dans les slogans du socialisme blanquiste. Comment en est-on arrivé à ce glissement, aux possibles effrayants? Il faudra que les recherches parviennent à déterminer si, oui ou non, Toussenel et Tridon ont lu Daumer, des traductions partielles de son œuvre ou de la littérature secondaire concernant ses thèses. Quoi qu'il en soit, les bases d'un antisémitisme populaire sont jetées. Elles se greffent sur un réflexe d'hostilité religieuse, de haine de classe et d'analogies hâtives. Dans la naissance de cet idéologème antisémite, un peu oublié de nos jours, la philologie, comme toujours au XIXème siècle, joue un rôle primordial.
L'anticapitalisme est couplé à un antisémitisme, basé, lui, sur une interprétation de nature philologique qui implique le refus d'un héritage "étranger".
b) Vacher de Lapouge et le "mythe aryen":
L'antisémitisme de gauche se retrouve chez Vacher de Lapouge. Formé à une école marxiste, le noyau central de l'idéologie de Vacher de Lapouge est constitué par un refus de l'individualisme et une adhésion aux théories déterministes, véhiculées par le matérialisme philosophique de l'époque. Les hommes, dans cette optique, sont non seulement déterminés par leur situation socio-économique mais aussi par leur biologie, par leur race. Telle est la démarche de Vacher de Lapouge. Son matérialisme philosophique l'induit à postuler un matérialisme biologique. Dans son livre principal, L'Aryen et son rôle social (5), il mêle marxisme et darwinisme, parle de lutte des races (superposée bien évidemment à la lutte des classes). August Strindberg, le grand dramaturge suédois, socialiste et anarchiste à sa façon, mettra en scène une intuition du même genre dans Mademoiselle Julie (Fröken Julie ). Fröken Julie, fille de la bonne bourgeoisie suédoise est séduite par son domestique, brute d'une vitalité débordante. Ce dernier prend la place d'un fils de bourgeois qui, normalement, aurait dû initier Fröken Julie à la sexualité. La lutte des classes est envisagée ici sous l'angle de la biologie et de la sexualité. Lecteur de Darwin, de Marx, de Schopenhauer et de Nietzsche, Strindberg réalise une synthèse que le XXème siècle n'est sans doute plus capable de faire, malgré un David Herbert Lawrence (même problématique dans L'Amant de Lady Chatterley ) ou un Rozanov (6).
Vacher de Lapouge renoue également avec une tradition plus ancienne, encore toute empreinte des délicatesses du XVIIIème, la tradition gobinienne. Gobineau, qui se déclarait Normand et, par conséquent, descendant des Vikings danois qui s'emparèrent, avec leur Jarl Rollon, de la Normandie au Xème siècle, voyait dans les Nordiques, les Germains, les peuples qui avaient enrichi l'Europe entière, apportant, outre leur sang, jugé plus "pur", leur sens de l'organisation et leurs qualités guerrières. Le drame du monde contemporain, c'est de ne pas cultiver cet héritage, de faire fi de cette qualité raciale et d'inconsciemment enclencher un processus de dénordicisation. Si les théoriciens racistes allemands, britanniques et américains (7) reprendront à la lettre cette thèse et lui donneront une ampleur considérable, n'allons surtout pas croire qu'en tant que Français, Gobineau constitue une exception. Le "mythe nordique", avant de partir à la conquête des pays anglo-saxons et germaniques, fut une idée bien française. Au début du siècle, Madame de Staël s'était enthousiasmée pour l'Allemagne des poètes et des penseurs et le XVIIIème siècle avait connu l'engouement pour l'Angleterre, surtout chez un Montesquieu. Le Professeur André Devyver, de l'Université de Bruxelles, a consacré, en 1973, un ouvrage de 608 pages à cette tradition française de germanomanie ou de nordicomanie. Intitulé Le Sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilshommes français de l'Ancien Régime (1560-1720) (Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1973), ce livre retrace l'histoire du "mythe germanique" depuis le début du XVIème siècle (Etienne Pasquier) jusqu'à la théorie des "vertus magiques du sang germanique" de Henry de Boulainvilliers (1658-1722) et ses prolongements (8).
Dans les origines du fascisme français, Sternhell met donc en exergue cette double tradition matérialiste portée par Vacher de Lapouge, celle du matérialisme philosophique et celle du matérialisme biologique. Le livre de Devyver lui semble inconnu. Mais, ici, on constatera aussi que des traditions décrétées parfaitement "démocratiques" (selon les critères en usage dans nos médias) ont, elles aussi, sacrifié au "mythe du sang germanique pur" puisque l'engouement qu'a montré tout le XVIIIème français pour ce qui était anglais partait du principe que le mode "communautaire" nordique, le mode de représentation communale ou parlementaire (et peut-être l'antique démocratie islandaise) constituaient des exemples historiques de sociétés non inféodées à un quelconque absolutisme. L'esprit politique de l'Europe du Nord, et plus spécialement de l'Angleterre, est rebelle à l'absolutisme. Il résiste . Niekisch, figure de proue du national-bolchévisme allemand, faisant sienne la définition de Dostoïevsky, selon laquelle les Allemands étaient un peuple protestataire , renouera, plus tard, dans son anti-romanisme anti-catholique, avec cette idée de résistance (Widerstand , comme le nom de son journal et de son cercle) mais en ne glorifiant pas, bien sûr, le parlementarisme anglais, mais bien l'esprit des Paysans révoltés du XVIème siècle, des Saxons de Witukind et des Chérusques d'Arminius. Chez Niekisch, l'influence du livre d'Engels sur la Guerre des Paysans n'a pas été sans importance non plus. Le mythe, indépendemment de ses interprétations et des peuples-acteurs qu'il met en scène, demeure le même. On pose un Nord "rebelle" (anglais, allemand ou scandinave) à un Sud qui croupit sous l'absolutisme. Par sa dénordicisation et par le recul subséquent de l'idée innée de liberté, présente chez les peuples du Nord selon Madame de Staël, Henry de Boulainvilliers, Gobineau, etc., la France serait en déclin. Elle serait décadante. De Vacher de Lapouge découle donc, affirme Sternhell, cette idée du déclin de la France, d'une France qui perd sa substance plus vite que les nations voisines. Il est vrai que la France, contrairement à l'Allemagne, l'Angleterre ou les Pays-Bas, connaissait, à la fin du siècle dernier, un tassement de sa croissance démographique. En 1899, le Baron Charles Mourre dressait le bilan de l'histoire de France, selon une optique semblable (in: D'où vient la décadence économique de la France. Les causes présentes expliquées par les causes lointaines , Paris, Plon/Nourrit, 1899). Parmi les causes du déclin français, Mourre cite: l'idée d'égalité (il rejoint en cela Gobineau), le culte du fonctionnariat, un trop important interventionnisme étatique (ce qui ne le range assurément pas parmi les "hommes de gauche"), l'affaiblissement de la natalité, l'immoralité publique, la question juive (leitmotiv de cette fin de XIXème et prélude à l'affaire Dreyfus), l'influence du climat (selon l'engouement déterministe de l'époque), etc. Mourre termine son ouvrage en expliquant pourquoi les Anglo-Saxons sont "supérieurs". Il ferme ainsi la boucle qui englobe Montesquieu et Gobineau, l'anglomanie du XVIIIème et la nordicomanie du XIXème. Cette supériorité s'expliquerait par la persistance d'un type d'organisation communautaire et du "foyer" familial. Mourre puise ses arguments chez Demolins et Le Play. Le leitmotiv persistera jusqu'à un Drieu La Rochelle qui sera fasciné par ses ancêtres normands, par la propension au sport que montrent les Anglais puis par la vigueur allemande mise en exergue par le culte du corps sain propre au national-socialisme.
Le "racisme" de Vacher de Lapouge lance trois idées-cadres: l'anti-individualisme, le déterminisme (biologique) et l'idée d'une France décadente (d'une France qui fait mal...). Ces trois idées-cadres sont déterminantes pour l'évolution ultérieure du fascisme français.
c) L'influence de Wagner:
Wagner a eu sur le XIXème siècle français une influence beaucoup plus importante qu'on ne le croit généralement. Barrès disait qu'il fallait honorer en lui "les préssentiments d'une éthique nouvelle". Ce sera, outre Barrès, l'écrivain et poète Paul Valéry qui se plongera le plus dans l'univers de la mystique wagnérienne. Mais au-delà de la littérature et de la musique, qu'apporte Wagner sur le plan strictement politique? En quoi est-il très précisément politisable? Il est politisable surtout parce qu'il a été lui-même un activiste de gauche. Maurice Boucher, germaniste français et Professeur à la Sorbonne, a consacré en 1947 un ouvrage aux idées politiques de Wagner (Les idées politiques de Richard Wagner. Exemple de nationalisme mythique , Paris, Aubier/Montaigne, 1947). Dans ce livre, Boucher évoque l'idée de perfectibilité humaine que Wagner avançait vers 1848. Mais cette perfectibilité, propre des idéologies de gauche, ne doit pas se subordonner à une quelconque représentation de l'au-delà. La perfectibilité est inscrite dans la nature matérielle. L'analogie avec Vacher de Lapouge est claire ici également. Et Wagner, malgré les mythes de ses opéras, se range dans la tradition matérialiste et révolutionnaire du XIXème. Sur le plan éthique, certes, son discours n'a rien de la sécheresse d'une démonstration matérialiste. Et, ajoute Boucher, si Wagner a cherché à concilier des intuitions chrétiennes avec l'hellénisme immortel, Herder, avant lui, jugeait cette synthèse impossible à faire et Nietzsche, bien sûr, la jugeait scandaleusement "immorale".
d) L'impact de Gustave Le Bon:
Sternhell souligne, à juste titre d'ailleurs, la grande influence de l'auteur de La psychologie des foules dans l'élaboration d'un corpus doctrinal "fasciste", si, du moins, il s'avère légitime de parler d'un corpus doctrinal fasciste. Gustave Le Bon se situe dans le sillage de la découverte de l'inconscient. Son influence a été et reste considérable. Chacun des quarante titres qu'il a publiés a été tiré à près de 500.000 exemplaires! Mussolini et Hitler ont lu sa Psychologie des foules avec attention et avec passion. Des passages entiers de Mein Kampf sont tirés des écrits de Le Bon. Mais l'impact des théories de Le Bon ne se limite pas aux seuls milieux des états-majors fasciste ou national-socialiste. Freud s'est basé sur lui pour rédiger sa Psychologie collective et son Analyse du moi. Ce qu'apporte Le Bon, c'est surtout une définition des instincts des peuples et de la foule. Ces instincts dominent tout et déterminent l'agir des hommes. La conscience est dès lors reléguée au second plan. Psychologie et biologie prennent le pas sur les fantasmes mécanicistes du siècle rationaliste. Au déterminisme rationaliste et mécaniciste se substitue un déterminisme d'ordre psychologique et biologique. Et Sternhell écrit: "Ce déterminisme implique un anti-individualisme extrême et une négation totale de la traditionnelle conception de la nature humaine". Psychologie collective, race, inconscient constituent des "forces obscures", l'âme invisible qui crée et secrète des institutions visibles. Une des composantes essentielles des fascismes selon Sternhell est précisément de placer ces "forces obscures" au-dessus de la "raison". Avec l'avénement des sciences du XIXème siècle, le culte de la raison s'effondre. Or, c'est sur ce culte, strictement individualiste, que se fondent nos sociétés et nos corpus juridiques. Parler de l'inconscient, des forces obscures des collectivités ou de la race, constitue donc un défi mortel aux structures juridiques de nos démocraties. La potentialité révolutionnaire de ces découvertes a été jugulée au cours du XXème siècle. Mais le barrage dressé tiendra-t-il sous la pression des instincts? La fin de ce siècle semble confirmer le contraire. L'agressivité des foules, comme, par exemple, sur les stades de football d'Angleterre ou du Heysel, devient telle qu'on se remet à douter de la raison humaine. Dans un autre registre, la vague écologiste, surtout en Allemagne, renoue avec des idéaux collectifs et avec l'idée de communauté si bien décrite par Ferdinand Tönnies. Sternhell ajoute que "forces obscures" de la psychologie et "mythes" soréliens possèdent bon nombre de caractéristiques communes. Nous y reviendrons.
e) Hippolyte Taine, maillon dans la chaîne:
Généralement, on ne considère guère Taine comme l'un des précurseurs du fascisme. Sternhell souligne avec brio l'importance qu'il a eu dans l'élaboration du dit fascisme français. Auteur du célèbre ouvrage Les origines de la France contemporaine et d'une Histoire de la littérature anglaise contemporaine , Taine fait de la "race" le premier facteur explicatif de l'histoire. Taine parle des "habitudes mentales innées" des peuples européens. Dans l'introduction à son histoire de la littérature anglaise, il énumère les trois facteurs déterminants qui président à la naissance de l'histoire et du génie littéraire d'un peuple: la race, le milieu et le moment. Trois déterminismes donc qui relient son analyse, sa méthode d'investigation historique, au corpus général de la pensée du XIXème siècle. Sternhell puise la majorité de ses arguments, pour ranger Taine parmi les précurseurs du fascisme français, dans l'introduction à l'Histoire de la littérature anglaise . On eut espéré quand même une analyse plus détaillée des Origines de la France contemporaine . Sternhell estimant globalement que le fascisme est une "réaction" contre les idées de 1789, leur rationalisme, leur individualisme et leur démocratisme, il aurait été utile de passer au peigne fin les douze volumes des Origines . Dans Maurice Barrès et le nationalisme français (Paris, Armand Colin, 1972), Sternhell dit simplement que Barrès tire de l'œuvre de Taine l'idée d'une France décérébrée et sur le déclin. Thèmes qui auront aussi leur impact sur Maurras, comme nous allons le voir. La référence à Taine aurait pu être, me semble-t-il, plus importante. Pour Sternhell, Taine est le maillon d'une chaîne qui relie Gobineau à Jules Soury (cf. infra) et à Barrès et ceux-ci aux fascistes français des années trente et de la collaboration.
f) l'influence prépondérante de Jules Soury:
Un des grands mérites de Sternhell, c'est d'avoir redécouvert la figure et l'œuvre de Jules Soury. Totalement oublié depuis quelques décennies, ce dernier était professeur à la Sorbonne et très populaire en tant que vulgarisateur scientifique et que propagandiste des idées de Darwin et Haeckel, au tournant du siècle. Certes, ses thèses correspondent en gros à celles, restées mieux connues, de Le Bon et de Vacher de Lapouge, et se développent autour d'un axe central: le déterminisme. Pour Soury, le monde social est régi par des "lois fatales", des "lois d'airain". Le libre-arbitre est une fable et l'homme moral aussi. L'homme, selon Soury, n'est qu'un des rouages de la gigantesque mécanique universelle. Il est le produit d'une sélection naturelle et la France, si elle a subi la défaite de 1871, c'est parce qu'elle ne s'est pas "épurée" à temps, qu'elle n'a pas voulu, à l'instar de l'Allemagne, redevenir une "race". Le langage de Soury est plus clair, moins ambigu, que celui des autres auteurs français situés dans la même veine.
Cette clarté sera perçue par Maurice Barrès qui a véritablement bu les paroles du professeur et les a faites siennes. Toute l'œuvre de l'auteur des Déracinés repose sur une interprétation, géniale sur le plan littéraire, des thèses de Soury. Nous mesurons par là l'importance du déterminisme de Soury dans la genèse du fascisme français.
3.La Droite prolétarienne
Dans cette genèse du fascisme français, Sternhell place le mouvement ouvrier anti-grèves des Jaunes . Cette juxtaposition est curieuse, surtout si l'on sait que, par exemple, Blanqui et Vacher de Lapouge, militants socialistes révolutionnaires, appartiennent, selon Sternhell, eux aussi, à l'ascendance du fascisme. Pour Sternhell, ce mouvement jaune , dirigé contre les mouvements de grève "rouges" par des hommes comme Lanoir et Biétry, exploite un mécontentement ouvrier en maniant un discours nationaliste à la Boulanger et chargé de thèmes antisémites. Ce sont ces idéologèmes-là qui incitent Sternhell à inclure le mouvement des Jaunes dans la généalogie du fascisme français. Il appelle ce mouvement une "droite prolétarienne" et constate qu'elle est opposée au prolétariat organisé par la gauche. Deux autres aspects de cette "droite prolétarienne" à signaler ici: le vertuisme et l'immobilisme social, préconisé comme étant dans l'intérêt des ouvriers.
4. L'extrême-gauche antidémocratique
Cette quatrième composante, d'après Sternhell, du fascisme français des origines est sans doute la plus importante. C'est elle qui aligne les noms les plus prestigieux, des noms connus dans l'Europe entière. Citons-en surtout trois: Lagardelle, Roberto Michels et Georges Sorel. Hubert Lagardelle définissait le socialisme comme un mouvement né pour lutter contre les idées libérales-bourgeoises. En prononçant cette définition, Lagardelle vise le mode de fonctionnement des démocraties libérales. Le mouvement ouvrier a commis l'erreur d'accepter le jeu démocratique et parlementaire. Ce faisant, il ne s'émancipe pas de l'Etat créé par les bourgeois. Roberto Michels, activiste de la SPD d'alors, le parti socialiste le plus puissant d'Europe, qualifiait la naissance de l'oligarchie socialiste de Verbonzung, Verkalkung, Verbürgerlichung, c'est-à-dire l'emprise des bonzes (des caciques), la sclérose doctrinale et l'embourgeoisement par le recrutement de trop de "juristes et d'avocats". Pour Michels, les socialistes officiels deviennent tout simplement une oligarchie parmi d'autres oligarchies. C'est alors que la veine révolutionnaire s'épuise. Quant à Georges Sorel, dont l'œuvre mérite à elle seule une longue exégèse, il est l'auteur des Réflexions sur la violence où, précisément, cette violence est conçue comme le moteur de l'histoire. La démocratie, pense Sorel, peut désormais travailler contre l'avénement du socialisme. Le syndicalisme, dans lequel Sorel place tous ses espoirs, réagira, lui, contre l'emprise de la démocratie et recourra, non aux urnes, procédé jugé aussi bourgeois que trompeur, mais à la violence qui effraie les "philanthropes", c'est-à-dire la grève générale.
5. Les dimensions non conservatrices de l'Action Française
L'Action Française, lancée par Vaugeois, Pujo et Maurras entre 1898 et 1900, est le modèle par excellence du mouvement de droite. Pourtant, elle contient dans son corpus doctrinal, des éléments que l'on classerait volontiers à gauche aujourd'hui. Nous y reviendrons dans la suite de cet exposé.
L'impact de Maurice Barrès
En 1972, quand paraissait en France l'ouvrage de Sternhell consacré à Maurice Barrès, le professeur Robert Soucy de l'Oberlin College de l'University of California (Berkeley) publiait un ouvrage intitulé Fascism in France. The Case of Maurice Barrès (University of California, 1972). Soucy cernait bien les six fondements de la pensée barrésienne. Formé à la lecture de Nietzsche, Dostoïevsky, Carlyle et Bergson (pour ne pas revenir sur les influences qu'il reçut de Wagner et de Soury), Barrès a d'abord navigué dans le "Culte du Moi". Le nationalisme ne le concernait pas et, lui, le fondateur du "culte des morts" écrivait alors: "Les morts, ils nous empoisonnent!". Petit à petit, son nationalisme allait se former et tourner autour de six axes, non coordonés en un système à la façon allemande et hégélienne, mais juxtaposés en un ensemble marqué d'esthétisme et de sensibilité. Ces six piliers sont:
1) Les trois vertus du héros "réaliste".
Ces trois vertus sont le sens du réel , de la "réalité". Ensuite, la force de la passion car les passions mènent le monde. Les passions et non les raisons frileuses. Et, enfin, l'énergie . Le culte de l'énergie, propre aux fascismes de l'entre-deux-guerres, découle tout droit de cette apologie barrésienne du dynamisme des chefs, des masses et des peuples.
2) Les racines.
Barrès découvrira ses racines lorraines. Du culte des racines découlera celui de la "Terre et des Morts".
3) Le vitalisme.
Pour Barrès, le vitalisme, c'est se fondre dans la volonté inconsciente des sentiments les plus obscurs de l'être, sentiments obscurs hérités de nos ancêtres, les Morts.
4) La démocratie de masse et le culte du chef.
Les masses sont le réceptacle des énergies obscures que le chef canalise et dirige vers des objectifs choisis. La liberté reçoit dès lors une nouvelle définition: c'est la force qu'acquiert un homme quand il est lié à d'autres hommes. Dans cette définition nouvelle de la liberté, posée par Barrès, se résument tous les arguments que nous avons préalablement analysés: le déterminisme hostile au libre-arbitre des libéraux et des conservateurs, l'impératif collectif de la race, des ancêtres et des morts dont nous devons poursuivre la mission historique. Enfin, l'inéluctabilité des "forces obscures", des "principes collectifs".
5) Le racisme.
C'est pour Barrès, l'héritage de Soury et l'idée de peuple, découverte chez Wagner.
6) Le culte du héros et le charisme.
De ces six "piliers", bien mis en évidence par Robert Soucy, Sternhell dégage les composantes de la théorie politique de Barrès, de son "nationalisme organique". Sternhell montre comment ces idées de base de Barrès vont être articulées dans la pratique politique qu'il suggèrera aux nationalistes français. Ce nationalisme implique:
1) Une hostilité farouche à la république "dissociée et décérébrée ".
2) L'affirmation de principes de stabilité.
Ces principes sont ceux qui découlent du culte de la Terre et des Morts. Ce culte permet aux Français de vivre "dans leur vérité propre". Barrès entame ici une polémique avec ce qu'il appelle le kantisme abstrait , un kantisme qui nous enseigne à agir de façon à ce que nos maximes puissent avoir une vérité universelle. Barrès s'insurge ici devant cet universalisme postulé par le kantisme car il arrache l'intellectuel à son peuple et en fait un déraciné .La stabilité historique d'une nation se mesure dès lors, dit Barrès, à sa capacité de défendre ses vérités propres et non à chercher la chimère d'une universalité quelconque (9).
3) Les facteurs de conservation.
Personnellement hostile au christianisme, Barrès finira par admettre le catholicisme comme un moyen de faire l'unité de la nation.
4) Les forces de destruction.
Celles-ci procèdent précisément des universalismes et des valeurs étrangères. Il convient de ne pas laisser au protestantisme la bride sur le cou car c'est une tradition allemande et non française (10). Parmi les universalismes les plus "pernicieux", selon Barrès, il y a le judaïsme (11). Ce dernier disloque la cohésion des nations, dit Barrès, et porte d'autres valeurs que celles de notre Terre et de nos Morts.
5) La question lorraine.
Province dont Barrès est issu, la Lorraine est en partie annexée à l'Allemagne impériale depuis la défaite française de 1871. Barrès part d'une exaltation de sa province, de son terroir, matrice de ses propres énergies. Cette province doit pouvoir échapper à un centralisme qui étouffe sa vitalité. La question lorraine sert de prélude à une idée barrésienne très importante, celle du régionalisme.
6) Le régionalisme.
En 1894-1895, Barrès mènera une campagne en faveur des libertés locales, régionales et syndicales. Il se fait là le porte-parole d'un fédéralisme dont les cellules de base seraient les provinces. Le fédéralisme permettrait justement de fédérer, de rassembler toutes les énergies de la nation et de n'en étouffer aucune.
Le rôle de l'Action Française
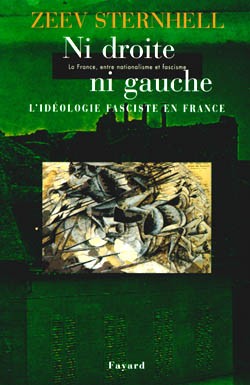 Née en 1898, sous l'impulsion de Vaugeois et de Pujo, l'Action Française prendra son envol définitif l'année suivante quand Maurras se joint à l'équipe initiale et quand se créent d'abord le Bulletin d'AF, puis la Revue d'AF. Charles Maurras sera le père du "nationalisme intégral" dont les deux idées-maîtresses seront le monarchisme (l'affirmation de la nécessité de faire gouverner la France par un roi fort et de décentraliser le pays) et la germanophobie, qui tournera souvent à l'obsession et au ridicule.
Née en 1898, sous l'impulsion de Vaugeois et de Pujo, l'Action Française prendra son envol définitif l'année suivante quand Maurras se joint à l'équipe initiale et quand se créent d'abord le Bulletin d'AF, puis la Revue d'AF. Charles Maurras sera le père du "nationalisme intégral" dont les deux idées-maîtresses seront le monarchisme (l'affirmation de la nécessité de faire gouverner la France par un roi fort et de décentraliser le pays) et la germanophobie, qui tournera souvent à l'obsession et au ridicule.
En plus du monarchisme et de la germanophobie, il convient d'ajouter une dimension résolument esthétique: le culte religieux qu'éprouvait Maurras pour la civilisation gréco-romaine, pour le Sud méditerranéen. Ce culte dérive d'une équation toute personnelle; Maurras est issu de la Provence et le soleil de sa patrie lui manquera toujours à Paris. En plus, depuis son jeune âge, il est sourd (ce qui renforce encore son caractère bourru et son entêtement devenu légendaire). Ce sont donc, chez lui, les organes de la perception visuelle et tactile qui auront le dessus. L'esthétisme maurrassien et son amour du soleil, de la lumière et des couleurs est le corollaire naturel de sa surdité. Ajoutons encore que Maurras sera, toute sa vie, fasciné par la personnalité de Richelieu.
Quel sera dès lors le nationalisme de Maurras ?
Avant toute chose, une synthèse. Lui-même dira qu'il n'innove rien et qu'il n'est qu'un perroquet. Ce "perroquet" n'est donc ni un philosophe ni un bâtisseur de systèmes mais un journaliste brillant, au talent sûr et indéniable et au style mordant. Le style prend ici le pas sur la vérité. L'esthétique sur le vrai. C'est là le propre des "races latines" comme le soulignait déjà Hippolyte Taine. Or, Maurras se sentait et se voulait "latin". Son engouement pour Taine, anglophile et germanophile, lui aura apporté sa propre définition du "Latin"! Pour Maurras, la France est une "déesse", l'œuvre des quarante rois capétiens et non de quelques décennies de démocratie. En fin de compte, le nationalisme intégral de Maurras, assez coupé des masses populaires, sera un nationalisme défensif, axé sur la xénophobie anti-allemande et sur l'antisémitisme. Ce nationalisme de repli sur soi est renforcé encore par le "traditionalisme" de Maurras. Qu'est-ce que le traditionalisme? C'est l'héritage des Contre-Révolutionnaires de Maistre, Bonald et Le Play. De l'œuvre de ces contre-révolutionnaires découle une apologie de l'Ancien Régime où le non-individualisme et l'organicisme permettaient une meilleure organisation de la société grâce aux corporations et aux corps de métier, dissous par les lois de la Révolution. Le nationalisme aura alors pour tâche de restaurer des structures sociales intermédiaires entre l'individu et l'Etat. Deuxième idée politique déduite de cette apologie de l'Ancien Régime: le régionalisme. La France était plus stable, affirment Maurras et ses disciples, quand les provinces avaient plus d'importance. La République néglige les meilleurs du peuple français: les paysans. Cette idée du "bon paysan" renoue avec un autre culte royaliste: celui des Chouans et des Vendéens.
Le traditionalisme maurrassien reste toutefois en-deçà de la critique portée en Allemagne à l'encontre des idées de 1789. Lorsque l'on analyse les ouvrages du Baron von Stein, d'Adam Müller ou de Savigny, on percevra mieux l'évolution des idées qui a d'abord porté au pouvoir les idéaux de 1789, puis a consommé le divorce entre la Révolution Française et les aspirations confuses qui dynamisaient le mouvement révolutionnaire pour être trahies par lui, puis a fait passé la volonté de participation de tous à la chose publique dans les mentalités germaniques par le truchement du romantisme. Maurras n'avait pas la moindre connaissance de la "politologie" romantique et réduisait celle-ci à certains aspects de Rousseau. Plus tard, Carl Schmitt analysera l'occasionalisme (12) romantique avec bien plus d'acuité que le chef de file de l'Action Française. L'organicisme de Maurras n'était finalement que fort superficiel. Faut-il y voir une des raisons majeures de l'échec politique de l'AF ?
Le nationalisme intégral de Maurras est également un "positivisme". Maurras, en effet, cherche à politiser à son profit les acquis de la philosophie d'Auguste Comte. N'étant pas chrétien et se définissant comme agnostique, Maurras ne peut pas justifier son idée monarchique par le recours au "droit divin". Ce qu'avaient fait les traditionalistes contre-révolutionnaires. Il lui faut donc avancer des arguments de nature "scientifique". Pour Maurras, ce ne sera donc pas Dieu qui veut la monarchie mais la "raison". La raison politique bien entendu. Il parlera donc d'un empirisme organisateur . Ce type de raison, invoqué par Maurras, n'est pas celui du siècle des Lumières, générateur de la Révolution et des idéaux de 1789 qu'il honnissait. La raison du XVIIIème siècle lui apparaît mièvre et démocratique. Celle qui le fascine, en revanche, est celle du XVIIème. Il revendique la clarté logique de ce XVIIème siècle où la France était la première puissance en Europe et où ses armées ravageaient le Saint Empire. Culte de Richelieu et de la clarté logique du XVIIème constituent donc les deux référentiels de base pour l'esthétique politique de Maurras. Ces référentiels sont ceux d'une France encore forte, d'une France qui a la population la plus dense du continent. Or, depuis la fin de l'épopée napoléonienne, ce n'est plus le cas. Le déclin démographique a commencé. L'Angleterre et l'Allemagne, l'Italie et la Russie ont connu des explosions démographiques formidables. La France perd son importance d'antan et Maurras, lecteur de Gobineau, de Taine, de Soury et sans doute aussi de Mourre (cf. supra), le sait. Il refuse ce déclin et rêve d'une France qui retrouverait sa puissance de jadis. C'est ici aussi que l'on peut observer la nature finalement "défensive" du nationalisme maurrassien.
Maurras ne pouvait ni se référer à la vigueur française des armées révolutionnaires ni à la geste grandiose de Napoléon. Son anti-républicanisme et son monarchisme l'en empêchaient. Il a donc puisé ses modèles exemplatifs dans le XVIIème. Les Allemands et les ressortissants des Pays-Bas du Sud, devenus Belgique depuis 1830, pourraient difficilement choisir comme référentiel ce siècle qui ne fut, pour eux, qu'une succession de misères atroces, de carnages, de villes incendiées, de famines et de guerres civiles. Pensons au Simplicissimus de Grimmelshausen (13) !
Reste la position de Maurras à l'égard de l'Eglise et du catholicisme. Sa position est double. Il dira "oui" à l'Eglise en tant que facteur d'ordre, en tant que principe organisateur. Il dira "non" au message intérieur du christianisme, parce que celui-ci repose sur des éléments juifs et non gréco-romains. Ce "oui" à l'Eglise et à ses principes hiérarchiques est inséparable du "non" au message des Evangiles, jugés "démocratiques". En dehors de l'Eglise, dira Maurras, les Evangiles sont un poison (14).
Parmi les aspects les plus intéressants du maurrassisme, aspects encore partiellement exploitables aujourd'hui, il faut évoquer le "socialisme anti-étatique". Maurras rejette le capitalisme parce qu'il est cosmopolite. Ce cosmopolitisme ne place a fortiori pas les intérêts de la nation française au-dessus de ses intérêts propres. De ce fait, pour Maurras, il doit être combattu. Cette position le rapproche du discours "révolutionnaire-syndicaliste" et du courant "anarcho-syndicaliste". "Monarchistes de gauche" et syndicalistes de diverses orientations se regrouperont en 1911 autour de la revue du Cercle Proudhon qui n'eut qu'une existence éphémère. Le dénominateur commun qui unissait ces hommes venus d'horizons aussi divers, c'était la volonté de donner au politique pur la priorité par rapport aux stratégies économiques cosmopolites. La défense de la nation, en tant qu'acquis historique incontournable, et la défense du peuple, en tant que masse démographique porteuse d'énergies héritées de l'histoire, se rejoignent dans une lutte commune contre une idéologie qui nie les héritages politiques et ne se soucie guère de la santé morale et physique des peuples. Pour les adversaires des monarchistes de gauche et des anarcho-syndicalistes (dont Georges Sorel), le "peuple" se présente comme une masse indifférenciée d'individus susceptibles d'être embauchés (et alors on les flatte) pour être ultérieurement licenciés, si les fluctuations du marché l'exigent. Cette gauche sociale et cette "droite" traditionaliste, non indifférente à la question ouvrière, se dressent donc conjointement face aux idéologies et aux acteurs politiques qui observent, pour leur strict intérêt personnel et financier, les soi-disant lois du marché. Pour la gauche et des hommes comme Lagardelle, Sorel et Michels (cf. supra), la social-démocratie accepte les lois du marché et se borne à demander de petits aménagements destinés à rendre la dictature du "marché" (nous serions tentés de dire la "théocratie" du marché) (15) supportable aux masses populaires. Cette acceptation par la social-démocratie "oligarchique" du jeu du marché a provoqué la désaffection de ses éléments les plus pugnaces et a contribué à la naissance des partis communistes, surtout au lendemain de la première guerre mondiale. Le fascisme est une autre variante de la réaction anti-sociale-démocrate. C'est vrai en France avec Sorel et Lagardelle. Ce sera vrai en Allemagne aussi avec des hommes et des femmes aussi différents que De Man, Liebknecht, Rosa Luxemburg, etc. Les PC et les "Luxemburgiens" riposteront par une nouvelle interprétation de l'œuvre de Marx et d'Engels. Les fascistes quitteront la tradition "marxiste" et puiseront leurs arguments dans d'autres doctrines et notamment celle de Proudhon.
Maurras dira, avec l'esprit de synthèse qu'on lui connaît: "Le nationalisme est comme une belle main et pour cette jolie main, un socialisme bien conçu, non démocratique et non cosmopolite, peut constituer un gant parfait". En conclusion, disons que l'anti-romantisme maurrassien repose sur deux idées-maîtresses: 1) l'hostilité à Rousseau, considéré comme le père spirituel de la Révolution et de la Terreur de Robespierre et 2) la germanophobie. L'Allemagne, aux yeux de Maurras, est la patrie du romantisme et le romantisme est le fruit des "brumes du Nord". A ces "brumes", il convient d'opposer le soleil des classicismes français et gréco-romain.
De 1914 à 1945
Avec Taine, Vacher de Lapouge, Drumont, Tridon, Toussenel, Barrès et Maurras, les assises du fascisme français du XXème siècle sont posées. C'est au départ de ces corpus doctrinaux que les écrivains fascistes et les théoriciens politiques qui se sont retrouvés dans leur sillage, échaffauderont leurs propres fascismes. J'insiste ici sur le pluriel . Nous verrons pourquoi. La première guerre mondiale sera une parenthèse sanglante. L'AF sombre dans le chauvinisme tricolore. Sorel se tait et désapprouve le carnage européen. Les esprits se séparent, alors qu'ils auraient pu joindre leurs voix et leurs protestations pour donner au siècle naissant la synthèse complète et définitive qu'il attendait et qu'il attend toujours. Après la guerre, l'acharnement des milieux de l'AF ne se tarit pas. Maurras rappelle sans cesse le testament politique de Richelieu, son idole: il faut coloniser subtilement la Belgique et le Luxembourg, les inclure dans une union douanière avec la France et les obliger à accepter des accords militaires. Bref, une annexion à peine déguisée que beaucoup en Belgique ne lui pardonneront jamais (16). Enfin, il faut morceler l'Allemagne, détacher si possible les régions catholiques du Sud de la Prusse protestante et "militariste", créer une république rhénane fantoche et en faire un protectorat français, imposer des réparations telles à l'Allemagne que la France puisse vivre sans travailler, etc. Les thèses maurrassiennes culminent lors de l'occupation de la Ruhr. Finalement, ce fut l'échec. Et aussi, faut-il l'ajouter, un mauvais calcul. Les colonies étaient déjà censées fournir à la France matières premières et richesses diverses; si l'on ajoutait l'Allemagne comme fournisseur obligé et contraint de produits finis et de machines-outils, l'on commettait finalement une erreur politique monstre: ne pas investir sur place et omettre de créer un outil industriel autochtone, basé sur une main-d'œuvre nationale, garante du bon fonctionnement de la machine économique. Par rapport à l'Allemagne qui, sous l'impulsion d'un économiste génial comme List (17), a toujours su créer son plein-emploi et produire une très large part de ses matières premières sur place en semi-autarcie, ce fut une faiblesse, une faiblesse que la France allait payer cher en 1940. L'historien J. Marseille (in: Empire colonial et colonialisme français , Albin Michel, Paris, 1985) reconnait que le colonialisme français a été un frein à l'essor, au développement et à la modernisation du capitalisme métropolitain (surtout sur le plan de l'outil). La décolonisation a plutôt été, dans les années 60, un mouvement de modernisation de la métropole française.
Plus clairvoyants et plus européens furent les "démocrates" Briand et Stresemann. Ces hommes ont cherché le rapprochement franco-allemand et la réconciliation au-delà des charniers de Verdun et de la Somme. Est-ce un hasard si Ferdinand de Brinon, ambassadeur de Vichy à Paris pendant la seconde guerre mondiale et chaleureux partisan de la collaboration franco-allemande, venait de ce pacifisme... L'intransigeance du nationalisme français, alors sans clairvoyance économique, a suscité la naissance d'un nationalisme allemand offensif, réponse à la politique de Clémenceau, considéré Outre-Rhin comme un nouveau Richelieu (18). L'irresponsabilité économique française se percevait également en Europe Centrale où elle a détaché les zones agricoles de Pologne et de Hongrie de ses débouchés traditionnels: l'Allemagne industrielle. Le peuple français n'a guère tiré profit de ce nationalisme-là, puisque son outil industriel n'a pas été rénové à la même vitesse que celui de l'Allemagne.
L'entre-deux-guerres a connu trois périodes successives dans l'élaboration de son fascisme. Ces périodes s'étendent, pour la première, de 1920 à 1930, puis de 1934 à 1940 et, enfin, de 1940 à 1945, celle de la "collaboration". Chaque génération a donc connu son fascisme.
La période de 1920 à 1930
Cette époque du fascisme français, la première, chronologiquement, du "fascisme conscient", a été dominée par la figure de Georges Valois, un fasciste naïf selon Sternhell. Valois a commencé sa carrière politique en tant que membre de l'Action Française. Il était un socialiste monarchiste. Son monarchisme dérive d'un culte du dirigeant, de l'homme d'Etat capable d'incarner et la théorie et la pratique. Pour Valois, Lénine et Mussolini étaient de tels hommes. Par la révolution bolchévique de 1917 et par la Marche sur Rome de 1922, Lénine puis Mussolini ont su allier théorie et pratique. Valois s'apercevra que Maurras n'est pas un homme de la même trempe. Il n'est qu'un théoricien, incapable d'accéder au pouvoir et de "marcher sur Paris". C'est la raison pratique qui a poussé Valois à quitter le milieu de l'AF et à fonder son propre mouvement, le Faisceau . La référence à Mussolini est clairement affichée. Le mot d'ordre de Valois, la clef de voûte de sa théorie politique se résume à une équation: "nationalisme + socialisme = fascisme".
Au départ, Valois n'était pas marxiste (au contraire de Mussolini et de Lénine) mais il n'était pas non plus anti-communiste, au sens où la droite classique, le fascisme des théoriciens ou des journalistes issus d'Action Française et celui des déçus du stalinisme (les adhérents du PPF de Doriot et de Victor Barthélémy) l'entendaient. Valois voulait unir les forces de gauche, les forces socialistes, dans un front unique pour le salut de la nation française. Ce front porterait un roi social au pouvoir. Dès lors, pourquoi ne pas marcher ensemble, main dans la main, communistes et fascistes? Cette idée, Valois a été à peu près le seul à la défendre en France après la première guerre mondiale. En Allemagne, la tentation "nationale-bolchévique" rassemblait plus de monde. Il suffit d'évoquer des noms comme ceux de Niekisch, Schlageter, Paetel, Tusk, Scheringer, Schulze-Boysen, Radek, Ernst von Salomon, etc.(19).
C'est en 1925 que Valois fonde son Faisceau . Le parti durera trois ans. Ensuite, Valois retrouvera les rangs de la gauche classique. Il abandonnera ses chimères royalistes et militera désormais pour une "République syndicale".
Il ne s'engagera pas dans la collaboration. Au contraire, actif dans un réseau de résistance, il sera arrêté en mai 1944 par la Gestapo et transféré au camp de Bergen-Belsen, où il mourra du typhus à l'âge de 66 ans.
La carrière de Valois prouve indubitablement son honnêteté foncière. C'est ce que Sternhell appelle, avec une inélégance que je déplore, de la "naïveté". Certes, les idées de Valois sont marquées de quelques incohérences. Catholique, sans adhérer aux thèses réactionnaires que le catholicisme a souvent fait siennes, Valois est aussi un "panlatiniste". Du temps du Faisceau , il cherchait à unir les nations romanes contre les puissances anglo-saxonnes. Maurras partageait sans doute cette option, mais sa germanophobie outrancière mettait l'ennemi anglo-saxon au second plan. Par son hostilité à l'égard des puissances thalassocratiques anglo-saxonnes, Valois a été un précurseur et a fait montre d'une remarquable clairvoyance. En effet, en février 1923, Londres et Washington imposent une limitation du nombre des navires de guerre. L'Allemagne est particulièrement visée, bien sûr. Mais l'Italie et la France sont presque traitées avec la même rudesse. Valois s'insurge contre cette entorse aux souverainetés nationales des pays romans. Aujourd'hui, dans la construction de projets spatiaux, dans l'organisation de nos exportations de céréales, dans la coopération en matières nucléaires avec des pays latino-américains ou arabes, les Etats-Unis sabotent toute initiative européenne. C'est la conséquence de leur intervention dans les affaires de notre continent en 1917. Le Faisceau soulignait là un problème grand-européen qui n'a pas cessé d'exister, qui s'est même renforcé par la seconde intervention des Etats-Unis en 1942 (débarquement en Afrique du Nord).
La vision du monde de Valois, contrairement à ce que semble dire Sternhell, est, elle aussi, marquée par deux dualismes d'essence "raciste": le dualisme Aryen/Asiate et le dualisme Aryen/Juif. La phobie du "péril jaune" tourmentait Valois et il rangeait la Russie entre l'Asie et l'Europe, la considérait comme une puissance tantôt asiatique tantôt européenne. Le dualisme aryen/juif correspond à l'héritage du XIXème siècle que véhiculent presque tous les penseurs, théoriciens et journalistes fascistes. Valois est aussi l'initiateur du culte de Jeanne d'Arc. Sur le plan des analyses comparatives entre doctrines allemandes et doctrines françaises que les historiens seront inmanquablement amenés à faire, un rapprochement entre l'hostilité de Valois à l'égard des thalassocraties et celle de l'Allemand Sombart à l'égard de la Händlermentalität anglo-saxonne (mentalité marchande) s'impose. Signalons que Sombart est un ex-marxiste qui confère au catholicisme un rôle non négligeable de barrage contre la progression de l'esprit marchand en Europe continentale. En Flandre, Sombart était fort lu chez les catholiques autoritaires (et fascistoïdes dirait-on aujourd'hui). C'est Victor Leemans qui l'a introduit à l'Université de Louvain par une brochure excellente sur le plan didactique: Werner Sombart. Zijn Economie en zijn socialisme , De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939.
Valois n'a pas eu d'héritiers, si ce n'est, dit Sternhell, le francisme de Bucard. Mais Bucard n'était ni un économiste brillant comme Valois ni un bon analyste des relations internationales. Son fascisme sera religieux, à la limite du caricatural. Il sera fait de défilés et de cérémonies aux morts. Il sera tout rituel. Sans avoir le moindre impact sur les événements de la vie politique française. Ce fascisme réellement naïf sera l'un des premiers à être "internationaliste", c'est-à-dire attentif et sympathique à l'égard des mouvements similaires d'au-delà des frontières de l'Hexagone.
Le deuxième fascisme: 1930-1940
Ce deuxième fascisme sera un fascisme de journalistes, écrit Pierre-Marie Dioudonnat (in: Je suis partout. 1930-1944. Les maurrassiens devant la tentation fasciste , Paris, La Table Ronde, 1973). Non pensé, non érigé en système à la façon marxiste ou hégélienne, ce fascisme est "senti". Il est plus vitaliste-barrésien que positiviste-maurrassien. C'est d'ailleurs ce qui consomme la rupture de la plupart de ces fascistes de la deuxième génération avec Maurras. Enfin, il prend nettement ses distances avec le "nationalisme intégral" du chef de l'Action Française et se déclare "internationaliste", partisan du "fascisme immense et rouge". Ce fascisme a la faiblesse de ne pas constituer une doctrine de d'Etat. Il est impossible de le considérer comme une théorie de la société que ses adeptes chercheraient à traduire dans le concret. Chaque écrivain, chaque journaliste du célèbre "Je suis partout " crée son propre fascisme. Les expériences personnelles s'avèrent déterminantes. L'occasionnalisme est ici roi, pour reprendre la terminologie critique de Carl Schmitt à l'encontre du romantisme allemand et de celui de Lamartine. Pour ce que Paul Sérant nommait le "romantisme fasciste", le reproche schmittien d'occasionnalisme nous apparaît également valable. Dans l'orbite de Je suis partout , évoluent d'anciens communistes (comme Doriot), d'anciens socialistes (comme Déat), d'anciens radicaux de gauche à tendances nationales-jacobines, d'anciens pacifistes enthousiastes de la SDN (comme de Brinon), d'anciens conservateurs (comme Gaxotte), d'anciens nationaux-républicains et d'anciens royalistes d'AF.
Cette diversité ne permet pas de former un mouvement unique, un seul parti d'union des forces fascistes. Celui qui a eu le plus de succès, dans ce sens, fut Doriot avec son PPF, parce qu'il est parti d'une base préalablement communiste dans son fief de la banlieue rouge de Paris, notamment la ville de Saint-Denis. En revanche, sur un plan strictement métapolitique, l'influence de ces journalistes et écrivains s'est fait sentir bien au-delà des groupuscules fascistes.
Sternhell a suscité beaucoup de polémiques en France depuis la parution de son dernier livre parce qu'il avait inclu dans la mouvance fasciste le personnalisme chrétien d'un Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit . Mounier était pourtant resté très critique à l'égard du fascisme. Il a admis que le fascisme soulevait de bonnes questions mais que, non spiritualiste, sa révolution demeurait insuffisante. Ce personnalisme avait reçu les influences du socialiste belge Henri De Man et s'était penché sur la tradition proudhonienne. La figure de Proudhon, rappelons-le, avait déjà rapproché royalistes de gauche et anarcho-syndicalistes au sein des Cahiers du Cercle Proudhon , revue fondée en 1911 et à laquelle Sorel avait collaboré. Sternhell ne distingue pas, je crois, les problèmes de fond des problèmes de langage. Mounier et les siens voulaient acquérir une audience politique et ne pouvaient faire autrement que de sacrifier aux modes du temps. Indubitablement, le fascisme et le national-socialisme avaient lancé des modes: celle du culte des corps et du sport, celle de la communauté populaire et des vertus intégratrices du nationalisme. Mounier se serait automatiquement marginalisé s'il n'avait pas tenu compte de ces engouements.
L'expérience des néo-socialistes s'axe sur l'œuvre de Henri De Man (Cf. notre article in Etudes et Recherches n°3, GRECE, Paris, 1984). De Man apporte les influences allemandes, parallèlement à la découverte de l'idée de communauté, théorisée par Tönnies en Allemagne et introduite en France par Raymond Aron en 1935. De Man, du temps où il séjournait en Allemagne, avait édité ses ouvrages chez l'éditeur conservateur-révolutionnaire Eugen Diederichs (Cf. La "Konservative Revolution" et ses éditeurs par Michel Froissard in Vouloir , n°13, février 1985, Wezembeek-Oppem). Diederichs voulait dé-barrasser le mouvement ouvrier des "scories" d'un marxisme dépassé.Les livres de De Man lui paraissaient importants dans cette optique. Sternhell comprend parfaitement l'importance de De Man dans la genèse d'un socialisme alternatif français. Mais faut-il prendre le néo-socialisme français pour un "fascisme"? N'ayant lu de De Man que les seuls ouvrages traduits ou rédigés directement en français, Sternhell ne comprend guère les contextes allemand et belge où est né le planisme demaniste. Sternhell ne maîtrise pas les langues allemande et néerlandaise et risque de considérer De Man comme un penseur français parmi d'autres ayant exercé une influence sur de futurs collaborateurs tels Déat. En fait, c'est parce que Déat, sociologue de formation, s'est fortement inspiré de De Man que Sternhell range le socialiste belge parmi les théoriciens pré-fascistes voire fascistes. De Man reste une sorte de keynésien doté d'une forte influence allemande. Sa doctrine se résume en quelques points (du moins nous bornons nous ici à n'en soulever que les principaux):
1) Le matérialisme marxiste est dépassé. Il faut remplacer le déterminisme marxiste par une "théorie des mobiles", c'est-à-dire une assise philosophique qui tienne compte des acquis des sciences psychologiques. Or Sternhell avait considéré le déterminisme comme la pierre angulaire du "pré-fascisme" d'un Vacher de Lapouge, d'un Taine et d'un Soury. Le fascisme est-il dès lors à la fois déterministe et anti-déterministe? L'une position n'exclut-elle pas automatiquement l'autre? Il faut relever, me semble-t-il, cette contradiction majeure. La réponse au débat qu'elle appelle se trouve chez Diederichs. Avant 1914, Diederichs publie Jaurès, les écrits du socialiste suédois Steffen, puis, après la Grande Guerre, ceux de De Man parce qu'ils tiennent tous compte de l'apport philosophique de Bergson. Vacher de Lapouge, marxiste au départ, passe au déterminisme biologique. C'est pour donner au socialisme une puissance que le déterminisme marxiste ne pouvait lui conférer. Chez Vacher de Lapouge, l'homme reste agi par sa race, par sa biologie. Mais on peut purifier une biologie défaillante par l'eugénisme, dit Vacher de Lapouge (et après lui, Montandon et Martial). De Man restaure la volonté de l'homme, donc un "libre arbitre" correcteur. Mounier, en tant que chrétien, se soucie aussi de la préservation d'une forme ou d'une autre de "libre arbitre". Aux yeux des contradicteurs de Sternhell (comme Gilbert Comte, cf. infra), c'est une erreur de vouloir assimiler au fascisme le personnalisme de Mounier, puisque celui-ci tient compte du libre arbitre, seul garant de la démocratie et de la liberté humaine. De Man, par son volontarisme, intéresse les disciples et les amis de Mounier. La distinction entre "fascisme" et "non-fascisme" passerait-elle par une acceptation ou un refus du libre arbitre? Sternhell aurait dû y penser pour s'éviter les polémiques.
De Man se situe à la charnière puisque l'homme socialiste, pour lui, est agi par une soif de nature psychologique: vouloir une dignité . Un person-naliste ne peut rester sourd à ce plaidoyer et à cette démonstration.
2) De Man distingue le socialisme du "marxisme vulgaire". Ce dernier ne serait qu'une vulgate maniée par les oligarques des partis socialistes ayant perdu leur punch révolutionnaire.
3) L'idée du socialisme allemand, c'est-à-dire d'un socialisme conforme à chaque peuple a très longtemps préoccupé De Man. Il a indubitablement subi les influences de Sombart, Rathenau, Rosa Luxemburg (son spontanéisme), des dissidents de la SPD, de Keyserling et vraisemblablement du livre d'Ernst Jünger, Der Arbeiter. Dans l'ensemble, son œuvre vise à remplacer l'archaïque matérialisme, le vieux déterminisme marxiste par un volontarisme qui ne parie pas sur les "forces obscures" de la race, comme chez Barrès, mais sur la puissance que peut déployer l'aspiration humaine à la dignité. La nuance est de taille et je crois que Sternhell ne l'a pas entièrement perçue. Certes, l'aspiration à davantage de dignité et les pulsions obscures relèvent l'une et l'autre de l'irrationnel. Mais tous les irrationnels sont-ils identiques? Faut-il reprendre la dichotomie posée jadis par Lukacs dans Die Zerstörung der Vernunft ?
L'internationalisme fasciste
Il est légitime de dire, avec Pierre-Marie Dioudonnat, que l'internationalisme du fascisme des collaborateurs de Je suis partout constitue à la fois une réponse et un défi à l'anti-fascisme organisé des intellectuels parisiens et des émigrés anti-fascistes d'Allemagne. L'internationalisme se renforce par le culte des actes beaux: la résistance des défenseurs de l'Alcazar, la guerre d'Espagne, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, les "cathédrales de lumière" de Nuremberg auxquelles participèrent Robert Brasillach, Lucien Rebatet et le futur Sénateur rexiste Pierre Daye, lui aussi collaborateur de Je suis partout . Parmi les événements commentés positivement, il y avait la victoire électorale de Léon Degrelle à Bruxelles en 1936. Mais le mouvement de Degrelle, à cette époque, n'avait vraiment pas encore grand'chose de commun avec les autres fascismes ou avec le national-socialisme allemand: pas de chemises ni d'uniformes, peu de drapeaux, un ancrage très net dans le milieu catholique. Le rexisme de 1936 était une réaction spontanée de citoyens écœurés par les turpitudes politiciennes et cherchant des garanties contre un chômage qui les menaçait en permanence.
Cet internationalisme se complète d'un culte vitaliste, d'une idée de la jeunesse (que Rex s'annexait puisqu'il s'affirmait le représentant des "jeunes plumes" contre les "vieilles barbes"), de la notion de joie . En effet, c'est sans doute l'énergisme de Barrès qui constitue le lointain ancêtre de cette idée de joie . Mais est-ce, à cette époque, une caractéristique du seul fascisme? Certes, le Dr. Robert Ley crée, en Allemagne, l'organisation Kraft durch Freude (La force par la joie) . Mais le monde socialiste marqué par le marxisme n'y reste pas étranger. De Man avait écrit La joie du travail , dans une perspective socialiste et le Front Populaire, quand il accède au pouvoir, en France, fait éclater partout sa joie: danses, pique-niques, vacances, auberges de jeunesse, randonnées à bicyclette, etc... Brasillach, lui, ricanait des "congés payés" tout en s'émerveillant des réalisations sociales de l'Allemagne nationale-socialiste, où les ouvriers partaient aussi en congés payés; sur les navires de l'organisation Kraft durch Freude , ils partaient en croisière en Baltique, en Méditerrannée, dans les fjords de Norvège,... Est-ce, chez Brasillach, une pointe de conservatisme au milieu d'une explosion de joie révolutionnaire, à la fois fasciste et socialiste? Curieusement, libéraux et conservateurs n'ont jamais sacrifié au culte de la joie. Les nouveaux sociaux-démocrates d'après 1945, à vrai dire, non plus... Sic transiit gloria mundi...
La collaboration et l'épilogue
Le fascisme français n'a jamais vu ses idées traduites dans la réalité. Après la défaire de 1940, le gouvernement de Vichy organise, dans la mesure de ses moyens, la société française selon les critères du "conservatisme" et du "corporatisme" de la droite traditionaliste catholique. Le modèle n'est ni l'Italie de Mussolini ni l'Allemagne de Hitler, mais le Portugal de Salazar ou l'Espagne de Franco voire l'austro-fascisme clérical et réactionnaire de Dollfuß. On renoue avec l'esprit anti-révolutionnaire des milieux royalistes les plus sclérosés. On se réfère aux thèses les plus à droite de Maurras.
Face à cette situation, les écrivains et journalistes de Je suis partout adhèrent au "mythe SS", à l'idéologie internationaliste que véhiculaient les centres de recrutement de la Waffen SS. De ces centres est né un véritable "européisme" très différent du "nationalisme intégral" de Maurras. La dimension cesse ici d'être étroitement "nationale" pour prendre une ampleur "continentale". La presse allemande traduite en Français, comme l'hebdomadaire berlinois Signal , répand cette idéo-logie européenne. Les références à l'histoire et au "Reich fédérateur" introduisent en France une nouvelle vision du politique. Qui n'a guère eu d'épigones, faut-il l'ajouter.
Le PPF de Doriot, formation solide avant-guerre, passe du communisme de ses membres fondateurs au fascisme anti-communiste, surtout quand Doriot lui-même devient lieutenant de la Wehrmacht. L'anti-communisme du PPF prend souvent des tournures passionnelles et l'empêche d'élaborer un socialisme nouveau, inspiré, par exemple, des idées de De Man.
Parmi les écrivains les plus originaux et les plus typiques de l'époque, citons Drieu La Rochelle. Ancien combattant de la Grande Guerre, il est un écrivain hors ligne, fasciné par le mythe de la jeunesse et le culte de la force. Malheureusement, sa personnalité demeure fragile. Il ne sera pas un capitaine politique. Dans l'évolution doctrinale, dont nous venons d'esquisser les grandes lignes, Drieu a toute sa place car son culte de l'énergie l'a conduit successivement à admirer le monde anglo-saxon, puis le national-socialisme allemand et, enfin, peu de temps avant son suicide, il a placé ses espoirs dans les potentialités de la Russie de Staline.
Les réactions à l'encontre des thèses de Zeev Sternhell
Nous avons examiné trois réactions très différentes: celle d'Armin Mohler, auteur de Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1933 , celle du Club de l'Horloge, laboratoire d'idées des droites libérales en France (RPR,UDF,FN) et, enfin, celle du journaliste du Monde , Gilbert Comte, qui nous signale les détournements possibles, à des fins politiques, de l'œuvre de Sternhell.
Armin Mohler se félicite du succès des travaux de Sternhell parce qu'ils sortent les recherches sur le fascisme d'un ghetto où philosophes et sociologues voulaient encadrer ce phénomène politique très complexe dans des concepts trop rigides. Les études de Sternhell, écrit-il dans Criticón (n°76, mars-avril 1983), sont le fruit d'un travail d'historien qui ne se préoccupe que de saisir des événements uniques. L'unicité de ces événements interdit précisément de les enfermer dans des catégories toute faites, catégories qui seraient marquées du sceau de l'universel. Mohler apprécie le fait que Sternhell se soit davantage penché sur le fascisme proprement politique et non sur le fascisme de salon (dixit Mohler) ou le fascisme littéraire. Ensuite, il souligne l'importance de l'analyse strictement française que pose Sternhell. Pour Mohler, en effet, la France est le bouillon de culture d'une intelligence fasciste à l'état pur, qui ne se retrouve nulle part ailleurs en Europe. Si l'Italie et l'Allemagne ont connu des régimes "fascistes" (ou plus ou moins qualifiables comme tels) pendant vingt-et-un ou douze ans, la France a généré, elle, un fascisme épuré où transparaissent toutes les thématiques dans un langage simple, limpide, beau, facilement maniable et communicable aux masses. Pour Mohler comme pour Sternhell, c'est donc la France qui a inventé le fascisme à défaut de l'avoir mis en pratique. Le fascisme français doit sa pureté au fait qu'il n'est jamais passé à la pratique et aux compromissions qu'elle implique. Le "consensus républicain" a été inébranlable. Aussi inébranlable que les cénacles où germaient les diverses pensées fascistes françaises. Mohler admire aussi, chez Sternhell, le choix de la chronologie. Une chronologie exacte, figée, est impossible à déterminer pour ce qui concerne l'émergence, le développement et l'effondrement du fascisme français. Il existe une sorte de continuité qui va de 1885 à 1940. Mais Sternhell perçoit parfaitement, dit Mohler, que les années qui précédèrent 1914 sont plus importantes que celles d'après la Grande Guerre. Les fondements sont jetés; les générations ultérieures n'ont fait que les exploiter.
Autres mérites de Sternhell selon Mohler: il néglige l'étude des groupuscules bizarres, il considère que le fascisme, à son époque, est une idéologie comme les autres et non une aberration vis-à-vis de lois de l'histoire soi-disant infaillibles; pour Sternhell, enfin, le fascisme n'est pas le propre de groupes sociaux bien déterminés. La cause du fascisme ne réside pas dans une quelconque crise économique ou dans les résultats de l'une ou l'autre guerre mais bien dans l'effondrement de vieilles valeurs, de vieilles certitudes. Il est le produit d'une crise de civilisation.
Les valeurs qui s'effondrent sont celles du libéralisme, ce sont les convictions de la fin du XVIIIème. Les catalyseurs du phénomène fasciste sont surtout les "révisionnistes de gauche", soréliens ou adeptes des thèses de Labriola, de Michels, de Lagardelle et, plus tard, de Henri De Man. Le fascisme enregistre des succès parce qu'il faut aller, comme le disait De Man, au-delà du marxisme . La marque du socialisme révisionniste est telle qu'aucune équation entre fascisme et conservatisme ne s'avère possible.
Ce fait, qu'aucune équation entre fascisme et conservatisme ne s'avère possible, le Club de l'Horloge parisien compte bien l'exploiter. Pour poser l'équation "socialisme = fascisme", dans un but politicien et électoraliste. Henry de Lesquen rappelle les thèses de Sternhell pour signaler que le fascisme et la droite (à laquelle de Lesquen veut s'identifier) s'opposent et que, contrairement aux apparences, le nationalisme les sépare! Au cours du même colloque (consigné dans un livre intitulé Socialisme et fascisme: une même famille? , Albin Michel, Paris, 1984), le professeur François-Georges Dreyfus part, lui, de l'analyse de Hayek et met en exergue de sa contribution une phrase de Moeller van den Bruck, citée par l'auteur de The Road to Serfdom : "Toutes les forces antilibérales se liguent contre tout ce qui est libéral". Dreyfus explique la filiation qui relie le fascisme italien au socialisme révisionniste, le doriotisme au communisme pragmatique de son chef avant son émancipation par rapport au PCF, les éléments socialistes de la Konservative Revolution (Sombart, le "socialisme prussien" de Spengler et de Moeller van den Bruck, etc.), les racines socialistes de la NSDAP et leur mise en pratique sous l'impulsion du Dr. Ley. Dreyfus, tout en utilisant quelques arguments teintés de racisme (il évoque l'asiatisme de certains penseurs allemands comme Keyserling, Rathenau et surtout...Spengler! Cette notion d'asiatisme , il la puise dans l'ouvrage du maurrassien Henri Massis, L'Occident et son destin ), cherche a jeter les bases d'une interprétation néo-libérale des phénomènes politiques du XXème siècle. Il s'agit de rejeter a priori les idéologies ou les pensées qui se situent en marge des traditions libérales et social-démocrate keynésienne. Le communisme orthodoxe et le fascisme sont ainsi fourrés dans le même sac, parce qu'ils n'acceptent pas l'organisation libérale de l'économie de la planète. En fait, c'est un maccarthysme doré que nous livre le Club de l'Horloge. Il n'est plus question de mettre en doute le bien fondé des idées personnelles de Thatcher et de Reagan, puisées chez Friedmann et Hayek, von Mises et les néo-conservateurs américains.
C'est également ce que craignent Gilbert Comte et Claude Julien (directeur du Monde Diplomatique). Le point de départ de leur critique vient du fait que Sternhell juge le personnalisme de Mounier proche des fascismes des années trente. Claude Julien, dans son éditorial du Monde Diplomatique de mars 1985, écrit: "Pour que ce "libéralisme" (celui que redécouvre Louis Pauwels en même temps que les vertus chrétiennes et l'efficace stratégie de la secte Moon, ndlr) puisse prospérer, il importe de discréditer tous ceux qui, dans un passé encore proche, osaient en dénoncer les tares et lui opposer une autre conception de l'homme et de la société...". Claude Julien montre bien ici à quelles fins les thèses de Sternhell pourraient servir: la défense et l'illustration d'un "totalitarisme libéral", hostile à tout autre vision de la société que celle qui la soumet aux lois du marché. Et il ajoute: "Le reaganisme et le néo-libéralisme voudraient briser les solidarités humaines qui font la vitalité d'une société, tout subordonner à de prétendues lois économiques, évacuer tout idéal qui oserait s'opposer au matérialisme capitaliste; bref, leur affairisme et leur pseudo-réalisme renverraient dans les marges toute option qui ne serait pas exclusivement dictée par d'arbitraires priorités économiques. Enfin deviendrait gouvernables des sociétés ainsi dépolitisées ". Voilà donc l'analyse que posent Julien et Comte. Les transgressions sont dangereuses. Point de salut hors des ukases libéraux.
Certes, reprocher à Sternhell son manque de sérieux dans l'analyse des sources, comme le fait Gilbert Comte (Cf. Zeev Sternhell, "historien" du fascisme en France , in: Le Monde Diplomatique , mars 1985), est sans doute un peu fort. Néanmoins, inclure tous les révisionnismes socialistes et le personnalisme chrétien de Mounier dans une idéologie qui constitue "le diable" pour nos contemporains, permet des récupérations politiques dans le style de celle d'Henry de Lesquen et de François-Georges Dreyfus. Récupérations qui renforcent la restauration libérale qui, en Angleterre, aux Etats-Unis et en Belgique, est en train d'allier le libéralisme à l'Etat policier. Un phénomène est ainsi en gestation: le libéralisme policier. L'Europe connaît son "pinochetisme".
Quelle conclusion tirer de l'œuvre de Sternhell? D'abord que les manichéismes faciles sont désormais révolus. Le fascisme, démon rituel de nos médias, a été un phénomène capillarisé dans l'ensemble des sociétés européennes. Personne n'y a échappé, même pas ceux qui l'ont combattu. Il a exercé des séductions irréfutables. Le processus d'exorcisme, à l'œuvre depuis quarante ans, est donc condamné à l'échec: les thèses du fascisme, dont finalement aucune ne lui est propre, sont susceptibles de revenir sous divers oripeaux, écologistes, conservateurs ou socialistes. A propos du nationalisme, le sociologue ouest-allemand Arno Klönne (in: Zurück zur Nation? , Diederichs, Köln, 1984; Cf. également, Martin Werner Kamp, Retour à la nation? in: Vouloir n°15/16, avril-mai 1985) a montré comment les thèses néo-droitistes, écologistes, le nationalisme de gauche de Herbert Ammon et de Peter Brandt (le fils de Willy), le nationalisme plus traditionnel, fichtéen et idéaliste, de Bernard Willms, le neutralisme allemand actuel, les thèses "nationales-révolutionnaires" portées par des revues comme Aufbruch et Wir Selbst , l'analyse des sociétés occidentales effectuée par le sociologue conservateur Günther Rohrmoser, se mélangent en un cocktail explosif qui risque de reléguer le vieux conformisme libéral au dépotoir de l'histoire, réalisant en même temps un pas en avant vers la réunification allemande et la libération continentale à laquelle aspirent tous les Européens conscients, de l'Est comme de l'Ouest. Un fructueux pot-pourri, semblable à celui où ont germé non seulement les fascismes français, mais aussi les socialismes révisionnistes et le personnalisme chrétien (les "transgressions" de ce siècle), est en train de se constituer en Allemagne Fédérale aujourd'hui. Ce phénomène s'exporte rapidement dans tous les pays de l'Est européen, sous domination soviétique. Face à cette germination, un événement comme celui qui a secoué la France de la fin 1984 aux législatives de mars 1986, le phénomène Le Pen, est dérisoire. L'homme intelligent ne doit pas perdre de temps à analyser cette réaction épidermique, privée de toute espèce de clairvoyance politique et économique.
Aujourd'hui aussi les manichéismes s'effondrent.
Les libéraux aimeraient pourtant les restaurer. Ils aimeraient voir le monde divisé en "bons libéraux" et en "mauvais tous les autres". Pour sortir de l'impasse, la lecture de Sternhell nous apparaît indispensable; mais en tenant compte des avertissements d'un maître contemporain, Claude Julien.
Robert STEUCKERS.
Bruxelles, février-juin 1985.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : histoire, fascisme, france, idéologie, théorie politique, philosophie, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 décembre 2009
L'alternative socialiste européenne

L'alternative socialiste européenne |
| « Le socialisme a été, au XIXe siècle, une réaction contre les brutalités sociales de l’industrialisation dans une société dominée socialement par la bourgeoisie et idéologiquement par les libéraux. Mais le socialisme a toujours ambitionné d’être autre chose. Notamment de s’inspirer d’une autre vision de l’homme. Un homme non pas seulement ni même principalement régi par ses intérêts mais à la recherche de la satisfaction d’exigences fondamentales comme du lien social et de la coopération. En d’autres termes, tout socialisme repose sur une anthropologie distincte de celle des libéraux. Il repose sur une anthropologie non individualiste. En conséquence, il ne peut y avoir de social-libéralisme : il faut choisir, et les socio-libéraux, par exemple le parti actuellement dit socialiste, ont choisi, ils ont choisi le libéralisme. En identifiant le socialisme à la liberté au sens de l’autonomie de chacun, Jacques Généreux dit très justement : "Ce sont les liens qui libèrent." (Le Socialisme Néo-Moderne ou l’Avenir de la Liberté, Seuil, 2009). Tout est dit : à savoir que la vraie liberté, c’est d’assurer autour de l’homme l’existence et la vitalité d’un réseau de solidarités. Sur cette base d’une vision "solidariste" de la société, qui exclut les schémas de pure rivalité et d’addition d’égoïsmes, les socialistes ont proposé bien des projets dès le XIXe siècle. En écartant les utopies les plus précoces et souvent les plus idéalistes, les plus intéressants des projets ont toujours été ceux qui prenaient appui sur l’expérience ouvrière elle-même pour proposer des restaurations de la maîtrise du travail de chacun, ou encore des autogestions, ou encore des autonomies ouvrières. A côté de cela, la part faite à l’Etat dans les projets socialistes a toujours été variable, sachant que l’Etat fait partie du politique mais n’est pas tout le politique. […] La révolution socialiste dans l’aire de civilisation européenne comme réponse concrète et comme mythe mobilisation pour nos peuples. Ainsi pourra-t-il être mis fin au pseudo-"libre-échange" des hommes et des marchandises, c’est-à-dire à la "chosification" de l’homme. Ainsi l’immigration de masse pourra-t-elle être enrayée. Ainsi le déracinement pourra-t-il faire place aux liens sociaux de proximité et aux identités reconquises. Ainsi la nation pourra-t-elle être à nouveau aimée comme patrie socialiste dans une Union des Républiques Socialistes Européennes. Un beau programme, moins irréaliste qu’il n’y paraît, car l’illusion serait de croire qu’on peut rester libre dans le monde de l’hyper-capitalisme mondialisé. »
Pierre Le Vigan, "Union des patriotes contre le mondialisme ?", Flash n°13, 7 mai 2009 |
00:30 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, sciences politique, idéologie, politologie, socialisme, alternative |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





