jeudi, 17 février 2011
Geopolitica della Romania
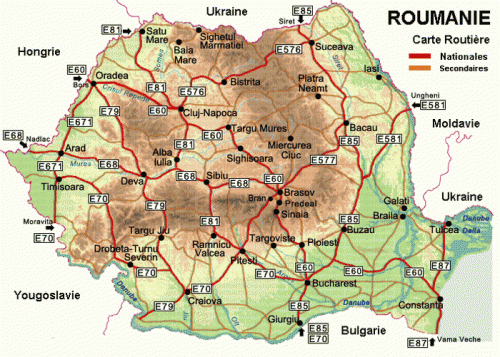
Aleksander G. Dughin:
Geopolitica della Romania
- I geni romeni e l’identità romena
La Romania ha dato al mondo, specialmente nel XX secolo, tutta una pleiade di geni di livello mondiale : Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Ştefan Lupaşcu, Jean Pârvulescu, Vasile Lovinescu, Mihail Vâlsan e molti altri.
Per quanto sia un piccolo Paese dell’Est europeo, sul piano intellettuale la Romania ha dato un contributo significativo alla civiltà, paragonabile a quello delle grandi nazioni europee e per poco non le ha superate. L’intellettualità romena ha di caratteristico che essa riflette lo spirito del pensiero europeo ed è indissolubilmente legata allo spirito tradizionale, traendo le proprie origini dalla terra e affondando le proprie radici nell’Antichità e in nell’Ortodossia di un immutato Oriente europeo.
Nel suo saggio su Mircea Eliade e l’unità dell’Eurasia, riferendosi alla natura eurasiatica della cultura romena, Claudio Mutti cita Eliade : « Mi sentivo il discendente e l’erede di una cultura interessante perché situata fra due mondi : quello occidentale, puramente europeo, e quello orientale. Partecipavo di questi due universi. Occidentale per via della lingua, latina, e per via del retaggio romano, nei costumi. Ma partecipavo anche di una cultura influenzata dall’Oriente e radicata nel neolitico. Ciò è vero per un Romeno, ma sono sicuro che sia lo stesso per un Bulgaro, un Serbo-Croato – insomma per i Balcani, l’Europa del Sud-Est – e per una parte della Russia » (M. Eliade, L’épreuve du Labyrinthe. Entretiens avec Claude-Henri Rocquet, Pierre Belfond, Paris 1978, pp. 26-27).
L’identità romena presenta una simbiosi tra vettori di civiltà orientali e occidentali, senza che gli uni prevalgano sugli altri. In ciò consiste l’unicità della Romania come società e come territorio e dei Romeni come popolo. La Romania e i Romeni si sono trovati divisi tra gl’imperi dell’Oriente (l’impero ottomano) e dell’Occidente (l’impero austro-ungarico), appartenendo alla chiesa ortodossa di rito bizantino e alla famiglia dei popoli di lingua neolatina.
Per gli eurasiatisti russi, questo è solo uno dei punti di approccio possibili, poiché essi prendono in considerazione una combinazione di coordinate occidentali ed orientali nella cultura e nella storia russa, dichiarando una specifica identità del popolo russo e dello Stato russo.
Quindi, nel quadro del dialogo culturale romeno-russo dovrebbe esser considerata la dottrina dell’eurasiatismo, la quale è autonoma, però, grazie alle varietà e alle proporzioni di cui essa dispone, ci offre una solida base per un mutuo approccio, ed una comprensione e un’amicizia reciproche.
Perciò la traduzione in romeno del libro I fondamenti della geopolitica, che contiene il programma della scuola geopolitica russa dell’eurasiatismo, può essere considerata un’opera di riferimento. Confido nel fatto che i Romeni, entrando in familiarità con la dottrina geopolitica dell’eurasiatismo di scuola russa, comprendano il paradigma del pensiero e dell’azione di Mosca sia in relazione al passato, sia in relazione al presente.
- La Romania e la struttura delle opzioni geopolitiche (euroatlantismo ed eurocontinentalismo)
Adesso, alcune parole sulla geopolitica della Romania. Nelle condizioni attuali, l’espressione « geopolitica della Romania » non è molto appropriata, se prendiamo in considerazione la Romania come soggetto di geopolitica. Nell’architettura del mondo contemporaneo un soggetto del genere non esiste. Ciò è dovuto alla logica della globalizzazione, nella quale il problema si presenta in questi termini : o ci sarà un solo « Stato mondiale » (world state), con un governo mondiale guidato e dominato direttamente dall’ « Occidente ricco », in primo luogo dagli USA, oppure si stabilirà un equilibrio tra i « grandi spazi » (Grossraum) dei « nuovi imperi », i quali integreranno quelli che finora abbiamo conosciuto come « Stati nazionali ». Nel nostro mondo, o si passerà dagli Stati nazione sovrani (come nell’Europa tra il XVI e il XX secolo) al governo mondiale (mondo unipolare) o avrà luogo il passaggio verso un nuovo impero (mondo multipolare).
In entrambi i casi, la dimensione della Romania come Stato non ci consente di dire – nemmeno in teoria – che la Romania possa diventare un « polo » ; perfino la Russia, col suo potenziale nucleare, le sue risorsde naturali e il suo messianismo storico, si trova in una situazione analoga.
In tali condizioni, la « geopolitica della Romania » costituisce una sezione della « geopolitica dell’Europa unita ». Questo non è soltanto un dato politico attuale, essendo la Romania un Paese membro dell’Unione Europea, ma è un fatto inevitabilmente connesso alla sua situazione geopolitica. Anzi, la stessa « geopolitica dell’Europa unita » non è qualcosa di garantito e sicuro. Perfino l’Europa presa nel suo insieme, l’Unione Europea, può basare la sua sovranità solo su un mondo multipolare ; solo in un caso del genere l’Europa sarà sovrana, sicché la Romania, in quanto parte dell’Europa, beneficierà anch’essa della sovranità. L’adozione del modello americano unipolare di dominio, che rifiuta all’Europa la sovranità, coinvolge anche la Romania in quanto parte dell’Europa.
Perciò la familiarità con le questioni geopolitiche non è qualcosa di necessario e vitale, ma l’argomento va preso in considerazione quando si tratta di allargare l’orizzonte intellettuale.
In verità, se prendiamo in considerazione quello che abbiamo detto più sopra ikn relazione al contributo dei Romeni alla scienza ed alla cultura dell’Europa, la geopolitica potrebbe essere una base molto importante per determinare il ruolo e le funzioni della Romania nel contesto europeo. Non è quindi casuale il fatto che le prospettive geopolitiche occupino una parte significativa nei romanzi di quell’Europeo esemplare che stato l’eccellente scrittore franco-romeno Jean Pârvulescu, saggista, poeta e pensatore profondo.
Il dilemma della geopolitica europea può essere ricondotto a una scelta fra l’euroatlantismo (riconoscimento della dipendenza da Washington) e l’eurocontinentalismo. Nel primo caso l’Europa rinuncia alla sua sovranità in favore del « fratello maggiore » oltremarino, mentre nel secondo caso essa insiste sulla propria sovranità (fino a organizzare un modello geopolitico e geostrategico proprio). Questa opzione non è completamente definita e sul piano teorico dipende da ciascuno dei Paesi dell’Unione Europea, quindi anche dalla Romania. Per questo motivo, che ha a che fare con la geopolitica della Romania nel senso stretto del termine, nel contesto attuale si rende necessaria una partecipazione consapevole e attiva nella scelta del futuro dell’Europa : dipendenza o indipendenza, vassallaggio o sovranità, atlantismo o continentalismo.
Una geopolitica del « cordone sanitario »
Nella questione dell’identità geopolitica dell’Europa è possibile individuare il modello seguente : ci sono i Paesi della « Nuova Europa » (New Europe), paesi est-europei che tendono ad assumere posizioni russofobiche dure, aderendo in tal modo all’orientamento euroatlantico, delimitandosi ed estraniandosi dalle attuali tendenze continentali della Vecchia Europa, in primo luogo la Francia e la Germania (la Gran Bretagna è tradizionalmente alleata degli USA).
Questa situazione ha una lunga storia. L’Europa dell’Est è stata continuamente una zona di controversie tra Europa e Russia : ne abbiamo un esempio tra il secolo XIX e l’inizio del secolo XX, quando la Gran Bretagna usò deliberatamente questa regione come un « cordone sanitario » per prevenire una possibile alleanza tra la Russia e la Germania, alleanza che avrebbe posto fine al dominio anglosassone sul mondo. Oggi si verifica ancora la stessa cosa, con la sola differenza che adesso viene messo l’accento sui progetti energetici e nei Paesi del « cordone sanitario » si fa valere l’argomento secondo cui si tratterebbe anche di una rivincita per l’ »occupazione sovietica » del XX secolo. Argomenti nuovi, geopolitica vecchia.
La Romania è uno dei Paesi della « Nuova Europa » e quindi fa oggettivamente parte di quel « cordone sanitario ». Di conseguenza, la scelta geopolitica della Romania è la seguente : o schierarsi dalla parte del continentalismo, in quanto essa è un Paese di antica identità europea, o attestarsi su posizioni atlantiste, adempiendo in tal modo alla funzione di « cordone sanitario » assegnatole dagli USA. La prima opzione implica, fra le altre cose, la costruzione di una politica di amicizia nei confronti della Russia, mentre la seconda comporta non solo un orientamento antirusso, ma anche una discrepanza rispetto alla geopolitica continentalista dell’Europa stessa, il che porta a un indebolimento della sovranità europea in favore degli USA e del mondo unipolare. Questa scelta geopolitica conferisce a Bucarest la più grande libertà di abbordare i problemi più importanti della politica internazionale.
La Grande Romania
Come possiamo intendere, in questa situazione, il progetto della costruzione geopolitica nazionalista della Romania, progetto analogo a quello noto col nome di « Grande Romania » ? In primo luogo si tratta della tendenza storica a costruire lo Stato nazionale romeno, tendenza sviluppatasi in condizioni storiche e geopolitiche diverse. Qui possiamo richiamarci alla storia, a partire dall’antichità geto-dacica e citando Burebista e Decebalo. In seguito sorsero i principati di Moldavia e di Valacchia, formazioni statali che esistettero in modo indipendente fino alla conquista ottomana.
Bisogna menzionare anche Michele il Bravo, che agli inizi del secolo XVII realizzò l’unione di Valacchia, Moldavia e Transilvania. Fu solo nel secolo XIX che la Romania conquistò la propria statualità nazionale, la quale venne riconosciuta nel 1878 al Congresso di Berlino. Il peso strategico della Romania è dipeso, anche nelle condizioni della conquista dell’indipendenza, dalle forze geopolitiche circostanti. Fu una sovranità relativa e fragile, in funzione dell’equilibrio estero di potenza, tra Sud (impero ottomano), Ovest (Austria-Ungheria, Germania, Francia, Inghilterra) ed Est (Russia). Di conseguenza, l’obiettivo “Grande Romania” rimase una “utopia geopolitica nazionale”, anche se ricevette un’espressione teorica integrale coi progetti di realizzazione di uno Stato romeno tradizionalista dei teorici della Guardia di Ferro (Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima), mentre nel periodo seguente la Realpolitik di Bucarest fu obbligata, da forze di gran lunga superiori al potenziale della Romania, a operare una scelta: Antonescu fu attratto verso la Germania, Ceausescu verso l’Unione Sovietica.
Per rafforzare l’identità nazionale, l’”utopia nazionale” ed anche l’”utopia geopolitica”, è estremamente importante non rinunciare in nessun caso al progetto “Grande Romania”, ma non si prendono in considerazione gli aspetti concreti dell’immagine della carta geopolitica, poiché un appello all’”ideale” potrebbe essere un elemento di manipolazione, tanto più che la Romania non dispone, nemmeno di lontano, della capacità di difendere, in queste condizioni, la sua sovranità sulla Grande Romania nei confronti dei potenziali attori geopolitici a livello globale e regionale (USA, Europa, Russia).
5. La strumentalizzazione del nazionalismo romeno da parte dell’atlantismo
Una delle forme più evidenti di strumentalizzazione dell’idea di “Grande Romania” si manifesta ai giorni nostri, quando una tale idea viene utilizzata negli interessi dell’atlantismo. Ciò ha uno scopo evidente: il nazionalismo romeno (perfettamente legittimo e ragionevole di per sé) nella Realpolitik fa appello all’idea di integrazione della Repubblica di Moldavia. Sembrerebbe una cosa del tutto naturale. Ma questo legittimo desiderio dell’unione di un gruppo etnico in un solo Paese, nel momento in cui la Romania è membro della NATO, sposterebbe ulteriormente verso la Russia le frontiere di questa organizzazione e, in tal caso, le contraddizioni tra Mosca e l’Unione Europea – e l’Occidente in generale - si esacerberebbero. In altri termini, l’utopia nazionale della “Grande Romania” si trasforma, nella pratica, in una pura e semplice estensione del “cordone sanitario”, la qual cosa non avverrebbe a beneficio dell’Unione Europea, bensì degli USA e dell’atlantismo. In questo contesto, il progetto atlantista mira in fin dei conti a privare l’Europa della sua sovranità, mostrando indirettamente il suo carattere antieuropeo o, quanto meno, anticontinentalista.
All’integrazione della Repubblica di Moldavia si aggiunge anche la Transnistria, che per la Russia rappresenta una posizione strategica in questa regione. Dal punto di vista strategico la Transnistria è molto importante per Mosca, non solo in quanto si tratta di una leva su cui essa può agire nelle relazioni a lungo termine con la Repubblica di Moldavia, ma, fatto più importante, nella prospettiva del probabile crollo dell’Ucraina e della sua divisione in due parti (orientale e occidentale), che prima o poi si verificherà per effetto della politica di Kiev successiva alla “rivoluzione arancione”. Nei Fondamenti della geopolitica c’è un capitolo sulla disintegrazione dell’Ucraina. Il capitolo in questione è stato scritto all’inizio degli anni NOvanta, ma, dopo la “rivoluzione arancione” del 2004, questa analisi geopolitica è diventata più esatta, più precisa. In una certa fase, la Transnistria diventerà un’importantissima base della Russia nella regione. In questa prospettiva, la Grande Romania diventa un ostacolo, cosa che gli strateghi atlantisti hanno previsto fin dall’inizio.
Le frizioni tra Romania e Ungheria, così come alcune frizioni con l’Ucraina, non sono importanti per gli atlantisti e questo aspetto del nazionalismo romeno non avrà il sostegno dell’atlantismo, a meno che ad un certo momento gli USA non pensino di poterlo utilizzare per destabilizzare la situazione secondo il modello della disintegrazione jugoslava.
Puntando sui sentimenti patriottici dei Romeni, gli operatori della geopolitica mondiale si sforzeranno di raggiungere il loro specifici obiettivi.
6. La Romania nel quadro del Progetto Eurasia
Adesso è possibile presentare, in poche parole, il modello teorico della partecipazione della Romania al Progetto Eurasia. Questo progetto presuppone che nella zona settentrionale del continente eurasiatico si stabiliscano due unità geopolitiche, due “grandi spazi”: quello europeo e quello russo. In un quadro del genere, l’Europa è concepita come un polo, come un’area di civiltà. A sua volta, la Russia comprende il Sud (Asia centrale, Caucaso) e l’Ovest (Bielorussia, Ucraina orientale, Crimea). Il momento più importante in un’architettura multipolare è l’eliminazione del “cordone sanitario”, questo perpetuo pomo della discordia controllato dagli Anglosassoni che è in contrasto sia con l’Europa sia con la Russia. Di conseguenza questi Paesi e questi popoli, che tendono oggettivamente a costituire la Nuova Europa, dovranno ridefinire la loro identità geopolitica. Tale identità si deve fondare su una regola principale: contemporaneamente accanto all’Europa e accanto alla Russia. L’integrazione in Europa e le relazioni amichevoli con la Russia: questo è il ponte che unisce i due poli di un mondo multipolare.
Tre Paesi dell’Europa orientale, possibilmente alleati degli altri, potrebbero adempiere a questo compito meglio di altri Paesi: la Bulgaria, la Serbia e la Romania. La Bulgaria è un membro dell’Unione Europea, è abitata da una popolazione slava ed è ortodossa. La Serbia non è un membro dell’Unione Europea, è abitata da Slavi, è ortodossa e tradizionalmente simpatizza per la Russia. Infine la Romania: Paese ortodosso, con una sua missione metafisica ed una accresciuta responsabilità per il destino dell’Europa. Alla stessa maniera, ma con certe varianti, si potrebbe parlare della Grecia. In tal modo la Romania potrebbe trovare una posizione degna di lei nel Progetto Eurasia, sviluppando qualitativamente lo spazio culturale e sociale che collega l’Est (Russia) con l’Ovest (Europa), spazio che assumerebbe l’identità dei Paesi ortodossi dell’Europa, mentre le caratteristiche distintive nazionali e culturali resterebbero intatte, vale a dire non si dissolverebbero nel mondo stereotipato del globalismo né si troverebbero sotto l’influenza del modo di vita americano, che annulla tutte le peculiarità etniche. Integrandosi nell’Unione Europea e stabilendo stretti legami con la Russia, la Romania potrà assicurare il proprio sviluppo economico e potrà conservare la propria identità nazionale.
Senza alcun dubbio, questo progetto richiede un’analisi attenta e deve costituire il risultato di uno sforzo intellettuale particolarmente serio da parte dell’élite romena, europea e russa.
7. Correzioni all’opera I fondamenti della geopolitica
Il libro è stato scritto per lettori russi, ma, come dimostrano le sue numerose traduzioni e riedizioni in altre lingue – specialmente in turco, arabo, georgiano, serbo ecc. – esso ha destato interesse anche al di fuori delle frontiere della Russia. Non bisogna dimenticare che esso è stato scritto negli anni Novanta del secolo scorso per quei Russi che, nel clima e nella confusione generale di riforme liberali e di espansione dell’Occidente, avevano perduto l’ideale nazionale; per lo più, infatti, esso riflette le realtà internazionali di quel periodo. Al di là di tutto questo, però, l’opera contiene riferimenti essenziali alle costanti della geopolitica – le quali sono identiche in ogni epoca – e, in modo particolare, allo spazio eurasiatico.
I principi enunciati nei Fondamenti della geopolitica sono stati sviluppati ed applicati alle nuove realtà storiche dei primi anni del XXI secolo e si ritrovano nelle mie opere successive: Progetto Eurasia, I fondamenti dell’Eurasia, La geopolitica postmoderna, La quarta teoria politica ecc.
I fondamenti della geopolitica si distingue per la presentazione del metodo geopolitico di base applicato al caso dell’Eurasia.
In diversi momenti successivi alla sua pubblicazione, il testo dei Fondamenti della geopolitica è stato riveduto, ogni volta sotto l’influenza degli eventi in divenire, e ciò ha indotto a chiarire certi punti di vista. In primo luogo, l’autore ha riveduto la sua posizione nei confronti della Turchia, posizione inizialmente negativa a causa dell’appartenenza della Turchia alla NATO, nonché dell’azione svolta negli anni Novanta dagli attivisti turchi nei Paesi della CSI. Verso la fine degli anni Novanta, però, la situazione della Turchia ha cominciato a cambiare, poiché alcuni membri dei gruppi kemalisti degli ambienti militari, così come l’élite intellettuale e molti partiti e movimenti politici si sono resi conto che l’identità nazionale turca è minacciata di scomparsa qualora Ankara continui ad eseguire gli ordini di Washington nella politica internazionale e regionale. Questi circoli sollevano un grande interrogativo, perfino per quanto concerne l’integrazione della Turchia nell’Unione Europea, proprio a causa dei timori relativi alla perdita dell’identità turca. I Turchi stessi parlano sempre più di Eurasia, vedendo in quest’ultima il luogo della loro identità, così come già fanno i Russi e i Kazaki. Per adesso i pareri sono discordi, non solo nell’élite politica, ma anche presso la popolazione. Ciò si riflette anche nel caso di alcuni dirigenti politici turchi (ad esempio il generale Tuncer Kilinc), che considerano la possibilità di ritirare la Turchia dalla NATO e di avvicinare la Turchia alla Russia, all’Iran e alla Cina nel nuovo contesto multipolare.
Di questa evoluzione della politica turca non c’è traccia nei Fondamenti della geopolitica; a tale argomento è completamente dedicato il recente lavoro L’Asse Mosca-Ankara. Nonostante i brani antiturchi, i Turchi hanno mostrato interesse nei confronti dei Fondamenti della geopolitica, che sono diventati un testo di riferimento ed un vero e proprio manuale per i dirigenti politici e militari, aprendo loro una nuova prospettiva sul mondo, non solo verso l’Occidente, ma anche verso Est.
Parimenti, nel libro non sono presi in esame la vittoria di Mosca in Cecenia, i fatti di New York dell’11 settembre 2001, i tentativi di creare un asse Parigi-Berlino-Mosca al momento dell’invasione americana in Iraq, la secessione del Kosovo e la guerra russo-georgiana dell’agosto 2008.
Ciononostante, il lettore attento dei metodi presentati nei Fondamenti della geopolitica avrà la possibilità di effettuare la propria analisi in relazione al Progetto Eurasia. La geopolitica è in grado di rispondere alle domande “che cosa” e “dove”, facendo sì che le risposte siano precise quanto più possibile. Ma, per quanto concerne un determinato momento del futuro, si capisce bene che le previsioni non possono essere altrettanto rigorose. La geopolitica descrive il quadro di manifestazione degli eventi in relazione con lo spazio, ma anche le condizioni e i limiti dei processi in divenire. Come sappiamo, la storia è una questione sempre aperta, per cui gli eventi che possono aver luogo nel loro quadro avverranno e si manifesteranno in modi diversi. Certo, gli eventi seguono il vettore della logica geopolitica, per allontanarsene qualche volta o addirittura per spostarsi su una direzione contraria. Ma anche questi allontanamenti recano in sé un senso e una spiegazione geopolitica, implicando tutta una serie di forze, ciascuna delle quali tende ad assumere i processi e gli avvenimenti a proprio vantaggio. Per questo si usano metodi diversi, al di fuori dell’esercito, che nei decenni passati aveva un ruolo essenziale, mentre adesso un ruolo più efficiente viene svolto dalla “rete” armata (guerra delle reti); quest’ultima ha l’obiettivo di stabilire un controllo sull’avversario ancor prima del confronto diretto, attraverso la cosiddetta “azione degli effetti di base”. In questa “guerra delle reti” la conoscenza o l’ignoranza delle leggi della geopolitica (e ovviamente di tutti gli effetti connessi) è determinante.
Quindi non c’è da meravigliarsi se proprio coloro che traggono il massimo vantaggio dai frutti della geopolitica dichiarano, rispondendo alla domanda circa la serietà di quest’ultima, che essi in linea di principio non si sottopongono ai suoi rigori.
(Trad. di C. Mutti)
* Aleksandr G. Dugin (n. 1962), dottore in filosofia e in scienze politiche, è rettore della Nuova Università, direttore del Centro Studi Conservatori dell’Università di Stato di Mosca, nonché fondatore del Movimento Eurasia. Il testo qui tradotto è la Prefazione scritta da A. Dugin per l’edizione romena dei Fondamenti della geopolitica (Bazele geopoliticii, Editura Eurasiatica, Bucarest 2011).
00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, roumanie, eurasisme, alexandre douguine, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 novembre 2010
Il mito, per Eliade, dà valore e significato al mondo e alla vita
di Francesco Lamendola
Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]  L’uomo non può vivere senza miti; meglio: non può vivere senza un sistema di pensiero mitico, che integri in se stesso l’intero fenomeno dell’esistenza.
L’uomo non può vivere senza miti; meglio: non può vivere senza un sistema di pensiero mitico, che integri in se stesso l’intero fenomeno dell’esistenza.
Poiché l’universo mitico è proprio delle culture arcaiche e di quelle tradizionali, comunque del mondo pre-moderno, esiste un atteggiamento di sufficienza e di distacco nei suoi confronti, quasi che si trattasse della espressione di un pensiero bambino, giustificato in un conteso “primitivo”, ma assolutamente incongruo nella razionale società odierna.
Questo grossolano pregiudizio scientista fa sì che la cultura occidentale moderna stenti a trovare gli strumenti operativi e le stesse categorie concettuali atti a comprendere il fenomeno della mitologia dall’interno, ossia cogliendone le vitali articolazioni con l’orizzonte spirituale dei popoli che l’hanno elaborata, per dare fondamento alla loro esistenza e per stabilire una relazione di corrispondenza fra se stessi e la realtà circostante.
Il mito non è soltanto uno strumento per razionalizzare i fenomeni naturali e per rassicurare le paure ancestrali dell’uomo, come vorrebbe la Vulgata scientista, ma qualcosa di molto più complesso e di molto più elevato: è una finestra sulla dimensione trascendente spalancata nell’immanente, sull’atemporale nel temporale, sull’assoluto nel relativo.
Grazie al mito, la realtà assume un significato e si presenta all’uomo sotto la categoria dei valori: a cominciare dalla sua stessa esistenza, collegata al passato (antenati) e al futuro (discendenti), nonché a tutti gli altri viventi, vegetali ed animali, al cielo, alla terra, alle stagioni, al giorno e alla notte; e pervasa da poderose correnti di presenze sovrumane, ora benevole ora maligne, che l’uomo stesso può, a determinate condizioni, comprendere e, talvolta, padroneggiare.
Se l’animale cade sotto la freccia del cacciatore, ciò non avviene per esclusivo merito dell’abilità di quest’ultimo; se la spiga di grano germoglia e giunge a maturazione, ciò non è solamente effetto del lavoro dell’agricoltore. Esiste un patto fra l’uomo e le forze della natura, sottoscritto dagli antenati e rinnovato continuamente mediante i riti sciamanici e le prescrizioni totemiche, grazie al quale la Terra offre all’uomo ciò di cui ha bisogno, purché ne usi con saggezza e con moderazione e purché si riconosca debitore di tutto ciò che riceve.
Il mito è la struttura di pensiero che rende ragione di tutto ciò e, di conseguenza, che offre all’uomo la prospettiva di un significato insito nelle cose, in tutte le cose, ivi compreso il suo stesso esistere; in questo senso, si può anche dire che il pensiero mitico è una forma embrionale di pensiero filosofico, o, per dir meglio, una forma di pensiero parallela al pensiero filosofico. Infatti la mitologia non è una sorta di filosofia bambina, ma una forma di pensiero che, come la filosofia, tende a spiegare l’origine delle cose e della vita; non limitandosi - però - alla dimensione del pensiero logico, né ad una conoscenza di tipo oggettivo ed esterno alle cose, ma calandosi, per così dire, nelle cose stesse, onde rivelarne il volto nascosto ed i significati profondi, che parlano all’uomo per mezzo di simboli.
Ciò non significa in alcun modo che il mito sia una forma di conoscenza inferiore alla filosofia; tanto è vero che un filosofo della statura di Platone si è servito del mito proprio per tentare di esplorare alcune delle verità più profonde e difficili. (Ma su tutto questo, vedi anche il nostro precedente articolo: «Il pensiero mitico è diverso, non certo inferiore a quello scientifico», particolarmente dedicato alla riflessione dell’epistemologo tedesco Kurt Hübner, apparso sul sito di Arianna Editrice in data 15/01/2008).
Il grande storico delle religioni Mircea Eliade ha dedicato gran parte dei suoi studi e delle sue riflessioni proprio ad illuminare il significato del mito nel contesto delle culture arcaiche, con particolare riguardo allo sciamanesimo; e, su tale argomento, ha scritto alcune delle pagine più significative che l’intera cultura europea abbia prodotto.
Osserva, dunque, Eliade in «Mito e realtà» (titolo originale: «Myth and Reality»; trasduzione italiana di Giovanni Cantoni, Roma, Borla Editore, 1974, pp. 144-46):
«In un mondo simile [ossia quello del mito], l’uomo non si sente rinchiuso nel suo modo d’esistenza; anch’egli è “aperto”, comunica con il mondo, perché utilizza lo stesso linguaggio: il simbolo. Se il mondo gli parla attraverso i suoi astri, le sue piante e i suoi animali, i suoi fiumi e i suoi monti, le sue stagioni e le sue notti, l’uomo gli risponde con i suoi sogni e la sua vita immaginativa, con i suoi antenati oppure con i suoi “totem” - ad un tempo natura, sovranatura ed esseri umani -, con la sua capacità di morire e risuscitare ritualmente nelle sue cerimonie di iniziazione (né più né meno della luna e della vegetazione), con il suo potere di incarnare uno spirito mettendosi una maschera, ecc. Se il mondo è trasparente per l’uomo arcaico, anche questo si sente “guardato” e compreso dal mondo. La selvaggina lo guarda e lo comprende (spesso l’animale si lascia catturare perché sa che l’uomo ha fame), come pure la roccia, o l’albero, o il fiume. Ciascuno ha la sua storia da raccontargli, un consiglio da dargli.
Pur sapendosi essere umano e accettandosi come tale, l’uomo delle società arcaiche sa anche di essere qualche cosa di più. Per esempio, sa che il suo antenato è stato un animale, oppure che può morire e tornare alla vita (iniziazione, trance sciamanica) , che può influenzare i raccolti con le sue orge (che può comportarsi con la sua sposa come il cielo con la terra o che può avere la parte del vomere e sua moglie quella del solco). Nelle culture più complesse, l’uomo sa che il suo respiro è vento, che le sue ossa sono simili a montagne, che un fuoco brucia nel suo stomaco, che il suo ombelico può diventare “centro del mondo”, ecc.
Non bisogna immaginare che questa “apertura” verso il mondo si traduca in una concezione bucolica dell’esistenza I miti dei “primitivi” e i rituali che ne dipendono non ci rivelano un’Arcadia arcaica. Come si è visto, i paleocoltivatori, assumendosi la responsabilità di far prosperare il mondo vegetale, hanno accettato ugualmente la tortura delle vittime a vantaggio dei raccolti, l’orgia sessuale, il cannibalismo, la caccia di teste.
Si tratta di una concezione tragica dell’esistenza, risultato della valorizzazione religiosa della tortura e della morte violenta. Un mito come quello di Hainuwele [tramandato nelle Isole Molucche, nella parte più orientale dell’odierna Indonesia], e tutto il complesso socio-religioso che esso articola e giustifica, forza l’uomo ad accettare la sua condizione di essere mortale e sessuato, condannato a uccidere e a lavorare per potersi nutrire. Il mondo vegetale e animale gli “parla” della sua origine, cioè, in ultima analisi, di Hainuwele; il paleo coltivatore comprende questo linguaggio e scopre un significato per tutto ciò che lo circonda e per tutto ciò che fa. Ma questo lo obbliga ad accettare la crudeltà e l’uccisione come parte integrante del suo modo d’essere. Certamente, la crudeltà, la tortura, l’uccisione, non sono comportamenti specifici ed esclusivi dei “primitivi”. Li si incontra lungo tutta la storia, talvolta con un parossismo sconosciuto alle società arcaiche. La differenza consiste soprattutto nel fatto che, per i “primitivi”, questa condotta violenta ha un valore religioso ed è ricalcata su modelli sovrumani. Questa concezione si è protratta a lungo nella storia. Gli stermini di massa di un Gengis Khan, per esempio, trovano ancora una giustificazione religiosa.
Il mito non è, in se stesso, una garanzia di “bontà” e di moralità. La sua funzione consiste nel rivelare dei modelli e nel fornire così un significato al mondo e al’esistenza umana. Anche il suo ruolo nella costituzione dell’uomo è immenso. In virtù del mito, lo abbiamo detto, le idee di REALTÀ, di VALORE, di TRASCENDENZA, vengono lentamente alla luce. In virtù del mito, il mondo si lascia cogliere come cosmo perfettamente articolato, intelligibile e significativo. Raccontando come le cose sono state fatte, il mito svela per chi e per che cosa sono state fatte e in quale circostanza. Tutte queste “rivelazioni” impegnano direttamente l’uomo, perché costituiscono una “storia sacra”.»
Come si vede, la visione di Eliade è lontanissima da ogni edulcorazione in chiave roussoiana delle società arcaiche; nessun mito del buon selvaggio, nessuna “bontà” intrinseca del mondo mitico: e, del resto, basta un minimo di conoscenza della storia e della letteratura antiche per rendersene immediatamente conto.
Non è forse per espletare un rito di natura espiatoria e propiziatoria che Achille uccide i dodici giovinetti troiani sulla pira di Patroclo; episodio che perfino il raffinato Virgilio, esponente di una cultura molto più “moderna”, riprende nella sua «Eneide»? Ebbene, si tratta di un’azione che acquista significato alla luce della credenza in un legame tra l’aldiqua e l’Aldilà, che trae origine e significato alla luce del mito: nel caso specifico, la credenza che il sangue di alcune vittime innocenti possa placare i Mani di un defunto strappato anzitempo alla vita.
E non sono forse piene le tombe etrusche, a cominciare dalla celeberrima Tomba François di Vulci, di simili raffigurazioni, addirittura impressionanti nella loro carica di tragicità e di cruento realismo, con il demone infernale Charun (latrino Charon), dall’aspetto spaventoso, che accompagna le anime nel loro viaggio al Regno dei morti?
Eliade ci ricorda che la pratica del sacrificio umano è indissolubilmente legata alle culture dei paleocotivatori; e l’archeologia ce ne dà conferma, da un capo all’altro del mondo, dall’Europa alle Americhe: ad esempio con le cerimonie dei Maya per scongiurare la siccità mediante il sacrificio di una fanciulla vergine, che veniva precipitata in un pozzo, o con quella degli Skidi Pawnee dedicata alla Stella del mattino, nella quale, sempre per propiziarsi le forze magiche della natura, essi uccidevano una vergine, all’alba, trafiggendola con piccole frecce infuocate.
Sbagliano, dunque, sia coloro i quali ostentano disprezzo verso la concezione mitica del mondo, sia coloro i quali la idealizzano in maniera ingenuamente acritica, proiettando su di essa il loro vagheggiamento di un Eden incontaminato e perfetto, che nasce dalla frustrazione di essere membri di una società esasperatamente individualista e materialista.
La funzione del mito era ed è essenzialmente quella di rivelare la dimensione nascosta, originaria, delle cose, mostrando la stretta interconnessione che tutte le congiunge e che unisce ad esse anche l’uomo.
Al tempo stesso, il mito tramanda il ricordo di un tempo in cui un ordine felice regnava nel mondo e l’uomo stesso godeva di uno statuto privilegiato; cose entrambe che sono andate perdute a causa di un disordine, di una perturbazione, di una caduta che ha incrinato l’assetto originario, ma che appunto il mito è in grado di recuperare, almeno parzialmente, consentendo all’uomo di ricollegarsi a quella fortunata condizione originaria.
In questo senso, è corretto affermare che il mito punta a reintegrare l’uomo nella sua pienezza ontologica e che tale reintegrazione assume le forme e la prospettiva di una elevazione, ossia di un superamento della sua condizione presente, limitata e precaria, per sviluppare e potenziare in lui le facoltà superiori, ivi compresa quella di parlare alle cose, alle piante, agli animali e, pertanto, di rinsaldare i vincoli magici che tengono in equilibrio le forze cosmiche.
Il mito si collega anche da questo lato allo sciamanesimo e dischiude all’uomo la possibilità di inserirsi non più da spettatore inerme o da vittima rassegnata, ma da autentico protagonista, nel gioco di tali forze cosmiche, dalle quale può attingere poteri e possibilità che, nello stato ordinario di esistenza, sono per lui inimmaginabili.
Infine il mito delinea una concezione sacrale del reale; una concezione, cioè, che, rivestendo di mistero e di potenza gli elementi del cosmo, si pone agli antipodi della nostra cultura secolarizzata e della sua pretesa di capire tutto, di spiegare tutto, di misurare e quantificare ogni cosa, alla luce del Logos strumentale e calcolante.
Il mito, infatti, non è, semplicemente, conoscenza del reale, ma rivelazione: e, come tale, presuppone un “corpus” di dottrine esoteriche che solo nei tempi e nei modi stabiliti possono venir trasmessi di generazione in generazione, essendo di origine superiore all’umana; ciò che va propriamente sotto il nome di Tradizione.
Riconoscendo una Tradizione sovrumana, dalla quale derivano tanto l’ordine cosmico, quando le dottrine iniziatiche che permettono all’uomo di scorgerlo, di rispettarlo e di porsi in sintonia con esso, il mito si pone, in effetti, come una forma di approccio al reale radicalmente diversa, e antagonista, rispetto a quella cui noi moderni siamo ormai talmente abituati, da considerarla l’unica vera e realmente efficace.
Una cosa è certa: finché non scenderemo dal piedistallo della nostra presunzione scientista, non potremo capire nulla del mito e continueremo o a denigrarlo, o a idealizzarlo, senza mai penetrarne l’intima essenza.
Che non si lascia catturare in schemi di tipo esclusivamente logico e scientifico, quali quelli cui siamo abituati da quattro secoli di razionalismo materialista e meccanicista; ma che richiede un salto, una discontinuità nel nostro atteggiamento verso il reale, che coinvolga non solo il Logos, ma tutte le nostre facoltà, a cominciare dai sensi interni e dalle potenzialità sopite dell’anima.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:10 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, religion, tradition, traditions, traditionalisme, mythologie, mythe, mythes, mircea eliade, roumanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 octobre 2010
Nationalism and Identity in Romania
Nationalism and Identity in Romania: A History of Extreme Politics from the Birth of the State to EU Accession
Radu Cinpoes (author)
Hardback £59.50
 The collapse of communism in Central and Eastern Europe produced a fundamental change in the political map of Europe. In Romania, nationalism re-emerged forcefully and continued to rally political support against the context of a long and difficult transition to democracy. Extreme right-wing party The Greater Romania Party gained particular strength as a major political power, and its persuasive appeal rested on a reiteration of nationalism and identity - and themes such as origins, historical continuity, leadership, morality and religion - that had been embedded in Romanian ideological discourse by earlier nationalist formations. Radu Cinpoes here examines the reasons for the strength and resilience of nationalism in Romania, from the formation of the state to its accession in the EU.
The collapse of communism in Central and Eastern Europe produced a fundamental change in the political map of Europe. In Romania, nationalism re-emerged forcefully and continued to rally political support against the context of a long and difficult transition to democracy. Extreme right-wing party The Greater Romania Party gained particular strength as a major political power, and its persuasive appeal rested on a reiteration of nationalism and identity - and themes such as origins, historical continuity, leadership, morality and religion - that had been embedded in Romanian ideological discourse by earlier nationalist formations. Radu Cinpoes here examines the reasons for the strength and resilience of nationalism in Romania, from the formation of the state to its accession in the EU.
Radu CinpoeA specializes in nationalism and identity politics. He is lecturer in Politics and Human Rights at Kingston University, where he also obtained his PhD in 2006.
Imprint: I.B.Tauris
Publisher: I.B.Tauris & Co Ltd
Series: International Library of Political Studies
Hardback
ISBN: 9781848851665
Publication Date: 21 Sep 2010
Number of Pages: 320
00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, nationalisme, identité, mouvement identitaire, roumanie, balkans, europe centrale, mitteleuropa, europe orientale, histoire, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 septembre 2010
Lettre ouverte de DEXTRA à l'Ambassadeur de Roumanie
00:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fance, roumanie, europe, affaires européennes, roms, nomades, expulsions, actualité, immigration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 11 septembre 2010
La metafisica del sesso in Mircea Eliade
di Giovanni Casadio* Mircea Eliade nacque nel marzo 1907 e morì nel 1986, quindi a poco più di 79 anni. Trascorse 3 anni in India, quasi un anno in Inghilterra, quasi 5 anni in Portogallo (Lisbona e Cascais), 11 anni a Parigi, 30 anni in America (Chicago) e naturalmente 33 anni in Romania, gli anni della formazione, durante i quali fece continui viaggi in Italia e in Germania. Durante i 30 anni di relativa stabilità a Chicago, quasi tutte le estati traslocava in Francia, con lunghe trasferte prima nel Canton Ticino e poi in Italia.
Fonte: Rinascita [scheda fonte]
“La vita è fatta di partenze”
Jurnalul Portughez, 19 luglio 1945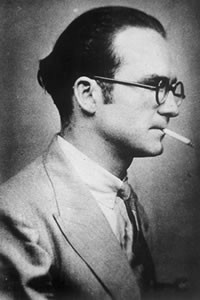
Si sposò due volte (come adombrato nel proverbio “di Venere e di Marte non si sposa e non si parte”, le nozze sono come un imbarco per un viaggio assai incerto). La prima moglie Nina Mareş (dal 1934 al 1944), la seconda Christinel Cottescu (dal 1950 al 1986) furono devotissime amanti, massaie e segretarie. Ebbe una decina di amori extraconiugali importanti (i più notevoli, quello con Maitreyi, per il contesto orientale e il libro – anzi i due libri – che ne seguirono, e quello con Sorana, per l’exploit orgasmico di cui parlerò nel seguito). E svariate altre donne: non tantissime come il coetaneo Georges Simenon (1903-1989), che si vantava di aver consumato un numero di donne superiore a quello delle matite usate nei suoi innumerevoli scritti (quattrocento e più romanzi e migliaia di articoli) e in un’intervista al vitellone romagnolo Federico Fellini dichiarava: “Fellini, je crois que, dans ma vie, j’ai été plus Casanova que vous! J’ai fait le calcul, il ya un an ou deux. J’ai eu dix mille femmes depuis l’âge de treize ans et demi. Ce n’est pas du tout un vice. Je n’ai aucun vice sexuel, mais j’avais besoin de communiquer!”
Ma anche i libri o gli articoli che si scrivono e poi (non sempre) si pubblicano sono partenze. Un elenco provvisorio, probabilmente in difetto, potrebbe essere il seguente: Romanzi o racconti lunghi: 15 - volumi di novelle: 4 - diari: 5 - volumi di memorie: 2 - drammi: 4 - saggi di storia delle religioni, di filosofia, di critica letteraria: 34 e più - curatele di opere singole o collettive: 2 tomi (Bogdan Hasdeu); 1 tomo (Nae Ionescu); 4 tomi (From Primitives to Zen: fonti di storia delle religioni), 15 voll. (Encyclopedia of Religion) - riviste fondate e dirette o co-dirette: 1. Zalmoxis, 2. Antaios, 3. History of Religions.
Aggiungiamo più di 1900 articoli, pubblicati in riviste e miscellanee di varia cultura soprattutto nel periodo romeno, ripresi solo in minima parte nelle opere menzionate sopra. E non parliamo degli infiniti frammenti inediti: abbozzi di libri non condotti a termine, note erudite, appunti di diario smarriti nei vari traslochi o da lui stesso gettati nelle fiamme o distrutti nel grande incendio che devastò il suo ufficio all’Università di Chicago un anno prima della morte. Molto si trova ancora nei 177 scatoloni del fondo Eliade conservato allo “Special Collections Research Center” presso la Regenstein Library della Università di Chicago, insieme alla corrispondenza, i manoscritti e le prime copie a stampa di tutti i libri pubblicati da Eliade, scritti su di lui e altro materiale interessante, compreso la famosa pipa, 5 temperini e un calzascarpe. Certo una bagattella al confronto della produzione del quasi coetaneo teologo indo-catalano Raimon Panikkar (1918-), al quale si devono più di 60 voll. e più di 1500 articoli, ma – si sa – i teologi scrivono sotto la dettatura di Dio (ed Eliade non era un teologo, contrariamente a quanto molti pensano). Ma un numero abbastanza cospicuo per comprendere che siamo di fronte a un essere fenomenale: un individuo ossessionato da una specie di delirio della scrittura-confessione, in funzione di una fuga dalla realtà (in gergo psicologico “escapismo”), che è poi una forma estrema di svago o distrazione, il cui scopo è d’estraniarsi da un’esistenza nei confronti della quale si prova disagio.
Infinite (in svariate lingue) le monografie, le miscellanee, gli articoli, le voci d’enciclopedia, le recensioni, le tesi di laurea sui più disparati aspetti della sua vita e della sua opera. E – ed è ciò che più conta – infinite citazioni dei suoi scritti in opere di storia delle religioni e di ogni altro genere letterario; per fare un esempio, Eliade è l’unico storico delle religioni menzionato in due opere chiave di due papi, Karol Józef Wojtyła (Varcare la soglia della speranza) e Joseph Ratzinger (Fede, verità, tolleranza).
La sua vita in Portogallo
In questa sede, ci proponiamo di affrontare alcuni momenti del suo vissuto interiore nel periodo portoghese. Premettiamo che Eliade stette in Portogallo, prima come addetto stampa, poi come consigliere culturale, poi di nuovo come addetto stampa, poi come privato cittadino (in ragione dei mutamenti del vento politico romeno) dal 10 febbraio 1941 al 13 sett. 1945, esattamente 4 anni e 7 mesi: sono date che parlano da sé …
Il Jurnal portughez è il più importante dei diari di Eliade per due motivi. Anzitutto esso si diversifica da Şantier (“Cantiere”, noto in Italia come Diario d’India) e dai tre voll. di Fragments d’un journal ovvero Journalul in romeno (che vanno dall’arrivo in Francia nel ’45 alla morte dell’autore nell’86) perché non fu ridotto (e censurato) dall’Autore per la pubblicazione, sia perché non ne ebbe il tempo sia perché non si trovò mai nella disposizione d’animo adatta per fare i conti con il vissuto psichico di quegli anni colmi di avvenimenti funesti per lui, per il suo paese e per il resto del mondo. Sia chiaro: quando Eliade scrive, scrive sempre col pensiero al lettore. Una volta, infatti, osserva che solo quando lui avrà sessant’anni quei pensieri potranno essere resi di pubblico dominio, e solo allo stato di “frammenti”, estrapolati dall’insieme delle confessioni: così scrive il 5 febbraio 1945. Alla sua morte la moglie Christinel non si è mai decisa a dare il permesso della pubblicazione: solo pochissimi intimi hanno avuto accesso al manoscritto conservato nel fondo Eliade della Biblioteca Regenstein di Chicago, tra i quali l’amico romeno Matei Calinescu (1934-2009) e il fedelissimo allievo e biografo McLinscott Ricketts. Ricapitolando, il testo manoscritto è stato pubblicato così come era stato buttato giù dall’autore, e sarebbe dunque la prima volta che ci troviamo di fronte ai pensieri immediati di Eliade, un autore che anche critici benevoli come N. Spineto e B. Rennie considerano un grande bugiardo, costruttore e manipolatore del proprio personaggio per la posterità.
Abbiamo detto che il Jurnal del periodo portoghese è più importante di tutti gli altri diari per due motivi. Il primo, si è visto, risiede nel suo carattere di documento genuino, immediato, in quanto presenta i suoi pensieri senza tagli o rielaborazioni. Il secondo motivo è di ordine contenutistico, e non è meno essenziale. In esso infatti sono narrati: 1) i pensieri e le emozioni che fanno da sostrato alle due opere di Eliade (apparse entrambe nel 1949 ma cominciate in quegli anni luttuosi) di gran lunga più lette e citate, cioè il Traité d’histoire des religions (prima concepito come “Prolegomeni” e poi ripresentato in inglese come Patterns) e il Mythe de l’éternel retour (successivamente presentato in inglese col titolo più descrittivo Cosmos and History); 2) le emozioni e i pensieri generati dal progressivo disfacimento – cui seguirà un inesorabile collasso – delle due cose che al Nostro erano più care, la patria -nazione romena, neamul românesc (sotto il rullo compressore delle armate sovietiche e per la inettitudine o complicità di “piloti orbi” di varie tendenze), e la sposa Nina Mareş (in seguito agli effetti devastanti di un cancro all’utero). E – come è stato notato anche da Alexandrescu, che definisce il Diario portoghese “Apocalisse di Eliade” o “secondo Mircea Eliade” (p. 317, trad. ital.; p. 26, ed. romena) – tra le due catastrofi esiste un inscindibile nesso, quale quello che può sussistere tra le vicende del macrocosmo-mondo e quelle del microcosmo-uomo, per restare nei termini di una polarità derivata da una tradizione – quella indiana – a lui estremamente familiare (si veda, ad es. nel Diario, la riflessione del 25 sett. 1942: “Quando l’uomo scopre sé stesso, ātman, scopre l’assoluto cosmico, brahman, e nello stesso tempo coincide con esso”, p. 49, trad. it.). In queste circostanze, e da esse condizionato e afflitto, egli elabora una serie di formule ermeneutiche che anticipano la filosofia delle due opere. Da queste circostanze, in maniera ancora più evidente, nascono una serie di riflessioni assolutamente brutali sulla situazione politica del tempo e sulla propria intimità personale, riflessioni che non mancheranno di suscitare gli strilli indignati delle anime belle e dei corifei della correttezza politica. Diamo quindi la parola all’autore stesso: all’Eliade intimo.
La bella giudea di Cordova
Anzitutto una riflessione sulla donna come virtuale soggetto e oggetto di desiderio e di innamoramento. Il 5 ottobre 1944 Eliade è a Cordova per un congresso in cui avrebbe parlato di miti sull’origine delle piante. Nella piazzetta di Maimonide adocchia “dal gruppo di curiosi che ci guardano passare, una ragazza straordinariamente bella, con una macchia bruna sotto gli occhi. Un tipo marcatamente ebraico” (p. 169 trad. it.). In lui si accende la fiamma del desiderio; non lo dice – secondo lo stile reticente e allusivo che è tipico del suo diario –, ma è evidente dalla narrazione che segue. “Al Depósito de Sementales (cioè il deposito degli stalloni), perché ci vengano mostrati i cavalli. Il primo cavallo che ci presentano è da monta: poderoso, ma terribile. In effetti il sesso non è mai bello, manca di grazia, non ha altra qualità tranne quella della riproduzione potenziata in modo mostruoso. Sono convinto che la maggior parte dei cavalli arabi e arabo-ispanici che ci vengono fatti vedere, superbi, nervosi e fieri, siano impotenti, o quasi. Il pensiero che la forza generativa che sento turbarmi sin dall’adolescenza potrebbe essere il grande ostacolo tra me e lo spirito puro, l’uccello del malaugurio del mio talento, mi deprime. Che cosa avrei potuto creare se fossi stato meno schiavo della carne!”. Eliade fu certo ossessionato dall’antitesi tra libido copulandi e libido scribendi (sentite entrambe come forme di creazione potenziale), ma non ricorse mai come il giudeo greco alessandrino Origene al rimedio estremo della castrazione. Per domare le urgenze della carne dovette attendere il naturale sedarsi dell’istinto sessuale, in seguito al trascorrere degli anni e grazie alla compagnia di una donna castrante come Christinel Cottescu. Lì a Cordova, la visione in rapida successione della bella giudea e dei potenti/impotenti stalloni fa scattare nella sua mente un’intuizione sulle modalità dell’eros femminile che è certo basata sulla sua ventennale esperienza di seduttore ma anche su una raffinata capacità di cogliere gli aspetti sottili della realtà, capacità che è poi anche quella che contraddistingue la sua ermeneutica dei fenomeni religiosi nei loro aspetti simbolici. “Dubito che le donne amino la violenza come stile erotico e abbiano un debole per gli uomini brutali. La donna è sensibile in primo luogo all’intelligenza (come la intende lei, ovviamente: “vivacità di spirito”, “facezia” [spirt, drăcos, glumeţ], ecc.); più che alla stessa bellezza. In secondo luogo, è sensibile alla bontà. Tutti i racconti con donne ossessionate da uomini brutali, ecc., sono invenzioni letterarie di certi decadenti. Statisticamente, e soprattutto nei villaggi, ciò che attrae nel 90 % le donne è il “cervello” (deşteptăciunea) e la bontà. Non è la capacità generativa a distinguerci dalle donne, ma l’intelligenza” (p. 170 trad. it.).
La conclusione di Eliade, per quanto generalizzante, è sicuramente fondata e potrebbe assegnare al suo autore un posto d’onore tra i trattatisti dell’amore nella serie che va da un Andrea Cappellano a un Henri Stendhal, fino a un Francesco Alberoni, si licet parvis componere magnis. Merita attenzione il corollario di questa riflessione che sembra caratteristico di una mentalità tipicamente maschilista, piuttosto disinvolta nei riguardi delle capacità intellettuali del gentil sesso: “Non è la capacità generativa a distinguerci dalle donne, ma l’intelligenza”.
Intelligenza e gentil sesso
Vuole egli intendere, con questa asserzione, che le donne sono prive di intelligenza?
Probabilmente sì, nel senso che le donne sarebbero prive di quel certo tipo di intelligenza o prontezza di spirito che esse prediligono in quegli uomini che ai loro occhi ne appaiono dotati. E credo invero che quel suo insistere sulla differenza (quella certa cosa che ci distingue dalle donne, “ne distingue de femei”), debba intendersi nel senso che le donne – come del resto gli uomini – sono naturalmente attratte (per la nota legge chimico-fisica sull’attrazione tra poli contrari) da quegli uomini che possiedono in maniera marcata una caratteristica di cui esse si sentono prive: il che naturalmente è vero solo in certi casi. E sarà lo stesso Eliade a notarlo in un pensiero successivo che sembra in netta contraddizione con questo.
L’11 aprile 1945, meno di un anno dopo, il Nostro è in uno stato di acuta irritazione nei riguardi dei suoi compatrioti maschi (in particolare i funzionari del ministero degli Esteri, pronti a inchinarsi di fronte al nuovo padrone sovietico) e in più soggetto a una crisi nevrastenica, “alimentata in modo naturale dalla mia insoddisfazione erotica”. Il suo pessimismo “per quel che riguarda la condizione attuale dell’uomo” lo induce ad impietose considerazioni che smascherano la (presunta) superiorità dell’intelligenza maschile. “Certe volte mi deprime l’enorme ruolo che continua a svolgere la vanità nella vita di quasi tutti gli uomini; superiore a quello del sesso, della fame o della paura della morte. Mi convinco egualmente che il maschio ‘in generale’ è di gran lunga più stupido di quello che ritenevo sino a qualche anno fa. La lucidità del maschio è una leggenda. Conosco, oggi, moltissimi uomini che sono stati scelti, menati per il naso e ‘acchiappati’ da donne completamente prive di ogni tipo di attrattiva – senza che essi avessero anche solo il sospetto del ruolo passivo che hanno avuto. (…) In moltissime coppie che ho conosciuto negli ultimi sette, otto anni, le mogli sono molto al di sotto del livello dei mariti, ma infinitamente più intelligenti e abili di loro, prova ne sia il fatto che se li tengono. Al contrario, quasi tutte le donne ammirevoli che ho conosciuto in questo lasso di tempo sono rimaste senza marito, perché nessun uomo ha saputo sceglierle. D’altronde, credo che quasi nessun uomo scelga. È sempre scelto. Come spiegarmi, altrimenti, tante coppie assurde che conosco? La stupidità dei maschi non è mai tanto evidente come quando, dopo molti amoreggiamenti e avventure, decidono di sposarsi. Quasi sempre la sposa ‘scelta’ è di gran lunga inferiore alle donne con le quali hanno flirtato, ecc.” (p. 264-265, trad. it.). Sei mesi prima, come abbiamo visto, pare che egli pensasse esattamente il contrario. Anche se sembra evidente che nell’un caso egli si riferisce alle condizioni in base alle quali la donna si lascia sedurre, nell’altro alla strategia che mette in atto per sedurre – a fini matrimoniali. Sulla donna, sul mistero della mente femminile, comunque, fa cilecca la razionalità di Mircea Eliade, come faceva cilecca la razionalità di un Platone o di un Schopenhauer.
L’eros come emozione
e orgasmo
E dall’eros come “innamoramento” passiamo a un’altra serie di riflessioni attorno a un altro aspetto paradossale della tematica erotica: l’eros come emozione legata all’evento fisiologico dell’eccitazione e dell’orgasmo, di nuovo da un punto di vista prettamente maschile. Tra il 2 e il 3 di febbraio del 1945, quando la disperazione per la “sparizione di Nina” gli pare intollerabile, quando la lettera di quasi licenziamento del Ministero degli Esteri lo getta praticamente sul lastrico, egli giunge, come avrebbe detto Eschilo, al mathein attraverso il pathein: a un intuizione geniale attraverso l’angoscia e la sofferenza (p. 227, trad. it.). Egli si domanda: “Che cosa significa la perdita di tua moglie, in confronto alla grande catastrofe mondiale, nella quale lasciano la vita decine di migliaia di persone al giorno, che annienta città e strema nazioni?”. La risposta che Eliade dà è lucidissima, e getta, per così dire, un ponte tra il macro- e il microcosmo; e significa, nel fondo, che la massa non è che una somma di individui tra loro incomunicabili. “Gli risponderei: immaginati un giovane innamorato da tanto tempo, che, un bel giorno, riesce a far sua la donna amata. È felice, e nel vederlo traboccare di felicità tu gli dici: ‘Che interesse può avere il fatto che tu oggi abbia posseduto una donna! Alla stessa ora, in tutto il mondo, almeno un milione di coppie stavano facendo, come te, l’amore. Non c’è nulla di straordinario in quello che ti è successo!’. E, malgrado ciò, lui, innamorato, sa che ciò che gli è successo è stato straordinario”. In questa minirealtà – che poi tanto minima non è – Eliade dà mostra di una capacità introspettiva che gli fa cogliere quel tanto di banale e di balordo che è implicito nell’atto della consumazione, che assume significato solo attraverso l’amore, amore che è in grado di produrre una trasformazione quasi alchemica dell’evento fisiologico. Una capacità introspettiva che è in fondo in sintonia (ci sia concesso questo accostamento che ad alcuni potrà apparire irriverente o impertinente) con la sua riflessione su tempo ed eternità, quale si ritroverà appunto nel libro alla stesura del quale si accingerà il mese successivo e che apparirà in Francia quattro anni dopo col titolo Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition (Paris 1949). Per il resto della notte lo rode l’insonnia, durante la quale si accavallano pensieri dominati da una disperazione atroce e senza apparente via di uscita (“sento che qualsiasi cosa faccia il risultato è la disperazione”). E di nuovo si rifugia nell’escamotage del libertinaggio fine a se stesso, svuotato di ogni dimensione romantica.
“E ho un’alternativa: se mi getterò di nuovo in esperienze (leggi: erotismo), mi consumerò invano, perché nessun piacere fisico può essermi di consolazione una volta estinto (può forse consolarmi l’aver stretto tra le braccia Rica, Maitrey, Sorana e qualche altra? Mai un ricordo erotico consola; tutto si consuma per sempre nell’atto; si ricorda l’amore, l’amicizia, la storia legata a una donna, ma ciò che è stato essenzialmente erotico, il fatto in sé diventa nulla nell’istante successivo alla sua consumazione). Così, mi dico che devo accontentarmi di un equilibrio fisiologico acquisito senza grattacapi (un’avventura qualunque e comoda) e concentrarmi sulla mia opera, lasciandomi passare accanto la vita senza sentirmi costretto ad assaporarla, a cambiarla né ad avvicinarmela”. Alla lucidità della diagnosi (effettivamente è così: il ricordo erotico non consola, tutto si consuma per sempre nell’atto, da cui il pessimismo sull’eros come adempimento fisiologico frustrante di Lucrezio nel IV libro del De Rerum Natura e l’insaziabile concupiscenza di Don Giovanni nel mito e nella letteratura) segue la banalità della terapia: “un’avventura qualunque e comoda”, cioè evidentemente mercenaria.
Insomma, per salvarsi dalla depressione conseguente alla débacle sua personale e della sua patria, Eliade (in fondo ha solo 38 anni, un’età in cui gli ormoni sono ancora assai attivi) si rifugia nel sesso come atto biologico di puro consumo. Nei giorni e nelle notti che vanno dal 5 marzo al 15 aprile 1945, mentre la storia macina gli eventi (per usare un’espressione carducciana) come in nessun altro momento del secolo testé trascorso, il Nostro macina i propri testicoli con accanimento per così dire terapeutico. Negli intervalli della cronaca del pellegrinaggio a Fatima, “per il riposo dell’anima di Nina e la salvezza della mia integrità spirituale” (18 marzo, p. 252, trad. it.), e del successivo ritorno a Cascais ove si ritrova a lottare con i tira e molla del Ministero degli Esteri romeno e con i fantasmi del proprio passato, è tutto un susseguirsi di annotazioni di eventi crudamente neurologici e fisiologici (p. 249-269 trad. it.). Il 5 marzo egli comincia a sperimentare la sua inedita tecnica di liberazione dalla crisi nevrastenica dando briglia sciolta alla sua sensualità e ad una sfrenata ginnastica sessuale. “Oggi – annota – sono tornato alla fisiologia. In un’ora ho fatto l’amore tre volte con la stessa donna, un po’ meravigliata, bisogna dirlo, del mio vigore. Domani o dopodomani consulterò un neurologo: voglio tentare tutto. Mi affliggerebbe apprendere, ad esempio, che la mia nevrastenia e la mia melanconia sono dovute alle adorabili funzioni seminali” (p. 249, trad. it.). Il 14 marzo, alla vigilia della partenza per Fatima, annota: “Ripeterò la mia arcinota tecnica di liberazione attraverso l’eccesso, di purificazione attraverso l’orgia. (…) Voglio sapere se la mia melanconia ha o no radici fisiologiche. Voglio liberarmi da ogni influenza seminale, anche se questa liberazione implicherà sedurre un centinaio di donne” (p. 251, trad. it.). Il 16 marzo riceve dal neurologo la risposta che si attendeva: “le melanconie dipendono da cause spirituali”, ma la crisi generale ha motivazioni più biologiche, legate alla sua ipersessualità insoddisfatta: “non posso raggiungere l’equilibrio se non solo dopo la realizzazione di quello erotico” (p. 252, trad. it.). E durante il viaggio, nonostante le consolazioni spirituali del paesaggio “archetipico” si ritrova a lottare coi soliti fantasmi ormonali: “Tutto ieri e oggi ossessionato dal sesso” (22 marzo, p. 257, trad. it.). L’11 aprile, di nuovo a Cascais, ripete a sé stesso che la crisi nervosa è basata sull’insoddisfazione erotica. Ma i rapporti saltuari, per quanto spinti al massimo della sollecitazione ormonale, non lo soddisfano abbastanza: “avrei bisogno di un’amante giorno e notte” (11 aprile, p. 264, trad. it).
La politica, la pausa,
il lavoro
Il 15 aprile finalmente il Nostro riprende a lavorare (dopo la crisi di melanconia del giorno precedente in cui ha vissuto “un distacco definitivo dall’opera, dalla cultura, dalla filosofia, dalla vita e dalla salvezza”), ed è alle prese con la rilettura di Isabel şi apele diavolului (1929/30), in vista di un’eventuale nuova edizione. E allora, quasi proustianamente, riaffiorano in lui sensazioni e ossessioni che lo perseguitavano al momento della stesura del libro e immediatamente dopo la sua apparizione in Romania. “Un particolare mi turba: l’accento che pongo sulla sterilità, sull’impotenza. … Mi sono chiesto se il mio rifiuto (nel romanzo) di possedere Isabel non potrebbe interpretarsi psicoanaliticamente come un’ossessione di impotenza. Visto che non ho mai avuto tale ossessione, mi chiedo da dove provenga il rifiuto di possedere una ragazza che ti si offre, complicato dalla gioia sadica di vederla posseduta da un altro. È probabile che questa domanda se la siano posta anche gli altri. Rammento che Sorana, dopo una giornata eroica [meglio: “brava”, romeno: zi de vitejie] nel rifugio di Poiana Braşov dove feci dieci volte l’amore con lei, mi confessò che il mio vigore l’aveva sorpresa; perché, dopo aver letto Isabel, mi credeva quasi impotente. Ma, spaventata dalla mia energia, si confidò con Lily Popovici, che lei riteneva avesse avuto più esperienze in fatto di uomini. Lily le disse che, se non mi avesse conosciuto, avrebbe pensato che mi fossi drogato, che avessi preso delle pillole, ecc. La cosa più divertente è che io neppure mi rendevo conto d’essere in realtà messo tanto “bene”. Mi sembrava che qualsiasi uomo, se una donna gli piaceva, ed era rilassato, poteva fare l’amore dieci volte! Più tardi, ho capito che questo è un privilegio abbastanza raro” (p. 268, trad. it.). Questa ossessione della virilità, presente nella sua narrativa giovanile, è certo esistente allo stato latente nella sua psiche (per quanto egli si affretti a precisare il contrario: “Il problema della potenza o dell’impotenza non mi ha mai preoccupato”), altrimenti mal si spiegherebbe questa sua ricorrente, quasi puerile compiacenza nell’esibizione delle sue prodezze priapiche, ed è da Eliade ricollegata a un rifiuto ben più radicato e conscio: il rifiuto di generare prole, che si lega poi al lacerante senso di colpa prodotto dalla morte di Nina per cause probabilmente legate a un aborto violento che lui stesso le aveva imposto.
In queste meditazioni di un Eliade alla soglia dei quarant’anni è teorizzata, sul piano individuale, una tecnica di liberazione dall’angoscia (in altre parole, una tecnica di “salvezza”), basata sulla ginnastica copulatoria e l’estasi eaiaculatoria, senza che si tenti di elevarla su un piano di trascendenza metafisica o di stabilire alcun rapporto con i valori catartici e salvifici dell’orgia, temi peraltro assai familiari all’Eliade autore, nel 1936, di Yoga, essai sur les origines de la mystique indienne. L’aggancio di questo tema con più ampie realtà filosofiche e storico-religiose sarà invece compiuto da un altro storico e pensatore che è stato un suo dialettico compagno di strada in varie imprese, l’italiano Julius Evola (1898-1974), in Metafisica del sesso (1958; II ed. 1969). Un libro, questo, anch’esso frutto di una catastrofe personale mirabilmente metabolizzata, un libro che Eliade non avrebbe mai potuto scrivere, anche se fu testimone della sua gestazione in un incontro avvenuto nel maggio del 1952. In esso, in particolare nel terzo capitolo (Fenomeni di trascendenza nell’amore profano), Evola tratta dell’amplesso da un punto di vista superiore, cercando di cogliere quegli effetti trascendenti che rappresentano l’acme dell’atto sessuale. Come ha scritto Franco Volpi nel Dizionario delle opere filosofiche (Milano 2000, p. 357), nella voce appositamente dedicata a quest’opera apparentemente così poco filosofica, “Evola sviluppa una considerazione metafisica del sesso, ritenendo tale fenomeno un elemento troppo importante nella vita degli esseri per lasciarlo a spiegazioni semplicemente positivistiche e sessuologiche. Il sesso è la forza magica più intensa della natura, capace di esercitare su tutti i viventi un’attrazione irresistibile e tale da fornire, secondo Evola, l’occasione per trascendere la mera corporeità ed elevarsi fino al piano dello spirito. Il fenomeno del sesso implica dunque un potenziale estatico, iniziatico, che può essere portato alla luce soltanto guardando a esso dalla prospettiva metafisica”. E, conclude Volpi, “nell’eros – nei suoi attimi sublimi, ma a volte anche in esperienze d’amore quotidiane particolarmente intense – balugina la trascendenza, la quale può infrangere i limiti della coscienza quotidiana e produrre un’apertura spirituale. Il fenomeno del sesso getta così un ponte tra la fisica e la metafisica, tra la natura e lo spirito”. Ma queste cose l’Eliade del 1945, innamorato senza speranza di una donna che è ormai un fantasma e soggetto ancora a violente tempeste ormonali, non poteva o non voleva dirle.
*Ordinario di Storia delle Religioni all’Università di Salerno
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:10 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, métaphysique, sexualité, roumanie, mircea eliade, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 10 juillet 2010
Rumänien: Im Namen des Volkes
00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe orientale, europe centrale, roumanie, europe, affaires européennes, politique internationale, crise, finances |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 05 juillet 2010
Se Cioran il nichilista scopre l'amore assoluto
di Mario Bernardi Guardi
Fonte: secolo d'italia
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:11 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, roumanie, cioran, lettres, littérature, philosophie, lettres françaises, lettres roumaines, littérature française, littérature roumaine, pessimisme, amour, amour absolu |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 23 juin 2010
De slapeloze uit Rasinari
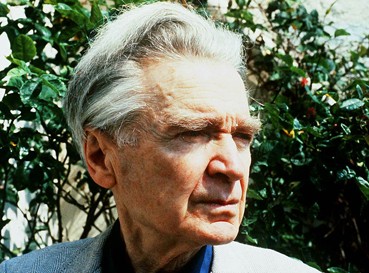 De slapeloze uit Răşinari
De slapeloze uit Răşinari
De slapeloze uit Răşinari
E. M. Cioran, On the heights of despair
 De Roemeense schrijvende filosoof E. M. Cioran, maakt mij bijzonder neerslachtig, maar doet mij daarvan de waarde realiseren. Met nadruk krijgt deze filosoof hier de voornaam 'schrijver' aangereikt. Zeer bekwaam is hij met woorden. Filosofie bij Cioran is van vlees en bloed, en moet daarom ook met het zwaard geschreven worden. Gaandeweg het boek doemde de impressie bij mij op dat zijn persoonlijke ontboezemingen, die meermaals als bijlage terugkeren, naast verstrengeld te zijn in de stukken - ook al erg ongebruikelijk in de filosofie - ertoe dienen om de filosofische wanhoop te bezweren. Maar die wanhoop - de ultieme wanhoop: de dood - is het enige waar we mee uit de voeten kunnen, want de logiek van de Griekse wijsgeren heeft voor Cioran afgedaan. Alleen door de lyriek beleven we de subjectieve chaos die ons universum beheerst.
De Roemeense schrijvende filosoof E. M. Cioran, maakt mij bijzonder neerslachtig, maar doet mij daarvan de waarde realiseren. Met nadruk krijgt deze filosoof hier de voornaam 'schrijver' aangereikt. Zeer bekwaam is hij met woorden. Filosofie bij Cioran is van vlees en bloed, en moet daarom ook met het zwaard geschreven worden. Gaandeweg het boek doemde de impressie bij mij op dat zijn persoonlijke ontboezemingen, die meermaals als bijlage terugkeren, naast verstrengeld te zijn in de stukken - ook al erg ongebruikelijk in de filosofie - ertoe dienen om de filosofische wanhoop te bezweren. Maar die wanhoop - de ultieme wanhoop: de dood - is het enige waar we mee uit de voeten kunnen, want de logiek van de Griekse wijsgeren heeft voor Cioran afgedaan. Alleen door de lyriek beleven we de subjectieve chaos die ons universum beheerst.'I despise the absence of risks, madness, and passion in abstract thinking. How fertile live, passionate thinking is! Lyricism feeds it like blood pumped into the heart!'
En:
'Haven't people learned yet that the time of superficial intellectual games is over, that agony is infinitely more important than syllogism, that a cry of despair is more revealing than the most subtle thought, and that tears always have deeper roots than smiles?'
Cioran's lyrisme van de wanhoop is ironisch, poëtisch, arrogant, paradoxaal en gewelddadig. Hij laat zijn licht schijnen over moderne zaken zoals hij daar noemt: vervreemding, absurditeit, het pijnlijke van het bewustzijn en de ziekte van de rede. Hij doet dat in zesenzestig korte, bondige, heftige hoofdstukken, alle gevuld met stevige aforismen. Nietzscheaans is Cioran in zijn afwijzing van het middelmatige, maar die is niet despotisch, want op lijden staat geen maat - lijden is altijd intern, nooit extern. Cioran gaat uit van zijn eigen lijden, dat een oorsprong heeft: slapeloosheid. Cioran lijdt aan slapeloosheid, en naar het schijnt heeft hij de kunde van het fietsen opgepakt om na uren en uren gefiets te proberen thuis in zijn kleine en schamele appartement in slaap te vallen. Vaak tevergeefs. Zijn fysieke gesteldheid is navenant en wordt de basis van zijn filosofie, zoals we lezen in Facing silence:
'Chronic fatigue predisposes to a love of silence, for in it words lose their meaning and strike the ear with the hollow sonority of mechanical hammers; concepts weaken, expressions lose their force, the word grows barren as the wilderness. The ebb and flow of the outside is like a distant monotonous murmur unable to stir interest or curiosity. Then you think it useless to express an opinion, to take a stand, to make an impression; the noises you have renounced increase the anxiety of your soul. After having struggled madly to solve all problems, after having suffered on the heights of despair, in the supreme hour of revelation, you will find that the only answer, the only reality, is silence.'
Ziekte, de eenzaamheid van de stilte maakt een mens lucide en doet hem de nietsheid ervaren. Hij moet die schrijnende kans met beide handen aangrijpen: 'Only the sick man is delighted by life and praises it so that he won't collapse.' Dit uitgangspunt voert de jonge Roemeense auteur naar verscheidene lyrische uitweidingen, die over de problematiek van de zelfmoordneiging zijn niet ondervertegenwoordigd. Met de zesenzestig hoofdstukken verwierf hij aan een universiteit in een grote stad (welke wordt niet duidelijk in de verantwoording) een plaats in Berlijn, alvorens een eindthese te schrijven over het Bergoniaanse intutionisme. Hij is pas drieëntwintig jaren jong en geboren te Răşinari, een klein, idyllisch Transsylvaans dorpje. Zal hij niet als een kwade zombie laveren tussen de zwartgeschaduwde stadsbussen en centrummuren?
Titels als The premonition of madness, Nothing is important, The world in which nothing is solved, Total dissatisfction, en The return to chaos geven een indruk van de beladen thematiek en haar behandeling; een stuk als Enthousiasm as a form of love geeft de speelsheid in die zwaarte weer. Mooi vind ik bovendien de stukken waarin Cioran zelf lijkt te balanceren, wild maar elegant te koorddansen, tussen het gewicht van zijn thema en de verwoording ervan. In The cult of infinity, een pleidooi voor de eindeloosheid, buigt hij zich over muziek.
'One of the principal elements of infinity is its negation of form. Absolute becoming, infinity destroys anything that is formed, crystallized, or finished. Isn't music the art which best expresses infinity because it dissolves all forms into a charmingly ineffable fluidity? Form always tends to complete what is fragmentary and, by individualizing its contents, to eliminate the perspective of the universal and the infinite; thus it exists only to remove the content of life from chaos and anarchy. Forms are illusory and, beyond their evanescence, true reality reveals itself as an intense pulsation. The penchant for form comes from love of finitude, the seduction of boundaries which will never engender metaphysical revelations. Metaphysics, like music, springs from the experience of infinity. They both grow on heights and cause vertigo. I have always wondered why those who have produced masterpieces in these domains have not all gone mad. Music more than any other art requires so much concentration that one could easily, after creative moments, lose one's mind. All great composers ought to either commit suicide or become insane at the height of their creative powers. Are not all those aspiring to infinity on the road to madness? Normality, abnormality, are notions that no longer mean anything. Let us live in the ecstasy of infinity, let us love that which is boundless, let us destroy forms and institute the only cult without forms: the cult of infinity.'
In de Kansas City Star van 11 november 1934 observeert een journalist, William Allen White, dat Franklin Delano Roosevelt 'has been all but crowned by the people.' Zijn radiopraatjes voor de openhaard nemen de mensen voor hem in, maar de depressie beklijft. In de Abessijnse stad Walwal is het 4 december tot een vuurgevecht gekomen tussen Italiaanse en Abessijnse troepen. Over de zelfmoord op 7 december van een Noorse zeeman in pension City in de Terneuzense Nieuwstraat blijft de commissaris in het ongewisse. Over het onbenullige van geschiedenis schrijft Cioran in History and eternity, ons ademloos achterlatend door een originele visie: geschiedenis is een nutteloos vacuüm?
'By outstripping history one acquires superconciousness, an important ingredient of eternity. It takes you into the realm where contradictions and doubts lose their meaning, where you can forget about life and death. It is the fear of life and death that launches men on their quest for eternity: its only advantage is forgetfulness. But what about the return from eternity?'
Met deze sporadische vraag geraken we tot het enige minuscule Socratische trekje in Cioran. De slapeloze lyriek van deze gewelddadige schrijver en filosoof zal hopelijk nog zoveel mogelijk open wonden open houden.
Aldo Fujimori
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, cioran, lettres, littérature, littrature française, littérature roumaine, lettres roumaines, lettres françaises, roumanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 06 mai 2010
A. Dugin: "Russia strongly rejects any presence of US Navy in the Black Sea
Aleksandr Dugin – „Russia strongly rejects any presence of US Navy in the Black Sea”
CP: – Mr. Dugin, we daily see demonstrations of the people in all major parts of the world. It’s a democratic way to express their disagreement. In Russia, the radical measures of the authorities but also the inability of the opposition led the right to protest in ridiculous. Population doesn’t believe in this „institution” of citizen. Maybe that’s why Kaliningrad episode was so much fuss. How see you this episode ?
AD: – There are some problemes with the functioning of democracy in Russia, I agree. But I think that there is the very big problem with the democracy as such in the West and in the other part of the world. The mass protest actions couldn’t reach the only real goal – to overthrow the capitalist system based on the expropriation of the real value of human work. The democracy on the global scale is bogus. It is completeness faked. What we call «democracy» is an Spectacle, with or without special glasses. Namely: in the advanced societies the Spectacle is very impressive as the 3D technology as in Avatar movie. In the more tradition societies, like Russia, with less davanced technologies, the illusions of Spectacle are much poorer. We, Russsians, are living in the first stage of capitalist lie. So our Spectacle of democracy is bad and the cruelty of capitalist exploitation is not masked properly.
The capitalism is something that is not compatible with the real democracy, human right and freedom and social justice. The only difference that I see consists in the fact that modern Russian capitalism is much cruder.
CP: – Remaining at the public perception. In Kaliningrad, the population turned out to be enthusiastic at speech of opposition leaders who rushed to claim disapproval of Putin’s regime (I say Putin and stop because nobody protests against Medvedev !). What errors underlying opposition to failure as a legitimate political force that must be taken into account ? What should be done to change the things ?
AD: – The problem is that now we haven’t real opposition in Russia. The majority is disinterested in politics and aproves in general features the course and discourse of Putin. Medvedev proves to be nothing at all, so he is not mentioned. The only group that is moving still are the marginals, paid by USA and other NATO countries, without political programm and having the only goal – distabilize the situation and to cause the problems to Putin’s souvereign rule. Sometime they manage get mass support – as in Kaliningrad case – but it is casual and without any effect on the national scale. In the distant zones of Russia the social problems are really very serious and that is the reason of some action of protest. Not associated with opposition politics. But in the USA, we are witness at much more animated mass action that usally lead nowhere. In my view, the Kaliningrad case is overestimated in the West. In Russia nobody knows and doesn’t wants to know either.
CP: – Media spoke of a future presidential party. What would be the logic and purpose of setting up a party of President Medvedev ? It spoke at a time of possible fractionation United Russia party. We’ll witness at a migration to a presidential party ?
AD: – There has been some speculation on this subject. But nobody speaks clear of such possibility yet. I doubt that it would be possible. Medvedev is completely zero as the man. Political man, I mean. United Russia is not the real political party either, but it is fully under Putin control. So for create „presidential party”, we need a real President. But that is exactly what we lack.
CP: – What means exactly in your view that “United Russia is not the real political party” ?
AD: – I mean the United Russia is an organisation without a clear ideology, without any political ideas, programms or common goals, existing only on the basis of Putin’s personal popularity and the political technology of the power in Kremlin, with zero grade of the autonomy. That is not good nor bad, just the state of affairs corresponding to the concrete historic situation. On that note as such.
CP: – Recently, Russia has changed protective speech on Iran issue. Then returned at more good feelings. And after has tightened speech… What is the real vision ? or Russian criticism just was a momentary attitude in the context of recently ended negotiations on START 2 ? We are talking about a very important treaty with global implications, so it is important each argument.
AD: – Iranian nuclear issue is likely to worry many leaders. But I think that the Russia has no reason at all to support West in its anti-Iranian position and considers Iran to be rather geopolitical ally of Russia. The NATO contrarily is regarded as possible enemi. That explains the ambivalent attitude of Russia in time. Russia had itself arguments that were useful in negotiations on START 2. We look carefully developments in the Iranian problem. But a decision to sign to sanction Iran would be only if there are conclusive evidences. Iran is our friend. It could turn once to becom nuclear friend. So is Israel. Israel is friend of USA and possesses the nuclear weapon. So is Pakistan also. Geopolitical speaking, there should be the symmetry.
CP: – For that spoke about START 2, it said that Russia’s anger (about the location of the missile shield elements in Eastern Europe) was still clamp for use in negotiations. U.S. officials said that last year ago Russia knew where will be new locations shield. And recently, Secretary of State Hillary Clinton said that these two are very different and not conditional on one another. So, Russia feels really threatened or just claim an reason to negotiate ?
AD: – Yes, Russia feels threatened because NATO keeps moving Eastward from the end of 80-s. Any step of NATO in the Eastern direction is a confirmation of the reasonability of our concerns. No one can persuade us that all this are friendly. The real frindly step was made by Gorbachov dissolving the Warsaw Pact. What followed ? The move on NATO to the East. It is unfriendly step and correctly perceived as an agression. All the other similar initiatives should be regarded and analized in this light.
CP: – Analysts argue that non-involvement of Western in elections in Ukraine were a fair trade with Russia on the location of the shield elements in the Black Sea. What do you think about ? Moreover, these two aspects – Ukraine as a buffer and new location of shield elements – something radically change on geopolitical building in this area ?
AD: – The Ukraine is the part of Russian influence. So the West has nothing to do with this. And the Orange Revolution is over. Russia strongly reject any presence of USA NAVI in the Blacksea. We will not tolerate the american vision of Caucases. Or the plan of the Greater Middle East project. I think that the Ukraine will be part of Russian-Eurasian defense system. Or this defensive system not included shield of U.S. I don’t see such cooperation possible. At least, not in this context.
Gabriela Ionita
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, mer noire, roumanie, marine, europe, affaires européennes, politique internationale, etats-unis, otan, atlantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 23 avril 2010
Cioran: martyr ou bourreau?
Cioran : martyr ou bourreau ?
Réflexions sur le renversant faux-pas d'un politicien libéral
par José Javier ESPARZA
Cioran. Que n'aura-t-on pas dit de Cioran ? Pour certains commentateurs, ce n'est qu'un écrivain qui publie des aphorismes médiocres, ce n'est que l'auteur d'une « philosophie pour concierges » ; pour d'autres, il est le meilleur écrivain vivant de langue française. Entre ces deux extrêmes, on trouve un immense éventail d'opinions de valeurs diverses. Ce que l'on n'avait jamais dit de Cioran, c'est qu'il était fasciste. Mais aujourd'hui, c'est fait ; on ne voit pas bien pourquoi, mais un politicien libéral espagnol lui a attribué la paternité idéologique du phénomène Le Pen !
Le renversant faux-pas du politicien libéral
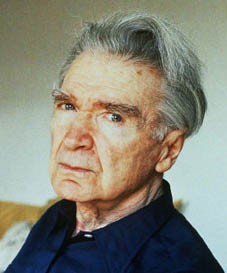 Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta Directiva del Club Liberal de Madrid qui fait bruyamment état de ses opinions philosophiques très particulières dans le supplément « Papeles para la Libertad » publié chaque semaine par le quotidien Ya (1). Dans l'un de ses articles, intitulé « Plus jamais Auschwitz », paru le 12 janvier 1988, Bernaldo de Quirós lançait un avertissement au monde libre, menacé par un danger imminent : Le Pen, locomotive d'un fascisme populiste, inspiré à son tour par un autre fascisme, plus dangereux, le fascisme intellectuel dont Bernardo de Quirós attribuait la responsabilité à une constellation étrange d'auteurs très différents les uns des autres : « Montherland » (il veut sans doute dire Montherlant), Fernando Savater (2), Alain de Benoist et le penseur roumain Emil Cioran. Et de citer en note l'œuvre de ce dernier « El aciago domingo » (il se réfère peut-être à « El aciago Demiurgo », Le mauvais démiurge en trad. esp.). Par le biais d'une opération grossière d'amalgame des concepts, Bemaldo de Quirós les rend tous responsables (de façon plus ou moins importante) de la paternité des idées anti-chrétiennes, tragiques et anti-libérales qui menacent le bon ordre régnant en Occident : l'ordre libéral.
Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta Directiva del Club Liberal de Madrid qui fait bruyamment état de ses opinions philosophiques très particulières dans le supplément « Papeles para la Libertad » publié chaque semaine par le quotidien Ya (1). Dans l'un de ses articles, intitulé « Plus jamais Auschwitz », paru le 12 janvier 1988, Bernaldo de Quirós lançait un avertissement au monde libre, menacé par un danger imminent : Le Pen, locomotive d'un fascisme populiste, inspiré à son tour par un autre fascisme, plus dangereux, le fascisme intellectuel dont Bernardo de Quirós attribuait la responsabilité à une constellation étrange d'auteurs très différents les uns des autres : « Montherland » (il veut sans doute dire Montherlant), Fernando Savater (2), Alain de Benoist et le penseur roumain Emil Cioran. Et de citer en note l'œuvre de ce dernier « El aciago domingo » (il se réfère peut-être à « El aciago Demiurgo », Le mauvais démiurge en trad. esp.). Par le biais d'une opération grossière d'amalgame des concepts, Bemaldo de Quirós les rend tous responsables (de façon plus ou moins importante) de la paternité des idées anti-chrétiennes, tragiques et anti-libérales qui menacent le bon ordre régnant en Occident : l'ordre libéral.
Le raisonnement de Bemaldo de Quirós n'est pas habituel. Peut-être plus accoutumé au tissu grossier des discours économistes qu'aux subtilités et aux clairs-obscurs de la pensée philosophique, le madrilène libéral confond tout avec tout pour élaborer vaille que vaille la réflexion suivante (qui n'est pas toujours explicite) dans son article : 1) le phénomène du populisme xénophobe devient à la mode (?) en France ; 2) en réalité, il y a plus important que cette vague politique immédiatement perceptible : l'existence en coulisse de penseurs comme Montherlant ou Alain de Benotst qui défendent des idées anti-chrétiennes et « aristocratisantes » ; 3) or, de Benoist « copie Cioran » ; et Savater aurait sa part de responsabilités dans la popularisation de Cioran en Espagne ; 4) ces auteurs s'appuient sur les thèses des historiens révisionnistes (?) qui nient l'holocauste juif (des références, svp...) ; 5) comme on ne peut plus défendre aujourd'hui une xénophobie antijuive, on prêche pour une xénophobie anti-africaine, et nous voici revenus à Le Pen, la boucle est bouclée. Naturellement, Bemaldo de Quirós n'écrit pas « Cioran est fasciste » mais son discours implicite est transparent lorsqu'il dit que de Benoist (qui, par conséquent, serait aussi « fasciste ») copie Cioran.
Si nous devions juger la pensée libérale en nous basant sur des opinions comme celle-là, nous devrions conclure que le libéralisme espagnol ne peut générer qu'une pensée malade, peureuse et hystérique devant tout ce qui s'oppose à l'empire du burger et de Superman. En effet, ni de Benoist ni Savater ni probablement Cioran, ne sont d'accord avec l'empire du dollar. Mais ce n'est pas une raison pour les prendre pour des confrères en conspiration et, moins encore, d'en faire les maîtres occultes de Le Pen qui, lui, par contre, ne manifeste guère son désaccord à l'égard de la domination du dollar, du nationalisme jacobin, du christianisme à la française et de Superman.
Le bourreau
Mais la question que pose directement l'article de notre libéral madrilène n'est pas aussi intéressante que la question de fond de tout ce problème : qu'est-ce qui les irrite ? Qu'est ce qui les rend nerveux ? Qu'est ce qui les dérange tant dans le discours de Cioran, eux, les défenseurs du statu quo ?
Il ne s'agit pas ici de défendre Cioran. Dans un article consacré au philosophe roumain, Savater écrivait : « Comment défendre les idées d'une personne qui soutient que s'accrocher à une idée, c'est se construire un échafaud dans le cœur, de celui qui défend les droits de la divagation contre les certitudes du système et propose comme unique fondement de ses opinions, l'humour momentané et spontané qui les suscite ? » (3). Non, Cioran est drôlement indéfendable. Et c'est sa première grande vertu, sa première grande opposition à l'ordre qui juge tout selon que c'est bon ou mauvais pour le futur historique (et hypothéqué) de l'ordre libéral.
C'est probablement bien malgré lui qu'Emil Cioran se mue en bourreau cruel du système qui l'entoure. Il ne pouvait en être autrement. Le courageux apatride roumain vit dans une civilisation qui adore l'homme, qui idôlatre le sens de l'histoire, qui s'enfonce confortablement dans le coussin de l'Occident.
Cioran méprise l'homme, l'histoire et l'Occident. Voilà ses trois péchés capitaux.
L’avenir du cyanure
« L'homme sécrète du désastre » écrit Cioran, et il affirme « Je crois au salut de l'humanité, à l'avenir du cyanure… » (4). Le mépris de l'humain, la conviction que l'homme, cette « unité de désastre » (5), a déjà donné le « meilleur » de lui-même, voilà une constante qui se répète de manière insistante dans l'œuvre de Cioran. « Engagé hors de ses voies, hors de ses instincts – écrit-il dans le Précis de décomposition –, l'homme a fini dans une impasse. Il a brûlé les étapes... pour rattraper sa fin ; animal sans avenir, il s'est enlisé dans son idéal, il s'est perdu à son propre jeu. Pour avoir voulu se dépasser sans cesse, il s’est figé ; et il ne lui reste comme resource que de récapituler ses folies, de les expier et d'en faire encore quelques autres » (6). Dans Valéry face à ses idoles (1970), il insiste : « Quand l'homme aura atteint le but qu'il s'est assigné : asservir la Création – il sera complètement vide : dieu et fantôme » (7). « Il n'est absolument pas nécessaire d'être prophète – écrit-il ailleurs – pour discerner clairement que l'homme a déjà épuisé le meilleur de lui-même, qu'il est en train de perdre sa contenance, s'il ne l'a déjà pas perdue » (8). L'humanité, par ses propres mérites, est « éjectée enfin de l'histoire » (9).
Histoire : banalité et apocalypse
La passion moderne pour l'histoire est précisément une autre des cibles préférées de Cioran. Pour lui, l'histoire est un « mélange indécent de banalité et d'apocalypse » (10). Le progrès et la modernité, formes de civilisation construites sur le culte de l'histoire et de sa contemplation utopique dans l'attente d'une fin heureuse, sont autant de bourbiers où naufrage la consternante espérance humaine. « Tout pas en avant – écrit Cioran –, toute forme de dynamisme comporte quelque chose de satanique : le "progrès" est l'équivalent moderne de la Chute, la version profane de la condamnation » (11). La même logique de la chute obscurcit le fantôme de la modernité : « être moderne, c'est bricoler dans l'Incurable » (12). Inéluctabilité de la marche de l'histoire ?
« Quiconque, par distraction ou incompétence, arrête tant soit peu l'humanité dans sa marche, en est le bienfaiteur » (13), affirme Cioran, en lançant un voile de terreur sur les consciences de ceux qui croyaient avoir construit la meilleure civilisation qui ait jamais existé sur terre.
Le spectre de l'Occident
Cette civilisation, c'est l'Occident, « un possible sans lendemain » (14), une civilisation née sur les dogmes de l'humanisme et de l'historicisme. Tous deux nous apparaissent aujourd'hui comme de vieux squelettes décharnés. « Les vérités de l'humanisme – dit Cioran –, la confiance en l'homme et le reste, n'ont encore qu'une vigueur de fictions, qu'une prospérité d'ombres. L'Occident était ces vérités : il n'est plus que ces fictions, que ces ombres. Aussi démuni qu'elles, il ne lui est pas donné de les vérifier. Il les traîne, les expose mais ne les impose plus ; elles ont cessé d'être menaçantes. Aussi, ceux qui s'accrochent à l'humanisme se servent-ils d'un vocable exténué, sans support affectif, d'un vocable spectral » (15). Image de ce spectre : l'homme occidental, un homme tourmenté, qui « fait penser à un héros dostoïevskien qui aurait un compte en banque » (16). De la même façon, tous les philosophes utopiques qui prétendirent trouver dans l'histoire un sens positif, une direction linéaire vers le meilleur, périssent : « Il y a plus d'honnêteté et de rigueur dans les sciences occultes que dans les philosophies qui assignent un "sens" à l'histoire » (17) ; le matérialisme historique ne suppose pas en réalité un changement qualitatif quant à la providence divine : « c'est changer simplement de providentialisme » (18).
L'Occident meurt, installée à cheval sur ces deux spectres. « C'est en vain que l'Occident se cherche une forme d'agonie digne de son passé » (19) ; mais personne n'a intérêt à s'éveiller : « l'Europe, indifférente à ceux qui vaticinent, persévère allègrement dans son agonie ; agonie si obstinée et durable qu'elle équivaut peut-être à une nouvelle vie » (20).
Cette féroce réalité que Cioran nous dévoile dans l'Occident contemporain, éclaire d'une nouvelle lumière des aspects plus quotidiens comme celui du colonialisme occidental dans ce qu'on appelle le Tiers Monde : « L'intérêt que le civilisé porte aux peuples dits arriérés est des plus suspects. Inapte à se supporter davantage, il s'emploie à se décharger sur eux du surplus des maux qui l'accablent, il les engage à goûter à ses misères, il les conjure d'affronter un destin qu'il ne peut plus braver seul » (21).
On comprend que, considérée de manière superficielle, cette thèse de Cioran puisse rappeler des filons bien précis de la pensée « réactionnaire » ou « traditionnelle ». En effet, il connaît les mystiques et se méfie des utopies ; il pense que l'homme est plus un animal qu'un saint, mais il croit que le théologien nous comprend mieux que le zoologiste ; on pourrait donc le considérer comme un de Maistre tourmenté et faible (au sens postmoderne de l'expression). Il contribue également à la confusion quand il écrit : « Tout semble admirable et tout est faux dans la vision utopique ; tout est exécrable, et tout a l’air vrai, dans les constatations des réactionnaires » (Essai sur la pensée réactionnaire) ; et quand il voit dans la politique « la malédiction par excellence d'un singe mégalomane » (Ibid.).
Mais il faut laisser cette impression immédiatement de côté si nous voulons comprendre le reste de la férocité cioranesque. Cioran est, en effet, un bourreau aux yeux du troupeau occidental, et d'une certaine façon, un « réactionnaire » au sens pur du terme, cependant toute sa violence ne provient pas d'une foi, elle est le résultat d'une immense déception, d'une condition angoissante, celle de l'« arrêté » à perpétuité au-dessus de l'abîme du monde. Dans cette perspective, Cioran n'est plus un bourreau, mais un martyr ; dans ce cas, il faut écarter de ce terme tout ce qui pourrait nous suggérer héroïsme, ascèse et salut. Lui-même se définit comme « un parvenu de la névrose, un Job à la recherche d'une lèpre, un Bouddha de pacotille, un Scythe flemmard et fourvoyé ».
Entre le dilettantisme et la dynamite
Élément déterminant dans l'angoisse de Cioran : sa condition d'apatride. « Un penseur – écrit-il – s'enrichit de tout ce qui lui échappe, de tout ce qu'on lui dérobe : s’il vient à perdre sa patrie, quel aubaine ! » (22). Orphelin de son appartenance et d'un enracinement, Cioran ne doit défendre aucune vision du monde, aucun préjugé, aucune certitude. Savater a tort d'y voir une libération ; pour Cioran, oui, ça l'est, mais à un prix très élevé : le droit au Temps et à l'histoire : « Les autres tombent dans le temps ; je suis, moi, tombé du temps » (23).
Léger, détaché du temps et de l'espace, Cioran ne trouve pas d'appui non plus dans les idéologies. Ici aussi, après avoir connu la fascination des extrêmes, il s'est « arrêté quelque part entre le dilettantisme et la dynamite » (24). Ni Dieu ni vie n'existent dans cet endroit. La vie est une « combinaison de chimie et de stupeur » (25), qui fait de la leucémie « le jardin où fleurit Dieu ». (26). Quant à Dieu lui-même...
Face à l'orgueil divin
« L'odeur de la créature nous met sur la piste d'une divinité fétide » (27). Ce cruel aphorisme de Cioran peut résumer toute l'amertume de celui qui estime inconcevable une divinité seulement intelligible au départ de l'humain. Cioran se rebelle contre la bonté du créateur du mal : « L'idée de la culpabilité de Dieu n'est pas une idée gratuite, mais nécessaire et parfaitement compatible avec celle de sa toute-puissance : elle seule confère quelque intelligibilité au développement historique, à tout ce qu'il contient de monstrueux, d'insensé et de dérisoire. Attribuer à l'auteur du devenir la pureté et la bonté, c'est renoncer à comprendre la majorité des événements, et singulièrement le plus important : la Création » (28). Face à l'orgueil divin, Cioran n'hésite pas à s'inscrire sur les listes du diable : « J'ai eu beau fréquenter les mystiques, dans mon for intérieur j'ai toujours été du côté du Démon : ne pouvant pas l'égaler par la puissance, j'ai essayé de le valoir du moins par l’insolence, l’aigreur, l’arbitraire et le caprice » (29).
Et cependant celui qui croit voir en Cioran une nostalgie du sacré ne se trompe pas : « Quel dommage que, pour aller à Dieu, il faille passer par la foi ! » (30) ; il écrit et ajoute : « Si je croyais en Dieu, ma fatuité n'aurait pas de bornes : je me promènerais tout nu dans les rues... » (31). Nostalgie ou furie – chez Cioran, c'est la même chose – l'écueil divin est probablement la raison ultime de sa pensée, de son attitude devant la vie et de son attitude face à sa propre œuvre. Une œuvre à laquelle Cioran accorde une importance énorme, non à cause de son contenu mais à cause de son effet cathartique, de sa fonction matérialisatrice de la rébellion intime. Et c'est ici, dans cette révolte, que l'on doit s'installer pour comprendre Cioran, pour situer sa férocité et son désir délibéré du scandale.
Vengeance en paroles
Mais avant tout : devons-nous comprendre Cioran ? Il est difficile d'aborder avec bonne conscience l'épineux Roumain. Dans Syllogismes de l'amertume, il prévient les audacieux : « Tout commentaire d'une œuvre est mauvais ou inutile, car tout ce qui n'est pas direct est nul » (32). Et dans une lettre à Savater, il affirme à propos de Borgès une chose qui pourrait bien s'appliquer à lui-même : « À partir du moment où tout le monde le cite, on ne peut plus le citer, ou, si on le fait, on a l'impression de venir grossir la masse de ses "admirateurs", de ses ennemis » (33).
Faisons donc abstraction de la vantardise bien compréhensible de l'analyste, car nous ne pouvons éviter de commenter l'auteur. Et signalons, qu'en écrivant, Cioran se libère, se rebelle, se venge, se drogue ; c'est là la raison de son œuvre : « J'écris pour ne pas passer à l'acte, pour éviter une crise. L'expression est soulagement, revanche indirecte de celui qui ne peut digérer une honte et qui se rebelle en paroles contre ses semblables et contre soi. (…) Je n'ai pas écrit une seule ligne à ma température normale. (…) Écrire est une provocation, une vue heureusement fausse de la réalité qui nous place au-dessus de ce qui existe et de ce qui nous semble être. Concurrencer Dieu, le dépasser même par la seule vertu du langage, tel est l'exploit de l'écrivain, spécimen ambigu, déchiré et infatué qui, sorti de sa condition naturelle, s'est livré à un vertige superbe, déconcertant toujours, quelquefois odieux » (34).
En dernière extrémité, nous pourrions dire que Cioran écrit selon sa mauvaise humeur : « Je n'ai rien inventé – écrit-il –, j’ai été seulement le secrétaire de mes sensations » (Écartèlement). Et il ne s'agit pas d'un faux jugement mais d'un jugement insuffisant. Les grogneries littéraires de Cioran ont porté une certaine critique, globale et aimable, si bien qu'en réalité, toute sa férocité n'est qu'un simple exercice de style ; il refuse ainsi toute espèce de vraisemblance avec la passion de l'apatride roumain, il réduit tout son discours à une simple pratique ludique ; il insulte par conséquent le fustigateur de la condition humaine et il méprise le contenu de l'hérésie pour faire l'éloge de son expression propre. Banal. La littérature carnivore de Cioran est volontairement hérétique ; mais même si elle ne l'était pas, toute sa capacité subversive s'y trouve, c'est indéniable, elle fait son effet et parvient à convaincre ceux qui ne sont pas d'accord car, comme l'écrit Cioran, « l'hérésie représente la seule possibilité de revigorer les consciences, […] en les secouant, elle les préserve de l'engourdissement où les plonge le conformisme » (35).
En tout cas, ce ne sera pas l'auteur qui nous enlèvera ce doute. Cioran juge délibérément avec cette ambivalence, avec cette ambiguïté. Il sait que c'est la seule façon de durer. Dans son essai sur Joseph de Maistre, il écrit quelque chose qu'il semble dire à propos de lui-même : « sans ses contradictions, sans les malentendus qu’il a, par instinct ou calcul, créés à son propre sujet, son cas serait liquidé depuis longtemps, sa carrière close, et il connaîtrait la malchance d'être compris, la pire qui puisse s'abattre sur un auteur » (36).
Qu'ils s'alarment...
C'est évident : face à une réalité aussi complexe que celle de l'écrivain Cioran, les propos de tous les Bernaldos de Quirós circulant dans ce vaste monde ne sont que des mesquineries pour feuilletons américains. Autre évidence : impliquer l'apatride tourmenté dans ce genre de questions politiciennes soulevées par exemple par un Le Pen relève de la plus solennelle des bêtises. Les racines de la philosophie de Cioran, cette philosophie tragique et anti-humaniste, qui semble tellement effrayer nos bons libéraux espagnols, véhicule une culture qui est européenne jusque dans la moëlle, depuis cinq mille ans au moins ! Et confondre cette philosophie plurimillénaire avec un politicien français de cette fin de siècle, peu porté par ailleurs sur les excès intellectuels, est une exagération un peu alarmante.
Mais c'est peut-être de cela qu'il s'agit : alarmer les gens. Non pas d'alarmer les gens parce que telle ou telle philosophie existe envers et contre la volonté des conformistes, mais d'alarmer les bonnes consciences, couleur de rose, parce qu'un Cioran, génial et cruel, récupère, illustre, diffuse et affirme la seule chose qui, aujourd'hui, peut conjurer le fantasme de l'Occident : la tragédie, l'anti-humanisme, l'éloge de la Chute, toutes sorties valables pour une civilisation qui, en effet – bien qu'elle ne veuille pas s'en rendre compte – est déjà tombée.
Qu'ils s'alarment. Peu importe. Plus personne n'écoute. Pendant ce temps, la pensée de Cioran, une pensée barbare, éloignée des chaires et des conférences mondaines, devenue paradoxalement dangereuse parce qu'elle est désormais commercialisable (et peut-être commercialisable aujourd'hui précisément parce qu'elle est barbare), mine convictions et bétonnages. Cette « herméneutique des larmes » (ainsi Cioran définit-il son style dans Des larmes et des saints) paraît s'emboîter à la perfection dans les angoisses contemporaines.
En 1934, dans une œuvre encore écrite en roumain, Pe culmile disperarii (« Sur les cimes du désespoir »), Cioran écrivait : « Est-ce que l'existence sera pour nous un exil et le néant une patrie ? ». Aujourd'hui, nous avons tous déserté l'existence ; aujourd'hui nous habitons tous le néant. Devons-nous nous étonner que l'angoisse de Cioran nous apparaisse comme sœur jumelle de notre propre angoisse ?
Les réactionnaires du XIXème siècle ont réagi contre le XVIIIème siècle en proposant un retour au XVIème siècle. Si aujourd'hui, en fin de modernité, il faut être réactionnaire (et soyons provocant : il n'est jamais mauvais d'être « réactionnaire », de réagir face aux phénomènes de déclin), seul peut l'être – et l'être dignement – le style de Cioran : sans propositions, sans alternatives. Le néant contre le vide ; l'angoisse doublée du râle face à la mort de toute illusion. C'est cela, finalement, la véritable dimension de Cioran : l'esthétique –puisqu'il n'y a plus d'éthique – menaçante d'une barbarie, en apparence fondée sur les Lumières, qui, seule, peut mettre un point final tragique à plus (ou beaucoup plus) de deux cents ans de civilisation à l'enseigne de l'Aufklärung.
José Javier ESPARZA
(1) Malgré son caractère superficiel fréquent, la lecture de ce supplément est à recommander. On y découvre tous les préjugés classiques de la droite libérale espagnole qui, aujourd'hui, affectée par la « vague Reagan », tente de remplir sa malle doctrinale de thèses réductionnistes et économicistes, propres à l'anti-pensée libérale. Antérieurement, ce même supplément avait consacré à la post-modernité, nouveau monstre à trois têtes, une série d'opinions vraiment délirantes.
(2) La persécution de Femando Savater parait s'être transformée en nouveau sport national. L'année passée et au cours d'un hommage rendu à Ché Guevara, Savater fut durement apostrophé et qualifié de « fasciste » par une partie du public présent, tout cela pour avoir dit que le Ché était « comme un bon Rambo ». Peu après, le politicien démocrate-chrétien et historien pro-américain Javier Tussell s'en prenait à l’auteur de La Tarea del héroe (« La Tâche du héros ») en l'accusant d'« irresponsabilité intellectuelle » à cause de ses déclarations critiques envers la fièvre monarchique espagnole. Aujourd'hui, Bemaldo de Quirós le rend en partie responsable du parrainage de Le Pen parce qu'« il copie Cioran » (?), Sans doute, la pensée de Savater est très critiquable mais, à notre avis, pas à cause de ces trois « crimes de pensée » qu'on lui impute à droite comme à gauche et qui constituent, justement, autant d'élans de lucidité chez ce philosophe qui suscite la polémique.
(3) F. Savater, « El indefendibile e indefenso Cioran », in Quimera, 4, febrero 1981.
(4) Syllogismes de l'amertume.
(5) Précis de décomposition. (6) op. cit.
(7) « Valéry face à ses idoles », texte repris dans le volume intitulé Exercices d'admiration : Essais et portraits (Gallimard).
(8) « L'enfer du corps », essai paru dans Le Monde, 3 février 1984.
(9) La chute dans le temps.
(10) Précis de décomposition.
(11) La chute dans le temps.
(12) Syllogismes de l'amertume. (13) ibid. (14) ibid. (15) ibid. (16) ibid. (17) ibid.
(18) Essai sur la pensée réactionnaire.
(19) Syllogismes de l'amertume.
(20) Essai sur la pensée réactionnaire.
(21) La chute dans le temps.
(22) Essai sur la pensée réactionnaire.
(23) La chute dans le temps.
(24) Syllogismes de l'amertume. (25) ibid. (26) ibid. (27) ibid.
(28) Essai sur la pensée réactionnaire. (29) ibid.
(30) Syllogismes de l'amertume. (31) op. cit. (32) ibid.
(33) Exercices d’admiration. (34) ibid. (35)ibid. (36)ibid.
Cioran à Paris en 1949, au moment où venait de paraître son premier ouvrage en français, le Précis de décomposition. Cioran a appris le français grâce à un invalide de la Grande Guerre, virtuose de la langue basque et de la langue française, érotomane délicat qui arpentait les boulevards de Montparnasse. Cet homme l'a exhorté à relire !es auteurs du XVIIlème siècle, à imiter leur perfection. Dans un interview accordé au philosophe allemand Gerd Bergfleth, Cioran rend hommage à cet invalide du Pays Basque, ce puriste de la langue et de la grammaire (Emil M. Cioran, Ein Gespräch, geführt von Gerd Bergfleth, Rive Gauche/Konkursbuchverlag, Tübingen, 1985; Cioran a donné cette entrevue en langue allemande ; le texte original en est donc le texte allemand).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, france, roumanie, lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, cioran, lettres roumaines, littérature roumaine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Cioran: une pensée contre soi héroïquement positive
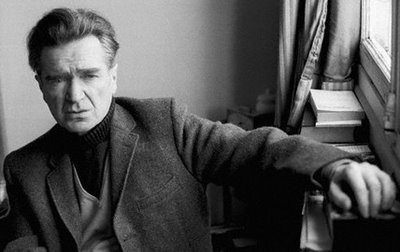
Cioran : une pensée contre soi héroïquement positive
Ex: http://www.revue-analyses.org/
Être le « héros négatif » de son temps, c’est, selon Cioran, trahir celui-ci : participer ou non aux tourments de son époque, c’est toujours faire le mauvais choix, se leurrer. Comme Cioran lui-même fut le « héros négatif » d’un « Âge trop mûr », l’étude que lui consacre Sylvain David se veut une « approche “sociale” » d’une œuvre qui fait l’apologie de la marginalité et du désistement. L’enjeu est d’explorer les ressources esthétiques et sociales de l’écriture d’un misanthrope plus ou moins sociable, qui s’est déclaré « métaphysiquement étranger » et dont l’ambition fut de s’adresser à « la communauté des exclus, des unhappy few » (p. 11) — les faibles, les ratés, son segment favori de lecteurs — vivant, tout en en étant conscients, dans une modernité aux accents spengleriens ou nietzschéens, nommée tantôt « décadence », tantôt « déclin », tantôt « crépuscule », tantôt « monde finissant ». Vivre et écrire en marginal participe d’un « héroïsme négatif », c’est-à-dire « de la chute », « de la décomposition », de la pensée « contre soi » (« le seul geste héroïque possible encore à l’homme moderne »), au fondement duquel l’auteur place la quête d’« une posture digne à opposer à l’inconvénient ou à l’inconvenance de la condition de l’homme moderne » (p. 17), d’une réponse lucide, parfois fataliste, aux questions incontournables de la modernité. C’est, selon Sylvain David, la source même de l’écriture cioranienne et de la posture négativement héroïque d’une œuvre qui s’articule autour de la dualité entre le sujet et la collectivité, d’une identité sapée par le doute, et d’un « penser contre soi-même » assidûment professé par l’auteur des Cimes du désespoir.
L’analyse de l’œuvre cioranienne passe — plus que jamais, après la mort de l’essayiste — par l’étape roumaine de sa création littéraire. Depuis onze ans, la question fondamentale est, selon certains critiques, de concilier « l’aristocrate du doute » et l’« antisémite de conviction ». Le « dévoilement du voile » annoncé par Alexandra Laignel-Lavastine en 2002 ne tente pas Sylvain David, qui, tout en reconnaissant une « historicisation » de la pensée cioranienne dans la deuxième étape de création de l’auteur de La Transfiguration de la Roumanie, refuse de l’historiciser in corpore ou à rebours et, par conséquent, de juger l’œuvre française en fonction de l’œuvre roumaine. La « seconde naissance » de Cioran passe, certes, par l’historicisation de sa pensée : celui qui prônait dans son premier livre roumain l’« héroïsme de la résistance et non de la conquête » allait admirer quelques années plus tard Corneliu Zelea-Codreanu et Hitler, pour s’attaquer ensuite à toute forme de fanatisme, d’engagement politique. Par conséquent, la tension fondamentale de l’œuvre cioranienne sera « la relation conflictuelle d’un homme avec son époque, son milieu, si ce n’est avec lui-même » (p. 23).
Les rapports entre l’écriture et le désengagement constituent la première partie du livre, intitulée Un discours (a)social. Les trois premiers livres français de Cioran (Précis de décomposition, 1949; Syllogismes de l’amertume, 1952; La Tentation d’exister, 1956) sont empreints de la certitude du déclin, de la décadence, de l’éternelle erreur. Si l’esprit moderne est marqué par « la négativité et le relativisme » (p. 24), l’œuvre de Cioran se distinguera non seulement en tant que « dénonciation du caractère insidieux de l’esprit moderne », mais aussi en tant que « discours (a)social » (p. 29). Dans cette période de passage, le segment français de l’œuvre cioranienne dénonce, juge et accuse systématiquement l’aspect politique, engagé, des écrits roumains. À cette époque, Cioran essaie de « se distancier d’une certaine incarnation de lui-même, de ce qu’il a déjà été » (p. 30). L’affirmation ne laissera aucun cioranien (ou cioranomane!) indifférent et place l’auteur de cet essai dans le camp modéré des lecteurs/exégètes de celui qui est accusé de « fuite lâche », de mémoire sélective, de mensonge et, surtout, de conservation du credo antisémite. Lire l’œuvre française de Cioran n’est pas, pour Sylvain David, « tenter de déterminer ce qu’a pu dire, ou faire, exactement l’essayiste, au cours des années 1930, mais plutôt de voir ce qu’il en pense, avec le recul, au moment où il entame sa nouvelle carrière » (p. 30). À l’encontre de ceux qui parlent de l’« insincérité permanente » de Cioran ou de son antisémitisme foncier et permanent, Sylvain David croit que « [p]lutôt que de commodément vouer son égarement de jeunesse à l’oubli », il convient de considérer que Cioran « revient inlassablement sur son expérience afin de comprendre et, éventuellement, dépasser les motivations qui ont pu le pousser à agir de la sorte » (p. 30).
En s’attaquant à la racine du Mal, de l’Intolérance, du Fanatisme, Cioran poursuit et accomplit un besoin d’expiation, de purification de ses jeunes égarements. La « rage tournée contre soi », la « négativité » se trouvent au cœur de cette écriture centrée sur la condition de l’homme moderne et qui réfléchit sur celle de l’écrivain dans une société de plus en plus politisée, de plus en plus divisée, de plus en plus radicalisée. La « poétique du détachement » qui illustre cette première étape de création française prend déjà contour dans le Précis de décomposition (Exercices négatifs à l’origine) que Cioran publiera en 1947 et s’articule non seulement autour de la « dénonciation de toute forme de dogmatisme ou d’intransigeance » (p. 36), mais aussi autour de l’écriture éclatée, fragmentaire, opposée, dira Cioran, à « la tentation de conclure ». Cette écriture fragmentée, fracturée est une expression de la modernité dans la mesure où la philosophie, le premier amour de l’essayiste, est, estime-t-il, incapable d’expliquer le monde ou le temps, qui mesure plutôt l’irrationalité contemporaine, le volet culturel de la durée, la fracture de la connaissance, du moi, la décomposition de la pensée et la décadence du Verbe.
Cette étape créatrice du métèque correspond à un métissage esthétique, autrement dit à l’éclatement de la forme littéraire, dont le principal matériau, la langue, se dissout et s’incarne sous diverses formes : le doute se radicalise et se détache du discours philosophique impersonnel et systémique. Aux idées abstraites, Cioran, devenu « penseur d’occasion », préfère la connaissance empirique; l’écrivain est un sceptique déçu par la philosophie (universitaire ou non), un moraliste qui, avant d’observer les gens, doit « dépoétiser sa prose ». L’idée que « toute démiurgie verbale se développe aux dépens de la lucidité » conduit à l’esthétisation de la négation, à la « négativité esthétique » (p. 95), à travers laquelle l’écriture mesure et dénonce le déclin inéluctable d’un monde, d’un système de valeurs partagées.
La deuxième partie de l’étude de Sylvain David — intitulée De l’histoire de la fin à la fin de l’histoire — a pour fondement « le grand récit de la Chute ». Le corpus (Histoire et utopie, 1960; La Chute dans le temps, 1964 ; Le mauvais démiurge, 1969) propose une relecture de la Genèse, dont le centre nerveux est le panorama de la vanité que déplore l’Ecclésiaste. Au centre de la deuxième étape de l’œuvre française de Cioran, on trouve le « Cioran de la maturité ». Placé également sous le signe de la négation, ce deuxième segment français de l’œuvre cioranienne met en scène un moi lui-même fragmenté, décomposé, qui ne met plus en question ses égarements de jeunesse, mais ses accès de pessimisme, de scepticisme. Sur le plan de l’écriture, l’aphorisme est supplanté par l’essai, dont les thèmes centraux sont l’homme, le péché originel, la chute, le temps historique et l’Occident moribond. Dans l’herméneutique cioranienne, le péché originel s’appelle la « douleur originelle » et la Chute vient couronner « l’inaptitude au bonheur » des descendants d’Adam et Ève; leur « don d’ignorance » est le seul à les rendre heureux. Lucifer, quant à lui, n’eut qu’à saper « l’inconscience originelle » du couple primordial et de sa progéniture — dont l’« inconvénient » d’exister fut la seule fortune —, ce qui laissa cet univers à la discrétion d’un « mauvais démiurge ». Conséquence directe du péché originel, la chute dans le temps est en même temps une chute vers la mort : « avancer » et « progresser » sont des concepts distincts chez Cioran, car aller vers la mort est un progrès vers l’involution, vers la disparition non seulement des hommes (ou des peuples), mais aussi des cultures, des civilisations sujettes au temps historique. Fatalement, l’« abominable Clio » enchaîne l’homme et le laisse « en proie au temps, portant les stigmates qui définissent à la fois le temps et l’homme ». Séduite par l’élan vers le pire, l’humanité court vers sa perte, autrement dit, vers l’avenir : c’est plus fort qu’elle, car, écrit Cioran dans ses Écartèlements, « [l]a fin de l’histoire est inscrite dans ses commencements ».
La troisième partie — Une autobiographie sans événements (incluant De l’inconvénient d’être né, 1973; Aveux et anathèmes, 1987; Écartèlement, 1979 : Exercices d’admiration, 1986) — correspond à un réinvestissement du temps présent complètement dépolitisé. La réflexion qui accompagne cet héroïsme négatif se fait en trois volets : le malheur (plus ou moins inventé) de l’homme moderne, l’écriture fragmentaire en tant que miroir d’un univers atomisé, désagrégé, inachevé, et le défi stoïque, positivement connoté, de l’héroïsme négatif de Cioran, autrement dit, « le courage de continuer à vivre et à écrire à l’encontre de ses propres conclusions, de son propre savoir » (p. 26). Les piliers de cette « autobiographie sans événements » sont le suicide et la « (re)naissance ». La biographie de Cioran fut marquée par un suicide jamais commis, puisqu’on ne peut pas tuer une idée. Ce que Cioran retient du suicide, c’est l’idée de se donner la mort, pas l’acte en soi : « sans l’idée du suicide — estimait-il — on se tuerait sur-le-champ! » D’ailleurs, si celui qui se vantait d’avoir « tout sacrifié à l’idée du suicide, même la mort », ne s’est pas suicidé, c’est parce que, disait-il plus ou moins amèrement, de toute façon, « on se tue toujours trop tard ». La même biographie fut également marquée par « l’inconvénient d’être né », voire d’être né Roumain, par les « affres de la lucidité », par les tortures du paradoxe, par l’effort de reconstruction intérieure et de mise en scène d’un moi aliéné. Dans le Paris aggloméré et automatisé, le regard du métèque s’arrête sur des gens que personne ne voit, venus, eux aussi, d’ailleurs, ou bien sur des clochards-philosophes. Sa lucidité — autrement dit, son « inaptitude à l’illusion » — fut celle d’une tribu sceptique, fataliste, anhistorique, celle de ces analphabètes brillants qui savent depuis toujours que l’homme est perdu et qui lui ont inculqué cette lucidité en même temps que « l’envergure pour gâcher sa vie ».
Étant lui-même un paradoxe vivant, Cioran ne put mettre en scène qu’une paradoxale série de représentations de soi : le moraliste qui, avant d’observer les hommes, se donne comme devoir primordial de « dépoétiser sa prose » tend la main à un être lucide pris pour un sceptique; le « parvenu de la névrose » est le frère du « Job à la recherche d’une lèpre » ; le « Bouddha de pacotille » cherche la compagnie tourmentée d’un « Scythe flemmard et fourvoyé », « idolâtre et victime du pour et du contre », d’un « emballé divisé d’avec ses emballements », d’un « délirant soucieux d’objectivité », d’un « douteur en transe » ou d’un « fanatique sans credo ». Cette rhétorique du paradoxe et de l’opposition projette, selon Sylvain David, non seulement l’image d’un marginal, d’un étranger, d’un exclu, d’un apatride métaphysique, mais également et surtout un jeu de contraires qui trouve son plaisir esthétique dans les contorsions, dans les volutes élégamment orchestrées par une pensée organiquement écartelée « entre scepticisme et besoin de croire, entre lucidité et illusion vitale » (p. 273). Cette mise en scène du moi artistique participe d’un « métacommentaire » qui prolonge non seulement « une détestation de soi primaire » (en tout cas, moins importante, semble-t-il), mais surtout d’« une forme d’amour trahi ou d’orgueil blessé » (p. 275). La visée de celui qui se voulait « le secrétaire de [s]es sensations » n’est pourtant aucunement narcissique, mais plutôt viscérale, car, disait-il, ce ne sont pas nos idées, mais nos sensations et nos visions — parce qu’elles « n’émanent pas de nos entrailles » et sont « véritablement nôtres » — qui peuvent, qui doivent nous définir. Cet attachement au sensoriel est, observe Sylvain David, l’apogée de l’héroïsme négatif de Cioran : en parlant de sensations et de visions qui sont les siennes, pas les nôtres — c’est-à-dire « non partagées avec le commun » —, le dernier Cioran défend son héroïsme négatif en explorant ce que son passé, son identité, ses souvenirs ont de négatif. Cet effort expiatoire est plus qu’une catégorie esthétique : il s’impose en tant que garantie morale de l’œuvre de maturité d’un homme « désintégré ».
Sur les ruines d’un univers déserté par les dieux, un penseur inclassable vint installer son Verbe ahurissant, héritier de la sobriété et de l’élégance des moralistes dont il se réclamait comme descendant légitime, aussi bien que de la saveur amère et de la souplesse de sa langue maternelle. Seuls l’aphorisme ou le fragment pouvaient représenter cet univers morcelé, éclaté. À l’encontre de Ionesco ou de Beckett, qui ont exploré l’absurde du langage, Cioran resta plutôt un classique, car, bien que conscient des mots, il a cherché, au-delà de la fonction poétique de la langue, à faire passer ses négations au niveau de la rhétorique; son univers n’est pas l’absurde, mais le paradoxe qui repose sur toute une série de malgré : poursuivre sa réflexion, malgré la déception que provoque chez lui la philosophie, malgré le mal que provoque sa propre conscience (ou sa propre lucidité); écrire, malgré les doutes quant à la capacité de son écriture à définir sa conception du monde; publier, malgré un nombre restreint de lecteurs et le dégoût que provoque en lui le flux éditorial parisien.
Certes, Cioran a écrit parce que, disait-il, chaque livre est « un suicide différé ». Paradoxalement ou non, son héroïsme négatif n’est ni agressif ni virulent, mais plutôt la représentation concrète de son aptitude — qui l’aurait cru? — « au compromis stoïque », de sa « capacité de se mouler aux circonstances de la modernité sans jamais pour autant s’y diluer ou s’y travestir » (p. 326). Il ne lui restait qu’à devenir « le sceptique de service » d’un monde en agonie ou « le secrétaire de [s]es sensations », puisque « être le secrétaire d’une sainte » n’a pas été la chance de sa vie.
Le Cioran français est, selon certains exégètes du moraliste, le masque du Cioran roumain séduit, dans les années 1930, par le mouvement nationaliste roumain et qui, une fois établi en France, n’a fait que réécrire ses livres roumains, afin de cacher ses jeunes égarements tout en restant fidèle à ses anciens credo. À l’encontre de certains de ses prédécesseurs, Sylvain David met au cœur de sa lecture de l’œuvre française de Cioran le fondement esthétique et social de l’art du fragment, dont l’auteur du Mauvais démiurge fut le maître incontesté. Complètement dépolitisés, les paradoxes cioraniens retrouvent toute leur beauté et leur profondeur et construisent, par le biais d’une analyse aussi subtile qu’objective, le parcours sinueux, mais combien passionnant, d’un « héroïsme à rebours ».
Compte rendu par : Liliana Nicorescu
Référence : Sylvain David, Cioran. Un héroïsme à rebours, Les Presses de l’Université de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2006, 338 p.
- Version PDF (93k)
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, france, roumanie, cioran, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, lettres roumaines, littérature roumaine, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 mars 2010
Codreanu: "La domination absolue de l'Esprit sur le corps..."
La domination absolue de l'Esprit sur le corps...
 "(...) Il y a deux aspects, pour la clarification desquels il faut avoir présent à l’esprit le dualisme de l’être humain, composé d’un élément matériel naturaliste et d’un élément spirituel. Quand le premier domine le second, c’est l’enfer. Tout équilibre entre les deux est chose précaire et contingente. Seule la domination absolue de l’esprit sur le corps est la condition normale et la prémisse de toute force vraie, de tout héroïsme véritable. Le jeûne est pratiqué par nous parce qu’il favorise une telle condition, affaiblit les liens corporels, encourage l’auto-libération et l’auto-affirmation de la volonté pure. Et quant à cela s’ajoute la prière, nous demandons que les forces d’en haut s’unissent aux nôtres et nous soutiennent invisiblement. Ce qui conduit au second aspect : c’est une superstition que de penser que dans chaque combat seules les forces matérielles et simplement humaines sont décisives ; entrent en jeu au contraire également les forces invisibles, spirituelles, au moins aussi efficaces que les premières. Nous sommes conscients de la positivité et de l’importance de ces forces. C’est pour cela que nous donnons au mouvement légionnaire un caractère ascétique précis. Dans les anciens ordres chevaleresques aussi était en vigueur le principe de la chasteté. Je relève toutefois qu’il est chez nous restreint au Corps d’Assaut, sur la base d’une justification pratique, c’est-à-dire que pour celui qui doit se vouer entièrement à la lutte et ne doit pas craindre la mort, il est bien de ne pas avoir d’empêchements familiaux. Du reste, on reste dans ce corps seulement jusqu’à 30 ans révolus. Mais, en tout cas, demeure toujours une position de principe : il y a d’un côté ceux qui ne connaissent que la “vie” et qui ne cherchent par conséquent que la prospérité, la richesse, le bien-être, l’opulence ; de l’autre, il y a ceux qui aspirent à quelque chose de plus que la vie, à la gloire et à la victoire dans une lutte tant intérieure qu’extérieure. Les Gardes de Fer appartiennent à cette seconde catégorie. Et leur ascétisme guerrier se complète par une dernière norme : par le vœu de pauvreté auquel est tenu l’élite des chefs du mouvement, par les préceptes de renoncement au luxe, aux divertissements creux, aux passe-temps dits mondains, en somme par l’invitation à un véritable changement de vie que nous faisons à chaque légionnaire."
"(...) Il y a deux aspects, pour la clarification desquels il faut avoir présent à l’esprit le dualisme de l’être humain, composé d’un élément matériel naturaliste et d’un élément spirituel. Quand le premier domine le second, c’est l’enfer. Tout équilibre entre les deux est chose précaire et contingente. Seule la domination absolue de l’esprit sur le corps est la condition normale et la prémisse de toute force vraie, de tout héroïsme véritable. Le jeûne est pratiqué par nous parce qu’il favorise une telle condition, affaiblit les liens corporels, encourage l’auto-libération et l’auto-affirmation de la volonté pure. Et quant à cela s’ajoute la prière, nous demandons que les forces d’en haut s’unissent aux nôtres et nous soutiennent invisiblement. Ce qui conduit au second aspect : c’est une superstition que de penser que dans chaque combat seules les forces matérielles et simplement humaines sont décisives ; entrent en jeu au contraire également les forces invisibles, spirituelles, au moins aussi efficaces que les premières. Nous sommes conscients de la positivité et de l’importance de ces forces. C’est pour cela que nous donnons au mouvement légionnaire un caractère ascétique précis. Dans les anciens ordres chevaleresques aussi était en vigueur le principe de la chasteté. Je relève toutefois qu’il est chez nous restreint au Corps d’Assaut, sur la base d’une justification pratique, c’est-à-dire que pour celui qui doit se vouer entièrement à la lutte et ne doit pas craindre la mort, il est bien de ne pas avoir d’empêchements familiaux. Du reste, on reste dans ce corps seulement jusqu’à 30 ans révolus. Mais, en tout cas, demeure toujours une position de principe : il y a d’un côté ceux qui ne connaissent que la “vie” et qui ne cherchent par conséquent que la prospérité, la richesse, le bien-être, l’opulence ; de l’autre, il y a ceux qui aspirent à quelque chose de plus que la vie, à la gloire et à la victoire dans une lutte tant intérieure qu’extérieure. Les Gardes de Fer appartiennent à cette seconde catégorie. Et leur ascétisme guerrier se complète par une dernière norme : par le vœu de pauvreté auquel est tenu l’élite des chefs du mouvement, par les préceptes de renoncement au luxe, aux divertissements creux, aux passe-temps dits mondains, en somme par l’invitation à un véritable changement de vie que nous faisons à chaque légionnaire."
Corneliu Zelea Codreanu
00:10 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réflexions personnelles, traditions, roumanie, mouvement légionnaire, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 février 2010
Raketenstationierung in Polen und Rumänien: USA setzen provokative Einkreisungsstrategie gegenüber Russland fort
Raketenstationierung in Polen und Rumänien: USA setzen provokative Einkreisungsstrategie gegenüber Russland fort
Schon vor einigen Tagen hat Washington bekannt gegeben, dass Polen die amerikanischen »Patriot«-Luftabwehrraketen angeboten werden, jetzt folgt die Ankündigung, dass das Raketenabwehrsystem »zum Schutz Europas« auf Rumänien ausgedehnt wird.
Obwohl Präsident Obama im September 2009 erklärt hatte, auf die geplante Stationierung moderner US-Raketen- und Radarsysteme in NATO-Ländern wie Polen und der Tschechischen Republik zu verzichten – eine Entscheidung, die allgemein als Schritt zur Reduzierung der Spannungen zwischen den USA und Russland betrachtet wurde –, zeigt sich jetzt, dass Washington lediglich den Ort der Stationierung und den Typ der Luftabwehrraketen verändert hat. Die Strategie der Einkreisung Russlands, für Moskau eine große militärische Herausforderung, wird also beibehalten. Die Gefahr einer weltweiten atomaren Katastrophe durch Fehlkalkulation bleibt unvermindert oder nimmt sogar noch zu.
Der rumänische Präsident Traian Basescu hat die Zustimmung seines Landes zu dem amerikanischen Plan der USA, im Rahmen des Raketenschutzschildes für Europa Abfangraketen auf rumänischem Territorium zu stationieren, bekannt gegeben. In der entsprechenden Ankündigung der USA hieß es, die Anlagen sollten 2015 einsatzbereit sein und dienten der Verteidigung gegen eine »aktuelle und künftige Bedrohung durch iranische Raketen«. Anstatt also die Pläne, die sich in Wirklichkeit ausschließlich gegen das noch verbliebene Nukleararsenal Russlands richten und nicht gegen eine mögliche Bedrohung Europas durch den Iran, tatsächlich aufzugeben, hat die Regierung Obama zu psychologischer Taktik gegriffen und das Offensivsystem einfach nur neu verpackt. Jetzt ist ein flexibleres System aus einer Kombination von luft- und seegestützten Abfangraketen geplant, die im Laufe der kommenden vier Jahre in Zentraleuropa stationiert werden sollen.
Die jüngste Ankündigung Rumäniens widerspricht Obamas Versicherung, er suche den Dialog mit Moskau, um gemeinsam und mit Beteiligung der Staaten der Europäischen Union die tatsächliche Bedrohungslage für beide Seiten zu untersuchen.
Dass die Bedrohung Moskau gegenüber wächst, wird auch dadurch bestätigt, dass die polnische Regierung in Warschau jetzt bekannt gegeben hat, dass die amerikanischen Patriot-Raketen im Norden des Landes, nur etwa 100 Kilometer von der Grenze zur russischen Enklave Kaliningrad entfernt, und nicht in Warschau stationiert werden sollen.
Wie der polnische Verteidigungsminister Bogdan Klich versichert, hat die Entscheidung, in Morag, das der russischen Grenze weit näher liegt als Warschau, eine Basis für die Patriot-Raketen zu errichten, keine strategischen Gründe. »In Morag konnten wir den amerikanischen Soldaten die besten Bedingungen und die optimalen technische Basis für die Ausrüstung bieten«, so Klich. Seine Erklärung klingt jedoch wenig überzeugend. Der polnische Außenminister und frühere Verteidigungsminister Radek Sikorski, der die provokative US-Raketenstrategie rückhaltlos unterstützt, gehört zum engen Kreis der neokonservativen Clique um Bush und Cheney. Sikorski war führendes Mitglied der Washingtoner Neo-Con-»Denkfabrik« namens American Enterprise Institute und Direktor der New Atlantic Initiative, die die Einkreisung Russlands unterstützt und dafür plädiert hat, so viele ehemalige Mitgliedsstaaten des Warschauer Pakts wie möglich in die NATO aufzunehmen.
Die Patriot-Einheit in Polen wird aus etwa 100 US-Soldaten bestehen; bis zu acht Raketensysteme sollen stationiert werden. Die ersten US-Soldaten werden Ende März in Polen erwartet. Das Patriot-Flugabwehrraketensystem (MIM-104) kann gegen taktische ballistische Raketen, Marschflugkörper und Flugzeuge eingesetzt werden.
Atomarer Erstschlag und Raketenabwehr
Die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems birgt das größte Destabilisierungpotenzial, nicht nur für die Beziehungen zwischen den USA und Russland, sondern auch für die Frage Frieden und Atomkrieg durch Fehlkalkulation.
Sollte es den USA gelingen, nur wenige Flugminuten von den russischen Raketensilos entfernt einen noch so primitiven Raketenschirm zu stationieren, während Russland nicht über ein entsprechendes Abwehrsystem verfügt, dann erhielte das Pentagon damit zum ersten Mal seit Anfang der 1950er-Jahre das – im Jargon der Militärstrategen – »nukleare Primat«, nämlich die Fähigkeit zu einem erfolgreichen Erstschlag. Bevor eine solche Drohung jedoch Wirklichkeit wird, steht die andere Seite, also Russland, unter dem enormen Druck, rechtzeitig zum Präventivschlag auszuholen. Für US-Militärexperten wie den ehemaligen Direktor des US-Raketenverteidigungsprogramms, Lt. Colonel Robert Bowman, stellt die Raketenabwehr das »fehlende Verbindungsglied [missing link] zu einem Erstschlag« dar. Kein Wunder, dass die amerikanisch-russischen Beziehungen ziemlich frostig wurden, als Washington Anfang 2007 die entsprechenden Pläne bekannt gab.
Dienstag, 09.02.2010
© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.
00:37 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, europe, affaires européennes, roumanie, pologne, etats-unis, otan, atlantisme, russie, missiles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 décembre 2009
L'insolente Cioran
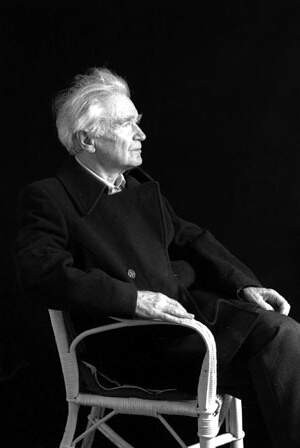 L'insolente Cioran
L'insolente Cioran
A sei anni dalla scomparsa di questo affascinante esponente della cultura europea del Novecento, arrivano nelle librerie italiane i Quaderni 1957 - 1972. L’opera raccoglie il prezioso contenuto di trentaquattro taccuini, ritrovati dopo la sua morte, ora pubblicati da Adelphi in un ponderoso tomo di oltre mille pagine, per la delizia di noi lettori. Si tratta degli appunti più intimi di uno sferzante fustigatore della modernità, «scettico di servizio in un mondo alla fine», scritti nel lungo arco di tempo che va dal giugno 1957 al novembre 1972. Vi si trovano, tenuti insieme da una scrittura iperbolica e densa di suggestioni incantatrici, riflessioni, sentenze fulminanti, ritratti strabilianti, descrizioni minuziose di significativi episodi vissuti, aneddoti e paradossi. Soprattutto emerge, tra le righe, l’animo inquieto di un artista affamato d’assoluto, di uno spirito religioso senza religione, di uno scrittore lucido e delirante al tempo stesso, che per la sua natura contraddittoria sfugge ad ogni classificazione, tanto da definirsi egli stesso un «idolatra del dubbio, un dubitatore in ebollizione, un dubitatore in trance, un fanatico senza culto, un eroe dell’ondeggiamento».
Francese d’adozione, Cioran rimane uno scrittore di stirpe rumena e sentimenti balcanici. Nasce a Rasinari (Sibiu) in Transilvania l’8 aprile del 1911 e i Carpazi sono i compagni della sua adolescenza. Rimane sempre legato alla «madre patria immersa nella bruma» anche quando nel 1937 decide di lasciare l’insegnamento nei licei e accettare una borsa di studio a Parigi, «piccola Bucarest […] la sola città del mondo dove si poteva essere poveri senza vergogna, senza complicazioni, senza drammi, la città ideale per essere un fallito». Ed infatti la sua vita parigina è caratterizzata da quel modus vivendi studentesco che Robert Brasillach definiva «l’eminente dignità del provvisorio», ben descritto da Mario Bernardi Guardi nella monografia che il mensile Diorama Letterario ha dedicato nel maggio 1991 (n.148) a Cioran, profeta della decadenza: «Provinciale d’ingegno e studente ribaldo, legge e scrive, ma va anche in giro in bicicletta per i Pirenei e la Bretagna. E vive, fino a quarant’anni, da avventuroso adolescente: ha in tasca pochi soldi, dorme negli ostelli, abita nelle soffitte, alloggia negli albergucci, mangia alla mensa universitaria».
Con sofferenza matura la decisione di rinunciare alla sua lingua d’origine per scrivere in francese. «Ho scritto in rumeno fino al ’47. Quell’anno mi trovavo in una casetta a Dieppe, e traducevo Mallarmé in rumeno. Di colpo, mi son detto: Che assurdità! Che senso ha tradurre Mallarmé in una lingua che nessuno conosce? Allora ho rinunciato alla mia lingua. Mi sono messo a scrivere in francese, ed è stato difficilissimo, perché, per temperamento, la lingua francese non mi si addice. Io ho bisogno di una lingua selvaggia, di una lingua da ubriaco. Il francese è stato per me una camicia di forza».
Sono invece in rumeno, questa «mistura di slavo e latino, idioma privo di eleganza ma poetico», le sue opere giovanili. A soli ventitre anni scrive un saggio di «sfida al mondo», Al culmine della disperazione (Adelphi 1998), che riscuote un certo successo e viene premiato.
Nel 1937 pubblica Ascesa della Romania. Vi si scorge un Cioran ancora attento all’attualità politico culturale, persino interventista nel dibattito del suo paese: «Nessuno può dirsi nazionalista se non soffre infinitamente del fatto che la Romania non possiede la missione storica di una grande cultura e che un imperialismo culturale e politico come quello delle grandi nazioni non possa appartenerle; non è nazionalista chi non può credere con fanatismo alla repentina sublimazione della nostra storia». Nello stesso periodo scrive: «La cultura rumena vive attualmente il suo momento decisivo: abbandonare dietro di sé la tragedia di una cultura su piccola scala e, attraverso le sue imprese in materia di teorie, d’arte, di politica e di spiritualità, compiere un destino specificamente aggressivo da grande cultura. Lo sforzo dei rumeni deve dunque mirare a strappare il loro paese dalla periferia della storia per condurlo sul proscenio…».
Insieme a numerose personalità della cultura, come lo storico delle religioni Mircea Eliade, si schiera a fianco della Legione dell’Arcangelo Michele. E’ una stagione brevissima, prevale presto lo scetticismo e la sfiducia in ogni rivoluzione. Anni dopo scriverà: «Ogni progetto è una forma di schiavitù». E anche: «Mi basta sentire qualcuno parlare sinceramente di ideale, di avvenire, di filosofia, sentirlo dire noi con tono risoluto, invocare gli altri e ritenersene l’interprete, perché io lo consideri mio nemico».
Prima di partire per la Francia pubblica a sue spese Lacrime e Santi (Adelphi 1990) e qualche anno dopo il suo ultimo libro in lingua rumena, Il tramonto dei pensieri. Si appassiona a Shakespeare e Baudelaire, a Dostoevskij, agli antichi gnostici, a Buddha e Pascal.
Lo influenzano soprattutto Spengler e Schopenhauer, suo «grande Patrono, boicottato dalla tromba degli utopisti, senza parlare di quella dei filosofi» e Nietzsche. Sono in molti a paragonarlo al grande tedesco, dal filosofo spagnolo Fernando Savater, allievo ed amico di Cioran nonché traduttore delle sue opere e autore della biografia Cioran, un angelo sterminatore (Frassinetti 1998), a Jean François Revel che lo definisce «il solo rappresentante letterariamente riuscito dell’arte dell’aforisma dopo Nietzsche».
Termina presto l’idillio con la filosofia, («ha vinto l’incantesimo della filosofia», scrisse Alain De Benoist), che abbandona per abbracciare «l’esperienza, le cose vissute, la follia quotidiana». Preferisce finire «prima in una fogna che su un piedistallo». Detesta la pedanteria dei filosofi, piuttosto che sposare dogmi vuole demolirne. Ritiene l’erudizione un pericolo mortale per l’umanità. «Il sapere […] ci condurrà inesorabilmente alla rovina», avverte.
Soprattutto Cioran non vuole rinunciare al suo «dilettantismo»: «Se fossi costretto a rinunciarvi è nell’urlo che vorrei specializzarmi». Le sue opere, in effetti, gridano, nell’intento di svegliare le coscienze dal torpore morale: «scuotendole, le preservo dallo snervamento in cui le sommerge il conformismo». In esse vibra un’energia baldanzosa e vitale che stride, solo apparentemente, con la sfiducia di Cioran.
La sua critica pungente si rivolge all’uomo contemporaneo, capace solo di «secernere disastro», alla ragione, «la ruggine della nostra civiltà», alla storia, «indecente miscela di banalità e apocalisse», al progresso, «l’ingiustizia che ogni generazione commette nei confronti di quella che l’ha preceduta» e al colonialismo occidentale nel Terzo Mondo, «l’interesse degli uomini civili per i popoli che vengono chiamati arretrati è molto sospetto, incapace di sopportarsi ancora, l’uomo civilizzato scarica su questi popoli l’eccedenza dei mali che lo opprimono, li incita a condividere le proprie miserie, li scongiura di affrontare un destino che ormai non può più affrontare da solo».
Eppure, pur esprimendo un inconfutabile pessimismo, Cioran non può essere ritenuto semplicisticamente un nichilista. Non si limita ad annunciare la catastrofica fine dell’occidente, ma invita tutti ad una vera e propria rivolta morale. Come ha scritto Bernardi Guardi il suo è comunque un messaggio positivo: «C’è da indietreggiare davanti a tanta copia d’angoscia. Eppure l’umor nero di Cioran, mettendoci in guardia contro tutto, paradossalmente ci insegna a riscoprire tutto, a fare carne e sangue di ogni esperienza, prima fra tutte quella del dolore, della religione, della morte».
C’è in lui, infatti, una robusta vena di sensibilità sociale, scevra di ogni forma di retorica, scarna e proprio per questo più sincera. E’ singolare come tale sentimento conviva con l’aristocratico distacco rispetto alle sorti del mondo che caratterizza questo autore solitario e metafisico.
La sua insofferente misantropia lo porta a scrivere feroci battute come queste: «appena si esce nella strada, alla vista della gente, sterminio è la prima parola che viene in mente […] quando passo giorni e giorni in mezzo a testi in cui si tratta unicamente di serenità, di contemplazione, di spoliazione, mi viene voglia di uscire per la strada e spaccare il muso al primo che incontro». La tolleranza diventa «una civetteria da agonizzanti». Malgrado affermazioni così temerarie Cioran non ha dubbi: «Ci si deve schierare con gli oppressi in ogni circostanza, anche quando hanno torto, senza tuttavia dimenticare che sono impastati con lo stesso fango dei loro oppressori». L’auspicio è quello di un mondo liberato dal lavoro, dove la gente possa «uscire in strada e non fare più nulla. Tutta questa gente abbrutita, che sgobba senza sapere perché, o si illude di contribuire al bene dell’umanità, che fatica per le generazioni future sotto l’impulso della più sinistra delle illusioni, si vendicherebbe allora di tutta la mediocrità di una vita vana e sterile, di tutto questo spreco di energia privo dell’eccellenza delle grandi trasfigurazione».
Per Cioran la scrittura non è un mestiere, ma un atto liberatorio. Si domanda: «Cosa sarei diventato senza la facoltà di riempire delle pagine. Scrivere significa distrarsi dei propri rimorsi e dei propri rancori, vomitare i propri segreti. Lo scrittore è uno squilibrato che si serve di quelle finzioni che sono le parole per guarirsi». Chiamato in numerose università a tenere dei corsi, rifiuta asserendo che ne è incapace, perché «ogni idea mi ripugna nel giro di un quarto d’ora».
In Italia, negli anni del più ortodosso fondamentalismo marxista, i suoi libri sono stati a lungo ignorati, in quanto ritenuti politicamente scorretti. Solo le edizioni del Borghese dettero alla luce due sue opere, Storia e Utopia (1969) e I nuovi Dei (1971), libro, quest’ultimo, ristampato successivamente anche dall’editore Ciarrapico nella bella collana de I classici della controinformazione, diretta da Marcello Veneziani.
Solo diverso tempo dopo ed in Italia soprattutto grazie ad Adelphi, che ne ha tradotto, nel corso degli ultimi quindici anni, quasi tutta l’opera, il grande pubblico ha potuto godere di buona parte dei suoi scritti, tra i quali la stessa Storia e Utopia (ovviamente trascurando di fare riferimenti alle precedenti edizioni), Il funesto demiurgo, L’inconveniente di essere nati, La caduta nel tempo, La tentazione di esistere, Sommario di decomposizione, Sillogismi dell’amarezza, Squartamento e Esercizi di ammirazione.
In questo libro, in particolare, conosciamo un Cioran anomalo, non più sarcastico ma, al contrario, persino generoso nel giudicare alcuni personaggi della cultura suoi contemporanei, tra i quali gli amati Eliade, Borges e De Maistre.
Sul futuro delle sue opere Cioran ha dichiarato: «Il destino dei miei libri mi lascia indifferente. Credo però che qualcuna delle mie insolenze resterà». Noi invece siamo convinti che la sua opera rimarrà di assoluta attualità, così come la sua figura di provocatore “insolente”.
A tal proposito la definizione che Cioran ha dato del grande pensatore reazionario Joseph de Maistre, è per noi, lettori devoti, la più adatta a descrivere proprio il grande rumeno: «Senza le sue contraddizioni, senza i malintesi che, per istinto o calcolo, alimentò sul proprio conto, il suo caso sarebbe stato liquidato da tempo, ed oggi soffrirebbe la disgrazia di essere capito, la peggiore che possa abbattersi su un autore».
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, roumanie, france, lettres roumaines, littérature roumaine, lettres françaises, littérature française, lettres, littérature, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 décembre 2009
Souffrance de la France et appel de l'Empire
Souffrance de la France et appel de l’Empire
par Pierre LE VIGAN
Cioran ausculte notre patrie
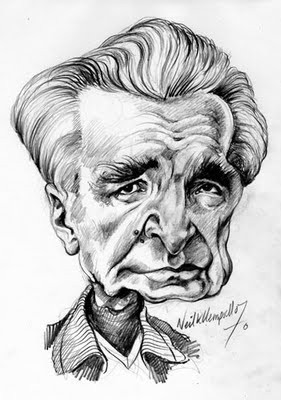
Un ennui tient à la clarté. C’est l’ennui qui tient au trop de clarté. « Je ne crois pas que je tiendrais aux Français [au sens d’être attaché à] s’ils ne s’étaient pas tant ennuyés au cours de leur histoire. Mais leur ennui est dépourvu d’infini. C’est l’ennui de la clarté. C’est la fatigue des choses comprises. » (Cioran, De la France, 1941). La France, dit-il encore, c’est la sociabilité, l’amour de la conversation. « C’est une culture a-cosmique, non sans terre mais au-dessus d’elle. »
Sur la fin de la France comme peuple, Cioran livre cette prodigieuse analyse, indépassée : « Un peuple sans mythes est en voie de dépeuplement. Le désert des campagnes françaises est le signe accablant de l’absence de mythologie quotidienne. Une nation ne peut vivre sans idole, et l’individu est incapable d’agir sans l’obsession des fétiches. Tant que la France parvenait à transformer les concepts en mythes, sa substance vive n’était pas compromise. La force de donner un contenu sentimental aux idées, de projeter dans l’âme la logique et de déverser la vitalité dans des fictions – tel est le sens de cette transformation, ainsi que le secret d’une culture florissante. Engendrer des mythes et y adhérer, lutter, souffrir et mourir pour eux, voilà qui révèle la fécondité d’un peuple. Les » idées » de la France ont été des idées vitales, pour la validité desquelles on s’est battu corps et âme. Si elle conserve un rôle décisif dans l’histoire spirituelle de l’Europe, c’est parce qu’elle a animé plusieurs idées, qu’elle les a tirées du néant abstrait de la pure neutralité. Croire signifie animer. Mais les Français ne peuvent plus ni croire ni animer. Et ils ne veulent plus croire, de peur d’être ridicules. La décadence est le contraire de l’époque de grandeur : c’est la re-transformation des mythes en concepts. […] Les Français se sont usés par excès d’être. Ils ne s’aiment plus, parce qu’ils sentent trop qu’ils ont été. Le patriotisme émane de l’excédent vital des réflexes; l’amour du pays est ce qu’il y a de moins spirituel, c’est l’expression sentimentale d’une solidarité animale. Rien ne blesse plus l’intelligence que le patriotisme. L’esprit, en se raffinant, étouffe les ancêtres dans le sang et efface de la mémoire l’appel de la parcelle de terre baptisée, par illusion fanatique, patrie. […] La France n’a plus de destin révolutionnaire, parce qu’elle n’a plus d’idées à défendre. Les peuples commencent en épopées et finissent en élégies. »
Cioran évoque l’appel de l’Empire : « Lorsque se défont les liens qui unissaient les congénères dans la bêtise reposante de leur communauté, ils étendent leurs antennes les uns vers les autres, comme autant de nostalgies vers autant de vides. L’homme moderne ne trouve que dans l’Empire un abri correspondant à son besoin d’espace. C’est comme un appel à une solidarité extérieure dont l’étendue l’opprimerait et le libérerait en même temps. » Et l’on comprend alors ce qu’on n’avait peut-être jamais compris avant : l’Empire est femelle, l’Empire, c’est la protection de la femme, de la mère, c’est le ventre. C’est la part féminine d’une aspiration au politique. D’où sa légitimité, d’où, aussi, la nécessité que cette part féminine ne s’exprime pas trop fémininement. En d’autres termes, l’Empire doit être républicain avant d’être démocratique (la République est la condition de la démocratie). Si c’est le contraire, on ajoute de la féminité à de la féminité, on ajoute de la domesticité à de la domesticité, de la protection à la protection, et c’est alors un déficit de masculinité qui se manifeste. Avec un très gros risques : ce sont les empires faibles qui sont les plus bellicistes (Russie et Autriche-Hongrie en 1914). Le Japon de 1941 n’est pas un contre-exemple : ce n’était pas un empire fort dans la mesure où le Japon était fort mais n’était aucunement un Empire, c’était une nation avec un Tenno, ce qui n’est pas du tout la même chose.
Pierre Le Vigan
00:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, france, cioran, roumanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 décembre 2009
Nuevas bases americanas en el mar Negro
Nuevas bases americanas en el mar Negro
El gobierno de Estados Unidos destinará más de $ 100 millones para construir nuevas bases militares en Bulgaria y Rumanía aunque la administración Obama haya suspendido recientemente sus planes para crear un escudo defensivo anti-misiles en otras partes de Europa oriental.
Según la revista semanal del ejército de los EE.UU. “Barras y Estrellas”, este último compromiso del Pentágono consiste en una base militar de $ 50 millones en Rumanía y otra de $ 60 millones en Bulgaria, que albergarán a 1.600 y 2.500 soldados estadounidenses respectivamente.
Se espera que la base de Rumanía esté terminada en los próximos dos meses, mientras que la apertura de la base búlgara está programado para el 2011 o 2012.
Las bases, financiadas por los Estados Unidos, aunque propiedad de los gobiernos de Rumanía y Bulgaria, serán compartidas por fuerzas americanas y de los países anfitriones, según la revista semanal.
Más de 2.000 soldados se encuentran realizando maniobras cerca de las dos naciones de Europa Oriental.
Durante una reciente visita a Rumanía, el vicepresidente Joe Biden dijo que Bucarest respaldaba la nueva configuración del escudo anti-misiles americano que Washington anunció tras la suspensión de su despliegue de misiles defensivos previstos en Polonia y la República Checa.
Esto significa que elementos del complejo anti-misiles americano pueden aparecer en Rumanía.
Además, los expertos estadounidenses dicen que la construcción de dos nuevas bases en Rumanía y Bulgaria está plenamente en consonancia con la redistribución de las tropas que el ex-presidente George W. Bush anunciara en 2004. Muchos analistas creen que el movimiento de tropas americanas hacia Rumanía y Bulgaria forma parte de una estrategia de redistribución mundial que comenzó en los primeros años de la administración Bush con el objetivo de desplazarlas de Alemania hacia hacia el este.
El Pentágono explica todo esto por la necesidad de llevar sus fuerzas cerca del inestable Oriente Medio.
Rusia lo ve como una amenaza directa a sus intereses por temor a que lo que comienza con una presencia relativamente pequeña del ejército americano en Rumania y Bulgaria, pueda finalmente verse aumentada en gran medida.
Además, la aparición de bases de la OTAN en el Mar Negro se suma a las instalaciones militares que Occidente tiene en el Mar Báltico, y que pone a Rusia en un aprieto.
En otra señal alarmante, cadetes de la academia militar de West Point están ahora recibiendo un curso intensivo de cultura y lengua rusa. Al igual que hicieran en los tres años previos a la invasión de Irak.
Preparándose para apropiarse de la riqueza de petróleo del Mar Caspio, Washington lo hará apoyándose en sus bases de Rumanía y Bulgaria y aumentando la inestabilidad en el Caucaso. ¿Para qué? Para poder enviar a sus fuerzas de paz allí para garantizar la seguridad del transporte de petróleo y gas. Y aquí el contingente americano en Rumanía y Bulgaria puede ser de mucha utilidad.
Traducido por Martin (investigar11S)
New US Bases on the Black Sea, by Mike Sullivan
00:22 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mer noire, etats-unis, otan, russie, atlantisme, occidentalisme, région pontique, bases militaires, turquie, roumanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 novembre 2009
Cioran: un hurlement lucide
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1993
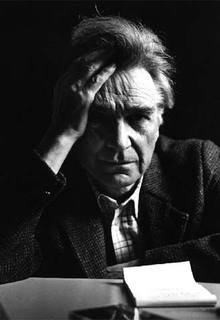 Cioran: un hurlement lucide
Cioran: un hurlement lucide
par Luis FRAGA
S'il s'avère difficile d'écrire un article pour défendre Cioran (Cioran a-t-il besoin d'être défendu?), les problèmes s'accroissent encore si l'on tente le contraire, si l'on veut l'attaquer, soumettre sa pensée aux feux de la critique: il faut s'armer de courage pour s'en prendre à celui qui, sans nul doute, est à la mode depuis plus de dix ans. Lui présenter des «objections», c'est aller à contre-courant. Mais les reproches qu'on lui a adressés, reproches qui ont servi à mythifier à outrance cet «hétérodoxe de l'hétérodoxie» n'allaient-ils pas, eux, à contre-courant.
Un brillant anti-système
Toute personne qui éprouve de la difficulté à se prononcer en toute sincérité contre Cioran n'a qu'une solution: tenter d'imiter ces hérétiques qui, soumis à la torture, ne persistaient dans leur hérésie que par bon goût. Et se répandre en louanges à l'endroit de Cioran pourrait sembler d'un mauvais goût comparable à celui qui tenterait d'ordonner en un système cohérent les écrits et les interjections mentales de celui qui a affirmé que «la pire forme de despotisme est le système, en philosophie et en tout».
L'avantage de l'anti-système est sa maigre vulnérabilité à toute attaque consistant en objections organisées systématiquement. On ne pourrait réfuter Cioran que de manière a-systématique et toujours dans l'hypothèse douteuse que cette réfutation dépasse le discours du Roumain sur le point précis grâce auquel il arrive justement à séduire: «l'éclat».
On peut être brillant au départ de la «lucidité» et également au départ de la «foi», et même des deux à la fois (à la condition que cette cohabitation soit possible), du moment que l'on soit suffisamment subjectif. L'objectivité est rarement brillante et ne parvient jamais à être géniale. Installé dans la lucidité, Cioran a le privilège de devoir être subjectif par la force.
La lucidité et la subjectivité déployées par Cioran lui donnent la force suffisante pour faire face à ce qui se trouve devant lui, sans aucune aide ou échappatoire possible. Avec une sincérité qui épouvante, Cioran paraît même jouir de cette manière tourmentée par laquelle il s'inflige l'atroce nécessité de remâcher sans cesse ses interrogations —et même ses obsessions— essentielles: l'histoire, Dieu, la barbarie, le suicide, le scepticisme et autres labyrinthes. Ceux-ci sont brillamment exposés comme les dépouilles tirées d'un immense dépeçage où l'on aurait séparé les ordures philosophiques pour laisser, dénudé, ce que personne n'aurait imaginé être essentiel.
Volonté de style
«Mystère. Parole que nous utilisons pour tromper les autres, pour leur faire croire que nous sommes plus profonds qu'eux» (Syllogismes de l'amertume, 1952).
Les grands négociateurs professionnels se distinguent avant tout par leur immense clarté dans la façon d'exposer leurs hypothèses, à l'écart de la complexité de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils prétendent. Idem avec le style concis et simple de Cioran. Il ne perd pas son temps dans les arcanes du langage et dans un discours prétendument «profond», et il va droit au but avec une précision de scalpel, dont on ne peut que faire l'éloge.
Ayant perdu la foi dans la grammaire («Nous continuons à croire en Dieu parce que nous croyons encore en la Grammaire»), le Roumain connait bien les limites du langage auquel il doit forcément recourir. Aussi le domine-t-il. Le français n'est pas sa langue maternelle et cependant peu d'écrivains vivants le manient avec tant d'efficacité. La proposition de Wittgenstein —«tout ce que l'on peut exprimer, il est possible de l'exprimer clairement»— voilà ce qu'auraient dû méditer avec une plus grande attention ceux qui prétendent snober le style «superficiel» de Cioran.
Indépendance
Avec une sincérité totale, Cioran accepte le défi d'être inclassable. Un poids plus lourd qu'on pourrait l'imaginer: il n'est pas facile d'être apatride et, à la longue, rares sont ceux qui survivent «sans profession ou métier connu».
«Lunatique», «hétérodoxe»: voilà, entre autres, les qualificatifs qui ont été appliqués à Cioran. Par ceux qui sont parvenus, tant bien que mal, à le «classifier». Ce sont également les étiquettes qu'acceptent bon gré mal gré ces rares personnages de la vie réelle qui, tirant orgueil de leur extrême lucidité, doivent maintenir coûte que coûte leur acharnement, rester digne d'éloges précisément parce qu'ils sont acharnés plus que de raison, demeurer indépendants, ne pas s'imposer ou ne pas accepter de se voir imposer une limite quelle qu'elle soit. Pendant la Renaissance, on appelait «humaniste» l'homme non unidirectionnel. Cioran rejeterait sans aucun doute cette désignation avec véhémence; de la même façon, il se moquerait très probablement de tout qui tenterait de le classer comme «réactionnaire», ou comme «sceptique», comme «païen» ou lui attribuerait d'autres étiquettes simplificatrices du même genre.
L'indépendance, comprise comme élimination progressive de tous points de référence, est un exercice douloureux, dont les douleurs ne disparaissent jamais. Difficile, par ailleurs, d'évaluer jusqu'à quel point le résultat obtenu compense le prix payé. De tous les génies du XIXième siècle, seul Wagner et Goethe se sont «bien débrouillés». Nietzsche, Hölderlin, Rilke et d'autres, nombreux, ont produit des écrits que l'on peut qualifier d'enviables. Et bien qu'ils puissent tous affirmer, avec Cioran, que «naître, vivre et mourir trompés, c'est ce que font les hommes», aucun d'entre eux, à l'évidence, n'a atteint l'indépendance à laquelle ils prétendaient parvenir; peut-être s'en sont-ils approchés, certains plus que d'autres, mais il ne s'y sont jamais installés, n'ont pas eu les pleins pouvoirs de l'homme réellement indépendant.
Par rapport au XIXième siècle, le XXième siècle offre peut-être l'avantage d'être réellement plus indépendant (bien que cela soit également difficile). Mais les hommes moyens continuent encore à exiger de tout un chacun des «étiquettes», des «professions» ou des «métiers». Ces hommes moyens font montre d'une attitude proche de celle de ces Etats qui aspirent à tout contrôler dans la société. Ils ne se sentent à l'aise face à une personne ou à un phénomène que s'ils peuvent le classer, lui donner un titre ou une étiquette, le conceptualiser. Titre, étiquette ou concept qui déterminera, par déduction, le type de relation qu'il faut avoir, au nom des conventions, avec l'étiquetté, le titré, le conceptualisé. «Les hommes ont besoin de points d'appui, ils veulent la certitude, quoi qu'il en coûte, même aux dépens de la vérité».
Le médiocre de notre temps tente d'ôter de sa vue, de ses pensées, tout ce qu'il ne comprend pas. Tout ce qu'il est incapable de comprendre. «Je suis comptable», «je suis avocat», «je suis vendeur» (parfois, plus souvent que nous ne l'imaginons, on recourt à l'euphémisme pour rendre digne un métier dont on perçoit bien les misères). Voilà donc les déclarations officielles à faire obligatoirement de nos jours en société.
Que des hérétiques comme Cioran ne confient pas au Saint Office Collectif leur titre de dépendance ou leurs numéros d'identification sociale, voilà qui les soumettra irrémédiablement à la réprobation générale et même à l'isolement. Ils ne réveilleront que la curiosité du petit nombre, ou la sympathie de personnalités plus rares encore, mais ils devront constater et accepter d'être toujours observés (et même jugés) avec la même colère critique que l'on appliquait jadis aux pires des hérétiques. L'indépendance coûte cher.
Cioran, l'Anti-Faust
On a parlé de Cioran comme du porte-drapeau de la philosophie du renoncement, de la «non-action» et du désistement. Ceux qui décrivent Cioran de la sorte prétendent rapprocher notre exilé roumain de son maître Bouddha et n'oublient généralement pas de mentionner son célèbre adage: «Plus on est, moins on veut». Ou de nous rappeler, en guise de plaisanterie, sa description fort crue de l'acte d'amour: il s'agirait «d'un échange entre deux êtres de ce qui n'est rien d'autre qu'une variété de morve». Le rapport qui existe entre Cioran et l'idée d'action (ou si l'on préfère, le désir) est un rapport de conflit.
Personne ne niera que le principe faustien de la souveraineté de l'action soit radicalement opposé au scepticisme féroce de celui qui élève l'inaction au rang de catégorie divine. Et même si l'action et le goût pour l'action sont compatibles avec la lecture de Cioran, nous nous trouvons néanmoins en présence de deux extrêmes irréconciliables. Un livre de Cioran est inimaginable sur la table d'un broker de New York. Et personne n'aura l'idée saugrenue d'emmener des livres de Cioran lors d'une régate de voiliers, d'une expédition dans l'Himalaya ou d'une escapade avec une belle femme dont on vient de faire la connaissance. Cependant, les fanatiques de l'action les plus intransigeants pourront se lancer dans une activité exceptionnelle, où ne détonneraient absolument pas certaines pages de Cioran: traverser un désert.
00:11 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roumanie, france, lettres françaises, littérature française, lettre, littérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 juin 2009
Paul Morand et Bucarest

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Paul Morand et Bucarest
Les éditions Plon viennent de rééditer la promenade littéraire de Paul Morand sur Bucarest. Notre collaborateur Hugues Rondeau, a glissé l'ouvrage dans ses poches et est parti à travers les rues de la capitale roumaine sur les traces de l'ambassadeur écrivain.
En arrivant dans la gare de Bucarest, le voyageur ne peut s'empêcher de se répéter cette entrée en matière des discours des ministres de la IIIe République que plaisante Morand : « la Roumanie, notre sœur latine ». Tout est latin en effet en cette ville où les cris résonnent de pavillons en immeubles, de boutiques en échoppes, au milieu des odeurs qu'exalte la chaleur dans les soupirs d'hommes paresseusement attablés. Vingt ans de national-communisme à la Ceaucescu, près d'un demi-siècle d'amitié tendue avec l'Union soviétique, n'ont pas entamé le caractère des Roumains. Là comme ailleurs les structures lourdes de l'histoire ont eu raison des vissicitudes du moment.
Paul Morand écrit que « Bucarest s'affermit au centre de l'amphithéâtre valaque protégé par le grand arc carpatique, courbé comme le dos d'un portefaix turc, et appuyé à sa base sur le fleuve nourricier par où était descendu un jour l'empereur Trajan, père des Roumains ». Pas une ligne n'est à changer dans cette description et s'il était quelque homme pressé qui mette en doute l'empreinte des Césars en Roumanie, il lui suffit pour se détromper d'observer les visages des habitants de Bucarest, autant de preuves que plus d'un légionnaire romain fut oublié au cœur de la Roumanie ou s'est oublié au cœur des Roumaines.
Bucarest, terre latine, en partage les défauts et d'abord celui d'un certain laisser-aller qui confine, en un parallèle de ses cousines Naples ou Tunis, à la saleté. Morand en fut dès l'abord frappé et reprend dans son texte les propos de voyageurs anglais, espions vénitiens ou négociants suédois qui voyaient au XVIIIe siècle s'entasser le fumier devant les portes. Les rues de Bucarest étaient alors de véritables radeaux sur la boue mouvante, « les véhicules y roulant lourdement, soulevant les madriers qui retombaient en s'enfonçant dans la glaise molle ».Le bitume et les trottoirs ont peu à peu, sous l'influence des Hohenzollern-Roumanie puis de la dictature communiste, pavé ce cloaque. Il n'en demeure pas moins qu'aujourdhui comme dans le Bucarest de 1935 que décrit Morand, routes et allées, impasses et cours, sont empreintes des remugles de la boue d'hier. Des époques d'une hygiène précaire, les habitants de la capitale roumaine ont conservé un redoutable fatalisme qui ruinait jusqu'aux rêves de pureté socialiste de Nicolae Ceausescu. Le voyageur ne doit pas hésiter à Bucarest pour se frayer le soir un chemin à enjamber les poubelles, vérifiant par la même que si en certaines cités, la nuit tous les chats sont gris, en Roumanie tous les rats sont noirs.
On connait l'intérêt que portait Morand aux cités radieuses, Venises de tous les sourires, on s'imagine donc que ce Bucarest des années trente a les attraits outranciers des belles du sud. Las, la ville est empreinte d'une indicible tristesse, apanage de toute éternité de la Roumanie. Morand l'explique, en reprenant un texte du prince de Ligne, par la domination turque qu'eut à subir pendant des siècles le pays. « La crainte qu'ils ont des Turcs, l'habitude d'apprendre de mauvaises nouvelles... les ont accoutumés à une tristesse invincible. Cinquante personnes qui se rassemblent dans une maison ou une autre ont l'air d'attendre le fatal cordon ». Il va sans dire que la terreur pratiquée par la mythique Securitate, bras armé du Conducator, n'a pas enclin les habitants de Bucarest à l'optimisme.

A première vue la ville manque donc d'attrait et déçoit le voyageur. Ce que résume Paul Morand en décrivant la lassitude de l'hospodar, gouverneur nommé par la Sublime Porte, qui arrivant d'Istambul, « trouve sa résidence misérable ».
Pourtant derrière ces façades lépreuses, le Bucarest de 1935 comme celui de 1990, recèle des charmes insoupçonnés. L'un des moindres n'est pas l'extraordinaire vitalité de ses intellectuels. Paul Morand s'avoue admiratif devant le talent multiforme des Roumains, véritable magie noire de l'esprit : « leur drôlerie, leur verve, leur mordant , leur rapidité , leur bon sens cynique les rendent redoutable. Il n'est pas facile de tenir sa place dans une discussion entre Roumains. » L'assertion reste aujourd'hui pertinente. Depuis la pseudo-révolution de décembre 1989, qui a brisé les cadres par trop rigides du stalinisme à la Ceausescu, Bucarest tout entière bruit des jeux de l'intellect. Les Roumains ont pendant les décennies du communisme triomphant maintenu la flamme vacillante de leurs brillantes élites (les écrivains Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Mihail Sadoveanu auxquels succèderent les exilés de génie : Cioran, Ionesco, Eliade, Vintilia Horia). La terre était féconde et de nouvelles pousses ne demandaient qu'à poindre. L'arrivée au pouvoir d'Ilescu a ainsi permis à des écrivains comme Doïna Cornea ou Alexandre Paleologu de devenir de véritables autorités morales. Morand qui chantait les louanges des salons littéraires du Bucarest des années trente n'aurait pas été outre mesure surpris de la curiosité intellectuelle de toute une population qui n'hésite pas aujourd'hui à afficher dans les magasins des portraits de Mircea Eliade.
Bucarest est aussi la Mecque des hommes de presse. Dans les années trente, les journaux y faisaient flores, Morand se délectant en son hôtel de la lecture de Cuvântul, de Curentul, de Criterion ou de Viata Romana, toutes publications « à la tenue tout à fait remarquable ». La dite révolution de décembre 1989 a permis à l'histoire de faire un saut dans le temps et de restaurer au delà des années de censure politique, le pluralisme de l'écriture. Le flâneur salarié qui met ses pas dans ceux de Paul Morand peut à son tour gagner son gîte avec une moisson de titres divers, parmi lesquels il faut surtout retenir le très anti-conformiste România Mare, nationaliste et anti-sémite ou la gazette littéraire Arca qui affiche une indépendance que l'Occident se doit de jalouser.
Cette exubérance intellectuelle séduit d'autant plus le lecteur francophone qu'elle se fait à l'ombre de Corneille et de Montesquieu. On ne dira jamais assez combien les Roumains sont pétris de culture française classique et des feux des Lumières. Paul Morand voit les prémices de cette osmose entre les deux pays dans la croisade que menèrent en 1396 Mircea le Grand, voevode de Valachie, et les chevaliers francs commandés par le fils du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, contre l'ennemi commun qu'était le Turc.
C'est alors noué dans le sang des combats et notamment dans les souffrances de la défaite de Nicopolis, une durable entente que viendra renforcer la lointaine protection qu'accorde au XVIe siècle Henri III, roi de France, à Pierre Boucle-d'Oreille, prince valaque avide de dominer l'ensemble des provinces roumaines. Quelques années plus tard, c'est un prince moldave, Jacques Basilic-Héraclide Despotas, qui entame des études de médecine à la faculté de médecine de Montpellier. Cette tradition se maintient jusqu'à nos jours et il n'est pas jusqu'au Premier ministre roumain en exercice, Petre Roman, qui n'ait été potache sur les bancs de l'université de Toulouse.
Paul Morand ne se lasse pas de ce visage de la Roumanie, terre d'épanouissement pour les élites. Pourtant il préfère consacrer les plus belles pages de son livre à d'autres minois, ceux des femmes de Bucarest. Elles l'ont dès l'abord séduit, au point qu'il a songé à donner pour sous-titre à cette balade citadine, « le portait d'une jolie femme ». Il est vrai que de temps immémoriaux les douces de Bucarest font rêver les hommes d'Orient et d'Occident. Le chroniqueur Dionisie Eclesiarcul raconte ainsi qu'un amiral ottoman exigea au cours d'une visite en Roumanie que les boyards lui amène leurs boyaresses. Devinant ses intentions, ils firent venir des prostitués, les couvrirent de bijoux et les présentèrent comme leurs femmes. Vers la fin de la soirée, l'amiral demanda à l'hospodar de lui garder la plus belle et d'envoyer les autres à ses lieutenants. Les Ottomans ne dominent plus le monde et la concupiscence des hommes n'est plus ce qu'elle était mais le voyageur ne se contraint guère pour détourner le regard vers tant de poitrines de paysannes que servent des pieds menus. Pour ceux qui douteraient de l'admiration que l'on se doit de porter à ces odalisques des Carpates, Morand cite encore une fois le prince de Ligne : « Des femmes charmantes (...) une jupe extrêmement légère, courte et serrée masque leurs charmants contours, et une gaze en manière de poche dessine et porte à merveille les deux jolies pommes du jardin de l'Amour.».
Ces lignes prennent toute leur signification si l'on sait que Morand qui aimait à dire « Je n'aime pas qu'on me mette la main dessus, que ce soit un homme ou une femme » (cité par Ginette Guitard-Auviste dans la Nouvelle Revue de Paris n°13), ne succomba que pour la main de la princesse Soutzo, ex-épouse d'un hospodar roumain. A ce grand sceptique du couple ( « Je pensais comme le disait souvent Marie Laurencin qu'un et un ne font pas deux, mais trois, et que trois ce n'est pas une bonne compagnie »), Hélène Soutzo s'offrira comme si indispensable qu'il ne saura lui survivre plus de dix-sept mois. Il est sans doute souhaitable pour tous les imitateurs de l'auteur de l'Europe galante en son périple roumain de tomber à leur tour dans les rets de fatales filles de Bucarest, (« Hélène était la seule femme que je puisse épouser : auprès d'elle je ne m'ennuie jamais »). A défaut, le voyageur des années quatre-vingt dix à qui plus d'un visage souri en autant de possibles aventures garde à son tour, une fois l'éloignement consommé, le parfum d'une ville sensuelle, avec en tête cette ritournelle de Le Cler, promeneur de 1860, et qui résume le labeur essentiel de la cité : « A Bucarest on fait l'amour, ou bien on en parle ». Cette évocation légère de l'infinie séduction des belles descendantes des tribus Thraces révèle peut-être finalement la véritable nature de l'âme roumaine. La Roumanie est une nation femelle et cela explique sans doute qu'au printemps des peuples, elle ait vécue son étrange révolution comme une Commedia dell Arte. Faux procès de vrais dictateurs, complots étranges et génocides de pacotilles prennent un tour nouveau à l'aune de la féminité analysée par Morand : « Les femmes (...) rebâtissent le monde à mesure que les hommes le détruisent. Les catastrophes, elles les banalisent en révolutions, les révolutions en fêtes foraines et, notre goût du meurtre, elles en font de l'amour (Le dernier dîner de Cazotte, Nouvelles des yeux, 1965)». Morand a donc volontairement placé le nœud gordien et l'épilogue de son livre sous le riche signe de la féminité, clé de la Roumanie car source de vie, ce qu'il résume ainsi : « La leçon que nous offre Bucarest n'est pas une leçon d'art mais une leçon de vie (...). Capitale d'une terre tragique où souvent tout finit dans le comique, Bucarest s'est laissé aller aux événements sans cette raideur, partant sans cette fragilité que donne la colère. Voilà pourquoi à travers la courbe sinueuse d'une destinée picaresque, Bucarest est resté gai ». Il est rarement en littérature d'observation que l'histoire aura rendu plus juste puisque aujourd'hui sur les ruines d'une bibliothèque détruite par les combats de l'hiver 1989 se pressent, dans les chaleurs de l'été, des jeunes filles en fleur, minaudant.
La Roumanie est ainsi une nation phénix, toujours prête à renaître de ses cendres et il suffirait que le gouvernement d'Iliescu suive dans la tombe la dictature du génie des Carpates pour que revive le Bucarest des années trente qu'a connu Morand. Ce serait là encore la démonstration du phénomène de glaciation qu'a fait subir le communisme aux peuples de l'Est, préservant par delà les miasmes de l'idéologie, leur véritable identité et peut-être également de façon plus malicieuse la preuve du génie littéraire de Paul Morand. En attendant cet hypothétique salut, Bucarest reste l'indispensable et unique (faute de guide officiel) Baedeker de la capitale roumaine. Morand a écrit dans Le Voyageur et l'amour : « l'amour est aussi un voyage », on serait tenté à la lecture de son livre de proclamer que l'inverse est aussi vrai, le voyage est un amour, Monsieur Morand, puisque vous nous faites tant aimer Bucarest.
Hugues Rondeau
Bucarest, Paul Morand, Plon, 293 pages, 100 francs.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, roumanie, france, paul morand, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 mars 2009
Hommage à Emil Cioran
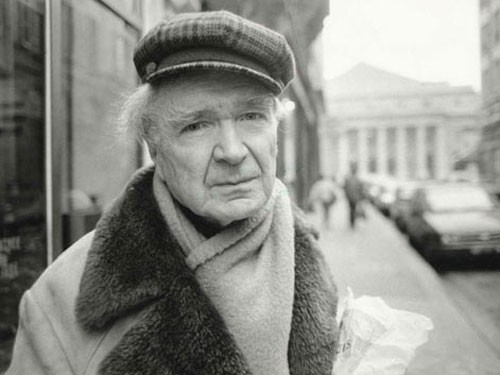
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Hommage à Emile Cioran
Au beau milieu de notre société de consommation et de plaisir, il était le héraut du déclin et du doute. L'écrivain roumain Emile Cioran est mort à Paris, à l'âge de 84 ans, le 20 juin 1995. Rien que les titres de ses livres, Précis de décomposition, Syllogismes de l'amertume ou De l'inconvénient d'être né, pourraient déclencher une dépression. Face à un homme comme Cioran, qui, selon sa propre confession, considère que toute rencontre avec un autre homme est une sorte de “crucifixion”, on est en droit de se poser la question que Nietzsche lui-même nous a suggérée: comment est-il devenu ce qu'il était?
Déjà à l'âge de dix ans, Cioran a vécu une sorte d'exclusion du Paradis. Il a dû quitter le monde de son enfance pour s'en aller fréquenter le lycée de Sibiu. Cioran décrit ce grand tournant de sa vie d'enfant: «Quand j'ai dû quitter ce monde j'avais le net pressentiment que quelque chose d'irréparable venait de se produire». Cet “irréparable” était très étroitement lié au monde simple des paysans et des bergers de son village natal. Plus tard, Cioran s'est exprimé sans ambigüité sur le monde de son enfance: «Au fond, seul le monde primitif est un monde vrai, un monde où tout est possible et où rien n'est actualisable».
Autre expérience décisive dans la vie de Cioran: la perte de la faculté de sommeil à l'âge de 20 ans. Cette perte a été pour lui “la plus grande des tragédies” qui “puisse jamais arriver à un homme”. Cet état est mille fois pire que purger une interminable peine de prison. Voilà pourquoi son livre Sur les cîmes du désespoir a été conçu dans une telle phase de veille. Cioran considérait que ce livre était le “testament d'un jeune homme de vingt ans” qui ne peut plus songer qu'à une chose: le suicide. Mais il ne s'est pas suicidé, écrit-il, parce qu'il ne pouvait exercer aucune profession, vu que toutes ses nuits étaient blanches. Elles ont été à l'origine de sa vision pessimiste du monde. Et jamais, dans sa vie, Cioran n'a été contraint de travailler. Il a accepté toute cette “peine”, cette “précarité”, cette “humiliation” et cette “pauvreté” pour ne pas devoir renoncer à sa “liberté”. «Toute forme d'humiliation» est préférable «à la perte de la liberté». Tel a été le programme de sa vie, aimait-il à proclamer.
Avant d'émigrer en France en 1937, Cioran écrivait Larmes et Saints, un livre qu'il considérait être le résultat de sept années d'insomnie. Ce que signifie l'impossibilité de dormir, Cioran l'a exprimé: la vie ne peut “être supportable” que si elle est interompue quotidiennement par le sommeil. Car le sommeil crée cet oubli nécessaire pour pouvoir commencer autre chose. Ceux qui doivent passer toutes leurs nuits éveillés finissent par segmenter le temps d'une manière entièrement nouvelle, justement parce que le temps semble ne pas vouloir passer. Une telle expérience vous modifie complètement la vie. Tous ceux qui veulent pénétrer dans l'œuvre de Cioran, doivent savoir qu'il a été un grand insomniaque, qu'il en a profondément souffert.
Les nuits de veille de Cioran sont aussi à l'origine de son rapport particulier à la philosophie. Celle-ci ne doit pas aider Cioran à rendre la vie “plus supportable”. Au contraire, il considère que les philosophes sont des “constructeurs”, des “hommes positifs au pire sens du terme”. C'est la raison pour laquelle Cioran s'est surtout tourné vers la littérature, surtout vers Dostoïevski, le seul qui aurait pénétré jusqu'à l'origine des actions humaines. La plupart des écrivains de langues romanes ne sont pas parvenu à une telle profondeur, écrivait Cioran. Ils sont toujours resté à la surface des choses, jamais ils n'ont osé s'aventurer jusqu'aux tréfonds de l'âme, où l'on saisit à bras le corps le “démon en l'homme”.
1937 a aussi été l'année où Cioran a dû reconnaître que la voie religieuse et mystique lui était inaccessible. Comme il le constatait rétrospectivement, il n'était tout simplement “pas fait pour la foi”. Car avoir la foi était au fond un don, écrivait Cioran, et on ne peut pas vouloir croire, ce serait ridicule.
Quand on prend connaissance de cet arrière-plan, on ne s'étonnera pas que Cioran revient sans cesse sur son expérience du “néant”, du “néant” qui ne devient tangible que par l'ennui. Du point de vue de Cioran, on ne peut supporter la vie que si l'on cultive des illusions. Et si l'on atteint la “conscience absolue”, une “lucidité absolue”, alors on acquiert la “conscience du néant” qui s'exprime comme “ennui”. Cependant, l'expérience de l'ennui découle d'un doute, d'un doute qui porte sur le temps. C'est à ce sentiment fondamental que pensait Cioran quand il disait qu'il s'était “ennuyé” pendant toute sa vie.
On ne s'étonne pas que Cioran avait un faible pour les cimetières. Mais ce faible n'a rien à voir avec les attitudes prises aujourd'hui par les Grufties. Pour notre auteur, il s'agissait surtout d'un changement de perspective. C'est justement dans une situation de douleur de l'âme, d'une douleur qui semble immense, démesurée, que le changement de perspective constitue la seule possibilité de supporter la vie. Quand on adopte la perspective du “néant”, tout peut arriver. Dans une certaine mesure, on en arrive à considérer comme parfaitement “normal” la plus grande des douleurs, à exclure toutes les “déformations par la douleur” qui conduisent au “doute absolu”.
Au cours des dernières années de sa vie, Cioran n'a plus rien écrit. Il ne ressentait plus l'“impérativité de la souffrance” qui fut toujours le moteur de sa production littéraire. Peut-être a-t-il tiré les conséquences de ses propres visions: nous vivons effectivement dans une époque de surproduction littéraire, surproduction absurde, totalement inutile.
Michael WIESBERG.
(trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres, littérature, lettres françaises, lettres roumaines, littérature française, littérature roumaine, france, roumanie, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 février 2009
De Sirenenzang van de Beschaving
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, décadence, déclin, roumanie, cioran, lettres roumaines, littérature roumaine, lettres, littérature, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 février 2009
Nae Ionescu: Abriss seines Lebens und Werkes
 Dora Mezdrea Mit einem Beitrag von Mircea Eliade Nae Ionescu (gest. 1940) war einer der einflußreichsten rumänischen Intellektuellen der Zwischenkriegszeit des vorigen Jahrhundert. Nach einem Studium der Mathematik und Philosophie in Bukarest und München war er Professor an der Bukarester Universität und Herausgeber der zeitweilig verbotenen Tageszeitung Cuvantul. Er war Logiker, Philosoph, orthodoxer Theologe und charismatischer Universitätslehrer. Auch durch seine Schüler Eliade, Cioran, Ionesco und Sebastian übte er nicht nur einen dominanten Einfluß auf das gesamte rumänische Geistesleben, sondern auch indirekt auf die westliche Kultur aus. Als Nationalist beeinflußte er auch die Eiserne Garde, der er, wie die Autorin nachweist, aber niemals angehörte. Das Buch ist für das Verständnis der ostmitteleuropäischen Geistesgeschichte und ihrer politischen Implikationen unentbehrlich. Dora Mezdrea hat sich durch ihre vierbändige Ionescu-Biographie als Spezialistin ausgewiesen. Das vorliegende Werk, von Erwin Hellmann ins Deutsche übertragen, wurde eigens für unseren Verlag verfaßt. Frau Mezdrea arbeitet am Literaturmuseum Bukarest. |
00:10 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roumanie, philosophie, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 janvier 2009
Emile Cioran and the Culture of Death
-
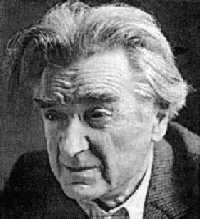
- Emile Cioran and the Culture of Death
by Tomislav Sunic
Speech held by the author at the European Synergies' Summer Conference in 2002 (Low Saxony, Germany)
Historical pessimism and the sense of the tragic are recurrent motives in European literature. From Heraclitus to Heidegger, from Sophocles to Schopenhauer, the exponents of the tragic view of life point out that the shortness of human existence can only be overcome by the heroic intensity of living. The philosophy of the tragic is incompatible with the Christian dogma of salvation or the optimism of some modern ideologies. Many modern political theologies and ideologies set out from the assumption that "the radiant future" is always somewhere around the corner, and that existential fear can best be subdued by the acceptance of a linear and progressive concept of history. It is interesting to observe that individuals and masses in our post-modernity increasingly avoid allusions to death and dying. Processions and wakes, which not long ago honored the postmortem communion between the dead and the living, are rapidly falling into oblivion. In a cold and super-rational society of today, someone's death causes embarrassment, as if death should have never occurred, and as if death could be postponed by a deliberate "pursuit of happiness." The belief that death can be outwitted through the search for the elixir of eternal youth and the "ideology of good looks", is widespread in modern TV-oriented society. This belief has become a formula for social and political conduct.
The French-Rumanian essayist, Emile Cioran, suggests that the awareness of existential futility represents the sole weapon against theological and ideological deliriums that have been rocking Europe for centuries. Born in Rumania in 1911, Cioran very early came to terms with the old European proverb that geography means destiny. From his native region which was once roamed by Scythian and Sarmatian hordes, and in which more recently, secular vampires and political Draculas are taking turns, he inherited a typically "balkanesque" talent for survival. Scores of ancient Greeks shunned this area of Europe, and when political circumstances forced them to flee, they preferred to search for a new homeland in Sicily or Italy--or today, like Cioran, in France. "Our epoch, writes Cioran, "will be marked by the romanticism of stateless persons. Already the picture of the universe is in the making in which nobody will have civic rights."[1] Similar to his exiled compatriots Eugène Ionesco, Stephen Lupasco, Mircea Eliade, and many others, Cioran came to realize very early that the sense of existential futility can best by cured by the belief in a cyclical concept of history, which excludes any notion of the arrival of a new messiah or the continuation of techno-economic progress.
Cioran's political, esthetic and existential attitude towards being and time is an effort to restore the pre-Socratic thought, which Christianity, and then the heritage of rationalism and positivism, pushed into the periphery of philosophical speculation. In his essays and aphorisms, Cioran attempts to cast the foundation of a philosophy of life that, paradoxically, consists of total refutation of all living. In an age of accelerated history it appears to him senseless to speculate about human betterment or the "end of history." "Future," writes Cioran, "go and see it for yourselves if you really wish to. I prefer to cling to the unbelievable present and the unbelievable past. I leave to you the opportunity to face the very Unbelievable."[2] Before man ventures into daydreams about his futuristic society, he should first immerse himself in the nothingness of his being, and finally restore life to what it is all about: a working hypothesis. On one of his lithographs, the 16th century French painter, J. Valverde, sketched a man who had skinned himself off his own anatomic skin. This awesome man, holding a knife in one hand and his freshly peeled off skin in the other, resembles Cioran, who now teaches his readers how best to shed their hide of political illusions. Man feels fear only on his skin, not on his skeleton. How would it be for a change, asks Cioran, if man could have thought of something unrelated to being? Has not everything that transpires caused stubborn headaches? "And I think about all those whom I have known," writes Cioran, "all those who are no longer alive, long since wallowing in their coffins, for ever exempt of their flesh--and fear."[3]
The interesting feature about Cioran is his attempt to fight existential nihilism by means of nihilism. Unlike many of his contemporaries, Cioran is averse to the voguish pessimism of modern intellectuals who bemoan lost paradises, and who continue pontificating about endless economic progress. Unquestionably, the literary discourse of modernity has contributed to this mood of false pessimism, although such pessimism seems to be more induced by frustrated economic appetites, and less by what Cioran calls, "metaphysical alienation." Contrary to J.P. Sartre's existentialism that focuses on the rupture between being and non-being, Cioran regrets the split between the language and reality, and therefore the difficulty to fully convey the vision of existential nothingness. In a kind of alienation popularized by modern writers, Cioran detects the fashionable offshoot of "Parisianism" that elegantly masks a warmed-up version of a thwarted belief in progress. Such a critical attitude towards his contemporaries is maybe the reason why Cioran has never had eulogies heaped upon him, and why his enemies like to dub him "reactionary." To label Cioran a philopsher of nihilism may be more appropriate in view of the fact that Cioran is a stubborn blasphemer who never tires from calling Christ, St. Paul, and all Christian clergymen, as well as their secular Freudo-Marxian successors outright liars and masters of illusion. To reduce Cioran to some preconceived intellectual and ideological category cannot do justice to his complex temperament, nor can it objectively reflect his complicated political philosophy. Each society, be it democratic or despotic, as a rule, tries to silence those who incarnate the denial of its sacrosanct political theology. For Cioran all systems must be rejected for the simple reason that they all glorify man as an ultimate creature. Only in the praise of non-being, and in the thorough denial of life, argues Ciroan, man's existence becomes bearable. The great advantage of Cioran is, as he says, is that "I live only because it is in my power to die whenever I want; without the idea of suicide I would have killed myself long time ago."[4] These words testify to Cioran's alienation from the philosophy of Sisyphus, as well as his disapproval of the moral pathos of the dung-infested Job. Hardly any biblical or modern democratic character would be willing to contemplate in a similar manner the possibility of breaking away from the cycle of time. As Cioran says, the paramount sense of beatitude is achievable only when man realizes that he can at any time terminate his life; only at that moment will this mean a new "temptation to exist." In other words, it could be said that Cioran draws his life force from the constant flow of the images of salutary death, thereby rendering irrelevant all attempts of any ethical or political commitment. Man should, for a change, argues Cioran, attempt to function as some form of saprophytic bacteria; or better yet as some amoebae from Paleozoic era. Such primeval forms of existence can endure the terror of being and time more easily. In a protoplasm, or lower species, there is more beauty then in all philosophies of life. And to reiterate this point, Cioran adds: "Oh, how I would like to be a plant, even if I would have to attend to someone's excrement!"[5]
Perhaps Cioran could be depicted as a trouble maker, or as the French call it a "trouble fête", whose suicidal aphorisms offend bourgeois society, but whose words also shock modern socialist day-dreamers. In view of his acceptance of the idea of death, as well as his rejection of all political doctrines, it is no wonder that Cioran no longer feels bound to egoistical love of life. Hence, there is no reason for him to ponder over the strategy of living; one should rather start thinking about the methodology of dying, or better yet how never to be born. "Mankind has regressed so much," writes Cioran, and "nothing proves it better than the impossibility to encounter a single nation or a tribe in which a birth of a child causes mourning and lamentation."[6] Where are those sacred times, inquires Cioran, when Balkan Bogumils and France's Cathares saw in child's birth a divine punishment? Today's generations, instead of rejoicing when their loved ones are about to die, are stunned with horror and disbelief at the vision of death. Instead of wailing and grieving when their offsprings are about to be born, they organize mass festivities:
If attachment is an evil, the cause of this evil must be sought in the scandal of birth--because to be born means to be attached. The purpose of someone's detachment should be the effacement of all traces of this scandal--the ominous and the least tolerable of all scandals.[7]
Cioran's philosophy bears a strong imprint of Friedrich Nietzsche and Indian Upanishads. Although his inveterate pessimism often recalls Nietzsche's "Weltschmerz," his classical language and rigid syntax rarely tolerates romantic or lyrical narrative, nor the sentimental outbursts that one often finds in Nietzsche's prose. Instead of resorting to thundering gloom, Cioran's paradoxical humor expresses something which in the first place should have never been verbally construed. The weakness of Cioran prose lies probably in his lack of thematic organization. At time his aphorisms read as broken-off scores of a well-designed musical master piece, and sometimes his language is so hermetic that the reader is left to grope for meaning.
When one reads Cioran's prose the reader is confronted by an author who imposes a climate of cold apocalypse that thoroughly contradicts the heritage of progress. Real joy lies in non-being, says Cioran, that is, in the conviction that each willful act of creation perpetuates cosmic chaos. There is no purpose in endless deliberations about higher meaning of life. The entire history, be it the recorded history or mythical history, is replete with the cacophony of theological and ideological tautologies. Everything is "éternel retour," a historical carousel, with those who are today on top, ending tomorrow at the bottom.
I cannot excuse myself for being born. It is as if, when insinuating myself in this world, I profaned some mystery, betrayed some very important engagement, made a mistake of indescribable gravity.[8]
This does not mean that Cioran is completely insulated from physical and mental torments. Aware of the possible cosmic disaster, and neurotically persuaded that some other predator may at any time deprive him of his well-planned privilege to die, he relentlessly evokes the set of death bed pictures. Is this not a truly aristocratic method to alleviate the impossibility of being?:
In order to vanquish dread or tenacious anxiety, there is nothing better than to imagine one's own funeral: efficient method, accessible to all. In order to avoid resorting to it during the day, the best is to indulge in its virtues right after getting up. Or perhaps make use of it on special occasions, similar to Pope Innocent IX who ordered the picture of himself painted on his death-bed. He would cast a glance at his picture every time he had to reach an important decision... [9]
At first, one may be tempted to say that Cioran is fond of wallowing in his neuroses and morbid ideas, as if they could be used to inspire his literary creativity. So exhilarating does he find his distaste for life that he suggests that, "he who succeeds in acquiring them has a future which makes everything prosper; success as well as defeat."[10] Such frank description of his emotional spasms makes him confess that success for him is as difficult to bear as much as a failure. One and the other cause him headache.
The feeling of sublime futility with regard to everything that life entails goes hand in hand with Cioran's pessimistic attitude towards the rise and fall of states and empires. His vision of the circulation of historical time recalls Vico's corsi e ricorsi, and his cynicism about human nature draws on Spengler's "biology" of history. Everything is a merry-go-round, and each system is doomed to perish the moment it makes its entrance onto the historical scene. One can detect in Cioran's gloomy prophecies the forebodings of the Roman stoic and emperor Marcus Aurelius, who heard in the distance of the Noricum the gallop of the barbarian horses, and who discerned through the haze of Panonia the pending ruin of the Roman empire. Although today the actors are different, the setting remains similar; millions of new barbarians have begun to pound at the gates of Europe, and will soon take possession of what lies inside:
Regardless of what the world will look like in the future, Westerners will assume the role of the Graeculi of the Roman empire. Needed and despised by new conquerors, they will not have anything to offer except the jugglery of their intelligence, or the glitter of their past. [11]
Now is the time for the opulent Europe to pack up and leave, and cede the historical scene to other more virile peoples. Civilization becomes decadent when it takes freedom for granted; its disaster is imminent when it becomes too tolerant of every uncouth outsider. Yet, despite the fact that political tornados are lurking on the horizon, Cioran, like Marcus Aurelius, is determined to die with style. His sense of the tragic has taught him the strategy of ars moriendi, making him well prepared for all surprises, irrespective of their magnitude. Victors and victims, heroes and henchmen, do they not all take turns in this carnival of history, bemoaning and bewailing their fate while at the bottom, while taking revenge when on top? Two thousand years of Greco-Christian history is a mere trifle in comparison to eternity. One caricatural civilization is now taking shape, writes Cioran, in which those who are creating it are helping those wishing to destroy it. History has no meaning, and therefore, attempting to render it meaningful, or expecting from it a final burst of theophany, is a self-defeating chimera. For Cioran, there is more truth in occult sciences than in all philosophies that attempt to give meaning to life. Man will finally become free when he takes off the straitjacket of finalism and determinism, and when he realizes that life is an accidental mistake that sprang up from one bewildering astral circumstance. Proof? A little twist of the head clearly shows that "history, in fact, boils down to the classification of the police: "After all, does not the historian deal with the image which people have about the policeman throughout epochs ?"[12] To succeed in mobilizing masses in the name of some obscure ideas, to enable them to sniff blood, is a certain avenue to political success. Had not the same masses which carried on their shouldered the French revolution in the name of equality and fraternity, several years later also brought on their shoulders an emperor with new clothes--an emperor on whose behalf they ran barefoot from Paris to Moscow, from Jena to Dubrovnik? For Cioran, when a society runs out of political utopia there is no more hope, and consequently there cannot be any more life. Without utopia, writes Cioran, people would be forced to commit suicide; thanks to utopia they commit homicides.
Today there are no more utopias in stock. Mass democracy has taken their place. Without democracy life makes little sense; yet democracy has no life of its own. After all, argues Cioran, had it not been for a young lunatic from the Galilee, the world would be today a very boring place. Alas, how many such lunatics are hatching today their self-styled theological and ideological derivatives! "Society is badly organized, writes Cioran, "it does nothing against lunatics who die so young."[13] Probably all prophets and political soothsayers should immediately be put to death, "because when the mob accepts a myth--get ready for massacres or better yet for a new religion."[14]
Unmistakable as Cioran's resentments against utopia may appear, he is far from deriding its creative importance. Nothing could be more loathsome to him than the vague cliche of modernity that associates the quest for happiness with a peaceful pleasure-seeking society. Demystified, disenchanted, castrated, and unable to weather the upcoming storm, modern society is doomed to spiritual exhaustion and slow death. It is incapable of believing in anything except in the purported humanity of its future blood-suckers. If a society truly wishes to preserve its biological well-being, argues Cioran, its paramount task is to harness and nurture its "substantial calamity;" it must keep a tally of its own capacity for destruction. After all, have not his native Balkans, in which secular vampires are today again dancing to the tune of butchery, also generated a pool of sturdy specimen ready for tomorrow's cataclysms? In this area of Europe, which is endlessly marred by political tremors and real earthquakes, a new history is today in the making--a history which will probably reward its populace for the past suffering.
Whatever their past was, and irrespective of their civilization, these countries possess a biological stock which one cannot find in the West. Maltreated, disinherited, precipitated in the anonymous martyrdom, torn apart between wretchedness and sedition, they will perhaps know in the future a reward for so many ordeals, so much humiliation and for so much cowardice.[15]
Is this not the best portrayal of that anonymous "eastern" Europe which according to Cioran is ready today to speed up the world history? The death of communism in Eastern Europe might probably inaugurate the return of history for all of Europe. Conversely, the "better half" of Europe, the one that wallows in air-conditioned and aseptic salons, that Europe is depleted of robust ideas. It is incapable of hating and suffering, and therefore of leading. For Cioran, society becomes consolidated in danger and it atrophies in peace: "In those places where peace, hygiene and leisure ravage, psychoses also multiply... I come from a country which, while never learning to know the meaning of happiness, has also never produced a single psychoanalyst."[16] The raw manners of new east European cannibals, not "peace and love" will determine the course of tomorrow's history. Those who have passed through hell are more likely to outlive those who have only known the cozy climate of a secular paradise.
These words of Cioran are aimed at the decadent France la Doulce in which afternoon chats about someone's obesity or sexual impotence have become major preoccupations on the hit-parade of daily concerns. Unable to put up resistance against tomorrow's conquerors, this western Europe, according to Cioran, deserves to be punished in the same manner as the noblesse of theancien régime which, on the eve of the French Revolution, laughed at its own image, while praising the image of the bon sauvage. How many among those good-natured French aristocrats were aware that the same bon sauvage was about to roll their heads down the streets of Paris? "In the future, writes Cioran, "if mankind is to start all over again, it will be with the outcasts, with the mongols from all parts, with the dregs of the continents.."[17] Europe is hiding in its own imbecility in front of an approaching catastrophe. Europe? "The rots that smell nice, a perfumed corpse." [18]
Despite gathering storms Cioran is comforted by the notion that he at least is the last heir to the vanishing "end of history." Tomorrow, when the real apocalypse begins, and as the dangers of titanic proportions take final shape on the horizon, then, even the word "regret" will disappear from our vocabulary. "My vision of the future," continues Cioran is so clear, "that if I had children I would strangle them immediately."[19]
*~*~*~*~*~*~*
After a good reading of Cioran's opus one must conclude that Cioran is essentially a satirist who ridicules the stupid existential shiver of modern masses. One may be tempted to argue that Cioran offers aan elegant vade-mecum for suicide designed for those, who like him, have thoroughly delegitimized the value of life. But as Cioran says, suicide is committed by those who are no longer capable of acting out optimism, e.g. those whose thread of joy and happiness breaks into pieces. Those like him, the cautious pessimists, "given that they have no reason to live, why would they have a reason to die?" [20] The striking ambivalence of Cioran's literary work consists of the apocalyptic forebodings on the one hand, and enthusiastic evocations of horrors on the other. He believes that violence and destruction are the main ingredients of history, because the world without violence is bound to collapse. Yet, one wonders why is Cioran so opposed to the world of peace if, according to his logic, this peaceful world could help accelerate his own much craved demise, and thus facilitate his immersion into nothingness? Of course, Cioran never moralizes about the necessity of violence; rather, in accordance with the canons of his beloved reactionary predecessors Josephe de Maistre and Nicolo Machiavelli, he asserts that "authority, not verity, makes the law," and that consequently, the credibility of a political lie will also determine the magnitude of political justice. Granted that this is correct, how does he explain the fact that authority, at least the way he sees it, only perpetuates this odious being from which he so dearly wishes to absolve himself? This mystery will never be known other than to him. Cioran admits however, that despite his abhorrence of violence, every man, including himself is an integral part of it, and that every man has at least once in his life contemplated how to roast somebody alive, or how to chop off someone's head:
Convinced that troubles in our society come from old people, I conceived the plan of liquidating all citizens past their forties--the beginning of sclerosis and mummification. I came to believe that this was the turning point when each human becomes an insult to his nation and a burden to his community... Those who listened to this did not appreciate this discourse and they considered me a cannibal... Must this intent of mine be condemned? It only expresses something which each man, who is attached to his country desires in the bottom of his heart: liquidation of one half of his compatriots.[21]
Cioran's literary elitism is unparalleled in modern literature, and for that reason he often appears as a nuisance for modern and sentimental ears poised for the lullaby words of eternal earthly or spiritual bliss. Cioran's hatred of the present and the future, his disrespect for life, will certainly continue to antagonize the apostles of modernity who never tire of chanting vague promises about the "better here-and-now." His paradoxical humor is so devastating that one cannot take it at face value, especially when Cioran describes his own self. His formalism in language, his impeccable choice of words, despite some similarities with modern authors of the same elitist caliber, make him sometimes difficult to follow. One wonders whether Cioran's arsenal of words such as "abulia," "schizophrenia," "apathy," etc., truly depict a nevrosé which he claims to be.
If one could reduce the portrayal of Cioran to one short paragraph, then one must depict him as an author who sees in the modern veneration of the intellect a blueprint for spiritual gulags and the uglification of the world. Indeed, for Cioran, man's task is to wash himself in the school of existential futility, for futility is not hopelessness; futility is a reward for those wishing to rid themselves of the epidemic of life and the virus of hope. Probably, this picture best befits the man who describes himself as a fanatic without any convictions--a stranded accident in the cosmos who casts nostalgic looks towards his quick disappearance.
To be free is to rid oneself forever from the notion of reward; to expect nothing from people or gods; to renounce not only this world and all worlds, but salvation itself; to break up even the idea of this chain among chains. (Le mauvais demiurge, p. 88.)
Notes:
[1] Emile Cioran, "Syllogismes de l'amertume" (Paris: Gallimard, 1952), p. 72 (my translation) return to text
[2] "De l'inconvénient d'être né" (Paris: Gallimard, 1973), p. 161-162. (my translation) (The Trouble with Being Born, translated by Richard Howard: Seaver Bks., 1981) return to text
[3] Cioran, "Le mauvais démiurge" ( Paris: Gallimard, 1969), p. 63. (my translation) return to text
[4] "Syllogismes de l'amertume", p. 87. (my trans.) return to text
[5] Ibid., p. 176. return to text
[6] "De l'inconvénient d'être né", p. 11. (my trans.) return to text
[7] Ibid., p. 29. return to text
[8] Ibid., p. 23. return to text
[9] Ibid., p. 141. return to text
[10] "Syllogismes de l'amertume", p. 61. (my trans.) return to text
[11] "La tentation d'exister", (Paris: Gallimard, 1956), p. 37-38. (my trans.) (The temptation to exist, translated by Richard Howard; Seaver Bks., 1986) return to text
[12] "Syllogismes de l'amertume", p. 151. (my trans.) return to text
[13] Ibid., p. 156. return to text
[14] Ibid., p. 158. return to text
[15] "Histoire et utopie" (Paris: Gallimard, 1960), p. 59. (my trans.) ( History and Utopia, trans. by Richard Howard, Seaver Bks., 1987). return to text
[16] Syllogismes de l'amertume, p. 154. (my trans.) return to text
[17] Ibid., p. 86. return to text
[18] "De l'inconvénient d'être né", p. 154. (my trans.) return to text
[19] Ibid. p. 155. return to text
[20] "Syllogismes de l'amertume", p. 109. return to text
[21] "Histoire et utopie" (Paris: Gallimard, 1960), p. 14. (my trans.) return to text
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roumanie, france, lettres françaises, littérature française, lettres roumaines, littérature roumaine, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 08 novembre 2008
Mircea Eliade et la Garde de Fer
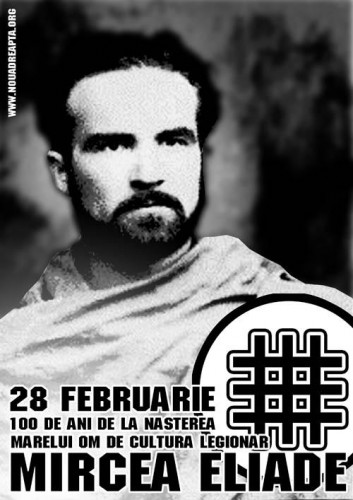
Mircea Eliade et la Garde de Fer
par Giovanni MONASTRA
Analyse:
Claudio MUTTI, Mircea Eliade e la Guardia di Ferro, Ed. All'Insegna del Veltro, Parma, 1989, 57 p., lire 8.000.
Au-delà des mythes de signes contraires qui circulent sur la Garde de Fer, au-delà des apologies ou des démonisations, on peut affirmer que le mouvement de Codreanu était profondément lié à la culture et à l'âme de la Roumanie; tentant de se mettre au diapason de cette culture et de cette âme, d'en épouser toute la complexité, cherchant à s'identifier à elles, le mouvement de Codreanu luttait pour faire sortir la nation roumaine de son état de décadence, de ces conditions d'existence jugées inférieures et propres aux pays balkaniques marqués par l'esprit levantin. La Roumanie était sujette aux influences extérieures les plus disparates, qui aliénaient ses racines les plus anciennes, niées purement et simplement par une certaine culture de tendance «illuministe» qui s'incrustait dans une société roumaine aux réflexes largement ruraux et intacts. L'action de la Garde de Fer, dans cette perspective, apparaît comme une entreprise titanesque, parfois velléitaire, vu la disproportion entre les forces en présence (les ennemis de la Garde de Fer détenaient le pouvoir absolu en Roumanie). Les légionnaires voulaient faire renaître leur peuple en très peu de temps, par le biais d'un activisme radical, portant sur de multiples niveaux: existentiel, éthique, spirituel, où la politique n'était, finalement, qu'un instrument de surface, utilisé par une stratégie d'une ampleur et d'une épaisseur bien plus vastes et profondes.
Dans les faits, la plupart des militants du mouvement s'exprimaient dans un style volontariste, entendaient témoigner de leur foi, faisaient montre d'un activisme fébrile, parfois aveuglément agressif: lumières et ombres se superposent inévitablement dans le phénomène légionnaire. Cependant, la force de ces militants profondément sincères a attiré la sympathie des intellectuels attachés à la patrie roumaine, à sa culture nationale et populaire, à sa substance ethnique; parmi ces intellectuels: Mircea Eliade, un jeune chercheur, spécialisé dans l'histoire des religions et du folklore.
Stefan Viziru, est-il Mircea Eliade?
Récemment, la publication posthume en français et en anglais d'une partie des journaux d'Eliade a jeté une lumière nouvelle sur cette période et sur l'attitude du grand historien des religions. Claudio Mutti a analysé ces journaux, offrant à ses lecteurs, condensées en peu de pages, de nombreuses informations inédites en Italie. Ce travail était nécessaire parce qu'en effet nous avons toujours été confrontés à une sorte de «trou noir» dans la vie d'Eliade, sciemment occulté par l'auteur du Traité d'histoire des religions. Mutti, pour sa part, croit discerner les indices d'un engagement dans l'un des romans d'Eliade, La forêt interdite, aux accents largement autobiographiques, qui se limite toutefois aux années 1936-1948.
Le protagoniste principal de l'intrigue du roman, Stefan Viziru, pourrait, d'après Mutti, dissimuler Eliade lui-même, mais sous un aspect qui, au premier abord, n'est pas du tout crédible. Viziru, en effet, se manifeste dans le roman comme un antifasciste démocratique, bien éloigné des positions de la Garde de Fer, mais qui est néanmoins arrêté pendant la répression anti-gardiste de 1938, parce qu'il a donné l'hospitalité à un légionnaire. Dans un tel contexte, Mutti estime très significatif le jugement exprimé par Viziru quand il s'adresse à un autre prisonnier de son camp d'internement: «Vous et votre mouvement accordez une trop grande importance à l'histoire, aux événements qui se passent autour de nous. La vie ne mériterait pas d'être vécue si, pour nous, hommes modernes, elle ne se réduisait exclusivement qu'à l'histoire que nous faisons nous-mêmes. L'histoire se déroule exclusivement dans le Temps, et, avec tout ce qu'il a de meilleur en lui, l'homme cherche à s'opposer au Temps [...]. C'est pour cette raison que je préfère la démocratie, parce qu'elle est anti-historique, je veux dire par là qu'elle propose un idéal qui, dans une certaine mesure, est abstrait, qui s'oppose au moment de l'histoire». Sous bien des aspects, nous retrouvons, dans ce jugement de Viziru, tout Eliade, avec son refus d'un devenir linéaire, absolu, quantitatif, totalisant.
Justement, Mutti nie que l'identification Viziru-Eliade puisse être poussée au-delà d'une certaine limite. Pour appréhender la position réelle d'Eliade vis-à-vis de la Garde de Fer —on a affirmé qu'il lui avait été totalement étranger— il faut lire le volume posthume de ses mémoires, concernant les années 1937-1960, où Eliade dément effectivement que le héros central de La forêt interdite est son alter ego, tout en donnant d'intéressantes précisions pour comprendre quelles furent ses positions politiques et idéologiques à l'époque. Eliade nous livre en outre d'intéressantes informations sur le climat qui règnait en Roumanie à la fin des années 30, au moment où le mouvement légionnaire connaissait un véritable triomphe. L'historien des religions nous décrit le sombre tableau des répressions gouvernementales contre la Garde de Fer: le roi et l'élite libérale-conservatrice au pouvoir cherchaient, par tous les moyens, à arrêter les progrès du mouvement légionnaire. Pour éviter toute provocation, Codreanu avait choisi la voie de la non-violence, mais le gouvernement, vu l'insuccès électoral des listes qui le soutenaient et vu l'augmentation continue du prestige légionnaire —comme l'écrit Eliade— opte pour le recours à la force: des milliers de membres de la Garde de Fer furent emprisonnés, à la suite de procédures d'une brutalité inouïe, qui semblent propres aux gouvernants roumains de toutes tendances, comme l'a prouvé encore l'histoire récente.
Mircea Eliade, assistant
de Nae Ionescu
Pendant la répression de 1938, plusieurs intellectuels qui avaient adhéré au mouvement de Codreanu furent arrêtés, tandis que le Capitaine était assasiné, la même année, par des sicaires du régime. Parmi les intellectuels embastillés, il y avait Nae Ionescu, un professeur d'université célèbre, dont Eliade était l'assistant. A propos de cette arrestation, il écrit: «De manière directe ou indirecte, nous étions tous, nous ses disciples et collaborateurs, solidaires avec les conceptions et les choix politiques du professeur». Cette «syntonie» a duré —même si Mario Bussagli a dissimulé une divergence de vue précoce entre les deux hommes— car Eliade a prononcé le discours funèbre aux obsèques de son maître en 1940.
Au cours de la répression anti-gardiste, Eliade lui-même a été interné dans un camp de concentration, mais pour une période assez brève. Il refusa de signer une abjuration pré-rédigée du mouvement légionnaire, malgré les fortes pressions qui étaient exercées sur les prisonniers (et face auxquelles un certain nombre d'entre eux cédaient). Eliade affirme dans ses mémoires: «Je jugeai qu'il était inconcevable de me dissocier de ma génération en plein milieu de la terreur, quand on poursuivait et persécutait des innocents». Une année auparavant, répondant à une question posée par le journal légionnaire Buna Vestire, Eliade avait déclaré: «Le monde entier se trouve aujourd'hui sous le signe de la révolution, mais, tandis que d'autres peuples vivent cette révolution au nom de la lutte des classes et du primat de l'économie (communisme) ou de l'Etat (fascisme) ou de la race (hitlérisme), le mouvement légionnaire est né sous le signe de l'Archange Michel et vaincra par la grâce divine [...]. La révolution légionnaire a pour fin suprême la rédemption du peuple». Dans cette phrase, transparait une adhésion au projet global de la Garde de Fer, qui n'est pas purement épidermique, de même qu'une mentalité bien différente de celle du personnage Stefan Viziru.
Après avoir consulté d'autres sources, Mutti soutient qu'Eliade a été candidat sur les listes électorales du parti de Codreanu et aurait été élu député peu avant la répression de 1938. Cette affirmation nous apparaît étrange, parce que si tel avait été le cas, si, effectivement, Eliade avait occupé un poste officiel et public, on l'aurait su depuis longtemps, sans même avoir eu besoin de recourir aux informations parues dans des publications jusqu'ici méconnues et rédigées par des légionnaires en exil, publications auxquelles Mutti pouvait accéder. Parmi les diverses mises au point présentées dans ce petit volume, signalons la partie visant à démontrer qu'Eliade était antisémite, ce qui est un mensonge et ne peut servir qu'aux détracteurs fanatiques de sa pensée. Toutes choses prises en considération, le travail de Mutti est équilibré quant au fond, en dépit de certains extraits qui idéalisent outrancièrement la Garde de Fer. Nous pouvons considérer que ce livre est une première contribution —qu'il s'agira d'approfondir— à l'étude d'un segment de la vie d'Eliade, tenue par lui-même dans l'ombre, pour des raisons somme toute bien compréhensibles. D'un segment de vie étroitement lié à l'une des plus tragiques périodes de l'histoire roumaine.
Giovanni MONASTRA.
(trad. franç.: Robert Steuckers)
00:14 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, roumanie, années 30, europe, politique, théorie politique, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 octobre 2008
Les frères Cioran et le passé gardiste
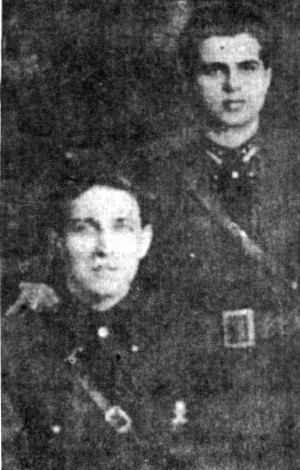
Les frères Cioran et le passé “gardiste”
Quand il voulait susciter le scepticisme des Parisiens, Emil Cioran se plaisait à dire que l'une des plus belles villes du monde était Sibiu/Hermannstadt. Et il pensait que Paris était devenue un “garage apocalyptique”. De Sibiu, il disait à ses interlocuteurs étonnés: «C'est une ville vraiment extraordinaire». Il aimait évoquer le temps où il habitait cette cité transylvanienne, proche de la frontière qui séparait l'empire des Habsbourg du Royaume balkanique de Roumanie: «Il y avait là-bas trois nationalités (l'allemande, la hongroise et la roumaine) qui vivaient en parfaite convivialité. Cet fait m'a marqué pour toute ma vie, car, depuis, je ne parviens pas à vivre dans une ville où l'on ne parle qu'une seule langue, car je m'y ennuie tout de suite».
C'est à l'âge de dix ans qu'Emil Cioran arrive à Sibiu/Hermannstadt, après avoir pleuré pendant tout le trajet parce que son père, le Pope orthodoxe Emilian, l'avait arraché au paradis de son enfance, afin qu'il puisse poursuivre des études. Ce paradis, c'était le village de Rasinari. Mais l'écrivain dira plus tard: «Après Rasinari, Sibiu est la ville que j'ai aimée le plus».
Le puiné du Pope Emilian Cioran, Aurel, aujourd'hui octogénaire, habite encore à Sibiu. C'est un avocat à la retraite. Mais s'il n'avait pas pu devenir avocat, il serait devenu moine; ce fut son frère Emil qui l'en dissuada. Un soir, après le repas, Emil l'invita à une promenade dans les bois qui s'étendaient au-delà de la ville de Sibiu et jusqu'à six heures du matin, à force d'arguments de tous genres, il démontra à Aurel qu'il fallait qu'il renonce à cette idée de se faire moine. Plusieurs années plus tard, Emil regretta d'avoir eu cette importante conversation avec Aurel; il confessa qu'en cette circonstance toute l'impureté de son âme s'était manifestée et que son acharnement n'était que le seul fruit de son orgueil. Il dit: «J'avais l'impression que tous ceux qui ne se soumettaient pas à mes argumentations démontraient qu'ils n'avaient rien compris».
Donc, au lieu de se retirer dans un monastère, Aurel s'en alla étudier la jurisprudence à Bucarest, dans la même institution où Emil s'était inscrit en philosophie et lettres.
Les deux frères se sont retrouvés ensemble sur les bancs des mêmes auditoires, où le philosophe Nae Ionescu donnait ses leçons. C'était une sorte de Socrate pour les générations des années 30 et il a formé des intellectuels qui très vite acquerront une réputation mondiale, comme Mircea Eliade, Constantin Noica et Emil Cioran.
Ce dernier, m'a raconté son frère Aurel, se rendait régulièrement aux cours de Nae Ionescu, même après avoir terminé ses études universitaires. Un jour, alors que la leçon était finie, le professeur a demandé aux étudiants: «Voulez-vous que je vous parle encore de quelque chose?». Emil s'est levé et a demandé: «Parlez-nous de l'ennui». Alors Nae Ionescu a appronfondi la thématique de l'ennui pendant deux heures. Une autre fois, le Professeur Ionescu a demandé à Emil Cioran de lui suggérer un thème à développer au cours de sa leçon; Cioran l'invita à parler des anges. Dans une faculté dominée par le rationalisme, seul Nae Ionescu pouvait se permettre de traiter de thèmes spirituels, parce que, comme l'a défini Eliade, il était “un logicien terrible”.
Immédiatement après la guerre, Aurel Cioran fut reconnu coupable d'avoir milité au sein du “Mouvement Légionnaire” et condamné à sept années de prison; sa sœur Gica reçut une peine analogue. Contrairement à Emil, qui s'est dissocié publiquement dans les années 60 de son propre passé de sympathisant de la Garde de Fer, Aurel revendique avec fierté l'option militante de sa jeunesse. Il a rencontré le “Capitaine” Codreanu dans des camps de travail légionnaires, où les jeunes réalisaient des travaux d'utilité publique négligés par le gouvernement.
Emil Cioran lui aussi fut fasciné par la figure de Codreanu; pour la Noël 1940, il écrivit un “profil intérieur” du Capitaine, dont on donna lecture à la radio à l'époque du gouvernement national-légionnaire. Dans ce texte, Cioran disait: «Avant Corneliu Codreanu, la Roumanie était un Sahara peuplé... Il a voulu introduire l'absolu dans la respiration quotidienne de la Roumanie... Sur notre pays, un frisson nouveau est passé... La foi d'un homme a donné vie à un monde qui peut laisser loin derrière lui les tragédies antiques de Shakespeare... A l'exception de Jésus, aucun autre mort ne continue à être présent parmi les vivants... D'ici peu, ce pays sera guidé par un mort, me disait un ami sur les rives de la Seine. Ce Mort a répandu un parfum d'éternité sur notre petite misère humaine et a transporté le ciel juste au-dessus de la Roumanie». Par ailleurs, quelques années auparavant, Emil Cioran avait écrit que “sans le fascisme l'Italie serait un pays en faillite”; ou encore: “dans le monde d'aujourd'hui, il n'existe pas d'homme politique qui m'inspire une sympathie et une admiration plus grande que Hitler”.
On peut penser que les prises de position du Cioran de ces années-là, en dépit de ses abjurations ultérieures, seront tôt ou tard utilisée pour démoniser son œuvre, pour lui faire en quelque sorte un procès posthume, semblable à celui que l'on a intenté contre Mircea Eliade. Quand j'évoquai cette éventualité, Aurel Cioran a perdu pendant un instant son calme olympien pour manifester une grande indignation et stigmatiser la mafia qui se livrait à de telles profanations. Au cours de ces derniers mois, a-t-il ajouté, une campagne de diffamation s'est déroulée en Roumanie contre la mémoire de Nae Ionescu, précisément parce qu'il fut le maître de toute cette jeune génération intellectuelle qui sympathisait avec le “Mouvement Légionnaire”.
De fait, à peine sorti de la maison d'Aurel Cioran, j'ai trouvé sur une échope trois éditions récentes de Nae Ionescu: un recueil de conférences tenues par le professeur en 1938 dans le pénitentier où il était enfermé avec toute l'élite du “Mouvement Légionnaire”. Parmi les internés, il y avait aussi Mircea Eliade. Emil Cioran était en France depuis un an.
Claudio MUTTI.
(article paru dans le quotidien indépendant L'umanità, 22 février 1996; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roumanie, garde de fer, années 30, populismes, nationalisme, liitérature, lettres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 22 octobre 2008
Entretien avec Aurel Cioran
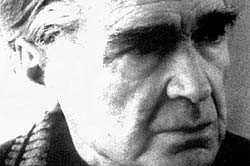
Entretien avec Aurel Cioran
Q.: Dans la nouvelle nomenclature des rues de Bucarest, on trouve aujourd'hui le nom de Mircea Eliade, mais à Sibiu, il n'y a pas encore de rue portant le nom d'Emil Cioran. Que représente Cioran pour ses concitoyens de Sibiu à l'heure actuelle?
AC: Donner un nom à une rue ou à une place dépend des autorités municipales. Normalement, il faut qu'un peu de temps passe après la mort d'une personnalité pour que son nom entre dans la toponymie. Quant à ce qui concerne les habitants de Sibiu et en particulier les intellectuels locaux, ils ne seront pas en mesure de donner une réponse précise à votre question.
Q.: Je vais vous la formuler autrement. Dans une ville où il y a une faculté de théologie, comment est accueilli un penseur aussi négativiste (du moins en apparence...) que votre frère?
AC: Vous avez bien fait d'ajouter “en apparence”. Dans un passage où il parle de lui-même à la troisième personne et qui a été publié pour la première fois dans les “œuvres complètes” de Gallimard, mon frère parle très exactement du “paradoxe d'une pensée en apparence négative”. Il écrit: «Nous sommes en présence d'une œuvre à la fois religieuse et antireligieuse où s'exprime une sensibilité mystique». En effet, je considère qu'il est totu-à-fait absurde de coller l'étiquette d'“athée” sur le dos de mon frère, comme on l'a fait depuis tant d'années. Mon frère parle de Dieu sur chacune des pages qu'il a écrites, avec les accents d'un véritable mystique original. C'est justement sur ce thème que je suis intervenu lors d'un symposium qui a eu lieu ici à Sibiu. Je vais vous citer un autre passage qui remonte à 1990 et qui a été publié en roumain dans la revue Agorà: «Personnellement, je crois que la religion va beaucoup plus en profondeur que toute autre forme de réflexion émanant de l'esprit humain et que la vraie vision de la vie est la vision religieuse. L'homme qui n'est pas passé par le filtre de la religion et qui n'a jamais connu la tentation religieuse est un homme vide. Pour moi, l'histoire universelle équivaut au déploiement du péché originel et c'est de ce côté-là que je me sens le plus proche de la religion».
Q.: Parlons un peu des rapports entre Emil Cioran et les lieux de son enfance et de sa jeunesse. Vous demandait-il de lui parler de Rasinari et de Sibiu?
AC: Il se souvenait de choses que moi j'avais complètement oubliées. Un jour, il m'a dit au téléphone: «Je vois chaque pierre des rues de Rasinari». Pendant toute sa vie, il a conservé en son fors intérieur les images avec lesquelles il a quitté la Roumanie.
Q.: Il n'a jamais manifesté le désir de revenir?
AC: Quand nous nous sommes séparés en 1937, il m'a dit, en avalant sa salive, dans le train: «Qui sait quand nous nous reverrons». Et nous ne nous sommes revus que quarante ans plus tard, mais pas dans notre pays. Il a toujours désiré revenir. En 1991, il a été sur le point de s'embarquer pour la Roumanie. C'est alors que la maladie l'a frappé, qu'il a dû rentrer à l'hôpital. Dans ces derniers moments, il a été contraint d'utiliser une chaise roulante. Il craignait forcément de voir une réalité toute autre, s'il était revenu. Et effectivement il y a eu beaucoup de changements; à Rasinari, la composition sociale a complètement changé: quasi la moitié des habitants du village travaillent à la ville, ce qui conduit forcément à un changement de mentalité. Tout est bien différent du temps où nous étions adolescents. A Rasinari, nous étions des gamins de rue, nous allions en vadrouille toute la journée à travers champs, forêts et rivières...
Q.: ... et à Coasta Boacii.
AC: Oui, en effet, il évoquait sans cesse, avec énormément de regrets, ce paradis qu'était Coasta Boacii. «A quoi bon avoir quitté Coasta Boacii?», disait-il. Ensuite, il y avait ce pacage, près de Paltinis, où nous nous rendions tous les étés. Nous y restions un mois, dans une baraque tellement primitive, située dans une clairière où régnait une atmosphère extraordinaire.
Q.: Vous avez été très proche de votre frère non seulement dans les années d'enfance mais aussi pendant votre adolescence et votre jeunesse. Parlez-moi de vos expériences communes...
AC: Nous assistions aux cours de Nae Ionescu à l'Université. Ce professeur était une figure extraordinaire! Beaucoup de gens venaient l'écouter et pas seulement des étudiants. Mon frère y retournait même après avoir quitté l'université, pour rendre visite au professeur. Un jour, dès que la leçon fut terminée, Nae Ionescu a demandé: «De quelles choses devrais-je encore parler?». Et mon frère, spontanément lui a répondu: «De l'ennui». Alors Nae Ionescu a prononcé deux leçons sur l'ennui. Par la suite, ses adversaires ne sachant plus quelles armes utiliser pour l'attaquer, parce qu'il était le maître à penser de toute la jeune génération d'intellectuels qui soutenaient le “Mouvement Légionnaire”, ils l'ont accusé d'être... un plagiaire! Ce genre d'attaques est une manifestation infernale... L'œuvre d'une mafia de criminels, qui a commencé par s'attaquer à Heidegger, puis à chercher à faire le procès d'Eliade...
Q.: ... et même de Dumézil!
AC: Toujours sous prétexte d'antisémitisme. En Roumanie, à l'époque, il y avait bien sûr de l'antisémitisme, en réaction à l'arrivée massive d'un million de juifs venus de Galicie. En ce temps-là, c'était un véritable problème. Mais j'ai l'impression que cette manœuvre visant à criminaliser Eliade, Noica et les autres intellectuels de la “jeune génération” produira des effets contraires à ceux désirés.
Q.: Vous avez milité dans le Mouvement Légionnaire. Avez-vous connu Corneliu Codreanu?
AC: C'était un homme exceptionnel à tous points de vue. Il avait du charisme. J'ai souvent dit qu'il était un trop grand homme pour le peuple roumain, trop sérieux, trop grave. Il voulait une réforme radicale, basée sur la religion. Il était un esprit très intensément religieux. Il y a encore une chose qui m'impressionne profondément aujourd'hui: la manière dont le Mouvement Légionnaire abordait les problèmes économiques. Le Mouvement avait ouvert des restaurants, des réfectoires, où l'on vous servait un très bon repas, avec du vin en quantité limitée. L'idée qui me paraissait extraordinaire, c'est que les prix n'étaient pas fixés. Chacun payait selon ses propres moyens ou selon son bon plaisir.
Q.: Où avez-vous connu le Capitaine?
AC: A Bucarest, parce que j'y étudiait la jurisprudence. Mais je l'ai rencontré deux ou trois fois dans un camp de travail légionnaire. C'était un homme exceptionnel à tous points de vue.
(propos recueillis à Sibiu le 3 août 1995 par Claudio Mutti et parus dans la revue Origini, n°13/février 1996; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:15 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres, littérature, lettres roumaines, lettres françaises, roumanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




_1.jpg)
.jpg)
.jpg) Griechenland ist mittlerweile wieder in genau derselben Situation wie kurz vor der berühmten Griechenland-Rettung, es kann nur noch kurzfristig und zu über zehn Prozent Zinsen auf dem Weltfinanzmarkt Kredite erhalten. Der einzige Unterschied zu damals ist: Die EZB kauft die riskanten und uneinbringbaren griechischen Staatsschulden auf, und Griechenland hat nun noch 110 Milliarden Euro Schulden mehr, die ihm als Hilfsprogramm zugesichert und teilweise ausbezahlt wurden.
Griechenland ist mittlerweile wieder in genau derselben Situation wie kurz vor der berühmten Griechenland-Rettung, es kann nur noch kurzfristig und zu über zehn Prozent Zinsen auf dem Weltfinanzmarkt Kredite erhalten. Der einzige Unterschied zu damals ist: Die EZB kauft die riskanten und uneinbringbaren griechischen Staatsschulden auf, und Griechenland hat nun noch 110 Milliarden Euro Schulden mehr, die ihm als Hilfsprogramm zugesichert und teilweise ausbezahlt wurden.



