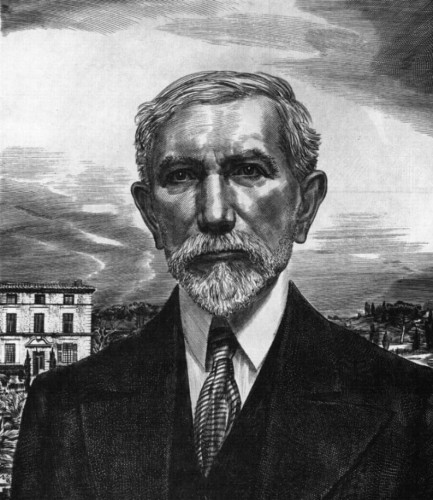samedi, 13 décembre 2014
Le fossé lexical se creuse

Le fossé lexical se creuse
La langue s'appauvrit ...
J'ai, à plusieurs reprises ces derniers temps, accompagné des enfants d'âge primaire dans de délicats exercices de grammaire. Ma nouvelle fonction me fait sillonner toute l'agglomération et me permet de découvrir les réalités de l'école primaire : un monde qui jusqu'alors m'était inconnu. Je devais, à chaque fois, expliquer à ces enfants de CP et de Cours élémentaire des phrases tirées de différents livres qui sont utilisés dans ces établissements.
Dans mes postes précédents, en Segpa, nous n'avions pas de livres, le travail en était grandement simplifié ; les enseignants se fabriquent eux-mêmes leurs exercices quand ils ont un peu de conscience professionnelle. Les phrases proposées sont alors le fruit de leur imagination et s'appuient sur le vécu des élèves dont ils ont la charge ; une sorte de méthode naturelle en quelque sorte.
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, éberlué, l'immense décalage entre les élèves et les phrases proposées par de grands éditeurs, sans doute conseillés par une armée de spécialistes et d'inspecteurs généraux, de linguistes et d'experts de la littérature jeunesse. Là, j'avoue que je me gausse un peu tant les petites phrases proposées frisaient la médiocrité et l'obsolescence désarmante. Rien à sauver ou presque ….
Mais, le pire fut alors d'expliquer à ces élèves, issus d'une diversité qui les prive le plus souvent de racines et de repères sémantiques, des mots qui apparemment leur étaient totalement inconnus. Il faut avouer que ces enfants vivent dans des quartiers péri-urbains où le rapport à la nature est des plus lointain. Mais de là à ne rien comprendre à ce point, je n'imaginais pas que ce fût possible …
Nous commencions avec une jument qui garde son poulain. Comme l'exercice portait sur le pluriel des verbes au présent, la jument introduisait sournoisement un « ent » qu'il fallait lire quand les suivants devenaient muets. Quelle fourberie ! Mais que dire de ce mot qui n'évoquait rien du tout à mes chers élèves. Alors, ne parlons pas du poulain, lui aussi inconnu au bataillon. La France n'est plus rurale et les éditeurs l'ont oublié.
Je n'étais malheureusement qu'au début du calvaire. La fameuse « pie », si utile quand on apprend à lire et à associer des sons simples, a perdu de sa superbe. Avec ou sans nid à proximité, elle ne dit rien qui vaille à nos apprentis lecteurs. Il est vrai que le bic a depuis longtemps supplanté le stylo-plume.
Continuant sur cette lancée, j'allais approfondir un peu plus le fossé qui se creusait devant moi. Il était question d'une charrue qui labourait. J'échappai de justesse au sillon tout en me cassant les dents dans mes vaines tentatives de donner du sens à ces deux termes agricoles. Le bon grain ne pousse plus et laisse la place à l'ivraie.
Un autre livre s'offrait des fantaisies moins délicates. Les sorcières y volaient sur des balais et, grâce à la télévision, l'imaginaire est plus accessible que le lexique rustique. Mais quand le grammairien distingué sort de son chapeau un sortilège, c'est à nouveau la panique dans les rangs. Voilà un mot bien trop long pour être compris désormais.
Le brave homme se risque alors à l'humour et évoque une sorcière qui chevauche un balai à moteur. Chevaucher demande bien des explications et il n'est pas acquis que la comparaison entre le balai et le cheval ait été perçue par tous, mais franchement, ce balai à moteur avait de nombreux ratés. Beaucoup décrochèrent devant cette astuce digne des blagues de carambar. J'y perdais mon latin de cuisine.
Je vous fais grâce de la suite. À chaque phrase, un ou deux mots sortaient du lexique connu et accessible à ces enfants dont la connaissance du monde semble se réduire à peau de chagrin. S'ils sont capables de maîtriser une console, un téléphone ou bien un ordinateur, en revanche, leur lexique pour décrire la nature, l'imaginaire et les métiers s'étiole au point de ne pouvoir donner de sens aux phrases qui leur sont proposées sur leurs livres de classe.
Que faire ? Les beaux esprits pourront prétendre réactualiser les phrases, les mettre à la sauce contemporaine en acceptant de jeter aux oubliettes tout un vocabulaire qui n'est plus de mise dans les cours de récréation. On peut pousser ce raisonnement en établissant un lexique de moins de 800 mots pour construire toute la scolarité de ces enfants.
Les autres, baissant les bras devant l'accablement qui ne peut que saisir celui qui se trouve confronté à ce désastre, se contenteront de faire de la grammaire sans expliquer le sens de ces phrases qui en valent bien d'autres, après tout. C'est ainsi que l'ont fait des cohortes d'élèves qui ne donnent plus de signification à ce qu'ils lisent …
Je pense qu'il serait grand temps de redonner à l'école la mission essentielle qu'elle n'aurait jamais dû perdre de vue : la maîtrise de la langue. Mais ceci n'est qu'un vœu pieu ; nous avons tant à faire pour éduquer le futur citoyen, consommateur, chauffeur, économiste, écologiste, informaticien et je ne sais quel autre besoin essentiel.
La langue, devant tant de nécessaires compétences incontournables est si dérisoire. Continuons à tarir le vocabulaire et l'expression. Les vaches seront mieux gardées ! Après tout, il suffira de mettre tout ce gentil monde devant une langue internationale réduite à un créole basique et le tour sera joué. Le français, c'est vraiment trop compliqué ….
Lexicalement vôtre.
- Source : C’est Nabum
00:05 Publié dans Ecole/Education, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : école, éducation, langue, lexique, lexicologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 06 octobre 2014
Warum Sprachen sterben
Warum Sprachen sterben
von Niels Krautz
Ex: http://www.blauenarzisse.com
Rund 3.000 Sprachen sind weltweit laut der UNESCO vom Aussterben bedroht. Es geht um weit mehr als Exotik: Sterben die Sprachen, verschwinden auch die Völker.
Es gibt viele von ihnen: nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, Amerika und Ozeanien. Aber keiner muss in die Ferne schweifen. Auch hier in Deutschland sind sie zu sehen, auf Schildern, in Ämtern und in Schulen. In Europa und Vorderasien heißen sie unter anderem Aragonesisch, Istriotisch, Gälisch oder auch Karaimisch. Sie muten meist etwas seltsam an und man hört sie kaum noch. Die Rede ist von bedrohten Sprachen und Dialekten.
Manche Ursprachen leben bis heute fort
Vor circa 50.000 Jahren entwickelte sich laut dem US-amerikanischen Linguisten Merritt Ruhlen in Afrika die erste Sprache der Menschheit, welche nur aus einigen Lauten zusammengesetzt war. Anderen Forschern zufolge soll der gemeinsame Vorfahre von Mensch und Neandertaler die ersten Worte bereits vor rund 500.000 Jahren geäußert haben. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich unsere Sprache immer weiter gewandelt. Neue Wörter kamen hinzu, die Räume flossen ineinander über. Oder sie wurden umgewandelt, um der jeweiligen Sprache besser zu dienen.
Allein der germanische Sprachraum umfasst nicht nur Europa, sondern auch Teile Amerikas und Vorderasiens. Aus ihm bildeten sich tausende von Dialekten heraus und dazu viele Sprachen, die wir heute noch abgewandelt sprechen. Doch zahlreiche von ihnen gingen im Lauf der Jahrhunderte verloren. Oder sie wurden so stark verändert, dass ihre Ursprungsform kaum noch zu erkennen ist.
Das Sterben der Sprachen ist kein Schicksal
Man könnte meinen, es sei der Lauf der Welt, dass Sprachen kommen und gehen. Doch das stimmt nicht ganz. In der modernen Welt halten sich Sterben und Neuentstehen nicht mehr in der Waage. Fast 2.000 Sprachen existieren weltweit, die von weniger als 1.000 Menschen gesprochen werden. In Amerika und Australien sind sogar 100 bis 200 vom Aussterben bedroht. Die Vorherrschaft einiger weniger Sprachen übt zunehmenden Druck auf andere aus. Englisch ist sicher eine der dominantesten davon. Auch die Mobilität der Volksgruppen und enge Kontakte der sozialen Netzwerke spielen dabei eine große Rolle.
Diese Entwicklung lässt sich am Beispiel der irischen Sprache – Gaeilge in der seit 1948 geltenden Orthografie – betrachten. Durch die große Hungersnot im 19. Jahrhundert und die darauf folgende Emigration zahlreicher Iren in die neue Welt reduzierte sich die Anzahl der Irisch sprechenden Menschen um 1,5 Millionen.
Das Irische konnte vorerst gerettet werden
Eltern brachten ihren Kindern die englische Sprache näher, damit sie in der besetzten Heimat bessere Chancen auf einen Arbeitsplatz hatten. Dadurch verdrängte Englisch zunehmend die irische Sprache. Sie wurde in der Öffentlichkeit nur noch als Sprache der Unterschicht angesehen.
Wiederbelebungsmaßnahmen wurden nach der Unabhängigkeit Irlands im Jahre 1922 eingeleitet, als sich das Land von der englischen Herrschaft befreite. Verschiedene Fördervereine des Irischen entstanden, zum Beispiel der „Conradh na Gaeilge“, was soviel heißt wie „Liga des Irischen”. Der Zensus von 2006 ergab jedoch, dass nur noch 1,66 Millionen Menschen, also 40,8 Prozent der Bevölkerung, irisch sprechen konnten. Davon waren höchstens 70.000 Muttersprachler, welche die Sprache aber nicht täglich gebraucht haben. Irland versucht daher die sinkende Tendenz der Irisch sprechenden Einwohner zu bremsen. Schilder, Amts– und Straßennamen wurden mit der englischen sowie der irischen Sprache beschriftet. In den Schulen wird in der eigentlichen Landessprache unterrichtet. Eine kleine Trendwende wurde damit zumindest geschaffen.
In Japan blieb die Sprachpolitik erfolglos
Die Förderung der gälischen Sprachen, wozu auch Irisch zählt, sind länderübergreifend. Denn auch Länder wie Schottland, Wales oder die Bretagne haben sinkende Zahlen, der die keltischen Dialekte sprechenden Bevölkerung zu verzeichnen und versuchen, diese Tendenz zu stoppen.
Ein drastisches außereuropäisches Beispiel ist die Sprache der Ainu. Dieses Volk lebt auf der Insel Hokkaido an der Nordspitze der japanischen Hauptinsel. Die Ainu unterscheiden sich ethnisch, kulturell und auch sprachlich von den Japanern. Ende der 1980er Jahre soll es nur noch 15 kompetente Ainu-Sprecher gegeben haben. Daher kann die Sprache als nahezu ausgestorben gelten. 1997 jedoch erließ Japan das Ainu-Gesetz, welches die Förderung und Unterstützung der Ainu-Sprache und des kulturellen Erbes dieses kleinen Volkes beinhaltete. Doch viele Sprachwissenschaftler fürchten, dass der Verlust dieser einzigartigen Sprache nicht mehr aufzuhalten sei ‒trotz der Bemühungen der japanischen Regierung.
Sprachimperialismus führt zum Sprachmord
Ein Großteil dieser Forscher sieht den Kulturimperialismus vieler großer Nationen des 19. Jahrhunderts als ausschlaggebend für das Sprachsterben an. Kleinere Völker wie die Ainu und die Iren sind folglich die Leidtragenden der Kulturdominanz großer Volksgruppen. Zu Recht sprechen viele von einem sogenannten „Linguizid“, einem „Sprachmord“.
Durch die stark ausgeprägte Dominanz des US-amerikanischen Englisch in Nordamerika stehen auch dort viele kleinere Ureinwohnersprachen vor dem Aussterben. Es handelt sich also nicht nur um ein Sprach-, sondern auch ein Kultursterben. Die Sprachgruppe des ehemals großen Stammes der Schoschonen, der in der mittleren USA beheimatet ist, gilt laut dem UNESCO Atlas of the World’s Languages in danger als stark bedroht. Denn es gibt nur noch ein paar tausend Menschen, die diese traditionsreiche Sprache sprechen. Doch bisher wurde kein landesweites Gesetz erlassen, welches das Sprachsterben indigener Völker verhindern könnte. Vor allem die Vereinten Nationen verabschiedeten eine Vielzahl internationaler Gesetze, welche die Rechte indigener Völker bewahren sollten. Ob sich die nationalen Regierungen daran zwangsläufig halten müssen, steht freilich auf einem anderen Blatt.
Auch in Deutschland stirbt die Sprachvielfalt
Das Sprachsterben und auch das Dialektsterben bleiben jedoch nicht nur ein Problem kleinerer Völker und Kulturen. Denn auch in Deutschland ist der Dialekt rückläufig. Der starke Einfluss hochdeutscher Medien und die Mobilität der Bevölkerung vermischen die verschiedenen Dialektvarianten. Daher gibt es einen starken Rückgang aller gesprochenen Dialekte in Deutschland. So wurden 2009 13 deutsche Regionalsprachen, darunter auch Kölsch und Bairisch, von der UNESCO als vom Aussterben bedroht gemeldet.
200 Sprachen sind demnach während der letzten Generationen ausgestorben, etwa 1.700 sind ernsthaft gefährdet, etwa 600 werden kaum noch gepflegt. Der stellvertretende Direktor des „Living Tongues Institute“ für bedrohte Sprachen in Washington, Robert Harris, erklärte: „Wenn wir eine Sprache verlieren, verlieren wir Jahrhunderte menschlichen Denkens über Zeit, Meerestiere, Rentiere, essbare Pflanzen, Mythen, Musik, das Unbekannte und das Alltägliche.“ Stirbt eine Sprache, dann verschwindet weitaus mehr als ein paar Vokabeln.
Bild: Zweisprachiger Wegweiser in Irland /flickr.com /wolfgangplusk /CC BY-NC-ND 2.0
00:05 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langues, linguistique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 juin 2014
Poutine ou le Maître de la Parole
Poutine ou le Maître de la Parole...
Nous reproduisons ci-dessous un texte remarquable de Philippe-Joseph Salazar, cueilli sur le site Les Influences et consacré à Vladimir Poutine et à sa parfaite maîtrise de la parole dans la conduite de la crise ukrainienne. Philippe-Joseph Salazar est philosophe et spécialiste de la rhétorique.
par Philippe-Joseph Salazar
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
On se souvient de la phrase du philosophe allemand Hegel, le génial auteur de la Phénoménologie de l’Esprit, quand il vit Napoléon passer sous sa fenêtre, en octobre 1806 : « J’ai vu l’âme du monde à la manœuvre » [1]. Eh bien, voilà un mois en écoutant Vladimir Poutine s’adresser à la Diète fédérale russe, lors de la réincorporation des terres irrédentes de Crimée à la Mère Patrie Russe, j’ai entendu parler l’âme du monde. J’ai entendu, et vu, la plus puissante des paroles se déployer, avec une telle sûreté de ton, une telle acuité d’arguments, une telle saisie du moment qu’une autre phrase de Hegel m’est venue naturellement aux lèvres : Poutine explique la politique « comme l’oiseau de Minerve qui prend son vol à la nuit tombée », pour mieux saisir sur le vif ceux qui n’y voient goutte, qui sont dans la nuit de leurs idées toutes faites, et ne savent plus ni parler, ni écouter – je veux dire « l’Ouest » comme le disent les médias, ces perroquets câblés.
Vladimir Poutine, âme du monde ? Ça mérite une explication. Maître absolu de la parole ? Ça mérite une analyse.
Depuis l’Irak et l’Afghanistan les directeurs de la communication des Etats-Unis et de l’OTAN ont mis au point une technologie rhétorique dite de « stratcomm », « communication stratégique », d’une simplicité qui s’est voulu génialement opérationnelle (ça tient sur une carte qu’on met dans la besace du trouffion, littéralement) et qui s’est révélée accablante d’efficacité, comme on le sait. Le spectacle désolant qu’offrent ces deux pays, jadis féodaux mais en paix, désormais féodaux mais en guerre, suffit à démontrer la terrible stupidité de la « stratcomm ». La stratcomm est supposée suppléer à la force brutale par l’influence persuasive, en alimentant le discours public et la propagande à coups de mots simples comme « stabilité, paix, prospérité » [2].
Dans le cas de l’Ukraine le mot clef, dès que l’Union Européenne, les Etats-Unis et l’OTAN ont mis le doigt dans l’engrenage, a été « désescalade ». Il faut « désescalader » ont répété les perroquets et les perruches médiatiques.
Le terme est codé : il implique que l’adversaire a « escaladé » ; en bon français (mais qui s’en soucie) le mot est très récent (1970) et il est militaire : « Ensemble d’opérations stratégiques visant à diminuer ou à supprimer la gravité des mesures militaires » [3]. On a bien lu : « mesures militaires ». Dans ce langage codé que parlent entre eux les services secrets, qui manipulent les médias en usant d’honorables correspondants, ou en plantant des infos sur les fameux réseaux sociaux, et les services de communication/propagande, le concept est militaire. Dire « désescalade » c’est déjà accuser la Russie d’avoir « escaladé ».
Qu’a fait Vladimir Poutine. Rien. Il a laissé dire. Sachant que s’il dit le mot, il est pris au piège.
Quel piège ? Celui-ci : le problème, avec le langage de la stracomm, c’est qu’il faut que l’adversaire le parle aussi. En philo on appelle ça le « différend » : vous m’accusez de ceci, et vous voulez que j’utilise pour me défendre les mots que vous employez pour m’accuser ? Le piège est grossier ! Car me défendre avec les termes que vous employez, c’est déjà accepter que c’est vous qui définissez le cadre de ma défense. Je suis cuit. Allez au diable ! Je « diffère » [4], et je dis autrement.
Un autre terme a donc été lancé par les services de stratcomm de l’OTAN et Cie, pour tenter de cerner et donc de cataloguer les récusants russophones d’abord de Crimée et depuis des régions frontalières orientales : ils ont été « radicalisés ». Les protestataires (on ne dit pas qu’ils sont des agents russes, ce qui est aussi difficile à prouver que de démontrer qu’à chaque fois qu’un chef de la CIA vient à Kiev, deux jours plus tard, comme par miracle, les Ukrainiens ont une poussée d’adrénaline et de frais uniformes), les protestataires, donc, sont « radicalisés ».
Ce terme est apparu lors de l’attentat de Boston par les frères Tsarnaev. « Ces jeunes gens ont été radicalisés » jacassait la presse américaine, aussitôt relayée par les médias français, jamais en retard d’une attrape. Or le terme est toujours employé à la voix passive : « ils ont été radicalisés », pas « ils se sont radicalisés » . Il existe un « par », un agent qui radicalise. Ici : la Russie, bien sûr [5].
Ce qui est intéressant est que, devant la faillite rhétorique de « désescalade/escalade », la stratcomm a tenté de lancer « radicalisation ». Mais, derechef, bec dans l’eau. Vladimir Poutine (et à faire pâlir d’envie le Quai d’Orsay, ce grand diplomate à la Metternich ou à la Kissinger, M. Lavrov), à la manœuvre, a fait comme si rien n’avait été dit. Il a ignoré. Magistral.
On va me dire : tout cela est un langage entre eux, nous, les péquins, on s’en tamponne le château arrière comme le déclama un jour Régine Crespin, sur la scène du Châtelet, dans son immortelle Grande Duchesse de Gérolstein. Or justement, la réplique de Vladimir Poutine à cette ligne de stratcomm a été de réduire l’OTAN, et les bavards de Bruxelles, non loin du GQG, à n’être que des grandes duchesses d’opérette. Il a simplement ignoré le mot, et donc mis de côté l’implication.
C’est alors que Poutine a retourné contre la communication « occidentale » sa propre méthode, à la stupéfaction des commentateurs américains depuis dix jours (Wall Street Journal, Reuters). Par exemple, il a ré-expédié à « l’Ouest » un autre terme clef de la stratcomm : « faire la guerre contre son propre peuple ».
De fait, dans l’arsenal rhétorique de la bienfaisance militaire occidentale, « to wage war against your own people », « faire la guerre contre votre propre peuple », a été l’expression clef, la litanie médiatique issue du glossaire américain de la stratcomm, pour justifier l’invasion de l’Iraq, l’intervention en Lybie et l’appui donné à la rébellion en Syrie : « Assad/Yanoukovitch, si vous faites la guerre contre votre propre peuple, alors nous, qui sommes les représentants de la démocratie, c’est à dire, du droit des peuples, nous avons le droit d’intervenir, car ce droit est moral ». Certes, mais encore ?
Vladimir Poutine a retourné l’expression. Les putschistes en place à Kiev « font la guerre à leur propre peuple ». Donc la Russie endosse le manteau dont s’est drapé jusque là « l’Ouest », pour venir à la défense des opprimés.
Du coup soudain, la chandelle est soufflée, et on n’entend plus l’expression naguère favorite de M. Obama. Lequel, par une de ces bévues dont il parsème ses discours quand il se prend lui-même dans les réticules séduisants de sa propre éloquence, a nommé la Russie : « Une puissance régionale ». Je suppose que ça a dû plaire à son auditoire américain, très cultivé, mais il suffit de regarder une mappemonde pour voir que ladite région, ma foi … Vladimir Poutine n’a de nouveau rien répliqué. Il laisse dire. Il ne pratique pas le jeu psychanalytique du fort-da, du tu me donnes, je te prends, je t’envoie, tu me renvoies, qui, chez Freud, est une marque d’infantilisme.
Quand on a rétabli les armoiries de la Russie impériale sur son drapeau, qu’on prépare un grandiose défilé militaire célébrant la victoire de l’Armée rouge sur l’Allemagne, qu’on méprise les fameuses sanctions comme un pauvre arsenal de boutiquier capitaliste, s’entendre dire que son empire, qui va de l’ancienne capitale Teutonique et prussienne de Königsberg à Vladivostok, on ne peut que sourire et laisser dire.
La maladie infantile du néo-capitalisme communicationnel est la fièvre de la réponse instantanée, de la re-réponse, de la re-re-réponse. Je ne vais pas vous faire un dessin. Voyez internet.
Laisser dire, un grand art. A « l’Ouest » règne l’irrépressible désir de parler, toujours, encore, et plus. De Russie, qui est aussi occidentale que nous le sommes, on mesure ses mots, comme à la manœuvre. Car, une des forces de la machine rhétorique de M. Poutine, est sa capacité à ne parler le langage de l’adversaire quand ça lui sert, et à ne rien rétorquer quand ça ne lui sert pas.
Car l’art du pouvoir exige le silence, la réponse mesurée à l’effet à obtenir, ce contrôle exigeant de soi-même à ne pas parler. A attendre. Et à frapper.
Dans la saga tragicomique et saignante de l’Ukraine, une vraie pièce d’Alfred Jarry, tout le monde est là à parler, à s’époumoner, à vitupérer, à baragouiner dans un anglais de bastringue (je recommande les débats désopilants sur France24 où des experts français bafouillent dans un anglais d’Auvergnat devant des Ukrainiens d’opéra-bouffe, sous l’œil ironique du très patient M. Picard), évidemment afin de satisfaire les médias – tandis que Vladimir Poutine, maître de la parole, calibre chaque conférence de presse, juge exactement du timing d’un communiqué, prend à chaque fois l’ « Ouest » au dépourvu, et simplement impose son rythme, son calendrier, sa marche, sa « manœuvre » en un mot.
Vladimir Poutine est donc l’âme du monde, au sens exact du « monde » dont il s’agit ici, le monde du politique, et au sens exact où « âme » signifie principe – Vladimir Poutine nous donne à voir ce que nous vîmes jadis à l’œuvre avec le Général, quand la France comprenait ce qu’est la puissance : la politique comme principe vital du monde où nous vivons, et la parole politique comme mesure de l’action à entreprendre.
Et l’âme, bien sûr, c’est aussi là où se loge, dans un fusil, la balle.
Philippe-Joseph Salazar
(Les influences, 6 mai 2014)
Notes :
[1] On traduit toujours mal cette phrase en français (« j’ai vu Napoléon passer à cheval », pourquoi pas en patinette ?) car, dans l’allemand de haute précision de Hegel, elle est terrible, et le mot clef y est « recogniziert » : Napoléon est là, dans une manœuvre de reconnaissance du terrain. Relisez cette phrase hautaine et décisive, où la langue ennemie devient presque du latin cicéronien : « Den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum rekognoszieren hinausreiten ».
[2] J’explique le montage dans ActuDéfense http://www.actudefense.com/salazar-stratcomm-chef-veut-pa....
[3] Trésor de la langue française, en ligne.
[4] Tout ça, of course, dans Lyotard.
[5] Dans l’attentat des Tsarnaev, les services de sécurité, incapables et d’avoir prévu et d’expliquer si/comment/pourquoi/avec qui, ont lancé dans la presse l’expression « self-radicalized », auto-radicalisés – ce qui était une manière de dire : nous n’avons pas à chercher plus loin qu’eux. La propagande n’a pas pris : les médias ont laissé tomber car un terroriste auto-radicalisé ne fournit par une « histoire » avec des complices, des réseaux, des épisodes, bref du tirage.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poutine, politique internationale, russie, parole, langue, linguistique, novlangue, manipulations médiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 05 mars 2014
Communiqué de L’Union des Russophones de France
L’Union des Russophones de France déplore le motif linguistique du conflit en Ukraine
L’Union des russophones de France est attristée par le conflit mettant aux prises russophones ukrainiens et russes en Ukraine et déplore particulièrement le motif linguistique du conflit, alors que le pays connait déjà une masse d’autres problèmes économiques, sociaux et politiques, autrement importants.
Tous les Ukrainiens, ou presque, sont russophones, à ne pas confondre avec les populations russes qui vivent en Ukraine depuis des siècles aussi. Un russophone connait le russe en plus et parallèlement à sa langue, comme souvent les francophones parlent également d'autres langues.
L’une des premières décisions du nouveau pouvoir de Kiev, à la légitimité contestée dans une grande partie du pays, en raison du recours à la force en violation de l’accord conclu la veille avec la caution de trois ministres de l’Union européenne et la présence d’un médiateur russe, a été l’interdiction du russe dans les régions où cette langue est maternelle. Imagine-t-on Ottawa interdire le français au Québec ? Bruxelles le flamand ? Ou Berne le français ou l’italien ?
Une telle décision est non seulement provocatrice et stupide et on voit les réactions qu’elle a suscitées en Crimée et dans d’autres régions de langue russe. Elle est aussi en complète contradiction avec les principes de l’Union européenne sur le respect des langues régionales et le droit des citoyens à utiliser leur langue y compris dans leur rapport avec l’administration. Car l’interdiction du russe en Ukraine, au-delà de l’atteinte à une liberté fondamentale, a des conséquences : on ne peut évidemment pas empêcher les gens de parler leur langue dans leur cuisine mais l’interdiction empêche de comprendre les actes de justice, les règlements administratifs, les dispositions sociales et même les notices des médicaments, ce qui dans le passé a causé des décès, lorsque les autorités oranges avaient déjà pris des mesures contre la langue russe. L’intention annoncée de brouiller toutes télévisions en russe sont aussi une atteinte à la liberté d’information.
L’Union des russophones de France se réjouit que des voix se soient trouvées à Lvov (Lviv), centre des ukrainophones, pour protester contre la mesure du pouvoir révolutionnaire en proclamant que « nous avons besoin du russe ». Et en effet, c’est grâce au russe que nous pouvons être en contact avec les Ukrainiens aujourd’hui, quel que soit leur camp ou leur opinion. Il en est de même avec tous les russophones du monde.
L’Union des russophones de France déplore en revanche, la complaisance des autorités françaises et de l’Union européenne à l’égard de cette mesure du pouvoir révolutionnaire de Kiev qui constitue une violation directe et caractérisée des principes même de l’Union européenne et, au-delà, de toute l’Europe.
Union des Russophones de France (URF)
Adresse de contact : Irina Krivova, présidente du directoire
Tél : 06 64 78 13 40 Courriel : union@russophonie. org
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : langue russe, langue ukrainienne, ukraine, russie, actualités, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 01 mars 2014
Het recht van talen op een territorium
Het recht van talen op een territorium
Linguistic Justice
Ex: http://www.doorbraak.be

Filosoof Philippe Van Parijs somt op waarom ‘autochtone’ talen een streepje voor behoren te hebben.
Op dinsdag 18 februari vond aan de faculteit letteren van de Antwerpse campus KU Leuven een debat plaats over ‘minderheidstalen in Canada en België’. De Canadese professor Lynne Bowker leidde in met een uitgebreide schets over de taal(politieke) situatie in haar thuisland. Daarna volgde een publiek debat tussen Peter De Roover en Philippe Van Parijs. Beide deelnemers vulden elkaar mooi aan in het evenwichtige debat waarbij ze de tegenstellingen niet opzochten maar elk vanuit een andere achtergrond de problematiek bespraken van meertaligheid, meertalig onderwijs, taalpolitiek, territorialiteit.
Omdat men ons van positieve bevooroordeling zou kunnen beschuldigen wanneer het onze gewezen chef-politiek betreft, zoemen we in op één aspect dat door Philippe Van Parijs specifiek werd belicht en ook onderwerp is van zijn boek Linguistic Justice for Europe and for the World.
Moderator Luc van Doorslaer vroeg of er een onderscheid mag worden gemaakt, zoals het geval is in charter van de Minderheidstalen, tussen traditionele talen en de talen van inwijkelingen. Hebben het Fins of Litouws meer rechten in Europa dan het Arabisch of Turks, hoewel die laatste twee veel meer sprekers tellen in de Europese Unie. Voor Peter De Roover was het antwoord voorspelbaar ‘ja’. Hij wees onder meer op de hoge economische en maatschappelijke kost van officiële ‘multitaligheid’. De filosoof Philippe Van Parijs trad hem daar in bij.
Nieuwe talen die samen met inwijkelingen een land binnenkomen, hebben ofwel een lagere status dan de lokale taal (het Turks of Arabisch in Vlaanderen) ofwel een hogere (het Frans vroeger, het Engels vandaag rond Brussel). In beide gevallen zijn er voor Van Parijs argumenten om de oorspronkelijke taal voorrang te verlenen.
Sociale cohesie
Sprekers van nieuwe talen met lagere status leren best de taal van de streek waar ze gaan wonen omdat anders de sociale cohesie, de maatschappelijke samenhang onder druk dreigt te komen. Mensen die elkaars taal niet kennen, kunnen moeilijk samen-leven. Het gebrek aan kennis van de lokale taal, werkt ook de sociale mobiliteit van de nieuwkomers tegen, wat leidt tot economische achterstand. Tenslotte is de kennis van het Nederlands noodzakelijk om volwaardig burger te kunnen zijn in Vlaanderen en bijvoorbeeld het politieke en maatschappelijke debat te kunnen volgen, laat staan er aan deel te nemen.
Ook voor sprekers van talen met een hogere status, is het aangewezen de taal te leren van het land waar ze naartoe gekomen zijn. Van Parijs denkt daarbij in het bijzonder aan inwijkelingen uit rijke landen die Engels spreken. De drie argumenten voor de talen met lagere status, zijn dan niet allemaal even zeer van toepassing. Engelstaligen hebben meestal geen kennis nodig van het Nederlands om zich economisch te handhaven. Maar Van Parijs ziet wel drie andere redenen.
De eerste noemt hij ‘parity of esteem’, wat we ongeveer kunnen vertalen als wederzijds gelijkwaardig respect. Als Engelstaligen weigeren Nederlands te praten, geven ze blijk van een soort neerbuigende koloniale ingesteldheid die moet worden afgekeurd.
Het tweede argument heet bij Van Parijs ‘kindness driven agony’, de door vriendelijkheid gedreven kwelling. Sprekers van het Nederlands die ook Engels beheersen zullen vanuit een soort vriendelijkheid snel overschakelen naar dat Engels als de gesprekspartner het Nederlands niet spreekt. Met goede bedoelingen legt de Nederlandstalige zich dan een beperking op, door de taal van de andere als communicatiemiddel te gebruiken. Dat leidt er toe dat de zwakkere taal verdrongen wordt door de sterkere, wanneer de gebruikers van de zwakkere ook de sterkere beheersen en het omgekeerde niet het geval is.
Tenslotte heeft elke taal het recht ergens ‘Queen’ te zijn, op één bepaald grondgebied als de belangrijkste taal te gelden. Laat het Frans wereldwijd meer gesproken worden dan het Nederlands, in Vlaanderen is het omgekeerde het geval. Talen zonder territorium waar die taal de hoofdrol speelt, hebben het erg moeilijk om zichzelf te handhaven. Deze set van drie argumenten respecteren, noemt de zelf meertalige Van Parijs een zaak van ‘linguistic justice’.
Foto: © Reporters
<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>
00:05 Publié dans Actualité, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, langues, linguistique, philippe van parijs |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 février 2014
LA CHARTE DES LANGUES REGIONALES

Michel Lhomme
http://metamag.fr
L’Assemblée Nationale a débattu le 22 janvier 2014 d’une proposition de loi constitutionnelle du groupe socialiste portant modification de la Constitution afin de permettre la ratification de la Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires. De nouvelles questions se posent.
La reconnaissance officielle de langues régionales ou minoritaires ne participe-t-elle pas de la déconstruction de l'Europe et ne vise-t-elle pas à accroître les fractures hexagonales déjà si nombreuses ? Le régionalisme européen n'est-il pas le serpent de mer de l'américanisation de l'Europe, de son « l'Otanisation » , de sa fédéralisation souhaitée par les Atlantistes ? La question est plus qu'embarrassante pour les partisans d’une Europe des régions, du particularisme régional contre l'Europe des nations ou des patries. Et si nous n'avions pas pressenti l'instrumentalisation des régions au sein de la construction européenne ? L’Assemblée nationale a voté le principe de la ratification de la Charte européenne des langues régionales qui a vu le jour en 1992 sur les bancs du Conseil de l’Europe. Elle vise à protéger et à promouvoir l’usage des langues dites régionales et minoritaires en Europe en leur conférant un statut officiel, et des moyens financiers pour renforcer leur usage notamment dans la sphère publique. La ratification avait buté sur l’article deux de notre Constitution selon lequel « la langue de la République est le français ». Si le Sénat suit demain l’Assemblée, ce qui devrait être le cas, eu égard aux postures politiciennes des différentes formations qui le composent, la voie à un changement de la Constitution sera ouvert. Et rapidement quelque 78 langues régionales auront un statut officiel en France.
L’éloignement et les particularismes locaux bien réels de l'Outre-mer, que l'on songe par exemple au Tahitien ou au Mahorais, justifient que les langues et cultures locales d’outre-mer soient protégées, y compris constitutionnellement mais en métropole, la situation n'est-elle pas tout autre ? Donner des droits linguistiques nouveaux, n'est-ce pas conforter les séparatismes et les communautarismes comme en Espagne ou en Flandre ? La question sous-jacente est-elle d'ailleurs vraiment celle à proprement parler des langues régionales ou celle de la langue arabe dialectale pratiquée dans certaines régions de France ?

Personne n’empêche aujourd'hui les Français d’échanger dans une langue régionale s’ils le souhaitent. Pôle emploi recourt régulièrement au créole pour faciliter la bonne compréhension des usagers aux Antilles mais faut-il aussi instaurer le multilinguisme pour tenir compte des langues de migrants (arabe dialectal, berbère, romani, wolof, swahili …), qui n’ont rien de régional mais sont parfois si importantes en certaines parties du territoire français qu'on n'entend plus que cela ? Est-ce là un moyen efficace pour renforcer l’intégration et permettre à chaque jeune Français de trouver sa place dans la société française ?

Ces débats de fond ont été esquivés. Pourtant, il semblerait que loin de l'actualité immédiate, il y ait eu un volontarisme et un empressement du gouvernement socialiste à faire passer la loi au plus vite. Pourquoi ? Certes, la ratification de la Charte constituait le 56e des 60 engagements du candidat François Hollande. De fait, le texte sur les langues régionales paraît aussi un cadeau qui ne mange pas de pain pour la Bretagne révoltée des bonnets rouges. Mais est-ce si innocent que cela ? Comment ne pas voir aussi que la reconnaissance officielle des langues régionales ou minoritaires participe de la déconstruction nationale programmée par les élites? Le texte ne va-t-il pas échapper à la logique régionaliste de 1992 pour servir d'autres intérêts, la dynamique d'une politique « remplaciste » ?
Revenons, sur ce point, sur quelques détails du texte de loi voté. Il précise à l’article 7-e que la notion de « groupe pratiquant une langue régionale » renvoie à la notion d’un peuple minoritaire enclavé dans un autre peuple. La proposition du groupe socialiste a donné une interprétation de la notion de « groupe » quasiment balkanique qui est contraire à ce que voulait la Charte de 1992 elle-même. De plus, les articles 9 et 10 de la Charte stipulent que « les langues régionales peuvent être utilisées en justice comme langue de procédure, l’accusé pouvant s’exprimer dans sa langue régionale' » et que « les autorités administratives utilisent les langues régionales, mettent à disposition des formulaires dans les langues régionales, et répondent dans cette langue »'. Ces dispositions sont bien évidemment contraires au bien connu article 2 de la Constitution de 1958.
En réalité, les députés socialistes ont fait diversion. Ils ont flatté les tenants des langues régionales ou minoritaires, et, en même temps, ils ont essayé de couper les ailes d’un texte qu’ils savent dangereux pour l’unité linguistique de la République. Bref, ils ont servi leurs intérêts électoralistes futurs auprès de la population immigrée. Ils ont en quelque sorte préparé le terrain de la division civile. Rappelons aussi que le Ministre de l'Education nationale a souhaité récemment généraliser, dans une feuille de route adressée aux éducateurs, l'enseignement de l'arabe ou d'une langue africaine mère dans les collèges et lycées pour favoriser, dit-il, sa chimère laïque de l'intégration. On voit bien que la charte des langues régionales sert maintenant de tout autre intérêt que ceux du royaume de Bretagne, du Comté de Nice ou du pidgin de la petite île de Saint-Martin dans les Caraïbes.
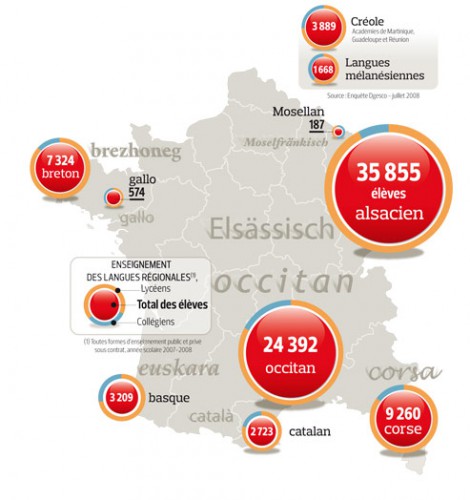
00:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Langues/Linguistique, Politique, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langues régionales, langues, linguistique, france, politique, régionalisme, terroirs, politique internationale, europe, affaires européennes, jacobinisme, éducation, apprentissage des langues |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 14 janvier 2014
Maurras, inlassable avocat des langues régionales
00:05 Publié dans Histoire, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles maurras, langues, langues régionales, linguistique, france, histoire, action française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 septembre 2013
LA GEOPOLITICA DELLE LINGUE
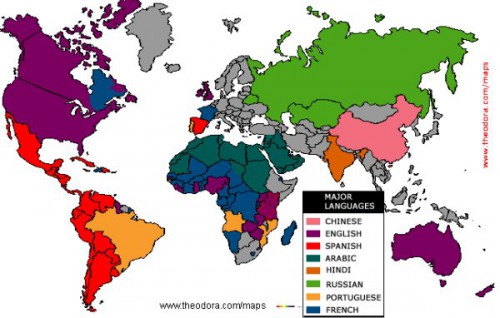
Claudio MUTTI
LA GEOPOLITICA DELLE LINGUE
Ex: http://www.eurasia-rivista.org
Sommario del numero XXXI (3-2013 [1])
“In queste condizioni, vi possono essere soltanto
lingue vincitrici e lingue vinte”
(J. V. Stalin, Al compagno Kholopov, 28 luglio 1950)
Lingua e Impero
Se il termine geolinguistica non fosse già utilizzato dai glottologi per significare la geografia linguistica o linguistica areale, ossia lo studio della diffusione geografica dei fenomeni linguistici, lo si potrebbe impiegare per indicare la geopolitica delle lingue, cioè il ruolo del fattore linguistico nel rapporto tra lo spazio fisico e lo spazio politico. A suggerire questa possibilità non è solo l’esistenza di analoghi composti nominali, come geostoria, geofilosofia, geoeconomia, ma anche la relazione della geopolitica delle lingue con una disciplina designata da uno di tali termini: la geostrategia.
“La lengua es compañera del imperio“: il nesso tra egemonia linguistica ed egemonia politico-militare, così icasticamente rappresentato dal grammatico e lessicografo Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), sottende la definizione che il Maresciallo di Francia Louis Lyautey (1854-1934) diede della lingua: “un dialetto che ha un esercito e una marina”. Al medesimo ordine di idee si ispira il generale Jordis von Lohausen (1907-2002), allorché prescrive che “la politica linguistica venga messa sullo stesso piano della politica militare” ed afferma che “i libri in lingua originale svolgono all’estero un ruolo talvolta più importante di quello dei cannoni”1. Secondo il geopolitico austriaco, infatti, “la diffusione d’una lingua è più importante d’ogni altra espansione, poiché la spada può solo delimitare il territorio e l’economia sfruttarlo, ma la lingua conserva e riempie il territorio conquistato”2. È questo, d’altronde, il senso della celebre frase di Anton Zischka (1904-1997): “Preferiamo i professori di lingue ai militari”.
L’affermazione del generale von Lohausen potrebbe essere illustrata da una vasta gamma di esempi storici, a partire dal caso dell’Impero romano, che tra i suoi fattori di potenza ebbe la diffusione del latino: una parlata contadina che con lo sviluppo politico di Roma diventò, in concorrenza col greco, la seconda lingua del mondo antico, usata dai popoli dell’Impero non perché costretti, ma perché indotti a ciò dal prestigio di Roma. Da principio il latino servì alle popolazioni assoggettate per comunicare coi soldati, i funzionari e i coloni; in seguito diventò il segno distintivo della comunità romana.
Tuttavia allo spazio imperiale romano, che per mezzo millennio costituì un’unica patria per le diversae gentes comprese tra l’Atlantico e la Mesopotamia e la Britannia e la Libia, non corrispose un’unica lingua: il processo di latinizzazione fu più lento e difficile quando i Romani si trovarono a contatto coi territori in cui si parlava la lingua greca, espressione e veicolo di una cultura che godeva, negli ambienti della stessa élite romana, di un prestigio superiore. Quello romano fu dunque in sostanza un impero bilingue: il latino e il greco, in quanto lingue della politica, della legge e dell’esercito, oltre che delle lettere, della filosofia e delle religioni, svolgevano una funzione sovranazionale, alla quale gli idiomi locali dell’ecumene imperiale non potevano adempiere.
Sicuramente è pressoché impossibile separare con una netta linea di confine il dominio del latino e quello del greco all’interno dell’Impero romano; nondimeno possiamo affermare che la divisione dell’Impero in due parti e la successiva scissione avvennero lungo una linea di demarcazione coincidente grosso modo col confine linguistico, che tagliava a metà sia i territori europei sia quelli nordafricani. In Libia, è proprio lungo questa linea che si è recentemente prodotta la frattura che ha separato di nuovo la Tripolitania dalla Cirenaica.
In seguito la carta linguistica dell’Europa ci presenta una situazione che Dante descrive identificando tre distinte aree: quella del mondo germanico, in cui fa rientrare anche Slavi e Ungheresi, quella di lingua greca, quella degl’idiomi neolatini3; all’interno di quest’ultima egli può ulteriormente distinguere le tre unità particolari di provenzale (lingua d’oc), francese (lingua d’oil) e italiano (lingua del sì). Ma Dante è ben lungi dall’usare l’argomento della frammentazione linguistica per sostenere la frammentazione politica; anzi, egli è convinto che solo la restaurazione dell’unità imperiale potrebbe far sì che l’Italia, “il bel paese là dove il sì suona”4, torni ad essere “il giardin dello ‘mperio”5. E l’impero ha la sua lingua, il latino, poiché, come dice lo stesso Dante, “lo latino è perpetuo e non corruttibile, e lo volgare è non stabile e corruttibile”6.
In un’Europa linguisticamente frammentata, che il Sacro Romano Impero vorrebbe ricostituire in unità politica, una potente funzione unitaria è svolta proprio dal latino: non tanto dal sermo vulgaris, quanto dalla lingua di cultura della res publica clericorum. Questo “latino scolastico”, se vogliamo indicarne la dimensione geopolitica, “è stato il portatore per tutta l’Europa, ed anche fuori, della civiltà latina e cristiana: confermandola, come nelle Spagne, nell’Africa (…), nelle Gallie; o acquisendo ad essa zone nuove o appena sfiorate dalla civiltà romana: la Germania, l’Inghilterra, l’Irlanda, per non parlare poi anche di paesi nordici e slavi”7.
Le grandi aree linguistiche
Fra tutti gl’idiomi neolatini, l’espansione maggiore è stata raggiunta dalla lengua castellana. In seguito alla bolla di Alessandro VI, che nel 1493 divise il nuovo mondo tra Spagnoli e Portoghesi, il castigliano si impose nelle colonie appartenute alla Spagna, dal Messico fino alla Terra del Fuoco; ma anche dopo l’emancipazione i singoli Stati sorti sulle rovine dell’Impero delle Americhe mantennero il castigliano come lingua nazionale, ragion per cui l’America latina possiede una relativa unità culturale e il dominio linguistico spagnolo si estende anche ad una parte del territorio statunitense.
Per quanto riguarda il dominio dell’altra lingua iberica, a testimoniare l’estensione dell’area coloniale che in altri tempi appartenne al Portogallo basterebbe il fatto che l’idioma di Camões è “la lingua romanza che ha dato origine al maggior numero di varietà creole, per quanto alcune siano estinte o in via di estinzione”8: da Goa a Ceylon, a Macao, a Giava, alla Malacca, a Capo Verde, alla Guinea. Tra gli Stati che hanno raccolto l’eredità lusofona, si impone oggi il Paese emergente rappresentato dall’iniziale dell’acronimo BRICS: il Brasile, coi suoi duecento milioni di abitanti, a fronte dei dieci milioni e mezzo che vivono nell’antica madrepatria europea.
L’espansione extraeuropea del francese come lingua nazionale, invece, è stata inferiore a quella che esso ha avuto come lingua di cultura e di comunicazione. Infatti, se il francese è la quinta lingua più parlata nel mondo per numero di locutori (circa duecentocinquanta milioni) ed è la seconda più insegnata come lingua straniera, si trova invece al nono posto per numero di madrelingua (circa settanta milioni; circa centotrenta se si aggiungono anche gl’individui bilingui). In ogni caso, è l’unica lingua a trovarsi diffusa, come lingua ufficiale, in tutti i continenti: è lingua di scambio in Africa, il continente che annovera il maggior numero di entità statali (più d’una ventina) in cui il francese è lingua ufficiale; è la terza lingua nell’America del Nord; è usata anche nell’Oceano Indiano e nel Pacifico meridionale. Gli Stati e i governi che a vario titolo hanno in comune l’uso del francese sono raggruppati nell’Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF), fondata il 20 marzo 1970 con la Convenzione di Niamey.
Eminentemente eurasiatica è l’area d’espansione del russo, lingua comune e ufficiale di uno Stato multinazionale che, pur nel succedersi di fasi storiche e politiche che ne hanno cambiato la dimensione territoriale, rimane il più esteso sulla faccia della terra. Se nel periodo sovietico il russo poteva essere glorificato come “lo strumento della civiltà più avanzata, della civiltà socialista, della scienza progressista, la lingua della pace e del progresso (…) lingua grande, ricca e potente (…) strumento della civiltà più avanzata del mondo”9 e in quanto tale reso obbligatorio nell’insegnamento dei paesi dell’Europa orientale, dopo il 1991 esso gode di un diverso statuto in ciascuno degli Stati successori dell’Unione Sovietica. Nella Federazione Russa, la Costituzione del 1992 sancisce il diritto di ogni cittadino alla propria appartenenza nazionale ed all’uso della lingua corrispondente ed inoltre garantisce a ciascuna Repubblica la facoltà di avvalersi, accanto alla lingua ufficiale russa, delle lingue delle nazionalità che la costituiscono.
Se il russo è al primo posto per l’estensione del territorio dello Stato del quale esso è lingua ufficiale, il cinese detiene la preminenza per il numero dei parlanti. Usato attualmente da circa un miliardo e trecento milioni di persone, il cinese si presenta fin dall’antichità come un insieme di varianti che rendono alquanto problematica l’applicazione del termine dialetto; fra tutte primeggia il mandarino, un gruppo grande e variegato che a sua volta si distingue in mandarino del Nord, dell’Ovest e del Sud. Il mandarino del Nord, che ha il suo centro a Pechino, è stato preso a modello per la lingua ufficiale (pǔtōnghuà, letteralmente “lingua comune”), parlata come lingua madre da più di ottocento milioni di persone. Ufficialmente la popolazione della Repubblica Popolare Cinese, che nella sua Costituzione si definisce “Stato plurinazionale unitario”, consta di cinquantasei nazionalità (minzu), ciascuna delle quali usa la propria lingua; fra queste, la più numerosa è quella han (92% della popolazione), mentre le altre cinquantacinque, che costituiscono il restante 8%, “parlano almeno sessantaquattro lingue, di cui ventisei hanno una forma scritta e sono insegnate nelle scuole elementari”10.
L’hindi e l’urdu, che possono essere considerati continuazioni del sanscrito, sono le lingue predominanti nel subcontinente indiano, dove dieci Stati dell’Unione Indiana costituiscono la cosiddetta “cintura hindi” e dove l’urdu è lingua ufficiale del Pakistan. La differenza più evidente tra queste due lingue consiste nel fatto che la prima si serve della scrittura devanagari, mentre la seconda fa uso dell’alfabeto arabo; sul piano lessicale, l’hindi ha recuperato una certa quantità di elementi sanscriti, mentre l’urdu ha incorporato molti termini persiani. Per quando riguarda in particolare l’hindi, si potrebbe dire che esso ha svolto nel subcontinente indiano una funzione analoga a quella del mandarino in Cina, poiché, formatosi sulla base di un dialetto parlato nelle vicinanze di Delhi (il khari boli), insieme con l’inglese è diventato, fra le ventidue lingue citate nella Costituzione indiana, la lingua ufficiale dell’Unione.
L’arabo, veicolo della rivelazione coranica, con l’espansione dell’Islam si è diffuso ben al di fuori dei suoi confini originari: dall’Arabia al Nordafrica, dalla Mesopotamia alla Spagna. Caratterizzato da una notevole ricchezza di forme grammaticali e da finezze di rapporti sintattici, incline ad arricchire il proprio lessico attingendo vocaboli da dialetti e da lingue straniere, l’arabo prestò il proprio sistema alfabetico a lingue appartenenti ad altre famiglie, quali il persiano, il turco, l’urdu; codificato dai grammatici e divenuto lingua dotta del dâr al-islâm, si sostituì al siriaco, al copto, ai dialetti berberi; arricchì con numerosi prestiti il persiano, il turco, le lingue indiane, il malese, le lingue iberiche; come strumento di filosofia e di scienza, influenzò le lingue europee quando i califfati di Bagdad e di Cordova costituivano i maggiori centri di cultura ai quali poteva attingere l’Europa cristiana. Oggi l’arabo è in diversa misura conosciuto, studiato ed usato, in quanto lingua sacra e di pratica rituale, nell’ambito di una comunità che oltrepassa il miliardo di anime. Come lingua madre, esso appartiene a circa duecentocinquanta milioni di individui, stanziati su un’area politicamente frazionata che dal Marocco e dalla Mauritania si estende fino al Sudan ed alla Penisola araba. A tale denominatore linguistico si sono richiamati i progetti di unità della nazione araba formulati nel secolo scorso: “Arabo è colui la cui lingua è l’arabo”11 si legge ad esempio nello statuto del Baath.
La lingua dell’imperialismo statunitense
In tutta la prima metà del Novecento, la lingua straniera più conosciuta nell’Europa continentale era il francese. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, “solo nel 1918 vennero istituite cattedre universitarie di inglese ed alla stessa data risale la fondazione dell’Istituto britannico di Firenze, che, con la sua biblioteca e i suoi corsi linguistici, divenne ben presto il centro più importante di diffusione appunto della lingua inglese a livello universitario”12. Alla Conferenza di pace dell’anno successivo gli Stati Uniti, che si erano ormai introdotti nello spazio europeo, imposero per la prima volta l’inglese – accanto al francese – quale lingua diplomatica. Ma a determinare il decisivo sorpasso del francese da parte dell’inglese fu l’esito della seconda guerra mondiale, che comportò la penetrazione della “cultura” angloamericana in tutta l’Europa occidentale. Dell’importanza rivestita dal fattore linguistico in una strategia di dominio politico non era d’altronde inconsapevole lo stesso Sir Winston Churchill, che il 6 settembre 1943 dichiarò esplicitamente: “Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. Gl’imperi del futuro sono quelli della mente”. Con la caduta dell’Unione Sovietica, nell’Europa centro-orientale “liberata” l’inglese non solo ha scalzato il russo, ma ha anche soppiantato in larga misura il tedesco, il francese e l’italiano, che prima vi avevano un’ampia circolazione. D’altronde, l’egemonia dell’inglese nella comunicazione internazionale si è ulteriormente consolidata nella fase più intensa della globalizzazione.
Così i teorici angloamericani del mondo globalizzato hanno potuto elaborare, basandosi sul peso geopolitico esercitato dalla lingua inglese, il concetto di “Anglosfera”, definito dal giornalista Andrew Sullivan come “l’idea di un gruppo di paesi in espansione che condividono principi fondamentali: l’individualismo, la supremazia della legge, il rispetto dei contratti e degli accordi e il riconoscimento della libertà come valore politico e culturale primario”13. Pare che ad introdurre il termine “Anglosfera” sia stato nel 2000 uno scrittore americano, James C. Bennett; a suo parere “i paesi di lingua inglese guideranno il mondo nel XXI secolo” (Why the English-Speaking Nations Will Lead the Way in the Twenty-First Century è il sottotitolo del suo libro The Anglosphere Challenge), poiché l’attuale sistema degli Stati è condannato a crollare sotto i colpi del cyberspazio anglofono e dell’ideologia liberale. Lo storico Andrew Roberts, continuatore dell’opera storiografica di Churchill con A History of the English Speaking Peoples since 1900, sostiene che il predominio dell’Anglosfera è dovuto alla lotta dei paesi anglofoni contro le epifanie del Fascismo (ossia – sic – “la Germania guglielmina, il nazismo, il comunismo e l’islamismo”), in difesa delle istituzioni rappresentative e del libero mercato.
Meno ideologica la tesi dello storico John Laughland, secondo il quale “l’importanza geopolitica della lingua inglese è (…) rilevante solo in funzione della potenza geopolitica dei paesi anglofoni. Potrebbe essere uno strumento da questi usato per rafforzare la loro influenza, ma non è una fonte indipendente di quest’ultima, perlomeno non della potenza militare”14. La lingua, conclude Laughland, può rispecchiare la potenza politica, ma non la può creare.
In questo caso la verità sta nel mezzo. È vero che l’importanza di una lingua dipende – spesso ma non sempre – dalla potenza politica, militare ed economica del paese che la parla; è vero che sono le sconfitte geopolitiche a comportare quelle linguistiche; è vero che “l’inglese avanza a detrimento del francese perché gli Stati Uniti attualmente restano più potenti di quanto non lo siano i paesi europei, i quali accettano che sia consacrata come lingua internazionale una lingua che non appartiene a nessun paese dell’Europa continentale”15. Tuttavia esiste anche una verità complementare: la diffusione internazionale di una lingua, contribuendo ad aumentare il prestigio del paese corrispondente, ne aumenta l’influenza culturale ed eventualmente quella politica (un concetto, questo, che pochi riescono ad esprimere senza fare ricorso all’anglicismo soft power); a maggior ragione, il predominio di una lingua nella comunicazione internazionale conferisce un potere egemone al più potente fra i paesi che la parlano come lingua madre.
Per quanto concerne l’attuale diffusione dell’inglese, “lingua della rete, della diplomazia, della guerra, delle transazioni finanziarie e dell’innovazione tecnologica, non vi è dubbio: questo stato di cose regala ai popoli di lingua inglese un incomparabile vantaggio e a tutti gli altri un considerevole svantaggio”16. Come spiega meno diplomaticamente il generale von Lohausen, il vantaggio che gli Stati Uniti hanno ricavato dall’anglofonia “è stato uguale per i loro commercianti e per i loro tecnici, per i loro scienziati e i loro scrittori, i loro uomini politici e i loro diplomatici. Più l’inglese è parlato nel mondo, più l’America può avvantaggiarsi della forza creativa straniera, attirando a sé, senza incontrare ostacoli, le idee, gli scritti, le invenzioni altrui. Coloro la cui lingua materna è universale, posseggono un’evidente superiorità. Il finanziamento accordato all’espansione di questa lingua ritorna centuplicato alla sua fonte”17.

Quale lingua per l’Europa?
Nei secoli XVI e XVII, dopo che la pace di Cateau Cambrésis (1559) ebbe sancito la dominazione spagnola in Italia, la lingua castigliana, oltre ad essere usata dalle cancellerie di Milano e di Napoli, si diffuse nel mondo della politica e delle lettere. Il numero delle voci italiane (e dialettali) nate in quel periodo per effetto dell’influsso spagnolo è elevatissimo18. Tra tutti questi ispanismi, però, alcuni furono usati solo in maniera occasionale e non si possono considerare come entrati nell’uso generale; altri ebbero vita effimera e scomparvero senza lasciar traccia; solo una minoranza entrò stabilmente a far parte del vocabolario italiano. In seguito alla pace di Utrecht (1713), che segnò la fine dell’egemonia spagnola nella penisola, l’influenza del castigliano sulla lingua italiana “è stata di gran lunga inferiore a quello dei secoli precedenti”19.
È lecito supporre che nemmeno il colonialismo culturale d’espressione angloamericana debba durare per l’eternità; anzi, alcuni linguisti già prevedono che all’odierna fase di predominio anglofono seguirà una fase di decadenza20. Essendo legato all’egemonia imperialistica statunitense, il predominio dell’inglese è destinato a risentire in maniera decisiva della transizione dallo stadio unipolare a quello multipolare, per cui lo scenario che la geopolitica delle lingue può ragionevolmente prefigurare è quello di un mondo articolato secondo il multipolarismo delle aree linguistiche.
Diversamente dal continente americano, che presenta una netta ripartizione tra il blocco anglofono del nord e quello ispanofono e lusofono della parte centrale e meridionale, l’Eurasia è il continente della frammentazione linguistica. Accanto ai grandi spazi rappresentati dalla Russia, dalla Cina o dall’India, relativamente omogenei sotto il profilo linguistico, abbiamo uno spazio europeo caratterizzato da una situazione di accentuato multilinguismo.
Perciò sarebbe stato logico che i fondatori della Comunità Economica Europea, se proprio volevano rifiutare una soluzione monolinguistica, adottassero come lingue ufficiali, tra quelle dei Paesi aderenti, le due o tre più parlate nell’area; magari scegliendo, in previsione dei successivi allargamenti della CEE, una terna di lingue che rappresentassero le tre principali famiglie presenti in Europa: la germanica, la romanza e la slava. Invece l’art. 1 del regolamento emanato nel 1958 indicò ben quattro lingue (francese, italiano, tedesco e olandese) come “lingue ufficiali e lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità”, col risultato che le “lingue di lavoro” sono oggi praticamente tre: francese, tedesco e inglese.
Il fallimento dell’Unione Europea impone di sottoporre a radicale revisione il progetto europeista e di rifondare su nuove basi l’edificio politico europeo. La nuova classe politica che sarà chiamata ad affrontare questo compito storico non potrà più eludere un problema fondamentale come quello della lingua.
1. Jordis von Lohausen, Les empires et la puissance, Editions du Labyrinthe, Arpajon 1996, p. 49.
2. Jordis von Lohausen, ibidem.
3. De vulgari eloquentia, VIII, 3-6.
4. Dante, Inf. XXXIII, 80.
5. Dante, Purg. VI, 105.
6. Dante, Convivio, I, 5.
7. Luigi Alfonsi, La letteratura latina medievale, Accademia, Milano 1988, p. 11.
8. Carlo Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Pàtron, Bologna 1982, p. 202.
9. “Voprosy Filozofij”, 2, 1949, cit. in: Lucien Laurat, Stalin, la linguistica e l’imperialismo russo, Graphos, Genova 1995, p. 52.
10. Roland Breton, Atlante mondiale delle lingue, Vallardi, Milano 2010, p. 34.
11. Michel ‘Aflaq, La resurrezione degli Arabi, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2011, p. 54.
12. I. Baldelli, in Bruno Migliorini – Ignazio Baldelli, Breve storia della lingua italiana, Sansoni, Firenze 1972, p. 331.
13. Andrew Sullivan, Come on in: The Anglosphere is freedom’s new home, “The Sunday Times”, 2 febbraio 2003.
14. John Laughland, L’Anglosfera non esiste, “I quaderni speciali di Limes”, a. 2, n. 3, p. 178.
15. Alain de Benoist, Non à l’hégémonie de l’anglais d’aéroport!, voxnr.com, 27 maggio 2013.
16. Sergio Romano, Funzione mondiale dell’inglese. Troppo utile per combatterla, “Corriere della Sera”, 28 ottobre 2012.
17. Jordis von Lohausen, ibidem.
18. Gian Luigi Beccaria, Spagnolo e Spagnoli in Italia. Riflessi ispanici sulla lingua italiana del Cinque e del Seicento, Giappichelli, Torino 1968.
19. Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, Bologna 1976, p. 76.
20. Nicholas Ostler, The Last Lingua Franca: English Until the Return of Babel, Allen Lane, London 2010.
Article printed from eurasia-rivista.org: http://www.eurasia-rivista.org
URL to article: http://www.eurasia-rivista.org/la-geopolitica-delle-lingue-2/20017/
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, claudio mutti, géopolitique, langues, linguistique, europe, affaires européennes, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 avril 2013
Politieke correctheid en taalepuratie
Politieke correctheid en taalepuratie: het mysterie van de verdwenen allochtoon
Tot een van de bloedigste regimes sinds de tweede wereldoorlog kan dat van de Rode Khmer gerekend worden, de militaire tak van de Communistische Partij van Democratisch Kampuchea (nu Cambodja). Hun bezieler en leider, Pol Pot, had het plan opgevat om de stedelijke beschaving, en eigenlijk de beschaving tout court, af te schaffen via massale deportaties naar het platteland. Men schat dat tussen 1975 en 1979 2 à 3 miljoen Cambodjanen (op een totaal van 7 miljoen) zijn omgekomen.
Behalve in wreedheid overtrof Pol Pot zijn leermeesters Stalin en Mao ook inzake de totale beslaglegging op het sociale verkeer en het privé-leven. Slapen, ontlasting, eten en drinken: het moest allemaal collectief gebeuren. Alles wat naar cultuur, expressie en individualiteit verwees, werd verboden, op straffe van executie: eigendom (uiteraard), naast kleding en uiting van persoonlijke smaak (iedereen liep in het zwart), boeken (behalve dan de reguliere communistische literatuur), het dragen van een bril (te intellectueel!), kennis van een vreemde taal (gevaar voor imperialistische smetten), maar ook vriendschappen en familiale banden die konden leiden tot groepsvorming buiten de cellulaire staatsstructuur. Allemaal fout, weg ermee.
Opmerkelijk is ook het belang dat de Khmers in hun ijver hechtten aan een juist taalgebruik. Daartoe moest er grote schoonmaak gehouden worden, niet alleen in de politieke terminologie. Woorden als vader of moeder waren taboe wegens niet conform de communistische gemeenschapszin, naast een hele resem andere vervuilde woorden uit de omgangstaal. Deze opkuis vereenvoudigde het leven aanzienlijk, en zou leiden tot de ideale maatschappij, zo meenden de Khmers oprecht: hun insteek was, hoe schandalig we dat nu ook vinden, idealistisch, op het maakbaarheidsprincipe gebaseerd, en, tja, in die zin zelfs politiek-correct.
Uiteindelijk werden de Khmers verjaagd door de Vietnamezen, die hen ook eerst in het zadel hadden geholpen. Waarna de indoctrinatie gewoon doorging. Tot daar de recente geschiedenis.
Newspeak
De verhouding tussen politieke macht en taalcontrole was het stokpaardje van de Engelse schrijver-filosoof George Orwell. Al in 1945 publiceerde hij zijn legendarisch geworden Animal Farm, een grotesk-satirische allegorie over een boerderij waar de varkens het hebben overgenomen en een welzijnsstaat creëerden volgens hoger beschreven Stalinistische principes. Maar de wreedheid is nagenoeg afwezig: de propaganda en de indoctrinatie hebben de vrijheidsberoving en de fysieke liquidatie grotendeels overbodig gemaakt. Iedereen is gelukkig omdat… het woord ongeluk gewoon is afgeschaft, meer moet dat niet zijn!
Orwell had vooral de Stalin-dictatuur voor ogen –in die zin was hij zelfs een pleitbezorger van de Koude Oorlog-, maar de eigenlijke visionaire dimensie van zijn distopische roman reikte verder: hij zag al de “perfecte democratie” opdoemen, waar macht en controle over het discours, in al zijn aspecten, samenvalt. Daartoe is dus geen dictatuur nodig, integendeel: hoe groter het gepalaver, hoe groter de verwarring, des te beter voor het systeem.
De moderne macht is niet meer repressief, ze grijpt in op het niveau van de taal, de betekenissen, de tekst. Ze organiseert de democratie en de publieke opinie op zo’n manier, dat de free speech alleen nog een variatie is op de legitieme thema’s, in een vast verbaal stramien. Alles wat daar buiten valt, wordt gekwalificeerd als ongeoorloofd, nefast, grof, extreem.
Het systeem dat vandaag spreekwoordelijk als “Orwelliaans” wordt gekarakteriseerd, drijft daarom voornamelijk op taalmanipulatie en massapsychologie, met de communicatiewetenschap als sleuteldiscipline. Zowel de simplifiërende on-liner als het omgekeerde, de quasi-onbegrijpelijke woordenbrij, behoren tot het retorisch arsenaal van de macht.
De moderne macht is niet meer repressief, ze grijpt in op het niveau van de taal, de betekenissen, de tekst.
Het ingrijpen in de woordenschat is daarvan een essentieel aspect: termen worden gedumpt, andere worden uitgevonden. De nieuwe termen zijn nooit helder of éénduidig,- ze zijn veeleer wollig en mistig, om de contradicties van het systeem zelf toe te dekken. In een weinig bekend essay van 1946, getiteld “Politics an the English Language”, doet George Orwell die newspeak haarfijn uit de doeken. Macht berust op verwarring en ondoorzichtigheid, en daartoe moeten er verbale mistgordijnen geschapen worden. Dat gebeurt op alle niveau’s. We kennen allemaal het fenomeen van de informaticatechneut die u om de oren slaat met vakjargon, en zo zijn autoriteit bevestigt: het is jammer genoeg schering en inslag.
Zowel systemen als individuen ontlenen hun autoriteit aan een complex taalgebruik, een groteske overdaad aan woorden, frasen, alinea’s en voetnoten, die op de duur alleen nog naar elkaar verwijzen. Het euvel komt voor bij wetenschappers, technici, kunstenaars, en zeker ook politici. Er ontstaan dan kasten van specialisten die elkaar afschermen via een jargon dat zogezegd noodzakelijk is om ingewikkelde knopen te ontwarren, terwijl ze de knopen juist nog dikker maken. (→ meer hierover: “Eilanden van gezond verstand”).
Op het politieke vlak wordt de verloren gegane legitimiteit (“wie gelooft die mensen nog?”) ruimschoots gecompenseerd door de professionele inbreng van spindoctors en communicatiestrategen allerhande. Woorden worden gecreëerd, gecombineerd, gedumpt, helemaal conform hun inwerking op de publieke opinie. Met de media uiteraard als noodzakelijke sluis, en het academisch-cultureel establishment als aangever.
Allo-wat?
Ik moest dan ook voortdurend aan Orwell denken, toen steden zoals Amsterdam en Gent aankondigden dat ze het woord “allochtoon” zouden schrappen.
Het woord werd ons ooit opgedrongen als hallucinant staaltje newspeak (omdat men niet over vreemdelingen, migranten of mensen-van-buitenlandse-origine mocht spreken), en nu wordt het dus door diezelfde taalpolitie weer afgevoerd. Verre van dit met het Rode Khmer-regime te willen vergelijken, stelt men toch vast dat hier een gelijkaardig politiek-correct voluntarisme aan het werk is: het idee dat problemen zich oplossen door de taal te fatsoeneren. Terwijl het net andersom is: de taal is een weerspiegeling van de sociale realiteit, die niet homogeen is, maar heterogeen en conflictueus.
De ontkenningsstrategie die erachter schuilt is perfide en lachwekkend tegelijk. Ooit stelde Steve Stevaert, nu actief als havenbaas in Vietnam, voor om de term “Vlaams Belang” niet meer uit te spreken, en enkel nog de afkorting “VB” te gebruiken (wat dan evengoed op “Vuile Bruinzakken” of “Vunzige Bastaards” kon slaan, kies zelf maar). Daarmee zou het probleem volgens hem wel van de baan geraken. Het was ook de tijd dat de zo slimme professor Etienne Vermeersch in de media elke vraag over die verboden partij beantwoordde met een lakoniek “Wie?”, in dezelfde optimistische veronderstelling dat het probleem zo zichzelf zou oplossen.
In het kader van een permanente goed-nieuws-show wordt de realiteit geregisseerd en verbaal uitgefilterd,- iets waar de media overigens voluit aan meedoen.
Dit taalkundig proberen te overrulen van de realiteit is typerend voor een maakbaarheidsideologie die au fond niet geïnteresseerd is in het werkelijke maatschappelijke spanningsveld: in het kader van een permanente goed-nieuws-show wordt de realiteit geregisseerd en uitgefilterd,- iets waar de media overigens voluit aan meedoen. De quasi-ethische omlijsting van het woordverbod (“onzuiver taalgebruik” wordt meteen ook “immoreel taalgebruik”) is kenmerkend voor een bovenbouw die wanhopig op zoek is naar legitimatie: Gent en Amsterdam, redders van het correcte Nederlands, en hoeders van de beschaving!
Op zich totaal betekenisloos geworden stoplappen als “racistisch” en “(on-) democratisch” fungeren als sleutelwoorden in deze epuratie, die ver voorbij de strikt politieke sfeer gaat. De manier bv. hoe kreupelen, steeds vanuit de bemoeizucht van de sociale sector, invaliden werden, dan gehandicapten, daarna mindervaliden, nog later andersvaliden, om voorlopig te eindigen als personen-met-een-beperking,- is tekenend voor de fascinatie van de socio-politieke sector voor labelling en semantische inkapseling.
We denken ook aan de systematische kruistocht van de reguliere media die afgeven op het “racistische”, “vunzige”, “barbaarse” taalgebruik op het internet, en de filters die worden toegepast op de eigen publieksfora. Op die manier proberen de elites taalkundig greep te krijgen op de massa, via een progressief-ethisch alibi, met zelfs esthetische parfums van “goede smaak”. De missionarishouding dus. Het is nog maar een kwestie van tijd, voor ze bij de UNESCO er achter komen wat de term “voil Janet” precies betekent, en dan krijgt het Aalsters carnaval zijn genadeslag…
Tentensletje
Conclusie? De overheid moet zich niet moeien met taalkundige epuratie. Als ze de treinen op tijd laat rijden en sneeuw ruimt ben ik al heel tevreden. Taal is iets levend, en baart constant nieuw materiaal dat van onderuit ontstaat, als vulkanische lava. Elk jaar neemt de Dikke Van Dale zo’n 1500 woorden op die tot de omgangstaal zijn gaan behoren. Het zijn woorden die soms door individuen worden verzonnen, schrijvers of journalisten, maar dikwijls ook uit de volksverbeelding zelf voortkomen. Vooral de jeugd- en jongerentaal is een vruchtbare bron, denk aan het tentensletje van de editie 2010.
In essentie loopt het woordenboek dus steeds de feiten achterna. Dat kan ook niet anders: de officiële taal, het AN, is maar een schaduw van de levende taal. Maar de Orwelliaanse krachten in het bestel willen op de feiten vooroplopen en de maatschappij kneden via het plichtlexicon, het Groene of het Rode boekje, het geadministreerde discours.
Toen een brave academische borst recent meende dat het woord “makak” moest geschrapt worden, wees Peter de Roover er fijntjes op dat dit woord vrijwel enkel nog gebruikt wordt… als scheldwoord door Marokkaanse allochtonen onderling. Ook het woord “neger” is in onbruik geraakt, niet bij decreet maar spontaan. Het woord boerka maakt in de volksmond dan weer opgang als vuilzak voor gemengd huishoudelijk afval. De etymologie is dikwijls complex en verrassend, het gebruik onorthodox. Zo is het woord “bougnoul” van oorsprong een Arabische term die… “neger” betekent. Verbieden dan maar?
De enige autonomie die mensen nog rest, en waar ze fanatiek aan moeten houden, is de vrijheid om hun woorden te kiezen, vanuit de onderbuik, niet alleen vanuit het hoofd.
Het verzet tegen de standaard- en plichttaal is fundamenteel, en gelukkig springlevend. Om die reden maak ik me, zoals de lezer al heeft kunnen vaststellen, ook niet al te druk over de spellingregels, uitgedokterd door een clubje taalgeleerden ergens in den Haag. Nog veel minder maak ik me bezorgd over de door puristen zo gehate chat- en SMS-taal, of andere idiomen en tussentalen. Integendeel, ze vormen een vitaal tegengewicht voor de opgelegde new speak, de bureaucratische sluiers en het abrakadabra van de systeemtechnici.
Deze stille –en soms luidruchtige- strijd tussen spontane idiomen en cultuurtaal is, is veel belangrijker dan de immer verwaterende politieke tegenstelling. Het is dé nieuwe conflictzone van de postmoderne democratie, waar alles draait rond retoriek, taalspelen, demagogie en massamanipulatie.
De enige autonomie die mensen nog rest, en waar ze fanatiek aan moeten houden, is de vrijheid om hun woorden te kiezen, vanuit de onderbuik, niet alleen vanuit het hoofd. En er desnoods nieuwe te verzinnen als het vocabularium niet volstaat.
De schutting- en straattaal, samen met het kernproza dat op het internet floreert, is geen verbale restfractie maar vormt, integendeel, de stamcellen van het spraakweefsel. In ons geval het Nederlands. Als containerbegrip, niet als standaard. De vitale kern van een taal bestaat uit schimpscheuten en krachttermen, niet uit blabla.
Daar kan de Gentse burgemeester Termont, goede leerling van Stevaert, niets aan veranderen. Gelukkig maar, dedju.
00:09 Publié dans Langues/Linguistique, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politiquement correct, political correctness, george orwell, langue, linguistique, novlangue, philosophie, actualité, flandre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 avril 2013
Deux ouvrages récents sur les origines indo-européennes
Deux ouvrages récents sur les origines indo-européennes
Linguiste, M. G. Devoto s’est très tôt intéressé aux réalités historiques, psychologiques, esthétiques qu’expriment et reflètent les faits de langue. En particulier, il n’a pas cessé, depuis ses débuts, de préconiser une collaboration étroite entre grammaire comparée et disciplines historiques. Dès 1931, l’essai Gli antichi Italici montrait l’efficacité de la méthode appliquée à l’Italie pré romaine, et deux éditions n’en ont pas épuisé le succès. Son commentaire des Tables eugubines (1940) est tout nourri d’histoire. Depuis lors, il n’est pas d’année qui n’ait apporté (notamment dans la revue Studi etruschi) le témoignage de la réflexion à laquelle M. Devoto soumettait les résultats conjoints de la linguistique, de l’archéologie, des sciences du droit et des institutions. Dans ces travaux, l’auteur confère à la préhistoire indo-européenne une dynamique, une historicité qu’elle n’avait pas avant lui. Les Scritti minori, recueillis en 1958, sont ainsi comme la préfiguration du grand oeuvre qu’il restait à construire: le livre de doctrine sur les origines indo-européennes.
Un grand oeuvre dont, après vingt-cinq années de recherches, l’auteur considère sans illusion l’inévitable caractère d’inachèvement: «un chantier», écrit-il ; et d’en «prendre congé», comme ferait l’artiste d’un chef-d’oeuvre ambitieux, si longtemps médité, si longuement accru et travaillé qu’à la fin il dépasse son auteur et ne lui appartient plus. Mais il y a là un excès de mod estie, et l’on devine que le livre de M. Devoto est plus qu’un recueil de données. Il comporte une doctrine, à la fois souple et originale, tout en restant, de propos délibéré, ouvert à la critique et à la révision. Comparé au livre récent de M. P. Bosch-Gimpera, analysé ici même en 1963 (1), il en diffère et par la méthode et par les dimensions.
Fondé presque entièrement sur l’archéologie préhistorique, l’exposé de M. Bosch-Gimpera, quoique fortement personnel, laisse assez loin l’aspect proprement linguistique de la recherche, et seules quelques données très générales y demeurent sous-jacentes; mais le problème crucial, qui est de retrouver le processus historique de la diffusion des dialectes indo-européens, demeure en quelque sorte dilué dans l’extrême foisonnement des faits archéologiques. En somme, M. Bosch-Gimpera n’imposait pas au comparatiste des vues nouvelles. Au contraire, M. Devoto a résolu — et c’est là son grand mérite — d’affronter successivement tous les aspects du problème, d’en réunir et d’en organiser toutes les données, sans jamais négliger l’historique de la recherche. M. Devoto est convaincu, évidemment avec raison, que la diffusion de l’indo-européen ne saurait, dans la plupart des cas, s’être accomplie sans un déplacement notable de groupes de colonisateurs ou de conquérants; qu’en outre, ces groupes d’hommes ne peuvent avoir imposé leur langue à l’exclusion de tous les autres éléments culturels, qu’ils soient de nature intellectuelle (faits sociaux, religieux, psychologiques) ou matérielle (outillage, céramique, armement, usages domestiques et funéraires). Des premiers, l’archéologie ne livre que des traces très indirectes; mais ils ont dû conditionner l’histoire du vocabulaire. Des autres, les témoignages livrés par le lexique sont plus fuyants; mais l’archéologie, là du moins où elle est suffisamment avancée, permet d’en restituer les modalités et les variantes avec une fidélité souvent surprenante. Le problème revient à déterminer dans quelle mesure, dans le cas des Indo-Européenes, vicissitudes de la civilisation, que révèle l’archéologie, peuvent correspondre avec les faits qui ont conditionné l’histoire linguistique.
Se situant au point de convergence de plusieurs disciplines qui relèvent de méthodes très différentes, pareille tâche présuppose un aménagement multilatérale des données retenues comme pertinentes. Mais M. Devoto a bien vu que le problème indo-européen étant un problème linguistique, l’enquête doit être orientée dans le sens qu’indiquent les faits de langue. Reste à savoir si l’auteur a opéré avec les faits linguistiques et avec les faits historico-culturels de façon à satisfaire à la fois les comparatistes et les archéologues, et s’il n’est pas inévitable que des faits aient été choisis et traités de manière un peu intentionnelle pour leur capacité de s’accorder les uns avec les autres. Il va de soi qu’en pareille matière, une tentative de solution ne va pas sans une forte part d’hypothèse, sans une sorte de démiurgie. On ne peut qu’admirer en tout cas l’étendue de l’effort déployé pour ordonner une matière aussi vaste et pour dominer un problème d’une complexité aussi décourageante.

Giacomo Devoto (Genova, 19 luglio 1897 – Firenze, 25 dicembre 1974)
Il n’y aurait pas proprement de «problème indo-européen» si l’on n’était à même d’établir l’existence d’une unité linguistique indo-européenne. Aussi est-ce à réexaminer la légitimité du problème, maintes fois mise en doute en ce dernier quart de siècle, que M. Devoto consacre son premier chapitre: reconstruction «structurale», esquissée dans ses grands traits, de l’indo-européen commun; rappel succinct des quelques faits relevant d’un état plus ancien, le «proto-indo-européen» (2); examen rapide du problème des rapports entre indo-européen et d’autres familles linguistiques — on sait qu’outre le sémitique et le finno-ougrien, on a noté des concordances lexicales jusqu’en chinois et en coréen: certaines ne sont peut-être pas fortuites, comme pour le nom du «miel» (chin. arch. *myet: i.-e. *medhu-) ou du «chien» (chin. arch. *k’iwen: i.-e. *k’won-), et posent la question d’antiques relations transasiatiquee et transsibériennes.
Le chap. II examine les données géographiques, anthropologiques et ethnologiques et fait l’historique des nombreuses controverses qu’elles ont soulevées. M. Devoto procède par éliminations successives, en ‘en tenant fermement à un principe simple mais rigoureux: sont à exclure a priori toutes les régions où des témoignages historiques ou linguistiques attestent ou font en trevoir que les populations de langue indo-européenne s’y sont progressivemeént établies à la suite de migrations, et où l’archéologie et l’épigraphie garantissent l’existence, jusqu’à des époques relativement récentes, de civilisations et de langues de substrat (Inde, y compris le bassin de l’Indus, Iran méridional, Caucase, Grèce, Italie, pays celtiques). L’aire qui demeure possible est limitée en gros par le Rhin, les Alpes, le bassin du Danube, les mers Noire et Caspienne; mais les confins orientaux, en direction des steppes, sont fuyants. Quant aux limites chronologiques, M. Devoto, avec raison, considère comme de date trop basse l’âge du Bronze de l’Europe centrale (débuts du IIe millénaire), mais le Mésolithique, qui a pourtant été proposé (avant le Ve millénaire), est visiblement trop haut (3).
M. Devoto estime le volume démographique des migrations comme étant en raison inverse de la supériorité technique ou politico-sociale des colonisateurs sur les colonisés. C’est dire qu’on ne doit pas s’attendre à en retrouver des traces archéologiques à la fois massives et très spécifiques. Aussi une grande partie du livre — et la plus personnelle — est-elle consacrée aux aspects techniques, idéologiques et sociologiques du monde indo-européen. L’auteur ne se fait guère d’illusion sur la vertu de la comparaison en ethnologie et en histoire du droit, et l’on ne peut qu’approuver sa prudence: la probabilité mathématique d’un morphème ou d’un sémantème n’a rien de commun avec celle d’un genre de vie ou d’une institution sociale ou religieuse, où la part de contingence est évidemment beaucoup plus grande.
En revanche, si faible que soit, par définition, la réductibilité de ses résultats à des faits d’ordre ethnique ou linguistique, l’archéologie est devenue au jourd’hui une science trop rigoureuse, trop objective pour n’être pas interrogé: c’est l’objet du chap. III. Selon M. Devoto, les éléments du décor d’une poterie peuvent être considérés comme des critères suffisants, car ils sont par nature non fonctionnels et reposent sur une tradition désintéressée, donc non contingente. Mais l’auteur ne marque pas assez nettement, peut-être, que si les groupements céramologiques n’ont guère de chance a priori de recouvrir des groupements linguistiques, c’est en vertu du fait d’expérience, méthodologiquement fondamental, que les conditions dans lesquelles se transmettent langues et éléments de civilisation sont radicalement différentes. Aussi M. Devoto ne renouvelle-t-il pas les imprudences des «lois» céramologico-linguistiques d’un O. Montelius ou d’un G. Kossinna, qui postulaient un parallélisme entre continuité culturelle (temps ou espace) et continuité ethnique, discontinuité culturelle et discontinuité ethnique. Et il ne cherche pas à identifier les expansions indo-européennes antérieures au IIIe millénaire, c’est-à-dire les expansions qui n’ont pas abouti à la formation des communautés historiques et qui n’offrent pas à l’historien un point d’arrivée où langue et culture soient indiscutablement associées. Ce que cherche avant tout à définir l’auteur, ce n’est donc pas la toute première communauté «proto-indo-européenne», insaisissable, mais plutôt un jeu de forces en mouvement, en partie antagonistes, propre à justifier l’éclatement culturel et linguistique postulé par l’histoire. De même que certains astres ont pu être identifiés par l’incidence de leurs mouvements sur l’ensemble d’un système, c’est par la dialectique des rapports entre traditions linguistiques et culturelles différentes que M. Devoto arrive à saisir l’existence d’une communauté indo-européenne. Ce jeu de forces, il en trouve le cadre, après bien des éliminations, et d’accord avec plusieurs préhistoriens (tels M. Bosch-Gimpera et Mme M. Gimbutas), dans le monde néolithique de la céramique rubanée. Celui-ci, on le sait, présente une relative uniformité entre le Rhin et l’Oder et entre la ligne Cologne-Magdebourg-Francfort-sur-Oder et le bassin de la Drave en Hongrie.
L’aire ainsi définie est vaste, notamment en direction de l’Ouest; et il s’agit d’une époque que les récentes datations au radio-carbone tendent à reporter au-delà du IVe millénaire. G. von Kaschnitz-Weinberg écartait la civilisation de la céramique rubanée, M. H. Hencken la restreint à l’une de ses composantes orientales. On pourrait craindre aussi que le caractère si particulier de la morphologie indo-européenne s’accorde mal avec l’hypothèse de populations nombreuses et dispersées, chez qui toute unité linguistique paraît vouée à une fragmentation dont il semble malaisé de placer les débuts vers le Ve ou même le IVe millénaire. Il est vrai que, d’une part, il ne s’agit pas, dans l’esprit de M. Devoto, d’identifier simplement les porteurs de la civilisation «rubanée» avec les porteurs de l’indo-européen, ni d’assimiler une certaine technique décorative — d’ailleurs dépourvue d’unité organique — à une tradition linguistique donnée. Et ce n’est que plus tard qu’apparaissent la plupart des phénomènes d’attraction, de résistance et d’expansion capables d’éclairer le problème des rapports entre le monde indo-européen et sa périphérie: pressions de l’extérieur et notamment du monde asianique et méditerranéen (spondylus gaederopus, céramique peinte, idoles anthropomorphes) mais aussi du monde nordique (civilisation de Rossen) ou occidental (civilisation du vase campaniforme); attractions et résistances exercées par des foyers extérieurs (Balkans, Thrace, Thessalie, Italie du Nord et du Sud); facteurs internes, foyers d’expansions futures (Hongrie et Silésie avec les civilisations de Jordansmühl, des amphores globulaires, de la céramique cordée; Bohême avec la civilisation d’Unëtice; de nouveau Hongrie et Silésie avec la civilisation de Lusace et l’expansion des Champs d’urnes). On le voit, ces phénomèn esse pour suivent jusqu’à l’âge du Bronze final. Après d’autres, M. Devoto attache une grande importance au dynamisme de la civilisation d’Unëtice, dont des éléments se retrouvent de la Pologne à la Roumanie, mais aussi, mêlés à des traits apenniniens, dans la culture lombardo-émilienne des «terramares». En réaction contre l’«anti-décorativisme» radical d’Unëtice, la civilisation des tumulus s’affirme surtout en direction de l’Occident où elle prépare l’expansion future de la civilisation de Lusace et des Champs d’urnes.
Or, on sait que ces dernières inaugurent en Europe le rite funéraire de l’incinération. Pour M. Devoto cet avènement marque un changement profond des conceptions eschatologiques: cette opinion ancienne paraît devoir être retenue dans certaines limites, en dépit des résistances qu’elle a rencontrées; mais souvent, et parfois très rapidement, les formes extérieures de l’inhumation et les croyances qui y sont attachées ont réagi sur l’incinération et ont tendu à la supplanter. L’auteur marque bien, en tout cas, que l’incinération n’implique, dans les lieux mêmes où s’élabore la culture de Lusace, ni une mutation ethnique ni de changements profonds de la civilisation: ainsi à Knoviz, en Bohême, on peut observer stratigraphiquement le passage graduel de la culture inhumante d’Unëtice à celle, incinérante, de Lusace. Il n’en reste pas moins vrai qu’ailleurs que dans ses foyers d’élaboration, l’incinération introduite par les porteurs des «Champs d’urnes» s’insère brutalement et globalement dans un horizon inhumant, et constitue dès lors le signe probable d’une immigration, peut-être numériquement faible, mais idéologiquement puissante. Ainsi, en Italie, le contraste entre Subapenniniens inhumants et Protovillanoviens incinérants est net à tous égards, quelque interprétation qu’on soit amené à donner de ce contraste.
Le chap. IV étudie la problématique des données linguistiques. La doctrine de M. Devoto est, on le sait, résolument progressiste: critique des conceptions généalogiques abstraites, exclusivement centrifuges, de la linguistique traditionnelle; vision très souple des relations entre mondes indo-européen et non-indo-européens; large utilisation des principes de la linguistique «spatiale». M. Devoto distingue ainsi des courants anti-indo-européens parallèles aux pressions extérieures reconnues par l’archéologie; les noms du «minerai de cuivre» (i.-e. *raud(h)o-) et du «bovin domestique» (*gwôu~), le système de numération duodécimal peuvent avoir été apportés par les mêmes courants de provenance anatolienne et mésopotamienne (cf. resp. sum. urud «cuivre» et gu «boeuf») qui ont introduit en Roumanie, en Thessalie, en Italie du Sud la céramique peinte; de même, le système vigésimal qui apparaît dans le monde celtique pourrait être mis en rapport avec le courant d’origine sud-occidentale représenté archéologiquement par la céramique campaniforme. Là où l’expansion indo-européenne rencontrait ces mêmes courants anti-indo-européens, il est arrivé que l’indo-européen, du moins en un premier temps, ne se soit pas imposé, et n’ait laissé à la langue de substrat que des traces isolées, lexicales ou morphologiques; il en est résulté, spécialement dans l’Europe méditerranéenne et en Anatolie, une frange de neutralisation que M. Devoto appelle péri-indo-européenne: il s’agirait en somme d’un processus amorcé mais non achevé d’indo-européisation. Cette notion permettrait d’expliquer la présence d’éléments indo-européens en étrusque, dans des parlers préhelléniques et asianiques, ainsi que des contaminations de traditions indo-européennes et «méditerranéennes»: des faits tels que gr. πννδαξ «fond de vase» à côté de πνθμήν, πύργος à côté de got. baùrgs «ville» mais aussi de médit. *parga-/*perga-, trouveraient ainsi leur explication.
Le chap. V dégage, par une étude exhaustive du lexique, les traits du patrimoine spirituel, institutionnel et technique. Un effort pour relier ce patrimoine notionnel aux réalités que fait connaître l’archéologie aboutit à de nombreuses explications de détail tantôt convaincantes, tantôt, il faut le dire, simplement ingénieuses. Si, par exemple, il existe un adjectif commun pour «mou, tendre» *mldu-) sans complémentaire pour «dur», c’est, enseigne l’auteur, que le premier avait dans cette communauté néolithique une valeur technique, et se référait à une certaine qualité de la pierre ou du bois les rendant propres à être façonnés: mais la non-aptitude n’est-elle pas aussi une valeur technique? De même, le rapport de lat. color avec celô «recouvrir» — on pourrait y ajouter celui, parallèle, de skr. varnah avec vrnóti — s’expliquer aipart la technique de la céramique peinte introduite dès une phase ancienne du Néolithique; mais l’indo-européen n’a de nom commun ni pour «couleur», ni pour« substance colorante»: M. Devoto ne craint-il pas que cette date soit beaucoup trop haute pour des faits suspects d’être des créations propres à chaque langue? V. h. all. hulsa, p. ex., ne signifie que «gousse».
C’est essentiellement dans les oppositions de nature sociale ou chronologico-spatiale des éléments du lexique que M. Devoto reconnaît le jeu des forces antagonistes qui exprime et explique tout à la fois les mouvements d’expansion indo-européens (chap. VI-VII). D’une part, le fait que les langues occidentales ont en commun un ancien vocabulaire agricole (dit «du Nord-Ouest») dont certains éléments se retrouvent dans les langues orientales (ainsi lat. arô: tokh. A âre «charrue») paraît confirmer l’antiquité de l’agriculture; mais celle-ci ne paraît pas avoir eu le caractère aristocratique de l’élevage. Sans doute, il est normal — et l’opinion avait été émise par A. Meillet — que les expéditions en direction de l’Orient, ayant traversé de vastes régions steppiques qui se prêtaient mal à une économie agraire, aient à la longue perdu une partie notable de ce vocabulaire; en revanche un semi-nomadisme a introduit des termes nouveaux liés de près ou de loin à l’activité pastorale (comme le numéral pour «mille» inconnu en Occident). On peut pourtant se demander si, dans certains cas, M. Devoto ne tend pas à s’exagérer l’antiquité du vocabulaire du Nord-Ouest, où il entre des mots isolés et de caractère anomal comme le nom de la «pomme» (osq. Abella, v. h. a. apful, etc.) ou de la «fève» (lat. faba, ν. h. a. bôna, etc.) et d’autres indiquant des traditions techniques acquises en commun, à une date qui peut être post-néolithique, comme le nom du «timon» (lat. têmô, etc.). Il demeure probable que certains éléments de ce vocabulaire sont de date plus récente et résultent d’une expansion dans des régions encore non ou imparfaitement indo-européisées: ne pourrait-on songer par exemple à la civilisation des tumulus, au Bronze moyen?
M. Devoto, dans plusieurs travaux antérieurs, a développé une théorie opposant un monde indo-européen «central», générateur d’innovations religieuses, économiques et sociales, à une périphérie vers laquelle seraient repoussés des éléments plus archaïques. Cette théorie, amplifiée, occupe le chap. VII. M. Devoto voit dans ces tendances révolutionnaires, de caractère essentiellement démocratique et collectiviste, l’une des causes profondes de la dislocation. Ce n’est pas à dire — le chap. VIII le montre abondamment — que des groupes archaïques déjà éloignés n’aient pu être rejoints plus tard par des groupes innovateurs, voire par des innovations lexicales isolées. M. Devoto pousse jusqu’au bout le principe de l’indépendance des isoglosses: les expéditions n’ont pas perdu tout contact avec la communauté restée sur place, non plus qu’avec d’autres groupes emigrants; et les communautés historiques représentent des synthèses, élaborées parfois tardivement, d’éléments porteurs de traditions non contemporaines. On reconnaît ici la fluidité des conceptions de l’école linguistique italienne, caractéristique notamment de M. V. Pisani. Mais si le principe est juste, et si cet assouplissement de la doctrine paraît historiquement nécessaire, l’application en est très délicate; il est à craindre que, sur ce point, la démonstration de M. Devoto ne suscite des résistances de la part des linguistes. On pourra trouver par exemple qu’il est accordé, d’une manière générale, trop d’importance aux isoglosses phonétiques, les faits de prononciation ayant une probabilité statistique beaucoup plus grande que les faits morphologiques. Et là même où l’idée générale paraît juste, il y aurait, dans le détail, des réserves à faire : ainsi, pp. 296 et 307, M. Devoto oppose à un nom animé *egni- du «feu», conçu comme une force agissante susceptible d’être personnalisée (cf. véd. Agnih), et maintenu dans les langues marginales, le nom inanimé, selon lui nouveau, *pür-, rattaché au verbe «purifier» (skr. punâti), conçu comme instrument de purification, et propre à l’aire centrale. Mais d’abord, on croira difficilement qu’un mot comme *pé∂2ur- n’appartient pas à la couche la plus ancienne du lexique, quand on considère qu’il apparaît en hittite avec une forme qui exclut un apport récent; car la conservation de la laryngale intérieure (pahkur, gén. pahhuenaš) semble exclure tout à fait qu’il n’ait pas été apporté en Anatolie par les premiers colons, autour de 2200/2000 av. J.-C. L’alternance r/n apparaît d’ailleurs dans des langues où l’analogie ne peut avoir joué aucun rôle, comme en germanique ou en arménien (hur «feu»: hn-oc «fourneau»). En outre, la forme *pe∂2- de la racine écarte tout rapprochement avec le groupe de skr. punâti où la racine a la forme *pew- (E. Benveniste, Orig. de la form des noms, p. 169).
Le chap. VIII, par lequel se clôt le volume, en constitue en même temps la conclusion et l’aboutissement. L’histoire de chaque grande communauté de langue indo-européenne s’y trouve reconstruite à la fois sur le plan archéologique et sur le plan linguistique, et la synthèse originale que constitue chacune d’elles, étudiée dans ses diverses composantes: superstrats indo-européens, adstrats anti-indo-européens, substrat indigène. Le courage et la loyauté scientifiques de M. Devoto se révèlent ici pleinement; M. Devoto ne s’est pas dérobé à l’obligation de reconstruire la préhistoire de chaque nation, et d’affronter le jugement d’une multitude de spécialistes. Il tire ainsi les conséquences extrêmes de sa doctrine, il en éprouve le bien-fondé. Le chapitre tout entier est d’un très vif intérêt. Aussi sera-t-on tenté de discuter çà et là avec l’auteur. P. 373, hitt. tuzziaš «armée» est donné comme équivalent à got. þiuda, ombr. tota «cité, peuple», etc., à l’appui du caractère «central» du hittite: mais, dans un livre que M. Devoto ne pouvait connaître (Hitt. et i.-e., pp. 123-124), M. Benveniste a montré que le mot hittite ne signifie à l’origine que «camp», ce qui écarte le rapprochement; le même ouvrage comporte en revanche bien des connexions nouvelles avec l’indo-européen «marginal»: hitt. â- «être chaud», skr. anti-, antikä «foyer, four», ν. irl. áith «id.»; hitt. allaniya- «suer», v. irl. allas «sueur»; hitt. hâ- «accepter pour véridique», lat. ô-men; h tt. hašša «foyer», osq. aasa, lat. âra, etc. Si les parlers anatoliens représentent avec le grec une tradition «centrale», la date très haute (avant 2.000 probablement) des migrations semble du moins exclure que les tendances innovatrices du monde central encore indivis aient eu le temps d’arriver à leur terme, et, tout en ne participant pas entièrement à l’archaïsme marginal, lexical et idéologique, de l’indo-iranien et de l’ensemble italique et celtique, le hittite et le mycénien demeurent archaïques de par leur date. J’hésiterais donc à mettre au compte d’innovations des termes comme hitt. watar (cf. myc. udo), myc. werege « Fέργει», etc.
Ce qu’on sait de la société mycénienne cadre d’ailleurs mal avec un aménagement démocratique des institutions; comme semble le reconnaître implicitement M. Devoto p. 382, si l’ancien *rëg- y a disparu au profit de Fάναξ, ce n’est pas parce que, dans le monde central, le « roi » avait déjà perdu son caractère aristocratique, mais parce que les rois minoens avaient un tout autre caractère que les chefs de tribus des sociétés néo-chalcolithiques de l’Europe centrale. Ce qui est vrai du monde slave, baltique, germanique ou illyrien vers 1500, 1000 ou même 500 av. J.-C. et plus tard encore ne l’était pas nécessairement autour de 2500-2000 av. J.-C.
Pp. 386-387 est à nouveau affirmée la théorie, due à M. Devoto et défendue du point de vue archéologique par M. M. Pallottino, d’une triple tradition à l’origine des peuples italiques. Sans engager ici une discussion approfondie de ces vues, archéologiquement défendables en effet, qu’il soit permis de présenter quelques remarques. Se baser sur le traitement des sonores aspirées pour établir une tripartition en «Protolatins» (cuit, des tombes à fosses), «Proto-Italiques» (Protovillanoviens, Vénètes) et Ombro-Sabelliens, c’est supposer que les traitements de l’époque historique étaient déjà ceux d’une protohistoire lointaine. Or, les traitements «protolatin» et sicule (Aetna), latin et vénète (aedês) et ombro-sabellique (Aefulae) peuvent présenter des stades divers d’une même évolution. Le fait que le vénète n’a pas participé au passage de la dentale à la labiale au voisinage de u, r, passage qui se conçoit mieux au stade spirant (cf. mon c. r. de G. Giacomelli, La lingua falisca, Latomus, XXIV [1965], p. 696), suffit à faire soupçonner que Latins et Vénètes étaient déjà séparés au moment où apparaissent les sonores. Et comment écarter ce stade spirant devant des faits comme wehô en face de uêxi , fingô ? Un mot comme figulus (de *ρίχ-εΙο-) ne montre-t-il pas que le -χ- avait encore une consistance au moment du passage de *-e- à -u- et que, par suite, la sonore intérieure du latin — et du vénète — est chose récente et résulte de répartitions délicates, propres à chaque dialecte? Le -t- de sicule Aίτνα, λίτρα ne peut-il vraiment être le témoin d’un très ancien *-th- «proto-italique» (ou, si l’on préfère, protovillanovien, cf. les découvertes récentes de Milazzo et de Lipari) qui tendait vers -t- au moment où les Grecs, vers le VIII-VIIe siècle, ont rendu ce phonème par -τ- et non par -Θ-?
Ce très bel ouvrage, dont la correction typographique n’est pas loin d’être parfaite, est pourvu d’une illustration archéologique de haute qualité, et d’autant plus précieuse qu’il s’agit le plus souvent de documents rares, qu’il faudrait aller chercher dans des recueils spéciaux. Le linguiste aura par là, pour la première fois peut-être, une vision concrète des groupements culturels que reconstitue l’archéologie dans les aires intéressées par le problème indo-européen. Des cartes très précises permettent d’ailleurs leur constante mise en place. On ne négligera pas, enfin, l’important lexique, qui groupe par catégories concrètes (termes généraux, activités mentales, familles, techniques, etc.) près de 1000 racines ou lexemes, et dont l’heureuse disposition permet d’apprécier du premier coup d’oeil l’extension de chaque élément dans les diverses parties du domaine.
* * *
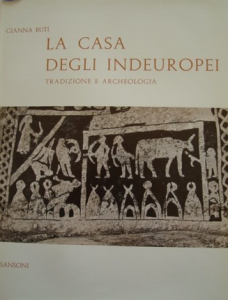
Dans la vaste et longue enquête qu’il a menée à travers le monde indo-européen, il est un dossier, et l’un des plus volumineux, dont M. Devoto a confié l’étude à une élève: celui de l’histoire de l’habitat. M.lle Gianna Buti a courageusement entrepris ce sujet difficile et elle a tiré, de l’étude parallèle des textes, des faits linguistiques et archéologiques une monographie originale, dont il n’existait aucun équivalent, et qui complète opportunément les Origini indeuropee. On peut d’ores et déjà affirmer qu’avec ce très heureux essai l’autrice se place parmi les spécialistes d’un ordre d’études qui a jusqu’ici été l’apanage des archéologues: l’architecture comparée des peuples indo-européens.
Une amicale préface de M. Devoto indique que, si le livre de M. S. M. Puglisi sur la civilisation apenninienne de l’Italie (paru dans cette même collection en 1959) marque, de la part d’un archéologue, une ouverture vers un échange fécond entre archéologie et linguistique, celui de M.lle Buti se veut une réponse du linguiste, aussi ouverte à cette même collaboration. L’ouvrage est richement illustré, et de belles planches, très originales, constituent un véritable album qui fait revivre l’histoire de l’habitat en Europe à travers l’espace et le temps.
Quelques pages liminaires examinent des points de terminologie et de méthode, et témoignent d’une vision très claire des difficultés du problème. A cet égard, il est intéressant de voir la pensée d’un maître revue et exposée par un disciple. Bien entendu, Mlle Buti réaffirme qu’il n’existe pas proprement de «maison indo-européenne», mais qu’il n’y a que «des manières indo-européennes d’appeler les maisons communes à tout un milieu naturel et culturel», chaque manière de dénommer la «maison», soit comme construction, soit comme lieu d’habitation, soit comme siège de la famille, dénote en face du concept «maison» une attitude psychologique différente et révélatrice. Une première partie est consacrée à cette étude de sémantique historique, et examin successivement l’habitation en cavités rocheuses — qui n’a guère laissé de traces lexicales, sauf peut-être dans le groupe de v. isl. kot, kytia, etc. —; l’habitation à demi creusée dans le sol, typique des communautés du Néolithique et du Bronze — qui s’exprime par la racine *(s)keu- de germ, hûs, serbo-cr. kùca, etc., et dont des témoignages classiques (Virgile, Strabon, Vitruve) ont gardé le souvenir —; l’habitation construite (en bois) au niveau du sol — qu’exprimerait la rac. *dem- «construire», cf. v. isl. timbr «bois de construction» comparé à all. Zimmer.
La seconde partie, fondée plus particulièrement sur les textes, étudie les problèmes de l’interprétation des faits: l’habitation dans la préhistoire indo-européenne, l’habitation dans la protohistoire de chaque peuple indo-européen en particulier (mondes indo-iranien, grec, etc.). On trouvera, p. 163, une curieuse carte donnant la distribution de la maison à atrium dans l’Europe centro-septentrionale.
Une bibliographie soignée et des index linguistiques et archéologiques rendront les plus grands services.
Les circonstances font que cette notice paraît au moment où M. Devoto vient de célébrer son soixante-dixième anniversaire et où, par suite, s’achève à Florence une carrière universitaire d’un éclat singulier. Les deux très beaux livres qui en sont le couronnement auraient sans doute mérité un recenseur moins pressé; du moins a-t-on essayé ici d’en faire saisir l’esprit, de mettre en lumière leur exceptionnelle puissance de reconstruction. Convaincants dans leurs démarches et séduisants dans la plupart de leur résultats, ils font grand honneur au talent et au dynamisme de M. G. Devoto et de son école.
Notes
(*) Giacomo Devoto, Origini indeuropee («Origines». Studi e materiali pubblicati a cura dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria), Florence, Sansoni, 1962, in-4°, xii-428 pp.; 74 figg. et XX pli. hors texte; à part, un fasc. in-4° paginé 425-521, 18.000 lires.
Gianna Buti, La casa degli Indeuropei. Tradizione e archeologia (même collection), Florence, Sansoni, 1962, in-4°, 207 pp., 37 figg. et XVI pli. hors texte, 10.000 lires.
(1) P. Bosch-Gimpera, Les Indo- Européens. Problèmes archéologiques. Préface et trad. de R. Lantier (Paris, 1961). Cf. J. Loicq dans R.B.PLH., XLI (1963), pp. 112 et suiv.
(2) Les comparatistes parlent d’habitude de «pré-indo-européen»; mais ce terme n’est pas conforme aux emplois actuels du préfixe pré- chez les historiens, et évoque des réalités antérieures à l’indo-européisation. Le terme «proto-indo-européen», sans équivoque, paraît donc préférable.
(3) Ceci n’implique pas, bien entendu, que l’on ne puisse supposer théoriquement l’existence, dès le Mésolithique ou le Pré-Néolithique de l’Europe orientale, par exemple, ou de régions encore situées plus à l’Est, de groupes d’hommes porteurs de dialectes se situant au début du continuum dont l’indo-européen conventionnel représente le dernier état avant le départ des premières expéditions «historiques»: une langue a toujours une histoire. Mais toute tentative de définition ou de localisation serait vaine, car il peut s’agir, à cette époque lointaine, de quelques tribus infimes possédant une culture matérielle identique à celle des tribus avoisinantes.
* * *
[Jean Loicq, Archéologie et linguistique historique. Deux ouvrages récents sur les origines indo-européennes. In: Revue belge de philologie et d'histoire. Tome 45 fasc. 1, 1967. Antiquité - Oudheid. pp. 86-96; de http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_1967_num_45_1_2671].
Jean Loicq
00:05 Publié dans archéologie, Langues/Linguistique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : indo-européens, livre, archéologie, traditions, europe, proto-histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 mars 2013
Mitteleuropa: Ursprung des Germanischen?
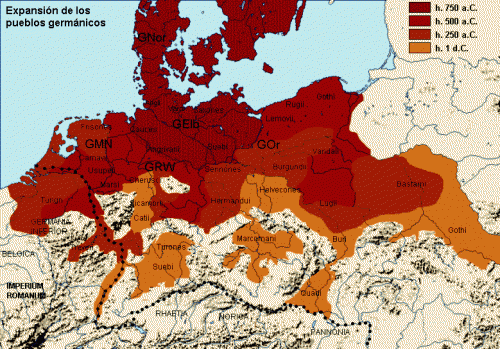
Mitteleuropa: Ursprung des Germanischen?
Ex: http://www.genius.co.at/
Buchbesprechung von Heinz-Dieter Pohl
Dieses ausgezeichnete Buch ist der Frühgeschichte des Germanischen gewidmet. Die germanische Sprachfamilie selbst, mit über 500 Millionen Muttersprachlern eine der größten der Welt, ist ein Glied in der indogermanischen (auch indoeuropäisch genannten) Sprachfamilie, die aus gut einem Dutzend weiterer Sprachen und Sprachfamilien besteht (u.a. Keltisch, Italisch [dazu Lateinisch, woraus Romanisch] Baltisch, Slawisch, Indoiranisch [woraus Iranisch und Indoarisch], Albanisch, Griechisch, Armenisch und einige ausgestorbene Sprachen). Ausgangspunkt der Darstellung ist das Protogermanische, also jene Sprachform, die dem eigentlichen Urgermanischen zugrunde liegt. Dieses hat ja bereits die „Erste“ oder germanische Lautverschiebung (in vorchristlicher Zeit, s.u.) durchgeführt; die „Zweite“ oder hochdeutsche Lautverschiebung ist erst später (frühestens um die Mitte des ersten nachchristlichen Jahrtausends) eingetreten. Von den beiden Lautverschiebungen waren die Konsonanten betroffen.
Der Verfasser vertritt die Auffassung, dass die erste Lautverschiebung im 5./4. Jhdt. v. Chr. einsetzt und schließlich im 1. Jhdt. v. Chr. abgeschlossen war. Das zugrunde liegende indogermanische Lautinventar wird traditionell beschrieben, also nicht im Sinne der „Glottaltheorie“. Insgesamt gesehen wird der Sprachzustand des Germanischen vor den Wanderbewegungen der Germanen, wie er beim Einsetzen der Lautverschiebung bestanden hat, erstmals zusammenfassend beschrieben; es ist die Zeit rund 600 (und vielleicht auch etwas mehr) Jahre vor den ersten überlieferten gotischen Texten. Erst mit der Lautverschiebung vollzieht sich der Übergang vom Protogermanischen zum Urgermanischen. Diese betraf die Verschlusslaute; die stimmlosen (Tenues) wurden zu Reibelauten (p t k kw > f þ χ χw),[1] die stimmhaften (Mediae) zu stimmlosen (also b d g gw > p t k kw) und die behauchten (Mediae aspiratae, also bh dh gh gwh) wurden zunächst zu stimmhaften Reibelauten und dann weiter zu b d g gw. Zur Zeit der Lautverschiebung war der Wortakzent (Betonung) noch variabel, d.h. jede Silbe konnte den Ton tragen und der konnte sich in der Flexion ändern. Die Tenues wurden im Inlaut nur dann zu stimmlosen Reibelauten, wenn der Ton auf dem vorangehenden Vokal lag, sonst wurden sie stimmhaft (z.B. gotisch broþar ‚Bruder‘ – fadar ‚Vater‘, althochdeutsch bruoder – fater aus indogermanisch *bhrater –*pətar, vgl. altindisch bhrata – pita).[2] Dies nennt man „Vernersches Gesetz“.
Vor dem Einsetzen der Lautverschiebung hat sich das Protogermanische überwiegend nur im Formensystem gegenüber den indogermanischen Grundlagen gewandelt. Im Bereich des Verbalsystems hat sich das Protogermanische (ähnlich wie das Protobaltische) am stärksten vom indogermanischen Zustand entfernt: erhalten geblieben ist nur das Präsens, das Perfekt wurde zum Präteritum schlechthin; die anderen Tempusformen wurden aufgegeben. Allerdings lebt das indogermanische Perfekt nur im sogenannten „starken“ Verbum (Typus binden – band – gebunden) sowie bei den „Präteritopräsentia“ (s.u.) weiter, bei den schwachen (vielfach abgeleiteten) Verben wurde ein neues „schwaches“ Präteritum gebildet (Typus sagen – sagte – gesagt), wegen des charakteristischen Dentallautes auch „Dentalpräteritum“ genannt. Seine historische Entstehung ist umstritten, seine Entstehungsgeschichte wird vom Verfasser anschaulich erklärt unter Berücksichtigung der verschiedenen Deutungsversuche; teils hat hier das Partizipium auf *-to-, teils das Verbum *do- ‚tun‘ eine große Rolle gespielt (auch das Keltische hat ein t-Präteritum, doch ob bzw. wie beide zusammenhängen muss offen bleiben). Als dritte Verbalklasse treten neben die starken und schwachen Verben die sogenannten Präteritopräsentia, die zwar aus dem indogermanischen Perfekt entstanden sind, aber als Zustandsverben mit resultativer Bedeutung im Germanischen Präsensbedeutung angenommen haben. Auch zu diesen wird dann ein „schwaches“ Präteritum gebildet. Eine Sonderstellung nehmen – wie in allen indogermanischen Sprachen – die hocharchaischen athematischen Verben ein; im Germanischen gehören dazu sein, tun, gehen, stehen und tun sowie wollen.
Das germanische Formensystem (Deklination und Konjugation) wird anschaulich dargestellt, in vielen Übersichten werden die protogermanischen Ausgangsformen den einzelnen altgermanischen Entsprechungen gegenübergestellt und es werden Vergleiche mit den indogermanischen Schwestersprachen gezogen. Auch die Wortbildung (v.a. die Wortzusammensetzung oder Komposition – typisch fürs Germanische im Gegensatz u.a. zum Lateinischen und Slawischen) und die Syntax (Satzlehre) werden behandelt. Interessant sind die Überlegungen zu den typisch germanischen Stilmitteln Metapher und Stabreim. Das Germanische macht nämlich von der Metapher in vorchristlichen Texten (Runeninschriften, Götter-und Heldendichtung) reichlich Gebrauch; diese Tradition setzt sich dann in der altnordischen Dichtung fort. Zwei Beispiele: widuhudaR ‚Waldhund‘ = ‚Wolf‘ oder Beowulf ‚Bienenwolf‘ = ‚Bär‘. Eine Besonderheit in der germanischen Lyrik ist der Stabreim, der in der gesamten altgermanischen Dichtung vorkommt. Historisch kann er erst zu der Zeit entstanden sein, als das Germanische bereits die Wortbetonung auf die erste Silbe des Wortes festgelegt hatte; im Laufe des Mittelalters wurde der Stab-durch den Endreim nach und nach abgelöst, doch Relikte haben sich bis heute erhalten – in Redewendungen wie Kind und Kegel oder mit Mann und Maus.
In Mitteldeutschland entstanden
Bezüglich des germanischen Wortschatzes zeigt Wolfram Euler, dass das Germanische in bestimmten Wortfeldern sehr altertümlich ist, so haben die Verwandtschaftsbezeichnungen (Vater, Tochter, Bruder usw.) und die meisten Körperteile (Auge, Nase usw.) und Tiere Entsprechungen auch in anderen indogermanischen Sprachen, einige Körperteile (z.B. Hand, Lunge, Zehe) und Tiere (z. B. Bär, Lamm) sind jedoch germanische Neubildungen. Solche gibt es Bereich des Grundwortschatzes nicht wenig, (z.B. Himmel, Erde, Schwert, Blut, trinken, Winter). Die Gründe dafür sind vielfältig.
Am Ende des Buches werden zahlreiche Textproben geboten, so u.a. die berühmte, auf August Schleicher zurückgehende Fabel „Das Schaf und die Pferde“ (indogermanisch – Proto-und Urgermanisch) sowie germanische „Vaterunser“-Paralleltexte (spätur-und protogermanisch – Gotisch – Althochdeutsch – Altenglisch – Isländisch), wodurch ein guter Einblick in die Struktur und Entwicklung der germanischen Sprachen geboten wird.
Auch zur „Urheimat“ der Germanen äußert sich der Verfasser. Er vermeidet allerdings aus guten Gründen diesen Terminus und spricht lieber vom Entstehungsgebiet. Auf Grund zahlreicher archäologischer Überlegungen und den Beziehungen zu den Kelten kommt Wolfram Euler zum Schluss, dass das Protogermanische im Mitteldeutschland entstanden ist (daher „mitteldeutsche Theorie“, auszugehen ist von einem Raum nördlich des Erzgebirges westlich der Elbe und südlich der Aller); dafür sprechen u.a. die alteuropäischen Gewässernamen, zu denen es in diesem Gebiet fließende Übergänge zu germanischen Namen gibt, die anderswo fehlen. Der zeitliche Rahmen ist ein Zusammenhang mit der Jastorf-Kultur (in der „vorrömischen Eisenzeit“). Skandinavien, das man lange (und auch ideologisch motiviert) für die „Urheimat“ der Germanen gehalten hat, ist also auszuschließen. Vielmehr kam es in Mitteleuropa zur Ausbildung und Entfaltung der germanischen Sprachen und Völker in einem Spannungsfeld zwischen dem Keltischen im Westen und Südwesten, Italischen im Süden, Baltischen im Nordosten und Slawischen im Osten.
Besonders hervorgehoben seien die zahlreichen schönen (farbigen) Abbildungen; schon auf dem Umschlag prangt der Sonnenwagen von Trundholm, der in die mittlere Bronzezeit zu datieren ist, auf der Vorderseite die „Tagseite“, auf der Buchrückseite die „Nachtseite“ des im Kopenhagener Nationalmuseum aufbewahrten Gefährts. Wer sich für die Frühgeschichte der Germanen und deren Sprache(n) interessiert, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen.
Anmerkungen
[1] Die Zeichen þ χ stehen für th (= englisches th) und ch.
[2] Die Buchstaben a o usw. bezeichnen Langvokale.
Die Auszeichnung der Langvokale findet sich nur in der den Abonennten zugänglichen PDF-Ausgabe
00:05 Publié dans archéologie, Histoire, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, germains, indo-européens, antiquité, antiquité germanique, langues germaniques, linguistique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 30 novembre 2012
El poder de una lengua es el poder de aquellos que la hablan

El poder de una lengua es el poder de aquellos que la hablan
Alberto Buela (*)
Cuando hablamos hoy del lenguaje y de la lengua, tema sobre el que hay miles y miles de trabajos escritos, sabemos que sigue vigente la enseñanza de Guillermo Humboldt, que cada idioma fomenta un esquema de pensamiento y unas estructuras mentales propias. Dime en que idioma te expresas y te diré cómo ves el mundo.
Así los hablantes modelan una lengua y ésta modela la mente proyectando un modelo de pensamiento que adquiere su expresión máxima en las identidades nacionales o regionales.
En el caso del castellano, éste es expresión de unas veinte identidades nacionales consolidadas.
Pero la lengua no es aquella aprendida, no es la segunda lengua. La lengua como lugar de poder es la asumida existencialmente. Y así podemos comprender como siendo 56 los países francófonos y 22 los hispanoparlantes, tenga el castellano mayor peso internacional que el francés.
Es que de los 56 países franco parlantes solo tres o cuatro han asumido el francés vitalmente, el resto lo usa por conveniencia. En general, para pedir créditos a la metrópoli.
Con el inglés pasa algo parecido pero en menor medida, porque el peso poblacional de los anglo parlantes es mayor (USA, Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda), no obstante la mayoría de los países que han declarado el inglés como idioma oficial, 59 en total, utilizan de hecho, infinidad de lenguas locales, que reducen la expresión de lo nacional en inglés. Por ej.: en Nigeria se hablan 521 lenguas. O en la India, ¿en qué expresa la identidad nacional el inglés, declarado idioma oficial? En nada.
Entonces, afirmamos que la lengua es un instrumento de poder cuando es asumida existencialmente, de lo contrario es un simple vehículo de comunicación como lo es el inglés en los aeropuertos.
En este sentido, el castellano como lengua occidental tiene una ventaja infinita respecto del inglés y del francés. Pues aun cuando supera al inglés, su máximo competidor, en más de cien millones de hablantes, posee la infinita ventaja que es efectivamente, la lengua oficial de veintidós naciones.
Si a ello le sumamos la proximidad lingüística del portugués (Brasil, Portugal, Mozambique, Angola et alii) se constituye una masa crítica de 800 millones de personas que pueden comunicarse entre sí sin mayor esfuerzo y, lo que es más importante, con estructuras mentales similares.
Esto no es un chiste, ni una anécdota, es un dato geopolítico de crucial importancia para comprender el mundo actual en profundidad.
Es incomprensible como de 31 Estados (22 hispano parlantes y 9 luso parlantes) no haya uno, al menos, que tenga una política internacional de defensa de la expresión lingüística luso-castellana.
Es incomprensible que los teóricos franceses, tan sutiles para otros asuntos, no se hayan apercibido que “la mayor presencia del español como lengua de trabajo internacional, garantiza una mayor presencia del francés, frente al inglés”.
En este campo específico estamos rodeados de un hato de ineptos. Ineptos que como el “rey cazador de elegantes” sostuvo en la última cumbre Iberoamericana de Cádiz que somos cuatrocientos millones los hispanoparlantes o como las autoridades del Instituto Cervantes que sostiene que somos 450 millones de castellano hablantes en el mundo ( cuando hoy sumamos 550 millones) y, para colmo de errores, que es la segunda lengua después del inglés: stultorum infinitus numerus est.
Más allá del rey Borbón y del Instituto Cervantes los usuarios habituales del castellano se han metido en el corazón del imperio talasocrático y así suman en USA, 45 millones. Este hecho bruto, real e indubitable ha hecho exclamar al estratega Samuel Huntington en El Reto Hispano, uno de sus últimos trabajos: “los estadounidenses están aceptando que se convertirán en dos pueblos, con dos culturas (anglo e hispana) y dos lenguas (inglés y español)…. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, cada vez hay más ciudadanos (sobre todo negros) que no pueden conseguir el trabajo o el sueldo que sería de esperar porque sólo pueden comunicarse en inglés… Si la expansión del español como segunda lengua de EE UU sigue adelante, con el tiempo podría tener serias consecuencias para la política y el gobierno”.
Es que el castellano además es un idioma pluricéntrico, pues a diferencia del inglés o el francés donde Londres y París se han constituido como centros de poder lingüístico, Madrid no tiene vocación de centralidad lingüística.
Es hora que nuestros gobiernos asuman una política internacional de la lengua. Que es castellano sea utilizado como lengua de trabajo de ámbito mundial. Informaciones recientes nos dicen que hoy en China el castellano es la lengua extranjera más estudiada. Que no hay un millón de hispano parlantes en Filipinas sino alrededor de diez millones. Que en Brasil el castellano no es considerada lengua extranjera en las universidades, pues su uso profesoral es habitual. En fin, contamos en definitiva con un instrumento geopolítico y metapolítico poderosísimo que no está explotado.[1]
(*) arkegueta, aprendiz constante
[1] Nobleza obliga y tenemos que rendir homenaje acá al esfuerzo del Prof. Renato Epifanio y quienes lo acompañan en el Movimiento Internacional Lusófono quien desde hace años viene trabajando en la consolidación del portugués como lengua internacional. (www.zefiro.pt)
00:05 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langues, linguistique, pouvoir linguistique, politique internationale, argentine, alberto buela, amérique latine, amérique du sud |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 05 novembre 2012
Mégalithisme et tradition indo-européenne

Mégalithisme et tradition indo-européenne
1. L’espace, le temps, la mesure dans le monde indo-européen
L’expression des notions d’espace et de temps est manifestement récente dans les langues indo-européennes, mais les notions elles-mêmes, et celle de leur mesure conjointe — base de l’architecture sacrée — certainement anciennes.
- 1.1. Les noms de l’espace et du temps dans les langues indo-européennes
L’expression des notions d’espace et de temps diffère d’une langue à l’autre, sauf quand elle a été empruntée, et surtout les termes qui les désignent présentent initialement une autre signification. C’est le cas pour le français temps. Il se retrouve certes dans l’ensemble des langues romanes, mais le latin tempus auquel il remonte est isolé en indo-européen. D’autre part, comme le montrent les formes tempête, tempérer, température, intempéries, le “temps qui passe” est initialement lié au “temps qu’il fait”, que distinguent les langues germaniques.
Il n’y a pas non plus d’ancien nom de l’espace, souvent désigné à partir d’une forme qui signifie “espace libre” comme le latin spatium ou la forme germanique d’où est issu l’allemand Raum. Certaines de ces formes peuvent s’appliquer au temps, comme le latin spatium et le français espace. Les seules désignations anciennes sont celles de l’espace libre, notamment la base sur laquelle reposent le latin rûs (campagne) et l’allemand Raum.
- 1.2 Espace et temps dans le système grammatical
Espace et temps ont une expression grammaticale. L’espace dans les compléments de lieu (lieu où l’on est, où l’on va, d’où l’on vient, par où l’on passe), dont certains sont à l’origine de cas grammaticaux comme l’accusatif d’objet, le temps dans les compléments de temps (instant ou durée), et les propositions subordonnées correspondantes. De plus, le temps s’exprime dans la conjugaison: le verbe indo-européen a un présent, *esti «il est» (grec esti, latin est), un prétérit ou imparfait *êst (grec ê), un futur, dit aussi “subjonctif” *eseti (latin erit). Au futur correspondent, dans le nom, le datif “prospectif” et les adjectifs correspondants, qui expriment la destination, la possibilité, l’obligation. Les 3 temps sont également à la base d’énoncés formulaires du Véda (le géant cosmique Prajâpati est aussi «ce qui fut» et «ce qui sera»), de l’Avesta (qui joue sur les temps du verbe être pour évoquer le présent, le passé et l’avenir, ou les vivants, les morts et les enfants à naître); selon l’Illiade, le devin Chalcas connaît «le présent, le passé et l’avenir»; et, à en juger par leurs noms, les 3 Nornes scandinaves Yrd, Verdandi, Skuld ont été mises en rapport avec les 3 temps. Le verbe indo-européen a de plus un “intemporel” *est (il est) employé pour les procès qui ne se situent pas dans le temps, comme les vérités générales.
- 1.3 La mesure de l’espace et du temps
Il existe une racine qui désigne la mesure de l’espace, “arpenter”, et du temps, “viser”, 2 procès dont la réalité physique diffère, mais dont le but est identique, et, par extension, diverses activités et diverses situations homologues comme “être en mesure de”, “prendre des mesures”. Elle possède 3 formes liées entre elles par des formes intermédiaires: *meH-, d’où *mê-, *met-, mêt-, *med-, *mêd-. Cette morphologie singulière indique une haute antiquité.
La première forme *meH-, conservée dans le nom hittite du “temps” (mehur) mais qui a évolué en *mê- dans les autres langues indo-européennes, est à la base du nom de la lune (conservé dans les langues germaniques, mais remplacé en latin par lûna) et du mois, que le français conserve aussi dans ses formes “savantes” (empruntées au latin) mensuel, trimestre, semestre. Elle l’est aussi dans le nom des mœurs, issu du latin môrês, pluriel de môs.
La deuxième forme *met-, mêt- est représentée en français par l’emprunt savant au grec mètre avec ses dérivés métrique, métrer, et ses composés diamètre, symétrie, géomètre, et certains composés en métro-: métrologie, métronome. Elle l’est également dans le nom de la mesure, et dans les formes savantes en mens- — immense, dimension, (in)commensurable, mensuration — qui se rattachent au participe passé mênsus du verbe latin mêtîrî: “mesurer” et “parcourir”. On note que cette forme comporte un n comme le nom de la lune (anglais moon, allemand Mond) et du mois (anglais month, allemand Monat).
Dans les langues baltiques, cette forme réunit les notions: “mesurer, en général” (lituanien matas: “mesure”), “mesurer le temps” (lituanien metas: temps, année), mais aussi “viser”, d’où “lancer” (lituanien mesti: “lancer”, d’où “jeter”) et “regarder” (lituanien matyti). Nous reviendrons ci-dessous § 2 sur cette indication significative.
La troisième forme *med-, *mêd-, est représentée en français par divers substantifs qui se rattachent directement ou non au latin modius (boisseau) comme muid, moyeu, trémie, moule ainsi que les invariants comme, comment, combien, qui se rattachent au latin quômodô, et les formes savantes en med-, médecin, remède, méditer, et en mod-, mode, modèle, module, modérer, modeste, moderne, modique. Cette troisième forme est également à la base du verbe “mesurer” des langues germaniques, allemand messen. Dans plusieurs langues, l’un de ses dérivés désigne le destin et, en vieil-anglais, le Dieu chrétien. S’y rattache aussi le perfecto- présent *môt (allemand müssen, anglais must) qui signifie initialement “avoir la place”, d’où “pouvoir”, puis “devoir”.
On voit par là que l’arpentage et la mesure du temps par visée, qui s’expriment par cette même racine, sont dans le monde indo-européen des activités à la fois anciennes et exemplaires. Or la mesure du temps est spatiale. Avant l’invention du sablier et de la clepsydre, qui permettent de mesurer directement une durée, on a mesuré le temps à partir des cycles temporels. Le cycle quotidien et le cycle mensuel s’observent directement, l’un par la place du soleil dans le ciel du jour, l’autre par l’aspect de la lune, et leurs extrémités sont directement saisissables. Mais la mesure du cycle annuel est moins aisée. On emploie à cet effet un instrument nommé gnomon.
2 – Le gnomon
La mythologie védique rend compte de la création de l’espace, ou plus précisément des 3 mondes, par les 3 pas de Vishnou, dieu mineur, mais qui deviendra l’un des 3 grands dieux des temps ultérieurs: son premier pas crée l’espace terrestre, son deuxième pas l’espace intermédiaire (ce que nous nommons l’atmosphère), son troisième pas le ciel. De la provient la fréquente identification de Vishnou au soleil. Mais comme le montre clairement le mythe de la décapitation de Vishnou, c’est la tête du dieu que l’Inde védique identifie au soleil, non le dieu lui-même. Reprenant une hypothèse antérieure, Falk (1987) a identifié Vishnou au gnomon. Le gnomon est l’artefact qui, dès l’époque védique, remplace l’arbre du soleil du stade antérieur de la mesure du temps. Avant de diviser le jour en sous-unités, les peuples primitifs ont cherché à déterminer les solstices. À cet effet, ils ont pris comme points de repère (que l’on vise, *met-) des sommets de montagnes ou des arbres: d’où par ex. l’arbre du Soleil (féminin) Saule, des Chansons mythologiques lettonnes (Jonval 1929 : 65 et suiv.). Ainsi la strophe 227:
Un tilleul touffu aux branches d’or
Pousse au bord de la mer, dans le sable;
Sur la cime est assise la Fille de Saule
Saule elle-même sur les branches d’en bas.
Un passage de la Taittirîya Samhitâ conserve le souvenir de cette notion. Après avoir indiqué que celui qui désire la splendeur doit offrir une vache blanche à Sûryâ (Soleil féminin, comme Saule, dont le nom est apparenté), et que le poteau sacrificiel doit être en bois de l’arbre bilva, le texte poursuit: «l’endroit d’où le soleil d’en haut naquit, c’est là que s’éleva l’arbre bilva. Le sacrifiant gagne la splendeur grâce au lieu d’origine du soleil». Ce “lieu d’origine” du soleil est manifestement l’arbre qui servait à déterminer le terme de sa course annuelle, comme l’arbre du soleil des chansons mythologiques lettonnes. Mais l’arbre du soleil a pu servir ultérieurement à subdiviser le jour, d’abord par la mesure de l’ombre portée, puis par sa place sur un cadran. Or c’est à partir de l’arbre que s’interprète l’image de la décapitation. Le soleil rouge du soir ou du matin qui s’éloigne de l’arbre pris comme repère peut être assimilé à une tête coupée qui se détache du tronc. Le gnomon en conserve parfois le souvenir: ainsi celui que décrit Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 36, 72-73: sa pointe était surmontée d’une boule dorée assimilée à une tête humaine.
À partir de ces considérations, j’ai proposé une nouvelle interprétation de la comparaison effectuée antérieurement par G. Dumézil entre la décapitation de Vishnou et celle du géant Mimir de la légende scandinave, ainsi qu’une étymologie du nom de Vishnou (Haudry 2001).
3 – Mégalithes et cycle annuel
Nombre de constructions mégalithiques d’Europe ont été édifiées sur la base du cycle annuel, comme le rappelle Vadé (2008 : 9 et suiv.):
«On sait depuis longtemps que Stonehenge n’est pas un monument isolé. Ce n’est que l’exemple le plus considérable d’une série de constructions circulaires de l’époque néolithique, soit en pierres, soit en bois, dont on trouve des vestiges depuis l’Europe du Nord jusqu’au Proche-Orient. En France, les enclos circulaires de plus de 100 m. de diamètre découverts à Étaples (Pas-de-Calais) et dépourvus de toute trace liée aux fonctions d’habitat présentent de fortes similarités avec les henges d’outre-Manche. Leur destination cultuelle, notent prudemment les archéologues, “ne semble pas totalement exclue”.
Mais c’est surtout en Allemagne qu’on a retrouvé de semblables constructions. La plus notable est le cercle de Goseck en Saxe-Anhalt, énorme ensemble tumulaire de 75 m. de diamètre, daté du début du Ve millénaire. Il comporte 3 cercles concentriques de terre et d’épieux et s’ouvre par 3 portails, dont l’un est orienté au nord et les 2 autres, au sud-est et au sud-ouest, correspondant au lever et au coucher du soleil au solstice d’hiver. Ensembles analogues au Portugal, avec les cercles de pierres de l’Alentejo également datés du Ve millénaire. Sensiblement à la même époque, en Nubie, l’important champ mégalithique de Nabta Playa, à une centaine de kilomètres à l’ouest d’Abou Simbel, comporte des alignements marquant le nord, l’est et le lever du soleil au solstice d’été ainsi qu’un petit cercle de pierres dont les couvertures correspondent également à l’axe nord-sud et à l’axe solsticial».
Il conclut :
«On est loin d’avoir fini d’établir la liste des lieux d’Europe comportant des “portes solsticiales” dûment aménagées. Une exposition récente [hiver 2006] sur L’Or des Thraces au Musée Jacquemart-André donnait l’occasion d’en découvrir plusieurs. Le plus spectaculaire est peut-être le monument mégalithique de Slantcheva Vrata dominant la “Vallée des rois thraces” près de Kazanlak. Plusieurs blocs empilés de main d’homme figurent une véritable porte, d’où l’on embrasse du regard tout le territoire sacré des rois odryses. Au moment du solstice d’été, le soleil passe par l’ouverture.
Il faudrait parler encore du site de Kokino en Macédoine (à 75 km environ de Skopje). L’archéologue Jovica Stankovski y a découvert en 2002, au sommet d’une colline de plus de 1.000 m. d’altitude, “un observatoire” daté d’environ 1800 avant notre ère. Selon l’astronome Gjorgii Cenev, de l’observatoire de Skopje, on y observait les solstices et les équinoxes, ainsi que la constellation des Pléiades, depuis d’énormes “trônes” de pierre face à l’horizon de l’est, où des repères marquaient les directions remarquables».
Mohen (2008 : 48 et suiv.) en cite quelques autres:

Newgrange (co. Meath, Irlanda).
«L’un des plus beaux exemples de cette intention précise est constituée par le couloir du grand tumulus dolménique de Newgrange (Co. Meath) en Irlande. Le fouilleur, M. Herity, constata en1963 qu’un linteau décoré, placé au-dessus et en arrière de la dalle de couverture de l’entrée du couloir, était en réalité le sommet d’une ouverture qui permaittait à un rayon du soleil levant de parcourir le couloir jusque dans la chambre. L’angle de cette ouverture, appelé roof-box, laissant passer le rayon lumineux rectiligne du soleil levant, le jour du solstice d’hiver, illuminait le fond du dolmen de plan cruciforme. Ainsi, comme le niveau du sol à l’entrée du couloir était à 2 m., en-dessous du sol de la chambre, lieu funéraire sacré, l’ouverture de la lucarne située au-dessus des 2 m., à l’entrée du couloir, permettait au rayon d’éclaircir la chambre. Impressionnés par cette précision, et le rôle du soleil solsticial, les archéologues ont pensé que les motifs spiralés ornant les grandes dalles disposés devant et à l’arrière du tumulus ou encore au pourtour de nombreux tumulus irlandais, dont ceux de Knowth ou de Dowth dans la même région irlandaise orientale, étaient peut-être en relation avec le mouvement perpétuel du soleil.
L’autre exemple qui prouve que l’observation des constructeurs préhistoriques de mégaliques pouvait être d’une précision extrême est celui de la dernière phase du monument de Stonehenge, système de fossés circulaires et de pierres dressées, délibérément orienté à partir d’un aménagement des trilithes disposés en U, entourant l’observateur situé au centre du dispositif en cercle, et visant à travers 2 pierres rapprochées l’endroit exact où le soleil apparaît à l’horizon, le jour du solstice d’été. Si cet axe de la phase 1, antérieure aux trilithes, reste approximatif en cadrant un angle entre 27°N et 24°N, le nouvel aménagement est très précis et juste; il est celui de la quatrième et dernière phase, contemporaine de l’implantation de 2 nouveaux menhirs laissant passer exactement la ligne d’observation allant du centre du site au point d’apparition du solstice d’été, selon l’axe principal de 24°N. Cette troisième phase est datée de 2250 à 1900 avant notre ère. C’est elle qui est encore, de nos jours, le cadre des célébrations contemporaines du solstice d’été».
Il mentionne également les alignements de Carnac, dont l’étude a permis à Alexandre Thom de déterminer l’unité de mesure utilisé, le “yard mégalithique” valant 0,829 m., et observe à ce propos:
«Il semble bien que le fait de dresser des monolithes réponde à un besoin de concrétiser un repère spatial que la lumière révèle, d’où l’attention particulière à l’emplacement topographique de la pierre dressée, d’où aussi les déplacements fréquents des pierres depuis les gîtes géologiques. L’endroit choisi pour l’implantation de la pierre est donc sans doute minutieusement choisi. La notion d’espace est de la même manière minutieusement calculée et se retrouve dans l’aménagement du territoire que les recherches archéologiques peuvent, dans le meilleur des cas, révéler. La place des mégalithes y est essentielle» (p. 51).
4 – Interprétations
Les mégalithes font l’objet de multiples interprétations, dont la conclusion de Mohen (p. 53) donne un aperçu: «Ces mégalithes et monuments sont des indicateurs pour ceux qui les mettent en œuvre. Ils reflètent des visions cosmiques de ces premiers agriculteurs mais aussi des préoccupations ancestrales et topographiques, liées sans doute à la légitimité du terroir et à la protection des aïeuls». Une précédente étude parue dans cette même revue (Haudry 2007-2008) fait écho à la théorie récente de Mahlstedt (2004), qui permet de donner un contenu à l’image indo-européenne du “ciel dans la pierre”, mais on s’en tiendra ici à leurs rapports avec le cycle annuel.
Le fait que les mégalithes apparaissent au Néolithique a suggéré une interprétation des rapports de leur disposition avec cycle annuel [cf. Culture mégalithique et archéoastronomie, Y. Verheyden, in Nouvelle École n°42, 1985]: ils auraient constitué un premier calendrier agricole. Cette utilisation est une possibilité qui ne peut être écartée. Elle est confirmée à l’âge du bronze par la présence, sur le disque de Nebra et à Kokino (Macédoine), comme on l’a vu ci-dessus, des Pléiades, dont Hésiode rappelle que leur lever et leur coucher constituait des signaux pour l’agriculteur:
«Au lever des Pléiades, filles d’Atlas, commencez la moisson, les semailles à leur coucher. Elles restent, on le sait, quarante nuits et quarante jours invisibles ; mais, l’année poursuivant sa course, elles se mettent à reparaître quand on aiguise le fer. Voilà la loi des champs» (trad. Paul Mazon).
Mais elle ne constitue sûrement pas la motivation initiale, comme l’observe Vadé (2008 : 12) :
«A-t-il fallu attendre l’agriculture, comme on le pense généralement, pour repérer les bornes de la course du soleil et en tirer parti pour le choix de certains lieux? Autrement dit, à défaut de structures d’observations construites, des orientations solaires privilégiées ne pourraient-elles être repérées dès le Paléolithique supérieur, à l’époque du grand art pariétal? Il semble bien, grâce aux recherches de Chantal Jègues-Wolkiewiez, que l’on puisse répondre par l’affirmative. On sait que cette chercheuse indépendante a provoqué une certaine sensation au cours de l’année 2000 en présentant au Symposium d’art préhistorique en Italie une communication sur la vision du ciel des Magdaléniens de Lascaux. On continue à discuter sur les interprétations qu’elle a proposées des peintures de la grotte.
Retrouver des constellations définies beaucoup plus tard et parler de zodiaque primitif ne va pas de soi. Mais ce qui n’est guère contestable, c’est la coïncidence de l’orientation de l’ancienne entrée de la grotte et de la direction du soleil couchant au solstice d’été. Il s’ensuit qu’à cette date le fond de la grande salle se trouve éclairé comme à aucun autre moment de l’année par les rayons du soleil vespéral. À partir de cette constatation, la chercheuse s’est demandé si d’autres grottes à peintures présentaient des particularités analogues. Elle a ainsi engrangé une moisson de résultats dont elle nous donne ici un échantillon concernant la grotte de Commarque — avec une étude parallèle sur la chapelle du château, où des fenêtres dissymétriques répondent au même souci de faire entrer la lumière solsticiale, tant cette préoccupation semble permanente dans les cultures restées traditionnelles».
Cette interprétation “traditionnelle” postule une continuité ininterrompue du Paléolithique au Moyen Âge comme l’indique Jègues-Wolkiewiez (2008 : 25) dans le résumé de son étude:
«Dans le sanctuaire magdalénien de Commarque, comme à Lascaux, le coucher solsticial d’été pénètre la grotte ornée par des artistes paléolithiques. À 50 mètres de distance dans l’espace, mais à douze millénaires de distance dans le temps, au Moyen Âge, les bâtisseurs de la chapelle Saint Jean du château de Commarque ont non seulement mis en valeur le coucher solsticial d’été, mais aussi le lever de l’hiver. Les rayons solaires pénètrent par les fenêtres situées de part et d’autre de l’autel et éclairent celui-ci.
Ces deux temps forts de l’année sont mis en valeur sur le territoire français par l’ornementation préférentielle des grottes ornées paléolithiques. Ce phénomène cyclique partageant l’année en deux temps avait non seulement été remarqué mais aussi exploité par les Paléolithiques. On peut se demander si la mise en scène des rayons de lumière du “roi du ciel”, lors de ces deux moments clefs de calcul du temps par les constructeurs catholiques du Moyen Âge ne relève pas du même concept que celui des païens du Paléolithique? »
Les conceptions sur lesquelles se fonde cette pratique remontant au Paléolithique supérieur ne sont pas attestées directement, faute de textes. Mais la continuité matérielle constatée rend admissible une continuité de la signification qui toutefois ne peut être précisée, et qui n’exclut pas la possibilité d’utilisations et de réinterprétations. La probabilité de la continuité est renforcée par ce que nous savons des courants traditionnels au sein du christianisme tels que les a mis en évidence Paul-Georges Sansonetti dans le numéro précédent de cette revue.
5 Mégalithisme et tradition indo-européenne
- 5.1 Conception et réinterprétation
Il n’est évidemment pas envisageable d’interpréter l’ensemble des données mentionnées ci-dessus par la tradition indo-européenne: certains lui sont extérieurs, notamment ceux du Proche-Orient et d’Afrique du nord, d’autres, comme l’orientation des grottes paléolithiques, lui sont antérieurs. Mais on peut déterminer les significations qui leur ont été attribuées, même s’il s’agit de la réinterprétation d’édifices conçus et mis en place par une population antérieure qui lui attribuait une autre signification.
- 5.2 Le symbolisme social de la “concordance”
La proximité formelle entre le nom indo-iranien du “moment propice”, du “temps fixé pour une activité” — *r(a)tu-, terme qui désigne par ailleurs le “modèle”, le “représentant idéal” —, et celui de la “vérité”, (a)rta-, suggère un rapport entre les 2 notions. Ce rapport est confirmé et précisé par le troisième représentant de la base *(a)rt-, l’adverbe grec arti, qui signifie à la fois “justement”, “récemment” et en premier terme de composés “convenablement”, “correctement”. Cet emploi est à la base d’une concordance formulaire que j’ai signalée jadis (en dernier lieu: Haudry 2009 : 84, 119, renvoyant à un travail antérieur) entre 3 composés grecs et leurs correspondants indo-iraniens, reflétant la triade héritée pensée, parole, action. Il semble que les Indo-Européens aient considéré la régularité des cycles temporels comme l’image cosmique de leur valeur suprême, la vérité, c’est-à-dire essentiellement de la “fidélité”, concordance entre ce que l’on dit (notamment ce que l’on promet) et ce que l’on fait. Les Yârya avestiques, génies des 6 saisons de l’année, sont des “modèles de vérité”, ashahe ratavô.
- 5.3 Concordance et retour annuel de la lumière
L’interprétation à partir de l’image cosmique de la vérité vaut pour la période récente de la période commune, celle dans laquelle les rapports sociaux se sont diversifiés et complexifiés, exigeant loyauté mutuelle entre les clans potentiellement rivaux, voire ennemis. Mais dans la phase la plus ancienne, on est encore loin de cette conception. La “concordance” entre l’événement humain, rassemblement, fête, sacrifice, et la manifestation cosmique, l’arrivée de la lumière solsticiale dans l’ouverture de l’enclos (initialement de la grotte), est l’essentiel. La concordance entre l’événement humain et l’événement cosmique avait sa signification en elle-même, et non par référence aux rapports sociaux. Dans la part de la tradition qui prend son origine dans le Grand Nord (Haudry 2006), le but du rite était d’assurer la régularité du cycle des saisons, et notamment le retour annuel de la lumière.
* * *
De: Hyperborée magazine n°10/11, 2011.
* * *
Bibliographie
FALK Harry, 1987: Vishnu im Veda, Festschrift für Ulrich Schneider: 112 et suiv.
JEGUES-WOLKIEWIEZ Chantal, 2008: Paléoastronomie à Commarque, VADÉ 2008: 23-45.
JONVAL Michel, trad., 1929: Les chansons mythologiques lettonnes, Paris: Picart.
HAUDRY Jean, 2001: Mimir, Mimingus et Vishnu, Festschrift für Anders Hultgård: 296-325.
HAUDRY Jean, 2006: Les Indo-Européens et le Grand Nord, Hyperborée, 3: 5-10.
HAUDRY Jean, 2007-2008: Du ciel de pierre au ciel dans la pierre, Hyperborée, 5 (2007): 18-24; 6 (mai 2008): 37-42; 7 (nov. 2008): 9-15.
HAUDRY Jean, 2009: Pensée, parole, action dans la tradition indo-européenne, Milan: Archè.
MAHLSTEDT Ina, 2004: Die religiöse Welt der Jungsteinzeit, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
MOHEN Jean-Pierre, 2008: Mégalithes européens de la préhistoire et orientations remarquables, in VADÉ 2008: 46-54.
VADÉ Yves (éd.), 2008: Étoiles dans la nuit des temps, L’Harmattan.
Jean Haudry
00:05 Publié dans archéologie, Histoire, Langues/Linguistique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean haudry, mégalithes, indo-européens, archéologie, protohistoire, histoire, linguistique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 19 septembre 2012
Bouckaert et al.: Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family
Bouckaert et al.: Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family
Onlangs lanceerde een team onder leiding van Remco BOUCKAERT (University of Auckland) een nieuwe hypothese inzake de oorsprong van de Indo-Europese talen.
Hieronder vindt u een paar recensies, alsook een link naar het oorspronkelijke artikel in Science zelf:
http://johnhawks.net/weblog/reviews/archaeology/recent/indo-european-anatolia-bouckaert-2012.html
http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2012/08/there-are-more-things-in-prehistory-than-are-dreamt-of-in-our-urheimat/
http://www.sciencemag.org/content/337/6097/957
Het betreft een soort intermediair standpunt tussen de Kurgan-hypothese van Gimbutas, Mallory en vele anderen en de Anatolië-hypothese van Renfrew, met de argumentatie dat de Indo-Europese talen wel degelijk hun oorsprong in Anatolië (ca. 8000 vot) zouden hebben, maar de huidige Indo-Europese "taalgroepen" in Europa waarschijnlijk in een later stadium (vanaf ca. 4000 vot) geleidelijk vanuit de Pontisch-Kaspische steppe naar Europa zouden zijn uitgewaaierd.
Op te volgen...
00:05 Publié dans anthropologie, Ethnologie, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, ethnologie, linguistique, indo-européens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 juin 2012
Il mondo anglosassone costituisce una civiltà totalmente diversa da quella europea continentale
di Francesco Alberoni
Fonte: il giornale [scheda fonte]

Il mondo anglosassone - Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Australia- costituisce una civiltà totalmente diversa da quella europea continentale. Fino al 1600 non c’era questa separazione. Ha inizio in Inghilterra con Hobbes e Locke, secondo cui lo Stato non sorge dal desiderio di realizzare valori più alti, ma come strumento per garantire ai cittadini la pace e la proprietà. Il sovrano non deve additare al popolo nobili mete, ma solo curarne gli interessi pratici. In seguito Adam Smith mostrerà che la ricchezza delle nazioni è prodotta da chi persegue fini egoistici. Bentham che anche quello che sembra altruismo è in realtà egoismo mascherato. Darwin che nell’evoluzione sopravvive chi ha un vantaggio competitivo sugli altri. Come in economia, dove vince chi sa fare meglio concorrenza.
Questo modo di pensare economicistico è stato esteso a poco a poco alla filosofia, alla sociologia, alla psicologia. Per spiegare come nasce una formazione sociale gli anglosassoni immaginano sempre che la gente si riunisca in vista di un vantaggio, faccia un calcolo dei costi benefici. Non è vero! Le chiese, i partiti, i sindacati, le nazioni si sono tutti formati attraverso movimenti collettivi a cui la gente ha aderito per una spinta ideale, mossa dalla fede. Pensiamo alla nascita del Cristianesimo,dell’Islam,al Risorgimento italiano. Gli anglosassoni non hanno mai fatto una teoria dei movimenti collettivi. E nemmeno una teoria dell’innamoramento perché scientificamente trovano assurdo che due persone si gettino l’uno nelle braccia dell’altro prima di sapere che vantaggio ne avranno, se saranno ricambiati e felici.
Nel Medioevo la gente considerava scientifico solo ciò che era scritto in latino ed aveva l’imprimatur della Chiesa. Gli anglosassoni molto semplicemente leggono solo quello che è scritto in inglese e che è pubblicato da loro. Negli ultimi decenni hanno imposto questo loro modo di pensare anche in Europa. Oggi anche da noi nessuna idea viene considerata scientifica se non è scritta in inglese e approvata dall’accademia anglosassone. L’alta cultura europea, la filosofia, le scienze umane non hanno più niente da dire, sono sparite, ammutolite. Domina solo l’economia coi suoi numeri,ma non ci sono più spiegazioni di ciò che succede veramente, e soprattutto non ci sono più idee, progetti, mete, piani valori.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Actualité, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monde anglo-saxon, langues, linguistique, politique internationale, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 novembre 2011
'Vergeet Engels, leer Duits!'
'Vergeet Engels, leer Duits!'
Staat het Europese Imperium op instorten? Wat onze eigen geblondeerde Edelgermaan uit Venlo betreft, die ons al langer onder Romeinse braspartijen gebukt ziet gaan, kan dat niet snel genoeg gebeuren: hij waant zich en nieuwe Claudius Civilis en wil de gulden terug. Knus Bataafs vergaderen onder de vertrouwde eikenboom, en dan met een hoog hek eromheen!
Eenogige gnoom
Maar de, net al iedereen in deze Bataafse contreien tot 1648, nog als onderdaan van de Roomse keizer geboren Oer-Nederlander Rembrandt heeft niet toevallig Claudius Civilis op zijn voor het Amsterdamse stadhuis bestemde schilderij van de samenzwering als eenogige gnoom afgebeeld.
In elk geval lijkt nu definitief een einde te komen aan het bewind van een premier die qua losbandigheid en decadentie inderdaad de meest beruchte Romeinse keizers naar de kroon kon steken. Maar net als Nero, die wel theatraal met zijn dolk zwaaide maar uiteindelijk geen zelfmoord durfde te plegen en daarvoor de hulp van een slaaf nodig had, tracht Berlusconi voorafgaand aan de eigen ondergang nog tijd te rekken, in dit geval om zijn louche financiële zaakjes te regelen. Als maffiabaas doet hij immers niet voor zijn Britse mede-mediamagnaat Murdoch onder.
Grote golfkarretjesvriend
Tot zover de grote golfkarretjesvriend van onze eigen gewezen Normen-en-Waarden-premier Jan Peter Balkenende.
Zoals men in Rome anno 68 na de liederlijke Nero de brave senator Galba tot keizer kroonde, heeft men in het huidige Rome nu de hoop op de brave senator Mario Monti gezet, die zijn vacanties niet tussen hoge vrouwelijke borsten maar tussen hoge Zwitserse bergen pleegt door te brengen. En zoals we uit 'Asterix en de Helvetiërs' weten: de Zwitsers zijn al sinds de dagen der Romeinen geen liefhebbers van wulpse hompen vlees maar van klef gesmolten kaas.
Eén waarschuwing is overigens op z'n plaats: ook Galba verloor indertijd binnen een paar maanden letterlijk zijn hoofd, omdat hij het woedende gepeupel niet de verlangde brood en spelen wist te geven, waarin Nero Berlusconi met zijn tv-shows wel zo goed in was. Na twee op Galba volgende nieuwe potentaten eindigde het Vierkeizerjaar met een machtsgreep van de norse veldheer Vespasianus, die zijn eerste belangrijke ervaringen als legioenscommandant in Germanië had opgedaan. Mondt ook de huidige chaos in Rome in een Germaans gekleurde militaire dictatuur?
Twee snelheden
Nu de nood op zijn hoogst is, blijkt waar in Europa de werkelijke macht ligt - en hoe zichtbaar die verschuift. Het Europa van twee snelheden, dat er officieel nooit mocht komen, is er al, met de Britten, als gevolg van de eeuwige eigen neiging tot halfslachtig van twee walletjes eten, buitenspel.
In de Eurozone geeft Berlijn de toon aan, omdat dat zich nu geen financiële lankmoedigheid meer veroorloven kan: het al langer aanwezige feitelijke machtsverschil tussen Duitsland en Frankrijk - ooit naar buiten toe en as met twee gelijkwaardige wielen - laat zich niet langer verbloemen.
Mentaal Germanen
Politiek-mentaal kleven daar grote risico's aan - de perceptie van een 'Duits dictaat' heeft in Griekenland al tot hysterische reacties geleid - maar puur beleidsmatig hoeven we met een rangorde Duitsland-Frankijk-Engeland niet ontevreden te zijn. Van alle drie lijkt Duitsland nu eenmaal het meest op ons: wat dat betreft zijn ook wij mentaal Germanen.
De financiële degelijkheid van de Duitsers is nu van hoger gewicht dan de AAA-status-glorie van de imagogevoelige Fransen. En het politieke belang dat de Fransen aan staatsinvloed op economisch terrein hechten valt, tegen de achtergrond van de machteloosheid van de democratie versus de dictatuur van de markt, op zijn beurt weer verre te prefereren boven het ontspoorde casinokapitalisme van de Engelsen.
Kostschooljongetje Cameron
Ook op persoonlijk vlak verdient de nuchtere Duitse domineesdochter Merkel de voorkeur boven een streberig product van de Franse meritocratie - maar Sarkozy op zijn beurt weer duidelijk boven dat van een negentiende-eeuwse klassemaatschappij, het geaffecteerde kostschooljongetje Cameron, waar onze eigen corpsbalpremier het zo goed mee vinden kan.
Dat zou eveneens voor links Nederland, dat terecht aan een rechtvaardige verdeling van aardse goederen hecht, de oriëntatie moeten bepalen. Liever de 'Rijnlandse' christendemocraat Merkel - 'geen enkele manager is tienmiljoen euro waard' - dan de Angelsaksische 'socialist' Mandelson: 'ik voel mij totaal niet ongemakkelijk bij mensen die onsmakelijk rijk worden'. Ik wel. En ik hoop velen met mij.
Of, om een uitspraak van Margaret Thatcher om te keren: alle neoliberale financiële ellende kwam de afgelopen dertig jaar uit het Westen. De redding zal nu van de andere kant moeten komen. Go east, young men!
De huidige interne Europese machtsverschuiving zou ook consequenties voor ons vreemdetalen-onderwijs moeten hebben. Vergeet het Engels, leer Duits. De gisteren andermaal door De Volkskrant tot machtigste Nederlander gebombardeerde werkgeversvoorzitter Wientjes heeft al herhaaldelijk op het belang daarvan gewezen, maar kan geen ijzer met handen breken zolang Rutte en De Jager zelf linguïstisch in gebreke blijven.
Wat Nederland nodig heeft, is niet een premier die de lof zingt van New York, maar eentje die kennis heeft van Berlijn. Maar misschien krijgt, als de huidige gedoogcoalitie binnenkort onder Knots druk op de villasubsidie uiteenspat, Den Haag al snel een welkome herkansing.
Overigens liep het ook met Claudius Civilis in het Vierkeizerjaar politiek niet goed af.
Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en columnist van vk.nl.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langue anglaise, langue allemande, europe, actualité, politique internationale, affaires européennes, pays-bas, linguistique, apprentissage des langues |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 10 juin 2011
Siberian language

English translation - Nat Krause, http://store.barcodesforless.com
The Siberian language or Sibirskoj (сибирской говор) is standardised form of certain Northern Russian dialects. It was developed by the Volgota cultural group in 2005.
Historical survey
Historically, there were various East Slavic dialects spoken in the area north of Kiev and east of Polotsk which were distinct from Ukrainian and Belorussian, but also distinct from the Moscovite dialects that later became standard Russian. A distinct Novgorod dialect appeared in 11th or 12th century and was used in writing for several hundred years. The evolution of literary languages based on those dialects, however, was, as in other places, conditioned by the local political situation, and Novgorod was part of the Russian empire from the 15th century onward. When Mikhail Lomonosov layed the groundwork for the standardised literary form of Russian, it was influenced by only a few the empire's old Slavic dialects; in addition, it borrowed numerous words from Old Church Slavonic and other European languages. Thus, it is possible to construct independent literary languages based on dialects spoken in other places.
The Old Siberian dialect, originating from northern Russian and Cossack dialects, was in use by the end of 17th century in parts of Siberia. Unlike in Ukraine and Belarus, the people of Russian Siberia did not develop a literary language during the course of the 19th century. Throughout the 20th century the use of Siberian dialects declined dramatically because of the establishment of the Russian language as the official national language and because of the depopulation of Siberian peasantry which was basis of the dialects. However, in the middle of the 20th century, several linguistic research attempts dealing with the Siberian dialects were started.
In 1873, P. A. Rovinski's Remarks on the Siberian Dialect and a Dictionary of the Same was published by the Siberian News Department of the Russian Newspaper Society. Regarding the Old Siberian dialect, Rovinski wrote: "The Eastern Siberian dialect has a particular phonetic system and many distinct grammatical forms. The dictionary contains three thousand local words unknown in the general Russian language". The modern project of collecting grammatical rules to form the standard this language was undertaken by Yaroslav Zolotaryov, while the other members of the Volgota cultural group assisted in collecting vocabulary from the various rural areas where the dialects in question are spoken.
Phonology
Siberian phonetics has the norms of a north Slavic dialect: the "g" (Г) is pronounced as a stop ([ɡ]), even though this corresponds to the Ukrainian and Belarussian fricative [ɣ] in many words In Siberian, the letter shcha (Щ) is unused, and native speakers of the Siberian dialects sometimes have difficulty pronouncing the sound it represents, [ɕː], in Russian. In Siberian, the letters O (O) and Ye (E) are always pronounced fully as [o] and [jɛ], respectively, whereas, in Russian they are generally pronounced as reduced vowels when they occur in unstressed syllables.Siberian often simplifies consonants clusters into simpler sounds, particularly at the end of words; for example, Russian starost corresponds to Siberian staros and Belarussian voblast corresponds to Siberian voblas.
Siberian also lacks the letters Yo (Ё) and E Oborotnoye (Э), which were added to Russian in the 18th century.
Grammar
The grammar of Siberian is similar to that of Russian. The notable distinctive aspect Siberian grammar concerns conjugation. In Siberian, it is typical for an ending which includes the sound [j] between two vowels to be simplified into one vowel without [j]. Examples of this are Russian znayet, corresponding to Siberian znat, and Russian krasnaya, corresponding to Siberian krasna.
14:50 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sibérie, russie, langues, linguistique, langues slaves, slavistique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 mai 2011
Le latin, langue d'Europe
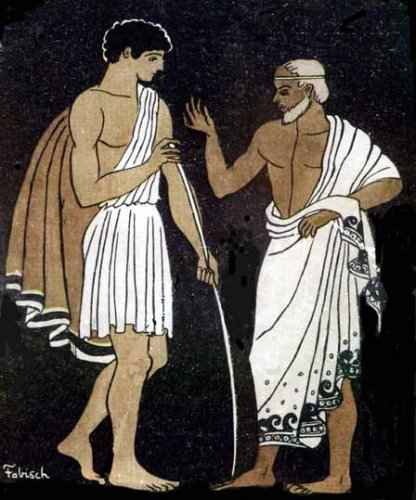
Le latin, langue de l’Europe
par Claude BOURRINET
Le problème qui nous occupe ne peut se présenter pour l’heure que comme un questionnement permanent, en attendant mieux. Celui de l’Europe étant loin d’être résolu, il est peut-être prématuré de se préoccuper de sa langue future. Pourtant, dans le combat que mènent les partisans d’une Europe unie et consciente de son identité, l’interrogation qui porte sur le vecteur par excellence de l’expression, de la pensée, de l’émotion et plus largement du rapport au monde est cruciale.
Qu’est-ce en effet qu’une langue, si l’on écarte le postulat a minima qui veut la réduire à une fonction uniquement communicationnelle (ce qu’est devenu, au demeurant, le basic-englishdans le contexte de globalisation actuel) ? Un rapport de force ? Une expression identitaire ? Un matériau à partir duquel on crée de l’imaginaire et de la pensée ? L’esprit même de création d’un peuple ?
Nécessité d’une langue commune
L’être de l’anglais est commercial et impérialiste. Il est l’affirmation d’un état de chose et d’une volonté. Les jeunes Anglo-Saxons, qu’ils soient anglais, américains, australiens ou néo-zélandais, étudient rarement une autre langue que la leur. Pourquoi « perdraient »-il un temps qu’ils peuvent consacrer à l’apprentissage du mercantilisme ? C’est d’ailleurs, en deçà de la Manche, l’argument suprême qui place l’anglais à la première place dans l’enseignement des langues, aux dépens des autres langues, jugées superfétatoires.
L’adoption de l’anglais comme langue européenne serait un acte d’allégeance au Diktatéconomico-civilisationnel anglo-saxon, et l’abdication devant la suprématie mondiale de la troisième fonction, celle des producteurs, des marchands et des matérialistes.
Ces remarques ne remettent nullement en cause la légitimité de l’anglais comme expression d’un génie particulier, qui a accru la richesse culturelle commune, en nous offrant des Shakespeare, des Kerouac, des Ezra Pound.
L’erreur qu’il faut éviter est d’abord de penser une hypothétique langue européenne en termes communicationnels, uniquement destinée à mettre en rapport des locuteurs, dans une sorte de neutralité technique qui nierait les racines et les spécificités (ou qui les comprendrait comme couleurs locales). Cette langue, manifestement, ne serait pas européenne (au sens identitaire), mais celle de l’ennemi, car ce serait l’anglais – efficacité oblige. Tout l’argument relatif à l’adoption d’une langue ou de plusieurs en Europe se réduit pour l’heure à des considérations malthusiennes d’économie – mais on voit bien que nous avons affaire à un véritable choix idéologique, qui va parfois contre le vou des familles.
Faisons-nous cependant l’avocat du diable. L’anglais pourrait-il devenir la langue de la communauté, comme le latin fut celle de l’Empire romain dans sa partie occidentale (avec le grec dans la partie orientale), ou comme il l’est de factodans l’Empire indien, à la suite d’un colonialisme autrement plus stérile que ne l’a été celui des Latins ?
Que nous apporte la civilisation anglo-saxonne ? Rome nous offrait sa haute culture, ses écrivains, en même temps que la civilisation grecque. Et, malgré notre dure défaite, nous, les Celtes, nous avons été vaincus par des hommes qui nous étaient assez proches (pour toutes sortes de raisons, qui tiennent à la langue, au substrat indo-européen, aux vertus louées dans les deux camps).
Certes, mais il se peut malgré tout que par là aussi les Anglo-Saxons nous soient « proches »…
L’Empire romain s’est instauré en plaçant dans son orbe des sociétés dont il respectait la personnalité, donc la langue, et, last but not least, en maintenant un ordre du monde encore largement conditionné par la Tradition, par la déférence à un cosmos immuable qui régissait les hommes, la nature et les dieux. L’Imperiumromain était constructeur en même temps que conservateur, mais il n’était pas destructeur (même s’il a exterminé les druides pour des raisons politiques).
Lorsqu’on envisage une langue, il faut nécessairement prendre en considération sa portée historique, le destin qu’elle traduit. Elle est ce qui éclaire notre chemin, derrière et devant. L’avenir appartient au peuple qui aura la plus longue mémoire, dit Nietzsche.
Or, actuellement, adopter l’anglais comme langue européenne, c’est nous suicider en tant que civilisation, c’est adopter une épistémèdestructrice qui nie toutes les valeurs fondant l’Europe métahistorique.
À mon sens, la seule langue qui signifie quelque chose par rapport à ce que nous désirons être, à ce que nous devons être, c’est le latin. Les Juifs ont ressuscité l’hébreu et en ont fait leur langue nationale et les musulmans ont gardé l’arabe classique comme langue religieuse et culturelle.
Techniquement, il n’existe aucune difficulté à restituer à nos écoles la tâche d’enseigner la langue (modernisée) de nos ancêtres, langue qui est restée vivante chez les doctes et les ecclésiastiques, même de langue germanique ou slave, jusqu’à la fin du XVIIIesiècle, et qui facilitait les échanges entre peuples de l’Europe (1).
Il ne s’agit pas ici du reste de louer le latin comme simple outil pédagogique, favorisant la rigueur et l’attention, et comme propédeutique à un certain nombre de connaissances linguistiques, culturelles ou historiques. Il est bien question du latin comme langue de civilisation européenne.
Persistance vitale des langues nationales
L’Europe, en tant qu’entité géopolitique, culturelle et religieuse (la Chrétienté) a disparu comme telle, déchirée par les poussées nationalistes du XVIesiècle, dont la Réforme a été l’expression et l’occasion. Les monarchies européennes les plus puissantes, confortées par la montée de la bourgeoisie commerçante et administrative, se sont appuyées sur le renforcement des langues nationales pour asseoir leur pouvoir et illustrer le rayonnement culturel de royaumes où le sentiment patriotique s’enracinait progressivement.
L’histoire de chaque langue nationale révèle l’existence de disparités dont les causes sont complexes, dues tout aussi bien aux aléas de l’Histoire (l’absence de conquête par Rome de la Germanie, d’une grande partie de la Bretagne ou de l’Irlande, par exemple) ou de caractères intrinsèques (d’ordre ethnique, géographique, territorial – par exemple, la proportion de populations préceltiques dans certaines régions, les contraintes favorisant telles activités économiques, la proximité ou la coexistence (due parfois à une conquête, à une occupation, comme celle des gallo-romains par les Francs). Le modelage d’un idiome appartient aussi à cette part de mystère qui entoure la constitution du génie d’un peuple. Qu’une langue, par des sonorités propres, le façonnage d’une personnalité même des mots du lexique, leur couleur, leur épaisseur, leur ombre, présente comme un être vivant une physionomie reconnaissable entre toutes, que le rythme lié à l’enchaînement de la syntaxe, aux accents, aux longueurs des syllabes, suscite une chanson propre, identifiable même par ceux qui en ignorent le sens, voilà qui est certes miraculeux (au sens d’admirable, digne d’être remarqué comme l’une des beautés de l’être humain) et suffit à expliquer qu’un tel terroir linguistique, pour peu qu’il ait été labouré, ait pu engendrer ces monuments que sont les ouvres littéraires, la poésie, le théâtre, le roman, etc.
La langue d’une nation est devenue ce que nous avons de plus intime en nous, et ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle la langue maternelle, puisqu’elle porte en elle les premiers sons que nous ayons entendus sur la Terre, dès notre naissance. L’enfant, l’adolescent, l’être mûr en sont nourris. Elle nous est comme une seconde nature. C’est par elle qu’un individu ou une communauté exprime ses certitudes, ses hésitations, ses souffrances, ses espoirs, et tous les accents de la beauté, de l’amour, de la haine ont été proférés avec ce qu’elle nous octroyait de substance.
Loin de déplorer la disparité linguistique dans le monde en général, et en Europe en particulier, il faut s’en réjouir, car elle a permis l’affirmation de sensibilités diverses, de visions du monde différentes.
Une langue ne s’épanouit pas seulement dans la clarté glorieuse des productions artistiques. Elle irrigue la vie la plus banale. Bien qu’Européen, je ne peux me savoir autrement que français, traversé par ma langue, une langue si charnelle que j’ai l’impression qu’elle a fait mon corps autant que ma sensibilité; et lorsque je parle de corps, je le conçois aussi généreusement absorbant et restituant que les géants rabelaisiens, dont la nourriture provient autant des mots habitant un paysage (à tel point que les noms de fleuves – Garonne, Rhône – sont souvent originaires d’une langue et d’une civilisation disparues, comme le mot Sindhu– Indus – est attribué à la langue buruski, qui serait l’unique descendante de la langue harappéenne parlée vers 1800 av. J.-C.), nommant une occupation humaine, traçant (tatouant ?) une Histoire, même fantasmée, sur la peau terrestre, que précipitent sur le monde des envies impérieuses avec un estomac, un sexe, une curiosité intellectuelle jamais rassasiés, car vivants.
La langue est liée à l’être qui la jette au monde comme l’inscription de sa propre nécessité et en reçoit sa confirmation.
Les langues dites nationales (on inclura dans cet ensemble les langues dites « régionales », comme le catalan, le basque, le breton, l’occitan, le corse etc.) ne sauraient disparaître sans que n’anéantisse notre rapport profond à la vie. Il est impensable de les remplacer par une langue continentale, car ce serait éradiquer non seulement nos racines, mais aussi arrêter la sève qui provient de la Terre pour nourrir notre être-au-monde.
Le système langagier européen doit donc être pluriel, ce qui ne signifie pas qu’il se présente sur un même plan.
Le latin, langue administrative, politique et hiératique
L’Europe sera autant un acte de la volonté que la résultante naturelle d’une longue Histoire. Comme Alexandre en Phrygie, face au noeud gordien, il faudra trancher. Nous ne sommes pas devant un cas de figure où une langue impériale serait le véhicule et la traduction de l’hégémonie d’un peuple, ou dans celle où elle serait commune naturellement, depuis des siècles, à un ensemble, comme le grec l’était de l’Empire byzantin (ou du moins de son élite).
Une fois admise la nécessité de maintenir (voire d’encourager) les langues « nationales », il s’agit de se demander ce que le latin occuperait comme fonction dans l’Europe unifiée et indépendante que nous appelons de nos voeux.
À mon sens, elle serait ce qu’ont été le mandarin en Chine et le sanskrit en Inde, c’est-à-dire d’une part une langue de l’administration et, de l’autre, une langue sacrée.
Il n’est pas impossible qu’à la longue, au bout de plusieurs générations, si l’enseignement d’une langue qui a été nôtre dans le passé est prodigué sérieusement (c’est là le coup d’épée auquel il été fait allusion précédemment), le latin parvienne à produire des ouvres aussi profondes que celles qui ont éclos sous l’emprise des langues nationales. Seul l’avenir peut en témoigner. Avant cette heureuse assomption, il est tout à fait possible, et nécessaire en ce qui concerne la première tâche, d’instituer le latin comme langue administrative et politique de l’Europe, et, pour ce qui est de la deuxième tâche, comme langue sacrée.
Dans le premier cas, on peut s’appuyer sur l’exemple de la Chine, qui a forgé son homogénéité par l’instauration d’une administration élitaire, dont le sommet était l’Empereur. L’intégration dans cette bureaucratie hiérarchisée se faisait par des concours extrêmement sévères, reposant sur des épreuves culturelles, où la poésie et les arts n’étaient pas omis. Cette sélection avait pour vertu de consolider une langue riche, sophistiquée, comme le ciment d’un ensemble géopolitique extrêmement hétérogène (l’Empire du Milieu), où des poussées centripètes se faisaient sentir de façon permanente. La caste des scribes, dotée d’une éthique et une philosophie solide (le confucianisme) portait sur ses épaules la destinée de l’Empire.
Dans le cas du sanskrit, nous avons une langue qui était, est encore, l’expression d’un savoir sacré immémorial, véritable « empire de la pensée » (Michel Angot) transmis par la caste des brahmanes. La sanskrta vac (« la parole ajustée ») est une fixation volontaire et en partie artificielle de l’ancien parler indo-ârya, qui cohabite avec environ cinq cents langues (les prakrits), idiomes vernaculaires parfois issus de langues dravidiennes. Il n’est pas rare en Inde de maîtriser plusieurs langues, y compris dans leur pratique savante.
L’exemple du sanskrit n’est pas sans nous poser des problèmes, notamment parce qu’il transmet un corpus mystique, ésotérique, exotérique, littéraire, philosophique, scientifique etc., et que le latin n’est plus en mesure d’en proposer un, d’autant plus que la cassure anthropologique (toute relative cependant) qu’a constitué le christianisme a rompu le fil avec la Religion originaire de l’Europe. Il n’est pas envisageable, sans doute, de réactiver tel quel le paganisme de l’Antiquité, ce qui serait d’ailleurs ridicule. L’approche païenne du monde se module en fonction des circonstances historiques et se traduit par des expressions aussi riches et variées qu’est le monde. C’est aux générations nées de la Révolution européenne de résoudre cette question. Néanmoins, il n’est pas impensable que le latin devienne aussi la langue sacrée des Européens dont la fraction la plus sensible à une approche mystique du monde s’emparerait pour créer une nouvelle « théologie » (dans un sens antéchrétien) (2).
Préparer l’Europe latine
Il n’est certes pas improbable que finalement ce soit l’anglais, aussi pauvre et commercial soit-il, qui l’emporte, et que son adoption finale par l’Europe des marchands, très active actuellement, achève le processus actuel qui conduit à la perte de notre indépendance.
Cependant, comme la fin du Kali Yuga (3) n’est pas perceptible à vue humaine, et que nul ne saurait en saisir la date, ni le commencement de sa négation, il est préférable de remplir, dans la mesure de nos forces et de nos possibilités, notre Dharma(4). Notre Devoir est donc d’inscrire nos enfants dans les cours de latin, de nous mettre nous-mêmes au travail, de l’apprendre et de l’approfondir. Cela à titre individuel. Sur le plan métapolitique, il serait judicieux de créer une association européenne de promotion du latin comme langue de la communauté, et d’intervenir de façon permanente dans ce sens.
Bien sûr, un tel projet semblera très modeste (peut-être trop décalé) en regard de combats politiques (voire métapolitiques) plus ambitieux et exaltants, dans la mesure où il redouble des pratiques qui existent déjà dans les familles ou au sein du monde de l’éducation. Pourtant, il s’agit de bien saisir l’importance de ce qui est en jeu. L’impression domine depuis quelques années, malgré l’existence d’un courant critique vis-à-vis de l’héritage de deux mille ans de christianisme, et face à la nécessité de susciter une Europe renouant avec son être, qu’un certain enlisement, un ressassement certains de thèmes et de discours nous amènent à désespérer de l’avenir. C’est comme si nous manquions en même temps de point d’attaque, et de levier pour soulever la masse qui nous barre le chemin. Ajoutons à cet état affligeant les divisions qui paralysent le mouvement européen identitaire. Or, si l’on se fixait un objectif consensuel tel que la défense et l’illustration du latin comme langue communautaire, avec un souci réel de réussir à fédérer les volontés (au-delà de nos « frontières » nationales, cela va de soi), d’approfondir la signification métapolitique d’un tel choix, de travailler ce qui concerne le génie propre de cette langue, en identifiant tout ce qu’elle nous apporte et nous apporterait, quitte à la moderniser (c’est une affaire de spécialistes, et il doit en exister chez nous), de sensibiliser les familles et les jeunes générations à cette tâche, nous serions peut-être en mesure de tenir là un moyen de parvenir à un résultat concret (évaluable). Nous aurions par ailleurs un excellent prétexte à rencontres, à débats, à éclaircissement riches et variés (car une langue ouvre des perspectives infinies). Sans compter l’écho qu’aurait, par delà les limites de notre camp, une telle affirmation culturelle, qui intéresserait beaucoup de monde (à commencer par les latinistes et les hellénistes).
Pour finir, essayons de nous rappeler combien de peuples ont conquis leur indépendance en engageant une grande partie de leur combat sur la question de la langue.
Claude Bourrinet
Notes
1 : Rien n’empêche d’ailleurs les peuples de l’Est de garder une langue slave comme le Russe, ce qui serait légitime d’un point de vue civilisationnel.
2 : Bien entendu, le grec et le sanskrit seraient considérés comme des langues « sacrées », peut-être étudiées dans des sortes d’« écoles cathédrales » païennes ou d’ashrama(communautés « religieuses » et philosophiques indhoues).
3 : Selon les Hindous, l’univers connaît, comme chez les Grecs, différents âges (yuga), dont l’évolution suit une courbe déclinante, jusqu’à l’âge du chaos (« l’âge de fer », l’âge de la déesse Kali, la déesse de la destruction). Selon certains, cette décadence est inévitable, et comme son achèvement ne peut aboutir qu’à un renouveau, un rétablissement de l’ordre cosmique, il est préférable non seulement de ne pas réfréner ce qui ne manquera pas de chuter, mais aussi de hâter cet effondrement.
4 : « Dharma désigne ce qui soutient et élève. Donc le principe fondamental à la base de toutes les manifestations de la vie est, au sens réel, le dharma. Ce principe est ce que nous appelons Dieu ou Vérité. Dharma signifie donc la connaissance de la grande Vérité qui soutient toutes choses. C’est seulement à la lumière de cette connaissance que la vie d’un être humain peut être harmonieusement ajustée dans ses aspects les plus divers. Ainsi le but du dharma est d’infuser dans toutes les activités de la vie la splendeur, la béatitude et la paix de la réalité divine. » ( Swâmi Râmdâs, « Présence de Râm », in Jean Herbert, Spiritualité hindoue, Albin Michel, coll. « Spiritualités vivantes », 1972, p. 117). « Du point de vue scientifique, le Dharma est la propriété caractéristique; du point de vue moral et légal, c’est le devoir; du point de vue psychologique et spirituel, c’est la religion, avec tout ce qu’elle doit impliquer; d’un point de vue général, c’est la justice et la loi; mais par-dessus tout, c’est le Devoir. » (Bhagavan Das, « The Science of Social Organisation », Ibid.)
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=1441
00:05 Publié dans Ecole/Education, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : latin, langue, linguistique, philologie, philologie classique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 février 2011
Geocultura: il potere della lingua
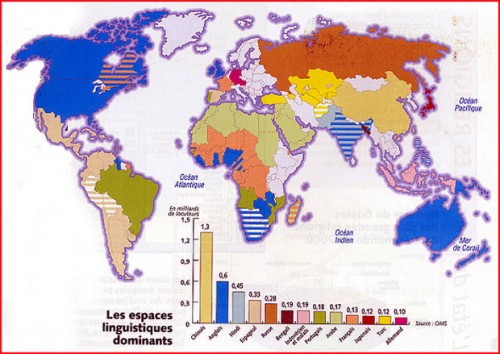
Geocultura: Il potere della lingua
Uno strumento internazionale
che può fare a meno delle politiche di Stato
Ex: http://www.eurasia-rivista.org/
I nordamericani, ovvero, quegli esseri umani che quantificano tutto, dove il gigantismo è il dio monocorde di una sinfonia noiosa come lo può essere quella di misurare tutto ciò che si fa, non lasciando posto al fare o smettere di fare “perché così lo voglio”, come accade con noi del “piccolo mondo”. Gli americani hanno appena eseguito una nuova indagine sull’uso e l’apprendistato del castigliano negli Stati Uniti (loro preferiscono chiamarlo spagnolo).
Le cifre sono le seguenti: 850.000 studenti universitari stanno imparando lo spagnolo, mentre che il francese lo seguono solo in 210.000; tedesco 198.000, giapponese 74.000 e cinese mandarino 74.000. Inoltre, circa 40 milioni di individui parlano con fluidità la lingua di Cervantes e 4 milioni di nordamericani Wasp (White anglosaxon protestant [Bianchi anglosassoni protestanti]) che non sono di origine ispana parlano correttamente lo spagnolo.
Continuando sempre con le cifre, questa nuova indagine mostra che l’89% dei giovani ispanici nati negli USA parlano inglese e spagnolo, contro il 50% delle generazioni precedenti. Si calcola che per il 2050 gli ispanici, vista la crescita della loro popolazione che supera in figli la media degli americani e dei neri, costituirà il 30% della popolazione. L’indice di natalità degli americani è del 1,5%, quello dei neri del 2% e quello degli ispani del 3,5%.
Nel mondo ispanico degli Stati Uniti è avvenuto un cambio di mentalità ed è che i genitori considerano come un vantaggio il bilinguismo dei loro figli, contrariamente a quanto accadeva un paio di generazioni fa. Così, qualche decennio fa i genitori chiedevano ai loro figli di non parlare lo spagnolo perché pensavano che il loro inserimento e progresso negli Stati Uniti sarebbe stato più veloce, mentre che adesso stimano che la pratica del bilinguismo offre loro maggiori possibilità di lavoro e d’integrazione sociale.
Questo cambio di paradigma ha dato luogo a un boom negli studi ispanici in America con il consueto effetto moltiplicatore che produce nelle società che gli sono periferiche come può esserlo il suo cortile posteriore: l’America ispanica.
D’altra parte, lo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione come Internet ha contribuito a questa forte espansione della pratica del castigliano in Nord America. Gli immigranti ispanici sono in contatto quotidiano con la loro cultura di origine, con le loro pratiche quotidiane, con i loro usi e costumi.
Com’è politicamente giudicato questo fenomeno dagli Stati Uniti? Dagli Stati Uniti un analista politico e strategico come Samuel Huntigton in un recente studio che ha per titolo La sfida ispana, afferma: «Il costante flusso d’immigranti ispani verso gli Stati Uniti minaccia di dividere questo paese in due popoli, due culture e due lingue. Diversamente dai precedenti gruppi d’immigranti, i messicani e gli altri ispani non si sono integrati nella cultura americana dominante, bensì hanno formato le proprie enclave politiche e linguistiche – da Los Angeles fino a Miami – e rifiutano i valori anglo protestanti che edificarono il suolo americano. Gli USA corrono un rischio se ignorano questa sfida. »
Da parte sua il politologo della Boston College, Peter Skerry, sostiene: «Diversamente dagli altri immigranti i messicani provengono da una nazione vicina che soffrì una sconfitta militare da parte degli Stati Uniti e si stabiliscono, soprattutto, in una regione che, in un altro tempo, formava parte del loro paese (…) Gli abitanti di origine messicana hanno la sensazione di stare in casa propria, fatto che gli altri immigranti non possono condividere.» Cosicché, quasi tutto il Texas, il Nuovo Messico, l’Arizona, la California, il Nevada e l’Utah formavano parte del Messico fino a che questo paese li ha persi come conseguenza della guerra d’indipendenza del Texas, nel 1835-1836, e la guerra tra il Messico e gli Stati Uniti, nel 1846-1848.
E, cosa si fa da parte del mondo ispano americano? In sostanza non si fa nulla, questo fenomeno lo si lascia muovere in una specie di forza delle cose per cui ciò che bisogna dare, si darà e ciò che bisogna cambiare, si cambierà. Non esiste, per quanto ne sappiamo, nemmeno una sola politica di Stato, di nessuno dei ventidue Stati iberoamericani sull’argomento dell’espansione, consolidazione e trasmissione del castigliano tra gli immigranti negli Stati Uniti. Questi sono lasciati alla loro sorte e arbitrio e non ricevono nessun aiuto né appoggio per consolidare la pratica di questa lingua.
Il fatto è che la dirigenza politica iberoamericana (eccetto lo straordinario caso di Lula) non vede nell’esercizio e nella pratica dello spagnolo una molla di potere internazionale, che in un universo di 550 milioni di parlanti la fa diventare la lingua più parlata al mondo. Non vedono nemmeno il prodotto lordo che abbiamo appena esposto.
Il caso Lula si pone di là della consuetudine, come lo è la dirigenza politica iberoamericana nel suo insieme, poiché lui da buon discepolo di Gilberto Freyre ha potuto affermare: «La cultura ispanica è alla base delle nostre strutture nazionali argentine e brasiliane, come vincolo transnazionale, vivo e germinale nella sua capacità di avvicinare le nazioni ». Nel mese di settembre 2008 firmò il decreto legge sull’”Accordo ortografico della lingua portoghese” che semplifica e unifica la forma di scrivere il portoghese tra gli otto Stati che lo utilizzano come lingua ufficiale (Portogallo, Brasile, Angola, Mozambico, Capo verde, Guinea Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor Orientale). Un accordo che egli ha qualificato strategico. Attualmente, in Brasile sono 12 milioni gli studenti che praticano correttamente lo spagnolo, il fatto è che l’uomo ispano capisce e, con un minimo di sforzo, parla con naturalità quattro lingue: il gallego, il catalano, il portoghese e lo spagnolo.
Il multi o polilinguismo con il quale il castigliano convive da sempre – la vita in Spagna e l’avventura dell’America sono state prove definitive – ci sta indicando che oggi, laddove il bilinguismo diventa così indispensabile come l’acqua, la nostra lingua si trova nelle migliori delle condizioni di qualsiasi altra per servire l’umanità nel suo complesso. E la loro cecità non gli consente di apprezzare che hanno fra le mani, senza avvalersene, lo strumento più prezioso per quanto concerne la politica internazionale.
Alberto Buela, UTN- Fed. del Papel, membro del Comitato scientifico di Eurasia. Rivista di studi geopolitici
(trad. di V. Paglione)
00:18 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langue, linguistique, langues du monde, espagnol, langue espagnole, actualité, soft power, métapolitique, géoculture, géopolitique, argentine, amérique latine, amérique du sud, alberto buela |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 octobre 2010
Indo-European Esperanto?
Indo-European Esperanto?
Ex: http://www.counter-currents.com/
The fragmentation of prehistoric Proto-Indo-European (PIE) into a bewildering array of mutually unintelligible European (and, more broadly, Caucasian—Armenian, Iranian, Indic, Tocharian, and Anatolian) languages has severely hobbled the cause of white survival. Language and cultural differences have divided an essentially homogeneous population into separate nationalities and sub-nationalities incapable of networking effectively, rendering all of them easy prey to the depredations of hostile organizations and governments. It is ironic that aliens are regarded as fellow citizens by the vast majority of whites, while many whites, including their own cousins in the old country or the new lands, are categorized as “foreigners.” Insurmountable language barriers play a large role in this.
How to remove these barriers while simultaneously preserving robust local and regional identities poses a problem. But the first order of business is to establish effective cross-cultural communication between concerned racialists presently speaking a Babel of incomprehensible languages.
In this light, a quixotic proposal from a handful of Spaniards calling themselves the Dnghu Group—also known as the Indo-European Language Revival Group—to revive Proto-Indo-European as the lingua franca of the European Union merits examination. The Dnghu Group has established a presence on the World Wide Web to promote its objectives.
A thousand or more planned languages have existed over the past two centuries, approximately a dozen of which developed a community of speakers of some kind, however small.
The most successful artificial language is the globalist-oriented Esperanto, invented by Ludwig L. Zamenhoff (1859-1917), a Jewish ophthalmologist who, like Carlos Quiles, the creator and prime mover behind the current proposal, developed his system while a medical student. A street in Tel Aviv, Israel, is named in Zamenhoff’s honor (redaction: and in Brussels also,.. although the road is awful and the architecture appaling...).
Despite its “success,” Esperanto has not exactly caught on. According to one estimate, in 1927 there were 128,000 Esperanto speakers (0.006% of the world’s population), while today there are 2 million, or 0.033%—an increase, to be sure, but still a negligible number of people.
Modern Indo-European (MIE)
The proposed language, “Modern Indo-European” (MIE)—or, interchangeably, “Europaio”—is a reconstructed, auxiliary language derived from work originally done in 2006 by Quiles and María Teresa Batalla. Quiles, a native Spaniard in his late twenties, is currently a medical student at the University of Extramadura (Universidad de Extramadura), which is located in a remote region of west central Spain bordering Portugal. Maria Batalla was a fellow Extramdura student at the time.
In October 2009 Carlos Quiles published the 824-page second edition of A Grammar of Modern Indo-European, issued by CreateSpace, a print-on-demand subsidiary of Amazon.com and described as “a complete reference guide to a modern, revived Indo-European language.” The outdated first edition of Quiles’ grammar can be downloaded for free here.
The Dnghu Group hopes that Modern Indo-European will become the official language of the European Union in twenty to forty years, much as revived Hebrew became Israel’s official language after a similar span of time. The Revival Group also hopes that eventually MIE will become the dominant auxiliary language globally. Initially, however, it would be taught to Europeans as a second language.
According to the Dnghu website, if Europaio has not been accepted by 2050, “it would possibly mean that Indo-European is becoming another language revival failure,” as happened with “Latin in the European Union after its abandonment in the 19th c. (the ‘recent Latin’ revival, promoted in the Congrès International pour le latin vivant, 1956, now mostly abandoned and forgotten), Ancient/Classical Greek in Greece (also ‘puristic’ Greek, the so-called Katharevousa), or Classic Coptic in Egypt in the 19th c., promoted by the Coptic Church.”
Quiles writes:
We obviously knew before beginning with this that it is very difficult to [make] happen, but it could happen—as it did with Hebrew—and we work on this because it is a possibility, because we are Europeanists and want a country united under a common language. . . . We know we are not experts, and that there are lots of people more prepared than us to work on PIE reconstruction, but we have been saying since we started in 2004 that our objective is IE [Indo-European] revival, not to impose our ideas on PIE; we want experts to collaborate.
The Indo-European Language Revival Group recommends that people interested primarily in learning a second language not study Modern Indo-European, but rather English. “However, a good intermediate choice would be to learn Sanskrit, Old Greek or Latin, or even early Germanic or Balto-Slavic dialects, as they are all natural approaches to older PIE [Proto-Indo-European] and to modern languages alike.”
Occidental Linguistics
As expected, the group’s members are oblivious to the urgent racial problems touched upon in the introductory paragraphs. Modern Indo-European, they assert, “is not about Indo-European speakers’ race or genetics.” Instead, in the words of prime mover Quiles, it is “a dream about a future United Europe under one common language, Indo-European. A common country where we can move and communicate with others as US citizens do in their country, not just as exchange students or workers, or to sell or buy things.”
Despite such sincere disclaimers, jaded readers will not be surprised to learn that at least one obsessive individual has rabidly attacked the Dnghu idea as “racist” and “Nazi.” Based upon his name, physiognomy, psychological quirks, totalitarian proclivities, and thinly-disguised anti-white bigotry, he is most likely Jewish.
A glance at the historical record reveals that Modern Indo-European has some unacknowledged but intriguing predecessors, quite possibly unknown to its proponents. In addition to various constructed “pan-” tongues—pan-Teutonic, pan-Slavic, pan-Celtic—it has been maintained by some that Germany intended to establish a kind of “Basic German” as the international language of a postwar, united Aryan Europe.
The most consequential predecessor of MIE, however, is Occidental (known after WW II as Interlingue), a planned language created in 1922 by Baltic German naval officer Edgar de Wahl (1867-1948). It was exceptionally popular in Europe prior to the Second World War, ranking as the fourth most prevalent planned language. Occidental emphasized European linguistic forms coupled with a Eurocentric philosophy.
 According to the late Donald J. Harlow, director of the Esperanto League of North America (ELNA), Edgar de Wahl, one of the first to learn Esperanto, “became the proponent of the only modification to the language’s structure that [Esperanto founder] Zamenhof found worthy of adoption after publication of the First Book.” However, Wahl grew disenchanted with Esperanto: “it simply was not Western enough for him.”
According to the late Donald J. Harlow, director of the Esperanto League of North America (ELNA), Edgar de Wahl, one of the first to learn Esperanto, “became the proponent of the only modification to the language’s structure that [Esperanto founder] Zamenhof found worthy of adoption after publication of the First Book.” However, Wahl grew disenchanted with Esperanto: “it simply was not Western enough for him.”
In Harlow’s opinion
the worst thing about Wahl’s language was the apparent philosophy of those who supported it. Wahl and his disciples were interested in the West, and to him the rest of the world was unimportant; it was doomed, or destined, to play, not merely a minor role, but no role at all. Civilization was a European phenomenon; only Europeans could be interested in international communication (plus those few Asians—Africans may not have entered into his world-view at all—who would consciously adopt the trappings of the West: seersucker suits, neckties, Catholicism and a Romance language), and so an international language should be intended only for Europeans. More specifically: Western Europeans; Wahl’s followers, like many Westerners of his day, generally expressed a cordial detestation for things Slavic, and this may have been the Estonian Wahl’s attitude, as well.
Whether this is an accurate depiction of Wahl’s or a majority of Occidental speakers’ views is impossible to say. Occidental’s last periodical, Cosmoglotta, ceased publication in 1985.
The Indo-European Language Revival Group’s proposed “Modern Indo-European” is not really an artificial, constructed language like Esperanto or Volapük, but rather a reconstructed historical language like Modern Hebrew. Although it is unlikely ever to see the light of day as envisaged, it is perhaps an instructive, if unconscious and unintentional, response to a real and pressing need: transnational white linguistic comprehensibility.
TOQ Online, November 2, 2009
00:20 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esperanto, langues artificielles, indo-européens, langues indo-européennes, linguistique, langues, langues européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 octobre 2010
Deutsch im Elsass und in der Tschechei
Deutsch im Elsaß und in der Tschechei
 In der Regel hat es die deutsche Sprache im Osten leichter als im Westen. Die Zahl derjenigen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, sinkt in den westlichen Ländern schneller als in den östlichen. Eine Ausnahme bilden offenbar Frankreich und die Tschechische Republik. Im Elsaß zum Beispiel gibt es kräftige sprachpolitische Maßnahmen, das Deutsche zu fördern, während die tschechische Regierung den Einfluß der deutschen Sprache zugunsten von Englisch systematisch eindämmt.
In der Regel hat es die deutsche Sprache im Osten leichter als im Westen. Die Zahl derjenigen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, sinkt in den westlichen Ländern schneller als in den östlichen. Eine Ausnahme bilden offenbar Frankreich und die Tschechische Republik. Im Elsaß zum Beispiel gibt es kräftige sprachpolitische Maßnahmen, das Deutsche zu fördern, während die tschechische Regierung den Einfluß der deutschen Sprache zugunsten von Englisch systematisch eindämmt.
Bemerkenswert ist in beiden Fällen, daß die Frage der Identität eine entscheidende Rolle spielt. Ausgerechnet der fortgeschrittene Verlust des Bewußtseins, daß das Elsaß historisch zum deutschen Sprach- und Kulturraum gehört, ermöglicht eine Wiederbesinnung auf die deutsche Sprache. Denn die wirtschaftliche Anziehungskraft der Bundesrepublik wird nunmehr wichtiger genommen als die kulturelle Absetzbewegung nach Frankreich. In elsässischen Tageszeitungen enthalten siebzig Prozent der Stellenangebote den Hinweis, daß der Arbeitgeber Deutschkenntnisse voraussetzt.
Elsässischer Werbefeldzug für Deutsch
Folglich erklärt Philippe Richert, der Präsident des elsässischen Regionalrats: „Das Beherrschen der deutschen Sprache ist für unsere Region längst nicht mehr nur eine Identitätsfrage. Deutschkenntnisse sind ein ausschlaggebender wirtschaftlicher Trumpf.“ Zwei Drittel der elsässischen Schüler und fast alle Grundschüler der 3. bis 5. Klasse lernen Deutsch. Zehn Prozent der Grundschüler werden sogar in zweisprachigen Klassen unterrichtet. Doch das erscheint vielen noch nicht als genug. Daher werben mittlerweile die Behörden für das Lernen der deutschen Sprache. Die Mittel für den Werbefeldzug wurden von 2009 auf 2010 auf 190.000 Euro verdreifacht. Das Werben für Deutsch wird von den wichtigsten politischen Instanzen gemeinsam mit der Straßburger Schulbehörde getragen.
Ganz anders sieht es in der Tschechischen Republik aus. Die dortige Regierung will sich in ihren sprachpolitischen Entscheidungen offenbar noch weiter von Deutschland entfernen. Anfang August beschloß das Parlament auf Vorschlag des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Petr Nečas, daß Deutsch künftig nicht mehr als erste, sondern frühestens als zweite Fremdsprache gelehrt werden darf. Der Koalitionsvertrag legt außerdem fest, daß ab 2012 Englischunterricht ab der dritten Klasse verpflichtend ist. Bereits jetzt lernen schon 618.000 Schüler Englisch, aber nur noch 111.000 Deutsch.
Deutsch als erste Fremdsprache in der Tschechei verboten
Wirtschaftliche Gesichtspunkte haben bei der Entscheidung der Prager Regierung offenbar keine Rolle gespielt, denn Deutschland ist der größte ausländische Investor. Der Handel mit der Bundesrepublik macht fast ein Drittel des gesamten Außenhandels der Tschechischen Republik aus. Die Leiterin der Spracharbeit des Prager Goethe-Instituts befürchtet, daß die tschechischen Schüler im späteren Berufsleben ohne Deutschkenntnisse Schwierigkeiten haben werden. Da erscheint es als wirtschaftlich wenig sinnvoll, die Bürger vom Deutschunterricht abzuhalten.
Es scheint also so zu sein, daß man sich in Prag lieber der Amerikanisierung an den Hals wirft, als die Standortvorteile zu nutzen, zu denen die derzeit noch verbreitete Kenntnis der deutschen Sprache gehört. Ein Leser tadelt auf der Facebook-Seite der Deutschen Sprachwelt die Prager Entscheidung: „Meines Erachtens sollte man überall in Europa Englisch als 1. Fremdsprache verbieten. Wer diese erste Fremdsprache lernt, lernt keine zweite. Es handelt sich nicht um ein Bildungsprogramm, sondern um ein Kulturassimilierungsprogramm.“
00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : langues, allemand, langue allemande, alsace, république tchèque, mitteleuropa, europe, affaires européennes, politique internationale, politique, politique linguistique, école, enseignement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 17 septembre 2010
Du verlan
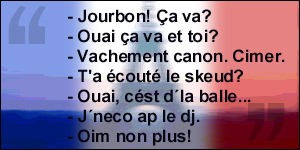
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Du VERLAN
L'origine de cette façon de s'exprimer est indéterminable: il est probable que l'inversion des syllabes existe depuis que l'homme a structuré un langage. L'utilisation du verlan est tout aussi hypothétique, pour masquer un mot cru, une vérité trop dure, pour que la domesticité présente ne comprenne pas... L'inversion portait sur un mot ou sur les deux ou trois mots clés de la phrase, et elle était orale. Les premières traces de verlan écrit remontent au début du 19ème siècle, dans les écoles militaires napoléoniennes: remarques ironiques sur un instructeur, rendez-vous pour faire le mur, descriptifs laconiques sur une bonne fortune... Dès le milieu du siècle, le processus s'était étendu aux lycées et collèges, surtout dans les pensionnats.
 La comparaison de ces petites notes laisse apparaître des constantes dans l'écriture: l'orthographe est respectée (d'où, il est plus correct d'écrire verlen), sont supprimées les lettres muettes en fin de mot, les doubles consonnes lorsqu'elles se retrouvent en début, les apostrophes sont bannies et le mot élidé est soudé au mot suivant; le S et le ILLE entraîne des modifications selon la phonétique (baiser = zébai, baisser = sébai); le verlan distingue les terminaisons avec consonnes prononcée et celles avec E muet (travail = vailtra, travaille = yevatra); aucune abréviation n'est notée et les diphtongues sont coupées en deux sons le plus souvent (viens = invi); les mots d'une syllabe sont laissés tels quels.
La comparaison de ces petites notes laisse apparaître des constantes dans l'écriture: l'orthographe est respectée (d'où, il est plus correct d'écrire verlen), sont supprimées les lettres muettes en fin de mot, les doubles consonnes lorsqu'elles se retrouvent en début, les apostrophes sont bannies et le mot élidé est soudé au mot suivant; le S et le ILLE entraîne des modifications selon la phonétique (baiser = zébai, baisser = sébai); le verlan distingue les terminaisons avec consonnes prononcée et celles avec E muet (travail = vailtra, travaille = yevatra); aucune abréviation n'est notée et les diphtongues sont coupées en deux sons le plus souvent (viens = invi); les mots d'une syllabe sont laissés tels quels.
Ce système d'écriture simple pouvait être très rapidement décrypté, aussi, lorsque certains personnages de la Commune ont repris le verlan, ils ont utilisé un double codage basé sur le jeu des sons: le message décomposé en syllabes phonétiques puis rangé en ordre inverse était retranscrit en d'autres mots pour donner un texte en français dont la clarté était douteuse; en cas d'interception, le décodeur s'acharnait sur le sens obscur des phrases et ne songeait pas à l'inversion; mais, s'il y pensait, tout était prévu: le verlan avait subi bien des métamorphoses. Les abréviations étaient courantes (M. D. = è me dé), l'argot ou les régionalismes entre “pays” firent leur apparition; on admit les variations d'un même phonème (o ou au, mais aussi p ou b, d ou t, etc...) et les approximations (viens et vingt).
Les sons composés pouvaient être ou non scindés (gla = gue la), les diphtongues notées ou non (reviens = in vi re ou vien re), la liaison marquée ou non (Paul et Jacques = po le ja que); les mots à une syllabes pouvait être inversés lettre à lettre (col = loc), les lettres muettes étaient soit ignorées soit rajoutées. Le but était de proposer quelques lignes cohérentes mais sibyllines; lorsque l'on tente de décoder ce type de phrases, on tombe presque toujours sur plusieurs possibilités ou sur un groupe de sons difficilement traduisibles parce que les mots nous sont devenus étrangers (patois ou français patoisant). En outre la ponctuation du texte original est supprimée au bénéfice du texte verlan.
Certains écrivains proches du milieu communard ont introduit dans leur œuvre le procédé, séduits par l'aspect ludique et, pour certain d'entre eux, pour le plaisir de savoir le lecteur en train de lire des insanités sans les soupçonner (Verlaine et Rimbaud par exemple sont particulièrement osés).
Le verlan dégénère lui aussi victime de l'inculture ou d'autres cultures: si le mot s'écrit aujourd'hui avec AN, c'est parce que, ailleurs, EN se prononce IN, mais, en français, il n'y a aucune raison de modifier l'orthographe du son. La phonétique n'est même plus respectée ou, plus exactement, elle respecte un accent étranger. Ce qui pourrait être un jeu culturel n'est plus que l'expression de la vulgarité et de la déchéance intellectuelle.
Marie BRASSAMIN.
00:05 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langues, linguistique, langue, argot, verlan |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 janvier 2010
Qui était Richard Fester (1910-1982)?
Qui était Richard Fester (1910-1982) ?
Ce savant allemand a séjourné de longues années en Scandinavie et en Espagne. Il a exercé la profession de traducteur et d’interprète, avant de devenir le fondateur et le principal chercheur de l’archéologie linguistique et de la paléolinguistique. L’objet principal de ses recherches a été l’histoire de l’émergence des langues. Sa thèse principale a été de dire que toutes les langues humaines ont un vocabulaire originel commun constitué de six archétypes, ce qu’il a tenté de prouver en étudiant plus de cent langues originaires de tous les continents. Cette théorie a rencontré l’intérêt de la communauté scientifique et pour étayer ses thèses, Richard Fester a publié bon nombre d’ouvrages :
Die Eiszeit war ganz anders, 1973.
Weib und Macht, 1979.
Sprache der Eiszeit, 1980.
Die Steinzeit liegt vor deiner Tür, 1981.
Urwörter der Menschheit, 1981.
Gert Meier rend hommage aux recherches de Richard Fester dans Im Anfang war das Wort, Haupt Verlag, Bern-Stuttgart, 1988.
00:15 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langues, linguistiques, protohistoire, préhistoire, ère glaciaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 décembre 2009
Mit Latein und Altgriechisch unsere Kultur verstehen: Ein
| Mit Latein und Altgriechisch unsere Kultur verstehen: Ein Plädoyer für die alten Sprachen |
| Geschrieben von: Marco Reese |
|
Englisch ist die Weltsprache. Das kann man nicht bestreiten. Chinesisch, aber auch Spanisch, Französisch und Russisch haben weltweit eine große Bedeutung. Die deutsche Sprache steht hintan. Um jedoch unsere deutsche und abendländische Kultur wirklich begreifen zu können, müssen wir viele Jahrhunderte in die Vergangenheit reisen: Unser Erbe beruht auf dem Griechischen und dem Latein. Das Abendland ist eine „Synthese des griechischen, römischen und christlichen Geistes“ Die Synthese erstreckt sich von den griechischen Epen Homers über die ebenfalls griechischen Werke Platons und des Aristoteles, die „Septuaginta“, die griechische Übersetzung des Alten Testaments und die hellenistische Literatur. Dazu tritt die im eigentlichen Sinne römische Literatur: exemplarisch seien hier Cato der Ältere, Caesar, Cicero, Sallust, Vergil, Livius, Seneca und Tacitus genannt. Schließlich ergänzen das griechische Neue Testament, lateinische und griechische Kirchenväter sowie die Werke der Neuplatoniker diese Liste. So viel zur Antike. Die alten Sprachen jedoch bleiben von Bedeutung: Das heutige Griechisch entwickelte sich linear aus dem früheren. Währenddessen entstanden aus dem spätantiken Latein einerseits die romanischen Sprachen, vor allem Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und auch Rumänisch. Außerdem wurde das eigentliche Latein zur Gelehrtensprache des entstehenden christlichen Abendlandes. Auch dieses Latein war einem Wandel unterworfen, allerdings einem sehr langsamen, da es nicht Muttersprache war. Vielmehr war es die Sprache der Kirche, der Wissenschaft und der Diplomatie. So stellte es neben dem Christentum ein einigendes Band Europas dar, ohne daß der innereuropäischen Vielfalt damit Abbruch getan worden wäre. Im 15. und 16. Jahrhundert widmeten sich Gelehrte wiederum stärker antiken lateinischen wie auch griechischen Autoren und Inhalten. Wir befinden uns in der Renaissance. Die Rezeption zumindest der lateinischen Werke der Antike war allerdings im Mittelalter nie ganz abgerissen. Zudem beschäftigte sich die Theologie ab dem 12. Jahrhundert auch mit Aristoteles. Hier lag eine Anregung durch orientalische Denkrichtungen vor, welche die griechische Philosophie rezipierten. Ab dem 16. Jahrhundert setzte eine weitere Emanzipation der Nationalsprachen ein. Für die deutsche Sprache ist freilich Luthers Bibelübersetzung zu berücksichtigen. Währenddessen blieb allerdings Latein nicht nur Liturgie- und Verkehrssprache der katholischen Kirche, sondern lange Zeit vorrangige Sprache der Wissenschaften. In der Diplomatie stieg während des Barock das Französische auf. Freilich hat sich dies längst geändert, aber noch heute sind in Deutschland Dissertationen und Habilitationen auch in lateinischer Sprache zugelassen. Gründe genug also, die lateinische und griechische Sprache als elementares Erbe Europas zu betrachten. Freilich sollte dazu eine entsprechende Beachtung im Schulwesen gehören. Zwar ist nicht gerade ein Untergang des altsprachlichen Unterrichts zu befürchten. Aber er wird heute viel weniger beachtet als noch vor einigen Jahrzehnten. Da altsprachlicher Unterricht als „elitär“ gilt, paßt er nicht so recht in eine geschichtslose, praktisch-materialistische Zeit, in der oft nur nach dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit und Verwertbarkeit geurteilt wird. Dabei öffnen einem die alten Sprachen einen ganzen Reigen an Erkenntnissen. Nicht nur schult die Beschäftigung mit diesen beiden Sprachen das analytische Vermögen. Die Kenntnis der lateinischen Sprache erleichtert zudem das Erlernen heutiger romanischer Sprachen. Auch der Wortschatz des Englischen ist lateinisch geprägt – wie auch zahlreiche Fachausdrücke diverser Wissenschaftsbereiche lateinischer wie griechischer Abkunft sind. Viel bedeutender aber ist, daß Latein und Altgriechisch in geschichtliche Hintergründe einführen, die für das Verständnis unserer Kultur unerläßlich sind. Josef Kraus, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, riet 1998 zur Stärkung des Fremdsprachenunterrichts, bemerkte jedoch: „Dazu gehört auch eine Stärkung des Lateinischen, das eine Brücke zu einer europäischen Mehrsprachigkeit bietet.“ Es ist daher zu begrüßen, wenn beispielsweise im Freistaat Thüringen der Lateinunterricht nun bereits ab dem fünften Schuljahr erteilt werden kann. Zwar ist dem Lateinischen aufgrund des Geschilderten weiterhin der Vorrang gegenüber dem Altgriechischen einzuräumen. Dennoch sollte Altgriechisch wieder verstärkt an Schulen und sei es in Form von AGs angeboten werden. Diese schöne Sprache ist leider viel zu selten geworden. Es sollte auch die Fähigkeit, ins Lateinische und Altgriechische zu übersetzen, im Unterricht wieder stärker gefördert werden. Dadurch beherrschen Schüler die Sprachen nachweisbar besser. Wenn die alten Sprachen erst einmal wieder auf einer gesunden Basis stehen, kann man über eine Ausweitung nachdenken. |
00:17 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langues mortes, latin, grec ancien, philologie classique, hellenisme, latinisme, éducation, école |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 05 décembre 2009
Por qué los finlandeses veneran tanto el latin?
¿Por qué los finlandeses veneran tanto el latín?
Ex: http://3via.eu/
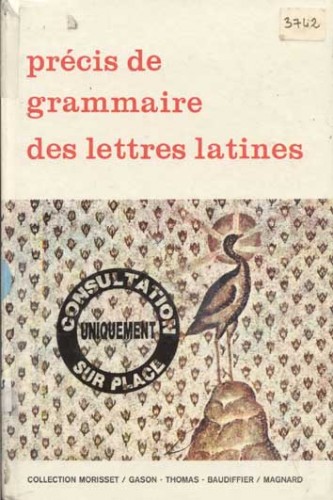 |
ANTONIO MARTÍNEZ
He aquí un hecho absolutamente insólito: de junio a diciembre de 2006, durante el periodo en que Finlandia actuó como país presidente de la Unión Europea, el gobierno finlandés se preocupó de que las noticias y resúmenes de las distintas comisiones, aparte de en las lenguas oficiales de la Unión Europea, se publicaran también en latín. ¿Una extravagancia irrelevante, el empeño exótico de algún friki del latín que había logrado colarse hasta el sillón de algún ministerio finés? No, en absoluto: es que, sorprendentemente, en Finlandia la lengua de Cicerón disfruta de un status y de una veneración extraordinarios.
 -Quod natura non dat, Salmantica non docet (lo que no se tiene por naturaleza ni siquiera Salamanca lo puede enseñar: no se pueden pedir peras al olmo, o sea, cada mollera tiene sus limitaciones).
-Quod natura non dat, Salmantica non docet (lo que no se tiene por naturaleza ni siquiera Salamanca lo puede enseñar: no se pueden pedir peras al olmo, o sea, cada mollera tiene sus limitaciones).
00:20 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langues, linguistique, latin, culture latine, philologie classique, rome antique, finlande, école, éducation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook