 "Para o soldado - escreve Philippe Masson em L'Homme en Guerre 1901-2001 - para o verdadeiro combatente, a guerra se identifica com estranhas associações, uma mescla de fascinação e horror, humor e tristeza, ternura e crueldade. No combate, o homem pode manifestar covardia ou uma loucura sanguinária. Encontra-se sujeito entre o instinto pela vida e o instinto mortal, pulsões que podem lhe conduzir à morte mais abjeta ou ao espírito de sacrifício.
"Para o soldado - escreve Philippe Masson em L'Homme en Guerre 1901-2001 - para o verdadeiro combatente, a guerra se identifica com estranhas associações, uma mescla de fascinação e horror, humor e tristeza, ternura e crueldade. No combate, o homem pode manifestar covardia ou uma loucura sanguinária. Encontra-se sujeito entre o instinto pela vida e o instinto mortal, pulsões que podem lhe conduzir à morte mais abjeta ou ao espírito de sacrifício.samedi, 14 juillet 2012
Warrior heritage of Ukrainian Cossacks
Warrior heritage of Ukrainian Cossacks
00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cosaques, russie, ukraine, histoire, militaria, musique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 juin 2012
Beethoven: Wellingtons Sieg
Beethoven: Wellingtons Sieg
00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : beethoven, musique, bataillede waterloo, waterloo, wellington, 19ème siècle, guerres napoléoniennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 avril 2012
La guérilla espagnole contre l'armée napoléonienne

Ex: http://anti-mythes.blogspot.com/
La guérilla espagnole contre l'armée napoléonienne sous l'éclairage de Carl Schmitt
Rappelons brièvement les faits : pour établir un "blocus continental" efficace contre la Grande-Bretagne, puissance maritime et commerciale et principale ennemie de la France, Napoléon entendait contrôler l’ensemble de la péninsule ibérique. Il envoya donc Murat avec des troupes en Espagne en 1808, sans provoquer de véritables réactions de la part d’une famille royale espagnole par trop affaiblie. Dans ce contexte de décomposition du pouvoir royal légitime, une première émeute populaire à Aranjuez poussa d’ailleurs le roi Charles IV à abdiquer au profit de son fils Ferdinand VII dans l’espoir de stabiliser la situation politique.
Mais l’entrée de Murat dans Madrid provoqua une véritable insurrection, celle du 2 mai, que le général français réprima durement. Sous la pression de Napoléon, Ferdinand VII abdiqua à son tour au profit, cette fois, de Joseph Bonaparte, frère aîné de l’Empereur, qui fut reconnu par une assemblée de notables Afrencesados (1). Mais le soulèvement du peuple était déjà quasi général. Il fut formellement encadré par des Juntas (juntes militaires) auto constituées qui refusèrent de reconnaître le coup de force français et qui, au nom du roi pourtant déposé, allaient diriger une résistance à l’occupant. Cette résistance héroïque rassembla, dans un premier temps, troupes régulières et civils en armes, ces derniers devant progressivement en constituer l’âme. Dès juin 1808, en effet, commença ce qu’on appellera bientôt une "guérilla" – le terme en tant que tel n’apparaîtra qu’en 1812 – qui se développa au fur et à mesure des défaites de l’armée régulière espagnole face à Napoléon. Ces défaites successives pousseront d’ailleurs de nombreux déserteurs à accroître le nombre de ces partisans. Ce qui va intéresser au premier chef Carl Schmitt dans la guerre de résistance espagnole à Napoléon, c’est précisément le fait que "le partisan de la guérilla espagnole de 1808 fut le premier à oser se battre en irrégulier contre les premières armées régulières modernes" (Schmitt, La notion de Politique – Théorie du Partisan, préface de Julien Freund ; traduction de Marie-Louise Steinhauser, Paris, Calmann-Lévy, 1972, page 214). Par "armées régulières modernes", il convient ici d’entendre celles issues des expériences de la Révolution française qui sont à l’origine d’une reformulation radicale du concept de "régularité" hérité de l’âge classique, et dont – aussi paradoxal que cela puisse paraître de prime abord – le "partisan", en tant que combattant irrégulier, constitue en quelque sorte le produit.
DE LA NOTION PROBLÉMATIQUE "D’IRRÉGULARITÉ"
Comme le relève Schmitt, il se trouve que "la différence entre combat régulier et combat irrégulier est fonction de la nette définition de ce qui est régulier et une antinomie concrète donnant lieu à une délimitation du concept n’apparaît qu’avec les formes modernes nées des guerres de la Révolution française" (op. cit., p. 213). Jusque-là avait prévalu un droit interétatique classique – le Jus Publicum Europaeum – au sein duquel le phénomène de l’hostilité était maintenu dans le cadre de guerres limitées, apanage exclusif des princes contre un ennemi stricto sensu "conventionnel". La principale caractéristique de ce droit classique résidait dans le fait qu’il comportait des distinctions nettes entre guerre et paix, entre combattants et non-combattants, entre un ennemi et un criminel. Et, comme le souligne Schmitt, "en regard de cette régularité toute classique" (op. cit., p. 218), l’idée même de soldat irrégulier était tout simplement inconcevable : "Le droit classique de la guerre (…) ne laisse pas de place au partisan au sens moderne. Ou bien celui-ci est, comme dans la guerre au XVIIIe siècle, qui est une affaire entre cabinets, une espèce de troupe légère, particulièrement mobile mais régulière, ou bien il est un criminel particulièrement méprisable, et il est alors tout simplement un hors-la-loi" (op. cit., p. 219).
Cette alternative tranchée est remise en cause à l’issue des bouleversements révolutionnaires, sur la base d’une délimitation nouvelle de la notion de "régularité", lorsque la notion d’État dynastique est reformulée comme État national et que l’armée des princes est conduite à se transformer en armée nationale. Schmitt discerne d’ailleurs la faillite du droit classique dans cette configuration juridico-politique qui voit la "victoire du civil sur le soldat le jour où le citoyen passe l’uniforme tandis que le partisan le quitte pour continuer à se battre sans uniforme" (op. cit., p. 306). À cet égard, loin de constituer une anomalie, l’émergence de la figure du partisan, en tant que combattant irrégulier, face à cette nouvelle "régularité" post révolutionnaire, ne constitue somme toute que l’une des deux faces d’un même Janus, celle du soldat-citoyen. En déferlant sur toute l’Europe continentale, le nouvel art militaire de l’armée napoléonienne, comme héritier de cette mutation fondamentale, va se trouver être, à la fois, vecteur et victime de ce nouveau modèle, dans la mesure où la guerre de l’âge classique, qui ne peut plus que faire figure de jeu conventionnel, va laisser la place à de véritables guerres des peuples, dont la guerre de résistance espagnole n’est que le premier d’une longue suite d’avatars. Ce qui intéresse Schmitt, c’est précisément de montrer que l’apparition du partisan en Espagne entérine une situation inédite qui a transformé l’ennemi "conventionnel", au cœur des guerres limitées que se livraient les princes dans le droit classique, en ennemi pour le coup bien "réel", au cœur de guerres devenues nationales : "L’élément principal de la situation du partisan de 1808 est qu’il risque le combat sur le champ limité de son terroir natal, alors que son roi et la famille de celui-ci ne savaient pas encore très bien quel était l’ennemi réel" (op. cit., p. 215).
En dépit de l’aura involontaire dont Ferdinand VII bénéficiait auprès de son peuple et qui l’a préservé, malgré lui, d’une condamnation sans appel de l’Histoire, ses hésitations devant l’événement majeur qui se joue s’expliquent sans doute par le fait qu’il se situe toujours par rapport à un droit classique de la guerre dérivé du Jus Publicum Europaeum. En revanche, le partisan espagnol, lui, appartient déjà au monde nouveau qui est en train d’advenir en matière stratégico-politique. "Seul le partisan espagnol rétablit le sérieux de la guerre, et ce fut contre Napoléon, c’est-à-dire dans le camp défensif des vieux États continentaux européens dont la vieille régularité devenue convention et jeu n’était plus en mesure de faire face à la nouvelle régularité napoléonienne et à son potentiel révolutionnaire. De ce fait, l’ennemi redevint un ennemi réel, la guerre, une guerre réelle. Le partisan défenseur du sol national contre le conquérant étranger devint le héros qui se battait réellement contre un ennemi réel" (op. cit., p. 304-305).
Mais l’apparition du phénomène du partisan n’allait pas forcément de soi pour des esprits encore largement imprégnés de l’idée de la vieille "régularité" militaire. Paradoxalement, c’est peut-être dans cette perspective qu’on peut saisir la portée des diverses tentatives juridiques de "régularisation" de la guerre de partisans par ce qui restait de l’État espagnol légitime ou de ce qui s’en réclamait alors, en l’occurrence les Juntas militaires.
LE PRÉCÉDENT EN 1808 D’UNE LÉGITIMATION DE LA GUERRE DE PARTISANS PAR LA JUNTA DE SÉVILLE
Ce qui est en effet capital dans l’apparition de cette forme de guerre irrégulière espagnole, c’est qu’elle va recevoir de la part de Juntas militaires régionales et/ou nationales, une sorte de réglementation juridico-politique – fait sans précédent dans l’Histoire – lui conférant une légitimité inédite rendue nécessaire par les circonstances. La passivité, face à l’envahisseur français, d’un gouvernement dépassé par les événements devait mettre au premier plan ces Juntas militaires, d’une part, les guérillas, d’autre part. Un premier cadre juridico-politique est donné dès le 6 juin 1808 par la Junta Suprema de Gobierno de Espana e Indias (la Junte de Séville), auto-constituée le 28 juin 1808, et qui déclare la guerre à l’Empereur Napoléon en ces termes : "… Nous déclarons la guerre sur terre et sur mer à l’Empereur Napoléon Ier et à la France, dont nous supportons la domination et le joug tyrannique ; et nous demandons à tous les Espagnols d’œuvrer hostilement à leur encontre et de leur causer le plus de dommages possibles selon les lois de la guerre" (Blanch, Historia de la guerra de la Independencia en Cataluna, Barcelone, 1968, p. 64).
Cette dernière précision a ceci de paradoxal et d’étrange qu’elle méconnaît le fait que la guerre patriotique espagnole n’est déjà plus une guerre de l’âge "classique". Les dites "lois de la guerre", selon la conception classique dans laquelle, comme le rappelle Schmitt, « l’ennemi a son statut », et dans laquelle "il peut être imposé des limites à la guerre" (Schmitt, op. cit., p. 12), sont d’ores et déjà sapées par la nouvelle forme d’hostilité "réelle" développée par la guerre de partisans qu’on cherche illusoirement à réglementer. Sans que ces auteurs en mesurent peut-être toutes les conséquences à terme, cette déclaration de juin 1808 apparaît comme le précédent le plus direct de légitimation de la guerre irrégulière. Il est complété le jour même par un second texte. Celui-ci, intitulé Prevenciones, s’adresse au peuple espagnol pour qu’il sache que certaines mesures sont indispensables à la bonne conduite de la lutte contre l’ennemi : "Il faut éviter les actions générales et privilégier les initiatives individuelles. Il est nécessaire de ne pas laisser l’ennemi se reposer un instant, de harceler sans répit ses flancs et son arrière-garde, de l’affamer, d’intercepter ses convois de vivres, de détruire ses entrepôts et de lui couper toutes les voies de communication entre l’Espagne et la France d’autre part" (Queipo de Llano, Historia del Levantamiento, Guerra y Revolucion de Espana, Madrid, 1835-1837, p. 232-233).
Ainsi est en train d’être "régularisée" une guerre de partisans dont la Junta pressent pourtant d’ores et déjà les éventuelles dérives, ce qui apparaît clairement dans l’article final des Prevenciones : "Il s’agira de faire comprendre et de persuader la nation que libérés, comme nous l’espérons, de cette guerre cruelle, et le trône à nouveau entre les mains de notre seigneur et Roi Ferdinand VII, les Cortes, sur sa convocation, réformeront les abus et établiront les lois dictées par l’expérience, pour le bien et la félicité publics ; deux notions que les Espagnols connaissent sans que les Français aient eu à les leur enseigner" (Queipo de Llano 1835, p. 233).
Pour l’heure, la Junta de Séville fait figure localement de pouvoir suprême, à l’image d’un organe de souveraineté nationale (comme les autres Juntas provinciales), et apparaît donc pour les Espagnols politiquement "compétente", dans la mesure où elle se réclame de l’ancien pouvoir légitime du roi Ferdinand VII. C’est bien à ce titre qu’elle ordonne d’ailleurs l’enrôlement massif de partisans comme auxiliaires des dernières troupes régulières espagnoles combattant encore Napoléon.
LE TOURNANT DE L’AUTOMNE 1808
La méthode paraît pour un temps donner de bons résultats puisque, le 19 août 1808, advient la première défaite française, celle de Baylen, face à 40.000 hommes de troupes régulières espagnoles unies à un noyau de volontaires et de francs-tireurs et au peuple andalou en armes. Ce succès ponctuel entretient en fait l’illusion sur les capacités réelles de l’armée régulière espagnole de résister durablement à l’armée napoléonienne. En effet, à l’automne 1808, devant les mauvais résultats de son armée, Napoléon, pour résoudre rapidement le problème espagnol avant de se mesurer à l’Autriche, décide de prendre en personne, le commandement des troupes le 6 novembre 1808. En virtuose militaire qu’il est, il retourne la situation en très peu de temps, remportant victoire sur victoire, et entre à Madrid le 4 décembre 1808 où il réinstalle aussitôt son frère Joseph. En Catalogne, le 15 décembre, le général Vivès est battu et lève le siège de Barcelone. Saragosse, assiégée pour la seconde fois par les Français le 20 décembre, capitule le 20 février 1809 en dépit d’une résistance héroïque.
La confiance relative qui perdurait dans ce qui restait de l’armée "régulière" espagnole née de la bataille de Baylen, s’en trouva considérablement altérée. La guérilla espagnole reste alors seule à s’opposer à l’envahisseur français et va, pour cette raison, prendre une ampleur inégalée. Comme le souligne Schmitt : "À l’automne de 1808, Napoléon avait vaincu l’armée régulière espagnole ; la guérilla espagnole proprement dite ne se déclencha qu’après cette défaite de l’armée régulière" (op. cit., p. 214). C’est à partir de là, en effet, que les Espagnols commencèrent véritablement à organiser des bandes de partisans sur une grande échelle pour continuer la résistance à Napoléon.
LE MANIFESTE DU 28 DÉCEMBRE 1808
Dans ce contexte d’échecs militaires retentissants pour ce qui se réclamait encore de l’armée régulière espagnole, la Junta Centrale , abasourdie, se réunit à Séville et publie le 28 décembre 1808 le Reglemento de partidas y cuadrillas, qui reprend en l’accentuant l’esprit du règlement de juin 1808. Ce règlement du 28 décembre 1808, en trente-quatre articles, est le premier texte réglementaire de portée nationale. On n’y parle cependant pas encore de "guérillas" ni de "guérilleros". À cette époque, le terme "guérilla" n’est pas encore intégré dans la terminologie de la guerre patriotique espagnole. Il a toujours sa signification technique, dérivée de la guerre classique, de "ligne de tirailleurs devant attaquer l’ennemi de front et sur ses flancs, ou troupe légère utilisée pour les reconnaissances et les escarmouches". Il renvoie encore au "partisan" du XVIIIe siècle, celui qui appartient à un "parti", ou détachement battant la campagne, à l’un de ces détachements dont le maréchal de Saxe écrivait qu’ils pouvaient traverser un royaume entier sans être repérés.
Dans le règlement de décembre 1808, on parle plus spécifiquement de partida, ("bande"), qui signifie, d’après Almirante dans le Dictionnaire Militaire, "toute troupe peu nombreuse", aussi bien régulière qu’irrégulière, et de cuadrilla , littéralement "troupe", "bande". Les partidas, sans spécification notable quant à leurs effectifs, rassemblent toutes sortes d’individus à l’exclusion des alistados ou solteados (les appelés aux armées). Les cuadrillas sont, quant à elles, des bandes de contrebandiers de "mer et de terre". Lorsque ce règlement est publié, des actions de partisans existent déjà depuis huit mois. Mais elles sont appelées à se développer. Ces dispositions légales tendent, en fait, à les assujettir autant que faire se peut à des règles dans lesquelles l’esprit militaire dominerait. Les principaux points abordés dans le règlement ont trait à la finalité de la guerre de partisans, à la composition des unités, à la collation des grades, à l’armement, aux soldes, aux règles de discipline et au butin.
Les deux types d’unités distinctes que sont les partidas et cuadrillas se trouvent donc mises sur pied avec pour mission d’assurer la sécurité du pays en semant la terreur et la désolation chez l’ennemi. Les partidas, d’abord, forment des groupes d’environ une cinquantaine d’hommes à pied et à cheval. Le commandement, et c’est important, est assuré par un chef du grade de commandant, un second, deux subalternes à cheval et trois à pied, ayant respectivement les grades militaires réguliers de lieutenant de cavalerie, sergent, et ainsi de suite. Les articles 24 et 28 visent à encadrer avec une certaine souplesse ces unités "irrégulières" en adoptant la structure des armées opérationnelles, à la fois pour éviter une trop grande anarchie et pour opérer sur l’ennemi avec le plus de rapidité et d’efficacité possibles. On retrouve là deux des traits essentiels dans la perspective d’une "théorie du partisan" selon Carl Schmitt, traits le plus souvent liés, sinon indissociables, et qui font figure de critères pour définir le partisan moderne en train d’advenir en Espagne ; à savoir : "l’irrégularité" et "le haut degré de mobilité du combat actif" (op. cit., p. 229) – la mobilité n’impliquant pas l’irrégularité, mais celle-ci impliquant nécessairement celle-là. Il est en outre prévu de répartir ces unités "irrégulières" dans les différentes divisions de l’armée en les soumettant aux ordres des généraux respectifs qui leur sont donnés comme chefs, ainsi qu’un adjoint. On voit bien l’intention des autorités de faire des partidas une émanation de l’armée "régulière". Pourtant, en contraste avec les règles militaires précitées, l’article 26 précise : "Les chefs locaux (ceux de l’armée qui encadrent les bandes de partisans) devront laisser agir les partisans avec le plus de liberté possible, tout en les gardant à leur disposition, pour la bonne conduite des opérations" (Horta Rodriguez, "La législation de la guérilla espagnole dans l’Espagne envahie (1808-1814)", in Revue historique des Armées, 1986/3, p. 33).
Il convient ici de s’interroger sur la raison d’être du cadre juridico-politique conféré aux bandes de "partisans". Les rédacteurs du règlement savent pertinemment qu’il existe déjà depuis juin des groupes de partisans plus ou moins nombreux. Le règlement "reconnaît" donc une nouvelle fois leur existence et légitime leur lutte au regard de l’occupation française. Mais à cela s’ajoutent d’autres motivations ou plutôt, devrait-on dire, d’autres soucis. Il est intéressant de savoir que "ceux qui auront accompli leur temps de service obtiendront une place dans la Renta (2) ou d’autres postes selon les circonstances" (Horta Rodriguez, p. 33).
Cela prouve le souhait déclaré de réintégrer à moyen terme le "partisan" dans l’armée "régulière", ou à défaut dans une forme de "régularité" quelconque. Enfin, le butin fait l’objet d’une réglementation minutieuse. La répartition du butin sera proportionnée à la solde et personne ne pourra s’immiscer dans sa distribution pour prévenir de la sorte toute forme éventuelle de contestation.
Les mêmes règles s’appliquent aux cuadrillas. Dans les faits, on tente bel et bien d’organiser, par ce biais, les contrebandiers qui agissent "au grand préjudice du trésor royal" (Horta Rodriguez, p. 34). L’article 19 est directement conçu à leur intention. Avant tout, il apparaît nécessaire de leur reconnaître une légitimité "politique" en louant leur valeur, leur intrépidité, leurs talents militaires pour conclure que, "n’ayant pu trouver une activité qui leur permette de s’épanouir, ils se sont lancés dans la contrebande". On leur promet, en tout cas, désormais "une carrière glorieuse et utile à l’État dans les circonstances actuelles" (Horta Rodriguez 1986 : 34). C’est leur statut qui s’en trouve ainsi radicalement modifié. On attribue en effet à cette activité "irrégulière", voire illégale en d’autres temps, mais si populaire en Espagne, le privilège en quelque sorte juridique de s’exercer en toute quiétude puisque cela sert la fin politique de la résistance à l’envahisseur français. Le péril couru par la Nation espagnole autorise en quelque sorte le recours à tous les palliatifs. En conséquence, on pardonne les crimes passés aux contrebandiers se présentant dans les huit jours devant le chef militaire ou politique, et qui se verront accorder une reconnaissance politique faisant d’eux des "partisans" et non de simples bandits de grand chemin.
Pour Schmitt justement, outre l’irrégularité, "un autre critère distinctif qui s’impose aujourd’hui à notre attention réside dans l’engagement politique qui caractérise le partisan de préférence à d’autres combattants" (op. cit., p. 224). Et c’est ici qu’il faut souligner l’importance cardinale du "tiers intéressé", qui se trouve être un "tiers régulier", dont parle Schmitt : en l’occurrence, les Juntas militaires qui se réclament de la légitimité royale et, au-delà, la puissance anglaise qui reconnaît le "partisan" comme un allié. C’est en effet ce tiers "qui procure cette sorte de reconnaissance politique dont le partisan qui combat en irrégulier a besoin pour ne pas tomber, tel le bandit et le pirate, dans le domaine non politique, ce qui signifie ici : dans le domaine de la criminalité" (op. cit., p. 290). C’est toute la subtilité de cette dimension politique qui confère au "partisan" son statut et qui a rendu le sujet tellement polémique jusqu’à nos jours.
LES NOUVELLES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DE 1809
"L’institutionnalisation" de la guérilla va se renforcer avec l’adoption de plusieurs dispositions. Elles sont au nombre de trois, en date respectivement du 1er janvier, du 28 février, et du 20 mars 1809. Elles contiennent les soubassements d’une guerre de partisans strictement définie, tout autant que les problèmes que celle-ci ne cessera de soulever.
La première disposition entend contrôler étroitement les Juntas provinciales qu’elle transforme en simple Juntas "d’observation et de défense". Celles-ci constituaient un des supports les plus efficaces pour l’esprit de résistance alimenté par des hommes qui défendaient avec ardeur la patrie de leurs ancêtres, le foyer familial, la terre qu’ils travaillaient, leur religion, et un mode de vie fermé aux ingérences étrangères. C’est là qu’on saisit avec une acuité toute particulière "le quatrième critère distinctif du partisan authentique" selon Carl Schmitt, "ce que Jover Zamora (3) a appelé son caractère tellurique. Celui-ci est très important pour la situation fondamentalement ‘défensive’ du partisan…" (op. cit., p. 229). Au reste, ces partisans étaient bien, comme le souligne encore Schmitt, "les défenseurs autochtones de la terre natale qui mouraient pro aris et focis, les héros nationaux et patriotiques (…) tout ce qui était réaction d’une force élémentaire, tellurique vis-à-vis d’une invasion étrangère (…), légitimité de son irrégularité de partisan" (op. cit., p. 288).
La seconde disposition, celle du 28 février, est un ordre royal émanant de la Junta Centrale : "La junte souhaitant donner une impulsion puissante en faisant appel à l’intérêt individuel, aux grandes motivations qui entraînent les habitants du royaume dans la lutte contre l’ennemi afin de lui causer le plus de tort possible, il a été décrété que les armes de toutes espèces, les chevaux, les vivres, les bijoux et l’argent qui seront pris à l’ennemi, par quelque particulier que ce soit, seront la propriété de celui qui les aura pris. Le droit de préférence dans l’achat des canons, armes, chevaux resteront à Sa Majesté ou au Trésor Royal ; le montant de ces choses leur sera payé avec ponctualité" (Horta Rodriguez, op. cit, p. 36).
La dernière des trois dispositions est le Manifeste édicté par la Junta Centrale le 20 mars 1809. Il reproche notamment aux généraux français les mauvais traitements infligés aux prisonniers et leur enjoint de considérer que tout Espagnol en mesure de prendre les armes est, aux yeux de la Junta un soldat de la patrie et doit être traité en conséquence par l’armée française – mais de manière unilatérale, et c’est précisément là tout le problème. Ce manifeste laisse entrevoir les conséquences et les difficultés insurmontables que fait surgir le "partisan" dans le droit classique de la guerre dont la Junta se réclame, alors même qu’elle légitimise ce type de combattant irrégulier. Comme l’explique Schmitt, en effet, "plus la discipline d’une armée régulière est stricte, plus elle est scrupuleuse dans sa distinction entre militaires et civils en ne considérant comme un ennemi que le seul adversaire en uniforme, et plus elle deviendra ombrageuse et irritable si, dans l’autre camp, une population civile qui ne porte pas l’uniforme participe, elle aussi, au combat. Les militaires réagiront par des représailles en fusillant, en prenant des otages, en détruisant des localités et ils tiendront ces mesures pour légitime défense face à des manoeuvres perfides et sournoises". (op. cit., p. 246-247). À cet égard, l’armée française est effectivement confrontée au problème du "traitement" à accorder à tout Espagnol pris les armes à la main, problème qu’elle ne parvient pas à résoudre, sinon le plus souvent par des exécutions sommaires, faisant de cette guerre d’Espagne l’une des plus cruelles et des plus horribles, et déjà perçue comme telle par ses contemporains. Le Manifeste poursuit en faisant allusion à la lutte de tout un peuple contre la tyrannie et l’envahisseur en ces termes : "Tout membre de cette nation doit trouver la protection des lois de la guerre, le général qui ne les respecte pas est un bandit qui s’expose à la colère du ciel et à la vengeance des hommes" (Canga-Arguelles, p.107).
Mais cela relève de l’anathème pur et simple dans la mesure où l’on touche là à une espèce de paradoxe : ce paradoxe réside dans le fait d’en appeler à des "lois de la guerre" d’un droit classique de la guerre, alors même que l’émergence de la figure du "partisan" les rend, de fait, caduques. Ces problèmes insolubles vont prendre une ampleur sans précédent avec le dernier règlement de 1809, intitulé "Instruction sur le corso terrestre".
"L'INSTRUCTION SUR LE CORSO TERRESTRE" D’AVRIL 1809
Le second grand texte réglementaire de portée nationale, "l’Instruction sur le corso terrestre" (4) du 17 avril 1809 suit le même esprit que les trois dispositions du début de l’année 1809. Ce texte, comportant dix-huit articles, a pour but de donner des directives concrètes aux "partisans", et, ipso facto, en détermine la figure "irrégulière". Le terme de "corso terrestre" est une alliance de mots circonstancielle (5), celle-là même qui consisterait à parler d’un "corsaire de terre", par opposition à un "pirate de terre".
D’après la doctrine traditionnelle espagnole, le corso a pour but d’empêcher l’ennemi de pouvoir se servir, lorsqu’il en a besoin, des voies de communication sur mer. Le corso est donc l’oeuvre du combattant qui, en état d’infériorité, ne peut livrer une bataille décisive ni détruire la force armée de l’ennemi. Ces similitudes avec ce que sera la guerre de partisan ne s’arrêtent pas là. Ce sont des forces peu nombreuses qui luttent contre un ennemi omniprésent et qui, en l’absence d’une lettre de patente, comme celle qui était accordée au corsaire des siècles précédents, risquent constamment de sombrer dans le brigandage. La distinction entre corsaire et pirate s’avère essentielle. Schmitt insiste sur l’importance discriminante du critère politique : "le caractère politique a (dans l’ordre inverse) la même structure que chez le pirate du droit de la guerre maritime dont le concept inclut le caractère non politique de son aspect néfaste qui vise le vol et le gain privé" (op. cit. p. 224). Par conséquent, poursuit Schmitt, il faut éviter de désigner le partisan, "de le définir comme un pirate de la terre ferme". Le comportement du "pirate" est sans référence aucune à une quelconque "régularité". Et d’ajouter : "Le corsaire, au contraire, court la prise de guerre sur mer et est muni de lettres par le gouvernement d’un État ; son irrégularité à lui n’est donc pas sans lien avec la régularité et c’est ainsi qu’il resta jusqu’à la déclaration de Paris de 1856 une figure juridiquement reconnue du droit international européen. De ce fait, une certaine comparaison est possible entre le corsaire de la guerre sur mer et le partisan sur terre…" (op. cit., p. 284).
Les projets et motivations de ce "corso terrestre" de 1809 se trouvent, pour l’essentiel, exposés dans le préambule de "l’Instruction" : à l’instar du "corso maritime", le "corso terrestre" a pour but principal d’anéantir les communications terrestres de l’ennemi. Ordre est donné d’entraver "l’approvisionnement en vivres et en moyens de subsistance de l’armée française dans le pays (…), de faire de même avec les courriers, d’observer leurs déplacements (…), de tenir les Français dans un état d’alerte et de fatigue permanentes (…) en leur faisant le plus de mal possible" (Horta Rodriguez , p. 37).
De cet ensemble de projets visant à durcir la conduite de la guerre en Espagne se détache la motivation qui justifie et légitime aux yeux des Espagnols cette guerre d’un nouveau type. Le préambule de "l’Instruction" stipule d’emblée : "Maintenant que nous connaissons la manière la plus vile que Napoléon a utilisée pour détruire et désorganiser la force militaire espagnole (…), n’est-il pas évident qu’il revient aux paysans de se regrouper pour combattre ses armées ?" (Horta Rodriguez, p. 38).
Les autorités n’ont pas eu le temps d’enrégimenter les Espagnols ni de leur donner un uniforme ; mais tous sont néanmoins des soldats pour ces mêmes autorités. Si le règlement de 1808 cherchait à "militariser" les bandes de "partisans", "l’Instruction sur le corso terrestre", de son côté, met plutôt l’accent sur les représailles qui entendent constituer la réponse aux actions ennemies. Dans le même texte, on souligne d’ailleurs le fait que l’ennemi ne reconnaît pas un statut de combattants aux paysans et en fait "d’innocentes victimes" (Horta Rodriguez, p. 37). On retrouve – posé de manière de plus en plus nette – le problème précédemment évoqué par le Manifeste de la Junta Centrale du 20 mars 1809 sur le "statut" des combattants lorsqu’apparaît la figure du "partisan", lequel ne permet plus de faire une distinction nette entre le combattant et le non-combattant. En 1809, les paysans majoritaires dans les rangs des partisans ne pratiquent pas une guerre "réglée", avec des limites bien définies. L’ennemi le lui rend d’ailleurs bien. Cette relation d’inimitié absolue tend à l’anéantissement mutuel. C’est ce danger de la "guerre folle", inhérente à la faillite du droit classique, sur lequel insiste Schmitt : "Le partisan moderne n’attend de son ennemi ni justice, ni grâce. Il s’est détourné de l’hostilité conventionnelle de la guerre domptée et limitée pour se transporter sur le plan d’une hostilité différente qui est l’hostilité réelle dont l’escalade de terrorisme en contre-terrorisme va jusqu’à l’extermination" (op. cit., p. 219).
L’objectif principal consiste de fait à mener une guerre "à outrance", susceptible de devenir une guerre encore plus inhumaine. Fait sans précédent, on arme tous les habitants des provinces occupées afin "d’assaillir et de dépouiller" les soldats français "chaque fois qu’une occasion favorable se présentera". Et ce, avec toutes les armes, quelles qu’elles soient, même les "interdites" (Horta Rodriguez, p. 37), ce que ne mentionnait pas le règlement de 1808. C’est de cette manière qu’on souhaite résoudre le problème de la disproportion des forces en présence pour être en mesure de se battre "à armes égales", imitant ainsi "la conduite barbare du satellite de Buonaparte » – pour reprendre les termes du texte – afin de « guérir le mal par le mal" (Horta Rodriguez, p. 37). La forme inhumaine que va prendre cette guerre est inhérente à la justification que tous les moyens sont bons pour pouvoir lutter "à barbarie égale". Le fait sans précédent, c’est de l’institutionnaliser. Il n’échappe naturellement pas à Alcano Galiano, l’auteur du "corso", que les raisons qui le sous-tendent sont dépourvues de noblesse, mais son règlement qui, pour la première fois, préconise la guerre totale, est présenté comme une réponse imposée par l’adversaire et un mode de combat induit par les circonstances. C’est pourquoi, "l’Instruction sur le corso" est, par nécessité, plus expéditive, plus cruelle et moins "militaire" que le règlement de 1808.
Après les motivations, examinons plus en détail l’organisation. Les paysans peuvent se regrouper en "cuadrillas d’infanterie et de cavalerie". La plupart des combattants "irréguliers" peuvent se grouper en cuadrillas, même loin du territoire occupé, dans les provinces limitrophes, ou proches de celles qui sont occupées. Mais, dans ce dernier cas, les cuadrillas ayant moins de raison d’être que celles de la zone occupée, doivent demander la "permission de justice" pour se constituer. Cette limitation témoigne du fait qu’on tente, dans cette guerre "irrégulière" sans règles fixes, de poser un cadre juridique minimal susceptible d’éviter, malgré tout, de véritables dérives "criminelles". De même, si la "bonne conduite" des membres de ces cuadrillas est reconnue, un passeport leur est alors délivré, lequel est censé les garantir des mauvais traitements par l’ennemi en zone occupée. Signalons enfin que, si la part du butin, dans le règlement de 1808, était accordée proportionnellement à la solde, en 1809, il n’y a dans ces cuadrillas ni solde, ni grade. Le butin est réparti d’un "commun accord", ce qui apparente davantage ce type de guerre au corso maritime auquel il se réfère.
LES DERNIERS TEXTES DE LA GUÉRILLA
Les derniers textes officiels de l’époque relatifs à une réglementation de la guérilla interviennent en 1812 et 1814. Entre 1809 et 1812, beaucoup de choses ont changé pour "l’envahisseur français". Et 1812 constitue d’une certaine manière l’année de la fin pour "l’ordre français" en Europe, et en Espagne plus particulièrement. Certes, le 9 janvier 1812, Valence tombe aux mains des troupes napoléoniennes, mais la guerre entre dans une phase d’offensive de grande envergure du côté des forces hispano-britanniques. Le 19 janvier, les troupes de Wellington conquièrent Ciudad Rodrigo, puis Badajoz, le 7 avril.
En 1812, Napoléon, alors en pleine campagne de Russie, se voit contraint d’ordonner, pour la première fois, le retrait de 30 000 hommes de la péninsule. Ils feront largement défaut sur le front espagnol. De fait, l’offensive de Wellington, le 22 juillet 1812, permit à celui-ci de remporter sur le général français Marmont la victoire des Arapiles. C’est à la suite de ce succès hispano-britannique que fut publié un nouveau règlement. Il prouve combien les Espagnols étaient conscients des dangers pour l’avenir de la nouvelle forme de guerre irrégulière qu’ils venaient pourtant de prôner. Il s’agit d’un reglemento para las partidas de guerillera, en date du 11 juillet 1812. Dans le même esprit, un dernier règlement sera publié en juillet, alors que la guerre était pratiquement terminée : le reglemento para los cuerpos francos o partidas de guerilla .
Le premier règlement du 11 juillet 1812, comportant un préambule et sept chapitres, entend apparaître comme une structure légale (6). Il n’a pas été établi avec précipitation, comme celui de 1808, ou dans le feu de l’action, comme "l’Instruction sur le corso terrestre". Il annonce la "normalisation", qui sera nettement édictée en 1814, lorsque se posera le problème de la réinsertion des guérilleros dans la société.
La stratégie demeure inchangée : "harceler l’ennemi et soutenir l’esprit patriotique des régions envahies (…)". Il faut "couper les routes militaires de l’ennemi, intercepter ses courriers et ses convois, attaquer ses hôpitaux et ses entrepôts" (Horta Rodriguez, p. 39). Le fait de souligner l’attaque des hôpitaux montre à quel point cette guerre est cruelle, faute de règles à respecter. Cela ne signifie pas que tous les guérilleros fussent toujours cruels : la guerre, la conduite de l’ennemi qui ne pouvait être indulgente par ces raisons mêmes, la personnalité des chefs des guérilleros, déterminaient bien souvent leur attitude. Notons, toutefois, qu’aucun des règlements de la guérilla n’a jamais fait allusion aux prisonniers, sujet épineux et vaste s’il en est.
Peut-être en contrepoint des dangers induits par cette forme de guerre sans limites, on cherche désormais à souligner le caractère "militaire" des guerillas de manière bien plus nette que dans le règlement de 1808. Ce caractère "militaire" se concrétise par la dépendance accrue des groupes de "partisans" vis-à-vis du général-en-chef ou du commandant de district, la soumission à la discipline et aux lois militaires, la suspension de fonction en cas de mauvaise conduite. On a le sentiment d’une reprise en main du phénomène par les instances "régulières". Fait capital, la collaboration avec l’armée s’établit dorénavant pour "chaque opération militaire importante". Le commandant a toute liberté d’action avec sa bande de « partisans » dans "l’attente des ordres du général en chef". L’élément nouveau, c’est que, lorsque ces troupes reçoivent des ordres des autorités citées, elles sont tenues de leur obéir en "allant jusqu’à abandonner leurs projets" (Horta Rodriguez, p. 39).
Les problèmes apparaissent lorsqu’on aborde la question du butin des bandes de "partisans", en particulier lorsqu’il s’y trouve des biens appartenant à des Espagnols. Il est établi que tout ce qui est pris devient la propriété exclusive des "partisans", exception faite de ce qui appartient "aux corps constitués de l’armée" ou aux "bons" Espagnols. Les biens pris et abandonnés par l’ennemi doivent, en effet, être rendus à leurs propriétaires, en laissant cependant aux "corps-francs" un quart de la valeur de ces biens.
Un élément inquiétant apparaît dans ces articles : c’est la notion problématique de "bons" Espagnols, ce qui suppose qu’il y en a de « mauvais » (Horta Rodriguez, p. 40). C’est l’un des aspects inévitables et tragiques de cette guerre patriotique qui tourne parfois à la guerre civile. Sont considérés comme "bons" Espagnols ceux qui soutiennent la lutte contre l’occupant français, et comme "mauvais" Espagnols les Afrancesados, autrement dit appartenant au parti pro-français et considérés comme de vulgaires collaborateurs. Mais, comme toujours dans de tels cas, les abus et les dérapages risquent d’être nombreux.
Immanquablement se pose la question de savoir si cela n’est pas susceptible de favoriser un banditisme pur et simple. Cela constitue un vrai problème dès lors que le contrôle du "tiers régulier" dont parle Carl Schmitt s’amenuise. De fait, l’article de 1812 enjoint de manière assez problématique, celui qui procède à l’arrestation, d’agir "avec justice", à l’instar du "bandit généreux". On mesure les dangers qui risquent, à terme, de surgir. Par définition, toute "justice" ne peut relever que d’une institution étatique, seule compétente en la matière : en d’autres termes, tout particulier n’est justiciable que devant une institution politique dont la régularité dérive du caractère souverain du pouvoir étatique constitué. Or, le texte autorise un particulier à la rendre en faisant appel à sa "bonne volonté" individuelle. Le règlement de 1812 insiste d’ailleurs sur les relations entre le peuple et les "bandes" (7). Violences et abus sont énumérés, ainsi que les sanctions que leurs auteurs peuvent encourir. Pour chercher à prévenir des dérapages, on interdit d’arrêter ou de poursuivre qui que ce soit, hormis les déserteurs. On révèle ainsi en creux les cas de détention arbitraire commis par quelques bandes qui s’érigent en juges des "mauvais Espagnols".
La comparaison des deux règlements de 1812 et 1814 s’avère particulièrement intéressante pour saisir l’évolution des esprits quant au problème du partisan espagnol. Pour la première fois, en effet, le terme de guerilla apparaît en tant que tel dans une réglementation. L’article II du règlement de 1812 précise que les partidas devront désormais porter le nom de "corps-francs" ; ces derniers préfigurent ceux qui existeront par la suite, notamment en France durant la guerre de 1870. Le règlement de 1814 s’intitule, pour sa part, "Règlement sur les corps francs et les partis de guérilla" – un substantif promis à la postérité.
La reconnaissance des services rendus par les "partisans" est, certes, explicite dans le préambule des deux règlements. Mais des différences entre les deux textes sont manifestes, en partie à cause du changement de conjoncture politique entraînée par la défaite de Napoléon (8) et le désir d’un retour à une normalisation politique. Ainsi, dans le premier règlement, celui du 11 juillet 1812, on exalte encore l’esprit patriotique et on préconise toujours l’augmentation du nombre des guérilleros, en accord toutefois avec les décisions prises aux Cortes, à savoir le parlement espagnol. Mais le préambule de 1812 reconnaissait déjà l’existence de guérillas qui, "profitant du désordre et de la confusion engendrée par les malheurs de la nation, ont abusé de la confiance qu’on avait mise en elles" (Horta Rodriguez, p. 41).
Le règlement du 28 juillet 1814, quant à lui, va jusqu’à porter un jugement très critique sur les précédents règlements et sur la guérilla dont "les circonstances et les troubles passés n’ont pas permis de fixer les règles avec discernement…" (Horta Rodriguez, p. 41). Ce dernier règlement est clairement dicté par le désir de dissoudre les guérillas. De fait, on se prépare à "réformer et dissoudre les bandes de partisans dont la conduite n’a pas été des plus brillantes" (Horta Rodriguez, p. 41). On abandonne non seulement la création de ces "corps", mais aussi l’idée de leur intégration éventuelle dans l’armée, comme cela avait pu être envisagé antérieurement.
Ainsi, les autorités renforcent des positions héritières de l’Ancien Régime qui trouveront leur consécration lors de la tenue du Congrès de Vienne, entre novembre 1814 et juin 1815. Schmitt considère d’ailleurs que ce Congrès peut se présenter comme une gigantesque œuvre de "Restauration", au sens propre comme au sens figuré : par-delà la "restauration" du principe de légitimité dynastique en Europe se trouve induit celui du droit classique de la guerre, mis à mal par la tornade révolutionnaire. C’est bien ce qu’annonce le règlement espagnol de 1814, qui sonne en fait comme une reprise en main, avec un retour à travers la « régularité » de l’armée, à la légitimité royale, une fois le danger passé.
Le problème délicat entre tous est celui de la réintégration de ces hommes dans la vie civile. Le règlement de 1812 avait prévu d’une manière imprécise mais néanmoins généreuse, la possibilité pour les officiers de la guérilla d’entrer dans l’armée. Le règlement de 1814 réaffirme encore cette possibilité, mais avec beaucoup plus de réserves. Il est stipulé que, "afin de ne pas porter préjudice en aucune manière aux classes méritantes de l’armée, ils occuperont, lorsqu’ils l’auront obtenu, à grade égal, un poste inférieur" (Horta Rodriguez, p.41). On ne saurait être plus explicite.
Les conséquences sur le plan européen induites par l’exemple espagnol de la guérilla et la légitimation juridico-politique qui lui est donnée sont considérables. Les différents règlements pour la guérilla espagnole constituent un précédent et un exemple décisif qui sera repris par d’autres pays en lutte contre Napoléon, notamment à travers l’Édit royal prussien d’avril 1813 – le Landsturm Ordnung –, puis lors de la campagne de Russie, voire bien au-delà.
Le Congrès de Vienne qui suit la défaite de Napoléon apparaît certes comme une tentative inédite de Restauration de l’ancien nomos européen de la terre et du droit classique qui lui était afférent. Il semble même renvoyer le "partisan" aux oubliettes de l’Histoire. Mais, pour Carl Schmitt, c’était mal mesurer l’importance de ce qui venait de se passer. L’émergence de la figure conceptuelle du partisan au sein d’un cadre juridico-politique sans précédent avait irréversiblement sonné le glas du droit "classique", et le fait est qu’il sera appelé au destin extraordinaire que l’on sait au XXe siècle.
David RIGOULET-ROZE
article paru dans les Cahiers du Centre d'Etudes d'Histoire de la Défense n°18 (2002)
NOTES :
1/ Littéralement "afrancisés", c'est-à-dire membres du parti pro-français.
2/ L'armée royale.
3/ Cf. Jover Zamora (José Maria), "La guerra de la Independencia Espanola en el marco de las guerras europas de liberacion (1808-1814)", in Historia de la guerra 1. La guerra de la Independencia Espanola y los sitios de Zaragoza, Universidad Ayuntamiento de Zaragoza, Saragosse, 1958, 636 pages, p. 41-165.
4/ Instruccion que Sa Majestad se ha dignado aprobar par el Corso terrestre contra los exécritos francesos, soumis par V. Alcala Galiano à la Junte Centrale.
5/ Selon le dictionnaire de la langue espagnole, le corso est "la campagne que les marchands, patentés par leur gouvernement, mènent contre les pirates ou les embarcations ennemies" ; la patente du corso, quant à elle, est une "cédule ou un brevet par lequel le gouvernement d'un État qui autorise un sujet à participer à l'expédition maritime contre les ennemis de la nation". Cf. Dictionario de la lengua espanola, Real Academia Espanola, Madrid, 1956, p. 374.
6/ Le règlement de 1812 fut publié à Cadix par Don Nicolas Gomez Requena.
7/ La régence avait déjà tenté de corriger par des décisions de portée limitée les abus que les règlements antérieurs n'ont pu que favoriser. Ainsi, le 15 septembre 1811, elle avait donné des instructions pour dissoudre les cuadrillas qui causent des torts à la population.
8/ La campagne de Russie s'achève en novembre 1812 par la Bérézina, et 1813 est l'année de la coalition générale contre Napoléon (Autriche, Russie, Prusse), lequel sera vaincu à la bataille de Leipzig en octobre 1813.
00:05 Publié dans Histoire, Militaria, Polémologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, histoire, époque napoléonienne, guerilla, théorie politique, carl schmitt, politologie, sciences politiques, philosophie, militaria, polémologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 avril 2012
Martin van Crevelds neues Werk
| Martin van Crevelds neues Werk „Kriegs-Kultur“ und die Frage, warum wir kämpfen |
|
Geschrieben von: Wolfram Wehl |
|
Ex: http://www.blauenarzisse.de/
|
|
Martin van Creveld zählt zu den renommiertesten Militärhistorikern weltweit. Nach seinem umstrittenen Werk Kampfkraft, erschien vor kurzer Zeit eine neue Publikation. In: Kriegs-Kultur. Warum wir kämpfen: Die tiefen Wurzeln bewaffneter Konflikte beschreibt van Creveld den Krieg als kulturelles Phänomen. Der Autor zeichnet in fünf Abschnitten ein detailliertes Bild verschiedener Kriegs-Kulturen. Diese reichen vom antiken Griechenland bis in die heutige Zeit. Nach van Creveld spiegelt sich eine Kriegs-Kultur vor allem in Bräuchen, besonderen Kriegs-Regeln (deren Überschreitung als schlimmstes Verbrechen galt), Kriegsspielen und dem Gedenken an den Krieg wieder. Waffen als Phallus-Symbole Zu Beginn stellt van Crefeld die These auf, dass Waffen nicht nur einfache Werkzeuge sind. Dies wird seiner Meinung nach bereits anhand der ausgewählten Namensgebung von Kriegsgeräten deutlich, wie beispielsweise die „Dicke Bertha“, ein Geschütz aus dem ersten Weltkrieg, oder die großen amerikanischen Flugzeugträger „Eisenhower“ und „McArthur“ bezeugen. Flugzeuge wurden häufig individuell angemalt, zeitweise auch mit leicht bekleideten Frauen. Lange Zeit war der Krieg schließlich eine reine Männerdomäne. Dies führt den Militärhistoriker zu einem spannenden Vergleich: Inwiefern können Kriegsgeräte als sexuelle Symbole wirken? So wird zum Beispiel bei Geschossen und Projektilen die Ähnlichkeit mit dem männlichen Geschlechtsteil dadurch verstärkt, dass ihre Spitzen oftmals einen hellen Farbanstrich erhalten. Gerade deswegen werden scharfe Waffen oft von Männern geschätzt, da sie nicht nur den Körper einer anderen Person zerreißen, sondern auch in ihn eindringen können. Krieg ist allgegenwärtig und ein Bestandteil menschlichen Lebens Dass der Krieg grausam und schrecklich ist, bestreitet van Creveld nicht. Dennoch übt er bis heute auf jeden Einzelnen eine persönliche Wirkung aus, wie sie in zahllosen Feldtagebüchern und Memoiren dokumentiert sind. Nicht nur in der Literatur (man denke an die Ilias), sondern vor allem in der Filmindustrie (Hollywood) hat das Thema Krieg einen festen Bestanteil. Die Regisseure wissen, dass man mit Filmstreifen wie Terminator oder Apocalypse Now ein breites Publikum begeistern kann. An vielen Stellen weist der Autor darauf hin, dass Krieg und Kriegsspiele (als Vorläufer vom Krieg) Männersache sind. Das fängt bei Schach, dem klassischen Kriegsspiel, an und geht über Gladiatorenkämpfe bis hin zu den großen Feldzügen des 20. Jahrhunderts weiter. In diesem Zusammenhang benennt er den Krieg als „großes Spiel“, wo es um Leben und Tod geht. Dazu schreibt van Creveld: „Füllt der Geruch der Gefahr die Luft, werden Soldaten von teuren Nichtstuern zu sehr wertvollen Erzeugnissen verwandelt.“ Am Ende steht die Frage, ob eine Nation auch ohne eine Kriegskultur auskommen kann. Dieser Gedanke wird vom Autor schnell verneint, denn diesen Ländern drohe der gesellschaftliche Zerfall und ihre Streitkräfte seien allerhöchstens noch „wilde Haufen ohne Manneszucht, ohne soldatische Regeln, die kaum noch kämpfen, sondern höchstens Gräuel verursachen.“ Schlimmer allerdings sei es, wenn die Streitkräfte „Opfer des Feminismus“ würden. Dadurch leide die gesamte Kriegs-Kultur und somit auch „die Fähigkeit, einen Krieg zu führen.“ Clausewitz widerlegen Das umfangreiche Werk Kriegs-Kultur ist aufgrund seiner Detailliertheit keine leichte Kost. Und doch liegt darin auch seine Stärke, da sich dem Leser aufgrund der Fülle des Materials völlig neue Zusammenhänge ergeben. So widerlegt van Creveld provokanterweise die These von Clausewitz, wonach Krieg lediglich ein Mittel zum Zweck sei, einen Gegner zu vernichten oder in die Handlungsunfähigkeit zu treiben. Der Autor zeigt nämlich vielmehr, dass der Krieg selber über die Jahrhunderte eine Faszination auf den Menschen ausgeübt hat, so sehr er sich auch dagegen wehren mag. Diese Begeisterung ist sowohl wichtiger Bestandteil wie auch Triebkraft der Kultur eines Krieges. In diesem Zusammenhang fügt er auch hinzu, dass jede Art „menschlicher Aktivität“ besser ausgeführt werde, wenn die Beteiligten bei ihrem Tun Vergnügen empfinden. Warum also sollte der Krieg davon eine Ausnahme bilden? Martin van Creveld: Kriegs-Kultur. Warum wir kämpfen: Die tiefen Wurzeln bewaffneter Konflikte. 560 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen. Ares-Verlag, Graz. 34,90 Euro. |
00:05 Publié dans Défense, Livre, Militaria, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, militaria, défense, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 20 février 2012
Le Capitaine Hermann Ehrhardt: ennemi de la République de Weimar et combattant clandestin
Jan ACKERMEIER:
Le Capitaine Hermann Ehrhardt: ennemi de la République de Weimar et combattant clandestin  Le Capitaine de corvette Hermann Ehrhardt était, au début des années 20, plus connu qu’Adolf Hitler. Il était l’espoir et la figure du chef pour la droite radicale allemande sous la République de Weimar. Il avait participé au putsch de Kapp; il avait combattu dans les Corps Francs; il avait été un “terroriste politique”, avait tiré les ficelles de plusieurs attentats politiques et était propriétaire terrien. A propos de sa personne, on affabulait et on brodait: on l’imaginait en permanence ourdissant des complots. Avec ses compagnons de combat, il était de toutes les conversations sous la République de Weimar, faisait souvent la une des journaux. Par deux fois, ce chef bien connu des Corps Francs a dû prendre la fuite en Autriche poursuivi par les sicaires de la police politique. La seconde fois, il est resté durablement sur le territoire de la république alpine et, en 1948, est devenu citoyen autrichien. Il est mort le 27 septembre 1971 dans son château à Brunn am Walde dans le Waldviertel. Quand il est mort, il y a quarante ans, son nom et son itinéraire politique avaient été oubliés depuis longtemps. Son décès n’a suscité qu’une brève notule dans le “Spiegel” de l’époque. Qui donc était cet homme qui, jusqu’à la fin des années 20, avait été considéré comme l’ennemi le plus dangereux de la jeune République de Weimar?
Le Capitaine de corvette Hermann Ehrhardt était, au début des années 20, plus connu qu’Adolf Hitler. Il était l’espoir et la figure du chef pour la droite radicale allemande sous la République de Weimar. Il avait participé au putsch de Kapp; il avait combattu dans les Corps Francs; il avait été un “terroriste politique”, avait tiré les ficelles de plusieurs attentats politiques et était propriétaire terrien. A propos de sa personne, on affabulait et on brodait: on l’imaginait en permanence ourdissant des complots. Avec ses compagnons de combat, il était de toutes les conversations sous la République de Weimar, faisait souvent la une des journaux. Par deux fois, ce chef bien connu des Corps Francs a dû prendre la fuite en Autriche poursuivi par les sicaires de la police politique. La seconde fois, il est resté durablement sur le territoire de la république alpine et, en 1948, est devenu citoyen autrichien. Il est mort le 27 septembre 1971 dans son château à Brunn am Walde dans le Waldviertel. Quand il est mort, il y a quarante ans, son nom et son itinéraire politique avaient été oubliés depuis longtemps. Son décès n’a suscité qu’une brève notule dans le “Spiegel” de l’époque. Qui donc était cet homme qui, jusqu’à la fin des années 20, avait été considéré comme l’ennemi le plus dangereux de la jeune République de Weimar?
Hermann Ehrhardt était né le 29 novembre 1881 à la lisière de la Forêt Noire, dans la localité de Diersburg dans le Pays de Bade. En 1899, il s’engage comme cadet de la mer dans la marine impériale allemande et y achève une carrière typique d’officier de marine. En 1904, alors qu’il a acquis le grade de sous-lieutenant (“Leutnant zur See”), il participe, sous les ordres du Lieutenant-Colonel Ludwig von Estorff, aux opérations destinées à mater la révolte des Hereros dans le Sud-Ouest africain, à l’époque colonie allemande. Ehrhardt lui-même décrira cette aventure, ainsi que d’autres épisodes de sa vie mouvementée, dans un livre intitulé “Kapitän Ehrhardt – Abenteuer und Schicksale” (“Capitaine Ehrhardt – Aventures et destinées”) et paru en 1924, alors que sa notoriété était à son zénith ainsi que son influence sur les droites politiques de l’époque de Weimar.
Quand éclate la première guerre mondiale, Ehrhardt était “Kapitänleutnant” et chef d’une demie flotille de torpilleurs. En cette qualité, il avait participé à la bataille du Skagerrak, notamment aux opérations qui avaient conduit à la destruction du destroyer britannique “HMS Nomad” de 1000 tonnes. La demie flotille d’Ehrhardt fut alors envoyée en Flandre en octobre 1916 pour lancer des opérations de reconnaissance et des raids dans la Manche, afin de protéger l’action des sous-marins. En 1917, Ehrhardt est promu “Korvettenkapitän”. En septembre de la même année, il devient le commandant de la IX flotille de torpilleurs, fonction qu’il conserve jusqu’à la fin des hostilités. Après l’armistice, en 1919, il conduit son unité à Scapa Flow, où les équipages font saborber les torpilleurs. Ehrhardt n’a pas assisté lui-même au sabordage de sa flotille car, avec la plupart de ses hommes, il était déjà retourné à Wilhelmshaven.
Le 27 janvier 1919, les communistes proclament la “République des Conseils de Wilhelmshaven”. Réagissant à cette mutinerie des matelots de Wilhelmshaven, Ehrhardt rassemble autour de lui 300 officiers de marine, des hommes de sa propre flotille ainsi que d’autres unités, et donne l’assaut, le soir même de la proclamation de cette “République des Conseils”, au quartier général des révolutionnaires. Le 17 février, il fonde, après une intense campagne de recrutement parmi les marins non communistes, la “Marinebrigade Ehrhardt”, l’un des premiers Corps Francs de l’après-guerre allemand. Elle compte environ 1500 hommes.
Avec ce Corps Francs, l’un des plus connu dans l’espace allemand entre 1918 et 1923, Ehrhardt participe à l’élimination des “républiques des conseils” de Munich et de Braunschweig en avril et en mai 1919. Dans le centre du pays aussi, la Brigade Ehrhardt met un terme à plusieurs foyers insurrectionnels. En août 1919, la Brigade est engagée contre la première insurrection polonaise en Haute-Silésie. A la fin de l’année 1919, la troupe se voit renforcée par des éléments issus des unités ayant opéré dans les Pays Baltes, si bien qu’elle finit par compter 4000 hommes. A la charnière des années 1919 et 1920, Ehrhardt et ses hommes sont au repos et casernés dans le camp d’entraînement de Döberitz près de Berlin, où la dissolution de tous les Corps Francs, y compris la Brigade de Marine d’Ehrhardt, doit avoir lieu, comme l’exigent les vainqueurs. 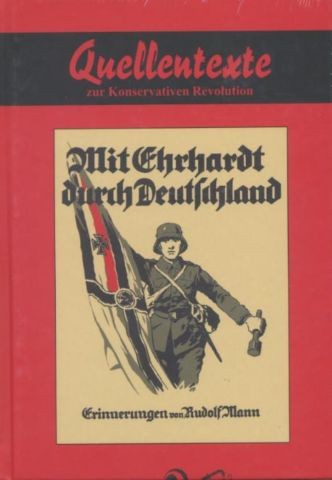 Au début du mois de mars 1920, Ehrhardt entre en rébellion contre l’ordre de dissolution et rejoint le putsch dit de Kapp, mené par un haut fonctionnaire prussien, Wolfgang Kapp, et par un général d’infanterie, Walther von Lüttwitz. La mission de la Brigade Ehrhardt était d’occuper le quartier gouvernemental de la capitale. Au cours de ce putsch, Ehrhardt a fait savoir ce qu’il entendait par “application de la violence” en cas de coup d’Etat: après que les fonctionnaires berlinois aient refusé de travailler pour le gouvernement putschiste, Ehrhardt aurait dit: “Eh bien, nous allons coller au mur les trois premiers fonctionnaires qui refusent de travailler. On verra bien alors si le reste va se mettre à travailler ou non”. Lorsque Kapp refusa d’appliquer cette mesure drastique, Ehrhardt a lâché ce commentaire: “Alors le putsch est fichu!”.
Au début du mois de mars 1920, Ehrhardt entre en rébellion contre l’ordre de dissolution et rejoint le putsch dit de Kapp, mené par un haut fonctionnaire prussien, Wolfgang Kapp, et par un général d’infanterie, Walther von Lüttwitz. La mission de la Brigade Ehrhardt était d’occuper le quartier gouvernemental de la capitale. Au cours de ce putsch, Ehrhardt a fait savoir ce qu’il entendait par “application de la violence” en cas de coup d’Etat: après que les fonctionnaires berlinois aient refusé de travailler pour le gouvernement putschiste, Ehrhardt aurait dit: “Eh bien, nous allons coller au mur les trois premiers fonctionnaires qui refusent de travailler. On verra bien alors si le reste va se mettre à travailler ou non”. Lorsque Kapp refusa d’appliquer cette mesure drastique, Ehrhardt a lâché ce commentaire: “Alors le putsch est fichu!”.
Après l’échec du putsch de Kapp et la dissolution effective de la Brigade, le 31 mai 1920, la tête d’Ehrhardt fut mise à prix en Prusse. Il prit la fuite et se réfugia en Bavière, à Munich, où les nationaux tenaient le pouvoir sous la houlette du premier ministre bavarois, le Chevalier Gustav von Kahr. Celui-ci toléra sa présence sur le sol bavarois et ne le fit pas extrader. Alors qu’une partie de ses anciens soldats et compagnons s’engageaient dans la Reichswehr nouvellement reconstituée, une autre partie choisit la clandestinité: par l’intermédiaire de l’“Organisation Consul”, ils participèrent à l’organisation et à l’exécution de nombreux attentats politiques. Ainsi, Matthias Erzberger, Karl Geis et Walter Rathenau ont été éliminés par d’anciens combattants de la Brigade Ehrhardt. Immédiatement après l’attentat perpétré contre Erzberger, Ehrhardt se réfugia en Hongrie car il craignait d’être arrêté, accusé d’avoir tiré les ficelles du complot fatal. Vu l’état de l’opinion publique après les premiers attentats, la Bavière n’offrait plus un refuge sûr pour le Capitaine.
En novembre 1922, Ehrhardt revient de son exil hongrois. Il est immédiatement arrêté. Mais, en juillet 1923, avec l’aide de ses hommes, Ehrhardt réussit une évasion spectaculaire et se réfugie en Suisse, puis revient à Munich sous une fausse identité. Dans les cercles nationalistes de la capitale bavaroise, il s’oppose de manière véhémente et ferme contre le putsch manigancé par Hitler et Ludendorff, car, à son avis, il avait été préparé de manière fort peu professionnelle. Dès ce moment, les nationaux-socialistes considèreront Ehrhardt comme une personnalité peu fiable. Le Capitaine a perdu aussi beaucoup de son prestige dans les rangs des droites allemandes. En avril 1924, vu l’imminence d’un procès pénal, Hermann Ehrhardt quitte le Reich pour l’Autriche; il revient en octobre 1926 après une amnistie générale décrétée par le Président Paul von Hindenburg. En 1931, Ehrhardt fonde le groupe “Gefolgschaft” (littéralement: la “Suite”), qui, malgré la perte de prestige subie par Ehrhardt, parvient encore à rassembler plus de 2000 de ses adhérants, ainsi que des nationaux-socialistes et des communistes déçus. Ils voulaient empêcher Hitler de prendre le pouvoir et fustigeaient la “mauvaise politique de la NSDAP”. Ehrhardt entretenait des rapports avec Otto Strasser et l’aile socialiste de la NSDAP. En 1933, Ehrhardt s’installe sur les terres du Comte von Bredow à Klessen dans le Westhavelland. En juin 1934, quand Hitler élimine Röhm, Ehrhardt aurait normalement dû faire partie des victimes de la purge. Il a réussi à prendre la fuite à temps devant les SS venus pour l’abattre, en se réfugiant dans la forêt toute proche. Les sicaires ne l’ont que mollement poursuivi car, dit-on, beaucoup de membres de sa Brigade avaient rejoint les SS. Ehrhardt s’est d’abord réfugié en Suisse puis, en 1936, en Autriche, où son épouse, le Princesse Viktoria zu Hohenlohe-Öhringen possédait un château à Brunn im Walde dans le Waldviertel. Ehrhardt n’a plus fait autre chose que gérer ces terres, que participer à des chasses au gibier et que s’adonner à la sylviculture. Il s’est complètement retiré de la politique.
Dès ce moment, les nationaux-socialistes considèreront Ehrhardt comme une personnalité peu fiable. Le Capitaine a perdu aussi beaucoup de son prestige dans les rangs des droites allemandes. En avril 1924, vu l’imminence d’un procès pénal, Hermann Ehrhardt quitte le Reich pour l’Autriche; il revient en octobre 1926 après une amnistie générale décrétée par le Président Paul von Hindenburg. En 1931, Ehrhardt fonde le groupe “Gefolgschaft” (littéralement: la “Suite”), qui, malgré la perte de prestige subie par Ehrhardt, parvient encore à rassembler plus de 2000 de ses adhérants, ainsi que des nationaux-socialistes et des communistes déçus. Ils voulaient empêcher Hitler de prendre le pouvoir et fustigeaient la “mauvaise politique de la NSDAP”. Ehrhardt entretenait des rapports avec Otto Strasser et l’aile socialiste de la NSDAP. En 1933, Ehrhardt s’installe sur les terres du Comte von Bredow à Klessen dans le Westhavelland. En juin 1934, quand Hitler élimine Röhm, Ehrhardt aurait normalement dû faire partie des victimes de la purge. Il a réussi à prendre la fuite à temps devant les SS venus pour l’abattre, en se réfugiant dans la forêt toute proche. Les sicaires ne l’ont que mollement poursuivi car, dit-on, beaucoup de membres de sa Brigade avaient rejoint les SS. Ehrhardt s’est d’abord réfugié en Suisse puis, en 1936, en Autriche, où son épouse, le Princesse Viktoria zu Hohenlohe-Öhringen possédait un château à Brunn im Walde dans le Waldviertel. Ehrhardt n’a plus fait autre chose que gérer ces terres, que participer à des chasses au gibier et que s’adonner à la sylviculture. Il s’est complètement retiré de la politique.
Après l’Anschluss, Hitler fit savoir à Ehrhardt qu’il pouvait vivre en paix dans le Waldviertel à condition qu’il ne s’exprime plus politiquement et renonce à tout activisme. Après la seconde guerre mondiale, Hermann Ehrhardt est devenu citoyen autrichien en 1948. Après sa mort, il a été enterré dans le cimetière de la commune de Lichtenau im Waldviertel. La pierre tombale, sous laquelle reposent Ehrhardt et son épouse (décédée en 1976), est décorée de l’insigne de la Brigade, présentant un drakkar viking.
Jan ACKERMEIER.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°41/2011; http://www.zurzeit.at/ ).
00:05 Publié dans Histoire, Militaria, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, histoire militaire, militaria, allemagne, weimar, années 20, années 30, années 40, corps francs, kapitän ehrhardt |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 février 2012
La crise de la défense européenne

Michael WIESBERG:
La crise de la défense européenne
La crise financière oblige les Etats européens à trancher dans leurs budgets militaires. Résultat: la puissance européenne est battue en brèche
Le modérateur de la série radiodiffusée “Streitkräfte und Strategien” (= “Forces armées et stratégies”) de la station allemande NDR avait déclaré, en avril 2011, que “les spéculateurs de la City londonienne et de Wall Street” avaient réussi ce que “les diplomates n’étaient jamais parvenus à faire en des décennies, c’est-à-dire à désarmer l’Europe”. On ne peut pas encore prévoir quelles seront les conséquences de ce désarmement généralisé, résultat des incontournables mesures d’austérité prises récemment. On peut d’ores et déjà le deviner en dressant la liste des insuffisances dont ont fait montre plusieurs pays de l’OTAN lors de leur dernière intervention en Libye: l’Italie s’est vue obligée de retirer son porte-avions du théâtre des opérations pour raisons budgétaires; en prenant cette décision, l’Italie, pense Christian Möllig de la Fondation berlinoise “Wissenschaft und Politik”, “a inauguré une nouvelle page dans l’histoire militaire”. Mais cet exemple italien n’est pas le seul: la Grande-Bretagne, elle, a mis du jour au lendemain son porte-avions hors service et a envoyé à la ferraille de nouveaux navires de guerre, des patrouilleurs, qui venaient de sortir d’usine. Aux Pays-Bas, le gouvernement a été contraint de mettre au rancart des chars de combat qui venaient juste d’être modernisés. Hors OTAN, l’Autriche doit, pour sa part, déclasser les deux tiers de ses chars.
L’ancien ministre américain de la défense, Robert Gates, lors de sa visite d’adieu au quartier général de l’OTAN à Bruxelles en juin 2011, a annoncé un “avenir triste et sinistre” voire un risque patent d’“insignifiance militaire”. Il semble qu’il avait raison. D’autant plus que les budgets européens sont grevés de lourdes charges qui s’étendront sur le long terme. La situation les contraint à d’autres coupes budgétaires qui porteront essentiellement sur les armées.
Les forces armées risquent dorénavant d’être sous-financées, ce qui entraîne le danger qu’elles deviennent totalement incapables d’action sur le terrain. A cela s’ajoute que la puissance hégémonique au sein de l’OTAN, les Etats-Unis, prévoit également de trancher dans ses budgets militaires au cours des dix prochaines années. Le Pentagone veut économiser 490 milliards de dollars dans les dix ans à venir. Mais le ministère américain de la défense commente avec mauvaise humeur les efforts budgétaires des Européens en matières militaires. Ces efforts ont d’ores et déjà conduit à un important déséquilibre du financement des dépenses de l’OTAN. Actuellement, les Etats-Unis financent 75% de toutes les dépenses de l’Alliance, chiffre qui montre, simultanément, que les Etats européens, membres de l’OTAN, sont entièrement dépendants de l’hégémon. Robert Gates, lors de sa visite d’adieu, prenait un ton menaçant, en disant que les Etats-Unis n’allaient plus longtemps tolérer “de mettre leurs chiches ressources financières au service de nations qui refusent de se donner à elles-mêmes les moyens nécessaires pour assurer leur défense”.
Dans son long article paru en novembre 2011 et significativement intitulé “Europa ohne Verteidigung” (= “L’Europe sans défense”), Christian Möllig explique que l’état désastreux de la défense européenne a sauté aux yeux lors de l’intervention de l’OTAN contre la Libye, et pas seulement à cause du retrait du porte-avions italien. “Pas un seul Etat européen, pour ne pas parler de l’Europe dans son ensemble, n’a été en mesure de faire valoir ses intérêts, par le truchement de sa puissance militaire, sur une distance supérieure à 1000 km”. Ce qui est le plus alarmant, ajoutait-il dans son article, c’est que les Européens sont très objectivement “sourds et aveugles” parce qu’ils ne disposent pas du géostrationnaire global C4ISTAR, auquel seuls les Etats-Unis ont accès. Cette station coordonne et soutient le renseignement, la reconnaissance et la direction des opérations. Un chiffre, avancé par Möllig, montre clairement quelle est l’importance de C4ISTAR: près de 90% des actions militaires entreprises en Libye n’auraient pas été possibles sans le soutien américain.
Vu cette misère de la défense européenne, les Etats du Vieux Continent cherchent fébrilement une voie royale pour concilier les impératifs de l’austérité et les intérêts européens en matière de sécurité. On entend des slogans comme ceux de la future “smart defence” ou des “armées bonzaï”: ils ne font que cacher péniblement une triste réalité, où l’on veut déguiser l’amère nécessité en vertu. La notion de “smart defence” est surtout défendue par le secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen: les 28 pays membres de l’Alliance Atlantique devraient tout simplement coordonner et fusionner leurs capacités militaires. Sur le plan concret, cela signifie, d’abord, renoncer à toutes voies singulières dans les projets d’armement et, ensuite, éviter tout “doublon inutile dans les capacités”. La “smart defence”, prétend le secrétaire général danois, conduit à “davantage de sécurité pour moins d’argent”. L’optimisme de Rasmussen ne tient pas face à la réalité. Les tentatives entreprises jusqu’ici pour aboutir à une politique de sécurité commune ne valaient pas le prix du papier sur lesquelles leurs pompeuses déclarations étaient imprimées. Peu de signes nous indiquent qu’il en sera autrement dans l’avenir, même si les budgets seront de toutes les façons réduits de manière drastique. Pourquoi? Markus Kaim, expert ès questions militaires auprès de la Fondation “Wissenschaft und Politik”, nous l’explique. C’est dû aux réflexes nationaux de “persistance”: “En fait, vu les contraintes économiques, il n’y a pas d’autres alternatives que la coopération et l’intégration”. Dans de nombreuses capitales, on considère toutefois que la politique de défense est “un élément constitutif incontournable de la souveraineté nationale”. Par conséquent, promptitude et volonté de coopérer avec les voisins sont fort réduites.
Qui plus est, il y a encore d’autres clivages: les Français et les Britanniques, depuis les opérations lancées contre la Libye de Kadhafi, réchignent à construire des “capacités communes” avec l’Allemagne, rapporte notamment le “Financial Times Deutschland” (FTD) en octobre 2011. L’Allemagne a, elle, “d’autres priorités”, notamment la réforme de la Bundeswehr. De surcroît, le ministre allemand de la défense, Thomas de Mazière, a déclaré “ne pas vouloir se heurter à ses propres gens”. Finalement, il y a encore, côté allemand, le droit de veto du Parlement pour les questions de guerre et de paix, ce qui s’oppose à toute possibilité de réaction rapide en cas de crise. Il faut aussi tenir compte des intérêts propres aux industries nationales d’armement et d’équipement, qui, selon le FTD, craignent de devoir lâcher leur part du gâteau, parce qu’elles engrangent de gros bénéfices “grâce aux commandes de leurs gouvernements respectifs”. Voilà pourquoi on ne s’étonnera guère de la réaction de Thomas de Mazière, qui tient pour limité le “potentiel d’intégration”.
Les visions de Rasmussen sur la “smart defence” formeront l’un des thèmes centraux à aborder lors du prochain sommet de l’OTAN à Chicago en mai 2012. Mais rien n’interdit de penser qu’elles resteront de l’ordre des voeux pieux. Il suffit d’évoquer un seul exemple: la fameuse troupe d’intervention rapide de l’UE, dont la création fut décidée en 1999 et qui aurait dû compter jusqu’à 60.000 hommes, se fait toujours attendre. Ensuite, les fameux “Battlegroups” de l’UE, qui sont en théorie disponibles depuis cinq ans, n’ont encore jamais été engagés, alors que nombreuses occasions se sont présentées.
On finira donc, en Europe, par avoir des “armées bonzaïs”, soit des armées en miniature, dont la puissance de frappe militaire sera plus que précaire. L’expert de la Fondation “Wissenschaft und Politik”, Christian Möllig, voit la deconstruction militaire de l’Europe s’effectuer sur le court terme en trois étapes. “D’abord les capacités militaires proprement dites vont se réduire, ensuite viendra le tour des capacités militaro-industrielles et, finalement, celui des compétences technologiques générales du Vieux Continent”. En bout de course, les Européens perdront toute capacité à coopérer à quoi que ce soit, ce qui, ipso facto, enlève à l’OTAN sa raison d’être.
D’après l’avis de nombreux experts, les rapports de force militaire dans le monde, au cours des prochaines années et pour toutes les raisons évoquées, se déplaceront de l’Occident, aujourd’hui encore vaille que vaille dominant, vers les pays émergeants, ce qui permettra de parler d’un “changement de paradigme géostratégique”, ajoute Möllig. Les Etats-Unis tiennent d’ores et déjà compte de cette future évolution, dans la mesure où le principal point focal de leurs attentions militaro-stratégiques se situe désormais dans l’espace pacifique, où la Chine est devenue un challengeur à prendre très au sérieux. Une étude publié dans “The Military Balance 2011”, organe de l’IISS (“International Institute for Strategic Studies”) de Londres, confirme cette tendance: “Les budgets de la défense des Etats occidentaux sont sous pression et leurs efforts d’armement sont désormais limités. Mais dans d’autres régions du monde, surtout en Asie et au Proche Orient, les dépenses militaires et les achats d’armement connaissent un véritable ‘boom’. Bon nombre d’indices convaincants nous incitent à penser qu’une redistribution générale de la puissance militaire est en train de se produire à l’échelle mondiale”.
Il est évident, poursuit l’étude londonienne, que les glissements qui se sont opérés par la redistribution de la puissance économique s’observent également dans les dépenses militaires. Les Etats-Unis et les autres puissances occidentales sont en train de perdre, conclut l’étude, leur monopole dans les domaines clefs des technologies militaires, y compris dans les techniques dites “Stealth” (engins furtifs), dans celles des aéronefs sans pilote (les drones) et dans la gestion cybernétiques des opérations. Pour les Etats européens du moins, on peut prévoir qu’ils ne joueront bientôt plus aucun rôle en tant que facteurs d’ordre à l’échelle du globe.
Michael WIESBERG.
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°5/2012; http://www.jungefreiheit.de ).
01:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, défense, crise de la défense, armées, militaria, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 janvier 2012
A Guerra como Experiência Interior
A Guerra como Experiência Interior
Análise de uma Falsa Polêmica
 "Para o soldado - escreve Philippe Masson em L'Homme en Guerre 1901-2001 - para o verdadeiro combatente, a guerra se identifica com estranhas associações, uma mescla de fascinação e horror, humor e tristeza, ternura e crueldade. No combate, o homem pode manifestar covardia ou uma loucura sanguinária. Encontra-se sujeito entre o instinto pela vida e o instinto mortal, pulsões que podem lhe conduzir à morte mais abjeta ou ao espírito de sacrifício.
"Para o soldado - escreve Philippe Masson em L'Homme en Guerre 1901-2001 - para o verdadeiro combatente, a guerra se identifica com estranhas associações, uma mescla de fascinação e horror, humor e tristeza, ternura e crueldade. No combate, o homem pode manifestar covardia ou uma loucura sanguinária. Encontra-se sujeito entre o instinto pela vida e o instinto mortal, pulsões que podem lhe conduzir à morte mais abjeta ou ao espírito de sacrifício.
00:05 Publié dans Littérature, Militaria, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, ernst jünger, première guerre mondiale, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 novembre 2011
Koltchack le héros blanc de Sibérie
Koltchack le héros blanc de Sibérie
par Jean Bourdier
Ex: http://anti-mythes.blogspot.com
 Certaines familles semblent vouées dès l'abord - on pourrait presque dire « abonnées » - à des destins exceptionnels. Tel fut le cas de la famille Koltchak.
Certaines familles semblent vouées dès l'abord - on pourrait presque dire « abonnées » - à des destins exceptionnels. Tel fut le cas de la famille Koltchak. Les ancêtres de l'amiral Alexandre Vassilievitch Koltchak, commandant en chef des Armées blanches de Sibérie durant la guerre civile qui suivit la révolution rouge de 1917, étaient, en fait, bosniaques. L'un d'eux, pacha de l'Empire turc, fut fait prisonnier par les Russes en 1739, alors qu'il combattait en Moldavie, et décida de devenir Cosaque et de se fixer en Russie. Toute une lignée de militaires valeureux était ainsi inaugurée.
C'est au cours de la guerre de Crimée que Vassili Koltchak, père de l'amiral et lui-même brillant officier du génie, connut une aventure hors du commun. Comme, après la prise du fort de Malakoff, des soldats français s'employaient à dégager un monceau de cadavres russes, ils s'aperçurent que l'un des « morts » respirait encore.
Vassili Koltchak se rétablit et termina sa carrière comme général, après avoir écrit un livre à succès « en captivité », sur son expérience de prisonnier de guerre.
Son fils Alexandre, né en 1872, a choisi, quant à lui, la marine et, d'emblée, sa carrière s'annonce fort brillante à plus d'un égard. Il s'est spécialisé dans les rercherches hydrographiques et océanographiques, sujets sur lesquels il publia des articles qui commencent à faire autorité.
En 1899, à l'âge de vingt-sept ans, il accompagne dans l'Arctique un célèbre explorateur polaire, le baron Toll. Il revient au bout de deux ans, Mais, en 1903, repart à la recherche du baron dont on est sans nouvelles.
Un mariage mouvementé
Cette fois, deux événements vont marquer son retour, en 1904 : le déclenchement de la guerre russo-japonaise et un mariage qui va se dérouler dans d'assez étranges conditions. S'étant rendu compte qu'il n'aurait pas le temps matériel de se rendre à Saint-Pétersbourg, où habite sa fiancée, avant de rejoindre son poste à Port-Arthur, le lieutenant de vaisseau Koltchak télégraphie à son père de lui amener la jeune fille à Irkoutsk, en Sibérie orientale. Là, la cérémonie a lieu, et, le jour même, les jeunes époux regagnent l'un Saint-Pétersbourg et l'autre Port-Arthur.
Après une congestion pulmonaire qui l'immobilise quelque temps, Koltchak prend le commandement d'un mouilleur de mines et se distingue rapidement par sa compétence et sa bravoure. Blessé, il est fait prisonnier et détenu au Japon, avant de pouvoir regagner la Russie par le Canada.
Le sabre à la mer
En 1911, il revient à l'état-major comme responsable du secteur-clé de la Baltique, poste où le trouvera la Première Guerre mondiale.
Il se distingue - en particulier par son utilisation des mines, - au point qu'il sera nommé contre-amiral dès 1915, à l'âge de quarante-trois ans, vice-amiral et commandant en chef de la flotte de la mer Noire en 1916.
Il occupe encore ce poste lorsque éclatent les troubles de 1917. Les marins mutinés envahissent la passerelle du navire amiral, cernent Koltchak et le somment de rendre le sabre d'honneur gagné durant la guerre russo-japonaise, qu'il porte à la ceinture. Calme, méprisant, le regard lointain, l'amiral détache le sabre de son ceinturon et le jette par-dessus bord.
- Ce qui est venu de la mer retourne à la mer, dit-il seulement.
Les mutins reculent, impressionnés. Néanmoins, l'amiral doit se mettre à la disposition du gouvernement provisoire de Kerenski, qui, se méfiant de cet officier par trop intransigeant, le charge, pour l'éloigner, d'une mission technique auprès du Secrétariat à la Marine des Etats-Unis.
Il reste plusieurs mois aux Etats-Unis, puis, au mois de novembre, le gouvernement Kerenski étant tombé, il décide de regagner la Russie en passant par le Japon. A Tokyo, il apprend l'ouverture par les Bolcheviks des pourparlers de Brest-Litovsk en fin d'un armistice avec les Allemands. Il n'est pas question pour lui de servir un gouvernement qui déserte ses alliés en pleine guerre.
Il va donc trouver l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Tokyo, sir Conyngham Greene, et lui propose, conformément à son devoir d'officier russe, d'aller combattre « si possible sur le front occidental, dans les troupes terrestres et, si nécessaire, comme simple soldat. »
De Kharbine à Orusk
L'ambassadeur britannique considère, à juste titre, que l'emploi d'un personnage de cette qualité à un rang obscur serait un incroyable gaspillage. Il télégraphie en ce sens à Londres, et, en janvier 1918, Koltchak est invité à rejoindre en Mésopotamie la mission militaire spéciale commandée par l'étonnant général Dunsterville - celui-là même qui servit de modèle à Kipling dans « Stalky and Co ».
Mais, faisant escale à Singapour, l'amiral y reçoit un message des Britanniques lui demandant de se mettre en rapport de toute urgence avec le prince Koudatchev, ambassadeur de Russie à Pékin, afin de se joindre aux dirigeants du Chemin de Fer de l'Est chinois, en Mandchourie. Il accepte avec beaucoup de réticence, pensant qu'on veut le mettre ainsi sur la touche en tant que combattant, mais se rend à Pékin pour être finalement expédié à Kharbine, au mois de mai, avec mission de réorganiser les troupes russes quelque 3.000 hommes - du Chemin de Fer.
Le climat d'intrigue, de chaos et de corruption qu'il trouve à Kharbine ne fait rien pour dissiper la méfiance initiale de l'amiral. Les Japonais, dirigés par le général Nakajima, le chef de leur mission militaire, contrôlent le territoire et tirent les ficelles. Koltchak ne l'admet pas, pas plus qu'il n'admet les prétentions du chef cosaque Semenov à se tailler un royaume personnel en Mandchourie.
Finalement, au mois de juillet, l'amiral se rend personnellement à Tokyo pour tirer la situation au clair avec le haut commandement japonais. Il n'obtient que des réponses dilatoires qui achèvent de l'exaspérer. Ce seront les Britanniques, une fois de plus, qui feront appel à lui. Afin qu'il se rende en Sibérie, où s'est installé un directoire politique pour le moins mélangé, et où une remise en ordre serait, de toute évidence, nécessaire. C'est le 13 octobre que l'amiral arrive par le Transsibérien à Omsk, où siège le gouvernement provisoire en question. On le nomme aussitôt ministre de la Guerre et de la Marine, mais il ne tarde pas à se rendre compte qu'un gigantesque coup de balai est nécessaire dans cet endroit où règnent en maîtres le marché noir et la gabegie, et où les troupes, mal encadrées et encore plus mal commandées, ont tendance à plier devant les offensives des Rouges.
Le dit coup de balai aura lieu dans la nuit du 17 au 18 novembre 1918.
En cette nuit, un détachement militaire, comprenant notamment de jeunes officiers, vient arrêter trois membres socialistes du directoire, dont le président Avksentiev, pour les conduire à la frontière. Le reste du directoire se réunit à l'aube et prononce sa propre dissolution, en demandant à Koltchak d'assumer le pouvoir suprême.
L'amiral met plusieurs heures à se laisser convaincre, mais accepte finalement en protestant de son absence totale d'esprit partisan dans le domaine politique.
« Je me fixe comme objectifs essentiels, proclame-t-il, la création d'une armée efficace, la victoire sur le bolchevisme et le rétablissement de l'ordre et de la légalité afin que le peuple puisse choisir librement et sans aucune entrave la forme de gouvernement répondant à ses vœux. »
Par moins 45 degrés
Le coup d'Etat est, dans l'ensemble, fort bien accueilli par la population, lasse de la corruption et de l'incapacité du défunt directoire. Il est également vu d'un œil très favorable par les Britanniques de la mission militaire du général Knox. Mais, du coup, il se heurte immédiatement à la méfiance et à l'hostilité du calamiteux général Janin, chef de la mission militaire française. Atteint du délire de la conspiration, cet officier général, dont la seule blessure de guerre répertoriée est une luxation de l'épaule gauche sur un quai de gare, veut à toutes forces voir « la main de la perfide Albion » derrière l'intervention de Koltchak, qu'il prend aussitôt en grippe. Il ne veut pas en démordre et son obstination maladive aboutira à livrer la Sibérie aux Rouges.
En revanche, l'accession au pouvoir de l'amiral rallie tous les suffrages du général Dénikine et de l'Armée blanche du sud de la Russie.
Dès le mois de décembre 1918, Koltchak fait reprendre l'offensive contre les Bolcheviques, avec d'appréciables succès. La jeune armée sibérienne, malgré les carences de son équipement, se bat avec brio, réussissant sur certains points du front de huit cents kilomètres sur lequel elle est engagée, à avancer de trente-cinq kilomètres par jour, par un froid de -45°. Des chefs militaires de haute valeur s'y révèlent, comme le jeune colonel Kappel, bientôt nommé général.
Mais l'amiral doit faire face à bien des problèmes. Le premier est celui de sa santé ; atteint d'une affection pulmonaire presque chronique, il est miné par la fièvre, sans, pour autant, ralentir son activité. De plus, à Omak, le désordre et le marché noir ont recommencé à sévir. Le 21 décembre, une tentative de soulèvement socialiste a été aisément jugulée par l'armée, mais les intrigues se poursuivent.
Le plus inquiétant de tout est l'attitude de la Légion tchèque, qui avait assuré, au début, une partie de l'effort militaire contre les Rouges. Cette légion avait toute une histoire. Elle avait été constituée à l'origine par Kerensky avec des Tchèques ayant servi, contraints et forcés, dans l'armée austro-hongroise et, faits prisonniers par les Russes, ayant accepté de reprendre les armes dans l'autre camp.
En mars 1918, les Bolcheviques avaient signé un accord les remettant à la disposition des Alliés. Ils devaient être acheminés avec leurs armes vers Vladivostok pour y être embarqués à destination du front occidental. Mais, en mai, alors que les trains les transportant se dirigeaient vers l'Oural, les Rouges avaient tenté de les désarmer, et de violents incidents avaient éclaté dans plusieurs gares, et notamment dans celle de Tcheliabinsk. Sur quoi, ayant mis les gardes rouges en déroute, les Tchèques avaient rejoint les forces antibolcheviques de Sibérie.
Mais ces soldats tchèques sont - à de remarquables exceptions près, comme le capitaine Rudolf Gaïda, devenu général russe à moins de trente ans - des « corps étrangers » dans les armées blanches. Beaucoup se réclament du gouvernement en exil social-démocrate fondé sous la protection des Alliés par Masaryk, qui considère Koltchak et les siens comme « réactionnaires ». Et, surtout, ils sont placés sous le commandement théorique du général Janin.
Lénine découragé
Dès le mois de décembre, ils doivent être relevés sur le front occidental et sont affectés à la garde du chemin de fer transsibérien entre Tcheliabinsk et le lac Baïkal.
Pourtant, au mois de mars 1919, l'offensive de l'armée sibérienne se poursuit avec un plein succès. Elle menace Kazan, et son objectif principal est bel et bien devenu Moscou. En avril, les troupes de Koltchak, qui progressent sur un front de trois cents kilomètres, sont à moins de six cents kilomètres de la capitale.
Le 14 mai, les Alliés adressent à l'amiral un télégramme où ils se déclarent prêts, contre certaines garanties politiques, à tenir le gouvernement d'Omsk comme représentant l'ensemble de la Russie, une assemblée constituante devant être convoquée« dès l'arrivée à Moscou ».
Koltchak répond favorablement, en faisant tenir un double de sa correspondance à Dénikine, qui, le 30 mai, dans un ordre du jour daté d'Eksterinoder, reconnaît spontanément l'autorité de l'amiral « comme le chef suprême du gouvernement russe et le commandant en chef de toutes les armées russes ».
Malgré les tergiversations des Alliés - et, en particulier, il faut bien le dire, des Français la partie semble presque gagnée pour les Blancs. D'autant qu'au Sud, les troupes de Dénikine ; passées, le 2 mars, à une offensive ayant connu, deux mois durant, un sort incertain, ont fini par s'imposer - à quarante-cinq mille contre cent cinquante mille Rouges - et avancent de telle manière qu'une jonction avec Koltchak est envisagée.
C'est au point qu'à Moscou, Lénine se laisse aller à une déclaration pieusement tue, maintenant, par les historiographes marxistes :
« C'est entendu, nous avons raté notre coup. Mais notre grande réussite peut se résumer par une comparaison capitale : à Paris, la Commune avait tenu quelques jours. En Russie, elle aura tenu quelques mois... »
Il est vrai qu'à la différence de son compère Trotski, toujours tenace, combatif et courageux, Lénine était facilement lâche devant l'événement comme il le montra aussi bien à Pétrograd en 1917 que lors de l'offensive du général Ioudénitch, commandant l'Armée blanche du nord-ouest, en octobre 1919. Mais sa réaction n'en demeure pas moins significative.
Malheureusement, la situation ne tarde pas à se dégrader sur le front tenu par les troupes sibériennes. A la fin du mois de mai 1919, alors que la victoire semblait en vue, la progression est stoppée. Puis on commence à reculer devant des forces bolcheviques considérablement renforcées et, surtout, mieux équipées et mieux ravitaillées.
L'Armée blanche de Sibérie a, en effet, des lignes de communication dangereusement étirées. Et si, depuis quelque temps, des navires alliés ont commencé à débarquer du matériel à Vladivostok, son acheminement jusqu'à la zone du front est extrêmement difficile, long et hasardeux.
En juin, l'armée sibérienne du centre doit se replier, et l'armée du nord, commandée par Gaïda, est contrainte de suivre le mouvement pour n'être pas prise à revers sur son flanc gauche. Durant tout l'été, la retraite se poursuit.
Face aux intrigues
A Omsk aussi, le temps se gâte. Les revers militaires n'ont fait qu'attiser les intrigues diverses, menées aussi bien par les politiciens locaux que par certains représentants des Alliés. Koltchak, de plus en plus miné par la maladie, continue néanmoins à se battre sur tous les fronts.
La corruption qui continue à régner parmi les fonctionnaires et même certains officiers indigne l'amiral.
Il mène une existence austère, sort peu, ne reçoit pas, n'assiste qu'aux dîners officiels et ne participe en rien à cette « dolce vita » fin de siècle qui fait tant de ravages parmi les cadres anciens et nouveaux du Gouvernement local.
Certes, il a une maîtresse, mais, bien qu'étant de notoriété publique, cette liaison unique, visiblement fondée sur des sentiments profonds, décourage les amateurs de scandales.
De plus, Anna Timireva, femme séparée d'un amiral, ancien subordonné de Koltchak, n'est pas de celles qui suscitent l'esclandre.
Le dernier convoi
Au mois d'octobre, l'offensive rouge est devenue carrément impossible à enrayer. Du côté sibérien, on ne compte plus guère que sur l'hiver pour ralentir la progression des Bolcheviques, mais l'hiver, précisément, tarde à venir cette année-là.
Le 10 novembre, les avantgardes rouges ne se trouvent plus qu'à une soixantaine de kilomètres d'Omsk, déjà abandonnée par les missions militaires alliées. Et le 14, la 27e Division rouge s'emparera de la capitale après quelques brèves escarmouches.
Le Gouvernement s'est embarqué quatre jours plus tôt en direction d'Irkoutsk. Koltchak, lui, attend le dernier moment et ne part que quelques heures avant l'entrée des troupes rouges dans les faubourgs d'Omsk.
Il a pris place avec Anna Timireva, son état-major, sa garde personnelle et quelques civils, à bord d'un extraordinaire convoi de sept trains, dont l'un, comportant, vingt-neuf fourgons clos, transporte la réserve d'or du Gouvernement russe, stockée en Sibérie. Il sera rejoint le 7 décembre, à la gare de Taïga, par le président du conseil, Victor Pepelaïev.
Ce dernier voyage de l'amiral va prendre rapidement les allures d'un véritable chemin de croix. Autour de lui, tout s'effrite et tout s'effondre. Les Tchèques, soutenus par l'éternel général Janin, sont passés de la neutralité hargneuse à un véritable sabotage.
Et, le 13 décembre, à la gare de Marinsk, ils n'hésitent pas à faire passer le convoi de Koltchak sur la voie annexe - où l'on n'avance qu'à vitesse réduite en raison de l'encombrement. Toutes les protestations envoyées par l'amiral, tant au général Janin qu'au général Syrovy, commandant les troupes tchèques, restent vaines. La trahison est en train de se consommer.
La situation est telle que, le 16 décembre, le jeune général Kappel, devenu commandant en chef des troupes sibériennes, envoie à Syrovy un télégramme furibond où il exige du général tchèque réparation immédiate. C'est en vain.
Cependant, à Irkoutsk, une organisation regroupant les socialistes révolutionnaires et les mencheviks tente un putsch. Bientôt, la ville se trouve partagée entre elle et les troupes fidèles à Koltchak...
L'amiral trahi
Le 5 janvier 1920, Janin fait transmettre à l'amiral, toujours bloqué par les Tchèques, la proposition suivante : il sera escorté jusqu'à Irkoutsk par les Alliés, mais à la condition qu'il abandonne son convoi et voyage dans un seul wagon. Après quelques hésitations, Koltchak accepte, et, le 8 janvier au soir, l'unique wagon, accroché à une locomotive, s'ébranle, avec, à son bord, l'amiral, Anna Timireva et Victor Pepelaïev. des sentinelles tchèques armées stationnent dans les couloirs. Et lorsque, le 15, le train arrive à lrkoutsk, ce sont des miliciens socialistes à brassards rouges qui occupent les quais de la gare : l'amiral Koltchak vient d'être livré à ses ennemis...
D'ailleurs, deux officiers tchèques montent à bord du train et précisent : sur ordre du général Janin, l'amiral et ses compagnons vont être remis aux « autorités politiques locales ».
Koltchak conserve son calme glacial.
- Ainsi, c'est vrai, dit-il simplement, les Alliés m'ont trahi...
Le 20 janvier, les dirigeants socialistes cèdent officiellement la place à un « Comité révolutionnaire » bolchevique, et le lendemain, 21, Koltchak est appelé à comparaître devant une « Commission d'enquête extraordinaire » de cinq membres, présidée par les commissaires politiques rouges Tchoudnovsky et Popov. Coïncidence : l'aimable général Janin est parti pour un long et mystérieux voyage...
Une double exêcution
Mais un homme n'abandonne pas la partie : Kappel.
Avec son adjoint Voitzek-Hovsky et les maigres troupes qui lui restent, il est décidé à sauver l'amiral à tout prix. Il fonce vers Irkoutsk, et, le 20 janvier, s'empare de Nijneoudinsk. Mais le jeune général a les deux jambes gelées et les poumons atteints. Il refuse de se faire évacuer et continue sa route sur un simple traîneau, sur la neige. Le 27 janvier, il expire, en passant son commandement à Voitzekhovsky.
Celui-ci est son digne successeur. Enlevant à un train d'enfer ses troupes, pourtant épuisées, il arrive le 5 février aux portes d'Irkoutsk en ayant tout balayé sur son passage.
Le jour même, la « Commission d'enquête extraordinaire », muée en tribunal avec l'approbation du soviet de Tomsk, a décidé de faire fusiller Koltchak et Victor Pepelaïev. Les deux condamnés sont amenés au bord de la rivière Outchakovka, entièrement gelée. On a creusé un trou dans la glace. Ayant récité leurs prières, les deux hommes viennent se mettre devant, le dos à la rivière. Koltchak a refusé qu'on lui bande les yeux.
Une salve, puis une seconde.
Frappés à mort, les deux corps ont basculé dans l'eau immobile. Au-dessus d'eux, la glace commence à se reformer.
_________________
00:05 Publié dans Biographie, Histoire, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, russie blanche, révolution russe, urss, armées blanches, histoire, 20ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 12 octobre 2011
J'avais un camarade par Angerfist62
00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, légion étrangère, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 10 octobre 2011
La Legion marche par Angerfist62
00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : militaria, musique, légion étrangère |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 05 octobre 2011
Une armée très secrète aux ordres d'Obama
Ferdinando CALDA:
Une armée très secrète aux ordres d’Obama
 Le “Washington Post” révèle quelles ont été les opérations menées par le “Joint Special Operation Command”, une unité de combat qui a reçu l’autorisation de tuer et qui n’est aux ordres que du seul Président
Le “Washington Post” révèle quelles ont été les opérations menées par le “Joint Special Operation Command”, une unité de combat qui a reçu l’autorisation de tuer et qui n’est aux ordres que du seul Président
Mardi 6 septembre 2011, le général américain David Petraeus a pris officiellement la direction de la CIA, en succédant à Leon Panetta, devenu, lui, secrétaire à la défense. La nomination de l’ancien commandant des forces américaines en Irak puis de la coalition internationale en Afghanistan est considérée par bon nombre d’observateurs comme un pas de plus vers la “militarisation” de l’agence de renseignement américaine.
Ce dangereux glissement vient d’être confirmé par un article récent du “Washington Post”, dans lequel l’auteur démontre que, depuis l’attaque du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles, la CIA est devenue de plus en plus “un groupe paramilitaire, sans pour autant avoir le devoir de responsabilité et de transparence que l’armée est tenue de garantir”. C’est là, pour d’aucuns, un véritable “retournement mortel”, qui a transformé les renseignements américains en une agence d’espionnage et en une “incroyable machine à produire la mort”, pour paraphraser un ancien agent secret. Il suffit de penser que de 2001 à aujourd’hui les bombardements par drones ont tué un peu moins de trois mille personnes.
Mais le “Washington Post” rappelle quelques aspects plus particuliers encore de cette évolution: la guerre secrète détient actuellement une portée bien plus vaste et la lutte contre le terrorisme, telle qu’elle est envisagée par la Maison Blanche, est désormais soustraite à tout contrôle de l’opinion publique et, surtout, du Congrès. En citant un extrait du livre, récemment publié, de deux journalistes, Dana Priest et William M. Arkin, intitulé “Top Secret America: The Rise of the New American Security State”, le quotidien explique comment s’organise depuis quelques années le “Joint Special Operation Command” (JSOC), une unité militaire d’élite, ultra-secrète, qui opère au-delà de toutes les obligations qui incombent normalement à la CIA elle-même. Il s’agit d’une véritable armée parallèle aux effectifs de 25.000 hommes, dotés de leurs propres drones, de leurs propres avions de reconnaissance et même de leurs propres satellites. Et surtout, il ne faut pas oublier ceci: ils ont le droit de tuer. Le Président —l’unique personne, mis à part le chef du Pentagone, à laquelle ils doivent rendre des comptes— a autorisé les hommes du JSOC de sélectionner des particuliers dans la liste noire qu’ils ont reçue et de les tuer (inutile de préciser: sans aucune autre forme de procès et sans justification de la moindre preuve).
C’est donc ce qui s’est passé en mai dernier, lorsque ces hommes ont pénétré sur le territoire pakistanais pour éliminer Ousama Ben Laden. Ou encore en avril 2006, quand ils ont tué le chef d’al-Qaeda en Irak, Abou Moussab al-Zarqawi. De plus, grâce au caractère secret de leurs missions, ils ont pu mener des actions dans des pays qui ne sont pas en guerre avec les Etats-Unis, comme le Yémen, la Somalie, les Philippines, le Nigéria et, finalement, la Syrie.
“Nous sommes la matière obscure. Nous sommes la force qui meut l’univers, mais que l’on ne peut pas voir”, a dit, en se vantant, un membre du Corps d’élite des Navy Seals. Et cet homme ajoute: “La CIA n’a ni les dimensions ni l’autorité requise pour faire les choses que nous, nous faisons”.
En effet, les deux journalistes du “Washington Post” notent dans leur livre que si la CIA, avec ses propres drones et forces paramilitaires, a tué des milliers de persones, chefs d’Al-Qaeda et moudjahiddins de cette mouvance, la JSOC en a tué beaucoup plus. Ainsi, si la CIA a capturé et interrogé avec des “méthodes peu orthodoxes” une centaine de “suspects de terrorisme”, la JSOC en a capturé et interrogé “dix fois plus”.
Ferdinando CALDA.
( f.calda@rinascita.eu ).
(article tiré de “Rinascita”, Rome, 9 septembre 2011, http://www.rinascita.eu ).
00:25 Publié dans Actualité, Défense, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, armée, us army, obama, services spéciaux |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 août 2011
Prof. Buela: Sur l'accord franco-brésilien pour les sous-marins d'attaque

Entretien avec le Professeur Alberto Buela sur l'accord franco-brésilien pour les sous-marins d'attaque
Buenos Aires (NOVOpress) – L’accord de coopération franco-brésilien pour la construction de sous-marins d’attaque est passé largement inaperçu et peu de commentateurs en ont pris la juste mesure. Nous avons interrogé le professeur Alberto Buela, un des rares spécialistes argentins de géopolitique, pour qu’il mette en perspective les ambitions navales du Brésil.
L’inspirateur de cette politique n’est pas un penseur d’aujourd’hui. De même que les Nord-Américains sont encore influencés par les théories d’Alfred Thayer Mahan (1840-1914), les Brésiliens n’ont pas oublié les écrits du penseur « intégrationniste » portugais Antonio Sardinha (1888-1925) dont l’ouvrage majeur A Aliança Peninsular défend la thèse de la transformation de l’Atlantique sud en « mare nostrum » d’une alliance ibero-américaine.
En Argentine nous vivons depuis 2003 dans le cadre d’un régime social-démocrate qui a écarté avec horreur le conflit armé du champ des options permises au politique. Depuis cette date, les gouvernements successifs poursuivent une politique obstinée de démantèlement des Forces armées dans leurs trois composantes, Terre, Air et Mer.
Alberto Buela : les Anglais possèdent une base puissante aux îles Malouines, dotée des équipements de détection les plus sophistiqués et d’avions de combat les plus modernes. Cette situation ne changera pas dans un avenir proche.
En revanche, une communauté de destin des nations du sud du continent, renforcée par une force aéronavale conjointe argentine, brésilienne et chilienne, chargée d’assurer la défense régionale, change la donne. Elle encourage les autres nations à nous traiter avec davantage de respect, notamment les puissances qui pillent nos ressources maritimes.
Mais nous devons être réalistes. Tant que le Brésil et l’Argentine ne seront pas capables de montrer le chemin en constituant une force navale conjointe, les Anglais n’ont rien à craindre. En outre, tant que les Argentins resteront obnubilés par leurs problèmes internes et qu’ils n’accorderont pas à leur inimitié avec le Royaume Uni l’importance qu’elle mérite, Londres peut dormir sur ses deux oreilles.
Enfin, de la même manière que le Brésil et l’Argentine se rapprochent, dans l’hémisphère nord les Anglais cherchent à se rapprocher des Français pour compenser leur inéluctable affaiblissement. Nous devons donc prendre en compte non plus un affrontement qui opposerait les nations américaines à l’Angleterre, mais à une alliance franco-britannique. Alors, les données du jeu ne seront que plus complexes.
00:05 Publié dans Actualité, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, brésil, france, europe, affaires européennes, amérique latine, amérique du sud, coopération militaire, atlantique sud, atlantique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 août 2011
La liberté, la démocratie, l'autonomie, mais non sans une défense forte

La liberté, la démocratie, l’autonomie, mais non sans une défense forte
Envisager l’avenir avec une conscience historique fondée sur des faits – correctif nécessaire à la falsification de l’histoire par le Rapport Bergier
par Tobias Salander
Ex:http://www.horizons-et-debats.ch/
A quelles conditions les citoyens suisses de 2011 peuvent-ils envoyer au monde le message selon lequel ils veulent conserver leur liberté, leur démocratie et leur autonomie et en même temps rester le peuple le plus pacifique mais le plus apte à se défendre? C’est à cette question, posée à temps dans une période de grave crise économique et financière aux répercussions encore imprévisibles en Occident, en particulier dans les zones dollar et euro, que répond une nouvelle étude sur l’histoire de la Suisse entre 1933 et 1945 due à la plume d’un économiste et ex-commandant de bataillon d’infanterie qui a travaillé pour la Banque mondiale, l’ONU, l’OCDE, divers gouvernements et commanditaires privés dans plus de 100 pays.
S’appuyant sur une quantité de publications scientifiques concernant la Seconde Guerre mondiale, Gotthard Frick, dans son livre intitulé «Krieg und die Selbstbehauptung der Schweiz 1933–1945» propose une vision nouvelle et complète de la manière dont la Suisse a affirmé son autonomie et ses valeurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il indique les leçons à en tirer pour l’avenir et apporte un correctif aux travaux de la Commission Bergier. Cet ouvrage peut être chaudement recommandé à tous les citoyens et en particulier aux professeurs d’histoire et à leurs élèves. Il nous offre une vision de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale qui, loin de tout dénigrement idéologique, rétablit les faits, vision que tous ceux qui les ont vécus ne pourront que confirmer.
Après les attaques des années 1990 contre la Suisse commandées par certains milieux financiers de la côte Est des Etats-Unis et livrées par une cinquième colonne de pseudo-artistes, de personnes «fatiguées de défendre la patrie» (Heimatmüde), de girouettes et de carriéristes vendus et vulnérables au chantage qui auraient voulu, au moyen d’une vaste manipulation psychologique, pousser le pays à intégrer le nouvel ordre mondial, Frick réussit, en évaluant clairement les événements historiques connus, à ressusciter la volonté du pays à affirmer son autonomie et ses valeurs et à aiguiser sa perception de l’avenir. Il ne s’agit pas pour lui uniquement d’apporter une contribution au débat sur l’avenir de l’Armée suisse. Si, à l’époque, il valait la peine de consentir d’importants sacrifices pour éviter la guerre au pays, il faudrait aujourd’hui également «engager des réflexions exhaustives et à long terme si nous voulons préparer notre pays à un avenir qui sera sans doute beaucoup plus difficile et exigeant et peut-être aussi beaucoup plus menaçant que ne le pensent aujourd’hui de nombreuses personnes». (p. 2 sqq.) Ce sont là des réflexions qui ne devraient pas être abordées sérieusement qu’à l’occasion des cérémonies du 1er-Août.
Ceux qui empêchent leurs concitoyens d’envisager le passé les privent d’une vision personnelle de l’avenir. Les interprétations tordues dont les idéologues de la Commission Bergier ont inondé le peuple – ils n’ont pas apporté de faits nouveaux mais uniquement des interprétations erronées de l’histoire – doivent maintenant être démontées patiemment pièce après pièce. Gotthard Frick a le grand mérite d’avoir accompli ce précieux travail d’assainissement. Son évocation de la volonté des Confédérés d’affirmer leur autonomie dans une situation difficile, c’est-à-dire entre 1933 et 1945, est si claire, si respectueuse des faits et toujours envisagée dans la perspective de l’époque actuelle qu’elle peut constituer pour la jeunesse un repère, un point d’ancrage à partir duquel elle pourra s’attaquer aux problèmes de l’heure en étant pleinement conscients de ce qu’ont réalisé nos ancêtres et de la spécificité de notre histoire, celle d’un peuple qui ne voulait pas se laisser asservir, qui aimait la liberté par-dessus tout et voulait prendre en main ses affaires, mais toujours en tenant compte de la situation, sensibles au sort du prochain au-delà des frontières, solidaires et apportant son aide en cas de nécessité. Frick nous offre un contrepoint bienvenu aux machinations déjà mentionnées et aux nouvelles machinations dont l’objectif facile à déceler est de faire entrer la Suisse dans l’UE et l’OTAN, à en faire par conséquent une vassale et un soutien occulte des intérêts des grandes puissances.
Chaque pays a une armée: la sienne ou une armée étrangère
Mettons l’accent sur certains aspects de la présentation de Frick qui sont importants pour notre époque: l’évocation concise des conquêtes d’Hitler et des plans des Alliés – que l’auteur ne présente pas dans l’ordre chronologique mais selon les motifs qui les sous-tendent et cela d’une manière éclairante – montre une chose qui doit paraître évidente aux personnes à l’esprit social et pacifiste: Dans un monde où il n’y a finalement, entre les Etats, jamais d’amitiés mais seulement des intérêts, il n’y a pas de place pour la liberté et la dignité quand les pays démocratiques n’envisagent ni ne préparent les situations de crise. Frick explique qu’on peut développer l’Etat providence, se déclarer neutre avec fierté et ne pas investir dans l’armement. Mais alors on ne doit pas s’étonner si la situation politique se modifie du jour au lendemain et si un pays autrefois ami vient remplir le vide ainsi créé. C’est ce qui s’est passé en 1940 avec le Danemark et la Norvège et ce serait de nouveau possible aujourd’hui. On pourrait dire que nous ne nous défendrons pas en cas d’attaque parce qu’il serait absurde de le faire contre une puissance plus forte. Quelles seraient les conséquences? L’occupant déporterait les hommes et les forcerait à travailler dans l’industrie d’armement pour remplacer les travailleurs et les paysans qui combattent dans l’armée de l’agresseur. Peut-être qu’on les contraindrait à se battre au sein de la machine de conquête, à tuer, ne serait-ce que pour ne pas être tués. Ces conséquences effroyables qu’ont subies les pacifistes belges, danois, norvégiens, français, etc. mais aussi ceux qui se sont bien défendus mais ont été vaincus, comme les Serbes, Frick les décrit fort bien et il détruit de manière salutaire l’illusion consistant à croire qu’on pourrait rester passif aujourd’hui, et que ce ne serait pas si terrible d’être asservi. Pour Frick, l’histoire dément cette attitude de manière douloureuse.
Des voix étrangères louaient la Suisse
S’appuyant sur une quantité de documents de généraux, d’hommes d’Etat et de journalistes, l’auteur montre que les efforts de défense de la Suisse, en particulier la création du Réduit national, étaient pris très au sérieux, et pas seulement en Allemagne. Grâce à ces déclarations d’éminents étrangers, il donne une image authentique de la Suisse de l’époque (cf. les encadrés). La Suisse n’y apparaît pas comme antisémite. Au contraire, dans l’opuscule «Welt-Dienst» de l’Erfurter Verlag – qui était financé par l’Etat – elle est décrite rageusement comme «le seul paradis d’Europe pour les juifs» (p. 15). Il n’y est pas question d’un prétendu défaitisme des Suisses mais de leur esprit combatif et de leur capacité à se défendre qui pourrait donner du fil à retordre à la Wehrmacht. C’est ce qu’écrivait le général des troupes de montagnes de la Wehrmacht Franz Böhme, qui se suicida pendant sa détention par les Alliés à Nuremberg, dans son étude relative à une éventuelle attaque contre la Suisse. Le Times de Londres soulignait qu’aucune armée au monde ne pouvait mobiliser ses troupes aussi rapidement que l’armée suisse et l’étude Tannenbaum de la Wehrmacht de 1940 confirme cette appréciation, bien qu’avec d’autres arrière-pensées.
Le «Kleines Orientierungsheft Schweiz» de l’état-major de l’armée de terre destiné aux troupes allemandes et datant du 1er septembre 1942 écrit à propos du système de milice suisse – que les idéologues de la Commission Bergier ont toujours dénigré: «Le système suisse de milice permet d’engager l’ensemble des soldats à un coût relativement modique. Il entretient l’esprit combatif très marqué depuis toujours dans le peuple suisse et permet la mise sur pied d’une armée qui, vu la petite taille du pays, est très forte, organisée de manière efficace et rapidement opérationnelle. Le soldat suisse se distingue par son amour de la patrie, sa résistance et son endurance.» (p. 55)
Le général Böhme est plein d’admiration pour le Réduit
Le général Böhme écrit à propos du Réduit – que les falsificateurs de l’histoire de la Commission Bergier considèrent comme un mythe: «La défense suisse du territoire dispose d’une armée de terre qui, notamment en raison de ses effectifs élevés représente un facteur extrêmement important. La prise du Réduit défendu par des troupes qui vont se battre avec acharnement représentera une tâche difficile.» (p. 57)
Cela semble étrange de voir vanter la valeur de nos ancêtres par un militaire de la Wehrmacht alors que grâce à des mensonges ordonnées par l’Etat, on voulait nous faire croire le contraire.
Frick montre parfaitement combien la préparation du retrait par le général Guisan du gros de l’Armée dans le Réduit était réfléchie et prévoyante. La faute capitale des généraux polonais, consistant à vouloir maintenir un front de 1500 kilomètres au lieu de s’appuyer sur les alliés naturels que sont les cours d’eau et de concentrer les forces armées, fut étudiée avec beaucoup d’attention par le général Guisan et son état-major. Ainsi, il fallut abandonner la ligne de défense de la Limmat établie à grands frais après la défaite française parce qu’elle était devenue inutile. Même si le flanc ouvert du Jura représenta pendant quelques semaines un danger considérable, il fut possible, grâce à un peu de chance, de mettre en place le Réduit sans que la Wehrmacht ne profite de la situation. La Suisse suivait aussi attentivement la lutte pour défendre les Alpes du Sud de la France où les troupes françaises résistèrent victorieusement aux forces de Mussolini et d’Hitler et elle pensait être sur la bonne voie avec son idée de forteresse alpine. Cela met dans un grand embarras les chefs de la guerre psychologique de la Commission Bergier avec leur dénigrement subjectif et fielleux de la conception du Réduit.
Les Alliés auraient pu raccourcir la guerre de plusieurs années
Frick réfute un autre argument incroyable, car sans aucun fondement, de notre cinquième colonne qui veut que la Suisse ait prolongé la guerre. Il constate en effet que les Alliés auraient pu réduire la durée de la guerre de plusieurs années en bombardant les installations allemandes de production de carburant. Les nazis savaient parfaitement que c’était leur talon d’Achille. Mais que s’est-il passé? Frick montre sans équivoque que les Alliés ont bombardé la population civile sans défense des villes protégée pourtant par le droit international. Ce fut un crime de guerre sans précédent au regard dudit droit et la plus grave erreur au point de vue stratégique. Ou ce «moral bombing», comme le qualifièrent Harris-la-Bombe et Churchill, n’était-il pas une erreur mais visait un autre objectif? Malheureusement, nous n’en saurons rien tant que les Alliés n’auront pas déclassifié les documents secrets de la Seconde Guerre mondiale. Il paraît qu’ils représentent plus de la moitié de la totalité des documents. Le fait que cela n’ait pas été fait après le délai habituel de quelques décennies est de mauvais augure.
La défense du pays aujourd’hui en 10 points
D’une part les mises au point de Frick nous permettent d’éclaircir nos idées et constituent un antidote à l’entreprise de démoralisation effectuée par la Commission Bergier et d’autre part son résumé en 10 points nous fournit des indications précieuses sur la manière dont nous pouvons tirer profit des leçons de l’histoire aujourd’hui dans une situation non moins explosive, si nous voulons garder la tête droite.
1. Fidélité aux valeurs spirituelles
La condition la plus importante qui permet à un peuple d’affirmer son autonomie est la fidélité à ses valeurs spirituelles. Elles donnent au peuple la force morale de subsister dans les situations extrêmes. Ce sont en Suisse les valeurs suivantes, telles qu’elles sont confirmées par les sources étrangères de l’époque de la guerre et que seuls les idéologues de la Commission Bergier tournent en dérision: l’amour de la patrie, l’indépendance, la démocratie directe, le fédéralisme, le pacifisme associé aux capacités de défense, «c’est-à-dire la volonté, en cas d’agression, de défendre ces valeurs et l’intégrité territoriale du pays jusqu’à épuisement de toutes les ressources humaines et matérielles, sans se poser de questions sur les chances de succès.» (p. 116)
Le respect d’autrui et des convenances ainsi que le maintien de relations normales avec tous les Etats ont toujours fait partie de ces valeurs.
2. Cohésion politique vis-à-vis de l’extérieur
Une autre condition importante de l’affirmation de soi réside pour Frick dans la cohésion politique vis-à-vis de l’extérieur. L’auteur insiste sur le fait que contrairement à d’autres pays, les puissances étrangères n’ont pas réussi à instrumentaliser les partis gouvernementaux suisses pour qu’ils défendent leurs intérêts. Même pour le Parti socialiste, la défense du pays était devenue, certes tard, «l’alpha et l’oméga de la politique suisse» (Oprecht, président du Parti).
3. Solidarité sociale
Il fallait également à l’intérieur une solidarité sociale. «Elle suppose une certaine mesure de la part de ceux qui détiennent le pouvoir économique et la conscience du fait que la force économique implique une responsabilité à l’égard de la société.» (p. 117) alors que les plus faibles renoncent aux luttes sociales. L’accord de paix entre employés et employeurs de l’industrie mécanique, de même que les allocations pour perte de gain et le rationnement alimentaire garantissaient que personne ne tomberait dans la misère en raison de son engagement pour la défense du pays.
4. Une armée crédible capable de se défendre
Le 4e point de Frick est la capacité de défense et la mise sur pied d’une armée crédible. L’attaque de la Suisse doit apparaître trop chère à tout agresseur potentiel et s’il se risque quand même à attaquer, il doit s’attendre à des combats long et acharnés. Cependant cela présuppose de bons équipements, une instruction rigoureuse préparant à la guerre, de la discipline et une grande indépendance des chefs et des soldats. Si l’on néglige la capacité de se défendre, il devient difficile de la rétablir en peu de temps. (Précision importante face au concept de «montée en puissance» d’Armée XXI!)
L’histoire apporte un démenti à ceux qui croient que l’on est épargné si l’on renonce à se défendre. Les conséquences en sont les prises d’otages, le recrutement de travailleurs forcés ou l’incorporation des hommes dans l’armée de l’occupant pour servir de chair à canon. «Il n’y a qu’une solution, qui est d’ailleurs parfaitement morale: défendre la paix mais posséder une armée forte prête à se battre uniquement en cas d’attaque, mais alors avec une détermination inflexible.» (p. 119)
5. Les Etats n’ont que des intérêts
Pour Frick, citant un Premier ministre anglais de jadis, les Etats n’ont ni amis ni ennemis, mais uniquement des intérêts: «Les petits pays surtout devraient se souvenir de cette maxime. Toutes les parties aux conflits n’agissent finalement qu’en fonction de leurs intérêts. Les sentiments d’amitié, l’identité des valeurs, la démocratie, les droits de l’homme n’ont joué aucun rôle quand il s’agissait de prendre des décisions.» (p. 119) A titre d’exemple, l’auteur mentionne notamment le fait que la Grande-Bretagne, entre 1939 et 1940, a étranglé économiquement la Suisse de manière impitoyable. Le ministre britannique des Affaires étrangères assura à l’envoyé de la Suisse que «la Grande-Bretagne éprouvait certes une grande sympathie pour la Suisse démocratique mais qu’elle menait un combat vital et qu’elle devait sauvegarder ses intérêts. Après la capitulation de la France, ce même gouvernement déclara qu’il était dans l’intérêt des Alliés que la Suisse maintienne sa capacité de défense et son indépendance le plus longtemps possible et qu’elle demeure un centre d’informations au cœur de l’Europe dominée par l’Allemagne. C’est pourquoi on ne devait pas exercer sur elle de trop grandes pressions économiques.» (p. 120)
6. La neutralité implique nécessairement la capacité de se défendre
La neutralité ne protège ni des amis ni des ennemis et le pays a donc absolument besoin d’une armée crédible pour se protéger. «L’Allemagne a attaqué de nombreux pays neutres, même ceux qui, à son initiative, avaient conclu peu avant des pactes de non-agression. Mais les Alliés ont agi de même lorsque cela correspondait à leurs intérêts». (p. 121)
Pour que la neutralité soit crédible, il faut la défendre contre toutes les parties, sans égard pour les sympathies ou les antipathies. C’est dans ce contexte que Frick place la rencontre entre le général Guisan et le général SS Schellenberg. Le général a assuré le haut commandant allemand que la Suisse était déterminée à combattre tous ceux qui violeraient l’intégrité territoriale de la Suisse, également les Alliés: «Il s’agissait d’empêcher l’Allemagne d’attaquer la Suisse par précaution parce qu’elle pouvait douter de la volonté de la Suisse de résister de toutes ses forces à un passage des Alliés à travers son territoire.» (p. 122)
7. Pas d’adhésion à des alliances
Pour Frick, il n’est jamais dans l’intérêt d’un petit pays d’adhérer à une alliance car les pays plus puissants ne font que défendre leurs intérêts même dans les alliances et utilisent les alliés plus faibles comme de la chair à canon.»
8. Capacité de défense et de souffrance d’un peuple
Ce point concerne la capacité de défense et de souffrance des peuples qui veulent garder leur indépendance. Frick rend hommage aux Britanniques après la capitulation de la France, aux juifs affamés du ghetto de Varsovie luttant contre les SS, à l’armée de la Résistance polonaise et également à l’Union soviétique qui a compté le plus grand nombre de victimes des Allemands. En ce qui concerne la Suisse, Frick soulève la question suivante: «Nous autres Suisses jouissons aujourd’hui d’une prospérité sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Peut-on attendre d’une telle société qu’elle comprenne quelle volonté de se battre et quels préparatifs matériels sont nécessaires pour persuader un agresseur potentiel que le rapport bénéfice-coût d’une attaque est négatif et qu’elle ne vaut pas la peine d’être tentée? Et pouvons-nous nous représenter la capacité de défense et de souffrance qu’il faudrait manifester si l’agresseur ne se laissait pas dissuader et que le peuple devait résister avec son armée dans une guerre?» (p. 124 sqq.)
Et il enfonce le clou: «Quelle proximité avec la terrible réalité d’une guerre, quels risques notre peuple protégé, gâté, démocratique et attaché aux droits de l’homme permet-il à son armée au cours de la formation des soldats? Quels moyens est-il disposé à lui accorder qui la rendent suffisamment forte pour tenir une guerre future, avec ses souffrances inimaginables, le plus éloignée possible du peuple ou, dans le pire des cas, pour combattre longtemps? Car notre victoire serait de résister longtemps et non pas d’aller défiler dans la capitale du pays agresseur.» (Frick, p. 125)
9. Réflexion à long terme
Frick invite à engager une réflexion à long terme malgré la tendance de la politique quotidienne à se limiter au court terme. On ne peut pas mettre sur pied une armée en peu de temps: «En tout cas, il faut beaucoup de temps pour créer une tradition de capacité à se défendre. Or toutes les puissances ont reconnu cette capacité à la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour Machiavel déjà, au XVe siècle, elle expliquait que les Suisses étaient le peuple le plus libre d’Europe.» (p. 125 sqq.)
10. Les décisions de politique intérieure sont toujours des signaux envoyés à l’extérieur
Pour Frick, nous devrions être conscients «que toutes les décisions que nous prenons ne sont pas uniquement de nature intérieure. Nous envoyons par là des signaux au monde qui les reçoit et les interprète.» (p. 126) Jusqu’en 1939, la plupart des démocraties européennes ont envoyé à Hitler le signal qu’elles étaient démoralisées et qu’elles n’étaient pas prêtes à se battre pour défendre leurs valeurs. La Grande-Bretagne et la France ont leur part de responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale parce qu’à Munich, elles ne se sont pas opposées de manière catégorique à Hitler: «En capitulant, ces deux puissances ont également désavoué la population de Berlin qui, 3 jours avant Munich, avait manifesté avec détermination contre la guerre.» (p. 126) En revanche, la Suisse fit savoir sans ambiguïté qu’elle était décidée à se battre. Le chef d’état-major allemand Halder notait au printemps 1940 dans son journal de guerre qu’une attaque de la France à travers une Suisse sans défense aurait été une éventualité séduisante. Mais il dut exclure cette option car la Suisse n’était pas sans défense.
Se préparer au pire
Dans sa conclusion, Frick écrit qu’une attaque contre la Suisse ou une guerre en Europe semble aujourd’hui inimaginable à beaucoup de personnes, de même qu’après la Première Guerre mondiale, personne ne s’attendait à une nouvelle guerre mondiale. Il est dans la nature de l’homme «de considérer une longue période de paix et, de manière générale, une situation en général bonne et agréable quasiment comme un don de Dieu qui va durer indéfiniment et de refouler les éventualités effrayantes.» (p. 127) Malheureusement, bien que l’on aimerait donner raison aux optimistes, l’histoire montre que «les comportements et les décisions irrationnels, souvent associés aux instincts humains les plus vils, déterminent toujours et partout la politique et l’action militaire.» (p. 127) Comme l’homo sapiens sapiens n’a pas changé récemment, on ne peut exclure ni une guerre en Europe ni une attaque contre la Suisse, même pas au cours des prochaines années. Que ceux qui trouvent cette idée trop bizarre méditent les dernières phrases de Frick: «Qu’arriverait-il si, par exemple, le monde ou seulement l’Europe sombrait, à cause des dettes accumulées, dans une grave crise monétaire et économique, et même s’effondrait, et si les nombreuses et anciennes tensions ethniques et territoriales se déchaînaient?» (p. 128) Sommes-nous aujourd’hui, à l’été 2011, éloignés de ce scénario? La «malice des temps» invoquée par nos pères fondateurs n’est-elle pas éternelle, à notre grand regret?
Combien d’années se sont écoulées entre la prise du pouvoir par Hitler et la remilitarisation de la Rhénanie, l’écrasement de la Tchécoslovaquie et l’invasion de l’Autriche et le début de la Seconde Guerre mondiale? Trois, cinq et six ans ! C’est pourquoi Frick conclut qu’il est indispensable «que la Suisse se prépare au pire tout en espérant qu’il n’arrivera pas». (p. 128) Il y a là un espoir mais aussi un appel auquel tout contemporain vigilant et amoureux de la liberté ne peut qu’acquiescer. •
Bibliographie
Gotthard Frick. Hitlers Krieg und die Selbstbehauptung der Schweiz 1933–1945. Eine neue, umfassende Sicht auf die Selbstbehauptung der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und die daraus für die Zukunft zu ziehenden Lehren. Eigenverlag Gotthard Frick, CH-4103 Bottmingen, Februar 2011,
ISBN 978-3-033-02948-4.
S’emparer du Réduit: une tâche difficile
«La défense suisse du territoire dispose d’une armée de terre qui, notamment en raison de ses effectifs élevés, représente un facteur extrêmement important. La prise du Réduit défendu par des troupes qui vont se battre avec acharnement représentera une tâche difficile.»
Franz Böhme, général des troupes allemandes de montagne, dans un plan d’attaque de la Suisse élaboré à l’intention de la SS à l’été 1943 (in: Gotthard Frick, Hitlers Krieg und die Selbstbehauptung der Schweiz 1933–1945, p. 57)
La Suisse représente un problème ardu
«Un dixième de la population suisse est sous les drapeaux, c’est plus que dans tous les autres pays du monde. Elle est prête à se battre pour défendre son style de vie. […] Les Hollandais seront une proie facile pour les Allemands car leur armée est misérable. La Suisse représentera un problème ardu et je doute que les Allemands vont se risquer à le résoudre.»
(William L. Shirer, journaliste américain, peu après le début de la guerre
(in: Gotthard Frick, Hitlers Krieg und die Selbstbehauptung der Schweiz
1933–1945, p. 54)
L’amour de la patrie des Suisses est extrêmement profond
«Le désir de se battre des soldats suisses est élevé et doit être placé sur le même plan que celui des Finlandais. Un peuple qui a de bons gymnastes a toujours en de bons soldats. L’amour de la patrie des Suisses est extrêmement profond.»
Franz Böhme, général des troupes allemandes de montagne, dans un plan d’attaque de la Suisse élaboré à l’intention de la SS à l’été 1943 (in: Gotthard Frick, Hitlers Krieg und die Selbstbehauptung der Schweiz 1933–1945, p. 57)
Ce qui serait arrivé à une Suisse occupée
L’exemple de la Grèce
«La Grèce resta occupée pendant trois ans par les troupes de l’Axe. Elle fut systématiquement pillée et dut livrer au vainqueur non seulement une grande partie de son équipement industriel et de ses véhicules et machines agricoles mais également, pendant tout le temps de l’occupation, une grande partie de ses vivres. Dès le premier hiver, cela provoqua une famine catastrophique à laquelle succombèrent quelque 100 000 Grecs et 80% des nouveau-nés. […] Les Grecs menant bientôt une guerre de partisans féroce, les troupes allemandes se vengèrent souvent, comme ailleurs, en fusillant la totalité de la population – hommes, femmes, enfants – de villages situés à proximité des attaques de la guérilla ou en exécutant des otages civils.»
(Gotthard Frick, Hitlers Krieg und die Selbstbehauptung der Schweiz 1933–1945, p. 92 sqq.)
L’exemple de la Yougoslavie
«Ici aussi, les Allemands prirent la population civile en otage. Pour chaque Allemand tué par les partisans, on fusillait 100 otages, pour chaque blessé, 50 otages. L’auteur de l’étude de 1943 sur l’attaque éventuelle de la Suisse, le général des troupes de montagne Franz Böhme, fut, en 1941, pendant deux mois et demi, général en chef doté des pleins pouvoirs en Serbie. Pendant cette seule période, 30 000 otages furent exécutés. Jugé au Tribunal militaire international de Nuremberg, il échappa à la condamnation, le 27 mai 1947, en se suicidant.»
(Gotthard Frick, Hitlers Krieg und die Selbstbehauptung der Schweiz 1933–1945, p. 91)
Problèmes d’un petit Etat neutre hier et aujourd’hui
Il n’y a pas de paix sans capacité de défense
«Notre capacité de défense vieille de plusieurs siècles a toujours été la sœur jumelle de notre amour de la paix et devrait le rester à l’avenir, quoi qu’il nous réserve.» (Frick, p. 3)
Quand on ne s’attend pas à une grande guerre, on néglige l’Armée
La Suisse est un des rares pays à s’être rendu compte assez tôt du danger représenté par l’Allemagne. Elle commença à se préparer au pire. En 1934, elle commença par la protection aérienne (aujourd’hui protection civile). Le 24 février 1935, le peuple approuva le projet de défense qui ouvrait la voie à un programme d’armement extraordinaire […] Le 21 septembre 1936, la Confédération émit un emprunt de défense nationale qui rencontra un vif succès. La durée de l’école de recrues fut allongée et l’instruction améliorée. On acheta du matériel de guerre, dont des avions de combat, et l’on développa les fortifications. Mais les lacunes importantes ne purent pas être comblées jusqu’au début de la guerre. On avait pendant trop longtemps négligé l’Armée en raison de l’idée, répandue dans le peuple, qu’une autre grande guerre était impossible.» (Frick, p. 12)
Cohésion entre la gauche et la droite
Ce n’est qu’en 1938, peu avant le début de la guerre, que le président du Parti socialiste Oprecht déclara: «La défense du pays est l’alpha et l’oméga de la politique suisse. Ce changement d’attitude se produisit certes beaucoup trop tard pour préparer l’Armée à la future guerre, mais il créa, à propos de cette question décisive de politique intérieure, une cohésion entre la gauche et la droite.» (Frick, p. 13)
Renforcer les valeurs suisses
«Le Schaffhousois Oscar Frey, le conseiller national Gottlieb Duttweiler (fondateur de Migros) et le professeur Karl Meyer, firent, depuis l’été 1940, des conférences dans tout le pays au cours desquelles ils insistaient sur la nécessité et la possibilité de la résistance. Inspiré par cela, le général Guisan institua, en mai 1941, la section Armée et Foyer dont l’objectif était de renforcer les valeurs suisses dans l’Armée et la population civile et de lutter contre le défaitisme et le découragement. C’était nécessaire car au vu de l’occupation rapide de la Yougoslavie puis de la Grèce par l’Allemagne, la Suisse doutait de nouveau de ses capacités de résistance. Ces deux opérations de la Suisse, qu’Hitler n’avait pas prévues d’emblée, apportèrent un répit supplémentaire.» (Frick, p. 14)
Crise de la lutte pour la survie économique
«Avec le début de la guerre commença pour la Suisse la crise de la lutte pour la survie. Il s’agissait d’assurer l’approvisionnement en denrées alimentaires, en carburants, en combustibles, en matières premières et en produits semi-finis, de poursuivre le réarmement, de continuer à faire du commerce avec le monde et de sauvegarder les emplois. Un chômage important aurait fait le jeu de l’extrême-droite. La Suisse introduisit le rationnement et l’économie de guerre, mit en place un programme d’extension des cultures et s’assura, en créant la «protection des militaires» (aujourd’hui «régime des allocations pour perte de gain»), pour que les familles des soldats mobilisés ne tombent pas dans la misère.» (Frick, p. 19)
Brutalité extrême des Alliés
«Bien que le droit international de la neutralité autorise expressément aux pays neutres le commerce avec les parties au conflit, chacun voulait que la Suisse mette fin à son commerce avec l’ennemi et ne livre à ce dernier ni biens stratégiques ni armes. L’extrême brutalité et le manque de compréhension des Alliés, en particulier des Etats-Unis, pour la situation exceptionnelle et difficile de la Suisse ne se différenciait en rien de celle des Allemands. Le conseiller fédéral Stampfli déclarait en 1944: Nous n’avons jamais été plus mal traités par les Allemands que nous le sommes maintenant par les Alliés. Ils étaient insensibles à la sympathie, à la démocratie, à l’Etat de droit et à des valeurs similaires.» (Frick, p. 19 sqq.)
C’est l’Armée suisse qui a mobilisé le plus rapidement
«Aucune armée au monde ne peut mobiliser ses troupes aussi rapidement que l’Armée suisse. C’est ce qu’écrivait le 11 novembre 1938 le Lord-maire de Londres dans le Times après une visite en Suisse. Il recommandait au Royaume-Uni d’adopter le système suisse. L’étude stratégique Tannenbaum de l’état-major allemand datant de 1940 estimait qu’une partie des troupes de frontières serait prêtes au combat au bout de 5 heures, les brigades de frontières et de montagne et les brigades légères dans les 24 heures, les divisions et les grands états-majors, c’est-à-dire la totalité de l’Armée en 48 heures. (A titre de comparaison, le chef d’état-major allemand Halder estimait, le 27 mars 1940, que la mobilisation de 20 divisions italiennes en vue d’opérations aux côtés de l’Allemagne prendrait deux semaines. A cela il fallait ajouter le temps de déplacement vers les lieux de combat.» (Frick, p. 53 sqq.)
Le mythe tenace d’une supériorité de la Wehrmacht
«Le mythe d’une supériorité militaire prétendument écrasante en 1939/1940 de l’Allemagne nazie est tenace. Il sert aujourd’hui encore de justification aux pays d’Europe de l’Ouest – y compris à la France – qui, démoralisés, ont pour la plupart capitulé sans véritable résistance.» (Frick, p. 74)
On n’épargne pas ceux qui se soumettent
«Il existe aussi des gens prêts à se soumettre dans le but d’avoir au moins la vie sauve. Comme le montrent la Seconde Guerre mondiale et tous les conflits ultérieurs, ces individus succombent eux-mêmes à la folie guerrière, non seulement en tant que victimes civiles de bombardements ou d’attaques de missiles ou d’artillerie, mais parce que des forces d’occupation sans scrupules les anéantissent pour des raisons politiques, racistes ou autres. Ou encore on les exécute en tant qu’otages pour venger des soldats ou des citoyens tués par des résistants. En effet, il y a dans chaque peuple des hommes qui préfèrent combattre plutôt que d’être asservis. En d’autres termes, renoncer à se défendre ne permet pas d’épargner la population d’un pays. Il n’y a qu’une solution, qui est d’ailleurs parsfaitement morale: défendre la paix mais posséder une armée forte prête à se battre uniquement en cas d’attaque, mais alors avec une détermination inflexible.» (Frick, p. 119)
00:05 Publié dans Affaires européennes, Défense, Histoire, Militaria, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, défense, militaria, suisse, armée suisse, défense suisse, europe, affaires européennes, europe centrale, mitteleuropa, politique internationale, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 21 juillet 2011
Chilenas Bellas en Uniforme Militar
Chilenas Bellas en Uniforme Militar
00:09 Publié dans Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chili, amérique latine, amérique du sud, militaria, armée, armée chilienne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 19 juillet 2011
Himno de Artilleria Española
Himno de Artilleria Española
00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : artillerie, armées, militaria, espagne, musique, musique militaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 juillet 2011
Himno deinfanteria espanola
Himno de infanteria española
00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : infanterie, armées, militaria, musique, musique militaire, espagne, armées espagnole |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 juillet 2011
Heidi Brühl (1966): Hundert Mann und ein Befehl
Heidi Brühl - 1966
Hundert Mann und ein Befehl
00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, musique, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 juillet 2011
Un message du polémarque

Un message du polémarque...
Cette semaine, Le Polémarque rend un hommage mérité au colonel Olrik (qui rime avec héroïque) via la plume enjouée de Jean-Jacques Langendorf et en profite pour saluer les années Cancer ! comme il se doit. A lire sur :
"On s'engage puis on voit"
Général von Verdy du Vernois
13:37 Publié dans Blog, Défense, Militaria, Polémologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blogs, polémarque, polémologie, militaria, thèmes militaires, armées |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 mai 2011
Präventivschlag Barbarossa
 |
Stefan Scheil Präventivkrieg Barbarossa Fragen, Fakten, Antworten Band 26 der Reihe Kaplaken. 96 Seiten, kartoniert, fadengeheftet, 8.50 € ISBN: 978-3-935063-96-8 8,50 EUR incl. 7 % UST exkl. Versandkosten |
|
Der Historiker Stefan Scheil ist einer der besten Kenner der Diplomatiegeschichte zwischen 1918 und 1945. In mehreren Büchern hat er Entfesselung und Eskalation des II. Weltkriegs analysiert und der platten These widersprochen, Deutschland sei alleinverantwortlich für dessen Ausbruch und Ausweitung. Im vorliegenden kaplaken faßt Scheil seine Studien zum deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Jahr 1941 zusammen. Er stellt und beantwortet die Frage, ob es sich um einen Überfall oder einen Präventivkrieg gehandelt habe. Scheil geht in seiner Argumentation von vier Bedingungen aus, die jeden Präventivkrieg grundsätzlich kennzeichnen, und legt sie als Maßstab an das „Unternehmen Barbarossa“ an.
Scheils Untersuchung mündet in über 50 Fragen, die jeder aufmerksame Leser selbst beantworten kann, bevor Scheil die Antwort gibt. Wer die Argumentation nachvollzieht, wer die Äußerungen und Planungen von sowjetischer Seite liest und den geheimen Aufmarsch der Roten Armee an der Westgrenze Rußlands zur Kenntnis nimmt, kann zuletzt Scheils Fazit nur zustimmen: „Wenn das Unternehmen Barbarossa nicht als Präventivkrieg eingestuft werden kann, hat der Begriff Präventivkrieg seinen Sinn überhaupt verloren.“
|
|
00:05 Publié dans Histoire, Livre, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, allemagne, livre, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 mai 2011
Bataille de Rocroi - Film "Alatriste"
Bataille de Rocroi (1643) - Film "Alatriste"
00:05 Publié dans Film, Histoire, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rocroi, guerre de trente ans, 17ème siècle, espagne, tercios, infanterie, piquiers, pays-bas, pays-bas royaux, pays-bas espagnols, histoire, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 avril 2011
Le Chant des Chasseurs Ardennais
Le Chant des Chasseurs Ardennais
Oxygeno
00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musqieu militaire, militaria, wallonie, ardennes, armées |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 avril 2011
Bataglione S. Marco - X-Mas
Battaglione S. Marco & X-MAS
00:05 Publié dans Histoire, Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, histoire, italie, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 avril 2011
Serbian Volunteers Song
Serbian Volunteers Song
00:05 Publié dans Histoire, Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serbie, militaria, musique, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 avril 2011
Russian Imperial March
Russian Imperial March
00:05 Publié dans Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, marche, musique, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 avril 2011
Legion cantando "Novio de la Muerte"
Semana Santa - Malaga 2008
Legion cantando "Novio de la Muerte"
00:05 Publié dans Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique militaire, espagne, légion espagnole |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook







