Boko Haram, letterlijk: westers onderwijs is een zonde. Het is de naam voor een Nigeriaanse rebellengroep, die vecht tegen het onderwijs in de wiskunde. De sekteleden zijn bang dat kinderen door de invloed van moderne scholen hun islamitische wortels verliezen. Hun leider Mohammed Yusuf pleit voor een religieuze samenleving zonder westerse invloeden: ‘De democratie en het huidige onderwijssysteem moeten veranderen. Anders zal de oorlog, die op het punt staat te beginnen, lang duren.’ Het belangrijkste strijdpunt van ‘Boko Haram’ is een verbod van moderne scholen, die vandaag steeds meer de islamitische scholen vervangen. In die laatste wordt traditioneel onder een boom of in een huisje aan de leerlingen het schrijven aangeleerd en het opdreunen van de Koran, en, op latere leeftijd, de Arabische literatuur en de theologie.

In veel islamitische scholen leren kinderen de Koran opdreunen en krijgen ze geen wiskunde.
Maar Engels, wiskunde en natuurwetenschappen worden niet onderwezen. Verzet tegen lessen biologie wegens soms expliciete seksuele feiten, tegen de dominantie van het Engels ‘van de Amerikaanse vijand’, of tegen geschiedenislessen die de evolutieleer voorstaan, het zou ons nog vertrouwelijk in de oren kunnen klinken. Maar wat ‘in hemelsnaam’ kan de oorzaak zijn van een tegenkanting tegen de wiskunde? Gebruikt de mathematica niet even abstracte patronen als deze die de moskeeën versieren? Duiden de ‘Hindoe-Arabische’ cijfers niet op een duidelijke band tussen de wiskunde en de Arabische wereld? Het woord ‘cijfer’ verwijst trouwens naar het Arabische sifr wat nul betekent. En nog steeds schrijven we bij het uitvoeren van een vermenigvuldiging onze getallen onder elkaar, van rechts naar links, alsof we Arabisch schreven.
In vele scholen in moslimlanden worden de exacte wetenschappen gewoon niet onderwezen. In de meerderheid van Aziatische madrassa’s of Koranscholen wordt geen cijfer geschreven, tenzij het een nummer zou zijn van een deel uit het Heilige Boek. De Arabische universiteiten blinken dan ook niet uit door de aanwezigheid van eersterangs wiskundigen: sinds 400 jaar is er geen enkele Arabische topwiskundige geweest – dit in grote tegenstelling tot bijvoorbeeld de ontelbare joodse namen die de wiskundige erelijsten sieren.
Slechte cijfers
Sinds 2003 oefent de Singaporese overheid grote druk uit op de Koranscholen, omdat de overheid had vastgesteld dat de kennis van niet-religieuze vakken er heel gebrekkig is. Ze eiste dat tegen 2010 de zes Singaporese madrassa’s een vastgesteld basisniveau zouden halen, zoniet zou hen het recht worden ontzegd om onderwijs te organiseren. Enkele scholen kregen een bijzondere ondersteuning van de regering en werden voorzien van de modernste technische snufjes. Hun onderwijsmodel, waarbij de leerlingen de dag weliswaar beginnen met een uitgebreide gebedssessie maar daarna toch wetenschappen en wiskunde studeren, wordt schoorvoetend uitgevoerd naar Indonesië en de Filippijnen.
Het contrasteert echter met de meerderheid van de traditionele Koranscholen in Zuidoost-Azië, waar leerlingen niets anders doen dan de Koran uit het hoofd leren, de hele dag lang. Meestal zijn het teksten geschreven in een voor hen onbegrijpelijke taal, het Arabisch, dat dikwijls niet de moedertaal is, noch de tweede taal.
De Organisatie van de Islamitische Conferentie, een onverdachte bron, berekende dat haar ruim vijftig leden gemiddeld slechts 8,5 wetenschappers, ingenieurs en technici hebben per 1.000 inwoners, waar het gemiddelde op 139,3 ligt voor de landen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En er moet worden bij gezegd dat sommige van die ‘wetenschappers’ zich al eens bezighouden met de berekening van de temperatuur van de hel, of met de chemische samenstelling van een djin, een ‘geest’ zoals die uit de lamp van Aladin.
Het aantal wiskundigen onder deze 8,5 wetenschappers is verwaarloosbaar. Ook het aantal wetenschappelijke publicaties bevestigt deze schrijnende toestand: zesenveertig moslimlanden samen leveren slechts 1,17% van de publicaties, en twintig Arabische landen samen 0,55%. De Amerikaanse ‘National Science Foundation’ stelde vast dat de helft van de 28 laagst scorende landen op het gebied van wetenschappelijke artikelen behoren tot de Organisatie van de Islamitische Conferentie. Toch is het moeilijk voor te stellen dat Arabische universiteiten met ronkende namen als ‘King Faisal University’ of ‘Prince Sultan University’ te klagen zouden hebben over een gebrek aan financiële middelen.
Een groots verleden
Toch waren het moslimgeleerden die de wiskundige wereld gedurende bijna 700 jaar domineerden. In de 8ste eeuw was er Musa al-Khwarizmi die in zijn ‘Huis der Wijsheid’ in Bagdad niet alleen sterrenkundige tafels opstelde maar ook het oudste leerboek in de rekenkunde, dat in zijn Latijnse vertaling tot in de 16de eeuw zou worden gebruikt, ook in Europa. De verbastering van zijn naam leidde trouwens tot ons woord ‘algoritme’.
Rond ‘onze’ millenniumwisseling was er Al Beruni die in wat nu Oezbekistan heet vele boeken schreef, waaronder een vijftiental over de wiskunde. Sommen van reeksen, algebraïsche vergelijkingen en de verdere ontwikkeling van stellingen van Archimedes: ze trokken allemaal zijn aandacht. De 11de eeuw kende de wellicht grootste wiskundige, dichter en filosoof uit het hele Midden-Oosten, de Pers Omar Khayyam. Hij besefte dat verhoudingen in geometrische figuren niet noodzakelijk tot getallen leiden die steeds als breuken kunnen worden geschreven. Hij had ook het idee om algebra (nog een woord met een Arabische etymologie) en meetkunde te combineren, ten einde vergelijkingen van de vorm x3 + px2 + qx + r = 0 op te lossen. Een tijdgenoot van hem was de eerste om het parallellenpostulaat van Euclides in twijfel te trekken, lang voor Nikolaj Lobatsjevski (Rusland) of Janos Bolyai (Hongarije) dit deden in de 19de eeuw. Het postulaat stelt het nochtans intuïtief voor de hand liggende feit dat door elk punt precies één evenwijdige gaat aan een gegeven rechte.


Een pagina uit een Latijnse editie van Euclides’ Elementen uit de 14de eeuw. Onderaan de pagina het beroemde parallellenpostulaat.
Een wiskundige ‘Prince of Persia’ was Ulugh-Beg (ca. 1393-1449), een kleinzoon van Ti-moer Lenk (1336-1405), die eerst gouverneur was in Samarkand en daarna de vorst van het gehele rijk. Hij zou een groot belang hechten aan de wetenschap en een enorme astronomische sterrenwacht laten bouwen. Onder zijn bewind werden Koranscholen een soort islamitische academies, waar ook wiskunde en sterrenkunde hoog in het vaandel werden gedragen. Tussen 1408 en 1437 werkten er zowat 70 sterrenkundigen, onder wie Al-Kashi (1380-1429). Al was de astronomie er het belangrijkste studiegebied, toch zou deze laatste bijvoorbeeld ook de decimalen van pi berekenen aan de hand van een 8.050.306.368-zijdig veelvlak. Zijn waarde was pi was 3,141 592 653 589 793 25, wat juist is tot op de 16 decimaal (de 17de moet 4 zijn, niet 5). Zijn ‘totaal nutteloze’ wereldrecord zou stand houden tot 1596 toen de Nederlander Ludolph van Ceulen er 20 berekende.
Al-Kashi berekende ook de sinus van 1° met een grote nauwkeurigheid, en dit 200 jaar voor Kepler. In 1449 werd Ulugh-Beg echter vermoord op zijn weg naar Mekka, door fundamentalisten geleid door zijn eigen zoon. Misschien konden de hovelingen het niet langer dulden dat hij meer aandacht had voor wetenschappelijke dan voor wereldse zaken, en met zijn dood kwam ook een einde aan de wetenschappelijke activiteiten in Samarkand.

Ulugh-Beg omringd door zijn astronomen. Onder zijn bewind werden Koranscholen een soort islamitische academies, waar wiskunde en sterrenkunde hoog in het vaandel werden gedragen.
Wiskunde wordt zinloos
Ulugh-Begs wiskundige activiteiten bleken de laatste oprisping van de islamitische wiskunde. Tegen het einde van de 15de eeuw zou de invloed van Shaykh Ahmad Sirhindi (1564-1624) verreikende gevolgen hebben. Deze geleerde uit Punjab beschouwde de wiskundigen als ‘idioten’ en hun bewonderaars als ‘nog ergere idioten en de ergste schepsels’. In zijn Maktubat I/266 schreef hij dat de wiskunde ‘totaal zinloos en absoluut nutteloos’ is. De wiskunde kon de mens immers niet van dienst zijn in zijn redding op weg naar het hiernamaals. Het volstond volgens hem om voldoende te kunnen rekenen om de verdeling van een erfenis te bepalen en om de richting te vinden waarin moet worden gebeden.
Sindsdien overheerst deze zienswijze ook bij de ‘Ulama’, de geleerden die de visie van de islam en de sharia bestuderen, met officiële goedkeuring. Opmerkelijk is dat Europa bijna op dat zelfde moment een einde maakte aan zijn lange traditie van neerkijken op de wiskunde. Weliswaar kwam Galileo Galilei (1564-1642) toen nog in moeilijkheden voor zijn wetenschappelijke vindingen, maar ongeveer vanaf ditzelfde tijdperk ontdeed West-Europa zich stilaan van het juk van het religieuze obscurantisme. Sinds de heilige Augustinus hadden vele christenen de wetenschap-om-de-wetenschap afgewezen, in een laatantieke traditie, en achtten ze de studie van de wiskunde alleen zinvol voor zover ze kon bijdragen aan ‘het waarachtige geluk’. Lange tijd werden de negatieve getallen door de katholieke kerk als des duivels beschouwd, waardoor alleen een enkele paus in zijn kamer wel aan wiskunde mocht doen, maar liefst niet de gewone christen.
In het Westen veranderden de tijden echter wel, en uiteindelijk zouden bijvoorbeeld de scholen van de jezuïeten de wiskunde zelfs zeer hoog in het vaandel dragen. Het is alsof rond 1600 het Westen en het Midden-Oosten elkaar kruisten: ze sloegen tegenovergestelde wegen in, vanuit tegenovergestelde vertrekpunten.

Volgens prof. Reza Sarhangi biedt de wetenschap jongeren uit Iran de mogelijkheid om de godsdienstige bekrompenheid te overstijgen en een internationale carrière uit te bouwen.
Olympiades
Maar het is niet allemaal kommer en kwel. De statistieken, zoals de al aangehaalde OESO-rapporten, zijn voor interpretatie vatbaar. De cijfers van de Wiskundeolympiade, een soort ‘wiskundige Olympische Spelen’, geven een volledig ander beeld. Zo staat het Iraanse team gemiddeld op de 10,9de plaats gedurende het laatste decennium, en nog twee jaar verder terug in de tijd, in 1998, stond het Iraanse team zowaar op de eerste plaats. Turkije bekleedt gemiddeld een 15,6de plaats, ver voor Israël dat slechts een gemiddelde 26ste plaats haalt, en dit in weerwil tot de uitzonderlijke palmares van de Joodse wiskundigen. Ter vergelijking, het Belgische team stond in dezelfde tijdsspanne gemiddeld op de 48,6ste plaats, en Nederland op de 52,4ste plaats. Dit is maar een paar plaatsen hoger dan bijvoorbeeld Marokko. Misschien halen bepaalde westerse landen juist een goed palmares in de ‘Quotation Index’ en andere statistische middelen om de belangrijkheid van onderzoek te meten, omdat moslim wiskundegenieën die op jeugdige leeftijd aan de Olympiade deelnamen, daarna in hun landen gaan werken. De geciteerde Amerikaanse ‘National Science Foundation’ zou ontgoocheld kunnen zijn wanneer ze zou natellen hoeveel in de VS geboren en getogen wetenschappers er het mooie weer maken aan de Amerikaanse wiskundedepartementen.
Wiskunde is bovendien een minder opvallende zonde tegen het halal-beginsel dan het niet dragen van een hoofddoek, het eten van een stuk varkensvlees of het drinken van wijn. Daarom is het verzet tegen de wiskunde van Nigeriaanse islamisten, Aziatische madrassa’s en westerse hardlinermoslims wellicht slechts een achterhoedegevecht, althans volgens Reza Sarhangi, hoogleraar aan het departement Wiskunde van de Towson University (VS). Deze Iraniër organiseert het congressencircuit ‘Bridges: Mathematical Connections in Art, Music, and Science’ en houdt graag voordrachten over ‘islamitische wiskunde’. Bij een glas wijn, waarvan hij fier vertelt dat het Perzië was dat de ‘godendrank’ uitvond, kan hij niet stoppen met het vermelden van redenen waarom ‘wiskunde mooi is’. Voorwaar een statement dat niet erg ‘halal’ is, maar hij stoort er zich niet aan: ‘Zelfs in de Islamistische Republiek zijn de wetenschappen van vandaag te belangrijk geworden, en niemand krijgt de wiskundige geest terug in de wonderlamp.’ Ook niet in die van Aladin.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg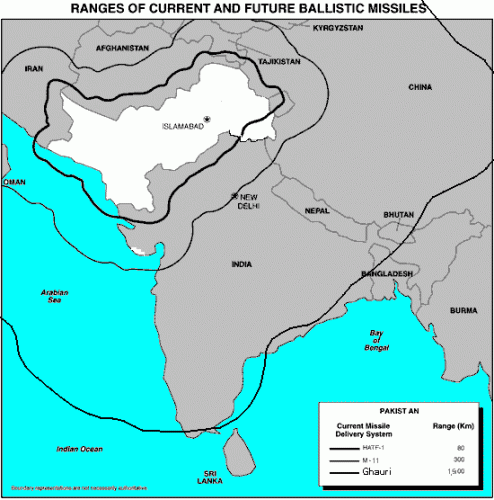

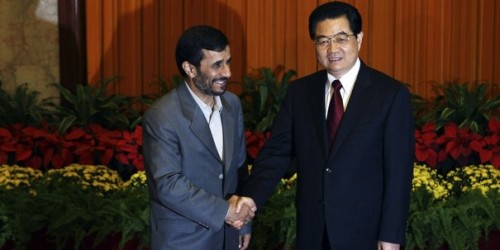






























 Auf Wunsch von US-Präsident Barack Obama musste der bisherige Afghanistan-Befehlshaber Stanley McChrystal seinen Hut nehmen. Grund waren despektierliche Äußerungen des Generals über die Administration in Washington. Nachfolger wurde General David Petraeus. Brisant, denn das von ihm verfasste Feldhandbuch gilt als radikalste Militärdoktrin der Gegenwart. Nun muss er sich auf den Pulverfässern von Irak und Afghanistan beweisen.
Auf Wunsch von US-Präsident Barack Obama musste der bisherige Afghanistan-Befehlshaber Stanley McChrystal seinen Hut nehmen. Grund waren despektierliche Äußerungen des Generals über die Administration in Washington. Nachfolger wurde General David Petraeus. Brisant, denn das von ihm verfasste Feldhandbuch gilt als radikalste Militärdoktrin der Gegenwart. Nun muss er sich auf den Pulverfässern von Irak und Afghanistan beweisen.


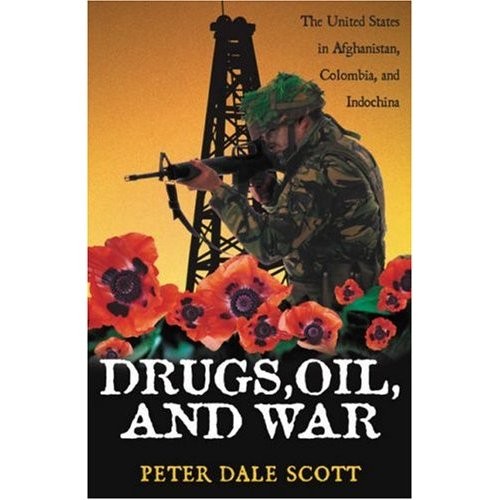 A geopolitical approach aimed at understanding the relationship between the worldwide US strategy and the presence of North American forces in Afghanistan is given. The US penetration in the Eurasian landmass is stressed particularly with regard to the Central Asian area, considered as the underbelly of Eurasia in the context of the US geopolitics. In order to determine the real players in the Afghan theatre, a critics is moved to some general concepts used in geopolitical and international relations studies. The main characteristics
A geopolitical approach aimed at understanding the relationship between the worldwide US strategy and the presence of North American forces in Afghanistan is given. The US penetration in the Eurasian landmass is stressed particularly with regard to the Central Asian area, considered as the underbelly of Eurasia in the context of the US geopolitics. In order to determine the real players in the Afghan theatre, a critics is moved to some general concepts used in geopolitical and international relations studies. The main characteristics



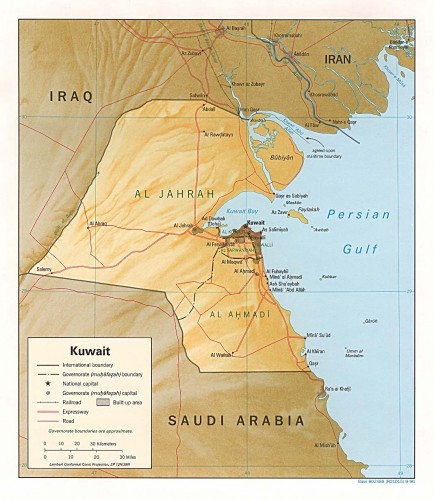
 Irak 1941: la révolte de Rachid Ali contre les Britanniques
Irak 1941: la révolte de Rachid Ali contre les Britanniques Dans un article pour le “Berliner Morgenpost”, intitulé “Was hätte Bismarck zum Bundeswehr-Einsatz gesagt?” (= “Qu’aurait dit Bismarck sur l’engagement de la Bundeswehr?”), l’écrivain et journaliste israélite Rafael Seligmann apporte une réponse claire et précise à cette question et explique comment l’Allemagne devra dans l’avenir moduler son engagement en Afghanistan. En répondant à cette question cruciale de l’actuelle politique étrangère et de la sécurité de la RFA, Seligmann rappelle l’utilité de se référer à Otto von Bismarck, une utilité que les politiciens allemands actuels n’oseraient jamais évoquer, même s’il en reconnaissent in petto le bien fondé.
Dans un article pour le “Berliner Morgenpost”, intitulé “Was hätte Bismarck zum Bundeswehr-Einsatz gesagt?” (= “Qu’aurait dit Bismarck sur l’engagement de la Bundeswehr?”), l’écrivain et journaliste israélite Rafael Seligmann apporte une réponse claire et précise à cette question et explique comment l’Allemagne devra dans l’avenir moduler son engagement en Afghanistan. En répondant à cette question cruciale de l’actuelle politique étrangère et de la sécurité de la RFA, Seligmann rappelle l’utilité de se référer à Otto von Bismarck, une utilité que les politiciens allemands actuels n’oseraient jamais évoquer, même s’il en reconnaissent in petto le bien fondé.



 Régis Debray, ooit de compagnon van Che Guevara en adviseur van de presidenten Allende (Chili) en Mitterrand (Frankrijk) heeft bij Flammarion een nieuw boek gepubliceerd: ‘Lettre à un ami israélien’.
Régis Debray, ooit de compagnon van Che Guevara en adviseur van de presidenten Allende (Chili) en Mitterrand (Frankrijk) heeft bij Flammarion een nieuw boek gepubliceerd: ‘Lettre à un ami israélien’.
