Ex: http://fortune.fdesouche.com/
« Le ciel qui surplombe le commerce mondial est noir de nuées d’orage. Les tambours de guerre battent de plus en plus fort. Certains guettent déjà l’équivalent de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand. Une étincelle suffirait à embraser la planète. » Voilà, dans le journal boursier britannique The Financial Times, l’introduction d’un article consacré aux relations commerciales sino-américaines. L’assassinat de l’archiduc avait été le prélude de la la Première Guerre mondiale. Le risque est réel de voir, le 15 avril, un rapport du trésor américain sur la monnaie chinoise provoquer le choc qui, à son tour, déclencherait la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Personne, dans le monde, n’échapperait aux retombées d’une telle guerre.
Depuis quelques mois déjà, d’agressifs sinophobes mènent tambour battant une offensive contre la monnaie chinoise, le yuan. Le sénateur de Pennsylvanie Arlen Specter disait en février : « Les Chinois raflent nos marchés et nos emplois. Entre 2001 et 2007, ils nous ont volé 2,3 millions d’emplois. Les subsides à leur industrie et la manipulation de leur monnaie sont des formes de banditisme international. »
Obama confirme que la Chine doit tolérer pour le yuan un cours de change « centré sur le marché .» Le cours bas du yuan coûte à notre pays des centaines de milliers, voire des millions d’emplois, ajoute le président. Un porte-parole de la Maison-Blanche menace : « Si la Chine ne corrige pas le cours du yuan, les États-Unis seront mis sous pression afin de prendre des mesures contre cette situation. »
Quelques jours plus tard, 130 sénateurs et membres de la Chambre des représentants adressent au président une lettre dans laquelle ils exigent que le gouvernement américain prenne des mesures au cas où les Chinois s’obstinent à ne pas relever le cours de leur monnaie. Le représentant du Maine, Michael Maud, déclare : « Si notre gouvernement n’entreprend aucune action, il met un frein à la relance économique, il entrave la possibilité pour les industriels et les petites entreprises des États-Unis d’étendre leur production et d’accroître l’emploi. »
Le raisonnement est donc le suivant : les produits chinois sont bon marché parce que le cours de la monnaie chinoise est très bas. Les marchés américains sont de ce fait inondés de produits chinois, ce qui fait que les usines américaines ne trouvent plus de débouchés. Et, ainsi, le chômage augmente. Les Chinois doivent réduire leurs importations en réévaluant le yuan. De la sorte, leurs produits aux États-Unis coûteront plus cher, les usines américaines tourneront mieux et pourront mettre plus de gens au travail.
Voilà le raisonnement. La question est celle-ci : qu’y a-t-il de vrai, dans tout cela ?
Le yuan est-il coupable ?
En 2004 déjà, nombre de membres du Parlement américain exigent que le gouvernement chinois relève le cours du yuan de quelque 25 pour cent. En juillet 2005, le gouvernement chinois décide de ne plus fixer le cours du yuan, mais de le laisser évoluer de façon limitée selon une baisse ou une hausse de son cours de tout au plus 0,3 pour cent par jour. Ce faisant, à la mi-2008, le yuan a grimpé de 21 pour cent par rapport au dollar. Durant cette période, l’afflux de marchandises chinoises aux États-Unis ne diminue pas. La réévaluation de 21 pour cent n’a pas résolu le problème. Aujourd’hui, les Américains exigent à nouveau une réévaluation du yuan.
La mémoire américaine aurait sans doute besoin de phosphore, mais pas celle des Chinois. Ceux-ci n’ont toujours pas oublié comment, dans les années 70 et 80, les Américains étaient venus insister chez leurs alliés japonais afin qu’ils réévaluent le yen et ce, pour les mêmes raisons, précisément, que celles invoquées aujourd’hui pour la réévaluation du yuan. Pour commencer, les Japonais avaient relevé leur monnaie de 20 pour cent. Et ils l’avaient fait cinq ou six fois d’affilée. En 1970, il fallait payer 350 yen pour un dollar. Aujourd’hui, 90 yen. Pour une réévaluation, c’en est une ! Mais le Japon exporte toujours beaucoup plus de produits vers les États-Unis qu’il n’en importe des mêmes États-Unis. Ceux-ci ont désormais un déficit commercial vis-à-vis du Japon qui, calculé par habitant, est même très supérieur au déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine. Et ce, malgré l’énorme réévaluation du yen japonais.
Bon nombre d’économistes américains n’embraient pas sur cette campagne contre la Chine. Ainsi, Albert Keidel, du Georgetown Public Policy Institute, qui déclare : « Je ne suis absolument pas convaincu que les autorités chinoises manipulent le yuan et que son cours est trop bas. Comment peut-on d’ailleurs déterminer si un cours est trop bas ? Il n’existe pas de méthode concluante pour ce faire. »
Pieter Bottelier est un économiste du Carnegie Endowment for International Peace (Fondation Carnegie pour la paix mondiale). Il dit : « Prétendre que la Chine manipule le yuan est absurde. La preuve en est, d’ailleurs, qu’après la chute de Lehman Brothers, le dollar a grimpé. Le yuan a grimpé en même temps. Si les Chinois manipulaient leur monnaie, ils l’auraient bien empêché de grimper. »
Robert Pozen, économiste de la Harvard Business School, n’est pas convaincu non plus de la chose. Il déclare : « Imaginez que les Chinois réévaluent leur monnaie de 15 pour cent. Cela changerait-il quelque chose ? À peine ? »
Daniel Griswold, directeur du Center for Trade Policy Studies à l’Institut Cato de Washington, ne suit pas non plus cette croisade contre le yuan. Il estime : « Un yuan réévalué n’apporterait pas beaucoup d’oxygène à l’économie américaine, pas même s’il était réévalué de 25 pour cent. Depuis 2002, le dollar a perdu beaucoup de sa valeur par rapport au dollar canadien et à l’euro européen et, pourtant, notre déficit commercial via-à-vis du Canada et de l’Europe ne cesse de s’accroître. La réévaluation d’une autre monnaie est rarement une solution aux problèmes internes d’une économie. »
Stephen Roach, chef pour l’Asie de la banque d’affaires américaine Morgan Stanley, ne veut pas entendre parler du lauréat du prix Nobel Paul Krugman qui, dans deux pièces d’opinion publiées dans le New York Times, réclamait des taxes à l’importation sur les produits chinois afin d’augmenter de la sorte de 25 à 40 pour cent le prix de ces produits aux États-Unis. Roach explique : « Le conseil de Krugman est particulièrement mauvais et complètement déplacé. Le yuan est en réalité une bouée éclairante dans la tempête qui nous entoure. Il y a chez nous des gens qui s’époumonent contre la Chine mais qui ne voient pas que les problèmes de notre économie se situent dans notre économie même. Il est temps que Krugman soit fermement remis à sa place. »
Même le Wall Street Journal écrit : « On ne peut en croire ses oreilles. Il y a réellement des hommes politiques et des hommes d’affaires américains qui prétendent que la cause de nos problèmes réside chez les Chinois. Ils utilisent le yuan comme bouc émissaire. »
Le Fonds monétaire international ne pense pas non plus que la réévaluation du yuan puisse être très salutaire : « Une réévaluation du yuan chinois aidera un peu l’économie américaine, mais ne résoudra pas les problèmes internes. Si le yuan chinois est réévalué de 20 pour cent et s’il se passe la même chose avec la monnaie des autres marchés asiatiques en pleine croissance, l’économie américaine pourra peut-être connaître une croissance de 1 pour cent. »
Ces économistes et institutions renvoient aux problèmes internes de l’économie américaine. Examinons l’un des principaux problèmes de cette dernière
Plus de produits avec moins de main-d’œuvre
Les États-Unis, soit à peine 5 pour cent de la population mondiale, produisent presque 25 pour cent de ce qui est produit annuellement dans le monde en marchandises et services. Il y a dix ans, ils n’en étaient encore qu’à 20 pour cent. Malgré la montée de la Chine, malgré « l’envahissement du marché américain, » la part des États-Unis dans la production mondiale a augmenté, passant d’un cinquième à un quart. La production s’étend, la part américaine de la production mondiale augmente. On se poserait la question : De quoi se plaint l’establishment américain, en fait ? Mais le problème est celui-ci : Cette production de plus en plus importante est réalisée par de moins en moins de travailleurs.
Le ministère américain de l’Emploi dit qu’en 1979, 19,5 millions de personnes travaillaient dans le secteur industriel (manufacturier) américain. Vingt-six ans plus tard, au premier trimestre 2005, ils sont encore 14,2 millions. La production réalisée par ces 14,2 millions de travailleurs en 2005 était le double de celle des 19,5 millions de 1979. Avec 25 pour cent de travailleurs en moins, on produit deux fois plus. Au cours des 15 premières années qui ont suivi 1979, date de départ du calcul du ministère de l’Emploi, il y avait peu de produits chinois sur le marché américain et, pourtant, les emplois disparaissaient constamment en masse. Le ministère estime qu’un pour cent seulement de ces emplois liquidés sont dus à l’influence de la Chine.
Au cours des 10 années écoulées, chaque travailleur aux États-Unis a produit en moyenne 2,5 pour cent de plus chaque année. Cette hausse de la productivité n’est pas utilisée pour alléger le travail, pour augmenter les salaires, pour appliquer une diminution de la durée du temps de travail ni non plus pour créer plus d’emplois. Les entrepreneurs américains font précisément le contraire : le fruit accru du travail est utilisé pour supprimer des emplois.
Pour les hommes politiques et le monde économique des États-Unis, il est plus facile de montrer du doigt la Chine et le yuan que de vérifier où en sont les choses dans l’économie américaine et de tenter de dégager une solution à ce problème.
L’impact positif de la Chine sur l’économie américaine
Le fait de montrer la Chine du doigt est encore plus étonnant quand on examine tout ce que l’économie américaine doit à la Chine. L’an dernier, au plus fort de la crise, les exportations globales des États-Unis baissaient de 17 pour cent, mais les exportations des États-Unis vers la Chine, par contre, ne régressaient que de 0,22 pour cent. Une aubaine, pour l’économie américaine.
Quelque 50.000 entreprises américaines sont actives en Chine. L’écrasante majorité y gagne beaucoup d’argent. Pour certaines, la Chine constitue même un ange salvateur. Le Financial Times écrit : « Si la General Motors croit en Dieu, elle doit sans doute être en train de prier à genoux pour le remercier de l’existence de la Chine. L’an dernier, la vente des voitures GM en Chine a augmenté de 66 pour cent, alors qu’aux États-Unis, elle baissait de 30 pour cent. Sans la Chine, la GM n’aurait pu être sauvée. »
Les chiffres de vente élevés de la General Motors et de la plupart des autres entreprises américaines en Chine ne sont possibles que parce que l’économie et le pouvoir d’achat de la population y croissent rapidement. C’est une bonne chose, non seulement pour les entreprises américaines en Chine, mais pour toute l’économie mondiale. La Chine est devenue le principal moteur économique de la planète. Le journal du dimanche britannique The Observer écrit : « La Chine tient la barre de la relance mondiale. Elle aide le reste de l’Asie et des pays comme l’Allemagne, qui exporte beaucoup vers elle, à sortir de la récession. La Chine est l’un des principaux facteurs à avoir empêché, en 2009, que le monde ne s’enfonce encore plus dans la crise. »
The Economist écrit dans le même sens : « La Chine connaît une croissance rapide alors que les pays riches sont en récession. Comment osent-ils montrer la Chine du doigt ? »
Chris Wood, un analyste du groupe financier CLSA Asia-Pacific Markets, dit que la Chine s’emploie davantage que les États-Unis à faire face à la crise. Les autorités chinoises accroissent le pouvoir d’achat des gens et c’est un puissant stimulant pour l’économie, ajoute-t-il.
Les chiffres lui donnent raison. Selon le bureau d’étude Gavekal-Dragonomics, le revenu net des ménages chinois dans la période 2004-2009 a augmenté en moyenne et par an de 7,7 pour cent à la campagne et de 9,7 pour cent dans les villes. Depuis le début de la crise, cette tendance s’amplifie encore. On peut le voir dans le tableau ci-dessous, qui reprend les divers indicateurs de l’économie chinoise pour les deux premiers mois de cette année.
Les indicateurs économiques en Chine, évolution en pour cent par rapport à la même période en 2009
-
| jan-fév 2010 |
| Croissance valeur industrielle ajoutée | + 20,7 % |
| Production d’électricité | + 22,1 % |
| Investissements (croissance réelle) | + 23,0 % |
| Vente au détail (croissance réelle) | + 15,4 % |
| Exportations | + 31,4 % |
| Importations | + 63,6 % |
| Vente de biens immobiliers | + 38,2 % |
| Revenu autorités centrales | + 32,9 % |
Source : Dragonweek, Gavekal, 15 mars 2010, p. 2
Aucune économie occidentale ne peut présenter de tels chiffres. Les indicateurs économiques occidentaux n’atteignent même pas 10 pour cent des indicateurs chinois. Comme l’écrit The Economist : « Comment osent-ils montrer la Chine du doigt ? »
Parcourons un peu la situation :
–les États-Unis savent que l’économie chinoise est un moteur de progrès pour toute l’économie mondiale et également, de ce fait, pour l’économie américaine ;
–ils savent que le yuan a à peine un effet négatif sur l’emploi aux États-Unis mêmes ;
–ils savent que c’est le Canada et non la Chine qui est le premier exportateur vers les États-Unis ;
–ils savent que 56 pour cent des exportations chinoises vers les États-Unis ne sont pas dues à des firmes chinoises mais viennent de multinationales américaines ;
–ils savent qu’un produit étiqueté « Made in China » aux États-Unis devrait généralement porter une étiquette « Made in China, the US, Japan, S-Korea, Taiwan, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam, Singapore, Malaysia » car, pour 55 pour cent des exportations chinoises, la Chine n’est que le lieu où les diverses composantes sont assemblées, alors que ces composantes ont été produites en dehors de la Chine ;
–ils savent que, du prix de vente des produits assemblés en Chine, une petite part seulement va à la Chine et la plus grosse part va aux producteurs des composantes de ces produits ;
–ils savent que, du fait que l’assemblage est confié à la Chine, les autres pays est-asiatiques exportent beaucoup moins vers les États-Unis, mais bien plus vers la Chine et que le total des exportations est-asiatiques, chinoises y compris, vers les États-Unis, ne sont pas plus importantes, mais moins importantes, qu’il y a dix ans.
Et, pourtant, la Chine et son yuan sont les têtes de Turcs. Daniel Griswold, du Center for Trade Policy Studies, déclare : « L’attitude agressive de Washington à l’égard de Beijing est inspirée par des considérations politiques et non économiques. »
Les motivations
Les États-Unis exigent que le yuan soit réévalué mais ils exigent également, et c’est plus important, que le yuan soit libéré. Actuellement, c’est la Banque nationale chinoise, qui détermine quotidiennement le cours du yuan – depuis juillet 2008, son cours est d’entre 8,26 et 8,28 yuan pour un dollar. Le président Obama a dit : « Le cours du yuan doit être davantage centré sur le marché. » Ce qui signifierait que son cours ne serait plus déterminé par la Banque nationale, mais par le marché. Ce serait une défaite pour l’économie planifiée chinoise et une victoire pour le marché. Car, alors, l’État perdrait l’un des moyens de sa politique financière indépendante et souveraine. L’UNCTAD, l’organisation des Nations unies pour le commerce et le développement, voit où les États-Unis veulent en venir et écrit dans un rapport concernant les dangers entourant le yuan : « Le repos et le calme après la tempête financière sont tout à fait révolus. Le casino qui s’est vidé voici un an, est à nouveau rempli. Une fois de plus, on joue et on parie jusqu’à plus outre. De même, la foi inébranlable dans le fondamentalisme du marché est tout à fait revenue. Cette foi naïve estime toujours que les problèmes économiques peuvent être résolus en confiant le cours des monnaies aux marchés financiers sauvages. Ceux qui pensent que la Chine va permettre aux marchés absolument non fiables de déterminer le cours de sa monnaie ne se rendent pas compte à quel point la stabilité interne de la Chine est importante pour la région et pour le monde. »
En d’autres termes, laisser le cours du yuan au marché, c’est la même chose que de confier vos enfants à un pédophile. Mais l’offensive des États-Unis contre le « cours très bas » du yuan et contre « l’emprise de l’État chinois sur la monnaie » encourage un groupe d’économistes et d’entrepreneurs chinois à réitérer leur appel en faveur d’« une monnaie plus libre, centrée sur le marché. » Les points de vue en faveur du marché et de moins d’intervention de l’État gagnent en force dans une certaine section du monde économique et universitaire chinois et ce n’est surtout pas pour déplaire aux États-Unis.
La deuxième raison de l’offensive américaine contre la politique financière du gouvernement chinois est à chercher aux États-Unis mêmes. Le chômage U6 aux États-Unis est à 16,8 pour cent. U6 désigne le chômage officiel plus les chômeurs qui ne cherchent plus de travail parce qu’ils sont convaincus qu’ils ne trouveront quand même pas d’emploi, plus les travailleurs à temps partiel qui aimeraient bien travailler à temps plein mais ne parviennent pas à trouver un emploi de ce type. Le chômage effrayant de 16,8 %, la crise économico-financière la plus grave depuis 1929, l’incertitude quant à savoir si l’Amérique va sortir de la crise et si les entreprises et les familles seront encore en mesure de rembourser leurs dettes, l’incapacité du gouvernement et des entreprises à éviter toute cette misère… tout cela renforce la question : Qui a provoqué cela ? Qui doit en payer la facture ? La Chine est un coupable tout indiqué. Si l’opinion publique emprunte cette direction, les problèmes internes et les contradictions mêmes de l’économie américaine n’apparaîtront pas à la surface. Le journal Monthly Review écrit : « L’intention consiste à convaincre les travailleurs américains que la cause des problèmes ne réside pas dans le système économique même mais dans le comportement d’un gouvernement étranger. »
Tertio, la Chine est également une cible pour une partie de plus en plus importante du monde politique et du monde des affaires des États-Unis pour des raisons géostratégiques. Dans le monde entier, la Chine grignote l’influence américaine. Avant notre ère et jusqu’au milieu du 19e siècle, le centre du monde a été l’Est de l’Asie. Après cela, il s’est déplacé vers l’Europe occidentale et les États-Unis. Aujourd’hui, il retourne vers l’Est de l’Asie. Les États-Unis cherchent des moyens de contrer ce processus et de l’inverser. Ils ne tolèreront pas de ne plus occuper la première place dans le monde. La Chine est de ce fait cataloguée comme un facteur négatif, menaçant. D’où le fait qu’on voit paraître aujourd’hui, aux États-Unis, des ouvrages comme « La Chine est-elle un loup dans le monde ? », de George Walden, et dans lequel le pays est décrit comme une menace de mort pour le monde entier, pour la liberté et la démocratie. Et d’où le fait aussi qu’un film comme « Red Dawn » (L’aube rouge) va bientôt sortir dans les salles américaines. Allez le voir et vous découvrirez avec effroi comment l’Armée populaire chinoise envahit la ville de Detroit.
Comment réagissent les autorités chinoises ?
Depuis 1991, les relations entre la Chine et les États-Unis sont plus ou moins stables. Cela parce que des dizaines de milliers d’entreprises américaines présentes en Chine gagnent à ce qu’il en soit ainsi. Cela tient également du fait que la Chine est le principal financier extérieur de la dette publique américaine. Et que l’exportation de tant de produits chinois vers les États-Unis tempère la hausse des prix à la consommation, ce qui est positif pour l’économie américaine.
Il semble toutefois que les motivations d’une bonne relation commencent à céder le pas devant les motifs d’attitude agressive envers la Chine. L’offensive des gens qui détestent la Chine fait céder les partisans américains des bonnes relations. Le journal britannique The Telegraph décrit le climat comme suit : « On est convaincu que les relations américano-chinoises sont importantes, mais on ne pense pas qu’une collision frontale entre les deux mènerait à une destruction mutuelle. Washington sortira vainqueur de la lutte. » Cette conviction fait reculer les entreprises américaines qui, ensemble, ont investi 60 milliards de dollars en Chine. Myron Brilliant, vice-président de la Chambre américaine de commerce, déclare : « Je ne pense pas que le gouvernement chinois puisse espérer que le monde américain des affaires va arrêter notre parlement. Notre Chambre de commerce reste un pont entre la Chine et les États-Unis, mais nous ne pouvons plus retenir les loups. »
En attendant, le gouvernement chinois résiste pied à pied. Il ne pliera en aucun cas face aux pressions américaines. En ce moment, le gouvernement examine comment les secteurs des importations et des exportations réagiront lors d’une réévaluation du yuan. Les autorités ont l’intention de réévaluer légèrement le yuan, entre 4 et 6 pour cent, pour des raisons macroéconomiques. Une réévaluation rendra les produits chinois plus chers, mais les produits importés seront meilleur marché. L’an dernier, la Chine a importé 1.000 milliards de dollars ; la réévaluation du yuan peut être salutaire à la diminution de l’important excédent commercial. La réévaluation conviendra également à la politique visant à transformer l’appareil économique en le faisant passer d’une production à bas prix à une production de valeur élevée. Et, conformément aux intentions des autorités chinoises, la réévaluation peut également déplacer certaines parties de l’appareil économique vers l’intérieur et l’Ouest du pays. Bref : si une réévaluation a bel et bien lieu, ce sera parce qu’elle cadrera avec la politique macroéconomique.
Mais une réévaluation légère du yuan sera absolument insuffisante aux yeux des gens hostiles à la Chine. Ils veulent une réévaluation d’entre 27 et 40 pour cent. La prochaine étape des « loups » (dixit Myron Brilliant, le vice-président de la Chambre américaine de commerce) sera le rapport semestriel du Trésor américain, qui sortira au plus tard le 15 avril. Il y a de fortes chances que le Trésor accuse la Chine de manipuler le yuan. Ce sera le signal, pour des membres de la Chambre des représentants, d’instaurer des taxes élevées à l’importation sur toute une série de produits chinois. Le Financial Times écrit : « Ca revient à utiliser une bombe atomique. » Car les autorités chinoises prendront des contre-mesures. La guerre commerciale sera alors un fait. La plus importante relation bilatérale dans le monde, celle qui existe entre les États-Unis et la Chine, va sombrer tout un temps dans un mutisme mutuel, avec toutes les conséquences qu’on devine pour les problèmes mondiaux qui ne pourraient être résolus que dans une approche collective.
Cet article a été écrit par Peter Franssen, rédacteur de www.infochina.be, le 26 mars 2010.
Sources
(dans l’ordre d’utilisation)
-Alan Beattie, « Skirmishes are not all-out trade war » (Les escarmouches n’ont rien d’une guerre commerciale totale), The Financial Times, 14 mars 2010.
-Gideon Rachman, « Why America and China will clash » (Pourquoi l’Amérique et la Chine vont se heurter), The Financial Times, 18 janvier 2010.
-Foster Klug, « US lawmakers attack China ahead of Nov. Elections » (Les législateurs américains attaquent la Chine bien avant les élections de novembre), Associated Press, 15 mars 2010.
-Andrew Batson, Ian Johnson et Andrew Browne, « China Talks Tough to U.S. » (Le langage musclé de la Chine à l’adresse des USA), The Wall Street Journal, 15 mars 2010.
-« US lawmakers urge action on renminbi » (Les législateurs américains veulent hâter les mesures sur le renminbi), The Financial Times, 15 mars 2010.
-Leah Girard, « US Clash w/ China of Currency Manipulation Heats Up » (Le choc entre les États-Unis et la Chine à propos de la manipulation des devises s’échauffe), Market News, 17 mars 2010.
-Xin Zhiming, Fu Jing et Chen Jialu, « Yuan not cause of US woes » (Le yuan n’est pas la cause des malheures américains), China Daily, 17 mars 2010.
-« Stronger yuan not tonic for US economy » (Un yuan plus fort n’aurait rien de tonique pour l’économie américaine), Xinhua, 18 mars 2010.
-Li Xiang, « Sharp revaluation of yuan would be ‘lose-lose’ situation » (Une forte réévaluation du yuan serait une opération perdante pour les deux pays), China Daily, 22 mars 2010.
-« The Yuan Scapegoat » (Le yuan, bouc émissaire), The Wall Street Journal, 18 mars 2010.
-« RMB is not a cure-all for US economy: IMF » (Le renminbi n’a rien d’une panacée pour l’économie américaine, prétend le FMI), Xinhua, 17 février 2010.
-Dan Newman et Frank Newman, « Hands Off the Yuan » (Ne touchez surtout pas au yuan), Foreign Policy in Focus, 16 mars 2010.
-William A. Ward, Manufacturing Productivity and the Shifting US, China and Global Job Scenes – 1990 to 2005 (La productivité manufacturière et le déplacement de la scène de l’emploi américaine, chinoise et mondiale – de 1990 à 2005), Clemson University Center for International Trade, Working Paper 052507, Clemson, 2005, p. 6.
-Daniella Markheim, « Le yuan chinois : manipulé, mal aligné ou tout simplement mal compris ?), Heritage Foundation, 11 septembre 2007.
-Brink Lindsey, Job Losses and Trade – A Reality Check (Pertes d’emplois et commerce – un contrôle de la réalité), Trade Briefing Paper, Cato Institute, n° 19, 17 mars 2004.
-« Premier Wen Says China Will Keep Yuan Basically Stable » (La Premier ministre Wen affirme que la Chine va maintenir la stabilité fondamentale du yuan), Xinhua, 14 mars 2010.
-Patti Waldmeir, « Shanghai tie-up drives profits for GM » (Shanghai fait grimper les bénéfices de GM), The Financial Times, 21 janvier 2010.
-Ashley Seager, « China and the other Brics will rebuild a new world economic order » (La Chine et les autres pays du BRIC vont rebâtir un nouvel ordre économique mondial), The Observer, 3 janvier 2010.
-« Currency contortions » (Contorsions monétaires), The Economist, 19 décembre 2009.
-« Fear of the dragon » (La crainte du dragon), The Economist, 9 janvier 2010.
-DragonWeek, Gavekal, 8 février 2010, p. 2.
-Daniel Griswold, « Who’s Manipulating Whom ? China’s Currency and the U.S. Economy » (Qui manipule qui ? La monnaie chinoise et l’économie américaine), Trade Briefing Paper, Cato Institute, n° 23, 11 juillet 2006.
-« China and the US Economy » (La Chine et l’économie américaine), The US-China Business Council, janvier 2009, p. 2.
-Ambrose Evans-Pritchard, « Is China’s Politburo spoiling for a showdown with America ? » (Le Politburo chinois cherche-t-il une confrontation avec l’Amérique ?), The Telegraph, 14 mars 2010.
-Martin Hart-Landsberg, « The U.S. Economy and China: Capitalism, Class, and Crisis » (L(« conomie américain et la Chine : capitalisme, classe et crise), Monthly Review, Volume 61, n° 9, février 2010.
-« Global monetary chaos: Systemic failures need bold multilateral responses » (La chaos monétaire mondial : les échecs systémiques nécessitent d’audacieuses réponses multilatérales), UNCTAD, Policy Brief n° 12, mars 2010.
-Ho-fung Hung, « The Three Transformations of Global Capitalism » (Les 3 transformations du capitalisme mondial), et Giovanni Arrighi, « China’s Market Economy in the Long Run » (L’économie de marché chinoise dans le long terme), tous deux dans : Ho-fung Hung, China and the Transformation of Global Capitalism (La Chine et la transformation du capitalisme mondial), John Hopkins University Press, Baltimore, 2009, pp. 3-9 et 23.
-Ambrose Evans-Pritchard, op. cit.
-James Politi et Patti Waldmeir, « China to lose ally against US trade hawks » (La Chine va perdre un allié contre les faucons du commerce américain), The Financial Times, 21 mars 2010.
-Keith Bradsher, « China Uses Rules on Global Trade to Its Advantage » (La Chine utilise à son propre profit les règles du commerce mondial), The New York Times, 14 mars 2010.






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg



 Les experts, du haut de leurs brillants diplômes obtenus à la sueur de très coûteuses études, appréhendent parfaitement la grave crise économique qui frappe la Grèce. Ils la commentent, d’ailleurs et comme toujours, fort savamment. Avec des mots, des comparaisons, des réflexions et des prévisions dont ils ont seuls le secret. Et qu’importe s’ils disent aujourd’hui le contraire de ce qu’ils affirmaient il y a peu et que les faits démentent demain leurs certitudes actuelles. Ils sauront tout aussi excellement démontrer qu’ils l’avaient annoncé et que le commun des mortels ne les a pas bien compris.
Les experts, du haut de leurs brillants diplômes obtenus à la sueur de très coûteuses études, appréhendent parfaitement la grave crise économique qui frappe la Grèce. Ils la commentent, d’ailleurs et comme toujours, fort savamment. Avec des mots, des comparaisons, des réflexions et des prévisions dont ils ont seuls le secret. Et qu’importe s’ils disent aujourd’hui le contraire de ce qu’ils affirmaient il y a peu et que les faits démentent demain leurs certitudes actuelles. Ils sauront tout aussi excellement démontrer qu’ils l’avaient annoncé et que le commun des mortels ne les a pas bien compris.



.jpg)

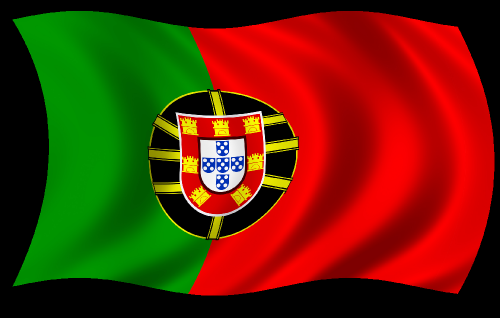









 Die Ursache für die dramatische Krise, die seit Anfang Januar den Euro auf Talfahrt geschickt und dem Dollar in gleichem Maße Aufwind verschafft hat, ist nicht einfach das Finanzproblem Griechenlands. Die Krise ist vielmehr das Resultat eines Komplotts und geheimer Absprachen zwischen einigen der mächtigsten Spekulanten an der Wall Street – zweifellos mit stillschweigender Rückendeckung durch das US-Finanzministerium. Das Ziel ist, den Dollar in dieser schwierigen Zeit dadurch zu retten, dass der Euro, die einzige Währung, die als alternative Reservewährung in Frage käme, geschwächt wird.
Die Ursache für die dramatische Krise, die seit Anfang Januar den Euro auf Talfahrt geschickt und dem Dollar in gleichem Maße Aufwind verschafft hat, ist nicht einfach das Finanzproblem Griechenlands. Die Krise ist vielmehr das Resultat eines Komplotts und geheimer Absprachen zwischen einigen der mächtigsten Spekulanten an der Wall Street – zweifellos mit stillschweigender Rückendeckung durch das US-Finanzministerium. Das Ziel ist, den Dollar in dieser schwierigen Zeit dadurch zu retten, dass der Euro, die einzige Währung, die als alternative Reservewährung in Frage käme, geschwächt wird.


 Par des tactiques analogues à celles qui ont favorisé les subprimes aux USA, Wall Street a aggravé la crise financière qui ébranle la Grèce et sapé la solidité de l’euro, en permettant aux gouvernements européens de dissimuler la croissance de leur endettement.
Par des tactiques analogues à celles qui ont favorisé les subprimes aux USA, Wall Street a aggravé la crise financière qui ébranle la Grèce et sapé la solidité de l’euro, en permettant aux gouvernements européens de dissimuler la croissance de leur endettement. Comment réagirait le peuple de France si ses "nouvelles élites dirigeantes" lui annonçait le gel des retraites publiques et privées…
Comment réagirait le peuple de France si ses "nouvelles élites dirigeantes" lui annonçait le gel des retraites publiques et privées…
 Een interessant artikel over Starbucks, het trendy imago daarvan bij links Europa en de nieuwe vestiging in Antwerpen.
Een interessant artikel over Starbucks, het trendy imago daarvan bij links Europa en de nieuwe vestiging in Antwerpen.
 Jour après jour, il apparaît de plus en plus clair que des banques et des fonds spéculatifs américains jouent l’éclatement de la zone euro : d’abord la Grèce avant le Portugal, l’Espagne, etc.
Jour après jour, il apparaît de plus en plus clair que des banques et des fonds spéculatifs américains jouent l’éclatement de la zone euro : d’abord la Grèce avant le Portugal, l’Espagne, etc. Les profits du capital financier reposent sur l’endettement, et sur une création illimitée de dettes, au niveau des sociétés, des ménages et du gouvernement, qui grossissent à une vitesse bien plus grande que le produit national brut mondial ou le commerce mondial. Comment espérer, dans ces conditions, atteindre à la stabilité de l’ordre monétaire international ou à l’efficacité du système ? Sa remise en ordre serait-elle compatible avec les intérêts en jeu et avec la libéralisation tous azimuts de l’économie ?
Les profits du capital financier reposent sur l’endettement, et sur une création illimitée de dettes, au niveau des sociétés, des ménages et du gouvernement, qui grossissent à une vitesse bien plus grande que le produit national brut mondial ou le commerce mondial. Comment espérer, dans ces conditions, atteindre à la stabilité de l’ordre monétaire international ou à l’efficacité du système ? Sa remise en ordre serait-elle compatible avec les intérêts en jeu et avec la libéralisation tous azimuts de l’économie ?