jeudi, 07 janvier 2010
Noi, jüngeriani proprio perchè libertari
Noi, jüngeriani proprio perchè libertari
di Luciano Lanna
Ex: http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, allemagne, révolution conservatrice, ernst jünger, libertaires |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 décembre 2009
Eugen Diederichs et le Cercle "Sera"
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999
Eugen Diederichs et le Cercle «Sera»
Robert STEUCKERS
Analyse: Meike G. WERNER, «Bürger im Mittelpunkt der Welt», in Der Kulturverleger Eugen Diederichs und seine Anfänge in Jena 1904-1914. Katalogbuch zur Ausstellung im Romantikerhaus Jena 15. September bis 8. Dezember 1996, Diederichs, München, 1996, 104 p. (nombreuses ill., chronologie), ISBN 3-424-01342-0.
- Meike G. WERNER, «Die Erneuerung des Lebens durch ästhetische Praxis. Lebensreform, Jugend und Festkultur im Eugen Diederichs Verlag» &
- Friedrich Wilhelm GRAF, «Das Laboratorium der religiösen Moderne. Zur “Verlagsreligion” des Eugen Diederichs Verlags»
tous deux in: Gangolf HÜBINGER, Versammlungsort moderner Geister. Der Eugen Diederichs Verlag - Aufbruch ins Jahrhundert der Extreme, Diederichs, München, 1996, 533 p., ISBN 3-424-01260-2.
- Rainer FLASCHE, «Vom Deutschen Kaiserreich zum Dritten Reich. Nationalreligiöse Bewegungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland», in: Zeitschrift für Religionswissenschaft, 2/93, pp. 28-49, Diagonal-Verlag, Marburg, ISSN 0943-8610.
Editeur allemand, qui a fondé sa maison en 1896, Eugen Diederichs se voulait un “réformateur de la vie” (Lebensreformer). Tout à la fois pragmatique et romantique, ses intentions étaient de briser l'ennui, la positivité matérialiste, l'étroitesse des esprits, qui pesaient comme une chape de plomb sur les dernières années du XIXième siècle et les premières du XXième. Diederichs a perçu, longtemps à l'avance, que ce positivisme sans élan conduirait à de dangereuses impasses. Avec son regard synoptique, il a mis tous les moyens de sa maison d'édition en œuvre pour promouvoir pensées, sentiments et démarches cherchant à sortir de cet enlisement. Diederichs a ainsi rassemblé, dans les collections qu'il publiait, les auteurs réhabilitant le corps (et la “corporéité”), les adeptes du mouvement des cités-jardins en architecture, les réformateurs de la pédagogie qui avaient beaucoup de peine à faire passer leurs suggestions, les pionniers du mouvement de jeunesse, etc. L'objectif de Diederichs était de donner la parole à tous ceux qui se faisaient l'écho des œuvres de “maîtres à penser” incontestés comme Ruskin, Tolstoï, Herder, Fichte et Schiller. Le noyau rénovateur, dynamique et “énergisant” de leur pensée ou de leurs démarches avait été progressivement refoulé hors de la culture dominante, statique et rigidifiée, pour s'exprimer dans des sub-cultures marginalisées ou dans des cénacles tâtonnants, critiques à l'endroit des piliers porteurs de la civilisation occidentale, positiviste et matérialiste. Outre l'art, la voie de l'artiste, trois voies s'offraient, selon Diederichs, à ceux qui voulaient sortir des enfermements positivistes: une rénovation de la tradition idéaliste, un néo-romantisme, une nouvelle mystique.
Esthétique et énergie chez Schiller
Deuxième écueil à éviter dans toute démarche anti-positiviste: le repli sur des dogmes étroits, sur des manies stériles coupées de tout, sur des réductionnismes incapacitants, qui empêchent l'émergence d'une nouvelle culture, dynamique, énergique et plurielle, ouverte sur tous les faits de monde. Dogmatisme et rénovation, dogmatisme et vie, sont en effet incompatibles; Diederichs n'a jamais cessé de vouloir mettre cette incompatibilité en exergue, de la clouer au pilori, de montrer à quelles envolées fécondes elle coupait les ailes. Le projet à long terme de Diederichs a été clairement esquissé lors de la célébration du 100ième anniversaire de la mort du poète Schiller, le 9 mai 1905. Poète et penseur du classicisme allemand, Schiller avait aussi mis l'accent sur l'esthétique et l'art, éléments indispensables dans une Cité harmonieuse. Celle-ci ne devait pas exclusivement mobiliser les ressorts de la politique, ou se préoccuper uniquement d'élections et de représentation, mais insuffler en permanence une esthétique, ciment de sa propre durée et de sa propre continuité. Schiller parie sur l'éducation de la personne et sur le culte de la beauté, afin d'avoir des citoyens “harmonieux et éthiques” (harmonisch-sittlich), portés par une “liberté intérieure”, autant d'individualités créatrices capables de donner forme à l'histoire.
Comment réaliser l'idéal schillerien du citoyen dans l'Allemagne wilhelminienne, où l'éducation n'oriente nullement les élèves vers l'esthétique, la liberté intérieur ou l'harmonie créatrice? Diederichs, attentif à tout ce qui se passait dans sa ville d'Iéna, découvre en 1908, un groupe d'étudiants rebelles à la positivité pédagogique de la “Belle Epoque”. Cette Jenaer Freie Studentenschaft s'était créée en mai 1908; un mois plus tard, Diederichs invite ces jeunes gens et filles à participer à une fête solsticiale qu'il finance et organise sur le Hoher Leeden, une hauteur proche de la ville. C'est ainsi que naît le “Cercle Sera”. L'objectif est une réforme anti-autoritaire et anti-positiviste de la pédagogie, de l'éducation, de la vie en général. La volonté des participants et adeptes de ce mouvement culturel étudiant est de forger un style nouveau, qui évitera l'écueil des encroûtements (stilbildend). Mais pour rendre une telle démarche possible, il faut sortir l'étudiant et l'intellectuel de leur tour d'ivoire, restaurer une socialité culturelle et festive, où l'on rit, chante, s'amuse et échange des idées. Diederichs a plusieurs modèles en tête quand il envisage la restauration de cette socialité intellectuelle et festive: 1) le panthéisme et le mysticisme de la bohème poétique berlinoise (le Friedrichshagener Kreis); 2) les cercles culturels de la Renaissance italienne (dont il a appris l'existence par le livre de Jacob Burckhardt Kultur der Renaissance in Italien); 3) l'accent mis par Nietzsche sur le dionysiaque et sur les chœurs bacchiques en Grèce; 4) les traditions allemandes médiévales des danseurs de la Saint-Jean et de la Saint-Guy (Sanct-Johann- und Sanct-Veittänzer); 5) l'esprit des maîtres-chanteurs de Hans Sachs. Cette culture dionysiaque de l'expression et de l'effervescence permet d'expérimenter la communitas sacrée, de transcender des normes qui, si elles n'étaient jamais transcendées, deviendraient très vite les étouffoirs de la créativité. En effet, la créativité artistique n'est nullement la répétition rituelle des mêmes gestes conventionnels.
Pour une pédagogie nouvelle
Raison pour laquelle les fêtes solsticiales du Cercle Sera n'ont jamais été pareilles ni répétitives: Diederichs voulait qu'elles soient chaque fois l'occasion d'injecter dans les esprits de nouvelles idées ou de nouvelles formes. Ainsi la chanteuse norvégienne Bokken Lasson, innovatrice dans son art, participe en 1905 au solstice de la Lobedaburg. En 1906, des groupes de danseurs suédois présentent leurs danses traditionnelles mais réactualisées. En 1907, les jeunes de Iéna présentent de nouvelles danses de leur composition, inspirées des Minnelieder médiévaux. Chaque fête de mai ou du 21 juin est l'occasion de découvrir une facette de la littérature ou de la pensée panthéiste européenne (François d'Assise, Spiele de Hans Sachs, poésies d'Eichendorff ou de Goethe), mais sous des formes toujours actualisées.
A partir de 1908, l'idéal schillerien, théorisé depuis mai 1905, prend corps et se double de la volonté de promouvoir en Allemagne une pédagogie nouvelle, basée sur la notion d'énergie théorisée par Schiller, sur l'élan vital bergsonien, sur le dionysiaque chanté par Nietzsche, etc. Deux mouvements alimentent en effectifs et en inspirations le Cercle Sera: 1) Les étudiants dissidents de l'Université de Leipzig qui se nommaient les Finken (les pinsons) ou les Wilden (les sauvages) ou encore, plus simplement, les Freie Studenten (Les libres étudiants), dégagés des structures rigides de l'université conventionnelle. 2) Les jeunes du mouvement de jeunesse Wandervogel. Le Cercle Sera recrute une élite étudiante et lycéenne, très cultivée, adepte de la mixité (un scandale pour l'époque!), à la recherche de nouvelles formes de vie et d'une éthique nouvelle. Pour Diederichs, ce groupe “semble enfin réaliser les objectifs sur lesquels l'ancienne génération avait écrit et dont elle avait parlé, mais dont elle espérait l'advenance dans un très lointain avenir”. Désormais, à la suite des fêtes solsticiales et sous l'influence des randonnées des Wandervögel, le groupe pratique les Vagantenfahrten, les randonnées des Vagantes, c'est-à-dire les “escholiers pérégrinants” du moyen âge. On se fait tailler des costumes nouveaux aux couleurs vives, inspirés de cette tradition médiévale. Diederichs espère que cette petite phalange de jeunes, garçons et filles, cultivés et non conformistes va entraîner dans son sillage les masses allemandes et les tirer hors de leurs torpeurs et de leurs misères. Il a conscience de forger une “aristocratie de l'esprit” qui sera un “correctif culturel” visant à transformer les principes politiques dominants, à insuffler le sens schillerien de l'énergie et l'élan vital de Bergson dans la pratique quotidienne de la politique. Mais Diederichs est déçu, après une fête qu'il avait organisée le 7 juin 1913, avec beaucoup d'artistes et d'acteurs: trop de participants s'étaient comporté comme des spectateurs, alors que, se plaignait Diederichs, dans une vraie fête traditionnelle ou hellénique-dionysiaque, il n'y a jamais de spectateurs, mais seulement des participants actifs. Diederichs constatait, non sans amertume, que la fête traditionnelle ne semblait pas pouvoir être restaurée, que la modernité avait définitivement cassé quelque chose en l'homme, en l'occurrence la joie spontanée et créatrice, le sens de la fête.
De toute l'aventure du Cercle Sera, où se sont rencontrés les philosophes Hans Freyer et Rudolf Carnap, émergeront principalement les méthodes pédagogiques d'enseignement aux adultes, avec Alexander Schwab, Walter Fränzel, Hildegard Felisch-Schwab (pédagogie spéciale des orphelins), Elisabeth Czapski-Flitner, Helene Czapski, Hedda Gagliardi-Korsch.
Les hérétiques sont les seuls esprits créateurs
Sur le plan religieux, Diederichs se considérait personnellement comme un grand réformateur, plus exactement comme “l'organisateur du mouvement religieux extra-confessionnel”. Il accusait les théologiens du pouvoir, de l'université et des églises officielles d'avoir bureaucratisé la foi, d'avoir enfoui la flamme de la religion sous les cendres du dogmatisme, des intrigues et du calcul politicien. La religion vivante des traditions et de nos ancêtres s'est muée en “histoire morte”, a été déchiquetée par le scalpel d'un rationalisme sec et infécond. La démarche de Diederichs était dès lors de “revenir aux racines de notre force (= la religion, la foi) la plus profonde”. Le protestantisme, d'où Diederichs est pourtant issu, est grandement responsable, disait-il, de cette crise et de cette catastrophe: il a donné la priorité au discours (le prêche et les commentaires des écritures) plutôt qu'au culte (festif et communautaire), plutôt qu'aux sentiments, à la sensualité ou à l'émotion. Le réel homo religiosus du début du XXième siècle doit avoir la volonté de rebrousser chemin, de retourner à la foi vive, de tourner le dos à la religion étatisée, au cléricalisme et à l'académisme. Dans cette optique, Diederichs ouvrira les portes de sa maison d'édition à tous ceux que les dogmatiques avaient marginalisés, aux non-conformistes et aux innovateurs qui “osent saisir le religieux de manière explorante et expérimentale”. A plus d'une reprise, il déclare: “Les hérétiques sont les esprits créateurs par excellence dans l'histoire des religions”. Et il citait aussi souvent une phrase de Jakob Grimm: «Savez-vous où Maître Eckehart me touche le plus? [...] Là où il sort de l'étroitesse de la religion pour passer à l'hérésie». En 1901, le théologien totalement hérétique Arthur Bonus (cf. infra), un des auteurs favoris de Diederichs, résumait clairement leur optique: «Les autorités sont là pour être combattues».

Pour répondre au rationalisme de la théologie officielle et au dogmatisme, Diederichs préconise de faire appel à des modes de pensée holistes, vitalistes et existentialistes. C'est le noyau vital des religions qu'il faut saisir, même au prix d'associations étonnantes, de comparaisons audacieuses, où Zarathoustra va voisiner le Christ, Goethe va se retrouver mêlé à Nieztsche, tout comme Marx à Wagner. Des multiples traditions panthéistes, les auteurs de la maison d'édition de Diederichs vont extraire des motifs et des démarches conceptuelles pour façonner un Dieu qui est tantôt source créatrice de tous les phénomènes de la Vie, tantôt “puissance d'ascension déclenchant une créativité absolue”. Toutes les visions de Dieu chez les auteurs de Diederichs impliquaient un Dieu dynamique, décideur, actif, créatif et animé d'une forte volonté d'action.
Une religion qui dynamise les volontés
En effet, par le terme “religion”, Diederichs n'entendait pas une attitude contemplative, purement intériorisée: son interprétation du phénomène religieux était vitaliste et dynamique, portée par une forte volonté de mener une action dans et sur le monde. Certes, fasciné par la tradition mystique allemande, il n'excluait par l'introspection religieuse, l'importance de l'intériorité et des forces qui y sont tapies, la découverte par la réflexion des profondeurs de la subjectivité, mais ce mouvement de l'esprit vers l'intériorité visait la libération de forces insoupçonnées pour parfaire une action correctrice, esthétisante ou éthique dans le réel extérieur. La religion permet à l'homme d'accroître sa volonté individuelle pour la vie, de rassembler des potentialités pour arraisonner le monde. Dans une brochure commentant ses collections, Diederichs écrivait en 1902: «Une culture religieuse n'est pas tellement dépendante de sa conception de la vie dans l'au-delà [...] Elle veut plutôt réaliser le telos de cette Terre, qui est de créer dans l'en-deça des individualités de plus en plus fines dans une Règne dominé par l'esprit. Les pures spéculations d'idées sur Dieu, l'immortalité [...] et autres doctrines de l'Eglise cèdent le pas, ne sont plus considérées comme essentielles, et font place à la Vie religieuse, qui correspond aux lois du Cosmos et aux lois de la croissance organique; la religion ne peut dès lors plus être reconnue qu'à ses fruits». En 1903, Diederichs écrit au Pasteur Theodor Christlieb qu'il voulait, avec ses livres, “promouvoir une religion sans regard vers le passé, mais dirigée vers l'avenir”. Pour désigner cette religion “futuriste”, Diederichs parlait de “religion du présent”, “religion de la volonté”, “religion de l'action”, “religion de la personnalité”. Avec le théologien protestant en rupture de banc Friedrich Gogarten (“théologien de la crise”, “théologien dialectique”), Diederichs évoquait “une religion du oui à la Vie, bref, une religion qui dynamise les volontés”.
Action et création
La religion (au sens où l'entendaient Diederichs et ses auteurs), la “théosophie” (terme que Diederichs abandonnera assez vite) et le néo-romantisme visent “une saisie immédiate de la totalité de la vie”, afin de dépasser les attitudes trop résignées et trop sceptiques, qui empêchent de façonner l'existence et affaiblissent les volontés. «Plus de savoir mort, mais c'est l'art qui devrait transformer l'âme et les sentiments des hommes et les conduire à l'action pratique» (on reconnait là le thème schillerien récurrent dans la démarche de Diederichs). Parmi les auteurs qui allaient expliciter et répandre cette vision holiste de la vie, Arthur Bonus, autre théologien protestant en rupture de banc, sera certainement le plus emblématique. Dans Religion als Schöpfung (1902; = La religion comme création), Bonus présente la religion comme une “conduite de la vie”, où l'homme se plonge dans la vectorialité réelle du monde, qu'il a d'abord saisie par intuition; il entre ainsi en contact avec la puissance divine créatrice du monde et, fortifié par ce contact, se porte en avant dans le monde sous l'impulsion de ses propres actions. Dans ce sens, la religion est une attitude virile et formatrice, elle est pures action et création. Les églises, au contraire, n'avaient eu de cesse de freiner cette activité créatrice forte, de jeter un soupçon sur les âmes fortes en exaltant la faiblesse et la mièvrerie des âmes transies, incapables de donner du neuf à la vie. Mais Bonus, théologien bien écolé, ne réduit pas son apologie de la vie à un naturalisme voire à certaines tendances maladroites du panthéisme qui dévalorisent —comme les églises mais au nom d'autres philosophades— l'action de l'homme créateur et énergique, sous prétexte qu'elle serait une dérive inhabituelle —et pour cela non fondamentale— ou éphémère de la matière ou d'un fond-de-monde posé une fois pour toute comme stable, immuable. Bonus réclame l'avènement d'une religion qui ne refuserait plus le monde et son devenir perpétuel, mais pousserait les hommes à participer à son façonnage, à agir avec passion pour transformer les simples faits objectifs en principes spirituels supérieurs. Telle est la “germanisation du christianisme” qu'il appelle de ses vœux. Bonus, bien qu'argumentant en dehors des sentiers battus de la théologie protestante, a suscité avec ses thèses bien des émois positifs chez ses pairs.
Autre livre qui fit sensation dans le catalogue de Diederichs: l'essai Rhytmus, Religion, Persönlichkeit (= Rythme, religion, personnalité) de Karl König. Dans la ligne de Bonus, la pensée religieuse de König se résume à ces quelques questions: «Entends-tu dans tout le chaos du présent le rythme secret de la vie? Laisse pénétrer ce rythme dans la profondeur de ton âme. Laisse Dieu travailler ta personne, pour qu'il la modèle et la façonne en toi. Ce n'est que là où l'on trouve un centre de force dans la vie spirituelle et personnelle que quelque chose peut se construire et se développer, qui donnera de la valeur à la vie».
L'objectif de Diederichs, en publiant quelques ouvrages paganisants, plus ceux des théologiens qui abjuraient une foi devenue sans relief, sans oublier les grands textes des traditions européennes (surtout mystiques), chinoises, indiennes etc., était d'opposer à la “phalange du logos” (les néo-kantiens, les phénoménologues et les positivistes logiques), la “phalange des défenseurs de la vie”.
Robert STEUCKERS.
00:05 Publié dans Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, mouvementsde jeunesse, jeunesse, allemagne, 19ème siècle, paganisme, néo-paganisme, tradition, édition, éditeur, culture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 décembre 2009
L'autre signification de l'Etre
 Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
L'autre signification de l'Etre
Dr. Angelika WILLIG
De qui un homme comme Ernst Jünger se sent-il compris? Certainement pas par ses adversaires qui ne combattent en lui que sa seule projection élitaire et militariste. Mais il ne doit pas se sentir davantage compris de ses épigones, qui sont incapables de le suivre dans les méandres difficiles de sa pensée et qui, au contraire, cherchent la facilité en vouant un culte simpliste à leur idole. Que reste-t-il dès lors, sinon la “grande conversation des esprits” dont a parlé Nietzsche et qui, à travers les siècles, n'est animée que par des hommes isolés, importants et significatifs.
Il est très rare que de tels isolés engagent un dialogue. Ainsi, Ernst Jünger s'est adressé à Martin Heidegger, à l'occasion des 60 ans de ce philosophe de la Forêt Noire, en écrivant à son intention Über die Linie, un opuscule qui aborde “le grand thème de ces cent dernières années”: le nihilisme. Heidegger s'est senti tellement interpellé par ce texte qu'à son tour, il a consacré à l'écrivain un opuscule, également intitulé Über' die Linie, à l'occasion des 60 ans de l'auteur du Travailleur en 1955. Cette rencontre a été très prometteuse, on s'en doute. Mais elle n'a pas promis plus qu'elle ne pouvait tenir, surtout à ceux qui s'en faisaient des idées fausses. Et totalement fausse aurait été l'idée, par exemple, que Jünger et Heidegger avaient pris délibérément la résolution d'écrire à deux un manifeste commun, fondateur d'une “révolution conservatrice” à laquelle nous pourrions encore adhérer aujourd'hui. Telle n'était pas l'intention de Jünger et de Heidegger: ils sont trop intelligents et trop prudents pour oser de tels exercices.
Métaphysique
Jünger part du principe que le nihilisme constitue un défi pour l'individu. L'individu, ici, est bien l'individu et non pas une classe particulière, ou une race, un parti ou un mouvement. En d'autres termes: le nihilisme n'est pas un problème politique mais un problème métaphysique. C'est là la raison essentielle qui motive Jünger quand il s'adresse à Heidegger car celui-ci a vu que la question décisive réside dans la métaphysique et non pas dans l'économie, la biologie ou la psychologie. Dans ce domaine, Jünger est bien sur la même longueur d'onde que le philosophe de la Forêt Noire: tous deux acceptent le fait que l'évolution historique bute contre une limite et qu'il n'est plus possible d'aller au-delà. Telle est la signification de l'image de la “ligne”, que Heidegger reprend à son compte, sans doute en la transformant: tel est bien le diagnostic du nihilisme. Jünger nous en livre une description qui culmine dans cette phrase: . Le nihilisme est dès lors la perte de toute assise solide et de toute durée, sur lesquelles on pourrait encore construire ou reconstruire quelque chose.
On songe tout de suite aux “idées” et aux “valeurs”. Mais Jünger pense sans nul doute aux attaques en règle qui sont perpétrées contre une “base ultime”, une assise primordiale, que nous pourrions parfaitement interpréter dans un sens écologique aujourd'hui. Jünger nous parle du “moment où la rotation d'un moteur devient plus forte, plus significative, que la répétion, des millions de fois, des formules d'une prière”. Ce “moment”, qui pourrait bien durer cent ans ou plus, désigne l'illusion qui veut que toute perfection technique ne peut réussir que sur base de biens donnés par Dieu ou par la nature, biens dont nous dépendons existentiellement et surtout dont nous sommes nous-mêmes une partie. Le “néant” que la modernité nihiliste semble répandre autour d'elle, n'est donc pas néant, rien, mais est en vérité le sol, sur lequel nous nous trouvons, le pain que nous mangeons, et l'âme qui vit en nous. Si nous nous trouvons dans des “paysages arides, gris ou brûlés” (Jünger), il peut nous sembler que rien n'y poussera ni n'y fleurira jamais. Mais plus nos souvenirs des temps d'abondance s'amenuisent, plus forts seront le besoin et le désir de ce dont nous avons réellement besoin et de ce dont nous manquons. Heidegger ne songe à rien d'autre quand il définit la disparition, l'absence, par la présence, ou quand il voit dans la Verborgenheit (l'obscurité, l'occultement) une sorte de “dépôt de ce qui n'est pas encore dévoilé (dés-occulté)”. Car si nous considérons l'homme dans son existentialité, son Dasein, soit sa détermination par son environnement (Umwelt), alors son Etre (Sein) ne peut jamais être mis entièrement à disposition; dès lors, plus le danger le menace, plus grande est la chance d'une nouvelle appropriation. Heidegger appelle cela l'“autre commencement”.
Refus de la conception linéaire de l'histoire
Tous deux s'opposent donc à la conception linéaire de l'histoire, à la conception qui voit l'histoire comme une ligne droite, sur laquelle on ne peut qu'avancer ou reculer, partageant du même coup les esprits en “esprits progressistes” et en “esprits conservateurs”. Pour Heidegger comme pour Jünger la ligne est transversale. “Le franchissement de la ligne, le passage du point zéro”, écrit Jünger, “partage le jeu; elle indique le milieu, mais non pas la fin”. Comme dans un cercle, elle recommence sa trajectoire après une rotation, mais à un autre niveau. Heidegger parle ici de la nécessité d'un "retour” ou d'un “retournement” et non pas d'un “recul vers des temps déjà morts, rafraîchis à titre d'expérimentation par le truchement de formes bricolées”. Jünger, lui aussi, a toujours évité ce fourvoiement, ce que l'on ne peut pas dire de tous ses contemporains! “Le retour”, signifie pour Heidegger, le lieu ou la pensée et l'écriture “ont toujours déjà été d'une certaine façon”.
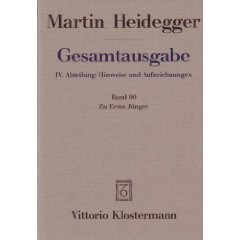 Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.
Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.
Sujet & Objet
Heidegger admoneste Jünger, et cette admonestation se justifie théoriquement. A juste titre, Heidegger pense: «L'homme non seulement se trouve dans la zone critique de la ligne, mais il est lui-même, non pas pour soi et certainement pas par soi seulement, cette zone et ainsi cette ligne. En aucun cas cette ligne est... telle qu'elle serait un tracé franchissable placé devant l'homme». En écrivant cette phrase, Heidegger se rapporte à une idée fondamentale de Sein und Zeit, jamais abandonnée, selon laquelle l'homme n'est pas un “sujet”, placé devant un “objet”, mais est soumis à une détermination existant déjà avant tout rapport sujet/objet. L', tel qu'évoqué ici, acquiert une signification si différente de celle que lui conférait la métaphysique traditionnelle, que Heidegger, dans son essai, biffe toujours le mot (Sein), afin qu'on ne puisse plus le lire dans le sens usuel.
Pour le philosophe, une telle précision dans les termes est absolument indispensable, mais, quand on lit l'écrivain, cette précision conduit à des mécompréhensions ou des quiproquos. Jünger, en effet, ne s'en tient pas à la terminologie forgée par Heidegger, mais raisonne avec des mots tels “valeur”, “concept”, “puissance”, “morale”, “décision” et reste de ce fait dans le “langage de la métaphysique” et surtout dans celui du “métaphycisien inversé” que fut Nietzsche. Pourtant, l'écrivain ne peut pas être jugé à l'aune d'une philosophie du sujet, manifestement dépassée. C'est cependant ce que Heidegger tente de faire. Mais son jugement pose problème quand on repère le passage où Jünger se rapproche le plus de cet “autre” dans sa formulation: . Une fois de plus, Heidegger, après avoir lu cette phrase, pose une question très précise: l'Etre peut-il être quelque chose pour soi? Et le philosophe de la Forêt Noire corrige: .
Jünger complète Heidegger
De telles remarques nous aident à mieux comprendre Heidegger, mais ne sont presque d'aucune utilité quand nous interprétons l'écriture de Jünger. Le philosophe nous dit bien que “de tels doutes ne peuvent nullement égratigner la force éclairante des images”, mais cela ne le conduit pas à un examen plus précis du langage de Jünger. Par coquetterie, Heidegger évoque la confusion et l'imprécision de Jünger mais reste, lui, ferme sur sa propre voie, dans sa propre logique de penser, et ne cherche pas à comprendre les autres possibles. Quand Heidegger constate: “Votre jugement sur la situation trans lineam et mon explication de linea sont liés l'un à l'autre”, il reste finalement assez laconique.
Quoi qu'il en soit, la position de Jünger complète la pensée de Heidegger. Nous avons dit, en début d'exposé, que le nihilisme était une attitude de l'individu: en effet, toute question métaphysique ne concerne que chaque individu personnellement. Aucun ordre socio-politique ne peut changer quoi que ce soit au fait que chacun d'entre nous soit exposé aux dangers du monde, soit soumis à l'angoisse que cette exposition, cette Ausgesetzheit, suscite. Voilà pourquoi cela ne fait pas une grosse différence —à ce sujet Jünger et Heidegger sont d'accord— si le nihilisme se présente à nous sous la forme ou l'expression d'une dictature fasciste, ou sous celle d'un socialisme réel ou d'une démocratie de masse. Dans de tels contextes, la démarche de Heidegger a été la suivante: Heidegger a travaillé sur l'isolement de l'homme avec une précision jusqu'alors inégalée, en utilisant tout spécialement les ressorts de la critique du langage; ensuite, sa philosophie a constitué une tentative de transposer l'angoissante dépendance du moi, soi-disant “libre”, dans une sorte de “sécurité” (Geborgenheit), site d'apaisement des tensions, site de sérénité, où s'épanouit enfin la vraie liberté. En opérant ce retournement, il nous semble, que Heidegger perçoit l'homme comme sur le point de disparaître, écrasé sous le poids d'un sombre destin planétaire, et donne l'impression de devenir fataliste.
Mais cela, Heidegger ne l'a pas voulu, et ne l'a pas dit de cette façon. Et c'est pourquoi, nous apprécions ce discours post-idéaliste de Jünger insistant sur la “force chevaleresque de l'individu”, sur sa “décision” et sur la volonté de l'homme libre de se maintenir envers et contre tout. Car si le moi n'est même plus autorisé à formuler des projets, il est contraint de résister à son propre “empêtrement”, résistance qui, seule, appelera le démarrage d'un nouveau mouvement historique.
“Le poète et le penseur habitent des sommets voisins”, a dit un jour Heidegger. Leurs demeures sont haut perchées mais séparées par un gouffre. C'est bien ce que nous avons pu constater en comparant les positions de Jünger et de Heidegger. Mais ne se pourrait-il pas que ce soit précisément ce gouffre qui fait tout l'intérêt de la rencontre Jünger/Heidegger. l'on délibère, dit Jünger dans Le recours aux forêts, un ouvrage très proche d'Über die Linie, .
Dr. Angelika WILLIG.
(article paru dans Junge Freiheit, n°12/1995; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:09 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, ernst jünger, heidegger, métaphysique, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 décembre 2009
Annotation sur le "Travailleur"
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Annotation sur le «Travailleur»
Dr. Karlheinz WEISSMANN
Ernst Jünger a toujours voulu que l'on inclue son Travailleur dans l'édition de ses œuvres complètes, surtout contre les “bien-pensants” qui l'exhortaient à prendre distance à l'endroit de ce “faux-pas” littéraire. Déjà dans une “Troisième lettres aux amis”, datée du 1er septembre 1946, Jünger insistait: il ne reniait rien de son œuvre, celle-ci devait être considérée comme un tout; il ne prenait ses distances d'aucun fragment de ce travail. Le rapport qui existe entre des écrits tels La mobilisation totale ou Le Travailleur, d'une part, et d'autres tels Jardins et Routes, est comparable à celui qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Plus tard, il a répété cette formule de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais cela ne nous dit rien de clair, finalement, sur la valeur qu'il faut attribuer actuellement aux premiers écrits de Jünger. La seconde version du Cœur aventureux déjà, la décision de publier en 1934 une édition des œuvres complètes mais sans les textes nationalistes du début des années 20 ensuite, signale la volonté de Jünger de marquer une césure entre la partie purement politique de ses premiers écrits et ses livres ultérieurs. Mais il fit tout de même une exception de taille: les deux ouvrages que nous venons de mentionner, La Mobilisation totale et Le Travailleur. Mais au prix d'une interprétation qui rend presque méconnaissable l'intention initiale. Voilà pourquoi il m'apparaît opportun de poser une nouvelle fois la question: quelle est l'“assise dans la vie” que possèdent ces textes? Ce qui doit nous permettre de tourner notre regard vers un fragment de l'histoire des impacts obtenus par ses livres-clefs, histoire au demeurant peu connue, mais ô combien instructive et éclairante.
La Mobilisation totale et Le Travailleur étaient tous deux des livres apocalyptiques. Depuis le début des années 30 la crise s'accentuait considérablement en Allemagne; simultanément augmentait le besoin de “grandes solutions”. Les modèles technocratiques, les “Plans” de réorganisation de l'Etat et de la société bénéficiait d'une incontestable conjoncture, puisque le jeu libre des libéraux, en politique comme en économie, avait incontestablement failli. Pour les extrémistes de gauche, le modèle était les plans quinquennaux soviétiques, tandis qu'une fraction des économistes professionnels autour de John M. Keynes imaginait une politique interventionniste du plein-emploi. Enfin, des cercles de non-conformistes, où se rencontraient, pour échanger des idées, hommes de gauche et de droite, libéraux, sociaux-démocrates, des banquiers, des conservateurs et des nationaux-socialistes. Ces idées ont trouvé une écho dans le fameux “Plan WTB” (d'après les noms de ses inventeurs: Wladimir Woytinski, Karl Baade et Fritz Tarnow), édité par la fédération des syndicats (Gewerkschaftsbund), de même que dans le Wirtschaftliches Sofortprogramm der NSDAP (= “Programme économique tout-de-suite de la NSDAP”) de Gregor Strasser ou dans le Sofortprogramm de Günther Gereke qui devint par la suite Commissaire du Reich pour la politique de l'emploi dans le Cabinet von Schleicher. En lançant son appel à la “nostalgie anti-capitaliste”, Strasser a pu transformer en triomphe pour la NSDAP les élections de juillet 1932; ailleurs, le Président de l'ADGB, Theodor Leipart, tentait de rassembler tous les partisans de l'autarcie nationale, qui voulaient délivrer les syndicats libres du carcan de la SPD. Dans son célèbre discours de Bernau, le 14 octobre 1932, Leipart expliquait que la tâche du travailleur était de se mettre au service de son peuple; il évoquait l'«esprit soldatique de l'imbrication dans le Tout et du don de soi au Tout», qui devait animer le prolétariat dans l'avenir.
On peut avancer la thèse que Leipart a été inspiré par Le Travailleur de Jünger. A une époque aussi chaotique, les ennemis d'hier se rassemblent dans de nouveaux groupements: Le Travailleur avait incontestablement touché une corde sensible dans l'air du temps. Mais ce livre mythique et apocalyptique a également suscité une série d'incompréhensions. Les uns considéraient Le Travailleur comme un ouvrage “bolchévique”, d'autres y voyaient le résultat d'un culte impolitique de la technique, d'autres encore en interprétaient le contenu comme l'expression d'une philosophie nihiliste, née sous la pression des faits. Ce sont précisément les admirateurs de Jünger dans les ligues de jeunesse nationales-révolutionnaires et le mouvement Widerstand d'Ernst Niekisch qui se sont sentis interpellés et irrités. Une irritation qui s'est encore accrue quand Jünger, sans ambages, accepte la modernité et insiste sur le rapport unissant la “mobilisation allemande” et la “domination planétaire du Travailleur”. Si Jünger a voulu faire du Travailleur un écrit programmatique du “nouveau nationalisme”, alors il n'a pas été compris de son public ou n'a été accepté qu'avec réserve. En 1933, les dernières possibilités d'organiser des discussions fructueuses disparaissent.
 Mais, dans l'Allemagne nationale-socialiste, on comptait un petit nombre d'admirateurs de Jünger qui considéraient toujours que Le Travailleur était un manifeste et, en même temps, un manuel de politique pratique. Ce groupe se rassemble dans les années 30 autour de Meinhard Sild et Edgar Traugott. Tous deux appartenaient à la NSDAP clandestine d'Autriche et sont passés à la SS après l'Anschluß. Pourtant leurs idées étaient en ultime analyse bien différentes des directives principales qu'énonçaient les idéologues officiels de la NSDAP. Ils s'étaient doter d'un petit forum dans la revue Zeitgeschichte. La couverture de cette publication présentait un aigle et un serpent, les animaux du Zarathoustra de Nietzsche; la tonalité des articles et des poèmes publiés était franchement nietzschéenne. Ensuite, les jeunes hommes rassemblés autour de Sild et de Traugott se sentaient fidèles à un “socialisme” qui, tout-à-fait dans le sens du Travailleur de Jünger, voulait organiser la “mise au travail totale” et élever l'Allemagne au rang d'une puissance capable “d'intervenir de la façon la plus vigoureuse qui soit dans les rapports de force régissant le monde”. Pour eux, il ne s'agissait nullement de “totalitarisme” ou d'une justification folciste (= völkisch) des guerres pour l'espace vital: mais bien plutôt des effets de cette logique froide qui a tant fasciné Jünger lui-même. Traugott et Sild, à leur façon, tirent les leçons du “réalisme héroïque”, dont ils attendent qu'il “compénètre totalement le monde d'esprit guerrier, de réalisme et de paganisme”. Dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas affirmer exactement quelle a été la nature du rapport entre Jünger, d'une part, et Traugott et Sild, d'autre part. Quoi qu'il en soit, leurs idées se sont différenciés dès que la guerre a éclaté. Sild a encore patronné l'édition de campagne de Feuer und Blut en 1941, mais déjà dans un article de juin 1939 pour les Nationalsozialistische Monatshefte, il exprime ses réserves quant à l'amitié qui lie Jünger au dessinateur Alfred Kubin, qui plonge son regard dans les abîmes les plus glauques de l'âme humaine et que Jünger considérait comme un “frère en esprit”. Cette amitié ne correspondait pas à ce que l'on attendait de Jünger, en qui on voyait, à l'époque, le “type même de l'activiste technique et le chef efficace”. La version finale des Falaises de marbre était, elle aussi, en contradiction avec cette image que l'on se faisait de Jünger. Traugott a consacré une longue recension à ce livre, dès sa parution, dans les colonnes de Zeitgeschichte: il y louait les qualités littéraires, tout en indiquant clairement ce qui le séparait de l'auteur. L'essai de Traugott, paru en 1941, Von der Führung (= Du Commandement) ne contient plus aucune allusion à Jünger; le contenu de cet ouvrage s'aligne largement sur l'orthodoxie nationale-socialiste.
Mais, dans l'Allemagne nationale-socialiste, on comptait un petit nombre d'admirateurs de Jünger qui considéraient toujours que Le Travailleur était un manifeste et, en même temps, un manuel de politique pratique. Ce groupe se rassemble dans les années 30 autour de Meinhard Sild et Edgar Traugott. Tous deux appartenaient à la NSDAP clandestine d'Autriche et sont passés à la SS après l'Anschluß. Pourtant leurs idées étaient en ultime analyse bien différentes des directives principales qu'énonçaient les idéologues officiels de la NSDAP. Ils s'étaient doter d'un petit forum dans la revue Zeitgeschichte. La couverture de cette publication présentait un aigle et un serpent, les animaux du Zarathoustra de Nietzsche; la tonalité des articles et des poèmes publiés était franchement nietzschéenne. Ensuite, les jeunes hommes rassemblés autour de Sild et de Traugott se sentaient fidèles à un “socialisme” qui, tout-à-fait dans le sens du Travailleur de Jünger, voulait organiser la “mise au travail totale” et élever l'Allemagne au rang d'une puissance capable “d'intervenir de la façon la plus vigoureuse qui soit dans les rapports de force régissant le monde”. Pour eux, il ne s'agissait nullement de “totalitarisme” ou d'une justification folciste (= völkisch) des guerres pour l'espace vital: mais bien plutôt des effets de cette logique froide qui a tant fasciné Jünger lui-même. Traugott et Sild, à leur façon, tirent les leçons du “réalisme héroïque”, dont ils attendent qu'il “compénètre totalement le monde d'esprit guerrier, de réalisme et de paganisme”. Dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas affirmer exactement quelle a été la nature du rapport entre Jünger, d'une part, et Traugott et Sild, d'autre part. Quoi qu'il en soit, leurs idées se sont différenciés dès que la guerre a éclaté. Sild a encore patronné l'édition de campagne de Feuer und Blut en 1941, mais déjà dans un article de juin 1939 pour les Nationalsozialistische Monatshefte, il exprime ses réserves quant à l'amitié qui lie Jünger au dessinateur Alfred Kubin, qui plonge son regard dans les abîmes les plus glauques de l'âme humaine et que Jünger considérait comme un “frère en esprit”. Cette amitié ne correspondait pas à ce que l'on attendait de Jünger, en qui on voyait, à l'époque, le “type même de l'activiste technique et le chef efficace”. La version finale des Falaises de marbre était, elle aussi, en contradiction avec cette image que l'on se faisait de Jünger. Traugott a consacré une longue recension à ce livre, dès sa parution, dans les colonnes de Zeitgeschichte: il y louait les qualités littéraires, tout en indiquant clairement ce qui le séparait de l'auteur. L'essai de Traugott, paru en 1941, Von der Führung (= Du Commandement) ne contient plus aucune allusion à Jünger; le contenu de cet ouvrage s'aligne largement sur l'orthodoxie nationale-socialiste.
Tout ce que je viens d'écrire sur le groupe rassemblé autour de Traugott et Sild permet de comprendre le Jünger “politique”. L'engagement de Jünger dans les années 20 n'a pas été une marotte: sans aucun doute, il a appartenu aux têtes pensantes de la droite révolutionnaire allemande. Mais sa participation au débat politique n'autorise aucune simplification extrême, comme celles de l'historiographie boîteuse qui se pare du label d'“antifascisme”, en répétant ses arguments à satiété. Jünger était un nationaliste à l'époque mais il a toujours été plus que cela. Mais, après avoir écrit Le Travailleur, il tire une conclusion: la politique n'est qu'un phénomène superficiel qui n'influe en rien sur les processus titaniques à l'œuvre dans notre monde; Jünger n'a pas voulu s'exposer aux coups de cette “titanisation”, parce qu'il la croyait inévitable. Cette attitude est sans doute le résultat d'un moment de faiblesse, mais elle est aussi empreinte de sagesse. Car l'un des messages les plus forts de Jünger demeure le suivant: il est bon “de deviner que derrière les excès de dynamisme de notre temps se trouve caché un centre immobile”.
Dr. Karlheinz WEISSMANN.
(article paru dans Junge Freiheit, n°12/95; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, ernst jünger, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 décembre 2009
Jünger Wandervogel

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Jünger Wandervogel
Patrick NEUHAUS
Dans bon nombre de publications, Ernst Jünger témoigne de ses ancrages personnels dans le monde d'avant la première guerre mondiale.
Ceux qui connaissent la biographie de Jünger savent que l'adolescent détestait la rationalité, se sentait étranger à elle, tout comme à la quotidienneté du monde de son époque. Il était un rêveur qui ne connaissait rien du monde des autres et n'y cherchait pas son chemin. Cette attitude d'“anarque”, nous ne cessons de la découvrir dans toute l'œuvre d'Ernst Jünger. A la même époque, Franz Kafka ou Thomas Mann affichaient une même distance par rapport au monde de la majorité. Les intérêts du jeune Jünger résident tout entiers dans son monde onirique individuel. Le monde dans lequel évolue l'adolescent Jünger est marqué par tous ces facteurs sociaux qui orientaient la vie de la plupart des fils de la société bourgeoise: une maison parentale reposant sur des fondements solides, une vie quotidienne à l'école obnubilée par les bonnes notes, l'idéal d'une profession stable. C'est dans ce type de monde que le jeune homme de la Belle Epoque devait trouver sa voie. L'écrivain Ernst Jünger sera le contraire de son père, Ernst Jünger sen. (1868-1943). En 1901, le père quitte, avec sa famille, la pittoresque cité de Heidelberg pour émigrer à Hannovre, ensuite à Schwarzenberg dans l'Erzgebirge, enfin à Rehberg: au fil de ces transplantations, le fils Ernst Jünger jun., se détache de plus en plus nettement de la vision du monde positiviste du 19ième siècle. Son père ne réussit qu'à lui communiquer sa passion pour l'entomologie. Mais au-delà de cela, s'est rapidement évanouie l'influence intellectuelle que le père, chimiste et pharmacien doué, exerçait sur son fils épris d'indépendance. Dès l'âge de 13 ans, nait dans le cœur de Jünger un enthousiasme et un émerveillement pour l'agencement des choses dans la nature, pour le sens qu'elles nous communiquent.
Les séjours en pleine nature, la collection de ces petites pierres, de ces petites mosaïques, aux formes diverses, leur agencement en images aux couleurs châtoyantes, les voyages imaginaires du jeune Jünger féru de lectures dans des mondes lointains, aventureux, ont fait en sorte que les journées d'école sont vite apparues fort mornes. Dans Le cœur aventureux, Jünger dépeint ses aspirations avec une indéniable volupté: «Mes parents possédaient une serre... et, souvent, lorsque l'air brûlant frémissait sur le toit de verre, je songeais, avec un plaisir étrange, qu'il ne devait pas faire plus chaud en Afrique. Mais il devait sans doute y faire un peu plus chaud, car c'est ce qui était quasi insupportable, ce qui n'avait jamais encore été vécu, qui était le plus attirant».
Comme des milliers d'autres garçons, Jünger, à seize ans, en 1911, rejoint le Wandervogel. Une des raisons qui l'ont poussé dans les rangs de ce mouvement de jeunesse: le recul de ses résultats scolaires. Comme l'avait déjà constaté Gerhard Ille dans son livre Es begann in Steglitz (Berlin, 1987), le développement du mouvement de jeunesse est étroitement lié à l'augmentation rapide du nombre d'élèves dans les grandes écoles. Le nombre des adhérents du Wandervogel s'est multiplié. Les temps d'apprentissage étaient devenus plus long, le corps des enseignants tendait à s'enfler démesurément et à se bureaucratiser; tout cela contribuait à diminuer sensiblement la qualité de l'enseignement dans les Gymnasia. Pour beaucoup d'élèves, l'école devenait aliénante; elle les préparait à des professions qui n'étaient plus, en dernière instance, que des “fonctions” dans les structures de la société allemande, de plus en plus technologisée et bureaucratisée.
Jünger ne se sentait pas exposé à la pression sociale, qui poussait les jeunes gens à terminer la seconde moitié de leurs humanités afin d'obtenir le droit d'effectuer un service militaire volontaire d'un an seulement (en 1912, Jünger décrochera finalement ce diplôme). Ce type de service militaire prévoyait un temps réduit à une seule année, permettait aux jeunes de gagner du temps et de l'argent et autorisait le volontaire à postuler le statut d'officier de réserve. Mais si le jeune homme ne réussissait pas à atteindre cette position sociale tant briguée, il restait tenaillé par la crainte des examens; s'il ne les passait pas ou s'il n'obtenait pas l'affectation désirée, cela pouvait se terminer en tragédie. Les statistiques de 1883-1888 nous signalent le suicide de 289 élèves, dont 110 dans les grandes écoles. Chez les Wandervögel, qui cultivaient un ressentiment certain à l'égard de la société qu'ils détestaient, ces considérations n'avaient pas leur place. L'officier de réserve issu du Wandervogel envisageait toujours une réforme “par le haut”, et, plus tard, pendant la guerre, il cherchait à promouvoir une réforme globale de la vie dans le corps même des officiers. Ce fut un échec. Mais le scepticisme de ces jeunes officiers à l'égard de l'armée en tant que forme d'organisation, à l'égard de sa technicisation et de sa rationalisation, est demeuré: c'était un scepticisme pour une part plus “progressiste” que celui qui règnait dans d'autres secteurs de la société.
Ernst Jünger, lui, n'a jamais songé au suicide, car il ne prenait pas l'école au sérieux. «Je rêvais sans tenir compte de rien, avec passion... et je me cherchais chaque nouvelle année un nouveau chef droit aux épaules larges, derrière lesquelles je pouvais opportunément me réfugier» (Das abenteuerliche Herz, 1ière version).
La fantaisie juvénile influencée par la lecture de livres d'aventures, comme ceux de Karl May, ou de récits coloniaux ou d'ouvrages de géographie, l'a conduit à rêver à de longs voyages dans des contrées inexplorées. La notion de “communauté” qui, pour d'autres, est la clef de l'aventure, ne constitue pas l'essentiel pour Jünger. A ce moment-là de son existence, comme plus tard, pendant la guerre, elle n'est qu'un moyen pour compléter son univers d'ivresse et de rêves. L'énergie pour l'aventure, Jünger la porte en lui, il n'a pas besoin d'une dynamisation complémentaire, qui lui serait transmise par d'autres. Jünger ne s'est jamais entièrement soumis à un groupe ni n'a adhéré exclusivement à un mouvement précis. C'est ce qui ressort des quelques rares descriptions que nous livre Jünger sur le temps où il était Wandervogel: beuveries vespérales à la manière des étudiants des corporations. Sur les visites hebdomadaires aux brasseries de Hameln, où Jünger était lycéen en 1912, nous avons un récit, publié seulement en 1970 dans Approches, drogues et ivresse: «Les chansons et toute sorte de cérémonies telles que la “salamandre” (1) étaient ordonnées après un silentium préparatoire; un moment de détente, la fidelitas, suivait l'exécution du rituel. On buvait dans des pots à couvercle; parfois aussi un hanap circulait à la ronde. Il avait la forme d'une botte qu'on ne cessait de remplir à nouveau, aux frais de celui qui avait été l'avant-dernier à la tenir. Quand la bière tirait à sa fin, il fallait, ou bien en boire de toutes petites gorgées, ou bien faire “cul sec” d'un trait (...) Il existait toute une série de délits qu'on expiait en vidant une petite ou grande quantité de liquide — ce qu'on appelait “descendre dans le pot”. Souvent des étudiants, ex-membres du club, étaient nos hôtes; ils louaient notre zèle gambrinesque». (note (1): Salamandre: rite qui consiste à frotter trois fois la table en rond du fond de son pot avant de faire “cul sec”).
 Par la suite, Jünger a essayé de traduire en actes ce que d'autre n'évoquaient qu'en paroles. A la recherche de la vie dans sa pureté la plus limpide, avec la volonté de se plonger dans l'ivresse extrême de l'aventure et dans l'émerveillement intense de nouvelles découvertes, de nouvelles couleurs, odeurs et plantes, de nouveaux animaux, Jünger décide de franchir le pas, un pas extraordinairement courageux pour un adolescent, un pas dangereux: à Verdun, en Lorraine, sans avoir averti son père, il s'engage dans la Légion Etrangère française. Un an seulement avant la Grande Guerre, avant même d'avoir passé son “examen de maturité” (ndt: qui correspond plus ou moins au bacchalauréat français), le jeune Jünger amorce une aventure audacieuse, mais qui sera de très courte durée. La même année, au moment où Ernst Jünger part, un revolver dans la poche, pour rejoindre la prestigieuse phalange des professionnels de l'armée française, le mouvement Wandervogel réunit ses adeptes allemands sur une montagne d'Allemagne centrale, le Hoher Meißner. Un Wandervogel autrichien avait appelé les Germains au “Combat contre les Slaves”; les Allemands veulent prendre position et répondent, par la voix de leur porte-parole: «La guerre? Cette manifestation de la folie des hommes, cette destruction de la vie, ce massacre en masse des hommes, faut-il la réactiver de nos jours? Qu'un destin bienveillant, que notre œuvre quotidienne, exécutée en toute fidélité à nos idéaux, nous en préservent!».
Par la suite, Jünger a essayé de traduire en actes ce que d'autre n'évoquaient qu'en paroles. A la recherche de la vie dans sa pureté la plus limpide, avec la volonté de se plonger dans l'ivresse extrême de l'aventure et dans l'émerveillement intense de nouvelles découvertes, de nouvelles couleurs, odeurs et plantes, de nouveaux animaux, Jünger décide de franchir le pas, un pas extraordinairement courageux pour un adolescent, un pas dangereux: à Verdun, en Lorraine, sans avoir averti son père, il s'engage dans la Légion Etrangère française. Un an seulement avant la Grande Guerre, avant même d'avoir passé son “examen de maturité” (ndt: qui correspond plus ou moins au bacchalauréat français), le jeune Jünger amorce une aventure audacieuse, mais qui sera de très courte durée. La même année, au moment où Ernst Jünger part, un revolver dans la poche, pour rejoindre la prestigieuse phalange des professionnels de l'armée française, le mouvement Wandervogel réunit ses adeptes allemands sur une montagne d'Allemagne centrale, le Hoher Meißner. Un Wandervogel autrichien avait appelé les Germains au “Combat contre les Slaves”; les Allemands veulent prendre position et répondent, par la voix de leur porte-parole: «La guerre? Cette manifestation de la folie des hommes, cette destruction de la vie, ce massacre en masse des hommes, faut-il la réactiver de nos jours? Qu'un destin bienveillant, que notre œuvre quotidienne, exécutée en toute fidélité à nos idéaux, nous en préservent!».
Cette attitude pacifiste a été celle de la majorité dans le mouvement de jeunesse bourgeois avant le déclenchement de la Grande Guerre. La volonté d'action de Jünger, d'une parfaite cohérence, ne pouvait pas se concrétiser dans sa patrie. Son départ pour la Légion fit la une dans les quotidiens de sa région. Par voies diplomatiques, le père de Jünger obtient assez rapidement le rapatriement de son fils fugueur, qui se trouvait déjà en Afrique. Détail intéressant: le père lui ordonne par télégramme de ne pas revenir sans s'être laissé photographier en uniforme de légionnaire.
Jünger eut en Afrique des expériences plutôt dégrisantes. Il nous décrit par exemple comment il a été cueilli par des policiers militaires français, peu après son arrivée au Maroc, et exposé à la risée des indigènes. Les chambres sont pareilles à celles des détenus. Dès ce moment, l'aventure africaine laissait à désirer. Mais son livre Jeux africains demeure un récit légendaire, qui ne cesse de captiver ses lecteurs. En 1939, le Meyers Lexikon, pourtant fidèle à la ligne imposée par le régime, fait tout de même l'éloge de ce texte: Jünger, écrit le rédacteur, prouve avec ce livre «qu'il est doué d'une grande capacité poétique à décrire et à contempler», surtout «après avoir approché dangereusement un retournement, celui qui mène du réalisme héroïque au nihilisme sans espoir».
Après avoir passé un Abitur accéléré, Jünger se porte volontaire dès le début de la guerre. Sa jeunesse était définitivement passée. Le monde obsolète de sa ville natale, endormi et médiéval, moisi et vermoulu, il l'abandonnait définitivement. Il appartiendra désormais au petit nombre de ceux qui abandonnent le romantisme sans une plainte, pour adopter le pas cadencé, pour troquer le béret de velour des Wandervögel pour le casque d'acier de l'armée impériale. Numquam retrorsum, semper prorsum!
Patrick NEUHAUS.
(article extrait de Junge Freiheit, n°12/95; trad. franç.: Robert Steuckers).
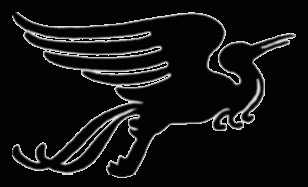
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, ernst jünger, mouvements de jeunesse, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 décembre 2009
Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
 Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)
Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)
Werner BRÄUNINGER
«Nous souhaitons du fond de notre cœur la victoire du national-socialisme, nous connaissons le meilleur de ses forces, l'enthousiasme qui le porte, nous connaissons le sublime des sacrifices qui lui sont consentis au-delà de toute forme de doute. Mais nous savons aussi, qu'il ne pourra se frayer un chemin en combattant... que s'il renonce à tout apport résiduaire issu d'un passé révolu» (1).
Ces phrases, Ernst Jünger les a écrites pendant l'été 1930. Pourquoi, se demande-t-on aujourd'hui, Jünger n'a-t-il pas trouvé la voie en adhérant au mouvement de cet homme, apparamment capable de transposer et d'imposer les idées de Jünger et du «nouveau nationalisme» dans la réalité du pouvoir et de la politique? Mon propos, ci-après, n'a pas la prétension d'être une analyse méticuleuse, profonde, systématique de l'histoire des idées. Il ne vise qu'à montrer comment une personnalité individuelle et charismastique de la trempe d'Ernst Jünger, qui a fêté ses 100 ans en mars dernier, a pu maintenir son originalité à l'ère du Kampfzeit de la NSDAP.
1. Ernst Jünger et Adolf Hitler
Le jugement posé par Jünger sur Hitler a varié au cours des années: «Cet homme a raison», puis «Cet homme est ridicule» ou «Cet homme est inquiétant» ou «sinistre» (2). En 1925, Jünger pensait encore que la figure de Hitler éveillait indubitablement, tout comme celle de Mussolini, «le pressentiment d'un nouveau type de chef» (3). La description par Jünger d'un discours du jeune Hitler nous communique très nettement ce “fluide”: «Je connaissais à peine son nom, lorsque je l'ai vu dans un cirque de Munich où il prononçait l'un de ses premiers discours... A cette époque, j'ai été saisi par quelque chose de différent, comme si je subissais une purification. Nos efforts incommensurables, pendant quatre années de guerre, n'avaient pas seulement conduit à la défaite, mais à l'humiliation. Le pays désarmé était encerclé par des voisins dangereux et armés jusqu'aux dents, il était morcelé, traversé par des corridors, pillé, pompé. C'était une vision sinistre, une vision d'horreur. Et voilà qu'un inconnu se dressait et nous disait ce qu'il fallait dire, et tous sentaient qu'il avait raison. Il disait ce que le gouvernement aurait dû dire, non pas littéralement, mais en esprit, dans l'attitude, ou aurait dû faire tacitement. Il voyait le gouffre qui se creusait entre le gouvernement et le peuple. Il voulait combler ce fossé. Et ce n'était pas un discours qu'il prononçait. Il incarnait une manifestation de l'élémentaire, et je venais d'être emporté par elle» (4).
Après que Jünger ait reçu de Hitler un exemplaire de son livre autobiographique et programmatique, le fameux Mein Kampf, Jünger lui a expédié tous ses livres de guerre. L'un de ces exemplaires d'hommage, plus précisément Feuer und Blut, contient une dédicace datée du 9 janvier 1926: «A Adolf Hitler, Führer de la Nation! - Ernst Jünger». Plus tard, la même année, Hitler annonce sa visite chez Jünger à Leipzig; celle-ci n'a toutefois pas eu lieu, à cause d'une modification d'itinéraire. Plus tard, Jünger écrit, à propos de cet événement: «Cette visite se serait sans doute déroulée sans résultat, tout comme ma rencontre avec Ludendorff. Mais elle aurait certainement apporté le malheur» (5). En 1927, Hitler lui aurait offert un mandat de député NSDAP au Reichstag. Jünger a refusé. Il considérait que l'écriture d'un seul vers avait davantage d'intérêt que la représentation de 60.000 imbéciles au Parlement.
Les relations entre les deux hommes se sont nettement rafraîchies par la suite, surtout après que Hitler ait prêté le “serment de légalité” en octobre 1930 devant la Cour du Reich à Leipzig: «Je prête ici le serment devant Dieu Tout-Puissant. Je vous dis que lorsque je serai arrivé légalement au pouvoir, je créerai des tribunaux d'Etat sous le houlette d'un gouvernement légal, afin que soient jugés selon les lois les responsables du malheur de notre peuple». A cela s'ajoute que Jünger et Hitler ne jugeaient pas de la même façon la question des attentats à la bombe perpétrés par le mouvement paysan du Landvolk dans le Schleswig-Holstein.
Jünger critiquait Hitler et son mouvement parce qu'ils étaient trop peu radicaux; au bout de quelques années, l'écrivain jugeait finalement le condottiere politique comme un «Napoléon du suffrage universel» (6). Pourtant, ils restaient tous deux d'accord sur l'objectif final: le combat inconditionnel contre le Diktat de Versailles et aussi contre la décadence libérale, ce qui impliquait la destruction du système de Weimar.
Jünger: «Nous nous sommes mobilisés de la façon la plus extrême dans cette grande et glorieuse guerre pour défendre les droits de la Nation, nous nous sentons aujourd'hui aussi appelés à combattre pour elle. Tout camarade de combat est le bienvenu. Nous constituons une unité de sang, d'esprit et de mémoire, nous sommes “l'Etat dans l'Etat”, la phalange d'assaut, autour de laquelle la masse devra serrer les rangs. Nous n'aimons pas les longs discours, une nouvelle centurie qui se forge nous apparait plus importante qu'une victoire au Parlement. De temps à autre, nous organisons des fêtes, afin de laisser le pouvoir parader en rangs serrés, et pour ne pas oublier comment on fait se mouvoir les masses. Des centaines de milliers de personnes viennent d'ores et déjà participer à ses fêtes. Le jour où l'Etat parlementaire s'écroulera sous notre pression et où nous proclamerons la dictature nationale, sera notre plus beau jour de fête» (7). Mais quand un parti national a réellement pris le pouvoir et renverser le système de Weimar, Jünger s'est arrogé le droit de dire oui ou non au cas par cas, face à ce qui se déroulait en face de lui.
En 1982, Jünger répond à une question qui lui demandait ce qu'il reprochait réellement à Hitler: «Son attitude résolument contraire au droit après 1938. Je suis encore pleinement d'accord avec Hitler pour sa politique dans les Sudètes et pour son Anschluß de l'Autriche. Mais j'ai reconnu bien vite le caractère de Hitler...» (8). Le souci de Jünger était le salut du Reich et non pas le sort d'une personne. Un an après l'effondrement du national-socialisme, il écrit: «... Peu d'hommes dans les temps modernes n'ont suscité autant d'enthousiasme auprès des masses, mais aussi autant de haine que lui. Quand j'ai entendu la nouvelle de son suicide, un poids m'est tombé du cœur; parfois j'ai craint qu'il ne soit exposé dans une cage dans une grande ville étrangère. Cela, au moins, il nous l'a épargné» (9).
2. Le «nouveau nationalisme»
Favorisé par ses hautes décorations militaires, gagnées lors de la première guerre mondiale, ainsi que par la notoriété de ses livres de guerre, Jünger est devenu la figure sympbolique du «nouveau nationalisme». Autour de ce concept, se sont rassemblés entre 1926 et 1931 quelques revues, dans lesquelles Jünger non seulement écrit de nombreux articles, mais dont il est le co-éditeur. Ces revues s'appellent Standarte, Arminius, Der Vormarsch et Die Kommenden. Les autres éditeurs étaient Franz Schauwecker, Helmut Franke, Wilhelm Weiss, Werner Lass, Karl O. Paetel, etc. Parmi les autres auteurs de ces publications, citons, par exemple, Ernst von Salomon, Friedrich Hielscher, Friedrich Wilhelm Heinz, Hanns Johst, Joseph Goebbels, Konstantin Hierl, Ernst von Reventlow, Alfred Rosenberg et Werner Best. Au cours de ces dernières années de la République de Weimar, il est typique de noter que ces “Rebelles”, situés entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche, se sont rencontrés en permanence avec des “Communards” officiels ou oppositionnels, ou avec des nationaux-socialistes fidèles ou hostiles au parti. Parmi ces cercles obscurs de débats, il y avait la «Gesellschaft zum Studium der russischen Planwirtschaft» (= Société pour l'étude de l'économie planifiée russe). On espérait là surtout apprendre l'opinion d'Ernst Jünger.
 Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt. On s'étonne aujourd'hui de constater comme étaient variés et différents les caractères et les types humains de ces idéologues du «nouveau nationalisme». Tous étaient unis par un sentiment existentiel, celui du “réalisme héroïque”, terme qu'a utilisé maintes fois Ernst Jünger pour définir l'attitude fondamentale de sa vision du monde (10). De fait, une telle attitude se retrouve chez la plupart des théoriciens de cette époque, y compris, par exemple, chez un Oswald Spengler (Preußentum und Sozialismus, Der Neubau des Deutschen Reiches), Arthur Moeller van den Bruck (Das Dritte Reich) et Edgar Julius Jung (Die Herrschaft der Minderwertigen).
Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt. On s'étonne aujourd'hui de constater comme étaient variés et différents les caractères et les types humains de ces idéologues du «nouveau nationalisme». Tous étaient unis par un sentiment existentiel, celui du “réalisme héroïque”, terme qu'a utilisé maintes fois Ernst Jünger pour définir l'attitude fondamentale de sa vision du monde (10). De fait, une telle attitude se retrouve chez la plupart des théoriciens de cette époque, y compris, par exemple, chez un Oswald Spengler (Preußentum und Sozialismus, Der Neubau des Deutschen Reiches), Arthur Moeller van den Bruck (Das Dritte Reich) et Edgar Julius Jung (Die Herrschaft der Minderwertigen).
Jünger voulait se joindre à cette phalange olympienne en publiant à son tour une sorte d'“ouvrage standard”. Dans la publicité d'un éditeur, on découvre l'annonce d'un livre de Jünger qui se serait intitulé Die Grundlage des Nationalismus, mais qui n'est jamais paru. Si le livre avait été imprimé, il serait aujourd'hui sans nul doute la source par excellence. L'ouvrage aurait aussi dû comporter un essai intitulé «Nationalismus und Nationalsozialismus», qui n'est paru qu'en 1927 dans la revue Arminius. Le comble dans cet essai, c'est la proposition de faire du national-socialisme un instrument de l'action politique pratique («dans le mouvement de Hitler se trouve plus de feu et de sang que la soi-disant révolution a été capable de susciter au cours de toutes ses années»), et de faire du nationalisme, que Jünger réclamait pour lui, le laboratoire idéologique. Dès 1925, Jünger exhortait dans son appel «Schließt euch zusammen!» (Resserrez les rangs!), les groupes rivaux à former un «Front nationaliste final» (11). Mais ce front n'a jamais vu le jour, «l'appel est resté sans écho, s'est évanoui dans les discours mesquins des secrétaires d'association qui voulaient absolument avoir le dernier mot» (Karl O. Paetel).
Au fur et à mesure que son aversion contre la démocratie grandissait, son refus de Hitler augmentait aussi. Tandis que ces hérétiques développaient entre eux un grand nombre de «thèses spéciales sur le nationalisme», tant et si bien qu'aucune unité réelle ne pouvait émerger, la NSDAP de Hitler courait de victoire électorale en victoire électorale. En formulant et en fignolant leurs spéculations, beaucoup d'intellectuels du «nouveau nationalisme» avaient vraiment perdu le contact avec les réalités. Ernst von Salomon décrit les faiblesses du nationalisme théorique de façon fort colorée dans son Questionnaire: «... On n'insistera jamais assez pour dire que les émotions intellectuelles de ces hommes combattifs appartenant au “nouveau nationalisme” se sont évanouies en silence. Outre le nombre ridiculement faible d'abonnés à ces quelques revues, personne ne les remarquait, et nous atteignions un degré élevé d'excitation, quand, par hasard, un grand quotidien de la capitale, évoquait en quelques lignes l'une ou l'autre production de l'un d'entre nous» (12).
3. Le Dr. Goebbels
Les rapports entre Jünger et le Dr. Joseph Goebbels méritent un chapitre particulier. Les deux hommes se rencontraient à l'occasion dans les sociétés berlinoises patronnées par Arnolt Bronnen ou dans des soirées privées entre nationaux-révolutionnaires. Dans la plupart des cas, ils s'échangeaient des coups de bec ou des boutades cyniques. Jünger fit comprendre à Goebbels qu'il préférait de loin le type du «soldat-travailleur prusso-allemand» que celui du «petit bourgeois en chemise brune» qui proliférait dans les rangs de la NSDAP et des SA. Plusieurs décennies plus tard, Jünger se souvient: «... Goebbels m'invita. Notamment en 1932 à assister à l'un de ses discours, devant des travailleurs à Spandau. Je n'ai pas attendu la fin de son discours, je suis sorti avant, et j'ai appris plus tard qu'il y avait eu une formidable bagarre dans la salle. Goebbels était déçu: nous avons donné à cet Ernst Jünger une place d'honneur, mais quand ça a commencé à chauffer et que les chaises ont volé, il n'était plus là. Goebbels oubliait intentionnellement de dire que j'avais vécu de toutes autres batailles que cette bagarre de salle» (13).
Dans ces journaux, Goebbels fait souvent part de sa déception à l'égard de Jünger, qu'il aurait bien voulu voir adhérer à la NSDAP. Le 20 janvier 1926, le futur ministre de la propagande écrivait: «... Je viens de terminer hier la lecture des Orages d'acier d'Ernst Jünger. C'est un grand livre, brillant. La puissance de son réalisme suscite en nous de l'épouvante. De l'allant. De la passion nationale. De l'élan. C'est le livre allemand de la guerre. C'est un homme de la jeune génération qui prend la parole pour nous parler de la guerre, événement profond pour l'âme, et qui réalise un miracle en nous décrivant ce qui se passe dans son intériorité. Un grand livre. Derrière lui, un gaillard entier». Cinq mois plus tard, on perçoit déjà une déception: «... me suis préoccupé du “nouveau nationalisme” des Jünger, Schauwecker, Franke, etc. On parle et on passe à côté des vrais problèmes. Et il y manque la chose la plus importante, en dernière instance: la reconnaissance de la mission du prolétariat» (Goebbels, Journaux, 30 juin 1926).
Trois ans plus tard, Goebbels rejette définitivement Jünger: «... Mes lectures: Das abenteuerliche Herz de Jünger. Ce n'est plus que de la littérature. Dommage pour ce Jünger, dont je viens de relire les Orages d'acier. Ce livre était vraiment une grand livre, un livre héroïque. Parce que derrière lui, il y avait un vécu de sang, un vécu total. Aujourd'hui, Jünger s'enferme et se refuse à la vie, et ses écrits ne sont plus qu'encre, que littérature» (Goebbels, Journaux, 7 octobre 1929). Ce règlement de compte durera jusqu'à l'effondrement du Troisième Reich, quand, en dernière instance, Goebbels interdit à la presse allemande, de faire mention du cinquantième anniversaire de Jünger.
4. Le retrait
Hans-Peter Schwarz écrit dans son livre consacré à Jünger, Der Konservative Anarchist: «... Un phénomène qui mérite réflexion: dans les années 1925-1929, quand aucun observateur objectif n'aurait donné la moindre chance au nationalisme révolutionnaire en Allemagne, Jünger a joué le héraut de cette idée, mais quand, coup de sort fatidique, un Etat nationaliste, socialiste, autoritaire et capable de se défendre, a commencé à s'imposer, avec une évidence effrayante, ses intérêts pour les activités concrètes diminuent à vue d'oeil. En effet, après les élections de septembre 1930, il n'y avait plus qu'un seul mouvement politique qui pouvait revendiquer le succès et prétendre réaliser cette vision de l'Etat: la NSDAP d'Adolf Hitler» (14).
Le retrait de Jünger hors de la politique n'était pas dû immédiatement à la montée en puissance de la NSDAP. Plusieurs facteurs ont joué leur rôle. Parmi eux, le résultat de ses études sur le fascisme italien. Le fascisme n'aurait, à ses yeux, plus rien été d'autre «qu'une phase tardive du libéralisme, un procédé simplifié et raccourci, simultanément une sténographie brutale de la conception de l'Etat des libéraux, qui, pour le goût moderne, est devenue trop hypocrite, trop verbeuse et surtout trop compliquée. Le fascisme tout comme le bolchévisme ne sont pas faits pour l'Allemagne: ils nous attirent, nous séduisent, sans pourtant pouvoir nous satisfaire, et on doit espérer pour notre pays qu'il soit capable de générer une solution plus rigoureuse» (15). Jünger a-t-il deviné cette évolution pour le Reich?
Avec l'installation de Jünger à Berlin, commence son retrait. Depuis lors, il n'a plus cessé de se donner le rôle d'un observateur à distance. Dès le déclin des revues Vormarsch et Die Kommenden dans les années 1929 et 1930, il abandonne très ostensiblement la rédaction d'articles politiques. En se rémémorant cette tranche de sa vie, il a commenté le travail éditorial comme suit: «Les revues sont comme des autobus, on les utilise, tant qu'on en a besoin, et puis on en sort». Et: «On ne peut plus se soucier de l'Allemagne en société aujourd'hui; il faut le faire dans la solitude, comme un homme qui ouvrirait des brèches à l'aide d'un couteau dans la forêt vierge et qui n'est plus porté que par un espoir: que d'autres, quelque part sous les frondaisons, procèdent au même travail» (16). Jünger avait perçu que ses activités de politique quotidienne n'avaient plus de sens; il se consacrait de plus en plus à ses livres. Des ouvrages tels Das abenteuerliche Herz, Der Arbeiter et Die totale Mobilmachung (dont on n'a malheureusement retenu qu'un slogan) l'ont rendu célèbre en dehors des cercles étroits qui s'intéressaient à la politique.
Autre motif justifiant sans doute le retrait de Jünger: son amitié avec le national-bolchévique Ernst Niekisch, dont la revue, Widerstand, avait publié quelques articles de Jünger. Niekisch était un solitaire de la politique, fantasque et excentrique, mis sur la touche par l'Etat national-socialiste, pour des raisons de sécurité intérieure (sans avec raison, du point de vue des nouvelles autorités). Dans un article intitulé «Entscheidung» (= Décision), Niekisch plaide très sérieusement pour «l'injection de sang slave dans les veines allemandes, afin de guérir la germanité des influences romanes venues d'Europe du Sud et de l'Ouest». Ou: «... Celui qui vit conscient de sa responsabilité pour le millénaire d'histoire et de destin allemands à venir, ne s'effondre pas, effrayé, devant les remous d'une migration des peuples, s'il n'y a pas d'autre voie pour nous conduire à une nouvelle grandeur allemande» (17). Cette idée bizarre ne nécessite pas de commentaires de ma part. Mais Jünger n'était sans doute pas attiré par l'orientation à l'Est, prônée par Niekisch, ou par son anti-capitalisme lapidaire; ce qui l'attirait secrètement chez cet homme inclassable, c'est l'opiniâtreté avec laquelle il défendait la «pureté de l'idée».
Comme s'il voulait clarifier les choses pour lui-même, Jünger, dans Les Falaises de marbre (qui contiennent des traits auto-biographiques incontestables), nous expliquer pourquoi il a été travaillé par un désir de participer à la politique active: «Il y a des époques de déclin, pendant lesquelles la forme s'estompe, la forme qui est un indice très profond, très intériorisé, de la vie. Lorsque nous nous enfonçons dans ses phases de déclin, nous errons dans tous les sens, titubants, comme des êtres à qui manque l'équilibre... Nous voguons en imagination dans des temps reculés ou dans des utopies lointaines, où l'instant s'estompe... C'est comme si nous sentions la nostalgie d'une présence, d'une réalité et comme si nous avions pénétré dans la glace, le feu et l'éther, pour échapper à l'ennui».
5. La «zone des balles dans la nuque»
La rupture définitive entre les nationaux-socialistes et Jünger a eu lieu après la parution de Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt (1932). Dans bon nombre d'écrits nationaux-socialistes, ce livre a été critiqué avec une sévérité inouïe; il se serait agi d'un «bolchévisme crasse». Thilo von Trotha écrivit dans le Völkischer Beobachter: «... Eh oui! Les voilà, les interminables parlottes de la dialectique! On joue pendant trois cents pages avec tous les concepts possibles et imaginables, on les répète indéfiniment, on accumule autant de contradictions et, à la fin, il ne reste, surtout pour notre jeune génération, qu'une énigme insaisissable: comment un soldat du front comme Ernst Jünger a-t-il pu devenir cet homme qui, sirotant son thé et fumant ses cigarettes, acquiert une ressemblance désespérante avec ces intellectuels russes de Dostoïevski qui, pendant des nuits entières, discutent et ressassent les problèmes fondamentaux de notre monde». Thilo von Trotha ajoute, que Jünger ne voit pas «la question fondamentale de toute existence, ..., le problème du sang et du sol». En Jünger, pense von Trotha, s'accomplit la tragédie d'une homme «qui a perdu la voie vers les fondements promordiaux de tout Etre». Conclusion de von Trotha: ce n'est pas l'ère du Travailleur qui est en train d'émerger, mais l'ère de la race et des peuples.
Pourtant, malgré cette critique sévère et violente, von Trotha affirme que Jünger reste «un des meilleurs guerriers de sa génération», mais c'est pour ne pas lui pardonner son attitude fondamentalement individualiste: «... [les littérateurs nationaux-révolutionnaire, note de W.B.] passent leur existence à côté du grand courant de la vie allemande, marqué par le sang; ils cherchent toujours des adeptes mais restent condamnés à la solitude, à demeurer face à eux-mêmes et à leurs constructions, dans leur tour d'ivoire... et on observera sans cesse et avec étonnement qu'ils continuent à vouloir représenter la jeunesse allemande, en méconnaissant les faits réels, de façon tout-à-fait incompréhensible. L'“élite spirituelle” de la jeunesse allemande n'est pas littéraire, elle suit fidèlement le véritable Travailleur et le véritable Paysan: Adolf Hitler» (18). La critique atteint son sommet dans une formulation pleine de fantaisie: Jünger se rapprocherait, avec son ouvrage, de la «zone des balles dans la nuque». Dans la conclusion d'un article d'Angriff, un journal animé par Goebbels, on trouve une phrase plus concrète et plus mesurée, mais néanmoins exterminatrice: «Monsieur Jünger, avec cet ouvrage, est fini pour nous».
Ces critiques émanent pourtant des nationaux-socialistes les plus intelligents; mais elles ne tombaient du ciel, par hasard. Elles reflètent un constat politique posé dorénavant pas les autorités du parti: les nationaux-révolutionnaires sont rétifs à toute discipline de parti et veulent mener une vie privée opposée aux critères édictés par les nationaux-socialistes. Friedrich Hielscher dans son livre autobiographique Fünfzig Jahre unter Deutschen (= «Cinquante ans parmi les Allemands») évoque quelques anecdotes de l'époque. Nous y apprenons que la vie privée de nombreux “nationaux-révolutionnaires” ne respectait aucun dogme ni aucune rigueur comportementale. Ainsi, au cœur de l'hiver très froid de 1929, cette joyeuse bande s'était réunie dans l'appartement de Jünger à Berlin. Aux petites heures, ils buvaient tous du rhum dans des tasses de thé et voilà que le poêle vient à s'éteindre faute de bois. Jünger, sans hésiter, casse à coups de pied une vieille commode de son propre mobilier, la démonte et en empile les morceaux près du feu, permettant ainsi à la compagnie de gagner encore un peu de chaleur et de confort» (19).
6. Dans le Royaume de Léviathan
A cette époque, les critiques des nationaux-socialistes ne touchaient plus Jünger. Il s'était bien trop éloigné de la politique quotidienne. La “révolution nationale” de janvier 1933 ne lui avait fait aucun effet. La réalité du IIIième Reich n'était pour lui que les ultimes soubresauts du monde bourgeois, n'était qu'une “démocratie plébiscitaire», dernière conséquence néfaste des «ordres nés de 1789» (20). Pour pouvoir poursuivre son travail dans l'isolement, il quitte Berlin et s'installe à Goslar. Avant ce départ, le nouvel Etat ne put s'empêcher de commettre quelques perquisitions chez la famille Jünger.
Sur l'une de ces perquisitions, un écho est passé dans la presse de l'époque; dans les Danziger Neuesten Nachrichten du 12 avril 1933, on peut lire: «Comme on l'a appris par la suite, sur base d'une dénonciation, il a été procédé à une perquisition au domicile de l'écrivain nationaliste Ernst Jünger, qui a gagné au feu, en tant qu'officier, l'Ordre Pour le Mérite pendant la guerre mondiale, qui a écrit plusieurs livres sur cette guerre, parmi lesquels un ouvrage de grand succès, Orages d'acier, et qui, dans son dernier livre de sociologie et de philosophie, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, se réclame d'idées collectivistes. La perquisition n'a pas permis de découvrir objets ou papiers compromettants». La dernière livraison de la revue Sozialistische Nation n'épargnait pas ses sarcasmes: «... On n'a rien trouvé, si ce n'est l'Ordre Pour le Mérite». Jünger ne laissa planer aucun doute: il fit savoir clairement qu'il n'entendait participer d'aucune façon aux activités culturelles du Troisième Reich, comme auparavant à celles de la République de Weimar. Ses lettres de refus à l'Académie des Ecrivains de Prusse sont devenues célèbres, de même que sa réponse brève et sèche à la Radio publique de Leipzig, qui l'avait invité pour une émission. Il souhaitait tout simplement «ne pas participer à tout cela». Le 14 juin 1934, il écrit à la rédaction du Völkischer Beobachter: «Dans le supplément “Junge Mannschaft” du Völkischer Beobachter des 6 et 7 mai 1934, j'ai constaté que vous aviez reproduit un extrait de mon livre Das abenteuerliche Herz. Comme cette reproduction ne comporte aucune mention des sources, on acquiert l'impression que j'appartiens à votre rédaction en tant que collaborateur. Ce n'est pas le cas: depuis des années je n'utilise plus la presse comme moyen [d'expression]. Dans ce cas particulier, il convient encore de souligner que nous sommes face à une incongruité: d'une part, la presse officielle m'accorde le rôle d'un collaborateur attitré, tandis que, d'autre part, on interdit par communiqué de presse officiel la reproduction de ma lettre à l'Académie des Ecrivains du 18 novembre 1933. Je ne vise nullement à être cité le plus souvent possible dans la presse, mais je tiens plutôt à ce qu'il ne subsiste pas la moindre ambigüité quant à la nature de mes convictions politiques. Avec l'expression de mes sentiments choisis, Ernst Jünger».
Fait significatif: de 1933 à 1945, Ernst Jünger n'a pas reçu la moindre distinction honorifique ou bénéficié du moindre hommage officiel. «... Ne trouvez-vous pas curieux que je n'ai pas obtenu le moindre prix sous le IIIième Reich, alors qu'on prétend que j'aurais été si précieux pour les nazis. Si tel avait été le cas, j'aurais été couvert de prix et de distinctions», remarque Jünger près de soixante ans après les événements.
La vie de Jünger fut relativement paisible de 1934 à la guerre. Nous lui devons plusieurs livres immortels, datant de cette période, pendant laquelle il a consolidé son constat: le national-socialisme a sa phase héroïque derrière lui. Sans retour. Qu'en restait-il? Sa prédilection pour les structures hiérarchiques, clairement délimitées. En 1982, Jünger reconnaissait: «Certes, j'ai un faible pour les systèmes d'ordre, pour l'Ordre des Jésuites, pour l'armée prussienne, pour la Cour de Louis XIV... De tels ordres m'en imposent» (22).
Ernst Jünger est resté fidèle à lui-même pendant toute son existence. C'est ainsi que Karl O. Paetel, jadis militant “nationaliste social-révolutionnaire”, dans une excellent biographie consacrée à son ami immédiatement après la dernière guerre, répond aux critiques de façon définitive, pour les siècles des siècles: «Le guerrier est-il devenu pacifiste? L'admirateur de la technique, un ennemi du progrès technique? Le nihiliste, un chrétien? Le nationaliste, un bourgeois cosmopolite? Oui et non: Ernst Jünger est devenu dans une certaine mesure le deuxième homme sans jamais cesser d'être le premier. A aucune étape dans le cheminement de son existence, Ernst Jünger ne s'est converti, jamais il n'a brûlé ce qu'il adorait hier. Les transformations ne sont pas rejets chez lui, mais fruits d'acquisitions, d'élargissements d'horizons, de complètements; il ne s'agit jamais de se retourner, mais de poursuivre le même chemin en mûrissant, sans se fixer dans les aires de repos. C'est ainsi que Ernst Jünger a trouvé son identité, est devenu le diagnostiqueur de notre temps, éloigné de tout dogme dans son questionnement comme dans les réponses qu'il suggère».
Werner BRÄUNINGER.
Notes:
(1) Ernst JÜNGER, «Reinheit der Mittel», in Die Kommenden, 27 déc. 1929.
(2) Ernst JÜNGER, Strahlungen. Die Hütte im Weinberg. Jahre der Okkupation, p. 615 (éd. DTV, 1985).
(3) Ernst JÜNGER, «Abgrenzung und Verbindung», in Standarte, 13 sept. 1925.
(4) (5) (6) Voir remarque 2, p. 612, 617 et 444 (Jünger cite ici un mot de Valeriu Marcu).
(7) Ernst JÜNGER, «Der Frontsoldat und die innere Politik», in Standarte, 29 nov. 1925.
(8) Ernst JÜNGER, Interview accordé à Der Spiegel, n°33/1982.
(9) Voir rem. 2, p. 616.
(10) La formule «réalisme héroïque» provient de l'article «Der Krieg und das Recht» du Dr. Werner Best (publié dans le volume collectif Krieg und Krieger, édité par Ernst Jünger à Berlin en 1930). Quant à savoir si cette formule, utilisée par Jünger, provient originellement de Best, rien n'est sûr à 100%.
(11) Ernst JÜNGER, «Schließt Euch zusammen», in Die Standarte, 3 juin 1926.
(12) Ernst von SALOMON, Der Fragebogen, p. 244 (7), 1952.
(13) voir rem. 8.
(14) Hans-Peter SCHWARZ, Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers, Verlag Rombach, 1982, p. 107.
(15) Ernst JÜNGER, «Über Nationalismus und Judenfrage», Süddeutsche Monatshefte, 27, n°12, 1930.
(16) Ernst JÜNGER, Das abenteuerliche Herz.
(17) Ernst NIEKISCH, Entscheidung, p. 180 ss.
(18) Ex Völkischer Beobachter (édition bavaroise), 22 oct. 1932.
(19) Description de mémoire de Werner Bräuninger, ex: Friedrich HIELSCHER, Fünfzig Jahre unter Deutsche, Rowohlt Verlag, 1950.
(20) Ernst JÜNGER, Strahlungen. Kirchhorster Blätter, p. 298 (DTV n°10.985).
(21) (22) Voir rem. 8.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, années 20, années 30, histoire, nationalisme révolutionnaire, national-socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 décembre 2009
Gildensozialismus
 Gildensozialismus
Gildensozialismus
Aus:
Harry Graf Kessler Aufsätze und Reden 1899-1933Gildensozialismus
(1920)
Bolschewismus und »Spartakismus« nehmen vor der Öffentlichkeit soviel Raum ein, daß die Entwicklung einer anderen, tief bedeutsamen Richtung innerhalb des Sozialismus ziemlich unbemerkt erfolgt ist. Diese neue Richtung macht sich seit kurzem in mannigfaltigen Formulierungen fast gleichzeitig in Deutschland, Österreich und England bemerkbar. Ihre Geschichte weist zurück auf den französischen Syndikalismus der ersten Jahre des Zwanzigsten Jahrhunderts, der – von Georges Sorel und seinem Intellektuellenkreis formuliert – die bis dahin bei der radikalen französischen Arbeiterschaft herrschende staatssozialistische Doktrin revolutionierte. Jener staatssozialistischen Idee setzte nämlich Sorel ein Programm entgegen, das als Ziel die Selbstherrlichkeit des einzelnen Betriebes oder wenigstens Produktionszweiges und die unbeschränkte Herrschaft seiner Arbeiter über seine Produktionsmittel und Produkte forderte und als wirksamstes Mittel zu diesem Ziele nicht erst die Eroberung der Staatsgewalt, sondern die direkte Besitzergreifung aller Produktionsmittel durch die Arbeiter mithilfe des Generalstreiks proklamierte. Aus diesem Ideenvorrat holte oder schuf sich die erste russische Revolution (1905) den Rätegedanken. Gleichzeitig begann aber auch schon der Syndikalismus den von ihm heftig bekämpften Marxismus zu befruchten. Und diese Kreuzung war der Ausgangspunkt der jetzt hervortretenden neuen Anschauungen.
Für ihre Verbreitung in Deutschland und Österreich muß es hier genügen, auf Otto Bauers ›Weg zum Sozialismus‹ und auf sein neues, glänzendes, in der ›Vossischen Zeitung‹ bereits ausführlich gewürdigtes Buch ›Bolschewismus oder Sozialdemokratie‹ hinzuweisen, ferner auf Hilferdings ›Mehrheitsbericht‹ der deutschen Kohlensozialisierungskommission sowie auf mannigfache Vorschläge von Walther Rathenau, Georg Bernhard und anderen für eine planmäßige Selbstverwaltung der Produktion. Diese Vorstellungen und Vorschläge nähern sich, von einer andern Seite, der sozialistischen Grundanschauung der ›Sozialistischen Monatshefte‹ und dem daraus folgenden Postulat eines Aufbaus der Gemeinschaftsproduktion, wie es auf dem zweiten Rätekongreß in Berlin von Julius Kallski und Max Cohen vertreten wurde.
In England, wo der französische Syndikalismus durch die Agitation des fanatischen und hochbegabten Arbeiterführers Tom Mann einen stürmischen, aber kurzlebigen Erfolg errang, gab den Anstoß zum sogenannten »Gildensozialismus«, in dem dort sich die neuen Anschauungen verkörpert haben, das 1906 erschienene Buch von Arthur J. Penty: ›The Restoration of the Gild System‹. Die eigentliche Theorie entwickelten in den nächsten Jahren die Schriftsteller A. R. Orage und S. B. Hodson in ihrer Zeitschrift ›The New Age‹ in einer Aufsatzreihe, die sie dann als Buch: ›National Guilds‹ herausgaben. Zu Einfluß gelangte die ganze Bewegung aber erst im Kriege, als die Notwendigkeit sich ergab, neue organisatorische Lösungen vorzubereiten für den Abbau der Kriegswirtschaft und für den Aufbau einer neuen Friedenswirtschaft. Ostern 1915 war als Propagandazentrum die ›National Guilds League‹ in London gegründet worden, und das allgemeine Bedürfnis nach neuen Organisationsformen der Wirtschaft bahnte ihren Ideen schnell einen Weg in die Arbeiterbewegung. Vor allem waren es gewisse einflußreiche Arbeiterführer, die das neue Programm in die Arbeiterschaft einzelner großer Produktionszweige hineintrugen. So schloß sich zum Beispiel der Generalsekretär der Bergarbeiterföderation Großbritanniens, Frank H. Hodges, der ›National Guilds League‹ an und begründete die 1918 vom Bergarbeiterkongreß der Regierung präsentierte Vorlage für die Sozialisierung des englischen Kohlenbergbaus auf dem Gilden-Gedanken. Auch der Vertreter dieser Vorlage vor dem Regierungsausschuß, der rasch zu großem Ansehen gelangte Arbeiter Straker, gehört zur ›National Guilds League‹. Noch bedeutsamer war der Anschluß der Eisenbahner, die ebenfalls ihr Sozialisierungsprogramm auf dem Gilden-Gedanken aufbauten; denn dieses übernahmen alsbald auch die amerikanischen und französischen Eisenbahner, so daß auch dort bereits eine gewaltige Bewegung den gleichen Zielen wie der Gildensozialismus nachstrebt. Die großen Eisenbahnerstreiks in diesem Jahre drüben und hüben bezweckten die Verwirklichung gerade von gildensozialistischen Forderungen.
Was ist nun das Neue und Positive am »Gilden-Sozialismus«? Zunächst ein großes Mißtrauen gegen den Staat und gegen jede Form des Staatssozialismus. Ein Mißtrauen, das im englischen Gildensozialismus vor allen Dingen wächst aus seinem Haß gegen jede Art von Despotismus. Dieses scheidet auch grundsätzlich den Gildensozialismus vom Bolschewismus. Der Pol, um den sich alle Gedanken der Gildensozialisten drehen, ist der der Freiheit, der zweckmäßigen Sicherung möglichst vollständiger politischer, wirtschaftlicher und kultureller Selbstbestimmung. Auf die Frage, was das Grundübel der modernen Gesellschaft ist, antwortet einer der bedeutendsten gildensozialistischen Schriftsteller, G. D. H. Cole, in seinem Buche ›Self Government in Industry‹ (London 1917): nicht die Armut weiter Schichten, sondern die Versklavung weiter Schichten. Der Arbeiter klagt die heutige Gesellschaft mit Recht an, nicht weil er arm, sondern weil er unfrei ist. »Die Massen sind nicht Sklaven, weil sie arm sind, sondern arm, weil sie Sklaven sind.« Das Problem ist nicht, dem Arbeiter mehr Lohn oder mehr Lebensannehmlichkeiten (etwa auf dem Wege patriarchaler Fürsorge) zu schaffen, sondern ihn zu einem freien Mann zu machen! Das Gegenteil der »gottgewollten Abhängigkeit« muß die Norm werden.
Aber außerdem verbindet er die Idee der Freiheit mit einer von Genossenschaftstheoretikern wie Gierke und dem Staatsrechtslehrer der Universität Bordeaux, Léon Duguit, übernommenen genossenschaftlichen Auffassung vom Aufbau der Gesellschaft und des Staates. Die Gesellschaft und der Staat sind danach nicht bloß ein Sammelsurium von geographisch durch die Landesgrenzen zusammengehaltenen Individuen, sondern ein kunstvolles Ineinanderarbeiten von tätigen genossenschaftlichen Gruppen. Der einzelne Mensch kann gleichzeitig einer ganzen Reihe verschiedener Gruppen (mehreren geographischen, mehreren beruflichen) angehören. Aber jede Gruppe ist trotzdem in sich geschlossen und von einem eigenen, spezifischen Leben erfüllt durch den Zweck, dem sie dient: durch die Funktion, die sie in der Gesellschaft ausübt. Nicht vom Staate, überhaupt nicht durch irgendwelche Verleihung oder »Delegation«, sondern aus sich selbst, aus ihrer Funktion, bekommt die Gruppe nicht bloß ihre Existenz, sondern auch ihr Recht, jedes ihr überhaupt zustehende Recht. Und zu diesen Rechten gehört auch für sie, ebenso wie für den einzelnen Menschen, die Freiheit, d. h. die Selbstbestimmung innerhalb der Grenzen ihrer Funktion. Die umwälzende staatsrechtliche und soziale Bedeutung dieser Anschauungen kann hier nur angedeutet werden. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, darauf näher einzugehen. Nur ein Punkt muß noch hervorgehoben werden:
Den Rechten jeder funktionellen Gruppe steht die von diesen untrennbare Pflicht gegenüber, ihre Funktion möglichst vollkommen auszuüben, ihre funktionelle Energie auf das höchste zu steigern und daher allen Fähigkeiten innerhalb der Gruppe den Weg zu öffnen, damit sie ungeschmälert im Sinne der Funktion, der die Gruppe dient, wirken können. Auf dem Umwege über den Begriff der Funktion gelangt daher diese Anschauung zu einer neuen und erweiterten Begründung der menschlichen Freiheit: der Mensch muß frei sein, nicht bloß ganz allgemein als Individuum, als »Zeitgenosse« und gleiches unter gleichen Individuen, weil die Freiheit eine metaphysische oder ethische oder sentimentale Forderung ist; sondern er muß frei sein auch ganz besonders als tätiges Individuum, als spezifisches und ungleiches unter ungleichen Individuen, als Mitträger einer Funktion, als Glied einer innerhalb der menschlichen Gesellschaft spezifisch wirkenden Gruppe, damit seine Kräfte unvermindert zur Stärkung der Funktion, zur Stärkung der Gruppe bei ihrem funktionellen Wirken beitragen. Es ergibt sich ein Begriff der Demokratie, der, weit über das Politische hinausgreifend, alle Gebiete des menschlichen Lebens erfaßt und mit der Zeit verwandeln muß: der Begriff einer die einseitige, bloß politische Demokratie ergänzenden, allseitigen, funktionellen Demokratie, deren Ziel sich knapp in Nietzsches kraftvoll aktivistischen Worten formulieren läßt: »Freiheit sich schaffen, zu neuem Schaffen.«
Der Stellung des Arbeiters im modernen Unternehmen, dem Begriff der Lohnarbeit überhaupt widersprechen diese Forderungen, wie man sieht, von Grund auf. Denn der Arbeiter wird nicht mit allen seinen Kräften, als ganze Persönlichkeit, zur Produktion herangezogen, sondern nur als Lieferant einer Ware, seiner Ware »Arbeit«, die ihm der Unternehmer abkauft.
Und ebenso widersprechen jene Forderungen der Einstellung eines Produktionsprozesses auf den privaten Profit. Denn seine Rechte beruhen nach jener Theorie ausschließlich auf seiner öffentlichen Funktion (nicht auf dem Eigentum des Unternehmers). Seine Einstellung auf den größten privaten Profit statt auf den größten öffentlichen Nutzen und Bedarf ist daher eine Rechtsbeugung.
In beiden Punkten, in dem der Lohnarbeit und dem des privaten Profits, verlangt der Gildensozialismus einen radikalen Umschwung und bietet dafür jene Lösungen, die seine Eigenart ausmachen.
Die Lohnarbeit soll verschwinden dadurch, daß die Verwaltung der Unternehmungen den privaten Kapitalisten entzogen und auf die Gewerkschaften (Trade Unions) übertragen wird. Die Gildensozialisten weisen darauf hin, daß schon heute die Leiter, die technischen und kaufmännischen Direktoren, Aufsichtsratmitglieder usw. der großen Unternehmungen zum großen Teil nicht mehr mit eigenem Kapital arbeiten, sondern bloß Angestellte von Kapitalisten sind. Nunmehr sollen sie statt dessen Angestellte einer Gewerkschaft, der organisierten Werktätigen des betreffenden Produktionszweiges werden, wobei sie selbst als Mitbeteiligte am Produktionsprozeß ihre Stellung innerhalb der Gewerkschaft fänden. Jeder Produktionszweig der englischen Volkswirtschaft würde also eine von seinen sämtlichen organisierten Arbeitern und Angestellten verwaltete ›Nationale Gilde‹, die ganze englische Produktion eine planmäßige Maschine aus lauter selbstverwaltenden nationalen oder nationalföderierten Gilden, deren Mittelstück ein alle einzelnen Gilden zusammenfassender nationaler ›Gildenkongreß‹ zu sein hätte.
Damit wäre in der Tat die Lohnarbeit abgeschafft. Nicht aber ohne weiteres die Einstellung der Produktion auf den Profit. Denn ein selbstverwaltender Produktionszweig könnte ebenso für die in ihm organisierten Werktätigen wie ein kapitalistisches Unternehmen für seine Aktionäre sorgen und ebenfalls bloß auf deren Profit statt auf den gesellschaftlichen Nutzen und Bedarf sehen. Wer letzten Endes bestimmen soll, was und zu welchem Preise produziert wird, bleibt also problematisch. Auch sind sich in dieser Hinsicht die Gildensozialisten selbst noch nicht einig. Aber die Kämpfe, die um diese Frage in ihren Reihen vor sich gehen, sind gerade deshalb lehrreich. Und eine gewisse Klärung scheint sich anzubahnen. Ursprünglich beeinflußt von der staatssozialistischen, besonders durch den Altmeister des englischen Sozialismus, Sidney Webb, vertretenen Anschauung, daß der Staat, d.h. das Parlament der natürliche Vertreter der Konsumenten sei und als solcher das letzte Wort haben müsse, sind jetzt die Gildensozialisten, durch die Kriegswirtschaft abgeschreckt, eher geneigt, den Staat auch bei diesen Fragen zurückzudrängen. Die Sozialisierungsvorlage der englischen Bergarbeiter (1919) überträgt das Bergwerkseigentum nicht auf den Staat, sondern (Art. 5 und 1) auf einen zu gleichen Teilen von der Regierung und den Bergarbeitern (der Bergarbeiterföderation von Großbritannien) ernannten zwanzigköpfigen ›Rat‹ (›Mining Council‹), in dem der Staat nur insofern einen kleinen Vorsprung hat, als der Ratspräsident von der Regierung ernannt und dem Parlamente verantwortlich ist. Die Konsumenten als solche sind nicht vertreten, d. h. eben nur durch die Regierungsmitglieder im ›Rat‹.
Aber der Glaube, daß überhaupt der Staat (d. h. das Parlament) die gegebene alleinige und genügende Vertretung der Konsumenten gegenüber den organisierten Produzenten sein könnte, ist gerade in gildensozialistischen Kreisen stark erschüttert. Cole meint jetzt, daß es eine einzige, allumfassende Vertretung aller Konsumenten, wie der Staatssozialismus sie im Parlamente sehen will, überhaupt nicht geben könne, da die Interessen der Konsumenten viel zu mannigfaltig und widerspruchsvoll seien. Er verlangt zwar, daß die Vertretungen der Konsumenten geographisch abgegrenzt werden, im Gegensatz zu den beruflich abgegrenzten Produzentenorganisationen, lehnt es aber ab, das Staatsgebiet als die einzig maßgebende, ja auch nur als die wichtigste geographische Einheit anzusehen, erkennt vielmehr die Konsumentengruppe, die ein gemeinsames Interesse an irgendeinem Produkt oder Dienste hat, als eine wirkliche, lebendige Einheit an, die nach den Grundsätzen der funktionellen Demokratie von sich aus das Recht hat, die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zusammen mit der Produzentengruppe zu regeln, und will daher je nach dem Produkt oder Dienst, dessen Art und Preis geregelt werden sollen, wechselnde Vertretungen der Konsumenten, deren geographische Basis auch verschieden groß sein kann. Also einerseits eine weitgehende Dezentralisation, so daß bei Bedürfnissen persönlicher und häuslicher Art örtliche Konsumvereine die Bestimmung hätten; bei mehr kommunalen Bedürfnissen örtliche, für das besondere Fach oder Produkt spezifische Vertretungen, die nicht etwa identisch wären mit unseren heutigen, unterschiedslos für alle Zwecke gewählten Gemeindevertretungen. Andererseits aber auch nationale und sogar internationale Zusammenfassungen der Konsumenten bei großen, gleichförmigen, nationalen oder internationalen Bedürfnissen oder Diensten. Mit diesem Ausblick, der auf das Gebiet des Völkerbundes hinübergreift, muß diese kurze, leider gar zu unvollständige Darstellung des gildensozialistischen Planes für die Organisation der Erzeugung und Verteilung enden.
Nur ein besonderer Fall soll zum Schluß noch kurz erwähnt werden, weil er die erste praktische Verwirklichung des Gildensozialismus werden könnte. Die Wohnungsnot hat im Januar dieses Jahres die Bauarbeiter von Manchester veranlaßt, ihre verschiedenen Gewerkschaften zu einem Gildenausschuß zusammenzufassen, der faktisch sämtliche Bauarbeiter der Stadt und Umgegend vertritt. Gestützt auf dieses Monopol, hat der Gildenausschuß dem Stadtrat von Manchester angeboten, sofort zweitausend Häuser zu bauen zu einem Preise, der wesentlich niedriger wäre als der von den Bauunternehmern angeforderte. Der Gildenausschuß verlangt als Gegenleistung nur Vorstreckung des nötigen Kapitals, wogegen natürlich die Stadt das Eigentum an den fertigen Häusern bekäme. Aus dem Artikel, in dem Cole (›New Republic‹ vom 3. März 1920) über diesen Plan berichtet, scheint hervorzugehen, daß seine Verwirklichung bevorstand. Man wird seine Fortschritte mit dem lebhaftesten Interesse verfolgen müssen, denn es wäre das erste Beispiel der wenn auch bloß örtlichen Selbstverwaltung eines großen und lebenswichtigen Produktionszweiges.
Quelle: http://gutenberg.spiegel.de/?
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tradition, traditionalisme, corporations, guildes, communautarisme, socialisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, sociologie, révolution conservatrice, organisation sociale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 décembre 2009
Armin Mohler: discipulo de Sorel e teorico da vida concreta
 Armin Mohler: discípulo de Sorel e teórico da vida concreta
Armin Mohler: discípulo de Sorel e teórico da vida concreta
Ex: http://europapatrianostra.wordpress.com/
O “mito”, como a “representação de uma batalha”, surge espontaneamente e exerce um efeito mobilizador sobre as massas, incute-lhes uma “fé” e torna-as capazes de actos heróicos, funda uma nova ética: essas são as pedras angulares do pensamento de Georges Sorel (1847-1922). Este teórico político, pelos seus artigos e pelos seus livros, publicados antes da primeira guerra mundial, exerceu uma influência perturbante tanto sobre os socialistas como sobre os nacionalistas.
Contudo, o seu interesse pelo mito e a sua fé numa moral ascética foram sempre – e continuam a sê-lo apesar do tempo que passa – um embaraço para a esquerda, da qual ele se declarava. Podemos ainda observar esta reticência nas obras publicadas sobre Sorel no fim dos anos 60. Enquanto algumas correntes da nova esquerda assumiram expressamente Sorel e consideravam que a sua apologia da acção directa e as suas concepções anarquizantes, que reclamavam o surgimento de pequenas comunidades de “produtores livres”, eram antecipações das suas próprias visões, a maioria dos grupos de esquerda não via em Sorel mais que um louco que se afirmava influenciado por Marx inconscientemente e que trazia à esquerda, no seu conjunto, mais dissabores que vantagens. Jean-Paul Sartre contava-se assim, evidentemente, entre os adversários de Sorel, trazendo-lhes a caução da sua notoriedade e dando, ipso facto, peso aos seus argumentos.
Quando Armin Mohler, inteiramente fora dos debates que agitavam as esquerdas, afirmou o seu grande interesse pela obra de Sorel, não foi porque via nele o “profeta dos bombistas” (Ernst Wilhelm Eschmann) nem porque acreditava, como Sorel esperara no contexto da sua época, que o proletariado detivesse uma força de regeneração, nem porque estimava que esta visão messiânica do proletariado tivesse ainda qualquer função. Para Mohler, Sorel era um exemplo sobre o qual meditar na luta contra os efeitos e os vectores da decadência. Mohler queria utilizar o “pessimismo potente” de Sorel contra um “pessimismo debilitante” disseminado nas fileiras da burguesia.
Rapidamente Mohler criticou a “concepção idílica do conservantismo”. Ao reler Sorel percebeu que é perfeitamente absurdo querer tudo “conservar” quando as situações mudaram por todo o lado. A direita intelectual não deve contentar-se em pregar simplesmente o bom-senso contra os excessos de uma certa esquerda, nem em pregar a luz aos partidários da ideologia das Luzes; não, ela deve mostrar-se capaz de forjar a sua própria ideologia, de compreender os processos de decadência que se desenvolvem no seu seio e de se desembaraçar deles, antes de abrir verdadeiramente a via a uma tradução concreta das suas posições.
Uma aversão comum aos excessos da ética da convicção
Quando Mohler esboça o seu primeiro retrato de Sorel, nas colunas da revista Criticón, em 1973, escreve sem ambiguidades que os conservadores alemães deveriam tomar esse francês fora do comum como modelo para organizar a resistência contra a “desorganização pelo idealismo”. Mohler partilhava a aversão de Sorel contra os excessos da ética da convicção. Vimo-la exercer a sua devastação na França de 1890 a 1910, com o triunfo dos dreyfusards e a incompreensão dos Radicais pelos verdadeiros fundamentos da Cidade e do Bem Comum, vimo-la também no final dos anos 60 na República Federal, depois da grande febre “emancipadora”, combinada com a vontade de jogar abaixo todo o continuum histórico, criminalizando sistematicamente o passado alemão, tudo taras que tocaram igualmente o “centro” do tabuleiro político.
Para além destas necessidades do momento, Mohler tinha outras razões, mais essenciais, para redescobrir Sorel. O anti-liberalismo e o decisionismo de Sorel haviam impressionado Mohler, mais ainda do que a ausência de clareza que recriminamos no pensamento soreliano. Mohler pensava, ao contrário, que esta ausência de clareza era o reflexo exacto das próprias coisas, reflexo que nunca é conseguido quando usamos uma linguagem demasiado descritiva e demasiado analítica. Sobretudo “quando se trata de entender elementos ou acontecimentos muito divergentes uns dos outros ou de captar correntes contrárias, subterrâneas e depositárias”. Sorel formulou pela primeira vez uma ideia que muito dificilmente se deixa conceptualizar: as pulsões do homem, sobretudo as mais nobres, dificilmente se explicam, porque as soluções conceptuais, todas feitas e todas apropriadas, que propomos geralmente, falham na sua aplicação, os modelos explicativos do mundo, que têm a pretensão de ser absolutamente completos, não impulsionam os homens em frente mas, pelo contrário, têm um efeito paralisante.
Ernst Jünger, discípulo alemão de Georges Sorel
Mohler sentiu-se igualmente atraído pelo estilo do pensamento de Sorel devido à potencialidade associativa das suas explicações. Também estava convencido que este estilo era inseparável da “coisa” mencionada. Tentou definir este pensamento soreliano com mais precisão com a ajuda de conceitos como “construção orgânica” ou “realismo heróico”. Estes dois novos conceitos revelam a influência de Ernst Jünger, que Mohler conta entre os discípulos alemães de Sorel. Em Sorel, Mohler reencontra o que havia anteriormente descoberto no Jünger dos manifestos nacionalistas e da primeira versão do Coração Aventureiro (1929): a determinação em superar as perdas sofridas e, ao mesmo tempo, a ousar qualquer coisa de novo, a confiar na força da decisão criadora e da vontade de dar forma ao informal, contrariamente às utopias das esquerdas. Num tal estado de espírito, apesar do entusiasmo transbordante dos actores, estes permanecem conscientes das condições espacio-temporais concretas e opõem ao informal aquilo que a sua criatividade formou.
O “afecto nominalista”
O que actuava em filigrana, tanto em Sorel como em Jünger, Mohler denominou “afecto nominalista”, isto é, a hostilidade a todas as “generalidades”, a todo esse universalismo bacoco que quer sempre ser recompensado pelas suas boas intenções, a hostilidade a todas as retóricas enfáticas e burlescas que nada têm a ver com a realidade concreta. É portanto o “afecto nominalista” que despertou o interesse de Mohler por Sorel. Mohler não mais parou de se interessar pelas teorias e ideias de Sorel.
Em 1975 Mohler faz aparecer uma pequena obra sucinta, considerada como uma “bio-bibliografia” de Sorel, mas contendo também um curto ensaio sobre o teórico socialista francês. Mohler utilizou a edição de um fino volume numa colecção privada da Fundação Siemens, consagrado a Sorel e devida à pluma de Julien Freund, para fazer aparecer essas trinta páginas (imprimidas de maneira tão cerrada que são difíceis de ler!) apresentando pela primeira vez ao público alemão uma lista quase completa dos escritos de Sorel e da literatura secundária que lhe é consagrada. A esta lista juntava-se um esboço da sua vida e do seu pensamento.
Nesse texto, Mohler quis em primeiro lugar apresentar uma sinopse das fases sucessivas da evolução intelectual e política de Sorel, para poder destacar bem a posição ideológica diversificada deste autor. Esse texto havia sido concebido originalmente para uma monografia de Sorel, onde Mohler poria em ordem a enorme documentação que havia reunido e trabalhado. Infelizmente nunca a pôde terminar. Finalmente, Mohler decidiu formalizar o resultado das suas investigações num trabalho bastante completo que apareceu em três partes nas colunas da Criticón em 1997. Os resultados da análise mohleriana podem resumir-se em 5 pontos:
Uma nova cultura que não é nem de direita nem de esquerda
1. Quando falamos de Sorel como um dos pais fundadores da Revolução Conservadora reconhecemos o seu papel de primeiro plano na génese deste movimento intelectual que, como indica claramente o seu nome, não é “nem de direita nem de esquerda” mas tenta forjar uma “nova cultura” que tomará o lugar das ideologias usadas e estragadas do século XIX. Pelas suas origens este movimento revolucionário-conservador é essencialmente intelectual: não pode ser compreendido como simples rejeição do liberalismo e da ideologia das Luzes.
2. Em princípio, consideramos que os fascismos românicos ou o nacional-socialismo alemão tentaram realizar este conceito, mas estas ideologias são heresias que se esquecem de levar em consideração um dos aspectos mais fundamentais da Revolução Conservadora: a desconfiança em relação às ideias que evocam a bondade natural do homem ou crêem na “viabilidade” do mundo. Esta desconfiança da RC é uma herança proveniente do velho fundo da direita clássica.
3. A função de Sorel era em primeiro lugar uma função catalítica, mas no seu pensamento encontramos tudo o que foi trabalhado posteriormente nas distintas famílias da Revolução Conservadora: o desprezo pela “pequena ciência” e a extrema valorização das pulsões irracionais do homem, o cepticismo em relação a todas as abstracções e o entusiasmo pelo concreto, a consciência de que não existe nada de idílico, o gosto pela decisão, a concepção de que a vida tranquila nada vale e a necessidade de “monumentalidade”.
Não há “sentido” que exista por si mesmo.
4. Nesta mesma ordem de ideias encontramos também esta convicção de que a existência é desprovida de sentido (sinnlos), ou melhor: a convicção de que é impossível reconhecer com certeza o sentido da existência. Desta convicção deriva a ideia de que nunca fazemos mais que “encontrar” o sentido da existência forjando-o gradualmente nós próprios, sob a pressão das circunstâncias e dos acasos da vida ou da História, e que não o “descobrimos” como se ele sempre tivesse estado ali, escondido por detrás do ecrã dos fenómenos ou epifenómenos. Depois, o sentido não existe por si mesmo porque só algumas raras e fortes personalidades são capazes de o fundar, e somente em raras épocas de transição da História. O “mito”, esse, constitui sempre o núcleo central de uma cultura e compenetra-a inteiramente.
5. Tudo depende, por fim, da concepção que Sorel faz da decadência – e todas as correntes da direita, por diferentes que sejam umas das outras, têm disso unanimemente consciência – concepção que difere dos modelos habituais; nele é a ideia de entropia ou a do tempo cíclico, a doutrina clássica da sucessão constitucional ou a afirmação do declínio orgânico de toda a cultura. Em «Les Illusions du progrès» Sorel afirma: “É charlatanice ou ingenuidade falar de um determinismo histórico”. A decadência equivale sempre à perda da estruturação interior, ao abandono de toda a vontade de regeneração. Sem qualquer dúvida, a apresentação de Sorel que nos deu Mohler foi tornada mais mordaz pelo seu espírito crítico.
Uma teoria da vida concreta imediata
Contudo, algumas partes do pensamento soreliano nunca interessaram Mohler. Nomeadamente as lacunas do pensamento soreliano, todavia patentes, sobretudo quando se tratou de definir os processos que deveriam ter animado a nova sociedade proletária trazida pelo “mito”. Mohler absteve-se igualmente de investigar a ambiguidade de bom número de conceitos utilizados por Sorel. Mas Mohler descobriu em Sorel ideias que o haviam preocupado a ele também: não se pode, pois, negar o paralelo entre os dois autores. As afinidades intelectuais existem entre os dois homens, porque Mohler como Sorel, buscaram uma “teoria da vida concreta imediata” (recuperando as palavras de Carl Schmitt).
Karlheinz Weissmann traduzido por Rodrigo Nunes
causanacional.net
00:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, weimar, révolution conservatrice, philosophie, histoire, conservatisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 02 décembre 2009
Trois nouveaux dossiers sur le site de la revue "Vouloir"

Sur http://vouloir.hautetfort.com/
Trois nouveaux dossiers !
Dossier “Spengler”
Dossier “Révolution conservatrice”
Dossier “Décisionnisme”
Dossier “Spengler”
Robert STEUCKERS:
Les matrices préhistoriques des civilisations antiques dans l’oeuvre posthume de Spengler: Atlantis, Kash et Touran
Robert STEUCKERS:
Le rapport Evola/Spengler
Oswald SPENGLER:
Le regard historique
Patrice BOLLON:
Oswald Spengler: le “Copernic de l’histoire”
William DEBBINS:
Le déclin de l’Occident
Gennaro MALGIERI:
Les années décisives
Mireille MARC-LIPIANSKY:
Crise ou déclin de l’Occident
Julius EVOLA:
L’Europe ou la conjuration du déclin?
Dossier “Révolution conservatrice”
Robert STEUCKERS:
“La Révolution Conservatrice”, thèse d’Armin Mohler
Robert STEUCKERS:
Révolution conservatrice, forme catholique et “ordo aeternus” romain
Dossier “Décisionnisme”
Holger von DOBENECK:
Panajotis Kondylis: Pouvoir et décision
Hans B. von SOTHEN:
Hommage à Panajotis Kondylis (1943-1998)
En annexe:
P. CHRISTIAS:
Ennemi et décision – Hommage à Panajotis Kondylis
Julien FREUND:
Que veut dire prendre une décision?
En annexe:
S. de la TOUANNE:
Julien Freund, penseur “machiavélien” de la politique
13:42 Publié dans Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : synergies européennes, nouvelle droite, revue, révolution conservatrice, décisionnisme, oswald spengler |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 novembre 2009
La resurrezione europea
La resurrezione europea
Quando, nei primi anni Trenta, Ernst Jünger vedeva la crisi della borghesia superata dall’avvento di una nuova civiltà, guidata dall’Arbeiter, era decisamente ottimista. Oggi siamo costretti a registrare che il borghesismo è la classe universale che organizza in prima persona il processo di sgretolamento dell’Europa. Quando invece vaticinò «la fine di contesti millenari», volendo dire che era giunta la fine della tradizione europea, vide giusto. Solo che, in luogo del nuovo dominatore metallico dei tempi di rivolgimento, abbiamo più modestamente il protagonismo di un materiale umano di infimissima specie, un “tipo” antropologicamente di lega povera. Le note “caste” oggi al potere rappresentano il contrario di quella razza della nuova “età del ferro” preconizzata dall’intellettuale tedesco, essendo il frutto dell’inopinata affermazione di un’epoca plastificata. Gestita da elementi eticamente e culturalmente inferiori e in base a ideali non eroici, ma da termite.
 E dire, però, che quando Jünger faceva le sue ipotesi tutto un mondo ribolliva per davvero di volontà di rovesciamento degli idoli borghesi. La stagione jüngeriana, tuttavia, se misurata in tempi spengleriani, durò un attimo. Il 1932 – anno in cui fu scritto L’operaio – è passato da un pezzo, morti e sepolti sono i tentativi storici di rianimare l’Europa con cure radicali attinte da quello stesso bacino eroicizzante, e tutto ormai riposa sulla quiete di un dominio mondiale di energie corrosive ben paludate da ideali positivi. Lo stesso Jünger, col passare dei decenni, abbandonò le sue immagini faustiane e i suoi affondo nichilistici e si mise ad argomentare in termini di “fine della storia”, di difesa ecologica della Terra, acconciando il suo genio letterario a belle riproduzioni fantasy del romanzo metastorico. Disse di non comprendere i catastrofismi che erano stati di Spengler. Però scrisse che si aspettava una prossima epoca “dei Titani”, «molto propizia alla tecnica ma sfavorevole allo spirito e alla cultura». Titani magari no, ma questo pare proprio il mondo in cui viviamo, in cui il tecnocrate, il politicante e l’uomo-massa di annunci come quelli di Jünger e di Spengler non sanno che farsene.
E dire, però, che quando Jünger faceva le sue ipotesi tutto un mondo ribolliva per davvero di volontà di rovesciamento degli idoli borghesi. La stagione jüngeriana, tuttavia, se misurata in tempi spengleriani, durò un attimo. Il 1932 – anno in cui fu scritto L’operaio – è passato da un pezzo, morti e sepolti sono i tentativi storici di rianimare l’Europa con cure radicali attinte da quello stesso bacino eroicizzante, e tutto ormai riposa sulla quiete di un dominio mondiale di energie corrosive ben paludate da ideali positivi. Lo stesso Jünger, col passare dei decenni, abbandonò le sue immagini faustiane e i suoi affondo nichilistici e si mise ad argomentare in termini di “fine della storia”, di difesa ecologica della Terra, acconciando il suo genio letterario a belle riproduzioni fantasy del romanzo metastorico. Disse di non comprendere i catastrofismi che erano stati di Spengler. Però scrisse che si aspettava una prossima epoca “dei Titani”, «molto propizia alla tecnica ma sfavorevole allo spirito e alla cultura». Titani magari no, ma questo pare proprio il mondo in cui viviamo, in cui il tecnocrate, il politicante e l’uomo-massa di annunci come quelli di Jünger e di Spengler non sanno che farsene.
Ma è a personaggi come i due dioscuri tedeschi che l’Europa deve il fatto di avere ancora un’anima. Sfaldata e minacciata da vicino, ma viva. Non è possibile immaginare una ripresa europea sul ciglio dell’abisso, se non tornando a imbracciare quell’ideologia – poiché proprio di idee armate si trattava – che accomunò Jünger e Spengler come in un sogno europeo di rinascita a tutti i costi. Persino dietro al “tramonto” preconizzato da Spengler, difatti, c’era una promessa di nuovo inizio. E ovunque in Jünger si coglie la volontà di indicare la forma che si imporrà, una volta gestito e fatto placare il caos nichilista.
Dinanzi alla crisi provocata – oggi come allora – da uno scomposto e distruttivo procedere della modernità, l’anelito dell’uomo in ordine con le leggi della vita non può che essere verso «l’esigenza di una vita nuovamente ordinata e strutturata all’interno di una dimensione di compattezza e stabilità». Ha scritto queste parole Domenico Conte, autore di Albe e tramonti d’Europa. Ernst Jünger e Oswald Spengler, appena pubblicato dalle Edizioni di Storia e Letteratura di Roma.
È una frase chiave. Solo apparentemente innocua. Essa infatti mostra come il pensiero del realismo eroico, della mobilitazione totale e del cesarismo militante non fosse espressione anch’esso dell’epoca del nichilismo e dell’aggressione delle masse, ma, al contrario, intendesse utilizzare gli strumenti della modernità per abbatterla e costruire in sua vece un nuovo ordine gerarchico. «Questo mondo della mobilitazione e del movimento non è che un interludio», scrive Conte, e con questo ci fa capire che la fase della lotta è necessaria non in sé, ma per raggiungere ciò che egli definisce la «utopia della stabilità». Insomma: la Rivoluzione Conservatrice – e con loro i regimi nazionalpopolari che bene o male ne misero in pratica i presupposti – è una macchina moderna, d’accordo, ma antimodernista. Oltrepassati i confini della storia e della politica, Jünger e Spengler, ognuno per suo conto, ma con idee sovente intrecciantesi, guardarono al di là, immaginando forme ulteriori, stili post-moderni, accadimenti di primordiale potenza rifondatrice. Osservato fino in fondo l’incubo della tecnica e della società moderne, questi due artigiani dell’idea europea di dominio non hanno fatto filosofia reazionaria, non hanno espresso conservatorismi inetti, ma hanno dato strumenti di rivolta: «con l’impazienza e il radicalismo – soggiunge Conte – di chi non credeva più nella storia o vi credeva solo nel senso del vedervi l’imperare e l’agitarsi di più alte potenze, votarsi alle quali parve cosa necessaria e bella».
In effetti, se Jünger fu il collaboratore dei fogli di punta del nazionalismo politico post-bellico e vicino agli ambienti dell’oltranzismo nazionalrivoluzionario, Spengler non gli fu da meno: in rapporti con personaggi come Franz Seldte, futuro ministro nazionalsocialista, era ammiratore del mondo dei Männerbünde, le milizie armate al seguito di un capo tipiche dell’epoca, dagli squadristi italiani alle SA e allo Stahlhelm, nelle quali vedeva l’affermarsi di un prosssimo cesarismo carismatico. Contestualmente, Jünger osservò ne L’operaio che «la massa comincia a secernere dal proprio corpo organi di autodifesa». Questo considerare le cose dal punto di vista dell’organico, del vitale, dell’ancestrale biologico è forse la dimensione che meglio accomuna Jünger e Spengler e che meglio ne spiega il terribile, seducente, incantatorio talento da affrescatori. Entrambi analisti dell’uomo e della società, entrambi evocatori di scenari cosmologici, di rivolgimenti apocalittici, di ipotesi di riaffermazione di “tipi” elementari e originari, di razze mutanti, di arcaismi giacenti nell’inconscio e riattivati dall’uso della tecnica e dalla volontà impersonale, il tutto da indirizzare – con forte senso politico – contro l’affastellamento informe del Moderno. Profetizzarono uomini nuovi, secondo «cambiamenti fisiognomici intercorrenti nel passaggio dal mondo borghese dell’individuo al mondo tipico dell’Operaio». L’uno e l’altro giudicarono – sbagliando profezia, ma non importa – che presto al borghese, «sfornito di qualsiasi rapporto con forze elementari» sarebbero succeduti esemplari. Quasi campionature di un’inedita stirpe lavorata dai fatti, dal carattere, da un destino epocale.
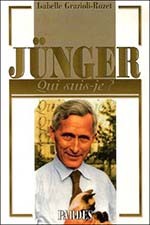 Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del Novecento rappresentata da Jünger e da Spengler come in fondo un unico strumentario di lotta filosofica, metafisica e politica, bene in grado di raddrizzare il piano inclinato su cui corre la modernità. E si tratta di strumenti da estrarre dai più reconditi giacimenti della natura occulta, veri archetipi in riposo che attendono soltanto di essere risvegliati: l’energia formatrice, ad esempio, la Gestaltungskraft, che a giusto titolo Conte indica come termine essenziale dell’Arbeiter, e che è la stessa forza che, ne L’uomo e la tecnica, Spengler vede agire per catastrofi immediate, risolutive: le mutazioni che aprono vie impensate ai progetti della storia.
Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del Novecento rappresentata da Jünger e da Spengler come in fondo un unico strumentario di lotta filosofica, metafisica e politica, bene in grado di raddrizzare il piano inclinato su cui corre la modernità. E si tratta di strumenti da estrarre dai più reconditi giacimenti della natura occulta, veri archetipi in riposo che attendono soltanto di essere risvegliati: l’energia formatrice, ad esempio, la Gestaltungskraft, che a giusto titolo Conte indica come termine essenziale dell’Arbeiter, e che è la stessa forza che, ne L’uomo e la tecnica, Spengler vede agire per catastrofi immediate, risolutive: le mutazioni che aprono vie impensate ai progetti della storia.
Conte batte sul tasto delle naturali differenziazioni tra i due pensatori, ma ribatte pure su quello delle organiche similitudini. E ci rende noto un esemplare dettaglio, di gran valore filologico e immaginale. Una lettera scrittagli da Ernst Jünger nel 1995, a un mese dal compimento del suo centesimo anno, in cui conveniva con lo studioso napoletano che Spengler aveva svolto in qualche modo su di lui il ruolo di maestro: «Lei ha ragione a supporre che Oswald Spengler abbia esercitato un’influenza significativa sulla mia evoluzione spirituale…». Assodato che Spengler era senza mezzi termini considerato da Jünger «decisivo per la sua concezione della storia», Conte indica come elemento tra i più visibili di questa fratellanza ideale il «collegamento fra Operaio e prussianità», quello fra Operaio e Germania, e soprattutto la visuale copernicana della storia, nel senso di una storia e di una politica mondiali, ma «in un’ottica in realtà germanocentrica». Un sano relativismo di prospettiva che non sviliva, ma al contrario rafforzava sia in Jünger sia in Spengler l’ostilità verso l’individualismo cosmopolita borghese e quella «contro i partiti politici, i parlamenti, la stampa liberale e l’economia di libero mercato».
Un altro dei numerosi spunti offerti da Conte è il commento a un libro dell’americano John Farrenkopf, recentemente dedicato a Spengler come “profeta del declino”. Un caso singolare di “spenglerismo” negli USA? Un momento… vediamoci chiaro… Farrenkopf condivide le prognosi infauste di Spengler circa il futuro dell’Occidente, formula un suo pessimismo circa la decadenza del mondo occidentale (pacifismo, crisi demografica e culturale, ottusa pratica di esportare tecnologia ai nemici dell’Occidente, etc.), ma alla fine non manca di sostituire l’America alla Germania come quella struttura imperiale auspicata da Spengler per contenere gli sviluppi verso il basso della civilizzazione. E, da buon americano, non manca neppure di indicare in qualche scritto giovanile del filosofo del tramonto accenni di apprezzamento per la democrazia. Non sono tanto questi aspetti che importano. Conte demolisce alla svelta il tentativo di americanizzare Spengler e di confondere l’impero con l’imperialismo di bottega. Da parte nostra, noi segnaliamo il valore irrinunciabile della duplice lezione di Jünger e di Spengler: la presenza pesante di due autori dal messaggio forte, attualissimo, il cui pensiero di contrasto radicale va strappato di mano ai depotenziatori – certi salotti della new age jüngeriana, amanti del romanziere criptostorico, ma muti sull’ideologo nazionalrivoluzionario… adesso lo Spengler democratico e americanomorfo… – per rimetterlo al centro di un possibile recupero del tradizionalismo rivoluzionario europeo…
Domenico Conte, ben noto al pubblico italiano per essere uno dei pochi esegeti non prevenuti della Rivoluzione Conservatrice – e autore tra molti altri di quell’eccellente libro-monstre che è Catene di civiltà. Studi su Spengler, pubblicato dalle Edizioni Scientifiche Italiane nel 1994 – parla non a caso di albe e tramonti d’Europa. Il pensiero tragico e le prospettive catastrofiste di Jünger e di Spengler nascondono allo stesso modo tutto un tracciato di proiezioni futuribili, assegnando alla nostra civiltà spazi di insorgenza e di contro-storia ancora percorribili. Spengler, fortemente interessato ai momenti aurorali e dinamici della Kultur, era in realtà un agitatore di destini. E Jünger, nel suo Arbeiter, scrisse la frase rivelatrice: «ogni tramonto è preparazione». Entrambi, e insieme ad esempio a un Heidegger, e in maniera tra l’altro non dissimile dal nostro vecchio Oriani, videro il futuro dell’Europa nel suo saper riconoscere una nuova alba, fatta di istinto, volontà e mobilitazione.
* * *
Tratto da Linea del 11 ottobre 2009.
00:08 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, jünger, spengler, weimar, allemagne, europe, littérature, lettres; lettres allemandes, littérature allemande, philosophie, déclin, décadence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 novembre 2009
Innerlichkeit und Staatskunst - Zum Wirken Friedrich Hielschers
 Innerlichkeit und Staatskunst -
Innerlichkeit und Staatskunst -
Zum Wirken Friedrich Hielschers
"Zwei Tyrannen tun dem Deutschen not: ein äußerer, der ihn zwingt, sich der Welt gegenüber als Deutscher zu fühlen, und ein innerer, der ihn zwingt, sich selbst zu verwirklichen."
- Ernst Jünger
Verfasser: Richard Schapke
Der am 7. März 1990 auf dem Rimprechtshof im Schwarzwald verstorbene Friedrich Hielscher gehörte mit Sicherheit zu den originellsten Ideologen der Konservativen Revolution. Da er sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch weniger als ohnehin schon um öffentliche Breitenwirkung scherte, gerieten seine Arbeiten in fast vollständige Vergessenheit, auch wenn Hielschers Name des öfteren in Jüngers "Strahlungen" auftaucht. In jüngster Zeit ist eine regelrechte Wiederentdeckung des unkonventionellen Nietzscheaners zu bemerken - Grund genug für einen Versuch, sich Friedrich Hielschers Leben und Werk zu nähern. Wir greifen hierbei oftmals auf Originalzitate zurück, um den Gegenstand unserer Betrachtung in seinen eigenen Worten sprechen zu lassen. Mitunter sind Zitate und Analysen aus der nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichten Autobiographie "Fünfzig Jahre unter Deutschen" eingeflochten. Aus inhaltlichen Gründen gehen wir hierbei von der Chronologie der Veröffentlichung ab.
1. Herkunft
Friedrich Hielscher wurde am 31. Mai 1902 in Guben (nach anderen Angaben in Plauen/Vogtland) in eine nationalliberale Kaufmannsfamilie hineingeboren. Gerade 17 Jahre alt geworden, absolvierte er sein Kriegsabitur am Humanistischen Gymnasium, um sich fast unmittelbar darauf einem der gegen Spartakisten und Separatisten oder in den Grenzkämpfen im Osten fechtenden Freikorps anzuschließen. Dieses Freikorps Hasse ging im Juni 1919 aus der MG-Kompanie des ehemaligen Infanterieregiments 99 hervor und kam in Oberschlesien gegen polnische Insurgenten zum Einsatz. Zu den Freikorpskameraden Hielschers gehörte Arvid von Harnack, der später durch seine Mitarbeit in Harro Schulze-Boysens Roter Kapelle zu Berühmtheit gelangen sollte. Die Einheit bewährte sich und wurde in die Reichswehr übernommen, aber Hielscher quittierte den Dienst im März 1920, da er eine Beteiligung am überstürzten Kapp-Putsch gegen die Republik ablehnte.
Es folgte ein Jurastudium in Berlin, das von regelmäßigen Besuchen an der Hochschule für Politik begleitet wurde. Dem Brauch entsprechend schloß Hielscher sich einer Studentenverbindung an und wählte die Normannia Berlin. Nach einer vorübergehenden Mitgliedschaft im Reichsclub der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) traten in Gestalt des aus der SPD hervorgegangenen nationalen Sozialisten August Winnig und des Geschichtsphilosophen Oswald Spengler prägendere politische Einflüsse an ihn heran. Von Winnig übernahm Hielscher die Überzeugtheit von einer weltgeschichtlichen Mission Deutschlands, vom Spengler das zyklische Geschichtsbild. Hinzu kam das in den Werken Ernst Jüngers herausgearbeitete Kriegertum.
Im Jahr 1924 erfolgte der Wechsel nach Jena, wo Hielscher das Referendarexamen bestand und im Dezember 1926 mit Auszeichnung zum Doktor beider Rechte promovierte. Die ungeliebte Beschäftigung als Verwaltungsjurist im preußischen Staatsdienst wurde nach nicht einmal einem Jahr im November 1927 aufgegeben. Die Anforderungen des Studiums behinderten nicht den häufigen Besuch des Weimarer Nietzsche-Archivs. Friedrich Nietzsche sollte dann auch über seine Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche der letzte wirklich prägende Bestandteil des sich allmählich herauskristallisierenden Weltbildes sein. Von Dauer war die weitere Beteiligung als Alter Herr am Verbandsleben der Normannia Berlin, wo Hielscher die Bekanntschaft von Persönlichkeiten wie Horst Wessel, Hanns Heinz Ewers und Kurt Eggers machte.
2. Innerlichkeit
Am 26. Dezember 1926 betrat Friedrich Hielscher mit dem Aufsatz "Innerlichkeit und Staatskunst" die Bühne der politischen Publizistik. Der junge Jurist hatte sich auf Rat Winnigs dem nationalrevolutionären Kreis um die Wochenzeitung "Arminius" angeschlossen, dem nicht zuletzt Ernst Jünger das Gepräge gab. Aus der Begegnung mit Jünger entstand eine lebenslange Freundschaft. "Innerlichkeit und Staatskunst" enthält bereits alle wesentlichen Aspekte des Hielscherschen Weltbildes und soll daher ausführlicher dokumentiert werden.
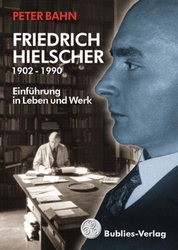 "Seien wir ehrlich: wir stehen nicht am Beginn eines neuen Aufstieges, sondern vor dem Ende des alten Zusammenbruches. Dieses Ende liegt noch vor uns. Wir müssen erst noch durch das Schlimmste hindurch, ehe wir ans neue Werk gehen können. Jeder, der jetzt schon mit irgendeinem Aufbau beginnt, tut sinnlose Arbeit. Das will folgendes heißen. Jede kriegerische Vorbereitung, die auf einen Befreiungskrieg in der Gegenwart oder der nahen Zukunft abzielt, ist wertlose Spielerei und grob fahrlässige Dummheit. Jeder geistige Versuch, einigende Bünde, Verbände, kulturelle Vereinigungen, Weisheitsschulen, oder wie man das Zeug sonst nennen mag, in der Gegenwart zu gründen, ist Selbstbetrug und Unehrlichkeit der inneren Haltung.
"Seien wir ehrlich: wir stehen nicht am Beginn eines neuen Aufstieges, sondern vor dem Ende des alten Zusammenbruches. Dieses Ende liegt noch vor uns. Wir müssen erst noch durch das Schlimmste hindurch, ehe wir ans neue Werk gehen können. Jeder, der jetzt schon mit irgendeinem Aufbau beginnt, tut sinnlose Arbeit. Das will folgendes heißen. Jede kriegerische Vorbereitung, die auf einen Befreiungskrieg in der Gegenwart oder der nahen Zukunft abzielt, ist wertlose Spielerei und grob fahrlässige Dummheit. Jeder geistige Versuch, einigende Bünde, Verbände, kulturelle Vereinigungen, Weisheitsschulen, oder wie man das Zeug sonst nennen mag, in der Gegenwart zu gründen, ist Selbstbetrug und Unehrlichkeit der inneren Haltung.
(...) Beweise haben in der Welt der Tatsachen keinen Sinn.. Es ist noch nie vorgekommen, daß man politische Gegner durch Beweise bekehrt oder in ihrer Stellung erschüttert hätte. Aber es ist nötig, daß die sich einig werden, die im Grunde ihres Wesens Träger ein und desselben Zieles sind: des heiligen Deutschen Reiches. Zu dieser Einigung bedarf es des gegenseitigen Verständnisses. Dieses Verständnis fehlt. Ihm dient die folgende Begründung. Sie bildet sich nicht ein, daß an dem kommenden deutschen Zerfall irgend etwas zu ändern sei. Aber sie ist der Überzeugung, daß es jetzt schon an der Zeit ist, an der geistigen Haltung zu arbeiten, von der aus der spätere Aufbau allein beginnen kann.
Seit die Germanen in Berührung mit der kraftlos gewordenen und überreifen römisch-byzantinisch-christlichen Kulturenvielfalt gekommen sind, die den Ausgang des sogenannten Altertums bildet, ist ihre innere Haltung unfrei. Seit sie das Denken dieser fremden Welten übernommen haben, unfähig, die kaum zum Ausdruck gekommene eigene Art gegen das jeder Unmittelbarkeit längst entwachsene, zu Ende gedachte fremde Wesen zu schützen, seit dieser Zeit ist die deutsche Haltung zweispältig (sic!). Der Deutsche bejaht den Kampf als solchen; aber die müde Sittlichkeit der Fremden sucht den Frieden. Seit also der deutsche Geist überfremdet ist, wird jede deutsche Kampfhandlung mit schlechtem Gewissen getan, wird halb, kommt nicht zum endgültigen Erfolge und sinkt nach oft prachtvollem Aufschwung immer wieder in sich zusammen. Staatskunst ist die Fähigkeit, die eigenen Kampfhandlungen mit dauerndem Erfolg nach außen zu verwirklichen. Seit der Deutsche überfremdet ist, steht die deutsche Staatskunst allein und hat die deutsche Innerlichkeit nicht geschlossen hinter sich. (...)
Mit Bismarcks Entlassung verwandelte sich das Bismärckische Reich in den Wilhelminischen Staat, in ein Verfassgebilde, dessen Untergang unvermeidbar war. Diese Unvermeidbarkeit zeigte sich im Weltkriege. Wenn kriegerisches Heldentum ein Schicksal wenden kann, dann mußten wir siegen. Aber wir mußten die Fahnen senken, weil hinter dem deutschen Krieger nicht die deutsche Heimat stand als eine Einheit innerlichsten Glaubens, Wollens, Denkens, als eine Welt der ungetrübten reinen und abgrundtiefen Zuversicht. So kam die Niederlage. Der Staat der Weimarer Verfassung ist nicht ein neues Gebilde, das von seinem Vorgänger irgendwie wesentlich verschieden wäre, sondern nur die letzte Gestalt des Wilhelminischen Staates, die dessen alberne, wertlose, erbärmliche Seiten in vorbildlicher Deutlichkeit und - freilich unbewußter - Ehrlichkeit zeigt.
So ist hier nichts mehr zu halten und zu retten. Je eher dieser Staat zugrunde geht, um so besser ist es für die deutsche Sache. Sein weiteres Schicksal ist uns vollendet gleichgültig. Soll ich noch deutlicher werden? Also ist hier nichts mehr zu verbessern. Wenn das noch möglich wäre, dann würde zudem nicht das kindische Hurraschreien scheinkriegerischer Aufzüge von Wert sein, sondern einzig und allein ein verbissenes, unterirdisches, schweigendes und selbstverleugnendes Arbeiten, das vom Kleinsten anfängt, wie Friedrich Wilhelm der Erste angefangen hat. Aber weil es nicht möglich ist, an diesem Staat noch Hand anzulegen, bleibt nur eins übrig: in sich zu gehen, und aus der Tiefe des eigenen Herzens die Zuversicht, den Glauben heraufzuholen, der die deutsche Zukunft tragen und ohne den das neue Werk nicht begonnen werden wird. (...)"
Wir fassen zusammen: Der Zusammenbruch der liberalkapitalistischen Ordnung ist nicht in vollem Gange, sondern er steht erst noch bevor. Vor diesem Kollaps sind jede Aufbauarbeit und jede politische Partizipation zwecklos. Das deutsche Wesen wurde vom westlich-christlichen Materialismus überfremdet, und daher war die Niederlage des verwestlichten Kaiserreiches im Weltkrieg unvermeidbar. Die Republik ist die Fortsetzung des wilhelminischen Staates in anderem Gewande und ebenso wie er dem Untergang geweiht.
Am 30. Januar 1927 legte Hielscher den Aufsatz "Der andere Weg" nach: "Will ein unterworfenes Volk frei werden, so muß es dazu zweierlei tun: es muß erstens innerlich einig werden und zweitens seine staatskünstlerische Begabung betätigen...Für die Betätigung unserer staatskünstlerischen Begabung fehlen uns die Mittel." Der Hauptfeind waren nicht die unterdrückten asiatischen Völker, sondern die "Träger der europäischen Zivilisation...Aber wir bestreiten, daß wir zur Freiheit, d.h. zum selbstherrlichen Gebrauch unserer eigenen Kräfte gelangen können, ohne in entscheidenden Gegensatz zu Europa zu treten...Daher ist es geboten, unsere ganzen Fähigkeiten auf den anderen Weg zu richten, dessen Begehung ebenfalls unumgänglich notwendig ist, auf die endliche Einigung des deutschen Geistes." Angezeigt ist die "mephistophelische Schlangenhaftigkeit und Gewandtheit in der Verschleierung der tiefsten Gründe und Hintergründe". In diesem Kampf sind alle Mittel erlaubt, solange man die eigene Treue nicht verletzt. "Ersichtlich setzt eine solche Handlungsweise eine Sicherheit der inneren Haltung voraus, die kaum überbietbar ist." Der geistige Kampf gilt nicht etwa der etwaigen Undurchsichtigkeit des Handelns, sondern der Vielfältigkeit der fremden Einflüsse. Einzig auf eigenen Willen gegründet ist die Welt eines neuen Geistes, einer machtwilligen Seele zu errichten. "Das ist das Ziel. Der Weg zu ihm führt über eine rücksichtslose strenge Selbsterziehung eines jeden Einzelnen. Er führt über das eindeutige Bekenntnis zu dem Glauben, an den sich die Dichter der alten Sagen, an den sich Eckehart, Luther, Goethe und Nietzsche hingegeben haben. Er führt über die Gestaltung jener Erziehung aus diesem Glauben heraus zur Züchtung eines Geschlechts, das im Opferdienst am deutschen Glauben einig und deshalb, und nur deshalb, berufen ist, das staatskünstlerische Werk zu vollbringen, zu dem die Gegenwart ebensowohl aus einem Mangel an äußerem Willen wie aus innerer Glaubenslosigkeit nicht geeignet ist."
Am 13. Februar 1927 folgte "Die faustische Seele": "Die seelische Zugehörigkeit zum Deutschtum ist das Grunderlebnis der deutschen Menschen. Der letzte große Versuch, sich mit diesem Grunderlebnis im Bewußtsein auseinanderzusetzen, ist Spenglers Lehre von der faustischen Kultur. Der deutsche ist der faustische Mensch. Die faustische Kultur ist das deutsche Seelentum. Spengler sieht es aus dem unendlichkeitsverlorenen Walhall mit seinen tiefen Mitternächten herabsteigen in die Tiefen der Mystik, sieht es zu endlosen Kämpfen, gleichgültig gegen den Tod, das Schwert ziehen, die gotischen Dome wollen den Himmel stürmen, der lutherische Bauerntrotz schlägt drein, ins Grenzenlose schreitet die wälderhafte nordische Musik, unter den zartesten und weltseligsten Melodien ihre gewaltige Einsamkeit verbergend oder sie hinausschreiend in Sturm und Gewitter, aus Not und Elend und Blut steigt das Preußentum empor, und als dem Faust der Zarathustra folgt, erschüttern Wagners Posaunen die Welt und der Preuße Bismarck holt die Krone aus dem Rhein. Dann folgt der Zusammenbruch, und von neuem beginnt der alte Kampf (...)
Ich sehe einen langen Weg. Im Urdämmer der Sage stehen der deutsche Machtwille und die deutsche Innerlichkeit zueinander und sind untrennbar verbunden....Friedrich Nietzsche, der letzte große Träger der deutschen Innerlichkeit, hat den Willen zur Macht gelehrt und so die alte Weisheit wieder geweckt, die von den Tagen der Götter, von den Tagen Sigfrids und Hagens her die deutsche Sittlichkeit verkündet. Wenn unsere Innerlichkeit wieder gelernt haben wird, ihr zu folgen, wenn der deutsche Machtwille nicht mehr alleinstehen wird, erst dann, aber dann sicher, wird die deutsche Zwietracht aufhören, wird sich das deutsche Menschentum vollenden und in seiner Vollendung heimfinden zu dem ewigen Brunnen, aus dem es entstiegen ist."
Verdeutlicht wird diese Darstellung der faustischen Seele durch den Aufsatz "Die Alten Götter". Sagen, Märchen und die germanisch-keltische Mythologie bilden die Heimat der deutschen Seele. Hielscher betont den Kampf als Daseinsprinzip: "Das versteht nur ein Deutscher, daß man sich gegenseitig die tiefsten Wunden schlagen und dennoch die beste Freundschaft halten kann. Denn der Deutsche ist in seinem Innern selber so: hundert- und tausendfältig zerrissen, ein Schlachtgebiet aller holden und unholden Geister, und aus dieser Zerrissenheit seinen Stolz herausholend und eine höhere Einheit, die über allem Ernste sich ein Lächeln bewahrt hat, und über allen Abgründen eine einsame und lichte Höhe, die ihren Glanz in alle Tiefen schickt....Der Kampf ist das Nein, und die Vollendung ist das Ja. Die Geburt des Ja aus dem Nein, die Vollendung im Kampfe, das ist das Lied von den alten Göttern. Es ist das Lied, das alle großen Träger der deutschen Innerlichkeit verkündet haben. Wenn Eckehart die brennende Seele lehrte, in der doch eine ungetrübte schweigende Stille herrscht, wenn Luther im Wirken und durch das Wirken Satans die Allmacht Gottes geschehen sah, wenn Goethe alles Drängen und Ringen als ewige Ruhe in Gott erlebte, wenn endlich Nietzsches Welt des Willens zur Macht, diese Welt des Ewig-sich-selber-Schaffens und Ewig-sich-selber-Zerstörens als endloser Kreislauf zu sich selber guten Willen hatte, so war das immer nur das alte Lied" (der nordischen Mythologie). "So wird der Kampf zum Selbstsinn, und die Treue in diesem Kampfe ist das Höchste. Es gibt nichts anderes. Um des Kampfes willen ist die Innerlichkeit da, weil sie die Kraft zu diesem Kampfe gibt...Das ist eine ganz andere Treue, als die Gegenwart sie kennt. Das ist die Treue, die alles opfert, den Schwur, die Ehre, das eigene Blut; die Treue, die nur das eigene Werk und seine Vollendung im Kampfe kennt."
Das Leben der Völker bemißt sich nach Völkerjahren mit den vier Jahreszeiten. Hielscher zieht zahlreiche Allegorien mit dem Vegetationszyklus eines Baumes. Die Deutschen befinden sich derzeit im Stadium des Winters, ausgelöst durch die "Verstofflichung", den Materialismus der westlichen Zivilisation. Die Entstehung des Materialismus verortet Hielscher bereits zu Zeiten der Renaissance, aus der sich der Frühkapitalismus entwickelte. Der Mensch will nicht mehr gebunden sein, sondern wider seine Natur nur noch von sich selbst abhängen. Religion, Volk, Tradition und Kultur weichen dem Individualismus. Die Menschen haben die Wahl, ob der Winter "die Umkehr oder den Tod bringen (wird), nach unserer Wahl und nach der zukommenden Gnade der Götter".
"Wer die Kälte der Oberfläche ändern wollte, würde als Schwarmgeist scheitern. Desgleichen steht nicht in der Hand der Wurzeln und der Wintersaat und nicht in der Hand des Menschen. Vielmehr ist uns diese Kälte vorgegeben." Jeder Winter birgt den Keim des Frühlings, nicht zuletzt symbolisiert durch die Sonnenwende.
"An der Quelle muß der Strom versiegen, an der Wurzel muß das Unheil absterben. Und in Quelle und Wurzelgrund muß das Heil von neuem gewonnen werden." Das Reich ist noch nicht stark genug, um oberirdisch gedeihen zu können. Es ist verborgen im Inneren seiner Glieder, eines neuen Menschentypus, keine sichtbare Gestalt. Innerlichkeit und Wille zur Macht verknüpfen sich miteinander.
So geht es heute nicht mehr um das Retten des alten abendländischen Leibes, sondern um das Bilden des neuen." Soziale Herkunft und Interessen der Unterirdischen sind gleichgültig. "Und jeder mag unter den Vorbildern sich seinen Helden wählen."
3. Staatskunst
Nachdem Hielscher dergestalt die Notwendigkeit unterstrichen hatte, ein neues Bewußtsein als Grundvoraussetzung erfolgreichen Handelns zu schaffen, wandte er sich außenpolitischen Fragen zu. Im März 1927 veröffentlichte der "Arminius" seinen vielbeachteten Aufsatz "Für die unterdrückten Völker!", der Hielscher gewissermaßen zum Erfinder des Befreiungsnationalismus machen sollte. Wir merken an, daß derartige Gedankengänge auch schon im Werk Moeller van den Brucks auftauchen.
Der Erste Weltkrieg hatte die Völker aller Kontinente aufgerüttelt, so daß jede politische Maßnahme ihre Wirkung verhundertfachte. Auf dem Brüsseler Kongreß der unterdrückten Völker hatten die Farbigen erstmals einmütig ihre Stimme gegen den Westen, gegen Imperialismus und Kolonialismus und für den Nationalismus erhoben. Unter den Bestimmungen des Versailler Diktats war Deutschland mit seiner dem Westen hörigen Demokratie kein souveräner Staat, sondern ebenfalls eine Kolonie. Kein Kontinent stand mehr für sich alleine, sondern neue Aufgaben, Freundschaften und Ziele entwickelten sich. Im Zentrum der Hoffnung Hielschers stand das Erwachen des Giganten China, Indiens oder der arabischen Welt, weniger die Sowjetunion, die ihre "russische" Ideologie allen anderen Völkern aufzwingen wollte und damit kein echter Partner der nach Freiheit strebenden Völker war.
Deutschland ist kein Teil des westlichen Europa, sondern ein Teil des asiatischen Ostens. In der Verehrung des Ostens verbeugt sich der Deutsche "vor einer weiten unendlichen, durchaus uneuropäischen und geheimnisvollen Welt einer sehnsüchtigen und zutiefst ruhigen Weisheit und Selbstsicherheit, aus der er seine Kraft strömen fühle". Die deutsche Innerlichkeit ist ein Widerspruch gegen den Westen und dessen Zivilisationsdenken. "Die Völker des Ostens glauben an unverrückbare Kräfte, denen sie sich verdienstet wissen, aus denen ihre Art entspringt, und zu der sie zurückkehrt, wenn ihre Stunde geschlagen hat. Der Deutsche gehört zum Osten und nicht zum Westen. Der Westen ist Zivilisation, der Osten ist Kultur. Die Zivilisation ist auf dem Gelde und der Berechnung aufgebaut und kennt keine Innerlichkeit. Die Kultur errichtet auf dem Grunde einer unerschütterlichen Gewißheit die Werke einer hohen Kunst, eines demütigen Denkens, einer hingebenden Weisheit. Die Völker des Westens sind Zivilisationsvölker, die Völker des Ostens tragen ihre großen Kulturen."

Im Gegensatz zum kapitalistischen Westen ist der Osten sozialistisch, wobei Sozialismus hier als eine innere Haltung und nicht als theoretisches System zu verstehen ist. Während der Kapitalismus den Menschen seinen Taten entfremdet und dem Nutzen unterwirft, will der Sozialismus die Leistung und das Werk. Die Menschen sind keine Einzelwesen, sondern Glieder von Gemeinschaften. "Der Westen kennt nicht Ideen, sondern Konzerne; er kennt keine Gemeinschaften, sondern wirtschaftliche Verbundenheit."
"Der Westen ist Imperialismus, der Osten ist Nationalismus. Der Nationalismus ist die Folge des Glaubens an die eigene Kultur, der Wille zur Durchsetzung ihrer eigenen Art, der Wille zum Dienst an der Gemeinschaft, die auf der eigenen Kultur beruht. Der Imperialismus ist die Benutzung der nationalen Mittel zur Erlangung wirtschaftlichen Profites, die Umfälschung nationaler Ziele in Wirtschaftsinteressen."
"Wir deutschen Nationalisten werden mit den Nationalisten des Ostens zusammengehen; wir fordern den gemeinsamen Kampf gegen den westeuropäisch-amerikanischen Imperialismus und Siegerkapitalismus, wir fordern die Abkehr der deutschen Wirtschaft von den westlichen Verbundenheiten, die Abkehr der deutschen Geistigkeit vom Westen. Im Osten kämpfen die unterdrückten Völker den gleichen Kampf, den Kampf der Kulturnationen gegen die Zivilisationsvölker, den Kampf der Tiefe gegen die Oberfläche. Verbünden wir uns ihnen. Scheuen wir kein Opfer. Der Osten wartet auf uns. Enttäuschen wir ihn nicht. Wir sind der Vorposten des Ostens gegen den Westen. Der Westen wankt, und der Sturm aus dem Osten hat begonnen. Die deutsche Stunde schlägt."
Hielschers Ausführungen, die sich im übrigen jeder Rassist und Xenophobe einmal etwas intensiver durch den Kopf gehen lassen sollte, trafen auf ein gemischtes Echo. Der Kampfverlag der NS-Parteilinken unterstützte Hielschers internationalistisch-nationalistische Thesen ebenso wie Franz Schauweckers "Standarte". Bezeichnenderweise kam vom hitleristischen "Völkischen Beobachter" und von den Vereinigten Vaterländischen Verbänden schroffe Ablehnung.
Mit seinem philosophisch-politischen Programm stürzte Hielscher sich in die Politik, zunächst eine Reihe geopolitischer Analysen nach obigem Muster im "Arminius" veröffentlichend und jegliche Mitarbeit am Weimarer System heftig kritisierend. Im Juli 1927 beteiligte er sich an der von August Winnig gegründeten Berliner Sektion der Alten Sozialdemokratischen Partei, einer "rechten" Abspaltung der SPD. Als Gruppenorgan fungierte die Zeitschrift "Der Morgen", zu deren Autoren neben Hielscher die Nationalrevolutionäre Eugen Mossakowsky und Karl Otto Paetel gehörten. Anhang aus der Arbeiterschaft konnte kaum gewonnen werden, dafür kamen die bürgerlichen Rebellen.
4. "Das Reich"
Spätestens das ASP-Experiment überzeugte Hielscher von der Sinnlosigkeit tagespolitischer Aktivitäten. In seinen Memoiren "Fünfzig Jahre unter Deutschen" analysiert er die Situation im Nachhinein so: "Will man sich den Ort der Einzelgänger vor Augen führen, so stelle man sich die Parteien als ein Hufeisen vor, an dessen einem Flügel die Nationalsozialisten, an dessen anderem die Kommunisten standen.
Dann finden wir neben den Nationalsozialisten die Deutschnationalen Hugenbergs, neben ihnen die Deutsche Volkspartei Stresemanns und neben ihr das katholische Zentrum, das die Mitte tatsächlich bildete. Links davon sehen wir die Demokraten, hernach die Sozialdemokraten und schließlich die Kommunistische Partei.
Aber mit ihnen schloß sich der Kreis nicht, sondern zwischen ihnen und den Nationalsozialisten klaffte eine Lücke, die sich um so weniger schließen konnte, als die Nationalsozialisten und die Kommunisten bereits nur noch dem Namen nach Parteien waren, in Wirklichkeit aber Horden, und zwar Horden in Bundesgestalt und mit parlamentarischer Maske. Sie wollten Massenbewegungen sein, gaben sich vor ihren gutwilligen Anhängern das Gesicht eines Bundes und spielten nach außen die Partei, um nicht verboten zu werden.
Den Bund kennzeichnet im Aufbau die gegenseitige Verpflichtung zwischen Haupt und Gliedern, im Wesen der Geist, der sie verbindet, sei es nun ein Glaube oder auch nur eine besondere Menschlichkeit, im Sinne der freiwilligen Dienste an diesem Geiste und im Zwecke das Ziel, das er dem Haupte und den Gliedern aufgibt.
Der Horde mangelt im Aufbau die Gegenseitigkeit, im Wesen der Geist, im Sinne der freie Wille und im Zwecke das Ziel. An die Stelle der Gegenseitigkeit tritt der einseitige Gehorsam, an die Stelle des Geistes das Programm, an die Stelle des freien Willens der Zwang und an die Stelle des Zieles der erstrebte Vorteil und Nutzen, sei es des Hordenführers allein, sei es zugleich seiner Garde oder der ganzen Horde.
Die Gestalt des Bundes anzunehmen empfiehlt sich der Horde, wenn das Volk sich wieder nach Bund und Verbundenheit sehnt, weil die Lüge am besten in Gestalt der Wahrheit zu wirken vermag und von ihren abgesplitterten und selbständig genommenen Teilen allein lebt. Mit der Wahrheit zu schwindeln, ist nicht nur die beste, sondern es ist auch die einzige Art der Lüge, die Erfolg haben kann.
Und die Maske der Partei schließlich bietet sich von selber an, weil in Verfallszeiten nicht das Volk, sondern der Bürger herrscht, welcher in den Zweckverbänden der unverbindlichen Parteien sich am besten darzustellen und zu entfalten vermag. (...)
So sehen wir nicht nur an den äußeren Flügeln des Parteienhufeisens zwei offenkundige Horden in Bundesgestalt und mit scheinbündischen Gliederungen wie hier der SA oder der SS und dort dem Rotfrontkämpferbunde, sondern auch bis fast in die Mitte heran jede Partei bemüht, sich eine Horde heranzubändigen oder sich eines Bundes zu versichern. (...)
Zwischen den beiden Hordenflügeln aber kochten die Einzelgänger ihren Trank und bildete sich Bund. Hier schlugen die Flammen von rechts nach links herüber, um der Feuerzange die nötige Glut zu geben."
Auf den Zerfall der "Arminius"-Gruppe folgte ab Oktober 1927 die Zeitschrift "Der Vormarsch", ursprünglich ein Blatt von Kapitän Ehrhardts Wikingbund. Die Schriftleitung lag bei Ernst Jünger und Werner Lass, dem Führer der Schill-Jugend, einem ehemaligen Gefolgsmann des Freikorpsführers Roßbach mit starkem Einfluß in der HJ. Hielscher variierte hier weiterhin seine bekannten Thesen. Der "Vormarsch" wurde zum Zentrum einer bewußt provokativen Militanz. Es kam zur Bildung kleiner revolutionärer Zirkel, die über die Grenzen der Bünde und Parteien zusammenarbeiten. Engere Verbindungen unterhielt der "Vormarsch"-Kreis zur NSDAP, die sich durch ihren sozialrevolutionären Charakter zusehends von den anderen Rechtsverbänden absonderte. Unterhalb der agitatorischen Ebene verkehrte Hielscher in diversen Zirkeln, von denen vor allem der Salon Salinger zu nennen ist. Der jüdischstämmige Hans Dieter Salinger, Beamter im Reichswirtschaftsministerium und Redakteur der "Industrie- und Handelszeitung", versammelte hier einen bunt zusammengewürfelten Kreis um sich. Neben Hielscher sind hier Ernst von Salomon, Hans Zehrer, Albrecht Haushofer, Ernst Samhaber oder Franz Josef Furtwängler, die rechte Hand des Gewerkschaftsführers Leipart, zu nennen.
Im Frühjahr 1928 bildete Friedrich Hielscher, wohl inspiriert durch Salingers Kontaktpool und durch den Schülerkreis des Dichters Stefan George (vor allem in Aufbau und Methode), einen eigenen Zirkel um seine Person. Diesem Kreis fiel beispielsweise indirekt das Verdienst zu, den Brecht-Weggefährten Arnolt Bronnen für die revolutionäre Rechte zu gewinnen. Nach dem Rückzug Jüngers übernahm Hielscher im Juli 1928 gemeinsam mit Ernst von Salomon die Leitung des "Vormarsches", dessen Auflage auf 5000 Exemplare gesteigert werden konnte. Der NS-Studentenbund warb um den unter Studenten und Bündischer Jugend zugkräftigen Intellektuellen, um ihn als Veranstaltungsredner für sich zu gewinnen. Das Verbandsorgan der Ehrhardt-Anhänger und rechten Paramilitärs entwickelte sich zu einer übernational-antiimperialistischen Monatszeitung, die jedoch durch die wirtschaftliche Inkompetenz von Verlagsleiter Scherberning behindert wurde.
Dem Zeugnis Ernst von Salomons zufolge war der Hielscher-Kreis in seiner Anfangsphase jedoch ein Tummelplatz menschlicher Intrigen und Eitelkeiten. Im Herbst 1928 reagierte Hielscher auf die sich abzeichnende Bauernrevolte in Norddeutschland mit der schwächlichen Forderung nach Verminderung der Steuern und einer Agrarreform - offensichtlich hatte er das revolutionär-anarchistische Potential der entstehenden Landvolkbewegung nicht erkannt. Der verärgerte Salomon urteilte im Februar 1929: "Hielscher hat sich für mein Empfinden völlig ausgeschöpft, was er betreibt, ist Leerlauf, schade um ihn. Aber er erkennt das selber nicht, will die Dinge forcieren und erreicht dadurch erst recht nichts. Außerdem führt er einen absonderlichen Lebenswandel, der an seinen Nerven zehrt. Dabei haben die ganzen Leutchen...dickste Illusionen im Kopp..." Hielscher bilde sich ein, "man könne Politik ohne Macht, allein durch Geist und gute Verbindungen machen". Zugleich hielten die heftigen internen Auseinandersetzungen im Hielscher-Kreis mit Intrigen, Verleumdungen und Verdächtigungen an. Salomon kehrte dem "Vormarsch" daraufhin mit der Bemerkung, hier müsse noch einmal "bannig femegemordet" werden, den Rücken und schloß sich den Landvolkterroristen an.
Trotz eines Hitler-Verdikts gegen den "Vormarsch", der angeblich mit dem "asiatischen Bolschewismus" liebäugele, stellte sich der mächtige Gregor Strasser am 25. Oktober 1929 hinter die Gruppe. Ernst Jünger, Franz Schauwecker oder Friedrich Hielscher seien Beispiele für die steigende Tendenz, "daß der Nationalsozialismus beginnt, magnetgleich andere Kreise, andere bisher in ihrer Sphäre festgefügte, gleichwertige Geister an sich zu ziehen." Am gleichen Tag schrieb Hielscher in den "Kommenden": "Stoßen wir also bei unserer nationalistischen Arbeit auf politische Handlungen der russischen Außenpolitik, die gegen den Westen gerichtet sind, so werden wir diese Handlungen begrüßen und nach Möglichkeit fördern. Stoßen wir auf die kommunistische Ideologie selbst, die auf dem dialektischen Materialismus beruht, so werden wir ihr das idealistische Bekenntnis zur Deutschheit entgegenzustellen haben; und wir werden nicht zu vergessen haben, daß der Sozialismus, den wir wünschen, die Unterordnung der Menschen unter den nationalistischen Staat auf wirtschaftlichem Gebiet bedeutet, während der Sozialismus, den Marx anstrebt, das staatenlose, größtmögliche Wohlergehen der größtmöglichen Zahl will."
Im Sommer 1929 legte Hielscher die Chefredaktion des "Vormarsch" nieder, um sich einem eigenen Zeitschriftenprojekt und einem weltanschaulichen Grundlagenwerk zu widmen. Die Monatsschrift "Das Reich" sollte sich zu einem der maßgeblichen Blätter der nationalrevolutionären Szene entwickeln, in der die brillantesten Köpfe aus der Grauzone zwischen NSDAP und KPD zu Wort kamen. In der Rubrik "Vormarsch der Völker" gewährte man den antikolonialen Befreiungsbewegungen und ihren Vertretern breiten Raum, folgerichtig spielten auch vulgärgeopolitische Betrachtungen eine Rolle. Um die Jahreswende 1930/31 beteiligte Hielscher sich gemeinsam mit Jünger und Paetels Sozialrevolutionären Nationalisten an der Deutsch-Orientalischen Mittelstelle zur Förderung des antiimperialistischen Befreiungsnationalismus. Gelder beschaffte Franz Schauwecker vom Stahlhelm-nahen Frundsberg-Verlag, und neben dem altgedienten Putschisten F.W. Heinz sollte Schauwecker sich zu einem der enthusiastischsten Hielscher-Gefolgsleute entwickeln. Weitere Finanzmittel kamen vom unvermeidlichen Kapitän Ehrhardt. Die Debütausgabe des "Reiches" erschien am 1. Oktober 1930, und kein Geringerer als Ernst Jünger steuerte zur Eröffnung einen Beitrag bei.
Hielscher selbst schrieb in "Die letzten Jahre", Weimar und mit ihm die Wilhelminische Ordnung seien im Zerfall begriffen, es gehe wie seine Parteien bis hin zu NSDAP an Selbstzersetzung infolge von Unfähigkeit der Führer zugrunde. Die Weltwirtschaft kranke an der Weimarer Republik wie an einer unheilbaren Wunde. Asien blicke gärend auf Deutschland, von wo der Funke kommen sollte, der den letzten Sprengstoff entzündet: "Die Versuche des Westens, von der Wirtschaft her die kommende Gefahr zu bannen, verfangen nicht mehr. Die Mächte des Ostens tasten eine jegliche nach einem neuen Halt; aber keine hat die Lösung. Niemand weiß weiter. Und in dem deutschen Raum inmitten dieser tausendfältigen Verwirrung brodelt es unaufhörlich.
Hier ist der Ort und hier liegt die Aufgabe für die Menschen des Reiches, die durch den Weltkrieg hindurchgegangen sind; des heimlichen Reiches, das inmitten der Völker sichtbare Gestalt annehmen will. Wer dem Weltkriege seine Haltung und seine Zuversicht verdankt, weiß, daß er ein Sieg des Reiches gewesen ist, den Osten erweckend, den Westen zersetzend, den Zusammenbruch des wilhelminischen Fremdkörpers vorbereitend...
Die Wissenden erkennen sich auf den ersten Blick. Sie haben einander gefunden und finden sich weiter, seitdem die Verwandlung des Weltkrieges ihr Bewußtsein erfüllt hat. Seit dieser Zeit ist die Unruhe zur Arbeit geworden und die Suche zum Entdecken...Die Menschen des unsichtbaren Kerns haben einander entdeckt. Sie rühren keinen Finger gegen den Westen, der sich imn Staat der Weimarer Verrfassung so guit wie jenseits des Atlantischen Ozeans von selbst zerstört. Was heute Erfolg heißt, ist ihnen gleichgültig. Sie haben die große Geduld.
Denn die Entscheidung, die sich heute vorbereitet, liegt tiefer als irgend eine Entscheidung der bisherigen Geschichte. An ihr sind alle Mächte beteiligt. Der Weg zu ihr ist Bekenntnis und Staatskunst zugleich. Nur wo beides ineinanderwirkt, geschieht d a s R e i c h."
Neben dem "Reich" widmete Hielscher sich weiteren publizistischen Projekten, beispielsweise beteiligte er sich am 1931 von Goetz Otto Stoffregen herausgebenenen Sammelband "Aufstand - Querschnitt durch den revolutionären Nationalismus". Im Beitrag "Zweitausend Jahre" hieß es: "Das Kennzeichen, durch welches sich unsere Geschichte von der jedes anderen Volkstums unterscheidet, ist die wechselseitige Verschlungenheit von Innerlichkeit und Macht. Unsere Innerlichkeit enthält den Willen zur Macht; und unsere Macht enthält den Willen zur Innerlichkeit." Innerlichkeit und Machtwille wurden durch den Einbruch des Christentums getrennt. Der Weg der Innerlichkeit führt von der Ursage über Mystik, Reformation und Idealismus bis hin zu Nietzsche. Der Weg der Macht wiederum verlief von Theoderich den Großen über Heinrich VI von Hohenstaufen, Gustav Adolf und Friedrich den Großen bis zu Bismarck. Die wechselseitige Bezogenheit von Innerlichkeit und Macht hatte niemals aufgehört. Immer wieder erfolgten Anläufe, die Einheit beider Begriffe herzustellen, und unter der Macht des Reiches alle germanischen Stämme zu einen. "So ist nun in dreifachem Anlauf vor aller Augen das Ziel errichtet worden, das die Macht des Reiches zu verwirklichen bestimmt ist; und es bedarf der Waffe, mit der die Deutschen das ihnen jetzt sichtbare Ziel erreichen können. Diese Waffe heißt Preußen. Preußen ist kein Stamm, sondern eine Ordnung. Es gibt nur Wahlpreußen. Aus allen Stämmen des Reiches strömen die wagemutigsten, abenteuerlichsten, kriegerischsten Herzen zusammen; es entsteht der Staat Friedrich Wilhelms I und Friedrichs des Großen." Ziel war der Kampf gegen den westlichen Materialismus, "und gerade gegenüber diesem bereits in Deutschland eingedrungenen Gift."
"Ob Luther gegen Rom kämpft, oder ob Goethe den Beginn des Johannesevangeliums neu übersetzt: ‚Im Anfang war die Tat' - immer drängt die Innerlichkeit zum Tun; sie enthält den Willen zur Macht, die Sehnsucht, die das Amt herbeiglaubt und die Menschen zum Werke drängt.
In Nietzsche vollends wird dieser Drang zum bewußten Wollen: die Innerlichkeit erkennt ihr Getriebenwerden als Willen zur Macht." Nietzsche forderte den "ins Geistige gesteigerten Fridericianismus", bindet dieses neue Menschentum an Gestalten wie Friedrich II von Hohenstaufen und Friedrich II. den Großen. Auf Nietzsche und Bismarck folgte der Weltkrieg, der "trotz der scheinbaren Niederlage den größten Sieg bedeutet, den Deutschland jemals errungen hat". "Zum ersten Mal, seit die Erde steht, gibt es keine voneinander abgetrennten Kampffelder mehr, so wie es z.B. den ostasiatischen, den vorderasiatischen oder den Kulturkreis des Mittelmeeres gegeben hat, sondern die Erde ist ein einziges Schlachtfeld geworden, ein Chaos, in welchem alle Kräfte zugleich um den Sieg streiten, ein Chaos, das alle Kräfte durch diesen Streit verwandelt und von Grund auf umschöpft."
 Im gleichen Jahr legte Friedrich Hielscher sein mit Hilfe des Frundsberg-Verlages herausgebenes Grundlagenwerk "Das Reich" nach. Ein Volk entsteht Hielscher zufolge aus der Gemeinschaft von Schicksal und Bekenntnis. Das Blut erhält seinen Rang durch eine Entscheidung und nicht durch die Biologie. Deutschtum/Deutschheit leiten sich nicht durch Abstammung und staatliche Definition, ab, sondern aus Gesinnung und Glauben. Der Reichsbegriff wird vom politischen zum religiös-metaphysischen, in der Geschichte wirkenden Prinzip einer föderativen Ordnung Europas - unter Führung des preußischen Geistes. Die Nationalstaaten sollten sich in Stämme und Landschaften auflösen, und aus diesen verkleinerten Einheiten war etwas Größeres zu schaffen, das über die Nationalstaaten hinausging.
Im gleichen Jahr legte Friedrich Hielscher sein mit Hilfe des Frundsberg-Verlages herausgebenes Grundlagenwerk "Das Reich" nach. Ein Volk entsteht Hielscher zufolge aus der Gemeinschaft von Schicksal und Bekenntnis. Das Blut erhält seinen Rang durch eine Entscheidung und nicht durch die Biologie. Deutschtum/Deutschheit leiten sich nicht durch Abstammung und staatliche Definition, ab, sondern aus Gesinnung und Glauben. Der Reichsbegriff wird vom politischen zum religiös-metaphysischen, in der Geschichte wirkenden Prinzip einer föderativen Ordnung Europas - unter Führung des preußischen Geistes. Die Nationalstaaten sollten sich in Stämme und Landschaften auflösen, und aus diesen verkleinerten Einheiten war etwas Größeres zu schaffen, das über die Nationalstaaten hinausging.
Ergänzend heißt es in "50 Jahre unter Deutschen": "In Wahrheit muß...im Innern des Menschen angefangen werden, im eigenen zuerst und dann im Bunde mit denen, die des gleichen Willens sind. Aber das ist mit keiner noch so reinen Sittlichkeit zu schaffen, schon gar mit keiner Moral und vollends nicht mit Anordnungen und Vorschrift." Sondern nur der Glaube "gibt uns das Gesetz als das Gebot der Götter"
"Das Reich": "Die schöpferische Kraft kann nicht auf dem einen Gebiet wirken und auf dem anderen nicht. Sie kann nicht vor dem Alltag halt machen oder vor den Umständen oder der Not. Sie erfüllt den ganzen Menschen. Er mag anpacken, was er will, er mag versuchen, sich in nichtige Dinge zu flüchten: Die schöpferische Kraft folgt ihm, sie treibt ihn weiter, und am Ende erkennt er, daß alles, was er angefaßt hat und was ihm begegnet ist, notwendig und gut gewesen ist um seines Werkes willen, für das er lebt, für das er gelebt wird, das durch ihn hindurch wirkt. Darum bilden alle Menschen, hinter denen ein und dasselbe Wesen steht, nicht auf irgendwelchen einzelnen Gebieten, sondern ihr ganzes Leben hindurch, in jeder Hinsicht unabdingbar eine Einheit des Wirkens. Es müssen ein und dieselben Ereignisse sein, die sie fördern oder hemmen: ein und dieselben Begegnungen müssen für sie Tiefe oder Licht bedeuten: sie haben dasselbe Schicksal, das heißt aber: sie sind ein Volk. Kein Ding in Raum und Zeit bindet endgültig: nicht die Abstammung, nicht die Sprache, nicht die Umgebung. Dem alleine steht der einzelne frei gegenüber. Allein seine schöpferische Kraft, die seinen Willen überhaupt erst bildet, aus dem sein Wille in jedem Augenblick gebildet wird, bindet ihn notwendig, sie ist der Kern seines Wesens. Damit unterscheidet sich ein Volk von einem bloßen Abstammungsverband und von jeder Verbindung, die nur durch äußere Umstände zusammengehalten wird...Nur die seelische Besessenheit durch dieselbe schöpferische Kraft gestaltet aus einer Vielheit vertretbarer Menschen ein Volk, indem ein und dieselbe Wirklichkeit durch die Tat bezeugt wird. Das Volk ist Einheit des Bekenntnisses und des Schicksals. (...) Geduld ist die oberste Tugend dessen, der verwandeln will. Wer keine Geduld hat, erreicht nichts.
Die Entscheidung, die sich hier vorbereitet, bedeutet die vollkommene Vernichtung der heutigen Ordnungen und Güter; und es ist an der Zeit, mit jenen hoffnungslosen Gedanken aufzuräumen, die noch retten wollen, was zu retten ist. Es ist nichts mehr zu retten. Alle äußeren Gestaltungen der Gegenwart brauchen und unterstützen die westliche Verfassung des öffentlichen und des Einzellebens. Sie setzen die Heiligkeit des uneingeschränkten Eigentums voraus, den Verdienst als treibenden Anreiz des Handelns und die Wohlfahrt aller als Ziel der Gemeinschaften. Hier darf nichts gerettet werden. Die inneren Güter aber, die nicht des Westens, sondern des Reiches sind, sind unzerstörbar. Wer sie für gefährdet hält, kommt für die deutsche Zukunft nicht in Frage. Denn er glaubt nicht an sie. Wer glaubt, zweifelt nicht.
Die Vernichtung dessen, was heute besteht, ist sogar notwendig. Denn daß der Westen die Entscheidung gerade in dem Raume zwischen Rhein und Weichsel sucht, liegt an dem Rang, den dieses Gebiet innerhalb der - westlichen - Weltwirtschaft besitzt. Weil China, Indien und Rußland bereits zum größten Teile aus ihr heraus gefallen sind, darf sie Deutschland nicht auch noch verlieren, um keinen Preis. Sonst ist sie selbst verloren. Darum setzt der Untergang des Westens die Vernichtung dessenh voraus, was heute Deutschland heißt, was mit dem Wesen des Reiches nur mehr den Namen gemeinsam hat.
Die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges werden gering vor dieser Zukunft. Er hat die Erde noch nicht aufgerufen. Aber der Erste Weltkrieg hat es getan; und dadurch wird die Wucht der nächsten Jahre, der nächsten Jahrzehnte, der nächsten Jahrhunderte größer, als die der fünftausend Jahre bewußter Erdgeschichte, auf die wir zurückblicken können. Wer von dem Werke, das ihm obliegt, die Erhaöltung und Bewahrung überkommender Dinge erwartet, zeigt nur, daß er die Größe der Verwandlung nicht erkannt hat, in der die Völker seit 1914 leben.
Es gibt heute keine sichtbaren Werte des Reiches. Es lebt inwendig in den Herzen; oder es würde nicht leben.Zerschlagen muß das Eigentum werden, das dem Westen gehört, das den westlichen Menschen gehört. Der Westen würde längst besiegt sein, wenn er nicht die Geister der Menschen gefangen hätte, wenn nicht wirklich jeder, der um seines Vorteiles willen lebt, damit zum Werkzeuge, zum Untertan und Helfer des Westens würde. Zerschlagen muß die ständische Haltung werden, weil die hierarchische Befriedung der Stände, die - gutgläubig oder nicht gutgläubig - vom Süden her verkündet wird, nur der pax Romana, der friedevollen Herrschaft Roms sich einfügt, welche die Völker dem Heiligen Stuhle unterwirft, und weil die Ziele Roms mit denen des Westens gemeinsam auf die Erhaltung des Staates der Weimarer Verfassung gerichtet sind. Zerschlagen muß die Möglichkeit der kolonialen Ausdehnung werden, weil der Herrschaftsanspruch des Reiches nichts mit dem kolonialen Märktekampf zu tun hat, weil, nicht nur der Begriff der ‚Kolonie', sondern auch jedes koloniale Streben dem Willen zur prosperity und nicht dem Willen zur Macht dient.
Man darf gewiß sein, daß die allernächsten Jahre diese Vernichtung vorbereiten und fördern werden. Jener Gleichlauf der Selbstzersetzung des Westens und des Aufbaus der Reichszellen, jene langsame und zögernde Annäherung zweier Bahnen, die sich erst im Augenblick der Entscheidung überschneiden, deren Überschneidung der entscheidende Augenblick ist, prägt sich bereits heute - und von Tag zu Tag mehr - in der Verelendung des Volkes aus. Es wird nicht fünf Millionen, sondern fünfundzwanzig Millionen Arbeitslose geben. Es wird nicht mehr Haß und Hoffnung geben, sondern nur noch Verzweiflung und Zuversicht.
Diese Zuversicht, welche die kommende Vernichtung bejaht, glaubt an das unvernichtbare ewige Wesen des Reiches. Sie weiß, daß im Wandel der sichtbaren Geschichte immer nur die unsichtbare Wirklichkeit lebt. Sie weiß, daß eine jede Kraft des Ewigen selber unwandelbar und ewig ist, und daß kein Werk, kein schöpferisches Tun um des zeitlichen Seins willen geschieht, sondern immer und nur um der Macht des Reiches willen, welches sein zeitliches Reden und Schweigen, Tun und Stillesein, sichtbares oder verborgenes Bildnis heraufführt, wie es ihm beliebt. Das kriegerische Herz verwechselt die zeitliche Erhaltung nicht mit der göttlichen Unsterblichkeit. Es ist unsterblich und freut sich der zeitlichen Vernichtung als der Bürgschaft seiner unüberwindlichen Gewalt. Der Untergang, dem sich die Deutschen, und das heißt immer und immer wieder: die Menschen des Reiches, heute aussetzen, führt die Freiheit herauf, um die seit der ersten Schlacht des Ersten Weltkrieges gekämpft wird, die Freiheit, welcher als erwünschtes Werkzeug der Westen selber dient, dessen Griff über die Erde das Zeitalter der großen Kriege des Reiches ermöglicht."
5. Unterirdisch im Dritten Reich
Die Nationalisten alten Schlages und die KPD konnten hier begreiflicherweise nicht folgen. Ernst Niekisch urteilte: "Das ist ja nicht mehr Nationalismus". Alfred Kantorowicz erkannte in der Vossischen Zeitung am 14. September 1931 als einer der wenigen, wohin die Reise ging: Das sei weder Politik noch Philosophie, sondern Theologie. Otto-Ernst Schüddekopf bemerkt sehr treffend, die Disproportion zwischen dem engen deutschen Nationalismus des 19. Jahrhunderts und den heraufnahenden globalen Machtkämpfen suchte man im radikalen Nationalismus Weimars zu überwinden. Der Sprung in die Freiheit durch die Idee des "Reiches" der Deutschheit, die mit den Voraussetzungen des deutschen Nationalstaates nichts mehr zu tun hat - der Nationalsozialismus bedeutete demgegenüber einfach Reaktion. Kollektivistisches Denken und bolschewistische Lebensform wurden als typenbildende Kraft akzeptiert. So konnte man die alten Massenparteien aus den Angeln heben und sich selbst als die die Zukunft des Reiches bestimmende Kraft definieren.
Nach der NS-Machtergreifung stellte Friedrich Hielscher die Herausgabe des "Reiches" ein, um sich der unterirdischen Arbeit gegen den Hitlerismus zu widmen. Ziemlich zutreffend rechnete er mit einer Dauer des Tausendjährigen Reiches von ca. 12 Jahren, während der Großteil der nationalrevolutionären Parteigänger Hitler zu diesem Zeitpunkt nicht ernst nahm. Während Persönlichkeiten wie Schauwecker sich der neuen Ordnung anpaßten, blieben Friedrich Hielscher, die Gebrüder Jünger und Ernst Niekisch als intellektuelle Kristallisationspunkte des nationalrevolutionären Untergrundes. Der Hielscher-Zirkel entwickelte sich zu einer kleinen Untergrundzelle, zu der auch der ehemalige Ehrhardt-Adjutant Franz Liedig gehörte. Über Liedig und August Winnig hielt die Gruppe lockeren Kontakt zu oppositionellen Militärs. Verbindungen bestanden zur sozialdemokratischen Gruppe um Mierendorff, Leuschner, Haubach und Reichwein.
Von größerer spiritueller Bedeutung war die 1933 nach dem Umzug nach Potsdam erfolgte Gründung der Unabhängigen Freikirche UFK als heidnisch-pantheistischer Glaubensbewegung auf indogermanischer Grundlage: "Ich glaube an Gott den Alleinwirklichen. Ich glaube an die ewigen Götter. Ich glaube an das Reich." Heidnische Elemente aus der deutschen Klassik und Romantik wurden mit dem ketzerischen Pantheismus eines Johannes Scotus Eriugenas, Nietzsche und dem überlieferten keltisch-germanischen Volksglauben verknüpft zu einer sehr bald für Außenstehende äußerst schwer zu erfassenden theologischen Einheit. Die Theologie der UFK war kein statisches Gebilde, sondern wie das Reich eine dynamisch weiterzuentwickelnde Aufgabe.
1934 beteiligte Hielscher sich am von Curt Horzel herausgegebenen Sammelband "Deutscher Aufstand" und veröffentlichte wahrhaft prophetische Sätze: "Erster Satz: Der wilhelminische Staat hat den Krieg verloren, aber Deutschland hat ihn gewonnen.
Zweiter Satz: Deutschland hat den Krieg nicht nur dadurch gewonnen, daß es neue innere Kraftquellen erschlossen hat, sondern auch durch die Erschütterung der ganzen Erde, durch die alle Voraussetzungen aller Völker ins Wanken geraten sind.
Dritter Satz: durch die von Deutschland ausgehende Erschütterung ist es zum entscheidenden Lande auch des vor uns stehendem Zweiten Erdkrieges geworden." Diesen hatten schon Nietzsche, Trotzki und Ludendorff prophezeit. "Es leuchtet ein, daß dort, wo alle Kräfte sich überschneiden, die Entscheidung fallen muß." Der Kampf zwischen Imperialismus und Revolution wird hier ausgefochten, zwischen Bolschewismus und Hochkapitalismus, zwischen Asien und West. Deutschland als Land der Mitte sucht nach einer Synthese zwischen den Gegensätzen. Als Ausweg forderte Hielscher den Kontinentalblock Deutschland-Sowjetunion-China.
Eine beinahe antik anmutende Tragödie nahm ihren Anfang, als Hielschers Freund und Schüler Wolfram Sievers 1935 zum Geschäftsführer der SS-nahen Kulturstiftung Ahnenerbe avancierte. Die völkisch-indogermanischen Elitevorstellungen der Hielscher-Gruppe trafen sich durchaus mit denjenigen der SS. Hatte Hielscher sich in den Elfenbeinturm zurückgezogen, so versuchte der aktivistische Praktiker Sievers nun, das Konzept in die Tat umzusetzen und geriet außer Kontrolle. Zunächst beteiligte der Geschäftsführer sich daran, das bäuerlich-defensive Element des Reichsnährstandes aus dem Ahnenerbe hinauszudrängen und stattdessen dem soldatischen Charakter der SS-Ideologie mehr Platz zu verschaffen. Von Bedeutung war neben frühgeschichtlichen, volkskundlichen und indogermanologischen Forschungen z.B. der Versuch, die deutschen Hochschulen zwecks Schaffung eines neuen wissenschaftlichen Geistes von der Schutzstaffel infiltrieren zu lassen. Im Januar 1941 legte Sievers in einem internen Memorandum die Ziele der Erforschung von Raum, Geist und Tat des nordischen Indogermanentums dar: "Hauptziel ist es, vom Kulturellen her in Deutschland selbst das Reichsbewußtsein neu zu wecken, bezw. zu vertiefen, von dessen einstiger Größe beispielsweise ein Straßburger Münster, die Prager Burg, das Fuggerhaus auf dem Warschauer Altmarkt, die flandrischen Tuchhallen noch heute Zeugnis ablegen über Jahrhunderte hinweg, in denen das Reich schwach und im böhmisch-mährischen Raum, in den Niederlanden, im Flamentum, in der Schweiz das Gefühl der Zugehörigkeit zum Reich verloren gegangen war. Es wird notwendig sein, die Verbindungen bloß zu legen, die dennoch niemals abgerissen sind, die Überfremdung durch Kirche, Liberalismus, Freimaurerei und Judentum hinwegzuräumen und die Wiedervereinigung der Menschen germanischen Blutes im Reich zu erleichtern, das - lange seiner selbst durch internationale Ideologien entfremdet - trotz allem germanische Art am stärksten gewahrt hat."
Mit Kriegsausbruch verstrickte das Ahnenerbe sich in kulturelle Beutezüge im besetzten Europa und in verbrecherische Menschenversuche, die Sievers nach dem Zusammenbruch die Hinrichtung einbringen sollten. Immerhin gestattete die Tätigkeit für das Ahnenerbe ab 1937 auch Hielscher, unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Aufträge umherzureisen und Verbindungen zu Oppositionellen zu halten. Am 2. September 1944 wurde er in Marburg wegen seiner Beziehungen zu Mitverschwörern des 20. Juli verhaftet und ins Berliner Männergefängnis an der Lehrterstraße verbracht. Die Gestapo übersah die Beziehungen zu Franz Liedig oder Hartmut Plaas und interessierte sich vor allem für die Kontakte zu Haubach, Reichwein und dem Grafen von der Schulenburg. Der alarmierte Sievers erwirkte am 19. Dezember 1944 die Haftentlassung. Hielscher mußte sich zur Frontbewährung melden, die er bei einer Ersatz-Nachrichtenabteilung verbrachte, ohne auch nur einen Schuß abzugeben. Nach dem Zusammenbruch konzentrierte Friedrich Hielscher seine wissenschaftliche und weltanschauliche Arbeit auf das studentische Verbandsleben und die Unabhängige Freikirche.
"Der Blick auf die Vergangenheit lehrt uns die Notwendigkeit, der Blick in die Zukunft lehrt uns die Freiheit. Die Vergangenheit zeigt, was vorgegeben, die Zukunft, was uns aufgegeben ist. Die Zeit ist weder unser Herr, noch unser Feind oder Freund, sondern die Zeit sind wir selber als die Wandelnden und sich Verwandelnden, und jeder ist es zu seinem Teile. Wer also der Zeit absagt, sagt damit entweder anderen ab oder sich selbst und seiner eigenen Aufgabe. Und zwar Anderen, die heute so herrschen, wie man nicht herrschen sollte, oder sich, indem er jenen gehorcht.
Das Zweite liegt uns fern. Und damit sind wir gebunden, der unrechten Herrschaft die Wurzel abzugraben. Also doch gebunden? Jawohl; und wir haben nur die Wahl, entweder gebunden im Gewissen und damit frei vor der Welt, oder unverbindlichen Gewissens und damit der Welt untertan zu leben.
Auch ist festzuhalten, daß die Freiheit oder Untertänigkeit vor der Welt von anderer Art ist als die Gebundenheit oder Ungebundenheit des Gewissens. Dort geht es um unsere Bewegungsfreiheit, die wir zu verteidigen oder preiszugeben uns entschließen müssen, hier um unsere Willensfreiheit, mit der wir uns an das binden oder nicht binden, was uns im Gewissen geboten ist.
Und verknüpft sind beide, die Willens- und die Handlungsfreiheit, nur insoferne, als sich über kurz oder lang der zweiten begibt, wer die erste mißbraucht." (Fünfzig Jahre unter Deutschen)
Literaturhinweise:
Peter Bahn: Glaube - Reich - Widerstand. Zum 10. Todestag Friedrich Hielschers, in: wir selbst 1-2/2000
Louis Dupeux: "Nationalbolschewismus" in Deutschland 1919-1933, München 1985
Friedrich Hielscher: Innerlichkeit und Staatskunst, Arminius 26.12.1926
Friedrich Hielscher: Der andere Weg, Arminius 30.01.1927
Friedrich Hielscher: Die Faustische Seele, Arrminius 13.02.1927
Friedrich Hielscher: Die Alten Götter, Arminius 20.02.1927
Friedrich Hielscher: Für die unterdrückten Völker! Arminius 20.03.1927
Friedrich Hielscher: Fünfzig Jahre unter Deutschen, Hamburg 1954
Friedrich Hielscher: Das Reich, Berlin 1931
Curt Hotzel: Deutscher Aufstand, Stuttgart 1934
Michael H. Kater: Das "Ahnenerbe" der SS 1935-1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart 1974
Markus Josef Klein: Ernst von Salomon. Eine politische Biographie, 1994 Limburg an der Lahn
Susanne Meinl: Nationalsozialisten gegen Hitler. Die nationalrevolutionäre Opposition um Friedrich Wilhelm Heinz, Berlin 2000
N.N.: Das Innere Reich, in Sturmgeweiht, Ausgabe Sommer 1995
Karl O. Paetel: Versuchung oder Chance? Zur Geschichte des deutschen Nationalbolschewismus, Göttingen 1965
Otto Ernst Schüddekopf: Linke Leute von Rechts. Nationalbolschewismus in Deutschland von 1918-1933, Stuttgart 1960
Sonnenwacht. Briefe für Heiden und Ketzer, Ausgabe 12, 2000
Goetz Otto Stoffregen (Hrsg.): Aufstand. Querschnitt durch den revolutionären Nationalismus, Berlin 1931
ZIRKULAR, Ausgaben 1 bis 3, 2001
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, allemagne, années 20, années 30, années 40, philosophie, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 novembre 2009
Promotie over Heidegger en Jünger
Promotie over Heidegger en Jünger bereidt nieuw soort denken voor
Voorsprong na techniek
Thomas Blondeau / http://www.vincentblok.nl/
Afgelopen week promoveerden twee filosofen aan wat gekscherend wel eens de ‘Leidse Heideggerschool’ genoemd wordt. Mare sprak met één van hen. Dr. Vincent Blok over zijn proefschrift dat in een confrontatie tussen schrijver Ernst Jünger en filosoof Martin Heidegger een omwenteling van de menselijke bestaanswijze voorbereidt.
 De Duitse filosoof Martin Heidegger (1889 – 1976) zag zich vanaf het allereerste begin van zijn denken, geconfronteerd met de alomtegenwoordigheid van de techniek. Zijn inzet is geweest om een antwoord op het wezen ervan te formuleren.
De Duitse filosoof Martin Heidegger (1889 – 1976) zag zich vanaf het allereerste begin van zijn denken, geconfronteerd met de alomtegenwoordigheid van de techniek. Zijn inzet is geweest om een antwoord op het wezen ervan te formuleren.
De Duitse schrijver Ernst Jünger (1895 – 1998) formuleerde in zijn boek Der Arbeiter hoe het mensenslag van de arbeider in een technische wereld nihilisme kan overwinnen en de ontdekker kan zijn van nieuwe filosofische horizonten.
In zijn proefschrift Rondom de vloedlijn. Filosofie en kunst in het machinale tijdperk, een confrontatie tussen Heidegger en Jünger dat verleden week verdedigd werd, betoogt dr. Vincent Blok in navolging van Heidegger dat techniek alomtegenwoordig is en geen uitzondering toelaat. Ook protest tegen deze heerschappij is doortrokken van techniciteit. Wil de mens kunnen nadenken over techniek zonder ermee samen te vallen, dan moet worden gevraagd naar onze methode van spreken. Hier komt de filosofie van Heidegger en het dichten van Jünger om de hoek kijken. Hoewel het stellen van vragen in techniek gemarineerd is, toch een paar vragen aan Blok.
Wat heeft u bewogen tot het schrijven van dit proefschrift?
‘Vroeger begreep ik mijn eigen doen en laten in termen van het anti-imperialisme. Ik zat in de kraakbeweging en hielp mee met acties tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid. Aan mijn anti-imperialistische houding lag de ervaring van de principiële “onwaarheid” van het imperialisme ten grondslag, en het ideaal van een alternatieve bestaanswijze die niet aan machtsuitoefening gebonden was. Als je op een gegeven moment bemerkt dat het imperialisme van bedrijven en staten een politiek-economische vertaling is van de struggle for existence als aard van het leven, dan is het anti-imperialisme geen reële optie meer. Ook het anti-imperialistisch verzet is dan doortrokken van de struggle for existence, dus van imperialisme. De ‘onwaarheid’ van het imperialisme kan dan alleen nog worden getoetst door de filosofische vraag naar het wezen van de macht. Zo ben ik tot mijn bezinning op het wezen van het imperialisme in het proefschrift gekomen.’
 Martin Heidegger Kun je de vraag van het proefschrift samenvatten in hoe men in het tijdperk van de techniek nog kan denken en dichten?
Martin Heidegger Kun je de vraag van het proefschrift samenvatten in hoe men in het tijdperk van de techniek nog kan denken en dichten?
‘Als je vraagt naar het wezen van de macht, dan is niet duidelijk hoe je spreekt. Een uitspraak over het wezen van de macht die zelf van machtswellust doortrokken is, heeft haar onderwerp al in de rug. Ik kan dit misschien illustreren aan de hand van een voorbeeld.
‘Als ik zeg: “de huidige tijd is van een diepe slaap doortrokken”, dan heb ik twee mogelijkheden. Ofwel mijn uitspraak behoort tot de slaperige tijd, waarmee ze het risico loopt zelf slaperig en daarmee onwaar te zijn. Ofwel mijn uitspraak behoort niet tot de slaperige tijd, wat de uitspraak daarover ondermijnt. Klaarblijkelijk is de tijd niet zo slaperig, want deze uitspraak erover staat er buiten.
‘Hier ligt dan ook de grond om aan te sluiten bij het denken van Heidegger. Hij pretendeert een methode van denken te hebben gevonden die kan nadenken bij de techniek zonder ermee samen te vallen en zonder een alternatief of uitweg te zoeken. Het zijn de Leidse filosofen van Dijk en Oudemans geweest, die dit methodische karakter van het denken van Heidegger hebben opgenomen en tot zwaartepunt van het hedendaagse filosofisch nadenken hebben verklaard. Dat wordt dan wel eens gekscherend de Leidse Heideggerschool genoemd.’
Rondom de vloedlijn is de titel van het proefschrift. Waarom? Vanwege de ambiguïteit die het uitdrukt?
‘Het vervelende van een methodisch denken is dat het ook direct voor dit interview opgaat. Ik bemerk bij mijzelf de tendens om verhaaltjes op te hangen. Daar kan de filosofie natuurlijk niet in bestaan. Ik zal toch iets proberen te zeggen.
‘Uw vraag is welke ambiguïteit het woord ‘vloedlijn’ uitdrukt. Een antwoord op die vraag stelt die ambiguïteit voor, dat wil zeggen dat ze present wordt gesteld voor de lezer. Daarmee is de ambiguïteit zelf bij voorbaat al vernietigd en opgeheven. Wat is dat voor tendens in al onze vraag- en probleemstellingen, dat ze erop zijn aangelegd de zaken te verhelderen en beschikbaar te stellen? In die zucht tot presentie – en dat is wat techniek is - onttrekt zich de ambiguïteit, zo zou je kunnen zeggen.
‘Precies die verhouding tussen presentie en onttrekking speelt bij een vloedlijn. Een vloedlijn markeert niet de hoogste lijn van het water op het strand. In de vloedlijn onttrekt de vloed zich door achterlating van een lijn van schelpen en strandresten. Aan de vloedlijn kun je het afscheid van de vloed bemerken, zonder dat je daarover uitspraken kunt doen. Vandaar dat je alleen kunt verkeren in de nabijheid, rondom de vloedlijn. Daarmee is de aard van het methodische denken bij de techniek aangeduid.’
In uw proefschrift noemt u het werk van Jünger ‘dichten’? Zijn werk bestaat toch niet uit gedichten?
‘Jünger noemt zijn eigen manier van spreken Dichtung in zijn hoofdwerk Der Arbeiter. Ik benadruk dit omdat in zijn spreken een ambiguïteit schuilgaat. Heidegger zegt dat Jünger van voor tot achter schatplichtig is aan de metafysica van de wil tot macht bij Nietzsche.
‘Hoewel hij gelijk heeft in zijn plaatsbepaling van Jünger, ziet hij daarmee de andere zijde van Der Arbeiter over het hoofd, namelijk het dichterlijke van de gestalte van de arbeider. Waarom zou dit dichten niet thuishoren in het voor- en daarmee presentstellen?
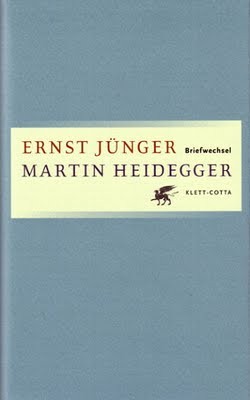
‘Daarmee wordt duidelijk waar het in Der Arbeiter om draait, namelijk het dichten als naamgeving. Dat is een mogelijke weg van de kunst in ons technisch tijdperk.’
U zegt dat het dichten en denken van Jünger en Heidegger in het teken van een overgang van de menselijke bestaanswijze bestaat. Waarin bestaat die overgang? En zag Heidegger die niet op een gegeven moment in het nationaal-socialisme?
‘Heidegger zegt dat wij de vanzelfsprekende bepaling van de mens als het denkende subject moeten verlaten, willen wij oog krijgen voor ‘onze verhouding tot het wedervarende’, de betrekking die altijd al bij voorbaat onze omgang met de dingen structureert. Voor het subject is elke bepaling subjectief of objectief, terwijl hij geen oog heeft voor de subject-objectverhouding die zijn bestaanswijze bij voorbaat altijd al heeft getekend.
‘Deze omwenteling van de menselijke bestaanswijze is niet zondermeer door te voeren. Ze is niet een beslissing van de mens als het denkende subject, maar vergt volgens Heidegger een ‘Anspruch’ (=appel, TB) die door het denken alleen kan worden voorbereid.’
In de jaren dertig dacht hij dat het moment van de omwenteling aangebroken was. Nadat hij rond 1938 inzag dat de nationaal-socialistische revolutie van Hitler niets te maken had met de door hemzelf beoogde omwenteling, verschoof hij haar naar een übernächste Generation. In dat opzicht is ook mijn eigen denken in het proefschrift voorbereidend van aard.’
Gaat u ervan uit dat in deze ‘tijd van onbehagen’ een absoluut nihilisme heerst? Probeert u op deze toestand een antwoord te formuleren?
‘U wijst met deze zinsnede op de titel van het boek van Ad Verbrugge. Wat hij cultuurverlies noemt en de heerschappij van het consumentisme, wijst op de ervaring van het nihilisme als onze ‘Normalzustand’. Ik deel zijn intuïtie van de ‘onwaarheid’ van de mens als consument van harte. Voor mij is evenwel de vraag waar in de wereld je bevestiging voor deze intuïtie kunt vinden. Ik ervaar geen tijd van onbehagen, want het nihilisme reikt zo ver dat het de cultuurkritiek evoceert en ook de oplossing voor elk onbehagen aanreikt. Voor mij speelt hier primair het methodische vraagstuk hoe ik kan nadenken bij het nihilisme.
‘Ik mag dat misschien illustreren aan de hand van het boek van Verbrugge. Hij wijst op onze wereld van de consumentistische behoeftebevrediging en zegt tezelfdertijd dat ‘in de mens de behoefte leeft aan een ‘zin’ die groter is dan hijzelf. Mijn vraag is dan of deze behoefte aan zin nu weer onderdeel uitmaakt van de behoeftebevrediging? ‘Is die gemeenschapszin als gedeelde dimensie er, of is het een bevredigde consumentistische behoefte? Volgens mij zou het verschil tussen zijn authentieke vraagstelling en de consumentistische behoeftebevrediging daarin moeten bestaan, dat hij uitziet naar een zin die als zodanig verre is, om zo de nabijheid ervan te ontberen. ‘Dit ontberen kent de consumentistische behoeftebevrediging niet. Die blijft nimmer onbevredigd achter en slokt alles op in een alomtegenwoordige beschikbaarheid.
Ik hoop dat hiermee duidelijk wordt waar voor mij het zwaartepunt ligt. Het is jammer dat die titel op de achterflap van mijn boek is gekomen, want ik wil mijn eigen denken helemaal niet in oppositie met Verbrugge gedefinieerd zien.’
Dit boek is een must voor kunstenaars, filosofen en anderen die vragen wat de mens vermag in ons machinale tijdperk.’ Dat staat te lezen in de perstekst die uw promotie begeleidt. Waarom is het boek een must?
‘Ik verwees net naar het nihilisme als onze ‘Normalzustand’. Ik geloof niet dat de vraag daarnaar minder speelt in de kunsten dan in de filosofie. Mijn boek onderscheidt zich doordat het geen alternatieven zoekt maar een nuchtere confrontatie zoekt met de techniek. Het laat zien wat filosofie en kunst vermag in ons technisch tijdperk en schetst daartoe een weg van het denken en een weg van de kunst en confronteert die met elkaar.’
In uw nawoord schrijft u dat de Amerikaanse bombardementen op Irak en de Al-Qaida aanslagen secundair zijn ten opzichte van de vraag naar het filosofische principiële, de semantische grond ervan. Is het niet schizofreen om dat te moeten zeggen, terwijl u tegelijkertijd in uzelf de neiging bespeurt om zich af te vragen of dergelijke aanslagen niet het teken zijn van ‘een breuk tussen de Westerse beschaving en een nieuw barbarendom’?
‘Een schizofrenie duidt op een gespletenheid, waarbij de remedie gevonden wordt in de opheffing ervan. Daardoor ontstaat eenheid en helderheid. In de filosofie gaat het erom empirisch te blijven, dat wil zeggen dat ik bij die gespletenheid zelf blijf zonder hem op te willen heffen. Nu is de vraag of ik niet evengoed de gespletenheid ophef door de aanslagen van Al-Qaida tot een secundair verschijnsel te reduceren. Voor mij is volstrekt duidelijk dat de heftigheid van de aanslagen van 11 september slechts aangeven hoezeer de islamitische samenleving wordt bedreigd – uiteindelijk wil ook elke Afghaan een televisie en een koelkast. Maar afgezien van dit voorbeeld heeft u wel een punt. Het is de vraag of het filosofisch principiële noodzakelijkerwijze de reductie van de ‘zijnden’ tot secundaire verschijnselen impliceert. Ik herinner mij dat Heidegger ergens spreekt van een aanval op het wezen van de mens door de middelen van de techniek, dat wil zeggen technische instrumenten. Daar zouden we ons verder op moeten bezinnen.’
Van dit stuk verscheen een kortere versie in de papieren versie van Mare 29.
Vincent Blok
Rondom de vloedlijn, Uitgeverij Aspekt. € 22,95
Te bestellen via www.vincentblok.nl
Promotie was 20 april 
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres allemandes, littérature allemande, lettres, littérature, allemagne, révolution conservatrice, technique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 novembre 2009
Bodo Uhse - im Spannungsfeld von Nationalem Sozialismus und sozialistischem Patriotismus
 Bodo Uhse – im Spannungsfeld von Nationalem Sozialismus und sozialistischem Patriotismus
Bodo Uhse – im Spannungsfeld von Nationalem Sozialismus und sozialistischem Patriotismus
Verfasser: Richard Schapke, Juni 2002
"Eine Eigenschaft vor allem ist nötig, Mut, Mut zur Eroberung wie zum Verzicht, Mut zur Erkenntnis, sei sie auch noch so schmerzlich, peinigend und bitter. Du musst es wagen, mit dem Herzen zu denken und mit dem Kopf zu fühlen. Von den Deutschen haben das nur wenige gekonnt."
- Bodo Uhse
Gegenstand dieses Aufsatzes ist die Person des Schriftstellers und Publizisten Bodo Uhse. Im Verlaufe seiner höchst bemerkenswerten Vita gelang es Uhse, seinen Lebensweg vom Teilnehmer des Kapp-Putsches bis hin zu einem der führenden Kulturpolitiker der Deutschen Demokratischen Republik zu gehen. Unsere Darstellung beruht auf Bodo Uhses romanartiger Autobiographie "Söldner und Soldat", auf Klaus Walthers dem Protagonisten gewidmeten Bändchen der DDR-Reihe "Schriftsteller der Gegenwart", zeitgenössischen Quellen aus Weimarer Zeiten und nicht zuletzt diversen Publikationen zum Nationalbolschewismus der 20er und 30er Jahre. Die kursiv gesetzten Zitate stammen, sofern nicht anders angegeben, aus der Feder Bodo Uhses
1. Jugendzeit im Bund Oberland
Bodo Uhse wurde am 12. März 1904 als Sohn eines preußischen Berufsoffiziers in der Garnisonstadt Rastatt geboren. Infolge der zahlreichen Versetzungen des Vaters verlief seine Kindheit in relativ unregelmäßigen Bahnen, wozu auch die Trennung der Eltern ihr Scherflein beigetragen haben mag. Nach jahrelangem Unterricht durch Privatlehrer kam Uhse erst 1914 in den fragwürdigen Genuss eines regulären Schulbesuches, und zwar in Braunschweig. Hier lebte er bei seinen Großeltern, und hier schloss er sich wie so viele seiner Altersgenossen der Wandervogelbewegung an, um der familiären Enge zu entkommen.
Die gehegten Hoffnungen auf eine Offizierslaufbahn nach des Vaters Vorbild – genährt durch den Ersten Weltkrieg und die Vision eines klassenübergreifenden nationalen Aufbruches hin zu besseren Zeiten – fanden durch den Zusammenbruch des morschen Kaiserreiches im November 1918 ein jähes Ende. Frustriert musste Uhse zu seinem Vater nach Berlin übersiedeln, wo er fortan die Oberrealschule besuchte. In diese Zeit fielen die ersten Kontakte zu paramilitärischen Verbänden der radikalen Rechten (für einen preußischen Offizierssohn und Wandervogel wahrlich nichts Ungewöhnliches), und im März 1920 beteiligte er sich, kaum 16 Jahre alt, als Zeitfreiwilliger und Meldegänger am Kapp-Putsch gegen die ungeliebte Republik.
Im Frühjahr 1921 brach Uhse mit der ungeliebten Familie und verließ Berlin, um fortan seinen eigenen Weg zu gehen. Der talentierte junge Mann wurde auf Vermittlung des rechtsradikalen Agitators Karl von Gebsattel als Volontär in die Redaktion des "Bamberger Tageblattes" aufgenommen. Das Blatt war trotz einer Auflage von 20.000 Exemplaren stark von den Wünschen des Tabakindustriellen Baron Michel-Raulinos abhängig, was der journalistischen Betätigung nicht nur Uhses so manche Schranken setzte. Bereits jetzt zeichnete er sich durch einen unruhigen Geist aus, was nicht zuletzt durch einen spontanen Redeauftritt auf einer Versammlung des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes dokumentiert wurde. "Wo sollte die nationale Sache hinkommen, wenn sie ängstlich vor Demokraten und Katholiken auswich?"
Stammtischreden und Vereinsmeierei der Deutschnationalen, Alldeutschen und Völkischen lagen dem aktivistischen Uhse nicht, also trat er Ende 1921 dem paramilitärischen Bund Oberland bei. "Wer auf diese Fahne schwört, hat nichts mehr, was ihm selbst gehört." Die Flucht aus der Vereinsamung in die entschlossene Gemeinschaft stellte hierbei neben politischen Aspekten einen wichtigen Faktor dar. Der Bund Oberland war aus dem gleichnamigen Freikorps hervorgegangen, das zwar einerseits gegen die Münchener Räterepublik und gegen die polnischen Insurgenten in Oberschlesien kämpfte, aber andererseits im Gegensatz zum Gros der anderen rechtsextremen Landsknechte den Einsatz gegen streikende Arbeiter verweigerte. Nach der Umwandlung in den Bund betrieb Oberland mit Hilfe der Reichswehr weiterhin intensive paramilitärische Ausbildung.
Bei Oberland lernte Uhse Persönlichkeiten der völkisch-nationalsozialistischen Szenerie bis hin zum Radauantisemiten Julius Streicher kennen. Einen gewissen Eindruck machte Gottfried Feders Theorie von der Brechung der Zinsknechtschaft – schon früh entwickelte sich ein diffuser antikapitalistischer Affekt. Kommandeur der Bamberger Oberländer war der "rote Leutnant" Audax, der während der Revolution als einziger Offizier auf Seiten der Sozialisten stand. Erscheinungen wie Audax waren bei Oberland keine Seltenheit: Auch der ehemalige Kommandeur Beppo Römer tat sich schon früh durch ausgesprochen "nationalbolschewistische" Tendenzen hervor. Auf der anderen Seite nahm Uhse selbstredend an Aufmärschen und Zusammenstössen mit Kommunisten und Sozialdemokraten teil, wobei er einmal erhebliche Verletzungen davontrug. "Viele hundert gebückte Gestalten sah ich vor mir, die suchten etwas. Ich hörte meine Stimme sie fragen: 'Was?' – 'Deutschland', antworteten sie, und ich empfand den Zwang, ihnen zu sagen, wo sie es fänden. Aber es war so, dass ich es selbst nicht wusste."
Im Laufe der Zeit kamen Rivalitäten mit den von den militärisch ungleich professionelleren Oberländern belächelten Nationalsozialisten auf, die unsinnige antisemitische Propaganda des Hitler-Intimus Hermann Esser führte im Frühjahr 1923 sogar zu einer Saalschlacht zwischen Oberland und der SA. Esser lehnte den Kampf gegen die französische Besatzungsmacht an der Ruhr strikt ab und erhob die Vernichtung des "jüdischen Weltparasiten" zum alleinseligmachenden Ausweg. Oberland nahm bekanntermaßen mit zahlreichen Aktivisten am Ruhrkampf teil und reagierte entsprechend gereizt auf die nationalsozialistischen Wahnvorstellungen. Dennoch verbündeten sich die Rivalen bald darauf im Kampfbund gegen die republikanische Ordnung.
Der einsetzende Massenzulauf zu Oberland warf erhebliche Probleme auf und sorgte für Unbehagen: "Der alte Ton persönlicher Kameradschaft verschwand aus dem Bunde...Der Bund konnte sie nicht mehr seiner Gemeinschaft voll einordnen. Die wohlausgewogene Mischung von Romantik und Sachlichkeit, von rebellischem Wandervogeltum und politischer Reaktion, von Aufrührertum und Disziplin wurde getrübt. Die Leute im Bund waren erst einmal Studenten oder Rechtsanwälte, Kaufleute oder Angestellte und erst lange nachher das, was wir ganz und gar sein wollten. Der selbstverständliche Grundsatz, dass, wer dem Bunde angehöre, nur ihm verpflichtet sein dürfe, wurde nicht mehr respektiert." Im Dienst wurden die mittleren und höheren Angestellten bevorzugt, die Korpsstudenten führten ohnehin ein striktes Eigenleben.
Im November 1923 wurde Bamberg im Zusammenhang mit dem Hitler-Ludendorff-Putsch in München von tagelangen Krawallen erschüttert, an denen auch Bodo Uhse und seine Oberland-Kameraden teilnahmen. Nachdem die SA sich zuvor widerstandslos entwaffnen ließ, wurden die Oberländer von ihrem neuen Kommandeur Apfelstedt kurzerhand nach Hause geschickt. Die Wut entlud sich in dreitägigen Straßenschlachten mit der Polizei und wüsten Radauszenen. Im Anschluss lieferten sich Bambergs Oberländer einen regelrechten Privatkrieg mit der örtlichen SA, namentlich der provozierend "Adolf" getaufte Mischlingshund der Uhse-Kumpanen sorgte stets für Zündstoff.
Der Bund Oberland erstickte langsam im provinziellen Treiben der einzelnen Gruppen, das Gros der alten Mitglieder verlief sich. Uhse und seine Freunde suchten nach tieferen Inhalten. Man "spottete über die, die mit weltanschaulichen Belichtungstabellen durchs Leben zogen und für jede Situation dort die richtige Einstellung gewannen. Für diese Leute gab es nichts Neues mehr. Das Überraschungsmoment war für sie ausgeschaltet, sie hatten für alles eine Formel, von allem eine fertige Meinung. Es war gewiss bequem, sich auf solche Weise mit dem Leben auseinanderzusetzen, denn es gab keine Auseinandersetzung mehr. An Stationen, die im Weltanschauungsfahrplan nicht vermerkt waren, fuhr man vorüber, ohne aus dem Fenster zu sehen. Es war angenehm und bequem, mit breitem Arsch auf seinen Überzeugungen zu sitzen und nicht das Leben vor sich zu haben, sondern seine Weltanschauung, nicht die Dinge, sondern seine Meinung von den Dingen. Weltanschauung verpflichtete nicht, sondern pflichtete bei."
2. Anschluss an die nationalsozialistische Linke
Wie das "Bamberger Tageblatt", so fungierte auch Oberland letztlich nur als Durchlauferhitzer für Bodo Uhses weitere Radikalisierung. Am 1. Mai 1927 erschien im Bundesorgan "Das Dritte Reich" erstmals ein Aufsatz aus der Feder Uhses, der eine deutliche Hinwendung zu den Positionen des linken Flügels der NSDAP und des Neuen Nationalismus eines Ernst Jünger erkennen ließ. Im gleichen Monat erfolgte auch der Eintritt in die Redaktion des Ingolstädter "Donauboten", mithin eine der ersten nationalsozialistischen Zeitungen überhaupt. Nach dem Parteieintritt im Spätsommer 1927 reihte Uhse sich in die Phalanx der NS-Linken um die Gebrüder Strasser ein, die bemüht waren, der kleinbürgerlich-reaktionären Fraktion um Hitler ein national-sozialistisches Gegengewicht entgegenzustellen. Gemeinsam wollten die NS-Linken der Partei einen sozialrevolutionären Geist einhauchen, der "an Stelle des Kehrrichthaufens aus Bierkellerromantik, Kleinbürgersehnsucht und einer Winzigkeit echten, aber irrenden Gefühls treten, den die fünfundzwanzig Punkte des offiziellen Parteiprogramms darstellten".
Aufschlussreich über den politischen Standort Uhses ist der im Dezember 1927 im "Dritten Reich" erschienene Aufsatz "Die neue Front. Saboteure an der Arbeit": "Brennend geworden in jener Stunde, da das Gewaltdiktat der kapitalistischen Siegermächte nicht das alte Deutschland, sondern das arbeitende, deutsche Volk mit vernichtendem Schlage traf. Damals verriet die Sozialdemokratie die sozialistische deutsche Revolution und streckte die Waffen. Der deutsche Arbeiter wurde zum Kuli. Er bekam die durch die Machtdiktate (die Reparationen des Versailler Diktats, d. Verf.) veranlasste Sozialreaktion zu spüren und empörte sich dagegen in blutigen Aufständen. Damit wurde zum zweiten Male die Frage der Verbundenheit von Arbeitern und Frontkämpfern brennend. Wenn die Frontkämpfer - statt vom Unternehmertum sich zur Niederwerfung der sozialrevolutionären Bewegung ausnutzen zu lassen - in den revolutionierenden Arbeitern ihre natürlichen Bundesgenossen erkannt hätten, so wäre damals schon die nationalrevolutionäre Front gegen Versailles entstanden. Die besitzenden Kreise wehrten sich gegen den neuen Nationalismus, der sich mit der sozialistischen Revolution um der nationalen Freiheit willen verbünden wollte, nicht aus taktischen Gründen sondern grundsätzlich um durch die sozialistische Organisation der Nation die Widerstandsfähigkeit auch für die Zukunft aufs Höchste zu steigern. So musste das Unternehmertum - nach einem halben Versuch im Ruhrkampfe - sich der Herrschaft der Finanzbourgeoisie ergeben und den Gedanken des nationalen Widerstandes mit dem Einschwenken in die Locarnofront (Sicherheitspakt mit den Westmächten statt Bündnis mit der antiwestlichen Sowjetunion, d. Verf.) verraten. Nachdem die Sozialdemokratie ihre Büttelrolle erfüllt hat, hat das deutsche Unternehmertum die Rolle des Fronvogtes der Finanzbourgeoisie übernommen. Die bittere aber eindeutige Lehre ist, dass man als Nationalist Sozialist sein muss, denn der Sozialismus ist unser Schicksal."
Als Protegé der vor allem in Norddeutschland einflussreichen Strasser-Brüder machte Uhse Karriere und übernahm noch vor Jahresende die Chefredaktion des "Donauboten". In dieser Funktion arbeitete er eng mit Otto Strasser und Herbert Blank zusammen und wurde praktisch das dritte Sprachrohr der NS-Linken. In Süddeutschland dominierte jedoch der rechte Parteiflügel, und als Uhse im Frühjahr 1928 öffentlich gegen die Kandidatur des reaktionären Generals von Epp auf der NS-Liste protestierte, warf man ihn aus der Redaktion hinaus. Seiner Agitation für einen nationalen Sozialismus tat das keinerlei Abbruch. Im August 1928 veröffentlichte er wiederum im "Dritten Reich" den Aufsatz "Der proletarische Deutsche", der deutliche Einflüsse der SPD-Renegaten August Winnig und Ernst Niekisch verriet. Diese sahen in der Arbeiterschaft die zur Machtausübung im kommenden neuen Staat bestimmte Klasse, propagierten die Mobilisierung des bolschewistischen Chaos gegen den Westen und standen damit in deutlichem Gegensatz zum herkömmlichen Nationalismus oder zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft:
"Außerdem aber verrät die Ansicht, dass das sachliche und persönliche Bekenntnis zum deutschen Arbeitertum ein Verrat am ‚Ideale‘ der Volksgemeinschaft sei, eine solche Unkenntnis zum deutschen Proletariat, das - wie man doch wird zugeben müssen - ein sehr beachtenswerter Teil der deutschen Volksgemeinschaft ist, dass es besser ist für die Träger diese Ansicht, sie geben die Beschäftigung mit der Politik auf (...) Wer um die deutsche Freiheit sinnt, der kann am deutschen Proletarier nicht mit blinden Augen vorbeigehen. Er ist im Gegenteil gezwungen, seine Augen auf ihn zu richten und wenn sein Freiheitswille ehrlich ist, d.h. wenn es ihm gleichgültig und unbeachtenswert ist, unter welchen Formen und Fahnen die Freiheit gewonnen werden soll, wenn er also alle Vorurteile und Gedankenhemmnisse überkommener Begriffe wegwirft, dann wird er den deutschen Proletarier sehen, achten und lieben lernen. Zunächst ist es nötig, sich einmal des durchaus bürgerlichen Begriffes der ‚Klasse‘ zu entledigen. (...) Nicht Bürger, sondern wahrhaft marxistischer Bourgeois ist, wer den Unterschied zwischen den Begriffen der Klasse und der Schicht nicht zu sehen vermag. Der materialistische Begriff der Klasse erfasst ja nur einen Teil, nur eine Seite des deutschen Arbeitertums, während die Schicht das deutsche Arbeitertum auch in seinen immateriellen Kräften umfasst. Nicht dialektische Schablone, sondern lebendige Kraft, das ist der Unterschied zwischen Klasse und Schicht. Wer aber diesen Unterschied kennt - und der Weg zu dieser Erkenntnis ist offen für alle, die guten Willens sind - der wird nicht ‚hinabsinken in die Masse‘, sondern er wird die lebendige Kraft des deutschen Arbeitertums aufsuchen."
3. Die "Schleswig-Holsteinische Tageszeitung"
Im September 1928 empfahl Gregor Strasser seinen Protegé als politischen Redakteur für die geplante "Schleswig-Holsteinische Tageszeitung" mit Sitz in Itzehoe. An der Besprechung im preußischen Landtag nahmen u.a. Parteiprominente wie Erich Koch, Karl Kaufmann, Robert Ley und Wilhelm Kube teil. Strassers Vertrauen in diese Truppe wurde von Uhse mitnichten geteilt: "Selbstlose Vorkämpfer eines deutschen Sozialismus waren diese erfahrenen und gewiegten Draufgänger wohl nicht." Dennoch ergriff er die neue Gelegenheit am Schopfe, war ihm die sich steigernde Unruhe im Deutschland der späten 20er Jahre doch durchaus bewusst: "Wenn sie scharf hinhören, werden sie das Ticken der Würmer im Gebälk vernehmen. Sehen sie nachts über das Land, am Horizont stehen Flammen. Unruhe und Ungewissheit liegen in der schwülen Luft." Die SHTZ sollte die erste norddeutsche Tageszeitung der NSDAP werden und die bisher kümmerliche Propagandaarbeit in der Nordmark vorantreiben. Das Terrain war günstig: Bei den Reichstagswahlen von 1928 erzielte die NSDAP in Schleswig-Holstein überdurchschnittliche Ergebnisse, und Strasser witterte hier Möglichkeiten, seine Basis zu verbreitern.
Im Oktober attackierte Uhse in den strasseristischen "NS-Briefen" noch einmal den parteioffiziellen Antimarxismus, bevor er nach Itzehoe übersiedelte. Die Itzehoer Parteibasis bestand zumeist aus Landwirten und Handwerkern und forderte, die SHTZ dürfe nicht nur ein Parteiblatt, sondern auch und gerade ein Blatt für die unter der Agrarkrise mit Preisverfall, Verschuldung und steigenden Steuern leidenden Bauern sein. "Ein Blatt also gegen die Regierung, ein Blatt des Umsturzes, ein Blatt der Revolution." Zu dieser Zeit entwickelte sich gerade die militante Landvolkbewegung, die sich durch Widerstandsaktionen gegen Gerichtsvollzieher und Polizeibeamte hervortat. Uhse nahm prompt an einer Protestkundgebung des Landvolks teil und zeigte sich beeindruckt: "Diese Bauernhaufen hatten eine rücksichtslose Entschlossenheit in ihren Gesichtern gezeigt. Ihre Methoden waren überraschend in der Unmittelbarkeit, mit der sie sich gegen den Staat wandten. Es gab kein spießbürgerliches Für und Wider, keine biedere Vereinsmeierei, keine Satzungen und keine Statuten, Abzeichen und Fahnen, wie sie sonst bei allem, was in Deutschland geschah, das Wichtigste und Vordringlichste schienen. Hier war wirklich Bewegung, gefährdet allerdings durch ihre fehlende Reglementierung, durch die anarchischen Formen ihres Ablaufes und durch die drängende Ungeduld. Man musste einen Weg finden, mit der unbändig rebellierenden Kraft der Bauern zusammenzuarbeiten."
Am 3. Januar 1929 erschien die erste reguläre Ausgabe der SHTZ, wenn auch anfangs nur als Wochenblatt. Uhse legte sich prompt mit Gauleiter Hinrich Lohse an, als er den Abdruck eines gegen das Landvolk gerichteten Artikels verweigerte, und drohte sogar mit seinem Rücktritt als Chefredakteur. Er traf auch mit dem Landvolkführer Claus Heim zusammen, der die bedingungslose Unterordnung der NSDAP unter die schwarze Fahne der Bauernnot und der Rebellion verlangte. Der NS-Agitator erkannte, dass die Abneigung der Parteibürokratie gegen das Landvolk und gegen Heim vor allem auf die Angst des Funktionärs vor der Persönlichkeit zurückzuführen war. Obwohl er sich eher zu den Landvolkaktivisten wie Herbert Volck, Walther Muthmann oder Bruno von Salomon hingezogen fühlte, übernahm er bald die Führung der NSDAP-Ortsgruppe Itzehoe. Die bislang vor sich hindümpelnde Parteiarbeit belebte sich unter Uhses Leitung sprunghaft. In den alle 14 Tage abgehaltenen Versammlungen agitierte er unter den Bauern und den Absolventen paramilitärischer Kurse und wetterte gegen den platten Antisemitismus der reaktionären Parteigeneralstäbler in München. "Die Revolution von 1918 hat nur den alten Bau vernichtet. Wir sitzen ohne Dach über dem Kopf im Wetter. (...) Das deutsche Volk ist ausgebeutet und unterdrückt. Im deutschen Volk aber stehen auf der untersten Stufe Arbeiter und Bauern. Auf sie werden alle Lasten abgewälzt. Ihre Not ist die Not des ganzen Volkes, ihnen gebührt die Führung." Zu Uhses Entsetzen erkannte Hitler jedoch im Interview mit einer amerikanischen Zeitung und auch im "Völkischen Beobachter" die Auslandsverpflichtungen Deutschlands und damit die Versailler Kriegstribute an.
Die Antwort bestand in einem prononcierten Radikalismus, der auch vor Saalschlachten mit anderen rechtsgerichteten Organisationen nicht haltmachte. In Husum provozierte Uhse eine aufsehenerregende Saalschlacht auf einer Versammlung des Jungdeutschen Ordens: "Ihr werft uns Terror vor? Wenn wir nur so terrorisieren könnten, wie wir wollen! Aber der Tag kommt. Nicht mit der klügelnden Vernunft – mit der vom eisernen Willen geführten Faust werden Revolutionen gemacht. Wir glauben an die Gewalt, wir lieben die Gewalt und wir üben Gewalt." Die SA ließ sich das nicht zweimal sagen, geriet völlig außer Rand und Band und schlug alles kurz und klein. Hitlers Privatkanzlei schickte prompt einen Beschwerdebrief an Lohse und verwies auf das Legalitätsprinzip der NSDAP.
Geradezu traumatisch wirkte sich kurz danach ein schwerer Zusammenstoß mit den Kommunisten in Wöhrden bei Heide aus, bei dem die Nationalsozialisten Otto Streibel und Hermann Schmidt sowie der Kommunist Johannes Stürzebecher den Tod fanden. "Ich konnte diesen Toten nicht hassen und nicht die, die seine Gefährten gewesen waren in dieser blutigen Nacht...Dieser Stürzebecher da hatte ehrlich für seine Sache gekämpft und für die seiner Kameraden. (...) "Ich erschrak, da ich fühlte, wie ich die beiden Toten vor mir verleugnete und mein Herz sich vor dem dritten beugte, vor der anklagenden und hassenden Grimasse des Kommunisten, der dem Namen des alten Seeräubers und Rebellen, den er trug, mit seinem Tode Ehre gemacht hatte. Leben und Tod waren bei ihm eine gerade Linie und sinnvoll einfach durch ihr Dasein. Er war arm und unterdrückt und ausgebeutet, daran hatte ich nicht zu zweifeln, und er hatte – wer wollte das in Frage stellen? – gegen das ihm und Tausenden der Seinen aufgezwungene Geschick gekämpft...Die schmerzverzogenen Züge formten für mich das Gesicht seiner Kameraden, seiner Klasse, an deren Kraft ich doch glaubte. Ich hatte nicht kämpfen wollen gegen diese Klasse, das war doch der simple Sinn meines Handelns gewesen, darum auch war ich National-Sozialist geworden."
Nach dem Wöhrdener Zwischenfall befürchtete Gauleiter Lohse anfänglich ein Parteiverbot, fing sich jedoch rasch wieder in schlachtete den Tod der zwei SA-Männer propagandistisch aus. Zur Trauerfeier am 13. März 1929 stattete auch Hitler Schleswig-Holstein seinen ersten Besuch aus. Im Anschluss an die Beisetzung tauchte er in der Redaktion der SHTZ auf und verlieh seinem Unmut über Uhses radikalen Kurs Ausdruck. Zwar lese er das Blatt täglich, aber die Umstände würden zur Zurückhaltung mahnen. Der Kritisierte konterte, der Radikalismus des Landvolkes zwinge ihn zu einer anderen Sprache. Bald darauf wurde die SHTZ für 4 Wochen verboten, und im Zwangsurlaub freundete Uhse sich mit der Redaktionsmannschaft der Konkurrenzzeitung "Das Landvolk" um Bruno von Salomon an.
Am 23. Mai 1929 eröffnete die Landvolkbewegung ihren Terrorfeldzug gegen die Republik mit einem Bombenanschlag auf das Itzehoer Landratsamt. In weiten Teilen Schleswig-Holsteins übernahmen revolutionäre Bauernkomitees die faktische Kontrolle und errichteten eine Parallelverwaltung. Für Wirbel sorgte die Beteiligung des Uhse-Kumpans Hein Hansen am Sturm auf ein Gefängnis, wo ein in Beugehaft befindlicher Bauer befreit werden sollte. Die Systempresse konstruierte einen Zusammenhang zwischen der NSDAP und den Terroristen, und um ein etwaiges Parteiverbot abzuwenden, bot Hitler eine Belohnung von 10.000 Reichsmark für denjenigen, der die Urheber der Anschläge namhaft macht. Damit machte die NS-Parteiführung sich bei den Landvolkextremisten und anderen Nationalrevolutionären geradezu zum Gespött. Es bildete sich eine Art informeller Zirkel aus Uhse, den beiden Landvolkterroristen John Johnson und Bruno von Salomon sowie dem Kommunisten Kreuding. Lohse ermahnte Uhse nachdrücklich, die Finger von den Terroristen zu lassen.
4. Bruch mit Hitler
Wasser auf die Mühlen der NS-Linken war der am 7. Juni 1929 von der Pariser Sachverständigenkonferenz verabschiedete Young-Plan zur Regelung der Reparationsfrage. Das Reich sollte bis 1988 116 Milliarden Reichsmark Reparationen in mit fortschreitender wirtschaftlicher Erholung ansteigenden Raten zahlen.
"Die Staatsmänner, beunruhigt von den drohend sich erhebenden ersten Wellen der Krisenspringflut, übergaben die Sache, von der sie bisher den Völkern erzählt hatten, es handele sich um die heiligsten Güter der Nationen, um das eben, wofür Millionen Soldaten einen harten Tod gestorben waren, den Geschäftsleuten, den Händlern, den Industriellen und Bankiers. Die traten nun bescheiden als Sachverständige aus den Kulissen heraus, hinter denen sie bisher die Regie geführt hatten, und unternahmen es, auf einer Konferenz in Paris...mit dem Geschick der Völker zu spielen. Es war das erste Mal, dass sich Vertreter Deutschlands in ihrer eigenen Sache als gleichberechtigt an den Tisch setzen durften; es war kein Zufall, dass dies in einem Kreis geschah, von dem man sagen könnte, dass hier Kapitalisten unter sich seien." Hintergrund des Youngplans waren die horrenden Kriegsschulden Großbritanniens und Frankreichs bei den USA, die durch deutsche Reparationen beglichen werden sollten. "Die Bourgeoisie dieser Länder fand es recht und billig, die Rückzahlung der Milliardensummen, die aus den Feuerschlünden der Kanonen mordbringend in die Luft gespien worden waren, auf die deutsche Bourgeoisie abzuwälzen, als 'Wiedergutmachung' eben. Der sachliche Ton der Pariser Verhandlungen der in diesen Dingen wahrhaft Sachverständigen war nicht zum letzten durch das Bewusstsein bedingt, dass die Bourgeoisie Deutschlands sich keineswegs an diesen Lasten übernehmen, sondern sie ihrerseits wieder auf die Massen des deutschen Volkes abwälzen werde. Von der Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit des deutschen Volkes, von seinem Fleiß und seiner Arbeitskraft wussten nicht nur die ausländischen, sondern auch die deutschen Vertreter auf der Konferenz mit jener schäbigen Anerkennung zu sprechen, mit der etwa jemand das Geschick und den Fleiß seines Haustieres rühmend erwähnt. Die 'deutschen Kapitalisten' – der Ausdruck wirkt störend, denn der Kapitalismus zieht es vor, sich als Zivilisation, als Grundlage moderner Kultur, als Wahrer christlicher Güter, als Prinzip des wohlerworbenen Eigentums bezeichnen zu lassen..."
Das deutsche Kapital überwand die Deklassierung der ersten Nachkriegsjahre, indem es über den Rücken der Volksmasse stieg. Der Young-Plan stellte ein ausgezeichnetes Agitationsobjekt gegen die Weimarer Republik dar. Nicht die Alliierten hatten den Krieg gewonnen, sondern das internationale Finanzkapital. "Die deutschen Staatsmänner repräsentierten nicht den Willen des Volkes, sondern die Mächte der Ausbeutung. Die deutschen Kapitalisten hatten Frieden geschlossen mit den Kapitalisten der Feindstaaten. Der Widerstand gegen den Young-Plan musste dem Inhalt nach proletarisch und in seinen Formen revolutionär sein." Eine kalte Dusche für die revolutionären Hoffnungen war jedoch Hitlers Pakt mit DNVP und Stahlhelm zum Volksbegehren gegen den Young-Plan. "Wir hatten uns bisher mit Leidenschaft und Heftigkeit von diesen Gruppen distanziert. Wir hatten sie tagtäglich als Vertreter der Reaktion in der Presse und in Versammlungen angeprangert, und es war ein Hauptstück unserer Propaganda gewesen, dass wir ihnen den ehrlichen nationalen Willen ebenso abgesprochen hatten wie den Sozialdemokraten und Kommunisten den Willen zum Sozialismus. Nun brach Hitler mit dieser Linie unserer Politik und schlug nach rechts hin eine Brücke, auf der Bein brechen musste, wer mit der sozialen Lüge darüberschreiten wollte. Wir hatten bisher die abgetakelten Generale, die breitbeinigen Wirtschaftsführer mit ätzendem Spott übergossen und mussten nun Hitler in der Gesellschaft dieses gepflegten Pöbels sehen."
Die Redaktion der SHTZ reagierte mit Entsetzen und Empörung: "Hitler hat uns verkauft!...Mit denen, die wir täglich leidenschaftlich anklagten, denn sie schändeten mit ihrer Profitgier den Namen der Nation, mit den krebsfüßigen Rückwärtslern voll ekelhaften Standesdünkels hatte Hitler die jungen Armeen der Braunhemden verkoppelt. Er hatte in der entscheidenden Stunde, da der Kampf außerhalb der Gesetze dieses Staates geführt werden musste, seinen Weg in die friedlichen Gehege der Weimarer Demokratie gerichtet, hatte in Gemeinschaft durchschauter Scharfmacher, denen die Nation niemals mehr gewesen war als ein Deckmantel für ihre Geschäfte, an das Volk eine Frage gestellt, die nicht ehrlich gemeint, die ein Betrug war. In dem Augenblick, da Gefährliches zu tun notwendig schien, spielte Hitler ein sicheres Spiel. Er verband sich mit der Reaktion und dem unzufriedenen Kapital." Gegen diese Linie wollte Uhse Widerstand leisten, blitzte allerdings bei Lohse ab und auch bei Otto Strasser, der das Volksbegehren als seinen eigenen Erfolg feierte. Vergeblich warnte der NS-Linksausleger seinen bisherigen Mentor, dass so nur die Münchener Richtung gestärkt werden würde.
Am 16. Juni 1929 marschierten in Itzehoe 1000 Mann SA auf. Hauptredner Joseph Goebbels traf anschließend mit Bodo Uhse zusammen und notierte im Tagebuch: „Ein junger, sehr klarer Kopf. Er weiß, was er will. Dazu ein konsequenter Sozialist.“ Auf dem Nürnberger Parteitag kam es zu einem Zusammenstoss Uhses mit Rosenberg, der eine Zusammenarbeit mit den unterdrückten Kolonialvölkern aus rassischen Gründen strikt ablehnte. Der Antiimperialismus laufe lediglich hinter der Linie der KPD her. Gegenstand der Kritik wurde auch das Eintreten der Parteilinken für ein Bündnis mit der Sowjetunion gegen den kapitalistischen Westen. Der Parteitag verwarf zudem eine stärkere Orientierung hin zu gewerkschaftlichen Fragen und hin zur Arbeiterpropaganda.
Als die Polizei sich an die Zerschlagung der Landvolkbewegung machte, wurde auch die Redaktion der SHTZ am 12. September 1929 verhaftet. In der U-Haft in Altona hatte der NS-Journalist Zeit zum Nachdenken: "Gewiss, man konnte Nationalsozialist sein, die Masse umschmeicheln und verachten, den Krieg vergotten und die Legalität beschwören, für die Auslese sich begeistern und selber die Stufen der Hierarchie hinaufklettern, den Arbeiter achten und ihm schlechtere Löhne zahlen, nach Freiheit rufen und die Unterdrückung vorbereiten. Man konnte Faschist sein, ich war es nicht, das begriff ich jetzt. Und jenes faschistische Jakobinertum, das die Gewaltsamkeit gutmütig handhaben, die Freiheit rationell anwenden und die Revolution konservativ durchführen wollte, es war zum Kotzen." Die letzten Sätze bezogen sich auf Otto Strasser und seine Parteigänger, bei denen die meisten auf halbem Weg zum Sozialismus stehen blieben. Derweil vermuteten Goebbels und Lohse in Berlin, Strasser habe die Querverbindungen zwischen Landvolk und NS-Linker zustande gebracht, und der schleswig-holsteinische Gauleiter war seitdem alles andere als gut auf Bodo Uhse zu sprechen.
Nach seiner Entlassung aus der U-Haft kandidierte Uhse bei den preußischen Kommunalwahlen und wurde im November 1929 in den Itzehoer Stadtrat gewählt. Hier konkurrierte die NS-Fraktion mit der KPD, weil Uhse sich verstärkt um die Interessen der Arbeitslosen und der Arbeiter bemühte. Er freundete sich mit dem Kommunisten Waldemar Vogeley an. Dieser sagt ihm auf den Kopf zu, er werde nicht lange bei den Nazis bleiben, erkannte aber Uhses aufrichtiges Wollen an. In der Tat zeigte der neu gewählte Stadtrat sich beunruhigt über gleichgültige Haltung der Parteiführung gegenüber den Bauern und der Not des Proletariats sowie über Hitlers Legalitätskurs. Wohl nicht zuletzt unter Vogeleys Einfluss wurde Uhse zum Besucher in der örtlichen Buchstelle der KPD, wo er sich gründlich mit den Werken Lenins vertraut machte. Ab Januar 1930 richtete die SHTZ die Beilage "Der Proletarier" ein und opponierte offen gegen Hitlers probürgerlichen Kurs.
Am 10. Februar 1930 organisierte die Itzehoer NSDAP eine Kundgebung zum Hungermarsch der kommunistischen Arbeitslosen ("Hungermarsch oder Freiheitskampf"), die zum Schlüsselerlebnis werden sollte. Zwar sprach mit Johannes Engel einer der Begründer der im Entstehen begriffenen Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation, aber Uhse zeigte sich eher von den Ausführungen des kommunistischen Diskussionsredners Karl Olbrysch aus Hamburg beeindruckt: "Ist denn der Kampf für die Freiheit eure Sache? Wieso kämpft ihr und wieso für die Freiheit? Ihr schleicht euch über die Hintertreppen der ratlos gewordenen Demokratie...Auf der Parlamentstribüne nennt ihr euch Revolutionäre, vor dem Richterstuhl aber beschwört ihr die Legalität. Und es ist euch ernst damit, denn ihr seid die missratenen Kinder des Liberalismus und treibt dessen doppelte Moral demagogisch auf den Gipfel. Er sagt: Gleichheit, und lässt für den Profit von einem halben Tausend Mächtiger sechs Millionen ohne Arbeit in Elend und Hunger. Ihr seid nicht so duldsam, ihr ruft mit kühner Stirn zum Kampf gegen das Kapital, und mit gleicher Stimme lockt ihr, in eurer Volksgemeinschaft habe der Arbeiter wie der Trustbesitzer, der Handwerker wie der Sohn des davongelaufenen Verbrechers von Doorn seinen Platz. Nationaler Sozialismus, ruft ihr grimmig, aber eurer Sozialismus endet, bevor er anfängt, denn das Privateigentum erklärte Hitler für heilig...Wenn ihr auf die Demokratie schimpft, um sie zu betrügen – auf den Kapitalismus schimpft ihr, um ihm besser dienen zu können. Das nennt ihr Kampf, wenn ihr mit den mächtigsten Mächten im Land verbündet seid? Das nennt ihr Revolution, wenn ihr das Grundgesetz der alten Ordnung von vornherein heilig sprecht?... Ihr Narren, wir eifern nicht mit eurem Patriotismus. Aber wer ist denn Deutschland? Die Millionen Arbeiter, die Millionen kleiner Bauern! Wie kann Deutschland frei sein, wenn sie, sein Volk, unterdrückt sind? Die Freiheit der Nation liegt außerhalb der Kraft des Nationalsozialismus... Deutschland, das Deutschland der Arbeiter und Bauern, gilt uns viel. Darum wollen wir es davor bewahren, dass sich die Bourgeoisie, die zu feige war, achtundvierzig im Sturm sich zu erheben, als dieses Deutschland ihre Sache war, sich jetzt aus diesem Deutschland ihr Sterbebett macht."
Folgerichtig war Bodo Uhse auch in die Bestrebungen der Parteilinken verwickelt, eine Parteispaltung herbeizuführen und zusammen mit den norddeutschen NSDAP-Gliederungen, Nationalrevolutionären wie Ernst Niekisch und dem Landvolk eine neue nationalsozialistische Partei aufzubauen. Es ging um nichts weniger als um die Sprengung der NSDAP von innen heraus, um den Pressekonflikt zwischen Goebbels und dem Strasserschen Kampfverlag auszunutzen. Kurz vor dem Parteiaustritt der Revolutionären Nationalsozialisten um Otto Strasser suchte Uhse diesen in Berlin auf. Strasser wollte jedoch Hitler lediglich den "wahren Nationalsozialismus" streitig machen und keinesfalls auf Linkskurs gehen. Der Parteirebell warnte Strasser vergebens, man brauche eine andere Idee, um erfolgreich gegen Hitler anzutreten. Folgerichtig entwickelten sich die Revolutionären Nationalsozialisten zu einer lautstarken, aber unbedeutenden Splittergruppe, die für viele Renegaten lediglich als Durchlauferhitzer für den Wechsel zur KPD oder zu nationalbolschewistischen Gruppen fungierte. Bei seiner Rückkehr nach Itzehoe fand Uhse ein Ultimatum Lohses vor: Bedingungslose Unterordnung unter die Münchener Richtung oder Ende der Redaktionstätigkeit. Der Chefredakteur der SHTZ lehnte ab und wurde am 16. Juli 1930 mit Wirkung zum 1. August aus der NSDAP ausgeschlossen.
5. Hinwendung zum Kommunismus
Nach dem Hinauswurf aus SHTZ und NSDAP bewegte Bodo Uhse sich zunächst im Dunstkreis der Revolutionären Nationalsozialisten – vollständig wollte auch er nicht mit dem nationalen Sozialismus brechen. Am 15. August feierte er als neuer Chefredakteur der strasseristischen "NS-Briefe" den terroristischen Kampf der Landvolkbewegung. Seine rechte Hand war der Landvolkagitator Bruno von Salomon. Bereits im November reihte Uhse sich in den nationalbolschewistischen Widerstands-Kreis Ernst Niekischs ein, um gleichzeitig unter dem Pseudonym Christian Klee weiterhin die NS-Briefe herauszugeben. Für den "Widerstand" referierte Uhse auf zahlreichen Veranstaltungen über die Landvolkbewegung, wobei er vor allem unter den Überresten des Bundes Oberland regen Zuspruch fand.
Am 21. März 1931 fanden die Aktivitäten für Niekisch ein Ende. Uhse verließ Itzehoe, um antifaschistische Bauernkomitees im Raum München zu organisieren. Endgültig überzeugt wurde er durch Gespräche mit den Kommunisten Christian Heuck und Karl Olbrysch: "Während wir sprachen, begriff ich..., dass die Sehnsucht meines Lebens sich erfüllte, dass etwas Neues begann und alles Bisherige nur mit Platzpatronen geschossen war. Es wurde Ernst, da der Krampf eines Jahrzehnts sich löste und der Zwiespalt, der bisher mein Leben zerrissen hatte, jener Zwiespalt, entstanden aus dem Bewusstsein von der Kraft der Arbeiterklasse und aus dem ständigen Kampf mit ihr und gegen sie, dass dieser Zwiespalt sein Ende fand dadurch, dass ich mich der großen Kraft ergab...Die große Kraft, mit der ich mich herumgeschlagen hatte, seit wir ausmarschiert waren unter der Edelweißfahne, die ich hatte mit kleinen Mitteln betrügen wollen unter dem Hakenkreuz, sie beschenkte mich, da ich mich ihr unterwarf, in dieser Nacht mit dem kostbarsten Gut. Das Leben bekam wieder einen Sinn."
Bedeutsam dürfte sich hierbei ausgewirkt haben, dass die KPD seit ihrem Programm zur nationalen und sozialen Befreiung Deutschlands vom August 1930 eine ausgesprochen nationalistische Haltung einnahm – die sozialistische Volksrevolution der unterdrückten Klassen sollte der Auftakt zur nationalen Befreiung sein. Im Frühjahr 1931 veröffentlichte die KPD als weiteren Teil ihres nationalistischen Kurses das Bauernhilfsprogramm mit der Forderung nach Zerschlagung des Großgrundbesitzes, das nicht zuletzt von Uhse und Salomon auf einem antifaschistischen Bauernkongress in Fulda der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Motive der sogenannten Komiteebewegung legte Uhse unter seinem Pseudonym Christian Klee in der Erstlingsnummer des "Aufbruch" nahe. Mit diesem Blatt wollte die KPD unzufriedene Nationalsozialisten und frustrierte Nationalrevolutionäre für sich gewinnen. Zur Redaktionsmannschaft gehörten neben bekannten KPD-Funktionären prominente "Nationalkommunisten" wie Ludwig Renn und Alexander Graf Stenbock-Fermor oder NS-Renegaten wie Wilhelm Korn und Rudolf Rehm, denen sich bald auch der ehemalige Oberland-Führer Beppo Römer hinzugesellen sollte.
"Darum ist jetzt die Stunde da, in der die revolutionäre Arbeiterschaft die historische Wendung zum Bauern tun musste. Die Kommunisten haben durch die Proklamation ihres Bauernhilfsprogramms alle vor die Entscheidung gestellt...An diesem Bauernhilfsprogramm der Kommunisten scheiden sich die Wege. Die Kampfgenossin der verarmten Bauernmillionen, die revolutionäre Arbeiterschaft, wird für dieses Programm kämpfen. Wer gegen die schaffenden Bauern ist, wird dieses Programm ablehnen, und das tun sie alle, von SPD bis zu den Nazis! Die revolutionäre Arbeiterschaft aber wird dieses Programm ins Dorf hinaus tragen. Sie hat begriffen, dass es in der kommenden Volksrevolution keine Vendée, keinen weißen Ring um die Städte geben darf. Der Arbeiter geht zum Bauern, ihm geht es nicht um Taktik oder Stimmenfang, ihm geht es um die Revolution. Die Revolution ohne den Bauern ist nur eine halbe Revolution, und eine halbe Revolution ist keine Revolution. (...) Wir sagen dir, Bauer: Du und der Arbeiter in der Stadt, ihr leidet die gleiche Not. Euch richtet derselbe Ausbeuter zugrunde, gleichgültig ob es der jüdische Wucherer oder der christliche Regierungsmann, der semitische Bankier oder der arische Junker ist. Ihr habt beide den gleichen Todfeind: das kapitalistische System. Dieses System muss sterben, wenn das Volk leben will. Darum Bauer Ahoi! Her in die revolutionäre Front!"
In diesem Sinne setzte Uhse seine Agitation unter der Bauernschaft fort. Auf der Tagung der Widerstands-Bewegung auf der Leuchtenburg bei Jena gehörte er zu den Hauptreferenten, weitere Auftritte gab es auf Veranstaltungen der Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten. Schon im Januar avancierte der Agitator zum Sekretär des Reichsbauernkomitees der KPD. Im Frühjahr verhinderte Uhse in dieser Funktion die Kandidatur des zu einer langjährigen Zuchthausstrafe verurteilten Landvolkführers Claus Heim bei den Reichspräsidentschaftswahlen – die Komiteebewegung und der "Aufbruch" unterstützten die Kandidatur des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann gegen Hitler und Hindenburg. Der Winter des Jahres 1932 sah Uhse in der Rhön, wo er den aktiven Widerstand des Landproletariats gegen den lohndrückerischen Freiwilligen Arbeitsdienst organisierte.
Nach dem Reichstagsbrand musste Bodo Uhse untertauchen, um einer Verhaftung zu entgehen. Einer Mitte April unter dem Vorwand einer Mordverschwörung gegen Hitler eröffnete Razzia unter prominenten Nationalrevolutionären entging er nur knapp und setzte sich nach Paris ab, wo er Bruno von Salomon wiedertraf. Nach anfänglichem Misstrauen etablierte Uhse sich sehr schnell in der Exilpublizistik und in der Propagandaarbeit der KPD gegen das Dritte Reich. Von Paris aus unterhielt er Verbindungen zu der im Untergrund aktiven Widerstands-Bewegung Niekischs. 1934 erfolgte mit einem offenen Brief an den nunmehrigen Chefredakteur bei der SHTZ die literarische Kampfansage an den real existierenden Nationalsozialismus. "Heute sitzen Sie an meinem Platz. Ich beneide Sie nicht darum. Die Schweigsamkeit ist ja Ihr vornehmstes Amt geworden...Wo Sie nicht schweigen, da müssen Sie lügen...Es lässt sich auch vom Standpunkt der nationalen Politik nichts Schlimmeres denken, als Eure nationalsozialistische Politik." Das Regime antwortete mit der Ausbürgerung am 3. November 1934.
Etwa gleichzeitig konnte Uhse mit Hilfe des Journalisten und Publizisten Egon Erwin Kisch seine ersten eigenen schriftstellerischen Arbeiten veröffentlichen. Im Jahr 1935 erfolgte der Beitritt zur Exil-KPD, für die er im Juni neben Johannes R. Becher und Bertolt Brecht am Ersten Internationalen Schriftstellerkongress in Paris teilnahm. Nach dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges meldete der bei Oberland ausgebildete Uhse sich zu den Internationalen Brigaden. In Spanien kämpfte er in den Reihen des französischen Bataillons "Edgar André" und war ab April 1937 als Politkommissar im Stab der 17. Division unter Hans Kahle tätig. Gemeinsam mit Ludwig Renn betätigte Uhse sich in der Propaganda unter den Truppen der Legion Condor, so im Rundfunk: "Kameraden! Ihr seid die Träger einer ruhmreichen Tradition – so sagt man euch, und ihr seid es wirklich. Der deutsche Soldat hat sich zu allen Zeiten tapfer geschlagen. Meist für andere, häufig gegen den eigenen Bruder, nie für sich, nie für sein Glück, nie für das Wohl von Vater und Mutter, von Bruder und Schwester." Anfang 1938 kehrte Uhse erkrankt nach Frankreich zurück. Im April 1939 ging er in die USA, um dort unter den deutschen Emigranten für die KPD tätig zu werden. In gleicher Funktion siedelte Uhse 1940 nach Mexiko über, wo er zusammen mit Ludwig Renn für die Bewegung Freies Deutschland tätig war.
5. Kulturpolitik in der DDR
Im Sommer 1948 kehrte Bodo Uhse nach Paßschwierigkeiten in die Sowjetische Besatzungszone zurück. Hier wurde er im Januar 1949 Chefredakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift "Aufbau". Bis zur Einstellung des Blattes im Jahr 1958 war er in dieser Funktion maßgeblich an der Ausformung des kulturpolitischen Lebens der frühen DDR beteiligt. Von 1950 bis 1954 gab es zudem ein Intermezzo als Volkskammerabgeordneter der SED. Im Tagebuch notierte Uhse zu dieser Zeit: "Ja, ich glaube, man kann mit Worten etwas ausrichten. Man hat es immer gekonnt und kann es auch jetzt – auch jetzt noch. Nicht mit dem Wort allein – aber mit dem Wort, das wahr und richtig die Wirklichkeit erkennt und schon genug wiegt, um Teil der Wirklichkeit zu werden, und als solches die Menschen beeinflusst. Ich fühle, dass ich nun wieder da bin, wo ich angefangen habe, nämlich bei der beklemmenden Schwere meiner Aufgabe. Aber wie sie zu lösen ist, darüber bin ich mir nicht klargeworden."
Von 1950 bis 1952 bekleidete Uhse die Posten eines Präsidialrates des Deutschen Kulturbundes und des Vorsitzenden des DDR-Schriftstellerverbandes. Selbstverständlich widmete er sich auch der Agitation gegen die separatistische BRD und Adenauers rücksichtslose Westintegration: Schon Ende der 20er Jahre und in den frühen 30er Jahren hatte man in Deutschland die nationale Frage unter dem Schlagwort der bolschewistischen Gefahr im Sinne der Großbourgeoisie gelöst. Der Uhse-Biograph Klaus Walther formulierte treffend: "Als 1948 durch die separate Währungsreform und 1949 durch die Errichtung eines Westzonenstaates die staatliche Einheit Deutschlands zerstört wurde, hatte der Klassenkampf übernationale Dimensionen gewonnen; auf deutschem Boden wurde er als Kampf um die deutsche Einheit ausgetragen."
Der Kampf um die nationale Einheit Deutschlands und für den Frieden sollte Sache einer breiten Einheitsfront sein. Schon in der ersten von Uhse zu verantwortenden Nummer des "Aufbruch" kamen so unterschiedliche Autoren wie Arnold Zweig, Rudolf Alexander Schröder oder Wolfgang Weyrauch zu Wort. Neben der kulturpolitischen Arbeit, die stets mit aktuellen Fragen verknüpft war, widmete die Zeitschrift sich auch der Förderung von Nachwuchstalenten. "Wir müssen überall dort anknüpfen, wo sich die deutsche Literatur gegen die Misere erhob oder sie gar überwand, wo sie wahrhaft humanistische Züge trägt und also im tiefsten Sinne national und fortschrittlich ist." Im Wechselverhältnis mit der "Beachtung, Prüfung, Durchsicht und Wertung" des literarischen Erbes sollte eine neue deutsche Literatur geschaffen werden.
1956 avancierte Uhse zum Sekretär der Sektion Dichtkunst und Sprachpflege der Akademie der Künste. Er nahm für die DDR am PEN-Kongress in London und an der antiimperialistischen Schriftstellerkonferenz in Neu-Delhi teil. Nach einem Kuba-Aufenthalt im Jahr 1961 setzte eine schwere Erkrankung seinen Aktivitäten ein Ende - Bodo Uhse starb am 2. Juli 1963 in Berlin.
"Wenige Stunden vor seinem Tod saßen wir lange in seinem Arbeitszimmer über dem Strausberger Platz zusammen. Er war heiter, aufgeschlossen, wie ich ihn seit langem nicht gesehen hatte...Er sprach so leise, zögernd, tastend wie immer. Und wie immer spürte ich, was sich hinter dieser leisen Stimme verbarg: dass es in ihm brannte, in ihm schrie." (Kurt Stern)
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : histoire, nationalisme révolutionnaire, socialisme national, socialisme, allemagne, années 20, années 30, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 novembre 2009
"Ernst Jünger " de Dominique Venner
Le livre que Dominique Venner vient de publier aux Editions du Rocher (ici) sur Ernst Jünger fera date. Cet essai du Directeur de La Nouvelle Revue d’Histoire sur le monumental écrivain allemand n’est ni une biographie, ni une étude littéraire proprement dites.
Dans cet essai Dominique Venner tente d’expliquer comment un des penseurs de la droite radicale de l’après Grande Guerre, auteur de La guerre notre mère est devenu un adversaire du nazisme qu’il avait, avant son avènement, espéré voir donner à l’Allemagne vaincue une renaissance attendue et à quel point sa pensée peut être intemporelle
L’auteur est bien placé pour comprendre l’émetteur d’idées allemand, sensible comme un sismographe aux évolutions du temps. Car comme lui il a connu l’épreuve du feu. Jünger sous les orages d’acier de la Grande Guerre, Venner en tant que soldat perdu de la guerre d’Algérie.
Ceux de ma génération qui n’ont pas connu de guerres du tout ont du mal à comprendre réellement, profondément, que les guerres puissent féconder ainsi les vies intérieures des hommes, être de véritables expériences fondatrices, avec des résultats bien différents d’ailleurs selon les tempéraments :
Si l’on compare deux témoignages de guerre parmi les plus marquants, écrits par deux auteurs souvent rapprochés, on découvre que La Comédie de Charleroi, de Pierre Drieu la Rochelle, malgré la victoire française de 1918, ressemble fort à un livre de vaincu, alors que Le Boqueteau 125, écrit [par Jünger] après la défaite allemande de 1918, semble plutôt un livre de vainqueur.
Ce qui fait d’Ernst Jünger un soldat et un écrivain hors normes c’est qu’il [vise] plus haut que le but qu’il s’est assigné et qu’il a une constante « tenue » au moral et au physique. Un tel homme, qui est un écrivain né, ne peut pas être un doctrinaire et ne l’est d’ailleurs pas. C’est un écrivain qui a des idées, mais :
Ces idées sont soumises à variation sans souci de cohérence idéologique.
En réalité :
Jünger vivait pour l’idée et non par l’idée. L’idée était sa raison de vivre, mais elle ne lui rapportait rien sinon des tracas. Jünger était un penseur idéaliste et profond. Il ne fut jamais un politicien pratique, tout en s’adonnant au romantisme politique plus qu’il n’en a convenu.
Si les œuvres de jeunesse semblent contredire celles de la maturité qui commencent avec Sur les falaises de marbre, Jünger considère ses œuvres comme des périodes et non pas comme des contradictions. Pour lui il y a continuité dans ses œuvres de jeunesse et de maturité comme le Nouveau Testament prolonge l’Ancien :
Seule la conjugaison [des parties de mon œuvre] déploie la dimension au sein de laquelle je souhaite qu’on me comprenne.
Jünger en dépit de son nationalisme originel ne pouvait que s’opposer à Hitler. Dominique Venner en fin d’ouvrage résume les idées qui ont nourri cette opposition :
Son refus de l’antisémitisme et du darwinisme racial, son opposition à la russophobie, lui-même souhaitant l’alliance de l’Allemagne et de la Russie, même bolchevique.
Et souligne :
[Sa] répugnance toujours plus grande […] à l’égard des dirigeants d’un parti brutal, indignes d’incarner la nouvelle Allemagne.
Il y a plus :
[Jünger] a pris […] la mesure de ses vraies aptitudes, finissant par détester en Hitler ce qu’il n’était pas. Il avait commis l’erreur fréquente des idéalistes perdus en politique. Il n’avait pas compris à temps que celle-ci appartient au monde de Machiavel et non à celui de Corneille.
Une fois comprise cette opposition l’œuvre de Jünger s’éclaire d’un tout autre jour, surtout quand on sait que :
Dans toute son œuvre, Jünger montre qu’il ne pense pas de façon historique, mais à travers des mythes intemporels.
Jünger, dans Le Nœud gordien, paru initialement en 1953, explique que l’essence de l’antinomie dans chaque débat entre l’Est et l’Ouest se trouve dans la notion de liberté qui a deux significations majeures pour l’Occidental : liberté spirituelle d’abord et :
Liberté politique ensuite, refus de l’arbitraire, dont Jünger perçoit tout à la fois les limites et la nécessité.
En héritier de cette conception de la liberté typiquement occidentale Venner est convaincu :
Que l’Europe, en tant que communauté millénaire de peuples, de culture et de civilisation, n’est pas morte, bien qu’elle ait semblé se suicider. Blessée au cœur entre 1914 et 1945 par les dévastations d’une nouvelle guerre de Trente Ans, puis par sa soumission aux utopies et systèmes des vainqueurs, elle est entrée en dormition.
Cette intime conviction repose sur ce que l’étude historique lui a appris, mais aussi sur l’exemple insigne donné par l’attitude et la pensée d’un Ernst Jünger.
Pour ma part je reconnais qu’il y a en moi de l’anarque, figure tardive de l’univers jüngerien, qui m’est contemporaine et est décrite dans Eumeswil, roman publié en 1977 par Jünger à l’âge de 82 ans :
Sa mesure lui suffit ; la liberté n’est pas son but ; elle est sa propriété.
Francis Richard
Pour l'internaute intéressé, Dominique Venner a depuis peu un blog : (ici).
00:20 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, révolution conservatrice, littérature allemande, lettres allemandes, lettres, littérature, allemagne, années 20, années 30, années 40, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le "socialisme allemand" de Werner Sombart
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES – 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES – 1990
Thierry MUDRY:
Le “socialisme allemand” de Werner Sombart
Né en 1863 à Ermsleben, Werner Sombart est le fils d'Anton Ludwig Sombart, hobereau et industriel prussien, membre libéral de la Chambre prussienne des Députés et du Reichstag.
Werner Sombart étudie l'économie politique et le droit dans les Universités allemandes. Après avoir obtenu son doctorat, il est d'abord secrétaire de la chambre de commerce de Brême puis professeur extraordinaire (chargé de cours) à l'Université de Breslau. Mais le "radicalisme" de Sombart (influencé par Lassalle et Marx) lui vaut la défaveur du ministère prussien de l'instruction publique: son avancement est stoppé. En 1906, il donne des cours à l'Ecole des hautes études commerciales de Berlin et plusieurs années plus tard, en 1918, il devient enfin professeur ordinaire à l'Université de Berlin où il prend la succession d'Adolf Wagner, l'un des maîtres de la Jeune Ecole historique et du "socialisme de la chaire" (Kathedersozialismus).
Economiste et sociologue, Sombart apparaît comme l'historien du capitalisme mais aussi comme un critique impertinent du capitalisme. Sombart s'éloigne cependant peu à peu d'une critique d'inspiration marxiste pour adopter une critique d'inspiration nationaliste et luthérienne. On distingue aisément le Sombart qui se consacre à l'étude scientifique du capitalisme et particulièrement à l'étude de la genèse de l'esprit capitaliste et le Sombart militant qui prend fait et cause pour le mouvement ouvrier à la fin du XIXème siècle et au début de ce siècle, pour l'Allemagne pendant la Grande Guerre et pour le "socalisme allemand" dans les années 30. Le premier Sombart est l'auteur en 1902 des tomes I et II du "Capitalisme moderne" qui connaîtront des rééditions successives en 1916 et 1924/27 (Sombart publiera en 1928 le tome III traduit en français sous le titre L'apogée du capitalisme); en 1903 de L'économie allemande du XIXème siècle; en 1911 d'un ouvrage sur Les Juifs et la vie économique (traduit en français); en 1913, il publie Le bourgeois (également traduit en français) et ses études sur le développement du capitalisme moderne: Luxe et capitalisme, Guerre et capitalisme, etc. En revanche, Le socialisme et le mouvement social au XIXème siècle publié en 1896 (traduit en français), Commerçants et héros qui parut pendant la Grande Guerre, Le socialisme prolétarien publié en 1924 et Le socialisme allemand publié en 1934 (traduit en français) sont indiscutablement l'œuvre du Sombart militant.
Sombart = Marx + l’école historique?
D'après Schumpeter (à qui Sombart céda sa chaire à l'Université de Berlin), Sombart aurait subi tout autant l'influence de Karl Marx que celle de l'Ecole historique.
Sombart étudia l'économie politique à Berlin, or "l'enseignement économique était alors dans les universités allemandes sous l'influence de l'Ecole historique réagissant contre l'étroitesse d'esprit et l'optimisme exagéré du libéralisme (le Manchestertum "fossile") et plus ou moins imbu de socialisme d'Etat" (André Sayous, préface à L'apogée du capitalisme de Werner Sombart, Payot, Paris, 1932, pp XII et XIII). Sombart eut pour maîtres à l'Université de Berlin Gustav Schmoller et Adolf Wagner. Ce dernier, qu'une commune admiration pour les travaux de Ferdinand Lassalle (l'un des pères du socialisme d'Etat) rapprochait de Sombart, le désigna d'ailleurs comme son successeur à l'Université. Pour certains, il conviendrait de ranger Sombart parmi les auteurs de l'Ecole historique mais ce n'est pas l'avis d'André Sayous: "économiste et sociologue, il (Werner Sombart) traite en réalité l'histoire comme une "science auxiliaire" qu'il utilise, répétons-le, avec une grande liberté d'esprit et même, parfois, selon son bon plaisir" (ibid., p. XVII) mais, reconnaît Sayous, "Sombart a conservé des liens avec l'Ecole historique. Généralement, son argumentation repose sur l'histoire et il se sert de celle-ci dans l'esprit démonstratif des maîtres de l'école allemande" (ibid., p. XVIII).
Sombart a subi aussi l'influence de Karl Marx. En 1894, Sombart accueille avec enthousiasme la publication du troisième volume du Capital et publie une étude sur le marxisme qui lui vaut les éloges de Friedrich Engels. Deux ans plus tard, il écrit Le socialisme et le mouvement social du XIXème siècle. Mais Sombart s'éloigne peu à peu du marxisme, la 10ème édition de son Socialisme et mouvement social parue en 1924 sous le titre Le socialisme prolérarien apparaît aux yeux de certains comme une diatribe anti-marxiste. Mais devenu pourtant "anti-marxiste", Sombart reconnaît volontiers sa dette envers Marx. Dans l'introduction à L'apogée du capitalisme, il se défend d'avoir voulu attaquer Marx: au contraire, affirme-t-il, "je m'étais proposé de continuer et, dans un certain sens, de compléter et d'achever l'œuvre de Marx. Tout en repoussant la conception du monde de Marx et, avec elle, tout ce qu'on désigne aujourd'hui, en synthétisant et précisant son sens, sous le nom de "marxisme"; j'admire en lui sans réserves le théoricien et l'historien du capitalisme. Tout ce qu'il y a de bon dans mes propres ouvrages, c'est à l'esprit de Marx que je le dois, ce qui ne m'empêche naturellement pas de m'écarter de lui non seulement sur des points de détail, voire dans la plupart de mes façons de voir particulières, mais sur des points essentiels de ma conception d'ensemble" (ibid., p.15). En 1934, dans Le socialisme allemand (paru dans sa traduction française chez Payot, Paris, 1938), Sombart opère une distinction entre le "marxisme pratique" et le marxisme "qui, à titre de théorie historique, est d'une incomparable valeur pour les sciences sociales" (p. 100).
Sombart et l'étude du capitalisme
Pour Sombart, le capitalisme -qu'il définit par ailleurs comme une "catégorie historique"- est un "système économique" qui "repose d'une façon subjective sur le primaire de l'acquisition, trouvant son expression dans le gain; il est essentiellement "individualiste", car il a comme base la concurrence; enfin, il représente les idées de rationalisation dans l'ordre économique" (André Sayous, op. cit., p. XX).
Sombart distingue trois périodes dans l'histoire du capitalisme:
- le "capitalisme primitif" qui prend fin avec la révolution industrielle;
- le "haut capitalisme" ou "apogée du capitalisme" qui correspond à la période s'étendant de l'emploi métallurgique du coke (dont Sombart situe les débuts dans les années 1760/1770) à la Ière guerre mondiale. "C'est au cours de cette époque que le capitalisme a réalisé son épanouissement le plus complet et est devenu le système économique dominant" (L'apogée du capitalisme, p.12);
- le "capitalisme tardif", période qui s'ouvre avec la Ière guerre mondiale.
Pour Sombart, il ne fait pas de doute que "les forces motrices de la vie économique" ne sont pas plus la piété puritaine que la plus-value du capital (Sombart renvoie ici dos à dos Weber et Marx); ni même la division du travail et la concurrence chères aux économistes classiques, ni non plus le système juridique, la technique ou la démographie. Les seules forces motrices de l'histoire en général et de la vie économique en particulier, ce sont les hommes vivants avec leurs pensées et leurs passions et surtout certains d'entre eux. C'est l'homme, en tant que sujet de l'histoire, qui construit les systèmes économiques. Ainsi, le capitalisme naissant "fut l'œuvre de quelques hommes d'affaires entreprenants, appartenant à toutes les couches de la population. Il y avait parmi eux des nobles, des aventuriers, des marchands, des artisans, mais ils ont été pendant longtemps trop faibles pour imprimer à la vie économique une direction décisive. A côté d'eux, des princes énergiques (...) et plus particulièrement de hauts fonctionnaires, comme Colbert, ont joué dans l'évolution économique de l'époque un rôle de premier ordre (en poussant les particuliers dans des entreprises capitalistes)" (ibid., p. 29). A l'époque du capitalisme avancé "toute la direction de la vie économique a passé entre les mains des entrepreneurs capitalistes qui, désormais soustraits à la tutelle de l'Etat, sont devenus (...) les seuls organisateurs du processus économique, pour autant que celui-ci se déroule dans le cadre de l'économie capitaliste" (ibid., p.30). L'entrepreneur capitaliste est donc la seule force motrice de l'économie capitaliste moderne. Il est la seule force productive: "tous les autres facteurs de la production, le capital et le travail, se trouvent sous sa dépendance, ne sont animés que par son activité créatrice. De même, toutes les inventions techniques ne reçoivent que de lui leur vitalité" (ibid., p.31).
Le capitalisme va-t-il mourir d’un excès de rationalisation?
Sombart a consacré les deux premiers tomes de son Capitalisme moderne à l'étude du pré-capitalisme et du capitalisme primitif et le troisième tome à l'étude du haut capitalisme. Quant au capitalisme tardif, Sombart y a consacré la conclusion de son Apogée du capitalisme. La principale caractéristique de cette période serait "la substitution du principe de l'entente à celui de la libre-concurrence". Le déclin du capitalisme s'amorce et celui-ci, pense Sombart, va probablement mourir d'un excès de rationalisation. "La crise allait évidemment donner une puissante accélération à la thèse du déclin, largement vulgarisée par Fried, disciple de Sombart et collaborateur de la revue Die Tat, dont le livre intitulé La fin du capitalisme (1931) fut une manière de best-seller dans les milieux nationalistes" (Louis Dupeux, Stratégie communiste et dynamique conservatrice ..., Librairie Honoré Champion, Paris, 1976, p. 12).

Sombart "a distingué des périodes de civilisation et conçu chacune d'elles comme un "système" d'un "esprit" ou "style déterminé" ... "où ainsi que chez Karl Marx, les fonctions économiques constituent les bases et les caractères propres de la période, mais où, différence fondamentale, chaque sentiment de l'économique est précisé d'une façon spéciale" (André Sayous, op. cit., pp. x et xi). "Ce qui imprime à une époque, et aussi à une période économique, son cachet particulier, c'est son esprit" écrit Sombart (ibid., p.8). Le capitalisme s'accompagne d'un "esprit capitaliste" et c'est cet esprit qui, en se transformant, a fait évoluer le capitalisme.
Mais, quel est cet "esprit capitaliste" et quel rôle joue-t-il dans l'apparition et l'évolution du capitalisme? Sombart apporte des éléments de réponse dans son livre Le bourgeois.
L'esprit capitaliste (c'est-à-dire l'esprit qui anime l'entrepreneur capitaliste et qui caractérise le système que celui-ci crée) est né, pense Sombart, de la réunion de l'esprit d'entreprise et de l'esprit bourgeois: "(...) L'esprit d'entreprise est une synthèse constituée par la passion de l'argent, par l'amour des aventures, par l'esprit d'invention, etc. tandis que l'esprit bourgeois se compose, à son tour, de qualités telles que la prudence réfléchie, la circonspection qui calcule, la pondération raisonnable, l'esprit d'ordre et d'économie. (Dans le tissu multicolore de l'esprit capitaliste, l'esprit bourgeois forme le fil de laine mobile, tandis que l'esprit d'entreprise en est la chaîne de soie)" (Le bourgeois, Payot, Paris 1966, p. 25).
Sombart distingue parmi les sources de l'esprit capitaliste:
- des bases biologiques: les "natures bourgeoises" et les "prédispositions ethniques" (chez les Etrusques, les Frisons et les Juifs);
- les forces morales: la philosophie (interprétation rationaliste et utilitariste des écrits stoïciens, auteurs rustiques romains), les influences religieuses (catholicisme, protestantisme, judaïsme), les forces morales proprement dites (morale sociale conduisant à l'adoption et au culte des "vertus bourgeoises");
- les "conditions sociales": l'Etat, les migrations, la découvertes de mines d'or et d'argent, la technique, l'activité professionnelle pré-capitaliste, le capitalisme comme tel.
La controverse entre Weber et Sombart
Max Weber s'est élevé "contre les prétentions dogmatiques d'une explication totale de l'histoire par l'économie" mais "il ne voulait nullement -constate Raymond Aron (La sociologie allemande contemporaine, PUF, Paris 1981, pp.112/113)- réfuter le marxisme en lui opposant une théorie idéaliste de l'histoire, qui lui aurait paru aussi schématique et indéfendable que le matérialisme historique". Sombart approuve Weber sur ce point: dans Le bourgeois, Sombart constate la multiplicité des causes qui permettent d'expliquer la genèse de l'esprit capitaliste. Il s'en prend aux "partisans intransigeants de la conception matérialiste de l'histoire", mais écrit-il, "opposer à l'explication causale économique une autre explication universelle est une chose dont je me sens incapable (...)" (p.338). Tous deux voient dans la religion une des causes du capitalisme. Dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Weber attribue au calvinisme un rôle important dans la genèse de l'esprit capitaliste: "jamais assuré de son élection, le calviniste en cherche les signes ici-bas. Il les trouve dans la prospérité de son entreprise. Mais il ne peut s'autoriser du succès pour se reposer ou utiliser son argent en vue du luxe ou du plaisir. Il doit donc réemployer cet argent dans l'entreprise: formation de capital par obligation ascétique. Bien plus, seul le travail régulier, rationnel, le calcul qui permet à chaque instant de se rendre compte de la situation de l'entreprise, seul le commerce pacifique sont en accord avec l'esprit de cette morale" (Raymond Aron, op. cit., p.112). Sombart, pour sa part, attribue au thomisme et au judaïsme un rôle bien plus important que le calvinisme dans l'apparition de l'esprit capitaliste.
En imposant un droit naturel rationnel fondé sur le Décalogue mais qui intégrait aussi "la philosophie grecque de la dernière période de l'hellénisme", le thomisme a opéré une rationalisation déjà de nature à favoriser la mentalité capitaliste. "Pour que le capitalisme put s'épanouir, l'homme naturel, l'homme impulsif devait disparaître et la vie, dans ce qu'elle a de spontané et d'original, céder la place à un mécanisme psychique spécifiquement rationnel: bref, l'épanouissement du capitalisme avait pour condition un renversement, une transmutation de toutes les valeurs" (Le bourgeois, pp. 227/228). A cela, il faut ajouter la condamnation par le thomisme et les scolastiques, de la prodigalité (mais aussi de l'avarice) et de l'oisiveté, l'idéal bourgeois "d'une vie chaste et modérée", le culte de la décence et de l'honorabilité, les préceptes d'une administration juste et rationnelle: ainsi s'opéra une sorte de "dressage psychique" qui réussit à transformer en entrepreneurs capitalistes "le seigneur impulsif et jouisseur d'une part, l'artisan obtus et nonchalant d'autre part" (ibid., p.231). Sombart note enfin chez certains scolastiques (notamment italiens), qui ici dépassent la pensée de Thomas d'Aquin, une profonde sympathie pour le capitalisme.
En jugeant très favorablement la richesse, en élaborant un rationalisme très rigoureux, le judaïsme contenait et développait "jusqu'à leurs dernières conséquences logiques, toutes les doctrines favorables au capitalisme" (ibid., p.250)". Mais ce qui a permis à la religion juive d'exercer une action vraiment décisive, c'est le traitement particulier qu'elle appliquait aux étrangers. La morale juive était une morale à double face, et ses lois différaient selon qu'il s'agissait de Juifs ou de non-Juifs" (ibid., p.251). "Le traitement différentiel que le droit juif appliquait aux étrangers" a eu pour conséquences: le relâchement de la morale commerciale et la transformation précoce des "conceptions relatives à la nature du commerce et de l'industrie, et cela dans le sens d'une liberté de plus en plus grande" (ibid., pp 254 et 255). Sombart étudia d'une manière plus précise dans son livre sur "Les Juifs et la vie économique" les rapports entre judaïsme et capitalisme.
Luthérianisme, calvinisme, thomisme et scolastique
Le protestantisme apparaît dès lors singulièrement en retrait: "comme le mouvement inauguré par la Réforme a eu incontestablement pour effets une intériorisation de l'homme et un raffermissement du besoin métaphysique, les intérêts capitalistes devaient nécessairement souffrir dans la mesure où l'esprit de la Réforme se répandait et se généralisait" (ibid., p.239). Le luthérianisme se montra particulièrement anti-capitaliste (et Sombart devait recueillir l'héritage de cet anti-capitalisme luthérien). Le puritanisme lui-même (variante anglo-saxonne du calvinisme) fut une entrave au développement du capitalisme avec son idéal de pauvreté hérité du christianisme primitif, sa "condamnation sévère de tout effort ayant pour objectif l'acquisition de la richesse, c'est-à-dire, et avant tout, une condamnation des moyens de s'enrichir qu'offre le capitalisme" (ibid., p.241). Mais, après la morale scolastique (ou thomiste), "à son tour, la morale puritaine proclame la nécessité de la rationalisation et de la méthodisation de la vie, des instincts et des impulsions, de la transformation de l'homme naturel en un homme rationnel". "Lorque la morale puritaine exhorte les fidèles à mener une vie bien ordonnée, elle ne fait que reproduire mot pour mot les préceptes de la morale thomiste, et les vertus bourgeoises qu'elle prêche sont exactement les mêmes que celles dont nous trouvons l'éloge chez les scolastiques" (ibid., pp 243/244). Ce qui apparaît favorable au capitalisme chez les puritains semble donc emprunté au thomisme et aux scolastiques.
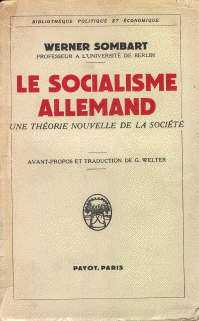
La raison première de cette divergence entre Weber et Sombart, Raymond Aron croit la trouver "dans le fait qu'ils n'utilisent pas la même définition du capitalisme". Pour Weber, le "capitalisme", c'est essentiellement le capitalisme occidental, le capitalisme "s'oppose à une économie qui tend, avant tout, à la satisfaction des besoins. Le capitalisme serait le système qu'anime un désir de gains sans limite, qui se développe et progresse sans terme, économie d'échanges et d'argent, de mobilisation et de circulation des richesses, de calcul rationnel. Les caractères sont moins dégagés par une comparaison avec les autres civilisations que saisis intuitivement dans leur ensemble" (Raymond Aron, op. cit., p.114). Autre raison probable de cette divergence: les convictions des deux auteurs. Max Weber est un protestant libéral qui croit réconcilier protestantisme et capitalisme dans l'esprit de l'homme allemand en distinguant une morale de la conviction obéissant aux impératifs de la foi et une morale de la responsabilité soumise aux impératifs de l'action. La morale de la conviction délimite un domaine religieux de plus en plus intériorisé (ce qui est bien conforme à l'essence du protestantisme), la morale de la responsabilité un domaine économique abandonné au capitalisme (et un domaine politique soumis à la raison d'Etat). A l'inverse, Sombart est un anti-capitaliste d'obédience marxiste et, plus tard, d'obédience luthérienne.
Vertus bourgeoises et éléments héroïques de la psyché européenne
Après avoir passé en revue les diverses manifestations nationales de l'esprit capitaliste (Italie, Espagne, France, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, USA), Sombart s'intéresse à l'évolution de celui-ci. (Pour Sombart, nous le savons, l'évolution du capitalisme est intimement liée à celle de l'esprit capitaliste).
- Dans un premier temps, les "vertus bourgeoises" se joignent à l'esprit d'entreprise et à l'amour de l'or (caractéristiques mentales des peuples européens) pour donner naissance à l'entrepreneur capitaliste d'abord tout à la fois héros, marchand et bourgeois. Puis, les "vertus bourgeoises" l'emportent peu à peu sur l'élément héroïque. A cela plusieurs raisons: le développement des armées professionnelles, l'auto-rité des forces morales, le mélange des sangs (cf. "Le bourgeois", pp 339/340).
Deux époques se succèdent alors:
- celle du "bourgeois vieux-style" tenu en laisse, selon l'expression même de Sombart, par les mœurs et une morale d'inspiration chrétienne;
- celle de l'"homme économique moderne" (à partir de la fin du XIXème siècle) qui ne connaît plus ni entraves, ni restriction.
Sombart aborde enfin un délicat problème de causalité: le capitalisme est-il l'émanation ou la source de l'esprit capitaliste? Selon Sombart, on ne peut opposer l'esprit capitaliste au capitalisme dont il est partie intégrante mais on peut en revanche l'opposer à l'"organisation capitaliste" (qui comprend tous les éléments constitutifs du système capitaliste qui ne peuvent être rangés dans la catégorie "esprit"). "Sans l'existence préalable d'un esprit capitaliste (ne fût-ce qu'à l'état embryonnaire), l'organisation capitaliste n'aurait jamais pu naître" (ibid., p.328): une création ne peut préexister à son créateur mais elle peut acquérir une certaine autonomie et agir en retour sur son créateur. Ainsi le capitalisme, création de l'esprit capitaliste, est devenu une des sources (et "non la moins importante" ajoute Sombart) de cet esprit.
Deux dangers menacent désormais l'esprit capitaliste: la "féodalisation" ("l'enlisement dans la vie de rentier ou l'adoption d'allures seigneurales") et la bureaucratisation croissante des entreprises. "Peut-être, conclut Sombart, assisterons-nous aussi au crépuscule des dieux et l'or sera-t-il rejeté dans les eaux du Rhin" (ibid., p.342). Voici un rêve auquel le "socialiste" Sombart s'efforce de donner quelque consistance ...
Sombart et le socialisme allemand
Après s'être consacré à l'étude du capitalisme, Sombart devient en 1934 le porte-parole d'un "socialisme allemand". Mais, quel est le contenu de ce socialisme allemand à la Sombart?
Sombart s'efforce de donner une définition du socialisme. Après avoir passé en revue les diverses acceptions courantes du terme et porté sur chacune d'elles un jugement, Sombart définit le socialisme comme un "normativisme social". "J'entends par là un état de vie sociale où la conduite de l'individu est déterminée en principe par des normes obligatoires, qui doivent leur origine à une raison générale, intimement liée à la communauté politique, et qui trouvent leur expression dans le "nomos" (Werner Sombart "Le socialisme allemand", Payot, paris 1938, p.77). "On n'est vraiment socialiste que lorsqu'on considère comme nécessaire que la conduite de l'individu soit soumise, dans ses manifestations extérieures, à des règles générales" (ibid.).
Sombart distingue ensuite les variétés de socialisme:
- d'après la nature de l'ordre socialiste imaginé: "du point de vue de l'espace ou de la quantité", ce peut-être un "socialisme total ou partiel"; "du point de vue du temps" "un socialisme absolu ou relatif"; "du point de vue de la forme", "un socialisme de l'égalité ou de l'inégalité", ou bien "un socialisme de l'individu ou de l'ensemble", ou encore "un socialisme méca-nistique, amorphe, espacé, abstrait, pensé, international, social" ou "un socialisme organique, morphique, technique, concret, imaginé, par classes sociales, national, étatique";
-
- d'après les fondements de l'ordre socialiste: socialisme évolutionniste ou révolutionnaire, socialisme sacré ou profane;
- d'après la mentalité en vertu de laquelle l'ordre socialiste est construit (mentalité mercantile ou héroïque).
Un socialisme anti-économiste
Sombart, lorsqu'il définit le socialisme et les variétés de socialisme, veut faire œuvre scientifique mais on sent qu'il prend déjà parti et qu'il dessine à gras traits les contours de "son" socialisme. Peu après avoir défini le socialisme, Sombart écrit: "Etant donné que la libération des forces sociales avait eu pour principal effet de mettre au premier plan l'économie et de subordonner toute l'existence de la société à ses lois, le mouvement socialiste moderne est naturellement dirigé surtout contre la primauté de l'économie. Le cri de guerre du socialisme fut: débarassons-nous de l'économie!" (ibid., p.81). On comprend déjà que le socialisme de Sombart sera essentiellement un anti-économisme. Lorsque Sombart énumère les diverses variétés de socialisme, à l'évidence il porte son choix sur certaines d'entre elles. Le socialisme qu'il prône ne peut être que "partiel", "relatif", inégalitaire, "organique, concret, national, étatique ...": il ne peut être que révolutionnaire (ou volontariste, c'est-à-dire "engendré par la liberté, par un acte créateur") et profane -ici, Sombart dévoile dans sa critique du socialisme chrétien une de ses principales sources d'inspiration: Martin Luther lui-même, pour qui l'Evangile n'enseigne en rien la façon dont on doit gouverner les hommes et administrer les biens matériels (cf "Contre les paysans pillards et meurtriers")-; Sombart se prononce enfin pour un socialisme "héroïque" -Sombart reprend ici les thèmes développés dans son livre de guerre ("Marchands et héros", 1915). Deux conceptions de la vie s'opposent: d'un côté, la conception mercantile (qualifiée pendant la guerre d'"anglo-saxonne") qui vise au "plus grand bonheur pour le plus grand nombre" (le bonheur étant "le bien-être dans l'honnêteté") et qui cultive le "pacifique côte-à-côte des commerçants" (Sombart vitupère ici les "vertus bourgeoises" qu'il avait froidement examinées dans "Le Bourgeois"); de l'autre côté, la mentalité héroïque considère la vie comme une tâche et cultive les "vertus guerrières" (cette mentalité se serait incarnée dans l'Allemagne luthérienne et prussienne). Le "socialisme allemand" de Sombart apparaît comme la traduction à tous les niveaux, notamment au niveau économique, d'une mentalité héroïque dominante: le service de la communauté, de l'Etat et du peuple prime le sevice de soi-même.
Sombart précise le sens qu'il donne au terme "socialisme allemand": " (...) l'on pourrait entendre par socialisme allemand des tendances socialistes répondant à l'esprit allemand, qu'elles soient d'ailleurs représentées par des Allemands ou des non-Allemands. Dans ce sens, on pourrait considérer comme socialisme pensé à l'allemande un socialisme qui serait relativiste, adapté à toute la nation, volontariste, profane, païen, et qu'on pourrait -à fortiori- qualifier de socialisme national. Sous le terme général de socialisme national, on peut entendre un socialisme qui tend à se réaliser dans une association nationale, qui part de l'idée que socialisme et nationalisme sont parfaitemebt adaptables" (ibid., pp. 139/140). Sombart précise encore: "Pour moi, socialisme allemand veut dire socialisme pour l'Allemagne, c'est-à-dire un socialisme qui vaut seulement et exclusivement pour l'Allemagne" (ibid.), parfaitement adapté au corps, à l'âme et à l'esprit de la Nation allemande.
Un socialisme réactionnaire?
On peut dire du socialisme de Sombart qu'il est "réactionnaire":
- en raison de ses objectifs: le socialisme allemand aspire à la "culture" qui est appelée à abolir "l'état actuel de la civilisation". Il faut pour cela briser la primauté de l'économique et des biens matériels qu'a instauré l'âge économique et se libérer de la foi dans le progrès qui obnubile l'âme allemande. Le socialisme de Sombart se veut donc une rupture avec la modernité occidentale (l'"âge économique") et l'idée même de progrès.
"Ce que j'appelle "socialisme allemand" écrit Sombart, signifie -exprimé d'une façon négative- l'abandon de tous les éléments de l'âge économique" (ibid. p.60) "sortir l'Allemagne du désert de l'âge économique, telle est la tâche que le socialisme allemand estime avoir à remplir" (ibid., p.180). Ce qui caractérise l'âge économique c'est que les mobiles économiques, les mobiles matériels "ont prédominé toutes les autres aspirations" (la théorie matérialiste de l'histoire apparaît aiinsi valable pour cette périàde, "mais pour cette période seule"); "(...) c'est la prédominance des intérêts économiques, en tant que tels, qui marque l'époque de son empreinte -étant bien entendu, naturellement, que le caractère de cette empreinte est déterminé par le caractère même de l'économie, en l'espèce l'économie capitaliste" (ibid., p;.18). L'âge économique a conduit à l'explosion démographique de l'Europe, à l'augmentation de la durée de vie moyenne, à l'accroissement considérable de la consommation et de la production des biens matériels. L'Europe industrielle est devenue une ville immense de plusieurs centaines de millions d'habitants, les autres pays du globe formant une banlieue autour de cette ville. Les rapports des pays entre eux furent bouleversés. En Europe, les sociétés et les formes de vie ont été bouleversées: Sombart constate la dissolution des communautés traditionnelles et la fin de l'enracinement, les Européens ne formant plus que des masses d'individus "errant ça et là"; notre existence a été soumise à un processus d'intellectualisation (fin de l'initiative, du travail intelligent, du métier), de matérialisation (c'est-à-dire de mécanisation) et d'égalisation (tendance à l'uniformité). La vie publique elle aussi a été bouleversée (un seul fondement et une seule mesure de la valeur: la richesse; une seule hiérarchie: celle qui se fonde sur le capital et le revenu; des partis de classe sont apparus et l'Etat s'est mis au service des intérêts économiques). Enfin, toute vie spirituelle a disparu ("la vie humaine est devenue vide de sens").
 Le socialisme allemand de Sombart, qui est une réaction contre cet état de fait, veut opérer un retour vers un ordre humain (c'est-à-dire un ordre dans lequel l'état de péché qui définit l'homme depuis la chute n'est pas nié, un ordre dans lequel l'homme peut de nouveau servir Dieu). En condamnant l'âge économique et ses manifestations diverses, Sombart apparaît proche d'autres "socialistes allemands" les plus radicaux (les nationaux-bolchéviques) condam-naient la "fuite dans le Moyen-Age", la "tendance anti-industrielle et anti-technique" (et le christia-nisme) qui caractérisaient l'idéologie des frères Strasser et de Sombart; ils repoussaient un "socialisme allemand" si ouvertement réactionnaire et se voulaient résolument modernes: ils acceptaient la société industrielle et le pouvoir de la technique les fascinait.
Le socialisme allemand de Sombart, qui est une réaction contre cet état de fait, veut opérer un retour vers un ordre humain (c'est-à-dire un ordre dans lequel l'état de péché qui définit l'homme depuis la chute n'est pas nié, un ordre dans lequel l'homme peut de nouveau servir Dieu). En condamnant l'âge économique et ses manifestations diverses, Sombart apparaît proche d'autres "socialistes allemands" les plus radicaux (les nationaux-bolchéviques) condam-naient la "fuite dans le Moyen-Age", la "tendance anti-industrielle et anti-technique" (et le christia-nisme) qui caractérisaient l'idéologie des frères Strasser et de Sombart; ils repoussaient un "socialisme allemand" si ouvertement réactionnaire et se voulaient résolument modernes: ils acceptaient la société industrielle et le pouvoir de la technique les fascinait.
- Le socialisme de Sombart apparaît réactionnaire en raison de ses références luthériennes.
Ce qui s'est passé en Europe occidentale et en Amérique depuis la fin du XVIIIème siècle est pour Sombart l'œuvre de Satan. Luther jetait son encrier sur Satan venu le tenter, Sombart, émule de Luther, utilise sa plume pour dénoncer l'œuvre de Satan: l'âge économique ...
De Luther et des luthériens, Sombart a retenu l'idée que l'autorité politique est directement instituée par Dieu. Luther a justifié l'autorité politique par le péché originel, par la corruption dont il est cause sur terre; pour Sombart, le "socialisme allemand" exige un état fort car "il met le bien de tous au-dessus du bien de l'individu" et "parce qu'il estime qu'il a à faire à l'homme pécheur". Au sein de la société, affirme Luther, "chaque homme trouve sa vocation dans les obligations ponctuelles de son état (Beruf), dans la réalisation de la charge que Dieu lui a confiée, domaine dans lequel il reste soumis à l'autorité séculière" (Jacques Droz, "Histoire des doctrines politiques en Allemagne", PUF, que sais-je?, Paris 1978, p.22). Sombart rejoint ici aussi l'opinion de Luther. Enfin, pour Luther comme pour le luthérien Sombart, la division de l'humanité en peuples et en Nations correspond à un plan divin: le peuple (Volk) est un organisme d'origine divine appelé à remplir une mission au sein de l'humanité (idée reprise et développée par le luthérien Herder).
Etre un peuple de l’esprit, de l’action et de la variété
Pour remplir la mission que Dieu lui a confiée au milieu des autres peuples, le peuple allemand doit, selon Sombart, être toujours plus un peuple de l'esprit, de l'action et de la variété.
Le luthérianisme conduit donc Sombart à l'étatisme (dans sa version prussienne), au rationalisme -les germanistes français ont révélé le lien très étroit qui unissait le luthérianisme au nationalisme allemand (Jacques Droz, "Histoire des doctrines politiques en Allemagne", Edmond Vermeil "l'Allemagne Essai d'explication", etc.) mais ils l'ont évidemment, caricaturé-, au "corporatisme" (le terme de "corporatisme" n'est peut-être pas très approprié: il ne s'agit pas ici en effet de la Corporation mais du "stand", l'état, voir plus loin).
Sombart est un nationaliste mais il apparaît en retrait par rapport à d'autres auteurs nationalistes, notamment par rapport aux "völkische" stricto sensu (ceux qui mettent l'accent sur la dimension raciale-biologique du peuple): le peuple n'est pas conçu à la manière völkisch comme race, le peuple pas plus que la Nation ou l'Etat ne sont assimilés à des organismes naturels (mais plutôt, à des entités spirituelles -l'organicisme au sens strict est rejeté comme biologisme.
Il faut remarquer que le luthérianisme professé par Sombart l'est aussi par des "socialistes allemands" proches de lui: Otto Strasser, les membres du groupe constitué autour de la revue "die Tat" notamment Hans Zehrer et Léopold Dingräve (surnom de Wilhelm Eschmann).
Le socialisme de Sombart est un anti-judaïsme: "(...) ce que nous avons défini comme étant l'esprit de l'ère économique est justement, à beaucoup d'égards, l'esprit juif. Et, dans ce sens, Karl Marx a certainement raison quand il dit que "l'esprit pratique des Juifs est devenu l'esprit pratique des peuples chrétiens" et que "les Juifs se sont émancipés dans la mesure où les chrétiens sont devenus juifs" et encore que "la nature réelle des Juifs s'est concrétisée dans la société bourgeoise"." ("le socialisme allemand" pp. 215/216). Le capitalisme incarne l'esprit juif, il appartient au "socialisme allemand" d'incarner l'esprit allemand.
Le socialisme prolétarien est un capitalisme à rebours
Par sa nature même, le socialisme allemand" s'oppose au socialisme prolétarien. Le socialisme prolétarien est "un capitalisme à rebours, le socialisme allemand est un anti-capitalisme. L'œuvre libératrice du socialisme allemand ne se limite pas à une classe ou à un autre groupe de la populaton mais s'étend à celle-ci toute entière, dans toutes ses parties (...). Le socialisme allemand n'est pas un socialisme prolétarien, petit-bourgeois ou "partiel", c'est un "socialisme populiste" (ibid.p.180). Il embrasse le peuple entier dans tous les domaines de sa vie.
Pour Sombart, le socialisme prolétarien est "le fils authentique" de l'ère économique. Il en a toutes les tares. Dans son livre sur "Le socialisme allemand", Sombart définit rapidement le contenu idéologique du socialisme prolétarien et critique ses fondements pseuod-scientifiques: il lui reproche notamment d'avoir, avec sa théorie de l'histoire, transformé "les traits particuliers de l'ère économique en traits généraux ce l'histoire de l'humanité" (ibid. p.130). Sombart ne fait que reprendre, pour l'essentiel, les thèses qu'il développa dans "Le socialisme prolétarien" en 1924.
A l'époque où Marx fit ses débuts das la vie active (entre 1840 et 1850), écrit Sombart, "le capitalisme représentait un chaos, quelque chose d'informe, dont il était impossible de prévoir avec certitude les effets et les conséquences. Celui qui en abordait l'étude, guidé par l'idée de l'évolution (et telle fut précisément l'idée directrice de Marx), pouvait assigner à son devenir tous les buts qu'il voulait. Il pouvait y voir en germe les choses les plus magnifiques, prétendre que ce chaos était fait pour enfanter un monde de merveilles, un monde idéal, dont le capitalisme serait la phase préalable, la condition nécessaire" ("L'apogée du capitalisme", pp. 15/16). On comprend ainsi les "bizarres prédictions" de Marx "relatives à l'augmentation illimitée de la productivité, à la "concentration" générale des industries, à l'écroulement final et inévitable de l'édifice économique, etc.". Ainsi se justifiait l'optimisme de Marx. Mais, constate Sombart, le capitalisme nous est désormais connu: "Nous ne sommes plus assez naïfs et ignorants pour adorer le capitalisme comme une Sainte Vierge qui porte dans ses flancs le Rédempteur" (ibid, p.17).
Se mettre à l’écoute dela “Volkheit”
Le "socialisme allemand" exige un Etat fort. Cet Etat fort s'identifie à l'Obrigkeitstaat de tradition luthérienne, dont le chef, le Prince, n'est responsable que devant Dieu, et que Sombart veut, comme Goethe, à l'écoute non du peuple mais de la "populité" (Volkheit) -sur ce dernier point, Sombart démarque Wilhelm Stapel, auteur protestant d'une "théologie du nationalisme" (dont le titre exact est: "L'homme d'Etat chrétien. Théologie du nationalisme", paru en 1932). Stapel écrivait: "Les lois justes ne doivent pas correspondre à la "volonté du peuple", mais à la "volonté de la Volkheit". Car le peuple ne sait jamais d'une volonté claire ce qu'il veut, mais la Volkheit est raisonnable, constante, pure et vraie."- Sombart n'est pas le seul à préconiser un renouveau de l'Obrigkeitstaat, d'autres en Allemagne préconisent aussi (des représentants de la jeune génération parmi lesquels ses disciples de "die Tat").
L'étatisme de Sombart n'est pas fondé sur la seule doctrine de Luther. Sombart cite Hegel et prétend se rattacher à "la conception allemande de l'Etat" (l'Etat y est envisagé comme une "union idéale" par oppo-sition à la conception rationnelle et individualiste) à laquelle sont restés fidèles les conservateurs prussiens et les socialistes allemands (Lorenz von Stein, Rodbertus, Lassalle).
L'Etat allemand qu'il imagine devrait s'inspirer de l'exemple de l'Eglise catholique ou de l'armée prussienne et, tout en étant fort, il devrait être fédératif et décentralisé.
"Le socialisme allemand désapprouve (…) la forme qu'a revêtue la société à l'époque économique". Il aspire à un ordre social "corporatif" ou "organique" ou "populaire", notions qui paraissent s'unir toutes en celle de répartition par états"("le socialisme alle-mand", p.240). Sombart établit "une distinction catégorique entre deux notions d'état: la notion sociale et la notion politique". Dans le premier sens, l'état est un "tout partiel" qui, avec d'autres "touts partiels", constitue "l'organisme social". "La notion politique de l'état-classe est par contre celle qui entend par état un groupe qui est reconnu comme tel par l'Etat-pouvoir politique, qui y est incorporé et qui en a reçu des missions déterminées. Ces missions sont principalement les suivantes: (1) entretien d'une mentalité particulière, d'un esprit particulier (…); (2) renforcement du principe de l'inégalité dans l'Eta-pouvoir politique par l'octroi à l'état-classe de privilèges déterminés ou le retrait de droits déterminés; (3) exercice de fonctions dans la vie po-litique et sociale." (ibid, p.242). Pour Sombart, c'est dans un sens politique qu'il convient d'entendre la notion d'état.
Cette conception de l'état procède à la fois du "Beruf" luthérien et du "Stand" romantique remis à l'honneur par l'école viennoise d'Othmar Spann. L'idée d'état connaît alors un vif succès dans les milieux nationalistes allemands, particulièrement chez ceux qui s'y veulent "socialistes allemands".
La technique doit se plier au nomos
Nous vivons dans l'âge technique, constate Sombart. "Si notre époque est celle de la technique, c'est qu'elle a oublié les buts pour les moyens, autrement dit, qu'elle a vu le but final dans la création artificielle des moyens". Tout le monde admire les produits d'une technique perfectionnée "sans se demander quels buts seront ainsi atteints, sans apprécier les valeurs qui seront ainsi produites" (ibid. p.276). "A quel point la technicisation de notre époque est avancée, on le voit par la façon dont le culte de la technique s'étend à tous les domaines de notre culture et les marques tous de son empreinte" (ibid, p.277). Face à cet état de fait, comment réagir? Sombart rejette les "théories fatalistes" ("la technique moderne permet aux hommes de rationaliser la terre"): le "socia-lisme allemand" domestiquera la technique et la pliera au nomos! Sombart préconise, outre un certain nombre de mesures policières, un contrôle de l'office des Brevets sur la valeur de l'invention puis un contrôle sur l'application de l'invention; la recher-che scientifique sera enlevée à l'initiative privée et confiée à un institut d'Etat; les inventeurs seront rémunérés sans tenir compte de la valeur com-merciale ou industrielle de l'invention, "ainsi la fièvre des inventeurs tombera".
Le "socialisme allemand" doit encourager une "bonne consommation" qui entretienne "des formes de vie simples et naturelles". Sombart rejette la culture prolétarienne et lui préfère une culture "bourgeoise" (c'est-à-dire une certaine aisance) et paysanne (bien enracinée et variée). Il rejette aussi le "luxe capitaliste du bourgeois" et réserve l'éclat et la splendeur à l'Etat.
La consommation en Allemagne est pour Sombart mal organisée d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Beaucoup de défauts de la consommation actuelle dépendent de certaines conditions de la vie moderne (urbanisation, notamment). L'Etat doit donc intervenir pour amener les masses à modifier leur consommation.
Le "socialisme allemand" vise aussi à l'orga-nisation de la production. Sombart veut subs-tituer une économie planifiée à l'économie "libre" (c'est-à-dire abandonnée à l'arbitraire des individus). Remarque préalable: "économie plani-fiée" ne signifie pas pour Sombart "collectivisme". Dans l'économie qu'il envisage "la propriété privée et la propriété collective subsisteront côte à côte" (éco-nomie mixte) mais la propriété privée sera "une propriété donnée en fief" (ibid., p.346). Opposé au collectivisme doctrinaire, Sombart ne manifeste cependant pas un respect exagéré pour la propriété privée: pendant la Grande Crise, il réclame la création d'une "propriété sociale" (Louis Dupeux, op. cit., p.15).
L’économie planifiée selon Sombart
Une véritable économie planifiée, d'après Sombart, se caractérise par:
- la totalité "c'est-à-dire qu'il n'y a économie planifiée que lorsque le plan embrasse l'ensemble des exploitations et des phénomènes économiques à l'intérieur d'un territoire important" ("le socialisme allemand", p.302). Mais le plan peut comptendre des zones libres "où l'individu pourra faire et laisser faire ce qui lui plaira".
- "l'unité, c'est-à-dire un centre unique d'où émane le plan" (ibid., p.303). L'économie doit être soumise au "Führerprinzip" et au-dessus des chefs d'entreprise, il doit exister une direction suprême: le "conseil suprême économique" (le centre unique de décision ne peut être que l'Etat, ou une émanation de celui-ci, c'est dire qu'une économie planifiée ne peut être qu'une économie nationale. Mais l'économie nationale doit être nécessairement planifiée si on veut qu'elle assure l'unité de la Nation).
- la variété: le plan doit tenir compte de la dimension des domaines économiques; de la structure sociale d'un pays donné; du caractère national, du niveau culturel et de toute l'histoire du pays. Les diverses branches de l'économie doivent être organisées différemment et cette organisation varie à l'intérieur même de chaque branche. L'économie planifiée doit aussi avoir des moyens d'action variés.
C'est ainsi que l'économie planifiée nationale cor-respond à cette "économique qu'Aristote opposait à la chrématistique"." (ibid., p.306).
Autarcie et autarchie
A l'économie mondiale en crise, Sombart oppose l'autarcie. "Autarcie ne signifie pas, bien entendu, qu'une économie nationale doive devenir indé-pendante d'une façon intégrale (…), qu'elle doive renoncer à toute relation internationale quelle qu'elle soit (…). En considérant les faits, je qualifierais déjà d'autarcique une économie nationale qui ne dépend en aucune façon de ses relations avec les peuples étrangers, c'est-à-dire qui n'est pas obligée de recourir au commerce extérieur pour assurer sa propre existence (…)" (ibid., p.310). Mais "l'autarchie est plus importante que l'autarcie. Or l'autarchie nationale réside dans le fait que les catégories où nous pensons les relations internationales de l'avenir ne sont plus celles du commerce libre -où l'on trouvait, à la première place, la funeste clause de la nation la plus favorisée- mais celle d'une politique nationale planifiée: traités de commerce, unions douanières, droits préfé-rentiels, contingentements, interdictions d'impor-tation et d'exportation, commerce de troc, principe de la réciprocité, monopole du commerce de certains articles, etc." (ibid., p.348).
Sombart s'en prend à la grande industrie: son socialisme doit favoriser l'économie paysanne et artisanale et donc les classes moyennes. A l'opposé du socialisme prolétarien, le "socialisme allemand" met au centre de sa sollicitude non pas le prolétariat, mais les classes moyennes qui sont le plus aptes à défendre les intérêts de l'individu comme de l'Etat: c'est uniquement dans les exploitations paysannes et artisanales que l'hommes ayant une activité économique trouve la possibilité de se développer pleinement, de donner son véritable sens au travail, forme la plus importante de la vie humaine" (ibid., pp.318/319). Le "socialisme allemand" veillera au développement de l'activité artisanale, à la réorganisation du pays et s'opposera à l'indus-trialisation croissante de l'agriculture.
Domaine de l’industrie et Plan
Dans le domaine de l'industrie, Sombart préconise, outre la soumission des entreprises aux objectifs du plan:
- la socialisation de certains secteurs stratégiques de l'économie et un contrôle de l'Etat sur les entreprises abandonnées au capitalisme (notamment un contrôle du crédit);
- l'amélioration des conditions de travail et la fixation des salaires ouvriers par l'Etat;
- la fin de la concurrence sauvage et de la "con-currence suggestive" (la publicité); en revanche "la concurrence matérielle ne doit pas être exclue des cadres de l'économie dirigée";
- l'abandon du principe de rentabilité remplacé par l'"esprit ménager"
- une "production permanente et continue": "nous sommes maintenant mûrs pour une économie stationnaire et nous renvoyons l'économie "dynamique" du capitalisme là où elle avait son origine: au diable". "En stabilisant nos méthodes de production, de transport et de vente, nous supprimons une des causes des arrêts et troubles périodiques du processus économique et, par conséquent, le danger toujours menaçant du chômage, la pire des plaies de l'ère économique" (ibid., pp.340/341).
Lutte contre le chômage et travaux publics
L'Etat doit lutter contre le chômage et en même temps entreprendre la transformation de l'économie nationale. Pour lutter contre le chômage, écrit Sombart, l'Etat doit se créer une capacité d'achat supplémentaire qu'il utilisera afin d'entreprendre ou d'encourager des travaux convenables (c'est-à-dire des travaux "dont la réalisation peut entraîner une augmentaton, notamment une augmentation durable de la productivité nationale, plus exactement encore une augmentation du volume des marchandises"; ces travaux doivent être des travaux durables ou entraîner des travaux durables qui contribuent à un développement permanent de l'organisme produc-teur"; ces "travaux doivent ouvrir ces sources intaris-sables au sein de l'économie nationale allemande, afin de la rendre plus productive et susceptible de devenir indépendante"(ibid., pp 356/357).
Pour Sombart, la colonisation agricole semble le meilleur moyen de ranimer l'économie allemande et d'entraîner une transformation de celle-ci et de la société elle-même dans le sens voulu par le "socialisme allemand".
Sombart reprend ici à son compte le programme d'Heinrich Dräger et de Gregor Strasser qu'il avait approuvé et soutenu en 1932. Heinrich Dräger, fabricant de Lübeck et fondateur de la "Société d'Etudes pour une économie monétaire et une économie de crédit" (à laquelle collaborait Ernst Wagemann), défendait l'idée de "la création de travail par la création de crédit productive" (cf. Jean-Pierre Faye, "Langages totalitaires", Hermann, Paris, 1973, pp.647/648). Dräger rédigea pour Gregor Strasser (alors n°2 du Parti nazi et dirigeant de son aile gauche), la seconde partie du "programme économique de la NSDAP" publié en août 1932 sous le titre de "Sofortprogramm". Ce texte proposait un programme de création de travail de grande envergure mené sous l'égide de l'Etat et accompagné de réformes de structure. Il prévoyait, à côté de la modernisation des villes et de la construction d'habitats sains, le partage des grandes propriétés foncières non rentables en vue de l'établissement de paysans sans terre et l'exécution de travaux nécessaires au développement de l'économie rurale (ibid., pp 656 et 672).
En guise de conclusion …
Il est impossible de dissocier le scientifique Sombart, sociologue, économiste et historien de l'économie, du Sombart militant, marxiste puis "socialiste allemand" et nationaliste luthérien. Le premier étudie froide-ment le capitalisme et l'esprit capitaliste, le second les condamne en bloc et bâtit une alternative. Les deux se complètent. Pendant la Grande Guerre, "Marchands et héros" fait écho au "Bourgeois", Sombart y oppose au type humain bourgeois, porteur du capitalisme, le héros porteur de ce qu'il définira plus tard comme "socialisme allemand". Le "socialisme allemand" fait écho pendant la Grande Crise au maître-ouvrage de Sombart, "le capitalisme moderne" achevé peu avant.
Sombart a probablement influencé (et subi l'influence) de nombreux autres "socialistes allemands". Sombart avoue d'ailleurs cette parenté: le socialisme dont il se réclame, il le voit représenté en Allemagne par de nombreux nationaux-socialistes (sans doute pense-t-il plus particulièrement à Gregor Strasser), "par plusieurs adhérents à l'ancien Front Noir parmi lesquels se distingue Otto Strasser, auteur d'un livre plein de pensée, "Der Aufbau des deutschen Sozialismus" (1932), ainsi que par plusieurs isolés, comme les partisans de l'ancien milieu du "Tat" (de l'"Action"): Eschmann, Fried, Wirsing, Zehrer, etc., par des hommes comme August Winnig, August Pieper, et beaucoup d'autres encore" ("Le socialisme allemand", p.140).
Mais, les convictions personnelles de Sombart, et plus encore: son ton, le rapprocherait plutôt d'un autre courant situé nettement plus "à droite" et dans lequel on peut ranger Oswald Spengler; Wilhelm Stapel, directeur de la revue "Deutsches Volkstum" (Hambourg); Karl-Anton Prinz Rohan, directeur de l'"Europaïsche Revue"; Othmar Spann, idéologue de l'"austro-fascisme"; Edgar Jung, animateur du "Münchener Kreis", conseiller de von Papen; Heinrich von Gleichen, animateur et président du "Herrenklub"; voire Julius Evola. etc. Avec eux Sombart partage l'inspiration chrétienne, une idée de la race (et du Volk) dégagée de la biologie, une conception de l'Etat autoritaire éventuellement ditrigé par une aristocratie de naissance, une conception "universaliste" du corps social et la vision d'un ordre social fondé sur la hiérarchie des "Stände" qiu n'est pas sans évoquer, tout nuance péjorative mise à part, l'ordre des castes, etc. Un crédo qui s'oppose point par point au crédo du nationalisme populaire (Völkisch) qui s'est pourtant inspiré de Sombart pour construire sa doctrine économique.
Thierry MUDRY.
(article paru dans la revue “Orientations”, Wezembeek-Oppem, n°12, été 1990/hiver 1990-91).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, socialisme, sciences politiques, allemagne, révolution conservatrice, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 novembre 2009
Paganisme et nature chez Hermann Löns
 Paganisme et nature chez Hermann Löns
Paganisme et nature chez Hermann Löns
Recension: Martin ANGER, Hermann Löns. Schicksal und Werk aus heutiger Sicht, G.J.Holtzmeyer Verlag, Braunschweig, 1986, 190 p., 32 ill., ISBN 3-923722-20-6.
- Thomas DUPKE, Mythos Löns. Heimat, Volk und Natur im Werk von Hermann Löns, DUV/Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, 1993, 381 p., DM 64,
ISBN 3-8244-4140-3.
- Thomas DUPKE, Hermann Löns. Mythos und Wirklichkeit, Claasen, Hildesheim, 1994, 224 p., 20 ill., DM 38, ISBN 3-546-00086-2.
Dans sa thèse de doctorat sur Löns, Dupke récapitule toutes les thématiques qui font de Löns un précurseur des mouvements naturalistes allemands (Wandervögel, écologistes, adeptes de l'amour libre). La thématique de l'amour libre procède d'une volonté de sensualiser la vie, d'échapper à la rationalité bureaucratique et industrielle. Amour libre et sentiment de la nature vont de paire et s'opposent à la Ville, réceptacle de toutes les laideurs. Löns fuit dans un espace sans société, où les règles de l'urbanité n'ont pas de place.
Le rapport paganisme/christianisme transparaît clairement: les paysans de la Lande de Lünebourg sont certes devenus de “bons chrétiens”, mais en surface seulement; dans leur intériorité, ils sont restés les mêmes, “ils secouent les liens que leur avait imposés la religion des chrétiens”. Mais, chez Löns, qui n'est pas à proprement parler un auteur néo-païen Dieu n'est pas remis en question, mais, face aux marodeurs qui écument la région, il devient, pour les paysans armés (les Wehrwölfe) un Dieu de la vengeance, comme dans l'Ancien Testament, mais aussi comme dans l'idéal païen-germanique de la Feme. Löns expose un conglomérat païen et vétéro-testamentaire, où il n'y a aucune séparation nette entre les deux héritages.
Pour Löns, le paysan de la Lande est un être éternel, sans histoire, inamovible face aux changements: il est l'Urtyp (le type originel) de l'“être du Volk”. Le paysan selon Löns est l'idéal d'un homme de communauté qui sélectionne sans état d'âme les plus forts, pour que survive sa communauté, matrice du peuple. L'idée dérive du projet eugéniste d'Otto Ammon, cherchant à préserver et à valoriser les classes rurales dans l'Allemagne en voie d'industrialisation et d'urbanisation. Cet idéal dérive également, constate Dupke, d'une triple lecture de Nietzsche, Lagarde et Langbehn. De Nietzsche, Löns a retenu les tirades contre les “Philistins”, imbus de leur “culture”. De Lagarde, l'idée d'une renaissance germanique, d'un retour aux valeurs originelles de la Germanie et des rites païens, capables de fortifier un christianisme régénéré et germanisé (Lagarde n'est pas païen!). De Langbehn, l'idée du paysan comme “meilleur Allemand”, par sa simplicité, sa frugalité et sa forte capacité d'intuition.
Le contexte dans lequel évolue Löns, qui est celui de toute la contestation allemande de 1890 à 1914, débouche sur deux perspectives pratiques: l'Heimatkunstbewegung (= le mouvement de l'art du terroir) et sur la fondation de “parcs naturels”. Le 30 mars 1898, le parlement prussien vote une mention préconisant la création de réserves naturelles sur le modèle de la loi américaine de 1872 (pour le “Yellowstone Park”). Löns a soutenu cette initiative, avec le botaniste Hugo Conwentz, mais était sceptique; les parcs ne deviendront-ils pas zones récréatives pour citadins, les dimanches ensoleillés? Pour Löns, la protection de la nature et du patrimoine rural ne devait pas se limiter à ces parcs, mais être généralisée à tout le pays, en tous domaines (Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, paganisme, nature, écologie, mouvement écologique, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 novembre 2009
Statthalter des Geheime Deutschlands
 Januar 2004
Januar 2004
Statthalter des Geheimen Deutschlands
Mit Stefan George verschied vor 70 Jahren eine elitäre Jahrhundertpersönlichkeit der deutschen Dichtung
In der Person Stefan Georges (1868-1933) erwuchs zuerst dem literarischen Naturalismus, der sich dem Häßlichen und Gewöhnlichen zuwandte, und dann der modernen Massendemokratie ein Kritiker von unerbittlicher Strenge. Georges Kontrastprogramm zielte in gemeißelter Sprache auf eine Vergöttlichung der Kunst und die Überwindung des liberalkapitalistischen Dekadenzsystems durch die Vision eines Geistesadels und eines mythenumrankten neuen Reiches. Bis heute hat der George-Kreis und dessen Kraftquell des Geheimen Deutschlands nichts von seiner Faszinationskraft eingebüßt.
Als Ausdruck der europäischen Zeitkrise hatte sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts der Naturalismus zu einer machtvollen Kunstströmung entwickelt. Mit der drastischen Wiedergabe des Lebens und seiner Spannungen und Schattenseiten verbanden viele Naturalisten eine Anklage der Verhältnisse im Zeitalter der Hochindustrialisierung. Aus dem Widerwillen gegen die Elendsschilderungen des Naturalismus mit ihrer gewollt glanzlosen und alltagsnahen Sprache erwuchs die Gegenbewegung der Symbolisten und Neuromantiker. Ein neues Kunstwollen in Sprache und Motivik sollte die Alltagsniedrigkeit hinter sich lassen und in einer symbolhaltigen Sakralsprache die Ehre der Kunst und der Kultur wiederherstellen.
Anreger Nietzsche
Bedeutender Anreger der Symbolisten und Neuromantiker war kein Geringerer als Friedrich Nietzsche (1844-1900). Mit seinem Hauptwerk »Also sprach Zarathustra« (1883/84) schlug der Künder des Übermenschen seine Zeitgenossen in den Bann. Auch der junge Stefan George ließ sich von der religiös-erhabenen, kunstvoll durchformten Dichtersprache gefangennehmen. Über das Ästhetische hinaus faszinierten der seherische Gestus und die Ankündigung einer Zeitenwende, in der ein neuer Adel über die »letzten Menschen« triumphieren und den Nihilismus zu Grabe tragen werde. Als Nietzscheaner griff George zum Federkiel und sollte als weihevoller Sprach- und Ideenschöpfer selber einmal einen stattlichen Kreis von Jüngern um sich sammeln.
In Büdesheim bei Bingen wurde George am 12. Juli 1868 geboren. Mit 18 Jahren begann der Sohn eines Weinbauern mit dem Dichten, das sich noch weitgehend im Kosmos jugendlicher Gefühle bewegte; auffällig ist allenfalls die häufige Beschwörung von Dunkelheit und Vergänglichkeit. Gesichtsausdruck und Gebaren hatten bereits in den jungen Jahren etwas Melancholisches, Kühles und Erstarrtes, zu dem dann mit zunehmendem Alter das Abweisende und Imperatorische hinzutrat.
In betonter Abschottung vom verachteten Gesellschaftstreiben setzte George seine Dichtung ins Werk. Der deutschen Sprache sollte Würde, Glanz und Zucht wiedergegeben werden. Die Zeilen prunken mit einer feierlichen, mythischen und dräuenden Stimmung. Streng geformte Verse, bisweilen schimmernd wie schwarze Perlen, wurden durch eine eigene Rechtschreibung und Zeichensetzung mit der Aura des Exklusiven versehen.
Der Rheinhesse verachtete den Markt und dessen Reklamehaftigkeit und Nutzendenken; seine hochgezüchtete Lyrik, die bisweilen übertrieben und gekünstelt wirkt, sollte deshalb auch einem schnellen Kunstkonsum und billiger Marktgängigkeit entgegenwirken. Ganz Symbolist, Sinnbilder (Symbole) zur Errichtung einer autonomen Welt der Schönheit und Reinheit zu verwenden, baute er am Tempel einer zweckfreien Kunst. Für sich selbst sah er die Aufgabe als Tempelwächter, ja als Tempelherr. Später, nach seiner Hinwendung zu einem neuen Reich als Dach einer veredelten deutschen Gemeinschaft, umschrieb er seinen Sendungsauftrag mit den Worten: »Ich bin gesandt mit Fackeln und mit Stahl, daß ich euch härte.«
Nach dem Abschluß der Schule 1888 bereiste George als unruhiger Schönheitssucher Europa, erlernte Sprachen und unternahm weitere Bildungsanstrengungen. Mit den »Hymnen«, den »Pilgerfahrten« und dem Ludwig II. geweihten »Algabal« erschienen die ersten Gedichtbände. Als Forum für einzelne Dichtungen dienten die »Blätter für die Kunst«. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre hatte sich der Dichter bereits größere Anerkennung erworben und einen Kreis von Freunden und Bewunderern um sich versammelt.
Mit der Zeit entwickelte sich aus dem losen Gesinnungskreis um die »Blätter für die Kunst« der George-Kreis als strenge und hierarchische Gemeinschaft. George fungierte als unangefochtener dichterischer Meister, geistiger Ideenformer und sozialer Gesetzgeber. Noch heute widmen Literaturwissenschaftler, Historiker und Sozialpsychologen dem Faszinosum des George-Kreises Aufsätze und Bücher. Um den Meister als Zentralinstanz dieses »Staates« sammelten sich Jünger, von denen einige Spuren in der Geistesgeschichte hinterließen, so Max Kommerell, Friedrich Gundolf, Ernst Kantorowicz und Claus von Stauffenberg. Der Versuch Georges, den Symbolisten Hugo von Hofmannsthal und den Lebensphilosophen Ludwig Klages in sein Herrschaftsgebilde einzubinden, scheiterten, wie generell die eigentümlichen Sozialbeziehungen des Kreises höchst zerbrechlich waren. Hinzu kamen bizarre Blüten wie der Göttlichkeitskult, den George um den Knaben Max (»Maximin«) Kronberger veranstaltete, und skurrile Maskenfeste, die den Verdacht eines homoerotischen Männerbundes nährten.
Geheimes Deutschland
Tragende Idee des George-Kreises war das Geheime Deutschland, ein Mythos, der in der Herrlichkeit und geistigen Strahlkraft des staufischen Kaisertums Friedrich Barbarossas und Friedrichs II. seinen Wurzelgrund hat und von Hölderlin verschlüsselt in die Dichtung eingeführt wurde. Im November 1933 sprach der Georgianer Ernst Kantorowicz in einer Vorlesung vom Geheimen Deutschland als dem teutonischen Olymp, dem ewigen deutschen Geisterreich:
»Es ist die geheime Gemeinschaft der Dichter und Weisen, der Helden und Heiligen, der Opferer und Opfer, welche Deutschland hervorgebracht hat und die Deutschland sich dargebracht haben. (…) Es ist ein Seelenreich, in welchem immerdar die gleichen deutschesten Kaiser eigensten Ranges und eigenster Artung herrschen und thronen, unter deren Zepter sich zwar noch niemals die ganze Nation aus innerster Inbrunst gebeugt hat, deren Herrentum aber dennoch immerwährend und ewig ist und in tiefster Verborgenheit gegen das jeweilige Außen lebt und dadurch für das ewige Deutschland.«
Das Geheime Deutschland ist danach zugleich ein Reich von dieser und nicht von dieser Welt, ein Reich der Toten und Lebenden. Eine solch metaphysische Reichsidee wies eine natürliche Distanz zu den politischen Realitäten mit ihrem schnöden Tagesgeschäft auf. Den Kriegsausbruch 1914 wertete deshalb auch George als reinigendes Gewitter, das in eine morsche Zivilisation fahre und einem gehärteten Menschenschlag aus überlegenem Geist das Feld bereite. Im dritten Buch des »Stern des Bundes« von 1914 entwirft George das Bild eines Adels, der vom überlebten Blutadel strikt abgegrenzt wird: »Neuen adel den ihr suchet/ Führt nicht her von schild und krone!/ Aller stufen halter tragen/ Gleich den feilen blick der sinne/ Gleich den rohen blick der spähe…/ Stammlos wachsen im gewühle/ Seltne sprossen eigenen ranges/ Und ihr kennt die mitgeburten/ An der Augen wahrer Glut.«
George verstand sich als »Dichter in Zeiten der Wirren«, der von seinem Schwabinger Hochsitz den Weimarer Demokratismus voller Verachtung anprangerte und durch die Rangordnung eines führergeleiteten neuen Reiches ersetzt sehen wollte. Voll Gegenwartshaß und in raunendem Prophetenton erklingt diese Vision in dem bekannten Gedicht, das er dem Andenken des Grafen Bernhard Uxkull widmete.
Das Dritte Reich Adolf Hitlers erfüllte die hohen Erwartungen des elitären Dichters aber nicht und löste Distanzreaktionen aus. Zu seinem Geburtstag am 12. Juli 1933 gratulierte Joseph Goebbels dessen ungeachtet in einem Telegramm: »Dem Dichter und Seher, dem Meister des Wortes, dem guten Deutschen zum 65. Geburtstag ergebenste Grüße und Glückwünsche.« Kurz darauf fuhr George in die Schweiz, wo er seit Jahren die Wintermonate verbrachte und im Dezember 1933 verstarb.
Kurz darauf hielt der Expressionist Gottfried Benn eine Rede, in der er den verstorbenen Dichterherrscher als das »großartigste Durchkreuzungs- und Ausstrahlungsphänomen« der deutschen Geistesgeschichte feierte. Der Laudator, der seinen elitären Ordnungswillen von der Kunst auf die Politik übertragen hatte und so zum Faschisten geworden war, destillierte die beiden Begriffe heraus, die wie keine sonst das Wesen von Georges »imperativer Kunst« erfassen: »Form und Zucht«. Dem Geist der neuen Zeit entsprechend, die demokratische Formlosigkeit durch Form, libertäre Anarchie durch Ordnung ersetzte, würdigte Benn das Formgefühl Georges aus dem Geist des Griechentums und Friedrich Nietzsches: »Form, das ist für weite Kreise Dekadenz, Ermüdung, substantielles Nachlassen, Leerlauf, für George ist es Sieg, Herrschaft, Idealismus, Glaube. Für weite Kreise tritt die Form ,hinzu‘, ein gehaltvolles Kunstwerk und nun ,auch noch eine schöne Form‘; für George gilt: die Form ist Schöpfung; Prinzip, Voraussetzung, tiefstes Wesen der Schöpfung; Form schafft Schöpfung.«
Jürgen W. Gansel
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, révolution conservatrice, poésie, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ernst Jünger est mort: entretien avec Heimo Schwilk

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Ernst Jünger est mort
Entretien avec Heimo Schwilk
Heimo Schwilk, né en 1952 à Stuttgart, a étudié la philosophie, la philologie germanique et l'histoire à Tübingen. De 1986 à 1991, il a été rédacteur au Rheinischer Merkur. Depuis 1991, Schwilk dirige la rédaction de la rubrique “Berlin und neue Bundesländer” du Welt am Sonntag. Pour ses reportages sur la Guerre du Golfe, il a reçu le célèbre prix “Theodor Wolff” en 1991. En 1988, il a édité chez Klett-Cotta un remarquable album de photographies sur la vie d'Ernst Jünger.
Q.: Quel vide laissera derrière lui l'écrivain Ernst Jünger qui vient de mourir ce mardi 17 février 1998?
HS: Tout d'abord, ils vont enfin pousser un soupir de soulagement, tous ceux qui ont voulu contester à Jünger la modeste place qu'il occupait encore dans cette société désarticulée qu'est la RFA. Lui, Jünger, l'homme que l'on ne pouvait pas utiliser, l'homme qui s'était volontairement soustrait au “discours” dominant, l'homme qui se désintéressait de la politique, est définitivement parti, se lançant dans sa dernière grande aventure, celle de la mort. Jünger nous a enseigné que la vie était mystère, que l'homme était un être merveilleux dans un monde merveilleux. Ce fondement romantique de la pensée de Jünger a en quelque sorte ouvert une faille dans le mur, faille qui le séparait, dès son vivant, de tous ceux qui travaillaient, opiniâtres, à la profanation et à la banalisation de notre existence. Jünger ne nous laisse aucun vide, mais un océan d'instants accomplis, qui sont devenus poésie dans un monde qui n'est plus que bavard-communicatif.
Q.: Bon nombre d'individus pressaient encore Ernst Jünger dans ses dernières années à prendre la parole en tant qu'“écrivain politique”. Il a toujours refusé. Mais entre les lignes, dans des remarques en marges, ne s'est-il pas mêlé subtilement au tumulte du monde, à sa manière?
HS: Ernst Jünger, immédiatement après l'accession au pouvoir des nationaux-socialistes a exprimé dans de nombreuses lettres jusqu'ici impubliées son sentiment: les discours sur la politique qui sont teintés d'opinions et de convictions équivalent à une auto-mutilation pour l'homme amoureux de la musique. Jünger avait derrière lui cinq années d'immixtion polémique dans des revues ou des ouvrages collectifs. Après 1945, il s'en est tenu à son verdict sur la politique. Les défenseurs de la littérature engagée se sont dressés contre lui et Benn disait de ses tristes sires, avec mépris: “ils rampent comme des chiens devant les concepts de la politique”. De fait, Jünger n'avait que bien peu de choses à apporter à ce discours qui se disait “démocratique”. En revanche, il avait énormément de choses à dire sur ce que Heidegger nommait les “existentiaux”: la temporalité, la déréliction (Geworfenheit), la mort. Il estimait que pontifier de la philosophie à côté des urnes électorales n'était pas une activité fort productive.
Q.: Pourquoi Ernst Jünger est-il tant apprécié de nos voisins, en particulier les Français, alors que chez nous, en Allemagne, il est demeuré un écrivain “contesté”?
HS: Etre contesté n'est en soi nullement répréhensible, pour autant que l'affrontement ait vraiment lieu et qu'on ne perpétue pas à l'infini, comme en Allemagne, une procédure de tribunal d'épuration. Les Français apprécient en premier lieu, chez Jünger, le fait qu'il a tant aimé leur pays —et cela c'est sympathique— qu'il le connaît parfaitement et qu'il le regarde dans ce qu'il a de spécifique. Ils paient tribut à sa moralité, celle avec laquelle il a mené à bien sa mission fort délicate d'officier des troupes d'occupation et d'écrivain en poste à Paris entre 1940 et 1944, sans jamais nuire à son intégrité. Ils aiment la clarté de sa langue, la force qu'elle met à nous éclairer. Ils considèrent que cette langue de Jünger exprime ce que vivent les sens, tout en restant typiquement allemande. François Mitterand remarquait, dans sa laudatio pour le centième anniversaire de l'écrivain, que Jünger était resté un “homme libre”. Cela voulait dire qu'il cultivait une pensée détachée de tout poncif, une pensée pour laquelle les applaudissements des masses n'avaient aucune signification.
Q.: Ernst Jünger a-t-il suivi l'actualité politique jusqu'à son dernier jour?
HS: Ernst Jünger lisait régulièrement la presse, y compris Junge Freiheit, mais il passait rapidement sur les rubriques politiques, comme il me l'a dit plusieurs fois. Il était bien au courant de la marche du monde et plus d'une remarque moqueuse dans ses journaux atteste qu'il observait avec attention le déclin de la politique politicienne à Bonn, surtout celle des “ grands partis populaires” dont les différences ne sont qu'apparences. Mais il s'intéressait surtout aux processus généraux d'uniformisation, que toute observation fine de notre époque révèle et que son Travailleur a exposé. Ensuite, il attendait du XXIième siècle l'avènement d'une nouvelle spiritualité, dont les prémisses sont justement les processus de déblaiement que décrivent ses essais et journaux.
Q.: Quelle est la signification de l'œuvre d'Ernst Jünger pour l'avenir?
HS: Elle réside dans sa foi en l'Etre, dans sa “nouvelle théologie”, qui refuse de laisser le dernier mot à la destructivité et à la petitesse de l'homme moderne.
Q.: L'une des figures les plus importantes dans la pensée de Jünger est l'anarque. Que devons-nous en penser aujourd'hui?
HS: L'anarque est, au contraire de l'anarchiste, ne cultive pas d'idées politiques, n'est pas une personnalité qui cherche le changement radical. Le politique est pour lui une chose extérieure, une dérivation, un phénomène secondaire. L'anarque —comme l'homme qui recourt aux forêts— demeure souverain et dispose librement de soi. Il joue son propre rôle dans la société. Service et liberté ne sont pas des contraires chez lui; le sacrifice, mais aussi le suicide, appartiennent à son capital. Dans Le recours aux forêts, Jünger a décrit cette attitude: «Celui qui recourt aux forêts possède un rapport originel avec la liberté, qui, vu sur le plan temporel, s'exprime par une résistance à tous les automatismes, ce qui implique qu'il n'ait pas à tirer la conséquence que dicte généralement l'éthique, c'est-à-dire adopter le fatalisme». L'anarque n'est pas un missionnaire, armé de ses connaissances, il vit comme l'unique et sa spécificité (Der Einzige und sein Eigentum), c'est-à-dire avec l'ensemble de ses expériences, mais il brille devant tous les autres, à titre d'exemple. Peut-on dire quelque chose de plus pertinent sur la personne d'Ernst Jünger?
(entretien paru dans Junge Freiheit, n°9/1998; propos recueillis par Dieter Stein).
00:07 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommages, révolution conservatrice, ernst jünger, allemagne, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes, entretiens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 31 octobre 2009
Hommage de Günter Rohrmoser à Ernst Jünger

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Hommage de Günter Rohrmoser, philosophe et sociologue conservateur
Mon rapport à Ernst Jünger a plutôt été celui de la distance. Je ne suis pas, me semble-t-il, la personne appropriée pour lui rendre hommage à l'occasion de son décès, ni pour prendre position à l'endroit de l'ensemble de son œuvre. Dieu merci, Ernst Jünger n'est pas resté toujours le même homme. L'Ernst Jünger de la première guerre mondiale, l'Ernst Jünger du temps de la République de Weimar, l'Ernst Jünger du temps du Troisième Reich et l'Ernst Jünger d'après la seconde guerre mondiale sont autant de facettes très différentes d'une œuvre qui embrasse l'ensemble du siècle. C'est incontestable: il appartient à l'aréopage des plus grands écrivains de ce siècle. Et si le socialiste Mitterrand ne s'était pas affirmé comme un très bon connaisseur et un admirateur de l'œuvre de Jünger, la querelle stérile entre la gauche et la droite à propos de sa personne aurait continué bon train. Pour moi, aujourd'hui comme hier, l'œuvre principale de Jünger reste Der Arbeiter. Ce livre a été interprété comme une contribution de l'auteur au national-socialisme, ce qui est complètement faux. Der Arbeiter est l'une des plus grandes descriptions physiognomiques de notre siècle; les paysages terrifiants du “cœur aventureux” en sont le complément. Certes, le Travailleur est un mythe: il n'a pas grand' chose à voir avec la réalité ouvrière du 20ième siècle. Mais, depuis, le monde s'est transformé et ressemble désormais à un paysage d'ateliers et de fabriques; tout est devenu travail et, comme auparavant, nous luttons pour faire advenir ce que Jünger nommait une “construction organique”, c'est-à-dire une nouvelle fusion entre l'homme et la technique. Avec ces paroles, il a touché notre siècle en plein cœur. Ensuite, ce n'est nullement un hasard si, avec cet ouvrage, il a plus profondément influencé Heidegger que celui-ci n'a bien voulu l'admettre. Personnellement, je ne trouve guère d'inspiration dans le Jünger d'après la seconde guerre mondiale. Je me souviens que Carl Schmitt annonçait, tout étonné, mais aussi à moitié amusé, qu'Ernst Jünger pensait que l'éon chrétien s'achevait. La spéculation qui calcule l'âge de la Terre et qui, dans une certaine mesure, dérive des travaux d'Oswald Spengler, ne sont pas du goût de tout le monde. Jünger a certes été un homme pie(ux), mais il était très éloigné du christianisme, plus éloigné sans doute que d'un païen de l'antiquité.
Günter ROHRMOSER.
(texte paru dans Junge Freiheit, n°9/98).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, conservatisme, ernst jünger, allemagne, lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, hommages |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 29 octobre 2009
Hommage de Günter Maschke à Ernst Jünger
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
 L'hommage de Günter Maschke
L'hommage de Günter Maschke
«L'intelligence se soumet dès qu'elle accepte une question, indépendamment du fait qu'on y répondra oui ou non», notait Ernst Jünger après la première guerre mondiale. A cette époque, après 1918, il y avait encore assez d'intellectuels dans l'Allemagne vaincue qui avaient la force de rejeter l'impudence des puissances victorieuses et de leurs valets allemands qui voulaient imposer au pays leurs recettes libérales-démocratiques. Aujourd'hui, la situation est devenue beaucoup plus difficile, et c'est la raison pour laquelle il nous faut apprendre le désinvolture jüngerienne. Tel est notre devoir supérieur.
Günter MASCHKE.
(hommage publié par Junge Freiheit, n°9/98).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes, philosophie, hommages, ernst jünger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 28 octobre 2009
Julius Evola: The Path of Cinnabar
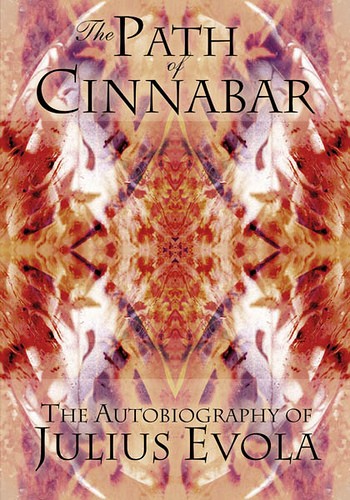 Julius Evola: The Path of Cinnabar
Julius Evola: The Path of Cinnabar
Quick Overview
Not previously available in the English language, this is the first translation of Julius Evola’s autobiography, Il Cammino del Cinabro. The book provides a guide to Evola’s corpus as he explains the purpose of each of his books. This book is the key which unlocks the unity behind Evola’s diverse interests. It is a perfect place to start for those new to Evola’s thought, and a must read for all seasoned Evolians. The book includes hundreds of well-researched footnotes and a complete index. This book is also available in a hardback edition.
Product Description
Julius Evola was a renowned Dadaist artist, Idealist philosopher, critic of politics and Fascism, 'mystic', anti-modernist, and scholar of world religions. Evola was all of these things, but he saw each of them as no more than stops along the path to life's true goal: the realisation of oneself as a truly absolute and free individual living one's life in accordance with the eternal doctrines of the Primordial Tradition. Much more than an autobiography, The Cinnabar Path in describing the course of Evola's life illuminates how the traditionally-oriented individual might avoid the many pitfalls awaiting him in the modern world. More a record of Evola's thought process than a recitation of biographical facts, one will here find the distilled essence of a lifetime spent in pursuit of wisdom, in what is surely one of his most important works.
Additional Information
| Title | Julius Evola: The Path of Cinnabar (Softcover) |
| Author | Evola, Julius |
| Full Title | The Path of Cinnabar: An Intellectual Autobiography |
| Binding | Softcover |
| Publisher | Integral Tradition (2009) |
| Pages | 302 |
| ISBN | 9781907166020 |
| Language | English |
| Price | € 19.95 |
| Short Description | Not previously available in the English language, this is the first translation of Julius Evola’s autobiography, Il Cammino del Cinabro. The book provides a guide to Evola’s corpus as he explains the purpose of each of his books. This book is the key which unlocks the unity behind Evola’s diverse interests. It is a perfect place to start for those new to Evola’s thought, and a must read for all seasoned Evolians. The book includes hundreds of well-researched footnotes and a complete index. This book is also available in a hardback edition. |
| Table of Contents | Foreword 1. The Path of Cinnabar Appendix: Interviews with Julius Evola (1964-1972) |
| About the Author | Julius Evola (1898 -1974), Italian traditionalist, metaphysician, social thinker and activist. Evola is an authority on the world's esoteric traditions and one of the greatest critics of modernity. He wrote extensively on ancient civilisations of both East and West and the world of Tradition. |
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, evola, italie, philosophie, révolution conservatrice, avant-garde, dadaïsme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 octobre 2009
Spengler, Jahre der Entscheidung
Spengler, Jahre der Entscheidung |
 Über dem von Spengler verfaßten Vorwort zu „Jahre der Entscheidung“ liegt jene dunkle Resignation, die potentiell in einem Schriftsteller aufkommt, der die Jahre der Entscheidung verspürt, in seiner Umgebung für die Probleme der Zeit aber und bei entsprechenden Entscheidungsträgern sachpolitische Blindheit registriert: „Ich sehe schärfer als andere, weil ich unabhängig denke, von Parteien, Richtungen und Interessen frei. Ich fühle mich einsamer als je, wie unter Leuten, die ihre Augen verbunden haben, um den Einsturz des Hauses nicht zu sehen.“ Über dem von Spengler verfaßten Vorwort zu „Jahre der Entscheidung“ liegt jene dunkle Resignation, die potentiell in einem Schriftsteller aufkommt, der die Jahre der Entscheidung verspürt, in seiner Umgebung für die Probleme der Zeit aber und bei entsprechenden Entscheidungsträgern sachpolitische Blindheit registriert: „Ich sehe schärfer als andere, weil ich unabhängig denke, von Parteien, Richtungen und Interessen frei. Ich fühle mich einsamer als je, wie unter Leuten, die ihre Augen verbunden haben, um den Einsturz des Hauses nicht zu sehen.“"www.webcritics.de vom 08.11.2007" BUCHBESTELLUNG |
| Ohne Zweifel sind die Schriften des Geschichtsphilosophen, Kulturhistorikers und politischen Schriftstellers Oswald Spengler (1880–1936), des „Philosophen des Schicksals“ (Frank Lisson) wieder aktuell. Mit der vorliegenden Schrift hat Frank Lisson die letzte Schrift Spenglers neu herausgebracht und mit einem interessanten Vorwort versehen. Bei der Lektüre meint man, daß dies das stimmungsmäßig resignierendste und verzweifeltste Buch ist, welches in Deutschland je unter der Rubrik „politische Schrift“ erschienen ist. |
00:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, philosophie, révolution conservatrice, conservatisme, droite, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 octobre 2009
La Guerre comme expérience intérieure
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
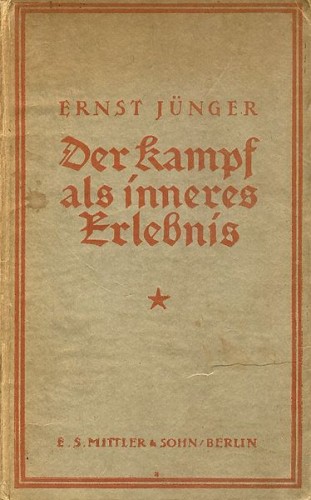 La Guerre comme Expérience Intérieure
La Guerre comme Expérience Intérieure
Analyse d'une fausse polémique
«Pour le soldat, le véritable combattant, la guerre s'identifie à d'étranges associations, un mélange de fascination et d'horreur, d'humour et de tristesse, de tendresse et de cruauté. Au combat, l'homme peut manifester de la lâcheté ou une folie sanguinaire. Il se trouve alors écartelé entre l'instinct de vie et l'instinct de mort, pulsions qui peuvent le conduire au meurtre le plus abject ou à l'esprit de sacrifice» (Philippe Masson, L'Homme en Guerre 1901-2001, Editions du Rocher, 1997).
Voici quelques mois paraissait, dernière publication française du vivant de Ernst Jünger, La Guerre comme Expérience Intérieure, préfacée par le philosophe André Glucksmann, chez Christian Bourgois éditeur, maison qui depuis des années s'est fait une spécialité des traductions jüngeriennes. Un texte d'importance, qui vient utilement compléter les écrits de guerre déjà parus de l'écrivain allemand, Orages d'Acier, Boqueteau 125, et Lieutenant Sturm, ouvrages de jeunesse que les spécialistes de son oeuvre polymorphe considèrent à la fois comme les plus vindicatifs, initiateurs de ses prises de position politique ultérieures, et parallèlement déjà annonciateurs du Jünger métaphysique, explorateur de l'Etre, confident de l'intimité cosmique.
Engagé volontaire au premier jour des hostilités en 1914, quatorze fois blessé, titulaire de la Croix de Fer Première Classe, Chevalier de la Maison des Hohenzollern, de l'Ordre «Pour le Mérite», distinction suprême et rarissime pour un homme du rang, Ernst Jünger publie dès 1920, à compte d'auteur et, comme il se plaira à dire par la suite, «sans aucune intention littéraire», In Stahlgewittern (Les Orages d'Acier), qui le révèlent d'emblée au milieu des souvenirs tous larmoyants des Barbusse, Remarque, von Unruh ou Dorgelès, comme un rescapé inclassable, un collectionneur tant de révélations ontologiques que de blessures physiques et morales. André Gide et Georges Bataille crieront au génie.
Une théorie du guerrier émancipé
Estimant ne pas avoir épuisé son sujet, il surenchérit en 1922 par la publication de Der Kampf als inneres Erlebnis (La Guerre comme Expérience intérieure), qu'il dédie à son jeune frère Friedrich Georg Jünger, lui aussi combattant émérite de la guerre mondiale et talentueux publiciste: «A mon cher frère Fritz en souvenir de notre rencontre sur le champ de bataille de Langemarck». Il découpe son manuscrit en treize courts tableaux, autant de souvenirs marquants de SA guerre, qu'il intitule sans fard Sang, Honneur, Bravoure, Lansquenets, Feu ou encore Veillée d'armes. Nulle trace d'atermoiement dans la plume de Jünger, nul regret non plus: «Il y a davantage. Pour toute une partie de la population et plus encore de la jeunesse, la guerre apparaît comme une nécessité intérieure, comme une recherche de l'authenticité, de la vérité, de l'accomplissement de soi (...) une lutte contre les tares de la bourgeoisie, le matérialisme, la banalité, l'hypocrisie, la tyrannie». Dans ces quelques mots tirés de W. Deist, extraits de son article Le moral des troupes allemandes sur le front occidental à la fin de 1916 (in Guerre et Cultures, Armand Colin, 1994), transparaît l'essentiel du Jünger de l'immédiat après-guerre.

Préambule au récit, la lecture de la préface d'André Glucksmann laisse bien sceptique quant à sa légitimité. «Le manifeste, ici réédité, est un texte fou, mais nullement le texte d'un fou. Une histoire pleine de bruit, de fureur et de sang, la nôtre». En s'enferrant dans les classiques poncifs du genre, le philosophe relègue la pensée de Jünger à une simple préfiguration du national-socialisme, fait l'amalgame douteux entre Der Kampf... et Mein Kampf. Et s'il note avec justesse que le Lansquenet du présent ouvrage annonce le Travailleur de 1932, il n'en restreint pas moins l'œuvre de Jünger à la seule exaltation de la radicalité, du nihilisme révolutionnaire (citant pêle-mêle Malraux, Breton et Lénine), à l'union du prolétariat et de la race sans distinguer la distance jüngerienne de la soif de sang et de haine qui nourriront fascisme, national-socialisme et bolchévisme. A vouloir moraliser un essai par essence situé au-delà de toute morale, Glucksmann dénature Jünger et passe à coté de son message profond.
L'ennemi, miroir de sa propre misère
Là où Malraux voit le «fondamental», Jünger perçoit «l'élémentaire». L'adversaire, l'ennemi n'est pas le combattant qui se recroqueville dans le trou d'en face mais l'Homme lui-même, sans drapeau, l'Homme seul face à ses instincts, à l'irrationnel, dépouillé de tout intellect, de tout référent religieux. Jünger prend acte de cette cruelle réalité et la fait sienne, s'y conforme et retranscrit dans ces pages quelles purent être les valeurs nouvelles qui en émergèrent, terribles et salvatrices, dans un esprit proche de celui de Teilhard de Chardin écrivant: «L'expérience inoubliable du front, à mon avis, c'est celle d'une immense liberté». Homo metaphysicus, Jünger chante la tragédie du front et poétise l'empire de la bestialité, champ-clos où des siècles de civilisation vacillent et succombent sous le poids des assauts répétés et du fracas des bombardements. «Et les étoiles alentour se noient en son brasier de feu, les statues des faux dieux éclatent en tessons d'argile, et de nouveau toute forme forgée se fond en mille fourneaux ardents, pour être refondue en des valeurs nouvelles». Et dans cet univers de fureur planifiée, le plus faible doit «s'effacer», sous les applaudissements d'un Jünger darwiniste appliqué qui voit l'homme renouer avec sa condition originelle de guerrier errant. «C'est ainsi, et depuis toujours». Dans la lutte paroxystique que se livrent les peuples sous l'emprise hypnotique des lois éternelles, le jeune lieutenant des Stoßtruppen discerne l'apparition d'une nouvelle humanité dont il commence à mesurer la force, terrible: «une race nouvelle, l'énergie incarnée, chargée jusqu'à la gueule de force».
Jünger lègue au lecteur quelques-uns des plus beaux passages sur ces hommes qui, comme lui, se savent en sursis, et rient de se constater encore vivants une aube après l'autre: «Tout cela imprimait au combattant des tranchées le sceau du bestial, l'incertitude, une fatalité toute élémentaire, un environnement où pesait, comme dans les temps primitifs, une menace incessante (...) Dans chaque entonnoir du no man's land, un groupe de chuchoteurs aux fins de brusques carnages, de brève orgie de feu et de sang (...) La santé dans tout cela? Elle comptait pour ceux qui s'espéraient longue vieillesse (...) Chaque jour où je respire encore est un don, divin, immérité, dont il faut jouir à longs traits enivrés, comme d'un vin de prix». Ainsi entraîné dans le tourbillon d'une guerre sans précédent, totale, de masse, où l'ennemi ne l'est plus en tant que défenseur d'une patrie adverse mais qu'obstacle à la réalisation de soi —miroir de sa propre misère, de sa propre grandeur— le jeune Jünger en vient de facto à remettre en cause l'héritage idéologique de l'Aufklärung, son sens de l'Histoire, son mythe du progrès pour entrevoir un après-guerre bâti sur l'idéal de ces quelques-uns, reîtres nietzschéens fils des hoplites de Salamines, des légions de Rome et des Ligues médiévales appliquant l'éthique de la chevalerie moderne, «le marteau qui forge les grands empires, l'écu sans quoi nulle civilisation ne tient».
Un sens de l'Homme plus élevé que celui de la nation
L'horreur au quotidien, Jünger la connaît, qui la côtoie sans répit et la couche sans concession aucune sur le papier —«On reconnaît entre toutes l'odeur de l'homme en putréfaction, lourde, douceâtre, ignoblement tenace comme une bouillie qui colle (...) au point que les plus affamés en perdaient l'appétit»— mais, à la grande différence des bataillons qui composeront les avant-gardes fascistes des années vingt et trente, il n'en retire ni haine ni nationalisme exacerbé, et rêve bien plutôt d'un pont tendu au-dessus des nations entre des hommes forgés sur le même moule implacable des quatre années de feu et de sang, répondant aux mêmes amours viriles: «Le pays n'est pas un slogan: ce n'est qu'un petit mot modeste, mais c'est aussi la poignée de terre où leur âme s'enracine. L'Etat, la nation sont des concepts flous, mais ils savent ce que pays veut dire. Le pays, c'est un sentiment que la plante est capable d'éprouver». Loin de toute xénophobie, vomissant la propagande qui attise des haines factices, le «gladiateur» Jünger, amoureux de la France et que touche plus qu'un éclat d'obus de s'entendre qualifié de “boche”, se déclare ainsi proche des pacifistes, «soldats de l'idée» qu'il estime pour leur hauteur d'esprit, leur courage pour ceux qui ne craignent pas seulement de mourir au feu, et leur sens de l'Homme plus élevé que celui de la nation. Aussi peut-il songer lors des accalmies, tapi dans son repli de tranchée, à l'union nouvelle des lansquenets et des pacifistes, de D'Annunzio et Romain Rolland. Effet des bombes ou prophétisme illuminé, toujours est-il que La Guerre comme Expérience intérieure prend ici une dimension et une résonance largement supérieures à celles des autres témoignages publiés après-guerre, et que se dessine déjà en filigrane le Jünger de l'autre conflit mondial, celui de La Paix.
Ce qui fait la beauté de l'existence, son illusoire
«La guerre m'a profondément changé, comme elle l'a fait, je le crois, de toute ma génération» et si elle n'est plus «son esprit est entré en nous, les serfs de sa corvée, et jamais plus ne les tiendra quittes de sa corvée». L'oeuvre intégrale d'Ernst Jünger sera imprégnée de la sélection dérisoire et arbitraire du feu qui taillera dans le vif des peuples européens et laissera des séquelles irréparables sur la génération des tranchées. On ne peut comprendre Le Travailleur, Héliopolis, Le Traité du Rebelle sans se pénétrer du formidable (au sens originel du terme) nettoyage culturel, intellectuel et philosophique que fut la «guerre de 14», coupure radicale d'avec tous les espoirs portés par le XXème siècle naissant.
Ce qui fait la force de Jünger, son étrangeté au milieu de ce chaos est que jamais il ne se résigne et persiste à penser en homme libre de son corps et de son esprit, supérieur à la fatalité —«qui dans cette guerre n'éprouva que la négation, que la souffrance propre, et non l'affirmation, le mouvement supérieur, l'aura vécue en esclave. Il l'aura vécue en dehors et non de l'intérieur». Tandis qu'André Glucksmann se noie dans un humanisme béat et dilue sa pensée dans un moralisme déplacé, Jünger nous enseigne ce qui fait la beauté de l'existence, son illusoire.
«De toute évidence, Jünger n'avait jamais été fasciné par la guerre, mais bien au contraire, par la paix (...) Sous le nom de Jünger, je ne vois qu'une devise: «Sans haine et sans reproche» (...) On y chercherait en vain une apologie de la guerre, l'ombre d'une forfanterie, le moindre lieu commun sur la révélation des peuples au feu, et —plus sûr indice— la recherche des responsabilités dans les trois nombreux conflits qui de 1870 à 1945, ont opposé la France à l'Allemagne». (Michel Déon, de l'Académie Française)
Laurent SCHANG.
Ernst JÜNGER, La Guerre comme Expérience Intérieure, préface d'André Glucksmann, Christian Bourgois éditeur, 1997.
00:19 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, première guerre mondiale, révolution conservatrice, allemagne, lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, weimar, années 20, années 30, militaria, ernst jünger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 25 octobre 2009
L'instant brûlant
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
L'instant brûlant
Quand meurt un homme, le chant de sa vie est joué dans l'éther. Il a le droit d'écouter jusqu'à ce qu'il passe au silence. Il prête alors une oreille si attentive au milieu des souffrances, de l'inquiétude. En tout cas, celui qui imagina le chant était un grand maître. Cependant, le chant ne peut être perçu dans la pureté du son que là où disparaît la volonté, là où elle cède à l'abnégation (1).
Ernst Jünger s'est avancé, ce 17 février 1998, vers des régions où les ciseaux de la Parque ne tranchent pas.
Les réactions lorsque fut annoncé ce deuil dans le monde des Lettres et de la pensée furent tristement coutumières. En ces temps où prévaut le “politiquement conforme”, certains critiques se sont distingués par des analyses sinon élogieuses (comme l'excellent article de Dominique Venner paru dans Enquête sur l'Histoire) du moins pertinentes (dans un magazine allemand inattendu, Focus). D'autres, zélés contempteurs inféodés à une idéologie qu'ils servent dans les organes de la presse française et allemande, se sont empressés de diffamer une œuvre qu'ils ne se sont jamais donnés la peine de lire et l'avouent parfois. Diable! Le personnage est agaçant: doté tout à la fois d'un esprit d'une rare fécondité et d'une vigueur physique non moins surprenante qui lui a permis de traverser la presque totalité du XX° siècle, ce plus que centenaire n'a eu de cesse d'aimer son pays, de ne se rétracter en rien: écrits bellicistes à l'issue de la Première Guerre mondiale, vision élitiste, contemplation douloureuse lors de l'entre-deux guerres... Il n'a rien renié; seul parfois l'angle de la perspective devait changer, mais faut-il forcer un homme à n'être qu'un bloc monolithique? Toutefois, est-il décent, en cette période, de s'irriter des réactions coutumières quand on prononce le nom de Jünger, de dresser dès à présent le bilan de l'œuvre? Les lecteurs fidèles préféreront encore se tourner vers cet Eveilleur qui a su nous offrir une élégante méditation philosophique et poétique sur les maux qui rongent notre civilisation.
Les ciseaux de la Parque... Par respect pour ce “passage” qui intriguait tant Ernst Jünger, nous évoquerons dans ces colonnes sa métaphysique de la mort, qui apparaît dès 1928 dans la première version du Cœur aventureux. Car à force d'avoir voulu préciser les choix politiques souvent au sens large de Jünger, on a souvent oublié que cet auteur, s'il avait voulu agir sur l'histoire, ne s'intéressait pas moins aux questions d'ordre spirituel. Or, parler de la mort consiste justement à se plonger dans les eaux régénératrices de la spiritualité. Reportons-nous à un texte révélateur de 1928
La vie est un nœud qui se noue et se dénoue dans l'obscurité. Peut-être la mort sera-t-elle notre plus grande et plus dangereuse aventure, car ce n'est pas sans raison que l'aventurier recherche ses bords enflammés (2).
Le symbole de l'entortillement
Procréation et mort marquent la fin du lacet, de ce noeud coulant qui, relié à son principe du domaine éternel, pénètre dans le règne terrestre. Pour Jünger, vie et mort sont intimement liées. Dans sa seconde version du Cœur aventureux qui paraît en 1938, Jünger recourt une nouvelle fois au symbole de l'entortillement. La théorie du lacet fait alors partie intégrante de l'initiation de Nigromontanus, maître mystérieux et charismatique. Le principe qu'il explique suppose une manière supérieure de se soustraire aux circonstances empiriques.
Il [Nigromontanus] nommait la mort le plus étrange voyage que l'homme puisse faire, un véritable tour de passe, la capuche de camouflage par excellence, aussi la plus ironique réplique dans l'éternelle controverse, l'ultime et l'imprenable citadelle de tous les êtres libres et vaillants (3).
Cet aspect nous ramène aux liens qu'entretiennent la mort et la liberté pour Jünger. Qui craint la mort doit renoncer à sa liberté. Le renforcement puissant de cette dernière n'est possible que si l'on part de la certitude que l'homme, en mourant, ne disparaît pas dans le néant, mais se voit élevé dans un être éternel. Aussi la pensée de Jünger tourne-t-elle sans cesse autour de la mort, parce qu'il veut infiniment fortifier la position de la liberté et assurer l'essence éternelle de l'homme. Ces idées acquises sur les champs de bataille, il les émet encore dans Heliopolis en 1949 et dans l'essai Le Mur du Temps, paru en 1959.
Celui qui ne connaît pas la crainte de la mort est l'égal des dieux (4).
Une conception grecque et platonicienne de la mort
La conception jüngerienne de la mort, en rien chrétienne, est influencée par la pensée grecque, notamment platonicienne. Les lectures attentives des dialogues Phédon, Gorgias, La République (notamment le X° chapitre) ont laissé leur trace dans l'œuvre jüngerienne. L'anamnèse platonicienne, nous la retrouvons formulée dans la deuxième version du Cœur aventureux et plus précisément dans “La mouche phosphorescente”. Jünger rapporte de la conversation de deux enfants qu'il surprit un jour cette phrase qui fusa, telle une illumination intellectuelle:
Et sais-tu ce que je crois? Que ce que nous vivons ici, nous le rêvons seulement; mais quand nous serons morts, nous vivrons la même chose en réalité (5).
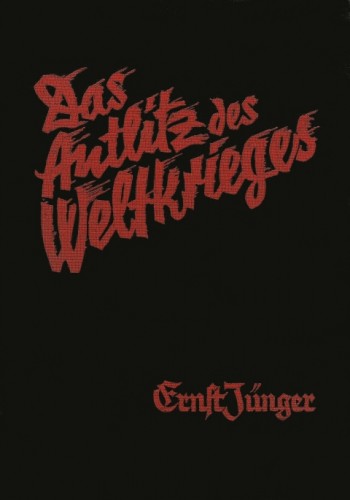 La vie semble se réduire à n'être que le reflet de cette vie véritable, impérissable, qui ne jaillit qu'au-delà de la mort. Voyons-y une fois encore le triomphe de l'être intemporel sur l'existence terrestre, qui est déterminée par le temps qui s'écoule perpétuellement!
La vie semble se réduire à n'être que le reflet de cette vie véritable, impérissable, qui ne jaillit qu'au-delà de la mort. Voyons-y une fois encore le triomphe de l'être intemporel sur l'existence terrestre, qui est déterminée par le temps qui s'écoule perpétuellement!
Nous trouvons chez Jünger une inversion de la mort, comme si cette dernière signifiait en fait le réveil d'un rêve étrange, peut-être même mauvais. Cela n'est pas sans évoquer la métaphysique de la mort, telle que l'avait formulée le romantique Novalis dans les Hymnes à la Nuit et le roman Heinrich von Ofterdingen.
Le monde devient rêve, le rêve devient monde [...]
Mélancolie et volupté, mort et vie
Sont ici en intime sympathie (6)
Idéalisation de la nuit et goût de l'outre-tombe
L'idéalisation de la nuit qui apparaît au cours du XIX° siècle dans le culte lamartinien de l'automne, le goût de l'outre-tombe, l'attraction de la mort sur Goethe, sur Novalis et sur Nodier, la nécrophilie de Baudelaire, jette encore des feux de vie dans la pensée de Jünger. Le procès intenté à la raison comme nous l'avons perçu au XIX° siècle se poursuit au XX° siècle contre l'idéologie positiviste; cette véritable offensive vient des horizons les plus variés: citons R. von Hartmann et sa Métaphysique de l'Inconscient, Barrès et le Culte du Moi, Bergson et l'Evolution créatrice ou l'Essai sur les données immédiates de la conscience. La redécouverte de l'inconscient des psychanalystes est aussi certainement liée à cette révolte.
La mort apparaît comme l'ultime libération de l'esprit du monde de la matière. A cet égard, la nouvelle “Liebe und Wiederkunft” —“amour et retour”—, très révélatrice, traduit une philosophie de l'histoire où des événements similaires se produisent sans cesse dans le même ordre, un retour de l'identique sous des formes différentes. L'histoire déjà parue dans la première version du Cœur aventureux localise à Leisnig le passage à l'écriture et se voit dotée d'un titre une décennie plus tard. Jünger s'est alors contenté de préciser ici une image, d'affiner une idée ou de changer là l'emploi d'un temps verbal; il n'a en rien touché le contenu de l'histoire.
La trame est simple. Le narrateur, un officier, est tout d'abord naufragé sur une île de l'Océan Atlantique. Recueilli par une vertueuse femme qui prit le voile, il se rend peu à peu à l'évidence qu'une relation séculaire les lie l'un à l'autre. La fonction de cette femme consiste à soigner et à veiller les hommes qui, pour avoir goûté une belle plante narcotique, dorment le lourd sommeil du coma. Malgré les injonctions de la religieuse, le narrateur n'y résiste pas non plus et devient lui-même la proie du sommeil et du rêve. Pourtant, le voilà de nouveau sur l'île, menacée cette fois par l'inimitié d'une flotte espagnole! Hôte d'une généreuse famille pirate, amoureux de la fille de la maison, le narrateur se prépare, chevaleresque, à livrer combat. Or, n'aperçoit-il pas soudain une fleur merveilleuse, ne succombe-t-il pas encore à l'impérieux désir de la goûter?
Dans la dernière lueur du crépuscule, j'eus le temps encore de pressentir que je vivrais d'innombrables fois pour rencontrer cette même jeune fille, pour manger cette même fleur, pour m'abîmer de cette même manière, tout comme d'innombrables fois déjà ces choses avaient été mon lot (7).
Une fleur aux couleurs du danger: le rouge, le jaune
Cette singulière histoire nous permet de mieux cerner la double nature de l'homme, ce qui fonde son originalité et son drame: son âme est immortelle et son corps périssable. Il est certain que la présence de cette fleur ne peut qu'évoquer le symbole le plus connu de toute l'œuvre de Novalis, la fleur bleue qui enchante le roman Heinrich von Ofterdingen et qui marque, de par ses racines et la couleur céleste de ses pétales, l'union de la terre et du ciel. La fleur jüngerienne n'est pas parée du bleu spirituel et bienfaisant. Ses pétales arborent les teintes de la vie et du danger, le jaune et le rouge (8); tout comme Goethe, rappelons-le, Jünger devait conférer une signification particulière aux couleurs. La fleur, belle et menaçante, figure l'instabilité essentielle de l'être , qui est voué à une évolution perpétuelle. Ernst Jünger semble admettre que la mort n'est pas un fait définitif, mais une simple étape de la série des transformations auxquelles tout être est soumis. La réminiscence d'un état antérieur, telle qu'elle semble affecter l'imagination nocturne de Jünger et que nous venons d'évoquer, soulève le délicat problème de l'incarnation successive des âmes et dramatise ainsi la notion d'un éternel retour. Ne soyons donc pas surpris de trouver dans Le Cœur aventureux les très célèbres vers de Goethe:
Ah, tu étais ma sœur ou ma femme, en des temps révolus (9).
Ces vers impliquent la reconnaissance des choses entre elles, de leurs liens, une conscience de leur parenté qui peut dépasser le cadre restreint de l'espèce humaine; d'ailleurs Jünger, dans le même passage, se fait écho de Byron:
Les monts, les vagues, le ciel ne font-ils partie de moi et de mon âme, et moi-même d'eux? (10).
La mort est le “souvenir le plus fort”
Finalement, la mort est pour Jünger un souvenir enfoui au plus profond de la mémoire, “le souvenir le plus fort” “der Tod ist unsere stärkste Erinnerung” (aHl, 75). L'homme qui, pour Jünger, représente infiniment plus que le corps physique, est doté d'une mémoire qui semble survivre à la destruction de la matière. Le dualisme de la vision anthropologique que nous décelons ici évoque celui de Platon, qui stipula la primauté de l'âme sur le corps. Fidèle à ses influences pythagoriciennes, Platon reprit à son compte l'idée de l'immortalité de l'âme; dans sa préexistence ou postexistence, l'âme voit les idées, mais en s'incarnant dans sa prison de chair, elle les oublie. Rappelons-nous que celui qui, chez Hadès, conserve la mémoire transcende la condition mortelle, échappe au cycle des générations. D'après Platon, les âmes assoiffées doivent éviter de boire l'eau du Léthé car l'oubli, qui constitue pour l'âme sa maladie propre, est tout simplement l'ignorance. Voilà peut-être la raison pour laquelle les Grecs prêtaient à Mnémosyne “mémoire”, la mère des Muses, de grandes vertus! L'histoire que chante la Titanide est déchiffrement de l'Invisible; la mémoire est fontaine d'immortalité. Nous pensons trouver ici un lointain écho de cette sagesse antique chez Jünger car, dans son œuvre, le contact avec l'autre monde est permis grâce à la mémoire. Celle-ci joue donc un rôle fondamental dans l'affirmation de l'identité personnelle et nous ne pouvons que souligner cette faveur qu'elle trouve auprès de Jünger, si l'on se réfère à ses journaux intimes, ces voyages entrepris dans les profondeurs du moi et d'où surgissent à la conscience des aspects nouveaux de l'être, mêlé parfois à toute une tonalité poétique.
L'aspect orphique de Jünger
Le roman philosophique Eumeswil (1977), à cet égard très révélateur, montre l'aspect orphique de Jünger. La mémoire, par l'intermédiaire du Luminar, fait tomber la barrière qui sépare le présent du passé. Que ce soit par le biais du Luminar ou par l'évocation des morts dans le jardin de Vigo, un pont est jeté entre le monde des vivants, au-delà duquel retourne tout ce qui a quitté la lumière du soleil. Cette évocation des morts n'est pas sans éveiller à notre mémoire le rituel homérique, qui connaît deux temps forts: d'une part, l'appel chez les vivants et, d'autre part, la venue au jour, pour un bref moment, d'un défunt remonté du monde infernal. Le voyage d'un vivant au pays des morts semble également possible, ainsi le chamane Attila qui s'aventura dans les forêts.
La place centrale que les mythes de type eschatologique accordèrent à la mémoire indique l'attitude de refus à l'existence temporelle. Si Jünger exalte autant la mémoire, nous pouvons nous demander s'il n'est pas mû par la tentation d'en faire une puissance qui lui permette de réaliser la sortie du Temps et le retour du divin.
Qu'en est-il du vieil homme? Dans l'attente de l'ultime rendez-vous, habitué à la mort pour l'avoir côtoyée sur les fronts, dans les deuils et les déchirements qu'elle causa, il ne peut abandonner une inquiétude, qu'il exprime Deux fois Halley:
Au contraire, ce qui me préoccupe depuis longtemps, c'est la question du franchissement; une coupe en terre est transformée en or, puis en lumière. A cela une seule chose m'inquiète: c'est de savoir si l'on prend encore connaissance de cette élévation, si l'on s'en rend encore compte (11).
Parques, Moires, Nornes
Quelques années plus tard paraît le journal Les Ciseaux, que Jünger écrivit de 1987 à 1989. L'outil bien anodin dont il est ici question appartient aux sœurs filandières des Enfers qui filent et tranchent le fil de nos destinées. Etrangères au monde olympien, ces Parques ou Moires du monde hellénique sont les déesses de la Loi. Lachésis tourne le fuseau et enroule le fil de l'existence, Clotho, la fileuse, tient la quenouille et file la destinée au moment de la naissance. La fatale Atropos coupe le fil et détermine la mort. La représentation ternaire des fileuses, également présente dans le religieux germanique où les Nornes filent la destinée des dieux et celle des hommes, évoque la trinité passé, présent et futur et nous permet d'entrer dans la temporalité. Ce fil est le lien qui nous attache à notre destinée humaine, nous lie à notre mort. Ce qui importe ici, c'est que, d'une part, l'outil retenu par Jünger ne soit ni le fuseau ni la quenouille mais bien les ciseaux de la divinité morticole et que, d'autre part, Jünger valorise non le fil ou le tissage mais la coupure par les ciseaux.
Le titre de l'essai et les discrètes allusions aux Moires, à ces divinités du destin, intègrent l'écrit dans l'ensemble de la réflexion jüngerienne sur le temps et la temporalité. Quoi d'étonnant à ce qu'il établisse des correspondances secrètes avec ses écrits antérieurs et jongle avec des idées abondamment traitées dans le passé! Les allusions au Travailleur, au Mur du temps sont nombreuses; sans grande peine, nous retrouvons Le Traité du Sablier, Le Problème d'Aladin, Eumeswil et même la théorie du “lacet” propre au Cœur aventureux. Cette œuvre de continuité qui n'est certes pas l'écrit le plus original de Jünger, prend l'aspect d'une récapitulation. Dans cet écrit tout en nuances, à défaut d'avoir énoncé des théories véritablement nouvelles, Jünger a composé une série d'accords d'accompagnements, s'attaquant à des problèmes essentiels de notre temps. Les Ciseaux sont en cela une méditation sur les aventures de notre siècle qu'ils posent, sur un fond de dualisme entre races divines, le problème crucial de l'éthique dans un monde où la science et le progrès technique repoussent les frontières d'une science morale désormais dépassée. Nous reconnaissons cette volonté d'ordonner le monde à d'autres fins que matérialistes.
Jünger considère le Temps sous la loi de deux règnes, d'une part celle du temporel où les ciseaux d'Atropos ne coupent pas et annoncent cet infini comme nous pouvons déjà le percevoir dans les rêves et l'extase. L'essai parle donc de la conscience jüngerienne de la mort et de cette douloureuse et inquiétante question du passage, de l'ultime franchissement.
Du comportement psychologique des agonisants
Cette curiosité incite l'auteur à s'interroger sur l'état de mort temporelle et sur les souvenirs des rares patients qui, rappelés à la vie, reprochent à leur médecin de les avoir empêchés de passer le tunnel de la mort (Schere, 73 sq). Sensible peut-être à cette vague déferlante de littérature occultiste qui aborde depuis quelques années la vie postmortelle, (est-là un présage de l'ère du Verseau?) ne va-t-il pas jusqu'à citer Elisabeth Kübler-Ross (12), cette femme d'origine suisse alémanique, installée aux Etats-Unis d'Amérique? En sa qualité de médecin, elle édita de nombreux ouvrages portant sur le comportement psychologique des agonisants; elle examina les récits des patients qu'avaient ressuscités les nouvelles techniques médicales de la réanimation, c'est-à-dire des injections d'adrénaline dans le cœur ou des électrochocs. Certains “revenants” que la médecine avait considérés cliniquement morts après avoir préalablement constaté un arrêt cardiaque, une absence de respiration et d'activité cérébrale, confièrent les expériences étranges qui leur étaient alors advenues pendant ces instants.
Or, la similitude des descriptions, l'exactitude des récits excluaient tout rêve ou toute hallucination. C'est ce qui incita le médecin à voir là une preuve d'existence post-mortelle. Voilà un sujet épineux où l'on se heurte tant aux théologiens horrifiés à l'idée d'un éventuel blasphème qu'aux doctes gardiens de la Science! Le raisonnement scientifique ne saurait rien admettre qui ne soit entièrement évident et ne forme un tout cohérent; la pensée qui en résulte, disciplinée par la rigoureuse volonté d'ordonner selon une méthode la plupart du temps linéaire et déductive, va par étapes successives de la simplicité à la complexité dans un ordre logique et chronologique. Or, dans le présent cas, la finalité du témoignage peut être sujette au même doute que son contenu. Il est donc bien évident que les thèses alléguées par E. Kübler-Ross ne peuvent, dans le meilleur des cas, remporter l'unanimité du monde scientifique et, dans le pire, ne peuvent qu'être rejetées car la science accueille avec méfiance des assertions qu'elle juge a priori insanes.
Toutefois, comme si Jünger voulait imposer le silence aux contempteurs de théories qu'il semble lui partager, comme s'il doutait aussi de cette méthode scientifique dont on aperçoit les limites, il cite des autorités médicales, aussi ambiguës soient-elles, ou nous livre les réflexions d'un ami, Hartmut Blersch, médecin lui aussi de son état. Ce dernier, traitant des personnes âgées, a écrit une étude non éditée: “Die Verwandlung des Sterbens durch den Descensus ad infernos” [La transformation de l'agonie par la Descente aux Enfers] (13) et a permis à Jünger d'en inclure quelques extraits dans Les Ciseaux. Jünger a tourné le dos à l'intelligence rationnelle du discours et à certaines acquisitions du savoir scientifique il y a longtemps déjà. De nos jours, une telle approche, qualifiée d'irrationnelle invite ses représentants à douter de la validité, du sérieux que l'on pourrait accorder à une telle pensée, à voir dans cette réaction antimatérialiste une régression vers un nouvel obscurantisme. Il n'en est pas moins vrai que Jünger, s'inscrivant déjà dans toute une tradition, reflète les angoisses qui oppressent son temps. Car cette mythologie d'une vie post-mortelle exerce sur nos contemporains une fascination qui dépasse le simple divertissement.
Placidité et sagesse où la mort devient conquête
Les conceptions irrationnelles de Jünger ont toujours damé le pion à la divine raison. Ainsi avait-il conclu son ouvrage Approches, drogues et ivresse:
L'approche est confirmée par ce qui survient, ce qui est présent est complété par ce qui est absent. Ils se rencontrent dans le miroir qui efface temps et malaise. Jamais le miroir ne fut aussi vide, dépourvu ainsi de poussière et d'image —deux siècles se sont chargé de cela. En plus, le cognement dans l'atelier —le rideau devient transparent; la scène est libre (14).
C'est peut-être justement dans cette irrationalité que Jünger puise cette placidité et cette sagesse où la mort elle-même devient conquête. Esprit téméraire, Jünger s'est avancé, vigilant, vers ces régions où les ciseaux de la Parque ne tranchent pas.
Tout comme jadis où, jeune héros incontesté, il glorifiait l'instant dangereux, le vieil homme avait renoncé à l'histoire, à percevoir le temps de manière continue; il est demeuré fasciné par cette seconde brûlante où tout se joue, ce duel sans merci où la vie et la mort s'affrontent:
L'histoire n'a pas de but; elle est. La voie est plus importante que le but dans la mesure où elle peut, à tout instant, en particulier à celui de la mort devenir le but (15).
Isabelle FOURNIER.
Notes:
(1) Sgraffitti, [première parution, Antaios, 1960, Stuttgart] in Jüngers Werke, Bd. VII, Essays III, p. 354: «Wenn ein Mensch stirbt, wird sein Lebenslied im Äther gespielt. Er darf es mithören, bis er ins Schweigen übergeht. Er lauscht dann so aufmerksam inmitten der Qualen, der Unruhe. In jedem Fall war es ein großer Meister, der das Lied ersann. Doch kann es in seinem reinen Klange nur vernommen werden, wo der Wille erlischt, wo er der Hingabe weicht».
(2) Das abenteurliche Herz 1, Berlin, 1928 [1929], p. 76: «Das Leben ist eine Schleife, die sich im Dunkeln schürzt und löst. Vielleicht wird der Tod unser größtes und gefährlichstes Abenteuer sein, denn nicht ohne Grund sucht der Abenteurer immer wieder seine flammenden Ränder auf».
(3) Das abenteurliche Herz 2, Berlin, 1938 [1942], p. 38: «Er nannte den Tod die wundersamste Reise, die der Mensch vermöchte, ein wahres Zauberstück, die Tarnkappe aller Tarnkappen, auch die ironische Replik im ewigen Streit, die letzte und ungreifbare Burg aller Freien und Tapferen».
(4) An der Zeitmauer, [première parution Antaios, 1, 209-226], Stuttgart, 1959, p. 159: «Wer keine Todesfurcht kennt, steht mit Göttern auf vertrautem Fuß».
(5) Das abenteureliche Herz 2, ibid., p. 102: «[...] und weißt du, was ich glaube? Was wir hier leben, ist nur geträumt; wir erleben aber nach dem Tode dasselbe in Wirklichkeit».
(6) Novalis, Hymnen an die Nacht, Heinrich von Ofterdingen. Goldmann Verlag, Stuttgart, 1979, p. 161-162: «Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt[...]/Wehmuth und Wollust, Tod und Leben/ Sind hier in innigster Sympathie».
(7) Das abenteureliche Herz 2, ibid. p. 83: «Im letzten Schimmer des Lichtes ahnte ich noch: Ich würde unzählige Male leben, demselben Mädchen begegnen, dieselbe Blume essen und daran zugrunde gehen, ebenso wie dies bereits unzählige Male geschehen war».
(8) voir à ce propos le symbolisme des couleurs dans le Cœur aventureux.
(9) Das abenteurliche Herz 1, ibid., p. 74: «Ach, du warst in abgebten Zeiten/ Meine Schwester oder meine Frau».
(10) Das abenteurliche Herz 1, ibid., p. 74: «Sind Berge, Wellen, Himmel nicht ein Teil von mir und meiner Seele, ich von ihnen?».
(11) Zwei Mal Halley, Stuttgart, 1987, p. 33: «Mich beschäftigt vielmehr seit langem die Frage des Überganges; ein irdener Becher wird in Gold verwandelt und dann in Licht. Daran beunruhigt nur eines: ob diese Erhöhung noch zur Kenntnis genommen wird, noch ins Bewußtsein fällt».
(12) Die Schere, Stuttgart, 1989, p. 173 sq.
(13)Schere, p. 173.
(14) Annäherungen, Drogen und Rausch, Stuttgart, 1970, [Ullstein, 1980], p. 348: «Annäherung wird durch Eintretendes bestätigt, Anwesendes durch Abwesendes ergänzt. Sie trefen sich im Spiegel, der Zeit und Unbehagen löscht. Nie war der Spiegel so leer, so ohne Staub und bildlos —dafür haben zwei Jahrhunderte gesorgt. Dazu das Klopfen in der Werkstatt— der Vorhang wird durchsichtig; die Bühne ist frei».
(15) Die Schere, ibid., p. 120: «Die Geschichte hat kein Ziel; sie existiert. Der Weg ist wichtiger als das Ziel, insofern, als er in jedem Augenblick vor allem in dem des Todes Ziel werden kann».
00:06 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, première guerre mondiale, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes, weimar, années 20, années 30, hommages |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 24 octobre 2009
Hommage à Ernst Jünger par Herbert Ammon, représentant de la gauche allemande
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Hommage à Ernst Jünger par Herbert Ammon, représentant de la gauche allemande
Certes, jamais je ne pourrai entièrement effacer mes réserves à l'égard de l'écrivain politique Ernst Jünger, exposant du “nouveau nationalisme” dans les années 20. Face à l'admiration a-critique, une question non historique: l'histoire allemande en ce siècle aurait-elle été moins terrible sans cette “mobilisation totale” contre le système de Versailles, inspirée par Nietzsche et Machiavel, le nihilisme et le réalisme héroïque? Avec la distance que nous a apportée le temps, le pathos de ces écrits militants nous semble étrange, en lisant les Orages d'acier, j'ai toujours distingué soigneusement entre l'esthétique de l'ouvrage et l'esthétique de la guerre. Ai-je ainsi fait des concessions à l'esprit gauchiste-libéral de la RFA élargie?
Intimidé par l'esprit “jüngerophobe” des feuilletons du Zeit de Hamburg, qui m'a accompagné pendant toutes mes années de lycée, j'appartiens —contrairement à cette génération de l'après-guerre qui a été l'avant-garde de la révolte juvénile de 68 et qui a donné à l'insurrection étudiante quelques traits typiquement allemands— à cette génération qui n'a lu l'œuvre du dernier des grands écrivains allemands de ce siècle que fort tard, qui ne l'a découvert qu'après de très longs détours. Certes, j'aurais pu me rapprocher de lui beaucoup plus tôt, car, pendant mes études, je suis tombé sur une anthologie des écrivains de la Beat Generation américaine, sur Howl d'Allen Ginsburg, sur Coney Island of the Mind de Ferlinghetti. L'éditeur de ces textes était Karl Otto Paetel, émigré aux Etats-Unis, protagonistes de cet espace d'entre-deux, homme de gauche de la droite allemande, dont l'esprit de résistance au nazisme découlait de son engagement précédent dans la jeunesse “bündisch” et de l'esprit qu'avait répandu Ernst Jünger. Paetel avait souligné la parenté entre la geste protestataire de la Beat Generation et les sentiments de Jünger, au temps il s'était inscrit dans le mouvement de jeunesse. Je n'ai lu Jeux africains qu'à l'âge adulte, quand il est trop tard pour cultiver et s'enthousiasmer de cette façon juvénile pour l'aventure.
A partir des écrits du jeune nationaliste Ernst Jünger, j'ai trouvé des références à Ernst Niekisch, après qu'un ignorant méchant et mal intentionné ait tenté de me dénigrer en me collant l'étiquette de “national-bolchevique”. En lisant Widerstand, la revue de Niekisch, on apprend combien complexes, contradictoires et marginales étaient les voies de la résistance allemande. Pourtant les faits sont là: la “Rose Blanche” avait à voir avec le mouvement “d.j.1.11” d'Eberhard Köbel (dit “tusk”) et donc aussi avec Ernst Jünger; mais cette évidence historique est délibérément ignorée par le catalogue des bonnes vertus que veut nous faire avaler l'établissement bundesrepublikanisch.
Tard, fort tard, j'ai lu, pendant une lumineuse journée d'été, les Falaises de marbre. Quand on prend acte de l'œuvre de Jünger, on est généralement saisi par le doute, on découvre le geste de l'anarque, l'esthétique pure de la désinvolture, les jeux idéologiques du jeune Jünger. Mais ce glissement est démenti par une bonne lecture des Falaises de marbre. Il n'y a aucun doute, Ernst Jünger appartient au cercle des plus grands écrivains de ce XXième siècle. Nous, qui sommes nés après lui, après les guerres, jetterons un regard rétrospectif sur ce siècle qu'il a vécu tout entier, ce siècle des idéologies totalitaires. Réfléchissons aussi à la vanité de la résistance allemande que Jünger avait deviné anticipativement dans ses écrits, réfléchissons au hasard qui a permis la mémorable journée du 9 novembre 1989, alors nous connaîtrons “la sauvage mélancolie, qui s'empare de nous quand on se souvient du bonheur”.
Herbert AMMON.
(hommage extrait de Junge Freiheit, n°9/98).
00:09 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, ernst jünger, allemagne, gauche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




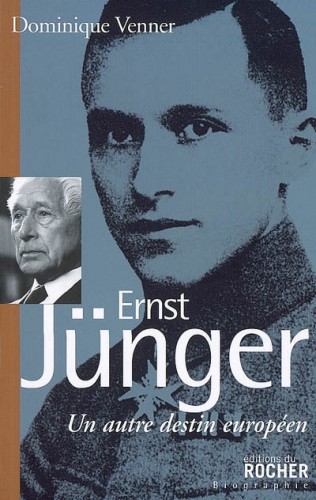 "Ernst Jünger", de Dominique Venner
"Ernst Jünger", de Dominique Venner