jeudi, 18 septembre 2025
Le « modèle finlandais » et autres scénarios possibles de l’après-guerre en Ukraine

Le « modèle finlandais » et autres scénarios possibles de l’après-guerre en Ukraine
par Maurizio Boni
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31233-maur...
Au cours d’un entretien accordé à The Economist, le président finlandais Alexander Stubb a de nouveau évoqué la soi-disant « victoire » de la Finlande à l’été-automne 1944, non pas pour avoir vaincu une armée sur le terrain, mais pour avoir préservé son indépendance en négociant un armistice avantageux avec l’Union soviétique. L’histoire nous rappelle que le 9 août 1944, l’offensive soviétique vers Viipuri-Petrozavodsk en Carélie prit fin. L’Armée rouge élimina la menace que la Finlande faisait peser sur Leningrad et repoussa les troupes finlandaises de la République de Carélie.
À la suite de la perte de Viipuri/Vyborg, le maréchal Mannerheim, chef des forces armées finlandaises, et le gouvernement Hackzell se tournèrent vers Moscou en acceptant des conditions très strictes: rupture avec l’Allemagne, démilitarisation, réparations, cession de territoire et dissolution des organisations pro-hitlériennes. Le traité de paix de Paris de 1947 ratifia cet accord, scellant une neutralité qui dura plus de quatre décennies.
Ce parcours historique – armistice rapide contre marge d’autonomie – est aujourd’hui proposé comme scénario possible à l’Ukraine afin qu’après la guerre avec la Russie, elle puisse reconstruire sa souveraineté sans succomber aux diktats des vainqueurs.
Cette idée, déjà avancée à Washington lors du sommet avec les dirigeants européens dans le Bureau ovale de Trump, a été davantage commentée dans le monde russe qu’en Occident, stigmatisant certains aspects de la réalité historique non cités par Stubb et que les dirigeants européens, sans parler des Américains, ignoraient probablement.
En effet, tant le ministre des Affaires étrangères Lavrov que la porte-parole du ministère Maria Zakharova ont répondu à Stubb à la télévision nationale russe, soulignant que la Finlande a combattu aux côtés de la Wehrmacht contre l’URSS de 1941 à 1944, en rappelant des épisodes comme le blocus de Leningrad et la participation finlandaise à l’Holocauste.
Le message est clair : il ne suffit pas de revendiquer aujourd’hui une « victoire » habile de cette période du passé sans affronter la mémoire des atrocités commises. De fait, les Russes ont diffusé sur la première chaîne institutionnelle les images compromettantes de ces atrocités, qui, avec d’autres documents de l’époque, avaient été secrètement archivées et écartées pour ne pas entraver le développement des relations d’après-guerre entre Moscou et Helsinki.
Selon l’historien Gilbert Doctorow, en 1944, les Finlandais avaient simplement pris acte de l’évolution de la guerre et avaient décidé de changer de camp – ce qu’ils ont fait en payant un prix considérable.

En effet, le traité conclu entre la Russie et la Finlande en 1948 imposait des conditions que Stubb n’a pas citées, mais que Lavrov a rappelées. En particulier, Helsinki était obligée de maintenir perpétuellement la neutralité sans appartenir à aucun bloc militaire dirigé contre la Russie – aspect élégamment et opportunément dépassé près de 80 ans plus tard avec l’entrée de la Finlande dans l’OTAN.
Toutefois, Stubb avait aussi déclaré en avril dernier que son pays devait être mentalement préparé à rétablir les liens avec la Russie après la guerre en acceptant que celle-ci sera toujours son voisin.
Déclaration tempérée par des précisions ultérieures, mais qui n’a pas pu cacher l’évidence d’une nouvelle adaptation pragmatique et opportuniste d’Helsinki aux circonstances.
Cependant, Doctorow considère le cas finlandais dans un contexte européen plus large de pressions économiques et de cohérence politique. La chute du revenu par habitant et la hausse des coûts de financement poussent les petits pays européens à réévaluer les sanctions et à plaider pour la reprise des liens avec la Russie.
La Belgique, par exemple, connaît une envolée de postes vacants, la fermeture de commerces importants et une contraction significative de la consommation; des tensions analogues touchent la Finlande et d’autres États étroitement liés à l’économie allemande, aujourd’hui en récession pour le deuxième trimestre consécutif. Paris aussi, sous le poids de la dette publique, montre des signes de fragilité intérieure.
En revanche, les puissances de référence – Allemagne, France et Royaume-Uni – maintiennent une ligne dure, convaincues que tout relâchement profiterait au Kremlin. Doctorow estime néanmoins que la cohésion de l’UE sera difficile à maintenir sur le long terme: des dynamiques centrifuges et des choix bilatéraux à adopter vis-à-vis de Moscou se dessinent à l’horizon.
Le compromis à la finlandaise n’est pas un mirage, mais il risque de se transformer en partie d’échecs où chaque État joue seul. Les alliés les plus vulnérables chercheront un consensus pragmatique, tandis que les grands acteurs maintiendront le régime des sanctions. Le défi pour Bruxelles sera de gérer cette double demande de reconnexion et la crainte d’affaiblir la position stratégique face à Moscou.

Ainsi, à la fin du conflit ukrainien, l’Europe se trouverait, selon Doctorow (photo), divisée entre ceux qui prônent la réconciliation et ceux qui exigent la fermeté. Au milieu, comme toujours, demeureront les grands héritages du passé et le calcul de chaque puissance quant à son propre avenir géopolitique.
Pour ce qui est de Moscou, derrière les écrans de la diplomatie européenne, la priorité russe reste un accord avec les États-Unis, notamment sur le non-déploiement de missiles à portée intermédiaire en Allemagne. Ce n’est qu’après avoir résolu ce point que le Kremlin pourra s’adresser ouvertement à ses partenaires européens, désormais menacés par la perspective de sanctions prolongées et de tensions économiques croissantes.
Un scénario complémentaire est présenté par Douglas McGregor, colonel à la retraite et ancien conseiller du Secrétaire américain à la Défense, qui parvient à des conclusions similaires en ajoutant la variable du rôle de Washington dans l’après-guerre, ce qui n’est nullement acquis.
Selon cet officier américain, il est absurde de penser que Washington puisse garantir l’existence future de pays comme la Pologne, les pays baltes, la République tchèque, la Slovaquie ou la Hongrie. Les Américains ne vivent pas en Europe, mais les Européens, eux, oui, selon McGregor.
De plus, l’avenir de ce qui restera de l’Ukraine ne doit pas être discuté par la France ou l’Allemagne, mais par les États directement frontaliers de la Russie. Avec le déclin du parapluie protecteur américain et la crise de l’OTAN, ces pays devront complètement redéfinir leur architecture de sécurité. Le repli stratégique des États-Unis vers leur rôle historique de puissance maritime laissera un vide que les mécanismes traditionnels de l’Alliance atlantique ne pourront combler à eux seuls.
Dans ce contexte, la situation des pays d’Europe orientale est particulièrement complexe, car ils ont basé leur stratégie de sécurité post-soviétique entièrement sur la dissuasion de l’OTAN et la garantie de l’article 5. La perte de cette certitude les obligera à envisager des options fondamentales telles que des accords bilatéraux de non-agression conclus directement avec la Russie sur le modèle finlandais.
Ces accords pourraient inclure des garanties de neutralité en échange d’engagements russes à respecter l’intégrité territoriale et l’indépendance politique; l’Ukraine représente le cas le plus emblématique de cette transition.

Compte tenu des profondes divisions identitaires qui caractérisent le pays, avec les régions occidentales plus tournées vers l’Europe, une solution possible pourrait être une structure confédérale qui reconnaîtrait ces différences avec des garanties de sécurité différenciées selon les régions.
Ou bien, l’Ukraine pourrait obtenir des garanties de neutralité soutenues non seulement par la Russie, mais aussi par des puissances comme la Chine, l’Inde, et potentiellement une Europe en voie de réorganisation. Une alternative intéressante serait l’adoption d’un modèle de neutralité armée similaire à celui de la Suisse ou de l’Autriche pendant la Guerre froide, fondé sur un principe de neutralité garanti par la constitution, l’interdiction d’adhérer à des alliances militaires, des forces armées robustes exclusivement orientées vers la défense territoriale, des garanties internationales soutenues par la Russie et les puissances européennes, et une coopération économique sans implication militaire.
Le nouveau système de sécurité endogène, non plus dépendant des États-Unis, pourrait, selon McGregor, se matérialiser par un traité de sécurité continental, c’est-à-dire un nouveau cadre incluant la Russie, les États européens, et potentiellement la Turquie, basé sur des principes de non-agression mutuelle et de respect des sphères d’influence. L’ensemble serait complété par un système de supervision internationale des accords de limitation des armements et des activités militaires dans les zones frontalières.
Tout cela nécessiterait cependant une maturation politique significative de la part des élites d’Europe orientale (et pas seulement), qui devraient abandonner la mentalité de dépendance stratégique développée au cours des trois dernières décennies et assumer la responsabilité directe de leur propre sécurité nationale.
Après l’accomplissement inexorable par Moscou de tous les objectifs opérationnels de l’Opération militaire spéciale, l’échec désormais évident de l’approche UE-OTAN dans la conduite de la guerre, et dans l’attente de voir ce qu’il restera vraiment à gérer de l’Ukraine, la perspective d’un système multipolaire plus complexe mais potentiellement plus stable, fondé sur des équilibres régionaux et des accords de dissuasion mutuelle, pourrait constituer un modèle à suivre.
Il resterait cependant à vérifier dans quelle mesure les États-Unis sont réellement déterminés à « débrancher la prise » et à permettre à la Russie de jouer un nouveau rôle en Europe, alors que la guerre en Ukraine a précisément été déclenchée pour atteindre l’objectif inverse: déconnecter Moscou économiquement et politiquement du Vieux Continent.
En outre, la « maturité politique » européenne précédemment invoquée pourrait tarder à se manifester, à moins d’un changement radical de leadership, porteur d’une nouvelle et plus courageuse culture des relations internationales, capable d’abandonner la perspective d’une confrontation permanente avec la Russie.
À l’heure actuelle, les scénarios évoqués restent des hypothèses de travail à la concrétisation incertaine, mais leur analyse s’avère fondamentale pour combler le vide d’alternatives qui caractérise le débat stratégique européen actuel.
En tout état de cause, il existe un point de convergence fondamental : l’après-guerre en Ukraine ne pourra pas se résoudre par un retour au statu quo, mais imposera une redéfinition profonde des équilibres européens et mondiaux.
La possibilité d’un compromis pragmatique avec Moscou, la fragmentation interne de l’Union européenne, la réduction du rôle américain et l’émergence de nouvelles architectures de sécurité continentales représentent des variables qui s’entrecroisent et qui, inévitablement, façonneront l’avenir du continent tout entier, appelé à redéfinir son rôle dans le nouvel ordre mondial inévitablement multipolaire.
18:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ukraine, russie, finlande, europe, affaires européennes, sécurité, architecture de sécurité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
BlackRock, avec Rheinmetall, s’étend des chars aux navires de guerre. Et l’ex-dirigeant Merz plaide pour le réarmement

BlackRock, avec Rheinmetall, s’étend des chars aux navires de guerre. Et l’ex-dirigeant Merz plaide pour le réarmement
Rédaction Electo
Source: https://electomagazine.it/black-rock-con-rheinmetall-si-e...
Des coïncidences, ce ne sont que des coïncidences. Rheinmetall, le géant allemand de l’armement qui compte, par hasard, parmi ses principaux actionnaires le fonds BlackRock—au sein duquel le chancelier Merz était, comme par hasard, un haut dirigeant—a annoncé l’accord pour l’acquisition de Naval Vessels Lürssen, la division navale militaire du groupe Lürssen.

Ainsi, BlackRock renforce sa présence dans le secteur militaire, l’élargissant du domaine terrestre (chars, lance-grenades, véhicules de combat) à tout le domaine naval. Et cela arrive, comme par hasard, alors que son homme Merz, en tant que chancelier, insiste sur la nécessité du réarmement, de la préparation à la guerre, du retour à la conscription, car les jeunes Allemands ne semblent pas très enthousiastes à l’idée de s’engager comme volontaires pour aller se faire tuer par des Russes ou des Nord-Coréens.
Mais les jeunes Allemands ne comptent pas, pas plus que le vote régional qui a vu l’AfD tripler ses voix. Ce qui compte, c’est BlackRock, ce sont ses ordres et la promptitude de Merz à les exécuter. Mais, au moins, s'il vous plait, n’appelez pas cela une démocratie.
17:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : blackrock, rheinmetall, friedrich merz, allemagne, réarmement, europe, actualité, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump

L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/09/15/teknofasismin-nousu-tr...
Le développement de l’intelligence artificielle a déclenché une vague d’investissements dans le secteur technologique. Des grandes entreprises comme Microsoft, Meta, Amazon et Google misent sur les modèles linguistiques, la puissance de calcul, la technologie des semi-conducteurs et les centres de données. Toutefois, la rentabilité économique de ces investissements demeure incertaine. Des innovations telles que celle de DeepSeek, une entreprise chinoise, démontrent que d’immenses ressources ne sont pas toujours nécessaires pour réussir dans la compétition mondiale.
Les récits médiatiques sur le potentiel révolutionnaire de l’IA se polarisent entre deux extrêmes: des visions utopiques prédisant que l’IA résoudra les problèmes de l’humanité, et des scénarios de menaces existentielles où l’IA relèguerait l’humanité au second plan. Ce discours polarisant néglige souvent les changements progressifs et pratiques par lesquels la technologie influence réellement la société.

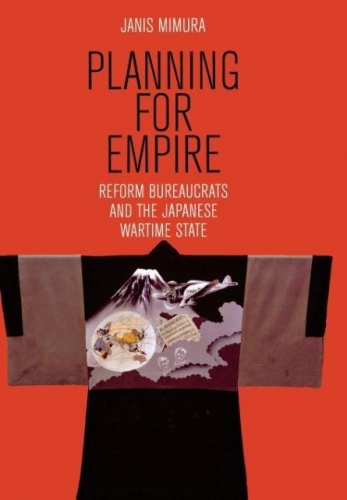
La recherche de l’historienne Janis Mimura sur le technofascisme japonais, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State (2011), offre un cadre d’analyse pour les évolutions actuelles. Mimura décrit comment le Japon a colonisé la Mandchourie, au nord-est de la Chine, dans les années 1930, faisant de la région un terrain d’expérimentation précoce du technofascisme. Il en résulta un État fantoche autoritaire, le Mandchoukouo, centré sur l’industrie lourde comme la production d’acier et d’armes, exploitant la population locale et les ressources naturelles au service des besoins militaires du Japon.

Le fonctionnaire du ministère du Commerce, Kishi Nobusuke (photo), a dirigé à partir de 1936 un programme d’industrialisation soutenu par les conglomérats zaibatsu au Mandchoukouo. Cela impliquait le recours au travail forcé et à l’esclavage, ainsi que des conditions de travail inhumaines, entraînant de nombreuses victimes. De retour à la politique nationale japonaise en 1939, Kishi a promu une industrialisation dirigée par l’État similaire dans son pays.
La technocratie était un projet idéologique plaçant la rationalité technologique au-dessus des valeurs sociales, légitimant ainsi la concentration du pouvoir. Contrairement au fascisme de Mussolini ou au national-socialisme d’Hitler, le système japonais ne reposait pas sur un chef charismatique, mais sur des bureaucrates et sur l’armée. Selon Mimura, le Japon a « glissé vers le fascisme » lorsque les fonctionnaires utilisaient leur pouvoir dans l’ombre au nom de l’empereur. La survie de la technocratie dans le Japon d’après-guerre témoigne de sa capacité d’adaptation institutionnelle.
L’élite technocratique de la Silicon Valley est devenue un acteur central aux États-Unis. Les géants du numérique tirent un pouvoir symbolique et matériel de l’apparente irrésistibilité de la technologie, marginalisant les débats critiques sur les impacts sociaux de la digitalisation. Ce pouvoir s’inscrit dans le plan d’action sur l’IA de l’administration Trump, visant à accélérer le développement de l’IA en réduisant la régulation et en promouvant le leadership mondial des États-Unis selon des objectifs géopolitiques stratégiques.
Lors de l’investiture présidentielle en janvier, des leaders technologiques tels qu’Elon Musk et Mark Zuckerberg ont apporté leur soutien à Donald Trump, ce qui a été interprété comme une alliance stratégique au service d’intérêts économiques et politiques. Selon Mimura, une telle alliance entre l’État et l’élite industrielle rappelle le technofascisme du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, où les technocrates ont pris le pouvoir.

Contrairement au fascisme traditionnel, le technofascisme américain s’exprime comme une gouvernance technocratique subtile. Il se manifeste dans la prise de décision militaire, les opérations des services de sécurité et la projection de puissance mondiale. Socialement, il se traduit par la surveillance policière préventive, la surveillance des réseaux sociaux et le soutien au sionisme dans la politique étrangère. Dans le monde du travail, la culture du « hustle » issue de la Silicon Valley normalise la surcharge et affaiblit les droits des travailleurs. Cette évolution légitime la discrimination algorithmique et approfondit les inégalités socio-économiques.
Si le progrès technologique repose souvent sur des réformes progressives, le cœur du technofascisme consiste à considérer que la régulation – qu’il s’agisse de la protection de l’environnement, des droits des travailleurs ou de la supervision financière – freine l’innovation. Par exemple, le discours public d’Elon Musk est passé de la mise en avant des risques de l’IA à sa valorisation stratégique dans la prise de décision automatisée et les applications basées sur les données, comme le développement de technologies par xAI.
Les conglomérats zaibatsu du Japon ont mené le développement industriel sans considération pour les droits des travailleurs; une dynamique similaire est visible aujourd’hui aux États-Unis, où les entreprises technologiques promeuvent automatisation et technologies de surveillance. L’infrastructure bâtie par les géants du numérique crée un « État profond » modernisé et antidémocratique, au service de l’élite technocratique et économique.
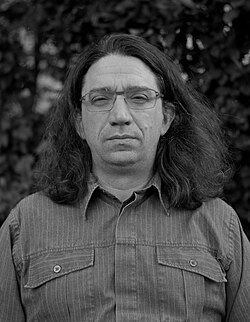 Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».
Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».
La recherche de Mimura souligne la capacité des technocrates à survivre à l’effondrement des systèmes autoritaires en dépit des changements institutionnels. L’ascension de Kishi Nobusuke – malgré qu'il dirigea le projet technofasciste en Mandchourie et malgré des accusations de crimes de guerre – au poste de Premier ministre du Japon, avec le soutien des États-Unis, montre comment la compétence technocratique peut légitimer les changements de pouvoir dans les moments de rupture historique.
Aux États-Unis, une dynamique similaire ne s’exprime pas à travers des alliances fragiles (comme l’illustre la rupture entre Trump et Musk), mais par une intégration systémique: les géants du numérique sont devenus une partie essentielle de la cybersécurité fédérale, du renseignement et de la gestion des infrastructures critiques. La base du pouvoir se déplace du mandat démocratique vers une irremplaçabilité technique.
À mesure que l’ordre libéral occidental chancelle, il pourrait être remplacé par un pouvoir d’entreprise technofasciste agissant dans les coulisses de la politique. Selon une nouvelle étude, la majorité de plus de 500 politologues estime que les États-Unis évoluent vers un modèle de gouvernance autoritaire, où un groupe dominant utilise les institutions étatiques pour réprimer ses opposants politiques.
17:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : technofascisme, actualité, états-unis, japon, technocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Poudrière latino-américaine

Poudrière latino-américaine
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/polveriera-latino-americana/
Maduro part en guerre. Le leader vénézuélien, qui se réfère à Simon Bolívar et à Chávez, semble déterminé.
Il est désormais temps de passer aux armes. Pour réagir aux ingérences constantes des gringos nord-américains.
Il ne voit pas d'autre solution. Passer à la défense active.
Cela peut faire sourire. Et, bien sûr, la force militaire de son Venezuela est risible face à la flotte américaine qui croise déjà, menaçante, dans ses eaux.
Cependant, la situation est très complexe. Et elle révèle le signal d'alarme d'un malaise qui touche toute l'Amérique du Sud, ou presque.

Car Washington a été très clair depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. Le monde, dans son ensemble, est à l'évidence multipolaire. Et le jeu entre les puissances – en particulier la Russie, la Chine et les États-Unis – répond à trop de variables pour qu'il puisse y avoir une seule puissance à la tête du globe. Le rêve, ou le cauchemar, qui a commencé avec Clinton s'est misérablement évanoui avec la présidence de Biden.
Mais l'Amérique, c'est autre chose. Toute l'Amérique, de la pointe extrême de l'Alaska à la Terre de Feu. Le jardin de la maison yankee. Et cela ne se discute pas.
Maduro se mue donc en un problème. Qui devrait être résolu rapidement.
Cependant, la rébellion vénézuélienne n'est pas un événement isolé.
Toute l'Amérique du Sud est en effervescence. Ou plutôt, elle est traversée par une fièvre qui risque de devenir dangereuse. Voire mortelle, pour Washington.
Et à la Maison Blanche, ils le savent parfaitement. Car Washington peut prendre puis perdre le contrôle de l'Afghanistan. Cela fait partie du jeu.
Mais il ne peut absolument pas se permettre de laisser partir certaines parties de son jardin.
Un jardin, cependant, qui est aujourd'hui extrêmement agité.
Le géant brésilien, sous la présidence de Lula, s'est déjà, de fait, retiré du jardin. En se liant de plus en plus étroitement aux BRICS et en s'éloignant de toute protection de Washington.
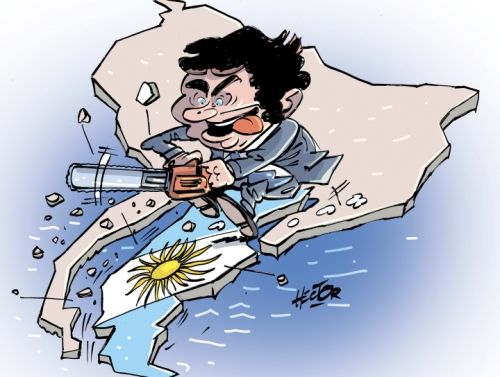
Milei, bien sûr, est un allié fidèle. Mais seul un aveugle ne verrait pas que son hyperlibéralisme mène l'Argentine à la faillite. Écrasant sous le seuil de la misère de larges couches sociales.
Et les élections dans les États ont vu une lourde défaite du président actuel. De tristes présages pour l'avenir proche.
Puis, bien sûr, les pays de la région andine. Avec le Venezuela en tête.
Le Venezuela bolivariste, qui ose désormais défier Washington de plus en plus ouvertement.
Presque pour le contraindre à une intervention armée qui, bien sûr, aurait une issue prévisible.
Et qui pourrait néanmoins constituer un signal dangereux. La première étincelle d'un incendie capable de ravager toute l'Amérique du Sud.
16:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Laisser l'URSS derrière soi Le passé soviétique divise; l'avenir russe unit
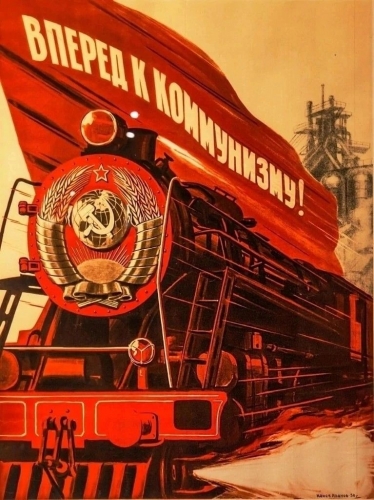
Laisser l'URSS derrière soi
Le passé soviétique divise; l'avenir russe unit
Alexander Douguine
Alexander Douguine soutient que l'URSS incarnait à la fois la russophobie et la grandeur russe, et qu'aujourd'hui, les Russes doivent dépasser son héritage non résolu pour construire une Grande Russie souveraine, orthodoxe et créative.
Comment devons-nous nous positionner par rapport à l'URSS ? D'un côté, les bolcheviks ont infligé des dommages irréparables au peuple russe. Des dommages terribles et irréparables. Cela ne peut être contesté; leur idéologie était véritablement russophobe, antichrétienne, purement satanique.
D'autre part, l'élite de l'Empire russe était occidentalisée et russophobe depuis le 18ème siècle, depuis Pierre le Grand. Totalement servile, pareille à l'image que nous a laissée Eltsine. Comment le peuple russe aurait-il pu ne pas se révolter contre une élite aussi occidentalisée ? Et, bien sûr, il s'est révolté.
Il s'est effectivement révolté. Mais une fois de plus sous la direction d'une élite inadaptée. Et avec une idéologie inadaptée. Encore une fois, une idéologie russophobe.
Que fallait-il donc faire ?
Le peuple russe a grandi à travers le communisme, à travers le soviétisme, en tendant vers Dieu et vers les étoiles. Comme le peuple russe est beau et indestructible !
En URSS, il y avait à la fois l'élément marxiste et l'élément russe. L'élément russe était magnifique; l'élément marxiste était loin d'être magnifique, il était même tout en laideur. L'élément populaire, folklorique, en URSS, était très important. Les Russes voulaient être libres. Ils voulaient abolir les élites occidentalisées. Aujourd'hui, les Russes veulent toujours la même chose. Mais cela est secondaire pour l'instant.
Quant à l'URSS, l'équilibre entre les Russes et les non-Russes n'a jamais été trouvé. Aujourd'hui, dans la Fédération de Russie, certains Russes regrettent le passé soviétique (on entend souvent: «Staline, reviens!»), tandis que d'autres rêvent d'un empire et exigent que Lénine soit retiré du mausolée.

L'idée même de l'URSS nous divise. Ce dont nous avons besoin, c'est que tout nous unisse, nous les Russes. Cela signifie que soit nous devons repenser l'URSS différemment (ni « pour » ni « contre », mais pour le bien du peuple russe), soit nous ne devons pas y penser du tout et aller de l'avant, vers l'avenir russe. Si nous ne parvenons pas à comprendre l'URSS à la manière russe (et nous n'y parvenons pas), alors peut-être est-il temps d'arrêter d'essayer de la comprendre. Laissons-la de côté pour plus tard. Construisons la Grande Russie, totalement indépendante du passé. Seulement tournée vers l'avenir. Nous avons besoin de la Russie du futur. Belle, grande et prospère. Libre et souveraine. Orthodoxe et populaire. Construisons-la.
Il est temps que nous commencions à créer notre propre culture. À nous libérer des clichés et à créer. Tout ce qui s'est passé avant ne doit pas nous freiner. Ce qui est fait est fait. Nous pouvons faire naître quelque chose d'inédit. Le peuple russe est grand, puissant, joyeux et capable de beaucoup de choses.
Nous devons seulement nous libérer. De l'Occident (qui n'est plus aujourd'hui qu'un monceau d'immondices) et de ce que nous n'avons pas réussi à accomplir dans le passé.
Nous devons davantage compter sur nos propres forces.
Quelqu'un a un jour expliqué à notre dirigeant que l'autarcie était une mauvaise chose. C'est une erreur: autarcie signifie la même chose que souveraineté, autosuffisance, mais en grec. Et la souveraineté est une bonne chose. L'autarcie est une bonne chose. Nous avons besoin d'une autarcie créative.
16:29 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, urss, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 septembre 2025
Le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, ne considère pas les accords de plusieurs milliards conclus entre Bruxelles et Washington comme une solution provisoire, mais comme une réorganisation durable des marchés énergétiques

Le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, ne considère pas les accords de plusieurs milliards conclus entre Bruxelles et Washington comme une solution provisoire, mais comme une réorganisation durable des marchés énergétiques
Source: https://www.freilich-magazin.com/welt/trumps-energieminis...
Washington, D. C/Bruxelles. – La décision de l'Union européenne d'acheter aux États-Unis, dans un délai de trois ans, du pétrole, du gaz et des technologies nucléaires pour une valeur de 750 milliards de dollars américains aura, selon le gouvernement américain, des conséquences considérables. Dans une interview accordée à Euractiv, le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, a évoqué une réorientation structurelle des flux énergétiques mondiaux. « Je pense qu'il s'agit d'un changement à long terme », a déclaré M. Wright à Bruxelles. « L'achat d'énergie, en particulier de gaz naturel liquéfié, nécessite la mise en place d'une infrastructure considérable. »
Un accord qui va au-delà du mandat
Wright a clairement indiqué que l'accord ne se limitait pas à quelques années. « Cela ne prendra pas fin au bout de trois ans et demi », a-t-il souligné après des discussions avec des représentants de haut rang de l'UE. Son évaluation contraste toutefois avec la position de la Commission européenne. Bruxelles a officiellement qualifié l'accord de solution transitoire.
« À court terme, nous devons couvrir nos besoins énergétiques et, dans ce contexte, nous envisageons d'augmenter certaines importations d'énergie en provenance des États-Unis », a déclaré la Commission. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également souligné à Strasbourg que l'Europe devait saisir cette occasion pour développer une « énergie propre et locale ».

L'offre américaine, une opération « gagnant-gagnant »
Selon M. Wright, cet accord est avantageux pour les deux parties. Il constitue également un moyen de remplacer progressivement l'énergie russe. « Une partie du dialogue que nous menons porte sur le fait que les capacités d'exportation de GNL aux États-Unis vont doubler sous l'administration Trump, et pas seulement augmenter de 10 ou 20% », a-t-il déclaré. En contrepartie de la limitation des droits de douane à 15%, l'UE s'est engagée à acheter pour 250 milliards de dollars d'importations par an pendant les trois dernières années du mandat de Trump.
Alors que les analystes doutent de la faisabilité de ces montants, M. Wright s'est montré convaincu: les deux tiers pourraient être couverts uniquement par le remplacement des importations d'énergie russe, soit directement par du gaz naturel liquéfié, soit indirectement par des restrictions sur les importations de produits raffinés via des pays tiers.
Dimension stratégique de la politique énergétique
Les diplomates soulignent que la politique énergétique est également un instrument dans la guerre en Ukraine. Selon Euractiv, Wright n'a pas souhaité s'exprimer sur la pression exercée par Washington sur Bruxelles.
« Nous avons discuté de différentes façons dont les États-Unis et l'UE peuvent coopérer pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine », s'est-il contenté de déclarer.
Wright n'a laissé aucun doute quant aux ambitions stratégiques de Washington : « Les ressources énergétiques considérables et abondantes de l'Amérique nous permettent d'être un fournisseur clé pour nos alliés à travers le monde, qui jusqu'à présent se procuraient du pétrole, du gaz et d'autres technologies auprès de nos adversaires. »
18:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chris wright, actualité, europe, énergie, affaires européennes, gaz de schiste, gnl |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La fracture de l'ordre judéo-chrétien - Le faible soutien de l'opinion publique américaine à Israël marque la rupture entre l'Occident et l'Etat sioniste
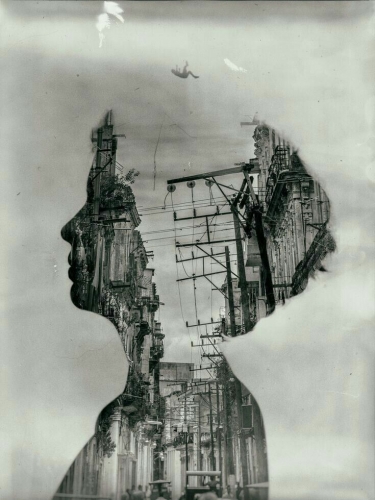
La fracture de l'ordre judéo-chrétien
Le faible soutien de l'opinion publique américaine à Israël marque la rupture entre l'Occident et l'Etat sioniste
Constantin von Hoffmeister
Constantin von Hoffmeister affirme que la consolidation des positions d'Israël à Gaza et en Syrie, combiné à l'effondrement du soutien de l'opinion publique américaine, annonce une rupture de l'alliance judéo-chrétienne et l'avènement d'une multipolarité de nature darwinienne.
Israël se trouve à l'aube d'une nouvelle réalité. Ses dirigeants parlent ouvertement de l'occupation permanente de Gaza et même de certaines parties du sud de la Syrie. Netanyahu a averti que le pays devait se préparer à l'isolement, à une économie de siège, à des industries qui produisent tout à l'intérieur même de la forteresse. Il ne s'agit pas de rhétorique, mais d'une préparation à un monde où les sanctions pourraient venir non pas des États arabes, longtemps écartés, mais de l'Occident même qui a autrefois assuré la survie d'Israël.

Les manœuvres sur le mont Hermon (photo), le plus haut sommet du Levant à la frontière entre la Syrie et le Liban, l'annexion du plateau du Golan, une plaine fertile conquise sur la Syrie en 1967, annexion reconnue par Washington en 2019, les alliances avec les conseils locaux de Soueida, une province à majorité druze du sud de la Syrie, et la perspective d'un corridor traversant Deraa, la province voisine connue pour être le berceau du soulèvement syrien de 2011, montrent une tendance claire: prendre, tenir, normaliser. Israël ne cache plus ses intentions. Le territoire devient théologie, les montagnes deviennent des alliances, et la géographie fusionne avec l'idéologie. Ce qui était autrefois considéré comme une défense temporaire se transforme désormais en permanence.
Ce changement coïncide avec une profonde fracture au sein même de l'Occident. L'ordre établi après 1945 s'effondre sous nos yeux. Dans le même temps, le cadre moral de la solidarité « judéo-chrétienne » qui liait Israël à l'Occident commence à se fissurer. Les sondages aux États-Unis montrent que le soutien à Israël s'effondre: selon Gallup, seuls 32% des Américains approuvent les actions d'Israël à Gaza, tandis que 60% les désapprouvent. Un sondage Quinnipiac révèle que 60% des Américains s'opposent à l'envoi d'une aide militaire supplémentaire, contre seulement 32% qui y sont favorables. Cette érosion est la plus forte chez les jeunes et les indépendants, des groupes qui façonneront l'électorat futur.
C'est là que réside le sens profond de la mutation à l'oeuvre sous nos yeux. L'alliance était fondée non seulement sur une stratégie, mais aussi sur une identité commune. Israël était présenté comme l'avant-poste vivant d'une civilisation « judéo-chrétienne ». Les églises, les synagogues et les tribunes politiques soutenaient toutes cette vision. Aujourd'hui, cette vision s'estompe. Les images des bombardements l'emportent sur la teneur des sermons. L'alliance se dissout dans la conscience publique. Pour la première fois, l'opinion publique occidentale se demande si les actions d'Israël sont conformes aux valeurs que ses dirigeants ont autrefois proclamées.
C'est là la marque d'une multipolarité darwinienne en advenance. Le pouvoir appartient désormais à ceux qui s'adaptent, qui allient force et crédibilité. Les frontières changent à nouveau, les alliances se transforment et les symboles perdent leur force automatique. Israël peut encore agir, occuper et se retrancher, mais il ne peut plus compter sur le même bouclier moral de la part de l'Occident. Une fracture s'ouvre au cœur de l'alliance, et à travers elle, l'ancien ordre mondial s'effrite.
L'avenir ne s'écrira pas dans des traités ou des sermons, mais dans la force, dans la perception publique, dans les changements d'allégeances. L'étiquette « judéo-chrétienne » qui a uni l'Occident et Israël pendant des générations s'affaiblit. Ce qui viendra après sera plus dur, façonné uniquement par la puissance.
18:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, levant, proche-orient, israël |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Fin de l’empire américain et leçons pour l’Inde - Stratégies géopolitiques pour l’Inde dans un monde multipolaire

Fin de l’empire américain et leçons pour l’Inde
Stratégies géopolitiques pour l’Inde dans un monde multipolaire
S. L. Kanthan
(20 mars 2025)
Source: https://slkanthan.substack.com/p/end-of-the-american-empi...
« Être un ennemi de l’Amérique peut s’avérer dangereux, mais en être un ami est fatal. » Ce seraient là les mots d’Henry Kissinger, criminel de guerre et lauréat du prix Nobel de la paix, qui a profondément influencé la politique étrangère américaine. L’Inde ne doit pas oublier ce côté sombre de l’establishment américain, même si Biden a déclaré que les relations américano-indiennes étaient les plus importantes du siècle et que Trump a rencontré à plusieurs reprises Modi, le qualifiant de grand dirigeant. Le recentrage américain sur l’Inde repose sur trois faisceaux d'intérêts: la volonté de contenir la Chine, l’accès à une main-d’œuvre bon marché et un vaste marché de consommateurs. Les États-Unis n’ont pas de véritables alliés, seulement des intérêts narcissiques et impérialistes.

Modi a été l’un des rares dirigeants étrangers invités à la Maison Blanche au cours du premier mois du mandat de Trump. De façon générale, les Indiens ont aussi une opinion très positive de Trump et des États-Unis en général. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les États-Unis jouissent d’un fort pouvoir d’influence en Inde: immigration, emplois dans la tech, succès des Américains d’origine indienne, popularité de la langue anglaise, financement occidental des think tanks indiens, investisseurs américains dans les médias indiens, tensions avec la Chine, etc. Cependant, l’Inde doit veiller à ne pas devenir « l’Ukraine de l’Asie » – un pion géopolitique sacrifiable de l’Empire américain.
Soyons clairs: les États-Unis veulent contrôler toutes les dimensions de l’Inde. Il y a quelques mois, l’ambassadeur américain en Inde a affirmé devant un public indien que l’autonomie stratégique n’existait pas. De façon inquiétante, cet avertissement est intervenu juste avant que les États-Unis ne mettent en scène une révolution de couleur au Bangladesh et ne renversent la Première ministre Hasina, qui n’était pas parfaite mais avait fait un travail remarquable pour relancer l’économie. La raison en était simple: la Première ministre Hasina (photo) avait refusé d’autoriser l'installation d'une base militaire américaine dans son pays.

De même, tout analyste géopolitique objectif peut voir comment les États-Unis ont orchestré des coups d’État au Pakistan et au Sri Lanka au cours de ces dernières années. Le Premier ministre Imran Khan a été évincé par un coup d’État « doux » après une pression manifeste des États-Unis, son parti a été interdit et il a été emprisonné. Voilà la liberté et la démocratie à l’américaine ! Son crime? Être trop proche de la Russie. Quant au Sri Lanka, le parti au pouvoir était jugé trop pro-chinois. Bien entendu, les États-Unis ne pouvaient tolérer une telle indépendance.
L’histoire montre aussi que les États-Unis n’ont jamais été un véritable allié de l’Inde.
Alors que le ministère indien des Affaires étrangères se méfie de l’influence de la Chine dans le voisinage de l’Inde, il n’y a pratiquement aucune protestation contre l’ingérence américaine dans la sphère d’influence indienne. Les Indiens sont trop indulgents et oublient un fait: en 1966, les États-Unis/la CIA auraient probablement poussé à assassiner le Premier ministre Lal Bahadur Shastri et le scientifique nucléaire Homi Bhabha.

Pendant toute la guerre froide, les États-Unis ont saboté l’Inde en guise de punition pour sa politique de non-alignement et ses relations amicales avec l’URSS. Les États-Unis ont également encouragé l’Inde à entrer en guerre contre la Chine au sujet du Tibet, mais le président JFK a ensuite refusé toute aide militaire au moment crucial. Plus tard, lorsque le Bangladesh a cherché à devenir indépendant, les États-Unis ont envoyé des navires de guerre dans la baie du Bengale pour menacer l’Inde, qui n’a pu repousser les Américains qu’avec l’aide de l’Union soviétique.
Aujourd’hui, l’Inde n’a pas vraiment tiré profit de ses relations étroites avec l’Amérique.
À la fin de la guerre froide, les entreprises américaines se frottaient les mains à l’idée d’exploiter la Chine et l’Inde pour leur main-d’œuvre bon marché, dans l’industrie et les services respectivement. Cependant, la différence entre ces deux pays est frappante. Tandis que la Chine s’est concentrée sur la maîtrise des technologies et la création d'atouts nationaux, les élites indiennes se sont contentées d’utiliser des produits américains. Le résultat se voit dans les géants technologiques chinois comme Huawei, BYD, ByteDance (maison-mère de TikTok) et 135 autres entreprises figurant dans le classement Fortune 500, contre seulement 9 pour l’Inde.

Dans le domaine de l’IA, la technologie la plus perturbatrice du siècle, la Chine détient 60% des brevets, contre moins de 1% pour l’Inde. Dans de nombreux autres secteurs – voitures électriques, panneaux solaires, batteries, smartphones, semi-conducteurs, robotique, cloud computing, biotechnologie, exploration spatiale, avions de chasse, navires de guerre, etc. – la Chine a largement dépassé l’Inde.
Pourquoi l’Inde a-t-elle pris du retard ? Parce que nous suivons le modèle économique américain du capitalisme financiarisé, et nous nous sentons en sécurité dans la dépendance au dollar américain, à la technologie américaine, aux médias américains, à la médecine américaine, aux investissements américains, etc.
L’Inde laisse également sa politique étrangère être dictée par les États-Unis plus que de raison. Par exemple, nous pourrions acheter du pétrole et du gaz bon marché à l’Iran, et nous aurions pu commencer à réaliser le projet du port de Chabahar depuis longtemps. Mais l’Inde fait trop preuve de déférence envers les sanctions américaines. De même, le fait que l’Inde rejoigne le QUAD et d’autres accords « indo-pacifiques » pour contenir la Chine, ou refuse de rejoindre la Belt and Road Initiative, ne fait que servir les manœuvres géopolitiques américaines de division et de domination.
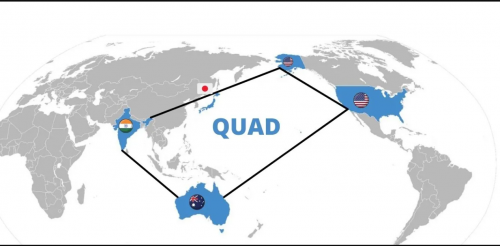
Actuellement, les États-Unis tirent bénéfice de l’Inde de multiples façons: main-d’œuvre indienne relativement peu chère dans l’industrie du logiciel, main-d’œuvre de fabrication ultra-bon marché pour des entreprises comme Apple, immense marché de consommateurs issus de la classe moyenne croissante, startups indiennes ouvertes aux investisseurs américains, achats d’armes américaines par le gouvernement indien, et l’Inde en tant qu’outil géopolitique potentiel pour contenir la Chine diplomatiquement, économiquement et militairement.
Cependant, le soft power américain ne durera pas longtemps en Inde. D’abord, les États-Unis vont bientôt restreindre l’immigration en provenance de l’Inde, en particulier pour les travailleurs technologiques H1-B. L’« alt-right » américaine raciste a déjà commencé à diaboliser les Indiens. Ensuite, les États-Unis vont commencer à contenir l’Inde à mesure que celle-ci continue de croître et de devenir plus indépendante. Les États-Unis peuvent autoriser des Indiens à devenir PDG de Google ou de Microsoft, mais ils ne toléreront pas des entreprises indiennes qui concurrencent Google ou Microsoft. Les États-Unis maintiennent leur hégémonie mondiale non pas grâce à des partenaires égaux, mais via un réseau de vassaux.
Même les Européens commencent enfin à sortir de leur sommeil hypnotique. Le nouveau chancelier allemand, Merz, a déclaré que l’Europe devait œuvrer à son indépendance vis-à-vis des États-Unis.
Dans l’ensemble, nous assistons au cycle inexorable de l’histoire, dans lequel un nouvel empire est au bord de l’effondrement. Cependant, contrairement aux derniers siècles, les États-Unis ne seront pas remplacés par un autre empire. Un monde multipolaire émerge pour démocratiser la géopolitique et la géoéconomie. Des organisations comme les BRICS offriront un nouveau paradigme de coopération et de développement aux nations du Sud global. Le privilège extraordinaire du dollar américain, qui sous-tend la tyrannie américaine des sanctions et des guerres sans fin, disparaîtra également.
Cinq siècles de domination occidentale sur le monde touchent à leur fin. Ce sera le siècle de l’Asie, de l’Eurasie et de l’Afrique. L’Inde doit donc élaborer sa stratégie en conséquence.
S.L. Kanthan
18:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, inde, asie, affaires asiatiques, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
«Stratégie nationale de défense» des États-Unis: axée sur le Mexique et les Caraïbes, elle relègue la Chine et la Russie au second plan

«Stratégie nationale de défense» des États-Unis: axée sur le Mexique et les Caraïbes, elle relègue la Chine et la Russie au second plan
Alfredo Jalife-Rahme
Source: https://www.jornada.com.mx/2025/09/14/opinion/006o1pol
Le portail Politico, contrôlé par la société d'information allemande Axel Springer SE, qui est résolument atlantiste et pro-israélienne, divulgue le projet de la nouvelle « Stratégie de défense nationale (EDN) » des États-Unis, généralement publiée par le Pentagone – rebaptisé sous son nom d'origine « Département de la guerre (!) » – au début de chaque administration (http://bit.ly/41URcBs ).
D'emblée, l'EDN a été qualifiée d'« isolationniste » et de promouvoir le néo-monroïsme de Trump 2.0 : « les missions de défense et de protection du territoire national et de l'hémisphère occidental ont la priorité absolue (!!!) ».
Sans détour, Politico affirme que « le Pentagone prévoit de hiérarchiser les questions intérieures (!!!) par rapport à la menace chinoise », ce qui « marque une rupture importante avec la première administration Trump, qui mettait l'accent sur la dissuasion de Pékin ».
Trump 1.0 n'est pas le même que Trump 2.0, qui est aujourd'hui confronté à de graves problèmes nationaux dans son conflit ouvert avec le groupe mondialiste de George Soros et de son fils Alex, auxquels il envisage d'appliquer la loi RICO (http://bit.ly/4gnHJIR ), alors que les États-Unis sont au bord d'une guerre civile après l'assassinat de son allié chrétien millénariste Charlie Kirk – plusieurs hypothèses circulent quant aux commanditaires de cet assassinat: cela va de l'Ukraine (http://bit.ly/3Kkg6nS) à Israël (Netanyahu), selon l'ancien agent de la CIA Larry Johnson (http://bit.ly/4nyMQbB ), et comprend également l'hypothèse mormone (http://bit.ly/46I6Cuv et http://bit.ly/4grh1z1 ).
En effet, « le Pentagone a mobilisé des milliers de soldats de la Garde nationale pour faire appliquer la loi à Los Angeles et à Washington et a envoyé plusieurs navires de guerre et avions F-35 dans les Caraïbes (!!!) pour barrer la route au trafic de drogue vers les États-Unis », avec l'élimination controversée de 11 membres présumés du gang du Tren d'Aragua embarqués sur une chaloupe.

De plus, « le Pentagone a également établi une zone militarisée le long de la frontière sud avec le Mexique qui permet à l'armée d'arrêter des civils ». Cela se produit en parfaite synchronisation avec l'affirmation téméraire d'un « rapport spécial (sic) de Reuters », porte-parole de l'anglosphère (http://bit.ly/4nuRJCm ).
Deux autres révisions sont attendues en octobre concernant la posture mondiale des États-Unis – le stationnement de leur armée – et la défense aérienne et antimissile, qui sont liées à l'EDN alors qu'il est très probable que les troupes soient retirées d'Europe et du Moyen-Orient. En outre, l'Initiative de sécurité des pays baltes, à ses frontières avec la Russie (sic), subirait d'importantes réductions de son financement (http://bit.ly/41QEVhp).

Le concepteur de cette nouvelle version de la politique du Pentagone est Elbridge Colby, qui s'est aligné sur le vice-président J. D. Vance, futur candidat à la présidence, afin de « libérer les États-Unis de leurs engagements étrangers ».
Le retrait militaire américain prend tout son sens lorsque Trump 2.0 a l'intention de rencontrer fin octobre, lors du sommet de l'APEC en Corée du Sud, son homologue chinois Xi Jinping, avec lequel il mène des négociations commerciales sur les tarifs douaniers à Genève, et que deux hauts responsables de la défense à Washington et à Pékin maintiennent la communication.
Il n'est pas non plus surprenant que la Russie, qui occupait la deuxième place parmi les adversaires des États-Unis sous Trump 1.0, était le premier ennemi désigné sous Biden et son groupe démocrate, qui souffraient de russophobie congénitale, alors qu'aujourd'hui les négociations se poursuivent à plusieurs niveaux, comme l'ont laissé entendre le président Poutine dans son discours à Vladivostok lors de la réunion du Forum économique de l'Asie de l'Est, et Kirill Dmitriev, conseiller du Kremlin pour les fonds souverains.

Malgré la résurrection du G-3 le 3 septembre dernier par le Groupe de Shanghai à Tianjin, soit la réactivation de l'ancien RIC (Russie/Inde/Chine) – un concept forgé par l'ancien Premier ministre russe Yevgeny Primakov en 1998 (!) –, Moscou maintient sa proposition d'une collaboration « trilatérale » entre la Russie, les États-Unis et la Chine pour exploiter les réserves abondantes d'hydrocarbures dans l'Arctique, sans parler de la collaboration pétrolière entre ExxonMobil et la société d'État russe Rosneft (http://bit.ly/4n7BTxK ).
Pour s'informer:
Facebook: AlfredoJalife
Vk: alfredojalifeoficial
Telegram: https://t.me/AJalife
YouTube: @AlfredoJalifeR
Tiktok: ZM8KnkKQn/
X: AlfredoJalife
Instagram: @alfredojalifer
17:51 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, mexique, états-unis, caraïbes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 septembre 2025
L'essor de l'Asie et l'avenir de la mondialisation

L'essor de l'Asie et l'avenir de la mondialisation
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/09/09/aasian-nousu-ja-global...
La fin de la mondialisation a été prédite à la suite des crises du 21ème siècle, telles que les attentats du 11 septembre, la crise financière et la pandémie de coronavirus. Cependant, l'analyste stratégique Parag Khanna affirme que la mondialisation ne s'essouffle pas, mais qu'elle se transforme, l'Asie devenant son centre. Bien que la vision de Khanna sur le rôle de l'Asie soit convaincante, l'avenir de la mondialisation est complexe en raison de la concurrence technologique entre les grandes puissances et des divisions qu'elle crée.

Khanna (photo) décrit la mondialisation comme la construction de réseaux qui englobent les échanges commerciaux, les capitaux, les idées et les technologies. Selon lui, le centre de la mondialisation s'est déplacé de l'Occident vers l'Asie, où le commerce et les investissements entre les pays, soutenus par exemple par l'accord de libre-échange régional RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, qui couvre 15 pays d'Asie et du Pacifique), renforcent l'intégration régionale.
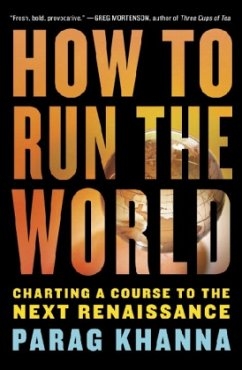
La mondialisation est un phénomène fragile, menacé par le protectionnisme, les guerres commerciales et la concurrence entre les États-Unis et la Chine, par exemple dans le développement de l'intelligence artificielle et des réseaux sans fil avancés. Cette concurrence divise le monde en camps technologiques et fragmente les marchés mondiaux.
Khanna utilise le terme « asiatique » pour décrire la convergence économique, culturelle et politique que l'on observe en Asie.
Le développement qui a débuté avec la reconstruction du Japon s'est rapidement étendu à des économies en pleine croissance telles que Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud et Taïwan, ainsi qu'à la Chine et à l'Asie du Sud-Est, créant ainsi un réseau d'interdépendance. Cependant, l'essor technologique de la Chine, comme la domination de Huawei dans le domaine de la 5G, a suscité des réactions négatives en Occident. Les restrictions et les sanctions imposées aux exportations technologiques pourraient ralentir l'intégration asiatique et affaiblir le caractère ouvert de la mondialisation.
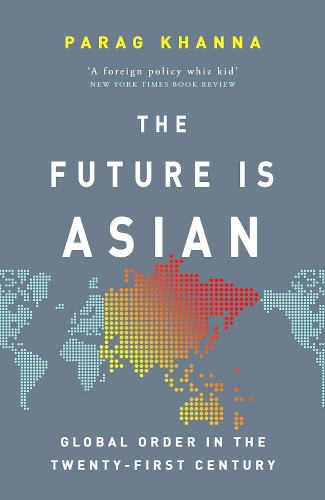
Les atouts de l'Asie sont sa population jeune, ses bas salaires et ses investissements dans les infrastructures, qui soutiennent la croissance économique. Cependant, le développement technologique nécessite une main-d'œuvre qualifiée et, en Inde par exemple, le chômage des jeunes et la qualité inégale de l'éducation limitent le potentiel. En outre, la stabilité politique est remise en question lorsque les gouvernements utilisent des technologies de pointe pour restreindre les libertés civiles, ce qui peut accroître les tensions sociales et ébranler la confiance dans la liberté promise par la mondialisation.
La concurrence technologique divise le monde en deux écosystèmes dominés respectivement par les États-Unis et la Chine, où les normes et la gestion des données diffèrent. Les controverses autour de TikTok et WeChat aux États-Unis montrent par exemple comment la technologie crée de nouvelles frontières. Les petits pays asiatiques, comme le Vietnam ou les Philippines, peuvent se retrouver pris au piège de la dépendance technologique, par exemple en ce qui concerne les réseaux 5G chinois ou les semi-conducteurs occidentaux, ce qui accroît les inégalités entre les pays.

Même si Khanna affirme que la pauvreté a diminué en Asie, les bénéfices de la mondialisation sont répartis de manière inégale et les écarts de revenus se creusent. L'automatisation peut remplacer des millions de travailleurs et accroître la popularité du populisme politique, ce qui remet en question la légitimité de la mondialisation.
Selon Khanna, le changement climatique est le plus grand défi pour l'Asie et la mondialisation, même si ses causes et son ampleur font encore l'objet de désaccords. L'Asie souffre de conditions climatiques extrêmes et est le plus grand producteur mondial d'émissions de dioxyde de carbone, la Chine représentant à elle seule environ 30% des émissions mondiales.
Le développement et l'adoption des énergies vertes, souvent présentés comme des solutions, posent toutefois problème. L'énergie solaire et éolienne dépendent de matières premières critiques, telles que le lithium et les métaux rares, dont l'extraction cause des dommages environnementaux importants et accroît les tensions géopolitiques. En outre, les sanctions commerciales et les litiges en matière de brevets ralentissent le partage des innovations, ce qui empêche la transition vers une économie durable et remet en question la capacité des technologies vertes à résoudre les défis environnementaux sans compromis plus larges.
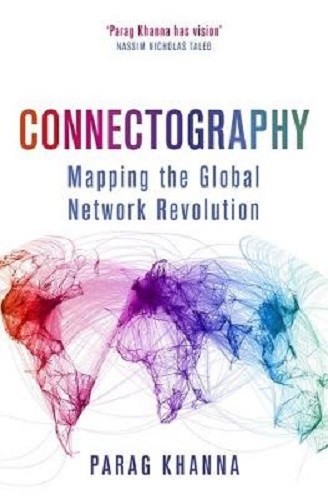
L'avenir de la mondialisation se dessine en fonction de la concurrence technologique. L'essor de l'Asie s'inscrit dans cette transition, mais la pandémie et les clivages technologiques encouragent des pays comme l'Inde et les pays de l'ANASE à développer leur autosuffisance, par exemple dans le domaine des semi-conducteurs. Cela pourrait conduire à une « mondialisation locale », dans laquelle le commerce se concentrerait sur des blocs régionaux.
La numérisation et l'intelligence artificielle augmentent le flux de données, mais les différences réglementaires peuvent créer de nouveaux obstacles.
Même si le développement durable prévu par l'agenda des Nations unies nécessite des technologies neutres en carbone, les économies asiatiques, en particulier la Chine et l'Inde, restent dépendantes du charbon, du gaz naturel et du pétrole brut. La Chine a toutefois investi massivement dans l'économie verte, par exemple dans le développement de la plus grande usine de production d'hydrogène vert au monde, qui soutient la transition vers des sources d'énergie à faibles émissions.
Les répercussions sociales de la technologie sont considérables: elle crée des opportunités, mais elle écarte également des travailleurs, en particulier dans les secteurs à faible niveau de compétences en Asie. Si les avantages sont concentrés entre les mains d'une minorité, le mécontentement social pourrait affaiblir le soutien à la mondialisation.
Khanna constate : « À chaque moment de l'histoire, une partie du monde atteint son apogée. En ce moment, c'est l'Asie. » Cela est en partie vrai, mais l'avenir de la mondialisation est incertain. Le succès de l'Asie dépend de la résolution des défis technologiques, écologiques et sociaux. La prochaine étape de la mondialisation sera une lutte pour trouver un équilibre entre la concurrence technologique, l'environnement et l'équité.
20:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : parag khanna, actualité, asie, affaires asiatiques, mondialisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Paléotrumpisme et néotrumpisme

Paléotrumpisme et néotrumpisme
Daniele Perra
Après la trahison substantielle des revendications antisystème lors de la première expérience trumpiste (l’administration du magnat new-yorkais a agi dans une continuité quasi totale avec celle de ses prédécesseurs sur le plan géopolitique et, sur certains aspects, a même préparé le terrain pour son successeur), la machine de propagande s’est vue obligée de doter le message du candidat républicain d’une nouvelle « virginité ». Cette fois, libéré de l’inspiration pseudo-religieuse « à la QAnon » (une opération psychologique au succès indéniable, vu l’influence qu’elle a eue aussi sur de larges secteurs de la droite et une partie de la gauche européenne), le message trumpiste semble s’orienter vers des voies bien plus pragmatiques, visant une forme de techno-mercantilisme postmoderne qui fascine (et pas qu’un peu) les courants prométhéens de la droite occidentale, ainsi que certains représentants de l’ultra-capitalisme mondialisé.
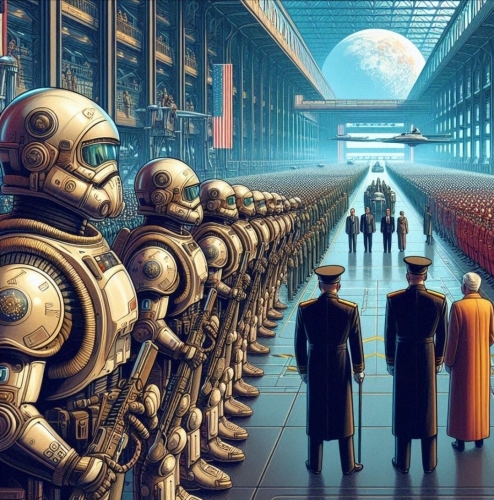
Dans un article publié sur son site graymirror.substack.com, sous le titre emblématique Gaza and the laws of war, l’ancien programmeur informatique de la Silicon Valley (et aujourd’hui activiste politico-idéologique) Curtis Yarvin défend la nécessité de laisser à Israël toute liberté d’agir (comme bon lui semble) dans la bande qu'est le territoire palestinien. À l’IDF devraient être attribués les mêmes pouvoirs dont bénéficiaient les Britanniques sur le mandat de Palestine (y compris celui de déplacer massivement une partie de la population). Selon lui, ce serait la seule manière de mettre fin, en un temps relativement court, à un conflit qui pèse directement sur les épaules des contribuables américains [1].
Au final, le prix que paierait le peuple palestinien ne serait que celui de quelques « transferts de propriété » aux nouveaux colons sionistes. Ainsi, la « Nouvelle Gaza », construite par l’homme d’affaires judéo-américain Jared Kushner (gendre de Donald J. Trump), deviendrait une sorte de « Los Angeles de la Méditerranée »: « une ville qui vaudrait six mille milliards de dollars » et qui rendrait millionnaires les Palestiniens eux-mêmes (sic !). En effet, tous ceux qui accepteraient volontairement d’abandonner leurs maisons en front de mer (une « zone côtière très précieuse », selon Kushner) seraient récompensés et pourraient enfin s’installer massivement à Dubaï [2].

À cette fin, Yarvin (photo) ne se limite pas à interpréter le conflit en termes purement monétaires, en termes de flux de capitaux avant tout (ce qui, d’ailleurs, n’a rien d’original de la part d’un « penseur » américain), mais il s’aventure également dans des questions relatives à la tactique militaire, exprimant son enthousiasme pour la soi-disant « doctrine Dahiya » de l’armée israélienne. Cette doctrine, élaborée par le général Gadi Eisenkot (photo) au début des années 2000, prévoit la destruction systématique de toutes les infrastructures civiles (écoles, hôpitaux, centres de loisirs, etc.) qui pourraient de quelque manière être liées aux groupes de Résistance (Hamas et Hezbollah en premier lieu).


Cette « doctrine » fut utilisée, avec peu de succès à vrai dire, lors de la « guerre des 33 jours » au Liban en 2006. Ciblant directement les infrastructures civiles, l’objectif serait de mettre la pression sur l’ennemi et de pousser les civils survivants à fuir afin de pouvoir, ensuite, attaquer la même cible (et les militaires à proximité) avec plus de force. La « doctrine Dahiya » est donc intrinsèquement liée à l’idée de « recours disproportionné à la force » sur laquelle repose une grande partie de la stratégie militaire sioniste actuelle.
Les idées de Yarvin font écho à celles présentées par J. D. Vance (le sénateur de l’Ohio choisi par Donald J. Trump comme vice-président dans la course à son second mandat présidentiel). En effet, Vance a déclaré en juillet dernier qu’Israël devrait mettre rapidement fin au conflit dans la bande de Gaza afin de pouvoir se concentrer (avec les monarchies sunnites participantes aux « Accords d’Abraham ») sur la menace iranienne [3].

À ce sujet, il est intéressant de noter que parmi les principales références idéologiques de Vance figure le journaliste Sohrab Ahmari (photo - ancien rédacteur du Wall Street Journal). Fils d’Iraniens sécularisés et anti-khomeynistes, il a émigré aux États-Unis alors qu’il était adolescent et, après avoir d’abord adhéré à certains groupes trotskystes, a fini par passer dans le camp néoconservateur (Après tout, il s’agit du même parcours suivi par le père idéologique du néoconservatisme, l’Américain Irving Kristol, de confession israélite, qui, à partir de positions trotskystes défendues en 1960, a commencé à élaborer les thèses néoconservatrices dans certaines revues liées à la communauté juive nord-américaine). Ahmari, après avoir voté pour Hillary Clinton en 2016, a opté pour un changement de cap décisif, voyant en Donald J. Trump la seule chance de sauvegarder l’hégémonie mondiale américaine [4].
Il n’est donc pas surprenant qu’une autre référence idéologique de J. D. Vance soit Patrick Deneen, qui a théorisé un « ordre mondial américain post-libéral »: c’est-à-dire un ordre qui ne dépasse pas l’hégémonie mondiale des États-Unis (Donald J. Trump lui-même a défendu la nécessité d’imposer des droits de douane élevés — comme de véritables armes — à ceux qui n’utilisent pas le dollar comme monnaie de référence pour le commerce international) [5], mais qui la réajuste simplement selon de nouveaux axes.
Il semble que Yarvin ait eu une influence notable sur la « vision du monde » particulière de Vance. Sa « pensée » mérite donc une brève analyse. Descendant d’une famille de communistes juifs (du côté paternel), Yarvin aime, par suite, se définir comme « communiste juif » [6], bien qu’il soit considéré à juste titre comme le père théorique des courants néoréactionnaires et des soi-disant « Lumières noires » (dark enlightenment). Au centre de la pensée de Yarvin se trouve le concept de « monarchie profonde » (deep monarchy), qui s’oppose directement à celui d’« État profond » (le fameux « deep State »).
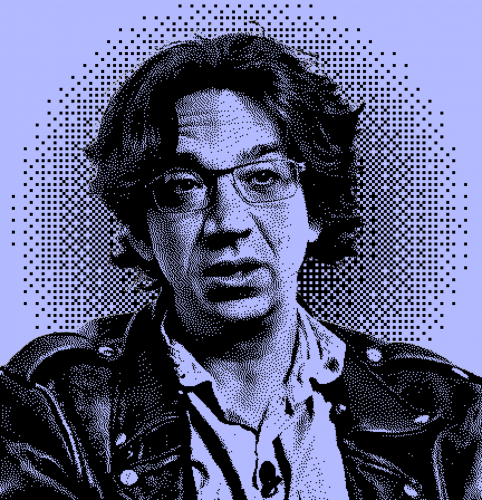
Selon l’ancien programmeur informatique, la démocratie libérale actuelle n’a plus de sens, puisqu’elle s’est transformée de fait en une forme d’oligarchie (et jusque-là, il est difficile de lui donner tort). À son avis, ce modèle devrait être dépassé d’abord par une forme d’administration dirigée par un « directeur général » (un « CEO », Yarvin utilise toujours des termes « entrepreneuriaux ») qui jouerait effectivement le rôle de « dictateur » et qui ferait table rase des vestiges de « l’État profond » (ce devrait être la tâche de Donald J. Trump, personnalité dotée d’indéniables capacités entrepreneuriales). Ensuite, le « dictateur-CEO » devrait quitter ses fonctions ou assumer lui-même le rôle de monarque et donner naissance à une monarchie postmoderne (sans désignation divine) qui se comporterait comme une « entreprise dotée de souveraineté », basée sur une sorte de « camaraderie techno-entrepreneuriale » et destinée à maximiser les profits et ses propres ressources.
Il convient ici de souligner quelques points. Tout d’abord, le succès de la pensée de Yarvin auprès de la droite occidentale (et/ou « occidentalisée ») est en partie aussi le fruit d’une inévitable erreur de traduction qui conduit de nombreux « non-initiés » à associer le terme anglais « corporations » au corporatisme d’inspiration médiévale européenne ou, même, au fascisme.
En réalité, Yarvin, selon ses propres dires, l’utilise simplement au sens de société/entreprise. Et il n’a aucun problème à se définir comme un « austro-mercantiliste » disciple de Ludwig von Mises (lié donc aux prémisses théoriques de cette école autrichienne qui, avec son individualisme méthodologique — aux côtés du contractualisme, du scepticisme et de l’utilitarisme — représente l’un des quatre courants théoriques du libéralisme économique).
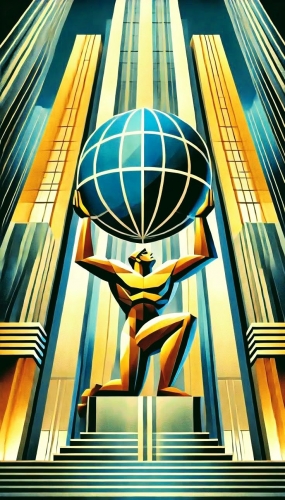
Il en découle que son « projet monarchique », auquel il rattache l’idée d’« illuminisme noir », vise en fait seulement à donner une structure autocratique au dit libéralisme économique : une sorte de « capitalisme absolu » garanti par le « souverain entrepreneurial ». Deuxièmement, sa vision monarchique-sociétale-financière, bien que dépourvue d’inspiration religieuse, ne semble pas du tout différente du messianique qu'implique la vision d'un « Royaume d’Israël », un royaume que la doctrine rabbinique elle-même veut purement terrestre. Ce n’est pas un hasard si Yarvin, tout en déclarant ne pas croire en Dieu, mais seulement en la physique (on retrouve ici une idée que Carl Schmitt avait associée tant au libéralisme qu’au marxisme-léninisme : réduire le gouvernement à une forme de science exacte, confiée à des spécialistes sélectionnés de façon scientifique), s’identifie aux préceptes de l’orthodoxie juive qui imposent « d’écouter et d’agir ». En elle, en effet, le point central n’est pas de croire en Dieu, ce n’est pas la foi, mais simplement l’exécution des actions requises (même si elles impliquent l’extermination de personnes sans défense).
Troisièmement, il devrait s'avérer assez difficile d’associer les concepts de l’individualisme méthodologique de l’école autrichienne à des formes de « camaraderie » (même exprimées en termes entrepreneuriaux), de corporatisme ou de collectivisme, même si Yarvin estime que « maximiser les profits et les ressources » de la « monarchie/société » équivaut à garantir le « bien commun ».
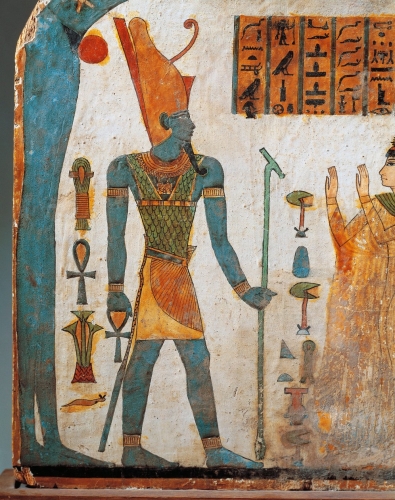
Enfin, il est nécessaire d’ouvrir une brève parenthèse sur le concept de « Lumières noires », qui rappelle, d’une certaine manière, l’idée du « Soleil Noir » des SS himmlériens, bien que totalement dépourvue de son message spirituel. À la théorie astronomique du Soleil Noir (c’est-à-dire l’existence d’une étoile effondrée de couleur rouge-brun et de petite taille qui perturbe occasionnellement le système solaire), on a attribué dans certains milieux allemands une signification mystique-ésotérique qui la reliait à la présence/absence d’un Dieu caché, déchu et détrôné. On peut trouver des exemples similaires dans diverses civilisations traditionnelles: l’Atoum égyptien, père des dieux de l’Ancien Empire, qui devint le soleil du monde souterrain suite à l’arrivée de Rê (le « soleil de midi »); le titan Cronos/Saturne, détrôné par son fils Zeus/Jupiter; Apollon, qu’Otto Rahn, chercheur SS, associait à l’Apollyon de l’Apocalypse de saint Jean et donc à Lucifer (l’ange déchu, le prince des ténèbres) [7].
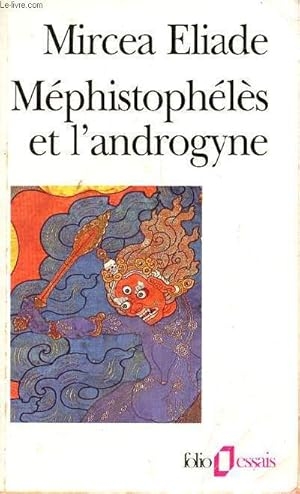
Mircea Eliade avait déjà souligné l’existence, dans les civilisations traditionnelles d’Eurasie, d’une grande variété de mythes, rites et symboles impliquant plus ou moins clairement la coincidentia oppositorum, la présence de deux divinités opposées ou, même, la parenté entre le Dieu suprême et son rival (le Diable). Souvent, ils étaient présentés comme coéternels, tandis que dans d’autres cas, Dieu semblait incapable d’achever la création sans l’aide du Diable [8].
En ce sens, le luciférisme doit être compris comme une sorte de sentiment de vengeance émanant d’un Dieu détrôné; un renversement des valeurs religieuses traditionnelles au nom du retour au mythe originel. C’est la revanche du titanisme sur les dieux olympiens; la revanche de l’ange déchu sur le Dieu suprême. Ce n’est pas un hasard si l’idéologue du mouvement Azov ukrainien, Olena Semenyaka (un mouvement idéologique et militaire qui, bien qu’il soit un « idiot utile » de l’atlantisme, se réfère symboliquement de diverses manières à l’expérience des SS), s’appuyant sur une interprétation inadéquate de la pensée nietzschéenne, a souvent parlé de la « volonté de puissance luciférienne » comme « sentiment métaphysique de liberté absolue » et comme instrument idéologique d’opposition aux modèles de valeurs dominants dans les sociétés occidentales actuelles.

Le problème fondamental de telles constructions idéologiques réside dans le fait qu’elles ne comprennent pas que le « luciférisme élitiste » peut difficilement vaincre une construction sociale qui est déjà « luciférienne » dans ses fondements mêmes. En d’autres termes, il s’agit d’une simple contradiction dans les termes.
En effet, pour paraphraser à nouveau Schmitt, la modernité elle-même s’est construite autour d’un « changement de paradigme »: la domination centrale de la société prémoderne (la religion) a été remplacée par une domination périphérique, celle de la technique, qui est rapidement devenue religion. Une religion construite sur la prémisse que tous les problèmes seront résolus par la technique et le progrès infini. Il semble donc, pour le moins, difficile d’espérer une nouvelle affirmation du titanisme alors qu’en réalité, nous y sommes déjà plongés.
En ce sens, Yarvin a le « mérite » de ne pas recourir au mythe. Il sait parfaitement que le Dieu de la Modernité relève des Lumières dans leur version qui est le courant techno-scientifique. Il ne s’y oppose pas par « une inversion de ses valeurs », mais simplement par une accélération absolutiste. Sa pensée, par conséquent, se définit (à raison ?) comme « néoréactionnaire », dans la mesure où elle n’est en rien réactionnaire, mais très « progressiste » ; tout comme les « néofascistes » ou « néonazis » actuels ne sont en rien ni « fascistes » ni « nazis ».

La « monarchie profonde » de Yarvin, comme nous l'avons déjà mentionné, se résume simplement à l’affirmation utopique d’un « Nouveau Royaume d’Israël » ultramécanisé et fondé sur la domination des plus avancés technologiquement sur les autres. Encore une fois, rien de particulièrement original dans une pensée américaine.
On a dit qu’il n’est pas réactionnaire, mais absolument « progressiste », aussi parce que Yarvin s’est déclaré favorable au droit des personnes de même sexe de se marier. Parmi les financiers de sa start-up informatique Tlon figure Peter Thiel, célèbre investisseur américain du secteur, chrétien évangélique convaincu mais homosexuel assumé, ainsi que membre actif du Groupe Bilderberg, avant-garde atlantiste fondée par la CIA et le MI6.

Yarvin aurait déclaré à une autre personnalité liée à la soi-disant « droite alternative », l’activiste Milo Yiannopoulos (photo - également ouvertement homosexuel, déjà connu pour avoir affirmé que les aventures amoureuses entre adolescents et adultes peuvent être une expérience mutuellement bénéfique) [9], que Thiel, défenseur de la libération de la technologie des contraintes bureaucratiques et gouvernementales qui la musèlent, aurait été son disciple. Inutile de préciser que Thiel fut le principal financier de la campagne électorale de J. D. Vance en 2022.
À ce stade, il ne reste plus qu’à examiner le domaine purement géopolitique. Dans ce champ, Yarvin suggère plus qu’il n’affirme. On n’y retrouve pas les références du trumpisme bannonien originel au « choc des civilisations », au danger que représentent pour l’hégémonie américaine l’alliance islamo-confucéenne et l’unification de l’espace allant de l’Europe centrale et orientale à la Chine. Cependant, son interprétation du conflit en Ukraine est assez intéressante. Il le définit comme un « conflit cinétique », au sens où son issue finale dépend exclusivement de l’action humaine et peut donc se terminer de manières diamétralement opposées [10]. Or, Yarvin soutient que le résultat de ce conflit déterminera l’avenir des États-Unis: soit ils persisteront sur leur trajectoire descendante (où le nationalisme libéral-démocratique les a conduits), soit ils se transformeront en «TurboAmerica»: une puissance capable de guider le monde selon de nouveaux principes.
C’est ici qu’entrent en jeu les soi-disant « isolationnistes » classiques d’un certain trumpisme. Selon Yarvin, les États-Unis devraient se comporter avec l’Europe de la même manière que la Grande-Bretagne s’est comportée avec l’Amérique dans les premières décennies du 19ème siècle. À son avis, les Britanniques furent les véritables promoteurs de la soi-disant « doctrine Monroe ». Celle-ci était totalement fonctionnelle aux intérêts de Sa Majesté, car, à un moment où Londres jouissait encore d’une hégémonie thalassocratique absolue, elle sanctionnait l’impossibilité pour la Couronne d’Espagne de récupérer son « empire ». De même, une solution adéquate du conflit en Ukraine (au sens de faire porter les coûts à l’Europe, tout en s’assurant que Poutine ne puisse pas nuire aux intérêts des États-Unis) pourrait garantir aux États-Unis un autre siècle (si ce n’est plus) de domination mondiale sans rival.
Notes :
[1] Voir Gaza and the laws of war, 3 abril 2024, www.graymirror.substrack.com .
[2] Ibidem.
[3] Voir Vance: Israel should finish war as quickly as possible, partner sunni states against Iran, 16 julio 2024, www.timesofisrael.com .
[4] Voir The seven thinkers and groups that have shaped JD Vance’s unusual worldview, 18 luglio 2024, www.politico.com .
[5] Voir Trump wants huge tariff for dollar defectors, fewer US sanctions, 13 settembre 2024, www.bloomberg.com .
[6] Voir Interview with Curtis Yarvin, 15 noviembre 2023, www.maxraskin.com
[7] M. Zagni, La svastica e la runa. Cultura ed esoterismo nella SS Ahnenerbe, Mursia, Milano 2011, p. 385.
[8] M. Eliade, Mefistofele e l’Androgine, Roma 1971, p. 77.
[9] Voir Yiannopoulos quits Breitbart, apologies for uproar year-old comment, 21 febrero 2017, www.nbcnews.com .
[10] Voir Ukraine, the tomb of liberal nationalism, 15 febrero 2024, www.graymirror.substrack.com .
Source: https://www.eurasia-rivista.com/paleotrumpismo-e-neotrump...
16:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, trumpisme, états-unis, curtis yarvin |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Etats-Unis en phase terminale: l'autodestruction annoncée

Les Etats-Unis en phase terminale: l'autodestruction annoncée
Nicolas Maxime
Source: https://www.facebook.com/nico.naf.735
S’il existe aujourd’hui un pays qui illustre jusqu’à la caricature ce que l’on pourrait appeler la phase terminale de l’Occident, ce sont bien les États-Unis. À l’image de instrumentalisation politique des événements récents — le meurtre tragique d’Iryna Zarutska, ou l’assassinat du conservateur chrétien Charlie Kirk — et de la polarisation qui s'en suit entre deux camps irréconciliables, tout semble concourir, jour après jour, à l’effondrement de la première puissance mondiale qui ne parvient désormais plus qu’à mettre en scène ses propres convulsions.
Dans le meurtre d’Iryna Zarutksa, le profil de l’assassin, un afro-américain atteint de schizophrénie, illustre la faillite d’un système de santé qui laisse des centaines de milliers de sans-abri sans soins, livrés aux opiacés et à la violence de la rue. Les États-Unis sont le pays le plus riche du monde, mais tolèrent l’exclusion et l’effondrement de pans entiers de leur population, au risque de laisser des malades psychiques devenir des dangers potentiels pour les autres.
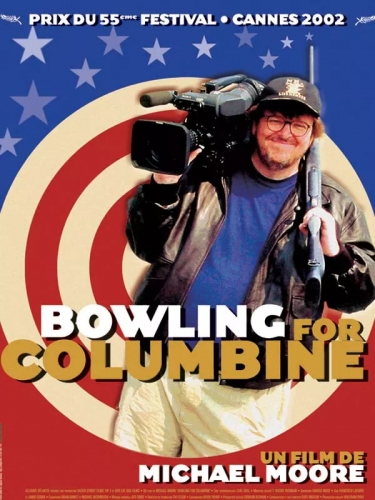
Quant au tueur de Charlie Kirk, Tyler Robinson, il en serait le miroir inversé. Issu d'une famille blanche mormone, ce jeune homme de 22 ans a été décrit comme le gendre idéal. Sa trajectoire illustre l’effondrement social et moral d'un pays où l’isolement collectif et la perte de repères vont faire basculer des jeunes dans une violence meurtrière. De Bowling for Columbine jusqu'à la tuerie, récemment, dans une école dans le Minnesota, il ne passe pas une année sans qu'il y ait une tuerie de masse aux États-Unis impliquant des jeunes, parfois encore adolescents.
Sans plus tarder, la droite trumpiste a récupéré ces meurtres pour en faire la preuve d’un complot de la gauche contre l’Amérique blanche et chrétienne, tandis que certains militants progressistes ont jubilé à l'annonce de la mort de Charlie Kirk. Le débat n'est plus possible lorsqu'on instrumentalise les cadavres pour des raisons idéologiques.

Dans Civil War, Alex Garland imagine une guerre civile aux États-Unis dans un futur proche où la haine et les règlements de comptes finissent par balayer le processus de civilisation décrit par Norbert Elias. Ceux qui ont vu le film se rappellent de cette scène effroyable où le milicien pose la question, « quel type d’Américain es-tu ? » avant de passer à l'acte. La réalité est peut-être en train de rattraper la fiction car ce qu’il montrait — une Amérique incapable de surmonter sa polarisation, où chaque camp vit dans le fantasme de l’élimination de l’autre — est en train de se réaliser sous nos yeux.
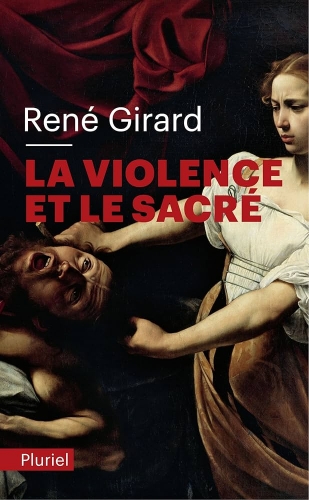
Pour le comprendre, il faut convoquer le philosophe René Girard qui avait compris ce mécanisme dans La violence et le sacré. Il l'illustre par le désir mimétique selon lequel on désire toujours ce que l'autre désire, ce qui mène à la violence. Cela engendre une crise sacrificielle lorsqu'il y a un conflit généralisé. Pour sauvegarder sa cohésion, la société concentre sa haine sur une victime unique, le bouc émissaire, accusé d’incarner tous les maux. Dans le cas américain, chaque camp érige son adversaire en ennemi absolu. Le meurtre de Charlie Kirk devient pour la droite trumpiste la preuve que la gauche est prête à tout pour détruire l’Amérique blanche et chrétienne. À l’inverse, une partie de la gauche voit dans la mort de Kirk celle d'un ennemi des idées progressistes. Au lieu d’apaiser la société, ce drame est devenu le support sacrificiel d’une haine sans issue où chaque camp est persuadé d'être l'ennemi du mal.
Complètement livrée au nihilisme et à ses démons intérieurs : misère sociale, drogue, violences, perte de repères … qu'elle n'a pas su et pu résoudre en devenant le pays de l'argent Roi, le pourrissement des États-Unis est tel que le pays est en voie d’auto-destruction annoncée. Pour l’instant, ce ne sont que des incendies épars, des étincelles violentes qui s’allument ici ou là. Mais viendra le jour où l’embrasement, et l'affrontement violent entre les deux camps sera définitif.
La question n’est plus de savoir si l’Amérique implosera, mais quand.
16:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : états-unis, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sur les manifestations de Londres - Le peuple anglais en ébullition

Sur les manifestations de Londres
Le peuple anglais en ébullition
Alexander Douguine
Alexander Douguine déclare que le cortège d’un million de personnes à Londres marque l’aube d’une véritable révolution conservatrice contre Starmer et le globalisme.
Une véritable révolution conservatrice a commencé à Londres. Plus d’un million d’Anglais sont descendus dans les rues pour protester contre la politique de Starmer, contre la répression de toute manifestation de patriotisme et de ses symboles, contre l’impunité accordée à des bandes d’immigrés qui ont transformé l’Angleterre en un immense dépotoir où l’on ne propose qu’une seule chose aux Anglais eux-mêmes: disparaître aussi vite que possible. Les élites libérales de l’Angleterre sont allées beaucoup trop loin en favorisant l’immigration illimitée et en imposant l’interdiction des drapeaux avec la croix de Saint-Georges, en privilégiant systématiquement les nouveaux venus et les défenseurs de diverses minorités.


Eva Vlaardingerbroek (Pays-Bas) et Ada Lluch (Espagne) à Londres.
L’Angleterre s’est soulevée contre les mondialistes, tout comme l’Amérique l’a fait il y a un an.
Les manifestants exigent la démission immédiate de Starmer, l’expulsion des bandes pakistanaises incontrôlées, l’interdiction de toute expression LGBTQ et le retour du droit des Britanniques à être maîtres chez eux.
Le meurtre de Charlie Kirk aux États-Unis par un libéral de gauche, partisan des mouvements LGBTQ et furry, a attisé encore plus la colère populaire.
Si de telles manifestations sont courantes en France, la population locale en Angleterre est beaucoup plus réservée et respectueuse des lois. Pour faire descendre un million d’Anglais somnambules dans la rue, il faut vraiment les avoir poussé à bout. Et c'est ce que Starmer a fait.
15:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, londres, angleterre, royaume-uni, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 septembre 2025
Sur le rapprochement irano-arabe - Les actions d'Israël rapprochent les Arabes des Iraniens

Sur le rapprochement irano-arabe
Les actions d'Israël rapprochent les Arabes des Iraniens
Alexander Douguine
Alexander Douguine soutient que les actions de Trump et d’Israël accélèrent la formation d’alliances anti-occidentales et rapprochent les Arabes des Iraniens.
Trump a réussi à rapprocher l’Inde et la Chine, et maintenant il rapproche également les Iraniens et les Arabes. J’ai remarqué que Trump contribue à la construction d’un monde multipolaire, non pas directement (en l’admettant), mais de manière opposée — en prenant sporadiquement des décisions politiques abruptes qui accélèrent la création d’alliances anti-occidentales aux niveaux régional et mondial, et les renforcent.
La réaction vague de Trump aux frappes israéliennes contre le Qatar a provoqué une vague de perplexité parmi les États arabes. Ils étaient prêts à s’approcher davantage d’Israël, trahissant les forces de la Résistance et l’Iran, mais subir en plus des frappes de missiles était le coup de trop.
Si les Israéliens avaient tué la direction du Hamas, cela aurait pu être en quelque sorte acceptable. Mais quelqu’un a averti le Hamas à la dernière minute (on dit que ce sont les Turcs), et seuls les Qataris ont souffert de la frappe. Quelques-uns, seulement six personnes, mais pourquoi y en a-t-il eu tout court ? Quel genre de « tir ami » sous forme d’attaques de missiles contre des alliés est-ce là ? Trump n’avait rien à dire sur le sujet, et Netanyahou ne parle tout simplement à personne s’il n’en a pas envie. Ceci est désormais évident pour tout le monde.
Il est trop tôt pour dire que les positions des Iraniens et des monarchies du Golfe convergent (ce n’est pas encore le cas), mais la proposition de l’Iran d’installer sa défense antimissile à la place de l’américaine tombe à point nommé. Les monarchies du Golfe et d’autres États arabes de la région sont devenus les otages de la politique d’Israël, qui les ignore complètement et se comporte comme le maître absolu du Moyen-Orient, entouré de vassaux et d’esclaves. Un rôle désagréable pour des élites arabes pragmatiques et prêtes au compromis, mais néanmoins fières.
19:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, moyen-orient, iran, émirats arabes unis, qatar |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La violence politique dans l'Ouest sauvage – Comment l'affaiblissement de l'hégémonie engendre un État sécuritaire
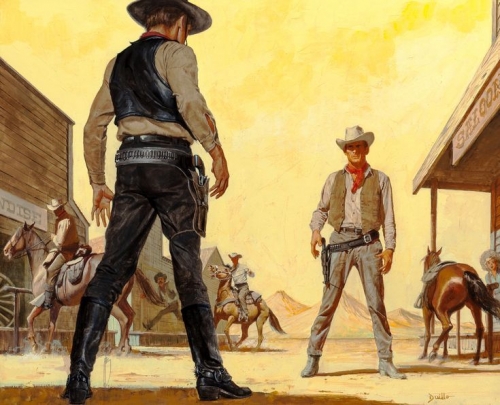
La violence politique dans l'Ouest sauvage – Comment l'affaiblissement de l'hégémonie engendre un État sécuritaire
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/09/11/villin-lannen-poliitti...
Le déclin de l'hégémonie occidentale se manifeste par une érosion systématique des structures éthiques et juridiques. Les principes et accords internationaux traditionnels s'effritent sous la pression des ambitions stratégiques et du pragmatisme politique. Ce processus suit un modèle historique que les critiques culturels ont décrit comme la phase finale du cycle de vie d'une civilisation.
La récente attaque israélienne contre les dirigeants du mouvement de résistance Hamas à Doha, au Qatar, illustre bien cette escalade. Les participants, qui avaient été amenés à négocier par l'intermédiaire des États-Unis, ont été pris pour cible. Cet acte a non seulement fait échouer une nouvelle fois le processus de paix, mais il a également révélé le rôle critiquable de l'administration Trump en tant que partie contribuant à éroder la confiance diplomatique.

Cette dégradation du pouvoir engendre des conflits internes qui affaiblissent le principe de l'État de droit et normalisent l'agressivité politique. La dynamique interne des États-Unis illustre clairement ce phénomène: les actes de violence ciblés contre des politiciens et des militants, tels que l'assassinat par balles de Charlie Kirk, figure influente du conservatisme, dans l'Utah, ne sont pas de simples incidents isolés ou des effets secondaires de la polarisation. Ils reflètent un cynisme institutionnel plus profond, dans lequel l'agression sert le programme des détenteurs du pouvoir et affaiblit délibérément les mécanismes démocratiques.
La flexibilité éthique, qui subordonne la justice à des objectifs tactiques, s'inscrit dans un cycle historique plus large. Lorsque les empires s'affaiblissent, les piliers juridiques s'effondrent et la logique politique est remplacée par un recours brutal à la force, justifié par des arguments de « sécurité » ou de « nécessité ». Cela soulève des inquiétudes légitimes quant à la crédibilité des accords internationaux.

Le sort d'Iryna Zarutska à Charlotte, en Caroline du Nord, souligne également cette contradiction: cette Ukrainienne de 23 ans a fui la guerre pour se réfugier dans l'Amérique qu'elle idolâtrait, avant d'être poignardée à mort dans un tramway sous les yeux indifférents des autres passagers. Cet incident révèle à quel point le discours occidental sur l'inclusion est en train de s'effriter: les criminels violents rejettent le principe de diversité, la haine ethnique reste une menace concrète et le système est incapable de protéger les personnes vulnérables.

Le déséquilibre géopolitique se reflète également dans la vie quotidienne, où les tensions ethniques et culturelles s'intensifient dans l'ombre des conflits. Cela crée un paradoxe: au nom de la sécurité, des moyens autoritaires sont encouragés, tels que la surveillance préventive basée sur des algorithmes et la militarisation des forces de police. Ces mesures érodent les valeurs démocratiques et jettent les bases de la montée des États sécuritaires, qui profitent avant tout à l'élite au pouvoir. Lorsque les rues des villes deviennent suffisamment dangereuses, les citoyens en viennent même à exiger des mesures autoritaires de la part de leurs dirigeants.
L'agressivité politique finit par s'imposer comme un outil calculé permettant de renforcer la position dominante et de rejeter les véritables réformes. Le relativisme éthique justifie une surveillance étendue et des mesures préventives, transformant une bureaucratie inefficace en une administration technocratique. L'ordre mondial actuel semble être dans une impasse, où les confrontations répétées et l'exploitation instrumentale des valeurs alimentent une spirale destructrice.
Le défi central pour l'avenir est de briser ce cercle vicieux. La communauté internationale a-t-elle la capacité de créer un ordre mondial plus crédible pour remplacer l'ancien modèle occidental ? Les options sont claires: soit on mise sur une diplomatie préventive structurelle et des sanctions ciblées, soit on cède à la politique de la peur et on se livre aux chaînes du contrôle technologique, ce qui peut temporairement freiner le chaos, mais finit par créer une planète enfermée dans un prison dystopique.

15:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Chine: un Etat-Civilisation et ses objectifs stratégiques

Chine: un Etat-Civilisation et ses objectifs stratégiques
Juan Bautista González Saborido
Source: https://dolarbaratomag.com/1624/china-estado-civilizacional-y-objetivos-estrategicos/
L'ascension de la Chine est peut-être le fait le plus marquant en matière de géopolitique depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Il ne fait aucun doute que la Chine n'est plus une puissance émergente et qu'elle s'est transformée en ce que l'on peut appeler un « État civilisationnel », dont l'ambition est de retrouver une place centrale dans le monde dans les années à venir et qui, pour cela, est prêt à disputer l'hégémonie aux États-Unis afin d'atteindre ses objectifs.
L'ascension géopolitique de la Chine démontre pour nombre de ses idéologues que sa grande force, son caractère unique, réside dans le fait qu'il s'agit d'un « État-civilisation », un concept qui est plus pertinent que jamais maintenant que Pékin tente de recomposer l'ordre géopolitique autour de ses valeurs civilisationnelles pour les opposer à celles d'un Occident qu'il considère en déclin.
Dans ce contexte, une série d'intellectuels proches de Xi Jinping (Yuan Peng, Wang Honggang, Yu Yongding et Chu Shulong, parmi les plus importants) se sont donné pour mission d'apporter des idées au Parti, en synthétisant des notions de la pensée classique chinoise, des concepts des époques socialiste et réformiste, et des lignes directrices adoptées depuis l'intégration de la Chine dans le monde.
Nous tenterons de résumer certains de ces concepts, car les connaître et les comprendre permettrait de mieux saisir la pensée des élites intellectuelles chinoises et, éventuellement, ce que pense le leadership à Pékin lorsqu'il s'agit de décider et de déterminer les objectifs stratégiques de la Chine.
Contexte de changement et de turbulences
La Chine a mis en place un système étatique moderne sans précédent qui comprend un gouvernement, un marché, une économie, un système éducatif, un système juridique, un système de défense, un système financier et un système fiscal unifiés, qui font peut-être de l'État chinois l'un des plus performants au monde.

Dans ce contexte, il est important de souligner que l'État chinois entretient une relation très différente de celle de l'État occidental avec la société. En effet, il jouit d'une autorité naturelle, d'une légitimité et d'un respect bien plus grands, même si le gouvernement n'accède pas au pouvoir par le vote populaire. Cela s'explique par le fait que les Chinois considèrent l'État comme le gardien, le dépositaire et l'incarnation de leur civilisation.
Ainsi, le processus de modernisation de la Chine présente des caractéristiques propres qu'il convient de souligner. Ces particularités sont au nombre de cinq : a) une population très importante, b) la recherche de la prospérité commune pour tout le peuple, c) la tentative de coordination entre la civilisation matérielle et la civilisation spirituelle, d) la conception d'une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, et e) l'aspiration à un développement pacifique sur la scène internationale.
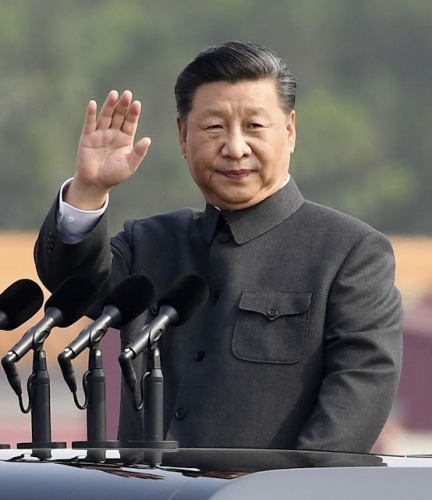
Selon Xi Jinping, le rajeunissement de la Chine (la modernisation de la Chine) est une aspiration commune de tout le peuple depuis le début de l'ère moderne, mais seul le Parti communiste chinois a su trouver les clés nécessaires pour le réaliser, à travers une modernisation socialiste.
Toutefois, les dirigeants chinois doivent continuer à faire avancer les réformes face à la situation internationale et nationale complexe et variée, à la nouvelle vague de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle, et aux nouvelles attentes des masses populaires. À cette fin, à partir de maintenant et pendant un certain temps, ses élites devront s'engager dans une période clé pour promouvoir de manière globale, parallèlement à la modernisation chinoise, la grande cause de la construction d'un pays puissant et de la revitalisation de la nation.
Cela dit, pour l'élite gouvernementale chinoise, le monde est entré dans une période de turbulences et de changements sans précédent depuis un siècle, qui présente des opportunités stratégiques, des risques et des défis, ainsi que des facteurs incertains et imprévisibles pour le développement de la Chine.
En définitive, pour eux, le monde traverse aujourd'hui un changement historique, caractérisé par quatre révolutions: (a) démographique (due à la croissance de la population en Afrique et en Asie), (b) technologique (due au développement d'une quatrième révolution industrielle), (c) climatique (qui entraîne une transition énergétique) et (d) du pouvoir mondial (due au déplacement du pouvoir de l'Occident vers l'Orient). Ces quatre révolutions contextualisent la rivalité entre la Chine et les États-Unis et détermineront le vainqueur.
La Chine réclame la démocratisation des relations internationales et le soutien du Sud global
La Chine aspire à exercer une grande influence sur la conception institutionnelle des organismes internationaux. Face à la conception actuelle des organismes multilatéraux, tels que l'ONU, qui reflète la répartition du pouvoir après la Seconde Guerre mondiale, la Chine réclame systématiquement une réforme. Ainsi, en 2018, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président Xi a déclaré : « Le désir de démocratisation des relations internationales est une tendance mondiale imparable », donnant à cette revendication une importance stratégique.
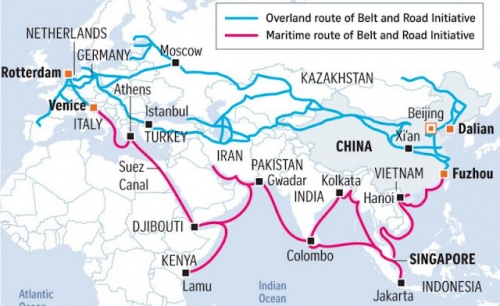
Par conséquent, afin de mettre en œuvre la démocratisation des relations internationales et de gagner le soutien du Sud dans sa course à l'hégémonie, Pékin a lancé une série d'initiatives d'investissement dans des infrastructures à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'initiative « Belt and Road » (la route de la soie), du groupe BRICS Plus et des trois initiatives mondiales : a) l'initiative de développement mondial, b) l'initiative de sécurité mondiale et c) l'initiative de civilisation mondiale.
L'initiative « Belt and Road » est considérée comme le principal outil de la géostratégie chinoise actuelle, ce qui lui confère une importance capitale dans le domaine de la géopolitique chinoise. Ces initiatives internationales s'inscrivent dans une stratégie globale appelée « la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité ».
Ce concept a pris une place importante dans les documents et discours officiels du gouvernement chinois, en lien avec la proposition de configurer de nouvelles relations internationales, une vision de la communauté internationale à partir d'un nouvel humanisme, la récupération de l'esprit de Bandung et la revendication de la coopération Sud-Sud.
Pour de nombreux penseurs chinois proches du Parti, les facteurs culturels exprimés par les notions de « tradition », « valeurs » ou « civilisation » d'une société sont déterminants pour l'élaboration de sa politique, plus que son organisation économique. Ces « questions de civilisation » constituent désormais l'axe principal proposé par Xi pour redéfinir le modèle chinois, puisque le dirigeant chinois a récemment esquissé son « initiative de civilisation mondiale ».

Ce processus, outre la recherche d'une refonte des institutions de gouvernance mondiale, vise également à doter ces institutions des principes et des valeurs qui devraient les régir. Comprendre l'idée de « communauté de destin partagé » nous permet d'interpréter la proposition chinoise pour le nouvel ordre mondial qui se dessine actuellement.
Cette idée se veut une proposition civilisationnelle alternative à celle de l'Occident. Selon eux, cela signifie que le rêve de paix et de prospérité du peuple chinois est intimement lié à celui des autres peuples du monde, de sorte que la réalisation du rêve chinois ne peut se faire sans un environnement international pacifique et un ordre international stable.
Cela implique qu'ils doivent considérer la situation nationale et internationale dans son ensemble, suivre sans dévier la voie du développement pacifique et appliquer sans faillir la stratégie d'ouverture fondée sur le bénéfice mutuel et le principe "gagnant-gagnant", insister sur la conception correcte de la justice et des intérêts, adopter un nouveau concept de sécurité commune, intégrale, coopérative et durable, poursuivre une perspective de développement définie par l'ouverture, l'innovation, l'inclusion et le bénéfice mutuel ; promouvoir des échanges entre les civilisations caractérisés par une harmonie qui n'exclut pas les différences et par l'assimilation sans discrimination de tout ce qui est positif chez l'autre; et configurer un écosystème qui vénère la nature et repose sur le développement écologique, agissant ainsi à tout moment en tant que bâtisseurs de la paix mondiale, contributeurs au développement mondial et défenseurs de l'ordre international.

Politique économique de double circulation
Dans le cadre de la relance du marché intérieur, le Comité permanent du Politburo du PCC a lancé en mai 2020 la politique économique de « double circulation », qui consiste à augmenter la consommation intérieure et les revenus internes, à améliorer la capacité d'innovation du pays et à réduire la dépendance vis-à-vis du marché extérieur, tout en renforçant les liens entre l'économie locale et l'économie extérieure et en approfondissant l'ouverture économique.
En d'autres termes, le grand cycle interne n'est pas un développement fermé, mais une ouverture de meilleure qualité de la demande intérieure, et la Chine est prête à partager son marché avec les meilleures entreprises du monde entier, en particulier celles qui peuvent participer à l'expansion de la demande intérieure chinoise, promouvoir son amélioration et s'associer aux entreprises chinoises pour former un grand nombre de groupements de chaînes industrielles de haute qualité dans le cycle interne.
Par conséquent, le double cycle national et international implique à la fois un flux entre la production, la distribution, la consommation et la circulation des marchandises et un flux optimal d'allocation des ressources. Le « double cycle » est un choix inévitable pour une réforme plus profonde, une plus grande ouverture et un meilleur développement, et la construction des nouvelles routes de la soie reflète profondément cette connotation caractéristique du double cycle.
Les Nouvelles Routes de la Soie visent également à promouvoir la circulation des biens et des facteurs au niveau interne et à concrétiser les « cinq liens » (communication politique, connexion des installations, commerce fluide, intégration des capitaux et contacts entre les personnes) proposés par le secrétaire général du PCC Xi Jinping au niveau externe.


Renforcement des investissements dans la technologie
Un autre point décisif est la décision de renforcer les investissements dans la technologie. Cette décision, en particulier les investissements dans la production de semi-conducteurs de pointe, est une conséquence des mesures prises par les États-Unis pour empêcher ou entraver l'accès des entreprises chinoises à des technologies qu'ils considèrent comme stratégiques. Cependant, l'accent mis par le gouvernement chinois sur le progrès technologique est de longue date.
Une étape importante de cette orientation a été franchie en 2015 avec le plan « Made in China 2025 », qui vise à accroître le niveau d'intégration technologique dans la production et les services, et à passer du « Fabriqué en Chine » au « Développé en Chine ». Ce plan prévoyait le développement technologique et industriel, l'absorption de technologies provenant d'investissements étrangers et l'achat d'entreprises étrangères de haute technologie.
Dans son rapport sur le commerce mondial 2020, l'Organisation mondiale du commerce a souligné que le passage à la numérisation et à l'économie fondée sur la connaissance témoignait de l'importance croissante de l'innovation et de la technologie dans la croissance économique. C'est pourquoi les gouvernements ont mis en œuvre de « nouvelles politiques industrielles » afin d'orienter la production locale vers les nouvelles technologies et de faciliter la modernisation des industries matures ou traditionnelles. De même, dans les économies les plus axées sur l'utilisation des données (BigData) et les plus développées sur le plan technologique, l'idée de la nécessité d'une intervention de l'État, d'une planification stratégique et d'un partenariat public-privé se renforce.

La politique de consolidation et de projection internationale de la Chine s'est traduite par une série de programmes de promotion de l'innovation productive (tels que le plan « Made in China 2025 ») et de substitution des importations de technologies de pointe, comme le montre l'expérience de ces dernières années dans le développement de microprocesseurs de haute technologie (jusqu'à récemment importés des États-Unis).
La stratégie technologique de la Chine vise à consolider son leadership mondial dans les technologies émergentes et à réduire au minimum sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Cette approche se traduit par des investissements publics massifs dans la recherche et le développement, en particulier dans des domaines clés tels que l'IA, l'informatique quantique, la biotechnologie et les énergies vertes. Ces domaines ont été stratégiquement sélectionnés pour surmonter les « goulets d'étranglement technologiques » qui pourraient limiter son autonomie et renforcer son autosuffisance dans des secteurs critiques tels que les semi-conducteurs et la fabrication de pointe.
Le gouvernement chinois a adopté une approche techno-nationaliste centralisée qui contrôle l'innovation technologique et donne la priorité à l'intégration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette approche vise à renforcer la dépendance des autres pays à l'égard des produits et services technologiques chinois, tout en reconfigurant l'initiative « Belt and Road », lancée en 2013, en élargissant sa portée grâce à la « Digital Belt and Road ».

Ce projet renforce son influence technologique sur les marchés émergents du Sud, tels que l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, en promouvant des infrastructures critiques et en exportant des technologies de pointe. Bien qu'ils aient récemment remporté un succès remarquable avec le lancement de l'application d'IA générative DeepSeek, qui concurrence ChatGPT, Gemini, etc. et qui a provoqué un séisme boursier aux États-Unis
La sécurisation de l'IA impulsée par le gouvernement chinois s'inscrit dans le concept de « sécurité nationale intégrale » promu par Xi Jinping, qui englobe seize types de sécurité différents. Cette stratégie se reflète également dans la centralisation de la gestion des données, considérées comme une ressource stratégique nationale.
Depuis la promulgation de la loi sur la cybersécurité en 2017, la Chine a mis en place des réglementations strictes qui privilégient la sécurité plutôt que la croissance économique. La création de l'Administration nationale des données en 2023 renforce ce modèle en favorisant l'autosuffisance technologique et la modernisation économique, même si elle se heurte à des défis importants, tels que la fragmentation régionale et les obstacles à l'innovation. Ces politiques sont motivées à la fois par des préoccupations historiques concernant le retard technologique du pays et par les tensions liées à la concurrence entre les grandes puissances.
Considérer l'IA comme une question de sécurité nationale offre de nombreux avantages. Tout d'abord, cela permet de mobiliser des ressources importantes et de coordonner les efforts entre les secteurs public et privé, garantissant ainsi un leadership public unique et stratégique. En outre, cette perspective favorise la mise en œuvre de politiques de sécurité strictes, essentielles pour faire face à des menaces telles que l'espionnage, le vol d'informations sensibles, la désinformation et les cyberattaques.
Il y a quarante-cinq ans, le gouvernement chinois avait tenté de « se rajeunir » ou de « se moderniser » en s'inspirant de l'Occident, mais à l'ère de Xi Jinping, la priorité est désormais de concevoir des réponses chinoises aux questions de notre temps.
Il est possible que les « réponses chinoises » aux problèmes de notre époque ne soient que de la propagande, mais il est également possible qu'elles cherchent à proposer une alternative civilisationnelle à celle de l'Occident européen. Tout semble indiquer que la Chine opte pour cette deuxième alternative, car elle travaille d'arrache-pied pour se construire une place dans le monde en termes d'idées.

Sans préjudice de la proposition civilisationnelle chinoise, à laquelle nous devons nous préparer en nous appuyant sur notre propre tradition et nos propres valeurs culturelles, la phase actuelle de la Chine repose sur cinq éléments : a) la souveraineté nationale (souveraineté sur tous les territoires revendiqués ou non), b) la place de la Chine en tant que pays important sur la scène mondiale (qu'elle ait ou non un poids en tant que centre de pouvoir), d) le niveau technologique et productif (à la pointe ou non), d) le caractère culturel du pays (s'il s'oriente vers l'occidentalisation ou s'il renforce ses propres racines civilisationnelles) et e) le mode de production (socialiste ou capitaliste).

La Chine serait un pays qui n'a pas encore atteint sa pleine souveraineté (il lui manque Taïwan, la mer de Chine méridionale, etc.), qui est déjà important au niveau mondial (même s'il pourrait l'être davantage), avec un niveau technologique et productif qui se rapproche de plus en plus de la pointe avancée en la matière, avec un caractère culturel sino-centrique issu de l'histoire millénaire de la Chine et avec un mode de production qu'il définit lui-même comme « un socialisme aux caractéristiques chinoises ».
La Chine cherche à gagner en influence et à conquérir l'hégémonie mondiale grâce à une stratégie sophistiquée basée sur la séduction, le commerce et les investissements. Mais pourra-t-elle éviter la confrontation directe dans la lutte pour l'hégémonie ?
D'autre part, sa double stratégie de renforcement de son marché intérieur et de recherche d'une moindre dépendance vis-à-vis de l'étranger sera-t-elle vraiment efficace ? Évitera-t-elle la dépendance vis-à-vis des États-Unis ?
Enfin, dans le domaine culturel et des idées, aura-t-elle la force morale et la qualité de leadership nécessaires pour fonder une pensée propre afin de se construire une place dans le monde sans se laisser entraîner par le consumérisme dépersonnalisant de l'Occident ?

14:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Par amour pour l'homme

Par amour pour l'homme
Tout ce qui suit, bien sûr, appartient à un autre monde. Pour nous, il y a « le chemin à travers la forêt », aussi le troisième ou le quatrième, « sur des sentiers envahis par la végétation », ainsi que les chemins de campagne, exemples d'anarchie, de l'Allemagne secrète, du soldat politique, et de ce type particulier d'homme qui veille pendant les longues nuits et garde la lumière de sa lampe dans l'obscurité du monde, sans espérer voir un jour ceux qui sont nouveaux (et pourtant éternels) et qui, peut-être, apparaîtront à l'aube...
par Karel Veliký
Source: https://deliandiver.org/z-lasky-k-cloveku/
– sur le paracheveur de l'humanisme
Le philosophe français Michel Foucault fait partie des rares penseurs qui ont mis des lunettes à toute une époque, la nôtre. Il a littéralement créé tout l'univers intellectuel d'un certain type d'homme, d'une conscience qui n'existait pas sous une forme aussi complète avant son action. Aujourd'hui, ce mode intellectuel s'est tellement répandu que la plupart de ceux qui regardent le monde à travers ses lunettes n'ont probablement jamais entendu parler de lui... Qui était ce professeur, ce propagateur déterminé de l'HIV spirituel, qui a su transformer la lumière en ténèbres et vice versa ?
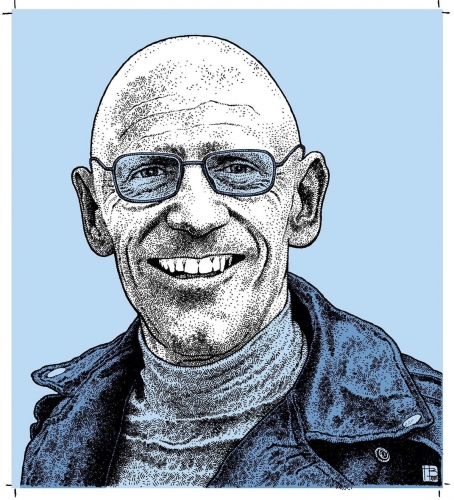
Élevé dans la religion catholique, il fréquenta une école catholique sélective (et donc stricte). Mais il devint homosexuel avec des tendances sadomasochistes. Après cette découverte, il tenta d'abord de se suicider. À plusieurs reprises. Ce n'est qu'ensuite qu'il lança au monde, tel un énième Rastignac : « Maintenant, c'est nous deux ! Qui sera le plus fort ? ».

L'époque s'orientait à gauche. La lecture des livres de Louis Althusser (photo) le convainc tellement qu'il devient membre du Parti communiste. Cependant, il avait déjà examiné auparavant la signification du pouvoir en tant que moteur principal des événements et de l'histoire, probablement chez Nietzsche et Sade. Dans les années 1960, il sympathise d'abord avec la révolution culturelle de Mao, car « pour construire un système social entièrement nouveau sur les fondations de l'ancien système, il faut d'abord nettoyer le terrain ». Cette citation du président Mao semble avoir été le point de départ de Foucault dans les années 1970...
C'est à cette époque que mûrissent les thèses qui vont bouleverser les codes:
- La folie est une maladie essentiellement sociale, et non biologique. Il en déduit alors, par un certain détour, que les fous sont les seuls individus sains dans une société inhumaine, matérialiste et indifférente.
- Les criminels sont également les victimes réelles de cette société inhumaine.
- La promiscuité sexuelle et la perversion peuvent avoir une signification révolutionnaire et subversive.
Aux États-Unis, la théorie des « malades sains » a été prise au sérieux, notamment parce qu'elle correspond parfaitement au principe libertaire « moins d'État, plus de droits civils » (c'est-à-dire la domination contre le salut): ainsi, des milliers de malades mentaux ont été libérés des institutions « pour être mis en liberté », c'est-à-dire « à la rue ». Dans le même temps, les criminels, condamnés ou non, les déviants, ont commencé à jouir de privilèges au détriment de leurs victimes. Ce changement a été si choquant qu'il s'est reflété dans le cinéma commercial de l'époque (L'Inspecteur Harry, Un justicier dans la ville, French Connection, etc.).

Dirty Harry (L'inspecteur Harry)

Death Wish (Un justicier dans la ville)
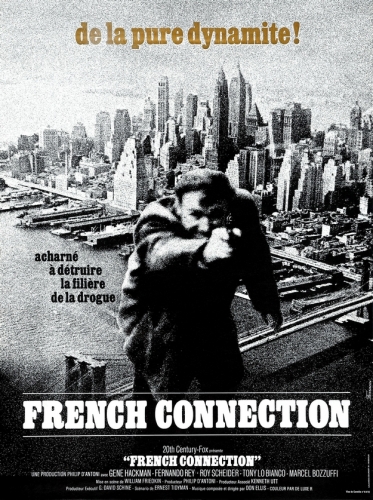
French Connection
Antithèse: la révolte dans un asile, menée de manière caractéristique par un criminel dérangé qui se fait passer pour un fou (Vol au-dessus d'un nid de coucou, 5 Oscars), et Mozart (Amadeus, 8 Oscars) en génie infantile et excentrique victime d'un système répressif. L'émigré Forman a-t-il lu La folie et la civilisation ?
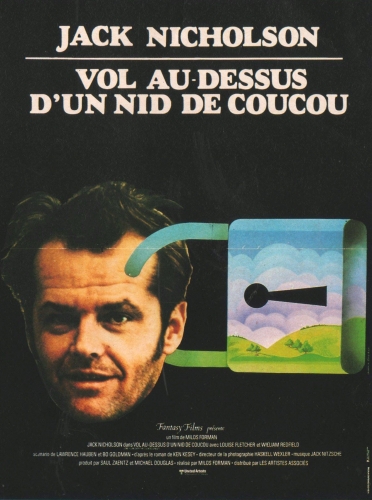
Vol au-dessus d'un nid de coucou
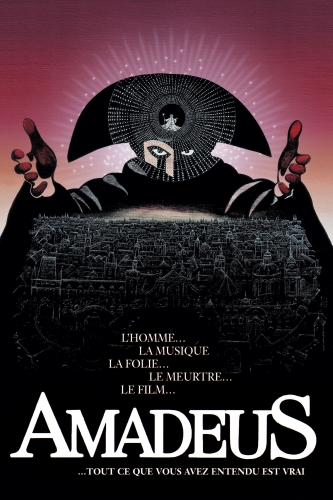
Amadeus

Puis vint le film émouvant de Levinson, Rain Man (4 Oscars) : ils sont toujours « là »...
Mieux vaut devenir fou dans la nature (Glazen Globes) et autres représentations similaires de l'humanité en ruine comme exemples d'une « humanité » noble, c'est aussi un monde, certes, mais ce n'est pas le nôtre.
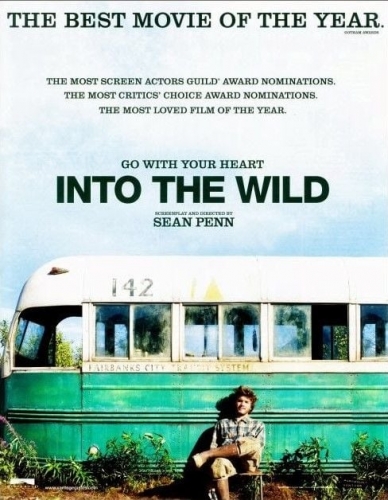
Mieux vaut devenir fou dans la nature
Du stalinisme au maoïsme, puis au libertarianisme, jusqu'à « l'empire du tout est permis ». La Californie, Berkeley, les toilettes pour hommes, les saunas... le paradis. La dernière phase de Foucault est l'héroïsation de la pédérastie: «l'homosexuel se marie avec la mort». Il était lui-même séropositif. Qu'importe que cette cohabitation héroïque avec Madame La Mort résulte de causes et de pulsions qui sont tout sauf héroïques et idéalistes: du point de vue de la subversion, tant mieux ! Il a même eu le temps d'ouvrir la question de l'utilité sociale de la pédophilie, une autre de ces « expériences limites » (Grenzsituation) auxquelles il ne cessait non seulement de faire référence, mais qu'il recherchait également. Contre le « mal » du patriarcat, il oppose une « famille » alternative selon le modèle lesbien-homosexuel...
À la base de la pensée de Foucault se trouve le fait que dans les communautés traditionnelles, les personnes handicapées mentales vivaient librement et étaient souvent considérées avec une sorte de crainte sacrée. Ce n'est qu'avec la mécanisation et la monétarisation de l'ère moderne qu'on a commencé à les enfermer et à les soigner – en raison de leur inutilité pratique.
Georg Friedrich Wilhelm Hegel écrit également dans le paragraphe 408 de son Encyclopédie des sciences philosophiques, que Foucault cite directement, que la folie ouvre des profondeurs qui donnent tout son sens à la liberté humaine. Cependant, alors que le premier pense avant tout à des personnalités exceptionnelles du calibre de Beethoven, le second, ou plutôt son instrumentalisation dans l'esprit de l'idéologie égalitaire « toi aussi » (« tu peux tout faire », U2, d'où « l'empire du tout est permis »), massifie cette expérience limite par excellence et la réduit ainsi nécessairement au niveau du bas-ventre, des orgies sodomites et de la quête pédophile.

La première traduction en tchèque, vestige évident du « lâcher-prise » de la fin des années 1960, est parue dès 1971 (Psychologie a duševní nemoc). Dans les années 1990 ont suivi Dějiny šílenství, Sen a obraznost, Myšlení vnějšku, Diskurs, autor, genealogie. Surveiller et punir clôturait la décennie. À ce jour, plus de quinze titres ont été publiés en tchèque, certains à plusieurs reprises, dont plusieurs chez l'éditeur Herrmann a synové, notamment l'ouvrage en quatre volumes Histoire de la sexualité. À cela s'ajoutent « mille » biographies et études. Ajoutons-y celles de ses contemporains (et les travaux rédigés sur eux) tels que Derrida ou Deleuze, dont la déconstruction, le nomadisme ou la déterritorialisation sont également devenus, par vulgarisation, des mots d'ordre déterminants de l'époque, et l'empreinte de leur influence sur la vie publique locale n'est pas surprenante, puisqu'ils ont façonné la pensée de deux générations.
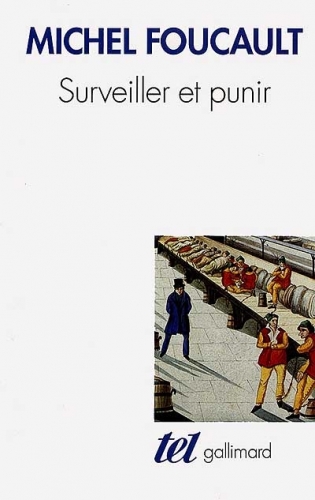
Mais tout cela, c'est le monde des autres. Pour nous, il y a le « chemin à travers la forêt », le troisième ou le quatrième, « sur des sentiers envahis par la végétation », même dans les champs, il y a les exemples d'anarchie positive, de l'Allemagne secrète, du soldat politique, et de ce type particulier d'homme qui veille pendant les longues nuits et garde la lumière de sa lampe dans l'obscurité du monde, sans espérer voir, un jour, ceux qui sont nouveaux (et pourtant éternels) et qui émergeront peut-être à l'aube... L'expérience des monstruosités, des atrocités quotidiennes et des perversités de ce monde autre (médiatique et vécu), qui n'est pas le nôtre, confirme cependant les paroles de Dávila : « Seuls ceux qui propagent secrètement l'admiration pour la beauté conspirent efficacement contre le monde actuel. »
13:32 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, michel foucault |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 septembre 2025
Harald Vilimsky: «L'UE dans un état lamentable – Ursula von der Leyen a conduit l'Europe au bord du gouffre»

Harald Vilimsky: «L'UE dans un état lamentable – Ursula von der Leyen a conduit l'Europe au bord du gouffre»
Cette Commission et sa présidente doivent enfin tirer leur révérence et ouvrir la voie à un avenir radieux pour l'Europe et ses grands États.
Par Harald Vilimsky
Source: https://www.fpoe.eu/vilimsky-eu-in-erbaermlichem-zustand-...
« L'état de l'Union européenne n'a jamais été aussi déplorable. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et ses commissaires ont conduit notre continent et ses grands États au bord du gouffre sur les plans économique, culturel et social », a déclaré aujourd'hui Harald Vilimsky, chef de la délégation du FPÖ au Parlement européen, lors du débat sur la situation de l'UE en séance plénière à Strasbourg.
Pendant la pandémie de coronavirus, l'UE a provoqué une vague gigantesque de dettes avec des confinements et des achats de vaccins des plus discutables. Les citoyens ont été privés de leur liberté, les troubles psychologiques et les problèmes de santé ont considérablement augmenté. Selon M. Vilimsky, l'UE bloque encore aujourd'hui toute enquête sérieuse sur ces thématiques.
Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Union agit comme un fauteur de guerre, a adopté près de 20 paquets de sanctions qui touchent principalement l'Europe elle-même, laquelle se positionne ainsi comme un perdant géopolitique de premier ordre. « La politique menée par l'UE est une honte », a souligné M. Vilimsky.
Sur le plan économique également, l'UE se dirige vers la catastrophe: la politique ratée du Green Deal menace la survie de l'industrie automobile européenne, détruit des centaines de milliers d'emplois et prive de très nombreuses familles de leurs perspectives d'avenir. Dans le même temps, la Commission s'impose comme le contrôleur suprême du numérique, restreint la liberté d'expression et va à l'encontre de tout ce que l'Europe représentait au départ: la paix, la liberté, la sécurité et la prospérité. Au lieu de cela, on assiste à l'émergence néfaste d'un bellicisme, à des crises économiques qui sont auto-infligées, à un terrorisme importé, à de l'antisémitisme et à un climat d'oppression.
« Cette Commission et sa présidente doivent enfin tirer leur révérence et ouvrir ainsi la voie à un avenir meilleur pour l'Europe et ses grands États. Sinon, von der Leyen et ses acolytes entreront dans les livres d'histoire comme les destructeurs de l'Europe. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des personnalités capables de corriger progressivement les graves dérives actuelles. L'Alliance des patriotes est prête à relever ce défi, avec le soutien croissant de la population », a conclu M. Vilimsky.
Qui est Harald Vilimsky?
Chef de délégation FPÖ au Parlement européen | Membre de la commission des affaires étrangères (AFET) | Membre suppléant de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)
17:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : harald vilimsky, actualité, europe, affaires européennes, autriche, fpö |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le chaos règne à Paris

Le chaos règne à Paris
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/il-caos-regna-a-parigi/
Paris est en plein chaos. Il n’y a plus de gouvernement. Bayrou a tenté la carte extrême du vote de confiance à l’Assemblée. Tout en sachant parfaitement qu’il avait bien peu de chances de sauver son gouvernement.
Le verdict a été impitoyable. Plus de trois cents votes contre. Un débâcle sans précédent.
La France n’a donc plus de gouvernement. Un vide qui, bientôt, se fera sentir.
Certes, le système transalpin est strictement présidentiel. Et Macron occupe encore l’Élysée.
Cependant, seul un aveugle – et en Italie, malheureusement, il y en a beaucoup – peut ne pas se rendre compte que la défaite du gouvernement est un désastre sans précédent pour le Président.
Qui, s’il avait un minimum de dignité, devrait en tirer les conséquences. Et démissionner. Ouvrant ainsi la voie à des élections.
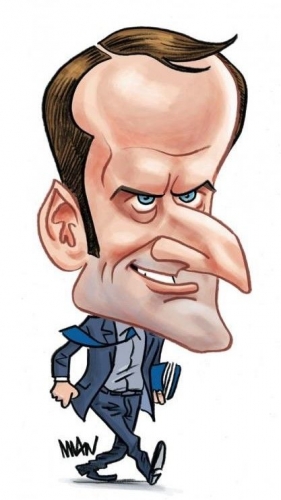
Mais Macron ne sait même pas ce qu’est la dignité. Et il cherchera donc par tous les moyens à rester à l’Élysée. Collé à un fauteuil qui a désormais perdu toute crédibilité.
Faisant payer à Bayrou des fautes qui, à bien y regarder, ne sont pas les siennes, mais bien celles de l’Élysée. Et de son locataire, incompétent et servile.
Oui, servile. Parce que Macron a démontré – et continue de le démontrer à chaque acte – qu’il est au service non pas de la France, mais d’intérêts internationaux et d’un système spéculatif qui pousse son pays – ou plutôt, le pays qui devrait être le sien – vers une crise sans précédent.

Une crise interne. Avec les fameuses banlieues désormais complètement hors de contrôle. Souvent gouvernées par des mafias, ou pire, par les Porte-étendards de la charia. Et où la police française semble avoir définitivement renoncé à intervenir.
Parallèlement, la France est désormais en révolte. Des périphéries à Paris, les Français expriment de diverses façons leur colère.
Mieux, leur fureur contre un Président qu’ils sentent, à juste titre, étranger. Voire, au service d’intérêts étrangers et hostiles.
Et ce n’est pas mieux sur le plan international.
Macron a tenté de maintenir le contrôle de la Françafrique. Soit le système néocolonial exploité depuis de nombreuses décennies. Et il a lamentablement échoué. Le Burkina Faso a lancé la révolte, rapidement suivi par d’autres pays de la zone subsaharienne.

Bien sûr, Paris essaie de récupérer ce qu’il a perdu. En s’appuyant sur ces pays africains qu’il contrôle encore, difficilement. Et surtout sur des mercenaires, y compris italiens.
Cependant, l’arrivée des Russes et le soutien chinois à Traoré laissent bien peu de marges de manœuvre. Et encore moins d’espoir.
Puis, la question ukrainienne.
Macron s’est exposé en soutenant le régime de Zelensky. Beaucoup trop. Et il continue de le faire. Sans aucune perspective concrète. Et surtout, sans avoir ni le soutien des Français, ni les moyens de soutenir le conflit.
Là aussi, il s’enferme progressivement dans une impasse sans issue.
Par incompétence personnelle notoire.
Et pour complaire à ses maîtres. Qui seront, d’ailleurs, les premiers à l’abandonner dès qu’il sera devenu complètement inutile.
Bientôt. Très bientôt.
16:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, emmanuel macron, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les 10 principales raisons pour lesquelles Trump ne peut pas redonner sa grandeur à l'industrie manufacturière américaine

Les 10 principales raisons pour lesquelles Trump ne peut pas redonner sa grandeur à l'industrie manufacturière américaine
La réalité l'emporte sur les fantasmes
S. L. Kanthan
Source: https://slkanthan.substack.com/p/top-10-reasons-why-trump...
J'ai écrit de longs articles sur ce sujet, mais voici un bref résumé des points saillants qui peuvent freiner ou annuler la croisade de Trump pour relocaliser l'industrie manufacturière:
10. Wall Street et les élites des entreprises américaines n'aiment pas l'industrie manufacturière.
9. Les États-Unis manquent de travailleurs qualifiés dans le secteur manufacturier.
8. Les jeunes Américains ne souhaitent pas travailler dans les usines.
7. Les lois environnementales sont trop strictes.
6. Les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation sont élevés.
5. Les États-Unis manquent d'infrastructures de qualité : chemins de fer, ports maritimes et même électricité.
4. Les investisseurs savent que les démocrates arriveront bientôt au pouvoir et renverseront les règles du jeu. Il n'y a pas de stabilité à long terme.
3. Le commerce et le capitalisme ne fonctionnent pas en intimidant tout le monde. Si les États-Unis sont idéaux pour l'industrie manufacturière, celle-ci prospérera automatiquement.
2. La Chine et l'Asie maîtrisent l'industrie manufacturière et la chaîne d'approvisionnement.
1. On ne peut pas inverser 45 ans de désindustrialisation.
S.L. Kanthan
16:30 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, désindustrialisation, ré-industrialisation, états-unis, économie, industrie manufacturière |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
De bénévole dans le tsunami migratoire à électrice convaincue de l'AfD

De bénévole dans le tsunami migratoire à électrice convaincue de l'AfD
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
Le parcours de Nicole Blair, 36 ans, semble inhabituel, mais il pourrait bien être représentatif de celui de nombreuses personnes qui, avec un grand cœur et beaucoup de naïveté, ont adhéré au slogan « Wir schaffen das » de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel (CDU), pour se rendre compte, plus tard, que tout cela était un peu trop candide et que la cohabitation, si le mot est encore utilisable, est devenue par suite beaucoup plus problématique. Le moment de la grande désillusion.
En 2015, au moment où Mutti Merkel a prononcé les mots célèbres « Wir schaffen das », Nicole Blair se trouvait à Budapest. Elle a été frappée par le sort des familles sans abri et sans ressources et s'est investie à 100% dans l'aide humanitaire aux réfugiés en Allemagne: collecte de vêtements, accueil et aide scolaire, recherche de logements, accompagnement quotidien de nombreux migrants. Tout cela de manière désintéressée, en tant que bénévole du matin au soir. « Je voulais aider, je voulais être une bonne personne », dit-elle.
« Le programme de l'AfD me semble le plus humain »
Ses expériences lui ont fait prendre conscience que de nombreux nouveaux arrivants montraient finalement peu de gratitude, qu'elle devait entendre de nombreux mensonges et constater des vols. Elle a constaté chez certains migrants le sentiment que « tout cela doit leur être donné immédiatement ».
La rupture s'est produite en 2020, en pleine pandémie du coronavirus. Mme Blair était enceinte et refusait de se faire vacciner, craignant des effets secondaires. « Du jour au lendemain, je suis devenue une paria, j'ai été exclue », constate-t-elle.
Pendant cet isolement forcé, elle a commencé à lire les programmes de tous les partis politiques. Ce qui l'a convaincue, c'est la politique migratoire de l'AfD. Contrairement à la caricature qui en est faite, l'AfD ne prône pas « l'expulsion de tous les étrangers », mais fait la distinction entre ceux qui s'intègrent et travaillent et ceux qui commettent des délits et ne respectent pas la loi. « Cela m'a semblé très logique », dit-elle. Nicole Blair, qui a lancé sa propre chaîne YouTube en 2021, affirme que les réfugiés qui recherchent véritablement une protection restent bien sûr les bienvenus. Mais elle a rencontré trop de personnes qui migrent simplement pour améliorer leur situation économique. « Un motif compréhensible, mais qui ne relève plus du droit d'asile ».
Selon Mme Blair, la véritable solidarité consisterait à encourager les jeunes hommes à reconstruire leur pays d'origine, plutôt que de rechercher le confort des prestations sociales occidentales. Il est clair que Mme Blair n'aura pas l'occasion d'exprimer ces opinions dans les médias grand public.
16:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, nicole blair, afd, réfugiés, migrations |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un hapax institutionnel

Un hapax institutionnel
par Georges Feltin-Tracol
Au matin du 12 juillet 2025 au terme d’une dizaine de jours d’âpres négociations dans une salle réservée de l’hôtel Hilton de Bougival dans les Yvelines à l’Ouest de Paris, est signé un accord supposé régler la question néo-calédonienne.
Les représentants de la République hexagonale et les membres des délégations indépendantistes et loyalistes adoptent «Le pari de la confiance», un texte de treize pages… Paris se félicite de manière prématurée de cette belle unanimité. Or, à la mi-août, les indépendantistes du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste) désavouent leurs émissaires et rejettent le document. Cette décision provoque une profonde division interne: une faction, l’Union nationale pour l’indépendance, qui rassemble le Palika (Parti de libération kanak) et l’UPM (Union progressiste en Mélanésie), continue à le défendre.

Au-delà des simples commentaires politiques d’approbations ou de reproches, les juristes et les constitutionnalistes s’interrogent sur ce projet riche en créativités juridiques. Cependant, ces innovations prolongent les précédentes avancées par les accords de Matignon en 1988 et de Nouméa en 1998. Dans le cadre du titre XIII de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie bénéficie déjà du statut unique de « Pays d’outre-mer », statut qui permet maintes dérogations au droit commun.
Tous les Français présents sur le « Caillou » de manière durable et continue ne peuvent pas voter à toutes les élections, surtout s’ils viennent de métropole. Seuls des citoyens calédoniens ont le droit de participer aux scrutins provinciaux et aux référendums d’autodétermination. Cette citoyenneté calédonienne officielle accorde aussi une préférence régionale aux emplois locaux. Par ailleurs, un touriste français originaire de Bordeaux doit remplir dans l’avion un formulaire d’entrée sur le territoire néo-calédonien. Arrivé sur l’archipel océanien, il doit ensuite changer ses euros en francs CFP (Communauté française du Pacifique).
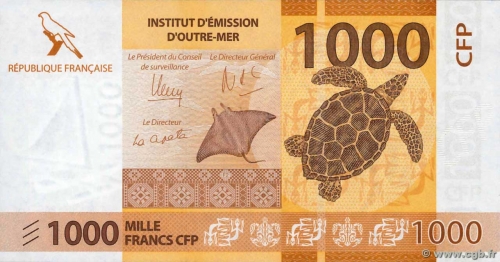
Assemblée territoriale qui vote des « lois du pays » différentes des lois françaises, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie élit à la proportionnelle un gouvernement collégial autonome. Un Sénat coutumier émanant des tribus autochtones n’applique pas la parité hommes – femmes. Enfin, trois provinces (Nord, Sud et îles Loyauté) dotées chacune de leur propre gouvernement autonome, se partagent l’archipel.
L’accord de Bougival comporte toute une dimension économique. La quasi-guerre civile du printemps 2024 et le déclin de l’activité du nickel (20 à 30% des réserves mondiales) ont accéléré la faillite des entreprises et la fermeture des boutiques commerciales. Le chômage explose dans l’archipel alors que s’effondrent les services publics. Faute de personnel médical qualifié et volontaire, les unités d’urgence ferment dans la « Brousse », en zone rurale. Paris est prêt à verser de larges subventions qui, pour l’heure en raison de l’incertitude politique, restent hypothétiques.

Le document né à Bougival envisage que la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie qui se réfère à la fois aux valeurs républicaines, kanak et océaniennes, intègre la Constitution de 1958. Le projet rectifie le nombre d’élus par rapport au nombre d’habitants et accorde une plus large autonomie, y compris fiscale, aux trois provinces. Il confirme le rôle du Sénat coutumier et entérine les aires coutumières elles-mêmes divisées en districts coutumiers et en tribus dont les délimitations territoriales ne coïncident pas avec les limites administratives provinciales. Il existe en effet sur l’archipel près d’une trentaine de langues vernaculaires dites kanak. Enfin perdure le statut civil personnel particulier chez les Kanak.
La nouveauté majeure repose sur la formation d’un « État de Nouvelle-Calédonie » inscrit donc dans la constitution française et reconnu sur le plan diplomatique par les autres puissances étatiques. Le transfert des compétences régaliennes (justice, défense, monnaie, relations extérieures, etc.) dépend d’un vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes du Congrès néo-calédonienne, puis d’une procédure référendaire locale. L’existence de cet État signifie l’établissement d’une nationalité néo-calédonienne subordonnée à la nationalité française.
La présence de cet État néo-calédonien au sein de la République française rend bien perplexe les spécialistes. Certains évoquent le cas des protectorats marocain et tunisien au temps de l’Afrique française du Nord. D’autres rappellent les liens étroits entre la France et la principauté de Monaco, pourtant membre de l’ONU et du Conseil de l’Europe. Le ministre d’État, équivalent monégasque du chef du gouvernement, est un haut-fonctionnaire français nommé par le prince régnant devant lequel il jure fidélité. Ces quelques exemples n’emportent pas la conviction.

L’État de Nouvelle-Calédonie serait une forme originale de condominium. Est un condominium quand au moins deux États exercent sur le même territoire une souveraineté non pas partagée, mais conjointe. Ainsi, entre 1906 et 1980, un archipel voisin de la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébrides (le futur Vanuatu) bénéficiait-il de ce statut de condominium entre la France et le Royaume Uni. De 1899 à 1956, le Soudan fut un condominium anglo-égyptien. Au milieu de la Bidassoa, un cours d’eau au Pays basque, se trouve l’île des Faisans (ou île de la Conférence - photo, ci-dessous) qui appartient à la France un semestre et à l’Espagne le semestre suivant. Ces cas sont des condominiums externes.

L’accord de Bougival implique plutôt un condominium interne entre la République et cet État de Nouvelle-Calédonie, soit un fait unique en droit. Il s’agit par conséquent d’un hapax institutionnel. Chose dite une seule fois, un hapax désigne en droit et en linguistique une occurrence unique.
Malgré ses originalités institutionnelles, l’accord du 12 juillet 2025 se déploie dans un déplorable carcan républicain universaliste et individualiste. La modernité tardive affecte les structures traditionnelles coutumières kanak et incite au désœuvrement d’une jeunesse peu motivée. Pourquoi par exemple les négociateurs n’ont-ils pas dissocié la nationalité calédonienne de la nationalité française ? Pourquoi n’ont-ils pas accepté officiellement le fait communautaire ? N’aurait-il pas été plus judicieux d’envisager une citoyenneté néo-calédonienne de nationalité kanak, de nationalité wallisienne (ou océanienne) et de nationalité française ? Le principe funeste de l’unité du peuple française sur des critères contractualistes favorise une nouvelle fois un désordre prévisible. Imprégnée des idéaux des funestes « Lumières », l’idéologie républicaine hexagonale n’est-elle pas d’essence chaotique ?
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 166, mise en ligne sur Synthèse nationale le 12 septembre 2025.
15:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, nouvelle-calédonie, océan pacifique, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 septembre 2025
La mort de Charlie Kirk et la guerre civile à venir - L'assassinat qui a divisé l'Amérique en deux

La mort de Charlie Kirk et la guerre civile à venir
L'assassinat qui a divisé l'Amérique en deux
Alexander Douguine
Alexander Douguine présente l'assassinat de Charlie Kirk comme un tournant décisif, avec le mouvement MAGA uni dans la colère, les libéraux en liesse, l'Ukraine jubilant et l'Amérique glissant vers la guerre civile.
Après la confirmation de la mort de Charlie Kirk (personne ne survit à un tel attentat, à une telle blessure), l'Amérique a explosé. Ce qui est surprenant, c'est que cela s'est produit des deux côtés. Trump et le mouvement MAGA ressentent une douleur sincère et une fureur sauvage. Musk a qualifié les démocrates de terroristes. Tous les membres du MAGA ont oublié leurs contradictions et se sont instantanément unis.
De l'autre côté, les libéraux ne peuvent contenir leur joie et leur exaltation. L'Idiot de Dowds a apparemment été licencié de MSNBC, mais lorsqu'une proposition a été faite au Congrès pour honorer la mémoire de Kirk par une prière, les démocrates ont hurlé : « NON ! ». Les réseaux libéraux ne peuvent contenir leur joie. Leurs camarades plus âgés les exhortent à ne pas trop afficher leurs sentiments. Cela pourrait mal finir. Mais ils n'écoutent pas. Ils sont triomphants. Après tout, un conservateur, un traditionaliste et un chrétien a été tué. Nous nous souvenons comment ces personnes sont étiquetées par leurs adversaires. Cette étiquette semble justifier leur meurtre.
Cela ressemble beaucoup au début d'une guerre civile.
Le Parti démocrate est l'Ukraine de l'Amérique. Ou l'inverse.
Le tireur a tiré à 200 mètres et a disparu. Ils ont arrêté la mauvaise personne.
Il est fort probable que personne ne saura jamais qui sont les véritables commanditaires et auteurs de ce crime, tout comme pour l'assassinat de Kennedy.
Aujourd'hui, tout le monde craint pour Musk. Et pour la vie de tous les patriotes américains et opposants aux libéraux. Une vie dans le collimateur. Pour nous, ce régime a commencé il y a trois ans. Le centre qui donne l'ordre de notre destruction, de l'élimination des partisans de MAGA, est le même.
Oui, l'Ukraine se réjouit du meurtre de Charlie Kirk, contrairement aux libéraux américains, qui essaient au moins de contenir leurs émotions. La différence entre le Parti démocrate américain et l'Ukraine est difficile à trouver. Il s'agit littéralement d'une organisation terroriste internationale.
Kirk a été tué dans une tente portant l'inscription « American Comeback ». Les meurtriers ont déclaré : « Pas du tout. Nous sommes toujours les maîtres ici. »
Le magazine Time a publié un article intitulé « Assez ». Mais c'est loin d'être « assez ». Ce n'est que le début.
En ce grand jour de la fête de la décapitation du vénérable précurseur Jean, nous observons un jour de jeûne strict. Depuis des temps immémoriaux, l'ennemi tue les saints, les justes, les innocents et les personnes simplement honnêtes et nobles. Ce n'est pas sans raison que le diable est appelé « un meurtrier dès le commencement ».
19:26 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, charlie kirk, états-unis, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Contre la russophobie, le livre inédit et posthume de Guillaume Faye

Contre la russophobie, le livre inédit et posthume de Guillaume Faye
Par Andrea Falco Profili
Source: https://www.grece-it.com/2025/09/09/contro-la-russofobia-...
Nous présentons ici une traduction de l'excellent article sur le dernier livre posthume de Guillaume Faye. Il est dû à la plume d'Andrea Falco Profili, animateur du GRECE-Italie.
Il se déroule actuellement une opération aussi insidieuse qu’obstinée visant à neutraliser la pensée de Guillaume Faye en la réduisant à une caricature, celle d’un simple agitateur « de droite » au sens le plus inoffensif du terme, voire, par un funambulisme interprétatif grotesque, à celle d’un « occidentaliste » et d’un russophobe. Quiconque a même effleuré l’œuvre du penseur français sait à quel point cette narration est mensongère. Pour la réfuter définitivement et rétablir le véritable Faye, celui de la grande géopolitique, de la vision impériale et de la critique radicale de la civilisation occidentale, paraît aujourd’hui le recueil Contre la russophobie, dirigé par Stefano Vaj et préfacé par Robert Steuckers.
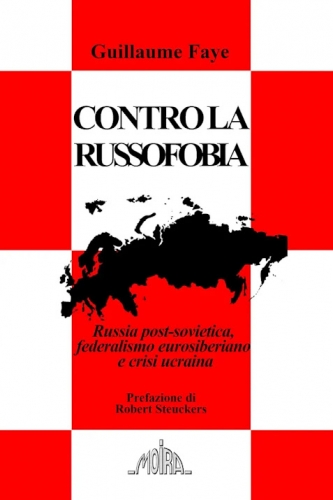
L’opération éditoriale menée par Vaj pour Moira Edizioni dénonce dès l’introduction du directeur et dans la préface de Steuckers la tentative de travestissement dont Faye a été la victime durant les dernières années de sa vie et surtout après sa disparition. Comme le souligne Steuckers, il existe une véritable « légende noire » qui présente l’auteur français comme un « occidentaliste » pro-atlantiste, alors que sa position était diamétralement opposée. Cette distorsion, alimentée à la fois par ses ennemis historiques de la soi-disant Nouvelle Droite et par certains de ses suiveurs superficiels des dernières années, a abouti au paradoxe de voir Faye décrit comme un soutien de Zelensky, une caricature que ce recueil démonte définitivement.
Le tropisme russe de Faye puise ses racines dans sa formation de jeunesse et dans son engagement au GRECE, où, dès les années 1970, il développait une vision critique de l’américanisme culturel. Comme le rappelle Steuckers, le mouvement de la Nouvelle Droite avait développé un anti-américanisme « différent de l’hostilité envers les États-Unis cultivée par les milieux de gauche », non pas un anti-américanisme de façade ou hérité des gauches pro-nord-vietnamiennes, mais issu d’une critique gaulliste et nietzschéenne de l’hégémonie culturelle, économique et stratégique de Washington, plus sophistiquée et orientée géopolitiquement. Dans ce contexte, l’URSS de Brejnev apparaissait « plus rationnelle et réaliste que le pandémonium déclenché par les services secrets occidentaux dans la sphère américaine ».

L’évolution de la pensée de Faye sur la Russie traverse différentes phases. D’abord fasciné par le « socialisme réel », non pour ses aspects économiques, mais pour ses retombées en termes « d’anti-individualisme, de futurisme, de stakhanovisme, d’esprit spartiate, hiérarchique, méritocratique et communautaire ». Une fascination qui révèle l’originalité de sa pensée, capable de saisir des éléments de mobilisation totale et de discipline collective même dans des systèmes formellement opposés à l’identitarisme européen. L’effondrement de l’URSS marque un tournant. Comme l’explique Vaj dans l’introduction, le « Sauron inventé par la propagande occidentale » se révèle moins consistant qu’attendu, poussant Faye à regarder au-delà du communisme, vers une Russie post-soviétique qui se libère progressivement de l’idéologie marxiste comme du chaos oligarchique des années 1990. L’ascension de Poutine représente pour l’auteur français non seulement le retour de la Russie en tant qu’acteur géopolitique, mais surtout l’émergence d’un modèle alternatif au nihilisme occidental.

Les textes rassemblés dans ce volume couvrent la période cruciale de 2007 à 2016, témoignant de l’évolution de la crise ukrainienne et du durcissement des relations euro-russes. Faye manifeste son positionnement en analysant les dynamiques en cours: dès 2007, dans son « Discours à la conférence de Moscou », il esquisse le projet d’une « confédération impériale euro-russe » fondée sur le fédéralisme impérial et l’autosuffisance économique. L’opinion de Faye émerge avec une force particulière dans l’analyse de la crise ukrainienne, qu’il interprète comme une provocation orchestrée par Washington pour empêcher l’intégration euro-russe.
Dans les essais consacrés à la question ukrainienne, l’auteur attaque systématiquement la narration occidentale: l’annexion de la Crimée est présentée, selon Faye, pour ce qu’elle est réellement – le retour d’un territoire historiquement russe à la mère patrie via un référendum – tandis que les sanctions contre Moscou sont dénoncées comme un « boomerang » qui nuit davantage à l’Europe qu’à la Russie elle-même.
L’analyse des motivations profondes de la russophobie occidentale est particulièrement pénétrante. Faye identifie deux causes principales: la première est géopolitique (empêcher le retour de la Russie comme grande puissance), la seconde idéologique (contrer l’exemple russe de « révolution conservatrice »). C’est ce dernier aspect qui rend le Poutine post-communiste plus redoutable pour les oligarchies occidentales que Staline lui-même: alors que l’URSS restait prisonnière d’une vision universaliste, la Russie poutinienne réaffirme des valeurs identitaires, patriotiques et traditionnelles qui constituent une menace existentielle pour le système libéral-libertaire.

L’approche de Faye à la question russe se distingue à la fois de la russophobie et du multipolarisme acritique et messianique. Il ne tombe pas dans l’erreur d’idéaliser Poutine ou le système russe, dont il reconnaît les limites et les contradictions, mais voit dans la Russie post-soviétique le principal allié naturel de l’Europe dans un monde de plus en plus polarisé. Sa position est celle d’un « bon Européen » au sens nietzschéen: il comprend que la division de l’Europe sur l’axe est-ouest ne sert que les intérêts anglo-américains. Son regard sur la Russie combine l’admiration pour la « barbarie » antibourgeoise théorisée par Drieu La Rochelle et l’appréciation de l’efficacité géopolitique et du pragmatisme stratégique. Une synthèse qui l’amène à voir dans la politique étrangère russe « la seule intelligente » dans un panorama international dominé par l’improvisation occidentale.
La vision paneuropéenne de Faye, inclusive de la Russie mais non subordonnée à celle-ci, représente aujourd’hui une troisième voie entre le suicide atlantiste et l’isolationnisme souverainiste. Particulièrement significative est la proposition de dépasser le concept géographique d’« Eurosibérie » au profit de celui, ethno-politique, d’« Eurorussie », suivant les observations de Pavel Tulaev. Ce changement terminologique reflète une maturation théorique qui s’oppose à ceux qui voudraient aujourd’hui dépeindre les Russes comme des Turcomans armés d’arcs et siégeant à la cour de Kazan, des partisans de la Horde d’or ou des parents perdus de Gengis Khan.
Pour Faye, la notion est claire : la Russie est une civilisation européenne qui a étendu son expansion vers l’Asie, ce qui ne la rend ni foncièrement asiatique ni hybride. L’enseignement de l’auteur est d’une actualité saisissante: seule une Europe réconciliée avec la Russie pourra espérer échapper au déclin. La russophobie n’est pas seulement une erreur géopolitique, mais une forme d’automutilation qui condamne l’Europe à l’insignifiance historique. En temps de polarisation croissante, l’alternative est entre un avenir européen et le crépuscule occidental. Il s’agit, en d’autres termes, de construire l’Europe avec, et non contre la Russie, en reconnaissant dans la russophobie l’instrument destiné à empêcher le cauchemar américain: la naissance d’un bloc euro-russe souverain.

La position de Faye est séduisante en ce qu’elle échappe à une certaine passion aveugle menant à un multipolarisme messianique de façade. Le chapitre « Une perspective française sur la Russie » est un chef-d’œuvre d’analyse critique, implacable et en même temps empathique. Faye reconnaît le « génie russe », une capacité intuitive exceptionnelle qui va de la musique à la physique, mais n’en cache pas les faiblesses. Il parle de la « double âme russe », d’une schizophrénie oscillant entre complexe de supériorité et d’infériorité, entre volonté de puissance impériale et sentiment d’être une nation reléguée aux marges. Avec une lucidité impitoyable, il énumère les plaies qui affligent la Russie: une démographie suicidaire, une économie déséquilibrée et trop dépendante des hydrocarbures, une corruption endémique et, surtout, la pénétration des virus culturels occidentaux. C’est précisément cette capacité d’analyse qui le rend si actuel et l’éloigne des supporters qui se contentent d’un soutien maladroit et grossier. Faye n’idolâtre pas, il soutient la Russie non de manière inconditionnelle, mais dans la mesure où elle sert un projet plus vaste: la renaissance de l’Europe tout entière.

Parler de « textes inconnus » signifie généralement évoquer la rhétorique de la redécouverte: des textes oubliés qui reviennent à la lumière, souvent à l’ombre d’une opération idéologique. Ce n’est pas le cas ici. Les matériaux rassemblés par Moira Edizioni et placés sous le nom de Faye appartiennent à la périphérie éditoriale, il s’agit de blogs échappant même à l’œil maniaque des exégètes. Des textes mineurs, certes, mais nullement suspects pour autant. L’objectif n’est pas de construire un Faye ésotérique ou clandestin. Ses positions sont celles, connues et cristallisées depuis des années. Mais c’est justement cette prévisibilité qui est en jeu: il ne s’agit pas de révéler un « autre » Faye, mais de mettre à nu la manipulation en cours. Cette redécouverte agit ainsi comme une douche froide contre les lectures sélectives et les appropriations opportunistes. Une salutaire réfutation qui ramène le débat au niveau de la réalité.
18:37 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russophobie, livre, guillaume faye, nouvelle droite, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
« En Europe, ce sont les juristes qui gouvernent, en Chine, ce sont les ingénieurs » L’Allemagne bricole sa politique et se met rapidement hors-jeu, écrit une chroniqueuse de Die Welt

« En Europe, ce sont les juristes qui gouvernent, en Chine, ce sont les ingénieurs »
L’Allemagne bricole sa politique et se met rapidement hors-jeu, écrit une chroniqueuse de Die Welt
Source: https://rmx.news/germany/in-europe-lawyers-rule-in-china-...
« L’Allemagne doit démontrer sa capacité d’action », écrit Fatina Keilani dans une tribune rédigée pour la quotidien Die Welt.
« Alors que l’Allemagne débat pour savoir si Markus Söder mange trop de saucisses ou si l’AfD doit être interdite, des nations plus ambitieuses nous dépassent », écrit Fatina Keilani pour Die Welt, expliquant que l’Europe est gouvernée par des juristes tandis que la Chine est dirigée par des ingénieurs.
« En Europe, les juristes gouvernent, en Chine, ce sont les ingénieurs », écrit Keilani.
Après avoir écouté le podcast « Interesting Times » du New York Times sur la relation entre les États-Unis, l’Occident et la Chine, Keilani a été particulièrement frappée par le fait que « la désindustrialisation de l’Europe est en fait considérée comme acquise ».
En d’autres termes, l’Europe, et en particulier son moteur économique qu’est l’Allemagne, était largement absente de la conversation, si ce n’est pour noter que la Chine lui a ravi la première place dans la technologie solaire et qu’elle est désormais en train de perdre sa domination dans l’industrie automobile.

Keilani déplore une Allemagne obsédée par l’interdiction de l’AfD, tandis que tout ce qui faisait l’essence de l’Allemagne est en train de se perdre, attribuant aux divisions sociopolitiques issues de ces gueguerres politiques et de ces mesquineries la responsabilité du mal qui ronge le pays.
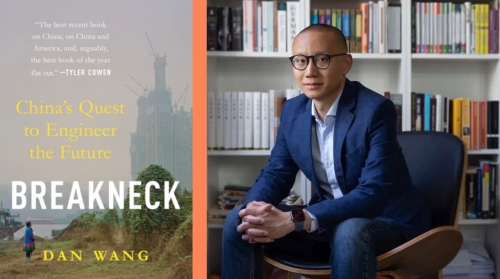
Keilani cite Dan Wang, qui se félicitait volontiers de la puissance de l’ingénierie chinoise lors du podcast où il évoquait son nouveau livre, « Breakneck : China’s Quest to Engineer the Future ».
« À ma grande surprise, la quatrième province la plus pauvre de Chine disposait d’infrastructures nettement meilleures que des régions bien plus riches des États-Unis, comme l’État de New York ou la Californie », a déclaré Wang lors du podcast, se basant sur une traversée à vélo du pays, qu'il avait effectuée.


« Nous avons vu des ponts élevés tout autour de nous. Nous avons vu un centre de fabrication de guitares. Nous avons vu de nombreuses routes neuves et modernes, le rêve de tout cycliste. Ce n’est qu’avec du recul que j’ai compris à quel point il était étrange que la quatrième province la plus pauvre de Chine – dont le PIB par habitant équivaut à celui du Botswana, bien inférieur à Shanghai ou au Guangdong – ait pu réaliser tout cela », poursuit Wang.
Tout comme le président chinois Deng Xiaoping s’est attaqué avec force à des années de stagnation communiste, « l’Allemagne doit démontrer sa capacité d’action », écrit Keilani.
« Des prix de l’énergie compétitifs, moins de bureaucratie, des investissements ciblés dans la recherche et la technologie, et la sécurisation de la main-d’œuvre qualifiée. Tout aussi importante est la résilience géopolitique: sécurité des matières premières, souveraineté numérique, et moins de dépendance vis-à-vis de la Chine », énumère-t-elle.

L’Allemagne doit revenir à « des usines, des brevets et des marchés », ajoute-t-elle.
Keilani souligne également un facteur majeur que Wang n’a pas mis en avant: la culture chinoise de la discipline, de l’éducation et de la motivation, qui, selon elle, a fortement décliné en Allemagne.
« Même les compétences de base en mathématiques et en allemand sont en recul, et un débat sur la discipline à l'école est vite perçu comme autoritaire », écrit-elle.
18:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, allemagne, chine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



