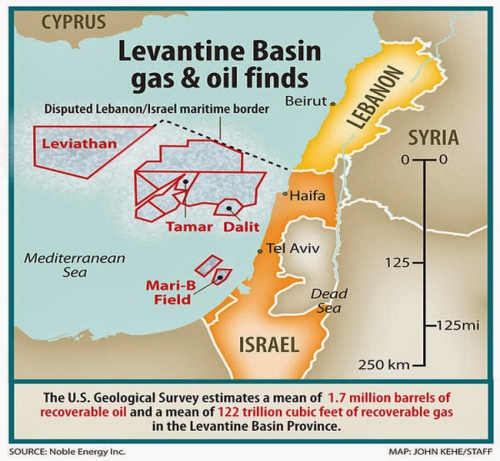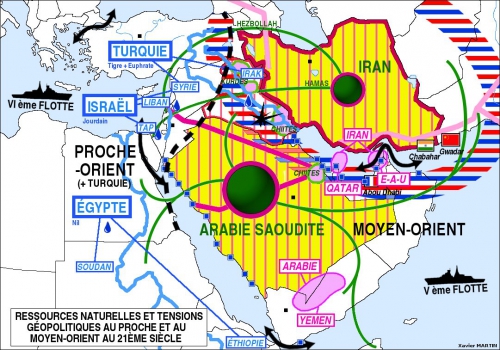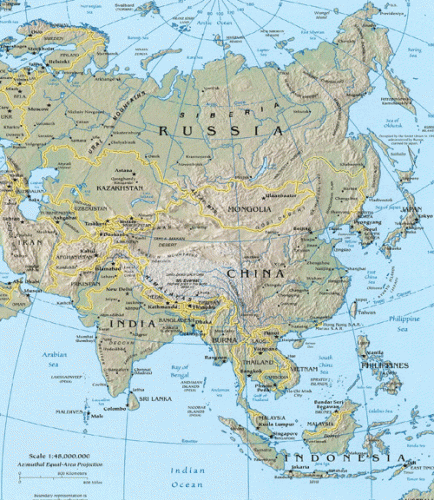mardi, 17 mars 2015
El 'Altyn', ¿un 'euro' para Eurasia?
Ex: http://www.elespiadigital.com
Una Zona Monetaria Común dentro de la Unión Económica Euroasiática (UEE) haría que la unión fuese aún más estable y económicamente atractiva, según un grupo de expertos citados por RIA Novosti.
La viabilidad de una moneda común para la unión compuesta por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Armenia está siendo analizada por el Banco Central de Rusia en colaboración con el Gobierno, a instancias del presidente ruso, Vladímir Putin.
Se estima que el 1 de septiembre de este año estará listo el análisis para determinar si la unión monetaria en la UEE es un proyecto viable.
El año pasado en Kazajistán fueron firmados los documentos que prevén la creación para 2025 del Banco Euroasiático y la creación de una moneda única para Bielorrusia, Rusia y Kazajistán. "La situación política exterior puede haber influido en las decisiones económicas, y el presidente de Rusia ha decidido acelerar este proceso", señala el director del departamento de análisis de la empresa de servicios financieros Alpari, Alexander Razuvaev.
El experto asegura que la nueva moneda "puede entrar en vigor el 1 de enero de 2016", argumentando que "la política controla la economía". Sin embargo, hay quienes opinan que la transición debe hacerse de manera más pausada.
Un 'altyn' para Eurasia
La denominación provisional de la moneda única de Eurasia es 'altyn' (una moneda usada históricamente en Rusia y en varios países de la región), nombre que fue evocado en público por el presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev. Sin embargo, según algunos medios de comunicación también se estaría discutiendo el nombre de 'euraz'.
El Banco Central de la UEE, que se encargará de supervisar la política monetaria única, estará ubicado en Alma-Ata, antigua capital kazaja. "Solo que no será un análogo del Banco Central Europeo. Probablemente las decisiones serán tomadas de manera unánime por los jefes de Estado o por las directivas de los Bancos Nacionales de los países miembro", dice Razuvaev.
Se estima que la moneda única sea similar al rublo ruso y se sustente en las exportaciones de materias primas de Rusia y Kazajstán. El mercado potencial de circulación ronda los 180 millones de personas, sumando un volumen total del PIB de más de 2 billones de dólares.
Un paso lógico
Por un lado, la introducción de la moneda única en la UEE es un paso lógico en el marco de la coordinación económica, sostienen los expertos. "La moneda única es la última etapa de la integración monetaria", explica el director del Centro de Estudios de Integración del Banco Euroasiático de Desarrollo, Yevgeni Vinokurov.
La unión monetaria puede tener un impacto positivo en el desarrollo del mercado común en el marco de la UEE, tanto en términos de evitar el impacto de las fluctuaciones de las monedas de los países participantes, como también de la simplificación de los cálculos internos, dijo a RIA Novosti el director general del Centro de Comercio Internacional Vladímir Salamatov.
Según Vinokurov, las monedas de la UEE dependen de facto y en gran medida del rublo ruso. "Esta es, en nuestra opinión, una razón más para considerar la integración. Ya que, de todas formas, la tasa de cambio de sus monedas se basará en el rublo", explica. Y concluye preguntándose: "¿no será mejor hacer este mecanismo claro y ajustable?".
Periodo de configuración
La introducción de una moneda única no se puede hacer de la noche a la mañana. "Necesitamos un período suficientemente largo de ajuste. Se trata de coordinar las políticas monetarias y cambiarias, y de la coordinación mutua de las tasas de cambio de las monedas nacionales", agrega Vinokourov.
Una condición importante para el buen funcionamiento de la unión monetaria es una coordinación fiscal (en términos de legislación fiscal). Solo después de eso será posible la introducción de una moneda única y un único centro de emisión, resalta el experto.
La ministra para la Integración y la Macroeconomía de la UEE, Tatiana Válovaya, hizo un llamamiento este martes a los países miembros a no apresurarse, afirmando que primero es necesario crear un mercado único y luego hablar de la posibilidad de una moneda única. "Pero es necesario coordinar la política monetaria", concluyó.
Economistas: El mundo está al borde de una crisis monetaria sin precedentes
El fortalecimiento del dólar estadounidense, la "muerte" del euro y 74 billones de dólares en derivados sobre divisas, todo eso puede provocar la mayor crisis monetaria, advierten expertos.
El economista Michael Snyder opina que el fortalecimiento del dólar que se observa estas semanas "no es una buena noticia".
"Un dólar fuerte perjudica a las exportaciones estadounidenses, dañando así la economía del país. Además, la debilidad del dólar ha impulsado una fuerte expansión de los mercados emergentes de todo el mundo. Mientras el dólar se fortalece, se hace mucho más difícil para los países pedir prestado y pagar las deudas viejas", escribió en su artículo en el portal Infowars.
Por otra parte está el euro, que se encamina hacia mínimos históricos. La moneda europea se acerca a la paridad con el dólar y "finalmente caerá bajó el dólar", cree Snyder.
"Esto va a causar un gran dolor de cabeza en el mundo financiero. Los europeos tratan de resolver sus problemas económicos mediante la creación de enormes cantidades de dinero nuevo. Es la versión europea de la flexibilización cuantitativa, pero tiene efectos secundarios muy negativos", advierte el economista.

Análisis: Cómo el Mercosur y la Unión Euroasiática desafían a Estados Unidos y la hegemonía del dólar
Por Ariel Noyola Rodríguez
Las estrategias de contención económica promovidas por Washington en contra de Moscú y Caracas precipitaron la reconfiguración de alianzas en el sistema mundial. Es que aunque Rusia se localice geográficamente en el norte del hemisferio, su agenda diplomática guarda una mayor vinculación con las economías emergentes. Lo mismo sucede en relación a los países de América Latina, la región que de acuerdo con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, está llamada a convertirse en un pilar clave en la construcción de un orden mundial multipolar.
Sin lugar a dudas, los nexos de Rusia con la región latinoamericana se profundizan de manera acelerada. Según la base de datos sobre comercio de mercancías de las Naciones Unidas (UN Comtrade, por sus siglas en inglés), los intercambios entre Moscú y América Latina alcanzaron una cifra récord de 18.832 millones de dólares en 2013, un monto 3 veces mayor en relación a 2004 (Brasil, Venezuela, Argentina, México y Ecuador son los 5 socios más importantes del oso ruso en América Latina).
Hay complementariedad económica en lo fundamental. Las exportaciones de Rusia hacia América Latina están concentradas en más de 50% en fertilizantes, minerales y combustibles. En tanto Moscú compra a los países latinoamericanos básicamente productos agrícolas, carnes y componentes electrónicos. De acuerdo con las proyecciones elaboradas por el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, el comercio bilateral alcanzará los 100.000 millones de dólares el año 2030, un aumento de más de 500%.
Sin embargo, también hay múltiples desafíos en el horizonte. El contexto recesivo de la economía mundial, la tendencia deflacionaria (caída de precios) en el mercado de materias primas (en especial el petróleo), la desaceleración del continente asiático y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, revelan la urgente necesidad de elevar los términos de la relación diplomática entre Rusia y los países latinoamericanos.
Como efecto de la caída del comercio entre Rusia y la Unión Europea, América Latina emerge de alguna manera como mercado sustituto y, al mismo tiempo, en calidad de receptora de inversiones de alta tecnología. En ese sentido, hay que destacar los proyectos de inversión del Consorcio Petrolero Nacional (conformado por Rosneft, Gazprom Neft, LUKoil, TNK-BP y Surgutneftegas) comprometidos con empresas de Brasil, Argentina, Venezuela, Guyana y Cuba, entre otros países.
Por añadidura, existe un amplio abanico de posibilidades para la construcción de alianzas científico-tecnológicas que por un lado, promuevan el desarrollo industrial de la región latinoamericana y, por otro lado, contribuyan a diversificar las exportaciones de Moscú, actualmente concentradas en los hidrocarburos.
El largo estancamiento de la actividad económica mundial, así como el aumento de la conflictividad interestatal por garantizar el suministro de materias primas fundamentales (petróleo, gas, metales, minerales, tierras raras, etcétera.) para la reproducción de capital, promueven la construcción de alianzas estratégicas a través de acuerdos de comercio preferenciales, inversiones conjuntas en el sector energético, transferencias tecnológicas, cooperación técnico-militar, etcétera.
Bajo esa misma perspectiva, la relación estratégica que Rusia mantiene con varios países latinoamericanos en el plano bilateral (Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, etcétera.), busca ampliarse en la región sudamericana a través la Unión Euroasiática (conformada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán) como punta de lanza.
Es que si bien el presidente Vladimir Putin planteó en 2011 (en un artículo publicado en el periódico 'Izvestia') convertir la Unión Euroasiática en un mecanismo puente entre la región Asia-Pacífico y la Unión Europea, el cerco impuesto en contra de la Federación Rusa por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) canceló temporalmente esa posibilidad.
En consecuencia, la Unión Euroasiática rompe sus límites continentales a través de la creación de zonas de libre comercio con China en el continente asiático, Egipto en el Norte de África y el Mercado Común del Sur (Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) en América Latina.
En los últimos años, la relación estratégica entre la Unión Euroasiática y el Mercosur representa la mayor apuesta de Rusia en la región sudamericana en materia de integración regional: ambos bloques poseen una extensión territorial de 33 millones de kilómetros cuadrados, una población de 450 millones de habitantes y un PIB combinado por encima de los 8,5 billones de dólares (11.6% del PIB mundial medido en términos nominales). La relación estratégica persigue dos objetivos generales. En primer lugar, disminuir la presencia de Estados Unidos y la Unión Europea en los flujos de comercio e inversión extrarregionales. Y en segundo lugar, acelerar el proceso de desdolarización global a través del uso de monedas nacionales como medios de liquidación.
La construcción de un sistema de pagos alternativo a la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Internacionales (SWIFT, por sus siglas en inglés) por parte de Rusia (China anunció recientemente el lanzamiento de un sistema de pagos propio, mismo que podría comenzar a funcionar el próximo mes de septiembre), así como la experiencia de América Latina sobre el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) para amortiguar los shocks externos sobre el conjunto de la región, son evidencia del creciente protagonismo de ambas partes en la creación de instituciones y nuevos mecanismos financieros que abandonan la órbita del dólar.
Es indudable, frente a la embestida económica y geopolítica emprendida por el imperialismo norteamericano, que las economías emergentes eluden confrontaciones directas a través de la regionalización. De manera sucinta, la Unión Euroasiática y el Mercosur deberán enfocar sus esfuerzos hacia una mayor cooperación financiera y en paralelo, articular un frente común en defensa de la soberanía nacional y los principios del derecho internacional.
En conclusión, la relación estratégica entre la Unión Euroasiática y el Mercosur tiene una enorme oportunidad para presentar ante el mundo parte de la exitosa respuesta de ambos bloques a la profundización de la crisis económica actualmente en curso y, con ello, contribuir de manera decisiva a debilitar los cimientos de la hegemonía del dólar.
00:05 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, union eurasiatique, eurasie, eurasisme, asie, affaires asiatiques, europe, affaires européennes, altyn, monnaie, devises, mercosur, dédollarisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une Alliance stratégique Iran/Russie/Egypte est-elle possible?

Une Alliance stratégique Iran/Russie/Egypte est-elle possible?

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, égypte, iran, europe, affaires européennes, afrique, affaires africaines, asie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 mars 2015
Israel, Gaza, and Energy Wars in the Middle East
 Talk of an oil glut and a potential further price drop seems to be growing. The cost of a barrel of crude now sits at just under $60, only a little more than half what it was at its most recent peak in June 2014. Meanwhile, under a barrel of woes, economies like China's have slowed and in the process demand for oil has sagged globally. And yet, despite the cancellation of some future plans for exploration and drilling for extreme (and so extremely expensive) forms of fossil fuels, startling numbers of barrels of crude are still pouring onto troubled waters. For this, a thanks should go to the prodigious efforts of "Saudi America" (all that energetic hydraulic fracking, among other things), while the actual Saudis, the original ones, are still pumping away. We could, in other words, have arrived not at "peak oil" but at "peak oil demand" for at least a significant period of time to come. At Bloomberg View, columnist A. Gary Shilling has even suggested that the price of crude could ultimately simply collapse under the weight of all that production and a global economic slowdown, settling in at $10-$20 a barrel (a level last seen in the 1990s).
Talk of an oil glut and a potential further price drop seems to be growing. The cost of a barrel of crude now sits at just under $60, only a little more than half what it was at its most recent peak in June 2014. Meanwhile, under a barrel of woes, economies like China's have slowed and in the process demand for oil has sagged globally. And yet, despite the cancellation of some future plans for exploration and drilling for extreme (and so extremely expensive) forms of fossil fuels, startling numbers of barrels of crude are still pouring onto troubled waters. For this, a thanks should go to the prodigious efforts of "Saudi America" (all that energetic hydraulic fracking, among other things), while the actual Saudis, the original ones, are still pumping away. We could, in other words, have arrived not at "peak oil" but at "peak oil demand" for at least a significant period of time to come. At Bloomberg View, columnist A. Gary Shilling has even suggested that the price of crude could ultimately simply collapse under the weight of all that production and a global economic slowdown, settling in at $10-$20 a barrel (a level last seen in the 1990s).
And here's the saddest part of this story: no matter what happens, the great game over energy and the resource conflicts and wars that go with it show little sign of slowing down. One thing is guaranteed: no matter how low the price falls, the scramble for sources of oil and the demand for yet more of them won't stop. Even in this country, as the price of oil has dropped, the push for the construction of the Keystone XL pipeline to bring expensive-to-extract and especially carbon-dirty Canadian "tar sands" to market on the U.S. Gulf Coast has only grown more fervent, while the Obama administration has just opened the country's southern Atlantic coastal waters to future exploration and drilling. In the oil heartlands of the planet, Iraq and Kurdistan typically continue to fight over who will get the (reduced) revenues from the oil fields around the city of Kirkuk to stanch various financial crises. In the meantime, other oil disputes only heat up.
Among them is one that has gotten remarkably little attention even as it has grown more intense and swept up ever more countries. This is the quarter-century-old struggle over natural gas deposits off the coast of Gaza as well as elsewhere in the eastern Mediterranean. That never-ending conflict provides a remarkable and grim lens through which to view so many recent aspects of Israeli-Palestinian relations, and long-time TomDispatch regular Michael Schwartz offers a panoramic look at it here for the first time.
By the way, following the news that 2014 set a global heat record, those of us freezing on the East Coast of the U.S. this winter might be surprised to learn that the first month of 2015 proved to be the second hottest January on record. And when you're on such a record-setting pace, why stop struggling to extract yet more fossil fuels? Tom
The Great Game in the Holy Land
How Gazan Natural Gas Became the Epicenter of An International Power StruggleGuess what? Almost all the current wars, uprisings, and other conflicts in the Middle East are connected by a single thread, which is also a threat: these conflicts are part of an increasingly frenzied competition to find, extract, and market fossil fuels whose future consumption is guaranteed to lead to a set of cataclysmic environmental crises.
Amid the many fossil-fueled conflicts in the region, one of them, packed with threats, large and small, has been largely overlooked, and Israel is at its epicenter. Its origins can be traced back to the early 1990s when Israeli and Palestinian leaders began sparring over rumored natural gas deposits in the Mediterranean Sea off the coast of Gaza. In the ensuing decades, it has grown into a many-fronted conflict involving several armies and three navies. In the process, it has already inflicted mindboggling misery on tens of thousands of Palestinians, and it threatens to add future layers of misery to the lives of people in Syria, Lebanon, and Cyprus. Eventually, it might even immiserate Israelis.
Resource wars are, of course, nothing new. Virtually the entire history of Western colonialism and post-World War II globalization has been animated by the effort to find and market the raw materials needed to build or maintain industrial capitalism. This includes Israel's expansion into, and appropriation of, Palestinian lands. But fossil fuels only moved to center stage in the Israeli-Palestinian relationship in the 1990s, and that initially circumscribed conflict only spread to include Syria, Lebanon, Cyprus, Turkey, and Russia after 2010.
The Poisonous History of Gazan Natural Gas
Back in 1993, when Israel and the Palestinian Authority (PA) signed the Oslo Accords that were supposed to end the Israeli occupation of Gaza and the West Bank and create a sovereign state, nobody was thinking much about Gaza's coastline. As a result, Israel agreed that the newly created PA would fully control its territorial waters, even though the Israeli navy was still patrolling the area. Rumored natural gas deposits there mattered little to anyone, because prices were then so low and supplies so plentiful. No wonder that the Palestinians took their time recruiting British Gas (BG) -- a major player in the global natural gas sweepstakes -- to find out what was actually there. Only in 2000 did the two parties even sign a modest contract to develop those by-then confirmed fields.
BG promised to finance and manage their development, bear all the costs, and operate the resulting facilities in exchange for 90% of the revenues, an exploitative but typical "profit-sharing" agreement. With an already functioning natural gas industry, Egypt agreed to be the on-shore hub and transit point for the gas. The Palestinians were to receive 10% of the revenues (estimated at about a billion dollars in total) and were guaranteed access to enough gas to meet their needs.
Had this process moved a little faster, the contract might have been implemented as written. In 2000, however, with a rapidly expanding economy, meager fossil fuels, and terrible relations with its oil-rich neighbors, Israel found itself facing a chronic energy shortage. Instead of attempting to answer its problem with an aggressive but feasible effort to develop renewable sources of energy, Prime Minister Ehud Barak initiated the era of Eastern Mediterranean fossil fuel conflicts. He brought Israel's naval control of Gazan coastal waters to bear and nixed the deal with BG. Instead, he demanded that Israel, not Egypt, receive the Gaza gas and that it also control all the revenues destined for the Palestinians -- to prevent the money from being used to "fund terror."
With this, the Oslo Accords were officially doomed. By declaring Palestinian control over gas revenues unacceptable, the Israeli government committed itself to not accepting even the most limited kind of Palestinian budgetary autonomy, let alone full sovereignty. Since no Palestinian government or organization would agree to this, a future filled with armed conflict was assured.
The Israeli veto led to the intervention of British Prime Minister Tony Blair, who sought to broker an agreement that would satisfy both the Israeli government and the Palestinian Authority. The result: a 2007 proposal that would have delivered the gas to Israel, not Egypt, at below-market prices, with the same 10% cut of the revenues eventually reaching the PA. However, those funds were first to be delivered to the Federal Reserve Bank in New York for future distribution, which was meant to guarantee that they would not be used for attacks on Israel.
This arrangement still did not satisfy the Israelis, who pointed to the recent victory of the militant Hamas party in Gaza elections as a deal-breaker. Though Hamas had agreed to let the Federal Reserve supervise all spending, the Israeli government, now led by Ehud Olmert, insisted that no "royalties be paid to the Palestinians." Instead, the Israelis would deliver the equivalent of those funds "in goods and services."
This offer the Palestinian government refused. Soon after, Olmert imposed a draconian blockade on Gaza, which Israel's defense minister termed a form of "'economic warfare' that would generate a political crisis, leading to a popular uprising against Hamas." With Egyptian cooperation, Israel then seized control of all commerce in and out of Gaza, severely limiting even food imports and eliminating its fishing industry. As Olmert advisor Dov Weisglass summed up this agenda, the Israeli government was putting the Palestinians "on a diet" (which, according to the Red Cross, soon produced "chronic malnutrition," especially among Gazan children).
When the Palestinians still refused to accept Israel's terms, the Olmert government decided to unilaterally extract the gas, something that, they believed, could only occur once Hamas had been displaced or disarmed. As former Israel Defense Forces commander and current Foreign Minister Moshe Ya'alon explained, "Hamas... hasconfirmed its capability to bomb Israel's strategic gas and electricity installations... It is clear that, without an overall military operation to uproot Hamas control of Gaza, no drilling work can take place without the consent of the radical Islamic movement."
Following this logic, Operation Cast Lead was launched in the winter of 2008. According to Deputy Defense Minister Matan Vilnai, it was intended to subject Gaza to a "shoah" (the Hebrew word for holocaust or disaster). Yoav Galant, the commanding general of the Operation, said that it was designed to "send Gaza decades into the past." As Israeli parliamentarian Tzachi Hanegbi explained, the specific military goal was "to topple the Hamas terror regime and take over all the areas from which rockets are fired on Israel."
Operation Cast Lead did indeed "send Gaza decades into the past." Amnesty International reported that the 22-day offensive killed 1,400 Palestinians, "including some 300 children and hundreds of other unarmed civilians, and large areas of Gaza had been razed to the ground, leaving many thousands homeless and the already dire economy in ruins." The only problem: Operation Cast Lead did not achieve its goal of "transferring the sovereignty of the gas fields to Israel."
More Sources of Gas Equal More Resource Wars
In 2009, the newly elected government of Prime Minister Benjamin Netanyahu inherited the stalemate around Gaza's gas deposits and an Israeli energy crisis that only grew more severe when the Arab Spring in Egypt interrupted and then obliterated 40% of the country's gas supplies. Rising energy prices soon contributed to the largest protests involving Jewish Israelis in decades.
As it happened, however, the Netanyahu regime also inherited a potentially permanent solution to the problem. An immense field of recoverable natural gas was discovered in the Levantine Basin, a mainly offshore formation under the eastern Mediterranean. Israeli officials immediately asserted that "most" of the newly confirmed gas reserves lay "within Israeli territory." In doing so, they ignored contrary claims by Lebanon, Syria, Cyprus, and the Palestinians.
In some other world, this immense gas field might have been effectively exploited by the five claimants jointly, and a production plan might even have been put in place to ameliorate the environmental impact of releasing a future 130 trillion cubic feet of gas into the planet's atmosphere. However, as Pierre Terzian, editor of the oil industry journal Petrostrategies, observed, "All the elements of danger are there... This is a region where resorting to violent action is not something unusual."
In the three years that followed the discovery, Terzian's warning seemed ever more prescient. Lebanon became the first hot spot. In early 2011, the Israeli government announced the unilateral development of two fields, about 10% of that Levantine Basin gas, which lay in disputed offshore waters near the Israeli-Lebanese border. Lebanese Energy Minister Gebran Bassil immediately threatened a military confrontation, asserting that his country would "not allow Israel or any company working for Israeli interests to take any amount of our gas that is falling in our zone." Hezbollah, the most aggressive political faction in Lebanon, promised rocket attacks if "a single meter" of natural gas was extracted from the disputed fields.
Israel's Resource Minister accepted the challenge, asserting that "[t]hese areas are within the economic waters of Israel... We will not hesitate to use our force and strength to protect not only the rule of law but the international maritime law."
Oil industry journalist Terzian offered this analysis of the realities of the confrontation:
"In practical terms... nobody is going to invest with Lebanon in disputed waters. There are no Lebanese companies there capable of carrying out the drilling, and there is no military force that could protect them. But on the other side, things are different. You have Israeli companies that have the ability to operate in offshore areas, and they could take the risk under the protection of the Israeli military."
Sure enough, Israel continued its exploration and drilling in the two disputed fields, deploying drones to guard the facilities. Meanwhile, the Netanyahu government invested major resources in preparing for possible future military confrontations in the area. For one thing, with lavish U.S. funding, it developed the "Iron Dome" anti-missile defense system designed in part to intercept Hezbollah and Hamas rockets aimed at Israeli energy facilities. It also expanded the Israeli navy, focusing on its ability to deter or repel threats to offshore energy facilities. Finally, starting in 2011 it launched airstrikes in Syria designed, according to U.S. officials, "to prevent any transfer of advanced... antiaircraft, surface-to-surface and shore-to-ship missiles" to Hezbollah.
Nonetheless, Hezbollah continued to stockpile rockets capable of demolishing Israeli facilities. And in 2013, Lebanon made a move of its own. It began negotiating with Russia. The goal was to get that country's gas firms to develop Lebanese offshore claims, while the formidable Russian navy would lend a hand with the "long-running territorial dispute with Israel."
By the beginning of 2015, a state of mutual deterrence appeared to be setting in. Although Israel had succeeded in bringing online the smaller of the two fields it set out to develop, drilling in the larger one was indefinitely stalled "in light of the security situation." U.S. contractor Noble Energy, hired by the Israelis, was unwilling to invest the necessary $6 billion in facilities that would be vulnerable to Hezbollah attack, and potentially in the gun sights of the Russian navy. On the Lebanese side, despite an increased Russian naval presence in the region, no work had begun.
Meanwhile, in Syria, where violence was rife and the country in a state of armed collapse, another kind of stalemate went into effect. The regime of Bashar al-Assad, facing a ferocious threat from various groups of jihadists, survived in part by negotiating massive military support from Russia in exchange for a 25-year contract to develop Syria's claims to that Levantine gas field. Included in the deal was a major expansion of the Russian naval base at the port city of Tartus, ensuring a far larger Russian naval presence in the Levantine Basin.
While the presence of the Russians apparently deterred the Israelis from attempting to develop any Syrian-claimed gas deposits, there was no Russian presence in Syria proper. So Israel contracted with the U.S.-based Genie Energy Corporation to locate and develop oil fields in the Golan Heights, Syrian territory occupied by the Israelis since 1967. Facing a potential violation of international law, the Netanyahu government invoked, as the basis for its acts, an Israeli court ruling that the exploitation of natural resources in occupied territories was legal. At the same time, to prepare for the inevitable battle with whichever faction or factions emerged triumphant from the Syrian civil war, it began shoring up the Israeli military presence in the Golan Heights.
And then there was Cyprus, the only Levantine claimant not at war with Israel. Greek Cypriots had long been in chronic conflict with Turkish Cypriots, so it was hardly surprising that the Levantine natural gas discovery triggered three years of deadlocked negotiations on the island over what to do. In 2014, the Greek Cypriots signed an exploration contract with Noble Energy, Israel's chief contractor. The Turkish Cypriots trumped this move by signing a contract with Turkey to explore all Cypriot claims "as far as Egyptian waters." Emulating Israel and Russia, the Turkish government promptly moved three navy vessels into the area to physically block any intervention by other claimants.
As a result, four years of maneuvering around the newly discovered Levantine Basin deposits have produced little energy, but brought new and powerful claimants into the mix, launched a significant military build-up in the region, and heightened tensions immeasurably.
Gaza Again -- and Again
Remember the Iron Dome system, developed in part to stop Hezbollah rockets aimed at Israel's northern gas fields? Over time, it was put in place near the border with Gaza to stop Hamas rockets, and was tested during Operation Returning Echo, the fourth Israeli military attempt to bring Hamas to heel and eliminate any Palestinian "capability to bomb Israel's strategic gas and electricity installations."
Launched in March 2012, it replicated on a reduced scale the devastation of Operation Cast Lead, while the Iron Dome achieved a 90% "kill rate" against Hamas rockets. Even this, however, while a useful adjunct to the vast shelter system built to protect Israeli civilians, was not enough to ensure the protection of the country's exposed oil facilities. Even one direct hit there could damage or demolish such fragile and flammable structures.
The failure of Operation Returning Echo to settle anything triggered another round of negotiations, which once again stalled over the Palestinian rejection of Israel's demand to control all fuel and revenues destined for Gaza and the West Bank. The new Palestinian Unity government then followed the lead of the Lebanese, Syrians, and Turkish Cypriots, and in late 2013 signed an "exploration concession" with Gazprom, the huge Russian natural gas company. As with Lebanon and Syria, the Russian Navy loomed as a potential deterrent to Israeli interference.
Meanwhile, in 2013, a new round of energy blackouts caused "chaos" across Israel, triggering a draconian 47% increase in electricity prices. In response, the Netanyahu government considered a proposal to begin extracting domestic shale oil, but the potential contamination of water resources caused a backlash movement that frustrated this effort. In a country filled with start-up high-tech firms, the exploitation of renewable energy sources was still not being given serious attention. Instead, the government once again turned to Gaza.
With Gazprom's move to develop the Palestinian-claimed gas deposits on the horizon, the Israelis launched their fifth military effort to force Palestinian acquiescence, Operation Protective Edge. It had two major hydrocarbon-related goals: to deter Palestinian-Russian plans and to finally eliminate the Gazan rocket systems. The first goal was apparently met when Gazprom postponed (perhaps permanently) its development deal. The second, however, failed when the two-pronged land and air attack -- despite unprecedented devastation in Gaza -- failed to destroy Hamas's rocket stockpiles or its tunnel-based assembly system; nor did the Iron Dome achieve the sort of near-perfect interception rate needed to protect proposed energy installations.
There Is No Denouement
After 25 years and five failed Israeli military efforts, Gaza's natural gas is still underwater and, after four years, the same can be said for almost all of the Levantine gas. But things are not the same. In energy terms, Israel is ever more desperate, even as it has been building up its military, including its navy, in significant ways. The other claimants have, in turn, found larger and more powerful partners to help reinforce their economic and military claims. All of this undoubtedly means that the first quarter-century of crisis over eastern Mediterranean natural gas has been nothing but prelude. Ahead lies the possibility of bigger gas wars with the devastation they are likely to bring.
Michael Schwartz, an emeritus distinguished teaching professor of sociology at Stony Brook University, is a TomDispatch regular and the author of the award-winning books Radical Protest and Social Structure andThe Power Structure of American Business (with Beth Mintz). His TomDispatch book, War Without End, focused on how the militarized geopolitics of oil led the U.S. to invade and occupy Iraq. His email address is Michael.Schwartz@stonybrook.edu.
Follow TomDispatch on Twitter and join us on Facebook. Check out the newest Dispatch Book, Rebecca Solnit's Men Explain Things to Me, and Tom Engelhardt's latest book, Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single-Superpower World.
Copyright 2015 Michael Schwartz
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, levant, chypre, gaza, israël, pétrole, gaz, gazoducs, hydrocarbures, méditerranée, méditerranée orientale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Russie répond à l’appel du Venezuela

La Russie répond à l’appel du Venezuela
Le président Obama doit se mordre les doigts d’avoir ouvert toutes grandes les portes à la présence militaire russe en Amérique latine et dans les Antilles. Par son décret, véritable déclaration de guerre contre le Venezuela, il aura incité ce dernier à faire appel aux bons offices de la Russie et de sa technologie militaire pour assurer sa défense. S’il s’agit pour le Venezuela d’un appui de grande importance, c’est pour la Russie, à n’en pas douter, une opportunité tout à fait inattendue. Une occasion en or pour Poutine de donner la pareille à Washington qui se fait si présent politiquement et militairement en Ukraine, dans les Balkans, la Mer noire et la Méditerranée.
La nouvelle du jour qui va interpeller très fortement les bien-pensants des politiques guerrières étasuniennes est que la Russie et le Venezuela vont se joindre aux manœuvres militaires défensives planifiées pour cette fin de semaine (14 et 15 mars) dans tout le Venezuela. Le ministre de la Défense, Serguéi Shoigu, a accepté l’invitation de son collègue vénézuélien, Vladimir Padrino Lopez, pour que la Russie participe aux exercices militaires des forces de défense antiaérienne et aux manœuvres de tir de lance-roquettes multiple russe BM-30 Smerch. À ceci s’ajoute l’entrée amicale de navires russes dans les ports du Venezuela.
Cette participation de la Russie à la défense du Venezuela contre les menaces d’invasion militaire de la part des États-Unis ne sera pas sans rappeler à Obama sa propre participation militaire en Ukraine et dans la majorité des pays frontaliers à la Russie. Il sera mal placé pour se plaindre du fait qu’un pays ami, la Russie, apporte son soutien à un autre pays ami, le Venezuela, lequel est menacé d’invasion par son pire ennemi, les États-Unis.
Nous ne sommes évidemment plus en 1962, lors de la crise des missiles à Cuba où la menace nucléaire était à 90 kilomètres des frontières étasuniennes. Au Venezuela, il n’y a pas d’armes nucléaires et les frontières des deux pays sont séparées par des milliers de kilomètres. De plus, l’Amérique latine d’aujourd’hui n’est plus celle des années 1960. De nombreux peuples sont parvenus à vaincre les résistances oligarchiques et impériales pour conquérir démocratiquement les pouvoirs de l’État et les mettre au service du bien commun. De nombreux organismes régionaux se sont développés. Leur présence devient une caution de l’indépendance et d’intégration des peuples de l’Amérique latine. C’est le cas, entre autres, d’UNASUR, de MERCOSUR, de l’ALBA, de CELAC.
De toute évidence, l’Oncle SAM s’acharne à ne pas reconnaître ces changements et continue de vivre comme si l’Amérique latine était toujours sa Cour arrière dont il peut disposer à volonté. Tôt ou tard, il faudra qu’il change son attitude et ses politiques. Ce ne sont plus ces peuples qui doivent changer leurs politiques et leur régime de gouvernance, mais c’est plutôt lui qui doit procéder à ce changement. Ce sont maintenant les peuples qui lui tordent le bras pour qu’il change ses vieilles habitudes impériales en celles de partenaire respectueux et respectables.
- Source : Oscar Fortin
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, russie, venezuela, amérique latine, amérique du sud |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Vénézuela «extraordinaire menace pour les Etats-Unis»

Le Vénézuela «extraordinaire menace pour les Etats-Unis»
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
Le président Nicolas Maduro a vivement réagi à la décision américaine. «Le président Barack Obama [...] a décidé de se charger personnellement de renverser mon gouvernement et d'intervenir au Venezuela pour en prendre le contrôle», a-t-il affirmé, au cours d'un discours télévisé de deux heures. En réponse, il a décidé de nommer ministre de l'Intérieur le chef des services de renseignements sanctionné par les Américains. Le plus haut responsable diplomatique à Washington a également été rappelé.
Nous avions indiqué ici, dans un article du 11 février, que tout laissait penser qu'un coup d'Etat contre le président Maduro, successeur de Hugo Chavez et aussi détesté à Washington aujourd'hui que ne l'était ce dernier de son vivant, était sans doute en préparation.
Effectivement, peu après, le 13 février, le maire de Caracas, et figure de l'opposition Antonio Ledezma avait été arrêté par les services de renseignement, soupçonné d'avoir encouragé un coup d'Etat dans le pays. Nous ne pouvons évidemment nous prononcer sur ce point. Néanmoins il est connu de tous que les Etats-Unis, directement ou par personnes interposées, ont l'habitude de faire tomber les régimes qui s'opposent à eux en provoquant de tels pronunciamientos.
Il est clair que la nouvelle déclaration de Barack Obama contre le Vénézuéla, ressemblant beaucoup à une déclaration de guerre, ne pourra qu'être interprétée à Caracas et dans les autres capitales, ainsi qu'au sein du BRICS, comme préparant une intervention militaire. Ainsi pourrait disparaître un gouvernement dont le grand tort est d'être non aligné sur Washington et allié de la Russie, sans compter le fait que le Vénézuela dispose d'importantes réserves de pétrole sur lesquelles les grandes compagnies pétrolières américaines aimeraient bien mettre la main.
L'affaire ne sera pas cependant aussi facile qu'Obama semblait le penser. On apprend ce jour 12 mars que la Russie va se joindre aux manœuvres militaires défensives planifiées pour cette fin de semaine (14 et 15 mars) dans tout le Venezuela. Le ministre de la Défense, Serguéi Shoigu, a accepté l'invitation de son collègue vénézuélien, Vladimir Padrino Lopez. La Russie participera aux exercices militaires des forces de défense antiaérienne et aux manœuvres de tir de lance-roquettes multiple russe BM-30 Smerch. À ceci s'ajoutera l'escale de navires russes dans les ports du Venezuela.
L'Amérique ne pourra évidemment pas comparer cela à la crise des missiles de 1962 l'ayant opposée à Cuba et indirectement à l'URSS. Mais nous pouvons être certain que l'accusation sera lancée. Il serait pertinent alors de rappeler à Obama sa propre participation militaire, directement ou via l'Otan, en Ukraine et dans la majorité des pays frontaliers à la Russie, à des manoeuvres militaires plus qu'agressives.
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, états-unis, venezuela, amérique latine, amérique du sud |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 mars 2015
Vers une Allemagne post-occidentale?

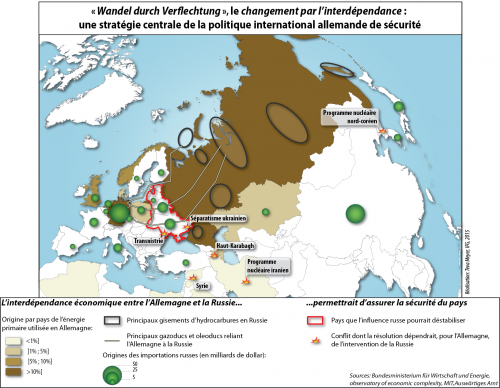


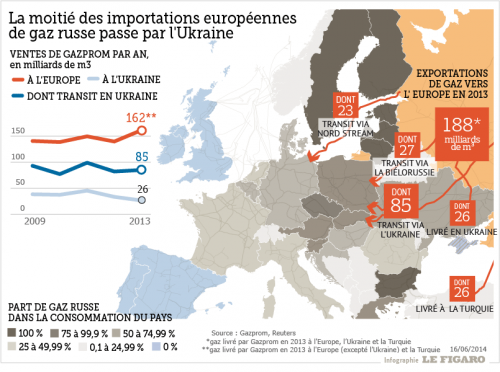
00:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, allemagne, politique internationale, géopolitique, russie, chine, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Russie, amie d'une Europe authentique

La Russie, amie d'une Europe authentique
par Thomas Ferrier
Ex: http://thomasferrier.hautetfort.com
La guerre civile ukrainienne, l’annexion de la Crimée et le récent assassinat de l’opposant libéral Boris Nemtsov, amènent les media occidentaux à considérer la Russie de Poutine comme une menace pour la paix en Europe. Selon une inversion accusatoire classique, un article du journal Le Monde du 23 février affirme même que la Russie considérerait l’Union Européenne « comme son ennemie ».
Que reproche-t-on réellement à Poutine ? De braver les interdits de la police de la pensée. De remettre en cause les dogmes d’un Occident sur le déclin. D’avoir redonné à la Russie ses lettres de noblesse, alors qu’elle était affaiblie et même avilie du temps d’Eltsine. Poutine en effet n’est pas un partisan déclaré d’une « gay pride » moscovite mais il préfère relancer la natalité du peuple russe, qui était auparavant au plus bas. S’il n’est pas nationaliste, désavouant les excès de la droite radicale, il est néanmoins patriote.
Gorbatchev a été abusé. S’il a eu raison de redonner leur liberté aux pays d’Europe centrale et orientale, s’il a été utile pour libérer la Russie d’une dictature nocive, les USA en revanche n’ont pas joué le jeu. Ils n’ont jamais traité la (nouvelle) Russie comme un partenaire respectable, à traiter avec correction. Pendant qu’Eltsine assistait impuissant ou complice au démantèlement du pays, engraissant les oligarques comme d’autres engraissent les oies, un par un, les pays d’Europe centrale adhéraient à l’OTAN, une organisation née pour enrayer le communisme et qui n’avait donc plus lieu d’exister après 1991.
Poutine a été choisi en 1999 par Eltsine mais sans avoir encore révélé qui il était. Il a tenu sa parole, protégeant la famille de l’ancien président de poursuites sans doute justifiées. En revanche, il a démantelé le système Eltsine, traquant sans répit les « marchands du temple ». Berezovski dut s’exiler et Khodorkovski finit en prison. Poutine a eu le temps d’analyser les causes du déclin de son pays et nommer les coupables. Au pouvoir, il va donc les combattre sans ménagement. D’un point de vue russe, ces gens ont trahi leur patrie.
Poutine a parfaitement compris que la Russie était une nation d’Europe et a maintenu la ligne de la « maison commune européenne » au moins jusqu’à 2005. Il a tendu la main à l’Union Européenne qui jamais n’a eu le courage de la saisir, préférant être la vassale des USA. S’il a obtenu difficilement l’abandon de la mise en place de bases américaines anti-missiles aux frontières du pays, il n’a pas pu enrayer la stratégie américaine contre son pays et n’a pas réussi à convaincre les autres Européens de se désolidariser de cette puissance qui a mis le continent sous diktat.
La stratégie russe consiste donc à neutraliser les vassaux de l’Amérique qui vivent à ses frontières, y compris par des actions militaires. La Transnistrie, l’Ossétie du nord et l’Abkhazie et maintenant le Donbass ukrainien, empêchent Moldavie, Géorgie ou Ukraine de rejoindre l’OTAN. L’adhésion à l’Union Européenne, dans la mesure où cette dernière ne se place pas en adversaire, ne le dérange pas. C’est une réponse impopulaire aux yeux de la communauté internationale et cause de conflits gelés. Il est trop facile d’en accuser la Russie. C’est bien parce qu’elle est victime d’une stratégie russophobe d’encerclement, pensée par les technocrates de Washington, républicains comme démocrates, qu’elle est contrainte de répondre comme elle le peut et sans bénéficier des appuis nécessaires pour éviter de jouer un « mauvais rôle ».
La balle est clairement dans le camp de l’Union Européenne. C’est à celle de décider si elle veut continuer à payer les pots cassés d’une stratégie atlantiste ou si elle est prête à prendre son destin en mains. La politique qu’elle mène est contraire à ses intérêts et surtout à ceux des peuples. Elle est vectrice de mondialisme lorsqu’elle devrait au contraire être un rempart.
Les USA n’ont peur que d’une chose, que l’Union Européenne et la Russie convergent et travaillent de concert pour l’intérêt des Européens. Ils favorisent donc en son sein tous les germes de décadence, promouvant toutes formes de communautarisme, et sont un soutien sans réserve d’une immigration massive indigeste et mettant en danger les valeurs les plus ancestrales de la civilisation européenne.
Or la Russie semble renoncer à cette espérance d’une Europe se libérant de ce joug et préfère se tourner par défaut vers l’Asie. Elle commet là une erreur majeure. Son avenir est européen et ne peut qu’être européen. Son salut est en elle et en nous, comme le nôtre d’ailleurs. Elle choisit d’encourager les passions centrifuges de l’Union Européenne au lieu d’encourager son unité, de peur que cette unité se fasse contre elle.
Mais les vrais européistes savent que la Russie a toujours été le rempart de l’Europe face à l’Asie avide de ses richesses. Et ils savent désormais que la Russie est aussi le rempart de l’Europe contre une Amérique qui nie ses racines européennes et se retourne contre la maison-mère, trahissant dans le même temps le peuple américain fondateur, de souche européenne, minoritaire sur son propre sol dans quelques décennies.
Les libéraux-atlantistes, dans et en dehors de la Russie, sont des ennemis déclarés de notre civilisation et de leur propre peuple. Les gouvernements d’Europe orientale qui tapent sur la Russie se trompent d’ennemis. Et les nationalistes ukrainiens, passéistes, bafouent les principes mêmes qu’ils devraient chérir, oubliant qu’ils sont des Slaves et (donc) des Européens et pas des Occidentaux. La Russie n’est pas l’ennemie de l’Europe, elle est une composante de l’Europe. Les Russes sont nos frères, comme le sont pour eux et pour nous les Ukrainiens. Mais la Russie attend que les Européens envoient à leur tour les bons signaux et redeviennent maîtres chez eux, dans tous les sens du terme.
L’alliance euro-russe, le ralliement de la Russie au projet d’unification politique du continent européen, voilà la seule ligne que devraient défendre de véritables Européens, d’âme et de sang, de cœur et de raison. En n’oubliant pas que les spéculateurs qui ont attaqué la Grèce et par ce biais la zone euro ne roulaient pas pour Moscou mais pour Washington. En n’oubliant pas qu’une Europe unie de l’Islande à la Russie sera et de loin la première puissance mondiale, détrônant les USA. En n’oubliant pas que la grande Europe sera capable de faire entendre sa voix, et ainsi de protéger concrètement son identité contre toutes les agressions, internes et externes, du mondialisme.
Si l’avenir de la Russie est européen, l’avenir de l’Europe est dans l’amitié avec la Russie, même « poutinienne ». Nous pourrons donner des leçons à Vladimir Poutine quand nous aurons su nous doter de vrais dirigeants et entreprendre les réformes indispensables pour notre salut. Et je ne doute pas qu’alors les Russes sauront nous encourager. Mais n’attendons pas d’eux qu’ils fassent le travail pour nous.
L’Europe avec la Russie, la Russie dans l’Europe !
Thomas FERRIER (PSUNE)
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : actualité, europe, russie, géopolitique, politique internationale, eurasisme, eurasie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Mali et Azawad

Ibrahima Sène*
Ex: http://metamag.fr
Comme les Etats Unis avec l’Armée de l’Etat Islamique qu’ils ont aidé à s’armer et à s’entraîner contre la Syrie, et qui aujourd’hui s’est retournée contre les intérêts américains, la France risque de voir un nouveau rapprochement du Mnla avec les groupes jihadistes, pour frapper ses intérêts dans la zone sahélo sahéliennes. Et Bamako, qui vient d’être frappé par un attentat meurtrier, risque de retourner à la case départ pour défendre militairement l’intégrité de son territoire et la sécurité de ses populations.
Moktar Belmoktar, chef d’un groupe armé proche d’Al Qaida, vient de revendiquer publiquement l’attaque terroriste de la nuit du 6 au 7 mars à Bamako, intervenue quelques jours seulement, après que le ministre des Affaires étrangères de la France a exigé des mouvements armés, en lutte contre Bamako, de « signer sans délai » les « Accords de paix d’Alger ».
Dans son communiqué rendu public, il ne fait aucun doute que c’est la France qui est visée dans cet attentat au Restaurant « La Terrasse », alors que le Belge et les Maliens tués dans une rue adjacente, ne seraient que des victimes collatérales lors de la fuite des assaillants. Le fait que cette attaque soit aussi intervenue dans un contexte marqué par le refus par certains mouvements rebelles de signer les « Accords d’Alger », sous prétexte de la nécessité d’un « délai pour consulter leurs bases », montre bien que ces « accords » ne mettront pas fin à la crise au Nord du Mali.
Ce serait un signal évident de la volonté de mettre en échec ce « compromis franco–algérien » pour ramener la paix dans cette partie de la zone sahélo sahélienne, que reflètent les « Accords d’Alger ». Les autorités françaises se sont avérées incapables de faire accepter par le Mnla, qu’elles ont toujours utilisé dans cette crise, ce « compromis franco-algérien » qui éloigne toute perspective d’un « Etat indépendant touareg » aux frontières de l’Algérie.
En effet, le Mnla est victime du changement politique intervenu en France avec le départ de Sarkozy et l’arrivée de François Hollande. Ce changement au niveau de l’Exécutif français, a entrainé des modifications dans les modalités de mise en œuvre des objectifs géostratégiques des autorités françaises dans la zone sahélo-sahélienne.

C’est ainsi que l’instrumentalisation du Mnla par Sarkozy, dans la mise en œuvre de la politique géostratégique de la France au Mali, avait comme contrepartie sa promesse de le soutenir pour obtenir, de Bamako, son accord pour transformer le Nord Mali en République indépendante de l’Azawad sous la direction de celui-ci.
C’est pour mettre en œuvre cet «Accord», rendu public à plus reprises par les dirigeants du Mnla sans jamais être démentis par les autorités françaises, que ce groupe armé fut transféré et équipé en Libye sous l’égide de la France, pour s’installer au Nord Mali, avant qu’il ne s’attaque aux forces de sécurités du pays pour proclamer l’Indépendance de l’Azawad.
De leur côté, les autorités françaises mirent la pression sur Bamako pour qu’il s’attèle à respecter le calendrier électoral et tenir des élections présidentielles, plutôt que de s’occuper de la libération du Nord Mali transformé en «République indépendante de l’Azawad».
Pour la France, il faillait, après les élections présidentielles puis législatives du Mali, que les nouvelles autorités puissent ouvrir des négociations avec les séparatistes du Nord et non mener une guerre pour libérer cette partie de leur territoire national.
L’acceptation de ce scénario français, par le président Malien de l’époque, Amadou Toumani Touré (ATT), fut fatal à son régime qui fut renversé par un coup d’Etat militaire mené par de jeunes officiers outrés de l’abandon de la souveraineté de leur peuple sur toute l’étendue du territoire malien, dont une partie était livrée à des troupes jihadistes qui se livraient à des massacres des troupes des forces de sécurité et des populations, livrées à elles par le gouvernement malien.
Cette réaction patriotique des jeunes officiers fut, pour Paris, un crime de lèse-majesté qu’il fallait sanctionner sans tarder et de façon exemplaire. C’est ainsi que Paris eut recours aux Chefs d’Etat de l’Uemoa, de la Cedeao et de l’Union Africaine (U.A), qui avaient à leur tête ses «hommes liges» , pour étouffer économiquement, financièrement, militairement et politiquement, le nouveau pouvoir militaire afin de l’empêcher de mobiliser le peuple malien d’un un « rassemblement de salut national» pour libérer le Nord de leur pays, et assurer l’intégrité de leurs frontières et la sécurité du peuple.
C’est pour cela que les avoirs extérieurs du Mali furent bloqués par l’UEMOA, comme cela fut le cas de la Côte d’Ivoire sous BAGBO, et un embargo économique et sur les armes fut décrété par la Cedeao. C’est dans ce cadre que Paris suspendit ses accords de défense avec le Mali, et qu’eut lieu le blocage à Accra des armes commandées par le gouvernement du Mali, bien avant la chute de A.T.T.
Cependant, les tentatives de Sarkozy de mobiliser une armée d’intervention de la Cedeao pour le «rétablissement de l’ordre constitutionnel » au Mali furent bloqués par la résistance du Ghana et du Nigéria, malgré l’activisme de partis politiques et d’organisations de la société civile du Mali, regroupés dans un «Front anti putschiste» pour réclamer le départ des militaires, le retour à l’ordre constitutionnel pour organiser les élections dans le « respect du calendrier républicain».
Ce contexte avait paralysé le nouveau pouvoir militaire et avait permis aux groupes jihadistes de sanctuariser le Nord Mali en y imposant un pouvoir islamique radical et de chasser, vers le Burkina, le Mnla qui les avait associés dans sa lutte indépendantiste.

C’est dans cette situation de triomphe des jihadistes qu’est intervenue la chute de Sarkozy, avec l’arrivée de Hollande qui dut changer de modalités de mise en œuvre de la politique géostratégique de la France, face au nouveau projet des groupes jihadistes,d’étendre leur pouvoir hors des limites du Nord Mali, baptisé République indépendante de l’Azawad, pour s’ébranler vers Bamako.
La France de Hollande ne pouvait donc plus attendre la tenue d’élections, encore moins l’envoi de troupes de la Cedeao, et décidait ainsi de l’« Opération Serval » en s’appuyant non pas sur l’armée malienne pour libérer le Nord Mali, mais sur le Mnla qu’elle a fait revenir du Burkina sous ses ailes. C’est ainsi que l’armée malienne fut parquée dans les environs de Gao, par la France, avec le soutien des Usa et la complicité des Nations Unies qui ont dépêché des forces pour maintenir la paix au Nord Mali, en laissant le Mnla contrôler la région de Kidal, d’où l’ «Opération Serval » avait chassé les jihadistes.
Cette deuxième occupation du nord Mali par le Mnla, grâce à la France, avait fini par convaincre ses dirigeants du respect, par Hollande, des engagements de Sarkozy d’amener Bamako à accepter leur revendication d’indépendance de l’Azawad. Et surtout que le nouveau pouvoir issu des élections présidentielles n’avait pas hésité de faire arrêter les dirigeants du putsch qui a fait tomber ATT et avait libéré certains de leurs principaux dirigeants pourtant accusés de « crimes de guerre », par les Autorités maliennes, et qui avaient même annulé les mandats d’arrêt internationaux lancés contre les autres. D’autant plus que le nouveau pouvoir avait signé de nouveaux « Accords militaires » avec la France, lui permettant d’exhausser son vœu de toujours de faire de la base militaire stratégique de Tessalit, au nord Mali, sa base opérationnelle dans le cadre de sa nouvelle opération militaire dans la zone sahélo sahélienne, baptisée « Bahran ».
Mais ce que le Mnla n’avait pas pu voir venir, c’est le changement de la politique française vis-à-vis de l’Algérie, qui ne voyait pas d’un bon œil l’avènement d’un Etat Touareg dans le nord Mali à ses frontières, et qui faisait d’elle l’alliée stratégique du nouveau pouvoir malien qui voulait empêcher la partition de son territoire. D’où le double rapprochement de Paris et de Bamako vers Alger.
C’est ainsi que l’Algérie, de verrou qu’il faillait faire sauter sous Sarkozy, au même titre que la Libye sous Khadafi, est devenue avec Hollande un partenaire stratégique dans la zone sahélo sahélienne avec qui il fallait coopérer. Et pour le Mali, l’Algérie est devenue un allié stratégique contre un Etat indépendant Touareg au Nord.
Ce n’est qu’avec la tenue des négociations de paix à Alger, que le Mnla a découvert peu à peu le changement de la politique française envers l’Algérie et ses conséquences sur les engagements qu’elle avait pris pour la réalisation de son projet politique. D’où le dépit amoureux entre Paris et le Mnla, qui refuse d’obéir aux injonctions de Paris pour signer « les Accords de Paix » d’Alger, et l’attentat spectaculaire du mouvement jihadiste proche de Al Qaida qui vient rappeler tristement ses engagements d’hier, à la France, vis-à-vis de l’Azawad.
Comme les Etats Unis avec l’Armée de l’Etat Islamique qu’ils ont aidé à s’armer et à s’entraîner contre la Syrie, et qui aujourd’hui s’est retournée contre les intérêts américains dans cette sous région du Moyen Orient, la France risque de voir un nouveau rapprochement du Mnla avec les groupes jihadistes, pour frapper ses intérêts dans la zone sahélo sahéliennes. Et Bamako, risque de retourner à la case départ pour défendre militairement l’intégrité de son territoire et la sécurité de ses populations.
La France, une fois Tessalit en poche, veut se retirer du Mali le plus rapidement possible pour concentrer ses efforts militaires au soutien du Tchad et du Niger dans la guerre contre Boko Haram, et exploiter au maximum, par sa présence, les conséquences de la reconfiguration du Nigéria et du Cameroun qu’entrainerait inéluctablement la partition attendue du Nigéria sous les effets conjugués des coups de Boko Haram et d’une grave crise post électorale. D’où son engagement total au « compromis franco-algérien » de paix qui lui permet, avec l’implication totale de l’Algérie, de mieux assurer la sécurité de ses intérêts économiques dans la zone, contre les jihadistes.
En effet, une crise post « électorale qui va paralyser l’Etat nigérian serait du pain béni pour Boko Haram en vue de faire éclater le Nigéria au détriment de nos aspirations pan africaines, et de la sécurité de nos peuples.
Les Nigérians qui ont poussé leur pays vers ce gouffre ont trahi à jamais ces aspirations des peuples d’Afrique pour satisfaire les intérêts géostratégiques des Usa et de la France en Afrique. Ils n’ont tiré aucune leçon de ceux qui, au Moyen Orient et au Mali, ont servi pour faire cette sale besogne pour les grandes puissances occidentales et qui aujourd’hui, par « dépit amoureux » s’en prennent à elles.
La preuve est aussi faite, que les « Accords de défense » avec la France et les Usa, signés par nos gouvernants, ne résistent nullement à leurs intérêts stratégiques qui priment sur nos intérêts nationaux que ces «Accords» sont censés défendre.
Bamako, devrait donc, lui aussi, profiter de l’implication totale d’Alger pour faire appliquer ces « accords de paix », et solliciter le soutien de la Cedeao, sous la direction du Ghana, et de l’Ua, sous la direction de Mugabe, pour faire respecter l’intégrité de son territoire et y assurer la sécurité de ses populations.
Plus que jamais, avec les « Accords d’Alger », les conditions sont politiquement réunies pour permettre à la Cedeao et à l’Ua, de remplir leurs missions historiques d’intégration de nos forces armées et de sécurité, pour défendre l’intégrité territoriale des Etats issus du colonialisme et la sécurité de leurs populations.
C’est ce défi que la crise politique et militaire du Nigéria lui impose aussi de relever. C’est pourquoi, il est attendu du pde la Cedeao et de l’Ua de s’impliquer auprès des partis politiques en compétition et des organisations de la société civile du Nigéria, pour éviter tout recours à la violence ou à la paralysie de l’Etat, pour régler les contentieux électoraux que le monde entier attend et que l’Afrique redoute profondément.
Pan Africanistes de tous les pays d’Afrique et de la Diaspora, Unissons-nous pour le respect des « Accords de paix d’Alger », et pour un « traitement politique » approprié de toute crise post électorale au Nigéria. Ne laissons pas les ennemis de l’Afrique nous avoir une nouvelle fois.
* journaliste à Penbazuka.org
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, géopolitique, afrique, affaires africaines, mali, azawad, france, géostratégie, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’inévitable chemin vers Damas
Chems Eddine Chitour*
Ex: http://metamag.fr

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, proche orient, levant, syrie, france, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Mit »Cips« gegen Swift: BRICS forcieren Bau der neuen Weltordnung

Mit »Cips« gegen Swift: BRICS forcieren Bau der neuen Weltordnung
Markus Gärtner
Die westliche Systempresse schreibt eifrig die BRICS-Gruppe mit über drei Milliarden Menschen in Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ab. Die Leitmedien illustrieren ausführlich wirtschaftliche und politische Plagen von Peking bis Moskau, die freilich nur die Hälfte der Wahrheit darstellen: Strauchelnde Regierungen, einbrechendes Wachstum sowie öffentliche Budgets, die Fässern ohne Boden gleichen.
Das ist derzeit in der tonangebenden Presse das durchgängige Szenario. Es soll suggerieren, dass Nordamerika und Europa trotz verheerender Schuldenberge, Vergreisung und Reformmüdigkeit sowie einem absurd aufgeblähten und vom Kollaps bedrohten Finanzsystem immer noch relativ gut dastehen und alternativlos dominieren.
Das Ablenkungsmanöver des Mainstreams wird dadurch abgerundet, dass wir als Publikum fast nirgends lesen, wie dramatisch sich in diesen Wochen das Entstehen eines neuen politischen und wirtschaftlichen Machtblocks in Asien, Südamerika und Afrika beschleunigt.
Die BRICS setzen in Windeseile um, was sie seit Monaten angekündigt haben. Sie bauen eine neue globale Ordnung, die die sklerotische westliche Infrastruktur schon bald ablösen soll.
Doch in den etablierten Zeitungen lesen wir fast nur, dass die großen Wachstumsmärkte jetzt ebenfalls auf den Bauch gefallen sind. Nach dem Motto: Die autoritär geführten Schwellenländer können es auch nicht besser.
Weiterlesen:
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, brics, économie, finances, devises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 mars 2015
El futuro de Eurasia: prolegómenos para la integración geopolítica del continente
Por Leonid Savin
Ex: http://www.elespiadigital.com
El comienzo del siglo XXI no ha sido tan color de rosa como fue descrito por los futurólogos y planificado por los políticos: una crisis financiera mundial, los problemas dentro de la zona euro, el “pantano” para las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán, los conflictos armados en Europa Central, Norte de África y el Medio Oriente, una serie de revoluciones de color en el espacio post-soviético, y disturbios en las capitales de Europa Occidental. Se diría que con la tecnología moderna, la herencia histórica y el acuerdo convencional sobre los derechos humanos, Europa ya ha definido su futuro y, si no está siguiendo lo planificado, por lo menos está manteniendo las políticas regulatorias en el ámbito de su competencia. Sin embargo, los desarrollos actuales indican que todo resultó ser más complicado. El mundo ha entrado en una zona de turbulencia geopolítica, con procesos en varios niveles, nuevos retos y respuestas asimétricas.
Además de la vieja dicotomía entre conservadores y progresistas, surgen en Europa nuevas tendencias políticas que intentan repensar su europeidad y priorizar el futuro desarrollo y la supervivencia. Variantes en relación al tema del futuro de la OTAN y la planificación de la defensa conjunta con los EEUU, fluyen desde cumbres marginales y anti-globalización como desde un fondo político intelectual, lo que demuestra la inutilidad de ejecutar la política de antiguos vectores.
La situación es tal que el debate contemporáneo en torno al futuro de Europa, el destino de Rusia y de otros países del continente, no puede considerarse por separado. De la investigación etimológica al replanteamiento pragmático del viejo Lebensraum (incluyendo la dependencia de recursos) – de una forma u otra, la superpoblada orilla de Eurasia desde Gibraltar hasta el mar de Barents está volviendo su mirada hacia el Este.
En cierta época, los conceptos de “Europa” y “Asia” se limitaron al mundo helenístico y a los países vecinos, dentro de un paradigma que asignó significados particulares. La expansión del Imperio Romano, la era de la gran migración y la difusión del cristianismo, cambiaron la estructura política de la parte occidental del continente euroasiático. Mientras esta región se sumergió en un frenesí feudal, un nuevo imperio se formó en las fronteras orientales. La Horda de Genghis Khan logró en un tiempo extraordinariamente corto unir por la fuerza kanatos, reinos y principados, extendiéndose a través de miles de kilómetros, mostrando un nuevo modelo de Estado, de diplomacia y de tácticas militares. La importancia histórica del proyecto mongol es simplemente asombrosa. Nadie más, ni antes ni después, fue capaz de crear tal vasto Imperio. Mientras tanto, hay claros marcadores geopolíticos de este fenómeno. Historiadores europeos modernos han señalado que la Rus había frustrado la oleada de nómadas de Asia hacia Occidente, salvando así a Europa de una inminente desaparición. Interpretaciones completamente diferentes se expresaron en relación con el destino de Rusia. Aunque la escuela soviética de pensamiento insistió en la existencia del yugo mongol-tártaro, la escuela histórico-filosófica euroasianista refuta tales supuestos, con el apoyo de elementos de hecho. De acuerdo con la teoría del cambio de los imperios, la Rus tomó la batuta de las hordas ya fragmentadas, en gran medida tomando prestados sus mecanismos de construcción del Estado, necesario para una mayor expansión.
Aunque anteriormente hubiera “campañas contra los cismáticos” y otros obstáculos (como en todas partes), la primera confrontación total de Oriente y Occidente comenzó con la “era de Gutenberg” [1]. La imprenta, originalmente concebida con el fin de ayudar a difundir la Palabra de Dios, no sólo dio lugar a un efecto contrario (porque la difusión de la Biblia socavó la autoridad de la Iglesia Católica), sino también a la aparición de las primeras instituciones de la guerra de la información. Mientras que las primeras embajadas de Europa occidental viajaron para comerciar con Moscú, la población local fue sometida a un adoctrinamiento, recurriendo a las metáforas del Antiguo testamento y creando una imagen poco favorecedora de los gobernantes de Rusia y de su pueblo.
Sin embargo, la primera ola de globalización que termina con el descubrimiento de América, apareció como el comienzo de una nueva era global. Al mismo tiempo, Europa, desgarrada por guerras y contradicciones, trasladó parte de su teatro de operaciones de combate a los territorios de los nuevos espacios abiertos, inaugurando así el comienzo de nuevos procesos civilizatorios.
Todavía había muchos episodios de comprensión mutua entre Rusia y Europa en una serie de cuestiones, sin embargo, con el inicio del siglo XX, la modernidad alcanzó todo su potencial, y tres ideologías principales saltaron a la arena: el marxismo con el postulado de la la lucha de clases; el corporativismo estatal con una perspectiva nacional, que se convirtió en el nacionalsocialismo y el fascismo; y el liberalismo. Las tres tendencias ideológicas no eran ajenas a las cuestiones territoriales, nacionales y de recursos, pero parece que la escuela geopolítica anglosajona deliberadamente ha demonizado a Rusia. Ellos hicieron de Rusia, conceptualmente, no sólo un Heartland, sino también una fuente de inestabilidad, de donde se originó el “tierra de vándalos” a imagen de los hunos, los turcos y los mongoles, que atacaron los alrededores del mundo romano [2]. A estas alturas, con la memoria histórica ya debilitada, después del colapso del Imperio Austro-Húngaro pocos estuvieron interesados en la historia del pueblo húngaro, que venía desde más allá de los Urales, y otros temas fueron pasados por alto. ¿Quién recuerda ahora a los ávaros, que una vez penetraron en el territorio de la actual Alemania y, de hecho, crearon Baviera (y ahora el tipo antropológico de la población de esta tierra federal es marcadamente diferente del de los sajones o de Westfalia), o de los eslavos, presidiendo el área del actual Berlín? ¿Y recuerdan en los círculos políticos polacos las ideas de un destacado dramaturgo y escritor, Stanisław Witkiewicz, quien en la década de 1930 expresó en su metáfora artística la ansiedad asociada a la amenaza de la migración desde China? [3]
Aunque estas observaciones pueden parecer insignificantes, son todos eslabones de una cultura estratégica de uno u otro estado con su pueblo, de alguna manera realizados en la geopolítica popular.
Turquificar Alemania, africanizar Francia, indianizar el Reino Unido, magrebizar Italia y España, y un número aún no determinado de chinos, vietnamitas y otras diásporas asiáticas en cada país de la UE, en la dinámica geopolítica, puede conducir a resultados muy impredecibles [4]. Mas la rápida islamización de los países europeos en el contexto de un declive demográfico de la población nativa. El estado de ánimo actual en algunos países de la UE, en particular entre los nuevos miembros, muestra claramente que a la gente no le gustan los proyectos de etno-globalización en su tierra natal, al menos en su forma presente [5]. Característicamente, el principal vector de la migración actual pasa por el eje Norte-Sur, no por el eje Este-Oeste, donde la frontera sanitaria artificial todavía juega el papel de parachoques disuasorio.
La guerra fría no sólo condujo a la división en dos bandos, sino también a la aparición de una nueva terminología. En Occidente hay una cristalización final de la filosofía política, conocida como atlantismo. Un político británico, John Williams, amplía este término calificándolo como teología atlantista [6]. Afirma que, como cualquier teología, el atlantismo se basa en el mito de que, en última instancia, los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Europa y Estados Unidos son inseparables. Al mismo tiempo, Williams cree que las relaciones entre los EEUU, Europa y Rusia durante la Guerra Fría son también otro mito, que se tradujo en una crisis de identidad propia.
La sustitución por el neo-atlantismo (el neologismo nació en Italia en la década de 1950) [7] como definición de las nuevas relaciones entre los miembros de la comunidad atlántica, tampoco duró mucho y está perdiendo rápidamente su sustancia interna. Así como con las instituciones de la democracia, resulta obvio que va a declinar. En este sentido, cabe señalar que el término “déficit democrático” ha surgido en Europa en 1977 para definir la incapacidad de los países miembros de la UE para abordar las cuestiones relacionadas con las necesidades de los ciudadanos europeos [8].
En este contexto, viendo a los Estados Unidos como su sucesor geopolítico, la Europa unida debe reconocer que no estaba en condiciones de hacer frente al programa de “Melting Pot“, y digerir todos los inmigrantes de sus antiguas colonias, junto con la nueva fuerza laboral de la migración continua.
El cuadro de la Europa pos-Guerra Fría fue transformado por la admisión de nuevos miembros en la UE. El factor mar Báltico-Negro fue añadido al factor dominante Atlántico-Mediterráneo, y los países de esta región se vieron obligados a enfrentarse a una serie de cuestiones: la adaptación del sistema jurídico, las instituciones políticas y civiles, la economía; tratando de preservar su memoria y sus tradiciones históricas nacionales al mismo tiempo. Junto con esta expansión geográfica fue posible la aparición de un discurso sobre el nuevo eje geopolítico, en cierta medida compitiendo con el viejo eje [9]. La cuestión de la centralidad para definir la nueva Europa (el término de Friedrich Naumann “Middle Europa“) también siguió siendo reinterpretada. Se propusieron definiciones tales como “MidiEurope“, “Dimidial Europa” y “Viscalian Europa“, que se basan en los términos latinos correspondientes [10]. Éstas definiciones se superponen con los conceptos existentes de Euroregiones, basados en el modelo de cuenca (el área de las cuencas del Mosa-Rin, las tierras bajas del Danubio). Una escuela geopolítica alemana sobre Eurafrica sonó de nuevo, sin embargo, bajo la influencia de los intereses franceses – creando así el fantasma de la Unión Mediterránea, que no pudo llegar a buen puerto debido al bloqueo alemán a la posibilidad de este proyecto. Del mismo modo, en las nuevas versiones posmodernas y tecno-políticas (con la energía y el componente de la comunicación) fue revivido el proyecto de Mezhmorye (“entre los mares” Báltico y Negro), del geógrafo y cartógrafo polaco Eugeniusz Romer, el prototipo que a su vez sirvió para la idea de Jagiellonian (Gran Lituania). Junto con los atractivos respecto a la comunicación (la adaptación de la ruta “desde los varegos a los griegos” en un nuevo guión), este modelo geopolítico tuvo un componente étnico-nacional, se asumió que la identidad cultural báltico-eslava serviría como una base adicional para la ejecución de este proyecto. Pero las preguntas acerca de la pertenencia a un tipo de civilización [11], a veces llamada el mundo occidental-cristiano o el super-ethnos europeo-occidental, condujo al descubrimiento de algunas contradicciones profundamente arraigadas en función de factores históricos o etno-políticos, que también tienen un componente pragmático que se expresa en la estructura de las fronteras y los puntos de vista sobre la asignación de los recursos. Frente la presión de los antiguos miembros de la UE para la homogeneización del espacio económico, que se refleja sobre todo en el hecho de que las empresas transnacionales han tenido acceso a los recursos nacionales, los Estados del eje mar Báltico-Negro estaban interesados en medidas proteccionistas contra un efecto tan unilateral de globalización.

Podemos decir que los intentos iniciales para establecer una Unión de cooperación regional, junto con los componentes históricos, hasta cierto punto han servido como base para la remodelación de este proyecto en un plano estratégico diferente, más amplio, que afecta a los intereses de las grandes potencias – continental (Euroasiática) y atlantista (mundialista). No es casualidad que cierto número de investigadores comenzaran a comparar el modelo del eje mar Báltico-Negro con una frontera sanitaria, como la que se formó después del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial. Un proyecto geopolítico, indirectamente asociado con tales ideas, llamado GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldavia), que no tuvo ningún verdadero desarrollo y fue concebido como un proyecto de los países occidentales (incluyendo los EEUU) para crear una barrera artificial entre la Rusia moderna y la UE.
Podemos recordar otra serie de proyectos, ni siquiera realizados, como Chimerica o Сhindia, pero a juzgar por la posición de la futura integración de Rusia y Europa, que en teoría es el proyecto más grande e importante que podría cambiar el orden mundial, es necesario hacer algunas observaciones preliminares. La alianza llamada Eurosiberia ya era considerada como una opción de futuro. La necesidad de convergencia fue destacada por Jean Thiriart, quien soñaba con un imperio desde Dublín hasta Vladivostok (no obstante, prediciendo la caída de la URSS).
Los opositores intransigentes a la amistad y la cooperación con Rusia apuntan a los precedentes históricos y a la imprevisibilidad del gobierno ruso. En realidad, Europa vió muchos más conflictos históricos. Incluso después de los Acuerdos de Helsinki, una guerra civil estalló en el corazón mismo de Europa – la de Yugoslavia, que tuvo consecuencias de largo alcance, incluyendo el reconocimiento de Kosovo. El movimiento moderado de los secesionistas y el separatismo radical en España, el Reino Unido y Bélgica continúa hasta nuestros días. Y quien vigile de cerca la crónica de los acontecimientos internacionales, encontrará fácilmente que los EEUU es el más impredecible: la promesa de no ampliar la OTAN hacia el Este en la década de 1990 y de permanecer en Kirguistán sólo durante dos años en la base de Manas (y en muchas otras, incluso en los países de la UE), fueron promesas vacías. Y si en este tipo de cuestiones de principio no existe ninguna garantía de que Washington no vaya a engañar de nuevo, ¿cómo es posible además trabajar con un socio tan fiable?
Ahora estamos en el siguiente punto de bifurcación, cuando existe una oportunidad de hacer un breve alto en el camino y repensar los procesos asociados a los patrimonios territoriales, los estados nacionales, los agravios históricos, etc., para crear una nueva estrategia común, adecuada para todos los actores de Eurasia. Por supuesto, el término puede tener varios significados semánticos. Por ejemplo, la India, China y el sudeste asiático son aglomeraciones demasiado específicas incluso para las antiguas repúblicas soviéticas. Y los primeros euroasianistas imaginaron Eurasia como Rusia, y no como Europa más Asia, considerándolo un mundo único. Sin embargo, Eduard Suess, en su obra fundamental “The Face of the Earth” [12], utiliza el concepto de Eurasia apuntando la arbitrariedad de los límites entre Europa y Asia, y que las fronteras no son sólo una herramienta de separación, sino también un fenómeno social complejo que une a las naciones y a los pueblos.
Quizás muchos señalarán un tipo muy diferente de conciencia de los pueblos y países desde Chukotka hasta el Atlántico, pero ¿sobre qué base los pueblos de Europa construirán juntos una existencia colectiva si ya hay tantas contradicciones en la UE? En nuestra opinión, para crear una plataforma geopolítica compartida que pueda satisfacer a todos, o al menos a la mayoría de las fuerzas, los desacreditados conceptos de democracia y liberalismo, y el populismo social de izquierda de partidos y líderes particulares, que son una nueva versión de la consigna de los francmasones – “libertad, igualdad, fraternidad” -, son poco adecuados. ¿Qué nueva idea debería unir y satisfacer a todos los pueblos de Eurasia?
El fundador del movimiento eurasiático, el geógrafo Petr Savitsky, propuso un modelo de ideocracia que se caracteriza por una visión del mundo compartida, y por la buena voluntad de las élites gobernantes en servir a la única idea rectora que representa “el beneficio del colectivo de los pueblos que habitan este particular mundo autárquico”[13]. Esta es una muy buena definición, y si este mundo se interpreta como el espacio del continente euroasiático, hay muchos puntos en común y perspectivas para una realización creativa.
Además, el común destino continental es el elemento vinculante que apunta las condiciones geopolíticas comunes. No es coincidencia que Hitler tratara de llegar hasta los Urales, lo cual habla acerca de la integridad de la plataforma del Este europeo, no obstante, incluso los Urales no son ya una barrera, y el extremo Oriente está más “europeizado” que algunas ciudades en las inmediaciones de Moscú. Las comunicaciones modernas y los centros de transporte crearon un mosaico geopolítico polifacético de un mismo cuadro. Y si antes del siglo XX todavía era posible hablar de un “obstáculo eurasiático”, en referencia a la extensión de las tierras del Imperio Ruso, a las eternamente congeladas latitudes del norte, y a la carencia de acceso a los mares cálidos, separados por Persia y la India, ahora todo eso es facilitado por los proyectos de infraestructura de transportes, las nuevas tecnologías y la comprensión de los principios de autarquía económica propuestos por Friedrich List.
Hace mucho tiempo llegó un momento en el que, a partir de pequeños grupos construidos sobre el principio de la autosuficiencia, fue necesario trasladarse a las zonas de “topogénesis” (o el lugar de desarrollo, el término propuesto por Peter Savitsky para explicar el conjunto de factores geográficos, étnicos, económicos, históricos y otros, que representan un todo) [14], y Grandes Espacios de Carl Schmitt. Dado el sistema político internacional contemporáneo de múlti-capas y multi-nivel, tal proyecto es factible.
Si bien no vamos a hablar sobre el futuro de la política migratoria (aunque Rusia tiene una gran cantidad de territorios no desarrollados que, como antes, pueden ser poblados por extranjeros – Catalina la Grande dio tierra a los alemanes; los kurdos, los serbios y otros pueblos encontraron refugio en Rusia), este delicado asunto debería ser resuelto con cuidado y gradualmente.
Aún así, hay que sacar algunas conclusiones relacionadas con la posibilidad de crear una configuración supranacional unificada.
La UE debería reconocer su dependencia constante de los recursos energéticos rusos. El “North Stream” ya había conectado Rusia con Alemania. El “South Stream” finalmente cerrará la dirección del Mar Negro. Todos los pragmatistas entienden que la idea de “Nabucco” es desequilibrada y motivada políticamente. Las tecnologías verdes resuelven el problema sólo parcialmente. Además de la energía, hay otros recursos naturales, incluyendo el agua, los minerales, los bosques, etc. Rusia ocupa una sexta parte de la tierra y posee el máximo inventario de estos recursos. Por supuesto, con las políticas posmodernas actuales y los procesos de globalización, uno puede ser dueño de la tierra de manera extraterritorial, pero en el caso de Rusia, al menos en el corto plazo, eso no es posible. Sólo las inversiones mutuas y los proyectos de integración (comenzando con la cancelación del régimen de visados), pueden abrir el acceso real a la gestión de estos recursos en nombre de los intereses comunes.
Es una cuestión de voluntad política. Sólo los fuertes pueden crear una formación tan gigantesca. Hagamos que esto sea una voluntad colectiva, aunque debemos actuar con decisión y audacia. Llámelo una autodeterminación geopolítica de todos los participantes del proceso.
Es posible que, junto con los procesos globales, nuevos horizontes conducirán a la creación de una nueva clase (relativamente hablando), y darán lugar a la superación de la dicotomía derecha-izquierda en algunos sistemas políticos. En el período de entreguerras en Europa hubo intentos de poner en práctica iniciativas interesantes bautizadas como “la tercera vía”. Es posible que en el proceso de diseño político una nueva teoría política sea creada [15].
¿Cómo continuará la discusión política, social, económica, de defensa y sobre muchos otros temas? Sólo podemos decir que es necesario un “multiálogo” [16] como herramienta para la comunicación interestatal y para la comunicación internacional, en el proceso de producción de las normas y las instituciones necesarias.
A pesar del proceso de creación de la Unión Euroasiática, como Vladimir Putin dijo en octubre de 2011 hablando de la participación de la UE en la construcción de Eurasia, tal proyecto está aún, al margen del discurso de grupos intelectuales independientes, sólo en el esfera de la imaginación. Pero, como escribió un famoso teórico estadounidense del comunitarismo, Michael Walzer, incluso un estado es invisible, y para que aparezca, debe ser imaginado, debe dársele un carácter, y luego, personificarlo y hacerlo visible. La imaginación, según Albert Einstein, es mejor que el conocimiento, por lo tanto, la configuración emergente de Eurasia es el retorno de un sueño para todos los pueblos del continente, que serán capaces de poner en práctica gradualmente en la realidad. Y el conocimiento existente (incluyendo la experiencia negativa), y la tecnología deberían ser instrumentos para esta Gran Empresa Geopolítica.
Notas:
[1] Marshall McLuhan. The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, 1962.
[2] J. Mackinder Halford. The Geographical Pivot of History, Geographical Journal, London, 1904.
[3] Stanislaw Witkiewicz. Nienasycenie. Powiesc, t. 1-2, Warsz., 1957.
[4] La cuestión del etnocentrismo en un estado nacional, es decir, la división entre “nosotros” y “ellos”, se planteaba a menudo en el discurso ideológico, reflejándose, por ejemplo, en una “caza de brujas”, y en una política nacional. Sin embargo, incluso en una sociedad homogénea en términos culturales y étnicos, siempre habrá algunos mecanismos invisibles que empujan a la violencia mutua. El filósofo francés René Girard propone apartarse del modelo de “etnocentrismo” y buscar la causa dentro de la sociedad, que durante la historia del mundo siempre ha necesitado un chivo expiatorio. Para obtener más información, consulte René Girard. La violencia et le Sacre. Grasset y Fasquelle, 1972.
[5] La prueba de esto es el fracaso del proyecto de la multiculturalidad, lo que fue reconocido por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy.
[6] John Williams, Atlanticism: The Achilles’ Heel of European Security, Self-Identity and Collective Will. http://www.redpepper.org.uk/atlanticism/
[7] Pietro Pirani. “The Way We Were”: Continuity and Change in Italian Political culture. 5, 2008. http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2008/Pirani.pdf
[8] Laffen, B. “Democracy and the European Union’, in Cram, L., Dinan, D. and Nugent, N. (eds.)
-Developments in the European Union, London: Macmillan Press Ltd., 1999, p. 334
[9] Leonid Savin. And the geopolitics of regional risks, Geopolitics No. 10
[10] Drynochkin A.V. Eastern Europe as an element of system of global markets. M: Olita, 2004. p. 11.
[11] Hay que señalar que no existe una clara interpretación del término “civilización”.
[12] Suess, Eduard. Das Antlitz der Erde. Wien, 1885.
[13] N.S. Trubetskoy. Acerca de la idea de un estado ideocrático, Eurasian chronicle. Issue XI. Paris, 1935. pp. 29-37.
[14] Peter Savitsky. The Continent Of Eurasia. – M.: Agraffe, 1997.
[15] Alain de Benoist propone llamar a una futura teoría que trascienda el marco del marxismo, el liberalismo y el fascismo, el Nuevo Nomos de la Tierra, y el profesor Alexander Dugin llama a tal ideología la Cuarta Teoría Política.
[16] Duke R. Gaming: The Future Language. N. Y.: Sage Publications, 1974.
(Traducción Página Transversal)
00:05 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, eurasie, eurasisme, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
China en Rusland lanceren in herfst anti-dollar alliantie

Rusland blijft Amerikaanse staatsobligaties dumpen
Het Amerikaanse dollar imperium loop op zijn einde.
Inzet: Enorm reclamebord in Bangkok, waar de Bank of China adverteert met ‘RMB (renminbi): De Nieuwe Keus – De Wereld Munt.’
Het einde van het Amerikaanse dollar imperium is een grote stap dichterbij gekomen nu na Rusland ook China een alternatief lanceert voor het door Amerika gedomineerde wereldwijde SWIFT betalingssysteem. Rusland werd hiertoe gedwongen door de Westerse sancties in verband met de situatie in Oekraïne. China is er echter op uit om op termijn de dollar als wereld reservemunt van de troon te stoten, en adverteert daar zelfs openlijk mee (3). Als in september of oktober het Chinese alternatief van start gaat en een succes wordt, dan dreigt een spoedige instorting van de Verenigde Staten als supermacht.
De al jaren dreigende ontkoppeling van de opkomende BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid Afrika) met de dollar wordt in het Westen nog altijd niet echt serieus genomen. Inmiddels blijkt dit proces al veel verder gevorderd te zijn dan ooit voor mogelijk werd gehouden.
Rusland lanceert alternatief en dumpt Amerikaanse staatsobligaties
Na uitgesloten te zijn van het internationale SWIFT betalingssysteem, een sanctie als gevolg van de –zoals onze lezers weten niet bestaande- Russische militaire acties in Oekraïne, lanceerde het Kremlin een alternatief waar meteen al 91 kredietinstellingen bij aangesloten werden. Tegelijkertijd dumpten de Russen een record hoeveelheid Amerikaanse schatkistpapieren, alleen al in december 2014 voor een bedrag van $ 22 miljard, maar liefst 20% van hun totaal (2).
Het Westen deed nogal lacherig over Ruslands alternatief voor SWIFT, want wat zou dat systeem voor zin hebben als andere landen er geen gebruik van zouden maken? Mocht dat onverhoopt wél gebeuren, dan zou de status van de dollar ernstig worden ondermijnd.
Chinezen lanceren in herfst CIPS
Nu blijkt dat het ‘onverwachte’ gevolg een Chinese navolging van de Russische stap is. Ook de Chinezen lanceren nu hun eigen internationale betalingssysteem: CIPS (China International Payment System), dat grensoverschrijdende transacties in yuan (renminbi) gaat regelen. Dit systeem zal mogelijk al in september of oktober actief worden.
De Westerse provocaties in Oekraïne hebben dus niet alleen Rusland, maar ook China er versneld toe aangezet stappen te ondernemen om de dollar los te laten. Eerder besloten Moskou en Peking al om een deel van hun onderlinge (olie)handel in de eigen valuta te gaan afrekenen.
Rol yuan in wereldhandel groeit snel
In november 2014 haalde de Chinese munt de Canadese en Australische dollar in en kwam het in de top-5 van internationaal meeste gebruikte valuta terecht. Tot nu toe moeten grensoverschrijdende yuan-transacties via zogenaamde clearing banken worden afgehandeld, maar met het nieuwe CIPS is die tussenstap niet langer nodig.
Omdat China de VS als grootste economie ter wereld aan het inhalen is, zal met CIPS steeds meer internationale handel niet langer in dollars, maar in yuans worden afgerekend. In december vorig jaar steeg het aantal wereldwijde betalingen met de Chinese munt al met 20,3% ten opzichte van een jaar eerder.
Rusland en China ‘gedwongen’ door regering Obama
‘Gesteld kan worden dat als het inderdaad een briljante tactische zet van de regering Obama was om Rusland –en door geopolitieke verwantschap ook China- uit het door de VS gecontroleerde monetaire transactie mechanisme te zetten en daarmee de twee grootste uitdagers van de Amerikaanse wereldwijde dominantie in hun eigen –of gezamenlijke- betalingssysteem te dwingen - wel, gefeliciteerd dan: dat is gelukt,’ wordt op de onafhankelijke financieel-economische website Zero Hedge sarcastisch geconcludeerd. (1)
Xander
(1) Zero Hedge
(2) Zero Hedge
(3) Zero Hedge
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, devises, dollar, yuan, rmb, rouble, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, chine, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 mars 2015
L'Amérique Latine défend le Venezuela face au décret du président Obama

L'Amérique Latine défend le Venezuela face au décret du président Obama
Rapprochement de Caracas avec Athènes
Après la décision du président Barack Obama, le 9 mars 2015, de décréter « l’urgence nationale aux États-Unis » face à la « menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et notre politique extérieure qu’est le Venezuela » (sic), le président de Bolivie Evo Morales a demandé une réunion d’urgence de l’UNASUR (organisme regroupant la totalité des nations sud-américaines) et de la CELAC (Communauté élargie des États Latino-américains et des Caraïbes) « pour nous déclarer en état d’urgence et défendre le Venezuela face à l’agression de Barack Obama. Nous allons défendre le Venezuela » Il a souligné l’importance de l’unité des peuples face à l’Empire qui tentent de « nous diviser, pour nous dominer politiquement et nous spolier sur le plan économique ».
Le président Correa, à travers son chancelier, a exprimé son « rejet le plus ferme de la décision illégale et extra-territoriale contre le Venezuela, qui représente une attaque inacceptable pour sa souveraineté ». Il a rappelé le signal négatif que constitue la signature de ce décret par Obama 48 heures après la visite de travail de l’UNASUR à Caracas. Cette délégation a enquêté sur la récente tentative de coup d’État contre le président Nicolas Maduro, élu en avril 2013, a rejeté l’ingérence extérieure, demandant aux secteurs violents de l’opposition de revenir à la voie électorale.
« Comment le Venezuela menace-t-il les Etats-Unis? A des milliers de kilomètres de distance, sans armes stratégiques et sans employer de ressources ni de fonctionnaires pour conspirer contre l’ordre constitutionnel étasunien ? Une telle déclaration faite dans une année d’élections législatives au Venezuela révèle la volonté d’ingérence de la politique extérieure étasunienne. » a déclaré pour sa part le gouvernement cubain.
Les mouvements sociaux latino-américains se sont mobilisés en défense de la démocratie vénézuélienne. Pour Joao Pedro Stédile, de la direction nationale du Mouvement des Sans Terre du Brésil : « Au Brésil il y a un peuple qui est avec vous, nous serons toujours solidaires et nous ne laisserons pas l’Empire envahir le Venezuela pour récupérer ses gisements de pétrole ». Le mouvement social bolivien a également manifesté sa solidarité. Rodolfo Machaca, dirigeant de la Confédération syndicale des travailleurs agricoles, a condamné l’ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures vénézueliennes, et leur complicité avec les violences organisées par la droite. Selon Machaca : « La situation au Venezuela nous préoccupe, c’est pourquoi nous proclamons notre solidarité avec ce pays, mais aussi avec le président Maduro. Nous condamnons l’ingérence nord-américaine, et toutes les tentatives de coup d’État ou autres manœuvres visant à la déstabilisation du Venezuela. ».
Rafael Correa dénonce les manipulations médiatiques contre le Venezuela
 Le 1er mars, depuis Montevideo, où il assistait à l’investiture du président uruguayen Tabaré Vasquez, le président Correa a déclaré : «Le Venezuela est confronté à une guerre économique et médiatique, et se retrouve dans la situation d’autres gouvernements progressistes d’Amérique latine, avant lui. Cette situation, on l’a déjà vécu en Amérique latine. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à (Salvador) Allende : la même guerre économique, le même type d’ingérence, les mêmes attaques médiatiques. De grâce, tirons les leçons de l’Histoire ». Selon Correa, cette ingérence « ne débouchera pas forcément sur ce qui est arrivé à Allende. Il n’en demeure pas moins que nous sommes confrontés chaque jour aux tentatives de déstabilisation de gouvernements démocratiques et progressistes d’Amérique latine, par la guerre économique, et à la manipulation mondiale en matière d’information ».
Le 1er mars, depuis Montevideo, où il assistait à l’investiture du président uruguayen Tabaré Vasquez, le président Correa a déclaré : «Le Venezuela est confronté à une guerre économique et médiatique, et se retrouve dans la situation d’autres gouvernements progressistes d’Amérique latine, avant lui. Cette situation, on l’a déjà vécu en Amérique latine. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à (Salvador) Allende : la même guerre économique, le même type d’ingérence, les mêmes attaques médiatiques. De grâce, tirons les leçons de l’Histoire ». Selon Correa, cette ingérence « ne débouchera pas forcément sur ce qui est arrivé à Allende. Il n’en demeure pas moins que nous sommes confrontés chaque jour aux tentatives de déstabilisation de gouvernements démocratiques et progressistes d’Amérique latine, par la guerre économique, et à la manipulation mondiale en matière d’information ».
Au sujet de l’arrestation du maire d’opposition de Caracas, Antonio Ledezma, accusé d’implication dans un complot visant à déstabiliser le gouvernement de Nicolas Maduro, le président Correa a déclaré qu’il était « réducteur de commenter cet événement sans connaître les détails de l’affaire, en outre la souveraineté et les institutions de chaque pays doivent être respectées ».
Le Venezuela et la Grèce renforcent leurs relations bilatérales
En visite officielle en Grèce le 6 mars, la ministre des Affaires étrangère Delcy Rodriguez a félicité le nouveau gouvernement du premier ministre Alexis Tsipras, au nom du Gouvernement Bolivarien et du peuple vénézuelien. Dès la victoire de Syriza, Maduro avait salué la décision des électeurs malgré « la campagne médiatique qui tentait de leur faire peur en présentant notamment Alexis Tsipras comme l’agent d’une dictature vénézuélienne »
La Chancelière vénézuélienne a été reçue par Alexis Tsipras qui a manifesté son intention d’accueillir prochainement en Grèce le président Nicolas Maduro, assurant de son soutien le Venezuela et son peuple et insistant sur l’affection qu’il lui porte.
Accompagnée de l’ambassadeur du Venezuela en Grèce – Farid Fernandez – Mme Rodriguez a eu aussi l’occasion de rencontrer son homologue grec Nikos Kotzias (photo). La réunion a porté sur la possibilité de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine économique et commercial. Nikos Kotzias a reçu des informations sur la situation actuelle au Venezuela et a souligné l’importance de nouer des relations solides dans les domaines de la technologie, de l’économie, du commerce et du tourisme.
Un désir commun s’est exprimé : qu’Athènes devienne l’un des principaux partenaires de Caracas.
Cette visite officielle en Grèce répond à la volonté de Caracas de renforcer l’émergence d’un monde multipolaire, au sein duquel prévaudront le respect mutuel, la compréhension, la coopération, mais aussi le droit pour les peuples à l’autodétermination, à la liberté et à la souveraineté.
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, venezuela, états-unis, obama, amérique latine, amérique du sud |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Empire du Chaos s'installe en Europe: l' État islamique en Ukraine

L'Empire du Chaos s'installe en Europe: l' État islamique en Ukraine
Kiev et les djihadistes: une sombre alliance
Alors que nous combattons l’État islamique, l’EI, alias ISIS, en Irak et en Syrie, et que les responsables américains soulignent le prétendu danger d’une attaque sur le territoire américain, Washington et le Califat se battent du même côté en Ukraine. Dans une remarquable série d’articles dans l’Intercept, Marcin Mamon s’est penché sur un aspect du conflit en Ukraine auquel personne d’autre n’a fait attention: le rôle joué par le Bataillon Doudaïev, «une force de combat des islamistes radicaux composée de Tchétchènes, mais incluant également des combattants de tout le Caucase ainsi que quelques Ukrainiens».
Les clés des organisations clandestines islamistes en Ukraine ont été remises à Mamon par un contact à Istanbul,Khalid, qui commande la branche ISIS locale. «Nos frères sont là», a-t-il dit à Mamon, et le journaliste s’est rendu en Ukraine où il a été mis en rapport avec un contact nommé Ruslan, qui l’a conduit au camp clandestin de Munayev.
Portant le nom du premier président de la Tchétchénie séparatiste, Djokhar Doudaïev, le bataillon Doudaïev était commandé par Isa Munayev, récemment tué dans l’est de l’Ukraine. Imprégnés d’une haine fanatique des Russes, qui soutiennent les rebelles de l’Est, les hommes de Munayev estiment également qu’ils paient une dette, puisque les bataillons du Secteur Droit ultra-nationaliste qui aujourd’hui luttent pour Kiev ont apparemment aidé les Tchétchènes dans le passé. Le Secteur Droit est un groupe paramilitaire ouvertement néo-fasciste qui a fourni une grande partie des forces qui ont rendu possible le coup d’État contre Viktor Ianoukovitch, l’ancien président ukrainien. Organisés en différents bataillons, dont la célèbre Brigade Azov, ils idolâtrent les collaborateurs nazis de la Seconde Guerre mondiale, qui ont combattu les troupes soviétiques: les ultra-nationalistes ont été accusés d’avoir commis desatrocités dans le Donbass, ainsi que de terroriser leurs adversaires politiques sur le front intérieur. D’après Mamon, ils ont également été impliqués dans la lutte contre les Russes dans la lointaine Tchétchénie, où l’ancien gros bonnet du Secteur Droit Oleksandr Muzychko a combattu aux côtés de Munayev et des frères contre les Russes.
Comme Ruslan l’a dit à Mamon:
« Je suis ici aujourd’hui parce que mon frère, Isa, nous a appelés et a dit: ‹Il est temps de rembourser votre dette. Il fut un temps où les frères de l’Ukraine sont venus [en Tchétchénie] et se sont battus contre l’ennemi commun, l’agresseur, l’occupant.›. »
A côté de cette solennelle éthique du guerrier, une autre raison probable du soutien de l’EI à Kiev est l’accès à des cibles occidentales, données ainsi aux terroristes. Comme Mamon l’indique:
«L’Ukraine est en train de devenir une étape importante pour les frères comme Ruslan. En Ukraine, vous pouvez acheter un passeport et une nouvelle identité. Pour 15 000 dollars, un combattant reçoit un nouveau nom et un document juridique attestant de sa citoyenneté ukrainienne. L’Ukraine ne fait pas partie de l’Union européenne, mais c’est une voie facile pour l’immigration vers l’Ouest. Les Ukrainiens ont peu de difficultés à obtenir des visas pour la Pologne voisine, où ils peuvent travailler sur les chantiers et dans les restaurants, comblant le vide laissé par les millions de Polonais qui sont partis à la recherche de travail au Royaume-Uni et en Allemagne. »
On nous dit que l’EI prévoit des attaques terroristes en Europe, et que les forces de sécurité sont occupées à recenser tous les suspects du continent; pourtant voici ce trou béant dans les défenses de l’Ouest, par où les frères s’infiltrent tranquillement, sans que les médias occidentaux en rendent compte. En coopération avec des groupes ultra-nationalistes comme le Secteur Droit, qui ont également créé leurs bataillons semi-autonomes, les islamistes d’Ukraine, brandissant des passeports ukrainiens, ont ouvert une passerelle vers l’Ouest.

Les demandes faites à Washington de commencer à fournir des armes létales au régime ukrainien font maintenant partie du débat de politique étrangère à Washington, avec les habituels suspects exhortant l’administration à ouvrir le robinet d’armement. Pourtant, les Ukrainiens disent qu’ils obtiennent déjà une aide létale de pays qu’ils refusent d’identifier, selon le membre officiel du Conseil de sécurité nationale ukrainienne Oleg Gladovsky:
«[L’aide provient] d’endroits où nous n’avons aucune influence et où il n’y a pas de tollé public à ce sujet (que nous avons nous-mêmes contribué à créer dans certains endroits, malheureusement). C’est de ces pays que nous sommes en train de recevoir de l’aide létale.»
Alors d’où vient cette aide?
«Dans l’est de l’Ukraine, écrit Mamon, le drapeau vert du djihad flotte sur certaines bases des bataillons privés.» Mais comment ces groupes de combat sont-ils privés?
L’armée ukrainienne en loques, composée de conscrits peu motivés et mal armés, ne fait pas le poids contre les séparatistes, qui se battent sur leur propre territoire contre un envahisseur. Le régime de Kiev dépend de ces arméesprivées pour fournir une colonne vertébrale à sa force de combat, et il semble y avoir une relation symbiotique difficile entre l’armée ukrainienne régulière et ces volontaires, avec une approche non interventionniste adoptée par Kiev pour ces derniers . Si le régime ukrainien reconnait ouvertement aujourd’hui obtenir de l’aide de pays non nommés, il est normal de se poser la question: le Bataillon Doudaïev obtient-il une aide directe à partir des mêmes sources que celles qui équipent en armes les rebelles islamistes radicaux de Syrie – le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis et les Saoudiens?
Comme les rebelles modérés syriens financés et soutenus par les Etats-Unis rejoignent l’EI en masse, le réseau djihadiste international étend ses tentacules en Ukraine pour reprendre le combat au nom de leurs frères.
L’un des principaux liens entre les factions ultra-nationalistes ukrainiennes et les islamistes était Oleksandr Muzychko, qui a combattu aux côtés du chef terroriste tchétchène Chamil Bassaïev – le cerveau derrière le massacre de l’école de Beslan – dans les guerres de Tchétchénie. L’année dernière, Muzychko a été tué dans une fusillade avec les policiers ukrainiens. Mais avant de disparaître, il était le visage public très évident du mouvement ultra-nationaliste d’Ukraine.
Dans une vidéo devenue virale, Muzychko et un groupe de ses compagnons du commando Secteur Droit sont entrés dans le bureau du procureur de la ville de Rivne, dans le nord-ouest de l’Ukraine, et ont giflé le procureur coupable de ne pas faire son travail à la satisfaction de Muzychko. Il a également fait irruption dans une réunion du conseil de la ville de Rivne, brandissant un fusil, et déclarant que le Secteur Droit ne désarmerait jamais. Alors que les autorités ont sans aucun doute trouvé les singeries de Muzychko ennuyeuses, ce genre de chose est normal dans la nouvelle Ukraine. Et il est probable que c’est son implication clandestine avec l’EI, bien plus que ses pitreries publiques, qui a provoqué la colère des autorités: elles lui ont tendu une embuscade et l’ont abattu le 24 mars de l’année dernière. Son implication avec la cellule EI en Ukraine est-elle devenue de plus en plus évidente, même pour ceux en Occident qui s’étaient contentés de regarder de l’autre côté?
Que les autorités de Kiev travaillent avec un avant-poste de l’EI est implicite dans toute l’article de Mamon: quand ce dernier s’est rendu au campement de Munayev en compagnie de Ruslan, ils n’ont eu aucune difficulté aux points de contrôle de l’armée ukrainienne, où la possibilité de percevoir des pots de vin ne faisait aucun doute, et ils sont passés à travers. Tout au long de l’article de Mamon nous entendons Munayev se plaindre de la pauvreté: le Bataillon Doudaïev, nous dit-on, doit dépendre d’activités criminelles pour financer le djihad. Pourtant, un oligarque mineur, nommé Dima leur remet 20 000 dollars, et il est question de vendre au marché noir de l’ambre à des «acheteurs du golfe Persique, y compris de riches cheikhs» – peut-être les mêmes riches donateurs qui ont si généreusement financé l’EI.
Les liens entre le régime de Kiev et l’enclave de l’EI en Ukraine sont nombreux, et seulement à demi cachés. Lorsque Mamon est arrivé au camp de Munayev, il a été accueilli par une voiture blindée qui, nous dit-on, a été donnée par Ihor Kolomoisky, l’un des hommes les plus riches d’Ukraine, récemment nommé gouverneur de Dniepropetrovsk. Kolomoisky, malgré son héritage juif, n’a aucun scrupule à s’allier à des groupes ouvertement antisémites comme le Secteur Droit, dont il a financé les bataillons: comme les djihadistes affiliés à l’EI, auxquels il a offert une voiture blindée, il ne pense qu’à la lutte contre Vladimir Poutine, qu’il méprise.
Une autre indication de l’alliance EI-Kiev est l’évasion d’Adam Osmaev, commandant-adjoint du Bataillon Doudaïev, d’une prison ukrainienne où il purgeait une peine pour avoir fomenté l’assassinat de Poutine. Après le coup d’état à Kiev, Munayev et ses compagnons ont fait sortir Osmaev de prison: quand ils ont été confrontés à la police ukrainienne à un barrage, ils ont été mystérieusement autorisés à passer. Comme le rapporte Mamon:
«Après une impasse dramatique, les Ukrainiens ont permis aux Tchétchènes de filer. (Il n’y a pas moyen de confirmer le récit de Ruslan, mais à l’automne 2014, le tribunal d’Odessa a soudainement déclaré qu’Osmaev avait suffisamment purgé sa peine et il a été libéré.) Osmaev et Munayev sont revenus à Kiev, et le bataillon Doudaïev a été créé.»
«De temps en temps, écrit Mamon, Munayev rencontre des représentants du Service de sécurité ukrainien, connu sous le nom de SBU.»
Le Bataillon Doudaïev compte environ 500 combattants, mais il y a aussi d’autres brigades djihadistes en Ukraine, organisées dans le Bataillon Sheikh Mansour, qui s’est détaché du Bataillon Doudaïev et «est basé à proximité de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine», ainsi que deux autres groupes composés des Tatars de Crimée, comptant chacun environ 500 djihadistes.
Comme l’aide des États-Unis coule à flot en Ukraine, dans quelle mesure va-t-elle retomber sur ces alliés de l’EI – et quelle sera son utilisation future? Si John McCain et Lindsey Graham arrivent à leurs fins, les armes américaines vont bientôt se trouver dans les mains de ces terroristes, dont il est sûr que le djihad contre les Russes se tournera vers l’Ouest et frappera les capitales de l’Europe.
C’est un retour de flamme avec une vengeance: nous créons nos propres ennemis, et leur donnons les armes pour nous faire du mal, alors même que nous affirmons notre besoin d’une surveillance universelle pour les combattre. Les savants fous formulant la politique étrangère américaine sont en train de créer une armée de monstres de Frankenstein – qui ne manqueront pas d’attaquer leurs créateurs bercés d’illusions.
- Source : Justin Raimondo-Traduction Claude Saker Francophone
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, ukraine, mer noire, caucase, tchétchènes, terroristes tchétchènes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 mars 2015
The Kiev-ISIS Alliance

The Kiev-ISIS Alliance
Militants with links to ISIS fight for Kiev in East Ukraine as part of 'Dzhokhar Dudayev battalion'
This article originally appeared at Antiwar.com
While we’re fighting the Islamic State, a.k.a. ISIS, in Iraq and Syria, and American officials tout the alleged danger of an attack on the US homeland, in Ukraine Washington and the Caliphate are fighting on the same side. A remarkable series of articles by Marcin Mamon in The Intercept has documented an aspect of the Ukraine conflict that no one else has paid any attention to: the role played by the "Dudayev Battalion," a fighting force of radical Islamists consisting of Chechens, but also including fighters from throughout the Caucasus as well as some Ukrainains.
The keys to Ukranie’s Islamist underground were handed to Mamon by a contact in Istanbul, "Khalid," who commands the ISIS branch there. "Our brothers are there," he told Mamon, and the reporter traveled to Ukraine where he was put in touch with a contact named Ruslan, who led him to Munayev’s clandestine camp.
Named after the first "president" of breakaway Chechnya, Dzhokhar Dudaev, the Dudayev Battalion was commanded by Isa Munayev, recently killed in a east Ukraine. Imbued with a fanatical hatred of the Russians, who are backing the rebels in the east, Munayev’s men also feel they are paying back a debt, since the ultra-nationalist Right Sector battalions now fighting for Kiev apparently helped the Chechens in the past. Right Sector is an openly neo-fascist paramilitary group which provided much of the muscle that made the coup against Viktor Yanukovych, former Ukrainian president, possible. Organized into various battalions, including the notorious Azov Brigade, they idolize the World War II collaborators with the Nazis, who fought Soviet troops: the ultra-nationalists have been accused of carrying out atrocities in the Donbass, as well as terrorizing their political opponents on the home front. According to Mamon, they also have been involved in fighting the Russians in far-off Chechnya, where former Right Sector bigwig Oleksandr Muzychko fought alongside Munayev and "the brothers" against the Russians. As Ruslan told Mamon:
"I am here today because my brother, Isa, called us and said, ‘It’s time to repay your debt. There was a time when the brothers from Ukraine came [to Chechnya] and fought against the common enemy, the aggressor, the occupier."
Aside from this solemn warrior ethic, another likely reason for ISIS support to Kiev is the access this gives the terrorists to Western targets. As Mamon puts it:
"Ukraine is now becoming an important stop-off point for the brothers, like Ruslan. In Ukraine, you can buy a passport and a new identity. For $15,000, a fighter receives a new name and a legal document attesting to Ukrainian citizenship. Ukraine doesn’t belong to the European Union, but it’s an easy pathway for immigration to the West. Ukrainians have few difficulties obtaining visas to neighboring Poland, where they can work on construction sites and in restaurants, filling the gap left by the millions of Poles who have left in search of work in the United Kingdom and Germany."
We are told that ISIS is planning terrorist attacks in Europe, and security forces are busy rounding up suspects all across the continent – and yet here is this gaping hole in the West’s defenses, where "the brothers" are quietly infiltrating without much notice in the Western media. In cooperation with ultra-nationalist groups like Right Sector, which have also formed their semiautonomous battalions, the Islamists of Ukraine, brandishing Ukrainian passports, have opened a gateway to the West.
Demands that Washington start giving lethal aid to the Ukrainian regime are now part of the foreign policy debate in Washington, with the usual suspects urging the administration to open the weapons spigot. Yet the Ukrainians are saying they’re already getting lethal aid from countries they refuse to identify, according to Ukrainian national security council official Oleg Gladovsky:
"[The aid is coming from] places where we have no influence and where there’s no public uproar about it (which we ourselves have helped created in some places, unfortunately). It’s from these countries that we’re now receiving lethal aid."
So where is this aid coming from?
"In eastern Ukraine," writes Mamon, "the green flag of jihad flies over some of the private battalions’ bases." But how "private" are these fighting groups?
The tatterdemalion Ukrainian army, consisting of poorly-motivated and poorly-armedconscripts, is a poor match for the separatists, who are fighting on their home turf against an invader. The Kiev regime is dependent on these "private" armies to provide the backbone of its fighting force, and there appears to be an uneasy symbiotic relationship between the regular Ukrainian army and these volunteers, with a hands-off approach taken by Kiev to the latter. If the Ukrainian regime is now openly acknowledging getting aid from unnamed countries, it’s fair to ask: is the Dudayev Battalion getting direct aid from the same sources supplying Syria’s radical Islamist rebels with arms – Qatar, Kuwait, the United Arab Emirates, and the Saudis?

As the US-funded-and –supported Syrian "moderate" rebels defect to ISIS in droves, the international jihadist network is extending its tentacles into Ukraine to take up the fight on behalf of their "brothers."
One of the key links between the Ukrainian ultra-nationalist factions and the Islamists was Oleksandr Muzychko, who fought alongside Chechen terrorist leader Shamil Basayev – the mastermind behind the Beslan school massacre – in the Chechen wars. Last year Muzychko was killed in a shoot-out with Ukrainian police, but before he went down he was the very visible public face of Ukraine’s ultra-nationalist movement.
In a video that went viral, Muzychko and a group of his fellow Right Sector stormtroopers entered the state prosecutor’s office in the city of Rivne, in northwestern Ukraine, and slapped the prosecutor around for not doing his job to Muzychko’s satisfaction. He also broke into a meeting of the Rivne city council, brandishing a gun, and declaring Right Sector would never disarm. While the authorities no doubt found Muzychko’s antics annoying, this sort of thing is "normal" in the new Ukraine, and it’s likely his involvement with the ISIS underground, rather than his public antics, brought down the ire of the authorities, who ambushed and shot him down on March 24 of last year. Was his involvement with the ISIS cell in Ukraine was becoming increasingly obvious, even to those in the West who had been content to look the other way?
That the Kiev authorities are working with the ISIS outpost is implied throughout Mamon’s piece: as Mamon made his way Munayev’s encampment in the company of Ruslan, they had no trouble at Ukrainian army checkpoints, where the opportunity to collect bribes was foregone and they were waved right through. Throughout Mamon’s piece we hear Munayev’s complaints of poverty: the Dudayev Battalion, we are told, must depend on criminal activities to finance their jihad. Yet one minor oligarch, named "Dima," hands them $20,000, and there is talk of selling black market amber to "buyers in the Persian Gulf, including wealthy sheikhs" – perhaps the same wealthy donors who have so generously funded ISIS.
The links between the Kiev regime and the ISIS enclave in Ukraine are numerous, and only half-hidden. When Mamon arrived at Munayev’s camp, he was met by an armored car that, we are told, was donated by Ihor Kolomoisky, one of the richest men in Ukraine who was recently appointed governor of Dnipropetrovsk. Kolomoisky, despite his Jewish heritage, has no compunctions about allying himself with openly anti-Semitic groups like Right Sector, whose battalions he has financed: like the ISIS-affiliated jihadists he gifted with an armored car, all he cares about is the fight against Vladimir Putin, whom he despises.
Another indication of the ISIS-Kiev alliance is the escape of Adam Osmayev, deputy commander of the Dudayev Battalion, from a Ukrainian jail, where he had been serving a sentence for plotting Putin’s assassination. After the coup in Kiev, Munayev and his fellow fighters broke Osmayev out of prison: when they were confronted by Ukrainian police at a checkpoint, they were mysteriously allowed to pass. As Mamonreports:
"After a dramatic standoff, the Ukrainians allowed the Chechens to go free. (There is no way to confirm Ruslan’s account, but in the fall of 2014, the Odessa court suddenly declared that Osmayev had fulfilled enough of his sentence and had been set free). Osmayev and Munayev came back to Kiev, and the Dudayev battalion was created."
"From time to time," writes Mamon, "Munayev met with representatives of the Ukrainian Security Service, known as the SBU."
The Dudayev Battalion numbers around 500 fighters, but there are also other jihadist brigades in Ukraine, organized into "the Sheikh Mansour battalion, which broke off from the Dudayev battalion" and "is based close to Mariupol, in the southeast of Ukraine," as well as two other groups composed of Crimean Tatars, each consisting of about 500 jihadists.
As US aid flows into Ukraine, how much of it will trickle down to these allies of ISIS – and to what future use will it be put? If John McCain and Lindsey Graham have their way, US arms will soon find their way into the hands of these terrorists, whose jihad against the Russians is bound to turn westward and strike at the capitals of Europe.
This is blowback with a vengeance: we are creating our own enemies, and giving them the weapons to harm us, even as we claim the need for universal surveillance in order to fight them. The mad scientists formulating US foreign policy are raising an army of Frankenstein monsters – who are sure to come after their deluded creators.
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires internationales, europe, affaires européennes, tchétchènes, terroristes tchétchènes, ukraine, donbass, donetsk, russie, eiil |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le monde anglo-saxon en guerre contre l’Europe?

Le monde anglo-saxon en guerre contre l’Europe?
Les accords de Minsk ont fait ressurgir une vérité oubliée un peu trop vite : les États européens ont un rôle fondamental et incontournable quand il faut gérer une crise sur ce continent.
Paris et Berlin se sont en effet bien gardés d’inviter Washington et Bruxelles, c’est-à-dire l’Otan et l’UE, à ces négociations de Minsk, destinées à avancer vers un accord de paix, dans cette guerre civile qui se déroule en Ukraine.
Ironie de l’histoire : la Biélorussie, régulièrement taxée de « dernière dictature d’Europe », a accueilli une rencontre ayant permis aux puissances continentales de bloquer les velléités guerrières anglo-saxonnes.
Prises entre l’enclume des faucons ukrainiens et le marteau de leurs sponsors américains, les élites ukrainiennes, qui auraient naïvement cru à la fable de leur intégration fraternelle au sein de la communauté euro-atlantique, doivent désormais déchanter.
Les rêves d’adhésion immédiate à l’Union Européenne et à l’OTAN sont partis en fumée, et le pays est maintenant très proche de la faillite. Le divorce avec la Russie sur le modèle géorgien se fait au prix d’une guerre contre le monde russe et donc quasi-directement contre la Russie. Dans le même temps, les oligarques qui ont pris le pouvoir en Ukraine après les événements de la place Maïdan ont mis les nations européennes face à une situation très complexe.
Du côté de l’Europe de l’ouest, on essaie de croire à la paix en Ukraine et de rester optimistes, mais une scission apparaît de plus en plus nettement. D’une part, se profile un axe qui recherche la paix et d’autre part un groupe qui souhaite un affrontement plus direct avec Moscou.
L’axe anglo-saxon, fauteur de guerre ?
Dans ce groupe, quatre acteurs principaux.
Il y a d’abord l’Angleterre, dont le ministre de la Défense Michael Fallon affirme que Moscou fait planer un « véritable danger » sur les pays baltes. Quant à l’ex-ministre britannique de la Défense Liam Fox, il martèle que les forces de l’OTAN doivent « offrir aux Ukrainiens les capacités nécessaires pour se défendre » et notamment des « armes antichars sophistiquées » car la Russie menacerait de dominer l’Europe. Même son de cloche pour l’ancien responsable des services secrets russes qui affirme que la Russie représente une « menace en tant qu’État » pour l’Angleterre.
Il y a le Canada, l’un des acteurs étrangers les plus actifs durant le Maïdan, fait rarement mis en lumière par les médias français, qui vient d’être clairement appelé à l’aide par les autorités ukrainiennes qui affirment se préparer à une « guerre d’envergure » contre la Russie. Et au passage, sans aucun doute, à balayer d’un revers de main les accords de Minsk.
Washington menace de son côté la Russie de sanctions d‘une extrême gravité en l’accusant de faire entrer des chars en Ukraine, ce que pourtant François Hollande lui même dément. Fort de ce mythe médiatique, Washington étudie même la possibilité de livrer des armes à l’Ukraine afin de torpiller la fragile tentative de « quintuple entente continentale » arrachée à Minsk pendant la nuit du 11 au 12 février.
Enfin il y a l’OTAN, dont le commandant adjoint de l’Alliance atlantique en Europe, le général Adrian Bradshaw, vient d’affirmer, tout comme l’ex-secrétaire général de l’Otan Anders Fogh Rasmussen, que la Russie pourrait être tentée d’envahir des pays membres du bloc. Grace à la crise ukrainienne, l’Alliance se redonne une raison d’exister et peut utiliser ses satellites en Europe (Pologne, États baltes…) pour constituer un cordon "Otanien" entre Paris, Berlin et Moscou. La crise en Ukraine a donc permis en quelque sorte l’apparition d’un projet de mur américain, qui remplacerait le mur de Berlin.
L’Europe face à ses contradictions historiques et systémiques
Un commentateur objectif et raisonnable pourrait se demander ce qu’un axe non-européen et maritime « Otan-Washington-Londres-Ottawa » peut apporter à une crise ne concernant que des puissances continentales européennes ou péri-européennes. Il pourrait avec étonnement constater que cet « axe du bien » a été exclu des négociations vers la paix mises en place par l’axe « Paris-Berlin-Moscou ». Il y a pourtant des explications à cela.
À la fin du second conflit mondial, l’Europe a confié sa défense aux États-Unis pour se protéger du péril soviétique. Lors de la disparition de ce danger, les Européens n’ont pas fait l’effort de créer un système de défense indépendant. L’OTAN a poursuivi son expansion vers l’est du continent, pays par pays. Dans cette organisation, la suprématie américaine coule de source.
La jurisprudence De Gaulle n’a pas fait tache d’huile, tandis que Berlin s’est montré incapable de s’affirmer en leader de la puissance militaire européenne. L’Allemagne se contentait de prendre le leadership économique d’une construction européenne ayant transformé les pays de l’union en sujets de ce nouveau Reich puissant économiquement, mais sans défense autonome.
Une Allemagne désormais prise en tenaille entre sa tendance naturelle à l’expansion vers l’Est (militaire en 1940, économique en 2000) et le risque d’une guerre ouverte dans laquelle elle serait la grande perdante, à cause de sa position économique dominante. Enfin, et peut être surtout, l’UE n’a toujours pas clairement défini ses frontières, ses limites civilisationnelles et par conséquent la limite territoriale et géographique de son expansion.
La Russie et les frontières du monde russe
L’Europe se retrouve face à une Russie en pleine mutation. Parallèlement au redressement économique spectaculaire qu’il a connu, le pays vit une mutation qui est de nature géopolitique. On l’imaginait devenir une puissance européenne ou quasi-européenne au début des années 2000 ; depuis quelques années, on constate au sein des élites russes une tendance géopolitique "eurasiatique" qui s’est beaucoup affirmée et qui tend à devenir dominante.
Ce changement de cap a logiquement entraîné une reconfiguration systémique et permanente tant de la politique étrangère russe, que de la gestion de ses marches (son étranger proche) et de la relation avec sa zone d’influence propre : le fameux « monde russe » que l’on peut qualifier « d’étranger intérieur », une notion difficile à comprendre pour les occidentaux.
Avec moins de 9 habitants au kilomètre carré, la Russie n’est pas un État nation européen comme les autres. Certaines frontières sont très éloignées du centre politique, et d’autres n’ont pas, en Russie, une signification identitaire aussi forte qu’en Europe occidentale. Cette réalité explique l’obsession russe d’avoir marches stables. L’existence de populations situées « hors » des frontières administratives de l’Etat russe actuel, mais se considérant comme appartenant au monde russe, complique encore les choses, que l’on pense par exemple aux Ossètes, aux populations russophones du Donbass ou à une partie de la population de la Moldavie.
Quel avenir pour l’Ukraine entre Washington, Moscou et l’Europe ?
Le retour de la Russie en tant qu’acteur géopolitique indépendant et autonome, ayant ses propres intérêts et les moyens de les défendre, est un élément clairement déstabilisant pour l’agenda américain en Eurasie et en Europe. Mais cette nouvelle donne place également l’Europe face à des choix stratégiques. L’affaire ukrainienne le démontre, en contraignant l’Europe à naviguer entre l’unilatéralisme de Washington et ses intérêts propres. Ces derniers n’allant pas du tout dans le sens d’une guerre sur le continent et contre la Russie, avec laquelle l’interaction commerciale, politique et économique est croissante depuis une quinzaine d’années.
Les Américains et les Européens ont globalement deux visions et des intérêts diamétralement opposés quant à l’avenir de leur relation avec l’Ukraine.
Pour Washington, l’Ukraine est un pion stratégique fondamental du fait de sa position géographique. Une fois l’Ukraine affranchie de l’influence de Moscou, elle pourrait se transformer en satellite docile, à l’extrémité est du continent, pour introduire l’OTAN en Eurasie, en commençant par la mer noire, et ainsi refouler la Russie vers l’Est. Le plus loin possible du « mur de Washington ».
L’Ukraine ne revêt en revanche aucun intérêt stratégique fondamental pour Paris ou Berlin, ni sur le plan militaire, ni sur le plan sécuritaire. Sur le plan économique, le pays peut représenter un marché potentiel pour certains produits européens, et pourrait devenir une source importante de main d’œuvre bon marché pour l’Allemagne. Sous cet angle, du reste, l’opération ukrainienne permet aux Etats-Unis de donner des gages économiques à leur allié allemand en Europe ; du moins tant que Berlin ne se permet pas de s’octroyer une quelconque liberté sur le plan militaire ou sécuritaire. Ceci explique en partie l’effroi qui a saisi Washington, Berlin et la soi-disant « nouvelle Europe » sous tutelle militaire américaine et sous domination économique allemande lorsque les Français ont esquissé la vente de navires Mistral, alors que dans le même temps l’Allemagne procède elle à des entraînements militaires avec des reproductions des mitrailleuses en bois en raison de la faiblesse de son budget militaire.
Si la paix revient en Ukraine, ce qui semble improbable, il faudra rebâtir, avec tous ces intérêts divergents, un système viable de relations Europe-Ukraine-Russie.
On imagine mal comment il pourrait pacifiquement s’esquisser sans que l’Ukraine ne redevienne ce que sa géographie et son histoire lui imposent d’être : un pont naturel entre la Russie d’un côté, et l’Europe centrale et occidentale de l’autre et surtout un tampon suffisamment étendu pour éviter au monde euro-occidental et au monde eurasien bien des heurts, et bien des affrontements.
Je dis improbable que la paix ne revienne car une question bien plus inquiétante se profile à l’horizon, question que les dirigeants occidentaux semblent ne pas vouloir se poser : l’Ukraine en tant qu’État existe-t-elle encore ?
- Source : Alexandre Latsa

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, angleterre, politique internationale, actualité, géopolitique, europe, états-unis, canada, monde anglo-saxon, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 mars 2015
Nieuwe Saudische koning probeert moslimcoalitie tegen Iran te vormen

Al 10.000 door Iran gecommandeerde troepen op 10 kilometer van grens Israël
Arabische media kiezen kant van Netanyahu tegen Obama
Breuk tussen Israël en VS brengt aanval op Iran dichterbij dan ooit
De sterk in opkomst zijnde Shia-islamitische halve maan zal zich tegen haar natuurlijke ‘berijder’ keren: Saudi Arabië, met in de ster op de kaart het centrum van de islam: Mekka.
De Saudische koning Salman, opvolger van de in januari overleden koning Abdullah, heeft de afgelopen 10 dagen gesprekken gevoerd met de leiders van alle vijf Arabische oliestaten, Jordanië, Egypte en Turkije, over de vorming van een Soenitische moslimcoalitie tegen het Shi’itische Iran. De Saudi’s hebben Iraanse bondgenoten de macht zien overnemen in Irak en Jemen, en weten dat zij zelf het uiteindelijke hoofddoel van de mullahs in Teheran zijn.
Grootste struikelblok voor de gewenste coalitie is de Moslim Broederschap, die gesteund wordt door Turkije en Qatar, maar in Egypte, Jordanië en Saudi Arabië juist als een terreurorganisatie wordt bestempeld. Koning Salman is dermate bevreesd voor een nucleair bewapend Iran, dat hij inmiddels bereid lijkt om ten aanzien van de Broederschap concessies te doen.
Saudi Arabië zal worden vernietigd
In zo’n 2500 jaar oude Bijbelse profetieën wordt voorzegd dat de Perzen (Elam = Iran) uiteindelijke (Saudi) Arabië zullen aanvallen (Jesaja 21). Jordanië (Edom en Moab) zal hoogstwaarschijnlijk ten prooi vallen aan Turkije (Daniël 11:41), dat eveneens Egypte zal aanvallen. Saudi Arabië komt dan alleen te staan en zal totaal worden vernietigd (Jeremia 49:21).
Het land waarin de islam is ontstaan voelt de bui al enige tijd hangen en probeert nu bijna wanhopig ‘het beest’ waar ze eeuwen op gereden heeft, gunstig te stemmen. Turkije zal echter nooit de alliantie met de Moslim Broederschap opgeven, net zoals Egypte nooit de Broederschap zal steunen.
Het beest dat de hoer haat
Enkele jaren geleden schreven we dat Turkije een geheim samenwerkingspact gesloten heeft met Iran. Beide landen hebben historische vendetta’s met de Saudi’s, die de Ottomaanse Turken verrieden met Lawrence van Arabië. Ook de vijandschap tussen het Wahabitische huis van Saud en de Iraanse Shi’iten bestaat al eeuwen.
Bizar: ISIS is oorspronkelijk een ‘uitvinding’ van de Wahabieten en niet de Shi’iten, maar streeft desondanks toch naar het einde van het Saudische koninkrijk. Hetzelfde geldt voor de Moslim Broederschap, Hezbollah en andere islamitische terreurgroepen. Dit is exact zoals de Bijbel het voorzegd heeft: de volken en landen van ‘het beest’ zullen ‘de hoer van Babylon’ haten, zich omkeren en haar verscheuren / met vuur verbranden.
Arabische media kiezen kant van Netanyahu tegen Obama
De Arabieren vallen zelf Israël echter (nog) niet aan omdat de Joodse staat een onverklaarde bondgenoot is tegen Iran. Onlangs zouden de Saudi’s zelfs hun luchtruim hebben opengesteld voor de Israëlische luchtmacht, nadat bekend werd dat de Amerikaanse president Obama vorig jaar dreigde Israëlische vliegtuigen boven Irak neer te schieten toen de regering Netanyahu op het punt stond Iran aan te vallen.
Diverse toonaangevende Arabische media kozen afgelopen week openlijk de kant van de Israëlische premier, nadat hij in diens toespraak voor het Amerikaanse Congres de toenadering van Obama tot Iran impliciet fel bekritiseerd had. Netanyahu’s woorden onderstreepten dat er de facto een breuk tussen Amerika en Israël is ontstaan, die zolang Obama president is niet meer zal worden geheeld. Dit brengt een Israëlische aanval op Iran dichterbij dan ooit tevoren (4).
Het is al jaren bekend dat Obama Netanyahu haat, en andersom is er eveneens sprake van groot wantrouwen en minachting. Net als in Jeruzalem ziet men ook in bijna alle Arabische Golfstaten, maar vooral in Saudi Arabië, Obama liever vandaag dan morgen verdwijnen.
In Iran wordt nog steeds ‘dood aan Amerika’ geschreeuwd
Wrang genoeg voor Washington geldt dat ook voor Iran. ‘Allahu Akbar! Khamenei is de leider. Dood aan de vijanden van de leider. Dood aan Amerika. Dood aan Engeland. Dood aan de hypocrieten. Dood aan Israël!’ schreeuwden Iraanse officieren begin februari toen Khamenei vol trots verklaarde dat Iran uranium tot 20% verrijkt had, terwijl hij Obama uitdrukkelijk had beloofd dit niet te doen.
Deze oorlogskreet wordt al sinds 1979 dagelijks gebezigd in Iran. In dat jaar liet de Amerikaanse president Jimmy Carter toe dat de hervormingsgezinde Shah van Iran werd afgezet door de extremistische Ayatollah Khomeini. Het onmiddellijke gevolg was een bloederige oorlog met Irak, waarbij meer dan één miljoen doden vielen.
Al 10.000 Iraanse troepen bij grens Israël
Zodra het door Turkije en Iran geleide rijk van ‘het beest’ Israël aanvalt, zullen Sheba en Dedan, de Saudi’s en de Golfstaten, enkel toekijken (Ezechiël 38:13). Dat we snel deze laatste fase van de eindtijd naderen blijkt uit het feit dat er op dit moment in Syrië al zo’n 10.000 door Iran gecommandeerde troepen – ‘vrijwilligers’ uit Iran, Irak en Afghanistan- op slechts 10 kilometer van de Israëlische grens staan. Dat zouden er in de toekomst 100.000 of zelfs meer kunnen worden (2)(3).
Het Vaticaan ‘de hoer’ en vervolger van christenen?
Terwijl de Bijbelse eindtijdprofetieën overduidelijk voor onze eigen ogen in vervulling gaan zijn veel Westerse christenen hier nog steeds blind voor, omdat hen geleerd is dat ‘de hoer’ het Vaticaan is, en de ‘valse profeet’ een toekomstige paus is die de grote wereldreligies met elkaar zal verenigen, daar het evangelie voor zal opofferen en katholieken en andere christenen (!) zal laten onthoofden omdat ze dit zullen weigeren.
Als ‘de hoer’ het Vaticaan is, dan zou dat echter betekenen dat de katholieke/ christelijke landen waar zij op ‘zit’ haar zullen aanvallen en verbranden. Denken mensen nog steeds serieus dat andere landen in Europa Rome zullen aanvallen, terwijl moslim terreurgroepen zoals ISIS regelmatig openlijk dreigen om in de nabije toekomst Italië binnen te vallen en het Vaticaan te vernietigen? Terwijl christenen in Irak, Egypte, Syrië, Nigeria en andere moslimlanden nu al worden vermoord en onthoofd vanwege hun geloof en omdat weigeren zich te bekeren tot de islam (= het beest te aanbidden)?
Moderne ‘Torens van Babel’ in Mekka
In eerdere artikelenstudies (zie hyperlinks onderaan) voerden we uitgebreid Bijbels bewijs aan –en geen giswerk theorieën- dat ‘de hoer van Babylon’, ‘dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus’ zich precies daar bevindt waar Johannes haar zag: in ‘de woestijn’ (Openbaring 17:3). Alleen al hierom kan het nooit om Rome, New York of Brussel gaan. De 7 gigantische torens bij het Ka’aba complex in Mekka –het grootste ter wereld- worden plaatselijk zelfs letterlijk ‘De berg Babel’ genoemd.
Eindtijd: Niet Europa of Amerika, maar Israël centraal
Niet Europa, niet Amerika en ook niet Rusland staan centraal in de Bijbelse eindtijdprofetieën van zowel het Oude als het Nieuwe Testament –al spelen zij natuurlijk wel een rol-, maar het Midden Oosten, Israël en de omringende moslimwereld. Pas als de coalitie van het (moslim)beest Israël aanvalt –bedenk dat de islam zichzelf omschrijft als ‘het beest uit de afgrond’!- met de bedoeling de Joodse staat weg te vagen en de laatste resten van het christendom in het Midden Oosten uit te roeien, zal de Messias, Jezus Christus, in eigen persoon neerdalen, tussenbeide komen en alle vijanden vernietigend verslaan.
Xander
(1) Reuters via Shoebat
(2) American Thinker
(3) The Christian Monitor
(4) KOPP
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, états-unis, israël, arabie saoudite, iran, moyen orient, mésopotamie, monde arabe, monde arabo-musulman, sunnites, chiites |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 mars 2015
Геополитика XXIV & XXV
Геополитика XXIV, 2014.
Экономика

Геополитика XXV, 2014.
Терроризм

00:05 Publié dans Géopolitique, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, revue, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Boko Haram : une opération secrète de la CIA pour diviser et régner en Afrique?

Boko Haram : une opération secrète de la CIA pour diviser et régner en Afrique?
Le but de la présence militaire étasunienne en Afrique est bien documenté : contrer l’influence chinoise et contrôler des endroits stratégiques et des ressources naturelles, y compris les réserves de pétrole. Cela a été confirmé il y a plus de 8 ans par le département d’État étasunien :
En 2007, le conseiller du département d’État étasunien, le Dr J. Peter Pham a commenté les objectifs stratégiques d’AFRICOM : « protéger l’accès aux hydrocarbures et autres ressources stratégiques abondantes en Afrique, une tâche qui consiste à protéger la vulnérabilité de ces richesses naturelles et à s’assurer qu’aucune autre tierce partie intéressée, comme la Chine, l’Inde, le Japon ou la Russie, n’obtienne des monopoles ou des traitements préférentiels ». (Nile Bowie,.US AFRICOM Commander Calls for “Huge” Military Campaign in West Africa, Global Research, 11 avril 2012)
Au début février, « de passage au Centre d’études stratégiques et internationales à Washington, D.C., le chef d’AFRICOM, le général David Rodriguez, a appelé à une campagne de « contre-insurrection » de grande envergure menée par les États-Unis contre des groupes en Afrique de l’Ouest ».
Le chef du Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM), le général Joseph Votel, a fait des remarques similaires la semaine dernière à l’Académie West Point de l’Armée étasunienne, affirmant que les équipes de commandos étasuniens doivent se préparer à de nouveaux déploiements contre Boko Haram et l’État islamique. (Thomas Gaist, US AFRICOM Commander Calls for “Huge” Military Campaign in West Africa, World Socialist Web Site, 2 février 2015)
Mark P. Fancher a souligné l’hypocrisie et « l’arrogance impérialiste » des pays occidentaux, qui « malgré la condamnation universelle du colonialisme », sont toujours prêts « à déclarer publiquement (sans excuses) leurs plans d’expansion et de coordination de leur présence militaire en Afrique » (Marc P. Fancher, Arrogant Western Military Coordination and the New/Old Threat to Africa, Black Agenda Report, le 4 février 2015)
Plus de troupes en provenance du Bénin, du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad sont maintenant déployées pour lutter contre Boko Haram.
Cette nouvelle guerre contre une autre entité terroriste obscure en Afrique n’est pas sans rappeler la campagne de propagande ratée de Kony 2012, drapée dans des idéaux humanitaires. Elle est utilisée comme un écran de fumée pour éviter d’aborder la question des victimes de la guerre contre le terrorisme et les causes réelles du terrorisme, et afin de justifier une autre invasion militaire. Il est vrai que Boko Haram fait des victimes, mais le but de l’intervention occidentale en Afrique n’est pas de venir à leur secours.
Le conflit le plus meurtrier dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale, celui qui fait toujours rage, se passe au Congo et l’élite occidentale et leurs médias ne s’en préoccupent pas. Cela démontre que les interventions militaires ne sont pas destinées à sauver des vies.
Pour comprendre pourquoi les médias se concentrent sur Boko Haram, nous avons besoin de savoir qui est derrière cette organisation. Quel est le contexte sous-jacent et quels intérêts sont servis?
Boko Haram : une autre opération clandestine des États-Unis?
Boko Haram est basé dans le nord du Nigeria, le pays le plus peuplé et la plus grande économie d’Afrique. Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole du continent et détient 3,4 % des réserves mondiales de pétrole brut.
En mai 2014, African Renaissance News a publié un reportage détaillé sur Boko Haram et la possibilité que l’organisation soit une autre opération secrète de la CIA visant à prendre le contrôle du Nigeria :
Le plus grand prix pour l’AFRICOM, qui vise à implanter une Pax Americana en Afrique, serait de réussir dans le pays africain le plus stratégique, le Nigeria. C’est là qu’entre en perspective la question de Boko Haram qui fait rage actuellement et la prédiction de l’Intelligence Council des États-Unis sur la désintégration du Nigeria en 2015, dont on a beaucoup parlé [...] (Atheling P Reginald Mavengira, Humanitarian Intervention” in Nigeria: Is the Boko Haram Insurgency Another CIA Covert Operation? Wikileaks, African Renaissance News, 8 mai 2014)
Dans les années 1970 et 1980, le Nigeria a aidé plusieurs pays africains « défiant ainsi clairement les intérêts des États-Unis et de leurs alliés occidentaux, une opposition ayant entraîné à l’époque un recul des initiatives occidentales en Afrique ». (Ibid.)
Le Nigeria exerce son influence dans la région grâce au leadership du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG, droite), une armée composée de soldats de divers pays africains et mise en place par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le groupe est intervenu dans la guerre civile au Liberia dans les années 90. Le Liberia a été fondé en 1821 par les États-Unis et a été dirigé par des Américano-Libériens pendant plus d’un siècle.
Les puissances occidentales, en premier lieu les États-Unis, ne sont évidemment pas prêtes à laisser les Africains avoir une armée multinationale dans laquelle ils ne détiennent pas de rôle de premier plan. L’ACRI, qui devint plus tard l’AFRICOM, a été formé en 2000 pour contenir l’influence du Nigeria et contrer l’ECOMOG, évitant ainsi l’émergence d’une force militaire africaine dirigée par des Africains.
Selon les documents de Wikileaks mentionnés dans l’article de Mavengira ci-dessus, l’ambassade étasunienne au Nigeria constitue :
une base d’opérations pour des actes de subversion de grande envergure et à grande portée contre le Nigeria, notamment l’écoute des communications du gouvernement nigérian, l’espionnage financier d’éminents Nigérians, le soutien et le financement de groupes subversifs, d’insurgés, de propagande de discorde entre les groupes disparates du Nigeria et l’utilisation de chantage relié aux visas afin de contraindre et d’amener des Nigérians de haut rang à agir en faveur des intérêts étasuniens. (Mavengira, op. cit., c’est l’auteure qui souligne)
Mavengira fait partie de la GreenWhite Coalition, un « groupe de défense citoyen bénévole composé de Nigérians de tous les groupes ethniques et de toutes les convictions religieuses ». Il écrit que le but ultime des opérations clandestines étasuniennes dans son pays consiste « à éliminer le Nigeria comme potentiel rival stratégique des États-Unis sur le continent africain ». (Ibid.)
Une enquête sur la secte Boko Haram par la Coalition GreenWhite a révélé que la « campagne de Boko Haram est une opération secrète organisée de la Central Intelligence Agency (CIA) étasunienne coordonnée par l’ambassade étasunienne au Nigeria ». Les États-Unis ont déjà utilisé leurs ambassades pour des opérations secrètes. L’ambassade de Benghazi s’est révélée être la base d’une opération secrète de trafic d’armes pour les mercenaires luttant contre Bachar Al-Assad en Syrie. Quant à l’ambassade en Ukraine, une vidéo de novembre 2013 a émergé récemment montrant un parlementaire ukrainien l’exposant comme le point central d’une autre opération clandestine destinée à fomenter des troubles civils et à renverser le gouvernement démocratiquement élu.

L’enquête de GreenWhite Coalition sur Boko Haram révèle un plan en trois étapes du National Intelligence Council des États-Unis visant à « pakistaniser » le Nigeria, internationaliser la crise et diviser le pays en vertu d’un mandat et d’une force d’occupation de l’ONU. Le plan « prédit » la désintégration du Nigeria pour 2015. Il convient de citer l’enquête en détail :
L’ensemble du rapport du [National Intelligence Council] est en réalité une déclaration d’intentions codée sur la façon dont les États-Unis prévoient éventuellement démanteler le Nigeria grâce à des complots de déstabilisation [...]
Étape 1: Pakistaniser le Nigeria
Vu la réalité existentielle du fléau de Boko Haram, la vague d’attentats et d’attaques sur les bâtiments publics sont susceptibles de dégénérer dans les mois à venir.
Le but est d’exacerber les tensions et la suspicion mutuelle entre les adeptes des deux religions au Nigeria et de les mener à la violence interconfessionnelle [...]
Étape 2: L’internationalisation de la crise
Les États-Unis, l’Union européenne et les Nations Unies appellerons à l’arrêt des violences. [...] Pour créer de l’effet, il y aura une couverture importante des médias internationaux sur la crise du Nigeria avec de soi-disant experts pour discuter de toutes les ramifications. Ces experts s’efforceront de créer l’impression que seule une intervention étrangère bienveillante pourrait résoudre la crise.
Étape 3: La grande division en vertu d’un mandat de l’ONU
L’on proposera d’abord l’intervention d’une force internationale de maintien de la paix afin de séparer les groupes belligérants et/ou un mandat de l’ONU assignant différentes parties du Nigeria à des puissances occupantes. Bien sûr, les États-Unis et leurs alliés, guidés par des purs intérêts économiques, auront préalablement discuté dans les coulisses des zones à occuper [...] (Ibid., c’est l’auteure qui souligne)
En 2012, le Nile Bowie écrivait:
Le Nigerian Tribune a rapporté que Boko Haram reçoit du financement de différents groupes de l’Arabie saoudite et du Royaume-Uni, en particulier du Fonds fiduciaire Al-Muntada, dont le siège est au Royaume-Uni et à la Société islamique mondiale de l’Arabie saoudite [8]. Lors d’une entrevue menée par Al-Jazeera avec Abou Mousab Abdel Wadoud, le chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) stipule que des organisations dont le siège est en Algérie ont fourni des armes au mouvement Boko Haram au Nigeria « pour défendre les musulmans au Nigeria et arrêter les avancées d’une minorité de croisés ».
Fait amplement documenté, les membres d’Al-Qaïda (AQMI) et du Groupe islamique combattant en Libye (GICL) ont combattu aux côtés des rebelles libyens et reçu directement des pays de l’OTAN des armes et du soutien logistique durant le conflit libyen en 2011 [...]
Image: Abdelhakim Belhadj, chef des rebelles pendant la guerre de 2011 en Libye et ancien commandant du Groupe islamique combattant en Libye lié à Al-Qaïda.
Pour l’administration Obama, l’appui clandestin à des organisations terroristes dans le but d’atteindre ses objectifs de politique étrangère semble être la condition préalable au commandement des opérations à l’étranger. Boko Haram existe comme une division séparée de l’appareil de déstabilisation étasunien, visant à briser le pays le plus peuplé d’Afrique et le plus grand marché potentiel. (Nile Bowie, CIA Covert Ops in Nigeria: Fertile Ground for US Sponsored Balkanization, Global Research, le 11 avril 2012)
Des reportages indiquent également que certains commandants nigérians sont possiblement impliqués dans le financement de l’insurrection.
Selon le reportage, un soldat nigérian dans l’État de Borno a confirmé que Boko Haram a attaqué Gamboru Ngala en leur présence, mais que leur commandant leur a demandé de ne pas repousser l’attaque. Le soldat a dit au Service Hausa de la BBC que des hélicoptères planaient dans le ciel tandis que les attaques étaient en cours. Trois cents personnes ont été tuées, des maisons et un marché brûlés tandis que les soldats regardaient, ayant reçu l’ordre de ne pas prêter assistance à ceux qui étaient attaqués. Le soldat a déclaré que l’insurrection de Boko Haram prendra fin lorsque les officiers supérieurs de l’armée cesseront de l’alimenter.

Lors des enlèvements de filles de Chibok, un soldat a affirmé en entrevue à SaharaReporters,
« Nous avons reçu l’ordre d’arrêter les véhicules transportant les filles, mais dès le début de la mission, nous avons reçu l’ordre contraire, soit de nous retirer. Je peux vous assurer que personne ne nous a demandé de chercher quiconque. »
Certains soldats soupçonnent leurs commandants de révéler les opérations militaires à la secte Boko Haram. (Audu Liberty Oseni, Who is Protecting Boko Haram. Is the Nigerian Government involved in a Conspiracy?, africanexecutive.com, 28 mai 2014)
Ces commandants auraient-ils été contraints par des éléments de l’ambassade étasunienne, tel que le suggère l’enquête de Greewhite Coalition citée auparavant?
Boko Haram: Le prochain chapitre dans la frauduleuse, coûteuse, destructrice et meurtrière guerre au terrorisme?
Il a été clairement démontré que la soi-disant guerre contre le terrorisme a fait croître le terrorisme. Nick Turse explique :
Dix ans après que Washington eut commencé à verser l’argent des contribuables dans la lutte contre le terrorisme et les efforts de stabilisation à travers l’Afrique, et que ses forces eurent commencé à exploiter le Camp Lemonnier [Djibouti], le continent a connu de profonds changements, mais pas ceux recherchés par les États-Unis. L’université de Berny Sèbe de Birmingham cite en exemple la Libye post-révolutionnaire, l’effondrement du Mali, la montée de Boko Haram au Nigeria, le coup d’État en République centrafricaine, et la violence dans la région des Grands Lacs de l’Afrique comme preuve de la volatilité croissante. « Le continent est certainement plus instable aujourd’hui qu’il ne l’était au début des années 2000, lorsque les États-Unis ont commencé à intervenir plus directement. » (Nick Turse, The Terror Diaspora: The U.S. Military and Obama’s Scramble for Africa, Tom Dispatch, 18 juin, 2013)
Que veulent les États-Unis en Afrique?
Lorsqu’il est question d’interventions à l’étranger, des décennies d’histoire ont démontré que les objectifs déclarés de l’armée étasunienne et ses véritables intentions ne sont jamais les mêmes. L’intention réelle ne consiste jamais à sauver des humains, mais plutôt à sauver des profits et à gagner du pouvoir. Les interventions des États-Unis et de l’OTAN ne sauvent pas, elles tuent.
Celles menées depuis le début du siècle ont tué des centaines de milliers, si ce n’est plus d’un million d’innocents. Difficile de dire combien, car l’OTAN ne veut pas vraiment savoir combien de civils elle tue. Comme le notait The Guardian en août 2011, il n’y avait « pas de projet international de grande envergure consacré au bilan des décès dans le conflit en Libye », à part durant une brève période.
En février 2014, « on estimait qu’au moins 21 000 civils [étaient] décédés de mort violente en raison de la guerre » en Afghanistan selon Cost of War. En ce qui concerne l’Irak, en mai 2014 on comptait « au moins 133 000 civils tués, victimes de violence directe depuis l’invasion ».
Quant à la Libye, les médias traditionnels ont d’abord menti à propos du fait que Kadhafi avait initié la violence en attaquant des manifestants pacifiques, un faux compte-rendu destiné à diaboliser Kadhafi et galvaniser l’opinion publique en faveur d’une autre intervention militaire. Comme l’explique le Centre Belfer for Science and International Affairs, « ce sont effectivement les manifestants qui ont initié la violence ».
Alan Kuperman écrit :
Le gouvernement a réagi aux gestes des rebelles en envoyant l’armée, mais n’a jamais intentionnellement ciblé de civils ou eu recours à l’usage excessif et aveugle de la force, comme l’ont affirmé les médias occidentaux [...]
Le plus grand malentendu à propos de l’intervention de l’OTAN, c’est qu’elle a sauvé des vies et a bénéficié à la Libye et ses voisins. En réalité, lorsque l’OTAN est intervenue à la mi-mars 2011, Kadhafi avait déjà repris le contrôle de presque toute la Libye, alors que les rebelles se retiraient rapidement vers l’Égypte. Ainsi, le conflit était sur le point de se terminer à peine six semaines après avoir éclaté, avec un bilan d’environ 1 000 morts, incluant les soldats, les rebelles et les civils pris entre deux feux. En intervenant, l’OTAN a permis aux rebelles de résumer leur attaque, prolongeant ainsi la guerre pendant encore sept mois et causant la mort d’au moins 7000 personnes de plus. (Alan Kuperman, Lessons from Libya: How Not to Intervene, Belfer Center for Science and International Affairs, septembre 2013)
Malgré ces chiffres, les médias tenteront encore une fois de nous convaincre que ce dont le monde a le plus besoin en ce moment est de se débarrasser du groupe terroriste Boko Haram et qu’une intervention militaire est la seule solution, même si la soi-disant guerre contre la terreur a en fait accru le terrorisme à l’échelle mondiale. Comme le faisait remarquer Washington’s Blog en 2013, « le terrorisme à l’échelle mondiale a diminué entre 1992 et 2004… mais est monté en flèche depuis 2004 ».

Le Guardian rapportait pour sa part en novembre 2014 :
L’Index mondial du terrorime (Global Terrorism Index) a enregistré près de 18 000 décès l’an dernier, un bond d’environ 60 % par rapport à l’année précédente. Quatre groupes sont responsables de la majorité de ces décès : le groupe État islamique (EI) en Irak et en Syrie; Boko Haram au Nigeria; les talibans en Afghanistan; et Al-Qaïda dans diverses parties du monde. (Ewen MacAskill, Fivefold increase in terrorism fatalities since 9/11, says report, The Guardian, 18 novembre 2014)
Le Guardian omet toutefois de mentionner, que tous ces groupes, y compris Boko Haram et le groupe État islamique, ont été, d’une manière ou d’une autre, armés, entraînés et financés par l’alliance des États-Unis et de l’OTAN, ainsi que leurs alliés au Moyen-Orient.
Grâce à l’appui clandestin des pays occidentaux, des marchands d’armes et des banquiers qui profitent de la mort et de la destruction, la guerre au terrorisme se porte bien. L’Occident prône des interventions militaires sans fin, feignant d’ignorer les causes réelles du terrorisme et la raison pour laquelle il se répand, cachant son rôle et de ce fait indiquant clairement son réel objectif en Afrique : alimenter le terrorisme pour déstabiliser et détruire des pays, justifiant ainsi l’invasion militaire menant à la conquête des terres les plus riches du continent africain, tout en feignant de sauver le monde de la terreur.
- Source : Julie Lévesque
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, géopolitique, afrique, affaires africaines, boko haram, nigéria, afrique occidentale, islamisme, djihadisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
„Energieunion“: Die EU erklärt Russland den Energiekrieg

Foto: Joshua Doubek/ Wikimedia (CC BY-SA 3.0)
Die EU-Kommission will, dass die Mitgliedstaaten energiepolitisch viel enger kooperieren. Die Rede ist von gemeinsamen Verhandlungen mit Lieferanten. Die Strom- und Gaspreise für die Kunden sollen dadurch günstiger werden, lautet das Versprechen. Derzeit ist die in den letzten Wochen kräftig beworbene „Europäische Energieunion“ zwar noch ohne praktische Auswirkung, wie der Energieexperte Fritz Binder-Krieglstein im Interview mit der Neuen Freien Zeitung erklärt. Denn in den EU-Vertrag, der den Nationalstaaten die Entscheidungshoheit über ihre Energiepolitik gibt, greifen die Pläne nicht ein – noch nicht.
Vorstellung der Ziele in Washington
Doch die Ziele, die EU-Politiker mit der Energieunion verfolgen, sind hoch gesteckt und haben nicht zwingend etwas mit Umwelt- oder Konsumentenschutz zu tun. Der Spanier Miguel Arias Cañete, EU-Kommissar für Energie, ließ bereits unmissverständlich wissen, wohin die Reise gehen soll. Die tatsächlichen Ziele erklärte er jedoch nicht den europäischen Bürgern, sondern den Zuhörern einer Grundsatzrede, die Cañete am 4. Februar 2015 in Washington hielt, und zwar beim „Atlantic Council“ – einer Denkfabrik, die sich folgendes zum Ziel gesetzt hat:
Förderung "konstruktiver US-Führerschaft" und US-amerikanischen Engagements in internationalen Angelegenheiten auf Basis der zentralen Rolle der atlantischen Gemeinschaft bei der Bewältigung der internationalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Vorsitzender des Atlantic Council war Chuck Hagel, ehe er im Jahr 2013 zum US-Verteigungsminister berufen wurde, der er bis 12. Februar 2015 blieb. Und mit US-Kriegspolitik hängt auch die EU-Energieunion eng zusammen, wie Kommissar Cañete in seiner Rede unumwunden zugab:
And finally on Ukraine. Our cooperation here has been immense. From reform measures in Ukraine, to sanctions against Russia. From reverse gas flow from Slovakia to Ukraine, to integration of South East Europe in the EU's energy market. All have been driven by EU-US cooperation.
Together then, we already have achieved so much, but we could still achieve so much more.
The best way to do this is through our trans-Atlantic market - the world's largest trade and investment zone.
Russisches Gas soll aus Europa gedrängt werden
Das Ziel ist klar: Russland soll als Lieferant aus dem europäischen Markt gedrängt werden. Dies wurde dort natürlich längst erkannt, wie nicht nur der Abbruch des Pipeline-Projekts "South Stream" durch Präsident Putin nach wiederholten Provokationen durch die EU zeigt. Laut dem russischen Energieexperten Sergej Kondratjew versucht die EU-Kommission, die europäischen Verbraucher in einem Pool zu vereinigen, in dem für jeden gleiche Bedingungen geschaffen werden werden. Bei Gazprom liege der Preisunterschied für europäische Abnehmer zwischen 20 und 30 Prozent, so der Experte gegenüber der rusisschen Nachrichtenagentur Sputnik. Gazprom verhandle daher bereits über eine massive Ausweitung seiner Gaslieferungen nach China.
Nachdem die strategischen Pläne zur Energieunion keine nennenswerten Änderungen im Energiemix – Stichwort „Energiewende“ – vorsehen, muss das Gas also künftig von woanders importiert werden. Hier kommt der von Canete bereits angesprochene „transatlantische Markt ins Spiel“. In Washington sagte der Energie-Kommissar weiter:
Energy needs to be a key part of Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership discussions. Our trans-Atlantic energy approach needs to be embedded in this new agreement, we need detailed provisions and promote common standards for the energy sector, and we need gas to be traded freely across the Atlantic.
Gas müsse also frei über den Atlantik gehandelt werden – als Teil des umstrittenen TTIP-Abkommens. Für die FPÖ, deren Umwelt- und Energiesprecher Norbert Hofer die EU-Pläne massiv ablehnt, steht fest, um welche Art von Gas es sich dabei handeln muss, nämlich um das durch Fracking gewonnene Schiefergas. Der Abbauboom der letzten Jahre hat die USA als Energieproduzent an Bedeutung gewinnen lassen. Im Interview mit FPÖ-TV sagt Hofer:
In Wirklichkeit versucht man über diese Energieunion, Gas aus den USA nach Europa zu transportieren, TTIP auch hier mit einfließen zu lassen, und man sagt den Menschen die Unwahrheit.
Offensichtlich sei von beiden Seiten des Atlantiks über die Köpfe der Bevölkerung hinweg bereits alles auspaktiert, so Hofer. Der Verdacht liegt nahe, denn der Vizepräsident der EU-Kommission, der Slowake Maroš Šefčovič, träumt bereits vom freien Energiefluss durch Europa, als wär er die fünfte EU-Grundfreiheit.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, géopolitique, énergie, gaz, gazoducs, hydrocarbures, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Etats-Unis en Europe. De quoi je me mêle?

Les Etats-Unis en Europe. De quoi je me mêle?
Peter Eisner
Ex: http://thomasferrier.hautetfort.com
Nous ne sommes vraiment pas en Europe. Nous avons toujours l’OTAN et, derrière l’OTAN, les Etats-Unis d’Amérique qui gouvernent notre politique dite « étrangère », laquelle est, bien souvent, la politique interne à l’Europe. Ce sont eux qui ont décidé de la manière dont allait se disloquer la Yougoslavie, avec des conséquences terribles pour cette région. Il est vrai que les Européens ont commencé par manquer à leur devoir, à commencer par les Allemands qui se sont empressés de reconnaître la Croatie, en ne convoquant pas une conférence pour organiser pacifiquement ce démembrement. Ce sont donc les Etats-Unis qui ont décidé des bons et des méchants, avec les bons Bosniaques musulmans qui pouvaient se permettre de bombarder le marché de Sarajevo pour en accuser les Serbes et les bons Croates qui ont chassé de leur terre les Serbes de la Krajina. Cela nous le savions depuis longtemps.
Nous pensions que l’Europe, nulle sur le plan des relations internationales, gérait un peu mieux son économie. Le problème de la dette grecque lui incombe ; ce sont les citoyens des autres pays européens qui paieront. Or qui faisait la loi en Grèce jusqu’aux dernières élections ? C’était une « troïka » représentant le FMI, la BCE et la commission. Le FMI est une instance internationale. Qu’a-t-il donc à faire dans nos problèmes ? A la rigueur il pourrait prêter à l’Europe qui prêterait à la Grèce ; mais il prête directement. Quant à la BCE, elle est indépendante. Il reste la commission, qui est à l’Europe ce que les fermiers généraux étaient à notre ancien régime. Où sont les représentants du peuple européen ? Le nouveau pouvoir grec a raison de ne plus vouloir de cette troïka. En revanche cela ne change rien pour lui sur le fond. Jusqu’ici nous n’avions que les conséquences d’une gestion lamentable des problèmes par des dirigeants européens incapables, en Grèce et ailleurs. Or voici que survient un fait nouveau. Monsieur Obama se permet de porter un jugement positif sur les demandes grecques. De quoi je me mêle ?
Ces derniers jours, la situation dans l’Ukraine orientale a appelé une initiative d’Angela Merkel et de François Hollande. L’idée n’était pas mauvaise, mais elle faisait suite à des déclarations belliqueuses en provenance des Etats-Unis, qui leur faisaient peur. Etait-ce un éclair de lucidité ? On peut en douter. Dans cette affaire il y a quelque chose qui cloche, indépendamment de tout jugement sur les responsabilités respectives des Ukrainiens et des Russes. Dans quel esprit nos deux chefs d’état sont-ils venus à Minsk ? Comme médiateurs ? Si c’était le cas, il fallait au moins respecter les apparences. Pourquoi les occidentaux se concertent-ils toujours avec Porochenko avant de parler à Poutine ? Pourquoi ce même Porochenko a-t-il été invité, après les accords de Minsk, à Bruxelles ? Ou alors ils veulent imposer leurs vues à la Russie. Pourquoi pas ? Mais, dans un tel cas, il leur est inutile de s’encombrer d’Ukrainiens qui ne peuvent que les gêner par leur intransigeance.
Il faut dire que les journalistes ne font pas preuve non plus d’une impartialité ne serait-ce qu’apparente. C’est ainsi que Vladimir Poutine, président élu comme les autres et juste plus populaire chez lui que ces autres, est qualifié de « maître du Kremlin » ? Pourquoi ne parle-t-on pas du maître (de la maîtresse ?) du Bundestag, du maître de l’Elysée ?
Il y a cependant bien pire. On a vu Biden donner des leçons et proférer des menaces. C’est son droit. Cependant quand il dit qu’il donnera des armes à l’Ukraine en cas d’échec, sans se soucier du responsable de l’échec, il pousse Porochenko à chercher cet échec. Sans doute l’échec n’a-t-il pas été total dans la mesure où les deux grands « européens » voulaient annoncer une issue positive à leurs opinions nationales. Mais on voit aujourd’hui Porochenko annoncer que le cessez le feu a peu de chances d’être respecté. Comment le sait-il ? Parce qu’il ne le fera pas respecter ? Or, si les accords ne sont pas suivis d’effet, on sanctionnera la Russie, sans chercher le responsable. D’ailleurs ces sanctions ne seront levées que si les tensions diminuent. On ne cherche pas non plus à savoir qui pourrait l’empêcher.
Il y a deux explications possibles. Ou bien les dirigeants de l’UE veulent se faire bien voir de la Pologne et des Etats-Unis. Ou alors ils cajolent Porochenko parce qu’ils veulent le lâcher. Peut-être est-ce un peu les deux. Ou alors ce ne serait qu’une nouvelle version du politiquement correct. Quand on est du « bon » côté, quand on œuvre pour la « bonne » cause, alors tout est permis. Les Anglo-Saxons savent très bien faire. Les américains ne savent-ils pas truquer les preuves quand ils croient avoir la justice pour eux ?
Dans cette ambiance, il est très étonnant que quelques politiciens et commentateurs se soient mis à tenir un discours différent de celui des dirigeants et des médias. C’est ainsi que, dans le journal Le Monde, François Fillon a écrit que les Etats-Unis s’étaient disqualifiés dans le différend entre Russes et Ukrainiens. C’est ainsi que, dans L’Express, Christian Makarian écrit que « notre incompréhension [de la Russie] révèle notre fainéantise intellectuelle, ce voluptueux sentiment de supériorité ». Il conclut magistralement ainsi : « on réagit [face à Vladimir Poutine qui exploite les déficiences molles du commerce] par la réduction du commerce. Or on ne peut lui répliquer que par une idée plus haute, plus vaste de l’Europe ». Dans le même journal, Jacques Attali, qu’on connaît plutôt comme un insupportable mondialiste, voit plus loin : « la Russie doit être notre alliée ». Le croissant de nos ennemis va « du Nigeria à la Tchétchénie, en passant par le Mali, la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan et une partie du Pakistan ». Il décrit en même temps les vrais ennemis d’Israël. Surtout il n’y met pas l’Iran, qu’il ne résume pas à quelques dirigeants aboyeurs, ni même les Chiites. Il semblerait qu’il ait enfin compris.
Peter EISNER (PSUNE/LBTF)
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, actualité, europe, affaires européennes, union européenne, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 mars 2015
“Djihadisation” de la crise ukrainienne

Il y a un pattern de la folie des psychologies occidentaliste-américaniste opérationnalisée par la médiocrité des esprits en une politique d’une bêtise proche de la perfection par son mécanisme répétitif et convulsif. Dans la crise ukrainienne, nous sommes au terme de ce pattern avec l’intrusion assez significative pour être appréciée comme structurelle des djihadistes islamistes, évidemment du côté de Kiev qui siphonne tous les déchets et ordures du désordre de la déstructuration-dissolution du bloc BAO.
• Commençons par le côté le plus léger de la bêtise arrogante et sûre d’elle des médias télévisés d’information US, – référence en la matière, – et CNN pour le cas, – référence des références, ajoutant la maladresse technique à l’inculture et à l’ignorance. L’incident indique symboliquement et selon une fatalité de l’inversion cette intrusion de l’islamisme dans la crise ukrainienne, au travers du penchant à la caricature extrême et fascinée pour le président Poutine. Cette historiette, rapporté par Sputnik.News le 27 février 2015 aurait pu figurer dans le bestiaire de la “haine-fascination” du bloc BAO pour Poutine, la maladresse de CNN largement inspirée par l’inculture pouvant être alors considérée comme un de ces “actes manqués” qu’affectionne la psychanalyse, transposé dans le domaine de la technique d’intendance de communication... Il s’agit de la substitution de l’illustration d’une nouvelle sur Jihadi Jonh (l’exécuteur de l’État islamique du journaliste James Foley, identifié comme Mohamed Emwazi, ayant vécu au Royaume-Uni et largement poussé vers l’extrémisme par le harassement sécuritaire des services idoines britanniques)...
«La CNN a affiché une image de Vladimir Poutine lors d'une information consacrée à l'identification du membre de l'EI ayant décapité le journaliste US James Foley. La chaîne de TV américaine CNN s'est excusée après avoir accompagné d'une image de Vladimir Poutine une information consacrée à l'identification du bourreau de l'Etat islamique. “En raison d'une défaillance du serveur vidéo, une photo de Vladimir Poutine préparée pour une autre info est apparue lors d'un bulletin d'informations. Nous présentons nos excuses pour cette erreur”, a indiqué la chaîne dans un communiqué. [...] En novembre 2014, la chaîne a[vait] “confondu” Barack Obama et Oussama ben Laden dans un sous-titre qui accompagnait une information sur les attaques ayant visé le soldat Robert O'Neill après qu'il eut affirmé avoir abattu le chef d'Al-Qaïda.»
• Tout cela pour nous conduire à la situation en Ukraine où il apparaît désormais assuré que les djihadistes islamistes, plus ou moins et plutôt beaucoup plus que moins connectés à l’État Islamiste (IE, ou ISIS/Daesh), se trouvent à l’œuvre en nombre respectable, parmi les diverses unités constituées mais absolument autonomes qui se battent du côté de Kiev contre les séparatistes de novorussia. On trouve donc un front néonazi-islamiste particulièrement significatif de l’esprit du temps, côté civilisation. C’est The Intercept, le site de Glenn Greenwald, qui donne une série de deux textes, extrêmement documentés, produits d’un reportage de Marcin Mamon sur place, en Ukraine (tous deux le 26 février 2015, sur le phénomène en général, et le 26 février 2015 sur l’aspect particulier de la mort du chef tchétchène Isa Munayev).
Il s’agit essentiellement de groupes de terroristes islamistes tchétchènes qui sont déjà sur place depuis un certain temps, venus sous l’impulsion du chef terroriste tchétchène Isa Munayev, abattu dans les combats ukrainiens Le 1er février. (1) Ces combattants sont directement liés à l’EI/ISIS/Daesh, témoignant de l’extension du nouveau phénomène terroriste né de la politique de déstructuration organisée selon une ligne aboutissant au nihilisme du désordre, principalement de la part des USA avec leurs alliés divers et exotiques (Israël, Qatar, Arabie), pour accoucher de ce que les dirigeants-Système désignent aujourd’hui comme la première menace contre la stabilité du bloc BAO selon un processus d’inversion complète désormais bien rôdé dans son automatisme échappant à tout contrôle organisé. Les lignes d’introduction du premier texte de Mamon ne laissent aucun doute sur cette parenté qui fait comprendre que l’Ukraine est effectivement entrée dans la zone d’action intensive du terrorisme islamiste, – bien entendu, du côté de Kiev.
«“Our brothers are there,” Khalid said when he heard I was going to Ukraine. “Buy a local SIM card when you get there, send me the number and then wait for someone to call you.” Khalid, who uses a pseudonym, leads the Islamic State’s underground branch in Istanbul. He came from Syria to help control the flood of volunteers arriving in Turkey from all over the world, wanting to join the global jihad. Now, he wanted to put me in touch with Rizvan, a “brother” fighting with Muslims in Ukraine.
»The “brothers” are members of ISIS and other underground Islamic organizations, men who have abandoned their own countries and cities. Often using pseudonyms and fake identities, they are working and fighting in the Middle East, Africa and the Caucasus, slipping across borders without visas. Some are fighting to create a new Caliphate — heaven on earth. Others — like Chechens, Kurds and Dagestanis — say they are fighting for freedom, independence and self-determination. They are on every continent, and in almost every country, and now they are in Ukraine, too.»

• Le 27 février 2015, toujours sur The Intercept, Glenn Greenwald donne la mesure de l’importance que le groupe de journalistes du site accorde à ce témoignage sur le déploiement des terroristes de l’IE en Ukraine. Greenwald commence par rendre compte du témoignage au Congrès d’un de ses vieux “ennemis intimes”, le directeur du renseignement national James Clapper affirmant la nécessité de l’envoi d’armes aux forces de Kiev ; cela, en posant la question désormais sempiternelle, notamment à la lumière de l’expérience syrienne et catastrophique : “Qui, exactement, allons-nous armer ?” Greenwald rappelle effectivement l’expérience syrienne, avec les flots d’armes destinées aux rebelles syriens anti-Assad, dits-modérés et convenables, et terminant dans les mains des extrémistes et des forces de l’EI. Il développe ensuite la description de la profusion de combattants néonazis et d’extrême-droite en Ukraine, à qui nombre de ces armes parviendront, et étend évidemment cette logique à la composante structurelle fondamentale nouvelle des terroristes islamistes, largement documentée par les textes de Mamon.
«A similar dynamic [as the one in Syria] is at play in Russia and Ukraine. Yesterday, Obama’s top national security official, Director of National Intelligence James Clapper, told a Senate Committee “that he supports arming Ukrainian forces against Russian-backed separatists,” as the Washington Post put it. The U.S. has already provided “non-lethal” aid to Ukrainian forces, and Obama has said he is now considering arming them. Who, exactly, would that empower?
«Russian President Vladimir Putin has long said that the Ukrainian coup of last year, and the subsequent regime in Kiev, is driven by ultra-nationalists, fascists, and even neo-Nazi factions. The Russian TV outlet RT also frequently refers to “the active role far-right groups have played on the pro-government side in Ukraine since the violent coup of the last year.” For that reason, anyone pointing out that arming the regime in Kiev would strengthen fascists and neo-Nazis is instantly accused of being a Putin propagandist: exactly like those arguing that the best anti-Assad fighters were al-Qaeda-affiliated were accused of being Assad propagandists (until that became the official position of the US Government). U.S. media accounts invariably depict the conflict in Ukraine as a noble struggle waged by the freedom-loving, pro-west democrats in Kiev against the oppressive, aggressive “Russian-backed” separatists in the east. But just as was true in Syria: while some involved in the Ukrainian coup were ordinary Ukrainians fighting against a corrupt and oppressive regime, these claims about the fascist thugs leading the fight for the Kiev government are actually true...»
Suit un long exposé rassemblant nombre de témoignages, de preuves évidentes, d’évidences aveuglantes, etc., sur l’importance et le rôle majeur que jouent ces forces néonazies quasiment incontrôlées, sinon par des oligarques eux-mêmes incontrôlés et dont l’autorité sur ces groupes ressemble d’ailleurs, plutôt, à une complicité où le financier (l’oligarque) n’a de poids que dans la mesure où il reste le financier, et se révèle finalement, dans le rapport de forces, aussi bien prisonnier de ces groupes que pseudo-inspirateur. Ayant terminé cet exposé largement documenté, Greenwald introduit le constat sur la présence des djihadistes, renvoyant aux articles de Mamon («The Intercept yesterday published reporting from Marcin Mamon on the role jihadists are playing in the conflict on behalf of the government»), pour finalement poser la question mille fois recommencée désormais dans toutes les aventures pathologiques du bloc BAO/des USA : «Now that Obama’s leading national security official is expressly calling for the arming of those forces, it is vital that the true nature of America’s allies in this conflict be understood.»
Il y a deux facteurs à considérer dans ces diverses interventions. D’abord, l’irruption de The Intercept, avec la caution appuyée de Glenn Greenwald et de son immense notoriété, dans la crise ukrainienne. Après un effacement de quelques mois, nous saluions le 16 janvier 2015 le “retour” de Greenwald dans un sujet de grande audience, – la crise-“Charlie” en France. A côté de cela, Greenwald/The Intercept s’étaient montrés assez modestes par rapport à la crise ukrainienne. Cela tenait notamment, à notre sens, à une position générale qui affecte plus ou moins les antiSystème de gauche sensibles à l’humanitarisme et aux “valeurs” qui vont avec, donc malgré tout sensible aux argumentaires du Système qui relève de l’affectivisme (ex-“affectivité”), redoutablement efficace. Cela tient à cette simple équivalence : s’engager comme il est naturel pour un antiSystème contre le cirque de Kiev, c’est objectivement se placer du côté de Poutine, et beaucoup dans la gauche antiSystème sont sensibles à l’image de diabolisation qui a été construite autour du président russe.
On a avait déjà ressenti cela, d’une façon évidemment beaucoup plus atténuée, lors de l’affaire Snowden où le groupe Greenwald avait joué un rôle majeur. Snowden ayant obtenu le droit d’asile en Russie, son soutien intensif impliquait là aussi qu’on se rangeât peu ou prou du côté de Poutine. De ce point de vue il y eut donc une certaine gêne, celle qu’on a décrite, mais qui n’interféra guère pour ce cas à cause du soutien massif apporté à Snowden qui primait sur tout le reste. Dans la crise ukrainienne, l’implication (du groupe Greenwald) était moins évidente et il y eut jusqu’à l’évolution actuelle une retenue beaucoup plus marquée que dans le cas précédent. Mais avec la documentation de l’intrusion du facteur islamiste/EI où le groupe Greenwald joue un rôle important, cette retenue s’atténue et il y a de fortes chances qu’elle continuera à s’atténuer considérablement, à la mesure de l’importance de l’engagement des islamistes qui ira en grandissant.
C’est un point important dans la mesure où le groupe Greenwald dispose toujours d’un très grand crédit et d’une influence à mesure, notamment dans l’intelligentsia occidentale. On avait déjà proposé cette interprétation lors du “retour” du groupe après les avatars de son incorporation dans le système FirstLook.org de Pierre Omidyar. C’était également pour la crise-“Charlie”, le 16 janvier 2015, et nous proposions ceci pour ce qui concerne la probable influence de cette évolution : «Plus encore, l’intervention de Greenwald donne également une caution internationale au constat encore plus important que la crise-Charlie déchire directement une classe occupant une place fondamentale dans la bataille, – la classe réunissant le monde intellectuel, le complexe médiatique avec presse-Système et réseaux antiSystème, le showbiz et ses diverses ramifications.» Cette fois, l’intervention dans la crise ukrainienne du groupe Greenwald interfère directement dans les positions de la classe intellectuelle américaniste-occidentaliste, dans ces positions qui sont absolument exacerbées jusqu’au paroxysme à cause du déterminisme narrativiste. C’est nécessairement, par le jeu des engagements et des oppositions, la dénonciation absolument hystérique à la position russe qui est indirectement attaquée, et Greenwald lui-même se trouvant dans ce cas nettement plus impliqué que dans les circonstances précédentes qui ont été rappelées du côté de Poutine.
Il faut dire que l’enjeu est de taille, – et c’est évidemment en venir au second point de ce commentaire. Certes, ce n’est pas la première fois qu’on signale, d’une façon plus ou moins documentée un certain engagement islamiste (tchétchène), ou des rumeurs d’engagement islamiste du côté de Kiev, dans la crise ukrainienne. Mais cette fois, l’engagement est minutieusement documenté ; il est clairement et directement connecté à l’État Islamiste/ISIS/Daesh et il est largement et minutieusement placé dans la logique opérationnelle de la catastrophe syrienne où l’action initiale a accouché du monstre EI que toutes les directions politiques du bloc BAO désignent et dénoncent désormais comme la principale menace.
Si cette nouvelle situation se confirme et si l’intrusion islamique est de plus en plus documentée comme c’est probable maintenant qu’elle est débusquée et mise en évidence du côté de la communication, c’est un facteur nouveau de très grande importance dans la problématique de la crise ukrainienne qui implique une quasi-intégration en devenir avec la crise du Moyen-Orient, renforçant encore l’aspect du cœur brûlant de la Grande Crise qu’est l’Ukraine. L’on comprend que ce facteur nouveau va contribuer à brouiller les cartes, à entraver d’une façon peut-être décisive l’effort constant du Système pour continuer à définir cette crise en termes manichéens (noir-blanc, méchants-gentils, etc.). Pour les pays européens, déjà confrontés dans un état d’esprit d’hyper-réaction sécuritaire et d’extrême activisme de communication à ce qui est perçu comme la conséquence (terrorisme) du développement de l’EI au Moyen-Orient, l’intrusion de ce facteur dans la crise ukrainienne représente un nouveau motif d’alarme d’une puissance considérable. Bien entendu, cette situation porte une contradiction encore plus insupportable que celle qui est apparue en Syrie, – à cause de la proximité géographique et des conditions déjà suspectes de nombre d’éléments du régime de Kiev : le soutien apporté à l’UE à un régime qui emploie des forces qui menacent directement, dans l’esprit des dirigeants européens, la sécurité et l’équilibre des pays dont ils ont la charge. La même contradiction, avec en plus l’aspect de la grogne transatlantique actuelle, marque la possible initiative de livraison d’armes US à l’Ukraine, dont une certaine partie parviendrait aux djihadistes d’Ukraine.
Note
(1) Mise à jour le 3 mars 2015. Dans le texte original, nous avions erronément mentionné la mort au combat de Munayev à “l'automne dernier”. En fait, l'affaire est beaucoup plus récente et participe directement de cette question de la présence djiadiste dans les combats en Ukraine : Munayev a été tué le 1er février, lors de la bataille de Debaltsevo.
00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, caucase, ukraine, tchétchène, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'AFRIQUE EN PERDITION... de l'Afrique du Nord au Sahel

Bernard Lugan*
Ex: http://metamag.fr
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, bernard lugan, géopolitique, afrique, affaires africaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The Neoconservative Threat to International Order

The Neoconservative Threat to International Order
Last week I was invited to address an important conference of the Russian Academy of Sciences in Moscow. Scholars from Russia and from around the world, Russian government officials, and the Russian people seek an answer as to why Washington destroyed during the past year the friendly relations between America and Russia that President Reagan and President Gorbachev succeeded in establishing. All of Russia is distressed that Washington alone has destroyed the trust between the two major nuclear powers that had been created during the Reagan-Gorbachev era, trust that had removed the threat of nuclear armageddon. Russians at every level are astonished at the virulent propaganda and lies constantly issuing from Washington and the Western media. Washington’s gratuitous demonization of the Russian president, Vladimir Putin, has rallied the Russian people behind him. Putin has the highest approval rating ever achieved by any leader in my lifetime.
Washington’s reckless and irresponsible destruction of the trust achieved by Reagan and Gorbachev has resurrected the possibility of nuclear war from the grave in which Reagan and Gorbachev buried it. Again, as during the Cold War the specter of nuclear armageddon stalks the earth.
Why did Washington revive the threat of world annihilation? Why is this threat to all of humanity supported by the majority of the US Congress, by the entirety of the presstitute media, and by academics and think-tank inhabitants in the US, such as Motyl and Weiss, about whom I wrote recently?
It was my task to answer this question for the conference. You can read my February 25 and February 26 addresses below. But first you should understand what nuclear war means. You can gain that understanding here.
The Threat Posed to International Relations By The Neoconservative Ideology of American Hegemony,
Address to the 70th Anniversary of the Yalta Conference, Hosted by Institutes of the Russian Academy of Sciences and Moscow State Institute of International Relations, Moscow, February 25, 2015, Hon. Paul Craig Roberts
Colleagues,
What I propose to you is that the current difficulties in the international order are unrelated to Yalta and its consequences, but have their origin in the rise of the neoconservative ideology in the post-Soviet era and its influence on Washington’s foreign policy.
The collapse of the Soviet Union removed the only constraint on Washington’s power to act unilaterally abroad. At that time China’s rise was estimated to require a half century. Suddenly the United States found itself to be the Uni-power, the “world’s only superpower.” Neoconservatives proclaimed “the end of history.”
By the “end of history” neoconservatives mean that the competition between socio-economic-political systems is at an end. History has chosen “American Democratic-Capitalism.” It is Washington’s responsibility to exercise the hegemony over the world given to Washington by History and to bring the world in line with History’s choice of American democratic-capitalism.
In other words, Marx has been proven wrong. The future does not belong to the proletariat but to Washington.
The neoconservative ideology raises the United States to the unique status of being “the exceptional country,” and the American people acquire exalted status as “the indispensable people.”
If a country is “the exceptional country,” it means that all other countries are unexceptional. If a people are “indispensable,” it means other peoples are dispensable. We have seen this attitude at work in Washington’s 14 years of wars of aggression in the Middle East. These wars have left countries destroyed and millions of people dead, maimed, and displaced. Yet Washington continues to speak of its commitment to protect smaller countries from the aggression of larger countries. The explanation for this hypocrisy is that Washington does not regard Washington’s aggression as aggression, but as History’s purpose.
We have also seen this attitude at work in Washington’s disdain for Russia’s national interests and in Washington’s propagandistic response to Russian diplomacy.
The neoconservative ideology requires that Washington maintain its Uni-power status, because this status is necessary for Washington’s hegemony and History’s purpose.
 The neoconservative doctrine of US world supremacy is most clearly and concisely stated by Paul Wolfowitz, a leading neoconservative who has held many high positions: Deputy Assistant Secretary of Defense, Director of Policy Planning US Department of State, Assistant Secretary of State, Ambassador to Indonesia, Undersecretary of Defense for Policy, Deputy Secretary of Defense, President of the World Bank.
The neoconservative doctrine of US world supremacy is most clearly and concisely stated by Paul Wolfowitz, a leading neoconservative who has held many high positions: Deputy Assistant Secretary of Defense, Director of Policy Planning US Department of State, Assistant Secretary of State, Ambassador to Indonesia, Undersecretary of Defense for Policy, Deputy Secretary of Defense, President of the World Bank.
In 1992 Paul Wolfowitz stated the neoconservative doctrine of American world supremacy:
“Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival, either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere, that poses a threat on the order of that posed formerly by the Soviet Union. This is a dominant consideration underlying the new regional defense strategy and requires that we endeavor to prevent any hostile power from dominating a region whose resources would, under consolidated control, be sufficient to generate global power.”
For clarification, a “hostile power” is a country with an independent policy (Russia, China, Iran, and formerly Saddam Hussein, Gaddafi, Assad).
This bold statement struck the traditional American foreign policy establishment as a declaration of American Imperialism. The document was rewritten in order to soften and disguise the blatant assertion of supremacy without changing the intent. These documents are available online, and you can examine them at your convenience.
Softening the language allowed the neoconservatives to rise to foreign policy dominance. The neoconservatives are responsible for the Clinton regime’s attacks on Yugoslavia and Serbia. Neoconservatives, especially Paul Wolfowitz, are responsible for the George W. Bush regime’s invasion of Iraq. The neoconservatives are responsible for the overthrow and murder of Gaddafi in Libya, the assault on Syria, the propaganda against Iran, the drone attacks on Pakistan and Yemen, the color revolutions in former Soviet Republics, the attempted “Green Revolution” in Iran, the coup in Ukraine, and the demonization of Vladimir Putin.
A number of thoughtful Americans suspect that the neoconservatives are responsible for 9/11, as that event gave the neoconservatives the “New Pearl Harbor” that their position papers said was necessary in order to launch their wars for hegemony in the Middle East. 9/11 led directly and instantly to the invasion of Afghanistan, where Washington has been fighting since 2001. Neoconservatives controlled all the important government positions necessary for a “false flag” attack.
Neoconservative Assistant Secretary of State Victoria Nuland, who is married to another neoconservative, Robert Kagan, implemented and oversaw Washington’s coup in Ukraine and chose the new government.
The neoconservatives are highly organized and networked, well-financed, supported by the print and TV media, and backed by the US military/security complex and the Israel Lobby. There is no countervailing power to their influence on US foreign power.
The neoconservative doctrine goes beyond the Brzezinski doctrine, which dissented from Detente and provocatively supported dissidents inside the Soviet empire. Despite its provocative character, the Brzezinski doctrine remained a doctrine of Great Power politics and containment. It is not a doctrine of US world hegemony.
While the neoconservatives were preoccupied for a decade with their wars in the Middle East, creating a US Africa Command, organizing color revolutions, exiting disarmament treaties, surrounding Russia with military bases, and “pivoting to Asia” to surround China with new air and naval bases, Vladimir Putin led Russia back to economic and military competence and successfully asserted an independent Russian foreign policy.
When Russian diplomacy blocked Washington’s planned invasion of Syria and Washington’s planned bombing of Iran, the neoconservatives realized that they had failed the “first objective” of the Wolfowitz Doctrine and had allowed “the re-emergence of a new rival . . . on the territory of the former Soviet Union” with the power to block unilateral action by Washington.
The attack on Russia began. Washington had spent $5 billion over a decade creating non-governmental organizations (NGOs) in Ukraine and cultivating Ukrainian politicians. The NGOs were called into the streets. The extreme nationalists or nazi elements were used to introduce violence, and the elected democratic government was overthrown. The intercepted conversation between Victoria Nuland and the US ambassador in Kiev, in which the two Washington operatives choose the members of the new Ukrainian government, is well known.
If the information that has recently come to me from Armenia and Kyrgyzstan is correct, Washington has financed NGOs and is cultivating politicians in Armenia and the former Soviet Central Asian Republics. If the information is correct, Russia can expect more “color revolutions” or coups in other former territories of the Soviet Union. Perhaps China faces a similar threat in Uyghurstan.
The conflict in Ukraine is often called a “civil war.” This is incorrect. A civil war is when two sides fight for the control of the government. The break-away republics in eastern and southern Ukraine are fighting a war of secession.
Washington would have been happy to use its coup in Ukraine to evict Russia from its Black Sea naval base as this would have been a strategic military achievement. However, Washington is pleased that the “Ukraine crisis” that Washington orchestrated has resulted in the demonization of Vladimir Putin, thus permitting economic sanctions that have disrupted Russia’s economic and political relations with Europe. The sanctions have kept Europe in Washington’s orbit.
Washington has no interest in resolving the Ukrainian situation. The situation can be resolved diplomatically only if Europe can achieve sufficient sovereignty over its foreign policy to act in Europe’s interest instead of Washington’s interest.
The neoconservative doctrine of US world hegemony is a threat to the sovereignty of every country. The doctrine requires subservience to Washington’s leadership and to Washington’s purposes. Independent governments are targeted for destabilization. The Obama regime overthrew the reformist government in Honduras and currently is at work destabilizing Venezuela, Bolivia, Ecuador, and Argentina, and most likely also Armenia and the former Central Asian Soviet Republics.
Yalta and its consequences have to do with Great Power rivalries. But in the neoconservative doctrine, there is only one Great Power–the Uni-power. There are no others, and no others are to be permitted.
Therefore, unless a moderate foreign policy arises in Washington and displaces the neoconservatives, the future is one of conflict.
It would be a strategic error to dismiss the neoconservative ideology as unrealistic. The doctrine is unrealistic, but it is also the guiding force of US foreign policy and is capable of producing a world war.
In their conflict with Washington’s hegemony, Russia and China are disadvantaged. The success of American propaganda during the Cold War, the large differences between living standards in the US and those in communist lands, overt communist political oppression, at times brutal, and the Soviet collapse created in the minds of many people nonexistent virtues for the United States. As English is the world language and the Western media is cooperative, Washington is able to control explanations regardless of the facts. The ability of Washington to be the aggressor and to blame the victim encourages Washington’s march to more aggression.
This concludes my remarks. Tomorrow I will address whether there are domestic political restraints or economic restraints on the neoconservative ideology.
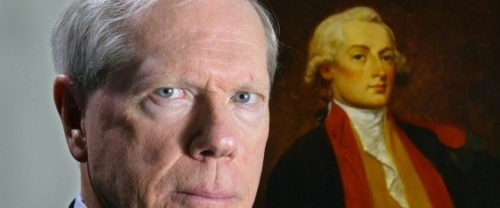
Paul Craig Roberts, Address to the 70th Anniversary of the Yalta Conference, Moscow, February 26, 2015
Colleagues,
At the plenary session yesterday I addressed the threat that the neoconservative ideology poses to international relations. In this closing session I address whether there are any internal restraints on this policy from the US population and whether there are economic restraints.
Just as 9/11 served to launch Washington’s wars for hegemony in the Middle East, 9/11 served to create the American police state. The Constitution and the civil liberties it protects quickly fell to the accumulation of power in the executive branch that a state of war permitted.
New laws, some clearly pre-prepared such as the PATRIOT Act, executive orders, presidential directives, and Department of Justice memos created an executive authority unaccountable to the US Constitution and to domestic and international law.
Suddenly Americans could be detained indefinitely without cause presented to a court. Habeas corpus, a constitutional protection which prohibits any such detention, has been set aside.
Suddenly people could be tortured into confessions in violation of the right against self-incrimination and in violation of domestic and international laws against torture.
Suddenly Americans and Washington’s closest allies could be spied on indiscriminately without the need of warrants demonstrating cause.
The Obama regime added to the Bush regime’s transgressions the assertion of the right of the executive branch to assassinate US citizens without due process of law.
The police state was organized under a massive new Department of Homeland Security. Almost immediately whistleblower protections, freedom of the press and speech, and protest rights were attacked and reduced.
It was not long before the director of Homeland Security declared that the department’s focus has shifted from Muslim terrorists to “domestic extremists,” an undefined category. Anyone can be swept into this category. Homes of war protesters were raided and grand juries were convened to investigate the protesters. Americans of Arab descent who donated to charities–even charities on the State Department’s approved list–that aided Palestinian children were arrested and sentenced to prison for “providing material support to terrorism.”
All of this and more, including police brutality, has had a chilling effect on protests against the wars and the loss of civil liberty. The rising protests from the American population and from soldiers themselves that eventually forced Washington to end the Vietnam War have been prevented in the 21st century by the erosion of rights, intimidation, loss of mobility (no-fly list), job dismissal, and other heavy-handed actions inconsistent with a government accountable to law and the people.
In an important sense, the US has emerged from the “war on terror” as an executive branch dictatorship unconstrained by the media and barely, if at all, constrained by Congress and the federal courts. The lawlessness of the executive branch has spread into governments of Washington’s vassal states and into the Federal Reserve, the International Monetary Fund, and the European Central Bank, all of which violate their charters and operate outside their legal powers.
Jobs offshoring destroyed the American industrial and manufacturing unions. Their demise and the current attack on the public employee unions has left the Democratic Party financially dependent on the same organized private interest groups as the Republicans. Both parties now report to the same interest groups. Wall Street, the military/security complex, the Israel Lobby, agribusiness, and the extractive industries (oil, mining, timber) control the government regardless of the party in power. These powerful interests all have a stake in American hegemony.
The message is that the constellation of forces preclude internal political change.
Hegemony’s Achilles heel is the US economy. The fairy tale of American economic recovery supports America’s image as the safe haven, an image that keeps the dollar’s value up, the stock market up, and interest rates down. However, there is no economic information that supports this fairy tale.
Real median household income has not grown for years and is below the levels of the early 1970s. There has been no growth in real retail sales for six years. The labor force is shrinking. The labor force participation rate has declined since 2007 as has the civilian employment to population ratio. The 5.7 percent reported unemployment rate is achieved by not counting discouraged workers as part of the work force. (A discouraged worker is a person who is unable to find a job and has given up looking.)
A second official unemployment rate, which counts short-term (less than one year) discouraged workers and is seldom reported, stands at 11.2 percent. The US government stopped including long-term discouraged workers (discouraged for more than one year) in 1994. If the long-term discouraged are counted, the current unemployment rate in the US stands at 23.2 percent.
The offshoring of American manufacturing and professional service jobs such as software engineering and Information Technology has decimated the middle class. The middle class has not found jobs with incomes comparable to those moved abroad. The labor cost savings from offshoring the jobs to Asia has boosted corporate profits, the performance bonuses of executives and capital gains of shareholders. Thus all income and wealth gains are concentrated in a few hands at the top of the income distribution. The number of billionaires grows as destitution reaches from the lower economic class into the middle class. American university graduates unable to find jobs return to their childhood rooms in their parents’ homes and work as waitresses and bartenders in part-time jobs that will not support an independent existence.
With a large percentage of the young economically unable to form households, residential construction, home furnishings, and home appliances suffer economic weakness. Cars can still be sold only because the purchaser can obtain 100 percent financing in a six-year loan. The lenders sell the loans, which are securitized and sold to gullible investors, just as were the mortgage-backed financial instruments that precipitated the 2007 US financial crash.
None of the problems that created the 2008 recession, and that were created by the 2008 recession, have been addressed. Instead, policymakers have used an expansion of debt and money to paper over the problems. Money and debt have grown much more than US GDP, which raises questions about the value of the US dollar and the credit worthiness of the US government. On July 8, 2014, my colleagues and I pointed out that when correctly measured, US national debt stands at 185 percent of GDP.
This raises the question: Why was the credit rating of Russia, a country with an extremely low ratio of debt to GDP, downgraded and not that of the US? The answer is that the downgrading of Russian credit worthiness was a political act directed against Russia in behalf of US hegemony.
How long can fairy tales and political acts keep the US house of cards standing? A rigged stock market. A rigged interest rate. A rigged dollar exchange value, a rigged and suppressed gold price. The current Western financial system rests on world support for the US dollar and on nothing more.
The problem with neoliberal economics, which pervades all countries, even Russia and China, is that neoliberal economics is a tool of American economic imperialism, as is Globalism. As long as countries targeted by Washington for destabilization support and cling to the American doctrines that enable the destabilization, the targets are defenseless.
If Russia, China, and the BRICS Bank were willing to finance Greece, Italy, and Spain, perhaps those countries could be separated from the EU and NATO. The unraveling of Washington’s empire would begin.
Paul Craig Roberts is a former Assistant Secretary of the US Treasury and Associate Editor of the Wall Street Journal. Roberts’ How the Economy Was Lost is now available from CounterPunch in electronic format. His latest book is How America Was Lost.
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, paul craig roberts, états-unis, neocons, néoconservateurs, bellicisme, bellicisme américain, sme américain |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 mars 2015
Michel Raimbaud : « Les États-Unis n'ont qu'une logique : celle du chaos »
Michel Raimbaud : « Les États-Unis n'ont qu'une logique : celle du chaos »
 Ancien ambassadeur français en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe, l'écrivain Michel Raimbaud* vient de publier « Tempête sur le Grand Moyen-Orient », un ouvrage qui s'annonce déjà comme un classique de la géopolitique moyen-orientale et eurasienne. Il revient sur ce projet élaboré par les néoconservateurs américains qui a non seulement déstabilisé le monde arabo-musulman, reconfiguré les relations internationales, mais fait désormais des vagues jusqu'en Europe, avec la violence qu'on connaît.
Ancien ambassadeur français en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe, l'écrivain Michel Raimbaud* vient de publier « Tempête sur le Grand Moyen-Orient », un ouvrage qui s'annonce déjà comme un classique de la géopolitique moyen-orientale et eurasienne. Il revient sur ce projet élaboré par les néoconservateurs américains qui a non seulement déstabilisé le monde arabo-musulman, reconfiguré les relations internationales, mais fait désormais des vagues jusqu'en Europe, avec la violence qu'on connaît.
Vous avez placé en épigraphe de votre livre cette citation de Voltaire : « Pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. » De qui parlez-vous?
Il suffit de voir autour de soi. La maxime s'applique à ce qu'on appelle le « pouvoir profond »… On ne peut pas critiquer certaines catégories de personnes et les sujets qui vont avec, dont ceux que je traite dans ce livre. Ce sont ces sujets sensibles.
Vous dites que l'expression « printemps arabe » n'est pas un concept arabe, mais occidental. Le nouveau président tunisien l'a confirmé. Est-ce cela qui explique ce qui s'est passé dans le monde arabe ?
Tout à fait. La naissance de ce concept est le fait d'intellectuels et de journalistes français. Il se réfère aux printemps démocratiques, celui de 1848 qui a tenté de bousculer les vieilles monarchies européennes vermoulues, le printemps de Prague en 1968, Mai-68 en France… Cette assimilation historique est un peu hâtive. Sans compter qu'en Tunisie, le printemps du jasmin, c'était en hiver !
Vous n'avez pas de mots assez durs pour évoquer le printemps arabe : « Une appellation plutôt usurpée pour une saison sinistre n'ayant guère d'arabe, à part le nom, qu'une vague façade en carton-pâte derrière laquelle se tapissent un fanatisme islamiste de la pire espèce, des pompes à finances wahhabites inépuisables », etc. Et j'en passe…
Je le pense depuis le début. Tous les pays arabes ont été touchés sauf les monarchies. Le Bahreïn est une exception à cause de sa « minorité » chiite qui constitue plus de 70 % de la population. Au Yémen, on a découvert à l'occasion de la guerre civile qu'il existe une minorité chiite, les zaydites, représentant 40 % de la population. Il y a des chiites cachés en Turquie, il en existe aussi au Pakistan, entre 20 % et 25 % de la population.
Qu'entendez-vous par un Grand Moyen-Orient situé entre l'empire atlantique et l'Eurasie ? Peut-on encore parler, à propos de l'Otan, d'un empire ? Quant à l'Eurasie, elle est encore embryonnaire. N'est-ce pas une anticipation ?
Oui c'est une anticipation. L'expression du Grand Moyen-Orient elle-même est de George Bush. Ce n'est plus un Moyen-Orient dans la mesure où il va de la Méditerranée à la Chine centrale. L'Eurasie est en gestation, certes, mais le changement se produit sous nos yeux. Les Brics sont en formation, surtout son noyau euro-asiatique. Cet ensemble a de l'avenir.
Mais le Grand Moyen-Orient n'est-il pas une vue de l'esprit ? On a l'impression, plutôt, d'un monde éclaté…
C'est le monde arabo-musulman d'aujourd'hui qui est éclaté. L'expression Grand Moyen-Orient est concise et couvre une vaste région. L'empire Atlantique se place face au bloc euro-asiatique. Ces blocs existent déjà et le deuxième est en voie d'organisation.
Comment expliquer que le mal nommé « printemps » ait pu réveiller la guerre froide ? Et que la Russie et la Chine se soient liguées pour contrer ce projet ?
Cette opposition russo-chinoise est une grande première. Jusqu'en 1991, le monde est bipolaire avec, entre les deux blocs, une Chine qui trouble un peu le jeu. Au milieu se trouvent les pays non-alignés, terre de mission pour les deux camps. En 1991, à la chute de l'URSS, on a cru en l'avènement du monde multipolaire. Ce n'était pas vrai : ce que l'on a vu, c'est l'avènement du monde unipolaire, le monde américain. L'Occident va alors pouvoir gouverner au nom de la « communauté internationale », sans opposition, pendant vingt ans, jusqu'en 2011. Puis il va s'évanouir avec les crises de la Libye et de la Syrie.
Tout capote avec ces pays, et nulle part ailleurs.
La Chine va se joindre à la Russie lors de la guerre de Libye, le vrai point de rupture. Auparavant, les deux pays avaient été mis en condition pour accepter la résolution 1973, avec l'idée qu'il fallait protéger la population civile. C'est la mise en œuvre de cette résolution qui a fait déborder le vase. Ils se sont rendu compte qu'ils avaient été bernés, et qu'ils avaient fait une erreur en s'abstenant.
Les bombardements commencent le lendemain de l'adoption de la résolution des Nations unies. L'Otan, qui n'y était mentionnée nulle part, entre en guerre, bombarde tout, démolit tout. En toute illégalité. Si on regarde le chapitre 7 de la charte des Nations unies, on constate que toutes les dispositions qui encadrent les interventions ont été violées. Y compris celles au prétexte humanitaire. Pour la Chine et la Russie, il n'y aura plus jamais de résolutions à la libyenne. Elles s'opposent six mois plus tard à la résolution sur la Syrie, apposant quatre fois leur veto. Je ne comprends pas que les Occidentaux n'aient pas compris que la Russie et la Chine ne rejoindraient plus jamais la fameuse communauté internationale pour ce genre d'aventures.
La Syrie est donc fondatrice de la nouvelle donne internationale…
C'est l'épicentre d'un conflit global qui dure depuis quatre ans. Si le gouvernement légal de la Syrie était tombé comme les autres auparavant, ou si le régime avait été renversé comme celui de Kadhafi, il y aurait eu d'autres printemps arabes. Mais la Syrie en a été le coup d'arrêt. Les Russes ne voulaient pas tant soutenir la Syrie, mais ils y ont trouvé un partenaire, un point d'ancrage solide. Avant l'Ukraine… Ils ont cultivé l'alliance et rameuté les Bric autour d'eux, à commencer par la Chine. Quatre vetos sur la Syrie : la Chine garde un profil discret, mais ferme. Impressionnant. Au summum de la crise sur les armes chimiques en Syrie, en 2013, il y avait certes les gesticulations russes et américaines, mais il y avait aussi des navires de guerre chinois au large des côtes syriennes. C'est une première et cela devrait faire réfléchir les Occidentaux.
Pourquoi l'Occident séculier soutient-il des mouvements islamistes qu'il combat chez lui ?
Par absence de logique. À ce propos, il faut distinguer les États-Unis et ses alliés au Conseil de sécurité, qui ont des traditions de grandes puissances, et les alliés privilégiés des États-Unis, mais qui n'ont pas les mêmes motivations. Globalement, les Américains sont ceux qui commandent et ont mis en œuvre une stratégie du chaos. Ils ont continué à soutenir les gens d'Al-Qaïda, dont ils sont les créateurs avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Puis, quand ils n'en ont plus eu besoin, ils les ont laissé tomber en leur disant « débrouillez-vous ». Mais toute cette affaire s'est retournée contre eux avec les attentats du 11-Septembre.
Les mouvements terroristes internationaux, comme ceux qui sévissent en Syrie et ailleurs dans le Moyen-Orient ou le monde musulman, sont des héritiers d'Al-Qaïda. Les États-Unis n'ont pas de raison de ne pas s'en servir, tout en sachant que ce n'est pas leur modèle social. Ils les utilisent puis, quand ils ne s'en servent plus, ils les bombardent.
Je ne crois pas que les États-Unis aient une sympathie particulière pour les mouvements islamistes, ni pour les Arabes d'ailleurs – cela se saurait. Mais ils peuvent s'accommoder de tout. Leurs meilleurs alliés sont des gouvernements islamistes. Ils ont du mal à trouver des alliés progressistes : ils n'en ont jamais eu dans l'Histoire.
Vous étiez ambassadeur à Riyad, où l'on vient d'assister à une scène de succession moyenâgeuse. Tous les chefs d'État occidentaux s'y sont rués pour prêter allégeance au nouveau roi d'Arabie. Qu'est-ce qui les fait vraiment courir, à part le brut ?
Le pétrole et les intérêts d'Israël. Dans tout le monde arabe, il existe un terreau favorable à la contestation, mais on n'a pas le droit d'y intervenir et de bombarder sous prétexte que les peuples sont menacés par des tyrans. D'autant qu'on se rend compte que ce type d'opération est menée pour changer le régime ou détruire le pays. Il est plus facile d'exploiter le pétrole avec des pays fragilisés.
Le pétrole détourné d'Irak et de Syrie va notamment vers Israël, sans besoin d'oléoducs. Vendu en contrebande à 15 dollars le baril lorsque celui-ci était à 120 dollars, ce pétrole a rapporté des revenus conséquents : 5 milliards de dollars. Des sommes qu'on ne transporte pas dans des matelas ! Il faut des banques, des complices pour les mettre sur le marché. Les circuits parallèles fonctionnent.
Des documents secrets du Pentagone à propos de la Libye viennent de donner une autre explication à cette guerre. Hillary Clinton, conseillée par les Frères musulmans, aurait caché à Obama que Kadhafi était en négociation avec le Pentagone pour passer la main, et que l'histoire du génocide menaçant les habitants de Benghazi était inventée de toutes pièces. L'Occident joue-t-il contre son propre camp ?
Il existe tellement de machinations qu'on finit par se prendre les pieds dans le tapis. Il y a toujours des histoires des services spéciaux, etc. Les renseignements sont pipés. Les services jouent un grand rôle là-dedans. Cela dit, Hillary Clinton n'est pas la finesse même sur la Libye, la façon dont elle rit à l'annonce de la mort de Kadhafi le prouve. Un ambassadeur américain a été tué de la même façon que lui pourtant.
Pourquoi la Syrie a-t-elle été jusqu'ici l'exception, et comment analyser l'émergence de l'État islamique ?
J'espère que la Syrie restera l'exception, du moins dans ce contexte-là. L'affaire est loin d'être terminée, mais il y a plusieurs raisons. Bachar al-Assad, quoi qu'on en dise, a une légitimité, il est populaire chez la majorité de ceux qui vivent en Syrie. Quels que soient les défauts de son régime, il est perçu dans le contexte actuel comme un rempart contre le démantèlement du pays. Il a des alliés chiites comme le Hezbollah, l'Iran, certainement une vieille alliance qui date du temps du shah. Il a un véritable partenariat avec la Russie : la Russie défend la Syrie, mais la Syrie défend aussi la Russie. Si la Syrie devait subir le sort des autres pays, la Russie le sentirait passer. Et son prestige international s'en ressentirait.
Quel est le jeu d'Israël ? Vous étiez ambassadeur au Soudan. Quel regard jetez-vous sur ce pays éclaté ?
Israël est derrière toutes les crises du monde arabe, toujours à l'affût. La sécession du Sud-Soudan est un triomphe de la diplomatie américaine et de la diplomatie israélienne. Il fallait transformer le Sud-Soudan en base israélienne, pour le complot contre ce qui reste du Soudan. Ils veulent affaiblissement de ce pays non pas parce qu'ils sont islamistes, mais parce qu'ils ont soutenu Saddam. Ils ne veulent pas la peau de Tourabi ou Al-Bachir, ils veulent couper le Soudan en morceaux. Ils ont réussi, et cela continue avec le Darfour.
Mais le nouvel État, le Soudan du Sud, n'est pas brillant…
Mais lequel des régimes nés des « printemps arabe » est-il brillant ? L'industrie de production de la démocratie américaine au nouveau Grand Moyen-Orient est un trompe-l'œil qui vient des années 1980-1990. Cela n'a rien à voir avec la démocratie et les droits de l'homme : cette stratégie sert à casser le monde arabo-musulman, comme cela est attesté dans de nombreux documents. Car les Américains font ce qu'ils disent, et disent ce qu'ils font.
Il y a un plan, ce n'est pas de la conspiration. Quels que soient les avatars pour soutenir tel ou tel camp, les options restent ouvertes. Au Bahreïn par exemple, ils soutiennent à la fois la rébellion, ce qui leur permet de dire qu'ils défendent les droits de l'homme et la démocratie, et la monarchie pro-saoudite sunnite. Et ils sont gagnants de toute façon. Ils ont fait la même chose au Yémen, et en Égypte, même chose : d'abord Moubarak, puis les islamistes, puis Morsi et maintenant Sissi. Ce n'est pas logique, c'est la logique du chaos. Et elle est bel et bien là.
Comment expliquer que le savoir-faire français sur le Moyen-Orient s'avère inopérant ? Il y avait une certaine politique arabe de la France qui est aujourd'hui introuvable. La diplomatie française est-elle victime de myopie ou d'une certaine posture idéologique ?
De Gaulle était un grand homme je pense. Il avait bien une politique arabe exemplaire, il a renversé le cours des relations franco-arabes après l'indépendance de l'Algérie et réussi à changer d'alliance après la guerre des Six-Jours. Après les néfastes conséquences de l'expédition de Suez, c'était un exploit. Une politique arabe a persisté dans une espèce de consensus politique en France. Puis, après le coup d'honneur sur l'Irak, en 2003, la France a commencé à rentrer dans le bercail occidental. Fini la récréation. Le bilan est désastreux.
Elle a pourtant un savoir-faire et avait une grande tradition diplomatique. C'est un grand pays, pas dans le sens d'un pays braillard qui manigance à tout prix… Un grand pays au sens positif du terme. Son retrait peut peut-être changer, mais je ne vois pas venir le changement maintenant.
Hollande continue de dire que l'État islamique et le régime de Bachar, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, deux ennemis à combattre…
Depuis quatre ans, on continue de dire le pire sur Bachar, qu'il va tomber d'une minute à l'autre… En réalité, ce sont les Américains qui peuvent changer d'avis et sont en train de le faire. Les alliés privilégiés de la France sont le Qatar, la Turquie et l'Arabie Saoudite. On a vu défiler les six monarques du Golfe à Paris, nos alliés. On soutient à la fois les terroristes modérés et les djihadistes démocratiques. C'est une position difficilement tenable, de la haute acrobatie. Les Américains, eux ne l'ont pas fait en même temps : d'abord alliés d'Al-Qaïda, puis leurs ennemis. Ils changent d'avis sans se gêner.
Fabius a dit qu'Al-Nosra, classée par les Américains comme organisation terroriste, fait du bon boulot en Syrie…
Tous les éléments spécialisés de la diplomatie française ont été dispersés ; les spécialistes de l'Orient, les arabisants ont été envoyés en Afrique du Sud ou ailleurs, avec la volonté de les remplacer par des technocrates. Résultat, les nouveaux diplomates n'ont pas la même carrure, produisent des rapports nuls, n'ont pas d'analyse sérieuse…
Les ambassadeurs français en Syrie et en Libye avaient pourtant alerté le gouvernement en le mettant en garde contre tout aventurisme.
Oui, mais celui de Syrie s'est ensuite fait taper sur les doigts et a fini par accepter de s'aligner sur la politique officielle.
Pensez-vous qu'on peut revenir à la diplomatie de l'après-Suez ? L'Occident est-il en train de comprendre ses erreurs et de changer ?
Le retour de De Gaulle au pouvoir a brisé un consensus, quand le gouvernement tripartite français, qui a duré douze ans, faisait que la France ne bougeait pas le petit doigt sans en référer à Washington. Cela inclut la période de Suez. Le plan Marshall avait un coût pour l'indépendance nationale française. Et l'Union européenne – conçue par les Américains plus que par les Européens eux-mêmes – a contribué à peser en ce sens. Toute l'histoire de l'atlantisme, l'idée de faire de l'Otan l'armée de l'Europe, n'est pas la conception française de l'Europe.
L'État islamique est-il une création indirecte de l'Occident ?
Il est le résultat de l'invasion américaine de l'Irak. On peut dire cela à tous les coups. Les Américains ont cassé toutes les institutions irakiennes (armée, police, gouvernement, parti baath, etc.) et facilité la prise de pouvoir par les chiites et des Kurdes au détriment des sunnites. Quand les officiers baathistes ont été mis en prison où séjournaient déjà les islamistes, les deux groupes ont fait connaissance. La prison a été le centre d'étude et de fusion entre des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement – comme cela arrive ailleurs.
L'État islamique aurait profité de la zone d'exclusion aérienne imposée depuis 1991. C'est là que Zarkawi et ses hommes se seraient développés.
En effet, c'est là qu'ils se sont développés. Il n'y avait plus d'État irakien et la porte était ouverte à toutes les aventures. Ce qui a favorisé les événements de juin 2013 ? Une conjonction d'islamistes et d'officiers du Baath irakien, désireux de revanche, pourchassés tous deux par les Américains. Ils ont décidé d'unir leur destin pour des objectifs différents. Peut-être pas pour le long terme.
L'Occident semble préférer le chaos aux États souverainistes…
C'est ce qui apparaît. Le chaos, c'est le but des néoconservateurs qui ont une vieille théorie : il fallait maîtriser toute la zone qui ceinturait le monde communiste soviétique et chinois, et d'autre part sécuriser les intérêts occidentaux. Les Américains se sont aperçus que cette zone était entièrement constituée de pays musulmans. C'est la ceinture verte musulmane, ce qui est devenu le Grand Moyen-Orient de Bush, gonflé au fil des pulsions américaines. Il y avait deux catégories de pays dans cette zone : les États forts, comme l'Iran du shah, ou la Turquie entrée dans l'Otan, peut être aussi l'Irak, des régimes amis de l'Occident. Et les autres qu'il fallait affaiblir, où il fallait provoquer des changements de régime, renverser les pouvoirs en place.
Puis des États ont viré de bord, comme l'Iran avec la révolution islamique. Quand la configuration est défavorable, on essaie de changer le régime, et si on n'y arrive pas, on casse l'État – en particulier les armées du monde arabe –, on ruine le pays. Cette stratégie figure dans beaucoup de documents américains ou israéliens. Ça s'est produit avec les armées égyptienne, irakienne, syrienne et sans doute algérienne.
Mais le chaos est contagieux et peut toucher les monarchies du Golfe. Celles-ci seraient-elles les grandes perdantes face à l'axe chiite ?
Dans l'esprit de certains dirigeants américains, c'est ce qui va arriver. Un ancien directeur de la CIA a dit qu'il fallait s'occuper des pays comme la Syrie et l'Égypte, déstabiliser huit pays… L'idée, c'est de leur « préparer » un islam qui leur convienne et d'aider les musulmans à accéder au pouvoir. Quand ces pays auront bien été déstabilisés, alors on pourra s'occuper de l'Arabie Saoudite. Le pacte de Quincy signé en 1945 a été renouvelé en 2005 pour soixante ans, mais il ne durera pas.
Les États-Unis n'ont pas aidé le shah à se maintenir au pouvoir. Il n'était plus fréquentable, il a été renversé. Résultat, l'ayatollah Khomeiny a aussitôt pris le pouvoir, et l'Iran est devenu un des ennemis publics numéro un de l'Amérique. Jusqu'en 1979, ce pays était pourtant l'allié stratégique, y compris l'allié nucléaire. Il existait une vraie coopération entre l'Iran et les États-Unis dans ce domaine, avec un traité, des laboratoires, etc.
La question nucléaire a été mise à l'ordre du jour en 2002. Après que l'Iran eut le temps de s'occuper de l'Irak… Avant on n'en parlait pas. Puis les Européens, avec des Américains qui en arrière-plan soutenaient la démarche, se sont benoîtement rappelés du traité de non-prolifération…
On est au cœur d'une nouvelle guerre froide avec l'Ukraine. Jusqu'où ce conflit va-t-il reconfigurer le nouvel ordre mondial en gestation ? Quels sont les effets sur le Grand Moyen-Orient ?
En France, on fait rarement un lien entre les différents problèmes, on a tendance à les saucissonner. Cela empêche une compréhension de la situation. J'ai peu entendu les gens établir un rapport entre la crise syrienne et la crise ukrainienne. Pourtant, il est évident. Il n'y aurait pas eu de relance de la crise ukrainienne s'il n'y avait pas eu la crise syrienne. Autrement dit, si la Russie avait laissé tomber Bachar, il n'y aurait pas eu une crise ukrainienne à ce niveau de gravité. On s'en serait accommodés. On a fait la surenchère surtout pour enquiquiner la Russie.
Sans la crise ukrainienne, les Brics auraient-ils pris la même importance sur la scène internationale ?
Sans la crise syrienne il faut dire. Car la crise ukrainienne est un développement de la guerre en Syrie. La guerre d'Ukraine s'inscrit dans le grand mouvement qui a déclenché les printemps arabes. En même temps qu'on essaie de contrôler des pays arabes musulmans et d'étendre petit à petit la zone de crise, on tente de casser ce qu'était l'URSS, réduite à la Russie. On veut contrôler la zone d'influence russe et la réduire au strict minimum. La Yougoslavie, en tant que pays communiste indépendant, était la partie la plus exposée ; elle sera dépecée.
Pour permettre l'intégration de toute l'Allemagne réunifiée dans l'Otan, le chancelier Kohl et Bush avaient promis à Gorbatchev que l'élargissement de l'Otan s'arrêtait là. Gorbatchev a reconnu avoir été berné. Cela a sonné la fin de la stabilité internationale. Le pacte de Varsovie a vécu, d'anciens États adhèrent à l'Union européenne et passent à l'Otan. Avec l'entrée des pays baltes dans cette organisation, la Russie est encerclée. Mais c'est la Géorgie qui a été la ligne rouge, puis l'Ukraine. La Géorgie a été le symbole du tournant de Poutine, qui avait au début décidé de collaborer avec les Occidentaux.
Les États-Unis admettent avoir contribué au renversement du régime de Kiev…
Les Européens ne sont pas très exigeants sur la légalité internationale. Peu avant que Ianoukovitch ne parte, la France, l'Allemagne, la Pologne… accouraient à Kiev pour signer un accord sur des élections anticipées entre le gouvernement, l'opposition et la Russie. Puis il y a le coup d'État et personne n'a protesté.
Il y a eu une révolution Orange en 2004-2005 en Ukraine, avant la Géorgie, puis les printemps arabes sont arrivés. C'est le rêve américain qui s'est réalisé. Mais après la crise syrienne, Obama a été vexé : on lui avait évité une guerre inutile et dangereuse, chef-d'œuvre diplomatique des Russes, et il était mis en embarras. Le président américain avait une revanche à prendre. En 2013, quand il a vu que la Russie avançait trop, notamment en Syrie, il s'en est pris à l'Ukraine. À partir de ce moment, fini la concertation entre les États-Unis et la Russie sur la Syrie.
Washington n'a plus laissé Moscou tenter de régler le problème.
Sauf dernièrement…
La Russie est revenue au premier plan. Même si je doute que les 100 000 assistants ou coopérants russes présents au début de la guerre en Syrie y soient tous encore. En fait Obama, n'est pas si va-t-en-guerre que cela. Il voudrait une solution d'un autre type, car ce qui se passe en parallèle de la guerre d'Ukraine est dangereux. Du temps des menaces de frappes américaines sur la Syrie, des armes chimiques, Obama a été menacé par une procédure d'impeachment. Sans compter les incertitudes sur les frappes américaines : lors d'un tir américain de deux missiles sur les côtes syriennes, par exemple, l'antiaérienne syrienne a réagi, l'un des missiles a été détruit et l'autre détourné. Et puis la guerre est impopulaire aux États-Unis. Cela dit, l'Ukraine est un chef-d'œuvre d'intox. On vole et on crie au voleur.
L'avenir du projet du Grand Moyen-Orient ?
Le projet démocratique certainement, même si, à mon avis, il n'y aura pas de démocratie ni printemps arabes. Le projet de domination reste, même s'il ne va pas forcément se réaliser. L'enjeu est toujours là pour les Américains. La ceinture verte est toujours utile pour encercler le postcommunisme. Même si la Chine est un régime aménagé, il est prudent de le « contenir » en quelque sorte. Les Occidentaux parlent toujours d'une opposition modérée en Syrie, je ne sais pas où ils la voient, mais c'est leur discours. Ils arment une opposition qui est en fait celle des djihadistes… L'alliance qui s'est forgée progressivement entre la Turquie, l'Arabie Saoudite et les Occidentaux, notamment États-Unis, France, Angleterre, alliance de circonstance s'il en est, résiste encore.
La Syrie peut-elle reprendre son autorité sur l'ensemble du territoire ?
Si on la laisse faire, je pense que oui. Le discours sur la démocratie est de moins en moins crédible. On n'a pas à intervenir dans les pays, même pas en Arabie Saoudite qui doit évoluer toute seule.
Le problème est que l'Arabie Saoudite exporte son idéologie, qu'elle en a une vision universaliste…
Elle exporte son idéologie pour éviter d'être attaquée à son tour. Mais celui qui a une vision universaliste, c'est Erdogan. Les projets qu'il concoctait avant le printemps arabe étaient différents. Il était proche de laSyrie et de la Libye. Maintenant, il est le soutien des Frères musulmans. Ilreçoit les visiteurs étrangers dans lepalais du Sultan avec une garde d'honneur de vingt-huit soldats représentantl es vingt-huit provinces ottomanes. Ce gouvernement islamiste est nostalgique.
00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook