Am Ende der Besprechung von Christian Schröder und Caroline Fetscher wird ein eben erschienener Schmöker mit dem Titel„Sprache – Macht – Rassismus“ empfohlen, der zur Beruhigung aller Verunsicherten „eine ausführliche Analyse des Sprachgebrauchs von Akif Pirincci“ enthalten soll.
Wie in seinem aktuellen Buch berief sich der Autor darauf, dass „die Wahrheit“ über diese aufziehende Gefahr von den Medien absichtlich verschwiegen werde. Die sprachliche Analyse führt den manipulativen und ideologischen Duktus von Pirincci klar vor Augen.
Die Autoren werden schon wissen, warum sie „Wahrheit“ in Anführungsstriche setzen. Zum einen scheint sie letztere ja nicht besonders zu interessieren; wer glaubt, auf der richtigsten aller Seiten zu stehen, muß keine Argumente bringen. Wie in Mangolds Rezension findet sich an keinem einzigen Punkt auch nur der Ansatz eines Versuches, Pirinçci sachlich zu widerlegen.
Zum anderen gehören sie augenscheinlich zu dem unter Linken weitverbreiteten Typus, der die Rede des Gegners schon dann für inhaltlich erledigt hält, wenn er sie rein „sprachlich“ dekonstruiert, was sich meistens darin erschöpft, alle Formulierungen und Gedanken, die einem nicht passen, in Anführungsstriche zu setzen oder suggestiv zu glossieren. Man spielt also „Ich sehe etwas, was du nicht siehst“, wobei die Linke heute in der Regel die Rolle der drei Tempelaffen einnimmt.
Freilich, alles hängt davon ab, was man sehen kann und will und was nicht. Machen wir die Stichprobe. Der Tagesspiegel zitiert:
„Künstler, Denker, Visionäre“ vermisst Akif Pirinçci. Statt ihrer muss der 54-jährige Deutschtürke eine Republik des „Raubtiersozialismus“ ertragen, in der er seine Steuern zahlt, um eine „verschwulte“ Polizei zu unterhalten, in der es von lotterhaften „Patchworkfamilien und Singlebörsen“ wimmelt, wo sich alle Welt „mit dem Abseitigen des Sexus“ beschäftigt, dessen „vielfältige Deformationen“ preist. Derart häufen sich die Zumutungen, dass der „Adoptivsohn“ seiner „liebsten Mutter, Deutschland“ zürnend und krakeelend in deren düstere Zukunft blickt.
Und hier noch ein paar Splitter von anderen Autoren [5] des Manuskriptum-Verlages [6]:
„Der Wohlfahrtsstaat hat uns in die Zange genommen.“ „Feminismus ist eine tropfende Hassreligion, ein totalitärer Umbau der Normalität.“ Die „auszehrende Monotonie des westlichen Diskurses“ führt zu einem „Dasein ohne Herkunft, Heimat, Nachkommenschaft und Transzendenz“.
Alles absolut richtig, daher: Zustimmung. Ich kann ehrlich gesagt, keinen Menschen mehr ernstnehmen, der das nicht so sieht.
Weiter:
Die Kernthese des Textes (…) lautet: In Deutschland dominieren suspekte Adepten der political correctness die Medien und das „kulturelle Leben“.
Auch das ist so offensichtlich richtig, daß, wer hier nicht zustimmt, entweder völlig naiv oder eben ein Förderer und Nutznießer besagter Zustände sein muß. Da hilft nur noch manisches Abwehr- und Verleugnungsgebell, und die Autoren bellen in der Tat, bis sie heiser sind.
Führen wir uns durch eine „sprachliche Analyse“ ihren „manipulativen und ideologischen Duktus klar vor Augen“. Es ist jedesmal dasselbe Gemisch, das hier Anwendung findet.
Punkt 1: man beginne mit einer faustdick demagogischen Verzerrung:
Akif Pirinçci wütet in seinem Buch „Deutschland von Sinnen“ gegen Frauen, Schwule und Zuwanderer.
Wer das Buch (oder auch nur seinen Titel) kennt, weiß, daß Pirinçci vielmehr gegen den Kult um „Frauen, Schwule und Zuwanderer“ vom Leder zieht, also gegen eine spezifische politische Agenda, deren Betreiber sich hinter der Lüge verstecken: „Wir sind die Frauen, die Schwulen, die Zuwanderer!“ Und diese werden dann, auf Schlagworte reduziert, auf die Schilde geheftet, um sich einerseits unangreifbar zu machen, und um andererseits zur moralischen Erpressung überzugehen: „Wer gegen uns und unsere Politik und unsere Lügen ist, ist gegen die Frauen, die Schwulen, die Zuwanderer!“ Da nützt es auch nichts, wenn ihre Kritiker mitunter selbst Frauen, Schwule oder Zuwanderer sind.

Punkt 2: ein Muß sind möglichst diffuse und vage Anspielungen über angebliche „Demokratiefeindlichkeit“ der inkriminierten Autoren oder Texte, völlig egal, ob diese Behauptung belegbar ist, oder nicht. Dahinter steckt eine weitere Lüge: „Wir sind die Demokraten, wir haben die Demokratie gepachtet, wer gegen uns ist, ist ein Demokratiefeind!“ In diesem speziellen Fall müssen sich die Tagesspiegel-Schreiberlinge um zwei bis drei Ecken herumwinden, um auch das noch raunend unterzubringen:
Erschienen ist das Pamphlet in einem Verlag, der Demokratiegegner und Sozialstaatshasser vereint.… Der Übergang vom Kulturpessimismus, dem viele Autoren der Manuscriptum-Verlagsgruppe anhängen, zur schneidigen Demokratieverachtung der Neuen Rechten ist fließend.
Punkt 3: der Kritiker der „political correctness“ hat niemals gute und objektive Gründe, warum er die Dinge sieht, wie er sie sieht, sondern immer nur niedere Beweggründe, die sich allein subjektiven Ursachen wie seiner psychischen Verfassung und seinem miesen Charakter verdanken. Zum Beispiel ist alles, was er schreibt, von schrecklich häßlichem Haß motiviert, und seine Kritik darf man auch nie „Kritik“ nennen, sondern nur als Haß bezeichnen:
Akif Pirinçcis Hass-Buch „Deutschland von Sinnen“… Verlag, der Sozialstaatshasser vereint. …
„Haß“ ist der Welt der Linken bekanntlich gänzlich fremd, weil dort eine haßfreie Zone herrscht, alle nur die besten und humansten Absichten haben und sich ständig an den Händen halten und ganz fest an „Liebe und Solidarität [7]“ und dergleichen glauben. Wenn ein Linker in Rage gerät, ist er allemal ein bißchen zornig, und dann immer nur deswegen, weil er sich über eine Ungerechtigkeit oder Lieblosigkeit oder Diskriminierung aufregt.
Punkt 4: „Haß“ allein genügt aber nicht, sondern der kritisierte Text muß auch lächerlich, läppisch, unfreiwillig komisch sein:
Die Kernthese des Textes, der sich streckenweise wie eine „Titanic“-Satire auf neokonservative Positionen liest, lautet…
Punkt 5: Und dabei vollkommen wirr und kreischüberkandidelt:
Pirinçci schildert diese Clique in einem schillernden Cocktail aus schrillen Ressentiments,
Punkt 6: Trotzdem wohlkalkuliert dem billigstmöglichen, populistischen Gusto angepaßt:
…er mixt ein Gebräu, das Abertausende gerne zu sich nehmen…
Denn war auf die Sarrazinaden noch der Puderzucker bürgerlicher Konvention gestreut, bietet Pirinçci rohes Fastfood für die Massen…
Punkt 7: man darf die Wirrnis des Pirinçci jedoch nicht allzu sehr verharmlosen, denn es handelt sich hier außerdem um einen hochgefährlichen, klinisch Geisteskranken, „brutal“ und „sentimental“ zugleich, der sich von „Feinden“ umzingelt fühlt, ganz so, wie wir gelernt haben, uns das Klischeebild vom Nazi-Verbrecher vorzustellen:
Im brutalisierten Furor gegen Deutschlands inneren Feinde wie in der sentimentalen Idealisierung von Deutschland als guter Mutter offenbart sich ein System psychischer Abspaltungen. Darin gleichen Pirinçcis imaginäre Gegner eher Karikaturen, Comic-Charakteren, als lebendigen Menschen, von denen er kaum einen Begriff zu haben scheint.
Daß sie letztere Manier selber ganz vortrefflich beherrschen, stellen die Autoren nur ein paar Zeilen weiter unter Beweis: sie behaupten etwa pauschal, daß es sich bei den Pirinçci-Lesern „offenbar“ um einen Haufen unterkomplexer, emotional verkrüppelter, pathologischer, ressentimentgetränkter Modernitätsverlierer handeln müsse, um überforderte Schwächlinge, die nur auf ein Stichwort lauern, um endlich die blutgeile, mörderische Urmenschensau vom Zaum zu lassen:
Offenbar sind tatsächlich beachtliche Anteile der Bevölkerung Deutschlands von Sinnen, diejenigen, die emotional mit dem pathologischen Wirrwarr dieser Publikation korrespondieren. Ob sie es aus Überforderung tun, um der Reizdichte und Komplexität der modernen, medialen Gesellschaft zu entkommen – als Symptomträger geben die Rezipienten Aufschluss über die epidemische Verbreitung von Ressentiments sowie das offenbar nur mit Mühen gebändigte Bedürfnis, ihnen enthemmt freien Lauf zu lassen.
Das ist klassische linke Bigotterie: die stupende Fähigkeit, in ein- und demselben Absatz genau das zu leisten, was man dem Gegner eben noch vorgeworfen hat, und dabei so selbstgerecht verbohrt zu sein, es nicht einmal zu merken. Inwiefern das mit einem „System psychischer Abspaltungen“ zu tun hat, die dann die Basis für Fremdprojektionen dieser Art bildet, oder ob es sich hier bloß um Knarzdummheit oder ungehemmte Demagogie handelt, sei dahingestellt.
Was die Neigung zu letzterer betrifft, so geben sich die Autoren nicht einmal ansatzweise Mühe, sie zu bändigen, sondern lassen mit Vollgas alle Zügel schießen. Da erscheint Pirinçci als der unmenschlichste, gewissenloseste Unmensch überhaupt, mit einem ultimativen ethischen Defekt, also böse:
Daher fehlt hier dann auch der politische Begriff von einer Gesellschaft, die ethische Vorstellung von Menschlichkeit überhaupt.
Und daraus kann nur was folgen? Punkt 8: Weil Hitler und „Mein Kampf“ per Mangold schon verschossen sind, wird das nächstschwerste Geschütz ausgepackt, die Dicke Breivik-Berta:
Gemeinsamer Nenner der an Anders Breiviks „Manifest“ zum Massaker erinnernden Tirade ist „schlussendlich ein vor allem von den Grünen im Laufe von dreißig Jahren installiertes Gutmenschentum, dessen Fundament aus nichts als Lügen besteht.“-… Anders als Breivik, der das Ausagieren von Ressentiment, Hass und Paranoia mörderisch zelebrierte, belässt es dieser Tobende offenbar beim Wort; man muss hoffen, dass auch seine Rezipienten so viel Zurückhaltung aufbringen.
„Offenbar“, nur vermutlich also, ist Pirinçci gerade eben noch kein Massenmörder; und man „muß“ (!) hoffen, daß seine Leser ebenfalls keine werden, und wenn, dann wäre er schuld. (Geht es, nebenbei gesagt, eigentlich noch niederträchtiger und hinterhältiger?)
Punkt 9: weil „Frauen“ im Schema des Kultes die „Guten“ sind, müssen die Autoren natürlich auf folgenden Umstand hinweisen:
Die zwei Dutzend Autoren der zum Manuscriptum-Verlag gehörenden Edition sind ausschließlich Männer –
Ausschließlich Männer! Und keine per Quote gestreuten „guten“, also weiblichen Menschen unter ihnen, nein, Männer unter sich! Was da wieder ausgebrütet wird! Daraus kann ja nur Übles erwachsen!
Um daraus aber einen richtigen Seitenhieb zu machen, muß eine weitere bewährte Platte aufgelegt werden. Um die besagten Kerle so richtig an den Eiern ihrer Mannesehre zu erwischen, werden sie als
ältere, verbittert bis weinerlich wirkende Männer,
bezeichnet. Das hat nun aber gesessen! Shame & Blame vom feinsten! Wir wissen doch alle, na klar: diejenigen, die mit den Folgen gewisser linker Politik nicht einverstanden sind, und es wagen, das Maul dagegen aufzumachen, sind allesamt Jammerlappen, Schwächlinge, Griesgräme, Loser, uncool, unmännlich und pensionsreif. Hört endlich auf zu heulen, ihr Mädchen! Indianer kennen Schmerz! Seid starke, richtige Männer und bekennt euch zur welterlösenden Mission des Feminismus! Und jetzt alle die Zähne zusammenbeißen und „schwul ist cool“skandieren!
deren Wut sich gegen die immergleichen Gegner wendet: die Emanzipation der Frauen, die Moderne, den Westen.
Ob der Hinweis auf die „immergleichen“ Gegner kritisch-abwertend gemeint ist? Das ist natürlich aus linkem Munde eine äußerst erheiternde Aussage. Beginnen wir gar nicht erst davon zu sprechen, warum „die“ Emanzipation „der“ Frauen, warum „die“ Moderne und „der“ Westen ein einheitlicher, makelloser, jeder Kritik enthobener Block des Immer-Guten, Immer-Gerechtfertigten sein sollen, und ihre „Gegner“ immer schlecht und widerlegt und unethisch. Das alles müssen wir doch Menschen, die mit der „Komplexität der modernen, medialen Gesellschaft“ so glänzend fertigwerden, daß sie es bei jeder Gelegenheit betonen müssen, nicht erzählen, oder?
Setzen wir hier einen Schlußpunkt. Unter all dem Gedöns haben die Autoren kein einziges inhaltliches Argument gegen Pirinçci (oder irgendeinen Autoren seiner Stoßrichtung) aufzuweisen. Die gute Sache allein entscheidet. Auf der einen Seite stehen gemäß ihrem Schlachtgemälde die potenziellen Verbrecher, die finsteren Ideologen, die Unterkomplexen, die Überforderten, die Bösen, die Unmenschlichen, die Uncoolen, die Alternden, die Schwächlinge, die alten Herren, die Frauenunterdrücker, die Jammersäcke, die Ungebildeten, die „Hasser“, die mühsam gebändigten Pogromgeilen und Massenmörder so weiter.
Und auf der anderen, auf ihrer Seite, steht selbstherrlich leuchtend das genaue Gegenteil: die Guten, die „Komplexen“, die „Differenzierten“, die Reflektierten, die Coolen, die Menschlichen, die Aufgeklärten, die Angst- und Haßbefreiten, die Souveränen, die Liebenden, die Solidarischen, die Modernen, die Rächer der Enterbten und so weiter, sich selbst schmeichelnde Selbstbilder, die schon längst zu Dauermasken erstarrt sind, aber durch keine inhaltliche Substanz mehr gedeckt werden.
Es ist nun genau diese überhebliche, zunehmend von der Wirklichkeit abgekoppelte Pose, die solchen Zorn und Haß bei all jenen erregt, die ihre Lügen und Anmaßungen nicht mehr hören können, und die unter den Folgen der von ihnen getragenen und mitverursachten Politik zu leiden haben.
Die Folgen ihrer Politik und Meinungsmache (zu denen inzwischen immerhin eine wachsende Zahl von Todesopfern gehört) [8] winken sie, sofern sie sie überhaupt zur Kenntnis nehmen, arrogant als Kollateralschäden ab, und unterstellen denjenigen, die sie zur Sprache bringen, niedrigste Absichten, beschimpfen sie, verletzen sie in ihrer Ehre, sprechen ihnen die Menschlichkeit und damit das Menschsein ab, erklären sie zu Feinden, nennen sie minderwertig und verhöhnen sie, schlechte Verlierer des großen Spiels zu sein, als dessen strahlende, selbstzufriedene, schlaue, dauergerechtfertigte, prahlende Sieger sie sich inszenieren.
„Sowas kommt von sowas“, lautet ein alter linker Slogan, und das Pirinçci-Buch ist nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen, sondern auch eine Frucht ihres eigenen Verhaltens. Da stehen sie nun und blinzeln wie blöd in die Sonne, und fragen sich, wieso gerade sie, die großen ewigen Unschuldslämmer und menschlichen Menschen plötzlich, aus heiterem Himmel, so wüst von diesem Türken beschimpft werden, der doch eigentlich auf ihrer Seite stehen müßte.
Nun fahren sie also reflexartig ihre üblichen Abwehrkanonen aus der rhetorischen Ramschkiste auf, und probieren eine Pistole nach der anderen aus (Textgenerator [9] gefällig?), inklusive Erpressungen, Verleumdungen, Unterstellungen, Anschwärzungen. Er sagt, wir seien geisteskrank? Das muß selber ein Geisteskranker sein! Er sagt, wir seien verantwortlich für schlechte, böse Dinge und Fehlentwicklungen? Das muß ein böser Mensch sein! Ein Psychopath! Ein Hitler! Ein sexuell Frustrierter! Ein Geschäftemacher! Ein Provokateur! Ein Fall für den Soziologen! Ein Fall für den Psychiater!
Überall suchen sie nach Erklärungen und Ursachen, nur nicht in der Wirklichkeit, nur nicht in sich selbst, niemals in sich selbst. Schon allein deswegen haben sie einen, zwei, drei, tausend Pirinçcis verdient, und kein Tonfall ist inzwischen zu scharf für sie.
URL to article: http://www.sezession.de/44690/deutschland-von-sinnen-das-bellen-der-getroffenen-hunde.ht
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/44690/deutschland-von-sinnen-das-bellen-der-getroffenen-hunde.html
URLs in this post:
[1] Image: http://www.sezession.de/44228/deutschland-von-sinnen-wie-akif-pirincci-zum-frauengeschichtsschreiber-wurde.html/pirincci
[2] Deutschland von Sinnen: http://antaios.de/buecher-anderer-verlage/aus-dem-aktuellen-prospekt/1480/deutschland-von-sinnen
[3] Godwin-Joker: http://www.sezession.de/44403/akif-pirincci-vs-ijoma-mangold-goldener-godwin-der-woche.html
[4] Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/kultur/akif-pirinccis-hass-buch-deutschland-von-sinnen-der-poebler-und-die-neue-rechte/9744444.html
[5] anderen Autoren: http://www.manuscriptum.de/edition-sonderwege/buecher/neuerscheinungen/titel/frank-boeckelmann-jargon-der-weltoffenheit/
[6] Manuskriptum-Verlages: http://www.manuscriptum.de/
[7] ständig an den Händen halten und ganz fest an „Liebe und Solidarität: http://weckerswelt.blog.de/2014/04/03/liebe-freundinnen-freunde-18143056/
[8] (zu denen inzwischen immerhin eine wachsende Zahl von Todesopfern gehört): http://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/antaios-thema/1127/deutsche-opfer-fremde-taeter.-auslaendergewalt-in-deutschland?c=13
[9] Textgenerator: http://www.taz.de/!136534/
[10] : http://de.wikipedia.org/wiki/Cultural_Marxism_(Schlagwort)
[11] : https://www.youtube.com/watch?v=PN2EoAZH1qQ
[12] : http://www.spiegel.de/panorama/justiz/a-964149.html
[13] : http://www.zeit.de/kultur/literatur/2014-04/debatte-intellektuelle-rechte-in-deutschland/seite-2
[14] : http://www.zeit.de/kultur/literatur/2014-04/debatte-intellektuelle-rechte-in-deutschland





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg



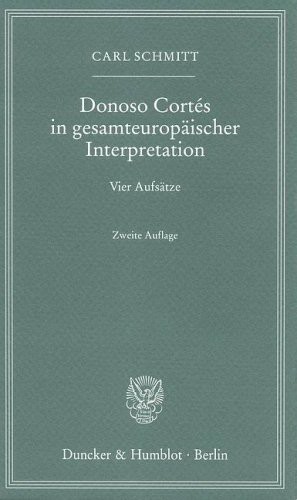 Cuando en Interpretación europea de Donoso Cortés, Carl Schmitt nos describe el pensamiento del político y diplomático español como un pensamiento de carácter “europeo”, nos muestra algo inédito dentro del llamado “pensamiento reaccionario”.
Cuando en Interpretación europea de Donoso Cortés, Carl Schmitt nos describe el pensamiento del político y diplomático español como un pensamiento de carácter “europeo”, nos muestra algo inédito dentro del llamado “pensamiento reaccionario”.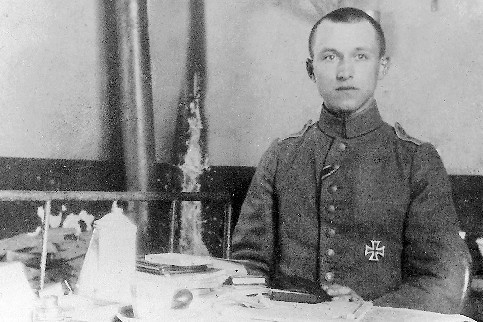 La aventura de Jünger cobra el símbolo de una organicidad rotunda enla relación social del intelectual con la producción de una clase concreta; se trata fundamentalmente de una personalidad que de alguna manera expresa Drieu la Rochelle: ”(es) el hombre de mano comunista, el hombre de las ciudades, neurasténico, excitado por el ejemplo de los fascios italianos, así como por el de los mercenarios de las guerras chinas, de los soldados de la Legión Extranjera” (8). Se verdadera patria son las llamas, la tensión del combate, la experiencia de la guerra. Su conformación íntima se encuentra manifestada en otro de aquellos que vivieron ”la encarnación de una civilización en sus últimas etapas de decadencia y disolución”, así dice Ernst Von Salomon en Los proscritos: ”sufríamos al sentir que en medio del torbellino y pese a todos los acontecimientos, las fatalidades, la verdad y la realidad siempre estaban ausentes” (9). Es este el territorio en que Jünger preparará la red invisible de su obra, recogiendo las brasas, los escombros, las banderas rotas. Cuando todo en Alemania se tambalea: se cimbran los valores humanitarios y cristianos, la burguesía se declara en bancarrota y los espartaquistas establecen la efímera República de Münich, aparecen los elementos vitales de su escritura, que atesorará como una trinchera imbatible heredera del limo, con la llave precisa que abrirá las puertas de la putrefacción a la literatura.
La aventura de Jünger cobra el símbolo de una organicidad rotunda enla relación social del intelectual con la producción de una clase concreta; se trata fundamentalmente de una personalidad que de alguna manera expresa Drieu la Rochelle: ”(es) el hombre de mano comunista, el hombre de las ciudades, neurasténico, excitado por el ejemplo de los fascios italianos, así como por el de los mercenarios de las guerras chinas, de los soldados de la Legión Extranjera” (8). Se verdadera patria son las llamas, la tensión del combate, la experiencia de la guerra. Su conformación íntima se encuentra manifestada en otro de aquellos que vivieron ”la encarnación de una civilización en sus últimas etapas de decadencia y disolución”, así dice Ernst Von Salomon en Los proscritos: ”sufríamos al sentir que en medio del torbellino y pese a todos los acontecimientos, las fatalidades, la verdad y la realidad siempre estaban ausentes” (9). Es este el territorio en que Jünger preparará la red invisible de su obra, recogiendo las brasas, los escombros, las banderas rotas. Cuando todo en Alemania se tambalea: se cimbran los valores humanitarios y cristianos, la burguesía se declara en bancarrota y los espartaquistas establecen la efímera República de Münich, aparecen los elementos vitales de su escritura, que atesorará como una trinchera imbatible heredera del limo, con la llave precisa que abrirá las puertas de la putrefacción a la literatura.
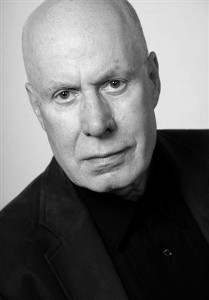 Was de Tocqueville 1830/40 mit angewiderter Faszination betrachtet, ist die Demokratie als Herrschaftsform des kämpfenden Bürgertums. Dieses Bürgertum triumphiert über das Feudalsystem und verteidigt seine Hegemonie gegenüber den Ansprüchen der nachdrängenden unteren Klassen. Es gibt ein Grundmuster demokratischer Rhetorik, Konsenshörigkeit und Vormundschaft, das gleichgeblieben ist bis auf den heutigen Tag. Dennoch – auch ein de Tocqueville konnte nicht ahnen, wohin die Standardisierung der öffentlichen Sprache und Weltanschauung in der spät- und nachbürgerlichen Ära führen würde. Im 19. Jahrhundert konkurrierten noch die Ordnungsideen des Liberalismus, des Konservatismus und des Sozialismus. Noch wurde ein Gemeinwille des Volkes und seiner Repräsentanten beschworen. Heute klingt schon die Übersetzung von demos verdächtig.
Was de Tocqueville 1830/40 mit angewiderter Faszination betrachtet, ist die Demokratie als Herrschaftsform des kämpfenden Bürgertums. Dieses Bürgertum triumphiert über das Feudalsystem und verteidigt seine Hegemonie gegenüber den Ansprüchen der nachdrängenden unteren Klassen. Es gibt ein Grundmuster demokratischer Rhetorik, Konsenshörigkeit und Vormundschaft, das gleichgeblieben ist bis auf den heutigen Tag. Dennoch – auch ein de Tocqueville konnte nicht ahnen, wohin die Standardisierung der öffentlichen Sprache und Weltanschauung in der spät- und nachbürgerlichen Ära führen würde. Im 19. Jahrhundert konkurrierten noch die Ordnungsideen des Liberalismus, des Konservatismus und des Sozialismus. Noch wurde ein Gemeinwille des Volkes und seiner Repräsentanten beschworen. Heute klingt schon die Übersetzung von demos verdächtig.

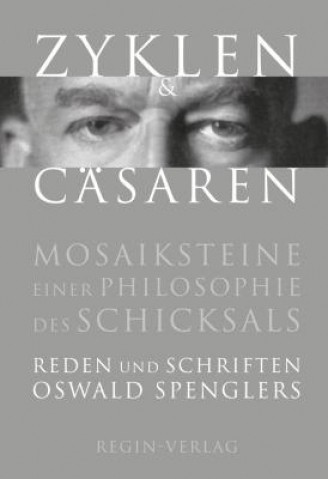

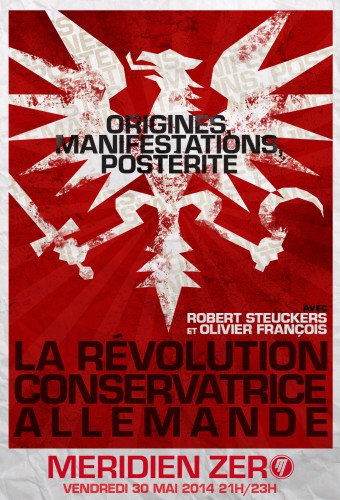
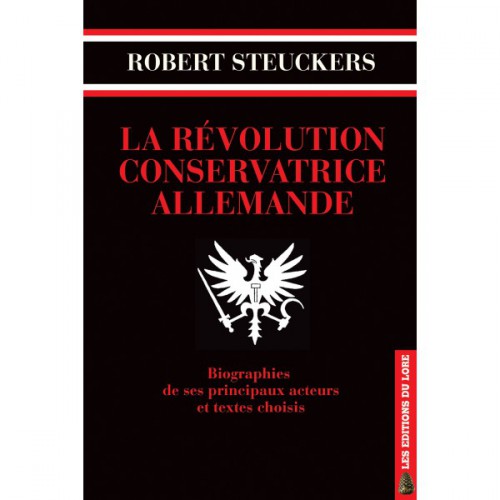


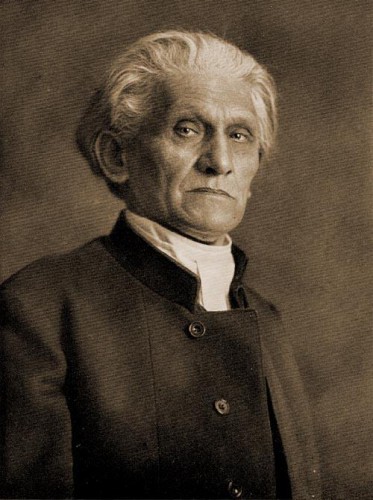
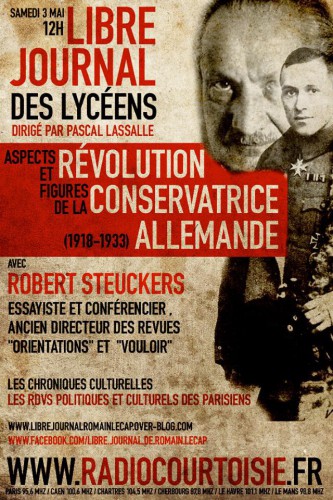


 Der evangelische Theologe Karl Richard Ziegert untersucht und kritisiert ausführlich die Rolle der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Entstehung der bundesdeutschen Zivilreligion.
Der evangelische Theologe Karl Richard Ziegert untersucht und kritisiert ausführlich die Rolle der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Entstehung der bundesdeutschen Zivilreligion.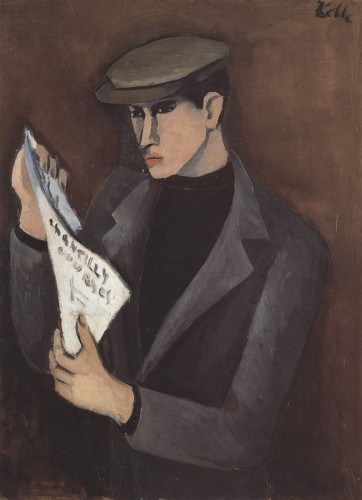
 I Tedeschi e i Russi sono i due grandi popoli dell’Europa Continentale che nel corso del Novecento si sono scontrati non una, ma due volte, nel corso di guerre sanguinose, che hanno compromesso l’equilibrio del Vecchio Continente.
I Tedeschi e i Russi sono i due grandi popoli dell’Europa Continentale che nel corso del Novecento si sono scontrati non una, ma due volte, nel corso di guerre sanguinose, che hanno compromesso l’equilibrio del Vecchio Continente.




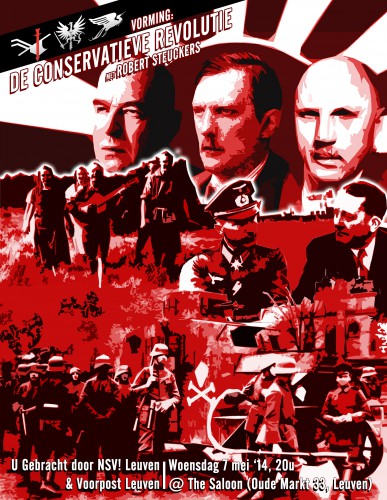


Ernst Jünger: yo soy la acción
por José Luis Ontiveros
Ex: http://culturatransversal.wordpress.com
En torno a la obra del escritor alemán Ernst Jünger se ha producido una polémica semejante a la que preocupó a los teólogos españoles en relación con la existencia del alma de los indios. De alguna manera, el hecho de que se le haya discutido en medios intelectuales mundiales con asiduidad, y el que una nueva política literaria tienda a revalorizarlo, le otorga, como lo hizo a los naturales el Papa Paulo III, la posibilidad de una lectura conversa; ya no traumatizada por su historia maldita, absolutoria de su derecho a la diferencia, y exoneradora de un pasado marcado por la gloria y la inmundicia.