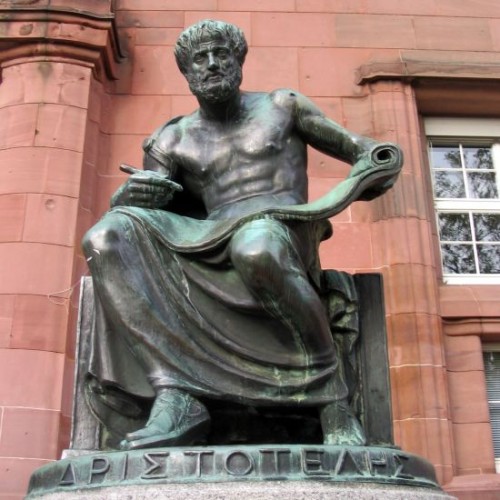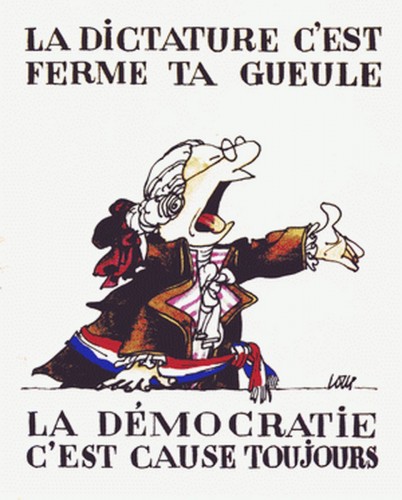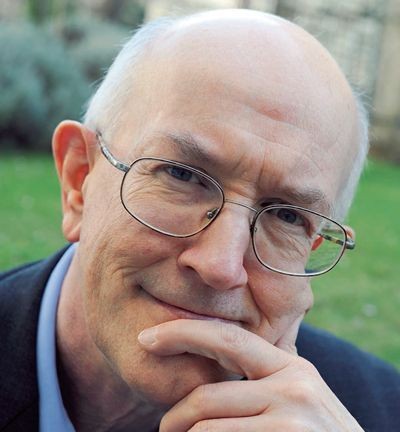mercredi, 15 décembre 2010
Nationalisme et populisme en Suisse
« Nationalisme et Populisme en Suisse. La radicalisation de la nouvelle UDC » de Oscar Mazzoleni
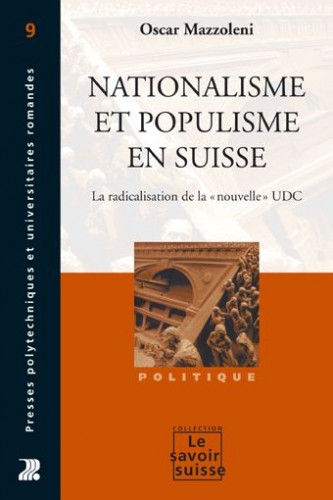 Ce livre montre l’évolution étonnante de la situation politique de la Suisse. A partir de 1991, l’Union Démocratique du Centre (UDC ; en Suisse alémanique SVP : Schweizerische Volkspartei), passe de 11,9% des voix à 28,9% en 2007. Dans le même temps, les partis « bourgeois » démocrate chrétien et radical démocratique passent de 18 à 14% et de 21 à 15%. Les petits partis de droite comme l’Action Nationale ou le parti des Automobilistes disparaissent. La confiance dans les partis en général passe de 50 à 30%
Ce livre montre l’évolution étonnante de la situation politique de la Suisse. A partir de 1991, l’Union Démocratique du Centre (UDC ; en Suisse alémanique SVP : Schweizerische Volkspartei), passe de 11,9% des voix à 28,9% en 2007. Dans le même temps, les partis « bourgeois » démocrate chrétien et radical démocratique passent de 18 à 14% et de 21 à 15%. Les petits partis de droite comme l’Action Nationale ou le parti des Automobilistes disparaissent. La confiance dans les partis en général passe de 50 à 30%
. Le carré magique de l’UDC
Selon l’auteur, l’Union Démocratique du Centre s’est renouvelée, rajeunie et radicalisée en appliquant une « formule gagnante » originale. Cette formule gagnante correspond à quatre thèmes dominants :
- - La critique de l’establishment et de la classe politique (pour Blocher, des bluffeurs prétentieux assoiffés de privilèges) au nom de la démocratie véritable ;
- - La défense de l’exception suisse et de l’identité nationale, notamment face à l’Europe et surtout face à l’immigration ;
- - Le libéralisme économique nuancé par la préférence nationale en matière sociale et la protection des agriculteurs ;
- - Le conservatisme moral fondé sur la lutte contre l’insécurité notamment.
Tradition et innovation, conservatisme et modernité
Le leader de l’UDC, Christoph Blocher, déclare : « notre secret, c’est que nous avançons sciemment et avec conviction sur la voie que nous nous sommes tracés entre tradition et innovation, entre conservatisme et modernité », les traditions étant pour lui les raisons profondes du succès du pays. D’après l’auteur, Blocher a renouvelé les méthodes du parti à partir de sa section de Zurich. Il a des moyens financiers importants une presse non négligeable avec notamment l’hebdomadaire national de haut niveau « Weltwoche ». Il dispose aussi d’une puissante association « l’association pour une Suisse neutre et indépendante ». Il a su mobiliser la clientèle des déçus du système politique, des abstentionnistes et de nombreux jeunes tout en fidélisant ses partisans.
L’originalité aussi de l’Union Démocratique du Centre est sa participation au gouvernement avec deux conseillers fédéraux (ministres) sur 7 de 2003 à 2007 : Samuel Schmidt et Christoph Blocher. Ainsi, le parti est à la fois dans le gouvernement et dans l’opposition mais c’est dû au système consensuel suisse d’élection des conseillers fédéraux (ministres) où tout parti important est représenté.
L’UDC : un mouvement démocrate identitaire
A la fin, l’auteur s’interroge sur l’étiquette à donner à un tel parti. Il récuse les mots « extrême droite » ou « droite radicale » ou « national conservatisme » pour préférer le national populisme. En réalité, l’auteur ne veut pas franchir le pas et reconnaître le caractère profondément démocratique de l’UDC d’où le choix du mot dévalorisant de « populisme ». On est en présence d’un parti démocrate national ou démocrate identitaire. Mais sa « formule gagnante est non double mais quadruple : démocratie directe (critique de l’oligarchie au pouvoir), conservatisme des valeurs (critique du laxisme et discours sécuritaire notamment), libéralisme économique (critique du fiscalisme et de l’étatisme) et défense de la nation (face à une immigration incontrôlée notamment). Ce faisant, l’UDC a remporté des victoires électorales uniques dans l’histoire récente de la Suisse sans compter ses succès dans les initiatives et référendums qu’elle a suscité en profitant de l’atout de la démocratie directe.
Yvan Blot
02/12/2010
Oscar Mazzoleni, Nationalisme et populisme en suisse. la radicalisation de la nouvelle UDC, Presses polytechniques et universitaires romandes, Collection : le savoir suisse, 2008 ; 141 pages.
Correspondance Polémia – 07/12/2010
00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suisse, démocratie, nationalisme, populisme, populisme de droite, udc, svp, europe, europe alpine, affaires européennes, politique, politique internationale, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 novembre 2010
Josef Schüsslburner: Konsensdemokratie
In der aktuellen Staffel der Reihe kaplaken hat der Jurist Josef Schüßlburner die „Konsensdemokratie“ hinterfragt. Sezession hat ihm drei Fragen dazu gestellt. Schüßlburner erklärt in diesem kurzen Gespräch, warum Deutschland ein Korrektiv zur linken Mitte braucht und wie es um die Erfolgsaussichten einer rechten Partei steht.
Herr Schüßlburner, wie wirkt es sich auf unseren Staat aus, wenn die großen Volksparteien kaum noch Unterschiede aufweisen?
 Die ideologische Konvergenz der sich über die „Mitte“-Verortung für das Volk setzenden Volks-Parteien belegt, daß sich das „eherne Gesetz der Oligarchie“ (Robert Michels) durchgesetzt hat. Es hat sich eine politische Klasse mit einer einheitlichen Weltsicht gebildet, die sich gegenüber maßgeblichen Forderungen aus dem Wahlvolk, das die Oligarchie über eine „Konsensdemokratie“ zu vertreten beansprucht, immunisiert. Die Tendenz zur Oligarchie bestätigt an sich die rechte Weltsicht gegenüber linken „demokratischen“ Wunschvorstellungen, jedoch ist es zum Zwecke der Wahrung des demokratischen Charakters der parlamentarischen Demokratie erforderlich, diesem „ehernen Gesetz“ entgegenzuwirken. Die Linke hat kein Interesse, da sie ja die Ideologie der oligarchischen Mitte bestimmt.
Die ideologische Konvergenz der sich über die „Mitte“-Verortung für das Volk setzenden Volks-Parteien belegt, daß sich das „eherne Gesetz der Oligarchie“ (Robert Michels) durchgesetzt hat. Es hat sich eine politische Klasse mit einer einheitlichen Weltsicht gebildet, die sich gegenüber maßgeblichen Forderungen aus dem Wahlvolk, das die Oligarchie über eine „Konsensdemokratie“ zu vertreten beansprucht, immunisiert. Die Tendenz zur Oligarchie bestätigt an sich die rechte Weltsicht gegenüber linken „demokratischen“ Wunschvorstellungen, jedoch ist es zum Zwecke der Wahrung des demokratischen Charakters der parlamentarischen Demokratie erforderlich, diesem „ehernen Gesetz“ entgegenzuwirken. Die Linke hat kein Interesse, da sie ja die Ideologie der oligarchischen Mitte bestimmt.
Warum braucht eine funktionierende Demokratie eine starke Linke und eine starke Rechte?
Der offene Links-Rechts-Antagonismus wirkt dem „ehernen Gesetz der Oligarchie“ entgegen und garantiert den repräsentativen Charakter der parlamentarischen Demokratie. Die Tatsache, daß diese repräsentative Situation in der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben ist, ergibt sich auch aus offiziösen Verlautbarungen, wonach 30 Prozent der Bevölkerung etwa ein „geschlossenes rechtes Weltbild“ und dergleichen haben würden, was ja gerade bei einem Verhältniswahlrecht dazu führen müßte, daß etwa ein Drittel der Bundestagsabgeordneten ein solches Weltbild haben sollten.
Diese Divergenz von Volk und Repräsentanten zeigt auch, daß die Demokratie in der Bundesrepublik ihren klassischen Anspruch nicht einlöst, die Freiheit des Volkes zu garantieren. Diese Freiheit zeigt sich neben der Tatsache, daß man sich etwa als „rechts“ einstufen darf, ohne durch Antidiskriminierungsgesetze diskriminiert zu werden, nicht zuletzt daran, daß dem Wahlvolk klare Alternativoptionen zur Verfügung stehen, welche sich dann auch in politischen Entscheidungen niederschlagen.
Aufgrund der aktuellen Debatte um eine „Sarrazin-Partei“ muß natürlich noch eine Frage folgen: Glauben Sie, daß sich in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Rechtspartei bilden könnte?
Der Verwirklichung einer normalen westlichen Demokratie mit einem freien und offenen Links-Rechts-Antagonismus stehen in der Bundesrepublik Deutschland starke Hindernisse entgegen. So sorgt das Konzept eines post-demokratischen „Europa“, das die Oligarchisierung beschleunigt, ohnehin dafür, daß die Wahlentscheidungen und damit das eigentlich demokratische Element immer weniger relevant werden, was allerdings mit einer ideologischen Aufwertung von Demokratie zu einer Zivilreligion einhergeht. Man muß auch einräumen, daß diese Zivilreligion der Oligarchie, die insbesondere in der „Bewältigung“ besteht, ihre Untertanen doch sehr im Griff hat. Vereinfacht: Ohne einen deutschen Berlusconi wird es nicht möglich sein, die nur freiheitliche Demokratie der linken Mitte in eine freie Demokratie des offenen Links-Rechts-Antagonismus zu überführen.
Vielen Dank für das Gespräch!
00:15 Publié dans Entretiens, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, allemagne, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, démocratie, démocratie consensuelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 novembre 2010
The Tyrant who is Obama's Role Model

The Tyrant who is Obama's Role Model
Jan von FLOCKEN
Ex: http://www.counter-currents.com/
Translated by Greg Johnson
When Barack Obama was officially inaugurated as President of the United States, the ceremony was charged with symbolism. The figure of Abraham Lincoln, assassinated in 1865, seemed omnipresent. Remember that 2009 is the 200th anniversary of the birth of Lincoln, who has become a kind of patron saint of Western democracy. Obama was not merely content to retrace Lincoln’s route, in the spring of 1861, departing from Philadelphia, passing through Baltimore, to arrive at the White House in Washinghton D.C. When he took the oath of office, Obama also insisted on placing his hand on the 156 year old velvet-covered Bible that “Old Abe” had used, swearing “to preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”
No one, though, has violated the Constitution more than Lincoln . . .
These attempts to draw parallels between the legendary statesman and the young president who is now America’s new hope, inadvertently stirred up all sorts of uncomfortable memories. Indeed, no President of the United States in the last 220 years has violated the Constitution and suppressed the basic rights of citizens more than Lincoln. His mandate was deployed under the bloody banner of a civil war between the Northern and Southern states. The latter left the Union in 1860–61 and founded their own state, the Confederacy. The American Constitution by no means prohibited secession of this type since it was only in 1868 that the Supreme Court ruled to the contrary. Initially, the two parties accepted the secession of the South. Thus it was that Horace Greeley, the influential editor of the New York Tribune and political friend of Lincoln, wrote in his newspaper, on November 9th, 1860: “I hope we will never have to live in a Republic maintained by bayonets.”
But it was these very bayonets that Lincoln used shortly after taking office. He seized the first excuse he found: in fact, an exchange of fire around Fort Sumter, which actually belonged to the Confederacy. This incident, which caused only some slight injuries, was used as pretext for a de facto declaration of war against the South, namely an appeal for 75,000 volunteers on April 15th, 1861. Lincoln then ordered an economic embargo against the Confederacy. The appeal and embargo were two serious political errors because they prompted the immediate secession of four hitherto neutral states: Virginia, Arkansas, North Carolina, and Tennessee.
In Maryland—which, by tradition, leaned toward the Confederacy, but which was to remain in the Union because of its proximity to Washington, D.C.—the population protested en masse against Lincoln’s warmongering. Lincoln immediately suspended the Constitutional principle of “Habeas Corpus” which protects the citizen from arbitrary arrest and guarantees his right to be heard by a judge within a short time. Annapolis, the capital of Maryland, and Baltimore, where Barack Obama went to follow Lincoln’s footsteps, were placed under martial law. On May 13th, 1861, the mayor of Baltimore, the chief of police, and all the members of the city council, were arrested, without any legal pretext, and were imprisoned until the end of the war in 1865. Ironically, among these political prisoners was the grandson of Francis Scott Key, who had composed the American national anthem, which sings the praises of “the land of the free and the home of the brave.”
When the Maryland legislature condemned these illegal and tyrannical actions, Lincoln immediately arrested 31 legislators, who were imprisoned from three to six months without trial. This forceful action clearly violated the sixth amendment to the Constitution, according to which any defendant is entitled to an immediate public trial by an independent jury. The Chief Justice of the Supreme Court, Roger B. Taney, the man before whom Lincoln had officially sworn his oath on the Bible, ordered the President make null and void these arrests because they too obviously violated the principles of the Constitution. The President had arrogated powers that are the sole prerogative of Congress. Following the admonitions of Roger B. Taney, Lincoln issued an order encouraging all public authorities to purely and simply ignore the judgment of the Supreme Court, which itself constitutes, obviously, a manifest violation of the Constitution. One observer, otherwise favorable to Lincoln, the German democrat Otto von Corvin, correspondent of the Times, noted at the time that Lincoln’s antics reminded him of a “village schoolmaster.”
In the course of the war, there were other infringements of the Constitution. The most notable of these occurred in June 1863, when Virginia was partially occupied by Northern soldiers, and a new state, West Virginia, was proclaimed, in violation of the Constitution’s stipulation that no new state can be created or established out of the territory of another.
All these assaults on the Constitution are excused today under pretext that Lincoln liberated the slaves. However, in the summer of 1862, a half year before the official proclamation of their emancipation, the President still held that: “If I could save the Union, without having to free even one slave, I would do it.”
Maintaining the Union eventually cost the lives of 600,000 people.
Americans should hope that in the future, Obama will be satisfied to imitate Lincoln only on festive occasions. For let us not forget that shortly after taking office in January, Obama said: “My politics consists in not having politics.”
Originally published in German in Junge Freiheit, no. 16, 2009
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, obama, histoire, abraham lincoln, démocratie, tyrannie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 novembre 2010
Communal Freedom and Democracy

Adolf Gasser’s attempt of a conceptual clarification
by Dr phil René Roca, historian, Switzerland
Ex: http://www.currentconcerns.ch/
The historian Adolf Gasser (1903 – 1985) suggests that democracy is a historically evolved but rather fragile achievement. In his major work “Gemeindefreiheit als Rettung Europas” (Communal freedom as the salvation of Europe)1 and in many further contributions he reflects on a definition of the term “democracy” which should be as comprehensive as possible. For Gasser the term has a historical, an ethical and an educational dimension. The term “communal freedom” is at the center of his considerations. Starting point of his theoretical considerations is a historical paper on “sound and fragile democracies” in Europe after World War I.
In 1919 all European states up to the Russian border were characterized by democratic structures. But during the next two decades the democratic beginnings disappeared in favor of authoritarian or totalitarian systems of government in many states. This could particularly be observed in states, which had introduced a democracy for the first time after World War I. Gasser does not consider the principal reason for this “widespread dying of European democracies” a foreign problem, but a domestic one. Democracy particularly failed in those states, in which it did not succeed to combine freedom and order to an “organic compound”. Those states, which had a specifically shaped democratic tradition, resisted the totalitarian temptation despite the world economic crisis and World War II. Among them were, besides the Anglo-Saxon countries USA and Great Britain, the Scandinavian states, Holland and Switzerland. This, Gasser says, proves that there are two kinds of democracies, sound ones and fragile ones:
“Therefore we are to refrain from claiming that somehow democracy as such or an interlinked economic system has failed. We rather have to keep in mind that the uniform term ‘democracy’ is a quite unrealistic abstraction. In reality the term democracy, like all other social auxiliary terms, reveals a different trait from country to country. ‘Democracy’ and ‘democracy’ can be rather different things despite corresponding constitutional features; particularly, its nature is determined by the spiritual-political attitude of the individual people. In other words: After all, democracy is not a matter determined by the kind of state order, but a matter determined by the people’s convictions.”2
Thus Gasser describes a feature, which makes it possible to differentiate clearly between the sound and the fragile democracies at any time. The terms “spiritual-political attitude” and “people’s convictions” illuminate an ethical dimension of democracy. To Gasser, this dimension is not ideationally inflated or ideologically curtailed, but linked with a fundamental structural feature. The feature is the organization of the communal and regional autonomy. All sound democracies, as different as they may be, have a
“traditional and extremely lively self-governing system of their local and regional subsidiary associations. Widespread decentralization of the administration: that is the essential characteristic of these ‹old and free people’s states›.”3
Gasser considers the contrast between decentralized and centralistic administrative systems to be the key to the problem, which explains why some democracies were successful and sustainable and others were not.
For Gasser, the starting point for decentralized public administration is the “free”4 commune, which has cooperative roots. The cooperative as “a particularly finely-woven organizing element”5 defines itself by the three so-called “selves”: self-governing, self-determination and self-help. If free communes, organized in such a manner, come together to build a state, this state is federal, thus structured in a decentralized way. The human dimension in this structure must be based on certain ethical principles. The people, based on their specific cultural background, develop into these socio-economic structures; they shape and advance them. The ethical principles provide the stability, security and predictability:
“State formations, which grew from bottom to top and which represent the concept of self-governing, are usually communities of a very special kind; because they are primarily held together by spiritual and ethical forces while power-political braces are subordinate.”6
The ethical dimension of communal freedom
With the description of different principles Gasser tries to define the ethical dimension more clearly. In this context, he speaks of a kind of “synthesis of civic watchfulness on the one hand and civic self-discipline on the other”7. This mental-moral dimension cannot simply be introduced by a written constitution. It does also not follow automatically, if a commune is free. In order to make this dimension humane, moral values are required, which are to be taught in education and set as an example within the political level. The free commune, Gasser writes, educates the citizens not to a quantitative, but to a qualitative way of civic thinking. This important element shows the commune as “autonomous small-scale organization”, as “a school for citizenship”8 in an educational context, which is both founded on values and creates them.
In the following Gasser’s different ethical principles will be described in more detail.
The principle of co-ordination
Civic community life is only possible in the context of an organizing principle. The two possible organizing principles are the principle of subordination and that of co-ordination. In other words, the principle of administration by authoritarian dominance opposes that of co-operative self-governing.
“Either the stately order becomes secured by an authoritarian command and power apparatus, or it is based on the free social will of a people’s collectivity.”9
In the first case the structure of the state develops essentially from top to bottom, in the second case from ground to top. Either the people have to get used to being commanded or (most of them) to obeying, or they are guided by the will to co-operate freely. In this context, Gasser mentions that there are of course mixed forms; however, all the examples show a certain tendency towards one of the two organizing principles.
For Gasser, the contrast “rule vs. cooperative” is the most important contrast social history knows. It sheds light on the most elementary foundations of human community life and has mental and moral consequences.
The principle of voluntariness
Co-operatively organized communes require free, social co-operation. The working together represents a synthesis of freedom and order and is possible only if the will to free collective co-operation is inseparably combined with the will to free collective integration. The free acceptance of voluntary and adjunct work in addition to the regular duties results in a militia system, which is indispensable for the smoothest possible social procedures on all national levels.
“A sound development of democracy on a large scale will only be possible where it is practiced and realized on a small scale every day.”10
The principle of shared responsibility
 The voluntary cooperation, which is practiced within the manageable area of the commune, naturally leads to a further ethical principle, the principle of the shared responsibility. It develops, as Gasser expresses, an “internal bond to reality”,11 i.e. primarily to the commune, which shapes a “system of collective readiness to share responsibility and to political tolerance”.12 Freedom must combine itself with a feeling of duty for the public matters, because
The voluntary cooperation, which is practiced within the manageable area of the commune, naturally leads to a further ethical principle, the principle of the shared responsibility. It develops, as Gasser expresses, an “internal bond to reality”,11 i.e. primarily to the commune, which shapes a “system of collective readiness to share responsibility and to political tolerance”.12 Freedom must combine itself with a feeling of duty for the public matters, because
“[…] where there is a lack of genuine will for responsibility, for shared responsibility, there is an immediate threat that freedom will dege nerate into bare individualism and egoism.”13
However, the individual does not completely dissolve in the collective; it must not subordinate to the community:
“Starting point of the cooperative, decentralized states is not the individual freedom, but the communal freedom. But there is a seed of individual freedom to be found inevitably in the communal freedom […].”14
The principle of the collective respect for law
A collective conviction of what is right is central to the communal freedom. Those national state systems that were developed from bottom to top, that are based on communal freedom, show a completely different development of the law than centralistic authoritarian states. The “ancient right” (or also the “ancient freedom”) developed in co-operative and decentralized political systems has become a tradition throughout the centuries, and in conflict situations it represents an important point of reference in each case. The old civic and legal education – often verbally delivered and condensed in a kind of customary law – was of great importance, because it was backed by the collective. This backing of the existing order, often expressed in rituals and symbols, is only possible if the order is considered to be absolutely legal in its basic outlines. If this legal order is to be changed and adapted, it is usually developed, but not destroyed.
The principle of collective confidence
According to Gasser, the co-operative combination of freedom and right creates forces of “outrageous moral strength”15. For Gasser, this is above all general political and social confidence. The individual’s readiness for confidence is a prerequisite for a collective fundament of trust. Under these circumstances, no communal citizen must fear a political breach of law by fellow citizens. This “being free from fear” represents a substantial characteristic of all co-operative and decentralized communities for Gasser. Where the communal freedom exists, people steadfastly stick to the decentralized organizing, self-governing principle, and usually native confidants are entrusted with certain executive functions. So bi-partisan readiness for confidence can develop, which leads to the acceptance of the democratic majority principle:
“Only from deep-rooted confidence in communalism, i.e. to the free community will, one is able to generally take it as natural that a majority considers the free will of a minority if possible – and a minority is for its part morally obliged to submit by its own free will to the free will of a people’s and a parliament majority.”16
The principle of collective tolerance
In the free commune, Gasser says, everyone is forced to compromise with the political opponent. If the communal citizen gets accustomed to being responsibly moderate in this small, assessable area, then “from the beginning strong forces of reconciliation and mediation are involved.”17
The “communal freedom” is not able to manufacture heavenly conditions. Human passions and feeling of hate remain components of human nature. However, these often destructive forces repeatedly encounter “wholesome barriers” in the free commune, which “diminish their political explosive effects”, Gasser states.18 One of these “barriers” is the readiness to compromise:
“Striving for clear compromises backed by genuine consideration for the justified vital interests and attitudes of our fellow citizens, also of those organized in other parties, must become second nature somehow, if the liberal democracy were to become a firmly rooted way of life.”19
From this collective tolerance emerges a high readiness to accept good faith as a guiding value. Thus one cannot absolutely guarantee but effectively secure the inner and outer peace of a community nevertheless.
Conclusion: the principle of ethical collectivism
Gasser’s term “communal ethics” is determined by the described mental and moral principles, to which the individual must feel bound. For its existence and advancement, the free commune requires such a “collective will to bind oneself”20 or, expressed differently, an “ethical collectivism”21. Gasser thus sheds light on the “internal nature”22 of democracy and gives his definition a socio-psychological dimension by including ethical principles.
Gasser always refers to this dimension in his texts. He starts out from a positive concept of man: Man is good by nature.23 As a person, each human being has certain rights and duties and can establish his necessary social relations at best in the surroundings of a free commune. Thus people develop their skills and forces and are able to solve the problems together with others. Thus, the autonomous small areas form the basis, and take influence on greater stately regions, regardless of their structure.
“Moral bonds” secure the peace of a society against inside threats as well as threats from outside. All communal and federal democracies, built from bottom to the top, have a basically pacifist tendency, Gasser claims. With its synthesis of freedom and order, the decentralized structure including free communes reaches a degree of social justice, which curbs militarist and expansive forces. The individual is more content, feels safe and cannot easily be seduced to foreign policy war adventures.
Educational dimension of communal freedom
Finally the “educational dimension” of communal freedom is to be presented briefly, as Gasser repeatedly mentions it. For him, the commune is a “humanitarian school for citizenship”24 and in a lively democracy it serves an educational purpose which should not be underestimated:
“Only in an assessable, natural community the normal citizen is able to acquire what we use to call political sense of proportion, a feeling for the human proportions. It is the only place where he can learn to understand and consider the justified requests of his neighbors and their different ideas and interests in the daily discussion; it is the only place where the necessary minimum of communal structure develops on the ground of freedom, which is able to effectively impede the tendency to authoritarianism as well as to anarchy. In this sense autonomous small areas remain irreplaceable schools for citizenship, without which the free democratic state would wither from the roots.”25
A lively democracy does not only require educated humans, who master cultural techniques and who acquire certain abilities and skills and develop them. A democracy also requires as it were the people’s “emotional intelligence”.26 This intelligence must develop in the family first, as well as in the assessable, natural community first; later on it can also be effective beyond that sphere. As far as educational issues are concerned, Gasser always refers to the work of Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827). In digesting and summarizing the different historical aspects and the ideas of progressive thinkers, Gasser can be called the actual discoverer of the “small region” and “assessability” as the basic conditions of a working democracy. Therefore it is certainly worthwhile to apply his ideas, modified by new research, to the question how direct democracy was historically developed in Switzerland.•
Translation Current Concerns
1 Adolf Gasser, Gemeindefreiheit als Rettung Europas. Grundlinien einer ethischen Geschichtsauffassung, Second, grossly extended edition, Basel 1947, p. 7–12.
2 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10.
3 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10f.
4 Gasser uses the term “free” or “freedom” in the context of a national political category of the “commune” quite comprehensively. He does not limit it to the political rights of co-determination. Those were limited in Switzerland in the “ancient régime” to the citizens of a single commune, i.e. they were exclusive. Only in times of the Helvetica and then again during Regeneration the rights of co-determination were extended on a cantonal level. Women were excluded longest.
5 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 15.
6 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 17.
7 Adolf Gasser, Bürgermitverantwortung als Grundlage echter Demokratie, in: Gasser,A., Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 43
8 Adolf Gasser, Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 147
9 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 12
10 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 11
11 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 19
12 Adolf Gasser, Der europäische Mensch in der Gemeinschaft, in: Gasser, A., Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 4
13 Gasser, Bürgermitverantwortung, p. 33
14 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 27
15 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 20
16 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 97
17 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 24
18 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 24
19 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 24
20 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 16
21 Gasser, Der europäische Mensch …, p. 4
22 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10
23 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 255
24 cf. Adolf Gasser, Die Schweizer Gemeinde als Bürgerschule (1959), in: Gasser, A., Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 85–91
25 Adolf Gasser, Zum Problem der autonomen Kleinräume. Zweierlei Staatsstrukturen in der freien Welt, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Attachment to the weekly magazine Das Parlament, vol. 31/77, p. 4
26 cf. Daniel Goleman, Emotional Intelligence, New York, 1996
Adolf Gasser
The Swiss historian Adolf Gasser (1903–1985) completed his studies in Heidelberg and Zurich with doctorates in history and classical philology. From 1928 to 1969 he taught as a grammar school teacher in Basel. In the course of his lectureships he became private lecturer in 1936 and an adjunct professor in 1942; from 1950 to 1985 he taught as an extraordinary professor for constitutional history at the University of Basel. After World War II he started an active lecturing activity in the Federal Republic of Germany. Gasser was joint founder of the Council of European Municipalities and Regions, from 1953 to 1968 he was a Liberal member of the Grand Council of Basel, and he was a president of the FDP of the canton Basel.
His works include (published in German language, all titles are translated here for better understanding):
– The territorial development of Switzerland. Confederation 1291–1797, 1932
– History of the People’s Freedom and Democracy, 1939
– Communal freedom as salvation of Europe, 1943
– On the foundations of the state, 1950
00:10 Publié dans Affaires européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, liberté communale, démocratie, suisse, europe, affaires européennes, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 novembre 2010
Ausschaffungsinitiative läuft auf Hochtouren
Ausschaffungsinitiative läuft auf Hochtouren

Plakat der Ausschaffungsinitiative: Gute Chancen bei der Abstimmung vorausgesagt Foto: www.kriminelle-nein.ch
„Darf die SVP aus Fotomodels Kriminelle machen?“ fragt der Schweizer Tagesanzeiger und zeigt „Ivan S.“. Auf der einen Seite als Aggressivität ausstrahlendes „Gang-Model“ der kanadischen Bildagentur iStockphoto, auf der anderen Seite als „Vergewaltiger“ auf dem Kampagnenfoto der Schweizerischen Volkspartei zur Ausschaffungsinitiative. Letztere soll am 28. November in eine Volksabstimmung münden, die über die verstärkte Abschiebung krimineller Ausländer entscheiden soll.
Darf die SVP das? Darf sie nicht? „Urherberrechtsverletztung“, „sehr bedenklich“, „ärgerliche Suggestion“, rufen die einen Kommentatoren, „typisches SVP-Marketing“, erklären die anderen. Das Marketing geht auf. Die Kampagne ist in aller Munde und die SVP-Ausschaffungsinitiative ebenso.
Umfragen räumen der Initiative gute Chancen ein
Geschult durch Dutzende Initiativen in den letzten Jahren weiß die Volkspartei, wie man das Wahlvolk erreicht und in die Kampagnen einbezieht. Das Thema ist brisant, und so haben sich schon über 3.000 Freiwillige gemeldet, die die SVP unterstützen wollen
„Werden Sie Mitglied im überparteilichen Komitee! Unterstützen Sie aktiv den Abstimmungskampf! Besuchen sie die Veranstaltung! Neben den Flugblätter und Plakaten mit der eindringlichen Botschaft „Ismir K. – Sozialbetrüger. Faruk B. – Mörder. ‘Werden sie nicht ausgeschafft weil es die Behörden so wollen?’“, werden die Schweizer auf allen Ebenen erreicht.
Gleich drei Internetseiten, die alles bieten: Argumente, Anlässe, Material und Videobotschaften. Dazu eine Vielzahl von Veranstaltungen für jedermann. So diskutierten am Sonntag zum Thema „Welche Schweiz wollen wir?“ SVP-Vizepräsident Christoph Blocher und der Schriftsteller Adolf Muschg auf der Weltwoche-Sonntagsmatinee. Das Volkshaus Zürich war bis zum Bersten gefüllt. „Kriminelle Ausländer ausschaffen?“ heißt es dann bei freiem Eintritt am 6. November um 10.30 Uhr im Zürcher Theater 11. Diesmal kreuzt Blocher die Klingen mit Nationalrat Daniel Vischer von den Grünen.
Doch nicht allein in Zürich gibt es eine Vielzahl von Terminen, auch in der „Provinz“ wird die Ausschaffung in Dutzenden öffentlichen Veranstaltungen diskutiert.
Verwirrung um den Gegenentwurf des Parlaments
Dabei geht es nicht nur um das Thema selbst. Denn die Volkspartei steht vor dem Dilemma „Gegeninitiative Nein – Ausschaffungsinitiative Ja“. Das Schweizer Parlament hat bereits im Juni einen Gegenvorschlag präsentiert, der der SVP-Ausschaffungsinitiative den Wind aus den Segeln nehmen soll. Die SVP ist empört: Im Gegenentwurf stehe nicht mehr die Abschiebung schwer krimineller Ausländer im Mittelpunkt, sondern die „Integration“, heißt es.
Nun ist doppelte Aufklärung angesagt. „So stimmen Sie richtig“, ist dann auch auf allen Ausschaffungsseiten zu lesen. Denn es ist gar nicht so einfach, auf dem Stimmzettel zwischen der Volksinitiative „Für die Ausschaffung krimineller Ausländer“ und dem Bundesbeschluß „über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer“ zu unterscheiden.
Die Schweizerische Volkspartei zeigt sich dennoch guter Dinge, denn allen Umfragen zufolge kann sie auf eine klare Zustimmung zur Ausschaffungsinitiative hoffen.
JF 45/10
00:23 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suisse, alpes, europe, affaires européennes, démocratie, référendum, référendum suisse, immigration, criminalité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 octobre 2010
Démocratie directe: la grande peur des bien-pensants!
Démocratie directe : la grande peur des bien-pensants !
La Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), créée par Jérôme Monod, organise, le 16 octobre 2010, à Lille, un colloque sur « Ce que le web fait à la démocratie représentative ». Un sujet dont l’intitulé paraît étroit (quid de la démocratie directe ?) et craintif.
Ce qui a conduit Yvan Blot, contributeur régulier de Polémia, et président de l’Association « Agir pour la démocratie directe » à proposer à la Fondapol une étude purement factuelle sur la démocratie directe. Il s’agissait d’un parangonnage portant sur les expériences suisse allemande italienne et américaine Un sujet intéressant d’autant que depuis 2008 la constitution française prévoit la possibilité d’organiser des référendums d’initiative populaire (à condition toutefois que la demande soit formulée par un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs).
Polémia
La peur du peuple
La réponse négative qu’il a reçue du Secrétaire général de la Fondapol, Mathieu Zagrodzki, est très révélatrice :
« Après réflexion et concertation approfondies, nous estimons que notre priorité aujourd’hui est de défendre la démocratie représentative. Notre sentiment est que la démocratie directe constitue l’une de ces voies de passage qui favorisent aujourd’hui l’expression du populisme, le risque le plus élevé se trouvant dans la rencontre entre cette procédure de décision et les questions très sensibles posées par l’immigration, comme l’a démontré le récent exemple de la votation citoyenne en Suisse sur l’interdiction des minarets. A l’heure où les divisions au sein de la société tendent à s’accroître, l’appropriation de la décision publique par des communautés locales nous semble plus de nature à créer de nouveaux problèmes qu’à fournir des solutions. En outre, une fondation pro-européenne comme la nôtre ne peut soutenir le développement de référendums locaux sans songer aux risques de blocage de l’intégration européenne qu’ils pourraient générer. Nous préférons ainsi vous annoncer à ce stade notre décision de ne pas engager le travail que vous nous proposez. »
Démocratie réelle ou démocratie de façade ?
La réponse d’Yvan Blot met les pieds dans le plat :
« Merci de votre franche réponse qui me permet de mieux situer les contours de l'oligarchie gouvernante actuelle. Vous savez fort bien que la démocratie représentative est une façade : les lois sont faites par les hauts fonctionnaires (dont je suis) et par les lobbies et médias qui gravitent autour, et certainement pas par les députés (je l'ai été). Le choix réel n'est pas aujourd'hui entre la démocratie dite représentative et la démocratie directe mais entre l'oligarchie actuelle et la démocratie réelle qui doit comporter à la fois des éléments directs et représentatifs comme en Suisse.
Les grandes menaces d'aujourd'hui, endettement des Etats jusqu'à la faillite par exemple, ne sont pas le fruit du « populisme» mais des décisions des oligarques régnants. Ceux-ci nous mènent à la catastrophe et c'est alors que vous verrez le triomphe du populisme qui vous fait peur. Quant à l'Europe, vouloir l'intégrer à marche forcée en ignorant les peuples, c'est bâtir sur du sable.
Forces oligarchiques contre forces démocratiques
Nos opinions divergent donc clairement. Je crois que l'idéologie oligarchique que vous incarnez ressemble à celle de l'Ancien Régime en 1789. J'espère que les événements qui vont produire sa chute de façon inévitable seront le moins violents possible. Je crains qu'en refusant la démocratisation de notre système politique, l'oligarchie qui s'approprie actuellement le pouvoir ne creuse sa propre tombe. C'est déjà arrivé dans l'histoire. L'attitude réactionnaire, même affublée du masque du progressisme, est une attitude perdante.
Je suis ravi de ce dialogue révélateur des forces oligarchiques et démocratiques en présence. J'espère au moins qu'elles pourront dialoguer et que la tentation de la censure des voix des citoyens ne l'emportera pas : toute censure est vaine et vaincue à terme. »
Yvan Blot
06/10/2010
Correspondance Polémia – 15/10/2010
00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, démocratie directe, politique, actualité, europe, affaires européennes, démocratie, populisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 octobre 2010
Une conférence à Nice sur la démocratie directe de type helvétique

14:30 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, démocratie directe, référendum, suisse, mouvement identitaire, identité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 17 septembre 2010
L'après-démocratie
L'après-démocratie
« L’Après-démocratie » est un recueil de textes, dans lequel Eric Werner (EW) défend la thèse générale suivante : plus personne ne peut décemment croire que nous vivions en démocratie. Il ne reste, du projet démocratique, que des traces – telles que les élections, tous les cinq ans, et qui consistent désormais à choisir entre l’aile gauche et l’aile droite d’un seul et même parti institutionnel.
Aile gauche et aile droite qui, au demeurant, font en pratique à peu près la même politique, imposée par « le vrai pouvoir ».
Un vrai pouvoir qui se situe au niveau de l’hyperclasse, et de son gouvernement mondial. Un vrai pouvoir échappe à tout contrôle démocratique, influence de manière décisive la « ligne éditoriale » de la presse, et pilote à distance la plupart des institutions, justice incluse, via des réseaux d’influence ramifiés. Ce vrai pouvoir décide de ce que vous ignorez, donc de ce que vous savez. Il vous éduque, il vous surveille, il vous juge. Il contrôle la démocratie, elle ne le contrôle pas.
Nous voici dans « l’après démocratie ».
*
Comment en est-on arrivé là ?
Fondamentalement, pour EW, il s’agit tout simplement de la mise à jour de ce que la « démocratie occidentale » était de manière latente – mise à jour rendue possible par la disparition de l’ennemi.
Un disparition de l’ennemi qui a levé les barrières que le système était obligé d’entretenir devant lui, pour échapper à son cours spontané…
Depuis que le communisme a été vaincu, l’Occident n’a plus besoin d’entretenir une façade pluraliste. Il s’engage donc dans la voie totalitaire, qu’il a longtemps combattue, mais qui est aussi, secrètement, son essence profonde.
Chronologiquement, l’adoption de la loi Gayssot arrive juste après la chute du Mur de Berlin : le totalitarisme occidental a littéralement éclaté au grand jour, dès que son adversaire ne fut plus là pour l’empêcher de s’exprimer.
Totalitarisme d’ailleurs d’autant plus redoutable que, fait observer EW, il est dissimulé par un formidable voile propagandiste de dénégation, bien plus habile que celui tendu jadis par les systèmes hitlériens ou staliniens.
EW nous renseigne, à ce propos, sur ce qui se produit en ce moment dans le monde germanophone (EW est suisse) – une évolution d’un monde voisin dont nous sommes, nous, en France, sans doute assez mal informés.
Un chiffre : en Allemagne, le nombre de personnes ayant fait l’objet de procédures pour « connections avec des groupes extrémistes » et « excitation du peuple » se montait, en 1998, à 9.549. En Suisse, deux juges ont été mis en vacances forcées après avoir prononcé une peine jugée trop légère contre un politicien d’extrême droite coupable d’un délit d’opinion. L’affaire fut rejugée, et le politicien a été condamné à 15 mois de prison ferme – pour comprendre l’échelle des peines sous-jacentes à cette décision, notons qu’à la même époque, l’auteur d’un viol sur une fillette de cinq ans fut condamné à une peine de neuf mois de prison avec sursis. Le monde germanophone est majoritairement en train, tout doucement, de basculer dans un totalitarisme ouvert, une répression judiciaire de la pensée dissidente – bien plus vite, bien plus nettement qu’en France.
*
Après avoir planté le décor, EW analyse cette dérive totalitaire.
Reprenant la distinction d’Arendt entre pensée et raisonnement, il montre que l’Occident contemporain est peuplé d’idéologues des Droits de l’homme qui raisonnent, mais ne pensent plus – en ce sens que leur raisonnement ne se réfère plus à la réalité. Cette disposition d’esprit particulière se combine avec des intérêts objectifs (toujours implicites) pour créer une ambiance générale d’intimidation. De là, vers la terreur, qui est désormais repositionnée dans le cadre général de l’insécurité – on ne terrorise plus en brutalisant, mais en exposant à une brutalité latente (économique, sociale, voire physique, avec une délinquance tolérée). Sous l’angle organisationnel, il n’y a évidemment aucun rapport entre l’arrestation par le NKVD au petit matin dans l’URSS des années 30 et l’agression au coin de la rue dans la France de 2010 ; mais sur le plan fonctionnel, le rôle de la terreur dans une mécanique d’intimidation générale et de sidération populaire est comparable. Le « racaille » raciste antiblanc est le SA du totalitarisme multiculturel américanomorphe (un point sur lequel EW revient fréquemment).
Plus profondément, une guerre cognitive est faite aux populations, par des moyens plus subtils que ceux dont disposaient les anciens totalitarismes. La dissolution du « nous » (famille, coutume, tradition, enracinement local et national) rend le « je » impensable (puisqu’il n’est plus inscrit dans rien, il « flotte »), et l’opinion bascule dans la formulation moue d’un consensus auquel « on » se rallie (« on » étant, finalement, un corps collectif « non-social », la somme des individualités disjointes reliées uniquement par le réseau médiatique). Il y a explosion des frontières de l’être mental des occidentaux, ce sont des organismes sans peau, en voie de dilution, « clients » parfaits du néo-totalitarisme occidental. L’ultime rempart contre l’illusion, l’école, est même désormais tombé, avec la généralisation du « pédagogisme », c'est-à-dire la manipulation des enfants pour leur faire intérioriser des attitudes bien précises, compatibles avec le système dominant.
Au-delà de ce constat somme toute aujourd’hui presque devenu banal, EW tente de mettre en lumière les causalités profondes du mécanisme décrit. Il s’intéresse, par exemple, à la sociologie de cette nouvelle domination, et souligne le rôle particulier qu’y tient manifestement la pègre – historiquement très souvent associée aux régimes totalitaires ou dictatoriaux. Les tyrans, rappelle EW, se méfient toujours beaucoup plus des honnêtes gens que des voyous, chez qui ils vont souvent recruter leur garde personnelle.
D’où une hypothèse sur la convergence spontanée entre l’idéologie de certains sociologues de l’excuse (« pro-racailles ») et le totalitarisme des marchés : version renouvelée du mécanisme décrit par La Boëtie et d’autres, mécanisme qui voulait que le tyran, pour garder sous contrôle les « abeilles domestiques », importât des « frelons étrangers ».
Dans cette optique, l’incubation d’une idéologie de la haine de soi n’est, en réalité, qu’un dispositif annexe ; le but est de tenir les « abeilles » dans la peur des « frelons ». Ce n’est ni plus ni moins que la généralisation des techniques utilisées, pendant la période de dénazification de l’Allemagne, par les conquérants américains (destruction programmée du modèle anthropologique germanique, supposé créateur de la « personnalité autoritaire » de type « fasciste » - d’où la fabrication d’une population féminisée, fragilisée, en quête de protection et donc facile à dominer).
D’où, encore, une hypothèse sur l’attitude différenciée des idéologues néo-totalitaires à l’égard du religieux. D’une manière générale, ils s’en méfient, puisque la religion définit un espace mental collectif structuré, donc de nature à s’opposer aux forces de dilution que le néo-totalitarisme instrumentalise. Mais ils se méfient du christianisme plus que des autres religions (islam en particulier), parce que le christianisme construit une métaphysique de la liberté, où la conscience individuelle peut en quelque sorte être équipée de manière autonome – ce qui implique que même si les forces de dilution détruisent toute structure collective, le christianisme peut continuer à structurer une révolte individuelle (chose que l’islam peut plus difficilement faire). D’où sans doute le fait que nos dirigeants combattent l’islam là où il est structurant d’une identité collective réelle (donc en Dal-el-Islam), mais en encourage l’importation chez nous, où il contribue à la déchristianisation.
*
Comment résister à ce néo-totalitarisme ? Voilà, évidemment, la question qu’EW ne peut éviter ; à quoi bon décrire l’ennemi, si ce n’est pas pour le combattre ?
EW souligne tout d’abord qu’il faut combattre en nous la tendance au défaitisme. Quand nous apprenons que 5 % des Suisses n’ont pas la télévision, ne nous lamentons pas qu’ils ne soient que 5 % ; prenons note du fait qu’ils sont déjà 5 %.
Ensuite et surtout, il faut, nous dit-il, sortir du piège consistant à reconnaître au pouvoir actuel un monopole de la capacité à gérer les problèmes qu’il a lui-même créer (l’immigration inassimilable, par exemple). Il faut poser le problème en termes renouvelés, et cesser de confondre révolte et résistance.
Le révolté et le résistant disent « non », l’un et l’autre. Mais pas de la même manière. Le révolté, c’est l’esclave fouetté qui, soudain, se retourne et fait face à son maître. Le résistant, lui, ne fait pas face : il s’efface, il sort du cadre de gestion construit par son maître.
C’est pourquoi le résistant est avant tout un adepte de la stratégie indirecte ; à l’opposé du révolté, qui cherche la confrontation directe avec le tyran à l’intérieur d’un contexte donné, le résistant pense l’action dans la durée, et cette action n’est pas nécessairement un affrontement avec le tyran – c’est avant tout un effort pour se préparer à la modification du contexte.
Le plus souvent, cette modification du contexte est obtenue tout simplement en durant : le résistant gagne tant qu’il ne perd pas, c'est-à-dire tant qu’il n’est pas anéanti. Et finalement, le résistant l’emporte s’il parvient à faire durer sa retraite flexible une seconde de plus que l’élan du pouvoir qui tentait de l’anéantir. Ensuite, une fois que le pouvoir s’est usé, qu’il a fabriqué lui-même la masse de contradictions internes qu’il ne peut plus gérer, alors la résistance peut passer à la contre-offensive.
Et donc, pour conclure, ce que sous-entend EW, c’est qu’il ne faut pas accepter la logique selon laquelle nous devrions tolérer le système parce qu’il est le seul à pouvoir gérer les problèmes qu’il a créés. Nous devons lui résister, pour être là quand il ne pourra plus gérer ces problèmes.
00:08 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, théorie politique, philosophie, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 22 juin 2010
Torheiten
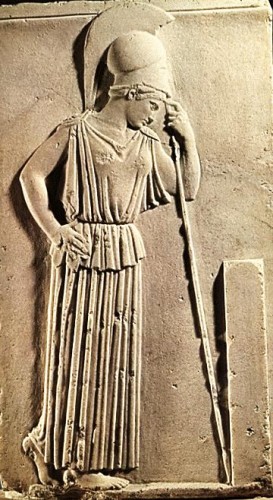 Torheiten
Torheiten
In der Politik kann es sich nicht anders verhalten, und infolgedessen pflegen politische Diskussionen in einer Demokratie unfachlich und praktisch unfruchtbar zu sein. Sie bedeuten eine ungeheuerliche Kraft- und Zeitvergeudung, wie es immer der Fall ist, wenn sich Laien in fachliche Dinge einmischen - noch dazu ohne für ihre Torheiten zur Verantwortung gezogen werden zu können - oder wenn Staatsführungen ihre Massnahmen auf ein laienhaftes Verständnis abstimmen müssen.
Hans Domizlaff, Die Seele des Staates. - Die Geburtsfehler der Demokratie. Privatdruck, Hamburg 1957.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, allemagne, etat, démocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 juin 2010
G. Sorel: Electoral Democracy and Stock Exchange
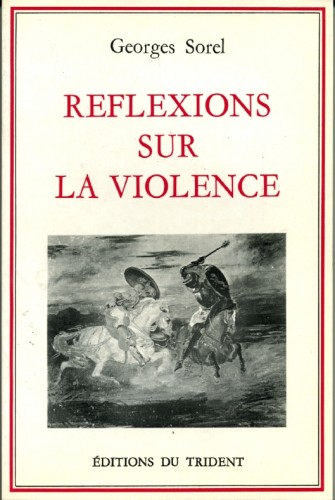 Georges Sorel: Electoral Democracy and Stock Exchange
Georges Sorel: Electoral Democracy and Stock Exchange
"Electoral democracy greatly resembles the world of the Stock Exchange; in both cases, it is necessary to work upon the simplicity of the masses, to buy the cooperation of the most important papers, and to assist chance by an infinity of trickery; there is not a great deal of difference between a financier who puts grand-sounding concerns on the market, which come to grief in a few years, and the politician who promises his fellow citizens an infinite number of reforms, which he does not know how to bring about and which resolve themselves simply into an accumulation of parliamentary papers. Neither one nor the other knows anything about production and yet they manage to obtain control over it, to misdirect it and to exploit it shamelessly: they are dazzled by the marvels of modern industry and they each imagine that the world is so rich that they can rob it on a large scale without causing any great outcry amongst the producers; to bleed the taxpayer
without bringing him to the point of revolt, that is the whole art of the statesman and the great financier. Democrats and businessmen have a very special science for the purpose of making deliberative assemblies approve of their swindling; parliamentary regimes are as fixed as shareholders' meetings. It is probably because of the profound psychological affinities resulting from these methods of operation that they both understand each other so perfectly: democracy is the paradise of which unscrupulous financiers dream."
(Reflections on Violence, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 221-222.)
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, élections, système électoral, théorie politique, philosophie, politologie, sciences politiques, socialisme, socialisme révolutionnaire, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 juin 2010
Schweiz lässt Volksinitiative für Ausweisung krimineller Ausländer zu
Schweiz läßt Volksinitiative für Ausweisung krimineller Ausländer zu
Der SVP-Gesetzesentwurf sieht die automatische Ausweisung von Ausländern bei schweren Straftaten oder Erschleichung von Sozialleistungen vor. Wörtlich heißt es hier:
„Sie (die Ausländer) verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind oder mißbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.“
Alternativ-Vorschlag öffnet Mißbrauch „Tür und Tor“
Kritiker machen völkerrechtliche Vorbehalte gegen diesen Gesetzesentwurf geltend. Der Alternativ-Vorschlag, der unter anderem von der Freisinnigen Partei (FDP)und den Christdemokraten (CVP) getragen wird, sieht entsprechend ausdrückliche Verweise auf das Völkerrecht vor, sowie das Gebot, das „Anliegen der Integraton“ zu berücksichtigen.
Die Ausschaffungsinitiative sieht damit allerdings „Tür und Tor“ geöffnet, um künftig Ausweisungen doch noch verhindern zu können: „Solche Formulierungen eröffnen unzählige Möglichkeiten für Rekurse und Beschwerden. Den Gerichten sind kaum mehr Grenzen gesetzt, zugunsten der auszuschaffenden Sträflinge zu urteilen“, heißt es in einer Stellungnahme der SVP.
Sozialdemokraten (SP) und Grüne im Nationalrat hätten die Ausschaffungsinitiative am liebsten für ungültig erklärt. (FA)
00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suisse, europe, affaires européennes, politique internationale, criminalité, immigration, référendum, démocratie, démocratie référendaire, confédération helvétique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 juin 2010
"Propaganda: Comment manipuler l'opinion en démocratie"
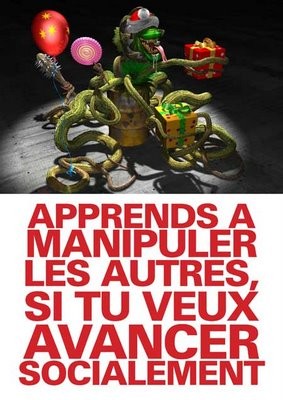 « Propaganda : Comment manipuler l'opinion en démocratie »
« Propaganda : Comment manipuler l'opinion en démocratie »
par Edward Bernays
Qui a dit : « L’ingénierie du consentement est l’essence même de la démocratie, la liberté de persuader et de suggérer » ?
Non, la propagande politique au XXe siècle n’est pas née dans les régimes totalitaires, mais au cœur même de la démocratie libérale américaine ; elle est née d’Edward Bernays, l’auteur de cette phrase.
Le père de la propagande
Edward Bernays (1891-1995), neveu de Sigmund Freud émigré aux Etats-Unis, est considéré comme le père de la propagande politique institutionnelle et de l’industrie des relations publiques, dont il met au point les méthodes pour des firmes comme Lucky Strike. Son œuvre aborde des thèmes communs à celle de Walter Lippmann, notamment celui de la manipulation de l’opinion publique. Il fit à ce titre partie du Committee on Public Information créé par Woodrow Wilson [président des Etats-Unis NDLR] pour gagner l’opinion publique américaine à l’entrée en guerre des États-Unis en 1917.
Conseiller pour de grandes compagnies américaines, Bernays a mis au point les techniques publicitaires modernes. Au début des années 1950, il orchestra des campagnes de déstabilisation politique en Amérique latine, qui accompagnèrent notamment le renversement du gouvernement du Guatemala, main dans la main avec la CIA.
Il a inventé cette technique moderne qui consiste à plier nos esprits aux projets de certains, technique que l’on nomme communément « propagande ».
Pour Bernays, la démocratie doit être pilotée par la minorité intelligente, c’est-à-dire, par l’élite...
Les méthodes de Bernays : de la théorie à la pratique.
En combinant les idées de Gustave Le Bon et Wilfred Trotter sur la psychologie des foules avec les idées sur la psychanalyse de son oncle maternel, Sigmund Freud, Eddy Bernays a été un des premiers à vendre des méthodes pour utiliser la psychologie du subconscient dans le but de manipuler l’opinion publique.
Pour lui, une foule ne peut pas être considérée comme pensante, seul le ça s’y exprime, les pulsions inconscientes. Il s’y adresse pour vendre de l’image dans des publicités, pour le tabac par exemple, où il utilise le symbole phallique. À la demande de l’industrie cigarettière, qui cherchait à faire tomber le tabou de la consommation du tabac par les femmes, il a notamment organisé des défilés très médiatisés de « fumeuses » jeunes et jolies qui affirmaient leur indépendance et leur modernité par l’acte de fumer en public (« Les torches de la liberté »...).
En politique, il « vend » l’image des personnalités publiques, en créant par exemple le petit-déjeuner du président, où celui-ci rencontre des personnalités du show-biz. Il considère qu’une minorité intelligente doit avoir le pouvoir « démocratique » et que la masse populaire doit être modelée pour l’accepter.
L’exemple de la première guerre mondiale
Des techniques de propagande ont été codifiées et appliquées la première fois d’une façon scientifique par le journaliste Walter Lippmann et le psychologue Edward Bernays au début du XXe siècle.
Pendant la Première Guerre mondiale, Lippman et Bernays furent engagés par le président des États-Unis Woodrow Wilson pour faire basculer une opinion américaine traditionnellement isolationniste vers l’interventionnisme. Pour cela, il fit appel aux Comités pour l’information du public (Comitee for Public Information) dirigés par le journaliste George Creel, « privatisant » ainsi la propagande de guerre.
La campagne de propagande de Creel, Lippman et Bernays effectuée pendant six mois fut si intense que l’hystérie anti-allemande générée a impressionné l’industrie américaine, qui découvrait tout à coup les immenses ressources que l’on pouvait déployer pour influencer l’opinion publique d’un pays entier. Bernays a inventé les termes d’esprit de groupe et d’ingénierie du consentement, des concepts importants en propagande appliquée.
Lord Ponsonby, un aristocrate anglais, socialiste et pacifiste, résuma ainsi les méthodes utilisées pendant le conflit (y compris par son propre pays) : Il faut faire croire :
- que notre camp ne veut pas la guerre
- que l’adversaire en est responsable
- qu’il est moralement condamnable
- que la guerre a de nobles buts
- que l’ennemi commet des atrocités délibérées (pas nous)
- .qu’il subit bien plus de pertes que nous
- que Dieu est avec nous
- que le monde de l’art et de la culture approuve notre combat
- que l’ennemi utilise des armes illicites (pas nous)
- que ceux qui doutent des neuf premiers points sont soit des traitres, soit des victimes des mensonges adverses (car l’ennemi, contrairement à nous qui informons, fait de la propagande).
L’historienne Anne Morelli a montré que cette grille pouvait s’appliquer encore aux conflits de la fin du XXe siècle. Certains soulignent aussi leur adéquations avec des conflits très actuels.
Les relations publiques, dont usent les États et les entreprises, s’inspirent directement des travaux de Lippman et Bernays.
En 1928, Bernays publie Propaganda
L’analyse de Chomsky :
« Le manuel classique de l’industrie des relations publiques », selon Noam Chomsky. Véritable petite guide pratique écrit en 1928 par le neveu américain de Sigmund Freud. Ce livre expose cyniquement et sans détour les grands principes de la manipulation mentale de masse ou de ce que Bernays appelait la « fabrique du consentement ».
Comment imposer une nouvelle marque de lessive ? Comment faire élire un président ? Dans la logique des « démocraties de marché », ces questions se confondent.
Bernays assume pleinement ce constat : les choix des masses étant déterminants, ceux qui viendront à les influencer détiendront réellement le pouvoir. La démocratie moderne implique une nouvelle forme de gouvernement, invisible : la propagande. Loin d’en faire la critique, l’auteur se propose d’en perfectionner et d’en systématiser les techniques à partir des acquis de la psychanalyse.
L’analyse de Blandine Josselin :
Car l’homme fait partie de ce « gouvernement de l’ombre », aujourd’hui « spin doctors » et autres conseillers en relation publique, qui régit toutes les activités humaines, du choix de nos lessives aux décisions de nos chefs d’Etat. A travers ses multiples exemples aux allures de complot, son oeuvre, Propaganda, est tout à la fois une théorie des relations publiques et le guide pratique de cette « ingénierie du consentement ».
Explicitant avec une clarté étonnante les multiples techniques et ressorts psychologiques de la propagande (le cher oncle n’est jamais bien loin !), cette oeuvre écrite en 1928 apparaît aujourd’hui comme un témoignage édifiant et profondément actuel qui aurait toute sa place dans un cours de self-défense civique. Précieux, ce « manuel » l’est par son absence totale de langue de bois. A la manière d’un Patrick Le Lay des grands jours, Bernays revendique sans même rosir son mépris pour le « troupeau » et son goût pour l’autorité. Si l’auteur choque aujourd’hui, il désarçonne aussi par tant de candeur et de ferveur pour ce qu’il chérit comme un progrès pour l’humanité. Il pousse surtout à réfléchir sur la réalisation de l’idéal démocratique tant la transparence et la consternante « bonne foi » de son argumentaire en trois temps paraît infaillible. Selon lui, la propagande n’est pas un vilain mot car l’action de dominer et manipuler les foules est inévitable, nécessaire pour « organiser le chaos » et même profitable pour « guider » la masse « égarée », ainsi soulagée de l’éreintante tâche de penser par soi-même. Bernays fonde tout son argument sur l’évacuation de l’individu et la fatalité du consentement populaire.
Anonymus
24/05/2010
Edward Bernays, Propaganda : Comment manipuler l'opinion en démocratie, Editeur Zones, octobre 2007, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Oristelle Bonis et préfacé par Normand Baillargeon, philosophe, professeur à l'université du Québec à Montréal, et auteur d'un Petit cours d'autodéfense intellectuelle paru chez Lux en 2007.
Sources :
00:15 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : propagande, manipulations, démocratie, médias |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 28 mai 2010
Il caso Chomsky e la democrazia in Israele
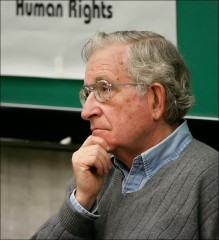 Il caso Chomsky e la democrazia in Israele
Il caso Chomsky e la democrazia in Israeledi Carlo Tagliacozzo
Fonte: Il Fatto Quotidiano
Il caso dell’ingresso negato a Chomsky in Israele e Palestina merita qualche considerazione. Non è un caso isolato, ma trattandosi di un personaggio di altissimo profilo ha avuto l’attenzione dei media. Centinaia e centinaia di giovani e non giovani attivisti che vogliono portare la loro solidarietà ai palestinesi vengono respinti all’ingresso in Israele e per 5 anni non possono più andarci. Ma il caso Chomsky ha una sua specificità: si tratta di un accademico della più alta istituzione americana, il MIT. Gli israeliani e i loro sostenitori, ma anche larghissima parte dei loro critici dinanzi alla proposta del boicottaggio accademico si inalberano inorriditi in nome della libertà di ricerca. Nel caso di Chomsky si è applicato un boicottaggio individuale, in quanto persona non gradita che si recava nella Palestina occupata e non in Israele. Un esempio che dovrebbe far riflettere quanti sostengono che Israele sia “l’unica democrazia in medio oriente”.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, démocratie, proche orient, méditerranée, chomsky, répression |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 23 décembre 2009
Erdogans neue Finte
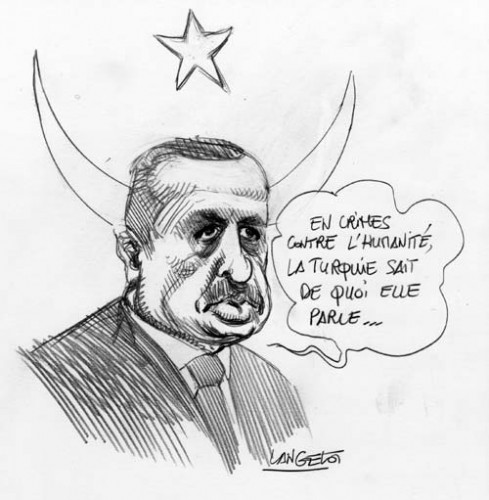 Erdogans neue Finte
Erdogans neue Finte
Der Premier will von den Mißständen in der Türkei ablenken
Von Andreas Mölzer
Ex: http://www.zurzeit.at
Vergangene Woche hat der türkische Ministerpräsident Erdogan seinen 15-Punkte-Plan zur Lösung der Kurdenfrage vorgestellt. Unter anderem soll es künftig erlaubt sein, daß in Schulen Kurdisch als Wahlfach angeboten wird, und Dörfer sollen ihre alten kurdischen Namen zurückbekommen – also Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Daher ist Erdogans Plan vor allem das Eingeständnis, daß die Türkei die Rechte ihrer größten ethnischen Minderheit bislang mit Füßen getreten hat.
Eigentlicher Adressat sind aber nicht die Kurden, sondern ist die Europäische Union. Denn mit seiner medial inszenierten Ankündigung beabsichtigt Erdogan, Brüssel von all den Mißständen abzulenken, welche in der Türkei den Alltag prägen. Die kleine christliche Minderheit etwa wird weiterhin diskriminiert, und es ist nicht davon auszugehen, daß der islamistische Premier medienwirksam einen Plan zur Verbesserung ihrer Lage vorstellen wird. Außerdem liegen im Bereich der Menschenrechte, vor allem bei der Meinungs- und Pressefreiheit, die Dinge nach wie vor im Argen, und Ankara weigert sich stur, das EU-Mitglied Zypern endlich anzuerkennen.
Insgeamt ist es mehr als fraglich, ob es tatsächlich zu einem Ende der Diskriminierung der kurdischen Minderheit durch Ankara kommen wird. Bekanntlich kann man ja vieles ankündigen, aber nur auf die Umsetzung kommt es an. Bestes Beispiel dafür ist die angebliche Annäherung der Türkei an Armenien, die vor wenigen Wochen die internationalen Schlagzeilen beherrscht hatte. Heute aber steht fest, daß die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Ankara und Eriwan alles andere als sicher ist. Denn die Türkei versucht mit allen Mitteln, Armenien die Bedingungen zu diktieren, und im Parlament in Ankara regt sich heftiger Widerstand gegen den angekündigten Vertrag mit dem Nachbarland.
Ähnlich verhält es sich mit Erdogans Plan, von dem der Regierungschef nur allzu gut wußte, welche unüberwindbaren innenpolitischen Hürden warten. Denn einerseits laufen die türkischen Oppositionsparteien gegen eine Ausweitung der Rechte für die Kurden Sturm und andererseits befindet sich Erdogans Regierungspartei im Sinkflug. Meinungsumfragen bescheinigen ihr 32 Prozent, das sind um 15 Prozent weniger als beim Wahlsieg vor zwei Jahren. Und sollte sich diese Entwicklung fortsetzen und die Opposition weiter an Boden gutmachen, dann wird es Erdogan nicht schwerfallen, die Kurden zu opfern.
Andreas Mölzer ist fraktionsloser Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Die hier zum Ausdruck gebrachte Meinung liegt in der alleinigen Verantwortung des Verfassers und gibt nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.
00:22 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, politique internationale, parlement européen, union européenne, europe, affaires européennes, méditerranée, kurdes, kurdistan, démocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 décembre 2009
De eendimensionale democratie
 De eendimensionale democratie
De eendimensionale democratie
Ex: http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/
Cohn-Bendit : "Les Suisses doivent revoter" (in Le Monde van 2 december 2009)
Zoals men de Ieren ook verplicht heeft opnieuw te stemmen over het verdrag van Lissabon.
Op de opwerping "Mais le peuple Suisse s'est exprimé… " raast hij door: "Et alors ? Les Suisses ont voté comme le feraient sans doute une bonne partie des Européens : avec l'angoisse vis-à-vis de l'islam rivée au corps, avec en tête les images des attentats-suicides au Pakistan et en Afghanistan."
"Et alors?" : dat een volk gekozen heeft, heeft dus geen enkele waarde. Althans niet wanneer de "verkeerde" keuze is gemaakt. Want eenmaal de "juiste" keuze gemaakt, krijgt men nooit meer de kans om anders te kiezen.
De Nederlanders en de Fransen hebben zelfs niet meer de kans gekregen om een tweede keer te stemmen: de beslissing van die volkeren heeft men gewoon naast zich neergelegd.
En de Vlamingen en Walen, de Engelsen en de Schotten, de Duisters en vele anderen hebben zelfs niet éénmaal mogen stemmen.
Democratie betekent voor de heersende kaste steeds duidelijker: het volk mag alleen kiezen als het de keuze maakt die opgelegd wordt.
En als ook dat niet lukt, dan zorgt men er wel voor dat men een ander volk schept, naar het woord van Bertold Brecht.
"Die Lösung
Nach dem Aufstand des 17. Juni
ließ der Sekretär des Schriftstellerverbandes
in der Stalinallee Flugblätter verteilen,
auf denen zu lesen war, daß das Volk
das Vertrauen der Regierung verscherzt habe
und es nur durch verdoppelte Arbeit
zurückerobern könne. Wäre es da
nicht einfacher, die Regierung
löste das Volk auf
und wählte ein anderes?"
00:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, suisse, référendum, totalitarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 novembre 2009
Hommage à Friedrich Naumann: visionnaire européen et homme politique national-libéral
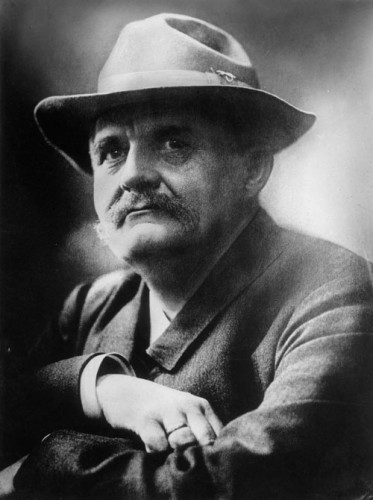 Anton SCHMITT:
Anton SCHMITT:
Hommage à Friedrich Naumann: visionnaire européen et homme politique national-libéral
Les partis politiques de la République Fédérale allemande cherchent tous à se donner des traditions spécifiques, ancrées dans leur propre histoire. Au cours de ces cinquante dernières années, la CDU, rassemblement de conservateurs, de catholiques, de libéraux et de nationaux, n’a pas cherché à se donner une légitimité historique et ne s’est pas davantage donné de ligne politique claire; ce n’est pas le cas chez les sociaux-démocrates et les libéraux. Ces deux familles politiques donnent aux fondations et aux agences fédérales proches de leur parti le nom de personnalités historiques qui ont jadis structuré ou promu le parti.
La fondation proche de la FDP libérale a reçu le nom de Friedrich Naumann, mort il y a 90 ans. Naumann était né le 25 mars 1860 à Leipzig, dans la famille d’un pasteur évangélique. Après son examen dit de “maturité”, il s’en alla étudier la théologie évangélique à Leipzig et Erlangen. Sur la scène politique allemande, il se manifeste pour la première fois à l’âge de 21 ans en adhérant au VDSt (“Verein Deutscher Studenten” ou “Association des Etudiants Allemands”), un association étudiante d’inspiration nationale. De cette association naîtra plus tard le “Kyffhäuser Verband”. En 1883, Naumann accepte un poste à la “Rauhes Haus”, une institution sociale établie à Hambourg. En 1886, il est nommé pasteur à Glauchau en Saxe puis s’installe à la “Mission Intérieure” à Francfort sur le Main en 1890. Il vise à promouvoir une rénovation fondamentale du protestantisme. Lors du Congrès évangélique-social, structure nouvellement fondée, il devient porte-paroles d’un groupe chrétien-social d’inspiration libérale. A partir de 1896, il mettra toujours davantage l’accent sur la nécessité de s’engager politiquement et fonde, dans cette optique, le “Nationalsozialer Verein” (“Association nationale et sociale”) et édite la revue “Die Hilfe” que reprendra plus tard Theodor Heuss, qui devint le premier président de la République Fédérale allemande après 1945. Les deux hommes vont propager l’idée d’un libéralisme socialement responsable. Après la fusion entre le “Nationalsozialer Verein” et la “Freisinnige Vereinigung” (“Union libre-penseuse”), Friedrich Naumann obtient un mandat au Reichstag. Il sera désormais membre du parlement allemand jusqu’à sa mort, à l’exception d’une très brève interruption.
Parallèlement à ce mandat politique, le “Naumannkreis” ou “Cercle Naumann” rassemble tous les esprits se définissant comme “libéraux”, qu’ils appartiennent à la grande bourgeoisie, aux classes moyennes ou au monde ouvrier; Theodor Heuss, Gustav Stresemann, Max Weber, Luja Brentano et Hellmut von Gerlach oeuvreront au sein de ce réseau associatif. En 1910, Naumann tente d’unifier tous les groupements libéraux de gauche et plaide pour une coopération active au sein du Reichstag avec les sociaux-démocrates. En 1914, il soutient le gouvernement dès qu’éclatent les hostilités mais rejette tout projet d’annexions trop importantes. Au lieu de cela, Naumann se fait l’avocat d’une fusion volontaire des Etats et puissances d’Europe centrale (Mitteleuropa) pour des motivations essentiellement économiques. Il veut donc une fédération économique étroite des pays centre-européens, flanquée d’une politique de développement des pays d’Europe orientale et d’Europe balkanique. A l’automne 1915 paraît son ouvrage “Mitteleuropa”, où il couche ses idées sur le papier. Rapidement, ce livre devient le plus lu de tous les écrits évoquant les buts de guerre de l’Allemagne. “Mitteleuropa” fut donc le travail qui exprima au mieux l’alternative que proposaient les civils aux annexions sauvages préconisées par les militaires, qui n’auraient provoqué que des morcellements inutiles, assortis d’irrédentismes chez les nations lésées qui auraient crié vengeance. L’idée d’une “Europe des Patries”, formulée plus tard par De Gaulle, remonte en fait à Naumann. Les structures du pouvoir de l’époque et la pensée des élites monarchistes auraient contrecarré la réalisation du plan “mitteleuropéen” de Naumann, aurait rejeté la fusion volontaire de toutes les entités politiques centre-européennes car une telle fusion impliquait un droit élargi à l’autonomie, une auto-limitation de tous les nationalismes devenus exacerbés au cours du conflit, une auto-limitation dictée par le nécessité que les sentiments de supériorité déclarés ne pouvaient toutefois pas admettre.
En 1917, Naumann soutient au Reichstag une résolution émanant de tous les partis de centre-gauche en faveur d’une paix de compromis. Et pour améliorer et garantir la qualité du personnel politique en Allemagne, il fonde, toujours en 1917, la “Staatsbürgerschule” à Berlin (“L’école des citoyens”) qui deviendra, à partir de 1920, la “Hochschule für Politik” (“Haute école de politique”). En 1918, on parvient enfin à rassembler les nombreux courants libéraux en deux partis, la DDP, libérale de gauche, et la DVP, libérale de droite. Naumann devient président de la DDP. Comment opérait-on, à l’époque, la distinction entre “libéraux de gauche” et “libéraux de droite”? Ils se distinguaient par leurs attitudes différentes sur la question sociale, qui ne peuvent plus s’expliquer aujourd’hui par la terminologie et les concepts actuels. Naumann représentara, en tant que président du parti, la DDP à la Commission constitutionnelle. Avec son parti, il luttera publiquement contre la signature du Traité de Versailles. Naumann espérait que le redressement de l’Allemagne s’opèrerait par des réformes spirituelles-intellectuelles , comme ce fut le cas de la Prusse après sa défaite face aux armées napoléoniennes.
Le 24 août 1919, Naumann meurt à Travemünde des suites d’une thrombose. Son décès prématuré, l’assassinat de Walther Rathenau par d’anciens combattants des Corps Francs, ensuite la mort de Gustav Stresemann, ministre libéral des affaires étrangères, priveront la jeune démocratie allemande de ses plus prestigieuses personnalités. Elles vivantes, la communauté populaire allemande aurait pu s’opposer efficacement aux bandes qu’Adolf Hitler et Ernst Thälmann ont lancées dans les rues. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier non plus la mort prématurée du social-démocrate Friedrich Ebert. Theodor Heuss, Marie Elisabeth Lüders, Gertrud Bäumer et Wilhelm Heile ont tenté de poursuivre l’oeuvre intellectuelle de Naumann.
La FDP actuelle est un parti pour rire: son principal intérêt économique est de plaire aux grands consortiums; elle a, disons-le en utilisant un euphémisme, un rapport assez difficile avec la question sociale. Rien ne rappelle l’oeuvre de Naumann dans cette FDP allemande. L’héritage de Naumann, dans l’espace linguistique allemand, n’est-il pas davantage incarné par la FPÖ autrichienne?
Anton SCHMITT.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°34/2009; traduction française: Robert Steuckers).
00:10 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, europe, europe centrale, mitteleuropa, libéralisme, national-libéralisme, première guerre mondiale, démocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 octobre 2009
La critica de Carl Schmitt al Parlementarismo
La Crítica de Carl Schmitt al Parlamentarismo
Por Luis Oro Tapia
El liberalismo propicia la publicidad y transparencia de la actividad política. El demoliberalismo quiso terminar con la política de gabinete y con los secretos de Estado, pero incurrió en dos prácticas análogas: la política de camarillas y el hermetismo del trabajo en comisiones. La burguesía, en su lucha contra la monarquía absoluta, opuso a la doctrina de la razón de estado y de los arcana imperii el ideal de la transparencia y de la publicidad de los actos de gobierno. Una de las finalidades originarias del parlamento era transparentar, mediante la antorcha de la razón pública y de la libre discusión, la manera como la autoridad gubernamental toma sus resoluciones.
Tal motivación tenía por meta superar la política secreta de los príncipes y de los consejos de gabinete. Este nuevo ideal concebía la política de gabinete, ejecutada por unas cuantas personas a puertas cerradas, como algo en sí mismo malvado y, por tanto, la publicidad de la vida política, por el mero hecho de ser tal, como algo bueno y saludable.
Sin embargo, la aspiración de transparencia y publicidad que pregonaba el liberalismo pronto devino en prácticas que negaban dicha expectativa. En efecto, en la Era Liberal las cada vez más pequeñas comisiones de partidos, o de coaliciones de partidos, deciden a puertas cerradas sobre aquello que afecta diariamente la vida de los ciudadanos. Más aún, los parlamentarios no deciden de manera autónoma, sino que deciden como representantes de los intereses del gran capital. Y estos últimos, a su vez, toman sus decisiones en un comité más limitado que afecta, quizás de manera mucho más significativa, la vida cotidiana de millones de personas. De hecho, las decisiones políticas y económicas, de las cuales depende el destino de las personas, no son (si es que alguna vez lo han sido) ni el fiel reflejo de la sensibilidad de la ciudadanía ni del debate público que en torno a ellas se pueda suscitar. Si la política de camarillas y el hermetismo del trabajo en comisiones se han convertido en la negación del discurso normativo liberal, que propiciaba la publicidad y la discusión, es natural que “la fe en la discusión pública tenía que experimentar una terrible desilusión”. En efecto, el funcionamiento del sistema demoliberal de gobierno ha resultado ser un fiasco, porque la evolución de la moderna democracia de masas ha convertido el eslogan de la discusión pública en una mera formalidad vacía.
Por cierto, la verdadera actividad política no se desarrolla en los debates públicos del pleno, puesto que las decisiones realmente importantes han sido tomadas previamente en las comisiones o “en reuniones secretas de los jefes de los grupos parlamentarios e, incluso, en comisiones no parlamentarias. Así, se origina la derivación y supresión de todas las responsabilidades, con lo que el sistema parlamentario resulta ser, al fin, sólo una mala fachada del dominio de los partidos y de los intereses económicos”.
Para Schmitt el Estado demoliberal es incapaz de actuar como unidad de decisión y de acción frente a situaciones límites. El liberalismo frente a un dilema que impele a tomar una determinación rápida queda atónito y elude tomar pronta y resueltamente un curso de acción a seguir. Así, por ejemplo, frente a la pregunta perentoria: “¿a quién queréis, a Barrabás o a Jesús?”, la urgencia de la respuesta queda aplazada con el nombramiento de una comisión parlamentaria investigadora que finalmente elude dar una respuesta concluyente. Para Schmitt, la esencia del liberalismo radica en la negociación y la indecisión permanente, puesto que tiene la expectativa de que en el debate parlamentario el problema se diluya, suspendiéndose así indefinidamente la resolución mediante la discusión eterna.
En el parlamentarismo, el pueblo como unidad orgánica, vale decir como totalidad, no está representado en el parlamento; por consiguiente, el régimen parlamentario no es democrático. Entonces, ¿a quiénes representan los parlamentarios? La respuesta teórica es a la nación, a la comunidad, a un todo orgánico. Sin embargo, en la práctica no es así, porque los parlamentarios representan a partidos políticos, tras los cuales están determinados intereses, y ellos están más preocupados de aumentar o de preservar sus cuotas de poder, que les permiten proteger sus respectivos intereses, que de velar por el bienestar del todo orgánico. Los partidos se relacionan entre sí “como poderosos grupos de poder social y económico, calculando los mutuos intereses y sus posibilidades de alcanzar el poder y llevando a cabo desde esta base fáctica compromisos y coaliciones”.
Schmitt afirma que en el parlamento no hay discusión, pero sí negociación y ajuste de intereses entre los partidos que tienen representación parlamentaria. Por tal motivo, Schmitt sostiene que afirmar que los parlamentarios alientan una genuina discusión pública sería faltar a la verdad. La brecha entre el ideal y la realidad es ostensible; en efecto, las relaciones entre los parlamentarios distan mucho del modelo de discusión pública que proponía Bentham. Este teórico del liberalismo sostenía que en el parlamento se encuentran las ideas y el contacto entre ellas hace saltar las chispas de la evidencia. Pero, en la práctica, no hay discusión razonada ni debate público, sino negociaciones de antesala en la que los partidos tienen por principal preocupación la defensa de sus intereses sectoriales y el cálculo estratégico de sus oportunidades para incrementar o conservar sus cuotas de poder.
Entonces, el debate público resulta ser una quimera. En efecto, en vez de prosperar una discusión en la que prevalece la argumentación racional, irrumpe la propaganda que tiene por objetivo seducir la emotividad del electorado. Así, la discusión pública primero es sustituida por la excitación de la sensibilidad e inmediatamente después por la movilización de las pasiones, lo cual se logra a través de afiches, carteles, consignas y otros medios que tienen por finalidad sugestionar a las masas.
¿Por qué el parlamentarismo está en crisis? Dicho en nuestro lenguaje: ¿Por qué la democracia liberal está en crisis? ¿Qué explica el desafecto que existe por ella? La democracia liberal como institución ha perdido sus raíces ciudadanas, manteniéndose sólo como un dispositivo formal vacío, como un organismo carente de un pathos, que funciona más por inercia y por falta de una mejor opción que por convicción. El languidecimiento del pathos del parlamentarismo ha debilitado la identidad existente entre representantes y representados; por consiguiente, el sistema demoliberal deviene, paradojalmente, en un régimen no democrático; concebida la democracia como la entiende Schmitt. ¿Qué es la democracia para Schmitt? Es, simplemente, la identidad que existe entre gobernantes y gobernados; entre la nación y el Estado; entre los seguidores y el líder; entre electores y elegidos, etc.
En las sociedades que poseen regímenes políticos demoliberales el afán de dar satisfacción a los intereses individuales y sectoriales en desmedro de la comunidad ha erosionado la moral pública. Tanto es así que en algunos Estados demoliberales “todos los asuntos públicos se han convertido en objeto de botines y compromisos entre los partidos y sus seguidores y la política, lejos de ser el cometido de una elite [de servidores públicos], ha llegado a ser el negocio, por lo general despreciado, de una, por lo general despreciada, clase”, concluye Schmitt.
00:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, parlementarisme, démocratie, partitocratie, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, sociologie, révolution conservatrice, weimar, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 septembre 2009
Pourquoi Patrick Buchanan a été si rapidement évincé...
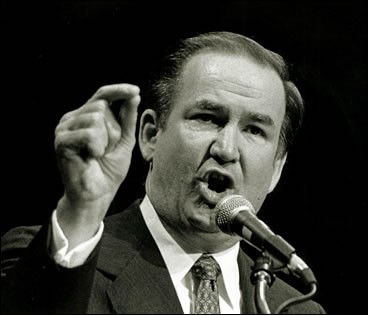
ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Pourquoi Patrick Buchanan a été si rapidement évincé...
Avant les primaires déjà, j'ai reçu une dépêche de Lucera, dans laquelle Siegfried Ostertag présentait une vision d'horreur: en Amérique, Patrick Buchanan pourrait bien rassembler sous sa bannière tant de nouveaux électeurs qu'en automne 1996, il deviendrait le concurrent républicain direct de Bill Clinton et chasserait peut-être celui-ci de son mandat.
En effet, lors des premières pré-élections, Buchanan a engrangé des résultats spectaculaires. Les intellectuels de la Côte Est se sont mis à hurler. Leurs satellites européens, avec les Allemands en tête, ont pâli. Josef Joffe appelle Buchanan “le marchand de peur” dans les colonnes de la Süddeutsche Zeitung, le 6 mars. Mais qui a peur dans le scénario? L'établissement d'Outre-Atlantique! Il a peur, grand'peur, de perdre ses pouvoirs.
Un flot d'injures s'est déversé sur Buchanan, flot qui n'a cessé de croître pour s'amplifier et devenir une véritable campagne diffamatoire. Hier on l'accusait d'être un “extrémiste de droite”; aujourd'hui, on le traite de “Jirinovski américain”. Ce qui est assurément plus sulfureux... A peine cette comparaison avait-elle été prononcée, que l'homme-qui-fait-un-malheur-à-Moscou la reprend à son compte et nomme Buchanan son “frère d'arme”. L'homme qui parodie la renaissance du nationalisme projette son ombre jusqu'au-delà de l'Atlantique... Et la campagne a continué: Buchanan est évidemment devenu un national-socialiste qui marchait dans les pas d'Adolf Hitler.
Le trouble-fête, d'élections anticipées en élections anticipées, a été systématiquement refoulé, battu, évincé. Mais les médias ont voulu être bien sûrs que cette éviction était définitive: même battu, Buchanan a encore été victime de manipulations savamment orchestrées. Dès les primaires de New York, le 7 mars, Buchanan avait des difficultés à se placer sur une liste. Son propre parti, qui prétend défendre la “vraie liberté américaine” face aux Démocrates, ne s'est pas géné pour faire passer le mot d'ordre bizarre “to stop Pat” avec des moyens totalitaires.
Cette attitude est pour le moins bizarre, car en stoppant Buchanan, les Républicains ont arrêté leur propre progression. Quelques jours après ces efforts pour éliminer leur candidat le plus populaire, plus aucun pronostic n'annonçait leur victoire. Mais ces prévisions pessimistes ne sont pas dues à l'absence de profil défini de Bob Dole, qui jouit apparemment de l'augmentation du nombre de ses électeurs et ne leur dit que des banalités: «Je ne suis pas un bavard. Je suis un homme d'action». Effectivement, Dole n'est pas un bavard, son discours ne reflète aucune verve, mais il n'est pas davantage l'homme d'action qu'il prétend être.
Les Républicains ont connu un succès retentissant il y a dix-huit mois en arrachant la majorité au Sénat et dans la Chambre des représentants: ce fut un séisme politique, mais il ne fut pas exploité car les Républicains ne sont pas parvenus à se faire entendre à l'assemblée et à exercer les pressions nécessaires sur l'établissement. Bob Dole et Newt Gingrich ont canalisé les flots protestataires émanant du peuple américain en direction de leur parti, mais ils les ont ensuite laissé stagner et mourir. Le porte-paroles le mieux profilé de cette protestation était Patrick Buchanan; aujourd'hui, réduit au silence, il ne pourra plus profiter des contestations et des protestations du peuple pour porter son parti au pouvoir.
Buchanan incarne aujourd'hui aux Etats-Unis un large front composé de mouvements de citoyens réagissant vigoureusement contre la décadence de l'Amérique, qui, le soir de la Saint-Sylvestre, a nommé, par la voix du Washington Post, Gengis Khan “homme du siècle”! L'impulsion fondamentale de cette profonde vague de protestation conservatrice est dirigée contre Wall Street et contre le pouvoir fédéral de Washington. Elle allie le “mouvement des culs-terreux” (les fermiers), d'une part, à celui des “Knights of Labor” (= “Les Chevaliers du Travail”) présents dans les grandes villes, d'autre part, dans un combat général contre les menaces que font peser la grande industrie et l'oligarchie financière sur la simple existence quotidienne de millions de citoyens modestes. A cette lutte contre la misère menaçante s'associe un autre combat, plus fondamental celui-là, contre l'abrutissement généralisé et la dépravation morale qu'apportent l'industrie des loisirs et les mass-media, ainsi qu'une lutte contre la libanisation du pays, due à la faillite totale du modèle multiculturel: aujourd'hui, effectivement, toutes les catégories sociales ou raciales de la population se sentent d'une façon ou d'une autre discriminées.
Cette Amérique frustrée lutte aujourd'hui pour avoir un accès direct à l'espace publique-médiatique, qui n'est finalement pas aussi solidement verrouillé qu'en Allemagne [et dans le reste de l'Europe]. Et cette Amérique frustrée est armée. Les “Sovereign Citizens” (= les Citoyens Souverains) s'exercent désormais à la résistance armée contre la violence “légale” de l'Etat.
Le mélange de frustration et de combativité qui s'observe actuellement aux Etats-Unis est explosif. Mais si Buchanan a voulu apporter des remèdes aux maux intérieurs de l'Amérique, il a également voulu changer sa politique extérieure, et de façon radicale. Le 19 février 1990, il avait publié un article sur la questions des frontières orientales de l'Allemagne dans le Washington Times (et 250 journaux américains et canadiens l'avait reproduit!); le 22 octobre 1990, dans les pages de The New Republic, il se rapprochait dangereusement des révisionnistes, en niant quelques aspects de la culpabilité allemande dans le génocide. Certes, l'objectif de Buchanan n'était pas de déployer une politique anti-polonaise ou d'intervenir dans les débats en faveur des révisionnistes, mais, plus précisément, de changer de stratégie planétaire, d'abandonner les anciens alliés russes, français et britanniques de la seconde guerre mondiale, et de renforcer considérablement les liens qui unissent Washington à ses “demi-alliés”, aux ennemis d'hier, l'Allemagne et le Japon. Peut-être se souvient-on subitement dans certains cercles politiques américains que les bons rapports entre les Etats-Unis et la Prusse, de Frédéric II à Bismarck, ont bénéficié aux deux partenaires.
Cette mutation potentielle des alliances a fait frémir les gardiens de l'ordre d'après 1945: ils ont conjugué tous leurs efforts pour bloquer l'ascension vertigineuse de Buchanan. Mais cela ne signifie pas pour autant que les forces innovatrices des Etats-Unis ont connu un échec durable. Le Parti Républicain n'a pas été capable de digérer les revendications de la base populaire, mais il est le seul à leur avoir donné momentanément une tribune. Aux dernières nouvelles, Buchanan songerait à se présenter comme candidat indépendant face à Dole et à Clinton. La rénovation de l'Amérique est retardée de quatre ans, sauf si le chaudron bouillonnant que sont devenus les States n'explose pas avant. Le XXIième siècle frappe à la porte...
Hans-Dieter SANDER.
(ex Staatsbriefe, Nr. 2-3/96).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, etats-unis, élections américaines, démocratie, conservatisme, amérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 septembre 2009
Pouvoirs oligarchiques et démocratie de façade
Pouvoirs oligarchiques et démocratie de façade
L’Intitut Néo-Socratique nous prie d’annoncer son cycle de conférences qui se déroulera au cours de l’année à venir sur le thème général :
Le Système oligarchique ;
comment il nous domine et comment s’en libérer !
La première conférence, prononcée par Yvan Blot, Président de l’Institut, se tiendra
Le lundi 14 septembre 2009 à 19H 30
A l’Hôtel Néva (rez-de-chaussée)
14 rue Brey – 75017 PARIS (près de l’étoile)
avec pour titre :
Notre démocratie de façade cache une oligarchie ;
Origine historique de cette situation
En avant propos de cette conférence, Polémia en présente la thématique qui sera abordée.
Pouvoirs oligarchiques et démocratie de façade
L’histoire de l’humanité est en grande partie l’histoire de ses classes dirigeantes. Dans toutes les sociétés sauf les sociétés très primitives, des classes dirigeantes sont apparues (Spencer) et ont cherché à justifier leur domination, en général avec succès. Ce succès reposait principalement sur leurs prestations, protéger la société du désordre intérieur et des ennemis extérieurs, notamment.
Très tôt, les anciens philosophes grecs perçurent que les dirigeants pouvaient rechercher leur intérêt propre et trahir le bien commun. La classification classique des régimes politiques d’Aristote vient de là : la monarchie vise le bien commun à l’inverse de la tyrannie. L’aristocratie vise le bien commun à l’inverse de l’oligarchie. Dans le langage actuel, la démocratie (Aristote disait : politeia que l’on traduit par république) vise le bien commun, ce qui n’est pas le cas du gouvernement démagogique.
Elites dévouées au bien commun ou élites courtermistes
Plusieurs critères permettent de distinguer les élites dévouées au bien commun et celles qui ne le sont pas :
Les propriétaires, rois ou aristocrates, ont une vision à long terme de la gestion de leurs biens, ce qui est beaucoup moins le cas des gérants salariés nommés pour une période courte. A l’heure actuelle, ce sont les gérants salariés, les « managers » qui gouvernent non seulement l’Etat mais aussi la plupart des grandes entreprises et les médias. C’est le règne de l’intérêt à court terme.
Un deuxième critère peut être le caractère plus ou moins « héroïque » des gouvernants, c'est-à-dire leur capacité à se sacrifier eux-mêmes pour autrui. Cette capacité est plus grande, par vocation même, chez les religieux ou les militaires, ou encore chez les savants ou professeurs amoureux de la vérité ou les juges et policiers amoureux de la justice.
Autrefois, l’aristocratie occupait les postes supérieurs de l’Etat. Elle n’avait pas que des mérites mais elle avait celui d’être d’essence militaire : le soldat est prêt à mourir, à donner sa vie pour son roi ou son pays. L’éthique du sacrifice ne lui était pas étrangère. Les gouvernants actuels ont une éthique de carrière bien différente.
« Les démocraties représentatives » ne sont que des oligarchies
Au vingtième siècle, on peut dire que les aristocraties ont été remplacées par des oligarchies. Ce n’est pas la version de l’histoire officielle car les oligarchies ont prétendu se battre pour la démocratie. On fait croire aux foules occidentales qu’elles vivent en démocratie, laquelle aurait remplacé les monarchies d’autrefois et leurs aristocraties nobiliaires. En réalité, nous vivons en oligarchies sous le nom de démocraties dites « représentatives ».
Essayez donc d’être candidat à une élection sans être membre d’un parti politique puissant : votre chance de vous faire élire est nulle ! Essayez donc de proposer une loi sur un sujet qui vous est cher. Il n’y a aucune procédure pour cela sauf dans les rares pays qui pratiquent la démocratie directe : la Suisse et l’Italie, au niveau national et local, l’Allemagne et l’ouest des Etats-Unis, au niveau local seulement.
Les vraies démocraties sont aujourd’hui celles qui combinent démocratie directe et démocratie représentative.
Seule la démocratie directe permet de contrôler les « gérants »
Pour les démocraties purement représentatives, le bilan n’est pas bon. Des études économiques très poussées, notamment du professeur suisse Kirchgässner, ont montré que les pays à démocratie directe ont des impôts 30% plus faibles, des dépenses publiques 30% plus réduites et une dette publique 50% plus faibles que les démocraties représentatives. Le PNB est plus élevé en moyenne.
De plus, du point de vue politique, les démocraties directes satisfont leurs citoyens (80% des Suisses sont satisfaits de leurs institutions. Dans les démocraties purement représentatives comme la France, les citoyens n’ont absolument pas le sentiment d’avoir une influence sur la politique de leur pays. Ils ne peuvent pas initier de référendums. Ils peuvent élire les députés présentés et sélectionnés par les grands partis politiques et c’est tout. Les programmes des partis se ressemblent de plus en plus. Le citoyen n’a plus guère de choix. D’après une enquête lourde menée par les politologues Bréchon et Tchernia, 40% des Français font encore confiance au parlement, autant pour les syndicats et 18% seulement font confiance aux partis politiques. Les Français n’ont pas l’impression que l’on gouverne en fonction des préoccupations et des intérêts du peuple.
Pour redonner du sens à la démocratie, il faut prendre conscience du caractère oligarchique du pouvoir actuel, qui est le pouvoir de gérants à court terme (rien à voir avec la gestion de vrais propriétaires). Il faut contrôler ces gérants : une seule voie pour cela : la démocratie directe.
Yvan BLOT
24/08/2009
Correspondance Polémia
11/08/2009
13:53 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, pensée politique, théorie politique, sciences politiques, antiquité grecque, grece antique, oligarchie, démocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 juin 2009
Fernau über Demokratie
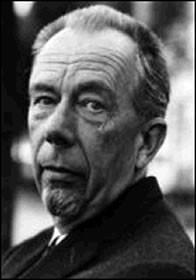
Erik LEHNERT - http://www.sezession.de/

Passend zu der sich hier entspinnenden Debatte möchte ich auf einen relativ unbekannten Text von Joachim Fernau hinweisen. Die „Fibel der Demokratie“ (1953) ist eine der Gelegenheitsarbeiten, die Fernau im Laufe der Zeit immer mal wieder verfaßt hat. Wenn die darin geäußerte Kritik an der Demokratie für unserer Ohren ungewohnt klingt, zeigt das nur, wie weit die Immunisierung der Demokratie gegen Kritik bereits fortgeschritten ist.
Offenbar war man (zumindest Fernau, wobei ich nicht glaube, daß er damit alleine stand) sich damals noch bewußt zu welchen Auswüchsen gerade die Herrschaft der Mehrheit führen kann. Das entscheidende Kapitel lautet:
Wir leben in einer unvollkommenen Welt.
Diese Welt besteht aus Menschen, die ihrerseits auch wieder unvollkommen sind.
Seit vielen tausend Jahren experimentieren wir.
Wir experimentieren heute immer noch. Auch die Demokratie in der Welt ist noch ein Experiment.
Wer dieser Tatsache nicht ins Auge sieht, wer es nicht verträgt, dies zu hören, ist ein Demagoge oder ein Schwärmer. Der erste Stoß, das erste Gegenargument, auf das er nicht vorbereitet ist, wird ihn aus dem Sattel heben.
Wer die moderne Demokratie vollendet findet, muß wohl an ihr mit herumgebastelt haben, denn nur Väter finden ihre Kinder immer schön.
Man pflegt heute allen Menschen, die von Schwächen der demokratisch-parlamentarischen Verfassungen sprechen oder sie gar ablehnen, üble Motive vorzuwerfen. Man hämmert der Masse ein, dies seien ganz gefährliche Burschen, die sich über den Volkswillen hinwegsetzen wollten. Kaum ist dieses Wort gefallen, so fühlt sich jedermann geradezu persönlich angegriffen.
Das ist eine Art, die sehr wirksam ist; aber sie ist überaus unfair und ehrabschneidend.
Natürlich gibt es solche Fälle. In allen Lagern pflegt ein Teil der Menschen aus Machtgelüsten und egoistischen Hoffnungen zu handeln. Ja, die Demokratie selbst ist ja schon ein Pochen auf einem „egoistischen“ Recht. Das wollen wir nicht vergessen.
Nein, die Probleme der parlamentarischen Demokratie kann man nicht mit dieser Handbewegung abtun.
Sie sind da.
Aber die größte Gewissensfrage, eine Gewissensfrage, die wirklich „auf Tod und Leben“ der Demokratie geht, haben wir noch gar nicht berührt. Sie ergibt sich nicht einmal aus den Mängeln der Praxis, sondern im Gegenteil, sie beginnt erst richtig, wie wird gerade dann brennend, wenn die Demokratie so vollständig wie möglich verwirklicht ist.
Die Gewissensfrage lautet:
Nehmen wir an, der Volkswille ließe sich in einer idealen Verfassung genau feststellen: Ist dieser Volkswille, wenn er verwirklicht wird, dann automatisch gut?
Sie ahnen, welche entscheidende Frage das ist!
Hier soll unser Gewissen antworten, ob wir an die Güte dieser Welt glauben, ob wir die Welt für im Grunde schön und die Menschen für vernünftig und klug halten. Oder ob wir die Welt als im Grunde problematisch und die Menschen als überwiegend schlecht und haltlos betrachten.
Es ist, auf den kürzesten Nenner gebracht, die Frage: Darf Quantität über Qualität gehen?
Das ist der empfindlichste Punkt der parlamentarischen Demokratie, und es ist fast eine Groteske, mit anzusehen, wie er in der Öffentlichkeit ängstlich vermieden wird.
Warum eigentlich?
Verschwindet er dadurch?
Es nützt nichts, davor die Augen zuzukneifen.
Wir wollen im Gegenteil dies in aller Seelenruhe untersuchen.
Wer die Demokratie liebt, soll sie sehend lieben.
Der Blick auf den Iran verdeutlicht das Gemeinte sehr schön. Dort ist man mittlerweile davon abgewichen, die Neuauszählung der Stimmen zu fordern. Vielmehr geht es um den Systemwechsel, der offenbar gegen der Mehrheit erzwungen werden soll. Das kann man ja beurteilen wie man will, aber demokratisch ist das nicht gerade. Ist die Demokratie also doch kein Absolutum? Wer hätte das gedacht…
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, démocratie, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 juin 2009
L'Europe? Quelle Europe?
L’Europe ? Quelle Europe ?
 par Pierre Vial
par Pierre Vial
Président de Terre et peuple
Les chiffres sont là. Eloquents. Une abstention à hauteur de 56,9% pour l’ensemble des 27 pays de l’Union européenne, de 59,5% pour la France. En majorité, les Européens ne se sont pas déplacés pour voter. Tout simplement parce que les Européens ne se sentent pas concernés par l’Europe. Tout au moins celle de Bruxelles. Et on les comprend, même si on sait que, qu’on le veuille ou non, que cela plaise ou non, notre vie quotidienne est, pour notre plus grand malheur, de plus en plus déterminée par des décisions bureaucratiques prises loin de nos terroirs (terroirs ? Qu’est-ce que c’est que ça ? disent les Eurocrates).
La crise et ses méfaits, tout particulièrement le chômage, auraient dû faire monter en puissance le vote protestataire et populiste. Ce fut le cas dans certains pays. Mais en France il n’y a plus que Le Pen lui-même à croire (ou à faire semblant de croire) en son rôle de tribun de la plèbe. Quant à l’extrême-gauche, elle n’a pas raflé la mise. Sarkozy, le joueur de flûte, continue à entraîner nombre de Gaulois, hébétés, vers le fleuve qui conduit au gouffre, tandis que les autres chefs d’Etat européens ne valent pas mieux.
Faut-il pour autant désespérer de l’Europe ? Evidemment non. Il faut garder notre foi intacte en ce grand dessein, ce puissant rêve de grandeur mobilisateur d’énergies qui s’appelle l’Europe. Mais pas n’importe laquelle. L’Europe des peuples et des terroirs. Notre Europe. Notre grande patrie européenne, tout à la fois confédérale et impériale (deux dimensions qui, si on veut bien y réfléchir, peuvent être totalement complémentaires, comme l’Histoire l’a déjà montré).
Notre Europe : tel est le dossier publié dans le prochain numéro de Terre et Peuple Magazine, avec des contributions de Robert Spieler, Alain Cagnat, Jean-Gilles Malliarakis et Pierre Vial.
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, élections européennes, parlement européen, démocratie, abstentions, france, européennes 2009 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 juin 2009
Mijn kritiek op de democratie
Een succesvolle methode is geweld en intimidatie. Gebruik terreur en niemand op termijn durft het meer tegen je op te nemen. De meeste mensen zijn geen idealisten en de fatsoenlijken onder hen moeten een gezin onderhouden. Ze zullen ook, als ze geconfronteerd worden met de dreiging van georganiseerd geweld eieren voor hun geld kiezen. Immers, idealen zijn niet zo belangrijk als je zoontje van 4 maanden en je vrouw die moeten eten. Overheers de straat en je overheerst de staat door het stemloket.
Een andere en ook meer subtiele methode om het gevaar van algemene verkiezingen die jouw kant niet op gaan te neutraliseren is het opwekken van een maatschappelijk taboe. In tegenstelling tot wat sommigen denken is het opwekken van een taboe niet zo moeilijk. Je grijpt een incident aan veroorzaakt door een ongelukkige drommel en je schreeuwt het van de hoogste toren hoe slecht de persoon wel niet is die het incident heeft veroorzaakt. Doe dit grondig en verruïneer de persoon publiekelijk. Herhaal dit proces met meerdere mensen en de meesten zullen de boodschap snappen. Om het af te maken koppel je taboe aan een partij, bij voorkeur mensen die toch al een slechte naam hebben door hun eigen geklungel.
Een concreet voorbeeld hiervan is de kwestie rond etniciteit en criminaliteit. Oftewel de kwestie Buikhuizen. Buikhuizen haalde het in zijn hoofd om een correlatie tussen etniciteit en criminaliteit te zoeken. Dat kan natuurlijk niet, vond links, omdat criminaliteit en al het andere slechte gedrag “voortkomt uit de sociaaleconomische klasse”. Oftewel geef een Marokkaanse vrouwenmishandelaar (daar zijn er genoeg van) een inkomen van 10.000 euro per maand en hij houd vanzelf op een magische wijze op zijn vrouw te slaan. Maar goed, de toon was gezet. Buikhuizen werd ontslagen en eigenlijk niemand durfde het er nog over te hebben tot aan de politiek aan toe. Het gevaar van rechts via de stembus was (tot 11 september 2001, uiteraard) succesvol geneutraliseerd.
Maar met stip de walgelijkste methode om kiezers te binden wordt, niet toevallig, gebruikt door de meest walgelijke partij uit ons politieke bestel. Namelijk de PvdA. De PvdA bind kiezers aan de partij door gedwongen solidariteit via belastingen. De PvdA staat het soort overheid voor die de burgerlijke kringen in de weg loopt en een de kerk onmogelijk maakt de armen op te vangen.
Het is bepaald geen toeval dat de PvdA populair is in de kringen van raamambtenaartjes, besturen van organisaties die leven op de riante cultuursubsidies en allochtonen. Dit is het resultaat van een goed uitgedacht beleid. Dit beleid houd concreet in: voor iedereen een uitkering.
Omdat geniale dingen in de kern altijd simpel zijn is deze methode ook meer dan succesvol. Immers, het leger mensen dat èèn van de riante uitkeringen ontvangt is vatbaar voor het argument dat als je de PvdA wegstemt de andere partij wel een kan gaan snoeien in het stelsel van de vele soorten uitkeringen. Het stemadvies luid dan altijd impliciet: stem PvdA! Dat het land kapot gaat aan het leger inactieven wat wordt gecreëerd deert niet. Zolang de PvdA aan de macht blijft komt de Brave New World immers weer een stukje dichterbij.
Advies: kies voor de afschaffing van het algemeen stemrecht. Kies voor beschaving.
00:13 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : démocratie, critique, politique, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 juin 2009
Des Européennes sans Europe!

Des européennes sans Europe !
Le Billet de Patrick Parment
 C’est Jean-Luc Mélenchon qui a le mieux commenté les résultats de cette élection européenne : les Français ne veulent pas de cette Europe-là. Cette Europe en question, c’est celle, technocratique, de Bruxelles ou de Strasbourg sur laquelle les Européens n’ont aucune prise. C’est une Europe du fric aux mains des lobbies, une Europe qui se gausse des peuples et de la personnalité de chacun d’entre eux. C’est une Europe sans conscience politique, sans vision géopolitique et sous influence. Les députés européens sont des guignols impuissants et les eurodéputés français largement débordés par les Anglais ou les Allemands, qui ont formé depuis longtemps le personnel ad hoc. La France ne s’impose à Bruxelles – et encore, voir la crise du lait – qu’en situation de rupture et quand le pouvoir politique s’en mêle pour régler en général un problème de politique intérieure. De ce point de vue, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer cette Europe-là. Ce reproche est d’ailleurs général sur le continent.
C’est Jean-Luc Mélenchon qui a le mieux commenté les résultats de cette élection européenne : les Français ne veulent pas de cette Europe-là. Cette Europe en question, c’est celle, technocratique, de Bruxelles ou de Strasbourg sur laquelle les Européens n’ont aucune prise. C’est une Europe du fric aux mains des lobbies, une Europe qui se gausse des peuples et de la personnalité de chacun d’entre eux. C’est une Europe sans conscience politique, sans vision géopolitique et sous influence. Les députés européens sont des guignols impuissants et les eurodéputés français largement débordés par les Anglais ou les Allemands, qui ont formé depuis longtemps le personnel ad hoc. La France ne s’impose à Bruxelles – et encore, voir la crise du lait – qu’en situation de rupture et quand le pouvoir politique s’en mêle pour régler en général un problème de politique intérieure. De ce point de vue, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer cette Europe-là. Ce reproche est d’ailleurs général sur le continent.
Mais à qui la faute, quand le mandat européen sert en politique intérieure à récompenser ou recaser des élus qui n’ont aucune compétence particulière. Le cas de Rachida Dati n’est pas isolé. Et le vote des électeurs ne fait que confirmer l’absence d’intérêt pour ce " bazar ".
On notera en premier lieu le fort taux d’abstention – près de 60%. C’est le premier démenti. Ensuite, le score de l’UMP est médiocre – autour de 28% -, même si elle arrive en tête, dans un paysage politique dévasté par un Sarkozy qui s’ingénue à brouiller les cartes et casser tous les repères.
Les échecs successifs du Parti socialiste l’ont anéanti et il n’arrive pas à cadrer son discours dans ce contexte de crise économique majeure. Etre anti-libéral ne suffit pas. Le PS a du mal à formuler une vision politique globale et cohérente de la société française dont il est déconnecté. Sarkozy est basique et pragmatique et carbure à l’esbroufe. Il occupe tout le champ médiatique sans exprimer pour autant une vision socio-économique cohérente. Pour des raisons qui nous échappent – pas tant que ça quand même –, il a décidé d’aligner sa politique étrangère sur celle des Etats-Unis. Il va avoir des surprises, Obama opérant des revirements, notamment sur le Moyen-Orient, lourds de conséquences.
Et le score des Verts de terre ! 16%, à parité avec le PS. Mais c’est un score qui nie l’Europe à plein nez. Les écolos n’ont aucune substance politique, c’est un vote par défaut quand on ne veut pas se prononcer pour la droite ou la gauche. Le seul dénominateur commun à tous ces gens-là, c’est le casse-croûte. Cohn-Bendit est depuis belle lurette un suppôt du libéralisme ambiant et un parfait opportuniste. Que vient foutre la mère Eva Joly dans ce bazar ? Expliquez-moi ça. Manquent Hulot et Arthus Bertrand pour compléter le tableau, mais eux ont trouvé d’autres filières pour se faire du pognon, nettement plus lucratives. Inutile de dire qu’à l’Europe, tout ce petit monde ne pèse rien. Donc, ce vote n’a, en soi, rien d’européen.
La déculottée que vient de prendre François Bayrou est intéressante, car elle situe bien le personnage sur la scène politique française. Il va falloir qu’il revoie ses théories et son égo surdimensionné vient d’en prendre un coup.
Non, ces élections, d’ailleurs expédiées en deux temps trois mouvements par les partis, n’intéressent personne. Ce qui, en soi, est fort dommage. Car cette Europe est une réalité avec laquelle on doit compter chaque jour. Si nous avions une classe politique responsable, on formerait un personnel en conséquence qui pourrait alors peser sur les décisions de Bruxelles ou de Strasbourg. Je ne dis pas que l’on s’en porterait mieux, je dis simplement qu’on cesserait d’être absent d’un jeu qui se fait souvent sans nous. Ce ne sont pas les gens qui manquent, c’est la volonté politique. Retour à la case départ.
14:32 Publié dans Le Billet de Patrick Parment
15:56 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élections européennes, europe, parlement européen, élection, démocratie, politique, politique internationale, affaires européennes, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 juin 2009
UE: toujours plus loin de la démocratie

Union Européenne : toujours plus loin de la démocratie... |
| Lundi, 25 Mai 2009 - http://unitepopulaire.org/ | |
| « La campagne pour le scrutin parlementaire qui se tiendra du 4 au 7 juin est lancée. La menace de l’abstention est forte, tant l’Union est accusée d’être une machine bureaucratique Rien de tel que des perspectives floues pour saboter une élection cruciale. A travers les vingt-sept pays de l’Union européenne, la campagne pour l’élection au Parlement européen lancée dimanche risque de ressembler à une opération massive de déminage. Trois cent septante-cinq millions d’électeurs sont convoqués, du 4 au 7 juin, pour élire les 736 eurodéputés qui les représenteront pendant cinq ans à Strasbourg et Bruxelles. Or, tandis que les sondages prédisent déjà une abstention record – supérieure à 60% – la confusion attendue pour la fin d’année 2009 rend assez impossible la mission des candidats. A une exception près: celle du camp eurosceptique, emmené par le parti Libertas du magnat irlandais Declan Ganley, leader du collectif noniste à l’origine du rejet du Traité de Lisbonne dans son pays lors du référendum du 12 juin 2008. Tout découle, justement, du suspense qui entoure toujours ce fameux texte, successeur de la défunte Constitution européenne enterrée par les non français et néerlandais de mai-juin 2005. […] La conséquence de ce flou politique est de brouiller encore plus l’image d’une Union déjà accusée d’être une machine bureaucratique éloignée des citoyens. La preuve est faite que le Parlement européen, plus puissant que les parlements nationaux dans les domaines de compétence communautaire, fonctionne sur la base de coalitions gauche-droite et d’alliances nationales éloignées des slogans de campagne. La probabilité est forte que la nomination de la future Commission, qui devra être avalisée par les eurodéputés, soit reculée à la fin 2009 pour tenir compte du référendum irlandais sur le Traité de Lisbonne, ce qui augmentera d’ici là les manœuvres en coulisses entre les Etats membres. » Le Temps, 18 mai 2009 |
00:40 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, démocratie, affaires européennes, union européenne, déficit démocratique, élections européennes, parlement européen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 mai 2009
M. Gauchet: "La démocratie du privé perturbe le collectif"
«La démocratie du privé perturbe le collectif»
Interview - Ex: http://www.liberation.fr/
Invité de «Libération», Marcel Gauchet dresse le bilan de deux années de sarkozysme. Et réagit à l’actualité tout au long de ce numéro spécial.
Théoricien de la crise de la démocratie et directeur de recherches à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Marcel Gauchet, 63 ans, répond aux questions de Libération.
Quel bilan politique dressez-vous des deux premières années de Nicolas Sarkozy à l’Elysée ?
Le sarkozysme est difficile à analyser, car il est caméléonesque. Il manie la contradiction sans complexe. En jouant sur tous les tableaux, il se rend insaisissable, ce qui explique que les protestations de la gauche le laissent indemne. Néanmoins, si on doit faire un bilan, on peut dire que le sarkozysme a probablement épuisé son capital initial et que s’il continue de faire illusion, c’est paradoxalement grâce à la crise, qui le prend à contre-pied, mais justifie, pour quelque temps encore, son activisme. L’essence du sarkozysme, c’est, sous le titre de la «réforme», l’idée que le moment est venu de banaliser la France, en économie, en diplomatie, dans l’éducation… C’est un programme de pasteurisation européo-libérale du pays, dont les deux armes principales sont d’une part la communication, que Nicolas Sarkozy manie en virtuose, et d’autre part la vitesse et l’emballement du rythme : réformes annoncées à jet continu pour déstabiliser les opposants, qui n’ont pas le temps de se mobiliser qu’on en est déjà à la réforme suivante ; multiplication des fronts pour brouiller les cartes, etc.
Cette formule serait en train de toucher à ses limites ?
J’en ai l’impression. D’une part, une bonne partie des prétendues réformes sont pour la galerie. Sarkozy sait marier comme personne l’intransigeance verbale et une gestion très chiraquienne des compromis. C’est un bonapartisme pour la télévision, où l’affichage de la volonté l’emporte sur la réalité. Ca ne marche qu’un temps et les limites de l’entreprise commencent à se voir. Ensuite, l’effet de surprise ne joue plus. La démarche se heurte à la résistance de l’exception française. Or celle-ci est solide. Elle repose sur une culture politique républicaine ancrée dans une vision très forte de l’histoire du pays. Sarkozy a eu tort de croire qu’il pouvait se contenter de concessions rhétoriques à ce noyau dur, avec les discours de Guaino. Il a sous-estimé la vitalité de ce cadre historique et mental. Aussi son action s’enlise-t-elle. Nous sommes en train de passer de la guerre de mouvement à la guerre de tranchées. La crise lui offre un répit qu’il a saisi avec son intelligence et sa souplesse habituelles. Elle fragilise son discours sur le fond, mais elle met en valeur son pragmatisme et son volontarisme, qui sont bien adaptés à la situation.
Les Français ne l’ont-ils pas élu justement pour ce programme de réformes ?
Les Français sont ambigus et contradictoires. Ils aspirent au changement car ils ont les réflexes d’une ancienne grande puissance qui ne veut pas abdiquer. Ils entendent rester dans le peloton de tête - de ce point de vue, le discours de Sarkozy a rencontré un écho profond dans la société. Mais ils veulent aussi rester ce qu’ils sont. Voilà pourquoi ils sont si réactifs dès qu’ils ont l’impression que l’on risque de toucher à ce qui constitue le cœur de l’expérience politique française. Dans le discours, Sarkozy a essayé de jouer sur les deux tableaux, en annonçant le changement tout en invoquant la France éternelle, de Jeanne d’Arc à Guy Môquet. Mais dans la pratique, ce grand écart s’est révélé intenable. L’histoire a disparu en route, au profit d’un changement souvent très ignorant des réalités françaises.
Le sarkozysme incarne-t-il une étape de la crise de la démocratie telle que vous l’analysez dans vos essais ?
Ce serait lui faire beaucoup d’honneur que d’y voir un phénomène historique significatif en lui-même. Le sarkozysme n’est qu’une conjoncture française, mais qui met néanmoins en lumière un élément sous-jacent de la crise de la démocratie : une volonté de pouvoir dont l’effet est une dévitalisation du pouvoir. Typique, par exemple, est la place démesurée donnée par le chef de l’Etat à la communication, comme si agir sur les images était transformer la réalité. Caractéristique, également, son impossibilité de faire le départ entre l’homme privé et sa fonction publique. Or une telle distinction, c’est l’âme même de la démocratie, où le pouvoir est dans les institutions, non dans les personnes. Chez Nicolas Sarkozy, la dimension institutionnelle est absente. L’autorité qui compte, à ses yeux, c’est la sienne, pas celle de l’Etat, dont il n’a pas le souci. Par ce trait, il incarne à merveille ce que j’appelle «la démocratie du privé», qui est un processus de désarticulation de la démocratie sous l’effet de l’individualisation et de la privatisation du monde.
L’idée que nous sommes passés d’une «démocratie du public» à une «démocratie du privé» est au cœur de votre réflexion actuelle. Qu’entendez-vous par là ?
Pour le dire abruptement, la question est de savoir si le collectif jouit d’une existence indépendante de celle des êtres qui le composent. Si oui, on peut lui donner une expression institutionnelle, une expression publique, distincte de l’expression privée des individus, qui ont par ailleurs voix au chapitre. Historiquement, c’est cette idée qui a longtemps prévalu. Elle a eu de beaux jours politiques, spécialement en France, où elle a constitué l’âme de l’Etat républicain. Dans ce cadre, les libertés individuelles sont supposées s’accomplir par la participation à la chose publique. Parallèlement, il est vrai, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis avaient développé des modèles plaçant l’accent davantage sur les libertés individuelles que sur la chose publique, sans ignorer le rôle de celle-ci. Mais depuis une trentaine d’années, cette tradition anglo-américaine s’est radicalisée et diffusée partout. La pente du monde est de remettre en question toutes les formes de collectivisation de l’existence politique, au nom de l’idée qu’il n’existe que les individus réels et leurs intérêts particuliers, et que c’est de leur interaction que doivent surgir les compromis acceptables pour tout le monde. C’est ce qu’on appelle le néolibéralisme. La chose publique, dans ce cadre, n’a plus de consistance par elle-même, elle n’est plus que l’instrument des demandes émanées de la sphère privée. Les institutions collectives sont discréditées, parce qu’elles sont toujours suspectes de ne pas prendre en compte les personnes concrètes. Sous couvert des mêmes règles, l’esprit du fonctionnement de la démocratie a complètement changé.
Néanmoins, la démocratie américaine se caractérise par des valeurs collectives très fortes : patriotisme et religion.
En effet. C’est, pour le coup, l’exception américaine : les Etats-Unis sont dotés d’une identité politique très forte et le pays où les libertés privées ont le plus de place. C’est fonction de la foi dans la «destinée manifeste» de l’Amérique et dans son rôle de puissance à l’échelle du monde. L’Etat-nation américain est projeté vers l’extérieur ; il n’organise pas la société à l’intérieur. C’est ce qui fait que la démocratie du privé coexiste avec une dimension publique axée sur le rayonnement des Etats-Unis. Les Européens, au contraire, ont abandonné toute politique de puissance et, dans leur démocratie sociale, le poids des institutions publiques est grand. Aussi chez eux l’irruption de la démocratie du privé est-elle très perturbatrice pour l’identité collective. Ils ne savent plus très bien où ils en sont. Autant, pour les Américains, la démocratie du privé se complète par un Etat tourné vers le dehors, autant, pour les Européens et en particulier pour les Français, elle se solde par l’incapacité d’assumer un héritage historique dont ils ne savent plus trop que faire, tout en y restant attachés.
La «démocratie du privé» s’accompagne d’une «oligarchisation» de la société, dites-vous, mais aussi d’une montée en puissance de la protestation. N’est-ce pas contradictoire ?
La démocratie du privé, ce n’est pas du tout le repli des gens dans leur foyer, le cocooning, la passivité : c’est l’alignement de chacun sur son intérêt d’individu et la légitimation absolue de celui-ci, donc de sa défense inconditionnelle. C’est dire que l’effervescence protestataire, la revendication et le contentieux sont garantis d’avance. Mais ces revendications campent sur leur particularité, en se plaçant à l’extérieur du politique. La protestation s’en remet en fait aux responsables et leur dit : «Voilà ce que nous voulons, débrouillez-vous pour trouver les moyens». Le mot-clé est résister. Mais si vous ne formulez pas de propositions, si vous ne prenez pas en charge le point de vue de l’ensemble où votre réclamation doit s’inscrire, ce sont les gouvernants qui le font pour vous. Le problème de cette formule, c’est qu’elle ne permet pas de remonter au collectif. Elle exige, mais délègue aux hommes politiques le soin de décider : ainsi, la protestation secrète naturellement l’oligarchisation. Du reste, le personnel politique s’accommode de la situation. Il a compris que si elle est parfois inconfortable, elle lui laisse les cartes bien en main. Le divorce entre le haut et le bas se creuse. Car les citoyens continuent dans le même temps d’aspirer à une grande politique. On a vu à l’occasion de la dernière élection présidentielle que leur attente était intacte. Les électeurs aspirent à une puissance du politique que toute leur pratique au quotidien a pour effet de rendre impossible. D’où le sentiment général d’une dépossession incompréhensible.
Comment s’en sort-on ?
D’une part, il ne faut pas sous-estimer la prise de conscience par les individus des contradictions et de l’impasse dans laquelle ils sont. Les gens ne sont pas stupides, ils voient bien que quelque chose coince. Car cette équation impossible, on la trouve à tous les niveaux : dans la famille, à l’école, dans l’entreprise. L’évolution du syndicalisme, par exemple, est significative. Mais ce mouvement des mentalités ne suffit pas à faire bouger les choses à lui seul. C’est la rencontre avec les circonstances historiques qui précipite le changement, dans les moments de choix qui font apparaître la nécessité de reprendre en compte le collectif. En la matière, nous avons tout ce qu’il nous faut sous la main : la crise financière, le défi écologique, le blocage européen, le déséquilibre des systèmes sociaux. L’art du politique, c’est de conjuguer ces deux forces.
La crise financière est-elle un autre symptôme de la «démocratie du privé» ?
Elle est le symptôme économique de la dérive politique entraînée par la confiance illusoire dans l’autorégulation des intérêts individuels. Elle fait apparaître la vacuité de ce rêve d’agrégation automatique. La vérité est qu’un monde mondialisé a plus besoin que tout autre d’une organisation. Savoir laquelle va nécessiter du temps, mais tel est le but qu’il faut se fixer et c’est dans une telle optique qu’on peut par exemple parler de protection économique.
Est-ce le nouveau rôle historique de la gauche ?
Autant je ne vois pas de raison de désespérer à long terme, autant je suis obligé de constater, en ce qui concerne la France actuelle, que nous sommes au plus bas. Nous payons le prix du mitterrandisme, qui a été le visage sous lequel la France a défini pour longtemps son attitude face à ce changement de cap du monde. Elle a commencé par le refuser, sous Giscard. Puis, dans les années 80, tandis que le Royaume-Uni avait élu Thatcher et les Etats-Unis Reagan, est arrivé Mitterrand, qui a installé une culture de la dénégation, consistant à s’adapter à la nouvelle donne, mais sans le dire. Les socialistes français en sont toujours là : ils ont la particularité d’être à la fois très rigides doctrinalement et très cyniques en pratique. A leur décharge, il faut dire que Mitterrand avait cru trouver une échappatoire en jouant l’Europe : puisque le modèle français était condamné, il a voulu construire à un échelon européen une nouvelle synthèse du libéralisme et de l’Etat fort. Faire une Europe française, en somme. Dans les années 80, le projet européen a été le grand espoir de la société française. Mais il se trouve que le projet a échoué : l’Europe telle qu’elle s’est développée n’est pas française, on peut même dire qu’elle est anti-française, tout simplement parce qu’elle reflète la réalité d’un monde qui va spontanément à rebours de notre héritage historique. Le désenchantement qui s’en est suivi vis-à-vis de l’Europe a été spectaculaire. Depuis, personne n’a fait l’effort de reprendre le problème à la racine. Jospin, qui semblait l’avoir compris, n’a pas osé. Ségolène Royal est passée à côté. La panne est complète.
Les deux grands courants concurrents du PS - le pôle écologiste et libertaire et la gauche radicale - vous semblent-ils porteurs de promesses ?
Non, pas la moindre, hélas ! La gauche radicale est une rémanence de notre histoire. C’est la Révolution française qui revient, par-delà le communisme. Besancenot nous propose un néo-hébertisme et Badiou nous réinvente Babeuf et sa Conjuration des Egaux. Tout cela bouillonne, exprime des choses profondes, mais n’offre guère de perspectives opératoires. Quant à la liste commune Cohn-Bendit-José Bové, la contradiction de la nouvelle démocratie individualiste du privé y atteint son sommet. Il n’y a vraiment que sur le papier que le souci écologique et la radicalisation des droits personnels collent ensemble !
Critiquer les droits de l’homme, n’est-ce pas encourager des formes politiques autoritaires ?
Je ne critique pas les droits de l’homme, je critique l’usage qu’on en fait, ce qui est fort différent. Ils sont indiscutables dans leur ordre, mais ne fournissent en rien une réponse générale, immédiate et totale aux questions qui nous sont posées. Ils établissent la base de légitimité du pouvoir dans nos sociétés ; ils énoncent ce qu’on ne doit en aucun cas violer et ce vers quoi nos sociétés doivent tendre, en tant que sociétés d’individus. Mais en aucun cas ils ne définissent le système politique ou l’organisation sociale qui permettront d’assurer leur développement. Les droits de l’homme sont le fondement et le but, pas le moyen. Ils ne nous dispensent pas, comme l’illusion du moment le fait croire, de réfléchir sur l’ordre politique et sur le fonctionnement de la société en tant que tels. Si l’idée de socialisme doit retrouver un sens vivant, c’est du côté de cette conjonction qu’il faut le chercher.
Recueilli par ÉRIC AESCHIMANN et LAURENT JOFFRIN
00:30 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, théorie politique, sociologie, philosophie, démocratie, droits de l'homme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



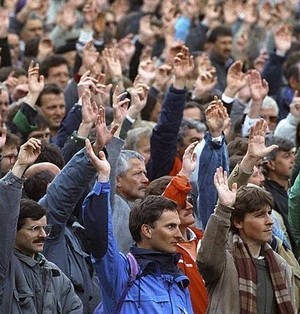 Ex:
Ex: 
 BERN. Die von der Schweizer Volkspartei (SVP) getragene
BERN. Die von der Schweizer Volkspartei (SVP) getragene