
La Turquie, alliée de toujours des Etats-Unis et nouveau challenger
Ex: http://mbm.hautetfort.com/
* Spécialiste des politiques européennes en Méditerranée et au Moyen-Orient, est actuellement responsable du programme « Turquie contemporaine » à l’Ifri. Ses travaux portent sur les développements de la politique interne en Turquie et sur les nouvelles ambitions diplomatiques turques
Membre de l’OTAN depuis 1952, la Turquie est un allié traditionnel des États-Unis, malgré des désaccords sur des dossiers comme Chypre ou l’Irak. Depuis la fin de la guerre froide, et particulièrement après l’arrivée de l’AKP au pouvoir, les relations entre les deux pays se sont toutefois tendues. Il va désormais falloir trouver un équilibre entre le besoin de reconnaissance d’une Turquie toujours plus ambitieuse à l’échelle régionale et les impératifs de sécurité américains.
Dans le cadre de ses synergies géopolitiques, le Diploweb.com est heureux de vous présenter cet article de Dorothée Schmid publié sous ce même titre dans le n°3:2011 de la revue Politique étrangère (Ifri), pp. 587-599.
L’INTENSE activité de la diplomatie turque, particulièrement au Moyen-Orient, embarrasse depuis quelques années plus d’une puissance établie. Si les Français s’inquiètent de la présence croissante des Turcs sur leurs terrains d’influence arabes, les États-Unis éprouvent quelque difficulté à s’accommoder des ambitions retrouvées d’un allié qui leur fut toujours précieux, mais également de la volatilité nouvelle de ses positions.
Ankara avait en effet habitué Washington à plus de retenue et de régularité. Ayant intégré dès 1952 la communauté disciplinée de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) comme puissance régionale d’appui, elle y rendait aux États-Unis des services intermittents mais rarement négociables, en échange d’un rattachement souple à la sphère de protection américaine. Pilier oriental de l’Alliance, la Turquie assurait la surveillance de sa frontière sud-est, Washington ne se permettant que rarement de commenter les accidents politiques intérieurs turcs, entre coups d’État à répétition et répression des minorités.
Ce gentlemen’s agreement stratégique a duré près de 40 ans, malgré quelques désaccords importants sur Chypre ou l’Irak. Mais la fin de la guerre froide et le 11 septembre 2001 ont créé les conditions de l’émancipation de la diplomatie d’Ankara, au moment même où son rôle central se confirmait au Moyen-Orient. Assumant d’une manière différente sa vocation de pays pivot, la Turquie entame alors une reconversion imprévue : longtemps plate-forme avancée de l’Occident au Moyen-Orient, elle se pose depuis quelques années en porte-parole auprès de l’Occident d’un monde arabo-musulman qui n’en finit pas de se décomposer et de se recomposer, et échappe de plus en plus à la maîtrise de Washington. L’équation stratégique américaine doit intégrer cette échappée orientale, avec des incertitudes majeures : il est en effet encore difficile d’évaluer si la Turquie a les moyens de ses ambitions dans la région et jusqu’à quel point ses intérêts y divergent de ceux des États-Unis.
Une Turquie toujours centrale
L’histoire et la géographie ont assigné à la Turquie une fonction centrale dans le système de la guerre froide : république laïque façonnée par Mustafa Kemal Atatürk sur le modèle des États-nations européens, elle est la sentinelle de l’Occident à sa frontière orientale. Cette fonction de rempart reste essentielle dans le calcul stratégique américain, mais évolue et se complexifie avec le temps.
Les fonctions géopolitiques d’un pays pivot
Les fondements du rapport turco-américain sont d’ordre sécuritaire. La situation géographique de la Turquie définit son importance dans la perception stratégique des États-Unis : le pays est au carrefour de deux continents et de plusieurs zones d’influence historique – russe, iranienne, etc. ; le Bosphore et les Dardanelles sont des verrous ; les principales routes énergétiques désenclavant les ressources de la Caspienne et du Moyen-Orient passent par le territoire turc ; et les sources du Tigre et de l’Euphrate se situent également en Turquie, ce qui en fait le château d’eau du Moyen-Orient. Fardeaux ou atouts, ces éléments offrent à la Turquie un choix de positionnement stratégique : elle peut être frontière, ou intermédiaire. Les décideurs américains tentent, depuis la fin du XXe siècle, de jouer sur ces deux vocations, selon leurs propres objectifs dans la région. La Turquie est pour eux un pays pivot, à même d’articuler des ensembles géopolitiques indépendants, mais aussi vulnérable car exposé, dans une région parcourue de tensions [1]. Le contrôle de la charnière turque est essentiel pour maîtriser la problématique moyen-orientale, en bonne harmonie avec l’ensemble européen. Pendant toute la guerre froide, la Turquie a été le poste avancé de surveillance de l’Occident à l’est, face à l’ennemi soviétique ; dans la décennie qui suit la chute du Mur, elle a été pensée comme bouclier contre l’islam radical.
La Turquie n’était donc pas, jusqu’à l’ouverture de l’ère AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi, Parti de la justice et du développement, d’origine islamiste, actuellement au pouvoir) en 2002, un enjeu stratégique en elle-même, mais bien un partenaire pour les dossiers géopolitiques régionaux. La relation bilatérale turco-américaine est fondée sur des intérêts stratégiques partagés, le niveau des relations économiques est faible, le dialogue politique existe, mais apparaît, jusqu’à une période récente, dénué de relief et de complicité. Cependant, Washington sait que la fonction d’intermédiaire géopolitique assignée à la Turquie est fragile et craint aujourd’hui plus que jamais que l’allié ne passe dans l’autre camp. Ancrer la Turquie à l’ouest est donc le premier objectif poursuivi par toutes les Administrations américaines depuis les années 1940. Cela passe, dans un premier temps, par le bénéfice du plan Marshall et par l’intégration à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – alors que la Turquie n’est pas entrée dans la Seconde Guerre mondiale ; par son admission à l’OTAN en 1952, en même temps que la Grèce, pour participer à la guerre de Corée ; puis par le lobbying en faveur du rapprochement de la Turquie avec la Communauté économique européenne (CEE) puis de son adhésion à l’Union européenne (UE). Les États-Unis entérinent ainsi sans état d’âme la double appartenance géographique et identitaire de la Turquie, contrairement à une Europe qui doute encore de ses frontières et dont l’imaginaire collectif reste marqué par des a priori négatifs, héritages des « turqueries » d’un Empire ottoman autrefois menaçant [2].
Un allié traditionnellement remuant
Partenaire stratégique, allié, mais pas forcément ami : c’est ainsi que la Turquie elle-même perçoit les États-Unis, une grande partie de l’opinion turque cultivant un antiaméricanisme de principe qui s’exprime par crises face aux grands événements internationaux. Les sondages d’opinion le démontrent : le sentiment antiaméricain se renforce étonnamment en Turquie au fil des décennies, nourri d’incidents objectifs et de représentations fantasmées, qui heurtent le nationalisme turc [3]. Imprégnées de culture politique européenne, voire française, les élites kémalistes traditionnelles n’ont jamais considéré les États-Unis comme un modèle de société ou d’organisation politique [4]. Ce sentiment antiaméricain est partagé par la gauche turque, sur fond d’anti-impérialisme, et par une bonne partie de l’armée et de la classe politique, qui se sentent négligées par Washington et lui prêtent régulièrement des intentions malveillantes à l’égard de la Turquie ; nombre de théories du complot circulent ainsi, attribuant la paternité des coups d’États militaires successifs à l’intervention occulte des Américains [5].
Seul le président Turgut Özal a fait preuve, dans la classe politique turque, d’une américanophilie réelle, coïncidant dans le temps, heureusement pour Washington, avec la première guerre du Golfe. Cette méfiance traditionnelle vis-à-vis des États-Unis se résorbe cependant en partie depuis l’arrivée de l’AKP aux affaires, ce dernier s’appuyant davantage sur de nouvelles élites anglophones, que leurs origines anatoliennes n’empêchent pas d’être plus en phase avec la mondialisation, et qui prisent surtout le modèle américain de liberté religieuse.
En pratique, la relation stratégique turco-américaine n’a jamais fonctionné de façon impeccable au-delà des années 1950. La Turquie est restée un allié compliqué et les accrocs n’ont pas manqué. La substance de la relation étant d’ordre sécuritaire, l’Administration américaine a longtemps fermé les yeux sur les petits accommodements de la Turquie avec la doxa démocratique occidentale. Les épisodes de confrontation sont en revanche réguliers dans le cadre de l’OTAN. Les Turcs ont ainsi gardé le souvenir très vif de plusieurs désaccords historiques où la puissance américaine a imposé ses vues contre les priorités nationales turques, d’où une amertume persistante. Les États-Unis se sont opposés à la Turquie sur la question chypriote en 1964 et en 1974, décrétant à l’époque un embargo sur les armes à destination de la Turquie ; dans les années 1980, l’aide militaire à la Turquie sera calibrée sur celle accordée à la Grèce, avec un ratio de sept pour dix. Mais les difficultés s’accumulent surtout du côté de l’Irak, où la préférence américaine pour les Kurdes inspire aux Turcs un malaise persistant. Fin 1991, une no-fly zone est établie dans le nord de l’Irak par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni pour protéger les insurgés kurdes irakiens de la vengeance programmée de Saddam Hussein. Les Turcs se résolvent à contrecœur aux opérations Provide Comfort et Poised Hammer, mises en œuvre à partir de la base d’Incirlik, construite près d’Adana, au sud de la Turquie, aux premiers temps de la guerre froide. Les Turcs acceptent également les sanctions prévues contre l’Irak, malgré la perte économique manifeste que cela implique pour eux. Ils assistent surtout à partir de ce moment-là avec inquiétude à l’autonomisation progressive du Kurdistan irakien, où la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), active en Turquie depuis 1984, commence à installer ses bases. L’ensemble de ces concessions marque durablement les esprits, et explique bien des réactions turques pour la suite de l’histoire irakienne.
1991-2001 : la décennie du basculement
La Turquie a pu craindre d’être marginalisée par la fin de la guerre froide ; elle s’est au contraire trouvée libérée d’une partie de ses obligations anciennes, tout en gagnant la possibilité de jouer d’autres rôles. La décennie 1991-2001, qui s’ouvre avec la première guerre du Golfe et s’achève avec le 11 septembre, apparaît ainsi a posteriori comme la décennie du basculement de la relation turco-américaine. Pour des raisons tenant à la fois aux circonstances régionales et à la trajectoire nationale des deux partenaires, l’équilibre des forces, traditionnellement très favorable aux Américains, bascule insensiblement du côté de la Turquie.
Dès les années 1990, l’alliance turco-américaine se consolide en se diversifiant ; la Turquie devient un partenaire multifonctions, pouvant contribuer à la résolution de bon nombre des difficultés diffuses posées par un système international instable. Elle est ainsi pleinement intégrée à l’équation de stabilisation de l’Europe balkanique et participe aux forces de maintien de la paix en Bosnie, au Kosovo, en Macédoine. Mais c’est le 11 septembre 2001 et ses suites qui la poussent au devant de la scène, en faisant un protagoniste essentiel des plans de Washington au Moyen-Orient. Les États-Unis considèrent à l’époque qu’une Turquie laïque, encore largement sous l’emprise des militaires, peut servir de digue contre la vague islamiste. Ce schéma de défense se double après le 11 septembre du fantasme d’une Turquie modèle politique, incarnant la démocratie musulmane avancée que l’Administration américaine rêve de répandre au Moyen-Orient.
L’impact du 11 septembre sur la Turquie est cependant ambigu. Traditionnellement en quête de réassurance identitaire, elle se trouve à l’époque mise en scène comme pays de l’entre-deux par des décideurs occidentaux devenus huntingtoniens, dans un monde découpé en zones antagonistes. Pensée comme « pont » entre les civilisations, ou comme instrument du dialogue avec un monde musulman hostile aux États-Unis, elle prépare dès ce moment sa reconversion et le réveil de sa vocation orientale assoupie.
Le pacte imprécis : la dérive de la relation turco-américaine
La relation turco-américaine traverse manifestement aujourd’hui une phase de réajustement houleux. Depuis le déclenchement de la seconde guerre du Golfe, accidents, désaccords et mésententes s’accumulent entre la première puissance mondiale et l’aspirant challenger qui a fait du Moyen-Orient le laboratoire de son renouveau économique et diplomatique. Cette dérive inquiète Washington, tandis qu’elle semble nourrir une forme d’exaltation à Ankara : la Turquie a cessé d’être un faire-valoir et fait comprendre qu’elle travaille désormais avant tout pour son propre compte.
La crise de 2003, tournant ou révélateur ?
La première crise de confiance significative entre les deux alliés a lieu le 1er mars 2003. Elle prend tout le monde par surprise et laisse le champ libre à des interprétations multiples. Ce jour-là, la Grande Assemblée nationale turque refuse le passage et le stationnement en Turquie de 62 000 militaires américains en route vers l’Irak. Les leaders de l’AKP, qui disposent pourtant d’une solide assise au Parlement, n’ont pas réussi à réunir la majorité absolue des voix ; la discipline de parti n’a vraisemblablement pas été strictement respectée, face à une opinion publique turque massivement opposée à la guerre en Irak. Le lendemain, le chef d’état-major de l’armée turque affirme pourtant qu’il apporte son soutien à l’opération américaine. Le secrétaire d’État américain adjoint à la Défense Paul Wolfowitz qualifie la prise de position turque de « grosse erreur », et les États-Unis agitent des menaces de rétorsion financière [6].
La crise est progressivement surmontée. La Turquie rejoint la coalition du côté des pays fournissant un appui logistique aux opérations, et obtiendra une compensation pour services rendus. Depuis 2003, la moitié des avions cargos militaires à destination de l’Irak sont bien partis de la base d’Incirlik. Mais le vote de 2003, qui a définitivement remis en cause la fiction d’un soutien turc automatique aux décisions de Washington, concentre toute la complexité d’un rapport empoisonné par le ressentiment turc. Pour compenser les brimades subies depuis 1991 sur le dossier kurdistanais, les Turcs ont donné libre cours à leurs divergences internes, et l’anarchie chronique de leur système de décision, que les Américains rebaptisent traditionnellement « instabilité », a accouché d’un blocage. La Turquie a infligé aux États-Unis un traumatisme majeur : elle cesse dès ce moment d’être considérée comme un allié fiable. La relation turco-américaine s’intensifie cependant, car les difficultés bilatérales impliquent de multiplier les consultations, mais tout se joue désormais sur le mode du rapport de forces. Les deux États entrent dans un système de marchandage permanent. La question irakienne devient le baromètre de la relation pendant quelques années de tâtonnements, désaccords et accusations mutuelles de traîtrise – les Turcs accusent les Américains de soutenir le PKK et mènent des opérations au Kurdistan irakien pour y traquer la guérilla, tandis que les Américains soupçonnent les Turcs de faciliter le passage d’Al-Qaida. Tout s’apaise progressivement à partir de 2008 : l’Irak devient le lieu privilégié du redéploiement de la puissance turque, au point qu’elle s’y impose comme relais politique naturel au moment du retrait américain.
Le modèle politique turc, entre « islam modéré » et « islamisme »
Un nouveau paramètre essentiel entre maintenant en jeu pour façonner la perception américaine de la Turquie. Celle-ci est gouvernée depuis 2002 par un parti d’origine islamiste, très préoccupé cependant durant ses premières années tests de démontrer son attachement à la modernité occidentale. L’AKP, que sa sociologie rend plus américanophile que les élites turques classiques, devrait en principe être l’ami de Washington ; il semble a priori être le candidat idéal pour incarner le fantasme américain d’un « islam modéré », ennemi de l’islam radical djihadiste que Washington combat ouvertement depuis le 11 septembre.
La place et l’influence réelle des islamistes dans le système politique turc ont pourtant toujours préoccupé les Américains, et l’État ami musulman a déjà failli basculer du mauvais côté en un moment de l’histoire récente. Parvenu au pouvoir en 1996 grâce à l’une de ces péripéties électorales dont la Turquie est coutumière, Necmettin Erbakan, le leader du Refah Partisi (Parti de la prospérité), parti islamiste ancêtre de l’AKP, s’était rapidement embarqué dans une surenchère islamique en interne comme en politique étrangère. Lorsque l’armée turque le persuada, moins d’un an plus tard, de démissionner, Washington se contenta d’affirmer à la fois son attachement au sécularisme et à la démocratie – deux préférences malaisément démontrables par un coup d’État militaire, fût-il qualifié par les analystes de soft, en comparaison de ceux qui avaient rythmé les décennies précédentes [7].
L’installation de l’AKP aux affaires ouvre une autre période ambiguë. Lorsque ce parti néo-islamiste, qui se décrit volontiers comme « musulman démocrate », à l’instar des démocrates chrétiens européens, gagne largement les élections de 2002 et se retrouve au Parlement en tête-à-tête avec les sécularistes du vieux parti kémaliste, le Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), beaucoup d’observateurs craignent une islamisation rapide de la Turquie. Quelques années plus tard, et malgré les gages d’ouverture donnés par l’AKP sur certains dossiers intérieurs qui s’avèrent fondamentaux au moins pour faire avancer le processus d’adhésion à l’UE (droits des Kurdes, place de l’armée dans le jeu politique, etc.), le soupçon d’un « agenda caché » islamique demeure [8].
Le contenu des télégrammes diplomatiques américains récemment révélés par WikiLeaks en dit long sur le malaise américain face à l’expérience AKP. On y lit des descriptions peu flatteuses du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, que l’ambassade américaine à Ankara perçoit comme un fondamentaliste islamique peu cultivé et peu ouvert, obsédé par le pouvoir et développant une tendance à l’autocratie, évoluant de surcroît dans un milieu très corrompu. L’appartenance d’une partie de son entourage à une confrérie islamique dérange les diplomates américains, de même que ses largesses envers des banquiers islamistes et son obstination à ne s’informer que par des journaux islamistes. En bref, le biais religieux imprègne les analyses des décideurs américains, également très inquiets de la montée de l’antisémitisme en Turquie [9].
L’échappée orientale de la diplomatie turque
Si l’évolution du paysage politique turc intéresse désormais plus sérieusement l’Amérique, c’est qu’elle a un impact évident sur les choix de politique étrangère du pays. L’activité diplomatique incessante et tous azimuts de la Turquie fascine beaucoup d’observateurs : puissance montante incontestée dans son environnement régional, elle s’impose sur de nombreux dossiers qui intéressent les États-Unis. À leur arrivée aux affaires, les cadres dirigeants de l’AKP n’avaient, à l’exception du président Abdullah Gül, qu’une faible expérience de l’international. Une décennie plus tard, le bilan diplomatique de l’équipe est impressionnant, mais les nouvelles options turques au Moyen-Orient sont une source régulière d’inquiétude pour Washington.
La politique étrangère turque est menée tambour battant depuis presque trois ans par le ministre Ahmet Davutoglu, ancien universitaire ayant développé une vision originale et turco-centrée du système international. Si ses premiers écrits le rattachent clairement à une généalogie islamiste, sa rhétorique actuelle insiste sur la portée du soft power et met en scène la Turquie comme une puissance bienveillante, acteur majeur dans son environnement régional immédiat mais désireuse d’intervenir bien au-delà [10]. Le Moyen-Orient est devenu le laboratoire d’action privilégié de ce ministre atypique, dont les ambitions ont rapidement été décrites aux États-Unis comme « néo-ottomanes », car se déployant dans les anciens espaces d’influence de l’Empire [11].
La présence turque au Moyen-Orient se renforce de plusieurs façons et embarrasse les États-Unis pour diverses raisons. Pour concrétiser son ambition de soft power, Ankara signe des accords de libre-échange et de libre circulation avec plusieurs pays arabes, dont la Libye et la Syrie, et se confirme comme acteur économique de premier plan sur des terrains encore difficilement praticables pour les entreprises occidentales, comme l’Irak. Sa diplomatie de médiation cherche à se rendre indispensable dans toutes les configurations de conflit : elle intervient comme médiateur entre la Syrie et Israël en 2008, s’interpose régulièrement entre les factions palestiniennes rivales du Fatah et du Hamas, ou entre les parties libyennes après mars 2011 ; défendant le principe d’une solution politique sur le dossier du nucléaire iranien, elle tente, en tandem avec le Brésil, de retarder l’adoption de nouvelles sanctions internationales contre Téhéran. Sa capacité à gérer des relations parallèles avec les différents centres de pouvoir en Irak, de Bagdad au gouvernement régional kurdistanais, tout en défendant les intérêts de la minorité turkmène, montre aussi que la Turquie sait organiser son influence dans le jeu politique interne de ses voisins quand ses intérêts vitaux (énergétiques, mais aussi politiques dans le cas des Kurdes) sont en jeu. La brouille est en revanche consommée avec Israël après l’épisode du Mavi Marmara au printemps 2010 ; la mort de neuf militants turcs lors de l’assaut des forces spéciales israéliennes contre le navire qui tente de forcer le blocus de Gaza propulse la Turquie comme héraut de la cause palestinienne.
Toutes ces avancées confortent le désir d’indépendance de la Turquie et lui permettent de marchander sa coopération avec les États-Unis sur des dossiers essentiels. Si elle s’est immédiatement jointe à la coalition en Afghanistan en 2001, elle s’y met en scène comme seul membre musulman de l’Alliance, n’y a pas envoyé de troupes combattantes et refuse d’y renforcer ses effectifs quand les États-Unis le lui demandent. Son positionnement dans l’OTAN apparaît d’ailleurs de plus en plus décalé. Au printemps 2009, la crise de la nomination du secrétaire général – Ankara bloquant dans un premier temps la candidature de Anders Fogh Rasmussen, l’ancien Premier ministre danois ayant soutenu en 2005 le quotidien Jyllands Posten dans l’affaire des caricatures de Mahomet –, a marqué le début d’une série de coups d’éclat destinés à valoriser son statut d’allié à part. Au sommet de Lisbonne de décembre 2010, la Turquie se rallie au projet de bouclier antimissile, mais obtient que l’OTAN ne désigne pas nommément l’Iran comme menace. Lors de la crise libyenne, la Turquie commence par s’opposer à l’intervention alliée, avant de rentrer tardivement dans le rang. Toutes ces manifestations d’autonomie incitent certains à prédire un possible retrait turc de l’OTAN ; par le passé, des analystes américains ont déjà pu suggérer que le pays n’y avait plus sa place [12]. C’est en tout cas dans cette enceinte multilatérale que se cristallisent le plus violemment les désaccords turco-américains, mais c’est aussi là, désormais, que se redéfinit en permanence le sens de la relation.
Le contenu précis des ambitions turques au Moyen-Orient est difficile à mesurer, de même que la capacité du pays à tenir ces ambitions dans un environnement qui se dégrade chaque jour, mais la rhétorique officielle reste impressionnante. Au soir de son nouveau triomphe électoral du 12 juin 2011, le Premier ministre Erdogan a ainsi prononcé à Ankara un « discours du balcon » illustrant la dimension identitaire de sa nouvelle politique étrangère et le désir de leadership des Turcs dans la région [13]. Dans un élan inédit remarqué des observateurs turcs et internationaux, le Premier ministre turc y affirmait que le résultat des élections turques était salué « à Bagdad, à Damas, à Beyrouth, à Amman, au Caire, à Tunis, à Sarajevo, à Skopje, à Bakou, à Nicosie », citant aussi Ramallah, Naplouse, Jénine, Jérusalem et Gaza, avant de parler de « victoire de la démocratie, de la liberté, de la paix, de la justice et de la stabilité ».
Un effacement américain programmé : quelles responsabilités pour la Turquie au Moyen-Orient ?
Cette confiance retrouvée de la Turquie dans son destin oriental ne devrait pas forcément inquiéter une Amérique qui peine de plus en plus à mettre seule de l’ordre dans la région. La Turquie étant maintenant en position de négocier sa contribution, il faut comprendre si elle est prête à jouer le rôle de puissance d’appui pour accompagner le retrait américain du Moyen-Orient, ou si elle souhaite s’imposer comme une puissance alternative, défendant une vision du monde différente.
S’accommoder de la nouvelle Turquie
L’émancipation rapide de l’allié jusqu’ici docile rend évidemment les calculs américains beaucoup plus complexes que par le passé. C’est, au fond, la réussite turque au sens large qui nourrit le dilemme américain. Washington a longtemps considéré que le pays était doté d’un fort potentiel économique et diplomatique, tout en notant que ses difficultés intérieures l’empêchaient de valoriser ce potentiel. Morton Abramowitz, ancien ambassadeur américain en Turquie sous l’ère Özal et conseiller de Bill Clinton, reprenait en 2000 l’éternelle interrogation américaine – quand ce pays tellement doté allait-il enfin décoller ? –, soulignant que la Turquie était encore plombée par sa dette extérieure, son instabilité politique et ses blocages identitaires, otage d’une classe politique corrompue et enfoncée dans le sous-développement [14]. Dix ans plus tard, l’étoile montante turque, libérée de bien des contraintes et de la plupart de ses tabous, affiche une baraka exceptionnelle et pose finalement bien plus de problèmes à l’ami américain.
Le diagnostic qui s’impose, au vu des accrocs de plus en plus fréquents entre les deux partenaires, est que les États-Unis et la Turquie sont entrés dans une zone de négociation continue afin de trouver un nouvel équilibre qui satisfasse à la fois le besoin de reconnaissance turc et les impératifs de sécurité américains. En dépit de son caractère moins stable, la relation turco-américaine n’a rien perdu de sa qualité stratégique ni de sa portée globale, même si elle se recompose autour de chaque dossier commun. La Turquie ne peut en effet être tenue à l’écart d’aucun des dossiers essentiels sur lesquels les États-Unis sont impliqués au Moyen-Orient. Depuis 30 ans, de l’Irak à l’Afghanistan, elle a aussi démontré qu’elle est un partenaire indispensable pour faire face aux crises imprévues [15]. Lorsque les objectifs concordent, elle demeure un auxiliaire ponctuel indispensable aux États-Unis. De son côté, Ankara ne peut évidemment pas davantage tourner le dos aux États-Unis, car elle ne peut assumer seule des fardeaux stratégiques multiples et dépend beaucoup de l’industrie américaine en matière d’armement [16]. Plus qu’en challenger, elle souhaite s’imposer comme partenaire à égalité.
La relation n’a donc rien perdu de son importance, mais elle a perdu ses automatismes. Rien ne coïncide plus de façon spontanée, en termes de besoins, d’intérêts et de priorités : la fin de l’alignement est/ouest et la diversification du portefeuille diplomatique turc ont introduit de nombreux décalages, que les deux partenaires doivent apprendre à gérer aussi bien que leurs convergences. La conduite de la relation requiert donc désormais une ingénierie humaine et technique exigeante. L’Administration américaine a pris acte de la volatilité nouvelle des Turcs et de leur désir d’être réévalués comme alliés, et se montre prête à mobiliser des compétences et du temps. Les canaux de communication entre les deux pays sont aujourd’hui très nombreux et actifs. Washington a beaucoup élargi son spectre d’interlocuteurs au-delà de l’armée et a appris à prendre au sérieux la classe politique et certains piliers de la société civile turque, comme les multiples think tanks nés ces dernières années. Les visites d’officiels américains se succèdent en Turquie, du président Obama à Hillary Clinton, en passant par le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), Leon Panetta, ou les délégations de parlementaires américains – qui doivent gérer, à leur niveau, un autre point de désaccord potentiel, autour de la question de la reconnaissance du génocide arménien.
Des dilemmes aux responsabilités partagées : une Turquie relais ?
La principale inquiétude concerne finalement les velléités des Turcs de promouvoir un nouvel ordre international allant à l’encontre des intérêts et des valeurs américains. De ce point de vue, la prétention des Turcs à s’ériger en porte-parole du monde musulman, ou à défendre la place des pays émergents dans le système de gouvernance mondial (notamment via le G20), ébranle régulièrement le cadre de discussion bilatéral. Son crédit étant notoirement affaibli au Moyen-Orient dans ce qui est aujourd’hui le périmètre d’influence des Turcs, Washington est évidemment contraint de prendre en compte les messages que la Turquie y diffuse. Le rôle majeur de la Turquie face à l’Iran dans le contexte irakien et sa capacité de médiation en Afghanistan sont des éléments essentiels dans l’équation de stabilisation régionale. S’il ne leur est pas toujours possible de travailler ensemble, la base d’une bonne entente doit en tout cas être maintenue, car la Turquie pourrait servir de relais modérateur sur tous ces terrains [17].
La diplomatie turque semble elle-même au bord d’un syndrome d’overstretch à l’américaine. Présente et active sur tous les terrains à sa portée, du Caucase aux Balkans, elle peine à maintenir sa cohérence et ne déploie pas une vision politique claire. À ce titre, la crise du printemps arabe constitue un test à grande échelle de la capacité des Turcs à assumer leurs responsabilités nouvelles de puissance. La Turquie est apparue absente face aux événements tunisiens, assez distante face à la révolution égyptienne, exagérément hésitante sur les dossiers libyen et syrien. Il est donc trop tôt pour dire si les essais diplomatiques en cours ouvrent des perspectives nouvelles au service d’une stabilité régionale mise à mal par l’expérience néoconservatrice. Les avancées turques au Moyen-Orient semblent encore souvent dictées par un désir de revanche sur l’histoire : reste à définir un projet viable pour l’avenir.
Copyright 2011-Schmid/Politique étrangère
Plus :
La revue Politique étrangère

Politique étrangère est une revue trimestrielle de débats et d’analyses sur les grandes questions internationales. Elle est la plus ancienne revue française dans ce domaine. Son premier numéro est paru en 1936, sous l’égide du Centre d’études de politique étrangère. Depuis 1979, elle est publiée par l’Ifri.
Son ambition est de mettre en lumière l’ensemble des éléments du débat en matière de relations internationales, de proposer des analyses approfondies de l’actualité et d’être un instrument de référence sur le long terme pour les milieux académiques, les décideurs et la société civile. Chaque numéro comporte au moins deux dossiers concernant un événement ou une dimension du débat international, ainsi que plusieurs articles s’attachant à décrypter les questions d’actualité.
Politique étrangère consacre en outre une large place à l’actualité des publications françaises et étrangères en matière de relations internationales.
Formulaire d’abonnement à Politique étrangère (Pdf)

[1] Cette notion de géopolitique classique est régulièrement appliquée à la Turquie par les stratèges américains ; voir l’analyse de P. Marchesin, « Géopolitique de la Turquie à partir du Grand échiquier de Zbignew Brzezinski », Études internationales, vol. 33, n° 1, 2002, p. 137-157. Le concept d’une Turquie pivot est régulièrement développé dans des ouvrages publiés aux États-Unis après le 11 septembre 2001 ; cf. S. Larrabee et I. O. Lesser, Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty, Santa Monica, CA, Rand, 2003.
[2] Z. Önis et S. Yilmaz, « The Turkey-EU-US Triangle in Perspective : Transformation or Continuity ? », The Middle East Journal, vol. 59, n° 2, 2005.
[3] Pour une analyse sur plusieurs années des données du Pew Research, voir S. Cagaptay, « Persistent Anti-Americanism in Turkey », Soner’s Desk, 10 janvier 2010, disponible à l’adresse suivante :. On y suit l’impressionnante plongée américaine post-11 septembre, jusqu’à 14 % seulement d’opinions favorables après l’élection de Barack Obama.
[4] « La République : visions franco-turques », interview réalisée par Dorothée Schmid avec Baskin Oran, Paris, Ifri, « Note franco-turque », n° 6, mai 2011.
[5] Ce contexte psychologique très tendu est finement analysé sur plusieurs décennies par C. Candar, « Some Turkish Perspectives on the United States and American Policy Toward Turkey », in M. Abramowitz, Turkey’s Transformation and American Policy, New York, Century Foundation Press, 2000, p. 128. Pour une actualisation du malaise turc après la crise de 2003, voir H. Bozarslan, « L’anti-américanisme en Turquie », Le Banquet, vol. 2, n° 21, 2004, p. 61-72.
[6] « Wolfowitz Says Turkey Made “Big, Big Mistake” In Denying Use of Land », The Turkish Times, avril 2003, n° 317.
[7] S. Arsever, « L’adieu turc à l’ami des Frères musulmans », Letemps.ch, 1er mars 2011.
[8] Mentionnant expressément ce danger, un éditorial récent de la presse anglo-saxonne a fait couler beaucoup d’encre en Turquie avant les dernières élections législatives : « One for the opposition », The Economist, 2 juin 2011.
[9] N. Bourcier, « WikiLeaks : Erdogan jugé autoritaire et sans vision », Lemonde.fr, 30 novembre 2010.
[10] Dans sa thèse de doctorat, le ministre A. Davutoglu proposait une lecture islamisante du système international qui suscita tardivement des commentaires inquiets outre-Atlantique : Alternative Paradigms : The Influence of Islamic and Western Weltanschauung on Political Theory, Lanham, University Press of America, 1994 ; voir M. Koplow, « Hiding in Plain Sight », Foreign Policy, 2 décembre 2010. L’ouvrage majeur d’A. Davutoglu, Stratejik derinlik : Türkiye’nin uluslararasi konumu [Profondeur stratégique : la position internationale de la Turquie], Istanbul, Küre Yayinlari, 2001, dans lequel il expose sa vision du monde à 360 degrés à partir du territoire turc, n’a pas été traduit en anglais.
[11] O. Taspinar, « Turkey’s Middle East Policies : Between Neo-Ottomanism and Kemalism », Washington, DC, Carnegie Endowment for International Peace, Middle East Center, septembre 2008, « Carnegie Paper », n° 10.
[12] B. Badie, « L’appartenance de la Turquie à l’OTAN est devenue plus coûteuse qu’utile », Lemonde.fr, 15 juin 2011 ; D. Pipes, « Does Turkey Still Belong in NATO ? », Philadelphia Bulletin, 6 avril 2009.
[13] J.-P. Burdy, « Retour sur le “discours du balcon” et sur la victoire d’un nouveau leader régional », Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT), 26 juin 2011, disponible à l’adresse suivante : < ovipot.hypotheses.org/5873>.
[14] M. Abramowitz, op. cit., introduction.
[15] Entretien avec Kadri Gürsel, éditorialiste au quotidien Milliyet, juillet 2011.
[16] R. Weitz, « Whither Turkey-US Arms Sales ? », Turkey Analyst, vol. 4, n° 11, 2011.
[17] E. Alessandri, « Turkey and the West Address the Arab Spring », The German Marshall Fund of the United States (GMF), « Analysis », 8 juin 2011.
 Officiellement, c'est à Paris le 19 mars et non à Washington qu'a été prise la décision de mener contre la dictature libyenne des opérations de guerre. Officiellement encore, c'est à Londres et non à Washington que ce 28 mars, on a justifié cette ingérence en faveur des rebelles qui piétinent au même moment devant Syrte. On y a donc reconnu comme pouvoir légitime un Conseil national de 33 membres, aux identités discrètes.
Officiellement, c'est à Paris le 19 mars et non à Washington qu'a été prise la décision de mener contre la dictature libyenne des opérations de guerre. Officiellement encore, c'est à Londres et non à Washington que ce 28 mars, on a justifié cette ingérence en faveur des rebelles qui piétinent au même moment devant Syrte. On y a donc reconnu comme pouvoir légitime un Conseil national de 33 membres, aux identités discrètes.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg







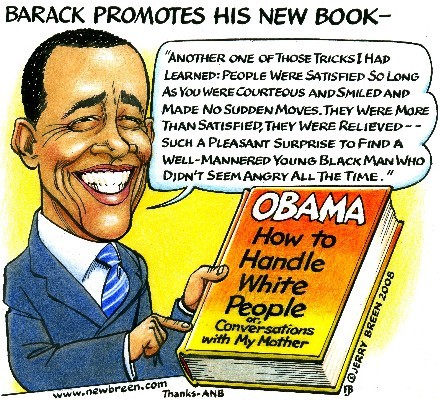 FB : Je ne dirais pas qu’il n’est qu’une simple marionnette. Je me réfère notamment à des informations accessibles à tout un chacun, qui ont été dûment documentées et vérifiées et qui proviennent des travaux d’un reporter et journaliste d’investigation australien, réputé fort sérieux et couronné de quelques prix. Il s’agit de John Pilger. Celui-ci a pu prouver qu’après sa collaboration avec Brzezinski à la Columbia Université, Obama a travaillé pour une organisation camouflée de la CIA, la « Business International Corporation », qui aurait également financé le coût énorme de ses études et apuré ses dettes auprès de son université. Je pense que l’on peut poser, en toute vraisemblance, l’hypothèse qu’Obama a travaillé pour la CIA.
FB : Je ne dirais pas qu’il n’est qu’une simple marionnette. Je me réfère notamment à des informations accessibles à tout un chacun, qui ont été dûment documentées et vérifiées et qui proviennent des travaux d’un reporter et journaliste d’investigation australien, réputé fort sérieux et couronné de quelques prix. Il s’agit de John Pilger. Celui-ci a pu prouver qu’après sa collaboration avec Brzezinski à la Columbia Université, Obama a travaillé pour une organisation camouflée de la CIA, la « Business International Corporation », qui aurait également financé le coût énorme de ses études et apuré ses dettes auprès de son université. Je pense que l’on peut poser, en toute vraisemblance, l’hypothèse qu’Obama a travaillé pour la CIA.









 Irgendwie sind seine Fans ziemlich still geworden. Kein Wunder: Da killt er in Pakistan fröhlich vor sich hin und knipst »Terroristen«, aber auch Zivilisten von der Luft aus ab. Mit ferngelenkten Drohnen. Ist ungefähr so wie ein Videospiel. Jemand sitzt an einem Bildschirm und betätigt einen Stick – und »paff«: Weg ist der Terrorist. Oder wer auch immer. Denn natürlich kann man Terroristen von Zivilisten gar nicht unterscheiden. Es ist ja das Wesen des Terroristen, dass er in zivil unterwegs ist. Uniformiert ist nur eine reguläre Truppe. Befindet sich der Terrorist in Wirklichkeit also gar nicht am Boden, sondern quasi am anderen Ende des Sticks? Oder gar im Weißen Haus? Das zu beweisen, erfordert nur ein wenig simple Logik.
Irgendwie sind seine Fans ziemlich still geworden. Kein Wunder: Da killt er in Pakistan fröhlich vor sich hin und knipst »Terroristen«, aber auch Zivilisten von der Luft aus ab. Mit ferngelenkten Drohnen. Ist ungefähr so wie ein Videospiel. Jemand sitzt an einem Bildschirm und betätigt einen Stick – und »paff«: Weg ist der Terrorist. Oder wer auch immer. Denn natürlich kann man Terroristen von Zivilisten gar nicht unterscheiden. Es ist ja das Wesen des Terroristen, dass er in zivil unterwegs ist. Uniformiert ist nur eine reguläre Truppe. Befindet sich der Terrorist in Wirklichkeit also gar nicht am Boden, sondern quasi am anderen Ende des Sticks? Oder gar im Weißen Haus? Das zu beweisen, erfordert nur ein wenig simple Logik.
 Obama-Berater will Verschwörungstheorien verbieten? Toll. Dann hat endlich die Geschichte von Obama bzw. Osama und den 19 Räubern ein Ende, die am 11. September 2001 auszogen, die Weltmacht USA zu attackieren. Oder die Verschwörungstheorien über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, die nie gefunden wurden. Oder die Theorien, dass der Iran demnächst eine Atombombe bauen kann. Doch man ahnt es schon: Diese Verschwörungstheorien sind natürlich nicht gemeint. Vielmehr sind jene Theorien im Visier von totalitären Politikern, die den obrigkeitlichen Blödsinn immer wieder als Verschwörungstheorie entlarven.
Obama-Berater will Verschwörungstheorien verbieten? Toll. Dann hat endlich die Geschichte von Obama bzw. Osama und den 19 Räubern ein Ende, die am 11. September 2001 auszogen, die Weltmacht USA zu attackieren. Oder die Verschwörungstheorien über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, die nie gefunden wurden. Oder die Theorien, dass der Iran demnächst eine Atombombe bauen kann. Doch man ahnt es schon: Diese Verschwörungstheorien sind natürlich nicht gemeint. Vielmehr sind jene Theorien im Visier von totalitären Politikern, die den obrigkeitlichen Blödsinn immer wieder als Verschwörungstheorie entlarven.
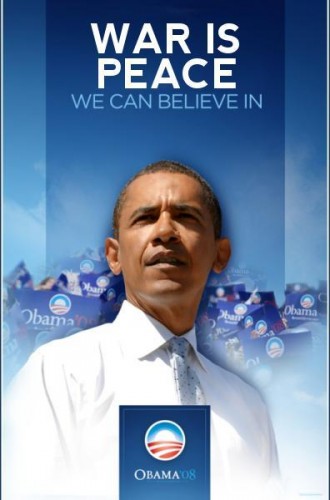 Sarà una guerra diversa quella che l’amministrazione Obama ha intenzione di condurre contro il terrorismo e i nemici degli Stati Uniti. Non certo meno costosa - visto che il piano spese presentato in questi giorni dal presidente è solo lievemente inferiore a quelli presentati negli ultimi due anni del suo predecessore - ma sicuramente diversa da quella di Bush. La nuova strategia messa a punto dal ministro della Difesa Robert Gates, infatti, punta soprattutto sull’aumento delle operazioni speciali segrete, sull’utilizzo massiccio degli aerei senza pilota e su una rinnovata attenzione nei confronti degli Stati “deboli”, come Yemen e Somalia, considerati un rifugio sicuro per gli uomini di Al Qaida. In generale, Gates ha sottolineato la necessità di abbandonare la precedente politica (eredità della Guerra Fredda), che chiedeva alle forze armate di prepararsi a combattere simultaneamente in due conflitti regionali (ad esempio in Vicino Oriente e nella penisola coreana), e di sostituirla con la capacità di fronteggiare diversi conflitti minori in ogni parte del mondo. Le linee guida di questo riordino sono descritte nel Quadriennal Defense Review (QDR), il rapporto quadriennale del Pentagono presentato lunedì scorso. Il testo indica come priorità attuale delle forze armate statunitensi il “prevalere nelle guerre odierne“ e sostiene la necessità di “smantellare le reti terroristiche” in Afghanistan e in Iraq.
Sarà una guerra diversa quella che l’amministrazione Obama ha intenzione di condurre contro il terrorismo e i nemici degli Stati Uniti. Non certo meno costosa - visto che il piano spese presentato in questi giorni dal presidente è solo lievemente inferiore a quelli presentati negli ultimi due anni del suo predecessore - ma sicuramente diversa da quella di Bush. La nuova strategia messa a punto dal ministro della Difesa Robert Gates, infatti, punta soprattutto sull’aumento delle operazioni speciali segrete, sull’utilizzo massiccio degli aerei senza pilota e su una rinnovata attenzione nei confronti degli Stati “deboli”, come Yemen e Somalia, considerati un rifugio sicuro per gli uomini di Al Qaida. In generale, Gates ha sottolineato la necessità di abbandonare la precedente politica (eredità della Guerra Fredda), che chiedeva alle forze armate di prepararsi a combattere simultaneamente in due conflitti regionali (ad esempio in Vicino Oriente e nella penisola coreana), e di sostituirla con la capacità di fronteggiare diversi conflitti minori in ogni parte del mondo. Le linee guida di questo riordino sono descritte nel Quadriennal Defense Review (QDR), il rapporto quadriennale del Pentagono presentato lunedì scorso. Il testo indica come priorità attuale delle forze armate statunitensi il “prevalere nelle guerre odierne“ e sostiene la necessità di “smantellare le reti terroristiche” in Afghanistan e in Iraq. Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.
Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.