
Parution du n°448 du Bulletin Célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Gianni Celati nous a quittés
Entretien avec Jean Guenot (II)
Un professeur suisse nous fait relire Bagatelles
Oscar Rosembly (1909-1990)
Rosembly dans Gringoire
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution du n°448 du Bulletin Célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Gianni Celati nous a quittés
Entretien avec Jean Guenot (II)
Un professeur suisse nous fait relire Bagatelles
Oscar Rosembly (1909-1990)
Rosembly dans Gringoire
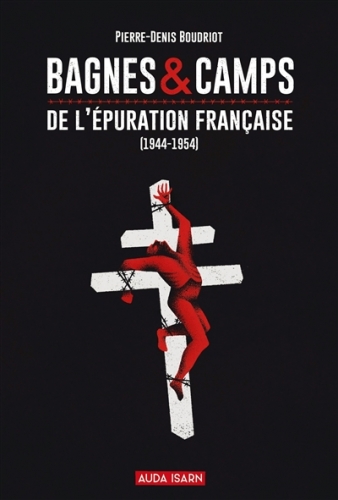
Mais c’est aux prisons françaises de l’épuration qu’un historien, Pierre-Denis Boudriot, vient de consacrer un livre d’autant plus passionnant que le sujet n’a jamais été traité auparavant. Cette plongée dans le monde carcéral de l’immédiate après-guerre est basée sur les nombreux témoignages de condamnés politiques. Aussi retrouve-t-on dans ce livre des personnages connus tels ceux déjà cités mais aussi Ralph Soupault, Lucien Combelle, Claude Jamet et d’autres qui payèrent parfois très cher leur engagement. L’auteur s’est également appuyé, ce qui est plus rare, sur les nombreuses notes et circulaires de l’administration pénitentiaire relatives aux maisons centrales et à leurs prisonniers. L’exceptionnelle richesse documentaire de ce fonds donne à cet ouvrage tout son prix. La confrontation de ces deux sources a permis de confirmer la véracité des écrits des épurés, souvent jugés tendancieux car pétris de ressentiment. De manière exhaustive, l’auteur analyse tout ce qui constitue la vie carcérale : le personnel pénitentiaire, la discipline, l’alimentation, le travail, la correspondance et le parloir, les lectures (autorisées), puis l’amnistie et les libérations conditionnelles ou anticipées. Et enfin, sous le titre « Une vie à recommencer », le retour au foyer. Ce sujet a concerné pas moins de 10.000 hommes et 4.000 femmes de toutes conditions sociales, connus ou pas. Un ouvrage dont le réalisme suscite une certaine compassion rétrospective tant les conditions de détention étaient dures à cette époque.
• Pierre-Denis BOUDRIOT, Bagnes & camps de l’épuration française (1944-1954), Auda Isarn [BP 80432, 31004 Toulouse cedex 6], 2021, 239 p., bibliographie et index (20 € franco)
09:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue, livre, épuration, univers carcéral, prison, années 40 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
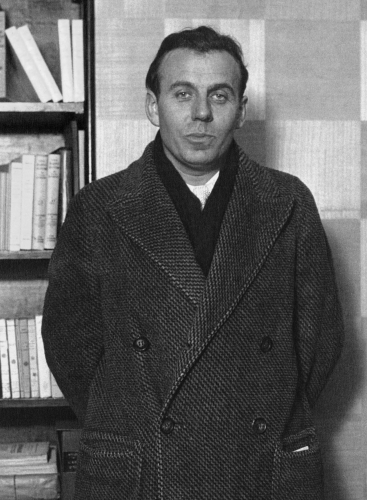
Parution du n°447 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Entretien avec Jean Guenot
Céline dans France-Soir (1946-47)
Entretien avec Oskar Hedemann
Suspicion et mauvaise foi. C’est ce qui caractérise l’article de Philippe Roussin sur l’affaire des manuscrits retrouvés. Il tance les ayants droit et loue le receleur. Selon lui, il n’y eut d’ailleurs pas de recel puisqu’il n’y eut pas de vol ! Explication : les manuscrits furent « abandonnés » [sic] par Céline. Spécieux. Tout juste si Roussin ne le suspecte pas d’avoir laissé ouverte la porte de son appartement lorsqu’il s’enfuit le 17 juin 1944. Peu importe que celui-ci ait écrit : « On ne va rien toucher à l’appartement on reviendra… l’on ne peut pas dire que l’on ne reviendra jamais. » Si Céline avait été propriétaire (et non locataire) de l’appartement rue Girardon, Roussin serait-il aussi péremptoire ? Ce qui l’insupporte, c’est que, dans cette affaire, l’écrivain soit considéré comme un volé, et donc une victime. Logique : si l’écrivain n’a pas été volé, les ayants droit n’avaient aucune raison d’ester en justice. Ce que Roussin omet soigneusement de préciser, c’est que si François Gibault et Véronique Chovin ont déposé plainte, c’est parce que Thibaudat refusait obstinément de restituer ces manuscrits qui leur appartiennent. Et entendait décider seul de leur sort : en l’occurrence, en faire don à l’Institut Mémoire de l’Édition (IMEC) dont il est proche. Par ailleurs, le fait que ce recel ait privé Lucette d’une joie certaine ne préoccupe nullement Roussin. Pas davantage le fait qu’à la fin de sa vie, elle avait un pressant besoin d’argent, ayant à rémunérer plusieurs personnes qui s’occupaient d’elle en permanence. Thibaudat, lui, se considérait comme le dépositaire des manuscrits, ce qui l’a autorisé à les garder par devers lui pendant des années. Le conseil des ayants droit, Jérémie Assous, n’a pas tort de dire que le journaliste de Libé est comparable à quelqu’un qui aurait gardé pendant des décennies dans son salon une toile de maître volée. Mais, de toute évidence, le droit moral et patrimonial des héritiers, Roussin n’en a cure. Mieux : il leur fait un procès d’intention en subodorant qu’ils pourraient garder sous le boisseau des textes compromettants, ce qui est saugrenu, connaissant l’objectivité du biographe qu’est Gibault. Roussin, auteur d’un livre sur Céline de 800 pages, a-t-il jamais éprouvé pour l’écrivain « une admiration sans bornes », à l’instar de Taguieff et Duraffour qui nous firent cette confidence dans leur livre obèse ? Sûrement pas. On comprend même, entre les lignes, que Céline ne mérite pas, selon lui, le statut de « plus grand écrivain français du XXe siècle » qu’on lui accorde généralement. Et de citer complaisamment l’appréciation de Houellebecq qui le considère comme « un auteur ridiculement surévalué ». Venant de la part de quelqu’un dont le style est aussi plat qu’une limande, cela prête à sourire. Quant à Roussin, il estime qu’il faut rendre grâce à ceux qui ont “recueilli” ces manuscrits pendant des décennies. Et qu’il faut, en revanche, juger âprement les ayants droit qui ont eu le front de déposer plainte. Il importe surtout de condamner, une fois encore et toujours, les fautes dont Céline s’est rendu coupable. Et de ressasser ad libitum les éléments du procès qui lui est intenté depuis près de 80 ans. C’est qu’il s’agit pour Roussin de conjurer « le mauvais vent d’hiver maurrassien de l’époque ». De la part d’un fonctionnaire, on pouvait s’attendre à davantage de réserve. L’ironie de l’histoire étant que cet article soit publié sur un site internet placé sous l’égide de Maurice Nadeau qui prit fait et cause pour Céline lorsqu’il était exilé.
• Philippe ROUSSIN, « Déshonneur et patrie : retour sur l’affaire Céline », En attendant Nadeau, 15 décembre 2021 [https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/12/15/deshonneur-patrie-affaire-celine].
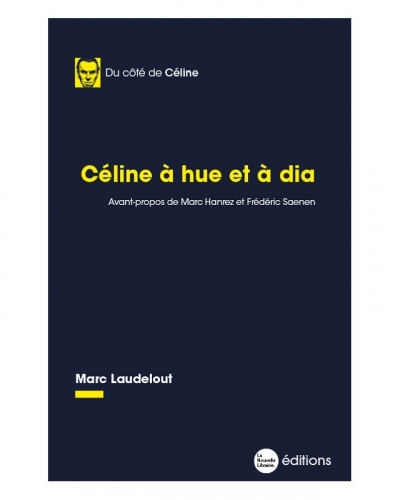
Marc Laudelout
Céline à hue et à dia
Louis-Ferdinand Céline est un immense écrivain. Il fut aussi antisémite et souhaita la victoire des forces de l’Axe. Deux raisons pour lesquelles il est légitime pour beaucoup de le honnir. Mais ce n’est pas suffisant pour certains qui, ajoutant la diffamation à la détestation, l’accusent d’avoir été un vil délateur, un auxiliaire de la police allemande et un partisan du génocide. Sans apporter aucune preuve formelle et contredisant ainsi les spécialistes intègres de l’écrivain : « Ses pamphlets ne présentent pas d’appel au meurtre explicite » (R. Tettamanzi) ; « Céline n’avait pas voulu l’holocauste et n’en avait pas même été l’involontaire instrument » (F. Gibault) ; « Les mesures que Céline préconise contre les juifs se suffisent à elles-mêmes, sans qu’on aille jusqu’à lui prêter une idée ou un désir d’extermination » (H. Godard).
D’autres enfin, pour enfoncer le clou, affirment que c’est un écrivain surévalué. Dans cet ouvrage, Marc Laudelout, éditeur du Bulletin célinien depuis 40 ans, épingle ces anticéliniens rabiques. Il évoque aussi diverses interférences littéraires, dresse le portrait de quelques figures (dont les « céliniens historiques ») et explore quelques faits liés à la biographie ainsi qu’à la réception critique de l’œuvre.
Un volume broché de 412 pages, 25 € frais de port inclus.
Exemplaire dédicacé sur demande.
Mode de règlement : chèque (bancaire ou postal) à l’ordre de M. Laudelout. Ou par virement bancaire sur le compte LCL du Bulletin célinien à Lille : IBAN : FR59 3000 2082 3100 0019 5794 L60 (BIC : CRLYFRPP).
Dans ce cas, il est recommandé de nous adresser un courriel signalant ce virement.
Autre mode de paiement : virement sur le compte du BC à Bruxelles : BE 79 0637 1647 0933 (BIC : GKCCBEBB).
Commander à :
Marc Laudelout
139 rue Saint-Lambert
B. P. 77
BE 1200 Bruxelles
14:34 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, céline, marc laudelout, livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 446 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Classement sans suite pour Thibaudat
Fantasmes et travail éditorial
L.-F. Céline : les derniers secrets
Céline dans France-Soir (1944-1945)
Catherine Rouayrenc nous a quittés
Almansor, ou le secret de famille. Les origines de Lucette Destouches.
L’expression « les années noires » désigne généralement les années d’occupation allemande durant la dernière guerre mondiale. On songe, par exemple, au Journal des années noires, 1940-1944 de Jean Guéhenno. Pour Céline, les années noires correspondent à l’exil, d’abord en Allemagne, puis au Danemark. La fin du bonheur, comme dit l’un de ses biographes. La période la plus éprouvante étant naturellement son arrestation survenue en décembre 1945, suivie d’une détention qui se prolongea jusqu’en janvier 1947. Aussi est-ce bien opportunément que Christophe Malavoy titre son dernier opus, L.-F. Céline. Les Années noires. Superbement illustré par José Correa, cet album s’avère le cadeau idéal à offrir en cette période de fêtes. En tout cas à ceux qui aimeraient en savoir plus sur cette partie de la vie de l’écrivain. Célinien patenté, Malavoy nous avait déjà montré sa bonne connaissance de la biographie avec un livre paru l’année du cinquantenaire de la mort. Ce qui surprendra, voire heurtera, certains, c’est que le texte soit ici rédigé à la première personne, l’auteur empruntant la voix, sinon le style, de Céline.
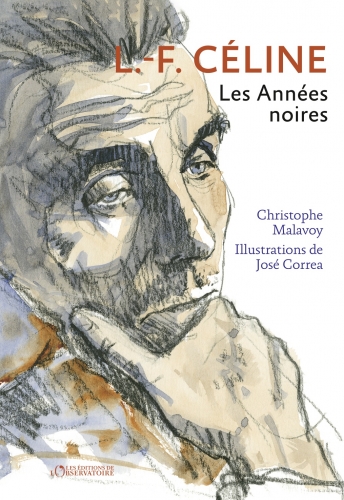
Cette initiative ne peut que susciter la perplexité puisque l’écrivain a lui-même narré cette partie de sa vie dans les derniers romans. Pourquoi dès lors paraphraser un écrivain de cette envergure en étant, nécessairement, en deçà de l’original ? Sur cette période, on aurait pu, tout aussi bien, choisir des extraits de l’œuvre qui eussent été en harmonie avec l’iconographie. Mais, après un temps d’adaptation, le lecteur se laisse prendre par le flux du récit, Malavoy réussissant, comme le comédien professionnel qu’il est, à endosser le rôle sans jamais verser dans la parodie. Ce qui est notable, c’est l’absence d’erreur factuelle. Lorsque c’est le cas, c’est à la suite de céliniens éminents. Ainsi, Céline n’a jamais songé à intituler l’une de ses œuvres Maudits soupirs pour une autre fois (p. 114). Comme cela a été rappelé ici – Nabe ayant récemment commis la même erreur –, c’est suite à une faute de lecture que deux titres envisagés par Céline furent amalgamés : “Au vent des maudits” et “Soupirs pour une autre fois”. Et c’est sous ce titre fallacieux qu’une version primitive de Féerie parut en 1985. Les autres erreurs relèvent vraiment du détail¹.
Comme les lecteurs du Bulletin le savent, José Correa est actuellement le meilleur portraitiste de Céline. C’est aussi un aquarelliste de talent comme en attestent les illustrations en couleurs qui figurent dans cet ouvrage. Lequel n’apprendra rien aux célinistes. Mais cet ouvrage leur est-il destiné ? Il s’adresse plutôt au grand public s’intéressant à Céline et ignorant des conditions de l’exil et du procès. Ce livre offre surtout la particularité d’être en empathie avec son sujet, ce qui, dans le cas de Céline, est suffisamment rare pour être relevé.
• Christophe MALAVOY & José CORREA, L.-F. Céline. Les Années noires, Les Éditions de l’Observatoire, 2021, 245 p. (22 €). Un second tome, racontant les dix années ultérieures, Le Misanthrope de Meudon, est en préparation.
17:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, céline, revue, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du n°62 de War Raok
EDITORIAL
La culture est l’ensemble des valeurs, des traditions et coutumes d’un peuple. Elle reflète le mode de vie et la vision du monde d’une communauté donnée. C’est toute l’identité d’un peuple. La culture est aussi le reflet de l’histoire, c’est-à-dire le vécu d’un peuple dès son origine et à travers les âges. L’acculturation est le rejet de ses valeurs, ses coutumes et traditions pour s’approprier des valeurs culturelles d’un autre groupe humain, en cherchant à s’identifier à ces mœurs et coutumes. Cette domination culturelle est une nouvelle forme de colonisation dont les médias aux ordres constituent les véritables instruments d’acculturation et en sont les principaux organes de promotion. Nous ne sommes pas sans savoir que tout changement de comportement, des coutumes et traditions, reflets du passé d’un peuple, conduisent à la disparition de ce peuple, de son identité et de sa culture.
La culture est l’âme vivante d’une nation et c’est ce qui fait qu’une nation est différente d’une autre. Selon un principe anthropologique, toutes les cultures se valent, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de culture qui soit supérieure à d’autre, puisque chaque culture a ses particularités et reflète un passé différent et unique d’un peuple. Et, c’est à travers les spécificités culturelles qu’on distingue les peuples, à savoir leur mode de vie, leur vision du monde, leur croyance.
Dans le cas de la Bretagne, si la politique de l’État français a été de tout temps de s’attaquer particulièrement à la langue bretonne, l’enseignement de l’histoire de la Bretagne n’a pas été épargné pour autant. Il est vrai que si les Bretons avaient eu une parfaite connaissance de leur histoire, nous ne serions très certainement pas dans cette situation actuelle de sujétion, dans cet état de dépendance et aurions recouvré depuis fort longtemps nos libertés perdues. La dimension celtique de l’histoire et de la culture bretonnes est en fait une manière de la singulariser par rapport au modèle culturel français, héritier de la tradition gréco-latine. Ainsi, on comprend mieux la méfiance, l’acharnement et l’opposition du « pays des droits de l’homme » à dispenser un enseignement généralisé de l’histoire millénaire du peuple breton à la jeunesse bretonne. Méfiance toutefois ! L’enseignement que nous voulons est celui d’une histoire de Bretagne authentique écrite par des historiens honnêtes et intègres et non par ce que pourrait proposer l’État français, par le biais de son Éducation nationale, un programme d’enseignement revu et corrigé, une histoire à sa convenance, une histoire falsifiée fleurant bon le négationnisme, une histoire convenable écrite par des idéologues manipulateurs !
Langue, histoire, coutumes, traditions… un rejet de ces valeurs peut inéluctablement conduire à une disparition de la culture bretonne en tant que telle si rien n’est fait. Dans ce constat de déperdition, quelle est donc la place d’une politique culturelle devant mettre en évidence les valeurs culturelles de la Bretagne au passé mémorable dans l’histoire de l’Europe ? Nous sommes à l’heure où la tendance fait croire que tout ce qui est étranger est bon et tout ce qui est local est mauvais. La Bretagne est reconnue comme un pays riche culturellement d’après son histoire, ses origines et l’ensemble des valeurs et traditions qui lui sont propres, cependant, elle n’est pas épargnée d’être un jour dans la liste des anciennes sociétés. En somme, le combat contre l’acculturation est avant tout une responsabilité de tous les Bretons, mais il incombe aux responsables politiques en Bretagne, en particulier au « croupion » Conseil Régional, de faire la promotion de la culture bretonne par tous les moyens. C’est une affaire politique qui nécessite l’apport de tous les secteurs concernés.
L’hostilité de la république française à l’égard de la Bretagne est toujours d’actualité. Avons-nous alors encore quelque chose à partager avec elle, qui bafoue notre identité et nous dénie toute autonomie, jusqu’à l’enseignement aux enfants de Bretagne de leur langue et de l’Histoire de leur pays ? Les Bretons doivent reprendre en mains l’enseignement de leur langue, mais également de leur histoire refusant ainsi les hérésies qui, par lavage des cerveaux, ont été introduites dans leurs esprits. Seul, un authentique pouvoir breton sera à même de défendre et de promouvoir cette culture bretonne à la fois héritière du passé de nos aïeux et tournée vers la créativité du futur.
Padrig MONTAUZIER

Sommaire War Raok n° 62
Buhezegezh vreizh page 2
Editorial page 3 (Padrig Montauzier)
Buan ha Buan page 4
Société
La cancel culture et la délégitimation de la mémoire page 9 (Giulio Battioni)
Politique
L’Alliance souverainiste bretonne,
un élan majeur pour la Bretagne page 11 (Meriadeg de Keranflec’h)
Tradition
Le symbolisme du cheval page 15 (Per Manac’h)
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton page 19 (Donwal Gwenvenez/Yann Mikael)
Histoire de Celtie
Importance du celtisme dans les Asturies page 23 (Carlos X. Blanco)
Tribune libre
Sur les prénoms non-français, objection M. Zemmour ! Page 25 (Youenn Caouissin)
Histoire de Bretagne
Le faux traité de 1532 page 26 (Docteur Louis Melennec)
Politique
La mosquée de Cologne, la charia en marche page 30 (Erwan Houardon)
Civilisation celtique
Littératures écrites et orales des civilisations celtiques page 32 (Fulup Perc’hirin)
Nature
L’écureuil, petit rouquin de nos forêts page 36 (Youenn Caouissin)
Lip-e-bav
Gratin du pêcheur aux herbes page 37 (Youenn ar C’heginer)
Keleier ar Vro
Un statut de résident pour la Bretagne page 38 (Meriadeg de Keranflec’h)
Bretagne sacrée
Les lavoirs page 39 (Per Manac’h)
14:29 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bretagne, celtisme, pays celtiques, nationalisme breton |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

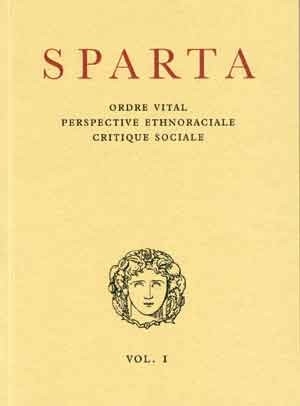
10:51 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, philippe baillet, tradition, traditionalisme, traditionalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
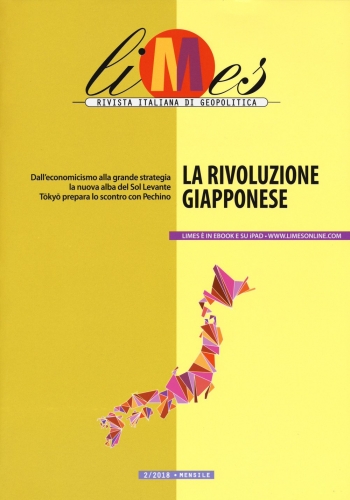
Le Japon selon la revue Limes
par Riccardo Rosati
Ex: https://www.barbadillo.it/76650-focus-il-giappone-secondo-il-periodico-limes-con-insofferenza-per-il-nazionalismo-al-governo/?fbclid=IwAR2iDgug2BU7isJXNpWRK6Jw5WoesNnc3BQFG5VXfbHElxcrpXjHMFlQ9y8
Une clarification et une orientation méthodologiques essentielles
Parler de Roland Barthes, c'est généralement parler de l'écriture, du texte, de la signification, et plus encore du sens. La question plus que légitime serait de savoir pourquoi cette référence au grand linguiste et homme de lettres français est faite dans une analyse de la monographie que le célèbre magazine géopolitique Limes a consacré au Japon en février dernier. À première vue, on pourrait penser à une référence au merveilleux texte que Barthes a adressé à ce pays, intitulé L'Empire des signes (1970), mais ce n'est pas le cas. La raison qui nous a poussés à commencer ces réflexions en parlant de l'écriture elle-même réside dans le fait que même un champ d'investigation et de recherche comme la géopolitique change de perspective, tout en révélant son identité, en fonction du lexique utilisé et de la manière dont les phrases sont formées. La première, qui est celle du Limes, tend à ne pas être hostile au global et au progrès d'une matrice technocratique; la seconde, suivie par moi-même, est au contraire encadrée par une position traditionaliste, pour laquelle, reprenant un concept cher au célèbre géopolitologue allemand Karl Haushofer (1869-1946), les nations sont toujours et avant tout: "le sang et le sol".

Nous avons ressenti le besoin de faire une telle introduction, car si, pour le volume que nous allons analyser, il nous arrive d'être en désaccord avec certaines des positions qui y sont exprimées, dans la plupart des cas, ce ne sera pas à cause de la qualité intrinsèque des articles individuels, qui sont pour la plupart d'un bon niveau, mais presque exclusivement à cause d'une distance méthodologique et intellectuelle insoluble.
La contribution la plus intéressante du numéro de Limes est intitulée : La révolution japonaise, et se trouve probablement dans l'éditorial lui-même (7-29), dans son examen articulé qui ne se limite pas à anticiper synthétiquement, comme cela arrive souvent dans des écrits de ce genre, les thèmes abordés ensuite par les différents articles, mais se concentre à proposer, même avec une certaine conviction, la perspective que Limes a sur la situation politique actuelle de l'Archipel. Il n'y a pas d'objection à cela, si ce n'est l'absence de signature de la personne qui a écrit cet éditorial ; un défaut, à notre humble avis, qui dénote une vocation d'écriture plus journalistique qu'académique. Moins "neutre", en revanche, est la compréhension schématique et partielle du Premier ministre japonais Abe Shinzō, qui apparaît comme une sorte de "refrain" dans les différentes contributions, mais uniquement dans celles signées par des Italiens. Néanmoins, malgré l'intolérance habituelle de la gauche italienne envers les soi-disant "hommes forts" aux penchants nationalistes, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître une part de vérité dans le jugement suivant sur la politique du Premier ministre japonais: "Jouer la carte de l'accord entre les démocraties libérales à des fins de propagande [...]" (18-20).

Le Japon est un monde à part, comme le savent les spécialistes, et un aspect important de ce numéro est précisément l'utilisation des réflexions de divers chercheurs et professeurs japonais, afin d'offrir une perspective interne sur les changements en cours au Soleil Levant. Plus d'une de ces contributions traite de la manière dont l'Empire japonais a étendu son influence pendant des années brèves mais décisives, en essayant en vain d'ériger la Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, jusqu'à son effondrement en 1945, lorsque les États-Unis, afin d'éviter une invasion directe du Japon, l'ont contraint à se rendre par un double bombardement atomique, criminel selon nous. Pour la première fois dans son histoire légendaire, l'Empire du Soleil est soumis au joug étranger, asservi à ceux que l'on appelle les "yeux bleus" (aoime), c'est-à-dire les Occidentaux.
Depuis son formidable redressement d'après-guerre, le Japon est synonyme, pour le reste du monde, d'avant-garde technologique, de locomotive industrielle internationale et de puissance financière et commerciale qui, dans les années 1980, semblait sur le point de dépasser même les États-Unis, dont ce pays asiatique complexe a été pendant des années une sorte de "serviteur géopolitique", agissant comme un porte-avions naturel, gardant l'océan Pacifique. La Seconde Guerre mondiale a fait du Japon un cas rare de coexistence d'une puissance économique et d'une minorité politique.
Bien que réduit à l'état de vassal des États-Unis, le Soleil Levant a su préserver son caractère, rester fidèle à sa mission patriotique supérieure en s'adaptant, par la force et non par le choix, et il faut toujours le garder à l'esprit, aux contraintes imposées par l'allié gênant. Néanmoins, cette grande nation a vécu jusqu'à aujourd'hui, changeant de peau mais certainement pas d'âme. Et pourtant, comme le souligne à juste titre l'éditorial, le "problème américain" existe toujours, ou plutôt est encore plus grand que par le passé, pour le Japon, dans sa nécessité, qui n'est guère facile: "Mais les réalistes de tonalité modérée - faisons abstraction des nombreux pacifistes et autres idéalistes - tendent à constater que la contrainte américaine subie reste pour l'instant indispensable face à la résurgence de la puissance chinoise, à l'hypothèque nucléaire nord-coréenne [...]" (15).

Deux écrits particulièrement intéressants
Comme mentionné, en général, toutes les contributions de la revue sont au moins intéressantes. Pour des raisons compréhensibles d'espace, nous nous attarderons ci-dessous sur ceux qui ont le plus retenu notre attention.
Nous aimerions tout d'abord mentionner l'article de Dario Fabbri, intitulé : L'importanza di essere Giappone (33-45), qui est essentiellement un "écho" de ce qui a déjà été dit dans l'éditorial, mais dans lequel nous trouvons quelques indications valables sur la formidable capacité de résistance et d'innovation de l'Archipel et de son Peuple.
Tōkyō réintègre la dimension géopolitique, sous le signe d'un ancien adage japonais : Keizoku wa chikara nari (継続は力なり, "Continuer, c'est pouvoir"). En fait, il n'y a aucun autre pays qui ait changé aussi radicalement, aussi rapidement et avec des effets aussi extrêmes au cours des deux derniers siècles que le Japon. D'un archipel isolé à une puissance coloniale en moins de trente ans ; d'une nation, bien que seulement formellement, historiquement vassale de la Chine, à un hégémon asiatique ; d'un ennemi juré des Américains à leur allié, tout en s'imposant comme l'avant-garde technologique de la planète. Des bouleversements effrayants qui auraient désintégré n'importe quelle communauté, démembré n'importe quel peuple, mais certainement pas les Japonais, telles sont les observations correctes de l'auteur.
Après tout, malgré l'ascension fulgurante du géant chinois au cours des quinze dernières années, le Japon reste la troisième économie mondiale. De même, la modernité obligatoire qui s'est emparée d'elle depuis la Seconde Guerre mondiale a sapé divers éléments: la langue, les coutumes et même le régime alimentaire, mais certainement pas sa véritable identité ethnique. En outre, au Pays du Soleil Levant, la confiance absolue dans la hiérarchie reste inchangée, ce qui a permis à la nation de se survivre et d'être essentiellement la culture unique qu'elle est. Un pays que l'on pourrait se risquer à résumer par un double axiome : la solidité en a fait un sujet ethnique incontournable ; tant de substance empêche ponctuellement sa compréhension à l'extérieur.

Le document de Fabbri, non pas en termes de style, mais en termes de contenu, nous trouve substantiellement en accord, sauf que la perspective que nous avons mentionnée au début nous oblige à reconnaître une erreur, et nous espérons qu'on nous pardonnera d'être draconien, ce qui est capital. C'est-à-dire définir le Japon comme une "thalassocratie" (33). Techniquement, une telle affirmation est correcte, mais seulement si l'on conçoit la géopolitique comme un réseau d'interactions économico-politiques; selon un point de vue moderne, donc dépourvu de la compréhension de l'essence spirituelle qui connote les lieux habités par les peuples, surtout dans le cas du Japon, puisque, comme l'explique encore Haushofer dans son texte extraordinaire: Il Giappone costruisce il suo impero (Parma, All'insegna Del Veltro, 1999), le Soleil Levant s'est effectivement déplacé dans la période de son expansionnisme en Asie à travers le vecteur maritime, mais pas du tout poussé par les vils objectifs mercantiles qui ont caractérisé d'abord l'Empire britannique et ensuite les Etats-Unis. Le Japon impérial était "en forme" une thalassocratie, mais dans la réalité historique, il s'est comporté comme une "tellurocratie". Ces différences de perspective peuvent sembler anodines, mais elles ne le sont pas ; au contraire, on mesure ici deux visions du monde absolument irréconciliables.

Fabbri a également édité une conversation très intéressante avec Tōmatsu Haruo (47-52), historien de la stratégie et doyen de la faculté des relations internationales de l'Académie de défense nationale (防衛大学校, Bōei Daigakkō) à Yokosuka. Nous considérons cette contribution comme la plus précieuse parmi celles incluses dans ce numéro de Limes. En effet, la précieuse perspicacité de Tōmatsu, notamment dans sa réflexion aiguë sur le dualisme entre Armée et Marine dans les hiérarchies militaires japonaises (48), constamment développé à partir de la restauration Meiji (1868), est une donnée historique cruciale pour la compréhension de la première période Shōwa (1926-1945) et que nous avons rarement eu la chance de retrouver dans les études des noms blasonnés - plus pour la gloire que pour la valeur tangible - de la yamatologie contemporaine. Cette rivalité acharnée entre l'armée et la marine s'accentue avec l'implication directe du Soleil Levant dans les affaires chinoises, faisant que la première, c'est-à-dire l'armée, gagne de plus en plus de poids politique, jusqu'à s'imposer comme le pouvoir du gouvernement proprement dit, inaugurant ce que les spécialistes ont l'habitude d'appeler le militarisme japonais, également défini comme: "Vallée sombre" (黒い谷, "Kuroi Tani").
Tōmatsu fait référence à un changement en cours au Japon, empreint de malaise, qu'il décrit comme: "Une phase délicate de suspension, en attente de devenir autre chose". D'un côté, il y a les bureaucrates, en charge de la politique étrangère depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont perdu toute sensibilité stratégique parce qu'ils sont habitués à compter sur les États-Unis. [Enfin, il y a des amiraux et des généraux, nostalgiques de l'empire, qui voudraient inaugurer une nouvelle saison expansionniste, sans envisager les graves conséquences que cela entraînerait. Le résultat est un pays qui oscille entre un nihilisme indolent et une agressivité réprimée [...]". (47). En répondant précisément à chacune des questions que Fabbri lui pose, l'érudit japonais offre de nombreuses pistes de réflexion non seulement sur le positionnement politique et stratégique actuel de son pays, mais surtout en le reliant à l'histoire récente de l'Archipel. Pour cette raison, nous considérons cet entretien comme un élément bibliographique qui devrait être constamment présent dans les futures études géopolitiques sur le Japon.
Autres écrits plus utiles
Il y a cependant d'autres écrits d'un intérêt certain inclus dans ce volume. Par exemple, celle de Nishio Takashi: Long live the todōfuken (53-59), dans laquelle il aborde la question de savoir comment les préfectures du pays ne sont plus aujourd'hui de simples unités administratives, mais des "entités écologiques", linguistiques et culturelles, capables même de façonner l'identité individuelle des citoyens.
Nishio explique comment, dans le système de gouvernance japonais actuel (un mot mal aimé, à juste titre, par le courant géopolitique traditionnel), le système des autonomies locales (todōfuken) est le plus ancien et le plus consolidé. On dénombre pas moins de 47 todōfuken dans l'archipel, dont les noms et les limites sont restés quasiment inchangés depuis la restauration Meiji. Cependant, si ces unités d'autonomie locale semblent être restées inchangées, leurs caractéristiques politiques et sociales ont, au contraire, changé de façon spectaculaire depuis l'établissement de l'État centralisé de la période Meiji.
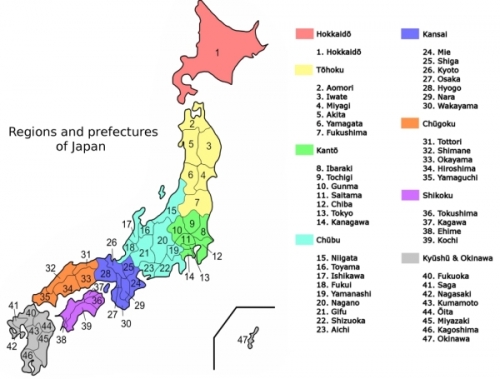
Le thème est traité dans l'article intitulé The Demographic Crisis and a New Meiji Restoration (73-78) de Stephen R. Nagy et est d'une actualité brûlante. Il y aborde la question du vieillissement très rapide de la population au Japon, une situation qui crée d'énormes problèmes sociaux et, surtout, économiques. Résoudre ce problème, même si une véritable solution ne semble pas avoir été trouvée par les dirigeants du pays, est d'une importance vitale. Par exemple, on tente de "remplacer" les gens par des robots - l'automate a toujours été un élément de grande fascination dans cette culture - pour certains emplois sociaux, bien que cela semble un remède plus proche de la science-fiction que de la vie réelle.
L'urgence démographique a incité le Parlement à adopter des politiques économiques, sécuritaires, migratoires et culturelles qui promettent de changer le visage du pays, même si dans le cœur des Japonais, à chaque grand changement, ils espèrent rester les mêmes.

Un thème que très peu de gens connaissent, et que presque aucun japonologue italien n'est coupable d'aborder, est celui que l'on trouve dans l'article de Ian Neary : Burakumin, the last ones will remain last (83-87), où il raconte la discrimination à l'égard des membres de la caste des exclus (en particulier les descendants des tanneurs de cuir), une forme de "racisme interne" qui révèle l'obsession toute japonaise de la pureté du sang. En fait, il existe même au Japon des agences d'enquête spéciales qui recherchent le passé des gens pour empêcher les mariages "mixtes". Toutefois, il convient de mentionner qu'en décembre 2016, la Diète (le Parlement japonais) a adopté une loi visant à promouvoir l'élimination de la discrimination à l'égard des burakumin (un terme que l'on peut traduire par "gens du village" ou "gens du canton"). C'est la première fois qu'un texte législatif fait référence à la ghettoïsation des communautés buraku.

Peu de pays ont lié leur histoire nationale à celle de leur marine autant que le Japon au cours des deux cents dernières années, comme nous le raconte Alberto de Sanctis dans son article : La rinascita della flotta nipponica nel nome delle antiche glorie (97-105). Au cours des quelques décennies entre les XIXe et XXe siècles, la flotte de combat japonaise (海軍, kaigun) a connu une croissance rapide et exponentielle qui lui a permis de jouer un rôle crucial dans l'histoire de l'Asie. Pendant des décennies, symbole incontesté du pouvoir impérial, la marine japonaise a contribué à faire du pays l'une des plus grandes puissances militaires de la première moitié du XXe siècle.

Il était bien sûr inévitable que la question de l'abdication prochaine du roi Akihito, prévue en 2019, soit abordée. Hosaka Yuji le fait dans : Le visage humain de l'empereur (121-125). Cet événement rappelle, bien qu'à distance, l'abdication du pape Benoît XVI le 28 février 2013, et fait prendre conscience au monde entier de la fragilité embarrassante, pour les Japonais, d'un souverain que, malgré les événements constitutionnels de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup dans l'Archipel n'ont jamais cessé de considérer comme divin. De plus, étant donné que le système actuel de l'empereur-symbole n'envisage pas un tel cas, la population japonaise a réagi avec une grande consternation à la décision de l'empereur (Tennō) d'abandonner essentiellement son rôle pour des problèmes personnels, comme si la nature humaine et divine de Tennō pouvait être séparée.

Enfin, si nous pensons à l'évolution du scénario politique de l'Extrême-Orient, il est très utile d'avoir abordé l'occupation japonaise (de 1910 à 1945) de la péninsule coréenne ; un épisode colonial qui a vu les Japonais commettre parfois de véritables crimes, notamment le phénomène des femmes dites de réconfort : de jeunes Coréennes contraintes de satisfaire les besoins sexuels de l'armée impériale. Une blessure, comme le raconte Antonio Fiori dans son article: Le détroit de Corée est toujours plus large (227-234), qui continue de peser sur les relations entre Tōkyō et la Corée du Sud, tandis qu'à l'opposé, l'enlèvement jamais élucidé de citoyens japonais par des agents de Pyongyang crée toujours des tensions. À cet égard, en Occident également, le cas de Yokota Megumi, qui a été enlevée par des agents infiltrés par la Corée du Nord, en novembre 1977, et n'est jamais rentrée chez elle, a fait la une des journaux. A ce sujet, le texte du journaliste Antonio Moscatello a été récemment publié : MEGUMI. Histoires d'enlèvements et d'espions de Corée du Nord (Naples, Rogiosi, 2017).
Le Japon ne fait pas de révolution, mais renaît !
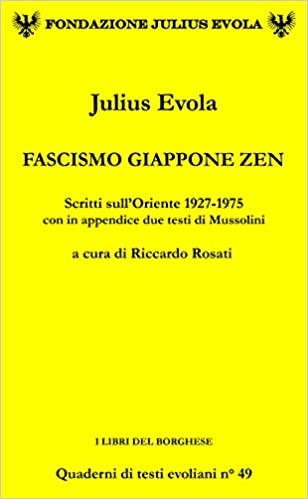 En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).
En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).
Le " Japon profond " dont on parle parfois n'est pas aussi connu qu'on le croit. Elle a été, et est encore, un noyau, essentiellement familier, au sommet duquel se dresse la figure du Souverain. L'américanisme de l'après-guerre a affaibli cette structure sociale exceptionnelle, exclusivement japonaise. Ce phénomène dissuasif de colonisation culturelle a été partiellement stoppé par la tragédie naturelle qui a frappé la région du Tōhoku le 11 mars 2011. Cet événement malheureux a cependant permis la renaissance du kizuna (絆, "lien"), recompactant toute une nation, alors hébétée par une aliénation de l'individu qui a atteint son apogée avec le phénomène des Hikikomori (引き篭り, littéralement: "ceux qui restent entre eux"), les jeunes qui s'enferment chez eux pendant des années, vivant une réalité faite uniquement d'Internet et de télévision, refusant tout contact direct avec les autres (à ce sujet, nous vous recommandons la série animée intelligente: Welcome to the N. H.K. [24 épisodes, 2006], réalisé par Yamamoto Yūsuke).
 Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.
Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.
L'éditorial du Limes se termine par une sorte de provocation: "Parmi les survivances des anciennes gloires, le bushidō ne semble pas briller. Pour la tristesse, nous l'imaginons, des esprits samouraïs" (29); presque comme si nous voulions nous moquer de manière incompréhensible de l'héritage politique et moral du grand Mishima Yukio, encourageant ainsi ce "Japon perdant", auquel nous avons consacré il y a quelques années un volume spécialisé agile (voir Riccardo Rosati, Perdendo il Giappone, Roma, Armando Editore, 2005). Nous ne pouvons certainement pas nous réjouir de cette position, car elle révèle précisément cette méconnaissance déjà stigmatisée du " Japon profond ".
Il est nécessaire de réaliser que ce que certains dirigeants conservateurs de l'Archipel, comme Ozawa Ichirō, voulaient et veulent encore aujourd'hui, c'est un retour à un "Japon normal" (22). En effet, un message, pas trop voilé, que l'on peut voir courir sous la surface de cette publication, est que le "révisionnisme historique" au Japon a des racines vigoureuses et que l'Occident atlantiste, qui est un point de référence pour un magazine comme Limes, ne le voit pas d'un bon œil. Encore une fois, bien que nous soyons loin de ces positions, nous ne pouvons pas nier l'exactitude des données ; il suffit de rappeler une figure telle que l'homme politique et écrivain Ishihara Shintarō, qui était aussi un ami de Mishima, qui a toujours soutenu que le Massacre ou le Viol de Nankin, perpétré pendant les six semaines qui ont suivi l'occupation de la ville par les troupes japonaises en décembre 1937, n'était que le résultat de la propagande du gouvernement de Pékin.
L'éditorial confirme également que quelque chose est en train de renaître au Soleil Levant, qui fera peut-être reculer les mains de l'histoire: "D'où le caractère unique de la nation japonaise, qui change tout en restant elle-même. Capable de voir sans être vu. Offrir au "barbare" le visage commode (tatemae), pour lui-même garder la pensée intime, authentique (hon'ne). Garder l'harmonie (wa), le bien suprême" (8). Ceci dit, pour rappeler combien le lexique est aussi un élément géopolitique, nous pensons que le titre même de ce livre est conceptuellement incorrect, étant donné qu'associer ce pays au mot "révolution" est mystifiant, puisqu'il l'a toujours abhorré, voir la Restauration (ou Renouveau) Meiji de 1868. D'ailleurs, l'un des plus grands spécialistes du Japon au siècle dernier, l'Italien Fosco Maraini, ne pensait pas différemment de nous: "Le cas japonais est extraordinairement intéressant en ce qu'il offre un exemple classique d'imperméabilité obstinée aux interprétations marxistes, de transparence lumineuse aux interprétations wébériennes" (Fosco Maraini, Ore giapponesi, Milan, Corbaccio, 2000, p. 13).
* Merci à la collègue orientaliste Annarita Mavelli pour ses suggestions et sa révision du texte.
@barbadilloit
Riccardo Rosati
16:01 Publié dans Géopolitique, Géopolitique, Histoire, Histoire, Revue, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques, revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
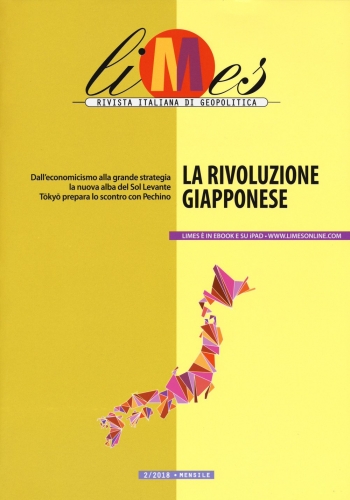
Le Japon selon la revue Limes
par Riccardo Rosati
Ex: https://www.barbadillo.it/76650-focus-il-giappone-secondo-il-periodico-limes-con-insofferenza-per-il-nazionalismo-al-governo/?fbclid=IwAR2iDgug2BU7isJXNpWRK6Jw5WoesNnc3BQFG5VXfbHElxcrpXjHMFlQ9y8
Une clarification et une orientation méthodologiques essentielles
Parler de Roland Barthes, c'est généralement parler de l'écriture, du texte, de la signification, et plus encore du sens. La question plus que légitime serait de savoir pourquoi cette référence au grand linguiste et homme de lettres français est faite dans une analyse de la monographie que le célèbre magazine géopolitique Limes a consacré au Japon en février dernier. À première vue, on pourrait penser à une référence au merveilleux texte que Barthes a adressé à ce pays, intitulé L'Empire des signes (1970), mais ce n'est pas le cas. La raison qui nous a poussés à commencer ces réflexions en parlant de l'écriture elle-même réside dans le fait que même un champ d'investigation et de recherche comme la géopolitique change de perspective, tout en révélant son identité, en fonction du lexique utilisé et de la manière dont les phrases sont formées. La première, qui est celle du Limes, tend à ne pas être hostile au global et au progrès d'une matrice technocratique; la seconde, suivie par moi-même, est au contraire encadrée par une position traditionaliste, pour laquelle, reprenant un concept cher au célèbre géopolitologue allemand Karl Haushofer (1869-1946), les nations sont toujours et avant tout: "le sang et le sol".

Nous avons ressenti le besoin de faire une telle introduction, car si, pour le volume que nous allons analyser, il nous arrive d'être en désaccord avec certaines des positions qui y sont exprimées, dans la plupart des cas, ce ne sera pas à cause de la qualité intrinsèque des articles individuels, qui sont pour la plupart d'un bon niveau, mais presque exclusivement à cause d'une distance méthodologique et intellectuelle insoluble.
La contribution la plus intéressante du numéro de Limes est intitulée : La révolution japonaise, et se trouve probablement dans l'éditorial lui-même (7-29), dans son examen articulé qui ne se limite pas à anticiper synthétiquement, comme cela arrive souvent dans des écrits de ce genre, les thèmes abordés ensuite par les différents articles, mais se concentre à proposer, même avec une certaine conviction, la perspective que Limes a sur la situation politique actuelle de l'Archipel. Il n'y a pas d'objection à cela, si ce n'est l'absence de signature de la personne qui a écrit cet éditorial ; un défaut, à notre humble avis, qui dénote une vocation d'écriture plus journalistique qu'académique. Moins "neutre", en revanche, est la compréhension schématique et partielle du Premier ministre japonais Abe Shinzō, qui apparaît comme une sorte de "refrain" dans les différentes contributions, mais uniquement dans celles signées par des Italiens. Néanmoins, malgré l'intolérance habituelle de la gauche italienne envers les soi-disant "hommes forts" aux penchants nationalistes, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître une part de vérité dans le jugement suivant sur la politique du Premier ministre japonais: "Jouer la carte de l'accord entre les démocraties libérales à des fins de propagande [...]" (18-20).

Le Japon est un monde à part, comme le savent les spécialistes, et un aspect important de ce numéro est précisément l'utilisation des réflexions de divers chercheurs et professeurs japonais, afin d'offrir une perspective interne sur les changements en cours au Soleil Levant. Plus d'une de ces contributions traite de la manière dont l'Empire japonais a étendu son influence pendant des années brèves mais décisives, en essayant en vain d'ériger la Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, jusqu'à son effondrement en 1945, lorsque les États-Unis, afin d'éviter une invasion directe du Japon, l'ont contraint à se rendre par un double bombardement atomique, criminel selon nous. Pour la première fois dans son histoire légendaire, l'Empire du Soleil est soumis au joug étranger, asservi à ceux que l'on appelle les "yeux bleus" (aoime), c'est-à-dire les Occidentaux.
Depuis son formidable redressement d'après-guerre, le Japon est synonyme, pour le reste du monde, d'avant-garde technologique, de locomotive industrielle internationale et de puissance financière et commerciale qui, dans les années 1980, semblait sur le point de dépasser même les États-Unis, dont ce pays asiatique complexe a été pendant des années une sorte de "serviteur géopolitique", agissant comme un porte-avions naturel, gardant l'océan Pacifique. La Seconde Guerre mondiale a fait du Japon un cas rare de coexistence d'une puissance économique et d'une minorité politique.
Bien que réduit à l'état de vassal des États-Unis, le Soleil Levant a su préserver son caractère, rester fidèle à sa mission patriotique supérieure en s'adaptant, par la force et non par le choix, et il faut toujours le garder à l'esprit, aux contraintes imposées par l'allié gênant. Néanmoins, cette grande nation a vécu jusqu'à aujourd'hui, changeant de peau mais certainement pas d'âme. Et pourtant, comme le souligne à juste titre l'éditorial, le "problème américain" existe toujours, ou plutôt est encore plus grand que par le passé, pour le Japon, dans sa nécessité, qui n'est guère facile: "Mais les réalistes de tonalité modérée - faisons abstraction des nombreux pacifistes et autres idéalistes - tendent à constater que la contrainte américaine subie reste pour l'instant indispensable face à la résurgence de la puissance chinoise, à l'hypothèque nucléaire nord-coréenne [...]" (15).

Deux écrits particulièrement intéressants
Comme mentionné, en général, toutes les contributions de la revue sont au moins intéressantes. Pour des raisons compréhensibles d'espace, nous nous attarderons ci-dessous sur ceux qui ont le plus retenu notre attention.
Nous aimerions tout d'abord mentionner l'article de Dario Fabbri, intitulé : L'importanza di essere Giappone (33-45), qui est essentiellement un "écho" de ce qui a déjà été dit dans l'éditorial, mais dans lequel nous trouvons quelques indications valables sur la formidable capacité de résistance et d'innovation de l'Archipel et de son Peuple.
Tōkyō réintègre la dimension géopolitique, sous le signe d'un ancien adage japonais : Keizoku wa chikara nari (継続は力なり, "Continuer, c'est pouvoir"). En fait, il n'y a aucun autre pays qui ait changé aussi radicalement, aussi rapidement et avec des effets aussi extrêmes au cours des deux derniers siècles que le Japon. D'un archipel isolé à une puissance coloniale en moins de trente ans ; d'une nation, bien que seulement formellement, historiquement vassale de la Chine, à un hégémon asiatique ; d'un ennemi juré des Américains à leur allié, tout en s'imposant comme l'avant-garde technologique de la planète. Des bouleversements effrayants qui auraient désintégré n'importe quelle communauté, démembré n'importe quel peuple, mais certainement pas les Japonais, telles sont les observations correctes de l'auteur.
Après tout, malgré l'ascension fulgurante du géant chinois au cours des quinze dernières années, le Japon reste la troisième économie mondiale. De même, la modernité obligatoire qui s'est emparée d'elle depuis la Seconde Guerre mondiale a sapé divers éléments: la langue, les coutumes et même le régime alimentaire, mais certainement pas sa véritable identité ethnique. En outre, au Pays du Soleil Levant, la confiance absolue dans la hiérarchie reste inchangée, ce qui a permis à la nation de se survivre et d'être essentiellement la culture unique qu'elle est. Un pays que l'on pourrait se risquer à résumer par un double axiome : la solidité en a fait un sujet ethnique incontournable ; tant de substance empêche ponctuellement sa compréhension à l'extérieur.

Le document de Fabbri, non pas en termes de style, mais en termes de contenu, nous trouve substantiellement en accord, sauf que la perspective que nous avons mentionnée au début nous oblige à reconnaître une erreur, et nous espérons qu'on nous pardonnera d'être draconien, ce qui est capital. C'est-à-dire définir le Japon comme une "thalassocratie" (33). Techniquement, une telle affirmation est correcte, mais seulement si l'on conçoit la géopolitique comme un réseau d'interactions économico-politiques; selon un point de vue moderne, donc dépourvu de la compréhension de l'essence spirituelle qui connote les lieux habités par les peuples, surtout dans le cas du Japon, puisque, comme l'explique encore Haushofer dans son texte extraordinaire: Il Giappone costruisce il suo impero (Parma, All'insegna Del Veltro, 1999), le Soleil Levant s'est effectivement déplacé dans la période de son expansionnisme en Asie à travers le vecteur maritime, mais pas du tout poussé par les vils objectifs mercantiles qui ont caractérisé d'abord l'Empire britannique et ensuite les Etats-Unis. Le Japon impérial était "en forme" une thalassocratie, mais dans la réalité historique, il s'est comporté comme une "tellurocratie". Ces différences de perspective peuvent sembler anodines, mais elles ne le sont pas ; au contraire, on mesure ici deux visions du monde absolument irréconciliables.

Fabbri a également édité une conversation très intéressante avec Tōmatsu Haruo (47-52), historien de la stratégie et doyen de la faculté des relations internationales de l'Académie de défense nationale (防衛大学校, Bōei Daigakkō) à Yokosuka. Nous considérons cette contribution comme la plus précieuse parmi celles incluses dans ce numéro de Limes. En effet, la précieuse perspicacité de Tōmatsu, notamment dans sa réflexion aiguë sur le dualisme entre Armée et Marine dans les hiérarchies militaires japonaises (48), constamment développé à partir de la restauration Meiji (1868), est une donnée historique cruciale pour la compréhension de la première période Shōwa (1926-1945) et que nous avons rarement eu la chance de retrouver dans les études des noms blasonnés - plus pour la gloire que pour la valeur tangible - de la yamatologie contemporaine. Cette rivalité acharnée entre l'armée et la marine s'accentue avec l'implication directe du Soleil Levant dans les affaires chinoises, faisant que la première, c'est-à-dire l'armée, gagne de plus en plus de poids politique, jusqu'à s'imposer comme le pouvoir du gouvernement proprement dit, inaugurant ce que les spécialistes ont l'habitude d'appeler le militarisme japonais, également défini comme: "Vallée sombre" (黒い谷, "Kuroi Tani").
Tōmatsu fait référence à un changement en cours au Japon, empreint de malaise, qu'il décrit comme: "Une phase délicate de suspension, en attente de devenir autre chose". D'un côté, il y a les bureaucrates, en charge de la politique étrangère depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont perdu toute sensibilité stratégique parce qu'ils sont habitués à compter sur les États-Unis. [Enfin, il y a des amiraux et des généraux, nostalgiques de l'empire, qui voudraient inaugurer une nouvelle saison expansionniste, sans envisager les graves conséquences que cela entraînerait. Le résultat est un pays qui oscille entre un nihilisme indolent et une agressivité réprimée [...]". (47). En répondant précisément à chacune des questions que Fabbri lui pose, l'érudit japonais offre de nombreuses pistes de réflexion non seulement sur le positionnement politique et stratégique actuel de son pays, mais surtout en le reliant à l'histoire récente de l'Archipel. Pour cette raison, nous considérons cet entretien comme un élément bibliographique qui devrait être constamment présent dans les futures études géopolitiques sur le Japon.
Autres écrits plus utiles
Il y a cependant d'autres écrits d'un intérêt certain inclus dans ce volume. Par exemple, celle de Nishio Takashi: Long live the todōfuken (53-59), dans laquelle il aborde la question de savoir comment les préfectures du pays ne sont plus aujourd'hui de simples unités administratives, mais des "entités écologiques", linguistiques et culturelles, capables même de façonner l'identité individuelle des citoyens.
Nishio explique comment, dans le système de gouvernance japonais actuel (un mot mal aimé, à juste titre, par le courant géopolitique traditionnel), le système des autonomies locales (todōfuken) est le plus ancien et le plus consolidé. On dénombre pas moins de 47 todōfuken dans l'archipel, dont les noms et les limites sont restés quasiment inchangés depuis la restauration Meiji. Cependant, si ces unités d'autonomie locale semblent être restées inchangées, leurs caractéristiques politiques et sociales ont, au contraire, changé de façon spectaculaire depuis l'établissement de l'État centralisé de la période Meiji.
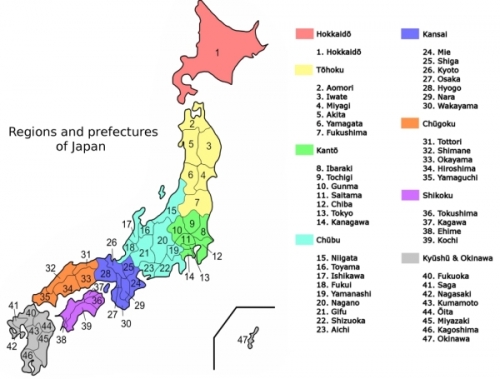
Le thème est traité dans l'article intitulé The Demographic Crisis and a New Meiji Restoration (73-78) de Stephen R. Nagy et est d'une actualité brûlante. Il y aborde la question du vieillissement très rapide de la population au Japon, une situation qui crée d'énormes problèmes sociaux et, surtout, économiques. Résoudre ce problème, même si une véritable solution ne semble pas avoir été trouvée par les dirigeants du pays, est d'une importance vitale. Par exemple, on tente de "remplacer" les gens par des robots - l'automate a toujours été un élément de grande fascination dans cette culture - pour certains emplois sociaux, bien que cela semble un remède plus proche de la science-fiction que de la vie réelle.
L'urgence démographique a incité le Parlement à adopter des politiques économiques, sécuritaires, migratoires et culturelles qui promettent de changer le visage du pays, même si dans le cœur des Japonais, à chaque grand changement, ils espèrent rester les mêmes.

Un thème que très peu de gens connaissent, et que presque aucun japonologue italien n'est coupable d'aborder, est celui que l'on trouve dans l'article de Ian Neary : Burakumin, the last ones will remain last (83-87), où il raconte la discrimination à l'égard des membres de la caste des exclus (en particulier les descendants des tanneurs de cuir), une forme de "racisme interne" qui révèle l'obsession toute japonaise de la pureté du sang. En fait, il existe même au Japon des agences d'enquête spéciales qui recherchent le passé des gens pour empêcher les mariages "mixtes". Toutefois, il convient de mentionner qu'en décembre 2016, la Diète (le Parlement japonais) a adopté une loi visant à promouvoir l'élimination de la discrimination à l'égard des burakumin (un terme que l'on peut traduire par "gens du village" ou "gens du canton"). C'est la première fois qu'un texte législatif fait référence à la ghettoïsation des communautés buraku.

Peu de pays ont lié leur histoire nationale à celle de leur marine autant que le Japon au cours des deux cents dernières années, comme nous le raconte Alberto de Sanctis dans son article : La rinascita della flotta nipponica nel nome delle antiche glorie (97-105). Au cours des quelques décennies entre les XIXe et XXe siècles, la flotte de combat japonaise (海軍, kaigun) a connu une croissance rapide et exponentielle qui lui a permis de jouer un rôle crucial dans l'histoire de l'Asie. Pendant des décennies, symbole incontesté du pouvoir impérial, la marine japonaise a contribué à faire du pays l'une des plus grandes puissances militaires de la première moitié du XXe siècle.

Il était bien sûr inévitable que la question de l'abdication prochaine du roi Akihito, prévue en 2019, soit abordée. Hosaka Yuji le fait dans : Le visage humain de l'empereur (121-125). Cet événement rappelle, bien qu'à distance, l'abdication du pape Benoît XVI le 28 février 2013, et fait prendre conscience au monde entier de la fragilité embarrassante, pour les Japonais, d'un souverain que, malgré les événements constitutionnels de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup dans l'Archipel n'ont jamais cessé de considérer comme divin. De plus, étant donné que le système actuel de l'empereur-symbole n'envisage pas un tel cas, la population japonaise a réagi avec une grande consternation à la décision de l'empereur (Tennō) d'abandonner essentiellement son rôle pour des problèmes personnels, comme si la nature humaine et divine de Tennō pouvait être séparée.

Enfin, si nous pensons à l'évolution du scénario politique de l'Extrême-Orient, il est très utile d'avoir abordé l'occupation japonaise (de 1910 à 1945) de la péninsule coréenne ; un épisode colonial qui a vu les Japonais commettre parfois de véritables crimes, notamment le phénomène des femmes dites de réconfort : de jeunes Coréennes contraintes de satisfaire les besoins sexuels de l'armée impériale. Une blessure, comme le raconte Antonio Fiori dans son article: Le détroit de Corée est toujours plus large (227-234), qui continue de peser sur les relations entre Tōkyō et la Corée du Sud, tandis qu'à l'opposé, l'enlèvement jamais élucidé de citoyens japonais par des agents de Pyongyang crée toujours des tensions. À cet égard, en Occident également, le cas de Yokota Megumi, qui a été enlevée par des agents infiltrés par la Corée du Nord, en novembre 1977, et n'est jamais rentrée chez elle, a fait la une des journaux. A ce sujet, le texte du journaliste Antonio Moscatello a été récemment publié : MEGUMI. Histoires d'enlèvements et d'espions de Corée du Nord (Naples, Rogiosi, 2017).
Le Japon ne fait pas de révolution, mais renaît !
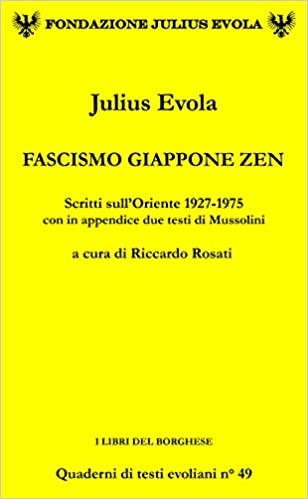 En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).
En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).
Le " Japon profond " dont on parle parfois n'est pas aussi connu qu'on le croit. Elle a été, et est encore, un noyau, essentiellement familier, au sommet duquel se dresse la figure du Souverain. L'américanisme de l'après-guerre a affaibli cette structure sociale exceptionnelle, exclusivement japonaise. Ce phénomène dissuasif de colonisation culturelle a été partiellement stoppé par la tragédie naturelle qui a frappé la région du Tōhoku le 11 mars 2011. Cet événement malheureux a cependant permis la renaissance du kizuna (絆, "lien"), recompactant toute une nation, alors hébétée par une aliénation de l'individu qui a atteint son apogée avec le phénomène des Hikikomori (引き篭り, littéralement: "ceux qui restent entre eux"), les jeunes qui s'enferment chez eux pendant des années, vivant une réalité faite uniquement d'Internet et de télévision, refusant tout contact direct avec les autres (à ce sujet, nous vous recommandons la série animée intelligente: Welcome to the N. H.K. [24 épisodes, 2006], réalisé par Yamamoto Yūsuke).
 Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.
Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.
L'éditorial du Limes se termine par une sorte de provocation: "Parmi les survivances des anciennes gloires, le bushidō ne semble pas briller. Pour la tristesse, nous l'imaginons, des esprits samouraïs" (29); presque comme si nous voulions nous moquer de manière incompréhensible de l'héritage politique et moral du grand Mishima Yukio, encourageant ainsi ce "Japon perdant", auquel nous avons consacré il y a quelques années un volume spécialisé agile (voir Riccardo Rosati, Perdendo il Giappone, Roma, Armando Editore, 2005). Nous ne pouvons certainement pas nous réjouir de cette position, car elle révèle précisément cette méconnaissance déjà stigmatisée du " Japon profond ".
Il est nécessaire de réaliser que ce que certains dirigeants conservateurs de l'Archipel, comme Ozawa Ichirō, voulaient et veulent encore aujourd'hui, c'est un retour à un "Japon normal" (22). En effet, un message, pas trop voilé, que l'on peut voir courir sous la surface de cette publication, est que le "révisionnisme historique" au Japon a des racines vigoureuses et que l'Occident atlantiste, qui est un point de référence pour un magazine comme Limes, ne le voit pas d'un bon œil. Encore une fois, bien que nous soyons loin de ces positions, nous ne pouvons pas nier l'exactitude des données ; il suffit de rappeler une figure telle que l'homme politique et écrivain Ishihara Shintarō, qui était aussi un ami de Mishima, qui a toujours soutenu que le Massacre ou le Viol de Nankin, perpétré pendant les six semaines qui ont suivi l'occupation de la ville par les troupes japonaises en décembre 1937, n'était que le résultat de la propagande du gouvernement de Pékin.
L'éditorial confirme également que quelque chose est en train de renaître au Soleil Levant, qui fera peut-être reculer les mains de l'histoire: "D'où le caractère unique de la nation japonaise, qui change tout en restant elle-même. Capable de voir sans être vu. Offrir au "barbare" le visage commode (tatemae), pour lui-même garder la pensée intime, authentique (hon'ne). Garder l'harmonie (wa), le bien suprême" (8). Ceci dit, pour rappeler combien le lexique est aussi un élément géopolitique, nous pensons que le titre même de ce livre est conceptuellement incorrect, étant donné qu'associer ce pays au mot "révolution" est mystifiant, puisqu'il l'a toujours abhorré, voir la Restauration (ou Renouveau) Meiji de 1868. D'ailleurs, l'un des plus grands spécialistes du Japon au siècle dernier, l'Italien Fosco Maraini, ne pensait pas différemment de nous: "Le cas japonais est extraordinairement intéressant en ce qu'il offre un exemple classique d'imperméabilité obstinée aux interprétations marxistes, de transparence lumineuse aux interprétations wébériennes" (Fosco Maraini, Ore giapponesi, Milan, Corbaccio, 2000, p. 13).
* Merci à la collègue orientaliste Annarita Mavelli pour ses suggestions et sa révision du texte.
@barbadilloit
Riccardo Rosati
16:01 Publié dans Géopolitique, Géopolitique, Histoire, Histoire, Revue, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques, revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
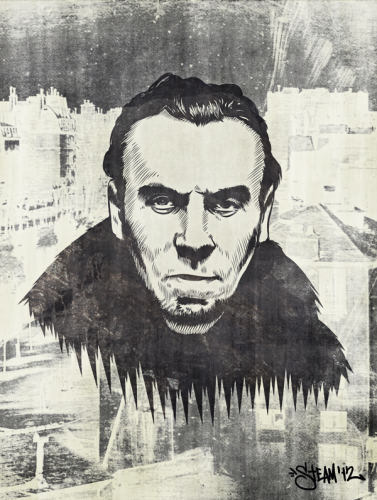
Parution du n°445 du Bulletin célinien
Sommaire :
Entretien avec Henri Godard
Céline vu par un journaliste nazi [1943]
François Gibault nous écrit
Céline parmi les maudits
Du voyage au bout de l’Enfer de Dante au Voyage au bout de la nuit de Céline
 Il est toujours divertissant de voir des intellectuels qui furent partisans d’un ordre totalitaire (communiste, puis maoïste) s’ériger en contempteurs des turpitudes idéologiques de Céline. La virulence de ces anciens commissaires politiques, jadis animateurs d’un “Front Culturel Révolutionnaire”, ne le cédait en rien à celle du pamphlétaire. Ainsi de Jean Narboni (1937), ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma à la pire époque de leur histoire. Il signe un petit livre, La grande illusion de Céline, s’apparentant davantage au libelle qu’à l’essai¹. Il y aurait pourtant des choses intéressantes à écrire sur la relation ambivalente de Renoir à Céline. Lequel avait détesté, comme on sait, le chef-d’œuvre de celui qui était son exact contemporain. Le film sortit sur les écrans la même année que Bagatelles où il fut étrillé pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le cinéma. Cela n’empêcha nullement Renoir de clamer son admiration à Céline. Pas seulement pour ses deux premiers romans mais aussi, plus tard, pour D’un château l’autre qualifié d’« épopée prodigieuse »². Il voulut même adapter Voyage au cinéma avant d’en être dissuadé par le producteur Pierre Braunberger.
Il est toujours divertissant de voir des intellectuels qui furent partisans d’un ordre totalitaire (communiste, puis maoïste) s’ériger en contempteurs des turpitudes idéologiques de Céline. La virulence de ces anciens commissaires politiques, jadis animateurs d’un “Front Culturel Révolutionnaire”, ne le cédait en rien à celle du pamphlétaire. Ainsi de Jean Narboni (1937), ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma à la pire époque de leur histoire. Il signe un petit livre, La grande illusion de Céline, s’apparentant davantage au libelle qu’à l’essai¹. Il y aurait pourtant des choses intéressantes à écrire sur la relation ambivalente de Renoir à Céline. Lequel avait détesté, comme on sait, le chef-d’œuvre de celui qui était son exact contemporain. Le film sortit sur les écrans la même année que Bagatelles où il fut étrillé pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le cinéma. Cela n’empêcha nullement Renoir de clamer son admiration à Céline. Pas seulement pour ses deux premiers romans mais aussi, plus tard, pour D’un château l’autre qualifié d’« épopée prodigieuse »². Il voulut même adapter Voyage au cinéma avant d’en être dissuadé par le producteur Pierre Braunberger.
Narboni pratique le billard à trois bandes : pour mieux accabler Céline, il épingle Armand Bernardini, et surtout George Montandon qui eut les mêmes phobies racialistes mais à un degré plus avancé. Le témoignage du fils (alors adolescent) du metteur en scène dépeignant, début 1938, un Céline menaçant Renoir du peloton d’exécution quand les Allemands seront là, se veut accablant. Vraisemblable alors qu’il voulait précisément empêcher un conflit jugé fratricide ? Testis unus, testis nullus… On n’ose pour autant qualifier ce témoignage de douteux. …Douteux ? C’est l’adjectif qu’utilise, par antiphrase, l’auteur pour caractériser le patronyme de Lucette Almansor, s’étonnant que Céline « ne semble pas s’en être avisé ni inquiété » (!). S’il connaissait mieux son sujet, il n’aurait pas subodoré « un lointain ancêtre arabe » et saurait que le bisaïeul de Lucette, Émile Almansor (1828-1897), enfant trouvé par la portière de l’hospice de Mortagne-au-Perche, fut ainsi dénommé par l’adjoint au maire, sans doute inspiré par ses lectures ou une page du dictionnaire³. Nulle origine arabe donc. Celle-ci ne préoccupait d’ailleurs nullement son époux : il pensait benoîtement qu’elle expliquait le goût de sa femme pour les danses orientales et espagnoles. Mais peut-on reprocher à Narboni de ne pas s’être sérieusement documenté, lui qui ne reconnaît même pas Lucette sur une photo où Céline « parle avec une femme au turban » ? Sur le parcours sinueux de Renoir, il y aurait eu bien des choses à rappeler. Après avoir été proche des anarchistes du groupe Octobre et de la bande à Prévert, il fut compagnon de route du PCF sous le Front populaire avant d’aller tourner un film dans l’Italie fasciste à la veille de la guerre, puis de faire, vainement, des offres de service à Vichy. Déçu, il s’exila, comme on sait, en Amérique où son admiration pour Céline demeura intacte4. « Je l’aime parce qu’il est passionné », disait-il.
• Jean NARBONI, La grande illusion de Céline, Éd. Capricci, 2021, 140 p. (17 €)
14:10 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
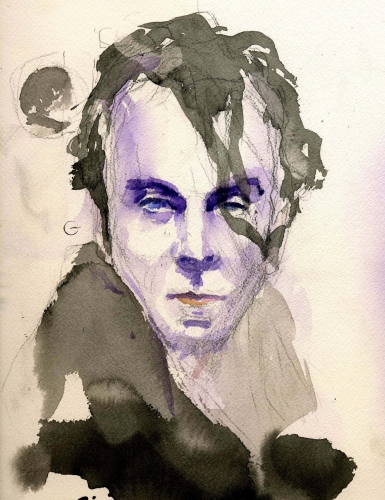
Parution du n°444 du Bulletin célinien
Sommaire :
 Céline à Rennes, en 1923
Céline à Rennes, en 1923
De Rosembly à Thibaudat
Chronologie 1944
L’Église vue par Thibaudat
Schopenhauer, la musique et Céline
Pierre-Marie Miroux nous écrit.
Calendrier Editorial
Plusieurs éditeurs avaient sollicité les ayants droit de Céline afin d’éditer ses manuscrits inédits. Comme c’était prévisible, c’est l’éditeur « historique » de l’écrivain qui publiera ce corpus. Si le contrat n’a pas encore été signé, un calendrier éditorial se précise.
Le mois passé, François Gibault et Véronique Chovin ont rencontré Antoine Gallimard pour esquisser les étapes de publication des différents textes. Celui-ci a souligné qu’ils sont tous les trois animés par « le même souci de restituer ces textes de manière intégrale. »¹ Et de rappeler qu’il avait signé avec Lucette un accord lui donnant un droit d’option pour les éventuels inédits à venir. Pour l’édition, il n’y aura pas de travail d’équipe à proprement parler mais, vu le temps à rattraper, d’une attribution lot par lot aux célinistes compétents. Le professeur Henri Godard concentrera son travail sur Casse-pipe dont il a déjà assuré l’édition (partielle) pour la Pléiade. Il s’agit donc de numériser sans délai les manuscrits mis en sécurité dans une banque. Seuls quelques céliniens privilégiés, comme Émile Brami et David Alliot, ont eu jusqu’à présent la chance de les voir. Dans un premier temps, deux ouvrages vont être publiés : le manuscrit intitulé « Guerre », vraisemblablement écrit après Voyage au bout de la nuit, et la version considérablement augmentée de Casse-pipe, soit plus de 400 feuillets inédits qui viendront compléter ceux déjà publiés en 1949². Ces deux manuscrits devraient voir le jour dans la collection “Blanche” à l’automne prochain. Ultérieurement une nouvelle édition du troisième volume de la Pléiade (qui comprend Casse-pipe et Guignol’s band) sera édité. Le directeur de cette collection, Hugues Pradier, assistait d’ailleurs à cette réunion. Quant aux autres manuscrits, Antoine Gallimard assure que tout le travail éditorial sera mené de telle sorte qu’il aboutisse avant 2031, échéance à laquelle l’œuvre de Céline tombera dans le domaine public. Dans dix ans exactement. Nul doute qu’il faudra moins de temps à Henri Godard (1937) pour achever ce travail. Alors qu’il avait annoncé avoir définitivement mis un terme à ses travaux sur Céline³, il est donc appelé à se remettre au travail. Tout se présente au mieux et il s’est naturellement déclaré ravi de cette réapparition de manuscrits. Tout en marquant son étonnement de l’avoir appris par la presse. Sans doute estime-t-il à juste titre que les ayants droit eussent pu songer que cette découverte le concernait au premier chef. Il s’agit maintenant d’établir un planning et de répartir le travail. Sans doute ne faudra-t-il pas compter sur les transcriptions effectuées par le receleur dont les éditeurs peuvent, par ailleurs, très bien se passer.
13:52 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution des numéros 441, 442 & 443 du Bulletin célinien
Sommaire du n°443 :
Céline en librairie
– La piste Rosembly
– Histoire d’une restitution
– Inventaire des manuscrits retrouvés
– Quand Libé s’invitait à Meudon
– Du braoum à la SEC
 Manuscrits retrouvés
Manuscrits retrouvésCéline n’a donc ni menti ni affabulé lorsque, dans sa correspondance et plusieurs de ces romans, il évoque ses manuscrits volés à la Libération. Extraordinaire affaire que ces trésors retrouvés près de 80 ans plus tard ! On la traite en détail dans ce numéro. L’écrivain revient ainsi à l’avant-plan de la scène littéraire, comme ce fut le cas lors de son éviction des “Commémorations nationales” ou de la réédition impossible des pamphlets par Gallimard. Cette découverte miraculeuse à suscité un important dossier de presse (écrite et audio-visuelle) nourri à la fois par l’importance de ces manuscrits et la controverse judiciaire. Cela a été aussi l’occasion pour les célinistes de disserter sur le sujet. Avec plus ou moins de perspicacité. La palme revient à Philippe Roussin qui s’était déjà distingué, il y a deux ans, en s’opposant de manière radicale à une édition scientifique des textes polémiques. Dans une interview à Libération, il assène plusieurs affirmations qui laissent pantois¹. À propos de la correspondance Céline/Brasillach, il affirme que le premier avait injurié le second dans la presse collaborationniste. C’est ignorer que l’accrochage eut lieu avant-guerre : Je suis partout avait publié un écho ironique lorsque les pamphlets furent retirés de la vente suite au décret Marchandeau. Mais Roussin sait-il que Céline fut très touché par la relecture de Voyage par Brasillach en 1943 et, plus encore, par le chapitre des Quatre Jeudis l’année suivante, où pour la première fois un critique reconnu lui donnait une place d’envergure dans une sorte d’histoire de la littérature française du XXe siècle ? Céline concluait son remerciement hâtif par un « Bien affectueusement », formule peu fréquente sous sa plume lorsqu’il s’adressait à un critique. À l’été 1943, il le pressa de demander comme lui un permis de port d’arme : « Si la plèbe se soulève un peu, ce ne sera sûrement pas pour assassiner les Allemands, le risque est trop grand ! mais pour nous assassiner, vous et moi et quelques autres ». À l’automne de cette année, il lui écrivit une lettre où il définit pour la première fois son style « tel le métro », « d’émotion en émotion » et en « transposition ». À propos des années londoniennes, Roussin écrit qu’il se pourrait que Céline s’y soit marié. A-t-il entendu parler de Suzanne Nebout et connaît-il les découvertes publiées il y a quinze ans sur le sujet ?² Pour parachever le tout, il se demande si la légende du Roi Krogold est une légende celte. Sait-il enfin que Céline la qualifiait lui-même de « légende gaélique » ? Tant de méconnaissance confond…
Parallèlement les jugements moraux n’ont pas été absents tant il apparaît impossible de parler de cette découverte sans rouvrir le procès Céline. À la télévision, David Alliot n’a pas craint de le qualifier d’« ordure humaine »³. On est loin de la position de Henri Godard dont je citai ici une déclaration qui lui avait été erronément attribuée. Il m’avait alors adressé ce rectificatif : « Je n’ai jamais prononcé pour mon compte la phrase “Céline est un pur salaud” qui m’est prêtée par l’AFP. Tout au plus ai-je pu la citer pour m’en dissocier, et le journaliste aura fait la confusion. J’avais négligé jusqu’à présent de faire la rectification, mais je vois que certains de vos lecteurs s’émeuvent de trouver cette phrase dans ma bouche, je les comprends, c’est pourquoi je vous serais reconnaissant de signaler ce démenti. »4
Sommaire du n°442 :
Entretien avec Jin Longge
– Céline dans Paris-Midi [1935-1939]
 C’était assurément une belle idée de choisir cette date anniversaire pour la création de la Société des lecteurs de Céline. Elle entend promouvoir son œuvre sans esprit sectaire. Bien des projets sont en gestation. Nul doute que les lecteurs du Bulletin se feront un plaisir, sinon un devoir, d’y adhérer. On lira dans ce numéro l’allocution prononcée par Émeric Cian-Grangé, qui va présider aux destinées de cette nouvelle association¹.
C’était assurément une belle idée de choisir cette date anniversaire pour la création de la Société des lecteurs de Céline. Elle entend promouvoir son œuvre sans esprit sectaire. Bien des projets sont en gestation. Nul doute que les lecteurs du Bulletin se feront un plaisir, sinon un devoir, d’y adhérer. On lira dans ce numéro l’allocution prononcée par Émeric Cian-Grangé, qui va présider aux destinées de cette nouvelle association¹.
Il y a donc soixante ans que disparaissait le grand fauve de la littérature française. Juillet 1961 : une vague de chaleur submerge la France, avec une nette tendance orageuse. C’est la présence d’un anticyclone, solidement ancré sur l’Europe centrale, qui commande sur l’hexagone un chaud flux du sud. Ce samedi 1er juillet, la chaleur est étouffante. Lucette, levée à six heures, trouve Céline à la cave, l’air absent, en quête d’un peu de fraîcheur. Elle le convainc de remonter dans sa chambre et de s’allonger. « Ferme tout. Je ne peux pas supporter la lumière ». Photophobie annonciatrice de l’hémorragie cérébrale qui le foudroiera vers dix-huit heures. Afin de ne pas être importunée par les journalistes, Lucette demandera aux amis de respecter la consigne de silence. Le 3 juillet, elle laisse publier un communiqué sur l’état de son mari « qui s’est subitement aggravé » [sic]. L’inhumation aura lieu le lendemain en présence de Claude Gallimard, Roger Nimier, Robert Poulet, Marcel Aymé, Lucien Rebatet, Jean-Roger Caussimon, Max Revol, Serge Perrault, Jean Ducourneau et deux journalistes : Roger Grenier (France-Soir) et André Halphen (Paris-Presse). Soixante plus tard, la fidélité est au rendez-vous. Sous un ciel radieux, quelques céliniens sont là : David Alliot, Laurent Simon, Pierre de Bonneville, Gérard Silmo,… Mais aussi diverses personnalités : Daniel Heck, président du Cercle des amis de Louis Bertrand, le peintre Serhgei Litvin Manoliu, Patrick Wagner, directeur de la revue Livr’arbitres, le libraire Pierre-Adrien Yvinec, l’écrivain Patrick Gofman, Pascal-Manuel Heu, spécialiste du 7e art, le journaliste Francis Puyalte,… Et des anonymes, simples admirateurs de Céline, qui ont tenu à assister à cet hommage. Cet anniversaire ne fut guère signalé par la presse². Et naturellement pas dans la revue municipale. Il faut remonter à plus d’une décennie pour y trouver trace de Céline dans un article consacré à quelques personnalités reposant au cimetière des Longs-Réages³.
Le même jour se tenait à Paris une vente exceptionnelle : celle de la collection de mon ami Patrice Espiau (†)4 qui consacra une bonne partie de sa vie à la constituer, réunissant de multiples éditions originales sur grand papier, mais aussi tout ce qui a été édité sur Céline : livres, plaquettes, revues, thèses, affiches, catalogues, etc. Une édition originale de Nord sur vélin (enrichi d’une page manuscrite), superbement reliée par Jean-Paul Miguet, fut adjugée pour plus de 20.000 €. La gloire posthume de l’écrivain est aussi faite de cela.
13:17 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
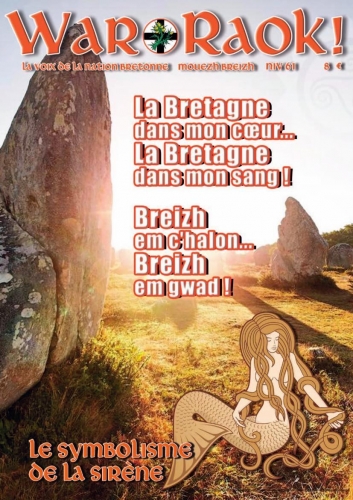
Parution du n°61 de la revue bretonne War Raok
EDITORIAL
Peut-on parler de souverainisme breton afin d’assurer l’épanouissement de l’identité bretonne?
par Padrig Montauzier
En Bretagne nous sommes, depuis longtemps, familiarisés avec les termes autonomistes, indépendantistes, voire séparatistes. Une nouvelle dénomination semble voir le jour depuis quelque temps, celle de souverainisme breton ! Comment peut-on définir succinctement ce nouveau concept ?
Toute nation qui ne s’administre pas elle-même connaît une rapide décadence. La Bretagne depuis la perte de son indépendance, de l’union de 1532 et plus depuis son annexion totale de 1790, en donne un exemple frappant. La Bretagne, enserrée dans l’un des États les plus centralisé d’Europe, n’a pas la possibilité de « s’auto-déterminer ». Elle n’a pas non plus la possibilité de « s’auto-organiser » ni de « s’auto-gérer ».

L'idée de la souveraineté de la Bretagne est fondée sur une vision et une interprétation nationalistes des faits historiques et des réalités sociologiques de la Bretagne. L’argument clé consiste à soutenir que la population bretonne forme un peuple distinct qui, dans le cadre du système politique français, ne peut exister qu’à titre de minorité ethnique, ce qui implique que le peuple breton ne peut se diriger lui-même et que son destin dépend totalement de l’État français et de ses gouvernements. Accepter un tel statut de minorité signifierait que les Bretons donnent leur accord à une totale subordination impliquant qu’ils renoncent à leur identité propre.
Cette souveraineté ne se fera pas contre la France, mais pour la Bretagne !
On peut imaginer que, dans un premier temps, dans une première étape, la Bretagne dispose d’un statut de large autonomie administrative et politique comme cela est mis en pratique aujourd’hui tout près de nous en Europe: en Catalogne, en Écosse, au Pays Basque, en Flandre… etc.
Ce positionnement est une rupture totale avec le centralisme et le jacobinisme français qui tuent les peuples et avec le dogme de « l’une et indivisible » contre nos libertés. On peut alors parler de souveraineté-association, combinaison de deux concepts : l'obtention de la souveraineté de l'État breton et la création d'une association politique et économique entre le nouvel État souverain et la France. On peut définir ce statut de souveraineté partagée ou co-souveraineté comme étant les pouvoirs d'une Bretagne de faire ses lois, de prélever ses impôts et d'établir ses relations extérieures. Une démarche loin d’être utopique, elle est même au contraire parfaitement rationnelle et le peuple breton a toutes les aptitudes nécessaires pour l’assumer. Cette souveraineté souhaitée rendra donc aux représentants du peuple breton le droit de gérer les affaires bretonnes et permettra ainsi à la Bretagne de protéger ses intérêts matériels, d’assurer son développement économique, de défendre ses libertés culturelles spécifiques et ses intérêts spirituels.

Ainsi, les Bretons pourront bâtir une Bretagne authentiquement bretonne tout en s’intégrant au monde moderne par l’enrichissement de ses propres valeurs et le refus d’un repli ou d’une autarcie mortelle. La Bretagne sera une terre de libertés, non pas formelles mais réelles sur tous les plans.
La situation actuelle de peuple colonisé n’a rien de stimulant, rien qui invite au dépassement de soi ou qui pousse à l’audace créatrice. À ce destin, courbé sous les vents de l’histoire, le souverainiste préfère les risques de vie qu’offre l’indépendance. C’est le sens de l’appartenance, la définition de l’identité, qui est l’enjeu majeur de la souveraineté. Les Bretons ont à choisir entre le statut de minorité et le statut de peuple à part entière.
Cette émancipation politique, économique, sociale et culturelle du peuple breton, ainsi que l’édification d’une Bretagne enfin maîtresse de ses destinées personnelles dans le respect d’une interdépendance qui l’unira à ses voisins européens… peut parfaitement convenir à une définition du souverainisme breton.
Les Bretons doivent être en première ligne pour revendiquer cette souveraineté de la Bretagne avec la tranquille assurance de disposer des atouts économiques suffisants pour afficher cette ambition.
Mais les Bretons sauront-ils se doter d’un tel projet de société ?
Padrig MONTAUZIER
Sommaire War Raok n° 61
Buhezegezh vreizh page 2
Editorial page 3. Padrig Montauzier
Buan ha Buan page 4
Société
Le tatouage traditionnel celtique page 9. Ronan Danic
Politique
Kofi Yamgnane, ses mémoires d’outre-haine page 10. Erwan Houardon
Culture bretonne
La destruction de la langue bretonne page 14. Louis Melennec
Tradition
Le symbolisme de la sirène page 16. Riec Cado
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton page 19. Donwal Gwenvenez
Histoire de Celtie
Highland titles page 23. Jérôme Le Bouter
Tribune libre
Les origines de la culpabilité blanche page 24. Tomislav Sunic
Histoire de Bretagne
Enfants de la Chouannerie, sublimes cœurs de héros page 28. Youenn Caouissin
Environnement
L’éolienne, nouveau symbole de la Bretagne ? Page 30. Erwan Houardon
Civilisations celtiques
Littératures écrites et orales des civilisations celtiques page 32. Fulup Perc’hirin
Nature
Les petits réverbères de la nature page 36. Youenn Caouissin
Lip-e-bav
Un repas breton page 37. Youenn ar C’heginer
Keleier ar Vro
L’État français contre les langues “régionales” page 38. Meriadeg de Keranflec’h
Bretagne sacrée
Bretagne, terre de châteaux page 39. Per Manac’h

17:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, revue, terre d'europe, pays celtiques, celtisme, celtitude, affaires européennes, régions d'europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
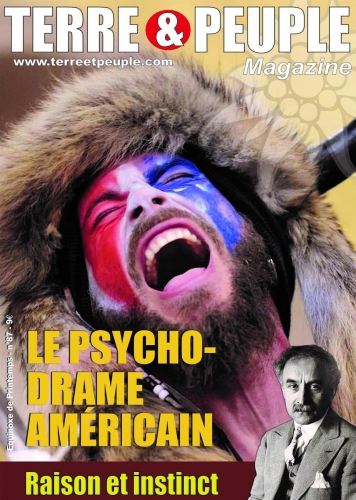
Compte rendu de lecture de TERRE & PEUPLE MAGAZINE n°87
Le T&P Magazine 87 est centré autour du thème « Le psychodrame américain ».
Dans son éditorial intitulé « Liberté » Pierre Vial dénonce le Système qui abuse du Covid pour nous soumettre à des règles castratrices. Citant Maurras, pour qui le désespoir est la sottise majeure, il appelle les identitaires à la résistance.
Le Comité directeur de Terre & Peuple réagit à la mise en scène Les Rivières Pourpres diffusée sur France 2, bobard d’or 2021 selon quoi Terre & Peuple mettrait le feu à des églises ! Des milliers de téléspectateurs découvrent ainsi son existence, voire sa démarche.
Claude Perrin, sous l’intitulé « Raison et Instinct », médite sur ces deux modes de lecture interne (inter-lect) de la réalité. Il souligne d’emblée que la laideur ne se compense pas par la fonctionnalité et que la beauté est aussi un mode d’expression de la vérité. Certaines qualités de l’homme qui ne relèvent pas de la rationalité finissent par disparaître du vocabulaire. Il en est ainsi de l’honneur, de la honte, du respect. Le sens du sacré tend à disparaître. Il n’y a plus d’amis ni d’ennemis, mais des individus qui composent selon leurs intérêts, là où le lien qui attachait Montaigne à La Boétie relevait de l’instinct. A présent, l’indigence du vocabulaire pèse de plus en plus dans l’agressivité. Tout est négociable. Souvent supérieures, les femmes revendiquent l’égalité que leur refusaient Rome comme le christianisme. Dieu crée Adam et ensuite une Eve pécheresse repentante. La Loi Salique exclut les femmes de la succession à la couronne de France. La lutte contre l’ignorance sert de prétexte à l’endoctrinement. Avec la disparition du latin, les cadres perdent le sens des mots. Le métier procure une prise sur le réel. Socrate oppose le savoir prétentieux des rhéteurs à la compétence des techniciens, médecins ou cordonniers. Montaigne goûte la vision des femmes, qui flairent d’instinct plus que de raison.

Pierre Vial ouvre le dossier « Le Psychodrame américain » en soulignant, pour ceux qui estiment n’avoir pas le temps de s’occuper des Américains, que ceux-ci s’occupent d’eux. Lors de la Première Guerre Mondiale, ils ont d’abord endetté les Européens, en leur vendant des armes, avant de venir finalement au secours de la victoire. Ils ont remis cela, en plus fort, lors de la Seconde. Ils ont ensuite vassalisé le monde « libre », pour le protéger de « l’Hydre rouge ». Il faut toutefois se garder de confondre les Sudistes fidèles avec les Yankees qui avancent leurs pions, au besoin par la terreur, sur la surface du globe. La prochaine cible est l’Iran. Moscou et Pékin, partisans d’un monde multipolaire, vont-ils laisser faire un impérialisme US au sein duquel des lignes de fracture se marquent.
Pierre Vial démontre ensuite que Joe Biden poursuit la politique sioniste de Donald Trump et même qu’il la développe.
Alain Cagnat retrace la « Genèse des fractures américaines », qui fragilisent, si pas la cohésion des Etats-Unis eux-mêmes, en tout cas celle de leurs populations, hétéroclites souvent jusqu’à l’antagonisme et les massacres. Au XVIIe siècle, la culture du tabac avait permis le développement et la prospérité d’une colonie en Virginie, grâce d’abord à une main d’œuvre antillaise noire, bientôt remplacée par des esclaves noirs africains. En Angleterre, la persécution des puritains motive ceux-ci à s’expatrier en Amérique du Nord, que la caste des WASP considère alors avoir reçu la mission divine d’exploiter. Les petits fermiers y survivent à peine de leur labeur et seules les grandes exploitations peuvent se permettre de nombreux esclaves. La Grande Famine de 1845 fait affluer des Irlandais en masse, suivis d’Allemands et d’Italiens dans le dernier quart du siècle. Papistes comme les Irlandais, ces derniers sont comme eux persécutés, mais s’en vengent par leurs mafias et leur prolificité. En 1881, suite aux pogroms en Russie, deux millions de Juifs Ashkénazes s’organisent (B’nai B’rith) et débarquent. Dynamiques et solidaires, ils sont ouvriers pour 60% en 1900, mais seront devenus employés pour 75% en 1930. Désintéressés du sort des Juifs européens durant la Seconde Guerre Mondiale, ils vont ensuite culpabiliser les opinions publiques occidentales (« qui savaient et n’ont rien fait »). Ne représentant que 2% de la population US, ils sont 16% du corps médical et 11% des avocats. Les Indiens, estimés 10 millions au XVe siècle, ne sont plus que 250.000 en 1890. Dès 1703, les autorités achètent les scalps 40£ la pièce. Leur ségrégation officielle n’est abolie qu’en 1948 pour l’armée et 1954 pour l’enseignement public. A présent, les Black Muslims et les Black Panthers prônent la violence. Le pasteur Martin Luther King, non-violent, qui avait obtenu la suppression de toute ségrégation, est assassiné. Les émeutes font de nombreux morts. La guerre du Vietnam (58.000 morts) passe, chez les Noirs, pour avoir été le sacrifice de la chair à canon noire. Entre temps, les USA subissent une invasion latino (en 2016 : 58 millions soit 18%), ce qui en fait la Nouvelle Babel, plutôt que la Nouvelle Jérusalem.
Alain Cagnat procède ensuite à l’écographie du cancer mental qui a affecté les campus américains dans l’euphorie de l’après-guerre. Une jeunesse dorée s’y ennuie et se pique alors de renverser la table. En 1964, à l’université de Berkeley, le Free Speech Movement met en cause la surconsommation et revendique plus liberté au sein du campus, tant sexuelle que politique. La French Theory (Sartre-Beauvoir) amplifie le mouvement, qui se gauchise jusqu’aux sympathies trotskistes et maoïstes. En 1968, un million d’étudiants font grève. Les noirs rallient les Black Panthers et les homos le Front de Libération Gay. Mais le soufflé a vite fait de retomber. Dans le rejet de l’American Way of Life, un mouvement de contre-culture rassemble alors une jeunesse beatnik, pauvre et désabusée, ou hippie (make love not war), ou Yippie, qui va fournir sa substance à l’islamo-gauchisme. Le prolétariat blanc s’est embourgeoisé et c’est parmi les immigrés musulmans que, dans les universités, la révolution peut trouver, faute de lutte des classes, un ferment d’égale effervescence. Dans les universités, où les mâles blancs sont dominants, va se développer un ethnomasochisme : seul le blanc est raciste et doit s’en repentir. La colonisation est un crime contre l’humanité. La réparation en est due jusqu’à la fin des temps. Les Blancs sont tenus à discrimination positive, notamment par relèvement des cotations scolaires et par des quotas dans les promotions. Le féminisme a été dynamisé dès 1965 dans les campus, où les Women Studies sont décomposées en Feminist Studies et en Gender Studies, et ensuite en Dishability Studies (handicapés) et en Fat Studies (obèses). Le Mouvement de Libération des Femmes réduit celles-ci à une minorité à protéger ! La criminalisation de l’homophobie des deux sexes introduit une dictature dans nos sociétés occidentales. Le mariage homosexuel nous a été imposé. Les couples de lesbiennes revendiquent la PMA. La Théorie du genre affirme que celui-ci est le produit de l’éducation. Des LGBTQ++ à la Théorie du Genre et de la Cancel Culture au Woke, les mouvements de déconstruction se bousculent pour détricoter cinq mille ans d’histoire.
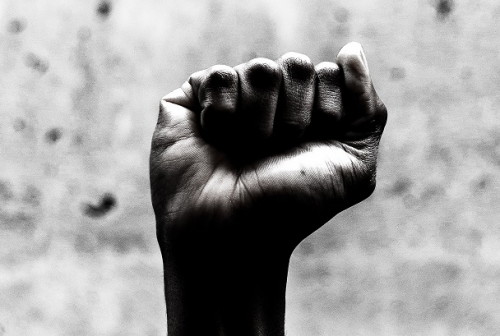
Robert Dragan décortique le « Drame shakespearien » de la réélection sabotée de Trump, qui au soir du scrutin jouissait d’une avance confortable. Dans la nuit, des camions déchargent des votes par correspondance démocrates à 90%. Une seule plainte pour irrégularité est remontée à la Cour Suprême qui l’a rejetée. Soutenu massivement par les médias, Biden se proclame vainqueur. L’Etat profond a triché. Le 6 janvier, les Grands Electeurs doivent être validés au Capitole. Trump y convoque 100.000 partisans, qui noient les minces cordons de police. On compte 5 morts, dont trois accidents de santé et la jolie Ashli Babbitt (filmée par ses amis, abattue par un civil !). La presse reprend la qualification démocrate des événements : une révolte concertée. Le 7 janvier, Trump prend dans un discours des distances à l’égard des manifestants et appelle à l’apaisement. Le Vice-Président Mike Pence refuse de procéder à son arrestation dans le cadre d’un impeachment. Le peuple américain a manqué sa révolution : on relève un écart anormal entre les sondages et autres estimations qui tous prédisaient la réélection, Trump remportant tous les états baromètres. Il importe de rectifier la caricature médiatisée de Trump : il est beaucoup plus profondément intelligent et social que la silhouette grossière servie au public. Son principe de base est de motiver les meilleurs à se surpasser au service des autres. Il n’est pas intéressé par la politique, sauf à la diriger effectivement.
Jean-Patrick Arteault situe le Grand Reset du monde occidental entre la dictature sanitaire du Covid 19 et populisme patriote trumpiste, frustré par les trucages massifs, mais optimiste jusqu’au déni des réalités. La mouvance populaire US QAnon a hissé Trump au rang d’une figure christique : « Ayez la foi : c’est déjà gagné ! », par refus du désespoir. Ces naïfs ne savent pas nommer les maîtres du monde. Mais quel camp servent-ils. Ne s’agit-il pas d’une opération conçue pour échouer, pour démotiver le commun d’agir ? La prise du Capitole est-elle à rapprocher de l’aventure des Gilets Jaunes ? Les incidents montés en épingle pour discréditer Trump et ses patriotes, la désactivation des comptes du président en exercice, les GAFAM s’érigeant en censeurs ? Soulagés de leur peur d’être délogés du pouvoir, les progressistes sont déterminés à écraser la réaction populiste, en s’appuyant sur les mouvances antifa et les Black Lives Matter. La crise sanitaire permet à l’oligarchie de sanctionner le peuple méfiant et indiscipliné. L’épisode Trump a fait peur, ce qui doit se payer. Au sein du Bloc Occidental, le bloc populaire des enracinés (les somewhere) est confronté à la caste élitaire des mondialistes (les anywhere). Leur affrontement donne lieu à une nouvelle Guerre Civile, devenue virulente dès l’élection de Trump. On lui a fait subir toutes les avanies, Covid compris. A peine intronisé, Biden rétablit le flux migratoire. La dictature sanitaire dévitalise le travail indépendant. La brutalité de l’agression stimule les éveillés. Ecartés du pouvoir durant quatre ans, les GAFAM sanctionnent les trumpistes. Les vaincus jacksoniens disposent de deux atouts : le grand nombre et le caractère fédéral des USA qui fractionne les fronts. La crise de 2008 révèle la fragilité du système. La démocratisation de la culture pourrait être fatale à la démocratie, la participation étant remplacée par l’ingénierie sociale. Le processus est vendu sous la dénomination Grande Réinitialisation. Par sa reprise en main par la Pastorale de la Terreur, la crise Covid a réalisé par la menace sanitaire l’appauvrissement planifié des classes moyennes et la précarisation des classes populaires.

Alban de Brissach esquisse le futur des Américains pressenti par la science-fiction. Il prend acte du pouvoir sans limite des GAFAM, qui peuvent priver de parole et d’argent un président US. Des entreprises de la Côte Ouest abusent de leur oligopole sur les technologies de l’information. En 1970 déjà, Ira Levin avait imaginé l’ordinateur Uniord qui contrôlait l’ensemble de l’information, gérant la santé physique et mentale et la baisse de l’entrain. On relèvera qu’aujourd’hui, sous l’accusation commode de désinformation, les GAFAM ont suspendu de nombreux comptes d’opposants à la vaccination !
Robert Dragan retrace l’histoire de l’économie allemande après la défaite de 1918. Les recettes fiscales sont alors en lourd déficit et les épargnants sont ruinés. La Reichsbank est à ce moment gouvernée par un conseil qui compte moitié d’étrangers. Elle est contrainte de gager 40% des Reichsmark sur l’or et 60% sur des devises. En 1933, le pays est aux abois, avec quinze millions de chômeurs. Une Troisième Voie économique redresse alors la situation en s’appliquant à faire coïncider l’offre avec la demande. Une commission des prix veille à stabiliser ceux-ci. A partir de 1933, le régime lutte contre les effets de la mondialisation et de la charge des réparations et dettes de la guerre. Il veille à procurer du travail à tous et double ainsi ses recettes fiscales, ce qui lui permet de pratiquer une politique sociale. Le chômage a très vite été résorbé. En 1939, la production a entre-temps progressé de 25%. Le redressement s’est accompagné d’un gonflement de l’épargne des particuliers. De 1933 à 1939, les prix à la consommation n’ont augmenté en moyenne que de 1,2% par an.

Robert Dragan relève ensuite l’existence relative de la Résistance, ses hauts faits et ses méfaits, notamment dans sa participation à la reconquête et à la guerre après la guerre (notamment dans les rangs de la Légion Etrangère). Il retrace par ailleurs l’épouvantable martyre des millions d’Allemands « déplacés », expulsés de leur patrie dans les provinces orientales et celui des millions de prisonniers de guerre (dont trois en URSS), dont 15% moururent. Si 5,4 millions d’Allemands ont péri pendant les hostilités, ce ne sont pas moins de 8,8 millions qui ont dépéri et sont morts après la fin de celles-ci.
Pierre-Paul Joubert rouvre le débat sur l’hydroxychloroquine (HCQ), ouvert par le Professeur Didier Raoult, de l’IHU de Marseille, selon qui l’HCQ réduirait de 70% le taux de létalité du Covid 19. Est effectivement troublante la différence du nombre des morts de l’épidémie entre Paris et Marseille. Le Pr. Raoult n’en est pas moins accusé de « charlatanisme » par l’ordre des médecins ! En Chine, la létalité du virus est très basse en comparaison de celle de l’Occident, Russie et USA compris. Les mutations du virus se succèdent. Les prédictions désastreuses ne se sont pas vérifiées et de loin : 6.500 décès au lieu des 70.000 promis. Il faut rétablir la liberté de prescription et de soins telle que la pratique le Pr. Raoult. Pour Macron, LA solution est le vaccin (qui pour Raoult est de la science-fiction). Les politiques ont sciemment utilisé la peur pour imposer des mesures inutiles, que d’aucuns assimilent à un crime contre l’humanité.
Georges Hupin.
00:44 Publié dans Nouvelle Droite, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, pierre vial, revue, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
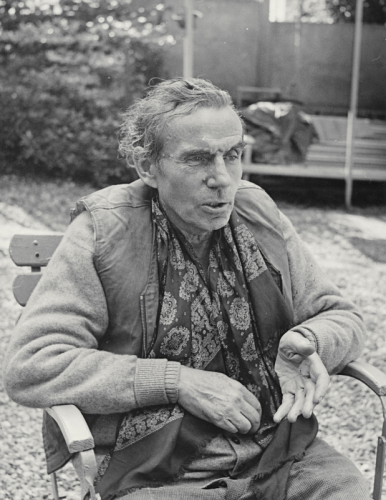
Parution du n°440 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
François Marchetti nous a quittés
Céline dans Paris-Midi (1ère partie)
Actualité célinienne
• Antoine LABYE, « Une heure avec Pierre Mertens », RCF [Liège], 8 mars 2021.
09:58 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
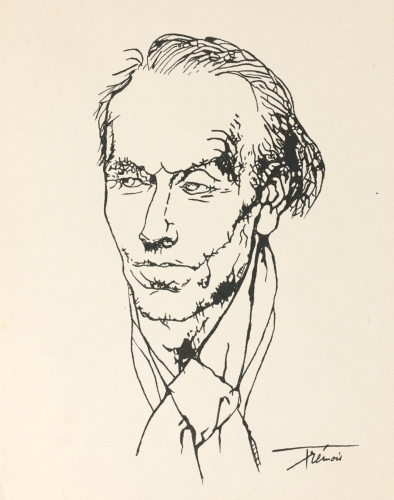
Parution du numéro 439 du Bulletin célinien
Sommaire :
Quand Chateaubriand prédisait la venue de Céline…
Le Journal de Rebatet
Céline dans Juvénal
Quand le fantôme de Céline met la Préfecture de police en émoi [archive]
 Il est périlleux pour un comédien de lire Céline. Le risque est d’en faire trop, de souligner les effets, bref de surcharger. Voilà un écueil qu’évite sans conteste Denis Podalydès. Après nous avoir donné une lecture intégrale de Voyage au bout de la nuit ¹, il nous gratifie, cette fois, de celle de Mort à crédit, sous la forme de deux disques compacts (format mp3). Autant le dire d’emblée : il ne fait pas l’unanimité auprès des céliniens si l’on en juge par les avis propagés sur les réseaux sociaux de l’Internet. Les uns goûtent peu sa lecture jugée monocorde même si elle est motivée par le souci de ne pas verser dans l’expressionnisme facile et vulgaire de certains interprètes. Les autres, la trouvent très fine, à l’opposé des lectures outrées qui abondent. En atteste ce commentaire : « Pas le plus musical, pas le plus jazzy, mais une véritable fragilité qui révèle de très belles nuances dans le texte… J’ai longtemps préféré Luchini pour son interprétation très “dansante” ; celle de Podalydès me paraît aujourd’hui tellement plus subtile, moins caricaturale. » À propos de sa lecture de Voyage, l’écrivain Thomas Compère-Morel estime qu’il a trouvé « la respiration parfaite de l’écriture célinienne pour nous en restituer la force brute ». Le critique littéraire Grégoire Leménager renchérit : « Loin de la gouaille de Michel Simon comme des éruptions jubilatoires de Luchini, ce sociétaire de la Comédie-Française lit Céline comme il lirait du La Bruyère. Soudain très grand siècle, avec une sobriété qui confine à la pureté, le saisissant bavardage de Bardamu y devient ce qu’il est aussi : un immense texte classique, qui oppose la beauté d’une langue à la trivialité du monde. » Il faut dire que Podalydès a l’intelligence de s’adapter au canal de diffusion : il ne s’adresse pas ici au public d’une salle de théâtre mais à une seule personne écoutant le texte dans l’intimité.
Il est périlleux pour un comédien de lire Céline. Le risque est d’en faire trop, de souligner les effets, bref de surcharger. Voilà un écueil qu’évite sans conteste Denis Podalydès. Après nous avoir donné une lecture intégrale de Voyage au bout de la nuit ¹, il nous gratifie, cette fois, de celle de Mort à crédit, sous la forme de deux disques compacts (format mp3). Autant le dire d’emblée : il ne fait pas l’unanimité auprès des céliniens si l’on en juge par les avis propagés sur les réseaux sociaux de l’Internet. Les uns goûtent peu sa lecture jugée monocorde même si elle est motivée par le souci de ne pas verser dans l’expressionnisme facile et vulgaire de certains interprètes. Les autres, la trouvent très fine, à l’opposé des lectures outrées qui abondent. En atteste ce commentaire : « Pas le plus musical, pas le plus jazzy, mais une véritable fragilité qui révèle de très belles nuances dans le texte… J’ai longtemps préféré Luchini pour son interprétation très “dansante” ; celle de Podalydès me paraît aujourd’hui tellement plus subtile, moins caricaturale. » À propos de sa lecture de Voyage, l’écrivain Thomas Compère-Morel estime qu’il a trouvé « la respiration parfaite de l’écriture célinienne pour nous en restituer la force brute ». Le critique littéraire Grégoire Leménager renchérit : « Loin de la gouaille de Michel Simon comme des éruptions jubilatoires de Luchini, ce sociétaire de la Comédie-Française lit Céline comme il lirait du La Bruyère. Soudain très grand siècle, avec une sobriété qui confine à la pureté, le saisissant bavardage de Bardamu y devient ce qu’il est aussi : un immense texte classique, qui oppose la beauté d’une langue à la trivialité du monde. » Il faut dire que Podalydès a l’intelligence de s’adapter au canal de diffusion : il ne s’adresse pas ici au public d’une salle de théâtre mais à une seule personne écoutant le texte dans l’intimité.
On ne compte plus les grands comédiens qui ont lu Céline : de Michel Simon à Pierre Brasseur en passant par Arletty, Le Vigan, Georges Wilson et bien entendu Luchini. Ce qui n’est guère connu, ce sont les lectures qui n’ont pas fait l’objet de disques. Ces trésors figurent dans les archives de l’Institut national de l’audiovisuel, ayant été diffusés jadis sur les ondes des radios publiques, particulièrement France-Culture. Plusieurs comédiens de grand talent ont, en effet, prêté leur voix à des émissions consacrées à Céline. Citons en vrac Jean-Louis Barrault, Michel Bouquet, Marcel Bozzuffi, Alain Cuny, André Dussolier, Julien Guiomar, Jean Négroni, Michel Piccoli, pour n’en citer que quelques-uns. Celui qui se dégage du lot, à mon sens, est Michel Vitold, excellent dans deux registres différents : un extrait éruptif de Bagatelles et un passage déchirant de Féerie où l’écrivain évoque sa mère décédée alors qu’il était en exil ². Une idée que je soumets à Laurent Vallet, président de l’I.N.A. (nommé en 2015 et renommé à ce poste en 2020) : éditer un disque consacré à Céline reprenant quelques unes de ses lectures d’anthologie.
• Louis-Ferdinand Céline. Mort à crédit. Lecture intégrale par Denis Podalydès. Gallimard, coll. “Écoutez lire”, 2021. Deux disques compacts. Durée : 23 heures. (26,90 €)
00:28 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
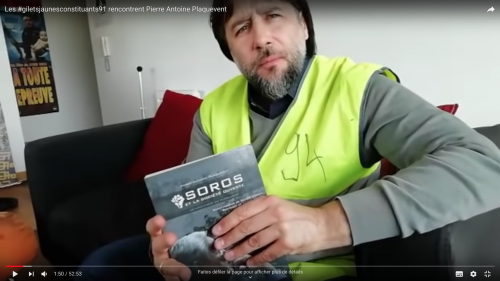
Dernières publications sur "Strategika"
Chers amis,
Voici mes derniers travaux publiés sur Strategika :
- "Société ouverte vs Chine : le choc des globalismes" (première partie)
00:25 Publié dans Actualité, Blog, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-antoine plaquevent, strategika, blog, revue, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
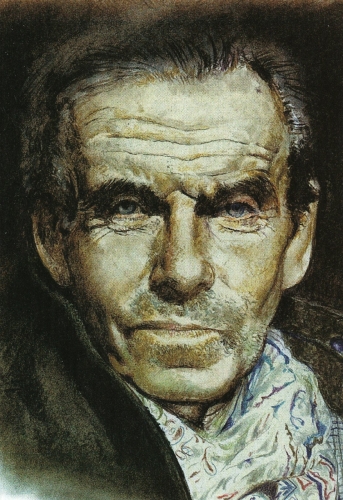
Parution du numéro 438 du Bulletin Célinien
Sommaire :
Céline et Gide
András Hevesi, premier traducteur de Céline en hongrois (2e partie)
L’Éternel féminin dans Voyage au bout de la nuit
 Au-delà de la mort, la fidélité de Bernard Morlino à Emmanuel Berl (1892-1976) est admirable. Ses nombreuses conversations rue de Montpensier, où Berl habita pendant 40 ans, furent son université. Outre une biographie, il poussa cette fidélité jusqu’à récolter à la Bibliothèque Nationale les articles de Berl pour en faire un recueil qui fut édité par Bernard de Fallois. Aujourd’hui, il est à l’origine de la réédition de Prise de sang, initialement paru en 1946, dans lequel Berl s’interroge sur la place des juifs en France, lui qui s’était toujours considéré français avant d’être juif. Curieux personnage qu’Emmanuel Berl. Appartenant à la même génération que Céline, il devint, comme lui, un pacifiste viscéral après avoir connu l’horreur de la Grande Guerre. Raison pour laquelle il soutint les accords de Munich. « J’ai été munichois. Il est étrange qu’en écrivant cette phrase, j’éprouve presque la sensation de faire un aveu ; l’immense majorité des Français fut non seulement résignée à Munich, mais exaltée par lui. » Au début de l’année 1939, ce pacifisme l’amena à accuser un certain Bollack, directeur d’une importante agence de presse, de corrompre des journalistes français pour qu’ils incitassent à la guerre contre l’Allemagne, accusation qui s’avéra fondée. Cela ne l’empêcha pas d’être l’un de ceux qui dénoncèrent très tôt le caractère militariste et antisémite du national-socialisme.
Au-delà de la mort, la fidélité de Bernard Morlino à Emmanuel Berl (1892-1976) est admirable. Ses nombreuses conversations rue de Montpensier, où Berl habita pendant 40 ans, furent son université. Outre une biographie, il poussa cette fidélité jusqu’à récolter à la Bibliothèque Nationale les articles de Berl pour en faire un recueil qui fut édité par Bernard de Fallois. Aujourd’hui, il est à l’origine de la réédition de Prise de sang, initialement paru en 1946, dans lequel Berl s’interroge sur la place des juifs en France, lui qui s’était toujours considéré français avant d’être juif. Curieux personnage qu’Emmanuel Berl. Appartenant à la même génération que Céline, il devint, comme lui, un pacifiste viscéral après avoir connu l’horreur de la Grande Guerre. Raison pour laquelle il soutint les accords de Munich. « J’ai été munichois. Il est étrange qu’en écrivant cette phrase, j’éprouve presque la sensation de faire un aveu ; l’immense majorité des Français fut non seulement résignée à Munich, mais exaltée par lui. » Au début de l’année 1939, ce pacifisme l’amena à accuser un certain Bollack, directeur d’une importante agence de presse, de corrompre des journalistes français pour qu’ils incitassent à la guerre contre l’Allemagne, accusation qui s’avéra fondée. Cela ne l’empêcha pas d’être l’un de ceux qui dénoncèrent très tôt le caractère militariste et antisémite du national-socialisme.
Ses relations avec Céline furent pour le moins étonnantes. Lorsque parut Bagatelles pour un massacre, il publia un article dans lequel il relevait que « le lyrisme emporte dans son flux la malice et la méchanceté ». Et d’ajouter : « Juif ou pas juif, zut et zut ! j’ai dit que j’aimais Céline. Je ne m’en dédirai pas ¹. » Un an plus tard, son libéralisme l’incita à condamner l’abus de censure que constituait, à ses yeux, le décret Marchandeau ² qui visait notamment les pamphlets céliniens. Il acceptait, en effet, l’idée de l’antisémitisme politique. Comme le lui reprochait son ami Malraux, il n’avait pas le sens de l’ennemi. Ce qu’il reconnaissait volontiers : « La haine n’est pas mon fort. » La mansuétude dont il fit preuve envers Céline n’était pas un cas particulier si l’on en juge par ces lignes : « Je suis persuadé que son cœur est pur de haine et que la provocation au meurtre fut toujours chez lui, figure de rhétorique. Les Juifs le croient antisémite Ils ont tort. Maurras n’est pas antisémite parce qu’il aime la Raison et qu’il n’est pas démagogue. Il ne vous reproche d’être juif que si vous ne dites pas comme lui… ». Aveuglement ? Libéralisme poussé jusqu’à l’outrance ? Les deux, sans doute… Après la guerre, il considéra que le racisme fut une formidable épidémie des années trente : « On ne parle pas avec indignation d’une épidémie. » Il dira à Bernard Morlino qu’il faut passer l’éponge sur Bagatelles pour ne retenir de Céline que l’inventeur d’un nouveau langage. Mais que restera-t-il de Berl ? Non pas ses pamphlets contre l’esprit bourgeois ou ses essais historiques, mais deux superbes récits parus après la guerre, Sylvia (1952) et Rachel et autres grâces (1965), sortes de confession d’un homme en quête de lui-même. Il rejoint ainsi Céline qui, après la guerre, rejetait la littérature des idées pour ne valoriser que celle où l’émotion prime.
• Emmanuel BERL, Prise de sang (présentation et bio-chronologie de Bernard Morlino ; postface de Bernard de Fallois), Les Belles Lettres, coll. “Le goût des idées”, 2020 (13,90 €)
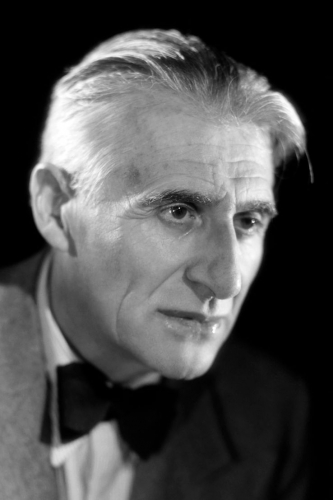
00:36 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
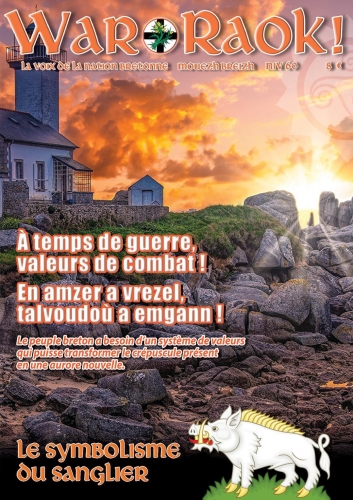
Parution du numéro 60 de la revue War Raok
EDITORIAL
Les voies du salut
Toute nation qui ne s’administre pas elle-même connaît inéluctablement une rapide décadence.
Il est vain pour un peuple de lutter si l’on a pas d’abord pris conscience des données fondamentales qui déterminent son aliénation. Nous voulons donner au peuple breton une forme qui empêche sa disparition et permettre son retour à la dynamique de l’histoire. Notre volonté d’émancipation n’est pas un enfermement : elle s’ouvre sur la reconquête d’un espace global, exigence de la géopolitique la plus réaliste. Gardons-nous d’un exclusivisme ethnique mal compris. La légitime préservation de nos caractères ethniques ne doit pas être un repli sur soi-même, même si nous pouvons être séduits par l’expression : « patriotisme ethnique » qui fixe des critères généraux et permet de parler de communauté nationale.
Dans l’Europe actuelle, Europe en pleine mutation, ce sont les nations sans État, les peuples aux droits bafoués, qui sont une nouvelle fois au premier rang des revendications. La rumeur vient d’Écosse, de Catalogne, du Pays Basque, de Flandre, de Corse ou de Bretagne, comme naguère des Pays Baltes ou d’Irlande… Partout renaissent des tensions légitimes qu’on aurait cru éteintes, et la marée des peuples opprimés bat aux portes du vieux continent.
La Bretagne depuis le traité d’union en 1532 (en fait il ne s’agit nullement d’un traité mais d’un simple acte interne à la France n’ayant aucun effet juridique en Bretagne), et plus encore depuis l’annexion de 1790, en donne un frappant exemple. De par sa position excentrée, la Bretagne n’a jamais offert pour l’État français qui en dispose aujourd’hui, que l’intérêt que l’on accorde à une zone stratégique ou à une colonie.
La nouvelle république française ne s’est jamais préoccupée de favoriser le développement industriel et commercial de ce petit peuple dont elle a rayé le nom de la carte et dont elle affecte d’ignorer l’existence. Son organisation d’essence révolutionnaire, centraliste et unitaire lui interdit de tenir aucun compte des spécificités et des intérêts particuliers de la Bretagne et son statut d’autonomie est de fait aboli unilatéralement par la force et sans le consentement et la participation des Bretons. C’est ainsi qu’un pays jadis des plus riches, à l’époque de sa souveraineté, devient une nation léthargique restée en marge de tout développement et progrès, qu’ont pu atteindre, parce ce que restées maîtresses de leurs destinées, d’autres petites nations comme la Norvège, le Danemark ou encore l’Islande.
Nous sommes en 2021. Les choses ont-elles évolué ? Je vous répondrai, oui et non.
Non du fait de la France qui poursuit inexorablement sa politique coloniale, qui persiste à enfermer le peuple breton dans une caserne administrative, dans une camisole centraliste, impérialiste et continue à vivre à l’heure napoléonienne.
Oui, parce que les Bretons se sont tournés, non vers le passé, mais vers l’avenir et, depuis maintenant de nombreuses années, ils ont su relever maints défis. La Bretagne peut ainsi s’honorer d’être devenue très compétitive dans de nombreux secteurs d’activités, tant au niveau européen qu’international.
La jeune Bretagne a renoué avec ses racines et est à ce jour fière de son identité. Elle refuse la politique d’assimilation et d’uniformisation de l’État français.
La Jeune Bretagne relève la tête et nombreux sont ceux qui rêvent de République bretonne ! La guérison serait-elle au bout du chemin ?
Voilà, succinctement énoncé, ce que nous, patriotes bretons, voulons, ce que notre peuple est en droit d’exiger pour sa prospérité matérielle, pour son épanouissement intellectuel et moral, au nom de la sagesse politique dont il a toujours fait preuve dans le passé, au cours de mille années d’indépendance et de trois cents ans d’autonomie.
A la France de dire si elle est disposée à donner satisfaction aux aspirations légitimes du peuple breton, ou si elle fait litière de ses beaux principes de liberté qu’elle-même continue à répandre dans le monde...
A la France de dire si nous devons encore avoir le moindre espoir ? La moindre confiance en ce pays qui nous a coûté trop de sang et de larmes.
Nos chers voisins sont-ils enfin disposés à s’incliner devant nos droits ou, si pour demeurer et rester Bretons, seul le divorce reste la solution ? Une chose est certaine, l’Europe des peuples est en marche. Les communautés ethniques relèvent fièrement la tête et amorcent un début de souveraineté.
Da c’hortoz donedigezh ur wir Republik vrezhon…
Padrig MONTAUZIER

SOMMAIRE N°60
Buhezegezh vreizh page 2
Editorial page 3 (Padrig Montauzier).
Buan ha Buan page 4
Politique :
Faut-il recommencer les Croisades ? Page 11 (Erwan Houardon).
Billet d’humeur :
Sommes-nous obligés de les croire ? Page 14 (Riec Cado).

Tradition :
Le symbolisme du sanglier page 16 (Gérard Thiemmonge).
Hent an Dazont :
Votre cahier de 4 pages en breton page 19 (Tepod Mab Kerlevenez hag An Deureugenn).
Tribune libre :
Pour une écologie cohérente et intégrale page 23 (Dominique Baettig).
Histoire de Bretagne :
Les Amazones de la Chouannerie page 25 (Youenn Caouissin).
Environnement :
Agriculture et écologie : cap vers la réconciliation ! Page 28 (Mael Le Cosquer).
Civilisation bretonne :
Le principe féminin, origine primordiale page 31 (Fulup Perc’hirin).

Nature :
Le héron cendré, le monsieur échasses de nos étangs page 35 (Youenn Caouissin).
Lip-e-bav :
Le gâteau nantais et gâteau à la peau de lait page 37 (Youenn ar C’heginer).
Keleier ar Vro :
Na stok ket ouzh ma c’hroaz page 38 (Meriadeg de Keranflec’h).
Bretagne sacrée :
Les Roches du Diable page 39 ( Per Manac’h).
00:15 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, war raok, bretagne, nationalisme breton, pays celtiques, peuples celtiques, celtes, celtisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 437 du Bulletin célinien
Sommaire :
La Société d’études céliniennes à la croisée des chemins
Mirabeau devancier de Céline
Céline dans Candide (2e partie, 1937-1944)
 Ce livre foisonnant séduira-t-il les céliniens érudits ? Ou auront-ils l’impression d’avoir déjà lu les différentes interprétations qu’il propose ? Il offre en tout cas l’avantage de considérer les pamphlets sous un angle essentiellement littéraire. On peut parfois le regretter, le contexte historique étant absent de l’ouvrage. Or la dégradation du personnel politique de la IIIe République explique aussi la virulence célinienne. Cela étant, l’auteur a raison d’affirmer d’entrée de jeu que les pamphlets sont des textes littéraires, au sens où ils attestent “d’un rapport à soi et au monde à travers une pratique de la langue écrite mise dans tous ses états”. Professeur de littérature médiévale et ancien haut fonctionnaire à l’Éducation Nationale, Jean-Charles Huchet s’intéresse depuis toujours à Céline. Au point de lui avoir consacré jadis trois études qu’il réutilise un peu dans cet ouvrage. Dense et bien documenté, ce livre rappelle une évidence : le génie célinien se manifeste autant dans les pamphlets que dans le reste de l’œuvre. L’auteur analyse de manière globale ce corpus qu’il nomme d’une expression récurrente le « Texte antisémite » sans faire de distinction entre les parties qui le composent. Fâcheux car comment ne pas faire de hiérarchie ? Bagatelles pour un massacre constitue une réussite littéraire éclatante saluée à l’époque par plusieurs détracteurs alors que les deux pamphlets suivants ne l’égalent pas sur ce plan, sinon le prologue pour l’un et l’épilogue pour l’autre. Dès lors qu’on analyse ces textes sur le plan littéraire, il apparaît indispensable de relever qu’ils ne peuvent être mis sur le même pied. En revanche, l’auteur rappelle utilement que même si ce corpus est irrémédiablement insupportable pour la sensibilité morale et politique d’aujourd’hui, l’œuvre est une et indivisible. Selon lui, l’antisémitisme n’est pas un accident biographique provoqué par une convulsion de l’Histoire. Il fait intimement partie de la vie et de l’œuvre de Céline. Le nier ou le minorer conduirait à passer à côté de la singularité de l’une et de l’autre. Et d’ajouter, ce qui est indéniable, que la moraline contemporaine n’en facilite pas la compréhension, préférant le jugement a priori et l’invective, voire le dolorisme victimaire. Ce livre irritera toutefois par ses interprétations basées sur des concepts freudiens (et lacaniens) exprimés de manière pesante. Et pas que dans ce cas-là comme en témoigne ce passage : « La rage antisémite et l’impossible satisfaction qui la meut n’auront pas suffi ni à la [= littérature, ndlr] refonder par des textes nouveaux ayant eu beau la convoquer de multiples façons ni à l’empêcher de s’évaporer dans les fulminations d’un genre emprunté, dont les pamphlets sont les “restes” subjectifs et littéraires dévoyés ». Est-ce ainsi que l’on s’exprime dans les hautes sphères de l’Éducation nationale ?…La doxa relative à ces textes litigieux est connue : ils sont à la fois illisibles et intolérables. Et ne relèvent précisément pas de la littérature hormis quelques passages (on cite toujours les mêmes) qui, eux, mériteraient à la limite d’être sauvés. Mais est-on encore à même de priser un livre dont on réprouve les idées ? Le temps où l’on mettait tout uniment en relief le génie pamphlétaire de Céline s’éloigne de nous. On songe au livre de Pierre Dominique, Les Polémistes français depuis 1789, dans lequel Céline occupait une place de choix. En raison du chapitre qui lui est consacré, cet ouvrage, paru un an après la mort de l’écrivain, serait assurément mal perçu aujourd’hui.
Ce livre foisonnant séduira-t-il les céliniens érudits ? Ou auront-ils l’impression d’avoir déjà lu les différentes interprétations qu’il propose ? Il offre en tout cas l’avantage de considérer les pamphlets sous un angle essentiellement littéraire. On peut parfois le regretter, le contexte historique étant absent de l’ouvrage. Or la dégradation du personnel politique de la IIIe République explique aussi la virulence célinienne. Cela étant, l’auteur a raison d’affirmer d’entrée de jeu que les pamphlets sont des textes littéraires, au sens où ils attestent “d’un rapport à soi et au monde à travers une pratique de la langue écrite mise dans tous ses états”. Professeur de littérature médiévale et ancien haut fonctionnaire à l’Éducation Nationale, Jean-Charles Huchet s’intéresse depuis toujours à Céline. Au point de lui avoir consacré jadis trois études qu’il réutilise un peu dans cet ouvrage. Dense et bien documenté, ce livre rappelle une évidence : le génie célinien se manifeste autant dans les pamphlets que dans le reste de l’œuvre. L’auteur analyse de manière globale ce corpus qu’il nomme d’une expression récurrente le « Texte antisémite » sans faire de distinction entre les parties qui le composent. Fâcheux car comment ne pas faire de hiérarchie ? Bagatelles pour un massacre constitue une réussite littéraire éclatante saluée à l’époque par plusieurs détracteurs alors que les deux pamphlets suivants ne l’égalent pas sur ce plan, sinon le prologue pour l’un et l’épilogue pour l’autre. Dès lors qu’on analyse ces textes sur le plan littéraire, il apparaît indispensable de relever qu’ils ne peuvent être mis sur le même pied. En revanche, l’auteur rappelle utilement que même si ce corpus est irrémédiablement insupportable pour la sensibilité morale et politique d’aujourd’hui, l’œuvre est une et indivisible. Selon lui, l’antisémitisme n’est pas un accident biographique provoqué par une convulsion de l’Histoire. Il fait intimement partie de la vie et de l’œuvre de Céline. Le nier ou le minorer conduirait à passer à côté de la singularité de l’une et de l’autre. Et d’ajouter, ce qui est indéniable, que la moraline contemporaine n’en facilite pas la compréhension, préférant le jugement a priori et l’invective, voire le dolorisme victimaire. Ce livre irritera toutefois par ses interprétations basées sur des concepts freudiens (et lacaniens) exprimés de manière pesante. Et pas que dans ce cas-là comme en témoigne ce passage : « La rage antisémite et l’impossible satisfaction qui la meut n’auront pas suffi ni à la [= littérature, ndlr] refonder par des textes nouveaux ayant eu beau la convoquer de multiples façons ni à l’empêcher de s’évaporer dans les fulminations d’un genre emprunté, dont les pamphlets sont les “restes” subjectifs et littéraires dévoyés ». Est-ce ainsi que l’on s’exprime dans les hautes sphères de l’Éducation nationale ?…La doxa relative à ces textes litigieux est connue : ils sont à la fois illisibles et intolérables. Et ne relèvent précisément pas de la littérature hormis quelques passages (on cite toujours les mêmes) qui, eux, mériteraient à la limite d’être sauvés. Mais est-on encore à même de priser un livre dont on réprouve les idées ? Le temps où l’on mettait tout uniment en relief le génie pamphlétaire de Céline s’éloigne de nous. On songe au livre de Pierre Dominique, Les Polémistes français depuis 1789, dans lequel Céline occupait une place de choix. En raison du chapitre qui lui est consacré, cet ouvrage, paru un an après la mort de l’écrivain, serait assurément mal perçu aujourd’hui.
• Jean-Charles HUCHET. La joie haineuse (Le moment pamphlétaire de Louis-Ferdinand Céline), L’Harmattan, coll. “Espaces littéraires”, 2020, 302 p.
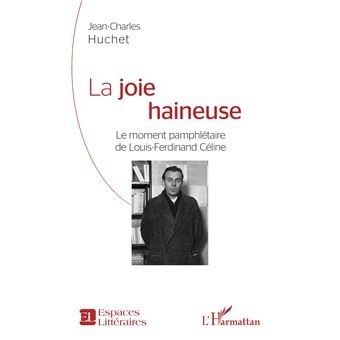
17:47 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
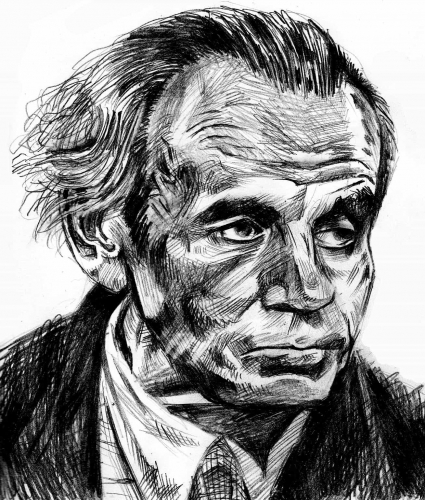
Le Bulletin célinien n°436 est sorti de presse !
Sommaire :
András Hevesi, premier traducteur de Céline en hongrois
Céline dans Candide (1932-1936) [première partie]

Dans cette épatante collection « Bouquins », vient de paraître la réédition de la biographie de Rimbaud par Jean-Jacques Lefrère (1954-2000). Cet hématologue le jour et biographe littéraire la nuit s’était essentiellement intéressé aux écrivains du XIXe siècle. Il est aussi l’auteur d’une biographie de Laforgue et de Lautréamont tout aussi érudites que celle-ci. À la fin de sa vie, il s’était attelé à une biographie de Céline qui ne restera malheureusement qu’à l’état d’ébauche (environ 200 pages). Il avait même fait le voyage au Cameroun pour prendre des notes sur place et voir ce qu’il y était possible de trouver. Son idée était de s’attaquer à l’un des auteurs les plus emblématique du XXe siècle, après avoir traité d’auteurs mythiques du siècle précédent. Il avait prévu trois volumes de 1500 pages chacun ! Hélas la maladie a cruellement eu raison de lui. Cette biographie aurait été passionnante et riche en découvertes tant Lefrère avait le culte des archives et de la recherche. Il avait déjà rassemblé une grande documentation, s’intéressant à tous les personnages secondaires qui avaient croisé Céline. Aussi était-il un peu écrasé par la masse de travail. Il insistait aussi sur le fait que, médecin lui-même, il avait une sorte de proximité avec le docteur Destouches. Cette recherche effrénée de la documentation se faisait parfois au détriment de l’essentiel : dans sa biographie de Rimbaud (qui compte plus d’un millier de pages), le poète s’évapore sous la masse de détails. Tout le contraire de la conception d’Henri Godard qui, pour sa biographie de Céline, fit sien ce propos de Malraux : « La biographie d’un artiste c’est sa biographie d’artiste. » À l’occasion de cette réédition, j’ai constaté que les querelles entre rimbaldiens sont au moins aussi vives que celles entre céliniens. Ce qui me rappelle cette plaisante réflexion de René-Louis Doyon à propos d’une autre confrérie : « On sait que les stendhaliens, plus que tous autres spécialistes, forment une gens susceptible, chatouilleuse, jalouse de leurs os médullaires et ne pardonnant à personne d’en analyser la substance, les accidents, les particularités, surtout si on ne fait point partie de cette communion tacite… »

Céline n’était pas un lecteur passionné de Rimbaud, lui préférant dans ce domaine les poètes du XVIe siècle, Louise Labé, du Bellay ou Ronsard. Mais il l’avait bien lu, comme en témoigne une lettre à son traducteur anglais dans laquelle il cite de mémoire des vers de la « Chanson de la plus haute tour¹ ». Dans une étude savante, une universitaire discerne ici et là dans l’œuvre célinienne l’empreinte rimbaldienne, une sorte de filiation cachée ². Ainsi, le prologue de Mort à crédit est vu comme une réécriture minutieuse des lettres dites du « Voyant », « Alchimie du verbe » ou « Nuit d’enfer ». C’est un peu poussé mais procure de surprenantes illustrations, non pas de la notion d’intertexte, mais de « compagnonnage » (Rimbaud-Céline) qui donnent à rêver. Ce qui paraîtra, en revanche, tangible, c’est l’affirmation de Céline qui assurait connaître la raison du départ de Rimbaud en Afrique : « Il en avait assez de tricher. (…) Il y a une hantise chez le poète de ne plus tricher. » L’alternative étant, comme on sait, de « mettre sa peau sur la table ».
• Jean-Jacques LEFRÈRE : Arthur Rimbaud (biographie), Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1408 pages (32 €)
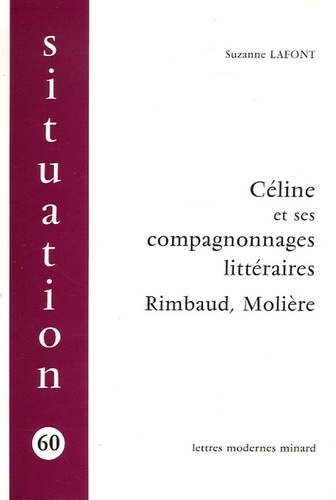
10:18 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, arthur rimbaud |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
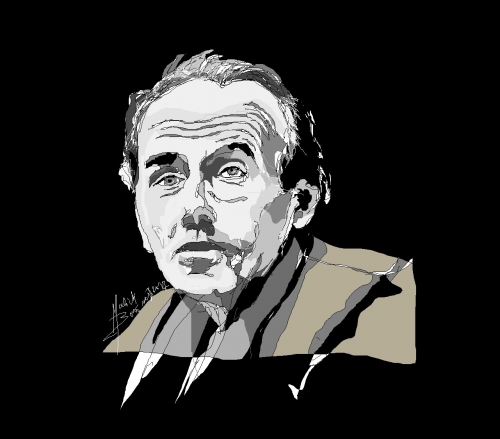
Parution du n°436 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Céline au Brésil. Entretien avec Amanda Fievet Marques
Proust vu et corrigé par Céline
Céline dans le Journal de guerre de Paul Morand
La visite de la Beat Generation à Céline
Évelyne Pollet rééditée à Céline.
Arrivera-t-il à Mauriac ce qui est arrivé à d’autres écrivains ? Deux ans avant sa mort, il écrivait : « À force de ne pas mourir, le romancier que je suis a été peu à peu recouvert par le journaliste, que certes je ne renie pas : il n’est pas impossible que le Bloc-notes ou les Mémoires intérieurs seront consultés encore à une époque où nul ne songera plus à ouvrir mes romans. » Ainsi de Voltaire qui pariait sur ses tragédies alors que c’est sa correspondance que nous lisons. Et Candide qu’il considérait comme une pochade. Même chose pour Mauriac : on ne lit plus guère le romancier des tourments entre la religion et la chair. Mais, cinquante ans après sa mort, l’atticisme, parfois corrosif, du chroniqueur s’apprécie toujours autant. Ce Bloc-notes (1952-1970) était épuisé depuis plusieurs années. Jean-Luc Barré, qui dirige la collection “Bouquins”, a eu la bonne idée de le rééditer. Il en signe aussi la préface, connaissant bien le sujet pour avoir publié une biographie de Mauriac qui révéla au grand jour son homosexualité refoulée. Ce qu’avait subodoré Céline qui voyait en lui « un rongé pédé qui n’a jamais osé ». Au-delà de l’actualité politique, le bloc-notes peut se lire comme on savoure, mutatis mutandis, les mémoires de Saint-Simon. On y trouve un Mauriac gambadant en toute liberté, bien plus libre qu’il ne l’est dans ses romans. Il n’y est jamais question de Céline si ce n’est pour paraphraser les titres de deux de ses livres : Voyage au bout de la nuit (7 avril 1956) à propos du gouvernement de Front républicain, et Bagatelles pour un massacre (13 février 1958) sur le bombardement de représailles d’un village tunisien en réponse à l’attaque d’un avion français. C’est tout et c’est peu. Il est vrai qu’il est difficile d’imaginer deux personnalités aussi dissemblables. Cela avait pourtant bien commencé : en décembre 1932, deux phrases (pourtant réticentes) de Mauriac sur Voyage dans le très lu Écho de Paris ¹, suivies apparemment d’une lettre plus sensible, lui avaient valu une belle réponse : « Vous venez de si loin pour me tendre la main qu’il faudrait être bien sauvage pour ne pas être ému par votre lettre. » ² Les choses s’envenimèrent par la suite. Mauriac, quoique partisan de la clémence envers les épurés, exprima des jugements hérissant Céline. Belle lettre d’insultes en retour : « Oh Canaille mais oui vous êtes ! Canaille par tartufferie, messes noires, ou connerie on ne sait ! ». Il lui envoie aussi une virulente dédicace au verso d’une reproduction du dessin de L’Illustré National. Avec une allusion à la fameuse dédicace au lieutenant Heller de la Propagandastaffel. Avant-guerre, Ramón Fernandez avait emmené Mauriac rue Lepic rencontrer l’auteur de Voyage. Répulsion instinctive : « Il faisait mante !… exactement !… (…) des gestes d’insecte… » Il le verra surtout « bicot de race ». Le fait que Mauriac critiquait dans L’Express la politique coloniale de la France n’arrangea pas les choses. Mais Céline n’avait-il pas déjà tout dit en 1933 ? « Rien ne nous rapproche, rien ne peut nous rapprocher ; vous appartenez à une autre espèce. »
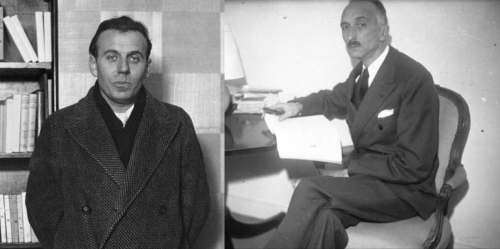
• François MAURIAC, Le Bloc-notes, 1952-1962 & 1963-1970, Robert Laffont / Mollat, coll. “Bouquins”, 2020, 2 volumes de 1290 & 1324 pages, index, préface de Jean-Luc Barré, édition établie et annotée par Jean Touzot.
11:32 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, louis-ferdinand céline, françois mauriac, revue, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
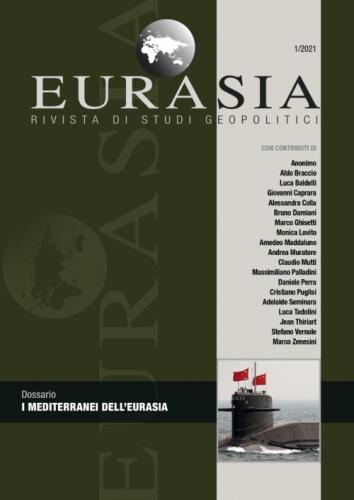
De la "Mare Nostrum" à l'Arctique, en passant par la Baltique, l'importance des "Méditerranéens" d'Eurasie
Un nouveau numéro d’Eurasia, la revue géopolitique de Claudio Mutti
Par Cristiano Puglisi
Ex: https://blog.ilgiornale.it/puglisi
Un précieux cadeau de Noël pour les passionnés de géopolitique ! En effet, le nouveau numéro (n° 61) d’Eurasia, Magazine d'études géopolitiques, vient d’être publié ces jours-ci (et est donc disponible à la vente). Le titre intrigue : "Les Méditerranéens d'Eurasie". Le volume traite du thème de la domination sur les mers, où de plus en plus de facteurs défient les grandes puissances de l'époque actuelle. Il parle bien sûr des États-Unis, de la Chine et de la Russie, mais aussi d'acteurs régionaux ambitieux comme la Turquie, engagée dans la Méditerranée orientale, théâtre, comme le disent les chroniques, d'un différend avec la Grèce, Chypre et la France. Mais pourquoi décliner le terme "Méditerranée" au pluriel ? Y a-t-il d'autres mers qui peuvent être définies de cette manière, d’être « entre les terres », en dehors de la Méditerranée éponyme ?
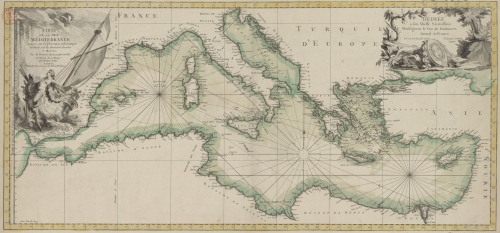
La Méditerranée - explique le directeur d’Eurasia, le professeur Claudio Mutti - est un bassin maritime qui, comme le dit le mot lui-même, est "au milieu des terres", étant presque entièrement circonscrit par elles. Si la mer Méditerranée par excellence est celle qui sépare les côtes de l'Europe, de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord, Yves Lacoste a identifié deux autres mers que l'on peut également définir comme "méditerranéennes", car elles sont entourées de terres : une "Méditerranée" américaine, formée par le golfe du Mexique et la mer des Antilles, ainsi qu'une "Méditerranée" extrême orientale, formée par la mer Jaune, la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale. En appliquant le critère de la géopolitique française à la masse continentale eurasienne, il en résulte que les rivages de notre grand continent sont baignés, outre la Méditerranée éponyme, par trois autres mers "méditerranéennes" : l'océan Arctique, la Baltique et la Méditerranée extrême-orientale".
On parle de réalités géographiques au centre du présent et de l'avenir du monde : si les États-Unis d'Amérique sont considérés comme l'archétype d'une puissance thalassocratique, il n'en va pas de même pour la Chine, pourtant le défi entre les deux géants géopolitiques semble destiné à devenir de plus en plus réel sur les mers.
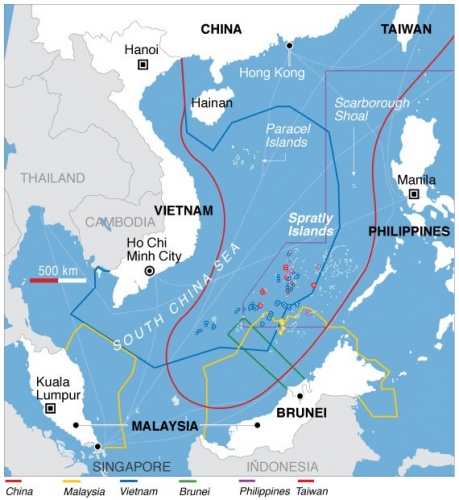
La stratégie terrestre des Etats-Unis - poursuit Claudio Mutti - après avoir tenté en vain d'attaquer la République populaire de Chine en déstabilisant ses provinces les plus intérieures (Tibet et Xinjiang), vise à saboter les projets d'infrastructure de la Nouvelle Route de la Soie. Mais plus que la terre, c'est la mer qui s'impose comme le théâtre du conflit sino-américain. Déjà à l'époque d'Obama, les États-Unis, alarmés par la suprématie productive que la Chine était en train d'acquérir, ont déplacé leur axe géostratégique vers la zone indo-pacifique, où s'installait le nouveau centre du commerce mondial. D'où l'importance géostratégique de la "Méditerranée" extrême-orientale et, en particulier, de la mer de Chine méridionale, une zone qui, en plus d'être riche en ressources naturelles, est le centre des activités économiques mondiales. Ici, dans cette zone contestée entre les deux superpuissances, la présence militaire des États-Unis vise à exercer une action d’ "endiguement" contre la Chine qui pourrait retarder le déclin de l'hégémonie américaine".
Mais, comme on l'a dit, il existe aussi une série de puissances régionales qui définissent leur vision stratégique avec bien plus qu'un simple regard sur le contexte maritime. Parmi celles-ci, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, auquel, dans ce numéro d'Eurasia, de nombreuses réflexions sont consacrées.

Cem Gürdeniz.
La projection maritime actuelle de la Turquie - explique Mutti - est codifiée dans la désormais célèbre doctrine du "Pays bleu" (Mavi Vatan) formulée par l'amiral Cem Gürdeniz. On peut dire que cette doctrine affine la vision géopolitique "néo-ottomane", qui a été révisée à la lumière de la nature péninsulaire de l'Anatolie et de l'importance fondamentale des mers qui baignent ses côtes. Les stratèges d'Ankara sont convaincus que le jeu de la suprématie mondiale se jouera sur les mers et les océans du monde. L'avenir de la Turquie dépendra donc de son enracinement dans la Méditerranée. C'est dans cette perspective qu'Ankara a ouvert plusieurs fronts sur les rives de la Méditerranée, de Chypre à la Libye, au risque de provoquer une levée de boucliers de tous côtés.

Fascinant, ne serait-ce que par la puissance qu'il exerce sur les fantasmes de l'imaginaire collectif, habitué à le relier aux souvenirs des expéditions historiques et héroïques, est la course pour la maîtrise de l'Océan Arctique...
Vous pouvez vous faire une idée de l'importance de l'océan Arctique (ou « Océan Glacial Arctique », selon le nom utilisé par les géographes italiens) - conclut M. Mutti - si vous considérez que l'année dernière, l'administration américaine a tenté d'acheter le Groenland, la plus grande île du monde, qui appartient politiquement au Danemark, l'un des huit États côtiers de la "Méditerranée" arctique. L'Arctique a pris une importance croissante non seulement pour les ressources naturelles présentes dans ses fonds marins, mais aussi pour les nouvelles routes maritimes qui le traversent, plus courtes et plus sûres que le canal de Suez, le canal de Panama ou le détroit de Magellan, même si les routes arctiques (dont l'utilisation est principalement saisonnière et liée au pétrole et au gaz naturel) sont encore loin de dépasser en importance les routes commerciales habituelles".
Pour commander ce numéro exceptionnel: https://www.eurasia-rivista.com/negozio/lxi-i-mediterranei-delleurasia/
12:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, claudio mutti, méditerranée, océan arctique, mer de chine du sud, turquie, europe, affaires européennes, politique internatiionale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
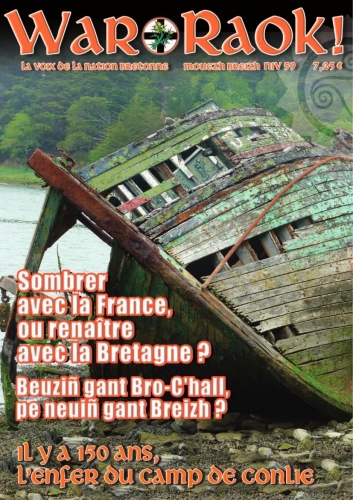
WAR RAOK n°59
Sommaire:
Buhezegezh vreizh page 2 (Michel Lugaid).
Editorial page 3 (Padrig Montauzier).
Buan ha Buan page 4 (Tepod Mab Kerlevenez, Meriadeg de Keranflec’h).
Politique
La barbarie n’épargne jamais rien... page 8 (Erwan Houardon).
Billet d’humeur
La République française : arme de destruction massive page 11 (Riec Cado).
Écologie
La protection de notre littoral page 14 (Mael Le Cosquer).
Tradition
Le corbeau dans les traditions indo-européennes page 17 (Alberto Lombardo).
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton page 19 (Donwal Genvenez).
Tribune libre
L’ineffable beauté de notre combat page 23 (Valérien Cantelmo).
Histoire de Bretagne
Il y a 150 ans, l’enfer du Camp de Conlie page 25 (Camille Le Mercier d’Erm).
Environnement
Entre spoliation et artificialisation des terres bretonnes page 28 (Erwan Houardon).
Civilisation bretonne
Rapports entre principes féminin et masculin page 31 (Fulup Perc’hirin).
Nature
“Courte queue”, le chat sauvage page 35 (Youenn Caouissin).
Lip-e-bav
Raie rôtie au lard page 37 (Youenn ar C’heginer).
Keleier ar Vro
Réunification de la Bretagne page 38 (Meriadeg de Keranflec’h).
Bretagne sacrée
Le Mont-Dol, un mont de légendes page 39 (Per Manac’h).

EDITORIAL
Le nationalisme : exaltation du sentiment national mais également volonté d’émancipation d’un peuple, son droit à disposer de lui-même
Dans un de mes anciens articles je ne boudais pas mon plaisir à mentionner cette petite phrase : « faisons lever une moisson d’espérance aux couleurs du nationalisme breton ».
Il n’est pas dans mon intention de donner ici un cours de philosophie politique, je n’en ai pas les compétences mais surtout j’ai toujours eu une autre préférence : l’action. Toutefois, la jeune génération de militants bretons a besoin de solides repères, de jalons afin de ne pas céder aux chants des sirènes et ainsi de ne pas déserter le terrain idéologique émasculé par des idéologies du déclin.
Comprendre le monde, réfléchir, élaborer des solutions requière de connaître le sens des mots. Le terme nationaliste, si décrié, si galvaudé, est pour nous Bretons un ingrédient nécessaire à la libération de notre peuple privé de ses droits nationaux.
Mais d’où vient cette opposition entre patriotisme et nationalisme ? Qui a intérêt à entretenir cet antagonisme qui naît en réalité des usages successifs qui ont été faits de ces termes tout au long de l’histoire ? Opposer patriotisme et nationalisme est un lieu commun du discours politique. Le patriotisme, notion méliorative et affective, serait l’amour de son pays, une conception ouverte de sa patrie, la volonté désintéressée de la servir et de la promouvoir. Le patriotisme serait ouvert et inclusif. A contrario, le nationalisme, notion péjorative, serait une doctrine agressive, un amour exalté de la patrie qui dégénérerait en impérialisme... Le nationalisme serait par définition fermé et exclusif.
Les oligarques qui œuvrent, depuis des dizaines d'années, à diaboliser le concept même de nationalisme, au motif spécieux que ceux qui se déclareraient nationalistes seraient prétendument des nostalgiques du fascisme ou du IIIème Reich, développent avec habileté un sophisme de culpabilité par association, technique fallacieuse qui consiste à tenter de décrédibiliser l'adversaire en prétendant qu'il serait semblable à quelqu'un, ou à quelque chose, de détestable sous le prétexte qu'il en partagerait une caractéristique. Il est remarquable que ces mêmes oligarques n'ont aucunement cherché à diaboliser de la même façon le concept de communisme.
« En situation de crise, la première chose à faire est de redonner aux mots leur véritable sens »
(Confucius)
Balayons d’un revers de main et jetons aux oubliettes la stupide et ridicule phrase imputée par erreur à un célèbre général français et dont l’auteur est en fait le romancier Romain Gary : « Le patriotisme c’est l’amour des siens…. le nationalisme, c’est la haine des autres ». Un autre imbécile s’était quant à lui autorisé à déclarer devant le parlement européen : « Le nationalisme, c’est la guerre ». (François Mitterrand 17 janvier 1995).
Pour nous militants bretons, le nationalisme, c’est avant tout la volonté du peuple breton à disposer d’un État souverain. La souveraineté étant de fait consubstantielle à l’État, être souverain signifie donc être maître chez soi, mais être maître chez soi nécessite d’avoir un chez soi, cela semblerait être une lapalissade mais il est, pour nous Bretons, impératif de le souligner.
Notre nationalisme, c'est la volonté politique de pouvoir vivre dans sa patrie, autrement dit dans sa nation, d'y être maître, ce qui implique de ne pas être sous la tutelle d’un pouvoir politique dirigé par un État étranger, en l’occurrence l’État français, sans sous-estimer la politique néfaste de l’Union européenne, véritable courroie de transmission des nouvelles oligarchies.
Les Bretons, depuis la perte de l’indépendance de leur patrie, cherchent à être les sujets, les maîtres de leur destin. Ils choisissent de mettre en avant telle ou telle facette de leur identité, cette identité bretonne forte et ancrée, pourtant persécutée et stigmatisée, qui a dû répondre à de si nombreuses attaques de la France ne désirant que l’effacer, la nier, et qui pourtant revient toujours comme le mouvement incessant des vagues s’étalant sur les plages bretonnes. Et étant donné qu'une identité forte est une condition nécessaire à la souveraineté d'une nation, le nationalisme s’impose naturellement comme la défense simultanée de la souveraineté et de l'identité. Ainsi, pour nous Bretons, patriotisme et nationalisme doivent inévitablement marcher main dans la main.
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année 2021.
D’an holl ac’hanoc’h e hetan un Nedeleg laouen hag ur Bloavezh mat 2021.
Padrig MONTAUZIER
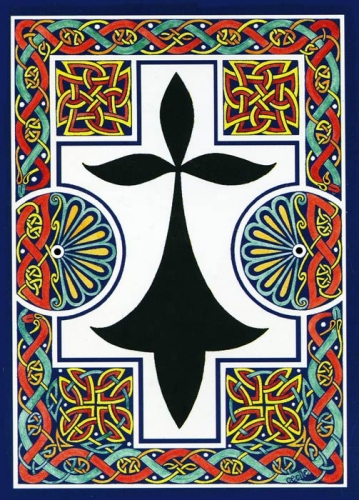
00:32 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, war raok, bretagne, nationalisme breton, padraig montauzier, celtisme, pays celtiques, terres d'europe, armorique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
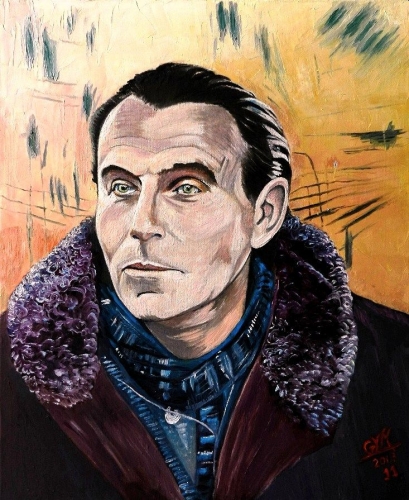
Parution du n°434 du Bulletin célinien

Sommaire :
Isak Grünberg, premier traducteur de Céline en allemand [II]
Christian Prigent et Céline
Quand André Balland voulait rééditer les pamphlets
Charles-Antoine Cardot nous a quittés
Céline dans Les Lettres françaises (suite)
Henri Guillemin face à Céline
Nos amis écrivent…
Le livre part d’un constat : tous les classiques de la littérature ont un jour été portés à l’écran. …Sauf Voyage au bout de la nuit. Émile Brami, qui connaît bien le sujet pour l’avoir déjà traité dans la revue Études céliniennes, lui consacre un petit volume illustré d’une quarantaine de photographies. Dans la première partie, il retrace toutes les tentatives avortées d’adaptation au cinéma. La presse des années trente est truffée d’échos comme celui-ci :
« Louis-Ferdinand Céline est parti mercredi pour l’Amérique par le Champlain. L’auteur de Voyage au bout de la nuit est attendu par les milieux littéraires de New York où la traduction de son livre connaît un vif succès. De là, L.-F. Céline partira par avion pour Hollywood afin de s’occuper de la mise en scène de son ouvrage dont Jacques Deval vient de négocier l’adaptation avec une firme d’éditions cinématographiques » (Le Populaire, 22 juin 1934).
Hélas pour Céline, ce projet ne verra pas le jour. Mais sans doute en est-il mieux ainsi. Michel Audiard, qui caressa longtemps l’espoir d’adapter Voyage, se félicitait finalement que le film n’eût jamais vu le jour : « …La littérature à ce niveau-là, on ne peut que saloper le coup. » La force et l’originalité du roman vient en effet de son écriture, d’où la difficulté de la transposition. Les autres livres de Céline n’ont pas davantage été adaptés à l’écran. Or, comme le rappelle l’auteur, les tentatives furent nombreuses : de Fellini à Leone en passant par Gance, Duvivier, Autant-Lara, Godard, Pialat, Dupeyron et tant d’autres. Émile Brami se penche sur les raisons qui rendent toute adaptation de Voyage périlleuse, ainsi que sur la possibilité d’adapter les autres romans de l’auteur. Restent les transpositions visuelles alternatives, telle la bande-dessinée même si les tentatives ne furent pas toujours concluantes. Jacques Tardi opta d’ailleurs pour l’illustration alors qu’antérieurement il adapta avec bonheur d’autres romans. Ce dont on est certain c’est que Céline, lui, avait tiré les leçons du cinéma : « Les écrivains d’aujourd’hui ne savent pas encore que le cinéma existe !… et que le cinéma a rendu leur façon d’écrire ridicule et inutile… péroreuse et vaine !… (…) leurs romans ne sont plus que des scénarios plus ou moins commerciaux, en mal de cinéastes !… » On sait qu’il appréciait surtout le cinéma muet. Cela remontait à l’époque où sa grand-mère, Céline Guillou, l’emmenait voir Le Voyage dans la lune de Méliès. Il révérait aussi Max Linder, Buster Keaton et Chaplin (celui d’avant le cinéma parlant). Plus tard, il fréquenta le milieu du cinéma au point de faire une figuration dans un film de Jacques Deval, Tovaritch (1935), tiré de sa pièce éponyme. Deux ans plus tard, l’auteur de Bagatelles pour un massacre polémiquait avec Jean Renoir dont il détestait La Grande Illusion ainsi que, d’une manière générale, le progressisme bêtifiant que l’on retrouve dans les films français des années trente. C’est aussi dans ce pamphlet que l’on trouve un portrait féroce, “avant la lettre”, de Harvey Weinstein, figure emblématique de ce que Céline nommait « Hollywood la juive ». Émile Brami cite d’ailleurs un large extrait de Bagatelles qui en témoigne. C’est dire si son livre est exhaustif.
• Émile BRAMI. Louis-Ferdinand Céline et le cinéma (Voyage au bout de l’écran), Écriture, 2020, 208 p., ill., index des noms cités.
On regrette l’absence d’une bibliographie qui recenserait les études antérieures sur le sujet, dont celles d’Éric Mazet (Études céliniennes, 2009 & L’Année Céline 2013 & 2014), d’Alain Cresciucci (Céline à l’épreuve, 2016) et d’Alain et Odette Virmaux (Cinématographe, novembre 1986).
21:17 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Notre société est malade. Nous traversons une pandémie de peur sans précédent et cette angoisse est savamment entretenue par nos gouvernants. C'est le système capitaliste et son modèle mondialiste qui sont la source du mal ; ce sont eux qui propagent l'infection. Nous avons tous les symptômes et nous n'avons aucun traitement pour les combattre. Les bonnes consciences peuvent se pencher à notre chevet et pleurnicher sur les ravages de la maladie, cela ne sert à rien. Nous devons trouver la force de vaincre cette maladie en nous-mêmes.
Faisons d'abord le bon diagnostic. Les menaces qui se déversent sur la France et l'Europe ont des causes précises.
Durant des années, les puissances occidentales ont fermé les yeux sur les agissements des islamistes quand ils servaient leurs intérêts. À l’origine en Afghanistan contre les Soviétiques, puis dans le Caucase contre les Russes. En Bosnie et au Kosovo, ils furent les alliés des « guerres humanitaires » contre les Serbes. Hier encore, on les retrouvait comme troupes de choc du chaos en Libye et en Syrie. Cette utilisation géopolitique de ces courants dans la déstabilisation des ennemis du Nouvel Ordre Mondial explique la complaisance affichée pour leurs réseaux en Occident et pour les pays et les clans de la péninsule arabique qui les financent jusque dans les années 2000. Cela se doublant par un clientélisme communautaire des élus dans certaines zones urbaines avec des objectifs purement électoraux.
Pourquoi notre territoire est-il devenu , dès lors, un champ de bataille ? Simplement du fait de la politique migratoire et d'ouverture des frontières voulue par les classes dominantes depuis 50 ans. L'idéal d'un monde ouvert et multiculturel cachait la froide logique d'une oligarchie qui voulait détruire le cadre populaire européen et exploiter toute la misère du monde pour son profit. Les beaux discours humanistes n'étaient qu'un argument publicitaire pour vendre cette entreprise. Ils volent en éclats aujourd'hui et nous laissent avec une société en miettes.
La désintégration de la France est aussi la conséquence de l'application de la doctrine du turbo-capitalisme. Exploser les communautés authentiques et les liens sociaux pour les remplacer par la lutte de tous contre tous. La loi du « Diviser pour mieux régner » arrive à sa conséquence finale de l'éclatement de la société. Ne partageant plus aucune référence commune, les différentes populations se regardent comme étrangères entre elles. Chacun s'enferme dans une bulle numérique peuplée uniquement par ses fantasmes et ses illusions. Les réseaux sociaux et les clashs médiatiques alimentent ces communautarismes identitaires low cost.

Les appels à la défense des valeurs républicaines ne sont qu'une mauvaise blague. Le fallacieux discours sur la liberté d'expression en France, et l'injonction à être encore ( et toujours) Charlie, est la preuve de l'épuisement de la bien-pensance bourgeoise. Elle n'a plus rien à opposer aux barbares que la défense du droit au blasphème et au nihilisme de ses valeurs de consommation rapide. Mourir pour cette « République » ? Non merci ! Si nous défendons une certaine « idée de la France » ( Spirituelle, populaire, révolutionnaire et enracinée) nous ne l'associons absolument pas avec ce système qui en est la négation.
Au final, le traitement du « terrorisme séparatiste » proposé par le bon docteur Macron est un faux deal : soit un conflit civil destructeur, soit la soumission à son Nouvel Ordre Moral. Cette stratégie libérale-sécuritaire est un moyen pour permettre la survie du système. Elle ne garantit plus la sécurité aux citoyens dans aucun domaine. En aucun cas, cela ne va dans le sens d’une émancipation de l'aliénation et de l'exploitation.
Dans le cadre de la sécurité sanitaire face au Covid 19, nous avons la même logique à l'œuvre. Ne voulant pas sacrifier les fondements du libéralisme à la protection du pays devant ce danger, le gouvernement a laissé ouvertes nos frontières et a désarmé nos barrières sanitaires. Son inconséquence et son incohérence lors de la « première vague » furent à l'origine de la catastrophe sanitaire et économique que nous subissons. Rappelons le encore une fois, l'incapacité à protéger les plus vulnérables et à mettre en place une politique sanitaire efficace est liée à l'application de la doctrine du turbo-capitalisme (destruction des services de protection sociale et sanitaire, liquidation de l'hôpital public, privatisation de la recherche médicale, délocalisation d'industries stratégiques, adoption des règles du commerce international et des législations transnationales).
On culpabilise les individus aujourd'hui pour cacher les vraies causes de cette crise. Le discours méprisant et l'infantilisation des Français par le gouvernement contribuent à faire naître une méfiance légitime face aux mesures de l'État. Ce ne sont pas les fake news ou les théories complotistes qui sapent le moral des gens, c'est l'incohérence des gouvernements. L'oligarchie fait semblant que tout est sous contrôle et que la vie (surtout économique) continue . Mais des bombes plus dangereuses sont déjà en préparation
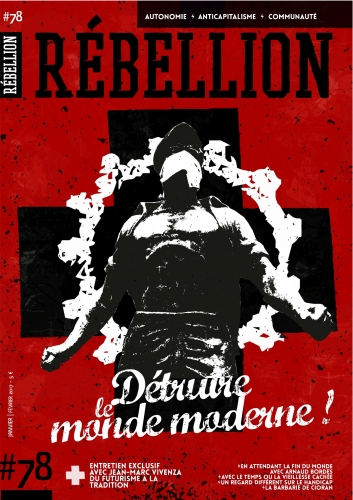
Confinement, couvre-feu, reconfinement : l'interdiction des rapports humains familiaux et amicaux aura des conséquences terribles sur une psychologie collective déjà fragile. Dans le même temps, on laisse la culture aux bons soins des GAFA et de Netflix. On ferme les lieux de cultes et on laisse ouvert les hypermarchés... Les transformations économiques qui vont naître du Covid 19 vont laisser des millions de travailleurs sur le carreau et ubériser les conditions de ceux qui sauveront leur emploi. Nous allons vers un plan de décroissance radicale qui ne sera ni très conviviale, ni volontaire pour le coup . La dégradation des conditions de vie et de travail de la majorité de la population mondiale s'accompagne de l’élévation vers les sommets du confort technologique d'une élite oligarchique mondiale .
Retrouvez sur notre site plus de textes : http://rebellion-sre.fr/
Vous pouvez participer à notre campagne d'autocollant " Le Virus c'est le capital":
http://rebellion-sre.fr/boutique/50-autocollants-le-virus...
12:19 Publié dans Actualité, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, virus, coronavirus, revue, revue rébellion, covid-19 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Cada número de esta revista se debe leer y meditar, no por estar de acuerdo con todo, sino por poder debatir los temas con un cierto nivel de calidad.
Revista de historia, metapolítica y filosofía.
Pedidos: edicionesfides@yahoo.es
192 págs. 20€.
Vamos a comentar solo algunos de sus textos:
– Editorial: El coronavirus y los mitos de la posmodernidad. No hay que caer en conspiraciones, pero es evidente que este tema del virus ha servido para probar medidas de control extremas sobre la población, logrando que acepten lo que sea, aterrorizándola con datos y con propaganda.
Y si este virus fuera mucho más letal hubiera provocado la creación de un Estado Policía mundial, un Estado del Terror.
La crisis además servirá para endeudarnos a todos aún más y ver la fragilidad del sistema financiero capitalista, ya endeudado hasta las nubes ANTES de esta crisis.

– Las leyes pioneras para la protección de los animales en España, por Jordi Garriga Clavé. Un texto magnífico que deberíamos leer todos, sobre cómo ha evolucionado, lenta y con atrasos, las relaciones humanas y los animales. Solo muy tarde, hace menos de un siglo, se empezaron a tener legislaciones donde los animales tuvieran ciertos ‘derechos’, aunque era más por no herir la sensibilidad de los humanos que por ellos mismos. En 1929 sale la primera legislación española sobre maltrato animal algo seria, que se reproduce en el texto.
Recordemos que fue el III Reich el primero en legislar que los animales tienen derechos por sí mismos.
 – Entrevista a Pierre Vial. Los años del GRECE (1968-1987). En la escuela de Gramsci. Este es un texto fundamental para entender las posiciones de eso que llamamos ‘metapolítica’.
– Entrevista a Pierre Vial. Los años del GRECE (1968-1987). En la escuela de Gramsci. Este es un texto fundamental para entender las posiciones de eso que llamamos ‘metapolítica’.
El único problema es que esta entrevista es del año 1990, se publicó en el año 2000, o sea hace 20 años, y no relata la continuación de la lucha de Pierre Vial, cosa fundamental.
El GRECE nace en 1968, tras comprobar el fracaso de la acción política directa y la necesidad de basar los valores e ideas esenciales de una alternativa al Sistema.
Era como un camino contra el activismo sin cabeza y el intelectualismo sin acción.
Los valores esenciales antisistema eran claros, ya los había definido el ‘fascismo’ genérico, pero su concreción en posiciones, ideas, política, cultura, arte, etc. debían actualizarse a los problemas tras 30 años de acabada la guerra.
La posición de Gramsci en el marxismo había sido algo similar, era preciso una cultura además de una lucha política. Pero para Gramsci la lucha cultural era solo una ayuda a la lucha política. En cambio, para nosotros la lucha cultura y arte es un fin, la lucha política es el medio para dar al pueblo cultura y arte.
Así pues, lograr una conquista cultural social era esencial, no solo como medio.
Primer fracaso: el Grece trató de entrar en los medios de masas, en diarios, radio, Tv incluso… con la ayuda de Pauwels en Figaro-Magazine, y Benoist usando pseudónimo en otros medios.
Eso llevó a dos problemas: uno, la traición de muchos que se pasaron a ideas del Sistema más aceptables, o se intelectualizaron contra toda acción. Y dos: no iban a tolerar esa actuación y amenazaron a Pauwels con un boicot económico y publicitario. Denunciaron como fascistas y nazis a todos los de Grece, y siguieron con ataques físicos.
Eso ya era evidente, había ya pasado en USA con gente como Eysenck, Jensen, etc. que fueron expulsados de las universidades y relegados del todo como ‘fanáticos racistas’, etc.
Grece siguió su lucha con Elements y Nouvelle Ecole, en temas como Ecología, genética, indo europeísmo, derecho a la diferencia, etc.
Como dice Vial, es mejor ser discreto en esas etapas de lucha, no creerse que el sistema va a permitir ‘democráticamente’ nuestra presencia.
El segundo cambio de Vial fue en 1987, la invasión inmigratoria era enorme ya, y consideró que debía trabajar con el Front National de JM Le Pen para tratar de parar esa destrucción racial de Francia.
Desgraciadamente la entrevista pasa en ese momento los años 90. No se describe como el FN inició una tremenda decadencia de valores e ideas a cambio de votos, que ha acabado con su cambio de nombre y de sentido, ya tipo VOX, y Vial se marchó del FN para formar Terre&Peuple, un frente de ideas y lucha sin concesiones.
 – In memoriam, por Juan Antonio Llopart. Un recuerdo necesario ante el inesperado fallecimiento de una gran camarada y persona, Carmen Padial, no solo luchadora con el MSR sino una persona dedicada a la maternidad, la ecología y naturaleza, vegetariana, que deja dos hijos pequeños de 9 años y otros dos ya mayores.
– In memoriam, por Juan Antonio Llopart. Un recuerdo necesario ante el inesperado fallecimiento de una gran camarada y persona, Carmen Padial, no solo luchadora con el MSR sino una persona dedicada a la maternidad, la ecología y naturaleza, vegetariana, que deja dos hijos pequeños de 9 años y otros dos ya mayores.
– La Cuarta Teoría Política y el problema del diablo, por Aleksander Duguin. Este texto tiene dos facetas, una absolutamente discutible y otra que no sabría ni como discutirla.
Empecemos por esta última, lo de ‘el problema del diablo’. Concuerdo en que el mayor éxito del diablo es hacer que la gente niegue la existencia de Dios y luego presentar sus antivalores como el nuevo dios de esa sociedad. Pero tras ello se lanza a una extravagancia sobre la Madre (la modernidad), el Padre (platonismo) y el Hijo (Aristóteles) que francamente es mejor dejar de intentar explicarla.
Veamos la parte discutible pero comprensible:
Cada vez que oigo la palabra ‘Cuarta Teoría Política’ miro a ver dónde se definen sus valores, principios, teorías, propuestas…. En este texto solo expone ‘contra que está’, pero no en favor de que.
Contra la modernidad, vale, los NS también, aunque diga que no. Contra el individualismo, más aún los NS que fomentan la comunidad absolutamente. Contra el materialismo, absolutamente un punto NS donde la economía está al servicio del pueblo y bajo control del Estado. Dice que los fascismos y comunismo han sido eliminados, bueno, el comunismo cayó por sus propios errores y desastres, los propios dirigentes comunistas no creyeron ya en el comunismo. Pero los fascismos fueron un enorme éxito, y cayeron militarmente por la alianza de comunistas y demócratas, no políticamente.
Pero no dice una sola palabra de sus propuestas de esa 4ª Teoría, y es que las veces que he escuchado algunas son copia muy poco maquillada de las propuestas Nacional revolucionarias y de los fascismos.
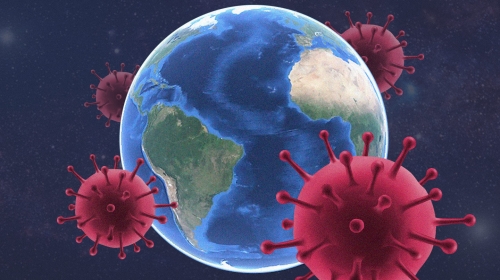
– Consecuencias geopolíticas de la crisis del coronavirus. Una propuesta para España, por José Alsina Calvés. Aunque personalmente creo que este tema del coronavirus no va a cambiar substancialmente nada del sistema una vez superado el tema sanitario, fuera de demostrar cómo se puede dominar y tiranizar a la sociedad con el miedo, y como lograr una enorme crisis económica sobre la ya enorme deuda anterior, lo que pase es algo que no podremos afirmar hasta dentro de unos años.
Pero vayamos a las propuestas muy razonables de geopolítica en España, dejando aparte el virus.
Las propuestas son básicamente:
Me parece un buen resumen de posibilidades, cada una con serios problemas de realización, que voy a resumir:
Y francamente ni siquiera en Grecia lograron despegarse de la UE, la deuda nos oprime y elimina la libertad.
Sin duda es la mejor solución, un grupo fuerte de países sí que podría resistir frente a la finanza, la UE y USA-Israel. Una pega: Rusia debe abandonar la idea de ser continuación o alabanza de la URSS. Los de Visegrado y los españoles, italianos, etc. no tienen ningunas ganas de soportar una sombra de la URSS. Rusia debería condenar a la URSS.
 – Para algunos, la seguridad sanitaria se convertirá en una parte fundamental de las estrategias políticas liberales, por Diego Fusaro. Un texto que indica que las urgencias sanitarias se van a convertir en un arma de dominación de las poblaciones. Curiosamente ya un francés* en el gobierno, Attali, dijo en el 2009 que las crisis sanitarias eran un mejor método de dominio y miedo para imponer medidas para un gobierno mundial a la población.
– Para algunos, la seguridad sanitaria se convertirá en una parte fundamental de las estrategias políticas liberales, por Diego Fusaro. Un texto que indica que las urgencias sanitarias se van a convertir en un arma de dominación de las poblaciones. Curiosamente ya un francés* en el gobierno, Attali, dijo en el 2009 que las crisis sanitarias eran un mejor método de dominio y miedo para imponer medidas para un gobierno mundial a la población.
Con datos bien dosificados y manipulados, con apoyo de algunos científicos sanitarios, con los medios de masas, se obliga mentalmente a que todos asuman las medidas más extremas como razonables y necesaria, colaborando con las medidas limitadoras de toda oposición, hasta el punto de llamar locos, o peligrosos a los que se opongan.
– Los monumentos conmemorativos en Dresde tras la IIGM en el 75 aniversario de la destrucción. Un artículo muy bien documentado y completo de los pocos y malos monumentos que se han levantado para conmemorar a los cientos de miles de civiles asesinados en Dresde con bombas de fósforo.
Describe como incluso esos monumentos no tienen normalmente imágenes o esculturas, solo frases, algunos muestran cierta culpa de los alemanes, y se han puesto al lado de otros donde se celebran a las victimas judías, o de otros temas para mezclar, de este modo las cosas.

– Entrevista con Martí Teixidor, por Jordi Garriga. Genial entrevista a este pintor que yo llamaría anarco-fascista, un rebelde, un revolucionario, un activista artístico contra el basurero del llamado arte actual. Poco conocido fue un ariete anti Tapies, anti la basura actual con sus cuadros y textos.

En Cedade pintó el cuadro ‘Dresde’, que llevamos a exponer en Austria, con enorme escándalo de las izquierdas.
19:15 Publié dans Nouvelle Droite, Revue, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nihilobstat, revue, espagne, nouvelledroite, synergies européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook