mercredi, 04 novembre 2009
Les signes symboliques des monuments funéraires du Schleswig et de la Flandre
 Les signes symboliques des monuments funéraires du Schleswig et de la Flandre
Les signes symboliques des monuments funéraires du Schleswig et de la Flandre
par Marc. EEMANS
(texte issu du Bulletin de l'Ouest, 1942, 17, pp. 196-197)
Le folkloriste bas-allemand, Freerk Haye Hamkens, que l'on connaît déjà par de nombreux travaux des plus intéressants dans le domaine de la «Volkskunde» de l'Allemagne du Nord, parmi lesquels nous citerons plus particulièrement «Das Nordische Jahr und seine Sinnbilder» et «Sinnbilder im Schleswiger Dom», vient de publier un nouvel ouvrage, dans lequel il nous expose toute sa science du symbolisme des signes traditionnels que l'on a coutume de graver depuis des temps immémoriaux sur les monuments funéraires.
Comme son titre l'indique (Sinnbilder auf Grabsteinen von Schleswig bis Flandern), le champ d'investigation du présent travail de Hamkens va des cimetières du Schleswig-Holstein, et plus particulièrement de l'île frisonne de Föhr, à ceux de l'agglomération bruxelloise. Partout Hamkens a soigneusement noté les signes symboliques conservés sur les tombes et il les a réunis dans son ouvrage en plusieurs catégories, essayant chaque fois de les grouper par genre et par familles. Pour chaque signe, Hamkens n'essaye pas seulement de déterminer la nature exacte du symbole relevé, mais encore de découvrir sa signification originelle qui diffère bien souvent du sens qu'on lui donne à l'heure présente, car «le but ultime, dirons-nous avec Hamkens, de l'étude des signes symboliques est, non seulement de relever le symbole comme tel, mais encore de déchiffrer sa signification ancienne et de trouver, si possible, les raisons qui ont présidé à sa signification actuelle. Certes, ce travail ne peut se faire en quelques mots, car le symbole étant quelque chose de vivant, ne se laisse pas enfermer dans un mot inerte. D'ailleurs, en tant que signe, il renferme en sa présence toute une série de significations, dont la connaissance est indispensable pour déchiffrer l'une de ses significations particulières».
Si pour certains symboles, tel le sablier, muni ou non de la faux fatidique, le symbolisme est clair; pour d'autres, au contraire, telle la main ou la couronne héraldique, le sens demeure obscur, et se prête à plus d'une conjecture.
Le même signe symbolique peut, d'autre part, avoir un sens totalement différent, selon qu'il sert à évoquer ou la mort, ou la vie. Il en est ainsi, par exemple, de la «main» que l'on trouve parfois, et cela depuis la préhistoire, sur certaines pierres funéraires, mais qui sert également de signe bénéfique, voire même de symbole de fécondité, comme l'affirment d'ail leurs, non sans quelque témérité, W.-F. Van Heemskerck-Düker et H.-J. Van Houten dans leur ouvrage consacré aux «Signes symboliques dans les Pays-Bas». Comment donc le passage a-t-il pu se faire de la «main», symbole funèbre, à la «main» en tant que signe bénéfique? Les explications possibles sont nombreuses cependant: il n'est également pas exclu que, même sur une tombe, la «main» figure aussi en tant que signe bénéfique notamment pour chasser les mauvais esprits qui pourraient troubler le repos du défunt.
Dans bien des cas également, les signes symboliques trouvent leur explication dans les coutumes ou le folklore général du lieu où on les relève. C'est ainsi, par exemple, que la couronne héraldique, figurant sur la tombe d'une jeune fille de 23 ans, rappelle la coutume de déposer une couronne virginale, c'est-à-dire l'ornement des épousailles, sur le cercueil de celles qui n'avaient pu s'en parer de leur vivant.
Partant de l'analyse des différents éléments qui ornent la pierre funéraire de l'évêque Nicolas 1er (1200-1216), qui se trouve au Dôme de Schleswig, Hamkens constate que les symboles qui ornent cette tombe (la croix, des palmettes et des signes solaires) relèvent de trois mondes totalement différents: le monde chrétien, le monde antique et le monde païen, et Hamkens de noter, dans son introduction, et cela non sans quelque raison: «Il est certes intéressant de noter que les signes que l'on retrouve encore de nos jours sur les pierres funéraires relèvent toujours d'un de ces trois mondes». «Comme signes chrétiens, écrit-il encore, il y a en tout premier lieu la croix, ensuite la croix et la feuille de palmier, ainsi que la composition faite de la croix, le cœur et l'ancre, en tant que symbole du groupe «foi-amour-espérance». Parfois aussi l'on trouve l'ancre seule, par allusion au passage des Psaumes: «J'ai trouvé enfin la terre qui éternellement retiendra mon ancre». Au même groupe, il faut rattacher les feuilles de palmier croisées, et la feuille de palmier seule. Il arrive qu'on évoque également la Jérusalem Divine, cependant que sur une tombe on voit également des mains sortant des nuages et se tendant vers la terre pour évoquer le fameux «laissez venir à moi les petits enfants». Comme il va de soi, il faut également rattacher au groupe chrétien les angelots et les têtes de Christ en porcelaine que l'on retrouve sur plus d'une tombe.
«Le monde antique n'a que fort rarement trouvé accès aux cimetières ruraux ou citadins, aussi peut-on dire que ce ne sont que les tombes des monarques, des nobles, des riches commerçants, des armateurs ou des savants qui sont pourvues de symboles empruntés au monde antique. Si ceux-ci, par hasard, sortent de leur sphère d'utilisation habituelle, ils sont aussitôt appelés à quelque symbolisme particulier, comme la Justice de telle tombe de l'île de Föhr, revêtue d'une crinoline du XVIIIe siècle. Quelques exceptions, comme la tombe du
«glücklichen Matthias» de Föhr, qui évoque la Fortune, se révèlent avec leurs inscriptions latines, comme un bien étranger à la tradition funéraire de nos contrées.
«Au troisième groupe appartiennent en premier lieu les attributs professionnels, comme ceux du menuisier, du maçon, du forgeron et du boucher, le moulin du meunier, ou le métier du tisseur de chanvre. Signalons plus particulièrement les images de vaisseaux sur les pierres tombales des cimetières de la côte, telles que celles que les grands navigateurs, les terre-neuviens, voire même les simples pêcheurs, avaient coutume d'en avoir, et cela en partie comme allusion à leur métier, et en partie comme symbolisation de l'ultime voyage. Un ancien marin devenu cultivateur n'hésitait également pas à croiser l'ancre et le sextant avec la gerbe de blé, pour rappeler les deux professions de sa vie».
«Ce troisième groupe se compose cependant surtout de signes, dont le rapport avec la mort et les funérailles n'est pas très évident; il en est ainsi du soleil ou du soleil levant avec un ou deux yeux, de la lune ou des étoiles, des oiseaux, des papillons, des serpents, des fleurs, des arbres ou de leurs branches, des ruches d'abeilles, des pommes, des couronnes, des losanges, des cœurs et des spirales. Tous ces signes se retrouvent seuls ou accouplés à d'autres signes du même groupe, ou à ceux de l'un des deux autres groupes. Ils sont toujours exécutés avec le plus grand soin et dominent généralement la pierre tombale, de telle manière que l'inscription funéraire n'est bien souvent plus que chose accessoire».
Il nous est hélas impossible de suivre ici, faute de place, Hamkens dans la description minutieuse de tous ces signes qui se font de plus en plus rares dans nos cimetières car la banalisation de la vie moderne et le détachement de plus en plus grand de nos contemporains des signes éternellement vivants qui nous lient à l'essence même de notre existence, y font également leurs ravages, au point que d'ici quelques décades, nos cimetières, à moins qu'un revirement ne se produise, seront devenus des lieux arides, dépourvus de tout contact avec les lois qui rythment la vie de l'homme et le font communier avec le principe de toutes choses.
Avant de terminer ces notes, trop brèves, en marge du beau livre de Hamkens, parfaitement édité par le «Deutscher Verlag: Die Osterlingen in Brüssel», constatons encore avec lui qu'un observateur attentif remar quera que la plupart des signes symboliques figurent sur des pierres tombales réparties dans plusieurs régions, cependant que d'aucuns, par contre, ne figurent que dans certaines régions bien déterminées. C'est ainsi, par exemple, que les papillons et les ruches d'abeilles se retrouvent un peu partout, ce qui n'empêche que ces dernières manquent cependant dans les environs de Eckernförde et de Borby. Le navire est une spécialité des îles frisonnes, que l'on ne trouve guère sur les tombes des gens de mer dans les cimetières des ports de la mer du Nord; sur certaines tombes de pêcheurs, on trouve cependant un bateau à voile avec filet. Le serpent entourant une boule, appartient en propre au duché de Schleswig, et plus spécialement à la région de Flensburg, tout comme la croix ou nœud magique ne se retrouve que sur les croix tombales d'Eckernförde. En comparant les dates on peut également constater que certains symboles n'apparaissent qu'à un moment déterminé pour évoluer lentement, comme on a pu le constater pour le groupe «foi-amour-espérance». D'autres symboles disparaissent brusquement, comme c'est le cas pour les bateaux à voile des îles frisonnes. Peut-être faut-il trouver pour cet exemple la raison de sa disparition dans le fait que de moins en moins de gens pratiquent encore le métier de marin».
Nombre d'autres constatations pourraient encore être faites, tout comme nombre d'autres conclusions (Hamkens ne s'en fait d'ailleurs pas faute), pourraient encore être tirées du présent travail d'investigation. Nous nous contenterons cependant d'en tirer, pour l'instant, la seule conclusion que voici: Avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant que toutes les tombes à symboles n'aient irrémédiablement disparu de nos contrées, il importe d'en dresser un inventaire aussi complet que possible, cela selon toutes les méthodes scientifiques de la «Volkskunde». De ce travail on pourra alors déduire certaines conclusions irréfutables quant à l'appartenance de telle ou telle région à tel ou tel groupe ethnique, quant aux influences étrangères, ou encore, quant à l'apparition ou à la disparition, dans les régions étudiées, de tel ou tel phénomène religieux, politique ou spirituel etc., etc. Bref, l'étude des signes symboliques des monuments funéraires, est un secteur nullement négligeable, comme on a pu s'en rendre compte par les présentes notes, de la «Volkskundeforschung»
Marc. EEMANS.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, symboles, symbolologie, mythes, mythologie, allemagne, flandre, pays-bas |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 novembre 2009
La resistencia corporativa en Francia: socialismo, tradicionalismo y "comunidades naturales"
| La resistencia corporativa en Francia: socialismo, tradicionalismo y “comunidades naturales”
por Sergio Fernández Riquelme / http://www.arbil.org/ Una introducción histórica explicativa | |
| Socialismo y tradicionalismo, supuestos enemigos doctrinales (histórica e ideológicamente) presentan rasgos comunes, e incluso caminos paralelos, en la Historia de las ideas políticas y sociales, en especial sobre el tema del corporativismo. Como bien demostró en el caso español Gonzalo Fernández de la Mora, mostrando las raíces organicistas comunes en tradicionalistas y socialistas, e incluso de liberales (al calor de la introducción del krausismo en España), “lo corporativo” sigue siendo es una realidad presente en el funcionamiento extraparlamentario (sindicatos y lobbys, colegios profesionales y grupos de presión, intereses económicos y poderes locales) de las democracias parlamentarias en Europa y en América a inicios del siglo XX. Y esta realidad, en su trayecto histórico, puede ser ejemplificada en el caso francés, paradigma del centralismo estatista y laicista, pero sede también de importantes debates y teorías de naturaleza corporativa. Así, y como otras modalidades de la Política social difundidas desde 1848 [1] , el corporativismo fue respuesta directa a la Cuestión social, presentada por historiadores sociales, sociólogos y juristas como consecuencia del impacto de la Revolución industrial, y como un mal que afectaba a la relación armónica entre clases. Pero lo corporativo no solo asumió la forma de una política social jurídica (política del trabajo) o asistencial; su especificidad radicaba en su propuesta grupal de regulación del conflicto surgido en las relaciones entre la propiedad y el trabajo. Los cuerpos sociales intermedios desempeñaban para Patrick de Laubier, un papel mediador clave para alcanzar la finalidad de la Política social, la “justice sociale” [2] . El poder político se convertía por ello en “l´intemédiaire de grupes organisés”, y el corporativismo aparecía como mediación entre el Estado y el Sindicalismo, los dos actores principales de la Política social. En este contexto, el notable desarrollo conceptual y doctrinal del corporativismo francés, desde su génesis en el siglo XIX, de tanta influencia en España [3] , no fue siempre paralelo al de su institucionalización jurídico-política. Bajo la herencia de la Ley Le Chapelier (1791), que marcó el camino en Europa a la destrucción legal de las “comunidades naturales” (en esencia las funciones sociales de municipios, gremios y familias), durante el siglo XIX tanto el liberalismo jacobino como el doctrinario hicieron caso omiso a las propuestas “socialistas” de Luis Blanc y Hénri de Saint Simon, y al legado “tradicionalista” de Luis de Bonald [1754-1840] y de Joseph de Maestre [1753-1821]. Incluso, las propuestas de reforma corporativa del modelo constitucional de la III República francesa, preconizadas por Émile Durkheim, Leon Duguit, M. Hariou, además de las tesis organicistas del liberal Bertrand de Jouvenel, no alcanzaron el sueño de una Cámara corporativa o gremial/profesional. Ni corporativismo ni solidarismo; sólo las presiones sindicales (con la CGT a la cabeza) y la influencia del Reichwirtschaftsrat de la Constitución de Weimar (1919), permitieron crear en Francia el Consejo Nacional de economía por el Decreto de 19 de enero de 1925, acuerdo corporativo reeditado en L´Accord de Matignon de junio de 1936 bajo la presidencia del frentepopulista León Blum [1872-1950] entre “les puissances économiques”: la CGPF empresarial y la CGT sindical [4] . Pero en este proceso de infructuosa institucionalización destacaron las elaboraciones de la sociología católica. A. de Mun, L. Harmel, F. Le Play o R. la Tour asumían ciertas tesis de los legitimistas de Bainville y los tradicionalistas de Bonald, especialmente la idealización de la pretérita sociedad de estamentos y gremios, de jerarquía patriarcal y núcleos familiares, de autonomías y solidaridades comunales. Frédéric Le Play [1886-1882] planteó una concepción “subsidiaria” del reformismo obrero y social, que situaba a la familia como “prototype de l´Etat” [5] . Esta propuesta fue sintetizada en la doctrina que denominaba como “patronalismo”, desarrollada en La réforme sociale en France (1864) y L´Organisation du travail (1870). Partiendo de la subordinación de lo político a lo ético, y de la interacción entre ciencia positiva y religión, Aunós leía en Le Play como “las intervenciones del Estado deben ser muy espaciadas, concretas y llenas de circunscripción, mostrándose igualmente pesimista en lo que se refiere al papel que han de desempeñar las asociaciones de clase”, y complementadas por el trabajo doméstico, la función social de la familia y la conciliación sociolaboral [6] . Igualmente, en el seno de la “L´Association Catholique” [1876-1890], junto al Manuel d´une corporation chrétienne (1890) de L.P. Harmel, destacó la obra del diputado católico Albert de Mun [1841-1914], dedicado no sólo a desarrollar los círculos católicos obreros en Francia, llegando hasta casi 30.000 miembros, o defender en el Parlamento de la III República los derechos de los fieles al magisterio vaticano; además generó una relevante teoría en sus discursos recogidos en La question ouvriére (1885) y L´Organisation professionelle (1901) [7] . Pero de todos los autores antes citados, destacó sobremanera el marqués René La Tour du Pin [1834-1942], de quién Aunós resaltaba su aportación de “los verdaderos cauces de las reformas sociales y de la organización corporativa” [8] . La Tour du Pin encabezó el modelo de Monarquía social católica desde la Francia finisecular. Frente al capitalismo burgués y el socialismo bolchevique, La Tour defendía la necesidad de un “Orden social católico” basado en la corporación profesional (de raigambre medieval): un orden que regulase corporativamente el mundo del trabajo (“organización corporativa de los talleres”), la economía y la política. “La constitución nacional” (o “leyes fundamentales del Reino”) era enemiga de las formas republicanas y monárquicas que sostenían el principio de la soberanía nacional. Las luchas sociales entre propietarios y obreros, la anarquía pública y el individualismo moral (visibles en 1848 y 1873) requerían con urgencia un nuevo modelo político social corporativo, de naturaleza cristiana y de modelo medieval-gremial. La doctrina sobre un “orden social cristiano” de La Tour se fundaba en el magisterio pontificio (religión católica), la mitología medieval (monarquía tradicional) y la fenomenología social (corporativismo de Durkheim). Bajo esta tras tradiciones, su orden resultaba así católico (“propiedad de Dios” bajo administración humana), monárquico (“un rey en la cúspide” que “cumple el más alto de los trabajos de la nación” y por ese “trabajo se hace verdaderamente rey”) traducido al lenguaje político-social), y orgánico (“por el cual los elementos que la componen se si ente unidos y solidarios, formando parte de un conjunto orgánico”). Un orden que se encontraba en condiciones, para La Tour, de adaptarse a las mutaciones contemporáneas mediante un “régimen corporativo” que “no debe implicar el retorno a las corporaciones medievales, sino la formación de otras más adecuadas al tiempo presente, a base de patrimonio corporativo, de la intervención en su constitución y gobierno de todos los elementos productores y el ascenso dentro de los oficios por obra de la capacidad profesional” [9] . Ahora bien, pese a décadas de notable fecundidad doctrinal, la escuela corporativa católica francesa se sometió, en gran parte, a las exigencias de realliment de la democracia cristiana con la III República francesa. Pese a ello, el fracaso del sistema político representativo de la III República, pese a la unidad nacional alcanzada por la movilización durante la I Guerra mundial, dio alas a nuevas fórmulas corporativas asentadas en regímenes fuertes y autoritarios, no directamente vinculadas al magisterio católico. En este proceso jugaron un papel determinante los doctrinarios participantes en el diario L`Action française (1905-1945), continuador de la Revue d'Action française fundada por Jacques Bainville [1879-1936]; intelectuales que definieron un moderno nacionalismo contrarrevolucionario, el cual fue modelo de renovación de los discursos, medios de difusión y aparatos organizativos de la creciente derecha antiliberal española [10] . En este movimiento jugó un papel decisivo su principal fundador e ideólogo, Charles Maurras [1868 1952], que convenció a cierto sector del nacionalismo galo de la necesidad de las tesis monárquicas y católicas. Influido por el nacionalismo de Maurice Barrès, Maurras retomó en esta revista el movimiento fundado en 1898< por el profesor de Filosofía Henri Vaugeois y el escritor Maurice Pujo. Trois idées politiques (1898) [11] fue el testimonio de su primera evolución ideológica [12] . De la mano de Maurras se generaba un nuevo tradicionalismo francés que integraba el bagaje intelectual del nacionalismo laico y positivista. Tras situarse radicalmente en contra del régimen parlamentario de la III República, Maurras encabezó la modernización de la doctrina tradicionalista combinando el positivismo sociológico y el legitimismo orleanista de Bainville [13] . En su obra Enquête sur la monarchie (1900-1909) fue delimitando doctrinalmente este nacionalismo integral y monárquico, que atrajo a numerosos republicanos y sindicalistas vinculados al ideal corporativo o a posiciones antiparlamentarias; su síntesis entre Nación y Tradición rompía la histórica posición antinacional del legitimismo, atrayendo a numerosos sectores de las clases medias deudoras espirituales de un catolicismo convertido en factor de legitimación cultural y de cohesión social, aunque nunca en dogma a seguir (visible en el público agnosticismo de Maurras) [14] . Maurras sintetizaba así las dispersas corrientes doctrinales de la derecha francesa, desde De Maistre hasta Bonald, pasando por Taine, Renan, Fustel de Coulanges, e incluso Proudhon- que había brotado a lo largo del siglo XIX como reacción al significado social y político de la Revolución de 1789 (tesis contenida en Romantisme et Révolution, 1922) [15] . Con todo ello, desde una visión positivista propia, que designó con el nombre de “empirismo organizador”, Maurras proclamó un nuevo orden en la sociedad, regido por una serie las leyes descubiertas por la historia y la sociología [16] . Siguiendo a Comte, Maurras asimilaba la sociedad a la naturaleza como “realidad objetiva”, independiente de la voluntad humana [17] . La sociedad suponía un “agregado natural” determinado por las leyes de jerarquía, selección, continuidad y herencia; así criticaba el romanticismo estético y literario de J.J. Rousseau, y vinculaba este método con la tradición católica y clasicista francesa (L'Action française et la religion catholique, 1914). Por ello cuestionaba tanto la Revolución de 1789, auténtica insurrección contra la genuina tradición francesa, representada por el orden monárquico, católico y clásico, inicio de la decadencia nacional que Francia padecía a lo largo del siglo XIX, y que llegaría a su cenit con la derrota ante Prusia en 1870; como la III República, culminación de estas “ideas destructivas” destructivas, especialmente una “democracia inorgánica” que sacralizaba el régimen electivo, la centralización administrativa, el monopolio burocrático, y con ello, la desintegración de la sociedad y el debilitamiento de la nación. Este nuevo orden propugnado por Maurras se materializaba, a través de una “encuesta histórica”, en la doctrina del nacionalismo integral y el ideal de la Monarquía como régimen de gobierno ideal y funcional [18] . La defensa de la nación francesa exigía la instauración de la monarquía tradicional y representativa, portadora de los valores característicos del catolicismo y del clasicismo [19] . Éste era el contenido de su “politique d'abord”, donde la monarquía hacía coincidir el interés personal del gobernante y el interés público, la herencia del poder político y la duración de la nación. Frente a la democracia republicana “desorganizada, discontinua y dividida, “el interés nacional” exigía la inmediata supresión del parlamentarismo y de los partidos políticos. Frente a ellos, la nueva Monarquía “representativa” reuniría el principio político monocrático en el monarca (que reunía en su persona la totalidad del poder) y el principio democrático en un conjunto de cámaras de carácter corporativo [20] . El Estado recuperaría, así, sus funciones tradicionales, respetando la libertad económica y social en mano de los individuos y las corporaciones. Este régimen garantizaría tanto la descentralización territorial (reconstruyendo las regiones), como la profesional restaurando los gremios, moral y religiosa (recuperando la influencia de la iglesia católica en la sociedad civil) [21] . Así llegó el momento de L'Action française [22] , empresa intelectual a la que se sumaron el economista Georges Valois [1878-1945], el polemista Leon Daudet, el historiador Jacques Bainville, el crítico Jules Lemaître, y unas juventudes proselitistas llamadas “ Camelots du Roi” [23] . Pero pronto se mostraron las veleidades políticas del grupo. En las elecciones de 1919 apoyaron a la Unión Nacional y lograron situar a Daudet en el Parlamento. Acusados de antisemitas y radicales, Pio XI condenó la obra de Maurras, situando sus libros en el Index Librorum Prohibitorum el 29 de diciembre de 1926 . Ahora bien, estas condenas no frenaron adhesiones como las de Georges Bernanos o Robert Brasillach, pero tampoco defecciones como la del mismo Valois, fundador del Faisceau, o de Louis Dimierm, nuevo dirigente de La Cagoule. Estas polémicas surgieron, en gran medida, de la posición ambivalente con respecto al fascismo italiano. Maurras alabó en numerosas ocasiones al nacionalismo fascista llegándolo a definir como “un socialismo libre de la democracia y de la lucha de clase”; pero también condenó tanto el totalitarismo de Mussolini como el estatismo exacerbado del nacionalsocialismo. En esta polémica medió el antiguo sindicalista Valois [24] , que propugnaba un entendimiento con estos regímenes, y con la “escuela” Georges Sorel. Así nació el Círculo Proudhon (1911), movimiento cultural contrario a la democracia liberal y a favor de la descentralización regional. Pero las posiciones esencialmente revolucionarias de los sorealianos, irreductibles en el ideal de la lucha de clases, se mostraron finalmente inadmisibles para la tradición organicista y gremialista del nacionalismo integral de Maurras. Georges Valois, pseudónimo de A.G. Greseent, vinculó tradicionalismo y fascismo en su obra L'économie nouvelle (1919). En ella planteaba un régimen sindical corporativizado, presidido por un gran Consejo económico y social nacional, articulado sobre la representación orgánica de oficios y regiones, y desarrollado a través de Consejos locales capaces de suministrar los representantes generales y de reflejar la voluntad de las pequeñas células de la vida social y económica [25] . Valois no hablaba del Parlamento del Trabajo socialista, sino de un esquema jerárquico divido en escalones de producción y en necesidades económica; por ello señalaba que “este esquema reposa no sobre una ideología, sino sobre principios deducidos de la observación de los hechos contemporáneos, y tiene en cuenta las necesidades de la producción y de las creaciones espontáneas de la vida económica” [26] . Esta preocupación por temas socioeconómicos le situó en la llamada “ala izquierda” de Accción francesa, ala que leia y debatía a G. Sorel y a P. Proudhon (Le Monarchie et la classe ouvriere, 1914, o La Revolution nacionale, 1922), y fue atraído finalmente por la experiencia del fascismo italiano (Le Fascisme, 1927) [27]. Años después, y a la sombra de Maurras, más de medio centenar de intelectuales buscaron en el “nacionalismo integral” el sistema político-social capaz de derrocar a la III República francesa. Esta generación tuvo su oportunidad en 1941, tras la división del país con la ocupación alemana. En febrero de 1941 Ch. Maurras denominó como “divina sorpresa” la decisión del mariscal Philippe Pétain [1856-1951] de expulsar a Pierre Laval del Gobierno; por ello apoyó de manera plena la política del Gobierno de Vichy, en el que vio el símbolo de la unidad nacional, como continuación de la "Unión sagrada ” de 1914. El mismo mariscal llamó a Maurras y sus discípulos para dotar al nuevo Estado francés de un armazón doctrinal corporativo y antiparlamentrio, amén de contar con “La legión de Combatientes y Voluntarios” del coronel La Roque como movimiento político, y de la integración de los miembros del PSF (Partido Social francés) y del PPF de Jaques Doriot (Partido popular francés). Así, en el París ocupado por las fuerza germanas, un sector declaradamente fascista se unió a las tesis de Drieu La Rochelle [1893-1945] sobre un Estado totalitario de extensión continental; mientras, en Vichy la “revolución nacional” desarrollada por Maurras tomó los valores conservadores de “trabajo, familia y patria”, alcanzando gran influencia los neotradicionalistas de Raphaël Alibert , convertido en ministro de Justicia, buscando establecer un régimen corporativo y agrarista. Los maurrasistas defendieron la retórica monárquica, los principios católicos, y la imagen idílica de la antigua sociedad gremialista y rural, gracias en gran medida a la labor de Philippe Henriot y Xaviert Vallat desde la Secretaria de propaganda. Pese a su rotundo “antigermanismo”, al final de la II Guerra mundial Ch. Maurras fue condenado a cadena perpetua y su revista fulminantemente prohibida. El nuevo régimen presidencialista y estatista marcado por el general Ch. De Gaulle [1890-1970], dejó al corporativismo limitado a la burocratización del poderoso sindicalismo obrero y funcionarial, y a las propuestas “populistas” de Pierre Poujade [1920-2003]. Poujade fue el responsable de la fundación en 1954 de la Union de défense des commerçants et artisans (UDCA), movimiento en defensa de los intereses de las clases profesionales y grupos artesanales de las provincias francesas, frente al sistema fiscal estatal y el monopolio burocrático propio de la IV República [28] . El poujadismo se convirtió durante varias décadas en el portavoz de los “trabajadores independientes", de los "artesanos y comerciantes" de la Francia “de abajo” contra las “200 familias privilegiadas” [29] . ·- ·-· -······-· Sergio Fernández Riquelme Notas
[1] Véase Jerónimo Molina, La política social en la historia. Murcia, Ediciones Isabor, 2004, págs. 160-189. [2] La aparición de la Política social respondía a una combinación de factores económicos políticos y psicológicos propios del siglo XIX, resultantes de la industrialización, el progreso de la democracia en el seno de los Estados centralizados y la creciente conciencia sobre los derechos políticos y sociales. Así definía a la Política social como “el conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación, o cambiar las condiciones de vida material y cultural de la mayoría conforme a una conciencia progresiva de derechos sociales, teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas de un país en un momento dado”. Esta definición cubría, para De Laubier, “un dominio que se sitúa entre lo económico y lo político como medio de conservación o reforzamiento del poder el Estado”. Patrick de Laubier, La Polítique sociale dans les societés industrielles. 1800 à nos tours . París, Economica, 1984, págs. 8-9. [3] Las concepciones reformistas o autoritarias del corporativismo alumbradas al otro lado de los Pirineos, ejercieron una enorme influencia en nuestro país, bien por la cercanía geográfica, bien por el ascendiente de superioridad intelectual que gran parte de los académicos hispanos les otorgó. Del corporativismo católico, la modernización funcional del pasado romántico de La Tour du Pin fue el referente básico del Estado corporativo de Aunós y del Estado nuevo de Pradera, mientras Albert de Mun marcó en buena medida a Severino Aznar. De Durkheim tomaron nota algunos intelectuales, más cercanos al naciente debate sobre la ciencia sociológica que a las siempre lejanas tesis sobre el positivismo y el funcionalismo: el krausoinstitucionista Azcárate criticaba el “sociologismo” de Durkheim por abordar la materia religiosa desde el positivismo sociológico. Véase Gumersindo de Azcárate, La religión y las religiones, Conferencia en la Sociedad El Sitio. Bilbao, 16 de mayo de 1909, págs. 259-260), Adolfo G. Posada fue lector suyo de la mano de Duguit y Le Bon, mientras Severino Aznar hacía referencia al prefacio de la segunda edición de la División apuntado que “toda escuela sociológica y positivista científica que tiene admiradores en todo el mundo culto ha llegado a las mismas conclusiones que desde hace medio siglo están difundiendo los reformadores sociales católicos. Durkheim, que no tiene ninguna religión positivista, y que es hoy el mayor prestigio sociológico de Francia, llegó a las mismas conclusiones que Hitze, sacerdote, uno de los más ilustres campeones del régimen corporativo de Alemania” Cfr. Severino Aznar Estudios económicos y sociales. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1946, pág. 214. Las primeras ediciones de las obras de Durkheim en España reflejan, por sus fechas, cierta tardanza en su publicación, y por sus traductores, cierta pluralidad de corrientes: el abogado Antonio Ferrer y Robert, el jurista Mariano Ruiz Funes, el sociólogo Carlos G. Posada, el politólogo Francisco Cañada y el líder sindical Ángel Pestaña. Posteriormente fue objeto de atención por la filosofía social de la Escuela de Madrid, y en especial por José Ortega y Gasset y su modelo burgués y meritocrático, profesional y laico de “orden moral” para la sociedad de su época. Mientras, del corporativismo sindical implantado por la CGT, tomaron nota socialistas como Fabra, De los Ríos y Besteiro; del “nacionalismo integral” de Charles Maurras y el “legitimismo” de Bainville quienes ayudarían decisivamente al punto de inflexión de la tradición corporativa española desde las páginas de Acción española o en el organicismo de la Lliga catalanista de F. Cambó y Ventosa.
[4] Al respecto véase Daniel Ligou, Histoire du socialisme en France, 1871-1971. París, Presses Universitaires de France, 1962, págs. 416-417. [5] F. Ponteil, Les classes bourgeoises et l´avenement de la democratie, 1815-1914. París, Albin Michel, 1968, págs. 438 sq. [6] Ídem , pág. 482. [7] G. Fernández de la Mora , Los teóricos izquierdistas de la democracia orgánica. Barcelona, Plaza y Janés, 1986. pág. 175. [8] Aunós lo llegaba a considerar como el verdadero “anti-Marx” en el prologará en la edición española René la Tour du Pin, Hacia un orden social cristiano. Madrid, Cultura español, 1936, pág. 34-35. [9] Ídem, pág. 484. [10] Su idea de “Monarquía neotradicional” afectó sobremanera a los alfonsinos de Renovación española, a los tradicionalistas de Pradera y a distintos intelectuales nacionalistas españoles (de Eugenio d´Ors a Ernesto Giménez Caballero). Con la lectura de Maurras, el neotradicionalismo hispano rescataba a Donoso y Balmes (entrelazados con Bonald y De Maistre), modernizaba la difusión de su doctrina y sus medios de movilización. Pese al agnosticismo declarado del doctrinario provenzal y la condena vaticana a través de la Encíclica Nous avons lu, varios elementos le hacían imprescindible: la restauración monárquica, el antidemocratismo corporativista, el nacionalismo tradicionalista, y la posibilidad de una “solución de fuerza”contrarrevolucionaria. [11] Recogido en Charles Maurras , “Trois idees politiques”, en Romantisme et Revoiution. París, Nouvelle Librairie Nationale, 1922, págs. 262 sq.
[12] Herni Massi , La vida intelectual en Francia en tiempo de Maurras . Madrid, Rialp, 1956, págs. 21 sq. [13] A quién prologó su obra Jacques Bainville , Lectures. París, Arthème Fayard, 1937. [14] Sobre los orígenes de este movimiento destacan las obras de Raoul Girardet , Le Nationalisme français, 1871-1914, Seuil, Paris, 1983 ; y François Huguenin, À l'école de l'Action française, Lattès, Paris, 1998
[15] Sobre su influencia en España véase P.C. González Cuevas , “Charles Maurras y España”, en Hispania, vol. 54, nº 188. Madrid, CSIC, 1994, págs. 993-1040; y “Charles Maurras en Cataluña”, Boletín de la real Academia de la Historia, tomo 195, Cuaderno 2. Madrid, 1998, págs. 309-362 [16] Charles Maurras , Romantisme et Revolution, Nouvelle Librairie Nationale, París, 1922, pág. 11.
[17] Ch. Maurras , “La politique religieuse”, en La democratie religieuse. París, Nouvelles Editons Latines, 1978, pág. 289.
[18] Pierre Hericourt, Charles Maurras , escritor político. Madrid, Ateneo, 1953, págs. 13 sq. [19] Dimensión de su pensamiento analizada por Alberto Caturelli, La política de Maurras y la filosofía cristiana. Madrid, Ed.Nuevo Orden, 1975. [20] Ch. Maurras, Encuesta sobre la Monarquía. Madrid , Sociedad General Española de Librería, 1935, págs. 65 y 705-706. [22] Movimiento estudiado por Eugene Weber , L'Action Frangaise. París, Fayard, 1985. [23] Junto al diario L'Action Française, otros órganos de difusión de las ideas maurrasianas fueron el Círculo Fustel de Coulanges o la Cátedra Syllabus. [24] Sobre su obra doctrinal podemos citar el estudio de Yves Guchet, Georges Valois .L’action Française - Le Faisceau - La république Syndicale. París, Albatros, 1975. [25] Georges Valois , L'économie nouvelle. París, Nouvelle Librairie Nationale, 1919, págs. 24 sq. [26] Publicado en España como G. Valois , “La representación de intereses”, en Acción española, nº 51, Madrid, 1934, págs. 80 y 81. [27] Eugene Weber , “Francia”, en H. Rogger y E. Weber, op.cit., págs. 63-108 . [28] Poujade protagonizó desde 1953 una revuelta contra el Estado francés, encabezando un notable grupo de pequeños comerciantes que protestaba contra la que consideraban como una elevada presión tributaria, tanto normativa como administrativa. Nacía el llamado “poujadismo”, que tras fundar el grupo político ”Unión de Defensa de los Comerciantes y Artesanos (UDCA)”, entró en la misma Asamblea Nacional de 1956 con 52 escaños, entre ellos el de un joven J. M. Le Pen. Aunque la llegada del general De Gaulle, a la presidencia de la República en 1958, comenzó a frenar la expansión de este experimento político, que años más tarde el Frente Nacional quiso capitalizar como antecedente. [29] Un testimonio directo lo encontramos en Pierre Poujade, J'ai choisi le combat Saint-Céré, Société générale des éditions et des publications, 1955. |
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, corporatisme, théorie politique, histoire, france, traditions, traditionalisme, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 28 octobre 2009
Julius Evola: The Path of Cinnabar
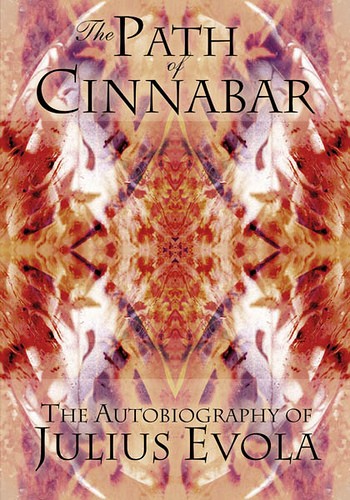 Julius Evola: The Path of Cinnabar
Julius Evola: The Path of Cinnabar
Quick Overview
Not previously available in the English language, this is the first translation of Julius Evola’s autobiography, Il Cammino del Cinabro. The book provides a guide to Evola’s corpus as he explains the purpose of each of his books. This book is the key which unlocks the unity behind Evola’s diverse interests. It is a perfect place to start for those new to Evola’s thought, and a must read for all seasoned Evolians. The book includes hundreds of well-researched footnotes and a complete index. This book is also available in a hardback edition.
Product Description
Julius Evola was a renowned Dadaist artist, Idealist philosopher, critic of politics and Fascism, 'mystic', anti-modernist, and scholar of world religions. Evola was all of these things, but he saw each of them as no more than stops along the path to life's true goal: the realisation of oneself as a truly absolute and free individual living one's life in accordance with the eternal doctrines of the Primordial Tradition. Much more than an autobiography, The Cinnabar Path in describing the course of Evola's life illuminates how the traditionally-oriented individual might avoid the many pitfalls awaiting him in the modern world. More a record of Evola's thought process than a recitation of biographical facts, one will here find the distilled essence of a lifetime spent in pursuit of wisdom, in what is surely one of his most important works.
Additional Information
| Title | Julius Evola: The Path of Cinnabar (Softcover) |
| Author | Evola, Julius |
| Full Title | The Path of Cinnabar: An Intellectual Autobiography |
| Binding | Softcover |
| Publisher | Integral Tradition (2009) |
| Pages | 302 |
| ISBN | 9781907166020 |
| Language | English |
| Price | € 19.95 |
| Short Description | Not previously available in the English language, this is the first translation of Julius Evola’s autobiography, Il Cammino del Cinabro. The book provides a guide to Evola’s corpus as he explains the purpose of each of his books. This book is the key which unlocks the unity behind Evola’s diverse interests. It is a perfect place to start for those new to Evola’s thought, and a must read for all seasoned Evolians. The book includes hundreds of well-researched footnotes and a complete index. This book is also available in a hardback edition. |
| Table of Contents | Foreword 1. The Path of Cinnabar Appendix: Interviews with Julius Evola (1964-1972) |
| About the Author | Julius Evola (1898 -1974), Italian traditionalist, metaphysician, social thinker and activist. Evola is an authority on the world's esoteric traditions and one of the greatest critics of modernity. He wrote extensively on ancient civilisations of both East and West and the world of Tradition. |
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, evola, italie, philosophie, révolution conservatrice, avant-garde, dadaïsme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 octobre 2009
L'exemple du héros
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
L'EXEMPLE DU HEROS
Dans la quatorzième livraison de la revue bimensuelle des Diipetes (Athènes, Grèce), un article de Thomas Mastakouri traite de la notion du Héros dans nos sociétés européennes antiques. Les idées développées par l'auteur, tout en étant discutables, ont cependant le mérite de nous interpeller et nous invitent à une profonde auto-réflexion critique.
Nous vivons à une époque de grande aliénation morale et il va de soi que de puissants intérêts économiques nous dirigent. Pour que ceux-ci puissent continuer à croître, ils n'ont besoin que d'une chose: transformer la masse des individus en troupeau, le citoyen devenant une unité docile, ne réagissant qu'en fonction de la volonté et des avantages des bergers. L'avilissement, la destruction de la personnalité sont à l'ordre du jour et la passivité a gagné la plupart des hommes. Qu'en est-il des réactions éventuelles? Qu'entend-t-on le plus souvent? “Laisse tomber”, “c'est un mauvais moment à passer”, “c'est nous qui allons sauver le monde?”, “il y a pire”, “on est bien comme ça”, etc... Et ceux qui tentent de réagir? Des mots creux, quelques insultes devant l'image du politicien qui apparaît sur le petit écran en attendant le jeu télévisé habituel avec ses cadeaux et ses starlettes.
La voie suivie aujourd'hui par l'humanité est celle du martyr; celui qui baisse la tête, parce qu'il a été ainsi éduqué par sa religion, ses gouvernants, son école, et ses parents. Mais est-ce que cela a toujours été ainsi et plus particulièrement dans nos contrées? Celui qui a quelques connaissances historiques et un peu d'esprit critique connaît la réponse. La civilisation qui, à une époque, a régné sur cette terre hellène ne se fondait pas sur l'exemple du martyr et de l'esclave mais sur celle du Héros qui, comme une flamme, se cache dans chacun d'entre nous et ne se transforme que rarement de nos jours en feu pour réchauffer, éclairer, brûler et se consumer.
L'hellénisme et la civilisation européenne en général ne se sont pas fondés sur la notion de masse comme d'autres civilisations antiques pour bâtir le monde contemporain mais au contraire sur celle de la personne.
Nos ancêtres adoraient les Héros comme des Dieux. Pour eux, il n'y avait pas de gouffre entre l'Homme et le Dieu et chaque Cité hellène honorait certains de ses morts comme des Déités. Ainsi, Athènes honorait Thésée et Cecrops, Sparte Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène et Clytemnestre, Thèbes Kadmos, la Théssalie Jason, l'Etolie Méléagre, la Crête Minos, Corinthe Belléphoron. Les Héros, mythiques ou historiques représentaient des exemples moraux et chaque Cité-Etat avait les siens exactement comme les saints patrons par la suite. Les Héros se réveillaient de leur profond sommeil et apparaissaient dans des circonstances de crise pour sauver leur cité chérie d'un danger qui les menaçait. Ainsi, Thésée apparut aux Athéniens avant la bataille de Marathon et la légende dit que les Galates furent mis en déroute à Delphes par le fantôme de Néoptolème, le fils d'Achille. Cet article n'a pas pour but de dresser la liste de tous les Héros du passé mais de mettre en valeur les caractéristiques essentielles de leur comportement qui servait de modèle à nos aïeux et a profondément transformé et relevé la civilisation hellène. Vivant, comme nous l'avons dit, à une époque de relachement et de dégénérescence des consciences, la mise en relief de ces particularités pourra sûrement nous fournir des armes qui nous permettraient de lutter contre l'aliénation qui menace de toutes parts.
Ainsi, le premier caractère du Héros est son individualité absolue. Il n'est jamais intégré dans la masse et ne suit ni ses réactions ni ses désirs. Sa volonté est exclusivement la sienne et, s'il devait être influencé par une quelconque obligation morale, il le fait sciemment, conscient des limites qu'il s'impose. L'héroïsme ne peut se développer au sein d'une société despotique que celle-ci soit théocratique ou absolutiste.
En second lieu, le Héros aime le changement. Sans évolution, quelque chose dort en nous et ne se réveille que rarement. Bien qu'il contribue à l'instauration de l'ordre au sein d'une société chaotique, lui-même préfère le désordre et l'incertitude. L'héroisme tel un aiguillon s'oppose aux acquis, refuse le compromis, secoue les fondements pourris d'une collectivité. Tout est en perpétuel mouvement, disait le grand philosophe Héraclite, et toute société figée, sans Héros pour la sortir de son marasme est, à plus ou moins long terme, vouée à disparaître. C'est ce qui est arrivé aux anciens Egyptiens. Pendant des millénaires, ils ont bâti une civilisation dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Cependant, leur système despotique et théocratique étouffait toute individualité. Qui peut nous citer un grand Héros égyptien? Quelqu'un —à l'exception des pharaons— qui, dans un éclat d'individualité ait fait évoluer l'Histoire?... Qu'en est-il advenu de cette brillante civilisation? Elle est enterrée sous les sables de l'Histoire, faute de Héros.
Les re'igions étrangères se sont abattues sur un empire romain décadent dont l'absolutisme démentiel s'était attelé à supprimer toute forme d'individualité et à niveler les membres de la société. Dès le début, le modèle du Héros fut remplacé par celui du martyr. Celui de l'individu qui se donne à une collectivité souveraine, un Dieu, un Gouvernement, un Empereur. L'exemple de celui qui vit et meurt sans se poser de questions, ne remet pas en cause les Dogmes qui lui sont imposés, croyant aveuglément et se remettant à d'autres pour son salut, sa protection et sa sécurité.
Certains confondent à tort Héros et martyr. Comme nous l'avons déjà dit, le Héros se bat jusqu'à son dernier souffle, ne rend jamais les armes, ne subit pas passivement son destin. Son principal souci consiste à valoriser l'immortalité de son âme, à la perfectionner au fil des luttes afin de gagner sa place parmi les Dieux et ce, sans l'aide de personne.
Il n'ignore pas que le combat est inhérent à la nature humaine, qu'il ne peut y avoir de progrès sans les contraires. Il ne s'avoue jamais vaincu même s'il sait que tout est perdu d'avance. Il place sa dignité et son honneur au-dessus des problèmes quotidiens. Ainsi, Achille était conscient de son destin funeste s'il devait venger la mort de Patrocle mais cela ne l'a pas empêché de le faire. Cucchulainn, le plus grand des Héros irlandais n'a pas hésité à prendre les armes alors même que son druide-instructeur lui avait prédit qu'il allait connaître la gloire et la grandeur mais qu'il allait en mourir avant que ne lui pousse un seul cheveu blanc sur la tête. Lorsque le dragon Fafnir, agonisant, menace Siegfried de sa malédiction, ce dernier lui répondit que bien que chacun voulut garder ses trésors pour toujours, l'heure de la mort arrivait pour tous. Ils sont tous Héros, c'est-à-dire des Hommes capables de défier leur destin et mêmes les Dieux s'ils pensent avoir raison où si une obligation morale le leur commande.
Il vient en aide aux faibles et aux veillards mais ne supporte ni les fainéants, ni les profiteurs et les voleurs. Il les considère comme des “fardeaux de la terre”, un poids pour la Terre-Mère. Il sait être courageux face au danger et patient devant les difflcultés de la vie quotidienne sans pour autant rechercher l'affliction et l'adversité. Il sait profiter des joies de la vie là où il les trouve, en écoutant une chanson, après un baiser, devant un endroit idyllique ou l'hilarité d'un enfant par ce qu'il sait que chaque instant est unique et qu'il ne se reproduira peut-être jamais. De plus, il n'est pas stupide. Il sait utiliser son intelligence chaque fois qu'il en a besoin. Il représente la supériorité de l'Homme face à l'animal. Il sait rire avec ses propres malheurs, car le rire est comme le vent qui chasse les nuages de la misère et du défaitisme. Il essaie de résoudre seul ses problèmes tout en respectant la Nature qu'il considère comme vivante et sacrée.
Les lectrices seront sans doute lasses d'entendre parler exclusivement de Héros masculins. En effet, les traditions européennes ne sont pas exemptes d'Héroïnes. Ainsi, la Béotienne Atalante tua les deux centaures qui avaient tenté de la violer, participa à l'expédition des Argonautes et fut la première à toucher le sanglier de Calydon au cours d'une chasse. La reine Kathe initia Cuchulainn à l'art de la guerre. La reine des Iceni de Grande-Bretagne, Boudicca (Bodicée), “la victorieuse” conduisit son armée contre l'envahisseur romain, mettant hors de combat de nombreuses légions. Tacite racontait que les femmes germaniques combattaient aux côtés de leurs hommes. Les Déesses étaient, dans l'antiquité, aussi nombreuses que les Dieux et étaient honorées et adorées avec la même ferveur. Cependant, le fait de tenir.une épée et de combattre comme un homme ne suffisait pas pour faire d'une femme une Héroïne. Antigone représente le modèle le plus significatif de l'Héroine qui ne renonça ni à son dévouement ni à sa grandeur d'âme pour lutter contre le pouvoir en place tout en sachant qu'elle allait connaître une fin atroce. Mais avec l'avènement d'un système patriarcal étranger à l'Europe, la femme allait bientôt être transformée en simple objet sexuel et de procréation.
Et aujourd'hui qui pourrait être considéré comme Héros? Citons quelques exemples: l'employé qui refuse de contribuer à s'enrichir sur le dos des autres tout en sachant qu'il risque de perdre son emploi, la mère qui élève seule son enfant et affronte avec fierté les ragots du voisinage, celui qui éteint sa télévision pour lire un livre ou écouter de la musique, la femme qui décide d'entreprendre des études dans une école qui n'admettait auparavant que des hommes. L'héroïsme se reconnaît à des milliers de petites et grandes choses de la vie quotidienne.
Les modèles de références de nos ancêtres étaient leurs propres Dieux. Les Olympiens, les Dieux des Celtes et ceux des Scandinaves étaient eux-mêmes des Héros, c'est-à-dire des êtres qui luttaient contre leur propre destinée, se battant comme les Hommes, avec leurs défauts et leurs qualités, à la recherche de leur propre éveil.
Les anciens Dieux n'étaient pas invincibles ni savants ni des modèles de bonté et cela les rapprochait des humains par rapport au Démiurge souverain, sans visage et inapprochable. Que cela n'en déplaise à certains, les anciens Dieux ne prodiguaient pas que des faveurs, ils ne considéraient pas tous les individus de la même façon. Ce n'est que grâce à son propre degré d'éveil que l'Homme pouvait atteindre l'Olympe, le Valhalla ou les Iles des Bienheureux. Les autres entamaient la descente dans le monde d'en bas dans l'attente de leur prochaine réincarnation et tenter à nouveau de se détacher de ce cycle infernal en accédant à la divination. Avec l'avènement de la nouvelle religion, le serviteur fut mis au même pied d'égalité que le maître et, pire encore, le Héros fut considéré comme un Homme ordinaire. Le régime totalitaire de l'ancienne et de la nouvelle Rome ne pouvait fonctionner autrement. Tous devaient être égaux sous la férule du Régime, de l'Empereur et de Dieu. Les conséquences ne se sont pas faites attendre. Chaque science ou philosophie contraires au dogmes ambiants étaient éradiquées. Toute recherche de la Beauté était considérée comme un tabou. Toute liberté de pensée et de choix fut condamnée. Ceux qui s'exprimaient différemment des normes établies étaient considérés comme hérétiques, jetés dans des geôles et brûlés vifs.
Les guerres des anciens fondées sur les mises en valeur individuelles et qui pouvaient être comparées à des scènes théâtrales ont cédé la place aux guerres d'intérêts ou de religions, inconnues jusqu'alors et qui ont tant fait couler de sang sur notre vieux continent. Le Héros guerrier a cédé la place au combattant sans volonté, simple pion au service d'un stratège qui, autrefois, dirigeait les combats sur le terrain, aujourd'hui, du fond d'une salle, entouré de spécialistes en guerres de tous genres, décide des batailles en se fondant sur des chiffres, des statistiques et des comparaisons. Le citoyen inconscient a, depuis fort longtemps, perdu son identité à l'exception d'un pseudo-droit ou obligation de voter de temps en temps pour ceux qui le dominent, sans pour autant qu'il puisse réellement s'exprimer sur la manière dont il est gouverné. L'agriculteur, l'artisan, le philosophe se sont mués en unités de consommation, qui doivent acheter de plus en plus en suivant les prescriptions de la publicité et du marché, indifférents à la catastrophe écologique qui se produit autour d'eux.
L'amour, ce cadeau des Dieux, cette communion des corps et des esprits, tel un feu ardent, a été transformé en péché, dépravation alors qu'au même moment il est utilisé de la façon la plus vile qui soit pour placer toutes sortes de produits auprès de récepteurs décérébrés jusqu'à leur dicter des modes de comportements. L'Homme sain qui était en contact permanent avec ses Dieux a, aujourd'hui, besoin d'intermédiaires, de “représentants de Dieu” sur Terre auto-proclamés, sous la menace permanente d'une damnation éternelle s'il lui venait à l'idée de douter ou de contester les dogmes en place. L'acception même de la notion de Héros a été déformée de la façon la plus ignoble qui soit, lorsqu'elle est utilisée de nos jours pour décrire des individus qui ne savent pas placer correctement trois mots mais se contentent simplement de planter quelques ballons dans des filets ou des paniers, vêtus comme des publicités ambulantes aux couleurs des généreux sponsors qui les financent. Les anciens Olympiens concouraient pour la gloire et un rameau d'olivier, les “héros” d'aujourd'hui pour la belle voiture que leur offrira le Président ainsi que les nouveaux et juteux contrats qui les attendent.
Un Homme censé ne peut qu'être affligé devant une telle situation. La voie du martyr, de l'individu aveuglé et passif qui confie son destin entre les mains de tierces personnes a conduit la société au bord du précipice. Que peut faire celui qui veut résister? Qui a la volonté de réagir différemment du bétail? La réponse est simple; il doit avoir du courage et continuer à être lui-même. S'il rencontre des compagnons qui partagent des points de vue identiques, entrer en contact avec eux sans pour autant abandonner son individualité. Le Héros n'a point besoin de maître ou de gourou car personne ne pourra le sauver à part lui-même.
Aussi, si vous ne craignez pas de vous promener dans des endroits sombres et affirmer que vous êtes dans le vrai; si vous croisez un enfant et que vous avez envie de jouer avec lui, de même que si vous rencontrez un vieillard et que vous voulez partager ses connaissances; si pour vous l'amour est un cadeau irremplaçable et non quelque chose dont vous avez honte; si chaque défi n'est pas pour vous ni trop difficile pour l'affronter ni trop facile pour l'ignorer; si vous permettez à chacun d'exprimer son opinion sans pour autant vous faire influencer; si vous voulez vider le verre de la vie jusqu'à la dernière goutte sans craindre les conséquences; si vous vous sentez ainsi, alors vous êtes sûrement sur le chemin du Héros. Et ceux qui regardent des cieux la destinée des Hommes doivent sûrement êtres fiers de vous.
Thomas MASTAKOURI.
(traduit en français par Nikiforos PERIKLIS).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : grèce, grèce antique, antiquité, histoire, mythologie, paganisme, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 09 octobre 2009
Michel, l'Archange impérial germanique
 Manfred MÜLLER:
Manfred MÜLLER:
Michel, l’Archange impérial germanique
Sur les pèlerins et les combattants michaëliques dans l’histoire allemande
Mai 1945: l’Allemagne est au fond de l’abîme. Le pays est en grande partie détruit. Des millions de soldats ont été tués au combat, sont portés disparus, sont prisonniers ou ont péri en fuyant les provinces de l’Est ou en en étant expulsés. Pour bon nombre d’Allemands, cette année fatidique signifie aussi l’effondrement de tout un monde spirituel. Beaucoup de catholiques allemands, qui suivaient alors scrupuleusement les étapes du cycle liturgique, ont tout de suite remarqué que les Alliés ont imposé la capitulation inconditionnelle de la Wehrmacht à la date du 8 mai. C’est le jour où l’Eglise fêtait l’apparition de l’Archange Michel dans les montagnes de Gargano en Apulie. Saint Michel, que beaucoup d’Allemands considéraient alors comme “l’Ange des Allemands” et l’honoraient à ce titre, se serait-il détourné de son peuple, à l’heure fatidique où il était livré à des vainqueurs sans pitié?
Dans la situation de guerre si critique de l’année 1945, certains avaient encore placé des espoirs en “l’Ange des Allemands”. Franz Führmann, originaire du Pays des Sudètes, national-socialiste qui passera après guerre au communisme, pour devenir un auteur à succès en RDA, nous rappelle dans son oeuvre une scène étonnante: son père, national-socialiste convaincu, avait intériorisé, lors des combats du Volkssturm, les conceptions religieuses contenues dans un “Chant à Saint Michel” du prêtre-poète autrichien Ottokar Kernstock:
“... zieh voran dem Heere, es gilt die deutsche Ehre, St. Michael, salva nos!”
(“... marche en tête de l’armée, car l’honneur allemand est en jeu, Saint Michel, sauve-nous!”).
Franz Führmann rappelle que son père lui avait confié en 1945 son espoir: l’Archange ferait un geste en ultime instance pour sauver le Reich en perdition; c’est en ces mots qu’il rappelle les paroles paternelles: “L’Ange des Allemands fendera le ciel de son épée et descendra pour sauver son peuple, à la dernière heure, au moment où la nuit sera la plus noire”.
Cet engouement allemand pour l’Archange remonte loin, aux débuts du moyen-âge. Sur le Monte Sant’Angelo, dans les montagnes de Gargano en Apulie, l’Archange Michel serait apparu entre 490 et 493. Dans une grotte de la montagne, en cette région où avaient prospéré les cultes antiques, l’archéologie peut prouver des correspondances entre ces cultes païens et le culte ultérieur et christianisé de Saint Michel. Un sanctuaire michaëlien s’est établi là, qui attire encore les pèlerins de nos jours (et aussi les touristes...). Parmi les innombrables pèlerins qui ont porté leurs pas là-bas, nous comptons quelques empereurs allemands.
Les Empereurs pèlerins au Monte Sant’Angelo
Othon le Grand a escaladé la montagne dédié à l’Archange lors de son troisième voyage en Italie. Il avait tenu à remercier l’Archange car, en 955, il avait pu battre définitivement les Hongrois à Lechfeld près d’Augsbourg. Il avait préservé ainsi les peuples christianisés de notre continent de la peur des raids dévastateurs des Hongrois. Lors de la bataille, l’image de l’Archange avait été portée à l’avant, sur l’étendard impérial du Roi des Allemands. La victoire de Lechfeld, qu’emporta Othon et ses guerriers michaëliques, jetta les bases d’une rénovation complète de l’institution impériale en Europe de l’Ouest, portée désormais par les Allemands (Translation Imperii ad Germanos).
Le deuxième pèlerin impérial allemand à Gargano fut Othon III. En février 999, le jeune Othon, âgé de 19 ans, escalada la montagne pieds nus depuis la plaine jusqu’à la grotte, en empruntant des sentiers abrupts et caillouteux: une épreuve très douloureuse pour un jeune monarque délicat et sensible. Cet exercice de pénitence cadrait bien avec la religiosité exaltée et enthousiaste de cet empereur, surtout à un moment de l’histoire européenne où les esprits étaient hantés par l’idée d’une fin du monde: en l’an 1000, le monde devait s’écrouler, croyait-on, et, lui, l’Empereur romain-germanique aurait alors pour tâche de conduire la chrétienté dans son ensemble vers le Christ apparaissant pour prononcer le Jugement Dernier.
En 1022, Henri II se rend à son tour à la grotte de Gargano. En 1137, Lothaire III de Supplinburg se trouve à proximité du site michaëlien avec une armée allemande. Le 8 mai de cette année, le jour même où l’Archange serait apparu à Gargano auparavant, Lothaire parvient à battre les Normands et à leur arracher le castel solidement fortifié du Monte Sant’Angelo et, ainsi, à garantir la domination impériale-germanique en Italie du Sud.
Très probablement, l’Empereur Frédéric II Hohenstaufen aurait, lui aussi, visité le sanctuaire de la montagne dédiée à l’Archange. Frédéric, qui, selon les critères médiévaux, était un “libre-penseur” sur le trône impérial, a donc été fasciné par la grotte cultuelle, qui, rappelons-le, attire encore et toujours pèlerins et touristes.
Le culte de Michel, le guerrier qui terrasse Satan, est venu du Sud, par l’intermédiaire des Lombards qui l’ont transposé en Bavière, et de l’Ouest, par l’intervention des missions irlandaises et anglo-saxonnes, qui l’ont généralisé dans l’Empire franc. La caste guerrière des Lombards, peuple germanique, avait été vivement impressionnée par la figure lumineuse de l’Archange, vigoureux combattant contre le Dragon et maître dirigeant des batailles. Les Lombards s’élançaient au combat avec son effigie sur leurs étendards. Chez les autres peuples germaniques de l’Empire franc puis du Saint Empire Romain de la Nation Germanique, le souvenir d’Odin, maître dirigeant des batailles lui aussi, a sûrement facilité l’adoption du culte michaëlique.
L’histoire du culte de Saint Michel est une thématique extrêmement complexe; quoi qu’il en soit, l’idée d’un “Ange des Allemands” s’est propagée en Allemagne aux 19ème et 20ème siècles.
Pendant la deuxième guerre mondiale, de nombreux jeunes Allemands qui avaient, dans les organisations de la jeunesse catholique, appris de leurs aumôniers l’importance de Saint Michel, ont servi dans la Wehrmacht, portés par les vertus que représentait l’Archange: la bravoure et la fidélité dans la défense de la patrie. Ces vertus correspondaient à celles que l’on a toujours traditionnellement attribuées à l’Archange, patron des Allemands. En septembre 1939, on pouvait lire dans un journal de l’Eglise catholique, dans le ton de l’époque: “Toujours, quand des temps durs ont frappé notre peuple... lorsque l’âme et le corps du peuple ont tremblé sous les coups puissants du destin, alors, du fond du coeur du peuple allemand, une figure s’est dressée, qui, par décret divin, est l’ange protecteur de ce peuple, et, par suite, est intimement apparenté à l’essence la meilleure de ce peuple. Alors se dresse Saint Michel, flamboyant dans sa volonté de défendre le peuple qui est sous sa protection, avec son épée et son bouclier, le voilà lumineux à la tête des Allemands. Ceux-ci, alors, le suivent et, sous sa direction, partent vers le combat et la victoire”.
Le père jésuite Friedrich Muckermann qui, de son exil, avait durement combattu Hitler, parfois en se fourvoyant terriblement, voyait encore, après la guerre, en l’Archange Michel, “l’Ange des Allemands”: “Tous ceux qui ont lutté pour une Allemagne chrétienne, avant Hitler, et sous Hitler, mèneront encore ce bon combat après Hitler. Car telle est la Voie allemande! Avec Dieu et avec Saint Michel!”. Dans les milieux protestants, la figure de “l’Ange des Allemands” était connue également. Ainsi, par exemple, Bernt von Heiseler, qui appartient à la “génération du front”, publie un poème en 1957 dédié “A l’Archange Michel”. La dernière strophe dit:
“Hilf den alten Kampf bestehen
den dein Volk schon oft bestand,
Erzanfänglicher der Engel
Michael, bewahr dies Land!”
(“Aide-nous à soutenir l’antique combat
que ton peuple à si souvent mené,
toi, l’Ange des débuts immémoriaux,
toi, Michel, protège ce pays!”).
Manfreed MÜLLER.
(article paru dans “DNZ”, Munich, n°25/2001; trad. franç.: Robert Steuckers, 2009).
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catholicisme, culte des saints, archanges, religion, empire, traditionalisme, mythologie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 05 octobre 2009
L'essence métaphysique du paganisme
L'essence métaphysique du paganisme
(analyse de la véritable spécificité de la pensée païenne)
* * *
Jean-Marc Vivenza
On le sait, mais on l'oublie trop souvent, ce sont les principes situés à la racine même des choses, qui fondent véritablement les idées génériques placées à l'origine des différentes conceptions du monde. Or ce qui distingue radicalement le paganisme du christianisme (termes qui, rappelons-le, concrètement, aujourd'hui, ne qualifient plus en Europe aucune réalité religieuse distincte puisque, que cela plaise ou non, l'histoire a conjugué non sans quelques difficultés il est vrai, ces deux dénominations en un seul destin), est une divergence majeure qui ne porte pas entre polythéisme et monothéisme (1), mais de façon irréconciliable porte sur la notion de création.
Ce qui spécifie, et sépare de manière catégorique le paganisme de la pensée biblique c'est leur analyse divergente au sujet de l'origine du monde, de l'origine de l'être. Si, pour les païens, le monde est de toute éternité incréé et suffisant ontologiquement, par contre, la pensée hébraique considère le monde comme résultant d'une création "à partir de rien", doctrine que la Bible place en tête de son introduction puisque le premier de ses versets nous dit, "Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre", (2). Les points de vue, les concepts païens et hébreux sont irréductibles, radicalement hétérogènes, il y a une incompatibilité foncière entre les deux approches de la question de l'existence du monde; c'est sur ce point que se trouve la véritable ligne de partage des eaux, la césure entre pensée hébraïque et pensée païenne. C'est sur ce point, et non pas sur l'allégeance exprimée à telle ou telle figure divine, à telle ou telle divinité tutélaire, dans l'attachement à Zeus l'olympien ou au Yawhé du Sinai, que se situe la divergence foncière.
I. Problème de la pensée religieuse.
On ne saurait trop insister sur ce que pourrait avoir d'illusoire l'idée, pour fonder une alternative nouvelle, qui consisterait à se rattacher à un paganisme affectif et dévotionnel, dans lequel seraient mis en concurrence et en opposition les dieux qualifiés "d'historiques", et le Dieu dit "unique" de la révélation biblique. C'est, hélas, sur cette fausse opposition, que se développa (et se développe encore...) une sorte de vague reliogisité païenne, dans laquelle est caressé l'espoir hypothétique d'un retour des dieux. Or jamais, sur ces questions, le vouloir ne peut avoir de prise, "il n'est pas possible de faire être par la volonté ou la parole les choses elles-mêmes" (3). Bien souvent, le désir d'un redéploiement d'un paganisme réel, tend à laisser penser, qu'il serait nécessaire de refaire surgir de nouveau les anciens mythes. Or, ou bien ce qui est mort est mort, et de la mort rien ne peut renaître, ou bien en réalité rien n'est jamais mort (les dieux en principe ne meurent pas...) et donc rien n'a jamais disparu, mais se trouve dissimulé sous d'autres appellations.
Le plus étrange dans l’examen de cette question religieuse, c'est que le paganisme finissant, nous montre une religiosité que l'on peut qualifier sans peine de préparatoire à l'avènement du christianisme, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. En effet, si nous regardons l'histoire avec attention, nous voyons que lorsque l'empereur Julien (361-363) tenta d'instaurer contre le christianisme triomphant, une religion à ses yeux plus conforme aux traditions gréco-romaines, il exprima sa doctrine en des termes, qui concilièrent le Sol Invictus et Attis: " Un Etre suprême, unique, éternel anime et régit l'organisme universel, mais notre intellect seul en conçoit l'existence. Il a engendré de toute éternité le Soleil, dont le trône rayonne au milieu du ciel. C'est ce second démiurge qui, de sa substance éminemment intelligente, procrée les autres dieux" (4). Ne serait-il donc pas permis de se demander sérieusement, dans quelle mesure, l'évolution des religions grecque et romaine n'a pas favorisé le triomphe du christianisme ?
Allons-même plus loin : si l'on étudie les choses avec réalisme, ne constate-t-on pas que dès Hésiode, qu'on le veuille ou non, la réflexion strictement religieuse des Grecs commence à ouvrir un chemin vers le monothéisme, et tente de fonder la morale sur la religion ? A Rome, la conception du Jupiter archaïque, arbitre souverain et garant de la bonne foi, attestera une orientation dans le même sens, plus instinctive certes, mais non moins évidente. Sans doute, l'entrée massive des éléments néo-platoniciens et orientaux dans la religion et la pensée hellénico-romaine rapprochera encore Athènes et Rome du christianisme futur, en fournissant un aliment mystique au désaroi du peuple, en répandant la notion de salut, en imposant, confusément encore, la conception d'un hénothéisme qui n'est pas éloigné, dans le stoïcisme, du monothéisme. Mais il est intéressant de voir que le mouvement religieux qui portait les esprits à l'époque impériale fut, dans son ensemble, plus que favorable à la pénétration du christianisme dans l'Empire. Et ce constat, doit nous porter à entreprendre une réflexion plus précise au sujet de la facilité avec laquelle le christianisme prit greffe sur le paganisme. Ceci n'est pas anodin et, disons-le clairement, jamais une religion étrangère n'aurait pu triompher si ne s'étaient pas trouvés des éléments communs à l'intérieur même du système religieux antérieur. Il n'existe absolument aucun exemple historique d'une religion s'imposant sans violence à un système étranger à elle-même, ou plutôt disons, qu'il n'existe qu'un seul exemple historique: le triomphe du christianisme à Rome sous Constantin ; voyons pourquoi.
Les causes de ce triomphe peuvent se résumer en quelques lignes significatives. Les cultes avaient en réalité, avec la nouvelle religion de nombreux traits identiques: la monolâtrie de fait qu'ils proclamaient, le souci de l'ascèse morale et spirituelle; autant l'admettre, quel que soit le degré d'élévation de tous ces cultes, ils répondaient tous aux mêmes besoins par les mêmes moyens. Fondés sur les notions de mort et de résurrection, de naissance nouvelle et de filiation divine, d'illumination et de rédemption, de divinisation et d'immortalité personnelles, ils prétendaient assurer aux fidèles le contact direct avec la divinité, et l'espoir d'une survie bienheureuse. Ils témoignaient en outre, par le biais d'une dévotion dirigée sur un seul dieu, d'une aspiration au monothéisme très prononcée. A l'intérieur de chaque "secte", le dieu sauveur était conçu comme supérieur à toutes les autres divinités et tendait à les éclipser. Mais il y a plus, les analogies de fond et de forme qui existaient entre tous les cultes conduisirent à penser que sous les noms d'Attis, de Mithra, etc... le même Dieu se manifestait, qu'on le considère comme le Dieu "véritable", ou comme un simple intermédiaire importait peu. Ceci explique pourquoi les tentatives prématurées d'Elagabal recevront de fait, leur consécration officielle grâce à Aurélien (270-275), qui sut habilement réaliser le syncrétisme devenu inévitable. On sait qu'il choisit pour divinité suprême Sol Invictus, dans lequel les fidèles des diverses sectes pouvaient reconnaître aussi bien Baal, qu'Attis, Osiris, Bacchus ou Mithra. Sol Invictus présentait d'autre part, l'avantage d'être assimilable à Apollon, et également à une vieille divinité romaine, Sol Indiges, dont l'origine remontait au temps mythique de la fondation de la cité. Sur cette lancée, Aurélien compléta son entreprise en faisant admettre définitivement la divinité de l'empereur vivant, considéré comme incarnation de Dieu sur la terre. En réalité la seule doctrine qui se heurta à l'antipathie du pouvoir, fut le stoïcisme qui, jusqu'à l'avènement de Marc-Aurèle, servit de refuge hautain à l'opposition.
Le christianisme, de son côté, héritant du judaïsme l'intransigeance des Macchabées, mit en pratique la parole du Christ: "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu" (5). Sujets loyaux de l'Empire, les chrétiens refusèrent d'encenser les dieux, et de reconnaître la divinité d'un homme, fût-il l'empereur. Leur crime aux yeux de l'Etat, fut politique et non religieux; ou plutôt, il ne fut religieux que parce que leur attitude manifestait fermement leur volonté de conserver leur foi à l'abri des contaminations du syncrétisme. En fait, l'Empire eût été prêt à accueillir le christianisme comme les autres religions, cela est si vrai, que c'est au nom même du syncrétisme et de l'intérêt de l'Etat que fut proclamée, en 313, l'égalité de la religion chrétienne avec la religion officielle par le rescrit de Licinius: "Nous avons cru, est-il dit, devoir donner le premier rang en ce qui concerne le culte de la divinité, en acordant aux chrétiens comme à tous, la libre faculté de suivre la religion qu'ils voudraient, afin que tout ce qu'il y a de divinité au ciel pût nous être favorable et propice, à nous et à tous ceux qui sont sous notre autorité" (6). Le testament religieux du paganisme gréco-romain finissant, n'était donc pas étranger au christianisme naissant, et les Pères de l'Eglise ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, qui ont vu en lui l'une des voies préparatoires que Dieu proposa aux hommes pour découvrir son visage.
Que l'on n'imagine pas, toutefois, en désespoir de cause, trouver dans le paganisme celto-germanique un "recours", qui représenterait un meilleur garant comparativement à l'héritage greco-latin, car la tradition nordique présente les mêmes dangers que sa soeur du sud. Les incessantes luttes fratricides entre les chefs tribaux dépourvus de toute conscience historique, la lente mais réelle disparition progressive de la classe sacerdotale (Godis), le venin intellectuel que représente l'idée d'une procession du divin d'un centre pur et inaltérable vers le dehors par une série d'hypostases et de démiurges, le sens du péché consistant dans l'éloignement du monde de son sens divin, on retrouve ici les mêmes et identiques facteurs d'une lente progression vers le Dieu unique.
Que nous enseignent ces faits ? Tout simplement que pour pouvoir échapper au monothéisme il convient, non pas de savoir "comment être païen" au sens religieux du terme, comme beaucoup l'ont cru et, l'imaginent malheureusement encore, mais de comprendre en quoi consiste véritablement l'essence du paganisme, non pas du point de vue religieux, mais du point de vue métaphysique, là où se situe l'authentique et irréductible divergence d'avec la pensée biblique, là où les thèses présentent une fracture, une incompatibilité foncière. Redisons-le, la religiosité n'est qu'une forme culturelle affective non autonome. Liée à un substrat collectif traditionnel, le sens religieux, par sa plasticité, peut se voir dépouillé de ses bases métaphysiques et s'adapter sans difficultés à d'autres conceptions. L'avènement du christianisme en est le plus bel exemple. Ce n'est donc pas au niveau du religieux qu'il nous faut découvrir l'essence du paganisme, mais au niveau de son essence profonde, au niveau de sa métaphysique propre, là où se déploie sa véritable nature. C'est pourquoi, il est vital d'atteindre l'essence de son ontologie, là où la question de l'être se révèle comme centrale, car c'est de ce point seulement que pourra surgir l'aurore d'un nouveau Sacré.
II. Le fondement de la métaphysique païenne.
L'originalité de la pensée païenne se situe sur un point fondamental, point qui ordonne tout l'édifice de son essence intime: le problème de l'éternité du monde, de son autosuffisance ontologique. Pour les païens, l'idée que le monde puisse avoir été créé, est une proposition absurde, incongrue, alors qu'elle est la base de la foi chrétienne, qui hérite en cela du créationisme biblique :"Credo in Deum Patrem omnipotentem creator coeli et terrae" (7). C'est là le centre, le coeur, de toutes les divergences.
La création, en climat théologique biblique, est une opération qui s'effectue "ex nihilo" (8), c'est-à-dire que rien ne lui préexiste, sauf Dieu bien évidemment (ce qui n'est d'ailleurs pas la moindre des incohérences de vouloir faire que la cause de l'existence des choses manque au principe même qu'elle prétend expliquer, échappant elle-même à la loi de la causalité dont on nous dit qu'elle préside à l'existence de toute chose!). Chez les païens au contraire, les dieux sont considérés comme les représentants suprêmes d'un Tout divin. Ils sont les premiers dans l'être, mais non point les premiers par rapport à l'être. Leur transcendance n'est pas reconnue, il n'existe pas de Grand Séparé; dans ces conditions, c'est au Grand Tout qu'est attribué la nécessité éternelle. Le problème pour le paganisme ne se pose qu'à partir d'une matière commune, nul ne s'avise de rechercher la cause de l'être ou du monde. Ce monde, cet être, n'a pas besoin d'autre explication que lui-même; il est nécessaire, et de cette nécessité, chez Aristote, le "Premier moteur" n'en est que le premier bénéficiaire, il n'en est pas la cause. Il meut, il actionne la machine universelle, il ne la crée pas. Son action présuppose quelque chose d'aussi nécessaire que lui, et qui représente une passivité éternelle sous son activité ou son influence.
Il importe cependant de réfléchir sur la validité et la crédibilité des thèses en présence ; pour ce faire, la philosophie n'a aucunement besoin des sciences physiques ou mathématiques, qui ont d'ailleurs plutôt tendance, depuis quelques années, à flirter étrangement avec la mythologie ou l'imaginaire, et à ne plus être en mesure d'élaborer un discours véritablement sérieux. D'autant que sur la question de savoir si le monde a été créé du néant ou pas, les sciences avouent humblement leur incapacité à pouvoir fournir une réponse, tant leur méthode les rend muettes sur ce sujet. La philosophie par contre, lorsqu'elle exerce son authentique faculté de jugement, dépasse en qualité, profondeur et certitude, toutes les hypothèses des disciplines fragmentaires; elle n'est pas mère de toutes les sciences pour rien!
La philosophie, effectivement, est capable (lorsqu'elle ne part pas de l'ego, mais du réel expérimenté en tant qu'il est, lorsqu'elle sait que le seul et véritable maître, c'est le réel), de par son jugement propre, de saisir et d'affirmer la vérité touchant l'Univers et les choses, et cette vérité est l'oeuvre de son intelligence analytique, car le réel est structuré selon un ordre et une logique qui relèvent de l'ontologie, c'est-à-dire de la science de l'être. C'est ainsi qu'avant même Nils Bohr ou Costa de Beauregard, et sans l'aide du lourd appareillage des laboratoires de physique nucléaire, on savait déjà au IVème siècle avant notre ère en Grèce, que l'espace et le temps ne sont pas des idées pures ou des catégories a priori, ni un réel consistant, antérieur aux objets qui le remplissent, mais précisément les accidents propres aux substances matérielles, dimensives et permensives.
III. L'être et le temps.
Examinons donc à l'aide de la logique analytique la thèse biblique d'une création "ex nihilo", et voyons si ce dont on nous parle, c'est-à-dire d'un état censé avoir précédé le monde, d'un état "d'avant le commencement", est une hypothèse crédible. Cet "avant le commencement" désigne un temps nous dit-on, mais de quel temps parle-t-on ? Y avait-il un temps avant le temps ? Cela n'a, pour dire les choses clairement, aucun sens, cela ne désigne rien; car il n'y a pas, et ne peut y avoir, deux temps, l'un avant où le monde n'existerait pas encore, l'autre après, le temps du monde, venant se superposer au premier comme un rail sur une voie préparée à le recevoir.
Si le monde est fini en arrière, il n'y a rien avant, ni temps ni autre chose. Il n'y a donc pas d'avant, il n'y a pas, et ne peut y avoir "d'avant le commencement". Pour qu'il y ait eu un moment, fut-il un moment du rien, il faut qu'il y ait quelque chose, or un moment est une position du temps, est le temps, est une mesure des choses existantes. La durée est un attribut, et la durée d'une chose ne pouvant précéder cette chose, il est clair que si cette chose est le Tout, il ne peut y avoir de durée en dehors d'elle. Un jour, nous dit-on dans la Genèse, Dieu se décida à donner l'existence au monde. Un jour! Quel jour ? Ce jour n'existe pas plus que cet "avant le commencement", il n'y a pas de durée où le loger. Le premier jour qui ait existé, c'est le premier jour du monde lui-même. Nous sommes, de ce fait, obligés d'admettre que le monde a toujours existé puisqu'il n'y a pas de jour où il n'ait pas existé !
La vérité, est que le temps commence avec le monde lui-même: il n'y a pas de temps en arrière; le tout du monde comprend aussi le tout de la durée. Le monde existe et a existé depuis tout le temps qui existe, il n'y a aucun temps possible où il n'ait pas existé, il n'y a pas, en toute logique, "d'avant le commencement" - le monde ne peut pas ne pas avoir toujours existé puisqu'il est. Quant à parler d'un temps "avant la création", d'un temps précédant le temps qu'inaugurerait la création, cela est une pure et chimérique imagination, une vision, un rêve enfantin. En effet, il ne peut y avoir continuité entre ce temps imaginaire et le temps réel, on ne met pas bout à bout un rêve et le réel. On ne peut faire commencer le monde qu'au début de la durée où il existe, car on ne compte les jours que de ce qui existe, ce qui n'existe pas ne peut pas se compter; il n'y a pas de premier jour pour ce qui n'a pas vu le jour: tout commencement est donc forcément une suite.
IV. L'être et le néant.
Mais poursuivons, plus avant encore, notre raisonnement, et voyons les conséquences qu'impliquent la croyance en l'hypothèse d'un temps fini en arrière, c'est-à-dire d'un temps ayant commencé après n'avoir pas été. On n'y pense peut-être pas assez, mais si le temps est fini en arrière, on est obligé de se heurter au vide et ainsi de s'imposer à un contact entre le tout et le rien. Or entre l'être et le néant, entre le tout et le rien, il ne peut y avoir contact, "du rien, rien ne vient" (9). C'est d'ailleurs l'opinion de Mélissos de Samos lorsqu'il écrit :"Ce qui était a toujours été et sera toujours (...) car rien n'aurait pu, de quelque manière que ce soit, sortir de rien" (frag., B 8), (10). Surgir du néant c'est ne pas surgir du tout puisque le néant est une pure négation; et voici cependant que l'on fait du néant un point de départ positif.
Le néant, "est" une pure négation d'existence, le néant "n'est" pas un état, le néant "n'est" que néant, (si toutefois nous pouvons employer le verbe "être" à propos du néant). Pour venir à l'être, ce que l'on implique en parlant d'une création, il faudrait qu'il y ait déjà de l'être, or "de ce qui n'est pas, rien ne peut surgir (...), rien ne peut être créé de rien" (11). Si l'on dit que Dieu a tiré le monde du néant, on sous-entend que du néant puisse apparaître quelque chose, mais le néant n'est pas et ne peut être un réceptacle dont quelque chose puisse être tiré. On l'a pourtant cru et enseigné! Il s'est même trouvé des théologiens chrétiens pour écrire: "le néant est une réalité, puisque Dieu en a tiré le monde" (12). Malheureusement on ne peut du néant faire succéder le monde, une succession dont un des termes est le néant est une absurdité manifeste! Du non-être à l'être, il n'y a ni proportion - ni relation possible - du néant, rien ne peut suivre. Il ne peut y avoir aucune possibilité concrète d'une création, aucun moment pour une initiative créatrice, il n'y a aucun fait nouveau qui aurait du néant avant lui. Dans le néant (si l'on peut ainsi s'exprimer), il n'y a point d'application pour une force, il n'y a ni situation ni modalité quelconque puisque le néant n'est pas, puisque le néant est la négation, l'absence totale d'être.
Tout phénomène, quel qu'il soit, s'explique par un antécédent d'où il procède, c'est une loi universelle intangible; donc ou bien il n'y a pas de création au sens où l'entendent les théologiens juifs, chrétiens et musulmans, et par déduction le monde ne peut pas avoir été créé, ou alors quelque chose qui n'est pas Dieu échappe à la causalité de Dieu. A cette question il n'existe qu'un remède, puisque nous ne pouvons trouver de sens acceptable au mot création, il nous faut dire (comme l'affirement toutes les traditions extérieures à la révélation biblique): l'univers n'est pas créé, il ne peut être ou avoir été créé de rien, et s'il n'a pas été créé de rien, c'est qu'il est, fut et demeurera. Il est l'être qui en tant que tel ne peut "provenir", puisque pour qu'il y ait de l'être maintenant, il faut obligatoirement qu'il y en ait eu toujours, car la vie vient du vivant, l'être vient de l'être.
Après avoir très rapidement souligé les difficultés relatives à la thèse créationiste, l'hypothèse d'un premier jour nous devient impensable, la précession du temps et de l'être par le néant aboutit au vide. Or le vide, dans ce cas, serait au minimum un espace ou une durée où l'on pourrait loger quelque chose; ce serait une capacité définie, avec des dimensions. Ce serait donc de l'être, car on ne peut pas dire que ce qui a des dimensions ne soit rien, il en est de même du temps.
Dire qu'à un moment donné le temps n'existait pas, c'est dire encore qu'il existait. Il ne peut donc pas y avoir de vide temporel à l'extrême bord de l'être, l'être ne peut être bordé par rien, ne peut se voir précéder par rien. On est toujours dans l'être, on ne peut rien supposer d'antérieur à l'être d'autre que de l'être. Dire qu'il puisse exister un état de non existence, serait jouer avec les mots: une négation n'est pas un état. Le rien n'étant rien, en affirmant que le monde fut créé du néant, on ne dit en réalité que du vent. Affirmer que le monde, le cosmos, sont créés du néant, c'est faire préexister le néant, or le néant, nous l'avons vu, ne peut en aucune façon exister ou même préexister, sous peine de cesser d'être du néant. Si le néant était, ce ne serait plus du néant. En conséquence le néant n'étant ni existant, ni préexistant, on peut en conclure que rien ne se crée ni ne se fait à partir de rien. L'être est premier, inévitablement. "L'être est, le néant n'est pas" (13), avait déjà énoncé Parménide, dans son poème qui est comme la parole aurorale de la philosophie; oui l'être est, car la création du monde à partir de rien est un mythe théologique biblique, une expression impropre à laquelle il est impossible de trouver un sens acceptable. "Ce monde, le même pour tous, ni dieu ni homme ne l'a fait, disait déjà Héraclite, mais il était toujours, il est et il sera, feu toujours vivant, s'allumant en mesure et s'éteignant en mesure" (14).
V. Conclusion.
En définitive, nous espérons être parvenu à montrer en quoi, aucun espoir sérieux d'une restauration de la pensée païenne n'est envisageable sans une interrogation fondamentale sur l'être.
Les éléments qui peuplent et enchantent le monde dans les religiosités païennes, ne peuvent trouver à affirmer leur vie sans une profonde compréhension des bases métaphysiques qui les sous-tendent. C'est d'ailleurs faute de cette compréhension que le christianisme a pu se développer, avec une telle facilité, parmi les populations antiques. S'il est donc nécessaire de rallumer certains feux, c'est celui de l'intelligence de l'être qui prime en premier lieu, c'est le seul qui ne soit pas symbolique et donc inutile. Si c'est à partir de l'être que pourra se déployer une nouvelle aurore du sacré, c'est que, "ce n'est qu'à partir de la Vérité de l'être que se laisse penser l'essence du Sacré" (15). La région de l'être est identique à la région du sacré, "le Sacré, seul espace essentiel de la divinité qui, à son tour, accorde seule la dimension pour les dieux, ne vient à l'éclat du paraître que lorsque, au préalable et dans une longue préparation, l'être s'est éclairci et a été expérimenté dans sa vérité" (16).
La question de l'être est l'unique question de la pensée, et ceci n'est pas une simple formule, car c'est elle qui commande l'ensemble de toutes les régions de l'étant, dont en premier lieu celle du sacré et donc du religieux dans lequel il s'exprime. Aborder la question du paganisme uniquement au niveau de son folklore, c'est confondre le fond et la forme. Seule l'expérience de l'être est une expérience fondatrice, qui nous permettra: " de refluer en nous-mêmes dans notre propre vérité" (17). La pensée doit rassembler notre "habiter", récapituler le pli de l'être et de l'étant, découvrir l'être comme ‘’fond de l'étant" (18), c'est-à-dire effectuer un saut dans l'être en tant que tel. Toutes les tentatives de restauration d'une religiosité païenne, sont de naïves plaisanteries si elles ne sont pas fondées sur une authentique démarche philosophique. La philosophie fut et reste, l'expression la plus achevée de la pensée digne de ce nom. Elle seule représenta un véritable obstacle aux affirmations chrétiennes, et ce n'est pas pour rien qu'il lui fallût de si longs siècles avant de pouvoir resurgir dans son autonomie, alors que dieux, déesses, elfes et fées, parvinrent rapidement à se déguiser sous les masques des saints et des apparitions, et continuent d'ailleurs toujours à y vivre fort bien.
L' histoire n'est rien d'autre que l'histoire de la vérité de l'être, elle est assignée à un destin en forme d'appel par delà le retrait du Sein. Si, selon la fort belle expression de Hegel, « l’'esprit du monde utilise les peuples et les idées pour sa propre réalisation » (19), l'histoire du monde est donc bien le jugement du monde. Le chemin du savoir répondant à l'essence du dire silencieux, s'accomplira comme mise en lumière de la substance invisible qui séjourne dans le temps, et ceci par delà mythes, symboles et fables de la piété affective. La pensée des choses présentes est le lieu où s'entrecroiseront occultation et dévoilement, le lieu qui livrera la mêmeté de l'être et de la pensée, selon l'intuition lumineuse de Parménide; "comme l'Etre absorbe l'essence de l'homme par la fondation de sa vérité dans l'étant, l'homme fait partie de l'histoire de l'Etre, mais seulement en tant qu'il se charge, qu'il perd, qu'il omet, qu'il libère, qu'il sonde ou qu'il dissipe son essence par rapport à l'Etre" (20).
Ce n'est donc, si nous l'avons bien compris, que par l'exercice d'une extrême tension de nature ontologique, que nous pourrons revenir à notre source originelle... si tant est que nous l'ayons un jour quittée!
* * * *
Notes.
(1) On est surpris aujourd'hui, grâce aux recherches récentes, de voir à quel point cette distinction, qui semblait fondatrice il y a peu de temps encore, n'obéit en réalité qu'à une convention de langage, tant il apparaît, en effet, que les tendances monothéistes ou hénothéistes ont travaillé en profondeur la pensée païenne (Mésopotamie, Egypte, Iran, Grèce, Rome), et influencèrent très fortement le polythéisme originaire des Hébreux en l'orientant vers une monolâtrie jalousement exclusive, tant est si bien que Misson écrit: "le monothéisme païen a bien préparé le terrain du christianisme". (cf. Lumière sur le paganisme Antique, A. Neyton, Ed. Letourney, 1995).
(2) ( Gen., 1, 1), Bible de Jérusalem, DDB, 1990.
(3) Aristote, Organon, V, Les Topiques, Vrin, 1987.
(4) P. de La Briolle, La Réaction païenne, vol II, 1934.
(5) Nouveau Testament, T. B. S., 1988.
(6) P. Grimal, La civilisation romaine, Arthaud, 1960.
(7) Ier Concile de Constantinople, (IIème oecuménique, 381).
(8) (11 Mac., Vll, 8), Bible de Jérusalem, DDB, 1990.
(9) Proclus, Commentaires sur le Timée, t. I, Belles Lettres, 1968.
(10) J-P Dumont, Les écoles présocratiques, Folio, 1990.
(11) Lucrèce, De Natura Rerum, I, 56, Flammarion, 1986.
(12) Fridugise de Tours, De Nihili et Tenebris, Patrol. Iat., 1526.
(13) Parménide, Le Poème, PUF, 1987.
(14) Héraclite, Fragments, PUF, 1983.
(15) M. Heidegger, Lettre sur l'humanisme, Aubier, 1980. (16) Ibidem.
(17) M. Heidegger, Essais et Conférences, Gallimard, 1990.
(18) M. Heidegger, Questions IV, Gallimard, 1990.
(19) G-H F. Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie, t. III, Vrin, 1978.
(20) M. Heidegger, Nietzsche, t. II, Gallimard, 1991.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : paganisme, tradition, métaphysique, philosophie grecque antique, grèce antique, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 septembre 2009
Le combat slave

ARCHIVES de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Le combat slave:
Entretien avec Alexandre Konstantinovitch Belov
Notre interlocuteur Alexandre K. Belov est un homme d'une force mentale rare. Il a visiblement intégré le sens du combat intégral et l'élévation spirituelle qui lui donnent une maîtrise de son art impressionnante. A. K. Belov rentre d'une tournée en Europe, où sa candidature a été retenue pour organiser des cours d'art martial slave dans les écoles de la police italienne. A cette occasion, il a été accueilli par nos amis milanais de Sinergie/Italia. J'ai eu personnellement l'insigne honneur de le rencontrer à son domicile à Moscou le 11 avril 1996 (G. Sincyr).
Q.: Dois-je vous appeler Belov ou Sélidor, qui est votre surnom?
AKB: Comme vous voulez. Sélidor est un surnom païen. C'est un nom “guerrier”. Mais je vous rappelle que les Russes sont les derniers en Europe à avoir gardé la tradition purement indo-européenne de s'appeler d'un nom patronymique.
Q.: Quand avez-vous commencé à vous occuper du “combat slave”?
AKB: J'ai inventé ce type d'art martial. J'ai commencé à le mettre au point à partir de 1972. A la fin des années 70, je pratiquais le karaté et j'avais obtenu le grade supérieur, la “ceinture noire”. Mais plus tard, le karaté a été interdit; j'ai alors entamé des recherches dans nos propres traditions et j'ai découvert une forme de combat russe très intéressante et très puissante. C'est en 1986 que j'ai achevé mon travail de rénovation de la pratique de cet art martial traditionnel oublié que j'ai appelé “combat slave”.
Q.: Quelles différences y a-t-il entre le “combat slave” et les autres formes de combat à mains nues?
AKB: Le “combat slave” est un système d'attaque. Nous ne nous défendons pas, nous attaquons. Le principe d'un combat de défense est absurde, à mes yeux, et n'est pas conforme aux mentalités des Spartiates et des Chevaliers européens. Le combat d'attaque est un combat honnête, sans procédés perfides. Cette tradition est à l'opposé de la tradition orientale. Celle-ci imite les mouvements des animaux alors que nous, nous imitons ceux des armes. Imiter les animaux constitue une perversité pour l'homme. Même chose pour les horoscopes orientaux: ils disent par exemple “c'est l'année du cochon” et ceux qui sont nés cette années-là disent “je suis un cochon”. Ce sont là des simplismes que je trouve dévalorisants.
Q.: Pourtant, il y a un culte du loup chez les Promores, les habitants de la côte de la Mer Blanche?
AKB: Le Loup est le totem des tribus guerrières. Mon totem est le Loup Bleu.
Q.: Où en est la communauté païenne à Moscou?
AKB: En 1994, une scission a traversé le mouvement païen. Nous nous sommes séparés des païens qui n'avaient que des intérêts mercantiles, pour former une véritable communauté de guerriers. Le guerrier ne peut pas être fondamentalement un chrétien. En effet, comment concilier le métier des armes, le métier de la guerre, avec le précepte chrétien d'aimer son ennemi? Au combat, le guerrier hait son ennemi, sinon il ne peut pas le combattre efficacement. Un vrai guerrier sera toujours un païen. En tant que Russes et que Slaves, nous vénérons essentiellement Peroun, le Dieu du Tonnerre dans la mythologie de nos ancêtres.
Q.: Combien de membres compte votre communauté?
AKB: Nous sommes environ 40.000.
Q.: Coopérez-vous avec d'autres organisations païennes?
AKB: Non, avec aucune autre organisation. A mon grand regret, je ne connais aucune organisation qui recherche tout à la fois force et sagesse.
Q.: Vous préparez la création d'un grand mouvement. Pouvez-vous nous en dire quelques mots?
AKB: Notre objectif est de créer en Russie une communauté de professionnels de la guerre, du combat et de la défense, structurée par des référentiels païens. Pour moi, tout guerrier est un prolétaire: il ne possède que sa force. Et seule sa force compte dans sa fonction. Je ne tiens pas le prolétariat pour une classe, mais pour un degré de développement mental.
(propos recueillis par Gilbert Sincyr et traduits par Anatoli M. Ivanov).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, paganisme, monde slave, slavistique, russie, arts martiaux |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 septembre 2009
Quand bouddhisme rimait avec impérialisme
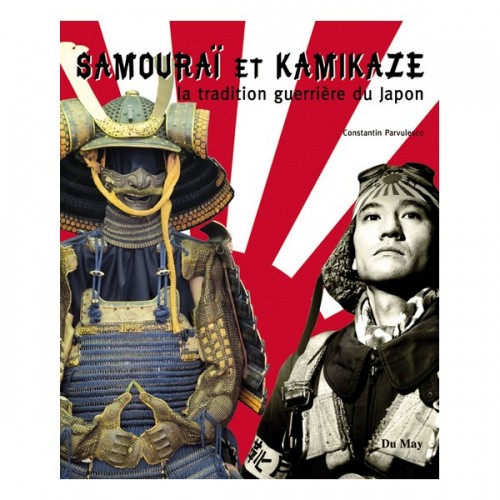
QUAND BOUDDHISME RIMAIT AVEC IMPERIALISME
par Laurent Schang
Avec le dernier tiers du XIXe siècle, l’archipel nippon connaît ses ultimes années d’isolationnisme. A rebours de la xénophobie ambiante, savamment cultivée par les conseillers shogunaux d’Edo (l’ancienne Tôkyô), la jeunesse samouraï se passionne pour l’Occident moderne et souhaite voir rapidement le Japon s’ouvrir au changement et au progrès tant vantés par ces drôles d’Occidentaux. Le 3 janvier 1868, le régime féodal est renversé et l’Empereur Mutsu-Hito, âgé de quinze ans, est officiellement proclamé seul détenteur du pouvoir. Le jour même, le Japon entre dans l’ère Meiji.
Jeunes et intrépides, volontaires et éclairés, les hommes qui s’emparent du pouvoir se veulent aussi ultranationalistes, conséquence d’une éducation isolationniste et du sentiment d’appartenance à une caste supérieure.
Mélange de théocratie, d’autoritarisme et de démocratie, la nouvelle Constitution, résolument conservatrice, s’attache plus à définir les devoirs du sujet que ses droits. Conscient de l’infériorité technique du Japon sur l’étranger, le nouveau gouvernement, malgré son inexpérience, bénéficie des deux atouts majeurs que sont un peuple sévère, religieux et travailleur, et l’appui du Tennô («l’Empereur ») en tant qu’agent fédérateur et ferment du renouveau national. Faisant preuve d’une remarquable adaptation intellectuelle et pourvues d’un solide aplomb, de nombreuses délégations d’émissaires et d’étudiants sont envoyées en Europe et en Amérique où, jouant de leur exotique affabilité, ils observent, étudient et enregistrent avec application les technologies occidentales.
Plus soucieux de réformes que de révolution, le Japon se modernise à grands pas et axe sa priorité immédiate sur ses besoins militaires et navals. D’origine largement rurale, l’armée nouvelle, calquée sur le modèle prussien, devient le centre de gravité de la nation. En l’espace de vingt ans, le monde assiste, d’abord incrédule puis inquiet, à l’émergence d’un Japon vindicatif qui organise sa révolution industrielle en préservant tout à la fois et son indépendance politique et les caractéristiques essentielles de sa civilisation.
Réussite incontestable, la restauration Meiji a su catalyser les énergies en sommeil de tout un peuple, transformant l’humeur belliqueuse de la noblesse, autrefois source de discorde et de faiblesse, en un argument précieux dans la lutte acharnée que le Japon s’apprête à livrer à l’homme blanc.
Bien sûr, pareille métamorphose ne va pas sans provoquer des conflits. La culture religieuse traditionnelle est ainsi profondément remaniée dans une finalité impérialiste. Le nouveau régime instaure un culte patriotique dont l’Empereur est la divinité vivante. Le Bushidô (littéralement « voie du guerrier »), auparavant réservé à la caste des samouraïs, est étendu à l’ensemble de la société. Le peuple entier adopte l’idéal martial pour code de vie.
On assiste également au retour en force d’une orthodoxie shintoïste revivifiée, sacralisant sol, sang et ancêtres en un même élan mystique, par opposition au bouddhisme d’importation plus récente, à vocation universaliste et relativiste. Religion étrangère, introduite au VIe siècle, le bouddhisme, après avoir frôlé l’interdiction pure et simple en raison de sa doctrine de la compassion et de la non-violence, est sommé de se conformer aux aspirations du Japon moderne. Les sectes bouddhiques choisissent de coopérer. Le « nouveau bouddhisme » sera donc loyaliste et nationaliste. La colombe s’est transformée en faucon. Le résultat : le Yamato damashii (« l’esprit du Japon »), religion d’Etat, syncrétisme de bouddhisme, de shintoïsme et de confucianisme.
Après une entrée fracassante dans l’âge industriel, le Japon se voit bientôt contraint par les nécessités économiques et démographiques de suivre les exhortations des Zaïbatsu, cartels industriels qui en appellent au colonialisme pour résoudre les difficultés de la nation. Le bouddhisme va fournir la justification morale à ses ambitions territoriales. D’agression militaire qu’elle était au départ, la guerre devient aux yeux des Japonais une mission mondiale d’émancipation des peuples opprimés, une « Sainte guerre pour la construction d’un ordre nouveau en Asie de l’Est ».
D.T. Suzuki, maître zen de nos jours encore vénéré, s’en fait le propagandiste zélé. Un précepte zen ne dit-il pas : « Si tu deviens maître de chaque endroit où tu te trouves, alors où que tu sois sera la vérité… » (1) Toutes les guerres que mènera le Japon au XXe siècle procéderont de la même politique de l’escalade. Du premier conflit sino-japonais en 1894-95 au fatal bombardement de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, en passant par l’invasion de la Mandchourie en 1931 et les trois attaques répétées contre l’URSS en 1938 et 1939.
Quant à l’implication du clergé bouddhique, on sait désormais grâce au livre de Brian Victoria (2) qu’il ne s’agissait pas d’un dérapage mais bien d’un processus logique inscrit dans l’évolution du bouddhisme nippon.
(1) cf. Aventures d’un espion japonais au Tibet de Hisao Kimura et Scott Berry, Editions Le Serpent de Mer.
(2) Le zen en guerre 1868-1945, Brian Victoria, traduction de Luc Boussard, Editions du Seuil, 21,04€.
00:15 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, bouddhisme, tradition, traditionalisme, extreme orient, militaria, guerre, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 septembre 2009
Figures animales dans la mythologie scandinave

Figures animales dans la mythologie scandinave
Au∂umla, la vache primordiale
Au∂umla (ou Au∂humla ou Au∂umbla) est la désignation en vieux-norrois (cf. Snorra Edda, Gylfaginning 5) de la vache originelle, primordiale, née du dégel des frimas primordiaux. Snorri raconte que les quatre flots de lait coulant de son pis ont nourri le géant Ymir, tandis qu'Au∂umla libérait Buri, l'ancêtre de tous les dieux, en lêchant pendant trois jours la glace salée qui le retenait prisonnier. Au∂umla signifie «la vache sans cornes et riche en lait» (du vieux-norrois au∂r, signifiant «richesse», et humala, signifiant «sans cornes»). Tacite nous parle déjà des vaches sans cornes que possédaient les Germains dans Germania, 5. La figure de la vache sacrée est liée, dans de nombreuses religions non germaniques, à la figure de la Terre-Mère (à l'exception des anciens Egyptiens qui vénéraient Hathor, une déesse du ciel à tête de vache). Ainsi, chez les Grecs, Hera (dont on dit qu'elle a «des yeux de vache») et surtout Isis, présentent encore, dans leur culte, des restes du culte de la vache. Dans le domaine germanique, il faut citer le dieu Nerthus, comme lié au culte de la vache. D'après Tacite, son effigie est promenée lors des processions cultuelles dans un chariot tiré par des vaches. Lorsque Snorri nous parle des quatre flots de lait (ou fleuves de lait), il sort vraisemblablement du domaine religieux indo-européen et germanique: les pis d'Au∂umla sont vraisemblablement un calque du mythe proche-oriental des quatre fleuves du paradis, liés au culte de la Magna Mater. Rudolf Simek, le grand spécialiste allemand de la mythologie scandinave et germanique, pense que cette image du pis générateur de quatre fleuves de lait, indique très nettement la formation chrétienne de Snorri.
Sleipnir, le cheval d'Odin
Sleipnir (du vieux-norrois, «celui qui glisse derrière») est le cheval à huit jambes d'Odin. Il est né du coït de Loki (qui avait pris la forme d'une jument) et de l'étalon géant Sva∂ilfari; Snorri nous rapporte ce fait dans son histoire des géants bâtisseurs (Gylfaginning, 41; on comparera ce récit à celui de Hyndluljód, 40). Snorri raconte que Sleipnir est le meilleur de tous les chevaux des dieux (Gylfaginning, 14; cf. aussi Grímnismál, 44); Hermo∂r, en chevauchant Sleipnir pour se rendre dans le Hel (le séjour des morts), saute au-dessus de la palissade entourant Hel (Gylfaginning, 48). Odin chevauche également Sleipnir pour se rendre en Hel (Baldrs draumar, 2); Haddingus, pris par Odin en croupe, voit toute la mer sous lui (cf. Saxo, Gesta Danorum, I, 24). Le Sigrdrifumál, 15, évoque les runes qui seraient inscrites sur les dents de Sleipnir. Sleipnir est très souvent cité dans les chants de l'Edda, mais rarement dans la poésie des scaldes. Son nom semble donc assez récent et n'est sans doute apparu que vers la fin du Xième siècle, pour désigner la monture d'Odin. Quand à l'histoire racontant sa naissance, par Loki transformé en jument, elle ne date vraisemblablement que de Snorri.
Snorri est de robe grise et possède huit jambes. Plusieurs sources mentionnent ces caractéristiques (Snorri, Gylfaginning, 41; Hervarar Saga ok Hei∂reks, strophe 72). Odin est toutefois représenté monté sur son coursier à huit jambes sur des pierres sculptées du Gotland, datant du VIIIième siècle (Tjängvide; Ardre). Sur d'autres pierres, Odin est à cheval, mais le cheval a très normalement quatre jambes. Ce qui nous permet d'émettre l'hypothèse que les anciens Scandinaves dessinaient huit jambes pour suggérer la vitesse. La représentation dessinée est ensuite passée dans le langage de la poésie et s'est généralisée.
Les images d'Odin représentent souvent le dieu à cheval. Bon nombres de ses surnoms indiquent le rapport d'Odin aux chevaux: Hrósshársgrani («celui qui a la barbe en crin de cheval») et Jálkr (le hongre). Les archéologues se demandent si Odin doit réellement être liée au culte du cheval. Il existe une interprétation mythologique naturaliste courante mais fausse, du mythe de Sleipnir: ses huit jambes représenteraient les huit directions du vent.
Le sculpteur norvégien Dagfinn Werenskiold a réalisé un bas-relief de bois représentant Odin monté sur Sleipnir. Sculptée entre 1945 et 1950, cette œuvre orne la cour de l'Hôtel de Ville d'Oslo. A l'époque contemporaine, Odin a été rarement représenté à cheval.
La légende veut que la crique d'Asbyrgi, dans le nord de l'Islande, soit l'empreinte du sabot de Sleipnir.
Sous le IIIième Reich, on avait l'habitude de donner le nom de Sleipnir aux bâteaux. En 1911, un navire de dépêche de la marine impériale allemande avait déjà reçu le nom de Sleipnir. En 1965, la marine norvégienne a donné le nom de Sleipnir à l'une de ses corvettes.
Depuis 1983/84, Sleipnir est également le nom d'un champ pétrolifère norvégien situé entre Stavanger et la côte septentrionale de l'Ecosse.
Hei∂run, la chèvre symbole d'abondance
Hei∂run est le nom d'une chèvre de la mythologie nordique. D'après le Grímnismál, 25, elle séjourne dans le Walhall et se nourrit des feuilles de l'arbre Læra∂r. De son pis jaillit un hydromel limpide qui coule directement dans les coupes des Einherier (les guerriers tombés au combat) (voir également Gylfaginning, 38). Dans le Hyndluljód, 46, 47, Hyndla reproche à Freya, outragée, qu'elle est aussi souvent «en rut» que Hei∂run. Le spécialiste néerlandais de la mythologie germanique, Jan De Vries, pense que les noms tels Hei∂vanr et Hei∂raupnir, dérive d'un mot cultuel, hei∂r, désignant l'hydromel des sacrifices. Sinon, la signification du mot reste obscure. Le mythe de la chèvre qui donne de l'hydromel doit être une interprétation typiquement nordique du vieux mythe de la vache originelle et nourrissière (Au∂umla). Chez les Grecs, nous avons la chèvre Amaltheia, donc les cornes sont des cornes d'abondance.
Ratatoskr, l'écureuil du frêne Yggdrasill
Ratatoskr, du vieux-norrois «dent qui fait des trous», est le nom de l'écureuil qui court le long du tronc du frêne Yggdrasill, l'arbre du monde, et va sans cesse de haut en bas et de bas en haut (Grímnismál, 30), pour aller rapporter au dragon Ní∂höggr, qui séjourne dans les racines, les paroles des aigles vivant dans les branches de l'arbre, afin, d'après Snorri (Gylfaginning, 15), de semer la zizanie. Les philologues n'ont pas encore pu prouver si ce récit est ou non un calque de la fable de Phèdre. En effet, le fait de semer la zizanie n'est pas une caractéristique originale de la mythologie nordique. L'écureuil Ratatoskr n'est vraisemblablement qu'un détail dans le mythe d'Yggdrasill, tel que nous le rapporte le Grímnismál.
Source: Rudolf Simek, Lexikon der germanischen Mythologie, Kröner, Stuttgart, 1984. ISBN 3-520-36801-3.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, mythologie, mythes, légendes, bestiaire, scandinavie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 septembre 2009
Garder les traditions ou vivre selon la Tradition?

Garder les traditions ou vivre selon la Tradition ?
L’un des premiers motifs de l’engagement militant aux Identitaires, c’est le refus volontariste de rester les bras croisés devant la « perte » de nos traditions, échos d’une identité lointaine que l’on souhaite défendre à travers l’entretien de ces rites ancestraux. Mais dans une société comme la nôtre, où les mœurs ont plus évolué en 50 ans qu’en 1 000 ans, « garder les traditions » s’apparente plus à un slogan révélateur du dépit des militants devant les grands bouleversements sociaux et culturels engendrés par le Progrès, qu’à une revendication politique sérieuse. En effet, rien de plus négatif qu’un tel slogan, rien de plus rasoir et de plus démotivant qu’une telle revendication. Le verbe « garder » a un sens précis : il est synonyme de conserver. Tel un pêcheur qui tenterait vainement de garder au bout de sa ligne l’énorme poisson emporté par l’irrésistible courant de la rivière. Je m’explique : on ne s’engage pas en politique, d’autant plus dans la mouvance identitaire, pour « sauver les meubles ». « Garder », « conserver », voire même « défendre » dans une certaine mesure, s’apparente à une posture rétrograde et aigrie, c’est un repli en défense plein d’amertume, un retour en arrière. Or, pour nous autres Identitaires, la politique est une aventure, une quête enthousiaste et une entreprise pleine de joie. Nous partons à l’assaut du pouvoir : nous ne nous agenouillons pas devant lui, implorant par nostalgie un sursis supplémentaire pour une fête ou une célébration laissée à l’abandon. Nous ne voulons pas réinstaurer un passé fantasmé (ce qui est de toute manière impossible) mais plutôt puiser dans le passé les éléments positifs utiles à une renaissance sociale, civilisationnelle et politique.
Nous ne nous engageons pas en politique comme le chauffeur de taxi, selon la caricature populaire, se lance dans une diatribe enflammée contre le fait que « tout fout le camp ». Soyons honnêtes : nous ne pouvons ressusciter ce qui est déjà mort. J’entends par là : nous ne pouvons pas vivre comme nos aïeux vivaient il y a deux siècles. Telles ces reproductions médiévales dans lesquelles de nombreux Français trouvent un certain exutoire, loin de leur malaise existentiel, blasés du métro-boulot-dodo. Cela, c’est le « folklore », c’est-à-dire l’exact contraire de l’identité, de la Tradition. Alors que le folklore consiste à danser la gigue autour du feu, habillés comme nos ancêtres et au son d’instruments disparus, vivre selon son identité, c’est tout simplement maintenir vivace, mais sous d’autres formes que celles aujourd’hui disparues, l’esprit qui animait nos ancêtres du temps où l’on dansait encore la gigue.
La Tradition ne se « garde » pas : elle s’entretient. Car la Tradition est avant tout un état d’esprit célébré sous des formes qui peuvent évoluer : la forme est importante mais le sens de la Tradition, c’est-à-dire sa raison d’être, l’est plus encore.
Or aujourd’hui, la plupart des associations s’étant donné pour objectif de « faire vivre » les traditions se limitent à faire du « folklore ». En effet, celles-ci se contentent d’être un musée itinérant d’une identité morte et enterrée. Car quiconque affirme défendre le « folklore » et le « patrimoine » formule en réalité un cruel aveu d’échec. A l’image de ces villages de Provence, vidés de leurs habitants par l’exode rural, colonisés par le tourisme de masse, résidence secondaire pour Parisiens, Britanniques et Hollandais aisés, où l’expression « enfants du pays » ne recouvre plus aucune réalité. Ces villages sont des territoires mis sous cloche (ou emballés sous vide, au choix), destinés à justifier notre statut de « première destination touristique mondiale ». Il y a des commerçants et des pseudo-artisans qui sont là pour faire rêver les touristes sur de « l’authentique » made in China, mais pas d’habitants, et donc pas de vie de village. Cela, c’est le folklore. Un mur de fumée « à l’ancienne » pour berner les touristes. C’est « sympa », « touchant », « naïf », « pittoresque », mais mort.
Ouvrons une parenthèse. La différence entre le folklore et la Tradition a des conséquences pratiques en termes de positionnement sur l’échiquier politique. Alors que l’homme « de droite » standard va draguer les électeurs à grands renforts d’images d’Epinal sur la « France des terroirs » (en tapotant le cul d’une vache devant les caméras par exemple), le militant identitaire va, lui, identifier les causes de la désertification rurale (la ruralité est le dernier refuge des traditions populaires, d’où l’intérêt de la préserver) et tenter d’y remédier via des mesures sérieuses : relocalisation de l’économie, lutte contre l’urbanisation et la spéculation immobilière, subventionnement de l’agriculture biologique, enseignement de la culture et de la langue régionale dès l’école primaire, etc.
Ainsi, une politique identitaire ne vise pas à manger du saucisson au Salon annuel de l’Agriculture, bref à être le « type sympa », mais à lutter en profondeur contre ce qui tue nos traditions depuis la racine. Refermons la parenthèse.
Les Identitaires ne s’accrochent pas désespérément à ce qui a disparu. Respectueux des rites ancestraux qui régissent une tradition millénaire, nous tenons plus encore à en respecter leur sens profond. Nous n’oublions pas qu’une tradition est la fille de circonstances sociales et culturelles, ou politiques, d’une époque donnée dans un lieu donné.
Par exemple, la bénédiction des calissons à Aix-en-Provence : chaque année, autour du 6 et 7 septembre, une messe est donnée, suivie d’une procession d’associations « folkloriques », en costume d’époque, avant de participer à la distribution populaire de calissons. Cette fête, appelée aussi « renouvellement du vœu Martelly », trouve son origine dans l’épidémie de peste qui toucha la capitale des comtes de Provence au début du 18ème siècle. L’élite politico-administrative et économique de la cité fuya, laissant derrière elle une population affamée. Seuls demeuraient l’évêque et l’assesseur (gouverneur de la ville pour le compte du roi) qui avaient organisé la bénédiction d’un grand nombre de calissons destinés à nourrir partiellement les Aixois. Martelly fait alors le vœu, en mémoire de ce drame, de faire bénir chaque année des calissons pour les distribuer aux Aixois. A l’origine, la « bénédiction des calissons » n’a donc rien de festif : elle répondait à une véritable catastrophe sanitaire et alimentaire, probablement la plus grave qu’ait connue Aix depuis sa fondation par les Romains. Aujourd’hui, combien d’Aixois connaissent le sens social et religieux de cette tradition ? De la même manière, combien d’Aixois savent que la plupart des saintes vierges qui ornent l’angle des immeubles de leur cité ont été installées à la même époque pour permettre à leurs ancêtres de prier pour la fin de l’épidémie et la guérison des blessés, depuis chez eux, afin d’éviter la contamination ? Pour un identitaire, ce qui importe par-dessus tout, ce n’est pas de défiler dans des costumes colorés pour provoquer les crépitements de flash des appareils photos tenus par les hordes de touristes japonais, mais plutôt de continuer à célébrer les valeurs humaines qui inspirent toute tradition.
Quand chaque année, des militants identitaires se retrouvent autour d’un « Noël provençal » (repas traditionnel), peu importe qu’il manque une nappe sur la table (trois selon le rite), que l’omelette aux truffes soit en réalité composée d’une autre spécificité de champignons ou que la traditionnelle morue ait cédé sa place à un poisson meilleur marché : une célébration ancestrale ne doit pas être une lubie de bourgeois aisés mais un moment de convivialité populaire. Si, pour faire perdurer un certain esprit, il est nécessaire (pour des raisons financières souvent), de déroger à quelques points précis de la règle, alors soit, il en sera ainsi, l’essentiel est de respecter l’âme d’une fête : pas de reproduire bêtement les gestes de nos aïeux par obsession mimétique. Pour nous, l’identité, ce « n’est pas ce qui ne change jamais, mais ce qui nous permet de rester nous-mêmes en changeant tout le temps » (Alain de Benoist).
Nous ne « gardons » pas les traditions, nous vivons selon la Tradition, tous les jours et en tout lieu : c’est-à-dire selon notre identité trente fois millénaire, malgré les évolutions et les révolutions. Fidèles au sens initial des traditions et à l’état d’esprit qui a présidé à leur naissance, soucieux de l’intégrité des rites qui servent de médium entre l’esprit d’antan et le peuple d’aujourd’hui, nous veillons toutefois à ne pas laisser la lettre primer sur l’esprit (selon la leçon des évangiles à propos des Pharisiens). La Tradition, c’est l’identité : passée, présente et future.
Julien LANGELLA
Article printed from :: Novopress.info France: http://fr.novopress.info
URL to article: http://fr.novopress.info/30642/garder-les-traditions-ou-vivre-selon-la-tradition/
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, réflexions personnelles, philosophie, identité, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 septembre 2009
La contribution à Il Regime Fascista de Friedrich Everling

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert Steuckers:
La contribution à Il Regime Fascista de Friedrich Everling
Ecrivain et théoricien monarchiste, Friedrich Everling, né en 1891 à Sankt-Goar et décédé en 1958 à Menton, est le fils du théologien protestant et homme politique Otto Everling. Juriste de formation, il embrasse d'abord la carrière diplomatique; mais fidèle à ses convictions monarchistes, il refuse de prêter serment à la République de Weimar et devient avocat. De 1924 à 1933, il est député deutschnationaler au Reichstag et y défend les thèses légitimistes les plus tranchées. A la même époque, il édite la revue Konservative Monatsschrift.
En 1933, sa carrière de député prend fin et il est nommé Conseiller supérieur au tribunal administratif de Berlin. Son œuvre comprend une définition de l'idéologie conservatrice, une prise de position dans la querelle des drapeaux (or-rouge-noir ou noir-blanc-rouge?), une défense du principe monarchique, des études sur les états (Stände) dans l'Etat post-républicain, la structuration organique du «Troisième Reich» (non entendu, au départ, dans le sens national-socialiste, bien qu'Everling fera son aggiornamento) qui prendra le relais du Second Reich défunt, etc.
La signature de Friedrich Everling apparaît le 18 avril 1934 dans Il regime fascista. Son article, intitulé «I Capi» (= Les Chefs), part d'une réflexion de Heinrich von Treitschke sur les personnalités fortes qui font l'histoire: «Ce sont les personnalités et les hommes qui font l'histoire, des hommes comme Luther, comme Frédéric le Grand et Bismarck. Cette grande vérité héroïque restera toujours vraie. Comment se fait-il que de tels hommes apparaissent, chacun dans la forme adaptée à son temps, voilà qui, pour nous mortels, demeurera toujours une énigme». Rappelant que cette phrase avait été écrite de la propre main de Mussolini sur un portrait du Duce offert à l'un de ses amis, Everling cherche à démontrer que ce ne sont pas les masses qui font l'histoire et forment les Etats, mais que l'idéal du Chef domine l'histoire. Se référant ensuite à Gustave Le Bon, auteur de La psychologie des foules, Everling rappelle que ces hommes qui font l'histoire sont des hommes de forte foi et de «long vouloir». Les Chefs ont pour moyens d'action l'affirmation, la répétition (l'unique mode rhétorique sérieux d'après Napoléon) et la volonté ou la capacité de transmettre quelque chose, une suggestion par exemple. A la base du pouvoir exercé par les Chefs, poursuit Everling dans son article d'Il Regime fascista, toujours en se référant à Le Bon, se trouve le prestige, mode de domination naturel qui paralyse les facultés critiques d'autrui, stupéfie, suscite le respect. Everling prouve ensuite qu'il est lecteur d'Evola, en citant cette phrase d'Imperialismo pagano, qui définit le Chef: «[Il est d'] une nature qui s'impose non par la violence, non par l'avidité ou par l'habilité à conduire des esclaves, mais en vertu du caractère irrésistible des formes qui transcendent la vie». Evoquant les études de Max Weber sur les figures charismatiques de la politique, Everling rejoint la critique du grand sociologue allemand qui parlait des «chefs par profession mais sans vocation»; Everling, lui, dit préférer parler des «chefs à salaire». En conclusion à cet article consacré à la nature et aux vertus du Chef, Everling écrit: «L'idéal du Chef ne peut être véritablement compris que par ceux qui, dans une certaine mesure, le portent déjà en eux. Reconnaître un tel idéal, pour un peuple, signifie un progrès pour le peuple entier. A la suite des nations qui marchent déjà dans ce sens —l'Allemagne et l'Italie— les autres embrayeront le pas».
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditon, traditionalisme, révolution conservatrice, allemagne, italie, années 30, philosophie, histoire, sciences politiques, politologie, théories politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 septembre 2009
La contribution à Il Regime Fascista de Wilhelm Stapel
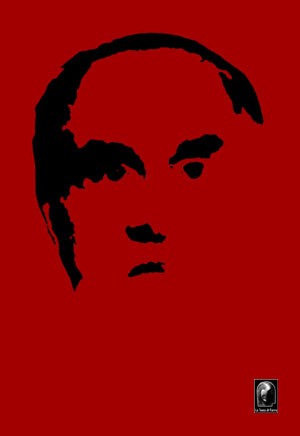
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert Steuckers:
La contribution à Il Regime Fascista de Wilhelm Stapel
Wilhelm Stapel (1882-1954) est l'une des figures-clé de la Révolution Conservatrice allemande. Fils d'un horloger, assistant de librairie, Stapel termine en 1910/11 des études d'histoire de l'art. En 1911, il collabore au journal libéral de gauche Der Beobachter (Stuttgart). En 1911, il adhère au Dürerbund (Association Dürer). De 1912 à 1916, il est rédacteur à la revue Kunstwart. En 1919, il fonde la revue Deutsches Volkstum qu'il dirigera jusqu'en 1938. Pour Armin Mohler (in Die konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 3ième éd., 1989, pp. 410-411), Stapel est «un mélange curieux de systématiste et de polémiste; sa plume était l'une des plus craintes de la droite». Ses rapports avec les autorités du IIIième Reich ont été tendus. En 1938, il est mis au ban de l'univers journalistique; sa revue Deutsches Volkstum cesse de paraître. L'objectif de Stapel était de donner une ancrage théologique au conservatisme allemand. En témoigne son ouvrage principal: Der christliche Staatsmann. Eine Theologie des Nationalismus (Hanseatische Verlagsanstalt, Hambourg, 1932). Après la disparition de Deutsches Volkstum, Stapel, contraint et forcé, a dû adopter un profil bas et faire toutes les concessions d'usage à la langue de bois nationale-socialiste. Malgré cela, son ouvrage principal, après 1938, Die drei Stände. Versuch einer Morphologie des deutschen Volkes (Hanseatische Verlagsanstalt, Hambourg, 1941), fait montre d'une originalité profonde. Comme l'indique le titre, Stapel tente de dresser une typologie du peuple allemand, distinguant trois strates majeures: les paysans, les bourgeois et les ouvriers.
La contribution de Wilhelm Stapel à Il Regime fascista, intitulée «Nazione, Spirito, Impero» (16 mars 1934), est composée, presque dans sa totalité, d'extraits de Der christliche Staatsmann. Ce qui laisse à penser que c'est Evola lui-même qui a choisi, peut-être sans autorisation, des extraits du livre et les a juxtaposés dans un ordre cohérent.
Ce qui intéressait Evola dans la théologie conservatrice de Stapel (baptisée «théologie du nationalisme» pour cadrer avec les circonstances), c'était sa condamnation du nationalisme bourgeois, de facture jacobine, étayé de références naturalistes. Ce qui ne signifie pas que Stapel rejette toutes les doctrines qui se donnent l'étiquette de «nationaliste». Dans son article d'Il regime fascista, Stapel admet l'existence des nationalités (nous dirions aujourd'hui des «ethnies»), dans la ligne de Herder et du jeune Goethe. Il admet également la distinction, opérée par Fichte, entre «peuples originaires» (les Germains et les Slaves), non mélangés, et «peuples mélangés», dont l'existentialité est un produit récent, impur, mal stabilisé (les peuples latins). Pour Stapel, Fichte, en soulignant ce caractère «originaire», respecte la création de Dieu, qui a créé les uns et les autres de façon telle et non autre, et introduit un motif conservateur, c'est-à-dire métaphysique, dans le nationalisme, le rendant de la sorte acceptable. En clair, cela signifie que les nationalismes slaves et germaniques, à base ethnique, sont acceptables, tandis que les autres, qui sont l'œuvre des hommes et non de Dieu, sont inacceptables. Le nationalisme allemand, tel qu'il procède de Fichte, «demeure étranger à la sécularisation vulgaire advenue dans le sillage du naturalisme et du rationalisme; ainsi, au lieu d'être la phase crépusculaire d'un cycle de pensée, ce nationalisme peut apparaître comme le principe d'une pensée nouvelle» («Nazione, Spirito, Impero», art. cit.).
L'homme étant incapable de connaître tous les paramètres de l'univers, il doit s'orienter dans le monde par l'intermédiaire de «formes figurées». Le monde de l'inconnu, de l'incommensurable, est voisin du nôtre; le Chrétien, écrit Stapel, le désigne du terme de «Règne de Dieu»; ce règne est un ordre qui domine le monde: Dieu en est le Seigneur. Etre chrétien, dans cette théologie de Stapel, procède d'une «prise de position métaphysique», comme d'ailleurs toute acceptation ou toute récusation. Opter pour Dieu, c'est évidemment accomplir un acte métaphysique, qui revient à dire: «je veux appartenir à ce Règne». «Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que l'homme se subordonne au Seigneur des Troupes célestes. Il entre comme un combattant dans une armée métaphysique (...) [Dans ce choix], l'élément "humain" ne varie pas mais dans la substance, s'opère une mutation. Celui qui a juré par le Dieu des Chrétiens, doit Lui être obéissant. Il doit faire peu de cas de sa propre vie humaine et de sa propre personnalité. Il doit obéir à Dieu et diriger, risquer, sa vie pour son honneur. Et cela ne signifie pas fidélité dans la joie d'accèder à la "sainteté", qui peut déjà être momentanément goûtée, mais signifie plutôt obéissance et solidarité guerrière. Tout ce que Dieu, en tant que Seigneur, ordonne, il faut le faire. Cela transcende toute philosophie, toute convulsion sentimentale impure du «converti», toute préoccupation d'évolutionnisme moralisant. Le savoir phraseur, le zèle moraliste, le sentimentalisme imbu de soi, tout cela est duperie à l'égard de soi-même. Décide-toi et laisse le reste à Dieu» («Nazione, Spirito, Impero», art. cit.).
Cette théorisation radicale de l'engagement métaphysique pour le Règne de Dieu a séduit Evola, comme l'ont fasciné, sur le plan pratique, les mouvements du Roumain Codreanu, la Légion de l'Archange Michel et la Garde de Fer. La notion de «Milice de Dieu», également présente dans la Chevalerie médiévale et dans l'idée de Djihad en Islam, sont des éléments actifs et significatifs de la «Tradition Primordiale», selon Evola. Cette adhésion, cette milice, va toutefois au-delà des formes. De tradition luthérienne et prussienne, Stapel rejette le culte catholique des institutions et du formalisme; pour lui, la décision du sujet de devenir «milicien de Dieu», de Le servir dans l'obéissance, vient toute entière de l'intériorité; elle n'est en aucun cas une injonction dictée par un Etat ou un parti. Il est intéressant de noter que cette théologie de l'engagement total, qui séduit le traditionaliste Evola, vient en droite ligne d'une interprétation des écrits de Luther. Donc du protestantisme dans sa forme la plus pure et non d'un protestantisme de mouture anglo-saxonne, où l'éthique du service et de l'Etat est absente. Ceux qui, dans les pays latins, croient trouver en Evola une sorte de religiosité qui remplacerait leur catholicisme, ou qui ajoutent à leur catholicisme, caricatural ou ébranlé, des oripeaux évoliens, ne comprennent pas toute la pensée de leur maître: le protestantisme luthérien a sa place chez Evola. Le culte des institutions formelles est explicitement rejeté chez Stapel: «Il n'existe ni Etats chrétiens ni partis chrétiens. Mais il existe des Chrétiens. [Les Chrétiens peuvent être citoyens ou membres de partis]. Ce qui les distingue des autres, n'est pas perceptible en tant que sagesse ou moralité ou douceur, etc., particulières mais réside dans l'imperceptible, dans la substance. Ils ont juré fidélité à leur Dieu. Ils sont sous les ordres du Seigneur des Troupes célestes. Pour cette raison, ils pensent et agissent dans un espace plus grand que les autres hommes. Pour eux, il n'existe pas seulement ce monde, mais un autre monde derrière celui-ci. Ils n'agissent pas seulement sur la terre mais toujours à la fois "dans le ciel et sur la terre". C'est pourquoi leurs décisions sont toujours déterminées autrement que les décisions des autres. Ils peuvent s'engager plus à fond, au-delà de tout ce qui est terrestre, également au-delà des moralités de ce monde, dans le sens où ils font ce que Dieu leur a donné mission de faire. Le Chrétien est mandaté par les faits de sa nature propre [Geschaffenheit, dans le texte original; littéralement, cela signifie sa «créaturité»; Evola, ou le traducteur d'Il Regime fascista, traduit parnatura propria] et de sa vocation. S'il a été créé Allemand, alors il devra mettre toutes ses énergies au service de sa germanité et de son Reich allemand. S'il a été créé Anglais, alors il devra mettre ses énergies au service de son peuple et de son Etat. Comme tout cela peut-il se concilier? Il faut qu'il laisse à Dieu le soin d'y veiller».
Quant au rôle de Luther, Stapel l'a définit dans un article de Deutsches Volkstum (1933, p. 181; «Das Reich. Ein Schlußwort»): «Quand l'Eglise est devenue inféconde et quand Dieu est entré en colère en s'apercevant de l'absence de sérieux de ses serviteurs, il a fait s'éveiller parmi les Allemands, peuple sérieux, un combattant et un prophète: Martin Luther. C'est ainsi que le Pneuma et l'Eglise ont été mis entre les mains des Allemands. A partir de ce moment, le Reich et l'Eglise, comme jadis chez les Romains, se retrouvaient entre les mains d'un seul peuple. Le Reich s'étendait alors sur tout le globe: dans le Reich de Charles-Quint, le soleil ne se couchait jamais. Mais chez Charles-Quint, le sang allemand de Maximilien s'était estompé et l'esprit allemand s'était éteint. L'Empereur n'est pas resté fidèle au peuple de son père. A l'heure où sonnait le destin du monde, il a failli. Au lieu de protéger et de laisser se développer l'Eglise de l'esprit, au lieu d'ordonner le monde selon les principes du Reich, il s'est enlisé dans des querelles d'intérêts. C'est ainsi qu'il a perdu et sa couronne et le Reich; le dernier véritable empereur s'est retiré, fatigué, dans un monastère, après avoir abandonné sa fonction. Ce n'est pas la Réforme qui est la cause de l'interrègne, mais l'infidélité et la négligence de Charles-Quint. Il n'a pas reconnu la véritable Eglise et a oublié [ce que signifiait] le Reich». Plusieurs analystes de la «Révolution Conservatrice» allemande, comme Martin Greiffenhagen (Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland, R. Piper Verlag, München, 1977), Kurt Sontheimer (Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, DTV, 3ième éd., 1978) ou Klaus Breuning (Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und Diktatur. 1929-1934, Hueber, München, 1969) ont mis en exergue l'importance capitale de l'œuvre et des articles polémiques de Stapel. Greiffenhagen, par exemple, montre qu'il n'y a aucune propension au «novisme» (à l'innovation pour l'innovation) chez Stapel, contrairement à tout ce qui est affirmé péremptoirement par le filon philosophique moderne; ce que les militants, ou les «miliciens de Dieu», doivent créer, parce que les circonstances l'exigent, n'est pas quelque chose de radicalement neuf, mais, au contraire, quelque chose d'original, de primordial, qu'il faut raviver, faire ré-advenir. Pour Stapel, c'est la notion de Reich qu'il faut rappeler à la vie. Dans Der christliche Staatsmann. Eine Theologie des Nationalismus, il écrit (p. 7-8): «Le Reich n'est pas un rêve, un désir; ce n'est pas une fuite dans une quelconque illusion, mais c'est une réalité politique archétypale (uralt) de nature métaphysique, à laquelle nous sommes devenus infidèles [...]. Lorsqu'Israël s'est détourné de Yahvé, Dieu a puni Israël, comme nous pouvons le lire dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous nous détournons du Reich, Dieu nous punit, comme nous le montre l'histoire allemande. C'est cela le Testament Allemand».
Stapel et Evola se réfèrent donc tous deux à un archétype métaphysique, transcendant toute forme de «sécularité», et visent, comme l'écrit Stapel (Der christliche Staatsmann, op. cit., p. 6), à forger un «front antiséculier». Front anti-séculier qui sera également porté par un anti-intellectualisme conséquent et radical: «La croissance de l'intellect s'est effectuée au détriment de la substance humaine, prise dans sa totalité. Le sentiment est devenu plus prosaïque et incolore (nüchtern); l'imagination terne et schématique; la passion a perdu son élan; l'instinct s'est amenuisé, n'est plus sûr de lui; la faculté de pressentir s'étiole. Mais, l'intellect croît et cherche, par le calcul, par la réflexion, par l'ébauche de belles idées, etc., à remplacer la source vive des sentiments, la fantaisie, l'instinct et le pressentiment. Tandis que l'homme croît et se développe toujours davantage dans l'orbite de l'intellect, les racines de son existentialité s'assèchent. A la place de réactions immédiates, inconscientes —qui sont bonnes quand la substance est bonne, mauvaises quand la substance est mauvaise— survient une éthique du cerveau» (Der Christliche Staatsmann, op. cit., p. 195).
Comme chez Evola, Rohan et Everling, nous trouvons, chez Stapel, une définition du chef, en tant qu'homme d'Etat: «Le véritable homme d'Etat unit en lui la "paternalité" (Väterlichkeit), l'esprit guerrier et le charisme. Paternellement, il règne sur le peuple qui lui a été confié. Lorsque son peuple croît en nombre, il lui fournit de l'espace pour vivre, en rassemblant ses forces guerrières. Dieu le bénit, lui donne bonheur et gloire, si bien que le peuple l'honore et lui fait confiance. L'homme d'Etat pèse et soupèse la guerre et la paix tout en conversant avec Dieu. Ses réflexions humaines deviennent prières, deviennent décisions. Sa décision n'est pas le produit d'un calcul, d'une soustraction, effectué(e) dans son entendement mais reflète la plénitude totale des forces historiques. Ses victoires et ses défaites ne sont pas des hasards dus à des facteurs humains, mais des dispositions de la Providence. Le véritable homme d'Etat est à la fois souverain, guerrier et prêtre» (Der christliche..., op. cit., p. 190). Si Evola manie l'opposition tellurique/ouranien ou matrilinéaire/patrilinéaire, Stapel, penseur luthérien et prussien, nomme «Romains», ceux qui ont, dans l'histoire, le sens de l'Etat, sont imperméables à toute forme de libéralisme, en dépit des formes républicaines ou impériales qu'ils peuvent défendre. Les négateurs de l'idée d'Etat sont, pour Stapel, les misérables «Graeculi», qui ne pensent ni n'agissent jamais de manière politique et ne réagissent que sous la dictée et l'emprise d'affects privés. Pour Stapel, la dichotomie directrice distingue donc les «Romains» des «Graeculi». Le parallèle avec Steding, qui opposait les défenseurs du Reich aux «neutres», est évident.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, révolution conservatrice, allemagne, italie, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, histoire, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 septembre 2009
Les contributions à Il Regime Fascista du Prince Karl Anton Rohan

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert STEUCKERS:
Les contributions à Il Regime Fascista du Prince Karl Anton Rohan (1898-1975)
Le Prince Karl Anton Rohan, issu d'une très ancienne famille bretonne, émigrée à Vienne et devenue autrichienne, fonde en 1924 le Verband für kulturelle Zusammenarbeit (= Association pour la Coopération Culturelle) et édite à Berlin, de 1925 à 1936, la célèbre Europäische Revue, qui donne aux cercles conservateurs et conservateurs-révolutionnaires (dans l'optique jungkonservativ) une dimension européenne, supra-nationale, impériale (dans le sens de Reich). Huppés et mondains, les cercles regroupés autour de l'Europäische Revue influençaient les milieux diplomatiques. Après que le Prince Rohan ait passé le flambeau de rédacteur-en-chef au Dr. Joachim Moras, l'importance du Conseiller d'Etat prussien, le Prof. Dr. Baron Axel von Freytagh-Loringhoven, n'a cessé de croître dans la revue.
Le Prince Rohan, dans son ouvrage Schicksalstunde Europas. Erkenntnisse und Bekenntnisse, Wirklichkeiten und Möglichkeiten (Leykam-Verlag, Graz, 1937), a esquissé un bilan de l'histoire spirituelle et événémentielle de l'Europe, en abordant le problème central de la personnalité dans l'éthique qu'il qualifiait de «spécifiquement européenne», en amorçant une réflexion sur le matérialisme et le rationalisme, erreurs philosophiques et politiques du monde moderne, et en annonçant le retour à l'avant-plan d'idées et d'idéaux non révolutionnaires, voire contre-révolutionnaires, pour lesquels, croyait-il, le fascisme et le national-socialisme préparaient le terrain, parce qu'ils étaient des réactions radicalement anti-bourgeoises. Les aristocrates qui ont encore en eux les vieux réflexes constructeurs du politique reviendront tout naturellement au pouvoir; mais ceux qui sont épuisés dans leur vitalité et leur créativité devront se ressourcer dans le grand nombre: «les vieilles figures sont fissurées; elles devraient se replonger dans le nombre, de façon à ce que, au départ de cette immersion dans le nombre, de nouvelles figures puissent croître et remonter à la surface» (p.383).
«Tout comme la caste supérieure déterminée par le sang et constituée par l'aristocratie n'a pas pu inclure dans les structures du pouvoir de l'ancien régime les forces montantes de la révolution bourgeoise, les autorités éphémères du monde bourgeois du XIXième siècle ont échoué dans leur tentative de capter et de diriger sur des voies d'ordre la "révolte des masses", la révolution de l'anti-bourgeois. Dans le vaste processus historique qu'est la révolution sociale, les anciennes autorités ont été broyées, étrillées, et aucune autorité nouvelle n'est encore apparue. Pour être plus précis: les signes avant-coureurs d'une nouvelle et véritable autorité ne sont présents sur la scène que depuis peu de temps; cette autorité nouvelle doit mûrir et s'affirmer. Ceux qui constituaient l'élite sont désormais fatigués. La vision du monde de nos relativistes d'esprit et de morale n'était vraiment pas appropriée pour servir de plate-forme à une domination sur les masses, au sein desquels même les plus arriérés savent désormais lire et écrire. Et les pédérastes et demi-puceaux émanant de la "jeunesse dorée" des classes supérieures urbanisées ne pouvaient évidemment pas apparaître aux yeux de l'ouvrier comme l'élite de ses vœux, à laquelle il devrait se soumettre. Les classes supérieures et la masse se comportent dans l'histoire comme le conscient et l'inconscient dans l'homme. La santé, au sens social comme au sens psychologique, est cet état de choses, dans lequel le dessous et le dessus entretiennent un rapport d'échange constant et fructueux, où le dessus est reconnu par le dessous, où le dessous donne au dessus la direction (vox populi, vox dei), où le dessus comprend le dessous et où la répartition naturelle des rôles de l'un et de l'autre se maintient en harmonie. Ce qui signifie que le haut, et seul le haut, doit agir, toutefois en acceptant une responsabilité pour le tout; et ces strates supérieures doivent agir en concordance avec les aspirations de la masse et avec ses exigences qui sont évidemment générales et confuses. Si la masse veut agir immédiatement (sans intermédiaire), en révolte contre le haut, alors il arrive ce qui arrive à l'individu qui agit au moment où son subconscient oblitère sa conscience: il y a des pots cassés et notre homme obtient presque toujours le contraire de ce qu'il avait désiré. Car, de toute éternité, le rôle des classes supérieures, de la direction, ou, au niveau de l'individu, de la conscience, c'est d'adapter et de canaliser dans le réel les sombres émotions et pulsions de la masse ou de l'inconscient. Sans ce rôle de régulateur et de transformateur, surviennent immanquablement des catastrophes. Si cet équilibre normal et sain, cette oscillation entre le haut et le bas, sont interrompus, la conscience poursuit sa vie sans lien avec son socle fait d'inconscient, si elle plane dans les airs, alors nous voyons apparaître les premières manifestations de fatigue. Sont alors nécessaires le repos, la détente, la récréation, la distraction. Toute révolution n'est jamais autre chose, ne peut jamais être autre chose, que l'expulsion d'une élite dominante par une élite dominée qui aspire à exercer le pouvoir; or tout processus révolutionnaire commence au sein des élites. On y est fatigué, on ne croit plus à ses propres forces. On trouve que ceux d'en bas, que les adversaires, ont en fait raison dans ce qu'ils disent et revendiquent. On décide de ne pas résister et on est balayé. C'est ainsi qu'en 1918 les monarchies ont été abandonnées par les détenteurs du pouvoir, avant même qu'elles n'aient été réellement attaquées. Si l'élite fatiguée ne veut pas prendre connaissance de ses symptomes, elle vivra de sa propre substance; alors la masse inconsciente, qui a perdu toute relation normale avec l'élite, se fera plus critique et plus turbulente. On verra alors apparaître de véritables troubles qui iront en crescendo, jusqu'aux crises névrotiques, jusqu'aux dépressions nerveuses. Si l'élite, qui a perdu toute véritable autorité et donc toute légitimité, refuse de se retirer du pouvoir, elle s'en tiendra au droit positif contre le droit naturel et refusera de faire passer les réformes nécessaires; alors la révolution dégénère en guerre civile» (pp. 381-383) . «La première démarche à accomplir, pour forger de nouvelles figures, une nouvelle élite qui entretient un contact sain avec la base, c'est de vivifier les hiérarchies que la révolution et la contre-révolution ont constituées. Il s'agit ici de construire une communauté de volonté. Discipline sévère, inclusion dans un ordre, mais aussi travail sans relâche aux postes qui ont été assignés, exécution précise des ordres reçus, voilà les premisses. Mais pour monter plus haut dans la nouvelle hiérarchie, il faut adhérer à un mythe politique, il faut être intérieurement emporté par l'esprit d'une Weltanschauung. Derrière les slogans que sont la "révolution mondiale", l'Italianità et la Romanità, le Volkstum et la race nordique, se profile toute une construction doctrinale avec ses fondements d'ordre historique, sociologique, économique, scientifique et aussi moral: il faut les accepter sans conditions car ils sont les présupposés qui fondent la confiance au sein de la communauté de volonté, qui sont nécessaires à l'exercice des plus hautes fonctions» (pp. 383-384). A la lecture de ces extraits, on s'aperçoit que l'intérêt d'Evola pour Rohan (et vice-versa: Rohan cite Révolte contre le monde moderne en page 25 de Schicksalsstunde Europas, op. cit.) vient d'une volonté partagée entre les deux hommes de dépasser définitivement les limites étroites du bourgeoisisme, de reforger dans la «mobilisation totale» une nouvelle aristocratie européenne supra-nationale. Pour Rohan, le fascisme italien et le national-socialisme allemand sont des effervescences provisoires, brutales et violentes, qui s'avèrent nécessaires pendant le laps de temps où il n'y a plus de véritable autorité. Dès que la «domination des meilleurs» sera installée, «la crispation se détendra, la militarisation actuelle des peuples se relâchera. Car la violence ne doit s'exercer que là où manque une autorité véritable. Un pouvoir réel devra nécessairement octroyer davantage de liberté, sans pour autant craindre l'effondrement des peuples et des Etats ni une diminution de leur puissance de frappe en cas de guerre ou en temps de paix» (p. 386). «Le nouveau type dominant, anti-bourgeois, a fait appel aux masses, il les a politisées, il les a fusionnées en unités disciplinées sous le signe de mythes nouveaux» (p. 387).
Dans Il Regime fascista, Rohan aborde la problèmatique de l'«autre Europe», qui est, écrit-il, «notre Europe», c'est-à-dire celle de la nouvelle phalange anti-bourgeoise, regroupant des ressortissants des anciennes aristocraties (comme, par exemple, Evola et lui-même) et les élites nouvelles, fascistes ou nationales-socialistes, qui ont réussi la «mobilisation totale» des énergies populaires. Dans l'article intitulé «L'altra Europa, la "nostra" Europa» (16 février 1934), Rohan oppose sa conception de l'Europe à celle d'un autre aristocrate autrichien, le Comte Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, auteur, en 1924, d'un projet de «Paneurope», regroupant tous les Etats du continent à l'exclusion de l'Angleterre et de la Russie. Cette Paneurope, qui a enthousiasmé Briand et Stresemann, devait s'inscrire dans la tradition libérale-démocratique et en étendre les principes à l'ensemble du continent. Rohan et Evola sont «paneuropéens», mais à l'enseigne de valeurs diamétralement opposées au libéralisme et au démocratisme, nés dans le sillage de 1789 ou imités des modes anglo-saxonnes.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, révolution conservatrice, allemagne, italie, histoire, années 30, conservatisme, idée européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 septembre 2009
El Camino del Guerrero Sagrado
El Camino del Guerrero Sagrado
Por Peggy Andrea
"¡Hoka Hey!" Exclama al guerrero Sioux cabalgando en la batalla, "Hoy es un buen día para morir". Un verdadero guerrero se atreve a lo imposible. El desafía la muerte y la respeta. Una historia acerca de guerreros Americanos Nativos dice así, "los Guerreros viven con la muerte a su lado, y el conocimiento de que la muerte está con ellos, provoca el coraje de afrontar cualquier cosa. Lo peor que nos puede suceder es que tengamos que morir, y ya que ese es nuestro destino inmutable, somos libres; Aquellos que lo han perdido todo ya no tienen algo a lo que temer".
El Camino del Guerrero Sagrado comienza con la toma de conciencia de que somos seres mortales, de que vamos a morir. Sabiendo esto, podemos ver nuestras vidas desde una mejor perspectiva. Sabiendo esto, podemos actuar SIEMPRE de manera tal que podamos morir centrados, más allá del miedo, en paz con lo que hemos hecho a partir de la materia prima de nuestras vidas. ¿La meta está en vivir bien nuestras vidas para eventualmente morir bien, a fin de que lo que es eterno en nosotros (nuestro espíritu?) sea puesto en libertad. Cada uno de nosotros debe llegar a un acuerdo con su Muerte personal. Por ejemplo, me gusta pensar que mi cuerpo es el descendiente de un acto de amor entre mi Espíritu y el mundo Elemental. ¡Me gusta pensar que MI muerte será una consumación final y una agridulce realización orgásmica de aquel amor!
El Guerrero Sagrado camina por su camino con su Muerte a su lado. Y su Muerte está disponible al Guerrero Sagrado como un consejero, maestro, y amigo. Esta relación con su Muerte invita al Guerrero Sagrado a ser el ser que verdaderamente es, para vivir su vida plena y completamente, para usar el poder interior. Como Agnes Whistling Elk dice en "The story Medicine Woman" Sólo llegarás a ser peligroso cuando aceptes tu muerte. Entonces te vuelves peligroso a pesar de cualquier cosa. Debes aprender a ver a los despiertos. Una mujer peligrosa puede hacer cualquier cosa porque ella está dispuesta a cualquier cosa. Una mujer poderosa es inimaginable porque lo inimaginable le pertenece a ella. Todo le pertenece a ella, y cualquier cosa es posible".
En la tradición Americana Aborigen, las historias de guerreros a menudo revelan una infancia poblada de agitación interior y agresividad externa. Los guerreros recién nacidos son sutiles para explorar el mundo y ellos no quieren que alguien o algo se cruce en sus caminos. Pueden luchar con sus hermanos o pueden poner a prueba a los padres despiadadamente. Los guerreros a menudo parecen haber nacido con un exceso de energía. Sus temperamentos son fogosos; Sus voluntades, fuertes. Un joven guerrero que esté frustrado con su apariencia física casi con seguridad compensará esto con un superávit de energía mental o emocional.
La historia del Jefe Gerrero Tewa Cottonwood, Pohaha, describe este asunto. Siempre enojada cuando joven, ella se rebeló cuando le fue instado hacer trabajo doméstico. Finalmente, su tribu consintió en dejarle ir a batallar, en donde se distinguió poderosamente. Luego, se afirma, su constante cólera desapareció y "se convirtió en una buena mujer". ¡Su nombre, Pohaha, quiere decir "húmedo entre las pierna ja ja" por su hábito de arrancarse el vestido para ridiculizar a sus enemigos con el hecho que ella fuera una mujer! Con el tiempo, la gran Pohaha llego a ser "Jefe Gerrero" elegido por los ancianos. Como Jefe de Guerra, ella tenía que guiar a su pueblo contra los enemigos, protegerles de enfermedades y tratarlos como sus hijos. Ella tomó seriamente su cargo; Y cuando ella murió, dejó su máscara y dijo que esta la representaría aun cuando esté muerta. " estaré contigo todo el tiempo," ella le dijo a su tribu, "la máscara soy yo".El pueblo Cottonwood conserva su máscara, y cuentan su historia, hasta el día de hoy.
Un joven guerrero es difícil de controlar. Una vez que al guerrero le es encomendada una tarea desafiante, estará este en el camino hacia el AUTOCONTROL. Los aborígenes americanos comienzan el entrenamiento guerrero con lecciones de caza, junto con las habilidades básicas de supervivencia en tierra salvaje. Le enseñan al joven cazador respeto por su "presa". Muestran a lo joven que para aprender de la Muerte personal (la Cazadora Final), uno necesita desarrollar humildad, paciencia, y una habilidad para mantener una cabeza despejada — o, al menos, despejar la cabeza rápidamente ! El entrenamiento de supervivencia en tierra salvaje es un concepto de bien para un Guerrero Sagrado — le da un conocimiento auténtico de su mundo, y de su relación a él. Le muestra a la Naturaleza como su primer Adversario. Ella aprende que uno no puede competir con tan poderoso Adversario . Pero ella también se entera de que este Oponente es un espejo de su corazón, y como tal merece respeto y, aun, amor. De esta comprensión, ella pasa a aprender autodefensa y confianza en sí misma.
Obviamente, éste es un camino de coraje. Los americanos nativos llaman a sus "guerreros valientes" ( en inglés "Braves" cuya traducción también es "guerreros indios") por una razón. ¡Cuanto más coraje ha mostrado, más honrado el guerrero es! "Los guerreros indios" (tanto hembra como varón) que cabalgaron en la batalla no trataron de dar muerte a la oposición. Fue considerado mucho más valiente humillar al enemigo acercándose lo suficientemente hasta simplemente tocarlo, o capturar la cofia de guerra, pipa ceremonial o el escudo. Matar a otro guerrero era considerado un acto a considerar cuidadosamente. Matar a inocentes era considerado cobardía. En días antiguos, se dice que los grandes guerreros no atacaban un campamento, pero entraban y eran bienvenidos. Eran llevados al "tipi (tienda cónica) enemigo" para descansar y ser alimentados. Entonces todos los jóvenes guerreros del campamento venían a desafiar al gran guerrero, esperando "sumar hazañas" pero frecuentemente tan solo los más afortunados lograban mantenerse en pie. Indudablemente obtuvieron algunas lecciones de la experiencia.
"La Captura" (lo que podríamos llamar robar) se convirtió en una de las máximas hazañas guerreras. Ya que no había idea de propiedad, esto era más como recuperar. Es aquí donde el insulto Blanco del "obsequiante indio" se originó. Las entidades (como los caballos) o los lugares (como un bosque o una llanura) no podrían ser "poseídas" por alguien; Por lo tanto le pertenecían a aquellos que se encargaban de ellos.
En el mundo moderno, nuestras batallas son usualmente peleadas en algo así como arenas diferentes. Pero el guerrero indio quieren ceder ante ti hasta que tengas poder a fin de que puedas convertirte en un adversario digno para otro guerrero digno ". ¿Qué es oposición, después de todo? Esta pregunta es central en el Camino Sagrado del Guerrero. Esta no implica desprecio. Es antieconómico sentir desprecio por personas u otras entidades. Un guerrero Aborigen Americano hablándole a un grupo de Americanos Blancos lo explica así, " Vosotros tenéis tal cólera, tal miedo y tal desprecio para con los llamados criminales que tu propio índice de criminalidad va mucho más lejos. Vuestra sociedad tiene un índice de criminalidad alto porque está en una posición perfecta para receptar el crimen. Tú deberías estar trabajando CON estas personas, no contra ellos. La idea es despreciar el crimen, no a las personas. Es más útil considerar a cada individuo como otro TÚ — considerar cada individuo como un representante del universo. Incluso el peor criminal en cadena perpetua sentado en su celda — el centro de él es la misma semilla, la semilla de la creación entera ".
¿Entonces cuál es el sentimiento que el Guerrero Sagrado cultiva dentro de sí mismo? El desapego es importante. " Todo el mundo que quiere seguir el camino del guerrero tiene que deshacerse de la obsesión: La compulsión de poseer y aferrarse de las cosas ".Es fácil de ver que caminando al lado de la Muerte propia puede ayudarle a uno recordar que " no te los puedes llevar contigo". Además, un guerrero fluido necesita estar libre de cargas, necesita tener libertad para pensar claramente, y moverse inmediatamente. También necesita poder vivir en el presente. Para cultivar el desapego, un guerrero desarrolla su sentido del humor y un gran sentido de la inventiva. Estos se convierten en sus escudos. Puede sentir sus fuertes y apasionadas emociones y entonces las puede dejar pasar a través de él. El puede reírse de sí mismo.
Pero hay un peligro en el desapego. Un guerrero puede volverse tan confiado en sí mismo que se vuelve arrogante e inflexible. Se vuelve incapaz de compasión. Lo que trae la "santidad" al camino del Guerrero Sagrado es el AMOR. Para el Guerrero Sagrado, el Amor es sentido cuando el corazón está abierto. Se dice que los grandes guerreros tienen grandes corazones, y hasta el guerrero más fuerte, más experto, más peligroso se vuelve Sagrado cuando se pone al servicio (como un Guardián o un Campeón) de un niño, un grupo indigente, un lugar santo, una tarea digna. SOBRE TODO, el Guerrero Sagrado está al servicio de aquellos que verdaderamente lo necesitan. El no hace esto para ellos, sino por sí mismo. Su amor y su servicio son gratis, sin apego o expectación — incondicional. El sabe, quizá más que cualquier otro, que amar verdaderamente es el acto más peligroso y más audaz que un Guerrero Sagrado puede realizar. Una doncella Apache, Lozen, se convirtió en una guerrera poderosa y respetada. Experta en montar y enlazar, ella logró siempre traer consigo a la tribu caballos enemigos. Estaba dedicada a ayudar a su gente. Se dice que una vez ella se encontraba sola en el territorio enemigo con una joven madre y su recién nacido. Ella pasó varios penosos meses conduciéndolos a un lugar seguro, cuándo ella terminó la tarea recién ahí comenzó a vivir nuevamente para sí misma. A medida que ella maduró en su compasión, comenzó a desarrollar la extraña habilidad de determinar la posición del enemigo, y se convirtió en una voz bienvenida en las reuniones tribales de estrategia. En toda la tradición Nativa Americana, hay muchos historias semejantes de Indios Guerreros de gran corazón. A la vez que ellos son muy admirados y honrados por su caza, combate, y habilidades de supervivencia, son aun más respetados y amados por su compasión y su bondad.
En el pasado, los Guerreros Sagrados lucharon por la protección y la supervivencia de sus tribus, y por satisfacción personal. Esto es todavía es así, pero en nuestra era, el concepto de "tribu" puede variar. El Guerrero Sagrado que viaja en "un camino con arrojo debe encontrar su campo de batalla sagrado. La pelea puede ser por la justicia, la paz, o el respeto. Muchos Guerreros Sagrados cumplen con la profecía Nativa Americana de los "Guerreros del Arco Iris" que dice, "cuando la Tierra esté enferma y moribunda, por todo el mundo las personas se rebelarán Como Guerreros del Arco Iris para conservar el planeta".Esta profecía es promovida por las palabras de un esquimal Nativo Americano moderno que dice, " Grande son las tareas futuras, aterradoras son las montañas de ignorancia y odio y prejuicio, pero los Guerreros del Arco Iris se levantarán tal como en las alas del águila para superar todas las dificultades. ¡Ellas estarán felices de hallar que ahora hay millones de personas por toda la tierra dispuesta y ansiosa a levantarse y unirse ellas para conquistar todas barreras que obstruyen el camino hacia un mundo nuevo y glorioso!
Ahora hemos tenido una conversación bastante larga. Démosle paso a la acción.
El Camino del Guerrero Sagrado comienza con la toma de conciencia de que somos seres mortales, de que vamos a morir. Sabiendo esto, podemos ver nuestras vidas desde una mejor perspectiva. Sabiendo esto, podemos actuar SIEMPRE de manera tal que podamos morir centrados, más allá del miedo, en paz con lo que hemos hecho a partir de la materia prima de nuestras vidas. ¿La meta está en vivir bien nuestras vidas para eventualmente morir bien, a fin de que lo que es eterno en nosotros (nuestro espíritu?) sea puesto en libertad. Cada uno de nosotros debe llegar a un acuerdo con su Muerte personal. Por ejemplo, me gusta pensar que mi cuerpo es el descendiente de un acto de amor entre mi Espíritu y el mundo Elemental. ¡Me gusta pensar que MI muerte será una consumación final y una agridulce realización orgásmica de aquel amor!
El Guerrero Sagrado camina por su camino con su Muerte a su lado. Y su Muerte está disponible al Guerrero Sagrado como un consejero, maestro, y amigo. Esta relación con su Muerte invita al Guerrero Sagrado a ser el ser que verdaderamente es, para vivir su vida plena y completamente, para usar el poder interior. Como Agnes Whistling Elk dice en "The story Medicine Woman" Sólo llegarás a ser peligroso cuando aceptes tu muerte. Entonces te vuelves peligroso a pesar de cualquier cosa. Debes aprender a ver a los despiertos. Una mujer peligrosa puede hacer cualquier cosa porque ella está dispuesta a cualquier cosa. Una mujer poderosa es inimaginable porque lo inimaginable le pertenece a ella. Todo le pertenece a ella, y cualquier cosa es posible".
En la tradición Americana Aborigen, las historias de guerreros a menudo revelan una infancia poblada de agitación interior y agresividad externa. Los guerreros recién nacidos son sutiles para explorar el mundo y ellos no quieren que alguien o algo se cruce en sus caminos. Pueden luchar con sus hermanos o pueden poner a prueba a los padres despiadadamente. Los guerreros a menudo parecen haber nacido con un exceso de energía. Sus temperamentos son fogosos; Sus voluntades, fuertes. Un joven guerrero que esté frustrado con su apariencia física casi con seguridad compensará esto con un superávit de energía mental o emocional.
La historia del Jefe Gerrero Tewa Cottonwood, Pohaha, describe este asunto. Siempre enojada cuando joven, ella se rebeló cuando le fue instado hacer trabajo doméstico. Finalmente, su tribu consintió en dejarle ir a batallar, en donde se distinguió poderosamente. Luego, se afirma, su constante cólera desapareció y "se convirtió en una buena mujer". ¡Su nombre, Pohaha, quiere decir "húmedo entre las pierna ja ja" por su hábito de arrancarse el vestido para ridiculizar a sus enemigos con el hecho que ella fuera una mujer! Con el tiempo, la gran Pohaha llego a ser "Jefe Gerrero" elegido por los ancianos. Como Jefe de Guerra, ella tenía que guiar a su pueblo contra los enemigos, protegerles de enfermedades y tratarlos como sus hijos. Ella tomó seriamente su cargo; Y cuando ella murió, dejó su máscara y dijo que esta la representaría aun cuando esté muerta. " estaré contigo todo el tiempo," ella le dijo a su tribu, "la máscara soy yo".El pueblo Cottonwood conserva su máscara, y cuentan su historia, hasta el día de hoy.
Un joven guerrero es difícil de controlar. Una vez que al guerrero le es encomendada una tarea desafiante, estará este en el camino hacia el AUTOCONTROL. Los aborígenes americanos comienzan el entrenamiento guerrero con lecciones de caza, junto con las habilidades básicas de supervivencia en tierra salvaje. Le enseñan al joven cazador respeto por su "presa". Muestran a lo joven que para aprender de la Muerte personal (la Cazadora Final), uno necesita desarrollar humildad, paciencia, y una habilidad para mantener una cabeza despejada — o, al menos, despejar la cabeza rápidamente ! El entrenamiento de supervivencia en tierra salvaje es un concepto de bien para un Guerrero Sagrado — le da un conocimiento auténtico de su mundo, y de su relación a él. Le muestra a la Naturaleza como su primer Adversario. Ella aprende que uno no puede competir con tan poderoso Adversario . Pero ella también se entera de que este Oponente es un espejo de su corazón, y como tal merece respeto y, aun, amor. De esta comprensión, ella pasa a aprender autodefensa y confianza en sí misma.
Obviamente, éste es un camino de coraje. Los americanos nativos llaman a sus "guerreros valientes" ( en inglés "Braves" cuya traducción también es "guerreros indios") por una razón. ¡Cuanto más coraje ha mostrado, más honrado el guerrero es! "Los guerreros indios" (tanto hembra como varón) que cabalgaron en la batalla no trataron de dar muerte a la oposición. Fue considerado mucho más valiente humillar al enemigo acercándose lo suficientemente hasta simplemente tocarlo, o capturar la cofia de guerra, pipa ceremonial o el escudo. Matar a otro guerrero era considerado un acto a considerar cuidadosamente. Matar a inocentes era considerado cobardía. En días antiguos, se dice que los grandes guerreros no atacaban un campamento, pero entraban y eran bienvenidos. Eran llevados al "tipi (tienda cónica) enemigo" para descansar y ser alimentados. Entonces todos los jóvenes guerreros del campamento venían a desafiar al gran guerrero, esperando "sumar hazañas" pero frecuentemente tan solo los más afortunados lograban mantenerse en pie. Indudablemente obtuvieron algunas lecciones de la experiencia.
"La Captura" (lo que podríamos llamar robar) se convirtió en una de las máximas hazañas guerreras. Ya que no había idea de propiedad, esto era más como recuperar. Es aquí donde el insulto Blanco del "obsequiante indio" se originó. Las entidades (como los caballos) o los lugares (como un bosque o una llanura) no podrían ser "poseídas" por alguien; Por lo tanto le pertenecían a aquellos que se encargaban de ellos.
En el mundo moderno, nuestras batallas son usualmente peleadas en algo así como arenas diferentes. Pero el guerrero indio quieren ceder ante ti hasta que tengas poder a fin de que puedas convertirte en un adversario digno para otro guerrero digno ". ¿Qué es oposición, después de todo? Esta pregunta es central en el Camino Sagrado del Guerrero. Esta no implica desprecio. Es antieconómico sentir desprecio por personas u otras entidades. Un guerrero Aborigen Americano hablándole a un grupo de Americanos Blancos lo explica así, " Vosotros tenéis tal cólera, tal miedo y tal desprecio para con los llamados criminales que tu propio índice de criminalidad va mucho más lejos. Vuestra sociedad tiene un índice de criminalidad alto porque está en una posición perfecta para receptar el crimen. Tú deberías estar trabajando CON estas personas, no contra ellos. La idea es despreciar el crimen, no a las personas. Es más útil considerar a cada individuo como otro TÚ — considerar cada individuo como un representante del universo. Incluso el peor criminal en cadena perpetua sentado en su celda — el centro de él es la misma semilla, la semilla de la creación entera ".
¿Entonces cuál es el sentimiento que el Guerrero Sagrado cultiva dentro de sí mismo? El desapego es importante. " Todo el mundo que quiere seguir el camino del guerrero tiene que deshacerse de la obsesión: La compulsión de poseer y aferrarse de las cosas ".Es fácil de ver que caminando al lado de la Muerte propia puede ayudarle a uno recordar que " no te los puedes llevar contigo". Además, un guerrero fluido necesita estar libre de cargas, necesita tener libertad para pensar claramente, y moverse inmediatamente. También necesita poder vivir en el presente. Para cultivar el desapego, un guerrero desarrolla su sentido del humor y un gran sentido de la inventiva. Estos se convierten en sus escudos. Puede sentir sus fuertes y apasionadas emociones y entonces las puede dejar pasar a través de él. El puede reírse de sí mismo.
Pero hay un peligro en el desapego. Un guerrero puede volverse tan confiado en sí mismo que se vuelve arrogante e inflexible. Se vuelve incapaz de compasión. Lo que trae la "santidad" al camino del Guerrero Sagrado es el AMOR. Para el Guerrero Sagrado, el Amor es sentido cuando el corazón está abierto. Se dice que los grandes guerreros tienen grandes corazones, y hasta el guerrero más fuerte, más experto, más peligroso se vuelve Sagrado cuando se pone al servicio (como un Guardián o un Campeón) de un niño, un grupo indigente, un lugar santo, una tarea digna. SOBRE TODO, el Guerrero Sagrado está al servicio de aquellos que verdaderamente lo necesitan. El no hace esto para ellos, sino por sí mismo. Su amor y su servicio son gratis, sin apego o expectación — incondicional. El sabe, quizá más que cualquier otro, que amar verdaderamente es el acto más peligroso y más audaz que un Guerrero Sagrado puede realizar. Una doncella Apache, Lozen, se convirtió en una guerrera poderosa y respetada. Experta en montar y enlazar, ella logró siempre traer consigo a la tribu caballos enemigos. Estaba dedicada a ayudar a su gente. Se dice que una vez ella se encontraba sola en el territorio enemigo con una joven madre y su recién nacido. Ella pasó varios penosos meses conduciéndolos a un lugar seguro, cuándo ella terminó la tarea recién ahí comenzó a vivir nuevamente para sí misma. A medida que ella maduró en su compasión, comenzó a desarrollar la extraña habilidad de determinar la posición del enemigo, y se convirtió en una voz bienvenida en las reuniones tribales de estrategia. En toda la tradición Nativa Americana, hay muchos historias semejantes de Indios Guerreros de gran corazón. A la vez que ellos son muy admirados y honrados por su caza, combate, y habilidades de supervivencia, son aun más respetados y amados por su compasión y su bondad.
En el pasado, los Guerreros Sagrados lucharon por la protección y la supervivencia de sus tribus, y por satisfacción personal. Esto es todavía es así, pero en nuestra era, el concepto de "tribu" puede variar. El Guerrero Sagrado que viaja en "un camino con arrojo debe encontrar su campo de batalla sagrado. La pelea puede ser por la justicia, la paz, o el respeto. Muchos Guerreros Sagrados cumplen con la profecía Nativa Americana de los "Guerreros del Arco Iris" que dice, "cuando la Tierra esté enferma y moribunda, por todo el mundo las personas se rebelarán Como Guerreros del Arco Iris para conservar el planeta".Esta profecía es promovida por las palabras de un esquimal Nativo Americano moderno que dice, " Grande son las tareas futuras, aterradoras son las montañas de ignorancia y odio y prejuicio, pero los Guerreros del Arco Iris se levantarán tal como en las alas del águila para superar todas las dificultades. ¡Ellas estarán felices de hallar que ahora hay millones de personas por toda la tierra dispuesta y ansiosa a levantarse y unirse ellas para conquistar todas barreras que obstruyen el camino hacia un mundo nuevo y glorioso!
Ahora hemos tenido una conversación bastante larga. Démosle paso a la acción.
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, esprit guerrier |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Découvrez le groupe folk flmand "Laïs"
Découvrez le groupe folk flamand Lais
LAÏS est né pendant l’été 1994 au cours d’un stage de folk à Gooik en Belgique. Trois jeunes chanteuses originaires de Kalmthout forment ce groupe qui signifie «voix» et fait référence également aux chansons érotiques du moyen-âge : Jorunn BAUWERAERTS, Nathalie DELCROIX et Annelies BROSENS. Influencées principalement par les voix du folk et du blues, les chanteuses Noires, Loreena McKENNITT, I MUVRINI, VÄRTTINÄ, Sinead O’CONNOR, les trois chanteuses flamandes sont surnommées «les voix d’ange» par Emmylou HARRIS.
Leur premier album, Laïs, sorti sur le petit label belge Wild Boar, démontre le talent de ces trois vocalistes ainsi que leur ouverture sur les musiques traditionnelles des pays européens. Les morceaux, pour la plupart interprétés en flamand, sont issus des traditions flamande, suédoise, italienne, etc. L’album comporte deux reprises, In this Heart de Sinead O’CONNOR et Grand Jacques de Jacques BREL, seul morceau chanté en français. Le livret est entièrement rédigé en flamand, à l’exception de quelques rares notes en anglais. Le trio LAÏS est accompagné par le groupe folk-rock belge KADRIL dont l’instrumentation principalement acoustique (guitare, viole, dulcimer, mandoline, harpe, accordéon), augmentée parfois d’une rythmique un peu rock mais pas trop (claviers, basse, guitare, batterie), dessine des paysages nostalgiques et colorés autour des «voix d’ange».
Le succès de LAÏS dans le monde du folk dépassant rapidement les frontières belges, le trio enregistre son deuxième album chez Virgin Belgique, Dorothea, distribué cette fois dans toute l’Europe. Le son est moins brut et «live» que sur le premier album, et l’on sent bien qu’une production affinée et plus lisse est passée par là. Qu’importe, les arrangements sont toujours superbes malgré une batterie plus présente, ce qui n’était pas toujours utile. Jorunn, Annelles et Nathalie sont accompagnées d’un nouveau groupe, où l’on retrouve deux membres de KADRIL, Hans QUAGHEBEUR (accordéon, vielle à roue) et Bart De COCK (harpe) en invité, augmentés de Fritz SUNDERMANN qui tient à lui seul la plupart des instruments (guitares acoustiques et électriques, charango, harmonium, basse, mandoline), Ronny REUMAN (batterie, percus, loops), Bart DENOLF (contrebasse, basse). Le répertoire reste dans la lignée du premier album, avec toutefois quelques compositions originales ou tirées de traditionnels, et davantage de morceaux chantés en français, dont Kenneke écrit par Gabriel YACOUB et l’incontournable Le Renard et la Belette, pour lequel les arrangements des «trois voix d’anges» sont tout de même plus subtils que celles des «trois Jean» (TRI YANN). Il a même été autorisé une voix d’homme en la personne de Ludo VAN DEAU sur le très beau morceau Le Grand Vent, une autre composition de Gabriel YACOUB, si enchanteur qu’il est repris en «bonus» pour clore l’album. Avec Dorothea, on n’a pas l’impression d’entendre LAÏS sur scène comme sur le premier album, mais plutôt de flotter sur des nuages douillets et cotonneux.
00:10 Publié dans Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : flandre, chanson, patrimoine de chants, patrimoine, folk, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La lecture évolienne des thèses de H. F. K. Günther

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert Steuckers:
La lecture évolienne des thèses de H.F.K. Günther:
Hans Friedrich Karl Günther (1891-1968), célèbre pour avoir publié, à partir de juillet 1922 et jusqu'en 1942, une Rassenkunde des deutschen Volkes (= Raciologie du peuple allemand), qui atteindra, toutes éditions confondues, 124.000 exemplaires. Une édition abrégée, intitulée Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes (= Petite raciologie du peuple allemand), atteindra 295.000 exemplaires. Ces deux ouvrages vulgarisaient les théories raciales de l'époque, notamment les classifications des phénotypes raciaux que l'on trouvait —et que l'on trouve toujours— en Europe centrale. Plus tard, Günther s'intéressera à la religiosité des Indo-Européens, qu'il qualifiera de «pantragique» et de «réservée», qu'il définira comme dépourvue d'enthousiasme extatique (cf. H.F.K. Günther, Religiosité indo-européenne, Pardès, 1987; trad. franç. et préface de R. Steuckers; présentation de Julius Evola). Günther, comme nous l'avons mentionné ci-dessous, publiera un livre sur le déclin des sociétés hellénique et romaine, de même qu'une étude sur les impacts indo-européens/nordiques (les deux termes sont souvent synonymes chez Günther) en Asie centrale, en Iran, en Afghanistan et en Inde, incluant notamment des références aux dimensions pantragiques du bouddhisme des origines. Intérêt qui le rapproche d'Evola, auteur d'un ouvrage de référence capital sur le bouddhisme, La Doctrine de l'Eveil (cf. H.F.K. Günther, Die Nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens, Hohe Warte, Pähl Obb., 1982; préface de Jürgen Spanuth). Pour Günther, les Celtes d'Irlande véhiculent des idéaux matriarcaux, contraires à l'«esprit nordique»; en évoquant ces idéaux, il fait preuve d'une sévérité semblable à celle d'Evola. Mais, pour Günther, cette dominante matriarcale chez les Celtes, notamment en Irlande et en Gaule, vient de la disparition progressive de la caste dominante de souche nordique, porteuse de l'esprit patriarcal. Dans sa Rassenkunde des deutschen Volkes (pp. 310-313), Günther formule sa critique du matriarcat celtique: «Les mutations d'ordre racial à l'intérieur des peuples celtiques s'aperçoivent très distinctement dans l'Irlande du début du Moyen Age. Dans la saga irlandaise, dans le style ornemental de l'écriture et des images, nous observons un équilibre entre les veines nordiques et occidentales (westisch); dans certains domaines, cet équilibre rappelle l'équilibre westique/nordique de l'ère mycénienne. Il faut donc tenir pour acquis qu'en Irlande et dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, la caste dominante nordique/celtique n'a pas été numériquement forte et a rapidement disparu. Le type d'esprit que reflète le peuple irlandais —et qui s'aperçoit dans les sagas irlandaises— est très nettement déterminé par le subsrat racial westique. Heusler a suggéré une comparaison entre la saga germanique d'Islande (produite par des éléments de race nordique) et la saga d'Irlande, influencée par le substrat racial westique. Face à la saga islandaise, que Heusler décrit comme étant "fidèle à la vie et à l'histoire du temps, très réaliste et austère", caractérisée par un style narratif viril et sûr de soi, la saga irlandaise apparaît, dans son "âme" (Seele), comme "démesurée et hyperbolique"; la saga irlandaise "conduit le discours dans le pathétique ou l'hymnique"; plus loin, Heusler remarque que "l'apparence extérieure de la personne est habituellement décrite par une abondance de mots qui suggère une certaine volupté". Heusler poursuit: "La saga irlandaise aime évoquer des faits relatifs au corps (notamment en cas de blessure), en basculant souvent dans la crudité, le médical, de façon telle que cela apparaît peu ragoûtant quand on s'en tient aux critères du goût germanique" (...). La saga chez les Irlandais nous dévoile, par opposition à l'objectivité factuelle et à la retenue de la saga islandaise, une puissance imaginative débridée, un goût pour les idées folles et des descriptions exagérées, qui, souvent, sonnent "oriental"; on croit reconnaître, dans les textes de ces sagas, un type de spiritualité dont la coloration, si l'on peut dire, vire au jaune et au rouge et non plus au vert et au bleu nordiques; ce type de spiritualité présente un degré de chaleur bien supérieur à celui dont fait montre la race nordique. Nous devons donc admettre que la race westique, auparavant dominée et soumise, est revenue au pouvoir, après la disparition des éléments raciaux nordiques momentanément dominants (...). A la dénordicisation (Entnordung), dont la conséquence a été une re-westicisation (Verwestung) de l'ancienne celticité (nordique), correspond le retour de mœurs radicalement non nordiques dans le texte des sagas irlandaises. Ce retour montre, notamment, que la race westique, à l'origine, devait être régie par le matriarcat, système qui lui est spécifique. Les mœurs matriarcales impliquent que les enfants appartiennent seulement à leur mère et que le père, en coutume et en droit, n'a aucune place comparable à celle qu'il occupe dans les sociétés régies par l'esprit nordique. La femme peut se lier à l'homme qu'elle choisit puis se séparer de lui; dans le matriarcat, il n'existait pas et n'existe pas de mariage du type que connaissent les Européens d'aujourd'hui. Seul existe un sentiment d'appartenance entre les enfants nés d'une même mère. La race nordique est patriarcale, la race westique est matriarcale. La saga irlandaise nous montre que les Celtes d'Irlande, aux débuts de l'ère médiévale, n'étaient plus que des locuteurs de langues celtiques (Zimmer), puisque dans les régions celtophones des Iles Britanniques, le matriarcat avait repoussé le patriarcat, propre des véritables Celtes de race nordique, disparus au fil des temps. Nous devons en conséquence admettre que, dans son ensemble, la race westique avait pour spécificité le matriarcat (...). Le matriarcat ne connaît pas la notion de père. La famille, si toutefois l'on peut appeler telle cette forme de socialité, est constituée par la mère et ses enfants, quel que soit le père dont ils sont issus. Ces enfants n'héritent pas d'un père, mais de leur mère ou du frère de leur mère ou d'un oncle maternel. La femme s'unit à un homme, dont elle a un ou plusieurs enfants; cette union dure plus ou moins longtemps, mais ne prend jamais des formes que connaît le mariage européen actuel, qui, lui, est un ordre, où l'homme, de droit, possède la puissance matrimoniale et paternelle. "Ces états de choses sont radicalement différents de ce que nous trouvons chez les Indo-Européens, qui, tout au début de leur histoire, ont connu la famille patrilinéaire, comme le prouve leur vocabulaire ayant trait à la parenté...". Le patriarcat postule une position de puissance claire pour l'homme en tant qu'époux et que père; ce patriarcat est présent chez tous les peuples de race nordique. Le matriarcat correspond très souvent à un grand débridement des mœurs sexuelles, du moins selon le sentiment nordique. La saga irlandaise décrit le débridement et l'impudeur surtout du sexe féminin. (...) Zimmer avance toute une série d'exemples, tendant à prouver qu'au sein des populations celtophones de souche westique dans les Iles Britanniques, on rencontrait une conception des mœurs sexuelles qui devait horrifier les ressortissants de la race nordique. La race westique a déjà d'emblée une sexualité plus accentuée, moins réservée; les structures matriarcales ont vraisemblablement contribué à dévoiler cette sexualité et à lui ôter tous freins. La confrontation entre mœurs nordiques et westiques a eu lieu récemment en Irlande, au moment de la pénétration des tribus anglo-saxonnes de race nordique; les mœurs irlandaises ont dû apparaître à ces ressortissants de la race nordique comme une abominable lubricité, comme une horreur qui méritait l'éradication. Chaque race a ses mœurs spécifiques; le patriarcat caractérise la race nordique. Il faut donc réfuter le point de vue qui veut que toutes les variantes des mœurs européennes ont connu un développement partant d'un stade originel matriarcal pour aboutir à un stade patriarcal ultérieur».
Comme Evola, mais contrairement à Klages, Schuler ou Wirth, Günther a un préjugé dévaforable à l'endroit du matriarcat. Pour Evola et Günther, le patriarcat est facteur d'ordre, de stabilité. Les deux auteurs réfutent également l'idée d'une évolution du matriarcat originel au patriarcat. Patriarcat et matriarcat représentent deux psychologies immuables, présentes depuis l'aube des temps, et en conflit permanent l'une avec l'autre.
Dans Il mito del sangue, Evola résume la classification des races européennes selon Günther et évoque tant leurs caractéristiques physiques que psychiques. En conclusion de son panorama, Evola écrit (pp. 130-131): «Du point de vue de la théorie de la race en général, Günther assume totalement l'idée de la persistence et de l'autonomie des caractères raciaux, idée plus ou moins dérivée du mendelisme. Les "races mélangées" n'existent pas pour lui. Il exclut en conséquence que du croisement de deux ou de plusieurs races naisse une race effectivement nouvelle. Le produit du croisement sera simplement un composite, dans lequel se sera conservée l'hérédité des races qui l'auront composé, à l'état plus ou moins dominant ou dominé, mais jamais porté au-delà des limites de variabilité inhérentes aux types d'origine. "Quand les races se sont entrecroisées de nombreuses fois, au point de ne plus laisser subsister aucun type pur ni de l'une race ni de l'autre, nous n'obtenons pas, même après un long laps de temps, une race mêlée. Dans un tel cas, nous avons un peuple qui présente une compénétration confuse de toutes les caractéristiques: dans un même homme, nous retrouvons la stature propre à une race particulière, unie à une forme crânienne propre à une autre race, avec la couleur de la peau d'une troisième race et la couleur des yeux d'une quatrième", et ainsi de suite, la même règle s'étendant aussi aux caractéristiques psychiques. Le croisement peut donc créer de nouvelles combinaisons, sans que l'ancienne hérédité ne disparaisse. Tout au plus, il peut se produire une sélection et une élimination: des circonstances spéciales pourraient —au sein même de la race composite— faciliter la présence et la prédominance d'un certain groupe de caractéristiques et en étouffer d'autres, tant et si bien que, finalement, de telles circonstances perdurent; il se maintient alors une combinaison spéciale relativement stable, laquelle peut faire naître l'impression d'un type nouveau. Sinon, si ces circonstances s'estompent, les autres caractéristiques, celles qui ont été étouffées, réémergent; le type apparemment nouveau se décompose et, alors, se manifestent les caractères de toutes les races qui ont donné lieu au mélange. En tous cas, toute race possède en propre un idéal bien déterminé de beauté, qui finit par être altéré par le mélange, comme sont altérés les principes éthiques qui correspondent à chaque sang. C'est sur de telles bases que Günther considère comme absurde l'idée que, par le truchement d'un mélange généralisé, on pourrait réussir, en Europe, à créer une seule et unique race européenne. A rebours de cette idée, Günther estime qu'il est impossible d'arriver à unifier racialement le peuple allemand. "La majeure partie des Allemands", dit-il, "sont non seulement issus de géniteurs de races diverses mais pures, mais sont aussi les résultats du mélange d'éléments déjà mélangés". D'un tel mélange, rien de créatif ne peut surgir».
C'est ce qui permet à Evola de dire que Günther développe, d'une certaine façon, une conception non raciste de la race. La dimension psychique, puis éthique, finit par être déterminante. Est de «bonne race», l'homme qui incarne de manière toute naturelle les principes de domination de soi. Après avoir été sévère à l'égard du bouddhisme dans Die Nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens (op. cit., pp. 52-59), parce qu'il voyait en lui une négation de la vie, survenu à un moment où l'âme nordique des conquérants aryas établis dans le nord du sub-continent indien accusait une certaine fatigue, Günther fait l'éloge du self-control bouddhique, dans Religiosité indo-europénne (op. cit.). Evola en parle dans Il mito del sangue (p. 176-177): «Intéressante et typique est l'interprétation que donne Günther du bouddhisme. Le terme yoga, qui, en sanskrit, désigne la discipline spirituelle, est "lié au latin jugum et a, chez les Anglo-Saxons la valeur de self-control; il est apparu chez les Hellènes comme enkrateia et sophrosyne et, dans le stoïcisme, comme apatheia; chez les Romains, comme la vertu purement romaine de temperentia et de disciplina, qui se reconnaît encore dans la maxime tardive du stoïcisme romain: nihil admirari. La même valeur réapparaît ultérieurement dans la chevalerie médiévale comme mesura et en langue allemande comme diu mâsze; des héros légendaires de l'Espagne, décrits comme types nordiques, du blond Cid Campeador, on dit qu'il apparaissait comme "mesuré" (tan mesurado). Le trait nordique de l'auto-discipline, de la retenue et de la froide modération se transforme, se falsifie, à des époques plus récentes, chez les peuples indo-germaniques déjà dénordicisés, ce qui donne lieu à la pratique de la mortification des sens et de l'ascèse". L'Indo-Germain antique affirme la vie. Au concept de yoga, propre de l'Inde ancienne, dérivé de ce style tout de retenue et d'auto-discipline, propre de la race nordique, s'associe le concept d'ascèse, sous l'influence de formes pré-aryennes. Cette ascèse repose sur l'idée que par le biais d'exercices et de pratiques variées, notamment corporelles, on peut se libérer du monde et potentialiser sa volonté de manière surnaturelle. La transformation la plus notable, dans ce sens, s'est précisément opérée dans le bouddhisme, où l'impétuosité vitale nordique originelle est placée dans un milieu inadéquat, lequel, par conséquent, est ressenti comme un milieu de "douleur"; cette impétuosité, pour ainsi dire, s'introvertit, se fait instrument d'évasion et de libération de la vie, de la douleur. "A partir de la diffusion du bouddhisme, l'Etat des descendants des Arî n'a plus cessé de perdre son pouvoir. A partir de la dynastie Nanda et Mauria, c'est-à-dire au IVième siècle avant JC, apparaissent des dominateurs issus des castes inférieures; la vie éthique est alors altérée; l'élément sensualiste se développe. Pour l'Inde aryenne ou nordique, on peut donc calculer un millénaire de vie, allant plus ou moins de 1400 à 400 av. JC». Evola reproche à Günther de ne pas comprendre la valeur de l'ascèse bouddhique. Son interprétation du bouddhisme, comme affadissement d'un tonus nordique originel, a, dit Evola, des connotations naturalistes.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, evola, philosophie, raciologie, races, allemagne, italie, anthropologie, ethnologie, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 septembre 2009
Les mentions de l'oeuvre de Christoph Steding dans les écrits d'Evola

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert STEUCKERS :
Les mentions de l'œuvre de Christoph Steding dans les écrits d'Evola
Christoph Steding (1903-1938), jeune érudit issu d'une très ancienne famille paysanne de Basse-Saxe, reçoit en 1932 une bourse de la Rockefeller Foundation pour étudier l'état de la culture et les aspirations politiques dans les pays germaniques limitrophes de l'Allemagne (Pays-Bas, Suisse, Scandinavie). Cette enquête monumentale prendra la forme d'un gros ouvrage, posthume et inachevé, de 800 pages. La mort surprend Steding, miné par une affection rénale, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1938. Un ami fidèle, le Dr. Walter Frank (1905-1945), classe et édite les manuscrits laissés par le défunt, sous le titre de Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur (= Le Reich et la maladie de la culture européenne). Le thème central de cet ouvrage: l'effondrement de l'idée de Reich à partir des traités de Westphalie (1648) a créé un vide en Europe centrale, lequel a contribué à dépolitiser la culture. Cette dépolitisation, pour Steding, est une pathologie qui s'observe très distinctement dans les zones germaniques à la périphérie de l'Allemagne. Toutes les productions culturelles nées dans ces zones sont marquées du stigmate de cette dépolitisation, y compris l'œuvre de Nietzsche, à laquelle Steding adresse de sévères reproches. L'Europe n'est saine que lorsqu'elle est vivifiée par l'idée de Reich. Les traités de Westphalie font que la périphérie de l'Europe tourne le dos à son noyau central, qui l'unifiait naturellement, par l'incontournable évidence de la géographie, sans exercer la moindre coercition. La Suisse se replie dans sa «coquille alpine»; la Hollande amorce un processus colonial qu'elle ne peut parachever par manque de ressources; la France devient grande puissance en pillant ce qui reste du Reich, en annexant l'Alsace, en ravageant la Franche-Comté comme le Palatinat et en ruinant la Lorraine; l'Angleterre tourne résolument le dos au continent pour dominer les mers. Ce processus d'extraversion contribue à faire basculer toute l'Europe dans l'irréalisme politique. Commencée dans la violence par les colonisateurs anglais et hollandais, cette extraversion, qui disloque notre continent, se poursuit dans la défense et l'illustration d'un libéralisme politique, culturel et moral délétère, qui corrompt les instincts. Ce phénomène involutif s'observe dans les littératures ouest-européennes du XIXième et du XXième siècles, où le psychologique et le pathologique sont dominants au détriment de tout ancrage dans l'histoire. Les énergies humaines ne sont plus mobilisées pour la construction permanente de la Cité mais détournées vers l'inessentiel, vers la réalisation immédiate des petits désirs sensuels ou psychologiques, vers la consommation.
Evola, dans une recension parue dans la revue La Vita italiana (XXXI, 358, janvier 1943, pp. 10-20; «Funzione dell'idea imperiale e distruzione della "cultura neutra"»; trad. franç. de Ph. Baillet, in Julius Evola, Essais Politiques, Pardès, Puiseaux, 1988), n'a pas caché son enthousiasme pour les thèses de Steding, pour sa critique de la culture «neutre» et dépolitisée, pour son plaidoyer en faveur d'un prussianisme rénové renouant avec l'éthique impériale, pour sa volonté de redonner une substance politique au centre du sub-continent européen. Evola formule deux critiques: il juge Steding trop sévère à l'encontre de Bachofen et de Nietzsche. «Certaines critiques de Steding, on l'a vu, pèchent par leur côté unilatéral: pour dénoncer l'erreur, il en vient parfois à négliger ce que certains auteurs ou certaines tendances pourraient offrir de positif à ses propres idées. Lorsqu'il évoque les "divinités lumineuses du monde du politique" opposées à la religion obscure des mythes, des symboles et des traditions primordiales, il court par exemple le risque de finir, à son corps défendant, dans le rationalisme, alors qu'il conçoit parfaitement la possibilité d'une exploration du monde spirituel qui aurait les mêmes caractères d'exactitude et de clarté que les sciences naturelles. Nombre des accusations portées contre Bachofen par Steding sont carrément injustes: on trouve au contraire chez Bachofen bien des éléments susceptibles de conforter, précisément, l'idéal "apollinien" et viril d'un Etat "romain" opposé au monde équivoque du substrat naturaliste et matriarcal. Et, au bout du compte, Steding subit en fait souvent l'influence salutaire des conceptions de Bachofen» (Essais politiques, op. cit., p. 155). «A l'égard de Nietzsche, l'attitude de Steding est pareillement unilatérale. Il est extrêmement discutable que la doctrine nietzschéenne du surhomme exprime réellement, comme le croit Steding, une révolte contre le concept d'Etat. Ce serait plutôt le contraire qui nous paraîtrait exact, à savoir qu'Etat et Empire ne sont guère concevable sans une certaine référence à la doctrine du surhomme, celle-ci exaltant une élite, une race dominatrice porteuse d'une autorité spirituelle précise. De fait, seule une élite ainsi conçue peut fonder cette primauté que revendique Steding pour l'Etat en face de ce qui n'est que simple "peuple"» (Essais politiques, op. cit., pp. 155-156). Evola conclut: «…l'ouvrage de Steding constitue un pas en avant digne d'être noté —surtout en Allemagne— sur le plan d'une clarification des idées, d'un alignement des positions, d'une reprise consciente de cette idée impériale qui, Steding l'a précisément montré, s'identifie à la réalité de la meilleure Europe» (p. 156).
Dans Sintesi di dottrina della razza, Evola avait déjà, dans un sens proche de la pensée de Steding, appelé à un dépassement de la conception neutre de la culture. Nous lisons, p. 25: «Est également combattu le mythe des valeurs "neutres", qui tend à considérer toute valeur comme une entité autonome et abstraite, alors qu'elle est en premier lieu l'expression d'une race intérieure donnée et, en deuxième lieu, une force qu'il convient d'étudier à l'aune de ses effets concrets, non sur l'homme en général, mais sur les divers groupes humains, différenciés par la race. Suum cuique: à chacun sa "vérité", son droit, son art, sa vision du monde, en certaines limites, sa science (dans le sens d'idéal de connaissance) et sa religiosité...». En évoquant le suum cuique, principe de gouvernement de la Prusse frédéricienne, Evola se place dans une optique très ancrée dans la Révolution conservatrice. En refusant l'autonomisation des valeurs, c'est-à-dire leur détachement du tout qu'est la trame historique du peuple ou de l'Empire, Evola est sur la même longueur d'onde que Steding, qui combat les mièvreries de la culture «neutre», psychologisante et dépolitisante, et que Bäumler qui voit, dans le mythe, la sublimation des expériences vécues d'un peuple, mais une sublimation qu'il attribue à l'action des valeurs telluriques/maternelles, contrairement à Evola.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, evola, allemagne, italie, philosophie, sciences politiques, politologie, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 septembre 2009
L'influence de J. J. Bachofen sur Julius Evola

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert Steuckers:
L'influence de J.J. Bachofen sur Julius Evola:
Outre les nombreuses références à l'œuvre de J.J. Bachofen qu'il trouve dans Révolte contre le monde moderne, le lecteur d'Evola découvre l'importance du théoricien suisse du matriarcat primitif dans un article paru dans Nuova Antologia en 1930 (cf. J. Evola, «Aspetti del movimento culturale della Germania contemporanea», in I saggi della Nuova Antologia, Ed. di Ar, Padova, 1982; trad. franç.: «Aspects du mouvement culturel de l'Allemagne contemporaine», in Totalité, 23, automne 1985) et dans son livre Sintesi di dottrina della razza (Ed. di Ar, Padova, 1978). Dans sa préface, le traducteur de la nouvelle version française de Révolte contre le monde moderne (L'Age d'Homme, 1991), Philippe Baillet, souligne à juste titre que l'œuvre de Bachofen est tout aussi importante pour la maturation des idées de Julius Evola que celle du pur traditionaliste français René Guénon. En effet, après sa période philosophique et dadaïste, Evola a recherché le socle extra-philosophique solide, tangible et réel pour asseoir sa métaphysique traditionnelle, étant entendu que ce socle pré-philosophique précède, de par son immuabilité, toute spéculation philosophique et échappe aux dégénérescences du devenir et du bavardage en chambre. Ce socle s'est constitué chez Evola par un double recours: d'une part, au bouddhisme et à la doctrine de l'éveil (laquelle implique notamment l'Abgeschiedenheit, le détachement par rapport aux vanités du monde, aux vanités de ceux qui ne savent dompter ni leur corps ni leur esprit); d'autre part, à l'œuvre de J.J. Bachofen. Celui-ci a mis en lumière, la «signification spirituelle et la mission de la romanité classique» (cf. art. cit., Totalité, 23, p. 18), en posant comme acquise l'existence de deux cultures universelles, l'une reposant sur le principe féminin (la culture méditerranéenne et pélasgique des origines, avec son culte de Démeter ou d'Isis, de Cybèle ou d'Ashtart, etc.); l'autre reposant sur le principe masculin, qui apparait dans le bassin méditerranéen par l'avènement du culte «thrace-hyperboréen» de l'Apollon delphique et de celui des héros solaires (Thésée, Jason, Cadmos, Héraklès). La lumière, «principe incorporel dépourvu de génération, immortel en soi en tant qu'essence simple et identique» se place au centre de ce nouveau «monde ouranien», propre de ceux qui «sont», par opposition à ceux qui «deviennent». La culture grecque classique, matrice de l'«Occident», procède donc, pour Evola, de ce principe héroïco-ouranien, mis en exergue par Bachofen. Pour ce qui concerne la romanité, Bachofen, dans son ouvrage sur la légende de Tanaquil (Die Sage von Tanaquil, Heidelberg, 1870), oppose une culture démétrico-tellurique portée par les anciennes cultures pré-romaines (étrusques, sabines, etc.) à une culture portée par des conquérants romains (nordiques), une culture virile, quiritaire et militaire. Pour Bachofen, et à sa suite Evola, la dynamique de l'histoire antique repose sur cet antagonisme irréductible entre principe féminin et principe viril. Cette vision transparaît clairement dans Révolte contre le monde moderne, et, dans une moindre mesure comme le souligne Philippe Baillet (op. cit.), dans Métaphysique du sexe.
Révolte contre le monde moderne est rigoureusement construit sur des schémas dérivés de Bachofen: civilisation du Père/civilisation de la Mère, spiritualité olympienne et solaire/spiritualité tellurique et lunaire, etc. (cf. Ph. Baillet, op. cit.). Evola tire donc de Bachofen, une «clef herméneutique» qu'il va appliquer à tous les niveaux de la réalité et à toutes les cultures (Baillet, op. cit.). L'opposition des deux mythes est présent au sein de toutes les cultures et, pour que celles-ci demeurent, ne chavirent pas dans l'«infra-humain démonique», il faut que triomphe le principe viril, solaire et ouranien; il faut qu'il apporte forme à la matière féminine. Pour souligner l'importance de sa dette à l'égard de Bachofen et pour marquer les différences qui existent entre les conclusions et l'approche de Bachofen, d'une part, et les siennes, d'autre part, Evola écrit, dans Le chemin du Cinabre (Ed. Arché/Ed. Arktos, Milan/Carmagnola, 1982; trad. franç.: Ph. Baillet): «Avec ces approches [celles de Bachofen] s'ouvrait pour moi un vaste et nouveau domaine dans lequel on pouvait appliquer et développer sur un arrière-plan grandiose de mythologies et d'interprétation de l'histoire la théorie des "deux voies". Il fallait unir, dans une synthèse articulée, les apports de Guénon, de Wirth et justement de Bachofen. Mais je repoussai le schéma évolutionniste de Bachofen. Le savant suisse avait en effet supposé un passage progressif de l'humanité antique d'un stade de promiscuité primoridale à la civilisation démétérienne de la Mère et de la Femme Divine, et puis un dépassement graduel de celle-ci dans la civilisation héroïco-paternelle liée à des cultes et des mythes ouraniens et héroïques et à une société positivement organisée (Bachofen avait vu là la "naissance de l'Occident" contre l'"Asie"). Au contraire, je fis remarquer la nécessité d'introduire une conception dynamique et de faire correspondre aux phases évolutives présumées d'une race humaine unique des influences opposées portées par des races différentes, agissant et réagissant l'une sur l'autre. En second lieu, on devait selon moi contester le caractère plus récent (de dernier "stade évolutif") de la civilisation ouranico-patriarcale et virile. En effet, cette civilisation se rattacha toujours, directement ou indirectement, à la tradition primordiale hyperboréenne elle-même, et on ne peut parler de son caractère plus récent que dans un sens relatif et local, dans les cas où cette tradition apparut et s'affirma, à travers des migrations, dans des régions qui se trouvaient auparavant sous le signe de la vision opposée de la vie et du sacré...» (p. 90).
Dans Sintesi di dottrina della razza, Evola puise également dans la carrière bachofenienne pour élaborer sa propre typologie raciale, induisant une hiérarchisation qui privilégie les types solaires/ouraniens, générateurs de cultures. Citons cet extrait significatif, p. 161: «En traitant des différentes gradations de la virilité et de la solarité, tout spécialement dans l'orbite des mystères antiques et des traditions connexes de la Méditerranée, Bachofen distingue opportunément le stade apollinien et le stade dionysiaque. Ici aussi, les analogies cosmiques lui servent de base. Il existe en effet deux aspects de la solarité. L'un est celui de la lumière en tant que telle, ce qui revient à dire qu'il participe d'une nature lumineuse immuable et céleste; tel est le symbole apollinien ou olympique, que l'on retrouve par exemple dans le culte delphique; on doit le considérer comme un filon de la pure spiritualité hyperboréenne, s'élançant jusqu'à la Méditerranée; tel est le stade qui, comme nous l'avons vu, définit la race de l'homme solaire. L'autre aspect de la solarité est celui d'une lumière qui nait et s'estompe, qui meurt et ressuscite, puis meurt une nouvelle fois et connait une nouvelle aurore, qui est, en somme, une loi du devenir et de la transformation. Au contraire du principe apollinien, nous avons affaire ici à la solarité dionysiaque. C'est une virilité qui aspire à la lumière au travers d'une passion, qui ne peut pas se libérer de l'élément sensuel et tellurique ni de l'élément extatique-orgiastique, propre aux formes les plus basses du cycle démétérien [Evola ajoute en note que c'est sur cette solarité-là que se base la conception de Ludwig Klages, qu'il qualifie de vitaliste et d'irrationaliste]. Le fait que l'on ait associé, dans le mythe et dans le symbole de Dionysos des figures féminines et lunaires est, de ce point de vue, assez significatif. Dionysos n'achève pas son trépas, ne change pas de nature. Il représente une virilité qui est encore terrestre, malgré sa nature lumineuse et extatique. Le fait que les mystères dionysiaques et bacchiques ont été associés à ceux de Démeter, plutôt qu'au mystère purement apollinien, indique clairement le point final de l'expérience dionysiaque: c'est un "mourir et devenir", non sous le signe de cette infinitude, qui est au-delà de toute forme et de toute finitude, mais bien plutôt de cette autre infinitude, qui se réalise et dont on jouit en détruisant formes et finitudes, et qui se rapporte, en conséquence, aux formes de la promiscuité tellurico-démétérienne... Du point de vue racial, on ne s'étonnera pas de constater que l'homme dionysiaque, sous les oripeaux du romantique, est très largement présent dans les races nordiques, qu'elles soient germaniques ou anglo-saxonnes. Ce qui nous confirme, une fois de plus, qu'il faut bien distinguer la race primoridale nordico-aryenne des races nordiques des époques plus récentes» (pp. 162-163).
Dans la revue La Torre, qu'Evola a dirigée en 1930 et dont il est sorti dix numéros (entre le 1er février et le 15 juin), trois extraits de l'œuvre de Bachofen ont été traduits et publiés: «Il simbolo» (n°7; extrait de Urreligion und antike Symbole, Leipzig, 1926, b.1, pp. 283-284 ); «La donna regale e la nascita di Roma» (n°9; extrait de Die Sage von Tanaquil, Heidelberg, 1870; trad. it. du Dr. Otto Lanz); et «La missione occidentale di Roma» (n°10; suite de l'article précédent).
Ces trois extraits ont été jugés fondamentaux par leurs traducteurs, Otto Lanz et Evola lui-même. Dans «Il simbolo», nous lisons: «Les mots rendent fini l'infini; les symboles conduisent l'esprit au-delà des frontières du monde fini en devenir, dans le monde infini et réel. Ils suscitent des pressentiments, sont signes de l'indicible et, comme l'indicible, ils sont inépuisables; (...) En cela réside la dignité occulte du symbole et la puissance des représentations mythiques qui y sont liées...». Dans cette définition, nous retrouvons la quête de l'Evola traditionaliste qui a succédé à l'Evola philosophe qui ne trouvait pas de socle ni de certitude affirmée, capable de transcender le nihilisme en marche, dans les spéculations philosophiques conventionnelles. Le mythe, surplombant le grouillement du devenir, insensible au nihilisme qui se déploie, suggère infinité et réalité immuable et intangible.
A la fin du second extrait de Die Sage von Tanaquil, nous lisons: «Rome, la cité aux origines aphroditiques prend peur d'avoir négligé pendant si longtemps la Mère et de s'être presque entièrement consacrée au principe viril de l'Imperium... Avec Pompée, Brutus, Cassius et Antoine, l'Orient subjugue l'Occident et, à leur chute, s'accomplit la ruine de l'Asie».
Evola rappelle, dans Le chemin du Cinabre (p.90), qu'il a traduit une série d'extraits de l'œuvre de Bachofen, 250 pages en tout, qui n'ont pu paraître qu'en 1949 chez l'éditeur Bocca sous le titre Les Mères et la virilité olympienne - Etudes sur l'histoire secrète du monde méditerranéen antique. Dans la préface qu'il a rédigée pour ce recueil (reproduite dans Alfred Bäumler, Nietzsche e Bachofen, Ed. Lupa Capitolina, Padova, 1985; cette introduction a également constitué un article dans la revue Via Solare), Evola résume toute la dette qu'il doit à l'explorateur suisse des cultes antiques grecs et romains. Jugeons-en par ces quelques extraits: «Chez Bachofen, ce qui est intéressant, en tout premier lieu, c'est la méthode. Cette méthode est neuve et révolutionnaire par rapport au mode général, scolaire et académique de prendre les civilisations, les cultes et les mythes antiques en considération, précisément parce que ceux-ci sont "traditionnels" au sens supérieur. Nous voulons dire par là que le mode par lequel l'homme appartenant à toute civilisation traditionnelle, parce qu'il est anti-individualiste et anti-rationaliste, aborde le monde de la religion, des mythes et des symboles est plus ou moins le même mode que celui par lequel Bachofen a cherché à découvrir le secret du monde des origines. La prémice fondamentale de toute l'œuvre de Bachofen, c'est d'affirmer que le symbole et le mythe sont des témoignages, dont doit tenir compte sérieusement toute science historique complète. Ce ne sont pas des créations arbitraires, des projections venues de l'extérieur ou de la fantaisie poétique: ce sont, bien au contraire, des "représentations des expériences propres à une race et interprétées à la lumière d'une religiosité spécifique", obéissant à une logique et à une loi bien déterminées. Par ailleurs, le symbole, la tradition, la légende ne doivent pas être pris en considération et évalués à l'aune de leur "historicité", au sens le plus restreint du terme (...) Ce qui doit être interrogé, c'est leur signification certaine en tant que fait de l'esprit, non leur signification à la fois problématique et historique. Là où l'événement enregistré et le document "positif" cessent de parler pour eux-mêmes, nous rencontrons le mythe, le symbole et la légende et nons pénétrons dans une réalité plus profonde, secrète et essentielle: dans une réalité dont les visages extérieurs, historiques et tangibles, que sont les sociétés, les races et les civilisations antiques ne sont que les conséquences». Evola ajoute qu'un événement peut laisser ou ne pas laisser de traces. De même, sa signification intérieure peut demeurer ou non. Historiens et archéologues ont donc affaire à des événements enregistrés, dont ils ne peuvent plus comprendre la signification intérieure, et à des événéments non consignés, ni par l'écrit ni par la trace archéologique, dont la signification intérieure demeure mais à un niveau métaphysique. Deuxième point, souligné par Evola: Bachofen inaugure une typologie des civilisation antiques. «En observant les mouvements propres aux diverses formes qui assumaient, dans le monde antique, les rapports entre les sexes, la recherche de Bachofen met en lumière l'existence de certaines formes typiques et distinctes de civilisation qui peuvent être reconduites à autant d'idées centrales, liées à leur tour à des attitudes générales, témoignant, elles, d'autant de visions du monde, du destin, de l'au-delà, du droit, de la société. De telles idées ont quasiment la valeur d'"archétypes" au sens platonicien: ce sont des forces qui donnent forme, en rapport étroit d'analogie avec les grandes forces inhérentes aux choses».
«Le monde que Bachofen prend en considération est essentiellement celui des civilisations antiques du bassin méditerranéen. La multiplicité chaotique des cultes, mythes, symboles, formes juridiques et coutumes que ce monde méditerranéen présente, laisse transparaître finalement, dans l'œuvre de Bachofen et sous des formes variées, l'efficacité de deux idées fondamentalement antithétiques: l'idée olympienne-virile et l'idée tellurique-féminine. Une telle polarité peut s'exprimer au travers des oppositions suivantes: la civilisation des Héros et la civilisation des Mères, l'idée solaire et l'idée chtonique-lunaire, la droit patriarcal et le matriarcat, l'éthique aristocratique de la différence et la promiscuité orgiastique-communiste, l'idéal olympien du "surmonde" et le mysticisme panthéiste, le droit positif de l'imperium et le droit naturel. Bachofen a découvert l'"ère gynécocratique", c'est-à-dire l'ère dans laquelle le principe féminin est souverain. Cette époque correspond à un stade archaïque de la civilisation méditerranéenne, lié aux peuples pelasgiques ainsi qu'à un groupe de gentes du bassin méridional-oriental et asiatique de la Méditerranée. Bachofen a très justement relevé le fait qu'aux sources, un ensemble d'éléments, variés mais en concordance, rappelle sans cesse ces peuples à l'idée centrale, selon laquelle, à l'origine et à l'apogée de toute chose, se trouve un principe féminin, une Déesse ou une Femme Divine, incarnant les valeurs suprêmes de l'esprit; face à elle, se place non seulement le principe mâle mais aussi celui de la personnalité et de la différence, lequel apparaît alors comme secondaire et contingent, comme sujet aux lois du devenir et de la déliquescence, tout à l'opposé de l'éternité et de l'immuabilité propres à la grande Matrice cosmique, à la Mère de la Vie. Cette Mère, en tant que telle, est la Terre, ou, en d'autres mots, la loi de la nature conçue comme un fait auquel même les dieux sont soumis». «La gynécocratie, c'est-à-dire la souveraineté de la femme, reflète la valeur mystique qui est attribuée à celle-ci dans la conception du monde gynécocratique. Par ailleurs, cette conception peut avoir pour contrepartie (dans ses formes les plus basses), l'égalitarisme du droit naturel, l'universalisme et le communisme. La non pertinence de tout ce qui est différence, l'égalité de toute singularité face à la Matrice cosmique, au principe maternant et "tellurique" (de tellus, la terre) de la nature dont provient toute chose et tout être et en laquelle, à nouveau, ils se dissolveront après une existence éphémère: voilà ce qui est à la base de la promiscuité communiste comme de la promiscuité orgiastique des fêtes, au cours desquelles, dans l'antiquité, on célébrait justement le retour à la Mère et à l'état de nature, et pendant lesquelles toutes les distinctions sociales étaient temporairement abolies. Le principe masculin n'a pas d'existence propre, outre la sienne individuée. Sur le plan matériel, il n'est que l'instrument de la génération, assujetti à la femme ou obscurci par la luminosité démétérienne des mères». «En opposition nette à cette vision, nous avons, dans le monde antique méditerranéen, le cycle de la civilisation olympienne-ouranienne. Dont le centre ne peut être constitué par les symboles de la Terre ou de la Lune, mais, au contraire, par ceux du Soleil et des régions célestes ("ouraniques", du terme grec ouranos); ni par ceux de la réalité naturaliste-sensuelle mais par ceux de l'immatérialité; ni par ceux du giron maternel ni, encore moins, de la virilité phallique qui en est la contrepartie, mais par ceux de la virilité ouranienne, liée au symbole du Soleil et de la Lumière; ni par ceux de la Nuit et de la Mère mais par ceux du Jour et du Père. L'idéal suprême, dans une telle civilisation, s'incarne précisément dans le monde "ouranien", compris comme celui des êtres lumineux, immuables, détachés, privés de naissance, opposés au monde inférieur des êtres qui naissent, deviennent, trépassent après une vie éphémère parce que toujours mélangée à la mort. Tel est le plus haut point de référence de la religion d'Apollon et de Zeus: c'est la spiritualité "olympienne", c'est la virilité immatérielle, c'est la "solarité" des dieux détachés de tout lien qui les lierait à la femme et à la mère et qui possèdent des attributs de paternité et de don».
Cette dualité métaphysique et religieuse de l'antiquité, mise en évidence par Bachofen à la fin du siècle dernier, Evola l'a transposée dans son époque. Voulant incarner le principe solaire, mettant sa personnalité au service d'un avivage de la tradition virile/solaire, Evola transpose dans le monde moderne l'argumentation de Bachofen, qui étudiait des réalités antiques. «L'époque moderne est "tellurique", non seulement dans ses aspects mécanistiques et matérialistes, mais aussi, et essentiellement, dans ses différents aspects "activistes", dans ses diverses religiosités de la vie, de l'irrationnel et du devenir, qui sont toutes antithèses, précisément, de ces conceptions classiques et olympiques du monde. Keyserling, du reste, a cru pouvoir parler de ce caractère "tellurique" —c'est-à-dire irrationnel, lié essentiellement à des formes de courage, de sacrifice, d'élan et d'attachement privées de toute référence véritablement transcendante— que présente ce mouvement moderne des masses, que l'on appelle, en fait, "révolution mondiale". Avec la démocratie, le marxisme et le communisme, l'Occident a pu réexhumer, dans des formes sécularisées et matérialisées, l'antique droit naturel, les lois niveleuses et anti-aristocratiques émanant de la Mère chtonienne, laquelle stigmatise l'injustice qu'est d'office toute différence: et le pouvoir conçu sur de telles bases, soit sur l'élément collectiviste, semble justement rétablir l'antique insignifiance du singulier, propre des conceptions "telluriques". Avec le romantisme moderne, resurgit Dionysos: c'est le même amour pour l'informe, le confus, l'illimité et la même promiscuité entre sensation et esprit, la même antithèse par rapport à l'idéal viril et apollinien de la clarté, de la forme, de la limite. Finalement, Nietzsche, qui exalte Dionysos, est une preuve vivante et tragique de l'incompréhension moderne pour cet idéal, et de la "telluricité" de diverses provenances. En outre, après avoir lu Bachofen, il n'est pas difficile de constater le caractère "lunaire" propre au type plus diffus de la culture moderne: nous entendons par là une culture basée sur un pâle intellectualisme creux, une culture inféconde détachée de la vie, s'épuisant dans la critique, dans la spéculation et dans la vaine créativité esthétisante: soit une culture qui se trouve en étroite relation avec une civilisation qui a élevé le raffinement de la vie matérielle à de formes extrêmes (dans la terminologie bachofénienne, on dirait: aphroditiques) et dans laquelle la femme et la sexualité elle-même sont devenues des thèmes prédominants, au point d'atteindre un degré pathologique et obsessionnel». Concrètement, la critique évolienne/bachofénienne des faits de civilisation d'ordre tellurique, débouche sur une critique de l'américanisme, sommet de la modernité: «Dans la civilisation anglo-saxonne, et surtout en Amérique, l'homme épuise sa vie et son temps dans le monde abrutissant des affaires et dans la chasse à la richesse —à une richesse qui, pour une bonne part, sert à payer le luxe, les caprices, les vices et les subtilités féminines— un tel homme, qui, tout au plus, s'intéresse au sport, a cédé volontairement à la femme le privilège, sinon le monopole, de s'occuper des choses "spirituelles". C'est surtout pourquoi, nous voyons, dans cette civilisation, pulluler les sectes "spiritualistes", spiritistes et occultistes, où la prédominance numérique de l'élément féminin est déjà en soi significative (deux femmes, Madame Blavatsky et Madame Besant, par exemple, ont fondé et dirigé la dite "Société Théosophique")...». Nous voyons que ce jugement, dérivé d'une lecture de Bachofen annonce la critique évolienne de l'américanisme et des pseudo-spiritualités contemporaines (Masques et visages du spiritualisme contemporain, Pardès, 1991).
Cette opposition constante, que Julius Evola, à la suite de Bachofen, perçoit dans l'histoire des civilisations antiques du bassin méditerranéen, entre un principe nordique/solaire/viril/ouranien et un principe autochtone/tellurique/féminin trouve une sorte d'équivalent dans les théories de Günther sur la nordicisation, puis la dénordicisation, du Sud de l'Europe, consignées dans ses deux ouvrages sur Rome et la Grèce (Lebensgeschichte des hellenischen Volkes, Franz von Bebenburg Verlag, Pähl, 1965; Lebensgeschichte des römischen Volkes, même éditeur, 1966). Les civilisations grecque et romaine déclinent, pour Günther, quand disparaissent progressivement l'hellénité (Hellenentum) et l'italicité (Italikertum), porteuses du «pantragisme» (Pantragismus) propre aux Indo-Européens selon Günther, au principe viril/solaire selon Evola.
Mais la réflexion sur l'œuvre de Bachofen plonge Evola dans un vaste débat intellectuel qu'on ne saurait occulter ici. Les thèses de Bachofen sur le matriarcat primitif ont suscité bon nombre de controverses au sein des cénacles de gauche: chez Friedrich Engels, qui en parle dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat; chez August Bebel, le théoricien social-démocrate allemand qui en déduit une théorie de la femme dans le socialisme; chez Max Horkheimer, qui voit dans le déclin du matriarcat antique, l'origine de la société autoritaire; chez Ernst Bloch, qui voit dans le culte de Gaia-Thémis une des sources (et non pas la seule comme chez Bachofen) des principes qui feront ultérieurement le droit naturel.
Bachofen a également influencé Ludwig Klages, dans sa théorie de l'«Eros cosmogonique» et de la «Magna Mater». Contrairement à Evola, qui affirme de manière tranchée l'opposition entre les polarités solaire/virile et lunaire/maternelle, Klages évoque une sorte de ying et de yang mêlant la lumière apollinienne, fécondante, et les symboles matriciels, tels l'œuf ou la cellule vitale primoridale, et oppose, d'une part, les forces de la vie, solaires et lunaires confondues, au créationnisme hébraïque: «En opposition tranchée au mythe juif de la création,qui veut que le monde ait été fait sur ordre d'un Dieu mâle, la Magna Mater émerge, selon la religiosité païenne, sur le mode d'une naissance, soit que la Terre, conçue comme une mère, l'a mise au monde, comme elle met arbres et plantes au monde, soit par partition de l'œuf primordial... Une terra mater et, en tant que telle, une pantwn mhthr, est la Pachamama des Péruviens, est Centeotl chez les Aztèques, (Yin chez les Chinois), Prthivi chez les Indiens, Isis et Neith chez les Egyptiens, Gaia et Déméter chez les Grecs, Tellus et Ceres chez les Romains, Nerthus chez les Germains et Belisana chez les Celtes» (cf. Ludwig Klages, «Die Magna Mater. Randbemerkungen zu den Entdeckungen Bachofens», in Hans-Jürgen Heinrichs, Materialien zu Bachofens »Mutterrecht«, Suhrkamp, Frankfurt am M., 1975, pp. 114-130). Annonçant les travaux de Jan De Vries et de Georges Dumézil, Ludwig Klages explique la symbolique de la couleur noire, attribuée à la troisième fonction productrice, dont les divinités sont souvent telluriques et féminines: «Noire est la couleur de la profondeur de la terre tout comme du giron maternel. C'est ainsi que l'on explique la noirceur de la Demeter Hippia arcadienne des Phigaléens, dont le surnom était Melainh; c'est ainsi que s'explique également le noircissement des visages, coutume, d'après Strabon, que pratiquent, avec grand soin, les femmes des Troglodytes, organisés selon les principes du matriarcat. Ces noirceurs font tout autant référence à la terre humide des champs qu'à la luxuriante puissance fécondante des marais et à l'obscurité de la tombe souterraine,...» (Ibid.). Klages opère la distinction entre l'esprit juridique matrilinéaire et l'esprit juridique patrilinéaire: « L'enfant né est mis au même niveau que le fruit qui a mûri et qui est tombé de l'arbre, naissance qui constitue la fin d'une série de procès, qui n'a été qu'entamée par l'ensemencement; de cette façon, la mise au monde de l'enfant est placée côte à côte avec la moisson, ce qui fait disparaître dans l'insignifiance l'acte de l'homme qui a lancé la semence. Bachofen, pour ce qui concerne la légitimité des enfants telle que la concevaient les doctrinaires du droit dans l'antiquité romaine, a prouvé que la signification attribuée par le droit d'Etat au moment de la conception, était totalement inconnue dans le "jus naturale". D'après le système naturel, la prima origo correspond à la naissance entièrement accomplie. Devenir et être accompli ont ici la même signification. Dans le système patrilinéaire, au contraire, on opère la distinction entre les deux et la prima origo commence avec l'ensemencement, non avec le fruit... Avec le principe de paternité, c'est l'idée de commencement qui est responsabilisante, tandis que dans le principe de maternité, c'est celui d'accomplissement-maturation. C'est là l'ensemencement et, ici, le fruit et la récolte qui sont pris en considération. Là, le devenir, c'est le commencement, ici, c'est la fin du développement. Là, il y a un avenir, ici, il n'y a qu'un passé; là, il y a un début, ici, seulement une fin... D'après le droit matriarcal, c'est la maturation du blé qui est sa prima origo (et) sa moisson est en même temps naissance et disparition-mort (...). D'après le droit patriarcal, au contraire, l'origine se situe dans l'ensemencement, non dans la moisson; d'après ce droit patriarcal, on prend l'espoir en considération; le droit matriarcal, ne prend, lui, que l'accomplissement en considération. Sur le plan cosmique, la mise sur pied d'égalité entre l'accouchement et l'accomplissement-maturation s'exprime par le rapport que faisaient les Anciens avec la dernière phase de la lune. En effet, selon la croyance commune des Anciens et de bon nombre de tribus primitives, les déesses de la lune sont presque toutes des déesses de l'accouchement et les filles viennent plus facilement au monde pendant les nuits de pleine lune».
Et Klages poursuit, en citant Bachofen: « Le droit matrilinéaire ne connaît que des ancêtres; le droit patrilinéaire ne connaît, lui, que des descendants... Le Père y apparaît comme le prwton kinoun, c'est-à-dire comme la première impulsion d'un mouvement, qui s'étendra devant lui, tout comme le fleuve s'écoule au départ de la source. La mère, au contraire, n'est jamais principium, mais toujours fin. Dans la longue succession des mères, chacune est représentante de la Terre, mère originelle». «Dans les générations successives, la Mère originelle se porte vers l'avant: c'est pourquoi on l'appelle mhthr isodromh, c'est-à-dire la Terre, Mère originelle, qui suit pas à pas le rythme de la succession des générations; incarnée dans les plus jeunes générations, elle constitue la fin, non le départ, de la longue lignée; c'est pourquoi, dans ce système, ce sont les plus jeunes, oploterh, ceux qui ont avancés le plus loin, qui ont la préférence, et non les plus anciens» (Ibid.). Dans un autre ouvrage fondamental, Vom kosmogonischen Eros (éd. actuelle: Bouvier Verlag, Bonn, 1972), Klages revient sur la question du droit naturel: «Bachofen a prouvé jusque dans le détail, qu'il existe un "droit naturel" se situant "au-delà du bien et du mal" et qui n'est troublé par aucun arbitraire légal (Gesetzeswillkür); ce droit naturel préserve le lien le plus intérieur, le plus profond, qui lie l'homme au monde et les hommes entre eux» (p.227). Les idéaux dérivant de l'esprit (Geist: instance que Klages oppose à la vie et à l'âme, Seele) finissent par oblitérer ce "droit naturel", voire le dénaturent. Pour Klages, les conceptions matrilinéaires, telluriques, symbolisées par l'Œuf primoridal, source d'une inépuisable fécondité, préservent l'intériorité la plus intime de l'homme, préservent les ressorts vitaux qui sont en lui. L'intellectualisme de l'esprit brise ces ressorts et remplace tous les réflexes organiques, naturels, par des déductions logiques et arbitraires, portées par une volonté de dominer. Ces quelques extraits de l'œuvre de Ludwig Klages montrent que certains cercles de la «Révolution conservatrice» plongent leurs arguments dans une «telluricité», dont la définition remonte notamment aux travaux de Bachofen sur la société «pélasgique». Ce culte allemand de la terre remonte bien évidemment au romantisme et à l'anthropocosmomorphisme de Carus. C'est dans ce recours à des valeurs telluriques que réside la grande différence entre l'approche philosophique/métaphysique de la Révolution conservatrice post-romantique et l'approche évolienne. A l'époque nationale-socialiste, Alfred Bäumler, disciple et préfacier de Bachofen, ennemi de Heidegger et membre de la NSDAP, relancera le débat en distinguant le «chtonique» du «dionysiaque» et de l'«apollinien». Embrayant sur son pari pour le «mythe» contre le «logos», Bäumler commence par souligner l'importance de l'œuvre de Bachofen, dans des termes semblables à ceux qu'utilisait Evola pour reconnaître sa dette envers le premier grand théoricien du matriarcat, sauf dans la conclusion, où il valorisait les réflexes «maternels», en même temps qu'il entonnait un plaidoyer pour le retour aux mythes: «Bachofen est éloigné de toute historicisation du mythe. Il fait le contraire: il "mythise" l'histoire» (...). Lorsque Bachofen déclare que le mythe est histoire», ... il veut dire «qu'il ne faut pas considérer que le contenu du mythe est fiction de poète, mais constitue un vécu réel de l'humanité historique (...). [Bachofen] veut avoir affaire à l'histoire intérieure de l'humanité, à la mutation qui s'opère dans les sentiments et dans les modes de penser. Ce sont les expériences vécues les plus anciennes de la race humaine, que nous transmet le mythe. (...) Maternel est le passé, dans le giron duquel repose tout ce qui a été, en opposition à l'avenir, paternel et agité, dont il faut causer l'advenance; maternel est le mythe en opposition au logos paternel; et maternelle est avant toutes choses la nature, qui englobe l'homme, indifférente au fait qu'il ait fait des efforts pour s'élever ou non, et qui couche tous les hommes dans le même repos. La mère donne la vie, la mère apporte la mort; elle est le destin incarné —et la "nature" des romantiques n'est finalement qu'un autre mot pour désigner le destin. La maternité, en tant qu'essence, ne tolère aucune division, fragmentation ou autonomisation. Elle est tout en une fois. Le mythe est maternel, parce qu'il nous donne d'un coup la totalité. La poésie et le droit sont saisis comme des expressions de la vie, qui est une; poésie et droit relèvent donc du mythe, parce que l'unité de la vie ne peut être saisie que par le mythe» (Alfred Bäumler, «Bachofen, der Mythologe der Romantik. Einleitung zu Der Mythos von Orient und Occident. Eine Metaphysik der alten Welt», aus den Werken von J.J. Bachofen, hg. v. Manfred Schröter, München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1926, 2ième éd., 1965, pp. CLXXXVI-CXCVI; repris in: Hans-Jürgen Heinrichs, op. cit.). Cette approche de Bäumler, nous allons le constater, est différente de celle de Klages qui, à la suite de son inspirateur visionnaire et exalté, Alfred Schuler, voit l'histoire comme un processus d'Entlichtung (d'assombrissement, littéralement de «dé-lumiérisation»), qui enclenche une série de processus catamorphiques: parcellarisation de l'humanité, fin de l'androgynité primitive, domination des femmes par les hommes, avènement de la volonté linéaire évolutive, donc de l'individualisme, de l'égoïsme et du subjectivisme qui atomisent l'humanité. Pour Schuler comme pour son disciple Ludwig Klages, l'Entlichtung contribue à fermer, à verrouiller, à étouffer la «vie ouverte», marquée par un temps cyclique, par l'éternel retour, par le règne des mères, par le temps des fêtes et de la joie collective (Cf. Robert Steuckers, «Alfred Schuler», in Encyclopédie des Œuvres philosophiques, PUF, à paraître en 1992). Schuler et Klages nient toute valeur à l'histoire, tandis que Bäumler, philosophe politisé, et Krieck, le théoricien et historien de la pédagogie, également ennemi de Heidegger, raisonnent en termes vitalistes; ils définissent tous deux la Vie comme un «cosmos vivant», un All-Leben. Mais cet All-Leben n'est pas irénique: c'est un monde de tensions perpétuelles, de luttes, de dynamique incessante. C'est le Mittgart (ou Midgard) de la mythologie scandinave; il désigne un monde intermédiaire entre l'Asgard (le monde des Ases, le monde de lumière) et l'Utgard (le monde de l'obscurité). Ce Mittgart est soumis, dit Krieck, au devenir (urd) et aux caprices des Nornes, figures mythologiques féminines qui tissent le destin de chacun des hommes. Les périodes de paix, rares, qui ensoleillent le Mittgart, lieu de résidence des hommes, lieu où se déroule l'histoire, sont de brefs répits succédant à des victoires jamais définitives sur les forces du chaos, émanant de l'Utgard. Pour Krieck, chez les Germains, une force agissante et fécondante, désigné par la notion de Heil, anime la communauté nationale. Ce Heil induit un flux ininterrompu de force qui avive la flamme vitale d'une communauté ou d'une personne et accroît ses prestations, permettant, dans la sphère politique, de fonder et d'organiser un Reich, un Etat, un espace politique, pour accoucher de l'histoire. Attentif aux forces émanant de l'All-Leben, l'élite politique doit dresser les énergies du Volk, rentabiliser au maximum l'héritage qu'il véhicule dans ses gènes et ses institutions, car l'absence de dressage (Zucht) conduit au mixage indifférencié et à la dégénérescence des instincts et des formes (cf. Robert Steuckers, «Ernst Krieck», in Encyclopédie des Œuvres philosophiques, PUF, à paraître en 1992).
En comparant ce qu'Evola, Klages, Schuler, Bäumler et Krieck tirent de leur lecture de Bachofen, nous nous replongeons dans l'un des débats essentiels qui a sous-tendu la «Révolution conservatrice» et nous constatons une oscillation permanente de la pensée entre les pôles maternels (Klages) et paternels (Evola), dont Krieck semble en avoir compris et pensé l'invariance et la pérennité. Son recours à l'All-Leben est proche du culte des mères chez Klages et Schuler; sa volonté de fonder une pédagogie disciplinante, pour contrer le chaos et l'indifférenciation, le rapproche du culte solaire et du culte des formes que l'on retrouve chez Stefan George et Julius Evola.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 31 juillet 2009
Hyperborée

Terre & Peuple - Wallonie - Communiqué
HYPERBOREE
Pierre-Emile Blairon, encore lui, nous a choyés avec la dernière livraison (n°8) de sa revue trimestrielle Hyperborée. Joliment illustrée, notamment par le dessinateur André Herbouze, elle est axée autour d’un thème double : ‘L’être différencié et l’âge d’or’. Ce dossier central bénéficie de deux contributions substantielles de Paul-Georges Sansonetti, qui s’interroge : la notion d’âge d’or a-t-elle encore une signification ? Et qui répond par l’affirmative en citant Julius Evola : « L’être différencié est le révolutionnaire qui prépare la renaissance. » Il baigne dans la tradition primordiale et son regard s’inscrit dans la rune dagaz, hache à double tranchant. Ces deux textes complémentaires sont assortis d’une étude d’Alain Colomb sur les quatre âges du monde germanique. Le dossier se conclut sur une définition du marterau de Thor à partir de la Pierre de Gotland et sur une heureuse digression de Pierre-Emile Blairon sur ‘Le rire des dieux’ ou comment vivre l’âge d’or durant l’âge de fer.
Sous la rubrique ‘Notre Europe’, Alain Cagnat signe la première partie d’un éloge particulièrement senti de l’Irlande et Paul Catsaras découvre l’importance des symboles dans l’œuvre et dans la vie d’Albrecht Dürer.
Il faut encore noter, dans ce numéro, l’article-guide de Julien Mord, modèle d’utilité concrète pour la construction vraiment écologique d’une maison.
Enfin, une copieuse ‘chronique du désastre’ effeuille une série de faits et documents qui prétendent, avec succès, raccrocher la revue Hyperborée à l’actualité. Dont le projet d’une mosquée au nord du cercle polaire arctique. Dont un film documentaire sur les manchots empereurs. Dont un livre sur l’érotisme solaire, de Michel Onfray. Dont une note sur Aymeric Chauprade, par qui le scandale est arrivé. Dont un livre de Louis-Christian Gautier sur l’antigravité entre Nazis et Nasa. Dont une relation de deux grands raids européens : celui de Ludovic Blairon, pour retrouver les lieux d’origine de la culture de la vigne, et celui de Mathilde Gibelin et Fanny Truilhé, pour accomplir un tour de l’Europe à pied.
(Abt annuel 34€ - 38€ hors de France ; éd. Crusoe, 4642 route de Roquefavour, F-13122 Ventabren, pierre.blairon@wanadoo.fr; www.hyperboreemagazinr.fr)
00:05 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paganisme, traditions, tradition, traditionalisme, hyperborée, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 25 juillet 2009
A propos de Merlin

A propos de Merlin
par Julia O'Laughlin
Merlin était un magicien druidique, un «homme sauvage des forêts», ayant des dons pour la prophétie et le chamanisme. D'autres noms lui ont été donnés: Lailoken, Myrrdin et Ambrosius. Ce dernier nom l'associe à l'«ambrosia», donnée par la Reine-Fée aux bardes et aux magiciens qu'elles avaient choisis comme les meilleurs.
Merlin a été engendré par la fille d'un roi, demeurée vierge, et qui reçut une nuit la visite d'un beau jeune homme mystérieux dans sa cellule de nonne. Les scribes chrétiens prétendent que ce jeune homme était en fait un incube et que, de ce fait, Merlin a été conçu délibérément pour devenir l'Antéchrist.
La lutte des dragons
Pendant la construction du temple du Roi Vortigern dans la plaine de Salisbury, la structure architecturale ne cessait de s'effondrer. Les astrologues du Roi prétendirent qu'il fallait un sacrifice, en l'occurrence le sang d'un enfant qui n'avait pas de père. Les regards se tournèrent vers Merlin. Heureusement pour lui, ses qualités de visionnaire le sauvèrent. Il vit en songe un dragon rouge et un dragon blanc en lutte dans un étang, en dessous des fondations du temple. Il put ainsi correctement prophétiser que Vortigern, le dragon rouge gallois, serait vaincu par Uther Pendragon, le dragon blanc britannique. Merlin utilisa ensuite sa magie pour construire le temple de Stonehenge en une seule nuit, faisant venir des pierres de Tipperary en Irlande par la force des chants qu'il entonna.
La Table Ronde
Merlin était également un forgeron et un artisan. C'est lui qui forgea l'armure magique du Roi Arthur, ainsi qu'une coupe miraculeuse que l'on a identifiée au Saint Graal. C'est lui aussi qui fit la Table Ronde, symbole de la Terre, avec l'image de la Grande Déesse au centre et son calendrier païen lunaire. Le premier nombre de Chevaliers qui s'assemblèrent autour de la table Ronde était de 28, ce qui correspond au mois lunaire.
Le culte de la Grande Déesse
Merlin a appris ses qualités de magicien auprès de la Grande Déesse qui nous apparaît sous de multiples avatars: la Fée Morgane, Viviane (= «celle qui vit») et la Dame du Lac. A la fin de sa vie, il retourna à la grotte sacrée pour y rester immobile, pris dans un sommeil enchanté, jusqu'à son prochain retour. Nos ancêtres croyaient que nous retournions, le jour de notre mort, dans la matrice de la Déesse Mère, symbolisée par une grotte.
Merlin est étroitement lié au culte de la Grande Déesse. L'abondance de la littérature «merlinique», jugée critique à l'égard de l'Eglise et de ses enseignements, fit que le Concile de Trente plaça le Livre des Prédictions de Merlin à l'index des livres interdits. Cet index est resté en vigueur jusqu'en 1966, lorsque le Pape Paul VI le supprima.
Julia O'Laughlin.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : traditionalisme, mythologie, mythologie celtique, monde celtique, celtitude, celtisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 24 juillet 2009
Le culte du Vent chez les Indo-Européens

Le culte du VENT chez les Indo-Européens
par le Prof. Albert CARNOY
Il y a quelques ressemblances entre les dieux du vent et ceux du feu. Tous deux sont changeants, insaisissables, tous deux sont inspirateurs et bons artisans. De même qu'on lisait l'avenir dans le foyer, on le devinait dans la chanson des vents. De même que les flammes de l'âtre sont des âmes, le vent emporte les âmes à travers l'espace. Un méchant vent les amène, une aimable brise les éloigne (l). Il est l'ami du feu qu'il attire et dans lequel les âmes également se réfugient. Si la flamme est destructrice et bienfaisante à la fois, il en est de même du vent qui apporte la vie ou la mort, la maladie ou la prospérité. Le feu est la vie qui circule dans les arbres, les plantes, les hommes. Le vent, d'après une conception fort étendue, fertilise les champs et répand partout la fécondité.
D'autre part, le vent est le compagnon de l'orage et des eaux. Il vient d'une caverne, celle des eaux. Les dieux des vents ou de l'orage sont les compagnons de celui des eaux. La tempête se complique d'éclairs et de lueurs diverses. Le vent est donc «fauve», comme on dit dans l'Inde. Il a ses flèches comme l'orage. Son chant est une musique. Il «inspire» les hommes, notamment dans les assemblées, mais il est capricieux et comme l'esprit, il souffle où il lui plaît.
Tels sont les caractères que l'on rencontre chez les dieux du vent et chez les divinités, soit issues des génies du vent, soit contaminées avec eux.
Dans l'Inde, il est Vâyu ou Vâta (mots tirés de la même racine que le néerl. waaien, «venter»), l'inséparable compagnon d'Indra et de Parjanya. Il allume des lueurs fauves. Il est, lui-même, fauve et traverse à toute vitesse le ciel sur des coursiers fauves «rapides comme la pensée» et munis de «cent yeux». Il accorde la gloire, les enfants et la richesse. Il se porte capricieusement où il lui plaît. Son souffle est celui des dieux.
Rudra et les Maruts
A côté de lui il y a les Maruts et il y a Rudra. Les premiers sont pour l'Inde ce que les nains et les géants de l'orage et des vents sont pour les Grecs et les Germains. Ce sont des êtres collectifs, plutôt effrayants que rassurants, formant une sorte de cortège aux dieux de l'orage. Ils apparaissent dans l'éclair, se font entendre dans le tonnerre. Le mugissement des vents est leur chant. Ils sont «les chantres du ciel». Ce sont eux qui entonnent un hymne triomphal quand le dragon est touché. Ils sont «fauves». Ils roulent sur des chars comme Vâyu. Ils font pleuvoir, et comme tels, ainsi que les Centaures, ils peuvent être bienfaisants et généreux mais ils sont capricieux et envoient leurs flèches où il leur plaît. Ils sont les fils de la «vache», c'est-à-dire, de la nuée.
Rudra réunit en lui la plupart des traits des Maruts. On l'appelle le «rouge» ou le «bruyant». Comme les Maruts et comme les orages, il s'attarde dans les montagnes. On insiste particulièrement sur sa qualité d'archer. Ses flèches sont rapides et terribles. Il fait ce qu'il veut, envoie la mort et la maladie ou sauve et guérit ceux qu'il protège. Il est le maître du bétail animal ou humain. Malheur à ceux sur qui il envoie ses chiens hurleurs avec lesquels il rallie sa troupe. On le rencontre dans les carrefours et dans les lieux déserts. Par euphémisme et pour l'engager à se montrer sous un aspect favorable, on lui donne déjà dans le Veda le surnom de çiva «propice», sous lequel il deviendra dans l'Inde brahmanique un dieu très important.
Il est impossible de ne pas être frappé par l'existence de nombreux traits communs entre Rudra et le dieu grec Apollon, sous sa forme la plus ancienne (2). Certes, ce dernier est beaucoup plus anthropomorphisé et il réunit dans sa personne des attributs d'origines diverses, de sorte que l'on a pu voir en lui un dieu solaire (ce qu'il fut postérieurement), un dieu du feu (3), un génie du bétail, etc. Il est vraisemblable, du reste, que des influences non grecques ont contribué à la formation de ce dieu si important de l'antiquité. Quoiqu'il en soit, dans l'appréciation de son caractère, on ne devrait jamais perdre de vue son association étroite avec Artemis. De même que celle-ci reçoit l'épithète de hekâte sous laquelle elle est parfois honorée comme une déesse spéciale, très puissante, lui, Apollon est hekatos, hekaergos, hekatêbolos. On a longtemps, à tort, traduit ces expressions par «qui agit au loin, qui atteint au loin». Leur sens étymologique «qui frappe à volonté, agit comme il lui plaît» est encore clairement conservé dans l'hymne à Hekatê, enchâssé dans la Théogonie d'Hésiode. Le poète nous dit qu'Hekatê inspire dans l'assemblée «qui elle veut», qu'elle donne gloire et victoire à «qui elle veut», qu'elle assure bonne chasse à «qui elle veut», qu'elle intervient dans les courses de chevaux comme elle le veut», qu'elle fait prospérer les troupeaux, si elle le veut» (4). Artemis et Hekatê, comme Apollon, protègent du trépas ou envoient la mort et la maladie de leurs flèches. Ils accordent leur pardon ou le refusent. Tous trois sont invoqués pour la fécondité des troupeaux et des familles. Artemis et Hekatê mènent des troupeaux d'âmes à travers les carrefours, les forêts et les montagnes. Elles apparaissent soudainement et causent des terreurs dans les lieux solitaires. Elles parcourent les solitudes la torche à la main. Elles aiment le clair de lune et ont fini par être traitées comme des divinités lunaires, tandis qu'Apollon devint un dieu solaire. Les trois aspects d'Hekatê, généralement interprétés comme se rapportant aux phases de la lune, sont peut-être plus anciens. On peut les comparer aux trois naissances de Rudra, ce dieu qui a tant de points communs avec ces déesses et avec Apollon.
La caractéristique de ces divinités est donc d'agir «capricieusement», comme il leur plaît, où il leur plaît. C'est là, évidemment, un trait indo-européen. Il convient particulièrement bien aux divinités des vents, surtout si l'on tient compte de ce que ces dernières donnent l'inspiration et apportent la maladie ou la prospérité.
Les Muses, déesses du vent
Apollon a, comme Rudra et Vâyu, un cortège de chantres. Ce sont les Mousai (Muses), filles de «Zeus, le dieu du tonnerre, qui se réjouit de la douce voix de ces déesses, quand elle se répand du haut de l'Olympe» (5). Les Muses, dont le nom signifie «tourbillon, tourmente», apparaissent dans ces vers comme des déesses du vent. L'agitation de l'esprit au moment de l'inspiration ou de la divination, est comparée à celle du vent. Apollon, comme les dieux du vent, est, par excellence, en Grèce, le dieu de la divination. Son nom est fermement attaché à l'oracle de Delphes. Quant à ce nom même, il a beaucoup intrigué les étymologistes. L'explication la plus probable est celle qui le rattache à apella, «assemblée, troupe». Apollon est donc comme Teutates, Ty, etc., le dieu des assemblées. Il est celui qui inspire ceux qui délibèrent, celui qui emporte la décision. Le mot doit, sans doute, aussi se comprendre —et c'est apparemment la signification la plus ancienne— en ce sens que Apollon est non seulement le conducteur des Muses, mais aussi celui des âmes, comme Artemis et la plupart des dieux du vent. Si Apollon apparaît quelquefois comme «loup», c'est à ce même titre, et là encore il y a une ressemblance avec Rudra et ses chiens hurleurs (6). Si Apollon est également «dauphin», c'est peut-être par contamination avec les dieux du feu (voyez ci-dessus); mais c'est peut-être aussi en tant que dieu du vent favorable qui mène les marins au port, car le dauphin était connu des anciens comme annonçant le beau temps. C'est, sans doute, aussi pour cela que toutes les fêtes d'Apollon se célèbrent en été et qu'il reçoit le surnom de Phoibos, «clair».
Hermês
Un dieu jeune qui n'a pas mal de traits communs avec Apollon, c'est Hermês. Les mythologues ont longtemps soutenu qu'il était un dieu du vent. La plupart d'entre eux tendent plutôt aujourd'hui à le considérer comme un dieu local d'Arcadie, génie des troupeaux, esprit de la fécondité ou peut-être démon des bornes ou des tas de pierres. Il serait d'autant plus vain d'entrer dans une discussion à ce sujet que le caractère d'Hermês, tel que nous le connaissons, comme celui d'Apollon, est d'origine complexe. Bien des dieux locaux, souvent d'origine préhellénique, ont évidemment été absorbés par ces deux divinités au fur et à mesure que leur popularité s'affirmait. Ce qui est certain en tout cas, c'est que beaucoup d'attributs caractéristiques des dieux du vent se rencontrent chez Hermês. Il est le dieu rapide par excellence. Il parcourt sans cesse les routes, sur lesquelles il exerce son pouvoir souverain, ce pourquoi il est le guide des voyageurs et le protecteur du commerce. Il est, par excellence, le conducteur d'âmes (psychopompos), et celui qui rassemble les troupeaux sur lesquels il exerce une garde spéciale. C'est lui, comme Apollon, qui donne le succès dans la palestre. Certains mythes démontrent son origine atmosphérique. Il a capturé, le jour de sa naissance, cinquante bœufs blancs aux cornes d'or et les a cachés dans une caverne. Il est argeïphontês, «plein d'éclat». Il a dérobé à Apollon ses flèches. Il est inventeur de la flûte, ce qui nous rappelle que tous les dieux du vent sont chanteurs et musiciens. S'il est en même temps dieu terrestre et souterrain, cela s'explique par des contaminations.
Mercurius romain, Esus gaulois
Les Romains ont identifié Hermês avec Mercurius, un simple «dieu occasionnel», protecteur des marchés. Ils ont ensuite appliqué ce nom à des dieux celtiques et germaniques très importants, offrant certaines ressemblances avec Hermês, en même temps que de notables différences. Le Mercure gaulois s'appelle Esus, «seigneur». Il était un des membres de la fameuse triade mentionnée par Lucain et, au témoignage de plusieurs auteurs, son culte était le plus important en Gaule. Ses épithètes nous font deviner qu'il était un dieu généreux (Vellaunos, «le très bon», Adsmerios, «le distributeur») et fécondant (Magniacos «qui fait prospérer»). Il régnait sur les chemins (Cimiacinos) (7)? César affirme qu'il était le protecteur du commerce et l'inventeur des arts.
Wodan
Le Mercure germanique est Wodan, dont le nom traduit celui du dieu romain dans angl., Wednesday; néerl., Woensdag; fr., Mercredi; lat., Mercuri diem. Ce nom est parent du lat., vates, « «divin inspiré», et de l'all., Wut, «fureur». L'inspiration, la divination sont en lui, comme chez les dieux du vent et chez les Muses, un aspect de l'impétuosité de son souffle. Wodan est un grand voyageur (Mercurius viator indefessus) et un conducteur d'âmes. Son cortège circule bruyamment dans le ciel pendant les nuits de tempête. Les éclairs nocturnes sont ses regards. Il est accompagné de deux loups et d'un cortège de corbeaux (les âmes). Comme Hermês, Wodan a un grand chapeau, que l'on interprète généralement comme représentant les nuages entourant les sommets avant un ouragan. Comme le dieu grec, il a aussi un bâton à la main. Il circule dans les airs sur un grand cheval blanc (ou noir), enveloppé dans un manteau noir. Comme Esus, il donne un vent favorable aux marins et protège le commerce. Wodan donne la richesse à ses adorateurs. D'autre part, il est le dieu de l'inspiration, de la poésie, de l'intelligence, celui qui connaît tous les secrets. Il accorde la fertilité aux champs, en raison de la croyance populaire allemande que «beau vent donne belle moisson». Aux îles Feroë, on pense que Wodan, de son souffle, peut faire croître la moisson en une nuit (8). Comme les autres dieux du vent, il donne la victoire «à qui il lui plaît».
Wodan a remplacé graduellement en Germanie Ty, le dieu suprême, dans beaucoup de ses attributs. Il joue dans la lutte contre les géants le rôle de Zeus dans la Théogonie.
Prof. Albert CARNOY.
(ex: Les Indo-Européens. Préhistoire des langues, des mœurs et des croyances de l'Europe, Vromant, Bruxelles, 1921, pp. 208-214).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, mythologie, indo-européens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 juillet 2009
La fête des Mères

La fête des Mères
par Otto Rudolf BRAUN
Déjà les Romains fêtaient la Fêtes des Matronalia: le 1 mars, les hommes offraient des cadeaux à leurs femmes et celles-ci en offraient à leurs servantes.
La Fête des Mères moderne a été lancée par une Américaine, Anna Jarvis, une militante fanatique pour les droits des femmes. Originaire de Philadelphie, Anna Jarvis avait perdu sa mère en 1905. Or elle aimait sa mère passionnément, au-delà de toute raison. Le jour du premier anniversaire du décès de sa mère, alors qu'elle se recueillait en son souvenir avec sa sœur Elsinor, elle eut l'idée d'introduire dans les coutumes américaines une journée en l'honneur de toutes les mères du monde.
Passionnée, car telle était sa nature, Anna Jarvis se mit aussitôt au travail. Avec une partie de son héritage, elle créa une agence de publicité à Philadelphie, parcourut toute l'Amérique pour promouvoir son idée d'une Fête des Mères. Quand elle constata que Philadelphie était trop éloignée de la capitale des Etats-Unis et qu'elle ne pouvait pas agir sans discontinuer sur le Congrès, elle créa une deuxième agence à Washington. Mais les députés et sénateurs se gaussaient de la «suffragette fanatique», comme on appelait alors toutes les femmes qui s'engageaient dans la cause féministe.
Mais, au bout du compte, l'obstination d'Anna Jarvis, paya; après huit années d'efforts et de propagande, le Congrès décida de faire du deuxième dimanche de mai la Fête des Mères. Le 8 mai 1914, le Président Woodrow Wilson signa le décret qui instituait cette coutume.
Mais l'esprit marchand s'empara de l'idée d'Anna Jarvis, ce qu'elle n'avait évidemment pas voulu. Le monde des affaires reconnut tout de suite la possibilité qu'offrait la Fête des Mères d'engranger de plantureux bénéfices. Cette Fête devenait très prosaïquement l'occasion de faire grimper les chiffres d'affaires. Les marchands tiraient profit de cette Fête qui aurait dû rester exclusivement celle du cœur, surtout du cœur innocent des enfants.
Anna Jarvis, toujours combative, commença un nouveau combat: contre la récupération par les marchands de sa Fête. Elle déposa plainte sur plainte contre des magnats, contre des secteurs entiers de l'industrie, mais perdit tous ses procès. Et aussi toute sa fortune. Dans la plus extrême pauvreté, Anna Jarvis est morte dans un foyer des pauvres de Philadelphie.
Mais elle avait atteint son objectif principal: le monde entier adopta son idée. le Mexique fut le premier pays à imiter les Etats-Unis. Ensuite, ce furent la France, l'Angleterre, les pays scandinaves, la Chine, le Japon et l'Inde.
L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ne s'alignèrent que plus tard sur la coutume, après les horreurs de la Grande Guerre et de ses suites. C'est en 1923 que la première Fête des Mères fut fêtée en Allemagne. Peu de temps après, Marianne Hainisch, épouse du Président de la première république fédérale autrichienne, et chef du mouvement des femmes en Autriche, introduisit la coutume dans son pays.
Aujourd'hui, la Fête des Mères profite surtout aux marchands. Ceux qui n'honore leur mère qu'une fois par an, peuvent se donner bonne conscience. Le monde du commerce a tenté d'introduire une Fêtes des Pères, pour accroître encore ses bénéfices. Mais la coutume n'a pas atteint la même popularité. Sans doute parce que la Fête des Mères correspond aux fêtes païennes traditionnelles de la fécondité, généralement tenues en mai.
(cf. Otto Rudolf Braun, Kleine Geschichte unserer Feiertage und Jahresfeste, Verlag Hohe Warte, D-8121 Pähl, 1979).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : tradition, maternité, traditionalisme, fêtes, mères, fête des mères |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 19 juillet 2009
L'église monacale irlando-écossaise, concurrente nord-européenne de Rome
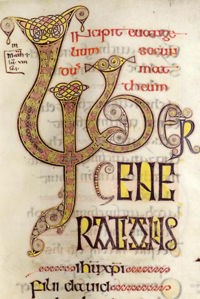
L'église monacale irlando-écossaise, concurrente nord-européenne de Rome
par Johanna BECK
Nos contemporains savent, généralement, que le christianisme nous est venu du sud, de Rome; et aussi que des moines-missionnaires sont venus d'Irlande à partir de la fin du 6ième siècle. On connait également le nom de quelques-uns de ces moines, comme Patrick, Colomban et Winfrith-Boniface; de même que le nom de quelques monastères, comme celui de Bangor, près de Belfast, d'Iona et de Lindisfarne sur les côtes occidentales et orientales de l'Ecosse. En revanche, on sait moins, aujourd'hui, que tout un réseau de petites communautés monastiques irlandaises s'était installé en Europe du Nord et aussi en Europe centrale; et on ne sait pas trop comment le christianisme est arrivé en Irlande ni qui l'y a apporté. Ce n'est que depuis quelques années que l'on a commencé des recherches sérieuses, précises et scientifiques pour attester les indices ou les suppositions des archéologues qui nous ont précédés.
On admet généralement que c'est Saint Patrick qui a apporté le christianisme en Irlande. Or, lors de son premier séjour dans la Verte Eirinn, en 412, il rencontre déjà des chrétiens. Dans le plus ancien manuscrit de sa Vita, on trouve cette phrase: «Je ne cherche pas à m'approprier le travail de mes prédécesseurs».
Pelagius contre Augustin
Vers 400, un jeune érudit irlandais, Pelagius, enseignait et prêchait à Rome. On sait qu'il s'est rendu à Carthage, sans doute pour y rencontrer Augustin, et puis, on perd sa trace. Dans sa théologie, il avait osé contredire le Père de l'Eglise, Augustin. Il enseignait que les hommes n'avaient pas tous été corrompus et perdus par la chute d'Adam, qui avait entraîné le péché originel. Pour Pelagius, le péché trouve plutôt son origine dans la volonté humaine, de même que le bien, la bonté. L'homme est donc libre et responsable de suivre ou l'exemple d'Adam ou celui du Christ. La cas de Pelagius prouve qu'en Irlande, on se préoccupait intensément de théologie chrétienne et qu'on y avait déjà fondé des écoles où l'on débattait de ces questions. Pelagius était certes un «marginal»; ses attaques contre l'Eglise de Rome ont provoqué la dite «dispute pélagienne» qui s'est poursuivie jusqu'en 529, d'abord avec virulence, ensuite sur un ton atténué. Rome en est sortie victorieuse.
Autre indice tendant à prouver que le christianisme avait acquis des formes fixes en Irlande dès la moitié du 4ième siècle: l'œuvre de Saint Ninian. Né vers 360 en Bretagne (= Angleterre actuelle), Saint Ninian passa quelque quinze années à Rome, où il fut sacré évêque. Après un séjour à Tours, sur les rives de la Loire, il retourna dans son pays et fonda le monastère Candida Casa sur la presqu'île britannique de Withorn, juste en face de Belfast en Irlande. Ce monastère se trouvait donc dans une région de l'actuelle Ecosse qui était celtique et picte et se trouvait bien au-delà de la frontière septentrionale du territoire britannique occupé par les Romains. Ninian était fidèle à l'Eglise de Rome. Son monastère, le premier de ce genre dans la région, exerça une profonde influence sur le pays, comme l'attestent les sources, et aussi sur l'Ouest, c'est-à-dire sur l'Irlande. Mais, réciproquement, la future Angleterre reçut d'Irlande bon nombre d'influences fécondes; la règle des monastères s'y imposa, alors qu'auparavant, elle était inconnue en Angleterre; de même, de nombreuses particularités liturgiques et de règles simples, ayant trait à la vie quotidienne. Le monastère Candida Casa devint ainsi une sorte de base irlandaise sur le territoire britannique. On y formait des prêtres et des clercs, qui essaimèrent pendant cent ans et fondèrent d'autres monastères.
Un monachisme d'origine égyptienne?
Le christianisme s'est répandu en Irlande par l'essaimage de communautés monastiques. Comme le pays est petit, ces communautés furent rapidement connues de tous et les moines n'eurent plus besoin de sillonner le pays pour missionner le peuple. Bientôt, chaque clan avait son monastère et les moines accomplissaient toutes les tâches dévolues aux hommes d'Eglise. C'est la raison pour laquelle on parle d'une église monacale irlandaise. Reste la question: comment ces moines sont-ils venus en Irlande?
Aux débuts du monachisme chrétien, nous trouvons le monachisme égyptien, né vers le milieu du 3ième siècle. Croyant que la fin du monde était proche, que le Jugement de Dieu était imminent, certains chrétiens avaient décidé de vivre une vie ascétique, de fuir le monde, moins par souci du salut personnel que par volonté de servir d'exemple pour la communauté toute entière et la représenter ainsi, pauvre et détachée des biens terrestres, devant Dieu. Ce monachisme présentait, dès ses débuts, deux tendences, le monachisme individuel, érémitique, et le monachisme communautaire, soumis à des règles très strictes de vie en commun. Le tout premier monastère, celui de Tabenisi, a été fondé en 320 sur une île du Nil. De là, sans cesse, des équipes de sept moines partaient pour fonder ailleurs une nouvelle communauté monastique. Cette conception du monachisme est arrivée en Occident à la fin du 4ième siècle; elle a aussitôt été combattue avec vigueur, ce qui l'a obligée à subir de multiples transformations.
Rôle primordial de l'Abbé
Curieusement, le monachisme irlandais présente des caractéristiques, perdues ailleurs en Occident, au cours de la transformation/altération des règles égyptiennes-orientales dans l'orbite romaine-occidentale. Seulement en Irlande, l'Abbé détient la plus haute dignité: les évêques consacrés lui sont subordonnés. Ensuite, dans l'art des enluminures, apanage des monastères irlandais, nous retrouvons des motifs issus du monachisme égyptien, des scènes de la vie de Saint Antoine, qui distribue ses biens et s'en va dans le désert pour mener une vie d'ermite, des éléments décoratifs typiquement coptes, comme les paupières des personnages peintes en noir ou des manières coptes de lire les textes bibliques. L'Evangile de Jean joue en Irlande un rôle important, comme en Orient, tandis qu'à l'Ouest, les Evangiles synoptiques sont mis à l'avant-plan. Quand on examine les légendes, on découvre le récit de sept moines égyptiens qui fondent un monastère, puis périssent martyrs, ce qui expliquent qu'on les ait représentés sur le socle d'une haute croix.
Tous ces éléments, ajoutés à d'autres encore, nous permettent d'avancer l'hypothèse d'une christianisation de l'Irlande et d'une constitution d'une église monacale irlandaise par des moines venus d'Orient, qui auraient contourné le continent. Ces moines seraient arrivés directement par mer, en empruntant des navires marchands, venus en Irlande pour y chercher de l'or, du cuivre ou de l'étain.
Le monachisme irlandais, une christianisation du druidisme?
Ce qui étonne, c'est que cette christianisation de l'Irlande n'a pas coûté de martyrs. Sans résistance, les Irlandais passaient au christianisme ou restaient païens. Les prêtres celtiques, c'est-à-dire les druides, les grands sages, se convertissaient, ce qui est en somme bien compréhensible, puisqu'ils auraient été une secte, venue, elle aussi, d'Orient. Les Druides connaissaient aussi la coutume de quitter leur communauté initiale à sept pour aller officier en un autre lieu sacré. En passant au christianisme monacal oriental, les Irlandais ne devaient pas abjurer leurs dieux et leurs déesses celtiques ni abandonner leurs coutumes: il leur suffisait de les intégrer. Divinités et coutumes celtiques ont été assimilées à des coutumes ou des saints chrétiens; dans leurs prophéties et leurs visions, les Druides les plus élevés dans la hiérarchie, comparent leurs lieux sacrés (bosquets, bois, sources, etc.) à ceux de la Terre Sainte, comme si la religiosité celtique avait précédé la religiosité chrétienne!
Cette tolérance a fait que pendant plusieurs siècles, les moines ont recopié, dans les monastères irlandais, les vieux mythes et les anciennes légendes celtiques. C'est ainsi que nous avons pu les conserver. Il est également intéressant de noter que la coiffure des druides —l'avant du crâne rasé et l'arrière de la chevelure longue et pendante— a été adoptée par les moines irlandais.
Saint Patrick, personnage moins important qu'on ne l'a cru?
L'église monacale irlandaise s'est développée très vite et Rome n'a pas pu s'y opposer. Raison pour laquelle, plus tard, elle a monté en épingle la personnalité de Saint Patrick et lui a attribué la christianisation de l'Irlande. De Saint Patrick, nous savons qu'il est né en 390 en Bretagne romaine et que, pendant ses jeunes années, il a été enlevé par des pirates et amené en Irlande. C'est à cette époque qu'il semble s'être tourné vers le christianisme. Il s'enfuit ensuite en Gaule, poursuit sans doute son voyage vers l'Italie, où il reçoit sa formation de prêtre. En 432, il débarque en Irlande, plus précisément en Ulster, dans le Nord-Est de l'île. Dans cette région, se trouve la colline de Tara, où l'ensemble des clans celtiques avait coutume de se rassembler. Patrick entame sa mission au nom de l'église de Rome, mais, apparemment, sans succès. Il n'aurait réussi qu'à se gagner les faveurs du Grand Roi d'Armagh, car dans le livre d'Armagh, nous trouvons sa Vita. Autrement, rien ne rappelle son souvenir. Il n'a pas réussi à fonder de monastère ni de communauté chrétienne. Et il n'a pas eu de successeur. Dans sa Vita, on raconte qu'il a étendu le christianisme «jusqu'à la limite au-delà de laquelle plus aucun homme ne vit». Selon toute vraisemblance, cela ne peut concerner que l'île d'Eirinn (Hibernia). Patrick meurt en 462.
Brendan en Amérique?
Dans un écrit du 8ième siècle, le Catalogus Sanctorum Hiberniae, dans lequel on trouve beaucoup de détails concernant l'église monacale irlandaise, on parle des monastères et de leurs fondateurs. L'Ile était recouverte de monastères, dont beaucoup étaient des écoles de haute spiritualité. En concordance avec la culture celtique-chrétienne, ce serait Sainte Brigit qui aurait fondé le célèbre monastère féminin de Kildare au 5ième siècle. A proximité, se trouvait un monastère masculin; elle les dirigeaient tous les deux en tant qu'Abbesse vers 500. Au même moment, Saint Brendan fonde Clonfert. Celui-ci nous a laissé le récit d'un long voyage sur l'océan, que l'on avait toujours pris pour de la pure fantaisie, jusqu'au moment où l'on s'est aperçu qu'il contenait des observations et des descriptions très précises en matières de navigation et de géographie. Cette précision atteste que des moines irlandais, sans doute à la recherche du pays des Bienheureux, ont sans doute atteint l'Amérique, en passant par l'Islande et le Groenland.
Puisque la christianisation de l'Irlande a été le fait de moines qui s'y sont fixés en communautés monastiques, les chrétiens qui habitaient les villages environnants appartenaient également au monastère. Dans les villes seulement, on devait célébrer des offices ailleurs que dans les monastères. Selon les vieilles règles coutumières et claniques des Celtes, l'Abbé ou l'Abbesse était propriétaire des terres et de la fortune du monastère. Or le territoire couvert par un monastère pouvait souvent avoir la taille d'une principauté. C'était les chefs de tribus qui confiaient leurs terres ou une partie de leurs terres aux moines. Raison pour laquelle ils réclamaient pour eux-mêmes la dignité d'Abbé, et la transmettaient de génération en génération. Les moines devaient obéissance à leur Abbé ou à leur Abbesse, comme les simples membres d'un clan à leur chef.
La configuration des monatères variait selon son importance ou selon la région où il se trouvait. Au centre du complexe architectural, il y avait toujours le bâtiment où l'on célébrait les offices religieux. Autour de celui-ci se regroupaient sans ordre précis les cellules monacales et les habitations. Parfois, toute la petite agglomération est entourée d'une palissade ou d'un mur de protection. Généralement, il y a également une tour, pourvue de cloches. Les bâtiments sont en bois ou en torchis (branchages recouverts de terre séchée). Le cimetière est hors les murs et toujours entouré d'une palissade ou d'un mur. Le chemin qui y mène est entouré de croix de bois ou de pierre.
On entre au monastère entre l'âge de quinze et dix-sept ans. On y passe d'abord trois années de probation. Les moines prennent en charge l'éducation et l'enseignement. L'idéal ascétique des moines égyptiens ne s'est pas imposé d'emblée. Le célibat, par exemple, ne s'est imposé qu'après de longues disputes vers la fin du 7ième siècle. A partir de cette époque, les contraventions aux règles monacales sont punies de lourdes peines; dans les locaux du monastère, les moines doivent garder le silence absolu.
Le pain est la nourriture principale. L'eau, la seule boisson tolérée. Ce n'est qu'après de longues décennies de querelles que des règles nouvelles acceptent la bière et, plus rarement, le vin. Pendant les périodes de jeûne, la nourriture est encore plus chiche. Mais, en contrepartie, les moines, y compris leur Abbé, doivent être autonomes et produire eux-mêmes leur nourriture. Les moines doivent donc travailler la terre et élever du bétail, filer et tisser, confectionner leurs vêtements, fabriquer des meubles et des outils. On ne sait pas grand'chose des règles du culte à cette époque, sauf que le jeudi saint, les moines se lavaient mutuellement les pieds et qu'au jour de Pâques, on pratiquait le vieux rite de bouter le feu au «bûcher pascal». Enfin, comme chaque tribu ou clan avait son propre monastère, chaque monastère avait ses propres coutumes et ses propres fêtes religieuses.
Textes antiques et légendes celtiques
Le travail intellectuel qui s'effectuait dans les monastères irlandais, consistait à approfondir les éléments de la foi chrétienne mais aussi et surtout à transmettre le savoir de l'antiquité classique, sur base des manuscrits disponibles, ainsi qu'à transcirre l'héritage oral des Celtes. Dans les enluminures, qui sont parmi les plus belles du monde, nous retrouvons des symboles de la vieille Irlande celtique et de l'Orient. Dans les arts plastiques, ces symboles sont également très présents (Croix; grandes croix irlandaises ou celtiques). Le latin est langue d'église, de science et d'écriture; la langue quotidienne celtique, elle, n'a jamais été éradiquée.
Columcille et Iona
L'expansion vers l'Est de l'église monacale celtique-irlandaise a commencé à partir d'Iona en Ecosse. Ce monastère avait été fondé par Columcille, que l'on appelle aussi Colomban l'Ancien. Columcille descendait d'une famille illustre; il est né en 521 et, dès l'âge de quinze ans, reçoit une formation dans plusieurs monastères. Les chroniques le décrivent comme un homme de haute stature, de grande intelligence, animé par un fougueux enthousiasme pour sa foi, comme un excellent poète et un bon copiste de textes anciens. Vers l'âge de trente ans, il quitte son monastère avec sept compagnons pour fonder de nouveaux monastères en Irlande. Là-bas, il eut une idée audacieuse qu'il mit aussitôt en pratique: en 563, il traverse la mer en direction de l'île de Hy (hy = île), située en face de la grande île de Mull sur la côte occidentale de l'Ecosse. Pour Columcille, Hy était la porte vers la Bretagne ex-romaine et le Continent, tout en étant suffisamment isolée pour pouvoir y servir Dieu dans la paix et la sérénité. Dans d'autres chroniques, on apprend qu'il aurait été mêlé à un bain de sang, perpétré par un roi irlandais, et que c'est la raison principale de sa fuite.
Imitation de Saint Antoine
Pour comprendre cette attitude, il faut savoir que l'une des caractéristiques essentielles du monachisme irlandais est de suivre l'exemple de Saint Antoine, qui consiste à partir dans le désert, s'éloigner de sa patrie, de tout ce que l'on aime et de tout ce qui est familier, pour expier ses péchés et pour ne plus se consacrer qu'à Dieu; mais aussi, dans la foulée, à convaincre d'autres personnes d'imiter cet exemple et de mener une vie de sainteté. Dans ce sens, les moines doués étaient sollicités par deux appels contradictoires: partir vers un pays lointain mais demeurer à l'abri du monde, sur une île par exemple, et d'y fonder un monastère tout en militant pour la conversion des autres. Derrière cette pratique religieuse, nous retrouvons l'antique coutume d'exclure les malfaiteurs ou ceux qui ont, par leurs actes ou par leurs omissions, jeté le discrédit sur la communauté ou entaché son honneur; les «bannis» sont ainsi envoyés vers des contrées inhabitées. Columcille, bien sûr, n'était pas un malfaiteur, car son départ n'a pas été secret et s'est fait avec l'appui de sa communauté. Mais il se sentait coupable. A l'île qu'il s'est choisie, il donne le nom d'Iona, mot hébreu signifiant la colombe. Son nom «Columcille» signifie en langue celtique «colombe de l'Eglise»; ce n'est pas son nom d'origine, mais celui qu'il a acquis et légué à la postérité.
Columcille et ses moines ont rendu l'île fertile et habitable; ils y ont construit une église en bois; puis des bâteaux avec l'aide d'habitants du pays. Les moines assurent par la suite l'éducation des enfants et prodiguent des soins aux malades. L'île, désormais habitable, attire des colons. La vie du monastère s'épanouit. Mot d'ordre: le travail est prière et la prière est travail. Les missionnaires issus d'Iona partent chez les Pictes, qui ne connaissaient encore rien du christianisme, puis vers les Orkneys et les Shetlands, vers l'Islande. En 583, Columcille couronne le premier roi des tribus pictes unifiées. Iona hérite du savoir de la «Candida Casa» de Withorn et devient de la sorte le berceau de la chrétienté écossaise. Raison pour laquelle on parle d'«église monacale» irlando-écossaise. Quand Columcille meurt en 597, après 34 années de travail, des monastères ont été fondés dans le sud de l'Angleterre; sa réputation a atteint les Francs de Gaule, les Wisigoths d'Espagne et les Lombards.
Destruction et reconstruction d'Iona
Après la mort de Columcille, son œuvre est poursuivie par des moines issus d'Irlande, jusqu'en 806 où l'île est attaquée par les Vikings qui détruisent le monastère. L'île sacrée devient alors une île des morts: en souvenir de son importance capitale, le premier roi du Royaume-Uni des Pictes d'Ecosse s'y fait inhumer en 860. Par la suite, Iona, pendant plus de 200 ans, devient le cimetière des rois de cette contrée septentrionale d'Europe. Dans ce cimetière royal, le Reilig Odhrain, nous trouvons les tombes de 48 rois écossais, 4 rois irlandais et 8 rois norvégiens; parmi eux: Duncan et son meurtrier Macbeth. Quand, au début du XIIIième siècle, s'établissent à Iona une abbaye bénédictine et un couvent de pères augustins, c'en est fini de la tradition irlandaise. Mais en 1938, quelque 150 hommes et femmes fondent la Iona Community sous l'égide du prêtre-ouvrier Macleod de Glasgow, qui, grâce à des dons, a entrepris de reconstruire l'Abbaye de Columcille.
Johanna BECK.
(texte issu de Mensch und Maß, 27ième année, n°4 [23.2.1987]; adresse: Ammerseestr. 2, D-8121 Pähl).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, celtes, celtisme, celtitude, irlande, ecosse, christianisme, monachisme, haut moyen âge |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 juillet 2009
Les pommes d'immortalité

Les pommes d'immortalité
par Julia O'Laughlin
De tous les fruits, la pomme est le fruit magique par excellence. Son nom latin est pomona, le terme générique pour désigner le fruit. La déesse romaine Pomona est la déesse de tous les arbres fruitiers et, plus généralement, de tout ce qui est «fructueux», de tout ce qui fructifie. Les banquets des Romains commençaient toujours par des œufs, symboles de la création, et se terminaient par des pommes, symboles de complétude.
Dans la Bible, le fruit de la connaissance que tend Eve à Adam était, en fait, la pomme de vie éternelle, attribut de la Grande Déesse-Mère. Les nombreux «paradis» que l'on attribue à la Grande Déesse-Mère se situent tous à l'Ouest, où poussent les pommes d'immortalité. Les Celtes appelaient leur paradis de l'Ouest Avalon, l'«Ile aux Pommes», un pays gouverné par le Fée Morgane, Reine des Morts. A son trépas, le Roi Arthur s'en alla vers cet Avalon mythique, pour se préparer à ressusciter et à revenir.
Les Scandinaves pensaient que les pommes étaient essentielles pour assurer la ressurection; c'est la raison pour laquelle ils plaçaient des plats remplis de pommes dans leurs tombes. Les pommes magiques de la déesse de jouvence Idun permettaient aux dieux nordiques d'échapper à la mort. Les pommes transportaient également, d'après les croyances populaires, les âmes d'un corps à l'autre. La pomme que l'on plaçaient dans la bouche du sanglier du Yule lui servait de cœur au cours de sa vie suivante.
La Déesse-Mère des Grecs, Hera, possédait un jardin où croissaient des pommes magiques et où l'Arbre de la Vie était gardé par son serpent sacré. L'histoire d'Adam et Eve et du serpent dans l'arbre est l'interprétation hébraïque d'une mythologie centrée sur le culte de la Déesse-Mère. De nombreuses représentations antiques l'attestent. Dans le mythe original, c'est la Déesse-Mère qui offre la vie à ses adorateurs et cette vie est symbolisée par une pomme. A l'arrière-plan, nous retrouvons généralement l'arbre et le serpent.
L'importance mystique de la pomme vient de son «pentacle» de Koré, caché en son centre et que l'on découvre en coupant la pomme transversalement. Exactement comme la Vierge Koré était cachée dans le cœur de la Terre-Mère, ou Déméter, et représentait l'âme du monde, son pentacle symbolique est caché dans la pomme.
L'étoile à cinq branches, placée dans un cercle, est un hiéroglyphe égyptien désignant la matrice du monde souterrain, lieu où s'effectuent les ressurections, grâce à la puissance du cœur-mère, vecteur des transformations.
Les jeux d'Halloween, du temps de Toussaint, se jouent très souvent avec des pommes. Ils nous viennent des fêtes celtiques du Samhain, la Fête des Morts. Les fleurs de pommiers étaient utilisées comme fleurs de mariage parce qu'elles symbolisaient la forme virginale de la Déesse, dont la maturité produit le fruit. Bien qu'ils aient utilisé la pomme sous sa forme florale pour assurer des mariages heureux et féconds, nos ancêtres n'ont jamais oublié les aspects dangereux de la pomme, quand elle est associée à la Grande Déesse sous son avatar de sorcière, de vieille femme acariâtre qui apporte la mort. La Grande Déesse, ne l'oublions pas, est à la fois Vierge et Mère, mais aussi Hel, déesse de la mort, et Hécate. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ont souvent décrit les pommes comme des fruits empoisonnés.
Julia O'Laughlin.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, mythologie, racines, mythes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 02 juillet 2009
La passé païen de Saint Nicolas

Le passé païen de Saint Nicolas
d'après Michael Damböck
On ne peut déterminer avec certitude les origines historiques de la figure de Saint-Nicolas. Aucun des récits relatant ses faits et gestes ne peut être attesté. La tradition chrétienne en fait le fils unique de parents riches, né vers 270 à Patras, une ville de Lycie en Asie Mineure. Il se serait distingué par sa piété et ses bienfaits. Sur ordre de Dieu, il aurait été oint évêque de Myra. Il serait mort en 342 ou en 347. Il aurait participé au Premier Concile de Nicée en 325, où il aurait pourfendu la thèse d'Arius, qui postulait des natures différentes pour chaque personne divine, et lui aurait opposé le point de vue orthodoxe, c'est-à-dire celui de la Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.
D'après la légende chrétienne, les ossements de ce saint fabuleux auraient été transportés en 1087 de Myra à Bari en Italie méridionale. Depuis lors, son culte n'a pas cessé de croître en Occident. Au début, les progrès de ce culte ont ressemblé à un véritable triomphe. Il a suivi les voies fluviales de l'Europe centrale et septentrionale, de même que les voies terrestres qui partaient d'Italie pour mener en France et en Allemagne. Cologne et Trêves sont devenues ainsi des hauts lieux du culte de Saint-Nicolas. Ce culte s'est ensuite étendu au Danemark, en Scandinavie et en Islande, de même que dans les colonies allemandes de Silésie et de Poméranie et, enfin, dans les villes baltes de Riga et de Reval. Dans l'Eglise orthodoxe, Saint-Nicolas était le de Dieu et on le priait pour obtenir toutes les faveurs possibles et imaginables. Russes et Bulgares disent encore aujourd'hui que Dieu mourait, ils ferait de Saint-Nicolas le nouveau Bon Dieu.
L'évêque des Enfants
Le jour de la Saint-Nicolas (le 6 décembre) était, au Moyen Age, le jour où l'on élisait l' (vers la fin du 13ième siècle). Avant que cette coutume ne s'impose, on fêtait l' un autre jour du temps de Noël, plus exactement le 28 décembre, jour de la fête des Saints Innocents. Au cours de cette fête, les jeunes clercs et escholiers choisissaient un parmi les leurs. L'élu devenait le maître de la cérémonie et dirigeait une procession en grande pompe, devenant, pour le temps de la fête, le maître de l'Eglise locale. Ce est à l'origine de la fête de Saint-Nicolas. L'Eglise, lors du Concile de Constantinople, a tenté d'interdire cette élection de l', mais a dû finir par la tolérer. La fête de l'évêque des escholiers était une véritable bouffonerie (comme l'est encore la fête des étudiants catholiques wallons, qui élisent un et se promènent dans les rues de Bruxelles, Namur, Louvain, etc. en commettant joyeusement quantité de bouffoneries, ndlr). Le parallèle entre cette fête de Saint-Nicolas et la fête médiévale des bouffons (ou des fous) est évident.
Quelle est la raison fondamentale du succès de ce culte et de son extraordinaire popularité? Saint-Nicolas est le protecteur des marins, des voyageurs, des pêcheurs, des constructeurs de ponts, des colons germaniques s'installant de l'Oder au Golfe de Finlande. Devenu au fil des temps le saint patron des voyageurs que guettaient bien des périls, Saint-Nicolas a fini également par étendre sa protection aux voleurs et aux brigands. Un détenu de la prison de Cologne avait, en 1933, un curieux tatouage sur le bras; il montrait deux larons et l'inscription suivante: !
Les racines mythologiques
de Saint-Nicolas
Saint Nicolas a remplacé dans le , le vieux dieu germanique des eaux, Hnikar (ou Nikuz). Hnikar est toutefois un surnom d'Odin. Voilà pourquoi Saint Nicolas était toujours représenté monté sur un cheval blanc et qu'il est devenu le patron des marins et des bateliers. Nos ancêtres tenaient énormément à leurs dieux et retransformaient rapidement tous les saints chrétiens, venus d'Asie Mineure ou du bassin méditerranéen, en des figures familières et bienveillantes, qui n'étaient rien d'autre que leurs bonnes vieilles divinités germaniques. L'Eglise était obligée d'attribuer à ses propres saints les caractéristiques immémoriales des dieux germaniques qui étaient honorés selon les traditions du peuple. Comme Saint-Nicolas remplace Odin dans l'imaginaire populaire, on le voit arriver sur son cheval blanc pour aller de maison en maison apporter des cadeaux, notamment des fruits: pommes, poires, noix voire des pâtisseries. Plusieurs sortes de biscuits sont associés à Saint-Nicolas (il nous en reste les speculoos, biscuits au gingembre à l'effigie du saint). D'autres pâtisseries représentent des animaux: coqs, poules, lièvres, cerfs, chevaux ou cochons (aujourd'hui ils sont en chocolat ou en massepain, notamment les cochons). Ces animaux en biscuit, massepain ou chocolat remplacent en fait les animaux que l'on sacrifiait en ce jour pour satisfaire le culte des âmes.
Les enfants, la veille, chantent des chansons ou récitent des prières pour Saint-Nicolas et en marquent le nombre sur une petite tablette carrée en bois, pour montrer leur piété. Ces tablettes (Klosahölzl en Bavière; les petits bois de Nicolas) sont déposées à côté de leur assiette. Coutumes encore respectées en Flandre et en Wallonie où les enfants font un dessin pour Saint-Nicolas qu'ils déposent sur la table où l'on placera leurs cadeaux. Sans oublier ni leur petit soulier ni une carotte pour son âne (qui a remplacé le beau cheval blanc d'Odin).
D'après Michael Damböck, Das deutsche Jahr in Brauchtum, Sage und Mythologie. Feste und Feiern im Jahreslauf, Verlag Damböck, Ardagger (Autriche), 1990, ISBN 3-900589-04-6.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, christianisme, paganisme, saints |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook






