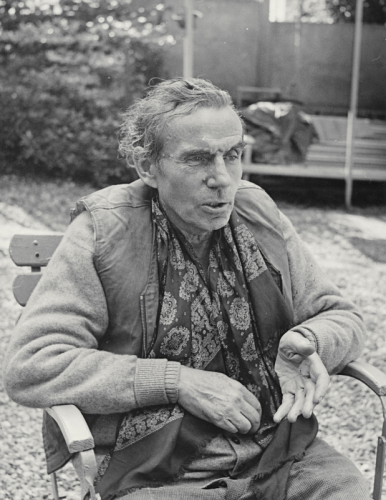
Parution du n°440 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
François Marchetti nous a quittés
Céline dans Paris-Midi (1ère partie)
Actualité célinienne
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Philosophie de Don Quichotte
Par Juan Manuel de Prada
La philosophie de Don Quichotte consiste à se battre contre l'esprit de notre temps, mais sans espoir de victoire.
Avant de renverser Don Quichotte sur le sable de la plage de Barcelone, le célibataire Samson Carrasco (déguisé à l'époque en Chevalier de la Lune Blanche) détermine expressément les règles du défi. Si Don Quichotte est vaincu, il devra se retirer dans son village pendant un an ; mais il doit d'abord déclarer que Dulcinée du Toboso n'est pas la plus belle dame du monde. En lui faisant abjurer la dame de ses pensées, Samson Carrasco entend, en effet, que la retraite de Don Quichotte soit définitive ; car un chevalier qui abandonne sa cause devient un homme sans mission.

Mais lorsqu'il est renversé et à la merci de son vainqueur, la lance de celui-ci pointée sur sa gorge, Don Quichotte, "comme s'il parlait du fond d'une tombe, d'une voix affaiblie et malade", refuse de renier sa bien-aimée : "Dulcinée du Toboso est la plus belle femme du monde, dit-il, et moi le chevalier le plus déshonoré de la terre, et il n'est pas juste que ma faiblesse conteste cette vérité. Pousse, chevalier, la lance, et finis-en, car tu m'as déjà déshonoré". Don Quichotte s'est donné à Dulcinée sans conditions, sans rien demander en retour, sans exiger en contrepartie de sa fidélité que Dulcinée lui réponde. Pourquoi, alors, la grandeur de Dulcinée devrait-elle dépendre de la faiblesse de son bras ? Ce n'est pas la force de Don Quichotte qui a déterminé que Dulcinée est la plus belle femme du monde, l'opinion inconstante des hommes ne change pas l'essence de la vérité. La loyauté de Don Quichotte envers Dulcinée n'a pas changé même lorsqu'il l'a vue transformée en un paysan sans classe ; elle ne changera pas non plus lorsque la lance du Chevalier de la Lune Blanche lui coupera la gorge. Et la détermination de Don Quichotte est si belle que même le méchant Samson Carrasco se rend: " Vive, vive dans son intégralité la renommée de la beauté de la dame Dulcinée du Toboso, que je suis déjà satisfait si le grand Don Quichotte se retire chez lui pendant un an".

Miguel de Unamuno a affirmé à juste titre que cette scène résume la philosophie du "quichottisme". Peu importe si, en luttant pour défendre la vérité, nous sommes vaincus et humiliés ; peu importe si notre moi déchu est vaincu, car la vérité, où vit notre moi éternel, ne peut être vaincue. Et le paradoxe veut que, à travers notre défaite, cette vérité brille avec plus d'intensité. Don Quichotte se jette dans toutes les entreprises sans se soucier de la défaite, il sait accepter sereinement l'échec car il est pleinement convaincu de la vérité qu'il défend. Il n'a d'autre aspiration que de se faire le défenseur de cette vérité, aussi n'admet-il pas de la négocier, il n'est pas prudent et ne calcule pas, il n'hésite pas et ne recule pas. Même s'il sait que cette vérité sera attaquée par toutes les canailles, même s'il sait qu'en la défendant contre vents et marées il sera vilipendé et moqué, il ne veut pas renoncer à la défendre ; car l'adhésion à cette vérité qui s'est nichée dans son moi éternel l'a dépouillé de l'amour-propre et des peurs humaines. Celui qui est guidé par l'amour de soi et les peurs humaines finit par déformer les demi-vérités, finit par craindre davantage son propre sort - le rejet de ses contemporains, la perte de prestige, etc. - que l'obscurcissement de cette vérité qui illumine nos jours.

La philosophie de Don Quichotte, aujourd'hui, se résume à lutter contre l'esprit de notre époque, même sans espoir de victoire. Et pour cela, nous devons être prêts à prendre de nombreux coups et à nous rendre ridicules, non seulement devant des hommes façonnés par la mentalité de l'époque, mais aussi devant nous-mêmes. Miguel de Unamuno affirme à juste titre que cette philosophie quichottesque est "la fille de la folie de la croix", où, en effet, le Christ s'expose au ridicule, non seulement devant les bourreaux qui se moquent de lui en lui demandant, au milieu des rires, de descendre de la croix, mais devant lui-même, qui aurait pu accéder à cette demande s'il avait seulement "retrouvé sa raison", c'est-à-dire s'il s'était libéré de la nature mortelle qui le maintient emprisonné sur la croix.
Don Quichotte aurait également pu éviter de nombreux problèmes et afflictions s'il avait seulement "retrouvé la raison" : car, comme nous le remarquons souvent tout au long du roman, c'est un homme qui réfléchit de manière très subtile et prudente et, par conséquent, il aurait pu élaborer des plans pour échapper aux dangers et aux complots, sans renier complètement sa vérité, en acceptant seulement de la dissimuler par divers subterfuges. Mais il ne le fait pas. Et, vaincu, Don Quichotte gagne mystérieusement ; devenant la risée de ses détracteurs, il triomphe d'eux.
C'est une leçon de morale extraordinaire, mais il faut un courage héroïque pour l'assumer. Faisons comme Don Quichotte, même avec une lance sur la gorge, même si nous devons retourner vaincus au village.
Source: http://novaresistencia.org/2021/07/29/a-filosofia-quixotesca/
19:04 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : don quichotte, philosophie, littérature, espagne, lettres, lettres espagnoles, littérature espagnole, cervantès, miguel de unamuno |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
12:32 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abel bonnard, france, histoire, livre, modérés, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

De Nietzsche à la Mitteleuropa, l'univers culturel de Roberto Calasso
Hommage à l'éditeur Roberto Calasso (1941-2021)
Andrea Muratore
Roberto Calasso, décédé ce 28 juillet, était, en fin de compte et tout simplement, un homme cultivé et libre. Et cela suffit pour comprendre l'incisivité de son travail dans le monde de l'édition italienne des XXe et XXIe siècles. Dans ce cas, ce n'est pas le caractère extraordinaire de l'ordinaire qui est frappant, mais plutôt la capacité de Calasso à façonner une structure éditoriale capable de donner l'exemple en Europe, une maison d'édition à l'image et à la ressemblance de sa vision du monde et de la culture.
En tant que directeur éditorial de la célèbre maison d'édition italienne Adelphi, Roberto Calasso a donné la parole à un éventail large et pluriel d'auteurs. De son époque et du passé. Parfois, on peut dire, de l'avenir, car il a anticipé la célébrité de certains auteurs ou a permis la transposition d'écrivains et d'essayistes en icônes "pop" grâce à ses intuitions réfléchies. Ce qui est particulièrement frappant, cependant, c'est l'ampleur des sujets sur lesquels s'est penchée la bibliothèque Adelphi, qui a rassemblé plus de 700 titres depuis 1965.
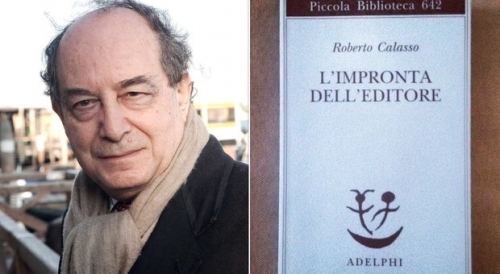
Une ampleur qui reflète la profonde curiosité culturelle du deus ex machina qui règnait sur Adelphi. Ethologie (Konrad Lorenz) et littérature du fantastique (J.R.R. Tolkien), ésotérisme (Gurdjeff et Guénon) et foi (Ignace de Loyola), penseurs séculiers (Benedetto Croce) et vrais mystiques (Simone Weil). Un courant de conscience continu, polymorphe, capable de s'adapter aux nombreux stimuli que Calasso et la maison Adelphi ont su saisir et transmettre, donnant naissance à des textes qui "risquaient de ne jamais devenir des livres", comme il l'écrivit en 2013 dans L'impronta dell'editore.
Calasso et Adelphi entre le sacré et le profane
Calasso était un personnage sui generis, qui ne pouvait être classé dans des groupes, des courants d'expression ou des domaines politiques précis. Il était le Franco Battiato de l'édition, capable de créer un univers de référence capable de visiter métaphoriquement des mondes lointains et de recevoir des stimuli hétérogènes de la part de ceux qui ont la bonne prédisposition pour y entrer. Parmi les auteurs publiés par Calasso figure Manlio Sgalambro, un philosophe dont la collaboration avec le maître sicilien est à l'origine de certains de ses textes les plus profonds ; il y avait aussi de la place pour un grand hérétique de la culture italienne comme Curzio Malaparte, un opposant à tous les conformismes; et les voyages dans des terres lointaines et les épopées culturelles, historiques, naturalistes et ethnographiques du britannique Bruce Chatwin, inaugurées par En Patagonie, un texte ayant la capacité profonde de mener à la découverte d'une accumulation profonde d'histoires et de récits humains, racontant une terre rude, glacée et inhospitalière aux antipodes de notre Europe.
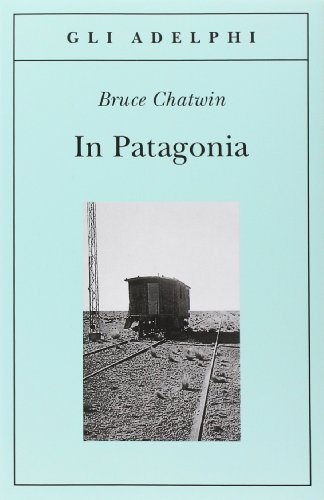
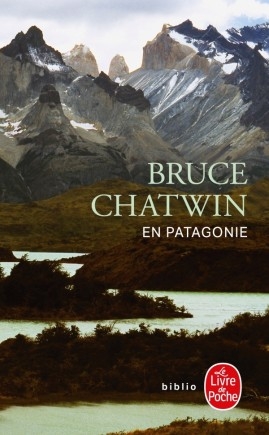
Chez Adelphi, sous la houlette de Calasso, le fleuve de la connaissance coule à un rythme inhabituel à l'ère de la société de l'information de masse. Et les protagonistes de ses collections sont souvent les grands hérétiques, les libres penseurs, les voix hors du chœur. Cela permet d'apprécier plus profondément le travail d'une maison d'édition qui, comme le rappelle Pangea, a su se distinguer par son autonomie, et a continué à le faire au cours du dernier demi-siècle, dans une phase où " les grands éditeurs, étourdis par le climat de l'après-guerre, pressés par les exigences moralisatrices et pédagogiques, par les préjugés politiques et culturels de la société bourgeoise naissante, ont publié des œuvres évidentes, laissant de côté "une grande partie de l'essentiel". Le sectarisme laïc, l'afflux catholique ou marxiste, semblaient obliger les éditeurs à n'accepter que des auteurs alignés, catalogués en grappes".
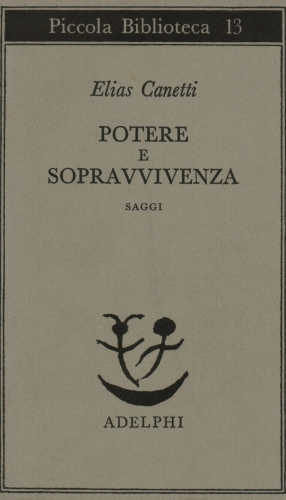
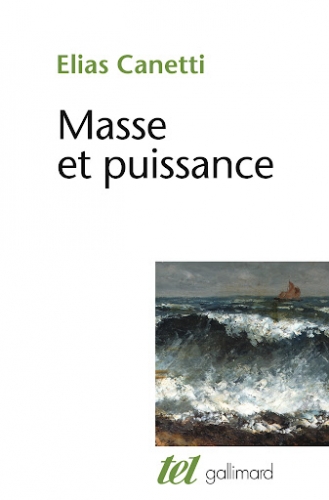
Qui d'autre, après tout, aurait pu apporter en Italie la meilleure version de Masse et puissance, le texte analysant le rapport entre les sociétés et l'autorité écrit par le penseur germano-britannique Elias Canetti, prix Nobel de littérature en 1981, une critique désacralisante des principales idéologies du vingtième siècle? Qui, dans les années 1970, redécouvrait Joseph Roth et, avec des romans fondamentaux tels que La crypte des capucins, un afflux considérable d'oeuvres venues d'Europe centrale, avec une belle nostalgie d'une Europe qui pouvait encore être considérée comme le centre du monde? Qui voudrait entreprendre un voyage culturel à la découverte des grandes religions du monde, en abordant l'hindouisme (avec une édition de la Bhagavadgita), le bouddhisme (avec Les actes du Bouddha du moine et poète Asvaghosa), le canon biblique et la traduction chrétienne?
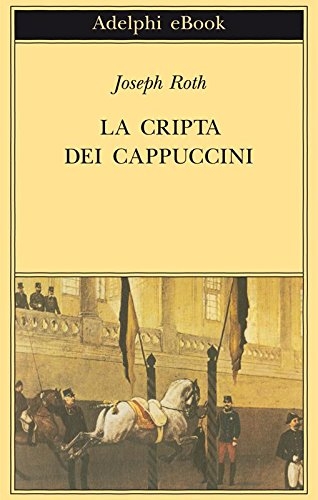

Dans ce dernier domaine, la maison Adelphi de Calasso a publié des versions éditées et commentées du Livre de Job, "nourriture, vêtement et baume pour ma pauvre âme" pour Soren Kierkegaard, et du Cantique des Cantiques de Saint François, en confiant l'édition au philosophe Guido Ceronetti, répondant avec la simplicité de la sagesse antique aux appels pompeux de l'hégémonie culturelle de l'époque ?
La redécouverte de Nietzsche
Calasso était un éditeur, mais aussi une énigme. On peut se demander si, en fin de compte, il n'a pas fait tout cela juste pour s'amuser. Pour le plaisir intellectuel de montrer que la culture est la culture, sans adjectifs, et par conséquent de se moquer des guerres tribales mises en scène par les "hégémons", les fidèles des partis et les écrivains du courant dominant. Profondeur et simplicité se rejoignent là où les auteurs "Adelphistes", les frères unis dans une vision culturelle commune, laissent leur empreinte en montrant les risques inhérents à un catalogage excessif des œuvres littéraires dans des schémas idéologiques et politiques. Irrévérencieux à l'égard des censeurs qui entendaient biffer des auteurs tels que Ernst Junger, qu'il a porté à l'attention du public italien à juste titre, Calasso a pu construire son opera omnia en restituant Friedrich Nietzsche à la culture italienne, dont la traduction presque intégrale représente une opération visant à rendre une justice culturelle et philologique à la mémoire d'un auteur controversé, trop souvent mal interprété dans notre contexte national.
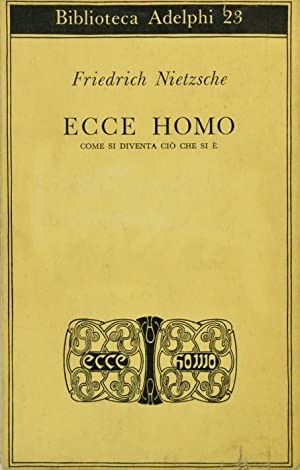
En particulier, dans la traduction et le commentaire de l'Ecce Homo de Nietzsche, qu'il réalise en 1969 à l'âge de 28 ans, on retrouve toute la curiosité, le flair et le sens culturel de Calasso. Comme pour s'acquitter d'une dette envers le grand philosophe rococo, Calasso traduit l'œuvre et la commente pour inverser la traditionnelle interprétation "dégénérative", en lisant, en fin de compte, dans le "Christ ou Dionysos ?" avec lequel se termine l'œuvre la plus autobiographique de Nietzsche, non pas la question irrésolue devant le déclin de son esprit mais le grand dilemme existentiel de l'homme contemporain, dont le démêlage est peut-être le grand don du penseur allemand. Il était conscient que l'Europe du 20e siècle serait perpétuellement imprégnée du dualisme entre sa vocation traditionnelle et un mouvement systémique vers l'entropie. Le fait même de rendre justice à la traduction littérale du terme "Übermensch", en balayant les éventuels qualificatifs obscurs inhérents au sulfureux "Superman", témoigne d'une telle attention et d'un tel soin pour les détails culturels et la pensée d'un auteur, même décédé, que cela dénote le profond respect de Calasso pour toutes les formes d'expression culturelle. Comme un véritable intellectuel libre. Capable de s'adresser au monde dans plusieurs langues, dans plusieurs styles et dans plusieurs modes d'expression. Avec la force perturbatrice des livres.
Source: https://it.insideover.com/societa/da-nietzsche-alla-mitteleuropa-luniverso-culturale-di-roberto-calasso.html
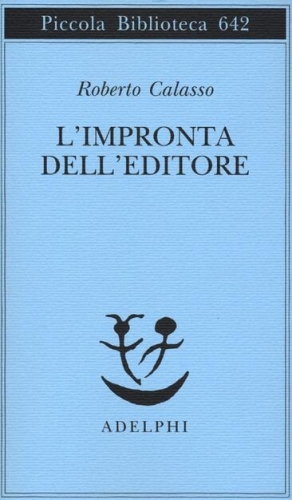
11:39 Publié dans Actualité, Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : édition, éditeurs, roberto calasso, italie, hommage, actualité, littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Tocqueville et Gobineau : entretiens sur notre décadence
par Nicolas Bonnal
J’ai beaucoup écrit et publié sur la Fin de l’Histoire. La notion est aristocratique : Chateaubriand, Tocqueville et Poe qui abominait la démocratie (voyez ses Entretiens avec une momie). J’ai enfin trouvé la correspondance de Tocqueville et Gobineau, qui évoquent tous les deux ce point expliqué au même moment par le mathématicien et historien Cournot. Le Second Empire c’est la prostration de notre histoire: étatisme, malthusianisme, chauvinisme et consumérisme.
Gobineau a travaillé jeune sous les ordres de Tocqueville. Ce dernier abomine ses théories mais le rejoint dans une certaine dimension, comme on verra tout à l’heure. Il écrit le 11 octobre 1853 :
« Je ne vous ai jamais caché, du reste, que j’avais un grand préjugé contre ce qui me paraît votre idée mère, laquelle me semble, je l’avoue, appartenir à la famille des théories matérialistes et en être même un des plus dangereux membres, puisque c’est la fatalité de la constitution appliquée non plus à l’individu seulement, mais à ces collections d’individus qu’on nomme des races et qui vivent toujours. »
Sur le racisme il dénonce un risque matérialiste et note le 17 novembre 1853 :
« Ainsi, vous parlez sans cesse de races qui se régénèrent ou se détériorent, qui prennent ou quittent des capacités sociales qu’elles n’avaient pas par une infusion de sang différent, je crois que ce sont vos propres expressions. Cette prédestination-là me paraît, je vous l’avouerai, cousine du pur matérialisme… »

En bon visionnaire humaniste, il pressent une doctrine horrible et dangereuse :
« Encore, si votre doctrine, sans être mieux établie que la leur, était plus utile à l’humanité ! Mais c’est évidemment le contraire. Quel intérêt peut-il y avoir à persuader à des peuples lâches qui vivent dans la barbarie, dans la mollesse ou dans la servitude, qu’étant tels de par la nature de leur race il n’y a rien à faire pour améliorer leur condition, changer leurs mœurs ou modifier leur gouvernement ? Ne voyez-vous pas que de votre doctrine sortent naturellement tous les maux que l’inégalité permanente enfante, l’orgueil, la violence, le mépris du semblable, la tyrannie et l’abjection sous toutes ses formes ? »
Tocqueville, 14 janvier 1857, écrira encore sur ce racisme honni par le christianisme :
« Le christianisme a évidemment tendu à faire de tous les hommes des frères et des égaux. Votre doctrine en fait tout au plus des cousins dont le père commun n’est qu’au ciel ; ici-bas, il n’y a que des vainqueurs et des vaincus, des maîtres et des esclaves par droit de naissance, et cela est si vrai que vos doctrines sont approuvées, citées, commentées, par qui ? par les propriétaires de nègres et en faveur de la servitude éternelle qui se fonde sur la différence radicale de la race.
Je sais que, à l’heure qu’il est, il y a dans les Etats-Unis du Sud des prêtres chrétiens et peut-être de bons prêtres (propriétaires d’esclaves pourtant) qui prêchent en chaire des doctrines qui, sans doute, sont analogues aux vôtres. »
Et, comme s’il annonçait Vatican II : « le gros des chrétiens ne peut pas éprouver la moindre sympathie pour vos doctrines. »
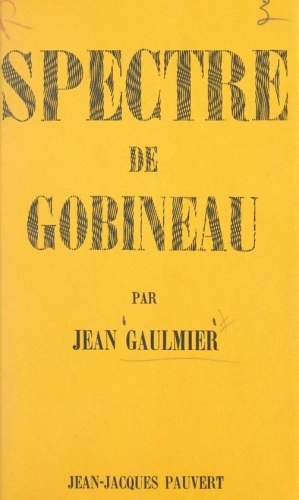
Mais il y a des accointances entre les deux esprits : la fatigue du monde. Tocqueville donc reprend son approche pessimiste et triste (le troupeau, la puissance tutélaire et douce) ; et cela donne un certain 20 décembre 1853 :
« Le siècle dernier avait une confiance exagérée et un peu puérile dans la puissance que l’homme exerçait sur lui-même et dans celle des peuples sur leur destinée. C’était l’erreur du temps ; noble erreur après tout, qui, si elle a fait commettre bien des sottises, a fait faire de bien grandes choses, à côté desquelles la postérité nous trouvera très petits. La fatigue des révolutions, l’ennui des émotions, l’avortement de tant d’idées généreuses et de tant de vastes espérances nous ont précipités maintenant dans l’excès opposé. »
Le monde est déjà fatigué ; idée essentielle chez Gobineau qui recherche une explication raciale (on la retrouve chez Günther). Mais Ibn Khaldun avait déjà tout dit, et cent fois mieux, sur le sujet : voyez mes trois textes sur le maître de Tunis et celui sur Glubb. Tocqueville et la fatigue des enfants du siècle :
« …Nous croyons aujourd’hui ne pouvoir rien et nous aimons à croire que la lutte et l’effort sont désormais inutiles et que notre sang, nos muscles et nos nerfs seront toujours plus forts que notre volonté et notre vertu. C’est proprement la grande maladie du temps, maladie tout opposée à celle de nos parents. »
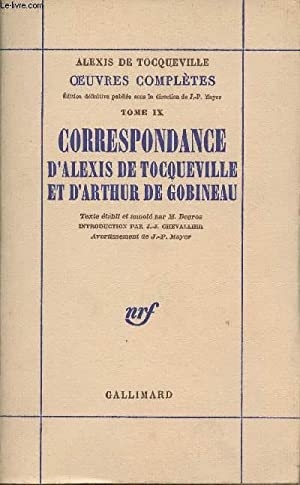
15 octobre 1854 : la parole est à Gobineau, qui évoque comme Musset cette lassitude du monde (qu’on retrouve chez Maurice Joly…) :
« Ensuite, je suis si convaincu que l’hébétement actuel des esprits est, d’une part, universel, dans tous les pays, de l’autre sans remède, sans ressource et en croissance indéfinie, qu’il n’y a, pour moi, que deux partis à prendre, ou me jeter à l’eau, ou suivre mon chemin sans m’occuper nullement de ce qu’on appelle l’opinion publique. Je me suis arrêté au second point et ne prends souci que de quelques centaines d’esprits qui se tiennent encore vivants au-dessus de l’atonie générale. »
Le moins qu’on puisse est que cet oublié a fait du bruit ensuite, et que les décadents occidentaux se sont bien ranimés dans la première moitié du siècle suivant…
Tocqueville taquine son subordonné alors :
« Vous voilà au cœur du monde asiatique et musulman ; je serais bien curieux de savoir à quoi vous attribuez la rapide et en apparence inarrêtable décadence de toutes les races que vous venez de traverser, décadence qui a déjà livré une partie et les livrera toutes à la domination de notre petite Europe qu’elles ont fait tant trembler autrefois. Où est le ver qui ronge ce grand corps ? Les Turcs sont des soudards…(13 novembre 1855). »
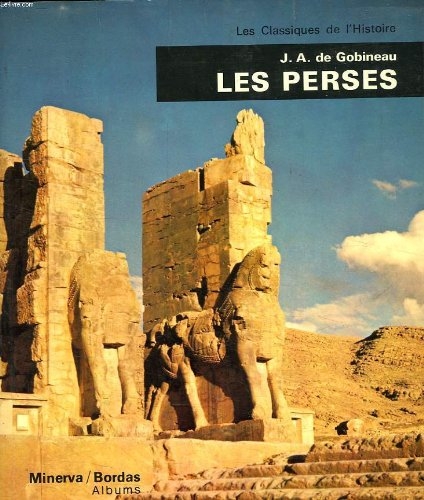
Gobineau adore Téhéran (où il est en poste) et ces Persans (derniers Aryens pêchus avec nos Afghans ?) qui donnent depuis Montesquieu tant de fil à retordre à nos thalassocraties occidentales. Et le 20 Mars 1856 Gobineau prend sa revanche :
« Allez tourmenter les Chinois chez eux, achevez la Turquie, entraînez la Perse dans votre mouvement, tout cela est possible, bien plus, inévitable. Je n’y contredis pas, mais, au bout de compte, les causes de votre énervement s’accumulent et s’accumuleront par toutes ces actions mêmes et il n’y a plus personne au monde pour vous remplacer quand votre dégénération sera complète. »
Dans une longue et belle missive (30 juillet 1856) Tocqueville retourne à sa mélancolie : c’est la fin des forces de l’Esprit…
« Vous vous plaignez avec raison du silence qu’on garde en France sur votre livre. Mais vous auriez tort de vous en affecter, car la raison principale naît de causes très générales que je vous ai déjà indiquées, et qui ne sont pas de nature à vous diminuer personnellement en rien. Il n’y a place aujourd’hui en France à aucune attention durable et vive pour une œuvre quelconque de l’esprit. Notre tempérament, qui a été si littéraire, pendant deux siècles surtout, achève de subir une transformation complète qui tient à la lassitude, au désenchantement, au dégoût des idées, à l’amour du fait et enfin aux institutions politiques qui pèsent comme un puissant soporifique sur les intelligences. »
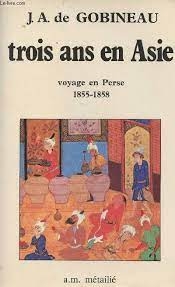 On est déjà sous la Ve république :
On est déjà sous la Ve république :
« La classe qui en réalité gouverne, ne lit point et ne sait pas même le nom des auteurs ; la littérature a donc entièrement cessé de jouer un rôle dans la politique, et cela l’a dégradée aux yeux de la foule. »
Mais Tocqueville (quel voyant tout de même) voit quel peuple va lire et aimer Gobineau :
« Les Allemands, qui ont seuls en Europe la particularité de se passionner pour ce qu’ils regardent comme la vérité abstraite, sans s’occuper de ses conséquences pratiques, les Allemands peuvent vous fournir un auditoire véritablement favorable, et dont les opinions auront tôt ou tard du retentissement eu France, parce que de nos jours tout le monde civilisé ne forme qu’un pays. Chez les Anglais et les Américains, si on s’occupe de vous, ce sera dans des vues éphémères de parti. »
En Amérique Gobineau aura ses partisans ; parce que, lui explique le Maître :
« C’est ainsi que les Américains dont vous me parlez et qui vous ont traduit me sont très connus comme des chefs très ardents du parti antiabolitionniste. »
Enfin une lettre géniale de Gobineau, qui annonce Guénon et son Autorité spirituelle et pouvoir temporel. Gobineau écrit :
« Vous avez admirablement montré que la révolution française n’avait rien inventé et que ses amis comme ses ennemis ont également tort de lui attribuer le retour à la loi romaine, la centralisation, le gouvernement des comités, l’absorption des droits privés dans le droit unique de l’État, que sais-je encore ? L’omnipotence du pouvoir individuel ou multiple, et ce qui est pire, la conviction générale que tout cela est bien et qu’il n’y a rien de mieux. Vous avez très bien dit que la notion de l’utilité publique qui peut du jour au lendemain mettre chacun hors de sa maison, parce que l’ingénieur le veut, tout le monde trouvant cela très naturel, et considérant, républicain ou monarchique, cette monstruosité comme de droit social, vous avez très bien dit qu’elle était de beaucoup antérieure à 89 et, de plus, vous l’avez si solidement prouvé, qu’il est impossible aujourd’hui, après vous, de refaire les histoires de la révolution comme on les a faites jusqu’à présent. Bref, on finira par convenir que le père des révolutionnaires et des destructeurs fut Philippe le Bel. »
Qui dit mieux ? La montée de l’Etat, du bourgeois de Taine et de cette classe moyenne honnie par Guénon tancées en une seule phrase !
 Gobineau lit le livre de Tocqueville sur l’Ancien régime et la révolution (ô France sinistre, voyez mon coq hérétique) ; voici ses commentaires cruels :
Gobineau lit le livre de Tocqueville sur l’Ancien régime et la révolution (ô France sinistre, voyez mon coq hérétique) ; voici ses commentaires cruels :
« Il y a d’ailleurs, je l’avoue, quelque chose d’assez vil dans cette assemblée qui avait applaudi aux premières violences, à cette sotte comédie de la prise de la Bastille, à ces premiers massacres, à ces incendies de châteaux, pensant que tout cela ne l’atteindrait pas, et simplement parce qu’elle n’avait pas prévu que l’on couperait aussi la tête à ses membres. Vous pensez qu’on peut qualifier le mal qu’elle a fait du nom d’erreurs généreuses ? Pourquoi généreuses ? Je hais certainement plus les Montagnards que les Constituants, mais je ne sais s’ils méritent davantage le mépris, et quant aux Girondins, j’en suis sûr. »
Et il résume, assez génialement je dois dire, le présent perpétuel des Français (Lettre de Téhéran, le 29 novembre 1856) :
« Un peuple qui, avec la République, le gouvernement représentatif ou l’Empire, conservera toujours pieusement un amour immodéré pour l’intervention de l’Etat en toutes ses affaires, pour la gendarmerie, pour l’obéissance passive au collecteur, au (illisible), à l’ingénieur, qui ne comprend plus l’administration municipale, et pour qui la centralisation absolue et sans réplique est le dernier mot du bien, ce peuple-là, non seulement n’aura jamais d’institutions libres, mais ne comprendra même jamais ce que c’est. Au fond, il aura toujours le même gouvernement sous différents noms…
Tocqueville résume alors la France moderne (16 septembre 1858) :
« Voilà ce qui m’attriste et ce qui m’inquiète, parce que le fait est nouveau et que, par conséquent, il est impossible encore de prévoir quelle sera sa durée. Il tient, je crois, en partie à l’extrême fatigue des âmes et aux nuages qui remplissent et alanguissent tous les esprits. Il faut de fortes haines, d’ardents amours, de grandes espérances et de puissantes convictions pour mettre l’intelligence humaine en mouvement et, pour le quart d’heure, on ne croit rien fortement, on n’aime rien, on ne hait rien et on n’espère rien que de gagner à la Bourse. »
Cela tombe bien, le CAC remonte et la presse est contente du prince-président.
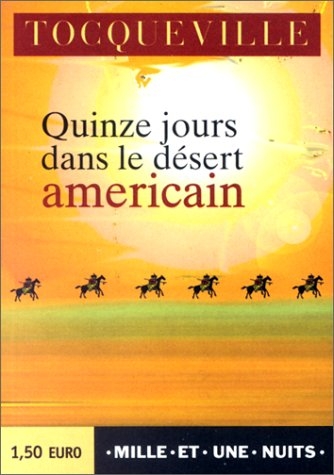 Soyons ironiques pour terminer. Voici ce que Tocqueville écrit du métis dans ses Quinze jours dans le désert (un des textes les plus beaux qui soient ; on y reviendra) :
Soyons ironiques pour terminer. Voici ce que Tocqueville écrit du métis dans ses Quinze jours dans le désert (un des textes les plus beaux qui soient ; on y reviendra) :
« Enfant des deux races, élevé dans l’usage de deux langues, nourri dans des croyances diverses et bercé dans des préjugés contraires, le métis forme un composé aussi inexplicable aux autres qu’à lui-même. Les images du monde, lorsqu’elles viennent se réfléchir sur son cerveau grossier, ne lui apparaissent que comme un chaos inextricable, dont son esprit ne saurait sortir. Fier de son origine européenne, il méprise le désert, et pourtant il aime la liberté sauvage qui y règne; il admire la civilisation, et ne peut complètement se soumettre à son empire. Ses goûts sont en contradiction avec ses idées, ses opinions avec ses mœurs. Ne sachant comment se guider au jour incertain qui l’éclaire, son âme se débat péniblement dans les langes d’un doute universel : il adopte des usages opposés, il prie à deux autels, il croit au rédempteur du monde et aux amulettes du jongleur, et il arrive au bout de sa carrière sans avoir pu débrouiller le problème obscur de son existence. »
Ce métis, c’est notre petit français postmoderne, non ?
Sources:
https://fr.wikisource.org/wiki/Correspondance_entre_Alexi...
https://fr.wikisource.org/wiki/Correspondance_entre_Alexi...
http://www.dedefensa.org/article/ibn-khaldun-et-le-modele...
https://www.dedefensa.org/article/sir-john-glubb-et-la-de...
https://www.amazon.fr/Chroniques-sur-lHistoire-Nicolas-Bo...
https://www.dedefensa.org/article/maurice-joly-et-le-gouv...
00:05 Publié dans Histoire, Littérature, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : tocqueville, alexis de tocqueville, gobineau, arthur de gobineau, 19ème siècle, france, histoire, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Georges Bernanos et la fin du réflexe de liberté chez les modernes
par Nicolas Bonnal
De son splendide pamphlet anticapitaliste et antimoderne « La liberté pourquoi faire ? » extrayons ces perles :
Bernanos redéfinit l’optimiste : « L’optimisme est un ersatz de l’espérance, dont la propagande officielle se réserve le monopole. Il approuve tout, il subit tout, il croit tout, c’est par excellence la vertu du contribuable. Lorsque le fisc l’a dépouillé même de sa chemise, le contribuable optimiste s’abonne à une Revue nudiste et déclare qu’il se promène ainsi par hygiène, qu’il ne s’est jamais mieux porté. Neuf fois sur dix, l’optimisme est une forme sournoise de l’égoïsme, une manière de se désolidariser du malheur d’autrui. Au bout du compte, sa vraie formule serait plutôt ce fameux « après moi le déluge », dont on veut, bien à tort, que le roi Louis XV ait été l’auteur. L’optimisme est un ersatz de l’espérance, qu’on peut rencontrer facilement partout, et même, tenez par exemple, au fond de la bouteille. »
Bernanos distingue optimisme et espérance :
« L’optimisme est une fausse espérance à l’usage des lâches et des imbéciles. L’espérance est une vertu, virtus, une détermination héroïque de l’âme. La plus haute forme de l’espérance, c’est le désespoir surmonté. […] Mais l’espérance se conquiert. On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers la vérité, au prix de grands efforts et d’une longue patience. Pour rencontrer l’espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu’au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. »
L’homme n’est pas un animal politique (on sait vite comment cela dégénère, surtout en ce moment) ; il est surtout un animal susceptible d’être sauvé, malgré son matérialisme et sa bestialité :

« L’homme, comme tout autre animal, ne vit que pour son bien-être, il n’y a rien pour lui qui soit plus précieux que la vie, et rien dans la vie qui ne soit plus précieux que la jouissance. Ce n’est souvent que trop vrai, soit. Mais si ce n’est pas vrai une fois sur cent, ou sur cent mille, ou sur un million, cela suffirait pour prouver que l’homme est un être capable de se dépasser lui-même, et dès lors le monde capitaliste ou marxiste ne peut plus être qu’une expérience faussée, puisqu’elle part d’une définition fausse de l’homme. »
Comme Virgil Gheorghiu (voyez mon texte sur la Vingt-cinquième heure et les esclaves mécaniques), Bernanos remarque nous payons cher notre inféodation à la technique (voyez smartphone et QR phone) :
« Car la machine est essentiellement l’instrument de la collectivité, le moyen le plus efficace qui puisse être mis à la disposition de la collectivité pour contraindre l’individu réfractaire, ou du moins le tenir dans une dépendance étroite. Quand les machines distribuent à tous la lumière et la chaleur, par exemple, qui contrôle les machines est maître du froid et du chaud, du jour et de la nuit. Sans doute, cela vous paraît très naturel. Vous haussez les épaules en vous disant que je veux en revenir à la chandelle. Je n’en veux nullement revenir à la chandelle, je désire seulement vous démontrer que les machines sont entre les mains du collectif une arme effrayante, d’une puissance incalculable. »
Ensuite notre grande âme annonce le contrôle aisé des cerveaux :
« […] Si vous n’y prenez garde, un jour viendra où les méthodes actuelles de la propagande paraîtront ridiculement désuètes, inefficaces. La biologie permettra d’agir directement sur les cerveaux, il ne s’agira plus de confisquer la liberté de l’homme, mais de détruire en lui jusqu’aux derniers réflexes de la liberté. […] »
C’est que l’homme moderne n’aime pas la liberté et qu’il est diablement simplifié (liberté, connecté, voter et consommer) :
« Des millions et des millions d’hommes dans le monde, depuis vingt ans, ne se sont pas seulement laissé arracher par la force la liberté de pensée, ils en ont fait, ils en feront encore, comme en Russie, l’abandon volontaire, ils considèrent ce sacrifice comme louable. Ou plutôt, ce n’est pas un sacrifice pour eux, c’est une habitude qui simplifie la vie. Et elle la simplifie terriblement, en effet. Elle simplifie terriblement l’homme. Les tueurs des régimes totalitaires se recrutent parmi ces hommes terriblement simplifiés. »

Poussant plus loin Gustave Le Bon Bernanos décrit la masse moderne, fasciste, libérale ou communiste, et il voit poindre un isolé groupe d’hommes libres :
« Les masses sont de plus en plus faites non pas d’hommes unis par la conscience de leurs droits et la volonté de les défendre, mais d’hommes de masse faits pour subsister en masse dans une civilisation de masse où le moindre petit groupe dissident d’hommes libres serait considéré comme une grave rupture d’équilibre, une menace de catastrophe, une espèce de lézarde, de fissure capable d’entraîner brusquement la chute de tout l’édifice. La dictature des masses n’est nullement la libération des masses. »
On rigole, mais seuls les saints pourront nous sauver, rappelle le Grand Georges :
« C’est la sainteté, ce sont les saints qui maintiennent cette vie intérieure sans laquelle l’humanité se dégradera jusqu’à périr. C’est dans sa propre vie intérieure en effet que l’homme trouve les ressources nécessaires pour échapper à la barbarie, ou à un danger pire que la barbarie, la servitude bestiale de la fourmilière totalitaire. »
Source:
Georges Bernanos, La liberté pourquoi faire ?
10:48 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : liberté, modernité, nicolas bonnal, georges bernanos, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Paul Nizan et le caractère technocratique de notre tyrannie bourgeoise
par Nicolas Bonnal
Nous sommes dirigés par des bourgeois, nous le savons grâce aux gilets jaunes maintenant. Même volage libertin, le « bourgeois sauvage », comme j’écrivais jadis, type Valls ou Hollande, sera sans pitié pour les questions de pognon et de mondialisation, et il le sera d’autant plus qu’il est préoccupé de questions de migrations, de climat, de régionalisme ultra ou de pollution. Il est humanitaire, donc plus moral que le peuple qu’il exploite et méprise. Soros, Rothschild, Macron, BHL, Pinault, les larbins surpayés de la télé et tutta quo sont des bourgeois qui estiment valoir plus que nous, en termes matériels, mais aussi moraux. Ils s’arrogent donc le droit de nous remplacer. Et ils ont gardé, avec leur modèle anglo-saxon, comme ennemi de toujours, la Russie, qui, tzariste, communiste ou orthodoxe-démocrate, a le pouvoir de les rendre fous.
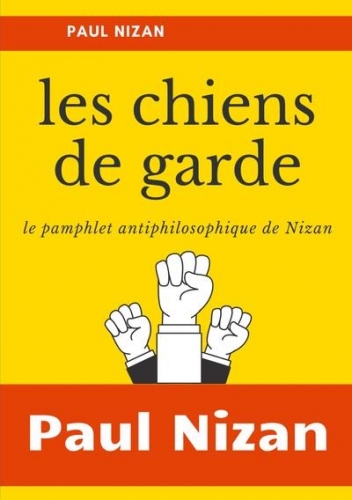
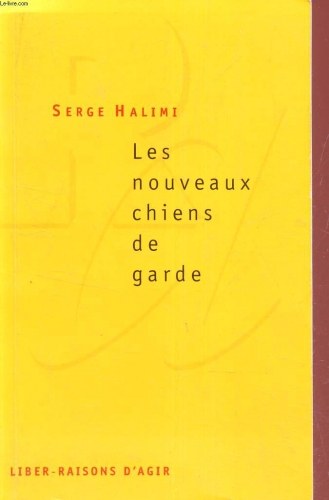
On en reviendra à Paul Nizan que j’ai enfin découvert en relisant les Nouveaux chiens de garde de Serge Halimi. Halimi a très bien décrit la déviance du journaliste de marché dans son livre bourré de notes, mais il a omis de rendre un hommage au livre de Nizan (voyez wikisource), qui est un chef-d’œuvre.
Le bourgeois exploite certes, et il aime les hommes, mais à distance. C’est pourquoi il n’aime pas son prochain. Le milliardaire américain conchie les déplorables, le milliardaire européen conchie son gilet jaune et le fait coffrer en lançant une énième chasse au terroriste invisible.
Nizan donc :
« Le bourgeois est un homme solitaire. Son univers est un monde abstrait de machineries, de rapports économiques, juridiques et moraux. Il n’a pas de contact avec les objets réels : pas de relations directes avec les hommes. Sa propriété est abstraite. Il est loin des événements. Il est dans son bureau, dans sa chambre, avec la petite troupe des objets de sa consommation : sa femme, son lit, sa table, ses papiers, ses livres. »
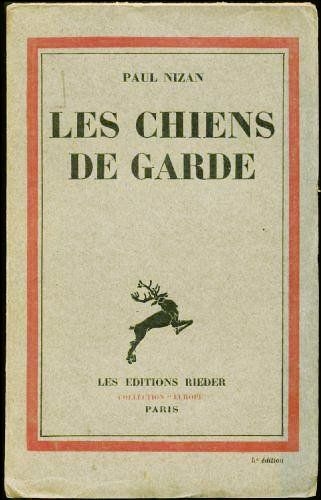 Jusque-là on est au dix-neuvième siècle. Après Nizan se montre visionnaire. Le bourgeois-Jules-Verne, coincé dans son avion, son building ou son condominium, voit le monde comme une émission de télé-réalité. Comme dans le sketch des Guignols qui nous montrait un Balladur effrayé de ces gens qu’il voyait des fois à la télé, et qui étaient des Français… Nizan annonce ici Debord et sa société du spectacle, il annonce aussi le monde des écrans où tout est vu à distance :
Jusque-là on est au dix-neuvième siècle. Après Nizan se montre visionnaire. Le bourgeois-Jules-Verne, coincé dans son avion, son building ou son condominium, voit le monde comme une émission de télé-réalité. Comme dans le sketch des Guignols qui nous montrait un Balladur effrayé de ces gens qu’il voyait des fois à la télé, et qui étaient des Français… Nizan annonce ici Debord et sa société du spectacle, il annonce aussi le monde des écrans où tout est vu à distance :
« Tout ferme bien. Les événements lui parviennent de loin, déformés, rabotés, symbolisés. Il aperçoit seulement des ombres. Il n’est pas en situation de recevoir directement les chocs du monde. Toute sa civilisation est composée d’écrans, d’amortisseurs. D’un entrecroisement de schémas intellectuels. D’un échange de signes. Il vit au milieu des reflets. Toute son économie, toute sa politique aboutissent à l’isoler. »
Charles Gave rappelait récemment que le bourgeois bobo adore l’humanité mais qu’il déteste les Français. Chez Nizan cela donne déjà ça :
« La société lui apparaît comme un contexte formel de relations unissant des unités humaines uniformes. La Déclaration des Droits de l’Homme est fondée sur cette solitude qu’elle sanctionne. Le bourgeois croit au pouvoir des titres et des mots, et que toute chose appelée à l’existence sera, pourvu qu’elle soit désignée : toute sa pensée est une suite d’incantations. Et en effet pour un homme qui n’éprouve pas effectivement le contact de l’objet, par exemple les malheurs de l’injustice, il suffit de croire que la Justice sera : elle existe déjà pour lui dès qu’il la pense. Il n’y a pas un écart douloureux entre ce qu’il éprouve et ce qu’il pense. »
Le bourgeois est dans l’abstraction. Au dix-neuvième on se fout en Grande-Bretagne de la famine irlandaise (trois millions de morts) mais on veut abolir l’esclavage en Amérique. John Hobson parlait d’inconsistance dans son classique sur l’impérialisme occidental : vers 1900, 90% des sanglantes conquêtes coloniales avaient des alibis humanitaires, comme aujourd’hui.
Nizan encore :
« Car sa vie n’est pas moins abstraite et solitaire que sa pensée. Un abîme ne sépare point son être privé et sa personne morale. Les Droits de l’Homme expriment assez complètement le peu de réalité qu’il possède. Marx a donné des descriptions admirables de cet Homme bourgeois « membre imaginaire d’une souveraineté imaginaire, dépouillé de sa vie réelle et individuelle et rempli d’une généralité irréelle ».
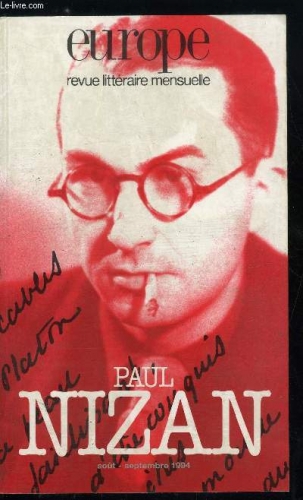
Le bourgeois crée une série d’êtres abstraits avec le transgenre et le reste, et de problèmes abstraits pour éviter de parler des questions qui fâchent, comme le fait qu’1% des gens détiennent 93% des richesses mondiales (80% selon le Figaro, mais pourquoi chicaner avec la presse-Dassault ?), ou que vingt-sept Français possèdent plus que trente-deux millions... Quand on sait que les premiers aiment les domestiques non déclarés, les éoliennes et les évasions fiscales, sans oublier l’art contemporain le plus putréfié (lisez Tolstoï qui le sentait venir), on comprend mieux nos problèmes, surtout qu’ils contrôlent les médias et ont fait élire leur falote et efféminée marionnette à l’Elysée en profitant de la fin, dangereuse pour eux à long terme, du binôme bouffon droite-gauche.
Puis Nizan décrit comment le bourgeois devient dangereux. La technologie est venue pour servir ses desseins, le cancer technologique dont nous parle Philippe Grasset dans plusieurs livres inspirés.
« Dans son univers où rien n’arrive réellement, il doit avoir, pour continuer à vivre, l’illusion qu’il se passe quelque chose. Mais l’intelligence est justement le seul élément de l’homme qui puisse se développer pour soi. La pauvreté réelle de la vie bourgeoise permit aux jeux de l’esprit une prolifération autonome. L’intelligence bourgeoise se développa comme un cancer.Ce que le bourgeois ne trouvait pas dans la pratique véritable de la vie humaine, il dut le remplacer par quelque chose qui était au dedans de lui, qui lui permettait malgré tout de s’affirmer qu’il vivait. »
On répètera cette phrase apocalyptique : « L’intelligence bourgeoise se développa comme un cancer. » Et cela donne dans les hautes sphères bureaucratiques le besoin de faire envahir l’Europe, de fracasser le monde arabe, de démolir la Chine ou la Russie, et de nous mettre sans rire aux énergies non polluantes tout en prenant l’avion cent fois par an.
Car on se doute que le destin de l’ère bourgeoise n’est pas de finir en despotisme éclairé. Découvrez Paul Nizan en tout cas, le penseur obscur qui a mis le doigt ou cela fait le plus mal : le bourgeois est prétentieux, il se la pète, il est content de lui alors qu’il commet toutes les injustices de la terre, que ce soit aujourd’hui en province, au Yémen, en Grèce ou en Palestine :
« Ne parlent-ils pas de Liberté, de Justice, de Raison, de Communion ? Ne se mettent-ils point sans cesse dans la bouche les mots d’Humanisme et d’Humanité ? Ne savent-ils point que leur mission est d’éclairer et d’aider les hommes ? C’est ainsi qu’ils font la théorie de la pratique bourgeoise, qu’ils font la métaphysique de l’univers auquel le bourgeois tient : le bourgeois fut toujours un homme qui justifiait son jeu temporel par le rappel de sa mission spirituelle. Le bourgeois sait. Ses fonctions économiquement, politiquement dirigeantes exigent d’être complétées et garanties par des fonctions spirituellement dirigeantes. »
Tout cela rappelle l’effarant Maurice Godelier, universitaire-anthropologue-concepteur de la théorie du genre, et qui avoue « être fonctionnaire au service de l’Humanité »…
Nizan sur notre omniprésente racaille philanthrope :
« Le bourgeois est conseiller et il est protecteur. Il incline à la philanthropie. Il fonde des dispensaires. Des crèches. Noblesse obligeait. Bourgeoisie oblige. »
Les sources principales :
Paul Nizan – les chiens de garde (wikisource.org)
Serge Halimi – les nouveaux chiens de garde (raisons d’agir)
Nicolas Bonnal – la culture comme arme de destruction massive, Céline pacifiste enragé (Amazon.fr)
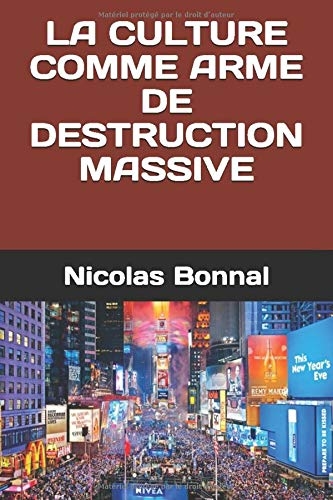
Guy Debord – Commentaires sur la Société du Spectacle
http://www.bvoltaire.fr/bourgeoisie-barbare-hait-populo-r...
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Gouverner-par-le-c...
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2018/01/15/tocquevill...
12:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul nizan, nicolas bonnal, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
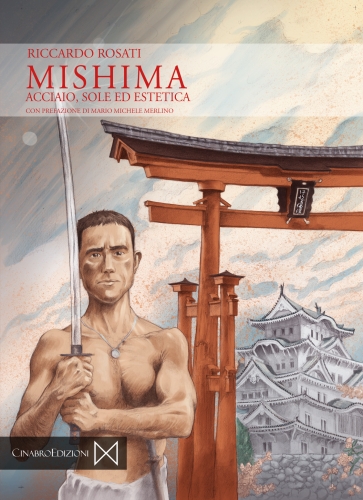
"Mishima, l'univers d'un esthète armé"
Le professeur Riccardo Rosati, interviewé par Michele De Feudis, analyse les multiples facettes de l'artiste japonais entre littérature, art et discipline martiale.
Propos recueillis par Michele De Feudis
https://www.barbadillo.it/97112-mishima-luniverso-di-un-esteta-armato/
Professeur Riccardo Rosati, Yukio Mishima est considéré comme un "esthète armé". A quoi doit-on cette interprétation ?
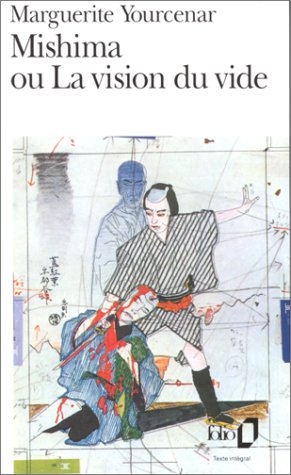 "Mishima, pour reprendre la précieuse définition qu'en donne Marguerite Yourcenar dans son excellent Mishima ou la Vision du vide (1980), est un "univers" dans lequel, en fait, le côté esthétique - je l'explique dans mon livre - joue un rôle prépondérant. À cet élément, le grand intellectuel et écrivain japonais a ajouté la discipline martiale/militaire, sous le signe de la redécouverte d'un héritage capital de cette culture japonaise traditionnelle à laquelle il s'est référé, dans la " deuxième partie " de sa vie, avec vigueur et rigueur ; à savoir le Bunbu Ryōdō (文武両道, la Voie de la vertu littéraire et guerrière), où la plume devient métaphoriquement une épée.
"Mishima, pour reprendre la précieuse définition qu'en donne Marguerite Yourcenar dans son excellent Mishima ou la Vision du vide (1980), est un "univers" dans lequel, en fait, le côté esthétique - je l'explique dans mon livre - joue un rôle prépondérant. À cet élément, le grand intellectuel et écrivain japonais a ajouté la discipline martiale/militaire, sous le signe de la redécouverte d'un héritage capital de cette culture japonaise traditionnelle à laquelle il s'est référé, dans la " deuxième partie " de sa vie, avec vigueur et rigueur ; à savoir le Bunbu Ryōdō (文武両道, la Voie de la vertu littéraire et guerrière), où la plume devient métaphoriquement une épée.
Heureusement, cette théorie a gagné du terrain dans l'exégèse de Mishima depuis un certain temps déjà, bien que plus à l'étranger qu'en Italie pour être honnête. Ce qu'il est essentiel de comprendre, cependant, c'est qu'il est parvenu à souder ces deux mondes, faisant de sa propre existence sa principale "œuvre d'art", du corps un temple et de l'écriture une forme sublime de lutte politique".
Comment avez-vous pris connaissance des écrits de Mishima ?
"'Quand j'étais à l'université. Même si j'étudiais la langue et la littérature anglaise et française, la fascination pour l'Empire du Soleil Levant était déjà dans mon cœur de garçon. Bien que pratiquant assidûment le karaté, je n'ai pas abordé les livres de Mishima pour des raisons évidentes et futiles. J'ai senti, avec les moyens grossiers que peut avoir un jeune étudiant universitaire, que cet auteur incarnait un certain type de Japon qui me semblait profondément "mien". C'est pourquoi, après avoir obtenu mon diplôme de feu l'IsIAO (Institut italien pour l'Afrique et l'Orient) à Rome, j'ai commencé à lui consacrer mes premiers articles universitaires. Ce n'était pas un sujet facile pour moi - rien n'est facile quand on a affaire à Mishima ! - mais sur lesquels je sentais que j'avais des concepts à exprimer.

Le Pavillon d'or à Kyoto, où Mishima a écrit un roman extraordinaire.
Quel itinéraire dans ses œuvres recommandez-vous ?
"Je ne pense pas qu'il y ait dans l'opus de Mishima une hiérarchie qui exige que certains volumes soient lus en premier et, comme je le soutiens dans la monographie que je lui ai consacrée, chacun de ses écrits fait partie d'un affluent qui revient invariablement, à la fin, à sa seule "source", Mishima lui-même. Je peux suggérer que l'on puisse choisir ses œuvres en fonction de ses goûts personnels : celles du combat politique ou celles qui ont une tournure plus autobiographique, sans pour autant négliger le côté purement romantique-sentimental, que l'on retrouve dans des romans comme Le tumulte des flots (潮騒, "Shiosai", 1954) ou La Musique (音楽, "Ongaku", 1964) ; dans ce dernier en particulier émerge un Mishima capable de pénétrer dans les profondeurs de la sphère psychologique féminine.
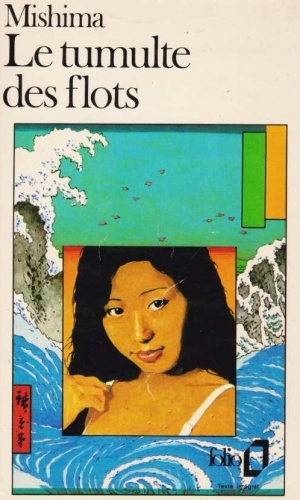

Néanmoins, il y a trois titres qui, en substance, représentent les moments saillants de son évolution artistique et personnelle. Je veux parler de Confessions d'un masque (仮面の告白, "Kamen no kokuhaku", 1949), imprégné des angoisses morales et sexuelles de sa jeunesse ; du Pavillon d'or (金閣寺, "Kinkakuji", 1956), dans lequel Mishima formule au plus haut niveau formel sa propre vision esthétique contrastée ; Le Soleil et l'acier ( 太陽と鉄, "Taiyō to tetsu", 1968), authentique manifeste idéologique de la dernière partie de son existence, ainsi que, à mon avis, un livre fondamental pour comprendre ce qu'il espérait pour sa personne et pour le Japon".
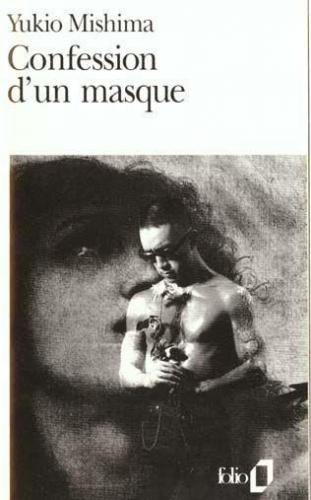


Y a-t-il des éléments dans Mishima qui le rapprochent de la figure publique de Gabriele D'Annunzio ?
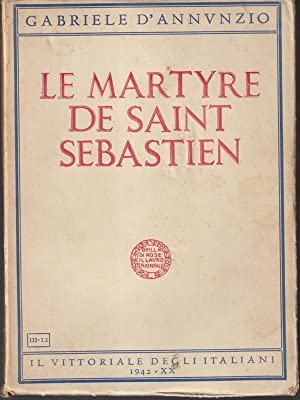 " Disons d'abord que Mishima était un admirateur du Vate, au point de traduire en 1965 l'une de ses œuvres : Le martyre de Saint Sébastien (1911). Outre la similitude immédiate de leurs personnalités, qui partagent une exaltation bien connue de l'action virile et de l'audace, il est utile de souligner qu'il existait également une proximité artistique entre les deux. Tous deux, bien qu'appartenant à des époques et des contextes culturels différents, relèvent de ce que les critiques littéraires appellent le "décadentisme". C'est-à-dire une déclinaison du romantisme où l'esthétique se greffe sur un "personnalisme" presque exagéré et, parfois, enclin à la désillusion, où apparaissent également des relents de dandysme.
" Disons d'abord que Mishima était un admirateur du Vate, au point de traduire en 1965 l'une de ses œuvres : Le martyre de Saint Sébastien (1911). Outre la similitude immédiate de leurs personnalités, qui partagent une exaltation bien connue de l'action virile et de l'audace, il est utile de souligner qu'il existait également une proximité artistique entre les deux. Tous deux, bien qu'appartenant à des époques et des contextes culturels différents, relèvent de ce que les critiques littéraires appellent le "décadentisme". C'est-à-dire une déclinaison du romantisme où l'esthétique se greffe sur un "personnalisme" presque exagéré et, parfois, enclin à la désillusion, où apparaissent également des relents de dandysme.
Malheureusement, le public ignore ou, pire encore, ne souhaite pas approfondir le côté purement artistique de ces deux somptueuses figures, préférant ne retenir que leur engagement politique. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude, même si je suis pleinement conscient qu'il s'agit de "l'attitude dominante".

Riccardo Rosati.
Mishima et les Jeux olympiques. Que ressort-il des Carnets, sujet auquel il consacre un chapitre dans le livre ?
"Je l'ai mentionné dans un article que j'ai écrit pour Barbadillo. On y découvre un nouveau Mishima, admirant les athlètes et la tension musculaire de leurs efforts. Cet aspect est cohérent avec la deuxième et dernière phase de sa vie et de sa pensée, celle dite du "fleuve de l'action", où le corps se transforme en œuvre d'art.
On retrouve un Mishima qui aime être journaliste pour des journaux (l'Asahi, le Hōchi et le Mainichi), suivant, entre autres disciplines, l'haltérophilie et le volley-ball. Le romancier s'est laissé envoûter par la ferveur sportive qui l'entourait, observant avec curiosité chaque geste, regard et émotion des athlètes : "Levant la main bien haut (il est 15h30), il se tenait près de la vasque olympique et semblait alors sourire", écrit-il de Yoshinori Sakai, le dernier porteur de la fameuse torche, le décrivant en train de s'approcher du brasero olympique lors de la cérémonie d'ouverture".

Le patriotisme au Japon : le témoignage de Mishima a-t-il eu un impact sur l'évolution de la culture japonaise ?
"Je suis désolé de l'admettre, mais non. Si le Soleil Levant avait eu ne serait-ce qu'un petit espoir de "se relever", je ne pense pas qu'il se serait tué. Dans son pays, il est considéré comme un grand auteur, même si peu de gens le lisent et que ses écrits font généralement l'objet de l'attention des chercheurs. Quant à son activité politique, elle est source d'embarras, comme c'est systématiquement le cas pour tous les Japonais qui ont choisi d'aller à contre-courant, et de ne pas se soumettre sans critique aux diktats d'une société souvent monolithique. En bref, Mishima est considéré comme un exemple à suivre uniquement à l'étranger. L'Archipel est progressivement devenu un pays frivole, voué à un consumérisme effréné et considérant ses traditions avec condescendance. La bande dessinée, le cinéma et la technologie sont des choses utiles et "agréables", mais ce n'était certainement pas le Japon que Mishima voulait faire revivre.

Y a-t-il de nouveaux documentaires qui ont vu le jour à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la mort de l'écrivain japonais ?
"Nous parlons de l'homme qui, avec Haruki Murakami, est l'auteur japonais le plus traduit au monde. De nombreux articles et essais ont été publiés sur Mishima, dont beaucoup sont d'un calibre considérable. Il ne reste donc pas grand-chose à découvrir, à l'exception de sa production théâtrale, qui n'a pas encore fait l'objet de traductions et de recherches adéquates. J'ajouterais qu'en Amérique, les critiques suivent une perspective biographique dans les études sur Mishima, alors qu'en France, au contraire, ils prêtent attention au côté artistique de ses œuvres - ce qui est ma propre approche - tandis qu'en Italie, ils ont encore tendance à évaluer essentiellement son "parcours politique".
Mishima n'est pas seulement un auteur japonais mais une personnalité fondatrice de l'archipel culturel non-conformiste. Quels auteurs ont poursuivi et poursuivent ses recherches héroïco-littéraires ?
"Au Japon" ? Aucun ! Avoir ce genre de profondeur humaine et de courage intellectuel, mélangé à un talent stupéfiant, est presque impossible à trouver chez une seule et même personne. N'oublions pas que les Japonais, mais c'est vrai pour tous les Extrême-Orientaux, sont un peuple très conformiste. Beaucoup plus honnêtes que nous, Occidentaux, bien sûr, mais peu enclins à des tentatives de rébellion ou d'individualisme. Mishima peut agir comme un stimulant, j'en suis absolument convaincu, pour quiconque, japonais ou non. Il faut cependant éviter les interprétations instrumentales ou les enthousiasmes non structurés. Nous parlons d'un personnage complexe qui est, à sa manière, un "univers", offrant ainsi de multiples facteurs à étudier et à analyser. L'important n'est pas d'en faire une sorte de Che Guevara de droite, d'en faire une icône intangible, alors qu'en fait c'était un homme qui aimait la vie, social et sociable, plein d'impulsions et non de haine".
Entretien réalisé par Michele De Feudis.
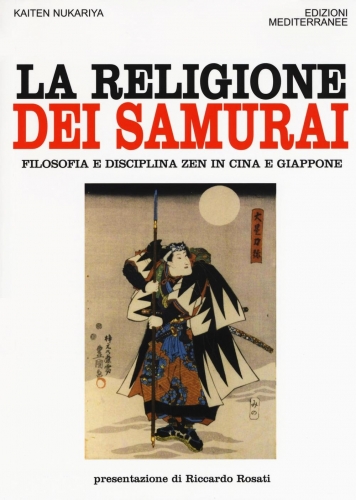
11:27 Publié dans Entretiens, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yukio mishima, entretien, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japaonaise, japon |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

"Ernst Jünger et les fulgurances d'un contemplateur solitaire"
Un entretien avec Luca Siniscalco, éditeur chez Bietti du livre de Nicolaus Sombart "Ernst Jünger. Un dandy dans les tempêtes d'acier".
Propos recueillis par Michele De Feudis
Ex: https://www.barbadillo.it/98602-ernst-junger-e-le-folgorazioni-di-un-contemplatore-solitario/
Luca Siniscalco, vous qui êtes spécialiste de la tradition et de la littérature allemandes, comment est né l'essai de Nicolaus Sombart sur Ernst Jünger ?
"Le petit volume Ernst Jünger. Un dandy nelle tempeste d'acciaio (= "Ernst Jünger. Un dandy dans les tempêtes d'acier") traduit une brève mais importante contribution de Nicolaus Sombart parue sous le titre Der Dandy im Forsterhaus (littéralement, "Le dandy dans la maison du forestier") dans le journal allemand Der Tagesspiegel du 29 mars 1995.
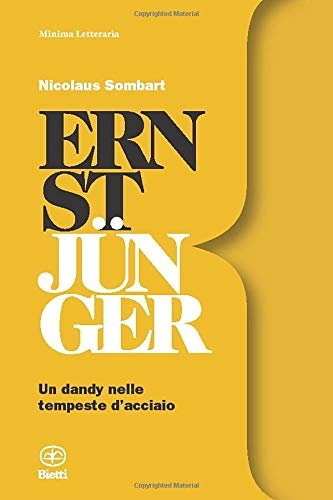
La version italienne que j'ai éditée, qui contient également une brève introduction au texte et une bibliographie essentielle de l'œuvre de Sombart, met à la disposition des lecteurs italiens une œuvre que l'auteur, qui s'est largement intéressé à la tradition révolutionnaire-conservatrice, quoique sous un angle essentiellement critique, tout au long de sa production d'essayiste, a conçue à l'occasion du centenaire d'Ernst Jünger (1895-1998) - et au moment même où Klett publiait le quatrième volume des journaux de Jünger intitulé Siebzig verweht.
Le texte de Sombart est donc une "mise au point" sur le Contemplateur solitaire, une esquisse "radiographique" d'un protagoniste fascinant et énigmatique du vingtième siècle, tout d'abord en raison de son caractère universel, au sein duquel toute définition possible est engloutie par sa fréquentation assidue des lieux "au mur du temps".
Pourquoi l'auteur définit-il Jünger comme la "conscience stylistique de l'Allemagne" ?
"Selon Sombart, Jünger est un auteur paradoxal - et pour cette raison même fécond - parce qu'il est déchiré par une dialectique interne entre l'identité allemande et le souffle "cosmopolite" international. Jünger est donc la "conscience stylistique de l'Allemagne", un "phénomène dans l'histoire de la littérature allemande", un "sismographe" (définition d'Ernst Niekisch, mais c'est Sombart lui-même qui la cite) de l'Allemagne moderne dans toutes ses transformations du 20ème siècle. "Plus que quiconque, il peut être décrit comme le chroniqueur d'un siècle d'histoire allemande - son siècle. Jünger est donc la forme, le type, l'archétype, le style - ça va sans dire au sens nietzschéen - de l'Allemagne. Dans le même temps, Jünger est toujours au-delà, épiant les domaines de cette superhistoire qui ne parle ni allemand, ni français, ni italien, ne connaissant que les silences de l'ineffable.

L'écriture de Sombart est intentionnellement consacrée à l'identification des tendances fondamentales de l'œuvre de Jüngler, qui se situe entre l'héritage allemand (lui-même le résultat de la conjonction de quatre idéaux-types, que Sombart considère, dans sa perspective d'adepte actuel des Lumières, avec une suspicion évidente: le militarisme aristocratique prussien, l'idéal de l'"Allemagne secrète", l'amour anti-moderne de la nature, le goût de l'insolite, qui se traduit par une passion pour la collection et le catalogage) et l'idéal "européen" et "international" du dandy. Sombart souligne que c'est le "dandysme" de Jünger qui apparaît comme son véritable trait dominant. C'est la quintessence d'une prise de pouvoir qui l'élève au-dessus du niveau du conteur allemand des bois et des prairies et qui fait de lui une superstar internationale. En cela, il surpasse ses rivaux Stefan George et Thomas Mann, qui, malgré tout leur talent, sont et restent des Allemands de province.
Quelle est la pertinence de la figure de l'écrivain allemand des Orages d'acier dans l'Allemagne d'aujourd'hui ?
Le succès, l'interprétation et " l'histoire des effets " de Jünger en Allemagne semblent comparables, pour autant que je sache, à son destin italien. Jünger est généralement connu comme un grand écrivain et un grand styliste - n'oublions pas qu'en 1982 il a remporté le prestigieux prix Goethe -, il a évoqué un petit cercle de "dévots" et d'enthousiastes, souvent liés à des cercles politiques conservateurs, pour les premiers, à des contextes de recherche académique (philosophique surtout) pour les seconds. Il reste un objet de suspicion au niveau de la vision anthropologico-politique et en vertu de son approche mythico-symbolique de la connaissance. Le destin d'un Anarque excentrique et inaccessible, que la modernité peine à métaboliser et préfère souvent marginaliser.
La Ernst und Friedrich Georg Jünger Gesellschaft, une association d'études dédiée aux frères Jünger, basée à Wilflingen, à laquelle j'ai le plaisir d'être associé, protège sa figure avec beaucoup de sérieux et de rigueur.
À l'heure du mondialisme, est-il possible de revenir à la vision de l'"État universel" développée par Jünger ?
"Ce n'est pas seulement possible, c'est nécessaire. C'est précisément parce que le statu quo exige des réponses capables de dépasser l'idée d'État-nation du 19ème siècle pour se tourner vers des perspectives continentales et futuristes que le texte de Jünger est plus que jamais d'actualité pour nous fournir des stimuli prospectifs.
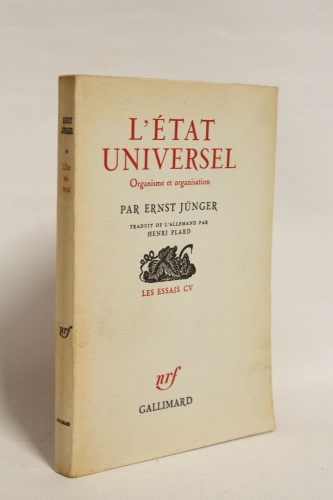
À première vue, l'enquête de Jünger sur l'État universel semble confirmer les espoirs des mondialistes. En fait, si l'on lit attentivement l'essai, il apparaît clairement que l'approche de l'auteur est avant tout phénoménologique, c'est-à-dire descriptive et non normative. Le fait que nous soyons destinés à évoluer vers un État mondial ne fait aucun doute pour tout analyste avisé. Les puissances titanesques et telluriques dont la technologie et le capitalisme sont l'épiphénomène historique vont dans ce sens. Ainsi, "l'état du monde n'est pas simplement un impératif de la raison, à réaliser par l'action conséquente d'une volonté. Si c'était le cas, si ce n'était qu'un postulat logique ou éthique, tout irait mal pour nous à l'avenir. C'est aussi quelque chose qui arrive. Dans l'ombre qu'elle projette devant elle, les anciennes images s'effacent. Jünger semble probablement avoir négligé la réapparition récente, à la fin du 20ème siècle, des racines ethnico-religieuses, du "choc des civilisations" sur lequel Huntington avait attiré l'attention. Et pourtant, si sa prophétie politique, qui rejoint d'une certaine manière l'idée de la "fin de l'histoire", semble, du moins dans le présent, loin de se réaliser, il est indiscutable que l'État mondial s'est réellement affirmé dans notre for intérieur, au sein d'un globalisme subtilement envahissant, qui, grâce à un solutionnisme technique et à la fourniture d'une anthropologie de nivellement des masses, conquiert les consciences plutôt que les territoires.
L'homme a la tâche d'affronter cette tendance avec une posture et un style dignes (mais pas nécessairement statiques). Jünger évoque, une fois de plus, le style de l'Anarque, qui, par son pouvoir de transfiguration, impose sa propre forme à la chaîne des événements. Même l'État mondial, selon la thèse de Jünger, peut devenir un nouveau Heimat si, pour citer l'introduction perspicace de Quirino Principe à cet essai, "l'individu, dans un monde dépourvu de formes symboliques, en produit de nouvelles, privilégiant la liberté à l'organisation et à l'ordre".
@barbadilloit
propos recueillis par Michele De Feudis
21:08 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, livre, nicolaus sombart, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le futur entre Huxley et Orwell
par Carlo Desideri
Source : InStoria & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-futuro-tra-huxley-e-orwell
En 1932, l'écrivain Aldous Huxley a publié l'un de ses plus célèbres romans, Le meilleur des mondes, qui est devenu à terme l'un des textes les plus représentatifs du genre dystopique dans la littérature du XXe siècle. Le monde imaginé par Huxley est un monde régi par un gouvernement mondial, où les principes éthiques et moraux tels que nous les connaissons sont complètement annulés et oubliés au profit d'une société divisée en castes, qui indiquent de véritables classes sociales, dédiée à l'idéologie progressiste et maintenue fermement par un véritable culte religieux appelé "culte de Ford", en l'honneur de l'entrepreneur américain dont la figure est adorée comme une sorte de divinité.

Le monde est dirigé par un groupe oligarchique appelé "alpha plus", qui jouit de privilèges supérieurs à la moyenne, mais qui doit maintenir un code de conduite blindé, basé sur une socialisation poussée, un temps de solitude réduit au minimum, des relations centrées principalement sur la polygamie, et l'expression constante de louanges et d'appréciation de la société du nouveau monde ; la répudiation de ce système social n'est en aucun cas autorisée ou envisagée.
En fait, dans la deuxième partie du récit, Huxley nous montre comment une forme de l'ancienne société a survécu, dans une réserve contrôlée et gérée par le gouvernement du nouveau monde comme un véritable lieu touristique, où il est possible de rencontrer des sujets, appelés "les sauvages", qui vivent selon des règles totalement opposées au nouveau monde, dans une structure sociale monogame, qui croit fermement aux idéaux du mariage et qui est fortement liée à une croyance religieuse - au point de conduire à un véritable fanatisme - largement basée sur le christianisme, mais avec quelques éléments rituels rappelant le paganisme.
Il est important de noter que les membres du nouveau monde entrent en contact avec les habitants de la réserve en tant que simples touristes, mais ils les considèrent comme fortement inférieurs et n'ont aucunement l'intention de laisser ces individus influencer leur mode de vie. Ce ressentiment est toutefois également ressenti par les sauvages, qui considèrent le nouveau monde comme un fléau et méprisent les idéaux qu'il représente.
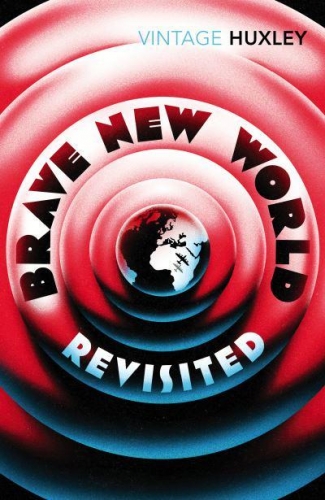
Deux structures sociales, donc, liées par des idéaux extrêmes et opposés, qui ne peuvent en aucun cas envisager une coexistence autre que celle décrite par Huxley qui prévoit le pouvoir et le contrôle de l'une sur l'autre. Dans les deux cas, l'invincibilité de la structure sociale présentée dans le récit est démontrée par l'évolution de l'histoire de ce qui peut être présenté comme les deux protagonistes.
Le premier est Bernard Marx, un représentant de la classe alpha plus qui ne se reconnaît pas du tout dans les impositions sociales, tendant vers l'isolement, des sentiments profonds envers une fille unique qui suggèrent une tendance à la monogamie et cherchant toujours à se rebeller et à agir selon ses propres désirs et non ceux des autres, mais lorsqu'il est menacé d'être transféré dans un endroit isolé, loin de chez lui, précisément à cause de sa conduite négative, perdant ainsi les privilèges que lui confère sa position sociale, il décide d'embrasser complètement le style de vie du nouveau monde, devenant peut-être l'une des principales figures représentatives de l'alpha plus.
Le second est John, un personnage qui vit dans la réserve et qui est reconnu comme appartenant au groupe des sauvages, mais qui est en fait le fils du principal représentant du plus alpha, qui a abandonné une de ses nombreuses compagnes dans la réserve qui, neuf mois plus tard, donnera naissance à John. Le garçon se trouve donc être un enfant de deux mondes; il a grandi dans la réserve, mais sa famille vient du nouveau monde. Cela l'amène à développer un teint de peau différent de celui des sauvages, c'est pourquoi il est traité avec une forte distanciation au sein de la réserve. Malgré cela, il est très conditionné par le mode de vie et les principes des sauvages et, suite à son transfert dans le nouveau monde, il développe un grand sentiment de malaise et de dégoût envers cette société qui lui offre tant, en réalité beaucoup trop pour lui, et d'une manière trop différente et contre toute logique telle qu'il la comprend, un malaise qui le conduira bientôt au suicide, ayant alors réalisé qu'il ne peut pas changer le monde dans lequel il se trouve vivre.

En 1949, un autre texte dystopique important, symbole du XXe siècle, est publié : 1984 de George Orwell, pour l'élaboration duquel il s'est inspiré du Nouveau Monde de Huxley, dans lequel il s'en prend amèrement à l'idéologie qui sous-tend les systèmes de pouvoir totalitaires, d'une manière en partie liée à l'analyse qu'il a développée dans ses travaux précédents, dont La Ferme des animaux, mais, alors que, dans ce texte, il analysait et critiquait principalement le système stalinien, dans 1984 nous pouvons trouver des éléments qui, en plus de nous ramener au stalinisme toujours fortement présent - comme la figure de Big Brother - peuvent être associés à toute forme de pouvoir totalitaire.
L'univers décrit par Orwell voit un monde divisé en trois macro-continents, constamment en guerre les uns contre les autres, formés à la suite d'une dernière grande guerre. L'histoire se déroule à Londres, qui se trouve sur le continent océanien, contrôlé par un parti totalitaire et oppressif, le Socing, dirigé par le personnage de Big Brother, dont on ne sait même pas s'il existe réellement.
Dans l'État d'Océanie, la vie de tout individu est extrêmement axée sur l'adoration et le respect du parti et de Big Brother et sur la haine des subversifs et des autres États. La société entière vit un quotidien programmé minute par minute et constamment surveillé par une série de caméras et de microphones situés partout, de la rue aux lieux de travail, et même dans les maisons; la vie privée n'est pas envisagée dans le cadre de 1984. Toute forme de subversion, même la plus minime et insignifiante, est sévèrement punie en prenant les sujets subversifs et en les transférant dans le lieu appelé le Ministère de l'Amour, où ils sont interrogés, analysés et finalement torturés jusqu'à ce que leur esprit devienne la proie du conditionnement du parti, les amenant à ressentir de la terreur, mais aussi de l'amour pour Big Brother; la vie de ces sujets, une fois soumise à la torture devient si vide et conditionnée qu'elle perd complètement son importance.
Le protagoniste de l'histoire est Winston, un homme qui travaille au ministère de la Vérité, le lieu où toutes les informations relatives à la situation interne et externe de l'État d'Océanie sont retravaillées puis rediffusées au profit de l'image du Parti, afin que la société puisse le percevoir comme parfait, supérieur à ses ennemis, internes et externes.
Winston n'est pas à l'aise avec les politiques du Parti, il déteste toute la situation qu'il est forcé de vivre, mais, en même temps, il doit faire attention à ne pas extérioriser de telles pensées. Dans l'Etat d'Océanie, en effet, il existe un organisme de surveillance appelé la psychopolice, qui a pour mission de trouver toute personne présentant des signes de pensées subversives à l'égard du parti, afin de la récupérer et de l'amener au ministère de l'amour.
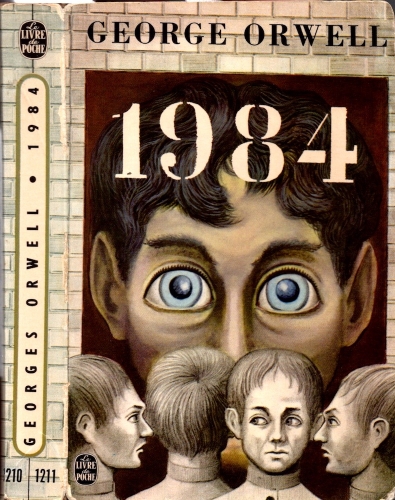
Winston cultive donc secrètement des pensées et des désirs non conformes aux principes totalitaires du parti et de Big Brother, jusqu'à ce qu'il rencontre Julia, une fille qui partage entièrement les visions de Winston. Winston et Julia entament une histoire d'amour en secret et prennent plaisir à enfreindre les règles imposées par le parti, qui incluent les relations amoureuses qui ne visent pas exclusivement la procréation et l'idolâtrie de Big Brother; toute pratique susceptible de véhiculer un plaisir personnel non lié à la figure du parti, qu'elle soit sexuelle ou ludique, est rigoureusement interdite.
Winston et Julia, dans la deuxième partie du roman, sont découverts et arrêtés. Une fois séparés, ils sont emmenés au ministère de l'Amour, où ils subissent des tortures physiques et psychologiques qui les amènent à s'abandonner totalement à une foi aveugle dans le parti, en le respectant, en le craignant et en l'aimant en même temps, ce qui rendra leur vie insignifiante et soumise au point d'éliminer totalement ce qu'ils étaient auparavant. À la fin, nous ne comprenons même pas complètement si Winston est réellement tué ou non, mais après tout ce qu'il a traversé et qui l'a façonné, cette information perd même de son importance.
L'histoire de Huxley et celle d'Orwell sont deux histoires apparemment aux antipodes l'une de l'autre, avec deux systèmes de contrôle basés sur des principes opposés, mais menant au même résultat. Les deux sociétés décrites sont complètement assujetties, liées par une idéologie unique qui ne permet aucune forme de subversion et qui punit lourdement toute forme de désobéissance.
Dans Le Nouveau Monde, le pouvoir est entre les mains d'un petit groupe d'individus ; dans 1984, au contraire, il est apparemment entre les mains d'un seul homme, mais dans les deux cas, il y a une forme de contrôle de fer, avec des moyens différents, mais menant au même résultat. Le libre arbitre est dans les deux cas complètement éteint et les systèmes décrits par les auteurs sont tous deux invincibles, les protagonistes n'ont finalement qu'une seule option: la soumission totale aux principes et au mode de vie imposés par le système, ce qui peut conduire à plus d'une conclusion, de la mort à la perte totale de la conscience de soi, mais dans tous les cas, toute forme de rébellion, qu'elle soit matériellement visible ou seulement sous forme psychologique ou spirituelle, est inévitablement éradiquée.
En 1958, Huxley publie un essai, d'une importance fondamentale pour ce qui concerne sa pensée politique et philosophique, reprenant son récit Le Nouveau Monde et associant ses éléments à la réalité géopolitique et sociale que vit la société mondiale et aux principaux événements qui, au cours des vingt-cinq dernières années, ont entraîné des crises et des changements.

Dans son essai, Huxley n'oublie pas de considérer le texte d'Orwell, en le louant d'un point de vue qualitatif et analytique, mais en observant que, si en 1949 l'univers décrit par Orwell pouvait être fortement crédible et refléter une réalité qui, selon toute vraisemblance, pouvait se retrouver au sein d'un système totalitaire comme celui présenté dans 1984, près de dix ans plus tard, les choses semblent avoir changé. En fait, Huxley observe que la société mondiale, qu'elle soit dans un système totalitaire ou démocratique, va lentement mais sûrement dans la direction qu'il a décrite dans Le Nouveau Monde. Même en Union soviétique, explique Huxley, les gens commencent à préférer le conditionnement transmis par un système de privilèges et pas seulement le conditionnement par la peur et la répression, même si, bien sûr, les formes de répression envers les subversifs, ou les sujets considérés comme tels, continuent d'exister.
Huxley explique que certaines formes de centralisation du pouvoir, économique et politique, peuvent se produire à la suite de certaines crises qui, si elles sont mal gérées, peuvent conduire à un point de rupture qui aboutit à la centralisation du pouvoir sur un seul sujet ou un petit groupe d'élite. En effet, dans les récits de Huxley et d'Orwell, ces centralisations du pouvoir se sont produites à la suite d'une sorte de crise mondiale apparemment liée à un contexte de guerre. En particulier, Huxley affirme que l'une des principales causes susceptibles de provoquer une crise qui rendrait inévitable une telle prise de pouvoir est le danger de surpopulation, qui entraînerait un déséquilibre entre la consommation et la disponibilité des ressources.
Toutefois, de nombreux éléments peuvent conduire à un point de rupture, ou point de non-retour, qui entraînerait à son tour les conséquences décrites ci-dessus. Il suffit d'un mauvais choix, d'une confiance mal placée dans un sujet, ou un groupe restreint de sujets, qui se révèlent alors incapables de gérer certaines situations, ou qui profitent de leur position pour instaurer une forme de régime doucement ou durement coercitif.
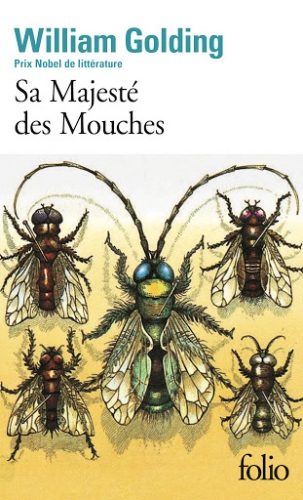
De nombreux exemples similaires peuvent être trouvés dans l'histoire politique, mais ils sont aussi fortement présents dans la littérature. On trouve un scénario similaire, par exemple, dans le roman Lord of the Flies de William Golding, publié en 1954. Golding imagine en effet un groupe d'enfants qui, à la suite d'un accident d'avion, se retrouvent à vivre sur une île déserte, sans guide adulte. Dans ce contexte, les enfants sont obligés de chercher un moyen de survivre par eux-mêmes et de former une société organisée.
Ils essaient donc de s'organiser dans une société semi-démocratique, mais, à la fin, la direction passera entièrement sous la responsabilité de l'un d'entre eux, celui qui s'avère être le plus fort et le plus charismatique et donc, apparemment, transmet la sécurité et la sérénité, même s'il était clair que le plus apte en réalité à assumer le rôle de guide était un autre personnage, un garçon prudent, sage et toujours dubitatif, inquiet pour l'avenir du groupe, mais constamment marginalisé et traité violemment par tous à cause de son peu de charisme et de sa piètre forme physique.
Au fur et à mesure que le leadership passe sous la coupe du mauvais sujet, ou des mauvais sujets (puisque vers la fin de l'histoire, il y aura un transfert de pouvoir), les garçons s'embarquent dans un voyage qui les amènera à faire des choix de plus en plus mauvais qui mettront en danger la structure même de la société et sa survie et qui les amèneront progressivement mais sûrement à régresser vers un état animal, abandonnant de plus en plus leur humanité.
Ces narrations romanesques, et bien d'autres encore, ont en commun la représentation d'une société d'un point de vue dystopique qui, à la suite d'une crise provoquée par diverses raisons, a atteint un point de non-retour et s'est enfoncée dans une voie qui mène inexorablement à la perte totale de ce que l'on considère aujourd'hui comme des valeurs et des droits humains. C'est pourquoi il est fondamental de pouvoir éviter d'atteindre ce point de rupture et de réagir judicieusement à certaines crises, sous quelque forme que ce soit, avant de commettre des erreurs dont il est difficile de revenir en arrière.
Carlo Desideri, In Storia.it N° 162 / Juin 2021 (CXCIII)
BIBLIOGRAPHIE
Golding W., Le Seigneur des mouches, Mondadori, Milan 2014.
Huxley A., Il Mondo Nuovo e Ritorno al Mondo Nuovo, Mondadori, Milan 2015.
Orwell G., 1984, Mondadori, Milan 2015.
Orwell G., La Fattoria degli animali, Mondadori, Milan 2014.
21:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature anglaise, lettres, lettres anglaises, aldous huxley, george orwell, dystopie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le solitaire en période d'incertitude
Ex : Association Minerva, https://grupominerva.com.ar/2021/06/
Par David Porcel Dieste
Je suis invité, ici, à écrire quelque chose sur Ernst Jünger (1895-1998) à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Si mon temps le permet, j'écrirai sur le Solitaire, car Jünger était, bien sûr, un Solitaire. À une époque comme la nôtre, où de plus en plus de personnes vivent connectées les unes aux autres, comme des constructions intersubjectives dans lesquelles l'inter est plus important que la subjectivité, parler du Solitaire peut sembler étrange, ou, du moins, étranger. Et ce, bien qu'une série d'écrivains chevronnés, tels que Peter Handke dans Essai sur le lieu tranquille (titre original : Versuch über den stillen Ort) ou le Japonais Seicho Matsumoto, l'aient déjà fait, et de quelle manière !
Solitaires étaient toutes ses Figures, qu'il a magistralement représentées dans chacun des moments du 20ième siècle dans lequel il a vécu. Solitaire est le Soldat inconnu qui, dans Orages d'acier (1920), incarne le sentiment d'aventure de celui qui fait de son expérience intérieure une expérience partagée. Indifférent aux couleurs et aux drapeaux, le soldat Jünger de la Première Guerre mondiale, armé de son fusil et de son ‘’journal thanatique’’, entame un nouveau rapport au danger qu'il n'abandonnera plus jamais: "Nous avions quitté les salles de classe des universités, les pupitres des écoles, les tableaux des ateliers, et en quelques semaines d'entraînement nous avions fusionné jusqu'à devenir un seul corps, grand et plein d'enthousiasme. Ayant grandi à l'ère de la sécurité, nous avons tous ressenti une envie de choses inhabituelles, de grands dangers. Et puis la guerre nous avait pris comme une ivresse. Nous étions partis pour le front sous une pluie de fleurs, dans une atmosphère enivrée de roses et de sang. C'est elle, la guerre, qui devait nous apporter cela, les choses grandes, fortes et splendides." [1].
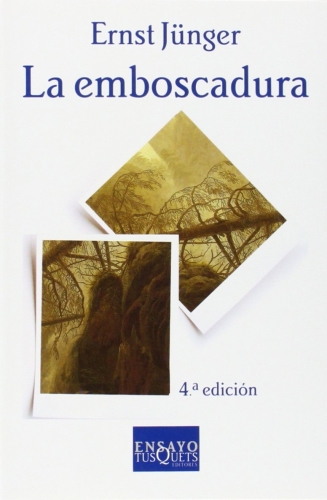
On a beaucoup réfléchi à l'eros et à ses formes, comme la polis et les théories politiques, l'art ou les typologies sociales, mais, par rapport à cela, on s'est peu intéressé au thanos et à ses fins, présents dans les figures du Soldat inconnu et de son héritier le Travailleur. Si tous deux sont mus par l'eros, ils incarnent également cette autre impulsion vers la destruction et le renouvellement. En effet, l'impératif de performance, que prend sur lui le "travailleur", héritier du soldat anonyme de la Première Guerre mondiale, est en même temps à l'origine de la construction et de la destruction, puisqu'il ne peut être construit que sur les ruines d'un passé suffisamment obsolète pour ne plus servir de fondement. Il convient de noter que Jünger n'est pas anti-Lumières, car il ne croit pas nécessaire d'affronter les Lumières; à ses yeux, il s'agit d'une autre tentative ratée de dompter le sauvage, de marquer le caché. C'est, redisons-le, un Solitaire, ou un Embisqué, comme il aimait à se définir, qui croyait au pouvoir des mythes.
Malgré le style combatif de son livre Le Travailleur (1932), avec sa mythologie de l'ouvrier, il n'avait pas l'intention de mobiliser ou de révolutionner les masses, comme on l'interprétait à son époque, mais de témoigner de l'entrée dans l'histoire d'une nouvelle force métaphysique qui se matérialiserait plus tard dans les grandes formations technologiques et politiques supranationales. Le travail est le rythme des poings, des pensées et du cœur ; le travail est la vie jour et nuit ; le travail est la science, l'amour, l'art, la foi, le culte, la guerre; le travail est la vibration de l'atome et le travail est la force qui fait bouger les étoiles et les systèmes solaires[2] - proclame Jünger pour souligner l'omniprésence de la figure du Travailleur. Car le "travail" est, pour l'Allemand, tout ce qui existe, organisé selon la loi du timbre et de l'empreinte [3], qui n'a rien à voir avec le principe moderne de causalité. La première inclut l'élémentaire ; qui, cependant, se rebelle contre la logique de cause à effet. Et parce qu'il inclut l'élémentaire, les cœurs énergiques et solitaires de ceux qui sont poussés à la mobilisation totale [4], que ce soit pour combattre sur les champs de bataille ou pour capituler dans les usines, sont aussi sous l'influence de cette force venue du fond primordial.
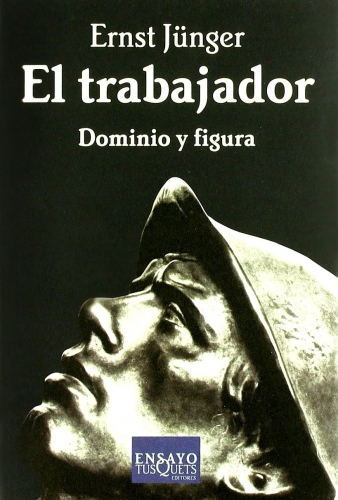
Mais Jünger voulait aussi se réfugier loin du monde des fonctions et de l'appel à la mobilisation. Et c'est dans ce but qu'il a inventé, au milieu du siècle dernier, son autre Figure - pendant du Travailleur - qu'il a lui-même représenté pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, et qu'il a appelé le Rebelle (l’Emboscado en espagnol). Avec le titre Traité du Rebelle/Recours aux forêts (1951), Jünger écrit pour ceux qui résistent à être annihilés par le défaitisme et le fatalisme de l'époque. Écrit en pleine guerre froide, il dépeint les sentiments de ceux qui ne se laissent pas gagner par la peur et décident de résister activement au monde des diktats et de l'automatisme: "Nous appelons rebelle, en revanche, ceux qui, privés de leur patrie par le grand processus et transformés par lui en individu isolé, finissent par se livrer à l'anéantissement. Ce destin pourrait être celui de beaucoup et même de tous - il n'est donc pas possible de ne pas ajouter une précision. Et cela consiste en ceci : la personne rebelle est déterminée à offrir une résistance et a l'intention de poursuivre la lutte, une lutte qui n'a peut-être aucune perspective" [5].
La forêt n'est pas pour Jünger un lieu naturel concret de retraite, comme la Forêt Noire l'était pour Heidegger ou les cabanes de Thoreau, mais le résultat d'une confrontation avec le monde par laquelle un territoire vierge s'ouvre à l'homme singulier pour se retirer du nihilisme et de la destruction. La forêt est maison (Heim), patrie (Heimat), secret (heimlich), non seulement dans le sens où elle cache, mais aussi dans le sens où, en cachant, elle protège. La forêt est l'intemporel, et c'est là que se retirent les personnages d'après-guerre de Jünger. Et ils se laissent submerger, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un abri. Ils résistent aux forces du nihilisme par le seul esprit, se donnant à la tâche qui les sort d'eux-mêmes et les ramène à une Nature qui semblait les attendre depuis l'éternité: "Tandis que le crime fleurissait dans le pays comme la moisissure pousse dans la forêt pourrie, nous étions de plus en plus profondément absorbés par le mystère des fleurs, et leurs calices nous paraissaient plus grands et plus rayonnants que jamais. Mais nous avons surtout poursuivi nos études sur le langage, car dans le mot nous avons reconnu l'épée magique dont l'éclat fait pâlir le pouvoir des tyrans. La parole, l'esprit et la liberté sont trois aspects et une seule et même chose " [6].

La dernière de ses Figures, l'Anarque, présent dans ses romans dystopiques du dernier quart du siècle, notamment dans Eumeswil (1977), représente le dernier refuge à partir duquel initier un nouveau rapport au monde et aux autres. Si le Rebelle représente la résistance active et l'ardeur de la passion, l'anarque incarne la résistance passive et la passion froide. L'Anarque n'est pas l'anarchiste, ni même l'Unique de Stirner. L'anarchiste croit encore à la société, à la possibilité de faire une société meilleure; il en va de même pour l'Unique de Stirner, qui s'unit en vue de renverser les drapeaux et les ismes. L'Anarque, lui, ne croit ni ne reconnaît aucun régime, ni ne plonge dans des paradis perdus. Au contraire, il n'a pas de société. Il vit, disons-le, éloigné de tout, ce qui peut le rattacher à un monde assez inconstant pour se retourner contre soi-même. Mais c'est précisément dans cette retraite qu'il trouve la sécurité et la paix: "L'Anarque, par contre, connaît et évalue bien le monde dans lequel il se trouve et a la capacité de s'en retirer quand il en a envie. En chacun de nous, il y a un fond ‘’anarquique’’, une impulsion originelle vers ‘’l'anarquie’’. Mais dès notre naissance, cet élan est limité par notre père et notre mère, par la société et l'État. Ce sont des saignements inévitables dont souffre l'énergie originelle de l'individu et auxquels personne ne peut échapper"[7]
Avec le proverbe "Pour l'homme heureux, aucune horloge ne dit les heures", si souvent répété dans son œuvre [8], Jünger semble nous rappeler que nous ne pouvons pas retourner à notre première enfance, mais que nous pouvons la ramener à nous, en provoquant le monde d'une manière totalement nouvelle pour laquelle seuls les esprits solitaires sont préparés. L'aventurier d’Orages d'acier, l'amoureux d'Héliopolis ou le navigateur d'Approches partagent un vif désir d'accumuler de nouvelles expériences et de viser de nouveaux buts, puis de les partager avec ceux qui, comme eux, sont également mus par le désir de se nourrir de l'innommé. Car la tradition, semble nous dire Jünger, nous a incités à tort à nous saisir de la vie, en y voyant un flux qu'il faut réorienter ou un champ de possibilités susceptible d'être confiné dans le domaine ennuyeux du ‘’dû’’. La tradition nous a incités à faire de la vie un ethos et de la pensée une éthique. Mais l'innommé compte aussi, prévient Jünger. Même la vie peut devenir quelque chose de poreux, ouvert à ce qui est déjà là, le laissant entrer, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus nous enseigner: "La douleur est une de ces clés avec lesquelles nous ouvrons les portes non seulement du plus intime, mais aussi du monde. Lorsque nous nous approchons des points où l'être humain se montre à la hauteur de la douleur ou supérieur à elle, nous accédons aux sources d'où découle sa puissance et au secret qui se cache derrière sa domination"[9].
(1) Tempestades de acero, Tusquets, Barcelone, 1987, p. 5.
(2) Le travailleur, Tusquets, Barcelone, 1993, p. 69, 70.
(3) "La loi qui, dans le domaine de la Figure, décide de l'ordre hiérarchique, n'est pas la loi de la cause et de l'effet, mais la loi, toute différente, du timbre et de l'empreinte; et nous verrons que, dans l'époque où nous entrons, nous devrons attribuer l'empreinte de l'espace, du temps et de l'être humain à une figure unique, la figure du Travailleur", Le Travailleur, p. 38
(4) Voir La movilización total, Tusquets, Barcelone, 1995.
(5) La emboscadura, Tusquets, Barcelone, 1993, p. 59, 60.
(6) Sobre los acantilados de mármol, Ediciones Destino, Barcelone, 1990, p. 92, 93.
(7) Los titanes venideros, Península, Barcelone, 1998, p. 56.
(8) Voir El libro del reloj de arena, Tusquets, Barcelone, 1998, p.13.
(9) Sobre el dolor, Tusquets, Barcelone, 1995, p. 13.
Tiré de : https://posmodernia.com/el-solitario-en-tiempos-de-incertidumbre/
18:12 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
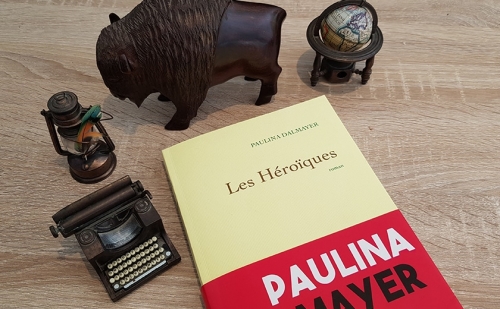
Luc-Olivier d'Algange:
Les Héroïques de Paulina Dalmayer (Grasset, 2021)
Voici un livre tout en muscles et en nerfs qui nous change de la flaccidité ordinaire du nihilisme confortable, de ces romans qui semblent écrits du bout des lèvres. Dans ces Héroïques, c'est tout un corps qui écrit, avec ses tendons, ses articulations, ses terminaisons nerveuses, l'électricité qui passe entre les neurones, le crépitement des phosphènes, la circulation du sang dans les veines et les battements du cœur, - sans oublier la peau, qui est le suprême organe de perception.
Wanda, qui est le personnage principal de ce roman, sait qu'elle va mourir, que ses jours sont comptés et que son corps, avant de se défaire, est le siège d'une âme qui persiste. Que faire pendant ces jours qui restent ? Et surtout comment faire ? Que se passe-t-il alors ? Dotée de cette certitude terrible, qui est la limite proche que l'on ne peut désormais dissimuler sous des nuées incertaines plus ou moins aimables, Wanda ne va pas théoriser un ars moriendi, elle va, au contraire, vivre et revivre, tuer et ressusciter, par la réminiscence et le désir, un ars amandi, un art d'aimer.

Nous apprendrons ainsi, dans ce voyage, que l'amour ne vaut que délié et divers, et qu'il faut dire, comme naguère, les amours, non seulement pour désigner par ce pluriel un nombre plus ou moins grand d'êtres aimés, mais aussi pour comprendre qu'il y a de nombreuses façons d'aimer, à l'impourvue, avec esprit, avec loyauté ou amitié profonde, dont aucune ne se laisse réduire en cette compacité sentimentale qui tasse en un même composé artificieux, - qui aura le charme des amalgames dentaires, - le sexe, le sentiment, le possession, la raison sociale, la soumission familiale, et autres occurrence du « gros animal », pour reprendre la formule platonicienne chère à Simone Weil, autrement dit de cette société, de ce collectivisme forcé, qui sont devenus les ennemis de la civilisation et de la civilité. L'héroïsme sera de s'en déprendre.
Ce roman cruel, comme le théâtre d'Artaud ou de Grotowski, - qui est l'un des personnages du roman, mais nous n'en divulguerons pas davantage, - ne se laisse pas lire comme une antienne morose ou déprimante : il nous regarde et nous déchiffre. Ce n'est pas un objet, mais une méthexis, une participation, vérifiant ainsi cette évidence : plus le propos est subjectif et personnel, plus il se tient dans la trame de son propre monde et mieux il opère à une sorte d'impersonnalité active où nous pourrons retrouver nos propres vérités et nos propres tentations, ainsi que le fait précisément Grotowski lorsqu'il s'interroge sur le passage du «rôle » à « l'essence » des personnages.
Le roman de Paulina Dalmayer nous force à garder en mémoire cette frontière frémissante qui sépare, et unit, notre « rôle » joué dans le monde de « l'essence » mystérieuse, hors d'atteinte, qui seule demeure, telle, derrière le défilement des images d'un film, la lumière du projecteur.

Wanda est polonaise, c'est dire qu'elle nous vient de la Mitteleuropa, et ce qu'elle nous dit, en se souvenant, et en agissant, vient de cette civilisation, prodigieusement complexe et vivante, qui elle aussi, est, à ce moment de l'Histoire, au voisinage de la mort. Autant dire qu'il ne faut pas s'attendre à ces préciosités étiques, ces plaintes bien gérées, ces mondanités moroses qui font, hélas, le fond le plus commun des romans français actuels. Nous sommes, avec Les Héroïques, du côté de Witkacy ou du Döblin du Voyage babylonien. L'ironie, qui traverse de part en part le roman comme un fluide salvateur, n'est point celle de l'intelligence énervée, - c'est-à-dire, par étymologie, privée de nerf, - mais celle du « double regard », qui saisit le jour et la nuit des personnages, d'un seul trait sûr, dans sa ductilité sensible immédiate et dans sa fin dernière.
Nous comprenons, en lisant ce roman de Paulina Dalmayer, - dont la suite est annoncée et attendue, - que le temps est un flux, un flot, voire sur quelque rivage ultime, une vague qui se retourne elle-même dans l'immémorial. Dans son échappée belle, les pieds nus dans la neige, Wanda se souvient, certes, de sa jeunesse polonaise, de la collective incarcération communiste, de sa malédiction familiale, de ses aventures théâtrales, mais le souvenir l'emporte, la soulève dans un présent qui n'appartiendra qu'à elle, pour le ressaisir et se laisser saisir, dans la roulement de la vague, par d'impondérables puissances dans l'extrême fragilité.
Tel est l'héroïsme, qui est un génie de l'intuition : sentir ce qui soulève dans ce qui défaille, vérifier l'existence de l'âme dans l'extinction du corps. Ce beau roman, cependant échappe à chaque phrase à la tristesse. Sa drôlerie se donne à nous les larmes aux yeux ; sans plaintes il va vers son recours, à vif, pour mieux nous laisser entrevoir la sagesse éperdue de vivre.
Luc-Olivier d'Algange.
09:48 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, littérature française, lettres, littérature, lettres françaises, paulina dalmayer, luc-olivier d'algange |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Zweig et Bernanos : la vie sans passeport (sanitaire ou autre) avant 1914
par Nicolas Bonnal
Le cataclysme totalitaire qui nous tombe dessus a des précédents dans notre Europe si démocratique et lumineuse, qui a aura inventé toutes les monstruosités du monde moderne. A l’heure ou le passe sanitaire est imposé à tous, où les comptes des non vaccinés, et leur téléphone, et leur eau, et leur électricité sont en passe d’être coupés (1), il est bon de le rappeler.
On va reprendre deux de nos écrivains favoris qui sont frères d’âme, le « juif libéral » et pacifiste Stephan Zweig, ami de Romain Rolland, et le catholique monarchiste Georges Bernanos, qui il y a un siècle dénonçaient la montée de l’étatisme totalitaire en Occident. Les deux grands esprits à cette époque remarquent l’émergence de deux contraintes : le passeport et le visa… Nos lecteurs pourront retrouver aussi nos écrits sur Chesterton et son détestable voyage en Amérique dans les années vingt. Contrôle et obsession anticommuniste au programme.
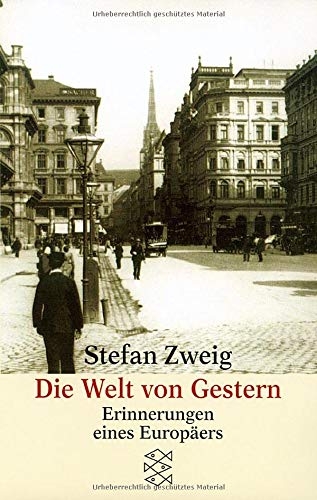 On commence par Zweig et son fastueux Monde d’hier (le plus grand livre du monde selon nous sur le vingtième siècle, ce siècle tué en 1914 et partiellement survivant dans les années vingt) :
On commence par Zweig et son fastueux Monde d’hier (le plus grand livre du monde selon nous sur le vingtième siècle, ce siècle tué en 1914 et partiellement survivant dans les années vingt) :
« La chute de l'Autriche a produit un changement dans ma vie privée que j'ai d'abord considéré tout insignifiant et purement formel : j'ai perdu mon passeport autrichien et j'ai dû demander aux autorités britanniques un document de substitution, un passeport apatride. Dans mes rêves cosmopolites, j'avais souvent imaginé dans mon cœur combien splendide et conforme à mes sentiments seraient de vivre sans État, de n'être obligé à aucun pays : et, par conséquent, appartiennent à tous sans distinction. Mais encore une fois, j'ai dû reconnaître à quel point le fantasme humain et dans quelle mesure nous ne comprenons pas les sensations les plus importantes jusqu'à ce que les ayons vécues nous-mêmes. »
Ce que nous allons vivre avec la dictature sanitaire de Macron-Schwab-Leyen nous allons bientôt le comprendre. Zweig poursuit :
« Tout consulat ou officier de police autrichien avait le droit ou l’obligation de me le prolonger en tant que citoyen à part entière. Au lieu de cela, le document pour étranger que les Anglais m'ont donné, j'ai dû le demander. C'était une faveur, mais une faveur qu’ils pouvaient me retirer à tout moment. Du jour au lendemain, il avait descendu un échelon de plus. Hier, il était encore un invité étranger et, en quelque sorte, un gentleman qui a passé ses revenus internationaux et payé ses impôts, et aujourd'hui j'étais devenu un émigré, un "réfugié". »
Préparez-vous, non-vaccinés, à ce statut de réfugié sur votre sol ; on est à 45% de vaccinés, attendez 51 puis 60% ; et arrêtez de dire que les chiffres sont truqués, de toute manière ils s’en moquent.
Zweig décrit l’entrée dans un monde pré-totalitaire en 1919 :
« En effet : rien ne démontre peut-être de façon plus palpable la terrible chute que le monde de la Première Guerre mondiale a connu comme limitation de la liberté de mouvement de l'homme et la réduction de son droit à la liberté. Avant 1914, la Terre appartenait à tout le monde. Tout le monde allait où il voulait et y restait aussi longtemps qu'il le voulait. Il n'y avait pas de permis ou autorisations; je m'amuse de la surprise des jeunes chaque fois que je leur dis qu'avant 1914 j'ai voyagé en Inde et en Amérique sans passeport et je n'en avais jamais vu de ma vie. »
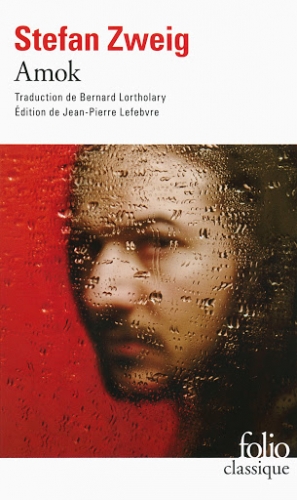 L’auteur d’Amok décrit ensuite ce monde d’avant la guerre mondiale éternelle voulue par les banquiers mondialistes :
L’auteur d’Amok décrit ensuite ce monde d’avant la guerre mondiale éternelle voulue par les banquiers mondialistes :
« Là les gens montaient et descendaient des trains et des bateaux sans demander ou être invités, ils n'avaient pas à remplir un seul des cent papiers qui sont requis aujourd'hui. Il n'y avait pas de sauf-conduits ou les visas ou l'un de ces tracas ; les mêmes frontières qu'aujourd'hui les douanes, la police et gendarmes se sont transformés en fil de fer barbelé, à cause de la méfiance pathologique de tous vis-à-vis de tous, ils ne représentaient que des lignes symboliques qui croisaient la même nonchalance que le méridien de Greenwich. »
La laisse électronique et même psychologique (désolé, il y a ou aura 80 ou 90% de volontaires extatiques) a perfectionné cette horreur. Zweig poursuit en n’oubliant pas les vaccins, conséquence du militarisme, des guerres et aussi cause partielle du génocide planifié et faussement nommé grippe espagnole :
« Toutes les humiliations qui avaient été autrefois inventés uniquement pour les criminels, ils étaient maintenant infligés à tous les voyageurs, avant et pendant le voyage. L'un devait être représenté de droite et de gauche, visage et profil, coupé ses cheveux pour qu'on puisse voir ses oreilles, laisser ses empreintes digitales, d'abord celles du pouce, puis ceux de tous les autres doigts ; De plus, il fallait présenter des certificats de toutes sortes : de santé, de vaccination et de bonne conduite, lettres de recommandation, invitations et adresses de parents, garanties morales et économiques, remplir des formulaires et signer trois ou quatre exemplaires, et si un seul de cette pile de papiers manquait, on était perdu. Cela ressemblait à des bagatelles, mais… »

Bernanos va utiliser le même mot : bagatelle. C’est le même en allemand. Zweig évoque ensuite notre avilissement qui en découle surnaturellement :
« Nous, les jeunes, avions rêvé d'un siècle de liberté, de l'âge futur du cosmopolitisme. Quelle part de notre production, de notre création et de notre la pensée s'est perdue à cause de ces singeries improductives qui avilissent en même temps l’âme! »
C’est dans le chapitre l’Agonie de la paix.
Voyons Bernanos, réfugié au Brésil comme Zweig, de six ans son cadet, et qui défendit la liberté comme personne, ce qui le rend peu lisible par les temps qui courent. Il fait les mêmes observations avec les mêmes mots que Zweig sur cette volonté médicale et donc pathologique de tout contrôler et de tout vérifier :
"Ce que vos ancêtres appelaient des libertés, vous l’appelez déjà des désordres, des fantaisies". « Pas de fantaisies ! disent les gens d’affaires et les fonctionnaires également soucieux d’aller vite, le règlement est le règlement, nous n’avons pas de temps à perdre pour des originaux qui prétendent ne pas faire comme tout le monde… », comme ne pas se vacciner par exemple. »
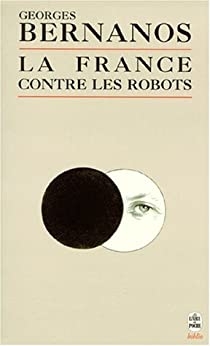 Après Bernanos évoque le passeport :
Après Bernanos évoque le passeport :
« Cela va vite, en effet, cher lecteur, cela va très vite. J’ai vécu à une époque où la formalité du passeport semblait abolie à jamais. N’importe quel honnête homme, pour se rendre d’Europe en Amérique, n’avait que la peine d’aller payer son passage à la Compagnie Transatlantique. Il pouvait faire le tour du monde avec une simple carte de visite dans son portefeuille. »
Oui, cela sonne un peu rustique et bucolique aux temps des commissaires politiques et sanitaires, pas vrai ? Puis on parle des empreintes digitales, autre bagatelle :
« Les philosophes du XVIIIe siècle protestaient avec indignation contre l’impôt sur le sel — la gabelle — qui leur paraissait immoral, le sel étant un don de la Nature au genre humain. Il y a vingt ans, le petit bourgeois français refusait de laisser prendre ses empreintes digitales, formalité jusqu’alors réservée aux forçats. Oh ! oui, je sais, vous vous dites que ce sont là des bagatelles. Mais en protestant contre ces bagatelles, le petit bourgeois engageait sans le savoir un héritage immense, toute une civilisation dont l’évanouissement progressif a passé presque inaperçu, parce que l’État Moderne, le Moloch Technique, en posant solidement les bases de sa future tyrannie, restait fidèle à l’ancien vocabulaire libéral, couvrait ou justifiait du vocabulaire libéral ses innombrables usurpations. »
Après on arrive au siècle des intellectuels qui comme les BHL ou Onfray vont tout justifier :
« Au petit bourgeois français refusant de laisser prendre ses empreintes digitales, l’intellectuel de profession, le parasite intellectuel, toujours complice du pouvoir, même quand il paraît le combattre, ripostait avec dédain que ce préjugé contre la Science risquait de mettre obstacle à une admirable réforme des méthodes d’identification, qu’on ne pouvait sacrifier le Progrès à la crainte ridicule de se salir les doigts. »
Et là comme Zweig, esprit peu religieux s’il en fut, Bernanos évoque l’avilissement de nos âmes :
« Erreur profonde ! Ce n’était pas ses doigts que le petit bourgeois français, l’immortel La Brige de Courteline, craignait de salir, c’était sa dignité, c’était son âme. »
Depuis ces temps nous n’avons fait que descendre. On va voir maintenant qui est prêt à payer pour la liberté.
Sources :
Bernanos – la France contre les robots (PDF sur le web)
Zweig – Le monde d’hier (LDP)
Nicolas Bonnal – Guénon, Bernanos et les gilets jaunes
09:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stefan zweig, georges bernanos, littérature, lettres, lettres allemandes, lettres françaises, littérature allemande, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Nouveauté:
PHILIP K. Dick et le Grand Reset en Occident
Par Tetyana Popova-Mozovska
Préface de Nicolas Bonnal
Dans les années 70 on évoquait au lycée un mage, un gourou, un écrivain qui sortait des catégories traditionnelles et scolaires mais n’entrait pas dans les nouvelles. Il faisait douter de la réalité du monde, de nos perceptions, et de notre humanité limitée à la consommation et à la perception de news. En outre il était perçu comme le prophète d’un futur effrayant et qui était déjà là. Bref, il était un oracle. Si Dostoïevski, Edgar Poe ou Balzac nous décrivaient un éternel présent qui venait du passé, cet écrivain mythique nous décrivait un éternel présent qui venait du futur. On le jugerait comme prophète et non comme styliste ou « réaliste ».
Cet écrivain bien sûr est Philip K. Dick - et mes amis des sections scientifiques le considéraient comme un génie réservé à une minorité choisie. On citait surtout « Ubik » dont le nom résonne comme celui d’un dieu de l’étrange. Après des essais de lecture infructueux, je finis par découvrir ce monstre littéraire en 1982 grâce au film « Blade runner ». Échec commercial à sa sortie, cet opus fasciné (et pas seulement fascinant) devint ensuite le film-culte par excellence. Les puristes reprochèrent plein de choses à une œuvre qui dessinait les grands traits de notre époque mondialiste, dystopique et travaillée par l’image. L’altération de la réalité par les simulacres était là, tout comme la technologie dangereuse, la difficulté de définir l’homme dans le monde capitaliste unifié et la fabrication artificielle par les images d’une mémoire collective planétaire effaçant l’expérience individuelle. Cependant la lecture de Dick me demeurait difficile. J’attendis d’autres films « Total recall », « Pay check », « Minority report » pour avoir une idée plus précise de cet univers « riche et étrange », digne des visions de Shakespeare et du baroque du Quichotte. Le futur dystopique, la dégradation d’un paysage planétaire déglingué et surtout la fabrication d’une mémoire artificielle me semble être des axes essentiels des écrits de Dick. Et c’est là qu’est intervenue Tetyana, passionnée et sérieuse.
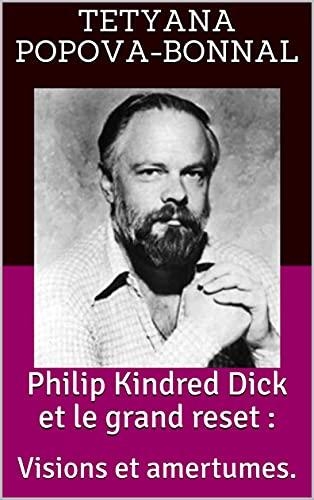
Sérieusement et systématiquement Tetyana a relu ou lu tous les ouvrages de Dick susceptibles d’expliquer l’étrange réalité dans laquelle nous sommes plongés. Depuis un an, nous avons en effet assisté à une accélération de cette réalité marquée par le totalitarisme technologique et l’effondrement énergétique/économique ; tout cela grâce au virus et aux mesures comme ce reset qui l’accompagne, sorti de cerveaux planétaires et dangereux. Bref, nous sommes rentrés au moins dans les grandes villes dans l’univers de Dick – un univers souvent comique et menaçant, comme dit notre auteure.

Tetyana a compulsivement a déniché les textes oubliés ou peu lus qui dessinent la réalité prévue par notre étrange prophète. Mais en bonne chrétienne elle a aussi insisté sur les contenus spirituels et « chrétiens-primitifs » de l’œuvre de Dick, dimension que beaucoup de critiques ont négligé ou oublié. De ce point de vue ce grand auteur pourrait être aussi un écrivain du « 8ème jour » quand nous serons réveillés du long sommeil impérial et ferré. Ce livre s'adresse donc à une élite « éveillée », et qui s’ignore encore.
Editions Tetyana, Amazon.fr. A paraître chez Avatar.
https://www.amazon.fr/dp/B096LPVB1R/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=BONNAL+DICK&qid=1622883747&sr=8-1
12:32 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philip k. dick, science-fiction, littérature, littérature américaine, lettres, lettres américaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Un roman intéressant: La Luz del Norte
Par Xuan Xosé Sánchez-Vicente
Je viens de terminer "La luz del norte", un roman de Carlos X. Blanco, écrivain et chercheur qui travaille fréquemment dans le domaine de l'asturien et de l'asturianisme.
Organisé en courtes unités narratives et avec une prose sans beaucoup de fioritures créatives ou transgressives, le roman est agréable et se lit bien, c'est-à-dire qu'il capte l'intérêt pour continuer à lire scène après scène.
La trame narrative est le contexte plus ou moins historique, dans le domaine de l'Espagne et des Asturies, allant de la défaite de Don Rodrigo au soulèvement de Pelayo et des Asturiens à Covadonga. Sur cette trame historique - racontée avec une liberté littéraire - est dépeinte la vie dans l'ancien royaume wisigothique (Tolède et Cordoue, fondamentalement), tant au niveau des protagonistes que sur le plan social : L'esclavage des chrétiens et des Goths et les violences qu'ils ont subies tant sur le plan physique qu'économique ; la connivence, de la même manière, avec les envahisseurs de la part des "traîtres" : les partisans de Witiza, comme Don Oppas, qui étaient ceux qui appelaient les envahisseurs Maures, ou les nobles qui se rendaient à l'envahisseur, comme le Goth Athala. D'autre part, la vie des asturiens libres est décrite : asturiens du centre et de l'est, asturiens vadiniens, dont le chef est Pelayo -goth et asturien à la fois- et cantabres libres, dirigés par le duc de Cantabrie, Alfonso.
Du point de vue de la narration de l'histoire, on alternera les épisodes ou les aventures de certains personnages qui ont des origines et des trajectoires différentes jusqu'à ce que, à la fin, ils soient regroupés à Covadonga et autour de Pelayo : Teud et Adosinda (la sœur de Pelayo), Teud et sa sœur Brunilda, Álvaro et Brunilda... Et, avec eux, des personnages historiques : outre Pelayo et Adosinda, les Oppas, Munuza, Alkama ?
Quant au reflet de l'histoire réelle dans la fiction romanesque, l'auteur utilise un squelette "réaliste" tout en incorporant des événements strictement inventés, qu'il accompagne de légendes sur Pelayo : sa naissance et ses racines, son voyage à Cordoue, la livraison d'Adosinda comme otage. Et, en même temps, l'invention d'un réseau de "moines sages et visionnaires" qui voient l'avenir et le réalisent.

Il y a un point où l'auteur peut rencontrer des résistances ou des obstacles chez certains lecteurs, à cause du fond "idéologique" ou de la vision du monde qui structure la vision de l'histoire dans le roman : certains, du point de vue nationaliste, le trouveront trop "gothique" et "hispaniste" et, peut-être, trop chrétien. D'autres, du point de vue d'une vision particulière de l'Espagne, le considéreront comme trop nationaliste asturien.
En vérité, si le roman est lu d'un point de vue purement littéraire, il est plus proche d'un roman d'aventures que de tout autre chose, et ces obstacles disparaissent parce que la coloration idéologique est alors réduite à un simple élément de l'intrigue et à la création d'une atmosphère.
Source : Blog de Xuan Xosé
Version originale en asturien :
https://nacionalismuasturianu.blogspot.com/2016/06/una-no...
Informations sur l'éditeur :
https://editorialeas.com/producto/la-luz-del-norte-por-ca...
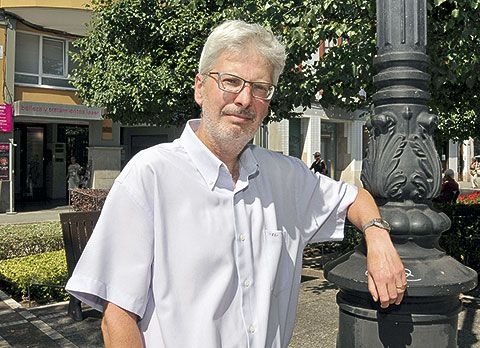
Critique littéraire de La luz del norte, de Carlos X. Blanco
Antonio Ríos (Docteur en Philosophie et expert en littérature)
C'est un cliché, mais il est vrai, que la meilleure critique et le meilleur honneur que l'on puisse faire à une œuvre et au travail de son auteur, c'est de lui montrer qu'il a passé des heures et des jours avec son œuvre, et que ce temps loin de tout écran d'ordinateur ou de tout appareil moderne, ces heures devant son livre en silence, n'ont pas été seulement un bienfait et un plaisir, mais aussi un dialogue critique, de conformité et de désaccord avec l'auteur. Cela dit, nous abordons une critique littéraire de l'œuvre La luz del norte (EAS, 2016) de Carlos X. Blanco.
"La luz del norte" nous parle de ce qui fut le germe de la reconquête espagnole, donc le germe de l'Espagne elle-même, de l'Espagne catholique et impériale, la base de la future nation espagnole. Don Pelayo est le personnage principal autour duquel tourne ce roman. Pelayo est le sparring-partner du roi Rodrigo, avec lequel il a subi la défaite de Guadalete en 711, bien que le roman commence après cet événement historique. Pelayo est un noble de lignée gothique et asturienne -c'est ainsi qu'il est présenté dans le livre, suivant ou mélangeant certaines Chroniques, inconnues de moi- qui a commencé à unir Goths, Asturiens, Cantabres et Hispaniques dans les montagnes des Asturies, initiant la résistance et la reconquête d'une péninsule ibérique envahie par l'Islam.
En tout cas, Pelayo n'est pas le seul protagoniste de ce -appelons-le pour le moment- roman, mais d'autres personnages ont autant ou plus d'importance que Pelayo : le jeune Teud, compagnon d'armes de Don Pelayo, qui doit fuir Tolède, la capitale du royaume wisigoth dévasté par l'invasion musulmane ; Álvaro, hispano-gothique qui partagera la captivité et les épreuves de Tolède et Cordoue avec Brunhilda, la soeur de Teud. La noble et guerrière Adalsinda, sœur de Don Pelayo, joue un rôle tout aussi important dans l'histoire que Brunhilda. L'imbrication de ces personnages, qui passent essentiellement de deux en deux, est très réussie dans ce roman. Pelayo-Teud, Álvaro-Brunhilda, Adalsinda-Teud, Pelayo-Adalsina, etc... Cet entrelacement continu des personnages libère cette histoire de l'individualisme, de l'introspection qui caractérise habituellement les personnages des histoires modernes, même dans les récits d'aventure actuels. Même l'ermite Bartholomé ne cesse d'être accompagné, car il semble être toujours "connecté" à sa sphère magique, avec laquelle il communique avec les frères de l'Ordre. Le triomphe du bien sur le mal n'est pas seulement, dans ce roman, le triomphe du christianisme sur l'islam, mais c'est surtout le triomphe de la noblesse d'esprit, de la fidélité à un bien qui, oui, semble vivre de manière innée dans un ordre hiérarchique, comme celui-ci : asturien-cantabrique, wisigothique, hispanique, etc...

À travers "La luz del norte", nous sommes insérés dans une péninsule ibérique dévastée par l'invasion musulmane et par la trahison des Wisigoths partisans de Witiza, et nous voyageons avec ses protagonistes à travers des villes comme Tolède, Emérita Augusta (Mérida), Cordoue. Bien que la description du paysage, des coutumes et de la variété des personnages ne soit pas très présente dans le roman - ce manque contribue à en faire une histoire très adaptée aux jeunes - nous avons une assez bonne idée de la différence des coutumes dans les différents territoires. L'auteur gère très bien le carrefour des coïncidences, des rencontres entre personnages et la composante de surprise qui ne devrait pas manquer dans un récit d'aventure, bien que ces rencontres soient parfois aussi improbables que celles des Persiles de Cervantes.
"La luz del norte" est un récit d'aventure. Mais je n'oserais pas le qualifier de "roman historique", car je pense que ce genre, si surfait de nos jours, ne parvient pas à rendre compte de ce qu'est ce livre. "Roman historique" est un terme déroutant en soi, car toute histoire qui sort du temps présent et dans laquelle on retrouve des personnages importants de l'histoire pourrait être considérée comme un roman historique, et donc des romans comme "La Flèche noire" de Stevenson ou "La Chartreuse de Parme" de Stendhal pourraient être considérés comme des "romans historiques", alors que, Dieu merci, ils ne le sont pas.
Bien que l'écheveau narratif de cette œuvre de Carlos X. Blanco soit unitaire et plein de caractère. La trame narrative de Blanco est unitaire et avec une structure forte, la division de l'oeuvre en tant de chapitres, les changements continus et drastiques de lieu, de personnages, etc... enlèvent à l'oeuvre le caractère de roman -qui est un genre moderne-, lui donnant plutôt le caractère de littérature épique classique, d'une part, et de conte moral et religieux miniaturiste dans le style des Cantigas d'Alfonso X, d'autre part (peut-être aussi -mais je ne le sais pas et un historien devrait en juger- dans le style des Chroniques sur la vie de Don Pelayo).
Assembler ces caractéristiques épiques et ce miniaturisme religieux avec le récit d'aventures pour les jeunes est le défi que, au-delà de la volonté de l'auteur, cette œuvre a en elle-même. Et je pense que l'œuvre sort très bien de ce défi... si nous n'étions pas en 2018 et si le monde n'était pas rempli de jeunes gens abrutis et planifiés par des adultes. Je vais nuancer cette pensée à la fin de cette critique. Allons de l'avant.
Le roman est donc un genre moderne, et "L'aurore boréale" n'est pas un livre moderne. Il ne cherche pas à séduire avec les artifices de la modernité, c'est pourquoi il a un caractère anachronique qui peut attirer et séduire autant de lecteurs qu'il peut en effrayer d'autres. Il est clair que le lecteur et le critique qui se sentent à l'aise dans la modernité seront effrayés par cette œuvre, le lecteur et le critique qui ont déjà senti la puanteur de la modernité et de la postmodernité seront attirés par "La lumière du Nord", bien qu'ils puissent être en désaccord avec certains aspects de l'œuvre.

Il s'agit d'une œuvre à l'atmosphère positive, c'est-à-dire qu'elle convient parfaitement aux jeunes ou aux adultes qui veulent raviver leur esprit de jeunesse. Nous ne trouvons dans la pièce ni autodestruction complaisante, ni destruction complaisante. Il n'y a pas le moindre soupçon de nihilisme dans cette œuvre. À mes yeux, sur le plan littéraire, cela joue à la fois en faveur et en défaveur de l'œuvre, car montrer le nihilisme, avoir une certaine tendance à la noirceur - au-delà des personnages très perfides du roman - est important en tant qu'avertissement et affichage des dangers qui guettent l'homme depuis le siècle des Lumières. La noirceur de Kafka ou de Céline est donc fondamentale, et le nihilisme dont fait preuve Dostoïevski est essentiel pour montrer l'effet d'une lumière très vive.
Le problème est que la littérature actuelle a fait du nihilisme sa base, franchissant toutes les limites de mise en garde, et ce à tel point que le nihilisme s'est déguisé en joie et en positivité. La Luz del Norte (La Lumière du Nord) n'est pas coupable de cette dernière, qui est une œuvre claire et positive, sans déguisement, bien qu'il y ait des vêtements anciens. Qui ne se souvient pas un peu d'Homère la première fois qu'Alvaro porte un coup mortel à un ennemi (p.135) ou Adalsinda au sien (p.210) ? Malgré ces éclairs homériques, "La lumière du Nord" a un air moins tragique, car ce ne sont pas les dieux qui déterminent au hasard un destin. Ici, on sait de quel côté la victoire tombera.
Dieu l'a tracé avec cet Ordre des frères cachés - si présent dans le livre -, mais les hommes devront le certifier par leurs efforts. Là où le christianisme apparaît, le funeste destin grec ne peut respirer.
Malgré l'anachronisme de l'œuvre, La Luz del Norte -"La lumière du Nord". est avant tout, j'insiste, un récit d'aventure. L'aventure "pure", et "pure" au sens moral et religieux du terme, l'aventure qui a pour finalité le triomphe du bien sur le mal. L'œuvre est évidemment manichéenne, sans que cela soit dit de manière péjorative. Il ne s'agit pas d'une aventure moderne à la manière de Stevenson, par exemple, puisque l'époque quasi mythique, ou du moins fondatrice, dont traite le roman, ainsi que le contenu et l'objet fondamentaux du roman, sont distincts de l'aventure moderne plus prosaïque. Ici, il n'y a pas de trésor caché sur une île, ici il y a un message moral et religieux à présenter et à défendre.
"L'aurore boréale" laisse au lecteur un goût de Moyen Âge vu d'un romantisme germanique, dans lequel la pureté est peut-être trop étroitement liée à la race. De manière obsessionnelle, les Asturiens et les Wisigoths semblent voir dans certains Hispaniques, des traits raciaux ou de caractère qui pourraient faire penser que l'Hispanique a aussi du sang gothique ou asturien, bien qu'il faille dire que la race n'est pas toujours porteuse de pureté dans cette œuvre ; rappelons-nous les personnages d'Ikko et d'Alfakai, les esclaves berbères qui libèrent Teud et Adalsinda, et dont il est dit : "Que le ciel vous bénisse, pour toujours je saurai que tous les membres de votre race ne sont pas des gens au cœur dur, cruels, barbares, avides d'or, de terres, d'esclaves et de plaisirs" (p. 185 ), ou le même juif Bartholomé, qui semble râblé, petit, courbé face à la puissante figure de Pelayo, et pourtant il est grand par son esprit et sa noblesse, en fin de compte, les vertus les plus importantes qui brillent dans cette histoire. N'oublions pas que l'un des êtres les plus dépravés du roman est le frère de Witiza, l'évêque Oppas, manifestement un gothique. Malgré cet idéal moral qui est au-dessus de la race et qui révèle l'ordre catholique du monde, l'histoire se débat intérieurement entre cette vision et la vision raciale romantique allemande. Les cheveux noirs, les "dents de cheval", les lèvres d'une énorme laideur arabe, trop caricaturale, contrastent avec les cheveux dorés, les blanchâtres, qui sont comme un rayonnement idéal et divin.
Pour le lecteur moyen d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'homme téléguidé, ces caractéristiques raciales et manichéennes peuvent sembler incompréhensibles ; cependant, je crois que c'est là l'attrait de cette histoire, dans la mesure où l'auteur s'introduit parfaitement dans une autre façon de penser, une façon de penser archaïque, que le romantisme a peut-être su voir avec nostalgie contre le triomphe croissant du politiquement correct, de la bureaucratie. C'est pourquoi "La Luz del Norte" ne devrait effrayer personne pour son manichéisme, car presque jusqu'à la post-modernité, le manichéisme était la façon dont la réalité était interprétée. Oui, il fut un temps où nous savions tous ce qu'était le bien et le mal, ce qu'était un homme et ce qu'était une femme.
D'autre part, le roman est imprégné d'une composante érotique qui se croise et se confond avec la composante idéale également. Cette composante érotique manifeste est peut-être l'aspect le plus moderne du roman. Souvenons-nous de Brunhild, nue et l'épée à la main devant son bien-aimé Álvaro, ou d'Adalsinda, se déclarant tout aussi nue, dans un éclair de blancheur devant Teud (l'auteur reprend ici la tradition -que j'ignore- selon laquelle les filles asturiennes se déclaraient devant les garçons et non l'inverse). Il appartient à chaque lecteur d'élucider s'il y a autre chose que de l'érotisme dans la façon dont les Arabes et les évêques Oppas assouvissent leur désir. Mais l'auteur n'a pas peur de l'inclure dans son livre. "C'est ainsi", a déclaré Benoît XVI lorsqu'il a vu "La Passion du Christ" de Mel Gibson. Et que cette époque de la conquête arabe était une conquête de vente d'esclaves, de trafic d'enfants et de belles filles de harem ne fait aucun doute pour quiconque connaît un minimum l'époque, la conquête arabe et l'islam.
À l'idéal de La Luz del Norte -"La lumière du Nord" - s'ajoute une composante magique qui imprègne l'ensemble de l'œuvre. Déjà le premier chapitre est le rite initiatique de Pelayo à Jérusalem, et tout ce qui se passe dans l'œuvre est vu dans les sphères magiques par les membres de l'Ordre des Frères Occultes, dont fait partie le juif converti Bartholomé, premier gardien zélé de la Grotte de Covadonga. Un Ordre qui prétend aller au-delà du christianisme, car son but est l'union de toutes les religions dans un idéal de pureté et de noblesse d'esprit. Très bien ficelé, l'auteur nous présente le berger de Liébana qui aide Bartolomé, peut-être le futur bienheureux de Liébana, qui finira par répandre la foi en présence de l'apôtre Santiago en Espagne.
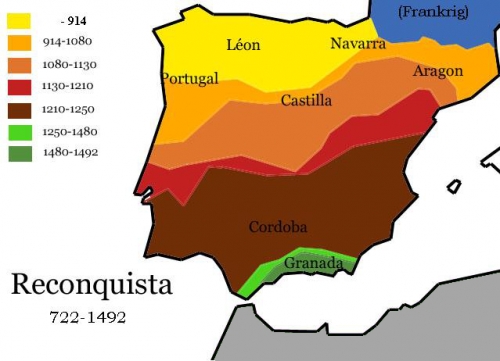
Ce roman, ce récit épique ou moral, a, en plus de nombreuses vertus littéraires, une vertu incontestable que, malheureusement, peu de gens pourront voir, c'est que ce livre ne doit rien à personne, il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas des lecteurs à tout prix. C'est parce que nous vivons dans une société où le langage et la pensée sont muselés, une société qui entend en quelques années anéantir les traditions millénaires, que ce livre peut faire peur à beaucoup plus de gens que ceux qui sont effrayés par l'enseignement dans les écoles qu'il y a des garçons avec et sans pénis et des filles avec et sans clitoris. Lorsque des livres comme celui-ci seront lus par les jeunes dans les écoles secondaires, notre société aura arrêté la spirale descendante qu'elle subit. J'ai bien peur que, pour le moment, ce ne soit qu'un rêve.
https://editorialeas.com/producto/la-luz-del-norte-por-ca...
https://latribunadelpaisvasco.com/art/8707/-la-luz-del-no...
08:08 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carlos x. blanco, livre, lettres, lettres espagnoles, littérature, littérature espagnole |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
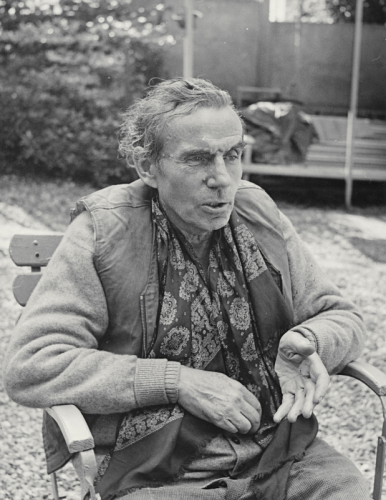
Parution du n°440 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
François Marchetti nous a quittés
Céline dans Paris-Midi (1ère partie)
Actualité célinienne
• Antoine LABYE, « Une heure avec Pierre Mertens », RCF [Liège], 8 mars 2021.
09:58 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Stefan Zweig et la grande uniformisation du monde
par Nicolas Bonnal
« On aurait dit des grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s’ennuyer. »
Le Voyage dans le passé.
La dictature sanitaire a renforcé la tendance lourde à l’extermination des nations, des cultures et des traditions. L’unification parfois folle et aberrante des politiques de santé au détriment de la santé des nations a bien renforcé ce « capitalisme totalitaire » (Bernanos) et anglo-saxon dont le but est le meurtre du monde par le lit social-impérialiste de Procuste de la mondialisation. Les persécutions et la dérive autoritaire des soi-disant démocraties occidentales et de l’Europe de la monstrueuse Van Der Leyen (descendante de nazis et d’esclavagistes tout de même, voyez Wikipédia) ne connaissent plus de limites et n’e connaitront plus, si nous n’y mettons un terme, d’une manière ou d’une autre.
Liquéfaction des nations, des sexes, des religions (avec la bonne volonté papiste c’est entendu) d’un côté, renforcement du terrorisme sanitaire et administratif de l’autre, le tout pour créer ce paradis infernal dont rêvent nos utopistes depuis des siècles (voyez le grand livre de Mattelart qui détaille bien la montée séculaire de cette utopie planétaire). L’alliance de la finance, du capital, des administrations et des médias sous contrôle rendent cette opération de magie noire apparemment imparable.

Cette dénonciation a souvent été l’apanage de gens de droite comme Céline ou Bernanos. Comme j’e l’ai montré c’est dans la Conclusion des mémoires d’outre-tombe que résonne le premier appel à la mobilisation politique et spirituel contre le monde moderne. Dans mon livre sur Céline j’ai établi un aparallèle entre les dénonciations souvent incomprises de Céline et les meilleurs chapitres du surprenant Loup des steppes de Hermann Hesse, qui lui aussi se déchaîne contre l’entrée en vigueur d’une civilisation basée sur la consommation, l’abrutissement et la massification ; j’ai nommé la civilisation américaine, pas la première qui a ses défauts et ses qualités comme toutes (qui va jeter la pierre à Poe, Melville, Frank Lloyd Wright ou Charles Ives ?) mais la deuxième celle de l’écrasement des identités de tout ordre, et qui réunit le monde sous la grand étendard (standardisation) de la consommation. C’est la révolution hollywoodienne si l’on veut, celle que célèbre Bernays dans un livre célèbre que j’ai maintes fois évoqué.
Elle apparait dans les années vingt et commence à gêner des gens plus à gauche, et même des « juifs cosmopolites » comme Stefan Zweig l’alors l’écrivain le plu dans le monde, et qui avant de devenir un nostalgique furieux (voyez l’admirable Monde d’hier) tente de dénoncer cette uniformisation/ américanisation du monde et de nous donner les moyens (toujours plus difficiles) d’y échapper.
C’est dans une dissertation que Zweig dénonce en 1926 cette entropie du monde moderne. Il voit deux choses : cette menace est américaine, et elle menace l’Europe, qui est encore le continent de la variété et des nations – aujourd’hui un conglomérat affairiste et russophobe. Zweig :
« Une impression tenace s’est imprimée dans mon esprit : une horreur devant la monotonie du monde…. Nous devenons les colonies de la vie américaine, de son mode de vie, les esclaves de la mécanisation de l’existence …»
Certes cette américanisation peut aussi enchanter les imbéciles ; mais Zweig voit dans cette américanisation une tendance lourde à la servitude volontaire. A la même époque Céline parle de ce troupeau américain de bêtes dociles, bien habituées à obéir. Un coup de woke et de Biden, de masque et de vaccin ?
Zweig : « Pour les âmes serviles tout asservissement parait doux et l’homme libre sait préserver sa liberté en tout lieu… Le vrai danger pour l’Europe me parait résider dans le spirituel. »
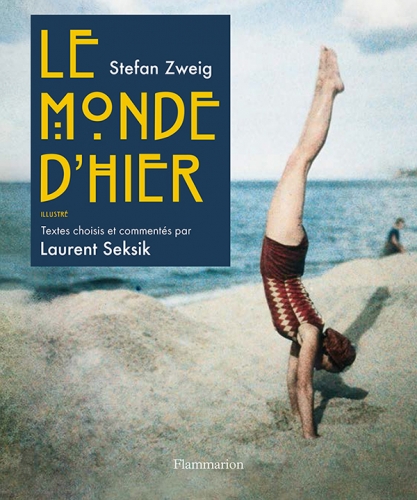
La Boétie parlé comme Chrysosotome des boissons, des tables et des spectacles pour abrutir les massés (voyez le passage sur les origines lydiennes du mot ludique) ; et Zweig de noter :
« La plupart des gens ne s’aperçoivent pas à quel point ils sont devenus des particules, des atomes d’une violence gigantesque. Ils se laissent ainsi entrainer par le courant qui les happe vers le vide ; comme le disait Tacite : « Ruere in servitium » ils se jettent dans l’esclavage ; cette passion pour l’auto-dissolution a détruit toutes les nations… »
La dissolution ici en Espagne comme en France (où l’on a pas besoin d déconsruire une histoire qui n’est plsu enseigéne depuis des décennies, pas vraie ?) de la nation est notoire. Et on ne parlera aps de ‘lAllemagne et du reste.
Zweig ajoute sur ce renforcement à la passivité (le masque étant un vêtement à la mode comme les autres maintenant) :
…Cette uniformité enivre par son gigantisme. C'est une ivresse, un stimulant pour les masses, mais toutes ces merveilles techniques nouvelles entretiennent en même temps une énorme désillusion pour l’âme et flattent dangereusement la passivité de l’individu. Ici aussi comme dans la danse, la mode et le cinéma, l’individu se soumet au même gout moutonnier, il ne choisit plus à partir de son maître intérieure mais en se rangeant à l’opinion de tous… Conséquences : la disparition de toute individualité, jusqu’à dans l’apparence extérieure. »
La conclusion de Zweig :
« Le fait que les gens portent tous les mêmes vêtements, que les femmes revêtent toutes la même robe et le même maquillage n'est pas sans danger : la monotonie doit nécessairement pénétrer à l’intérieur. Les visages finissent tous par se ressembler parce que soumis aux mêmes désirs… Une âme unique se crée, mue par le désir accru d’uniformité, et la mort de l‘individu en faveur d’un type générique».
Et à l'époque ou un serviteur de la Bête comme Bernays, encense ce monde de la manipulation et d’uniformisation, Zweig écrit : "Séparons-nous à l'intérieur mais pas à l'extérieur: portons les mêmes vêtements, adoptons le confort de la technologie, ne nous consumons pas dans une distanciation méprisante, dans une résistance stupide et impuissante au monde. Vivons tranquillement mais librement, intégrons nous silencieusement et discrètement dans le mécanisme extérieur de la société, mais vivons enfin en suivant notre seule inclination, celle qui nous est la plus personnelle et gardons notre propre rythme de vie...".

Zweig lutte contre l'empire (le monde moderne donc). Ce n'est pas un hasard s'il se rapproche d'une autre machine à niveler, l'empire romain, dont le résultat fut de rendre les hommes sots (voyez nos réflexions sur Hollywood et l'idiocratie) pour des siècles. Il rapproche donc notre écrivain de Sénèque qui note (Lettre à Lucilius, V): "Ayons des façons d'être meilleures que celles de la foule, et non par contraire (Id agamus ut meliorem vitam sequamur quam vulgus, non ut contrariam...)".
C’est que Sénèque aussi avait en tant que penseur fort à faire avec son empire…
On peut trouver le texte en bilingue de Zweig aux éditions Allia, pour une somme dérisoire.
18:44 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, stefan zweig, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Luc-Olivier d'Algange
Tulipes d'orage
Le Roman de la langue de Philippe Barthelet, éditions Pierre-Guillaume de Roux.
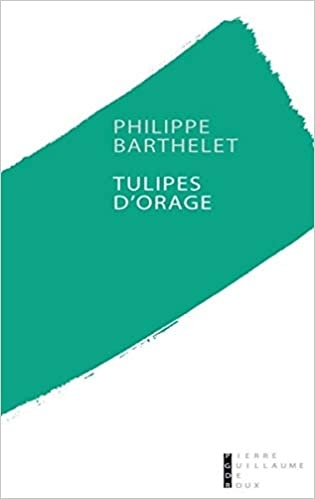 Les grands livres poursuivent généralement un dessein autre que celui qui apparait de prime abord, laissant ainsi carrière à la surprise et à l'aventure. Là où l'on serait tenté de ne voir que des chroniques concernant l'usage de la langue française, se loge, comme dans un logis alchimique, une poétique et une métaphysique. Loin de n'être que le gardien du bon usage, tel que le conçoivent les professeurs et les académiciens, Philippe Barthelet veille sur le seuil, car la langue n'est pas seulement un instrument de communication (et l'on ne sait que trop à quoi elle se réduit souvent) mais une manifestation du Logos. Reprendre nos contemporains lorsqu’ils parlent et écrivent n'importe comment, en sabir pédant ou en traduidu, n'est pas seulement une question de forme, - ou bien elle l'est au sens le plus profond, la forme n'étant autre, par étymologie, que l'Idée, ainsi que le savaient les platoniciens, et après eux, nos théologiens du Moyen-Age.
Les grands livres poursuivent généralement un dessein autre que celui qui apparait de prime abord, laissant ainsi carrière à la surprise et à l'aventure. Là où l'on serait tenté de ne voir que des chroniques concernant l'usage de la langue française, se loge, comme dans un logis alchimique, une poétique et une métaphysique. Loin de n'être que le gardien du bon usage, tel que le conçoivent les professeurs et les académiciens, Philippe Barthelet veille sur le seuil, car la langue n'est pas seulement un instrument de communication (et l'on ne sait que trop à quoi elle se réduit souvent) mais une manifestation du Logos. Reprendre nos contemporains lorsqu’ils parlent et écrivent n'importe comment, en sabir pédant ou en traduidu, n'est pas seulement une question de forme, - ou bien elle l'est au sens le plus profond, la forme n'étant autre, par étymologie, que l'Idée, ainsi que le savaient les platoniciens, et après eux, nos théologiens du Moyen-Age.
Le Roman de la langue, dont Tulipes d'orage est le septième livre, n'est pas un addenda au dictionnaire, mais bien, comme son titre l'indique, une tentative romanesque et romane, de raviver la puissance des mots français et de contrebattre leur avilissement. Traité contre le ternissement, l'usure, la tristesse des vocables abandonnés à l'idéologie et à la publicité. Nous apprenons ainsi que la langue française, vivace, est de nature à traverser le pire hiver, celui où nous sommes, avec ses “auteures” et son écriture “inclusive”.
Chaque livre a son usage. Les uns nous distraient de ce que nous ne pouvons ou ne voulons voir, les autres nous informent, avec l'inconvénient, précisément, de porter souvent atteinte à la forme la plus heureuse de la pensée, qui, pour être, n'a besoin que de peu d'aliments, frugale par nature, et de pratique épicurienne. D'autres livres nous laissent songeurs, invitations au voyage. Plus rares encore ceux qui répondent à une attente essentielle et qui tiennent leur place, royale, aussi bien contre le temps qu'en faveur de ce qui, dans le temps, demeure et se perpétue, - disons la Tradition, qui vaut bien une majuscule, et dont nous apprenons, par ce roman de la langue, qu'elle n'est pas un conservatisme jaloux, une réaction morose, mais le cours même de la rivière, celle qui féconde les paysages qu'elle traverse, et dont les œuvres françaises sont les scintillements, les épiphanies, sous l'irrécusable et catholique soleil du Verbe.
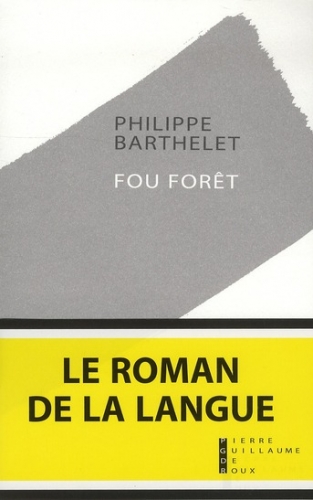 Au temps des identités abstraites, fabriquées et vindicatives, qui menacent de faire disparaître, de façon impure et compliquée, par décomposition, cette disposition providentielle que fut la France, il importe, plus que jamais, de ne pas se tromper de combat, et de fonder notre souveraineté, non dans ces mouvantes et fragiles institutions que les politiciens ravagent à loisir, mais dans la seule évidence qui peut encore en témoigner: notre langue, laquelle tient à distance le pathos, la lourdeur et le système, et nous donne ainsi la chance d'être moralistes, en évitant d'être moralisateurs.
Au temps des identités abstraites, fabriquées et vindicatives, qui menacent de faire disparaître, de façon impure et compliquée, par décomposition, cette disposition providentielle que fut la France, il importe, plus que jamais, de ne pas se tromper de combat, et de fonder notre souveraineté, non dans ces mouvantes et fragiles institutions que les politiciens ravagent à loisir, mais dans la seule évidence qui peut encore en témoigner: notre langue, laquelle tient à distance le pathos, la lourdeur et le système, et nous donne ainsi la chance d'être moralistes, en évitant d'être moralisateurs.
La langue se dégrade à mesure que l'idéologie des moralisateurs l'imprègne. La fausseté, à la différence des mauvaises pensées, qui se donnent et apparaissent comme telles, ne peut se dire dans une langue juste. C'est une bien funeste illusion que de croire que notre bien, notre beau, selon la formule de Rimbaud, sont ailleurs que dans notre langue, d'imaginer la reconquête ailleurs que dans une Matinée d'ivresse, de vouloir une souveraineté qui ne fût dans une âme et un corps. C'est assez dire que dans ce roman de la langue française, que prolongent ces Tulipes d'orage, nous sommes plus proches de Rimbaud ou de Scève que du Bescherelle ou même du Littré, - c'est dire que nous sommes loin, comme le cerisier en fleur l'est de la folie des hommes dans le poème qui figure en exergue du Hagakuré.
Loin de ce monde, c'est bien dire au cœur du silence qui règne sur toute formule heureuse, à la façon d'un ciel sur le feuillage. Le Roman de la langue de Philippe Barthelet guerroie contre la langue défigurée et appauvrie, non par un goût vétilleux de la correction, mais en appel à d'impondérables et indéfectibles richesses nues, - les plus hautes fidélités étant légères, comme le vent qui souffle où il veut.
Luc-Olivier d'Algange
11:55 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, philippe barthelet, livre, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Vigny et la servitude militaire: propos atemporels sur la lettre des généraux
par Nicolas Bonnal
La réaction des militaires est une bonne et intéressante chose. Renvoyons dos à dos le national-chauvinisme et le gauchisme écervelé, et soulignons en quoi cette réaction lettrée est importante : elle donne raison à Vigny et nous confirme dans notre présent éternel. Depuis 200 ans rien ne bouge en France : le peuple est cuit et cocu, la bourgeoisie et les banquiers sont tout-puissants et mondialistes, le nationalisme et le catholicisme sonnent creux. Alors on râle comme Céline.
Dans Servitude et grandeur militaire, texte magique que je mets au niveau de la conclusion des Mémoires d’outre-tombe, on peut lire ceci sur nos militaires ennuyés après les épopées napoléoniennes (on en reparle) :
« Leur couronne est une couronne d’épines, et parmi ses pointes je ne pense pas qu’il en soit de plus douloureuse que celle de l’obéissance passive. »
 Vigny qui est jeune officier comprend aussi que les militaires seront toujours un peu ringards, un peu en retard : « …la vie ou du caractère militaire, qui, l’un et l’autre, je ne saurais trop le redire, sont en retard sur l’esprit général et la marche de la Nation, et sont, par conséquent, toujours empreints d’une certaine puérilité. »
Vigny qui est jeune officier comprend aussi que les militaires seront toujours un peu ringards, un peu en retard : « …la vie ou du caractère militaire, qui, l’un et l’autre, je ne saurais trop le redire, sont en retard sur l’esprit général et la marche de la Nation, et sont, par conséquent, toujours empreints d’une certaine puérilité. »
Les militaires sont résignés (toujours ?) :
« Ce n’est pas sans dessein que j’ai essayé de tourner les regards de l’Armée vers cette GRANDEUR PASSIVE, qui repose toute dans l’abnégation et la résignation. »
Vigny rappelle le destin glorieux des militaires d’antan. Il souligne comme Tocqueville que la grande France est morte sous Louis XIV (et comme il a raison !) :
« Soumis à l’influence toute populaire du prêtre, il ne fit autre chose, durant le moyen âge, que de se dévouer corps et bien au pays, souvent en lutte contre la couronne, et sans cesse révolté contre une hiérarchie de pouvoirs qui eût amené trop d’abaissement dans l’obéissance, et, par conséquent, d’humiliation dans la profession des armes. Le régiment appartenait au colonel, la compagnie au capitaine, et l’un et l’autre savaient fort bien emmener leurs hommes quand leur conscience comme citoyens n’était pas d’accord avec les ordres qu’ils recevaient comme hommes de guerre. Cette indépendance de l’Armée dura en France jusqu’à M. de Louvois, qui, le premier, la soumit aux bureaux et la remit, pieds et poings liés, dans la main du Pouvoir souverain. »
Cette histoire d’uniformes m’évoque celle des masques ; combien ont refusé vraiment d’en porter ? Vous ? Moi ? Un sur mille ? Un sur un million ?
Et de donner ce bel exemple (l’inévitable vieux noble breton) :
« Ils haïssaient particulièrement l’uniforme, qui donne à tous le même aspect, et soumet les esprits à l’habit et non à l’homme. Ils se plaisaient à se vêtir de rouge les jours de combat, pour être mieux vus des leurs et mieux visés de l’ennemi ; et j’aime à rappeler, sur la foi de Mirabeau, ce vieux marquis de Coëtquen, qui, plutôt que de paraître en uniforme à la revue du Roi, se fit casser par lui à la tête de son régiment : «Heureusement, sire, que les morceaux me restent, »dit-il après. C’était quelque chose que de répondre ainsi à Louis XIV. »
Après Napoléon donc l’armée piétine et devient fonctionnaire :
« L’Armée moderne, sitôt qu’elle cesse d’être en guerre, devient une sorte de gendarmerie. Elle se sent honteuse d’elle-même, et ne sait ni ce qu’elle fait ni ce qu’elle est ; elle se demande sans cesse si elle est esclave ou reine de l’État : ce corps cherche partout son âme et ne la trouve pas.

L’homme soldé, le Soldat, est un pauvre glorieux, victime et bourreau, bouc émissaire journellement sacrifié à son peuple et pour son peuple qui se joue de lui; c’est un martyr féroce et humble tout ensemble, que se rejettent le Pouvoir et la Nation toujours en désaccord. »
Vigny souligne l’ennui :
« La vie est triste, monotone, régulière. Les heures sonnées par le tambour sont aussi sourdes et aussi sombres que lui… La servitude militaire est lourde et inflexible comme le masque de fer du prisonnier sans nom, et donne à tout homme de guerre une figure uniforme et froide. Aussi, au seul aspect d’un corps d’armée, on s’aperçoit que l’ennui et le mécontentement sont les traits généraux du visage militaire. »
Obéir, obéir, obéir, tel est votre destin, militaires, fût-ce à des Macron, à des Hollande, à des Sarkozy et aux leaders américains de l’OTAN :

« La Grandeur guerrière, ou la beauté de la vie des armes, me semble être de deux sortes: il y a celle du commandement et celle de l’obéissance. L’une, tout extérieure, active, brillante, fière, égoïste, capricieuse, sera de jour en jour plus rare et moins désirée, à mesure que la civilisation deviendra plus pacifique ; l’autre, tout intérieure, passive, obscure, modeste, dévouée, persévérante, sera chaque jour plus honorée… »
On parle beaucoup de Napoléon ces temps-ci. Vigny aussi, et un peu plus intelligemment que les commentateurs câblés :
« C’est une chose merveilleuse que la quantité de petits et de grands tyrans qu’il a produits. Nous aimons les fanfarons à un point extrême et nous nous donnons à eux de si bon cœur que nous ne tardons pas à nous en mordre les doigts ensuite. La source de ce défaut est un grand besoin d’action et une grande paresse de réflexion. Il s’ensuit que nous aimons infiniment mieux nous donner corps et âme à celui qui se charge de penser pour nous et d’être responsable, quitte à rire après de nous et de lui. »
Le futur est au Gambetta, au Paul Reynaud, au Sarkozy :
« Bonaparte est un bon enfant, mais il est vraiment par trop charlatan. Je crains qu’il ne devienne fondateur parmi nous d’un nouveau genre de jonglerie… »
Vigny imagine une conversation entre le pape et Napoléon. Et le phénomène corse d’éructer contre le vieux pontife en des termes américains (« nous inventons la réalité » - voyez Karl Rove) :
« Mon théâtre, c’est le monde ; le rôle que j’y joue, c’est celui de maître et d’auteur ; pour comédiens j’ai vous tous, Pape, Rois, Peuples ! et le fil par lequel je vous remue, c’est la peur ! - Comédien ! Ah ! il faudrait être d’une autre taille que la vôtre pour m’oser applaudir ou siffler, signor Chiaramonti !Savez-vous bien que vous ne seriez qu’un pauvre curé, si je le voulais ? Vous et votre tiare, la France vous rirait au nez, si je ne gardais mon air sérieux en vous saluant. »
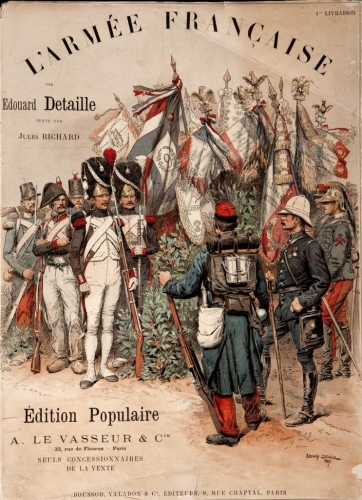
La France avec Napoléon devient le pays de la pose militaire (René Girard en a bien parlé dans son livre sur Clausewitz) et cela va lui coûter de cher de 1870 à 1940 :
- « C’est vrai ! Tragédien ou Comédien. - Tout est rôle, tout est costume pour moi depuis longtemps et pour toujours. Quelle fatigue ! quelle petitesse ! Poser ! toujours poser ! de face pour ce parti, de profil pour celui-là, selon leur idée. Leur paraître ce qu’ils aiment que l’on soit, et deviner juste leurs rêves d’imbéciles. »
Dans le même temps Vigny pressent l’effondrement chrétien du pays (cela met du temps un effondrement, voyez Michelet sur cette question) :
« Cependant il secoua la tête avec tristesse, et je vis rouler de ses beaux yeux une larme qui glissa rapidement sur sa joue livide et desséchée. Elle me parut le dernier adieu du Christianisme mourant qui abandonnait la terre à l’égoïsme et au hasard. »
Vigny résume cette ennuyeuse époque bourgeoise (lisez ce qu’écrit Marx sur Malthus comme as du « dépeupler bourgeois » pour comprendre) :
« Les Grandeurs éblouissantes des conquérants sont peut-être éteintes pour toujours. Leur éclat passé s’affaiblit, je le répète, à mesure que s’accroît, dans les esprits, le dédain de la guerre, et, dans les cœurs, le dégoût de ses cruautés froides. Les Armées permanentes embarrassent leurs maîtres. »
Il ne reste comme chez Balzac que la consommation :
« Dans le naufrage universel des croyances, quels débris où se puissent rattacher encore les mains généreuses ? Hors l’amour du bien-être et du luxe d’un jour, rien ne se voit à la surface de l’abîme. On croirait que l’égoïsme a tout submergé ; ceux même qui cherchent à sauver les âmes et qui plongent avec courage se sentent prêts à être engloutis. »
Comme tous les vrais chrétiens (Drumont, Bloy, Bernanos), Vigny comprend les cathos bourgeois issus de la Révolution et du concordat mieux que personne :
« Les chefs des partis politiques prennent aujourd’hui le Catholicisme comme un mot d’ordre et un drapeau ; mais quelle foi ont-ils dans ses merveilles, et comment suivent-ils sa loi dans leur vie ? - Les artistes le mettent en lumière comme une précieuse médaille, et se plongent dans ses dogmes comme dans une source épique de poésie ; mais combien y en a-t-il qui se mettent à genoux dans l’église qu’ils décorent ? »
Mais remontons le moral des troupes – et pas du troupeau de la servitude volontaire. Que reste-t-il à nos soldats alors et aux rares rebelles de la France du coronavirus et du nouvel ordre mondial ? Oh, un mot pas très compliqué : l’honneur.
Vigny : « Cette foi, qui me semble rester à tous encore et régner en souveraine dans les armées, est celle de l’HONNEUR. L’Honneur, c’est la conscience, mais la conscience exaltée. - C’est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie portée jusqu’à la plus pure élévation et jusqu’à la passion la plus ardente. »
Le baroud d’honneur, comme on dit. On verra si nous en sommes capables, et si nous saurons pour une fois ne pas nous contenter d’un paraphe.
Sources :
https://www.dedefensa.org/article/balzac-et-la-prophetie-...
https://www.les4verites.com/international/chateaubriand-e...
https://www.dedefensa.org/article/comment-loccident-zombi...
https://www.amazon.fr/Louis-Ferdinand-C%C3%A9line-pacifis...
10:15 Publié dans Actualité, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, actualité, livre, alfred de vigny, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, armée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

11:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles maurras, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Luc-Olivier d'Algange: Entretien avec Anna Calosso, à propos du paganisme et du christianisme
Anna Calosso: On discerne dans presque toutes les pages que vous écrivez une sorte de filigrane sacré, tantôt chrétien, dans Lux Umbra Dei, et tantôt païen, dans Le Songe de Pallas, ou dans vos poèmes du Chant de l'Ame du monde, et parfois l'un et l'autre, comme dans L'Ombre de Venise,- qui vient d'être réédité, avec d'autres textes inédits dans un vaste receuil intitulé L'Ame secrète de l'Europe.
Luc-Olivier d'Algange: Allons en amont... Nous vivons dans un Purgatoire mais le Paradis s'entrevoit par éclats. Dans ces éclats le temps se rassemble puis vole au-dessus de lui-même, dans l'éther où vivent les dieux. Dans la tradition européenne le paganisme et le christianisme s'enchevêtrent, moins en théorie qu'en pratique, dans les rites, les légendes et les œuvres qu'elles soient poétiques, picturales ou architecturales. Est-il même possible, depuis le Moyen-Age, pour ne rien dire de la Renaissance, d'être chrétien sans être quelque peu païen, et à l'inverse ? Souvenons-nous simplement que le Versailles du « Roi Très-Chrétien » fut un temple apollinien.
Les « monothéistes » purs et durs le savent qui considèrent le catholicisme comme « associationniste », autrement dit comme un paganisme, voire comme une mécréance. Allons plus loin... Il me semble qu'il est même possible d'être catholique, ou païen, sans croire, en laissant simplement s'éprouver en nous le sens du surnaturel, du Temps au-delà du temps. Ce qui s'éprouve n'est-il pas plus profond que ce que l'on croit ?
 Au demeurant, la croyance, comme l'opinion, sont affaires subjectives, souvent superficielles et étroites. On se demande pourquoi les hommes sont si attachés à leurs croyances: ils aiment l'étroitesse, ils s'y croient à l'abri, - grave illusion. Ils croient pour n'avoir pas à éprouver. La citerne croupissante leur semble préférable à la source vive... Et moins ils éprouvent et plus ils veulent faire croire, imposer leurs croyances qui ne reposent alors que sur leur incommensurable vanité.
Au demeurant, la croyance, comme l'opinion, sont affaires subjectives, souvent superficielles et étroites. On se demande pourquoi les hommes sont si attachés à leurs croyances: ils aiment l'étroitesse, ils s'y croient à l'abri, - grave illusion. Ils croient pour n'avoir pas à éprouver. La citerne croupissante leur semble préférable à la source vive... Et moins ils éprouvent et plus ils veulent faire croire, imposer leurs croyances qui ne reposent alors que sur leur incommensurable vanité.
La « gnôsis », qui dépasse la « doxa », ne se réduit pas au « gnosticisme », qui serait une autre croyance, mais une nouvelle profondeur, la profondeur de l'immédiat, la profondeur du sensible: telle couleur qui nous vient en transparence, tel silence entre les notes de Debussy ou de Ravel. La pensée ne vaut qu'anagogique, en vol d'oiseau. Certes la pensée s'exerce, mais elle se saisit au vol. Elle est un commerce avec l'impondérable qui nous vient de loin... Ce beau, ce vaste lointain est la profondeur de la présence.
A force de s'identifier à une croyance, la croyance elle-même se perd, devient écorce morte, revendication hargneuse. Cela se voit, hélas, tous les jours. Le ressentiment s'ensuit contre tout ce que nous aimons, la liberté d'allure et de propos, Villon, Rabelais, Musset, la musique, les cheveux au vent... Un grand défi se pose à l'honnête homme: ne pas être gagné lui-même par le ressentiment contre le ressentiment. Pour cela, cependant, il faut bien connaître ses ennemis, et plus encore, ses amis. Honorer ce qui nous est amical. L'air du matin qui nous délivre des songes moroses, les amants heureux de Valery Larbaud, les grains de pollen de Novalis, la bienveillance pleine de courage de Nietzsche, les rameaux, les rameaux d'or...
Toujours garder en mémoire : se garder du pathos et de l'outrance, et de ceux qui les propagent, et être, à cet égard, d'une intransigeance parfaite et limpide... Ne pas céder, tant qu'il est possible, sur nos vertus, nos légendes héritées, d'autant qu'européennes, elles sont arborescente, pleines de rumeurs et légères. Réciter en soi, de temps à autres, quelques noms, Homère, Pindare, Villon, Dante, Rabelais, Montaigne, Hölderlin, Shelley, Nerval…
Ce qui nous en vient n'est pas un dogme, un système, un goût peut-être, un savoir qui est saveur, une possibilité de traverser la vie, moins chagrine, moins vengeresse, moins stupide. Ces noms, comprenons bien, désignent des œuvres, et ces œuvres sont des évènements d'une bien plus grande importance, Horace le savait déjà, que les événements dits historiques ou politiques. Chacun de ces événements de l'âme est un avènement, l'entrée dans un Temps secret qui a tout à nous dire, à chaque instant. Si nous devions formuler un vœu, ou une prière, ce serait: Que chaque instant soit l'éclat de son Paradis !

Anna Calosso: Vos ouvrages récemment parus sont de préoccupations et de tons forts divers. Notes sur l'Eclaircie de l'être est consacré à Heidegger, Intempestiva Sapientia sont des propos, des formes brèves, proches de Joseph Joubert, Apocalypse de la beauté est une méditation sur la philocalie et la lumière émanée des icônes. Quel unité fonde ces diverses approches, s'il en est une ?
Luc-Olivier d'Algange: La réponse la plus simple, ce serait l'auteur. Mais sans doute ne suffit-elle pas pour un auteur auquel il semble assez souvent avoir pratiqué, comme une diététique, voire comme un exercice spirituel, une certaine « impersonnalité active », pour reprendre la formule de Julius Evola, elle-même issue de la philosophie stoïcienne. Au demeurant, je serais enclin à penser que, d'une certaine façon, toute activité créatrice nous impersonnalise dès lors que l'art n'est plus seulement, pour nous, l'expression de notre « moi » mais un véhicule, un vaisseau, un instrument de connaissance.
Enfin, les thèmes que vous indiquez ne sont pas si éloignés qu'il semblerait aux spécialistes de l'un ou de l'autre. C'est bien dans une éclaircie de l'être que surgissent et scintillent les formes brèves de Joseph Joubert. Les épiphanies qu'évoque la Philocalie orthodoxe, sont, elles aussi, surgissement. La beauté, enfin, est notre Haut Désir.
Anna Calosso: Si l'on vous en croit, la beauté mène un combat contre la laideur, la laideur de ce monde, la laideur moderne....
Luc-Olivier d'Algange: Ou peut-être, serait, dans l'autre sens, la laideur qui mène un combat contre la beauté... Il me semble parfois assister au spectacle d'une volonté planificatrice de la laideur, avec ses stratégies, ses machines de guerre, la télévision, l'architecture de masse etc... Il y a dans la beauté comme une ingénue, une inconsciente présence de l'être. La beauté est-elle combative ? Elle est une victoire à chaque fois qu'elle advient. Elle se suffit à elle-même, d'où le sentiment de plénitude qu'elle nous apporte, elle est, comme la rose d'Angélus Silésius, « sans pourquoi ». La laideur, elle, est un mouvement de destruction concerté, elle est le « quoi » du pourquoi, un ressentiment, une représentation; c'est la grimace de la jalousie à laquelle cependant toujours échappe ce qui est.
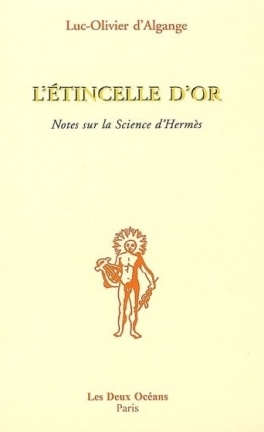 Le vaste enlaidissement de tout ne doit pas nous dissimuler que la beauté demeure, et l'enlaidissement même, dans sa planification, dans sa volonté, témoigne de la souveraineté de la beauté qui sera humiliée, recouverte, insultée mais jamais défaite. Le brin d'herbe perce le goudron.
Le vaste enlaidissement de tout ne doit pas nous dissimuler que la beauté demeure, et l'enlaidissement même, dans sa planification, dans sa volonté, témoigne de la souveraineté de la beauté qui sera humiliée, recouverte, insultée mais jamais défaite. Le brin d'herbe perce le goudron.
On accuse souvent les amants de la beauté d'être des esthètes, et « l'esthète », il va sans dire, dans la bouche de ces moralisateurs, est un méchant homme. Mais est-il un plus généreux acte de bonté que de vouloir répandre la beauté, l'honorer et tenter de faire vivre nos semblables en sa compagnie ? Que serait une bonté qui serait laide ? Nous le savons par les meurtrières utopies, ces maîtresses du kitch. On voudrait alors pouvoir respirer, repousser les fanatiques, les « arriérés de toutes sortes », selon la formule de Rimbaud, les obtus, les puritains, pour élargir l'espace et le temps, laisser venir à nous des confins d'or et d'azur. C'est ainsi que l'idée d'une défense de la beauté redevient pertinente. Elle se fera par touches exquises, par intransigeances transparentes, par nuances, « sur des pattes de colombe », autant dire de la façon la plus aristocratique possible, - ce qui ne veut pas dire que chacun n’y soit pas convié. La beauté est ce qui ne passe pas. Au contraire des mœurs, elle demeure elle-même dans ses manifestations. Le temple de Delphes, les fresques de Piero de la Francesca sont aussi beaux pour nous qu'ils le furent pour leurs contemporains. Voici bien l'approche du Temps au-delà du temps, l'effleurement de son aile...
Anna Calosso: Tel pourrait bien être le cœur de vos écrits, dire le Temps au-delà du temps, dire le cœur du temps, l'éternité de l'Instant, et je songe, en particulier à ce poème, Le Sacre de l'Instant.
Luc-Olivier d'Algange: L'activisme planificateur nous assigne à une temporalité, laquelle nous pousse en avant à toutes fins utiles, mais n'oublions pas qu'en avant, c'est la mort, et non la mort toute nue, vouée aux vautours ou au feu, mais la mort profitable. Cette mort profitable, c'est la vie, toute la vie assignée au temps du travail et de l'usure... Je ne vois guère d'autre objet à la pensée, et précisément à une pensée qui résiste et se rebelle, que d'œuvrer à la révélation, à la réactivation d'autres temporalités secrètes, transversales ou latérales. J'en dis quelques mots dans un essai récent, Les dieux, ceux qui adviennent... Au discours du temps utilitariste, profane et profanateur, du discours qui nous sépare de nous-mêmes et du monde, opposons la fidélité à un autre cours, une rivière enchantée, un Lignon, dont Honoré d'Urfé savait qu'il traverse une géographie sacrée.
Toute géographie, au demeurant, est sacrée, mais nous l'avons oublié. Qui n'a observé que selon les lieux où nous nous trouvons, nos pensées changent de cours ? Une qualité particulière à tel lieu nous imprègne. ce que nous sommes est dans cet accord, dans cet échange magnétique, à la fois intime et impersonnel, par notre façon de nous y mouvoir, de même que la musique, à chaque note, désigne le silence pur où elle se pose, le révélant par ses interstices.
 Anna Calosso: Il semblerait que dans votre éloge de l'accord entre l'homme et son paysage, il y eût une implicite critique du « cosmopolitisme », tel, du moins qu'il se revendique parfois aujourd'hui.
Anna Calosso: Il semblerait que dans votre éloge de l'accord entre l'homme et son paysage, il y eût une implicite critique du « cosmopolitisme », tel, du moins qu'il se revendique parfois aujourd'hui.
Luc-Olivier d'Algange: Votre précision est importante : tel qu'il se revendique aujourd'hui. La critique, implicite ou explicite, en l'occurrence, porte bien davantage sur la globalisation, et la mondialisation, qui ont pour conséquences les communautarismes les plus obtus, les plus incarcérés, que sur le « cosmopolitisme », mot grec qui désigne une pratique spécifiquement européenne. On doute fort que ces grands cosmopolites à leur façon, que furent Fernando Pessoa, Valery Larbaud, Paul Morand, Mircea Eliade, et, plus en amont, Goethe ou Frédéric II de Hohenstaufen, eussent éprouvés la moindre sympathie pour l'actuelle globalisation. Le cosmopolite, l’habitant du cosmos, de l’ordre, est enraciné et peut s'enraciner, et il peut aussi éprouver le sens de l'exil, qu'évoquaient Hölderlin ou, plus proche de nous dans le temps, Dominique de Roux... Le cosmopolite goûte le charme de la découverte, de la mission de reconnaissance. Le globalisé, lui, est partout chez lui dans le nulle part. Le cosmopolitisme appartient, dans son ambiguïté même, à la tradition européenne. Le globalisé n'appartient à rien, sinon aux outrances de sa subjectivité. Dans ce monde déchu, qui est celui de la séparation, du diaballein, la pire séparation est celle qui règne dans le monde globalisé; chacun y étant le geôlier de soi-même. Autant le cosmopolitisme était le luxe de ceux qui s'inscrivent dans un tradere, autant la globalisation est la misère, fut-elle cossue et bancaire, des renégats.
Anna Calosso: L'adversaire, si je vous suis, est donc l'uniformisation...
Luc-Olivier d'Algange: oui, elle, et la schématisation, la simplification, la généralité et l'abstraction, choses plus ou moins équivalentes en la circonstance. La liberté n'est possible que dans un monde complexe et même profus, mais d'une profusion, non point numérique mais concrète. Si tout est plat, on nous tire à vue. Il faut, pour être libre, des espaces secrets, des labyrinthes, des passages vers d'autres mondes et d'autres temps. Tanizaki écrivit un Eloge de l'ombre, dont je conseille la lecture. Ceux auxquels on colle volontiers l'étiquette « anarchistes de droite » aiment le secret, les abbayes de Thélème, les Ermitages aux buissons blanc, les « mondes flottants », comme on dit au Japon. Le monde ante-moderne excellait à ces désordres féconds qui obéissaient à un ordre supérieur, invisible. Voyez une cité médiévale, ses recoins, ses surprises, son harmonie qui semble improvisée, voyez encore Venise et comparez les aux productions des architectes et urbanistes modernes conçues rigoureusement pour travailler, vendre et surveiller. Quelques architectes modernes eurent même l'idée de supprimer les rues, où l'on se promène, et de créer un dispositif où les hommes, parqués selon leurs catégories professionnelles, iraient directement de leur appartement à leur lieu de travail, avec pour seules stations intermédiaires le garage collectif et le supermarché. Nous sommes là aux antipodes de ce que Pasolini nommait la société des arcades où les castes se mêlaient dans la recherche des conversations, des saveurs et des plaisirs, dans le goût de l'otium. L'étymologie dit bien que c'est le negotium qui est la négation de l'otium. On voit aussitôt de quel côté est le nihilisme.
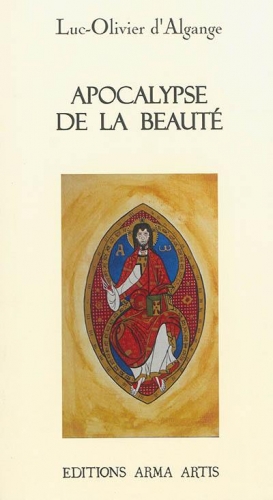 Anna Calosso: Le nihilisme est quelque chose qui doit être surmonté nous dit Nietzsche...
Anna Calosso: Le nihilisme est quelque chose qui doit être surmonté nous dit Nietzsche...
Luc-Olivier d'Algange: Surmonté est le mot juste. Tout homme de ce temps est contraint à la traversée du nihilisme. Que voit-il dans ce parcours ? Les murs qui l'enserrent de plus en plus ou la lueur au loin, celle des « aurores » védiques ? La critique de la modernité est souvent perçue comme le fait de « réactionnaires », - mais nombre de ceux que l'on nomme ainsi ne le sont guère. Ce ne sont pas les formes anciennes qu'ils veulent restaurer mais perpétuer les forces, l'imagination créatrice qui les firent naître. Ce qui est tout autre chose.
Anna Calosso: J'hésite enfin à vous poser cette question, un peu trop courue: êtes-vous optimiste ou pessimiste ?
Luc-Olivier d'Algange: La grande espérance, la plus lumineuse, nous vient lorsque tout est à désespérer. Peut-être même y a-t-il quelque chose de providentiel dans le détachement auquel nous sommes obligés, et dont nous serons peut-être les obligés. Une réduction à l'essentiel s'opère, un feu de roue alchimique. Les œuvres qui ne sont plus enseignées publiquement deviennent un secret, dont naît une discipline de l'arcane. La beauté perdue au milieu de la laideur devient éperdue. La destruction des formes visibles nous livre au « séjour auprès de l'invisible invulnérable » pour reprendre la formule de Heidegger. L'hostilité du monde renforce l'amour entre quelques-uns. Les temps prochains seront aux Calenders.
08:53 Publié dans Entretiens, Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, philosophie, christianisme, paganisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Littérature turque : religion, géopolitique, identité
Entretien avec Apollinaria Avrutina, turcologue à Saint-Pétersbourg
Propos recueillis par Daniil Avdeev
Ex : https://www.geopolitica.ru/
L'art - la conscience de soi de la société. À travers le prisme de la littérature, nous apprenons comment une nation se voit et voit ses voisins, ce en quoi elle croit, ce qu'elle pleure et ce qu'elle espère. C'est pourquoi, dans notre conversation avec Apollinaria Avrutina, docteur en philologie, éminente spécialiste russe de la philologie turque et directrice du ‘’Centre pour la Turquie moderne et les relations russo-turques’’ à l'université d'État de Saint-Pétersbourg, nous parlerons de la littérature turque, un pays qui prend actuellement de plus en plus de poids sur la scène géopolitique mondiale.
La Turquie publiera bientôt la première collection complète des œuvres de Léon Tolstoï en turc. D'une manière générale, notre grand compatriote a toujours été aimé par l'intelligentsia turque et n'a pas été trop accepté par les dirigeants "de droite" de ce pays. Ainsi, dans la préface de la première édition du roman Anna Karénine, l'éditeur s'est plaint que la traduction n'ait pas vu le jour pendant plus de 20 ans parce que c’est un texte faisant la promotion des valeurs occidentales et du christianisme. Cependant, sous le règne d'Atatürk, de nombreuses œuvres de l'écrivain ont été publiées, notamment son récit Le Père Serge, qui tient presque du manifeste. Et maintenant, une collection complète d'œuvres, y compris des notes et de la correspondance, en plus des romans, des nouvelles et des paraboles. Comment et dans quelle mesure notre littérature russe a-t-elle influencé les figures littéraires turques au siècle dernier?
Je suppose que l'influence de Tolstoï (en particulier) sur la littérature turque moderne est très grande, et qu'elle se lit dans presque tous les auteurs turcs modernes considérés comme plus ou moins classiques. En fait, Tolstoï est publié en masse en Turquie, et l'a toujours été (du moins dans la seconde moitié du 20ème siècle). La première traductrice turque de Tolstoï vivait à Istanbul - elle s'appelait Olga Lebedeva - et elle avait écrit un merveilleux ouvrage sur l'histoire de la littérature russe, en langue turque. Elle correspondait avec Tolstoï. Mais elle a oublié d'inclure Dostoïevski dans son anthologie, la première anthologie de littérature russe en Turquie - curieusement - alors que Dostoïevski était déjà très populaire en Russie à cette époque. Lorsque nous examinons la littérature turque du 20ème siècle, en particulier - à partir du milieu de celui-ci (les années 50) et au-delà - nous voyons les œuvres d'écrivains tels que Ahmet Hamdi Tanpınar et Orhan Pamuk, qui ont été traduites en russe. Chacun de ces auteurs veut imiter les œuvres de Tolstoï, mais à sa manière. Les deux auteurs ont les "notes" de Tolstoï et les pensées de Tolstoï. Tanpinar est appelé le ‘’Tolstoï turc’’, car il a emprunté de nombreuses idées à Léon Tolstoï, et son roman A Mind at Peace, publié en russe en 2018, en est d'ailleurs la preuve la plus évidente. Il dépeint la société (turque) dans l'entre-deux-guerres, après le mouvement de libération. Tout ce qui est décrit fait penser à Guerre et Paix, en fait: l'histoire de gens ordinaires avec en toile de fond les changements tectoniques qui se produisent dans la société. Il n'y a probablement pas grand-chose à dire sur l'amour d'Orhan Pamuk pour Tolstoï, et il a lui-même déclaré que Tolstoï est l'un de ses principaux maitres en littérature (d'ailleurs, il a aussi comme l'un de ses principaux professeurs de littérature, Tanpinar). Les nombreuses références de Pamuk à Tolstoï dans ses œuvres sont bien connues. Il suffit de dire qu'il a écrit son roman Le musée de l'innocence comme un Anna Karénine turc: il voulait aussi écrire un manuel sur son époque, un "musée" de son temps.
Après tout, Tolstoï n'était plus seulement un grand écrivain russe, mais un maillon important de la tradition littéraire mondiale, y compris de la tradition occidentale. Ici, je pense qu'il serait approprié de poser la question: peut-on généralement qualifier la littérature turque moderne d'originale, ou essaie-t-elle généralement de suivre les tendances et les courants du monde ?
Il me semble que la littérature turque est orientée vers la littérature russe. De plus, au milieu du vingtième siècle, elle était orientée vers la littérature française avec son modernisme - elle était, en général, empruntée aux Français. Mais à part cela, dans l'ensemble, elle est extrêmement originale. Mais si nous regardons le travail des jeunes écrivains contemporains, nous voyons dans chacun d'eux les traits de Tolstoï ou de Dostoïevski. Ces deux écrivains (qui, soit dit en passant, font partie du programme scolaire en Turquie et sont recommandés par le ministère de l'éducation en tant que lecture obligatoire pour les collégiens) ont une énorme influence sur les auteurs turcs. Avant-hier encore, j'ai participé à un débat animé par l'écrivain turc Defne Suman. Cette soirée littéraire était basée sur sa lecture du roman Anna Karénine. Nous étions réunis autour de ‘’Zoom’’, il y avait des traducteurs du monde entier - et il y avait beaucoup d'écrivains, beaucoup de traducteurs et de turcologues - et donc nous discutions du roman Anna Karénine, ou plutôt, les Turcs en discutaient, et j'écoutais avec curiosité.
J'espère que je n'irai pas à l'encontre de la vérité en disant que votre vie est en partie consacrée à l'écrivain Orkhan Pamuk...
Je ne dirais pas cela: je traite avec de nombreux écrivains, je promeus le travail des écrivains russes en Turquie et j'essaie de traduire autant de textes différents que possible. Au contraire, une partie de ma vie est consacrée à la littérature turque, mais pas toute.

Je veux dire, vos noms sont souvent à côté l'un de l'autre.
Eh bien, oui, parce que j'ai traduit la plupart de ses romans et l'ai fait venir en Russie à plusieurs reprises. C'est vrai.
Qu'est-ce qui pourrait attirer un turcologue spécialisé vers cet auteur ?
Eh bien, un turcologue spécialisé est attiré par une variété de textes turcs, une variété de romans. Lorsque j'étais à l'université, nous avions l'habitude de lire uniquement Orhan Pamuk: principalement Le Château blanc, Le livre noir - en turc, comme lecture à domicile. Mais maintenant les étudiants lisent d'autres romans car, à part Pamuk, il y a beaucoup de bons auteurs turcs, connus dans le monde entier. Donc nous ne nous limitons plus à Pamuk maintenant. Bien que son prix Nobel ait renforcé la position de la littérature turque dans le monde.
En parlant de gloire internationale. Il y a une opinion selon laquelle la "communauté mondiale" essaie de faire pression sur la Turquie à travers la figure de cet écrivain. En général, la relation de cet homme avec le gouvernement turc est un sujet long et controversé. Qu'avez-vous à dire concernant ces allégations ?
Citez-moi au moins un écrivain populaire, dont les opinions sont en accord avec le cours de l'État. Il n'y a pas de pression sur le pouvoir via la figure d'Orhan Pamuk et il n'y en aura jamais. De plus, si la communauté internationale tente d'exercer une pression sur les autorités turques par l'intermédiaire de Pamuk, ce dernier aura des ennuis. La Turquie est stricte à ce sujet: personne ne se promène avec des lanternes et des drapeaux. De plus, Pamuk lui-même dit toujours (avant toute interview, par exemple): "Nous ne parlons en aucun cas de politique, je ne parle pas de politique. Ces dernières années, surtout après son procès très médiatisé de 2005, il a essayé de se distancer le plus possible de la politique et de ne pas s'y impliquer de quelque manière que ce soit.
En général, vous savez, il existe une attitude très ambivalente à son égard en Turquie, beaucoup de gens le considérant comme un traître pour ses opinions libérales. L'attitude négative prévaut; de nombreux Turcs le qualifient de "traître à la patrie" (en turc, cela ressemble à vatan haini). En même temps, Orhan Pamuk lui-même aime son pays natal, aimerait vivre en Turquie (où il vit maintenant la plupart du temps) et ne veut pas "jouer avec le feu" dans ces questions. Il veut continuer à vivre dans son pays natal.
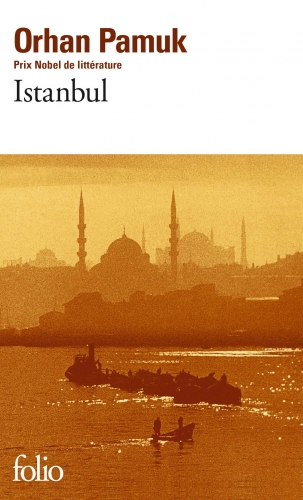
Cela dit, les Turcs l'apprécient en tant que figure culturelle. Il y a une double attitude très étrange envers Pamuk. D'un côté, beaucoup de gens le détestent. En revanche, lorsque Pamuk va prendre un verre au restaurant et marche dans la rue, les gens s'écartent et s'inclinent presque devant lui. Tout le monde le traite avec respect et est (en partie) fier qu'il vive dans le quartier, dans le même bâtiment qu'eux.
Peut-on dire que les autorités et le peuple turcs modernes sont intéressés à faire entendre la voix de leur littérature à l'étranger ?
Oui, ils le sont. Le gouvernement turc fait beaucoup pour cela. Le ministère de la culture de la République de Turquie a un projet spécial pour soutenir et promouvoir la littérature turque dans le monde. Et la littérature turque traduite est assez populaire; en outre, certains écrivains turcs essaient d'écrire en anglais (ils sont ensuite traduits en turc). En général, il s'agit d'une tendance globale chez les auteurs orientaux. C'est à peu près comme ça que Nabokov l'a fait aussi : ce Russe écrivait en anglais. Par exemple, Khaled Hosseini écrit en anglais, Elif Shafak écrit en anglais, et ainsi de suite...
La tendance au néo-ottomanisme et au pan-turquisme est de plus en plus visible en Turquie aujourd'hui. Ces idéologies ont-elles leurs "hérauts" parmi les écrivains turcs modernes?
Je dirais que le panturquisme n'est pas le bienvenu en Turquie, bien qu'il y soit présent. Les cercles dirigeants le soutiennent "point par point" lorsqu'il leur est favorable. Quant à la politique du pan-turquisme, elle est bien sûr présente. Nous sommes probablement très semblables à la Turquie à cet égard. La Turquie représente l'ancien grand empire ottoman et la Russie l'ancien grand empiredes Tsars et des Soviets. Dans les deux pays, les souvenirs du grand passé impérial sont très vivants. Il y a une attitude face à la réalité depuis la position majestueuse de "Seigneur du monde" (enfin, de la moitié du monde, au moins). À une époque, la Turquie était désireuse de rejoindre l'Europe, l'Union européenne, désir dont il est d'ailleurs beaucoup question dans les livres de Pamuk (par exemple, dans D’autres couleurs). Aujourd'hui, les Turcs se moquent de l'Europe et de l'Union européenne. Ils croient en leur propre voie, en leur propre mission, en leur propre idée.
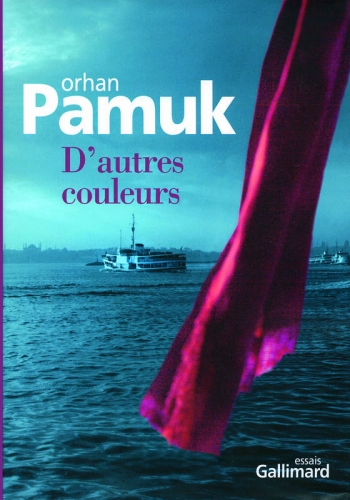
Et je ne dirais pas qu'il y a des "idéologues panomaniaques" parmi les écrivains. Il y a des auteurs qui écrivent sur le pan-ottomanisme, mais dans la fiction, il s'agit plutôt d'une forme de fiction, par exemple, une histoire sur des événements dans le contexte de l'histoire de l'Empire byzantin, dans le contexte de l'histoire de l'Empire ottoman. Ce type de fiction est très populaire. Maintenant, en Turquie, les romans historiques sur la vie des sultans, la vie de la cour, des courtisans, des artistes sont très populaires. Mais je pense que ce n'est pas lié à l'idéologie du pan-ottomanisme. Il me semble que la littérature turque existe par elle-même et n'est orientée vers aucune des idéologies - ni celle d'Atatürk, ni celle du panturquisme, ni celle du pan-ottomanisme. Les écrivains turcs sont, bien sûr, dans l'ensemble, un "point de convergence plutôt libéral". Ils sont largement orientés vers les pays occidentaux, dans une moindre mesure vers la Russie. Certains d'entre eux sont orientés vers leur passé, leur histoire, leur culture. Mais il n'y a pas de pression idéologique.
On peut donc dire que dans la littérature turque, l'élément national s'exprime plutôt à travers une sorte de ressentiment, une sorte de flair nostalgique ?
Oui. En général, le concept de hüzün - mélancolie, nostalgie - est celui de la nostalgie du passé révolu du grand empire. C'est quelque chose qui ressemble au "désir russe".
Comment peut-on caractériser l'identité des Turcs modernes? Quelle proportion de cette identité est turque? Et Quelle est la part " ottomane "? La part islamique?
Je l'appellerais Ottomane-islamique. Mais là encore, la société turque est très diverse. Il y a des gens qui sont très "modernes", très "européens". Et il y a des gens qui sont très traditionnels. La société est comme une courtepointe en patchwork; elle est très différenciée. Mais il est certain qu'il n'y a pas de personnes indifférentes. Les Turcs en général sont extrêmement passionnés.
Dans les termes de la "Noomachie" d'Alexandre Douguine: quel est le ‘’Logos’’ de la Turquie? Léger, ascétique, apollonien, crépusculaire, esthétique, logos de Dionysos ou logos chthonique, logos de Cybèle (son sanctuaire est situé sur le territoire de la Turquie...) ?
Vous savez, je réfléchis à cette question depuis longtemps. Apparemment, elle doit être apollinienne. Bien que l'islam turc ait toujours été très "libéral", large, ouvert et pas aussi rigide que dans d'autres pays.
Au XXIe siècle, la sécularisation de la population en Turquie a été de plus en plus prononcée sous la pression de l'industrialisation. Par ailleurs, le gouvernement d'Erdogan est largement favorable à l'Islam. Comment la question de la religion se reflète-t-elle dans la littérature contemporaine de la Turquie?
Vous savez, je ne dirais pas que la Turquie se sécularise. Je dirais qu'il se passe la même chose en Turquie que ce qu'Orhan Pamuk a décrit dans son roman Neige de 2006: "nous sommes fiers de notre âme "non-européenne", nous sommes fiers du fait que nous ne sommes pas européens. Nous sommes fiers de ne pas être comme vous, et nous n'allons pas enlever le hijab: au contraire, nous le remettrons volontiers". Il me semble qu'à l'heure actuelle, la conscience religieuse de la société est très forte et qu'il existe un besoin aigu de foi parmi les masses. Il existe certes des "îlots libéraux", mais je dirais qu'à l'heure actuelle, même l'élite, qui a toujours été plus ou moins orientée vers l'"occidentalisation", s'est tournée vers l'Islam. J'en ai parlé plus d'une fois dans mes articles: cela se reflète parfaitement dans les œuvres d'Orhan Pamuk, car si nous suivons les grandes lignes de ses œuvres (en partant des premiers romans jusqu'aux plus récents), il est absolument clair que dans les premiers romans, les personnages se cherchent entre l'Est et l'Ouest et souffrent ensuite pour avoir choisi les idéaux occidentaux. Leur vie part complètement en vrille. Dans les romans de la période centrale (par exemple, Le musée de l'innocence), les personnages sont punis pour avoir transgressé les traditions de la société musulmane, et punis très sévèrement. Dans le dernier roman, le héros, qui a choisi une tradition occidentale plutôt qu'une tradition islamique orientale, est assassiné par son propre fils, un féroce musulman. Et le fils ne le paie en aucune façon ; il se retrouve, devient un écrivain célèbre, et le père meurt sans jamais se réaliser. Les œuvres de Pamuk montrent clairement que la société turque (et la société orientale en général) évolue dans la direction opposée à celle de l'Occident.
 Le spécialiste russe de l'islam Ruslan Silatev a un jour qualifié la littérature religieuse turque circulant en Russie de "propagande du panturquisme" et l'a qualifiée de provocation pour les musulmans de notre pays. Dans quelle mesure son affirmation correspond-elle à la réalité ?
Le spécialiste russe de l'islam Ruslan Silatev a un jour qualifié la littérature religieuse turque circulant en Russie de "propagande du panturquisme" et l'a qualifiée de provocation pour les musulmans de notre pays. Dans quelle mesure son affirmation correspond-elle à la réalité ?
Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Il s'agit peut-être d'une déclaration "à l'emporte-pièce", car il existe une énorme quantité de littérature différente publiée en Turquie (ainsi qu'en Russie). Il y a du normal et il y a du ‘’pas normal’’. Il existe une très bonne littérature religieuse turque. Il existe de bons ouvrages réalisés par de bons auteurs. Il y a des œuvres qui sont maintenant traduites en russe et qui sont publiées dans les meilleures maisons d'édition de notre pays. Mais il y a aussi des livres qui sont interdits dans la Fédération de Russie, même s'ils sont disponibles dans les grandes foires du livre turc. Vous ne pouvez pas juger "sans discernement" la littérature religieuse turque, elle est différenciée, elle aussi. D'ailleurs, il existe une énorme quantité de littérature religieuse pour enfants. J'ai personnellement vu des maisons d'édition absolument merveilleuses en Turquie qui publient une excellente littérature musulmane pour enfants, très bien publiée et merveilleusement, magnifiquement écrite. Quel est le problème avec ça ? Peut-être qu'en Russie, nous ne parvenons pas à filtrer tout ce qui nous est apporté. De plus, tout le monde ne connaît pas le turc.
Et qu'en est-il de l'éventuelle propagande du panturquisme par la Turquie? Peut-elle constituer une menace pour la Russie?
Je ne pense pas qu'il y ait de "menace" pour la Fédération de Russie. Une autre chose est qu'ils essaient certainement d'introduire ces idées dans la conscience publique dans certaines de nos régions (parfois avec un succès variable), mais les menaces... Vous savez, les musulmans russes et les Turcs sont tellement intégrés dans notre espace international et interculturel que parler de toute idée... qui peut influencer la situation dans le pays dans une certaine mesure... Je pense que ce n'est pas nécessaire.
En général, le "précurseur" de la fiction en Turquie (ainsi que dans tout le monde islamique) est la poésie religieuse. Cette tradition a-t-elle une place dans la littérature moderne de la Turquie ?
Nous ne devons pas parler uniquement de la poésie religieuse. C'est une petite partie de toute la littérature ottomane: il y avait de la poésie lyrique et de la poésie satirique ; il y avait de la prose - humoristique, hagiographique, satirique, et des descriptions de villes. Il y avait beaucoup de choses différentes. Vous voulez sans doute parler de la littérature soufie, qui ne représente qu'une partie de l'ensemble de la littérature turque. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'elle se développe. De nos jours, il y a, bien sûr, des ashiqs. Au Moyen Âge, c'étaient des derviches errants qui chantaient l'amour d'Allah, et aujourd'hui, ils sont un peu comme nos bardes, et on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une tradition strictement religieuse.

De plus, les écrivains turcs aiment écrire sur les derviches. Comme tous les écrivains turcs que vous rencontrez, ils écrivent sur les derviches parce que ça se vend bien et que c'est très populaire en Occident.
Parmi les antimondialistes, il existe une notion populaire selon laquelle l'"hégémon mondial" du système libéral global ne peut être vaincu que par l'émergence de "centres de pouvoir" indépendants dans le monde, capables de s'opposer tous ensemble à l'hégémon. La Russie et la Turquie voient de tels "centres de pouvoir indépendants". Néanmoins, il existe un certain nombre de contradictions géopolitiques entre la Turquie et la Russie. Serons-nous des alliés les uns des autres contre l'"ennemi commun" ou des rivaux dans l'arène géopolitique locale ?
Comme je l'ai dit, la Russie est un pays autosuffisant, et la Turquie est un pays autosuffisant. Je pense que nous ne parlons ici que de partenariat et de coopération dans le cadre des intérêts des deux pays. Bien sûr, comme nous l'avons vu, il existe d'autres forces dans le monde qui tentent d'influencer nos relations, mais je pense que notre autosuffisance prévaut dans cette situation.
Et comment les différentes minorités sont-elles représentées dans la littérature turque moderne? Je ne parle pas des minorités sexuelles, bien sûr, mais des minorités religieuses, nationales...?
Très bien représentées! En Turquie, il existe une constellation d'écrivains issus de ces minorités. Il y a beaucoup d'écrivains juifs qui écrivent en turc - je suis en train de traduire un roman intitulé A Time to Love, de Liz Behmoaras. Il s'agit de la relation entre un homme musulman et une femme juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en général, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sur les Arméniens, sur les Juifs. L'histoire de la famille arménienne, l'histoire de la famille juive... Un sujet populaire dans la littérature turque.
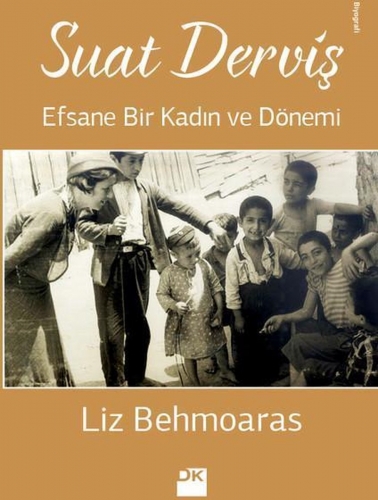
En tant que représentant d'une publication traditionaliste de droite, je ne peux m'empêcher de poser une question particulière: quelles œuvres d'écrivains turcs pourriez-vous conseiller à nos lecteurs conservateurs ? Que pouvons-nous apprendre de ces œuvres ?
Mon œuvre préférée, que j'ai traduite pendant 10 ans, est le roman Rest d'Ahmed Hamdi Tanpınar, dont j'ai déjà parlé. Il a été publié en 2018 par Ad Marginem. Je le recommande à tous les conservateurs. Et probablement aussi le roman Ces choses étranges en moi d'Orhan Pamuk. Ces deux romans traitent du destin d'un homme au milieu d'une société turque différente, en pleine mutation. Dans l'ensemble, ces romans traitent de la tradition, de la manière dont une société persiste face au changement. Elle survit grâce à ses traditions, grâce à sa culture.

13:50 Publié dans Entretiens, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, entretien, littérature, lettres, lettres turques, littérature turque, orhan pamuk |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le premier roman de Thomas Clavel plonge le lecteur dans un récit inquiétant qui s’inscrit dans le genre dystopique si certains faits d’actualité ne corroboreraient pas la préfiguration d’un effrayante avenir immédiat.
« Bo-bo » parisien, brillant khâgneux, normalien sorti de la rue d’Ulm, agrégé en lettres, Maxence Baudry se délecte de la littérature française des XIXe et XXe siècles. Sa thèse « brillamment soutenue (p. 13) » porte sur L’impossible silence de Maurice Blanchot. Écrivain qui se défiait de la notoriété et réprouvait les modes médiatiques, Maurice Blanchot (1907 – 2003) signa en 1961 la pétition des intellectuels de gauche contre la guerre d’Algérie. Tenant une ligne ultra-gauchiste, il vomissait le camp d’en-face d’où il provînt naguère. Avant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Blanchot rédigeait en effet des articles au vitriol dans différentes publications de la « Jeune Droite ». Aux côtés de Jean de Fabrègues et de Thierry Maulnier, il signait dans Combat et L’Insurgé. Leur teneur se caractérisait par leur virulence…
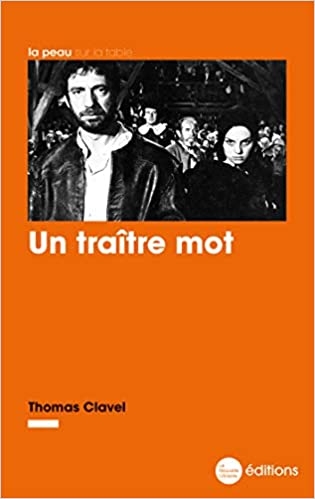 Ne répondez jamais au téléphone !
Ne répondez jamais au téléphone !
Maxence Baudry « depuis quatre ans […] enseignait la littérature à Paris 3 (p. 12) ». Il mène une vie paisible jusqu’au jour où, démarché de façon honteuse par une télévendeuse impudente, il se voit forcer de prendre « un abonnement d’un an à notre pack découverte, exceptionnellement à quarante-neuf euros par mois pendant les trois premiers mois pris au tarif habituel et préférentiel de quatre-vingt-dix-neuf euros par mensualité (p. 15) ». Furieux, il compare l’attitude de cette professionnelle à celle des Roms qui écument les stations de métro de la Capitale.
Maxence Baudry ne sait pas qu’il vient de tomber dans la délinquance verbale. Convoqué au commissariat, il est mis en examen pour « oppressisme dans l’exercice de fonctions enseignantes, romophobie caractérisée et diffusion de contenu idéologique à caractère xénophobe sur les réseaux sociaux (p. 41) ». Le policier a écouté la conversation téléphonique enregistrée et découvert qu’en corrigeant une copie, le prévenu avait osé mettre un quatre sur vingt à une « afro-étudiante », accompagnée du commentaire suprématiste suivant : « Copie insuffisante, travail minimal; il faudra approfondir certaines notions d’histoire littéraire manifestement jamais rencontrées (p. 40). » Horreur de la bonne conscience cosmopolite ! Baudry aggrave encore en cas. Sur son blogue personnel dédié à la littérature, il a commenté un roman de Renaud Camus, véritable pestiféré de la République décadente des Lettres.
Maxence Baudry doit se rendre « le lundi suivant à treize heures, à la quatrième chambre correctionnelle du Palais de Justice (p. 57) » parce que « lorsqu’un individu est inculpé pour délit verbal, l’audience est enregistrée dans des délais exceptionnels (p. 47) ». Cette rapidité revient à « la loi d’Application du Vivre Ensemble (p. 42) » qui est « une loi d’exception (p. 47) ». « Cette loi révolutionnaire avait la particularité de réprimer plus sévèrement les mots que les actes. Une mauvaise parole sur la voie publique enregistrée avec un téléphone portable; un tweet ou une publication Facebook dont on avait conservé la trace grâce à une capture d’écran; un article partagé sur un blog; une conversation privée filmée à l’insu d’un locuteur imprudent : tout cela coûtait désormais plus cher qu’une agression physique (p. 43). » Une modification légale la complète en permettant des indemnisations versées par le condamné « à titre de préjudice subi ou bien de récompense civique (p. 45) ». Il s’agit « d’inciter les citoyens à adopter une conduite moralement responsable (et hautement lucrative) de délation systématique (pp. 45 – 46) ».

Thomas Clavel ne fait qu’extrapoler des cas déjà prévus dans les différentes lois liberticides hexagonales, voire occidentales. Des militants identitaires du local lillois, La Citadelle, sont poursuivis pour des propos enregistrés en caméra caché par un stipendié d’AJ+, le médiat jeune de la chaîne de télévision Al Jazeera. L’auteur aurait cependant pu développer le contexte politique en imaginant que l’acceptation de cette loi « liberticidissime » revienne à la présidente de la République Christian Taubira, à son Premier ministre Najat Vallaud-Belkacem, à la ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Clémentine Autain, au ministère de la Guerre (contre les Blancs), Assa Traoré, et au ministre de l’Intérieur, de l’Accueil inconditionnel des réfugié.e.s – migrant.e.s – exilé.e.s et de la Lutte impitoyable contre toutes les haines Cédric Herrou, Alice Coffin s’installant pour sa part au ministère de l’Éducation transnationale.
Un vivre ensemble obligatoire
Au tribunal, face aux parties civiles, à l’accusation publique et à un auditoire hostiles, Maxence Baudry se défend seul. Il a appris que les honoraires des avocats « avaient explosé, les nouveaux dossiers de crimes de parole étant presque toujours perdus par la partie défendresse (p. 57) ». Dans sa plaidoirie, le prévenu commet l’erreur de se justifier. Il est forcément « condamné à une peine de deux ans de détention avec mandat de dépôt et au versement d’une indemnisation de quatre mille euros au bénéfice de la plaignante Noema Korokossi pour préjudice moral (p. 70) ». Le jugement est « irrévocable, les voies de recours étant impossibles en cas de viol de la loi AVE (p. 71) ».
Plutôt que de se justifier, Maxence Baudry aurait dû se lancer dans une défense de rupture théorisée par l’avocat Jacques Vergès. Ainsi aurait-il nié la légitimité juridique de cette monstruosité et contesté la légalité même du tribunal. Contributeur à Causeur et à Boulevard Voltaire, Thomas Clavel reste un libéral conservateur individualiste et légaliste. Or, face à une telle ignominie décrite dans cette fiction, l’affrontement physique s’impose. Puisqu’il est plus gravement sanctionné dans ce monde affreux de dire que de faire, les victimes de la loi AVE ne devraient-elles pas agir en jusqu’au-boutistes assumés ?
 Outre l’erreur de plaider sa bonne foi devant des juges politisés, Maxence Baudry en commet une autre, antérieure, celle de se rendre à la convocation du commissariat du Ve arrondissement. Il aurait dû suivre pour la circonstance les étrangers délinquants sans-papiers qui n’y répondent jamais. Mais la convocation devient bientôt une perte de temps. L’Arménien Vahé, scénariste de son état, rechigne à adapter Le Nom de la Rose d’Umberto Ecco en remplaçant la jeune paysanne amante du novice franciscain par une Africaine tétraplégique promue héroïne principale de la série… Exagération narrative ? Que nenni ! L’Agence spatiale européenne envisage de recruter pour ses prochaines missions des candidats handicapés. On peut dès lors proposer que les déficients visuels (ou les sans-permis) conduisent les bus et les tramways de la RATP.
Outre l’erreur de plaider sa bonne foi devant des juges politisés, Maxence Baudry en commet une autre, antérieure, celle de se rendre à la convocation du commissariat du Ve arrondissement. Il aurait dû suivre pour la circonstance les étrangers délinquants sans-papiers qui n’y répondent jamais. Mais la convocation devient bientôt une perte de temps. L’Arménien Vahé, scénariste de son état, rechigne à adapter Le Nom de la Rose d’Umberto Ecco en remplaçant la jeune paysanne amante du novice franciscain par une Africaine tétraplégique promue héroïne principale de la série… Exagération narrative ? Que nenni ! L’Agence spatiale européenne envisage de recruter pour ses prochaines missions des candidats handicapés. On peut dès lors proposer que les déficients visuels (ou les sans-permis) conduisent les bus et les tramways de la RATP.
Ulcéré, Vahé répond vertement à son producteur. Il n’obéit à aucune convocation policière. La police l’arrête chez lui. Et s’il avait immédiatement riposté en faisant feu sur eux derrière sa porte ? Aurait-il été jugé pour l’acte ou pour le propos initial à moins que la peine capitale soit rétablie pour ce cas spécifique ? La différence de traitement est d’ailleurs notable entre les prisonniers de droit commun et les « pénitents » coupables de crimes textuels et perçus comme des « malades psychiatriques ». Dans cette dystopie, l’État anarcho-tyrannique fait qu’« en quelques mois seulement, la moitié de la population carcérale d’Île-de-France avait été remplacée. Par voie de conséquence, les taux de délinquance et de criminalité avaient explosé dans certains départements. Mais les rédactions des principales chaînes d’information en continu avaient reçu l’ordre de détruire tous les fichiers vidéo en leur possession qui témoignaient des récentes atteintes aux biens et à la personne (p. 167) ».
Rééducation mentale forcée
Dans la maison d’arrêt de Villepinte, qui ressemble plus à un pénitencier étatsunien, la privatisation en moins, où Maxime Baudry se retrouve détenu, les « pénitents » portent un uniforme couleur sépia distinctif. Sur le modèle des camps du Viet Minh qui endoctrinaient les prisonniers français avec la complicité de l’infâme crapule Georges Boudarel qui ne fut jamais inquiété par les instances universitaires, les détenus subissent chaque mardi une séance obligatoire et délirante de vivre ensemble. On pense ici aux méthodes anglo-saxonnes de rééducation collective imposées aux Sudistes à la fin de la Guerre de Sécession en 1865, aux Afrikaners après la Guerre des Boers en 1901 et au peuple allemand entre 1945 et 1949. Dans ce dernier cas, il en a quand même résulté un chef-d’œuvre d’Ernst von Salomon, Le Questionnaire (1951). Le pédagogue responsable de ce prêchi-prêcha hebdomadaire abjecte ne mériterait-il pas une sévère correction surtout si la violence sur la personne est plus acceptable que la virulence des propos ? Quant au « mitard », le politiquement correct exige de l’appeler « salle de lecture (p. 141)». C’est « une pièce sans fenêtre, ni bibliothèque, avec un petit lit et un WC. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, une enceinte encastrée dans le mur diffusait (à un niveau d’intensité sonore déterminé à l’avance mais que le directeur pouvait modifier à sa guise depuis l’extérieur) les enregistrements de livres audios appartenant à la collection Jeunesse et Diversité du fonds documentaire de l’Éducation nationale (p. 141) ». Pourquoi ne pas la saccager ? Pourquoi les « pénitents » qui sont des dissidents – prisonniers politiques – détenus d’opinion ne se mutinent-ils pas ? Ils appartiennent à une France polie, convenable et bien-élevée. À tort ! Ils gagneraient à agir en hooligans, en pittbulls, en nouveaux Vandales politiques. Contre l’anarcho-tyrannie étatique, c’est une France réfractaire, rebelle et insurgée qui devrait répliquer coup pour coup.

Certes, des embastillés suivent Maxence Baudry. Il leur apprend à résister au bourrage de crâne en réenchantant la syntaxe et le vocabulaire, en retrouvant l’étymologie, l’orthographe et la grammaire, en se réappropriant la sémantique. Bientôt, les détenus les plus déterminés constituent un contre-atelier informel de réaction linguistique sans que cela ne débouche sur un véritable réseau clandestin de résistance à l’intérieur de la maison d’arrêt. Thomas Clavel ignore peut-être que de telles structures sont possibles et qu’elles ont existé à diverses périodes contemporaines. Les détenus appartiennent à la France bien élevée, respectueuse des lois.
En dépit d’une fin assez conformiste, c’est un honorable roman qui annonce (un peu trop tardivement ?) des temps difficiles. Il esquisse un début de commencement de réaction vitale à la seule échelle individuelle. Oui, seule une minorité agissante et engagée saura évincer les autres minorités organisées. N’oublions jamais, l’exemple récent des « Gilets Jaunes » en fait foi, que l’histoire n’est pas populiste, mais aristocratique.
Georges Feltin-Tracol
• Thomas Clavel, Un traître mot, Éditions La Nouvelle Librairie, coll. « La peau sur la table », 2020, 230 p., 14,90 €.
00:37 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas clavel, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
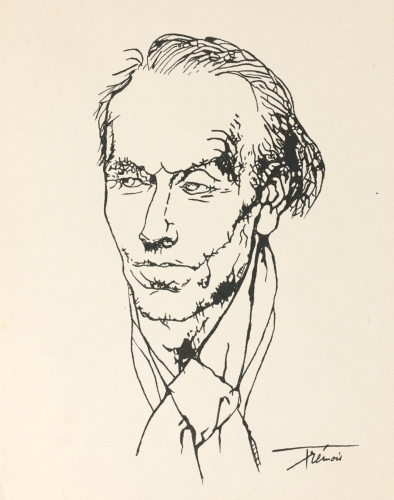
Parution du numéro 439 du Bulletin célinien
Sommaire :
Quand Chateaubriand prédisait la venue de Céline…
Le Journal de Rebatet
Céline dans Juvénal
Quand le fantôme de Céline met la Préfecture de police en émoi [archive]
 Il est périlleux pour un comédien de lire Céline. Le risque est d’en faire trop, de souligner les effets, bref de surcharger. Voilà un écueil qu’évite sans conteste Denis Podalydès. Après nous avoir donné une lecture intégrale de Voyage au bout de la nuit ¹, il nous gratifie, cette fois, de celle de Mort à crédit, sous la forme de deux disques compacts (format mp3). Autant le dire d’emblée : il ne fait pas l’unanimité auprès des céliniens si l’on en juge par les avis propagés sur les réseaux sociaux de l’Internet. Les uns goûtent peu sa lecture jugée monocorde même si elle est motivée par le souci de ne pas verser dans l’expressionnisme facile et vulgaire de certains interprètes. Les autres, la trouvent très fine, à l’opposé des lectures outrées qui abondent. En atteste ce commentaire : « Pas le plus musical, pas le plus jazzy, mais une véritable fragilité qui révèle de très belles nuances dans le texte… J’ai longtemps préféré Luchini pour son interprétation très “dansante” ; celle de Podalydès me paraît aujourd’hui tellement plus subtile, moins caricaturale. » À propos de sa lecture de Voyage, l’écrivain Thomas Compère-Morel estime qu’il a trouvé « la respiration parfaite de l’écriture célinienne pour nous en restituer la force brute ». Le critique littéraire Grégoire Leménager renchérit : « Loin de la gouaille de Michel Simon comme des éruptions jubilatoires de Luchini, ce sociétaire de la Comédie-Française lit Céline comme il lirait du La Bruyère. Soudain très grand siècle, avec une sobriété qui confine à la pureté, le saisissant bavardage de Bardamu y devient ce qu’il est aussi : un immense texte classique, qui oppose la beauté d’une langue à la trivialité du monde. » Il faut dire que Podalydès a l’intelligence de s’adapter au canal de diffusion : il ne s’adresse pas ici au public d’une salle de théâtre mais à une seule personne écoutant le texte dans l’intimité.
Il est périlleux pour un comédien de lire Céline. Le risque est d’en faire trop, de souligner les effets, bref de surcharger. Voilà un écueil qu’évite sans conteste Denis Podalydès. Après nous avoir donné une lecture intégrale de Voyage au bout de la nuit ¹, il nous gratifie, cette fois, de celle de Mort à crédit, sous la forme de deux disques compacts (format mp3). Autant le dire d’emblée : il ne fait pas l’unanimité auprès des céliniens si l’on en juge par les avis propagés sur les réseaux sociaux de l’Internet. Les uns goûtent peu sa lecture jugée monocorde même si elle est motivée par le souci de ne pas verser dans l’expressionnisme facile et vulgaire de certains interprètes. Les autres, la trouvent très fine, à l’opposé des lectures outrées qui abondent. En atteste ce commentaire : « Pas le plus musical, pas le plus jazzy, mais une véritable fragilité qui révèle de très belles nuances dans le texte… J’ai longtemps préféré Luchini pour son interprétation très “dansante” ; celle de Podalydès me paraît aujourd’hui tellement plus subtile, moins caricaturale. » À propos de sa lecture de Voyage, l’écrivain Thomas Compère-Morel estime qu’il a trouvé « la respiration parfaite de l’écriture célinienne pour nous en restituer la force brute ». Le critique littéraire Grégoire Leménager renchérit : « Loin de la gouaille de Michel Simon comme des éruptions jubilatoires de Luchini, ce sociétaire de la Comédie-Française lit Céline comme il lirait du La Bruyère. Soudain très grand siècle, avec une sobriété qui confine à la pureté, le saisissant bavardage de Bardamu y devient ce qu’il est aussi : un immense texte classique, qui oppose la beauté d’une langue à la trivialité du monde. » Il faut dire que Podalydès a l’intelligence de s’adapter au canal de diffusion : il ne s’adresse pas ici au public d’une salle de théâtre mais à une seule personne écoutant le texte dans l’intimité.
On ne compte plus les grands comédiens qui ont lu Céline : de Michel Simon à Pierre Brasseur en passant par Arletty, Le Vigan, Georges Wilson et bien entendu Luchini. Ce qui n’est guère connu, ce sont les lectures qui n’ont pas fait l’objet de disques. Ces trésors figurent dans les archives de l’Institut national de l’audiovisuel, ayant été diffusés jadis sur les ondes des radios publiques, particulièrement France-Culture. Plusieurs comédiens de grand talent ont, en effet, prêté leur voix à des émissions consacrées à Céline. Citons en vrac Jean-Louis Barrault, Michel Bouquet, Marcel Bozzuffi, Alain Cuny, André Dussolier, Julien Guiomar, Jean Négroni, Michel Piccoli, pour n’en citer que quelques-uns. Celui qui se dégage du lot, à mon sens, est Michel Vitold, excellent dans deux registres différents : un extrait éruptif de Bagatelles et un passage déchirant de Féerie où l’écrivain évoque sa mère décédée alors qu’il était en exil ². Une idée que je soumets à Laurent Vallet, président de l’I.N.A. (nommé en 2015 et renommé à ce poste en 2020) : éditer un disque consacré à Céline reprenant quelques unes de ses lectures d’anthologie.
• Louis-Ferdinand Céline. Mort à crédit. Lecture intégrale par Denis Podalydès. Gallimard, coll. “Écoutez lire”, 2021. Deux disques compacts. Durée : 23 heures. (26,90 €)
00:28 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Il n’y avait pas un bon et un mauvais Céline : il y avait Céline, un point c’est tout!
Par Francesco Subiaco
SOURCE: https://culturaidentita.it/non-cera-un-celine-buono-e-uno...
"La postérité est surtout exigeante pour son hypocrisie." Une hypocrisie qui, comme l'écrit Pol Vandromme, les conduit à mesurer les artistes avec la lentille du moralisme, à la myopie qui regarde le passé, ou pire l'art, avec les yeux du présent. Laisser de côté la grande littérature pour des raisons politiques, sans se soucier du style, de l'œuvre, voilà de quoi il retourne. Même si, trop souvent, une mauvaise écriture a été pardonnée au nom d'une mauvaise politique. Cependant, Vandromme, critique belge et cosmopolite, n'était pas affecté par ces myopies et consacrait son activité à la diffusion d'auteurs gênants, dont les grandes œuvres ne pouvaient être éclipsées par des moralismes. Parmi eux, Louis Ferdinand Céline, raconté dans un splendide essai du même nom publié par ITALIA STORICA, sous la direction d'Andrea Lombardi. Un essai nécessaire pour connaître ce maudit auteur capable d'écrire les grands chefs-d'œuvre du vingtième siècle, comme Voyage ou Nord. Un auteur réadmis trop tard, et partiellement seulement, au Panthéon des Lettres, tiraillé entre la thèse du bon Céline des premiers romans et du mauvais Céline des pamphlets et de la trilogie allemande.
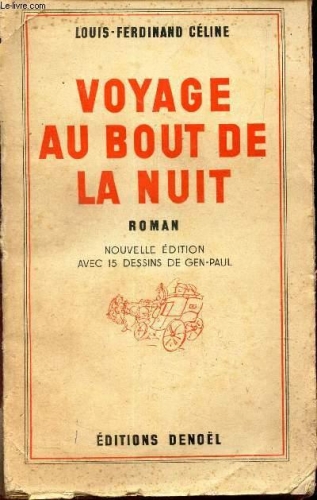
Vandromme parvient à mettre en évidence comment, cependant, cette différence n'est qu'apparente, comment les pamphlets, inexcusables et déplorables par leur contenu, ne peuvent être séparés de la personnalité et du style de cet Ezéchiel parisien, puisque "les romans racontent la peur, les pamphlets cherchent à la détruire", mais les uns comme les autres sont les enfants de la même atmosphère et du même monde. Un monde dont le thème fondamental est la peur, qui est exacerbée, déformée, créant des monstres, créant des rêves d'obsessions. Des obsessions qui sont le lent présage de la mort, de la dissolution. D'une condition de putréfaction et de fin dont Céline s'illusionne pour s'en sortir grâce aux exorcismes de ses pages. Une peur que l'on retrouve dans tous les textes de Céline et qui se manifeste par la "dénonciation de l'imposture contemporaine, du long combat victorieux que la décadence menait contre l'instinct de l'espèce". Une dénonciation qui devient un réquisitoire contre la guerre, comme la prophétie de la mort. Une mort qui est "la seule vérité de la vie", pour laquelle la guerre est une tragédie, un crime humanitaire sans "si" ni "mais". Une description de la condition existentielle amplifiée par un langage expressionniste et déformant, qui plonge dans les abîmes de l'âme humaine, voyant ses monstruosités, ses petitesses. La création de personnages parmi les plus vrais de la littérature et un style qui parvient à devenir porteur d'un nouveau naturel. Un naturel qui bouleverse le langage et en fait le grand mégaphone des émotions. En le transformant en un discours artificiel et vrai. De la petite musique qui fait bouger l'âme des ténèbres et de la nuit. La couleur des fantasmagories absurdes de Guignol’s Band et de Mort à crédit, de la liquéfaction du mot, de la fragmentation et du délire. Qui raconte la foule solitaire, le crépuscule halluciné du colonialisme, le désert de la guerre, la rage du bombardement, de Voyage a Nord. Vandromme vivisectionne le langage, les thèmes et les masques de l'œuvre de Céline, entre l'imminence de la peur, la destruction de la guerre et l'innovation linguistique. Récit de ce chroniqueur et styliste de la décadence, entre l'ironie de Swift et le cynisme de La Rochefoucauld. Réaliser l'exégèse de romans et de pamphlets, évalués à la lumière de leur validité stylistique, en considérant toujours l'horreur de son contenu. En nous disant que "nous ne devons pas avoir peur de ses livres". La société littéraire doit être capable de supporter tous les scandales et toutes les folies, d'avaler ses œuvres et de digérer ses mesquineries." D'autre part, comme le disait Arbasino, "l'œuvre d'art s'écrit elle-même". Et il parle le langage du style et de l'émotion".
Francesco Subiaco.
11:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, lettres, littérature française, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Louis-Ferdinand Céline et le "blabla" idéologique de notre temps
par Frédéric Andreu-Véricel
Au temps où la liberté de déplacement était encore autorisés, une odyssée cycliste m'avait conduit à coudoyer la maison d'exil de L.F. Céline au Danemark. Point d'orgue de ce voyage, ma rencontre inopinée avec un témoin direct de l'époque, dont je comprends aujourd'hui la responsabilité face à l'Histoire. Olé Seyffart-Sorensen, huit ans à l'époque des faits, a en effet noué une touchante complicité avec le «Géant» (A l'époque, le gamin accompagnait son père dans la masure, prêtée par l'avocat danois, pour y effectuer de menues réparations de boiserie, cette masure ou Céline et Lucette passèrent bon gré, mal gré, plus de trois années).
Bref, avec le temps, ce voyage semble avoir délivré sa charge heuristique au delà de l'anecdote. La question est de savoir ce que le mal aimé des Lettres Française dirait des avancées sociétales du XXIème siècle, de cet art contemporain qui s'impose dans nos rues ébahies et autres confinements à répétition. Céline est mort il y a 70 ans (le même jour que Ernest Hemingway) mais une grande oeuvre peut agir aussi comme une réplique, au sens sismique du terme, du substrat de la civilisation.
Les confinements ont, à leur manière, contribué à donner des messages nouveaux à mon questionnement célinien. Je songe aux truculents entretiens radiophoniques disponibles sur internet, résonnant avec cette époque de basses eaux que nous traversons.
L'entretien de 1957, réalisé pour le compte d'une radio suisse, sonne comme un véritable roman radiophonique. Le fond sonore se compose de bruits divers et chants de menâtes qui donnent à ces propos une hilarité toute particulière que l'on retrouve bien sûr dans ses romans. L'auteur d'Un château l'autre qui se joue des faiblesses du journaliste, déclare notamment :
«Je suis femme du monde, Monsieur, et non pas putain ; j'ai des faiblesses pour qui je veux... Je me sacrifiais pour mes semblables. Je n'ai pas eu d'avantage à me sacrifier !"...
Quant aux innombrables colloques et recensions qui font flores sur la toile, aussi passionnants fussent-ils, ils ne m'ont pour autant pas fait basculer dans le célinisme confessionnel. C'est même en réaction contre un certain nombre de "poncifs" véhiculés autour de Céline, comme celui de l' "écrivain styliste", que j'ai commis cet article. Je voulais le surligner avec d'autant plus d'audace que ce poncif, répété en choeur par tous les épigones, provient de Céline lui-même. Dans un entretien de 1957, il déclare : « On parle de "messages". Je n'envoie pas des messages au monde. L'Encyclopédie est énorme, c'est rempli de messages. Il n'y a rien de plus vulgaire, il y en a des kilomètres et des tonnes, et des philosophies, des façons de voir le monde... ».

L'auteur du Voyage a martelé à plusieurs reprises qu'il n'était pas un "homme à idées, un homme à messages" mais il s'exprimait après avoir échappé à "la plus grande chasse-à-courre qui ait été organisée dans l'Histoire", au terme de dix-huit mois de réclusion au Danemark et six ans d'exil hors de France avant son retour équivoque.
Après guerre, l'Histoire était en cours d'être réécrite à la faveur des vainqueur. Et cette histoire fut écrite symétriquement contre le projet européen d'Hitler et la France de Céline. A son retour en France, son image d'écrivain maudit le contraint donc à une semi-clandestinité. A l'étage de la maison de Meudon, Lucette prodigue ses cours de danse ; au rez-de-Chaussée, le médecin Destouches reçoit quelques patients. Il écrira les trois romans fulgurants de la «trilogie allemande» (D'un château l'autre, Nord et Rigodon) mais réserve désormais ses visions politiques aux rares amis fidèles.
Pour cette période meudienienne, deux thèses s'affrontent, celle des Céliniens qui prétendent que sa posture et sa tenue vestimentaire de clochard aristocrate étaient surjouées et factices, et celle du très dévoué rédacteur de la revue célinienne, Marc Laudelout, qui penche au contraire pour un retrait jüngérien de Céline sur le mode «anarque».

Quelle que soit la réalité vécue, Céline fut sans conteste un "lanceur d'alerte" avant l'heure. Grand blessé de 1914, il milita contre la déclaration de guerre d'une France dont il présageait l'issue tragique. Il fustige une déclaration de guerre perdue d'avance. Il sera perçu pour un héros au début du second conflit mondial. A son retour en France, il restera un sage à la mode de Diogène-le-Cynique dans la villa de Meudon.
Sur l'art célinien, l'erreur généralement commise est à mon avis double :
1) Dissocier le style émotif de Céline et son "message" textuel est le premier travers dans lequel tombent nombre de Céliniens. En réalité, cette dichotomie n'est pas plus plus opératoire que la séparation franche entre la vie et l’oeuvre d 'un auteur. Ces manoeuvres appartiennent au monde proustien relayé par certains universitaires détachés des contacts avec les réalités et les sortilèges de l'écriture, promptes à créer une religion de ces séparations abstraites tout en se gardant bien d'occulter les distinctions lorsqu'elles s'imposent, le pays réel et le pays légal, par exemple.
A mon avis, style et « idées » ne sont tout simplement pas séparables, pas plus que forme et force en peinture aurait dit René Huyghe.
Certes, le travail de restitution de l'émotion du langage parlé dans l'écrit ne fait pas de Céline un théoricien des idées ni un "philosophe" stricto sensu, bien qu'il puisse, à mon avis, être perçu comme un "cynique". Céline est comme les cyniques grecs, proche des animaux. Il aime la compagnie des chats, des perroquets et des chiens ("cynique" provient d'ailleurs du latin cynismus pour désigner ce qui concerne le "chien"). Comme les Cyniques grecs, il aime à exprimer sans ménagement des sentiments, des opinions contraires à la morale reçue.
Les Cyniques ont pris pour modèle le chien car cet animal aime "ronger les os". Les Cyniques rongeaient les Idées platoniciennes. Céline, lui, est celui qui ronge le "blabla" que ce soit celui des va-en-guerres des années 30 que celui des chantres des évolutions sociétales des années 60. Céline est par exemple, avant Marshall Mac Luhan, un critique de la télévision et la publicité dont il pressent le pouvoir sur les masses dès 1953. Il anticipe la société du spectacle de Guy Debord. Il perçoit la portée idéologiques de la « réclame ».
On peut imaginer sans peine ce qu'il écrirait aujourd'hui face au "soft power" néolibéral de la machine macronienne, les avancées de la démocrature mondialiste sous couvert d'hystérie sanitaire. Il tournerait à coup sûr en dérision toute cette grossière mascarade ! Gageons également qu'il aurait été le premier à porter le "gilet jaune" sur les rond-points du pourtour parisien sur le mode "périféerique pour une autre fois" !

2) En revanche, contrairement à l'idée répandue, le style célinien est moins le retour de la langue populaire (la langue de la rue) que l'art de restituer l'émotion de la langue. Céline cherche à nettoyer la dentelle de la langue des formalismes et du métalangage hérités de la langue diplomatique du XVIIème siècle. Il désenclave la langue, il ne lui fait pas faire le trottoir. Mort à Crédit fourmille de mots d'argot, mais Féerie pour une autre fois, oeuvre la moins comprise du corpus, touche la dentelle même de la langue.
Si la langue est marquée, comme toutes réalités, par des mouvements de balancier, la langue romanesque de Céline marque incontestablement un "retour" à la langue pré-scripturale, souterraine, dionysiaque et rabelaisienne. Mais celle-ci ne s'identifie à mon avis pas à la "langue de la rue". Ceux qui soutiennent cette thèse se rangent sans même le savoir du côté de la critique allemande qualifiant les romans de Céline d'Asphalt Literatur, critique intéressante mais étrangère à la francophonie.
A mon avis, la langue célinienne a plus a voir avec le mouvement transcendantalisme américain qu'à l'Asphalt Literatur. Mais Céline est un Européen, au lieu de faire son miel du passé amérindien, il renoue avec le fond païen celtique, notamment. N'oublions pas que "Céline" est le prénom que Louis-Ferdinand emprunte à sa grand-mère bretonne, celle qui transmis au fils unique Destouches, choyé par ses parents, les légendes bretonnes des "Saints de la main gauche".
On comprends maintenant mieux pourquoi Céline se disait opposé aux idées: son style est déjà "idéologique", il n'a pas besoin d'exposer des idées pures ou phosphorer sur tels ou tels débats de société. Ce n'est pas un théoricien. A mon sens, on comprends que Céline a agit avec les idées comme il a agit avec la langue française dont il épure les lourdeurs et les formes figées. Il s'agit d'un « rendu émotif » de la langue française et non d'un bilan d'idées.
J'avance par ailleurs l'idée que Céline fut aussi le pionnier des "lanceurs d'alerte" en ouvrant notamment le sillon à Guillaume Faye.
3) Parmi les héritiers de Céline...: Se demander quelles « personnalités » pourraient aujourd'hui revendiquer l'héritage de Céline, c'est déjà y répondre. Bien sûr, le nom de Guillaume Faye vient à l'esprit comme une évidence. Le théoricien des années 80, l'"Esprit fusée" de la ND, fut aussi un humoriste sur les ondes de Sky Rock, un « homme total » décrié jusque dans ses propres rangs, comme il se doit pour un Célinien pur sucre. Nous savons que Faye mourut en état de semi-clochardisation à Paris.
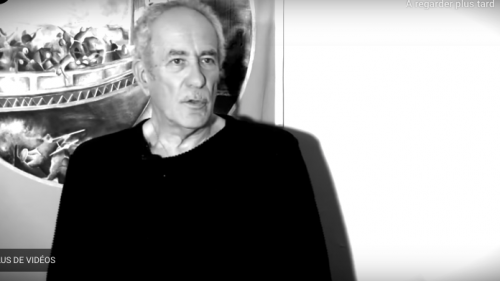
Parmi les héritiers, je pense aussi au directeur artistique Joël Labruyère dont certains textes sont céliniens sans chercher à l'être. Dans la chanson Le Dieu Azard, le chansonnier développe une satire des "prêchi-prêcha" de la religion républicaine et scientiste; on ne saurait mieux s'inscrire dans le sillon du Céline pourfendeur des "blablas" pseudo-démocratiques de son temps, d'autant que la scénographie du clip avec des personnages à masques d'animaux n'est pas sans évoquer les réalités augmentées du roman célinien.
https://communaute-rose-epee.fr/2021/03/31/le-studio-des-brigandes-le-dieu-hazar-hasard/
Notons au passage que Céline est l'inventeur du néologisme "blabla" (dans Bagatelle pour un massacre) mais aussi de la ponctuation "émotive", entre autres innovations entrées aujourd'hui dans l'usage. L'héritage célinien est esthétique, il irradie tous les arts, littérature et cinéma notamment car la langue agit par cristallisation des innovations esthétiques.
Les entretiens relatifs à Céline sur internet réservent quelques perles à leurs auditeurs attentifs. Au cours du colloque tenu en 2011 sur le thème de Céline et L'Histoire : http://www.lepetitcelinien.com/2011/02/colloque-louis-ferdinand-celine-paris.html un intervenant prend la parole (à 3:27:00 minutes de l'émission) à propos des "chochottes anglaises", qui n'est autre que Robert Faurisson ! Vous pourrez sans doute reconnaître le truculent professeur au ton de sa voix. L'intervenant reste anonyme mais déclare être "demi-écossais".
Profitons de ce clin d’oeil amusant pour souligner l'apport du professeur en matière d'analyse textuelle, son interprétation étonnante de l'énigmatique poème "Voyelles" de Arthur Rimbaud a fait date. Ne le réduisons donc pas à son révisionnisme héroïque.
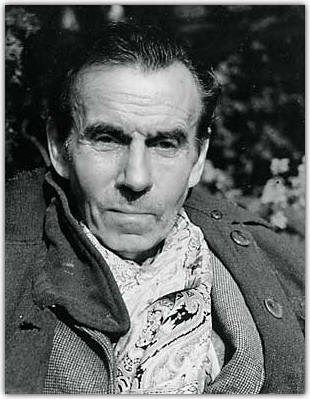 Les génies se reconnaissent souvent par leur pluralité, leur côté insaisissable, leur décalage par rapport à leur temps et au "polythéisme des valeurs". Céline fut à la fois un écrivain de génie, un lanceur d'alertes, et comme Apollinaire en son temps, un visionnaire. Il a notamment annoncé le déclin français, le crépuscule occidental, ainsi que la montée en puissance de la Chine. Il n'est pas exagéré de dire que nous serons tous un jour ou l'autre "céliniens", conscients ou non de cet héritage. Dès le Voyage, Céline annonce avoir renouvelé la littérature pour deux cent ans. Les génies se reconnaissent aussi par les phénomènes de cristallisations mimétiques qu'ils entraînent, malgré eux, après coup. On songe que Céline le reprouvé, le proscrit des commémorations, reste l'un des écrivains français le plus lu dans le monde. Il est l'objet d'un journal bimensuel publié depuis les années 80 regroupant tous les articles et publications à son sujet. Quel autre auteur peut en dire autant ?
Les génies se reconnaissent souvent par leur pluralité, leur côté insaisissable, leur décalage par rapport à leur temps et au "polythéisme des valeurs". Céline fut à la fois un écrivain de génie, un lanceur d'alertes, et comme Apollinaire en son temps, un visionnaire. Il a notamment annoncé le déclin français, le crépuscule occidental, ainsi que la montée en puissance de la Chine. Il n'est pas exagéré de dire que nous serons tous un jour ou l'autre "céliniens", conscients ou non de cet héritage. Dès le Voyage, Céline annonce avoir renouvelé la littérature pour deux cent ans. Les génies se reconnaissent aussi par les phénomènes de cristallisations mimétiques qu'ils entraînent, malgré eux, après coup. On songe que Céline le reprouvé, le proscrit des commémorations, reste l'un des écrivains français le plus lu dans le monde. Il est l'objet d'un journal bimensuel publié depuis les années 80 regroupant tous les articles et publications à son sujet. Quel autre auteur peut en dire autant ?
4) L'art de Céline est le contraire même de l'art contemporain. La révolution célinienne touche le fond d'air de son temps (comme on pourrait dire : « le fond de l'air est célinien ») à l'instar d'un sismographe qui enregistre les mouvements telluriques d'un sol. Si l'influence de Céline est souterraine, si sa figure irrite autant qu'elle fascine, c'est sans doute parce qu'il travaille en dehors de toute climatisation idéologique (y compris fasciste). Son travail a consisté à décaper les couches de peinture de la langue pour atteindre sa trame émotive, d'où le génie qu'on lui prête. Il lui arrivait de paraphraser Saint Jean : « au début était l'émotion».


En matière d'art, il appréciait les impressionnistes, Vlaminck, etc. Il n'aimait pas la peinture abstraite, par exemple Dubuffet, qui, lui, avait une admiration éperdue pour Céline. Mais ses préférences allaient à Breughel, Bosch, etc. Bref, un choix éclectique.
Les tendances d'une certaine littérature et de l'Art Contemporain (AC) vise au contraire la monoculture. L'idée est d'expulser la trame émotive de l'art pour ne garder que la couche de peinture superficielle, conceptuelle, hors-sol, idéologique. D'où l'impression que les expositions d'AC ne touchent plus l'âme des spectateurs mais seulement l'épiderme et qu'elles s'imposent à l'instar de « slogans ». On peut parler à leur endroit de stratégie d'im-position et non d'ex-position. Tout se passe comme si les artistes subventionnés de l'AC agissaient à rebours de Céline.
Céline épure la langue de ses lourdeurs, le résultat est une langue qui est à la fois populaire et poétique sans chercher à l'être, poétique par « grâce », alors que les homards géants qui s'imposent sur nos places publiques sont tout au contraire des concepts déguisés en oeuvre, interdisant de ce fait tout espèce de réminiscence. L'émotion est remplacée par la provocation; le talent par la soumission à un logiciel idéologique et financier indiscutable, minutieusement démontré dans les ouvrages d'Aude de Kerros.

Dans une émission de radio, Aude de Kerros pose par ailleurs une question d'une grande actualité : « Peut-on être dissident dans le système libéral ?». La réponse à cette question est moins simple qu'il n'y paraît. Le libéralisme a transformé l'anti-fascisme (secondairement, l'anti-communisme) en neutralité politique. Dans une discussion entre amis, il faut être antifasciste pour être neutre et commencer à avancer un argument. Toutes vérités entre les lignes (la pensée transversale) sont désormais proscrites. Contemporain de la télévision, Céline disait que l'homme moderne était « lourd et épais ». Mais imaginait-il qu'il puisse atteindre l'obésité actuelle ?
Aujourd'hui, toute critique de l'AC pose un trouble. Si vous critiquez des oeuvres où l'âme a été remplacée par le concept, vous êtes automatiquement «suspecté» de dissidence. L'amalgame tombe sur vous comme une avalanche, et pour éviter les descellements des plaques de neige idéologiques, vous vous faites petit et discret.
Si, a contrario, vous critiquez frontalement l'AC ou la boite à munitions idéologiques qu'il contient (théorie du genre, théorie du climat) vous êtes automatiquement suspecté car l'AC cristallise l'astralité du néo-libéralisme. L'homme à qui il correspond est un homme hors-sol, interchangeable et consumériste, un homme sans âme et sans révolte.
Dans le climat idéologique actuel, l'AC reflète donc un enjeu idéologique. A mon sens, la dissidence consiste précisément d'en revenir «aux oeuvres», éprouvées et éprouvantes, aux Bergers d'Arcadie, à la Vierge au chancelier Rolin, sans pour autant passer d'une monoculture à une autre. Max Weber parle de « polythéisme des valeurs » ; c'est dans cette direction qu'il faut se diriger. Le Kolumba Museum de Cologne est à mon avis, un exemple de muséographie innovante échappant à la fois au passéisme réactionnaire et au progressisme idéologique.
L'auteur du Voyage a mis en lumière, comme Rabelais en son temps, les «sentiments innommables». Il en ressort un sentiment de provocation, parfois de malaise, mais à rebours de la provocation programmée de l'AC car Céline ne fait pas table rase du passé, il démystifie au contraire tous les « blablas » de notre temps y compris dans la langue elle-même. Dans son chef d'oeuvre Féerie pour une autre fois, on trouve la formule suivante. A tout seigneur, tout honneur ; nous voudrions terminer par elle:
"C'est des filigranes, la vie. Ce qui est écrit net, c'est pas grand chose. Ce qui compte, c'est la transparence. La dentelle du temps, comme on dit."
PS : Le récit de notre rencontre avec Ole et de mes aventures au Danemark, disponible ici:
https://www.lulu.com/en/en/shop/fr%C3%A9d%C3%A9ric-andreu-v%C3%A9ricel/voyage-au-bout-de-c%C3%A9line/paperback/product-98ynm8.html?page=1HYPERLINK "https://www.lulu.com/en/en/shop/frédéric-andreu-véricel/voyage-au-bout-de-céline/paperback/product-98ynm8.html?page=1&pageSize=4"&HYPERLINK "https://www.lulu.com/en/en/shop/frédéric-andreu-véricel/voyage-au-bout-de-céline/paperback/product-98ynm8.html?page=1&pageSize=4"pageSize=4)
Frédéric Andreu-Véricel
contact : fredericandreu@yahoo.fr
16:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook