
Presseschau
August 2018
AUßENPOLITISCHES
Reform der Europäischen Union
Weniger EU ist mehr Europa
von Michael Paulwitz
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/weniger-e...
Rechtspopulisten-Stiftung in Europa
Bannon plant europäische Revolte
Vom Brexit und den Rechten in Italien inspiriert, will der ehemalige Chefstratege Donald Trumps nun das EU-Parlament aufmischen.
http://www.taz.de/!5518650/
EU-Wahlen 2019
Deutsche Politiker reagieren mit Sorge auf geplante Bannon-Stiftung
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/deutsch...
Bannon-Stiftung
Das Establishment zittert
von Boris T. Kaiser
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/das-estab...
Sonntagsheld (71) – Der Bannon-Maréchal-Komplex
https://sezession.de/58953/sonntagsheld-71-der-bannon-mar...
Europäische Asylpolitik
Macron beruft Botschafter in Ungarn wegen Pro-Orban-Memo ab
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/macron-beru...
Polizei erschießt jungen Mann: Schwere Unruhen in Nantes
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/unruhen-...
Nach tödlichen Schüssen
Ausschreitungen in Nantes gehen weiter
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/ausschreitu...
Niederlande
Chef von Migrantenpartei fordert Holländer zum Verlassen des Landes auf
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/chef-von-mi...
Kleine Entspannungsgesten zwischen Spanien und Katalonien
https://www.heise.de/tp/news/Kleine-Entspannungsgesten-zw...
Pressekonferenz
Puigdemonts letzter Akt in Deutschland
von Thorsten Brückner
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/puigdemonts...
Spanien
Ein Land auf dem Weg ins Asylchaos
von Marco Pino
https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/ein-land-auf-dem-...
(Globale Zu- und Abwanderung)
Einwanderung
Polen wirbt philippinische Gastarbeiter an
https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/polen-wirbt-phili...
Absurdistan, Provinz Nord
Die Situation in Schweden
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-situation-i...
(Überforderter Zivilschutz)
Schweden: "Die größten Brände werden wir nicht löschen können"
50 Brände zählt Schweden im Moment. Es sei die schwierigste Situation, in der sich der Rettungsdienst jemals befunden habe, sagt der Chef des Zivilschutzes.
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-07/sc...
Tarnkappenfregatte klar für den Einsatz
Die Modernisierung der russischen Marine schreitet voran. Nächste Woche wird in St. Petersburg das erste Schiff einer neuen Klasse von Tarnkappenfregatten für die russische Marine in Dienst gestellt.
http://www.kn-online.de/Nachrichten/Politik/Russlands-Mar...
Syrien: Rebellenkämpfer geben eine der letzten Provinzen auf
Im Süden von Syrien können Regimetruppen die Provinz Kuneitra übernehmen. Oppositionelle sollen nach einem Abkommen mit den Rebellen nach Idlib im Norden gehen dürfen.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/syrien-rebell...
Mögliche Kooperation in Syrien - Kurden verhandeln mit Assad
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/moegliche-kooperatio...
Syrienkonflikt
Israel bombardierte offenbar Ziele nahe dem Flughafen von Damaskus
Das Ziel soll ein Waffenlager der libanesischen Hisbollah-Miliz gewesen sein: Israel hat nach Angaben von Aktivisten und dem syrischen Staats-TV Stellungen in der Hauptstadt beschossen.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-israel-bomba...
Naher Osten: Syrien meldet Luftangriff durch Israel
Israel hat nach syrischen Angaben Raketen auf Armeestellungen abgefeuert. In Daraa fehlen laut der Hilfsorganisation Oxfam Tausenden Menschen Wasser und Nahrungsmittel.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/naher-osten-s...
Diskriminierung
Israel verabschiedet umstrittenes "Nationalitätsgesetz"
Benjamin Netanyahu sprach von einem "Schlüsselmoment" in der Geschichte des Zionismus und des Staates Israel: Mit knapper Mehrheit hat das Parlament ein Gesetz durchgebracht, das arabische Israelis diskriminiert.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/israel-verabschiede...
Abstimmung in der Knesset
Israel beschließt Nationalitätengesetz
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/israel-besc...
Islamische Flüchtlinge in Südostasien
Südkorea: Demonstranten wollen keine Asylbewerber im Land
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/suedkorea-d...
China will Militärbeziehungen zu Afrika ausbauen
https://www.dw.com/de/china-will-milit%C3%A4rbeziehungen-...
Streit der Supermächte
„Amerika beginnt den größten Handelskrieg der Geschichte“
http://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/amerika-beginnt-den-g...
Ehemalige US-Außenministerin
Rundumschlag: Albright attackiert Trump, Orbán und Putin
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/rundumschla...
(So kommt die Hetze von oben unten an…)
Donald Trumps Hollywood-Stern mit Spitzhacke zertrümmert
https://www.derwesten.de/politik/donald-trumps-hollywood-...
(Gesetz gegen Maskierung von "Antifaschisten" in den USA)
A new bill aims to send masked Antifa activists to jail for 15 years
https://edition.cnn.com/2018/07/12/us/unmasking-antifa-ac...
Kuba führt strengere Regeln für den Privatsektor ein
https://www.nzz.ch/wirtschaft/kuba-fuehrt-neue-strengere-...
"Kommunismus" gestrichen
Was die neue Verfassung für Kuba bedeutet
Kubas Parlament hat eine Verfassungsreform abgesegnet. Darin taucht erstmals das Wort Privatbesitz auf. Und was steht sonst noch drin? Die wichtigsten Antworten.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kuba-was-die-verfas...
Reform: Kuba streicht "Kommunismus" aus der Verfassung
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/kuba-verfassu...
Venezuela: IWF prognostiziert Inflationsrate von einer Million Prozent
Wegen der Geldpolitik in Venezuela rechnet der Internationale Währungsfonds mit weiterem Preisverfall: Die Lage erinnere an die Weimarer Republik.
https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-07/venezuela-hyperinf...
(Zur Situation in Südafrika)
Farmlands
https://www.youtube.com/watch?v=a_bDc7FfItk

INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK
(Andreas Voßkuhle versucht sich in ideologischer Schützenhilfe…)
Populismus
Klopfzeichen aus der Karlsruher Echokammer
von Wolfgang Müller
https://jungefreiheit.de/wissen/2018/klopfzeichen-aus-der...
AfD-Parteitag
Ein Samstag im „bunten“ Augsburg
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/ein-sam...
AfD-Bürgerdialog in Dessau
Von Storch attackiert Merkel, „Dessau Nazifrei“ von Storch
https://www.mz-web.de/dessau-rosslau/afd-buergerdialog-in...
Beatrix von Storch in Hanau
Protest gegen AfD: Lautstark und friedlich
https://www.op-online.de/region/hanau/hanau-hunderte-demo...
AfD
Enthüllungsbuch: Verfassungsschutz forderte Höcke-Ausschluß
https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/enthuellungsbuch-...
„Union der Mitte“
CSU-und CDU-Mitglieder stellen sich gegen Seehofer und hinter Merkel
https://www.berliner-zeitung.de/politik/-union-der-mitte-...
„Union der Mitte“
In CDU und CSU formiert sich Widerstand gegen angeblichen Rechtsruck
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/in-cdu-...
Einwanderungspolitik
Schäuble sieht kein Problem in offenen Grenzen
https://jungefreiheit.de/politik/2018/schaeuble-sieht-kei...
Pressekonferenz mit Merkel
Kanzlerin ohne Bedrängnis
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/kanzler...
Äußerungen über Flüchtlinge
Gemeinderat will Grünen-Politiker Palmer Maulkorb verpassen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/gemeind...
Schleswig-Holstein
Kritik an Sexualerziehung: Winterhoff darf kein Richter werden
https://jungefreiheit.de/kultur/2018/kritik-an-sexualerzi...
Ausländer in der Bundeswehr
Armee vor dem Offenbarungseid
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/vor-dem-o...
Neuer Chef beklagt : „Die Luftwaffe befindet sich an einem Tiefpunkt“
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/luftwaffen-chef...
Bundeswehr blamiert sich mit Transen-Soldaten
http://unser-mitteleuropa.com/2018/07/06/bundeswehr-blami...
(Ein FAZ-Kommentator mit dem üblichen angelernten eindimensionalen Geschichtsbild…)
Rommel statt Dragqueens : Poggenburgs Sehnsucht nach 1942
von Lorenz Hemicker
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/andre-poggenbur...
Deutschland als Nuklearmacht?
„Noch immer wird Deutschland misstrauisch beäugt“
https://www.welt.de/politik/article180142080/Atomdebatte-...
Streitkräfte
Britische Streitkräfte auch nach 2020 in Nordrhein-Westfalen
https://www.nrz.de/politik/britische-armee-auch-nach-2020...
Paderborn
Das Militär wird länger in der Senne üben
Vielstimmige Debatte: OWL-Politiker sehen die Weichenstellung überwiegend positiv
https://www.nw.de/nachrichten/regionale_politik/22191352_...
"Osmanen Germania"
Innenminister Horst Seehofer verbietet rockerähnliche Gruppe
https://www.focus.de/politik/deutschland/rockeraehnliche-...
Verbotene Osmanen Germania
Das verbirgt sich hinter der türkischen Gang
http://www.sueddeutsche.de/panorama/osmanen-germania-port...
Platz am Humboldtforum
Streit um Einheitsdenkmal für Berlin eskaliert
Der politische Unmut über den Haushaltsausschuss des Bundestages wächst.
https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article214735835/...
Kommentar
Wie mit dem Einheitsdenkmal umgegangen wird, ist ein Skandal
Das Einheitsdenkmal mit Hinhaltemanövern ins Wanken zu bringen, ist würdelos, meint Martin Nejezchleba.
https://www.morgenpost.de/meinung/article214738493/Wie-mi...
Paragraph 90 Strafgesetzbuch
2.500 Euro für eine zerschnittene Deutschlandfahne
von Martina Meckelein
https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/2-500-euro-fuer-e...
Jewish Claims Conference
Deutschland hilft Holocaust-Opfern mit weiteren 75 Millionen Euro
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/deutschland...
(Pädagogische Holocaust-Schülerausflüge sollen es richten…)
Judenhass weiter im Fokus
Antisemitismus: Übergriffe an Schulen und beim Sport
https://www.op-online.de/hessen/antisemitismus-hessen-jud...
„Antisemitismus ist unislamisch“
Interview mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus179337122/Ext...
Bundesregierung will Anlaufstellen für antisemitische Vorfälle schaffen
https://rp-online.de/politik/deutschland/antisemitismusbe...
Einheitsdenkmal
Geld für Einheitsdenkmal soll im September fließen
Grüne: Der Haushaltsausschuss darf das Projekt nicht weiter blockieren. Die Notarielle Beurkundung des Kaufvertrages ist im August.
https://www.morgenpost.de/berlin/article214897689/Geld-fu...
Nach Äußerung zum 20. Juli
AfD-Parteiführung distanziert sich von Steinke
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afd-par...

LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE
Masseneinwanderung gegen Kapitalismus
„Kanakisierung unserer Gesellschaft“
von Wolfgang Müller
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/kanakis...
Linke Migrations-Fantasien: Die Revolution soll einwandern
https://www.achgut.com/artikel/linke_migrationsfantasien_...
(Gegner der "multikulturellen Gesellschaft" werden als "Faschisten" attackiert)
Politischer Wandel
Migrationsforscherin sieht Europa in "präfaschistischer Phase"
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/migrati...
Grüne Jugend
Parteinachwuchs greift Habeck wegen Nationalhymnen-Zitats an
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/partein...
Prozess gegen Identitäre: Sellner pocht auf gewaltfreie Handlungen
https://derstandard.at/2000082795586/Prozess-gegen-Identi...
Prozeß gegen Identitäre Bewegung
Ohnmacht, Verzweiflung, Wut
von Thorsten Hinz
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/ohnmacht-...
Strafbare Gesinnungen? Prozeß gegen die Identitäre Bewegung
https://sezession.de/58746/strafbare-gesinnungen-prozess-...
Keine kriminelle Vereinigung: Freispruch in Identitären-Prozess
https://www.tagesstimme.com/2018/07/26/keine-kriminelle-v...
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/prozess-geg...
Freispruch für die Identitären!
https://sezession.de/58947/freispruch-fuer-die-identitaeren
Warum ich unseren Freispruch nicht feiere
Von Martin Sellner
https://sezession.de/59039/warum-ich-unseren-freispruch-n...
Urteil im NSU-Prozeß
Eine Bühne für die radikale Linke
von Hinrich Rohbohm
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/eine-bu...
Linke Sammlungsbewegung
Wagenknecht macht ernst
https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/wagenknecht-macht...
Mühlheim
Populisten-Floskeln auseinander genommen
Themenabend über den Rechtsruck: Persönliche Abstiegsängste
https://www.op-online.de/region/muehlheim/beim-themenaben...
Parteitag der AfD in Augsburg (JF-TV Reportage)
https://www.youtube.com/watch?v=xUyMXLgotGU
AfD-Parteitag
Roth kritisiert Friedrich für „Linksfaschisten“-Äußerung
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/roth-kr...
(Zitat: "Das neue bundesweite Netzwerk, in dem sich mehr als 30 Flüchtlingsinitiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen wie etwa der Berliner Flüchtlingsrat Medico International, die Naturfreundejugend Deutschland oder die Interventionistische Linke (IL) zusammengeschlossen haben, fordert ein Ende der `Abschottung Europas´...")
Flüchtlinge Protest gegen das Sterben
Das Netzwerk „Seebrücke“ fordert Schutz für Bootsflüchtlinge. Dafür geht das Bündnis am Samstagabend auf die Straße.
http://www.fr.de/frankfurt/fluechtlinge-protest-gegen-das...
(Neues Netzwerk "Seebrücke" der linken Einwandererlobby)
Offenbacher solidarisch mit Seenotrettung
Kundgebung vor Rathaus: „Wir hätten sie retten können“
https://www.op-online.de/offenbach/offenbacher-zeigen-sic...
(Physiognomik von "Antifaschisten"…)
Einige Demonstranten
Proteste bei AfD-Parteitag in Neu-Isenburg: Bilder
https://www.op-online.de/region/neu-isenburg/proteste-afd...
Burgscheidungen
Treffen mit 1000 Teilnehmen
Buntes Dorffest gegen rechtsnationales AfD-Treffen
https://www.op-online.de/politik/rechter-afd-fluegel-trif...
(Skurril. Die übliche linke Opfer-Geschichte?...)
Die Polizei sucht nun Zeugen
Blutige Auseinandersetzung bei AfD-Veranstaltung
https://www.op-online.de/region/hanau/zwei-maenner-attack...
Linksextremismus
Regierung: Rote Hilfe verfolgt weiter verfassungsfeindliche Ziele
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/regieru...
(Demonstration "Ausgehetzt")
Öffentliches Meinungsklima
München: Demonstranten werfen CSU Hetze vor
https://jungefreiheit.de/politik/2018/muenchen-demonstran...
Frankfurt
Demonstration
Linksradikale ziehen durch das Gerichtsviertel und fordern Freilassung der G20-Randalierer
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Linksradikale-ziehen-...
Linksextreme Demo startet in städtischer Liegenschaft
Selbstdemontage des Rechtsstaats in Frankfurt nicht weiter hinnehmbar
http://www.bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=1320
Stadt Frankfurt – ein Fall für den Verfassungsschutz
Skandal um das Klapperfeld weitet sich immer weiter aus
http://www.bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=1322
Universitätsgebäude
Nordrhein-Westfalen geht gegen Hausbesetzer in Aachen vor
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/nordrhe...
Nach Angriff auf Verbindungsstudenten
Polizei durchsucht linken Szenetreff in Greifswald
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/polizei...
„Hack the System!“
Linksextremisten bereiten Cyberattacken auf Staat und Wirtschaft vor
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/linksex...
Mutmaßliche Linksextremisten
Linksextreme attackieren und bedrohen FPÖ- und AfD-Abgeordnete
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/linksex...
Linksextremismus
Weiterer Anschlag auf AfD-Abgeordneten: Radbolzen von Auto entfernt
https://jungefreiheit.de/politik/2018/weiterer-anschlag-a...
Linke Gewalt
Buchlesung mit Dr. Weißmann über die 68-er führt in Münster zu linksradikalen Tumulten
https://philosophia-perennis.com/2018/04/26/buchlesung-mi...

EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT
Asylkompromiß zwischen CSU und CDU
Mit der Spritzpistole gegen Waldbrände
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/mit-der-s...
Grüne, Linke, Journalisten
Von Wut-Smiley bis Brechreiz: Asylkompromiß sorgt für Empörung
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/von-wut-s...
Gastbeitrag von Norbert Blüm
Wo, C, bist du geblieben?
http://www.sueddeutsche.de/politik/gastbeitrag-von-norber...
Asyldebatte
Blüm attackiert Unionsparteien und Einwanderungs-Kritiker
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bluem-a...
Kirchen und Flüchtlingshilfe
Kardinal Marx greift CSU an
https://jungefreiheit.de/politik/2018/kardinal-marx-greif...
Asyldebatte
Wegen Seehofer: „Moabit hilft“ lehnt Nachbarschaftspreis ab
https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/wegen-seehofer-mo...
„Union der Mitte“
Bildungsministerin erklärt Asylkrise für überwunden
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bildung...
Hunderte Flüchtlinge stürmen in spanische Nordafrika-Exklave
https://www.gmx.net/magazine/politik/fluechtlingskrise-in...
Nach Grenzstürmung
Ceuta: Schwarzafrikaner greifen spanische Polizisten an
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/ceuta-schwa...
(Ein nicht untypisches Psychogramm…)
Asylpolitik
Schweden: Studentin verhindert Abschiebung nach Afghanistan
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/schweden-st...
(gleiches Muster…)
Ausweisung per Flugzeug
Finnland: Grünen-Mitarbeiterin scheitert mit Abschiebe-Verhinderung
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/finnland-gr...
(… auch ein Psychogramm…)
Ermordete Studentin
EKD-Chef verurteilt Haßkommentare im Fall Sophia L.
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/ekd-che...
Appell an Kanzlerin
Rheinstädte wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/rheinst...
Freiburg und Solingen
Weitere Städte wollen Mittelmeer-Flüchtlinge aufnehmen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/weitere...
Auswärtiges Amt
Über 300.000 Personen kamen per Familiennachzug
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/ueber-3...
Einreise per Flugzeug
Mit dem Asyl-Flieger nach Deutschland
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/mit-dem...
Migration: Fast jeder Vierte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund
https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-08/migration-deutsc...
(Ein Mensch, den wir dringend im Land benötigen)
Rückführung gescheitert
Verurteilter Gewaltverbrecher beantragt Asyl in Berlin
Die Rechtsanwältin des 25-Jährigen verhinderte seine Abschiebung in die Türkei. Die Bundespolizei musste die Rückführung abbrechen.
https://www.morgenpost.de/berlin/article214949803/Verurte...
(Ein schlechtes Geschäft)
Polen und Ungarn abgestraft
EU will 400 Euro für jeden Eingewanderten zahlen
https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2018/eu-will-400-euro...
Flüchtlingshelfer
„Lifeline“: Kapitän auf Kaution frei – Böhmermann ruft zu Spenden auf
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/lifeline-ka...
(Spendengelder fließen)
Prominente Unterstützung für Lifeline
ProSieben-Moderator ruft zu Spenden für Flüchtlingsschiff auf
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/prosieben-m...
Europapreis
SPD-Fraktion in Bayern zeichnet „Lifeline“-Kapitän aus
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/spd-fra...
(Ein weiterer Pressekommentar, der die Dimension des anrollenden Problems nicht ansatzweise verstanden hat)
Flüchtlingshelfer werden kriminalisiert
Kommentar: Stolz auf Europa?
https://www.op-online.de/politik/kommentar-stolz-europa-s...
Sea-Watch
Malta hindert weiteres deutsches NGO-Schiff an Weiterfahrt
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/malta-hinde...
Gerettete Migranten bedrohen italienische Schiffsbesatzung
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/gerettete-m...
Seenotrettung
Italienisches Boot bringt Flüchtlinge nach Libyen – Kritik von Reisch
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/italienisch...
Rettungseinsätze vor libyscher Küste
„Aquarius“ sticht wieder in See
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/aquarius-st...
Ostwestfalen-Lippe
Flüchtlingsbürgen erhalten Zahlungsbescheide – Klagen angekündigt
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/fluecht...
Über 50 Personen an Bord
Bislang größte Abschiebeaktion nach Afghanistan
https://jungefreiheit.de/politik/2018/bislang-groesste-ab...
AfD-Anfrage
Tausende abgelehnte und ausgereiste Asylbewerber zurück in Deutschland
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/tausend...
Bundespolizei
Jede zweite Abschiebung mißlingt
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/jede-zw...
Asylbewerber
Tausende beantragen Familiennachzug
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/tausend...
Migration
Auch qualifizierte Einwanderung öffnet die „Büchse der Pandora“
von Manfred Ritter
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/auch-qual...
Im Namen der Vielfalt
Gütersloh will Stadt „multikulturell durchmischen“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/gueters...
Fernsehtip
"Aus den Flüchtlingen der achtziger Jahre wurde ein gefürchtetes Phänomen"
von Christian Vollradt
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/aus-den-fluec...
Betrug mit mehreren Identitäten
Niedersachsen: Asylbewerber erschleicht fast 25.000 Euro Sozialleistungen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/nieders...
(Die neue SPD…)
Neuötting
Mit Kopftuch und Dirndl für Erdogan
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/mit-kopft...
Islam in Deutschland
Kaufbeuren: Bürger stimmen gegen Moscheebau
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/kaufbeu...
(Zuwanderungsprobleme werden als "Extremismus"-Probleme deklariert)
Beratungsstelle zu Extremismus-Prävention
„Wir hören zu, ohne zu urteilen“
https://www.op-online.de/offenbach/beratungsstelle-extrem...
Polizei nimmt kriminelle Familien-Clans ins Visier
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_wes...
Im Wert von zehn Millionen Euro
Polizei beschlagnahmt 77 Immobilien von Araber-Clan
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/polizei...
Hanau
Sexualdelikt auf Hauptfriedhof: So verhalten Sie sich richtig
https://www.hanauer.de/ha_50_111557048-29-_Sexualdelikt-a...
Offener Brief
Tschetschenen erheben Vorwürfe gegen Cottbusser Polizei
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/tschets...
Kriminalstatistik
„Migrantengewalt wird Deutschen in die Schuhe geschoben“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/migrant...
Spieler veröffentlicht Video
Naziparolen gegen Mannschaft der Spvgg. Dietesheim: Polizei ermittelt
https://www.op-online.de/region/muehlheim/naziparolen-mai...
Freundschaftsspiel mit Betonung
Nach Rassisten-Angriff: Fußballer setzen Signal
https://www.op-online.de/region/muehlheim/nach-rassisten-...
Gewalt gegen Rettungskräfte
Fußabtreter der Nation
von Hans-Hermann Gockel
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/fussabtre...
Messerattacke
Flughafen Düsseldorf: Angreifer verletzt Sicherheitsmann schwer
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/flughaf...
Staatsanwaltschaft
Fall Susanna F.: Ali Bashar soll weiteres Kind vergewaltigt haben
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/fall-su...
In Pankower Park ermordet
Seine DNA verriet den Killer von Melanie Rehberger
https://www.bz-berlin.de/berlin/pankow/seine-dna-verriet-...
Ausländer gegen Schüler im Allgäu
„Früher gingen die Mädchen gerne fort“
von Lukas Steinwandter
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/frueher...
Angriffe im öffentlichen Raum
Berlin: Mehrere Fälle von Ausländergewalt am Wochenende
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/berlin-...
Gewalttat in Lübeck: Mehrere Verletzte in einem Bus
https://www.huffingtonpost.de/entry/berichte-uber-gewaltt...
(Zum Fall in Lübeck ein Kommentar)
Sonntagsheld (70) – Knüppel auf den Kopf
https://sezession.de/58856/sonntagsheld-70-knueppel-auf-d...
Hessen
Trio greift Soldaten in Bad Hersfeld an
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/trio-gr...
Vortäuschung einer Straftat
Angriff auf Soldaten war frei erfunden
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/angriff...
(Die beschriebenen Menschen sind Sinti und Roma)
Massenschlägerei in Gelsenkirchen
50 Menschen schlagen mit Stühlen und Baseballschlägern aufeinander ein
https://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/massenschl...
Mehrjährige Haftstrafen
Dessau: Eritreer wegen Gruppenvergewaltigung verurteilt
https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/dessau-eritreer-w...
https://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/dessau-rossl...

KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES
Gespräch mit einem Schlossgestalter
„Das ist die Sehnsucht nach Schönheit“
Sebastian Rost verziert den Berliner Stadtschloss-Nachbau mit barockem Dekor. Dabei ist der 49-jährige Stuckateur ein Gegner des Wiederaufbaus.
http://www.taz.de/Gespraech-mit-einem-Schlossgestalter/!5...
Neue Altstadt Frankfurt
„Städte mit historischem Kern sind beliebter“
http://www.fr.de/frankfurt/neue-altstadt-frankfurt-staedt...
Stuttgart 21
Teurer Machbarkeitswahn
von Henning Lindhoff
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/teurer-ma...
(Zwangsfinanziertes Fernsehen versucht AfD totzuschweigen)
Wegen Nichteinladung von AfD-Politikern
Holm wirft ARD Nanny-Journalismus vor
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/holm-wi...
Studie zur Berücksichtigung der Oppositionsparteien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Beispiel der vom NDR produzierten Nachrichtensendung "Tagesschau"
https://afd-fraktion-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/0...
Politiker-Statements
Diskriminiert die „Tagesschau“ die AfD?
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/diskriminiert...
(Vorwürfe: Medien machten AfD erst bundestagsfähig…)
Sommerpause
Talksendungen machen Urlaub
https://www.volksstimme.de/kultur/kino-tv/sommerpause-tal...
Das Höhlendrama von Thailand und die Medien
Grenzenlose Naivität
von Boris T. Kaiser
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/grenzenlo...
(Gewalt- und Mordaufrufe vom Chef der Satire-Zeitschrift Titanic, Tom Wolff)
Shitshorm gegen die „Zeit“
Rückzugsgefecht der Gesinnungstaliban
von Thorsten Hinz
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/rueckzugs...
Meinungsfreiheit
Facebook duldet Holocaust-Leugnungen
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/facebook-duld...
Vielfalt und Sexismus
Fifa fordert weniger schöne Frauen bei WM-Ausstrahlung
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/fifa-fo...
(Migranten suchen schuld für eigene Fehler bei angeblich diskriminierenden Deutschen…)
Hashtag "MeTwo"
Schuldzuweisungen für das eigene Versagen
von Boris T. Kaiser
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/schuldzuw...
Australische Münzprägeanstalt reagiert auf Sexismus-Vorwürfe bei Sparschweinen
https://www.wochenblatt.de/news-stream/deutschland-welt/a...
(Feministische Mutter hat Kind vorgeschoben…)
Weil Siebenjährige protestierte: Straßenschild wird geändert!
https://www.brigitte.de/aktuell/buzz/neuseeland--siebenja...
Auch Frankfurt bekommt dauerhaft queere Ampelpärchen
https://www.mannschaft.com/2018/07/auch-frankfurt-bekommt...
Auftritt beim Berliner CSD
Morddrohungen und Polizeischutz wegen "Allah is gay"-Shirt
Der Ex-Muslim Amed Sherwan wird beim Berliner CSD mit dem T-Shirt laufen, wird deshalb bedroht. Im Gespräch zeigt er sich erschüttert.
https://www.morgenpost.de/berlin/article214948721/Morddro...
Ja-heißt-Ja
Spanien plant Verschärfung des Sexualstrafrechts
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/spanien-pla...
Erziehungsnotstand und Widerstand – ein Aufruf
https://sezession.de/58735/erziehungsnotstand-und-widerst...
Schleswig-Holstein
Schüler schwänzt Moschee-Besuch: Eltern sollen Bußgeld zahlen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/schuele...
Streit um „Wohlfühllabel“-Äußerung
Lesben- und Schwulenverband: Wagenknecht schürt Homophobie
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/lesben-...
Kunstaktion in Luzern: Handyklingeln vom Kirchturm
"Wenn dieser bekannte Ton plötzlich von oben erklingt, sind die Leute verwirrt"
https://www.domradio.de/themen/bist%C3%BCmer/2018-07-10/k...
Ausscheiden bei der Fußball-WM
Mazyek fordert Rücktritt von Grindel und Bierhoff
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/mazyek-...
(Horror, in Kroatiens Fußball wird nicht mit Multikulti und Islam kokettiert…)
Der ganz normale Nationalismus: Kroatiens Koketterie mit dem Ustascha-Regime
https://www.gmx.net/magazine/sport/fussball/wm/normale-na...
(Nachklapp zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft)
Montagsheld (69) – Schwarz-Weiß-Malerei
https://sezession.de/58751/montagsheld-69-schwarz-weiss-m...
#MeTooFoot
WM-Feier in Paris: Opfer sexueller Übergriffe sollen sich bei Polizei melden
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/wm-feier-in...
Özil verteidigt Foto mit Erdogan und schießt gegen Medien
https://www.welt.de/sport/fussball/article179774764/Mesut...
Mesut Özils brutale Breitseite gegen den DFB-Präsidenten
https://www.welt.de/sport/article179798840/Mesut-Oezil-Br...
Mesut Özil tritt aus Nationalmannschaft zurück
https://www.welt.de/sport/fussball/article179781626/Mesut...
Pressestimmen zum Özil-Rückritt
"Mit dieser Generalabrechnung macht er sich selbst zum Buhmann"
Verlierer auf beiden Seiten - das ist der Tenor der deutschen Pressestimmen nach dem Rücktritt Mesut Özils. Die Nationalmannschaft verliert einen genialen Spieler - und Özil selbst verspielt ein wichtiges Gut.
http://www.spiegel.de/sport/fussball/mesut-oezil-was-die-...
Für DFB-Chef Grindel geht es jetzt um viel mehr als nur seine Zukunft
https://www.welt.de/sport/article179799738/Fall-Oezil-Fue...
Bundesjustizministerin
Barley warnt nach Özil-Rücktritt vor Rassismus
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/barley-...
Grünen-Chef zum Fall Özil
Habeck: Saat der politischen Rechten geht auf
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/habeck-...
(Sorge um das Image der Integrations-Vorzeigeobjekte)
Nationalmannschaft
Fall Özil: Schäuble gibt DFB Hauptschuld
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/fall-oe...
(Zu den altbekannten Thesen von Andreas Zick)
Der Fall Özil
Die Schimäre von der rassistischen Gesellschaft
von Lukas Mihr
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/die-schim...
Unsere Radikalität
Von Johannes Poensgen
https://sezession.de/58698/unsere-radikalitaet
Affirmative Action
Rassismus im Gewand der Minderheitenförderung
von Lukas Mihr
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/rassismus...
(Zum neuen Buch von Thilo Sarrazin)
Meinungsfreiheit
Eine unbequeme Wahrheit
von Jörg Kürschner
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/eine-unbe...
Wegen Roland Tichy
Friedrich Merz lehnt Ludwig-Erhard-Preis ab
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/merz-le...
Neue Regeln für Überläufer
Von Götz Kubitschek
https://sezession.de/59010/neue-regeln-fuer-ueberlaeufer
Nathalie Quintane: „Wohin mit den Mittelklassen?“
https://sezession.de/58604/nathalie-quintane-wohin-mit-de...
Demokratie
Multikulti-Nachbarschaft verringert Wahlbeteiligung Deutscher
https://jungefreiheit.de/wissen/2018/multikulti-nachbarsc...
Flüchtlinge mit bunten Federn
Laissez-faire im Umgang mit Nilgänsen?
http://www.bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=1317
(Einwanderung, Diversity…)
Invasive Art
Kalikokrebs bedroht deutsche Gewässer
Er frisst Unmengen und vermehrt sich rasend schnell: Der aus Nordamerika eingeschleppte Kalikokrebs wütet in deutschen Gewässern. Umweltschützer überlegen nun sogar, Seen trockenzulegen.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/kalikokrebs-in-d...
"Eine sehr gute Qualität"
Geschäftsmann will Gletschereis an ausgewählte Bars verkaufen
Salz aus dem Himalaya, Rindfleisch aus Kobe - keine Idee scheint Freunden exklusiver Genüsse zu verrückt zu sein. Jetzt will ein Norweger Cocktail-Eiswürfel von einem Gletscher anbieten, Umweltschützer sind alarmiert.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/eiswuerfel-v...
Beschwerdebrief an Werberat
Grüne nehmen Nutella ins Visier
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/gruene-ne...
Sonntagsheld (68) – Etiam si omnes..
https://sezession.de/58738/sonntagsheld-68-etiam-si-omnes
Das war’s. Diesmal mit: Schwarzen Fußballspielern, neostalinistischen Verhören und Feridun Zaimoglu
von Ellen Kositza
https://sezession.de/58745/das-wars-diesmal-mit-schwarzen...
Referentin der Amadeu Antonio Stiftung
Naidoo siegt im Antisemitismusstreit
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/naidoo-...
Das war’s. Diesmal mit: Auschwitz als Chance …
Von Ellen Kositza
https://sezession.de/58923/das-wars-diesmal-mit-auschwitz...
(Interview mit Heinz Bude über 1968)
"Wir rennen los, aber wissen nicht wohin"
https://www.taz.de/!5518533/
(Beginn des bargeldlosen Zeitalters)
Commerzbank
Kunden kommen wegen Buchungspanne nicht an ihr Geld
https://www.focus.de/finanzen/banken/konten-ploetzlich-le...
(SPD schon 1922 gegen Abschiebungen)
Die SPD verhinderte beizeiten Hitlers Ausweisung
Bayerns konservativer Innenminister wollte den NS-„Führer“ 1922 abschieben. Warum der SPD-Chef dies ablehnte und welche Konsequenzen Hitler später daraus zog, zeigt eine neue Studie.
https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article1...
"Marx von rechts" und der Panikmodus
In wenigen Wochen erscheint ein neues Buch im Jungeuropa Verlag. Es sorgt schon jetzt für Anfeindungen und Zensurmaßnahmen.
https://sezession.de/58857/marx-von-rechts-und-der-panikm...
Duisburg
Theater: Von Ibsens „Volksfeind“ zum „Volksverräter!!“
https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-volksv...
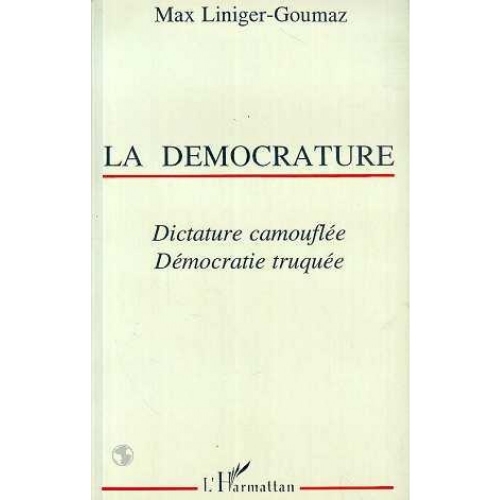








 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
















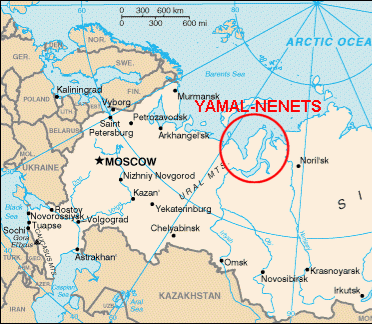 L''acheminement de GNL par le détroit de Béring est 1,5 fois plus rapide qu'en contournant l'Europe par la Méditerranée, l'océan Indien, puis le Pacifique (un aller-retour prend 44 jours au lieu de 68). Ce qui représente une économie de 3,2 millions de dollars pour chaque trajet.
L''acheminement de GNL par le détroit de Béring est 1,5 fois plus rapide qu'en contournant l'Europe par la Méditerranée, l'océan Indien, puis le Pacifique (un aller-retour prend 44 jours au lieu de 68). Ce qui représente une économie de 3,2 millions de dollars pour chaque trajet.




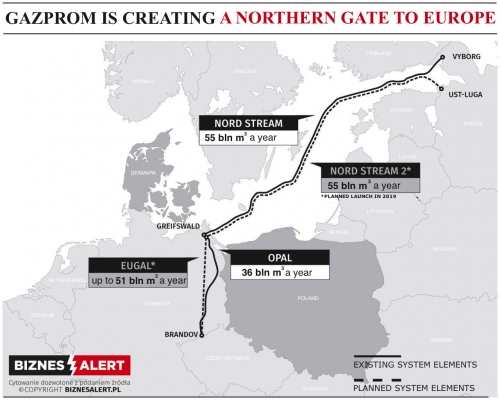






 •
• 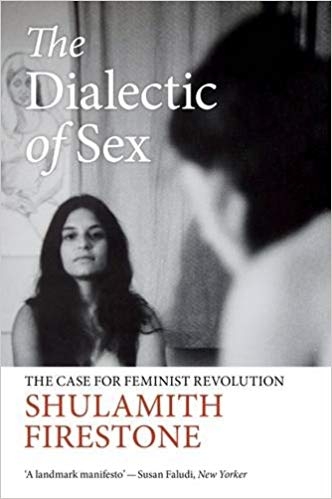 Pour mémoire, Shulamith Firestone avait écrit en 1970 dans La dialectique du Sexe : « Tout comme le but final de la révolution socialiste n’était pas juste l’abolition des privilèges économiques de classe mais l’abolition des classes elles-mêmes, le but final de la révolution féministe ne doit pas être … l’abolition des privilèges masculins mais l’abolition des différences sexuelles elles-mêmes ». Nous y sommes en effet. L’objet du délit (première référence). La salutaire réaction pleine d’ironie cinglante d’Anne-Sophie Chazaud sur Causeur qui pointe « les élucubrations d’un gauchisme culturel moribond. »
Pour mémoire, Shulamith Firestone avait écrit en 1970 dans La dialectique du Sexe : « Tout comme le but final de la révolution socialiste n’était pas juste l’abolition des privilèges économiques de classe mais l’abolition des classes elles-mêmes, le but final de la révolution féministe ne doit pas être … l’abolition des privilèges masculins mais l’abolition des différences sexuelles elles-mêmes ». Nous y sommes en effet. L’objet du délit (première référence). La salutaire réaction pleine d’ironie cinglante d’Anne-Sophie Chazaud sur Causeur qui pointe « les élucubrations d’un gauchisme culturel moribond. » 
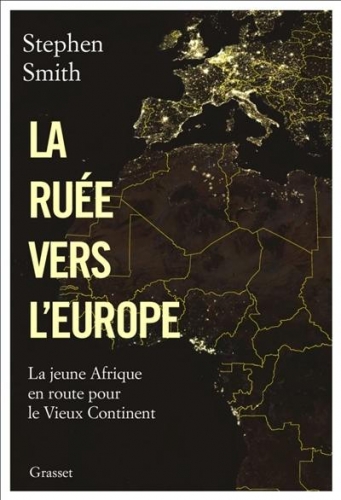 •
• 
 •
•  •
• 







