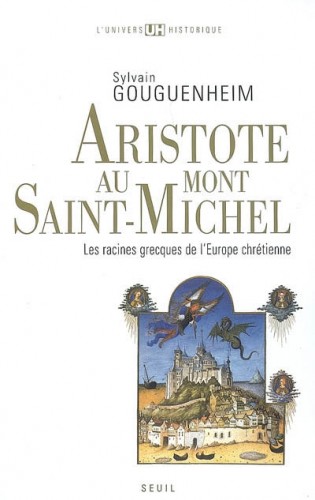jeudi, 23 octobre 2014
Paganism & Christianity, Nietzsche & Evola
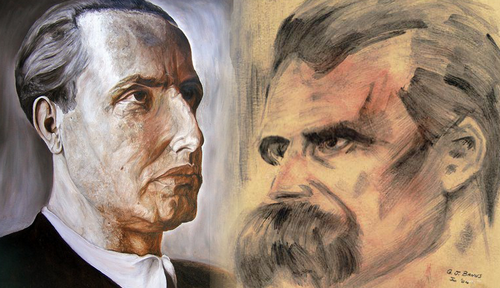
Paganism & Christianity, Nietzsche & Evola
By Jonathan Bowden
Ex: http://www.counter-currents.com
Editor’s Note:
This text continues the transcript by V. S. of Jonathan Bowden’s interview at the Union Jack Club in London on Saturday, November 21, 2009, after his lecture/performance on Punch and Judy [2]. The title is editorial.
Q: When did you decide to convert to paganism and why?
B: Well, I never really converted to paganism. I mean, there are some orthodox pagans, if you can have such a thing, who probably think I am not one. But I’m a Nietzschean and that’s a different system. Somebody made this for me. [Points to odal rune pendant.] And I like Odinic paganism sort of as an objectification of my sort of sensibility. Does one believe the gods objectively exist in another realm? Well, you see, religion is a philosophy about life which is sacristic and has rituals in which you partly act out, therefore it’s more important because it’s made slightly more concrete than ideas or it’s really just based upon ideas. There are relatively simple but powerful ideas at the crux of all the big religious systems. Most people are born in a system and just accept that and go along with it as long as it’s not too onerous or they feel like they live their life through it properly.
I just agree with the ethics of that type of Nordic paganism, which is really how the Vikings lived and how they behaved. I’m less concerned with small groups, which I respect. I like the Odinic Rite, but I personally believe that those sorts of things will only ever activate post-modern minorities and very small ones at that.
I think people should identify with what they think they are and the values that they hold. This symbol really means strength or courage or masculinity or the first man or the first principle of war or the metaphysics of conflict. So, I just think it’s a positive system of value.
I never really was a Christian. Culturally, I have great admiration for elements of Christian art. More so than most people who are pagan who have violently reacted against it. I don’t really share that emotionalism. But I don’t agree with Christian ethics. Deep down, they’ve ruined the West, and we’re in the state that we are because of them.
Q: Just added on to that: How do we create more Nietzscheans? How do we spread Nietzscheanism as a religion, as an idea?
B: You’ve got to get people quite young. I think you’ve got to introduce alternative value systems to them. This is a society that says weakness is good, weakness should be pitied, the ill are weak, the disabled are weak, people who’ve got various things wrong with them (too fat, too thin, bits dropping off) they need help. They may need help. But the value system that lies behind that desire to help worships the fact of weakness and the fact that people are broken. If you worship the idea of strength and tell the weak to become stronger, which is a reverse idea for helping them essentially. You help them in order to get stronger. You totally reverse the energy pattern and you’ve reversed the system of morals that exists in this culture now. You’ve reversed the sort of things that Rowan Williams or his predecessor or his likely successor always says, basically. I think that’s what you have to do.
I personally think it’s a moral revolution, not anything political, that will save the West, because all the technology is here, all the systems of power are here. You only have to change what’s in people’s minds. It’s very difficult though.
Q: So, to a young person watching this video, never heard of you before, where would he go to find out about Nietzscheanism?
B: Just go to the Wikipedia page, surprisingly, although it’s a bit trivial, is actually quite accurate in a tendentious way. Although some of the philosophical debates about him and the genealogy of his works might confuse people because it views it in an academic way. And you don’t need to put his name to it. There’s a cluster of power-moral, individualistic, elitist, partly antinomian, partly gnostic, partly not, partly pagan, vitalist and other ideas which go with that sort of area.
Strength is morality. Weakness is sin. Weakness requires punishment. If you’re weak, if you’re obese, if you’re a drug addict, become less so. Become stronger. Move towards the sun. Become more coherent. Become more articulate. Cast more of a shadow. It’s almost a type of positive behaviorism in some ways. But it’s not somebody wagging their finger and so on, because you’re doing it for yourself. It comes from inside.
Q2: Do you not think though that Nietzscheanism doesn’t have a transcendental element to it?
B: That’s why I’m wearing this [rune pendant], you see, because I probably think there ought to be such a thing. Many people need to go beyond that. If his thinking before he went mad, probably because he had tertiary syphilis, it’s up to sort of 1880, so we’re talking about thinking that’s 130 years old.
I think in some ways he’s an anatomist of Christianity’s decline, because Christianity been declining mentally and in some ways extending out into the Third World where it’s real catchment area now is. I mean, there will be a non-White pope soon. Christianity will begin to wear the face of the south very soon. It’s the ideal religion for the south. It’s pity for those who fail, for those who are weak, for those who are hungry, for those who are broken. Have pity on your children, O Lord. It’s an ideal religion. Don’t take it through violence or fear or aggression. Submit and be thankful for what He will give you in His wisdom.
But it’s ruining us. For centuries we were strong even despite that faith, but of course we made use of it. The part that fits us is the extreme transcendence of Christian doctrine. That’s what Indo-Europeans like about that faith. The enormous vaulting cathedrals, the Gothic idea that you can go up and up and up. It’s that element in it that we like, and we made into ourselves. But we forgot the ethical substratum. We forgot the sort of troll-like ethical element that there is no other value but sympathy, there is no other value than compassion, that love is the basis of all life. And ultimately that is a feminine view of civilization which will lead to its collapse in masculine terms.
Q2: How would you view the works of Julius Evola?
B: Yes, they’re the counter-balance to Nietzsche. There is a lot of religious elements in there of a perennialist sort that a lot of modern minds can’t accept. You see, Nietzsche is a switchblade, and nearly all people in this society are modern even if they think they’re not. Nietzsche is a modern thinker. Nietzsche is a modernist. Nietzsche can reach the modern mind. Nietzsche’s the most Right-wing formulation within the modern mind that people can accept.
My view is that people who accept Evola straight out aren’t living in the modern world. That’s not a criticism. It’s a description of where they are. I think for people to become illiberal they have to become illiberal first within the modern world. Some people would say you have to go outside of it. You know, the culture of the ruins and the revolt against the modern world, per se. But I personally think that we’re in modernity.
But there will be people who go to Nietzsche and Thus Spake Zarathustra, which is really a semi- or pseudo-religious text, is not enough and they’ll want to go beyond that and they’ll want a degree and a tier of religiosity. The dilemma always in the West is what to choose. Back to Christianity or on to paganism? Which system do you choose?
Evola said he was a Catholic pagan, didn’t he? One knows what he means. But I see paganism peeping out of everything. I see paganism peeping out of Protestantism, the most Jewish form of Christianity, through its power-individualism and its extremist individuality (Kierkegaard, Carlyle, Nietzsche). I see paganism saturating Catholicism and peeping out of it at every turn, aesthetically, artistically, the art of the Renaissance, the return of the Greco-Roman sensibility, the humanism of the ancient world. Some of the greatest classicists were Medieval Popes and so on. I see it just looming out. The whole structure of the Catholic Church is a Roman imperial structure, Christianized. So, I see it peeping out.
Our law is Roman. All of our leaders were educated and steeped in the classical world to provide a dialectical corollary to Christianity without them being told that’s what is happening. The decline of the classics is partly because people don’t want to go back there, basically. So, you don’t teach it to anyone apart from tiny little public school elites, which are .2% of the population who read a few authors who no one else even knows exist. You know, big deal.
The difficulty with Evola is that it’s a very great leap for the modern mind. Although in his sensibility, I agree with his sensibility, really. I agree with him going out amidst the bombings, not caring. I agree with that sort of attitude towards life, which is an aristocratic attitude towards life. But we’re living in a junk food, liberal, low middle class society. You’ve got to start where you are. I think Nietzsche is strong enough meat for most people and is far, far, far too strong for 80% now.
Today, the mentally disabled have been allowed into the Paralympics. So, you will have the 100 yard cerebral palsy dash at the next Olympics in London in 2012. This is the world we’re living in. Nietzsche would say that’s ridiculous and so on. And that is a shocking and transgressive and morally ugly attitude from the contemporary news that we see. So, it’s almost as if Nietzsche’s tough enough for this moment.
But I’m interesting in that he said, “God is dead in the minds of men.” That doesn’t necessarily mean, of course, although he was a militant atheist, he’s living open the idea that . . . [God objectively exists—Ed.]. You see, the Christian idea of God was dying around him, mentally, and it has died. I mean, hardly anyone really, deep down, believes that now. Even the people who say that they do don’t in the way that they did 100 years ago or their predecessors did.
So, it has died, but I think there are metaphysically objectivist standards outside life. Whether our civilization can revive without a return to them is very open. It’s very questionable. Where that discourse is to come from is . . . The tragedy would be if Christianity sort of facilitated our greatness, but ended up ruining us, which of course might be the true thesis.
Now we’re getting into deep waters.
Q: What is your view of Abrahamic religions?
B: I think religion is a good thing. The Right always supports the right of religion to exist. Religion does cross ethnic and racial boundaries. Afghanistan was Buddhist once. I prefer people to have some sort of religious viewpoint, even the most tepid sort of thing, but none at all, because at least there is a structure that is in some sense prior.
But, personally, I prefer tribally based religions. I prefer religions that are about blood and genetics and honor and identity and are nominalist and that are specific. But I think people will adopt different systems because they’re physiologically different even within their group. You can see that about certain people. Certain people, Christianity suits them very well and they can be quite patriotic and quite decent people and so on in that system and there we are. But for me? No.
I’m a barbarian in some ways. People can worship what gods they want within the Western tradition, and that’s all right.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/10/paganism-christianity-nietzsche-evola/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2012/09/NietzscheSeated.jpg
[2] Punch and Judy: http://www.counter-currents.com/2013/03/the-real-meaning-of-punch-and-judy/
00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, julius evola, nietzsche, révolution conservatrice, paganisme, tradition, traditionalisme, christianisme, jonathan bowden |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 avril 2014
Charles Péguy, un hétérodoxe entre socialisme et christianisme
Charles Péguy, un hétérodoxe entre socialisme et christianisme
Méridien Zéro a reçu Rémi Soulié, critique littéraire au Figaro Magazine pour évoquer avec lui la figure de Charles Péguy, poète, écrivain et essayiste.
A la barre, Olivier François assisté de Jean-Louis Roumégace.
A la technique JLR.
Pour écouter:
http://www.meridien-zero.com/archive/2014/02/13/emission-...
00:05 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rémi soulié, charles péguy, socialisme, christianisme, france, entretien, histoire, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 septembre 2013
Monothéismes et paganismes
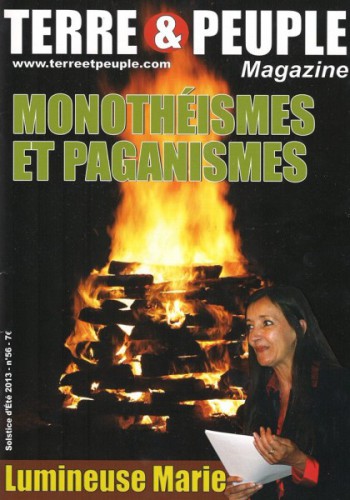
Monothéismes et paganismes
Le numéro 56 de TERRE & PEUPLE Magazine est presque tout entier consacré aux monothéismes et aux paganismes.
Pierre Vial consacre son éditorial à un pieux hommage qu’il rend à ‘l’âme altière’ de Dominique Venner, derrière qui il a lui-même marché depuis ses quinze ans, car il n’a jamais suivi d’autre chef que lui. Il nous engage ‘à nous orienter sur cette ‘étoile polaire’. Il cite Bruno de Cessole, pour qui le dernier geste de Dominique Venner n’a rien du désespoir. C’est au contraire un sacrifice accompli pour réveiller nos consciences.
Pierre Vial ouvre ensuite le dossier ‘Monothéismes et paganismes’ pour souligner que l’islam se trouve dans un rapport de filiation avec les deux autres monothéismes et qu’un gouffre sépare ces trois religions du désert des religions de la forêt. Il se réfère aux archéologues israéliens Finkelstein et Silbermann, pour qui la saga biblique n’est qu’un produit de l’imagination, conçu sous la dynastie davidique, et à Jean Soler, qui a démontré que les épisodes d’Abraham et de Moïse ne peuvent plus être considérés comme historiques. Les dominations étrangères, assyrienne et perse, et les déportations des Hébreux ont alors été interprétées comme une punition pour leur tolérance à l’égard de dieux étrangers, ce qui doit les faire passer à la monolâtrie (pour un Dieu national), qui se muera bientôt dans une alliance privilégiée avec le Dieu unique et universel et justifiera une réécriture de la Bible à la fin du IVe siècle seulement.
Pour les Indo-Européens, Jean Haudry souligne que leur polythéisme s’est accommodé d’accumuler la tradition, sans jamais en retrancher ni craindre les contradictions et les paradoxes. Avec les temps historiques, les dieux, frères des hommes, ont tendance à s’en éloigner, peut-être suite au feu qui leur a été volé par Prométhée, et suite aux comportements inamicaux des héros, ‘contempteurs des dieux’. En Grèce, l’athéisme va apparaître avec l’atomisme matérialiste et l’épicurisme. Chez les Iraniens, le mazdéisme, avec son dieu suprême Ahura Mazda (Seigneur Sagesse), est une tentative avortée de monothéisme. Dans l’hindouisme, la recherche de l’unité fait évoluer le polythéisme en panthéisme. Toutefois, Brahma et Civa forment avec Vishnu le Trimurti ou Trinité, mais les trois composantes de la triade (avec les trois couleurs, blanche, rouge, noire qui leur sont associées) leur sont préexistantes.
Traitant la distinction entre monothéisme et polythéisme, Robert Dragan remarque que la Bible désigne paradoxalement le Dieu unique par le pluriel Eloïm, alors que Aristote (sur qui saint Thomas d’Aquin appuiera largement sa Somme théologique) pose les preuves d’un Dieu créateur qui est de nature différente des autres dieux, qui ne sont que représentation du monde, donc des créations des hommes. La clé métaphysique des païens n’est pas la révélation dogmatique, mais la contemplation muette qu’on n’atteint par recherche par ascèse, notamment celle des mystiques chrétiens.
Claude Perrin rappelle que les juifs sont passés du polythéisme à la monolâtrie d’un Dieu réservé au seul peuple juif. Les chrétiens en feront le Dieu de tous les peuples, notamment tous les peuples conquis par l’Empire romain, ce qui ne pouvait que séduire l’Empereur Constantin. Tard venu, le monothéisme a fait d’innombrables emprunts au polythéisme. Rare substitut qui subsiste aux dieux anciens : le Père Noël.
Claude Valsardieu dresse une fiche ‘théométrique’ extraordinairement fouillée d’Apollon, divinité solaire de la conscience éclairée, qui surclasse l’intelligence mercurienne, de l’esprit prophétique, qui transcende la raison logique, de l’harmonie supérieure, de la beauté radieuse, de l’espérance. Dieux guérisseur pourfendeur du Python, il dirige ses flèches contre la maladie. D’origine hyperboréenne, ses premières représentations sont égyptiennes.
Pierre Vial esquisse les traits les plus marquants de notre néo-paganisme : le ré-enchantement d’un monde qui a été diabolisé, méprisé et honteusement maltraité. Notre paganisme est une réalité charnelle et vécue, c’est le rejet de l’intolérance des religions fanatiques, c’est la revendication de la dignité des hommes libres et responsables d’eux-mêmes. C’est un paganisme de méditation, de sagesse, de combat, de fécondité, d’enracinement, de sublimation par le culte du sacré, un paganisme de fidélité, à la tradition de nos anciens, à notre sang et à notre terre.
Alain Cagnat retrace la voie qui a mené du monothéisme à l’universalisme mondialiste. On attribue à Aménophis IV Akhenaton, pharaon de la XVIIIe dynastie (XIIIe AC) la paternité d’un monothéisme qui a été sans lendemain. Moïse ne remonterait qu’au VIIIe siècle AC, mais le monothéisme juif serait en fait beaucoup plus récent. Yahveh, dieu unique n’est au départ qu’un dieu national qui ne tolère pas le culte d’autres divinités par les juifs. C’est la condition contractuelle de leur suprématie, voire de leur surhumanité. Le christianisme est le même monothéisme étendu par saint Paul à tous les peuples du monde. Adopté par Constantin, le monothéisme chrétien est imposé à tous les peuples de l’Empire romain. Cette adoption lui assure un triomphe sur ces peuples jusqu’à la fracture interne de la réforme des protestants et la contestation. Celle des humanistes d’abord et ensuite celle des Lumières d’un esprit sanctifié par une influence maçonnique évidente, qui édifie un nouvel universalisme, avec une nouvelle métaphysique du progrès illimité, poursuivi dans le cadre d’un Contrat social régi par des Droits de l’Homme, révélés eux aussi par le même esprit saint laïc. Les Droits de l’Homme sont le credo insurpassable de la tolérance, lequel prescrit l’intolérance contre les ennemis de la liberté obligatoire. Comme il prescrit le droit et bientôt le devoir d’ingérence pour sanctionner les dissidents. Engendré par le libéralisme, l’individu doit pouvoir se libérer de tout lien qui l’attache à un groupe, fût-ce sa famille et rien ne peut entraver son activité économique sur un marché de libre concurrence. En soignant son propre bien, il fait le bien de tous, de toute l’humanité car le marché de doit pas connaître de frontières, surtout pas nationales, car il y a une équation entre nation et shoah. Il ne peut y avoir d’autre règle que l’auto-régulation du marché par l’équilibre de l’offre et de la demande. Elle s’impose aussi bien au travail qu’aux marchandises et services et le chômage exerce sur le prix du travail une pression bénéfique pour le prix des produits, qu’elle s’exerce par la concurrence des travailleurs des pays à bas salaires ou des travailleurs immigrés, dessinant avec les délocalisations le spectre d’un nouvel esclavagisme. Le mondialisme a connu un grand essor avec l’effondrement de l’URSS et la disparition du monde bipolaire et avec l’intégration des pays BRIC (Brésil/Russie/Inde/Chine) dans le grand marché sans nations. Celui-ci favorise la consolidation de quelques dizaines de multinationales, Certaines de ces ‘majors’, avec les banques qui leur sont associées par participations croisées, sont plus puissantes qu’un état comme la France et nombre de dirigeants politiques démocratiques sont issus de leur sérail (Goldman Sachs). Cette maffia a eu l’habileté d’inciter les états à s’endetter, non plus auprès de leurs administrés, mais auprès du capitalisme apatride. Marx, qui dénonçait cette dictature de la troisième fonction promettait de la renverser par la dictature du prolétariat, non moins matérialiste ni non moins mondialiste. L’Eglise catholique, mondialiste par définition même, avait vu ses prêtres ouvriers attirés par le marxisme, se syndiquer à la CGT, voire adhérer au parti. Dans les colonies, les missionnaires ont alors ressuscité la Controverse de Valladolid (sur la légitimité de la colonisation), et se sont plus préoccupés du bien temporel des indigènes que de leur bien spirituel. Pie XII intimera aux missionnaires l’ordre de ne plus occidentaliser les indigènes, mais de respecter leur identité et de promouvoir leur indépendance. Nombre de chrétiens soutiendront activement le Vietminh et les égorgeurs du FLN. La théologie de la libération fait la synthèse du marxisme et du message chrétien. C’est la cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, qui condamnera la trop grande implication du clergé dans la révolution politique. Délaissant le marxisme moribond, les tenants de la théologie de la libération vont s’engager dans les combats modernes de l’altermondialisme et de l’antiracisme, lequel va notamment obtenir que le mot ‘race’ soit supprimé » de tous les textes officiels français. Toute recherche d’identité est condamnée comme discriminatoire. Jusque là, on reconnaissait communément les races bibliques issues des trois fils de Noé, avec une multitude de subdivisions. Le mythe de l’ancêtre commun né en Afrique, rapidement invalidé par les découvertes scientifiques, n’est plus reçu que par les Noirs. L’antiracisme s’est rapidement étendu à toute discrimination, physique, sexuelle, religieuse. Le mixage que poursuit le multiculturalisme est une machine à tuer les peuples. Il ne débouche pas du tout sur un mélange généralisé des races, mais sur le communautarisme ou repli de chaque groupe dans des ghettos, avec une sérieuse perspective de guerre interethnique. La fin du cycle est proche.
Sous le titre ‘Gouverner par le chaos’, Thibault, membre de la rédaction du scriptoblog, répond à la question que posait, en 1929 déjà, le Dr Edward Bernays, l’auteur de ‘Propaganda, comment manipuler l’opinion en démocratie’ : « Ne pourrait-on pas mobiliser les masses sans qu’elles s’en rendent compte ? ». Neveu de Freud, Bernays est avec Walter Lippmann, un des fondateurs de l’ingénierie sociale, technique scientifique qui prétend par le contrôle de toutes les sphères du vivant pouvoir écraser toute déviance à la pensée correcte. Notamment par l’association d’idées (le chien de Pavlov qui salivait au seul tintement de la sonnette qui accompagnait tous ses repas ou la diabolisation des contestataires d’aujourd’hui par leur reductio ad hitlerum). L’institut Tavistock, financé par Rockefeller, a théorisé ces méthodes dites de contre-insurrection. Le projet exprimé est de mettre en place « un fascisme à visage démocratique », en affaiblissant notre moral, par des crises suscitées, des désordres entretenus, un management négatif, l’immigration de remplacement et le communautarisme, la discrimination positive de minorités ethniques, religieuses, sexuelles, la déstabilisation par l’affolement dans la submersion dans une surabondance d’information, le neuro-marketing. Les ingénieurs sociaux analysent et mesurent les réactions chimiques aux stimuli qu’ils administrent à leurs cobayes humains, rythmes, couleurs, poses, gestuelle. Un des objectifs à terme de cette guerre cognitive serait la cybernétisation de l’humanité.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite, Revue, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paganisme, monothéisme, christianisme, nouvelle droite, revue, terre et peuple |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 13 juin 2013
Anarchie et Christianisme de Jacques Ellul
"Anarchie et Christianisme" de Jacques Ellul
Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com/
 Anarchie et Christianisme, deux gros mots pour certains, deux mots inconciliables pour d’autres. Jacques Ellul ne s’y trompe pas et l’écrit lui-même en introduction:
Anarchie et Christianisme, deux gros mots pour certains, deux mots inconciliables pour d’autres. Jacques Ellul ne s’y trompe pas et l’écrit lui-même en introduction:
« La question ici posée est d’autant plus difficile que les certitudes à ce sujet sont établies depuis longtemps, des deux côtés, et jamais soumises à la moindre interrogation. Il va de soi que les anarchistes sont hostiles à toutes religions (et le christianisme est de toute évidence classé dans la catégorie), il va non moins de soi que les pieux chrétiens ont horreur de l’anarchie, source de désordre et négation des autorités établies. » (p.7)
Jacques Ellul aborde ici deux sujets qui lui tiennent à cœur. L’auteur est surement un des plus brillants intellectuels d’après-guerre. Spécialiste de Marx il prend pourtant parti pour la mouvance anarchiste. Protestant, il brosse une vision d’un christianisme qui se rapproche du christianisme des origines, ce « bolchevisme de l’Antiquité » qu’a tant fustigé la Nouvelle Droite. Il demeure aussi un spécialiste du droit romain et un critique de la pensée bourgeoise et de la technique. Il est l’auteur, à la suite de Léon Bloy, d’Exégèse des nouveaux lieux communs (1966).
Anarchie et Christianisme est un livre assez court, 160 pages environ dans l’édition dont je dispose. Encore une fois, il est assez appréciable de pouvoir lire des livres synthétiques, sans que cela dénature la pensée ou le propos de l’auteur. Deux grandes parties structurent cet ouvrage. Tout d’abord le Chapitre Ier : L’anarchie du point de vue d’un chrétien puis le Chapitre II : La Bible, source d’anarchie.
L’auteur commence par poser les bases de son anarchisme : « Si j’écarte l’anarchisme violent, reste l’anarchisme pacifiste, antinationaliste, anticapitaliste, moral, antidémocratique (c'est-à-dire hostile à la démocratie falsifiée des Etats bourgeois), agissant par des moyens de persuasion, par la création de petits groupes et de réseaux, dénonçant les mensonges, les oppressions, avec pour objectif le renversement réel des autorités quelles qu’elles soient, la prise de parole par l’homme de la base, et l’auto-organisation. Tout cela est très proche de Bakounine. » (p.24)
Cette partie est d’ailleurs remarquablement intéressante car Jacques Ellul plaide pour des actions de rupture avec la société. L’auteur donne un certain nombre de domaines : refus de l’enseignement obligatoire, du service militaire, des vaccinations, de la police, retour à la terre, … et donne l’exemple d’un ami à lui, persécuté par l’administration pour avoir refusé de vacciner son bétail… Lorsque nous voyons le chemin parcouru depuis, avec les normes toujours plus drastiques de l’UE, soutenu par les lobbies pharmaceutiques, chimiques, etc…, on ne peut que saluer la clairvoyance de ces quelques lignes. D’ailleurs, la profondeur de sa pensée s’exprime en ces quelques mots : « Bien attendu, ce ne sont que des petites actions, mais si on en mène beaucoup, si on est vigilant, on peut faire reculer l’omniprésence de l’Etat. Compte tenu que la « décentralisation » menée à grand bruit par Defferre a rendu la défense de la liberté beaucoup plus difficile. Car l’ennemi ce n’est pas l’Etat central aujourd’hui, mais l’omnipotence et l’omniprésence de l’administration. » (p.28). Décédé en 1994, Jacques Ellul n’aura pas eu le temps de mesurer les effets dévastateurs du traité de Maastricht soutenu par la gauche (y compris Mélenchon). Lui le pourfendeur de l’administration et des techniciens… traité qui rajoute des contraintes à celles dénoncées par Ellul dans l’action des mouvements dissidents. Par ailleurs, comme le rappelle l’auteur « qui paie, commande ! » (p.29). Une phrase qui devrait restée gravée dans les esprits, car elle est non seulement au cœur du rapport de domination capitaliste, mais également plus largement dans la plupart des rapports de domination entre les hommes.
Ces quelques pages sur l’anarchisme sont très vivifiantes pour accroître certaines réflexions quant aux façons d’agir. Jacques Ellul aura écrit avant l’avènement d’internet, qui constitue aujourd’hui un formidable moyen de contournement de l’Etat et de diffusion des idées comme le sont les radios internet (Méridien Zéro) ou les différents blogs (Novopress, Zentropa, …). La technologie peut avoir du bon…
La deuxième partie, La Bible, source d’anarchie défend la thèse selon laquelle le message du Christ, puissamment révolutionnaire, s’oppose aux différentes formes de domination de l’homme par l’homme selon le sens composé à partir du grec an-arkhé. Cette partie se présente donc comme une forme d’exégèse et s’attarde aussi sur la Bible hébraïque, problématique de ce point de vue, en raison de l’omniprésence des figures royales. Jacques Ellul fait aussi œuvre d’historien, en replaçant le message christique dans son contexte et particulièrement dans celui de l’affrontement avec le pouvoir romain et le pouvoir hérodien, dépendant des Romains. Un élément est particulièrement intéressant dans cette partie du livre, la réflexion sur le Diable, bâti sur le terme grec diabolos, qui signifie « le diviseur ». Pour Ellul, « l’Etat et la politique sont facteurs de division entre les hommes ». Cette réflexion pourrait faire écho à cet extrait de l’Epitre aux Galates de Paul de Tarse : « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus l’homme et la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ. » Un chrétien doit donner sa priorité à la Foi et tenter de rompre les barrières qui divisent l’humanité. La sous-partie Apocalypse est d’ailleurs très claire sur ces différents points d’après l’auteur : « […] il y’a une opposition radicale entre la Majesté de Dieu et toutes les puissances et pouvoirs de la terre (d’où l’erreur considérable de ceux qui disent qu’il y’a continuité entre le pouvoir divin et les pouvoirs terrestres, ou encore, comme sous la monarchie, qu’à un Dieu unique, tout-puissant, régnant dans le ciel, doit correspondre sur Terre un Roi unique, également tout-puissant ; l’Apocalypse dit exactement le contraire !) »
Nous ne doutons pas que cette seconde partie, dont nous vous laissons découvrir l’intégralité de la réflexion, pour éviter les raccourcis, suscitera des débats autant au sein des Chrétiens, qu’au sein de tous ceux qui sont attachés à leur terre, à leur patrie.
Ce qui me frappe dans la lecture de ce petit livre, c’est qu’on y trouve une pensée qui s’oppose en bien des points à ce qui fut celle de la Nouvelle Droite et en particulier de celle de Dominique Venner qui notait dans le Choc de l’histoire ou encore dernièrement dans son testament politique que l’Europe n’avait pas de religion identitaire (à l’inverse, par exemple, de l’Inde). La ND proclame une pensée très marquée par le paganisme et l’importance de la hiérarchie (aristocraties), là où Ellul en chrétien sincère s’y oppose. Pourtant, je dois bien admettre que la pensée d’Ellul est fortement « séduisante » car elle présente un christianisme qui s’oppose dans ses bases au monde dans lequel nous vivons et qui offre l’espérance.
Que l’on s’intéresse à la pensée anarchiste, au christianisme ou qu’on cherche quelques « cartouches intellectuelles », la lecture d’Anarchie et Christianisme s’impose. C’est aussi un moyen d’entrer en contact avec la pensée de Jacques Ellul avec ce qu’elle a de plus profonde : sa foi chrétienne.
Jean
Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source.
00:05 Publié dans Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anarchie, christianisme, jacques ellul, philosophie, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 05 mai 2013
Semitic Monotheism
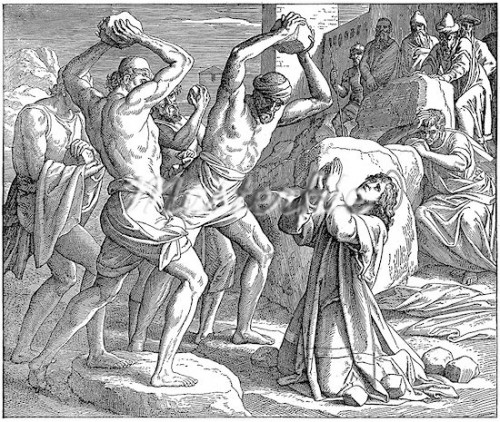
S. Gurumurthy:
S. Gurumurthy argues that the monotheistic Semitic religions of what he calls "the West" brought intolerance to India. Traditionally, Gurumurthy argues, Indian culture was characterized by a liberal pluralism stemming from the polytheism of Hindu beliefs.
In the history of human civilization there have been two distinct ways of life -- the eastern and the Semitic. If we look at the history of India and of its people on the one hand and at the history of Semitic societies on the other, we find a glaring difference. In India the society and individual form the center of gravity, the fulcrum around which the polity revolves, and the state is merely a residuary concept. On the other hand, in the Semitic tradition the state wields all the power and forms the soul and the backbone of the polity. In India, temporal power was located in the lowest units of society, which developed into a highly decentralized social network. This was the very reverse of the centralized power structures that evolved in the Semitic tradition of the West. We had decentralizing institutions, of castes, of localities, of sects belonging to different faiths; of groups of people gathering around a particular deity or around a particular individual. Society was a collection of multitudes of self-contained social molecules, spontaneously linked together by socio spiritual thoughts, symbols, centers of pilgrimage, and sages. In the West the most important, and often the only, link between different institutions of the society was the state.
THE RESIDUAL STATE
Of course, the state also existed in India in the past, but only as a residual institution. It had a very limited role to perform. Even the origin of the state is said to be in the perceived necessity of an institution to perform the residual supervisory functions that became necessary because a small number of people could not harmonize with the rest in the self- regulating, self-operating and self powered functioning of the society. The state was to look after the spill-over functions that escaped the self-regulating mechanisms of the society. The Mahabharata, in the Santiparva, defines the functions of the state precisely thus. The state was to ensure that the one who strays away from public ethics does not tread on others. There was perhaps no necessity for the state at one point in our social history. The evolution of society to a point where certain individuals came to be at cross purposes with the society because of the erosion of dharmic, or ethical values, introduced the need for a limited arbiter to deal with "outlaws" who would not agree to be bound by dharma. That task was entrusted to the state. This appears to be the origin of the state here. So the society or the group, at whatever level it functioned, was the dominant reality and the state was a residual authority. The society had an identity distinct from the state. Social relations as well as religious and cultural bonds transcended the bounds of the state.
DHARMA VS. SOCIAL CONTRACT
People in the Semitic society, on the other hand, seem to have burdened themselves with the state the moment they graduated from tribalism and nomadic life to a settled existence. Thus the Semitic society never knew how to live by self-regulation. People never knew how to exist together unless their lives were ordered through the coercive institution of the state. The concept of self-regulation, the concept of dharma, the personal and public norms of action and thought that we have inherited from time immemorial, did not have any chance to evolve. Instead what evolved, for example in the Christian West, was the "social contract" theory of the state. And this became the basis of the nation state that dominated during the era of Western hegemony. But even before that, a mighty state, a nation-less state, had already evolved in the West. It was a state that cut across all nations, all societies, all ethnicities, all faiths, all races. This was the kind of state developed by the Romans. The statecraft of the Romans purveyed power and power alone. Later, after the collapse of the nationless state, tribal nationalism began to be assertive. This nation state, whose power was legitimated according to socio-religious criteria, became the model for the Semitic society. Far from being an arbiter, the state became the initiator, the fulcrum of the society.
STATELY RELIGION
Western society thus became largely a state construct. Even geography and history began to follow state power. In the scheme of things, the king symbolized total power, the army became crucial to the polity, and the police indispensable. The throne of the king became more important than the Church, and his word more important than the Bible, forcing even the Church to acquire stately attributes and begin competing with the state. That is why the first Church was founded in Rome. Because of the social recognition of state power and the importance that it had acquired, religion had to go to the seat of the state. That is how Rome, and not Bethlehem, became the center of Christian thought. The Church developed as a state-like institution, as an alternative and a competing institution. The Church began to mimic the state, and the Archbishop competed with the King. And finally religion itself became a competitor of the state. Naturally there were conflicts between these two powerful institutions -- between the state and the Church, and between the King and the Archbishop. Both owed allegiance to the same faith, the same book, the same prophet -- and yet they could not agree on who should wield ultimate power. They fought in order to decide who amongst them would be the legitimate representative of the faith. And, in their ^ght, both invoked the same God. The result was a society that was at war with itself; a society in which the stately religion was at war with the religious state. The result also was centralism and exclusivism, not only in thought, but also in the institutional arrangements. Out of such war within itself -- including between Christianity and Islam -- Semitic society evolved its centralist and exclusivist institutions that are now peddled as the panacea for the ills of all societies. As the monotheistic civilization rapidly evolved a theocratic state, it ruled out all plurality in thought. There could not be any doubt, there could not be a second thought competing with the one approved and patronized by the state, and there could not even be a second institution representing the same faith. The possibility of different religions or different attitudes to life evolving in the same society was made minimal. No one could disagree with the established doctrine without inviting terrible retribution. Whenever any semblance of plurality surfaced anywhere, it was subjected to immediate annihilation. The entire social, political and religious power of the Semitic society gravitated toward and became slowly and finally manifest in the unitary state. Thus single-dimensional universality, far more than plurality, is the key feature of Western society. The West, in fact, spawned a power-oriented, power-driven, and power-inspired civilization which sought and enforced thoughts, books, and institutions.
GUARDIAN SAGES
This unity of the Semitic state and the Semitic society proved to be its strength as a conquering power. But this was also its weakness. The moment the state became weak or collapsed anywhere, the society there also followed the fate of the state. In India, society was supported by institutions other than the state. Not just one, but hundreds and even thousands of institutions flourished within the polity and none of them had or needed to use any coercive power. Indian civilization -- culture, arts, music, and the collective life of the people guardianship of the people and of the public mind was not entrusted to the state. In fact, it was the sages, and not the state, who were seen as the guardians of the public mind. When offending forces, whether Sakas or Huns or any others, came from abroad, this society -- which was not organized as a powerful state and was without a powerful army or arms and ammunition of a kind that could meet such vast brute forces coming from outside -- found its institutions of state severely damaged. But that did not lead to the collapse of the society. The society not only survived when the institutions of the state collapsed, but in the course of time it also assimilated the alien groups and digested them into inseparable parts of the social stream. Later invaders into India were not mere gangs of armed tribes, but highly motivated theocratic war-mongers. The Indian states, which were mere residues of the Indian society, caved in before them too. But the society survived even these crusaders. In contrast, the state-oriented and state-initiated civilizations, societies and cultures of the West invariably were annihilated with the collapse of the state. Whether the Romans, the Greeks or the Christians, or the later followers of Islam, or the modern Marxists -- none of them could survive as a viable civilization once the state they had constructed collapsed. When a Semitic king won and wiped out another, it was not just another state that was wiped out, but all social bearings and moorings of the society -- all its literature, art, music, culture and language. Everything relating to the society was extinguished. In the West of today, there are no remnants of what would have been the products of Western civilization 1500 years ago. The Semitic virtue rejected all new and fresh thought. Consequently, any fresh thought could prevail only by annihilating its predecessor. At one time only one thought could hold sway. There was no scope for a second.
EASTERN PLURALISM
In the East, more specifically in India, there prevailed a society and a social mind which thrived and happily grew within a multiplicity of thoughts. "Ano bhadrah kratavo yantu visatah" ("let noble thoughts come in from all directions of the universe") went the Rigvedic invocation. We, therefore, welcomed all, whether it was the Parsis who came fleeing from the slaughter of Islamic theocratic marauders and received protection here for their race and their religion, or the Jews who were slaughtered and maimed everywhere else in the world. They all found a secure refuge here along with their culture, civilization, religion and the book. Even the Shia Muslims, fearing annihilation by their coreligionists, sought shelter in Gujarat and constituted the first influx of Muslims into India. Refugee people, refugee religions, refugee cultures and civilizations came here, took root and established a workable, amicable relationship with their neighborhood. They did not -- even now they do not -- find this society alien or foreign. They could grow as constituent parts of an assimilative society and under an umbrella of thought that appreciated their different ways. When first Christianity, and later Islam, came to India as purely religious concerns, they too found the same assimilative openness. The early Christians and Muslims arriving on the west coast of India did not find anything hostile in the social atmosphere here. They found a welcoming and receptive atmosphere in which the Hindus happily offered them temple lands for building a church or a mosque. (Even today in the localities of Tamilnadu temple lands are offered for construction of mosques). It was only the later theocratic incursions by the Mughals and the British that introduced theological and cultural maladjustments, creating conflict between the assimilative and inclusive native ways of the East and the exclusive and annihilative instincts of Islam and even Christianity. Until this occurred, the native society assimilated the new thoughts and fresh inputs, and had no difficulty in keeping intact its social harmony within the plurality of thoughts and faiths. This openness to foreign thoughts, faiths and people did not happen because of legislation, or a secular constitution or the teachings of secular leaders and parties. We did not display this openness because of any civilizing inspiration and wisdom which we happened to have received from the West. Yet, we are somehow made to believe, and we do, that we have become a somewhat civilized people and have come to learn to live together in harmony with others only through the civilization, the language, the statecraft and the societal influence of the West! It is a myth that has become an inseparable component of the intellectual baggage that most of us carry.
SURVIVING THE SEMITIC ONSLAUGHT
Religious fanaticism, invaded us and extinguished our states and institutions, our society could still survive and preserve its multidimensional life largely intact. Our survival has been accompanied, however, with an extraordinary sense of guilt. In our own eyes, we remain a society yet to be fully civilized. This is because, as the state in India quickly became an instrument in the hands of the invaders and colonizers, we were saddled not just with an unresponsive state, but a state hostile to the nation itself. A state-less society in India would have fared better. Such a paradox has existed nowhere else in the history of the world. When we look at the history of any other country, we find that whenever an overpowering alien state came into being, it wiped out everything that it saw as a native thought or institution. And if the natives insisted on holding on to their thought and institutions, then they were wiped out. But the Indian society survived under an alien and hostile state for hundreds of years, albeit at the price of having today lost almost all initiative and self confidence as a civilization.
GIVE ME YOUR PERSECUTED
How did the assimilative Hindu cultural convictions fare in practice, not just in theory and in the archives? This is probably best seen by comparing the Iranians of today with the Parsis of India. A few thousand of them who came here and who now number 200,000 have lived in a congenial atmosphere. They have not been subjected to any hostility to convert, or to give up their cultural or even racial distinction. They have had every chance, as much as the natives had, to prosper and evolve. And they did. They have lived and prospered here for 1500 years, more or less the same way as they would have lived and prospered in their own lands, had those lands not been ravaged by Islam. Compare an average Parsi with an average Iranian. Does the Persian society today display any native attributes of the kind that the Parsis, living in the Indian society, have managed to preserve? One can ^nd no trace of those original native attributes in the Iranian society today. That is because not only the native institutions, native faiths and native literature, but also the native mind and all vestiges of native originality were wiped out by Islam. That society was converted and made into a uniform outfit in form, shape and mental condition. On that condition alone would Islam accept it. What Islam did to the natives in Egypt, Afghanistan and Persia, or what Christianity did to the Red Indians in America, or what Christianity and Islam did to each other in Europe, or the Catholics did to Protestants, or the Sunnis did to Shias and the Kurds and the Ahmedias, or what the Shias did to the Bahais, was identical. In every case the annihilation of the other was attempted -- annihilation of other thoughts, other thinkers and other followers. The essential thrust of the Semitic civilizational effort, including the latest effort of Marxist monotheism, has been to enforce uniformity, and failing that, to annihilate. How can the West claim that it taught us how to lead a pluralistic life? If you look at history, you find that they were the ones who could not, and never did, tolerate any kind of plurality, either in the religious or the secular domain. If it has dawned upon them today that they have to live with plurality, it must be because of the violence they have had to commit against themselves and each other. The mass slaughter which the Western society has been subjected to by the adherents of different religious thoughts and by different tyrants is unimaginable, and perhaps they are now sick of this slaughter and violence. But the view we get, and are asked to subscribe to, is that the "civilized" West was a peaceful society, and that we brutes down here never knew how to live at peace with ourselves and our neighbors until liberated by the literate. What a paradox!
TEMPORAL POWER
The foundation of the Semitic system is laid on temporal power. For acceptance and survival in this system even religion had to marry and stick to temporal authority at the cost of losing its spiritual moorings. It was with this power -- first the state power, which still later was converted into technological power -- that the Christian West was able to establish its dominance. This brute dominance was clothed in the garb of modernity and presented as the civilization of the world. The aggressively organized Western society, through its powerful arm of the state, was able to overcome and subordinate the expressions of the self- governing decentralized society of the East that did not care to have the protection of a centralized state. Our society, unorganized in the physical sense, although it was much more organized in a civilizational sense, had a more evolved mind. But it did not have the muscle; it did not have the fire power. Perhaps because of the Buddhist influence, our society acquired disproportionately high Brahmatejas, Brahminical piety and authority, which eroded the Kshatravirya, the temporal war-making power. So it caved in and ceded temporal authority to the more powerful state and the statecraft that came from outside. The society that caves in is, in terms of the current global rules, a defeated society. This society cannot produce or generate the kind of self-confidence which is required in the modern world.
DYNAMIC CHRISTIANS, STAGNANT MUSLIMS
The nation-state was so powerful, that other countries, like India, could not stand against it. And when the nation-state concept was powered by religious exclusivism it had no equal. When religion acquired the state, the church itself was the first victim of that acquisition. Christianity suffered from the Christian state. It had to struggle not only against Islamic states and Islamic society, but also against itself. As a consequence, it underwent a process of moderation. First, it experienced dissent, then renaissance through arts, music and culture. Thus Christianity was able to overcome the effect of theocratic statecraft by slowly evolving as a society not entirely identified with the state. First the state began to dominate over the Church on the principle of separation between the religious and temporal authorities. The result was the evolution of the secular state. Thus the King wrested the secular power from the Archbishop. Then through democratic movements following the French Revolution, the people wrested power from the King. Later commerce invaded public life as the prime thrust of the Christian West. The theocratic state abdicated in favor of a secular state, the secular state gave way to democracy and later democracy gave way to commerce. Then power shifted from commerce to technology. And now in the Christian West, the state and the society are largely powered by commerce and technology. The Christian West today is even prepared to give up the concept of the nation-state to promote commerce fueled by technological advance. Look at the consolidation that is taking place between Mexico, Canada and the United States of America around trade, and the kind of pyramidal politico economic consolidation that is taking place in Western Europe. All this is oriented towards only one thing West.
ISLAM REMAINED UNCHANGED
While the Christian West has evolved dynamically over the past few centuries, the story of Islam is one of 1500 years of unmitigated stagnation. There has never been a successful attempt from within Islam to start the flow, so to speak. Anyone who attempted to start even a variant of the mainstream flow -- anyone who merely attempted to reinterpret the same book and the same prophet -- was disposed of with such severity that it set an example and a warning to anyone who would dare to cross the line. Some, who merely said that it was not necessary for the Islamic Kingdom to be ruled by the Prophet's own descendants were wiped out. Some others said that the Prophet himself may come again -- not that somebody else might come, but the Prophet himself may be reborn. They were also wiped out. The Sunnis, the Shias, the Ahmedias, the Bahais -- all of whom trusted the same prophet, revered the same book and were loyal to the same revelation -- were all physically and spiritually maimed. From the earliest times, Islam has proved itself incapable of producing an internal evolution; internally legitimized change has not been possible since all change is instantly regarded as an act of apostasy. Every change was -- and is -- put down with bloodshed. In contrast, the Hindu ethos changed continuously. Though, it was always change with continuity: from ritualistic life, to agnostic Buddhism, to the Ahimsa of Mahavira, to the intellect of Sankara, to the devotion of Ramanuja, and finally to the modern movements of social reform. In India, all these changes have occurred without the shedding of a single drop of blood. Islam, on the other hand retains its changelessness, despite the spilling of so much blood all around. It is the changelessness of Islam -- its equal revulsion towards dissent within and towards non-Islamic thoughts without -- that has made it a problem for the whole world.
ISLAM IN INDIA
The encounter between the inclusive and assimilative heritage of India and exclusive Islam, which had nothing but theological dislike for the native faiths, was a tussle between two unequals. On the one side there was the inclusive, universal and spiritually powerful -- but temporally unorganized - native Hindu thought. And on the other side there was the temporally organized and powerful -- but spiritually exclusive and isolated -- Islam. Islam subordinated, for some time and in some areas, the Hindu temporal power, but it could not erode Hindu spiritual power. If anything, the Hindu spiritual power incubated the offending faith and delivered a milder form of Islam -- Sufism. However, the physical encounter was one of the bloodiest in human history. We survived this test by fire and sword. But the battle left behind an unassimilated Islamic society within India. The problem has existed since then, to this day.
ISLAM, INDIA AND THE CHRISTIAN WEST
The Hindu renaissance in India is the Indian contribution to an evolving global attitude that calls for a review of the conservative and extremist Islamic attitudes towards non-Islamic faiths and societies. The whole world is now concerned with the prospect of extremist Islam becoming a problem by sanctifying religious terrorism. So long as the red flag was flying atop the Kremlin, the Christian West tried to project communism as the greatest enemy of world peace. It originally promoted Islam and Islamic fundamentalism against the fanaticism of communism. The West knew it could match communism in the market-place, in technology, in commerce, and even in war, but it had no means of combating communism on the emotive plane. So they structured a green Islamic belt -- from Tunisia to Indonesia -- to serve as a bulwark against Marxist thought. But that has changed now. When communism collapsed, extremist Islam with its terrorist tendencies instantly emerged in the mind of the Christian West as the major threat to the world.
HINDUS SURVIVED MUSLIM INVASION
We must realize that we have a problem on hand in India, the problem of a stagnant and conservative Islamic society. The secular leaders and parties tell us that the problem on our hands is not Islamic fundamentalism, but the Hindutva ideology. This view is good only for gathering votes. The fact is that we have a fundamentalist Muslim problem, and our problem cannot be divorced from the international Islamic politics and the world's reaction to it. To understand the problem and to undertake the task of solving it successfully, we must know the nature of Hindu society and its encounter with Islam in India. As a nation, we are heckled by the secularist historians and commentators: "You are caste-oriented, you are a country with 900 languages, and most of them with no script," they say. "You can't even communicate in one language, you don't have a common religious book which all may follow. You are not a nation at all. In contrast, look at the unity of Islam and its brotherhood." But the apparently unorganized and diverse Hindu society is perhaps the only society in the world that faced, and then survived, the Islamic theocratic invasion. We, the Hindu nation, have survived because of the very differences that seem to divide us. It is in some ways a mind- boggling phenomenon: For 500 to 600 years we survived the invasion of Islam as no other society did. The whole of Arabia, which had a very evolved civilization, was run over in a matter of just 20 years. Persia collapsed within 50 years. Buddhist Afghans put up a brave resistance for 300 years but, in the end, they also collapsed. In all of these countries today there remains nothing pre- Islamic worth the name save for some broken down architectural monuments from their pre-Islamic past. How did our society survive the Islamic onslaught? We have survived not only physically, but intellectually too. We have preserved our culture. The kind of music that was heard 1500 years ago is heard even today. Much of the literature too remains available along with the original phonetic intonations. So the Indian society continued to function under a hostile occupation even without a protective state. Or rather, we survived because our soul did not reside in an organized state, but in an organized national consciousness, in shared feelings of what constitutes human life in this universe that happens to be such a wonderfully varied manifestation of the divine, of Brahman.
HINDUTVA AS INDIA'S ANCHOR
The assimilative Hindu cultural and civilizational ethos is the only basis for any durable personal and social interaction between the Muslims and the rest of our countrymen. This societal assimilative realization is the basis for Indian nationalism, and only an inclusive Hindutva can assimilate an exclusive Islam by making the Muslims conscious of their Hindu ancestry and heritage. A national effort is called for to break Islamic exclusivism and enshrine the assimilative Hindutva. This alone constitutes true nationalism and true national integration. This is the only way to protect the plurality of thoughts and institutions in this country. To the extent secularism advances Islamic isolation and exclusivism, it damages Hindu inclusiveness and its assimilative qualities. And in this sense secularism as practiced until now conflicts with Indin nationalism. Inclusive and assimilative Hindutva is the socio-cultural nationalism of India. So long as our national leaders ignore this eternal truth, national integration will keep eluding us.
Center for Policy Studies, Madras.
1993.
00:08 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bjp, tradition, traditionalisme, monothéisme, religion, intolérance, islam, christianisme, hindouisme, inde, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 19 novembre 2012
Genèse de la pensée unique
Genèse de la pensée unique
par Claude BOURRINET
« Il n’y eut plus de rire pour personne. »
Procope
Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, spécialiste du platonisme tardif (le néoplatonisme) avait bousculé quelques certitudes, dans son ouvrage publié en 2006, « la lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif », en montrant que les structures de pensée dans l’Empire gréco-romain, dont l’aboutissement serait la suppression de toute possibilité discursive au sein de l’élite intellectuelle, étaient analogues chez les philosophes « païens » et les théologiens chrétiens. Cette osmose, à laquelle il était impossible d’échapper, se retrouve au niveau des structures politiques et administratives, avant et après Constantin. L’État « païen », selon Mme Athanassiadi, prépare l’État chrétien, et le contrôle total de la société, des corps et des esprits. C’est la thèse contenue dans une étude éditée en 2010, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive.
Un basculement identitaire
L’Antiquité tardive est l’un de ces concepts historiques relativement flous, que l’on adopte, parce que c’est pratique, mais qui peuvent susciter des polémiques farouches, justement parce qu’ils dissimulent des pièges heuristiques entraînant des interprétations diamétralement apposées. Nous verrons que l’un des intérêts de cette recherche est d’avoir mis au jour les engagements singulièrement contemporains qui sous tendent des analyses apparemment « scientifiques ».
La première difficulté réside dans la délimitation de la période. Le passage aurait eu lieu sous le règne de Marc Aurèle, au IIe siècle, et cette localisation temporelle ne soulève aucun désaccord. En revanche, le consensus n’existe plus si l’on porte le point d’achoppement (en oubliant la date artificielle de 476) à Mahomet, au VIIe siècle, c’est-à-dire à l’aboutissement désastreux d’une longue série d’invasions, ou aux règnes d’Haroun al-Rachid et de Charlemagne, au IXe siècle, voire jusqu’en l’An Mil. Ce qui est en jeu dans ce débat, c’est l’accent mis sur la rupture ou sur la continuité.
Le fait indubitable est néanmoins que la religion, lors de ce processus qui se déroule quand même sur plusieurs siècles, est devenue le « trait identitaire de l’individu ». L’autre constat est qu’il s’éploie dans un monde de plus en plus globalisé – l’orbis romanus – dans un empire qui n’est plus « romain », et qui est devenu méditerranéen, voire davantage. Une révolution profonde s’y est produite, accélérées par les crises, et creusant ses mines jusqu’au cœur d’un individu de plus en plus angoissé et cherchant son salut au-delà du monde. La civilisation de la cité, qui rattachait l’esprit et le corps aux réalités sublunaires, a été remplacée par une vaste entité centralisée, dont la tête, Constantinople ou Damas, le Basileus ou le calife, un Dieu unique, contrôle tout. Tout ce qui faisait la joie de vivre, la culture, les promenades philosophiques, les spectacles, les plaisirs, est devenu tentation démoniaque. La terre semble avoir été recouverte, en même temps que par les basiliques, les minarets, les prédicateurs, les missionnaires, par un voile de mélancolie et un frisson de peur. Une voix à l’unisson soude les masses uniformisées, là où, jadis, la polyphonie des cultes et la polydoxie des sectes assuraient des parcours existentiels différenciés. Une monodoxie impérieuse, à base de théologie et de règlements tatillons, s’est substituée à la science (épistémé) du sage, en contredisant Platon pour qui la doxa, l’opinion, était la source de l’erreur.
Désormais, il ne suffit pas de « croire », si tant est qu’une telle posture religieuse ait eu sa place dans le sacré dit « païen » : il faut montrer que l’on croit. Le paradigme de l’appartenance politico-sociale est complètement transformé. La terreur théologique n’a plus de limites.
Comme le montre Polymnia Athanassiadi, cet aspect déplaisant a été, avec d’autres, occulté par une certaine historiographie, d’origine anglo-saxonne.
Contre l’histoire politiquement correcte
La notion et l’expression d’« Antiquité tardive » ont été forgées principalement pour se dégager d’un outillage sémantique légué par les idéologies nationales et religieuses. Des Lumières au positivisme laïciste du XIXe siècle, la polémique concernait la question religieuse, le rapport avec la laïcité, le combat contre l’Église, le triomphe de la raison scientifique et technique. Le « récit » de la chute de l’Empire romain s’inspirait des grandes lignes tracées par Montesquieu et Gibbon, et mettait l’accent sur la décadence, sur la catastrophe pour la civilisation qu’avait provoquée la perte des richesses antiques. Le christianisme pouvait, de ce fait, paraître comme un facteur dissolvant. D’un autre côté, ses apologistes, comme Chateaubriand, tout en ne niant pas le caractère violent du conflit entre le paganisme et le christianisme, ont souligné la modernité de ce dernier, et par quelles valeurs humaines il remplaçait celles de l’ancien monde, devenu obsolète.
C’est surtout contre l’interprétation de Spengler que s’est élevée la nouvelle historiographie de la fin des années Soixante. Pour le savant allemand, les civilisations subissent une évolution biologique qui les porte de la naissance à la mort, en passant par la maturité et la vieillesse. On abandonna ce schéma cyclique pour adopter la conception linéaire du temps historique, tout en insistant sur l’absence de rupture, au profit de l’idée optimiste de mutation. L’influence de Fernand Braudel, théoricien de la longue durée historique et de l’asynchronie des changements, fut déterminante.
L’école anglo-saxonne s’illustra particulièrement. Le maître en fut d’abord Peter Brown avec son World of late Antiquity : from Marcus Aurelius to Muhammad (1971). Mme Athanassiadi n’est pas tendre avec ce savant. Elle insiste par exemple sur l’absence de structure de l’ouvrage, ce qui ne serait pas grave s’il ne s’agissait d’une étude à vocation scientifique, et sur le manque de rigueur des cent trente illustrations l’accompagnant, souvent sorties de leur contexte. Quoi qu’il en soit, le gourou de la nouvelle école tardo-antique étayait une vision optimiste de cette période, perçue comme un âge d’adaptation.
Il fut suivi. En 1997, Thomas Hägg, publia la revue Symbolae Osbenses, qui privilégie une approche irénique. On vide notamment le terme le terme xenos (« étranger ») de son contenu tragique « pour le rattacher au concept d’une terre nouvelle, la kainê ktisis, ailleurs intérieur rayonnant d’espoir ». Ce n’est pas un hasard si l’inspirateur de cette historiographique révisionniste est le savant italien Santo Mazzarino, l’un des forgerons de la notion de démocratisation de la culture.
La méthode consiste en l’occurrence à supprimer les oppositions comme celles entre l’élite et la masse, la haute et la basse culture. D’autre part, le « saint » devient l’emblème de la nouvelle société. En renonçant à l’existence mondaine, il accède à un statut surhumain, un guide, un sauveur, un intermédiaire entre le peuple et le pouvoir, entre l’humain et le divin. Il est le symbole d’un monde qui parvient à se maîtrise, qui se délivre des entraves du passé
Polymnia Athanassiadi rappelle les influences qui ont pu marquer cette conception positive : elle a été élaborée durant une époque où la détente d’après-guerre devenait possible, où l’individualisme se répandait, avec l’hédonisme qui l’accompagne inévitablement, où le pacifisme devient, à la fin années soixante, la pensée obligée de l’élite. De ce fait, les conflits sont minimisés.
Un peu plus tard, en 1999, un tome collectif a vu le jour : Late Antiquity. A Guide to the postclassical World. Y ont contribué P. Brown et deux autres savants princetoniens : Glen Bowersock et Oleg Grabar, pour qui le véritable héritier de l’empire romain est Haroun al-Rachid. L’espace tardo-antique est porté jusqu’à la Chine, et on met l’accent sur vie quotidienne. Il n’y a plus de hiérarchie. Les dimensions religieuse, artistique politique, profane, l’écologique, la sexuelle, les femmes, le mariage, le divorce, la nudité – mais pas les eunuques, sont placées sur le même plan. La notion de crise est absente, aucune allusion aux intégrismes n’est faite, la pauvreté grandissante n’est pas évoquée, ni la violence endémique, bref, on a une « image d’une Antiquité tardive qui correspond à une vision politiquement correcte ».
La réaction a vu le jour en Italie. Cette même année 1999, Andrea Giardina, dans un article de la revue Studi Storici, « Esplosione di tardoantico », a contesté « la vision optimiste d’une Antiquité tardive longue et paisible, multiculturelle et pluridisciplinaire ». Il a expliqué cette perception déformée par plusieurs causes :
— la rhétorique de la modernité,
— l’impérialisme linguistique de l’anglais dans le monde contemporain (« club anglo-saxon »),
— une approche méthodologique défectueuse (lecture hâtive).
Et, finalement, il conseille de réorienter vers l’étude des institutions administratives et des structures socio-économiques.
Dans la même optique, tout en dénonçant le relativisme de l’école anglo-saxonne, Wolf Liebeschuetz, (Decline and Full of the Roman City, 2001 et 2005), analyse le passage de la cité-État à l’État universel. Il insiste sur la notion de déclin, sur la disparition du genre de vie avec institutions administratives et culturelles légués par génie hellénistique, et il s’interroge sur la continuité entre la Cité romaine et ses successeurs (Islam et Europe occidentale). Quant à Bryan Ward-Perkins, The fall of Rome and the End of Civilization, il souligne la violence des invasions barbares, s’attarde sur le trauma de la dissolution de l’Empire. Pour lui, le déclin est le résultat de la chute.
On voit que l’érudition peut cacher des questions hautement polémiques et singulièrement contemporaines. Polymnia Athanassiadi prend parti, parfois avec un mordant plaisant, mais nul n’hésitera à se rendre compte combien les caractéristiques qui ont marqué l’Antiquité tardive concernent de façon extraordinaire notre propre monde.
Polymnia Athanassiadi rappelle, en s’attardant sur la dimension politico-juridique, quelles ont été les circonstances de la victoire de la « pensée unique » (expression ô combien contemporaine !). Mais avant tout, quelle a été la force du christianisme ?
La révolution culturelle chrétienne
Le christianisme avait plusieurs atouts à sa disposition, dont certains complètement inédits dans la société païenne.
D’abord, il hérite d’une société où la violence est devenue banale, du fait de la centralisation politico-administrative, et de ce qu’on peut nommer la culture de l’amphithéâtre.
Dès le IIe siècle, en Anatolie, le martyr apparaît comme la « couronne rouge » de la sainteté octroyée par le sens donné. Les amateurs sont mus par une vertu grecque, la philotimia, l’« amour de l’honneur ». C’est le seul point commun avec l’hellénisme, car rien ne répugne plus aux esprits de l’époque que de mourir pour des convictions religieuses, dans la mesure où toutes sont acceptées comme telles. Aussi bien cette posture est-elle peu comprise, et même méprisée. L’excès rhétorique par lequel l’Église en fait la promotion en souligne la théâtralité. Marc Aurèle y voit de la déraison, et l’indice d’une opposition répréhensible à la société. Et, pour une société qui recherche la joie de vivre, cette pulsion de mort paraît bien suspecte.
Retenons donc cette aisance dans l’art de la propagande – comme chacun sait, le nombre de martyrs n’a pas été si élevé qu’on l’a prétendu – et cette attirance morbide qui peut aller jusqu’au fond des cœurs. Le culte des morts et l’adoration des reliques sont en vogue dès le IIIe siècle.
Le leitmotiv de la résurrection des corps et du jugement dernier est encore une manière d’habituer à l’idée de la mort. Le scepticisme régnant avant IIIe siècle va laisser place à une certitude que l’on trouve par exemple chez Tertullien, pour qui l’absurde est l’indice même de la vérité (De carne christi, 5).
L’irrationalisme, dont le christianisme n’est pas seul porteur, encouragé par les religions orientales, s’empare donc des esprits, et rend toute manifestation surnaturelle plausible. Il faut ajouter la croyance aux démons, partagée par tous.
Mais c’est surtout dans l’offensive, dans l’agression, que l’Église va se trouver particulièrement redoutable. En effet, de victimes, les chrétiens, après l’Édit de Milan, en 313, vont devenir des agents de persécution. Des temples et des synagogues seront détruits, des livres brûlés.
Peut-être l’attitude qui tranche le plus avec le comportement des Anciens est-il le prosélytisme, la volonté non seulement de convertir chaque individu, mais aussi l’ensemble de la société, de façon à modeler une communauté soudée dans une unicité de conviction. Certes, les écoles philosophiques cherchaient à persuader. Mais, outre que leur zèle n’allait pas jusqu’à harceler le monde, elles représentaient des sortes d’options existentielles dans le grand marché du bonheur, dont la vocation n’était pas de conquérir le pouvoir sur les esprits. Plotin, l’un des derniers champions du rationalisme hellène, s’est élevé violemment contre cette pratique visant à arraisonner les personnes. On vivait alors de plus en plus dans la peur, dans la terreur de ne pas être sauvé. L’art de dramatiser l’enjeu, de le charger de toute la subjectivité de l’angoisse et du bon choix à faire, a rendu le christianisme particulièrement efficace. Comme le fait remarquer Mme Athanassiadi, la grande césure du moi, n’est plus entre le corps et l’âme, mais entre le moi pécheur et le moi sauvé. Le croyant est sollicité, sommé de s’engager, déchiré d’abord, avant Constantin, entre l’État et l’Église, puis de façon permanente entre la vie temporelle et la vie éternelle.
Cette tension sera attisée par la multitude d’hérésie et par les conflits doctrinaux, extrêmement violents. Les schismes entraînent excommunications, persécutions, batailles physiques. Des polémiques métaphysiques absconses toucheront les plus basses couches de la société, comme le décrit Grégoire de Nysse dans une page célèbre très amusante. Les Conciles, notamment ceux de Nicée et de Chalcédoine, seront des prétextes à l’expression la plus hyperbolique du chantage, des pressions de toutes sortes, d’agressivité et de brutalité. Tout cela, Ramsay MacMullen le décrit fort bien dans son excellent livre, Christianisme et paganisme du IVe au VIIIe siècle.
Mais c’est surtout l’arme de l’État qui va précipiter la victoire finale contre l’ancien monde. Après Constantin, et surtout avec Théodose et ses successeurs, les conversions forcées vont être la règle. À propos de Justinien, Procope écrit : « Dans son zèle pour réunir l’humanité entière dans une même foi quant au Christ, il faisait périr tout dissident de manière insensée » (in 118). Des lois discriminatoires seront décrétées. Même le passé est éradiqué. On efface la mémoire, on sélectionne les ouvrages, l’index des œuvres interdites est publié, Basile de Césarée (vers 360) établit une liste d’auteurs acceptables, on jette même l’anathème sur les hérétiques de l’avenir !
Construction d’une pensée unique
L’interrogation de Polemnia Athanassiadi est celle-ci : comment est-on passé de la polydoxie propre à l’univers hellénistique, à la monodoxie ? Comment un monde à l’échelle humaine est-il devenu un monde voué à la gloire d’un Dieu unique ?
Son fil conducteur est la notion d’intolérance. Mot piégé par excellence, et qui draine pas mal de malentendus. Il n’a rien de commun par exemple avec l’acception commune qui s’impose maintenant, et dont le fondement est cette indifférence profonde pour tout ce qui est un peu grave et profond, voire cette insipide légèreté contemporaine qui fuit les tragiques conséquences de la politique ou de la foi religieuse. Serait intolérant au fond celui qui prendrait au sérieux, avec tous les refus impliqués, une option spirituelle ou existentielle, à l’exclusion d’une autre. Rien de plus conformiste que la démocratie de masse ! Dans le domaine religieux, le paganisme était très généreux, et accueillait sans hésiter toutes les divinités qu’il lui semblait utile de reconnaître, et même davantage, dans l’ignorance où l’on était du degré de cette « utilité » et de la multiplicité des dieux. C’est pourquoi, à Rome, on rendait un culte au dieu inconnu. Les païens n’ont jamais compris ce que pouvait être un dieu « jaloux », et tout autant leur théologie que leur anthropologie les en empêchaient. En revanche, l’attitude, le comportement, le mode de vie impliquaient une adhésion ostentatoire à la communauté. Les cultes relevaient de la vie familiale, associative, ou des convictions individuelles : chacun optait pour un ou des dieux qui lui convenaient pour des raisons diverses. Pourtant les cultes publics concernant les divinités poliades ou l’empereur étaient des actes, certes, de piété, mais ne mettant en scène souvent que des magistrats ou des citoyens choisis. Ils étaient surtout des marques de patriotisme. À ce titre, ne pas y participer lorsqu’on était requis de le faire pouvait être considéré comme un signe d’incivisme, de mauvaise volonté, voire de révolte. En grec, il n’existe aucun terme pour désigner notion de tolérance religieuse. En latin, l’intolérance : intolerentia, est cette « impatience », « insolence », « impudence » que provoque la présence face à un corps étranger. Ce peut être le cas pour les païens face à ce groupe chrétien étrange, énigmatique, considéré comme répugnant, ou l’inverse, pour des chrétiens qui voient le paganisme comme l’expression d’un univers démoniaque. Toutefois, ce qui relevait des pratiques va s’instiller jusqu’au fond des cœurs, et va s’imprégner de toute la puissance subjective des convictions intimes. En effet, il serait faux de prétendre que les païens fussent ignorants de ce qu’une religion peut présenter d’intériorité. On ne s’en faisait pas gloire, contrairement au christianisme, qui exigeait une profession de foi, c’est-à-dire un témoignage motivé, authentique et sincère de son amour pour le dieu unique. Par voie de conséquence, l’absence de conviction dûment prouvée, du moins exhibée, était rédhibitoire pour les chrétiens. On ne se contentait pas de remplir son devoir particulier, mais on voulait que chacun fût sur la droite voie de la « vérité ». Le processus de diabolisation de l’autre fut donc enclenché par les progrès de la subjectivisation du lien religieux, intensifiée par la « persécution ». Au lieu d’un univers pluriel, on en eut un, uniformisé bien que profondément dualiste. La haine fut érigée en vertu théologique.
Comment l’avait décrit Pollymnia Athanassiadi dans son étude de 2006 sur l’orthodoxie à cette période, la première tâche fut de fixer le canon, et, par voie de conséquence d’identifier ceux qui s’en écartaient, à savoir les hérétiques. Cette classification s’élabora au fil du temps, d’Eusèbe de Césarée, qui procéda à une réécriture de l’Histoire en la christianisant, jusqu’à Jean Damas, en passant par l’anonyme Eulochos, puis Épiphane de Salamine.
Néanmoins, l’originalité de l’étude de 2010 consacrée à l’évolution de la société tardo-antique vers la « pensée unique » provient de la mise en parallèle de la politique religieuse menée par l’empire à partir du IIIe siècle avec celle qui prévalut à partir de Constantin. Mme Athanassiadi souligne l’antériorité de l’empire « païen » dans l’installation d’une théocratie, d’une religion d’État. En fait, selon elle, il existe une logique historique liant Dèce, Aurélien, Constantin, Constance, Julien, puis Théodose et Justinien.
L’édit de Dèce, en 250, est motivé par une crise qui faillit anéantir l’Empire. La pax deorum semblait nécessaire pour restaurer l’État. Aussi fut-il décrété que tous les citoyens (dont le nombre fut élargi à l’ensemble des hommes libres en 212 par Caracalla), sauf les Juifs, devaient offrir un sacrifice aux dieux, afin de rétablir l’unité de foi, le consensus omnium.
Deux autres persécutions eurent lieu, dont les plus notoires furent celles en 257 de Valérien, en 303 de Dioclétien, et en 312, en Orient, de Maximin.
Entre temps, Aurélien (270 – 275) conçut une sorte de pyramide théocratique, à base polythéiste, dont le sommet était occupé par la divinité solaire.
Notons que Julien, le restaurateur du paganisme d’État, est mis sur le même plan que Constantin et que ses successeurs chrétien. En voulant créer une « Église païenne », en se mêlant de théologie, en édictant des règles de piété et de moralité, en excluant épicuriens, sceptiques et cyniques, il a consolidé la cohérence théologico-autoritaire de l’Empire. Il assumait de ce fait la charge sacrale dont l’empereur était dépositaire, singulièrement la dynastie dont il était l’héritier et le continuateur. Il avait conscience d’appartenir à une famille, fondée par Claude le Gothique (268 – 270), selon lui dépositaire d’une mission de jonction entre l’ici-bas et le divin.
Néanmoins, Constantin, en 313, lorsqu’il proclama l’Édit de Milan, ne saisit probablement pas « toute la logique exclusiviste du christianisme ». Était-il en mesure de choisir ? Selon une approximation quantitative, les chrétiens étaient loin de constituer la majorité de la population. Cependant, ils présentaient des atouts non négligeables pour un État soucieux de resserrer son emprise sur la société. D’abord, son organisation ecclésiale plaquait sa logique administrative sur celle de l’empire. Elle avait un caractère universel, centralisé. De façon pragmatique, Constantin s’en servit pour tenter de mettre fin aux dissensions internes génératrices de guerre civile, notamment en comblant de privilèges la hiérarchie ecclésiastique. Un autre instrument fut utilisé par lui, en 325, à l’occasion du concile de Nicée. En ayant le dernier mot théologique, il manifesta la subordination de la religion à la politique.
Mais ce fut Théodose qui lança l’orthodoxie « comme concept et programme politique ». Constantin avait essayé de maintenir un équilibre, certes parfois de mauvaise foi, entre l’ancienne religion et la nouvelle. Pour Théodose, désormais, tout ce qui s’oppose à la foi catholique (la vera religio), hérésie, paganisme, judaïsme, est présumé superstitio, et, de ce fait, condamné. L’appareil d’État est doublé par les évêques (« surveillants » !), la répression s’accroît. À partir de ce moment, toute critique religieuse devient crime de lèse-majesté.
Quant au code justinien, il défend toute discussion relative au dogme, mettant fin à la tradition discursive de la tradition hellénique. On élabore des dossiers de citations à l’occasion de joutes théologiques (Cyrille d’Alexandrie, Théodoret de Cyr, Léon de Rome, Sévère d’Antioche), des chaînes d’arguments (catenae) qui interdisent toute improvisation, mais qui sont sortis de leur contexte, déformés, et, en pratique, se réduisent à de la propagande qu’on assène à l’adversaire comme des coups de massue.
La culture devient une, l’élite partage des références communes avec le peuple. Non seulement celui-ci s’entiche de métaphysique abstruse, mais les hautes classes se passionnent pour les florilèges, les vies de saints et les rumeurs les plus irrationnelles. L’humilité devant le dogme est la seule attitude intellectuelle possible.
Rares sont ceux, comme Procope de Césarée, comme les tenants de l’apophatisme (Damascius, Pseudo-Denys, Évagre le Pontique, Psellus, Pléthon), ou comme les ascètes, les ermites, et les mystiques en marge, capables de résister à la pression du groupe et de l’État.
Mise en perspective
Il faudrait sans doute nuancer l’analogie, la solution de continuité, entre l’entreprise politico-religieuse d’encadrement de la société engagée par l’État païen et celle conduite par l’État chrétien. Non que, dans les grandes lignes, ils ne soient le produit de la refonte de l’« établissement » humain initiée dès le déplacement axiologique engendré par l’émergence de l’État universel, période étudiée, à la suite de Karl Jaspers, par Marcel Gauchet, dans son ouvrage, Le désenchantement du monde. Le caractère radical de l’arraisonnement de la société par l’État, sa mobilisation permanente en même temps que la mise à contribution des forces transcendantes, étaient certes contenus dans le sens pris par l’Histoire, mais il est certain que la spécificité du christianisme, issu d’une religion née dans les interstices de l’Occident et de l’Orient, vouée à une intériorisation et à une subjectivité exacerbées, dominée par un Dieu tout puissant, infini, dont la manifestation, incarnée bureaucratiquement par un organisme omniprésent, missionnaire, agressif et aguerri, avait une dimension historique, son individualisme et son pathos déséquilibré, la béance entre le très-haut et l’ici-bas, dans laquelle pouvait s’engouffrer toutes les potentialités humaines, dont les pires, était la forme adéquate pour que s’installât un appareil particulièrement soucieux de solliciter de près les corps et les âmes dans une logique totalitaire. La question de savoir si un empire plus équilibré eût été possible, par exemple sous une forme néoplatonicienne, n’est pas vaine, en regard des empires orientaux, qui trouvèrent un équilibre, un compromis entre les réquisits religieux, et l’expression politique légitime, entre la transcendance et l’immanence. Le néoplatonisme, trop intellectuel, trop ouvert à la recherche, finalement trop aristocratique, était démuni contre la fureur plébéienne du christianisme. L’intolérance due à l’exclusivisme dogmatique ne pouvait qu’engager l’Occident dans la voie des passions idéologiques, et dans une dynamique conflictuelle qui aboutirait à un monde moderne pourvu d’une puissance destructrice inédite.
Il faudra sans doute revenir sur ces questions. Toutefois, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce que nous sommes devenus. De plus en plus, on s’aperçoit que, loin d’être les fils de l’Athènes du Ve siècle avant le Christ, ou de la République romaine, voire de l’Empire augustéen, nous sommes dépendants en droite ligne de cette Antiquité tardive, qui nous inocula un poison dont nous ne cessons de mourir. L’Occident se doit de plonger dans son cœur, dans son âme, pour extirper ces habitus, ces réflexes si ancrés qu’ils semblent devenus naturels, et qui l’ont conduit à cette expansion mortifère qui mine la planète. Peut-être retrouverons-nous la véritable piété, la réconciliation avec le monde et avec nous-mêmes, quand nous aurons extirpé de notre être la folie, la « mania », d’exhiber la vérité, de jeter des anathèmes, de diaboliser ce qui nous est différent, de vouloir convertir, persuader ou contraindre, d’universaliser nos croyances, d’unifier les certitudes, de militariser la pensée, de réviser l’histoire, d’enrégimenter les opinions par des lois, d’imposer à tous une « pensée unique ».
Claude Bourrinet
• Polymnia Athanassiadi, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive, Paris, Les Belles Lettres, 2010.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2092
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, pensée unique, théologie, christianisme, christianisme primitif |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 mai 2012
Jésus au Cachemire?
Moestasjrik / “’t Pallieterke”:
Jésus au Cachemire?
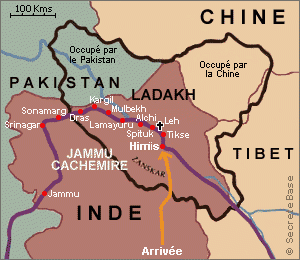 Un récit traditionnel évoque parfois la présence des tribus perdues d’Israël sur le territoire afghan actuel. D’autres parlent de leur présence au Cachemire voisin, où, dit-on, elles auraient reçu la visite d’un certain Jésus de Nazareth. Telle était, de toutes les façons, la thèse d’un aristocrate russe, Nicolaï Notovitch qui l’a consignée dans un ouvrage “Le Voyage de Jésus au Cachemire et ses prêches aux tribus perdues d’Israël”, publié en 1890 après une expédition aventureuse dans l’Himalaya. Notovitch affirmait qu’il avait trouvé un manuscrit de la main même de Jésus dans un monastère lamaïste du Ladakh, la partie ethniquement tibétaine du Cachemire.
Un récit traditionnel évoque parfois la présence des tribus perdues d’Israël sur le territoire afghan actuel. D’autres parlent de leur présence au Cachemire voisin, où, dit-on, elles auraient reçu la visite d’un certain Jésus de Nazareth. Telle était, de toutes les façons, la thèse d’un aristocrate russe, Nicolaï Notovitch qui l’a consignée dans un ouvrage “Le Voyage de Jésus au Cachemire et ses prêches aux tribus perdues d’Israël”, publié en 1890 après une expédition aventureuse dans l’Himalaya. Notovitch affirmait qu’il avait trouvé un manuscrit de la main même de Jésus dans un monastère lamaïste du Ladakh, la partie ethniquement tibétaine du Cachemire.
Selon Notovitch, Jésus aurait voyagé entre sa treizième et sa vingt-neuvième année à travers l’Iran, se serait rendu auprès des communautés juives d’Afghanistan puis aurait visité les sites sacrés de l’Inde. Il y aurait étudié les traditions les plus profondes, parfois pour les reprendre à son compte mais aussi, plus souvent, pour les rejeter car, tout comme les Pharisiens de Palestine, les sages de l’Orient l’auraient considéré comme un polémiste original et innovateur. Jésus aurait ainsi rejeté le système indien des castes, ce qui confèrerait à sa pensée une dimension égalitaire et finalement très moderne, trop moderne, dirions-nous, pour ne pas être suspecte. Ce n’est qu’après avoir littéralement fait le plein de savoir que Jésus est revenu en Palestine, où il a commencé son étonnante carrière de “Messie”. Ses mémoires sur ses années de formation en Orient, il les aurait laissées dans la bibliothèque d’un monastère, où Notovitch les aurait vues dix-huit siècles plus tard. Jusqu’à présent, Notovitch aurait donc été le seul à les avoir vus, car personne n’a plus jamais retrouvé ultérieurement ce fameux manuscrit.
Le récit de voyage de Notovitch a été immensément populaire dans les cercles qui s’adonnaient à la théosophie, sorte de doctrine mélangeant bouddhisme et christianisme, dont est issu l’actuel mouvement “New Age”. La thèse de Notovitch y est considérée comme une preuve du statut de gourou de Jésus, un gourou qui se mettait en travers de toutes les religions institutionalisées et se plaçait ipso facto dans la communauté mondiale des “Maîtres de la sagesse”. Jésus est ainsi dépouillé de son aura de “Fils de Dieu” pour devenir, plus simplement, un des guides qui nous mènent vers le sentier d’une spiritualité universelle. Ainsi, Jésus aurait dit aux prêtres du culte du feu en Iran, en des termes très anarchisants et très “New Age”: “Tant que le peuple n’avait pas de prêtres, les âmes de ses fils étaient en Dieu”. Voilà qui est clair: pas besoin d’église, il faut directement “expérimenter Dieu”.
Pourtant, le manuscrit que Notovitch aurait vu au Ladakh contient des détails qui ne vont nullement dans le sens du message théosophique d’ “une profonde unité de toutes les religions”, du moins selon les termes qu’en rapporte l’aristocrate russe. Ainsi, Jésus aurait lancé une polémique contre la doctrine de la réincarnation. C’est logique: la réincarnation implique que la mort n’est qu’une phase intermédiaire et sans importance qui “passe” sans effort, tandis que la Bible pose la mort comme un problème central, notamment comme une punition suite au péché originel, tant et si bien que la mission de Jésus consiste à surmonter la mort. Les adeptes du New Age affirment au contraire que “les premiers chrétiens croyaient eux aussi à la réincarnation”, jusqu’au jour où “l’Eglise autoritaire et patriarcale de Rome” décida de combattre cette croyance pour des motifs purement intéressés et vénaux.
Cependant, le récit de Notovitch ne se termine pas par le retour de Jésus vers sa terre natale. Après sa résurrection, il aurait désigné Pierre comme son représentant, son pape, et serait retourné en Orient. Il se serait installé au Cachemire où il serait mort de sa belle mort à l’âge de 115 ans. Depuis lors, ou du moins depuis un changement de tombeau, ses restes reposeraient au mausolée de Rauzabal à Srinagar. Cette ville est aujourd’hui le théâtre permanent d’attentats à la bombe et de tirs entre factions rivales mais toute personne qui a le goût de l’aventure peut aller s’incliner, là-bas, sur le tombeau du Christ. Le corps est soustrait aux regards et déposé dans un cercueil car, autrement, craignent les musulmans, les chrétiens pieux pourraient se mettre à le manger, s’ils interprètent au sens large le sacrement de l’eucharistie.
Que Jésus, après sa vie publique, serait revenu au Cachemire et qu’il y repose, est aussi la thèse d’un philosophe local, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian qui l’a consignée dans un petit livre, “Jésus en Hindoustan” (1899). Dans cet ouvrage, la légende a des implications politiques. Lorsqu’Ahmad a entendu parler du récit de Notovitch, il a aussitôt compris qu’il pouvait le solliciter pour se conférer personnellement la dimension d’un prophète. Le problème qui tourmentait Ahmad, c’est que, selon l’islam, Mohammed est le prophète définitif; après lui, aucun autre prophète ne viendra. Il n’y a pas de “postcriptum” possible dans le Coran! Ensuite, tous les prophètes que reconnaît l’islam ont vécu au Proche-Orient. La présence de Jésus en Inde pouvait prouver, au moins, que ce pays, à son tour, était un lieu idoine pour accueillir un prophétisme. Et cela appuyait la revendication d’Ahmad de devenir prophète à son tour.
Cela ne l’a guère aidé car ses disciples, les “ahmadijjas” ou “qadianis” sont poursuivis au Pakistan en tant qu’hérétiques. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont de pauvres brebis innocentes: souvent, ils désespèrent de ne pouvoir prouver à la masse des musulmans de la région qu’ils entendent pratiquer un islam plus pur et, pour compenser cette frustration, ils se montrent très souvent plus fanatiques que les autres à l’endroit des non-musulmans. Les musulmans ne les considèrent pourtant pas comme des coreligionnaires, malgré la légitimité qu’ils cherchent à se donner via Jésus (rappelons aussi que les musulmans rejettent le seul Prix Nobel de physique qui soit “musulman”, le Pakistanais Abdus Salma, parce qu’il est un “ahmadijja”).
Quel est le résultat de tout cela? Nous avons donc un noblion russe égaré, qui découvre un manuscrit qui devrait bouleverser le monde entier, mais ne le laisse voir à personne. Nous avons ensuite un musulman narcissique qui utilise un récit nouveau sur la vie (et la mort) de Jésus pour justifier sa propre prétention à devenir l’envoyé de Dieu. Bref: nous avons là un cas classique de folie religieuse ou, plutôt, de folie privée que l’on affuble d’oripeaux religieux. L’affaire Notovitch-Ahmad est un exercice réussi, le premier dans la liste, où des imaginations fertiles ont cherché à ébranler les convictions religieuses conventionnelles. Ce fut bien une variante antérieure de la démarche qui sous-tend le “Da Vinci Code”.
MOESTASJRIK.
(article paru dans “ ’t Pallieterke”, Anvers, 8 mars 2006; trad. franç.: avril 2012).
00:02 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, religion, christianisme, jésus, jésus-christ, cachemire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 février 2012
Miti e simboli del paganesimo e del cristianesimo
Miti e simboli del paganesimo e del cristianesimo
Il cristianesimo come negazione dell’ethos, la proiezione dell’ideale morale nella sfera ultraterrena
Fabio Calabrese
Ex: http://www.rinascita.eu/
 Nella storia dell’Europa e della cultura europea, paganesimo e cristianesimo si sono, oltre che combattuti senza pietà (soprattutto da parte cristiana, le cui persecuzioni contro i pagani furono assai più violente, spietate e prolungate nel tempo di quelle pagane contro i cristiani) variamente sovrapposti, intrecciati, mescolati.
Nella storia dell’Europa e della cultura europea, paganesimo e cristianesimo si sono, oltre che combattuti senza pietà (soprattutto da parte cristiana, le cui persecuzioni contro i pagani furono assai più violente, spietate e prolungate nel tempo di quelle pagane contro i cristiani) variamente sovrapposti, intrecciati, mescolati.
In particolare, l’affermazione del cristianesimo non fu dovuta a predicatori ingenui, appassionati e idealisti, ma a scaltri e pragmatici politicanti. Costoro non ebbero mai nessuno scrupolo a impadronirsi non solo di luoghi di culto, di divinità locali da trasformare disinvoltamente in santi e madonne, ma anche di complessi ideologici-mitologici-simbologici molto vasti, creando delle situazioni ambigue, difficili da districare se non si hanno le idee chiare e non si dispone di una base culturale robusta. Peggio ancora, possono generare l’impressione che l’abisso che separa il paganesimo dal cristianesimo sia un semplice fossato che si può scavalcare senza troppi problemi. E’ questo un motivo che, forse, non ho evidenziato a sufficienza nell’articolo Il cioccolatino e l’incarto (http://www.ereticamente.net/2011/12/il-cioccolatino-e-lincarto.html) per spiegare come mai molti tradizionalisti sedicenti evoliani siano saltati sulla sponda cattolica considerando un semplice approfondimento quella che a tutti gli effetti è una vera e propria abiura. Lo storico Antonio Brancati ha fatto un’interessante analisi di quella che è stata chiamata l’opera di inculturazione cristiana, che è altra cosa e più sottile della prevalenza del cristianesimo in epoca tardo antica a livello di istituzioni, richiese almeno un millennio e ancora oggi è difficile dire se abbia davvero trionfato completamente sulla spiritualità nativa dell’Europa.
In pratica tutto ciò che era troppo radicato nella coscienza europea per essere proibito o estirpato, venne “battezzato”, dalle divinità trasformate in santi, al samain celtico convertito nella festività di ognissanti, alla celebrazione del solstizio d’inverno trasformata nel cosiddetto natale di Gesù Cristo (che nessuno sa quando sia effettivamente nato), e via dicendo:
“Un tipico esempio di questa contaminazione è il cosiddetto “magico cristiano”, ossia un complesso insieme di veri e propri riti magici di derivazione chiaramente pagana ma debitamente “ribattezzati” mediante l’uso di preghiere ampiamente accettate dalla Chiesa e l’abuso di ampi gesti di croce: riti frequentemente praticati per ottenere la fertilità dei campi o per riacquistare in qualche modo la perduta salute del corpo” (1).
Un complesso mitico-simbolico particolarmente importante che si è prestato a questa operazione che gli storici hanno chiamato di inculturazione, ma che noi potremmo anche chiamare di appropriazione indebita, è rappresentato dal Santo Graal, uno di quei miti-simboli potenti che ci fanno capire che il processo di trasformazione, per usare la terminologia di Oswald Spengler, della Kultur europea in una Zivilization mondialista, anodina, senza volto, non si è ancora del tutto (e forse non sarà mai) completato.
Per capire il reale significato del Graal, occorre fare riferimento al contesto storico nel quale il mito è nato: la Britannia del V secolo alla vigilia dell’invasione sassone, un ambiente sostanzialmente pagano, anche se già oggetto di una prima superficiale cristianizzazione. Re Artù ha perso la regalità a causa dell’inconsapevole incesto con Morgana e deve essere riconsacrato con quella che verosimilmente era stata la coppa della sua incoronazione primitiva. Cosa c’è di più ovvio in un ambiente nel quale un radicato paganesimo nativo inizia a mescolarsi ai riti e ai simboli della religione importata, che la coppa, il calderone usato per la consacrazione dei re celtici (il termine Graal viene dal latino gradalis che indica un recipiente piuttosto ampio, come il celebre calderone di Gundsrupp, d’altra parte, sempre da qui viene l’italiano grolla) fosse confuso con il calice dell’eucaristia?
E’ tuttavia una concezione pagana del tutto incompatibile con il cristianesimo quella che emerge dalla narrazione del mito arturiano. Merlino (come la sua copia moderna, Gandalf) è evidentemente un druido e non un prete, ma soprattutto il re celtico è portatore di una legittimità e di una sacralità propria in quanto “figlio di Lugh” che il druido può riconoscere e certificare ma non creare con la consacrazione, egli è - come nell’antica religione romana - “pontifex”, chiamato a fare da ponte fra la terra e il cielo, ed è per questo che la decadenza di Artù provoca l’isterilimento della terra. Il cristianesimo non ammette altro pontefice (titolo, come ben sappiamo, usurpato dalla romanità) che il vescovo di Roma, sedicente vicario di Cristo.
L’idea della regalità sacrale è una concezione pagana totalmente opposta al cristianesimo; un punto che il filosofo (cattolico) Massimo Cacciari aveva colto molto bene in un’intervista rilasciata al giornalista Maurizio Blondet e da questi riportata nel libro Gli “adelphi” della dissoluzione (2):
“Il cristianesimo è necessariamente sovversivo di ogni potere politico che si pretende autonomo”.
Tanto più allora di una sacralità che non passi attraverso la Chiesa, unica autorizzata interprete “di Dio” su questa terra.
In quell’intervista davvero memorabile, il filosofo-sindaco di Venezia espresse concetti tali da far pensare che solo un opportunismo politico in contrasto con le sue convinzioni profonde l’abbia spinto a militare non solo nel gregge cattolico, ma nell’area politico-culturale di sinistra. Ecco quel che disse allora a Blondet riguardo ai fascismi e alla seconda guerra mondiale:
“Per sradicare il Giappone dal proprio sacro nomos, non ci volle nulla di meno che l’olocausto nucleare. Migliaia di tonnellate di bombe furono necessarie per stroncare Fascismo e Nazismo, “forme di che cercavano di ricollegare la società a un Ethos”.
Poco più sopra, aveva precisato che:
“Ethos, o per i latini Mos, non è affatto ciò che noi oggi intendiamo per “etico” o “morale”. Ethos non indicava comportamenti soggettivi; indicava la “dimora”, l’abitare in cui ogni uomo si trova alla nascita, la radice a cui ogni uomo appartiene. In questo senso, un greco non era più o meno “etico” per sua scelta o volontà. Egli apparteneva a un ethos. A una stirpe, a un linguaggio, a una polis. Che non era stato lui a scegliere (…).
Ogni società tradizionale ha, o meglio è, un ethos. Ogni società tradizionale, come un albero rovesciato, ha la sua radice nella legge divina, nel nomos. La legge della polis, dice Erodoto, è l’immagine di Dike [la dea della Giustizia]. Un ethos impone all’uomo valori che non è a scegliere, a decidere, ma a cui appartiene”.
Un rapporto profondo fra uomo e“polis”, “civitas”, che non solo il cristianesimo ha negato, e infatti Cacciari ci spiega ancora che il cristianesimo: “E’ stato dirompente rispetto a ogni ethos”, ma potremmo addirittura definire il cristianesimo puramente e semplicemente come la negazione dell’ethos, la proiezione dell’ideale morale nella sfera ultraterrena e contemporaneamente nella dimensione soggettiva. In altre parole, come aveva chiaramente intuito Jean Jacques Rousseau: “Il cristianesimo separa l’uomo dal cittadino”.
Quello che dovremmo dunque aspettarci dai fascismi sarebbe un recupero consapevole della simbologia pagana e il rifiuto di qualsiasi tendenza cristianeggiante; purtroppo però spesso le cose non sono affatto andate in questo modo.
In particolare, per quanto riguarda il mito del Graal, a dare forma alla versione cristiana (o cristiano-esoterica) di esso è stato un occultista tedesco vissuto fra le due guerre mondiali, Otto Rahn.
Il Graal sarebbe stato un oggetto connesso alle origini del cristianesimo, anche se non è ben dato di capire cosa, se il calice dell’Ultima Cena, un recipiente in cui qualcuno – pare Giuseppe d’Arimatea – avrebbe raccolto il sangue uscito dal costato di Cristo quando fu trafitto dalla lancia di Longino, o ancora secondo una terza e più fantasiosa versione, il Sang Real, nientemeno che la stirpe dei discendenti di Cristo e Maria Maddalena.
Nessuna di queste tre versioni regge a un’analisi minimamente seria. Se andiamo a rileggere il racconto evangelico vediamo che viene data importanza all’atto della consacrazione, non al contenitore che – ammesso che l’episodio sia realmente avvenuto – sarà stato una comune stoviglia finita dopo la cena nell’acquaio assieme alle altre. Sempre il racconto evangelico demolisce la seconda versione: ci racconta che il costato di Cristo sarebbe stato trafitto post mortem. Da un cadavere in cui la circolazione sanguigna si è interrotta, non possono uscire che poche gocce. Immaginiamoci Giuseppe di Arimatea – che aveva già il contenitore pronto – schizzare a tutta velocità fra le gambe dei soldati romani per raccoglierle, ma stiamo parlando del vangelo o di Asterix? Quanto alla terza versione; noi non abbiamo nessuna notizia storica sulla vita di Cristo risalente a fonti diverse dai vangeli che a loro volta non sono in alcun modo un documento storico attendibile, non possiamo escludere che Gesù Cristo, sempre che sia realmente vissuto, abbia avuto dei discendenti, ma il collegamento che è stato ipotizzato fra ciò e la stirpe reale merovingia è fantasioso e ridicolo.
Accanto a ciò Rahn nel suo libro Crociata contro il Graal (3) presenta una serie di ipotesi una più fantasiosa dell’altra secondo la quale esso sarebbe stato portato nella Francia meridionale, passato in custodia prima degli Albigesi poi dei cavalieri Templari, e la Chiesa avrebbe organizzato la crociata contro gli Albigesi e il processo all’ordine templare precisamente allo scopo di impadronirsene. Tutta la paccottiglia pseudo-esoterica che in tempi più vicini a noi Baigent, Leigh e Lincoln, i tre inglesi autori de Il santo Graal (4) hanno scopiazzato alla grande, e che poi a sua volta Dan Brown ha scopiazzato ne Il codice Da Vinci(5).
Disgrazia vuole che Otto Rahn riuscisse a infinocchiare (scusatemi, ma non riesco a trovare un’altra espressione) nientemeno che il ReichsfuhrerSS Heinrich Himmler che lo nominò ufficiale delle SS ad honorem. Addirittura nel 1944, quando era in corso l’attacco angloamericano alla Francia, Himmler arrivò a distogliere dal fronte una delle migliori divisioni di Waffen SS, la Das Reich spedirla a cercare il santo Graal nei luoghi indicati da Rahn, senza che – ovviamente –venisse trovato nulla.
I “pallini” occultistici di Himmler erano ben lungi dall’essere condivisi dagli altri dirigenti nazionalsocialisti che ne facevano spesso oggetto di ilarità; nonostante ciò, sono serviti dopo la guerra a una caterva di sedicenti storici cialtroni e senza scrupoli i cui capostipiti sono stati nei primi anni ‘60 Louis Pauwels e Jacques Bergier nel libraccio Il mattino dei maghi (6), per costruire l’immagine di un nazismo esoterico e satanista.
Sarebbe forse invece il caso di indagare l’aspetto superstizioso e stregonesco dell’antifascismo, come io ho cercato di fare nel testo Il fascismo secondo Indiana Jones, (http://www.centrostudilaruna.it/il-fascismo-secondo-indiana-jones.html), pubblicato sul sito del Centro Studi La Runa al quale vi rimando.
In tempi recenti soprattutto il successo planetario mediaticamente ben pompato del Codice Da Vinci Dan Brown e della sua versione cinematografica (una delle pellicole più brutte in assoluto della storia del cinema) ha rilanciato l’idea di un cristianesimo esoterico, idea che è una totale contraddizione, in quanto fino all’avvento dell’islam non è esistita una religione meno esoterica e più plebea del cristianesimo. Gli elementi di questo cristianesimo esoterico sono quelli indicati dal quinto al nono evangelista, ossia Rahn-Baigent-Leigh-Lincoln-Dan Brown: santo Graal, Catari (Albigesi) e cavalieri Templari.
Cosa si debba pensare della versione cristiana del mito del Graal ve l’ho appena spiegato. Quanto ai Catari o Albigesi, essi non furono tanto un movimento ereticale, quanto piuttosto una vera e propria rinascita pagana, l’ho ampiamente spiegato nell’articolo Risorgimento, rinascimento, rinascita pagana (http://www.ereticamente.net/2011/11/risorgimento-
rinascimento-rinascita.html), presente sul sito di “Ereticamente” al quale di nuovo vi rimando.
Riguardo ai cavalieri Templari, c’è un discorso che merita di essere approfondito.
Certamente, al di là delle accuse palesemente infondate che furono loro mosse, al di là del fatto che l’Ordine cavalleresco fu sciolto e i suoi membri incarcerati, torturati e mandati al rogo perché il re di Francia Filippo il Bello e papa Clemente V erano desiderosi di mettere le mani sulle ricchezze che esso aveva accumulato, su di un altro piano c’è verosimilmente una ragione più profonda per tutto ciò.
Gli Ordini cavallereschi, Templari in primis, hanno incarnato una figura di monaco-guerriero, un tipo di spiritualità che la Chiesa ha dovuto evocare in un momento critico della sua storia, ma che rimaneva profondamente estranea al cristianesimo, e di cui si è sbarazzata appena possibile.
Questa figura che non trova corrispondenze di sorta nel cristianesimo né tanto meno giustificazioni“scritturali”, le trova invece molto fuori da esso, nella tradizione indiana ed estremo-orientale. Si pensi per la tradizione indiana alla Bhagavad Gita, il testo sacro incentrato sulla figura del divino guerriero Arjuna, e per quella estremo-orientale, nipponica, al bushido, la via del guerriero, vera e propria via ascetica attuata attraverso l’arte della guerra, che era praticata dai samurai, e che poi durante l’ultimo conflitto mondiale ha animato lo spirito dei kamikaze. Forme di spiritualità, lo si vede bene, assolutamente non rapportabili al cristianesimo.
Anni fa, mi è capitato di trovarmi coinvolto in una discussione piuttosto accesa con una signora che si dichiara “evoliana” e che mi ha rimproverato piuttosto aspramente l’antipatia che non ho mai cercato di nascondere per la religione del Discorso della Montagna. A suo dire infatti, nel corso dei due millenni della sua storia, il cristianesimo si sarebbe incrostato di simbolismi di origine pagana che l’esperto di tradizioni può comunque riconoscere e fruire (?).
Sarà anche, ma perché abbassarsi a un simile compromesso? Perché ricorrere a una copia deformata e mutila quando si può risalire all’originale?
Nel corso della discussione, questa signora si vantò di non leggere altri autori tranne Julius Evola e John R. R. Tolkien (e mi sembrò un’ottima candidata a ritrovarsi in compagnia di Adolfo Morganti a scadenza più o meno breve), e in quel momento mi parve proprio di cogliere l’essenza del tradizionalismo, cioè una mentalità che si crede forte perché è chiusa. A mio parere, la forza non può nascere dalla paura di confrontarsi con altre forme di pensiero. La forza nasce dal coraggio, non dalla paura.
Tuttavia, a questo riguardo, cosa possiamo dire di John Tolkien, autore, come sappiamo, svisceratamente amato dai tradizionalisti sia cattolici sia sedicenti evoliani?
Penso che quello che ho da dire non sarà gradito ai tolkieniani, ma io credo che sia difficile trovare uno scrittore o un uomo qualsiasi in più profonda contraddizione con se stesso di quanto non lo fosse John R. R. Tolkien. Egli dichiarava avversione per il mondo celtico, eppure elementi celtici emergono in quantità dalla sua narrativa; si professava cristiano, eppure il tipo di visione del mondo e di etica che è possibile desumere dai suoi romanzi, è tutto meno che cristiano.
Del celtismo che interpretava solamente come separatismo scozzese, gallese, nord-irlandese, Tolkien aveva un’idea ristretta, e da leale suddito britannico, lo detestava, eppure tutta la sua narrazione rigurgita di elementi celtici: non sono solo le figure di elfi, nani, orchi e troll direttamente provenienti dalla mitologia celtica attraverso il folclore popolare; c’è anche la figura di Gandalf, straordinariamente simile a quella di un druido, e si pensi all’anello di Sauron, un Graal di segno capovolto, non da trovare ma da perdere o distruggere.
Noi sappiamo che qualcuno – come August Derleth – ha cercato di interpretare perfino un autore come H. P. Lovecraft in senso cristiano; era impossibile che John R. R. Tolkien sfuggisse a interpretazioni di questo genere quando egli è stato il primo a fraintendersi.
Noi sappiamo che nel mondo occidentale siamo più o meno tutti “cristiani” sulla carta, perché siamo stati battezzati molto prima che avessimo la capacità di decidere in merito o di dire la nostra opinione, e di solito tendiamo a non dare alla cosa molta importanza, Tolkien però apparteneva alla minoranza cattolica inglese, una minoranza – è risaputo – veramente esigua.
Isociologi ci insegnano che, quanto più una minoranza è ristretta, tanto più è forte il senso di appartenenza ad essa dei suoi membri; un’adesione che può essere anche emotivamente molto forte, come quando si tifa per una squadra di calcio, ma poi bisogna vedere come questo si rapporti a quella che chiameremmo la visione del mondo profonda di una persona, e in qualche caso, come appunto quello di John R. R. Tolkien, può essere che non vi si rapporti per nulla.
L’etica di Tolkien non è cristiana, è di tipo eroico, tradizionale, guerriero, indoeuropeo, che non comanda di porgere l’altra guancia ai nemici, ma di combatterli con le armi in pugno.
Se esaminiamo nel Signore degli anelli (7) la figura di Gandalf, vediamo facilmente che è modellata su quella di Merlino, e assomiglia molto di più a un druido che non a un sacerdote cristiano.
Consideriamo un attimo il rapporto fra Gandalf e Aragorn, è una relazione che implica la pari dignità dell’autorità sacrale “druidica” di Gandalf con quella regale e guerriera incarnata da Aragorn. Questa concezione va contro il cristianesimo che non ammette che le altre funzioni, diverse da quella sacerdotale, possano avere una dignità e tanto meno una sacralità autonoma, ed è invece consonante con la tradizione indoeuropea e celtica. Questo diverso segno si vede bene nella parole del Merlino di Excalibur di John Boorman (sappiamo che Merlino è l’erede della tradizione druidica e che Boorman ha reso bene quanto meno lo spirito del personaggio) che incoraggia Artù dicendogli: “Eppure hai estratto la spada dalla roccia, io non avrei potuto farlo”.
Il potere magico-druidico ha dei limiti che la regalità sacrale può oltrepassare. Artù e Aragorn sono, come il re celtici “figli di Lugh”, portatori di una regalità sacrale che Merlino e Gandalf possono riconoscere e garantire, ma non creare attraverso una consacrazione.
In altre sedi, mi è capitato di definire Tolkien un “celta suo malgrado”, un giudizio che non vedo alcun motivo di modificare. Per quanto ciò possa dispiacere ai moderni esegeti di Tolkien di impostazione cattolica, considerando i tratti druidici della figura di Gandalf e la concezione della regalità sacrale incarnata dalla figura di Aragorn, potremmo dire che l’autore del Signore degli anelli è stato anche un pagano suo malgrado.
In ogni caso, io ritengo sia pericoloso ritenere “un maestro” un uomo in così profonda contraddizione con se stesso, perlomeno bisognerebbe avere le idee ben chiare prima di accostarsi alla sua opera letteraria.
Arrivata in Italia negli anni ‘70, l’opera letteraria di John R. R. Tolkien, per motivi che sono ovvi, subì da parte della cultura di sinistra un pesante ostracismo e boicottaggio, e questo ha fatto sì che “a destra” ricevesse un’accoglienza entusiastica e acritica, al punto che, ad esempio, i raduni di giovani della“destra radicale” furono chiamati “campi hobbit” con riferimento ai personaggi del Signore degli anelli.
Tuttavia negli stessi anni negli Stati Uniti il Signore degli anelli, oggetto di letture di ben altro tipo, era diventato “la bibbia” degli hippy californiani. Perché? Perché, letta in chiave anarchica o almeno anarcoide, la lotta contro Sauron, l’Oscuro Signore, veniva vista come metafora del rifiuto e della lotta contro qualsiasi tipo di potere e di autorità.
Si trattava, come è facile comprendere, di una lettura profondamente falsata e scorretta, perché – bisogna ammetterlo – in Tolkien non c’è per nulla l’esaltazione dell’anarchismo; al potere tirannico di Sauron, infatti, si contrappone l’autorità legittima; l’autorità civile-guerriera di Aragorn e quella magico-sacerdotale di Gandalf.
Tuttavia anche questa è una storia che abbiamo già visto innumerevoli volte: alla menzogna cristiana segue come ulteriore falsificazione la menzogna marxista, c’è tutta la nostra storia degli ultimi due secoli in questo.
Il cristianesimo, spostando il sacro nella sola dimensione del soprannaturale, ha totalmente desacralizzato l’esistenza, è ancora Massimo Cacciari a dircelo:
“Il Cristianesimo non ha più radici in costumi tradizionali, in una polis specifica, in un ethos; non ha più nemmeno una lingua sacra (...). Il Cristianesimo si rivela essenzialmente sovversivo dell’Antichità e dei suoi valori; esso spezza definitivamente i legami fra gli Dei e la società. L’ethos antico era una religione civile (...). Il Cristianesimo, consumando la rottura con gli dei della Città, sradica l’uomo (…). Uno stato doloroso: il Cristianesimo getta l’uomo nella libertà come un è gettato in [un] mare in tempesta”.
Le rare volte in cui sono in vena di sincerità, questi cristiani merita proprio di stare a sentirli. Esprimendo una linea di pensiero molto simile a quella esposta da Cacciari, nel libro Ipotesi su Gesù, Vittorio Messori ammette che “Quando i pagani accusavano i cristiani di essere atei, avevano perfettamente ragione” (8).
Per noi, che ci siamo assunti il compito di “ricollegare la società a un ethos”, miti e simboli pagani ancora presenti nella nostra cultura rappresentano un deposito prezioso da trasmettere e rivitalizzare, ma proprio questo impone di stare attenti alle contaminazioni cristiane.
Note
Antonio Brancati: Popoli e civiltà, vol. 1, La Nuova Italia, Firenze 1990, pag. 49-51.
Maurizio Blondet: Gli “adelphi” della dissoluzione, Ares, Milano 2000.
Otto Rahn: Crociata contro il Graal (Kreuzzug gegen den Graal), Barbarossa, Saluzzo 1979.
Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln: Il santo Graal (The Holy Blood and the Holy Grail), Rizzoli, Milano 2005.
Dan Brown: Il codice Da Vinci (The Da Vinci Code), Mondadori, Milano 2003.
Louis Pauwels, Jacques Bergier: Il mattino dei maghi (Le matin des magiciens), Mondadori, Milano 1997.
John R. R. Tolkien: Il signore degli anelli (The lord of the Rings), Bompiani, Milano 2003.
Vittorio Messori: Ipotesi su Gesù, SEI, Torino 1976.
Fabio Calabrese
www.ereticamente.net
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mythes, mythologie, dieux, religion, paganisme, christianisme, rome, rome antique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 juillet 2011
La religions des Seigneurs
La religion des Seigneurs
par Willy Fréson
Éric Stemmelen, La religion des seigneurs – Histoire de l’essor du christianisme entre le Ier et le VIe siècle, éd. Michalon, Paris, 2010. € 22.
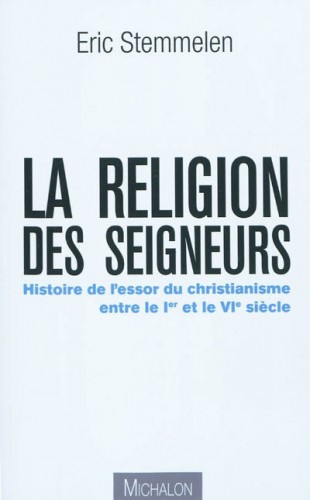 En affirmant à la fois l’unicité et l’intelligibilité du cosmos, puis en l’investiguant par la libre réflexion appuyée sur l’observation et l’expérimentation, les Grecs de l’antiquité avaient fait accomplir à la pensée un véritable saut quantique. Sur ce plan, aucune civilisation ne fut jamais comparable – la nôtre, immergée dans son ébriété marchande et technicienne, n’étant que l’héri- tière bâtarde et improbable du « miracle grec ». Cette performance unique fut au fondement de la culture dite « gréco-romaine », dont le cadre politique fut, durant des siècles, l’œuvre tenace d’un autre peuple de génie, l’Empire romain que Nietzsche considérait comme « la forme d’organisation la plus grandiose jamais atteinte jusque-là, et en comparaison de quoi tout ce qui précède, tout ce qui suit, n’est qu’ébauche, amateurisme, dilettantisme » (L’Antéchrist, § 58).
En affirmant à la fois l’unicité et l’intelligibilité du cosmos, puis en l’investiguant par la libre réflexion appuyée sur l’observation et l’expérimentation, les Grecs de l’antiquité avaient fait accomplir à la pensée un véritable saut quantique. Sur ce plan, aucune civilisation ne fut jamais comparable – la nôtre, immergée dans son ébriété marchande et technicienne, n’étant que l’héri- tière bâtarde et improbable du « miracle grec ». Cette performance unique fut au fondement de la culture dite « gréco-romaine », dont le cadre politique fut, durant des siècles, l’œuvre tenace d’un autre peuple de génie, l’Empire romain que Nietzsche considérait comme « la forme d’organisation la plus grandiose jamais atteinte jusque-là, et en comparaison de quoi tout ce qui précède, tout ce qui suit, n’est qu’ébauche, amateurisme, dilettantisme » (L’Antéchrist, § 58).
L’ouvrage d’Éric Stemmelen dont il est ici question aborde un épisode absolument crucial de notre histoire puisqu’il ne s’agit de rien de moins que de comprendre comment une secte juive dissidente a pu en arriver à conditionner toute la destinée future de l’Europe et du monde en s’emparant du pouvoir dans l’Empire romain et en détruisant de l’intérieur une civilisation millénaire. Car, proclamait déjà le philosophe au marteau, « le christianisme a été le vampire de l’imperium Romanum, il a défait du jour au lendemain ce que les Romains avaient fait de prodigieux, défricher le sol où édifier une grande civilisation qui avait le temps pour elle » (ibidem). L’auteur constate que le phénomène est traditionnellement étudié dans sa dimension idéologique et, donc, à partir des témoignages chrétiens. Il choisit, quant à lui, de privilégier une démarche différente : elle consiste à délaisser le roman fantastique tramé par ces sources « internes » pour envisager résolument le processus du dehors, en le replaçant « dans les évolutions politiques, économiques, sociales du monde romain » (p. 10).
Stemmelen commence par faire un sort au mythe de l’irrésistible ascension du christianisme, censé culminer avec la conversion de l’usurpateur Constantin (306-337). Et en effet, comme ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l’histoire, on ne s’étonnera pas que, jusqu’à nos jours, l’historiographie traditionnelle soit imprégnée d’une vision plutôt conforme aux vœux de l’Église : le surnom de « Grand » conféré à Constantin est, en ce sens, révélateur. Depuis le triomphe de cette dernière, le christianisation est en effet présentée comme un processus irrésistible, nécessaire et bénéfique, s’inscrivant dans le « sens providentiel de l’histoire » et venant parachever le cycle civilisateur du progrès humain. Le récit se résume à la geste héroïque et vertueuse d’une communauté militante vouée au bien-être et au salut de l’humanité souffrante, à l’éloge des qualités intellectuelles et éminemment morales du message véhiculé par les évangiles (τὸεὐαγγέλιον : la « bonne » nouvelle) et, last but not least, à l’évocation des sanglantes persécutions prétendument orchestrées par un pouvoir romain buté dans son pathétique attachement aux traditions « païennes ». Ainsi, en 1939, l’historien et académicien Jérôme Carcopino, parlant de la chrétienté, écrit sans rire : « Évidemment sa croissance souterraine a progressé avec une étonnante rapidité ; … La religion des Juifs avait exercé son attrait sur nombre de Romains séduits par la grandeur de son monothéisme et la beauté du Décalogue. Celle des Chrétiens qui rayonnait des mêmes lumières, mais qui, de plus, divulguait un splendide message de rédemption et de fraternité, ne tarda pas à y substituer son propre prosélytisme » (La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire, p. 163). Dans cette vision, le monde romain était déjà largement et spontanément converti dès le IIIe siècle. Le ralliement de Constantin au parti chrétien et sa conversion apparaissent dès lors comme l’achèvement d’un processus et non comme un « basculement ». C’est ce qu’écrit, par exemple, le cardinal Daniélou dans sa Nouvelle histoire de l’Église (1963) : « Au début du IVe siècle, les forces vives de l’empire étaient en grande partie chrétiennes. … En dégageant l’empire de ses liens avec le paganisme, Constantin ne sera pas un révolutionnaire. Il ne fera que reconnaître en droit une situation déjà réalisée dans les faits ».
Or, les résultats les plus récents de la recherche infirment cette sentence, et c’est sur eux que s’appuie la thèse de Stemmelen. Il faut surtout signaler les travaux de Robin Lane Fox et d’Alan Cameron aux États-Unis, de même que ceux de Pierre Chuvin et de Claude Lepelley en France. Ils apportent un sérieux bémol à cette vulgate de l’histoire chrétienne. En bonne méthode critique, ces auteurs sont retournés aux sources pour constater que la dite vulgate n’a guère d’autres fondements que les écrits, partisans et polémiques, des auteurs chrétiens eux-mêmes. En fait, de nombreux témoignages montrent que jusqu’en plein IVe siècle, les cultes traditionnels – « païens » – gardent toute leur vigueur ; à l’inverse, jusque vers le milieu du IIIe siècle, le corpus des textes non chrétiens ne comporte que très peu de témoignages de l’existence du christianisme, sans parler de l’authenticité douteuse de certains d’entre eux. Il en va de même des données épigraphiques, papyrologiques et archéologiques dont l’importance ne devient vraiment significative qu’à l’approche du IVe siècle. Si ce constat pose un rude problème méthodologique du fait que les affirmations de l’apologétique chrétienne – déjà suspectes en soi – ne peuvent guère être contrôlées par des recoupements externes, il laisse en tout cas soupçonner que la secte chrétienne a plus ou moins végété durant deux bons siècles, sinon dans le mépris, du moins dans la quasi indifférence générale, perdue qu’elle était dans le foisonnement des religions et des doctrines philosophiques d’un monde polythéiste et donc « pluraliste » par nature. Ce soupçon devient conviction lorsque l’on considère la faiblesse numérique des chrétiens avant et longtemps encore après leur prise du pouvoir : selon des estimations plausibles – car fondées sur des documents peu nombreux, certes, mais néanmoins révélateurs –, à la fin du IIe siècle, ils ne représentaient qu’à peine 2 % des habitants de l’Empire, et, au début du IVe, pas plus de 4 ou 5 %. Encore faut-il tenir compte des disparités régionales inhérentes à l’immensité de l’Empire : dans les provinces européennes, hormis Rome et quelques villes importantes, on tombe à 1 ou 2 %. Quant à l’Égypte, riche de sa documentation papyrologique et tenue pour l’un des premiers gros bastions du christianisme, elle ne devait compter tout au plus que 20 % de convertis à la même époque. On est loin de l’irrésistible et rapide conversion des masses décrite par les historiens conformes ! Et pour ce qui est des trop fameuses « persécutions », soit dit en passant, elles relèvent, pour l’essentiel, de fictions propagandistes chrétiennes : jusqu’au milieu du IIIe siècle et surtout jusqu’aux mesures bien trop tardives de Dioclétien (284-305), le pouvoir romain ne se préoccupa guère d’une secte si peu importante – de minimis non curat praetor –, et les actions antichrétiennes se résumèrent à des faits anecdotiques locaux, plutôt rares et aux effets limités.
Ce constat entraîne une conséquence capitale : le ralliement de Constantin ne peut plus être considéré comme l’aboutissement inévitable d’une christianisation avancée de l’Empire, mais bien comme un coup de force révolutionnaire qui imposa, en peu de temps, la dictature du parti de « Dieu ». Ceci apparaît d’autant plus clairement que, par ailleurs, la « question constantinienne » semble désormais tranchée. Elle s’était longtemps posée aux historiens qui s’interrogeaient sur la date de la conversion de Constantin : était-ce en 312, après sa fameuse vision et sa victoire décisive sur Maxence au pont Milvius, ou plus tard, en 326, après les meurtres de son propre fils Crispus et de sa seconde épouse Fausta, ou encore en 337, sur son lit de mort, lorsqu’il reçut enfin le baptême (une astuce d’époque, pour se faire pardonner jusqu’au dernier de ses innombrables péchés) ? On a maintenant de bonnes raisons pour fixer l’événement en 312 et pour rechercher sa cause du côté des nécessités politiques bien plus que des convictions religieuses.
La grande crise du IIIe siècle, avec ses usurpations, ses sécessions et ses guerres civiles, avait en effet gravement ébranlé l’image impériale. Pour la restaurer, les « empereurs soldats » avaient recouru à un stratagème idéologique qui consistait à se poser comme les représentants sur terre d’un dieu suprême. Aurélien s’était ainsi voué à Sol Invictus, tout comme les tétrarques Dioclétien et Maximien respectivement à Jupiter et à Hercule, ce qui leur conférait une légitimité d’essence divine, censée disqualifier les usurpateurs. Or, précisément, Constantin était un usurpateur qui, en 306, n’avait pas reculé devant un coup d’État et devant une guerre civile pour s’assurer de la succession de son père, Constance Chlore, au détriment des règles constitutionnelles de la Tétrarchie nouvellement instaurée par Dioclétien. Confrontés à des adversaires qui s’appuyaient sur les cultes encore vivaces des divinités traditionnelles de l’Empire, il s’était d’abord tourné vers les figures tutélaires d’Apollon et de Sol Invictus avant de sauter un pas décisif en adoptant, pour mobiliser ses troupes, une divinité d’un tout autre genre et en misant sur l’appui d’un mouvement religieux très minoritaire, certes, mais disposant d’atouts idéologiques indiscutables, et solidement organisé par des activistes passés maîtres dans l’art de l’agit-prop. Depuis longtemps, en effet, malgré son penchant affiché pour les misérables, l’ecclésia chrétienne avait réussi à gagner de l’influence auprès de certains éléments des couches aisées voire fortunées de la société, sans doute séduits par l’aplomb d’une doctrine qui non seulement prétendait donner réponse catégorique à toutes les interrogations existentielles, mais encore synthétisait des idées familières véhiculées autant par les gnoses et mystères orientaux que par une certaine philosophie grecque (dualisme, monothéisme, universalisme, eschatologie, sotériologie). Ce sont ces milieux qui avaient fourni le financement et les cadres éduqués indispensables à la propagande et à la crédibilité du mouvement au plus haut niveau. Ainsi, l’Africain Tertullien (entre 160 et 225) tout comme Minucius Felix, son quasi-contemporain, étaient des avocats des plus aisés, l’un à Carthage, l’autre à Rome, et nombreux étaient les évêques issus de familles très riches, tel Cyprien à Carthage (200-258).
C’est ainsi que l’on peut établir une conjonction entre les besoins de la politique et l’offre idéologique de l’époque : pour assurer son coup de force politique, Constantin fit le pari d’une nouvelle légitimité reposant sur une formule simple, démagogique et à l’efficacité prometteuse. L’analyse ne peut toutefois s’arrêter en si bon chemin car, ce faisant, l’usurpateur prenait le risque de se mettre à dos l’écrasante majorité des habitants de l’Empire. Comment, dès lors, expliquer son calcul ? Stemmelen, comme il l’a annoncé dans son prologue, procède alors à une approche « externe » des faits et vise à démontrer que le succès durable de Constantin tint au soutien décisif de la classe dominante des grands propriétaires, elle-même déjà largement gagnée par le christianisme.
Si l’on admet les aspects les moins contestables de la pensée de Marx, il faut ici rappeler que toute société se construit autour de trois contraintes qui sont l’exploitation économique, la domination politique et l’hégémonie idéologique. Selon le sociologue Robert Fossaert (La société. I : Une théorie générale, 1977), « l’instance économique tend à représenter l’ensemble des pratiques et des structures sociales relatives à la production de la vie matérielle de la société. Le concept central à partir duquel elle s’organise est celui de mode de production. L’instance politique tend à représenter l’ensemble des pratiques et des structures sociales relatives à l’organisation de la vie sociale. Le concept central à partir duquel et autour duquel elle s’organise est celui de l’État ». Quant à l’instance idéologique, elle se définit de la façon la plus large « comme l’analyse de l’ensemble des pratiques par lesquelles et des structures dans lesquelles les hommes-en-société se représentent le monde où ils vivent ». Si l’on transpose ces considérations au cas historique qui nous préoccupe, on voit que sa victoire de 312 assura à Constantin la mainmise sur l’appareil d’État romain (il liquidera Licinius, son corégent et beau-frère, en 325), laquelle conditionna la mise en place de l’hégémonie idéologique de l’Église et du parti chrétiens. Or, le caractère durable et, en fait, définitif de cette révolution induit nécessairement que des éléments dominants de la société étaient partie prenante dans l’opération car, comme le rappelle Stemmelen, « aucun régime politique ne peut gouverner contre la classe qui détient le pouvoir économique » (p. 110). Ce point constitue le noyau de la thèse développée par l’auteur, et il le résume comme suit (pp. 271-72) :
« Au IIe siècle, l’économie romaine est entrée dans un nouveau mode de production, fondé sur la propriété latifundiaire et sur le colonat, qui s’est substitué à l’esclavage traditionnel, en particulier en Orient et en Afrique. Il consiste à faire exploiter de très grands domaines agricoles par des paysans, dénommés « colons » [coloni], qui, bien que « libres » et non pas esclaves, doivent demeurer attachés à la terre qu’ils travaillent, pour le compte et au bénéfice d’un richissime propriétaire. Pour que ce système fonctionne, il est nécessaire que ces paysans se soumettent à l’autorité des grands propriétaires fonciers, qu’ils acceptent de travailler pour le compte d’autrui alors que leur statut d’hommes libres ne les y oblige pas, contrairement aux esclaves, et enfin qu’ils fondent une famille et qu’ils assurent une descendance afin que perdure l’exploitation. Or, dans un monde aux mœurs plutôt relâchées, où règne une certaine oisiveté (le travail et la soumission étant réservés aux esclaves), rien n’incite des hommes libres à se plier à de telles contraintes. La religion chrétienne va fournir aux propriétaires l’instrument idéologique adéquat car elle est la seule à promouvoir avec force les valeurs d’autorité, de travail et de famille. Sa vision très particulière de la sexualité, réduite à sa fonction reproductrice, s’oppose radicalement aux mœurs antiques. Les nouveaux seigneurs fonciers vont donc favoriser l’essor de cette secte très minoritaire et utiliser ses cadres, les évêques, d’abord pour asseoir leur tutelle sur les coloni, ensuite pour s’emparer du pouvoir politique, ceci aux dépens de l’ancienne classe dominante esclavagiste représentée par l’ordre sénatorial. La création d’un empire chrétien s’ensuivra, avec la mise en place, au IVe siècle, d’un régime dictatorial, entièrement voué à la puissance et à l’enrichissement des seigneurs, et qui procèdera à une christianisation forcée. »
Dans son principe, cette thèse est séduisante en ceci qu’elle tente d’expliquer le triomphe de l’Église chrétienne non plus par de simples considérations idéologiques (les « vertus » intrinsèques du discours chrétien) mais, plus largement et plus fondamentalement, par des arguments d’ordre politique, économique et social. À la suite des profondes mutations subies par l’Empire romain durant le IIIe siècle,elle décrit, en fait, l’émergence d’un ordre nouveau totalitaire où, au travers d’une stricte hiérarchie de « seigneurs » (domini ; plus tard, en latin ecclésiastique, seniores), se conjuguent de manière saisissante les rets de l’exploitation économique, de la domination politique et de l’hégémonie idéologique. De haut en bas, on a ainsi le Dominus céleste – créateur et principe de l’univers –, puis le dominus terrestre – l’empereur, jadis simple princeps et désormais maître du monde par la grâce divine –, et enfin, de multiples domini locaux – grands propriétaires, soutiens et bénéficiaires ultimes du système tout autant qu’incarnation de celui-ci auprès du commun des mortels.
La démonstration, pourtant, ne laisse pas de susciter quelques objections. On ne peut, en effet, que s’étonner de voir l’auteur reprendre une affirmation du juriste italien Aldo Schiavone disant que « la crise de l’esclavage romain s’accompagne, à partir des débuts du troisième siècle après J.-C., de l’effondrement de tout le système économique de l’empire » (p. 30). Ce point de vue catastrophiste, fondé surtout sur les textes et partagé naguère par nombre de spécialistes, est aujourd’hui dépassé. Les recherches récentes des archéologues dessinent au contraire une image nettement plus favorable de la situation économique de l’Empire durant ce siècle troublé ; elles présentent, en outre, un tableau très différencié suivant les périodes et les régions. Par exemple, on sait maintenant que, si l’Afrique a connu alors un véritable « boom » économique, ce ne fut pas au détriment d’autres provinces et encore moins à celui de l’Italie, prétendument en complète régression : simplement, les acteurs économiques, les réseaux d’échanges et les centres de gravité ont évolué avec le temps. En particulier, les conséquences du déclin de la main d’œuvre servile ont été exagérées. Elle a surtout touché l’Italie, où les esclaves avaient été très nombreux à la suite des conquêtes de la République ; mais le processus s’était amorcé dès le Ier siècle de notre ère et, dans le monde rural, ses effets avaient été absorbés depuis, grâce aux restructurations rendues possibles par la persistance d’une nombreuse paysannerie libre, en Italie comme dans les provinces. Ceci dit, le nombre des esclaves restait tout de même non négligeable, ce qui, d’ailleurs, ne heurtait en rien les idéologues chrétiens. Dans ces conditions, on ne peut affirmer, sans plus, que « le colonat s’est substitué à l’esclavage traditionnel » et que « les nouveaux seigneurs fonciers » se sont établis « aux dépens de l’ancienne classe dominante esclavagiste représentée par l’ordre sénatorial ». La réalité fut plus complexe, sans aucun doute, mais, vu le caractère limité de nos sources, elle se laisse difficilement appréhender.
Le problème du colonat illustre bien cet état de choses. Le colon était un paysan libre qui, contre redevance, recevait le droit de cultiver une parcelle de terre agricole. Ce genre de bail à métayage était courant sur les grands domaines (praedia) privés ou publics du monde romain. Sous l’Empire tardif, les textes législatifs révèlent une apparente dégradation de la condition des colons. Ces derniers, ainsi que leurs descendants, sont désormais impérativement liés (adscripti) à leur « lieu d’origine » (origo), c’est-à-dire à la terre qu’ils cultivent. Ceci est apparu comme une préfiguration du servage médiéval, et, longtemps, on a cru y voir une mesure destinée à remédier à la défaillance de l’économie esclavagiste. En réalité, l’obligation de rester sur sa terre d’origine est une conséquence de la grande réforme fiscale promulguée par Dioclétien en 287. À cette occasion fut introduit le système de l’impôt par répartition qui consistait à attribuer à chaque unité fiscale, du haut en bas de la hiérarchie administrative, un certain nombre de parts (capita) de la charge globale. Les grands domaines fonciers comptèrent de la sorte parmi les unités de base, et, afin de soulager les agents du fisc, leurs propriétaires, les domini, eurent chacun pour tâche de répartir et de percevoir l’impôt (capitatio) dans leur domaine propre – ce qui n’était sans doute que la systématisation d’un pragmatisme bien antérieur. Aussi est-ce pour assurer la pérennité du rendement fiscal que les colons furent légalement adscrits à la terre. Ceux-ci restaient donc libres car l’obligation à laquelle ils étaient assujettis était de droit public et non privé : autrement dit, la loi visait à garantir l’intérêt de l’État – i. e. la rentrée de l’impôt – et non celui des propriétaires fonciers qui, de leur côté, bien sûr, cherchaient à maintenir leurs baux. Cependant, si la législation visait, au départ, à protéger les colons, elle ouvrait indéniablement la portes aux pires abus en déléguant aux domini non seulement la collecte de la capitation mais aussi le contrôle de l’obligation faite aux colons de rester en place. À la longue, évidemment, au gré des défaillances de l’État, le pouvoir de ces « seigneurs » finit par rompre l’équilibre et par détourner à son profit ce fragile cadre juridique.
Dans un monde où l’agriculture représentait encore la part majeure de l’économie, les grands propriétaires fonciers étaient, sans conteste, les principaux détenteurs des moyens de production, d’autant qu’ils étaient aussi impliqués dans les échanges commerciaux. Sous l’Empire tardif, ils formèrent une classe particulièrement opulente et puissante, en Orient et, plus encore, en Occident. On ne saurait dire, toutefois, qu’elle s’est constituée, par la grâce du colonat, en opposition à l’ancien ordre sénatorial « esclavagiste ». Elle est, en fait, le résultat des évolutions politiques, sociales et économiques des trois premiers siècles de l’Empire qui ont vu l’ancienne aristocratie italienne s’ouvrir peu à peu aux élites provinciales puis aux parvenus de toute sorte, alors même que l’économie agraire se restructurait diversement suivant les régions, en privilégiant d’autres modes de production que l’esclavagisme. Nonobstant, ce correctif mis à part, il est tout à fait plausible qu’une partie au moins de la classe des « seigneurs » ait joué un rôle actif et intéressé dans la promotion d’un christianisme promouvant si opportunément les valeurs « d’au- torité, de travail et de famille » ; de nombreux signes montrent, en tout cas, que cette classe s’est largement ralliée au camp de Constantin puis de ses fils à partir de la victoire décisive du premier en 312, réalisant ainsi le « basculement » évoqué par Stemmelen.
Reste, maintenant, un point essentiel. De ce qui a été dit jusqu’ici, on peut conclure que l’ébranlement de l’Empire, au IIIe siècle, n’est pas, dans son essence, assimilable à une crise économique majeure – et encore moins à un « effondrement » –, comme le conçoit Stemmelen à la suite de toute une tradition historiographique marquée du plus typique des réductionnismes « modernes », à savoir l’économisme (« réduction à l’économie des finalités sociales et des buts du politique »). S’il en avait été ainsi, jamais l’Empire n’eût pu y survivre comme il le fit. La crise, bien réelle en tout état de cause, fut plutôt la conséquence d’un collapsus politique induit par une impasse géopolitique. Les effets de cette dernière, un temps maîtrisés, finiront par mener, au Ve siècle, à l’effondrement militaire et politique de l’Empire romain en Occident.
Depuis ses origines, en effet, le système impérial souffrait d’une contradiction majeure car, pour le faire accepter au terme de sanglantes guerres civiles qui avaient abattu le pouvoir du Sénat, Auguste, le premier empereur, avait dissimulé les réalités de la nouvelle monarchie militaire en perpétuant le décorum des institutions républicaines. On était donc toujours officiellement en République et le Sénat gardait, au moins nominalement, un certain nombre de prérogatives, dont la désignation de l’empereur, présenté comme le princeps, « le premier des sénateurs » (d’où le nom de « principat » donné au régime). Or, malgré l’opposition larvée de l’ordre sénatorial, les réalités ultimes du pouvoir se trouvaient maintenant de facto aux mains de l’armée (perpétuant l’idée du peuple romain en armes), sans qu’aucun principe constitutionnel ne vînt clairement définir les modalités de la succession impériale.
Par ailleurs, la République, régime oligarchique d’assemblée – par nature méfiant à l’égard des grands commandements affectés à de grandes entreprises –, n’avait jamais élaboré de concept stratégique autre qu’empirique et s’en tint toujours à quelques principes, dont le plus constant consista à ne dépasser sous aucun prétexte l’écosystème du bassin méditerranéen, berceau de la civilisation et base du système international dans lequel se déployait la politique romaine. Le Sénat crut possible, en effet, de se réserver « la part utile » du monde, quitte à abandonner le reste à son sort, faisant sur ce point essentiel bon marché des pesanteurs de la géopolitique et transposant à l’échelle de l’œkoumène un comportement de propriétaire terrien typique de l’aristocratie romaine. Ce fut le génie novateur de César qui, au temps de la révolution romaine, amena la rupture avec cette posture restrictive en concevant une authentique « grande stratégie » accordée à la vision d’un empire universel. Le nouveau concept tirait les conséquences de la situation très particulière et aussi très préoccupante de l’empire républicain, lequel, bordant presque tout le pourtour de la Méditerranée, se présentait comme une île inversée, avec ses côtes tournées vers l’intérieur et ses territoires déployés en arc de cercle, ouverts aux profondeurs continentales. La vulnérabilité de ces frontières interminables s’étant brutalement révélée lors de l’invasion cimbrique qui avait frappé l’Italie et les provinces depuis la péninsule balkanique jusqu’à l’Espagne (113-101), l’objectif de César fut alors d’annuler ces frontières en portant les limites de l’empire jusqu’aux rivages de l’océan. La fameuse « guerre des Gaules » (58-51) fut l’amorce de cette « grande stratégie » qui, d’emblée, s’orienta vers l’Europe, hinterland de l’Italie. La mort du « dictateur » empêcha la réalisation d’un plan qu’il prévoyait de poursuivre depuis la Caspienne jusqu’à l’Atlantique. Le projet fut cependant repris par son petit neveu, Auguste, le premier empereur, qui, après avoir plus clairement encore donné la priorité stratégique à l’Europe plutôt qu’à l’Orient, poussa jusqu’à la Baltique, la Bohême et le bassin des Carpates. L’échec final de ce projet perspicace – dû plus à des raisons de politique intérieure qu’aux difficultés rencontrées (révoltes germaniques et illyriennes) – et le repli sur le Rhin et le Danube ordonné par Tibère, son successeur, constituèrent le tournant décisif de toute l’histoire stratégique romaine, car c’est sur ce front, entre mer du Nord et mer Noire, qu’allait se décider le destin de l’Empire et, par suite, de l’Europe. Cette décision, qui devait se révéler définitive, eut une double conséquence : d’une part, elle entraîna le retour, sur un mode élargi, à l’empire méditerranéen, caractérisé par un manque de profondeur stratégique sur le théâtre européen, et, d’autre part, elle redonna, par contrecoup et comme sous la République, la priorité à l’Orient et à ses mirages. Ce choix équivalait à une faute géopolitique capitale dont, aujourd’hui encore, la portée historique semble échapper autant aux historiens qu’à Stemmelen, qui écrit benoîtement que « Julien, comme bien avant lui Trajan ou Septime Sévère, avait compris que l’Orient pourrait redonner à l’empire romain une raison d’être et une identité collective » (p. 163).
Aussi, s’il n’y eut manifestement pas progression linéaire mais basculement du monde traditionnel vers l’ordre nouveau, la raison première en fut, selon toute apparence, la conjonction fatale entre les fragilités internes du régime impérial et une configuration géopolitique au plus haut point défavorable. La crise, déjà latente depuis la fin du IIe siècle, atteint son maximum au cours du IIIe, surtout durant les cinquante années qui s’écoulent de l’assassinat d’Alexandre Sévère (235) à la proclamation de Dioclétien (284). L’Empire est alors confronté à des attaques de grande ampleur simultanément sur plusieurs fronts. À l’est, sur le plateau iranien, la dynastie parthe déclinante cède la place à celle, beaucoup plus agressive, des Sassanides, lesquels se réclament de l’héritage des Achéménides, jadis vaincus par Alexandre le Grand ; en clair, ils revendiquent tout l’Orient romain et percent les défenses de celui-ci jusqu’à la Méditerranée. Au sud, les nomades du désert africain multiplient les razzias. Enfin, les peuples germaniques et leurs alliés s’ébranlent sur un front allant de la mer du Nord à la mer Noire, et lancent une multitudes de raids sans cesse renouvelés sur les provinces européennes de l’Empire : bientôt l’Espagne, l’Italie, la Grèce et même l’Asie Mineure sont touchées. La profonde dénivellation culturelle séparant l’Europe romaine des « Barbares » avait été l’occasion pour ces derniers de se mettre à l’école de la civilisation romaine, tout comme il l’avaient fait, jadis, à celle des Celtes laténiens. L’archéologie révèle aujourd’hui l’ampleur des influences exercées par Rome sur ses voisins du Nord – à travers une diplomatie active, un commerce téléguidé, un recrutement assidu de mercenaires et un transfert étonnant de richesses et de technologies. Le résultat fut une militarisation et une organisation croissante des sociétés germaniques, dont les liens gentilices furent de plus en plus doublés par des structures politico-guerrières héritées des Celtes d’Europe centrale et perfectionnées au contact de la machinerie militaire romaine, celles des comitatus (all. Gefolgschaften) vouant, par serment, de grandes compagnies à des chefs de guerre entreprenants, capables de mener des actions prédatrices et de redistribuer ensuite le butin accumulé.
Sous cette formidable pression, le système défensif romain fut débordé et le transfert répété de troupes du front européen vers l’Orient entraîna la ruée toujours renouvelée de véritables armées germaniques vers les richesses convoitées du Sud. Pillages, destructions, massacres et déportations de prisonniers ne se comptèrent plus ; les provinces européennes furent ainsi le plus durement touchées et c’est là qu’on peut voir se profiler, à des degrés variables, le plus d’impacts économiques et sociaux. Le paroxysme fut atteint en 260, lorsque la défaite et la capture de l’empereur Valérien par les Perses entraîna la sécession de pans entiers de l’Empire, contraints de prendre acte de la défaillance du pouvoir central et d’assurer eux-mêmes leur défense. Les pronunciamientos et les usurpations, autant que les guerres internes et externes, consacrèrent le rôle démesuré des armées et achevèrent ainsi de désorganiser l’État. Celui-ci, en la personne des « empereurs-soldats », n’eut alors de cesse de se trouver une nouvelle légitimation capable de mobiliser les forces nécessaires à la reconquista et à la restauration de l’Empire. C’est dans ce contexte de chaos à peine maîtrisé que se place la totale refonte des institutions tentée par Dioclétien, encore placée sous les auspices de la religion romaine traditionnelle, et qui devait aboutir à l’éphémère système tétrarchique. C’est toujours dans ce contexte que le rebelle Constantin cherchera à imposer son pouvoir, cette fois, selon Stemmelen, en s’appuyant sur un tout nouveau parti de possédants et dans un esprit révolutionnaire implacable et sans scrupules que perpétueront ses successeurs. Jésus dit le « Christ », l’icône du nouveau régime, n’avait-il pas été explicite, en son temps, lorsqu’il déclarait sans ambages : « Quant à mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les en ma présence » (Luc, 19, 27).
Conclusion : l’Histoire officielle mérite, à maints égards, une révision radicale. Les « racines chrétiennes de l’Europe », dont on nous rabat les oreilles, constituent un mensonge absolu : depuis quand des racines se trouvent-elles si haut sur l’arbre ? La christianisation fut un accident tardif de l’histoire européenne. Celle-ci plonge ses vraies racines bien plus loin, dans un passé fabuleux dont le Parthénon, les mégalithes et la grotte Chauvet ne sont que des étapes parmi tant d’autres. C’est en cela qu’il faut saluer le bel effort de Stemmelen : « La religion des Seigneurs » est un essai et, comme tel, l’ouvrage n’est pas exempt d’objections critiques, mais il n’en demeure pas moins un livre documenté et stimulant pour la discussion, d’autant que l’importance de son sujet n’est pas à démontrer.
Willy Fréson, juin 2011.
00:05 Publié dans Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, christianisme, antiquité, antiquité romaine, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 31 décembre 2010
Radical Islam vs. Christianity

Ex: http://www.washingtontimes.com/news/2010/dec/23/radical-i...
Radical Islam vs. Christianity
The cross is near extinction in the ancient lands of its origin
By Jeffrey T. Kuhner
The Washington Times
Mugshot - An Iraqi policeman stands guard at the scene of a car bomb attack in
front of a Syrian Catholic Church, in Baghdad, Iraq, Monday Nov. 1, 2010.
Islamic militants held around 120 Iraqi Christians hostage for nearly four
hours in a church Sunday before security forces stormed the building and
freed them, ending a standoff that left dozens of people dead, U.S. and
Iraqi officials said. (AP Photo/Khalid Mohammed)
As Americans celebrate Christmas in peace in our nation, many Christians
across the Middle East are in peril: Muslim fanatics seek to exterminate
them.
Over the past several years, Christians have endured bombings, murders,
assassinations, torture, imprisonment and expulsions. These anti-Christian
pogroms culminated recently with the brutal attack on Our Lady of Salvation,
an Assyrian Catholic church in Baghdad. Al Qaeda gunmen stormed the church
during Mass, slaughtering 51 worshippers and two priests. Father Wassim
Sabih begged the jihadists to spare the lives of his parishioners. They
executed him and then launched their campaign of mass murder.
Their goal was to inflict terror - thereby causing chaos in the hopes of
undermining Iraq's fledgling democracy - and to annihilate the country's
Christian minority. After the siege, al Qaeda in Mesopotamia issued a
bulletin claiming that "all Christian centers, organizations and
institutions, leaders and followers, are legitimate targets for" jihadists.
Since the 2003 war in Iraq, Christians have faced a relentless assault from
Islamic extremists. Many of these groups, such as the Assyrians, consist of
the oldest Christian sects in the world, going back to the time of Christ.
Some even speak Aramaic, the language used by Jesus. The very roots of our
Christian heritage are being extirpated.
Religious cleansing is taking place everywhere in Iraq - by Shiites, Sunnis
and Kurds. Before the toppling of Saddam Hussein, there existed more than 1
million Christians in Iraq. They are now mostly gone - scattered to the
winds, sacrificed on the altar of erecting an Islamic state. Churches have
been closed or blown up. Hundreds of thousands have been expelled. Nearly
two-thirds of the 500,000 Christians in Baghdad have fled or been killed. In
Mosul, about 100,000 Christians used to live there. Now, just 5,000 remain.
Soon there will be none.
The rise of radical Islam threatens Christian communities not only in Iraq,
but across the Middle East. In Egypt, Coptic Christians routinely are
murdered, persecuted and prevented from worshipping - especially during
religious holy days such as Christmas and Easter. In the birthplace of
Christ, Bethlehem, Christians have largely been forced out. In Nazareth,
they are a tiny remnant. In Saudi Arabia, Muslim converts to Christianity
are executed. Churches and synagogues are prohibited. In Turkey, Islamists
have butchered priests and nuns. In Lebanon, Christians have dwindled to a
sectarian rump, menaced by surging Shiite and Sunni populations.
The Vatican estimates that from Egypt to Iran there are just 17 million
Christians left. Christianity is on the verge of extinction in the ancient
lands of its birth. In short, a creeping religious genocide is taking place.
Yet the West remains silent for fear of offending Muslim sensibilities. This
must stop - immediately. For years, Pope Benedict XVI has been demanding
that Islamic religious leaders adopt a new policy: reciprocity. If Muslims -
funded and supported by Saudi Arabia - can build mosques and madrassas in
Europe and America, then Christians - Catholics, Protestants and Orthodox -
should be entitled to build churches in the Arab world. For all of their
promises, however, Muslim leaders have failed to deliver. In fact, the
situation has only deteriorated.
Clearly, some Muslims cannot live in peaceful coexistence with non-Muslim
peoples - especially in countries where Muslims form the majority. Christian
minorities living in the overwhelmingly Muslim-dominated Middle East pose no
possible danger to Islamic hegemony. Hence, why the hatred against them?
This is a repeat of an old historical pattern: the periodic ebb and flow of
Islamic jihadism. From its inception, Islam has been engaged in a struggle
with Christian civilization. Led by the Prophet Muhammad some 600 years
after the birth of Christ, the Muslim faith spread across the Middle East
through violence and war. Christians were either forcibly converted or
slowly expelled from their ancestral lands. Following the conquest of the
Arabian Peninsula, Muslim armies invaded North Africa, Spain, France and the
Balkans. At one point, they even reached the gates of Vienna - until they
were repelled by the brave knights of Catholic Croatia. The sword of Islam
sought to conquer Christian Europe.
Bernard Lewis, the foremost historian on the Middle East, rightly argues
that the Crusades were not the result of Western imperialism; rather, they
signified a belated - and only partially successful - effort to liberate
once-Christian territories from Islamic aggression. Europe was saved;
Jerusalem and the Middle East were not.
Today's anti-Christian pogroms are not new. They are what Christians have
historically faced - persecution, death and martyrdom. In Roman times,
Christians were thrown to the lions in the Coliseum. In the Islamic world,
they are being murdered, raped, beheaded and thrown out of their homes. The
only difference is the means, not the end.
The Christians of the Middle East are dying for their convictions, as did so
many others before them. For this, they will receive their just reward in
heaven. Their deaths are a salient reminder that, contrary to liberal myth,
Islam is not a "religion of peace." Instead, it contains a militant segment
bent on waging a holy war against infidels and erecting a global caliphate.
There is, however, a true religion of peace. It began with a baby boy born
in a manger in Bethlehem. Jesus, the Prince of Peace, came to shine a light
into the dark souls of men. As Christians recall and celebrate that humble
birth, we also should stand in solidarity with those who are, 2,000 years
later, still being persecuted in His name.
Jeffrey T. Kuhner is a columnist at The Washington Times and president of
the Edmund Burke Institute.
00:15 Publié dans Actualité, Islam | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, chrétiens d'orient, proche orient, moyen orient, islam, persécutions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 20 septembre 2010
Gnose et politique chez Jacob Taubes
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986
Gnose et politique chez Jacob Taubes
 Gnose et politique. Apparamment deux do- maines sans rapports aucuns l'un avec l'autre. La Gnose, c'est la théologie, la religion de la fuite hors des vanités de ce bas monde. La Gnose, c'est le refus de l'histoire, donc l'exact opposé du politique qui, lui, est immersion totale dans l'imma- nence de la Cité, dans le grouillement des passions et des intérêts. Pour Jacob TAUBES, pourtant, il est possible d'interpré- ter historiquement le déploiement des idéaux gnostiques, de repérer les traces que le mental gnostique a laissé, par le truchement du christianisme, dans les idéologies politiques. Ce travail de recherche, il l'a entrepris lors d'un colloque de la Werner-Reimers-Stiftung, tenu à Bad Homburg en septembre 1982. Les actes de ce colloque sont désormais disponibles sous forme de livre (références infra).
Gnose et politique. Apparamment deux do- maines sans rapports aucuns l'un avec l'autre. La Gnose, c'est la théologie, la religion de la fuite hors des vanités de ce bas monde. La Gnose, c'est le refus de l'histoire, donc l'exact opposé du politique qui, lui, est immersion totale dans l'imma- nence de la Cité, dans le grouillement des passions et des intérêts. Pour Jacob TAUBES, pourtant, il est possible d'interpré- ter historiquement le déploiement des idéaux gnostiques, de repérer les traces que le mental gnostique a laissé, par le truchement du christianisme, dans les idéologies politiques. Ce travail de recherche, il l'a entrepris lors d'un colloque de la Werner-Reimers-Stiftung, tenu à Bad Homburg en septembre 1982. Les actes de ce colloque sont désormais disponibles sous forme de livre (références infra).
Le thème central, celui de la Gnose comme phénomène religieux, a déjà été abondem- ment exploré. Mais uniquement en tant que phénomène religieux de la fin de l'antiquité. Lors du colloque de Bad Homburg, la plupart des participants ont d'ailleurs abordé la Gnose sous l'angle strictement théologique, relatant ses avatars antiques. La Gnose n'est pourtant pas morte; elle s'est infiltrée dans le discours politique moderne. Odo MARQUARD définit la Gnose comme suit: "La Gnose est la positivisation de la Weltfremdheit (le fait d'être étranger au monde) et la négativisation du monde". Selon MARQUARD, la Gnose génère une conception eschatologique de l'histoire qui juge mauvais le monde tel qu'il est et valorise du même coup toute marginalité affichée par rapport à lui. Le Moyen Age jugule les débordements de l'eschatologisme, en posant un Dieu "bon", créateur d'un monde globalement positif. Ce monde, produit d'un créateur bon, ne peut en conséquence qu'être bon, conforme à sa bonté infinie. Le Moyen Age met donc un terme à la Weltfremdheit de la Gnose et revalorise la création. L'Augustinisme part du principe que cette "bonne création", ce "bon monde" a été perverti(e) par l'homme qui a abusé de sa liberté et s'est servi des richesses de cette création pour satisfaire des appétits de puissance. Le "bon monde", comme le "Bon Dieu", sont victimes de la "malifacture" de l'homme. Pour MAR- QUARD comme pour le théologien et philosophe Hans BLUMENBERG, le nomina- lisme constitue un retour de la Gnose en restituant au "Bon Dieu" une totale liberté d'action et donc une irresponsabilité vis-à-vis de ses créations qui, automatiquement, ne sont plus globalement considérées comme positives.
Cette "maléfaction" du monde provoque l'âge des révolutions populaires, des contestations sociales, des guerres de religions, parce que les hommes veulent abattre le monde tel qu'il est pour le remplacer par un monde idéal. A la suite de ces querelles, de ces guerres civiles perma- nentes, l'Europe connaîtra un deuxième dépassement du mental gnostique grâce à la "neutralisation" (Carl SCHMITT en parlera abondemment, dans le sillage de ses études sur HOBBES). L'Etat hobbesien neutralise ainsi les querelles religieuses; il valorise le monde régi par le Prince. Un siècle plus tard, LEIBNIZ parlera du meilleur Dieu, créateur du meilleur des mondes possibles. Dans cette optique, l'immanence acquiert à nouveau une valeur positive. La réalité de l'existence est acceptée telle quelle par les Lumières anglo-saxonnes. Le monde est acceptée mais, simultanément, dépourvu de tout caractère sensationnel.
A cette disparition du merveilleux et de l'enthousiasme eschatologique, succédera iné- vitablement la récidive gnostique, avec le pessimisme de ROUSSEAU et le concept marxiste d'aliénation. Pour MARQUARD, cette récidive gnostique recèle un danger très sérieux: celui de ne plus tenir compte des réalités complexes du monde immanent (jugées reflets du mal en soi) et d'engendrer une praxis du politique reposant sur le tout-ou-rien.
L'objet du colloque de Bad Homburg était d'accepter cette interprétation de l'histoire des idées politiques en Europe ou de la réfuter. Pour le professeur berlinois Richard FABER, pourfendeur génial de la notion d'Occident (Cf. Orientations no.5), le chemi- nement de MARQUARD est typiquement libéral, rattachable aux Lumières anglo-saxonnes, qui biffent des esprits les enthousiasmes et les fureurs révolutionnaires. Le Dieu "bon" des Lumières anglo-saxonnes, mais aussi de LEIBNIZ, est, pour MARQUARD, mort sous les coups de la récidive gnostique et du romantisme comme le signale un autre participant au colloque, Ioan P. CULIANU. Pour FABER, les thèses de MARQUARD expriment ipso facto un néo-conservatisme rigide, à mettre en parallèle avec la renaissance des thèses néo-libérales anti-révolutionnaires de HAYEK et de von MISES. L'alibi de MARQUARD, affirme FABER, est son "polythéisme", en tant qu'acceptation des diversités du monde. Mais ce polythéisme, ajoute encore FABER, minimise la fonction politique, qui est par définition transformatrice et quasi-prophéti- que. Les dieux du polythéisme marquardien sont "la science, la technique et l'économie" qui engendreront la neutralisation dont notre époque, héritière directe des gnoses romantique et marxiste, aurait rudement besoin.
Dans une seconde contribution au colloque de Bad Homburg, FABER s'attaque au théologien et philosophe germano-américain Eric VOEGELIN. Si MARQUARD et BLUMENBERG valorisaient essentiellement l'anti-gnosticisme des Lumières anglo-saxon- nes, VOEGELIN valorise, lui, la neutralisation médiévale de l'eschatologisme gnostique. Il y voit le véritable génie de l'Occident car, dans le libéralisme philoso- phique du XVIIIème siècle et dans le positivisme comtien, se cache l'idée d'une révolution permanente, d'une incomplétude du monde qui se "guérit" par de petites interventions chirurgicales. Le monde n'est pas accepté, dans ces philosophies sociales et politiques, comme globalement "bon". Dans les débats politiques, cela engendre une praxis marquée d'indécision voire un chaos non violent. Pour FABER, pourtant, VOEGELIN, BLUMENBERG et MARQUARD doivent être renvoyés dos à dos comme produits "occidentaux" qui refusent de percevoir le monde comme tissu conflictuel incontournable.
On le constate: le débat est sans fin, il interpelle toute l'histoire spirituelle et intel- lectuelle de l'Europe. Le politique véhicule nécessairement la gnose et nier les éléments gnostiques correspond à une négation partielle du politique.
Autre trésor que nous avons découvert dans les actes de cet époustouflant colloque, qui nous ouvre de vastes horizons: un essai d'Ekkehard HIERONIMUS sur le dualisme et la Gnose dans le mouvement völkisch allemand et plus précisément dans les cénacles qui ont adhéré au national-socialisme. Nous y reviendrons dans une prochaine contribution...
Robert STEUCKERS.
Jacob TAUBES, Gnosis und Politik, (Religionstheorie und Politische Theologie, Band II), Wilhelm Fink Verlag / Verlag Ferdinand Schöningh, München/Paderborn, 1984, 306 S., 78 DM.
00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gnose, politique, politologie, sciences politiques, philosophie, jacob taubes, tradition, eschatologie, christianisme, judaïsme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 août 2010
Perché in Giapponeil cristianesimo è "straniero"
Perché in Giappone il cristianesimo è "straniero"
di Sandro Magister - Kagefumi Ueno
Fonte: L'Espresso [scheda fonte]
Annientamento del "sé", divinizzazione della natura, rifiuto di un Dio personale. I capisaldi della cultura giapponese spiegati dall'ambasciatore del Sol Levante presso la Santa Sede
di Sandro Magister
Già un'altra volta, quest'anno, www.chiesa ha messo in luce l'estrema difficoltà che incontra il cristianesimo a penetrare in Giappone.
È una difficoltà che riguarda anche altre grandi civiltà e religioni asiatiche. Il cardinale Camillo Ruini – quand'era vicario del papa e presidente della conferenza episcopale italiana – indicò più volte la principale ragione di questa impermeabilità nel fatto che in Giappone, in Cina, in India manca la fede in un Dio personale.
È per questo motivo – aggiungeva – che la sfida lanciata ai cristiani dalle civiltà asiatiche è più pericolosa di quella di un'altra religione monoteista come l'islam. Mentre l'islam, infatti, stimola se non altro i cristiani ad approfondire e rinvigorire la propria identità religiosa, le civiltà asiatiche "spingeranno piuttosto nel senso di una ulteriore secolarizzazione, intesa come denominatore comune di una civiltà planetaria".
Per quanto riguarda il Giappone, un'autorevole conferma di questo assunto viene da una conferenza tenuta il 1 luglio scorso al Circolo di Roma dall'ambasciatore giapponese presso la Santa Sede, Kagefumi Ueno.
La conferenza – riprodotta quasi integralmente più sotto per gentile concessione del suo autore – mette in evidenza con rara chiarezza l'abisso che separa la visione cristiana dalla cultura e religiosità del Giappone.
L'ambasciatore Ueno si definisce d'orientamento buddista-scintoista. E nella conferenza parla non da diplomatico ma da "pensatore culturale", come in effetti egli è. Il suo centro d'interesse sono da molti anni le civiltà e le culture. Su questo tema ha scritto numerosi saggi e parlato a vari congressi.
Un suo saggio pubblicato poco prima di arrivare a Roma come ambasciatore, quattro anni fa, ha per titolo: "Contemporary Japanese Civilization: A Story of Encounter Between Japanese 'Kamigani' (Gods) and Western Divinity".
Una sintesi della sua conferenza al Circolo di Roma è uscita su "L'Osservatore Romano" del 14 agosto.
_________
CULTURA E RELIGIOSITÀ NEL GIAPPONE MODERNO
di Kagefumi Ueno
Credo che vi siano almeno tre elementi che caratterizzano la religiosità giapponese come filosoficamente distinta dal cristianesimo.
Le tre parole chiave sono "sé", "natura" e "assolutizzazione".
In primo luogo, sul concetto di "sé" c'è una nettissima distinzione tra la visione buddista-scintoista e quella monoteista occidentale.
Secondo, nel concepire la natura l'oriente e l'occidente differiscono sostanzialmente. Mentre i giapponesi vedono la natura come divina, i cristiani non condividono la stessa riverenza.
Terzo, quanto ai giudizi di valore, a motivo della loro mentalità religiosa i giapponesi in genere hanno una propensione molto minore degli occidentali ad assolutizzarli.
DISSOLVERE IL "SÉ"
Primo elemento: il "sé". Come differisce il concetto religioso tradizionale giapponese di "sé" dalla visione occidentale? Per dirlo con parole semplici, i buddisti-scintoisti credono che, al fine di raggiungere la vera libertà spirituale, essi devono "cacciar via" ogni "karma" (desiderio), "ego", "interesse", "speranza" e anche "sé". Qui il termine "cacciar via" è sinonimo di abbandonare, rinunciare, dissolvere, svuotare, azzerare, ridurre a niente. In altre parole, lo stato finale della mente, la genuina libertà del pensiero, o la realtà ultima possono essere ottenuti solo dopo aver cacciato via il proprio sé o dissolta la propria identità. Il sé e l'identità devono essere assorbiti nella Madre Natura o universo.
Invece, le religioni monoteiste sembrano essere basate sull'assunto che gli esseri umani sono "miniature" del divino. Gli umani sono definiti per riflettere l'immagine del divino. Essi quindi, per definizione, sono chiamati a essere "divini", o almeno "mini-divini". Per avvicinarsi al divino sono comunque destinati a purificare, consolidare, elevare o portare a perfezione il proprio sé. Mai deve accadere, dunque, che caccino via il loro sé. Il cacciar via il proprio sé è semmai considerato immorale o peccaminoso.
In breve, i monoteisti sono chiamati a massimizzare, a portare a perfezione il proprio sé. Quindi, sono "massimalisti". Con questa idea in mente, non ci vuole una speciale immaginazione per capire che un "sé mini-divino" massimizzato o portato a perfezione è inviolabile o sacro.
All'opposto, i buddisti-scintoisti sono chiamati, al fine di raggiungere la realtà suprema, a minimizzare, cioè a cacciar via il loro sé. Quindi essi sono "minimalisti". Anche la dignità o l'onore di ciascuno è qualcosa a cui non devono legarsi. Mai guardano a se stessi come a delle "mini-divinità". Non accade mai che essi debbano perfezionare se stessi per arrivare più vicini al divino. Un simile desiderio è un tipo di "karma" che essi devono cacciar via.
Insisto, i buddisti-scintoisti credono che da ultimo non ci si deve legare ad alcun desiderio od ossessione, inclusa l'esaltazione di sé. Ognuno dev'essere completamente distaccato dal desiderio di esaltare se stesso.
Fin qui ho fatto una specie di esercizio intellettuale, con l'assunto che le differenti religiosità comportino differenti concetti di "sé". A questo proposito, l'immagine che mi sono fatta è che il "sé" degli occidentali è simile a una grossa, solida, splendente sfera d'oro che deve essere costantemente lucidata, pulita e consolidata, mentre il "sé" dei buddisti è simile ad aria o fluido senza forma, elastico, difficile se non impossibile da lucidare e pulire.
Secondo la religiosità giapponese, ciò a cui si deve rinunciare non è limitato al "karma", ai desideri e al "sé". Bisogna essere distaccati anche da ogni pensare logico. In definitiva, per i giapponesi, la religiosità è un ambito nel quale il "logos" in quanto "ragione", il pensiero logico e l'approccio deduttivo devono anch'essi essere cacciati via.
In particolare, per la tradizione buddista Zen, anche valori opposti come il bene e il male sono qualcosa che va trasceso. Nel senso più profondo della religiosità buddista, nello stadio ultimo dello spirito non vi è nessuna santità, nessuna verità, nessuna giustizia, nessun male, nessuna bellezza. Anche la speranza è qualcosa a cui non ci si deve legare, a cui bisogna rinunciare. La libertà ultima è data dall'assoluta passività.
I giapponesi credono anche che devono essere distaccati dal desiderio di tendere all'eternità. Nell'universo non c'è niente di eterno o di assoluto. Ogni essere resta "effimero", cioè come un niente. Ogni essere rimane "relativo". La realtà ultima è nel "vuoto", nel "nulla", nell'"ambiguo".
Per vedere come la filosofia orientale ci dice che si deve essere distaccati dal "logos", ecco alcune citazioni riprese da buddisti Zen e in particolare da opere di Daisetsu Suzuki:
– "Molti è uno. L'uno è molti".
– "Essere è non essere".
– "L'essere è 'mu', nulla. 'Mu' è l'essere".
– "La realtà è 'mu'. 'Mu' è la realtà".
– "Ogni cosa è nel 'mu', sorge dal 'mu', è assorbita nel 'mu'".
– "Una volta distaccati dalla visione razionale, si trascendono opposti concetti come bene e male".
– "Nel senso più profondo della religiosità buddista, non vi è nessuna santità, nessuna verità, nessuna giustizia, nessun male, nessuna bellezza".
– "La libertà ultima è data dalla passività assoluta".
– "Alla fine, lo spirito sarà come un albero o una pietra".
VENERARE LA MADRE NATURA
Secondo elemento di differenziazione: la natura. Per gli occidentali, la divinità è nel Creatore invece che nella natura, la quale è prodotta da lui. Invece, per i buddisti-scintoisti la divinità è nella stessa natura, dal momento che manca del tutto l'idea di un Creatore che abbia creato l'universo dal nulla. La natura è stata generata da sé stessa, non da una forza extranaturale. Il divino permea la natura. E permea quindi anche gli esseri umani.
La divinità della Madre Natura abbraccia ogni cosa: uomini, alberi, erbe, rocce, sorgenti e così via. Per i buddisti-scintoisti la realtà suprema non esiste al di fuori della natura. In altre parole, la divinità è intrinseca alla natura. [...]
Per i giapponesi, gli uomini e la natura sono una sola realtà inseparabile. Gli esseri umani sono parte della natura. Non c'è alcuna distinzione o barriera concettuale tra le due cose. Una sensazione di distanza tra le due è considerata insignificante o inesistente.
A questo proposito vorrei commentare una formula alla moda, la "simbiosi (o convivenza) con la natura", che è spesso considerata una formula pro-ecologista. A me questo concetto pare invece che includa una sfumatura di arroganza, di "umanocentrismo", poiché conferisce agli uomini una posizione paritaria con la natura. Secondo la religiosità tradizionale giapponese, gli uomini devono essere sudditi della natura. È la natura, non gli uomini, che deve essere protagonista. Gli uomini dovrebbero essere umili giocatori che non possono pretendere una condizione pari a quella della natura. Devono scrupolosamente ascoltare le voci della natura e umilmente accettare ciò che la natura comanda. Ecco perché la formula "convivenza con la natura" suona troppo umanocentrica per il pensiero tradizionale giapponese.
Su questo sfondo, in termini di amore o rispetto per la natura o gli animali, la cultura giapponese è profonda e ricca. Nella sua tradizione così come oggi, i giapponesi trattano la natura o gli animali in una maniera piena di rispetto. Quasi con uno spirito religioso.
Ad esempio, molti dirigenti di polizia in tutto il paese usano officiare una cerimonia per rendere grazie agli spiriti di cani poliziotto deceduti, o per placare le loro anime una o due volte all'anno nei santuari a loro dedicati.
Qualcosa di simile avviene nei tradizionali villaggi dei cacciatori di balene. Essi usavano officiare cerimonie religiose per rendere grazie agli animali o per consolare e placare gli spiriti delle vittime, le balene. Alcuni ancora lo fanno. E facendo così, fanno da bilancia spirituale tra gli uomini e gli animali loro vittime.
Allo stesso modo, in alcuni ospedali vi sono associazioni che celebrano annualmente dei rituali, chiamati "hari-kuyoo", per addolcire gli spiriti degli "aghi", specie quelli delle iniezioni.
Nelle campagne, la gente venera alberi maestosi, grandi rocce, cascate o sorgenti trasformandole in templi scintoisti con dei festoni bianchi detti "shimenawa". Inoltre, molte montagne, a cominciare dal Fuji, e numerosi laghi in Giappone sono ritenuti sacri.
La religiosità o mentalità dei giapponesi ora descritta – che alcuni studiosi chiamano panteista o animista – è chiaramente e vitalmente incorporata in molte opere culturali giapponesi, siano esse di letteratura, di poesia, di pittura, di incisioni o d'altro, indipendentemente dalla terminologia che si può usare.
Ad esempio, Higashiyama Kaii, un grande pittore di paesaggi, disse una volta in un'intervista televisiva che, con l'avanzare della maturità, era divenuto consapevole che la natura talvolta gli parla. Egli percepisce la sua voce e avverte i suoi sentimenti. E quindi, aggiunse, la sua opera di pittore di paesaggi è fatta non da lui, ma dalla natura stessa.
Sinilmente, Munakata Shiko, famoso incisore di legno, disse in tv che, quando la sua anima è in pace, egli compie la sua opera di incisione come ispirata dallo spirito del legno che sta incidendo. Quindi, aggiunse, non è lui ma lo spirito del legno che fa il vero lavoro. [...]
NON ASSOLUTIZZARE I VALORI
Terzo elemento di differenza: l'assolutizzazione dei valori. A motivo della descritta mentalità religiosa buddista-scintoista, i giapponesi non amano legarsi a "valori assolutizzati". Non credono che vi sia una giustizia assoluta o un male assoluto. Dicono piuttosto che ogni essere è, in sostanza, "relativo". Per loro ogni valore, intendo dire ogni valore positivo, è valido fino a quando si scontra con altri valori. Quando lo scontro tra valori avviene, essi credono che nessun valore particolare deve essere assolutizzato a spese di altri. Semplicemente perché, nel senso più profondo della loro filosofia, non c'è niente di assoluto nell'universo. Esiste solo l'effimero, l'impermanente.
Detto altrimenti, nell'applicare i valori, i giapponesi in genere preferiscono avere un approccio "soft". Ad esempio, alcuni anni fa, prima in Danimarca e poi in altri paesi d'Europa, ci fu uno scontro di ideologie [a proposito di vignette su Maometto] tra coloro che tenevano alla libertà di espressione e coloro che difendevano la dignità religiosa. Questa vicenda non ebbe in Giappone una grande risonanza pubblica, ma immagino che la maggioranza dei giapponesi, se informati degli elementi in gioco, avrebbero detto che assolutizzare la fede di una parte (quella favorevole alla libertà di espressione) a spese dei valori degli altri – cioè affrontare la questione in modo rigido invece che "soft" – era immotivato o imprudente. A questo proposito, durante quella vicenda io stesso ebbi la sensazione che la mentalità di alcuni disegnatori ed editori danesi sembrava essere troppo "monoteista", nel senso che assolutizzavano un particolare valore come qualcosa di trascendentale, di sacro e di inviolabile. In quel caso particolare, faccio notare che la Chiesa cattolica preferì un approccio "soft". Simile a quello preferito dai giapponesi.
Come ho detto, i giapponesi trattano la natura o gli animali in un modo pieno di rispetto. Nonostante ciò, la maggioranza dei giapponesi non si spinge fino ad applicare il concetto dei diritti umani agli animali, come fanno alcuni paladini di tali diritti. Di tanto in tanto esce la notizia che alcuni animalisti fondamentalisti hanno assaltato laboratori nei quali alcuni animali sono sacrificati per finalità tipo la ricerca di nuove medicine. Inoltre, si ricorda la notizia di un gruppo ambientalista radicale che assaltò una baleniera giapponese nell'Oceano Antartico. Essi non solo assalirono la nave a più riprese, ma anche lanciarono bottiglie di sostanze chimiche che ferirono alcuni membri dell'equipaggio della nave.
In questi casi, i protagonisti giustificarono la loro violenza o violazione dei valori altrui sostenendo che la loro finalità era sacra e quindi assoluta. Giustificarono i loro atti dicendo che essi dovevano combattere contro un male assoluto. In questo modo "assolutizzarono" la loro fede e fecero blocco con i loro sacri valori, senza pensare di violare i valori di altri. Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2010, papa Benedetto XVI ha espresso preoccupazione per la visione eccessiva di alcuni ecologisti o animalisti che conferiscono lo stesso livello di dignità agli animali e agli uomini. Questo è un altro esempio di come la Chiesa cattolica pare essere riluttante riguardo a un approccio rigido o a una "assolutizzazione" di un valore particolare. Lo stesso fanno i giapponesi, con la loro tradizionale mentalità religiosa.
UN CRISTIANESIMO "STRANIERO"
A questo punto si può capire perché, a motivo della mentalità religiosa giapponese che si differenzia dal cristianesimo nei sensi sopra detti, anche oggi molti giapponesi trovano il cristianesimo in qualche modo straniero (od occidentale).
E anche si può capire perché la quota dei cristiani in Giappone resta sempre al di sotto dell'1 per cento e quella dei cattolici al di sotto dello 0,5 per cento.
Ciò non significa che i giapponesi rifiutino di accettare il cristianesimo in tutto. Molti di essi provano simpatia per questa fede e i suoi insegnamenti, non però al 100 per cento, ma al 70-80 per cento. Il restante 20-30 per cento è riconducibile alla differenza di fondo, fondamentalmente culturale e filosofica, tra le due realtà.
A motivo di questa differenza, il cristianesimo appare ai giapponesi come "appartenente ad altri", non a loro stessi.
UN IBRIDO TRA MODERNITÀ E TRADIZIONE
Osservo ora la religiosità giapponese attraverso lo spettro della premodernità, della modernità e della postmodernità.
Nel passato, sino alla fine del XIX secolo, si riteneva in ogni angolo del mondo che la modernizzazione delle nazioni potesse essere ottenuta solo in società con religiosità monoteista, in particolare col cristianesimo. Si pensava che la modernizzazione e il monoteismo fossero legati assieme, direttamente o indirettamente. Si era convinti che le società con religiosità politeiste, animiste o panteiste, come il buddismo o lo scintoismo, non fossero modernizzabili, a differenza dei paesi occidentali.
L'impressionante modernizzazione del Giappone ha smentito questa credenza. Oggi molte nazioni non cristiane hanno raggiunto livelli evidenti di modernità, sull'esempio del precedente giapponese. Di conseguenza, il loro progresso ha ulteriormente sciolto il legame concettuale tra modernizzazione e monoteismo. È stato reso chiaro che l'approccio politeista, animista o panteista non rappresenta un regresso, se messo a confronto con l'approccio monoteista.
In Giappone in particolare, la modernità scientifica, tecnologica e razionale non solo coesiste con una mentalità panteista e animista premoderna, ma è rinvigorita e rafforzata da tale mentalità.
Insisto. Molti prodotti giapponesi di alta tecnologia sono pensati, progettati, prodotti e messi sul mercato ad opera di giapponesi che hanno in larga misura la mentalità e la religiosità che ho descritto. Sottolineo che il livello tecnologico o la qualità del prodotto sono migliorati dalla combinazione di due distinte mentalità: la scientifica e l'animista.
Ad esempio, molte società giapponesi spesso invitano preti scintoisti a officiare cerimonie rituali quando installano nuovi macchinari nelle loro fabbriche, per invocare l'efficienza del loro funzionamento. Allo stesso modo, essi officiano anche dei rituali per placare o ringraziare lo spirito dei vecchi macchinari prima di smantellarli. E ancora, i costruttori di case celebrano rituali scintoisti per pregare per la riuscita dei futuri lavori, con una cerimonia sul terreno di costruzione. Quasi tutte queste cerimonie sono celebrate da preti scintoisti, solo raramente da preti buddisti. Perché? Perché la maggior parte dei giapponesi preferiscono che siano dei preti scintoisti a occuparsene, convinti che gli spiriti della casa o del luogo, della terra o degli edifici debbano essere presi in cura dallo scintoismo.
Insomma, nel Giappone di oggi la mentalità panteista e animista premoderna è strettamente legata alla modernità dell'alta tecnologia. E dunque si può dire che la civiltà giapponese contemporanea è un ibrido di premodernità e di modernità. Quindi assolutamente postmoderna!
ECONOMIA BUDDISTA, PER UN TERRENO COMUNE
Ho fin qui messo a fuoco la dimensione filosofica, nella quale la distinzione tra l'oriente e l'occidente è ragguardevole. Io credo, tuttavia, che al livello pratico c'è un terreno comune tra le due parti.
Un'ottantina di anni fa il Mahatma Gandhi, il padre fondatore dell'India moderna, citò il "commercio senza moralità" come uno dei "sette peccati sociali". Gli altri sei peccati che egli elencò erano la "politica senza principi", la "ricchezza senza lavoro", il "divertimento senza coscienza", la "conoscenza senza carattere", la "scienza senza moralità" e il "culto senza sacrificio" (sembra di ascoltare un papa).
Anche il papa e la Santa Sede in numerosi messaggi hanno ripetutamente condannato la mancanza di considerazioni morali da parte di molti leader del mondo degli affari.
In Giappone simili richiami si odono da tempo, in particolare tra economisti di orientamento buddista. In effetti, negli ultimi decenni alcuni economisti hanno cominciato ad amalgamare la filosofia buddista con le analisi economiche, fondando una nuova disciplina chiamata "economia buddista", di cui ora dirò gli elementi di base.
Gli economisti buddisti sono molto critici del neoliberismo che ha dominato le politiche economiche delle maggiori potenze mondiali negli ultimi decenni, portando a un aggravamento delle disparità economiche, a una mancanza di equità, a un predominio assoluto del profitto e a un deterioramento dell'ambiente a livello globale.
Per quanto vi siano delle diverse visioni tra gli economisti buddisti, essi condividono i seguenti otto principi, come loro minimo comune denominatore:
– rispetto della vita;
– non violenza;
– chisoku (la capacità di sapersi accontentare);
– kyousei (la capacità di convivere assieme);
– semplicità, frugalità;
– altruismo;
– sostenibilità;
– rispetto delle diversità.
Ad esempio, Ernest Friedrich Schumacher, un economista tedesco che è tra i fondatori dell'economia buddista, autore del celebre libro "Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered", ha particolarmente insistito su "chisoku" e "semplicità".
Allo stesso modo, Wangari Maathai, un'ambientalista kenyana che ha vinto il Nobel per la Pace nel 2004, crede in una filosofia affine all'economia buddista. È famosa come sostenitrice della campagna "mottainai", cioè della campagna internazionale dei tre "ri": riusa, riduci e ricicla. Alcuni anni fa, mentre era in Giappone, si imbatté nella parola giapponese "mottainai" che in sostanza significa "mai gettare le cose minime perché anch'esse hanno un valore intrinseco". Così ebbe l'ispirazione di lanciare la sua campagna, cioè si convinse che lo "Spirito di Mottainai" che anima lo spirito dei tre "ri" doveva essere diffuso globalmente. Ella sostiene che per assicurare la protezione e la conservazione dell'ambiente globale, lo "Spirito di Mottainai" è indispensabile. Questo spirito che ella invoca è in evidente sintonia con i principi base dell'economia buddista.
Gli economisti buddisti reclamano politiche che portino tra l'altro a:
– distacco da un approccio che privilegi solo la crescita;
– distacco da una produzione dipendente dal petrolio;
– instaurazione di un nuovo sistema internazionale che elimini la violenza.
Nell'attuale instabilità e incertezza dell'economia mondiale, che ha rafforzato lo scetticismo nei principi del libero mercato, l'economia buddista guadagna un'attenzione crescente. Sarebbe interessante avviare un dialogo in questo campo tra economisti di orientamento sia buddista sia cattolico.
*
Per concludere con una battuta, consentitemi di chiamare il buddismo-scintoismo "sushi spirituale" e il cristianesimo "spaghetti spirituali". Quello che ho cercato di dire è che il "sushi spirituale" e gli "spaghetti spirituali" hanno sapori diversi. Ma ho anche aggiunto che entrambi sono "squisiti". Sia l'uno che gli altri arricchiscono profondamente le vite degli uomini. Senza uno di essi, le culture umane sarebbero terribilmente noiose e aride.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, asie, affaires asiatiques, extrême orient, religion, christianisme, shintoïsme, tradition, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 avril 2010
The Germanization of Early Medieval Christianity
 EUROPEAN SYNERGIES – MANAGERS’ SCHOOL / BRUSSELS/LIEGE –
EUROPEAN SYNERGIES – MANAGERS’ SCHOOL / BRUSSELS/LIEGE –
OCTOBER 2004 – BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION
The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to Religious Transformation
by James C. Russell
Price: US$25.00
Product Details
* Paperback: 272 pages ; Dimensions (in inches): 0.72 x 9.16 x 6.08
* Publisher: Oxford University Press; Reprint edition (June 1, 1996)
* ISBN: 0195104668
Editorial Reviews
Synopsis
While historians of Christianity have generally acknowledged some degree of Germanic influence in the development of early medieval Christianity, this work argues for a fundamental Germanic reinterpretation of Christianity. This treatment of the subject follows an interdisciplinary approach, applying to the early medieval period a sociohistorical method similar to that which has already proven fruitful in explicating the history of Early Christianity and Late Antiquity. The encounter of the Germanic peoples with Christianity is studied from within the larger context of the encounter of a predominantly "world-accepting" Indo-European folk-religiosity with predominantly "world-rejecting" religious movements. While the first part of the book develops a general model of religious transformation for such encounters, the second part applies this model to the Germano-Christian scenario. Russell shows how a Christian missionary policy of temporary accommodation inadvertently contributed to a reciprocal Germanization of Christianity.
Ingram
While historians of Christianity have generally acknowledged some degree of Germanic influence in the development of early medieval Christianity, Russell goes further, arguing for a fundamental Germanic reinterpretation of Christianity. He utilizes recent developments in sociobiology, anthropology, and psychology to help explain this pivotal transformation of the West. This book will interest all who wish to further their understanding of Christianity and Western civilization.
Reviewer: Elliot Bougis "coxson" (Taichung, Taiwan)
I stumbled upon this book while researching for a study of the conjoined paganization/Christianization of Medieval literature. What a find! As the reviewer above mentioned, Russell's strength lies in the amazing range of his scholarship. This intellectual breadth, however, does not detract from Russell's more focused, balanced, and lucid examination of key points (e.g., anomie as a factor in social religious conversion, fundamental worldview clashes between Christianity and Germanic converts, etc.). Russell covers a lot of ground in a mere 200+ pages. Moreover, his final assertions are modest enough to be credible, and yet daring enough to remain highly interesting. Plus, from a research perspective, the bibliography alone is worth a handful of other books. This book has been normative in my decisions about the contours of any future scholarship I pursue. Alas, I was left hungering for a continuation of many of the themes, to which Russell often just alludes (e.g, the imbibed Germanic ethos as the animus for the "Christian" Crusades, the contemporary implications of urban anomie for our globalizing world, etc.). Of course, such stellar scholarship cannot be rushed. Surely Russell's next inquiry is worth the wait!
Brilliant and innovative study of Germanic religiosity, September 2, 1999
Reviewer: A reader
Scholar James Russell has given us an important work with this detailed study. Subtitled "A sociohistorical approach to religious transformation," it is an exceedingly well-researched and documented analysis of the conversion of the Germanic tribes to the imported and fundamentally alien religion of Christianity during the period of 376-754 of the Common Era. Russell's work is all the more dynamic as he does not limit his inquiry simply to one field of study, but rather utilizes insights from sources as varied as modern sociobiological understanding of kinship behaviors, theological models on the nature of religious conversion, and comparative Indo-European religious research. Dexterously culling relevant evidence from such disparate disciplines, he then interprets a vast array of documentary material from the period of European history in question. The end result is a convincing book that offers a wealth of food for thought-not just in regards to historical conceptions of the past, but with far-reaching implications which relate directly to the tide of spiritual malaise currently at a high water mark in the collective European psyche. The first half of Russell's work provides an in-depth examination of various aspects of conversion, Christianization and Germanization, allowing him to arrive at a functional definition of religious transformation which he then applies to the more straightforward historical research material in the latter sections of the book. Along the way he presents a lucid exploration of ancient Germanic religiosity and social structure, placed appropriately in the wider context of a much older Indo-European religious tradition. Russell completes the study by tracing the parallel events of Germanization and Christianization in the central European tribal territories. He marshals a convincing array of historical, linguistic and other evidence to demonstrate his major thesis, asserting that during the process of the large European conversions Christianity was significantly "Germanicized" as a consequence of its adoption by the tribal peoples, while at the same time the latter were often "Christianized" only in a quite perfunctory and tenuous sense. Contrary to simplistic models put forth by some past historians, this book illustrates that conversion was not any sort of linear "one-way street"; a testament to the fundamental power of indigenous Indo-European and Germanic religiosity lies in the evidence that it was never fully or substantially eradicated by the faith which succeeded it. As Russell shows, a more accurate scenario was that of native spirituality and folk-tradition sublimated into a Christian framework, which in this altered form then became the predominant spiritual system for Europe. Russell's Germanization of Early Medieval Christianity is wide-ranging yet commanding in its contentions, and academia could do well with encouraging more scholars of this calibre and fortitude who are able to avoid the pitfall of over-specialization and produce works of great scope and lasting relevance. Make no doubt about it, this is a demanding and complex book, but for those willing to invest the effort, the benefits of understanding its content will be amply rewarding, and of imperative relevance for anyone who wishes to apprehend the past, present and future of genuine European religiosity.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, christianisation, allemagne, germanie, europe centrale, missions, histoire, moyen âge, période médiévale, époque médiévale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 03 février 2010
Revue "Hyperborée": Qu'est-ce que l'ésotérisme?

SOMMAIRE DU N°9
Qu’est-ce que l’ésotérisme ?
DOSSIER L’ÉSOTÉRISME CHRÉTIEN
Ganagobie : des mosaïques pas très catholiques
Thulé sous le masque chrétien
L’image du Golgotha et les mythes nordiques
Le secret polaire de l’Ordre du Temple
Les saints du calendrier et le symbole zodiacal
La religion orthodoxe, gardienne de la Tradition
LU, VU, ENTENDU
Charbonneau-Lassay et le Bestiaire du Christ
La chanson populaire
Page solaire
Le feu de Naciketas
Les alignements du Ménec
Vincenot, de Pierre Vial
Célestin et Amycus
ORIGINES
La Nwyvre, l’énergie procréatrice des origines
Pensée, parole, action dans la tradition européenne
NOTRE EUROPE
La Sardaigne : du temps et des dieux
L’Irlande - 2e partie : Du génocide à la reconquête
EDITORIAL DU N°9
Qu'est-ce que l'ésotérisme ?
Qu’est-ce que l’ésotérisme ? C’est le monde tel qu’il existe et tel que le voient certains êtres selon une logique et une vision qui ne sont pas apparentes ou reconnues par les autres. Nietzsche disait que le philosophe exotérique voit les choses d’en bas, tandis que le philosophe ésotérique les voit d’en haut. Cette explication n’est guère satisfaisante ; l’ésotériste n’est pas, dieu merci, un philosophe, tout au moins, dans son acception actuelle. Et, les choses, il ne les voit ni d’en haut ni d’en bas, il les voit à travers, superposées, ou comme à la lecture d’un palimpseste. Don Juan, le chaman yaqui de Castaneda, assimilait la connaissance aux peaux d’un oignon qu’il faut éplucher pour en découvrir le secret (… en pleurant). On peut tout aussi bien s’en référer à l’image de la peau humaine ; on ne voit des êtres que leur apparence physique. La peau humaine comporte elle aussi plusieurs couches ; sa fonction permet de protéger – quelquefois de refléter – l’intérieur. L’étymologie du mot ésotérisme renvoie à ce dernier mot, intérieur, avant de signifier caché. Mais il n’y a pas lieu d’opposer exotérisme et ésotérisme, comme il n’y a pas lieu d’opposer science moderne et ancienne qui sont deux aspects d’un même corpus. Evidemment, l’accélération de notre fin de cycle fait que l’on n’a guère le loisir de pousser l’investigation plus loin que les apparences.
Le monde est régi par un ensemble de lois qui ne sont pas édictées par les hommes. Lorsque le temps fut venu de les occulter, puisqu’on entrait dans l’« âge sombre », ces lois et principes furent conservés sous forme de symboles, architecturaux, artistiques, ou autres, sous forme de transmission orale, ou écrite, de traditions rituelliques ou autres perpétuées depuis le fond des âges. Eliade, Evola, Dumézil, ou Guénon et bien d’autres ont largement contribué à expliquer ces modes de transmission dans les sociétés anciennes ou celles contemporaines, qu’on nomme « primitives » mais chez lesquelles perdurent encore bien des signes d’un savoir oublié. L’ésotérisme est donc la science qui étudie les connaissances qui ne sont pas accessibles à une perception immédiate, tout en incluant celles qui le sont – qui peut le plus peut le moins – et qui structurent le monde en profondeur. Et dès l’origine. Ces connaissances étant éternelles et universelles, l’ésotérisme peut encore se définir comme la voie de leur transmission.
De ce fait, les connaissances exotériques contemporaines, telles que les hommes les pratiquent d’une manière qu’ils définissent comme « rationnelle » ou « cartésienne » et qu’ils appellent « scientifiques », ces connaissances somme toute superficielles - « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil » - ne sont qu’une infime partie du matériau intellectuel, et spirituel, que les hommes ont à leur disposition, de même que nous n’exploitons qu’une infime partie des potentialités de notre cerveau. Un domaine – celui le plus en pointe - de ces nouvelles sciences a inclus, ou plutôt rejoint, nous dirions presque spontanément, naturellement, certaines de ces anciennes connaissances ; c’est celui de la physique quantique, qui fausse justement ces règles de logique scientifique qu’on pensait indétrônables et incontournables. Le serpent se mord la queue. La science et la tradition se sont rejoints et ont un bel avenir commun.
L’ésotérisme chrétien
« Y a-t-il ésotérisme chrétien ou christianisme ésotérique ? dans le premier cas, le christianisme est fondamentalement un ésotérisme qui s’est dégradé en religion ; dans le second cas, le christianisme est une religion qui comporte quelques éléments ésotériques et a pris quelques formes ésotériques ».
Quant à nous, nous n’avons pas opposé exotérisme ou science à ésotérisme ou spiritualité. Il conviendrait tout autant de ne pas opposer paganisme et christianisme, en vertu d’une tradition de continuité redécouverte dans le présent numéro d’Hyperborée par Paul-Georges Sansonetti ; car il existe un ésotérisme chrétien qui énonce, lorsqu’on y prête attention, les mêmes vérités que professaient les spiritualités anciennes, que le christianisme dogmatique (ou religieux, comme l’écrit Riffard ) a tenté d’éradiquer par l’épée et le feu. Pour dire autrement, la Tradition s’est maintenue au sein même de ce qui pouvait être considéré comme son plus implacable ennemi. Ce qui nous permet, à nous, d’être encore là, nous référant à ces quelques bribes de savoir, tout aussi précieuses que la moindre molaire d’un mammouth qui permet aux archéologues de reconstituer le mastodonte dans son ensemble. Et à quelques injections d’ADN de faire marcher les spécimens congelés dans un proche avenir.
Et l’on s’attend, au jour du Jugement dernier, comme diraient les chrétiens, à voir se lever et s’animer toutes ces figures de pierre patiemment et délicatement sculptées dans la fraîcheur et la pénombre des cloîtres par des hommes courageux dont la mission était de transmettre ces connaissances primordiales, au nez et à la barbe (blanche) des Pères de l’Eglise.
Mais cela aurait-il pu se produire s’il n’y avait eu dans les fondements même du christianisme quelques éléments qui auraient permis cette continuité, à commencer par le personnage du Christ ?
Et même la vaste entreprise de récupération décidée d’une manière systématique par l’Eglise n’a-t-elle pas permis de sauvegarder certains vestiges ? On peut penser, bien sûr, à ces temples païens, eux-mêmes construits sur des lieux telluriques et qui ont été détruits, certes, mais aussi marqués, par l’emplacement d’une chapelle ? ou à cette surabondance de saints, destinés à remplacer les anciens dieux, lesquels étaient, rappelons-le encore une fois, des principes. Le coucou chrétien n’aurait, dans ce cas, fait que garder le nid au chaud pour le retour de l’aigle.
Pour illustrer ce qui vient d’être dit, voici le récit d’une petite expérience, que chacun peut faire sur le site de n’importe quel édifice chrétien près de chez lui.
J’ai découvert sur un tourniquet de l’unique bistrot d’un village perdu de la Drôme provençale une revue fort bien faite par une équipe d’érudits locaux qui s’appelle Mémoire d’Ouvèze, du nom de la rivière qui arrose les villages de ce pays aux confins de la Drôme et du Vaucluse, et qui a sinistre « mémoire » puisque c’est elle qui a emporté une partie de Vaison-La Romaine il y a quelques années. Ce numéro était consacré aux chapelles du Val d’Ouvèze et recense une trentaine de ces bâtiments qui sont souvent des petites merveilles d’architecture (voir encadré).
Notre dossier sur « l’ésotérisme chrétien » n’est évidemment pas exhaustif, nous aurions par exemple aimé évoquer la grande figure de Rudolf Steiner dont nous avons parlé à maintes reprises dans cette revue ; ce n’est que partie remise.
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : traditions, tradition, traditionalisme, ésotérisme, ésotérisme chrétien, christianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 décembre 2009
Chine: l'impact psychologique de la révolte "Taiping" (1851-1864)

« Moestasjrik » : ‘t Pallieterke :
Chine : l’impact psychologique de la révolte « Taiping » (1851-1864).
Quand on se demande pourquoi les autorités politiques séculières ont si peur des mouvements religieux sectaires, comme, par exemple, l’actuel régime chinois, dont le communisme est devenu « soft », craint la secte Falungong, il faut étudier l’histoire de la révolte Taiping qui, entre 1851 et 1864, a ravagé la Chine centrale et méridionale en faisant près de vingt millions de morts, plus encore que la première guerre mondiale en Europe.
La révolte a été dirigée par une figure prophétique typique, Hong Xiuquan, qui s’était converti au protestantisme et imaginait être le frère de Jésus Christ. Conséquence des traductions lacunaires de la Bible en chinois, sa théologie chrétienne était largement « déviationniste ». Il n’acceptait que Dieu le Père, rejetait la Sainte Trinité et, bien sûr aussi, le précepte de la foi qui veut que Jésus ait été « le seul et unique fils de Dieu », puisqu’il y en avait deux : Jésus et lui-même ! Le compagnon de Hong, Yang Xiuqing imaginait qu’il était, lui aussi, un prophète mandaté par Dieu.
L’aventure commença par une révolte dans une ville de Chine du Sud, Jintian, en janvier 1851, soulèvement populaire qui parvint à mettre en déroute les troupes impériales. En 1851, Hong proclame dans cette ville le « Taiping Tianguo », c’est-à-dire « le royaume céleste de la paix suprême ». Dans les masses déshéritées, il parvient à recruter un grand nombre d’adeptes, surtout au sein de la minorité non chinoise des Zhuang et dans la strate sociale des migrants intérieurs de Chine, les Keija ou Hakka. Son armée compta bien vite un bon million de combattants. Elle conquit la grande métropole de la Chine du Sud, Nanjing (« la capitale du Sud ») et en fit la capitale de Hong, après l’avoir débaptisée et renommée « Tianjing » (« la capitale céleste »). La moitié supérieure de l’uniforme des combattants Taiping était rouge et la partie inférieure, bleue. Ces combattants portaient les cheveux longs, d’où leur surnom de « changmao » (= les hommes aux longs cheveux »).
Les partisans Taiping ne se sont pas donné la peine d’intéresser les classes supérieures à leur cause. Hong appelait systématiquement l’empereur le « roi de l’enfer ». Il expropriait les grands propriétaires terriens et, souvent, les exécutait. Pour sélectionner ses fonctionnaires, il avait supprimé les examens portant sur les auteurs classiques du confucianisme, dont les livres étaient accusés de répandre de la « sorcellerie », pour les remplacer par des examens portant sur la Bible. Des milliers de temples de la religion autochtone chinoise ont été détruits. Les Taiping professaient l’égalité de tous les hommes, sous la forme d’un néo-illuminisme protestant, né pendant les campagnes contre l’esclavage, en allant même plus loin, dans l’optique traditionnelle chinoise, en prêchant l’égalité de l’homme et de la femme. Son armée comptait dès lors quelques bataillons féminins. Hong avait adopté le principe monogamique chrétien mais, à l’instar de bon nombre de chefs de secte, il avait fait une exception pour lui et conservé son harem.
Le mouvement finit par contrôler une grande partie de la Chine, sans être sérieusement défié avant 1861. Entre 1856 et 1860, l’armée impériale avait d’autres soucis : elle devait affronter la France et l’Angleterre à l’occasion de la deuxième guerre de l’opium. Dans le cadre de ce conflit, en 1859, le capitaine américain Josiah Tattnall, sans avoir reçu aucun ordre de sa hiérarchie, était venu en aide au commandant en chef de l’armée britannique, Sir James Hope, quand ce dernier affrontait une armée chinoise. Plus tard, Tattnall justifia cette entorse à la neutralité américaine par les mots célèbres d’un vieux poème écossais : « Blood is thicker than water » (= le sang est plus épais que l’eau), ce qui signifiait que la solidarité raciale de deux officiers blancs perdus dans un océan de Chinois était plus importante que tout le reste. Cette guerre s’est terminée par la destruction du palais d’été de l’empereur, situé en dehors de Beijing, et par l’acceptation, par les Chinois, d’une nouvelle série de « droits spéciaux » et de privilèges pour les puissances occidentales, leurs diplomates et leurs commerçants.
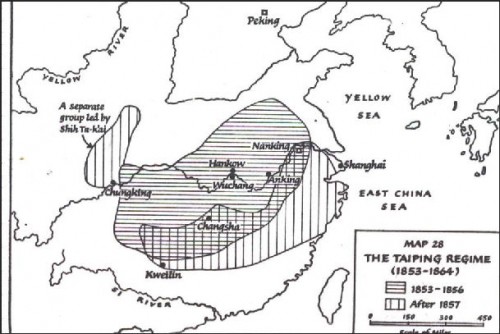
Le modèle de Mao
Immédiatement après la signature du traité de paix, les Britanniques sont venus en aide à l’empereur pour mater définitivement la révolte (à laquelle participaient quelques aventuriers occidentaux et quelques zélotes protestants). C’est alors que la fortune changea de camp. Lorsque les Taiping menacèrent Shanghai en 1862, où habitait une importante communauté d’Occidentaux, une armée britannique, sous les ordres du Général William Staveley, vint dégager la ville de l’étau des révoltés. Visant le même objectif, l’Américain Frederick Townsend Ward, de son côté, avait organisé une armée de soldats chinois commandés par des officiers occidentaux, mettant en œuvre les méthodes techniques les plus modernes de l’époque. Frederick Townsend Ward tomba au combat en 1863 et, à la demande du gouverneur local, Sir Staveley détacha son homme de confiance, Charles George Gordon, pour commander cette armée nouvelle et expérimentale. Après toute une série de succès impressionnants, l’empereur de Chine donna à cette armée le titre de « Changjiejun » (= « Armée toujours victorieuse »).
Gordon parvint à conquérir un point nodal dans le dispositif des Taiping, Chanchufu, et brisa de la sorte l’épine dorsale des révoltés. Il licencia son armée et laissa aux troupes impériales le soin de terminer le travail. En 1864, les Impériaux chinois prirent Nanjing et passèrent au fil de l’épée non seulement tous les combattants Taiping qui leur tombèrent sous la main mais aussi une bonne partie de la population civile. Hong était décédé depuis quelques mois ; son fils avait pris sa succession mais il n’avait ni le charisme ni le talent militaire de son géniteur pour pouvoir maintenir intact son Etat de nature sotériologique. Ses lieutenants, du moins les survivants, s’enfuirent dans tous les coins de l’empire. Au cours des décennies suivantes, quelques-uns d’entre eux organiseront encore des révoltes locales, notamment celle des musulmans des provinces occidentales.
L’historiographie maoïste s’était montré très positive à l’égard de la révolte Taiping : pour elle, c’était une prise du pouvoir bien organisé de la classe travailleuse, animée par les bons idéaux mais qui devait finalement échouer parce qu’elle n’avait aucun plan ni aucun mode d’organisation à « fondements scientifiques ». D’autres révoltes paysannes avaient déjà échoué parce qu’elles souffraient du même mal, sauf celles qui avaient été détournées par des aristocrates locaux qui surent bien souvent gérer les masses populaires pour les faire œuvrer au bénéfice de leurs propres ambitions. Pour les maoïstes, ces lacunes des révoltes populaires antérieures à Mao ne seront comblées que par l’adoption du marxisme-léninisme ; celui-ci impliquait une organisation rationnelle (avec un parti prolétarien d’avant-garde soumis à la centralisation démocratique) et une analyse scientifique de la situation ; ces deux atouts ont donné la victoire finale au peuple. Une étude maoïste sur les mérites de la révolte Taiping reprend les mots de Lénine : « Parfois, une lutte des masses, même pour une cause sans espoir, se révèle utile pour éduquer finalement ces masses et pour les préparer à la lutte finale ».
« Moestasjrik » / « ‘t Pallieterke ».
(article paru dans « ‘t Pallieterke », 16 mai 2007 ; trad.. franç. : Robert Steuckers, déc. 2009).
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, asie, chine, révoltes, 19ème siècle, religion, christianisme, protestantisme, messianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 décembre 2009
Citation de D. H. Lawrence
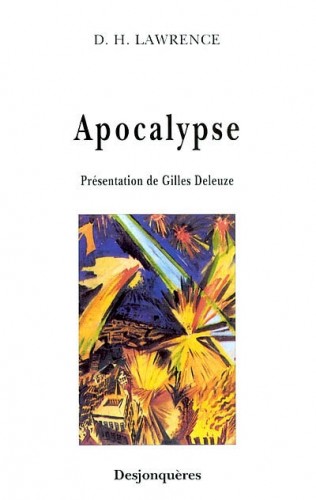 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999
APOCALYPSE:
Un commentaire païen de l'Apocalypse selon Saint-Jean
«L'Apocalypse nous montre ce à quoi nous résistons, résistance contre-nature, nous résistons à nos connexions avec le cosmos, avec le monde, la nation, la famille. Toutes nos connexions sont anathèmes dans l'Apocalypse, et anathèmes encore en nous. Nous ne pouvons pas supporter la connexion. C'est notre maladie. Nous avons besoin de casser, d'être isolés. Nous appelons cela liberté, individualisme. Au-delà d'un certain point, que nous avons atteint, c'est du suicide. Peut-être avons-nous choisi le suicide. C'est bon. L'Apocalypse aussi choisit le suicide, avec l'auto-glorification que cela implique.
Mais l'Apocalypse montre, par sa résistance même, les choses auxquelles le cœur humain aspire secrètement. La frénésie que met l'Apocalypse à détruire le soleil et les étoiles, le monde, tous les rois et tous les chefs, la pourpre, l'écarlate et le cinnamome, toutes les prostituées et finalement tous les hommes qui n'ont pas reçu le “sceau” nous fait découvrir à quel point les auteurs désiraient le soleil et les étoiles et la terre et les eaux de la terre, la noblesse et la souveraineté et la puissance, la splendeur de l'or et de l'écarlate, l'amour passionné et une union juste entre les hommes indépendamment de cette histoire de “sceau”. Ce que l'homme désire le plus passionnément, c'est sa totalité vivante, une forme de vie à l'unisson, et non le salut personnel et solitaire de son “âme”.
L'homme veut d'abord et avant tout son accomplissement physique, puisqu'il vit maintenant, pour une fois et une fois seulement, dans sa chair et sa force. Pour l'homme, la grande merveille est d'être en vie. Pour l'homme, comme pour la fleur, la bête et l'oiseau, le triomphe suprême, c'est d'être le plus parfaitement, le plus vivement vivant. Quoi que puissent savoir les morts et les non-nés, ils ne peuvent rien connaître de la beauté, du prodige d'être en vie dans la chair. Que les morts apprêtent l'après, mais qu'ils nous laissent la splendeur de l'instant présent, de la vie dans la chair qui est à nous, à nous seuls et seulement pour une fois. Nous devrions danser de bonheur d'être vivants et dans la chair, d'être une parcelle du cosmos vivant incarné. Je suis une parcelle du soleil comme mon oeil est une parcelle de moi-même. Mon pied sait très bien que je suis une parcelle de la terre, et mon sang est une parcelle de la mer. Mon âme sait que je suis une parcelle de la race humaine, mon âme est une partie organique de l'âme de l'humanité, tout comme mon esprit, une parcelle de ma nation. Dans mon moi le plus privé, je fais partie de ma famille. Rien en moi n'est solitaire ni absolu, sauf ma pensée, et nous découvrirons que la pensée n'a pas d'existence propre, qu'elle n'est que le miroitement du soleil à la surface des eaux.
Si bien que mon individualisme est en fait une illusion. Je suis une parcelle du Grand Tout, et n'y échapperai jamais. Mais je peux nier mes connexions, les casser, devenir un fragment. Alors, c'est la misère.
Ce que nous voulons, c'est détruire nos fausses connexions inorganiques, en particulier celles qui ont trait à l'argent, et rétablir les connexions organiques vivantes avec le cosmos, le soleil et la terre, avec l'humanité, la nation et la famille. Commencer avec le soleil, et le reste viendra lentement, très lentement».
(D. H. LAWRENCE, Apocalypse, 1931; éditions Balland, Paris, 1978 pour la traduction française, pp. 210 à 212).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, lettres, littérature, philosophie, lettres anglaises, littérature anglaise, apocalypse, religion, christianisme, paganisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 décembre 2009
Symboles: du monde païen au monde chrétien

Archives de SYNERGIES EUROPPEENNES - 1999
SYMBOLES, DU MONDE PAïEN AU MONDE CHRETiEN
Marie BRASSAMIN
Depuis la nuit des temps, l'homme use de symboles: les dessins rupestres sont symboles religieux et non, comme on l'a cru longtemps, des fresques narratives. La symbolique évolue en fonction du degré de la civilisation: on peut distinguer quatre étapes qui se chevauchent et/ou coexistent.
1) Le symbole matérialise un concept philosophique ou religieux inaccessible autrement au commun des mortels. En général, le symbole est inclus dans une narration, mythe, conte, légende, épopée...
2) Le symbole représente une chose concrète ou abstraite et se substitue à elle par souci de poésie (neige et vieillesse), par pudeur ou tabou (avoir la puce à l'oreille), par similitude de forme (ventre et grotte), par recouvrement de caractère (rat et avarice)...
3) Le symbole masque une vérité que l'on ne veut pas ou que l'on ne peut pas exprimer en clair: ésotérisme (alchimie), sociétés secrètes ou sectes (franc-maçonnerie), politique, psychanalyse...
4) Le symbole permet les jeux de mot, sur les armes (Hugues Capet, abbé de Senlis, élu roi, pris pour écu un semis de lys —cent lis— sur champ d'azur —le fleuve—); les rébus, le pictionary (contraction de picture et dictionary).
La deuxième série permet d'obtenir quelques renseignements sur les mœurs, la troisième est inexploitable sauf par les personnes concernées directement, la quatrième catégorie, un temps utilisée pour favoriser l'éveil des enfants à leur langue matemelle, a été abandonnée par suite de trop nombreuses confusions de sens et d'orthographe.
Universalité des symboles philosophiques
Les symboles philosophiques et religieux sont remarquables par leur universalité. Du Mexique au Danemark, du Japon à la France, de Chine en Australie, le même animal, la même plante expriment la même idée. Aucune explication rationnelle ne peut être avancée sinon l'observation: mais est-ce vraiment une explication? En effet, à partir d'une même observation, il est possible d'entreprendre différentes études qui déboucheront sur des enseignements différents; or, les anciennes civilisations ont une sorte d'uniformité de vue! Ces symboles, dont certains remontent au néolithique, ont été repris ou absorbés par la religion chrétienne, mais, l'Europe seule est réellement concernée car, la christianisation de l'Amérique s'est faite par le vide (massacres importants, isolation des autochtones, non-souci de conversion); celle de l'Afrique n'a concerné que les zones non-musulmanes, les massacres furent politiques, et, du point de vue religieux, les idoles ont cédé le pas aux rituels (“Gospel” par exemple); en Asie, comme dans le monde islamisé du temps passé, il y a eu coexistence (pas forcément pacifique) des anciennes religions et de la nouvelle.
Sanctuaires mariaux et déesses-mères païennes
D'une facon générale, on remarque que les sanctuaires mariaux les plus importants se situent sur les zones d'influence d'une déesse païenne: Lourdes et la Vénus de Cauterets, et, plus troublant, les régions ayant opté pour le protestantisme sont les aires de tribus guerrières où les femmes ne jouaient aucun rôle dans l'organisation sociale (épouses et mères seulement), alors que les pays actuellement catholiques et fortement attachés à la Vierge furent des nations dévouées à une déesse-mère toute puissante (Maeva en Irlande).
Le nomadisme et le fractionnement en petites unités sociales ont aussi joué un rôle dans l'essaimage des symboles et leur amalgame au christianisme. Jusqu'en l'an 500, les mouvements migratoires répondent à des impératifs alimentaires plus que conquérants, même si l'on se bat souvent. Si, durant une période de 30 à 50 ans aucune épidémie ou catastrophe naturelle ne décimait la tribu, il y avait surpopulation, d'où nécessité d'éliminer le surnombre d'individus par un départ concerté. Pour accroître les chances de survie des exilés, plusieurs tribus regroupaient leurs migrants, et se mettait en marche une horde qui, en cours de route, s'augmentait souvent. Chaque groupe avait son langage, ses dieux, ses coutumes, mais, chemin faisant, progressivement et inconsciemment, tout cela se mêlait. Ils allaient ainsi, parfois en un voyage de plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'ils trouvent une terre vierge pouvant les nourrir: partis des Monts de Thuringe vers la Pologne puis la Biélorussie, descendant vers l'Ukraine pour revenir sur leurs pas par la Slovaquie, la Hongrie, atteindre la vallée du Rhône, la descendre, suivre la côte méditerranéenne jusqu'à l'Andalousie, tel fut le périple des Wisigoths d'Espagne! (Une partie de la troupe s'installa sur une bande de terre de l'Italie du Nord à la Croatie actuelles, en gros). Au terme du voyage, ceux qui étaient partis étaient morts en route, ceux qui arrivaient ne savaient pas leur origine, la culture initiale s'était diluée au contact d'autres cultures (haltes, compagnons de voyage, unions...); le temps est facteur d'oubli.
Le CYGNE:
Sous la forme de cet oiseau, Zeus féconda Léda. Dans la Grèce antique, le cygne n'est pas un animal local, mais, le pays est situé sur un axe de migration: les gens ont pu voir un animal, fatigué ou blessé, lors d'une pause. La rareté, la beauté ont fait naître l'idée de l'associer à Zeus. Sur l'axe de migration, en Europe centrale, les devins étudiaient le vol des cygnes pour en tirer un présage pour l'année nouvelle (qui commençait au printemps). Pour les peuples familiers des cygnes, plus que la grâce et la blancheur, le fait marquant était sa disparition durant les mois de froidure. Il devint donc symbole de pureté et de jeunesse: de nombreuses légendes mettent en scène des hommes-cygnes (Lohengrin en Allemagne; Andersen d'après des traditions orales, au Danemark;...). Il est à noter que le cygne est associé à une femme (épouse, sœur) mais que la femme elle-même n'est que rarement cygne.
Ces légendes orales ont atteint des régions où le cygne est très rare, voire inexistant, il a donc été remplacé logiquement par l'oie et le canard. L'oie était associée au dieu Mars dans la Rome antique (les oies du Capitole). Sequana est représentée debout, un canard dans ses bras ou à ses pieds: le long de la vallée de la Seine, il existe plusieurs représentations de la Vierge au canard, (av. le XIIième siècle). Très tôt, les tribunaux ecclésiastiques, (l'Inquisition), se sont élevés contre cette imagerie: le canard a toujours joui de mœurs sexuelles douteuses, contre sa volonté sûrement!!! Extrait d'un texte religieux du XIIième, en français moderne: «L'oie est un animal blanc extérieurement, mais sa chair est noire; Notre Seigneur l'a mise parmi les hommes afin qu'ils ne se laissent pas duper par ces faux croyants dont l'apparence de pureté cache l'âme la plus noire; la Très Glorieuse Mère de notre Sauveur ne saurait être représentée au côté de cet animal ou de tout autre lui ressemblant». Le rapport cygne-pureté ou cygne-protection divine est aussi linguistique. Au VIième siècle, on constate dans des traductions latines, un glissement entre Algis = cygne et Hal ghis = protection du sanctuaire (actuelle Allemagne). Plus tard, le gothique oublié, pour garder cette association, on liera étymologiquement swen = blanc et sunn = soleil (mot féminin) (XIième).
Le SANGLIER:
Lui aussi est un animal courant et va englober dans sa symbolique la laie, le cochon et la truie. Dans la Grèce, la mythologie représente le sanglier comme instrument des dieux: il est tueur ou tué selon que le héros a été condamné par les dieux ou testé (Héraclès, Adonis, Attis...). Le sanglier était attribut de Déméter et d'Atalante. Dans les cultures germano-nordiques, il est attribut de Freya, et Frey, son frère, a pour monture un sanglier aux poils d'or. C'est peut-être Freya qui est devenue en terres erses et celtiques la déesse Arwina, figurée avec un sanglier, et qui, en France, a donné son nom aux Ardennes et à l'Aude, ainsi que divers prénoms: Aude, Audrey, Aldouin, Ardwin... En outre, en Irlande et en France, le sanglier représente symboliquement la classe des druides et, plus tard, les prêtres: il figure à ce titre sur un des chapiteaux de la basilique de Saulieu —21—. Parce que lié à la fécondité, de nombreuses légendes mettent en scène des héros élevés par des suidés; parce que lié à la force mâle, sa chasse fut longtemps initiatique.
L'Eglise a tenté d'intervenir, mais sans succès cette fois, pour quatre raisons essentielles:
1) trop répandus, sangliers et porcs sont une ressource alimentaire importante; la peau, les défenses, les ongles, les os... tout ce qui n'est pas mangeable sert à l'artisanat utilitaire;
2) il est associé à trop de saints populaires: Antoine, Emile, Colomban...;
3) mettre l'interdit sur les porcs serait avoir la même attitude que les juifs,
4) en Allemagne, il y eut confusion étymologique entre Eber = sanglier et Ibri, ancêtre mythique des Hébreux et donc du Christ, parfois représenté sous forme de sanglier (à Erfurt notamment).
Le CERF:
Le dernier élément du bestiaire symbolique que je présente est le CERF (élan, renne, chevreuil, daim...). «Au pied de l'Arbre du Monde, quatre élans broutaient...», ainsi commence la légende germano-nordique. La Bible, Cantique des Cantiques, développe l'association femme-gazelle, laquelle correspond très exactement à l'association femme-biche. Héraclès chasse la Biche aux Pieds d'Airain tandis qu'Artémis se promène dans un char tiré par quatre biches. De nombreuses légendes mettent en scène des femmes-biches: Ossian en Irlande, naissance de la Hongrie... Gengis Khan serait né d'une biche et d'un loup! La biche, sous son apparente douceur, reste un animal inquiétant, toujours doté de pouvoirs magiques: fée ou sorcière se transformant ou innocente victime d'un maléfice.
Les mâles, par contre, sont symboles de force et de courage, image issue de tribus où la chasse est vitale. Leur ramure est associée aux rayons du soleil: le dieu celte Esus porte une ramure de cerf. C'est ce rapport qu'il faut voir dans le char (symbole solaire également) du Père Noël, tiré par des rennes (solstice d'hiver). Quant aux cornes des cocus, elles sont historiques et honorifiques! Lorsque les rois, puis empereurs, de Byzance prenaient pour favorite, concubine ou maîtresse une femme mariée, des cornes d'or étaient apposées sur la façade de la maison de l'époux, en signe de haute distinction. L'Eglise a tenté de gommer ces cerfs gênants parce que trop païens, sans plus de succès qu'avec les sangliers, parce que:
1) le cerf était un gibier noble, uniquement chassé par les nobles et le dévaloriser était s'attaquer à la force politique et militaire;
2) de ce fait, ils étaient, aux yeux du peuple, nobles et sacrés (peine de mort pour le manant qui abattait un cerf);
3) trop de saints populaires l'avaient pour attribut: Hubert, Meinhold, Oswald, Procope...
Cependant, le travail de sape des ecclésiastiques a donné un résultat inattendu, l'expression “couard comme un cerf”, en dépit du bon sens.
De la symbolique des plantes
Pour la symbolique des plantes, la signification est plus ciblée, car, jusqu'au XVIIIième siècle, la classification n'existait pas, et, deux plantes voisines peuvent être dissemblables alors que deux plantes sans parenté peuvent se ressembler. La situation géographique, climat et géologie, influe plus sur les plantes que sur les animaux. Enfin, une plante est statique, et frappe moins l'imagination qu'un animal. Donc, les plantes symboles sont médicinales ou comestibles, avec une restriction: nous devons garder à l'esprit que durant plusieurs millénaires la plante-mère a évoluée par sélection naturelle ou intervention humaine (l'épeautre a une action bénéfique sur le système nerveux que le blé n'a pas).
Le CHARDON:
Le CHARDON, plante médicinale (il en existe plusieurs variétés), et légume en période de disette (avant l'artichaut ou en son absence), a frappé l'imagination parce qu'il pousse dans des conditions extrêmes (terrain pauvre, résistance aux chaleurs et aux froidures)... Il a donc été symbole de la résistance à l'oppresseur (en Ecosse) et étalé sur les portes ou posé sur les cheminées pour chasser les mauvais esprits. Le chardon acaule s'ouvre ou se resserre en fonction du taux d'humidité de l'air: ne sachant à quoi attribuer ces mouvements de corolle, certains peuples l'utilisèrent comme oracle: on posait une question au chardon et on revenait le lendemain, si le chardon était ouvert la réponse était favorable. Il fut aussi symbole de la femme-mère protectrice du foyer en référence à la carde (qui servait à carder la laine). Les gnomes et autres esprits domestiques s'en servaient pour punir (mis dans les litières, paillasses, chaussures...) ou pour aider (carder, guérir...). Les ronces et le citronnier ne poussant pas partout, il fut Couronne d'Epines du Christ.
La TANAISIE:
La TANAISIE est un chrysanthème, qui, comme le chardon, se dessèche sans faner. De cette qualité d'immortelle et de sa couleur jaune, elle fut très tôt associée au soleil, d'autant qu'elle fleurit en été, puis, aux débuts de la christianisation, à la vie éternelle. L'odeur très forte qu'elle dégage dut être liée à des pratiques magiques avant que l'homme ne s'avise qu'elle éloigne bon nombre de “parasites” (avec plus ou moins d'efficacité): puces, poux, mouches, moustiques... La médecine progressant, de l'usage externe, on passa à l'usage interne, tisanes et décoctions vermifuges: l'Eglise suivit, et la tanaisie devint symbole de la foi missionnaire. Mais, en faire des bouquets que l'on pendait dans les étables ou les pièces d'habitation en fit, très tôt aussi, une fleur ornementale et le symbolisme y perdit sa force et sa valeur.
L'EGLANTINE:
L'EGLANTINE (et la rose), sont symboles de jeunesse inaltérable, de noblesse et de pureté; ces fleurs furent naturellement attributs de la Vierge; en Grèce, rattachées au mythe et au culte d'Adonis, elles expriment la métamorphose et la renaissance. Souvent représentées en quintefeuilles sur les écus, bas-reliefs, chapiteaux, linteaux, guirlandes..., ces fleurs font intervenir un autre type de symbole, plus profond peut-être, celui des chiffres: 5 = 3 + 2, c'est l'association du concept mâle (3) et du concept femelle (2).
Arbres-symboles
Très peu nombreux sont les arbres symboles paiens devenus symboles chrétiens: peut-être parce que dans l'esprit des hommes anciens il n'existait que deux types d'arbres, ceux que l'on pouvait utiliser (chauffage, construction, teinture, alimentation...) et ceux qui ne servaient à rien; les premiers étaient trop “matérialistes”, les seconds “inexistants” pour qu'ils aient valeur symbolique.
Le CHENE:
Cependant, le CHENE, par son aspect majestueux et la qualité de son bois s'est imposé. Il est toujours associé à un dieu majeur: Thor dans les civilisations nordiques, Donar en Allemagne, Perkunas en Lithuanie, Zeus en Grèce, Jupiter à Rome; arbre isolé représentant le dieu lui-même, bois sacrés ou forêts sanctuaires. Si, en Grèce le chêne était la demeure des dryades (nymphes), en Europe Centrale il se transformait en une sorte de sirène-vampire. Pour les chrétiens, il est symbole d'immortalité: le bois de la Croix fut longtemps en chêne! Le chêne sous lequel Saint Louis rendait la justice est sûrement plus symbolique qu'historique.
Le SAPIN:
Le SAPIN, a un parcourt plus tortueux et moins net. A l'origine, le pin noir est attribut d'un dieu ou déesse des batailles, sur une grande partie des pays nordiques et baltes: il était habituel de pendre les dépouilles (sauf le cadavre) des soldats vaincus aux branches de ces arbres; il est bien difficile de démêler le rite social du rite religieux d'un tel comportement, les deux étant probablement liés: image tangible de la victoire et offrande. Au moment de la christianisation de ces régions, cette pratique s'était effacée, mais, devaient subsister, de façon occulte, des “dons” à un arbre représentant une divinité, sortes d'ex voto. Par quelles arcanes de la mémoire collective cette coutume a-t-elle transitée? Car, ce n'est qu'au XIXième siècle que le Sapin de Noël (un épicéa, le plus souvent), a resurgi, les branches couvertes d'offrandes, mais associé au christianisme sans être élément religieux. Il faut noter que le “mai” a une autre origine, reprise par les “Rameaux”.
Les choses-symboles
Les choses symboles sont innombrables et surtout reflet de civilisation. Il nous est difficile, à nous, hommes modernes, d'imaginer ce que tel objet pouvait représenter pour les hommes anciens: un pot, c'est toujours un pot, un récipient pour cuire ou conserver. Il y a mille ans, un pot était signe d'aisance, objet utilitaire et précieux que l'on transmettait en héritage; c'était aussi la recherche de la meilleure argile, du décor; c'était encore l'angoisse de la cuisson dernière épreuve pouvant anéantir bien des heures de travail; c'était enfin l'image d'une famille réunie dans l'assurance d'un repas; c'était... peut-on savoir?
Le CŒUR:
Dans l'imagerie religieuse, sans cesse revient le CŒUR. Il était courant de prêter à ce muscle les qualités du cerveau, à ce point que, de nos jours, restent toute une série d'expressions qui en atteste: agir selon son cœur, va où le cœur te porte... Les premières formes d'écriture en Europe sont des idéogrammes dont certains subsisteront jusqu'au XIIIième siècle avec valeur de lettre (runes), d'autres disparaîtront: le cœur est de ceux-là. Il était symbole de la femme puisqu'il représente en réalité les organes génitaux externes stylisés, symbole étendu à tout ce qui est d'essence féminine, il est associé à la terre et au soleil, au cycle de reproduction et de culture. L'iconographie chrétienne en a largement usé et abusé comme représentation de l'Amour, siège des pensées et sentiments nobles... au point que le cœur dans tous ces états (sauf celui de viande!) s'étale depuis des siècles dans une certaine littérature qui fut tour à tour courtoise, galante, romanesque avant d'être rose, grivoise ou X!
L'ANCRE:
L'ANCRE n'est pas présente dans les anciennes cultures, et pour cause, c'est un objet récent. Sans que rien le laisse prévoir, l'ancre est apparue associée à la Vierge sur quelques représentations moyenâgeuses, sporadiquement et spontanément, puis est retombée dans l'oubli. Cette bizarrerie n'en est que plus suspecte, d'autant que les dites Vierges, en pied sur l'ancre, surgissent dans les terres, loin de la mer et des voies d'eau navigables: il faut y voir la transposition d'une déesse (Freya?) debout sur le marteau de Thor. Beaucoup plus tard, les mariniers reprirent cette image, en toute logique. Quant aux croix ancrées, il s'agit d'un système de fermeture de porte et non d'une ancre; les croix ancrées sont apparues tout d'abord sur les écus, dans les armes et signifiaient “je garde au nom du Christ”.
Le MARTEAU:
Puisque le MARTEAU est cité, autant signaler que lui n'a jamais quitté la symbolique païenne; Thor, juge impitoyable des guerriers, a transmis, tel quel, son instrument aux hommes contemporains: le marteau siège au tribunal! Avant d'être utilisé, également avec le sens de sentence rendue, par les commissaires priseurs, il servit, toujours avec ce sens, a entériner les mariages. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, on pouvait trouver dans les campagnes françaises des “forgeux”: forgerons véritables qui, en plus de leur métier somme toute banal, chassaient les esprits; le malade (souvent névrosé ou psychotique) était étendu nu sur une table dans la forge; le “forgeux” abattait sur lui sa masse la plus effrayante et arrêtait son geste au ras de la poitrine ou du ventre. Ou on était débarrassé de toute psychose ou on devenait complètement fou de terreur!
Les premières sociétés humaines dressèrent des axes de vie ou axes du monde, symbole du lien des dieux avec les hommes. Sous différents aspects, ce symbole est universel et perdure: menhir, lingam, pyramide, totem, arbres ou pieux sculptés... La Croix et les cierges (avec la flamme en plus) sont chargés de ce sens.
L'évolution n'est donc que la prise de conscience des phénomènes et leur enrobage dans diverses enveloppes fournies par la société. Notre esprit est le même que celui de Lucy!
Marie BRASSAMIN.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditions, traditionalisme, paganisme, christianisme, symboles, symbolologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 septembre 2009
Gerbert l'Européen

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Gerbert l'Européen
En 1996, un colloque consacré à Gerbert, le pape de l'an Mil, Sylvestre II, a eu lieu à Aurillac. Les actes de ce colloque viennent d'être publiés sous le titre de Gerbert l'Européen. Pierre Riché écrit en introduction à propos de Gerbert, alors archevêque de Reims: «Il attire de nombreux élèves venus de toutes les régions de l'Europe. Son école rayonne même en Lotharingie, en Italie, en Germanie. Un écolâtre de Magdebourg étonné par ce succès, envoya un de ses étudiants saxons pour prendre des notes au cours de Gerbert à Reims. Malheureusement, il n'était pas compétent et fit à son maître un rapport inexact. Gerbert devait prouver sa supériorité à Ravenne en 981. Pour son élève Otton III, il écrivit un traité de logique. Ses connaissances sur l'astrolabe à partir de 983 sont l'objet de discussions mais sa lettre à Lobet de Barcelone, traducteur d'un traité arabe, prouve qu'il s'intéresse à la question. La construction de son abaque fait penser qu'il connaît l'existence des chiffres arabes. Sa science musicale est indéniable . Après sa mort, les disciples de Gerbert ont vanté ses mérites et de nombreux manuscrits contenant ses œuvres authentiques ou non ont été diffusés. Gerbert a si bien redonné vigueur à l'enseignement de la dialectique et des sciences qu'il inquiète les clercs de son époque. En cela, il rappelle Boèce qui était son modèle, et dont il connaît les œuvres. Comme lui, Gerbert est un homme de science, son Dieu n'est pas tellement celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais le Dieu des philosophes et des savants. Comme Boèce, il croit que Dieu est le Bien suprême, celui qui régit le monde, qui organise l'harmonie des sphères et détient les Idées; comme Boèce, la philosophie est sa consolation: “La philosophie est le seul remède que j'ai trouvé... J'ai préféré les loisirs de l'étude qui ne trompent jamais aux incertitudes et aux hasards de la guerre”. C'est à ses amis d'Aurillac qu'il écrit cette lettre à une époque de difficultés, car Gerbert l'Européen qui connaît la Catalogne, Rome, Reims, Ravenne, la Saxe, les pays slaves, est resté fidèle à son monastère d'Aurillac et trouve auprès de ses anciens maîtres un réconfort. C'est en pensant à ses maîtres d'Aurillac qu'il a écrit: “La gloire du maître, c'est la victoire du disciple”». Les actes regroupent vingt-trois interventions d'universitaires et chercheurs français et étrangers (JdB).
Gerbert l'Européen, Comité d'expansion économique du Cantal, Hôtel du Département , F-15.000 Aurillac. 364 pages. 195 FF.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, papes, catholicisme, christianisme, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 19 juillet 2009
L'église monacale irlando-écossaise, concurrente nord-européenne de Rome
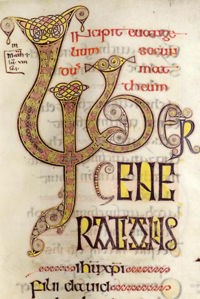
L'église monacale irlando-écossaise, concurrente nord-européenne de Rome
par Johanna BECK
Nos contemporains savent, généralement, que le christianisme nous est venu du sud, de Rome; et aussi que des moines-missionnaires sont venus d'Irlande à partir de la fin du 6ième siècle. On connait également le nom de quelques-uns de ces moines, comme Patrick, Colomban et Winfrith-Boniface; de même que le nom de quelques monastères, comme celui de Bangor, près de Belfast, d'Iona et de Lindisfarne sur les côtes occidentales et orientales de l'Ecosse. En revanche, on sait moins, aujourd'hui, que tout un réseau de petites communautés monastiques irlandaises s'était installé en Europe du Nord et aussi en Europe centrale; et on ne sait pas trop comment le christianisme est arrivé en Irlande ni qui l'y a apporté. Ce n'est que depuis quelques années que l'on a commencé des recherches sérieuses, précises et scientifiques pour attester les indices ou les suppositions des archéologues qui nous ont précédés.
On admet généralement que c'est Saint Patrick qui a apporté le christianisme en Irlande. Or, lors de son premier séjour dans la Verte Eirinn, en 412, il rencontre déjà des chrétiens. Dans le plus ancien manuscrit de sa Vita, on trouve cette phrase: «Je ne cherche pas à m'approprier le travail de mes prédécesseurs».
Pelagius contre Augustin
Vers 400, un jeune érudit irlandais, Pelagius, enseignait et prêchait à Rome. On sait qu'il s'est rendu à Carthage, sans doute pour y rencontrer Augustin, et puis, on perd sa trace. Dans sa théologie, il avait osé contredire le Père de l'Eglise, Augustin. Il enseignait que les hommes n'avaient pas tous été corrompus et perdus par la chute d'Adam, qui avait entraîné le péché originel. Pour Pelagius, le péché trouve plutôt son origine dans la volonté humaine, de même que le bien, la bonté. L'homme est donc libre et responsable de suivre ou l'exemple d'Adam ou celui du Christ. La cas de Pelagius prouve qu'en Irlande, on se préoccupait intensément de théologie chrétienne et qu'on y avait déjà fondé des écoles où l'on débattait de ces questions. Pelagius était certes un «marginal»; ses attaques contre l'Eglise de Rome ont provoqué la dite «dispute pélagienne» qui s'est poursuivie jusqu'en 529, d'abord avec virulence, ensuite sur un ton atténué. Rome en est sortie victorieuse.
Autre indice tendant à prouver que le christianisme avait acquis des formes fixes en Irlande dès la moitié du 4ième siècle: l'œuvre de Saint Ninian. Né vers 360 en Bretagne (= Angleterre actuelle), Saint Ninian passa quelque quinze années à Rome, où il fut sacré évêque. Après un séjour à Tours, sur les rives de la Loire, il retourna dans son pays et fonda le monastère Candida Casa sur la presqu'île britannique de Withorn, juste en face de Belfast en Irlande. Ce monastère se trouvait donc dans une région de l'actuelle Ecosse qui était celtique et picte et se trouvait bien au-delà de la frontière septentrionale du territoire britannique occupé par les Romains. Ninian était fidèle à l'Eglise de Rome. Son monastère, le premier de ce genre dans la région, exerça une profonde influence sur le pays, comme l'attestent les sources, et aussi sur l'Ouest, c'est-à-dire sur l'Irlande. Mais, réciproquement, la future Angleterre reçut d'Irlande bon nombre d'influences fécondes; la règle des monastères s'y imposa, alors qu'auparavant, elle était inconnue en Angleterre; de même, de nombreuses particularités liturgiques et de règles simples, ayant trait à la vie quotidienne. Le monastère Candida Casa devint ainsi une sorte de base irlandaise sur le territoire britannique. On y formait des prêtres et des clercs, qui essaimèrent pendant cent ans et fondèrent d'autres monastères.
Un monachisme d'origine égyptienne?
Le christianisme s'est répandu en Irlande par l'essaimage de communautés monastiques. Comme le pays est petit, ces communautés furent rapidement connues de tous et les moines n'eurent plus besoin de sillonner le pays pour missionner le peuple. Bientôt, chaque clan avait son monastère et les moines accomplissaient toutes les tâches dévolues aux hommes d'Eglise. C'est la raison pour laquelle on parle d'une église monacale irlandaise. Reste la question: comment ces moines sont-ils venus en Irlande?
Aux débuts du monachisme chrétien, nous trouvons le monachisme égyptien, né vers le milieu du 3ième siècle. Croyant que la fin du monde était proche, que le Jugement de Dieu était imminent, certains chrétiens avaient décidé de vivre une vie ascétique, de fuir le monde, moins par souci du salut personnel que par volonté de servir d'exemple pour la communauté toute entière et la représenter ainsi, pauvre et détachée des biens terrestres, devant Dieu. Ce monachisme présentait, dès ses débuts, deux tendences, le monachisme individuel, érémitique, et le monachisme communautaire, soumis à des règles très strictes de vie en commun. Le tout premier monastère, celui de Tabenisi, a été fondé en 320 sur une île du Nil. De là, sans cesse, des équipes de sept moines partaient pour fonder ailleurs une nouvelle communauté monastique. Cette conception du monachisme est arrivée en Occident à la fin du 4ième siècle; elle a aussitôt été combattue avec vigueur, ce qui l'a obligée à subir de multiples transformations.
Rôle primordial de l'Abbé
Curieusement, le monachisme irlandais présente des caractéristiques, perdues ailleurs en Occident, au cours de la transformation/altération des règles égyptiennes-orientales dans l'orbite romaine-occidentale. Seulement en Irlande, l'Abbé détient la plus haute dignité: les évêques consacrés lui sont subordonnés. Ensuite, dans l'art des enluminures, apanage des monastères irlandais, nous retrouvons des motifs issus du monachisme égyptien, des scènes de la vie de Saint Antoine, qui distribue ses biens et s'en va dans le désert pour mener une vie d'ermite, des éléments décoratifs typiquement coptes, comme les paupières des personnages peintes en noir ou des manières coptes de lire les textes bibliques. L'Evangile de Jean joue en Irlande un rôle important, comme en Orient, tandis qu'à l'Ouest, les Evangiles synoptiques sont mis à l'avant-plan. Quand on examine les légendes, on découvre le récit de sept moines égyptiens qui fondent un monastère, puis périssent martyrs, ce qui expliquent qu'on les ait représentés sur le socle d'une haute croix.
Tous ces éléments, ajoutés à d'autres encore, nous permettent d'avancer l'hypothèse d'une christianisation de l'Irlande et d'une constitution d'une église monacale irlandaise par des moines venus d'Orient, qui auraient contourné le continent. Ces moines seraient arrivés directement par mer, en empruntant des navires marchands, venus en Irlande pour y chercher de l'or, du cuivre ou de l'étain.
Le monachisme irlandais, une christianisation du druidisme?
Ce qui étonne, c'est que cette christianisation de l'Irlande n'a pas coûté de martyrs. Sans résistance, les Irlandais passaient au christianisme ou restaient païens. Les prêtres celtiques, c'est-à-dire les druides, les grands sages, se convertissaient, ce qui est en somme bien compréhensible, puisqu'ils auraient été une secte, venue, elle aussi, d'Orient. Les Druides connaissaient aussi la coutume de quitter leur communauté initiale à sept pour aller officier en un autre lieu sacré. En passant au christianisme monacal oriental, les Irlandais ne devaient pas abjurer leurs dieux et leurs déesses celtiques ni abandonner leurs coutumes: il leur suffisait de les intégrer. Divinités et coutumes celtiques ont été assimilées à des coutumes ou des saints chrétiens; dans leurs prophéties et leurs visions, les Druides les plus élevés dans la hiérarchie, comparent leurs lieux sacrés (bosquets, bois, sources, etc.) à ceux de la Terre Sainte, comme si la religiosité celtique avait précédé la religiosité chrétienne!
Cette tolérance a fait que pendant plusieurs siècles, les moines ont recopié, dans les monastères irlandais, les vieux mythes et les anciennes légendes celtiques. C'est ainsi que nous avons pu les conserver. Il est également intéressant de noter que la coiffure des druides —l'avant du crâne rasé et l'arrière de la chevelure longue et pendante— a été adoptée par les moines irlandais.
Saint Patrick, personnage moins important qu'on ne l'a cru?
L'église monacale irlandaise s'est développée très vite et Rome n'a pas pu s'y opposer. Raison pour laquelle, plus tard, elle a monté en épingle la personnalité de Saint Patrick et lui a attribué la christianisation de l'Irlande. De Saint Patrick, nous savons qu'il est né en 390 en Bretagne romaine et que, pendant ses jeunes années, il a été enlevé par des pirates et amené en Irlande. C'est à cette époque qu'il semble s'être tourné vers le christianisme. Il s'enfuit ensuite en Gaule, poursuit sans doute son voyage vers l'Italie, où il reçoit sa formation de prêtre. En 432, il débarque en Irlande, plus précisément en Ulster, dans le Nord-Est de l'île. Dans cette région, se trouve la colline de Tara, où l'ensemble des clans celtiques avait coutume de se rassembler. Patrick entame sa mission au nom de l'église de Rome, mais, apparemment, sans succès. Il n'aurait réussi qu'à se gagner les faveurs du Grand Roi d'Armagh, car dans le livre d'Armagh, nous trouvons sa Vita. Autrement, rien ne rappelle son souvenir. Il n'a pas réussi à fonder de monastère ni de communauté chrétienne. Et il n'a pas eu de successeur. Dans sa Vita, on raconte qu'il a étendu le christianisme «jusqu'à la limite au-delà de laquelle plus aucun homme ne vit». Selon toute vraisemblance, cela ne peut concerner que l'île d'Eirinn (Hibernia). Patrick meurt en 462.
Brendan en Amérique?
Dans un écrit du 8ième siècle, le Catalogus Sanctorum Hiberniae, dans lequel on trouve beaucoup de détails concernant l'église monacale irlandaise, on parle des monastères et de leurs fondateurs. L'Ile était recouverte de monastères, dont beaucoup étaient des écoles de haute spiritualité. En concordance avec la culture celtique-chrétienne, ce serait Sainte Brigit qui aurait fondé le célèbre monastère féminin de Kildare au 5ième siècle. A proximité, se trouvait un monastère masculin; elle les dirigeaient tous les deux en tant qu'Abbesse vers 500. Au même moment, Saint Brendan fonde Clonfert. Celui-ci nous a laissé le récit d'un long voyage sur l'océan, que l'on avait toujours pris pour de la pure fantaisie, jusqu'au moment où l'on s'est aperçu qu'il contenait des observations et des descriptions très précises en matières de navigation et de géographie. Cette précision atteste que des moines irlandais, sans doute à la recherche du pays des Bienheureux, ont sans doute atteint l'Amérique, en passant par l'Islande et le Groenland.
Puisque la christianisation de l'Irlande a été le fait de moines qui s'y sont fixés en communautés monastiques, les chrétiens qui habitaient les villages environnants appartenaient également au monastère. Dans les villes seulement, on devait célébrer des offices ailleurs que dans les monastères. Selon les vieilles règles coutumières et claniques des Celtes, l'Abbé ou l'Abbesse était propriétaire des terres et de la fortune du monastère. Or le territoire couvert par un monastère pouvait souvent avoir la taille d'une principauté. C'était les chefs de tribus qui confiaient leurs terres ou une partie de leurs terres aux moines. Raison pour laquelle ils réclamaient pour eux-mêmes la dignité d'Abbé, et la transmettaient de génération en génération. Les moines devaient obéissance à leur Abbé ou à leur Abbesse, comme les simples membres d'un clan à leur chef.
La configuration des monatères variait selon son importance ou selon la région où il se trouvait. Au centre du complexe architectural, il y avait toujours le bâtiment où l'on célébrait les offices religieux. Autour de celui-ci se regroupaient sans ordre précis les cellules monacales et les habitations. Parfois, toute la petite agglomération est entourée d'une palissade ou d'un mur de protection. Généralement, il y a également une tour, pourvue de cloches. Les bâtiments sont en bois ou en torchis (branchages recouverts de terre séchée). Le cimetière est hors les murs et toujours entouré d'une palissade ou d'un mur. Le chemin qui y mène est entouré de croix de bois ou de pierre.
On entre au monastère entre l'âge de quinze et dix-sept ans. On y passe d'abord trois années de probation. Les moines prennent en charge l'éducation et l'enseignement. L'idéal ascétique des moines égyptiens ne s'est pas imposé d'emblée. Le célibat, par exemple, ne s'est imposé qu'après de longues disputes vers la fin du 7ième siècle. A partir de cette époque, les contraventions aux règles monacales sont punies de lourdes peines; dans les locaux du monastère, les moines doivent garder le silence absolu.
Le pain est la nourriture principale. L'eau, la seule boisson tolérée. Ce n'est qu'après de longues décennies de querelles que des règles nouvelles acceptent la bière et, plus rarement, le vin. Pendant les périodes de jeûne, la nourriture est encore plus chiche. Mais, en contrepartie, les moines, y compris leur Abbé, doivent être autonomes et produire eux-mêmes leur nourriture. Les moines doivent donc travailler la terre et élever du bétail, filer et tisser, confectionner leurs vêtements, fabriquer des meubles et des outils. On ne sait pas grand'chose des règles du culte à cette époque, sauf que le jeudi saint, les moines se lavaient mutuellement les pieds et qu'au jour de Pâques, on pratiquait le vieux rite de bouter le feu au «bûcher pascal». Enfin, comme chaque tribu ou clan avait son propre monastère, chaque monastère avait ses propres coutumes et ses propres fêtes religieuses.
Textes antiques et légendes celtiques
Le travail intellectuel qui s'effectuait dans les monastères irlandais, consistait à approfondir les éléments de la foi chrétienne mais aussi et surtout à transmettre le savoir de l'antiquité classique, sur base des manuscrits disponibles, ainsi qu'à transcirre l'héritage oral des Celtes. Dans les enluminures, qui sont parmi les plus belles du monde, nous retrouvons des symboles de la vieille Irlande celtique et de l'Orient. Dans les arts plastiques, ces symboles sont également très présents (Croix; grandes croix irlandaises ou celtiques). Le latin est langue d'église, de science et d'écriture; la langue quotidienne celtique, elle, n'a jamais été éradiquée.
Columcille et Iona
L'expansion vers l'Est de l'église monacale celtique-irlandaise a commencé à partir d'Iona en Ecosse. Ce monastère avait été fondé par Columcille, que l'on appelle aussi Colomban l'Ancien. Columcille descendait d'une famille illustre; il est né en 521 et, dès l'âge de quinze ans, reçoit une formation dans plusieurs monastères. Les chroniques le décrivent comme un homme de haute stature, de grande intelligence, animé par un fougueux enthousiasme pour sa foi, comme un excellent poète et un bon copiste de textes anciens. Vers l'âge de trente ans, il quitte son monastère avec sept compagnons pour fonder de nouveaux monastères en Irlande. Là-bas, il eut une idée audacieuse qu'il mit aussitôt en pratique: en 563, il traverse la mer en direction de l'île de Hy (hy = île), située en face de la grande île de Mull sur la côte occidentale de l'Ecosse. Pour Columcille, Hy était la porte vers la Bretagne ex-romaine et le Continent, tout en étant suffisamment isolée pour pouvoir y servir Dieu dans la paix et la sérénité. Dans d'autres chroniques, on apprend qu'il aurait été mêlé à un bain de sang, perpétré par un roi irlandais, et que c'est la raison principale de sa fuite.
Imitation de Saint Antoine
Pour comprendre cette attitude, il faut savoir que l'une des caractéristiques essentielles du monachisme irlandais est de suivre l'exemple de Saint Antoine, qui consiste à partir dans le désert, s'éloigner de sa patrie, de tout ce que l'on aime et de tout ce qui est familier, pour expier ses péchés et pour ne plus se consacrer qu'à Dieu; mais aussi, dans la foulée, à convaincre d'autres personnes d'imiter cet exemple et de mener une vie de sainteté. Dans ce sens, les moines doués étaient sollicités par deux appels contradictoires: partir vers un pays lointain mais demeurer à l'abri du monde, sur une île par exemple, et d'y fonder un monastère tout en militant pour la conversion des autres. Derrière cette pratique religieuse, nous retrouvons l'antique coutume d'exclure les malfaiteurs ou ceux qui ont, par leurs actes ou par leurs omissions, jeté le discrédit sur la communauté ou entaché son honneur; les «bannis» sont ainsi envoyés vers des contrées inhabitées. Columcille, bien sûr, n'était pas un malfaiteur, car son départ n'a pas été secret et s'est fait avec l'appui de sa communauté. Mais il se sentait coupable. A l'île qu'il s'est choisie, il donne le nom d'Iona, mot hébreu signifiant la colombe. Son nom «Columcille» signifie en langue celtique «colombe de l'Eglise»; ce n'est pas son nom d'origine, mais celui qu'il a acquis et légué à la postérité.
Columcille et ses moines ont rendu l'île fertile et habitable; ils y ont construit une église en bois; puis des bâteaux avec l'aide d'habitants du pays. Les moines assurent par la suite l'éducation des enfants et prodiguent des soins aux malades. L'île, désormais habitable, attire des colons. La vie du monastère s'épanouit. Mot d'ordre: le travail est prière et la prière est travail. Les missionnaires issus d'Iona partent chez les Pictes, qui ne connaissaient encore rien du christianisme, puis vers les Orkneys et les Shetlands, vers l'Islande. En 583, Columcille couronne le premier roi des tribus pictes unifiées. Iona hérite du savoir de la «Candida Casa» de Withorn et devient de la sorte le berceau de la chrétienté écossaise. Raison pour laquelle on parle d'«église monacale» irlando-écossaise. Quand Columcille meurt en 597, après 34 années de travail, des monastères ont été fondés dans le sud de l'Angleterre; sa réputation a atteint les Francs de Gaule, les Wisigoths d'Espagne et les Lombards.
Destruction et reconstruction d'Iona
Après la mort de Columcille, son œuvre est poursuivie par des moines issus d'Irlande, jusqu'en 806 où l'île est attaquée par les Vikings qui détruisent le monastère. L'île sacrée devient alors une île des morts: en souvenir de son importance capitale, le premier roi du Royaume-Uni des Pictes d'Ecosse s'y fait inhumer en 860. Par la suite, Iona, pendant plus de 200 ans, devient le cimetière des rois de cette contrée septentrionale d'Europe. Dans ce cimetière royal, le Reilig Odhrain, nous trouvons les tombes de 48 rois écossais, 4 rois irlandais et 8 rois norvégiens; parmi eux: Duncan et son meurtrier Macbeth. Quand, au début du XIIIième siècle, s'établissent à Iona une abbaye bénédictine et un couvent de pères augustins, c'en est fini de la tradition irlandaise. Mais en 1938, quelque 150 hommes et femmes fondent la Iona Community sous l'égide du prêtre-ouvrier Macleod de Glasgow, qui, grâce à des dons, a entrepris de reconstruire l'Abbaye de Columcille.
Johanna BECK.
(texte issu de Mensch und Maß, 27ième année, n°4 [23.2.1987]; adresse: Ammerseestr. 2, D-8121 Pähl).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, celtes, celtisme, celtitude, irlande, ecosse, christianisme, monachisme, haut moyen âge |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 02 juillet 2009
La passé païen de Saint Nicolas

Le passé païen de Saint Nicolas
d'après Michael Damböck
On ne peut déterminer avec certitude les origines historiques de la figure de Saint-Nicolas. Aucun des récits relatant ses faits et gestes ne peut être attesté. La tradition chrétienne en fait le fils unique de parents riches, né vers 270 à Patras, une ville de Lycie en Asie Mineure. Il se serait distingué par sa piété et ses bienfaits. Sur ordre de Dieu, il aurait été oint évêque de Myra. Il serait mort en 342 ou en 347. Il aurait participé au Premier Concile de Nicée en 325, où il aurait pourfendu la thèse d'Arius, qui postulait des natures différentes pour chaque personne divine, et lui aurait opposé le point de vue orthodoxe, c'est-à-dire celui de la Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.
D'après la légende chrétienne, les ossements de ce saint fabuleux auraient été transportés en 1087 de Myra à Bari en Italie méridionale. Depuis lors, son culte n'a pas cessé de croître en Occident. Au début, les progrès de ce culte ont ressemblé à un véritable triomphe. Il a suivi les voies fluviales de l'Europe centrale et septentrionale, de même que les voies terrestres qui partaient d'Italie pour mener en France et en Allemagne. Cologne et Trêves sont devenues ainsi des hauts lieux du culte de Saint-Nicolas. Ce culte s'est ensuite étendu au Danemark, en Scandinavie et en Islande, de même que dans les colonies allemandes de Silésie et de Poméranie et, enfin, dans les villes baltes de Riga et de Reval. Dans l'Eglise orthodoxe, Saint-Nicolas était le de Dieu et on le priait pour obtenir toutes les faveurs possibles et imaginables. Russes et Bulgares disent encore aujourd'hui que Dieu mourait, ils ferait de Saint-Nicolas le nouveau Bon Dieu.
L'évêque des Enfants
Le jour de la Saint-Nicolas (le 6 décembre) était, au Moyen Age, le jour où l'on élisait l' (vers la fin du 13ième siècle). Avant que cette coutume ne s'impose, on fêtait l' un autre jour du temps de Noël, plus exactement le 28 décembre, jour de la fête des Saints Innocents. Au cours de cette fête, les jeunes clercs et escholiers choisissaient un parmi les leurs. L'élu devenait le maître de la cérémonie et dirigeait une procession en grande pompe, devenant, pour le temps de la fête, le maître de l'Eglise locale. Ce est à l'origine de la fête de Saint-Nicolas. L'Eglise, lors du Concile de Constantinople, a tenté d'interdire cette élection de l', mais a dû finir par la tolérer. La fête de l'évêque des escholiers était une véritable bouffonerie (comme l'est encore la fête des étudiants catholiques wallons, qui élisent un et se promènent dans les rues de Bruxelles, Namur, Louvain, etc. en commettant joyeusement quantité de bouffoneries, ndlr). Le parallèle entre cette fête de Saint-Nicolas et la fête médiévale des bouffons (ou des fous) est évident.
Quelle est la raison fondamentale du succès de ce culte et de son extraordinaire popularité? Saint-Nicolas est le protecteur des marins, des voyageurs, des pêcheurs, des constructeurs de ponts, des colons germaniques s'installant de l'Oder au Golfe de Finlande. Devenu au fil des temps le saint patron des voyageurs que guettaient bien des périls, Saint-Nicolas a fini également par étendre sa protection aux voleurs et aux brigands. Un détenu de la prison de Cologne avait, en 1933, un curieux tatouage sur le bras; il montrait deux larons et l'inscription suivante: !
Les racines mythologiques
de Saint-Nicolas
Saint Nicolas a remplacé dans le , le vieux dieu germanique des eaux, Hnikar (ou Nikuz). Hnikar est toutefois un surnom d'Odin. Voilà pourquoi Saint Nicolas était toujours représenté monté sur un cheval blanc et qu'il est devenu le patron des marins et des bateliers. Nos ancêtres tenaient énormément à leurs dieux et retransformaient rapidement tous les saints chrétiens, venus d'Asie Mineure ou du bassin méditerranéen, en des figures familières et bienveillantes, qui n'étaient rien d'autre que leurs bonnes vieilles divinités germaniques. L'Eglise était obligée d'attribuer à ses propres saints les caractéristiques immémoriales des dieux germaniques qui étaient honorés selon les traditions du peuple. Comme Saint-Nicolas remplace Odin dans l'imaginaire populaire, on le voit arriver sur son cheval blanc pour aller de maison en maison apporter des cadeaux, notamment des fruits: pommes, poires, noix voire des pâtisseries. Plusieurs sortes de biscuits sont associés à Saint-Nicolas (il nous en reste les speculoos, biscuits au gingembre à l'effigie du saint). D'autres pâtisseries représentent des animaux: coqs, poules, lièvres, cerfs, chevaux ou cochons (aujourd'hui ils sont en chocolat ou en massepain, notamment les cochons). Ces animaux en biscuit, massepain ou chocolat remplacent en fait les animaux que l'on sacrifiait en ce jour pour satisfaire le culte des âmes.
Les enfants, la veille, chantent des chansons ou récitent des prières pour Saint-Nicolas et en marquent le nombre sur une petite tablette carrée en bois, pour montrer leur piété. Ces tablettes (Klosahölzl en Bavière; les petits bois de Nicolas) sont déposées à côté de leur assiette. Coutumes encore respectées en Flandre et en Wallonie où les enfants font un dessin pour Saint-Nicolas qu'ils déposent sur la table où l'on placera leurs cadeaux. Sans oublier ni leur petit soulier ni une carotte pour son âne (qui a remplacé le beau cheval blanc d'Odin).
D'après Michael Damböck, Das deutsche Jahr in Brauchtum, Sage und Mythologie. Feste und Feiern im Jahreslauf, Verlag Damböck, Ardagger (Autriche), 1990, ISBN 3-900589-04-6.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, christianisme, paganisme, saints |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 juin 2009
De l'humanisme italien au paganisme germanique: avatars de la critique du christianisme dans l'Europe moderne et contemporaine

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
De l'humanisme italien au paganisme germanique: avatars de la critique du christianisme dans l'Europe moderne et contemporaine
Robert STEUCKERS
Conférence prononcée au Palais des Congrès d'Aix-en-Provence le 12 janvier 1997, à l'invitation de l'association Yggdrasil
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis et camarades,
Le premier cadre unificateur solide qu'a connu la civilisation européenne reste l'empire romain, qui a d'abord été repris en mains par les Francs, puis par la Nation Germanique, mais flanqué d'une institution parallèle se réclamant elle aussi, dans une certaine mesure, de la “forme romaine”: l'Eglise catholique. De la chute de Rome à l'émergence des Etats nationaux à partir de la Renaissance, l'écoumène européen est un mixte complexe de romanité, de germanité et de christianisme, avec des apports importants, négligés jusqu'ici par l'historiographie ouest-européenne, mais étudiés en profondeur en Europe slave: ces apports sont la religiosité celtique déformée par les moines missionnaires irlandais et les “mystères pontiques”, nés sur le pourtour de la Mer Noire, liés à l'antique Iran avestique. C'est ce leg scythe-sarmate-iranien qui aurait transmis l'idéal (ou certains idéaux) de la chevalerie médiévale. Mais quand cesse de fonctionner plus ou moins harmonieusement cette synthèse qui a dominé vaille que vaille des Mérovingiens à Louis XI, à Charles le Hardi (dit le “Téméraire” en France) et à Maximilien de Habsbourg, quelques représentants de la pensée européenne entendent opérer un retour aux origines les plus vierges de l'européité.
Quels textes vont-ils être sollicités pour retourner aux sources les plus anciennes de l'Europe? Sources qui précèdent évidemment la christianisation. Ces textes sont les seuls qui évoquent une Europe non marquée par les routines et les travestissements de la civilisation romaine ou chrétienne, non marquée par ses étiquettes et ses hypocrisies. Pour les humanistes du XVième siècle italien qui entendent retrouver une vigueur vitale simple derrière la rigueur compliquée et figée des étiquettes (celles des cours et, en particulier, de la Cour des Ducs de Bourgogne) ou qui entendent renouer avec une notion de liberté publique et civique pour faire face aux premières manifestations de l'absolutisme royal, le modèle de l'Europe pré-romaine et “pré-civilisée” est celle des peuples germaniques de l'antiquité. Ceux-ci ont gardé en eux les vertus simples et efficaces des premiers Romains, disent nos humanistes de la Renaissance. En 1441, l'historien italien Leonardo Bruni, qui s'inscrit dans une perspective républicaine au sens vieux-romain et germanique du terme, redécouvre les textes latins sur les Goths, notamment ceux de Procope de Césarée. C'est lui qui donne le coup d'envoi à l'“humanisme gothique”, qui poursuivra sa trajectoire jusqu'à Vico et Montesquieu, fondera le nationalisme des Allemands, des Scandinaves et des Flamands et débouchera sur les spéculations et les communautés “völkische” de toutes tendances qui ont vu le jour dans le sillage des mouvements de jeunesse du début de notre siècle.
En 1453, un autre humaniste italien, Enea Silvio Piccolomini, rédige quelques réflexions sur le De origine actibusque Getarum de Jordanès, permettant aux érudits de mieux connaître les origines des peuples germaniques. En 1470, à Venise, grâce à la nouvelle technique de l'imprimerie, Vindelino da Spira (Windelin von Speyer), réédite la Germania de Tacite, qui devient du même coup l'ouvrage de référence de tous ceux qui revendiquent une idéologie à la fois républicaine (au sens vieux-romain du terme) et communautaire, donnant à la représentation populaire une place cardinale dans la vie politique, les assemblées d'hommes libres se plaçant au-dessus des monarques. Avant cette réédition de la Germania de Tacite, le texte n'était accessible qu'à une poignée de privilégiés, dans les bibliothèques des monastères; désormais, il est accessible à un grand nombre de lettrés. Les peuples germaniques n'apparaissent plus systématiquement comme des barbares cupides et violents qui avaient pillé Rome en 410 (ou en 412 comme on le croyait à l'époque). L'humaniste Flavio Biondo, entre 1438 et 1453, après avoir réhabilité prudemment la figure du Roi ostrogoth Théodoric, analyse les causes de la décadence de Rome: elles se ramènent pour l'essentiel à l'amenuisement des vertus républicaines, à l'abandon de la souveraineté populaire au profit d'un monarque isolé. Flavio Biondo anticipe ainsi Machiavel, fondateur d'une idéologie républicaine, fondée sur la virtù politique, héritée de la Rome la plus ancienne.
Ce rappel de l'œuvre des premiers humanistes de la Renaissance italienne nous montre que le recours à une antiquité pré-chrétienne et païenne, en l'occurrence la Germanie non romanisée, est une revendication républicaine, hostile à l'absolutisme et aux démarches de type théocratique. Il faut ajouter que le travail de Biondo ne participe nullement d'un primitivisme qui poserait ante litteram les Germains de Tacite comme de “bons sauvages” non exotiques. Biondo est anti-primitiviste: il ne veut pas d'une sympathique anarchie pastoraliste mais, au contraire, promouvoir un ordre non décadant: son Théodoric n'est dès lors pas décrit comme un barbare vertueux et inculte, qui végète sans orgueil dans une simplicité rustique, mais un Roi cultivé et efficace, qui consolide son pouvoir, administre ses Etats et restaure en Italie une Rome dans ses principes premiers, c'est-à-dire dans des principes antérieurs à la décadence, qu'il est capable d'imposer parce que, roi germanique, il a conservé les vieilles vertus romaines qui sont les vertus germaniques de son temps. Le Théodoric de Biondo est un Prince “humaniste”, qui annonce le Prince fictif de Machiavel, dont l'influence sur la science politique et la philosophie de l'Etat n'est pas à démontrer.
Reprocher aujourd'hui à des chercheurs de recourir à des passés anciens pour retrouver les principes premiers d'une communauté politique ou les fondements du droit, et considérer dans le même temps que ces reproches se justifient au nom d'une “idéologie républicaine”, est une contradiction majeure. Ne peuvent être considérés comme républicains au plein sens du terme que ceux qui n'ont de cesse de retourner aux principes premiers de l'histoire politique de leur peuple. Les autres travestissent en républicanisme leur autoritarisme ou leur théocratisme (qui est et demeure théocratisme même quand ils baptisent “Dieu”, “Logos”).
Enea Silvio (Æneas Silvius) Piccolomini, spécialiste des Goths et d'abord chancelier de l'Empereur germanique Frédéric III puis Pape sous le nom de Pie II (de 1458 à 1464), rejette explicitement le primitivisme et demande aux humanistes et érudits de ne pas interpréter la Germania de Tacite dans un sens pastoraliste et primitiviste, ce qui reviendrait à rejeter tous les apports de la civilisation, quels qu'ils soient. Polémiquant avec Martin Mayer (ou Mair) de Mayence, qui interprète Tacite au pied de la lettre et voit ses ancêtres chattes, suèves ou alamans comme de bons bergers idylliques, Piccolomini parie au contraire pour la Germanie de son temps, avec ses richesses, ses fabriques, ses industries, son agriculture, dont la Flandre et le Brabant sont les plus beaux joyaux. Cette Germanie élargie aux anciennes provinces romaines limitrophes (Belgica, Helvetia, Rhætia, Pannonia) doit sa prospérité matérielle et ses richesses culturelles à une vertu que Tacite avait bien mise en exergue: la liberté. Dans ses textes métapolitiques relatifs au monde germanique, en dépit de sa position de Chancelier impérial et de futur Pape, Piccolomini est donc un républicain, au même titre que Biondo et, plus tard, Machiavel. La liberté germanique est une vertu politique dans le sens où elle octroie à tous ses ressortissants des droits garantis, permettant le libre déploiement de leurs talents personnels. La liberté de Piccolomini n'est donc pas une “innocence” ou une “inactivité” mais un tremplin vers des réalisations sociales, politiques et économiques concrètes. Cette liberté-là, qui libère quantité de potentialités positives, doit être imitée par tous les Européens de son temps, pense-t-il, doit sortir de cette Germanie, qui est en charge de la dignité impériale depuis la translatio imperii ad Germanos. Depuis cette translatio, les Germains sont “Romains” au sens politique du terme. Et comme ils sont les porteurs de l'impérialité, ils sont davantage “romains” que les Italiens du temps de Piccolomini. C'est derrière leur bannière que les peuples d'Europe doivent se ranger, écrit le futur Pie II, pour barrer la route à la puissance ottomane, qui, elle, n'est en rien “romaine” à ses yeux.
Ces réflexions sur la “pureté primitive” des Germains de Tacite, sur la notion germanique de liberté et sur l'impérialité militaire des Germains amènent Piccolomini à rédiger en 1458, quelques mois avant d'accéder à la dignité pontificale, un manifeste européen, intitulé De Europa, où la Germanie est décrite comme le centre de gravité géographique d'une Europe qui doit s'apprêter à affronter rapidement l'Empire ottoman, pour ne pas succomber sous ses coups. Piccolomini meurt en 1464, très désappointé de ne pas avoir été écouté et de ne pas avoir vu l'Europe entière unie autour de l'Empereur et du Saint-Siège, pour faire face en Méditerranée et dans les Balkans à la puissance ottomane. L'œuvre de Piccolomini, le futur Pape Pie II, est donc intéressante à plus d'un titre, car:
- elle autorise la référence constante aux racines les plus anciennes de l'Europe;
- elle fait de la liberté civique/populaire la vertu cardinale du politique;
- elle rejette les interprétations primitivistes qui sont politiquement incapacitantes (et refuse sans pitié les “germanismes” primitivistes);
- elle réinscrit ce double recours aux racines et à la liberté populaire dans un cadre géopolitique européen, dont les fondements n'apparaissent plus comme exclusivement chrétiens, mais comme consubstantiels à la population majoritaire du centre de l'Europe.
Face à la “correction politique” que certains cénacles tentent d'imposer en France et ailleurs depuis deux décennies, il m'apparaît bon de méditer l'œuvre de ces humanistes et de ce Pape géopolitologue. En effet, les officines “politiquement correctes”, en décrivant ces recours comme des avatars plus ou moins maladroits du nazisme, ignorent et rejettent le travail positif des humanistes et des érudits italiens du début de la Renaissance, qui s'apprêtaient à relancer dans le débat politique européen la notion de liberté républicaine, une liberté féconde pour les arts et l'industrie. Comment expliquer la réticence de ces cénacles français contemporains, qui se disent “républicains”, mais se montrent hostiles à la démarche intellectuelle, philologique, qui a réhabilité le républicanisme de la Vieille Rome, mis en évidence les vertus germaniques “primitives” et l'idée de liberté? Parce que dans la France du 16ième siècle, le recours aux racines germaniques, franques en l'occurrence, de l'histoire française n'est pas un recours à la liberté populaire, mais une justification du pouvoir franc sur le substrat démographique “gallo-romain” ou “celto-ligure”. Ou du moins est-il perçu comme tel. La notion de “liberté” des humanistes et érudits italiens est en revanche une notion plus vaste, ne faisant pas référence à la conquête d'un territoire par une ethnie guerrière dominante qui s'attribuera des franchises, mais à un principe général d'autonomie des communautés politiques, qu'il s'agit de conserver pour libérer des énergies positives. Le cas de la Gaule envahie par les Francs de souche germanique n'est pas un cas susceptible d'être généralisé à l'Europe entière.
De Machiavel à Vico, de Vico à Montesquieu, la notion de liberté est défendue et illustrée par des exemples tirés des sources latines classiques relative au monde germanique. Quand la France entre dans l'ère républicaine à partir de 1789, les romantiques allemands, libertaires se réfèrant à la vision idyllique de la Germanie primitive, adhèrent avec enthousiasme aux idées nouvelles. Mais ils déchantent très vite quand se déchaîne la Terreur et s'installe la Convention. Ainsi, le poète Friedrich Gottlieb Klopstock rédige en 1794 un poème appelant à une “guerre chérusque” contre une France qu'il juge faussement “républicaine”, au nom de ses propres valeurs républicaines. Dans cet appel guerrier, il invoque la puissance des dieux et des déesses de l'ancienne Germanie: Hlyn, Freya, Nossa, Wodan, Thor et Tyr. Dans ce texte, les dieux de l'Edda ne sont encore que des ornements poétiques. Pour Klopstock, la France a retrouvé brièvement sa liberté, a incarné par sa Révolution l'idéal multiséculaire de cette liberté germanique, mais elle s'en est très vite détournée. La seconde vague des révolutionnaires a trahi l'idée sublime de liberté que Montesquieu avait défendue et n'a pas davantage réalisé l'idéal de Thomas Jefferson qui voulait que le sceau du nouvel Etat nord-américain invoquât “les enfants d'Israël” d'une part, biblisme oblige, mais aussi les figures de “Hengist et Horsa, chefs saxons, dont les Anglais descendaient et dont les nouveaux citoyens des Etats-Unis devaient défendre les principes politiques et reprendre les modes de gouvernement”. On le voit, dans un premier temps, le recours à la liberté germanique n'exclut pas les références à l'héritage biblique, mais, dans un deuxième temps, les figures de la Bible disparaissent et les spéculations idéologico-politiques se portent sur les dieux païens de l'antiquité germanique. Plusieurs facteurs ont provoqué cet infléchissement vers le passé le plus lointain de l'Allemagne ou de la Scandinavie, facteurs que nous retrouvons ultérieurement dans presque toutes les références habituelles aux paganismes que l'on énonce en Europe et en Amérique du Nord:
- premier facteur, l'idée de la relativité historique des cultures, véhiculée dans le sillage des travaux philosophiques de Herder;
- deuxième facteur, issu directement de l'idéologie des Lumières: la critique du cléricalisme qui entraîne une critique des missions chrétiennes de l'époque carolingienne. Le catholicisme d'abord, puis le christianisme en général, sont accusés d'avoir oblitéré la liberté germanique et d'avoir, via l'augustinisme, introduit un “courant doloriste”, dans la pensée européenne, rejetant et condamnant ce “bas-monde” imparfait en espérant le ciel, dévalorisant les cités terrestres au profit d'une hypothétique “Jérusalem céleste”. Les Romantiques, les vitalistes et les néo-païens rejettent instinctivement un courant fort complexe qui part d'Augustin pour retrouver les flagellants du Moyen Age, pour revenir sous d'autres formes chez les Puritains de Cromwell et chez les Jansénistes français, et, enfin, pour aboutir à certains “Républicains” français athées ou agnostiques, mais fascinés par les concepts géométrisés des Lumières, qu'ils opposent à toutes les turbulences de la vie des peuples, jugées comme des imperfections qu'il faut effacer pour “perfectionner” le monde.
Herder, bien que pasteur protestant, critique modérément les conversions forcées du Nord de l'Europe, mais, si ses critiques sont furtives, à peine perceptibles dans son œuvre, sa notion de la relativité des cultures et sa revalorisation des aurores culturelles font des disciples au langage plus idéologique, moins nuancé et plus programmatique. Ainsi, en 1802, le Conseiller d'Etat prussien Wilhelm Reynitzsch publie à Gotha un ouvrage qui donne véritablement le coup d'envoi aux futures spéculations “völkisch” (folcistes) et celtisantes, d'autant plus qu'il confond encore allègrement Celtes et Germains, druides et scaldes. Son ouvrage, tissu de spéculations imprécises sur les Celtes et les Germains, est à l'origine de toutes les futures renaissances païennes, de factures germanique et celtique. Le livre de Reynitzsch est le premier à introduire des thématiques folcistes qui apparaîtront et réapparaîtront sans cesse ultérieurement. Ces thématiques sont les suivantes:
1. Les anciens Germains avaient une religion originelle monothéiste, dont le dieu était Tus ou Teut, force spirituelle des origines, dont ils ne pouvait ni sculpter ni peindre ni dessiner les traits. Cette thématique montre que le clivage entre monothéisme et polythéisme, vulgarisé par Bernard-Henry Lévy et Alain de Benoist, est historiquement plus récent et ne recoupe par nécessairement le clivage paganisme/christianisme.
2. Odin (Vodha) est un prophète divinisé qui aurait vécu vers 125 av. J.C. parmi le peuple des Goths dans les plaines de l'actuelle Russie ou de l'actuelle Ukraine et qui aurait apporté savoir et sagesse aux Germains de l'Ouest. Odin aurait pérégriné en Europe, accompagné par ses compagnons, les Ases, et par sa femme, Freya. L'idée d'un Odin historique puis divinisé, chez Reynitzsch, vise clairement à remplacer le Christ par cette figure du dieu borgne et inquiétant dans l'imaginaire religieux des Allemands.
3. Reynitzsch est quasiment le premier à ne plus dévaloriser les anciennes croyances, il leur octroie un statut de naturalité qu'il oppose aux doctrines, non naturelles, des “prêtres romains” (catholiques).
4. Reynitzsch veut fusionner ces croyances antiques avec le rationalisme du 18ième siècle, rattachant de la sorte son néo-paganisme au filon de l'idéologie des Lumières, ce qui ne sera plus le cas pour les néo-paganismes des années 20 et 30.
5. La christianisation est responsable de l'oppression des femmes (thème féministe), du déclin des anciennes coutumes (thèmes de la décadence et de la déperdition des énergies), de la servilité des Européens devant l'autorité (thème libertaire), de l'irrationalité et de la superstititon (thème anticlérical).
Reynitzsch appartient nettement à la tradition de l'Aufklärung et du rationalisme anticlérical. Ce haut fonctionnaire prussien est manifestement un disciple tardif de Voltaire et de son protecteur Frédéric II. Peu d'intellectuels allemands de son temps le suivront et l'on verra apparaître davantage, chez les nationalistes anti-napoléoniens, l'idée d'un “christianisme germanique” dur, chevaleresque et guerrier (ein Gott, der Eisen wachsen ließ, der duldet keine Knechte...), hérité plutôt du poème épique Heliand (le Sauveur), répandu en Germanie dans le haut moyen âge pour favoriser la conversion des autochtones: le Christ devait apparaître comme un preux guerrier et non pas comme un messie souffrant et humble.
En Scandinavie, en revanche, la thématique de l'affrontement entre christianisme et paganisme se propage plus distinctement par l'action d'une “Ligue gothique”, née en 1809. Le théologien danois Nicolai Frederik Severin Grundtvig rédige Nordens Mytologi, le livre de la mythologie nordique qui réhabilite totalement l'histoire pré-chrétienne du Danemark, pays où le système d'éducation ne tracera plus une ligne de démarcation entre un passé pré-chrétien systématiquement dévalorisé et une ère chrétienne systématiquement survalorisée. Mais Grundtvig, qui est pasteur, tente de réconcilier christianisme et paganisme, où le “Père” Odin, l'Allvater Odin, est, dit-il, le père véritable, charnel et inconnu de Jésus Christ!
Après les guerres napoléoniennes, sous la Restauration et à l'ère Metternich, les thématiques néo-païennes s'estompent, mais reviennent notamment en 1832 dans le mouvement nationaliste de gauche, pour revendiquer, via le recours aux antiquités germaniques et à la mythologie néo-païenne, une république populaire allemande, soustraire à l'idéologie restaurative de l'ère Metternich. Ainsi, lors des fêtes de Hambach en 1832, à laquelle participent des Polonais, des Français et des Italiens, l'agitateur nationaliste-révolutionnaire Philipp Jakob Siebenpfeiffer invoque “Thuisko, le dieu des libres Germains”, pour qu'il bénisse la lutte du petit peuple opprimé contre les Princes et les Rois. Le Frison radical-démocrate et socialiste Harro Harring appelle les dieux anciens à la rescousse pour lutter contre le “Trône et l'Autel”. On le voit: les références païennes indiquent toujours à cette époque un engagement radicalement révolutionnaire et libertaire, qui n'a rien à voir avec une restauration contre-révolutionnaire des “archétypes”, comme l'affirme à tort toute une historiographie pseudo-marxiste.
Plus tard, en dépit du marxisme social-démocrate qui considère que tout discours ou toute spéculation religieuse relève de la “fausse conscience”, la mouvance socialiste allemande ne cesse de véhiculer des bribes de paganisme et de naturalisme, au moins jusqu'à la fondation du IIième Reich en 1871. A partir de ce moment-là, la sociale-démocratie évacue de son discours toutes les formes d'“irrationalismes”, incluant non seulement les références poétiques ou néo-païennes aux dieux antiques, germaniques ou gréco-romains, mais aussi, ce qui est plus surprenant et peut-être plus grave, les thématiques très concrètes et très quotidiennes de la bonne alimentation, de l'abstinence de tabac et d'alcool en milieux ouvriers, de l'habitat sain et salubre (thématique majeure des socialistes “pré-raphaëlites” en Angleterre), de l'écologie et du respect de l'environnement naturel, de l'hygiène en général (y compris l'hygiène raciale que l'on retrouvera “sotériologisée” dans certains discours racistes ou sociaux-darwinistes ), du naturisme (réhabilitation et libération du corps, FKK), etc.
Cette évacuation et cette transformation du mouvement socialiste en une pure machine électorale et politicienne va provoquer le divorce entre le néo-paganisme (et tous les autres réformismes “naturalistes”), d'une part, et le socialisme-appareil, d'autre part. Ce divorce est à l'origine du courant “völkisch” (folciste), qui n'est pas “à droite” au départ mais bel et bien dans le même camp que les pionniers du socialisme, Marx et Engels compris.
En 1878, le philosophe Paul de Lagarde publie son ouvrage programmatique Die Religion der Zukunft (La religion de l'avenir). Il y développait la critique de l'“universalisation” du christianisme, qui allait entraîner la déperdition définitive de l'élan religieux dans le monde et plaidait en faveur de la réhabilitation des “religions nationales”, des élans de la foi partant d'un enracinement précis dans un sol, seuls élans capables de s'ancrer véritablement et durablement dans les âmes. Pour Paul de Lagarde, les religions locales sont dès lors les seules vraies religions et les religions universalistes, qui cherchent à quitter les lieux réels occupés par l'homme, sont dangereuses, perverses et contribuent finalement à éradiquer les vertus religieuses dans le monde.
Parallèlement à cette théologie du particulier s'insurgeant contre les théologies universalisantes, plusieurs autres idées s'incrustent dans la société allemande du 19ième siècle et finissent par influencer les cultures anglo-saxonnes, française et russe. Ces idées sont pour l'essentiel issues du bînome Schopenhauer-Wagner. Schopenhauer formule en un bref paragraphe de son ouvrage Parerga und Paralipomena le programme de tous les néo-paganismes ultérieurs, surtout les plus extrémistes et les plus hostiles aux Juifs: «Nous osons donc espérer qu'un jour l'Europe aussi sera nettoyée de toute la mythologie juive. Le siècle est sans doute venu où les peuples de langues japhétiques [= indo-eur.] issus d'Asie récupéreront à nouveau les religions sacrées de leur patrie: car, après de longs errements, ils sont enfin mûrs pour cela». L'antisémitisme qui saute aux yeux dans cette citation n'est plus un antisémitisme religieux, qui accuse le peuple juif d'avoir réclamé à Ponce-Pilate la mort du Christ, mais un antisémitisme qui considère toutes les formes d'héritage judaïque, y compris les formes christianisés, comme un apport étranger inutile qui n'a plus sa place en Europe. La référence “japhétique” ou “indo-européenne” ne relève pas encore d'un “aryanisme” mis en équation avec le germanisme, mais est une référence explicite aux études indiennes et sanskrites. Le “japhétisme” de Schopenhauer est donc indianiste et non pas celtisant ou germanisant.
Wagner ne sera pas aussi radical, bien qu'on prétende souvent le contraire. Il opposera certes binairement un optimisme (progressiste) juif à un pessimisme “aryen”, mais il tentera, comme les nationalistes allemands qui n'avaient pas suivi Reynitzsch et comme le Danois Grundtvig, de réconcilier christianisme et paganisme, en ne cherchant qu'à se débarrasser de l'Ancien Testament. Autre thématique née dans les cercles wagnériens: Marie n'est pas une “immaculée conception” mais une fille-mère qui a donné la vie au fils d'un légionnaire romain (de souche européenne), reprenant là une vieille thématique des polémiques anti-chrétiennes du Bas-Empire, et édulcorant la position extrême de Grundvigt, pour qui Jésus était le fils du prophète gothique Odin! Pour Wagner comme pour Houston Stewart Chamberlain, le Nouveau Testament est donc le récit d'un prophète de souche européenne, que révèle au mieux l'Evangile de Jean car il met bien en évidence la quête permanente du divin dans la personne de Jésus de Nazareth, quête qui est une révolte contre la religion figée et étriquée des Pharisiens de l'époque, qui ne remettaient rien en question et ne confrontaient jamais leurs dogmes aux aléas du réel.
A-t-on affaire ici à de pures spéculations nées dans des cercles repliés sur eux-mêmes, qui connaissent un certain succès de mode mais ne touchent pas la majorité de la population? Oui et non. Ces spéculations ne naissent pas dans des cerveaux imaginatifs. Elles sont le produit des sciences humaines du 19ième siècle, où l'historicisme, l'éthique et la rationalisation progressent et font du christianisme non plus LE grand et unique récit de la civilisation occidentale, mais un récit parmi d'innombrables autres récits. Il a une histoire, qu'il s'agit désormais de ramener à ses justes proportions; il est la volonté de vivre une certaine éthique, qu'il s'agit de définir clairement; il est l'expression imagée et merveilleuse d'un projet de société et de vie parfaitement raisonnable. Ce scientisme des sciences humaines semble incontournable à la veille du 20ième siècle. Le pasteur protestant progressiste Friedrich Naumann, qui sera plus tard nationaliste et théoricien de la Mitteleuropa et d'une forme de planisme en économie, entamera une “mission” dans le monde ouvrier en vue de ramener les prolétaires déchristianisés dans le giron de l'Eglise réformée évangélique; il axera sa pastorale autour de la figure d'un “Christ socialiste et homme du peuple”, d'un Christ travailleur et charpentier, thématique de récupération qui nous reviendra dans les années 60 de notre siècle, mais dans une perspective différente. A l'époque de Naumann, vers 1890, cette idée paraît totalement incongrue et la mission échoue. Naumann ne retourne pas au christianisme, il s'en éloigne, récapitulant dans sa personne toutes les étapes de la culture allemande en matière religieuse: protestant par protestation anti-catholique, chrétien-ouvrier par refus de la bourgeoisie protestante à la foi sèche et rébarbative, païen par refus de l'inculture sociale-démocrate et de la fébrilité politicienne.
En Autriche, les pangermanistes se mobilisent, s'ancrent dans le camp libéral autour de la personne de Georg von Schönerer, s'opposent tout à la fois aux Juifs, aux Habsbourgs et à l'église catholique qui les soutient. Schönerer veut imposer un calendrier “völkisch”, qui commencerait en 113 av. J.C., date de la victoire des Cimbres et des Teutons sur les Romains à Noreia. Dans certains cercles pangermanistes proches de Schönerer, on fête les solstices et deux courants commencent à se profiler:
a) les adeptes d'une religion immanente de la nature et des lieux concrets, regroupés autour de la revue Der Scherer; ce filon du néo-paganisme allemand mêle un refus des mécanisations de la société industrielle, surtout de ses effets pervers, à une volonté de rééquilibrer la vie quotidienne dans les grandes villes, en organisant des services d'hygiène, des manifestations sportives, des randonnées, en réclamant des espaces verts, des excursions ou des séjours à la campagne, en renvoyant dos à dos ce qui ne lui paraissait plus “naturel”, à savoir le moralisme étriqué des églises conventionnelles et la vie dans les villes surpeuplées, sans air et sans lumière. C'est sur ce courant que se brancheront très vite les mouvements de jeunesse, tels le Wandervogel. Ce filon m'apparaît toujours fécond.
b) les adeptes d'une nouvelle religiosité plus tournée vers l'occultisme, regroupés autour de la revue Heimdall.
Dans les années 1890, l'occultisme connaît en effet une renaissance en Allemagne: Guido von List développe une théosophie, tandis que Jörg Lanz von Liebenfels théorise une “aryosophie”, qui débouchera en 1907 sur la fondation d'un “Ordo Novi Templi”, sorte de loge où fusionnent en un syncrétisme bizarre les références germanisantes, un christianisme “aryen” et des rituels maçonniques. Ce filon-là du néo-paganisme allemand m'apparaît très spéculatif, peu susceptible d'être transmis à de larges strates de la population voire à des élites restreintes mais quand même assez nombreuses pour créer des espaces de résistance durables et efficaces dans la société. Enfin, la veine occultiste a suscité et suscite encore beaucoup de fantasmes, qu'exploitent souvent les journalistes en mal de sensationnel. La seule et unique chance pour le mouvement occultiste de se maintenir à l'heure actuelle reste, à mon avis, l'espace de la création musicale voire de la peinture ou de la sculpture. Ce filon demeure élitaire, marqué de rites et de gestes souvent mécompris. Il est indubitablement une expression de la culture européenne de ces 150 dernières années, mais il est peu susceptible de se généraliser dans la société et d'apporter une réponse immédiate aux blessures psychiques et physiques de l'ère industrielle et de l'âge des masses.
Mais si à l'époque ces tentatives naturalistes ou occultistes restent réservées à de très petits groupes, finalement fort marginalisés, d'autres tentent justement, au même moment, de s'ouvrir aux masses et de fonder une véritable “troisième confession”, qui se juxtaposera au catholicisme et au protestantisme en Allemagne. En 1900, Ernst Wachler, qui est juif et mourra en 1944 dans le camp de concentration de Theresienstadt, fonde la revue Deutsche Zeitschrift et appelle à un recours sans détours à la religiosité autochtone et pré-chrétienne de la Germanie. Parmi ceux qui répondront à son appel, il y avait, curieusement, des antisémites classiques comme Friedrich Lange et Theodor Fritsch, mais aussi une figure plus complexe et à notre sens plus significative, Wilhelm Schwaner, éditeur de la revue Der Volkserzieher et animateur du Volkserzieher-Bund. L'objectif est clair: il faut éduquer le peuple à des sentiments religieux, communautaires et sociaux différents de ceux de la société industrielle, renouer avec les archétypes d'une socialité moins conflictuelle et moins marquée par l'égoïsme. Schwaner est ce que l'on appelle à l'époque un Lebensreformer, un réformateur pragmatique de la vie quotidienne, ancré dans le parti social-démocrate et dans les cercles “libres-penseurs” du libéralisme de gauche, où il apprendra à connaître Walther Rathenau, qu'il influencera, notamment dans les définitions archétypales des races “aryennes” et “sémitiques” que ce ministre israëlite du Reich a utilisées très fréquemment dans ses écrits, prouvant par là même que ces spéculations sur les archétypes n'étaient pas l'apanage des seuls nationalistes, conservateurs ou militaristes. Mais Schwaner reste dans le no-man's-land entre “christianisme germanique” et “religiosité völkische”.
Après la première guerre mondiale, le nombre croît de ceux qui franchissent le pas et abandonnent cette position intermédiaire que représentait le “christianisme germanique”. Les païens avérés n'étaient pas plus de 200 dans l'Allemagne d'avant 1914. Ils se regroupaient dans deux cénacles intellectuels, la Deutschgläubige Gemeinschaft ou la Germanische Glaubens-Gemeinschaft. La plupart sont issus de la bourgeoisie protestante. Ceux qui proviennent du catholicisme gardent malgré tout des attaches avec leur milieu d'origine, car le catholicisme a conservé le culte des saints, avatars christianisés des dei loci, et bon nombre de fêtes folkloriques, notamment les carnavals de Rhénanie et d'Allemagne du Sud, dont la paganité foncière n'est certes pas à démontrer. L'absence de tels “sas” —entre superstrat chrétien et substrat païen— dans le protestantisme conduit plus aisément les contestataires protestants à revendiquer haut et fort leur paganisme. Parmi les premiers adhérants de la Deutschgläubige Gemeinschaft, nous trouvons Norbert Seibertz, qui nous a laissé une confession, où il exprime les motivations qui l'ont poussé à abandonner le christianisme. Elles sont variées, peut-être même un peu contradictoires:
- La vision chrétienne est en porte-à-faux avec les acquis des sciences naturelles. Ce premier motif de Seibertz est donc scientiste. Mais rapidement le monisme scientiste, vulgarisé par les matérialistes militants regroupés autour d'Ernst Haeckel, lui apparaît tout aussi insuffisant, non pas parce qu'il rejette le biologisme implicite de cette école antireligieuse, mais parce que cette volonté d'alignement sur les sciences exactes ne répond pas à la question du désenchantement.
- Les progrès des humanités gréco-latines sont tels au 19ième siècle, que le monde grec et romain suscite de plus en plus souvent l'enthousiasme des lycéens et des étudiants. Devant le sublime de la civilisation antique, le christianisme apparaît fade aux yeux du lycéen Seibertz.
Je dois vous confesser que ces deux motivations majeures de Seibertz ont été aussi les miennes, à quelques décennies de distance. Mais comment articuler ce double questionnement, comment retrouver le sens religieux au-delà d'une science qui ruine les dogmes chrétiens et au-delà d'humanités qui font apparaître le christianisme dans son ensemble comme un corpus bien fade, tout en ne pouvant plus ressusciter la paganité grecque ou romaine dans sa plénitude? Faut-il remplacer les catéchismes par un autre catéchisme, les icônes d'hier par de nouvelles icônes? Apparemment simple, cette question ne l'est pourtant pas. Si les icônes des églises sont automatiquement reconnues comme des icônes religieuses même par ceux qui ont tourné le dos au christianisme, instaurer de nouvelles icônes s'avère fort problématique, car comment générer le consensus autour d'elles et, pire, comment ne pas sombrer dans le ridicule et la parodie? Les débuts du néo-paganisme organisé en Allemagne ont été marqués par des querelles de cette nature. D'après Karlheinz Weißmann, réflexions, querelles et discussions ont permis, avant 1914, de dégager trois des principaux axes du néo-paganisme de notre siècle:
1. Le christianisme est une aliénation historique, qui a oblitéré les sentiments religieux spontanés des Européens. Ce constat découle des acquis des philologies classique et germanique. La religion conventionnelle est donc ravalée au rang d'une manifestation aliénante, elle est perçue comme une superstructure imposée par un pouvoir foncièrement étranger au peuple. Cette thématique de l'aliénation se greffe assez aisément à l'époque sur la “libre-pensée” du monde ouvrier et sur la critique socialiste de l'“opium du peuple”.
2. Les néo-paganismes semblent ensuite rejetter l'idée d'un Dieu personnel. Dieu, car ils sont païens et monothéistes, est une émanation cosmique de la force vitale à l'œuvre dans le monde, qui donne forme aux innombrables manifestations et phénomènes du réel. Sur ce panthéisme cosmique se greffent déjà à l'époque toutes les spéculations sur la Nature et la Terre, qui sous-tendent encore aujourd'hui les spéculations les plus audacieuses de la pensée écologique radicale, qui se donne le nom d'écospohie, de géomantie ou de “perspective gaïenne” (Edward Goldsmith). Cette option pour un dieu non personnel, compénétrant toutes les manifestations vitales, renoue également avec la mystique médiévale allemande d'un Maître Eckhart, considéré par les néo-païens comme le représentant d'une véritable religiosité européenne et germanique, transperçant la chape dogmatique de l'aliénation chrétienne. Ensuite, ce panthéisme implicite renoue avec le panthéisme de Goethe, prince des poètes allemands, mobilisé à son tour pour étayer les revendications anti-chrétiennes. Le néo-paganisme du début du siècle est donc monothéiste et panthéiste, dans ses rangs, on ne vénère pas les dieux comme les chrétiens vénéraient le Christ ou la Vierge ou les Saints ou les Archanges. On ne remplace pas les icônes chrétiennes par une iconologie néo-païenne. On reste au-delà de la foi naïve des masses.
3. Le troisième grand thème du néo-paganisme allemand du début du siècle est un rejet clair et net de la notion chrétienne du péché. Dieu n'est pas en face de l'homme pour les néo-païens. Il n'est pas dans un autre monde. Il ne donne pas d'injonctions et ne récompense pas après la mort. L'éthique néo-païenne est dès lors purement immanente et “héroïque”. Elle n'est pas ascétique selon le mode bouddhiste, elle n'exige pas de quitter le monde, mais chante la joie de vivre. L'éthique néo-païenne est acceptation du monde, elle cherche le divin dans toute chose, veut le mettre en exergue, l'exalter, et refuse toutes les formes de rejet du monde sous prétexte que celui-ci serait marqué d'imperfection. Cette dimension joyeuse du néo-paganisme, qui interdit de mécréer du monde, au contraire des spéculations néo-païennes plus philosophiques ou historiques sur l'aliénation ou le panthéisme, permet d'atteindre les masses, et plus particulièrement les mouvements de jeunesse. Couplé à l'écosophie implicite du panthéisme, ce culte de la joie est explosif sur les plans social et politique. En 1913, quand les mouvements de jeunesse d'orientation Wandervogel se réunissent autour de feux de camp au sommet du Hoher Meissner pour écouter le discours du philosophe Ludwig Klages, c'est parce que celui-ci leur parle sans jargon du désastre que subit la Nature sous les assauts de l'économicisme, de la technocratie et du “mammonisme”, soit du culte de l'argent. Ce discours, vieux de 84 ans, garde toute sa fraîcheur aujourd'hui: l'écologiste sincère y adhèrera sans hésiter.
La Grande Guerre bouscule tout: l'universalisme de l'écoumène euro-chrétien est fracassé, émietté, les nations sont devenues des mondes fermés sur eux-mêmes, développant leurs propres idoles politico-idéologiques. La propagande alliée avait répété assez souvent que les démocraties occidentales s'opposaient à l'Allemagne parce qu'elle était la patrie de Nietzsche, prophète de l'anti-christianisme et du néo-paganisme. Certains Allemands vont se prendre au jeu: puisque leurs adversaires se posaient comme les défenseurs de la “civilisation” et de la “démocratie”, ils se poseraient, eux, comme les défenseurs de la “culture” et de l'“ordre”. Si Rousseau était posé comme le prophète de la démocratie française, qui s'opposait à Nietzsche, celui-ci devenait à son tour le prophète d'une Allemagne appelée à révolutionner la pensée et à “transvaluer” toutes les valeurs. Et puisque cette Allemagne était accusée d'avoir propagé un paganisme, les cérémonies d'hommage aux soldats morts sur les champs de bataille de la Grande Guerre révèlent un retour à des pratiques anciennes, antiques, non chrétiennes, que l'on avait oubliées en Europe: réserver aux combattants tombés à la guerre un “bois sacré”, immerger le corps d'un soldat inconnu dans les eaux du Rhin, bâtir un mausolée sur le modèle de Stonehenge à Tannenberg en Prusse Orientale ou ériger des monuments semblables à des tombes mégalithiques ou des dolmens: voilà bien autant de concessions de l'Etat et de l'armée aux paganismes des intellectuels et des érudits. Enfin, l'effondrement de la structure impériale et de l'Etat autoritaire (Obrigkeitsstaat), élimine le Trône et l'Autel de la vie politique et inaugure l'ère de la privatisation du sentiment religieux. Etat libéral de modèle français, la République de Weimar sépare l'Eglise de l'Etat, ce qui démobilise bon nombre d'anciens fonctionnaires de leurs liens formels avec les confessions conventionnelles et crée un certain climat de désaffection à l'égard des anciennes structures religieuses. Outre un certain renforcement des associations néo-païennes et un approfondissement de la question des religions autochtones au niveau universitaire, on assiste, dans les premières années de la République de Weimar, entre 1919 et 1923, à une inflation de fausses mystiques, de bizarreries spiritualistes, d'astrologisme, etc. C'est là une manifestation du pluralisme absolu et anarchique de la culture de Weimar. L'anti-christianisme le plus radical, quant à lui, adopte un ton messianique: il attend l'avènement du “Troisième Reich”, sorte de transposition dans l'immanence de l'idée augustinienne d'une “Jérusalem céleste”. Ce messianisme s'exprime notamment dans le cadre d'une organisation parapolitique très importante de l'époque, le Deutsch-Völkischer Schutz- und Trutzbund, qui a compté jusqu'à 170.000 membres. Parallèlement au messianisme, le “Juif” devient l'ennemi principal, alors que l'antisémitisme avait été très atténué dans les néo-paganismes d'avant 1914 et était quasiment absent dans les années de guerre. Les réflexions sur les religions autochtones cèdent le pas à la propagande politique et au recrutement de volontaires pour le Corps Franc “Oberland”. Mais passée la grande crise des cinq premières années de la République, ce radicalisme politique s'estompe et les néo-païens retournent à une myriade de petits cénacles ou d'associations culturelles, cultivant des idées et des projets tantôt originaux tantôt bizarres.
Le clivage persiste néanmoins entre occultistes, qui restent marginaux mais assurent la continuité avec leurs prédécesseurs d'avant 1914, et “naturalistes”, qui entendent forger un néo-paganisme rationnel, basé sur la philologie, l'archéologie, les sciences naturelles et biologiques, les découvertes de la diététique, etc. Trois tendances idéologico-philosophiques voient cependant le jour, dans la période 1925-1933, entre Locarno et l'accession de Hitler au pouvoir:
1. Les nouvelles générations issues du Wandervogel introduisent dans le mouvement néo-païen le style du mouvement de jeunesse, avec les chants, le romantisme du feu de camp et la réhabilitation des danses populaires.
2. Les femmes sont admises dans ses associations sur pied d'égalité avec les hommes, car la thématique féministe de l'anti-christianisme a fait son chemin.
3. Les spéculations sur le monothéisme des Germains et des Scandinaves cèdent le pas à une réévaluation du polythéisme. On n'hésite donc plus à se déclarer “polythéiste”. Le 19ième siècle avait implictement cru que le monothéisme avait été un “progrès” et que le retour au polythéisme constituerait une “rechute dans le primitivisme”. Les perspectives changent dans les années 20: la pluralité des dieux, disent les néo-païens sous la République de Weimar, fonde la tolérance païenne, qu'il s'agit de restaurer. Dans les panthéons polythéistes, les dieux sont une famille, ils se présentent à leurs adorateurs par couple, les déesses, féminisme anti-chrétien oblige, contestent souvent les décisions de leurs divins époux, car le paganisme et le polythéisme n'ont absolument pas la rigueur patriarcale du yahvisme chrétien.
En 1933, quand Hitler accède au pouvoir, son parti entend défendre et protéger un “christianisme positif” (qui n'est pas explicité, mais qui signifie ni plus ni moins un christianisme qui n'entravera par le travail d'un Etat fort qui, lui, ne se déclarera pas ouvertement “chrétien”). Les propagandistes anti-chrétiens les plus zélés et les néo-païens les plus intransigeants sont tenus à distance. Une théologie chrétienne reformulée d'après les modes et le langage national-socialistes, portée par des théologiens réputés comme Friedrich Gogarten, Emanuel Hirsch, Gerhard Kittel, Paul Althaus, etc. est mise en œuvre pour “conquérir les églises de l'intérieur”. On peut cependant remarquer que, de leur côté, les églises, surtout la catholique, opèrent un certain aggiornamento, pour aller à la rencontre du Zeitgeist:
- réhabilitation des visions cycliques de l'histoire et de la pensée héraclitéenne du devenir chez les philosophes catholiques Theodor Haecker et E. Przywara;
- vision d'un “Dieu qui joue”, innocent comme l'enfant de Nietzsche, toujours chez Haecker;
- concessions diverses au panthéisme;
- vision d'un “Christ Cosmique” et “christologie cyclique” chez Leopold Ziegler;
- vision d'un “Christ dansant” chez Stefan George;
- théologie du Reich chez Winzen, où la paysannerie et le culte du “sang et du sol” trouvent toute leur place, afin de contrer la propagande anti-chrétienne en milieux ruraux des nationaux-socialistes Rosenberg, Darré et von Leers;
- spéculations sur l'incarnation divine et sur l'excellence de la paysannerie germanique, porteuse du glaive de l'église, c'est-à-dire de l'institution impériale;
- retour à la nature mis en équation avec un retour au divin, etc.
Si les églises ne se méfiaient pas du néo-paganisme avant 1914, elles s'inquiètent de ses progrès après 1918, vu l'affluence que connaissent les cercles “völkisch” et néo-païens. C'est la raison qui poussent les plus hautes autorités de l'Eglise à adopter un langage proche de celui des groupes “völkisch”. Hitler, lui, veut promouvoir le “mouvement de la foi des Chrétiens allemands”, dans le but avoué de construire une grande église nationale-allemande qui surmonterait la césure de la Réforme et de la Contre-Réforme. Certains cercles sont dissous, les autres sont invités à rejoindre de vastes associations contrôlées par le parti. Parmi ces associations, la principale fut la Deutsche Glaubensbewegung, dirigée par le philosophe et indianiste Wilhelm Hauer, par l'ancien diplomate anti-britannique et militant völkisch Ernst zu Reventlow, par le philosophe Ernst Bergmann, soucieux de construire une “Eglise d'Etat” non-chrétienne. L'objectif de ces trois hommes était d'assurer à l'Allemagne une rénovation religieuse, englobant éléments non chrétiens, pré-chrétiens et traditionnels, c'est-à-dire des éléments de la religiosité éternelle des peuples qui s'étaient ancrés dans la culture allemande sous une forme christianisée. Le mouvement était a-chrétien plutôt qu'anti-chrétien. Finalement, il s'auto-dissolvera, son présidium abandonnera toute vie publique, pour laisser la place à une organisation de combat anti-chrétienne, servant le parti dans sa lutte contre les églises, dès la fin de la lune de miel entre les nationaux-socialistes et les hiérarchies confessionnelles.
Après 1945, les néo-païens ou les “völkisch-religieux” se fondent dans deux organisations: chez les Unitariens (Deutsche Unitarier) qui se réorganisent à partir de 1948 et dont la figure de proue deviendra Sigrid Hunke (“La vraie religion de l'Europe”); et dans le Bund freireligiöser Gemeinden (Ligue des communautés religieuses libres), constitué en 1950. Wilhelm Hauer recrée en 1950 l'Arbeitsgemeinschaft für freie Religionsforschung und Philosophie qui entretiendra de bons rapports avec les deux autres organisations. Les personnalités politiques des décennies précédentes y sont rares et le profil idéologico-politique des membres des deux organisations (celle de Hauer étant plus scientifique) correspond davantage à celui des nationaux-libéraux d'avant 1914. Les thématiques abordées sont celles de la liberté religieuse, du panthéisme et du rapport entre sciences naturelles ou biologiques et foi religieuse.
En 1951, Wilhelm Kusserow, chassé de Berlin-Est où il est resté professeur jusqu'en 1948, fonde son Artgemeinschaft sur les débris du Nordische Glaubensbewegung. Sans ambages, les membres affirment se reconnaître dans leur germanité et sont ouvertement plus “nationalistes” que les unitariens et les “Freireligiösen”. En 1957, cette association fusionne avec les restes de celle de Norbert Seibertz.
Au moment où la fusion de ces associations a-chrétiennes voire anti-chrétiennes s'opère, l'Eglise abandonne, par la voie du Concile Vatican II, toutes ses références à la Rome antique pré-chrétienne, à l'“organon” euro-médiéval. Une bonne fraction du catholicisme européen appelait jadis à renouer avec l'“Ordo Æternus” romain, qui, dans son essence, n'était pas chrétien, était au contraire l'expression d'une paganisation politique du christianisme, dans le sens où la continuité catholique n'était pas fondamentalement perçue comme une continuité chrétienne mais plutôt comme une continuité archaïque, romaine, latine. Aux yeux de ces catholiques au fond très peu chrétiens, la “forme catholique” véhiculait la forme romaine en la christianisant en surface. Carl Schmitt était l'un de ces catholiques, pour qui aucune forme politique autre que la forme romaine n'était adaptée à l'Europe. Il était catholique parce qu'il avait une vision impériale romaine, qui, après la translatio, deviendra germanique. Il critiquait l'idéologie des Lumières et le positivisme juridique et scientiste parce que ces idéologies modernes rejetaient la matrice impériale et romaine, rejetaient cette primitivité antique et féconde, et non pas l'eudémonisme implicite du christianisme. De même, Vatican II rejettera cette romanité fondamentale pour ne retenir que l'eudémonisme chrétien. Dans les milieux conservateurs, dans les droites classiques, ce refus de la romanité, de la forme politique impériale romaine ou des formes stato-nationales qui ramenaient l'impérialité à un territoire plus restreint, provoque un véritable choc. Ni le catholicisme ni même le christianisme n'apparaissent plus comme les garants de l'ordre. De cette déception, naît la “nouvelle droite” française, d'autant plus qu'un Maurras, qui est encore à l'époque la référence quasi commune de toutes les droites, avait clairement aperçu la distinction entre forme politique et relâchement eudémoniste: pour lui, l'Eglise était facteur d'ordre tandis que l'Evangile, un “poison”. Si l'Eglise rejette complètement les résidus d'impérialité romaine, ou les restes d'un sens antique de la civitas, qu'elle véhiculait, elle n'est donc plus qu'un “poison”: voilà donc un raisonnement maintes fois tenu dans les rangs de la droite française. Une fraction de celle-ci cherchera dès lors de nouvelles références, ce qui la conduira à découvrir notamment Evola, la Révolution Conservatrice allemande, l'univers des néo-paganismes, la postérité intellectuelle de Nietzsche, au grand scandale de ceux qui demeurent fidèles à un message chrétien-catholique, qui n'est plus du tout envisagé sous le même angle par les autorités supérieures de l'Eglise catholique.
Les années 60 voient éclore de nouvelles thématiques, imitées des néo-primitivismes nord-américains: New Gypsies, New Indians, Flower People, Aquarians, Hippies, etc. La nouvelle religiosité ne s'ancre plus dans le socialisme politique ou dans le nationalisme exacerbé, mais dans un espace complètement dépolitisé. Une question se pose dès lors. Le recours aux passés pré-chrétiens de l'Europe doit-il s'opérer sans l'apport d'un projet politique ou, au moins, d'une vision claire de ce que doit être un Etat, une constitution, un droit? Doit-il s'opérer sans décider quelle instance doit avoir la pré-scéance: est-ce le peuple, porteur d'une histoire dont il faut assurer la continuité, ou est-ce la structure étatico-administrative, dont il s'agit de maintenir, envers et contre tout, le fonctionnement routinier, même aux dépens de la vie?
Le danger des modes “New Age”, même si elles induisent nos contemporains à se poser de bonnes questions, c'est justement de sortir des lieux de décision, de s'en éloigner pour rejoindre une sorte de faux Eden, sans consistance ni racines.
Ce risque de dérapage nous oblige à poser l'éternelle question: que faire?
- Premier rudiment de réponse: il y a beaucoup de choses à faire dans un monde si pluriel, si diversifié, si riche en potentialités mais aussi si éclaté, si émietté, si divisé par des factions rivales ou des options personnelles ou des incommunicabilités insaisissables; il y a beaucoup de choses à faire dans un monde pluriel, où faits positifs et faits négatifs se juxtaposent et désorientent nos contemporains.
- Deuxième élément de réponse: affronter un monde riche en diversités, encadrer cette diversité sans l'oblitérer ou la mutiler, implique:
de moduler sa pensée et son action de ré-immersion dans le passé le plus lointain de l'Europe sur les acquis de la philologie indo-européenne. Sans préjuger de leurs options sur d'autres questions indo-européennes, les travaux d'Emile Benveniste, de Thomas V. Gamkrelidze et de Viatcheslav V. Ivanov, et même de Bernard Sergent, nous permettent de saisir la portée sémantique fondamentale du vocabulaire des institutions indo-européennes primitives, et de savoir ce que les termes veulent dire en droit, afin que soit restaurer une société où les citoyens sont égaux en dignitié. C'est cette égalité en dignité, mise en exergue par Tacite, qui fait que les tribus s'appellent assez souvent “les amis”, les “parents” ou “le peuple” (Teutones, Tutini de Calabre, Teutanes d'Illyrie, etc.). Cette harmonie sociale est un modèle impassable: on a vu avec quel enthousiasme les humanistes italiens l'ont exhumé au XVième siècle, avec quel zèle les pionniers du socialisme l'ont adopté, avec quel respect Marx et surtout Engels (dans Les origines de la propriété privée, de la famille et de l'Etat) en parlent dans leurs livres, enfin, avec quelle obstination les socialistes “völkisch”, futurs nationalistes, l'ont explicité. Mais au-delà des enthousiasmes légitimes, il faut construire, rendre plausible, déniaiser les engouements. Ce travail n'est possible que si l'on comprend concrètement, sans basculer dans l'onirique, ce que les mots que nous employons veulent dire, ce que les termes qui désignaient nos institutions à l'aurore de notre histoire signifient réellement.
Enfin, un recours aux ressorts les plus antiques de l'Europe, comme de tous les autres continents, implique une attention particulièrement soutenue à la valeur des lieux. Si l'installation monotone dans un seul lieu n'est sans doute pas exaltante, n'excite pas l'esprit aventureux, l'ignorance délibérée et systématique des lois du temps et de l'espace, des lois du particulier, est une aberration et une impossibilité pratique. En transposant souvent leur telos dans un “autre monde”, soustrait aux règles du temps et de l'espace, le courant doloriste et augustinien du christianisme, les fidéismes athées à coloration “rationaliste”, les pratiques administratives de certains Etats, les déviances du droit vers l'abstraction stérile, ont arraché les hommes à leurs terres, aux lieux où le destin les avait placés. Cet arrachement provoque des catastrophes anthropologiques: fébrilité et déracinement, errance sans feu ni lieu, discontinuités successives et, finalement, catastrophes écologiques, urbanisme dévoyé, effondrement des communautés familiales et citoyennes.
Tout néo-paganisme positif, non sectaire, non replié sur une communauté-ersatz doit agir pour contenir de telles déviances. Il doit opérer ce que le théoricien britannique de l'écologie, Edward Goldsmith, appelle un retour à Gaïa, à la terre. Mais ce retour à une écologie globale, remise dans une perspective plus vaste et plus spiritualisée, plus “éco-sophique”, ne saurait se déployer sans un engagement social concomitant. Le retour des hommes à des lieux bien circonscrits dans l'espace —de préférence ceux de leurs origines, ceux où ils retrouvent les souvenirs ou la tombe d'un bon vieux grand-père sage et souriant— et l'organisation en ces lieux d'une vie économique viable à long terme, satisfaisante pour eux et pour les générations qu'ils vont engendrer, sont autant de nécessités primordiales, à l'heure où la mondialisation des marchés exerce ses ravages et exclut les plus fragiles d'entre nos concitoyens, à l'heure où les migrations tous azimuts n'aboutissent nulle part sinon à la misère et à l'exclusion.
Récemment, dans un dossier “Manière de voir” (n°32), le Monde diplomatique, lançait un appel planétaire à la résistance contre les aberrations socio-économiques installées par l'“armada des économistes orthodoxes”, dont la panacée la plus tenace était celle de la fameuse “bulle commerciale” dans laquelle le libre-échange devait être roi absolu et où aucune stabilité sociale, aucun legs de l'histoire, ne devait entraver la course folle vers une croissance exponentielle des chiffres d'affaires. Les rédacteurs du Monde diplomatique réclamaient un “sursaut républicain”, contre la résignation des élites du “cercle de la raison”, qui appliquent sans originalité ni imagination ces doctrines du libéralisme total qui ne tiennent compte ni des limites du temps ni de celles de l'espace. Dans le cadre de cette revendication, ces rédacteurs n'hésitaient pas à rappeler les atouts de la “solidarité rurale” et du “maillage associatif” dans les campagnes, formes d'organisation communautaires et non sociétaires, mais dont le ciment ne peut être qu'une variante de l'organisation clanique initiale des peuples, où se conjuguent liberté constructive et autonomie, soit deux vertus qui avaient enthousiasmé les humanistes de la Renaissance italienne qui avaient lu Tacite et initié à leur époque le premier grand “sursaut républicain”. Face au fétichisme de la marchandise, disent les rédacteurs du Monde diplomatique, “il n'y a pas d'autre issue que de résister, afin de défendre les derniers fragments de la liberté des peuples de disposer de leur propre destin”. Nous n'avons pas d'autre programme. Car nous aussi, nous voulons une “Europe des citoyens”, c'est-à-dire une Europe d'Européens inclus dans des cités taillées à leurs mesures, des cités qui ont une histoire et un rythme propres. Nous nous donnons toutefois une tâche supplémentaire: aller toujours aux sources de cette histoire et de ce rythme. Pour rester fidèles à la démarche des humanistes de la Renaissance et des premiers socialistes libertaires qu'a allègrement trahis la sociale-démocratie, en se livrant à ses petits jeux politiciens et en décrétant toute réflexion sur notre très lointain passé comme l'expression mièvre et ridicule d'une “fausse conscience”.
Cette “fausse conscience” est pour nous une “vraie conscience”, notre “conscience authentique”. Car cela ne sert à rien de critiquer les orthodoxies de l'économie dominante, si c'est pour adopter le même schéma abstrait. L'autonomie des peuples, c'est de vivre en conformité avec leur plus lointain passé. C'est affirmer haut et fort la continuité, pour ne pas périr victime d'une pensée sans racines et sans cœur.
Le combat contre les idéologies dominantes, contre les confessions qui tiennent le haut du pavé et stérilisent les élans religieux authentiques, ne peut nullement être un combat entre érudits distingués, à l'abri des grands courants intellectuels et politiques du siècle, mais au contraire un combat qui apportera le supplément d'âme nécessaire à ce grand “sursaut républicain” qu'appellent nos contemporains. C'est à ce combat que j'ai voulu vous convier aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Robert STEUCKERS.
(Forest, du 8 au 10 janvier 1997).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : traditions, traditionalisme, paganisme, mythologie, histoire, philosophie, mythes, humanisme, christianisme, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 14 mai 2009
Konversion zum Islam: Eine neue Antwort auf die Identitätskrise
| Konversion zum Islam: Eine neue Antwort auf die Identitätskrise |
| Geschrieben von Carlo Clemens - http://www.blauenarzisse.de/ | |
|
Ich selbst kann den Weg vom orientierungslosen, getauften Deutschen hin zur Konversion zum Islam sehr gut nachvollziehen. Obwohl ich eigentlich schon immer im Denken ein Konservativer war, der sich für die christlich-abendländische Prägung Deutschlands und Europas stark machte, gab es in meinem Leben durchaus Phasen, in denen ich mir ernsthafte Gedanken über die Vorteile und Konsequenzen des islamischen Glaubens gemacht habe. |
00:30 Publié dans Islam | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : islam, religion, crise religieuse, sociologie, christianisme, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 février 2009
Islam-Occident : l'histoire interdite?
Islam-Occident, L'histoire interdite ?
Débat. Le livre de Sylvain Gouguenheim déclenche la polémique.
Frédéric Valloire, le 06-06-2008 : Sur: http://www.valeursactuelles.com
Un pavé dans la mare du conformisme, notait Valeurs actuelles, le 25 avril dernier, en présentant dans la page Focus Histoire l’ouvrage de Sylvain Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, les racines grecques de l’Europe chrétienne, paru au début du mois de mars aux éditions du Seuil. Quelques jours plus tard, naissait “l’affaire Gouguenheim”.
L’auteur, professeur d’histoire médiévale à l’École normale supérieure de Lyon, ne peut répondre : son avocat lui a demandé d’être silencieux. Sa dernière intervention est un entretien dans le Monde du 25 avril, où il se dit « bouleversé par la virulence et la nature des attaques ». Et il récuse les intentions qu’on lui prête.
Que dit-il ? Parmi les routes de transmission qui ont permis à l’Occident médiéval, du VIe au XIIe siècle, de connaître les textes grecs antiques, en particulier ceux d’Aristote, et de les traduire, la filière arabe n’est pas la seule. Il existe une filière byzantine, relayée par la Sicile et l’Italie du Sud, où le grec était encore utilisé par les marchands, les ambassadeurs et les clercs. Peuvent s’y ajouter quelques monastères isolés dans un monde où la langue savante est le latin, tels celui de Saint-Gall en Suisse actuelle et surtout celui du Mont-Cassin. Mais connaître le grec en Occident demeurait un exploit : le plus surprenant étant Jean Scot Érigène, un théologien irlandais du IXe siècle, qui connaissait Platon et traduisit en latin des Pères grecs de l’Église.
En outre, Gouguenheim relève que les grands philosophes arabes Al-Fârâbi, Avicenne, Averroès ne lisaient pas les textes originaux en grec mais dans des traductions. Elles étaient effectuées pour la plupart par des chrétiens d’Orient qui connaissaient le grec, l’arabe, tel Hunayn ibn Ishaq. Existaient même à Bagdad des cercles de traducteurs, La Maison de la sagesse, où ils se retrouvaient et qu’un universitaire de Yale, Dimitri Gutas, a examiné dans un ouvrage (Pensée grecque, Culture arabe, Aubier, 2005), que ne mentionne pas Gouguenheim. Tout cela n’est certes pas nouveau.
L’idée forte de Gouguenheim est de considérer que, dans cette transmission des idées grecques, les filières européenne et byzantine ont été plus importantes que la filière arabe, même par l’intermédiaire de l’Andalousie. En particulier grâce à un personnage mal connu, sans être inconnu, Jacques de Venise (mort après 1148). Selon Gouguenheim, ce premier traducteur d’Aristote au XIIe siècle « mériterait de figurer en lettres capitales dans les manuels d’histoire culturelle » et aurait travaillé au Mont-Saint-Michel. Ce qui est certain, c’est que ses traductions connaissent un succès stupéfiant et qu’elles se différencient de celles venues du monde islamique, qui filtraient la pensée d’Aristote, n’en retenant que ce qui était compatible avec les dogmes religieux et en laissant les aspects politiques.
À première vue, une querelle de spécialistes. Qui a tourné à la guerre de positions. Et qui assure le succès du livre : il dépasse les 7 000 exemplaires vendus, en moins de deux mois. Un chiffre élevé pour un ouvrage paru dans la collection, prestigieuse et exigeante, qu’est L’Univers historique.
La réception du livre commence par un long article, fort élogieux, du journal le Monde du 4 avril, « Et si l’Europe ne devait pas ses savoirs à l’Islam ? ». Signé par Roger-Pol Droit, il salue un livre « précis, argumenté, fort courageux, qui remet l’histoire à l’heure ». Même accueil chaleureux ou curieux dans le mensuel le Monde de la Bible, Ouest-France, le Figaro littéraire, la Libre Belgique.
Le 25 avril, sur une page entière, le Monde fait marche arrière devant « l’émotion d’une partie de la communauté universitaire ». En fait, quarante historiens et philosophes emmenés par Hélène Bellosta et Alain Boureau. Partis à l’assaut de ce qui, pour eux, n’est que vieilles lunes et vieux savoirs, ils reçoivent le renfort de deux médiévistes, l’un de Paris-VIII, l’autre de Montpellier, qui portent une charge violente contre cet ouvrage « prétendument sérieux », mais dicté « par la peur et l’esprit de repli ». Et les pétitions hostiles à Gouguenheim circulent.
Le lundi 28 avril, un appel lancé par deux cents « enseignants, chercheurs, personnels, auditeurs, élèves et anciens élèves » de l’ENS de Lyon, des lettres et des sciences humaines, où enseigne Sylvain Gouguenheim, demande une enquête informatique approfondie pour savoir s’il a donné en bonnes feuilles des pages de son ouvrage à Occidentalis, un site d’“islamovigilance”. Les pétitionnaires, qui se drapent vertueusement dans l’indépendance de la recherche surtout lorsqu’elle est « inattendue et iconoclaste », ont des réflexes de délateurs. Sans en discuter les thèses, simplement parce que « l’ouvrage de Sylvain Gouguenheim sert actuellement d’argumentaire à des groupes xénophobes et islamophobes qui s’expriment ouvertement sur Internet », ils mettent l’essai à l’index. Ont-ils été entendus ? La direction de l’école fait savoir qu’elle va créer un comité d’experts afin d’étudier les pièces du dossier. Pire : elle se propose d’auditionner l’historien avant de transmettre un avis au conseil d’administration de l’école, « qui évaluera les suites à donner ». Procédé scandaleux autant qu’injuste : Gouguenheim n’a commis aucune faute.
Le 30 avril, Libération, qui, la veille, avait fait paraître une recension plutôt neutre de l’ouvrage, donne la parole à cinquante-six chercheurs en histoire et en philosophie du Moyen Âge qui ont lu (tous ? on peut en douter) Aristote au mont Saint-Michel. Après avoir relevé les coquilles et les maladresses, ils attaquent le fond de l’ouvrage. Que lui reprochent-ils ? d’avoir un présupposé identitaire (l’Europe s’identifiant à la chrétienté) et de déclarer que même en l’absence de tout lien avec le monde islamique, l’Europe chrétienne médiévale se serait approprié l’héritage grec et aurait suivi un cheminement identique. Bref, de réduire dans les domaines de la raison et du politique l’influence islamique et « de déboucher sur des thèses qui relèvent de la pure idéologie », de faire du « racisme culturel » et d’avoir une démarche qui « relève d’un projet idéologique aux connotations politiques inacceptables ». Cela est dit avec des mots qui tuent, tant ils sont connectés au négationnisme : « révision », « relecture fallacieuse ».
Le 5 mai, Télérama, dans le style que ce journal affectionne, mi-rigolard, mi-moralisant, prend le relais : résumé réducteur du livre, sélection de phrases sorties de leur contexte, suppression des nuances et des restrictions qu’apportait l’auteur. Un ton néostalinien pour dénoncer les « thèses islamophobes de Sylvain Gouguenheim » et la pente dangereuse prise par les éditions du Seuil qui l’ont cautionné en le publiant ! Monte au créneau le philosophe Alain de Libera, l’un des premiers à réagir. Il est vrai qu’il était épinglé, poliment, sans acrimonie, par Gouguenheim. Et Libera de se déchaîner : « L’hypothèse du Mont-Saint-Michel, comme chaînon manquant dans l’histoire du passage de la philosophie aristotélicienne du monde grec au monde latin, a autant d’importance que la réévaluation du rôle de l’authentique Mère Poularde dans l’histoire de l’omelette. » Et de conclure : « Cette Europe-là n’est pas la mienne. Je la laisse au “ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale” et aux caves du Vatican. » La discussion de fond ? À peine amorcée, très vite elle dérape, glisse, fuit, s’attarde sur des détails.
Sur la Toile, de blog à blog, par milliers, les réponses fusent, dépassent toute correction d’autant que l’anonymat y est le plus souvent la règle. On parle de « Gouguenheim au Mont-Saint-Adolf » ; on lui imagine des sympathies à l’extrême droite, même s’il rappelle qu’il appartient à une famille de résistants et si l’une des annexes (d’ailleurs anachronique) de son livre souligne les liens entre l’islam et le nazisme, à travers une intellectuelle allemande, Sigrid Hunke ; on le condamne pour avoir cité un ouvrage de René Marchand, journaliste et essayiste arabisant, de sensibilité gaulliste. Sur Internet, on s’affiche gouguenheimien ou antigouguenheimien.
Rappel à l’ordre et au bon sens : dans l’Express du 15 mai dernier, « outré par ces attaques », déplorant « la véhémence des critiques », le médiéviste Jacques Le Goff sort de sa réserve. Il juge le livre « intéressant mais discutable » et remarque que « peu des principaux médiévistes » ont rejoint le collectif des cinquante-six. Pour soutenir l’auteur, il consacrera l’un de ses prochains Lundis de l’histoire sur France Culture à l’étude de Gouguenheim, les Chevaliers Teutoniques chez Tallandier (lire Valeurs actuelles n° 3720). Une intervention salutaire.
Que les polémiques se soient développées, rien d’étonnant. Il y a les ambitions personnelles, le sentiment de propriété sur tel ou tel domaine qu’ont les universitaires et qui les entraîne souvent à considérer celui qui empiète sur leur domaine comme un ennemi. Il y a les positions politiques ou idéologiques plus ou moins conscientes, qui sont liées autant à des sentiments personnels qu’à de vagues notions de solidarité de chercheurs. Et il y a le confort intellectuel, qui pousse à épouser les idées dominantes, ce que Max Gallo regrettait le dimanche 27 avril, à propos de ce livre, sur France Culture : « Dès lors que l’on n’est pas tout à fait d’accord avec la doxa [en l’occurrence la connaissance des philosophes grecs par l’intermédiaire de l’islam], avec ce qui règne, même quand on est un médiéviste indiscutable, il devient dangereux de faire de l’histoire. »
Ce qui surprend le plus, c’est la rapidité et la violence des réactions. Car il n’y eut aucune protestation lorsque l’islamologue Bernard Lewis expliquait en 1988 (le Langage politique de l’islam, Gallimard) que les mots “citoyen”, “liberté” n’existaient pas dans l’islam classique. Aucune réaction lorsque, en 2002, Jacques Heers donnait au premier numéro de la Nouvelle Revue d’histoire, un article intitulé « La fable de la transmission arabe du savoir antique », qui s’achevait ainsi : « Rendre les Occidentaux tributaires des leçons servies par les Arabes est trop de parti pris et d’ignorance : rien d’autre qu’une fable, reflet d’un curieux penchant à se dénigrer soi-même. » Rien non plus, en 2006, à la sortie d’un petit essai Au moyen du Moyen Âge (repris, augmenté, il sera réédité en septembre chez Flammarion) de Rémi Brague, professeur de philosophie à l’université de Paris-I. Or, ce spécialiste d’Aristote, de saint Bernard et de Maïmonide consacre plusieurs pages aux problèmes de traduction des textes grecs venus du monde arabe et rejoint, à bien des égards, l’étude de Gouguenheim.
Serions-nous entrés dans un monde de plus en plus intolérant ? Qui ne cesse de légiférer en histoire ? Qui confond histoire et mémoire ? Ce que craint Pierre Nora, l’un des fondateurs de l’association Liberté pour l’histoire, qui appelle à l’abrogation de toutes les lois mémorielles, y compris de la loi Gayssot. « L’histoire rassemble, dit cet historien, la mémoire divise. »
00:30 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moyen âge, philosophie, histoire, islam, europe, monde arabo-musulman, christianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 28 janvier 2009
Hypathie, vierge martyre des païens
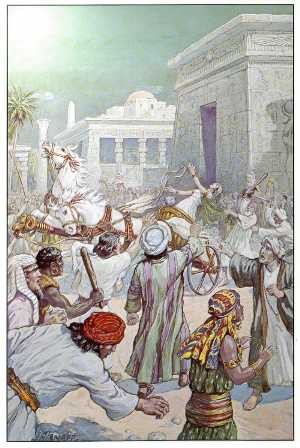
Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - COMBAT PAÏEN - DÉCEMBRE 1990
B. Favrit-Verrieux:
Hypathie, vierge martyre des Païens
"Dors, ô blanche victime en notre âme profonde,
Dans ton linceul de vierge et ceinte de lotos;
Dors! l'impure laideur est la reine du monde
Et nous avons perdu le chemin de Paros (…)
Demain, dans mille années,
Dans vingt siècles, —qu'importe au cours des destinées—
L'homme étouffé par vous se dressera (…)
Votre œuvre ira dormir dans l'ombre irrévocable".
Leconte de Lisle (Hypathie et Cyrille)
Alexandrie, 415. Cinq ans après le sac de Rome, alors que l'Empire s'écroule, l'Egypte vit à l'heure des derniers feux du paganisme antique. L'Occident est acquis à la cause du "Galiléen", l'Orient résiste encore, mais il n'est qu'en sursis. La ville égyptienne abrite une population multiconfessionnelle; la cohabitation s'avère de plus en plus difficile. Face aux Juifs et aux païens "Hellènes": les partisans de Jésus, manœuvrés par l'évêque Cyrille, et qui comptent bien se rendre maîtres de la place.
Dans cette atmosphère tendue se dresse Hypatie, la vierge des païens et, si l'on en croit les relations de Socrate (1) et Damaskios, l'ultime rempart du paganisme. Son père, prêtre des dieux et scientifique de renom, lui a enseigné la mathématique, l'astrologie et la philosophie. Elle a grandi dans le culte des dieux; elle sait que tout flanche et agonise autour d'elle; pourtant, elle se refuse à suivre la théorie des conversions. Un combat sans espoir, perdu d'avance… En cela réside toute sa signification.
Hypathie enseigne la philosophie, elle a le verbe haut mais la grâce l'habite; tous les témoignages convergent lorsqu'il s'agit d'évoquer sa grande beauté. On a coutume de la représenter au milieu d'un cénacle, le cercle de ses fidèles qui, avec elle, refusent de voir les dieux s'exiler pour céder la place aux religions de l'intolérance.
Les Juifs et les chrétiens s'affrontent à coups d'émeutes et de pogroms sous les regards inquiets d'Hypatie et des siens; à quand leur tour?… Il y aussi la lutte d'influence que se livrent Oreste, préfet de la ville, et l'évêque Cyrille. Pour une cause mal définie, le préfet d'Alexandrie aurait fait torturer à mort un chrétien, un provocateur dont les Juifs ont exigé la tête. L'affaire dégénère bientôt et c'est le massacre entre les deux communautés. Cyrille, qui a l'avantage de la supériorité numérique, fait détruire les synagogues et expulser les Juifs. Puis, emporté par son élan, l'évêque harangue ses troupes qui jettent l'anathème sur le représentant de Rome. Oreste cherche alors à se concilier les faveurs d'Hypatie dont l'influence est toujours notoire pour tenter de réduire Cyrille et ses moines fauteurs de troubles. On rapporte aussi que frappé par la beauté de la jeune femme, le préfet d'Alexandrie, bien que baptisé, aurait longuement hésité à s'engager sur le voie du paganisme. Il n'en fit rien.
Lorsque la vierge païenne est prise à partie en pleine ville par la foule chrétienne fanatisée qui l'arrache de sa voiture et la traîne au Caesarium, il ne réagira pas. Sur les marches du temple impérial, Hypatie est "déshabillée, tuée à coups de tessons, mise en pièces… Ses restes sont ensuite promenés dans les rues et brûlés…" (3). Désormais, Cyrille et Oreste peuvent envisager la réconciliation…
Dans son avant-propos à un ouvrage de Gabriel Trarieux (4), George Clemenceau eut cette phrase: "Hypatie contre Jésus. La Grèce toujours contre sa mère l'Asie, la beauté contre la bonté, fût-il jamais plus passionnante tragédie?" Passionnantes ou pas, il est des tragédies dont les païens que nous sommes ne peuvent s'accommoder et veulent éviter. Contre l'éradication de la beauté et le règne du lit de Procustre, nous devons montrer notre détermination face à l'intolérance qui règne chez nous et le retour des tabous et des amalgames minables. Nos spécificités, notre religiosité européennes nous ont toujours enseigné de ne pas nous agenouiller, nous encaloter, nous voiler, nous asservir, de privilégier l'amour des libertés pour que s'élève l'être face à ses sensibilités identitaires. Hypatie, la chaste et belle païenne, n'a pas voulu se taire et se prosterner. Elle a montré la voie. Souvenons-nous du culte d'Athénée Poilias qu'elle tenta d'honorer jusqu'au bout et de sa croisade contre le Crucifié.
B. Favrit-Verrieux.
Notes:
(1) Histoire de l'Eglise.
(2) Vie d'Isidore.
(3) Chronique des derniers païens - Pierre Chuvin (Les belles Lettres: Fayard, Paris, 1990).
(4) Hypatie - Cahiers de la quinzaine (Paris, avril 1904).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, christianisme, judaïsme, antiquité, antiquité grecque, egypte ancienne, religion |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 24 janvier 2009
Les "Millenarians" américains, principal soutien à Israël

Les “Millenarians” américains, principal soutien à Israël
Entretien avec Richard Melisch
Q.: Monsieur Melisch, les Etats-Unis pourront-ils se détacher bientôt de la tutelle du lobby pro-israélien?
RM: Il n’y a pas que le lobby pro-israélien qui influence depuis longtemps la politique proche-orientale des Etats-Unis. Cette politique est déterminée par des éléments bien plus radicaux, qui se définissent comme “sionistes chrétiens”. Ils résident principalement dans les états du sud-ouest des Etats-Unis; on les appelle également les “Millenarians”, un courant qui compte 55 millions d’âmes. Ce sont des protestants, venus au départ de toutes les factions du protestantisme comme les baptistes, les luthériens, les episcopaliens, etc., mais qui, à la différence de leurs coreligionnaires qui ne sont pas “millénariens”, sont fermement convaincus que Jésus Christ, en chair et en os, descendra des cieux pour atterrir à Jérusalem, non pas dans un futur lointain, mais très bientôt. A partir de Jérusalem, le Christ livrera la bataille d’Armageddon, où les méchants seront annihilés. Alors commencera son “Royaume de mille ans”. Cette croyance au retour charnel du Christ à Jérusalem implique, pour ces “sionistes chrétiens” et ces “millénariens”, que Washington doit soutenir les sionistes juifs de l’Etat d’Israël, afin que la “terre sainte” soit débarrassée de tous les “sombres terroristes”, agents du “Mal”, avant l’arrivée du Christ. George W. Bush est l’un de ces 55 millions de “Millenarians”.
Quoi qu’il en soit, le lobby pro-israélien et les zélotes chrétiens, interprètes fanatisés de l’Ancien Testament, excerceront encore leur influence pendant quelques années sur l’établissement politique américain, dominé depuis 1776 par les WASP (“White Anglo-Saxon Protestant”). Mais, inéluctablement, le “God’s own Country” ne pourra plus être sauvé: le plus grand danger qui le guette n’est pas une “arme de destruction massive”, iranienne ou autre, mais relève des fluctuations démographiques. Vu le développement démographique exponentiel que connaissent les minorités non-WASP, les Américains blancs ne seront plus, vers 2040, qu’un des trois grands groupes ethniques du pays, à égalité avec les “Hispanics” et les Afro-Américains. Rien qu’au cours de ces cinq dernières années, cinq états de l’Union ont subi une mutation ethnique, minorisant les Blancs et hissant un des deux autres grands groupes au statut de composante ethnique majoritaire.
Les rapports majorité/minorité vont donc changer tant dans les villes que dans les campagnes, tant au Sénat qu’au Congrès, où de nouvelles coalitions donneront le ton, en toute légitimité démocratique. Il est très peu probable qu’un “Congrès” américain, dominé par des “Hispanics” ou des Afro-Américains, accepte, dans le futur et indéfiniment, de payer les milliards de dollars annuels que versent les Etats-Unis à Israël. Cette évolution est déjà perceptible dans ses premières manifestations, encore jugées anodines: il y a trois ans, un député du Congrès s’est emparé du microphone et a tenu son discours en langue espagnole. Un grand silence règnait dans la salle. Personne n’a protesté.
(extrait d’un entretien accordé au DNZ, n°4/2009, Munich; trad. franç.: Robert Steuckers).
Les thématiques de l’entretien correspondent à celles développées par l’auteur dans son ouvrage de référence: “Der letzte Akt – Die Kriegserklärung der Globalisierer”, Hohenrain, Tübingen, 413 pages, 19,90 Euro.
| ||
Über das Produkt
Rückentext:
| ||
00:46 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, israël, millenarians, millénariens, sectes, protestantisme, christianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





 Obwohl offizielle Statistiken oftmals kaum aussagekräftig sind, da aus Angst vor vermeintlich rassistischer Diskriminierung viele Differenzierungen unter den Teppich gekehrt werden, geht man laut dem Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland Stiftung e.V. (ZIAD) in Soest davon aus, daß es in der Bundesrepublik Deutschland heute etwa 3,5 Millionen Muslime gibt – 6,5 Prozent mehr noch als im Jahr 2006. Ein unglaublicher Geburtenüberschuß und Familiennachzug machen es möglich. Doch nicht alle Muslime müssen aus dem islamischen Kulturbereich stammen: Jedes Jahr sind es mehrere tausend Konvertiten, die in der Religion des Propheten Mohammed den wahren Sinn und den richtigen Weg sehen.
Obwohl offizielle Statistiken oftmals kaum aussagekräftig sind, da aus Angst vor vermeintlich rassistischer Diskriminierung viele Differenzierungen unter den Teppich gekehrt werden, geht man laut dem Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland Stiftung e.V. (ZIAD) in Soest davon aus, daß es in der Bundesrepublik Deutschland heute etwa 3,5 Millionen Muslime gibt – 6,5 Prozent mehr noch als im Jahr 2006. Ein unglaublicher Geburtenüberschuß und Familiennachzug machen es möglich. Doch nicht alle Muslime müssen aus dem islamischen Kulturbereich stammen: Jedes Jahr sind es mehrere tausend Konvertiten, die in der Religion des Propheten Mohammed den wahren Sinn und den richtigen Weg sehen. dem Islam zugewendet haben, haben sich zuvor auch mit dem Christentum, der Religion in die sie hineingeboren wurden, auseinandergesetzt. Doch für kaum einen versprühen mausgraue Kirchengemeinden noch einen attraktiven Charme, geschweige denn einen Ausweg aus der inneren Depression. Viele Konvertiten begründen ihren Schritt damit, daß sie Probleme mit dem christlichen Dogma der Dreifaltigkeit Gottes hätten sowie mit den klaren religiösen Vorschriften im Islam, so Muhammad Salim Abdullah, Seniordirektor des Islam-Archives. Und wie soll man als Deutscher oder Nicht-Deutscher eine Kultur respektieren oder für sich beanspruchen, die sich gerade mitten in ihrer kulturellen Selbstaufgabe befindet?
dem Islam zugewendet haben, haben sich zuvor auch mit dem Christentum, der Religion in die sie hineingeboren wurden, auseinandergesetzt. Doch für kaum einen versprühen mausgraue Kirchengemeinden noch einen attraktiven Charme, geschweige denn einen Ausweg aus der inneren Depression. Viele Konvertiten begründen ihren Schritt damit, daß sie Probleme mit dem christlichen Dogma der Dreifaltigkeit Gottes hätten sowie mit den klaren religiösen Vorschriften im Islam, so Muhammad Salim Abdullah, Seniordirektor des Islam-Archives. Und wie soll man als Deutscher oder Nicht-Deutscher eine Kultur respektieren oder für sich beanspruchen, die sich gerade mitten in ihrer kulturellen Selbstaufgabe befindet?