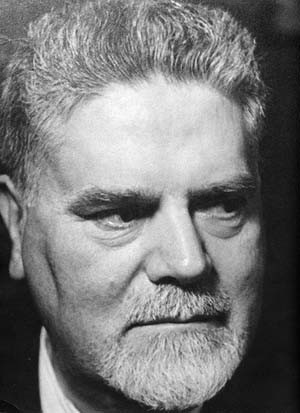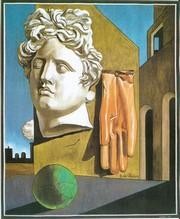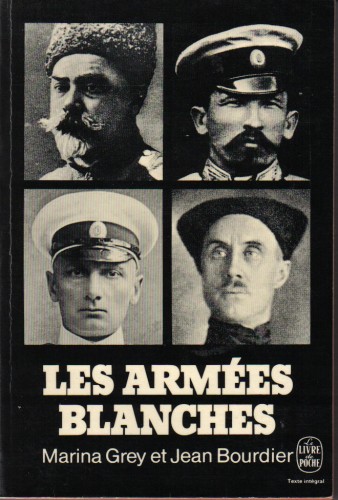SYNERGIES EUROPÉENNES - CRITICON (Munich) - IDHUNA (Genève) - Août 1986
Armin MOHLER:
Zeev Sternhell, nouvel historiographe du fascisme
Un livre, paru à Paris en 1983, a complètement bouleversé l'historiographie du fascisme. Ce livre porte le titre de: Ni droite ni gauche. L'idéologie du fascisme en France. Gros de 412 pages, il est publié par les éditions du Seuil, maison pourtant connue pour ses tendances de gauche.
L'auteur, Zeev Sternhell, professeur de politologie à l'Université Hébraïque de Jérusalem, est né en Pologne en 1935. Il est actuellement le Directeur du "Centre d'Etudes Européennes" et, peu avant la parution de Ni droite ni gauche, il avait fondé le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Civilisation Française.
Son livre est très dense. Il abonde en outre de répétitions car, ce qui importe pour Sternhell, homme au tempérament fougueux, c'est d'inculquer au lecteur certains jugements inhabituels. Mais il serait erroné de lui reprocher l'emploi de "concepts vagues". A l'opposé du spécialiste jusqu'ici accrédité de l'étude du fascisme, Ernst Nolte, Sternhell n'a pas reçu de formation philosophique. Il est un authentique historien qui se préoccupe de recenser le passé. Pour lui, chaque réalité historique est "irisable", on ne peut la ramener à un seul concept, il faut en considérer les diverses facettes. Dès lors, contrairement à Nolte, Sternhell ne construit pas un schéma abstrait du fascisme, dans lequel il conviendra d'enserrer ensuite les phénomènes concrets. Il renvoie de préférence ces phénomènes à toute une variété de concepts qu'il puise toutefois dans le vocabulaire politique traditionnel, afin de les cerner et de les localiser.
S'il entre dans notre propos de résumer ici un ouvrage aussi complexe, notre exposé ne pourra cependant pas remplacer la lecture de ce livre. Il en est plutôt l'introduction.
1. Qui est Zeev Sternhell?
1.1. Indubitablement, il est un authentique homme de gauche. Le journal Le Monde (14.1.1983) déclare à son sujet: Sternhell entra en mai 1977, après la victoire électorale de Begin et la chute du Parti Travailliste, dans la vie politique israëlienne. Il créa le Club 77, un rassemblement d'intellectuels de l'aile d'extrême-gauche du Parti Travailliste. Ce Club s'engagea dans une politique de modération envers le monde arabe et milita pour l'évacuation de la Cisjordanie; en matière de politique interne, il chercha à favoriser une politique aussi "socialiste" que possible, c'est-à-dire accordant le maximum d'égalité. Au sein du Parti Travailliste, Sternhell fait partie d'une minorité, tout en étant membre du Comité Exécutif".
1.2. Sternhell est un "gramsciste". A l'instar de toute la gauche revendicatrice et contestatrice de sa génération, il s'est libéré de l'orthodoxie marxiste. Il rejette expressément la conception matérialiste de l'histoire (pp.18-19).
A la suite de Gramsci (et a fortiori de l'inspirateur de ce communiste italien, Georges Sorel), Sternhell se rallie à la conception historiographico-philosophique qui veut que les idées ne soient pas le reflet des réalités, mais l'inverse.
1.3. Le point de départ de la démarche de Sternhell: le révisionnisme. Le fait que Sternhell se soit consacré à l'étude du fascisme s'explique sans aucun doute par son intérêt pour la biographie des révisionnistes, ceux qui ont tenté de changer et de réformer le marxisme orthodoxe. De Ni droite ni gauche, il ressort que le révisionnisme de "droite" (p.35) ou révisionnisme "libéral" (p.81), qui mène à des alliances et des compromissions avec le libéralisme bourgeois et qu'incarne un Eduard Bernstein (en France, Jaurès) fascine moins Sternhell que le révisionnisme de "gauche" (p.290), mouvement amorcé par Sorel et les syndicalistes révolutionnaires qui refusaient les "ramollissements" du socialisme et passèrent ultérieurement au fascisme. Sternhell s'intéresse en particulier à un nouveau courant socialiste d'alors qui, dépassant l'opposition Sorel/Bernstein, vit le jour au lendemain de la Grande Guerre: le révisionnisme "planiste" ou "technocratique" (p.36) du socialiste belge Henri De Man et du néo-socialiste français Marcel Déat. Ce révisionnisme-là aboutit directement au fascisme.
1.4. Sternhell contre le fascisme de salon. L'orientation "socialiste", qui sous-tend l'étude de Sternhell sur la problématique du fascisme, se traduit par le peu d'intérêt marqué pour les formes de fascismes philosophiques ou littéraires. Trait caractéristique: Sternhell ne mentionne nulle part les deux écrivains les plus importants appartenant au fascisme, Céline et Rebatet. Et Sternhell néglige encore d'autres aspects du fascisme de salon, du fascisme des penseurs "qui finissent leur vie en habit vert" (p.22). Vu les multiples facettes du fascisme français (et européen)(p.21), Sternhell s'adjuge le droit de poser une analyse pars pro toto: il prétend se consacrer en ordre principal à l'étude de secteurs négligés jusqu'ici (p.9).
2. La France, modèle du fascisme?
2.1. Pourquoi la France? Le livre de Sternhell veut développer une définition du "fascisme" en se basant sur l'exemple français. Cette intention peut étonner. La France, en effet, si l'on excepte l'intermède de l'occupation allemande, n'a jamais connu un régime qualifiable de "fasciste". L'Italie, l'Allemagne voire l'Espagne seraient à cet égard de meilleurs exemples. Mais Sternhell, nous allons le voir, déploie de très sérieux arguments pour justifier son choix.
2.2. Les études antérieures de Sternhell. Ces arguments, pour nous, ne sauraient se déduire des travaux antérieurs de Sternhell, qui portaient tous sur la France. Dès le départ, il orienta son attention vers le fascisme, même s'il l'on peut supposer qu'un changement de perspective aurait pu se produire et lui faire choisir un autre territoire de recherches. Ce que Sternhell découvrit très tôt dans ces secteurs délaissés par la recherche qu'il se trouvait sur la bonne voie. Deux livres aussi copieux avait précédé Ni gauche ni droite. Le premier s'intitulait Maurice Barrès et le nationalisme français (1972). Le second, La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme (1978), traitait de la même époque historique, mais le grand thème de Sternhell, le fascisme, apparaissait pour la première fois dans le sous-titre. La recherche a imméditament considéré ces deux ouvrages comme des classiques. Les sujets de ces livres sont à la fois plus sectoriels et plus généraux que la thématique du troisième, que nous commentons ici. Dans Ni gauche ni droite, Sternhell cherche à forger un classification globale et détaillée du phénomène fasciste qu'il entend maîtriser conceptuellement.
2.3. La France a inventé le fascisme. Le premier argument de Sternhell, pour situer le champ de ses recherches en France, c'est que ce pays a vu naître le fascisme vingt ans avant les autres, notamment vers 1885 (p.41). Sternhell n'emploie qu'occasionnelle- ment le terme de "pré-fascisme" pour qualifier les événements entre 1885 et 1914 (p.21). Une figure comme celle de Maurice Barrès portait déjà en elle les germes de tout le fascisme ultérieur. Et quand j'ai énoncer la même hypothèse en 1958, je me suis heurté à une surprenante incompréhension de la part des experts français...
2.4. La France comme contre-modèle. Le second argument qu'avance Sternhell est plus complexe. Il contourne deux écueils. Parmi les grands pays de l'Europe continentale, la France est celui où la position dominante de l'idéologie et de la praxis politique du libéralisme a été la moins menacée, du moins jusqu'à la défaite militaire de 1940 (p.41). Sternhell souligne (p.42) le fait que la révolution libérale la plus importante et la plus exemplaire de l'histoire s'est déroulée dans ce pays et attire notre attention sur les phénomènes du "consensus républicain" (p.43) et du "consensus centriste" (p.52) qui sont les clés de voûte de l'histoire française contemporaine. C'est précisément à cause de ces inébranlables consensus que Sternhell opte pour la France comme champ d'investigation. Car le fascisme, en France, n'est jamais parvenu au pouvoir (p.293) et, écrit Sternhell, "le fascisme n'y a jamais dépassé le stade de la théorie et n'a jamais souffert des compromissions inévitables qui faussent toujours d'une façon ou d'une autre l'idéologie officielle d'un régime. Ainsi on pénètre sa signification profonde et, en saisissant l'idéologie fasciste à ses origines, dans son processus d'incubation, on aboutit à une perception plus fidèle des mentalités et des comportements. Et on comprend mieux, semble-t-il, la complexité des situations et l'ambiguïté des attitudes qui font le tissu des années trente". C'est là, de toute évidence, un principe heuristique, dérivé d'une option radicalement gramsciste qui pose le primat des idées et réfute celui des contraintes factuelles.
3. Les problèmes de "périodisation"
3.1. Impossibilité de poser des datations exactes. Comme doit le faire tout véritable historien, Sternhell fait varier légèrement les dates. Mis à part pour les événements ponctuels, il n'est pas aisé de fournir des dates précises, bien délimitées dans le temps, pour désigner l'émergeance ou l'assomption d'un courant d'idées politiques. C'est pourquoi Sternhell examine le phénomène "fasciste" dans l'espace d'un demi-siècle.
3.2. Continuité entre 1885 et 1940. Fait essentiel pour Sternhell: cette période est "dans l'histoire de l'Europe, une période véritablement révolutionnai- re". Et il poursuit: "En moins d'un demi-siècle, les réalités sociales, le mode de vie, le niveau technologique et, à beaucoup d'égards, la vision que se font les hommes d'eux-mêmes changent plus profondément qu'à aucun autre moment de l'histoire moderne" (p.45). Dès lors, cette période forme une unité, si toutefois l'on met entre parenthèses les quatre années de la Grande Guerre (pp.19 et 290). Et Sternhell l'écrit expressément: "Au cours de ce demi-siècle, les problèmes de fond n'ont guère varié" (p.60).
3.3. Trois générations. Bien qu'il soit conscient de cette continuité, Sternhell procède cenpendant à des subdivisions dans le temps; ainsi, par exemple, quand il parle des "fascistes de 1913" comme des fascistes d'un type particulier. Il distingue trois générations de fascistes (cf. pp. 30, 52 et 60): d'abord les boulangistes et les anti-dreyfusards de la fin des années 80; ensuite, avant 1914, ceux de la "deuxième génération", celle du mouvement des "Jaunes" dans le monde ouvrier et de l'Action Française de Maurras, qui atteint alors son apogée; en finale, il évoque, comme troisième génération, le "fascisme d'après-guerre".
3.4. Le poids d'une époque. Il est à remarquer que Sternhell accorde nettement plus de poids aux premières décennies de l'époque qu'il étudie. Pour lui, sur le plan qualitatif, les années qui précèdent la Grande Guerre revêtent davantage d'importance que les décennies qui les suivirent car, dans cette avant-guerre, tout ce qui est essentiel dans l'élaboration du fascisme doctrinal a été dit et mis en œuvre.
4. Prolégomènes du fascisme
4.1. Refus de prendre en considération les groupuscules excentriques. Sternhell s'intéresse aux "propagateurs d'idées". Il ne ressent aucune envie de perdre son temps à étudier ce fascisme folklorique de quelques illuminés qui jouent aux brigands, fascisme caricatural dont les médias font leurs choux gras. Il n'a que mépris pour ceux qui axent leurs recherches sur ce type de phénomènes marginaux (p.9): "A l'époque déjà, quand un groupe de la Solidarité française se fait photographier à l'entraînement au pistolet, toute la presse de gauche en parle pendant des semaines: un quelconque défilé de quelques dizaines de "chemises bleues" soulève alors beaucoup plus d'intérêt que le patient travail de sape d'un Thierry Maulnier ou d'un Bertrand de Jouvenel...".
4.2. Le fascisme, une idéologie comme les autres. Sternhell parle de la "banalité du fascisme" (p.296): "Dans les années trente, le fascisme constitue une idéologie politique comme les autres, une option politique légitime, un état d'esprit assez courant, bien au-delà des cercles restreints qui assument leur identité fasciste...". Selon Sternhell, le fascisme était "un phénomène possédant un degré propre d'autonomie, d'indépendance intellectuelle" (p.16). Il s'élève contre "le refus fondamental de voir dans le fascisme autre chose qu'un accident de l'histoire européenne" (p.18). Pour Sternhell donc, c'est une erreur de ne considérer le fascisme que comme "une simple aberration, un accident, sinon un accès de folie collective..." (p.18). A la fin de son ouvrage (p.296), Sternhell nous met en garde contre ceux qui propagent l'opinion que les fascistes n'étaient que des "marginaux". Nombreux sont les "fascistes" qui ont été jugés, par leurs contemporains, comme les "plus brillants représentants de leur génération" (Luchaire, Bergery, Marion, de Jouvenel).
4.3. Les courroies de transmission. "L'idéologie fasciste constitue, en France, un phénomène de loin plus diffus que le cadre restreint et finalement peu important des adhérents aux groupuscules qui s'affublent de ce titre" (p.310). Deux pages plus loin, Sternhell explique comment il s'est fait que "l'idée fasciste" ait pu se propager dans un milieu si prêt à recevoir son message: "Les fascistes purs furent toujours peu nombreux et leurs forces dispersées. Leur influence véritable s'exercera par une contribution continue à la cristallisation d'un certain climat intellectuel; par le jeu des courroies de transmissions secondaires: des hommes, des mouvements, des revues, des cercles d'études,..." (p.312).
4.4. Difficulté de situer sociologiquement le fascisme. Sternhell insiste sur le fait que le fascisme "prolifère aussi bien dans les grands centres industriels de l'Europe occidentale que dans les pays sous-développés d'Europe de l'Est" (p.17). Et il aime se moquer de ceux qui croient pouvoir ranger le fascisme dans des catégories sociales bien déterminées. Il est significatif que Sternhell attire notre attention sur une constante de l'histoire des fascismes: "le glissement à droite d'éléments socialement avancés mais fondamentalement opposés à la démocratie libérale" (p.29). Si cette remarque se vérifie, elle s'opposera à toutes les tentatives de rattacher l'idéologie fasciste à des groupes sociaux trop bien définis.
4.5. Pour expliquer le fascisme: ni crises économiques ni guerres. Ce qui m'a frappé aussi chez Sternhell, c'est l'insistance qu'il met à montrer la relative indépendance du fascisme vis-à-vis de la conjoncture (pp.18 et 290). Il ne croit pas que la naissance du fascisme soit due à la pression de crises économiques et, assez étonnamment, estime que la première Guerre mondiale (ou tout autre conflit) a eu peu d'influence sur l'émergence du phénomène. En ce sens, Sternhell s'oppose à la majorité des experts ès-fascisme (pp.96 et 101). C'est dans cette thèse, précisément, que se manifeste clairement l'option "gramsciste" de Sternhell, nonobstant le fait que jamais le nom de Gramsci n'apparaît dans l'œuvre du professeur israëlien. Sternhell ne prend les "crises" au sérieux que lorsqu'il s'agit de crises morales, de crises des valeurs ou de crise globale, affectant une civilisation dans son ensemble.
4.6. "Auschwitz" en tant qu'argument-massue n'apparaît nulle part. Sternhell fait preuve d'une étonnante objectivité, ce qui est particulièrement rare dans les études sur le fascisme. Mais une telle attitude semble apparemment plus facile à adopter en Israël qu'à New York ou à Zurich. Ainsi, Sternhell n'hésite pas à reconnaître au fascisme "une certaine fraîcheur contestataire, une certaine saveur de jeunesse" (p.80). Il renonce à toute pédagogie moralisatrice. Mais il est très conscient du "problème de la mémoire", mémoire réprimée et refoulée; il l'évoquera notamment à propos de certaines figures au passé fasciste ou fascisant qui, après 1945, ont opté pour la réinsertion en se faisant les porte-paroles du libéralisme: Bertrand de Jouvenel (p.11), Thierry Maulnier (p.12) et surtout le philosophe du personnalisme, fondateur de la revue Esprit , Emmanuel Mounier (pp 299 à 310).
5. La formule du fascisme chez Sternhell
5.1. Les carences du libéralisme et du marxisme. Après cette introduction, nous sommes désormais en mesure d'expliciter l'alchimie du fascisme selon Sternhell. Pour cet historien israëlien, le fascisme s'explique en fonction d'un préliminaire historique, sans lequel il serait incompréhensible: l'incapacité du libéralisme bourgeois et du marxisme à assumer les tâches imposées par le XXème siècle.Cette incapacité constitue une carence globale, affectant toute notre civilisation, notamment toutes les institutions, les idéologies, les convictions qu'elle doit au XVIIIème, siècle du rationalisme et du mécanicisme bourgeois. Libéralisme et marxisme sont pour Sternhell les deux faces d'une même médaille. Inlassablement, il souligne que la crise de l'ordre libéral a précédé le fascisme, que cette crise a créé un vide où le fascisme a pu se constituer. Fallait-il nécessairement que ce fascisme advienne? Sternhell ne se prononce pas, mais toute sa démonstration suggère que cette nécessité était inéluctable.
5.2. Révisionnistes de gauche et nationalistes déçus. Généralement, pour expliquer la naissance du fascisme, on évoque la présence préalable d'un nationalisme particulièrement radical et exacerbé. Sternhell, lui, trouve cette explication absurde. D'après le modèle explicatif qu'il nous suggère, l'origine du fascisme s'explique bien davantage par le fait qu'aux extrémités, tant à gauche qu'à droite, du spectre politique, des éléments se sont détachés pour se retrouver en dehors de ce spectre et former un troisième et nouvel élément qui n'est plus ni de gauche ni de droite. Dans la genèse du fascisme, Sternhell n'aperçoit aucun apport appréciable en provenance du centre libéral. D'après lui, le fascisme résulte de la collusion de radicaux de gauche, qui n'admettent pas les compromis des modérés de leur univers politique avec le centre mou libéral, et de radicaux de droite. Le fascisme est, par suite, un amalgame de désillusionnés de gauche et de désillusionnés de droite, de "révisionnistes" de gauche et de droite. Ce qui paraît important aux yeux de Sternhell, c'est que le fascisme se situe hors du réseau traditionnel gauche/centre/droite. Dans l'optique des fascistes, le capitalisme libéral et le socialisme marxiste ne s'affrontent qu'en apparence. En réalité, ils sont les deux faces d'une même médaille. L'opposition entre la "gauche" et la "droite" doit disparaître, afin qu'hommes de gauche et hommes de droite ne soient plus exploités comme chiens de garde des intérêts de la bourgeoisie libérale (p.33). C'est pourquoi la fin du XIXème siècle voit apparaître de plus en plus de notions apparemment paradoxales qui indiquent une fusion des oppositions en vigueur jusqu'alors. L'exemple le plus connu de cette fusion est la formule interchangeable: nationalisme social / socialisme national. Sternhell (p.291) insiste sur la volonté d'aller "au-delà", comme caractéristique du climat fasciste. Le terme "au-delà" se retrouve dans les titres de nombreux manifestes fascistes ou préfascistes: "Au-delà du nationalisme" (Thierry Maulnier), "Au-delà du marxisme" (Henri De Man), "Au-delà du capitalisme et du socialisme" (Arturo Labriola), "Au-delà de la démocratie" (Hubert Lagardelle). Ce dernier titre nous rappelle que le concept de "démocratie" recouvrait le concept de "libéralisme" jusque tard dans le XXème siècle. Chez Sternhell également, le concept de "capitalisme libéral" alterne avec "démocratie capitaliste" (p.27).
5.3. L'anti-ploutocratisme. L'homme de gauche qu'est Sternhell prend les manifestations sociales-révolutionnaires du fascisme plus au sérieux que la plupart des autres analystes, historiens et sociologues de son camp. Si Sternhell avait entrepris une étude plus poussée des courants philosophiques et littéraires de la fin du XIXème, il aurait découvert que la haine envers la "domination de l'argent", envers la ploutocratie, participait d'un vaste courant à l'époque, courant qui débordait largement le camp socialiste. Cette répulsion à l'encontre de la ploutocratie a été, bien sûr, un ferment très actif dans la gestation du fascisme. De nombreux groupes fascistes s'aperçurent que l'antisémitisme constituait une vulgarisation de cette répugnance, apte à ébranler les masses. L'antisémitisme, ainsi, offrait la possibilité de fusionner le double front fasciste, dirigé simultanément contre le libéralisme bourgeois et le socialisme marxiste, en une unique représentation de l'ennemi. Parallèlement, cette hostilité envers la ploutocratie pré-programmait très naturellement le conflit qui allait opposer fascistes et conservateurs.
5.4. La longue lutte entre conservateurs et fascistes. Vu la définition du fascisme qu'esquisse Sternhell, il n'est guère étonnant qu'il parle d'une "longue lutte entre la droite et le fascisme" (p.20) comme d'une caractéristique bien distincte, quoiqu'aujourd'hui méconnue, de l'époque et des situations qu'il décrit. Et il remarque: "Il en est d'ailleurs ainsi partout en Europe: les fascistes ne parviennent jamais à ébranler véritablement les assises de l'ordre bourgeois. A Paris comme à Vichy, à Rome comme à Vienne, à Bucarest, à Londres, à Oslo ou à Madrid, les conservateurs savent parfaitement bien ce qui les sépare des fascistes et ils ne sont pas dupes d'une propagande visant à les assimiler" (p.20). Aussi Sternhell s'oppose-t-il (p.40) clairement à la classification conventionnelle de la droite française, opérée par René Rémond, qui l'avait répartie en trois camps: les ultras, les libéraux-conservateurs et les bonapartistes. Il n'y a, en fait, jamais eu que deux camps de droite, les libéraux et les conservateurs, auxquels se sont opposés les révolutionnaires, les dissidents et les contestataires.
5.5. A la fois révolutionnaires et modernes. Avec ces deux termes, utilisés par Sternhell pour désigner le fascisme, l'historien israëlien a choqué ses collègues politologues. Pour lui, en effet, le fascisme est un phénomène réellement révolutionnaire et résolument moderne. "Une idéologie conçue comme l'antithèse du libéralisme et de l'individualisme est une idéologie révolutionnaire". Plus loin (p.35), Sternhell expose l'idée, d'après lui typiquement fasciste, selon laquelle le facteur révolutionnaire qui, en finale, annihile la démocratie libérale est non pas le prolétariat, mais la nation. Et il ajoute: "C'est ainsi que la nation devient l'agent privilégié de la révolution" (p.35). Les passages évoquant le modernisme du fascisme sont tout aussi surprenants. A propos d'un de ces passages (p.294), on pourrait remarquer que cette attribution de modernisme ne concerne que les fascismes italien et français:"Car le fascisme possède un côté moderniste très développé qui contribue à creuser le fossé avec le vieux monde conservateur. Un poème de Marinetti, une œuvre de Le Corbusier sont immédiatement adoptés par les fascistes, car, mieux qu'une dissertation littéraire, ils symbolisent tout ce qui sépare l'avenir révolutionnaire du passé bourgeois". Un autre passage s'adresse clairement au fascisme dans son ensemble: "L'histoire du fascisme est donc à beaucoup d'égard l'histoire d'une volonté de modernisation, de rajeunissement et d'adaptation de systèmes et de théories politiques hérités du siècle précédent aux nécessités et impératifs du monde moderne. Conséquence d'une crise générale dont les symptômes apparaissent clairement dès la fin du siècle dernier, le fascisme se structure à travers toute l'Europe. Les fascistes sont tous parfaitement convaincus du caractère universel du courant qui les guide, et leur confiance dans l'avenir est dès lors inébranlable".
6. Eléments particuliers de l'idéologie fasciste
6.1. L'anti-matérialisme. Puisque, pour Zeev Sternhell, le fascisme n'est pas simplement le produit d'une mode politique, mais une doctrine, il va lui attribuer certains contenus intellectuels. Mais comme ces contenus intellectuels se retrouvent également en dehors du fascisme, ce qui constitue concrètement le fascisme, c'est une concentration d'éléments souvent très hétérogènes en une unité efficace. Citons les principaux éléments de cette synthèse. Sternhelle met principalement l'accent sur l'anti-matérialisme (pp. 291 & 293): "Cette idéologie constitue avant tout un refus du matérialisme, c'est-à-dire de l'essentiel de l'héritage intellectuel sur lequel vit l'Europe depuis le XVIIème siècle. C'est bien cette révolte contre le matérialisme qui permet la convergence du nationalisme antilibéral et antibourgeois et de cette variante du socialisme qui, tout en rejetant le marxisme, reste révolutionnaire...Tout anti-matérialisme n'est pas fascisme, mais le fascisme constitue une variété d'anti-matérialisme et canalise tous les courants essentiels de l'anti-matérialisme du XXème siècle...". Sternhell cite également les autres éléments de l'héritage auquel s'oppose le fascisme: le rationalisme, l'individualisme, l'utilitarisme, le positivisme (p.40). Cette opposition indique que cet anti-matérialisme est dirigé contre toute hypothèse qui voudrait que l'homme soit conditionné par des données économiques. C'est quand Sternhell parle de la psychologie que l'on aperçoit le plus clairement cette opposition. Ainsi, il relève (p. 294) que les "moralistes" Sorel, Berth et Michels "rejettent le matérialisme historique qu'ils remplacent par une explication d'ordre psychologique". "Finalement", poursuit Sternhell, "ils aboutissent à un socialisme dont les rapports avec le prolétariat cessent d'être essentiels".Et il insiste: "Le socialisme commence ainsi, dès le début du siècle, à s'élargir pour devenir un socialisme pour tous, un socialisme pour la collectivité dans son ensemble,..." (p. 295). Plus explicite encore est un passage relatif au révisionnisme de Henri De Man, qui, lui, cherche la cause première de la lutte des classes "moins dans des oppositions d'ordre économique que dans des oppositions d'ordre psychologique".
6.2. Les déterminations. Il serait pourtant faux d'affirmer que, pour le fascisme, l'homme ne subit aucune espèce de détermination. Pour les intellectuels fascistes, ces déterminations ne sont tout simplement pas de nature "mécanique"; entendons par là, de nature "économique". Comme l'indique Sternhell, le fasciste ne considère pas l'homme comme un individu isolé, mais comme un être soumis à des contraintes d'ordres historique, psychologique et biologique. De là, la vision fasciste de la nation et du socialisme. La nation ne peut dès lors qu'être comprise comme "la grande force montante, dans toutes ses classes rassemblées" (p. 32). Quant au socialisme, le fasciste ne peut se le représenter que comme un "socialisme pour tous", un "socialisme éternel", un "socialisme pédagogique", un "socialisme de toujours", bref un socialisme qui ne se trouve plus lié à une structure sociale déterminée (Cf. pp. 32 & 295).
6.3. Le pessimisme. Sternhell considère comme traits les plus caractéristiques du fascisme "sa vision de l'homme comme mu par des forces inconscientes, sa conception pessimiste de l'immuabilité de la nature humaine, facteurs qui mènent à une saisie statique de l'histoire: étant donné que les motivations psychologiques restent les mêmes, la conduite de l'homme ne se modifie jamais". Pour appuyer cette considération, Sternhell cite la définition du pessimisme selon Sorel: "cette doctrine sans laquelle rien de très haut ne s'est fait dans le monde" (p. 93). Cette définition rappelle en quoi consiste le véritable paradoxe de l'existentialité selon les conservateurs: la perception qu'a l'homme de ses limites ne le paralyse pas, mais l'incite à l'action. L'optimisme, au contraire, en surestimant les potentialités de l'homme, semble laisser celui-ci s'enfoncer sans cesse dans l'apathie.
6.4. Volontarisme et décadence. Sternhell, qui n'est pas philosophe mais historien, n'est nullement conscient de ce "paradoxe du conservateur". Il constate simplement la présence, dans les fascismes, d'une "énergie tendue" (p. 50) et signale sans cesse cette volonté fasciste de dominer le destin (pp. 65 & 294). Sternhell constate que le problème de la décadence inquiète le fasciste au plus haut point. C'est la raison pour laquelle celui-ci veut créer un "homme nouveau", un homme porteur des vertus classiques anti-bourgeoises, des vertus héroïques, un homme à l'énergie toujours en éveil, qui a le sens du devoir et du sacrifice. Le souci de la décadence aboutit à l'acceptation de la primauté de la communauté sur l'individu. La qualité suprême, pour un fasciste, c'est d'avoir la foi dans la force de la volonté, d'une volonté capable de donner forme au monde de la matière et de briser sa résistance. Sternhell se livre à de pareilles constatations jusqu'à la dernière ligne de son ouvrage; ainsi, à la page 312: "Dans un monde en détresse, le fascisme apparaît aisément comme une volonté héroïque de dominer, une fois encore, la matière, de dompter, par un déploiement d'énergie, non seulement les forces de la nature, mais aussi celles de l'économie et de la société".
6.5. La question de la vérité. D'une part, le pessimisme; d'autre part, le volontarisme. Pour une pensée logique, ce ne pourrait être là qu'un paradoxe. Mais le fascisme se pose-t-il la question de la vérité? Voyons ce que Sternhell déclare à propos de l'un des "pères fondateurs" du fascisme: "Pour un Barrès par exemple, il ne s'agit plus de savoir quelle doctrine est juste, mais quelle force permet d'agir et de vaincre" (p. 50). Comme preuve du fait que le fascisme ne juge pas une doctrine selon sa "vérité", mais selon son utilité, Sternhell cite Sorel au sujet des "mythes" qui, pour l'auteur des Réflexions sur la violence, constituent le moteur de toute action: "...les mythes sont des "systèmes d'images" que l'on ne peut décomposer en leurs éléments, qu'il faut prendre en bloc comme des forces historiques... Quand on se place sur le terrain des mythes, on est à l'abri de toute réfutation..." (pp. 93 & 94).
En résumé...
Nous n'avons pu recenser le livre de Sternhell que dans ses lignes fondamentales. Nous avons dû négliger bien des points importants, tels son allusion à la "nouvelle liturgie" comme partie intégrante du fascisme (p. 51), à son anti-américanisme latent (même avant 1914) (p. 290); nous n'avons pas approfondi sa remarque signalant que, pour le fascisme, la lutte contre le libéralisme intérieur a toujours été plus importante que la lutte menée contre celui-ci pas certains dictateurs... (p. 34). En tant que recenseur, je me permets deux remarques, pouvant s'avérer utiles pour le lecteur allemand. D'abord, l'Allemagne n'est que peu évoquée chez Sternhell. En fait de bibliographie allemande, il ne cite que les livres de Nolte traduits en français; on peut dès lors supposer qu'il ne maîtrise pas la langue de Goethe. Ma seconde remarquer sera de rappeler au lecteur allemand ma tentative de redonner une consistance au concept de "fascisme", en le limitant à un certain nombre de phénomènes historiques (Cf. Der faschistische Stil, 1973; trad.franç.: Le "style" fasciste, in Nouvelle Ecole, n°42, été 1985). Sternhell, pour sa part, a donné au terme "fascisme" une ampleur énorme. Son effort est justifiable, dans la mesure où sa vaste définition du "fascisme", au fond, correspond à ce que je désignais sous l'étiquette de "révolution conservatrice". Bref, on peut dire du livre de Sternhell qu'il a envoyé au rebut la plupart des travaux consacrés jusqu'ici à l'étude du fascisme...
Armin MOHLER.
(recension tirée de la revue Criticón, Munich, n°76, mars-avril 1983; traduction française d'Elfrieda Popelier).
 In Preußentum und Sozialismus (1919), gli Italiani, insieme ai Francesi, sono le nazioni anarchiche contrapposte alle nazioni socialiste (Spagnoli, Inglesi, Prussiani). «Nel XV secolo, l’anima di Firenze si rivoltava contro lo spirito gotico […]. Quello che noi chiamiamo Rinascimento è la volontà antigotica di un’arte composta e di una formazione intellettuale raffinata; è, assieme alla gran quantità di Stati predoni, alle repubbliche, ai condottieri, alla politica del “momento per momento” descritta nel classico libro di Machiavelli, al ristretto orizzonte di tutti i disegni di potenza – compresi quelli del Vaticano in quel periodo – una protesta contro la profondità e la vastità della coscienza cosmica faustiana. A Firenze è nato il tipo del popolo italiano». Nei frammenti storici, ascriverà l’anima di Firenze all’origine etrusca, ma non si dilungherà altrimenti sull’Italia.
In Preußentum und Sozialismus (1919), gli Italiani, insieme ai Francesi, sono le nazioni anarchiche contrapposte alle nazioni socialiste (Spagnoli, Inglesi, Prussiani). «Nel XV secolo, l’anima di Firenze si rivoltava contro lo spirito gotico […]. Quello che noi chiamiamo Rinascimento è la volontà antigotica di un’arte composta e di una formazione intellettuale raffinata; è, assieme alla gran quantità di Stati predoni, alle repubbliche, ai condottieri, alla politica del “momento per momento” descritta nel classico libro di Machiavelli, al ristretto orizzonte di tutti i disegni di potenza – compresi quelli del Vaticano in quel periodo – una protesta contro la profondità e la vastità della coscienza cosmica faustiana. A Firenze è nato il tipo del popolo italiano». Nei frammenti storici, ascriverà l’anima di Firenze all’origine etrusca, ma non si dilungherà altrimenti sull’Italia.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg



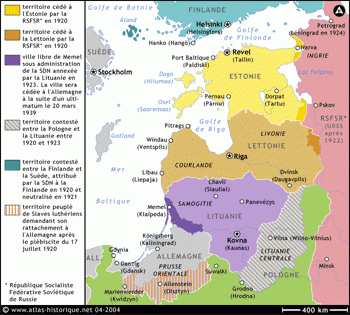
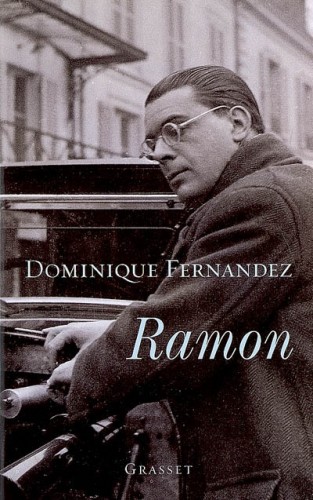
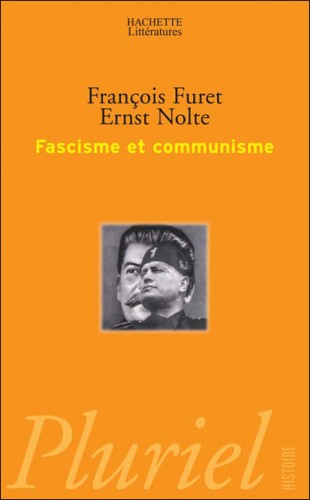
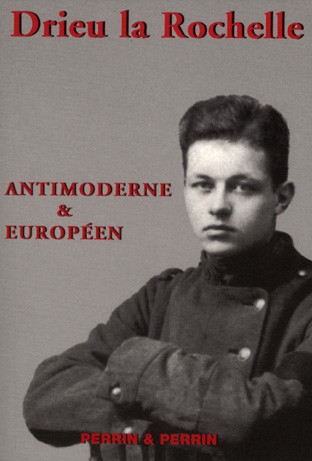



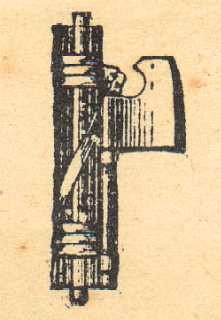
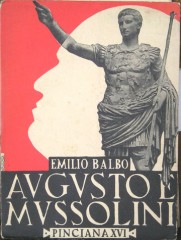 Numerosi autori antichi hanno parlato di Historia magistra vitae ("la Storia è maestra di vita") - formula coniata da Cicerone -, e molti intellettuali posteriori ribadirono e riproposero il concetto. La Storia, intesa in senso gnoseologico (ossia la conoscenza che noi abbiamo dei fatti storici), sarebbe un ottimo "strumento" grazie al quale ci è possibile riconoscere eventi simili tra loro, e che ci permetterebbe quindi di comportarci di conseguenza. Lo stesso Machiavelli basò su questo concetto il suo celeberrimo trattato Il Principe: colui che conosce la storia e quali furono gli esempi di virtù o d’errore che occorsero di fronte ad analoghe condizioni, egli saprà indirizzare gli eventi a suo favore e sarà il "vero" e ottimo principe, ossia il reggitore dello Stato. Tuttavia Guicciardini si mostrò scettico nei confronti di questa teoria, e obiettò che gli avvenimenti storici non si ripetono mai nella stessa maniera, e che il buon statista deve essere in grado di interpretarli correttamente, escogitando volta a volta le soluzioni migliori.
Numerosi autori antichi hanno parlato di Historia magistra vitae ("la Storia è maestra di vita") - formula coniata da Cicerone -, e molti intellettuali posteriori ribadirono e riproposero il concetto. La Storia, intesa in senso gnoseologico (ossia la conoscenza che noi abbiamo dei fatti storici), sarebbe un ottimo "strumento" grazie al quale ci è possibile riconoscere eventi simili tra loro, e che ci permetterebbe quindi di comportarci di conseguenza. Lo stesso Machiavelli basò su questo concetto il suo celeberrimo trattato Il Principe: colui che conosce la storia e quali furono gli esempi di virtù o d’errore che occorsero di fronte ad analoghe condizioni, egli saprà indirizzare gli eventi a suo favore e sarà il "vero" e ottimo principe, ossia il reggitore dello Stato. Tuttavia Guicciardini si mostrò scettico nei confronti di questa teoria, e obiettò che gli avvenimenti storici non si ripetono mai nella stessa maniera, e che il buon statista deve essere in grado di interpretarli correttamente, escogitando volta a volta le soluzioni migliori.