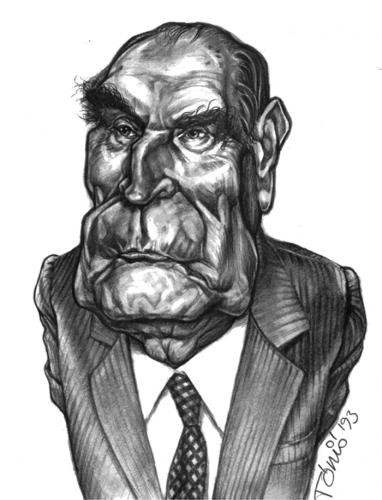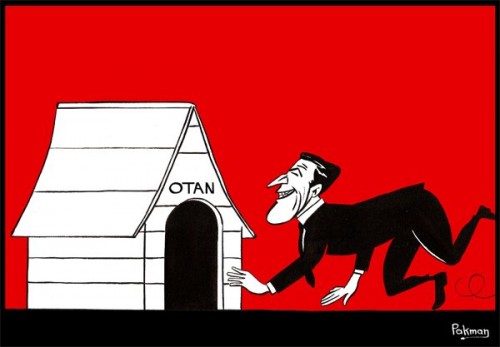Souvenirs
Souvenirsjeudi, 30 avril 2009
Le crépuscule des élites
Le Crépuscule des élites
Cf. : http://www.tatamis.fr
 Préface de Roland Dumas
Préface de Roland Dumas
UN OUVRAGE DECAPANT
Après une carrière riche d’écrivain, de journaliste et de chef d'entreprise, Louis Dalmas consacre son talent à la publication d'un livre intitule de façon amusante “Le crépuscule des élites”.
Mais le plus troublant n’est pas dans le titre, il est dans la lecture de chacun des chapitres. II touche à tout avec une ironie cinglante et des vérités qui sont communicatives. Le tout est bien écrit, de façon agréable, et composé de telle manière qu'on s'y retrouve toujours.
Chacun y découvrira des situations ou bien des problèmes qu'il aura connus dans sa vie, dont il a souffert et sur lesquels il n'a pas toujours conclu ; qu'il s’agisse de l’information, qu'il s’agisse de l'Amérique, qu’il s’agisse du Proche-Orient, qu’il s’agisse de la Yougoslavie dont j’ai cru compren-dre que Louis Dalmas était amoureux (en parti-culier de la Serbie), rien ne manque à cette œuvre.
Mais, le plus drô1e du livre est dans la confection de chaque chapitre. En effet, l’écriture elle-même est composée de personnages qui interviennent et qui disent les choses dans le langage de tout le monde. Madame Sorladon (?) ou Madame Méla-mois (?) dont les noms phonétiquement font déjà rire, sont chargées de nous décrire le cadre dans lequel va se dérouler le prochain chapitre et sont des comparses nécessaires à la bonne marche de cet ouvrage.
On passe de la conversation de tous les jours à quelque chose de plus sophistiqué, de plus recherché, de plus acide aussi. On y trouve des phrases de bon sens, des évidences comme on peut en entendre tous les jours. Celle-ci par exem-ple : “L’évolution des sociétés est lente et l’erreur de certains politiciens est de ne pas s’en rendre compte”. À qui le dites vous, Madame Sorladon ?
Madame Mélamois – au nom si évocateur – est en réalité Madame “Tout le Monde”.
L’information, la presse ne trouvent guère grâce aux yeux de Louis Dalmas. Je ne le lui reproche-rai pas, bien au contraire. J’ai noté ce passage : “Selon ces cuistres (les journalistes !), toute opinion, pour être crédible, doit être aussi en-nuyeuse et difficile à assimiler que possible. Il n'y a qu’à feuilleter le terne oracle de l'intelligentsia française – Le Monde – pour en être convaincu”. C’est une opinion que je partage depuis un grand nombre d’années et que le temps qui passe n’altè-re en rien...
Mais il peut être bien plus sévère encore. Quel spectacle que celui-ci : “L’équipe est sur le terrain. Les joueurs ont les yeux bandés. Comme ils ne voient ni le ballon, ni les buts, ils courent dans tous les sens et shootent dans le vide. Sur les maillots, on distingue le logo du club, un cerveau avec des trous de gruyère sur un plateau de fromages. De temps en temps, deux hommes se heurtent de plein fouet. On les évacue sur une civière marquée ‘offerte par la Banque Mondiale’ et le grand écran à un bout du stade affiche ‘c’est la faute à Milosevic’”. Comme quelqu'un d’autre avait écrit “C'est la faute à Voltaire et à Rous-seau !”...
Tout le texte est à l’avenant, les raccourcis sont saisissants, les images percutantes, mais il res-pecte un certain équilibre quand même dans la critique systématique qui correspond au titre du “Crépuscule des élites”. Le rythme respecte la même cadence tout au long du livre et à chaque chapitre. II est enjoué, équilibré et agréable.
Je recommanderai particulièrement le passage intitulé “Les deux visages de l'Amérique”.
L'ensemble est signifiant. II mérite d’être lu com-me tel. Ce livre connaîtra le succès par son originalité et par la maîtrise de la pensée de l'au-teur.
J’y retrouve à plusieurs occasions ce sentiment d’affection que nourrit l'auteur pour le peuple serbe. Dans le dialogue entre Madame Mélamois et Madame Sorladon, nos deux complices accom-pagnatrices, apparaît cette phrase :
“– Mais ces Serbes, ils ont tout de même commis des atrocités, non ?
– Qu’est ce que vous croyez Madame Mélamois, que la guerre c’est un match de football, déjà que dans les stades on se fout sur la gueule, alors sur les champs de bataille, vous imaginez...”
Et plus loin :
“– Et comme le dit Monsieur, quand on diabolise tout un peuple comme on l’a fait avec les Serbes, ça devient du racisme et c’est d'autant plus triste que ce coup-là, parmi les persécuteurs, se sont trouvés les descendants ou les proches de ceux mêmes qui avaient été persécutés.
– Les juifs ?
– Non, Madame Mélamois, pas les juifs, des juifs...”
Tout cela flaire la bonne humeur en surface. Mais en réalité, on plonge dans la profondeur des choses.
En écrivant cette préface, je ne puis m’empêcher de rapprocher ces pages écrites pour être lues de la période ou je dirigeais le ministère des Affaires étrangères et où le sentiment anti-serbe dominait. En effet, la scène politique internationale, au mé-pris de ce qu'avait été I'histoire de nos deux pays, histoire aux eaux mêlées, en était le reflet.
Roland Dumas
Avocat, ministre des Relations extérieures de 1984 à 1986, ministre des Affaires étrangères de 1988 à 1993, Président du Conseil Constitutionnel de 1995 à 2000.
Prix : 19,90€
00:20 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sociologie, politique, actualité, monde contemporain, satire, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 29 avril 2009
Hommage à Jacques d'Arribehaude
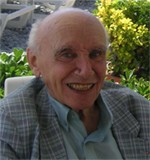
Hommage à Jacques d’Arribehaude
Le mois passé, j’évoquais le souvenir de Pierre Monnier mort à Nice le 27 mars 2006. Par une douloureuse coïncidence, peu de temps après avoir bouclé ce numéro, j’apprenais le décès de Jacques d’Arribehaude survenu le… 27 mars dans cette même ville où il s’était retiré depuis quelques années. Encore un témoin qui s’en va – et non des moindres. Au début des années soixante, il avait – lui et son complice Jean Guenot – rencontré Céline à Meudon. Ils lui posèrent des questions pertinentes auxquelles les journalistes ne l’avaient guère habitué. Témoignage d’autant plus précieux qu’il fit l’objet d’un enregistrement ¹.
Mais la figure de Jacques d’Arribehaude ne se limite pas, loin s’en faut, à cela. Il nous laisse, en outre, un récit de qualité (Adieu Néri, Prix Cazes 1978) et surtout un journal dont je ne suis pas le seul à penser qu’il restera. La dernière lettre que j’ai reçue de lui date de décembre dernier. Il me remerciait précisément pour le compte rendu du dernier opus de son journal ² : « Je suis très touché par ce magnifique et généreux article. Votre mise en parallèle avec Léautaud est un superbe hommage, non seulement à S’en fout, mais à la poignée de lecteurs pour lesquels j’existe et qui me sont attachés. Et c’est très justement que vous rappelez l’importance capitale que n’a jamais cessé d’avoir Céline dans les méandres de l’existence. J’aimerais bien connaître avant de disparaître la reconnaissance qu’a connu Léautaud in extremis, et qui en fait une captivante Mémoire littéraire du siècle dernier, mais je n’y compte guère. Si la planète tourne encore, peut-être dans un siècle ou deux, pour peu qu’il existe encore quelques chercheurs et lecteurs. Comme disait Balzac, notre Shakespeare, “ Tout a toujours été de mal en pire” »
Pessimiste gai, Jacques m’a toujours frappé par son élégance morale. Jamais je ne l’ai entendu se plaindre, même lorsqu’il fut hospitalisé pour une grave opération au Val de Grâce où nous allâmes, Éric Mazet et moi, lui rendre visite. Au contraire : c’est là qu’il nous lut des pages extraites de son journal, pleines de cette roborative alacrité qui était la sienne. Si ses livres ne connurent jamais le succès public, au moins son talent fut-il reconnu par ses pairs : Pol Vandromme, Christian Dedet, Philippe Sénart ou Jean-Louis Curtis. Engagé dans les Forces françaises libres à dix-huit ans, décoré comme il se doit de ce qu’il appelait comiquement ses « bananes patriotiques » ³, Jacques d’Arribehaude estimait que son passé l’autorisait à commenter librement les aléas de l’histoire et de la politique. Et il ne s’en privait pas, ni dans son journal, ni dans les articles qu’il a écrits ici et là. C’était un homme d’une liberté sans faille qui ne craignait pas de tout dire, au risque de voir ses livres ne recevoir quasi aucun écho dans la grande presse, ce qui fut effectivement le cas.
Ce numéro entend rendre l’hommage qui lui est dû ; j’ai bien conscience qu’il est utopique d’évoquer ici toutes les facettes de cette riche personnalité. Grand diariste certes mais aussi voyageur-ethnologue, amoureux de peinture (il avait lui-même un joli talent d’aquarelliste), polémiste, fou de littérature et surtout homme attachant, fidèle en amitié et au jeune homme intrépide qu’il fut.
Marc LAUDELOUT
1. Céline à Meudon, 4 cassettes disponibles auprès de Jean Guenot, B.P. 40101, 92216 Saint-Cloud (90 € franco).
2. Marc Laudelout, « Le retour de Jacques d’Arribehaude », Le Bulletin célinien, n° 302, novembre 2008.
3. Médaille des Évadés, Croix du combattant volontaire de la Résistance, Croix des services volontaires dans la France libre, Croix du combattant 39-45, Chevalier de la Légion d’honneur.
00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Louis-Ferdinand Céline - Jacques d'Arribehaude
Louis-Ferdinand Céline - Jacques D'Arribehaude
À quoi donc restait-il attaché et de quelles valeurs gardait-il la nostalgie ? je remarquais que ce monde d'avant 14 où il était né et qu'il haïssait à bien des égards, lui laissait des souvenirs très contradictoires. Après un demi-siècle, son horreur de la société et des conditions d'exploitation de la Belle époque, restait intact, mais il s'y mêlait un respect profond pour la laborieuse honnêteté, la modestie patiente, humble et discrète, des petites gens d'alors, et que sa mère représentait parfaitement à ses yeux.
L'évolution du monde lui paraissait soumise à d'impitoyables lois biologiques, et les discours, les professions de toi idéologiques, les concerts de l'O.N.U. lui faisaient hausser les épaules. Pour lui, le blanc était « un fond de teint » appelé à se modifier. Il ne prétendait pas que le monde à venir serait meilleur ou pire, simplement ce monde-là ne le concernait plus, ne l'intéressait plus.
À la fin de sa vie, assez curieusement, il rendait hommage à Proust, bien loin de lui sans doute, mais fossoyeur génial, tout comme lui, d'un monde pourri.
Jacques d'Arribehaude
(Lomé, 26 octobre 1962)
Extrait du "Cahier de l'Herne Louis-Ferdinand Céline", 1963, volume I.
Source
00:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 avril 2009
Terre & Peuple Magazine n°39
Terre et Peuple Magazine n°39 - Printemps 2009
| ||||||||
00:30 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, nouvelle droite, géopolitique, identité, droite, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jean Giono e "Le Chant du Monde"
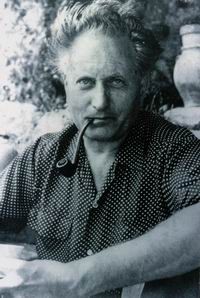
Jean Giono e “Le Chant du Monde” | |
|
|
| |
| Il paganesimo di Jean Giono (foto) è stato ben identificato da Thierry Maulnier, che scriveva nel 1943, nella sua rubrica del quotidiano “Laction française”: “Il signor Giono è uno di quei rari artisti per i quali il grande Pan non è morto e non è ancora pronto a morire”. Punto di vista rafforzato da quello di Henry Miller: “Nell’opera di Giono chiunque possiede una dose sufficiente di vitalità e di sensibilità, riconosce subito ‘le chant du monde’. Secondo me questo canto, di cui egli ci dà con ogni nuovo libro delle variazioni senza fine, è molto più prezioso, più commovente, più poetico del Cantico delle creature”. (The books in my life, 1951). Non si saprebbe spiegare meglio quale abisso separi il mondo biblico dall’universo di Giono. |
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, écologie, nature, provence, provençalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
An Interview with Dominique Venner
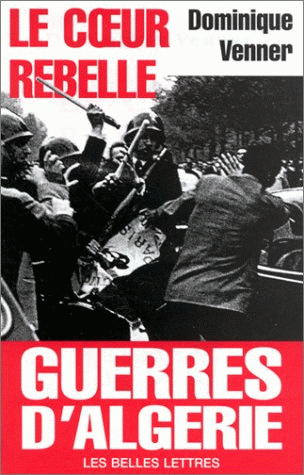
An Interview with Dominique Venner
by Michael O'Meara
TRANSLATOR’S NOTE: It’s testament to the abysmal state of our culture that hardly one of Dominique Venner’s more than forty books have been translated into English. But everything he writes bears directly on us — “us” here referring not specifically to the anglophone world, but to the European world that exists wherever white men still carry on in any of the old ways.
Venner is more than a gifted historian who has made major contributions to the most important chapters of modern, especially 20th-century European history. He has played a key role in both the development of the European New Right and the “Europeanization” of continental nationalionalism.
It is his “rebel heart” that explains his engagement in these great struggles, as well as his interests in the Russian Revolution, German fascism, French national socialism, the U.S. Civil War, and the two world wars. The universe I’ve discovered in his works is one that reminds me of Ernst von Salomon’s “Die Geächteten” — one of the Homeric epics of our age.
The following interview is about the rebel. Unlike the racial conservatives dominant in U. S. white nationalist ranks, European nationalism still bears traces of its revolutionary heritage — opposed as it is not merely to the alien, anti-national forces, but to the entire liberal modernist subversion, of which the United States has been the foremost exemplar. -Michael O’Meara
Question: What is a rebel? Is one born a rebel, or just happens to become one? Are there different types of rebels?
Dominique Venner: It’s possible to be intellectually rebellious, an irritant to the herd, without actually being a rebel. Paul Morand [a diplomat and novelist noted for his anti-Semitism and collaborationism under Vichy] is a good example of this. In his youth, he was something of a free spirit blessed by fortune. His novels were favored with success. But there was nothing rebellious or even defiant in this. It was for having chosen the side of the National Revolution between 1940 and 1944, for persisting in his opposition to the postwar regime, and for feeling like an outsider that made him the rebellious figure we have come to know from his “Journals.”
Another, though different example of this type is Ernst Jünger. Although the author of an important rebel treatise on the Cold War, Jünger was never actually a rebel. A nationalist in a period of nationalism; an outsider, like much of polite society, during the Third Reich; linked to the July 20 conspirators, though on principle opposed to assassinating Hitler. Basically for ethical reasons. His itinerary on the margins of fashion made him an anarch, this figure he invented and of which after 1932 he was the perfect representative. The anarch is not a rebel. He’s a spectator whose perch is high above the mud below.
Just the opposite of Morand and Jünger, the Irish poet Patrick Pearse was an authentic rebel. He might even be described as a born rebel. When a child, he was drawn to Erin’s long history of rebellion. Later, he associated with the Gaelic Revival, which laid the basis of the armed insurrection. A founding member of the first IRA, he was the real leader of the Easter Uprising in Dublin in 1916. This was why he was shot. He died without knowing that his sacrifice would spur the triumph of his cause.
A fourth, again very different example is Alexander Solzhenitsyn. Up until his arrest in 1945, he had been a loyal Soviet, having rarely questioned the system into which he was born and having dutifully done his duty during the war as a reserve officer in the Red Army. His arrest, his subsequent discovery of the Gulag and of the horrors that occurred after 1917, provoked a total reversal, forcing him to challenging a system which he once blindly accepted. This is when he became a rebel — not only against Communist, but capitalist society, both of which he saw as destructive of tradition and opposed to superior life forms.
The reasons that made Pearse a rebel were not the same that made Solzhenitsyn a rebel. It was the shock of certain events, followed by a heroic internal struggle, that made the latter a rebel. What they both have in common, what they discovered through different ways, was the utter incompatibility between their being and the world in which they were thrown. This is the first trait of the rebel. The second is the rejection of fatalism.
Q: What is the difference between rebellion, revolt, dissent, and resistance?
DV: Revolt is a spontaneous movement provoked by an injustice, an ignominy, or a scandal. Child of indignation, revolt is rarely sustained. Dissent, like heresy, is a breaking with a community, whether it be a political, social, religious, or intellectual community. Its motives are often circumstantial and don’t necessarily imply struggle. As to resistance, other than the mythic sense it acquired during the war, it signifies one’s opposition, even passive opposition, to a particular force or system, nothing more. To be a rebel is something else.
Q: What, then, is the essence of a rebel?
DV: A rebel revolts against whatever appears to him illegitimate, fraudulent, or sacrilegious. The rebel is his own law. This is what distinguishes him. His second distinguishing trait is his willingness to engage in struggle, even when there is no hope of success. If he fights a power, it is because he rejects its legitimacy, because he appeals to another legitimacy, to that of soul or spirit.
Q: What historical or literary models of the rebel would you offer?
DV: Sophocles’ Antigone comes first to mind. With her, we enter a space of sacred legitimacy. She is a rebel out of loyalty. She defies Creon’s decrees because of her respect for tradition and the divine law (to bury the dead), which Creon violates. It didn’t mater that Creon had his reasons; their price was sacrilege. Antigone saw herself as justified in her rebellion.
It’s difficult to choose among the many other examples. . . . During the War of Succession, the Yankees designated their Confederate adversaries as rebels: “rebs.” This was good propaganda, but it wasn’t true. The American Constitution implicitly recognized the right of member states to succeed. Constitutional forms had been much respected in the South. Robert E. Lee never saw himself as a rebel. After his surrender in April 1865, he sought to reconcile North and South. At this moment, the true rebels emerged, who continued the struggle against the Northern army of occupation and its collaborators.
Certain of these rebels succumbed to banditry, like Jesse James. Others transmitted to their children a tradition that has had a great literary posterity. In the “Vanquished,” one of William Faulkner’s most beautiful novels, there is, for example a fascinating portrait of a young Confederate rebel, Drusilla, who never doubts the justice of his cause or the illegitimacy of the victors.
Q: How can one be a rebel today?
DV: How can one not! To exist is to defy all that threatens you. To be a rebel is not to accumulate a library of subversive books or to dream of fantastic conspiracies or of taking to the hills. It is to make yourself your own law. To find in yourself what counts. To make sure that you’re never “cured” of your youth. To prefer to put everyone up against the wall rather than to remain supine. To pillage in this age whatever can be converted to your law, without concern for appearance.
By contrast, I would never dream of questioning the futility of seemingly lost struggles. Think of Patrick Pearse. I’ve also spoken of Solzhenitsyn, who personifies the magic sword of which Jünger speaks, “the magic sword that makes tyrants tremble.” In this Solzhenitsyn is unique and inimitable. But he owed this power to someone who was less great than himself. To someone who should gives us cause to reflect. In “The Gulag Archipelago,” he tells the story of his “revelation.”
In 1945, he was in a cell at Boutyrki Prison in Moscow, along with a dozen other prisoners, whose faces were emaciated and whose bodies broken. One of the prisoners, though, was different. He was an old White Guard colonel, Constantin Iassevitch. He had been imprisoned for his role in the Civil War. Solzhenitsyn says the colonel never spoke of his past, but in every facet of his attitude and behavior it was obvious that the struggle had never ended for him. Despite the chaos that reigned in the spirits of the other prisoners, he retained a clear, decisive view of the world around him. This disposition gave his body a presence, a flexibility, an energy that defied its years. He washed himself in freezing cold water each morning, while the other prisoners grew foul in their filth and lament.
A year later, after being transferred to another Moscow prison, Solzhenitsyn learned that the colonel had been executed. “He had seen through the prison walls with eyes that remained perpetually young. . . . This indomitable loyalty to the cause he had fought had given him a very uncommon power.” In thinking of this episode, I tell myself that we can never be another Solzhenitsyn, but it’s within the reach of each of us to emulate the old White colonel.
French Original
“Aujourd’hui, comment ne pas être rebelle?”
http://www.jisequanie.com/blogs/index.php?2006/06/18/13-entretien
avec-dominique-venner-comment-peut-on-ne-pas-etre-rebelle
On Venner
“From Nihilism to Tradition”
http://www.theoccidentalquarterly.com/vol4no2/mm-venner.html
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, nationalisme révolutionnaire, rébellion, coeur rebelle, droite, france, histoire, entretiens, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 24 avril 2009
Drieu on the Failure of the Third Reich
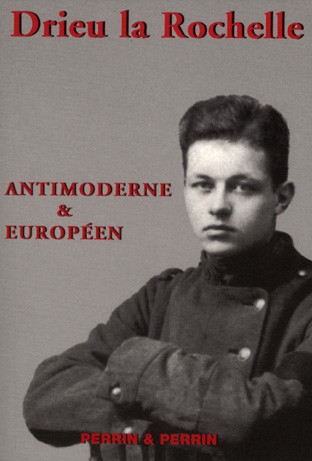
by Michael O’Meara
TRANSLATOR’S NOTE: The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany. This dictatorship — whose defining characteristic, East and West, is its techno-economic worship of the Jewish Moloch — was subsequently imposed on the rest of Europe and, in the form of globalization, now holds the whole world in its grip. For white nationalists, the defeat of National Socialist Germany is both the pivotal event of the 20th century and the origin of their own movement. Opposing the powers which are one generation away from exterminating their race, white nationalists resume, in effect, the struggle of the defeated Germans. But they do so not uncritically.
As an idea and a movement, National Socialism (like Fascism) was a product of the late 19th-century political convergence that brought together elements from the revolutionary anti-liberal wing of the labor movement and elements from the revolutionary anti-liberal wing of the nationalist right. Hitler’s NSDAP was the most imposing historical offshoot of this anti-liberal convergence, but one not always faithful to its origins — which bears on the fact
that Hitler shares at least part of the responsibility for the most devastating defeat ever experienced by the white race.
It is not enough, then, for the present generation of white nationalists to honor his heroic resistance to the anti-Aryan forces. Of greater need, it seems to me, is to identify and come to terms with his failings, for these, more than his triumphs, now weigh on our survival as a people.
The following is an excerpt from a piece that Pierre Drieu La Rochelle wrote in the dark days after August 1944, after the so-called “Liberation” of Paris and before the suicide that “saved” him from De Gaulle’s hangman. It was written in haste, on the run, and never completed, but is nevertheless an illuminating examination of Hitler’s shortcomings (even where incorrect).
The central point of Drieu’s piece (and it should be remembered that he, like many of France’s most talented thinkers and artists, collaborated with the Germans in the hope of creating a new European order) is that Germany alone was no match for the combined powers of the British Empire, the United States, and the Soviet Union. Only a Europe recast on the basis of National Socialist principles, he believed, could triumph against the Jew inspired coalition. Hitler’s petty bourgeois nationalism, critiqued here by Drieu, prevented him from mobilizing the various national families of Europe in a common front, proving that his distillation of the anti-liberal project was inadequate to the great tasks facing the white man in this period.
*
From Drieu’s “NOTES SUR L’ALLEMAGNE:”
I was shocked by the extreme political incompetence of the Germans in 1939, ‘40, and ‘41, after the victories [which made them Europe's master]. It was in this period that their political failings sealed the fate of their future military defeat.
These failings seem even greater than those committed under Napoleon [in the period 1799-1815, when the French had mastered Europe]. The Germans obviously drew none of the lessons from the Napoleonic adventure.
Was German incompetence the incompetence of fascism in general? This is the question.
The imbecilic maxim guiding Hitler was: “First, wage and win the war; then, reorganize Europe.” This maxim contradicted all the lessons of history, all the teachings of Europe’s greatest statesmen, particularly those of the Germans, like Frederick and Bismarck. It was Clausewitz who said war is only the extension of politics.
But even if one accepts Hitler’s maxim, the German dictator committed a number of military mistakes:
1. Why did he wait six months between the Polish campaign and the French campaign?
2. Why did he squander another ten months after the French campaign?
3. Why in late 1940 did he wage a futile aerial assault on England, instead of striking the British Empire at its most accessible point, Gibraltar?
After July 1940 [when no European power opposed him on the continent], he could have crossed Spain, destroyed the [English] naval base at Gibraltar, and closed off the Mediterranean.
The armistice with Pétain [which led to the establishment of the Vichy regime] was [another] German disaster. If the French had followed [Paul] Reynaud [the last Premier of the Third Republic who advocated continued resistance from France's North African colonies], the Germans would have been forced to do what was [militarily] necessary to win the war. For once master of Gibraltar, Hitler would have rendered [the English base at] Malta useless, avoided the Italian folly in the Balkans [which doomed Operation Barbarosa in Russia], and assured the possibility of an immediate and relatively uncostly campaign against [English occupied] Egypt. Rather than bombing London, he should, instead, have seized Alexandria, Cairo, and Suez. This would have settled the peace in the Balkans, avoiding the exhausting occupations of Greece and Yugoslavia, [it would have cut England off from her overseas empire, and guaranteed Europe's Middle Eastern energy sources].
These military failings followed from Hitler’s total lack of imagination outside of Germany. He was [essentially] a German politician; good for Germany, but only there. Lacking political culture, education, and a larger tradition, having never traveled, being a xenophobe like many popular demagogues, he did not possess an understanding of what was necessary to make his strategy and diplomacy work outside Germany. All his dreams, all his talents, were devoted to winning the war of 1914, as if conditions [in 1940] were still those of 1914. . . He thus underestimated Russian developments and totally ignored American power, which had already made itself felt in 1914.
He did understand the importance of the tank and the airplane [whose military possibility came into their own after 1918], but not in relationship to the enormous industrial potential of Russia and America. He neglected [the role of] artillery, which was a step back from 1916-1918. He is least reproachable in his estimation of submarine warfare, whose significance was already evident in the Great War. But even here, the Anglo-Saxons [i.e., the Anglo-Americans] deployed their maritime genius in a way difficult for a European continental to anticipate.
Hitler’s political errors [, however,] were far worse and more thorough-going than his military errors. He hardly comprehended the problem, seeing it in terms of 1914 — in terms of diplomacy, national states, cabinet politics, and [rival] chancelleries. His understanding of Europe did not even measure up to that of old aristocrats like Bismarck and Wilhelm II, who never forgot the traditions of solidarity that united Europe’s dynasties, courts, and nobilities. . .
It is curious that this man who knew how to inspire the masses in his own country, who always maintained the closest contact with his people, never, not for a second, thought of extending his [successful] German policies to the rest of Europe. He [simply] did not understand the necessity of forging a policy to address Europe domestically and not just internationally. Diplomats and ambassadors had lost command of the stage — it was now in the hands of political leaders capable of winning the masses with the kind of social policies that had succeeded in Germany and could succeed elsewhere.
Hitler didn’t understand this. After his armies invaded Poland, France, and elsewhere, he never thought of implementing the social and political practices that had worked in Germany . . . He never thought of carrying out policies that would have forged bonds of solidarity between the occupied and the occupiers. . .
These failures lead me to suspect that the Germans’ political stupidity . . . owed something to fascism — that political and social system awkwardly situated between liberal democracy and Communist totalitarianism.
In the fascist system there was something of the “juste milieu” that could not but lead to the Germans’ miserable failure. [A French term meaning a "golden mean" or a "happy medium," "juste milieu" is historically associated with the moderate centrist politics (or anti-politics) of bourgeois constitutionalists -- first exemplified by France's July Monarchy (1830-48) and subsequently perfected in the American party system].
The Germans have no political tradition. For centuries, most of them inhabited small principalities or cities where larger political forces had no part to play. There was, however, Vienna and Berlin. In these two capitals, politics was the province of a small [aristocratic] caste. The events of 1918 [i.e., the liberal revolutions that led to the Weimar and Viennese republics] abruptly dislodged this caste, severing its ties from the new governing class.
Everything that has transpired in the last few years suggests that Germany remains what it was in the 18th century . . . a land unable to anchor its warrior virtues in politically sound principles . . .
[Part of this is due to the fact that] the German is no psychologist. He is too much a theoretician, too intellectually speculative, for that. He lacks psychology in the way a mathematician or metaphysician does. German literature is rarely psychological; it develops ideas, not characters. The sole German psychologist is Nietzsche [and] he was basically one of a kind. . . Politically, the Germans [like the French] are less subtle and plastic than the English or the Russian, who have the best psychological literature and hence the best diplomacy and politics.
Hitler’s behavior reflected the backward state of German, and beyond that, European attitudes. This son of an Austrian custom official inherited all the prejudices of his father’s generation (as had Napoleon). And like every German nationalist of Austrian extraction, he had an unshakable respect for the German Army and the Prussian aristocracy. Despite everything that disposed him against it, he remained the loyal Reichwehr agent he was in Munich [in 1919]. . . If he subsequently became a member of a socialist party [Anton Drexler's German Workers' Party] — of which he promptly became the leader — it was above all because this party was a nationalist one. Nationalism was always more important to him than socialism — even if his early years should have inclined him to think otherwise . . .
Like Mussolini, Hitler had no heartfelt commitment to socialism. [Drieu refers here not to the Semitic socialism of Marx, with its materialism, collectivism, and internationalism, but rather to the older European tradition of corporate socialism, which privileges the needs of family, community, and nation over those of the economy] . . . That’s why he so readily sacrificed the [socialist] dynamism of his movement for the sake of what the Wehrmacht aristocracy and the barons of heavy industry were willing to concede. He thought these alone would suffice in furnishing him with what was needed for his war of European conquest. . .
Fascism failed to organize Europe because it was essentially a system of the “juste milieu” — a system seeking a middle way between communism and capitalism. . .
Fascism failed because it did not become explicitly socialist. The narrowness of its nationalist base prevented it from becoming a European socialism . . . Action and reaction: On the one side, the weakness of Hitlerian and Mussolinian socialism prevented it from crossing national borders and becoming a European nationalism; on the other, the narrowness of Mussolinian and Hitlerian nationalism stifled its socialism, reducing it to a form of military statism. . .
Source: Pierre Drieu La Rochelle. Textes retrouvées.
Paris: Eds. du Rocher, 1992.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, national-socialisme, troisième reich, lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, france, europe, fascisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 avril 2009
France asservie par l'OTAN: Chauprade - De Gaulle, même combat

00:17 Publié dans Affiches | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, de gaulle, gaullisme, géopolitique, affaire chauprade, polémique, censure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 21 avril 2009
"Cette gaieté paradoxale et prodigieuse"
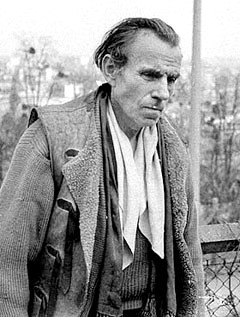
« Cette gaieté paradoxale et prodigieuse » [1957]
Nous avions exhumé l’article de Lucien Rebatet paru à la sortie de D’un château l’autre. Voici celui de Robert Poulet qui évoque, dans l’introduction, la polémique née au sein de la rédaction de l’hebdomadaire Rivarol.
Dans les circonstances difficiles, il vaut mieux être tout à fait clair et tout à fait franc. J’ai lu, comme tout le monde, l’interview que Louis-Ferdinand Céline a donnée à L’Express le mois dernier. J’y ai retrouvé, ni plus ni moins, le ton, l’humeur, les dispositions qui ont toujours distingué l’auteur du Voyage au bout de la nuit. Avec les mêmes facéties truculentes, les mêmes défis burlesques, la même affectation de platitude et de grossièreté, qu’il mettait déjà dans ses discours au temps glorieux de ses débuts, et qui comme alors enveloppent bel et bien une extraordinaire hardiesse de pensée et d’expression... En ayant l’air de se moquer de tout et de lui-même, Bardamu vient d’asséner à ses adversaires qui avaient pensé cette fois le prendre au piège, des vérités comme aucune oreille française n’en a encore entendu depuis dix ans. Et les artificieux propos de Mme Françoise Giroud ¹ ne parvenaient pas une seconde à couvrir cette voix qui porte, jusque dans le registre le plus contenu, quand Céline joue, avec des intonations redoutables, la scène de l’esclave rebelle et puni : du Plaute tranposé dans ce siècle sans élites ; un morceau plus que remarquable, et où l’on ne découvre, mon cher Pierre-Antoine Cousteau, pas un atome de reniement ².
À celui qui ne fut jamais d’aucun clan, et qui se définit justement par cette autonomie totale, qui va jusqu’à la manie, jusqu’à la furie, on ne saurait demander de respecter la « loi du clan » – à laquelle je ne crois pas, quant à moi. Je n’ai de considération que pour la probité individuelle, pour l’amitié, pour la solidarité du malheur, qui est une question de sentiment. Il ne me paraît pas du tout qu’en l’occurrence le persécuté Céline, le méconnu Céline ait enfreint ces règles de pure hygiène morale. Celles-ci ne sauraient exiger qu’un écrivain de vigoureux tempérament cesse de se manifester sous l’aspect qui répond en lui à des nécessités quasi constitutionnelles.
L’œuvre et l’outil
Depuis vingt-cinq ans tout juste, l’auteur de Normance a toujours réussi à conjuguer le profond sérieux, qui se dissimule dans son œuvre et dans sa vie, et qui s’y approfondit encore en pathétique, avec la nature orageuse et volcanique de son art ; et aussi avec l’impatience irritée, le besoin de scandale et de contradiction, qu’excite chez lui – c’est sa vocation particulière – la soif de vérité, de pureté, de justice. Dès le commencement, on a reconnu dans cet anarchiste aux visions obscènes, aux propos blasphématoires, un défenseur déçu et meurtri de la tradition. Cet iconoclaste garde en lui le regret des « bonnes façons de vivre ». Sa manière de servir le beau et le vrai, c’est de s’insurger aveuglément contre toutes les impostures qui en tiennent lieu, dans une société faussée à la base ; de s’insurger sans réserve, sans mesure, comme il convient à l’indignation et à la déréliction. Et, comme les choses qu’il faut bafouer ont pris l’aspect des usages et des lois, l’insurrection célinienne s’ouvre par une explosion de délire subversif.
Les révolutionnaires professionnels n’en sont pas encore revenus, d’avoir vu naguère cet isolé, ce vagabond de la pensée, battre une fois pour toutes les records de négation, de destruction, de malédiction qu’ils pensaient avoir établis depuis cent ans, et qui, par comparaison avec la terrible et naïve « table rase » où s’installe Bardamu, paraissent les fruits d’une timidité ridicule. Personne n’avait jamais poussé la dérision de tout aussi loin que le petit médecin de banlieue, mal embouché, sorti d’on ne sait quels remous coloniaux, maritimes, internationaux, populaires, et qui surgit un matin de 1931 sur la scène de Paris.
Dès ses premiers mots, il montra ce que peut être, réellement, un contempteur du monde moderne. Du coup on vit les mœurs, les usages, la sensibilité, le langage même, chanceler sur leurs bases. D’autant que le novateur s’était fabriqué l’outil qu’il fallait ; un style comme on n’en avait jamais vu nulle part, fait d’argot décanté, qu’entrecoupent des soupirs, des haussements d’épaules ; le mouvement d’un discoureur de bistrot qui crache de mépris entre deux onomatopées ou qui a des renvois de vin bourru ; rythme essentiellement vulgaire, qui soutient une émotion parfaitement indépendante, parfaitement aberrante, mais d’une secrète noblesse.
Le génie deux fois escamoté
Le miracle se reproduisit, en plus éclatant encore, avec Mort à crédit. Seulement, déjà la tourbe des imitateurs s’était jetée sur le pur produit du célinisme. Dès avant la guerre, les sous-Céline pullulaient ; et maintenant il en est qui n’ont jamais lu leur modèle, qui n’ont jamais entendu prononcer son nom, ayant trouvé leur provende chez des épigones et des caudataires qui l’avaient pesamment remâchée ; et prospérant en outre dans une atmosphère intellectuelle que régit la conspiration du silence, au détriment de « l’auteur le plus original qui soit apparu en Europe depuis un siècle » (dixit Middleton Murry) ³.
Que reprochent à Céline les critiques qui pendant deux lustres l’ont supprimé de l’histoire littéraire, exclu de la vie littéraire, jeté moralement dans des oubliettes aussi profondes que celles dans lesquelles le grand écrivain languit au Danemark, pour avoir « vendu les plans de la Ligne Maginot » (ô alliance de la méchanceté et de la sottise, dont Hamlet devait rire amèrement à Elseneur, distante d’une portée de mitraillette) ? Ils lui reprochent (au nom d’un principe né de la guerre) d’avoir écrit des pamphlets contre les Juifs avant la guerre.
L’extravagance furibarde de Bagatelles pour un massacre et des Beaux draps avait sa source – c’est visible pour qui étudie de sang-froid ces pages pleines de divagations, d’imprudences, de méprises monumentales, pêle-mêle avec quelques beautés sulfureuses – dans l’angoisse que la vue trop exacte des hécatombes imminentes, voulues par les uns, acceptées par les autres, inspirait à un homme dont la pensée première, la définition initiale est l’horreur des maux évitables, avec la rage de crier cette horreur, fût-ce dans la confusion extrême qui accompagne les grandes crises de prophétisme.
Quoi qu’il en soit, l’événement Céline, pour des motifs qui ne tenaient pas à la littérature, et même qui ne se rattachaient pas aux idées de résistance et de collaboration, étrangères à ce j’men-fichiste fabuleux, à ce parangon d’anarchie, disparut d’une époque qui, sans lui, se révélait inexplicable. La jeunesse française ignore le romancier contemporain dont l’attitude, l’esprit, le vocabulaire, répondent le mieux au chaos mental et moral dans lequel elle se complaît, se raccrochant à des interprètes beaucoup moins qualifiés, beaucoup moins expressifs – et surtout beaucoup moins libres.
Quelques petites choses
Aux hommes de lettres « engagés », auxquels la nouvelle génération a un moment prêté l’oreille, faute de mieux, la révélation célinienne oppose, au contraire, le spectacle d’une âme soucieuse de se dégager à fond, de se dégager de tout, pour avoir senti soudain que toutes les contraintes sociales, avec les doctrines et les institutions dont elles découlent, étaient en train d’appesantir sur l’Occidental du XXème siècle une énorme chape de mensonge, faits de la corruption et de la falsification du patrimoine humain. Procédant du même état d’âme, le Voyage fit le même bruit d’écroulement que le dernier effort de Samson. Si les jouisseurs du désordre, les adorateurs de l’absurde, étaient conséquents avec eux-mêmes, ils se tourneraient de ce côté, pour voir enfin sortir de la terre, au milieu des décombres que Louis-Ferdinand Céline remue avec de sanglants sarcasmes, la pousse verte du naturel, en attendant la fleur de la charité, que n’ont pas étouffée toute cette colère et toute cette haine.
S’il y a dans ce temps-ci un écrivain qui l’exprime en plein, et qui même anticipe sur le temps à venir, avec des mots que sans doute on ne comprendra tout à fait qu’au-delà des effondrements qui y conduisent, c’est bien celui-ci, dont pourtant la plupart de nos successeurs n’ont aucune idée par la faute des témoins prévenus et des serviteurs infidèles de la littérature.
Ils tablèrent d’abord sur l’absence du personnage, puis sur son affaiblissement. Depuis son retour en France, l’auteur de L’Église a publié trois livres, dont les deux premiers, malgré des passages étonnants, que lui seul pouvait écrire, avaient quelque chose de blessé, un souffle rauque de grabataire ; un creux s’ouvrait au cœur de cette élocution toujours abondante et puissante. Puis, il y eut les Entretiens avec le professeur Y, où s’étirait et se gonflait une pugnacité convalescente. Mais voici D’un château l’autre. Et nul ne peut nier que le grand Céline soit revenu.
C’est si vrai que les chevaliers de la distraction calculée, les spécialistes de la bouche en cul-de-poule et de la mine-de-rien ont compris qu’il fallait changer de tactique. Du moment qu’on renonçait à faire comme si l’homme et l’œuvre étaient morts ou mieux, n’avaient jamais existé, il n’y avait pas de moyen terme : il fallait se précipiter à leur rencontre. Ainsi s’explique le tumulte exceptionnel qui s’est élevé dans la presse depuis trois semaines. Tout d’un coup, le réprouvé, le maudit, l’intouchable, est devenu l’un des thèmes majeurs de la publicité journalistique, l’un des bouffons favoris que ses organisateurs proposent au public. Et ainsi, tout en jouant les Frontins et les Scapins, au commandement et conformément à sa pente, Céline a-t-il pu se débarrasser de deux ou trois petites choses qu’il avait sur le cœur...
Une réalité seconde
Passons outre à ces numéros de cirque, mais d’un cirque sur lequel plane un drame. Et arrêtons-nous devant le livre qui a provoqué la rentrée du clown (voir les conséquences du fait dans un célèbre conte d’Edgar Poe 4 ).
On sait que les romans céliniens sont toujours tirés d’une réalité interprétée et transverbérée à laquelle s’applique le martèlement du verbe, dont les coups rapides et répétés finissent par forger une réalité seconde, chargée de poésie frénétique et sarcastique, avec une épouvante au bout. Cette fois, c’est sur ses souvenirs d’Allemagne – où il dut fuir en 1944, menacé de mort, sans nul motif – que l’auteur a travaillé. Il en résulte que, par exemple, on voit surgir à Sigmaringen une image du Maréchal Pétain, une image de Pierre Laval, et beaucoup d’autres images dont chacune a l’air d’être quelqu’un, de porter un nom. Purs cauchemars, où naturellement n’interviennent aucune des délicatesses ou des précautions que l’auteur a toujours instinctivement méprisées, à tort ou à raison, ne trouvant son maximum d’expressivité que dans l’irrespect intégral. Néanmoins, je défie bien les esprits les plus mal disposés de retirer d’un tel tableau une idée amoindrie des personnes qu’il met en scène.
Cela éclate surtout aux yeux de ceux qui prennent la peine de lire jusqu’au bout ces trois cent cinquante pages à la température d’ébullition. Il en sera récompensé par des plaisirs, par des surprises, dont les lecteurs des romans à la mode, si infirmes, si timorés sous leur masque de fausses audaces, ont perdu l’habitude. Il y a, notamment, une hallucination au bord de la Seine, qui rappelle dans le féerique et dans l’effrayant la fameuse « galère » du Voyage, et laisse loin derrière elle les plus échevelés pensums surréalistes. Il y a l’errance en chemin de fer. Il y a l’écriture, qui est encore plus divisée qu’avant ; ce n’est plus qu’un halètement musical, comme dans les premiers Stravinsky. Il y a cette gaieté paradoxale et prodigieuse, où entrent des éléments enfantins, des éléments jupitériens, à mi-chemin entre le petit garçon qui faisait des niches à ses copains en poussant dans Paris la voiture de sa mère dentellière, et le démiurge qui se moque de sa création au moment de la détruire.
En ce cas, le monde finirait par un cri de désespoir, qui ressemblerait furieusement à un cri de joie. C’est pourquoi l’on peut croire qu’au fin fond de la dissolution universelle à la Céline, il y a un noyau de santé. Puisse-t-il en tirer tout le suc, le cher homme !
En attendant, voici son bouquin. Le troisième de sa main qui ait chance de défier les siècles. Citez-moi seulement une dizaine de contemporains, dans les trois générations, qui puissent en dire autant !
Robert POULET
(Rivarol, 4 juillet 1957)
Notes
1. C’est François Giroud qui avait rédigé le chapeau rédactionnel de cette interview paru dans L’Express (14 juin 1957) sous le titre « Voyage au bout de la haine ».
2. Poulet répond ici à l’article de P.-A. Cousteau paru dans Lectures françaises (juillet-août 1957) sous le titre « Fantôme à vendre ».
3. John Middleton Murry (1889-1957), critique littéraire anglais, époux de Katherine Mansfield.
4. « La Barrique d’amontillado », avec son personnage tragique de Fortunato.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, belgique, lettres belges, littérature belge |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 11 avril 2009
Céline - Hergé, le théorème du perroquet
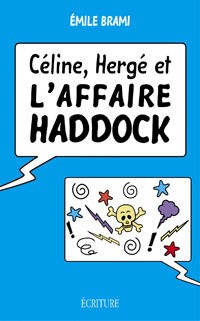
Céline – Hergé, le théorème du perroquet
Dans son dernier ouvrage intitulé Céline, Hergé et l’affaire Haddock ¹, notre brillantissime ami Émile Brami, nous expose sa théorie sur les origines céliniennes des célèbres jurons du non moins célèbre capitaine. Même s’il ne dispose pas de « preuves » en tant que telles, l’on ne peut être que troublé par ces faisceaux qui lorgnent tous dans la même direction. En attendant l’hypothétique découverte d’une lettre entre les deux susnommés ou d’un exemplaire de Bagatelles pour un massacre dans la bibliothèque Hergé, nous en sommes malheureusement réduits aux conjectures. Pendant la rédaction de son livre, j’indiquais à Émile Brami quelques hypothèses susceptibles de conforter sa thèse. Par exemple, est-ce que le professeur Tournesol et Courtial de Pereires partagent le même géniteur ? etc. C’est un heureux hasard qui me fit découvrir un autre point commun entre le dessinateur de Bruxelles et l’ermite de Meudon. Hasard d’autant plus intéressant, qu’à l’instar de Bagatelles pour un massacre, les dates concordent. Si les premières recherches furent encourageantes, l’on en est également réduit aux hypothèses, faute de preuve matérielle.
Grâce aux nombreuses publications dont Hergé est l’objet, l’on en sait beaucoup plus sur la genèse de son œuvre. Grâce aux travaux de Benoît Mouchard ², on connaît maintenant le rôle primordial qu’a joué Jacques Van Melkebeke dans les apports « littéraires » de Tintin. Mais surtout les travaux d’Émile Brami ont permis, pour la première fois, de faire un lien entre les deux, et de replacer la naissance du capitaine Haddock et la publication de Bagatelles pour un massacre dans une perspective chronologique et culturelle cohérente. Néanmoins, il n’est pas impossible que d’autres liens entre Céline et Hergé figurent dans certains albums postérieurs du Crabe aux Pinces d’or.
Le lien le plus « parlant », si l’on ose dire, entre le dessinateur belge et l’imprécateur antisémite est un perroquet, héros bien involontaire des Bijoux de la Castafiore.
Lorsque Hergé entame la rédaction de cet album au début des années 1960, il choisit pour la première (et seule fois) un album intimiste. Coincé entre Tintin au Tibet et Vol 714 pour Sydney, Les Bijoux de la Castafiore a pour cadre exclusif le château de Moulinsart. Tintin, Milou, Tournesol et le capitaine Haddock ne partent pas à l’aventure dans une contrée lointaine, c’est l’aventure qui débarque (en masse) chez eux. Et visiblement, l’arrivée de la Castafiore perturbe le train-train habituel de nos héros. Les Bijoux de la Castafiore offre également l’intérêt d’être un album très « lourd » du point de vue autobiographique, avec des rapports ambigus entre la Castafiore et Haddock (projets de mariage), des dialogues emplis de sous-entendus (« Ciel mes bijoux ») et, au final, bien peu de rebondissements et d’action. Néanmoins, au milieu de ce joyeux bazar, émerge un élément comique qui va mener la vie dure au vieux capitaine. C’est Coco le « perroquet des îles », qui partage de nombreux points communs avec Toto, le non moins célèbre perroquet de Meudon.
Tout d’abord, il y a l’amour que Hergé et Céline portent aux animaux. L’œuvre d’Hergé est truffée de références au monde animal ; quant à Céline, il transformera son pavillon de Meudon en quasi arche de Noé… Mais revenons aux deux psittacidés. Dans les deux cas, les perroquets sont offerts par des femmes. Lucette achète le sien sur les quais de la Mégisserie. La Castafiore destine « cette petite chose pour le capitaine Koddack ». Dans les deux cas, Céline et Haddock ne sont pas particulièrement ravis de voir arriver l’animal dans leur demeure. Mais au final, ils finissent par s’y faire, voire s’en réjouissent. Céline fait de son perroquet un compagnon d’écriture, le capitaine Haddock s’en sert pour jouer un mauvais tour à la Castafiore. Autre élément commun, les deux perroquets portent presque le même nom ; « Toto » pour celui de Céline, et « Coco » (avec un C comme Céline ?) pour celui de Haddock. Certes, ce n’est pas d’une folle originalité, mais bon… Détail intéressant, les deux espèces sont différentes. Lucette rapporte à Meudon un perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus, communément appelé « Jaco » ³). La Castafiore offre un perroquet tropical (Ara ararauna 4). Autre détail intéressant, dans les deux cas, les perroquets parlent. Céline apprend au sien quelques mots, et même un couplet de chanson. Celui de Haddock se contente de répéter des phrases. Or de ces deux perroquets, le seul qui a la capacité de retenir quelques mots, et de parler, est bel est bien le perroquet gris du Gabon. Le perroquet tropical peut reproduire des sons (téléphone, moteur de voiture, etc.) mais il ne possède pas les capacités vocales que lui prête Hergé. Est-ce une erreur délibérée ? Est-ce que la documentation d’Hergé était défaillante ? Est-ce dû à l’ajout précipité du perroquet dans Les Bijoux de la Castafiore ? Cette dernière hypothèse a notre préférence.
L’autre élément qui accrédite l’hypothèse du perroquet est chronologique. La conception des Bijoux de la Castafiore et la mort de Céline sont concomitantes. Alors qu’Hergé est en train de construire l’album, Céline décède, en juillet 1961. Si peu de journaux ont fait grand cas de cette nouvelle, Paris-Match évoquera, dans un numéro en juillet et un autre, en septembre 1961, la disparition de Céline (et d’Hemingway, mort le même jour). Largement illustrés de photographies, deux thèmes récurrents se retrouvent d’un numéro l’autre : Céline et son perroquet Toto. Dans son numéro de juin, Paris Match s’extasie devant la table de travail de Céline sur laquelle veille le perroquet, dernier témoin (presque muet) de la rédaction de Rigodon... Dans le numéro de septembre, l’on peut voir la photographie de Céline dans son canapé, avec Toto, ultime compagnon de solitude.
Grâce aux biographes d’Hergé, on sait que ce dernier ne lisait pour ainsi dire jamais de livres. Quand il s’agissait de ses albums, il demandait à ses collaborateurs de préparer une documentation importante afin qu’il n’ait plus qu’à se concentrer sur le scénario et le dessin. Éventuellement, il lui arrivait de rencontrer des personnes idoines qu’il interrogeait sur un sujet qui toucherait de près ou de loin un aspect de ses futurs albums (Bernard Heuvelmans, pour le Yéti, par exemple…). Si Hergé lisait peu de livres, on sait, par contre, qu’il était friand de magazines 5 et qu’il puisait une partie de son inspiration dans l’actualité du moment. La grande question est : a-t-il eu dans les mains les numéros de Paris-Match relatant la mort de Céline ? C’est hautement probable car l’on sait qu’il lisait très régulièrement ce magazine. S’en est-il servi pour Les Bijoux de la Castafiore ? Pour cela, il suffit de comparer la photographie de Céline dans son canapé à Meudon, à celle de Haddock dans son fauteuil, à Moulinsart. La comparaison est probante.
En voyant ainsi Céline et son perroquet dans Paris-Match, Hergé s’est-il souvenu des conversations qu’il avait eu autrefois à ce sujet avec Melkebeke ou Robert Poulet ? A-t-il admiré autrefois Céline, non pas forcément comme écrivain, mais comme « idéologue » antisémite ? A-t-il décidé de faire un petit clin d’œil discret au disparu en reprenant son fidèle perroquet ? Malheureusement, il est encore impossible de répondre. Lentement, les éditions Moulinsart ouvrent les « archives Hergé » en publiant chaque année un important volume chronologique sur la genèse des différentes œuvres du dessinateur. À ce jour, ces publications courent jusqu’aux années 1943, et il faudra attendre un petit peu pour en savoir plus sur la genèse des Bijoux de la Castafiore et de son célèbre perroquet.
Reste néanmoins un élément troublant. Dans son livre, Le Monde d’Hergé 6, Benoît Peeters publie la planche qui annonce la publication des Bijoux de la Castafiore dans les prochaines livraisons du Journal de Tintin. Sur cette planche apparaissent tous les protagonistes du futur album, Tintin, Haddock , les Dupond(t)s, Tournesol, Nestor, la Castafiore, Irma, Milou, le chat, l’alouette, les romanichels, etc. Mais point de perroquet, qui pourtant a une place beaucoup plus importante que certains protagonistes précédemment cités. Hergé a-t-il rajouté Coco en catastrophe ? Coco était-il prévu dans le scénario d’origine ? Pourquoi Hergé fait-il parler un perroquet qui ne le pouvait pas ? Erreur due à la précipitation ? Ou à une mauvaise documentation ? Est-ce la vision de Céline et de son compagnon à plumes qui ont influencé in extremis cette décision en cours de création ? Détail intéressant, dans ses derniers entretiens avec Benoît Peeters, Hergé avoue qu’il aime se laisser surprendre : « J’ai besoin d’être surpris par mes propres inventions. D’ailleurs, mes histoires se font toujours de cette manière. Je sais toujours d’où je pars, je sais à peu près où je veux arriver, mais le chemin que je vais prendre dépend de ma fantaisie du moment » 7. Coco est-il le fruit de cette « surprise » ? À ce jour, le mystère reste entier, mais peut-être que les publications futures nous éclaireront sur ce point… Il serait temps ! Mille sabords !
David ALLIOT
1. Éditions Écriture. Les travaux d’Émile Brami sur Hergé et Céline ont été présentés au colloque de la Société d’Études céliniennes de juin 2004 à Budapest, et partiellement publiés par le magazine Lire de septembre 2004.
2. Benoît Mouchart, À l’ombre de la ligne claire, Jacques Van Melkebeke le clandestin de la B. D., Vertige Graphic, Paris, 2002.
3. Il est amusant de noter que ce perroquet est relativement courant dans les forêts du golfe de Guinée, et que sa répartition s’étend de l’Angola jusqu’à en Sierra Leone. Peut-être que le jeune Louis-Ferdinand Destouches en vit-il quelques-uns lors de son séjour au Cameroun…
4. Originaire d’Amérique du Sud, ce perroquet ne vient nullement « des îles », comme l’indique la Castafiore.
5. Hasard ? Les Bijoux de la Castafiore évoque justement le poids grandissant des médias dans la société.
6. Benoît Peeters, Le Monde d’Hergé, Casterman, 1983.
7. In Le Monde d’Hergé, entretien du 15 décembre 1982. Cité également par Émile Brami, p. 73.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, france, bandes dessinées, 9ème art, hergé, belgicana, belgique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 10 avril 2009
La expansion de la OTAN y el beso francés
La expansión de la OTAN y el beso francés

La OTAN, el principal brazo transatlántico del complejo militar industrial de los Estados Unidos, no deja de expandirse. La amenaza soviética, su supuesta raison d’être originaria, desapareció hace veinte años. Pero al igual que el complejo militar industrial, la OTAN sigue viva y en constante expansión, alimentada por arraigados intereses económicos, una inveterada inercia institucional y la fijación paranoide de unos think tanks desesperados por encontrar “amenazas” por doquier.
A comienzos de abril, este Behemoth se dispone a celebrar su 60 aniversario en las ciudades vecinas de Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania), atravesadas por el Rin. En ocasión de la efemérides, recibirá un especial regalo del cada vez más impopular presidente francés, Nicolás Sarkozy: el regreso de Francia a su comando militar. Un acontecimiento burocrático de este tipo, cuyo significado práctico dista de estar claro, proporciona a los corifeos de la OTAN y a los plumistas de turno algo sobre lo que cacarear. ¿Veis?, los tontuelos de los franceses han comprendido su error y han vuelto al redil.
Sarkozy, por supuesto, presenta las cosas de otro modo. Asegura que la integración de Francia al comando militar de la OTAN realzará su importancia en el mundo y le permitirá influir en la estrategia y las operaciones de una Alianza que nunca abandonó y a la que ha contribuido de forma ininterrumpida por encima de sus obligaciones.
Este argumento, sin embargo, oculta que fue precisamente el inconmovible control de los Estados Unidos sobre la estructura militar de la OTAN lo que persuadió a Charles de Gaulle a abandonarla en marzo de 1966. Su decisión no obedeció a un simple capricho. Había intentado sin éxito modificar el procedimiento de toma de decisiones de la Alianza hasta que entendió que era imposible. La amenaza soviética había remitido en parte y de Gaulle no quería verse arrastrado a operaciones bélicas que consideraba innecesarias, tales como el intento de Estados Unidos de ganar en Indochina una guerra que Francia ya había perdido y que consideraba inviable. De Gaulle prefería que Francia pudiera proseguir defendiendo sus intereses en Oriente Medio y África. Además, la presencia militar de Estados Unidos en Francia estimulaba las manifestaciones plagadas de “Yankees go home”. En ese contexto, el traspaso a Bélgica del comando militar de la OTAN satisfizo a todos.
El antecesor de Sarkozy, Jacques Chirac, erróneamente considerado “anti-americano” por los medios de Estados Unidos, ya estaba dispuesto a reincorporarse al comando de la OTAN si obtenía algo sustancial a cambio, como el comando mediterráneo de la Alianza. Pero los Estados Unidos se negaron en redondo.
Sarkozy, en cambio, ha decidido batallar por las migajas. Su objetivo es la asignación de oficiales franceses a un comando en Portugal y a algunas bases de entrenamiento en los Estados Unidos. “No hubo negociación alguna. Dos o tres oficiales franceses más bajo las órdenes de los norteamericanos no cambia nada”, observó en un reciente coloquio sobre Francia y la OTAN el ex ministro de exteriores francés Hubert Védrine.
Sarkozy anunció la reincorporación el 11 de marzo, seis días antes de que la cuestión fuera debatida en la Asamblea Nacional. Todas las protestas serán, por consiguiente, en vano. A simple vista, esta rendición incondicional parece obedecer a dos causas fundamentales. Una es la psicología del propio Sarkozy, cuyo amor por los aspectos más superficiales de los Estados Unidos, escenificado en su discurso ante el Congreso norteamericano en noviembre de 2007, produce vergüenza ajena. Sarkozy debe ser el primer presidente francés al que parece no gustarle Francia. O, al menos, al que – de verlos en televisión- parecen gustarle más los Estados Unidos. Por momentos se tiene la impresión de que ha querido ser presidente de Francia no por amor al país sino como una revancha social en su contra. Desde un comienzo ha mostrado una clara disposición a “normalizar” Francia, esto es, a rehacerla de acuerdo al modelo norteamericano.
La otra causa, menos obvia pero más objetiva, es la reciente expansión de la Unión Europea. La rápida absorción de los antiguos satélites de Europa del Este, a los que hay que sumar a las ex repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania, ha alterado de manera drástica el equilibrio de poder dentro de la propia Unión Europea. El núcleo de las naciones fundadoras, Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, es incapaz de encauzar la Unión hacia una política exterior y de seguridad única. Después de que Francia y Alemania se negaran a apoyar la invasión a Irak, Donald Rumsfeld las descalificó como parte de la “vieja Europa” y apeló maliciosamente a la “nueva Europa” para que se sumara a los designios estadounidenses. El Reino Unido, al oeste, y los “nuevos” satélites europeos del Este, están más atados política y emocionalmente a los Estados Unidos de lo que lo están a la Unión Europea que les proporcionó considerable ayuda económica para su desarrollo y capacidad de veto en las cuestiones políticas relevantes.
La expansión, en efecto, enterró el sempiterno proyecto francés de construir una fuerza de defensa europea que pudiera actuar con autonomía del comando militar de la OTAN. Los dirigentes de Polonia y de los Estados bálticos quieren que Estados Unidos los defienda a través de la OTAN y punto. Jamás aceptarían el proyecto francés de una Unión Europea no atada a la OTAN y a los Estados Unidos.
Francia tiene su propio complejo militar industrial, muy inferior, ciertamente, al de Estados Unidos. Pero es el más grande de Europa occidental. Un complejo así necesita mercados de exportación para su industria armamentística. El mejor mercado potencial serían una fuerzas armadas europeas independientes. Sin dicha perspectiva en el horizonte, algunos podrían pensar que la integración a comando militar podría abrir los mercados de la OTAN a los productos militares franceses.
Se trata, sin embargo, de una esperanza huera. Los Estados Unidos se han reservado con celo los principales suministros de la OTAN para su propia industria. Es improbable que Francia llegue a tener una influencia significativa en la OTAN, por las mismas razones por las que ha acabado por abandonar su intento de construir un ejército europeo. Los propios europeos están profundamente divididos. Con Europa dividida, los Estados Unidos mandan. Es más, con la profundización de la crisis, el dinero para armamentos comienza a escasear.
Desde el punto de vista del interés nacional francés, esta endeble esperanza de poder colocar en el mercado los propios productos militares es nada comparada con las desastrosas consecuencias políticas que tiene el gesto de lealtad protagonizado por Sarkozy. Es cierto que incluso fuera del comando militar de la OTAN, la independencia francesa era sólo relativa. Francia apoyó la incursión de los Estados Unidos en la primera guerra del Golfo. En vano el presidente François Mitterand esperó con ello ganar influencia en Washington, el clásico espejismo que deslumbra a los aliados de Estados Unidos en operaciones más dudosas. En 1999, Francia se sumó a la guerra de la OTAN contra Yugoslavia, a pesar de las dudas existentes en los altos mandos. En 2003, sin embargo, el presidente Jacques Chirac y su ministro de relaciones exteriores Dominique de Villepin hicieron gala de su independencia y rechazaron la invasión de Irak. Hay bastante acuerdo en que el plantón francés permitió a Alemania hacer lo mismo. Y a Bélgica.
El discurso de Villepin ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 14 de febrero de 2003, defendiendo la prioridad del desarme y de la paz sobre la opción de la guerra, levantó una abrumadora ovación. Villepin se granjeó una amplia popularidad alrededor del mundo y reforzó el prestigio francés, sobre todo en el mundo árabe. De regreso en París, no obstante, el odio personal entre Sarkozy y Villepin alcanzó cotas de pasión operísticas, y no es infundado sospechar que el compromiso de obediencia con la OTAN de Sarkozy es también un acto de revancha personal.
El efecto político más devastador de todo esto es, sin embargo, la impresión que se ha generado de que “Occidente”, Europa y los Estados Unidos, se han enrocado en una alianza militar contra el resto del mundo. Contemplado de manera retrospectiva, el disenso francés prestaba un servicio a Occidente en la medida en que generaba la impresión, o la ilusión al menos, de que todavía era posible pensar y actuar de forma independiente, y de que alguien en Europa podía llegar a escuchar lo que otras partes del mundo se dice y piensa. Ahora, este “cierre de filas” sellado por los valedores de la OTAN como una manera de “mejorar nuestra seguridad” activará las alarmas en el resto del mundo.
El imperio parece cerrar filas con el propósito de regir el mundo. Los Estados Unidos y sus aliados no reclaman abiertamente el gobierno del mundo, pero sí su control. Occidente controla las instituciones financieras mundiales, el FMI y el Banco Mundial. Controla el poder judicial, el Tribunal Penal Internacional, que en 6 años de existencia sólo ha sentado en el banquillo a un oscuro señor de la guerra congolés y ha abierto cargos contra otras 12 personas, todas ellas africanas. Mientras, los Estados Unidos provocan la muerte de cientos, miles, acaso millones de personas en Irak y Afganistán, al tiempo que apoyan la agresión de Israel contra el pueblo palestino. Para el resto del mundo, la OTAN no es más que el brazo armado de esta empresa de dominación. Y todo ello en un momento en el que el sistema financiero capitalista dominado por los países occidentales está arrastrando a la economía mundial al colapso.
Tamaña exhibición de “unidad de Occidente” al servicio de “nuestra seguridad” sólo puede generar inseguridad en el resto del mundo. Mientras, la OTAN no ha cejado en su intento de rodear a Rusia con bases militares y alianzas hostiles, principalmente en Georgia. Pese a las sonrisas de sobremesa con su contraparte ruso, Sergei Lavrov, Hillary Clinton no ha dejado de insistir en el obcecado mantra de que las “esferas de influencia son inaceptables”. Con ello, claro está, se refiere a la histórica esfera de intereses rusa, a la que Estados Unidos está incorporando agresivamente a su propia esfera de influencia a través de la OTAN.
No es de extrañar, en este contexto, que China y Rusia hayan aumentado su cooperación defensiva. Los intereses económicos y la inercia institucional de la OTAN están empujando el mundo hacia un escenario pre-bélico mucho más peligroso que la Guerra Fría. La lección que la OTAN se resiste a aprender es que la búsqueda de enemigos crea enemigos. La guerra contra el terrorismo promueve el terrorismo. Rodear a Rusia con misiles sedicentemente “defensivos” –cuando todo estratega sabe que un escudo acompañado de una espada es también un arma ofensiva- hará de Rusia un enemigo.En busca de amenazas
Para probarse a sí misma que, en verdad, es una entidad “defensiva”, la OTAN no cesa de buscar amenazas. Pues lo tiene fácil, puesto que el mundo es un lugar convulso, en buena medida gracias al tipo de globalización económica que los Estados Unidos han impuesto en las últimas décadas. Acaso haya llegado la hora de realizar esfuerzos políticos y diplomáticos para impulsar vías internacionales que permitan abordar cuestiones como la crisis económica, el cambio climático, el uso de la energía, los hackers y las “ciber-guerras”. Los think tanks vinculados a la OTAN ven en estos problemas “amenazas” que deberían ser tratadas a través de la OTAN. Esto conduce a militarizar las decisiones políticas allí donde, por el contrario, deberían desmilitarizarse.
Pensemos, por ejemplo: ¿cómo se podría abordar la supuesta amenaza del cambio climático con medios militares? La respuesta parece obvia: utilizando las fuerzas armadas contra las poblaciones forzadas a abandonar sus hogares por la sequía o por las inundaciones. Tal vez, como en Darfur, la sequía podría conducir a enfrentamientos entre grupos étnicos o sociales. Entonces, la OTAN podría decidir quiénes son los “buenos” y bombardear al resto. Este tipo de cosas.
Todo parece indicar, en efecto, que el mundo se está metiendo en muchos problemas. La OTAN parece dispuesta a afrontarlos utilizando sus fuerzas armadas contra las poblaciones descontroladas. Este propósito podrá verse con toda claridad en la celebración del 60 aniversario de la OTAN que tendrá lugar en Estrasburgo/Kehl el 3 y 4 de abril. Ambas ciudades se convertirán en auténticos campos militares. Los residentes de la tranquila ciudad de Estrasburgo están obligados a solicitar credenciales para salir y entrar a sus hogares durante el feliz evento. En momentos clave, no podrán dejar sus casas, salvo bajo circunstancias extraordinarias. El transporte urbano se detendrá. Las ciudades estarán muertas, como si hubieran sido bombardeadas, para permitir a los dignatarios de la OTAN montar su show por la paz.
El momento culminante de todo este espectáculo será la sesión fotográfica de diez minutos en la que los líderes de Francia y Alemania intercambien un apretón de manos en el puente sobre el Rin que conecta ambas ciudades. Será como si Angela Merkel y Nicolás Sarkozy sellaran la paz entre Alemania y Francia por primera vez. Los locales permanecerán encerrados en su casa para no perturbar la pantomima. La OTAN se comportará como si su mayor amenaza fuera el pueblo de Europa. Y es muy posible que, por esa vía, la mayor amenaza para el pueblo de Europa llegue también a ser la OTAN.
Diana Johnston es una escritora y periodista estadounidense especializada en temas de política exterior europea y occidental. Fue una participante activa del movimiento contra la guerra de Vietnam. Entre sus últimos trabajos se encuentra Fool’s Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions, (Monthly Review Press, 2003) un alegato contra la guerra emprendida en los Balcanes en 1999. Es colaboradora habitual de la revista Counterpunch.
Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : europe, france, affaires européennes, otan, atlantisme, sarkozy, etats-unis, impérialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 08 avril 2009
Le trio infernal de l'atlantisme "français"
On ne présente plus Nicolas Sarkôzy, mais on rappellera qu'il est le petit-fils d'un éminent représentant de la communauté juive de Salonique qui l'a largement élevé. Cette communauté juive de Salonique était réputée pour son aisance à se mouvoir au sein des arcanes du pouvoir ottoman et à en profiter durant l'occupation turque en Grèce. Cet héritage explique sans doute pourquoi Nicolas Sarkôzy s'est toujours montré fort soucieux de satisfaire toutes les demandes du CRIF et a reçu, en 2003, le prix de la tolérance du Centre Simon Wiesenthal pour son action contre l'antisémitisme. Son élection a été saluée en Israël comme une excellente nouvelle. Il n'y a pas lieu d'insister. C'est, aussi, un amoureux inconditionnel des États-Unis, à tel point que c'est là-bas que, sitôt élu, il est allé se ressourcer.
On ne présente plus non plus Bernard Kouchner, d'origine juive russe, spécialiste du business humanitaire et de la consultante de luxe, fidèle d'Israël et ami de dirigeants israéliens, ancien "Gauleiter" de la MINUK au Kossovo où il a couvert l'épuration ethnique perpétrée par les Albanais aux dépends des Serbes selon les vœux de ses maîtres américains. Devenu ministre des Affaires étrangères de la république française, il multiplie les signes d'allégeance à toutes les modes occidentales.
En revanche, beaucoup moins connu du grand public, Jean-David Lévitte mérite une mention spéciale. C'est l'éminence grise de Nicolas Sarkôzy en politique étrangère, le vrai patron de celle-ci, ce qui l'amène parfois à entrer en conflit avec l'ego démesuré de Bernard Kouchner. Né en 1946, diplômé de I.E.P. de Paris et de l'Institut national des langues et civilisations orientales, il a entamé une carrière diplomatique avant de servir Jacques Chirac de 1995 à 2000, ce qui lui a valu de devenir le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York puis ambassadeur aux États-Unis à partir de 2002. Là-bas, il sut faire évoluer la position diplomatique de la France, mal perçue depuis l'opposition à la seconde guerre d'Irak en 2003, dans un sens plus "compréhensif" " des positions américaines. Le 16 mai 2007, Nicolas Sarkôzy l'intègre à sa garde rapprochée comme conseiller diplomatique avant de lui confier les rênes du nouveau Conseil National de Sécurité, véritable pilote de la nouvelle diplomatie française. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est le fils de Georges Lévitte, issu d'une famille juive d'Ukraine réfugiée d'abord en Allemagne en 1922, puis en France. Son père a eu une influence déterminante sur le renouveau de la pensée religieuse juive après la Seconde Guerre mondiale en même temps qu'il s'est engagé à l'Ainerican detvish Committee et a collaboré au Fonds Social Juif Unifié. Jean-David Lévitte a donc grandi dans un milieu familial très lié à la fois à la communauté juive, au sionisme et aux États-Unis.
C'est donc ce trio qui est aux commandes de la politique étrangère française depuis le printemps 2007. Un double rapprochement s'est alors effectué tant vis-à-vis de l'entité sioniste israélienne que des États-Unis d'Amérique, avec accélération du processus depuis que le nouveau locataire de la Maison Blanche apparaît plus fréquentable que l'ancien. Leur grand chantier actuel est la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN."
Source : Terre & Peuple n°39.
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, otan, atlantisme, europe, affaires européennes, défense, occidentalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 02 avril 2009
De Machiavelli van het Elysee
De Machiavelli van het Elysée
Een onthutsende kijk in de keuken van politicus François Mitterrand (1916-1996)
Het recentelijk verschenen François Mitterrand surft nadrukkelijk niet op gevoelens van nostalgie. Evenmin hanteert de auteur de kettingzaag. In plaats van ‘tonton’ laat Vincent Gounod het beeld domineren van de ‘Sfinx’ – die andere bijnaam van Mitterrand. Deze biografie is een knappe synthese van bestaande levensbeschrijvingen die de afgelopen tien jaar zijn verschenen. Bekende journalisten zoals Jean Lacouture en Pierre Péan of voormalige mitterrandistes als Jacques Attali en Hubert Védrine waren vol lof of schreven hun verbittering van zich af. Aanvullend materiaal haalde Gounod uit interviews met politici, onder wie de extreemrechtse Jean-Marie Le Pen, voormalig premiers Laurent Fabius en Edith Cresson of Mitterrand-vertrouweling Roland Dumas.
Gounods interpretatie is kritisch maar in balans. Mitterrand was geen ideoloog maar een machtspoliticus pur sang. Geen nieuw inzicht, maar Gounod overtuigt omdat hij precies analyseert, met veel gevoel voor de historische context en politieke omgeving, hoe Mitterrand politiek bedreef en, omgekeerd, zelf door de politiek gedreven werd. Dit levert een juweel van een Nederlandstalige politieke biografie op over de Mitterrand als machtspoliticus.
Gounod plaatst Mitterrands route naar het Élysée en zijn invulling van de macht prachtig in het perspectief van de naoorlogse Franse politiek en politieke cultuur. Intriges, verraad, wraak en – incidenteel – genade in Mitterrands dans om de politieke macht wisselen elkaar in adembenemend tempo af in de twee delen ‘ambitie’ en ‘macht’ waaruit het boek bestaat.
Haat
Gounod staat uitvoerig stil bij de diepgewortelde haat die Mitterrand koesterde tegen politieke vijanden, ook rivalen binnen zijn partij. Zo vernederde hij dertig jaar lang zijn partijgenoot en rivaal Michel Rocard. Uiteindelijk, in 1988, bood hij hem het premierschap aan. Een geste van verzoening? Integendeel. ‘Over 18 maanden kunnen we door hem heenkijken’, aldus de president. Rocard hield het bijna drie jaar vol maar was vervolgens politiek opgebrand. Dit voorbeeld tekent Mitterrand als Macher en machiavellist.
Mitterrand werd in 1916 geboren in een katholiek-provinciaal milieu. Tijdens zijn studententijd in Parijs flirtte hij wel met rechts-nationalistische kringen maar, en Gounod staat hier uitgebreid bij stil, een fascist of extreme nationalist was Mitterrand beslist niet. In de oorlog maakt hij carrière in het met de Duitse bezetter collaborerende Vichy-regime. En toen hem duidelijk werd dat de oorlog voor de Duitsers verloren was en er in Vichy geen toekomst schuilde, knoopte Mitterrand contacten aan met het verzet. Onder de schuilnaam Morland steeg zijn ster snel. Later zei hij over deze periode: ‘Mensen zijn niet zwart of wit, mensen zijn grijs.’ Zijn leven lang koesterde hij vriendschappen met personen die fout waren in de oorlog. Loyaliteit aan zijn persoon vond hij belangrijker dan ideologische zuiverheid.
De kneepjes van het politieke vak leerde Mitterrand tijdens de Vierde Republiek (1946-1958). Terwijl regeringen in dit instabiele parlementair systeem over elkaar heen buitelden, hopte het jeune talent vanaf zijn 30ste heel handig van ministerspost naar ministerspost. Terwijl hij genoot van het mondaine Parijse leven en van zijn reputatie als notoir rokkenjager, bekwaamde hij zich in de politique politicienne. Macht stelde hij in dienst van zijn eigen ambities. Gounod vergelijkt hem met een Florentijns prelaat: paternoster in de ene hand, dolk in de ander. In de jaren zestig trok Mitterrand fel van leer tegen president Charles de Gaulle. Diens Vijfde Republiek zag hij als een ‘permanente staatsgreep’. Eenmaal zelf president bleek het prettig toeven in deze autoritaire republiek.
Een ander kenmerk van de burgerlijk conservatieve Mitterrand is dat hij nooit een socialist is geweest maar wel socialistisch leerde spreken. Gounod analyseert dit op fraaie wijze. In 1971, bij zijn machtsgreep binnen de Parti Socialiste (PS), had hij nog geen partijkaart. Zijn filippica tegen de macht van het geld, in combinatie met meesterlijk strategisch manoeuvreren, leverden hem de voorzittershamer op. De PS, een politiek huis met vele kamers, hield hij vervolgens met verdeel-en-heerspolitiek onder controle.
Tamtam
In zijn jacht op het Élysée sloot Mitterrand een strategisch verbond met de communisten, in de jaren zeventig toch nog goed voor twintig procent van het electoraat. Dat hij na de oorlog een rabiate anticommunist was geweest, soit. In 1981, bij zijn derde gooi naar het presidentiële pluche, slaagde hij in zijn ambitie. Maar de met veel tamtam doorgevoerde nationalisaties werden vanaf 1983 teruggedraaid. Uiteindelijk was er weinig socialisme terug te vinden in zijn beleid. Op dezelfde overtuigende wijze toont Gounod ook aan dat Mitterrand geen Europeaan in hart en nieren was. Pas na het echec van het socialistisch experiment bekeerde Mitterrand zich tot Europa. Prestige-overwegingen en zijn eigen plek in de geschiedenisboekjes speelden daarin een grote rol.
Mitterrands presidentschap eindigde in mineur met financiële ophef rond de PS, teleurgestelde vertrouwelingen en zijn verborgen gehouden ziekte. Mitterrand leed vanaf 1981 aan prostaatkanker maar weigerde dat openbaar te maken. Pas vlak voor zijn vertrek uit het Élysée gaf hij openheid van zaken. De doodzieke president stond toen ook toe dat zijn oorlogsverleden werd opgerakeld en dat de Fransen werden ingelicht over Mazarine, zijn dochter uit een buitenechtelijke relatie.
Gounods biografie is rijk gevuld. Het enige dat ontbreekt is meer informatie over de privélevens die Mitterrand leidde of over zijn intellectuele belangstelling. Ook had Gounod aandacht mogen besteden aan een ander belangrijk aspect van de monarchale president: de grands travaux waarmee hij Parijs verfraaide zoals de piramide van het Louvre en de nieuwe Bibliothèque Nationale. Maar dat zijn details. François Mitterrand. Een biografie overstijgt het eenvoudige politieke portret van een president. Dit is ook een ‘handboek politiek’ door de onthutsende kijk in de keuken van het verschijnsel machtspolitiek.
00:25 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, france, europe, socialisme, affaires europeennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 avril 2009
Letribunal administratif suspend la d&écision du ministre contre Ayméric Chauprade
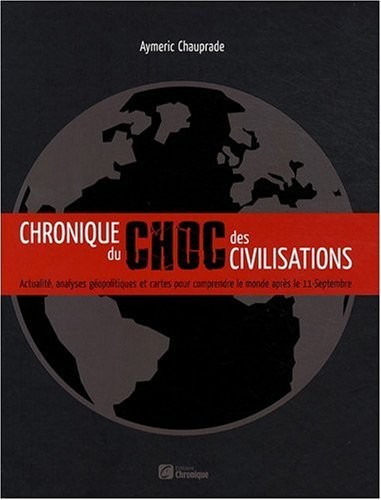
Le tribunal administratif suspend la décision du ministre contre Aymeric Chauprade
SOURCE : SECRET DEFENSE
Le tribunal administratif de Paris, saisi dans le cadre d'un référé-liberté, a suspendu ce lundi après-midi la décision du ministre de la Défense (ndlr : Hervé Morin, en photo) mettant fin à la collaboration d'Aymeric Chauprade avec les organismes de formation, en particulier le Collège interarmées de défense (CID). La justice demande au ministère d'organiser une procédure disciplinaire contradictoire. "C'est une belle victoire", se réjouit Aymeric Chauprade.
Le 5 février dernier, cet enseignant de géopolitique a été congédié par le ministre de la Défense à la suite d'un article paru dans Le Point. Chauprade est l'auteur d'un livre, "Chronique du choc des civilisations", dans lequel il présente avec complaisance les thèses qui attribuent les attentats du 11 septembre à un complot américano-israélien. Chauprade, qui se définit comme appartenant à la "droite conservatrice", enseignait au CID depuis dix ans.
Un premier référé avait été rejeté au début du mois, au motif que la décision ne portait pas une "atteinte grave à son niveau de revenu". Ce jugement se basait sur les déclarations orales du ministre, mais Aymeric Chauprade a reçu, le 25 février, un courrier officiel du ministère de la Défense lui annonçant la suppression de toutes ses vacations. Chauprade n'enseignait pas qu'au CID, mais dans de nombreuses autres institutions de la Défense : Cesa, Ensom, Gendarmerie, Marine, etc. Il estime que cela représente près des deux tiers de ses revenus.
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, affaire chauprade, france, censure, totalitarisme, arbitraire, défense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Entretien sur Céline avec Philippe Alméras
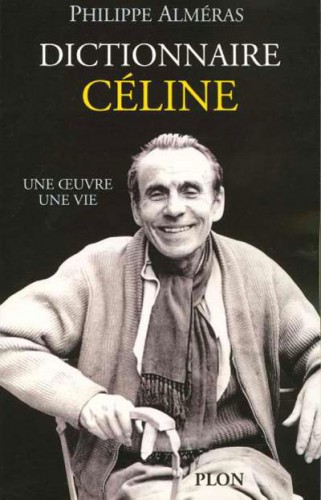
Entretien avec Philippe Alméras
Philippe Alméras est un personnage controversé dans le petit monde des céliniens. Nous avons déjà dit ici ce que nous pensions de sa biographie de Céline qui n’est assurément pas un modèle d’équanimité. Au moins lui reconnaîtra-t-on une puissance de travail peu commune. Ainsi c’est entièrement seul qu’il a rédigé un Dictionnaire Céline, coiffant ainsi au poteau les autres céliniens qui nourrissaient ce projet. Nous l’avons rencontré pour lui poser quelques questions sur un sujet qui l’occupe depuis quarante ans et dont ce dictionnaire est l’aboutissement.
Comment vous est venue l'idée de ce Dictionnaire Céline ?
Accidentellement : j'avais oublié mon ordinateur portable dans le train de Paris. Aussitôt signalée, la perte a été déclarée irréparable : « On ne retrouve jamais les ordinateurs ». J'en ai donc acheté un autre. Fourni sans la moindre notice d'instruction, naturellement. Pour apprendre à m'en servir, découvrir par exemple la touche qui mange le texte, j'ai eu l'idée de transcrire mes notes, fiches, entretiens, tout cela vieux souvent de trente ans et plus. Et l'ordre alphabétique allait de soi.
Habituellement, ce genre d'ouvrage est le résultat d'un travail d'équipe. La tâche ne vous a pas paru colossale pour un seul homme ?
À vrai dire, je ne me suis rendu compte de ce que je faisais qu'après 200 ou 300 pages. Si je m'étais mis en tête de réunir un Dictionnaire de 850 pages, le « colossal » de la chose m'aurait probablement inhibé et nous en serions encore au projet.
Si cela avait été possible, auriez- vous souhaité travailler dans une équipe ou préférez-vous, somme toute, le cavalier seul ?
Il y avait, lorsqu'une indiscrétion a révélé mon travail en cours, deux ou trois projets similaires. Quelqu'un a proposé une conjonction des données et des talents. Cela ne s'est pas fait. Je le regrette et je ne le regrette pas : ce que ce Dictionnaire aurait gagné en précision, il l'aurait sans doute perdu en spontanéité. Est-ce vraiment un hasard si ce genre de travail est toujours la responsabilité d'un seul et si les œuvres collectives aboutissent souvent à des mishi-mashi de cotes mal taillées ? Tu me laisses ceci, je t'accorde cela.
Comment avez-vous conçu ce Dictionnaire ?
Il s'est façonné de lui-même chemin faisant. Une entrée en appelait une autre, un dépouillement d'autres dépouillements. J'avais intégré les témoignages reçus, ils ont failli disparaître lorsque tel éditeur candidat les a jugés diffamatoires ou futiles.
Les céliniens vous ont souvent reproché une trop grande partialité à l'égard de votre sujet. Pensez-vous que ce Dictionnaire soit susceptible de provoquer à nouveau ce type de critiques ?
Cette partialité m'a été pour ainsi dire laissée en lot, les autres ne parlant que sources, références, tours de mains, etc. Mon premier travail visait à décrire le passage de Mort à crédit aux Bagatelles, du « roman » au « pamphlet ». Devant l'impossibilité de le faire recevoir ou même lire, je me suis obstiné à présenter mes petites trouvailles, et certains disent avec raison : la problématique de Céline a changé.
Cela dit, et cela dépassé, la forme du Dictionnaire est en soi objectivante. Elle oblige à aborder chaque chose sous ses angles divers et la promenade d'une entrée à l'autre fait le reste. Le fait même de pouvoir retrouver tel fait et telle citation et de les comparer à tels autres est en soi instructif. J'ai beaucoup appris à le faire. D'ailleurs, je ne suis pas resté seul longtemps même si le fait de dire qu'il s'agissait d'un travail personnel et subjectif a protégé l'entreprise qui ne manquait pas de concurrents.
Les notices de ce Dictionnaire ne sont pas seulement consacrées à des personnages mais aussi à des thèmes. Sur quels critères se sont fondés vos choix ?
Le premier critère était de faire figurer tout ce dont nous disposons aujourd'hui. Le second de traiter sa production sans exclusive comme cela se fait souvent au nom des bonnes mœurs ou des bons sentiments. Céline en trente ans d'activité a abordé des thèmes et des genres différents selon une progression et des modalités dont la continuité n'apparaît pleinement qu'après 1961. Au Dictionnaire de mettre cela à jour.
En quoi Céline est-il, selon vous, un grand écrivain ?
Je pourrais vous dire, comme tel autre, que le fait d'être publié dans La Pléiade est une garantie. Ce serait peut-être un peu court. Répondre qu'on le trouve prodigieusement doué, avec son goût des « diamants du langage parlé » ne serait même pas suffisant. Il ne faut pas oublier que ce qu'il dit – juste ou faux – est au moins aussi intéressant que la façon dont il le dit. Dans sa langue de prédilection – celle de la pré-Renaissance – on faisait la distinction entre « matire » et « sen ». C'est la combinaison qui fait bien sûr Céline : sans tabous ni précautions, il cite son temps comme le toréador cite le taureau. Ce n'est pas la meilleure des métaphores s'agissant de l'homme de tous les égards et de toutes les tendresses envers les animaux, mais je n'en vois dans la minute pas d'autre.
Comme le pays (lui avec) s'est refait une mémoire littéraire et historique à l'automne 44, il reste le seul à parler de ce dont il est convenu jusqu'à nouvel ordre de ne plus parler. C'est, après érosion, comme ces témoins de pierre des grands déserts d'Anatolie : indestructible.
Le fait que le Dictionnaire soit l'œuvre d'un seul auteur en fait quelque chose de très personnel : un Dictionnaire certes, mais en même une sorte de « Céline vu par Alméras ». Récusez-vous cette façon de considérer votre travail ?
Le « Céline vu par Alméras » reste encore à écrire. Il faudra que je le définisse d'abord. Ce Dictionnaire est à cette date mon travail le moins personnalisé. J'y ai rassemblé les pièces disponibles du puzzle célinien en m'efforçant d'envisager tous les angles et en donnant la parole à tout le monde. Nommément, ce qui devrait fournir à chacun l'occasion de répondre pour corriger ce qui lui paraîtra encore trop interprété. Cela devrait favoriser le rapprochement des diverses obédiences. Les clivages entre céliniens me paraissent dus à la particularité des parcours et aux options politiques prêtées à l'autre. Sur les faits tout le monde se rejoint.
En quoi ce Dictionnaire est-il aussi redevable au journaliste que vous fûtes ?
J'ai utilisé certainement des approches apprises à Réalités-Entreprise où je m'étais fait une spécialité paresseuse des portraits de dirigeants. Il existe une technique de l'interview. Dans le journalisme j'ai aussi appris le devoir absolu de ne pas ennuyer à mort le lecteur ou l'auditeur. Mais à ce compte une bonne partie des céliniens sont journalistes d'autant que tous ou à peu près tous ont interrogé les témoins du temps. Moi, quand je me suis rendu compte que je n'obtiendrais pas par cette voie la réponse à la question posée (quelles était la vision du monde et les opinions de Céline entre 1927 et 1936 ?), ce sont les textes que j'ai interrogés, et c'est le chartiste qui a découvert que – pour citer un exemple marquant – ce que Céline avait vraiment écrit dans telle lettre à Élie Faure, ce qui libérait la datation des « mauvaises idées ». Joie lorsque les photocopies ont confirmé ma radiographie. Et certitude dès lors d'aller dans la bonne direction.
La manière dont vous considérez l'homme Céline n'a pas toujours été empreinte de la plus grande bienveillance. Mais ne considérez-vous pas qu'il s'agit en l'occurrence d'une personnalité très ambivalente ? Tour à tour radin et généreux, méfiant et imprudent, courageux et timoré, cynique et sentimental, etc.
Il était effectivement tout ce que vous dites, et tout à la fois mais n'est-ce pas notre sort à tous si nous sortons du type : l'avare, le malade imaginaire, Don Juan… et si nous entrons dans la carrière sans plan à la main ? Cette question de « bienveillance » me reste toujours aussi peu compréhensible. C'est un effet du Céline entre haines et passion où j'ai mis à jour tout ce que je savais alors de la vie de Céline. M'entendre dire que j'avais écrit un livre haineux ou me voir décrit à d'innocents étrangers comme « l'auteur d'une biographie extrêmement hostile à Céline » me déconcerte alors comme maintenant. S'il s'était agi de témoigner devant un tribunal, l'exercice serait différent. Je mentirais avec l'accusé. Céline ne risque plus sa peau. Céline ne faisait pas dans l'eau tiède et rarement dans la bienveillance. Il avait le regard aigu et la dent dure. Ceux qui lui veulent le plus de mal sont à mon sens ceux qui occultent, travestissent son œuvre et font de lui un délirant : « Céline the fou » décrit dans les endroits les plus inattendus. J'ai conscience pour ma part de lui avoir rendu la santé mentale et des dents : est-ce malveillant ?
Commentant votre biographie, Henri Godard a écrit qu’on avait l’impression de lire la vie d’un second Drumont (et donc que l’accent n’était pas suffisamment mis sur l’écrivain). Que pensez-vous de cette observation ?
Êtes-vous sûr qu'il a écrit cela ? Et que cela a été imprimé ? Je ne l'ai pas lu. La seule biographie de Drumont que je connaisse est celle de Bernanos que Céline a pu lire en 1932. En voilà un qui n'hésitait pas. Il faut supposer que Godard a voulu me flatter, ce qui n'est pourtant pas son genre. Il est vrai que le lyrisme mystico-patriote de Bernanos n'est pas non plus le mien. Peut-être aussi est-ce la « grande peur » que Godard dit lui-même éprouver qui a amené Drumont sous ses doigts. Passons.
Comment jugez vous les travaux de vos confrères céliniens ? Quels ont été, de votre point de vue, les apports décisifs ?
Ils ont tous eu leur importance ou leur intérêt même si je m'attache plus aux coups de projecteurs et aux apports factuels qu'aux paraphrases et aux commentaires. Merci à ceux qui ont apporté des documents (Lainé les lettres à Garcin, Nettelbeck les lettres à Cillie Pam, Pécastaing les lettres à Zuloaga et ainsi de suite). Celui qui a fait le travail documentaire le plus important est évidemment Jean-Pierre Dauphin. On peut regretter le coup de sang ou le point d'honneur qui lui a fait quitter la partie dont il s'exagérait à mon avis les dangers et les enjeux.
Pour vous, le « fil rouge » de l’œuvre de Céline est ce racisme biologique que vous voyez apparaître très tôt et qui est présent jusque dans l’ultime Rigodon. Même si cet aspect de l’œuvre n’est pas négligeable, n’avez-vous pas l’impression d’avoir tellement mis l’accent sur ceci qu’il semble que, pour Céline lui-même, son travail d’écrivain était subordonné à cette préoccupation ?
Ce fil, c'est vous qui le voyez. Céline, personne ne le nie, a cru au corps, à la santé du corps, au dépassement du corps, comme tout le monde aujourd'hui (sport, beaux enfants, pas d'alcool), mais comme on ne le faisait pas alors. D'où les effets de rupture.
Il a ensuite étendu au groupe (aux « communautés ») la prescription aux individus. Est-ce unique ?
Comment ces conceptions qu’on dit maintenant temporaires, sans portée littéraire et donc à oublier, entrent dans l'écriture, la sous-tendent et l'orchestrent, voilà ce qu'il est permis de se demander. « L’homme, c’est le style », disait Céline et cela peut autoriser à aller de l'homme au style... Au moins le temps de voir. Surtout si, comme lui, on ne croit pas à la Littérature en soi.
Quelles sont les éventuelles critiques auxquelles vous vous attendez au sujet de ce travail ?
Vous les avez anticipées : trop personnel, trop désinvolte, trop copieux, trop léger. On chicanera des dates et des virgules. Je ne parle pas des « signes diacritiques » sans lesquels Céline nous reste imperméable. Jean-Pierre Dauphin avait eu l'idée d'assortir ses calepins de bibliographie de pages blanches ou chacun inscrivait ses apports. Si ce Dictionnaire n'avait pas déjà atteint la taille critique, j'aurais bien voulu l'imiter. Chacun aurait pu inscrire son apport, celui qu'il garde jalousement par devers lui. Les exemplaires auraient été disponibles en solde au bout de quatre ou cinq ans, on les aurait collationnés et l'on aurait « Le Dictionnaire Céline » dont nous rêvons tous : impeccable, exhaustif, unanime.
(Propos recueillis par Marc LAUDELOUT)
Comment j'ai commencé à travailler sur Céline
par Philippe Alméras
Quand j’ai commencé à « travailler sur Céline », il y en avait deux : celui d’avant 1937 et celui d’après, que certains vouaient d’ailleurs à la poubelle.
Plus le temps a passé et plus les Céline se sont multipliés. Les Anglo-Saxons parlent des neuf vies du chat. Le chat Céline en a eu bien plus, surtout si l’on ajoute celles qu’il s’est fabriquées à celles qu’on lui a prêtées.
Il a été successivement l’enfant du Passage et de la rue Marsollier, le stagiaire en langues d’Allemagne et d’Angleterre, l’apprenti commerçant, le cuirassier de Rambouillet, le combattant d’août 14, l’agent consulaire de Londres, le colon du Cameroun, le grouillot-journaliste d’Eurêka, le propagandiste antituberculeux de la Fondation Rockefeller, le bachelier éclair, l’étudiant en médecine tout aussi pressé, le mari et le père temporaire, l’hygiéniste itinérant de la SDN, le médecin en clientèle, le consultant du dispensaire à Clichy, l’auteur de théâtre, le pharmacien visiteur médical, le rédacteur de Voyage au bout de la nuit, Goncourt raté et événement littéraire de l’année 1933, le héros d’une légende misérabiliste, l’explorateur des enfances de Mort à crédit, le polémiste engagé des « pamphlets », le prophète vérifié un temps (1940-1944), l’émigré d’Allemagne puis du Danemark, le prisonnier de la Vestre Fængsel, le rural malgré lui de Korsør, le banlieusard de Meudon et l’auteur d’un come back qui n’allait pas de soi, l’écrivain restauré. Soit trois fois neuf vies de chat. Et l’enchaînement des œuvres dans une langue indéfiniment renouvelée.
À ces métamorphoses s’ajoutent les images qu’un lectorat multiple s’est faites de lui. Si les céliniens ne s’aiment guère en règle générale, c’est qu’ils ont chacun leur Céline. En 1932, Daudet le monarchiste et Descaves le nostalgique de la Commune se rejoignent certes dans l’admiration pour le Voyage, mais pas pour les mêmes raisons. L’étudiant Lévi-Strauss le voit socialiste. Bernanos le catholique lit le roman de la déréliction d’un monde sans Dieu. Décor, philosophie, tout renvoyant au peuple, certains croient à un Céline peuple et donc populiste, et c’est d’ailleurs sous cette forme que, génération après génération, il trouve chez les jeunes ses nouvelles recrues. Aujourd’hui le Voyage en poche serait encore le plus « fauché », le plus « chouré », le plus volé des livres dans un temps où les livres se volent de moins en moins. (…)
Philippe ALMÉRAS
(extrait de la préface du
Dictionnaire Céline)
Philippe Alméras, Dictionnaire Céline. Une œuvre, une vie, Plon, 2004, 880 pages.
00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 mars 2009
"The Independent dresse un portrait à charge de Sarkozy
The Independant dresse un portrait à charge de Sarkozy
"Quand il a rendu visite au Président italien, en une demi-heure, le téléphone de Sarkozy a sonné quatre fois. A chaque fois Sarkozy a répondu. (...) Le Président autrichien s'est senti honoré. Durant leur rencontre, il n'y a eu que deux appels. (...)Lors des préparations de sa visite d'Etat en Grande Bretagne, les services diplomatiques de deux pays partageaient la même anxiété. Pouvait-on faire confiance au Président pour éteindre son portable ? S'il sonnait pendant le banquet officiel et qu'il réponde, que ferait le Prince Philip ?
"Le français est la langue des diplomates. (...) Quand les éminences diplomatiques ont su comment leur Président s'était comporté, elles ont eu honte."
"Il est faux de dire que le Président consacre tous ses soins à Carla Bruni. En plus de sa frivolité et de son manque de tact, le Président épuise son équipe par son hyper-activité. Cela pourrait être une qualité à une condition : que cela corresponde à une stratégie. Mais il n'y a pas de stratégie."
"Un diplomate français désespéré résume le régime Sarkozy : "Il n'y a plus de Cinquième République. C'est Louis XV et Madame du Barry."
00:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, diplomatie, sarkozy, politique, europe, affaires européennes, grande-bretagne, presse, médias |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 mars 2009
Hommage à Emil Cioran
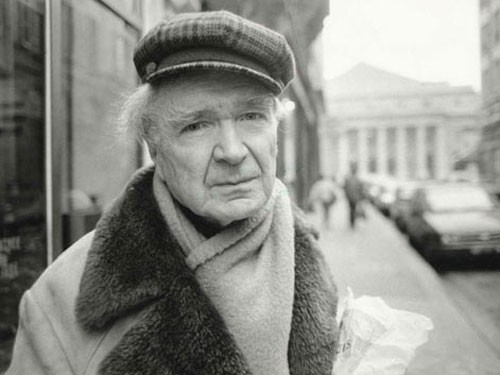
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Hommage à Emile Cioran
Au beau milieu de notre société de consommation et de plaisir, il était le héraut du déclin et du doute. L'écrivain roumain Emile Cioran est mort à Paris, à l'âge de 84 ans, le 20 juin 1995. Rien que les titres de ses livres, Précis de décomposition, Syllogismes de l'amertume ou De l'inconvénient d'être né, pourraient déclencher une dépression. Face à un homme comme Cioran, qui, selon sa propre confession, considère que toute rencontre avec un autre homme est une sorte de “crucifixion”, on est en droit de se poser la question que Nietzsche lui-même nous a suggérée: comment est-il devenu ce qu'il était?
Déjà à l'âge de dix ans, Cioran a vécu une sorte d'exclusion du Paradis. Il a dû quitter le monde de son enfance pour s'en aller fréquenter le lycée de Sibiu. Cioran décrit ce grand tournant de sa vie d'enfant: «Quand j'ai dû quitter ce monde j'avais le net pressentiment que quelque chose d'irréparable venait de se produire». Cet “irréparable” était très étroitement lié au monde simple des paysans et des bergers de son village natal. Plus tard, Cioran s'est exprimé sans ambigüité sur le monde de son enfance: «Au fond, seul le monde primitif est un monde vrai, un monde où tout est possible et où rien n'est actualisable».
Autre expérience décisive dans la vie de Cioran: la perte de la faculté de sommeil à l'âge de 20 ans. Cette perte a été pour lui “la plus grande des tragédies” qui “puisse jamais arriver à un homme”. Cet état est mille fois pire que purger une interminable peine de prison. Voilà pourquoi son livre Sur les cîmes du désespoir a été conçu dans une telle phase de veille. Cioran considérait que ce livre était le “testament d'un jeune homme de vingt ans” qui ne peut plus songer qu'à une chose: le suicide. Mais il ne s'est pas suicidé, écrit-il, parce qu'il ne pouvait exercer aucune profession, vu que toutes ses nuits étaient blanches. Elles ont été à l'origine de sa vision pessimiste du monde. Et jamais, dans sa vie, Cioran n'a été contraint de travailler. Il a accepté toute cette “peine”, cette “précarité”, cette “humiliation” et cette “pauvreté” pour ne pas devoir renoncer à sa “liberté”. «Toute forme d'humiliation» est préférable «à la perte de la liberté». Tel a été le programme de sa vie, aimait-il à proclamer.
Avant d'émigrer en France en 1937, Cioran écrivait Larmes et Saints, un livre qu'il considérait être le résultat de sept années d'insomnie. Ce que signifie l'impossibilité de dormir, Cioran l'a exprimé: la vie ne peut “être supportable” que si elle est interompue quotidiennement par le sommeil. Car le sommeil crée cet oubli nécessaire pour pouvoir commencer autre chose. Ceux qui doivent passer toutes leurs nuits éveillés finissent par segmenter le temps d'une manière entièrement nouvelle, justement parce que le temps semble ne pas vouloir passer. Une telle expérience vous modifie complètement la vie. Tous ceux qui veulent pénétrer dans l'œuvre de Cioran, doivent savoir qu'il a été un grand insomniaque, qu'il en a profondément souffert.
Les nuits de veille de Cioran sont aussi à l'origine de son rapport particulier à la philosophie. Celle-ci ne doit pas aider Cioran à rendre la vie “plus supportable”. Au contraire, il considère que les philosophes sont des “constructeurs”, des “hommes positifs au pire sens du terme”. C'est la raison pour laquelle Cioran s'est surtout tourné vers la littérature, surtout vers Dostoïevski, le seul qui aurait pénétré jusqu'à l'origine des actions humaines. La plupart des écrivains de langues romanes ne sont pas parvenu à une telle profondeur, écrivait Cioran. Ils sont toujours resté à la surface des choses, jamais ils n'ont osé s'aventurer jusqu'aux tréfonds de l'âme, où l'on saisit à bras le corps le “démon en l'homme”.
1937 a aussi été l'année où Cioran a dû reconnaître que la voie religieuse et mystique lui était inaccessible. Comme il le constatait rétrospectivement, il n'était tout simplement “pas fait pour la foi”. Car avoir la foi était au fond un don, écrivait Cioran, et on ne peut pas vouloir croire, ce serait ridicule.
Quand on prend connaissance de cet arrière-plan, on ne s'étonnera pas que Cioran revient sans cesse sur son expérience du “néant”, du “néant” qui ne devient tangible que par l'ennui. Du point de vue de Cioran, on ne peut supporter la vie que si l'on cultive des illusions. Et si l'on atteint la “conscience absolue”, une “lucidité absolue”, alors on acquiert la “conscience du néant” qui s'exprime comme “ennui”. Cependant, l'expérience de l'ennui découle d'un doute, d'un doute qui porte sur le temps. C'est à ce sentiment fondamental que pensait Cioran quand il disait qu'il s'était “ennuyé” pendant toute sa vie.
On ne s'étonne pas que Cioran avait un faible pour les cimetières. Mais ce faible n'a rien à voir avec les attitudes prises aujourd'hui par les Grufties. Pour notre auteur, il s'agissait surtout d'un changement de perspective. C'est justement dans une situation de douleur de l'âme, d'une douleur qui semble immense, démesurée, que le changement de perspective constitue la seule possibilité de supporter la vie. Quand on adopte la perspective du “néant”, tout peut arriver. Dans une certaine mesure, on en arrive à considérer comme parfaitement “normal” la plus grande des douleurs, à exclure toutes les “déformations par la douleur” qui conduisent au “doute absolu”.
Au cours des dernières années de sa vie, Cioran n'a plus rien écrit. Il ne ressentait plus l'“impérativité de la souffrance” qui fut toujours le moteur de sa production littéraire. Peut-être a-t-il tiré les conséquences de ses propres visions: nous vivons effectivement dans une époque de surproduction littéraire, surproduction absurde, totalement inutile.
Michael WIESBERG.
(trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres, littérature, lettres françaises, lettres roumaines, littérature française, littérature roumaine, france, roumanie, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 mars 2009
Atlantisme, occidentalisme. Pourquoi N. Sarkozy veut que la France réintègre le commandement de l'OTAN
| ||||
|
Le Général de Gaulle se retourne dans sa tombe. 43 ans après sa décision de retirer Paris du commandement militaire intégré de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN, créée en 1949, 22.000 employés et 60.000 militaires permanents), son dangereux successeur à l'Elysée multiplie les déclarations (1) pour que la France y reprenne désormais "toute sa place". "Toute sa place" est une formule qui, dans l'approche de Nicolas Sarkozy, signifie clairement un engagement sans réserve aux côtés des Etats-Unis. Fidèle à sa méthode autocratique du "J'écoute mais je ne tiens pas compte", il fait fi des voix de plus en plus nombreuses qui s'opposent à sa décision (2) et fait dire qu'il n'y aura ni référendum ni même de vote au Parlement sur la question.
Il entend bien concrétiser seul son choix stratégique et balayer d'un coup d'un seul un demi-siècle de politique étrangère et d'indépendance française dès les 3 et 4 avril prochain, lors des cérémonies du 60e anniversaire de l'OTAN à Strasbourg et Kehl.
Histoire de confirmer sa volonté d'intégrer la France dans les hautes sphères politico-militaires de l'OTAN, Nicolas Sarkozy a d'ores et déjà pris l'année dernière deux initiatives très applaudies par son ami George W. Bush. Un, il a doublé la présence militaire française en Afghanistan en envoyant un millier de soldats combattre avec les américains contre les Taliban, alors que chacun sait que cette guerre est déjà perdue et que l'enlisement des troupes y est assuré (le nombre de soldats français morts sur le terrain depuis est déjà suffisamment éloquent).
Deux, il a soutenu activement le projet de déployer un bouclier antimissile américain en Europe centrale, quitte à braquer sérieusement la Russie (Heureusement Barack Obama semble être en train de déminer cette énième provocation bushiste aux relents de Guerre froide). La récente volonté affichée de rapprocher Paris et Londres, principal allié des Etats-Unis dans ses guerres en Irak et en Afghanistan, est également un signe plus discret, mais tout aussi fort, d'allégeance à Washington.
Seule contrariété pour le néo-conservateur de l'Elysée, ce n'est plus son ami fauteur de guerres George W. Bush qui est au pouvoir, mais Barack Obama, à l'évidence moins enclin à semer la terreur partout dans le monde au nom de la lutte anti-terroriste.
Cette rupture dans la politique d'indépendance de la France se drape bien entendu d'arguments à usage médiatique du type "Amis, alliés, mais non inconditionnels", ou "nécessaire rénovation car nous ne sommes plus en 1966", ou encore "La France ne perdra rien de sa souveraineté" (3). Nicolas Sarkozy dit vouloir développer avec l'OTAN une "Europe de la Défense efficace". Depuis son élection, il ne cesse de répéter qu'une Europe de la Défense indépendante et l'ancrage atlantique sont les deux volets d'une même politique de sécurité. Mais quelle OTAN, pour quelle mission de défense européenne ? et la France a-t-elle quelque chose à gagner à réintégrer le commandement militaire de l'organisation, avec lequel elle coopère déjà très bien ? Elle fournit déjà 2.800 soldats pour l'occupation de l'Afghanistan, et maintient actuellement 36.000 soldats dans divers autres pays (Kosovo, Côte d'Ivoire, etc.).
Il est bien illusoire d'imaginer que les Etats-Unis donneront plus de place aux Européens et aux Français dans la nouvelle Alliance. Jaap De Hoop Scheffer a d'ailleurs bien précisé le 12 février 2009 à Paris que, si la France réintégrait le Commandement militaire intégré de l'Alliance atlantique, ce serait de toutes façons toujours à lui qu'il revenait "de gérer les choses au sein de l'OTAN, comme la position française au sein des structures de commandement, les généraux, etc". Tout au plus les Etats-Unis accorderont-ils quelques commandements militaires sans importance à un ou deux généraux français -- on parle vaguement d'un poste à Norfolk (Virginie, USA) ou à Lisbonne (Portugal) -- sans que cela puisse réellement permettre à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) de s'affirmer et de de peser significativement sur les décisions de l'OTAN.
Dans tous les conflits (Afghanistan, Serbie, Kosovo, etc) où la France s'est retrouvée engagée aux côtés des militaires américains, ce sont systématiquement ces derniers qui décident et contrôlent de façon unilatérale toutes les opérations, en particulier les frappes, reléguant la France et les autres pays alliés au rang de simples exécutants. On ne les imagine guère se plier aux décisions des français dans l'avenir. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que si de Gaulle est sorti de l'OTAN, c'est notamment parce qu'il demandait un directoire partagé de l'Organisation, ce que les Américains lui ont refusé.
Et la suite a montré que la France, puissance moyenne disposant de l'arme nucléaire et d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, existait finalement plus à l'échelle mondiale en s'affirmant de façon autonome qu'en s'effaçant dans ce qu'il appelait le "machin" atlantiste.
Autre risque, la réintégration de Paris dans une OTAN qui sert de plus en plus de caution et de bras armé à l'impérialisme américain, sera sans nul doute perçu dans les grandes capitales du monde non-occidental comme un affaiblissement et un alignement sur les Etats-Unis, ce qui lui fera perdre le peu d'influence qui lui reste encore.
Quant à la "Voix de la France", qui selon Nicolas Sarkozy deviendrait plus forte dans le concert des Nations si elle réintègre l'OTAN, elle semble jusqu'à présent avoir moins souffert des discours et des choix du Général de Gaulle -- ou même de ceux de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, par exemple en 2003 à l'ONU lors du refus de la France de suivre les Etats-Unis dans l'invasion de l'Irak -- que ceux des "caniches" européens de George W. Bush (Tony Blair, José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, José-Maria Aznar,...).
Mais l'essentiel n'est pas là.
Le projet de Nicolas Sarkozy, cet anti de Gaulle, ne consiste pas en un renforcement de la défense européenne, ou du moins pas pour lui donner plus de pouvoir et d'indépendance comme il le prétend. A travers ses choix diplomatiques et stratégiques il est à l'évidence tout à sa "vision" purement occidentaliste de la France et de l'Europe. Pour lui, la France doit s'affirmer "dans sa famille occidentale" et dans "les valeurs occidentales qui sont pour elle essentielles" (Discours de janvier 2008 devant le corps diplomatique français). Il partage avec son mentor George W. Bush une idéologie qui se fonde avant tout sur la défense d'une civilisation occidentale qui serait aujourd'hui attaquée par le monde islamiste. Lorsqu'il déclare faire en sorte que "Paris et l'ensemble des capitales occidentales parlent désormais toutes d'une seule voix", c'est surtout pour défendre les causes occidentales que les discours et les aventures guerrières de Bush "contre l'Axe du Mal et la Barbarie" ont totalement galvaudées: la Démocratie, la Liberté, l'universalisme des Droits de l'Homme, la lutte contre le terrorisme.
Comme George W. Bush et comme tous les néo-conservateurs islamophobes, Nicolas Sarkozy est dans une logique de guerre contre tout ce qui ne relève pas des "valeurs occidentales" judéo-chrétiennes, tant en matière d'économie que de politique et de religion. Il exècre et ne cesse de diaboliser les partis islamistes qualifiés de terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas, n'imaginant pas que son propre occidentalisme est à l'Occident ce que le fondamentalisme islamiste est à l'Islam.
Il est au plus près des cercles israélo-américains d'extrême-droite qui, afin de "garantir la paix et la sécurité", prônent une domination occidentale du monde, quitte pour cela à passer à l'offensive et à se lancer dans une guerre de civilisation "globale". Pour Nicolas Sarkozy il s'agit de défendre mais aussi désormais d'imposer par tous les moyens, et notamment par la guerre, un nouvel ordre occidental soi-disant "moral" (comprendre surtout "néo-libéral") qui doit régner sur l'ensemble de la planète.
Cette idéologie d'autodéfense agressive se nourrissant du conflit avec l'islamisme autorise ainsi l'OTAN -- qui à l'origine n'a qu'une mission de défense limitée aus territoires occidentaux -- à aller porter la guerre aux confins de la planète pour défendre des intérêts géostratégiques essentiellement américains, quand ce n'est pas parfois purement israéliens, à titre d'une soi-disant "légitime défense" contre le terrorisme islamiste. De hauts stratèges et chefs d'état-major de l'OTAN planchent même actuellement sur de réjouissantes nouvelles options militaires.
Ces docteurs Folamour réclament en effet le droit d'effectuer des frappes préventives, y compris avec l'arme nucléaire, sans autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Lorsque l'on connaît le désir insensé des Israéliens et de leurs amis américains -- Même avec Barack Obama, il y a peu de chances que les Etats-Unis modifient leur politique de soutien inconditionnel à l'Etat d'Israël -- d'aller bombarder l'Iran, on imagine aisément à quoi la sainte alliance transatlantique risque bientôt de servir.
C'est avec cette "vision" guerrière et occidentaliste du monde, ruineuse et extrêmement dangereuse pour la France, que Nicolas Sarkozy entend jouer un rôle international. En infléchissant la doctrine militaire française pour mieux s'aligner sur la politique étrangère américaine, dont on connaît pourtant les errements et l'agressivité aussi inefficace que désastreuse, il commet une erreur diplomatique et stratégique majeure.
------------
Notes
1) Annoncé dès la campagne électorale de 2007, ce projet sarkozyste n'a cessé d'être remis sur la table, tant par Nicolas Sarkozy que par Bernard Kouchner (Ministre des Addaires étrangères) et Hervé Morin (Ministre de la Défense) afin d'y "préparer l'opinion", notamment pour le Président de la République à travers le Discours de janvier 2008 devant le corps diplomatique français, lors du Sommet de l'OTAN à Bucarest en avril 2008 et la semaine dernière encore lors d'une conférence sur la sécurité à Munich.
2) Parmi les responsables politiques qui s'opposent à la décision autocratique de Nicolas Sarkozy, on note celles de François Bayrou pour qui la réintégration dans le commandement militaire de l'OTAN serait "une défaite pour la France" et un "un aller sans retour" [...] "En nous alignant, nous abandonnons un élément de notre identité, une part de notre héritage, et nous l'abandonnons pour rien". Il demande que le choix fait par le Général de Gaulle en 1966 "ne soit pas bradé et jeté aux orties", ajoutant qu'un tel choix ne peut aujourd'hui être modifié "que par un référendum du peuple français". Dans un entretien au Nouvel Observateur, François Bayrou précise sa pensée. Pour lui, en réintégrant l'OTAN, la France se range "aux yeux du monde" dans un "bloc occidental" [...] "euro-américain d'un côté, le reste du monde de l'autre. Ceci, pour la France et son histoire, son universalité, est un renoncement". Il affirme que "ce que nous sommes en train de brader, ce n'est pas seulement notre passé mais aussi notre avenir, une partie du destin de la France et de l'Europe". Pour le Parti Socialiste, qui demande un débat et un vote parlementaire sur la question, "Aucune explication recevable n'est apportée sur l'intérêt pour la France de ce retour" et les "conditions et contreparties de cette réintégration ne sont pas connues". Jean-Marc Ayrault, chef de file des députés PS, estime que "La France doit garder son autonomie de décision" et que celle-ci "ne peut pas être prise par le président seul". Les anciens ministres socialistes de la Défense Paul Quilès et Jean-Pierre Chevènement ont également publié des tribunes dans la presse pour exprimer leur rejet de cette décision "très dangereuse pour la sécurité de la France". [...] "Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres", affirment-ils. "Si la France entre dans l'OTAN, il n'y a plus d'espoir de politique étrangère et de sécurité commune, plus d'Europe de la défense", affirme également le socialiste Jean-Michel Boucheron. La réintégration "limiterait notre souveraineté et serait le signe d'un alignement sur l'administration américaine qui banaliserait la singularité de la France", estiment pour sa part le Parti Communiste. Du côté de l'UMP, une partie des députés exprime aussi son opposition: Jacques Myard proteste contre ce "retour qui va lier les mains de la France et l'arrimer à un bloc monolithique occidental dirigé par les Etats-Unis" tandis que Lionnel Luca explique que "Pour un grand nombre de pays arabes, le fait que la France soit dans l'OTAN est un mauvais signal". Jean-Pierre Grand regrette cet "arrimage plein et entier aux Etats-Unis". "Il y a dans le monde entier des pays qui attendent de la France qu'elle demeure une transition, une passerelle, et qu'elle ne s'aligne pas sur les Etats-Unis", renchérit Georges Tron. Le gaulliste ex-UMP Nicolas Dupont-Aignan s'engage lui dans une quasi campagne contre le projet et exige un débat parlementaire. Daniel Garrigue, député ex-UMP de la Dordogne, s'est de son côté fendu d'une tribune intitulé "Bonjour, messieurs les traîtres !". Pour lui, "Rien ne justifie le retour de la France dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et la remise en cause de l'un des rares consensus forts de notre pays -- voulu en l'occurrence par le général de Gaulle avec la sortie de l'Otan en 1966 et confirmé par ses successeurs, y compris par le socialiste François Mitterrand. Nous y perdrons la considération que nous avions sur la scène internationale et particulièrement notre capacité à être entendus dans un certain nombre de conflits, notamment au Proche et au Moyen-Orient. [...] "Pour tous ceux qui croient en la France et en la construction de l'Europe, cette décision de rejoindre l'Otan qui n'a été ni concertée, ni discutée, ni approuvée par les Français ou par le Parlement, constitue bien une véritable trahison". Alain Juppé, ancien Premier Ministre de Jacques Chirac, renouvelle lui aussi ses critiques en demandant si la France n'était pas en train de "faire un marché de dupes en rentrant sans conditions" dans le commandement de l'OTAN. Mais le plus farouche opposant à Droite est l'ancien Premier Ministre Dominique de Villepin. Pour lui, la France "va se trouver rétrécie sur le plan diplomatique" et sera plus vulnérable au terrorisme. "Alors que le Sud est en train de s'affirmer, dans un monde qui est en train de basculer, faut-il donner le sentiment de se crisper sur une famille occidentale ?", s'interroge-t-il. Comme François Bayrou, il estime que si la France avait été intégrée aux structures de commandement de l'OTAN en 2003, elle aurait été obligé de suivre les Etats-Unis de Geoorge W. Bush dans la guerre contre l'Irak.
3) Discours de Jaap De Hoop Scheffer, Secrétaire général de l'OTAN, devant les parlementaires français le 12 février 2009.
_______________
*http://www.republique-des-lettres.fr/journal.php
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, france, otan, atlantisme, occidentalisme, etats-unis, gaullisme, géopolitique, stratégie, défense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Zemmour, une élite comme les autres?
Zemmour, une élite comme les autres ?
 Par Karl Hauffen
Par Karl Hauffen
En lisant la dernière brève de Zemmour dans laquelle il se félicite de la mort des régions françaises, j’ai soudain pris conscience de la béance qui me séparait de ce patriote de plume. Car si la mort de ses régions est une chance pour la France, on est bien en droit alors de se demander ce que revêt exactement le terme de France. Qu’est-ce que la France pour Zemmour et avec lui, pour l’ensemble de l’intelligentsia intra-muros qui postillonne à longueur de temps le mot France comme d’autres celui d’Europe.
On aimerait qu’il nous explique une bonne fois pour toute ce qu’est au juste la France ? Un roman de Balzac ? Une poésie de Victor Hugo ? Napoléon et son code civil ? De Gaulle et sa grandiloquence de brave papi ? Un peu tout ça à la fois sans doute… Difficile donc de ne pas réprimer un certain pincement ironique devant cette vision proprement désincarnée et cérébrale de la nation. Dans ce fatras poussiéreux de bibliothèque, on cherche avec peine un corps vivant doté d’une âme. L’intelligent Zemmour nous offre-là la figure parfaite de l’idiot-savant - cette particularité dont seules les grandes écoles d’État parisiennes ont la recette - qu’il aime pourtant tant à fustiger par ailleurs. Inutile alors de discourir à longueur d’émissions sur le déclin de la France. Car une nation qui n’a pas d’autres points d’ancrage identitaire qu’une liste de bouquins, un carton rempli de textes administratifs et, encadrées de dorure, des photos d’hommes d’État illustres dans de ridicules costumes de parade est forcément une nation condamnée. Ce qu’aime et veut sauver Zemmour, ce n’est pas la France, mais son musée, ou plus exactement son mausolée.
La France meurt de son centralisme bureaucratique et des relations incestueuses qu’entretiennent entre elles les élites parisiennes. Elle meurt à petit feu d’être représentée par un aréopage de parvenus, élus mais sans pouvoir, intarissables bavards mais dénués de la moindre liberté d’initiative. Qui décide ? Les conseillers du président et les hauts-fonctionnaires au crâne d’œuf grouillant dans les couloirs des ministères aux nominations ronflantes et aux compétences à rallonge. Qui les a élus ? Personne. Ils sont là depuis des décennies et survivent inlassablement aux alternances gouvernementales, leurs mille projets de loi à tiroirs sous le bras. Cette caste d’idiots-savants est si savamment idiote qu’on connait à l’avance les solutions qu’elle proposera, que notre président s’appelle Mitterrand, Chirac ou Sarkozy. Pour combler les déficits ? Créons un nouvel impôt. Pour lutter contre le chômage ? Créons une subvention. Pour lutter contre l’insécurité ? Créons une commission. Pour lutter contre la dérive communautariste qu’induit une politique migratoire inconsidérée ? Créons un observatoire ou mieux encore, une Haute autorité de lutte quelconque.
La France de Zemmour est pourrie de la tête, une tête bouffie qu’une thrombose bureaucratique ne fait que rendre plus hideuse encore. La France qui travaille, celle silencieuse qui ne rappe pas, celle industrieuse des ouvriers, des petites gens, des petits entrepreneurs, cette France-là ne circule pas en vélib dans Paris intra-muros, ne lit pas Balzac et n’éprouve aucun orgasme particulier de la lecture emphatique des textes administratifs qu’on oppose quotidiennement à ses velléités de liberté. L’antimondialiste Zemmour qui se plait à moquer l’Europe désincarnée de Bruxelles rêve une France autant désincarnée, si ce n’est même plus. Que tout ceci est tragi-comique ! C’est en aimant la France de cette façon-là, que la petite bande des souverainistes autorisés, celle des Max Gallo, des Henri Guaino et des Villepin, contribue à en aggraver l’agonie. Zemmour ne déroge donc pas à la règle. Ne lui en déplaise, mais la France d’après, celle qui aura définitivement tué ses pays charnels, ne sera ni ce mausolée auquel il rêve, ni même cette ultime tentative de rester fidèle au souvenir du premier consul.
Sans ses régions, la France ne sera qu’une tête décapitée sanguinolente posée sur son propre cadavre en putréfaction. Un État lancé sans entrave sur la voie totalitaire avec tout en haut, un pouvoir qui aura définitivement retiré à ses couches populaires leur dernier outil de contrôle démocratique. La région, on le voit partout en Europe, est le premier espace d’adhésion et d’expression politique. Elle est la première brique sociale par laquelle la collectivité des hommes doit nécessairement passer pour se retrouver et se mettre en situation d’amorcer une action politique. Entre régionaux, on se comprend, on utilise les mêmes mots avec les mêmes accents. Quand on sait y lire, un Alsacien en dit plus en un regard que Zemmour en deux heures d’émission. S’organiser au niveau de la région devient alors plus simple, coule de source. Qu’attend donc Zemmour de ce découpage administratif qui refusera d’entendre les revendications d’hommes de même culture, de même souche sociale, conditionnés par le même contexte économique et moulés par des mœurs communes qui n’ont rien à voir avec celles apprêtées qui se pratiquent dans le monde clos du show-biz parisien ?
La France meurt chaque jour un peu plus de son incapacité à connecter une élite arrogante avec une population réduite au silence et Zemmour, dont on apprécie souvent par ailleurs les analyses pertinentes et affutées, nous dit sans rire que tout ceci est bel et bon. Comment ensuite le croire lorsqu’il prétend aimer la France ? En cela, il nous démontre qu’il fait bien partie, ni plus, ni moins, du même cercle fermé des élites autorisées, malgré le fait qu’il ait fait métier de les brocarder. S’il aime la France, il nous avoue son indifférence pour les Français, c’est-à-dire ce fragile assemblage de peuples européens qui composent la France. Zemmour est tombé amoureux d’un portait, mais il s’interdit d’en regarder l’incarnation vivante dans toute sa nudité. Car la France n’est pas seulement une idée, elle est avant tout une réalité organique complexe et diverse.
[cc] Novopress.info, 2009, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine
[http://fr.novopress.info]
Article printed from :: Novopress.info Alsace / Elsass: http://alsace.novopress.info
URL to article: http://alsace.novopress.info/?p=807
00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : france, actualité, sociologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Loup et l'Agneau ou la tentation sophistique

Le Loup et l'Agneau ou la tentation sophistique
Chacun sait que le plaisir de l'écrivain réside dans l'incertitude et la difficulté. La Fontaine est un auteur difficile.
Le Loup et l'Agneau est exemplaire en ceci qu'il vient à contre-temps des autres fables du recueil, que le système de la logique fabuliste et moraliste (histoire et leçon de l'histoire) a été tourné en dérision par celui même qui s'en faisait le champion, détournant du même coup la loi morale, qui se voudrait pourtant le fondement et la direction du récit. Ce système de pensée vient évidemment en opposition à la puissante croyance officielle, et je m'en remets aux sermons et aux oraisons funèbres de Bossuet, en la divine Providence, principe de cohésion historique et personnel. L'ouverture de la Fable est avant tout un coup de théâtre, ou un coup de force: double renversement: dans la topologie du discours, la morale, contrairement à ce que l'on observe dans la majorité des Fables, ne se trouve pas à la fin, comme la déduction suit la réflexion, mais en tête. Comme s'il s'agissait d'une induction, d'une intuition. Le préfixe latin in- signifiant “dans”, la “morale” se trouverait en embryon dans l'histoire, comme pré-établie. Première surprise.
La Fontaine commence donc: “La raison du plus fort est toujours la meilleure”, mettant sur un même plan deux notions traditionnellement opposées: la force et la raison. Au premier renversement d'une fable à l'envers, s'ajoute la surprise d'une fable à rebours, par l'évocation d'une anti-morale, d'une contre-morale. L'opinion commune admet que la raison l'emporte sur la force —en tout cas dans une société policée, comme l'était celle de Louis le Grand—; a contrario, avec le fabuliste, la force est supérieure à la raison. Et l'histoire de la Fable ne le démontre pas, elle le montre.
Le seul argument du loup, c'est la faim. Et pourtant la pudeur, si chère aux contemporains de La Fontaine et si chère à la littérature galante, précieuse ou érotique, la fardera. Ce qui excusera cette appétance obscène et la légitimera, c'est l'art de la circonvolution rhétorique. Seulement l'agneau la dénichera au terme du clair-obscur de la série argumentation/réfutation. On pourrait ici démonter le mécanisme du dialogue à la fois si théâtral et si drôle, mais aussi et combien inquiétant. Le loup en serait comme un Tartuffe de la logique. Car quelle belle critique de la raison faite en ces temps de Descartes et de classicisme —le premier recueil de Fables ayant été rédigé trente ans après le Discours de la méthode... La raison érigée en escroquerie. La raison, insinue La Fontaine, est ce que l'on veut bien en faire, ce que la force veut bien faire d'elle.
Sans ignorer le point de vue sexuel de la Fable (Le petit chaperon rouge de Perrault est sur ce terrain bien comparable), La Fontaine aborde la morale et la fable à l'imitation des Anciens, mais dans une perspective sophistique. Qu'implique alors cette induction? Que la raison peut tout démontrer (qu'elle est un outil, qu'elle n'est pas une fin). Que la raison ne fait que justifier, elle n'est qu'une excuse à nos faiblesses. On en est exactement à ce que démontraient les sophistes, réputés pour soutenir sur la place publique un jour une thèse et le lendemain l'inverse: non point l'absurde de l'humaine condition —qui est postérieur, mais ce qui est rationnel est aussi affectif, que la rationalité n'est qu'une bizarrerie d'affectivité. Et plus loin: le savoir, les connaissances ne sont qu'un cumul d'affectivité “objectivée”.
Cela nous ramène à un La Fontaine inquiétant, dont se méfiait Rousseau, à juste titre, un La Fontaine libertin non-voilé (de mœurs et de pensées) où perce sous l'auteur des Fables l'auteur des Contes en vers, l'écrivain du règne des sens, du trouble et de l'irrationnel.
Le Loup et l'Agneau, Fable 10, Livre 1 (publication: 1668).
Jean-Charles ANGRAND.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, 17ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 mars 2009
Sarkozy battles General De Gaulle's NATO retreat
Sarkozy battles General de Gaulle's NATO retreat
16 March, 2009, http://russiatoday.ru/
French President Nicolas Sarkozy has gone against the late General Charles de Gaulle’s decision in 1966 to remove France from NATO, but that move promises to be something of a public relations disaster.
Intensive security measures are planned as tens of thousands of anti-NATO demonstrators plan to block the summit during the military organization’s 60th Anniversary conference in Strasbourg in April.
Sarkozy is pulled in different directions over reintegrating with the NATO military machine. He believes France needs US friendship to do business worldwide and wants to benefit from the US military umbrella. He has worked hard to overcome the violent hostility to France that dates back to the quarrel over the war in Iraq, which saw Americans pouring French wine into the Potomac River, but he also wants a European defence policy for Europe and does not want to follow the US into Vietnam style quagmire in Afghanistan.
Above all, the French want to keep their independence and have no intention of seeming to become the next British style US poodle. Yet much of the world sees NATO as the military arm of US foreign policy. Sarkozy thinks that he can achieve these contradictory aims from within the alliance but the result is that different levels of the French government are giving off conflicting messages.
The administration is playing up two opinion polls that show a small majority of French people in favour of reintegration. Much of the press have dutifully echoed the result. Little attention has been paid to the high figure of 21% of ‘don’t knows’. Equally the French press has ignored completely the Angus Reid poll that shows that only a tiny 12% of French people think that the engagement in Afghanistan boosted by Sarkozy, ‘has been mostly a success’ – the lowest figure for six comparable western European nations.
Faced with this President Sarkozy has appointed a personal envoy to Afghanistan and Pakistan, Pierre Lellouche. In so doing he reinforces France’s diplomatic presence in the region at a time when policy is under review by the United States and its NATO allies. The move follows similar appointments by Britain and Germany, which in turn were triggered by the appointment of the veteran diplomat Richard Holbrooke to head up a similar US diplomatic mission. For the moment, despite US pressure, there is no question of sending more troops.
It is likely that the appointment of Lellouche has been made after consultation with the Americans. His career path confirms this. He has close links with America and achieved a doctorate in law at Harvard University. In his political career he has specialised in foreign relations and in particular NATO. He is President of the French parliamentary delegation to NATO and was President of the NATO Parliamentary Assembly from 2004 -2006. Last year he conducted a cross-party parliamentary enquiry into conditions in Afghanistan. He worked with Holbrooke in Bosnia in the 1990s.
The importance of the appointment of Holbrooke, linked to that of his French, German and British counterparts, to a hard pressed President Obama is clear from the fact that it came only two days into his presidency. Any support for him by France is welcome. President Sarkozy has appointed an envoy very much to the taste of his allies and has talked of staying in Afghanistan ‘as long as is necessary’. However, in Washington, recently his Minister of Defence Hervé Morin put it differently:
“We will have to stay as long as is needed… Our aim is not to stay there for ever. That is what the President of the Republic has reminded us several times.”
And he went so far as to pose the question: “Why not set, quite rapidly, a date for the beginning of the withdrawal of the alliances forces?”
Lellouche himself was more blunt:
“It is right that we operate as co-pilots in the international strategy in Afghanistan. There must not be a repetition of unilateral excesses of the Bush era, which provoked a deep gulf between the United States and its NATO allies”.
He said that the French government would ‘test’ the dialogue proposed by President Obama. “Let us hope that it works. We will not stay in Afghanistan indefinitely”. He stressed that the conflict there “was a war and not an international police operation. The proof is that France spends nearly €200 million a year on its army in Afghanistan whilst spending only €11 billion on civilian aid”. He pin pointed the withdrawal of all but 7,000 US troops at the time of the invasion of Iraq in 2003, as the main cause of the deterioration of the allied position in Afghanistan. But he said “The game is not lost. Studies show that if there is a lack of support for the Karzai government, the people do not want a return to the rule by the Taliban.”
By fully rejoining NATO, France removes a thorn from the US diplomatic flesh and adds the full support of the world’s second biggest diplomatic service backed up by Western Europe’s only genuinely independent nuclear deterrent plus experienced and respected military forces. Even so, quite how much influence France will really have over policy in Afghanistan, with a total of only 3,300 troops deployed, remains to be seen. The United States now has 38,000 present with a further 15-30 thousand to arrive shortly.
The point is underlined by the announcement that French troops there are now to come directly under US command whereas before they operated as an independent unit. This will be grist to the mill of those in France who claim NATO reintegration means loss of national control. It will not help Prime Minister François Fillon, who after some hesitation, decided to call for a vote of confidence on the question in the French National Assembly. By putting the survival of the government on the line he will win easily and it gives him a chance to counter the arguments of those within his own party and in the opposition who oppose the move.
Despite this neat political manoeuvre, the reality is that the French President is confronted by real opposition from many in the French political class over NATO reintegration and in particular involvement in Afghanistan. They argue, often privately, that this is more a colonial war to control pipeline routes from central Asia to the sea coast of Pakistan than about democracy. Worse they suggest it may be an excuse to establish a long term presence in the region with no other real military aim.
They point to the coincidence that the US led invasion followed one month after the award by the Taliban government of a key energy contract to an Argentinean company rather than American Unocal and that before becoming President, Hamid Karzai was an oil consultant to Chevron in Kazakhstan. The same Afghan President requires a twenty four hour a day American body guard of over 100 men to stay alive, unlike his much criticised Communist predecessor.
They question why after seven years, the US security services that employ 100,000 people and spend an astounding $50 billion a year, cannot find Osama Bin Laden. They note that Afghanistan has become the world’s biggest producer of heroin under Western occupation.
Finally they do not think the war can be “won” in any meaningful sense. They echo the view of Canadian Prime Minister Stephen Harper, who told CNN:
“Quite frankly, we are not going to ever defeat the insurgency. Afghanistan has probably had – my reading of Afghanistan history is – it’s probably had an insurgency forever of some kind.” The Canadian parliament has voted to withdraw all troops by 2011.
Despite all this there are indications that President Sarkozy will eventually take the risk of sending more troops. Under the French constitution it is his decision alone, but this will not happen before the controversial NATO summit in Strasbourg in April and the vote in parliament. In any event he will do what he can to prevent the alliance from failing in Afghanistan because he believes that such an outcome would damage NATO credibility perhaps fatally. This is especially the case in the light of the recent humiliation of Western financial institutions.
All this leaves the United States and its NATO allies confronting the classic military dilemma well summarized by Winston Churchill over a hundred years ago:
“It is one thing to take the decision not to occupy a position. It is quite another to decide to abandon it once occupied.”
More troops may just make it possible in one form or another to ‘declare a victory and go home’ to the great relief of the French electorate and government. This process is likely to be accelerated by the bankrupt finances of the NATO governments.
Robert Harneis for RT
00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, otan, gaullisme, sarkozy, france, affaires européennes, politique, géopolitique, atlantisme, occidentalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 mars 2009
Chauprade: refonder un monde multipolaire

Chauprade : "refonder un monde multipolaire" |
| Ex: http://unitepopulaire.org/ | |
| « Mes détracteurs cherchent à faire de moi un complotiste. Or, je ne suis pas plus complotiste que ceux qui défendent la version officielle [des attentats du 11 Septembre]. […] Ne perdons pas de vue que le monde est partagé entre deux représentations de ces attentats. En Chine, en Russie, dans le monde arabe, en Amérique latine, bref dans l’écrasante majorité du monde non occidental, on ne croit pas à la version officielle. Je ne dis pas qu’il faut reprendre à son compte ces doutes, je dis simplement que cela fait partie de la réalité géopolitique du monde. […] Je revendique le droit de douter. C’est là le fondement de la recherche scientifique. En histoire et en géopolitique, cela consiste à s’interroger sur la vérité de tel ou tel événement historique, de la confirmer, de la nuancer ou de l’infirmer, si elle est inexacte dans sa formulation. C’est cela qu’on nous refuse. Car au-delà de mon cas, ce qui est remis en question, c’est le droit élémentaire de douter, de s’interroger. Je ne suis pas le seul. Beaucoup d’autres ont été frappés avant moi. Ce qui montre qu’il y a un resserrement des libertés dans notre pays. […] Dès le moment où un Etat, en l’occurrence les Etats-Unis, a délibérément menti sur les armes de destruction massive pour justifier son attaque contre l’Irak, je ne vois pas ce qui justifierait de prendre pour parole biblique la version qu’il donne du 11 Septembre. […] Le point de départ du mondialisme est la finance new-yorkaise, qui n’a cessé d’accroître son emprise sur le monde. Elle fait de la géopolitique depuis l’entrée en guerre des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale. Or, la finance est entrée en crise, et avec elle le projet mondialiste. Le moment est venu de refonder un monde multipolaire. Ma crainte, c’est que les Européens soient absents de cette refondation. On voit les Russes, les Chinois, les Sud-Américains. On ne voit pas émerger de conscience européenne, ni de réveil des peuples européens. L’Europe semble être tombée en léthargie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Or, la paix découle d’équilibres entre les puissances. Dès lors que l’une d’entre elles s’affaiblit dans son identité, dans ses capacités militaires, dans sa faculté à se penser, elle s’expose à disparaître, broyée par des civilisations fières de leur identité, qui ont le nombre avec elles. […] J’invite mes amis à rester discrets. Moi je suis sorti et je vais continuer le combat à l’extérieur. Eux doivent rester pour le mener à l’intérieur. Que mes amis ne s’inquiètent pas pour moi. Ils vont voir mon combat redoubler en intensité. »
Aymeric Chauprade, interviewé par Le Choc du Mois, février 2009
|
00:40 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : censure, france, liberté d'expression, multipolarité, politique internationale, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 mars 2009
Drieu La Rochelle. Il mito dell'Europa
Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa

Pierre Drieu La Rochelle (Parigi, 3 gennaio 1893 – Parigi, 15 marzo 1945)
Questo libro, edito nel lontano 1965, poi ristampato nel 1981, ed ormai reperibile nel migliore dei casi in sbiadite fotocopie, rivelò al distratto pubblico italiano la figura di Pierre Drieu La Rochelle. A questa lacuna, aveva in parte rimediato un libro di Paul Serant (Romanticismo fascista) uscito qualche anno prima, ma fu solo con questo piccolo saggio che esplose la passione per questo “poeta maledetto” del Novecento. Contemporaneamente alla scoperta in Italia della figura del “collaborazionista” La Rochelle, in Francia cominciavano ad essere ristampati i suoi testi, come in una timida, comune, primavera del pensiero anticonformista brutalmente azzittito con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale.
La Rochelle è sicuramente una personalità forte, uno scrittore dal temperamento d’acciaio, ma anche un polemista dalle grandi capacità di romanziere. Questa sua grande sensibilità fu probabilmente dovuta all’esperienza tragica nella Prima Guerra Mondiale (in cui fu ferito tre volte), e all’estrazione borghese della sua famiglia, rovinata da crisi economiche e sentimentali.
Sicuramente Drieu sapeva che non si potevano servire due “padroni”, la verità e la notorietà, scegliendo così di essere compreso bene, ma da pochi. Non a caso gli autori del libro, sottolineano la figura di questo poeta come quella del miglior Nietzsche: un’inattuale appunto, che ha lasciato fosse il fluire del tempo a dispiegare tutta la sua attualità e profeticità.
L’analisi del pensiero di La Rochelle segue così per ognuno dei tre autori una prospettiva differente: se Romualdi ne analizza la personalissima Weltanschauung, il suo esempio, identificato come militia per l’Europa, è il contributo di Giannettini, mentre Prisco si sofferma sulla storia “personale” di questo.
Dopo la crisi del ‘29, mentre tutti i suoi amici d’infanzia scelgono di abbracciare le sorti dell’Internazionale comunista, Drieu fa una scelta impopolare: egli comincia a proclamarsi apertamente fascista. Il suo fascismo è però quello di chi non può fare a meno di denunciare i mali della decadenza, di elaborare una personale rivolta contro quel “tramonto dell’occidente” già raccontato da Spengler, e dagli autori tedeschi della Rivoluzione Conservatrice.
Per questo, Drieu non fu solo un “intellettuale fascista”, come qualcuno ha voluto etichettarlo un po’ troppo semplicisticamente. Fu uno scrittore che credette di trovare una risposta alle sue domande e alle sue speranze nel fascismo o, meglio, in una certa immagine del fascismo che si era creato. Particolare fondamentale, poiché se non si tiene conto di ciò, si rischia di non capire la sua critica e lucida analisi dei regimi di Mussolini e di Hitler, e quell’atteggiamento anticonformista (appunto “maledetto”) che gli attirò le antipatie sia delle destre che delle sinistre dell’epoca.
La sua Europa non è un’Europa “neutra”: aborto esangue ed intellettuale dei federalisti di Strasburgo o d’altri democratici tout court. La sua Europa è invece quella volontà unica e formidabile, già narrata da Nietzsche, che nel sacrificio e nella stirpe, trova la sua ragion dessere. Non aveva allora torto Drieu La Rochelle, a scrivere poco prima di morire che le generazioni future si sarebbero chinate, incuriosite, sui suoi libri per cogliere un suono diverso da quello solito.
Drieu, però, a differenza di molti altri “redenti” o fascisti “pentiti”, volle pagare sino in fondo, dimostrando che ancora oggi le parole possono essere scritte «con il sangue e non solo con l’inchiostro». Avrebbe potuto fuggire come molti, starsene tranquillo per un po’ e ritornare in patria dopo qualche anno. No. Sarebbe stato troppo facile, troppo moderno per lui. Drieu La Rochelle moriva perciò suicida, il 15 Marzo 1945 nel momento della “liberazione”.
* * *
A. Romualdi, M. Prisco, G. Giannettini, Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa, Edizioni del Solstizio, 1965.
[Tratto da “il Borghese”, n.8, Agosto 2008]
Andrea Strummiello
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, fascisme, années 30, années 40, europe, européisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 mars 2009
La fin de la singularité française dans l'OTAN
La fin de la singularité française dans l'Otan
La France doit-elle reprendre « toute sa place » dans l'Otan en retournant dans son commandement intégré, qu'elle avait quitté en 1966 ? Ou doit-elle conserver sa position actuelle, présente dans l'organisation, militairement engagée dans des opérations au Kosovo et en Afghanistan sous drapeau otanien mais sans participer à ses organes de commandement pour maintenir son autonomie de décision ? Le débat fait - du moins en apparence - rage dans la classe politique française. Dans quelques semaines, le sommet de Strasbourg et Kehl des 3 et 4 avril prochain, doit en principe célébrer le soixantième anniversaire de l'organisation qui, paradoxalement, a survécu au décès du Pacte de Varsovie et l'annonce du retour complet de l'enfant terrible français au sein de sa « famille » euro-atlantique.
Ce dernier geste, très attendu aussi bien à Washington qu'à Berlin, est pourtant, en grande partie, symbolique. Certes, la France pourrait obtenir deux commandements : l'un basé à Norfolk en Virginie (Etats-Unis) chargé de la conduite des transformations de l'alliance, et un autre à Lisbonne, qui accueille le QG de la force de réaction rapide (Nato Response Force, ou NRF). Le dossier n'est cependant pas totalement bouclé, car ce retour signifie une très forte augmentation du nombre d'officiers français à l'Otan et, donc, d'une réduction concomitante des contingents britannique et allemand. Et l'assentiment des 25 autres alliés. Si tous les feux verts sont obtenus, cette montée en puissance pourrait s'étaler sur trois à quatre ans.
Mais au-delà de caractéristiques techniques, ce retour scelle avant tout, symboliquement, le dernier maillon d'un rapprochement avec l'Amérique et la communauté atlantique, amorcé par Jacques Chirac. Car depuis 1995 la France, et cela en dépit de la violente controverse sur l'Irak avec George W. Bush, a déjà fait une grande partie du chemin en acceptant de participer à des missions militaires et en devenant l'un des principaux contributeurs de forces, notamment au sein de la NRF. Au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001, la France n'avait d'ailleurs pas hésité à se ranger du côté de tous les alliés pour évoquer la clause de solidarité collective avec les Etats-Unis, selon laquelle une attaque contre l'un des membres est une attaque contre tous.
Mais ce sont souvent les symboles qui sont le plus sujets à polémique, surtout lorsqu'ils touchent à des concepts comme l'indépendance de la politique étrangère de la France et sa souveraineté. Des concepts qui étaient d'ailleurs au coeur de la décision du général de Gaulle dans sa lettre du 7 mars 1966 au président américain Lyndon Johnson. Pour la France, il s'agissait alors « de recouvrer sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté, actuellement entamée par la présence permanente d'éléments militaires alliés ». Ce qui avait conduit notamment à l'évacuation des états-majors de l'Otan de Versailles et Fontainebleau un an après. Mais Paris avait d'autres soucis : conserver toute son autonomie de décision sur la force de frappe nucléaire six ans après la première explosion d'une bombe atomique française et refuser de suivre les Etats-Unis dans toutes leurs aventures militaires à l'étranger. Cela au moment même où ils s'engageaient lourdement dans la guerre du Vietnam.
Aujourd'hui, le contexte a profondément changé. D'une part, le monde n'est plus divisé en deux blocs. C'est d'ailleurs aussi pour se placer en dehors de cette politique de blocs et à un moment où s'amorçait une certaine détente que le général de Gaulle avait choisi de se retirer du commandement intégré, lui ouvrant ainsi la voie à un dialogue avec l'URSS et la Chine. La fin de la Guerre froide - et en dépit des nouvelles tensions avec la Russie - a une autre conséquence : celle d'avoir mis un terme à l'équilibre de la terreur entre les deux blocs par le feu nucléaire. Ce qui réduit évidemment la portée de la question de l'autonomie de la force de frappe nucléaire française vis-à-vis de l'Amérique.
Pourtant, il ne faut pas se faire d'illusions. Le retour total dans l'Otan de la France soulève au moins deux autres interrogations : quid de l'Europe de la défense ? Certes, tout est fait pour expliquer que les Américains reconnaissent enfin cette dimension européenne, mais elle restera un élément complémentaire de l'organisation atlantique, et non « autonome ». L'autre question est très simple. Le président Barack Obama ne peut que se féliciter du choix de Nicolas Sarkozy, car ce qu'il souhaite aujourd'hui le plus de la France comme de tous ses alliés, c'est l'envoi de troupes supplémentaires de leur part en Afghanistan. Il s'agit de savoir si alors Paris pourra lui dire « non ». Le mur de Berlin est tombé. La singularité française est en train de suivre. Mais jusqu'à quel point ?
Jacques HUBERT-RODIER
Source : LES ECHOS
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, france, otan, atlantisme, occidentalisme, armées, défense, alliance atlantique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 mars 2009
Soutien tunisien à Ayméric Chauprade
Le soutien des Tunisiens : "Choc de civilisations" et liberté de penser
Si toute histoire n'est que narration, l'Histoire, la grande, elle aussi est une narration. Elle est faite d'agencement causal d'évènements avec la prétention de dire le réel (les évènements) et le vrai (l'agencement causal).
 L'Histoire ainsi faite influe sur le futur et détermine les rapports de forces actuels.
L'Histoire ainsi faite influe sur le futur et détermine les rapports de forces actuels.
Les attentats du 11 septembre 2001 n'échappent pas à cette logique. La restitution qu'en ont faite les autorités américaines dès les premiers jours a constitué non seulement une version officielle, mais aussi une légitimation pour des actions futures (les guerres d'Afghanistan et d'Irak) et une nouvelle politique mondiale : la lutte contre le terrorisme avec le camp du Bien et l'axe du Mal...
Et si la version officielle du 11 Septembre n'était qu'une vulgaire manipulation destinée à légitimer une nouvelle politique définie bien avant ces évènements ? C'est ce qu'on appelle habituellement "la thèse du complot", largement répercutée par la fiction américaine. Nombreux sont les films et les romans où l'on voit de sombres personnages, de préférence de la CIA ou du FBI, ourdir les machinations les plus rocambolesques pour atteindre des objectifs tortueux, un peu comme un coup d'échec, en apparence sans aucune utilité, mais qui prépare une attaque fatale une dizaine de coups plus tard.
Il y a beaucoup de points d'ombre dans la version officielle du 11 Septembre. Il y a ceux qui relèvent de la science (l'effondrement total des deux tours jumelles et d'une autre tour, la tour 47, pour des raisons assez inexplicables) et ceux relatifs à l'enquête elle-même. Il y a aussi l'imbrication prouvée
des services de renseignements israéliens dans l'environnement humain des jihadistes d'Al Qaïda chargés d'accomplir les attentats. L'important, aujourd'hui, n'est pas de statuer définitivement
sur la véracité de la version officielle et des versions "alternatives", mais de ne pas verrouiller ce champ d'investigation...
Et c'est justement de cela dont il s'agit, et en France, pays de Descartes et de Voltaire ! Aymeric Chauprade est un expert en géopolitique connu et reconnu. Il a enseigné les dix dernières années dans la prestigieuse Ecole de Guerre, dépendant du Ministère de la Défense français. Il a publié en janvier 2009 un livre "Chronique du choc des civilisations" qui lui a valu, presqu'immédiatement d'être congédié par le ministre de la Défense lui-même. Son "crime" ? C'est celui d'avoir consacré son premier chapitre à l'exposition des principales réserves sur la version officielle du 11 Septembre (Voir les bonnes feuilles du livre en page 14).
Le Professeur Chauprade n'est pas un auteur farfelu qui cherche la notoriété à n'importe quel prix. C'est un expert en géopolitique et un homme de science. Il se définit lui-même comme un conservateur classique (voir l'entretien qu'il nous a accordé en page 13). Chauprade n'adhère pas à la thèse du complot, mais il trouve que les arguments présentés contre la version officielle ne manquent pas de pertinence.
Il est évident que ce qui a aggravé le "cas Chauprade" auprès de certains grands médias français est l'implication, qui reste à déterminer, des services de renseignements israéliens dans l'entourage humain des kamikazes du 11 Septembre.
La célérité de la réaction du ministre de la Défense français est vraiment curieuse. Est-il interdit de douter dans le pays de Descartes ? Les idées émises dans le livre de Chauprade sont-elle délictueuses ? A le lire, on n'y voit ni racisme, ni diffamation, ni antisémitisme. Comment comprendre la réaction massive des grands médias pour défendre le magazine français qui a repris les caricatures danoises considérées blasphématoires par de nombreux Musulmans et le lynchage à échelle réduite d'Aymeric Chauprade ?
Y a-t-il des vérités sacrées et d'autres pas ? Le livre de Chauprade est prémonitoire, non pas à cause de ses doutes sur la version officielle du 11 Septembre, mais du titre même "Chronique du choc des civilisations" qui rappelle le célèbre livre de Samuel Huntington "Le choc des civilisations". Les intellectuels libres peuvent de moins en moins penser contre leur communauté ou leur civilisation. Un intellectuel occidental qui attaque l'Islam, même s'il frise le racisme et même si son argumentation est basée sur de fausses informations, trouve immédiatement des réseaux de solidarité et tous les grands médias revendiqueront sa liberté de penser.
Mais s'il s'attaque à certaines "vérités officielles" qui fondent la conscience occidentale, la machine médiatico-politique le broiera. Encore faut-il rappeler que la situation de l'intellectuel libre en terre d'Islam est loin d'être reluisante. Lui ne risquera pas l'omerta des médias et l'infamie publique seulement, mais aussi son intégrité physique et parfois sa vie.
Qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, le "Choc des civilisations" est en ordre de bataille. Ses premières victimes sont la liberté de penser et les intellectuels indépendants.
Zyed KRICHEN
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, censure, totalitarisme, liberté d'expression, europe, affaires européennes, maghreb, afrique du nord, liberté de penser, choc des civilisations |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook