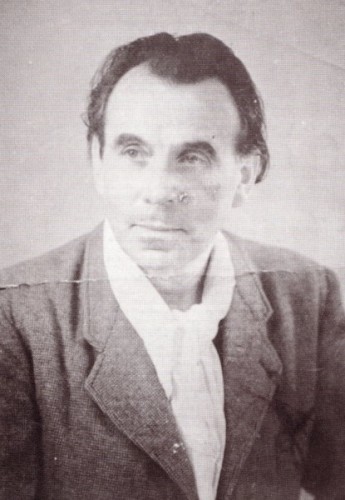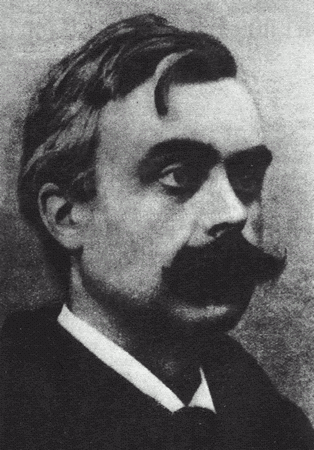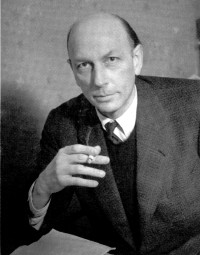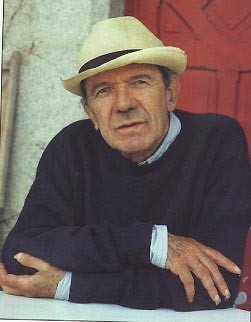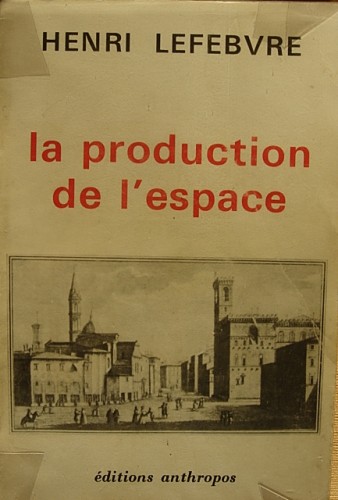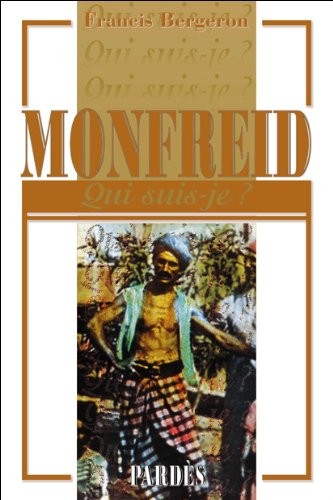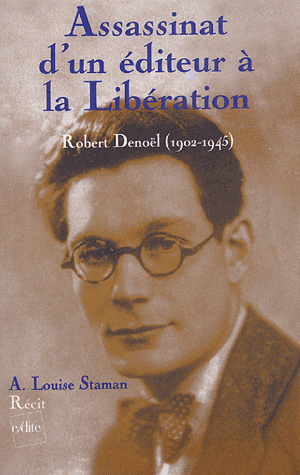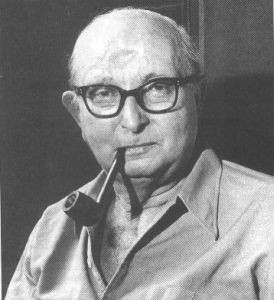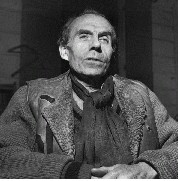Archives de "SYNERGIES EUROPEENNES" - 1999
Les pistes manquées de la «nouvelle droite»
Pour une critique constructive
Robert STEUCKERS
En avril/mai 1987, Guillaume Faye claquait la porte du GRECE, principale officine du mouvement politico-intellectuel français que les journalistes avaient appelé la «nouvelle droite», histoire de lui donner un nom médiatisable. Faye y était resté pendant près de quinze ans, il avait porté le mouvement à bout de bras à ses heures de gloire. Il en ressortait dégoûté. Dans un texte récapitulatif qu'il a rédigé et qui est paru fin 1998 dans un livre intitulé L’archéofuturisme (éd. L’Æncre, Paris), il exprime clairement son désappointement ; il avait dégagé, dans un mémorandum dont il ne souhaite pas la publication mais qu’il nous avait soumis, les écrasantes responsabilités d'Alain de Benoist dans l'échec de ce mouvement de pensée, fort prometteur au départ, parce qu'il voulait réactiver ce que les idéologies dominantes avaient refoulé et ce que les multiples réductionnismes à l’œuvre dans la société excluaient ou refusaient de prendre en compte. Dans L’archéofuturisme, Faye, avec un langage plus feutré que dans son mémorandum, énonce les tares du mouvement, nous indique quelles ont été les impasses dans lesquelles celui-ci s'est fourvoyé et enlisé (paganisme folklorique, gauchisme révisé, fétichisme pour des mots creux, etc.) . Ensuite, il nous esquisse onze pistes pour relancer une dynamique, qui ne devra pas nécessairement s'appeler la “nouvelle droite”, le concept ayant fait faillite, désormais grevé de trop d'ambigüités.
Les options philosophiques de Faye mettent l'accent sur le futurisme, sur la prospective davantage que sur l'archéologie ou la mémoire, même s'il dit clairement que toute prospective futuriste doit avoir des assises historiques, des référentiels archétypaux. Néanmoins, la lecture de ses textes, l'audition de ses discours montrent que la fulgurante personnalité de Faye n'a nulle envie d'être trop embarrasée, trop incapacitée par le poids d'un héritage, quel qu'il soit. Puisqu'il nous enjoint de pratiquer et de propager un “archéo-futurisme”, sorte de mixte d'hellénité idéale et de fulgurances à la Marinetti —que Faye situe volontiers dans un environnement urbain et architectural mêlant Vitruve et Mies van der Rohe— dressons à notre tour un bilan et esquissons un projet, pour ce volume qui a pour objectif premier d'inaugurer l'ère de la “post-nouvelle-droite”. Notre approche sera peut-être moins “futuriste” que celle de Faye, elle privilégiera les continuités historiques, sans pour autant sombrer dans les archaïsmes qui condamnent à l'inaction et “muséifient” les discours.
Une terminologie ambiguë
Mais avant de passer au vif du sujet, rappelons que le terme de « nouvelle droite » est trop ambigu : le « new right » des pays anglo-saxons s’assimile à un curieux mixte de vieux conservatisme, de néo-puritanisme religieux et de néo-libéralisme offensif (lors de la montée de Reagan au pouvoir) ; la « Neue Rechte » allemande a un passé résolument national-révolutionnaire ; la nouvelle droite française est essentiellement portée par une association de combat métapolitique, le GRECE (Groupement de Recherches et d’Etudes sur la Civilisation Européenne). Nos critiques ne s’adressent pas à la « new right » anglo-saxonne, dont nous ne partageons pas les postulats et qui se déploie dans des aires politiques qui ne sont pas les nôtres, ni, a fortiori, à la « Neue Rechte » allemande dont nous nous sentons très proche, mais au GRECE (dont nous ne nions pas les acquis positifs) et à son « gourou », qui a toujours refusé toute direction collégiale, développé un culte puéril de sa personnalité, et s’est entouré d’hurluberlus dévots et sans culture, dont le cortège aurait inspiré Jérôme Bosch et fait la fortune du Dr. Freud. De club politico-culturel offensif et rupturaliste, le GRECE s’est transformé en une secte étriquée de copains plus ou moins farfelus, animée par un « Chancelier », sorte de gagman sexagénaire, grande gueule toujours occupée à monter des sketches au goût douteux, qui n’ont rien d’élitiste ni de philosophique ni de métapolitique. Triste épilogue…
Pourtant l’affaire GRECE n’avait pas commencé dans le gag (sauf si l’on se réfère à Roland Gaucher) (1). Le GRECE a constitué une réaction salubre contre la mainmise gauchiste-vulgaire sur les esprits dans les années 70. Cette réaction, cette volonté a permis de sortir du refoulement toute une panoplie de thématiques historiques ou organiques, d’introduire dans le débat les thématiques biologisantes ou les découvertes d’une psychologie différencialiste abordées aux Etats-Unis ou en Angleterre (Ardrey, Koestler, Eysenck, etc.). L’exploitation de l’œuvre de Konrad Lorenz et d’Irenäus Eibl-Eibesfeldt explique le franc succès du GRECE, explique aussi pourquoi nous avons été immanquablement attirés vers lui. Les numéros d’Eléments ou de Nouvelle école de 1975 à 1986 restent des sources de références incontournables. Malgré d’inévitables lacunes, dues à la faiblesse des moyens et des effectifs, le corpus prenait forme, lançait des débats, fécondait des esprits. Quelques adversaires de la ND ont reconnu l’importance de ses apports (Raymond Aron, par exemple).
Dans les années fortes de la ND, des dizaines de cadres ont été formés dans la discrétion, qui ont ensuite été injectés à divers niveaux de la vie politique ou culturelle de la France. A l’abri des regards, ces hommes et ces femmes continuent à faire du bon travail, dans des réseaux associatifs, dans des modules de recherches, chez des éditeurs... Mais ils ont abandonné la secte, ne la fréquentent plus, n’influencent malheureusement plus les jeunes qui y cherchent une voie et n’utilisent plus ce langage codé, repérable, stéréotypé, qui révèle une vulgate plutôt qu’une méthode.
La ND : un bon démarrage
Autre apport non négligeable de la ND : avoir contribué à « déculpabiliser » la culture dite de droite, diabolisée depuis 1945. C’est sans doute le principal motif de la haine que voue la gauche établie à la ND et à l’entreprise d’Alain de Benoist. Cette haine s’est déployée avec une férocité pathologique à partir de l’été 1979, quand la ND influençait fortement un hebdomadaire à très gros tirage, le Figaro-Magazine, dirigé par Louis Pauwels. Alain de Benoist y tenait la rubrique des « idées », poste d’avant-garde très efficace pour faire changer les mentalités, indiquer de nouvelles pistes à la culture française. L’idée d’une « école de pensée », formant des cadres en toute autonomie, la volonté de détruire les refoulements de la culture dominante et de proposer du neuf, sans jamais recourir à de vieilles lunes, ont contribué à forger le « mythe ND ». Très rapidement pourtant, l’offensive s’est soldé par un échec : l’idéologie dominante, les vigilants de la république, la gauche parisienne, les dévots d’un catholicisme progressiste ou intégriste se sont ligués contre la nouvelle venue et l’ont contrainte à la retraite. La ND a dû céder face au néo-libéralisme et au culte moralisant des droits de l’homme (couverture des pires dénis de droit que l’histoire ait jamais vécus). Dans les propres rangs de la ND, l’enthousiasme a fait place à l’aigreur. La lucidité a disparu au profit de la paranoïa. Au lieu d’admettre que la ND a battu en retraite, après un très beau combat, parce que les effectifs étaient trop réduits et encore insuffisamment formés, le microcosme néo-droitiste parisien a sombré dans les pleurs et les grincements de dents. Quinze ans après le ressac, malgré l’ouverture opportune de nouvelles pistes (écologie, communautarisme, etc.), aucune réflexion philosophique réelle et profonde n’est venue renforcer les options de départ. Vœux pieux et lamentations anti-technicistes ou anti-libérales ne peuvent tenir lieu de discours critique : nous aurions voulu une étude plus approfondie de Carl Schmitt, de Gramsci, de Hans Jonas, de Sombart, de De Man, etc. Et un plongeon dans le vaste océan de la postmodernité philosophique (Lyotard, Foucault, Deleuze, Guattari, etc.), ce qui aurait été tout naturel pour un mouvement d’origine française.
En juin 1989, lors d’une séance de formation au « Cercle Héraclite », ouvert aux cadres du mouvement, j’avais voulu marquer mon retour au GRECE, après un éclipse de près de six ans, en attirant l’attention des cadres (ou ce qu’il en restait…) sur l’ampleur et la pertinence de la critique contemporaine des philosophes français : je n’ai rencontré qu’indifférence, incompréhension et hostilité (pour lire le texte de cette intervention, cf. « La genèse de la postmodernité », in : Vouloir, n°54/55, 1989). « Je n’ai rien compris », m’a dit un cadre après mon exposé.
De même, les options biologisantes du GRECE avaient besoin —Alain de Benoist ne me contredira pas, même s’il est retourné récemment à sa manie comptable de calculer les quotients intellectuels— d’un solide ravalement. Il me paraissait nécessaire d’ouvrir les recherches de la ND aux théories de la cognition humaine, proposée par les disciples de Konrad Lorenz, encadrés par Riedl et Wuketits, de renouer avec la théorie des systèmes de Ludwig von Bertalanffy et avec son actualisation par le Japonais Maruyama, d’introduire dans les débats français les travaux de l’Allemand Friedrich Vester (cf : mon exposé au séminaire de mai 89 de l’équipe de Vouloir, tenu en Flandre, et visité par une équipe de cadres du GRECE dirigée par Charles Champetier : « Biologie et sociologie de l’“auto-organisation” », in Vouloir, n°56/58, 1989). « Je n’ai rien compris » fut une nouvelle fois la réaction d’un cadre (non, non, ce n’était pas Champetier : il était parti dans les campagnes flamandes à la recherche d’un magasin vendant des cigarettes. Ce toxicomane était en manque… faut comprendre… ).
En février 1991, à Pérouse en Ombrie, lors de mon exposé au colloque des ND française (A. de Benoist), italienne (M. Tarchi & A. Campi) et britannique (M. Walker), j’ai insisté sur une prise en compte de la méthode de Derrida pour éviter de développer une conception figée de l’identité, propre à certains partis nationalistes ou populistes, dont de Benoist lui-même soulignait les insuffisances. J’ai voulu étayer cette critique de de Benoist, en plaçant le débat à un niveau politologique et philosophique, en refusant de le laisser à celui des invectives stériles (cf. « Dévolution, Grand espace et régulation », in : Vouloir, n°73/75, 1991) (2). Cette critique de l’ « identitarisme figé » impliquait une réflexion sur les notions de différAnce et de différEnce chez Derrida. Pour tout commentaire, de Benoist, après mon exposé, m’a demandé pourquoi j’avais parlé de ce « con » de Derrida. Il semblait me prendre pour un fou.
Un refus d’abandonner ses insuffisances…
Ces trois incidents, un peu burlesques, montrent qu’il n’y avait pas, au sein de la ND, une volonté claire de se démarquer de certaines insuffisances ou de certains passéismes ni de consolider ses bonnes intuitions de départ. La ND ne voulait pas d’ouverture à la pensée française contemporaine, alors que tout le débat allemand et américain est profondément empreint des apports de Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida, etc. La ND ne voulait pas répondre sérieusement au reproche inlassablement ressassé de « biologisme » que lui adressaient ses adversaires. Elle aurait dû revendiquer son organicisme biologisant mais en l’étayant d’arguments scientifiques incontestables, au lieu d’être pétrifiée de frousse dès qu’un adversaire lui reprochait de faire de la « biopolitique ». La ND en est arrivée à démoniser elle-même tout discours biologisant-organicisant, avec des arguments boîteux, tirés de doctrines éthiques irréalistes ou d’une lecture un peu courte des critiques traditionalistes formulées à l’encontre du vitalisme. Enfin, les remarques méprisantes d’un Alain de Benoist sur la pensée de « Derridada » sont assez sidérantes, quand on sait que la ND est accusée, encore aujourd’hui, d’avoir fondé un « discours identitaire », repris par l’extrême-droite, accusée à son tour, de développer une vision étriquée et figée de l’identité. Malgré ses discours passionnels contre Le Pen (« le programme du FN me soulève le cœur », répondait-il aux journalistes d’une revue bourrée de fautes d’orthographes monstrueuses), de Benoist ne développe pas une théorie valable de l’identité, qui échappe tout à la fois au fixisme des vieilles droites et aux reproches des professionnels de l’anti-fascisme.
En ce début de l’année 1999, la ND vient de publier son premier manifeste (ouf, enfin, ça y est…). Si les pistes suggérées ou les constats qui y sont formulés rencontrent grosso modo mon approbation, j’estime toutefois que ce manifeste reste au niveau des vœux pieux ou de la protestation moralisante. Il lui manque précisément de bonnes références philosophiques.
Mon auto-critique
Enfin, mes critiques peuvent sembler oiseuses après tant d’années dans le sillage de la ND. En effet, le reproche pourrait aisément fuser : « Qu’as-tu f… là pendant si longtemps ? ». Pour ma défense, je dirais qu’il n’y avait rien d’autre en francophonie, et que mon intérêt pour le GRECE était parallèle à un intérêt pour les initiatives allemandes et italiennes de même nature. Je suis effectivement abonné à Criticón et à Junges Forum depuis 1978, bien avant mon passage au GRECE. Je lisais Linea de Pino Rauti et j’achetais en versions italiennes les livres d’Evola qui n’étaient pas traduits en français. Très tôt, j’ai pu comparer avantages et lacunes des uns et des autres. Ensuite, dès 1976, j’ai suivi de très près les initiatives de Georges Gondinet, à l’époque nullement assimilables à celles du GRECE. J’ai toujours, me semble-t-il, opté pour la pluralité des sources d’information contre le réductionnisme et l’assèchement sectaires. C’est une option qui me parait toujours valable : je demande donc à tout ceux qui s’intéressent à la ND parce qu’ils veulent sortir du ronron dominant de ne pas réduire leurs sources d’information à une et une seule officine, mais de chercher systématiquement la diversité. C’est par une pratique diversifiante et différAnciante (Derrida !) que les « refuzniks » que nous sommes finiront par appréhender et arraisonner le réel dans toutes ses facettes. Et ainsi gagner la bataille métapolitique, promise par de Benoist, avant qu’il n’opère ses replis frileux : peur de la politique, peur des populismes, peur des journalistes qui le critiquent, peur des langages francs et crus, peur de réaffirmer son biologisme, peur d’être traité de fasciste, peur de ne pas être reçu par une huile quelconque. Pas besoin d’être grand philosophe pour condamner et mépriser une telle attitude. Il suffit de se rappeler l’adage : la peur est mauvaise conseillère.
La «nouvelle droite» et l'histoire
Les regards que la «nouvelle droite» française a jetés sur l'histoire de l'Europe ont toujours été flous et ambigus. Quant à la «nouvelle droite» italienne, elle s'est fort préoccupée de redéfinir l'histoire du fascisme (alors que cette tâche était pleinement assumée par Renzo de Felice ou Zeev Sternhell). Redéfinir le fascisme était la tâche de son principal promoteur à l'université, était son boulot de chercheur, et nul parmi nous ne contestara évidemment cette fonction qui fut et reste la sienne.
A Paris, la vulgate ND —en disant « vulgate », je n’incrimine ni de Benoist ni d’autres exposants de la ND, mais une mouvance difficilement définissable que l’on a, à tort, assimilée à la ND et qui compénètre tout le champs des droites françaises— n’a pas développé une vision de l’histoire cohérente : tout au plus perçoit-on chez elle un vague mixte de vision décadentiste et de nordicisme (indo-européen), où les accents pessimistes de Gobineau (mal lu) et de Spengler (mal digéré) se mêlent aux accents « normandistes » et pessimistes du dernier Drieu. Chacun de ces auteurs est passionnant en soi. Chacun d’eux nous livre une œuvre aux strates multiples :
- Gobineau, notamment, outre son nordicisme (qui lui est vivement reproché) réhabilite le rôle de la Perse dans le rayonnement des peuples indo-européens et critique l’intellectualisme hellénistique (source de déclin) ; la Perse nous lègue notamment une éthique guerrière et chevaleresque, dont héritera, après bien des détours et à travers un filtre chrétien, les chevaliers médiévaux ; toute une historiographie et maints ragots colportés font de Gobineau l’inventeur d’un racisme hargneux devant à terme déboucher sur « l’impensable » ; en réalité Gobineau fut un grand voyageur ouvert à l’Islam iranien et à l’Orient, méprisant les « petits crevés » (comme il appelait les nullités des beaux quartiers de Paris) et ne prenant pas l’Europe pour « l’ombilic de l’univers l’univers » (cf. Jean Boissel, Gobineau (1816-1882). Un Don Quichotte tragique, Hachette, 1981 ; cf. également Alexis de Tocqueville, Œuvres Complètes, Tome IX, Correspondance d’A . de Tocqueville et d’A. de Gobineau, Gallimard, 1959). Gobineau est celui qui a ouvert la pensée française aux mystiques panthéistes de la Perse, qui a, bien avant Derrida, réclamé une ouverture de notre pensée à cet univers intellectuel.
- Spengler, avec sa notion de pseudo-morphose des civilisations, avec son mythe touranien, sa classification des cultures (faustienne, magique, etc.) ;
- Drieu, avec expérience de combattant de 1914, son passage à Dada (et sa participation à titre de témoin à décharge au « procès Barrès »), sa carrière d’écrivain parisien, ses tentations politiques (Doriot, etc.), ses réflexions sur les traditions, notamment sur Guénon, découvertes tardivement lors de la parution de son Journal.
Ces trois auteurs peuvent être interprétés de manières très diverses. Ils échappent ou devraient échapper à toute vulgate et à tout réductionnisme interprétatif.
Une pitoyable vulgate
Par ailleurs, une bonne part des militants de la mouvance de la “nouvelle droite” parisienne se percevaient comme les héritiers de ce complexe idéologique plus mystique que politique, plus idéaliste que concret, un complexe que l'on cultivait en ghetto à l'exclusion de tout autre et qui mêlait le “fascisme français” et les “écrivains maudits de la collaboration”. Ils mêlaient simultanément ce corpus complexe au filon nordiciste, issu d’une lecture très partielle de Gobineau voire de Vacher de Lapouge (3), où l'histoire était perçue comme l'amenuisement continu de l'influence physique et métaphysique des peuples germaniques en Europe, dont la France, leur pays, n'était que très partiellement l'héritière, une héritière, qui plus est, qui avait explicitement rejeté cet héritage depuis l'Abbé Siéyès.
Grosso modo, disons que, avant l'aggiornamento des années 90, dans les premières décennies de l'histoire de la ND, consciemment ou inconsciemment, l'accent était mis sur le filon Gobineau-Drieu la Rochelle, reprise des pamphlets anti-fascistes et anti-racistes, mais cette option, chez les camarades pseudo-nationalistes et néodroitistes, était revendiquée avec chromos brekeriens en prime; ce filon était détaché de tous contextes politiques réels puis simplifié en une vulgate assez étriquée, suscitant la commisération de tous ceux qui vivent quotidiennement les assauts du monde réel, sous quelque forme que ce soit. Dans les corridors et les coulisses de la ND parisienne, on avait l'impression d'errer dans une utopie irréelle, sous une bulle de verre où étaient voués aux gémonies tous les faits de vie réelle qui contrariaient l'image idéale du monde, des hommes et des Français, rêvée par ces petits étudiants ratés ou ces médiocres employés de banque subalternes, au profil psychologique instable et, qui, à cause de ce handicap, parce qu'ils ressentaient ces lacunes et ces tares en eux-mêmes, s'étaient recyclés, pour se donner une importance toute fictive, dans une “lutte métapolitique planétaire”.
Appuyés par tout un commerce de colifichets frappés du logo du GRECE, les tenants de la vulgate balbutiaient ou gribouillaient des fragments aussi oniriques que décousus de ce fatras nordico-fascisto-parisien; ces fragments, ils les faisaient dériver de ce filon pseudo-gobinien et les exprimaient en textes ou en images ou en discours avinés après le dessert, puis les ressassaient à l'infini, sans le moindre esprit critique en les mêlant à des interprétations naïves et juvéniles des mondes ouraniens-olympiens et des chevaleries idéales, décrits par Evola dans Révolte contre le monde moderne. Critiques du catholicisme populaire, volontiers blasphémateurs à l'égard des chromos, des crucifix, des vierges et des Saintes-Rita à la mode de Saint-Sulpice, les galopins du GRECE répétaient sous d'autres signes les mêmes travers que les chaisières et les bigotes des paroisses d'arrière-province.
L'anti-fasciste professionnel sans profession bien établie, l'ineffable “René Monzat”, a eu beau jeu de dénoncer cette bimbeloterie dans Le Monde, le 3 juillet 1993. Ce triste garçon, dont la jugeotte n'a certainement pas la fulgurance pour qualité principale, concluait au “nazisme fondamental” du GRECE, parce que de Benoist, qui n'est ni nazi ni rien d'autre que lui-même, rien d'autre que sa propre égoïté narcissique, s'était copieusement “sucré” en vendant des “tours de Yule” en terre cuite —modèle SS-himmlérien— à ses ouailles, en multipliant le prix de base de son grossiste allemand par dix!
Un scandinavisme irréel et onirique
Mais le nordicisme/germanisme de Gobineau s'inscrit dans une histoire plus complexe, dont la ND n'a jamais véritablement rendu compte: elle a contribué à pétrifier ce filon, surtout à le ridiculiser définitivement (Dumézil l'avait compris!), sans en avoir extrait les potentialités toujours vives, sans avoir dégagé, par exemple, l'apport géopolitique et géostratégique du monde nordico-scandinave dans l’histoire générale des peuples européens: ouverture des voies maritimes nord-atlantiques, exploitation de l'axe Baltique/Mer Noire, ouverture du commerce eurasien via le comptoir de Bulgar dans l'Oural, organisation du commerce fluvial sur le Dniepr, le Don et la Volga, ouverture de la Caspienne et accès du commerce européen à la Perse et à la Mésopotamie: autant de routes qui restent, aujourd'hui plus que jamais, d'une brûlante actualité. Non: pour la clique d'esprits bornés qui sautillaient et s'agitaient autour du gourou de Benoist (qui assurément ne partageait pas leurs simplismes), les Scandinaves du IXième au XIième siècles n'étaient ni des techniciens hors ligne de la navigation ni des commerçants audacieux qui ouvraient l'Europe au monde: ils étaient décrits comme des espèces de cannibales chevelus et moustachus qui pillaient les couvents ou, pire, comme des ruraux simplets, vivotant en dehors des tumultes du monde, confectionnant avec de la terre cuite des luminaires disgrâcieux (qui font rétrospectivement frémir Monzat et ses commanditaires du Monde) plutôt qu'étudiant la résistance des bois à la mer et au vent, la carte du ciel pour s'orienter en haute mer, l'aérodynamisme des coques de navires pour se lancer dans des expéditions hardies. Etre technicien ou commerçant, dans la vision du monde des débiles adeptes du grincheux gourou néo-droitiste, c'était déchoir dans la “troisième fonction”, c'est-à-dire la fonction du travail, de la production, jugée mineure par ces oisifs qui ne commandaient rien, qui ne produisaient rien, qui vivaient d'allocations ou de postes de fonctionnaire, mais qui croyaient, dur comme fer, qu'ils étaient potentiellement les souverains de la future “grande Europe”. Les Vikings imaginaires des milieux néo-droitistes n'étaient pas admirés pour ce qu'ils avaient été, des explorateurs, des marins et des négociants, mais parce qu'on leur prêtait des canons physiques stéréotypés: une blondeur et une vigueur qui étaient absentes, dans la plupart des cas, chez ces vikingomanes d'Auteuil-Neuilly-Passy. On sort ici de la politique, de la métapolitique, pour entrer de plein pied dans la psychopolitique voire la psychiatrie tout court.
Restaurer la « virtù » des Romains et des Germains
Revenons à l'histoire: le mythe nordiciste qui traverse l'historiographie européenne depuis les humanistes italiens du XVième siècle est surtout l'expression idéalisée de deux soucis récurrents dans la pensée politique de notre continent: la disparition de la virtù politique, de la force de façonner le politique pour le bien de la Cité, où la virtù était d'abord posée comme le propre du peuple et du Sénat de l'Urbs romana, puis par translatio imperii, comme le propre des peuples germaniques. Cette virtù est une idée républicaine au sens étymologique du terme, comme nous l'a explicité Machiavel dans son Prince. Elle s'oppose, en tant que telle, au césaro-papisme du Vatican qui, au XVième siècle, montre ses limites et s'enlise dans une impasse; elle s'oppose aussi aux tentatives de centraliser les Etats monarchiques au détriment des corps concrets qui composent la Cité. Dans ce sens, l'amenuisement de l'influence des peuples germaniques n'est rien d'autre que l'amenuisement de la virtù dans les corps politiques d'Europe et non pas la déperdition d'un quelconque système coercitif. L'assomption de la virtù équivaut à la perte d'autonomie des corps concrets de la Cité, à la dévitalisation des sociétés civiles. La vision de Gobineau n'est jamais qu'une manifestation tardive —à l'ère romantique qui est à l'évidence traversée par un spleen qui, risque, chez les esprits faibles, de s’avérer incapacitant— de ce souci récurrent de la virtù dans l'histoire des idées politiques en Europe; Gobineau n'a pas infléchi sa démarche dans un sens juridique et concret, alors même que le XIXième siècle s'interrogeait sur les sources du droit (Savigny, Ihering, de Laveleye, Wauters, etc.); il a, malgré lui et pour le malheur de sa propre postérité, jeté les bases d'un discours tissé de lamentations sur l'amenuisement du germanisme.
Dans la même veine pessimiste, Hippolyte Taine a été un penseur beaucoup plus concret et méthodique: la ND ne l'a jamais abordé. De même, rien n'a jamais été fait sur la problématique des races en France, qui a agité tout le débat du XIXième siècle, en opposant celtisants (Augustin et Amédée Thierry, H. Martin, Guérard, le “génie celtique de J. de Boisjoslin), germanisants (le mythe “franc” chez Chateaubriand, Guizot, Mignet, Gérard, Montalembert, de Leusse) et romanisants (Littré). Ce débat ne portait pas seulement sur la définition de la “race” et n'était nullement une anticipation des réductions caricaturales du national-socialisme, mais portait sur le droit, sur la manière de façonner la Cité, de répartir les tâches entre les classes. Taine parlait d'un “réalisme à connotation populaire et raciale”. Pour la ND, l'onirique a primé sur le réalisme que Taine appelait de ses vœux. Pourquoi ce refus ?
Drieu la Rochelle, écrivain dans le Paris décadent d'après 1918, après son comportement héroïque pendant la Grande Guerre et sa fréquentation des dadaïstes et des surréalistes, perçoit les enjeux du monde avec une remarquable lucidité, mais celle-ci est estompée par son pessimisme, par un décadentisme finalement assez pitoyable et par un spleen que révèlent pleinement les pages de son Journal (par ailleurs mine inépuisable de renseignements de toutes sortes). Après la défaite de l'Axe en 1945 et le suicide de Drieu, ce pessimisme et ce spleen sont d'autant plus incapacitants pour qui veut construire une véritable alternative philosophique, idéologique et politique. Plutôt qu’au Drieu triste, il faut retourner au Drieu visionnaire !
Echec de l’Axe, faillite de la « métaphysique occidentale »
Car 1945 n'est pas simplement l'échec de l'Axe: il est l'échec de toute la métaphysique et de la civilisation occidentales. Les Alliés ont gagné cette guerre sur le terrain, incontestablement, mais ils n'ont rien proposé d'autre que du “réchauffé”, comme le prouve, presque a contrario, le succès indéniable de la philosophie “déconstructiviste”, née en Amérique et chez Derrida dans le sillage de Heidegger. Ce dernier a perçu en germe de réelles potentialités dans la “révolution allemande” (en 1934 pendant la parenthèse de son “rectorat”), mais aussi de terribles impasses dans son volontarisme outrancier, où la volonté poussée à son paroxysme rompait les liens de l'homme avec les continuités qui le nourrissent spirituellement et politiquement et son constitutives de son identité profonde. Mais, en constatant les impasses du national-socialisme, Heidegger n'a pas davantage opté pour les visions américaniste et bolchéviste de la société et du monde. Face à cet éventail de faits et de pensées, face à ce triple rejet de la part de Heidegger, la ND aurait pu et dû:
- abandonner les pessimismes incapacitants;
- renouer au-delà de Gobineau avec le républicanisme de Machiavel, avec la notion de virtù, présente dans la Rome antique et, par translatio imperii, chez les peuples germaniques (comme l'avait bien vu la lignée des observateurs de Tacite aux humanistes italiens et de ceux-ci à Montesquieu, ce dernier étant une référence incontournable pour toute pensée démocratique sérieuse, c'est-à-dire pour toute pensée démocratique qui refuse d'accorder le label “démocratique” à tout ce qui se présente comme tel aujourd'hui en Europe occidentale).
- être attentive plus tôt, dès le départ, à la démarche de Heidegger; au lieu de lui avoir consacré une attention méritée dès le début de son itinéraire, la ND, vers la fin des années 60 et au début des années 70, mue par une sorte de paresse philosophique, a préféré parier pour une vulgate anti-philosophique tirée de la philosophie anglo-saxonne (une caricature malhabile de l'“empirisme logique”) pour qui les questions métaphysiques ou axiologiques, le langage métaphysique et l'énoncé de valeurs, sont vides de sens.
- dans la foulée d'une réception de Heidegger, la ND aurait pu embrayer sur le filon “déconstructiviste”, poursuivre une critique serrée de la “métaphysique occidentale” et ne pas laisser l'arme du déconstructivisme à ses adversaires! Cet abandon de l'arme du “déconstructivisme” condamne la ND à du sur-place, puis, inéluctablement, au déclin et au pourrissement. Sans une bonne utilisation de l’arme « déconstructiviste », la ND ne peut développer une critique crédible des institutions en place ou des fausses alternatives (gauchistes). Elle risque alors de passer pour un simple appendice intellectuel, un salon où l’on cause, un havre pour oisifs argentés, juste en marge du pouvoir.
Déconstructivisme et France rabelaisienne
Ensuite, la ND aurait pu faire advenir une pratique de la déconstruction permanente dans le champ de l'histoire. Je m'explique: surplombé par une métaphysique particulière (platonico-chrétienne), l'Occident a agi sur le terrain de l'histoire d'une certaine façon, c'est-à-dire d'une façon que déplorent les contestataires radicaux de cette métaphysique, de cet Occident et de cette histoire. La métaphysique occidentale, sur le terrain, a fait des dégâts, comme le constatait Heidegger. Ont été effacés de l'espace occidental, au nom d'une métaphysique particulière: les ressorts des communautés naturelles d'Europe, un processus qui est à l'œuvre, inexorablement, depuis la centralisation du Bas-Empire romain décadent jusqu'à une christianisation manu militari, en passant par la mise au pas des âmes par l'Inquisition, par la philosophie politique de Bodin qui ne laisse pas de place aux corps intermédaires de la société (c'est-à-dire aux corps concrets de la souveraineté populaire), par les déismes et les rationalismes hostiles à toutes originalités et tous mystères, par l'éradication des fêtes populaires, des fêtes de jeunesse, de l'espace de liberté des goliards et des vagantes, de l'univers dionysiaque-rabelaisien. Jamais la ND ne s'est branchée sur ces filons pluri-millénaires, jamais elle n'a utilisé ses atouts et ses entrées dans le monde journalistique français pour promouvoir les écrits de ceux qui faisaient le constat de cette éradication pluriséculaire, en dehors de tout encadrement politicien, idéologique ou “clubiste”. Si elle l'avait fait, jamais personne n'aurait pu lui reprocher de camoufler derrière un discours modernisé, une volonté de “réchauffer” la vieille soupe nationale-socialiste.
Parallèlement à cette négligence du filon rabelaisien, la ND n'a pas davantage revalorisé les luttes paysannes et populaires contre les Etats, expressions politiques de cette métaphysique occidentale. Elle a refusé cette démarche, malgré les appels incessants d'un Thierry Mudry notamment, parce qu'elle était prisonnière d'un seul mot: l'inégalitarisme. Alain de Benoist, soucieux de sa vocation pontificale au sein du microcosme néo-droitier, a développé pendant sa carrière dans la grande presse (Valeurs actuelles, Le Spectacle du Monde, Le Figaro-Magazine, partiellement, Magazine-Hebdo) tout un discours, somme toute assez boîteux, sur l'“inégalité”, avec des calculs de QI, des dérivées et des asymptotes comparant l'intelligence des Pygmées et des Suédois, des Mongols d'Oulan Bator et des Equatoriens de Quito, laissant entrevoir, peut-être même à son insu, un modèle pyramidal où il aurait trôné très haut, au sommet de la pyramide, avec le monde entier à ses pieds d’auguste membre de la MENSA (le club français qui recrute des gens dont le QI est supérieur à la moyenne, mais dont on ne jauge pas l'état psychologique avant de les admettre au bar select de l'association). Telle est sans doute la vision onirique qui traverse les rêves du Pape de la “nouvelle droite”. Tout cela est bien divertissant, mais où est l’intérêt (méta)politique d’une telle posture ?
Ignorance des révoltes populaires
L'option “inégalitaire” de la ND, illustrée avec une opiniâtreté quasi monomaniaque, interdisait de se pencher sur les luttes populaires, sous prétexte que Marx, Engels, Bloch, etc. s'étaient intéressés à la “Guerre des Paysans” du début du XVIième siècle et qu'un mouvement qui choisissait le label de “droite” ne pouvait évidemment frayer avec des “marxistes” (!!!!!!???), retentissante sottise qui a laissé ce terrain fécond des luttes et des révoltes populaires à des socialistes ou à des communistes qui, par ailleurs, étaient, eux aussi, prisonniers de la “métaphysique occidentale”, à cause de leur matérialisme figé (mécaniciste et physicaliste) et de leur rationalisme étriqué (acceptant les acquis de ce rationalisme more geometrico qui a commencé à mutiler les corps concrets de la souveraineté populaire dès la Renaissance). De même, les dimensions populaires des révoltes françaises du XVIIième siècle, des révoltes populaires et paysannes contre la monarchie et contre la république à la fin du XVIIIième, les petites jacqueries du XIXième (étudiées par l'historien Hervé Luxardo) (4), n'ont malheureusement pas eu de place dans les réflexions de la ND.
L'option anti-chrétienne, le rejet des structures dérivées de la “métaphysique occidentale” ne devrait pas déboucher sur le refus de s'identifier aux luttes des peuples réels contre les pays légaux, des concrétudes charnelles contre les abstractions juridiques et rationalistes, refus qui condamne la ND à n'être qu'un salon de précieux bavards aux ambitions limitées, sans connexions utiles avec le monde extérieur. Les professions de foi “organicistes” ne sont que purs discours si elles ne suggèrent pas une politique organique concrète. Les “intellectuels organiques” sont toujours à la tête du peuple réel ou, au moins, commandent un fragment du peuple réel, fût-il dispersé au travers de réseaux divers (professions, syndicats, partis, clubs, etc.). A terme, un club de pensée à vocation métapolitique et/ou politique doit rallier sous une seule bannière nouvelle des citoyens dispersés dans de multiples structures en voie d'obsolescence, car l’obsolescence est la loi de l'histoire pour les structures, quelles qu'elles soient. La ND ne peut plus parfaire un tel travail de rassemblement car les vieux droitismes figés qu'elle ne cesse de véhiculer (anti-égalitarisme rédhibitoire débouchant sur un anti-populisme incapacitant), malgré ses dénégations, l'empêchent paradoxalement de se brancher sur les quelques gauches organiques à vocation contextualiste (qui proclament et démontrent que le cadre, le contexte social, économique et politique doivent être respectés en tant que tels dans la théorie et dans la pratique, contrairement aux universalismes traditionnels des gauches; en France, une telle gauche est représentée par le MAUSS, c'est-à-dire le «Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales», que de Benoist courtise en vain, à coup des viles flatteries, depuis tant d'années).
Un piètre personnel subalterne
Enfin, il y a une autre démarche de la ND qui est condamnée à l'impasse: par son parisianisme, par son repli frileux autour de son gourou, elle s'est révélée incapable de disperser les centres dynamiques du mouvement sur tout le territoire français; ensuite, elle a été handicapée par sa frilosité à sortir des frontières de l'Hexagone et, à cause de la piètre qualité intellectuelle de son personnel subalterne à penser véritablement l'Europe, à apprendre les dynamiques politiques, culturelles et sociales à l'œuvre en Italie, en Allemagne, en Espagne, dans le Bénélux, en Scandinavie, etc., et à agir efficacement dans un contexte européen (ce qui implique de maîtriser plusieurs langues, d'accepter que l'Autre parle la sienne et non pas le français exclusivement, d'écouter poliment un exposé en allemand, en italien ou en anglais sans éprouver le besoin pressant de sortir pour fumer un clope dans le patio ou pour descendre une pils au comptoir, etc.). Les tentatives plus récentes de la ND parisienne de sortir des frontières de France se heurtent au même ballast structurel: recrutement d'autodidactes spécialisés en bricolages idéologiques, de vieux copains sans qualifications précises, de marginaux sans originalité et bourrés de fantasmes, de caractériels repêchés dans les poubelles des partis identitaires qui les ont exclus pour incapacité sur tous plans pratiques.
Ensuite, la ND parisienne n'a cessé d'être obnubilée par les “débats” parisiens dont tout le monde se fout à 30 km de la capitale française, ce qui lui a interdit de susciter un nouveau mouvement de contestation global, organique, dans tout l'Hexagone. Certes, Alain de Benoist —rendons-lui justice— a eu la volonté de se brancher sur les débats philosophiques américains, allemands, italiens, mais il n'a pas enseigné à ses ouailles la façon de maîtriser les sources non françaises d'information et de documentation qui auraient permis de renforcer dans le discours quotidien de la ND ce “poumon extérieur”, apportant en permanence des bouffées d'arguments neufs et de les déployer avant ses adversaires. De plus, comme d'habitude, de Benoist a eu l'art de recruter des étudiants ratés, des jojos hauts en couleurs ou tristes comme des ados coincés, incapables de lui porter ombrage (pour lui, c'était l'essentiel...) mais tout aussi incapables de maîtriser ne fût-ce qu'un basic English. Ils se coupaient du même coup de toute une documentation utile pour la révolution culturelle à laquelle ils étaient censés participer, dans le laboratoire de pointe qu'of course le GRECE prétendait être! De Benoist a voulu s'ouvrir sur l'Allemagne, jamais il n'a péché dans le sens d'un nationalisme français fermé sur lui-même, hostile au monde entier, rejetant l'Europe en construction, peuplé de “rancuneux” (cette belle expression, que mentionne encore le Littré a été réintroduite dans le discours politique par Michel Winock). Cette attitude de bon Européen, chez de Benoist, a suscité mon respect et ma sympathie, du moins au départ. Mais tandis qu'il était européiste, sans arrière-pensée, il a laissé la bride sur le cou à des pseudo-théoriciens d'un nationalisme français irréaliste dans ses expressions héroïcisantes et naïves, que le lecteur pantois, habitué à des analyses plus fines, a trouvé dans éléments n°38 (intitulé: «Pourquoi la France?»). Ensuite, il n'a cessé de fréquenter un certain Philippe de Saint-Robert (la particule serait fictive!), apôtre d'un hexagonalisme de droite et d'un anti-européisme navrant, rêvant de reconstituer la France aux 130 départements de Napoléon (5). Ces démarches délirantes ont empêché la fusion du corpus néo-droitiste et des revendications régionales en France, fusion qui aurait permis une évolution graduelle vers une constitution fédérale de modèle allemand, espagnol ou helvétique. La ND aurait dû indiquer dans son programme l'objectif qu'elle s'assignait pour la France et pour le bien des peuples de l'Hexagone: faire advenir dans les esprits une constitution fédérale pour une VIième République française, rompant de la sorte avec l'étatisme fermé d'inspiration bodinienne que n'avaient jamais abandonné les factions nationalistes françaises de diverses moutures. Le travail de la ND aurait dû être de préparer l'avènement à terme de cette VIième République, de façon à ce que la France ait une constitution en harmonie avec les autres pays de l'Europe en voie d'unification, de façon à ce qu'il y ait homogénéité constitutionnelle dans tous les Etats de l'Union avant l'unification monétaire et avant la suppression des frontières. Aujourd'hui, nous avons presque l’une et l’autre, mais sans homogénéité constitutionnelle, ce qui est une hérésie et une aberration: la ND aurait pu prévoir cette imposture et suggérer une alternative crédible. En ne le faisant pas à temps, elle n'a pas assumé sa responsabilité historique. Elle n’a pas respecté sa promesse d’être une instance de « première fonction » (instance incarnant la souveraineté et le droit selon Dumézil). On peut se demander pourquoi…
Régionalisme et critique de l’Etat bodinien
Si elle avait forgé sur le terrain une alliance durable avec les mouvements régionaux sérieux, la ND aurait travaillé à l'élaboration concrète de cette constitution fédérale pour l'Hexagone, niant du même coup les formes étatiques de la “métaphysique occidentale” qui ont oblitéré les sociétés françaises de François Ier au jacobinisme. Pour parfaire cette alliance ND/régionalismes, le club métapolitique d'Alain de Benoist aurait dû développer une vision non-bodinienne de l'Etat, une conception symbiotique des corps intermédiaires (qui sont, ne cessons jamais de le rappeler, les véritables corps concrets de la souveraineté populaire), permettant de coupler régionalismes et revendications sociales et populaires concrètes, en nouant cette idée symbiotique aux combats syndicalistes, en se débarrassant de son discours néo-libéral (ante litteram) sur l'égalitarisme et l'inégalité, qui ont fait qu'elle a été accusée sans interruption de “social-darwinisme” (de Benoist a eu beau s'en défendre par la suite, ce stigmate lui est resté collé à la peau).
Enfin, un mouvement métapolitique comme le GRECE, qui prétend dans son sigle même, vouloir appréhender l'ensemble des dynamiques à l'œuvre dans la civilisation européenne, n'a jamais raisonné sur les grandes forces historiques et géopolitiques qui ont traversé les régions d'Europe. Comme beaucoup de visions non dynamiques de l'histoire, le GRECE semble avoir cultivé lui aussi une vision figée de l'histoire, où des figures hiératiques, fortement typées, répéteraient inlassablement le même drame, sans imprévus autres que ceux prévus par le scénariste, avec, pour toile de fond, une tragédie réitérée en boucle sous la détestable impulsion des mêmes tricksters. Le gourou du GRECE aimait à se dire “spenglérien”, mais aucun lecteur de Spengler ne se reconnaîtra dans sa “vision” (bigleuse et non plus faustienne) de l'histoire européenne.
Dans l'officine néo-droitiste parisienne, peu de choses ont finalement été dites sur les lignes de force de l'histoire suédoise, allemande, russe, balkanique, hispanique, sur les dynamiques géopolitiques effervescentes le long des grands axes fluviaux d'Europe, sur les enjeux territoriaux, comme si ces tumultes millénaires allaient tout d'un coup s'apaiser, dès que le gourou déciderait, du haut de sa magnificence, de prendre la parole. Sa germanolâtrie, qui n'est rien d'autre qu'une coquetterie parisienne, ne parvient pas à s'articuler en Allemagne, où les nouvelles droites (très diverses) sont bien en prise avec les problèmes d’histoire et d’actualité. Le gourou de la ND est balourd dans le débat allemand. Son Allemagne de fillettes à longues tresses nouées, de ruraux coiffés de petits chapeaux bavarois, de soldats altiers et perdus, n'est qu'une Allemagne de chromos: l'Allemagne réelle est une Allemagne d'ingénieurs méticuleux, de philosophes précis et rigoureux, de philologues pointilleux, d'industriels efficaces, de techniciens chevronnés, de négociants redoutables, de révolutionnaires radicaux, de moralistes jusqu'au-boutistes, de syndicalistes combatifs, de juristes tenaces. Mais de cette Allemagne-là, il n'en a pas parlé, sans doute auraient-elles effrayé ses ouailles, donné des cauchemars aux petits garçons fragiles qui l'admirent tant. Pensez-vous, ils auraient dû cesser de rêver, et commencer à travailler.
Refus de l’histoire réelle et images d’Epinal
Lors d'un face-à-face avec la presse russe, à Moscou le 31 mars 1992, où deux journalistes de la revue moscovite Nach Sovremenik me demandaient quelle était ma position dans la nouvelle crise balkanique et face à la Serbie de Milosevic, j'ai répondu en rappelant des événements importants de l'histoire européenne comme la Guerre de Crimée, le Traité de San Stefano (1878), l'aide apportée par les Russes à la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie au XIXième siècle et leur désir de voir une paix s'instaurer entre Serbes et Bulgares, etc. Pendant que je répondais à cette question, importante pour les Russes qui ont la mémoire historique longue, au contraire des Occidentaux, en m'engageant sur un terrain qui n'intéressait pas de Benoist, le bougre m'enjoignait de me taire sans mettre de bémol à sa voix, tirait sur les pans de mon veston en cachant son bras derrière le large dos d'Alexandre Douguine, sans se rendre compte qu'il était tout à la fois grossier pour les journalistes qui me mettaient sur la sellette et ridicule en pleurnichant de la sorte parce qu'il n'était plus le seul à pouvoir parler (6). Outre le narcissisme époustouflant du gourou, cet incident burlesque montre bien le refus néo-droitiste de l'histoire réelle; lourde tare, car si l'on ne prend pas le pouls de l'histoire au-delà des clivages politiciens et au-delà du clivage binaire gauche/droite, si on ne lit pas l'histoire à travers les textes des traités qui l'ont jalonnée, on agit sous la dictée de “représentations platoniciennes”, autrement dit d'“images d'Epinal”, artificielles, arbitraires, déconnectées du réel. Or les “images d'Epinal” sont toujours classées quelque part, étant par définition figées, non mouvantes parce que non vivantes. En maniant ses fantasmes esthétiques et éthiques (son obsession à vouloir édicter une “morale”...), de Benoist a énoncé un discours en marge du fonctionnement réel des Etats de notre continent, il s'est soustrait au jeu dramatique de l'histoire, par désintérêt, délibérément ou par peur de l'engagement. Grave péché contre l'esprit. Pire, une telle démarche relève de la médiocrité et, en disant cela, je songe à une réplique dans le Malatesta de Montherlant: «En prison, en prison, monsieur. Pour médiocrité!».
L'incapacité de la “nouvelle droite” à énoncer un corpus de droit cohérent
D'emblée, le propos de la “nouvelle droite” n'est pas de discourir sur le droit (l’aventure de la petite revue Hapax, torpillée par de Benoist, a malheureusement été trop éphémère, pour qu’on l’analyse ici). Pourtant, question légitime, peut-on penser le destin d'une civilisation, peut-on s'engager pour la défense et l'illustration d'une culture sans jamais penser le droit qui doit la structurer? La ND a voulu faire remonter les racines de l'Europe à la matrice indo-européenne. Volonté légitime, exprimée notamment par Emile Benvéniste dans son Vocabulaire des institutions indo-européennes. Dans cet ouvrage fondamental, véritable exploration en profondeur du vocabulaire indo-européen, Emile Benvéniste jetait les bases d'une recherche fondamentale. En effet, le vocabulaire institutionnel indo-européen révèle l'origine de toutes nos pratiques juridiques; les racines linguistiques les plus anciennes se répercutent toujours dans notre vocabulaire juridique et institutionnel, tout en véhiculant un sens précis qui ne peut guère être effacé par des manipulations arbitraires ou être enfermé dans des concepts trop étroits. Une bonne connaissance de cette trajectoire et surtout de ces étymologies est impérative.
L'idéologie dominante en France a jeté un soupçon systématique sur ce type de recherches, sous prétexte qu'il entretient des liens inavoués et occultes avec le national-socialisme. La ND a été accusée de relancer la thématique nationale-socialiste des “aryens” en se référant aux recherches indo-européanisantes. D'où un ensemble de quiproquos navrants qui ont la vie dure et qui font les choux gras de quelques petits graphomanes “anti-fascistes”, dûment stipendiés par de mystérieuses officines ou carrément par l'argent du contribuable. Pourquoi une telle situation? Le droit positif actuel, avec ses référents mécanicistes issus de la pensée matérialiste du XVIIIième siècle et d'un jusnaturalisme moderne qui se voulait détaché de tout contexte historique, ne peut tolérer, sous peine d'accepter à terme sa propre disparition, une recherche féconde et profonde sur les archétypes du droit en Europe. Un retour systématique à ces archétypes ruinerait également les assises politiques de la France (et d'autres pays), qui sont de nature coercitive en dépit du discours “démocratique” qu'ils tiennent à titre de pure propagande.
Dans le contexte français, la ND, par les maladresses de de Benoist et par sa manie des iconographies d'inspiration nationale-socialiste dont il truffait ses journaux, a permis aux vigilants de l'ordre jacobin et républicain de continuer à jeter le soupçon sur toutes les recherches indo-européanisantes. Il leur suffisait de dire: “voyez cet éditeur de chromos nazis dans des revues intellectuelles qui ne cessent de parler des Indo-Européens, il n'y a tout de même pas de fumée sans feu...”. En effet, dans le contexte des années 70, la confluence possible de certains linéaments contestataires de la “pensée 68” (chez Deleuze et Foucault) et d'un recours aux archétypes du droit, aurait pu contribuer à fonder un droit de rupture, tout à la fois futuriste et archétypal, en dépit de l'anti-juridisme fondamental de Foucault. En ultime instance, cet anti-juridisme foucaldien n'est rien d'autre qu'un anti-positivisme dans la mesure où le positivisme s'était entièrement emparé du droit surtout en France mais aussi ailleurs en Europe. Le positivisme avait édulcoré et figé le droit, qui était ainsi devenu mécanique et légaliste, suscitait une inflation de lois et de règlements, n'acceptait plus de modifications souples et d'adaptations, sous prétexte que la “loi est la loi”. En jetant un discrédit total sur les études indo-européennes (parce qu'elles contenaient en germe une contestation de l'ordre juridique positiviste de la République), en posant systématiquement l'équation « études indo-européennes = nouvelle droite = néonazisme », les journalistes-laquais du régime bloquent à titre préventif toute contestation des structures archaïques de la France républicaine. L'histoire devra établir si de Benoist a oui ou non joué sciemment le rôle de la “tête de Turc”, pour permettre cet exorcisme permanent et donner du bois de rallonge à la vieille république...
Ignorance de l’héritage de Savigny
Carl Schmitt s'est insurgé contre le positivisme et le normativisme juridiques, contre leur rigidité et leur fermeture à toute rénovation: sa position se veut “existentialiste”. Ainsi le droit, l'Etat, une constitution, une institution sont autant de corps ou d'entités vivantes, animées de rythmes lents, qu'il s'agit de capter, d'accepter, de moduler et non d'oblitérer, de refuser et d'éradiquer. Ces rythmes dépendent du temps et de l'espace, de l'histoire et de la tradition. Schmitt s'inspire ici de Friedrich Carl von Savigny. Ce juriste allemand du début du XIXième siècle, spécialiste du droit romain, voyait dans le droit un continuum, légué par les ancêtres (mos majorum), sur lequel on ne pouvait intervenir au hasard et subjectivement sans provoquer de catastrophes. Savigny concevait le droit comme un héritage et rejetait les manies modernes à vouloir imposer un droit, des lois et des constitutions inventées ex nihilo, au départ d'a priori idéologiques, de préceptes moraux ou éthiques adoptés en dehors et en dépit de la continuité historique du peuple. Savigny s'est opposé au code napoléonien, d'essence révolutionnaire, et aux constitutions écrites qui figeaient le flux vivant du Volksgeist (cf. Friedrich Karl von Savigny. Antologia di scritti giuridici, a cura di Franca De Marini, Il Mulino, Bologna, 1980).
Savigny, ses maîtres Gustav Hugo et Philipp Weis, partaient du principe que toute codification constituait une fausse route, était susceptible de déboucher sur l'arbitraire et la tyrannie. Le droit vit de l'histoire et ne peut être créé arbitrairement par des législateurs-techniciens au gré des circonstances ni imposé de force au peuple. Le droit se forme par un long processus organique, propre à chaque peuple. Toute intervention arbitraire dans le continuum du droit interrompt le processus naturel de son développement; même dans une phase de déclin, quand le pouvoir est obligé de recourir à des décrets coercitifs, la codification est dangereuse car elle fige et stabilise un droit corrompu, désormais privé de force vitale. La fixation et la stabilisation du droit en phase de décadence perpétuent des régimes foireux voire iniques. Carl Schmitt écrit dans son célèbre texte qui rend hommage à Savigny et déclare que son œuvre est “paradigmatique”: «Le droit en tant qu'ordre concret ne peut être détaché de son histoire. Le véritable droit n'est pas posé (gesetzt) [comme une loi], mais émerge d'un développement non intentionnel (absichtslos) ... Le positivisme, venu ultérieurement, ne connaît plus ni origine ni patrie (Heimat). Il ne connaît plus que des causes ou des normes fondamentales posées comme si elles étaient des hypothèses. Il veut le contraire d'un droit dépourvu d'intentionnalité; son intention ultime est de dominer et d'obtenir en tout la “calculabilité”».
Pour Ulrich E. Zellenberg, qui s'inscrit aujourd'hui dans le sillage de Savigny et Schmitt, le droit «s'exprime dans les mœurs de la communauté, qui sont perçus comme corollaires de la volonté de Dieu. Le droit et la justice sont dès lors une seule et même chose. Il n'y a pas de différence entre le droit positif et le droit idéal. Comme le Prince et le juge ne sont pas appelés à créer un droit nouveau, mais à garantir le droit déjà existant, les revendications individuelles, les décisions à prendre dans les cas concrets et les innovations de fait se légitimisent comme des recours au droit ancien, ou comme le rétablissement de son sens propre» (cf. Ulrich E. Zellenberg, « Savigny », in : Caspar von Schrenck-Notzing, Lexikon des Konservativismus, Stocker, Graz, 1996).
Défense de la « societas civilis » et droit de résistance
Le droit historique, acquis à la suite d'une longue histoire et non fabriqué par des légistes professionnels, implique a) la défense de la societas civilis et b) le droit de résistance à l'arbitraire et à la tyrannie. La volonté du positivisme de légiférer à tout crin met le droit à la disponibilité des seuls légistes professionnels. Conséquence: le droit devient l'instrument d'une minorité cherchant à asseoir son pouvoir, par ingénierie sociale. Même les “institutions” comme la famille, le mariage, etc. sont à la merci des interventions arbitraires d'une caste isolée de la societas civilis. Pour Schmitt, les “ordres concrets”, les institutions anthropologiques (selon la définition qu'en donne Gehlen), sont des bastions de résistance contre la frénésie légiférante des législateurs positivistes; ces “ordres concrets” imposent des limites à l'ingénierie sociale et juridique, mettent un frein au flux normatif et obligent les légistes à accepter les règles des ordres concrets sous peine de les détruire. La rage légiférante des légistes positivistes (Schmitt: “les législateurs motorisés”) détruit la confiance des citoyens dans le droit, qui perd toute autorité et toute légitimité.
Sur le plan historique, la réaction de Savigny s'oppose tout à la fois à l'école philosophique de Christian Wolff (1679-1754), qui inspire l'absolutisme rationalisant, et aux partisans de l'adoption systématique du code napoléonien (Anton Thibaut, 1774-1840). Le droit germanique prévoit le droit de résistance à la tyrannie: au moyen-âge, ce droit s'inscrit dans les obligations réciproques du seigneur et du vassal, puis dans le droit des états de la société de s'opposer à la violence arbitraire du Prince. Avec Althusius, le droit de résistance est le droit de la societas civilis à s'opposer à l'absolutisme.
Cette brève esquisse des principes de droit de la pensée dite “conservatrice” montre que le discours de la ND aurait dû s'infléchir vers une défense tous azimuts de la liberté populaire contre les instances bodiniennes, coercitives et jacobines de la République française. Sur le plan culturel, cette démarche, renouant avec la défense conservatrice, anti-absolutiste et anti-révolutionnaire de la societas civilis, aurait dû recenser, commenter et glorifier toutes les étapes et les manifestations de révolte populaire en France contre l'arbitraire de l'Etat. De même, la ND aurait dû participer à la définition d'un droit ancré dans l'histoire, comme Savigny l'avait fait pour l'Allemagne. Pour un mouvement qui prétendait mettre la culture au-dessus de la routine politicienne, de l'économie ou même du social, il est tout de même étonnant de ne jamais avoir rien publié sur la notion de Kulturstaat chez Ernst Rudolf Huber, partiellement disciple de Schmitt car il était fasciné par la notion d'“ordre concret”. Le Kulturstaat de Huber est un Etat qui tire son éthique (sa Sittlichkeit) et ses normes d'une culture précise, héritage de toutes les générations précédentes. Cette culture est une matrice prolixe, ouverte, fructueuse: elle est une “source” organique inépuisable tant qu'on n'attente pas à son intégrité (Savigny et, à sa suite, Schmitt insistaient énormément sur cette notion de “source”/“Quelle”, sur l'image parlante de la “source” en tant que génératrice du droit). La notion de source chez Savigny et Schmitt, la notion de “culture” chez Huber interdisent de voir dans le droit et dans l'Etat de pures intances instrumentales. Le Kulturstaat n'est pas un Zweckstaat (un Etat utilitaire, sans continuité, sans ancrage territorial, sans passé, sans projet). Le rôle de l'Etat est de protéger l'intégrité de la “source”, donc de la culture populaire. Telle est la première de ses tâches. Par suite, la culture n'est pas quelque chose qui relève de l'“esprit de fabrication”, de la “faisabilité” comme on dit aujourd'hui, elle génère des valeurs intangibles, lesquelles à leur tour fondent l'idée de justice et justifient l'existence de secteurs non marchands, comme l'éducation (cf. Max-Emanuel Geis, Kulturstaat und kulturelle Freiheit. Eine Untersuchung des Kulturstaatskonzepts von Ernst Rudolf Huber aus verfassungsrechtlicher Sicht, Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1990).
Sur base de cette approche du droit, que possèdent les écoles conservatrices allemande, autrichienne, italienne et espagnole, la ND aurait pu :
- développer une critique des instances révolutionnaires institutionalisées en France et dans les pays influencés et meurtris par le républicanisme révolutionnaire et l'impact du code napoléonien;
- aligner ce pays sur les préoccupations politiques de son environnement européen (car l'organicisme se répercute finalement sur l'ensemble des familles idéologiques, au-delà des clivages politiciens);
- préparer au niveau européen une contre-offensive organique bien étayée;
- élaborer des correctifs contre les miasmes de la centralisation, de l'utilitarisme anti-culturel, de la déconstruction des secteurs non-marchands au niveau eurocratique, etc.
Savigny, école historique, Bachofen
Schmitt, dans son plaidoyer pour un recours aux principales idées-forces de Savigny (cf. «Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft», in: Verfassungsrechtliche Aufsätze, Berlin, 1973), fait explicitement le lien entre la démarche de Savigny dans le domaine du droit, d'une part, et celle de Gustav von Schmoller et de son “école historique” en économie, d'autre part. En outre, Schmitt annonce la nécessité de se replonger dans l'étude de la Tradition, en évoquant notamment Bachofen et l'approfondissement des études de philologie classique. Celles-ci nous donnent une image désormais très précise de la plus lointaine antiquité européenne. Les sources les plus antiques du droit nous apparaissent dans toute leur densité religieuse. Grâce aux efforts des philologues, les visions édulcorées de l'antiquité classique qu'un certain humanisme scolaire avait véhiculées, disparaissent dans les poubelles de l'histoire. Schmitt écrit: «Il ne s'agit nullement aujourd'hui de revenir en arrière à la façon des réactionnaires, mais de conquérir une immense richesse de connaissances nouvelles, qui pourront s'avérer fructueuses pour le présent dans le domaine des sciences du droit; nous devons nous emparer de ces richesses et les mettre en forme» (op. cit., p. 416). Dans cet appel de Schmitt, le lien entre les sciences juridiques et la nouvelle philologie classique, considérablement enrichie depuis Bachofen, est clairement établi. Schmitt légitimise dans le discours politologique le recours à la Tradition. L'héritage philologique est mobilisé dans le but de donner à la Cité un droit correspondant à son histoire et à ses origines, à ses sources. La ND a mal utilisé cet héritage philologique, surtout en répétant et en paraphrasant Dumézil, en le mêlant à certaines intuitions d'Evola, lui-même inspiré par Bachofen, mais sans jamais le mobiliser pour proposer un autre droit, pour opposer, au droit républicain et révolutionnaire institutionnalisé, un droit véritablement conforme aux sources européennes du droit. Alain de Benoist a raté le coche: il a fait de son pur discours culturel (cultureux!) un but en soi. Il a failli à sa mission. Il a trahi. Il a servi l'adversaire. Par ses maladresses et son absence de suite dans les idées, par sa négligence du message de Carl Schmitt, il a servi les ennemis de la population française, les ennemis de l'Europe, les ennemis des peuples européens.
Schmitt, en réclamant une recherche bi-disciplinaire, unissant le droit et la philologie d'après Bachofen, entendait donner un instrument à l'élite future de l'Europe: si le droit est demeuré coutumier en Angleterre mais reste aux mains des possédants de la société civile, si le droit est aux mains de fonctionnaires-légistes en France, auxquels fait face la société civile aidée de ses avocats trop souvent impuissants, l'Allemagne, dans l'esprit de Savigny, doit aligner une phalange de professeurs de droit et de philologues, capables de juger selon le sens du droit et non selon les formes et les règles abstraites. Cette phalange de juristes traditionnels et de philologues remplacerait l'ancienne “Chancellerie impériale”, chargée d'arbitrer les diversités du Saint-Empire. Schmitt appelait ainsi de ses vœux une “première fonction” souveraine, organisée selon le projet de Savigny. Cette “première fonction” utiliserait les méthodes organicistes et historiques. La ND, si elle avait été dirigée par des hommes compétents, aurait eu la chance de devenir une telle élite. Malheureusement, elle ne s'est pas concentrée sur les tâches que Schmitt assignait à celle-ci. Elle a pratiqué un occasionalisme systématique et ridicule, où toutes les occasions de “faire le malin” étaient bonnes, de briller dans les salons parisiens peuplés d'imbéciles aux cerveaux pourris par les folies révolutionnaires et jacobines, par l'“esprit de fabrication” (Joseph de Maistre !), par les slogans les plus absurdes, dont Bernard-Henri Lévy et toute la clique des vedettes médiatisées ont donné un bel exemple lors de la crise bosniaque. Tel était l’objectif prioritaire de de Benoist : réussir des coups médiatiques sans lendemain. Face à cette basse-cour parisienne, la ND n'a pas opposé un projet clair: au contraire, elle a présenté un véritable “mouvement brownien” de brics et de brocs d'idées diverses, sans liens apparents entre elles. Du coup, elle ne faisait pas le poids devant ceux qui avaient une longueur d'avance sur elle dans le monde “intellectuel” (?) parisien.
Un droit familial et collégial
Le recours aux études indo-européennes aurait également pu dépasser le clivage qui avait ruiné la postérité de Savigny en Allemagne: l'opposition stérile entre romanistes et germanistes, c'est-à-dire entre partisans du droit romain et partisans du droit germanique. Aujourd'hui, la philologie et les études indo-européennes indiquent au contraire une source commune, plus ancienne, propre à toutes les grandes traditions populaires européennes, et se situant au-delà de ce clivage artificiel romanité/germanité. Tel a été l'apport d'Emile Benveniste, du Géorgien Thomas V. Gamkrelidze, du Russe Vjaceslav V. Ivanov, de Dumézil et de Bernard Sergent. Dans tous ces travaux qui révèlent à nos contemporains les matrices culturelles du monde indo-européen, une part importante de ces volumes respectables traite des “institutions”. Gamkrelidze et Ivanov sont très précis pour tout ce qui concerne les liens sociaux, base du droit privé et du droit public, de l'antiquité à nos jours. Si la ND s'était référée à ces corpus, plutôt que de tirer de Dumézil une sorte de sous-mythologie guerrière, tout juste digne des jeux de rôle pour adolescents désorientés, elle n'aurait jamais essuyé le reproche de “national-socialisme”.
Avec un apport philologique solide, la ND aurait été mieux armée face à ses adversaires. Le droit primitif indo-européen est familial et collégial, il implique la liberté, le droit de résistance à la tyrannie, la délibération démocratique: la ND aurait eu beau jeu de ruiner les arguments de ses adversaires républicains en France. En critiquant tout apport philologique, ceux-ci se rangeaient automatiquement dans le camp des partisans de l'absolutisme, de la coercition, de la rupture entre société civile et appareil d'Etat. La ND aurait arraché leurs masques avec délectation: ces faux démocrates sont de vrais terroristes et le républicanisme institutionalisé n'est pas démocratique, il est même le pire des contraires de la démocratie. La ND aurait pu confisquer pour elle seule le label de “démocratie”. Schmitt conseillait même d'appeler Tocqueville à la rescousse... Effectivement, devant la phalange regroupant Savigny, Tocqueville, Schmoller, Schmitt et les philologues indo-européanisants, le discours républicain serait bien rapidement apparu pour ce qu'il est: un bricolage sans consistance.
Enfin, la notion de Volksgeist apparait certes comme typiquement allemande. Les savants allemands ont étudié en profondeur, de Herder aux frères Grimm, les tréfonds de l'âme populaire germanique. Mais, en dehors de la sphère culturelle et linguistique germanique, les philologues slaves ont pris le relais et ont exploré à fond les coins et les recoins de l'âme slave. Une telle demarche a été entreprise pour la France par quelques esprits aussi hardis que brillants (Van Gennep), mais cet acquis doit à son tour être politisé et instrumentalisé contre les partisans républicains de la “cité géométrique” (ce terme est de Georges Gusdorf, autre penseur capital qui a été totalement ignoré par de Benoist ; on peut légitimement se poser la question ; pourquoi cet ostracisme ?).
Entrelacs très dense de juridictions et de traditions
L'ancienne France n'avait peut-être pas de constitution, mais elle n'était pas un désert juridique. Au contraire: l'histoire des droits communaux ou municipaux, les structures juridiques des paroisses des provinces de France, les assemblées organisées ou non par des syndics permanents ou élus, la diversité des instances de justice, le régime de la milice populaire, l'assistance publique et l'organisation des hôpitaux et des maladreries, la fonction des prudhommes, les protections accordées à l'agriculture, sont autant de modèles, certes complexes, qui expriment la vitalité du petit peuple et sont les garants de ses droits fondamentaux face au pouvoir.
C'est dans ces entrelacs très denses de juridictions et de traditions juridiques que s'est épanouie la France rabelaisienne, la fameuse gaîté française (cf. Albert Babeau, Le village sous l'Ancien Régime, rééd., Genève, 1978, éd. or., Paris, 1878). Plutôt que d'encourager les fantasmes douteux et vikingo-germanolâtres de certains adolescents fragiles (ou de gâteux précoces...), la ND française aurait dû renouer avec cette France joyeuse des libertés villageoises, même si le type du gai Gaulois, païen, paillard et libertaire ne correspond pas au personnage sinistre, lugubre, grognon et tyrannique qui orchestre aujourd’hui cette ND moribonde, tenaillé par un ressentiment hargneux de vieille femme délaissée. Le recours à la vieille France rabelaisienne aurait été détonnant si la ND l'avait couplé à une exploitation idéologique efficace de cette distinction capitale qu'avait opérée l'ethnologue Robert Muchembled entre la “culture du peuple” et la “culture des élites”. La culture du peuple est fondamentalement païenne (c'est-à-dire paysanne et tournée vers les rythmes naturels auxquels nul ne peut échapper), elle est axée sur la diversité du réel et sur les innombrables différences qui l'animent. La culture des élites est étriquée, schématisée, géométrique avant la lettre, répressive, “surveillante et punissante” (pour reprendre les expressions favorites de Michel Foucault), en un mot, scolastique. Le pari pour la culture populaire rabelaisienne impliquait aussi de prendre parti
- pour les révoltes régionales contre la “cité géométrique” montée par Siéyes et les révolutionnaires ;
- pour la diversité des expressions populaires dans les anciennes provinces de France ;
- pour les révoltes populaires en général, que ces révoltes soient paysannes, régionalistes, syndicales ou ouvrières.
Cette triple prise de parti permettait de renouer avec la notion de “droit de résistance”.
Mais hélas: l'option droitière, le désir irrépressible (mais jamais réalisé!) de “manger à la table des puissants”, de servir de mercenaires aux droites du pouvoir, de débiter inlassablement des discours anticommunistes ineptes, de s'allier avec des politiciens droitiers véreux qui étalent leur prose dans la presse bourgeoise, de vouloir à tout prix collaborer à cette presse (parce qu'elle paie bien), empêchaient de jouer cette double carte de la défense et de l'illustration de la vieille France populaire et rabelaisienne, de revendiquer le droit de résistance de la societas civilis, de défendre le peuple réel contre ses oppresseurs, légistes ou militaires. Mais les puissants n'ont pas accepté le mercenariat proposé, le gourou de la ND a été remercié; c'est alors que l'on a assisté à un aggiornamento de la ND, à une tentative de s'ouvrir sur la gauche intellectuelle, ses cénacles, ses salons. Mais comment entrer dans ce monde-là, quand on revient piteusement d’en face, quand on a voulu se faire le gendarme intellectuel d'une fausse droite qui n'est jamais rien d'autre que la vraie gauche républicaine institutionnalisée?
Créer une « chancellerie impériale »
Schmitt, dans son projet de reconstituer une sorte de “chancellerie impériale” en créant son élite de juristes traditionnels et de philologues, gardiens du plus ancien passé de l'Europe, n'entendait pas jeter brutalement tout l'édifice juridique révolutionnaire-institutionalisé à terre. Il jetait un soupçon sur la validité et surtout sur la légitimité de cet édifice, il constatait que l'inflation de lois et de réglements, que la fixation sur les normes avaient conduit à un totalitarisme insidieux, à une tyrannie des normes, à l'émergence d'une cage d'acier institutionnelle rendant aléatoires les changements et les adaptations nécessaires. Or, en France, le gaullisme des années 60, pourtant héritier du républicanisme français, gère une constitution, celle de la Vième République, qui a reçu indirectement, via René Capitant, l'influence de Schmitt et de l'école décisionniste allemande. L'influence de Schmitt a parfois été considérée comme “étatiste”; on a dit qu'elle servait à soutenir les vieux Etats de modèle occidental et leurs appareils de contrôle et de répression. C'est là une interprétation schématisante de son œuvre. Nous l'avons vu en analysant son plaidoyer pour un retour à la démarche de Savigny. La societas civilis et ses ordres concrets sont, pour Schmitt, des instances et des valeurs d'ordre et de discipline, sont les réceptacles de vertus créatrices. Les constitutionnalistes de la Vième République, en suivant la logique de Schmitt, ont dû parvenir au même constat. Et admettre que le républicanisme français et ses imitateurs en Europe généraient une coupure problématique et perverse entre la societas civilis et les appareils d'Etat. Dans les années 60, les politologues gaulliens ont réfléchi à la question: le hiatus entre societas civilis et appareils d'Etat devait être surmonté par trois innovations réellement fécondes: a) la participation dans le domaine économico-industriel, b) la création d'un Sénat des professions, hissant l'élite de la societas civilis au plus haut niveau de l'Etat et de la représentation politique; c) la création d'un Sénat des régions, permettant de redonner à tous les territoires de l'Hexagone une représentation directe sur une base locale, contournant ce que Gusdorf avait appelé l'“ivresse géométrique de la France en carrés” (in La conscience révolutionnaire. Les idéologues, Paris, 1978).
Malgré ses dénégations, malgré ses déclarations réitérées de vouloir sortir du ghetto de l'extrême-droite, de Benoist n'a jamais cessé d'être accroché par toutes sortes de fils à la patte à ses petits copains de l'ex-OAS qui faisaient de l'anti-gaullisme un dogme et étaient tellement aveuglés par leurs ressentiments qu'ils ne constataient pas les mutations positives du gaullisme dans les années 60. Certes, de Benoist a un jour écrit un bon article dans le Figaro-Magazine, où il affirmait être gaullien plutôt que gaulliste. Mais la transition qu'il semblait annoncer par cet article en est restée là... Seul Europe, Tiers-Monde, même combat constitue une tentative d’Alain de Benoist de sortir concrètement du duopole de la Guerre Froide, mais, hélas, ce livre n’a pas eu de suite, n’a pas été remis à jour après 1989. Armin Mohler avait enjoint les Allemands à parier sur l’alliance française et l’appui aux « crazy states » hors d’Europe. Alain de Benoist lui a emboîté le pas. Mais où est la recette pour l’après-perestroïka ? Quelle théorie sur la Russie ? Alain de Benoist est fidèle à sa maladie : rien que les idées abstraites et les éthiques désincarnées, ses pièces de meccano. Pour le reste, fuite hors de l’histoire, fuite hors du monde.
Droit de résistance et citoyenneté active
Enfin, si la ND avait renoué avec la notion —pourtant éminemment conservatrice— de “droit de résistance”, elle n'aurait eu aucune peine à déployer un projet de citoyenneté active (et participative), et à défendre les secteurs non-marchands (éducation, secteur médical) battus en brèche par l'économicisme ambiant. Aujourd'hui, les quelques références à une citoyenneté active dans les textes de la nouvelle droite semblent tomber du ciel, semblent n'être qu'une manie et qu'un caprice passager, que les vrais partisans de la citoyenneté active ne prennent pas au sérieux. Mais nous, Sampieru, Mudry et moi-même, qui avions revendiqué très tôt cette orientation vers le peuple réel, étions traités par le gourou de “trotskistes” ou d'“écolos”, de lecteurs de la revue Wir Selbst, jugée à l'époque dangereusement “gauchiste”. Aujourd'hui, le gourou est lui-même devenu, paraît-il, un “trotskiste” et un “écolo”, il flatte bassement mais sans résultat le directeur de Wir Selbst, alors, pour dédouaner ses anciennes injures, il a fait écrire à l'un de ses serviteurs italiens une lettre insultante qui nous campait comme les “teste matte della Mitteleuropa” (les têtes brûlées de la Mitteleuropa). Vouloir la subsidiarité, le rétablissement du droit de résistance, vouloir un droit plongeant dans l'humus de l'histoire, être fidèles à Carl Schmitt, est-ce un programme capable de séduire des “têtes brûlées”? (7).
Lacunes économiques et géopolitiques
Enumérer les multiples errements de la ND française exigerait un livre entier. En guise de conclusion, signalons encore que l'économie a été une parente pauvre de la “révolution métapolitique” de la secte GRECE. Rien de sérieux n'a été entrepris pour faire connaître dans un public large les thèses des économistes hétérodoxes. En matière de géopolitique, on a vaguement évoqué un binôme franco-allemand (insuffisant dans l'Europe actuelle) et répété un anti-américanisme incantatoire, plus éthique que pratique. Alain de Benoist n'a jamais reproché aux Américains de fabriquer des “traités inégaux” avec toutes les autres puissances de la planète, n'a jamais analysé sérieusement le déploiement de la puissance américaine depuis l'indépendance des Etats-Unis: lors d'un colloque du GRECE, devant le public abasourdi, son argument principal ne fut-il pas de dire: “la sodomie entre époux est passible des tribunaux dans certains Etats de l'Union”. Et de Benoist, immédiatement après avoir prononcé cette phrase historique, regardait son public, semblait attendre une réaction. Les participants regardaient leurs chaussures d'un air géné. Et de Benoist a continué à parler, passant de la sodomie à autre chose, comme les polygraphes passent de la physique nucléaire à la bande dessinée. L'argument obsessionnel et pathologique de la sodomie épuise-t-il toute critique de l'américanisme?
Les litanies anti-américaines, justifiées par l'esthétisme, par l'éthique guerrière européenne, par l'hostilité au christianisme en général et au christianisme protestant américain en particulier, par la volonté obsessionnelle de défendre la liberté de se sodomiser en rond n'apportent rien de concret. Ligues de vertu puritaines et hystériques et cénacles pansexualistes et promiscuitaires ne servent jamais que de dérivatifs: pendant que les uns et les autres vocifèrent et s'agitent, ils ne se mêlent pas du fonctionnement de la Cité, au vif plaisir des dominants. La CIA peut dormir sur ses deux oreilles.
La CIA peut dormir sur ses deux oreilles…
La ND, qui se pose en théorie comme un mouvement pour la défense et la sauvegarde de l'Europe, n'a jamais formulé une géopolitique continentale d'un point de vue français. On connait les visions mitteleuropéennes de la géopolitique allemande, voire les projets de Kontinentalblock dérivés de la pensée de Haushofer. Jamais la ND française n'a vulgarisé les acquis de la géopolitique française contemporaine: aucun texte n'a été publié sur les ouvrages de Hervé Coutau-Bégarie, de Pascal Lorot, de François Thual, de Jacques Sironneau, d'Yves Lacoste (un “gauchiste”...), de Michel Foucher (un méchant qui a travaillé pour Globe...), de Zaki Laïdi (un “Arabe”...), de Michel Korinman, etc. alors que, dans toute l'Europe, ces travaux sont pionniers et inspirent les écoles géopolitiques en place. Pire, jamais la ND n'a emboîté le pas à Jordis von Lohausen qui demandait aux Français et aux Allemands de défendre l'Europe “dos à dos”, ce qui impliquait un engagement français sur l'Atlantique, une défense de la marine française, traditionnellement européiste et vaccinée contre les excès de germanophobie qui ont souvent agité les milieux militaires. La ND parisienne a-t-elle défendu les marins français et leurs projets, a-t-elle recommandé la lecture des écrits théoriques de l'amirauté? Non. La CIA peut dormir sur ses deux oreilles. La Navy League aussi. La germanophilie et l'européisme germanisant de la ND de de Benoist sont des leurres, des attrape-nigauds, des miroirs aux alouettes. Une politique germanophile et européiste en France est une politique de soutien à la marine du pays et implique un engagement civil et militaire dans l'Atlantique; l'Allemagne réorganise la continent avec la Russie; la France garde la façade atlantique. Dos à dos, disait Lohausen.
En philosophie, les carences de la ND sont effrayantes. Alors qu'en Allemagne, terre par excellence de la philosophie, tous recourent aux philosophes français contemporains pour court-circuiter les routines qui affligent la pensée allemande d'aujourd'hui, que des fanatiques tenaces cherchent à aligner sur les critères les plus étriqués de la “political correctness”, la ND parisienne a délibérément ignoré les grands philosophes français contemporains. J'ai même entendu dire et répéter dans les rangs de la ND qu'il n'y avait plus de “grands philosophes” aujourd'hui, mis à part de Benoist, bien sûr, le génie d'entre les génies! On ne saurait être plus à côté de la plaque!
Enfin, une stratégie métapolitique ne saurait être purement esthétique, ni virevolter au gré de tous les vents ni présenter ses arguments dans le désordre à la façon du “mouvement brownien” des particules. Une stratégie métapolitique ne peut se placer en-deçà de l'effervescence politicienne et partisane, que
- si elle se donne pour tâche de retrouver et de renouer des fils conducteurs,
- si elle capte et repère des forces dans le grouillement du réel ;
- si elle procède à un travail d'archéologie des institutions.
Les méthodes d'un tel travail, les philosophes français nous les ont léguées. Encore faut-il ne pas les avoir ignorés...
En bref, pour nous, entre autres textes de référence pour orienter notre travail, nous avons choisi celui de Schmitt, commenté dans cet exposé. Ensuite, nous posons des objectifs clairs, nous ne percevons pas le travail théorique comme un jeu de salon. Ces objectifs sont:
- restauration d'un droit européen basé sur ses racines et ses sources les plus anciennes (référence à Savigny).
- restauration des droits des communautés réelles qui font le tissu de l'Europe.
- restauration d'une “chancellerie impériale” capable d'harmoniser cette diversité juridique, corollaire de la diversité européenne (et cette chancellerie impériale doit compter des hommes et des femmes de toutes nationalités, capables de maîtriser plusieurs langues européennes).
- maintenir les systèmes de droit ouverts, afin d'éviter les fanatismes normativistes et toute forme de “political correctness”.
- prévoir une instance décisionnelle en cas de danger existentiel pour l'instance politique (nationale ou européenne).
- étude systématique des traditions d'Europe, comme Schmitt nous l'a demandé.
- coupler cette restauration juridique et cette méthode historique à un programme hétérodoxe en économie (la référence que fait Schmitt à l'école historique de Gustav von Schmoller).
Les remarques de Kowalski
Ce programme est vaste et interpelle quasiment toutes les disciples du savoir humain. Mais ce progamme ne saurait en aucun cas s'abstraire du mouvement de l'histoire. Et s'encombrer du ballast inutile des fantasmes, des images d'Epinal, des vanités personnelles... Pour terminer, signalons tout de même une hypothèse sur la ND, formulée par un politologue allemand, Wolfgang Kowalsky (in: Kulturrevolution? Die Neue Rchte im neuen Frankreich und ihre Vorläufer, Opladen, 1991). Kowalsky, après avoir analysé l'évolution des idéologies politisées en France, de mai 68 à l'avènement de Mitterrand, après avoir examiné le rôle de la ND dans cette longue effervescence, concluait en disant que la “métapolitique” de la ND, plus exactement son programme de “révolution culturelle”, était une arme contre la société civile (Kulturrevolution als Barriere gegen die Zivilgesellschaft). Certes, l'argumentation de Kowalsky est confuse, il confond allègrement ND et FN, croit en un “partage des tâches” entre ces deux formations (ce qui est une lubie des enquêteurs anti-fasciste professionnels sans profession définie). Néanmoins, la question de Kowalsky doit être posée, mais différemment: vu l'absence totale de consistance des discours de la ND sur le droit, l'économie, la géopolitique, les relations internationales, la staséologie (l'étude des mouvements sociaux; ce néologisme est de Jules Monnerot), l'histoire, l'organisation de la santé, les projets pratiques en écologie et en approvisionnement énergétique, etc., nous sommes bien obligés, à la suite de Kowalsky, de constater que la societas civilis, espace réel de la civilisation ou de la culture européenne, ne trouve dans la ND aucun argument pour assurer sa défense contre l'emprise croissante d'un monde politique totalement dévoyé, qui n'a plus d'autre projet que de se perpétuer, en s'auto-justifiant à l'aide d'arguments vieux de deux ou trois siècles, en pillant la societé civile par une fiscalité délirante, en la contrôlant par la presse et les médias stipendiés, en surveillant et en punissant ceux qui osent contester ce pouvoir inique (emprisonnement de fédéralistes français, poursuites judiciaires contre des indépendants contestant le système de sécurité sociale, contrôle de la fonction médicale, etc., toutes pratiques que l'on trouve évidemment dans d'autres pays). Kowalsky exagère sans nul doute en suggérant que de Benoist a construit pour toute la France une barrière contre la société civile, pour protéger et perpétuer le système bodinien, en place depuis Richelieu et les jacobins. Le rôle de de Benoist, s'il a vraiment été un dérivatif, a été plus modeste: empêcher que dans les milieux dits de “droite”, des argumentaires en faveur de la décentralisation, du fédéralisme, de la défense de la société civile, de la réforme juridique, judiciaire et constitutionnelle, qu'un retour aux projets gaulliens de participation et de sénat des professions et des régions (oubliés depuis le départ et la mort du Général), ne se cristallisent et ne se renforcent, afin de défier sérieusement le système en place et d'opter pour une révolution européenne armée d'un programme cohérent. La “métapolitique” selon de Benoist n'a été qu'un rideau de fumée, qu'un dérivatif, n'a servi qu'à désorienter de jeunes étudiants en ne les mobilisant pas pour un travail juridique, économique, sociologique et philosophique politiquement fécond à long terme. Pistes perdues... Rendez-vous manqués… Aveuglement ou sabotage ? L’Histoire nous l’apprendra…
Robert STEUCKERS,
Forest, février 1998.
(1) Roland Gaucher, qui reconnaît pleinement les mérites du GRECE, lui reprochant toutefois une méconnaissance de la stratégie de Gramsci, sait aussi croquer avec humour les travers que nous dénonçons par ailleurs : « Je me souviens ici d’une intervention d’Alain de Benoist, qui m’avait frappé lors d’un colloque organisé par l’Institut d’études occidentales. Quand vint son tour de parler, partant du fond de la salle, il s’avança, raide et gourmé, un rouleau de papier à la main. Ses partisans se levèrent pour l’acclamer — il n’était, à l’époque, guère connu mais il avait déjà su constituer sa clique et sa claque. Je n’ai pas retenu grand chose de son intervention, sinon l’expression d’un rejet radical de l’histoire de Job sur son fumier. Selon lui, elle ne nous touchait pas. Elle était radicalement étrangère à la cultue européenne » (Roland Gaucher, « Les Nationalistes en France, tome 1, La traversée du désert (1945-1983), p. 157). Plus loin, Gaucher se fait plus caustique encore : « J’en finirai sur cette aspect du GRECE avec une anecdote qui me fut un jour contée par le regretté Bonomo aujourd’hui décédé, excellent reporter, d’origine pied-noir. Bonomo, il y a une quinzaine d’années (peut-être à l’époque de la création du « Fig-Mag ») avait servi de pilote à Alain de Benoist et à un de ses amis pour un raid vers le Cap Nord. Bonomo conduisait la voiture, les deux autres étaient assis à l’arrière. Et au fur et à mesure que le temps passait, il était clair que se développait chez ces deux Nordiques un sérieux complexes de supériorité à l’égard de ce Méditerranéen, poisson de second choix. On parvint enfin au terme du voyage, en un point X… que la tradition nordico-païenne avait sans doute désigné : - Alors, raconte Bonomo, de benoist et son pote jaillissent de la voiture. Et, frappant de leurs petits poings leurs maigres bréchets ils avancent jusqu’au bord de la falaise et ils crient, extasiés, le visage levé vers le soleil pâle : « Père ! Père ! C’est nous ! Nous sommes revenus ! Nous t’adorons ! ». Bref, c’était gentil papa Soleil ! (op. cit., pp. 157-158).
(2) Près de Pérouse en février 91, Alain de Benoist était assis au fond de la salle de conférence, une salle magnifique de cet ancien couvent transformé en centre de séminaires, avec un parquet du XVIIIième parfaitement restauré. Il était interdit de fumer pour ne pas abîmer ce parquet. Alain de Benoist fumait, sale et dépenaillé, avec son costume fripé, sa chemise souillée et ses pompes qui n’avaient plus vu de cirage depuis des lunes. Une auréole de fumée s’élevait au-dessus de son crâne et de celui de sa maîtresse, vêtue d’un jeans troué et effiloché aux niveaux du genou et de la fesse gauche, curieux contraste avec toutes les dames italiennes présentes, dont l’élégance, ce jour-là, était véritablement époustouflante. Les copains parisiens ramenaient des bords de la Seine le look clodo. «Le style, c’est l’homme », disait Ernst Jünger et Alain de Benoist aimait à répéter cette phrase. Je l’ai aussi méditée, en le regardant, ce jour-là. Vers la moitié de mon exposé, il s’est levé pour aller fumer dehors, rappelé à l’ordre par le concierge. Il est revenu à l’entracte pour me dire : « Pourquoi t’as parlé de Derridada ?».
(3) Cette lecture partielle est une lecture anti-fasciste de Gobineau. Bon nombre d’hurluberlus de droite ont repris telles quelles les calomnies répandues sur Gobineau en France par les tenants d’un anti-racisme vulgaire, qui feraient bien mieux de s’inspirer des expériences de Gobineau en Orient pour développer un anti-racisme cohérent. Force est de constater que les vulgates anti-racistes et racistes partagent la même vision tronquée sur l’œuvre magistrale de l’orientaliste Gobineau.
(4) Cf. Hervé Luxardo, « Les paysans. Les républiques villageoises. 10ème-19ème siècle », Aubier, Paris, 1981 ; Hervé Luxardo, « Rase campagne. La fin des communautés paysannes », Aubier, Paris, 1984.
(5) et, du même coup, de refaire de Hambourg le chef-lieu du département des “Bouches-de-l'Elbe”. Fantasme qui avait déjà valu au bonhomme quelques ennuis, quand il était en poste à Bruxelles et rêvait de commencer sa marche vers l'Elbe, en conquérant la Wallonie et les Fourons.
(6) Il fallait le voir! Il aurait fait les délices d'un caricaturiste primesautier, avec ses sourcils tombant tristement, comme la chute des moustaches d'un Tarass Boulba de fête foraine, la bouche ouverte, la mâchoire pendouillant misérablement comme s'il venait d'essuyer un uppercut, les bajoues agitées de convulsions nerveuses, la lippe inférieure tremblotante, retenant à peine, grâce à la forte viscosité d'une salive nicotinée, son éternel bout de clope à moitié éteint et pestilentiel!
(7) Et que faut-il penser de la clique des vikingomanes de Paris et des environs, du fameux Chancelier du gourou, pied-noir et grande gueule, s'époumonant à hurler les pires inepties lors des universités d'été du GRECE, s'agitant à formuler un grossier paganisme de bazar oriental, et que faut-il penser de cette maîtresse vulgaire et illettrée qui faisait naguère, la clope au bec et l'invective sur la lippe, la pluie et le beau temps dans les bureaux du gourou, et que faut-il penser du Président actuel de la secte qui grenouillait dans les années 60 dans un groupe ultra-raciste (à faire pâlir Julius Streicher!) exclu avec fracas par Jean Thiriart de “Jeune Europe” à Bruxelles, d'un Président qui nous lance une fatwah du haut de sa tribune, lors du dernier colloque du GRECE, en prétendant que nous sommes de « dangereux extrémistes » ? Non, ceux-là ne sont pas des “teste matte”: c'est, paraît-il, l'avant-garde de l'élite européenne. Mais est-ce bien cette élite-là que Schmitt appelait de ses vœux? Je me permets d'en douter.
 Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/
Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/


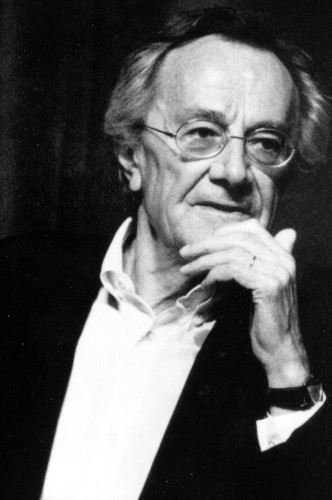

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg