 Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/
Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/dimanche, 15 mars 2009
Drieu La Rochelle. Il mito dell'Europa
Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa

Pierre Drieu La Rochelle (Parigi, 3 gennaio 1893 – Parigi, 15 marzo 1945)
Questo libro, edito nel lontano 1965, poi ristampato nel 1981, ed ormai reperibile nel migliore dei casi in sbiadite fotocopie, rivelò al distratto pubblico italiano la figura di Pierre Drieu La Rochelle. A questa lacuna, aveva in parte rimediato un libro di Paul Serant (Romanticismo fascista) uscito qualche anno prima, ma fu solo con questo piccolo saggio che esplose la passione per questo “poeta maledetto” del Novecento. Contemporaneamente alla scoperta in Italia della figura del “collaborazionista” La Rochelle, in Francia cominciavano ad essere ristampati i suoi testi, come in una timida, comune, primavera del pensiero anticonformista brutalmente azzittito con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale.
La Rochelle è sicuramente una personalità forte, uno scrittore dal temperamento d’acciaio, ma anche un polemista dalle grandi capacità di romanziere. Questa sua grande sensibilità fu probabilmente dovuta all’esperienza tragica nella Prima Guerra Mondiale (in cui fu ferito tre volte), e all’estrazione borghese della sua famiglia, rovinata da crisi economiche e sentimentali.
Sicuramente Drieu sapeva che non si potevano servire due “padroni”, la verità e la notorietà, scegliendo così di essere compreso bene, ma da pochi. Non a caso gli autori del libro, sottolineano la figura di questo poeta come quella del miglior Nietzsche: un’inattuale appunto, che ha lasciato fosse il fluire del tempo a dispiegare tutta la sua attualità e profeticità.
L’analisi del pensiero di La Rochelle segue così per ognuno dei tre autori una prospettiva differente: se Romualdi ne analizza la personalissima Weltanschauung, il suo esempio, identificato come militia per l’Europa, è il contributo di Giannettini, mentre Prisco si sofferma sulla storia “personale” di questo.
Dopo la crisi del ‘29, mentre tutti i suoi amici d’infanzia scelgono di abbracciare le sorti dell’Internazionale comunista, Drieu fa una scelta impopolare: egli comincia a proclamarsi apertamente fascista. Il suo fascismo è però quello di chi non può fare a meno di denunciare i mali della decadenza, di elaborare una personale rivolta contro quel “tramonto dell’occidente” già raccontato da Spengler, e dagli autori tedeschi della Rivoluzione Conservatrice.
Per questo, Drieu non fu solo un “intellettuale fascista”, come qualcuno ha voluto etichettarlo un po’ troppo semplicisticamente. Fu uno scrittore che credette di trovare una risposta alle sue domande e alle sue speranze nel fascismo o, meglio, in una certa immagine del fascismo che si era creato. Particolare fondamentale, poiché se non si tiene conto di ciò, si rischia di non capire la sua critica e lucida analisi dei regimi di Mussolini e di Hitler, e quell’atteggiamento anticonformista (appunto “maledetto”) che gli attirò le antipatie sia delle destre che delle sinistre dell’epoca.
La sua Europa non è un’Europa “neutra”: aborto esangue ed intellettuale dei federalisti di Strasburgo o d’altri democratici tout court. La sua Europa è invece quella volontà unica e formidabile, già narrata da Nietzsche, che nel sacrificio e nella stirpe, trova la sua ragion dessere. Non aveva allora torto Drieu La Rochelle, a scrivere poco prima di morire che le generazioni future si sarebbero chinate, incuriosite, sui suoi libri per cogliere un suono diverso da quello solito.
Drieu, però, a differenza di molti altri “redenti” o fascisti “pentiti”, volle pagare sino in fondo, dimostrando che ancora oggi le parole possono essere scritte «con il sangue e non solo con l’inchiostro». Avrebbe potuto fuggire come molti, starsene tranquillo per un po’ e ritornare in patria dopo qualche anno. No. Sarebbe stato troppo facile, troppo moderno per lui. Drieu La Rochelle moriva perciò suicida, il 15 Marzo 1945 nel momento della “liberazione”.
* * *
A. Romualdi, M. Prisco, G. Giannettini, Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa, Edizioni del Solstizio, 1965.
[Tratto da “il Borghese”, n.8, Agosto 2008]
Andrea Strummiello
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, fascisme, années 30, années 40, europe, européisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 mars 2009
La fin de la singularité française dans l'OTAN
La fin de la singularité française dans l'Otan
La France doit-elle reprendre « toute sa place » dans l'Otan en retournant dans son commandement intégré, qu'elle avait quitté en 1966 ? Ou doit-elle conserver sa position actuelle, présente dans l'organisation, militairement engagée dans des opérations au Kosovo et en Afghanistan sous drapeau otanien mais sans participer à ses organes de commandement pour maintenir son autonomie de décision ? Le débat fait - du moins en apparence - rage dans la classe politique française. Dans quelques semaines, le sommet de Strasbourg et Kehl des 3 et 4 avril prochain, doit en principe célébrer le soixantième anniversaire de l'organisation qui, paradoxalement, a survécu au décès du Pacte de Varsovie et l'annonce du retour complet de l'enfant terrible français au sein de sa « famille » euro-atlantique.
Ce dernier geste, très attendu aussi bien à Washington qu'à Berlin, est pourtant, en grande partie, symbolique. Certes, la France pourrait obtenir deux commandements : l'un basé à Norfolk en Virginie (Etats-Unis) chargé de la conduite des transformations de l'alliance, et un autre à Lisbonne, qui accueille le QG de la force de réaction rapide (Nato Response Force, ou NRF). Le dossier n'est cependant pas totalement bouclé, car ce retour signifie une très forte augmentation du nombre d'officiers français à l'Otan et, donc, d'une réduction concomitante des contingents britannique et allemand. Et l'assentiment des 25 autres alliés. Si tous les feux verts sont obtenus, cette montée en puissance pourrait s'étaler sur trois à quatre ans.
Mais au-delà de caractéristiques techniques, ce retour scelle avant tout, symboliquement, le dernier maillon d'un rapprochement avec l'Amérique et la communauté atlantique, amorcé par Jacques Chirac. Car depuis 1995 la France, et cela en dépit de la violente controverse sur l'Irak avec George W. Bush, a déjà fait une grande partie du chemin en acceptant de participer à des missions militaires et en devenant l'un des principaux contributeurs de forces, notamment au sein de la NRF. Au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001, la France n'avait d'ailleurs pas hésité à se ranger du côté de tous les alliés pour évoquer la clause de solidarité collective avec les Etats-Unis, selon laquelle une attaque contre l'un des membres est une attaque contre tous.
Mais ce sont souvent les symboles qui sont le plus sujets à polémique, surtout lorsqu'ils touchent à des concepts comme l'indépendance de la politique étrangère de la France et sa souveraineté. Des concepts qui étaient d'ailleurs au coeur de la décision du général de Gaulle dans sa lettre du 7 mars 1966 au président américain Lyndon Johnson. Pour la France, il s'agissait alors « de recouvrer sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté, actuellement entamée par la présence permanente d'éléments militaires alliés ». Ce qui avait conduit notamment à l'évacuation des états-majors de l'Otan de Versailles et Fontainebleau un an après. Mais Paris avait d'autres soucis : conserver toute son autonomie de décision sur la force de frappe nucléaire six ans après la première explosion d'une bombe atomique française et refuser de suivre les Etats-Unis dans toutes leurs aventures militaires à l'étranger. Cela au moment même où ils s'engageaient lourdement dans la guerre du Vietnam.
Aujourd'hui, le contexte a profondément changé. D'une part, le monde n'est plus divisé en deux blocs. C'est d'ailleurs aussi pour se placer en dehors de cette politique de blocs et à un moment où s'amorçait une certaine détente que le général de Gaulle avait choisi de se retirer du commandement intégré, lui ouvrant ainsi la voie à un dialogue avec l'URSS et la Chine. La fin de la Guerre froide - et en dépit des nouvelles tensions avec la Russie - a une autre conséquence : celle d'avoir mis un terme à l'équilibre de la terreur entre les deux blocs par le feu nucléaire. Ce qui réduit évidemment la portée de la question de l'autonomie de la force de frappe nucléaire française vis-à-vis de l'Amérique.
Pourtant, il ne faut pas se faire d'illusions. Le retour total dans l'Otan de la France soulève au moins deux autres interrogations : quid de l'Europe de la défense ? Certes, tout est fait pour expliquer que les Américains reconnaissent enfin cette dimension européenne, mais elle restera un élément complémentaire de l'organisation atlantique, et non « autonome ». L'autre question est très simple. Le président Barack Obama ne peut que se féliciter du choix de Nicolas Sarkozy, car ce qu'il souhaite aujourd'hui le plus de la France comme de tous ses alliés, c'est l'envoi de troupes supplémentaires de leur part en Afghanistan. Il s'agit de savoir si alors Paris pourra lui dire « non ». Le mur de Berlin est tombé. La singularité française est en train de suivre. Mais jusqu'à quel point ?
Jacques HUBERT-RODIER
Source : LES ECHOS
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, france, otan, atlantisme, occidentalisme, armées, défense, alliance atlantique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 mars 2009
Soutien tunisien à Ayméric Chauprade
Le soutien des Tunisiens : "Choc de civilisations" et liberté de penser
Si toute histoire n'est que narration, l'Histoire, la grande, elle aussi est une narration. Elle est faite d'agencement causal d'évènements avec la prétention de dire le réel (les évènements) et le vrai (l'agencement causal).
 L'Histoire ainsi faite influe sur le futur et détermine les rapports de forces actuels.
L'Histoire ainsi faite influe sur le futur et détermine les rapports de forces actuels.
Les attentats du 11 septembre 2001 n'échappent pas à cette logique. La restitution qu'en ont faite les autorités américaines dès les premiers jours a constitué non seulement une version officielle, mais aussi une légitimation pour des actions futures (les guerres d'Afghanistan et d'Irak) et une nouvelle politique mondiale : la lutte contre le terrorisme avec le camp du Bien et l'axe du Mal...
Et si la version officielle du 11 Septembre n'était qu'une vulgaire manipulation destinée à légitimer une nouvelle politique définie bien avant ces évènements ? C'est ce qu'on appelle habituellement "la thèse du complot", largement répercutée par la fiction américaine. Nombreux sont les films et les romans où l'on voit de sombres personnages, de préférence de la CIA ou du FBI, ourdir les machinations les plus rocambolesques pour atteindre des objectifs tortueux, un peu comme un coup d'échec, en apparence sans aucune utilité, mais qui prépare une attaque fatale une dizaine de coups plus tard.
Il y a beaucoup de points d'ombre dans la version officielle du 11 Septembre. Il y a ceux qui relèvent de la science (l'effondrement total des deux tours jumelles et d'une autre tour, la tour 47, pour des raisons assez inexplicables) et ceux relatifs à l'enquête elle-même. Il y a aussi l'imbrication prouvée
des services de renseignements israéliens dans l'environnement humain des jihadistes d'Al Qaïda chargés d'accomplir les attentats. L'important, aujourd'hui, n'est pas de statuer définitivement
sur la véracité de la version officielle et des versions "alternatives", mais de ne pas verrouiller ce champ d'investigation...
Et c'est justement de cela dont il s'agit, et en France, pays de Descartes et de Voltaire ! Aymeric Chauprade est un expert en géopolitique connu et reconnu. Il a enseigné les dix dernières années dans la prestigieuse Ecole de Guerre, dépendant du Ministère de la Défense français. Il a publié en janvier 2009 un livre "Chronique du choc des civilisations" qui lui a valu, presqu'immédiatement d'être congédié par le ministre de la Défense lui-même. Son "crime" ? C'est celui d'avoir consacré son premier chapitre à l'exposition des principales réserves sur la version officielle du 11 Septembre (Voir les bonnes feuilles du livre en page 14).
Le Professeur Chauprade n'est pas un auteur farfelu qui cherche la notoriété à n'importe quel prix. C'est un expert en géopolitique et un homme de science. Il se définit lui-même comme un conservateur classique (voir l'entretien qu'il nous a accordé en page 13). Chauprade n'adhère pas à la thèse du complot, mais il trouve que les arguments présentés contre la version officielle ne manquent pas de pertinence.
Il est évident que ce qui a aggravé le "cas Chauprade" auprès de certains grands médias français est l'implication, qui reste à déterminer, des services de renseignements israéliens dans l'entourage humain des kamikazes du 11 Septembre.
La célérité de la réaction du ministre de la Défense français est vraiment curieuse. Est-il interdit de douter dans le pays de Descartes ? Les idées émises dans le livre de Chauprade sont-elle délictueuses ? A le lire, on n'y voit ni racisme, ni diffamation, ni antisémitisme. Comment comprendre la réaction massive des grands médias pour défendre le magazine français qui a repris les caricatures danoises considérées blasphématoires par de nombreux Musulmans et le lynchage à échelle réduite d'Aymeric Chauprade ?
Y a-t-il des vérités sacrées et d'autres pas ? Le livre de Chauprade est prémonitoire, non pas à cause de ses doutes sur la version officielle du 11 Septembre, mais du titre même "Chronique du choc des civilisations" qui rappelle le célèbre livre de Samuel Huntington "Le choc des civilisations". Les intellectuels libres peuvent de moins en moins penser contre leur communauté ou leur civilisation. Un intellectuel occidental qui attaque l'Islam, même s'il frise le racisme et même si son argumentation est basée sur de fausses informations, trouve immédiatement des réseaux de solidarité et tous les grands médias revendiqueront sa liberté de penser.
Mais s'il s'attaque à certaines "vérités officielles" qui fondent la conscience occidentale, la machine médiatico-politique le broiera. Encore faut-il rappeler que la situation de l'intellectuel libre en terre d'Islam est loin d'être reluisante. Lui ne risquera pas l'omerta des médias et l'infamie publique seulement, mais aussi son intégrité physique et parfois sa vie.
Qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, le "Choc des civilisations" est en ordre de bataille. Ses premières victimes sont la liberté de penser et les intellectuels indépendants.
Zyed KRICHEN
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, censure, totalitarisme, liberté d'expression, europe, affaires européennes, maghreb, afrique du nord, liberté de penser, choc des civilisations |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 mars 2009
P. Quilès: le retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN est inutile et dangereux
Paul Quilès : Le retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN est inutile et dangereux
 Le 7 mars 1966, le général de Gaulle retirait la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est-à-dire des comités et des groupes où prenait corps l'intégration des forces armées des pays de l'Alliance atlantique. Les forces françaises étaient déliées des contraintes de la planification militaire commune et n'avaient plus à occuper des positions prédéterminées dans le dispositif de défense allié. Notre pays restait cependant tenu par les obligations de l'article 5 prévoyant une clause d'assistance mutuelle en cas d'agression.
Le 7 mars 1966, le général de Gaulle retirait la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est-à-dire des comités et des groupes où prenait corps l'intégration des forces armées des pays de l'Alliance atlantique. Les forces françaises étaient déliées des contraintes de la planification militaire commune et n'avaient plus à occuper des positions prédéterminées dans le dispositif de défense allié. Notre pays restait cependant tenu par les obligations de l'article 5 prévoyant une clause d'assistance mutuelle en cas d'agression.
Durant les années 90, si la France a réintégré le comité militaire, où se réunissent les ministres de la défense des pays membres de l'Alliance, elle est restée à l'écart de trois structures :
- le comité des plans de défense, où s'élabore la planification de défense, c'est à dire les objectifs de forces à atteindre en fonction des missions et des scénarios ;
- le commandement militaire permanent intégré, qui comprend la chaîne de commandement permanente et où s'élabore la planification opérationnelle ;
- le groupe des plans nucléaires, où les pays non‑nucléaires sont informés de la politique nucléaire suivie par les Etats‑Unis et la Grande Bretagne dans le cadre de l'OTAN.
Ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est le retour dans ces organisations, à l'exception du groupe des plans nucléaires. Déjà en 1997, J. Chirac avait tenté sans succès cette opération, les Américains refusant de céder à un général français le commandement opérationnel de Naples.
Pour justifier son choix du retour dans le commandement militaire intégré, N. Sarkozy invoque trois arguments :
1- L'influence de la France ne serait pas à la hauteur de son engagement militaire et financier et ce retour lui permettrait de gagner de l'influence, notamment pour transformer et « européaniser » l'Alliance.
Il se trouve que l'influence dans l'Alliance est liée aux capacités militaires et non au statut par rapport au commandement militaire intégré. On l'a vu en 1999, lorsque, au moment du conflit du Kosovo, la France avait plus de poids que l'Allemagne dans les décisions prises par l'Alliance.
Quant au poste de « commandant suprême allié transformation », envisagé pour la France, il peut sembler prestigieux, mais il est dans les faits secondaire. Localisé à Norfolk, en Virginie, actuellement occupé par un général américain, il a pour mission de faire évoluer le dispositif militaire de l'Alliance, pour le rendre apte à des opérations lointaines, mais ce n'est pas un commandement opérationnel. En réalité, ce sont les Etats-Unis qui détiennent l'essentiel de l'expertise et du pouvoir de décision en matière de réorganisation des forces et d'actualisation des doctrines militaires dans l'OTAN, ce qui explique la localisation de ce commandement.
Le commandement opérationnel suprême est détenu par le Saceur, dont personne n'envisage qu'il soit détenu par un autre militaire que le commandant des forces américaines en Europe. Son adjoint, le deputy Saceur, a une mission importante, puisqu'il commande les opérations de l'Europe de la défense, quand l'UE fait appel aux moyens de l'OTAN en activant les accords dits « Berlin plus », mais il est traditionnellement britannique ou allemand, par rotation. En dessous de ces commandements, on trouve celui de Brunssum, également britannique ou allemand, et surtout celui de Naples, traditionnellement dévolu aux Américains, qui conduit les opérations en Méditerranée orientale, c'est à dire en direction du Proche-Orient. C'est celui de Lisbonne, d'importance nettement moindre, qui reviendrait à un Français.
La véritable question n'est pas celle de l'influence dans l'OTAN, mais celle de la capacité d'influencer les Américains pour faire évoluer l'OTAN, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 1989, en maintenant une structure très lourde de 15 000 militaires. Quant à espérer influencer le processus de planification de défense, c'est tout simplement illusoire, parce que cette planification est en fait dictée par la doctrine d'emploi de l'armée américaine. L'européanisation de l'Alliance est donc un leurre, à l'image de la politique pratiquée par Tony Blair, qui a échoué, alors que celui-ci pensait influer sur la politique des Américains en étant leur allié le plus fidèle.
2 - le retour dans le commandement intégré serait une condition posée par nos partenaires européens pour faire progresser l'Europe de la défense.
N. Sarkozy a annoncé ce retour de manière implicite lors du « discours aux ambassadeurs » en août 2007. Depuis lors, tous nos partenaires considèrent que la décision est prise et qu'il n'est donc pas nécessaire de faire des concessions à la France pour ce qui concerne la défense européenne.
C'est pour cela que la France n'a pas pu obtenir la création d'un état-major de commandement permanent pour la PESD (politique européenne de sécurité et de défense), à laquelle se sont opposés les Britanniques. Sans cet état-major, la défense européenne n'a pas d'autonomie et dépend de la planification et des moyens collectifs de l'OTAN pour les opérations lourdes. Depuis lors, les Britanniques essaient de pousser l'idée d'une harmonisation des planifications de défense de l'OTAN et de la PESD, ce qui enlèverait toute autonomie et donc tout intérêt au processus de construction de l'Europe de la défense.
Au total, on voit que la perspective de retour de la France dans l'OTAN, loin de renforcer la PESD, l'a affaiblie et peut être même compromise définitivement.
3 - Le retour dans le commandement intégré serait un gage de la réconciliation transatlantique et permettrait à la France d'établir avec les Etats-Unis des relations de meilleure compréhension, dans le respect des intérêts de chacun.
Militairement parlant, ce retour n'a pas d'importance. Quand la France participe à une opération, des officiers français sont intégrés dans les chaînes de commandement opérationnel.
Politiquement parlant, il n'en va pas de même. L'appartenance au commandement intégré introduit une présomption de disponibilité des forces françaises « assignées » à l'OTAN. Pour une mission militaire donnée, la participation française sera supposée acquise et le rôle du contingent français largement prédéterminé. La capacité de la France à infléchir la conduite de la mission -dans une interposition au Proche-Orient, par exemple- serait réduite d'autant. On ne voit pas en quoi cette situation réduirait les « malentendus transatlantiques ».
Symboliquement surtout, l'effet serait considérable. Jusqu'ici, le statut spécifique de la France dans l'OTAN était vu, notamment dans les pays arabes, comme le symbole d'une certaine indépendance de la France par rapport aux Etats-Unis et comme la preuve d'une volonté d'autonomie de la PESD. Cette perte d'image risque donc d'affaiblir la France et l'Europe et de déséquilibrer davantage encore la relation transatlantique.
Faire le pari d'une rupture majeure de la politique étrangère des Etats-Unis, qui laisserait plus d'autonomie à l'Europe et s'engagerait vers un multilatéralisme de compromis, est hasardeux. Rien n'indique que la nouvelle administration américaine ait décidé de renoncer aux privilèges de son « leadership ». Tout en promettant les plus larges consultations au sein de l'Alliance, le Vice-président Biden ne vient‑il pas de déclarer à Munich que « les Etats-Unis agiraient en partenariat chaque fois qu'ils le pourraient, mais seuls quand ils le devraient » ? Quant à la mission de l'OTAN en Afghanistan, s'il paraît aujourd'hui acquis que les Etats-Unis demanderont aux Européens d'y contribuer plus largement, il ne semble pas qu'ils envisagent de les associer davantage aux décisions essentielles. En revenant dans les structures intégrées de l'OTAN, la France ne serait pas dans la meilleure position pour faire prévaloir, conjointement avec ses partenaires européens, les voies d'une solution politique au conflit afghan, si jamais les Etats-Unis espéraient venir à bout de la rébellion en ayant principalement recours à l'action militaire.
La décision de N. Sarkozy est donc dangereuse, parce que porteuse de risques pour la qualité des relations transatlantiques. Elle est de plus inutile, alors même que le statut de la France dans l'OTAN était accepté par les Etats-Unis et ne nuisait en rien à la relation franco‑ américaine.
Paul Quilès
Ministre socialiste de la Défense (1985-1986)
Président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale (1997-2002)
00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, europe, affaires européennes, otan, atlantisme, occidentalisme, défense, armées, etats-unis, alliance atlantique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 mars 2009
L. F. Céline: la grande attaque contre le Verbe
Louis-Ferdinand Céline : La grande attaque contre le Verbe
Il faut, dit-il, sortir les phrases de leur sens usuel, d'un écart très léger comme on déplace une porte hors de ses gonds:
"Le style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens."
Ce "labeur" exige beaucoup de doigté. Céline enchaîne immédiatement sur sa "grande attaque contre le Verbe":
"Vous savez, dans les Ecritures, il est écrit : "Au commencement était le Verbe" Non! Au commencement était l'émotion..."
Tecniquement parlant, l'auteur décrit, par l'image, les procédés grâce auxquels il fait passer le langague parlé à travers l'écrit, pour atteindre, dit-il ailleurs, "cette espèce de prose versifiée (...) de dentelle" toute "en émotion et en violence" (1), un travail aussi "éreintant" que celui du médium en transe. Il faut gauchir, "tordre la langue tout en rythme, cadence, mots"(2). "C'est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai." (3)
Les gonds et la porte sont aussi un archétype très ancien. En posant son Verbe magique en rival de celui des Ecritures, Céline ne pouvait guère faire l'impasse sur ce point. L'idée d'axe du monde, de cycle, d'ouverture et de fermeture des portes solsticiales, tout ceci est contenu dans l'image de la porte et des gonds, nommés dans l'Antiquité par le même mot "cardo", d'où dérive le terme "cardinalis" servant à désigner les quatre directions de l'espace. Dans la symbolique romane les portes désaxées figurent une atteinte à l'âme du monde et à celle de l'homme. Le Christ, que l'Evangéliste désigne par le Verbe est dit "la Vraie Porte".
[...] La "grande attaque contre le Verbe" menée par Céline a bien d'autres finalités qu'un simple retour à la pureté des origines émotives du langage. Le métro célinien est tellement contre-nature que le colonel Réséda, à l'esprit si lent, finit par céder à la panique :
"il voit le métro sur le boulevard!... là, sur le boulevard Sébastopol!... il se cramponne... (...) Les rails!... qu'il crie, lui (...) traître! les rails!... il a dévissé tous les rails!... (...) au secours! au secours! (...) il a mis des soupirs partout!... monstre anarchiste!... vendu!... traître!... traître!..."
La vision n'est pas si délirante. Elle énonce le remède. Le colonel hurle:
"C'est le métro! (...) c'est le métro!" "Sauvez-moi! sauvez-moi tous!" "Un taxi pour l'amour de Dieu!"
Dans son accès de démence, Réséda propose une sortie du métro, au jour, il achète des fleurs, "les lys, les glaïeuls, les roses", véritable antidote. La fable ne saurait se contenter de cette fin : Réséda perd ses lys; hypocritement Céline les ramasse, mais le coeur n'y est pas :
"C'est vrai, il perdait ses fleurs!... (...) il en perd encore!... j'en ramasse..."
Récapitulons: Les Entretiens avec le Professeur Y constituent une véritable parabole de l'oeuvre célinienne, de ses tropismes, et de l'envoûtement qu'elle exerce sur le lecteur. L'auteur y livre rétrospectivement la théorie et la pratique de ses écrits, tout particulièrement leur phase "au noir" constituant sa grande période créatrice. Le renversement des valeurs diurnes, symboliquement la Surface - avec majuscule - la chute active, accélérée vers le "bout de la nuit" sont exprimés par la métaphore du métro Pigalle.
L'écrivain fera basculer ses fables pseudo-biographiques dans cet "Espace Pigalle" ainsi que toute la matière substancielle de ses romans.
Le choix dit Pascalien de Céline témoigne d'une sacralité inversive. Descendre au gouffre par le "Nord-Sud", à toute vapeur, s'y boucler avec les voyageurs en un trajet strictement nocturne analogue à la navigation des morts, signifie un renversement caractéristique de substitution de la nuit au jour. Telle est la politique qui sera celle de Céline dans Voyage au bout de la nuit, métaphoriquement et intuitivement comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, puis, bien plus tard, consciemment dans les Féerie dont les allégories offrent un véritable florilège de tous les gestes de l'Oeuvre au noir, première époque célinienne.
Les Entretiens considèrent l'état mental des voyageurs-lecteurs entraînés dans l'abîme : vivre dans les ténèbres substituées au jour sous la dictature du magicien-inventeur-ferroviaire est une situation inviable, à plus forte raison si l'auteur réussit, comme il l'a fait dans Voyage, à faire passer pour naturelle cette chute aux enfers. Céline ajoute dans un entretien avec A. Zbinden :
"Et pour tout avouer, si je me suis mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas certain que ce ne soit pas volontairement. (...) Je me suis isolé, pour ainsi dire. Isolé, c'est pour être plus en face de la "chose".
[...] Il avait de quoi s'isoler volontairement face à la "chose", la redouter, lui attribuer tous les malheurs, estimer qu'ils remontent à Voyage, "le seul livre vraiment méchant" de sa carrière... (4) C'est peut-être dans cette magie noire du Verbe qu'il faut chercher le trouble que Céline inspire. C'est peut-être la perversité, le malaise, la délectation du pacte forcé avec la nuit que certains lecteurs lui pardonnent le moins.
Source : Denise Aebersold, Goétie de Céline, SEC, 2008.
Notes
1- Lettre de Céline au Dr Camus du 24 mai 1950, citée par P. Alméras, in Dictionnaire Céline, pp 802-803.
2- Lettre du 16 avril 1947 à Milton Hindus.
3- Entretien avec Claude Sarraute, Le Monde, 1/6/1960, Cahiers Céline 2.
4- Préface à une réédition de Voyage au bout de la nuit, 1949.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, france, philosophie, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 mars 2009
Retour dans l'OTAN: Bayrou réclame un référendum
Retour dans l'Otan : Bayrou réclame un référendum
Le président du Modem François Bayrou a déclaré ce dimanche, lors du lancement de sa campagne pour les européennes, que le projet de réintégrer la France dans l'Otan, serait une "défaite" pour la France et l'Europe. Il juge que c'est aux Français de trancher cette question.
 François Bayrou, président du Mouvement Démocrate (MoDem), a qualifié dimanche 8 février de "défaite" pour la France et pour l'Europe le projet de réintégration de la France dans le commandement de l'Otan, défendu par Nicolas Sarkozy, jugeant qu'un tel sujet exigeait un référendum.
François Bayrou, président du Mouvement Démocrate (MoDem), a qualifié dimanche 8 février de "défaite" pour la France et pour l'Europe le projet de réintégration de la France dans le commandement de l'Otan, défendu par Nicolas Sarkozy, jugeant qu'un tel sujet exigeait un référendum.
Tout comme l'ancien premier ministre Dominique de Villepin, François Bayrou se dit opposé au retour de la France dans le commandement de l'Otan. Lors d'une conférence nationale du MoDem à Paris, il a demandé que le choix qui avait été fait en 1966 par le général de Gaulle, de quitter la structure militaire intégrée de l'Alliance atlantique, "ne soit pas bradé, pas jeté aux orties".
Une réintégration serait "un aller sans retour", a-t-il prévenu. "Parce qu'il n'est pas imaginable qu'un grand pays comme le nôtre, à chaque alternance, entre et sorte du commandement intégré".
"Un tel choix, aussi lourd, ne peut pas se faire par les autorités politiques seules, encore moins par le président de la République. Ce choix ne peut se faire que par un référendum du peuple français", a déclaré M. Bayrou, interrogé par la presse à l'issue de la réunion.
"C'est un changement de cap radical, qui porte atteinte au patrimoine historique et diplomatique de la France, et un tel choix ne peut pas se faire en catimini, simplement par entente au sein d'une majorité passagère. Il faut que ce soit une décision majeure du peuple français", a-t-il ajouté.
En réintégrant cette structure, "nous lâchons la proie pour l'ombre", a également déclaré M. Bayrou à la tribune. "En nous alignant, nous abandonnons un élément de notre identité dans le concert des nations, y compris dans le concert des nations européennes".
"C'est une défaite pour la France", et "c'est une défaite pour l'Europe", a-t-il affirmé. "Nous abandonnons une part de notre héritage, et nous l'abandonnons pour rien".
"Quand on est intégrés, on ne compte plus", a assuré le député des Pyrénées-Atlantiques. "On peut être indépendants en étant alliés, on ne peut pas être indépendants en étant intégrés".
L'ex-candidat à la présidentielle s'en est pris également au ministre de la Défense Hervé Morin, qui fut un de ses lieutenants du temps de l'UDF.
"Il a dit : 'il faut arrêter de barguigner'. Et il a ajouté: 'notre position d'indépendance aujourd'hui, elle est purement symbolique'", a cité M. Bayrou. "Innocent !" s'est-il exclamé. "On peut en dire des bêtises, en deux phrases!".
Le président Nicolas Sarkozy a fait un nouveau pas samedi, devant la conférence sur la sécurité de Munich (sud de l'Allemagne), vers un retour complet de Paris dans l'Otan.
Source : L'EXPRESS
13:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otan, france, atlantisme, occidentalisme, alliance atlantique, armées, défense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lucien Combelle
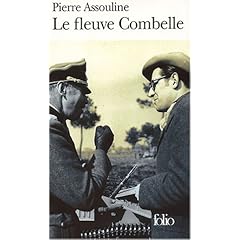
Lucien Combelle
...Voici bientôt quinze ans qu’il nous a quittés. Je n’ai dû le rencontrer qu’une ou deux fois, rue Monge où il habitait alors. C’était en compagnie de Laurence Granet qui avait soutenu, quelques années auparavant, une thèse de doctorat sur « L’idéologie fasciste dans les œuvres de Brasillach, Drieu La Rochelle, Rebatet ». Le souvenir de ces conversations s’est effacé. Je me souviens seulement du jour où, en public, il évoqua, au risque de lui nuire, son « éditeur fasciste » [sic] qui publia au début des années quatre-vingts ses souvenirs de prison. Cette sortie ne fut pas sans choquer un ami célinien qui fit cette réflexion : « Tout de même, il exagère, c’est lui qui a été fasciste ! ». Longtemps, j’ai cru que, dans son journal Révolution nationale, il s’était montré partisan d’un fascisme « libéral », je veux dire moins radical que celui prôné par ses confrères de la presse parisienne. Jusqu’à cet été 1988 où, pour annoter la correspondance que lui adressa Céline sous l’Occupation, je dépouillai, à la Bibliothèque Royale (de Belgique), la collection complète de cet hebdomadaire. Comme l’a également montré Jeannine Verdès-Leroux, qui s’est livrée au même exercice, Lucien Combelle était, bien au contraire, partisan d’un collaborationnisme sans concessions. C’est dire si Vichy n’était pas ménagé, surtout quand le régime prenait l’initiative, approuvé en cela par l’Église, de censurer en zone non occupée des écrivains jugés délétères : « Valéry, Fargue interdits. Demain Gide et Proust. Et Céline et Marcel Aymé. Et Montherlant. La France officielle semble vouloir retrouver sa beauté en avalant la jouvence de l’abbé Soury, et soigner ses blessures avec de l’eau bénite »¹. On n’est donc pas étonné de le voir dénoncer ensuite l’une des plus hautes autorités du clergé français, « Mgr Gerlier, primat des Gaules – quelle fâcheuse consonance ! – qui se permet de jouer au conseiller d’État et se mêler aux affaires de César. Monseigneur n’aime point l’antisémitisme. Monseigneur n’est pas révolutionnaire. (…) Il est démocrate et pluraliste, comme on dit. Bref, Monseigneur est, à sa manière, un dissident » ². Fustigeant le chef de l’Action française, Combelle n’y allait pas davantage de main morte : « M. Maurras a été antisémite et antidémocrate pour son bonheur et pour le nôtre. Mais, pour son malheur et pour celui de la France, M. Maurras reste germanophobe. La France, pour lui, c’est le félibrige » ³. « Révolution » est sans doute le mot qui revient alors le plus souvent sous sa plume : « Nous sommes, ou les acteurs, ou les témoins, selon une bonne ou une mauvaise fortune, d’une révolution mondiale, d’une révolution qui est née très exactement sur notre continent, dans cette Europe qui, pour notre orgueil, continue à étonner le monde » 4. « Grand garçon, intelligent, très cultivé, avec l’esprit caustique, bon avec les copains, plutôt désagréable avec ceux qui lui avaient fait dans les bottes, Combelle cultivait une pointe de cynisme » 5 : c’est ainsi que le décrit Henry Charbonneau, venu, comme lui, de l’Action française.
Après la guerre, Lucien Combelle présentera naturellement un profil nettement moins tranché. Ainsi, lors de l’émission « Apostrophes » (1978), il évoqua le « jeune fasciste sincère, de bonne foi et naïf » qu’il fut. C’est seulement chez le juge d’instruction, ajouta-t-il, qu’il découvrit ce qu’est la responsabilité des intellectuels. Philippe Alméras, qui l’avait rencontré, lui aussi, dans les années quatre-vingts, garde le souvenir de sa grande prudence : « Comme tous les ébouillantés de la Libération, il craignait l’eau froide 6 ». Céline entretint avec lui une relation du même type (un peu paternelle) que celle qu’il noua avec Henri Poulain, le secrétaire de rédaction de Je suis partout. D’une vingtaine d’années leur aîné, il ne craignait pas de les morigéner dès que paraissait dans leur journal respectif un article qu’il désapprouvait. Ainsi, à propos de cet éditorial sur (ou plutôt contre) Maurras : « Combelle fait l’enfant. Il sait aussi bien que moi l’origine de l’horreur de Maurras pour l’Allemagne – le Racisme 7. » Ou à propos d’un compte rendu du livre, Pétition pour l’histoire, d’Anatole de Monzie : « Tu dédouanes Monzie à présent et son histoire ? La merde est à ton goût ! Rien de plus pourri que ce vieux pitre – membre de la Ligue des Droits de l’Homme – membre de la Lica – grand ami de Lecache et Jean Zay ! » 8. Les exemples sont nombreux… Contrairement à Poulain, exilé en Suisse, Combelle reverra Céline. C’est seulement à la parution d’Un château l’autre qu’il reprit contact. « Tout ceci ne nous rajeunit pas ! » 9, lui répond Céline, une dizaine d’années après la tourmente qui les vit embastillés l’un à Copenhague, l’autre à Fresnes.
Marc LAUDELOUT
Notes
1. Lucien Combelle, « Avec ou sans prières », Révolution nationale, 22 août 1942.
2. Id., « Où en sommes-nous ? », Révolution nationale, 26 septembre 1942.
3. Id., « La France de M. Maurras », Révolution nationale, 31 mai 1942.
4. Id., « Ceci commande cela », Révolution nationale, 8 mai 1943.
5. Henry Charbonneau, Les mémoires de Porthos, La Librairie française, 1981 (rééd.).
6. Philippe Alméras, « Lucien Combelle relaps », Le Bulletin célinien, janvier 2006.
7. Lettre du 31 mai 1942 in L’Année Céline 1995, Du Lérot-Imec Éditions, 1996, p. 122.
8. Lettre du 21 août 1942, Ibidem, p. 127.
9. Lettre du 12 août 1957, Ibid., p. 154.
Bibliographie
Lucien Combelle est l’auteur de six livres : Je dois à André Gide (Frédéric Chambriand, 1951) ; Chansons du Mirador (Frédéric Chambriand, 1951) ; Prisons de l’espérance (ETL, 1952) ; Louis Renault ou un demi-siècle d’automobile française (La Table ronde, 1954) [signé d’un pseudonyme : Lucien Dauvergne] ; Péché d’orgueil (Olivier Orban, 1978) et Liberté à huis clos (La Butte aux cailles, 1983). Sous le titre « Céline, le pérégrin », il a préfacé un recueil de textes de Céline (Le style contre les idées, Complexe, 1987). Il a également écrit le scénario d’une bande dessinée de José Fernandez Bielsa, Quand les héros étaient des dieux (Dargaud, 1969). Au début des années 80, il avait l’intention d’écrire, en collaboration avec Laurence Granet, un Panorama des écrivains de l’Occupation ; le projet n’a pas abouti. En 1997, Pierre Assouline lui a consacré un livre, Le fleuve Combelle (Calmann-Lévy). L’année suivante, Lucien Combelle lui accorda une série de cinq entretiens dans le cadre de l’émission À voix nue sur les ondes de France-Culture (25-29 juillet 1998). Le 1er décembre 1978, à l’occasion de la parution de son livre de souvenirs, Péché d’orgueil, il participa – aux côtés de Henri Amouroux, Raymond Bruckberger, Jean-Luc Maxence et Dominique Desanti – à l’émission Apostrophes de Bernard Pivot sur le thème « Les intellectuels et la collaboration ». Il donna également son témoignage dans le film documentaire d’Alain de Sédouy et Guy Seligmann, Paris l’outragée (Antenne 2, 1989). On trouvera dans L’Année Céline 1995 (Du Lérot, 1996) la correspondance que lui adressa Céline, présentée et annotée par Éric Mazet. Plusieurs ouvrages retracent brièvement son itinéraire : Dictionnaire Céline de Philippe Alméras (Plon, 2004), Dictionnaire commenté de la Collaboration française de Philippe Randa (Jean Picollec, 1997) et Histoire de la Collaboration de Dominique Venner (Pygmalion, 2000). Sur son activité sous l’Occupation, on lira le livre de Jeannine Verdès-Leroux, Refus et violences. Politique et littérature à l’extrême droite des années trente aux retombées de la Libération (Gallimard, 1996), qui s’appuie sur une lecture de ses articles de l’Occupation.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, années 30, années 40, épuration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 mars 2009
L'Alsace en Europe
L’Alsace en Europe: Rives du Rhin ou plateau lorrain, il faut choisir!

Parmi les mesures qui devraient être rendues publiques figurerait le regroupement - sur des bases à priori volontaires - de quelques-unes des 22 régions actuelles qui ne devraient plus à l’avenir en former que 15 dans le but de leur donner “une dimension européenne”.
C’est ainsi que serait envisagé le regroupement des actuelles régions Alsace et Lorraine au sein d’une super région du Grand Est.
Une telle proposition reflète le tropisme franco-parisien de ses auteurs tout comme la méconnaissance des réalités régionales et européennes.
L’observation de ce qui se passe chez nos proches voisins européens nous montre au contraire que la viabilité d’une région, d’un Land allemand ou d’un canton suisse, n’est pas fonction de l’importance de sa superficie ni de sa population, mais de son homogénéité et des atouts liés à sa situation géographique comme à la présence sur son territoire d’activités économiques à forte valeur ajoutée, et à son rayonnement culturel.
C’est le cas de la Freie und hansestadt Hamburg, la ville libre et hanséatique de Hambourg, qui avec ses 1,8 M d’habitants et ses 755 km² est le premier des 16 Länder allemands pour le PIB par habitant.
Plus grand port d’Allemagne et deuxième port européen, la Ville-Etat d’Hambourg a su depuis la fin de la guerre se spécialiser dans les domaines de la chimie, de la construction aéronautique et navale, et est devenu un leader en matière de technique médicale et de biotechnologie, tout en développant un fort secteur des services.
Plus proche de nous la prospérité du canton de Bâle-Ville, le plus petit des cantons suisses avec ses 190 000 habitants et ses 37 km², vient encore contredire le raisonnement du Comité Balladur.
Vouloir noyer l’Alsace dans un hypothétique Grand Est reviendrait en fait à nous couper de l’espace du Rhin Supérieur qui est notre espace de vie et de développement naturel et historique, et à nous éloigner du centre économique européen qui court de l’Italie du Nord jusqu’à Londres en passant par la vallée du Rhin et la Ruhr sous la dénomination de Banane Bleue.
Il est urgent que ces réalités reviennent à l’esprit des grands élus alsaciens et que la dimension régionale et européenne de l’Alsace l’emporte sur la logique nationale.
La clé de la prospérité de l’Alsace et son avenir se trouvent sur les deux rives du Rhin, pas sur le plateau lorrain.
Article printed from :: Novopress.info Alsace / Elsass: http://alsace.novopress.info
URL to article: http://alsace.novopress.info/?p=803
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, régions, régionalisme, autonomisme, alsace, france, collectivités locales, balladur |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 février 2009
Zeev Sternhell, historiographe du fascisme
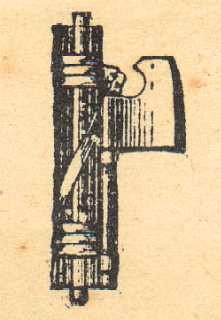
SYNERGIES EUROPÉENNES - CRITICON (Munich) - IDHUNA (Genève) - Août 1986
Armin MOHLER:
Zeev Sternhell, nouvel historiographe du fascisme
Un livre, paru à Paris en 1983, a complètement bouleversé l'historiographie du fascisme. Ce livre porte le titre de: Ni droite ni gauche. L'idéologie du fascisme en France. Gros de 412 pages, il est publié par les éditions du Seuil, maison pourtant connue pour ses tendances de gauche.
L'auteur, Zeev Sternhell, professeur de politologie à l'Université Hébraïque de Jérusalem, est né en Pologne en 1935. Il est actuellement le Directeur du "Centre d'Etudes Européennes" et, peu avant la parution de Ni droite ni gauche, il avait fondé le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Civilisation Française.
Son livre est très dense. Il abonde en outre de répétitions car, ce qui importe pour Sternhell, homme au tempérament fougueux, c'est d'inculquer au lecteur certains jugements inhabituels. Mais il serait erroné de lui reprocher l'emploi de "concepts vagues". A l'opposé du spécialiste jusqu'ici accrédité de l'étude du fascisme, Ernst Nolte, Sternhell n'a pas reçu de formation philosophique. Il est un authentique historien qui se préoccupe de recenser le passé. Pour lui, chaque réalité historique est "irisable", on ne peut la ramener à un seul concept, il faut en considérer les diverses facettes. Dès lors, contrairement à Nolte, Sternhell ne construit pas un schéma abstrait du fascisme, dans lequel il conviendra d'enserrer ensuite les phénomènes concrets. Il renvoie de préférence ces phénomènes à toute une variété de concepts qu'il puise toutefois dans le vocabulaire politique traditionnel, afin de les cerner et de les localiser.
S'il entre dans notre propos de résumer ici un ouvrage aussi complexe, notre exposé ne pourra cependant pas remplacer la lecture de ce livre. Il en est plutôt l'introduction.
1. Qui est Zeev Sternhell?
1.1. Indubitablement, il est un authentique homme de gauche. Le journal Le Monde (14.1.1983) déclare à son sujet: Sternhell entra en mai 1977, après la victoire électorale de Begin et la chute du Parti Travailliste, dans la vie politique israëlienne. Il créa le Club 77, un rassemblement d'intellectuels de l'aile d'extrême-gauche du Parti Travailliste. Ce Club s'engagea dans une politique de modération envers le monde arabe et milita pour l'évacuation de la Cisjordanie; en matière de politique interne, il chercha à favoriser une politique aussi "socialiste" que possible, c'est-à-dire accordant le maximum d'égalité. Au sein du Parti Travailliste, Sternhell fait partie d'une minorité, tout en étant membre du Comité Exécutif".
1.2. Sternhell est un "gramsciste". A l'instar de toute la gauche revendicatrice et contestatrice de sa génération, il s'est libéré de l'orthodoxie marxiste. Il rejette expressément la conception matérialiste de l'histoire (pp.18-19).
A la suite de Gramsci (et a fortiori de l'inspirateur de ce communiste italien, Georges Sorel), Sternhell se rallie à la conception historiographico-philosophique qui veut que les idées ne soient pas le reflet des réalités, mais l'inverse.
1.3. Le point de départ de la démarche de Sternhell: le révisionnisme. Le fait que Sternhell se soit consacré à l'étude du fascisme s'explique sans aucun doute par son intérêt pour la biographie des révisionnistes, ceux qui ont tenté de changer et de réformer le marxisme orthodoxe. De Ni droite ni gauche, il ressort que le révisionnisme de "droite" (p.35) ou révisionnisme "libéral" (p.81), qui mène à des alliances et des compromissions avec le libéralisme bourgeois et qu'incarne un Eduard Bernstein (en France, Jaurès) fascine moins Sternhell que le révisionnisme de "gauche" (p.290), mouvement amorcé par Sorel et les syndicalistes révolutionnaires qui refusaient les "ramollissements" du socialisme et passèrent ultérieurement au fascisme. Sternhell s'intéresse en particulier à un nouveau courant socialiste d'alors qui, dépassant l'opposition Sorel/Bernstein, vit le jour au lendemain de la Grande Guerre: le révisionnisme "planiste" ou "technocratique" (p.36) du socialiste belge Henri De Man et du néo-socialiste français Marcel Déat. Ce révisionnisme-là aboutit directement au fascisme.
1.4. Sternhell contre le fascisme de salon. L'orientation "socialiste", qui sous-tend l'étude de Sternhell sur la problématique du fascisme, se traduit par le peu d'intérêt marqué pour les formes de fascismes philosophiques ou littéraires. Trait caractéristique: Sternhell ne mentionne nulle part les deux écrivains les plus importants appartenant au fascisme, Céline et Rebatet. Et Sternhell néglige encore d'autres aspects du fascisme de salon, du fascisme des penseurs "qui finissent leur vie en habit vert" (p.22). Vu les multiples facettes du fascisme français (et européen)(p.21), Sternhell s'adjuge le droit de poser une analyse pars pro toto: il prétend se consacrer en ordre principal à l'étude de secteurs négligés jusqu'ici (p.9).
2. La France, modèle du fascisme?
2.1. Pourquoi la France? Le livre de Sternhell veut développer une définition du "fascisme" en se basant sur l'exemple français. Cette intention peut étonner. La France, en effet, si l'on excepte l'intermède de l'occupation allemande, n'a jamais connu un régime qualifiable de "fasciste". L'Italie, l'Allemagne voire l'Espagne seraient à cet égard de meilleurs exemples. Mais Sternhell, nous allons le voir, déploie de très sérieux arguments pour justifier son choix.
2.2. Les études antérieures de Sternhell. Ces arguments, pour nous, ne sauraient se déduire des travaux antérieurs de Sternhell, qui portaient tous sur la France. Dès le départ, il orienta son attention vers le fascisme, même s'il l'on peut supposer qu'un changement de perspective aurait pu se produire et lui faire choisir un autre territoire de recherches. Ce que Sternhell découvrit très tôt dans ces secteurs délaissés par la recherche qu'il se trouvait sur la bonne voie. Deux livres aussi copieux avait précédé Ni gauche ni droite. Le premier s'intitulait Maurice Barrès et le nationalisme français (1972). Le second, La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme (1978), traitait de la même époque historique, mais le grand thème de Sternhell, le fascisme, apparaissait pour la première fois dans le sous-titre. La recherche a imméditament considéré ces deux ouvrages comme des classiques. Les sujets de ces livres sont à la fois plus sectoriels et plus généraux que la thématique du troisième, que nous commentons ici. Dans Ni gauche ni droite, Sternhell cherche à forger un classification globale et détaillée du phénomène fasciste qu'il entend maîtriser conceptuellement.
2.3. La France a inventé le fascisme. Le premier argument de Sternhell, pour situer le champ de ses recherches en France, c'est que ce pays a vu naître le fascisme vingt ans avant les autres, notamment vers 1885 (p.41). Sternhell n'emploie qu'occasionnelle- ment le terme de "pré-fascisme" pour qualifier les événements entre 1885 et 1914 (p.21). Une figure comme celle de Maurice Barrès portait déjà en elle les germes de tout le fascisme ultérieur. Et quand j'ai énoncer la même hypothèse en 1958, je me suis heurté à une surprenante incompréhension de la part des experts français...
2.4. La France comme contre-modèle. Le second argument qu'avance Sternhell est plus complexe. Il contourne deux écueils. Parmi les grands pays de l'Europe continentale, la France est celui où la position dominante de l'idéologie et de la praxis politique du libéralisme a été la moins menacée, du moins jusqu'à la défaite militaire de 1940 (p.41). Sternhell souligne (p.42) le fait que la révolution libérale la plus importante et la plus exemplaire de l'histoire s'est déroulée dans ce pays et attire notre attention sur les phénomènes du "consensus républicain" (p.43) et du "consensus centriste" (p.52) qui sont les clés de voûte de l'histoire française contemporaine. C'est précisément à cause de ces inébranlables consensus que Sternhell opte pour la France comme champ d'investigation. Car le fascisme, en France, n'est jamais parvenu au pouvoir (p.293) et, écrit Sternhell, "le fascisme n'y a jamais dépassé le stade de la théorie et n'a jamais souffert des compromissions inévitables qui faussent toujours d'une façon ou d'une autre l'idéologie officielle d'un régime. Ainsi on pénètre sa signification profonde et, en saisissant l'idéologie fasciste à ses origines, dans son processus d'incubation, on aboutit à une perception plus fidèle des mentalités et des comportements. Et on comprend mieux, semble-t-il, la complexité des situations et l'ambiguïté des attitudes qui font le tissu des années trente". C'est là, de toute évidence, un principe heuristique, dérivé d'une option radicalement gramsciste qui pose le primat des idées et réfute celui des contraintes factuelles.
3. Les problèmes de "périodisation"
3.1. Impossibilité de poser des datations exactes. Comme doit le faire tout véritable historien, Sternhell fait varier légèrement les dates. Mis à part pour les événements ponctuels, il n'est pas aisé de fournir des dates précises, bien délimitées dans le temps, pour désigner l'émergeance ou l'assomption d'un courant d'idées politiques. C'est pourquoi Sternhell examine le phénomène "fasciste" dans l'espace d'un demi-siècle.
3.2. Continuité entre 1885 et 1940. Fait essentiel pour Sternhell: cette période est "dans l'histoire de l'Europe, une période véritablement révolutionnai- re". Et il poursuit: "En moins d'un demi-siècle, les réalités sociales, le mode de vie, le niveau technologique et, à beaucoup d'égards, la vision que se font les hommes d'eux-mêmes changent plus profondément qu'à aucun autre moment de l'histoire moderne" (p.45). Dès lors, cette période forme une unité, si toutefois l'on met entre parenthèses les quatre années de la Grande Guerre (pp.19 et 290). Et Sternhell l'écrit expressément: "Au cours de ce demi-siècle, les problèmes de fond n'ont guère varié" (p.60).
3.3. Trois générations. Bien qu'il soit conscient de cette continuité, Sternhell procède cenpendant à des subdivisions dans le temps; ainsi, par exemple, quand il parle des "fascistes de 1913" comme des fascistes d'un type particulier. Il distingue trois générations de fascistes (cf. pp. 30, 52 et 60): d'abord les boulangistes et les anti-dreyfusards de la fin des années 80; ensuite, avant 1914, ceux de la "deuxième génération", celle du mouvement des "Jaunes" dans le monde ouvrier et de l'Action Française de Maurras, qui atteint alors son apogée; en finale, il évoque, comme troisième génération, le "fascisme d'après-guerre".
3.4. Le poids d'une époque. Il est à remarquer que Sternhell accorde nettement plus de poids aux premières décennies de l'époque qu'il étudie. Pour lui, sur le plan qualitatif, les années qui précèdent la Grande Guerre revêtent davantage d'importance que les décennies qui les suivirent car, dans cette avant-guerre, tout ce qui est essentiel dans l'élaboration du fascisme doctrinal a été dit et mis en œuvre.
4. Prolégomènes du fascisme
4.1. Refus de prendre en considération les groupuscules excentriques. Sternhell s'intéresse aux "propagateurs d'idées". Il ne ressent aucune envie de perdre son temps à étudier ce fascisme folklorique de quelques illuminés qui jouent aux brigands, fascisme caricatural dont les médias font leurs choux gras. Il n'a que mépris pour ceux qui axent leurs recherches sur ce type de phénomènes marginaux (p.9): "A l'époque déjà, quand un groupe de la Solidarité française se fait photographier à l'entraînement au pistolet, toute la presse de gauche en parle pendant des semaines: un quelconque défilé de quelques dizaines de "chemises bleues" soulève alors beaucoup plus d'intérêt que le patient travail de sape d'un Thierry Maulnier ou d'un Bertrand de Jouvenel...".
4.2. Le fascisme, une idéologie comme les autres. Sternhell parle de la "banalité du fascisme" (p.296): "Dans les années trente, le fascisme constitue une idéologie politique comme les autres, une option politique légitime, un état d'esprit assez courant, bien au-delà des cercles restreints qui assument leur identité fasciste...". Selon Sternhell, le fascisme était "un phénomène possédant un degré propre d'autonomie, d'indépendance intellectuelle" (p.16). Il s'élève contre "le refus fondamental de voir dans le fascisme autre chose qu'un accident de l'histoire européenne" (p.18). Pour Sternhell donc, c'est une erreur de ne considérer le fascisme que comme "une simple aberration, un accident, sinon un accès de folie collective..." (p.18). A la fin de son ouvrage (p.296), Sternhell nous met en garde contre ceux qui propagent l'opinion que les fascistes n'étaient que des "marginaux". Nombreux sont les "fascistes" qui ont été jugés, par leurs contemporains, comme les "plus brillants représentants de leur génération" (Luchaire, Bergery, Marion, de Jouvenel).
4.3. Les courroies de transmission. "L'idéologie fasciste constitue, en France, un phénomène de loin plus diffus que le cadre restreint et finalement peu important des adhérents aux groupuscules qui s'affublent de ce titre" (p.310). Deux pages plus loin, Sternhell explique comment il s'est fait que "l'idée fasciste" ait pu se propager dans un milieu si prêt à recevoir son message: "Les fascistes purs furent toujours peu nombreux et leurs forces dispersées. Leur influence véritable s'exercera par une contribution continue à la cristallisation d'un certain climat intellectuel; par le jeu des courroies de transmissions secondaires: des hommes, des mouvements, des revues, des cercles d'études,..." (p.312).
4.4. Difficulté de situer sociologiquement le fascisme. Sternhell insiste sur le fait que le fascisme "prolifère aussi bien dans les grands centres industriels de l'Europe occidentale que dans les pays sous-développés d'Europe de l'Est" (p.17). Et il aime se moquer de ceux qui croient pouvoir ranger le fascisme dans des catégories sociales bien déterminées. Il est significatif que Sternhell attire notre attention sur une constante de l'histoire des fascismes: "le glissement à droite d'éléments socialement avancés mais fondamentalement opposés à la démocratie libérale" (p.29). Si cette remarque se vérifie, elle s'opposera à toutes les tentatives de rattacher l'idéologie fasciste à des groupes sociaux trop bien définis.
4.5. Pour expliquer le fascisme: ni crises économiques ni guerres. Ce qui m'a frappé aussi chez Sternhell, c'est l'insistance qu'il met à montrer la relative indépendance du fascisme vis-à-vis de la conjoncture (pp.18 et 290). Il ne croit pas que la naissance du fascisme soit due à la pression de crises économiques et, assez étonnamment, estime que la première Guerre mondiale (ou tout autre conflit) a eu peu d'influence sur l'émergence du phénomène. En ce sens, Sternhell s'oppose à la majorité des experts ès-fascisme (pp.96 et 101). C'est dans cette thèse, précisément, que se manifeste clairement l'option "gramsciste" de Sternhell, nonobstant le fait que jamais le nom de Gramsci n'apparaît dans l'œuvre du professeur israëlien. Sternhell ne prend les "crises" au sérieux que lorsqu'il s'agit de crises morales, de crises des valeurs ou de crise globale, affectant une civilisation dans son ensemble.
4.6. "Auschwitz" en tant qu'argument-massue n'apparaît nulle part. Sternhell fait preuve d'une étonnante objectivité, ce qui est particulièrement rare dans les études sur le fascisme. Mais une telle attitude semble apparemment plus facile à adopter en Israël qu'à New York ou à Zurich. Ainsi, Sternhell n'hésite pas à reconnaître au fascisme "une certaine fraîcheur contestataire, une certaine saveur de jeunesse" (p.80). Il renonce à toute pédagogie moralisatrice. Mais il est très conscient du "problème de la mémoire", mémoire réprimée et refoulée; il l'évoquera notamment à propos de certaines figures au passé fasciste ou fascisant qui, après 1945, ont opté pour la réinsertion en se faisant les porte-paroles du libéralisme: Bertrand de Jouvenel (p.11), Thierry Maulnier (p.12) et surtout le philosophe du personnalisme, fondateur de la revue Esprit , Emmanuel Mounier (pp 299 à 310).
5. La formule du fascisme chez Sternhell
5.1. Les carences du libéralisme et du marxisme. Après cette introduction, nous sommes désormais en mesure d'expliciter l'alchimie du fascisme selon Sternhell. Pour cet historien israëlien, le fascisme s'explique en fonction d'un préliminaire historique, sans lequel il serait incompréhensible: l'incapacité du libéralisme bourgeois et du marxisme à assumer les tâches imposées par le XXème siècle.Cette incapacité constitue une carence globale, affectant toute notre civilisation, notamment toutes les institutions, les idéologies, les convictions qu'elle doit au XVIIIème, siècle du rationalisme et du mécanicisme bourgeois. Libéralisme et marxisme sont pour Sternhell les deux faces d'une même médaille. Inlassablement, il souligne que la crise de l'ordre libéral a précédé le fascisme, que cette crise a créé un vide où le fascisme a pu se constituer. Fallait-il nécessairement que ce fascisme advienne? Sternhell ne se prononce pas, mais toute sa démonstration suggère que cette nécessité était inéluctable.
5.2. Révisionnistes de gauche et nationalistes déçus. Généralement, pour expliquer la naissance du fascisme, on évoque la présence préalable d'un nationalisme particulièrement radical et exacerbé. Sternhell, lui, trouve cette explication absurde. D'après le modèle explicatif qu'il nous suggère, l'origine du fascisme s'explique bien davantage par le fait qu'aux extrémités, tant à gauche qu'à droite, du spectre politique, des éléments se sont détachés pour se retrouver en dehors de ce spectre et former un troisième et nouvel élément qui n'est plus ni de gauche ni de droite. Dans la genèse du fascisme, Sternhell n'aperçoit aucun apport appréciable en provenance du centre libéral. D'après lui, le fascisme résulte de la collusion de radicaux de gauche, qui n'admettent pas les compromis des modérés de leur univers politique avec le centre mou libéral, et de radicaux de droite. Le fascisme est, par suite, un amalgame de désillusionnés de gauche et de désillusionnés de droite, de "révisionnistes" de gauche et de droite. Ce qui paraît important aux yeux de Sternhell, c'est que le fascisme se situe hors du réseau traditionnel gauche/centre/droite. Dans l'optique des fascistes, le capitalisme libéral et le socialisme marxiste ne s'affrontent qu'en apparence. En réalité, ils sont les deux faces d'une même médaille. L'opposition entre la "gauche" et la "droite" doit disparaître, afin qu'hommes de gauche et hommes de droite ne soient plus exploités comme chiens de garde des intérêts de la bourgeoisie libérale (p.33). C'est pourquoi la fin du XIXème siècle voit apparaître de plus en plus de notions apparemment paradoxales qui indiquent une fusion des oppositions en vigueur jusqu'alors. L'exemple le plus connu de cette fusion est la formule interchangeable: nationalisme social / socialisme national. Sternhell (p.291) insiste sur la volonté d'aller "au-delà", comme caractéristique du climat fasciste. Le terme "au-delà" se retrouve dans les titres de nombreux manifestes fascistes ou préfascistes: "Au-delà du nationalisme" (Thierry Maulnier), "Au-delà du marxisme" (Henri De Man), "Au-delà du capitalisme et du socialisme" (Arturo Labriola), "Au-delà de la démocratie" (Hubert Lagardelle). Ce dernier titre nous rappelle que le concept de "démocratie" recouvrait le concept de "libéralisme" jusque tard dans le XXème siècle. Chez Sternhell également, le concept de "capitalisme libéral" alterne avec "démocratie capitaliste" (p.27).
5.3. L'anti-ploutocratisme. L'homme de gauche qu'est Sternhell prend les manifestations sociales-révolutionnaires du fascisme plus au sérieux que la plupart des autres analystes, historiens et sociologues de son camp. Si Sternhell avait entrepris une étude plus poussée des courants philosophiques et littéraires de la fin du XIXème, il aurait découvert que la haine envers la "domination de l'argent", envers la ploutocratie, participait d'un vaste courant à l'époque, courant qui débordait largement le camp socialiste. Cette répulsion à l'encontre de la ploutocratie a été, bien sûr, un ferment très actif dans la gestation du fascisme. De nombreux groupes fascistes s'aperçurent que l'antisémitisme constituait une vulgarisation de cette répugnance, apte à ébranler les masses. L'antisémitisme, ainsi, offrait la possibilité de fusionner le double front fasciste, dirigé simultanément contre le libéralisme bourgeois et le socialisme marxiste, en une unique représentation de l'ennemi. Parallèlement, cette hostilité envers la ploutocratie pré-programmait très naturellement le conflit qui allait opposer fascistes et conservateurs.
5.4. La longue lutte entre conservateurs et fascistes. Vu la définition du fascisme qu'esquisse Sternhell, il n'est guère étonnant qu'il parle d'une "longue lutte entre la droite et le fascisme" (p.20) comme d'une caractéristique bien distincte, quoiqu'aujourd'hui méconnue, de l'époque et des situations qu'il décrit. Et il remarque: "Il en est d'ailleurs ainsi partout en Europe: les fascistes ne parviennent jamais à ébranler véritablement les assises de l'ordre bourgeois. A Paris comme à Vichy, à Rome comme à Vienne, à Bucarest, à Londres, à Oslo ou à Madrid, les conservateurs savent parfaitement bien ce qui les sépare des fascistes et ils ne sont pas dupes d'une propagande visant à les assimiler" (p.20). Aussi Sternhell s'oppose-t-il (p.40) clairement à la classification conventionnelle de la droite française, opérée par René Rémond, qui l'avait répartie en trois camps: les ultras, les libéraux-conservateurs et les bonapartistes. Il n'y a, en fait, jamais eu que deux camps de droite, les libéraux et les conservateurs, auxquels se sont opposés les révolutionnaires, les dissidents et les contestataires.
5.5. A la fois révolutionnaires et modernes. Avec ces deux termes, utilisés par Sternhell pour désigner le fascisme, l'historien israëlien a choqué ses collègues politologues. Pour lui, en effet, le fascisme est un phénomène réellement révolutionnaire et résolument moderne. "Une idéologie conçue comme l'antithèse du libéralisme et de l'individualisme est une idéologie révolutionnaire". Plus loin (p.35), Sternhell expose l'idée, d'après lui typiquement fasciste, selon laquelle le facteur révolutionnaire qui, en finale, annihile la démocratie libérale est non pas le prolétariat, mais la nation. Et il ajoute: "C'est ainsi que la nation devient l'agent privilégié de la révolution" (p.35). Les passages évoquant le modernisme du fascisme sont tout aussi surprenants. A propos d'un de ces passages (p.294), on pourrait remarquer que cette attribution de modernisme ne concerne que les fascismes italien et français:"Car le fascisme possède un côté moderniste très développé qui contribue à creuser le fossé avec le vieux monde conservateur. Un poème de Marinetti, une œuvre de Le Corbusier sont immédiatement adoptés par les fascistes, car, mieux qu'une dissertation littéraire, ils symbolisent tout ce qui sépare l'avenir révolutionnaire du passé bourgeois". Un autre passage s'adresse clairement au fascisme dans son ensemble: "L'histoire du fascisme est donc à beaucoup d'égard l'histoire d'une volonté de modernisation, de rajeunissement et d'adaptation de systèmes et de théories politiques hérités du siècle précédent aux nécessités et impératifs du monde moderne. Conséquence d'une crise générale dont les symptômes apparaissent clairement dès la fin du siècle dernier, le fascisme se structure à travers toute l'Europe. Les fascistes sont tous parfaitement convaincus du caractère universel du courant qui les guide, et leur confiance dans l'avenir est dès lors inébranlable".
6. Eléments particuliers de l'idéologie fasciste
6.1. L'anti-matérialisme. Puisque, pour Zeev Sternhell, le fascisme n'est pas simplement le produit d'une mode politique, mais une doctrine, il va lui attribuer certains contenus intellectuels. Mais comme ces contenus intellectuels se retrouvent également en dehors du fascisme, ce qui constitue concrètement le fascisme, c'est une concentration d'éléments souvent très hétérogènes en une unité efficace. Citons les principaux éléments de cette synthèse. Sternhelle met principalement l'accent sur l'anti-matérialisme (pp. 291 & 293): "Cette idéologie constitue avant tout un refus du matérialisme, c'est-à-dire de l'essentiel de l'héritage intellectuel sur lequel vit l'Europe depuis le XVIIème siècle. C'est bien cette révolte contre le matérialisme qui permet la convergence du nationalisme antilibéral et antibourgeois et de cette variante du socialisme qui, tout en rejetant le marxisme, reste révolutionnaire...Tout anti-matérialisme n'est pas fascisme, mais le fascisme constitue une variété d'anti-matérialisme et canalise tous les courants essentiels de l'anti-matérialisme du XXème siècle...". Sternhell cite également les autres éléments de l'héritage auquel s'oppose le fascisme: le rationalisme, l'individualisme, l'utilitarisme, le positivisme (p.40). Cette opposition indique que cet anti-matérialisme est dirigé contre toute hypothèse qui voudrait que l'homme soit conditionné par des données économiques. C'est quand Sternhell parle de la psychologie que l'on aperçoit le plus clairement cette opposition. Ainsi, il relève (p. 294) que les "moralistes" Sorel, Berth et Michels "rejettent le matérialisme historique qu'ils remplacent par une explication d'ordre psychologique". "Finalement", poursuit Sternhell, "ils aboutissent à un socialisme dont les rapports avec le prolétariat cessent d'être essentiels".Et il insiste: "Le socialisme commence ainsi, dès le début du siècle, à s'élargir pour devenir un socialisme pour tous, un socialisme pour la collectivité dans son ensemble,..." (p. 295). Plus explicite encore est un passage relatif au révisionnisme de Henri De Man, qui, lui, cherche la cause première de la lutte des classes "moins dans des oppositions d'ordre économique que dans des oppositions d'ordre psychologique".
6.2. Les déterminations. Il serait pourtant faux d'affirmer que, pour le fascisme, l'homme ne subit aucune espèce de détermination. Pour les intellectuels fascistes, ces déterminations ne sont tout simplement pas de nature "mécanique"; entendons par là, de nature "économique". Comme l'indique Sternhell, le fasciste ne considère pas l'homme comme un individu isolé, mais comme un être soumis à des contraintes d'ordres historique, psychologique et biologique. De là, la vision fasciste de la nation et du socialisme. La nation ne peut dès lors qu'être comprise comme "la grande force montante, dans toutes ses classes rassemblées" (p. 32). Quant au socialisme, le fasciste ne peut se le représenter que comme un "socialisme pour tous", un "socialisme éternel", un "socialisme pédagogique", un "socialisme de toujours", bref un socialisme qui ne se trouve plus lié à une structure sociale déterminée (Cf. pp. 32 & 295).
6.3. Le pessimisme. Sternhell considère comme traits les plus caractéristiques du fascisme "sa vision de l'homme comme mu par des forces inconscientes, sa conception pessimiste de l'immuabilité de la nature humaine, facteurs qui mènent à une saisie statique de l'histoire: étant donné que les motivations psychologiques restent les mêmes, la conduite de l'homme ne se modifie jamais". Pour appuyer cette considération, Sternhell cite la définition du pessimisme selon Sorel: "cette doctrine sans laquelle rien de très haut ne s'est fait dans le monde" (p. 93). Cette définition rappelle en quoi consiste le véritable paradoxe de l'existentialité selon les conservateurs: la perception qu'a l'homme de ses limites ne le paralyse pas, mais l'incite à l'action. L'optimisme, au contraire, en surestimant les potentialités de l'homme, semble laisser celui-ci s'enfoncer sans cesse dans l'apathie.
6.4. Volontarisme et décadence. Sternhell, qui n'est pas philosophe mais historien, n'est nullement conscient de ce "paradoxe du conservateur". Il constate simplement la présence, dans les fascismes, d'une "énergie tendue" (p. 50) et signale sans cesse cette volonté fasciste de dominer le destin (pp. 65 & 294). Sternhell constate que le problème de la décadence inquiète le fasciste au plus haut point. C'est la raison pour laquelle celui-ci veut créer un "homme nouveau", un homme porteur des vertus classiques anti-bourgeoises, des vertus héroïques, un homme à l'énergie toujours en éveil, qui a le sens du devoir et du sacrifice. Le souci de la décadence aboutit à l'acceptation de la primauté de la communauté sur l'individu. La qualité suprême, pour un fasciste, c'est d'avoir la foi dans la force de la volonté, d'une volonté capable de donner forme au monde de la matière et de briser sa résistance. Sternhell se livre à de pareilles constatations jusqu'à la dernière ligne de son ouvrage; ainsi, à la page 312: "Dans un monde en détresse, le fascisme apparaît aisément comme une volonté héroïque de dominer, une fois encore, la matière, de dompter, par un déploiement d'énergie, non seulement les forces de la nature, mais aussi celles de l'économie et de la société".
6.5. La question de la vérité. D'une part, le pessimisme; d'autre part, le volontarisme. Pour une pensée logique, ce ne pourrait être là qu'un paradoxe. Mais le fascisme se pose-t-il la question de la vérité? Voyons ce que Sternhell déclare à propos de l'un des "pères fondateurs" du fascisme: "Pour un Barrès par exemple, il ne s'agit plus de savoir quelle doctrine est juste, mais quelle force permet d'agir et de vaincre" (p. 50). Comme preuve du fait que le fascisme ne juge pas une doctrine selon sa "vérité", mais selon son utilité, Sternhell cite Sorel au sujet des "mythes" qui, pour l'auteur des Réflexions sur la violence, constituent le moteur de toute action: "...les mythes sont des "systèmes d'images" que l'on ne peut décomposer en leurs éléments, qu'il faut prendre en bloc comme des forces historiques... Quand on se place sur le terrain des mythes, on est à l'abri de toute réfutation..." (pp. 93 & 94).
En résumé...
Nous n'avons pu recenser le livre de Sternhell que dans ses lignes fondamentales. Nous avons dû négliger bien des points importants, tels son allusion à la "nouvelle liturgie" comme partie intégrante du fascisme (p. 51), à son anti-américanisme latent (même avant 1914) (p. 290); nous n'avons pas approfondi sa remarque signalant que, pour le fascisme, la lutte contre le libéralisme intérieur a toujours été plus importante que la lutte menée contre celui-ci pas certains dictateurs... (p. 34). En tant que recenseur, je me permets deux remarques, pouvant s'avérer utiles pour le lecteur allemand. D'abord, l'Allemagne n'est que peu évoquée chez Sternhell. En fait de bibliographie allemande, il ne cite que les livres de Nolte traduits en français; on peut dès lors supposer qu'il ne maîtrise pas la langue de Goethe. Ma seconde remarquer sera de rappeler au lecteur allemand ma tentative de redonner une consistance au concept de "fascisme", en le limitant à un certain nombre de phénomènes historiques (Cf. Der faschistische Stil, 1973; trad.franç.: Le "style" fasciste, in Nouvelle Ecole, n°42, été 1985). Sternhell, pour sa part, a donné au terme "fascisme" une ampleur énorme. Son effort est justifiable, dans la mesure où sa vaste définition du "fascisme", au fond, correspond à ce que je désignais sous l'étiquette de "révolution conservatrice". Bref, on peut dire du livre de Sternhell qu'il a envoyé au rebut la plupart des travaux consacrés jusqu'ici à l'étude du fascisme...
Armin MOHLER.
(recension tirée de la revue Criticón, Munich, n°76, mars-avril 1983; traduction française d'Elfrieda Popelier).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, italie, france, fascisme, années 20, années 30, 20ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 février 2009
Le secret américain de Nicolas Sarközy

Le secret américain de Nicolas Sarkozy
Par Philippe Bourcier de Carbon*
Ex: Journal du chaos 7, 2009
Dans les coulisses du pouvoir, il y a ceux mis au devant de la scène, ceux qui restent dans l’ombre
et, surtout, ceux des tréfonds que nul n’entrevoit jamais. Qui connaît Frank George Wisner ? Ce
senior américain, diplomate et homme de réseaux, pourrait bien être la clé pour expliquer
l’ascension fulgurante de Nicolas Sarkozy. Le chef de l’Etat français bénéficie là du meilleur
conseiller occulte pour jouer un rôle dans la marche du monde. A condition que le Président
continue de servir avant tout les intérêts de l’Empire américain, que celui-ci soit dirigé par Bush ou
Obama.
« Un néoconservateur américain à passeport français » : la formule cinglante d’Eric Besson au sujet de
Nicolas Sarkozy, formulée en vue de la campagne électorale de 2007, demeure d’une lucidité
implacable. Le nouveau ministre chargé de l’immigration n’ira sans doute plus remettre en question
le patriotisme de son mentor. Il n’en demeure pas moins que le mystère du succès rapide dans la
conquête du pouvoir suprême par Nicolas Sarkozy passe par l’analyse de son rapport personnel
aux Etats-Unis.
A cet égard, le destin peut s’avérer facétieux lorsqu’il veut avantager un jeune ambitieux désireux
d’atteindre les sommets. C’est vers la fin des années 70 que le jeune loup du RPR saura tirer profit
d’une fortune incomparable : le remariage de sa belle-mère, Christine de Ganay, avec un
personnage prometteur de la vie politique américaine, Frank George Wisner.
Celui-ci avait déjà hérité d’une charge lourde : le patronyme et la carrière sulfureuse d’un homme
exceptionnel, dans ses coups d’éclat comme dans sa folie, Frank Gardiner Wisner (1909-1965),
cofondateur de la CIA. Le père Wisner, impliqué dans les renversements du pouvoir au Guatamala
et en Iran, restera célèbre pour l’opération Mockingbird (un noyautage réussi des médias
américains par des agents de la CIA), avant de se suicider en 1965, victime de démence. Né en
1938 à New York, diplômé de Princeton, le jeune Frank George ne marchera pas exactement dans
les pas de son père mais suivra plus habilement un tracé parallèle : la diplomatie, dont on connaît
les passerelles avec le monde de l’espionnage. Il apprendra ainsi l’arabe au Maroc dans son
détachement effectué pour le compte du Département d’Etat avant un bref passage par Alger
après l’indépendance et un long séjour au Vietnam. De retour à Washington en 1968, il sera chargé
des affaires tunisiennes. Plus tard, après la spécialisation dans les questions asiatiques et arabes,
Frank George Wisner exerça le poste d’ambassadeur en Zambie, en Egypte, aux Philippines et en
Inde.
Derrière ces honorables activités, qui ont culminé par un poste de sous-secrétaire d’Etat sous
Clinton et, plus récemment, dans sa médiation pour la Troïka dans le règlement de la crise au
Kosovo, Frank G. Wisner demeure, selon ses détracteurs, la clé de voûte dans l’exécution de
l’espionnage économique pour le compte de la CIA. Mieux encore, l’homme est la caricature du
personnage multicartes et influent, présent dans tous les centres réels ou fantasmés du pouvoir
parmi lesquels les fameux Council on Foreign Relations ou le groupe Bilderberg. Mais c’est en 1997
qu’un tournant s’opère : après avoir longtemps manoeuvré dans le monde feutré de la diplomatie et
des renseignements, Wisner se risque à mélanger encore plus les genres en rejoignant, au sein de
son conseil d’administration, l’entreprise Enron, la célèbre compagnie énergétique qui fera scandale
quatre ans plus tard et dont la gigantesque fraude en Californie, portant sur des milliards de
dollars, ne sera jamais exactement détaillée, « grâce » à la disparition des milliers de pages
caractérisant la fraude fiscale dans la destruction des bureaux de la SEC, gendarme américain des
opérations boursières , lors de la chute de la Tour 7 du World Trade Center.
Ironie du sort, ou étrange coïncidence, la sécurité de ce gratte-ciel (effondré alors qu’il ne fut pas
percuté par un avion en ce jour du 11 Septembre 2001) relevait de la compagnie Kroll Associates,
qui appartenait alors à l’AIG, assureur dont Wisner est le vice-président . S’il est vrai que les
entreprises prestigieuses sont souvent interconnectées de par leurs administrateurs, il est notable
de constater la récurrence curieuse de Wisner dans les anomalies du 11 Septembre. Ainsi, pour
résumer, l’homme, spécialiste du monde musulman et de l’espionnage économique, responsable
haut placé de Enron et de l’AIG, échappe à toute poursuite judiciaire lors du scandale Enron, jamais
complètement décrypté de par la destruction des détails compromettants lors de la chute
controversée d’un immeuble du World Trade Center qui abritait également, autre heureuse
coïncidence, les bureaux de la CIA dédiés précisément à l’espionnage économique…
Quel rapport dès lors entre ce personnage sulfureux et Nicolas Sarkozy, mis à part le lien familial
d’antan ?
A priori, il serait logique de présumer que le temps et la distance géographique auront
naturellement creusé le fossé entre le chef de l’Etat et la famille de l’ancienne belle-mère. Il n’en est
rien. Pour preuve, la campagne électorale de l’UMP qui a porté triomphalement au pouvoir, et dès
la première tentative, Nicolas Sarkozy, disposait dans ses rangs d’un acteur discret, responsable de
la section anglophone, mais dont le nom est suffisamment éloquent : David Wisner. Celui-ci semble
également reprendre le flambeau de la lignée Wisner puisqu’il a intégré le Département d’Etat en
septembre dernier, après des études d’arabe.
Et au-delà du légitime renvoi d’ascenseur du chef de l’Etat envers le fils de son parrain d’outreatlantique,
un autre fait passé inaperçu mérite d’être évoqué, non comme la preuve mais plutôt
comme l’indice de la volonté présidentielle d’occulter l’existence et les agissements troubles de
Wisner. S’il s’avère à l’avenir que les fameux délits d’initiés opérés à la veille du 11-Septembre ont
été le fait de citoyens américains avertis, dont le point commun serait d’être à la jonction du
renseignement et de la finance, alors il ne serait guère étonnant de voir figurer sur la liste de ces
personnes au vent d’un « attentat terroriste imminent » un certain Frank George Wisner. Outre
qu’il ait bénéficié de la destruction du dossier fiscal Enron tout en étant dans le même temps
responsable de la sécurité du World Trade Center via Kroll Associates ( détenue par AIG), une
réçente réaction de Nicolas Sarkozy pourrait laisser penser que le silence en la matière doit
s’imposer.
En effet, selon le Canard Enchaîné du 24 septembre 2008, le Président avait vivement critiqué le
Pdg de la chaîne info internationale, France 24, pour avoir organisé un débat sur la « théorie du
complot » autour du 11-Septembre. Cette réaction de Nicolas Sarkozy pourrait prêter à sourire si
elle venait simplement confirmer sa propension légendaire à tout régenter, y compris la
programmation audiovisuelle. Mais compte tenu de l’implication éventuelle d’un de ses proches
dans les coulisses logistiques et financières de l’attentat du World Trade Center, la colère
présidentielle prend une tout autre tournure. De par le signal qu’il envoie ainsi aux journalistes
mainstream tentés d’évoquer à l’antenne la question des zones d’ombre du 11-Septembre, le
message relève plus de la censure tacite d’un sujet grave que de l’irritation d’un téléspectateur
capricieux. Sans aller jusqu’à faire de Wisner un des instigateurs du 11-Septembre, il est plus
vraisemblable de supposer que sa position et ses relations l’ont idéalement avantagé pour faire
partie de ceux à avoir, « au mieux » anticipé l’événement, au pire participé par une quelconque
assistance matérielle, en l’occurrence la mise à disposition de la gestion de la sécurité électronique
des 3 tours effondrées, de par l’implosion de bombes pré-installées selon certains scientifiques
spécialistes de la démolition contrôlée.
Au-delà des inévitables spéculations sur le rôle exact de Wisner dans l’opération à multiples
facettes du 11-Septembre, force est de constater que l’homme dispose des diverses relations
accumulées depuis près de 50 ans dans les élites dirigeantes des Etats-Unis et les cercles
internationaux pour pouvoir, si besoin est, favoriser le jeune politicien impétueux que son épouse
française affectionne. Nicolas Sarkozy doit beaucoup à Jacques Chirac pour son maillage lent et
progressif du corps électoral français. Il doit sans doute davantage encore à Frank George Wisner
pour avoir obtenu l’assentiment et la faveur de l’hyper-puissance occidentale.
Les parrains occultes du Président et méconnus du citoyen sont souvent les plus redoutables.
* Philippe Bourcier de Carbon est démographe à l'Ined (Institut national des études démographiques).
00:47 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, etats-unis, sarkozy, politique, actualité, relations internationales, atlantisme, occident, occidentalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 février 2009
Affaire Chauprade: lettre ouverte à Hervé Morin
Lettre ouverte à Hervé Morin,
ministre de la Défense euro-atlantiste
par Georges Feltin-Tracol - http://www.europemaxima.com/
Monsieur le ministre de la Défense de l’Occident,
Je m’autorise de vous interpeller avec un titre erroné puisque, renouant avec une mauvaise habitude pratiquée sous le septennat giscardien, le terme « nationale » a été supprimé de l’intitulé officiel de votre ministère. Permettez-moi par conséquent de vous désigner tour à tour comme le ministre de la Défense euro-atlantiste ou celui de la Défense de l’Occident, tant ces deux appellations me paraissent vous convenir à merveille.
Si je vous adresse aujourd’hui la présente algarade, sachez au préalable que je ne vise nullement l’élu local normand que vous êtes par ailleurs. L’adhérent au Mouvement Normand que je suis, soutient, tout comme vous, l’indispensable (ré)unification normande des deux demi-régions. Notre désaccord concerne l’avenir de la France, de son armée et de l’Europe de la défense.
Je vous dois d’être franc. Quand en mai 2007, vous avez été nommé au ministère de la rue Saint-Dominique, j’ai immédiatement pensé à une erreur de recrutement : vous n’êtes pas fait pour occuper ce poste, faute d’une carrure suffisante. Comment cela aurait pu être autrement avec un Premier ministre qui, lui, est un fin connaisseur de la chose militaire depuis de longues années ? Il s’agissait surtout de vous récompenser pour avoir abandonné (trahi, diraient de mauvaise langues) entre les deux tours de la présidentielle votre vieil ami François Bayrou et rallié le futur président.
D’autres, tout aussi non préparés aux fonctions de ce ministère éminemment régalien, auraient acquis au contact des militaires une stature politique afin de viser, plus tard, bien plus haut. Hélas ! Comme l’immense majorité de vos prédécesseurs depuis 1945, voire depuis l’ineffable Maginot, et à l’exception notable d’un Pierre Messmer, d’un Michel Debré ou d’un Jean-Pierre Chevènement, vous êtes resté d’une pâleur impressionnante. Pis, depuis votre nomination, vous avez démontré une incompétence rare qui serait risible si votre action ne nuisait pas aux intérêts vitaux de la France et de l’Europe.
À votre décharge, je concède volontiers qu’il ne doit pas être facile de diriger un tel ministère à l’ère de l’« omniprésidence omnipotente » et de sa kyrielle de conseillers, véritables ministres bis. Faut-il en déduire qu’une situation pareille vous sied et que vous jouissez en fait des ors de la République ?
Je le croyais assez jusqu’à la survenue d’un événement récent. Depuis, j’ai compris que loin d’être indolent, vous effectuez un véritable travail de sape, pis une œuvre magistrale de démolition systématique qui anéantit quarante années d’indépendance nationale (relative) au profit d’une folle intégration dans l’O.T.A.N. américanocentrée, bras armé d’un Occident mondialiste globalitaire.
Vous vous dîtes partisan de la construction européenne alors que vous en êtes l’un de ses fossoyeurs les plus déterminés. L’Europe, sa puissance sous-jacente, ses peuples historiques vous indiffèrent, seule compte pour vous cette entité despotique de dimension planétaire appelée « Occident ».
Qu’est-ce qui m’a dessillé totalement les yeux en ce 6 février 2009 ? Tout simplement votre décision inique et scandaleuse de congédier sur le champ Aymeric Chauprade de son poste de professeur au Collège interarmées de Défense (C.I.D.). Brillant spécialiste de géopolitique, Aymeric Chauprade présente, dans un nouvel ouvrage Chronique du choc des civilisations, des interprétations alternatives à la thèse officielle des attentats du 11 septembre 2001. Exposer ces théories « complotistes » signifie-t-il obligatoirement adhérer à leurs conclusions alors qu’Aymeric Chauprade, en sceptique méthodique, prend garde de ne pas les faire siennes ?
Peu vous chaut l’impartialité de sa démarche puisque, sur l’injonction du journaliste du Point, Jean Guisnel, auteur d’un insidieux article contre lui, vous ordonnez son exclusion immédiate de toutes les enceintes militaires de formation universitaire. Mercredi dernier - 11 février -, l’infâme Canard enchaîné sortait une véritable liste d’épuration en vous enjoignant d’expulser d’autres intervenants rétifs au politiquement correct. Auriez-vous donc peur à ce point (si je puis dire) de certains scribouillards pour que vous soyez si prompt à leur obéir, le petit doigt sur la couture du pantalon ? Faut-il comprendre que Jean Guisnel et autres plumitifs du palmipède décati sont les vrais patrons de l’armée française ?
Avez-vous pris la peine de lire l’ouvrage incriminé ? Votre rapidité de réaction m’incite à répondre négativement. Il importe par conséquent de dénoncer votre « attitude irresponsable, irrespectueuse et indigne », car « nier la réalité est une attitude particulièrement inquiétante pour un ministre et qui n’atteste pas du courage que chacun est en droit d’attendre d’un haut responsable politique ». Qui s’exprime ainsi ? M. Jean-Paul Fournier, sénateur-maire U.M.P. de Nîmes, irrité par la fermeture de la base aéronavale de Nîmes - Garons, cité par Le Figaro (et non Libé, Politis ou Minute) du 9 février 2009. Le sénateur Fournier a très bien cerné votre comportement intolérable et honteux.
Aymeric Chauprade interdit de tout contact avec le corps des officiers d’active, vous agissez sciemment contre l’armée française, contre la France. En le renvoyant, vous risquez même de devenir la risée de l’Hexagone. En effet, le 12 juillet 2001, Aymeric Chauprade publiait dans Le Figaro un remarquable plaidoyer en faveur d’un « bouclier antimissile français ». Et que lit-on dans Le Figaro du 13 février 2009 ? « La France se lance dans la défense antimissile »… Certes, nul n’est prophète en son pays, mais quand même, ne peut-il pas y avoir parfois une exception ?
Votre action injuste me rappelle d’autres précédents quand l’Institution militaire sanctionnait des officiers coupables de penser par eux-mêmes et de contester ainsi le conformisme de leur temps : le général Étienne Copel, le colonel Philippe Pétain, le lieutenant-colonel Émile Mayer, le commandant Charles de Gaulle.
Anticonformiste, Aymeric Chauprade l’est avec talent et intelligence ; il s’inscrit dans la suite prestigieuse des Jomini, Castex et Poirier. Voilà pourquoi le réintégrer au C.I.D. serait un geste fort pour l’indispensable réarmement moral d’une armée qui en a grand besoin.
Je doute fort, Monsieur le ministre de la Défense euro-atlantiste, que ma missive vous fera changer d’avis. Qu’importe ! Libre à vous de rester insignifiant et de figurer dans les chroniques comme le Galliffet de la réflexion stratégique.
Recevez, Monsieur le Ministre, mes salutations normandes.
Georges Feltin-Tracol,
rédacteur en chef du site Europe Maxima,
membre du Mouvement Normand,
signataire de la pétition de soutien à Aymeric Chauprade.
00:48 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : censure, france, géopolitique, polémique, totalitarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
B. Lugan: pour en finir avec la colonisation
 Pour en finir avec la colonisation
Pour en finir avec la colonisation
Ce livre montre que durant la brève parenthèse coloniale, les pays colonisateurs n’ont pas pillé l’Afrique et que les colonies étant un boulet économique, politique et social, la décolonisation était une urgente et impérieuse nécessité ; les Européens d’aujourd’hui et à plus forte raison ceux de demain n’ont de dette ni à l’égard de l’Afrique ni des Africains ; le mythe de la culpabilité coloniale est une arme permettant de désarmer moralement l’Europe face à la contre-colonisation de peuplement qu’elle subit actuellement et que la culture de repentance-soumission risque de faire des Français, de nouveaux ” colonisés “. Ce livre montre également que la colonisation fut d’abord une grande idée de gauche reposant sur les idéaux universalistes de 1789. Il souligne aussi que pour résoudre les insolubles problèmes liés à l’immigration venue de nos anciennes colonies, seules sont proposées les recettes éculées d’assimilation-intégration qui y furent inapplicables et les mêmes impératifs du toujours plus de subventions qui firent capoter toutes les politiques de développement. Or, ce qui a échoué hier en Afrique échoue déjà dans les banlieues où il est impossible de procéder par amputation territoriale comme l’avait fait le général de Gaulle. Ce livre montre enfin que l’histoire n’est jamais écrite. Les Français après 130 ans de présence en Algérie, les Portugais après 400 ans en Angola et les Arabes après 700 ans en Espagne, tous ont appris à leurs dépens que la colonisation n’est pas éternelle dès lors que les indigènes ne sont plus disposés à la subir. Ce livre est illustré de nombreuses cartes et contient un index.
Bernard Lugan est docteur ès Lettres et enseigne l’histoire de l’Afrique à l’université de Lyon III. Il fut professeur à l’université nationale du Rwanda de 1972 à 1983. Il est conférencier au CHEM (Centre des hautes études militaires à Paris), à l’IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale à Paris) et au CID (Collège interarmées de défense à Paris). Il est expert auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), ONU.
Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info
URL to article: http://qc.novopress.info/?p=4785
00:17 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualité, colonialisme, colonisation, france, afrique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 février 2009
La Nymphe de Maillol

00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, sculpture, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 février 2009
Marc-Edouard nabe résiste à l'Obamania
MARC-EDOUARD NABE RESISTE A L’OBAMANIA
Par Unité Populaire : http://unitepopulaire.org/
 « Ça m’étonne. Moi, si passionné par les Noirs américains et si fanatique de l’Afrique en général, je reste de marbre face à l’élection historique de Barack Obama... Ça ne me fait strictement rien. Aucune émotion, pas un tressaillement de bonheur. Suis-je devenu insensible ? Normalement, ça aurait dû me faire plaisir que le petit Blanc McCain se fasse mettre par le grand Noir Obama, je ne comprends pas... Je regarde autour de moi, ce sont des torrents de larmes. Un Noir enfin à la Maison Blanche ! Les plus durs à cuire fondent d’extase. Les incrédules sont à genoux en train de remercier le Ciel, les défaitistes chantent victoire, les revenus de tout y repartent. Pour les uns, l’élection d’Obama, c’est plus fort que le premier homme qui a marché sur la Lune. Pour les autres, c’est plus constructif que la destruction du mur de Berlin. (...)
« Ça m’étonne. Moi, si passionné par les Noirs américains et si fanatique de l’Afrique en général, je reste de marbre face à l’élection historique de Barack Obama... Ça ne me fait strictement rien. Aucune émotion, pas un tressaillement de bonheur. Suis-je devenu insensible ? Normalement, ça aurait dû me faire plaisir que le petit Blanc McCain se fasse mettre par le grand Noir Obama, je ne comprends pas... Je regarde autour de moi, ce sont des torrents de larmes. Un Noir enfin à la Maison Blanche ! Les plus durs à cuire fondent d’extase. Les incrédules sont à genoux en train de remercier le Ciel, les défaitistes chantent victoire, les revenus de tout y repartent. Pour les uns, l’élection d’Obama, c’est plus fort que le premier homme qui a marché sur la Lune. Pour les autres, c’est plus constructif que la destruction du mur de Berlin. (...)
Tout le monde adore Obama, alors forcément je suis contre... Quel rabat-joie ! Je suis bien bête de ne pas profiter de cette joie mondiale. C’est peut-être à cause de tout ce que j’entends comme conneries...Vincent Cassel dit que "tout à coup, on a envie de vivre aux États-Unis". Rama Yade minaude : "Nous sommes tous Américains, cette fois, on peut le dire dans le sens positif." Le roi du storytelling, Christian Salmon, se pâme : "Avec lui, l’Amérique qu’on aime est de retour ! ". Quant à Dorothée Werner, laide éditorialiste de Elle, elle danse carrément la samba dans sa cuisine : "Comment résister à l’euphorie qui gonfle le monde ? " D’ailleurs, pour toutes les mouilleuses du Elle, Obama c’est Cassius Clay + Robert Redford + Steve McQueen. Pourquoi ne pas ajouter James Dean et Gérard Philippe ? De plus en plus blanc à force d’additions ! Ce qu’elles veulent dire, ces blanchâtres, c’est que, dans leur idéal de Noir, Obama est une somme de soustractions : c’est Malcolm X – George Jackson – Frantz Fanon – Bobby Seale – Angela Davis... Le pompon a été décroché par Philippe Val affirmant sans rire qu’avec Obama élu, c’est enfin le XXIe siècle qui commence ; Ben Laden et son 11-Septembre, c’était encore du XXe ! D’accord, mais que des sans-couilles l’adorent ne suffit pas à expliquer que je ne bande pas. (...)
En France, le racisme est à peine caché sous l’antiracisme consensuel et les tollés des faux-derches franchouillards qui se cabrent au moindre mot de travers. En France, les racistes sont avant tout ceux qui se réjouissent qu’un Noir soit élu du moment qu’il est noir, parce que pour eux tous les Noirs se ressemblent. (...) Fin du racisme, tu parles ! Comme si les Noirs n’allaient plus être persécutés grâce à l’élection d’Obama ! On a vu comment les Arabes vivent sous le règne de Rachida Dati ! Dès qu’un métèque a un petit pouvoir, il ne pense qu’à une chose : faire du zèle contre sa race, pour montrer aux Blancs qu’il n’est pas un métèque justement, et qui paie les pots cassés ? Les autres métèques, ceux sans pouvoir ! Classique. Au pays des antiracistes auto-éblouis, le seul qui reste mesuré dans son obamania, c’est le président... Vexé comme un pou. Obama démode Sarko, Michelle écrase Carla . Premier président juif français, c’est bien. Premier président noir américain, c’est mieux. Sarkozy, qui pensait en 2007 innover dans le genre jeune loup vulgos libéralo-people s’est fait doubler un an et demi après. Comment rattraper le retard soudain pris ? En foutant des Noirs partout ! "Ne me cachez plus ces minorités visibles qu’en temps normal je n’aurais su voir..." (...)
"Obama a réalisé enfin le rêve de Martin Luther King ! " Le hic, c’est que dans son I have a dream, King disait textuellement qu’il ne voulait pas que "les gens soient jugés pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur personne". Pour quoi d’autre est jugé Barack Obama aujourd’hui ? Ce sont ses deux grands-mères qui le définissent le mieux. La première est une grosse mama qu’on a vu danser de joie en boubou dans son bidonville de Kogelo... le drapeau yankee flottant sur le Kenya. Le Kenya, terre de safaris pour beaufs, est un des rares pays d’Afrique qui ne présente aucune espèce d’intérêt. Seule la Centrafrique est plus nulle encore. Rien ne peut sortir de bon du Kenya, à part quelques Massaï qui d’ailleurs n’en sortent pas. La seconde grand-mère d’Obama, une Blanche, a toute sa vie tremblé de peur en croisant des Noirs dans les rues de Kansas City. Elle est morte la veille de son élection. Quand elle a senti que c’était inéluctable, mémé a préféré mourir... Elle ne voulait pas voir ça : un négro à la Maison Blanche, fût-ce son petit-fils !
C’est son programme peut-être qui me débecquette... Sa gestion de la crise financière ne laisse aucun doute : monsieur ne pense qu’à subventionner les banques, il veut réparer le capitalisme lui aussi, mais à l’avantage des riches. Sa priorité : rassurer les gros portefeuilles provisoirement à sec. Comme tout pratiquant du capitalisme, il est à genoux devant les banques avec l’excuse que la Banque n’est pas plus démocrate que républicaine, elle est la Banque. C’est comme Dieu, il n’est ni de gauche ni de droite, il est Dieu. Et aujourd’hui, Dieu, ce sont les trusts. Sur le dollar, il y aura bientôt écrit : In Trust we trust. C’est le pantin de l’Usure. Obama veut "sauver l’économie", c’est-à-dire les firmes et entreprises, avec la même rengaine fredonnée partout depuis le krach de septembre 2008 : "Sauvons les patrons et ils vous trouveront du boulot !" sauf que une fois que les pauvres auront aidé les riches à se renflouer, Obama et les autres chefs leur diront : "Sorry ! Il ne reste plus rien pour vous, chers pauvres... Next time ! " Pauvres pauvres !
Sur le plan international, Obama va être pire que Bush. Il suffit de voir son équipe. Tout ce qu’il a trouvé, c’est Hillary Clinton et Mme Albright, toutes les deux hyper contre Saddam, faiseuses d’anges irakiens, archi pour les guerres de 1991 et de 2003... Obama a même poussé le vice jusqu’à vouloir engager Colin Powell ! Oui la salope de l’anthrax ! Juste parce qu’il est noir, soi-disant... Pourquoi pas Condoleezza Rice ? Elle aussi est bronzata, comme dirait Berlusconi. Quel raciste, cet Obama ! Sans arrêter de sourire, il enverra plus de Noirs sur la chaise électrique, histoire qu’on ne l’accuse pas de chouchoutage... Obama va aussi travailler avec les mecs de McCain et prendre comme conseiller Joseph Biden, le stratège de John Kerry... James Jones à la Sécurité, Robert Gates à la Défense, Timothy Geithner au Trésor... Jolis messieurs ! Ce n’est plus de l’ouverture, c’est de la béance... Et ça prouve bien que dans son esprit de collabo, la politique c’est bonnet noir, noir bonnet. Tout l’espoir d’une "nouvelle Amérique" a été absorbé par sa stupéfaction d’avoir élu un Noir. Il n’y aura plus de place pour un autre "changement". Ça m’étonnerait beaucoup que le nouveau président annule le Patriot Act. À la limite, il fermera Guantanamo, qu’est-ce que ça peut lui foutre puisque d’autres pénitenciers arbitraires s’ouvriront ailleurs, directement dans les pays ennemis. Il parle déjà de rayer l’Iran de la carte. (...)
L’Irak. Obama annonce un retrait définitif des troupes pour 2011. Évidemment, ce sera reculé à 2012 où il sera remplacé par un autre salaud qui, lui, les maintiendra ! Pour le reste, son objectif est avoué dès le début : capturer Ben Laden ! Oui, cet abruti d’Hawaïen en est resté là. L’Afghanistan. Obama va y envoyer bien plus de soldats encore que Bush et ceux-là seront prélevés en Irak. Vases communicants ! Et s’il n’y en a pas assez, il en tapera à ses chers alliés qui ne pourront rien refuser à un Noir président de l’Amérique, ce pays exemplaire ! Pour finir, son directeur de cabinet est déjà nommé : Rahm Emmanuel, un engagé volontaire dans l’armée israélienne en 1991... Soyons clair : une rampouille sioniste à se damner. Pendant toute sa campagne, Obama a réitéré son soutien indéfectible à Israël. Il veut une Jérusalem israélienne, et des renforts de troupes sur le saint terrain occupé par ces sales Palestiniens... Tout pour Israël ! 78 % de Juifs Amerloques ont voté pour lui. On peut leur faire confiance: ils n’auraient pas élu un nègre s’ils n’avaient pas été sûrs qu’il soit leur man ... Non, tout ça, c’est encore du procès d’intention...
Ça y est. J’ai trouvé. Ce qui me gêne chez Obama, c’est que grâce à lui l’Amérique va redorer son blason de merde ! Yes he can, ce con. J’ai compris à quoi il va servir, ce faux Noir. L’Amérique reprend du poil de la bête, autant dire qu’elle va bientôt s’arracher les cheveux puisque la bête, c’est elle. "L’Amérique se réconcilie avec elle même et avec le monde ! " Ah, bon ? Je connais des milliards d’individus qui n’ont pas du tout envie de se réconcilier avec ce pays d’ordures... Pour en arriver à élire un Noir, c’est que les Yankees étaient à bout... Obama n’a pas été élu parce qu’il était Noir, mais parce que les Blancs au pouvoir ont compris qu’en mettant un Noir devant, l’Amérique allait pouvoir revenir au 1er rang en effaçant ses saloperies. Son image était tellement noircie par ses crimes qu’il fallait bien un Noir pour la nettoyer. Obama blanchit l’Amérique. Obama ne s’en cache pas : il veut redonner "la stature morale" de l’Amérique. En a-t-elle déjà eu une depuis le premier jour où les Espagnols débarquant ont tiré à l’arquebuse sur les Indiens venus leur apporter des fleurs sur la plage ? L’Amérique sera toujours porteuse de guerre et de mort. Kafka avait tout compris: au début de son roman L’Amérique (1911), ce n’est pas un flambeau que le héros voit dans la main de la statue de la Liberté, mais un glaive...
L’Amérique se fout d’Obama, ce qu’elle voulait, c’est faire semblant aux yeux des autres de se laver de Bush alors qu’elle l’a plébiscité deux impardonnables fois. Ne pas oublier que les pires bushistes sont ceux-là mêmes qui ont voté Obama. Logiquement, il ne devrait pas y avoir assez d’oreilles pour mettre toutes les puces dedans. Personne ne semble trouver anormal que les néoconservateurs pro-Bush se soient métamorphosés en obamiens de la vingt-cinquième heure. Il y a pourtant une raison à cela : pour mieux ré-enculer le monde, il fallait à l’Amérique un nouveau gode. Une rédemption de l’Amérique par un Noir ? Je n’y crois pas une seconde. C’est le plus mauvais cadeau fait aux vrais Afro-Américains. (...)
Il va déculpabiliser l’Amérique à peu de prix, car on s’extasie qu’il ait pu devenir président, mais qu’est-ce que c’est qu’être président des États-Unis ? C’est rien comme honneur dans le monde, c’est minable comme fonction, c’est la grosse honte ! Le plus beau jour de la vie d’un Noir, c’est d’entrer à la Maison Blanche, c’est ça le summum de la gloire ? C’est encore se soumettre en esclave, se faire reconnaître par le maître blanc, lui prouver qu’on est respectable comme lui, qu’on est son égal. Il n’était pas esclave, il vient de le devenir. Il a l’air ravi d’être enfin devenu l’esclave de l’Amérique. Le métis avait un complexe de n’être pas un bon nègre au service du maître. "Oncle Tom cherche Oncle Sam ! " Le Destin a répondu à sa petite annonce. Je sais maintenant pourquoi ce Noir me laisse froid. »
Marc-Edouard Nabe, 20 janvier 2009 (ce texte a été placardé sur les murs de Paris sous forme d’une grande affiche, selon la grande tradition révolutionnaire du pamphlet)
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : obama, etats-unis, france, lettres françaises, littérature française, littérature, lettre, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 février 2009
Chauprade porte plainte
CID : Chauprade porte plainte contre Morin pour "discrimination" devant la Cour de Justice de la République
 "Aymeric Chauprade, qui a été congédié le 5 février du Collège interarmées de Défense à la suite de la parution d'un texte mettant en doute ce qu'il appelle la "version officielle" des attentats du 11 septembre, estime que le ministre de la Défense Hervé Morin "a commis un acte de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-2 du Code Pénal qui punit de trois ans de prison le fait de sanctionner autrui pour ses idées". Son avocat, Maître Antoine Beauquier va saisir la Cour de Justice de la République pour obtenir des sanctions à l’encontre du ministre de la Défense.
"Aymeric Chauprade, qui a été congédié le 5 février du Collège interarmées de Défense à la suite de la parution d'un texte mettant en doute ce qu'il appelle la "version officielle" des attentats du 11 septembre, estime que le ministre de la Défense Hervé Morin "a commis un acte de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-2 du Code Pénal qui punit de trois ans de prison le fait de sanctionner autrui pour ses idées". Son avocat, Maître Antoine Beauquier va saisir la Cour de Justice de la République pour obtenir des sanctions à l’encontre du ministre de la Défense.Se définissant lui-même comme appartenant à la "droite conservatrice", très hostile au courant "néo-conservateur", Aymeric Chauprade affirme que "ses opinions politiques et ses convictions religieuses déplaisaient à Hervé Morin. Croyant plaire à l’entourage du Président de la République, monsieur Morin, qui n’a pas caché que sa décision avait été prise en considération de ce que monsieur Chauprade, de religion catholique, était critique à l’égard de la politique américaine devra répondre de son comportement devant la juridiction compétente" peut-on lire dans un communiqué qu'il publie ce matin. Il ajoute qu'Hervé Morin "a manqué à ses devoirs de ministre, au mépris des principes élémentaires qui gouvernent notre droit public, notamment le droit au débat contradictoire".
Par ailleurs, Chauprade devrait attaquer Le Point en diffamation. La décision du ministre a été prise à la suite de la lecture d'un article de Jean Guisnel sur le site Défense ouverte du Point.fr. Cette affaire devrait également avoir un volet devant le tribunal administratif.
Source
A écouter :
>>> Aymeric Chauprade sur Radio-Courtoisie
11:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : censure, france, géopolitique, liberté d'expression, discrimination, 11 septembre 2001 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 février 2009
Pourquoi N. Sarközy veut que la France réintègre le commandement de l'OTAN
Pourquoi Nicolas Sarkozy veut que la France réintègre le commandement de l’OTAN
Le Général de Gaulle se retourne dans sa tombe. 43 ans après sa décision de retirer Paris du commandement militaire intégré de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN, créée en 1949, 22.000 employés et 60.000 militaires permanents), son dangereux successeur à l’Elysée multiplie les déclarations (1) pour que la France y reprenne désormais “toute sa place”.
“Toute sa place” est une formule qui, dans l’approche de Nicolas Sarkozy, signifie clairement un engagement sans réserve aux côtés des Etats-Unis. Fidèle à sa méthode autocratique du “J’écoute mais je ne tiens pas compte”, il fait fi des voix de plus en plus nombreuses qui s’opposent à sa décision (2) et fait dire qu’il n’y aura ni référendum ni même de vote au Parlement sur la question. Il entend bien concrétiser seul son choix stratégique et balayer d’un coup d’un seul un demi-siècle de politique étrangère et d’indépendance française dès les 3 et 4 avril prochain, lors des cérémonies du 60e anniversaire de l’OTAN à Strasbourg et Kehl.
Histoire de confirmer sa volonté d’intégrer la France dans les hautes sphères politico-militaires de l’OTAN, Nicolas Sarkozy a d’ores et déjà pris l’année dernière deux initiatives très applaudies par son ami George W. Bush. Un, il a doublé la présence militaire française en Afghanistan en envoyant un millier de soldats combattre avec les américains contre les Taliban, alors que chacun sait que cette guerre est déjà perdue et que l’enlisement des troupes y est assuré (le nombre de soldats français morts sur le terrain depuis est déjà suffisamment éloquent). Deux, il a soutenu activement le projet de déployer un bouclier antimissile américain en Europe centrale, quitte à braquer sérieusement la Russie (Heureusement Barack Obama semble être en train de déminer cette énième provocation bushiste aux relents de Guerre froide). La récente volonté affichée de rapprocher Paris et Londres, principal allié des Etats-Unis dans ses guerres en Irak et en Afghanistan, est également un signe plus discret, mais tout aussi fort, d’allégeance à Washington. Seule contrariété pour le néo-conservateur de l’Elysée, ce n’est plus son ami fauteur de guerres George W. Bush qui est au pouvoir, mais Barack Obama, à l’évidence moins enclin à semer la terreur partout dans le monde au nom de la lutte anti-terroriste.
Cette rupture dans la politique d’indépendance de la France se drape bien entendu d’arguments à usage médiatique du type “Amis, alliés, mais non inconditionnels”, ou “nécessaire rénovation car nous ne sommes plus en 1966″, ou encore “La France ne perdra rien de sa souveraineté” (3). Nicolas Sarkozy dit vouloir développer avec l’OTAN une “Europe de la Défense efficace”. Depuis son élection, il ne cesse de répéter qu’une Europe de la Défense indépendante et l’ancrage atlantique sont les deux volets d’une même politique de sécurité. Mais quelle OTAN, pour quelle mission de défense européenne ? et la France a-t-elle quelque chose à gagner à réintégrer le commandement militaire de l’organisation, avec lequel elle coopère déjà très bien ? Elle fournit déjà 2.800 soldats pour l’occupation de l’Afghanistan, et maintient actuellement 36.000 soldats dans divers autres pays (Kosovo, Côte d’Ivoire, etc.).
Il est bien illusoire d’imaginer que les Etats-Unis donneront plus de place aux Européens et aux Français dans la nouvelle Alliance. Jaap De Hoop Scheffer a d’ailleurs bien précisé le 12 février 2009 à Paris que, si la France réintégrait le Commandement militaire intégré de l’Alliance atlantique, ce serait de toutes façons toujours à lui qu’il revenait “de gérer les choses au sein de l’OTAN, comme la position française au sein des structures de commandement, les généraux, etc”. Tout au plus les Etats-Unis accorderont-ils quelques commandements militaires sans importance à un ou deux généraux français — on parle vaguement d’un poste à Norfolk (Virginie, USA) ou à Lisbonne (Portugal) — sans que cela puisse réellement permettre à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) de s’affirmer et de de peser significativement sur les décisions de l’OTAN. Dans tous les conflits (Afghanistan, Serbie, Kosovo, etc) où la France s’est retrouvée engagée aux côtés des militaires américains, ce sont systématiquement ces derniers qui décident et contrôlent de façon unilatérale toutes les opérations, en particulier les frappes, reléguant la France et les autres pays alliés au rang de simples exécutants. On ne les imagine guère se plier aux décisions des français dans l’avenir. Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler que si de Gaulle est sorti de l’OTAN, c’est notamment parce qu’il demandait un directoire partagé de l’Organisation, ce que les Américains lui ont refusé. Et la suite a montré que la France, puissance moyenne disposant de l’arme nucléaire et d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, existait finalement plus à l’échelle mondiale en s’affirmant de façon autonome qu’en s’effaçant dans ce qu’il appelait le “machin” atlantiste.
Autre risque, la réintégration de Paris dans une OTAN qui sert de plus en plus de caution et de bras armé à l’impérialisme américain, sera sans nul doute perçu dans les grandes capitales du monde non-occidental comme un affaiblissement et un alignement sur les Etats-Unis, ce qui lui fera perdre le peu d’influence qui lui reste encore.
Quant à la “Voix de la France”, qui selon Nicolas Sarkozy deviendrait plus forte dans le concert des Nations si elle réintègre l’OTAN, elle semble jusqu’à présent avoir moins souffert des discours et des choix du Général de Gaulle — ou même de ceux de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, par exemple en 2003 à l’ONU lors du refus de la France de suivre les Etats-Unis dans l’invasion de l’Irak — que ceux des “caniches” européens de George W. Bush (Tony Blair, José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, José-Maria Aznar,…).
Mais l’essentiel n’est pas là. Le projet de Nicolas Sarkozy, cet anti de Gaulle, ne consiste pas en un renforcement de la défense européenne, ou du moins pas pour lui donner plus de pouvoir et d’indépendance comme il le prétend. A travers ses choix diplomatiques et stratégiques il est à l’évidence tout à sa “vision” purement occidentaliste de la France et de l’Europe. Pour lui, la France doit s’affirmer “dans sa famille occidentale” et dans “les valeurs occidentales qui sont pour elle essentielles” (Discours de janvier 2008 devant le corps diplomatique français). Il partage avec son mentor George W. Bush une idéologie qui se fonde avant tout sur la défense d’une civilisation occidentale qui serait aujourd’hui attaquée par le monde islamiste. Lorsqu’il déclare faire en sorte que “Paris et l’ensemble des capitales occidentales parlent désormais toutes d’une seule voix”, c’est surtout pour défendre les causes occidentales que les discours et les aventures guerrières de Bush “contre l’Axe du Mal et la Barbarie” ont totalement galvaudées: la Démocratie, la Liberté, l’universalisme des Droits de l’Homme, la lutte contre le terrorisme. Comme George W. Bush et comme tous les néo-conservateurs islamophobes, Nicolas Sarkozy est dans une logique de guerre contre tout ce qui ne relève pas des “valeurs occidentales” judéo-chrétiennes, tant en matière d’économie que de politique et de religion. Il exècre et ne cesse de diaboliser les partis islamistes qualifiés de terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas, n’imaginant pas que son propre occidentalisme est à l’Occident ce que le fondamentalisme islamiste est à l’Islam. Il est au plus près des cercles israélo-américains d’extrême-droite qui, afin de “garantir la paix et la sécurité”, prônent une domination occidentale du monde, quitte pour cela à passer à l’offensive et à se lancer dans une guerre de civilisation “globale”. Pour Nicolas Sarkozy il s’agit de défendre mais aussi désormais d’imposer par tous les moyens, et notamment par la guerre, un nouvel ordre occidental soi-disant “moral” (comprendre surtout “néo-libéral”) qui doit régner sur l’ensemble de la planète.
Cette idéologie d’autodéfense agressive se nourrissant du conflit avec l’islamisme autorise ainsi l’OTAN — qui à l’origine n’a qu’une mission de défense limitée aus territoires occidentaux — à aller porter la guerre aux confins de la planète pour défendre des intérêts géostratégiques essentiellement américains, quand ce n’est pas parfois purement israéliens, à titre d’une soi-disant “légitime défense” contre le terrorisme islamiste. De hauts stratèges et chefs d’état-major de l’OTAN planchent même actuellement sur de réjouissantes nouvelles options militaires. Ces docteurs Folamour réclament en effet le droit d’effectuer des frappes préventives, y compris avec l’arme nucléaire, sans autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU. Lorsque l’on connaît le désir insensé des Israéliens et de leurs amis américains — Même avec Barack Obama, il y a peu de chances que les Etats-Unis modifient leur politique de soutien inconditionnel à l’Etat d’Israël — d’aller bombarder l’Iran, on imagine aisément à quoi la sainte alliance transatlantique risque bientôt de servir.
C’est avec cette “vision” guerrière et occidentaliste du monde, ruineuse et extrêmement dangereuse pour la France, que Nicolas Sarkozy entend jouer un rôle international. En infléchissant la doctrine militaire française pour mieux s’aligner sur la politique étrangère américaine, dont on connaît pourtant les errements et l’agressivité aussi inefficace que désastreuse, il commet une erreur diplomatique et stratégique majeure.
Noël Blandin, pour la République des Lettres
Notes
1) Annoncé dès la campagne électorale de 2007, ce projet sarkozyste n’a cessé d’être remis sur la table, tant par Nicolas Sarkozy que par Bernard Kouchner (Ministre des Addaires étrangères) et Hervé Morin (Ministre de la Défense) afin d’y “préparer l’opinion”, notamment pour le Président de la République à travers le Discours de janvier 2008 devant le corps diplomatique français, lors du Sommet de l’OTAN à Bucarest en avril 2008 et la semaine dernière encore lors d’une conférence sur la sécurité à Munich.
2) Parmi les responsables politiques qui s’opposent à la décision autocratique de Nicolas Sarkozy, on note celles de François Bayrou pour qui la réintégration dans le commandement militaire de l’OTAN serait “une défaite pour la France” et un “un aller sans retour” [...] “En nous alignant, nous abandonnons un élément de notre identité, une part de notre héritage, et nous l’abandonnons pour rien”. Il demande que le choix fait par le Général de Gaulle en 1966 “ne soit pas bradé et jeté aux orties”, ajoutant qu’un tel choix ne peut aujourd’hui être modifié “que par un référendum du peuple français”. Dans un entretien au Nouvel Observateur, François Bayrou précise sa pensée. Pour lui, en réintégrant l’OTAN, la France se range “aux yeux du monde” dans un “bloc occidental” [...] “euro-américain d’un côté, le reste du monde de l’autre. Ceci, pour la France et son histoire, son universalité, est un renoncement”. Il affirme que “ce que nous sommes en train de brader, ce n’est pas seulement notre passé mais aussi notre avenir, une partie du destin de la France et de l’Europe”. Pour le Parti Socialiste, qui demande un débat et un vote parlementaire sur la question, “Aucune explication recevable n’est apportée sur l’intérêt pour la France de ce retour” et les “conditions et contreparties de cette réintégration ne sont pas connues”. Jean-Marc Ayrault, chef de file des députés PS, estime que “La France doit garder son autonomie de décision” et que celle-ci “ne peut pas être prise par le président seul”. Les anciens ministres socialistes de la Défense Paul Quilès et Jean-Pierre Chevènement ont également publié des tribunes dans la presse pour exprimer leur rejet de cette décision “très dangereuse pour la sécurité de la France”. [...] “Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres”, affirment-ils. “Si la France entre dans l’OTAN, il n’y a plus d’espoir de politique étrangère et de sécurité commune, plus d’Europe de la défense”, affirme également le socialiste Jean-Michel Boucheron. La réintégration “limiterait notre souveraineté et serait le signe d’un alignement sur l’administration américaine qui banaliserait la singularité de la France”, estiment pour sa part le Parti Communiste. Du côté de l’UMP, une partie des députés exprime aussi son opposition: Jacques Myard proteste contre ce “retour qui va lier les mains de la France et l’arrimer à un bloc monolithique occidental dirigé par les Etats-Unis” tandis que Lionnel Luca explique que “Pour un grand nombre de pays arabes, le fait que la France soit dans l’OTAN est un mauvais signal”. Jean-Pierre Grand regrette cet “arrimage plein et entier aux Etats-Unis”. “Il y a dans le monde entier des pays qui attendent de la France qu’elle demeure une transition, une passerelle, et qu’elle ne s’aligne pas sur les Etats-Unis”, renchérit Georges Tron. Le gaulliste ex-UMP Nicolas Dupont-Aignan s’engage lui dans une quasi campagne contre le projet et exige un débat parlementaire. Daniel Garrigue, député ex-UMP de la Dordogne, s’est de son côté fendu d’une tribune intitulé “Bonjour, messieurs les traîtres !”. Pour lui, “Rien ne justifie le retour de la France dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et la remise en cause de l’un des rares consensus forts de notre pays — voulu en l’occurrence par le général de Gaulle avec la sortie de l’Otan en 1966 et confirmé par ses successeurs, y compris par le socialiste François Mitterrand. Nous y perdrons la considération que nous avions sur la scène internationale et particulièrement notre capacité à être entendus dans un certain nombre de conflits, notamment au Proche et au Moyen-Orient. [...] “Pour tous ceux qui croient en la France et en la construction de l’Europe, cette décision de rejoindre l’Otan qui n’a été ni concertée, ni discutée, ni approuvée par les Français ou par le Parlement, constitue bien une véritable trahison”. Alain Juppé, ancien Premier Ministre de Jacques Chirac, renouvelle lui aussi ses critiques en demandant si la France n’était pas en train de “faire un marché de dupes en rentrant sans conditions” dans le commandement de l’OTAN. Mais le plus farouche opposant à Droite est l’ancien Premier Ministre Dominique de Villepin. Pour lui, la France “va se trouver rétrécie sur le plan diplomatique” et sera plus vulnérable au terrorisme. “Alors que le Sud est en train de s’affirmer, dans un monde qui est en train de basculer, faut-il donner le sentiment de se crisper sur une famille occidentale ?”, s’interroge-t-il. Comme François Bayrou, il estime que si la France avait été intégrée aux structures de commandement de l’OTAN en 2003, elle aurait été obligé de suivre les Etats-Unis de Geoorge W. Bush dans la guerre contre l’Irak.
3) Discours de Jaap De Hoop Scheffer, Secrétaire général de l’OTAN, devant les parlementaires français le 12 février 2009.
00:50 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, otan, atlantisme, france, sarkozy, gaullisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 février 2009
Ayméric Chauprade contre-attaque...
Aymeric Chauprade contre-attaque...
SOURCE : LE SALON BEIGE
 Interrogé dans le Libre Journal d’Emmanuel Ratier sur Radio Courtoisie, le professeur de géopolitique des officiers supérieurs de l'Armée française a déclaré qu'il n'adhérait pas aux théories alternatives sur le 11 septembre. Néanmoins, dans le cadre de son ouvrage sur le choc des civilisations, il avait estimé que ces théories, scientifiquement intéressantes, avaient leur place. De plus, en tant qu'analyste, il se permet librement de douter du rapport officiel américain sur les attentats, doute qui ne le fait toutefois pas adhérer aux théories pour lesquelles il a été brutalement exclu. Il fait remarquer que les Américains sont capables de mentir pour arriver à leurs fins, comme l'a montré la fausse accusation à l'égard de l'Irak de Saddam Hussein concernant les armes de destructions massives. En outre, il rappelle qu'aux Etats-Unis, ce débat est ouvert et libre. Et de constater, mais on le savait, que la liberté d'expression n'existe plus en France.
Interrogé dans le Libre Journal d’Emmanuel Ratier sur Radio Courtoisie, le professeur de géopolitique des officiers supérieurs de l'Armée française a déclaré qu'il n'adhérait pas aux théories alternatives sur le 11 septembre. Néanmoins, dans le cadre de son ouvrage sur le choc des civilisations, il avait estimé que ces théories, scientifiquement intéressantes, avaient leur place. De plus, en tant qu'analyste, il se permet librement de douter du rapport officiel américain sur les attentats, doute qui ne le fait toutefois pas adhérer aux théories pour lesquelles il a été brutalement exclu. Il fait remarquer que les Américains sont capables de mentir pour arriver à leurs fins, comme l'a montré la fausse accusation à l'égard de l'Irak de Saddam Hussein concernant les armes de destructions massives. En outre, il rappelle qu'aux Etats-Unis, ce débat est ouvert et libre. Et de constater, mais on le savait, que la liberté d'expression n'existe plus en France.
Convaincu d'avoir été écarté en raison de ses idées, il poursuivra le ministre de la Défense en justice pour discrimination. Il a en outre accusé un lobby de type "néo-conservateur" français, proche des intérêts américains, d'avoir voulu lui nuire en raison de ses critiques à l’égard de l’hégémonie américaine..
Michel Janva
15:16 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, censure, totalitarisme, liberté d'expression, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 février 2009
Encore un mauvais coup contre la liberté de recherche et la liberté d'expression
Encore un mauvais coup contre la liberté de recherche et la liberté d'expression
Trouvé sur: http://www.polemia.com/
Aymeric Chauprade, chargé du cours de géopolitique au Collège interarmées de défense (CID, l'ancienne Ecole de guerre) a été brutalement congédié ce matin par le ministre de la Défense Hervé Morin, à la suite d'un article paru dans « Le Point ». Hervé Morin lui reproche d'être l'auteur d'un « texte au travers duquel passent des relents inacceptables » consacré aux attentats du 11 septembre, présentés comme le fruit d'un complot israélo-américain. Aymeric Chauprade vient de publier une « Chronique du choc des civilisations » aux éditions Chronique-Dargau, dont « Le Point » cite quelques expressions choc :
« L'attaque des tours jumelles du World Trade Center de New York et du
Pentagone par des terroristes préparés par al-Qaïda ? »
« Le nouveau dogme du terrorisme mondial »,
« Une « version officielle ».
Au World Trade Center, « l'incendie n'a pas été si violent que le prétend la commission d'enquête ».
« L'onde de choc n'a pas pu provoquer l'effondrement. (...) Seule une démolition contrôlée par des explosifs permet d'obtenir un effondrement aussi rapide et parfait. »
Rien que du politiquement incorrect !
Quelques heures après la parution de cet article, le professeur est débarqué par le ministre de la Défense qui l'explique :
« J'ai découvert un texte au travers duquel passent des relents inacceptables. Sur onze pages, on nous parle d'un complot israélo-américain imaginaire visant à la conquête du monde. Quand j'ai appris cela mardi soir, j'ai donné pour consigne au général Desportes, le directeur du Collège interarmées de défense [le supérieur de M. Chauprade], de ne pas conserver ce monsieur Chauprade dans son corps enseignant. Il n'a absolument rien à faire à l'École militaire ».
Interrogé par Libération/Secret défense, Aymeric Chauprade, 40 ans, se déclare « stupéfait »:
« On me coupe la tête. Je n'ai eu aucun contact avec le cabinet du ministre, qui n'a pas cherché à m'entendre avant de prendre cette décision à la suite de la parution d'un seul article ». « Très fâché », Chauprade entend se défendre.
Sur le fond de ce qui lui est reproché, il s’explique à son tour :
« Je présente la thèse [du complot américano-israélien], certes de manière avantageuse, mais sans la faire mienne. Je souhaitais mettre en opposition deux façons de voir le monde, sachant que la moitié de l'humanité pense que les attentats du 11 septembre sont le fruit d'un tel complot » et non l'oeuvre des islamistes d'Al Qaïda. »
Dès ce jeudi après-midi, des élèves du CID s'élevaient contre ce qui s'apparente, à leurs yeux, à une « chasse aux sorcières » au nom de « la pensée unique ».
Aymeric Chauprade, qui enseignait cette semaine aux officiers de l'armée marocaine, à Kenitra, sera reçu demain matin par le directeur du CID, le général Vincent Desportes. Il lui a été demandé de cesser immédiatement ces activités et n'assurera donc pas le séminaire « Energie et développement durable » qu'il devait animer ce vendredi. Aymeric Chauprade enseigne au CID depuis 1999 et dirige le cours de géopolitique depuis 2002. (…). [Il est] officier de réserve de la marine. Outre son séminaire, son cours porte sur les méthodes d'analyse géopolitique, destiné à des officiers d'environ 35 ans. Ses activités au CID représente environ un tiers de ses activités et donc de ses revenus. Il est par ailleurs éditeur et auteur de plusieurs ouvrages, dont une « Géopolitique, constantes et changements dans l'histoire » aux éditions Ellipses.
« Il n'a jamais fait de prosélytisme dans ces cours, n'a jamais exprimé sa vision du monde, mais en faisant état de ses fonctions au CID dans ces livres, il engage l'institution militaire avec des thèses qui ne sont pas les nôtres » assure le général Vincent Desportes, qui commande le CID.
Le général Desportes, qui est l'une des têtes pensantes des armées et l'auteur de nombreux livres, s'affirme « intellectuellement en opposition avec les thèses défendues par Chauprade, qui sont assez peu recevables ».
Dans ces livres et ses articles, Chauprade défend une théorie du choc des civilisations, au travers notamment d'une opposition entre l'Europe (incluant la Russie) et l'Islam.
Et « Le Point » de présenter Aymeric Chauprade dans l’introduction de l’article :
« Aymeric Chauprade est un géopoliticien qui ne cache pas ses convictions. Directeur de campagne de Philippe de Villiers aux européennes de 2004, en charge de la Revue française de géopolitique, il est très réservé sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.(…). Il s'est montré critique sur le récent « Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale », ce qui ne manque pas de courage pour un enseignant censé se trouver en phase avec la politique de défense nationale »..
Sources :
http://secretdefense.blogs.liberation.fr/defense
et
http://lesalonbeige.blogs.com/
5/02/09
Correspondance Polémia
05/02/09
« Chronique du choc des civilisations »
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_ss_w?__mk_fr_FR=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&fieldkeywords=Chronique+du+choc+des+civilisations&x=14&y=19
« Géopolitique, constantes et changements dans l'histoire »
http://www.amazon.fr/Géopolitique-Constantes-changements-dans-lhistoire/dp/2729811222/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1233938778&sr=8-2
Correspondance Polémia
00:53 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : censure, dicature, terreur, géopolitique, france, choc des civilisations, 11 septembre 2001 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Bulletin célinien n°305
Le Bulletin célinien
 Le Bulletin célinien, n° 305, février 2009:
Le Bulletin célinien, n° 305, février 2009:Au sommaire:
Marc Laudelout : Hommage à quatre céliniens
Dossier sur Lucien Combelle (1913-1995) : textes de Pierre Assouline, Lucien Combelle, François Gibault, Marc Laudelout, Dominique Venner.
J.-L. Aubrun : "Un grand poète épique" [1936]
Jean-Paul Louis : L'Année Céline 2007
Marc Laudelout : Censure et diffamation
Le Bulletin célinien
B. P. 70
B 1000 Bruxelles 22
http://louisferdinandceline.free.fr
Un numéro de 24 pages, 6 euros franco.
celinebc@skynet.be
00:20 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'été de Maillol

00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, sculpture, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 février 2009
Retour de la France au sein de l'OTAN: Ankara étudie la demande française...

Retour de la France au sein de l’Otan : Ankara « étudie avec circonspection » la demande française… : "Dans sa décision de réintégrer le dispositif militaire de l’Alliance atlantique, Sarkozy n’avait sans doute pas prévu qu’il devrait recevoir le blanc-seing de la Turquie… Par la voix de son ministre des affaires étrangères, Ali Babacan, le gouvernement turc vient en effet de déclarer qu’il est « toujours en train d’évaluer » la demande française de retour dans le commandement de l’Organisation. « Les modalités (d’un retour de la France) sont en train d’être discutées au sein de l’Alliance atlantique. Est-ce qu’il y aura un vote (des pays membres) ou pas, on ne le sait pas encore », a expliqué M. Babacan samedi à la presse turque. Il a précisé que le retour de la France dans l’alliance occidentale « est plutôt une affaire politique que légale. La plupart des alliés de l’Otan y voient une décision positive, mais nous sommes toujours en train de l’évaluer », laissant entendre que gouvernement turc pourrait s’y opposer si Paris continuait de freiner l’entrée d’Ankara dans l’UE. Soucieux d’engranger les voix du camp national, Nicolas Sarkozy avait fait du non à l‘entrée de la Turquie dans l’UE l’un des thèmes de sa campagne pendant la présidentielle de 2007, prônant à la place un « partenariat spécial », dont Ankara ne veut pas entendre parler. Pendant sa présidence tournante de six mois, de juillet à décembre 2008, le président français avait néanmoins accepté d’ouvrir deux nouveaux chapitres de la candidature de la Turquie, portant leur nombre à 10 (sur 35). Un geste considéré comme tout à fait insuffisant par la partie turque, qui, réponse du berger à la bergère, pourrait s’opposer aux demandes françaises de réintégrer le commandement militaire de l’Otan…" Source
09:51 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, france, otan, atlantisme, sarkozy, alliance atlantique, occidentalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 février 2009
A propos de Céline et Karl Epting

À propos de Céline et Karl Epting
On conviendra qu’en étant l’éditeur, il m’est difficile de commenter le livre sur Céline et Epting ¹. Aussi je me bornerai à évoquer quelques réactions vues dans la presse et surtout sur la toile. Le tirage limité imposa un service de presse réduit et, ipso facto, la réception critique.
P.-L. Moudenc note que « Céline épistolier s'y montre tel qu'avec la plupart de ses autres interlocuteurs : surtout préoccupé de réalités matérielles, obtention de papier pour la publication de ses livres, visas pour se rendre au Danemark en passant par Berlin, paiement de droits d'auteur par son éditeur allemand. À l'occasion, il présente une requête pour un ami victime de la censure. S'il se risque à des considérations plus générales, c'est pour déplorer, en juillet 1943, que la collaboration ait été ratée “ par erreur et sottise dès le début, et entêtement et prétention par la suite ”. Nul propos antisémite ou vraiment raciste — sinon une interrogation sur l'hypothétique ascendance de Racine “ dont le théâtre n'est qu'une fougueuse apologie de la Juiverie ”, antienne reprise depuis Bagatelles. En ce domaine, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tant pis pour les ennemis forcenés d'un Ferdinand prétendu doctrinaire. Voire, comme le prétendait l'Agité du bocal (Sartre), stipendié par les nazis. Les textes d'Epting, écrits entre 1944 et 1963, sont ceux d'un témoin qui a saisi l'importance quasi universelle de l'écrivain dans la littérature de son siècle : “La critique culturelle de Céline, écrit-il à juste titre, représente l'un des grands contrepoints au développement de la civilisation rationaliste, technique et industrielle des années 1930 et 40, au témoignage plus profond et humain que des centaines d'analyses sociologiques, dont nous avons pu prendre connaissance depuis.” » ².
Ce que Moudenc trouve négligeable est, au contraire, mis en évidence par Pierre Assouline sur son blog. Son commentaire est, en effet, intitulé : « Quand Louis-Ferdinand Céline dénonçait Racine aux Allemands ». À propos de la publication de cette correspondance, il estime qu’elle vaut le détour pour deux raisons : « D’abord parce que l’auteur Frank-Rutger Hausmann, professeur de langue et littérature française à l’université de Fribourg-en-Brisgau, y apporte l’éclairage qui manquait sur la personnalité et les idées de Karl Epting, personnage clé de la collaboration intellectuelle franco-allemande sous l’Occupation, directeur de l’Institut allemand qui ouvrit ses portes dès le 1er septembre 1940 en l’hôtel Sagan, rue de Talleyrand (VIIème) afin d’y organiser des expositions, des conférences, des concerts et y recevoir le gratin littéraire parisien qui le bouda d’autant moins que la propagande pour la Nouvelle Europe avait le bon goût de n’y être pas ostentatoire. Epting, parfait francophone (difficile de parler de francophilie quand celle-ci arrive juchée sur des chars) fut un célinien inconditionnel dès la parution du Voyage au bout de la nuit en 1932 et le resta jusqu’à sa mort. Manifestement “ensorcelé” par l’écrivain, il admirait en lui l’héritier de Rabelais. Il ne cessera de le défendre contre ses compatriotes (Abetz, Payr…) qui lui reprochait son style hystérique, vulgaire, populaire et ordurier, pour ne rien dire de l’immoralité du fond. Quelques articles de ce célinien absolu sont reproduits à la fin. » À propos des soupçons de Céline à l’égard de Racine, il précise que « naturellement, la généalogie de Jean Racine a été maintes fois étudiée, par Raymond Picard notamment, et cette spéculation y est évoquée comme peu probable, ainsi que l’indique Arina Istratova dans ses précieuses notes en bas de page. Elle y rappelle également, en puisant aux meilleures sources, que si la Comédie-Française a bien monté entre 1940 et 1944 huit pièces de Molière et six de Corneille, il n’y en eut que deux de Racine (Andromaque et Phèdre) ³ ». L’intérêt du blog d’Assouline, l’un des plus fréquentés de la blogosphère, c’est qu’il reproduit les commentaires des internautes. Cette note de lecture en a suscité d’abondants, le pire côtoyant le meilleur. Comme on s’en doute les anticéliniens primaires n’ont pas manqué de se déchaîner. Bref florilège : « Je suis toujours étonné, pour ne pas dire scandalisé, que l’on puisse encore apprécier un tel type !!! » ; « Comment un esprit aussi épais dans sa vie ne le serait-il pas dans ses écrits et, de fait, il l’est, épais, son style est époustouflant mais sa voix d’auteur est obsessionnelle, paranoïaque, elle le révèle. » ; « Ce type relevait de la psychiatrie et d’un traitement carabiné. » ; « Ce vieux couillon blême de Céline, s’il avait pu lire, de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé (Fayard), il l’aurait sans doute moins ramené sur le sujet… » ; « Encore Céline ! Cet espèce de con monstrueux, avare et grossier personnage ! Les propos de Céline sont toujours du même niveau, et dans tous les domaines. Il faut vraiment en avoir une sacré dose pour croire que cet idiot ait été un écrivain. Lâchez nous un peu les baskets avec ce monstre de foire ! ». Fermez le ban !
Assurément plus nuancé, et tout aussi révélateur, le commentaire suivant : « Je me souviens, ayant lu Les Idées de Céline d’Alméras et sa biographie, n’avoir pu rouvrir aucun des livres de Céline pendant des années, rejet que n’avaient produit ni le Vitoux ni le Gibault. C’est l’enthousiasme d’un de mes amis, relisant Mort à crédit, qui m’a incité à le reprendre. Je l’ai relu en deux jours, estomaqué par son génie. En fait, le problème de Céline est insoluble. Il est sans excuses et il est immense. Il est aussi souvent délirant, c’est très frappant dans les Lettres de prison, comme s’il était allé trop loin dans l’exploration de la réalité, si loin qu’il ne s’agit plus du tout de réalité mais d’un magma puant d’où s’exhalent de préférence les pires saloperies. La question de Racine semble au premier abord à part, bouffonne, sans grande portée. Est-ce qu’il ne se fout pas un peu du monde en dénonçant un écrivain mort depuis près de 250 ans ? Sinon, je serais tenté d’y voir un acte de soumission absolue au vainqueur, un reniement total de sa propre culture et de ses fondements, à peu près sans exemple, bien moins drôle qu’il n’y paraît d’abord et finalement très grave. Imagine-t-on un Allemand, au cas où la France aurait occupé l’Allemagne, allant dénoncer Goethe ? ».
Sur un autre blog 4, un célinien, lui aussi anonyme mais reconnaissable entre tous comme nous l’avons déjà écrit, s’interroge : « Epting, francophile ? C'est passer sous silence les livres qu'il écrivit contre les Français entre 1934 et 1940 sous divers pseudonymes. Epting, “conservateur chrétien” parce qu'il écrit après guerre dans un journal qui a pour titre Christ und Welt – mais qui était dirigé par l'ancien rédacteur en chef de Signal 5 ? Hum… C'est blanchir Epting pour noircir Céline ? Ce n'est pas de sang dont parle Céline à propos de Racine, mais de nom, d'ancêtres, et d'inspiration poétique, d'un théâtre reposant sur le thème de l'amour, en opposition aux pièces de Corneille ou de Molière. » Quant à Philippe Alméras, cité par Assouline dans son commentaire, notre internaute ne décolère pas et en profite pour cibler, mais sans les nommer ceux-là, de prétendus céliniens : « Alméras, spécialiste de Céline ?... Pas moins qu'un autre… mais pas plus qu'un autre… et on en compte un nouveau tous les ans, tous les six mois, de spécialiste de Céline… à chaque nouveau livre... Il suffit de ressortir des lettres déjà publiées il y a vingt ans, d'y ajouter trois photos jusque là éparpillées dans diverses publications, d'appeler le tout “dossier inédit”, d'envoyer le tout à divers journalistes qui n'ont pas le temps de vérifier la qualité de la marchandise, et vous voilà consacré “spécialiste de Céline” auprès des néophytes. Ce n'est pas très nouveau. C'est la loi du commerce et de la publicité. C'est ce qu'on appelle aussi de la compilation et de la divulgation. Rien à voir avec la recherche. De la divulgation, il en faut, bien sûr... C'est même essentiel... Mais faudrait tout de même pas confondre. Le Dictionnaire Céline d'Alméras, sous son beau ramage et son beau plumage, est inutilisable par les étudiants ou les chercheurs céliniens tant il recèle d'erreurs, de contrevérités, de partis pris, d'approximations, de citations tronquées, d'interprétations fallacieuses et spécieuses. Un livre entièrement à refaire. Pas à corriger ! à refaire ! Les gens sérieux pourront faire la comparaison avec le Dictionnaire de Gaël Richard. Les jésuites diront : “C'est pas pareil...” En effet, ce n'est pas pareil ! Il y a le travail de première main et celui de seconde main. La recherche et la compilation. »
Revenons à Epting à propos duquel Frédéric Saenen se demande si « les premiers germes d’un célinisme digne de ce nom » ne seraient pas apparus sous sa plume : « On serait en droit de se poser la question, au vu de la pertinence des analyses qu’il développe, notamment dans ses articles au quotidien Christ und Welt. Sa vision de l’homme-Céline est elle aussi empreinte d’une lucidité confondante. Epting, en intitulant sa contribution aux Cahiers de L’Herne de 1963 « Il ne nous aimait pas », allait lancer une formule qui tranchait définitivement avec l’image d’un Céline thuriféraire du Grand Reich et de la Germanité. Il en profite aussi pour souligner la dynamique de cette si étonnante « contradiction intérieure » qui rendait le personnage à la fois attachant et infréquentable : « le contraste profond entre sa prise de position à l’égard des collectivités impersonnelles […], dans laquelle il pouvait être d’une cruauté qui, dans ses propos, allait jusqu’au paroxysme et son comportement à l’égard de l’individu concret, homme ou bête, dans lequel il n’a jamais cessé de rester le médecin et le protecteur. » Et Saenen de conclure : « Céline ? Un Docteur Jekyll et un Écrivain Hyde ! Cela fait soixante ans qu’on vous le dit… 6 »
Marc LAUDELOUT
Notes
1. Frank-Rutger Hausmann, L.-F. Céline et Karl Epting, Le Bulletin célinien, 2008, 146 p. Édition établie par Arina Istratova. Tirage limité à 410 exemplaires. 35 €, franco.
2. P.-L. Moudenc, « La bibliothèque célinienne s’enrichit encore », Rivarol, 19 décembre 2008.
3. Pierre Assouline, « Quand Louis-Ferdinand Céline dénonçait Racine aux Allemands », La République des livres, 12 décembre 2008 [http://passouline.blog.lemonde.fr]
4. Commentaire anonyme, 15 décembre 2008, à propos de « “ Quand Céline dénonçait Racine aux Allemands ” par Pierre Assouline », Entre guillemets…,13 décembre 2008 [http://ettuttiquanti.blogspot.com].
5. Ce sont naturellement les divers arrticles de Karl Epting publiés après la guerre qui ont permis de le qualifier de la sorte. Voir notamment sa contribution au colloque consacré, six ans avant sa mort, à Simone Weil.
6. Frédéric Saenen (article à paraître dans Le Magazine des livres).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, allemagne, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 février 2009
Les Etudes rebatiennes
Association littéraire: Les Etudes Rebatiennes
 Novopress, 5/2/2009 : "Les Deux étendards, chef d’œuvre classique et maudit.
Novopress, 5/2/2009 : "Les Deux étendards, chef d’œuvre classique et maudit.Qu’est-ce qu’un livre classique ? C’est « une œuvre contemporaine de tous les âges » comme le disait Sainte Beuve. Échappant au contexte qui l’a vu naître, sans prétendre illusoirement à l’intemporalité, le classique traverse les modes et les aléas de l’histoire. C’est un texte qui parle à l’intelligence et au cœur. Les deux étendards serait-il resté un classique méconnu du fait de la conspiration du silence engendrée par les opinions politiques scandaleuses de l’auteur ? Nous le pensons. Nous en avons l’intuition.
Mais une intuition, même partagée par des esprits prestigieux, demande à être élaborée. Or, seul le tamis du travail d’exégèse et du commentaire critique que les Etudes rebatiennes se proposent d’engager aujourd’hui permettra, notamment en arrachant la littérature au politique de qui en masque la substance, de transformer cette intuition en certitude incontestable. Nous espérons que la publication d’inédits, de témoignages et d’entretiens, l’organisation de colloques en apporteront les preuves définitives.
C’est pourquoi les Etudes rebatiennes ont été fondées. Elles se donnent pour tâche de contribuer au rayonnement de l’œuvre littéraire de Lucien Rebatet. Les Etudes rebatiennes s’adressent donc aux amoureux de la grande littérature.
La revue
Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles ; actualité rebatiennes ; vie de l’association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu’elles soient œuvres de qualité élaborées par des personnes compétentes. Le premier numéro sortira dans un an.
Renseignements, abonnements : etudesrebatiennes@gmail.com
00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, littérature française, lettres françaises, lettres, littérature, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 février 2009
La guerre de Vendée et le système de dépopulation
| | La Guerre de la Vendée et le système de dépopulation Par Gracchus Babeuf Présenté et annoté par Reynald Secher et Jean-Joël Brégeon – Préface par Stéphane Courtois – Avant-propos par Reynald Secher Paru en : Novembre 2008 24,00 € - Disponible - 240 pages  | |
| En 1795, dans un ouvrage publié à l'occasion du procès de Jean-Baptiste Carrier, l'auteur des noyades de Nantes, Gracchus Babeuf, père du communisme, l'une des grandes figures de la Révolution française, soulevait la question de fond de la nature de la répression perpétrée par la Convention en Vendée. Ce livre doublement, révolutionnaire par son contenu et son titre « Du système de dépopulation », se présente comme un réquisitoire très bien documenté, et d'une incroyable modernité, contre la politique dictatoriale menée par les Conventionnels et Robespierre en France, en 1793 et 1794, politique qui devait conduire, entre autres, à l'anéantissement et à l'extermination des Vendéens, Bleus et Blancs confondus, et de préférence des femmes des enfants. Collaborations : Jean-Joël Brégeon - Stéphane Courtois - Reynald Secher |
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution française, terrorisme, génocide, extermination, exterminisme, vendée, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 février 2009
L'educazione da Le Bon a Gentile
L’educazione da Le Bon a Gentile
Le Bon è conosciuto principalmente per la sua celeberrima Psychologie des foules (Psicologia delle folle), pietra miliare per la storia degli studi sui comportamenti delle masse. Le sue teorie illustrano che le folle, per loro intrinseca natura, agiscono non già perché sospinte dal lume della ragione, bensì secondo istinti irrazionali: ogni individuo, a prescindere dalla propria cultura e dal proprio livello sociale, unendosi alla folla, smarrisce la propria razionalità lasciandosi trasportare dall’inconscio collettivo, perdendo di fatto la propria individualità: «La logica e la ragione non sono mai state le vere guide delle nazioni. L’irrazionale ha sempre rappresentato uno dei più forti incentivi all’azione che l’umanità abbia mai conosciuto».
La massa è priva di freni inibitori ed è quindi eminentemente distruttiva, mai costruttiva, e la sua azione è mossa da un desiderio di distruggere per conservare, non già per innovare: «gli istinti della folla sono istinti conservatori». Le masse sono altresì estremamente volubili e volitive al tempo stesso, e da qui Le Bon elabora la teoria del capo carismatico, l’unico che possa efficacemente cavalcarne i furori, il quale non fornisce loro argomentazioni logiche e razionali, bensì intende le loro esigenze e i loro sentimenti e sa indirizzarli: «Non è ai lumi della ragione che il mondo si è trasformato. [...] I sistemi filosofici di fatti non propongono alle folle che argomenti, quando invece l’animo umano chiede solo speranze».
 Psicologia delle folle fu pubblicata nel 1895, andando a minare il positivismo di stampo illuministico che era alla base delle democrazie di fine ‘800: se si negavano infatti alle masse moderazione e raziocinio, l’ideale di regime democratico sostenuto dal popolo illuminato veniva ineluttabilmente meno. Le sue tesi furono poi raccolte e messe in pratica da due esempi paradigmatici di capo-popolo: Mussolini e Lenin.
Psicologia delle folle fu pubblicata nel 1895, andando a minare il positivismo di stampo illuministico che era alla base delle democrazie di fine ‘800: se si negavano infatti alle masse moderazione e raziocinio, l’ideale di regime democratico sostenuto dal popolo illuminato veniva ineluttabilmente meno. Le sue tesi furono poi raccolte e messe in pratica da due esempi paradigmatici di capo-popolo: Mussolini e Lenin.Da tali considerazioni psicologiche e sociologiche di Le Bon nacque, infine, il suo noto aforisma assurto a summa del suo pensiero politico:
Un’altra opera fondamentale di Le Bon è Psychologie de l’éducation (Psicologia dell’educazione), che vide la luce nel 1910. In essa il Nostro analizzava la decadenza della scuola e dell’università francese, indicandone le cause – tra l’altro già comprese dagli accademici coevi – e proponendo il proprio ideale di educazione per la gioventù.
All’inizio del XX secolo si discuteva in Francia di una riforma della scuola e dell’università, giacché le condizioni dell’istruzione vi apparivano critiche e scoraggianti. Sono veramente sorprendenti, in proposito, le calzanti analogie tra la scuola della Francia del primo ‘900 e quella italiana attuale!
Gli accademici francesi, di fronte a tale profonda crisi, si arrovellavano invano il cervello al fine di escogitare le giuste modifiche da apportare ai programmi scolastici. Tuttavia fu Le Bon ad intuire genialmente che la chiave di volta non era da ricercare nei programmi, bensì nel metodo di insegnamento.
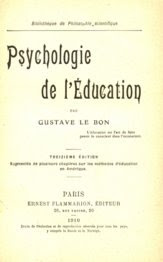 Gli studenti, dalle elementari sino alle facoltà universitarie, sono condannati all’apprendimento mnemonico di manuali che servirà loro unicamente alla “recitazione” in sede d’esame. Già di per sé il manuale rappresenta un accesso al sapere di seconda mano, poiché filtrato da colui che lo ha redatto, il quale ha già dato – per forza di cose – un’impronta personale alla materia che intende trattare. Lo studente non è quindi libero di trarre il nutrimento della propria cultura direttamente dalla fonte ma, impossibilitato al giusto sviluppo del suo senso critico, non fa che ripetere nozioni impostegli dall’alto. Ma la vera sciagura è che coloro che hanno buona memoria ma poca intelligenza vengono più spesso premiati a scapito degli altri più meritevoli.
Gli studenti, dalle elementari sino alle facoltà universitarie, sono condannati all’apprendimento mnemonico di manuali che servirà loro unicamente alla “recitazione” in sede d’esame. Già di per sé il manuale rappresenta un accesso al sapere di seconda mano, poiché filtrato da colui che lo ha redatto, il quale ha già dato – per forza di cose – un’impronta personale alla materia che intende trattare. Lo studente non è quindi libero di trarre il nutrimento della propria cultura direttamente dalla fonte ma, impossibilitato al giusto sviluppo del suo senso critico, non fa che ripetere nozioni impostegli dall’alto. Ma la vera sciagura è che coloro che hanno buona memoria ma poca intelligenza vengono più spesso premiati a scapito degli altri più meritevoli.L’apprendimento acritico del libro scolastico porta inoltre con sé il catastrofico abbandono dell’attività manuale e fisica, tra l’altro snobbata dai genitori perché ritenuta plebea e squalificante. Al contrario Le Bon insiste sul fatto che il lavoro manuale, complementare a quello intellettuale, tempri e fortifichi la volontà del giovane discente, il quale possa poi godere e gioire del successo finale scaturito dal suo sudore e dal suo sacrificio.
Il sociologo francese si mostrava tuttavia scettico nei confronti di una riforma che potesse veramente raddrizzare le disgraziate sorti della scuola e dell’università. Occorreva infatti anzitutto cambiare la mentalità dei maestri e dei professori, malauguratamente troppo vecchi e fieri per cambiare; se con loro – essi pensavano – il metodo aveva funzionato, ciò voleva dire che esso era il migliore: pura e presuntuosa vanità… Tutti coloro che invece si dimostravano liberi e innovatori venivano inevitabilmente messi in minoranza o ignorati.
Il vero ideale di Le Bon riguardo all’educazione era quello che riuscisse a formare il carattere e la personalità dei giovani, in luogo di preparare quest’ultimi alla monotona “recitazione” di un sapere che non è il loro. La scuola deve dunque formare ed educare prima ancora che istruire.
Per Le Bon, in ultima analisi, un uomo si valuta in base al suo carattere, non alla sua cultura.
Nel 1923 il ministro dell’Istruzione varò dunque tale riforma che si ispirava in buona parte ai princìpi fondamentali propugnati da Le Bon.
Il sapere enciclopedico non era più praticabile. Esso affondava le proprie radici nel lontano medioevo, nel quale tutto lo scibile umano si credeva – dopo la rivelazione di Cristo – dato una volta per sempre. Il metodo mnemonico era stato poi perfezionato dai padri gesuiti e finalizzato all’apprendimento del latino, dando ottimi frutti. Ma ora che le conoscenze per tutte le materie si erano arricchite in maniera più che massiva, era veramente troppo il pretendere dal giovane studente una titanica impresa di memorizzazione di tutte queste nozioni.

Per la riforma gentiliana era quindi necessario riaccendere nella scuola la fede nelle forze spontanee dello spirito, e di assegnare di nuovo ad essa come fine non già l’enciclopedia o l’immediata utilità, bensì la formazione della personalità del discente. Occorreva dunque riaffiatare la scuola con la vita, della quale doveva essere prosecuzione e consapevole approfondimento, non già negazione.
L’ideale enciclopedico, più consono alla mentalità delle masse, tende a valutare quantitativamente ogni forma di attività umana, premuta com’è da esigenze utilitarie. Tale utilitarismo, di stampo anglosassone, pone l’individuo in grado di trarre dal patrimonio del sapere il maggior numero possibile di nozioni immediatamente utilizzabili. Per i fautori della nuova riforma, invece, il sapere non esiste avulso dalla matrice che lo crea e lo alimenta – ossia la mente dell’uomo – ed educare significa suscitare e disciplinare energie, non già distribuire nozioni. Il manuale è dunque bandito: a insegnare poesia saranno i poeti, a insegnare filosofia saranno i filosofi. In questo modo il giovane studente, attraverso la lettura diretta delle fonti, dovrà sviluppare il proprio senso critico e svegliare la sua capacità di giudizio. Il manuale, ossia il sapere preconfezionato, lascia il posto alla dura ricerca del ragazzo, il quale si farà da sé il proprio manuale, frutto del suo lavoro intellettuale, e quindi veramente acquisito.
 Deve parimenti essere reintrodotta l’attività fisica, complementare a quella speculativa, di cui il regime fascista farà una bandiera, poiché, attraverso lo sforzo fisico, il discente deve temprare la propria volontà e il proprio senso del sacrificio in vista dell’obiettivo finale.
Deve parimenti essere reintrodotta l’attività fisica, complementare a quella speculativa, di cui il regime fascista farà una bandiera, poiché, attraverso lo sforzo fisico, il discente deve temprare la propria volontà e il proprio senso del sacrificio in vista dell’obiettivo finale.Ma come è possibile superare lo scetticismo che aveva espresso Le Bon riguardo alla mentalità dei professori che dovranno farsi carico di questo cambiamento metodologico? Come è possibile far loro rinunciare al metodo che li ha formati e che quindi reputano retto e giusto?
I riformatori fascisti si appellarono dunque non già ai vecchi maestri della vecchia scuola, bensì ai giovani, a quegli stessi giovani che hanno entusiasmo e voglia di cambiare e innovare.
E non poteva essere altrimenti in un nazione che viveva e cantava al suono di Giovinezza…
00:15 Publié dans Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, italie, 20ème siècle, éducation, école, pédagogie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook







