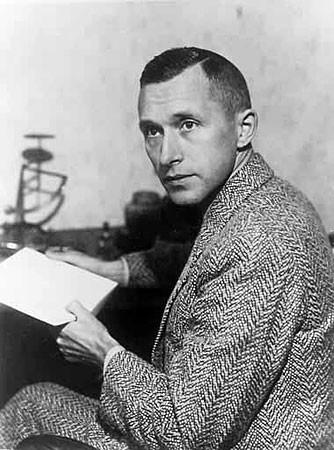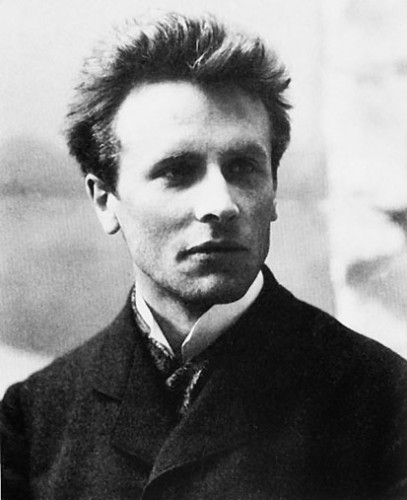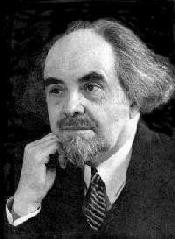Quelques dates et quelques étapes dans le retour de la conscience païenne en Europe
Robert STEUCKERS
L'objectif de cette longue liste est de donner au lecteur et à l'éventuel mémorisant l'envie d'approfondir quelques aspects de l'aventure néo-païenne à l'œuvre en Europe depuis les humanistes italiens du XVième siècle. Cette liste n'est pas du tout exhausive. Nous sommes conscients de ses lacunes, mais nous avons d'abord voulu évoquer des étapes ou des événements peu connus, significatifs et non réductibles aux vulgates paganisantes ou anti-paganisantes qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui. Nous n'avons pas repris les étapes de la redécouverte archéologique ou linguistique des faits indo-européens, indissociables toutefois de la reprise en compte de notre plus lointain passé. Nous avons arrêté nos investigations dans les années 20 de ce siècle.
1176: A Cardigan au Pays de Galles, se tient le premier Eisteddfod gallois en présence de Lord Rhys ap Grufydd.
1365- c. 1430: Christine de Pizan, qui préfigure le féminisme européen, commence son traité d'héraldique par une invocation directe à Minerve, déesse des facultés intellectuelles, de l'intelligence et des armes. Minerve remplace ainsi la figure abstraite de la Sapientia.
1422-1427: Découverte dans les milieux humanistes italiens du texte de Tacite, Germania. La redécouverte de ce texte ouvre la pensée européenne aux réalités non classiques de l'Europe du Nord.
1431: L'humaniste italien Lorenzo Valla publie De voluptate, tentant de concilier la ferveur spirituelle chrétienne et la fantaisie sensuelle des Epicuriens, en rejetant le filon stoïcien qui érigeait la frigidité au rang de vertu. La parution de ce texte est contemporaine de la représentation picturale de nombreuses Vénus, nymphes, grâces et muses.
1450: A Rimini en Italie, Leon Battista Alberti construit en 1450 le Tempietto Malatestiano, en l'honneur du condottieri Sigismondo Malatesta, ennemi du Pape. Toutes les icônes de ce temple sont païennes, notamment un soleil faisant référence directe à Apollon. Pie II, en dépit de sa tolérance et de ses largesses de vue, condamne ce temple, comme expression du paganisme mais en réalité il le refuse car il est un “pied-de-nez” à l'institution pontificale, et excommunie Malatesta.
1450: Naissance à Schlettstadt (Sélestat) en Alsace de l'humaniste, juriste et théologien allemand Jakob Wimpfeling. Sur base de la Germania de Tacite, réédité par Konrad Celtis en 1500, il développe les premières manifestations du nationalisme allemand. Les Germains de Tacite sont proches de la nature, simples et guerriers: tel est le modèle de la meilleure humanité (comme le disait aussi Machiavel en admirant et en préconisant le système des milices paysannes et guerrières suisses). Chez Wimpfeling toutefois, le modèle germanique ne doit pas uniquement conduire à exalter la guerre, mais à promouvoir d'autres vertus importantes en Europe du Nord et en Europe centrale: l'humanité, la magnanimité, le courage civique et l'hospitalité. Il défend farouchement la germanité naturelle de l'Alsace contre les premières manifestations de la francisation.Wimpfeling meurt dans sa ville natale en 1528.
1455: La ville de Pienza commande des travaux de réaménagement urbain à Federico de Montefelto. Parmi les innovations, celui-ci fait construire un temple dédié aux Muses (Tempietto delle Muse). L'iconographie païenne s'y juxtapose à l'iconographie chrétienne.
1459: Naissance à Wipfeld près de Schweinfurt de l'humaniste allemand Konrad Celtis (en réalité Konrad Bickel ou Pickel). Philosophe itinérant, poète récompensé en 1487 par l'Empereur Frédéric III, ami des humanistes italiens, fondateur des premières sociétés littéraires polonaise (Sodalitas Vistulana; Cracovie, 1489-91) et hongroise (Sodalitas literaria Hungerorum), ensuite de nombreuses sociétés littéraires allemandes (à Vienne et en Rhénanie). Konrad Celtis écrit en latin, mais un latin non académique, proche de la simplicité populaire. Il édite en 1487 les textes de Sénèque et en 1500 la Germania de Tacite. Quand il édite ce texte mineur de Tacite (mais combien important pour la prise de conscience nationale future des Allemands), ses intentions sont anti-cléricales et, à l'instar de du Bellay et Ronsard, de défendre la langue populaire contre un latin figé et les trop nombreux emprunts à l'italien. Celtis lance une idée qui fera son chemin: Tacite, dans Germania, nous enseigne les vertus de la simplicité et de la primitivité. Dans certains textes, il applique la méthode de Tacite aux Allemands de son siècle, en vantant les mérites de la simplicité scythe, à imiter. Celtis introduit ainsi les premiers linéaments de la russophilie des nationalistes et des conservateurs allemands. Konrad Celtis meurt à Vienne en 1508.
1472: Naissance à Ingstetten près de Justingen dans le Wurtemberg de l'humaniste et poète Heinrich Bebel, fils de paysan. Professeur de rhétorique à l'université de Tübingen, il est nommé “poeta laureatus” par l'Empereur Maximilien I en 1501. Bebel lutte contre la scolastique étouffante, développe les armes de la satire et de l'ironie dans sa rhétorique, revalorise les traditions populaires et le langage non frelaté de l'homme du peuple. Cette simplicité permet le politique, car elle a donné à l'antique Rome républicaine ses vertus de paysans-soldats frugaux, figures par excellence destinées à la gloire militaire et impériale. Or les Allemands du temps de Bebel doivent assurer la responsabilité de l'Empire. Ce n'est que sur base d'une simplicité, comparable à la frugalité romaine antique, que cette mission divine peut être assurée. Bebel meurt en 1518 à Tübingen.
1484: Le 5 décembre 1484, le Pape émet la Bulle “Summis desiderantes” contre les sorcières.
1486: Pic de la Mirandole prépare, pour l'assemblée d'humanistes et d'érudits qu'il a convoqués à Rome et qui sera interdite par le Pape, une De hominis dignitate oratio, où il définit la gloire de l'homme par sa capacité à changer, à adopter des comportements différents. L'espace où agit l'homme n'est pas clos comme celui des anges ou des animaux. Cette absence de fermeture lui permet de devenir ce qu'il veut devenir. L'homme peut végéter comme une plante, se démener comme une brute, danser comme un dieu, raisonner comme un ange ou se retirer dans l'antre de sa solitiude. “Qui hunc notrum chameleonta non admiretur?” (= Qui d'entre nous n'admirerait pas ce chaméléon?). Spécialiste de la redécouverte de la paganité hellénique pendant la renaissance italienne, l'historien anglais Edgard Wind écrit: «Dans cette poursuite aventureuse de sa propre auto-transformation, l'homme explore l'univers comme s'il s'explorait lui-même. Et plus il porte ses métamorphoses vers le lointain, plus il découvre que ces phases variées de son expérience sont transposables les unes dans les autres: car toutes reflètent en ultime instance l'Un, dont elles développent des aspects particuliers. Si l'homme ne sent pas l'unité transcendante du monde, il perdra également son inhérente diversité. Pic exprime cette idée de manière cryptée mais indubitable dans l'une de ses conclusiones orphiques: “Celui qui ne peut attirer Pan à lui, approchera Protée en vain”». Pic de la Mirandole fait l'équation entre Pan et le Tout, réintroduit dans la pensée européenne le polythéisme orphique, la vision renaissanciste d'un univers pluriel.
1486/87: Les dominicains et inquisiteurs allemands Jacob Sprenger (Bâle) et Heinrich Institoris (Schlettstadt/Sélestat) publient le Hexenhammer (Malleus maleficarum), manuel de l'inquisition contre les sorcières.
1496: Dans Practica Musice l'humaniste Luc Gafurius publie une image montrant l'harmonie divine, où ne figurent que les muses, les dieux et la cosmologie païenne.
1508-1511: Raphaël installe son Ecole d'Athènes dans le Vatican, ce qui banalise les images des dieux et des déesses païennes dans toute l'Europe.
1514: L'humaniste Justus Bebelius traite dans ses ouvrages de l'ancienne religion des Germains et des druides gaulois.
1520: A Piacenza en Italie, le juriste Gianfrancesco Ponzinibio s'insurge contre les procès en sorcellerie dans un réquisitoire imprimé et diffusé. En 1523, il doit répondre à l'inquisiteur de Spina.
1532: L'humaniste français Jean le Fèvre publie son ouvrage Les Fleurs et Antiquitez des Gaules, où il est traité des Anciens Philosophes Gaulois appellez Druides, première approche de la religiosité celtique en France.
1556: L'humaniste français Picard reprend la mythologie imaginaire d'Annius de Viterbe (1498), du moins pour ce qui concerne les Gaulois.
1563: Le médecin du Duc de Clèves, d'obédience calviniste, Johannes Weyer (1516-1588) rédige un ouvrage pour dénoncer la folie des procès de sorcellerie et le dédie à l'Empereur Ferdinand I, frère de Charles-Quint (Über die Blendwerke der Dämonen, Zaubereien und Giftmischereien). L'Empereur le félicite mais l'ouvrage sera mis à l'index.
1567-1570: Le sculpteur Giovanni di Bologna installe des statues de bronze des divinités païennes dans la ville de Bologne (Hercule), dans les Jardins de Boboli (Oceanus) et à Florence (Neptune).
1579: Le juriste toulousain Forcadel, dans De Gallio Imperio et Philosophia reprend à son tour la vision d'Annius de Viterbe, mais y ajoute des paragraphes importants sur la fonction juridique des Druides. Forcadel entend ainsi, implicitement, revenir à un droit plus conforme au passé de la Gaule/France.
1582: L'humaniste écossais George Buchanan (1506-1582), dans son “Histoire de l'Ecosse”, jette les bases des études celtiques comparées. Il souligne la parenté des langues celtiques.
1585: L'humaniste français Noël Taillepied publie Histoire de l'estat et républiques des Druides, Eubages, Sarronides, Bardes, Vacies, anciens François, gouverneurs des pais de la Gaule, depuis le déluge universel, iusques à la venue de Jésus Christ en ce monde. Compris en deux livres, contenans leurs loix, police, ordonnances, tant en l'estat ecclésiastique, que séculier. Taillepied consacre vingt sections de cet ouvrage aux codes légaux et aux ordonnances des druides. Le retour à la Gaule chrétienne chez cet humaniste est lié à une volonté de retrouver un droit accordant au peuple davantage de libertés concrètes.
1592: Le prêtre catholique et théologien Cornelius Loos (ca. 1546-1595) est sommé de se rétracter: il avait protesté contre les exécutions de sorcières par le feu à Trêves où il était professeur. Le Nonce de Cologne Ottavio Mirto Frangipani l'avait fait enfermer dans l'abbaye de Saint-Maximin. Après sa rétractation, il dirige une paroisse à Bruxelles, mais continue de s'insurger contre les procès en sorcellerie. Il est à nouveau enfermé et meurt prisonnier.
1594: Une tentative échoue d'organiser un Eisteddfod au Pays de Galles.
1602: Adriaen de Vries, disciple du sculpteur Giovanni di Bologna, installe la première statue païenne hors d'Italie, à Augsburg en Bavière. Il s'agit d'une fontaine d'Hercule. Désormais, les figures du panthéon païen remplacent sur les fontaines les représentations médiévales de Saint-Georges.
1618: Le poète et dramaturge anglais John Fletcher, dans sa pièce consacrée à la figure de Bonduca (= le reine celtique Boadicée, résistante à la l'occupation romaine), fait apparaître sur scène des druides et des bardes dans une séquence dansée. La perspective de Fletcher est patriotique et renoue avec le passé celtique de l'Angleterre, exalté comme vierge de toute influence continentale.
1622: Le poète et humaniste anglais Michael Drayton (1563-1631) publie son long poème en alexandrins intitulé Polyolbion, où il conte les merveilles de la Britannia, mélangeant doux idyllisme et patriotisme. Dans ce poème, les druides apparaissent comme des “bardes sacrés” dont la connaissance des mystères de la nature a été la plus profonde jamais acquise par les hommes.
1623: L'humaniste et médecin Guenebault publie Le réveil de l'antique tombeau de Chyndonax, Prince des Vacies, druides celtiques, dijonnois,... Dans cet ouvrage, l'auteur insiste sur la fonction juridique des druides.
1627: Le Jésuite Adam Tanner (1572-1632), professeur à Ingolstadt, veut réintroduire le “Canon Episcopi”, selon lequel la sorcellerie n'est que superstition sans fondement. Puisqu'il n'y a pas de fondement, les tortures et les exécutions sont inutiles. L'Inquisition menace de lui faire subir la torture.
1631-1632: Le Jésuite allemand Friedrich von Spee (1591-1635) demande de limiter les procès en sorcellerie dans sa “Cautio criminalis”. Des pressions sont exercées sur le RP von Spee. La guerre de Trente Ans ruine ses efforts.
1635: Le luthérien de tendance piétiste Johannes Matthäus Meyfart (1590-1642) tente de reprendre le combat du Jésuite von Spee, cette fois dans les territoires protestants, mais se fait beaucoup d'ennemis.
1648: L'humaniste allemand Elias Schedius publis De Dis Germans (= Des dieux des Germains), traitant de la religion des “anciens Germains, Gaulois, Bretons et Vandales”.
1660: Le roi d'Angleterre Charles II fait figurer sur les nouvelles pièces de monnaie anglaises la déesse Britannia, ce qui n'avait plus été fait depuis l'empire romain. L'Etat ou la nation sont désormais considérés comme des divinités. L'hymne patriotique anglais Rule, Britannia en est un autre témoignagne. En Allemagne, apparaît la déesse Virtembergia (= Wurtemberg), sur le sommet du Château Solitude près de Stuttgart en 1767.
1670: John Aubrey fonde l'association druidisante Mount Haemus Grove, dont l'inspiration dérive d'une société du même nom qu'aurait fondée à Oxford en 1245 le barde Philipp Bryddod.
1676: Aylett Sammes écrit dans sa Britannia Antiqua Illustrata, que les druides croyaient en l'immortalité de l'âme, ainsi qu'à la transmigration de celle-ci, à la façon de Pythagore. Les druides auraient supplanté des prêtres phéniciens en Bretagne, constituant de la sorte un “clergé” autochtone, plus en prise avec la spiritualité du peuple celtique-britannique.
1692: Le prêtre réformé néerlandais Balthasar Bekker (1634-1698) est destitué. Il avait étudié les superstitions relatives aux comètes, aux œuvres du Diable et aux fantômes, puis avait condamné les procès en sorcellerie au nom de la raison et du message des saintes écritures.
1703: Dans The Description of the Western Islands of Scotland, Martin Martin traite des cercles de pierres dressées dans les Orkneys et signale qu'ils étaient des lieux de cultes païens.
1703: L'abbé breton Pezron lance la vogue des études celtiques sur le continent (dans L'antiquité de la nation et la langue des Celtes). C'est lui qui donne au terme “celte” sa connotation actuelle.
1707: Le philologue gallois Edward Lhuyd collationne une quantité de matériaux écrits, oraux et chantés dans les pays celtiques pour en faire la base d'études comparées de celtologie dans le cadre de l'Université d'Oxford.
1717: John Toland, successeur de John Aubrey (cf. 1670), fonde l'Ancient Druid Order.
1718-1742: Le maître-jardinier Stephen Switzer énonce les règles pour installer des statues de divinités païennes dans les jardins publics et privés (cf. Ichonographica Rustica).
1720: Lord Cobham commande au sculpteur anglais John Michael Rysbrack de lui faire sept statues représentant les divinités saxonnes des jours, pour ses jardins de Stowe.
1720: L'Allemand Johann G. Keysler, dans Antiquitates Selectae Septentrionales et Celticae, publiées à Hannovre, décrit les résidus des anciens cultes païens en Allemagne, dans les Pays-Bas et en Grande-Bretagne.
1723: Le pasteur Henry Rowlands de l'île d'Anglesey publie Mona Antiqua Restaurata, où le druidisme n'est plus considéré comme diabolique mais comme l'expression d'une conscience de l'harmonie de la nature. Pour le reste, il les dénigre comme tenants d'un culte barbare et sanglant.
1740: Simon Pelloutier publie son Histoire des Celtes, cherchant, surtout dans la deuxième édition de 1770, à mettre sur pied d'égalité les religions celtique et germanique pour des motifs politiques.
1747: L'architecte anglais John Wood l'Ancien (1704-1754) énonce l'hypothèse que sa ville natale de Bath était à l'origine le lieu d'un culte druidique et apollinien. Wood s'intéresse ensuite au site de Stonehenge, dont il reproduit la géométrie sacrée pour une place de Bath, appelée “Circus”. Dans son ouvrage Choir Gaure, il associe directement Stonehenge aux cultes druidiques. Il jette ainsi les bases d'une renaissance druidique en Angleterre.
1750: Le prêtre catholique Hieronymus Tartarotti fait paraître à Venise un vigoureux plaidoyer contre les procès en sorcellerie.
1752-1766: Le Comte de Caylus, dans son grand Recueil des antiquités, émet l'hypothèse que les mégalithes ouest-européens sont des sites cultuels pré-druidiques. A la fin de sa vie, il les qualifiera de “druidiques”.
1754: William Cooke publie An Enquiry into the Druidical and Patriarchal Religion.
1760-62-63: Le poète écossais James MacPherson de Kingussie publie des “traductions” (fictives) d'anciens manuscrits gaëliques d'Ecosse. Ils deviendront célèbres sous le nom d'Ossian. Il lance ainsi la vogue romantique pour le celtisme.
1763: Sir James Clerk fait ériger la statue d'un druide à l'entrée de son château, Penicuik House, à Midlothian en Ecosse.
1764: Le poète gallois Evan Evans publie Specimens of the Poetry of the Ancient Welsh Bards. En 1784, il publie Musical and Poetical Relics of the Welsh Bards.
1766: Le médecin personnel de l'Impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, Reine de Hongrie, Gerhard van Swieten (1700-1772), transmet un mémoire visant à supprimer la torture et les exécutions en matières de sorcellerie, celle-ci n'étant que l'expression de la sottise, de la folie ou de la mélancolie. En 1768, le code de la pratique judiciaire impérial interdit la torture dans les procès de sorcellerie. Ainsi la Grande Impératrice Marie-Thérèse met un terme à la folie inquisitoriale de la West-Flandre à la Transylvanie.
1766: En Bavière, Don Ferdinand Sterzinger (1721-1786) et Eusebius Amort stigmatisent les procès en sorcellerie et portent un coup fatal à l'Inquisition dans leur pays.
1771: Fondation au Pays de Galles du mouvement celtisant et révolutionnaire, d'inspiration druidique, Cymdeithas Gwyneddigion, qui s'affirmera plus tard comme “radical” et “républicain”.
1779: Naissance à Vesterbro près de Copenhague du poète danois Adam Gottlob Oehlenschläger. Il deviendra le poète de la renaissance nationale danoise et puisera ses inspirations dans le patrimoine de la mythologie et des sagas scandinaves. Avec la notable exception d'une pièce sur Aladin et d'une interprétation des “Mille et une nuits”. Il meurt en 1850 à Copenhague.
1781: Henry Hurle fonde à Londres l'Ancient Order of Druids, une société ésotérique fonctionnant selon les règles de la maçonnerie.
1782: Naissance à Kyrkerud dans le Värmland du poète suédois Esaias Tegnér. La publication de son poème Svea en 1811 fait de lui le poète patriotique par excellence. Il aborde les mêmes thématiques patriotiques que la Ligue Gothique de Geijer. Les grandes lignes de force de son œuvre sont la fantaisie, le courage héroïque, l'enthousiasme, l'élégance ironique, la sensualité, exprimés dans une forme claire et classique. Il s'oppose au patriotisme réactionnaire et obscurantiste et estime que les thèmes de la mythologie scandinave doivent être mobilisés pour faire de la Suède un Etat d'avant-garde sur la scéne européenne. A partir de 1825, il sombre dans le pessimisme, la misanthropie et la mélancolie. Il meurt en 1846 à Östrabo près de Växjö.
1783: Naissance à Ransäter dans le Värmland de l'écrivain suédois Erik Gustav Geijer. Dans sa jeunesse, il est un adepte des Lumières mais se tournera rapidement vers le romantisme national. Il fonde la Ligue Gothique (Götiska Förbundet), expression de la conscience nationale suédoise, basée sur les vertus attribuées aux peuples sacandinaves. Iduna (= nom de la déesse scandinave de la jeunesse) est la revue dans laquelle il exprime ce corpus idéologique. A la fin de sa vie, Geijer élabore une philosophie de la personnalité, qu'il oppose à celles de Hegel et Feuerbach, où apparaissent également des thèmes comme la joie de vivre dans la nature, le renoncement aux biens de consommation, l'ancrage dans l'existence. Geijer meurt en 1847 à Stockholm.
1786: L'Irlandais Joseph Walker publie Historical memoirs of the Irish Bards.
1787: Une pièce de monnaie de la Parys Mine Company de l'île d'Anglesey est ornée de la tête d'un druide, couronnée de feuilles de chêne. L'île est considérée dès cette époque comme le site majeur d'un culte druidique (cf. 1723).
1787: Thomas Taylor traduit l'“Hymne orphique à Pan”, induisant les poètes romantiques à redécouvrir l'âme de toutes choses.
1789: La poétesse irlandaise Charlotte Brooke publie Reliques of Irish Poetry.
1789: Thomas Jones de Crowen, agitateur politique gallois, réétablit la fête traditionnelle celtique de l'Eisteddfod (concours de chants et de poésies d'inspiration nationale et identitaire). Son compatriote, également membre du groupe identitaire et celtisant Gwyneddigion, Edward Williams, alias Iolo Morganwg, recrée la cérémonie druidique du Gorsedd.
1791: Fondation de l'“Association bretonne” par Armand de la Rouerie, afin de restaurer l'autonomie bretonne dans le respect des clauses du Traité de 1532. De la Rouerie prévoyait le recours aux armes pour rétablir la légitimité. Il avait soutenu la révolution française jusqu'à la suppression du Parlement de Bretagne par l'Assemblée nationale.
1792: Le premier Gorsedd est tenu publiquement au Pays de Galles, le 21 juin 1792. En octobre, Edward Williams/Iolo Morganwg célèbre une fête druidique de l'équinoxe en plein Londres.
1793: A Posen (Poznan), encore sous juridiction polonaise, deux femmes accusées de sorcellerie, sont brûlées sur le bûcher, avant l'arrivée des juges prussiens qui avaient interdit l'exécution et déclaré le procès nul et non avenu.
1796: Dans ses Origines gauloises, La Tour-d'Auvergne traite des dolmens et des alignements de pierres dressées en Grande-Bretagne et en Armorique.
1804: Edward Davies publie Celtic Researches, approfondissant ainsi l'étude du druidisme et des cultes païens celtiques.
1805: Fondation de l'académie celtique en Bretagne par l'érudit Jean-Francis Le Gonidec.
1805: Jacques Cambry publie Monuments celtiques, contribution importante à la redécouverte de la religiosité native dans les pays celtiques. Les monuments mégalithiques sont druidiques et ont une fonction astronomique, conclut-il.
1809: Edward Davies poursuit son œuvre (cf. 1804) et publie The Mythology and Rites of the British Druids.
1815: Samuel Rush Meyrick et Charles Hamilton Smith publient Costume of the Original Inhabitants of the British Islands.
1818: Le 22 janvier 1818, l'écrivain anglais Leigh Hunt écrit à Thomas Jefferson Hogg une lettre exprimant brièvement les sentiments des écrivains paganisants, après la chute de Napoléon. Pour guérir l'Europe du “christianisme et de l'industrialisation”, il faut rétablir, dit-il, la religio loci, symboliser l'éternité de la vie en décorant sa maison de branches de houx ou de sapin (comme rappels de l'éternelle verdeur de la vie), se souvenir du “grand dieu Pan”.
1819: La fête de l'Eisteddfod accepte d'inclure dans ces cérémoniaux le Gorsedd gallois et druidique.
1820: Une Société celtique se constitue en Ecosse, immédiatement après la dernière révolte républicaine contre l'union avec l'Angleterre.
1821: Dans une lettre à Thomas J. Hogg, le poète romantique anglais Percy Bysshe Shelley exprime sa dévotion à Pan.
1823: Le philologue et linguiste allemand Julius Klaproth utilise pour la première fois le terme “indogermanisch” dans son ouvrage publié à Paris Asia polyglotta.
1828: Le professeur de criminologie de l'Université de Berlin, Karl-Ernst Jarcke énonce l'hypothèse que les procès de sorcellerie visaient à éradiquer les tenants de l'ancienne religiosité germanique.
1831: James Hardiman, poète irlandais, publie un recueil de textes de ménestrels irlandais: Irish minstrelsy.
1831: A La Scala de Milan, on joue pour la première fois Norma de Bellini, qui contient un thème druidique, avec, lors de la première présentation publique, un décor de fond représentant Stonehenge. Cette pièce connaîtra un succès formidable en Angleterre.
1832: Mendelssohn achève son œuvre chorale Die Erste Walpurgisnacht, décrivant la fête païenne traditionnelle de la veille de Mai (30 avril), où les villageois en fête sont attaqués par les chrétiens, effraient ceux-ci et les mettent en déroute.
1836: Le poète et celtisant breton Théodore Hersart de la Villemarqué publie Barzaz Breiz: chants populaires de la Bretagne.
1837: Naissance à Valenciennes en Hainaut du poète celtisant Charles De Gaulle (oncle du général), chantre du pan-celtisme. Philologue bien écolé, bon connaisseur des langues galloise et gaëlique-irlandaise. Il devait son inspiration celtisante à une grand-mère maternelle, Marie-Angélique McCartan, descendante d'un officier irlandais de l'armée française. Le Barzaz Breiz de Hersart de la Villemarqué a eu une grande influence sur lui.
1838: De la Villemarqué et Le Gonidec se rendent à la réunion galloise d'Abergavenny, organisée par Cymdeithas y Cymreigyddion y Fenni, nouant des relations étroites entre celtisants bretons et gallois. Cette visite inspire la résurrection de l'Association bretonne.
1839: L'archiviste allemand Franz-Joseph Mone de la ville de Bade énonce l'hypothèse que les éléments dionysiaques du culte sorcier, persécuté au moyen-âge et aux débuts de l'époque moderne, sont les résidus clandestins d'un culte né dans les colonies grecques de la zone pontique, amenés en Germanie par les Goths, chassés d'Ukraine par les Huns.
1842: L'historien breton Alexis-François Rio publie une étude intitulée La petite chouannerie, qui inspirera Charles de Gaulle, hostile au centralisme parisien et partisan de la légitimité et de l'autonomie bretonnes.
1844: Naissance à Brighton de l'écrivain socialiste et réformiste Edward Carpenter qui injectera le paganisme dans le mouvement socialiste anglais (Socialist League, Fellowship of the New Life dont est issue la fameuse Fabian Society). Pour Carpenter, le socialisme doit conduire les peuples à retrouver une vie libre, primitive, simple, saine, morale, basée sur les idées de Whitman, Thoreau et Tolstoï. En 1883, Carpenter fonde une “communauté auto-suffisante” à Millthorpe entre Sheffield et Chesterfield. Son ouvrage principal date de 1889 (et s'intitule: Civilisation: Its Cause and Cure). Il y réclame notamment le retour des divinités féminines et apaisantes (Astarté, Diana, Isis, etc.). Carpenter meurt en 1929, après avoir exercé une influence durable sur les mouvements socialistes et pré-écologiques.
1848: Jacques d'Omalius d'Halloy défend devant l'Académie Royale de Bruxelles pour la première fois l'hypothèse d'une origine européenne des civilisations avestique (Perse) et védique (Inde). Près de vingt ans plus tard, il défendra la même thèse devant la Société d'Anthropologie de Paris.
1850: Naissance de la philosophe anglaise Jane Ellen Harrison, qui, dans ses recherches, a démontré le “substrat primitif” de la religion olympienne et investigué les pratiques populaires sous-jacentes de l'art et de la rationalité grecs. Elle a montré que les structures intellectuelles les plus élaborées dérivaient en fin de compte de “pratiques vernaculaires” simples, courantes dans le paysannat. Pour Jane Ellen Harrison, ce processus consistait à purger la religion de la peur. Elle s'intéressait plus particulièrement au mysticisme orphique, qu'elle considérait comme la purification et l'édulcoration de rites dionysiaques antérieurs, plus sanglants.
1853: Sur base des travaux de l'abbé Pezron (cf. 1703), le philologue allemand Johann Caspar Zeuss publie sa Grammatica Celtica, base de toutes les études philologiques contemporaines sur les langues celtiques.
1854: Ernest Renan publie son fameux Essai sur la poésie des races celtiques (deuxième édition en 1859).
1854: Naissance de James Frazer, futur fondateur de l'école de Cambridge, qui a cherché à démontrer que le christianisme exprimait un mythe universel, celui du jeune dieu qui meurt et ressuscite, repérable dès le mythe babylonien de Tammuz. Il sera l'auteur de The Golden Bough, publié en deux éditions entre 1890 et 1915. Cet épais ouvrage est une mine d'information sur les rites, les croyances et les traces de ce culte.
1858: Le pouvoir parisien fait interdire l'Association Bretonne, porte-voix de la légitimité en Bretagne. Elle continue cependant à fonctionner dans la clandestinité.
1859-1863: Adolphe Pictet (1799-1875) publie Les origines indo-européennes ou les Aryas primitifs. Essai de paléontologie linguistique.
1864: Parution dans la Revue de Bretagne d'un long article de Charles de Gaulle. Cette publication, dirigée par Arthur de la Borderie, était d'inspiration royaliste et catholique. De Gaulle y plaide pour l'auto-détermination des régions celtophones, Bretagne comprise. Il se réfère à Tacite, par ailleurs inspirateur antique des filons germanisants en Italie, en Allemagne et chez Montesquieu, qui disait, à l'adresse des Romains qui entraient en décadence: «La langue du conquérant dans le bouche du conquis est toujours la langue de l'esclavage». Cette maxime a inspiré les nationalismes à fondement linguistique, sans doute aussi la pensée de Herder et initié les mouvements de libération, se servant de la langue comme levier. De Gaulle appelait aussi les peuples celtiques à émigrer uniquement en Patagonie, afin de ne pas se disperser au milieu d'allophones (anglophones, hispanophones, lusophones ou francophones au Québec). De Gaulle s'aligne ainsi sur le projet similaire d'un Gallois, Michael D. Jones, qui nommait la Patagonie “Y Wladfa”. De Gaulle plaidait en même temps pour le droit des Araucaniens, habitants aborigènes de la Patagonie, à qui les colons celtes devaient accorder des droits culturels et politiques. A la fin de l'année, cet article, considérablement étoffé, parait à Paris et à Nantes sous le titre de Les Celtes au dix-neuvième siècle - appel aux représentants actuels de la race Celtique.
1865: Naissance à Rothbach en Alsace du philosophe, poète et écrivain allemand Friedrich Lienhard, grand défenseur des arts et artisanats régionaux. Il s'oppose au naturalisme et à la littérature issue des grandes villes, au profit d'un néo-romantisme et d'un ruralisme, exprimant le fond-du-peuple. Dans son roman Oberlin, il plaide en faveur d'une religion populaire. Entre 1896 et 1900, il publie une trilogie sur Till Eulenspiegel et, en 1900, un ouvrage sur le roi Arthur (König Arthur). Lienhard meurt en 1929 à Weimar.
1866: Michael D. Jones fonde la colonie galloise de Patagonie.
1867: Sous l'impulsion des propositions de Charles De Gaulle, l'idée panceltique a fait son chemin en Irlande et en Grande-Bretagne. Les philologues joignent leurs efforts pour créer des chaires de langues celtiques dans les universités. En 1867, le poète anglais Matthew Arnold prononce quatre leçons publiques intitulées On the Study of Celtic Literature; elles sont publiées dans le Cornhill Magazine, puis sous forme de livre. Arnold ne plaide pas pour un retour des langues celtiques dans la vie quotidienne. Il réclame l'avènement de l'anglais dans la pratique, mais, simultanément, l'étude approfondie du patrimoine celtique à l'université. Les matières du fond celtique doivent être utilisées “pour rendre les Anglais plus intelligents, grâcieux et humains”. Plus tard, Yeats, dont la dette à l'égard d'Arnold est indubitable, considèrera la tradition celtique comme un trésor à exploiter pour enrichir la culture et la littérature anglaises.
1869: Nicolas Dimmer installe un appendice de l'United Ancient Order of Druids à Paris. Le druidisme prend pied en France.
1869: Les “libres penseurs” italiens organisent un congrès international à Naples. Pour Erich Fromm, qui a étudié l'impact dans le socialisme européen de la libre pensée, les participants de ce congrès formaient l'aile radicale de ce “nouvel humanisme” qui se constituait au XIXième siècle. Les Freidenker allemands Ronge et Uhlich y prennent part. L'orientation politique est nettement à gauche: les “libres penseurs” veulent l'émancipation, l'égalité, les droits de l'Homme, etc. Mais le dépassement du christianisme institutionalisé est déjà à l'ordre du jour.
1869: Naissance à Maulburg en Pays de Bade de l'écrivain et peintre allemand Hermann Burte. Il a été un précurseur de l'expressionnisme, mais d'un expressionnisme national, tourné vers l'exaltation de la germanité. Son roman Wiltfeber (1912) est inspiré de Nietzsche et stigmatise les phénomènes de décadence qui frappent l'Europe à la fin du XIXième et à la Belle Epoque. Son conservatisme axiologique (= conservateur des valeurs traditionnelles du peuple) prend pour thèmes principaux la nature, le paysage et l'amour. Burte est l'auteur notamment de sonnets érotiques, inspirés de la tradition littéraire shakespearienne et du patrimoine régional alémanique, riche en proverbes, contes et contines érotiques et sensuels. Burte traduisait aussi beaucoup de poèmes français, notamment ceux de Voltaire. Wiltfeber a connu un large succès dans le mouvement de jeunesse Wandervogel. Burte visait une germanisation de la religion en Allemagne, corollaire d'un retour universel des lois du sol et du peuple dans la pratique religieuse.
1870: Dans son essai intitulé La science des religions, Emile Burnouf tente de définir les lois qui président à l'éclosion des grandes religions du monde. Disciple de Renan, Burnouf estime que les peuples européens font montre d'une tendance au polythéisme, tandis que les peuples sémitiques d'une tendance au monothéisme. C'est cela qui explique le monothéisme de surface de la pratique religieuse dans l'Europe médiévale et moderne. Notamment la doctrine catholique de l'incarnation (du Christ dans l'humanité ou dans une partie de l'humanité) est typiquement d'origine hellénistique. Dieu s'incarne et connaît de multiples hypostases, ce qui rétablit en quelque sorte le polythéisme implicite des peuples européens (Grecs, Perses, Indiens). Cette part de la théologie chrétienne est dérivée d'une matrice indo-européenne, à la fois grecque, perse et indienne. Le judaïsme n'est pas exempt non plus d'influences européennes. La notion de “douceur naturelle”, d'amour des choses de ce monde, est également un leg paléo-européen. De même, le culte de la Lumière, très net dans l'Iran antique, dans l'art gothique et dans le culte de Saint-Michel.
1873: Lancement de la Revue Celtique, d'inspiration pan-celtique, sous la direction d'un ami de Charles De Gaulle, Henri Gaidoz.
1873: Sir Henry Thompson propose l'abolition des lois britanniques interdisant la crémation des morts. Le clergé s'y oppose. Le druide Dr. William Price de Llantrisant (1800-1893) défie les conventions établies en pratiquant la crémation de son enfant mort à cinq mois en 1884. Il est jugé à Cardiff et acquitté. En 1893, à sa mort, il est à son tour brûlé, lors d'une cérémonie funéraire accompagnée de rites païens, mais cette fois en toute légalité, car les lois se sont adaptées, sous la pression d'un druide païen, pour des motifs essentiellement religieux.
1873: Naissance à Farsø du romancier danois Johannes Vilhelm Jensen, qui s'inscrira pendant toute sa carrière sous l'enseigne du vitalisme. En 1901, dans Kongens Fald (= La chute du roi), il déplore l'absence de vitalité des Danois. Son œuvre principale est une fresque intitulée Den lange Rejse (= Le long voyage), brossant l'histoire de l'humanité et se voulant un “pendant darwinien de l'Ancien Testament”. De nombreux éléments mythologiques européens et des thématiques issues des sagas norroises étoffent cette fresque. Jensen doit beaucoup à Heine, Whitman et Kipling. Il théorise à la fin de sa vie la vision d'une “expansion gothique”, où la Scandinavie est considérée comme la base de départ de la civilisation européenne et américaine (Den gothiske Renæssance/La renaissance gothique, 1901). En 1944, Jensen obtient le Prix Nobel de littérature. Il meurt à Copenhague en 1950.
1874: Naissance de l'architecte allemand Bernhard Hoetger qui exhorte ses collègues à respecter les genius loci des sites où ils élèvent leurs bâtiments ou monuments. En 1925, il utilise des éléments du paganisme germanique pour construire le “Worpsweder Café”. En 1927, il utilise ces mêmes éléments lors de l'exposition des artistes de Worpswede. Son œuvre principale est la Böttcherstraße de Brème (1923-1931), dont Ludwig Roselius fut le commanditaire. Dénommé “Haus Atlantis”, le bâtiment principal de la Böttcherstraße relevait de la haute technologie, avec pour matériel principal l'acier. Sur l'une des façades, figurait une statue d'Odin attaché à l'arbre, sur fond d'une roue de runes; c'est la seule des nombreuses statues de l'immeuble qui subsiste aujourd'hui, après les bombardements de la seconde guerre mondiale. Toutes les autres sculptures ont disparu dans la tourmente.
1875-1877: Parution d'un livre important de l'ethnologue W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte (= Cultes forestiers et champêtres). Ces ouvrages auront une forte incidence sur les mouvements fondés par Oskar Michel, Ernst Wachler et Wilhelm Schwaner en 1903-1904 ainsi que dans les pratiques du mouvement Wandervogel.
1875-1888: Parution continue de la revue Celtic Magazine, porte-voix du mouvement pan-celtique.
1878: Lors de l'Eisteddfod gallois de Pontypridd, l'archi-druide prie la divinité indienne Kali, introduisant un élément hindouiste dans les pratiques néo-païennes d'Europe occidentale.
1885: Le philologue et archéologue allemand Ludwig J. Daniel Wilser évoque l'origine européenne des cultes solaires en Egypte et en Mésopotamie dans Die Herkunft der Deutschen. Neue Forschungen über Urgeschichte, Abstammung und Verwandtschaftsverhältnisse unseres Volkes. Il réiterera sa thèse dans Herkunft und Urgeschichte der Arier, une conférence prononcée à Stuttgart devant l'association des anthropologues du Wurtemberg le 11 février 1899.
1886: La Highland Land League écossaise se réunit en septembre 1886 à Bonar Bridge pour jeter les bases d'une coopération étroite entre les peuples celtiques. Les Ecossais, moins celtophones que les Irlandais ou les Gallois, sont considérés désormais comme partie prenante du mouvement pan-celtique. Le Gallois de Patagonie, Michael D. Jones, participe à cette manifestation.
1886: Naissance à Cambridge de la poétesse anglaise Frances Crofts Cornford, petite-fille de Charles Darwin. Elle dirigera le cercle des néo-païens de Cambridge à partir de 1911. Elle était une disciple de Jane Ellen Harrison (cf. 1850). Son fils Rupert John Cornford (né en 1915) s'est engagé dans les Brigades Internationales en Espagne, a défendu l'Université de Madrid et est tombé à Cordoba. Sa vision de la vie était vitaliste et activiste, proche de celles de Malraux ou Hemingway. Frances Cornford meurt en 1960.
1887: Naissance à Rugby du poète anglais Rupert Chawner Brooke. Il restera longtemps l'incarnation littéraire de la jeunesse et de la beauté. Il meurt sur un navire-hôpital dans l'Egée en 1915. Il fait partie de la génération des poètes anglais de la guerre comme Blunden, Sassoon, Owen et Rosenberg. Patriote et socialiste, il faisait partie de la Fabian Society et fondera à Cambridge le cercle des néo-païens en 1908.
1888: Naissance à New York du dramaturge américain Eugène Gladstone O'Neill. Il obtiendra le Prix Pulitzer en 1915 et le Prix Nobel en 1936. O'Neill modernise le théâtre américain en s'inspirant d'Ibsen, Shaw, Strindberg et Nietzsche ainsi que de ses compatriotes Mencken et Nathan. Ses personnages sont des marins, son style est expresionniste, son message est d'affirmer la vie. Après avoir frôlé un retour au catholicisme de sa jeunesse (cf. Days without End), il retourne définitivement au naturalisme et au pessimisme, qui font la trame de son œuvre (cf. The Iceman Cometh, 1939). Le message que laisse O'Neill: l'acception créative et païenne de la vie. Il meurt en 1953.
1892: Salomon Reinach publie à Paris L'origine des Aryens. Histoire d'une controverse, où il prend position contre le “mythe de l'ex Oriente lux”. En 1893, dans un article de la revue L'Anthropologie (n°4/1893), significativement intitulé «Le mirage oriental», il exhorte les Européens à revaloriser leur passé et abandonné leur dépendance à l'égard d'un Orient qu'ils ont eux-même fécondé.
1893: Fondation de la revue The Celtic Monthly. Elle prend le relais du Celtic Magazine.
1894: Fondation du Deutschbund, première association religieuse de type “völkisch” par le rédacteur en chef de la Tägliche Rundschau, Friedrich Lange. Parmi les autres fondateurs: Gerstenhauer, conseiller ministériel et chef du mouvement “chrétien-allemand”; Adolf Bartels, principal historien et critique des littératures allemande et internationale à l'époque en Allemagne.
1895: En mars 1895, Lloyd George apporte son soutien à Sir Henry Dalziel, qui réclame l'auto-détermination des peuples celtiques dans le Royaume-Uni. Cette proposition de loi a failli passer. Il lui a manqué vingt-six voix.
1899: Fondation dans l'Ile de Man de l'Yn Cheshaght Ghailckagh (Société Celtique de l'Ile de Man).
1899: Lors de l'Eisteddfod gallois, le Breton Le Fustec, attaché à l'United Ancient Order of Druids de Paris est sacré druide. En 1900, il s'auto-proclame Premier Grand Druide de Bretagne, fondant une organisation qui existe toujours aujourd'hui.
1901: Fondation en Cornouailles de la Kowethas Kelto-Kernuack (Société Celtique des Cornouailles).
1901: Les Bretons instituent leur propre cérémonie du Gorsedd.
1903: Eugen Diederichs, éditeur à Iéna, publie le livre du théologien dissident Arthur Bonus, Religion als Schöpfung (= La religion comme création), renouant avec le sens germanique du religieux, incarné dans la figure médiévale de Maître Eckehardt. Cette publication donne le coup d'envoi d'une collection de livres sur les grands courants mystiques du monde, qui existe encore aujourd'hui.
1903: Oskar Michel fonde le Deutschreligiöser Bund dans la forêt de Teutoburg, sous le monument érigé en l'honneur d'Arminius. Le mouvement se fondera plus tard dans la mouvance “chrétienne-allemande”.
1904: Le poète anglais Kenneth Grahame publie Pagan Papers. Ce recueil est un hymne doux et idyllique au Grand Pan. En 1908, dans The Wind in the Willows, il approfondit sa vision panique, sensuelle et vitaliste. Grahame voulait créer “une religion splendide, capable de tout embrasser, de faire émerger une hiérarchie d'hommes unissant en leur intériorité le prêtre et l'artiste, pour supplanter et détruire totalement l'âge commercial actuel”.
1905: Sous l'impulsion de l'éditeur Eugen Diederichs, la fête du solstice d'été au Lobedaburg est rehaussée par la présence de la chanteuse norvégienne Bokken Lasson, qui retrouvait des mélodies et des tonalités du plus ancien patrimoine musical scandinave.
1906: Toujours sous l'impuslion d'Eugen Diederichs, la Fête de Mai au Lobedaburg est organisée pour rendre hommage à Ellen Key, dont le “sermont sur la montagne” d'inspiration panthéiste, est rehaussé par le chant au soleil de François d'Assise et la récitation de poèmes de Goethe.
1907-1908: Le Professeur Ludwig Fahrenkrog —qui fondera un mouvement religieux en 1913 (cf.)— publie une série d'articles dans la revue de Wilhelms Schwaner (Der Volkserzieher), où il précise les fondements de la religiosité germanique, au-delà du clivage chrétien/païen: Dieu est en nous, la loi est en nous, la rédemption vient de nous-mêmes. Au cours de ces deux années, Fahrenkrog fonde également un Bund für Persönlichkeitskultur (= Association pour la culture de la personnalité), appelé à consolider sa vision de la religiosité germanique, reposant sur le culte des fortes personnalités.
1907: Matthäus Much publie son livre Die Trugspiegelung orientalischer Kultur (= Le mirage de la culture orientale), où il proclame l'autochtonité des cultures européennes, sans pour autant nier qu'elles aient reçu des apports de l'Orient.
1907: Grand solstice d'été organisé par Eugen Diederichs sur les Roches de Rothenstein. Des chanteurs y chantent des Minnelieder médiévaux; des agriculteurs de la région présentent des pièces de théâtre populaires en dialecte.
1908: Fondation à Cambridge, dans le sillage des artistes pré-raphaëlites, d'un groupe qui s'est dénommé les “Néo-Païens”. Y participaient l'artiste Gwen Raverat et le poète Rupert Brooke. En 1911, la poétesse Frances Cornford reprend ce groupe peu actif en mains, mais il ne connaîtra pas un grand avenir, en dépit de l'intérêt des œuvres de ses animateurs.
1908: Sir Winston Churchill est initié à l'Albion Lodge of the Ancient Order of Druids à Oxford.
1908: En mai 1908, un groupe d'étudiant d'Iéna fonde l'association “Jenaer Freie Studentenschaft”. L'éditeur Eugen Diederichs prend immédiatement contact avec eux pour organiser la fête du solstice d'été, le 21 juin. Cette fête marque le point de départ de l'association néo-païenne d'Eugen Diederichs, qu'on nommera le “Sera-Kreis” (le Cercle Sera).
1910: Eugen Diederichs soutient financièrement un groupe de théologiens protestants dissidents pour qu'ils participent au congrès des tenants de la freie Religion à Munich.
1911: Au début de l'année 1911, Otto Sigfrid Reuter fonde un “Deutscher Orden” où il entend défendre les idées exposées dans son petit livre Sigfrid oder Christus?, paru en 1909. De ce “Deutscher Orden” émergera plus tard l'organisation “Deutschreligiöse Gemeinschaft” qui deviendra la “Deutschgläubige Gemeinschaft”.
1911: Parution dans la maison d'édition d'Eugen Diederichs du livre du théologien non confessionnel et anti-conformiste Arthur Bonus, intitulé Vom neuen Mythos, appel à l'éclosion en Allemagne d'une nouvelle mystique holiste, vitaliste et organique. Cette thématique influencera fortement le mouvement de jeunesse. En cette même année 1911, Bonus sort également son Zur Germanisierung des Christentums, réclamant une germanisation du christianisme, c'est-à-dire une modulation de la pratique religieuse et de la foi sur la mystique médiévale de Maître Eckehardt.
1911-1912: Adolf Kroll et Ernst Wachler franchissent le pas, abandonnent le “christianisme germanique” pour adopter une “religiosité germanique” sans détour chrétien. Ils demandent que les “païens de religiosité germanique” se rassemblent autour des revues Hammer et Heimdall. Ils fondent également la Gesellschaft Wotan (= Société Wotan).
1913: Le professeur d'art Ludwig Fahrenkrog fonde la “Germanische Glaubensgemeinschaft”.
1917: Le théologien non chrétien Arthur Drews publie en 1917 son ouvrage Freie Religion. Vorschläge zur Weiterführung des Reformationsgedankens. Il entendait débarrasser la religion de toute forme de “dogme”. Il déplorait que la “religion libre” (freie Religion) n'avait été qu'un conglomérat confus de toutes sortes de fragments épars de religiosités anciennes ou conventionnelles: humanisme des Lumières, panthéisme goethéen, héroïsme nietzschéen, platitudes matérialistes. Drews plaidait pour un corpus plus sérieux et mieux étayé.
1919: Le préhistorien allemand Carl Schuchhardt publie son ouvrage Alteuropa. Dans ce livre, il parle de l'origine européenne des civilisations avestique et védique et de l'influence des peintures des grottes d'Altamira ainsi que des reliefs de Laussel sur les civilisations égyptienne et babylonienne. La culture égyptienne a donc des racines dans l'Europe occidentale mégalithique. Les obélisques solaires sont des avatars des menhirs mégalithiques. Les alignements de pierres dressées d'Europe occidentale sont devenus les allées de statues d'Abouzir ou les allées de sphynx de Karnak. Les mastabas de l'ancienne Egypte rappellent les dolmens de l'Europe du Nord.
1921: Jessie Weston, proche de l'école (néo-païenne) de Cambridge, spécialiste en littératures romanes et professeur à l'Université de Paris, commence ses recherches sur le Graal. Le mythe du Graal dérive des cultes celtiques de la fertilité, affirme-t-elle.
1928: Les Corniques instituent leur propre cérémonie du Gorsedd.
1971: Les trois cérémonies (galloise, bretonne et cornique) du Gorsedd joignent leurs efforts le 3 septembre 1971. L'objectif était d'unifier les rituels des trois communautés celtiques-brythoniques.

 La Tradizione era altresì fondamentale nella vita politica e, in particolar modo, per il Senato. I membri di quest’ultimo, infatti, erano i discendenti degli eroi che fecero grande Roma e, giacché secondo i Romani la virtus maiorum si trasmetteva di padre in figlio, la auctoritas e la legittimazione del potere dei senatori venivano direttamente dalla gloria dei loro antenati. Tale principio si manifestava al massimo grado nei funerali pubblici delle famiglie patrizie, in cui tutte le imagines degli antenati della gens (maschere di cera che riproducevano le fattezze degli avi) sfilavano in lunghi cortei che si concludevano con l’orazione celebrativa, nella quale si lodavano, oltre alle virtù del defunto, le gloriose gesta dei suoi progenitori. Era quindi obbligatorio per gli eredi delle grandi famiglie di Roma conoscere le imprese dei propri antenati, e l’educazione dei giovani nobili verteva eminentemente sulla trasmissione dei mores maiorum. È emblematica al riguardo l’immagine, lasciataci dalla letteratura antica, di Scipione Emiliano che ritrova vigore e propensione a grandiose gesta osservando le immagini dei suoi avi.
La Tradizione era altresì fondamentale nella vita politica e, in particolar modo, per il Senato. I membri di quest’ultimo, infatti, erano i discendenti degli eroi che fecero grande Roma e, giacché secondo i Romani la virtus maiorum si trasmetteva di padre in figlio, la auctoritas e la legittimazione del potere dei senatori venivano direttamente dalla gloria dei loro antenati. Tale principio si manifestava al massimo grado nei funerali pubblici delle famiglie patrizie, in cui tutte le imagines degli antenati della gens (maschere di cera che riproducevano le fattezze degli avi) sfilavano in lunghi cortei che si concludevano con l’orazione celebrativa, nella quale si lodavano, oltre alle virtù del defunto, le gloriose gesta dei suoi progenitori. Era quindi obbligatorio per gli eredi delle grandi famiglie di Roma conoscere le imprese dei propri antenati, e l’educazione dei giovani nobili verteva eminentemente sulla trasmissione dei mores maiorum. È emblematica al riguardo l’immagine, lasciataci dalla letteratura antica, di Scipione Emiliano che ritrova vigore e propensione a grandiose gesta osservando le immagini dei suoi avi. Ma tale culto della Tradizione non esisteva esclusivamente nelle autorevoli famiglie patrizie, ma era altresì venerata la gloria populi Romani, ossia la Tradizione comune a tutto il popolo di Roma.
Ma tale culto della Tradizione non esisteva esclusivamente nelle autorevoli famiglie patrizie, ma era altresì venerata la gloria populi Romani, ossia la Tradizione comune a tutto il popolo di Roma.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg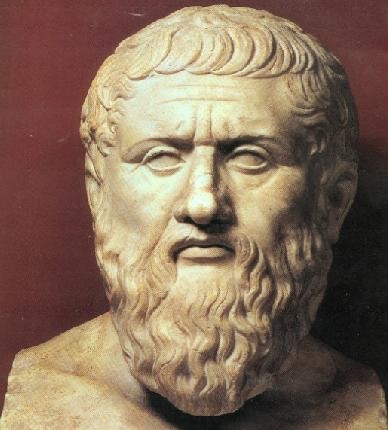
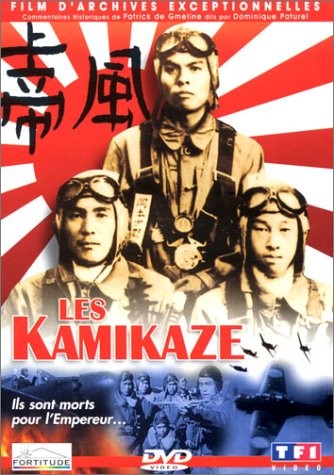

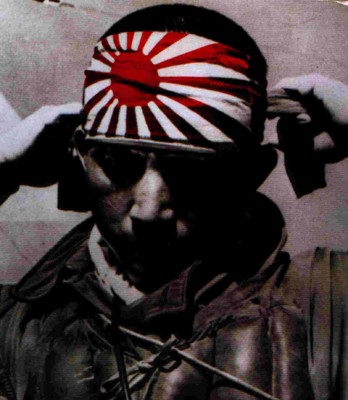

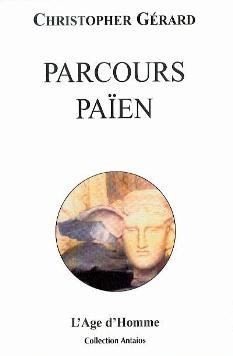
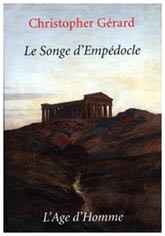
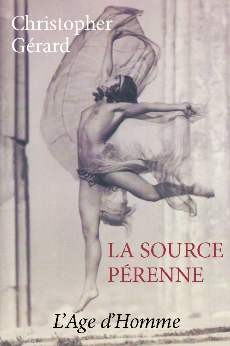

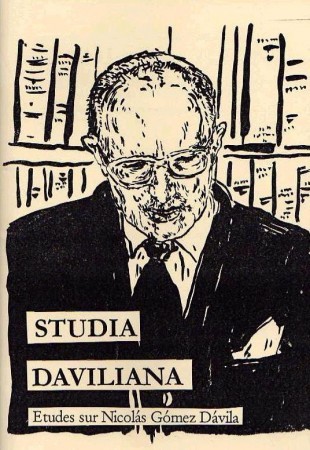









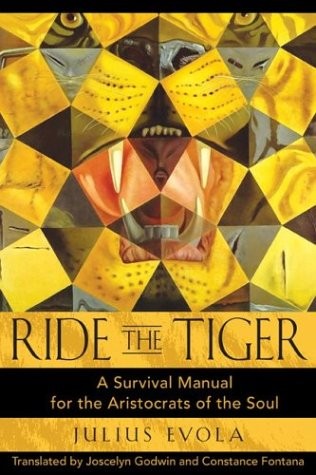


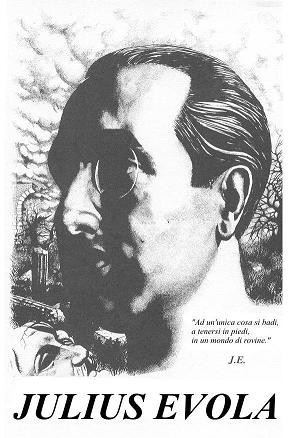

 La période de Noël est un moment idéal pour tester la solidité de ses convictions et la cohérence de ses engagements politiques, notamment sur les questions de l’écologie et de l’anti-consumérisme.
La période de Noël est un moment idéal pour tester la solidité de ses convictions et la cohérence de ses engagements politiques, notamment sur les questions de l’écologie et de l’anti-consumérisme.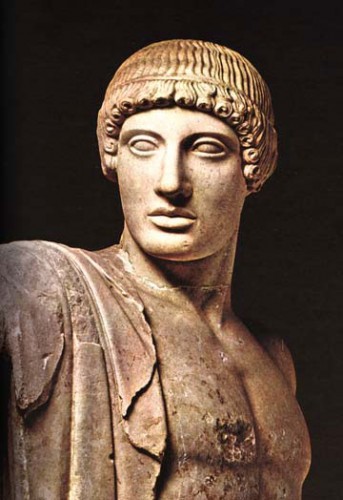
 Lutte des classes, lutte des idéologies, lutte des cultures, luttes des peuples, l'Histoire se résume aux rapports entre les identités, et principalement à leur lutte. Leur lutte à mort dès lors que les prétentions croissent et que l'espace se restreint. Le déconstructionisme ambiant lui-même tient du combat identitaire: la tentative d'extermination par un type humain particulier, d'un autre type humain. Car le multiculturalisme est tout sauf une idée. La théorie de la libre sélection des traditions et des repères n'est sécrétée qu'à posteriori, pour légitimer un penchant naturel qui ne tient pas du choix. Pour sacraliser la simple expression d'un organisme, un organisme faible; ce demos auquel les hiérarchies donnent un cadre et une forme. Nous assistons à l'affrontement mortel entre une humanité dont le propre est de ne pouvoir s'identifier à rien, de ne produire aucune haute culture, et pour qui le multiculturalisme n'est que la traduction intellectuelle d'une nécessité vitale - et le camp de ceux qui sont ou aspirent à être.
Lutte des classes, lutte des idéologies, lutte des cultures, luttes des peuples, l'Histoire se résume aux rapports entre les identités, et principalement à leur lutte. Leur lutte à mort dès lors que les prétentions croissent et que l'espace se restreint. Le déconstructionisme ambiant lui-même tient du combat identitaire: la tentative d'extermination par un type humain particulier, d'un autre type humain. Car le multiculturalisme est tout sauf une idée. La théorie de la libre sélection des traditions et des repères n'est sécrétée qu'à posteriori, pour légitimer un penchant naturel qui ne tient pas du choix. Pour sacraliser la simple expression d'un organisme, un organisme faible; ce demos auquel les hiérarchies donnent un cadre et une forme. Nous assistons à l'affrontement mortel entre une humanité dont le propre est de ne pouvoir s'identifier à rien, de ne produire aucune haute culture, et pour qui le multiculturalisme n'est que la traduction intellectuelle d'une nécessité vitale - et le camp de ceux qui sont ou aspirent à être.