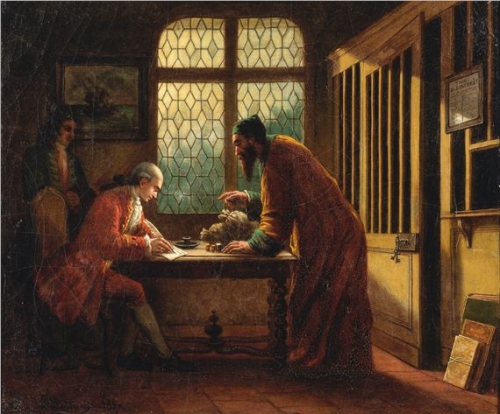mardi, 03 février 2026
Les indicateurs économiques allemands annoncent des temps difficiles
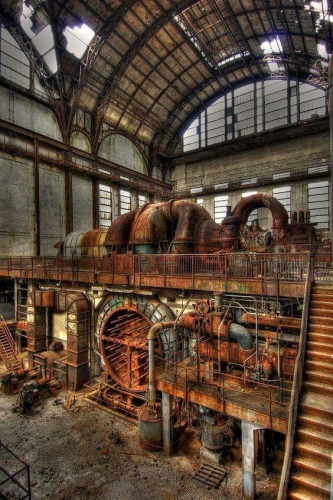
Les indicateurs économiques allemands annoncent des temps difficiles
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
Les chiffres du bureau de conseil aux entreprises Falkensteg montrent que le nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises (entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros) aura augmenté de 25% en 2025 par rapport à 2024. Depuis la crise du coronavirus, le nombre de faillites de moyennes entreprises a triplé. Le chercheur Jonas Eckhardt parle d'une évolution dramatique, car selon lui, il ne s'agit plus d'une faiblesse conjoncturelle, mais de problèmes structurels profonds.
 Pour 2026, le cabinet de conseil Falkensteg prévoit également une augmentation supplémentaire du nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises. Selon Jonas Eckhardt (photo), nous pouvons nous attendre à une augmentation de 10 à 20%. Les principales causes ont déjà été mentionnées: des consommateurs incertains qui reportent leurs achats (construction automobile et mécanique), des coûts énergétiques élevés (en raison de la transition énergétique verte) et une bureaucratie, une réglementation sans équivalent en Europe, même en Flandre.
Pour 2026, le cabinet de conseil Falkensteg prévoit également une augmentation supplémentaire du nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises. Selon Jonas Eckhardt (photo), nous pouvons nous attendre à une augmentation de 10 à 20%. Les principales causes ont déjà été mentionnées: des consommateurs incertains qui reportent leurs achats (construction automobile et mécanique), des coûts énergétiques élevés (en raison de la transition énergétique verte) et une bureaucratie, une réglementation sans équivalent en Europe, même en Flandre.
Les chiffres des exportations baissent, ceux des importations augmentent
Ces chiffres indiquent également une «fatigue économique» en Allemagne. En novembre 2025, les exportations allemandes ont baissé de 2,5% par rapport à octobre, soit la plus forte baisse mensuelle depuis mai 2024. Dans le même temps, les importations de marchandises étrangères en Allemagne ont augmenté de 0,8%. Il s'agit de chiffres officiels, publiés par l'Office fédéral allemand de la statistique.
Les exportations allemandes ont atteint 128,1 milliards d'euros, tandis que les importations étrangères en Allemagne se sont élevées à 115,1 milliards d'euros. L'excédent commercial s'élève ainsi à 13,1 milliards d'euros, alors qu'il était encore de 17,2 milliards d'euros en octobre. La plus forte augmentation des importations a été enregistrée pour les marchandises en provenance de Chine, ce qui n'est bien sûr pas tout à fait surprenant. C'est une augmentation de 8% par rapport au mois d'octobre.
Une dernière donnée économique concernant notre principal partenaire commercial, l'Allemagne: depuis le début de l'année 2026, les réserves de gaz dans les réservoirs allemands ont atteint leur niveau le plus bas en 15 ans. Selon le Verband der europäischen Gasinfrastrukturbetreiber (GIE ou Union des gestionnaires d'infrastructures gazières européennes), les réserves de gaz en Allemagne représentaient 53% de la capacité maximale de stockage au 5 janvier. Normalement, le niveau à la fin janvier est de 70%. L'Agence allemande pour le réseau gazier a donc appelé les Allemands à économiser leur consommation de gaz. Heureusement, l'Allemagne peut compter sur les importations de gaz via la France et la Belgique. La moyenne européenne des réserves de gaz s'élève à 59% de la capacité disponible. Avec 53%, l'Allemagne se situe clairement en dessous de cette moyenne. En Pologne, où il fait également très froid en ce moment, les réservoirs de gaz sont actuellement remplis à plus de 80%.
L'Allemagne est dans une situation difficile. Cela ne sera pas sans conséquences pour les autres États membres de l'UE.
20:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, europe, allemagne, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 janvier 2026
Joseph Stiglitz et le déclin de l’Europe

Joseph Stiglitz et le déclin de l’Europe
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/stiglitz-e-il-declino-delleuropa/
Joseph Stiglitz n’utilise pas de périphrases. Il ne tourne pas autour du sujet. Il va droit au cœur de la question.
L’euro a échoué dans sa seule et essentielle mission: favoriser l’unification, politique et économique, de l’Europe.
Et il a échoué parce qu’il a été totalement soumis aux intérêts particuliers des lobbies financiers et des pays individuels, totalement indifférents à l’intérêt commun.
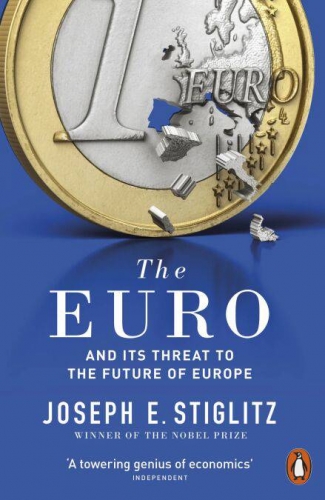
Au contraire, ils ont agi dans le sens opposé à celui de l’intégration européenne. Ils ont exploité l’euro sans jamais initier un processus d’intégration politique, pourtant nécessaire.
Une évaluation extrêmement sévère. Surtout parce qu’elle ne vient pas d’un quelconque idéologue, mais d’un Prix Nobel d’économie. De plus, d’origine démocratique, avec Keynes comme référence.
Bien sûr, Stiglitz a reçu le Nobel pour la microéconomie.
Mais, avec le temps, il a commencé à s’intéresser de plus en plus aux grands problèmes, économiques certes, mais aussi politiques et sociaux.
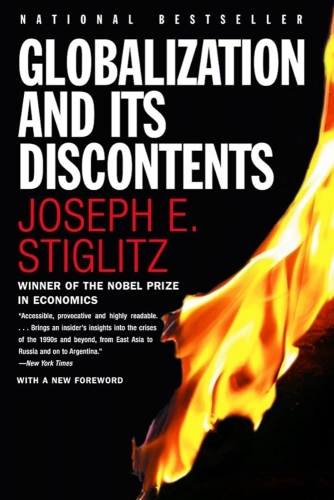
Il est devenu une référence pour tous ceux, notamment en Europe, qui contestent cette union… abstraite. Qui ne tient pas compte des peuples et des hommes réels.
Aujourd’hui, Stiglitz, qui est de formation démocrate, est considéré comme une référence aussi bien par les formations populistes/conservatrices européennes que par la gauche radicale. Autrement dit: par ceux qui ne sont pas du tout satisfaits de cette Europe.
Il n’a pas changé, cependant. Il reste, fondamentalement, un démocrate américain, influencé par la pensée de Keynes. Et totalement éloigné de ceux qui, d’un côté ou de l’autre, voudraient le pousser vers une dérive politique.
Après beaucoup d'errances et de réflexions, Stiglitz en est arrivé à une conclusion:
L’Europe, l’Union européenne, a échoué dans sa mission. Et trahi son destin.
Il ne reste donc que deux options.
La première est très improbable. Pour ne pas dire impossible. Réformer radicalement l’Union européenne. Lui donner une autre forme. Faire de l’euro un instrument d’unification politique.
Ce qui est empêché par la volonté des pays européens eux-mêmes. Trop liés à leurs intérêts particuliers. Un petit commerce fermé.
Surtout celle de l’Allemagne et des pays du Nord. Qui ne veulent pas la croissance économique et politique du Sud, des pays en développement.
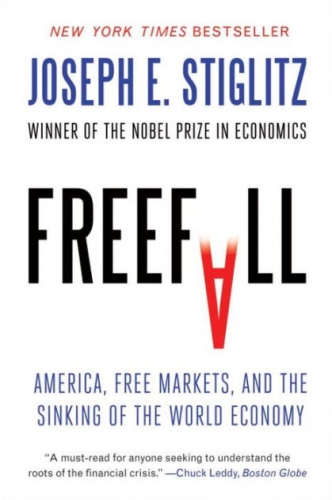
Et donc, à défaut de cette option, il ne reste que l’autre:
Renoncer à l’euro. Mettre fin à l’expérience de la monnaie commune. Qui s’est révélée pire qu’un échec. Qui s'est révélée néfaste.
Cette décision, selon Stiglitz, n’est ni facile ni indolore. Mais elle est possible, car l’euro n’a que vingt ans. Peu, mais suffisamment pour en constater l’échec.
Il faut donc mettre fin à cette expérience négative. En payant, certes, un prix élevé. Mais moins coûteux et douloureux que de continuer sur une voie erronée.
Abandonner l’euro, donc. Et repartir à zéro.
Vingt ans, dit-il, ce n’est pas grand-chose. Presque rien. Nous sommes encore à temps pour inverser cette tendance au déclin.
Avant qu’elle ne devienne un précipice.
19:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph e. stiglitz, actualité, europe, euro, affaires européennes, économie, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’Inde propose d’interconnecter les monnaies numériques pour contourner le dollar

L’Inde propose d’interconnecter les monnaies numériques pour contourner le dollar
Source: https://mpr21.info/india-propone-interconectar-las-moneda...
La Reserve Bank of India a présenté une proposition au gouvernement de New Delhi pour relier les monnaies numériques des banques centrales des pays du BRICS, facilitant ainsi les transactions commerciales et touristiques entre ces économies émergentes. Cette initiative, qui pourrait figurer à l’ordre du jour du sommet des BRICS de cette année, qui se tiendra en Inde, représente une étape supplémentaire dans la quête du bloc pour une autonomie financière par rapport au système monétaire international dominé par le dollar.
La proposition de la banque centrale indienne intervient à un moment où les technologies financières numériques se positionnent comme des alternatives crédibles aux systèmes de paiement traditionnels. La banque recommande que ce sujet soit au centre du prochain sommet des BRICS, ce qui pourrait constituer la première fois qu’un tel projet est officiellement débattu au niveau des chefs d’État et de gouvernement du bloc.

L’interconnexion permettrait aux monnaies numériques émises par les banques centrales de chaque pays membre de communiquer entre elles, créant ainsi un réseau de paiement transfrontalier direct. Les secteurs du commerce bilatéral et du tourisme font partie des bénéficiaires potentiels immédiats de ce système, qui élimine les multiples conversions de devises et réduit les coûts de transaction pour les entreprises et les voyageurs se déplaçant entre ces pays.
L’initiative s’inscrit dans un mouvement plus large vers une plus grande indépendance vis-à-vis des mécanismes financiers établis. Depuis leur création, les pays membres du bloc partagent le désir commun de construire un ordre mondial distinct, défiant l’hégémonie des puissances occidentales dans les affaires internationales. Leur objectif principal est de rééquilibrer la dynamique de pouvoir au sein des institutions financières mondiales, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, où leur poids économique et démographique réel n’est pas proportionnellement reflété dans les processus décisionnels.

Les pays du bloc défendent les principes de souveraineté et de non-ingérence, s’opposant notamment à l’utilisation des systèmes de paiement internationaux comme instruments de pression politique. Les sanctions économiques occidentales, qui dépendent en grande partie du contrôle des flux financiers en dollars, ont renforcé la détermination des BRICS à développer leur propre infrastructure. La création de la Nouvelle Banque de Développement en 2014 a déjà été une manifestation concrète de cette stratégie d’autonomie financière, permettant aux pays émergents de financer leurs projets de développement sans dépendre exclusivement des institutions occidentales.
Ce type de coopération dépasse les questions purement monétaires et vise à établir des plateformes alternatives pour l’échange économique et politique, réduisant progressivement la dépendance structurelle aux monnaies et systèmes de paiement traditionnellement dominants.
La proposition indienne se base sur les conclusions du sommet des BRICS de 2025 à Rio de Janeiro, où les pays ont explicitement demandé à renforcer l’interopérabilité entre les systèmes de paiement nationaux des États membres. Cette déclaration collective a posé les bases d’une coordination accrue dans le domaine de l’infrastructure financière numérique, en reconnaissant le potentiel transformateur des technologies de monnaies numériques.

Plusieurs pays du bloc ont déjà réalisé des avancées significatives dans le développement de leurs propres monnaies numériques émises par des banques centrales. La Chine expérimente depuis plusieurs années avec son yuan numérique, tandis que l’Inde a lancé son roupie numérique en phase pilote. Ces expérimentations créent les conditions techniques nécessaires pour envisager une intégration régionale des systèmes.
La Banque centrale indienne a déclaré publiquement que ces efforts ne visent pas à promouvoir la dédollarisation du commerce international, une déclaration très prudente qui contraste avec l’impact potentiel évident de ce système sur l’utilisation du dollar américain dans le commerce entre économies émergentes. Il s’agit d’une stratégie diplomatique visant à éviter une confrontation directe avec Washington.
19:35 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, inde, dédollarisation, brics |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 02 janvier 2026
Chinois, Arabes, Indiens, Américains: tous s'arrachent les reliquats d'une Allemagne en déroute

Chinois, Arabes, Indiens, Américains: tous s'arrachent les reliquats d'une Allemagne en déroute
Enrico Toselli
Source: https://electomagazine.it/cinesi-arabi-indiani-statuniten...
À qui revient l'Allemagne ? À eux ! Non, non, pas aux Allemands. Mais à tous ceux qui mettent sur la table des industriels de l'ancienne locomotive de l'Europe une somme considérable en dollars, roupies, yens, yuans, rials. En somme, toute devise provenant de n'importe quelle partie du monde est la bienvenue. Tout comme en Italie. La seule différence est qu'ici, les acheteurs potentiels se montrent difficiles lorsqu'il s'agit d'acheter l'ancienne Ilva ou les nombreuses entreprises métallurgiques en difficulté, tandis que l'industrie allemande profite encore d'une image d'efficacité.
Le résultat, cependant, est le même. On vient faire ses achats en Europe parce que les entrepreneurs du Vieux Continent ne sont plus à la hauteur de leurs pères et grands-pères qui ont bâti les entreprises. Avec les exceptions incontournables, bien sûr. Ferrero s'engage à se développer tant en interne que par des acquisitions à l'étranger. Mais c'est justement une exception. Avec quelques autres. En Italie comme en Allemagne. Et aussi en France, à part Arnault et quelques autres rares entrepreneurs.

Pour le reste, mieux vaut beaucoup d'argent, puisqu'on est fichu, et tout de suite. Volkswagen s'apprête, pour la première fois, à fermer une usine sur le sol allemand. Et il y a déjà des étrangers prêts à prendre la relève. Cela vaut pour la chimie, les technologies de pointe, les secteurs innovants, les services qui attirent les Américains.
Les acquisitions étrangères ont augmenté ces dernières années, représentant un cinquième de toutes celles effectuées dans l'Union européenne, et concernent non seulement les grands groupes, mais aussi, de plus en plus souvent, les PME.
Les données relatives aux investissements étrangers greenfield, c'est-à-dire ex novo, sont également particulièrement intéressantes. L'Espagne occupe la première place en Europe, suivie de près par l'Allemagne. Cela signifie que les entrepreneurs étrangers croient au potentiel des travailleurs européens, ainsi qu'aux opportunités offertes par les différents pays. Ce sont les entrepreneurs européens qui manquent de courage et de compétences. Ils sont remplacés par des collègues venus du monde entier.
Ils rachètent des entreprises mécaniques, automobiles et électroniques. Mais les Chinois sont également sur le point de finaliser l'acquisition d'activités commerciales telles que celles du groupe allemand Ceconomy, qui détient, en Italie, le réseau Mediaworld. Sans oublier le secteur de la mode et de l'alimentation.
16:46 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 décembre 2025
Le Décalogue de Friedrich List
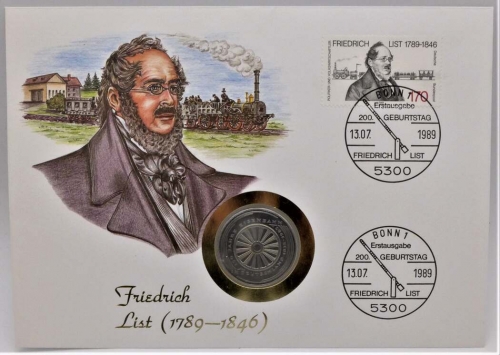
Le Décalogue de Friedrich List
Source: https://civenmov.blogspot.com/2025/09/decalogo-de-friedri...
 Friedrich List (Reutlingen, 1789-1846), économiste allemand visionnaire, pionnier du développement économique, s’est fait connaître dans le domaine des idées par sa défense inconditionnelle du protectionnisme ainsi que des investissements publics dans les infrastructures (ports, routes, chemins de fer, télégraphes) et dans l’éducation en tant que moteurs essentiels du développement industriel, face au libre-échange et à la mondialisation économique naissante au début du 19ème siècle. Fonctionnaire, activiste et journaliste, ses idées réformistes, notamment l'idée de Zollverein (une proposition d’union douanière allemande), ont été alimentées par son exil en Amérique du Nord, où il s’est développé en tant qu’industriel et investisseur dans l’exploitation minière, tout en promouvant dans la presse les idées contenues dans son œuvre majeure de 1841: Le Système National de l’Économie Politique (Das nationale System der politischen Ökonomie), destiné à soutenir l’industrie naissante aux États-Unis face à la concurrence déloyale britannique. À la fin de sa période américaine, il fut nommé consul de Saxe.
Friedrich List (Reutlingen, 1789-1846), économiste allemand visionnaire, pionnier du développement économique, s’est fait connaître dans le domaine des idées par sa défense inconditionnelle du protectionnisme ainsi que des investissements publics dans les infrastructures (ports, routes, chemins de fer, télégraphes) et dans l’éducation en tant que moteurs essentiels du développement industriel, face au libre-échange et à la mondialisation économique naissante au début du 19ème siècle. Fonctionnaire, activiste et journaliste, ses idées réformistes, notamment l'idée de Zollverein (une proposition d’union douanière allemande), ont été alimentées par son exil en Amérique du Nord, où il s’est développé en tant qu’industriel et investisseur dans l’exploitation minière, tout en promouvant dans la presse les idées contenues dans son œuvre majeure de 1841: Le Système National de l’Économie Politique (Das nationale System der politischen Ökonomie), destiné à soutenir l’industrie naissante aux États-Unis face à la concurrence déloyale britannique. À la fin de sa période américaine, il fut nommé consul de Saxe.
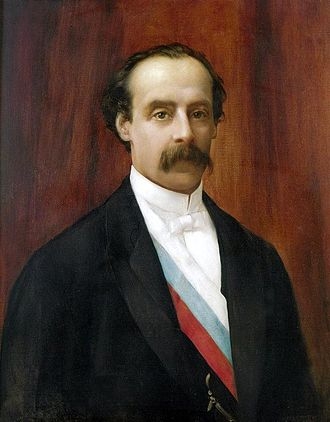
Après près d’un siècle de méfiance et de boycott de la politique centrée sur l’État, en 1948, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a été créée à Santiago du Chili, ravivant les idées de List sur le protectionnisme économique sélectif et le développement industriel endogène, sous l’influence notamment du célèbre économiste Raúl Prebisch (photo), qui fut secrétaire exécutif de l’organisation entre 1950 et 1963. 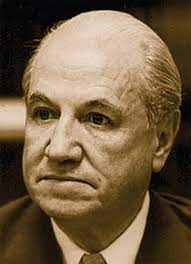 Prebisch, pionnier dans l’étude du structuralisme économique et de la théorie de la dépendance, a formulé une hypothèse pertinente sur la dégradation des termes de l’échange entre les économies industrialisées et les pays producteurs de matières premières.
Prebisch, pionnier dans l’étude du structuralisme économique et de la théorie de la dépendance, a formulé une hypothèse pertinente sur la dégradation des termes de l’échange entre les économies industrialisées et les pays producteurs de matières premières.
Aujourd’hui, dans le monde postlibéral, les idées de Friedrich List, notamment son insistance sur le protectionnisme et le développement industriel dirigé par l’État, résonnent profondément dans le modèle économique chinois, caractérisé par la planification centralisée, la protection des industries stratégiques, d’énormes investissements dans des projets d’infrastructure mondiaux comme l’Initiative Belt and Road, et la priorité donnée à l’éducation technoscientifique dans le cadre des "Quatre Modernisations", une politique ambitieuse depuis 1978 visant à transformer la Chine en une grande puissance moderne. Depuis les réformes de Deng Xiaoping, qui ont ouvert la Chine au marché mondial tout en maintenant un contrôle étatique fort, jusqu’à la direction de Xi Jinping, qui a consolidé cette vision avec un accent mis sur l’autosuffisance et l’influence sur le reste du monde, la Chine a adapté ces principes aux défis du 21ème siècle, projetant un modèle de développement efficace et souverain stratégiquement.
 Les économistes contemporains tels que Ha-Joon Chang (photo), Erik S. Reinert, Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz, Alice Amsden, Robert Wade, Justin Yifu Lin, Sanjaya Lall et Keun Lee renforcent les thèses de List, en promouvant le protectionnisme et les politiques publiques industrielles, en opposition aux économistes et écoles libérales: l'école de Chicago, l'école autrichienne, les théories néoclassiques et le Consensus de Washington, qui privilégient le libre marché et une intervention étatique minimale, aggravant ainsi les défauts de la mondialisation désordonnée (augmentation des inégalités, instabilité financière, migrations massives, stagnation des économies industrialisées et pauvreté dans les pays en développement).
Les économistes contemporains tels que Ha-Joon Chang (photo), Erik S. Reinert, Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz, Alice Amsden, Robert Wade, Justin Yifu Lin, Sanjaya Lall et Keun Lee renforcent les thèses de List, en promouvant le protectionnisme et les politiques publiques industrielles, en opposition aux économistes et écoles libérales: l'école de Chicago, l'école autrichienne, les théories néoclassiques et le Consensus de Washington, qui privilégient le libre marché et une intervention étatique minimale, aggravant ainsi les défauts de la mondialisation désordonnée (augmentation des inégalités, instabilité financière, migrations massives, stagnation des économies industrialisées et pauvreté dans les pays en développement).
 Chang et Reinert ont démontré que le protectionnisme historique a catalysé l’industrialisation dans les nations développées; Rodrik (photo) et Stiglitz ont montré les limites du marché dérégulé pour générer un développement équitable; Mazzucato souligne le rôle de l’État entrepreneurial dans l’innovation technologique (exemple notable: la Silicon Valley aux États-Unis), réfutant la suprématie du secteur privé; et Amsden, Wade, Lin, Lall et Lee mettent en avant le succès des “tigres asiatiques” (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan) grâce à des politiques étatiques ciblées, dépassant les résultats des recettes libérales et consolidant un paradigme de souveraineté économique et de compétitivité mondiale.
Chang et Reinert ont démontré que le protectionnisme historique a catalysé l’industrialisation dans les nations développées; Rodrik (photo) et Stiglitz ont montré les limites du marché dérégulé pour générer un développement équitable; Mazzucato souligne le rôle de l’État entrepreneurial dans l’innovation technologique (exemple notable: la Silicon Valley aux États-Unis), réfutant la suprématie du secteur privé; et Amsden, Wade, Lin, Lall et Lee mettent en avant le succès des “tigres asiatiques” (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan) grâce à des politiques étatiques ciblées, dépassant les résultats des recettes libérales et consolidant un paradigme de souveraineté économique et de compétitivité mondiale.
Le Décalogue de Friedrich List
1. Protection de l’industrie nationale : Les pays en développement doivent mettre en place des droits de douane et des politiques protectionnistes pour favoriser la croissance de leurs industries locales face à la concurrence étrangère.
2. Priorité au pouvoir productif : Le développement économique doit se concentrer sur l’augmentation de la capacité de production d’une nation, et non seulement sur l’accumulation de richesse immédiate.
3. Différenciation entre les économies : Les politiques économiques doivent s’adapter au niveau de développement de chaque pays ; ce qui profite à une nation industrialisée n’est pas toujours approprié pour une économie en développement.
4. Importance de l’industrie manufacturière : La fabrication est essentielle pour le progrès économique, car elle génère de l’innovation, de l’emploi et une richesse durable.
5. Infrastructures comme base du développement : L’État doit investir dans les infrastructures (transports, communications) pour intégrer les marchés internes et renforcer l’économie.
6. Éducation et formation technique : Le développement économique nécessite une population instruite et qualifiée, capable de stimuler l’innovation et la productivité.
7. Intervention stratégique de l’État : Le gouvernement doit jouer un rôle actif dans la planification et la promotion de secteurs économiques stratégiques.
8. Unité économique nationale : L’intégration des marchés internes et la coopération entre régions au sein d’une nation sont essentielles à la croissance économique.
9. Critique du libre-échange absolu : Le libre-échange profite principalement aux nations déjà industrialisées, tandis que les économies émergentes ont besoin d’une protection temporaire.
10. Vision à long terme : Les politiques économiques doivent privilégier le développement durable et l’indépendance économique de la nation plutôt que les gains à court terme.
15:55 Publié dans Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, protectionnisme, autarcie, friedrich list, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 décembre 2025
Sans production de masse à faible coût, les armées ne gagneront aucune bataille

Sans production de masse à faible coût, les armées ne gagneront aucune bataille
Source: https://mpr21.info/sin-una-produccion-en-masa-de-bajo-cos...
Les grandes puissances occidentales mènent le monde vers un état de guerre permanente, pour cela il faut réduire considérablement les coûts, surtout ceux des arsenaux. C’est pourquoi les économistes sont de plus en plus présents dans les ministères de la Défense.
Les arsenaux ne sont guère plus que des tas de ferraille qui, en plus de rouiller par inactivité, deviennent rapidement obsolètes. Les armées ne peuvent pas garantir que leur équipement fonctionnera lorsqu’elles en auront besoin.
Les médias spécialisés en économie s’occupent de plus en plus ouvertement du réarmement européen, et l’ancien adage prodigué en facultés d’économie, « canons ou beurre », est dépassé. Comme nous l’avons vu dans le cas de l’Allemagne, la question est de savoir quel type de canons il faut fabriquer.

Il en va de même en France, qui en 2022 a placé un homme d’affaires, Emmanuel Chiva (photo), à la tête de la Direction Générale de l’Armement pour fusionner l’armée avec le capital privé et accélérer l’introduction de technologies de pointe. Dans la guerre à faible coût, la France et les Européens « sont très en retard par rapport à la Russie », reconnaissent les médias (*).
En 2018, Chiva a créé l’Agence d’Innovation pour la Défense, qui s’est attaquée à l’intelligence artificielle et aux satellites militaires. L’objectif n’est pas de préparer l’armée à la guerre, mais y préparer l’économie. La Direction Générale de l’Armement impose aux entreprises de constituer des réserves de minéraux stratégiques et de préparer la conversion militaire de lignes de production civiles.
Par exemple, ils ont obligé les usines Renault à produire des drones et d’autres équipements militaires.
Jusqu’à présent, l’équipement militaire français reposait sur des technologies très avancées mais extrêmement coûteuses et produites en très faibles quantités. La nouvelle politique de réarmement souhaite changer cela pour passer à des armes à faible coût, notamment des drones.
Il ne sera pas possible de gagner une bataille future sans une ligne de production capable de fabriquer des armes légères en grande quantité. La Russie fabrique chaque jour des milliers de drones FPV bon marché, ce qui lui permet d’atteindre des objectifs sur le champ de bataille avec une précision très élevée, contrairement aux missiles d’artillerie non guidés, qui sont beaucoup plus chers et ne disposent pas de la précision nécessaire.
Bien que l’artillerie et les chars restent utiles dans certaines situations, la présence omniprésente de drones en Ukraine, qui causent plus de la moitié des attaques mortelles, redéfinit les besoins opérationnels, au détriment des armes lourdes traditionnelles.
Note:
(*) https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/drones-motos-...
19:11 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, économie de guerre, défense, actualité, europe, affaires européennes, drones |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 décembre 2025
Face à la crise, une autre Europe

Face à la crise, une autre Europe
Pierre Le Vigan
La crise est en Europe, l’Europe est en crise. Nous l’analysions en 2012. Si les choses se sont aggravées, les origines de la crise économique restent les mêmes : la crise des économies et des sociétés européennes est avant tout une crise de la domination d’une certaine économie, financiarisée. Au détriment des producteurs européens.
 Le présent texte est un issu d’un entretien. Il date du 18 octobre 2012 et a été publié dans le livre collectif Face à la crise, une autre Europe, édité par Synthèse nationale éditions en 2012, sous la direction de Roland Hélie. Nous avons actualisé cet entretien en 2021. Les 10 dernières années n’ont pas infirmé nos analyses, mais ont accru nos raisons d’être inquiets face au cours actuel des choses. Mais aussi nos raisons de lutter, et notre envie de ne pas laisser le pays aux mains de ses fossoyeurs : les agents des puissances d’argent et d’un pacte mondial de corruption dont le Great Reset est un élément majeur.
Le présent texte est un issu d’un entretien. Il date du 18 octobre 2012 et a été publié dans le livre collectif Face à la crise, une autre Europe, édité par Synthèse nationale éditions en 2012, sous la direction de Roland Hélie. Nous avons actualisé cet entretien en 2021. Les 10 dernières années n’ont pas infirmé nos analyses, mais ont accru nos raisons d’être inquiets face au cours actuel des choses. Mais aussi nos raisons de lutter, et notre envie de ne pas laisser le pays aux mains de ses fossoyeurs : les agents des puissances d’argent et d’un pacte mondial de corruption dont le Great Reset est un élément majeur.
1 - La crise remonte, dit-on, à 2008. Estimez-vous que ses causes sont beaucoup plus anciennes ?
Depuis 2007 se sont succédé une crise financière (les ’’subprimes’’, des crédits à taux élevés amenant à une flambée des prix de l’immobilier) puis une crise bancaire, avec la faillite de certains établissements de crédit en 2008. Cela a généré une crise des Etats eux-mêmes, prenant en charges les déficits des banques, les renflouant et les sauvant. Ceci s’est manifesté par un déficit accru de leurs budgets, notamment sociaux, mais aussi par une réduction de leurs dépenses, même dans les domaines régaliens (défense, police, justice). Ce sont ensuite les banques, sauvées par les Etats, qui ont prêtés aux Etats, incapables de boucler leurs budgets sans déficits.
Compte tenu de la globalisation des systèmes financiers, la crise venue des Etats-Unis s’est diffusée partout. La seule crise des ‘‘subprimes’’ a abouti à la perte de quelques 2000 milliards de dollars, soit environ le PIB de la France d’alors (2008). Puis est intervenu le plan de sauvetage des banques américaines. Il a été de l’ordre de 700 milliards de dollars. Les Etats ont ensuite mis sur pied des plans de relance de l’économie : ce furent des plans nationaux. Ils ont eu un effet très modeste. En 2012, dans les plupart des pays d’Europe, la non-croissance s’est confirmée, quand ce n’est pas la récession pure et simple. Le chômage s’aggrave, les plans de réduction des déficits sont à l’évidence intenables, et pas seulement en Grèce.
C’est dans la mesure où aucun problème économique n’a été réglé début 2020 que le Covid a été un prétexte pour engager une dévalorisation massive de l’argent (du Capital) par la mutualisation partielle des dettes d’Etat, et par un plan de relance (subventions et emprunts de 750 milliards d’euros). C’est l’hélicoptère à Covid qui a déversé ces sommes, créées par la planche à billets, sur l’Europe. Ces sommes ne correspondent à aucune valeur dans l’économie réelle. Tout ceci était prévu auparavant au nom de l’ « urgence » écologique. Mais il a été plus facile de faire passer ces mesures au nom du Covid 19, à partir d’une savante orchestration de la peur d’une maladie fort peu létale. Le Covid (c’est le virus du covid et non la maladie du covid) a ainsi été l’occasion de faire sauter des verrous qui étaient de moins en moins tenables et de moins en moins tenus : les 3 % de déficit des budgets publics, le taux de 60 % d’endettement. Sur ces 2 critères, la France est à 9 % de déficit, et 120 % de dette. Autant dire que le Covid a été le moyen, qui ne doit pas grand-chose au hasard, d’opérer une transformation du management du Capital. C’est ce que l’on appelle la Grande Réinitialisation (Great Reset), à la suite de Klaus Schwab qui en a défendu le projet dans un livre.
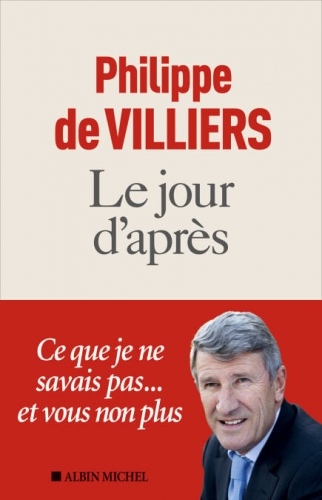 Philippe de Villiers, qui publie Le Jour d’après (Albin Michel, 2021) écrit : « Avec la création de l’OMC en 1995, les grands acteurs de la globalisation avaient voulu un monde sans frontières, les uns par intérêt, pour ouvrir un marché planétaire de masse ; les autres par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts et favoriser la fraternité cosmique. Ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloisons: une planète hautement pathogène et contagieuse. Ils le savaient et s’y préparaient. Ils attendaient la ‘’fenêtre d’opportunité’’ pour changer la société, pour changer de société. L’affaire a plutôt réussi. » Il poursuit : « La Big Tech s’est enrichie, et le biopouvoir s’est installé durablement avec l’hygiénisme d’État. (…) La biopolitique a tué la politique. Knock a euthanasié Aristote : l’animal social est devenu un asymptomatique désocialisé. » (Figarovox, 14 mai 2021) La surveillance marchande fusionne avec la surveillance numérique. L’enfermement numérique devient obligatoire. Les communautés, les liens, les nations sont sommées de laisser la place aux solitudes grégaires et consuméristes.
Philippe de Villiers, qui publie Le Jour d’après (Albin Michel, 2021) écrit : « Avec la création de l’OMC en 1995, les grands acteurs de la globalisation avaient voulu un monde sans frontières, les uns par intérêt, pour ouvrir un marché planétaire de masse ; les autres par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts et favoriser la fraternité cosmique. Ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloisons: une planète hautement pathogène et contagieuse. Ils le savaient et s’y préparaient. Ils attendaient la ‘’fenêtre d’opportunité’’ pour changer la société, pour changer de société. L’affaire a plutôt réussi. » Il poursuit : « La Big Tech s’est enrichie, et le biopouvoir s’est installé durablement avec l’hygiénisme d’État. (…) La biopolitique a tué la politique. Knock a euthanasié Aristote : l’animal social est devenu un asymptomatique désocialisé. » (Figarovox, 14 mai 2021) La surveillance marchande fusionne avec la surveillance numérique. L’enfermement numérique devient obligatoire. Les communautés, les liens, les nations sont sommées de laisser la place aux solitudes grégaires et consuméristes.
Ayant acté la totale désindustrialisation de notre pays, nos gouvernants n’ont gardé qu’un objectif : le contrôle de la population et les profits des gros actionnaires. Déjà, Jospin, de 1997 à 2002, avait largement privatisé. De 2012 à 2017, le gouvernement Hollande s’est lancé dans une politique de soumission accrue à la finance. « Dans 5 ans, Hollande sera un géant ou un nain », affirmait Emmanuel Todd (Marianne, 5 octobre 2012). On a vu le résultat. La politique de Macron depuis 2017 a consisté à la fois à essayer de comprimer les dépenses publiques – mais sans réduire aucunement l’immigration, tout au contraire – notamment à comprimer les indispensables dépenses régaliennes, et à brader à l’étranger ce qu’il restait de nos fleurons industriels. Seuls les profits de la finance intéressent Macron (c’est son cœur de métier) et seuls ces profits sont la préoccupation de ceux qui l’ont porté au pouvoir comme délégué du Capital. Ces gens sont bien entendu les ennemis de notre pays.
* * *
Il faut toutefois remonter avant 2008 pour comprendre la crise. Ses racines sont plus anciennes. Elles remontent à la fin de la convertibilité du dollar en or (1971), à la suraccumulation du capital, dont la genèse est analysée dans Le Capital de Marx (livre III, chapitre 15), à sa perte consécutive de profitabilité, aux différentes formes de dévalorisation de ce capital par obsolescence accélérée, au surenchérissement des matières premières du à leur caractère limité, au coût croissant de leur extraction.
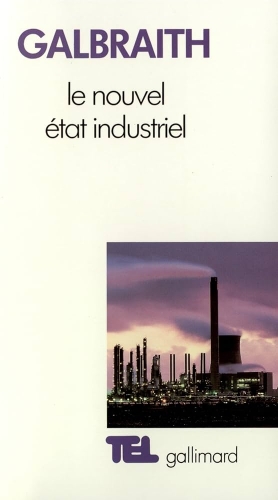 Plus profondément, la crise économique est liée à l’épuisement du modèle fordiste, fondé sur un compromis entre, d’une part, le développement capitaliste et la recherche du profit et, d’autre part, l’extension d’un grand marché rentable de producteurs-consommateurs au pouvoir d’achat en progression. Ce modèle fordiste privilégiait le manager sur l’actionnaire. C’était l’ère des organisateurs analysée par James Burnham, ou encore le « Nouvel Etat Industriel » de John K. Galbraith. C’était les politiques économiques menées en France sous de Gaulle, et aux Etats-Unis sous John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. C’était le fordisme, c’était les trente Glorieuses, et c’était la réalité d’un certain progrès matériel et d’un relatif ascenseur social. C’était donc aussi une certaine forme de circulation des élites. Ce sont les années dont Eric Zemmour a la nostalgie, non sans raisons (même si c’était aussi l’époque, dans les usines, des cadences infernales).
Plus profondément, la crise économique est liée à l’épuisement du modèle fordiste, fondé sur un compromis entre, d’une part, le développement capitaliste et la recherche du profit et, d’autre part, l’extension d’un grand marché rentable de producteurs-consommateurs au pouvoir d’achat en progression. Ce modèle fordiste privilégiait le manager sur l’actionnaire. C’était l’ère des organisateurs analysée par James Burnham, ou encore le « Nouvel Etat Industriel » de John K. Galbraith. C’était les politiques économiques menées en France sous de Gaulle, et aux Etats-Unis sous John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. C’était le fordisme, c’était les trente Glorieuses, et c’était la réalité d’un certain progrès matériel et d’un relatif ascenseur social. C’était donc aussi une certaine forme de circulation des élites. Ce sont les années dont Eric Zemmour a la nostalgie, non sans raisons (même si c’était aussi l’époque, dans les usines, des cadences infernales).
Depuis la fin du fordisme, nous n’avons pas de modèle viable. La richesse se concentre à un pôle de la société, et la pauvreté partout ailleurs. C’est la « société en sablier » (Alain Lipietz, 1998). 50 % des Américains se partagent un peu plus de 1 % de la richesse du pays. 50 % de la population mondiale se partagent 2 % de la richesse mondiale. Il n’est pas besoin d’être un égalitariste forcené pour constater que cet écart est excessif, malsain et même suicidaire. Quand, il y a un siècle, un patron gagnait quelque 30 fois le salaire de son ouvrier le moins bien payé, l’écart est passé à 400 ou 500 fois. Le travail devient rare, les machines ont remplacé les hommes et, plus encore, les hommes les moins bien payés remplacent sans fin ceux qui sont encore un peu mieux payés. Les Cambodgiens remplacent les ouvriers Chinois, en attendant d’être remplacés eux-mêmes par des Africains quand ceux-ci seront pleinement intégrés au marché mondial.
 Sismondi (portrait, ci-contre) demandait au XIXe siècle que l’investissement dans les machines donne lieu à une rente servie aux travailleurs devenus en surnombre. Ce peut être le salaire indirect, tel le droit à la formation, l’accès aux soins, etc. Ce peut être aussi les assurances chômage, ou un revenu minimum. Or, sur tous les postes sociaux, y compris ceux qui concernent la santé (avec les centaines de milliers de suppression de lits d’hôpitaux), une formidable régression sociale se manifeste. « Le pouvoir de l’argent permet de neutraliser toutes les tentatives de régulation de la finance », note à juste titre Paul Jorion. Il y a à cela une raison, et elle explique que l’on ne puisse revenir aux Trente Glorieuses même si les gouvernants ne cessent depuis 35 ans de promettre une sortie de crise, après de nouveaux « ajustements », c’est-à-dire de nouveaux démantèlements des protections sociales. En effet, dans la logique du productivisme, l’ « Etat stratège », l’Etat keynésien visant le plein emploi, ne pouvait être qu’une étape. C’est ce qu’il a été. Il eut fallu sortir de la domination du politique par l’économique, en réformant profondément l’Etat, en en faisant un « Etat du peuple tout entier ». Si l’économie est vraiment le destin, la dérégulation est forcément ce vers quoi nous tendons. Or la dérégulation est un tout, comme l’est la mondialisation. La dérégulation concerne le marché du travail, les salaires, les flux migratoires, la finance, et même les moeurs. « La crise impose de supprimer la référence à la durée légale du travail », expliquait François Fillon (10 octobre 2012). C’est le programme qu’a appliqué Macron. Pour les mondialistes, il faut toujours plus de déréglementation. Les premières victimes en sont les peuples. Ceux-ci ont ensuite la solution de subir ou bien de changer radicalement les règles du jeu, comme l’a fait l’Islande.
Sismondi (portrait, ci-contre) demandait au XIXe siècle que l’investissement dans les machines donne lieu à une rente servie aux travailleurs devenus en surnombre. Ce peut être le salaire indirect, tel le droit à la formation, l’accès aux soins, etc. Ce peut être aussi les assurances chômage, ou un revenu minimum. Or, sur tous les postes sociaux, y compris ceux qui concernent la santé (avec les centaines de milliers de suppression de lits d’hôpitaux), une formidable régression sociale se manifeste. « Le pouvoir de l’argent permet de neutraliser toutes les tentatives de régulation de la finance », note à juste titre Paul Jorion. Il y a à cela une raison, et elle explique que l’on ne puisse revenir aux Trente Glorieuses même si les gouvernants ne cessent depuis 35 ans de promettre une sortie de crise, après de nouveaux « ajustements », c’est-à-dire de nouveaux démantèlements des protections sociales. En effet, dans la logique du productivisme, l’ « Etat stratège », l’Etat keynésien visant le plein emploi, ne pouvait être qu’une étape. C’est ce qu’il a été. Il eut fallu sortir de la domination du politique par l’économique, en réformant profondément l’Etat, en en faisant un « Etat du peuple tout entier ». Si l’économie est vraiment le destin, la dérégulation est forcément ce vers quoi nous tendons. Or la dérégulation est un tout, comme l’est la mondialisation. La dérégulation concerne le marché du travail, les salaires, les flux migratoires, la finance, et même les moeurs. « La crise impose de supprimer la référence à la durée légale du travail », expliquait François Fillon (10 octobre 2012). C’est le programme qu’a appliqué Macron. Pour les mondialistes, il faut toujours plus de déréglementation. Les premières victimes en sont les peuples. Ceux-ci ont ensuite la solution de subir ou bien de changer radicalement les règles du jeu, comme l’a fait l’Islande.
« L’universel, c’est le local moins les murs », dit Miguel Torga. Il est temps de réhabiliter le local car l’universel qui prétendrait se passer du local tuerait la vie elle-même dans sa chair. Ce n’est pas un hasard si c’est un « petit » peuple comme les Islandais, héritier d’une longue tradition démocratique, qui a donné le signal de l’indépendance retrouvée. De même que c’est dans la « petite » Suisse qu’il y a encore quelques éléments d’une vraie démocratie. « Small is beautiful ». Small peut en tout cas être plus efficace que le gigantisme.
2 - Au-delà d’une simple crise économique, pensez-vous que nous avons affaire à une crise beaucoup plus profonde ?
 Nous avons affaire à ce que Pier Paolo Pasolini (photo) appelait un « cataclysme anthropologique ». C’est-à-dire que les cadres mêmes de la vie, les cadres des représentations éclatent. La crise de la transmission, et donc de l’éducation, qui en est un sous-produit, est la conséquence de cette crise.
Nous avons affaire à ce que Pier Paolo Pasolini (photo) appelait un « cataclysme anthropologique ». C’est-à-dire que les cadres mêmes de la vie, les cadres des représentations éclatent. La crise de la transmission, et donc de l’éducation, qui en est un sous-produit, est la conséquence de cette crise.
La crise économique est d’abord une crise de la domination de la vie par l’économique. « L’économisme est bien la grande idéologie actuelle », écrit Peter Ulrich. « Antérieurement, pas une seule forme d’argumentation idéologique n’a exercé d’influence comparable dans le monde. La critique de l’économisme ou la critique de la ratio économique exempt de toute limitation consiste, dans la perspective des sciences humaines, à rattraper un peu ce que le siècle des Lumières a réalisé. » C’est effectivement le paradoxe : les Lumières ont prétendu porter un projet d’émancipation, mais ont abouti à une nouvelle crédulité, à un nouvel obscurantisme : la croyance en la toute-puissance autorégulatrice de l’économie. C’est la traduction philosophique d’une réalité sociologique et politique, et celle-ci a été justement dénoncée sous le nom de dictature de l’argent.
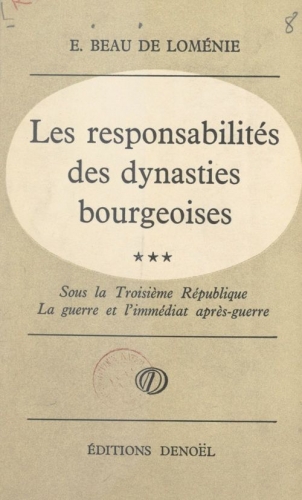 « L'argent, le gros argent n'est, n'a été ni à Droite ni à Gauche. Pour sauver ses avantages les plus abusifs, il n'a cessé de jouer alternativement de la Gauche et de la Droite, le plus souvent même de la Gauche, en exploitant un certain nombre d'idéologies », écrivait Emmanuel Beau de Loménie (La Parisienne, N° « La droite », octobre 1956). (il est vrai qu’Emmanuel Beau de Loménie en tirait des conclusions insuffisamment rigoureuses en mettant en cause, presque seule, une caste issue du 18 Brumaire, les « Jacobins nantis », ou « le syndic de défense des régicides » dont parle Louis Madelin). La crise économique est en fait une crise de la domination de l’économie. Plus profondément, le problème de notre temps est que la domination de l’argent fait que tous les biens sont ramenés à des marchandises. Tout est calculable en argent et tout est calculé en argent. Donc, tous les biens deviennent aliénables. En ce sens, l’homme n’est plus propriétaire de rien, ni de son métier, ni d’une maison de famille, ni d’un patrimoine spirituel, ni du droit de décider du sens de sa vie. « L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénation absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lit tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même », écrit Marx (Le Capital, 1867). Ce que nous vivons est donc, en toute rigueur, une crise non de l’économie, activité qui devrait être limitée à satisfaire les besoins du peuple (la conduite des « affaires de la maison »), mais une crise de la chrématistique, c’est-à-dire une crise de l’accumulation des biens et plus encore de l’accumulation de l’argent.
« L'argent, le gros argent n'est, n'a été ni à Droite ni à Gauche. Pour sauver ses avantages les plus abusifs, il n'a cessé de jouer alternativement de la Gauche et de la Droite, le plus souvent même de la Gauche, en exploitant un certain nombre d'idéologies », écrivait Emmanuel Beau de Loménie (La Parisienne, N° « La droite », octobre 1956). (il est vrai qu’Emmanuel Beau de Loménie en tirait des conclusions insuffisamment rigoureuses en mettant en cause, presque seule, une caste issue du 18 Brumaire, les « Jacobins nantis », ou « le syndic de défense des régicides » dont parle Louis Madelin). La crise économique est en fait une crise de la domination de l’économie. Plus profondément, le problème de notre temps est que la domination de l’argent fait que tous les biens sont ramenés à des marchandises. Tout est calculable en argent et tout est calculé en argent. Donc, tous les biens deviennent aliénables. En ce sens, l’homme n’est plus propriétaire de rien, ni de son métier, ni d’une maison de famille, ni d’un patrimoine spirituel, ni du droit de décider du sens de sa vie. « L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénation absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lit tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même », écrit Marx (Le Capital, 1867). Ce que nous vivons est donc, en toute rigueur, une crise non de l’économie, activité qui devrait être limitée à satisfaire les besoins du peuple (la conduite des « affaires de la maison »), mais une crise de la chrématistique, c’est-à-dire une crise de l’accumulation des biens et plus encore de l’accumulation de l’argent.
Avec l’Habeas Corpus de 1679, nous sommes passés de l’idée d’une société bonne à celle de justice dans les rapports sociaux, ce qui n’est pas la même chose. L’équité dans les rapports entre individus est nécessaire, mais elle n’a de sens que dans le cadre d’une pensée du bien commun. Nous sommes ensuite passés avec le triomphe de l’individualisme au XVIIIe siècle à la référence à l’idée d’intérêt comme seul facteur de légitimation : donner libre cours à la recherche de son intérêt serait la meilleure façon d’accroitre la richesse sociale globale, identifiée à ce qui reste du bien commun. Ce qui est bon pour moi serait automatiquement bon pour tous. C’est la Fable des abeilles (1714-1729) de Bernard Mandeville. C’est une habile façon de moraliser la recherche de son intérêt individuel. On n’est pas obligé d’être convaincu.
Si le bien commun n’est que ce qui est mesurable, alors, en effet, comment trouver quelque chose de plus rigoureusement mesurable que la richesse monétaire ? C’est pourquoi une solution purement économique à une crise qui n’est pas qu’économique n’a pas de sens. « Le refus d’envisager d’autres approches de la crise par les partis au pouvoir un peu partout en Europe, leur incapacité à penser hors du tout économique (entendez libéral) ne relève ni d’un complot, ni d’un manque d’imagination. Elle reflète à la fois les rapports de force actuels entre les acteurs et illustre combien le référentiel des hommes politiques est déphasé par rapport à la crise actuelle », écrit Michel Leis. Une civilisation meurt quand ses élites ne comprennent pas la nature d’un processus en cours, ou quand elles en sont complices – ce qui est le cas. Les « élites », ou plutôt les classes dirigeantes sont le moteur du productivisme effréné, de la mondialisation capitaliste, de la consommation et consumation de la planète par l’homme
La crise actuelle est d’une nature très différente des crises précédentes, comme par exemple celle qui a succédé à la défaite de 1870. Alors que l’éducation se répandait dans les années 1870-1880, nous sommes confrontés à une décivilisation, comme l’écrit Renaud Camus. L’homme se re-primitivise. C’est l’obsolescence de l’homme, et pas seulement celle des objets, qui menace. La technophilie devenue technofolie asservit l’homme. Appareillé, des écouteurs aux oreilles, tenu en laisse par ses propres instruments, devenu un appendice de ses propres prothèses, un périphérique de ses propres appareils, l’homme est devenu l’objet de ses objets.
 Le culte de la technique amène à penser que tout ce qui est possible doit être réalisé. D’où une nouvelle barbarie sophistiquée, peut-être la pire de toute. Günther Anders affirmait en 1977 que « la tâche morale la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime » (Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse?, Paris, Allia, 2001). On ne saurait mieux dire.
Le culte de la technique amène à penser que tout ce qui est possible doit être réalisé. D’où une nouvelle barbarie sophistiquée, peut-être la pire de toute. Günther Anders affirmait en 1977 que « la tâche morale la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime » (Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse?, Paris, Allia, 2001). On ne saurait mieux dire.
3 – Peut-on imaginer un instant que les politiciens français et européens actuels soient capables de résoudre cette crise ?
Il n’y a pas de nouveau de Gaulle, capable de prendre des décisions historiques tranchantes, fussent-elles douloureuses. Non que les hommes politiques français et européens soient tous médiocres. Jean-Pierre Chevènement, Arnaud Montebourg, quelques autres parfois n’ont pas formulé des analyses sans intérêt. Le problème est que la plupart des hommes politiques ont du mal à s’élever au-dessus des préoccupations économiques à court terme. Tout est fait au demeurant pour cela, toute la logique du système consiste à faire des élus des relais du système. La dévalorisation et même l’oubli de la culture générale, des humanités, de la culture historique contribuent aussi à leur enlever le recul qui serait nécessaire pour dépasser les préoccupations gestionnaires à court terme.
Dans le même temps, tout est mis en place pour limiter, voire interdire l’expression du peuple sur les sujets essentiels. Or, ce ne peut être que du peuple qu’un sursaut pourrait venir, en liaison bien entendu avec des activités militantes. « Il se trouve des époques violentes où l’Etat renaît pour ainsi dire de ses cendres et reprend la vigueur de la jeunesse … mais ces évènements sont rares », écrit Rousseau (Contrat social, livre II, chapitre VIII).
Il faut un événement déclencheur. Les couvercles les mieux arrimés finissent par sauter sous la pression. Demain est entre les mains du peuple. « Le peuple, qui a l'avenir et qui n'a pas le présent ; le peuple, orphelin, pauvre, intelligent et fort ; placé très bas, et aspirant très haut ; ayant sur le dos les marques de la servitude et dans le cœur les préméditations du génie » (Victor Hugo, préface de Ruy Blas).
4 – Face à cette crise, une autre Europe est-elle concevable ? Si oui, laquelle?
Je souhaite que les nations d’Europe pèsent dans le même sens: indépendance vis-à-vis des Etats-Unis, rapprochement sans asservissement avec la Russie. Je sais que les nations d’Europe pèseront plus ensemble que séparées. A condition que certaines ne soient pas le cheval de Troie de puissances non européennes. Je suis européen de cœur et je veux une Europe-puissance, mais pas seulement une Europe-puissance, je veux aussi une Europe comme modèle de civilisation. Une Europe-équilibre face aux excès de la modernité.
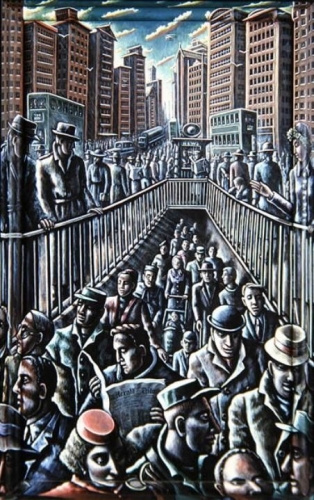
Nous refusons « la fourmilière américaine tout comme soviétique », disaient les non conformistes des années trente. Aujourd’hui, il s’agit de refuser tout aussi bien la financiarisation/désindustrialisation des économies américaines et européennes que le contrôle social de la Chine « Populaire » et son modèle de développement (à quel prix humain et écologique ?). Une dictature capitalo-communiste, dans le cadre d’une société de surveillance et d’une citoyenneté « à points » ? Non merci. Il faut aussi refuser la désindustrialisation chez nous et le développementisme à tout prix ailleurs pour une autre raison : l’un est la condition de l’autre, l’un est l’autre face de l’autre. C’est parce qu’il n’y a plus d’industrie en Europe – et surtout en France – qu’elle est en Asie.
Il faut assurément que l’Europe retrouve une économie industrielle, que seule l’Allemagne garde (relativement d’ailleurs, car elle est largement sous-traitée en Europe de l’est). Mais ce retour à l’industrie doit se faire de manière ordonnée et responsable par rapport à l’environnement. (il est à noter que notre agriculture productiviste est infiniment plus dévastatrice par rapport à l’environnement que ne le seraient nombre d’industries disparues du paysage de notre pays).
Concernant la méthode, l’objectif d’une Europe confédérale, ce que j’appelle l’Empire européen (un Empire non impérialiste, qui serait l’organisation de la diversité des peuples européens), me parait souhaitable, mais il est évident qu’une Europe confédérée n’a de sens que si elle est aux mains des peuples. Or, la « construction » européenne actuelle en est très éloignée. Dés lors, il faut savoir faire un pas en arrière quand on va dans une mauvaise direction. C’est pourquoi ceux qui prédisent la sortie de l’euro et pensent que nous devons l’anticiper, ou ceux qui pensent que l’euro devrait devenir une simple monnaie commune (si cela est possible), et non pas unique, ne me paraissent pas forcément de « mauvais Européens ».
 La condition impérative pour une autre Europe, c’est que les peuples se ressaisissent de leur destin. Le souverainisme national ne me parait pas tenable à long terme, mais il peut être une étape avant de construire une Europe autocentrée, avant un protectionnisme européen, une maitrise européenne des frontières, un souverainisme européen. Une économie autocentrée (André Grjebine, 1980). Actuellement, les peuples ont le sentiment d’être dépossédés d’eux-mêmes, ils considèrent que l’Europe telle qu’elle est, l’UE, contribue à cette dépossession. De fait, l’Europe actuelle est profondément antidémocratique. Il faut remettre la démocratie au coeur de l’action politique, il faut la faire vivre localement, car le local est un fragment du global. Disons-le simplement : les peuples doivent décider. Ils doivent décider de tout et partout. La démocratie n’est pas le « pouvoir de la populace », rappelait Rousseau. Le mondialisme – et la pseudo-gouvernance mondiale qui se profile – se fait au nom d’un cosmopolitisme que Rousseau appelait déjà une « vertu de papier ». La dimension mondiale de nombreux problèmes ne veut aucunement dire que les peuples doivent disparaitre et se fondre dans un moule unique : le producteur-consommateur du grand marché mondial uniformisé. A problèmes mondiaux, solutions locales. Ce sont les diversités de peuples, de culture, de civilisations qui sont la chance du monde.
La condition impérative pour une autre Europe, c’est que les peuples se ressaisissent de leur destin. Le souverainisme national ne me parait pas tenable à long terme, mais il peut être une étape avant de construire une Europe autocentrée, avant un protectionnisme européen, une maitrise européenne des frontières, un souverainisme européen. Une économie autocentrée (André Grjebine, 1980). Actuellement, les peuples ont le sentiment d’être dépossédés d’eux-mêmes, ils considèrent que l’Europe telle qu’elle est, l’UE, contribue à cette dépossession. De fait, l’Europe actuelle est profondément antidémocratique. Il faut remettre la démocratie au coeur de l’action politique, il faut la faire vivre localement, car le local est un fragment du global. Disons-le simplement : les peuples doivent décider. Ils doivent décider de tout et partout. La démocratie n’est pas le « pouvoir de la populace », rappelait Rousseau. Le mondialisme – et la pseudo-gouvernance mondiale qui se profile – se fait au nom d’un cosmopolitisme que Rousseau appelait déjà une « vertu de papier ». La dimension mondiale de nombreux problèmes ne veut aucunement dire que les peuples doivent disparaitre et se fondre dans un moule unique : le producteur-consommateur du grand marché mondial uniformisé. A problèmes mondiaux, solutions locales. Ce sont les diversités de peuples, de culture, de civilisations qui sont la chance du monde.
PLV
Pierre Le Vigan a publié :
L’effacement du politique, La barque d’or
Le grand empêchement. Comment le libéralisme entrave les peuples, Perspectives libres-Cercle Aristote
Eparpillé façon puzzle. Macron contre le peuple et les libertés, Perspectives libres-Cercle Aristote
Le Coma français, Perspectives libres-Cercle Aristote
17:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, crise, crise de 2008, libéralisme, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 28 novembre 2025
La “progéniture monstrueuse”: brève histoire de l’intérêt
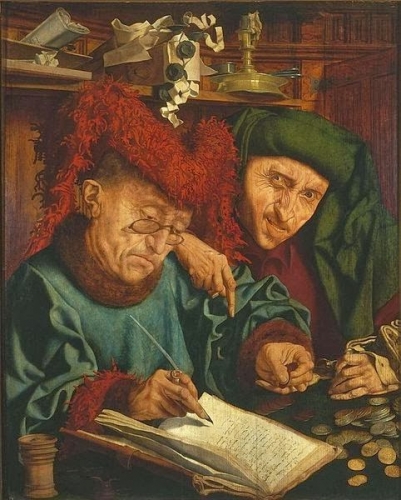
La “progéniture monstrueuse”: brève histoire de l’intérêt
Par Andrea Falco Profili
Source: https://www.grece-it.com/2025/10/30/la-progenie-mostruosa...
Aristote la qualifia de “commerce le plus haï”, une activité contre nature où l’argent, par essence stérile, se reproduisait de façon monstrueuse par lui-même. Pendant des millénaires, l’acte de prêter avec intérêt a été un tabou moral, repoussant et inacceptable. Dans le folklore médiéval, les démons remplissaient la bouche du prêteur décédé de pièces brûlantes, une punition jugée appropriée pour un abomination telle que l’usure. Le monde antique, en effet, connaissait bien la puissance socialement destructrice de la dette : il avait conçu à cet effet un mécanisme de suppression, l’institution du Jubilé. Une année sacrée, qui servait de réinitialisation légale où les terres revenaient à leurs anciens propriétaires et, surtout, où la libération de l’esclavage de la dette était proclamée. C’était la tentative ultime de freiner une pratique odieuse.
Ces échos d’une ancienne répugnance morale ont été, depuis, enfouis par l’histoire. La longue marche du crédit a transformé le péché capital en une pratique financière respectable. Mais, en se dotant de méthode, il faut retracer comment il a été possible d’en arriver là.
Comme nous l’avons dit, dans le monde antique, l’intérêt était perçu comme un acte repoussant et inacceptable, on parlait de faire “enfanter” l’argent, un acte que Aristote, dans le premier livre de La Politique, condamne immédiatement, déclarant la stérilité de l’argent. L’usurier, en faisant “accoucher” des pièces de monnaie à partir d’autres pièces, crée une progéniture artificielle, un tokos (qui signifie aussi “rejeton” en grec), qui est une monstruosité. La pratique du prêt était considérée odieuse car elle constituait le principal instrument de soumission. Dans le monde grec-romain et au Proche-Orient, un paysan dont la récolte tournait mal était contraint de grever sa terre, puis ses outils, puis ses enfants, et enfin lui-même. C’était la réalité du crédit: l’esclavage pour dettes. Des populations entières étaient dépossédées et asservies non par une armée envahissante, mais par un registre comptable. Le créancier voyait sa richesse croître non par le travail, mais par la désolation d’autrui. C’était un système qui dévorait la société de l’intérieur, concentrant la terre et le pouvoir entre les mains d’une oligarchie, tandis que la masse de la population sombrait dans une servitude permanente.
La dette accumulée, laissée à elle-même, devient une entropie sociale et se concentre jusqu’à détruire le tissu même de la communauté, créant une fracture irrémédiable entre créanciers et débiteurs. Cette répulsion ne se limita pas au paganisme philosophique ou à la culture catholique. Elle fut universelle, si bien que l’Église chrétienne primitive, suivant les Évangiles (“Prêtez sans espérer rien en retour”), fut implacable. Les pères de l’Église, à partir de Saint Thomas d’Aquin, furent unanimes dans leur condamnation de l’usure comme péché mortel, défini comme un vol sans demi-mesure. Faire payer pour l’usage de l’argent, disait Thomas, c’était faire payer pour le temps. Les conciles ecclésiastiques interdisaient aux usuriers de recevoir les sacrements et même la sépulture en terre consacrée. L’Islam, dans le Coran, est peut-être encore plus clair, en comparant l’usurier à celui qui est “touché par Satan” car il déclare littéralement la guerre à Dieu et à son prophète en poursuivant cette pratique.
Pendant plus de deux mille ans, les trois grandes traditions intellectuelles et morales d’Europe et du Proche-Orient – la philosophie grecque, la loi chrétienne et la loi islamique – s’accordaient sur la malignité absolue de l’usure, avec une voix unanime.
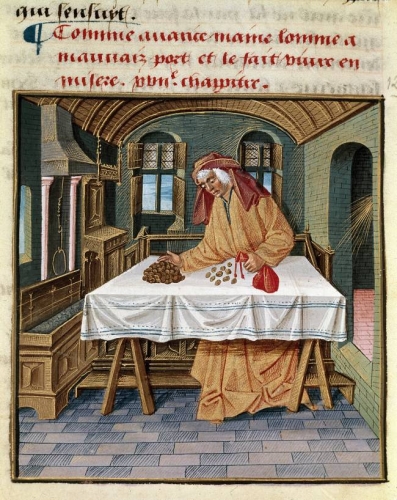
La question est alors la suivante: comment a-t-il été possible d’arriver à la situation actuelle, comment un paria moral a-t-il pu s’intégrer dans l’administration courante en dissimulant son passé de pratique répugnante. Il s’agit en effet d’un chef-d’œuvre de sophistique, d’un lent lavage de cerveau collectif qui a duré des siècles, a commencé par de petits détails et des jeux terminologiques. Les théologiens et juristes du bas moyen-âge commencèrent à creuser des fissures dans le mur, en postulant les droits du prêteur d’argent. Si le créancier subissait un dommage, ou perdait une opportunité de gain, il devenait opportun et justifiable qu’il reçoive une compensation, un “intérêt”. Le terme même d'“intérêt” fut choisi délibérément pour s’éloigner du mot “usure”, lequel était chargé de haine. Par la suite, furent créés les Monts de Piété, officiellement nés pour lutter contre l’usure, qui étaient des institutions franciscaines prêtant de l’argent aux pauvres en demandant en échange seulement un petit intérêt, juste suffisant à couvrir les coûts opérationnels. Cela semblait charitable, mais le tabou avait été brisé et, pour la première fois, une institution chrétienne légitimait l’intérêt. La digue avait cédé.
Le coup de grâce arriva avec la Réforme protestante. En plus de Luther, c’est Jean Calvin qui fournit la justification théologique que le capitalisme naissant attendait. Calvin distingua entre le prêt au pauvre (qui constituait encore un péché) et le prêt à l’entrepreneur, arguant que l’intérêt était le gain légitime de celui qui permettait à un autre homme de tirer du profit en lançant une activité. À partir de ce moment, les coordonnées de l’argent dans la société changèrent irrémédiablement : on ne parle plus d’argent stérile mais de capital, et l’usurier, parasite, changea de nom pour devenir l'“investisseur”, devenant un partenaire dans le progrès.
Depuis ce moment, la marche du crédit fut inarrêtable. Les Lumières ont sécularisé le sujet (Bentham, Adam Smith), liquidant les anciennes interdictions désormais considérées comme relevant de superstitions médiévales qui entravaient le libre marché. Les banques, autrefois activités marginales et honteuses, sont devenues les temples de la nouvelle économie. Aujourd’hui, le système que les Européens d’autrefois voyaient comme un cancer social est désormais le système circulatoire en place. La re-signification a permis de remplacer la peur de la dette par celle de ne pas en avoir assez (on parle maintenant de “mauvais crédit”). Les gouvernements ne cherchent pas à effacer les dettes, mais s’endettent pour payer les intérêts sur les dettes précédentes. Même l’institution du Jubilé ne survit que dans son sens spirituel dans un catholicisme en déclin, tandis que sa valeur économique et sociale est oubliée et ridiculisée comme une impossibilité économique. En revanche, il existe son opposé : le sauvetage (bailout), où les dettes faillies des puissants ne sont pas effacées, mais transférées sur le dos du public. L’apothéose de cette transformation est survenue avec la crise financière de 2008. Quand le château de cartes construit sur les prêts hypothécaires s’effondra, on a pu s'attendre à un retour à la santé. Au contraire, ce fut la victoire définitive de la logique de la dette. Les sauvetages bancaires dans le monde atteignirent des chiffres astronomiques. Ce ne furent pas les dettes des désespérés qui furent effacées, mais celles des requins financiers qui furent socialisées. Les spéculateurs qui avaient parié et perdu furent sauvés par l’argent public, tandis que des millions de familles perdirent leurs maisons. On choisit de récompenser ceux qui avaient créé la catastrophe, ceux qui en subirent les conséquences découvrirent vite le sens du mot “austérité”.
Le cercle est bouclé, la “progéniture monstrueuse” d’Aristote s’est tellement multipliée qu’elle a dévoré ses propres parents. Et le monde, sans même s’en rendre compte, est devenu son enfant adoptif.
Andrea Falco Profili
17:26 Publié dans Actualité, Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : usure, prêt à intérêt, économie, aristote, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 16 novembre 2025
Le déclin du néolibéralisme et le côté obscur du capitalisme: les perspectives de Branko Milanović sur le bouleversement mondial
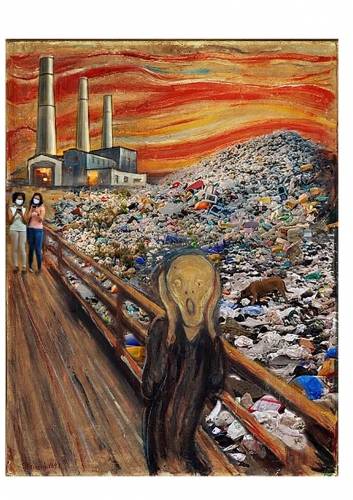
Le déclin du néolibéralisme et le côté obscur du capitalisme: les perspectives de Branko Milanović sur le bouleversement mondial
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/11/10/uusliberalismin-rappio...
L’économiste américano-serbe Branko Milanović s’est affirmé comme l’un des chercheurs les plus incisifs de notre époque sur les inégalités mondiales et le capitalisme. Dans une interview centrée sur son ouvrage The Great Global Transformation (2025), Milanović examine les forces historiques qui ont détruit l’ordre mondial néolibéral dirigé par les États-Unis depuis 1989.

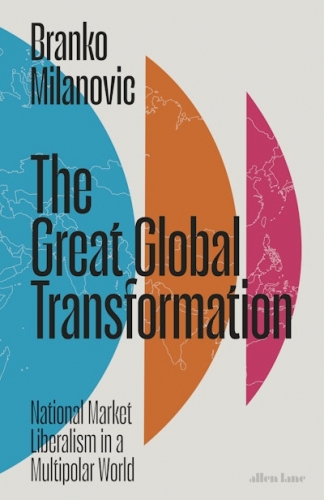
Son analyse ne donne cependant pas lieu à l’optimisme, mais met en garde contre la montée des traits les plus destructeurs du capitalisme. Selon Milanović, le monde est en train de passer à une nouvelle ère caractérisée par le multipolarisme et un libéralisme de marché de plus en plus réduit au niveau national. Cela aggrave encore davantage les crises générées par la mondialisation.
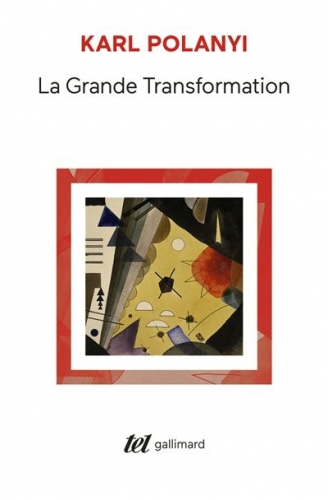
Le point de départ de Milanović fait référence à l’ouvrage classique de Karl Polanyi La Grande Transformation (1944). Alors que Polanyi expliquait l’effondrement du libéralisme de marché du XIXe siècle et ses mouvements de résistance, Milanović en fait autant pour la mondialisation néolibérale actuelle.
L’ouvrage de Polanyi tentait de comprendre ce qui s’était passé d’abord avec l’industrialisation, puis avec l’effondrement du nouvel ordre dans les années 1920-1930. De même, Milanović analyse la période depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, marquée par la domination occidentale et ses défis. Pourquoi ces changements ont-ils eu lieu ? Et qu’est-ce qui a changé ?

Au cœur de cette mutation se trouve l’ascension de l’Asie, en particulier de la Chine, dans la politique mondiale. Milanović résume ce développement paradoxal dans la préface de son nouveau livre : « La montée de la Chine, rendue possible par le néolibéralisme mondial, a rendu inévitable la fin du néolibéralisme global. »
Une analyse purement économique donne une image positive de cette montée asiatique. La richesse mondiale a triplé, et l’inégalité économique s’est réduite à mesure que la pauvreté en Chine, en Inde et dans d’autres pays densément peuplés diminue. Cependant, comme le souligne Milanović, ces tendances globales positives ont engendré de nouveaux problèmes tant sur la scène internationale que dans les sociétés nationales.
« La montée d’un pays comme la Chine, avec son PIB ajusté au pouvoir d’achat dépassant celui des États-Unis, crée un conflit géopolitique, car les États-Unis ne veulent pas renoncer à leur hégémonie mondiale et perçoivent la Chine comme un défi. »
Parallèlement, les classes moyennes occidentales, souffrant de pertes d’emplois et de baisse des salaires, se sont tournées vers des leaders populistes. Selon Milanović, « la montée de l’Asie est un changement si profond que personne ne peut espérer qu’il se fasse sans douleur. »
Un autre héritage essentiel du néolibéralisme mondial est la nouvelle classe dirigeante que Milanović décrit comme la homoploutia — une élite enrichie tant par le capital que par des emplois hautement rémunérés. Une telle classe sociale s’est constituée aussi bien aux États-Unis qu’en Chine, ce qui brouille la distinction entre deux modèles totalement différents: aux États-Unis, l’élite justifie sa position par ses mérites et ses diplômes, tandis qu’en Chine, la clé du pouvoir réside dans l’appartenance au Parti communiste.
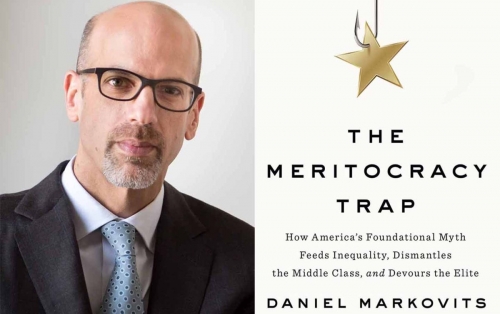
Milanović cite le livre de Daniel Markovits, The Meritocracy Trap (2019), et note que « les ‘stahanovistes’ d’aujourd’hui », ceux qui travaillent dans la finance, ressentent « une fierté presque calviniste de leur succès et méprisent ceux qui ne réussissent pas ». Cette arrogance, combinée à la perte d’emplois causée par la montée asiatique, a engendré un large mécontentement qui s’est retourné contre l’élite.
Le néolibéralisme reposait sur quatre piliers : les marchés libres, les libertés négatives nationales, la libre-échange et le cosmopolitisme. Aujourd’hui, ces piliers tombent. Selon Milanović, rien de radicalement nouveau ne doit émerger en remplacement, seulement une version modifiée du passé : cf. « le libéralisme national de marché dans un monde multipolaire. »
Dans un système incarné par des figures comme Trump, le libre-échange et le cosmopolitisme ont été remplacés par un protectionnisme agressif, et le libéralisme social subit également des attaques continues. La seule composante restante de l’ancienne idéologie est la liberté des marchés dans les limites de leur espace économique.
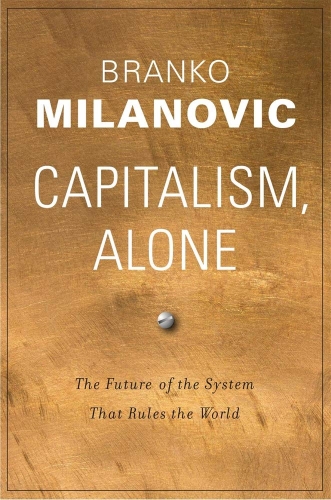
Milanović insiste sur le fait que Trump ne se contente pas de poursuivre la politique économique néolibérale, mais l’approfondit : baisses d’impôts, déréglementation, faveur aux taxes sur le capital. Le résultat est un système fragile, explosif et alimentant les inégalités, qui ne résout pas mais aggrave les crises engendrées par la mondialisation.
Même si les leaders populistes ne améliorent pas les conditions de vie de leurs supporters, l’antagonisme envers l’élite est si fort que la population continue de les soutenir. « Les insatisfaits accepteraient n’importe quel régime, tant qu’il élimine les élites au pouvoir, même s’ils n’en bénéficient pas eux-mêmes », affirme Milanović.
Sa vision du capitalisme est sombre : il le voit comme un système fondamentalement immoral, sans fin immédiate, même à cause des limites des ressources. En référence à La Société du Spectacle de Guy Debord, Milanović décrit un monde où tout a été marchandisé.
« Toute la sphère de la vie quotidienne et privée est probablement commercialisée. La cuisine est commercialisée. La garde des chiens est commercialisée. La prise en charge des personnes âgées est commercialisée. Même la mort est commercialisée. La disparition presque totale de la famille est la dernière conséquence de ce phénomène, car la famille repose sur des fonctions qui ne sont pas commerciales. »
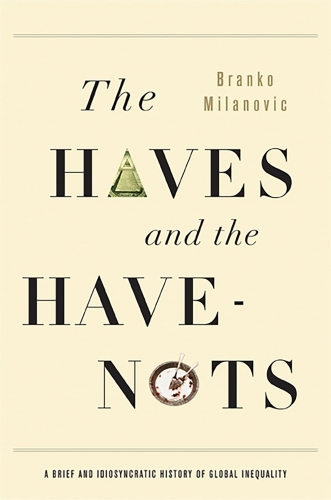
Bien que Milanović ne prévoie pas explicitement une guerre, sa conclusion pessimiste est claire : la direction actuelle n’annonce rien de bon. Les traits intrinsèques du capitalisme — égoïsme, quête de profit et marchandisation de tout — accentuent les problèmes sociaux au lieu de les résoudre.
Un monde qui abandonne la mondialisation néolibérale ne reviendra pas à un équilibre, mais s’enfoncera de plus en plus dans les tendances les plus destructrices du capitalisme. En conséquence, le système mondial sera fragmenté, en colère et de plus en plus dangereux.
15:42 Publié dans Actualité, Economie, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : branko milanovic, capitalisme, livre, économie, néolibéralisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 novembre 2025
La bataille des terres rares pousse l'Europe à planifier son économie

La bataille des terres rares pousse l'Europe à planifier son économie
Source: https://mpr21.info/la-batalla-de-las-tierras-raras-empuja...
Dans la guerre des matières premières, l'Europe est tombée dans son propre piège. Elle a tenté de bloquer et s'est elle-même retrouvée bloquée. Elle dépend des réserves stratégiques, des achats en gros et du soutien accru du public à l'industrie. Une certaine autarcie revient et les pays européens doivent reprendre le contrôle de leurs chaînes de production.
Le vieux G2 de la Guerre froide revient aussi. Si en matière militaire, les États-Unis doivent négocier avec Moscou, en économie, il faut parler avec Pékin. La “troisième voie” n'existe pas, du moins pas pour le moment. La Commission européenne attend de voir, comme les autres pays du monde. Si elle rejoint la politique de Washington, comme elle l'a fait jusqu'à présent, elle devra aussi encaisser les représailles chinoises.
Ici, la “main invisible” a peu de place, aussi Bruxelles revient à l'intervention publique et à la planification. La Commission européenne se prépare à se doter d'une série d'outils pour garantir ses approvisionnements en terres rares et autres métaux critiques, un petit défi pour ceux qui ne parlaient que de concurrence et de libre-échange auparavant.
La planification économique revient. Bruxelles détaillera son nouveau programme d'action début décembre. Il reposera sur trois piliers: la création de réserves stratégiques de métaux, une plateforme centralisée pour l'achat de matières premières et l'accélération du soutien financier aux projets miniers et de raffinage en territoire européen pour développer la production locale.
“Un changement général s'opère dans la doctrine économique au sein de la Commission: un désir d'être moins naïf en matière commerciale et d'assumer, en tant qu'autorité publique, un rôle dans l'organisation de l'économie et des chaînes de valeur”, assure un collaborateur de Stéphane Sejourné, vice-président de la Commission et initiateur du projet. “C'est quelque chose de nouveau, et c'est aussi une demande du secteur entrepreneurial”, expliquent-ils à Bruxelles.

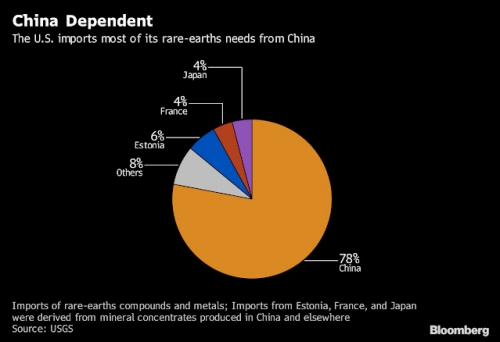
Les piliers sont conçus pour fonctionner en synergie: pour garantir la faisabilité des projets européens, une stratégie consiste à assurer des volumes d'achat de la future production, qui pourraient être réalisés via une plateforme centralisée pour accumuler des stocks.
Contrairement aux pays européens, la Chine a toujours contrôlé les marchés des métaux, notamment ceux tirés des terres rares et les métaux spécialisés, essentiels à la fabrication d'éoliennes, de moteurs électriques, d'équipements militaires et de puces électroniques. L'Europe était consciente de ses vulnérabilités depuis plusieurs années, mais tout s'est accéléré avec le début de la guerre économique, avec les blocages et les représailles chinoises.
Depuis les contrôles à l'exportation imposés par la Chine depuis avril dernier, les envois de terres rares ont été considérablement réduits, au point que certains secteurs industriels, en particulier l'automobile, ont été contraints de fermer plusieurs lignes de production.
Alors que les États-Unis ont réagi rapidement en acquérant directement des participations dans des producteurs locaux et en accumulant des réserves, le changement a pris plus de temps à se concrétiser en Europe. Il a d'abord fallu déterminer si les Européens n'étaient que des victimes collatérales de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et si la situation reviendrait à la normale avec le temps, ou s'il n'y aurait aucune amélioration significative.
Après avoir défini une liste de métaux critiques, comprenant le nickel, le cuivre, le lithium et les terres rares, l'Union européenne a activé son mécanisme réglementaire avec l'adoption de la Loi sur les matières premières critiques. Cette législation, adoptée l'année dernière, stipule que l'Europe doit extraire au moins 10% des métaux qu'elle consomme à l'intérieur de ses frontières, en traiter au moins 40%, et ne pas dépendre d'un seul pays pour plus de 65% de son approvisionnement, à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. De plus, 15% de ses besoins doivent être couverts par le recyclage en Europe.
L'autarcie est complétée par une liste d'environ quarante projets stratégiques pouvant bénéficier d'un financement de Bruxelles, ainsi que par des procédures accélérées pour l'obtention des permis nécessaires.

Pays-Bas capitulent dans l'affaire Nexperia
Le gouvernement néerlandais fait marche arrière dans l'affaire Nexperia, ce qui constitue un revers sérieux. Après des semaines de négociations, les Pays-Bas se préparent à abandonner le contrôle de Nexperia, le fabricant de puces à capitaux chinois saisi en vertu d'une loi datant de plusieurs décennies.
Ce pillage s'était produit après une vague de chaos dans la chaîne d'approvisionnement qui avait paralysé l'industrie automobile européenne.
Une manœuvre politique depuis La Haye s'est transformée en l'un des plus grands différends technologiques de l'année, mettant en danger la production de constructeurs automobiles tels que Volkswagen, Honda et Stellantis.
20:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, terres rares, europe, affaires européennes, union européennes, autarcie, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 06 novembre 2025
Un expert économique fait une prévision choc: l'Allemagne risque 25 ans de dépression permanente

Un expert économique fait une prévision choc: l'Allemagne risque 25 ans de dépression permanente
Munich. Ce n'est plus un secret depuis longtemps : depuis des années, les fonds alloués aux entreprises privées en Allemagne sont insuffisants. Les investissements dans le secteur privé sont retombés au niveau de 2015. Dans le même temps, les dépenses publiques ont considérablement augmenté, soit de 25 % depuis 2015.
Le professeur Clemens Fuest (photo), directeur de l'Institut Ifo de Munich, a dressé un tableau alarmant de la situation dans le journal « Bild am Sonntag » et a choqué avec ses prévisions : « L'Allemagne est en déclin économique depuis des années. La situation est désormais dramatique. » Et : « Des millions de citoyens constatent déjà une baisse de leur niveau de vie. » Cet économiste renommé craint une dépression durable de 25 ans, similaire à celle qu'a connue l'Italie.

En effet, la crise actuelle représente déjà la plus longue période de faiblesse économique de l'histoire de la République fédérale. D'autres problèmes s'y ajoutent, tels que les pénuries d'approvisionnement en terres rares en provenance de Chine, qui entraînent déjà des arrêts de production.
Mais ce ne sont pas seulement les décisions politiques prises à Berlin qui pèsent sur l'économie allemande, mais aussi les obstacles réglementaires imposés par Bruxelles. Fuest demande un allègement conséquent des charges bureaucratiques pesant sur les entreprises. Il s'agit notamment des obligations étendues en matière de documentation dans le domaine du CO₂ et tout au long des chaînes d'approvisionnement, qui sont pratiquement impossibles à respecter dans la pratique (st).
Source: Zu erst .de, Nov. 2025.
17:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, affaires européennes, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Code de la main invisible: la dystopie potentielle du capitalisme cybernétique

Code de la main invisible: la dystopie potentielle du capitalisme cybernétique
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/10/30/nakymattoman-kaden-koo...
La numérisation a atteint une nouvelle étape : ses promesses ne sont plus vendues comme des utopies, mais deviennent des conditions obligatoires pour la viabilité sociale. La logique de fonctionnement des technologies intelligentes est déjà si évidente que s’y opposer semble insensé. On vend au peuple le saut numérique comme un outil facilitant le quotidien, mais en même temps, cela crée un cadre pour un avenir technocratique autoritaire.
Le nouvel ordre mondial est contrôlé par une machinerie dépassant l’humanité – un totalitarisme électronique imaginé par les technocrates, où les identités numériques, les monnaies centrales (CBDC) et la surveillance en temps réel fusionnent les individus et les nations en pixels dans un flux de données sans fin. La période de pandémie mondiale de COVID-19, avec ses restrictions, n’était qu’un test pour cette évolution codée QR.
Le paradoxe de l’intelligence artificielle – une révolution mondiale et en même temps une réalité quotidienne, omniprésente – se reflète inévitablement aussi dans le domaine de la géopolitique. Le futur système international ne sera pas tant multipolaire que technopolaire: les tensions entre États seront dominées par des divisions dans l’infrastructure technologique.
Comment cela se manifeste-t-il ? Les États-Unis ont déclaré que l’intelligence artificielle est un impératif de sécurité nationale, la Chine mise sur une stratégie visant la souveraineté technologique, et la Russie souligne l’importance stratégique de l’IA pour renforcer sa politique de sécurité. Cette course à l’armement ne crée pas des idéologies radicalement différentes, mais des itérations répétées du même algorithme, avec des nuances différentes.
L’intelligence artificielle est une illusion téléologique, une pseudo-conception qui aide le projet capitaliste, détaché de la gestion humaine, à maintenir son visage. Le capitalisme n’est pas un outil pour l’homme, mais une machinerie décentralisée qui façonne le monde selon sa propre dynamique. Son objectif est de tout transformer en données vendables et en ressources contrôlables. Même la décision politique est soumise aux algorithmes, et l’identité numérique détermine la valeur de la citoyenneté.

Ce mécanisme est cependant en train d’atteindre une étape où sa propre logique d’optimisation se retourne contre lui. Il ne produit plus de nouveauté, mais consomme l’ancien jusqu’à l’épuisement. Le capitalisme fait face à une crise existentielle profonde : il n’a plus besoin de l’humain dans ses processus de production, mais sa légitimité et ses conditions d’opération dépendent encore de la consommation et du pouvoir d’achat des individus. La fin du modèle économique basé sur la consommation marque la montée en puissance de la fin du paradigme de la richesse occidentale.
Dans cette nouvelle réalité, ce ne sont plus les interactions humaines qui créent le marché, mais une version cybernétique de la main invisible d’Adam Smith ; un processeur d’informations connecte le charbon et le silicium pour accomplir sa tâche. Dans un monde technopolaire, la compétition entre les États-Unis et la Chine n’est pas une lutte entre civilisations, mais des fluctuations internes au capital-machines: en Chine, ce sont des points de confiance nationaux et le yuan numérique couvrant toute l’Asie, tandis qu’aux États-Unis, la FedNow – le système de paiement – et les réseaux de surveillance des géants technologiques.
La tokenisation est le composant central de cette machinerie. La vision de Larry Fink, directeur du plus grand gestionnaire d’actifs au monde, du « tout digitalisé » transforme les ressources, l’identité et même les voix en jetons programmables dans la blockchain – en fragments de droits d’utilisation conditionnels, contrôlés en temps réel par des banques centrales et des fonds d’investissement comme BlackRock, via une manipulation algorithmique.
Lorsque le système est de moins en moins capable de produire une croissance réelle, il tente de compenser ce déficit par une propagande intense exploitant les crises de sécurité et les stratégies d’urgence. Les vagues de licenciements et la pauvreté sociale sont dissimulées derrière une vaste campagne idéologique qui encadre la fusion entre automatisation et financement comme une avancée posthumaniste – un progrès supérieur au développement humain.

Ce récit est une promesse que l’intelligence artificielle représente une finalité logique du processus, visant l’automatisation du travail et de la prise de décision humaine. C’est la transcendance religieuse du capitalisme – une illusion qui résout le conflit de la production en promettant une utopie numérique, où la monnaie numérique contrôlée par les banques centrales guide la consommation, et où les applications d’identité numérique empêchent toute “activité non conforme”.
L’effort mondial pour l’intelligence artificielle, avec ses réseaux de capteurs, transforme la population de la planète en une entité parfaitement surveillée. Le système de confiance de la Chine, la machine de surveillance des États-Unis et l’administration digitalisée de la Russie en sont des incarnations. Ce réseau s’étend notamment avec la norme eIDAS 2.0 de l’UE et le programme de la quatrième révolution industrielle activement promue par le Forum économique mondial.
C’est la fantaisie des cercles financiers d’un contrôle total. La production de contenu infinie et le traitement automatique de l’information produisent constamment “pas tout à fait ce que l’on voulait”. Le produit intérieur brut peut augmenter, mais le niveau de satisfaction reste faible: la “ville intelligente” est une prison numérique où les monnaies numériques à date de péremption manipulent le comportement des résidents.
Il est révélateur que les défenseurs de la démocratie parlementaire en Occident ne soutiennent pas la véritable démocratie directe, même si la technologie la rend déjà possible. Au lieu de cela, ils rejettent toutes les formes de démocratie authentique en la qualifiant de populisme dangereux, et ses représentants deviennent, d’une manière ou d’une autre, partie intégrante du système, même sous contrôle de l’opposition.
Cela révèle une caractéristique essentielle du cybercapitalisme : le pouvoir technocratique maintient l’illusion de la participation tout en s’isolant de toute influence réelle sur l’action politique. La participation citoyenne se limite à des canaux modérés où l’expression des opinions est autorisée dans des cadres stricts – sans véritable liberté d’expression ni pouvoir de décision.
Cette crise de légitimité peut conduire à une instabilité sociale, mais aussi à des solutions autoritaires. Les gouvernants peuvent “maintenir l’ordre” par une censure croissante et une répression sévère de la résistance. Dans un scénario dystopique, la surveillance numérique et la technologie de l’intelligence artificielle deviennent de nouveaux instruments de domination, où les droits des citoyens sont sacrifiés sur l’autel de la stabilité systémique.
Le problème n’est donc pas la menace d’une super-intelligence fictive, mais la machinerie cybernétique elle-même: l’alliance entre économie et technologie, qui promettait des voitures volantes et l’abondance, n’a produit avec sa politique de déchéance qu’un vide, hâtivement dissimulé derrière des bavardages. Du point de vue des citoyens, la lutte des grandes puissances est déjà perdue : il ne reste qu’une réalité cybercapitaliste omniprésente, où les algorithmes servent une surveillance technocratique éternelle, et où les différences culturelles disparaissent face à la convergence technologique.
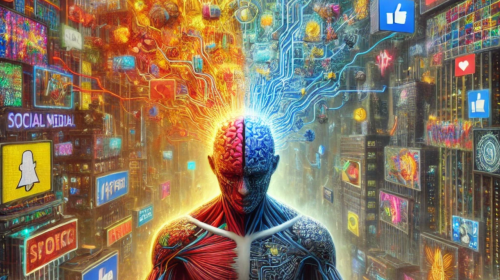
Pourtant, des résistances peuvent émerger des fissures et marges du système dominant. Les communautés coopératives et les réseaux locaux d’échanges tentent de nouvelles formes de solidarité, mais leur succès n’est pas garanti – elles doivent lutter contre la pénurie de ressources et la pression réglementaire, tandis que les gouvernements refusent de laisser les systèmes parallèles menacer leur monopole. Par ailleurs, la majorité des citoyens s’adapte inévitablement à l’écosystème numérique des villes intelligentes.
Ce processus n’est pas laissé au hasard, mais contrôlé par une politique systématique. La recherche d’efficacité et d’économies par les autorités mène en pratique à l’objectif de réduire la population, facilitant ainsi l’ajustement des survivants à un état plus gérable. Ce plan repose sur l’intelligence artificielle et la robotique, permettant une production sans main-d’œuvre humaine à grande échelle.
Finalement, la machinerie du cybercapitalisme ne doit plus forcer la main: les gens l’adoptent comme un mode de vie normal. Les portefeuilles d’identités numériques et la surveillance algorithmique ne sont pas des contraintes extérieures, mais des cadres créés par le code de la main invisible, auxquels la société se soumet silencieusement. Le plus grand danger n’est pas la destruction de l’humanité sous le pouvoir de la machine, mais cette apathie profonde qui croit que le monde ne pourrait être autre chose que la création de ce déterminisme digitalisé.
17:10 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, capitalisme cybernétique, intelligence artificielle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 01 novembre 2025
L’économie est cyclique et le capitalisme intrinsèquement instable : l’échec de l’école de Chicago et l’effondrement des États-Unis
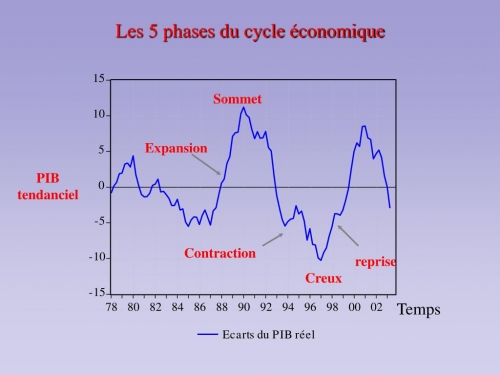
L’économie est cyclique et le capitalisme intrinsèquement instable : l’échec de l’école de Chicago et l’effondrement des États-Unis
de Fabrizio Pezzani
Source: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/keynes-aveva-ragi...
Face au chaos mondial, il ne faut pas oublier les visions prophétiques mais réalistes de John Maynard Keynes, que les chercheurs ayant continué à défendre sa conception de la cyclicité naturelle de l’économie ont renforcées par des analyses empiriques des faits. Si nous voulons soutenir une vision anthropologique de la crise, nous ne pouvons pas dissocier la connaissance des outils dont nous disposons de celle des sujets qui utilisent ces outils pour satisfaire leurs besoins.
Lorsque Keynes affirme que le capitalisme est naturellement instable, il relie également cette observation à la dynamique de la nature humaine, qui fait du capitalisme un instrument destiné à réaliser les désirs. En ce sens, on ne peut dire que le capitalisme existe indépendamment de la structure psychique des hommes qui le créent et le gouvernent ; en d’autres termes, il n’existe pas un capitalisme en tant qu’entité abstraite, mais il existe des hommes capitalistes qui façonnent ce modèle de relations économiques au sein d’un système social. Sa dynamique est dans un équilibre instable parce qu’il n’existe pas de systèmes, même sophistiqués, permettant de définir la notion de juste profit.
Si l’on pouvait, en se limitant à la détermination du résultat d’exploitation, définir « rationnellement » et avec certitude quelle part revient au capital investi et quelle part revient aux travailleurs, la plupart des luttes sociales s’en verraient peut-être allégées. Dans la tradition juive, l’institution de l’année sabbatique et dans la tradition chrétienne, l’institution de la période jubilaire avaient pour but d’annuler les positions de dette et de crédit entre les différents membres de la société ; ainsi, on posait une limite temporelle à l’accumulation. Tout cela n’est plus possible aujourd’hui.
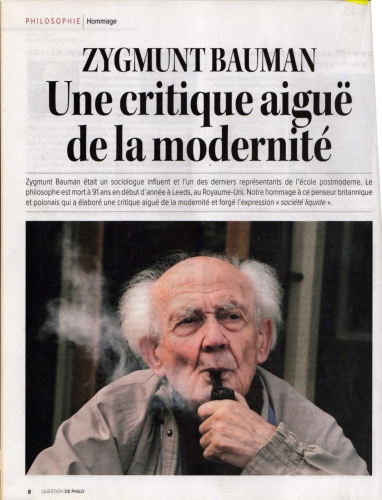
Pour reprendre la définition de « société liquide » que Bauman utilise pour décrire un système social en constante mutation et difficile à stabiliser, on peut étendre ce même concept, aujourd’hui, à l’économie qui, dans le cadre d’une société liquide, ne peut qu’être elle-même liquide. Il est donc naturel que l’économie, et encore plus la finance, deviennent un système perpétuellement instable, car il n’est pas possible de définir la « mesure » dans la répartition du bonheur ou de la richesse, si celle-ci est fonction de la réalisation du bonheur.
Contrairement aux systèmes mécaniques ou naturels pour lesquels la mesurabilité permet de déterminer les lois physiques qui les régissent, en mettant en évidence le risque de points ou de moments de rupture – la chute d’un grave, la portée d’une grue, la combinaison d’agents chimiques, la mesure des paramètres biologiques d’un organisme – dans la société, le système relationnel de personnes différentes, dont la composante émotionnelle et psychique n’est pas mesurable, rend impossible la détermination du point de non-retour d’un processus déséquilibrant la société elle-même.
Il n’est pas possible de dire quel est le pourcentage de personnes sous le seuil de pauvreté qui représente le dernier stade avant l’effondrement, ni de faire de même pour la concentration de richesse, le chômage ou d’autres pathologies sociales. Simplement, la société humaine ne possède pas d’éléments certains et mesurables de son point de rupture, et toutes les révolutions et guerres de l’histoire démontrent l’incapacité à prévoir le krach.
Si Louis XVI avait compris le niveau de misère de la population française, il aurait envoyé des chariots de pain et non des soldats. Il en a été de même pour la Russie des Romanov et les États-Unis contre la couronne anglaise. L’histoire confirme la vision de Keynes et annonce l’échec d’un libéralisme qui, sans règles morales, devient dévastateur car il finit par favoriser la partie la plus barbare de l’homme.
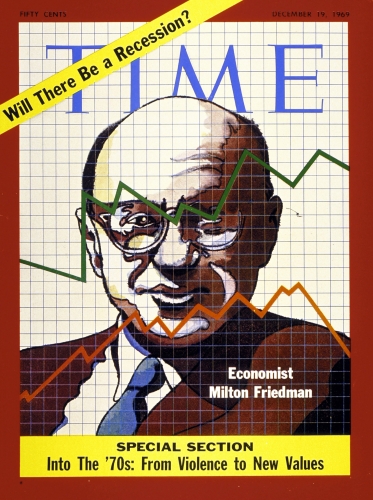
L’école de Chicago, représentée par Milton Friedman – qui a reçu le prix Nobel en 1976, deux ans après celui de Hayek de l’École de Vienne, qui campait sur une position contraire – a fini par s’opposer à la fausseté de ses hypothèses, dans lesquelles la réalité doit s’adapter au modèle, et le cas du Chili de Pinochet est l’expression la plus évidente de la grossière erreur de ne pas considérer l’histoire et la nature humaine dans la vie sociale.
Penser qu’on peut appliquer la même recette à des réalités profondément différentes, comme c’était le cas du Chili, avec ses disparités de richesse et son retard culturel, aurait été impossible dans une réalité comme celle d’Amérique du Nord. L’ignorance n’est jamais le problème que doit affronter l’évolution de la science, mais plutôt l’arrogance de ceux qui se considèrent investis de la vérité indiscutable ; malheureusement, c’est toujours la population pauvre qui en paie le prix.
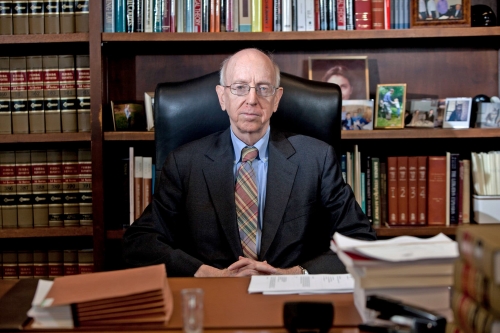
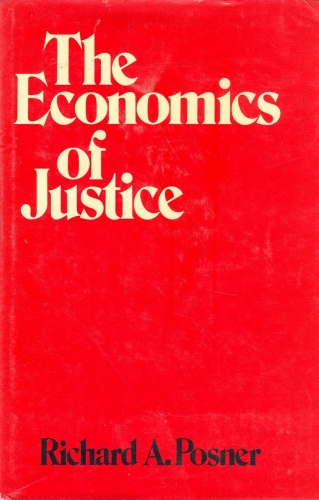

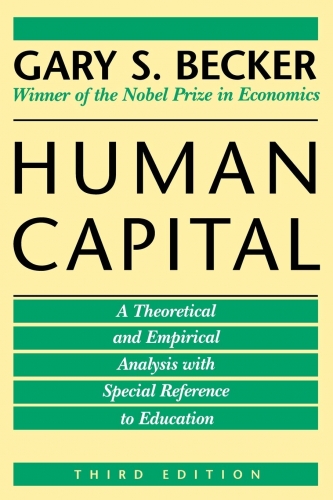
Les travaux de Posner, mais aussi ceux de Gary Becker, montrent à quel point, même dans le monde culturel américain, on comprend le lent effondrement d’un modèle incapable de répondre aux problèmes qu’il a créés et qui, ne voulant pas ou ne pouvant pas se remettre en question, ne fait qu’aggraver et empirer ces problèmes. Leur référence à la pensée de Keynes devient de plus en plus forte et entendue.
Les États-Unis, qui ont indissolublement adopté cette culture en la transformant en vérité absolue, sont la représentation extrême de la vérité trahie : un pays qui a oublié ses principes constitutifs, représentés par les formules E pluribus unum et In God we trust, et qui fait face à un effondrement socio-culturel sans précédent dans son histoire. Avoir confié l’avenir à la finance a été un suicide, car en fin de compte, cette fausse vérité des marchés rationnels a fini par dépouiller la société de l’intérieur, et aujourd’hui, c’est un géant aux pieds d’argile. Aujourd’hui, les États-Unis, comme on peut le voir, sont un pays qui, sur le plan social, est avant toute chose, techniquement en faillite.
08:48 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, économie cyclique, états-unis, monétarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 20 octobre 2025
Qui commande (réellement) en Europe?

Qui commande (réellement) en Europe?
par Alessandro Volpi
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31472-ales...
Qui commande en Europe ? En Allemagne, BlackRock détient des participations, directement ou par l’intermédiaire de fonds qu’il possède, comprises entre 3% et 10% dans Commerzbank, Deutsche Bank, Continental, Adidas, Bayer, Lufthansa, Sofran, Daimler, AG, Basf, Allianz, Siemens, Thyssen Krupp, Münchener Re, Rheinmetall, Hensholdt. À cet ensemble de participations s’ajoute une longue liste d’actions détenues, en dessous du seuil de 3%, dans de très nombreuses autres sociétés allemandes, notamment dans le secteur du crédit et des assurances.
En France, la société dirigée par Larry Fink détient des parts comprises entre 3% et 9% dans Sanofi, TotalEnergies, LVMH, Schneider Electric, Société Générale, Orpea.
Là aussi, comme en Allemagne et en Italie, BlackRock possède des participations inférieures à 3% dans de très nombreuses sociétés françaises, avec une incidence notable dans le secteur bancaire. En Angleterre, la société américaine gère une série de fonds UCITS domiciliés sur l’île, qui détiennent d’importantes participations dans des sociétés britanniques, tout en enregistrant une présence directe dans Shell, NetWest Group et Preqin.

Les participations de BlackRock en Espagne sont concentrées dans le système bancaire, dans BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander, CaixaBank, où la part détenue oscille entre 6% et 8%, ainsi que dans une série d’autres secteurs où la part possédée dépasse 5%, notamment Iberdrola, Repsol, Enagas, Redeia, Telefonica, Grifols, Fluidra, Merlin et AM-Deus.

Une importance particulière, la société américaine y a un poids notable dans Naturgy, dont elle contrôle 10%.
À ces données générales s’ajoutent trois autres considérations:
La première est que BlackRock est l’actionnaire principal des sociétés qui gèrent la Bourse de Londres, celle de Francfort et celle de Milan.
La deuxième, déjà évoquée pour l’Italie, concerne la présence massive dans presque tous les États européens d’un vaste circuit de vente des ETF produits par BlackRock, visant à capter l’épargne diffusée. À ce sujet, il faut souligner que le secteur des ETF connaît une croissance rapide, avec un marché européen total de plus de 2800 milliards de dollars, destiné, précisément, à « capter » une large part de l’épargne gérée, avec plus de 11 millions de plans d’épargne, uniquement en ETF.
La troisième considération est de souligner que BlackRock n’est qu’un des trois grands fonds américains qui dominent la scène européenne, car des considérations similaires seraient possibles pour Vanguard et State Street, dont l’action, par rapport à la société présidée par Fink, repose surtout sur la production d’ETF et de fonds contenant d’importants paquets d’actions de sociétés italiennes.
14:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, économie, blackrock |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 septembre 2025
Les 10 principales raisons pour lesquelles Trump ne peut pas redonner sa grandeur à l'industrie manufacturière américaine

Les 10 principales raisons pour lesquelles Trump ne peut pas redonner sa grandeur à l'industrie manufacturière américaine
La réalité l'emporte sur les fantasmes
S. L. Kanthan
Source: https://slkanthan.substack.com/p/top-10-reasons-why-trump...
J'ai écrit de longs articles sur ce sujet, mais voici un bref résumé des points saillants qui peuvent freiner ou annuler la croisade de Trump pour relocaliser l'industrie manufacturière:
10. Wall Street et les élites des entreprises américaines n'aiment pas l'industrie manufacturière.
9. Les États-Unis manquent de travailleurs qualifiés dans le secteur manufacturier.
8. Les jeunes Américains ne souhaitent pas travailler dans les usines.
7. Les lois environnementales sont trop strictes.
6. Les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation sont élevés.
5. Les États-Unis manquent d'infrastructures de qualité : chemins de fer, ports maritimes et même électricité.
4. Les investisseurs savent que les démocrates arriveront bientôt au pouvoir et renverseront les règles du jeu. Il n'y a pas de stabilité à long terme.
3. Le commerce et le capitalisme ne fonctionnent pas en intimidant tout le monde. Si les États-Unis sont idéaux pour l'industrie manufacturière, celle-ci prospérera automatiquement.
2. La Chine et l'Asie maîtrisent l'industrie manufacturière et la chaîne d'approvisionnement.
1. On ne peut pas inverser 45 ans de désindustrialisation.
S.L. Kanthan
16:30 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, désindustrialisation, ré-industrialisation, états-unis, économie, industrie manufacturière |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 septembre 2025
L’industrie en déclin: le nouveau PDG de KTM secoue les politiciens

Crise économique
L’industrie en déclin: le nouveau PDG de KTM secoue les politiciens
Source: https://unzensuriert.de/309014-industrie-im-niedergang-ne...
Rajiv Bajaj, le nouveau principal actionnaire de KTM originaire d’Inde, a déclaré que la production industrielle en Europe est “en fin de vie”. Dans une interview avec CNBC TV18, il a également évoqué la possibilité de transférer la production de KTM. Les motos fabriquées en Inde contribuent déjà de manière significative aux bénéfices de l’entreprise.
Capacité sous l’épée de Damoclès
Le PDG de KTM, Gottfried Neumeister, a répondu que les usines de Mattighofen et Munderfing sont pleinement occupées, avec plus de 10.000 motos produites en août. Cependant, il admet que la restauration de chaînes d’approvisionnement stables reste un défi majeur.

Les insiders de l’industrie pensent aussi qu’il est possible que les futures gammes de modèles soient effectivement conçues en Asie – sans que cela implique nécessairement une perte d’emplois en Autriche.
Moins 7% dans la production industrielle
Le cas de KTM est symptomatique de toute l’Europe. La Chine, notamment, a considérablement renforcé sa base industrielle au cours des années et domine désormais des secteurs clés comme la technologie des batteries et le photovoltaïque. Alors que la production industrielle en République populaire a augmenté de plus d’un tiers depuis 2019, les grandes économies de l’UE restent encore nettement en-dessous de leur niveau d’avant la crise du Covid.
L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne enregistrent ensemble une baisse de plus de 7 %.
Frais énergétiques élevés et bureaucratie excessive
Pour les fournisseurs, notamment en Autriche, cela signifie une demande en baisse et une incertitude croissante dans la planification. Les coûts énergétiques élevés, la bureaucratie débridée et la dépendance à la politique – notamment en ce qui concerne les subventions – mettent les entreprises en difficulté.
Conflits commerciaux pesants avec les États-Unis
Les tensions sont aggravées par la politique commerciale transatlantique. La Commission européenne a proposé de supprimer totalement les droits de douane sur les biens industriels américains – dans l’espoir que Washington réduise ses taxes de 15 %. Mais le président américain Donald Trump maintient des tarifs élevés et a récemment renforcé ceux qui pèsent déjà sur certains produits européens.

Signaux économiques contradictoires
Les données actuelles de l’office statistique Eurostat dressent un tableau sombre : alors que le PIB de l’UE a augmenté légèrement de 0,1 % au deuxième trimestre, la production industrielle affiche une tendance à la baisse. En juin, elle avait diminué de 1 % par rapport au mois précédent, et on espère encore une petite hausse de 0,5 % sur l’année. Dans la zone euro, les chiffres sont encore plus faibles.
À la croisée des chemins
L’industrie européenne se trouve à un tournant : d’un côté, les entreprises doivent faire face à des désavantages liés aux sites, à la pression des coûts mondiaux et aux charges politiques ; de l’autre, il existe encore un potentiel pour assurer la base industrielle grâce à des investissements ciblés, à la promotion technologique et à une politique commerciale indépendante.
La question de savoir si l’Europe pourra rester à flot dépend aussi d’un changement de cap urgent dans la politique actuelle. L’Argentine sous le président Javier Milei montre qu’il est possible de changer de direction rapidement et de ramener la prospérité.
15:46 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : industrie, crise économique, europe, affaires européennes, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 25 août 2025
La stratégie globale derrière les droits de douane américains selon Stephen Miran

La stratégie globale derrière les droits de douane américains selon Stephen Miran
Par Domenico Moro
Source: https://comedonchisciotte.org/la-strategia-globale-dietro...
Les droits de douane marquent le deuxième mandat de Donald Trump. Cependant, le président américain affiche une attitude hésitante en matière de droits de douane, menaçant de les augmenter ou de les suspendre, puis à nouveau de les augmenter ou de les diminuer.
Si nous voulons comprendre les causes profondes des droits de douane et du comportement hésitant de Trump, nous devons nous détacher du contingent et essayer de comprendre quelle est la stratégie globale.
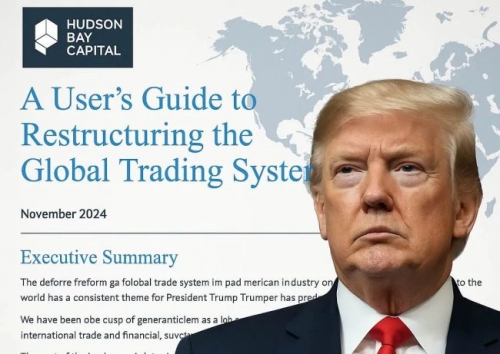
À cet égard, nous devons nous référer à Stephen Miran, qui est le stratège de la politique douanière et qui est actuellement président du Council of Economic Advisor, un organisme interne au Bureau exécutif du président des États-Unis, dont la tâche est de conseiller le président sur les questions économiques. Au cours du premier mandat de Trump, Miran a été conseiller principal au ministère du Trésor, puis stratège principal chez Hudson Bay Capital Management, un grand investisseur institutionnel au sein du Trump Media & Technology Group, qui gère également la plateforme Truth Social.
Nous devons notamment nous référer à un texte de Miran qui constitue le manifeste de la politique douanière, A User's Guide to Restructuring the Global Trading System (Guide de l'utilisateur pour la restructuration du système commercial mondial), publié par Hudson Bay en novembre 2024, parallèlement à la victoire de Trump.
Introduction
Commençons donc par voir ce que dit ce texte. Miran commence par attribuer à la surévaluation du dollar la raison du déficit commercial extérieur et du déclin de l'industrie manufacturière américaine. Miran se propose d'identifier les outils permettant de remédier à ces problèmes. L'outil unilatéral le plus important est celui des droits de douane qui, contrairement à l'opinion courante, n'augmentent pas nécessairement l'inflation. En effet, lorsque les droits de douane ont été augmentés en 2018-2019, pendant le premier mandat de Trump, il n'y a pas eu d'augmentation notable de l'inflation, notamment parce que les droits de douane ont été compensés par le renforcement du dollar.
Un autre instrument consiste à abandonner la politique du dollar fort. La surévaluation du dollar a, d'une part, créé des déficits commerciaux de plus en plus importants et, d'autre part, pénalisé l'industrie manufacturière américaine au profit du secteur financier. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille abandonner le rôle du dollar comme monnaie de réserve, mais qu'il faut trouver des moyens de conserver aux États-Unis une partie des avantages que les autres pays tirent de la fourniture de réserves. Au partage des coûts liés à la fourniture des actifs de réserve s'ajoute celui des coûts du parapluie de sécurité que les États-Unis fournissent à leurs alliés.
Les bases théoriques
Miran établit un lien entre le déclin de l'industrie manufacturière américaine, dû à la surévaluation du dollar, et la dégradation des communautés où existaient auparavant des centres industriels. À la suite de la désindustrialisation, de nombreuses personnes deviennent dépendantes de l'aide sociale et de la drogue ou sont contraintes de se déplacer vers des régions plus prospères. Au départ, on estimait à 2 millions le nombre d'emplois perdus, mais de nombreux emplois qui, bien que n'étant pas liés à l'industrie manufacturière, dépendaient de celle-ci ont également été supprimés. La perte de l'industrie manufacturière a également un impact sur la sécurité des États-Unis, souligne Miran, car ce secteur est nécessaire pour contrer l'essor non seulement économique mais aussi militaire de la Chine et de la Russie : « Si vous n'avez pas de chaînes de production pour fabriquer des armes et des systèmes de défense, vous n'avez pas non plus de sécurité nationale. Comme l'a déclaré le président Trump : « Si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas de pays » (1).
Mais, se demande Miran, pourquoi le dollar ne se déprécie-t-il pas en présence de déficits commerciaux importants, permettant ainsi de rééquilibrer la balance commerciale ? Normalement, les devises devraient s'adapter à long terme à la balance commerciale: si un pays enregistre un déficit commercial prolongé, sa devise se déprécie, ce qui entraîne une augmentation des exportations et une diminution des importations, afin de rééquilibrer la balance commerciale. Un autre aspect important est la notion d'équilibre financier. Selon cette conception, les devises s'ajustent jusqu'à inciter les investisseurs à détenir des actifs libellés dans différentes devises.
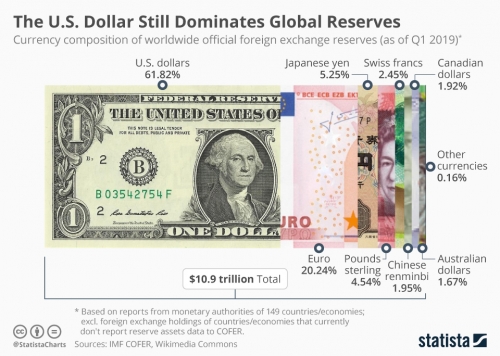
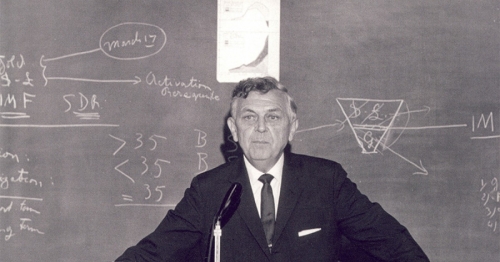
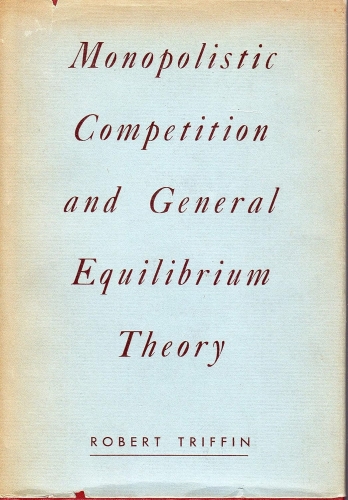
Ces mécanismes ne fonctionnent toutefois pas si la monnaie nationale est une monnaie de réserve, comme c'est le cas du dollar. Étant donné que les États-Unis fournissent des actifs de réserve au monde entier, la demande de dollars et de titres d'État américains (UST) ne dépend ni de la balance commerciale ni de l'optimisation des gains financiers. Ces actifs sont détenus à l'échelle mondiale davantage pour des raisons politiques que pour optimiser les gains. Comme l'a déclaré l'économiste belge Robert Triffin (photo), les actifs de réserve sont une fonction du commerce et de l'épargne mondiale, et non de la balance commerciale ou des rendements des titres du pays qui détient la monnaie mondiale.
Les États-Unis supportent donc ce déficit non pas parce qu'ils importent trop, mais parce qu'ils doivent exporter des UST afin de fournir des actifs de réserve et de faciliter la croissance mondiale. Plus le PIB américain diminue par rapport au PIB mondial, plus le déficit est difficile à soutenir. Toujours selon Triffin, il arrive un moment où le déséquilibre économique devient si important qu'il menace le statut de monnaie de réserve internationale. Cependant, malgré la réduction de leur part dans le PIB mondial de 40 % dans les années 1960 à 26 % aujourd'hui, les États-Unis sont encore loin de ce danger, car il n'existe aucune alternative au dollar, ni le yuan renminbi chinois, qui ne répond pas aux critères requis d'une monnaie internationale, tels que la convertibilité totale, ni l'euro, étant donné que l'économie de la zone euro s'est davantage contractée que celle des États-Unis au cours des dernières décennies.
Face au relatif recul de l'économie américaine, la structure actuelle des droits de douane américains – 3 % en moyenne, contre 5 % pour l'UE et 10 % pour la Chine – semble adaptée aux caractéristiques d'une époque très différente de la nôtre, où les États-Unis devaient assumer la charge de relancer l'économie européenne et japonaise après la guerre et de créer des alliances contre l'URSS.
Miran identifie alors les conséquences d'être une nation détentrice d'actifs de réserve.
La possibilité d'emprunter à bon marché. En réalité, les États-Unis n'empruntent pas nécessairement moins cher que les autres pays, mais ils peuvent emprunter davantage sans que les taux d'intérêt augmentent.
Une monnaie plus forte. La demande de réserves fait monter le dollar bien plus haut qu'il ne le devrait selon la balance commerciale, ce qui le surévalue. Cela se produit surtout en période de crise, car les investissements en dollars sont les plus « sûrs ». C'est pourquoi l'emploi dans le secteur manufacturier baisse considérablement aux États-Unis pendant une récession, sans qu'il soit possible de le récupérer pendant la phase de reprise.
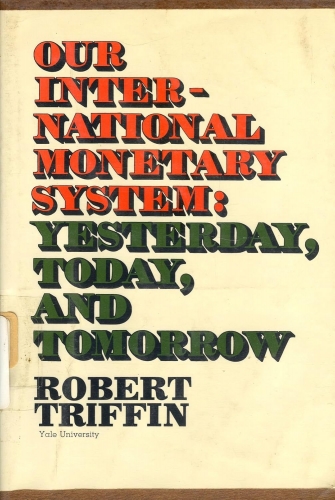
Extraterritorialité financière. Le fait de disposer d'une monnaie de réserve permet aux États-Unis d'exercer leur volonté en matière de politique étrangère et de sécurité en utilisant leur puissance financière plutôt que leur puissance physique. En effet, les sanctions que les États-Unis imposent dans le monde entier grâce à leur statut de détenteur de la monnaie de réserve constituent une forme moderne de blocus naval.
Ainsi, le statut de monnaie de réserve n'offre qu'un faible avantage en termes de coût des emprunts et un inconvénient majeur, à savoir la surévaluation du dollar qui érode la compétitivité des produits américains, compensé en partie toutefois par l'avantage géopolitique que représente la possibilité d'imposer des sanctions. Mais en échange de leur statut de monnaie mondiale, les États-Unis fournissent aux démocraties libérales, outre un vaste marché pour leurs exportations manufacturières, un autre service, celui d'un parapluie défensif. Les déficits commerciaux et la défense sont donc liés par la monnaie. Cette situation devient plus lourde pour les États-Unis, car à mesure que leur poids relatif dans l'économie mondiale diminue, le déficit courant augmente et la capacité de produire des équipements militaires diminue. Pour toutes ces raisons, selon Miran, il existe aux États-Unis un consensus croissant en faveur d'un changement des relations qui les lient au reste du monde.
Si les États-Unis veulent changer le statu quo, ils doivent trouver des solutions. En général, les solutions unilatérales sont plus susceptibles d'avoir des effets indésirables, tels que la volatilité des marchés. Les solutions multilatérales sont, en revanche, très difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre, même si elles contribuent à réduire la volatilité en impliquant les pays étrangers dans les décisions. Le dollar est une monnaie de réserve non seulement parce qu'il offre stabilité, liquidité, ampleur du marché et primauté du droit, mais aussi parce que les États-Unis peuvent projeter leur puissance physique dans le monde entier, façonnant et défendant l'ordre mondial. Le lien entre le statut de monnaie de réserve et la sécurité nationale est une histoire de longue date.
Selon Miran, les droits de douane et les politiques monétaires permettent d'améliorer la compétitivité de l'industrie manufacturière en réaffectant la production et les emplois aux États-Unis. Les droits de douane ne visent pas à réinternaliser les secteurs dans lesquels d'autres pays – par exemple le Bangladesh dans le textile – ont un avantage comparatif, mais à préserver l'avantage concurrentiel des États-Unis dans les productions à forte valeur ajoutée. En outre, étant donné que les politiques commerciales et de sécurité sont étroitement liées, les droits de douane auront tendance à défendre les installations industrielles nécessaires à la sécurité nationale, dont la portée doit être comprise au sens large, incluant par exemple des produits tels que les semi-conducteurs et les médicaments.
L'objectif n'est pas d'éliminer le statut de monnaie de réserve du dollar, que Trump a menacé de droits de douane élevés pour les pays qui l'abandonneraient, mais de partager avec ses alliés le poids de la fourniture d'actifs de réserve et du parapluie de défense.

Les droits de douane
Miran pose d'abord la question de la mesure dans laquelle les droits de douane sont compensés par l'appréciation de la monnaie. Si le taux de change et les droits de douane se compensent presque entièrement, les droits de douane n'entraînent aucune augmentation de l'inflation, mais il n'y a pas de rééquilibrage commercial. À l'inverse, si le taux de change ne compense pas les droits de douane, les importations du pays soumis aux droits deviennent plus chères et, par conséquent, il y aura un certain rééquilibrage des flux commerciaux, mais aussi des prix plus élevés. Le choix se pose donc entre une faible inflation et un rééquilibrage commercial. Le seul aspect qui ne change pas dans les deux cas est que les droits de douane génèrent d'importantes recettes fiscales.
L'histoire récente, comme celle des droits de douane imposés à la Chine par la première administration Trump, montre, selon Miran, qu'il n'y a pas d'augmentation notable de l'inflation, puisque le yuan renminbi s'est alors déprécié de 13,7 % par rapport au dollar, compensant ainsi une grande partie de l'augmentation des droits de douane à 17,9 %. Si la compensation monétaire n'est pas mise en œuvre, les prix augmenteront à la suite des droits de douane et les consommateurs en supporteront le poids. Toutefois, avec le temps, les prix élevés inciteront à une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, les producteurs américains amélioreront leur compétitivité en vendant davantage sur le marché intérieur et les importateurs seront incités à trouver des alternatives aux produits importés soumis à des droits de douane.
La situation du marché financier est différente de celle du marché des marchandises. Si la compensation monétaire réduit la volatilité des prix à la consommation, elle peut entraîner une plus grande volatilité sur les marchés financiers, du moins à court terme. Toutefois, Miran souligne : « Ce qui importe, c'est de savoir si les droits de douane ont un effet durable, car, comme tout investisseur le sait, les réactions initiales du marché s'annulent souvent et s'inversent avec le temps» (2).
La variable financière la plus puissante pour expliquer les variations monétaires sur les marchés financiers est l'écart entre les taux d'intérêt. Pendant la période de guerre commerciale, l'avantage des rendements des obligations d'État américaines a diminué, passant d'environ 2 % en janvier 2018 à environ 1,5 % au moment de l'armistice dans la guerre commerciale en septembre 2019, malgré la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine en 2018. La baisse des rendements peut rendre plus difficile l'appréciation du dollar et, par conséquent, ne pas compenser la hausse des droits de douane. Toutefois, Miran estime que la compensation monétaire se produira lors de la prochaine série de droits de douane.
Miran se concentre désormais sur les modalités de mise en œuvre des droits de douane. Une augmentation forte et soudaine des droits de douane peut accroître la volatilité des marchés. Mais dès le premier mandat de Trump, l'introduction des droits de douane s'est faite progressivement : « Les droits de douane étant un outil de négociation, le président s'est montré versatile dans leur mise en œuvre – l'incertitude quant à leur application, leur date et leur ampleur renforce le pouvoir de négociation en créant la peur et le doute» (3). Une telle approche progressive aidera les entreprises à redéfinir leurs chaînes d'approvisionnement, facilitant ainsi le transfert de la production hors de Chine.
Un autre aspect important de la mise en œuvre des droits de douane au cours du second mandat de Trump serait la segmentation des différents pays en plusieurs groupes soumis à des droits de douane différents en fonction de leurs relations avec les États-Unis, notamment en matière de défense. En effet, « les pays qui veulent rester sous le parapluie de sécurité doivent également rester sous le parapluie du commerce équitable. Un tel instrument peut être utilisé pour faire pression sur d'autres nations afin qu'elles se joignent à nos droits de douane contre la Chine, créant ainsi une approche multilatérale des droits de douane » (4). De cette manière, en créant un mur douanier mondial autour de la Chine, la pression sur cette dernière pour qu'elle réforme son système économique s'accentuera.
Il y a également la question du rapport entre les droits de douane et la fiscalité. Selon Miran, la réduction des impôts, par exemple sur le travail, est un moyen de générer des investissements et des emplois aux États-Unis, surtout si elle est financée par des droits de douane sur les importations étrangères. Les conséquences économiques d'une augmentation des droits de douane pourraient être moins problématiques qu'une augmentation des impôts sur le revenu et le capital. Le fait que les droits de douane augmentent d'abord le bien-être avant de le diminuer implique l'existence d'un taux de droits de douane « optimal », au niveau duquel un pays a obtenu tous les avantages possibles et où un droit plus élevé réduit le bien-être. Selon Miran, le droit optimal pour les États-Unis est de 20 %. Une autre question est celle des éventuelles représailles des pays auxquels les États-Unis imposent des droits de douane, qui peuvent conduire à une escalade bien au-delà des droits optimaux. Cependant, les États-Unis, qui sont de loin la plus grande source de demande mondiale et disposent d'un marché des capitaux solide, peuvent résister à une escalade plus que la Chine.


Un autre moyen de dissuader les représailles douanières est la menace de rendre moins contraignantes les obligations de défense mutuelle, en ne garantissant plus le parapluie nucléaire américain. Par exemple, si l'Europe impose des contre-droits de douane sur les importations en provenance des États-Unis, mais augmente en même temps ses dépenses militaires, cela permet aux États-Unis d'alléger le fardeau de la sécurité mondiale et « de se concentrer davantage sur la Chine, qui est de loin la plus grande menace pour l'économie et la sécurité nationale américaine que ne l'est la Russie, tout en générant des recettes » (5).
Quoi qu'il en soit, les droits de douane sont un moyen d'augmenter les impôts des étrangers afin de maintenir ceux des Américains à un niveau bas et d'éviter que la prolongation de la réduction des impôts sur le revenu ne se traduise par une nouvelle dette publique.
Les devises
Outre les droits de douane, la surévaluation du dollar peut être contrée par une réévaluation des devises des partenaires commerciaux. Les politiques monétaires posent toutefois le problème de rendre les actifs en dollars moins attractifs aux yeux des investisseurs étrangers. Une dévaluation du dollar pourrait provoquer une fuite massive des capitaux hors du marché des obligations d'État américaines, ce qui entraînerait une hausse des rendements à long terme. Cela aurait des répercussions négatives sur plusieurs secteurs de l'économie, à commencer par la construction.
Ce risque augmenterait si l'inflation restait élevée et si la banque centrale américaine (Fed) décidait de relever ses taux d'intérêt. C'est pourquoi il sera important pour l'administration Trump de coordonner sa politique monétaire avec une politique réglementaire et énergétique déflationniste. En outre, une part importante des ventes des entreprises du S&P 500 est réalisée à l'étranger, et ces ventes ont plus de valeur lorsque le dollar se déprécie.
Historiquement, les accords monétaires multilatéraux ont été le principal moyen de guider les changements intentionnels du taux de change du dollar. L'un d'entre eux était l'accord du Plaza en 1985, lorsque les États-Unis, en accord avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et le Japon, ont coordonné l'affaiblissement du dollar. Aujourd'hui, les devises les plus importantes, outre le dollar, sont l'euro et le yuan chinois, mais il y a peu de raisons de s'attendre à ce que l'Europe et la Chine acceptent de renforcer leurs devises. Selon Miran, il est possible que l'Europe et la Chine deviennent plus malléables après une série de droits de douane punitifs et acceptent une forme d'accord monétaire en échange d'une réduction des droits de douane. Miran propose d'appeler un tel accord « accord Mar-a-Lago », du nom de la résidence de Trump en Floride.

Les différences entre aujourd'hui et 1985 sont toutefois nombreuses. À commencer par l'ampleur de la dette publique américaine, qui était alors de 40 % du PIB et atteint aujourd'hui 120 %, ce qui pose des problèmes plus importants de gestion de la hausse des rendements des obligations d'État. La solution serait de justifier la réduction des taux par la nécessité de financer la fourniture par les États-Unis d'un parapluie de sécurité. De cette manière, les pays partenaires seront incités à échanger leurs UST à court terme contre des UST à cent ans. La durée plus longue contribuera à réduire les rendements et la volatilité du marché financier. Ainsi, un seul accord permet d'atteindre plusieurs objectifs : réduire la valeur du dollar, et donc le déficit commercial, et partager avec les étrangers le coût de la zone de sécurité.
Tout cela fonctionne si les pays partenaires concernés disposent d'actifs en dollars à vendre pour réduire la valeur du dollar. Contrairement à 1985, les réserves d'UST ne sont pas aujourd'hui situées en Europe, mais au Moyen-Orient et en Asie de l'Est, notamment en Chine, au Japon et en Arabie saoudite. Ces pays seraient moins disposés à satisfaire les demandes des États-Unis que les Européens en 1985. Il serait donc préférable que les instruments monétaires soient utilisés après les droits de douane, qui constituent un levier supplémentaire dans les négociations.
Beaucoup à Wall Street pensent qu'il ne peut y avoir d'approche unilatérale de la dévaluation du dollar, car cela nécessiterait une baisse des taux d'intérêt par la Fed, ce qui ne semble pas pouvoir se produire aussi facilement. En réalité, ce n'est pas vrai, car il existe une série d'instruments qui peuvent être utilisés. L'un d'entre eux est l'International Emergency Economic Power Act (IEEPA) de 1977. Si la cause de la surévaluation du dollar est la demande d'actifs de réserve, l'IEEPA peut être utilisée pour la réduire, par exemple au moyen d'une user fee (taxe d'utilisation), en retenant une partie du paiement des intérêts sur ces titres.
Cela pourrait toutefois entraîner une fuite du dollar, des pics des taux d'intérêt et des restrictions au pouvoir d'extraterritorialité. Pour éviter ces problèmes, on peut commencer par une taxe d'utilisation modeste, puis trouver au fil du temps le « juste » niveau et différencier selon les pays, comme cela a déjà été fait avec les droits de douane, en augmentant la taxe d'utilisation pour les adversaires géopolitiques tels que la Chine, par exemple, et enfin s'assurer la coopération volontaire de la Fed. À cet égard, il est essentiel que le « double » mandat de la Fed soit un triple mandat : plein emploi, prix stables et taux d'intérêt modérés à long terme. Ce dernier engagement permet d'intervenir si les taux d'intérêt atteignent un pic en raison de la politique monétaire.
Une autre approche unilatérale consiste à renforcer les devises étrangères en vendant des dollars et en achetant des devises étrangères. Dans ce cas, le risque réside dans l'inflation qui peut être générée par l'émission massive de dollars par la Fed pour acheter des devises étrangères. Dans ce cas, la Fed peut opérer une stérilisation de l'intervention qui soutiendra le dollar et contrera certains effets des ventes. Pour ces raisons, les économistes se sont montrés sceptiques quant à l'utilisation de ce moyen pour intervenir sur la devise. Tout dépendra donc du contexte dans lequel cette politique sera adoptée : dans un contexte de faible inflation, une stérilisation modérée est envisageable.
Considérations sur le marché et la volatilité
Selon Miran, le président Trump pourra, au cours de son second mandat, se concentrer sur ses objectifs centraux : la réindustrialisation, la revitalisation de l'industrie manufacturière et l'amélioration de la compétitivité internationale. Trump a acquis une expérience discrète en matière de droits de douane au cours de son premier mandat, tandis qu'une intervention sur la politique du dollar serait une nouveauté.
C'est pourquoi, en matière de politique monétaire, il convient d'être plus prudent qu'en matière de politique douanière et d'attendre que l'inflation et le déficit soient faibles afin d'éviter des hausses des taux d'intérêt qui pourraient s'accompagner d'un changement de politique sur le dollar, et surtout d'attendre un changement à la tête de la Fed qui garantisse sa coopération volontaire. Étant donné qu'une faible inflation est nécessaire pour permettre à la Fed de baisser ses taux, il faudra recourir à des politiques structurelles, par le biais de libéralisations de l'offre, de déréglementations et de réductions des prix de l'énergie.
Les approches monétaires unilatérales présentent des risques accrus de volatilité. Sans l'aide de la Fed pour plafonner les rendements et sans la volonté des détenteurs étrangers de bons du Trésor américain de renégocier la durée de la dette, une administration dispose de peu d'options pour stabiliser les rendements.
Pour ces raisons, une approche multilatérale visant à renforcer les monnaies sous-évaluées peut contribuer à contenir la volatilité indésirable. Un accord dans lequel les partenaires commerciaux des États-Unis convertissent leurs réserves en UST à très longue échéance allégerait la pression de refinancement sur le Trésor, améliorerait la viabilité de la dette et renforcerait l'idée que la fourniture d'actifs de réserve et le parapluie de défense sont étroitement liés. De cette manière, le dollar et les rendements à long terme pourraient baisser ensemble.
Dans tous les scénarios possibles, il y a des conséquences communes. Premièrement, une distinction claire est établie entre les amis, les ennemis et les neutres. Les amis sont ceux qui se trouvent sous le parapluie sécuritaire et économique, et en partagent les coûts. Ceux qui se trouvent en dehors du parapluie de sécurité se retrouveront également en dehors des accords commerciaux amicaux. Deuxièmement, l'expulsion de pays étrangers de la couverture du parapluie de sécurité américain peut entraîner une augmentation de la perception du danger et, par conséquent, une augmentation des primes de risque pour les actifs de ces pays. Troisièmement, il y aura une augmentation de la volatilité sur les marchés monétaires. Quatrièmement, les efforts pour trouver une alternative au dollar s'intensifieront. À cet égard, Miran est convaincu que les tentatives d'internationalisation du yuan et de création d'une monnaie des BRICS continueront d'échouer, mais qu'il est en revanche possible que l'or et les cryptomonnaies se renforcent.
Les conclusions de Miran
Miran réaffirme que son objectif est de trouver des moyens de remédier au déficit commercial et public tout en évitant les effets secondaires indésirables. L'opinion de Wall Street selon laquelle il n'est pas possible de modifier délibérément la valeur du dollar est fausse. Il existe de nombreux moyens, unilatéraux et multilatéraux, l'important étant de minimiser la volatilité qui en résulte. Quoi qu'il en soit, il est très probable que les droits de douane, qui constituent un important outil de négociation, seront utilisés avant tout autre instrument monétaire. Il est donc probable que le dollar se renforce avant d'inverser sa tendance, si tant est qu'il le fasse. Miran conclut en disant qu'« il existe une voie par laquelle l'administration Trump peut reconfigurer le commerce et les systèmes financiers mondiaux au profit de l'Amérique, mais cette voie est étroite et nécessitera une planification minutieuse, une exécution précise et une attention particulière aux mesures à prendre pour minimiser les conséquences négatives » (6).

Nos conclusions
La lecture du texte de Miran est très intéressante, car elle correspond en grande partie à ce que Trump a fait et dit jusqu'à présent, en expliquant sa logique interne et en la replaçant dans le contexte de la redéfinition des relations entre les États-Unis et le reste du monde, à commencer par leurs alliés. Cela implique, étant donné que les États-Unis sont la première économie mondiale et le premier acheteur mondial, comme Miran l'anticipe déjà dans son titre, une restructuration du système commercial mondial.
Le plus frappant est que Miran considère le rôle du dollar comme monnaie de réserve internationale et le rôle des États-Unis en tant que puissance militaire garante de l'ordre mondial comme un service que les États-Unis offrent généreusement aux autres pays. Un service qui coûte aux États-Unis la désindustrialisation, un déficit commercial important et une dette fédérale énorme. Les autres pays sont donc des profiteurs, comme l'ont affirmé à plusieurs reprises Trump et son vice-président, J.D. Vance, en référence à l'Europe, qui bénéficierait gratuitement du parapluie de sécurité et du marché américain.
Le fait est cependant que l'interprétation de Miran renverse la réalité effective des choses. La désindustrialisation est avant tout le produit de la logique interne du mode de production capitaliste et, en particulier, de la tendance à la baisse du taux de profit. Les géants américains ont délocalisé une part considérable de leur production à l'étranger, car à l'étranger – au Mexique, en Chine et en Asie de l'Est – les profits étaient plus importants et le coût du travail moins élevé. La surévaluation du dollar a certainement joué un rôle, mais dans une mesure plus limitée que ne le prétend Miran.
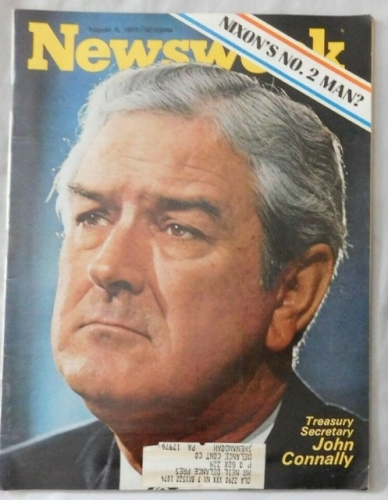 Mais l'aspect le plus important est que le dollar et son rôle de monnaie d'échange commercial et de réserve mondiale ne sont pas un fardeau, mais plutôt le « privilège exorbitant » des États-Unis, comme l'a affirmé l'ancien président français Giscard d'Estaing. C'est ce privilège qui lui a permis de financer sa double dette, commerciale et publique, en imprimant simplement des dollars. Les dépenses militaires colossales servent à imposer de manière coercitive l'hégémonie américaine et le rôle international du dollar. Ce n'est donc pas un hasard si le secrétaire américain au Trésor, John Connally, a déclaré en 1971 que « le dollar est notre monnaie et votre problème », lorsque les États-Unis ont rendu le dollar inconvertible en or, se donnant ainsi la possibilité de s'endetter à leur guise.
Mais l'aspect le plus important est que le dollar et son rôle de monnaie d'échange commercial et de réserve mondiale ne sont pas un fardeau, mais plutôt le « privilège exorbitant » des États-Unis, comme l'a affirmé l'ancien président français Giscard d'Estaing. C'est ce privilège qui lui a permis de financer sa double dette, commerciale et publique, en imprimant simplement des dollars. Les dépenses militaires colossales servent à imposer de manière coercitive l'hégémonie américaine et le rôle international du dollar. Ce n'est donc pas un hasard si le secrétaire américain au Trésor, John Connally, a déclaré en 1971 que « le dollar est notre monnaie et votre problème », lorsque les États-Unis ont rendu le dollar inconvertible en or, se donnant ainsi la possibilité de s'endetter à leur guise.
Mais si le dollar est l'instrument qui permet aux États-Unis de gérer leur double dette, quelle est la raison de l'introduction de droits de douane élevés et de politiques visant à dévaluer le dollar ? La raison, toujours selon le raisonnement de Miran, réside dans le fait que ces politiques s'opposent aux délocalisations et favorisent les relocalisations de l'industrie manufacturière. En effet, toujours selon Miran, sans industrie manufacturière, il n'y a pas de sécurité nationale, surtout si celle-ci est entendue au sens large, comme l'autonomie dans les productions stratégiquement importantes, telles que l'acier, les semi-conducteurs et les médicaments. D'ailleurs, la guerre en Ukraine a mis en évidence les graves insuffisances de l'industrie militaire américaine dans l'approvisionnement de Zelensky en armes et en munitions, aggravées par l'aide que les États-Unis ont simultanément offerte à Israël.
Une industrie de l'armement plus forte est nécessaire car – et c'est là l'autre point important du raisonnement de Miran – les rapports de force économiques et politiques ont changé ces dernières années. En particulier, la Chine s'est développée au point de devenir « de loin la plus grande menace pour l'économie et la sécurité nationale des États-Unis, plus encore que la Russie ». Étant donné que la Chine dispose d'une industrie manufacturière très forte et désormais également à la pointe de la technologie, les États-Unis ne peuvent se permettre d'avoir une industrie manufacturière faible et dépassée.
Un autre aspect important est la viabilité de la dette publique américaine et donc le niveau des taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain (UST). Comme nous l'avons vu, Miran, toujours dans le but de résoudre le déficit commercial et de relancer l'industrie manufacturière, soutient que le dollar doit être dévalué ou, ce qui revient au même, que les monnaies des principaux partenaires économiques, à commencer par le yuan et l'euro, doivent être réévaluées. Or, le problème est que la dévaluation du dollar rend les investissements en dollars moins attractifs, y compris ceux dans les UST, ce qui fait remonter les rendements. L'optimum pour les États-Unis serait plutôt un dollar dévalué et des taux d'intérêt bas sur la dette publique.
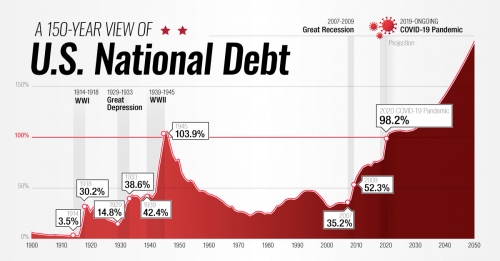
Or, depuis le début de l'année, le dollar s'est déprécié de 13 % par rapport aux principales devises, tandis que les taux d'intérêt sur la dette à 10 ans sont passés de 1,1 % en 2021 à environ 4,3 % en juillet 2025. À cela s'ajoute, sous la présidence Biden, la plus forte augmentation de la dette publique jamais enregistrée, soit 8 500 milliards de dollars supplémentaires. La tendance sous Trump ne semble pas s'inverser, compte tenu de l'ampleur du budget fédéral pour 2026, qui, entre autres raisons, a conduit à la rupture entre Trump et Musk. La hausse des taux et de la dette publique a fait exploser les dépenses nettes d'intérêts : de 658 milliards de dollars en 2023 à 880 milliards en 2024, pour atteindre plus d'un billion prévu en 2025, soit trois fois le niveau de 2020 (7).
Pour ces raisons, Miran souligne à plusieurs reprises la nécessité pour la Fed de respecter un triple mandat, en ajoutant à la pleine emploi et à la stabilité des prix la poursuite de taux d'intérêt modérés à long terme. Ce n'est pas un hasard si, ces derniers mois, Trump a vivement critiqué le président de la Fed, Jerome Powell, pour ne pas avoir baissé les taux d'intérêt. Toujours en lien avec le taux d'intérêt sur la dette fédérale, Miran propose de parvenir à un accord, qu'il appelle l'accord de Mar-a-Lago, avec les partenaires économiques pour une dévaluation concertée du dollar qui prévoit également un passage des UST à court terme à des UST à très long terme, ce qui rendrait le financement de la dette moins coûteux pour les États-Unis.
Revenons donc aux droits de douane qui, selon le raisonnement de Miran, sont avant tout un moyen de négociation pour imposer deux objectifs : dévaluer le dollar et financer la dette publique. Les droits de douane peuvent être instaurés, supprimés ou réduits si les autres pays acceptent les conditions imposées par les États-Unis, telles que l'appréciation de leur monnaie, l'acceptation d'acheter des dettes à très long terme et de réaliser des investissements productifs sur le sol américain. Un autre moyen de négociation important est la menace de retirer le parapluie de sécurité aux pays qui ne respectent pas les conditions imposées par les États-Unis. Miran explique également l'attitude hésitante de Trump en matière de droits de douane par la volonté d'augmenter le pouvoir de négociation, en créant le doute et la peur à travers l'incertitude. En définitive, les droits de douane, les politiques monétaires, le parapluie de sécurité sont autant d'expressions d'une politique de chantage par laquelle les États-Unis tentent de se faire financer par le reste du monde, y compris leurs alliés. Il s'agit d'un comportement parasitaire, basé sur l'accumulation par expropriation et typique de la phase impérialiste du capitalisme.
À ce stade, il est naturel de se demander : les politiques envisagées par Miran seront-elles couronnées de succès ? C'est une question importante, car en cas de succès ou d'échec, le monde auquel nous serons confrontés dans les prochaines décennies pourrait être très différent. Il est toutefois difficile de répondre à cette question aujourd'hui, après seulement six mois d'administration Trump, notamment parce que les variables à prendre en compte sont nombreuses.
Nous pouvons toutefois avancer quelques hypothèses. En ce qui concerne la relocalisation de la production, les choses bougent déjà, puisque les dix premières multinationales pharmaceutiques, face à la perspective de droits de douane élevés, ont annoncé 316 milliards de dollars de nouveaux investissements pour se relocaliser sur le sol américain (8). Un autre exemple à cet égard est celui du Japon qui, en échange d'une réduction des droits de douane à 15 %, a promis 550 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis (9). En ce qui concerne le statut du dollar, il est possible que sa part dans les réserves mondiales, actuellement de 57,74 % (10), continue de s'éroder, notamment en raison de l'utilisation abusive qui en a été faite pour infliger des sanctions et de la tactique hésitante de Trump en matière de droits de douane, qui l'ont affaibli. D'autre part, les pays du BRICS ont eux-mêmes reconnu qu'une monnaie commune n'était pas viable, mais ils ont en même temps déclaré vouloir utiliser de plus en plus leurs monnaies nationales comme moyen de transaction commerciale internationale. Cela se produit d'ailleurs déjà depuis le début de la guerre en Ukraine dans les échanges de matières premières énergétiques entre la Russie, d'une part, et la Chine et l'Inde, d'autre part.

Quoi qu'il en soit, comme le soutient Miran, les États-Unis ont peu de marge de manœuvre pour mener des politiques monétaires alternatives si la Fed ne baisse pas ses taux et surtout si, au niveau mondial, les conditions imposées par les États-Unis ne sont pas acceptées. C'est précisément là que réside le principal problème pour les États-Unis. Une grande partie du monde, celle que l'on appelle le « Sud global », ne semble plus disposée à se soumettre à l'Occident et en particulier aux États-Unis. Cela vaut surtout pour la Chine et la Russie, mais aussi pour le Brésil et de nombreux autres pays. La Chine et le Brésil, en particulier, ont réagi avec fermeté lorsque Trump a menacé d'imposer des droits de douane très élevés. L'expansion même des BRICS témoigne de la volonté d'un nombre croissant d'États de trouver des lieux de confrontation et de coopération alternatifs à ceux que les États-Unis et l'Occident collectif ont offerts dans le passé.
La situation est différente pour l'Occident collectif, dont font partie l'Europe occidentale et le Japon. Les pays qui en font partie semblent les plus perméables aux politiques de chantage de Trump et les plus disposés à lui venir en aide, notamment parce qu'ils tirent de nombreux avantages du système économique mondial organisé autour des États-Unis. En témoignent la soumission observée lors du dernier sommet de l'OTAN, où l'Europe a accepté d'augmenter ses dépenses militaires à 5 % du PIB, et la réticence de l'UE à envisager des contre-mesures douanières à l'encontre de Trump, justifiée par le mantra « il faut éviter une guerre commerciale avec les États-Unis ». Une guerre commerciale ou, mieux, une confrontation interimpérialiste, comme on aurait dit autrefois, qui est en réalité déjà en cours. À cet égard, il semble que l'unité de l'Occident soit quelque chose à laquelle Trump accorde une valeur bien inférieure à celle que lui attribue Meloni.
Par Domenico Moro pour ComeDonChisciotte.org
25.07.2025
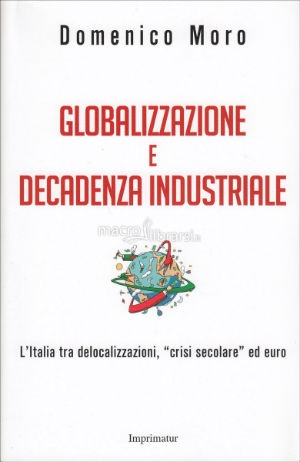
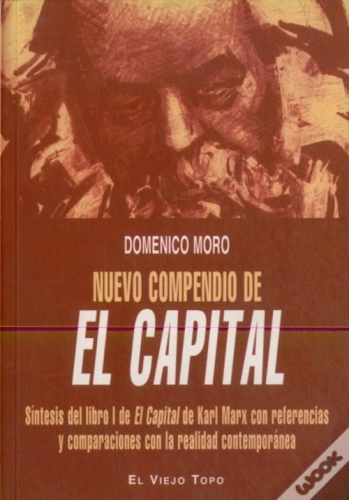
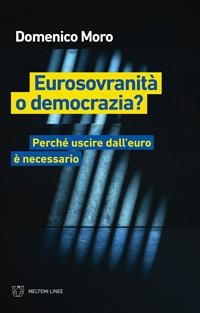
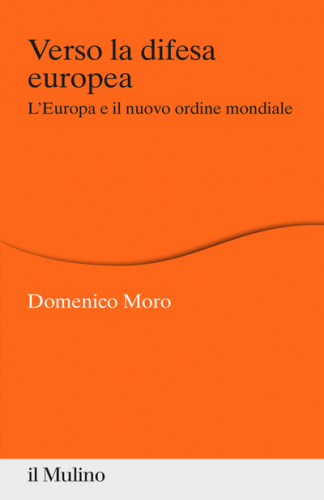
Domenico Moro s'intéresse à la mondialisation et à l'économie politique internationale. Il est l'auteur de Globalizzazione e decadenza industriale (Mondialisation et déclin industriel) et Nuovo compendio del Capitale (Nouveau compendium du Capital) ; Eurosovranità o democrazia? Perché uscire dall'euro è necessario (Eurosouveraineté ou démocratie ? Pourquoi il est nécessaire de sortir de l'euro), Meltemi, Milan 2020.
NOTES
(1) Stephen Miran, A User's Guide to Restructuring the Global Trading System, Hudson Bay Capital, 24 novembre 2024, p. 5.
(2) Ibidem, p. 19.
(3) Ibid., p. 22.
(4) Ibid., p. 23.
(5) Ibid., p. 26.
(6) Ibid., p. 38
(7) Peter G. Peterson Foundation, What are Interest costs on the national debt? 14 juillet 2025. Committee for a responsible Federal Budget, Interest costs could explode from high rates and more debt, 20 mai 2025.
(8) Monica D'Ascenzo, « Effet des droits de douane sur l'industrie pharmaceutique : 316 milliards investis aux États-Unis », Il Sole24ore, 23 juillet 2025.
(9) Stefano Strani, « Droits de douane, accord États-Unis-Japon : des tarifs à 15 % et Tokyo investira 550 milliards aux États-Unis », Il Sole24ore, 24 juillet 2025.
(10) Données du FMI, Composition monétaire des réserves officielles de change (Cofer), 2025 T1.
13:31 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, stephen miran, états-unis, tarifs douaniers, économie, finances, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 juin 2025
Le socialisme de marché de Chen Yun
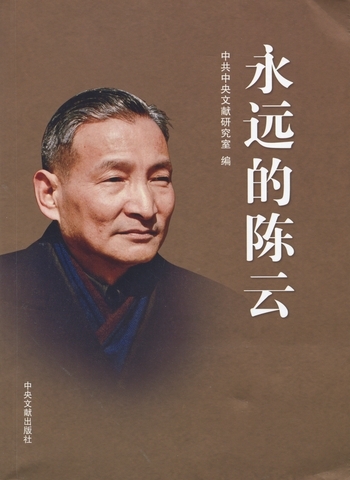
Le socialisme de marché de Chen Yun
Luca Bagatin
Source: https://electomagazine.it/il-socialismo-di-mercato-di-che...
Chen Yun (1905 – 1995) fut un homme d'État et révolutionnaire important qui contribua à construire l'économie socialiste dans la République populaire de Chine, à la moderniser et à la guider vers le progrès.
Cette année marque le 120ème anniversaire de sa naissance, et le président chinois Xi Jinping a voulu lui rendre hommage et le remettre en mémoire, lors d’un discours prononcé le 13 juin dernier dans la Grande Salle du Peuple à Pékin.
Inscrit au Parti communiste chinois (PCC) depuis 1924, Chen Yun fut élu en 1930 comme membre suppléant du Comité central du PCC. Quatre ans plus tard, il entra dans le Bureau politique du parti, puis dans le Comité permanent.
Dans les années 40, il fut nommé responsable économique des zones occupées par les communistes, et après la fondation de la République populaire en 1949, il fut nommé Vice-Premier ministre jusqu’en 1966, s’occupant des secteurs liés à l’économie, aux finances et aux infrastructures. Entre 1956 et 1958, il occupa le poste de ministre du Commerce.
Chen Yun, que l’on pourrait, à mon avis, qualifier de « Roberto Tremelloni chinois » en raison de son pragmatisme et de ses compétences économiques, a occupé, durant à peu près les mêmes années, les mêmes fonctions que notre excellent ministre de l’Économie social-démocrate. Contrairement à Mao, Chen Yun pensait que le socialisme ne pouvait se développer qu’à travers l’économie de marché et une décentralisation accrue. Avec le temps, les faits leur donneront raison.
En réalité, Chen Yun, critiqué pour ses idées lors de la Révolution culturelle, fut un soutien de Deng Xiaoping dans les années suivant la mort de Mao, et, avec lui, l’un des promoteurs de la nouvelle voie réformatrice du socialisme chinois.

En 1979, il fut à nouveau nommé Vice-Premier ministre et, sous la direction de Deng Xiaoping, il lança les réformes économiques qui ouvrirent la Chine au marché, tout en maintenant les secteurs clés sous contrôle public et en préservant la planification économique.
Ce sera la recette du succès de la République populaire chinoise: non pas la transition vers le capitalisme, mais le renouvellement et le renforcement du socialisme par la libération des forces productives du pays.
L’action de Chen Yun fut et demeure une source d’inspiration pour les générations suivantes de dirigeants communistes chinois, de Jiang Zemin à Hu Jintao, jusqu’au président actuel, Xi Jinping.
Dans son discours commémoratif du 120ème anniversaire de la naissance de Chen Yun, le président Xi a rappelé son ardeur de révolutionnaire ouvrier et marxiste, qui contribua à libérer la pays de l’oppression et du chaos.
Il a notamment souligné que « le camarade Chen Yun a consolidé et maintenu des idéaux et des convictions solides, un esprit fort et des principes de parti, un style pragmatique et une recherche de la vérité, un sens simple du service public et l’esprit d’étudier avec diligence, qu’il a cultivés et conservés tout au long de sa longue carrière révolutionnaire, incarnant les nobles qualités des communistes. Il a affirmé : « La chose la plus agréable pour une personne est de participer à la révolution et de lutter pour les intérêts du peuple. Quiconque abandonne le peuple et le parti ne peut rien réaliser ». Lors de moments critiques, il a toujours maintenu la position politique correcte, exprimé clairement ses attitudes, et quand le développement de la cause du parti rencontrait des difficultés, il a toujours su garder sa lucidité, présenté des opinions originales sur la base d’une réflexion attentive, et trouvé des moyens efficaces de résoudre les problèmes».

Le Chine d’aujourd’hui, d’ailleurs, regarde avec fierté et confiance son socialisme aux caractéristiques chinoises, qui a des racines anciennes et solides, et qui est le fruit des efforts de ceux qui ont contribué à le bâtir. Elle est, par ailleurs, en première ligne pour la paix, la coopération et le bénéfice mutuel entre les pays, dans un monde de plus en plus à la dérive et irresponsable.
Comme l’a écrit notre ami le professeur Giancarlo Elia Valori, grand ami de la Chine et de la coopération internationale, dans un récent article: « En 2023, le président Xi Jinping a solennellement proposé l’Initiative pour la Civilisation mondiale, soutenant la promotion des valeurs communes de toute l’humanité, soulignant l’héritage et l’innovation des civilisations, et renforçant les échanges et la coopération internationale dans les sciences humaines. (…) Premièrement, il faut défendre l’égalité des civilisations, afin qu’il n’y ait pas d’ethnies hiérarchisées avec des cheveux blonds et des yeux bleus qui dominent sur les autres, car il n’y a pas de supériorité ou d’infériorité des civilisations. Les chemins de développement et les systèmes sociaux de tous les peuples doivent être respectés; il faut rejeter les conflits entre civilisations; s’opposer à l’ingérence dans les affaires intérieures; résister à l’arbitraire unilatéral; préserver l’équité et la justice; et partager la dignité égale ».
« Il est un devoir de soutenir un multilatéralisme authentique ; d’appuyer l’ONU dans son rôle important dans la promotion du dialogue entre civilisations; de remplacer la confrontation par la coopération; de faire en sorte que le système gagnant-gagnant prévaut sur celui à somme nulle; et d’adopter la voie de la coexistence pacifique entre différentes civilisations ».
« Deuxièmement, il faut promouvoir les échanges entre civilisations. La communauté internationale doit renforcer ces échanges et l’apprentissage mutuel; tirer la sagesse du dialogue entre les civilisations pour résoudre les problèmes mondiaux et élargir le chemin de la modernisation mondiale. (…) Troisièmement, il faut promouvoir le progrès de la civilisation (…) Seul le dialogue compose la mélodie de l’intégration et peut bâtir une civilisation humaine meilleure, qui soit la synthèse de toutes les réalités ethniques et culturelles de notre seule planète habitée».
Des paroles sages en une époque où la sagesse — de « notre côté » — semble avoir disparu. Remplacée par un vide assourdissant rempli d’idéologie, de fanatisme, d’ignorance, d’irresponsabilité, de préjugés, de haine et de violence.
12:16 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chen yun, chine, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 juin 2025
Le nouveau contrat social

Le nouveau contrat social
(Article publié dans La Emboscadura del Siglo XXI, nº16, novembre 2023, pp. 10-14)
Jordi Garriga
Récemment, la nouvelle a été annoncée que, dans Silicon Valley, l'entreprise Meta allait licencier 10.000 travailleurs qui, avec ceux qui avaient été licenciés au cours des mois précédents par Amazon, Google, Microsoft, IBM et d'autres entreprises technologiques, faisaient partie d'un chiffre sidérant de 200.000 salariés licenciés. La plupart d'entre eux devaient sûrement se consacrer à des tâches répétitives et presque automatiques, mais il y en avait aussi beaucoup, parmi eux, qui disposaient de bonnes connaissances et qui ont également été sacqués, malgré leurs capacités.
Même s’il est heureux que nos goûts et nos loisirs coïncident avec la demande du marché du travail, même ce genre de loterie vitale ne nous libère pas de l’anxiété professionnelle. Ce qui est remarquable dans cette nouvelle, c’est qu’on étudie sérieusement comment l’intelligence artificielle (IA) pourra combler ces lacunes si elles s’avèrent à nouveau nécessaires.
Nous ne sommes pas tous ingénieurs en informatique, peut-être que beaucoup d’entre nous n’aimeraient pas cela voire détesteraient sûrement ce métier. La plus normale des choses, c'est d’avoir des vocations qui ne sont pas économiquement viables. La plupart des gens ne désirent pas courir après l’argent et vivre des journées de travail interminables. Je me souviens du conseil que mon père m'a donné, lorsqu'il a perçu quelle était ma vocation et mes préoccupations, toutes clairement intellectuelles : "trouver un travail pour vivre et pendant ton temps libre cultiver ta vocation". Je suis très reconnaissant pour ces conseils, car ils m'ont permis de vivre dans ce système économique, de survivre à la réalité qui m'entoure. Mais bien sûr, le temps qu’il me reste en dehors du travail, je ne peux pas le consacrer tout entier ou presque à mes intérêts. Il faut remplir le réfrigérateur, fonder une famille, cultiver une vie sociale, résoudre toutes sortes de situations qui, dans le meilleur des cas, me permettent de consacrer une heure ou une demi-heure à mes loisirs, en tant qu'adulte fonctionnel. Et dans cette situation, moi et des millions d’autres personnes, nous nous trouvons piégés. On nous dit que dans ce monde il faut trouver le bonheur, mais il nous fuit, après nos efforts pour faire de l'argent et pour assurer son travail au quotidien, argent et travail toujours de plus en plus rares et incertains.
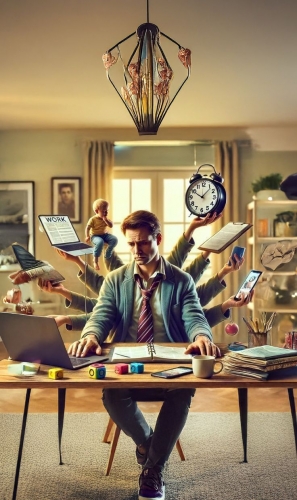
Même si la peur de perdre son emploi à cause des machines relève d'une crainte déjà très ancienne, il ne fait aucun doute que la mise en œuvre accélérée et exponentielle d'entités robotiques laisse déjà des millions de personnes au chômage dans le monde. Un simple répondeur de n'importe quelle entreprise, qui répond à des milliers d'appels 24 heures sur 24 supplée déjà des dizaines d'employés, pour seulement quelques centimes de frais... Face à la révolution technologique, face aux robots, l'être humain est un concurrent de plus en plus fragilisé et remplaçable.
Quoi Faire ? Dans le passé, ce qu’on appelle le contrat social, celui qui donnait à chaque individu une place dans nos sociétés, était la capacité productive. Qui avait remplacé celui des domaines du Moyen Âge. Aujourd’hui, de nombreux individus ne sont plus issus de la classe prolétarienne, mais sont directement issus de la classe précaire, celle qui est descendue sur l’échelle sociale et doit se contenter des logements partagés, d'emplois à la journée ou à l’heure, sans possibilité de fonder une famille ou d’avoir un simple avenir sans problèmes. Il est nécessaire de renouveler ce contrat, cette manière de pouvoir avoir un statut viable sans les théories apocalyptiques qui parlent allègrement de réduction du surplus de population sur la planète.

L'un des outils révolutionnaires pour garantir une vie digne à la population est ce que l'on appelle le Revenu de Base Universel (désormais RBU).
Des tests pilotes ont été réalisés dans plusieurs pays, mais aucun ne constitue un véritable RBU. Soit les projets sont réalisés dans des villages africains ou asiatiques, soit dans des conditions familiales ou autres. En Finlande, l'initiative la plus ambitieuse a été annulée en 2018. Ce n'est qu'en Iran qu'un système presque tel est en vigueur depuis 2011, consistant en un paiement inconditionnel, différent pour les célibataires et les familles, qui sert à atténuer la suppression des subventions pour les produits de base.
Bien entendu, la première objection qui vient à l’esprit est qu’il s’agit d’un salaire en échange d'un "non-travail". Que ce sera une manière de maintenir les gens dans la paresse et que personne n'ira chercher du travail s'il a déjà les moyens de vivre. Eh bien, il ne s’agit pas de cela ni d’un instrument de lutte contre la pauvreté (d’autant plus que les subventions n’ont JAMAIS mis fin à la pauvreté).
Philosophie du BRU
Qu’est-ce que le revenu de base universel ? Le RBU, pour ne pas être une autre forme de subvention ou de paiement, est un revenu périodique UNIVERSEL et INCONDITIONNEL obligatoire. Universel car il s'adresse à tous les citoyens adultes de l'État sans autre condition que d'être cela, des citoyens, et inconditionnel car il n'exige pas de contrepartie, ni matérielle (pour une dépense déterminée) ni intellectuelle (loyauté à un régime ou à un parti). En dehors de ça, tout autre mode n’est plus un RBU, c’est autre chose.
A quoi ça sert ? C'est un outil pour la configuration nécessaire d'un nouveau contrat social. Ne se fonde pas sur la productivité ou la capacité des individus, laissés à la merci des lois de la jungle capitaliste, au nom d’un darwinisme social qui nous considère comme de simples animaux en survie. Un nouveau contrat social est nécessaire dans l'Occident moderne qui considère chaque individu comme porteur d'une dignité intrinsèque (qu'il s'agisse d'une perspective religieuse ou éthique) et comme membre d'une communauté nationale qui protège la vie de ce citoyen contre les requins du capitalisme apatride.
Il ne s'agit pas d'une mesure utopique : il y aura toujours des riches et des pauvres, des inégalités et des injustices, des désirs de profit et de pouvoir... Cette mesure doit contribuer à détourner le chemin que le productivisme a tracé jusqu'à présent, en forgeant des sociétés où la réussite matérielle est apparue comme le meilleur indicateur de la valeur de l'individu, où l'échelle des valeurs et la structure sociale aident les plus avides, psychopathes et corrompus à faire leur loi. Cela détourne le progrès humain vers une vie plus créative et plus profonde, où là encore une activité purement lucrative est considérée comme quelque chose de certainement nécessaire, mais non comme un facteur de prestige, tout comme de nombreuses activités quotidiennes nécessaires ont tendance à être naturellement cachées.
C’est un instrument qui pourrait contribuer à mettre fin au règne de l’argent. Parce que maintenant l’argent est le roi ou le dieu, mais avec ce système il deviendrait subordonné, un simple instrument pour créer le bonheur individuel tant chanté dans tant de déclarations pompeuses et creuses de réalités concrètes.
Car s’ils nous assurent que le bonheur est le but des êtres humains sur Terre, alors le RBU est un bon instrument. La productivité n’est pas le bonheur, elle ne l’a jamais été. Le travail comme alternative au fait de ne pas mourir de faim ne peut être définie comme libératrice ou dignifiante.
Le RBU, comme je le soulignerai plus tard, est un outil de liberté individuelle, de progrès social et d’indépendance nationale :
- La liberté individuelle car elle libère les capacités innées de chaque individu.
- Le progrès social car le groupe social n'est plus une jungle d'entités avides de consommation et en lutte constante dans une perspective matérialiste.
- L'indépendance nationale parce que le pouvoir politique est placé au-dessus du pouvoir économique, n'étant plus l'otage des puissances financières apatrides.

La plus grande critique du capitalisme est l’exploitation des êtres humains sur le marché du travail, moins il y a de réglementation et de contrôle, mieux c’est. Le plus grand mal est le capital, en tant que propriétaire des moyens de production. Il faut alors retirer le pouvoir au capital. L’ancien socialisme prônait l’union prolétarienne pour lutter pour cela, mais il n’a pas abandonné la logique productiviste et ouvrièriste, partageant la philosophie rationaliste de la classe bourgeoise qui a créé le capitalisme. Le travail ne peut plus être une valeur en soi. C'est une sphère de vie inférieure. Si le problème est l’exploitation humaine, alors son instrument, l’argent, doit être éliminé, le réduisant à un instrument non de pouvoir, mais de confort. Le fétichisme de la productivité comme mesure de la valeur individuelle doit être démoli ; le fait de pouvoir accéder au marché du travail ne doit conférer aucune qualité humaine supérieure.
Le RBU est l’instrument permettant de passer de l’égalité formelle à l’égalité réelle, de l’égalité comme souhait inscrit dans les Constitutions politiques bourgeoises à une réalité politique précise. Si un individu n’a pas les moyens matériels de réaliser les droits politiques dont il dispose, c’est comme s’il ne les avait pas. Le RBU est l'outil permettant à la fois de pouvoir dire NON à l'employeur qui souhaite exploiter et de dire NON au partenaire violent. Et de dire OUI à la vraie vie, au dasein de chaque sujet : l'aliénation sociale provoquée par le travail salarié disparaît, car ce travail, cette activité n'est plus indispensable pour pouvoir vivre.
Pour être artiste ou chercheur, par exemple, vous n’auriez pas besoin de subventions politiques, de mécénat ou d’être né dans une famille aisée. L’art et la science seraient réellement des activités populaires, élevant le niveau national.
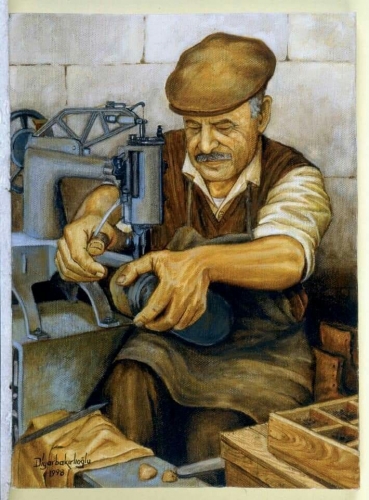
Les individus en quête de profit pourraient continuer à agir (la nature humaine n’est pas si changeante), et ceux qui ont d’autres préoccupations ne seraient pas forcés de s’y soumettre, de sorte que la sélection humaine basée sur la capacité financière ou la personnalité matérialiste serait éliminée pour de types humains plus désirables, orientés vers l’art ou la recherche scientifique.
Pour y parvenir, un combat à mort, matériel et idéologique, sera nécessaire. Soutenir et réaliser la multipolarité sur la planète est essentiel pour le RBU, car une finance unique l’empêchera par tous les moyens, alors que dans un monde avec une pluralité de systèmes économiques, il y aura toujours un écart pour cela. Et d’autant plus que certains gourous de l’économie occidentale annoncent déjà que c’est une mesure qui finira par être inévitable…

Ce qui se passe maintenant, c'est que les élites ne veulent pas mettre en œuvre ce système, elles proposent seulement de relever l'âge de la retraite et le salaire minimum, d'offrir l'aumône aux enfants ou de donner de l'argent pour le loyer. Des pièces pour rapiécer une vieille outre à vin sur le point d'éclater. Ils ne veulent pas partager ni redistribuer la richesse avec le peuple, qui en est le véritable bénéficiaire.
Puisque la richesse nationale appartient au peuple et que la redistribution de cette richesse doit être une loi. C’est pourquoi le RBU n’a pas pour objectif d’éradiquer la pauvreté, mais de redistribuer la richesse.
Fonctionnement
On ne soulignera jamais assez que ce n’est pas une rémunération accordée pour ne pas travailler. Les paresseux ont toujours existé et existeront toujours, et cette rémunération sera sûrement utile à beaucoup d’entre eux, mais aussi à la société: tout le monde connaît ces éléments dans la sphère de l'emploi et à quel point ils sont inefficaces et boycotteurs, c’est pourquoi déjà, par une telle mesure, on élimine un frein dans le monde du travail. De plus, s’ils ont de l’argent, ils le dépenseront quand même, ce qui sera également bénéfique pour les entreprises. Même ceux qui ne font rien devront manger tous les jours...
Ensuite, il y a des gens qui, après avoir quitté leur travail, finiront par en avoir assez de ne rien faire et entreprendront peut-être des activités qui rempliront des facettes de leur vie qu'ils ignoraient, ou leur permettront de se consacrer à des loisirs qui, dans la foulée, pourraient finir par être un emploi ou une nouvelle source de revenus…
Des personnes irresponsables existeront toujours sous n’importe quel régime économique. Le RBU servira simplement à garantir que personne n'enlève la dignité à un citoyen, ce qui, le cas échéant, pourrait le conduire au suicide. Quoi qu’il en soit, les citoyens eux-mêmes ne peuvent leur retirer cette dignité que s’ils sont mal administrés. Grâce au RBU, les gens SERONT responsables de leur propre responsabilité et OUI, ils seront, dans une large mesure, responsables de leur propre situation économique.
Le principal acteur pour rendre cette mesure possible est la communauté politique organisée, c'est-à-dire l'État : pour calculer le RBU, le distribuer et garantir les services publics et la collecte nécessaire.
La mise en œuvre du RBU nécessite que l'État retrouve sa souveraineté sur la Banque centrale (la création monétaire) et qu'il contrôle totalement ou largement les entreprises de transport et d'énergie, ainsi que les domaines de l'éducation, de la santé et du logement : contrôle des flux monétaires, prix et qualité.
Le RBU serait calculé sur la base du salaire moyen de 70% des travailleurs sur l'ensemble du territoire national, en laissant de côté les salaires les plus élevés. Il en serait de même sur tout le territoire pour ne pas vider certaines localités de leurs habitants, pour que cela n'arrive plus comme aujourd'hui à cause de notre grave déséquilibre territorial. La RBU calculée annuellement représenterait 60% de cette moyenne. Par exemple, si la moyenne s'avère être de 2.000 euros par mois, le RBU qui serait délivré à chaque citoyen adulte serait de 1200 euros, révisable annuellement.
Le RBU ne tiendrait pas compte du fait que tel ou tel citoyen soit riche ou pauvre, son sexe, sa race, son état civil, etc. C'est un instrument rationnel qui rendrait tous égaux dans la communauté politique aux yeux de l'État. Il ne serait pas non plus contrôlé à quoi il servirait dans chaque cas.
Bien entendu, on ne pourrait pas renoncer au RBU, ni le retirer à aucun citoyen, car il serait inhérent à la nationalité. Ce revenu serait disponible du simple fait d’être membre de la famille nationale.
Cette théorie est incompatible avec la logique libérale, car elle repose sur l’exploitation des nations par le biais de dettes monétaires fictives et de chantage au travail par l’importation de main d’œuvre bon marché et servile en provenance du tiers monde.

L’immigration de masse serait étouffée dans l’œuf, puisque ces revenus ne seraient pas destinés aux étrangers et que le fait d’avoir des travailleurs étrangers serait fortement imposé et contrôlé. Le salaire minimum serait également instauré pour éviter tout abus.
Les travailleurs nationaux n’émigreraient pas ailleurs s’ils avaient une vie décente assurée. Et obtenir la nationalité serait très difficile, car des régularisations massives impliqueraient des dépenses énormes (et n’entraîneraient aucun avantage d’exploitation), sans compter le fait qu’une fois la citoyenneté obtenue, personne ne pourrait la lui retirer.
Il y aurait très probablement un effet de contagion : les populations des pays voisins le souhaiteraient également. Une véritable révolution mondiale se produirait, même si elle s’accompagnerait très probablement de guerres, les élites extractives résistant à la nouvelle réalité jusqu’au dernier travailleur mort.
Bien que cela dépasse le cadre de ce travail, je vais donner quelques visions et mesures qui pourraient accompagner le RBU :
- Naturellement, les allocations de chômage, de vieillesse, voire de dépendance pourraient disparaître (ou être radicalement revues) car elles ne seront plus indispensables et seront couvertes par ce versement à durée indéterminée, puisque le RBU est censé couvrir les dépenses de base (logement, nourriture, équipement… ).
- Cette mesure pourrait permettre la formation de jeunes familles émancipées. Les jeunes ne seraient plus obligés de choisir entre leur vocation et leur ventre, entre émigrer ou vivre chez leurs parents jusqu'à 40 ans. La santé mentale de la population s'améliorerait considérablement.
- Les salaires augmenteraient parce que personne n'accepterait des abus accompagnés d'heures interminables ou de mauvaises conditions de travail.
- Cela encouragerait la création d'entreprises par les fils de familles ouvrières, car ce soutien serait toujours là. La création d’entreprises ne serait plus le monopole des familles aisées.
- Le RBU doit être intouchable et insaisissable. En cas de dettes et de non-paiements, la personne qui avait des dettes et qui a été saisie par l'intermédiaire de la banque ne verra jamais le montant du RBU affecté, à l'exception du surplus. Exemple : si un RBU est de 1200 euros, et qu'au moment de son encaissement il y a 2000 euros au total sur le compte, 800 euros seront saisis, de sorte que vous ne pourrez jamais avoir plus de revenus supplémentaires sur votre compte chaque mois. Une seule exception serait dans le cas d'une pension alimentaire destinée aux enfants de ce citoyen.
- Dans les écoles publiques et privées, une matière appelée « Économie et Finance » devrait être enseignée obligatoirement, où les citoyens apprendraient dès le plus jeune âge le fonctionnement de l'économie, ses mécanismes et ses astuces. Même si les escrocs et les requins financiers continueront toujours d’exister. La nature humaine ne change pas.
- Les condamnés auraient également droit à leur RBU, qui servirait à financer leur séjour derrière les barreaux.
- S'il y a des retraités qui veulent continuer à travailler, puisqu'à partir d'un certain âge ils seraient obligés d'arrêter de travailler (car l'objectif de la vie est différent), on pourrait leur accorder des mesures extraordinaires en taxant lourdement leur activité et en décourageant le désir présumé de profit, qui deviendrait une valeur secondaire dans le nouveau contrat social. Comment n'y aurait-il pas de retraite payée (il pourrait y avoir des régimes privés), en échange ils auraient des médicaments, des transports, des musées, etc. gratuit et des réductions sur les produits de base.

CONCLUSION
Un nouveau contrat social est nécessaire. Bien entendu, le RBU ne peut être considéré ni comme une panacée miraculeuse ni comme la seule mesure à adopter : d’énormes changements sociaux, économiques et politiques devront se produire pour y parvenir correctement. Une première étape pour les nationalistes de n’importe quel pays sera de s’approprier cette proposition, car elle est totalement antilibérale, réduisant l’argent à un serviteur plutôt qu’à un maître. Il faut faire campagne pour que cette mesure ne soit pas diabolisée, comme cela s'est produit il y a un siècle avec le repos dominical ou les congés payés, dénoncés comme catastrophiques pour l'économie, alors que la cupidité des grands hommes d'affaires, des multinationales et des finances constituait le grand obstacle afin que plus de 90 % de la population puisse simplement se reposer.
Il faut surtout montrer à travers des systèmes comme le RBU que personne n’est superflu et que la condition humaine n’est pas une simple condition animale, d’usage et de force. Les classes extractives n’hésiteront pas à recourir à l’eugénisme et au malthusianisme plutôt que d’accepter de partager une petite partie de leur butin.
15:42 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, contrat social, allocation universelle, revenu universel |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 31 mai 2025
Le GNL américain coûte trois fois plus cher à l'UE que le gaz russe acheminé par gazoduc

Le GNL américain coûte trois fois plus cher à l'UE que le gaz russe acheminé par gazoduc
Source: https://report24.news/us-lng-kostet-eu-dreimal-so-viel-wi...
Le gaz naturel liquéfié provenant des États-Unis est cher. Très cher. Mais pour des raisons idéologiques, on renonce au gaz bon marché acheminé par gazoduc depuis la Russie. Cela nuit aux consommateurs et à l'industrie en Europe. Combien de temps cela peut-il encore durer ?
La facture de la transition énergétique ratée de l'Europe commence à se faire sentir, et elle est plus élevée que certains ne l'avaient prévu. Alors que l'Union européenne mise de plus en plus sur les « énergies renouvelables » totalement peu fiables, telles que l'énergie éolienne et solaire, et souhaite abandonner complètement les importations de gaz russe d'ici 2027, les données actuelles d'Eurostat révèlent une réalité complexe: le gaz naturel liquéfié américain coûte déjà deux fois plus cher aux consommateurs européens que le GNL russe.
Les données publiées par la Berliner Zeitung parlent d'elles-mêmes. Au premier trimestre 2025, les pays de l'UE ont payé en moyenne 1,08 euro par mètre cube pour le GNL américain, tandis que le gaz naturel liquéfié russe coûtait 0,51 euro. Une différence de prix de plus de 100 %. Il est intéressant de noter que malgré tous les signaux politiques, l'UE continue d'importer des quantités considérables de gaz russe, ce qui montre clairement à quel point il est difficile dans la pratique de renoncer à cette source d'énergie rien que pour des raisons idéologiques.
Le volume des importations révèle une dépendance persistante
Les statistiques d'importation du premier trimestre 2025 brossent un tableau complexe de l'approvisionnement énergétique européen. Avec 13,4 milliards de mètres cubes, le GNL américain a dominé les importations de gaz liquéfié et représenté 48% de tous les achats de GNL de l'UE. Pour cette quantité, l'Union européenne a investi 14,7 milliards d'euros, une somme considérable qui illustre le prix de la diversification. Dans le même temps, l'UE a acheté 5,3 milliards de mètres cubes de GNL russe pour 2,7 milliards d'euros, soit une part de 19%.
La comparaison avec le gaz naturel russe acheminé par gazoduc est particulièrement révélatrice: à 0,32 euro le mètre cube, il ne coûte qu'environ un tiers du prix du GNL américain. Le gazoduc de la mer Noire a acheminé 5,3 milliards de mètres cubes supplémentaires, d'une valeur totale de 1,75 milliard d'euros, principalement vers la Hongrie et la Slovaquie. Ces chiffres montrent que, malgré sa réorientation politique, l'Europe reste fortement dépendante des approvisionnements énergétiques russes.
Il est intéressant d'examiner cette évolution dans son contexte historique: le système de connexions avantageuses par gazoducs, mis en place au fil des décennies, a longtemps procuré des avantages concurrentiels à l'Allemagne et à d'autres pays de l'UE. L'industrie allemande pouvait compter sur un approvisionnement énergétique fiable et peu coûteux, une base qui doit désormais être reconstruite, mais à un coût nettement plus élevé.
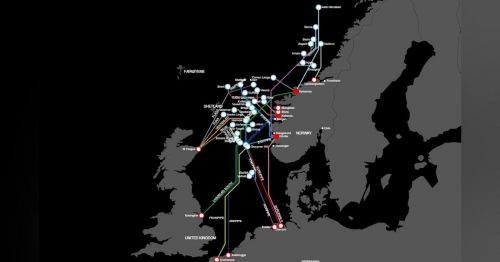
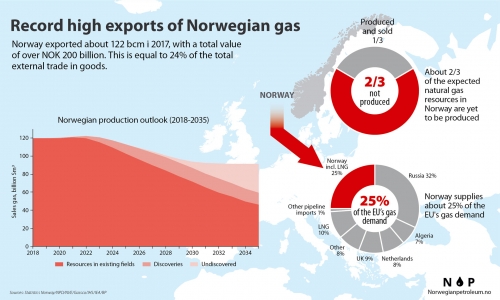
La Norvège, l'alternative la moins coûteuse
Les livraisons de gaz norvégien présentent une dynamique de prix intéressante. Le gaz acheminé par gazoduc depuis la Norvège ne coûtait que 0,24 euro par mètre cube à l'UE, soit un prix encore plus avantageux que celui du gaz russe acheminé par gazoduc. Cette différence de prix s'explique principalement par les voies de transport directes via les gazoducs établis en mer du Nord, tandis que le gaz russe doit être détourné via la Turquie et d'autres pays de transit en raison de la nouvelle situation géopolitique. Ces détournements augmentent considérablement le coût du transport. Cependant, la Norvège ne dispose pas d'une capacité de production suffisante pour approvisionner la moitié du continent en gaz naturel.
Au premier trimestre 2025, l'UE a acheté du gaz acheminé par gazoduc à des pays tiers pour un montant total de 10,2 milliards d'euros, la majeure partie provenant de la Norvège. Ces chiffres montrent clairement que les sources de gaz alternatives peuvent offrir des prix tout à fait compétitifs, mais uniquement si les voies de transport sont directes et exemptes de complications géopolitiques. À titre de comparaison, en 2021, le prix moyen à l'importation était encore d'environ 0,20 euro par mètre cube pour le gaz naturel acheminé par gazoduc, un niveau de prix qui semble appartenir à une autre époque compte tenu des développements actuels.
Bruxelles prévoit un arrêt complet des importations d'ici 2027
En mai 2025, la Commission européenne a présenté des plans ambitieux visant à mettre fin à toutes les importations de gaz russe d'ici fin 2027. Bruxelles souhaite mettre fin aux nouveaux contrats et aux contrats spot existants d'ici fin 2025. Afin de faciliter la sortie des entreprises des contrats à long terme, la Commission envisage des instruments juridiques tels que des droits de douane plus élevés ou des quotas zéro. Ces mesures doivent permettre aux entreprises énergétiques européennes d'invoquer la « force majeure » et de résilier les contrats à long terme sans pénalités.
Le calendrier est toutefois entaché de grandes incertitudes et les défis pratiques sont considérables. Les entreprises énergétiques européennes doivent non seulement trouver des sources d'approvisionnement alternatives, mais aussi faire face à des coûts nettement plus élevés, qui seront finalement répercutés sur les consommateurs et l'industrie.
La différence de prix entre le gaz américain et le gaz russe montre clairement quelles seront les charges financières qui pèseront sur les ménages et les entreprises. Pour les secteurs à forte consommation d'énergie, cela pourrait entraîner des désavantages géographiques qui ne pourront être pleinement évalués qu'à long terme.
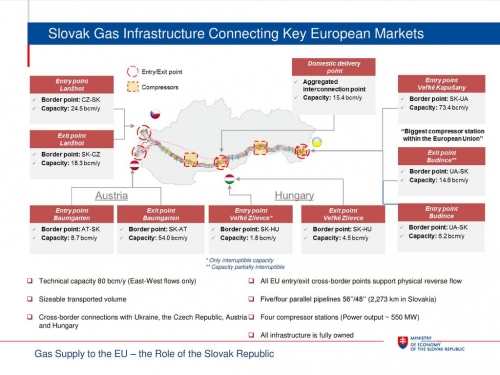
La Hongrie et la Slovaquie font résistance
Tous les États membres de l'UE ne soutiennent pas le rejet radical du gaz russe. La Hongrie et la Slovaquie ont déjà annoncé leur intention de bloquer les mesures prévues, car ces deux pays dépendent fortement, d'un point de vue structurel, des livraisons de gaz russe à bas prix. Leur situation géographique en fait des destinataires naturels du gaz russe acheminé par gazoduc via la route de la mer Noire. Un arrêt complet des importations exposerait ces pays à des problèmes d'approvisionnement considérables et à des augmentations de coûts drastiques.
La Commission européenne prévoit néanmoins d'imposer ses mesures à la majorité qualifiée, contournant ainsi le veto de certains États membres, notamment la Hongrie et la Slovaquie. Cette approche est toutefois politiquement explosive et pourrait peser davantage sur l'unité de l'Union européenne en matière d'énergie. La question reste légitime de savoir si une stratégie énergétique aussi coûteuse peut être maintenue à long terme sur le plan politique et économique, alors que les charges pour les consommateurs et l'industrie ne cessent d'augmenter. Après tout, ce ne sont pas seulement les budgets des ménages qui sont en jeu, mais aussi la compétitivité internationale des entreprises européennes – un aspect qui est parfois négligé dans le débat politique.
14:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gnl, gaz naturel, gazoducs, europe, affaires européennes, union européenne, énergie, hydrobarbures, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 mai 2025
Economie verte et écologisme néolibéral

Economie verte et écologisme néolibéral
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/business-ecologico-el-ambientalis...
Il existe un paradoxe apparent lié à la question de l'apocalypse environnementale qu'il convient d'aborder : le logo dominant dans le cadre du technocapitalisme du nouveau millénaire non seulement ne reste pas silencieux face au dilemme de la catastrophe imminente, mais l'élève au rang d'objet d'une prolifération discursive hypertrophique. L'urgence environnementale et climatique est, à juste titre, l'un des sujets les plus soulignés et les plus discutés dans l'ordre actuel du discours.
Cela semble, à première vue, une contradiction dans les termes, si l'on considère que poser ce dilemme revient à énoncer la contradiction même du capital, qui est son fondement. Ne serait-il pas plus cohérent avec l'ordre technocapitaliste d'occulter - ou du moins de marginaliser - cette question problématique, d'une manière similaire à ce qui se passe avec la question socio-économique du classisme et de l'exploitation du travail, rigoureusement exclue du discours public et de l'action politique ?
Affirmer que, contrairement au problème de l'exploitation du travail (qui reste largement invisible et qui, de toute façon, peut être facilement éludé par le discours dominant), la question environnementale est claire et évidente aux yeux de tous, oculos omnium, et que, par conséquent, il serait impossible de l'éviter comme si elle n'existait pas, revient à faire une affirmation vraie mais, en même temps, insuffisante: une affirmation qui, en outre, n'expliquerait pas les raisons pour lesquelles le discours dominant non seulement aborde ouvertement la question, en la reconnaissant dans sa pleine réalité, mais tend même à l'amplifier et à la transformer en une urgence et en une véritable urgence planétaire.

La thèse que nous entendons soutenir à cet égard est qu'il existe une différence notable entre la question environnementale et la question socio-économique (que Marx appellerait, sans périphrase et à juste titre, « lutte des classes »). Cette dernière ne peut en aucun cas être « normalisée » et métabolisée par l'ordre technocapitaliste qui, en fait, opère de telle sorte qu'elle n'est même, tendanciellement, jamais mentionnée (ni, ça va sans dire par les forces du camp gauche de la politique, depuis longtemps redéfini comme gauche néolibérale ou, mieux encore, « sinistrash » - gauche poubelle). Margaret Thacher, quant à elle, avait déjà ostracisé le concept même de classe sociale, le qualifiant de vestige inutile et pernicieux du communisme (selon ses propres termes : « la classe est un concept communiste. Il sépare les gens en groupes comme s'il s'agissait de parcelles et les monte ensuite les uns contre les autres").
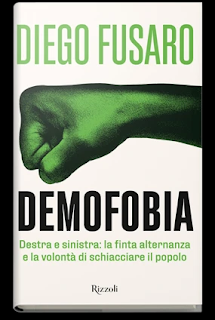 Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).
Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).
Contrairement à la question socio-économique, la question environnementale peut être métabolisée et - littéralement - rentabilisée par l'ordre technocapitaliste pour de multiples raisons. Précisons toutefois que l'ordre discursif néolibéral affronte et, en fait, amplifie la question environnementale et climatique dans l'acte même par lequel il la déclare abordable et résoluble mais toujours et seulement dans le cadre du technocapitalisme, neutralisant a priori la pensabilité de toute arrière-pensée ennoblissante éloignée de la prose de la réification du marché et de la Technique. Et c'est en fonction de cette clé herméneutique que s'explique l'intensification discursive néolibérale de l'urgence climatique et environnementale, toujours caractérisée par l'occultation de la matrice capitaliste des désastres.
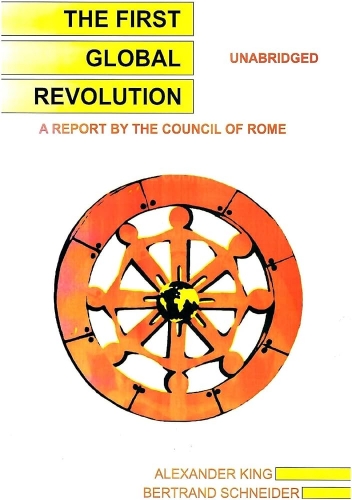
Bien canalisée dans les rails de la mondialisation néolibérale, la question environnementale peut jouer, pour l'ordre dominant, le rôle d'une fonction efficace de défocalisation du regard sur la question socio-économique, le classisme, l'exploitation et l'impérialisme. Pour comprendre cet usage apotropaïque dans toutes ses implications, on peut par exemple se référer au rapport de 1991 intitulé La première révolution mondiale, publié par le « Club de Rome », une association fondée en 1968 par l'homme d'affaires Aurelio Peccei, le scientifique écossais Alexander King et le turbo-capitaliste milliardaire David Rockefeller : une entité que l'on peut à juste titre classer parmi les nombreux think tanks (du Cato Institute à la Heritage Foundation, de l'Adam Smith Institute à l'Institute of Economic Affairs) au service de l'ordre dominant, auquel ils apportent une caution idéologique.
Ainsi, on peut lire dans le rapport de 1991 : « Dans la recherche d'un nouvel ennemi qui pourrait nous unir, nous avons trouvé l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, la pénurie d'eau potable, la faim et d'autres choses du même genre serviraient notre objectif ». En somme, la question verte doit être habilement identifiée comme une contradiction fondamentale et un « ennemi commun » capable de nous unir ("un nouvel ennemi pour nous unir") dans une bataille qui, d'une part, détourne le regard du conflit entre le Serviteur et le Seigneur et, d'autre part, conduit le premier à adhérer à nouveau à l'agenda du second, notamment aux nouvelles voies du capitalisme écologique telles qu'elles seront sculptées dans les années à venir.
Le rapport du Club de Rome peut être accompagné d'un autre document datant de deux ans plus tôt qui, malgré les différences de nuances et d'intensité des approches, propose un schéma de pensée convergent. Il s'agit d'un discours prononcé par Margaret Thatcher le 8 novembre 1989 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est animé, entre les lignes, par la volonté d'identifier un nouvel « ennemi commun » pour remplacer le « socialisme réel », déjà en déclin (il est significatif que le discours de la Dame de fer ait eu lieu à la veille de la chute du mur de Berlin). Et que, par conséquent, il peut être assumé comme le nouveau défi global au capitalisme, en impliquant tout le monde dans son projet. Selon Thatcher, « de tous les défis auxquels la communauté mondiale a été confrontée au cours de ces quatre années, l'un d'entre eux est devenu plus évident que tous les autres, à la fois en termes d'urgence et d'importance : je veux parler de la menace qui pèse sur notre environnement mondial ».
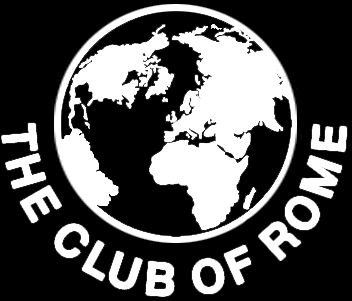
Le sermon de la Dame de fer est parfois encore plus symptomatique du nouvel esprit du temps que le rapport du « Club de Rome », en particulier dans son insistance sur la nécessité de traiter la question environnementale sans renoncer à l'impératif de croissance, préservant ainsi le capitalisme sous une forme éco-durable tout en se consacrant à la croissance économique. Pour reprendre les termes de Thatcher, « nous devons faire ce qu'il faut sur le plan économique. Cela signifie que nous devons d'abord avoir une croissance économique continue afin de générer la richesse nécessaire pour payer la protection de l'environnement ». L'astuce - une constante dans l'ordre du discours néolibéral - consiste à dénoncer le problème environnemental, en accompagnant immédiatement la dénonciation de la reconnaissance que la croissance, le développement et les auri sacra fames - la faim d'or maudite - du capital ne sont pas la cause, mais la solution possible : « nous devons résister à la tendance simpliste de blâmer l'industrie multinationale moderne pour les dommages causés à l'environnement. Loin d'être les méchants, ce sont eux sur qui nous comptons pour enquêter et trouver des solutions ».
Ainsi, suivant le discours de Thatcher, qui résume le nouvel esprit du capitalisme vert in statu nascendi - en phase d'émergence - la critique du capitalisme comme cause de la destruction de l'environnement (en un mot, l'environnementalisme socialiste) serait une « tendance simpliste », du fait que les industries multinationales, « loin d'être les méchants », sont les agents qui peuvent mener les recherches et trouver les solutions au dilemme. Cependant, le non sequitur dans lequel la réflexion de Thatcher, et avec elle, la raison d'être néolibérale elle-même, s'enlisent est que, même à supposer que les entreprises multinationales puissent trouver la solution, cela ne peut servir d'alibi à leur responsabilité dans la genèse de la tragédie, comme semble l'indiquer le passage cité plus haut. Et, de toute façon, comme nous essaierons de le montrer, les « solutions » recherchées et trouvées par l'industrie multinationale moderne évoluent toujours sur la base de l'acceptation (et de la reproduction perpétuelle) de la contradiction qui génère le problème.
Par conséquent, l'ordre hégémonique admet et même encourage le discours sur la catastrophe, tant qu'il est invariablement articulé dans les périmètres du cosmos technocapitaliste, supposé comme un a priori historique non modifiable ou, en tout cas, comme le meilleur système possible à la fois parmi ceux qui ont déjà existé et parmi ceux qui pourraient éventuellement exister en tant qu'alternative.
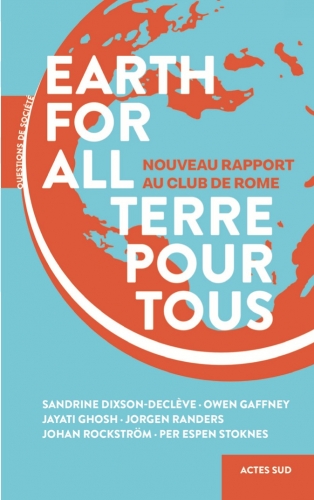
L'évocation constante de la catastrophe climatique et l'exigence d'y remédier sont donc permises et d'ailleurs constamment induites, à condition que les recettes et les solutions soient administrées par la logique du profit et le maintien de la forme valeur comme fondement du système de production.
Enfin, si l'environnementalisme néolibéral est ouvertement promu et pratiqué par les modèles politiques de l'Occident - ou, plus précisément, de l'Ouest -, l'environnementalisme socialiste est découragé et diabolisé, soit sur la base de ce que Fisher a défini comme le « réalisme capitaliste » (selon lequel il n'y aurait pas d'alternatives à ce qui existe), soit sur la base de la stigmatisation de la passion utopique et anti-adaptative, idéologiquement assumée comme prémisse à la violence et au retour des atrocités du 20ème siècle.
En d'autres termes, le turbo-capitalisme pose et débat la question de l'apocalypse verte en se présentant comme la solution et non comme l'origine du problème: ainsi, tout en cultivant les causes de la catastrophe, il se propose de travailler sur les effets, dans une perspective qui, de surcroît, est fonctionnelle à la préservation de la logique du capitalisme lui-même. Il va sans dire qu'affronter le dilemme environnemental en restant sur le terrain du technocapitalisme signifie, dans la meilleure des hypothèses, ne pas le résoudre et, dans la pire (comme nous pensons que c'est effectivement le cas), renforcer encore les bases de la catastrophe.
En particulier, nous tenterons de montrer comment, sous la forme de l'environnementalisme néolibéral, le discours turbo-capitaliste sur l'apocalypse verte tente, d'une part, de moduler les stratégies de résolution de la catastrophe qui, présupposant l'ordre technocapitaliste et son maintien, sont toutes vouées à l'échec et, d'autre part, de neutraliser préventivement la viabilité de l'option de l'environnementalisme socialiste. Sans exagérer, si le logo hégémonique s'approprie le discours environnemental, c'est en raison de sa volonté de le sortir du camp socialiste pour le ramener - et donc le « normaliser » - sur le terrain néolibéral, plutôt qu'en raison de sa volonté réelle de remédier au cataclysme qui s'annonce. D'autre part, pour les porte-drapeaux du fanatisme techno-économique - pour paraphraser Jameson - il est plus facile et moins douloureux d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.

L'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale s'explique par trois raisons principales, qui seront examinées ci-dessous : (a) la transformation de l'urgence environnementale elle-même en une source d'extraction de la plus-value, qui se produit surtout en vertu du système manipulateur de l'économie verte et de ses « sources renouvelables » d'affaires ; (b) le brouillage du regard par rapport au conflit socio-économique (qui, comme on l'a rappelé, ne peut être incorporé et normalisé dans l'ordre technocapitaliste, contrairement à la question environnementale) ; (c) la fabrique de la crise et le gouvernement de l'économie de marché, qui sont les principaux responsables de l'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale ; c) la fabrique de la crise et l'utilisation gouvernementale de l'urgence, sous la forme d'un « Léviathan vert » qui utilise la crise elle-même comme ars regendi - l'art de gouverner - pour consolider, optimiser et étendre la domination technocapitaliste sur la vie.
Sur la base de ces hypothèses, l'économie verte peut être comprise à juste titre comme la solution que la raison néolibérale propose pour la question environnementale, dans une tentative non pas tant de sauver la planète (et avec elle, la vie) du capitalisme, mais de sauver le capitalisme lui-même des impacts environnementaux et climatiques. En d'autres termes, l'économie verte aspire à garantir que le capital puisse, de quelque manière que ce soit, surmonter sa contradiction intrinsèque qui se traduit par l'épuisement des ressources et la neutralisation du « remplacement organique » de la mémoire marxienne : pour rendre cela possible, le punctum quaestionis - l'état de la question - conduit à la redéfinition du capitalisme lui-même, selon une nouvelle configuration verte, qui lui permet de poursuivre la valorisation de la valeur, en évitant la récession et en reportant dans le temps l'éclatement de la contradiction.
Les élites turbo-financières apatrides s'approprient les revendications écologistes croissantes, nées dans les années 1970 et devenues de plus en plus solides, et les détournent vers les circuits de l'économie verte, en cohérence avec laquelle la limite environnementale doit être perçue non pas comme un obstacle au développement, mais comme une opportunité de profit sans précédent, comme un moteur de croissance renouvelé et comme le fondement d'un nouveau cycle d'accumulation.
L'erreur qui est à la base de l'« économie verte » et, plus généralement, de l'environnementalisme néolibéral dans toutes ses extra-inspections, peut être facilement identifiée dans la conviction générale que la contradiction ne réside pas dans le capitalisme en tant que tel, mais dans son fonctionnement, encore insuffisamment calibré pour trouver un équilibre avec la nature.
En somme, le capitalisme est perçu comme la thérapie d'un mal qui, tout au plus, peut être compris comme la conséquence d'une application encore perfectible du capitalisme lui-même. Il va sans dire que ce qui échappe à la raison d'être néolibérale, c'est que, comme Marx et Heidegger l'ont montré - bien que sur des bases différentes - c'est le fondement même du technocapitalisme qui consomme les entités dans leur totalité et conduit à l'épuisement de la nature.

En bref, le capitalisme n'est pas malade, comme les hérauts de l'économie verte et de l'environnementalisme néolibéral semblent vouloir le suggérer : il est la maladie. Il ne s'agit donc pas de guérir le capitalisme, mais de guérir l'humanité et la planète du capitalisme. Cela signifie que ni la justice sociale ni même un véritable environnementalisme ne peuvent exister sans l'anticapitalisme. Prétendre guérir le capitalisme signifie seulement perpétuer, sous de nouvelles formes, le système d'oppression de l'homme et de la nature par l'homme.
La dévastation de l'environnement et le changement climatique générés à son image par le technocapital (heideggérien dans son « oubli de l'Être » et sa volonté de puissance de croissance démesurée) deviennent, grâce à l'économie verte, un phénomène par lequel la ruse de la raison capitaliste (comme nous pourrions aussi l'appeler, en empruntant la formule hégélienne), se trompe elle-même en croyant pouvoir résoudre la contradiction, désormais indéniable parce qu'attestée par les données scientifiques et l'expérience quotidienne.
En d'autres termes, puisque la contradiction est réelle et évidente, et que ses effets désastreux tendent à se manifester dès le temps présent, l'ordre libéral s'emploie à la résoudre par des méthodes qui ne remettent pas en cause l'ordre capitaliste lui-même et qui, de surcroît, permettent de le maintenir et même de le renforcer.
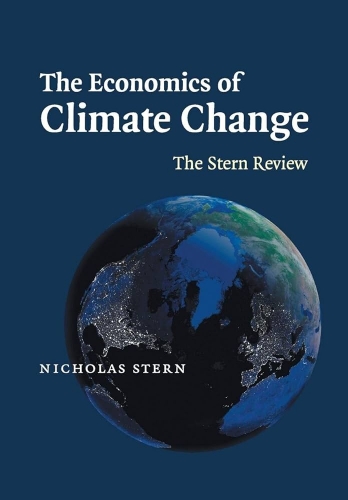
Selon la ligne théorico-pratique ouverte par le « Rapport Stern » (2006), l'économie verte conçoit de nouvelles sources de profit qui, sans affecter réellement le processus de production, ont simplement - ou semblent avoir - moins d'impact sur l'environnement et le climat. En substance, ils recommandent que nous fassions simplement ce que nous faisons déjà, mais d'une manière verte. Ainsi, non seulement le capitalisme se trompe lui-même (et nous trompe) en prétendant avoir trouvé la solution à la catastrophe environnementale dont il a été l'un des principaux responsables, mais il se revitalise et revitalise sa propre logique en modifiant les hypothèses du mode de production et en conquérant de nouveaux marchés, en inventant de nouvelles stratégies et en encourageant la consommation de nouvelles marchandises « éco-durables ».
17:34 Publié dans Actualité, Ecologie, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, économie verte, club de rome, diego fusaro, philosophie, philosophie politique, capitalisme, actualité, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 mai 2025
Les exportations chinoises augmentent malgré les droits de douane américains

Les exportations chinoises augmentent malgré les droits de douane américains
Source: https://dissident.one/chinese-export-stijgt-ondanks-ameri...
La Chine enregistre des exportations record en avril, à la veille de négociations commerciales de première importance avec les États-Unis.
Les exportations chinoises ont fortement augmenté en avril malgré les droits de douane imposés par Donald Trump sur les expéditions vers les États-Unis à l'occasion du « Jour de la libération ». Cela a renforcé la position de Pékin à l'approche de négociations commerciales de toute première importance qui débutent ce week-end, rapporte le FT.
Ces bons résultats ont été obtenus alors que les entreprises chinoises ont réorienté leurs flux commerciaux vers l'Asie du Sud-Est, l'Europe et d'autres destinations après que des droits de douane excessifs ont été imposés par les deux plus grandes économies du monde.
Les douanes chinoises ont indiqué vendredi que les exportations en dollars avaient augmenté de 8,1% par rapport à l'année précédente. La croissance a ainsi dépassé les prévisions des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une croissance de 1,9%. Il s'agit toutefois d'un ralentissement par rapport à la croissance de 12,4% enregistrée en mars, lorsque les chiffres étaient soutenus par les exportateurs qui voulaient devancer les droits de douane prévus en expédiant leurs marchandises aux États-Unis.
Les importations ont diminué de 0,2% en avril. C'est le troisième mois consécutif de baisse des importations. Cette situation suscite des inquiétudes quant aux excédents commerciaux croissants de la Chine. Ces excédents sont à l'origine d'une grande partie des tensions avec les États-Unis.
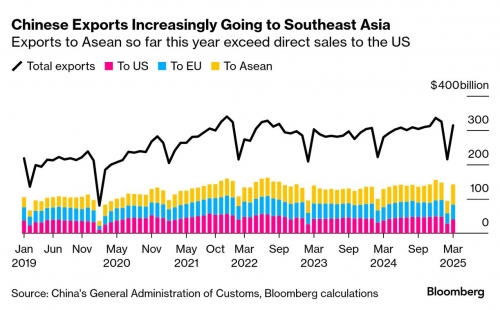
« Cela semble encore pire pour les États-Unis à l'approche des négociations commerciales », a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Grande Chine auprès de la banque ING. Elle a ajouté que la contraction des importations chinoises semble s'être faite au détriment des exportations américaines vers le pays.
Selon Heron Lim, économiste chez Moody's Analytics, les échanges commerciaux de la Chine avec les États-Unis ont chuté de 21% en glissement annuel en avril, mais les échanges avec les pays d'Asie du Sud-Est ont augmenté dans les mêmes proportions et ceux avec l'UE ont progressé de 8%.
« Les expéditions vers l'Indonésie, la Thaïlande et le Viêt Nam ont connu les plus fortes augmentations », a déclaré M. Lim.
Ces bons résultats devraient accroître la pression sur les représentants commerciaux américains, qui s'apprêtent à rencontrer leurs homologues chinois pour des négociations à Genève, à partir de samedi.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant commercial Jamieson Greer représenteront les États-Unis, tandis que la Chine a déclaré que sa délégation serait dirigée par le vice-premier ministre He Lifeng, le plus haut responsable économique chinois.
Le mois dernier, M. Trump a augmenté les droits d'importation sur la plupart des produits chinois jusqu'à 145% et a annoncé qu'il imposerait de nouveaux droits même sur les petits paquets en provenance du pays. Pékin a réagi en imposant des droits d'importation de 125%.
Dans un premier temps, il a également imposé des droits de douane punitifs au Viêt Nam, à la Thaïlande et à d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui ont accumulé d'énormes excédents commerciaux avec les États-Unis. De nombreuses entreprises ont construit des sites de production dans ces pays pour remplacer la Chine.
Trump a ensuite annoncé une pause de 90 jours sur les droits de douane du « Jour de la Libération », dans l'attente de négociations avec la plupart des pays, à l'exception de la Chine.
Les exportateurs ont donc eu la possibilité d'acheminer leurs marchandises vers les États-Unis via l'Asie du Sud-Est.
Jens Eskelund, président de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine, a déclaré jeudi que le nombre de réservations pour des expéditions chinoises vers les États-Unis avait chuté de 30 à 50%. Il a toutefois précisé que le nombre de réservations pour le reste du monde avait en fait augmenté.
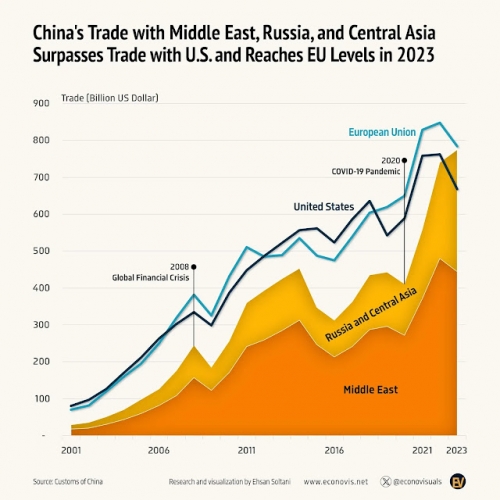
« Les exportations chinoises vers le reste de l'Asie semblent particulièrement performantes, mais aussi vers le Moyen-Orient et, dans une certaine mesure, vers l'Europe », a-t-il déclaré. « Bien sûr, la Chine est touchée... mais nous constatons que, dans une certaine mesure, d'autres marchés peuvent absorber une partie des marchandises qui ne sont pas destinées aux États-Unis ».
L'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis s'est élevé à 20,46 milliards de dollars en avril, pour un total de 96,2 milliards de dollars. Toutefois, les exportations vers les États-Unis ont chuté de 17,6% par rapport au mois précédent, ce qui indique que la Chine a développé ses échanges avec d'autres marchés.
Dans un communiqué analysant le commerce en renminbi chinois au cours des quatre derniers mois, les fonctionnaires des douanes ont noté que le commerce avec les pays d'Asie du Sud-Est, l'UE et le long de l'initiative Belt and Road, le principal projet d'infrastructure internationale de Pékin, avait augmenté. Les échanges avec les États-Unis ont diminué, a-t-on ajouté.
Jorge Toledo, ambassadeur de l'UE en Chine, a critiqué vendredi le déficit commercial croissant entre la Chine et le reste du monde. Il a ajouté que les contrôles des exportations de Pékin et « l'absence de règles du jeu équitables pour les entreprises européennes » suscitaient « d'énormes inquiétudes ».
« La situation ne s'améliore pas... il faut faire quelque chose », a-t-il déclaré à la China Europe International Business School de Shanghai.
Selon l'agence de presse nationale chinoise Xinhua, Lu Daliang, porte-parole des douanes, a déclaré que « la coopération globale de la Chine avec les pays voisins continue de s'approfondir et que les relations économiques et commerciales sont de plus en plus étroites ».
10:48 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, droits de douane, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 mai 2025
Les droits de douane de Trump: une politique économique à la puissance géopolitique explosive

Les droits de douane de Trump: une politique économique à la puissance géopolitique explosive
Ramesh Thakur
Source: https://uncutnews.ch/trumps-zoelle-wirtschaftspolitik-mit-geopolitischer-sprengkraft/
La carrière politique de Donald Trump montre de manière impressionnante que son rejet par les élites et les médias ne correspond pas à l'état d'esprit d'une grande partie de la population. Derrière sa politique souvent critiquée comme chaotique, il y a bien une logique stratégique : en politique intérieure comme extérieure, Trump poursuit l'objectif de « rendre sa grandeur à l'Amérique ».
Le souci n'est pas tant que sa politique n'ait pas de plan, mais que sa mise en œuvre soit menacée par l'incompétence ou l'amateurisme - comme par exemple l'utilisation de groupes de discussion non sécurisés pour des informations sensibles.
Son projet politique comprend trois piliers centraux :
- En politique intérieure, il veut abolir les objectifs nets zéro, les réglementations DEI (diversité, égalité, inclusion) et l'auto-identification de genre - tous des ensembles de règles qui, selon lui, paralysent l'économie et la société tout en favorisant les divisions identitaires.
- En politique étrangère, il aspire à se retirer des guerres sans fin, à répartir plus équitablement le fardeau de la défense entre les alliés et à se retirer d'un mondialisme qui a érodé la base industrielle de l'Amérique.
- Au-delà des frontières, il voit dans l'immigration de masse une menace qui relie la politique intérieure et la politique extérieure.
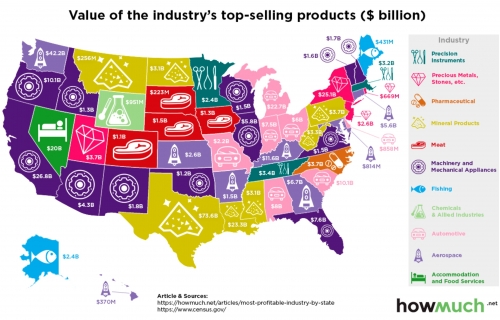
Trump en est convaincu : cet agenda doit restaurer la fierté nationale, protéger l'Amérique contre l'exploitation et faire en sorte que les Etats-Unis redeviennent la première puissance industrielle et militaire.
Les droits de douane : Trump rompt avec le mondialisme
C'est là que la politique douanière de Trump intervient comme outil central. Historiquement, le libre-échange était considéré comme une situation gagnant-gagnant dans la théorie économique - mais dans la pratique, il a fait des gagnants et des perdants. Selon Trump, la mondialisation a récompensé les « élites de partout », tandis que les travailleurs et les régions intérieures (« les gens de nulle part ») ont perdu.
Les droits de douane doivent précisément corriger cela. Ils pénalisent la délocalisation de la production à l'étranger, encouragent le rapatriement de l'industrie aux Etats-Unis et doivent renforcer à nouveau la cohésion sociale. Le nationalisme de Trump suit le principe suivant : les hommes sont des citoyens de nations, et non de simples unités d'une économie mondiale.
Une politique commerciale qui renforce l'économie chinoise mais affaiblit la production américaine est en contradiction avec ce principe. Le contrat social entre le gouvernement et les citoyens ne peut être maintenu que si les intérêts du peuple ont la priorité sur les règles des marchés mondiaux.
Renégocier l'ordre commercial - ou le rompre ?
La thèse de Trump : l'ordre commercial mondial - par exemple par le biais de l'OMC - serait incapable d'imposer des règles équitables contre des acteurs comme la Chine ou le mercantilisme de l'UE. Ses droits de douane punitifs sont donc des moyens de négociation, voire des instruments de pression, pour contraindre d'autres pays à offrir de meilleures conditions.
Dans le même temps, il prend le risque que les pays concernés tentent de se détourner stratégiquement des Etats-Unis - mais Trump fait le pari qu'aucune nation ne préférera à long terme choisir la Chine comme partenaire. Des exemples comme le Zimbabwe, qui a suspendu les droits de douane américains, ou la Grande-Bretagne, qui dépense davantage pour la défense malgré des coupes dans la santé et l'aide au développement, montrent pour lui les premiers succès.

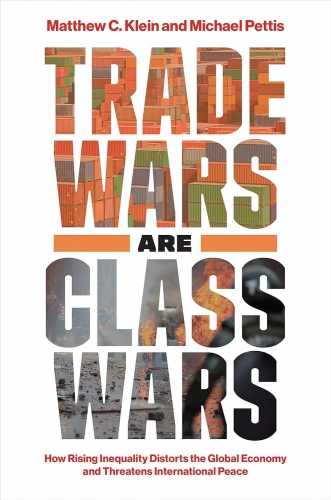
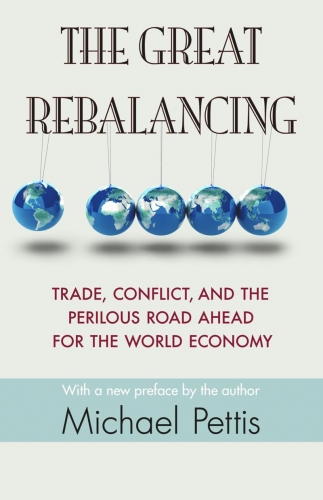
Objectif : un nouvel équilibre mondial
Selon l'économiste Michael Pettis (photo), le commerce mondial est devenu de plus en plus dysfonctionnel: les déséquilibres économiques intérieurs ont été traduits en déséquilibres mondiaux par des droits de douane, des subventions et des obstacles au commerce. L'approche de Trump veut recalibrer ce système: s'éloigner d'un ordre mondial qui subordonne les intérêts nationaux à la logique du système.
Ce qui, à long terme, devrait aboutir à:
- une plus grande croissance des salaires,
- une parité commerciale équitable
- et à une production industrielle plus robuste.
Focalisation stratégique: endiguer la Chine
Pour Trump, la Chine est la plus grande menace stratégique, tant sur le plan économique que militaire. Son idée d'une paix en Ukraine s'inscrit donc également dans une stratégie plus large: détacher la Russie de la Chine, de la même manière que Nixon avait autrefois détaché la Chine de l'Union soviétique.
La reconnaissance officielle par la Maison Blanche d'une éventuelle fuite du laboratoire de Wuhan pourrait également faire partie de cette stratégie d'isolement vis-à-vis de la Chine. L'historien Victor Davis Hanson le résume ainsi: le fil conducteur de la politique de Trump - du Panama à l'Ukraine, de DEI à la politique énergétique - est la crainte de voir la Chine établir une nouvelle sphère d'hégémonie en Asie de l'Est, comme le Japon l'a fait dans les années 1940.
Les droits de douane comme moyen de protéger la souveraineté
Pour Trump, la parité commerciale est cruciale : la Chine monte en gamme, les Etats-Unis stagnent. Mais les Etats-Unis sont encore en tête pour de nombreux facteurs clés. Pour défendre cela, il faut, selon Trump :
- Des budgets disciplinés;
- Des frontières sûres;
- Une éducation axée sur la performance;
- Une indépendance énergétique
- et une réorientation stratégique des relations commerciales mondiales.
Conclusion : risque de guerre froide, mais protection par l'autarcie
Le risque est de voir se développer une nouvelle guerre froide par le biais de spirales tarifaires réciproques. Mais les leçons de la crise COV ID sont claires: les chaînes d'approvisionnement en provenance de Chine sont vulnérables - politiquement et logistiquement.
La réponse de Trump: renforcer l'industrie nationale, y compris dans le domaine de l'armement. L'autarcie est un prix à payer pour la souveraineté et la liberté.
*
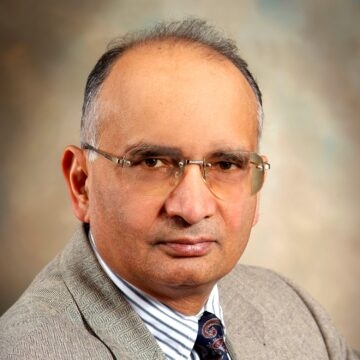
Ramesh Thakur, chercheur senior au Brownstone Institute, est ancien secrétaire général adjoint des Nations unies et professeur émérite à la Crawford School of Public Policy de l'Australian National University.
Source : https://brownstone.org/articles/making-sense-of-trumps-ta...
11:58 Publié dans Actualité, Actualité, Economie, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : donald trump, états-unis, droits de douane, tarifs douaniers, économie, actualité, donald trump, états-unis, droits de douane, tarifs douaniers, économie, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les droits de douane de Trump: une politique économique à la puissance géopolitique explosive

Les droits de douane de Trump: une politique économique à la puissance géopolitique explosive
Ramesh Thakur
Source: https://uncutnews.ch/trumps-zoelle-wirtschaftspolitik-mit-geopolitischer-sprengkraft/
La carrière politique de Donald Trump montre de manière impressionnante que son rejet par les élites et les médias ne correspond pas à l'état d'esprit d'une grande partie de la population. Derrière sa politique souvent critiquée comme chaotique, il y a bien une logique stratégique : en politique intérieure comme extérieure, Trump poursuit l'objectif de « rendre sa grandeur à l'Amérique ».
Le souci n'est pas tant que sa politique n'ait pas de plan, mais que sa mise en œuvre soit menacée par l'incompétence ou l'amateurisme - comme par exemple l'utilisation de groupes de discussion non sécurisés pour des informations sensibles.
Son projet politique comprend trois piliers centraux :
- En politique intérieure, il veut abolir les objectifs nets zéro, les réglementations DEI (diversité, égalité, inclusion) et l'auto-identification de genre - tous des ensembles de règles qui, selon lui, paralysent l'économie et la société tout en favorisant les divisions identitaires.
- En politique étrangère, il aspire à se retirer des guerres sans fin, à répartir plus équitablement le fardeau de la défense entre les alliés et à se retirer d'un mondialisme qui a érodé la base industrielle de l'Amérique.
- Au-delà des frontières, il voit dans l'immigration de masse une menace qui relie la politique intérieure et la politique extérieure.
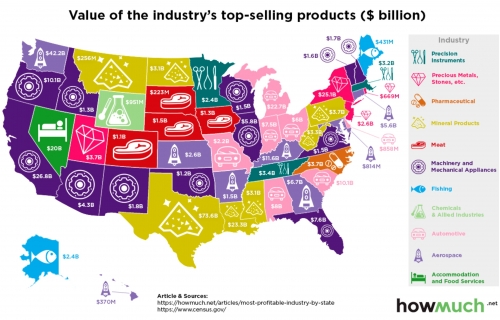
Trump en est convaincu : cet agenda doit restaurer la fierté nationale, protéger l'Amérique contre l'exploitation et faire en sorte que les Etats-Unis redeviennent la première puissance industrielle et militaire.
Les droits de douane : Trump rompt avec le mondialisme
C'est là que la politique douanière de Trump intervient comme outil central. Historiquement, le libre-échange était considéré comme une situation gagnant-gagnant dans la théorie économique - mais dans la pratique, il a fait des gagnants et des perdants. Selon Trump, la mondialisation a récompensé les « élites de partout », tandis que les travailleurs et les régions intérieures (« les gens de nulle part ») ont perdu.
Les droits de douane doivent précisément corriger cela. Ils pénalisent la délocalisation de la production à l'étranger, encouragent le rapatriement de l'industrie aux Etats-Unis et doivent renforcer à nouveau la cohésion sociale. Le nationalisme de Trump suit le principe suivant : les hommes sont des citoyens de nations, et non de simples unités d'une économie mondiale.
Une politique commerciale qui renforce l'économie chinoise mais affaiblit la production américaine est en contradiction avec ce principe. Le contrat social entre le gouvernement et les citoyens ne peut être maintenu que si les intérêts du peuple ont la priorité sur les règles des marchés mondiaux.
Renégocier l'ordre commercial - ou le rompre ?
La thèse de Trump : l'ordre commercial mondial - par exemple par le biais de l'OMC - serait incapable d'imposer des règles équitables contre des acteurs comme la Chine ou le mercantilisme de l'UE. Ses droits de douane punitifs sont donc des moyens de négociation, voire des instruments de pression, pour contraindre d'autres pays à offrir de meilleures conditions.
Dans le même temps, il prend le risque que les pays concernés tentent de se détourner stratégiquement des Etats-Unis - mais Trump fait le pari qu'aucune nation ne préférera à long terme choisir la Chine comme partenaire. Des exemples comme le Zimbabwe, qui a suspendu les droits de douane américains, ou la Grande-Bretagne, qui dépense davantage pour la défense malgré des coupes dans la santé et l'aide au développement, montrent pour lui les premiers succès.

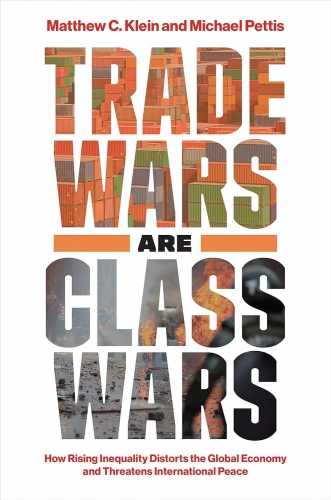
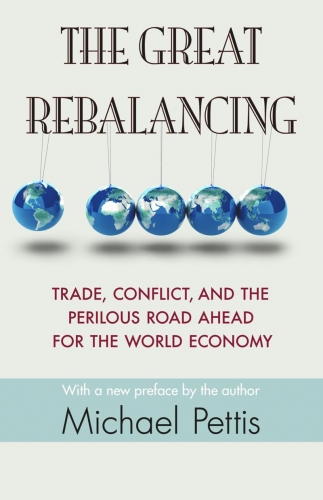
Objectif : un nouvel équilibre mondial
Selon l'économiste Michael Pettis (photo), le commerce mondial est devenu de plus en plus dysfonctionnel: les déséquilibres économiques intérieurs ont été traduits en déséquilibres mondiaux par des droits de douane, des subventions et des obstacles au commerce. L'approche de Trump veut recalibrer ce système: s'éloigner d'un ordre mondial qui subordonne les intérêts nationaux à la logique du système.
Ce qui, à long terme, devrait aboutir à:
- une plus grande croissance des salaires,
- une parité commerciale équitable
- et à une production industrielle plus robuste.
Focalisation stratégique: endiguer la Chine
Pour Trump, la Chine est la plus grande menace stratégique, tant sur le plan économique que militaire. Son idée d'une paix en Ukraine s'inscrit donc également dans une stratégie plus large: détacher la Russie de la Chine, de la même manière que Nixon avait autrefois détaché la Chine de l'Union soviétique.
La reconnaissance officielle par la Maison Blanche d'une éventuelle fuite du laboratoire de Wuhan pourrait également faire partie de cette stratégie d'isolement vis-à-vis de la Chine. L'historien Victor Davis Hanson le résume ainsi: le fil conducteur de la politique de Trump - du Panama à l'Ukraine, de DEI à la politique énergétique - est la crainte de voir la Chine établir une nouvelle sphère d'hégémonie en Asie de l'Est, comme le Japon l'a fait dans les années 1940.
Les droits de douane comme moyen de protéger la souveraineté
Pour Trump, la parité commerciale est cruciale : la Chine monte en gamme, les Etats-Unis stagnent. Mais les Etats-Unis sont encore en tête pour de nombreux facteurs clés. Pour défendre cela, il faut, selon Trump :
- Des budgets disciplinés;
- Des frontières sûres;
- Une éducation axée sur la performance;
- Une indépendance énergétique
- et une réorientation stratégique des relations commerciales mondiales.
Conclusion : risque de guerre froide, mais protection par l'autarcie
Le risque est de voir se développer une nouvelle guerre froide par le biais de spirales tarifaires réciproques. Mais les leçons de la crise COV ID sont claires: les chaînes d'approvisionnement en provenance de Chine sont vulnérables - politiquement et logistiquement.
La réponse de Trump: renforcer l'industrie nationale, y compris dans le domaine de l'armement. L'autarcie est un prix à payer pour la souveraineté et la liberté.
*
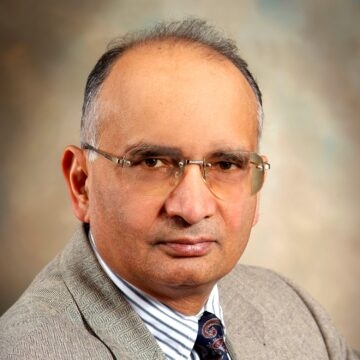
Ramesh Thakur, chercheur senior au Brownstone Institute, est ancien secrétaire général adjoint des Nations unies et professeur émérite à la Crawford School of Public Policy de l'Australian National University.
Source : https://brownstone.org/articles/making-sense-of-trumps-ta...
11:58 Publié dans Actualité, Actualité, Economie, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : donald trump, états-unis, droits de douane, tarifs douaniers, économie, actualité, donald trump, états-unis, droits de douane, tarifs douaniers, économie, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 avril 2025
7 avril 2025: un "Lundi noir"

7 avril 2025: un "Lundi noir"
Leonid Savin
Le 7 avril 2025, des fluctuations brusques des cours des actions et des prix de diverses ressources (y compris le pétrole et le gaz) ont été ressenties dans tous les pays. Leurs indicateurs ont chuté et ont varié de six à trente pour cent. Plusieurs bourses dans différents pays ont fermé plus tôt en raison des craintes d'une baisse continue des indices. Les cryptomonnaies ont suivi le marché boursier traditionnel et se sont effondrées en moyenne de dix pour cent. Des trillions de dollars ont ainsi « brûlé » lors des échanges. Seule une légère hausse a été observée sur les bourses internationales pour l'euro, le dollar américain, l'or et l'argent. Ces interrelations ont encore une fois montré où se dirigent les investisseurs internationaux en cas de situations floues sur les marchés boursiers.
Apparemment, la clarté ne semble pas se profiler à l'horizon. Les analystes financiers ont prédit un maintien de la volatilité à un niveau d'environ 10 % dans un avenir proche.
Cependant, contrairement à de nombreux « jours noirs » précédents dans l'histoire, la tempête financière actuelle était attendue à l'avance.
La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré la semaine dernière que les mesures tarifaires « présentent clairement un risque significatif pour les perspectives mondiales dans une période de faible croissance économique. Il est important d'éviter des mesures qui pourraient causer encore plus de dommages à l'économie mondiale. Nous encourageons les États-Unis et leurs partenaires commerciaux à travailler de manière constructive pour résoudre les tensions commerciales et réduire l'incertitude ».
Il était également prévu que les exportations américaines, en particulier en provenance des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, diminueraient à court terme, alors que les partenaires commerciaux réduiraient leurs importations. Les producteurs américains souffriraient d'une baisse des revenus — comme cela s'est produit avec les agriculteurs américains de soja pendant la guerre commerciale de 2018-2019 — tandis que d'autres pays s'efforceraient de combler le vide laissé par les États-Unis.
Les mesures de rétorsion de la part d'autres pays pourraient également entraîner une augmentation des tarifs existants aux États-Unis, ce qui nuirait aux consommateurs, car les entreprises devraient soutenir des coûts sous la forme de prix plus élevés. On s'attend à ce que le ménage américain moyen soit déjà confronté à une augmentation des dépenses de plus de 1200 dollars par an. L'imposition de tarifs de réciprocité a également suscité d'autres inquiétudes, notamment l'impact potentiel sur le marché boursier américain et la diminution de la confiance des alliés dans le leadership économique des États-Unis.
Et cela se passe maintenant.
Il y avait cependant un aspect intéressant qui maintenait le suspense : les investisseurs et les dirigeants politiques s'efforçaient de déterminer si les tarifs de Trump faisaient partie d'un nouveau régime permanent ou d'une tactique de négociation visant à obtenir des concessions de la part d'autres pays.

Il semble que les deux options soient possibles : Trump utilisera cette situation pour des négociations bilatérales ciblées, défendant les intérêts américains tout en représentant une tendance qui caractérisera son deuxième mandat présidentiel (avec la possibilité que cette politique se poursuive sous son successeur, J. D. Vance).
Il n'est pas surprenant qu'il ait déclaré que l'UE devrait également payer les États-Unis en remboursant les dettes, et que la Chine devrait équilibrer son commerce extérieur en éliminant le déficit existant vis-à-vis des États-Unis. Cela rappelle déjà les vieux mécanismes de la Realpolitik, et non la magie noire du turbocapitalisme ou même du zeta-capitalisme (terme utilisé pour décrire une économie liée au secteur technologique de l'information de haute technologie, qui inclut les principales entreprises informatiques mondiales).
Cependant, puisque tous ces impulsions précédentes venaient des États-Unis, on peut se demander si Donald Trump ne nuira pas à son propre pays avec ses mesures tarifaires.
Les partisans de l'économie libérale mondiale affirmaient déjà avant l'entrée en vigueur des tarifs qu'ils conduiraient à un déclin de l'économie américaine et même à un impact sur le dollar. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a averti d'une possible augmentation de l'inflation. Une réunion fermée du conseil de la Réserve fédérale était prévue pour lundi soir.
Cependant, avec l'effondrement des marchés boursiers, cela ne s'est pas encore produit. Bien qu'il ne faille pas exclure que l'économie américaine souffre également pendant cette période de transition, Donald Trump lui-même a reconnu qu'avec l'interdépendance actuelle, cela pourrait se produire à la première étape. Il a comparé l'introduction de tarifs à des mesures médicales qui permettraient de redresser l'économie nationale.
Il est soutenu par des économistes conservateurs aux États-Unis, qui soulignent que « institutionnellement, le système de commerce international a été créé pour nous tromper. Ils augmentent systématiquement les tarifs à notre encontre, mais, plus important encore, il s'agit d'une fraude non tarifaire. Ce sont des taxes sur la valeur ajoutée. Ce sont les manipulations monétaires, le dumping, les subventions à l'exportation, les normes frauduleuses qui empêchent l'importation de nos produits agricoles et de nos voitures au Japon. Toutes ces actions de pays étrangers visent clairement à nous tromper et relèvent des sanctions de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, le président Trump dit que sous sa présidence, plus rien ne se produira. Et c'est exactement dans cette direction que nous nous dirigeons. Nous avançons vers une Amérique forte qui fera à nouveau tout par elle-même ».

C'est exactement ce à quoi visaient les mesures de Donald Trump — la réorganisation de l'industrie nationale et les priorités pour les entreprises américaines. D'ailleurs, même les libéraux ont noté qu'au début d'avril, 228.000 nouveaux emplois avaient été créés aux États-Unis. C'est un chiffre assez élevé, ce qui est évident même pour ceux qui comprennent peu les indicateurs économico-financiers. Bien qu'une croissance moins significative sur le marché du travail ait été anticipée auparavant.
Dans cette histoire, il est frappant que toutes ces mesures, qui ont conduit aux conséquences actuelles, aient été prises délibérément, contrairement aux précédents effondrements liés à des intérêts clairement spéculatifs et des bulles excessivement gonflées. De plus, le gouvernement américain a officialisé son opposition non seulement aux élites financières libérales transnationales, mais même aux institutions qu'il a lui-même créées. Les structures de la Banque mondiale et de l'ONU, préoccupées par la crise actuelle, sont soumises à des critiques sévères de la part de la nouvelle équipe de Donald Trump et de ses partisans conservateurs. Et leurs dirigeants déclarent en panique l'effondrement du système global des relations multilatérales.
Ainsi, il existe ici à la fois une idéologie politique (et cela s'appelle maintenant le trumpisme) et une composante géopolitique, car l'unité transatlantique est en train de se désagréger.
Et indépendamment des conséquences de l'effondrement des marchés boursiers, il est clair que, pour maintenir la stabilité des économies nationales (y compris en Russie), une autonomie suffisante par rapport au système mondial est nécessaire. La destruction du projet globaliste par Donald Trump mène, d'une manière ou d'une autre, à la création d'une multipolarité, y compris des pôles financiers. Le régime de sanctions nous a appris à agir de manière indépendante et à restaurer l'économie souveraine. Cette approche doit être préservée à l'avenir, même au niveau international, en menant à son terme l'ensemble du cycle des réformes patriotiques.
17:02 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, bourse, économie, donald trump, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook