mercredi, 23 mars 2022
Jean Thiriart : un professeur pour la Patria Grande ibéro-américaine

Raphael Machado:
Jean Thiriart : un professeur pour la Patria Grande ibéro-américaine
Ex: https://novaresistencia.org/2022/03/22/jean-thiriart-um-professor-para-os-defensores-da-patria-grande-ibero-americana/?fbclid=IwAR1RS7wPU_ymrdgQKbOhC_dl-RMliHRtvKAzntzAmxBcYkLL5vFHRPky2ag
La journée d'hier marquait le 100ème anniversaire de la naissance de Jean Thiriart, théoricien national-révolutionnaire et continentaliste européen, grand critique de l'OTAN et défenseur d'une alliance entre l'Europe et le Tiers-Monde contre les USA. Inconnu dans notre pays, mais ayant influencé les défenseurs de l'idée de la Patria Grande, Thiriart doit encore être étudié attentivement pour les leçons qu'il a à donner à tous les dissidents ibéro-américains.
"Les Grecs de l'Antiquité n'ont pas compris la progression nécessaire de la Cité-État à l'État-Territoire. La grande majorité des Européens ne comprend pas la progression nécessaire des États territoriaux vers les États continentaux. Il en va de même pour l'Amérique latine." - Jean Thiriart
Le 22 mars 2022 marquera les 100 ans de la naissance de Jean Thiriart. Ce nom n'évoque des souvenirs que chez quelques rares Européens que l'on pourrait appeler, aujourd'hui, des dissidents, des opposants à la pensée hégémonique. Pour les Ibéro-Américains, même parmi les dissidents, Thiriart reste un grand inconnu.
Bien qu'il ne soit pas de notre ressort de tenter de présenter la totalité de la vie, de l'œuvre et de la pensée de Thiriart, notre intention est de signaler quelques idées et réflexions intéressantes qui peuvent instruire les dissidents ibéro-américains qui se positionnent comme défenseurs de l'idée d'une Patria Grande.
Contours biographiques
Thiriart est né le 22 mars 1922 à Bruxelles, en Belgique, dans une famille libérale à tendance socialiste. Adolescent, il est actif dans des organisations telles que la Jeune Garde socialiste unie et l'Union socialiste antifasciste, mais au début de la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Ligue Fichte, une organisation nationale-populaire (ou völkisch) qui suit une ligne que l'on pourrait considérer comme nationale-bolchévique. À la même époque, il rejoint l'association des Amis du Grand Reich allemand, une organisation qui rassemble tous les éléments de l'extrême gauche socialiste belge qui prônent le collaborationnisme avec l'Allemagne.
Il ne s'agit pas ici d'un virage nationaliste dans un sens bourgeois ou d'extrême droite, mais d'une évolution logique et directe d'un socialisme hétérodoxe vers un paneuropéanisme "national-bolchevique" (ou, plus précisément, communautaire). Le collaborationnisme de Thiriart suivait une logique simple : l'Europe doit être unifiée et doit le faire selon des lignes anti-libérales, anti-capitalistes, anti-atlantiques, quelle que soit la puissance qui soit le moteur de ce processus. Pour lui, même en tant que jeune homme, c'était une question de survie.
Il revient à la politique en 1960, au sein du Comité d'action et de défense des Belges d'Afrique, qui deviendra le Mouvement d'action civique. Dans cette période délicate, où le monde assistait aux processus de décolonisation, Thiriart a compris que, d'un point de vue géopolitique, l'Europe avait besoin d'une connexion méridionale, d'une sortie vers le sud - vers l'Afrique - afin de se protéger des armes de la tenaille représentée par les États de dimension continentales qu'étaient alors les États-Unis et l'URSS. Le soutien apporté par la Jeune Europe (l'organisation paneuropéenne qu'il avait fondée en 1960) à l'"Organisation de l'Armée Secrète" (OAS), une conspiration militaire française qui s'opposait à la décolonisation de l'Algérie, s'inscrit dans une logique similaire. L'idée était d'utiliser l'Algérie comme un pont, comme un "poumon extérieur" pour gonfler un processus révolutionnaire dans toute l'Europe. Date également de la même période, l'effort (infructueux) pour construire un soi-disant "Parti national européen", rassemblant des nationaux-révolutionnaires de tout le continent.
Même après la dissolution de l'OAS, le militantisme de Thiriart reste fébrile et la Jeune Europe s'étend à pratiquement tous les pays d'Europe occidentale. Cette période des années 1960, fertile en non-conformisme politique, voit de nombreux périodiques animés par le mouvement, tels que "L'Europe communautaire", "Jeune Europe" et "La Nation européenne". Au cours de la même période, il a tenté de créer un syndicat continental et une association universitaire continentale.
Du point de vue de la politique étrangère, Thiriart passe de la défense de l'Euro-Afrique à la défense d'une alliance égale Europe-Tiers Monde. La théorie a été assortie de la pratique. Déjà proche de Ceausescu et par son intermédiaire, Thiriart parvient en 1966 à rencontrer Zhou Enlai, ministre des Affaires étrangères de la Chine maoïste. En 1967, il cherche une connexion algérienne. En 1968, il rencontre Nasser en Egypte et se rend en Irak à l'invitation du Ba'ath. Thiriart et son organisation vont également tisser des liens plus étroits avec la Résistance palestinienne (Roger Coudroy, le premier Européen à mourir pour la cause palestinienne, était un militant de Jeune Europe). Plusieurs personnalités de ces gouvernements et d'autres gouvernements du tiers-monde et non-alignés collaboreraient aux publications de Jeune Europe. L'objectif principal de tous ces contacts était d'obtenir un soutien matériel pour la formation des soi-disant Brigades européennes, qui auraient leur baptême du sang dans la lutte pour la libération palestinienne et débarqueraient en Europe en tant qu'armée de libération.

Le lien entre Jean Thiriart et Juan Domingo Peron, chef d'orchestre de l'Argentine de 1946 à 1955, mérite un commentaire séparé, en raison de son importance pour les Ibéro-Américains. Pendant son exil à Madrid, Perón a personnellement rencontré Thiriart et les deux hommes sont devenus amis. Le chef d'Etat argentin était un lecteur assidu de La Nation européenne et a été interviewé par Thiriart lui-même pour la publication. Il serait impossible de mettre en évidence une influence à sens unique entre les deux, car l'immense synchronisation entre eux, notamment entre les idées qu'ils ont tous deux exprimées à partir de la fin des années 1960, indique une forte influence mutuelle entre tous les niveaux de leur pensée.
La synchronicité théorique entre Perón et Thiriart est particulièrement pertinente pour nous, mais avant d'en venir, enfin, aux leçons que les Ibéro-Américains devraient tirer de Thiriart, nous clôturerons le cycle biographique du penseur.
Après avoir été déçu par le manque de soutien à ses projets, Thiriart s'est à nouveau retiré de la politique pendant plus de 12 ans, n'y revenant qu'au début des années 1980 pour republier ses œuvres et soutenir le parti de la Communauté nationale européenne. Pendant 10 ans encore, jusqu'à sa mort en 1992, Thiriart a étendu son influence sur une nouvelle génération de dissidents, dont le philosophe russe Alexandre Douguine, prônant non plus la construction d'un empire européen entre les États-Unis et la Russie, mais une Europe de Dublin à Vladivostok.
De l'État-nation à l'État-continent
"Seules les nations de dimension continentale ont un avenir". - Jean Thiriart
Une première évaluation par Thiriart de la condition européenne est basée sur la perception que les États-nations européens (France, Allemagne, Italie, etc.), tels qu'ils se sont constitués, sont trop faibles pour s'opposer aux États-continents dans leur processus de consolidation du pouvoir. Par conséquent, aucun des pays européens n'était porteur de la souveraineté. En pratique, cela a conduit les nations européennes à graviter autour des États-continents, l'Europe occidentale étant devenue une simple péninsule de la thalassocratie américaine.
Si l'Europe est une péninsule, l'Amérique ibérique est une arrière-cour. Le terme "arrière-cour" est déjà un classique pour désigner la condition de subalternité de la myriade de pays artificiels qui peuplent notre continent. La fragmentation de l'Ibéro-Amérique n'était pas accidentelle, mais le résultat d'une stratégie thalassocratique propre à l'Empire britannique. Le Brésil, colonisé par le Portugal, a failli suivre le même sort, mais a réussi à préserver son unité grâce à l'autorité impériale qui, par le charisme qui lui était propre et par la force des armes, a garanti la stabilité territoriale.

Ne nous y trompons pas : malgré ses dimensions, même le Brésil ne peut se libérer. Dans une perspective réaliste, malgré sa taille, le Brésil devra tout de même prendre soin de ses frontières. De plus, c'est un pays sans armes nucléaires. Afin de garantir une souveraineté authentique, il est nécessaire qu'un processus de libération se déroule de manière concomitante dans toute l'Amérique ibérique, comme l'a commenté Perón dans l'interview, déjà mentionnée, accordée à Thiriart.
Dans la géopolitique des "Grands Espaces", il n'est pas encore défini si l'Ibéro-Amérique constituerait concrètement un ou deux Empires, mais même si nous prenons la version la plus petite, celle d'un Empire ibéro-américain du Sud, nous nous projetterions comme un État-continent avec plus de 400 millions d'habitants, les plus grandes réserves d'eau douce du monde et un rôle fondamental dans la géopolitique alimentaire, en plus d'immenses réserves de lithium, d'uranium, d'or, de cuivre et du très important pétrole.
Peron lui-même serait évidemment tout à fait d'accord sur ce point, et tous ses efforts sont allés dans ce sens, comme le commente L'Heure du peuple. Le géopolitologue Marcelo Gullo aborde également le sujet, de manière très actuelle, à travers le concept de "seuil de pouvoir", c'est-à-dire d'un niveau de pouvoir nécessaire pour qu'une structure politique soit considérée comme véritablement souveraine. Dans cette perspective, à partir du moment où les Américains sont arrivés dans le Pacifique, seuls les États de dimension continentale peuvent être considérés comme souverains.
Le libéralisme est pire que le communisme
"Nous devons nous débarrasser de l'approche simpliste, en noir et blanc, qui voit le communisme et le national-socialisme comme des pôles opposés l'un à l'autre. Ils étaient bien plus des concurrents que des ennemis". - Jean Thiriart
Jean Thiriart était proche de l'extrême droite nationaliste française au début des années 1960, à l'époque du Mouvement d'Action Civique et des liens avec l'OAS. Ce bref contact avec ce secteur politique a fixé en Thiriart un rejet de l'anticommunisme, du racisme, du capitalisme et des déviations libérales de la mouvance nationaliste bourgeoise.
Dans une optique qui renverse axiologiquement la logique des réflexions poppériennes, Thiriart (comme d'autres grands de son temps, tels que Drieu la Rochelle) a perçu que le fascisme et le communisme étaient beaucoup plus proches l'un de l'autre que la plupart de leurs propres adhérents ne l'avaient compris et que l'anticommunisme viscéral des secteurs patriotiques (comme l'antifascisme virulent des secteurs socialistes) les rendait tous plus facilement cooptés et instrumentalisés par la thalassocratie libérale.
Si ce point de vue était perspicace dans les années 1960, il est aujourd'hui encore plus valable, plus évident, mais on continue à l'ignorer. Aujourd'hui, des personnalités comme Diego Fusaro et Alain Soral défendent une politique transversale, dans le style d'une "gauche du travail, droite des valeurs" et critiquent l'antifascisme et l'anticommunisme comme des outils du libéralisme hégémonique. Le péronisme lui-même était l'exemple d'un type de construction politique qui réunissait des figures issues des deuxième et troisième théories politiques, pour construire une nouvelle métapolitique et une nouvelle praxis politique.
Avec Moscou, contre Washington
"[...] l'objectif doit être d'expulser à tout prix les Américains d'Europe. La puissance tutélaire, les USA, a créé en Europe des habitudes de sécurité, de facilité et, de fil en aiguille, de renoncement à l'initiative personnelle et, finalement, de soumission. L'atlantisme est l'opium de l'Europe politique [...]". - Jean Thiriart
Comme Thiriart comprenait le jeu géopolitique de son époque, l'Europe occupée depuis la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis, n'était qu'une tumeur apposée surle flanc ouest de l'URSS. Fragmentée en États-nations et sous occupation militaire, elle n'avait pas d'existence propre, pas de destin.
Le cours de la guerre froide a conduit Thiriart, déjà dans les années 1980, à réaliser qu'entre les États-Unis et l'URSS, les États-Unis représentaient un mal infiniment plus grand. En fait, si dans les années 1960, il avait adopté une position typique "Ni Washington ni Moscou", à partir des années 1980, il a adopté une position "Avec Moscou, contre Washington", prônant la conquête de l'Europe occidentale par l'Armée rouge et l'unification d'un État continental englobant l'Europe et la Russie dans une structure unique.

L'effondrement soviétique et la guerre froide n'ont pas affaibli l'évaluation de Thiriart ; au contraire, ils ont rendu encore plus évidente la nature néfaste de l'action atlantiste américaine et internationale. L'effondrement soviétique a garanti l'hégémonie mondiale aux États-Unis. La bipolarité a été remplacée par l'unipolarité.
Si dans les derniers moments de la guerre froide, même en période de bipolarité, il était possible de voir la nécessité de soutenir Moscou contre Washington, dans les conditions de l'unipolarité, il ne peut y avoir aucun doute : Moscou ne représente pas seulement elle-même, mais les aspirations à la libération de tout le tiers-monde. Il ne s'agit pas ici de soumission à la Russie, surtout en ce qui concerne l'Amérique ibérique, mais d'une alliance fondée sur le respect mutuel contre l'ennemi de la Cause des Peuples.
Dans ce conflit, aucune neutralité n'est possible. La Russie, étant l'avant-garde de la multipolarité, doit être soutenue dans tout ce qui affaiblit l'unipolarité, l'OTAN et les États-Unis. Si la Russie échoue dans la phase actuelle, ce n'est pas seulement la Russie qui sera vaincue, mais toute la lutte des peuples et le moment unipolaire se stabilisera peut-être dans un ordre unipolaire, capable de durer encore des décennies, voire des siècles.
Le fait que Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, ait récemment déclaré que la question de l'Amazonie était plus importante que la crise ukrainienne elle-même présente un intérêt particulier pour nous, Ibéro-Américains. L'OTAN, qui a même des partenaires en Amérique ibérique, prépare un siège de l'Amazonie, le Heartland de l'Amérique du Sud, et l'un des espaces les plus stratégiques de la planète.
Alors que les Etats-Unis se retirent de nombreux "avant-postes" dans le Vieux Monde, la tendance est qu'ils cherchent à garantir leur propre "arrière-cour", renforçant la tendance à renouveler la "Doctrine Monroe", visant spécifiquement à fragmenter et à affaiblir encore plus les pays ibéro-américains.
Étant donné que les Ibéro-Américains, en tant que communauté continentale, ne possèdent pas d'armes nucléaires, seule une alliance tactique avec la Russie et la Chine peut empêcher une tragédie. Une alliance, bien sûr, insoumise, basée sur des relations gagnant-gagnant, mutuellement avantageuses.
Après l'effondrement irréversible de l'unipolarité et la "provincialisation" des USA, ramenés au statut de simple centre d'un pôle nord-américain, nous pourrons enfin tracer notre propre voie et même nous engager dans des relations positives et harmonieuses avec les USA. Mais c'est un long chemin à parcourir.

Communautarisme : vaincre le capitalisme et le marxisme
"Par exemple, une centrale hydroélectrique nécessite (...) une nationalisation. En sens inverse, la production et la distribution de produits agricoles et avicoles nécessitent l'économie libre (...). Le marxisme dogmatique veut tout nationaliser, le libéralisme veut tout privatiser, le communautarisme veut conserver un contrôle politique absolu tout en permettant la plus grande liberté économique possible." - Jean Thiriart
Enfin, comme note fondamentale, il faut rappeler l'insistance de Thiriart sur la nécessité d'abandonner tant le modèle économique capitaliste, fondé sur l'exploitation égoïste et usuraire, que le modèle économique communiste, fondé sur un utopisme qui réduit l'homme à une fourmi.
Dans cette sphère, les sources et inspirations de Thiriart sont multiples et passent par le corporatisme typique des projets de la troisième théorie politique des années 30 et la pensée de figures classiques de la philosophis ou de l'économie politiques comme Friedrich List ou Johann Gottlieb Fichte. Sur la base de ces sources et d'autres, Thiriart défend un modèle économique autarcique dont le but serait la maximisation du pouvoir.
Réunissant les aspects de la planification et de la libre entreprise, Thiriart envisage une économie dans laquelle l'État dirige tous les secteurs stratégiques de manière planifiée et centralisée, tandis que la distribution de biens et la fourniture de services, ainsi que d'autres secteurs non stratégiques, sont organisés selon des modèles de petite propriété ou par des coopératives fonctionnant selon la logique de l'autogestion.
Les parallèles avec des modèles proches du monde ibéro-américain sont intéressants. Les modèles managérialistes d'économie mixte sont présents dans les idéaux du travaillisme et du péronisme, sans compter que le communautarisme de Thiriart (qui comporte également des éléments de représentation des entreprises en politique) est proche de la "Communauté organisée" de la ligne péroniste.
En somme, en ces 100 ans de Jean Thiriart, auguste inconnu, appelé par beaucoup "le Lénine de la révolution européenne", une révolution toujours en cours, nous devons nous souvenir du rôle fondamental du penseur authentiquement paneuropéen dans la construction de ce que nous appelons la "dissidence".
Bien qu'il ait écrit principalement pour un public européen, il n'a pas manqué de penser à l'importance du tiers monde et au fait que l'Europe ne pouvait se libérer qu'avec le soutien du tiers monde et vice versa. Voilà donc un auteur qui devrait alimenter la réflexion de tous les universitaires et militants qui rêvent de la Patria Grande ibéro-américaine.
15:52 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, jean thiriart, continentalisme, continentalisme ibéro-américain, jeune europe, nationalisme européen, rafael machado |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 02 mars 2022
Pino Rauti et la méthode de la politique

Pino Rauti et la méthode de la politique
Source: https://vendemmietardive.blogspot.com/search?updated-max=2022-02-07T23:16:00-08:00&max-results=7
Sur la crise russo-ukraino-américaine, il y a quelques jours, constatant l'habituel réflexe atlantiste de notre droite italienne, fruit d'un conditionnement perpétuellement matraqué, et constatant ensuite avec un profond découragement que, par rapport à il y a trente ans, il n'y a pas eu le moindre pas en avant, j'ai évoqué et presque invoqué le nom de Pino Rauti. Les réactions ont été de trois types : ceux qui ont exprimé les mêmes sentiments que moi, ceux qui ont critiqué ma position, en insistant sur les erreurs politiques du secrétaire du MSI, et enfin ceux qui, s'appuyant sur des sources fallacieuses, ont reproduit les accusations qu'une certaine gauche conspirationniste avait faites autrefois, en alléguant des compromis avec des pouvoirs forts et des complots plus ou moins obscurs.
La troisième perspective est de loin la plus imparfaite. Elle serait vraiment répréhensible si elle n'était que le fait de quelqu'un y croit réellement. Mais il y a là une erreur de méthode : on ne peut accepter des thèses sans examiner leur contenu polémique et les déformations dont elles font l'objet par rapport à l'inimitié politique radicale et à la haine fanatique que cette inimitié peut parfois susciter. Une fois cela fait, on peut évaluer leur incohérence réelle et les reléguer au chapitre de la psychopathologie politique, en invitant ceux qui les ont acceptés de bonne foi à ne plus tomber dans de tels pièges.
La deuxième thèse, concernant les erreurs politiques de Pino Rauti, est certainement plus grave. La longue carrière politique de l'homme politique calabrais peut faire l'objet de critiques. Il y a eu quelques mauvais choix dans les années 1960 et 1970, mais surtout, la grande occasion gâchée de prendre le secrétariat du MSI en 1990-91 a représenté un point de non-retour pour tout un milieu de militants, de dirigeants, de politiciens et d'intellectuels. Pris dans un tourbillon de tactiques pour leur propre intérêt, dans un contexte de faiblesse électorale du parti, avec des alliés prêts à prendre sa place, il a fini par commettre la plus grosse erreur de toutes, qui n'a pas été de perdre sa position de leader du parti, mais de ne laisser aucun témoignage auquel ses partisans pourraient se raccrocher dans l'avenir. D'où, par exemple, la position profondément erronée sur la guerre dans le Golfe. L'erreur était de taille, précisément parce que Rauti n'a pas réussi, à ce moment-là, à suivre le style politique qu'il avait lui-même cultivé auparavant et communiqué à son cercle de référence, préférant un coup d'échecs inutile à une action ayant un fort attrait symbolique et une profonde valeur historique et culturelle.
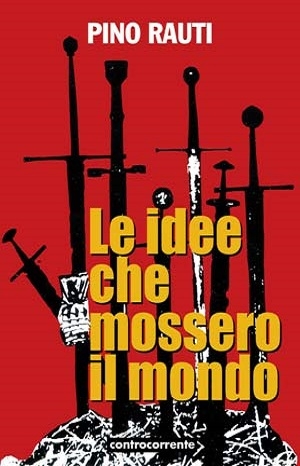
Sur cette question, cependant, la possibilité même de détecter son erreur la plus évidente, il faut le reconnaître, est à mettre sur le compte de sa grandeur. Et ici, nous devons comprendre ce qu'était l'enseignement de Pino Rauti. Pour résumer, nous pouvons utiliser le titre de l'un de ses textes, Le idee che mossero il mondo (Les idées qui ont fait bouger le monde). Il a inoculé à un milieu de militants politiques le merveilleux sérum d'un idéalisme particulier. Le moteur de l'histoire réside dans l'élaboration d'une vision du monde et de la vérité capable de s'imprimer dans la réalité, entraînant d'abord les hommes puis, avec eux, les choses. Il n'y a rien de plus radicalement antithétique à la modernité et à son matérialisme général. Il y a ce qu'il a appelé une "utopie lucide" à promouvoir et à ancrer dans le temps et l'expérience de notre peuple. Nous allons ici au-delà du volontarisme idéologique qui a connu un certain succès au XXe siècle, se montrant même compatible avec les élaborations matérialistes. Ici, au contraire, nous pouvons parler de la politique comme d'une science de l'esprit. Seule une révolution intérieure, commençant par la culture d'une idéosphère historico-philosophico-scientifique, peut produire non pas tant l'accès au pouvoir d'une élite à la place d'une autre, mais un changement radical dans la direction du chemin historique de notre civilisation. Se préparer à ce grand projet, se mouvoir à l'aise dans les grandes questions du temps et du monde, et en même temps apprendre le dur métier de l'homme politique (je me réfère, bien sûr, à Weber) au service de son propre peuple dans le petit et le quotidien : c'est le style que Rauti a communiqué à son peuple, et c'est précisément cela qui l'a rendu, comme nous tous, critiquable.

Et c'est précisément parce que nous pouvons être critiqués que nous n'avons pas peur de critiquer, surtout ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de plus grand plaisir que d'affirmer les raisons de la pensée contre ceux qui pensent avoir raison uniquement en vertu de la position de pouvoir qu'ils occupent... et de là, on avancera peut-être l'argument risible d'une éthique de la responsabilité omniprésente (bien au-delà de ce que Weber lui-même lui avait accordé). Il n'y a rien que nous ayons stigmatisé avec plus de conviction : rester au pouvoir et demander lâchement de la compréhension pour ses mécanismes "irrésistibles", raconter aux gouvernés le conte de fées de l'impuissance "irrésistible" des gouvernants et, pendant ce temps, profiter des avantages personnels de cette usurpation impuissante. Voici donc le "feu au quartier général" de l'appel d'en bas pour que les élites se lèvent, qui n'est pas une faction mais un soutien, qui n'est pas une conspiration mais un activisme révolutionnaire qui appelle les élites à leur devoir, même difficile, ne renonçant pas à offrir leur aide. On dira qu'il s'agit en soi d'une formulation idéalisée. Certes, mais c'est sans doute le style que nous avons essayé d'incarner sous la direction de Pino Rauti et dans le sillage de son expérience. Et ce style est désespérément nécessaire à la droite d'aujourd'hui, à une époque de croissance et, si vous voulez, de succès social et médiatique. Parce que la scène politique italienne et européenne est pleine de météores, de droites et de droites de gouvernement et de gouvernement aussi, mais si Giorgia Meloni veut être quelque chose de différent, elle doit puiser dans cet héritage éthique et politique, en écoutant attentivement sa sacro-sainte critique et en en tirant le meilleur parti, peut-être en partant des questions internationales les plus urgentes.
Publié par Massimo Maraviglia
https://vendemmietardive.blogspot.com/search?updated-max=2022-02-07T23:16:00-08:00&max-results=7
15:55 Publié dans Histoire, Hommages, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, italie, pino rauti, hommage, msi, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 février 2022
Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres
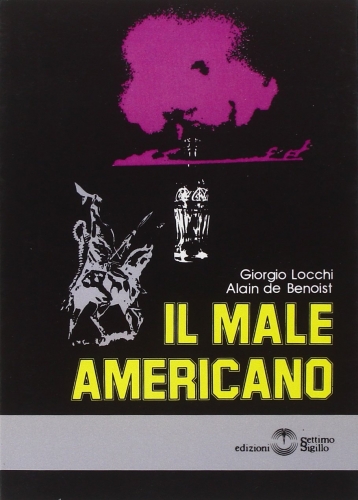
Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres
par Antonio Pannullo
Ex : http://www.secoloditalia.it
Giorgio Locchi est décédé à Paris, où il vivait depuis les années 50, le 25 octobre 1992. Aujourd'hui, Giorgio Locchi, journaliste, essayiste et écrivain, n'est plus très connu en Italie, surtout des jeunes, mais il est l'un des penseurs qui ont eu le plus d'impact sur la communauté anticommuniste européenne (il n'aimait pas le terme "droite") à partir des années 1970. On sait peu de choses de sa vie privée, et ce que l'on sait, on le doit à la fréquentation systématique de ses "disciples" italiens, des jeunes hommes issus du mouvement missiniste (MSI) des années 1970. Ces jeunes hommes, enflammés par le feu sacré de la politique et le désir de changer ce monde, se rendent à Paris, à Saint-Cloud, où Locchi vit et gagne sa vie comme correspondant du quotidien romain Il Tempo. Parmi ces jeunes hommes, nous nous souvenons certainement de Gennaro Malgieri, Giuseppe Del Ninno, Mario Trubiano, Marco Tarchi et d'autres. Quoi qu'il en soit, bien que méconnu en Italie, Giorgio Locchi a été en quelque sorte le "père noble" des grands bouleversements culturels européens dans la mouvance de la droite (nous n'écrivons le mot "droite" que par convention), lorsque de ce néofascisme missiniste pur est née la dimension culturelle, incarnée par une Nouvelle Droite, comme on l'a appelée en fait plus tard. Cette Nouvelle Droite regardait au-delà du régime fasciste mais pensait plutôt au potentiel, partiellement mis en pratique, de cette philosophie et doctrine européiste et anti-égalitaire, bien que modernisatrice, qui aurait encore beaucoup à dire et à donner à notre civilisation quelque peu décadente (pour être généreux). Ensuite, la figure de Giorgio Locchi a été révélée en France, mais grâce aux Italiens, comme le rappelle Del Ninno. Locchi était l'un des fondateurs du G.R.E.C.E., le Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, créé en 1968 notamment avec Alain de Benoist, un intellectuel et journaliste français bien connu, qui était avec Locchi dès le début, même si de Benoist était plus jeune.

Giorgio Locchi a vécu à Paris pendant de nombreuses années. Il est toutefois né à Rome en 1923, sa famille avait des liens avec le monde du cinéma et du doublage, il était lui-même un ami de la famille de Sergio Leone ; il a fait ses études à l'école classique nazaréenne où, bien que totalement non-catholique, il a gardé son estime et sa gratitude pour les pères piaristes, qui ont toujours respecté sa liberté de pensée et qui lui ont toujours garanti une autonomie maximale de jugement et de critique. Il a poursuivi ses études, notamment en germanistique, musique, sciences politiques, mais surtout en civilisation indo-européenne, sujet sur lequel il nous a laissé un livre et de nombreux écrits.
Les jeunes du Fronte della Gioventù et du MSI des années 1970 et 1980 ont été littéralement foudroyés par son livre Il male americano (Lede editrice), dans lequel Locchi prédisait tout ce qui ne devait pas arriver mais qui nous arrive encore. Pour Locchi, le fait d'avoir été vaincu par une guerre dévastatrice n'annihile pas les idées qui ont conduit à cette guerre. Ils survivent sous les formes et les nuances les plus disparates. Après la création du G.R.E.C.E., que nous appellerions aujourd'hui un think tank, la Nouvelle Droite a commencé à se faire un nom non seulement en France et en Italie, mais dans toute l'Europe occidentale. Et en parlant d'Europe, Locchi voulait se rendre à Berlin à l'époque de la réunification allemande. À partir de ce moment, la signature de Locchi, qui utilisait également le pseudonyme Hans-Jürgen Nigra, a commencé à apparaître dans des magazines proches de la Nouvelle Droite, tels que Nouvelle Ecole, Eléments, Intervento, la Destra, l'Uomo libero et bien sûr notre quotidien Secolo d'Italia. Entre-temps, il a fourni de précieuses informations aux lecteurs italiens avec une superbe correspondance sur les événements en Algérie, sur les Français de 68, et aussi sur la naissance de l'existentialisme.
Comme l'a clairement écrit Gennaro Malgieri dans son admirable hommage à Giorgio Locchi (1923-1992) dans Synergies européennes en février 1993 (ndt: dans la revue Vouloir, pour être exact), les idées de Locchi étaient en fait les idées d'une Europe qui n'existe plus, mais ce n'était pas une raison pour ne pas en défendre ou en illustrer les principes. Ces idées portent sur cette Europe éternelle à laquelle l'Europe économique de notre période d'après-guerre ne ressemble en rien. Par exemple, note encore Malgieri, l'attitude de Locchi à l'égard du fascisme n'est pas une simple nostalgie ou une protestation, mais il a recueilli dans le ferment culturel de cette époque et de cette expérience toutes les idées et initiatives qui n'étaient pas et ne sont pas obsolètes. "Il nous a fait part de ses réflexions à ce sujet dans son ouvrage intitulé L'essence du fascisme (Il Tridente, 1981). Il fait référence à la vision du monde qui a inspiré le fascisme historique, mais qui n'a pas disparu avec la défaite de ce dernier. Ce livre est encore un prodigieux "discours de vérité" au sens grec du terme, qui cherche à écarter du fascisme toutes les explications fragmentaires qui sont faites actuellement et toutes les formes de diabolisation visant à générer des préjugés". Giorgio Locchi a également écrit un livre sur le "mythe surhumaniste".
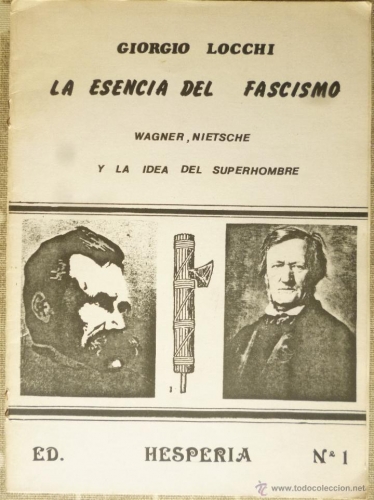
Dans son enquête, Locchi affirme qu'il n'est pas possible de comprendre le fascisme si l'on ne réalise pas qu'il est la première manifestation politique d'un phénomène spirituel plus large, dont il fait remonter les origines à la seconde moitié du XIXe siècle et qu'il appelle "surhumanisme". Les pôles de ce phénomène, qui ressemble à un énorme champ magnétique, sont Richard Wagner et Friedrich Nietzsche qui, à travers leurs œuvres, ont mélangé le nouveau principe et l'ont introduit dans la culture européenne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sur ce, Locchi a écrit le livre Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste (éditions Akropolis), difficile mais extrêmement lucide, qui a eu les éloges du critique musical Paolo Isotta dans les colonnes du Corriere della Sera.
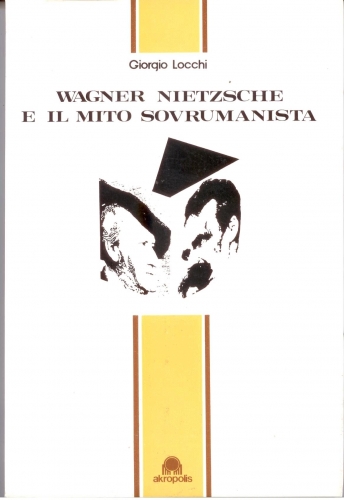

Locchi nous a laissé des livres peu nombreux mais importants. Sa vie témoigne d'un engagement cohérent, profond et crucial, qu'il serait bon d'explorer davantage aujourd'hui. Il y a quelques années, Francesco Germinario lui a consacré un livre, Tradizione, Mito e Storia (éditions Carocci), dans lequel l'auteur définit les caractéristiques de la droite radicale, en s'attardant sur ses exposants les plus significatifs. Il y a deux ans, au siège romain de Casapound, s'est tenue une conférence sur Giorgio Locchi en présence de son fils Pierluigi et d'Enzo Cipriano, également ami et disciple de Locchi depuis des années.

16:53 Publié dans Hommages, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio locchi, nouvelle droite, philosophie, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dimitri nous a quittés. Retour sur le parcours de Guy Mouminoux

Dimitri nous a quittés. Retour sur le parcours de Guy Mouminoux
par Kristol Séhec
Source: https://www.breizh-info.com/2022/02/28/180572/dimitri-nous-a-quittes/
Décédé le 11 janvier 2022, Guy Mouminoux reste connu pour son seul roman, le récit de guerre autobiographique Le Soldat oublié (sous le pseudonyme de Guy Sajer) ainsi que pour ses bandes dessinées humoristiques ou historiques (sous le pseudonyme de Dimitri).
Guy Mouminoux est né à Paris le 13 janvier 1927. En 1916, son père, un poilu fait prisonnier à Verdun, avait rencontré sa mère pendant sa détention en Allemagne. Guy vit sa jeunesse en Alsace et est passionné par la lecture des revues de bandes dessinées humoristiques pour enfants. Il a le don du dessin et rêve d’en faire son métier. Mais en 1940, lorsque cette région est annexée par l’Allemagne, il rejoint les camps de jeunesse allemands. En 1943, comme d’autres « malgré-nous », enrôlé dans la division Grossdeutschland de la Wehrmacht, il participe, à seulement seize ans, aux combats sur le front de l’Est.
* Les bandes dessinées pour enfants.
Dans la première partie de sa carrière, sans avoir fait d’études aux Beaux-Arts, Guy Mouminoux se consacre à la bande dessinée pour enfants, l’une de ses passions de jeunesse. Fin 1946, il publie Les Aventures de Mr Minus, sa première bande dessinée humoristique. C’est le début d’une longue participation aux illustrés pour la jeunesse, d’obédience catholique (Cœurs vaillants…) ou communiste (Vaillant). Il faut se souvenir qu’en octobre 1945, alors que Cœurs vaillants est provisoirement interdit de publication le temps de contrôler s’il a « collaboré », les communistes lancent leur propre journal pour la jeunesse, Vaillant, en jouant sur la confusion des titres. A partir de 1959, il reprend dans Cœurs vaillants la série Blason d’argent, contant les aventures d’Amaury, preux chevalier combattant l’injustice. Il se fait alors un nom dans le monde de la bande dessinée.

Guy Mouminoux participe également dans le journal Spirou aux Belles histoires de l’oncle Paul, courts récits historiques pour enfants. Au journal Spirou, il rencontre Jijé, auteur majeur de la bande dessinée chrétienne, qui devient l’un de ses meilleurs amis. Ils réaliseront ensemble, au milieu des années 1960, quelques tomes de la série Les Aventures de Jean Valhardi. En 1964, pour le magazine Pilote, il crée une série humoristique, Goutatou et Dorauchaux, imaginant que deux chats constituent l’équipage d’un remorqueur. On découvre alors son style caractéristique qu’il reproduira pour la série Le Goulag. De 1970 à 1980, il crée pour Tintin, la série humoristique Rififi, jeune moineau turbulent, chassé du nid par ses frères à cause des punitions qu’il leur attire.
* Le soldat oublié.
En 1967, Mouminoux publie Le Soldat oublié chez Robert Laffont, qui obtient en 1968 le Prix des Deux Magots. Traduit en près de 40 langues, vendu à près de trois millions d’exemplaires, ce récit autobiographique décrit sa participation aux combats au sein de l’armée allemande. On découvre que Guy est mis au service du Reich allemand, dans le cadre de l’Arbeitsdienst. Il participe au ravitaillement des troupes sur le front de l’Est. Durant l’hiver 1942, le froid est intense. Son unité n’arrive pas à rejoindre à Stalingrad la 6e armée allemande de Paulus. Elle recule de Kharkov à Kiev. Début 1943, après une permission à Berlin où il rencontre Paula, il se porte volontaire pour être incorporé dans la division Grossdeutschland. Il participe alors à la bataille de Koursk, avant de reculer jusqu’au Dniepr. Tentant de repousser l’avancée soviétique, il combat aux côtés des enfants et des vieillards du Volkssturm. En avril 1945, il se rend aux Anglo-américains. Prisonnier de guerre, il est rapidement libéré du fait de son origine française.
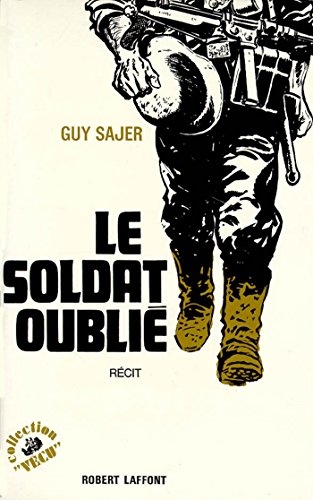
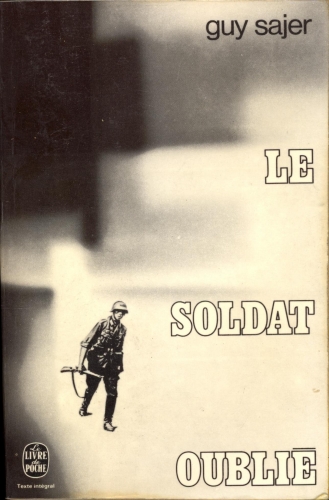
Dans ce récit, il révèle la forte camaraderie au sein de l’armée allemande. Il décrit dans le détail les conditions de vie du soldat allemand. On découvre le terrible hiver russe (−40 °C), provoquant gelures et amputations. Mais bien que Mouminoux ait pris soin de signer ce roman sous pseudonyme, Guy Sajer (d’après le nom de jeune fille de sa mère), le monde de la bande dessinée découvre la véritable identité de l’auteur, qui reste fasciné par le courage de ces soldats prêts à donner leur vie pour une cause. Dès lors, Guy Mouminoux est parfois rejeté par certaines maisons d’édition.
* Le goulag.
En 1975, Guy Mouminoux prend le pseudonyme de Dimitri. Il réalise alors sa principale série, Le goulag, qui paraît dans les magazines Hop !, fanzine, Charlie mensuel, L’Hebdo de la BD, L’Écho des savanes, L’Événement du jeudi et Magazine hebdo. Il y rencontre Wolinski, Cavanna, Cabu, Gébé, Choron… et Reiser, qui devient l’un de ses meilleurs amis. Le personnage principal du Goulag, Eugène Krampon, flegmatique ouvrier parisien émigré en Union soviétique, est interné au goulag 333 en Sibérie à la suite d’un malentendu. Il vit alors de surprenantes aventures, devenant pilote d’essai, soldat à la frontière sino-russe, champion de football… Il découvre qu’à la chute de l’empire soviétique, la Russie s’ouvre au capitalisme. Les hamburgers remplacent la bonne cuisine russe ! Mais il ne pense qu’à retrouver sa belle Loubianka. En s’adressant à un public plus adulte, Dimitri accède alors à la reconnaissance. Il expliquait que « Le Goulag, pour moi c’est la vie. Il nous entoure, nous sommes en plein dedans. On peut en pleurer mais aussi en rire. C’est un peu comme à la guerre » (Le Choc du Mois, nov. 1990, p. 54). Si Dimitri dénonce avec humour le régime communiste, il reste très attaché au peuple russe.
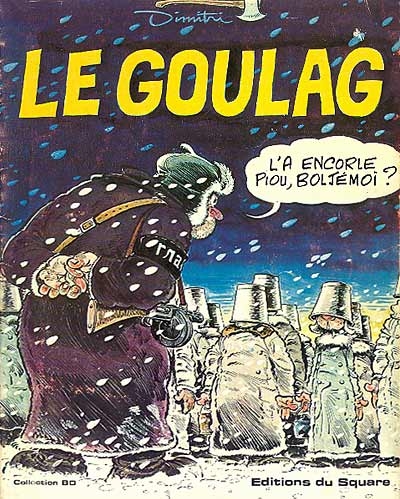

Après la disparition de René Goscinny, en 1977, Mouminoux est même pressenti par Georges Dargaud, alors en conflit avec Albert Uderzo, pour poursuivre la série Astérix le Gaulois.
Durant cette période, la gauche le soupçonne d’être d’extrême-droite et la droite l’accuse de fréquenter la gauche.
* La période d’humour grinçant.
Dimitri réalise au début des années 1980 de nombreuses bandes dessinées satiriques.
Deo Gratias (1983), composée d’histoires courtes à l’humour noir grinçant, révèle le constat désespéré de Dimitri sur la civilisation moderne. Sa critique du féminisme, une femme exigeant de livrer un combat de boxe à un homme, est particulièrement féroce. Le noir et blanc lui convient très bien.
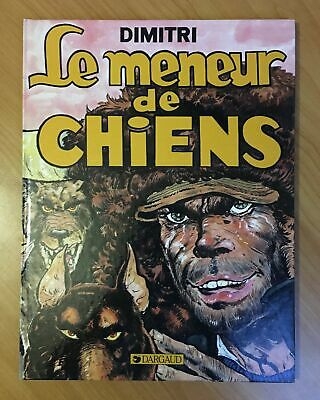

Dans Le Meneur de chiens (1984), un homme détestant la civilisation moderne s’apprête à se suicider. Mais il découvre alors qu’il a le pouvoir de parler aux chiens. Il va mener une meute de chiens féroces à l’assaut d’humains sans défense. Il leur ordonne de les tuer et de les manger. Dans cet album impitoyable, les attaques sont si sanglantes qu’il s’agit presque d’une bande dessinée d’horreur.
Les Mange-merde (1985) décrit une société gangrenée par l’insécurité et le chômage. La révolte gronde. Un jeune chef d’entreprise est ruiné. Il croise la route d’un jeune inventeur. Ensemble, ils rentrent dans un bistrot, qualifié de « dernier refuge gaulois ». Ils vont fuir une bande de racketteurs. De nouveau, Dimitri use de son humour noir féroce pour révéler l’état de la société.
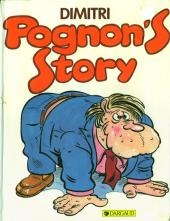 Pognon’s story (1986) est une étonnante satire socio-politique teintée d’humour grinçant. Qu’on en juge. Un homme, en vacances au bord de la mer, va tenter de gagner de l’argent en déformant son corps pour prendre l’aspect d’animaux. Puis il intègre l’équipage d’un bateau en partance pour l’Amérique centrale. Il y rencontre une aventurière nymphomane qui cherche à acheter frauduleusement des véhicules militaires au Honduras. Puis un ermite lui révèle le secret d’une pierre magique qui rend leur lucidité à ceux qui se l’accrochent aux testicules ! Mais ce pouvoir inquiète le gouvernement…
Pognon’s story (1986) est une étonnante satire socio-politique teintée d’humour grinçant. Qu’on en juge. Un homme, en vacances au bord de la mer, va tenter de gagner de l’argent en déformant son corps pour prendre l’aspect d’animaux. Puis il intègre l’équipage d’un bateau en partance pour l’Amérique centrale. Il y rencontre une aventurière nymphomane qui cherche à acheter frauduleusement des véhicules militaires au Honduras. Puis un ermite lui révèle le secret d’une pierre magique qui rend leur lucidité à ceux qui se l’accrochent aux testicules ! Mais ce pouvoir inquiète le gouvernement…
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, la bande dessinée Les Consommateurs (1987), à l’humour caustique, n’est pas une critique de la société de consommation. Un faux médecin se retrouve sans cabinet. Il accepte de se rendre au chevet d’un escroc international protégé par les services secrets. Après s’être fait piquer les fesses par une arête de barracuda ensorcelée, celui-ci se transforme en salamandre et ne peut vivre que dans une baignoire.
Dans La Grand’messe (1988), un éboueur veut changer de métier. Après un accident de voiture, il devient le sosie d’un ministre et le remplace pour déclamer des discours politiques vides de sens. Dimitri critique ici les politiciens qui méprisent leurs électeurs, qu’ils soient de gauche, de droite ou du centre.
L’abattoir (1989) lui vaut son éviction de chez Dargaud. Dimitri imagine qu’un homme au bout du rouleau s’enrôle dans la police. C’est l’occasion pour lui de dénoncer le lynchage d’une police désarmée et son abandon par le pouvoir judiciaire. Il affirme qu’ « on voudrait instaurer le désordre et le chaos qu’on ne s’y prendrait pas autrement » (Le Choc du Mois, nov. 1990, p. 54).
* Les récits historiques.
A partir des années 1980, Dimitri participe au grand succès de la bande dessinée historique, avec des récits particulièrement poignants. Ce sont les conditions extrêmes qui l’inspirent. Pour chacun de ces albums, Dimitri se documente très sérieusement. Il achète des maquettes pour dessiner les modèles sous tous les angles.
La Seconde Guerre mondiale reste son thème de prédilection. Son chef d’œuvre reste sans doute Kaleunt (1988). Il raconte le parcours de Heinrich Schonder, commandant de l’Unterseeboot 200, qui ne montre guère d’intérêt pour le régime national-socialiste. On prend conscience de la terrifiante vie des sous-mariniers, jusqu’à ce que ce sous-marin soit coulé le 24 juin 1943. Le dessin expressif et la colorisation sont superbes.


L’année suivante, dans Raspoutitsa (1989), Dimitri retrace, après la bataille de Stalingrad, la captivité d’un soldat allemand. Il illustre parfaitement son désespoir, marchant dans la neige au sein de colonnes de prisonniers rejoignant les camps de Sibérie.
D’autres bandes dessinées ont pour cadre la seconde guerre mondiale. Dans D-LZ129 Hindenburg (1999), Dimitri envisage l’hypothèse qu’un complot est à l’origine de l’embrasement du dirigeable Hindenburg, lors de son atterrissage le 6 mai 1937.
Dans Kursk tourmente d’acier (2000), Dimitri décrit, avec une multitude de commentaires, le parcours d’un soldat de l’armée allemande engagé dans la bataille de Kursk, lequel va être témoin de l’atrocité de la guerre. Kamikazes (1997) décrit la psychologie d’un jeune aviateur nippon sacrifiant sa vie pour sa patrie. Dimitri montre que son sens de l’honneur est le même que celui des samouraïs.
Dans le tome 2 de Sous le feu ! (2011), Dimitri prône le sens de l’honneur d’un jeune officier nippon descendant d’une famille de samouraïs. Au cours de la bataille de Malaisie (décembre 1941), il se bat avec bravoure et respecte ses prisonniers. Mais, sanctionné par un officier supérieur, il doit maintenant surveiller des prisonniers anglais chargés de construire un pont. Malgré le sabotage du pont, il continue de défendre les prisonniers de guerre anglais. Cet esprit chevaleresque envers l’ennemi lui évitera la prison en 1945. Dans tous ces récits de guerre, Dimitri explore la conscience tourmentée du guerrier. Mais Dimitri endosse également le point de vue des alliés. Le Convoi (2001) révèle ainsi l’angoisse des marins américains, livrant des armes à l’armée russe, toujours sous la menace des bombardiers et sous-marins allemands.
A titre exceptionnel, Dimitri réalise en 2008 le scénario du tome 1 de la série Les oubliés de l’Empire. Il raconte le parcours d’Üdo Sajer, un jeune wurtembergeois de 16 ans. En 1805, fasciné par l’armée napoléonienne, celui-ci parvient à s’engager, quitte le Saint-Empire romain germanique, et suit une formation militaire. Mais dès sa première bataille, le jeune Sajer découvre l’horreur de la guerre… Dimitri semble ainsi s’amuser à imaginer son parcours s’il était né deux siècles plus tôt, remplaçant ainsi la Wehrmacht par l’armée Napoléonienne.
* La fascination pour la forêt et la mer.
Dès qu’il avait un moment de libre, Dimitri partait se promener en forêt. Il s’y réfugiait lorsqu’il était contrarié, déprimé. Il a célébré son amour pour la forêt dans la bande dessinée Hymne à la forêt (1994). A la fin du premier millénaire, un chevalier errant fuit au coeur de la forêt profonde de la Saxe. Il détient une pierre noire qui va lui donner d’étranges pouvoirs. Après bien des péripéties, il se métamorphose en un beau guerrier solaire à l’armure magique… Sorti en 2007, La Malvoisine s’inspire du Roman de Renard. Dimitri imagine les mésaventures d’un vieux sage, qui tente de faire régner l’ordre et la justice entre les humains et les animaux, et de sa voisine guerrière qui considère que l’homme doit dominer le monde animal. Pour cette histoire, il reprend le dessin animalier de sa jeunesse. Mais ces deux légendes médiévales sont cependant décevantes.
Également fasciné par la mer, Dimitri était un fidèle des fêtes maritimes internationales de Brest. Dans nombre de ses récits, il montre la dureté de la vie en pleine mer.
Meurtrier (1998) évoque la dramatique vie d’un pauvre orphelin, qui après avoir perdu ses parents à l’âge de cinq ans, est pris en charge par une sinistre institution, condamné à une peine de prison pour meurtre, puis devient fantassin pendant la première guerre mondiale. Cet album permet à Dimitri de dessiner de terrifiantes tempêtes maritimes.
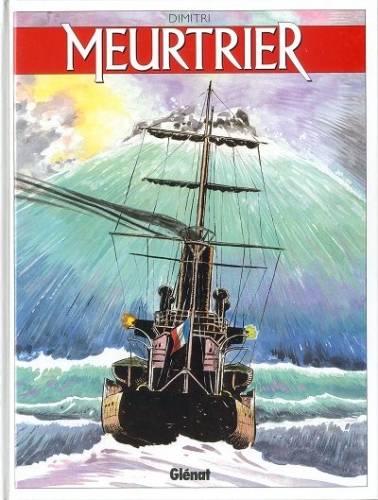
Dans Haute Mer (1993), Dimitri décrit, à l’aube de la première guerre mondiale, le parcours d’un baleinier qui va s’aventurer dans les eaux de l’arctique. Prêt à affronter tous les dangers, le commandant recherche en mer une créature mythique. Le dessin réaliste de Dimitri est si soigné qu’on a l’impression d’être immergé en haute mer.
Dans Sous le pavillon du Tsar (1995), Dimitri nous dévoile la bataille navale de Tsushima, opposant les 27 et 28 mai 1905 les forces russes du Tsar Nicolas II aux japonais. On découvre le quotidien des marins de la flotte russe ainsi que l’horreur d’une bataille navale moderne.

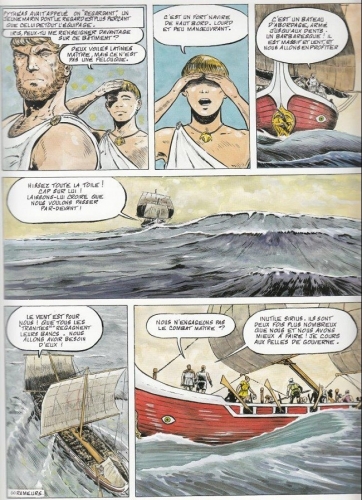
Le récit de Dimitri le plus surprenant reste sans doute Le Voyage (2003) publié chez Albin Michel en 2003. Aux alentours de 330 avant J.C, le savant Pytheas, originaire de la colonie grecque de Massalia (Marseille), prend la mer pour explorer l’Europe nordique. Il passe les Colonnes d’Hercule (détroit de Gibraltar) et découvre le phénomène des marées, alors inconnu des Grecs. Parvenant à éviter des pirates maures, il pousse plus au nord et atteint l’Armorique et ses mégalithes. Après le pays des Pictes, il parvient à l’île de Thulé, située sur le cercle arctique. Cédant la place à l’imaginaire, Dimitri n’hésite à conter une rencontre entre Pytheas et les dieux antiques puis le peuple atlante. Relire cette bande dessinée après la mort de Dimitri reste un moment émouvant…
Dimitri se définissait comme un européen, ne se sentant en Europe nulle part dépaysé (Le Choc du Mois, fév. 1989, p. 68). Il paraissait très calme, aux manières policées. Mais sa vie restait marquée par son expérience de combattant pendant la seconde guerre mondiale. Il s’exprimait ainsi : « Il m’arrive encore de sauter du lit la nuit. Les trente mois que j’ai passé dans l’armée représentent pour moi 75 % de mon expérience vitale. Le reste de mon existence me semble, en comparaison, si aimable, si facile… Et c’est peut-être monstrueux à dire, mais cette période atroce de ma vie constitue, en même temps, toute ma richesse. Quoi que je fasse, quoi que je cherche comme source d’inspiration, je tombe invariablement là-dessus » (Vécu, juin 2000, p. 85).
Sur le plan artistique, Dimitri avait appris son métier sur le tas. Auteur complet, il réalisait le scénario et le dessin. C’est peut-être la raison pour laquelle son dessin rond, au trait de pinceau nourri, racé et viril, était si caractéristique. Il dessinait avec ses tripes. On retrouvait toujours dans ses bandes dessinées l’idée dramatique qu’on n’échappe pas à son destin. Mais cette idée était souvent portée avec humour.
Conseils de lecture (parmi les œuvres encore éditées) :
– Le soldat oublié, 784 pages, 12 euros, Tempus Perrin.
– Récits de guerre t. 1 (Sous le pavillon du Tsar, Kamikazes, Meurtrier), 144 pages, 16 euros, Glénat.
– Le Voyage, 56 pages, 12,75 euros. Albin Michel BD.
Kristol Séhec
[cc] Breizh-info.com, 2022, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine
10:42 Publié dans Bandes dessinées, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dimitri, guy sajer, guy mouminoux, bandes dessinées, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 23 février 2022
Harald Neubauer
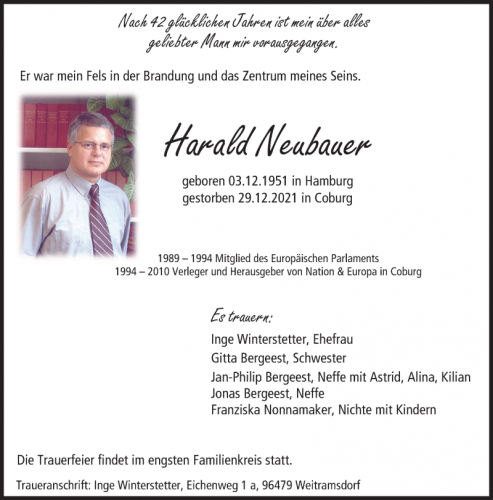
19:01 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harald neubauer, hommage, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
À la mémoire de l'académicien Igor Rostislavovich Shafarevich
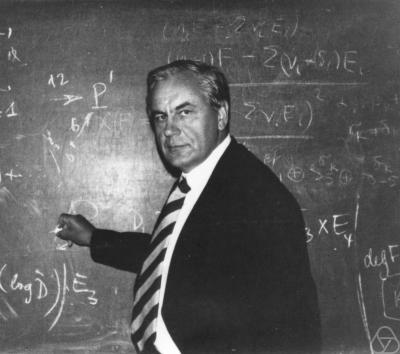
À la mémoire de l'académicien Igor Rostislavovich Shafarevich (Chafarevitch)
par Arkady Minakov
Source: https://www.geopolitica.ru/article/pamyati-akademika-igorya-rostislavovicha-shafarevicha
Le 19 février 2022, cela fera cinq ans qu'Igor Rostislavovitch Shafarevich est décédé. Il était sans aucun doute l'une des figures clés de la société russe du dernier tiers du XXe siècle et du début du XXIe siècle.
On ne peut pas dire que son nom soit peu connu de nos jours, mais peu de choses sont dites et écrites à son sujet dans l'espace public. Il y a de très bonnes raisons politiques à cela, pour lesquelles la figure de Shafarevich dans les années 1980 a été négativement mythifiée et tabouisée dans les médias libéraux.
Shafarevich est né le 3 juin 1923 à Zhytomyr. Son père, Rostislav Stepanovich, est diplômé du département de physique et de mathématiques de l'université d'État de Moscou et a travaillé comme professeur de mécanique théorique. Shafarevich se souvient : "L'origine de mon père n'est pas très claire. C'est-à-dire qu'il est lui-même originaire de Zhytomyr, mais d'où viennent ses parents - pas très clair pour moi. La racine "Shafar" elle-même figure dans le dictionnaire des racines slaves du Sud ou slaves de l'Ouest. J'ai rencontré un tel nom de famille dans des références à un auteur polonais, et on le trouve également en Serbie. Selon les rumeurs familiales, mon grand-père venait de Serbie. Cette conclusion est tirée d'abord du fait qu'il était orthodoxe (il était sacristain dans une église), et ensuite qu'il venait de l'Ouest : il parlait russe avec un accent. Et quel autre Occident orthodoxe y a-il? ...".
Sa mère, Yulia Yakovlevna, philologue de formation, ne travaillait pas la plupart du temps. Son père était le directeur de la succursale de la ville d'une banque d'État. Shafarevich se souvient : "C'était une occupation très dangereuse, car les premières troupes qui arrivaient prenaient tout l'or, et les suivantes exigeaient qu'il le donne. Plusieurs fois, il a été emmené au peloton d'exécution".
Certaines des terribles réalités des années post-révolutionnaires se sont fermement ancrées dans l'esprit du garçon : "... j'ai assisté à la tragédie de la paysannerie russe. Mes parents louaient la moitié d'une cabane de paysans en été au lieu d'une datcha (et les paysans déménageaient dans l'autre moitié). Elle se trouvait non loin de la ville actuelle de Pushkino. Le village s'appelait Kuronovo. Il n'existe plus - le terrain sur lequel il se trouvait a été inondé par le réservoir. Je me souviens que des choses étranges se sont produites lors de la construction du réservoir. Pendant la journée, mes amis et moi jouions aux raiders cosaques sur la rive, en nous cachant dans les buissons, et le soir, des personnes qui me semblaient énormes, à moi, un enfant, en raison de la différence de taille, ont été conduites dans les buissons. Des chiens aboyeurs les gardaient. Je n'ai pas communiqué avec eux, j'ai juste vu cette image d'une masse sombre s'étendant devant notre maison".
Les parents de Shafarevich lui ont donné une excellente éducation, il connaissait plusieurs langues et était extrêmement cultivé pour son âge. Déjà dans sa maturité, il a dressé une liste de vingt livres, qui lui ont fait "la plus grande impression". Parmi eux figuraient les byliny russes, les contes d'Afanasiev, des frères Grimm, Le Prométhée enchaîné et les Euménides d'Eschyle, l'Histoire d'Hérodote, le Faust de Goethe, Pouchkine et Dostoïevski. Ces livres lui ont très probablement été lus lorsqu'il était enfant.
Le cercle de lecture de Shafarevich s'est considérablement enrichi d'ouvrages de fiction moderne, d'ouvrages historiques, philologiques et philosophiques : des livres de Soljenitsyne (Un jour dans la vie d'Ivan Denisovitch, Le Pavillon des cancéreux, L'Archipel GULAG), des "rednecks" de V.I. Belov ("Kanun") et autres. I. Belov ("Eve"), V. G. Raspoutine ("Adieu à la mère"), études de la mythologie, de la littérature et de la culture russes anciennes, ouvrages sur l'histoire de la société occidentale et russe. Une place spéciale dans cette liste a occupé les livres des penseurs conservateurs russes I.A. Ilyin "Sur la monarchie et la république" et "Nos tâches" ; I.L. Solonevich "Narodnaya Monarchiya", L.A. Tikhomirov "L'État monarchique".

À l'école, Shafarevich a développé un intérêt très profond pour l'histoire (il avait même l'intention de devenir historien, mais a ensuite considéré à juste titre que dans l'URSS extrêmement idéologisée, l'étude professionnelle de l'histoire entraînerait un coût moral et intellectuel trop important). Finalement, il a opté pour les mathématiques.
Dès l'âge de treize ans, il suit le programme scolaire en mathématiques, puis le programme de la faculté de mécanique et de mathématiques de l'université d'État de Moscou, où il passe ses examens externes. En huitième année, le jeune homme phénoménalement doué a suscité l'intérêt des professeurs du MGU (B. K. Delaunay), et en neuvième année, Igor Shafarevich a commencé des travaux de recherche en algèbre et en théorie des nombres. Après avoir quitté l'école, il est accepté en dernière année de la faculté de mécanique et de mathématiques et obtient son diplôme en 1940, à l'âge de 17 ans. Shafarevich a soutenu sa thèse de doctorat à l'âge de 19 ans et sa thèse de doctorat à l'âge de 23 ans. Il a rejoint la faculté du département de mécanique et de mathématiques de l'Université d'État de Moscou en 1944, et à partir de 1946, il a intégré le personnel de l'Institut mathématique Steklov (MIAN). Il a supervisé la soutenance de plus de trois douzaines de thèses de doctorat. En 1958, Shafarevich a été élu membre correspondant de l'Académie des sciences de l'URSS et en 1991, il a été élu membre de l'Académie des sciences de Russie. Il a reçu le prix Lénine en 1959 pour la découverte de la loi générale de réciprocité et pour avoir résolu le problème inverse de la théorie de Galois. Les principaux travaux de Shafarevich portaient sur l'algèbre, la théorie des nombres et la géométrie algébrique. Il était l'un des mathématiciens les plus connus de notre époque, et membre des principales académies et centres scientifiques étrangers.
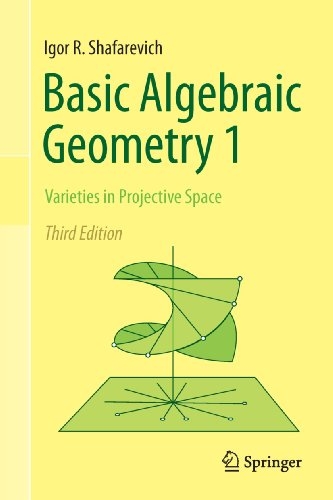
Shafarevich percevait les mathématiques comme "une belle symphonie se poursuivant sans fin", et l'opportunité de s'y évader du monde des dictats idéologiques, son "sens et sa beauté l'ont amené à réaliser le but religieux de la connaissance du monde". Lors d'une conférence prononcée à l'occasion de la remise du prix Heinemann en 1973 à l'Académie de Göttingen, Shafarevich a particulièrement insisté sur la relation entre la religion et les mathématiques, accordant une nette priorité à la religion : "Ce n'est pas la sphère la plus basse en comparaison, mais la plus haute de l'activité humaine - la religion - qui peut donner un but aux mathématiques. <...> Les mathématiques ont été formées en tant que science au 6e siècle avant J.-C. dans l'union religieuse des Pythagoriciens et faisaient partie de leur religion. Les mathématiques avaient un objectif clair : c'était un moyen de fusionner avec le divin en comprenant l'harmonie du monde exprimée dans l'harmonie des nombres. <...> Je voudrais exprimer l'espoir que, pour la même raison, il peut maintenant servir de modèle pour la solution du principal problème de notre époque : trouver un but religieux plus élevé et le sens de l'activité culturelle de l'humanité.
En l'absence d'un objectif religieux supérieur, toute l'activité scientifique de l'humanité ne mène qu'à la destruction globale.
Cependant, ce ne sont pas seulement ses succès en mathématiques qui ont rendu Shafarevich célèbre dans le pays et dans le monde. En tant que mathématicien, il reste connu d'un cercle relativement restreint de professionnels. Son activité sociale et politique dans le cadre du mouvement dissident, qui a vu le jour en URSS à cette époque, lui a apporté une notoriété incommensurable. Dès 1955, il a signé la "Lettre des trois cents" adressée au Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique en solidarité avec la protestation des biologistes contre Lyssenko. En 1968, il a signé une lettre collective pour défendre le militant dissident des droits de l'homme A.S. Yesenin-Volpin, qui était emprisonné dans un hôpital psychiatrique. Et dès la fin des années 1960, Shafarevich devient l'un des leaders du mouvement dissident, rejoignant le "Comité des droits de l'homme en URSS" organisé par A.D. Sakharov, créé fin 1970, où il fait de la protection des droits des croyants l'un des thèmes principaux. Shafarevich occupait une position particulière au sein du Comité : "J'étais membre du Comité, mais j'étais irrité par le manque de direction dans ses activités. Il me semblait inutile d'étudier la situation des droits de l'homme en URSS, et non de se battre pour eux. J'ai rédigé un rapport sur l'état des religions en URSS. En préparant le rapport, j'ai souligné que la persécution anti-religieuse se produit dans tous les pays socialistes, sans exception. Partout où le socialisme s'est manifesté, que ce soit en Albanie, en Chine, partout les mêmes événements ont eu lieu : persécution de toute confession existante, persécution des croyants, quelle que soit leur croyance. Cela m'a fait réfléchir à la nature du socialisme lui-même.
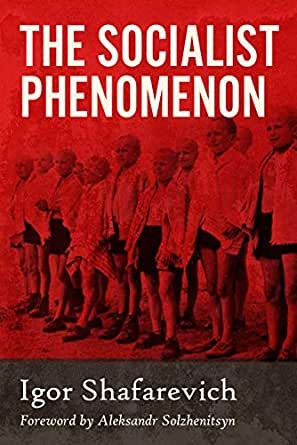
Shafarevich a exposé sa vision du socialisme, remarquable par la profondeur et la clarté de sa compréhension, dans un court article intitulé "Socialisme", publié dans la collection "De sous les rochers", conçue par lui et A.I. Solzhenitsyne comme une sorte de continuation des célèbres collections "Jalons" et "De profondeur". Shafarevich a présenté le socialisme comme une conséquence des grandes crises vécues à plusieurs reprises par l'humanité. Le socialisme en tant que théorie et pratique est une manifestation du désir d'autodestruction de l'humanité, du Néant ; il est hostile à l'individualité, relègue l'homme au niveau des détails d'un organisme étatique et cherche à détruire les forces qui soutiennent et renforcent la personne humaine : la religion, la culture, la famille, la propriété individuelle.
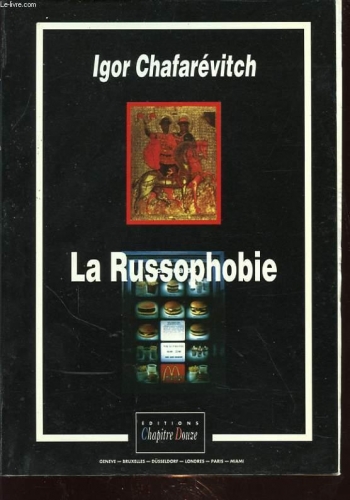
Immédiatement après l'arrestation et la déportation hors d'URSS de son co-auteur Soljenitsyne en février 1974, Shafarevich a écrit des lettres ouvertes pour défendre l'écrivain. Il a été renvoyé de l'université d'État de Moscou en 1975 et n'y a plus enseigné depuis. Cependant, il n'a pas été touché par de graves représailles à cette époque. La situation s'est aggravée lorsqu'en 1982, il a laissé le manuscrit de son essai "Russophobie", écrit en 1980, partir en "samizadat" : "Les vrais problèmes ont commencé lorsque j'ai écrit 'Russophobie'. ... J'ai écrit de nombreux ouvrages, mais c'est celui-là qui est vraiment célèbre. L'homme de la rue, si vous lui demandez qui est Shafarevich, serait capable d'associer mon nom exclusivement à cette œuvre.
Shafarevich lui-même pense que la principale chose qu'il a faite dans cet essai a été de généraliser le concept de "petites gens", qui a été introduit pour la première fois par l'historien français Augustin Cochin, qui a analysé la situation des cercles intellectuels en France avant la révolution de 1789 : "Cochin a décrit comment les "salons" français ont préparé la révolution. Elle a été réalisée par des personnes unies par un sentiment commun, à savoir le mépris et la haine de leur propre pays et de leur culture. Ils niaient toutes ses réalisations, considéraient la France et les Français comme quelque chose de peu de valeur par rapport à d'autres nations qui, selon eux, avaient remporté de grands succès, et insistaient sur le fait que seul un renversement radical dans tous les domaines de la vie ferait de la France "une partie de l'humanité éclairée". Les conséquences de leurs activités étaient terribles."
Shafarevich a suggéré qu'un tel phénomène - une "petite nation" - apparaît en période de crise majeure dans n'importe quel pays, qu'il s'agit d'une sorte de phénomène mondial. En tant que "petit peuple", Shafarevich voyait les sectes calvinistes protestantes en Angleterre pendant la Révolution anglaise du XVIIe siècle, les "illuminati" et les "encyclopédistes" en France à la veille de 1789, les "Hégéliens de gauche" en Allemagne, qui ont ouvert la voie à l'émergence du marxisme et de l'anarchisme, les nihilistes russes des années 1860 et 70... Ce sont ces minorités religieuses et idéologiques qui ont formé le noyau de la "contre-élite" et ont été la cause et le moteur de tous les grands cataclysmes sociaux qui se sont abattus sur les pays susmentionnés.

Le "petit peuple", dans l'interprétation de Shafarevich, n'est pas un courant national à proprement parler, car il pourrait inclure des représentants de différentes ethnies et nationalités. Cependant, à la veille des révolutions de 1905-1907 et de 1917 en Russie, ainsi que plus tard en URSS dans les années 1970 et 1980, "un certain courant de nationalisme juif" a joué un rôle majeur dans le "petit peuple".
C'est cette disposition qui a provoqué un grave conflit dans le mouvement social de l'époque, car dans la perception du camp dissident-libéral, elle permettait d'interpréter la "russophobie" comme un vulgaire pamphlet antisémite.
Au même moment, le KGB, alors dirigé par Yuri Andropov, a commencé à répandre des rumeurs sur l'arrestation possible du scientifique. Le début des années 1980 a été marqué par les arrestations et la persécution d'un certain nombre de membres du "Parti russe" de l'époque. Shafarevich se souvient de cette époque comme suit :
"Un document sur ce sujet est maintenant connu - la lettre d'Andropov au Politburo... Andropov y parle de certains "Russes" dangereux, qui sont apparus à la place de défenseurs des droits de l'homme vaincus. C'est à ce moment-là que la chasse aux personnes d'"obédience russe" a commencé. Ainsi, en 1982, L.I. Borodin a été arrêté. D'ailleurs, alors que l'enquête était déjà terminée, on lui a dit : "Votre sort est scellé. Voulez-vous savoir qui sera le prochain ? Shafarevich." Il a raconté cela à l'avocat, ce dernier à sa femme, sa femme à moi".
Néanmoins, Shafarevich n'a pas été arrêté, bien que la réaction à ce livre La russophobie soit encore tangible : sa femme a été suspendue de son enseignement à l'Institut d'ingénierie et de physique, et son fils n'a pas été admis au département de physique de l'Université d'État de Moscou.
Le conflit s'est particulièrement intensifié après la publication de l'essai en 1989 dans le journal "pseudo-romantique" Nash sovremennik. Des lettres collectives de protestation signées par Y. N. Afanas'ev, A. D. Sakharov, D. S. Likhachev, des mathématiciens américains, etc. se sont coalisés contre Shafarevich. En 1992, l'Académie nationale des sciences des États-Unis a appelé Shafarevich à refuser volontairement de devenir membre de l'Académie, car il n'existe aucune procédure d'expulsion de l'Académie (en 2003, Shafarevich l'a lui-même quittée en signe de protestation contre l'agression américaine contre l'Irak).
À partir de la fin des années 1980, Shafarevich a participé sporadiquement aux initiatives politiques et culturelles du mouvement national-patriotique alors naissant : on connaît sa participation symbolique à des organisations telles que l'Union nationale russe, l'Assemblée du peuple russe, le Front du salut national, le Parti démocratique constitutionnel-Parti de la liberté du peuple et le Centre panrusse de la droite nationale. Il a également contribué pendant un certain temps à des publications telles que le journal Den et le magazine Nash sovremennik.

Cependant, dans les années 1990 et au cours de la première décennie des années 2000, Shafarevich a joué son principal rôle public non pas en tant qu'homme politique, ce qu'il n'a jamais été, mais en tant qu'auteur d'interviews, d'articles et de livres, sans lesquels l'autodéfinition idéologique d'une partie du mouvement national conservateur moderne n'aurait pas été possible. Parmi eux, l'article "Deux routes vers un même précipice" mérite une mention spéciale, dans lequel le socialisme et le capitalisme sont considérés comme les hypostases d'une seule et même civilisation, dans laquelle tout ce qui est organique et naturel est étranger, tout est remplacé par un mécanisme complètement artificiel, où le rythme de travail et le style de vie sont subordonnés à la technologie, où tout est standardisé et unifié : la langue, les vêtements, les bâtiments.
Une telle civilisation est exceptionnellement productive à certains égards, comme sa capacité à nourrir sa population, à générer de l'énergie, à produire des armes de destruction massive, à contrôler et à manipuler la conscience de masse, etc. Mais cette civilisation, qui détruit activement la nature et supprime tous les aspects organiques et traditionnels de la vie, porte les germes de sa propre disparition, réduisant l'homme au plus bas niveau, celui de son essence animale. Cela doit inévitablement conduire à une crise spirituelle, démographique et écologique mondiale. La différence entre le mode de "progrès" occidental et le socialisme est que le premier est plus "doux" et repose davantage sur la manipulation de la conscience de masse, tandis que le second s'appuie incomparablement plus sur la violence directe et la coercition. Shafarevich a essentiellement appelé à la recherche d'une "troisième voie" qui mobiliserait l'expérience de toutes les formes de vie plus organiques pour surmonter la crise menant à la disparition de l'humanité.

La dernière œuvre majeure de Shafarevich est le traité "L'énigme des trois mille ans", consacré à la question juive, qu'il a écrit pendant vingt-cinq ans (c'est-à-dire depuis 1977).
L'idéologie de la "troisième voie", partagée par presque tous les courants conservateurs en Russie, a été développée en son cœur dans les écrits de Shafarevich, à commencer par son article programme "Deux routes vers un précipice" (1989). Le terme "russophobie", l'un des premiers utilisés par F.I. Tyutchev, a pris racine grâce à Shafarevich, d'abord dans le discours national-patriotique, et depuis environ 2014, il est fermement ancré dans la rhétorique officielle.
Shafarevich est décédé le 19 février 2017 et a été enterré au cimetière de Troekurovsky. En dépit de sa renommée nationale et internationale et de son prestige extrêmement élevé dans le milieu patriotique, dont certains avaient à cette époque réussi à s'engager de manière constructive avec l'establishment, il n'y a pas eu de condoléances de la part des autorités suprêmes, ni de reportages sur sa mort sur les chaînes de télévision centrales.
Principaux travaux de I.R. Shafarevich :
Shafarevich I. R. Socialism / I. R. Shafarevich // From under the boulders : a collection of articles. - M. : Paris : YMCA-PRESS, 1974. - С. 29-72.
Shafarevich I. R. Russophobia / I. R. Shafarevich. Œuvres complètes : en 6 vol. - Moscou : Institut de la civilisation russe, 2014. - VOL. 2 - P. 273-395.
Shafarevich I. R. Two roads to one precipice / I. R. Shafarevich. Collection complète des œuvres : en 6 volumes. - Moscou : Institut de la civilisation russe, 2014. - VOL. 2. - P. 3-54.
16:45 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, igor r. chafarevitch, russie, mathématiques, sciences, dissidence soviétique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 février 2022
Günter Maschke est mort - Nécrologie pour mon ami !
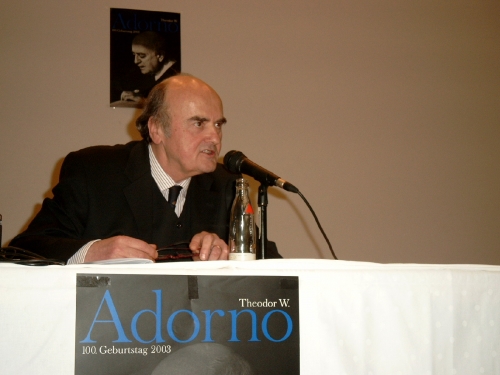
2003: Günter Maschke à Francfort lors d'un colloque sur le philosohe Adorno.
Günter Maschke est mort - Nécrologie pour mon ami !
par Werner Olles
Source: https://wir-selbst.com/2022/02/12/gunter-maschke-ist-tot-nachruf-auf-einen-freund/
Il y a quelques personnes dont l'existence même donne réconfort. C'est le cas de mon cher ami Günter Maschke, qui est décédé de manière inattendue le 7 février, trois semaines seulement après son 79e anniversaire. Une semaine plus tôt, nous nous étions encore parlés au téléphone, il était de bonne humeur, travaillait à son petit livre d'anecdotes sur Carl Schmitt et se réjouissait de l'arrivée du printemps, car nous pourrions alors à nouveau manger ensemble au restaurant italien. Et puis mercredi, j'ai vu sa photo sur le blog "acta diurna" de Michael Klonovsky et j'ai lu la nouvelle de sa mort, je n'ai d'abord pas voulu y croire et je n'arrive toujours pas à y croire aujourd'hui.
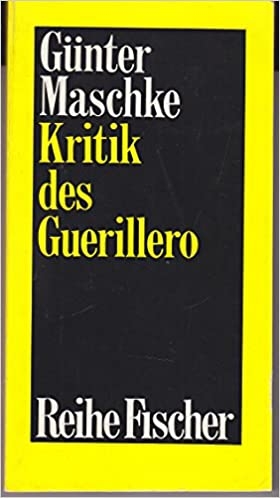
Nous nous sommes rencontrés au milieu des années 1980, alors qu'Alain de Benoist devait parler de la "Nouvelle Droite" dans une maison privée quelque part dans le Taunus. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait là quatre ou cinq personnages que j'ai reconnus comme étant des membres du Kommunistischer Bund (KB) - avec lequel j'avais encore sympathisé dix ans auparavant -, ce qui a conduit l'organisateur, un avocat de Francfort, à annuler la rencontre. Maschke a écumé de rage et a écrit à ce monsieur une lettre amère dont la teneur était la suivante : "Si nous nous dégonflons déjà devant une telle bande d'hirsutes du KB, comment allons-nous arriver un jour au pouvoir ?". En tant qu'ancien radical de gauche, cela m'a touché au cœur, et lorsque nous nous sommes découverts de nombreux points communs, il avait par exemple appris le métier d'assureur comme moi, avait été membre du SDS, puis du SPD, mais avait renoncé au communisme après son asile sur l'île de Cuba, tandis que chez moi, quelques années plus tard, la triste réalité de la gauche, dans le propre cadre des mes fréquentations, a suffi à détruire mes utopies socialistes.
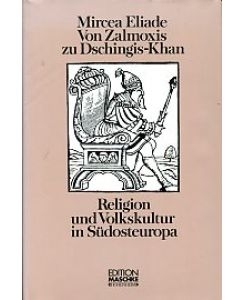
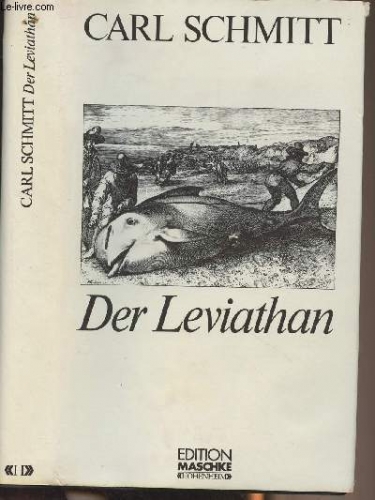
Deux productions du plus haut intérêt de la maison "Edition Maschke".
Nous nous sommes ensuite rencontrés plus souvent, nous sommes allés manger ensemble ou allés siroter quelques breuvages au café, et il était toujours présent lors des réunions mensuelles à la "Nibelungenschänke", auxquelles participaient également Martin Mosebach, Lorenz Jäger, l'artiste de cabaret Matthias Beltz, Gerd Koenen, Claus Wolfschlag, "notre" député de l'époque au Römer (le parlement de la ville de Francfort, ndt) Wolfgang Hübner, Eckhard Henscheid, Götz Kubitschek et Ellen Kositza. Cela s'est encore intensifié après le décès de sa chère Sigrid il y a six ans, dont il s'est occupé avec dévouement jusqu'à la fin. C'est alors que s'est révélée une facette que beaucoup ne soupçonnaient pas chez un homme qui, en tant que professeur invité à l'Académie de la marine de guerre de La Punta au Pérou, enseignait à ses élèves officiers la théorie de la lutte contre les partisans de son propre maître Carl Schmitt et qui avait lui-même participé à deux campagnes contre les terroristes du Sentier lumineux ("Sendero Luminoso"). De ces campagnes, il nous est parvenu une anecdote savoureuse qui mérite d'être retenue : Lors d'une fusillade à Ayacucho, l'armée fut bombardée de grenades de mortier par le Sendero, et alors que la place du marché de la petite ville était jonchée de débris et de cadavres, Maschke découvrit dans la vitrine d'une librairie, curieusement restée à peu près intacte - le libraire s'était sagement éclipsé - un livre de son ennemi préféré Jürgen Habermas "Théorie de la communication sans domination". Ses camarades ne furent pas étonnés de le voir ensuite éclater de rire malgré le carnage qui l'entourait. Dans son magnifique livre "La parole armée", il décrit d'ailleurs dans un essai du même nom l'ascension du "Sendero", une lecture qui coupe le souffle.
Günter Maschke est né le 15 janvier 1943 à Erfurt. Son père biologique étant mort pendant les dernières années de la guerre, il a été adopté par un monsieur Maschke, un fabricant de tricots de la classe moyenne. Son père adoptif, un Stresemannien politique qu'il aimait beaucoup, déménagea avec sa famille et son entreprise à Trèves à la fin de la guerre. C'est là que le jeune Günter grandit dans une Allemagne d'après-guerre marquée par la France, obtint son certificat d'études secondaires (Mittlere Reife), puis son baccalauréat (Begabtenabit) des années plus tard dans le Bade-Wurtemberg, et adhéra aussitôt à l'Union allemande pour la paix (Deutsche Friedensunion, DFU), une organisation de façade du KPD interdit, financée par la RDA, ce qui fit sensation dans la ville catholique de Trèves et provoqua des tumultes et lui valu des insultes, ce qui lui plut beaucoup. Il était logique qu'il rejoigne également le KPD illégal peu de temps après.
Avec Rudi Dutschke, Frank Böckelmann, Herbert Nagel et Dieter Kunzelmann, il était actif dans la "Subversive Aktion", puis plus tard dans le SDS. Il a déserté l'armée allemande, mais pas pour des raisons pacifistes, s'est réfugié en Autriche où il fut connu sous le nom de "Dutschke de Vienne". Lorsque la police a voulu l'expulser vers l'Allemagne, l'ambassadeur cubain lui a offert l'asile. Pendant les deux années qu'il passa sur l'île à sucre, Maschke découvrit le côté obscur du communisme, une économie moribonde, la faim et une répression excessive, le système des mouchards, la mentalité habituelle de l'Amérique latine qui consiste à ne rien faire, et le "petit protégé" de Castro devint avec le temps un opposant grâce à son amitié avec le dissident et poète Heberto Padilla. Lorsque le régime l'accusa de "conspiration", même le Lider Maximo - qu'il vénérait malgré tout parce que Castro avait tenu tête au principal ennemi de l'Amérique latine, les États-Unis - ne put plus le protéger : la police militaire cubaine est venue le chercher, a glissé un bon cigare dans la poche de sa chemise à l'aéroport et l'a mis dans l'avion. En Allemagne, un an de prison l'attendait à Landsberg. Pendant cette période, qu'il ne regretta jamais, il mit sur pied la bibliothèque de la prison et fit ce qu'il aimait le plus : lire.


En haut, Maschke à son retour de Cuba. En bas, Maschke attend son procès qui le conduira à purger treize mois de prison à Landsberg en Bavière.
Il serait trop long d'énumérer toutes les étapes de sa vie aventureuse. Jusqu'à la mort de Carl Schmitt en 1985, il a travaillé comme pigiste permanent pour la FAZ. Sa nécrologie de Schmitt, qui venait de mourir, incita Dolf Sternberger à écrire un contre-article et Maschke à démissionner de son poste à la FAZ. Maschke fonda sa propre maison d'édition, "Edition Maschke", donna des conférences, surtout à l'étranger, en Espagne, en France, en Colombie, écrivit de magnifiques essais, commenta et traduisit les œuvres de Juan Donoso Cortés - il suffit de lire son essai "La dictature légale du général Narváez et Donoso Cortés (1847/51)" - et devint à Francfort-sur-le-Main le point focal où convergeaient de jeunes intellectuels de droite, surtout des admirateurs étrangers de Schmitt, auxquels il offrait en quelque sorte des cours privés. Il donna d'innombrables interviews sur Carl Schmitt, le droit international, la constitution de la République fédérale d'Allemagne qui n'existe toujours pas - sa première interview dans le JF "Die Verfassung ist unser Gefängnis" (la constitution est notre prison) est légendaire - et cultiva son existence d'érudit privé, traité avec un soin relatif, même par la très controversée plateforme Wikipedia.

En principe, tout ce qu'il a couché sur le papier mérite d'être lu, mais surtout Das bewaffnete Wort (La parole armée) avec les essais "Sterbender Konservativismus und Wiedergeburt der Nation" (Conservatisme mourant et renaissance de la nation), dans lequel il recommandait aux conservateurs de s'abolir en tant que tels pour renaître en tant que nationaux-révolutionnaires, "Die Verschwörung der Flakhelfer" (La conspiration des aides de camp), qu'il faut avoir lu pour comprendre un tant soit peu le rôle étrange et l'image de soi de la République fédérale et "Die schöne Geste des Untergangs" sur l'écrivain fasciste et décadent Pierre Drieu la Rochelle, un essai que - on a peine à le croire - la FAZ osait encore publier en 1980. Si vous souhaitez également connaître des informations personnelles sur lui ou ce qu'il pense de la soi-disant "nouvelle droite", vous pouvez vous reporter au livre d'entretiens de 200 pages intitulé Verräter schlafen nicht (Les traîtres ne dorment pas). Celui qui veut savoir pourquoi il a mis fin à sa carrière à la FAZ cinq ans plus tard, malgré l'intercession de Joachim Fest, lira Der Tod des Carl Schmitt et la partie qu'il contient "Sankt Jürgen und der triumphierende Drache - Anläßlich Habermas' neueste Angriff auf Carl Schmitt". Il comprendra alors pourquoi - comme aimait à le dire Maschkino - cela ne vaut pas la peine de se pencher sur les théories de Habermas qui, selon les mots de Maschke, "sont réfutées tous les soirs aux informations". Et ce, bien que ce dernier l'ait tout de même qualifié de "seul véritable renégat du mouvement soixante-huitard". C'est pourquoi Maschke réitère : "Que sont cent pages de Habermas face à une page de Hobbes ou de Gehlen ?"
"Pour Werner Olles -in hoffnungsschwacher, doch heiterer Verbundenheit", c'est en ces termes qu'il m'a dédicacé le dernier livre cité, "Das bewaffnete Wort", avec la dédicace "Die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht! " Maintenant, il est parti, notre esprit le plus brillant, le plus intelligent et en même temps le plus attachant, mais nous ne nous rendrons pas tant que nous serons en vie. Mais en même temps, sa mort marque la fin d'une époque, non seulement pour moi et tous ses amis personnels, mais aussi pour toute la Nouvelle Droite intellectuelle, dont il a toujours accompagné l'action avec un intérêt vigilant et une solidarité critique.
Maschkino, mon cher et fidèle ami, tu me manques, tu nous manques à tous, et tu me manques déjà, ton humour si merveilleusement particulier, ton rire tonitruant, ta noblesse et ta jovialité, l'absence totale de prétention - même pour le mendiant assis avec son gobelet en carton devant Rewe, tu avais quelques mots aimables et surtout toujours quelques euros sous la main - ah, je ne sais pas par où commencer ni par où m'arrêter. Si tu ne te sentais pas très bien, ce qui était dû au "Général Zucker" (= le diabète, ndt), il t'arrivait d'être un peu rude et de me crier que mes articles n'étaient pas non plus "si géniaux" et que je devais "modérer" mes "accès de colère" et de "haine" dans mon "discernement", pour me serrer dans tes bras quelques minutes plus tard. Il reste les souvenirs de nos repas communs chez Pino et chez Apulia, de nos discussions et de nos promenades à Rödelheim, où tu rencontrais une connaissance tous les dix mètres, de l'admiration dont tu jouissais en tant que "le Professore" chez nos deux Italiens préférés, alors que j'étais "le Teemann" (Monsieur-le-thé), car je ne buvais jamais que du thé vert.
À la question "Croyez-vous en Dieu ?", tu as répondu un jour dans une interview : "Pas toujours, mais souvent !" Pour un agnostique confirmé, qui était protestant dans sa jeunesse, qui a qualifié le Vatican II de l'Église catholique de "suicide", c'est beaucoup. Lors d'une conversation sur Dieu que nous avons eue un jour après un bon repas méditerranéen, tu as insisté sur le fait que tu irais plutôt en enfer. Je n'étais pas d'accord et finalement, je n'ai rien trouvé d'autre à dire que "d'accord, mais alors je viendrai te voir de temps en temps". Tu as eu une crise de rire et tu as immédiatement parlé de mon projet à tous les invités avec enthousiasme. Ce genre d'expérience reste à jamais gravé dans ma mémoire.
Mon bon Mashkino, je te remercie pour ta fidèle amitié et pour les moments uniques que nous avons passés ensemble et que je n'oublierai jamais. Un jour viendra où nous nous reverrons, peu importe où, mais je pense que ce sera plutôt là-haut. D'ici là, je suis avec toi en pensée !
Ton ami Werner Olles.
19:44 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, hommage, werner olles, allemagne, carl schmitt |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 février 2022
Günter Maschke (1943 - 2022): hommages de ses amis !

Sur cette photo, voir note.
Günter Maschke (1943 - 2022): hommages de ses amis !
Témoignages de Peter Weiss, Michael Klonovsky, Martin Mosebach, Thor von Waldstein, Frank Böckelmann
Günter Maschke, né en 1943 à Erfurt, a grandi à Trèves. Il a été l'un des protagonistes de la révolte étudiante allemande des années 1960, principalement à Vienne, où il a organisé l'opposition extraparlementaire à partir de 1967. En 1967-69, il a obtenu l'asile politique à Cuba, puis a été arrêté et expulsé pour activité contre-révolutionnaire en raison de son parti pris pour Heberto Padilla.
Depuis, cet érudit sans chaire a travaillé pendant de longues années pour la rubrique "Feuilleton" du Frankfurter Allgemeine Zeitung, en tant qu'écrivain indépendant, essayiste et traducteur. Maschke, qui a "détourné sa libido de Fidel Castro vers Carl Schmitt", le "seul renégat de la génération 68" (Jürgen Habermas), est un écrivain brillant et est toujours resté attaché à la relation entre le mot et l'acte révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Outre Carl Schmitt, il s'intéressait particulièrement à Leo Kofler, Ernst Bloch, Donoso Cortés et Joseph de Maistre et a largement contribué au programme de la maison d'édition Karolinger.

Peter Weiss, à droite, avec le spécialiste suisse des questions militaires, Jean-Jacques Langendorf.
Peter Weiß, KAROLINGER Verlag
Nous nous étions rencontrés en 1982. Le contact avec Jean-Jacques et Cornelia Langendorf à la Foire du livre de Francfort a été rapidement suivi d'une visite à Vienne, en compagnie de son épouse Sigrid, où nous avons jeté les bases d'une longue amitié en discutant et en buvant abondamment. Il fut bientôt très impliqué dans la maison d'édition, dont il devint un associé au sens immatériel du terme. Avec Langendorf, il fonda la "Bibliothèque de la réaction", où il édita entre autres de Maistre, Donoso Cortés, Romieu, Constantin Frantz, Lasaulx, traduisit avec le soutien de Martin Mosebach les Escolios Sucesivos de Gómez Dávila et publia ses propres livres Der Tod des Carl Schmitt et Das bewaffnete Wort. Il nous convenait et convenait à la maison d'édition, dans laquelle l'intérêt personnel a toujours prévalu sur les perspectives du marché, ce qui se reflète également dans notre développement économique.

La fierté de Maschke venait aussi de sa sensibilité, qui lui faisait parfois monter les larmes aux yeux : "On utilise volontiers mes travaux, mais on ne les cite jamais". Il a sacrifié deux fois sa carrière économique à Carl Schmitt : lorsqu'il a publié l'essai de Schmitt sur le Léviathan dans sa propre maison, Edition Maschke, et lorsqu'il rédigea sa nécrologie de Schmitt dans le F.A.Z., où il était un collaborateur libre mais permanent. Quelque temps plus tard, sur notre stand à la foire du livre, l'éditeur Joachim Fest lui avait demandé de collaborer à nouveau au journal. Maschke lui a répondu sèchement : "Je n'y pense pas". Il pouvait aussi être assez drôle. Il avait parfois des relations un peu tendues avec Marcel Reich-Ranicky. Lorsque celui-ci lui reprocha un jour de dire du mal de lui, Maschke répliqua : "Oui, mais seulement dans votre dos !"
Un éminent savant, un caractère difficile et noble, mon bon ami. Fiducit !
Si, moi !
Michael Klonovsky
Günter Maschke a dit un jour de son père adoptif et nourricier, qu'il vénérait beaucoup, qu'il faisait preuve d'un désintérêt quasi monstrueux pour les opinions des autres. Quelle merveilleuse et rare qualité. Elle s'est transmise à son fils, qui était un solitaire, un esprit libre, génial, brillant, d'une méchanceté parfois divine - "Pourquoi ne pas livrer des armes dans des régions en crise ? C'est là qu'on en a besoin !" - et toujours divertissant. A l'époque de la soi-disant décision à prendre popur savoir quelle allait être la capitale (de la RFA réunifiée, ndt), Maschke s'est retrouvé dans un sondage de rue organisé par quelque chaîne de télévision, et les reporters lui ont demandé s'il souhaitait Berlin ou Bonn comme capitale allemande.
"Je suis pour Vienne !", déclara Maschke.
Personne ne parle de Vienne, lui répondit-on.
"Si, moi !"
Ce "Si, moi !" est devenu pour moi une tournure répétée en permanence, un runnig gag, une confession en deux mots.
Je me la rappellerai toute ma vie.

MASCHKINO
Martin Mosebach
Cet ennemi juré de la démocratie était l'homme le plus démocratique que j'aie jamais vu - cela impliquait de considérer tous ceux qu'il rencontrait comme des égaux dont la conscience devait absolument être guidée vers la vérité - la vestibulaire serbe de la bibliothèque universitaire , avec laquelle il réorganisait les Balkans, ou le chauffeur de taxi afghan qu'il informait sur le "Great game" des années 1900, la femme de ménage indienne à qui il baisait la main. Lorsque l'on se promenait avec lui dans la ville ou que l'on s'asseyait dans un café, on pouvait imaginer l'action de Socrate : comme le philosophe, il abordait simplement toutes sortes de personnes et les engageait dans une conversation. Lui qui avait appris très précisément, en théorie et en pratique, ce qu'est la "tolérance répressive", croyait profondément à la liberté de la discussion générale et ne comprenait jamais qu'il en soit exclu. En même temps, son tempérament impétueux pouvait aussi conquérir des ennemis - ennemi était d'ailleurs un titre honorifique à ses yeux - mon beau-frère danois, social-démocrate fidèle à la ligne, a déclaré après une soirée avec Maschke : "Je n'ai jamais vu un homme avec des opinions aussi terribles qui m'ait été aussi exceptionnellement sympathique".
Il a été un stimulateur et un rassembleur ; je lui dois le lien avec la maison d'édition Karolinger qui m'a conduit à découvrir Gómez Dávila et a encouragé la publication de mes essais liturgiques - les deux impulsions maschkiennes ont eu la plus grande influence sur ma vie. J'ai vu le bohémien effréné se transformer, après son mariage, en un travailleur universitaire acharné, creusant des dizaines de milliers de pages - ses éditions de Donoso Cortès et de Carl Schmitt, abondamment annotées, lui auraient ouvert la voie de l'université, lui l'érudit sans chaire se tenant à une large distance de sécurité du monde académique, ce qui n'était évidemment pas envisageable : "J'aurais dû prêter serment à la Constitution !". Face à la figure paternelle de Carl Schmitt, il préservait une totale liberté : "Il n'était pas à la hauteur de son génie" et "Après avoir lu chaque ligne de Schmitt, je ne pourrais plus dire, avec la meilleure volonté du monde, ce que cet homme pensait", tel était son résumé dans les dernières années. Vers la fin de sa vie, il est devenu d'une douceur et d'une souplesse suspectes et s'est réconcilié avec de nombreux ennemis - c'était façon d'exprimer de la piété. Je ne reverrai plus jamais quelqu'un comme lui.

GÜNTER MASCHKE
Thor von Waldstein
Günter Maschke était un esprit libre. Il se distinguait par tout ce qui manque le plus à l'intellectualisme réellement existant et au climat "spirituel" que cet intellectualisme a préparé durant la deuxième République allemande : l'indépendance intérieure, la sagesse, le sens de la réalité, le courage et la capacité de penser jusqu'au bout des choses, même lorsque le juste milieu dominant se sent obligé s'affaisser les zygomatiques ou même lorsque des "applaudissements du mauvais côté (du spectre politique, ndt)" menacent. Il n'a pas seulement méprisé les beati possidentes du status quo, qui aiment prendre un bain tiède d'atlantisme et qui adorent les rapports de force déterminés par l'étranger dans la Grande Allemagne de l'Ouest, il les a sincèrement détestés. Oui, il pouvait haïr comme seul est capable de le faire celui qui n'a pas encore éteint dans son cœur l'amour d'une autre Allemagne, une Allemagne de Hölderlin couronnée de fleurs, avec des enfants qui rient et sans les ravages de la rééducation. Derrière la façade de son grandiose esprit de publiciste, le connaisseur de la nature humaine pouvait découvrir le visage d'un homme qui souffrait comme un chien des tristes conditions de sa patrie, mais aussi, plus globalement, de la "machine à broyer et à émietter le monde moderne" (Maschke dixit).
Si les poètes sont, comme l'a dit Gottfried Benn, admiré par Maschke, dans son éloge funèbre de Klabund, "les larmes de la nation", alors Günter Maschke était un écrivain qui a su, comme peu d'autres, mettre le doigt sur la confusion politique déplorable qui règne chez les Allemands. Si les Allemands devaient tout de même trouver la force de mettre fin à leurs vacances hors de l'histoire pour réapparaître en tant que pion indépendant sur l'échiquier de la politique, ils ne pourront pas se passer du bagage intellectuel marqué par la personnalité de Maschke.
Pour ma part, je perds avec Günter Maschke un ami attachant, au charme duquel il était difficile de résister lors de ses conversations au long cours à travers l'histoire intellectuelle européenne. Pas un seul nuage n'est venu assombrir notre amitié de plus de 36 ans, marquée par une confiance mutuelle. Marcel Proust dit que tous les paradis sont des paradis perdus, et pourtant la mort de Günter Maschke ne m'ôtera pas le souvenir des rayons de soleil de son amitié. Je n'oublierai pas la finesse de son caractère et la noblesse de son attitude. Continuer à travailler dans son esprit pour l'avenir de notre patrie européenne meurtrie reste pour moi un devoir.

À LA MORT DE GÜNTER MASCHKE
Frank Böckelmann, TUMULT
Lorsque j'ai appris il y a quelques heures que l'ami Maschke était décédé, j'en ai été abasourdi - au sens littéral du terme. Car Maschkino - c'est le nom qu'il signait dans ses lettres - avait l'habitude d'annoncer depuis longtemps son effondrement prochain et souvent aussi la fin de sa vie, régulièrement dans des conversations et des messages après la mort de sa femme Sigrid en 2014. J'étais donc habitué à ce qu'il ne meure pas finalement. Ces derniers temps, il y avait même de plus en plus d'appels à l'aide ("Sinon, je vais TRÈS mal - sur plusieurs fronts, et tu devrais être un peu plus gentil avec moi"), ainsi que des expressions de confiance lors de la rédaction de son livre sur Carl Schmitt. Et maintenant, il serait vraiment mort ?
Il n'y a aucun doute à ce sujet, même si cela me semble irréel. Günter Maschke a passé sa vie dans l'enthousiasme et le désespoir créatifs et intellectuels. Il n'avait aucune distance par rapport à ceux qui croisaient son chemin et aux objets de sa passion - Carl Schmitt, le droit international, le droit de la guerre comme droit de l'homme, la "Constitution que nous n'avons pas", la misère allemande universelle, le monde hispano-américain. C'est pourquoi il était aimé, même par ses adversaires, du moins, je le suppose. Il partageait avec enthousiasme mon point de vue selon lequel le terme "conservateur" était devenu sans objet, donc insignifiant. Pour caractériser la situation, il ne reculait devant aucune condamnation, pour mettre en avant ses propres mérites dans la querelle des thèses, devant aucune auto-humiliation et auto-glorification. C'est pourquoi c'était une torture - pardon, Maschkino! - d'être exposé à tes monologues. Et pourtant, tu les évoquais sans cesse. Malheur à celui qui, en ta présence, laissait briller une lueur d'espoir stratégique dans l'évaluation des rapports de force politiques ! Il était impitoyablement taxé d'inconscience et de soumission.
C'est ainsi que le cercle de Maschke à Francfort accueillait de préférence les oiseaux de mauvais augure. Dans son appartement de Rödelheim, on assistait régulièrement - par exemple les jours où se déroulait la foire du livre - à un concours de surenchère de la part de ceux qui étaient, avec ardeur, des désespérés. Ce penchant pour la rigueur a toujours eu une note existentielle chez Maschke. J'ai fait sa connaissance en 1964 lors d'un méfait de notre action subversive à l'occasion du congrès catholique allemand à Stuttgart (et par son intermédiaire, j'ai connu la famille Ensslin). La nuit, en marchant à côté de moi sur le lieu du délit, il ne discutait pas du tout de méthodes, mais me demandait des titres de livres - si je connaissais tel ou tel auteur et ce que je pensais de ses théories. La suite est connue et sera désormais racontée à nouveau chez les amis et les ennemis : Tübingen, Ernst Bloch, sa désertion de l'armée, Vienne, Cuba, Heberto Padilla, la prison, l'abandon de la gauche, Carl Schmitt, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Die Verschwörung der Flakhelfer" et autres farces grandioses où il expulsait les esprits du temps (toutes ont été publiées chez KAROLINGER), les retraites éditoriales, les histoires de femmes tragiques, l'activité de professeur à l'école navale péruvienne (avec le pistolet à la ceinture), alliance avec d'autres grands dans l'Olympe de Carl Schmitt et combat final contre les caprices du diabète ("Général Zucker").
Ce que je voulais dire : Machkino, tu es toujours resté un enfant qui a fait preuve d'intrépidité intellectuelle et politique pour conquérir l'affection qui te revenait. Tu ne connaissais que deux sujets : la grande situation et toi-même. Tu étais insupportable dans tout ce que tu faisais. Pour résister au désespoir, il n'y avait pour toi que la voie de la connaissance sans compromis. Je t'aime.
MASCHKE
Lorenz Jäger, FAZ
Que n'a-t-il pas été : déserteur et théoricien de la guerre, d'abord à gauche puis à droite, le tout avec des élans assez violents ; athlétique (il avait joué au football) et en même temps intellectuel d'une subtilité extrême. Pour un homme de droite, ses diatribes contre les "chers Allemands" étaient difficilement supportables, pour un homme de gauche, son sarcasme envers toutes les utopies. Peut-être que ce qui frappait d'abord chez lui, même les étrangers, c'était sa stature. Dans les deux sens du terme : de grande taille ; quand il le voulait, sa voix pouvait être tonitruante. Impressionnante aussi sa stature intellectuelle et, finalement, personnelle : celle d'un homme de lettres qui, dans les années 1970, a lancé des réimpressions de classiques oubliés de la gauche non communiste, qui, à l'époque, a développé dans ce journal (= FAZ) l'histoire des idées politiques au plus haut niveau et à qui l'on doit plus tard d'excellentes éditions de penseurs réactionnaires : Carl Schmitt et Donoso Cortés. Sa nécrologie de Carl Schmitt, à laquelle Dolf Sternberger s'était violemment opposé, a brisé sa carrière dans notre journal.
Günter Maschke est né le 15 janvier 1943, le mois de Stalingrad. Adopté, il grandit à Trèves, dans la zone d'occupation française. Toute sa vie, la littérature française et la pensée politique française sont pour lui la référence. Les extrêmes le touchent. Il devient membre de l'"Union allemande pour la paix", une organisation pacifiste (en réalité infiltrée par les communistes), puis se tourne avec un instinct sûr vers l'original et adhère au KPD illégal. Il écrit des poèmes, le recueil Sorgen um Kaspar est annoncé aux éditions de Gudrun Ensslin (dont il épouse la sœur) et de Bernward Vesper. Il est ironique que Maschke, qui commentera plus tard le classique de Clausewitz Vom Kriege, se soustraie au service militaire. Après son activité au sein du groupe Subversive Aktion, auquel appartenait également son ami de toujours Frank Böckelmann, il a déserté, mais pas par pacifisme de principe. Son sens des rapports de force était déjà si prononcé à l'époque que Rudi Dutschke l'avait surnommé "Maschkiavelli". Sa fuite l'a conduit à Vienne, où il avait un cercle de soutien intellectuel de gauche, dont faisait partie le philosophe Günther Anders. Lorsque le gouvernement autrichien a voulu l'extrader, les Cubains lui ont accordé l'asile. Il vécut un certain temps sur l'île socialiste et se maria une seconde fois, avec une Afro-Cubaine dont la vision pragmatique des choses l'aida à se désillusionner face aux absurdités du stalinisme tropical. Il fit la connaissance du poète et dissident Heberto Padilla, dont il traduisit plus tard l'œuvre en allemand. Cette amitié ne passa pas inaperçue aux yeux du régime castriste, qui le fit rapidement arrêter et expulser. De retour en Allemagne, il dut purger une peine de prison prononcée pour désertion.


Ce sont des écrits sur la guerre qu'il a publiés et commentés : On lui doit une excellente édition, malheureusement épuisée, de L'art de la guerre de Sun Tsu. En tant que professeur invité, il a enseigné à l'école de la marine péruvienne à La Punta dans le cadre de ce que l'on appelle la "contre-insurrection", la stratégie antipartisane. L'un de ses meilleurs essais remonte à cette époque. Maschke a magistralement analysé la guérilla maoïste du "Sentier lumineux", le groupe terroriste le plus cruel et le plus efficace en dehors de l'espace islamique. Son histoire se révèle être celle d'une expansion du système éducatif (péruvien) qui fut ratée car imposée de manière technocratique et centralisée dans l'une des régions les plus sous-développées du pays, qui a dérapé et a débouché sur la superstition du pouvoir presque magique qu'aurait une doctrine (cf. Das bewaffnete Wort).
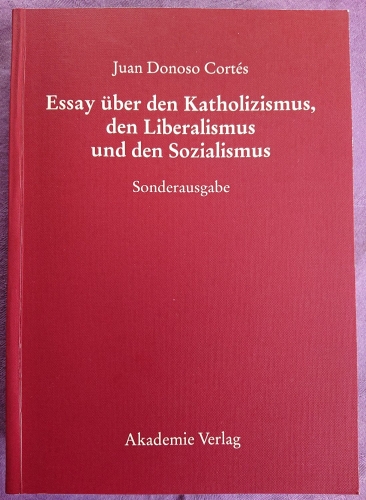
Parmi les réalisations scientifiques de Maschke figurent les éditions de deux éminents penseurs de la droite: Juan Donoso Cortés, dont il a publié les "Essais sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme", et Carl Schmitt, dont il a dirigé les essais sur le droit international - "Paix ou pacifisme" (Berlin 2005). Mais Maschke, devenu ultra-réactionnaire, a lui aussi mis en mouvement des écrits qui semblaient figés. Non pas qu'il s'agisse principalement de problèmes de différentes versions et de réécritures. Dans le cas de Maschke, le mouvement s'est plutôt produit dans le commentaire. Le processus par lequel les pensées de Donoso et de Schmitt se sont formées et ont été reprises ou contestées par les contemporains est alors devenu clair. L'éditeur Mashke ne laissait aucune thèse de ses dieux domestiques passer la barrière sans être vérifiée. Et soudain, ce n'était pas seulement tel ou tel texte qui devenait plausible (parfois, à la fin, il perdait aussi de sa plausibilité dans le processus de commentaire), mais un massif de pensées collectives apparaissait, avec tous les sommets, les fissures et les abîmes imaginables ; d'une simple surface de texte, quelque chose de tridimensionnel et de plastique apparaissait.
Aujourd'hui encore, on lit un travail de Maschke qui s'était attaqué au récit central et identitaire de l'intelligentsia de la République fédérale. L'essai "Verschwörung der Flakhelfer" (= Conspiration des auxiliaires de la défense anti-aérienne) commençait en 1985 par un coup de tonnerre : "La République fédérale, mi-cour industrielle ordonnée, mi-zone de loisirs avec corbeille à papier régulièrement vidée, cette terre résiduelle large comme une serviette de toilette, dont les habitants sont avides d'inoffensivité, est en même temps le pays dans lequel chacun peut devenir l'ennemi constitutionnel de l'autre". Là où Jürgen Habermas ou encore Heinz Bude veulent reconnaître dans la génération née vers 1928 la première cohorte stable de démocrates, Maschke parle désormais d'un "homoncule antifasciste": le prétendu "citoyen responsable" vit dans un "entrelacement de recherche de plaisir et de contrition". La distanciation fondamentale avec le système politique de sa patrie, qui le motivait lorsqu'il était jeune (et gauchiste musclé, ndt), est donc demeurée quasi intacte.
On s'incline devant un intellectuel authentique. Certes : de la droite. Mais pas un droitier. Même la cause à laquelle il s'est consacré (il y en a eu plusieurs au cours de sa vie), il pouvait parfois la considérer avec distance et avec un esprit abyssal. Il renonça avec résignation à l'achèvement d'un grand traité de droit international lorsqu'il sentit ses forces décliner. Son dernier projet devrait consister en une petite collection de malentendus qui se sont formés autour de Carl Schmitt, que ce dernier les ait provoqués lui-même ou que d'autres les lui aient attribués par manque de discernement. Il faudrait espérer qu'une partie du matériel soit publiable. Günter Maschke est décédé au début de cette semaine à Francfort.
Note:
Cette extraordinaire photo, que nous devons à Michael Klonovsky, a été prise dans le bureau de Maschke. Elle m'interpelle tout particulièrement car, lorsque je me rendais chez lui, à l'occasion des foires du livre de Francfort, c'est exactement là, à l'emplacement où nous voyons une vieille et archaïque machine à écrire, que Sigrid, son épouse, me dressait un lit de camp. J'ai donc dormi moults nuits dans le saint des saints de l'univers maschkien ! (Robert Steuckers).
10:34 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, günter maschke, peter weiss, martin mosebach, frank böckelmann, michael klonovsky, thor von waldstein, carl schmitt, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 février 2022
Günter Maschke (1943-2022), un souvenir
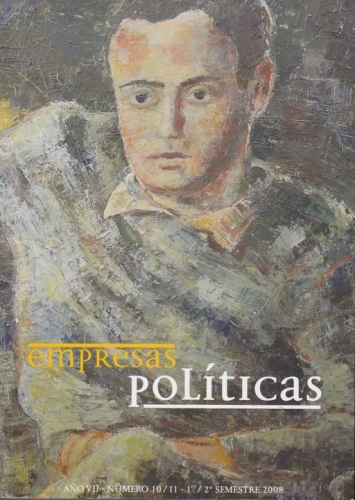
Portrait de Günter Maschke, qui ornait son salon à Francfort, choisi pour une couverture de l'excellente revue espagnole Empresas politicas.
Günter Maschke (1943-2022), un souvenir
Prof. Carlo Gambescia
Source: http://carlogambesciametapolitics2puntozero.blogspot.com/... & https://cargambesciametapolitics.altervista.org/gunter.../
Le souvenir le plus vif, que j'ai de Günter Maschke, décédé lundi dernier, le 7 février, remonte probablement à un Julien Freund, bien vieilli, comme tout bon vin, d'il y a de nombreuses années. Lisez comment il le dépeint dans L'aventure du politique, livre paru en l'an de grâce 1991:
"Il y a quelques années, en 1986, une conférence internationale sur Carl Schmitt s'est tenue à Speyer (Spire). Là aussi, la principale obsession des universitaires présents était de savoir si Carl Schmitt avait été un homme de droite, de gauche ou du centre. Cela n'avait aucun intérêt. Mais soudain, un homme s'est levé et a pris la parole de manière spontanée, en parlant d'autorité. Ses paroles m'ont frappé et m'ont consolé intellectuellement. Je voulais dîner avec lui au restaurant Feuerbach. L'itinéraire de cet homme, Günter Maschke, est fascinant. Maschke faisait partie du groupe d'étudiants qui a provoqué des émeutes à Berlin entre 1967 et 1968. Il était un compagnon de Rudi Dutschke, Baader Meinhof et quelques autres. Arrêté et libéré à deux reprises, il s'installe dans la patrie de ses rêves, Cuba. Mais à Cuba, il a été arrêté et libéré grâce à l'intervention d'un ambassadeur étranger. C'est alors qu'il a fait connaissance avec l'œuvre de Carl Schmitt et qu'il en est devenu un spécialiste. Il a déclaré : "Je me suis parfaitement rendu compte qu'il y avait un ennemi au centre de notre action, mais nous ne savions pas lequel, et nous n'avions pas le concept d'ennemi. Et quand j'ai lu Schmitt, tout est devenu clair pour moi. On sort transformé d'une expérience comme celle de Maschke et, surtout, capable de donner le juste poids aux mots'' (*).
Homme indocile et curieux, désabusé de la politique, polyglotte érudit, il est venu au réalisme schmittien. Attentif, comme le prouve sa façon d'être, aux aspects concrets d'une œuvre, celle de Carl Schmitt, elle l'escorté comme au-delà de la droite et de la gauche. Mais pas dans un sens crypto-fasciste, comme le comprennent encore certains interprètes italiens superficiels, pour le meilleur et pour le pire. Mais plutôt comme un levier - je parle du travail schmittien - pour étudier la politique à travers les régularités du politique.
C'est-à-dire se concentrer sur l'analyse de ce qui reste réellement, au-delà de la rhétorique trop facile sur les valeurs et les intérêts. L'étude, en somme, de ce qui précède et dépasse la politique. Et qui ne se complaît donc pas dans l'esthétique impuissante de la noblesse de la défaite, ni ne caresse des paradis totalitaires inexistants, tout comme elle dédaigne le trafic apparemment inoffensif des petits intérêts.
"C'est ainsi que sont les politiciens" est une de ses expressions récurrentes. Ce n'était pas de la résignation, mais une autodiscipline imposée par le réalisme. Une approche de la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'elle devrait être selon tel ou tel code moral ou religieux. La politique, comme une acceptation, je le répète, des régularités de la politique. Tout d'abord, comme on le lit dans le portrait de Freund, celui de l'ami-ennemi.
La figure de l'érudit schmittien était flanquée du "personnage" Maschke. De grande taille, il portait des chapeaux à larges bords qui le rendaient encore plus imposant. D'apparence grincheuse, mais avec les yeux vifs d'un enfant, peut-être impénitent, avec un regard qui parfois, dans les moments de calme, entre un élan intellectuel et un autre, se perdait à la poursuite d'on ne sait quelles aventures et exploits mystérieux du Puer Aeternus.
Cependant, il était implacable avec les opportunistes, auxquels, comme un vrai Maschkiavelli, qui avait tant vu, il réservait des plaisanteries acerbes. Oubliez alors le Puer Aeternus...
Des blagues, souvent si subtiles qu'elles n'étaient pas remarquées par le malheureux concerné, qui en souriait même. Mais pas par certaines des personnes présentes, les plus rusées, presque complices, intellectuellement complices. Un scénario que Maschke pouvait moralement se permettre, car, comme le souligne son ami Jerónimo Molina, très proche de Maschke, dans le sillage d'Álvaro D'Ors, il "détient l'auctoritas" (**).
Le professeur Molina est l'auteur d'un important "Liber Amicorum ofrecido a Günter Maschke" (***), qui contient tous les éléments critiques, biographiques et bibliographiques nécessaires à une étude plus approfondie de Maschke, auquel nous renvoyons les lecteurs.
Je l'ai rencontré en personne. Comment oublier un déjeuner animé à Rome ? Mais aussi son feu de plaisanterie en d'autres occasions, "récité" de manière olympienne et imperturbable ? Cependant, je ne pense pas qu'il soit juste d'évoquer une sorte d'amitié profonde, comme cela arrive à de nombreux autopromoteurs qui savent profiter de toutes les circonstances. Disons qu'il y avait une estime mutuelle.
J'ai soumis à Maschke, que j'avais rencontré au milieu des années 90, un certain nombre de projets d'édition, qui n'ont malheureusement pas été réalisés, sans que ce soit de sa faute ou de la mienne.
Qu'il repose en paix, à la droite de Carl Schmitt.
Attention, droite non pas dans un sens idéologique, mais dans un sens méta-politique. Qu'il soit assis, pour employer un terme noble, comme un juge politique, au-dessus de la misère et de la noblesse des affaires humaines.
Sans perdants, sans gagnants. "Voilà à quoi ressemble le politique".
Carlo Gambescia.
(*) Julien Freund, L'aventure du politique. Conversations avec Charles Blanchet, édition italienne sous la direction de Carlo Gambescia et Jerónimo Molina, Edizioni Il Foglio, 2021, p. 49 (https://www.ibs.it/avventura-del-politico-conversazioni-con-libro-julien-freund/e/9788876068928 )
(**) Jerónimo Molina, Gaston Bouthoul, inventeur de la polémologie, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2019, p. 23.
(***) Numéro spécial édité par Jerónimo Molina de la revue Empresas Políticas, VII, n° 10-11, 1er et 2ème semestre 2008.
11:01 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, hommage, carlo gambescia, allemagne, carl schmitt |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 février 2022
Günter Maschke est mort

Günter Maschke est mort
Benedikt Kaiser
Source: https://podcast.jungeuropa.de/guenter-maschke-ist-tot/
Avec Günter Maschke, c'est un autre "renégat" de jadis qui s'éteint, après Hans-Dietrich Sander (2017). Formé à la gauche radicale, désillusionné par elle - et s'en détournant avec un certain cynisme qu'il a conservé toute sa vie -, il est devenu un solitaire de droite. "Comme plus personne ne veut brûler, le monde s'assombrit", écrivait Maschke dans le recueil Das bewaffnete Wort publié en 1997. Lui-même ne brûlait cependant plus depuis des décennies, mais s'était depuis longtemps résigné à une impasse - à mon avis exagérée - de la politique pratique de droite.
Ceux qui s'intéressent de plus près aux dates et aux césures de la vie de Maschke trouveront leur bonheur dans le Staatspolitisches Handbuch ou ici, mais surtout dans un recueil d'entretiens publié en 2011 (voir plus loin).
En lieu et place, voici un petit guide bibliographique pour les jeunes lecteurs. Car Maschke n'est plus connu de tous. Bien sûr, cela n'est pas seulement dû à la paresse de lecture supposée ou réelle d'une partie des générations montantes. C'est aussi tout simplement parce que l'auteur et publiciste Maschke, qui maîtrisait plusieurs langues et trouvait surtout ses admirateurs dans le monde roman, s'est fait rare ces dernières années. Les éditions méticuleuses de Donoso Cortés et de Carl Schmitt étaient pour lui une priorité absolue - il ne devait et ne voulait pas présenter régulièrement des recensions, des articles ou des essais dans divers périodiques.
Néanmoins, la plume de Maschke a produit des écrits durables qui, pour la plupart, ne sont plus disponibles que chez les bouquinistes. Ceux qui s'y intéressent trouveront leur bonheur sur le net.
Trois titres sont à mentionner en guise d'introduction. (Je les présente selon ma propre subjectivité, et non selon des critères chronologiques ou autres).
Das bewaffnete Wort. Aufsätze von 1973–1993, Wien 1997.
Si cela ne sonnait pas comme une hérésie, je dirais : Tout ce que Maschke avait à dire se trouve entre les deux couvertures de ce volume. Des textes clés comme "Die Verschwörung der Flakhelfer" (1985) et "Sterbender Konservatismus" (1987) y figurent, tout comme son éloge de Pierre Drieu la Rochelle ("Die schöne Geste des Untergangs", 1980). Maschke a retravaillé cet hommage à Drieu en été 2010 pour mon propre premier ouvrage, Eurofaschismus und bürgerliche Dekadenz (Kiel 2011), et m'a autorisé à le reproduire en tant que préface. Cela m'a rempli de gratitude à l'époque et encore aujourd'hui. Cela a sans doute permis à certains lecteurs des textes de l'"Eurofascisme" d'avoir une sorte de "confiance anticipée" : "Si Maschke s'en charge, c'est que ça doit être bon", m'a effectivement dit un ou deux ans plus tard un lecteur un peu âgé lors d'une rencontre dans le nord de l'Allemagne.
Verräter schlafen nicht, Kiel 2011.
200 pages de Maschke, 200 pages de suspense. Maschke répond à des questions sur son époque au sein du KPD illégal, sa désertion, l'activisme à Vienne, l'exil à Cuba. Dans le style qui lui est propre, il décrit son éloignement de la gauche et son cheminement vers la droite, parle de sa maison d'édition ("Edition Maschke"), dans laquelle il a réalisé des projets de passionné avant de trouver les thèmes de sa vie - Carl Schmitt et la guerre, Donoso Cortés et le catholicisme. Pour finir, Maschke parle librement de la "nouvelle droite" et de ce qu'il en pense. Il ne se fait pas d'illusions, ses chances sont extrêmement faibles. Mais : "Être pessimiste et se battre, c'est la tâche, il est vrai, la plus difficile".
Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt/Main 1973.
Entièrement imprégné de l'esprit de l'époque, Maschke, dans cette "Critique du guérillero" est marque par la "lutte de libération" des révolutionnaires internationaux, surtout d'Amérique latine. Par "guérilla", Maschke saisissait le "peuple combattant irrégulier" qui résiste à une armée régulière. Clausewitz, Schmitt et Mao se retrouvent dans une synthèse lorsque Maschke, en tant qu'"homme de terrain", analyse la révolution cubaine et les aspirations qui y sont liées. Pour Maschke, il était déjà clair à l'époque que "Sorel l'emportait sur Marx", car pour les Cubains aussi, les mythes, notamment nationaux, étaient plus importants que les catégories marxistes dans leur lutte anti-américaine pour la liberté.
On pourrait certes mettre en avant d'autres livres de ce natif d'Erfurt et Francfortois d'adoption, comme le recueil de textes Der Tod des Carl Schmitt (Vienne 1987/2012). Mais l'essence de l'œuvre de Maschke est contenue dans ces trois ouvrages. Ceux qui souhaitent découvrir cet auteur, que le philosophe de cour de la maison RFA, Jürgen Habermas, a qualifié de "seul renégat du mouvement soixante-huitard" (et qui n'a pas seulement donné tort à Bernd Rabehl), devraient trouver dans ces volumes leur juste entrée en matière.
Günter Maschke, Repose en paix.
(Auteur : Benedikt Kaiser)
20:36 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, hommage, carl schmitt, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Günter Maschke nous a quittés...

Valerio Benedetti:
Günter Maschke nous a quittés...
J'ai appris avec une grande tristesse que Günter Maschke nous a quittés. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maschke était l'un des principaux intellectuels de la nouvelle droite allemande, ainsi que l'un des plus grands connaisseurs de la pensée de Carl Schmitt. Il y a environ un an, j'ai eu le plaisir de l'interviewer pour Il Primato Nazionale (dans le numéro d'avril 2021), un magazine qui s'est toujours distingué par son dialogue avec les meilleurs esprits de la culture non-conformiste en Europe.
Comme je n'avais pas d'adresse électronique, nos conversations se déroulaient principalement par téléphone (des conversations qui duraient en moyenne une heure et demie, qui me prenaient littéralement la vie, mais c'était toujours un plaisir de l'écouter). Maschke m'avait dit qu'il était malade depuis un certain temps et, apparemment, sa santé s'était détériorée. J'avais espéré lui rendre visite à Francfort mais, en partie à cause de la pandémie, cela n'a pas été possible. Afin d'honorer sa mémoire, je reproduis ici la fiche biographique que j'ai rédigée pour le présenter aux lecteurs d'Il Primato Nazionale :
Au fil des ans, la bibliographie sur Carl Schmitt est devenue interminable. Mais en tout état de cause, quiconque souhaite s'aventurer dans les profondeurs de la pensée de Schmitt ne peut manquer de rencontrer le nom de Günter Maschke. Sa connaissance du grand juriste et philosophe allemand est presque encyclopédique. Des qualités que même ses plus ardents détracteurs (et ils sont nombreux) sont obligés de reconnaître. Avec son intellect brillant et sa langue acérée, Maschke est un polémiste né. Et sans lui, peut-être, notre connaissance de Schmitt n'aurait pas été sauvée des interprétations abusives que de nombreux interprètes libéraux et marxistes en ont fait.
Et dire que Maschke a fait ses premiers pas en politique au sein du parti communiste allemand, qui avait été interdit en Allemagne de l'Ouest en 1956. C'est dans ces milieux qu'il a rencontré la charismatique Gudrun Ensslin, qui a fondé avec d'autres la Rote Armee Fraktion (Raf), un groupe terroriste d'extrême gauche redouté. Mais ce n'est pas Gudrun qui a conquis le cœur de Günter, mais sa sœur Johanna, avec laquelle il devait se marier en 1965. Lorsque sa femme et lui s'installent à Tübingen, Maschke a l'occasion d'étudier la philosophie à l'université locale et d'assister aux conférences d'Ernst Bloch. Insoumis, il s'enfuit en Autriche, où il rejoint la Commune de Vienne et est arrêté pour avoir participé à une manifestation contre la guerre au Viêt Nam. Grâce à des protestations médiatiques efficaces, ses compagnons de lutte ont réussi à empêcher son extradition vers la République de Bonn, ce qui lui a permis d'atterrir à Cuba, où il a trouvé l'asile politique.
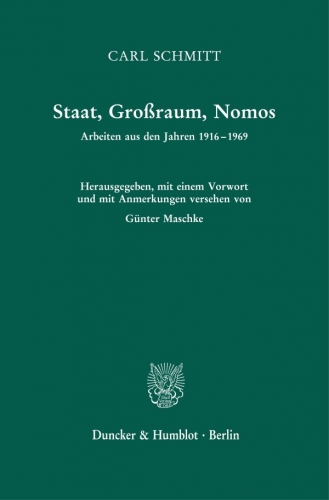
C'est toutefois pendant son séjour sur l'île des Caraïbes (1968-1969) que Maschke rompt avec l'idéologie marxiste : il exprime à plusieurs reprises des critiques à l'égard du gouvernement castriste et refuse de nombreux postes proposés par le régime, au point d'être finalement expulsé du pays pour "activité contre-révolutionnaire". À son retour, il a finalement dû purger un an de prison pour désertion. Entre-temps, ses reportages sur le Cuba de Castro ont eu beaucoup de succès et lui ont ouvert les portes de la prestigieuse maison d'édition Suhrkamp et du Frankfurter Allgemeine Zeitung, le principal quotidien allemand. En 1985, il a écrit une notice nécrologique à la mémoire de Carl Schmitt qui a déclenché un nid de frelons avides de controverses. Sa lecture des œuvres de Schmitt avait en effet été décisive pour sa "conversion" politique (ce qui restera pour ses anciens camarades une trahison douloureuse), à tel point que Maschke noua une solide amitié avec Schmitt, lui rendant souvent visite dans son "exil" à Plettenberg. Cependant, sa nécrologie en l'honneur de Schmitt a déclenché une dispute amère avec Jürgen Habermas, qui s'est terminée par le renvoi de Maschke de la Faz [comme il me l'a fait remarquer après la publication de l'interview, c'est en fait Dolf Sternberger et non Habermas qui était responsable de son expulsion].
Son excommunication publique, qui lui a causé des problèmes évidents, n'a pas empêché Maschke de poursuivre ses études sur Donoso Cortès et Carl Schmitt et de s'imposer comme le plus grand spécialiste de Schmitt et de sa pensée. Et, ajouterions-nous, comme l'un des interprètes les plus lucides des catégories idéologiques dominantes aujourd'hui.
A relire: http://www.archiveseroe.eu/cortes-a48274023
20:01 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, hommage, allemagne, carl schmitt |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Günter Maschke est décédé

Günter Maschke est décédé
Nous avons appris le décès de Günter Maschke en début de semaine à Francfort-sur-le-Main.
Maschke, renégat de 68 et spécialiste de Schmitt, était lié au travail de la revue Sezession, en tant que lecteur et interlocuteur régulier. A l'occasion de son décès, nous publions l'article que Karlheinz Weißmann a rédigé sur Günter Maschke pour le troisième volume du Staatspolitisches Handbuch ("Vordenker").
Günter Maschke est né en 1943 à Erfurt et est arrivé avec sa famille à Trèves en 1949 en tant qu'enfant adopté. Il quitta l'école avec le certificat d'études secondaires et fit un apprentissage d'agent d'assurance. Il adhéra d'abord à l'organisation communiste maquillée "Deutsche Friedensunion", puis au KPD illégal, et suivit des cours à l'école supérieure technique de Stuttgart.
Maschke entra ainsi en contact avec les milieux estudiantins de gauche (il fit notamment la connaissance de Gudrun Ensslin, dont il épousa la sœur Johanna en premières noces), passa à Tübingen et étudia la philosophie avec Ernst Bloch. Parallèlement, il travailla comme rédacteur d'un journal étudiant marxiste et participa à la "Subversiven Aktion", un précurseur de la légendaire "Kommune 1", puis au travail du Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS).
En 1965, Maschke déserte l'armée allemande et s'enfuit à Paris, mais ne parvient pas à y trouver refuge et arrive à Vienne via Zurich, où il devient rapidement l'une des figures centrales de la Nouvelle Gauche. Il a été arrêté en 1967 après une manifestation anti-Vietnam. Un sit-in devant la prison de la police empêcha l'extradition prévue vers la République fédérale, et les autorités autrichiennes permirent à Maschke de partir pour Cuba, le seul État prêt à lui accorder l'asile.
Mais la pauvreté et le caractère totalitaire du système local lui déplaisaient autant que le système capitaliste de l'Allemagne de l'Ouest. Emprisonné à nouveau pour "conspiration contre-révolutionnaire", le gouvernement cubain l'a expulsé vers Madrid. Finalement, Maschke retourna en République fédérale d'Allemagne, où il purgea la peine de prison qui lui restait à purger et travailla comme journaliste après sa libération.
Nombre de ses travaux ont servi à l'autocritique de son milieu initial, d'abord à partir d'une position de gauche peu orthodoxe, puis d'une position libérale, et enfin d'une position conservatrice. Son point de repère est devenu Carl Schmitt, dont il connaissait les écrits depuis longtemps, mais qu'il percevait comme des déclarations propres à l'ennemi conservateur. Cela a changé de manière spectaculaire à partir de la fin des années 1970. En tout cas, de nombreux textes qu'il publiait en tant que rédacteur de la Frankfurter Allgemeine montraient un ton de plus en plus acerbe.
Maschke utilisait une terminologie inspirée de Schmitt et une envie d'irriter l'adversaire qui n'était tolérée que tant qu'il avait la réputation d'être un étrange gauchiste, mais un gauchiste tout de même. Cela a changé après une attaque générale contre Jürgen Habermas, qui a forcé Maschke à quitter la FAZ.
Depuis lors, Maschke a accompli un travail extraordinaire en tant que "droitier sans domicile fixe", exégète et continuateur de Schmitt, et a contribué à sortir les grands contre-révolutionnaires - Donoso Cortés en tête - de l'oubli. Son influence marquante sur le programme de la maison d'édition viennoise Karolinger ou la revue Etappe qu'il a codirigée parlent d'elles-mêmes. Il fait sans aucun doute partie des intellectuels de droite les plus importants de l'après-guerre, même s'il a depuis longtemps enterré tout espoir d'efficacité pratique.

Les écrits de Günter Maschke :
Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973
Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987
Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997
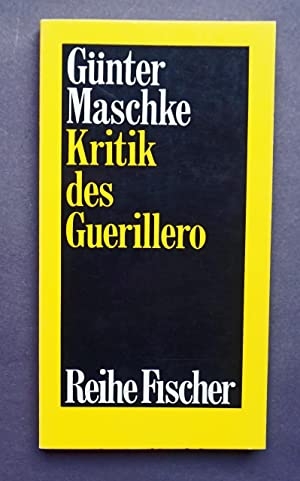
Parmi les ouvrages majeurs dont il fut l'éditeur:
Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995
Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.
Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011
ik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973
Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987
Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997
Als Herausgeber unter anderen:
Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995
Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.
Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011
Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973
Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987
Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997
Als Herausgeber unter anderen:
Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995
Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.
Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011
Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973
Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987
Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997
Als Herausgeber unter anderen:
Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995
Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.
Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011
Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973
Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987
Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997
Als Herausgeber unter anderen:
Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995
Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.
Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011
19:39 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, allemagne, carl schmitt, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 février 2022
Otto Braun, écrivain soldatique: "Je vais m'accrocher, quoi qu'il arrive"

Otto Braun, écrivain soldatique: "Je vais m'accrocher, quoi qu'il arrive"
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/io-terro-duro-qualunque-cosa-accada-otto-braun-giovanni-sessa/
 Nous avons souvent noté que le destin des livres est insondable. Des volumes précieux, porteurs d'une nouvelle vision du monde, se sont révélés tels quelques décennies seulement après leur publication. D'autres, au contraire, moins significatives, mais imprégnées du bon sens de la conjoncture historique dans laquelle elles étaient appelées à voir le jour, ont obtenu un écho immédiat. Le livre que le lecteur s'apprête à lire, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Il s'agit du Journal et de lettres d'un jeune volontaire de guerre, Otto Braun, et de son témoignage paradigmatique. La première édition italienne, publiée en 1923, a été éditée par le philosophe politique Enrico Ruta sous le titre Journal et lettres, et a attiré l'attention d'un petit groupe d'intellectuels dont, comme on le verra, les philosophes Benedetto Croce et Julius Evola. L'un des premiers à avoir saisi le caractère exceptionnel de ce recueil a été l'idéaliste magique, qui a identifié le jeune auteur comme un porte-flambeau ante litteram de ses propres positions spéculatives.
Nous avons souvent noté que le destin des livres est insondable. Des volumes précieux, porteurs d'une nouvelle vision du monde, se sont révélés tels quelques décennies seulement après leur publication. D'autres, au contraire, moins significatives, mais imprégnées du bon sens de la conjoncture historique dans laquelle elles étaient appelées à voir le jour, ont obtenu un écho immédiat. Le livre que le lecteur s'apprête à lire, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Il s'agit du Journal et de lettres d'un jeune volontaire de guerre, Otto Braun, et de son témoignage paradigmatique. La première édition italienne, publiée en 1923, a été éditée par le philosophe politique Enrico Ruta sous le titre Journal et lettres, et a attiré l'attention d'un petit groupe d'intellectuels dont, comme on le verra, les philosophes Benedetto Croce et Julius Evola. L'un des premiers à avoir saisi le caractère exceptionnel de ce recueil a été l'idéaliste magique, qui a identifié le jeune auteur comme un porte-flambeau ante litteram de ses propres positions spéculatives.
[...] La publication de ce texte est également liée à un souvenir de l'écrivain. Il fait également référence au "destin" du livre que nous présentons. En 2008, j'ai contacté le philosophe Franco Volpi par téléphone, bien que je ne le connaisse pas personnellement. Quelques années auparavant, il avait écrit la préface des Essais sur l'idéalisme magique d'Evola : je lui ai demandé s'il accepterait de répondre à mes questions concernant son parcours intellectuel, l'état d'avancement de la traduction des œuvres de Heidegger dans laquelle il était engagé, la Révolution conservatrice et Evola. L'interview devait être publiée par un petit éditeur romain. Il a été très gentil, mais a décliné l'invitation. Au cours de la conversation, qui a duré plus d'une heure, nous avons longuement discuté de l'idéalisme magique. À la fin, il m'a dit, en tenant compte de mes intérêts : "Je vous conseille vivement de vous intéresser à Otto Braun. C'est un auteur vraiment extraordinaire, dont on sait peu de choses. J'ai demandé à mes étudiants de faire des recherches sur lui en Allemagne, mais la partie la plus importante de son œuvre est essentiellement son journal et ses lettres. Veuillez faire de votre mieux, si possible, pour réaliser une nouvelle édition afin que nous puissions enfin en discuter à nouveau. J'ai accepté son invitation. Je dédie ces brèves notes à la mémoire de Volpi, un intellectuel courageux et profond qui est toujours allé au-delà des barrières de l'"académiquement correct".

Otto Braun est né à Berlin le 27 juin 1897. Il était le fils du Dr Heinrich Braun et de Lily von Kretschmann, auteur de Memorien einer Sozialistin (1910-1911) inspiré du Memorien einer Idealistin de Malwida von Meysenburg, connu dans les milieux socialistes allemands pour avoir pris une part active à la controverse théorique et politique entre l'orthodoxie de Bebel et le révisionnisme de Bernstein. Dans cette diatribe, le jeune Otto et samère se sont rangés du côté de ces derniers. Le jeune homme est influencé intellectuellement par ses parents bien-aimés, mais il est aussi sensible à l'amour de son pays, qu'il vit avec enthousiasme, sans jamais atteindre le piètre niveau du nationalisme chauvin. Lorsque la guerre éclate, il tente de s'engager comme volontaire, mais sans succès. Il demanda de l'aide à un général connu et ami de la famille et put ainsi reprendre le mousquet. Il fut blessé à plusieurs reprises et tomba héroïquement au front en 1918, alors qu'il avait une vingtaine d'années.
Pour comprendre la valeur théorique et existentielle de l'expérience de cet enfant prodige, il faut tenir compte du fait suivant : son époque a vu la condensation de tensions inexplicables, qui ont agi avec force tant au niveau individuel que collectif en Europe, plus précisément en Europe centrale, qui, après la Grande Guerre, a vu la dissolution de deux structures impériales, l'empire des Habsbourg et le Second Reich.

D'un point de vue général, il est donc nécessaire de placer les pages de Io terrò duro, qualunque cosa accada (Je tiendrai bon, quoi qu'il arrive) à côté des expériences de vie et de pensée contemporaines d'Otto Weininger et de Carlo Michelstaedter, profondément marquées par la réémergence du tragique. Les trois auteurs appartiennent à ce vaste mouvement intellectuel qui a transcrit dans ses productions à la fois les signes tangibles de la fin d'un monde, le monde bourgeois-chrétien selon l'expression de Hegel, et la possibilité de la réalisation d'un Nouveau Départ de l'histoire européenne.
Nous faisons référence, ici, à ce corps de pensée que Massimo Cacciari a défini comme la "métaphysique de la jeunesse" et qui englobe la génération née "autour" du 20 novembre 1889, jour où Gustav Mahler a dirigé sa première symphonie à la Philharmonie de Budapest : "C'est le temps de la mémoire. Tous ceux qui sont nés "autour" de la première symphonie de Mahler y participent : leur "jeunesse" n'est qu'un élément de composition, un mouvement dans le contexte de la symphonie, fuyant vers leur propre Trauermarsch (marche funèbre)".
Une expérience spéculative marquée par le négatif et le refus de toute référence transcendante qui, traversant Stirner et Nietzsche, partageait aussi le platonisme inversé de Lukács: "L'absolu, ce qui n'admet pas de médiation, l'univoque, n'est que le concret, le phénomène individuel ". Nos auteurs ont été amenés à vivre socratiquement, en privilégiant la dimension éthique, la décision et le choix qui, chez eux, à la différence de Kierkegaard, ne visait plus le religieux au sens propre, mais le Werk, l'œuvre qui, de ce point de vue, aurait dû réaliser la réunification de la vie et de la pensée, du fini et de l'infini.
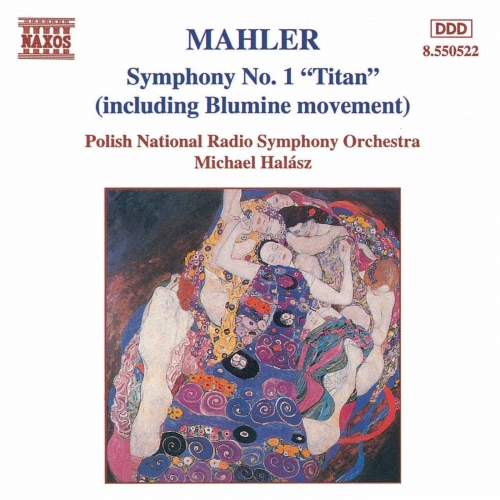
Weininger, Michelstaedter et Braun présupposent le fondement spéculatif non avoué de la philosophie weiningerienne du als-ob, du comme si. Selon Cacciari, l'"héroïsme" théorico-pratique auquel ils se consacrent "consiste [...] à nous préserver de toute illusion et, dans cet état d'âme, à viser à donner forme à notre in-dividuel, comme si nous vivions dans une Culture, comme si cet in-dividuel était réellement un symbole". [...]
Les pages de ce livre marquent les étapes de l'éducation d'Otto, visant à conquérir la dimension proprement humaine que les Grecs bien-aimés avaient attribuée au seul aner, et jamais au simple anthropos, l'homme "dimidié", centré sur la dimension biologique-existentielle. Dans la philosophie classique, l'homme était considéré comme "incapable de se posséder lui-même", en proie aux corrélations de la conscience induites par le rapport toujours changeant entre le moi et le monde, typique de l'homme "rhétorique", proie facile du dieu de la philopsuchía.
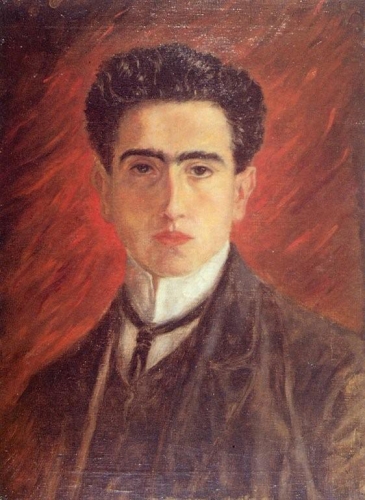
Michelstaedter (portrait, ci-dessus) dit de cet "animal humain": "Sa fin n'est pas sa fin, il ne sait pas ce qu'il fait ni pourquoi il le fait : son action est un être passif parce qu'il n'est pas lui-même tant que la faim de vie vit en lui, irréductible, obscure". Eh bien, le jeune Otto Braun, comme en témoignent les pages passionnées de ce volume, visait à réaliser en lui l'hégémonikon, le centre intérieur capable de donner une direction hyperbolique à notre parcours existentiel, à travers l'élan déterminé par l'acquisition de la qualité d'andreia, de "force d'âme". [...] Seuls des hommes puissants et vertueux auraient pu relever la fortune de l'Allemagne (pour le jeune homme, l'Allemagne, en raison de son intime relation de fraternité avec la Grèce antique, était synonyme d'Europe), la crise dans laquelle tombait la Kultur était trop grande : "a-t-on jamais vu chez les hommes une telle prostitution de tout sentiment, une désertion aussi maligne de tout ce qui est fort et sévère, une destruction aussi méthodique de toute idée de noblesse ?".
Il était certain que l'incipit vita nova porterait les stigmates de la civilisation hellénique, car : "l'homme futur portera inconsciemment en lui un esprit qui sera en partie conséquent à l'esprit grec". Il ne prône pas un retour au passé, rien à voir avec des perspectives régressives. Dans la nouvelle civilisation, les réalisations de la modernité et celles des Anciens palpitent ensemble. Le Nouveau Départ verrait la formation d'un monde ancien-moderne.
Ainsi, la prophétie de Gémiste Pléthon se serait réalisée : "Une religion s'élèvera, à laquelle tous les hommes se soumettront ; seulement elle ne sera ni chrétienne ni païenne, mais très semblable au paganisme". En Grèce, il a apprécié la superbe synthèse du dionysiaque et de l'apollinien dans toutes ses créations. Chez ce peuple, la forme conquise dans les arts, la poésie et la philosophie faisait pourtant allusion à l'origine chaotique du monde. La religion grecque, en outre, était "civile", politique, dans la mesure où elle avait son ubi consistam in : "un consentement du peuple". Cela a conduit ces hommes à ne pas se livrer à la contemplation de sur-mondes, ni à dissoudre leur individualité dans le Tout, à la recherche d'un nirvana annulateur. Au contraire, ils n'ont jamais fait de distinction entre nature et super-nature, corps et esprit. Otto a été confirmé dans cette conviction par sa lecture passionnée de Sappho et d'Alceus. Il s'est également attardé sur Protagoras et, réfléchissant à sa pensée, a compris la nécessité de laisser les Grecs parler enfin de leur propre voix, alors que nous, les modernes, "traduisons tout dans une terminologie chrétienne".
[...] D'où la déclaration explicite de lui-même comme "polythéiste", "païen", "fidèle à la vie". Cette profession de foi se manifeste le plus souvent par l'exaltation de la nature et de sa beauté. [...] L'intérêt d'Evola pour Braun, nous l'avons mentionné déjà dans ses lignes. A l'époque où le philosophe romain se proposait, après l'expérience Dada, de tracer les coordonnées théoriques sur lesquelles construire l'idéalisme magique, il regardait avec admiration Braun, dont il avait lu l'œuvre dans l'édition allemande de 1921. Le penseur traditionaliste place Braun aux côtés d'autres "esprits de la veille", tels que Weininger, Michelstaedter, Gentile, Hamelin et Keyserling [...] .
Dans Braun, selon Evola, "ce qui est mis en évidence [...], c'est essentiellement l'aspect de la puissance efficace, de la transformation de la valeur en force absolue opérant au sein même de l'antithèse de la réalité brute". Chez lui, il ne s'agirait pas de philosophie au sens scolastique, de l'élaboration d'un système, car ce qui intéresse vraiment le jeune Allemand, c'est : "le spectacle grandiose de l'autocréation d'une volonté titanesque, d'une foi inébranlable, d'un pouvoir démiurgique pour que la valeur devienne vie, réalité absolue". Le dieu auquel Braun fait référence veut devenir un "corps", l'homme. Par conséquent, à la lumière de "l'évangile de la volonté", noyau vital de la vision du monde d'Otto Braun, il est nécessaire de transformer ce que la vie nous offre, en le conformant à notre but. C'est en cela que réside la liberté de la volonté.
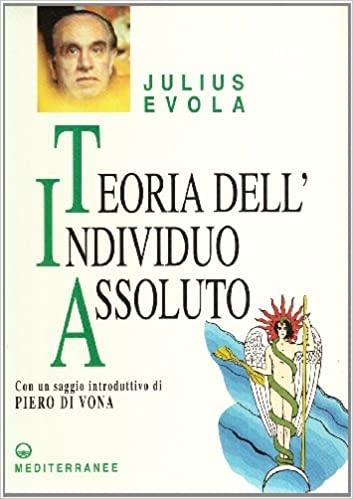
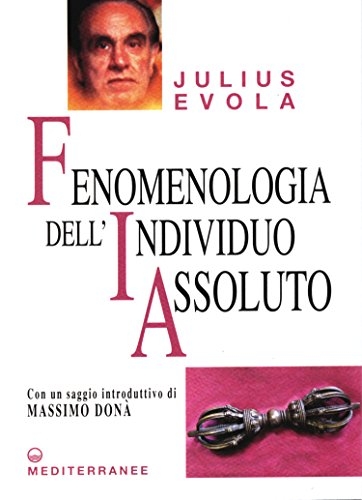
Evola ne peut manquer d'apprécier, chez le jeune homme, la "fidélité à la vie", le débarcadère grec impliquant la récupération de la physis et l'attribution à l'art d'un rôle essentiel sur le chemin de l'épanouissement. Il reconnaît également le trait carlylien de l'héroïsme politique de Braun, de son appréciation de l'homme d'État : "au religieux, au poète et au sage, il opposait le héros, et pour lui, de nos jours, héros signifiait homme d'État". Il était conscient que la véritable "domination" sur soi et sur la réalité ne devenait un fait réel que pour ceux qui avaient résolu la corporéité en liberté, comme cela se produit le long des chemins initiatiques, mais ce n'était qu'une intuition le long de ce chemin. La limite de la proposition de Braun se trouve, pour Evola, dans le fait qu'il a vécu la volonté de l'homme comme subordonnée : "à une obéissance supérieure, il a humilié le Moi en le soumettant à une tâche, à une mission qui semblait procéder presque d'un démon, d'une puissance supérieure". Le fait de " se mettre au service d'un dieu " aurait détourné Braun de la réalisation de l'immanence pure : le daimon, dans cette perspective, représentant une réalité transcendante. Michelstaedter s'était reconnu dans la centralité originelle de l'ego, la Persuasion, Braun, selon Evola, ancrait cette centralité au devoir. Il est donc inévitable, pour mettre véritablement en œuvre une vie de liberté et de puissance, qui sera pour Evola celle de l'individu absolu, d'intégrer les perspectives des deux jeunes "divins" en une seule.
En effet, il nous semble que, malgré une certaine ambiguïté théorique, liée au traitement du devoir à poursuivre résolument, qui pourrait lier l'ego, ne le rendant pas absolu, libre, Braun reste, en ce qui concerne le daimon, dans la perspective hellénique de la transcendance immanente, également typique de la vision évolienne. Selon la leçon de Gian Franco Lami, vivre "au service d'un dieu", n'implique pas l'abandon mystique au Principe, mais est un moment essentiel du parcours vertueux, anagogique, du philosophe qui, reconnaissant ses limites, n'a pas la prétention : "d'atteindre et de posséder définitivement la "vraie sagesse"". Dans l'acceptation du résultat aporétique du philosopher, dans la reconnaissance du "savoir socratique du non-savoir", l'homme prend conscience que le processus d'ordonnancement, en lui-même et dans la communauté, est toujours in fieri, comme la vie.


En outre, Lami lui-même a précisé comment le daimon pythagoricien-socratique "est qualifié au niveau terrestre, comme une fonction naturellement humaine, qui s'exprime dans l'accompagnement de l'individu, en tant qu'agent pensant, le long de son parcours existentiel spécifique". Dans ces mots nous pouvons voir le sens du destin personnel de Braun, fidèle au daimon, à la voie réalisable de la transcendance immanente toujours in fieri, pleinement en ligne avec l'idéalisme magique évolien. Le philosophe romain sait que le Moi, comme l'a précisé Massimo Donà "dans la mesure où il est inconditionné, ne peut être identifié à aucune forme", il doit nier toute norme irréfutable, se soustraire à tout impératif, même lorsqu'il est lié par "la liberté inconditionnelle elle-même". L'individu absolu, incapable de trouver la paix dans un positum, bien que non limité, ne manque pas le non-moi, n'exclut pas la limite. Cette situation l'incite à refaire, à refonder, à la lumière de l'infondabilité du principe, la liberté, lui-même et le monde. Raison de plus pour y retourner et lire, Je m'accrocherai, quoi qu'il arrive.
(extrait de la préface de Giovanni Sessa, Destinée et Postérité. Le Printemps Sacré d'Otto Braun, au livre d'Otto Braun, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Journal et lettres d'un jeune volontaire de guerre, en librairie aux éditions OAKS à partir du 19 janvier - pp. 255, euro 20.00).
14:54 Publié dans Hommages, Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otto braun, première guerre mondiale, hommage, giovanni sessa, philosophie, révolution conservatrice, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, littérature soldatique, esprit soldatique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 05 février 2022
José Martí et la théorie de l'équilibre des forces

José Martí et la théorie de l'équilibre des forces
Leonid Savin
Ex: https://www.geopolitica.ru/article/hose-marti-i-teoriya-balansa-sil
Texte du discours de Leonid Savin, prononcé lors de la célébration du 169e anniversaire de la naissance de José Martí, Maison Centrale des Scientifiques, 28 janvier 2022.
L'environnement international actuel rappelle quelque peu la fin du 19e siècle: l'ordre européen précédent changeait rapidement et, à l'époque des empires et du colonialisme, cela avait un effet mondial et des conséquences imprévisibles.
L'héritage intellectuel de José Martí est d'un intérêt considérable à cet égard, car sa vision des processus en cours démontre son acuité géopolitique. Sa formulation du besoin d'équilibre peut être considérée comme une anticipation de la multipolarité et s'inscrit bien dans le paradigme de la théorie du réalisme politique (qui a émergé plus tard).
Après avoir été élevé à la tête du parti révolutionnaire cubain en avril 1892, José Martí a dû faire face à une situation internationale extrêmement difficile. D'une part, Cuba, ainsi que les autres Antilles, pouvaient difficilement obtenir l'indépendance de l'Espagne sans le soutien des États-Unis. Et une telle expansion de l'influence directe et prépondérante de Washington était alors déjà activement discutée dans les cercles politiques américains.
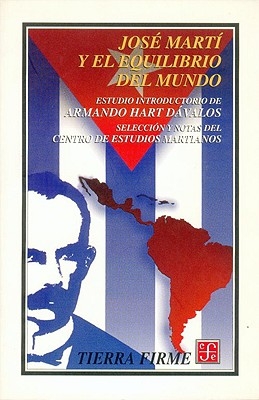 D'autre part, il était nécessaire d'assurer l'unité et le soutien à Cuba de la part de l'Amérique latine, où il y avait aussi pas mal de turbulences. En particulier, l'Argentine et le Brésil luttaient pour la suprématie dans la région, tandis que ce dernier était économiquement dépendant des États-Unis. Depuis 1880, la politique étrangère du Brésil était fondée sur une alliance stratégique avec les États-Unis, qui furent le principal marché pour ses exportations, notamment le café. Le Brésil justifiait ce besoin par la crainte de l'émergence d'une alliance hispano-américaine dans le Cône Sud, dirigée par l'Argentine, qui pourrait être dirigée contre ses propres intérêts.
D'autre part, il était nécessaire d'assurer l'unité et le soutien à Cuba de la part de l'Amérique latine, où il y avait aussi pas mal de turbulences. En particulier, l'Argentine et le Brésil luttaient pour la suprématie dans la région, tandis que ce dernier était économiquement dépendant des États-Unis. Depuis 1880, la politique étrangère du Brésil était fondée sur une alliance stratégique avec les États-Unis, qui furent le principal marché pour ses exportations, notamment le café. Le Brésil justifiait ce besoin par la crainte de l'émergence d'une alliance hispano-américaine dans le Cône Sud, dirigée par l'Argentine, qui pourrait être dirigée contre ses propres intérêts.
Il y avait donc un risque sérieux tant pour l'unité latino-américaine que pour l'affirmation de l'hégémonie nord-américaine sur la région. Après le coup d'État du général Deodoro de Fonseca, Martí avait l'espoir d'un changement possible de la politique étrangère brésilienne, ce qui ne s'est toutefois pas produit. Dans l'ensemble, José Martí a fait peu de références au Brésil. En outre, il a cessé d'utiliser le terme "Amérique latine" et l'expression "unité latino-américaine". Au lieu de cela, Martí a présenté "l'Amérique hispanique" ou a parlé de "l'Amérique espagnole". Ou, bien sûr, a introduit le désormais célèbre concept de "Notre Amérique".
À la même époque, le célèbre historien et officier de marine américain Alfred Thayer Mahan publiait son ouvrage classique, The Importance of Naval Power in History. Il y affirme que le contrôle des mers est la clé de l'expansion prévue des Etats-Unis. Et la croissance subséquente du commerce américain avec le monde, en particulier l'Asie, comme il l'a expliqué dans des articles ultérieurs, assurerait un avenir heureux au peuple américain, libéré des crises de surproduction, de faim et de chômage qui ravageaient régulièrement l'économie américaine.
Le thème central du document était l'exemple de la Grande-Bretagne, considérée à l'époque, selon Mahan, comme l'ennemi potentiel le plus dangereux des États-Unis.
En 1890, il publie dans le magazine américain Atlantic Monthly un article révélateur intitulé The United States looking outward, dans lequel il analyse l'importance stratégique des Antilles.
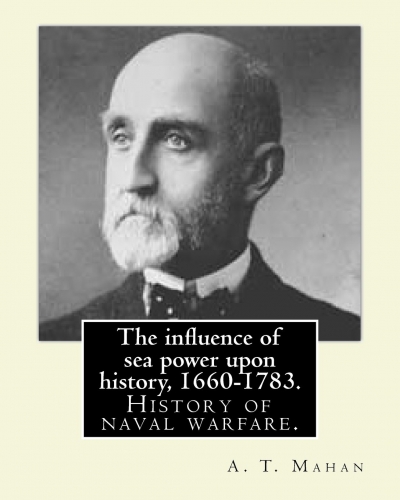
Avec une franchise extraordinaire, il estime que les Grandes Antilles, notamment Cuba, doivent nécessairement passer sous le contrôle des États-Unis, afin de protéger un canal interocéanique, dont la construction est alors prévue au Panama ou au Nicaragua.
Mahan mentionne spécifiquement le passage du vent, la route la plus courte vers le canal prévu, dont la construction, selon lui, ne peut commencer sans le contrôle des zones proches du rivage, grâce à un système de bases navales sur les deux rives dudit canal. La clé de sa politique antillaise était Cuba. Ses idées bénéficient d'un large soutien au Congrès, sous la pression de l'homme politique républicain Henry Cabot Lodge et de son ami, le vice-président puis président Theodore Roosevelt.
Le gouvernement américain n'a pas perdu de temps pour proposer d'acheter l'île au gouvernement espagnol. L'Espagne, furieuse de cette offre, a refusé de vendre. Marti, en revanche, pensait qu'il fallait hâter l'action révolutionnaire pour obtenir l'indépendance de Cuba par une guerre soudaine et foudroyante contre l'Espagne, ce qui lui permettrait, après la victoire, d'établir un équilibre dans les Antilles espagnoles. L'idée était de stopper pour un temps ou pour toujours l'expansion des Etats-Unis dans les Caraïbes grâce à l'unité de Cuba, Porto Rico, Saint-Domingue et même Haïti, soutenue par des pays sensibles aux intérêts de la libération des Antilles espagnoles. Il s'agit de l'Argentine, du Mexique, de plusieurs pays d'Amérique centrale et des deux puissances européennes que sont l'Angleterre et l'Allemagne, qui sont alors en conflit avec l'empire américain naissant.
On peut se faire une idée plus précise du projet stratégique révolutionnaire de Marti dans ses réflexions, qu'il a consignées dans son carnet alors qu'il travaillait pour la firme française Lyon and Company à New York en 1887. Marti faisait référence aux déclarations du vice-consul français selon lesquelles, moyennant un investissement minime, un passage interocéanique pourrait être construit pour relier le Pacifique à l'Atlantique. La société britannique a alors immédiatement déclaré son intention d'acquérir les droits de construction du canal, ce dont la presse s'est fait l'écho et qui a incité Marti à formuler sa vision stratégique : "Ce que d'autres voient comme un danger, je le vois comme une garantie : alors que nous devenons assez forts pour nous défendre, notre salut et la garantie de notre indépendance sont dans la balance de puissances étrangères concurrentes. Là, à l'avenir, au moment où nous serons pleinement déployés, nous courrons le risque d'unir contre nous des pays concurrents mais apparentés - (Angleterre, USA) : d'où la politique étrangère centraméricaine et nous devons chercher à créer des intérêts divers dans nos différents pays, sans permettre une prédominance claire et accidentelle, d'une quelconque puissance."
En adhérant à ce critère, Martí développait une stratégie d'équilibre face à l'expansion américaine.
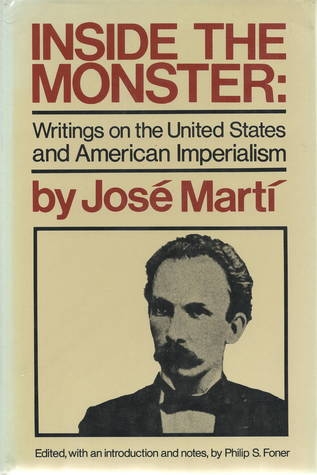
Il convient de noter que le chef de la délégation argentine à la conférence internationale américaine de Washington, Roque Saenz Peña, partageait les idées de Jose Marti. Ensuite, alors que Saenz Peña était à la tête du ministère des affaires étrangères pour une courte période d'un peu plus d'un mois, il a présenté la candidature de José Martí au poste de consul à New York.
La nouvelle de sa nomination en octobre 1890, et en provenance du Paraguay (il était consul en Uruguay depuis 1887) soulignait que l'Argentine était susceptible de soutenir la lutte cubaine pour l'indépendance, une perspective désagréable pour le gouvernement espagnol mais aussi pour le gouvernement américain.
Après sa nomination, sa première apparition politique a eu lieu au Twilight Club de New York lors d'un dîner spécial consacré à Cuba. Marti a accepté une invitation à rejoindre les rangs du club, qui était alors une sorte de groupe national hors de contrôle, dont les rangs comprenaient des intellectuels tels que Walt Whitman, Mark Twain, Mark Durkham, le magnat de l'acier et milliardaire Andrew Carnegie et dont le président était le général Carl Friedrich Wingate.
Le message de Marti lors de la réunion du club était directement lié au débat croissant sur le "contrôle" de Cuba et d'autres pays des Caraïbes et d'Amérique continentale. Le discours avait des connotations anti-impérialistes et constituait une réponse au projet annexionniste de Mahan et du groupe de congressistes républicains conservateurs qui le soutenaient.
Marty a traité Mahan et les politiciens conservateurs américains cherchant à intervenir dans les pays d'Amérique latine de fous et d'ignorants, ce qui était en fait une déclaration politique au nom des trois pays d'Amérique du Sud qu'il représentait aux États-Unis. Les membres du Twilight Club ont ensuite salué le discours de José Martí par des applaudissements et ont soutenu les droits du peuple cubain dans sa lutte pour l'indépendance.
Quant aux pays européens, la première priorité de José Martí est l'Angleterre, à l'époque la puissance européenne la plus présente et la plus puissante en Amérique latine, qui, pendant la lutte de Simón Bolívar contre l'Espagne, a soutenu le libérateur en envoyant la légion britannique.
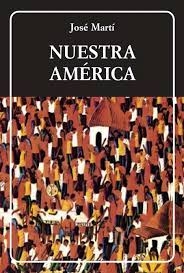 En 1887, Marti a également rédigé une note adressée au Parti libéral du Mexique, dans laquelle il critiquait les préjugés du journaliste et promoteur américain David Ames Welk sur le Mexique, dans un article publié dans le Popular Science Monthly, Dans cette discussion, il faisait remarquer: "La République d'Argentine connaît une croissance plus rapide que celle des États-Unis. Et celui qui a aidé l'Argentine est intéressé à aider toute l'Amérique: l'Angleterre".
En 1887, Marti a également rédigé une note adressée au Parti libéral du Mexique, dans laquelle il critiquait les préjugés du journaliste et promoteur américain David Ames Welk sur le Mexique, dans un article publié dans le Popular Science Monthly, Dans cette discussion, il faisait remarquer: "La République d'Argentine connaît une croissance plus rapide que celle des États-Unis. Et celui qui a aidé l'Argentine est intéressé à aider toute l'Amérique: l'Angleterre".
En deuxième position, on trouve l'Allemagne sous la direction du fondateur de l'unité allemande, Otto von Bismarck, qui, du début des années 80 jusqu'à son départ du pouvoir en 1890, a soutenu les fortes aspirations maritimes de l'Allemagne.
À cette époque, l'Allemagne possède des bastions sur plusieurs îles stratégiques du Pacifique, mais au-delà, Bismarck a même imaginé d'organiser l'émigration allemande vers Cuba et a même demandé à l'Espagne un port sur l'île pour une base navale allemande.
On sait que Marti a envoyé des lettres aux vice-consuls des deux pays depuis les environs de Guantanamo quelques jours avant sa mort, ce qui a suscité l'intérêt des deux bureaux. Selon des chercheurs contemporains (l'Allemand Martin Franzbach et l'Anglais Christopher Hall) qui ont pu retrouver les messages de Marti, les vice-consuls ont pris note des informations de José Martí et les lettres ont suscité une réaction officielle positive.
Tout cela montre une construction systématique du concept d'équilibre international autour des Grandes Antilles, c'est-à-dire Cuba, Porto Rico, Saint-Domingue et Haïti.
Enfin, il convient de rappeler qu'il existait un autre projet défendu par les patriotes portoricains Eugenio Maria de Ostos, Ramon Emeterio Betances. Il s'agit de l'idée d'une Confédération des Caraïbes, dont il est question dans des articles datant des années 80, et même avant, mais surtout dans le journal Fatherland, en 1894-95, c'est-à-dire à la veille du déclenchement des hostilités à Cuba. Marti ne s'opposait pas à ces objectifs révolutionnaires, mais ils semblaient inopportuns à l'époque. La priorité aurait dû être l'indépendance des Antilles hispanophones.
La Confédération des Caraïbes pourrait distancer les puissances européennes, qui étaient en train de régler leurs graves différends avec les États-Unis au sujet d'un éventuel soutien à la révolution cubaine, que Marti jugeait nécessaire pour assurer l'indépendance des Antilles hispanophones.
Mais José Martí explorait la possibilité d'une Union latino-américaine. Avant 1881, il a écrit sur le sujet dans son carnet la façon dont il l'imaginait : la Grande Confédération des Peuples d'Amérique Latine ne devrait pas être à Cuba mais en Colombie (pour éviter le danger d'une annexion violente de l'île).
L'idée de base était que l'unité continentale serait créée par une confédération hispano-américaine, pour laquelle aucune ressource ne serait épargnée. Et chaque État aurait une liberté totale pour les alliances et les actions défensives.
Ainsi, nous pouvons voir que les idées de José Martí ont préfiguré l'émergence de la multipolarité et de la théorie de l'équilibre des forces sur lesquelles les réalistes et les néo-réalistes ont construit leurs concepts. Il convient donc d'étudier son héritage et, si nécessaire, de l'adapter à la réalité contemporaine.
14:03 Publié dans Géopolitique, Histoire, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antilles, cartaïbes, cuba, josé marti, amérique latine, amérique du sud, amérique centrale, politique internationale, histoire, hommage, multipolarité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 janvier 2022
L'Europe comme Révolution: hommage à Jean Thiriart

L'Europe comme révolution
Par Augusto Marsigliante
Source: https://www.eurasia-rivista.com/leuropa-come-rivoluzione-2/
A l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Thiriart et du trentième anniversaire de sa mort, les initiatives se succèdent pour explorer la pensée de cet important penseur européen. La publication d'une étude précise de Lorenzo Disogra (L'Europa come rivoluzione. Pensiero e azione di Jean Thiriart, Edizioni all'insegna del Veltro), une occasion précieuse pour approfondir la figure de Thiriart, a été consacrée à la rencontre organisée le 24 janvier 2022 par le Corriere Nazionale et animée par Matteo Impagnatiello.
Outre l'auteur du livre, ont participé à la réunion le directeur de la revue d'études géopolitiques Eurasia et un étudiant de Thiriart, Claudio Mutti, et Luca Tadolini, de l'association Centro Studi Italia. Comme nous le verrons à travers les différents discours qui ont suivi, la pensée de Thiriart est toujours d'une grande actualité, dans la perspective d'une souhaitable unification européenne en une entité politique souveraine et indépendante, enfin libérée de l'emprise étouffante de la superpuissance thalassocratique américaine.
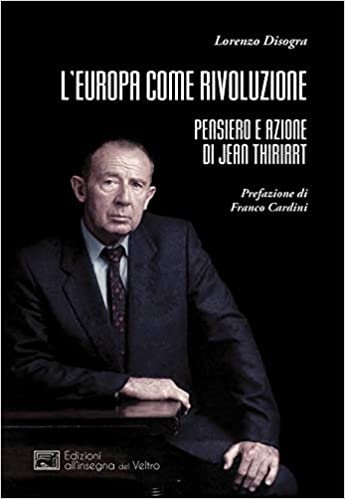
Dans ses remarques introductives, le professeur Mutti a souligné que la période actuelle connaît un important regain d'intérêt pour l'œuvre et la pensée de Thiriart, comme en témoigne la publication d'au moins une douzaine d'ouvrages qui lui sont consacrés, parmi lesquels on peut citer les suivants, outre, bien sûr, l'étude de Disogra - précédée d'une préface de Franco Cardini et d'une postface de Mutti lui-même, tous deux anciens militants du mouvement de Thiriart -, la biographie réalisée par Yannick Sauveur (Jean Thiriart, il geopolitico militante, Edizioni all'insegna del Veltro, Parma 2021). Dans le présent article, nous citerons d'autres ouvrages nécessaires à une étude approfondie de l'œuvre de Thiriart, redécouverte surtout grâce aux Edizioni all'insegna del Veltro, qui ont publié au fil des ans des dizaines de ses articles dans la revue d'études géopolitiques Eurasia.
Si nous voulons esquisser une synthèse de la pensée de Thiriart, nous pourrions penser à tort que nous sommes face à un itinéraire politique contradictoire, mais au contraire, comme nous le verrons, il a toujours maintenu une cohérence fondamentale, jusqu'au bout : en effet, l'idée de construire un sujet politique européen unitaire et souverain, de Brest à Bucarest d'abord et de Vladivostok à Dublin ensuite, n'a jamais disparu dans toutes les spéculations de Thiriart. Un idéal sans doute emprunté à la théorie schmittienne du Großraum, qui constitue une tâche historique inéluctable pour l'Europe. Nous sommes au milieu des années 60, et parler de la nécessité d'une "grande patrie européenne unitaire, puissante et communautaire" dans un continent écrasé par la rivalité entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie constitue déjà une intention révolutionnaire en soi.
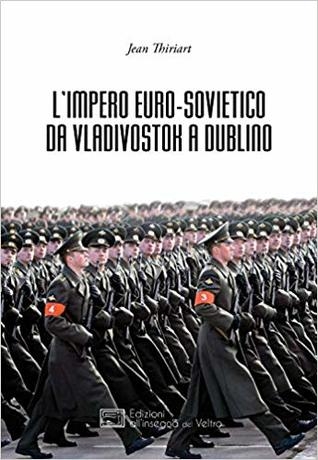
Cette ébauche de perspective eurasienne a atteint sa pleine maturité au fil des ans, dans la perspective non plus d'une opposition mais d'une unification avec l'Union soviétique. Ce parcours a finalement abouti à un événement symboliquement important : le voyage de Thiriart à Moscou en 1992, au lendemain de la dissolution de l'URSS et quelques semaines seulement avant la mort du géopolitologue belge. L'empire européen théorisé dans les années 1960 est devenu un empire eurasien, à opposer à la thalassocratie américaine : la Russie est la principale puissance géopolitique du bloc eurasien (le "Heartland") et, en tant que telle, une composante indispensable d'un seul État indépendant et souverain. Thiriart assigne donc à la Russie, par rapport à l'Europe, un rôle unificateur semblable à celui joué par le Piémont dans le cas italien ou par la Prusse dans le cas allemand.
Thiriart peut donc à juste titre être considéré pour les peuples européens ce qu'Isocrate a représenté pour les Grecs. De même qu'Isocrate voyait dans le royaume macédonien le noyau de l'unité hellénique, le penseur belge espérait une réunification des peuples européens en une entité plus vaste, unitaire et géopolitiquement pertinente. Pour y parvenir, cependant, la Russie aurait dû se libérer du poids de la superstructure idéologique marxiste et abandonner toute prétention contre-productive de "russifier" l'Europe.

Il va sans dire que l'Europe d'aujourd'hui n'est certainement pas l'Europe prônée par Thiriart. C'est une Europe à la merci de la politique expansionniste agressive de l'OTAN, qui menace la Russie, le seul État resté indépendant et souverain, presque jusqu'à ses frontières, et qui est divisée, comme une tenue d'Arlequin, en pas moins de vingt-sept États à la souveraineté quasi nulle. Dépourvu de souveraineté militaire, étant donné que le Haut Représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère a récemment réaffirmé la complémentarité des forces de défense européennes avec l'Alliance atlantique. Privé de souveraineté monétaire, étant donné que la "monnaie commune" européenne n'est pas émise par un État européen, mais par une institution financière. Tout ce que nous avons, en somme, se réduit à une entité bureaucratique qui est perçue, au mieux, comme étrangère et hostile, quand elle n'est pas ouvertement hostile aux intérêts des peuples européens.
L'intervention centrale de cette intéressante rencontre a été celle de l'auteur du volume dédié à Thiriart, Lorenzo Disogra, un jeune politologue bien préparé qui a élargi et approfondi sa thèse de licence pour ce volume. Dans un premier temps, son discours s'est concentré sur l'actualité de Thiriart : pourquoi l'étudier aujourd'hui ? Les raisons sont éminemment géopolitiques : la situation actuelle est en effet la même que celle qui prévalait lorsque le penseur belge a exposé ses théories, puisque nous sommes confrontés à une Europe qui constitue un sujet politique totalement insignifiant sur la scène internationale, fragmentée en une myriade d'intérêts particuliers.

En outre, le caractère purement politique, réaliste et pragmatique de la pensée de Thiriart - à la manière de Machiavel ou de Schmitt, pour être précis - la rend difficilement intégrable dans des frontières idéologiques rigides. Malgré l'apparente incohérence qui lui a été attribuée à tort (son passage du militantisme de gauche à la collaboration avec le Troisième Reich dans sa jeunesse, son soutien à des groupes pro-colonialistes tels que l'OAS, et enfin son soutien controversé à l'Europe de Maastricht en 1992), il existe une cohérence fondamentale qui a caractérisé toute sa vie et son œuvre : l'idéal d'une Europe unitaire et souveraine en tant qu'acteur géopolitique enfin autonome. La réalisation de cet idéal a toujours été la base du pragmatisme politique thiriartien. Nous pouvons donc le définir comme un authentique radical pro-européen, toujours engagé dans la réalisation du projet d'une Europe de type jacobin en tant que nation (l'influence de la Révolution française sur un modèle d'État centralisé et unitaire est remarquable).
Comme mentionné plus haut, la jeunesse de Thiriart, issu d'une famille libérale et progressiste, a été marquée par le passage du militantisme au sein de la gauche belge à la collaboration, qui lui a coûté la prison et l'a éloigné de la vie politique pendant une quinzaine d'années. Dans les années 1960, la proclamation de l'indépendance du Congo - dans une période historique marquée par l'émancipation progressive des États africains du colonialisme européen - a de nouveau suscité un retour à la politique pour Thiriart. Il ne faut cependant pas le confondre avec un nostalgique du colonialisme, mais plutôt avec un fervent défenseur des intérêts européens, plus que jamais en question à ce moment de l'histoire.
En 1961, Jeune Europe a été fondé, le premier mouvement pro-européen transnational avec des racines européennes. En 1963, l'ouvrage fondamental de Thiriart, Un Empire de 400 millions d'hommes, l'Europe (récemment réédité par Avatar éditions, Dublin 2011), sort de l'imprimerie. Pour la première fois, l'idée d'une unité supranationale européenne, de Brest à Bucarest, dans un seul État-nation autocratique et descendant (certainement pas un État démocratique parlementaire) y fait son chemin. Une Europe unie deviendrait ainsi la troisième puissance géopolitique du monde, une alternative indépendante et souveraine à Moscou et Washington.
Au milieu des années 1960, Jeune Europe a progressivement évolué vers des positions plus ouvertement pro-soviétiques. L'Europe devrait donc s'unir à la Russie, dans leur intérêt mutuel, pour chasser l'ennemi commun, les États-Unis d'Amérique. C'est également au cours de ces années que nous trouvons un soutien explicite à la résistance vietnamienne, une appréciation de la lutte de Fidel Castro et de Che Guevara à Cuba, et une solidarité avec la résistance palestinienne.
Thiriart cherche également à obtenir le soutien de Nasser dans une tentative d'instaurer une lutte mondiale quadri-continentale (Europe et Russie, Asie, Afrique, Amérique latine) contre l'Occident. Les "Brigades européennes" ne se concrétisent cependant jamais et 1969 marque la fin de l'expérience militante de Jeune Europe. Cette expérience aura un prolongement dans notre pays, où certains des étudiants les plus précieux de Thiriart donneront vie à des expériences politico-militantes significatives, parmi lesquelles il convient de mentionner l'Organisation Lutte Populaire - identifiée par le monde journalistique comme nazie-maoïste -, à laquelle est consacrée une importante étude d'Alfredo Villano, Da Evola a Mao, Luni editrice, Milan 2017.
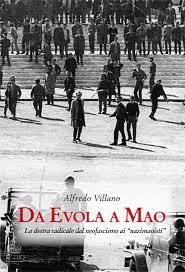 Après une nouvelle période d'éloignement de la scène politique, son retour dans les années 1980 avec une série d'écrits - voir notamment le livre L'impero euro-sovietico da Vladivostok a Dublino (Edizioni all'insegna del Veltro, Parma 2018) - coïncide avec une élaboration plus mature du théoricien belge : le concept d'intégration continentale eurasienne dans un "Empire euro-soviétique de Vladivostok à Dublin" est renforcé : l'Union soviétique et l'Europe sont indispensables l'une à l'autre pour atteindre le "seuil" territorial et démographique permettant de s'opposer à la puissance hégémonique atlantique. Dans cette vision, il y a un dépassement définitif de la critique thiriartienne du communisme, auquel on reconnaît un mérite indiscutable : celui de la domination du politique sur l'économique, indispensable à la protection de la souveraineté. L'approche de Thiriart sur le communisme mérite un examen plus détaillé, pour lequel nous renvoyons aux études citées dans cet article ; il suffit ici de souligner comment il a interprété un communisme "démarxisé" en faveur d'un communisme "hobbesien" (sur ce thème, voir, entre autres, AA. VV., Europa Nazione, AGA Editrice, Milan 2021).
Après une nouvelle période d'éloignement de la scène politique, son retour dans les années 1980 avec une série d'écrits - voir notamment le livre L'impero euro-sovietico da Vladivostok a Dublino (Edizioni all'insegna del Veltro, Parma 2018) - coïncide avec une élaboration plus mature du théoricien belge : le concept d'intégration continentale eurasienne dans un "Empire euro-soviétique de Vladivostok à Dublin" est renforcé : l'Union soviétique et l'Europe sont indispensables l'une à l'autre pour atteindre le "seuil" territorial et démographique permettant de s'opposer à la puissance hégémonique atlantique. Dans cette vision, il y a un dépassement définitif de la critique thiriartienne du communisme, auquel on reconnaît un mérite indiscutable : celui de la domination du politique sur l'économique, indispensable à la protection de la souveraineté. L'approche de Thiriart sur le communisme mérite un examen plus détaillé, pour lequel nous renvoyons aux études citées dans cet article ; il suffit ici de souligner comment il a interprété un communisme "démarxisé" en faveur d'un communisme "hobbesien" (sur ce thème, voir, entre autres, AA. VV., Europa Nazione, AGA Editrice, Milan 2021).

En 1992, comme nous l'avons déjà mentionné, le dernier acte significatif de la vie de Thiriart fut un voyage à Moscou, dans une Russie dévastée par la fin de l'expérience soviétique et les misérables "réformes" d'Eltsine. C'est précisément sur la dernière année de la vie de Thiriart, et en particulier sur ses prises de position controversées sur l'Europe de Maastricht, que Luca Tadolini a centré son intervention. En citant de larges et éclairants extraits d'un débat radiophonique, il a eu le mérite de rappeler que, même dans ce cas, il faut reconnaître la cohérence fondamentale du "géopoliticien militant".
Dans son dernier discours public, Thiriart s'est prononcé en faveur de l'adhésion de la France à l'Europe de Maastricht - nous sommes dans l'imminence du référendum - parce que la France, seule, ne peut rien contre la puissance excessive de l'Atlantique : une entité étatique de moins de 250 millions d'habitants ne peut même pas penser constituer une entité politique assez forte pour compter pour quelque chose. Bien sûr, c'est une Europe de banques, de bureaucrates, asservie aux États-Unis et à son bras militaire, l'OTAN, mais de manière pragmatique, nous devons reconnaître que l'Europe est déjà aux mains des États-Unis depuis 1945. Il faut donc sortir de la logique de Yalta, il faut faire l'Europe à tout prix, "il faut commencer par des mollusques", pour reprendre une expression pittoresque de Thiriart.
Une fois de plus, conformément à ce qu'il a toujours affirmé, il réaffirme avec force la nécessité d'une unification continentale menée par la Russie, qui ne commette pas les mêmes erreurs fatales que l'Europe allemande ou, plus loin dans le temps, l'Europe napoléonienne menée par la France, lorsque les intérêts particuliers des différentes puissances l'emportaient sur une vision commune, détruisant ainsi le rêve de la "grande Europe" : l'Europe a besoin de la Russie autant que la Russie a besoin de l'Europe, et il faut toujours garder cela à l'esprit.

Il ne s'agit donc pas de subir l'impérialisme en créant une Europe unie, mais de construire un empire. Une Europe, comme nous l'avons vu, non pas démocratique et parlementaire, mais jacobine, centralisée et unitaire. Le seul précédent historique de cette situation se trouve dans l'Empire romain, ennemi mortel de Carthage, le précurseur de l'impérialisme américain.
En 1989/90, après la dissolution de l'Union soviétique, nous n'avons heureusement pas assisté à la "fin de l'histoire" qui avait été prédite ; cependant, l'élargissement de l'Alliance atlantique à l'Est constitue une menace qui n'est pas du tout propice à une conciliation fructueuse des intérêts communs russo-européens, comme le démontre malheureusement la crise ukrainienne actuelle. En conclusion, du point de vue de la réalisation souhaitable d'un monde multipolaire dans lequel la superpuissance atlantique n'exerce plus son emprise, la pensée de Jean Thiriart reste d'une pertinence déconcertante, grâce aussi au travail méritoire de réédition de ses écrits et de redécouverte de sa pensée.
15:00 Publié dans Eurasisme, Géopolitique, Histoire, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanthiriart, hommage, europe, européisme, eurasie, russie, eurasisme, géopolitique, histoire, européisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 12 janvier 2022
In memoriam: Guy Sajer alias Dimitri (1927-2022)

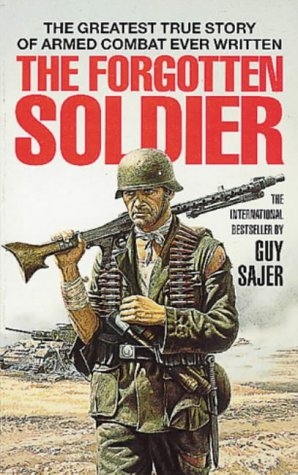 Quoiqu'il en soit, Le Soldat oublié demeure un des plus touchants car réalistes ouvrages du genre : le livre connut la consécration démocratique et commerciale du livre de poche - 3 millions d'exemplaires vendus en une presque quarantaine de langues dont le chinois (nationaliste ?) - et même littéraire - Prix éminemment germanopratin des Deux Magots. Et l'armée américaine l'a même conseillé à ses officiers !
Quoiqu'il en soit, Le Soldat oublié demeure un des plus touchants car réalistes ouvrages du genre : le livre connut la consécration démocratique et commerciale du livre de poche - 3 millions d'exemplaires vendus en une presque quarantaine de langues dont le chinois (nationaliste ?) - et même littéraire - Prix éminemment germanopratin des Deux Magots. Et l'armée américaine l'a même conseillé à ses officiers !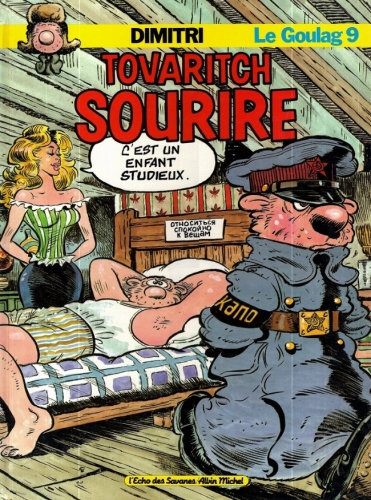
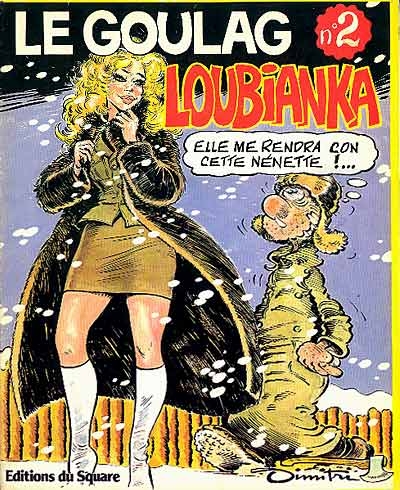




18:31 Publié dans art, Bandes dessinées, Hommages | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : guy sajer, guy mouminoux, dimitri, bande dessinée, 9ème art, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 janvier 2022
La sagesse active d'Antonio Medrano

La sagesse active d'Antonio Medrano
Sur l'oeuvre du traditionaliste espagnol, décédé en ce mois de janvier 2022
Guillermo Mas Arellano
Source: https://elcorreodeespana.com/libros/730121004/La-sabiduria-activa-de-Antonio-Medrano-Por-Guillermo-Mas.html
Il y a quelques mois, les traditionalistes du monde hispanophone ont dit adieu à l'un des plus grands représentants contemporains de cette école de pensée en Espagne : Aquilino Duque. Peu de temps après, le 23 novembre, le romancier et professeur d'université Antonio Prieto, l'un des plus grands spécialistes de la Renaissance et un important représentant de l'humanisme en Espagne, est décédé. Après plusieurs années au cours desquelles nous avons dû faire nos adieux à des personnalités aussi importantes que José Jiménez Lozano, Antonio Bonet Correa et Francisco Calvo Serraller, nous apprenons aujourd'hui le décès d'Antonio Medrano. Une fois de plus, nous sommes abandonnés dans le noir, sans la lumière qui nous permettait d'entrevoir l'au-delà de l'obscurité.
La nouvelle année a déchiré son rideau avec une nouvelle tout aussi dévastatrice pour la pensée traditionnelle : le décès, le samedi 8 janvier 2022, du grand Don Antonio Medrano. Un brillant prosateur, Duque, est parti avant lui, tout comme un profond penseur, Medrano, est parti maintenant, sans que le remplacement au sein du savoir traditionnel soit évident. Cela met en danger toute une école de la connaissance. Il reste cependant une pléthore de belles idées exprimées en mots serrés, rassemblées dans des articles et des livres.
Issu d'une famille de militaires, dont un père aviateur et des ancêtres ayant combattu lors de la Reconquête, Medrano était diplômé de l'ICADE (Institut catholique de gestion des entreprises) et polyglotte. Il s'est spécialisé dans le conseil aux hommes d'affaires du monde entier, sur la base de sa connaissance approfondie de la philosophie pérenne (Sophia Perennis), qu'il a recueillie et adaptée à l'époque actuelle avec maestria.
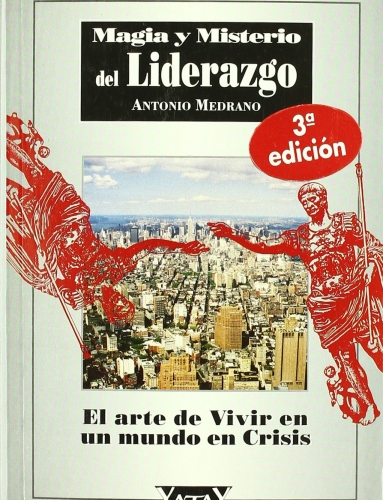
C'est à la suite de ce travail de formation nécessaire qu'est né son ouvrage le plus abouti et le plus instructif : Magie et mystère du leadership. L'art de vivre dans un monde en crise (Magia y misterio del liderazgo. El arte de vivir en un mundo en crisis). Publié par Yatay, comme tous ses livres, c'est le premier livre de lui que j'ai lu, fasciné, après l'avoir découvert grâce à une interview que l'historien Gonzalo Rodríguez García, son plus grand disciple et, maintenant, son principal continuateur, a réalisée avec lui pour sa chaîne Youtube baptisée El Aullido del Lobo : LA LUCHA CON EL DRAGÓN.
Outre des livres tels que Sabiduría Activa ou La lucha con el dragón, Antonio Medrano était connu pour les réunions animées qu'il dirigeait et pour le travail continu de conseil personnel pour lequel beaucoup lui sont reconnaissants aujourd'hui. Sa philosophie avait dans la connaissance de soi et le renoncement à l'ego une pierre de touche comme pilier fondamental pour l'initiation sur le chemin de la Tradition et de la Vérité en des temps d'obscurcissement moral et de Kali-Yuga. Pour Antonio Medrano, nous sommes tous les héros de notre propre vie, engagés dans un travail acharné pour faire sortir l'ordre du chaos et vaincre le dragon qui est en nous, une bataille qui se joue jour après jour.
Medrano a été l'un des grands critiques de la Modernité philosophique, peut-être le seul aujourd'hui avec Dalmacio Negro, car il articulait sa critique de l'idéal utopique de "l'homme nouveau", à un tel niveau de profondeur lorsqu'il s'agissait de pointer les grands maux de notre époque chez nos contemporains espagnols: "Faire comprendre que l'homme ne peut être réduit à la simple catégorie de travailleur, de consommateur, de spectateur, de citoyen, de contribuable, d'électeur ou de militant, c'est-à-dire à une entité qui travaille, produit, consomme ou vote, ou qui jouit du spectacle et du divertissement qui lui sont offerts (le panem et circenses que les tyrannies accordent à la plèbe), comme c'est malheureusement souvent le cas aujourd'hui. La personne humaine n'est pas un simple numéro anonyme (une partie aliquote d'une quantité ou d'une masse plus importante), un objet ou un produit avec lequel on peut faire ce que l'on veut, un simple individu à la merci des idéologies et de leur ingénierie sociale. Le nihilisme, qui se présente très souvent sous le faux visage de l'humanisme, détruit à la fois la foi en la réalité (la confiance en l'être) et l'amour de la réalité, les deux piliers sur lesquels repose la vie humaine, une vie humaine digne de ce nom.
Et ce faisant, elle introduit deux ferments fatals qui rendent la vie humaine et personnelle impossible : la méfiance à l'égard de la réalité et la haine ou le mépris de cette même réalité. Deux forces négatives qui conduisent à un lent mais implacable suicide émotionnel, une mort à petit feu, qui se traduit souvent rapidement par un suicide physique ou l'autodestruction finale de l'individu. Sur ces deux bases pourries, il est impossible de construire une vie personnelle authentique, solide, saine et vigoureuse. L'individu qui en a fait son atmosphère vitale, au lieu de progresser dans le processus de personnalisation, en devenant de plus en plus une personne, se dégrade et s'avilit, se déforme, diminue sa qualité humaine et devient progressivement moins une personne".

Synthétisant la philosophie de l'Orient et de l'Occident, Medrano visait à régénérer la pensée d'une Europe égarée par les guerres mondiales successives, par l'amélioration individuelle de ses dirigeants et de tous ceux qui demandaient conseil au Maître. Héritier presque direct de Julius Evola ou de René Guénon, Medrano a étudié sans œillères idéologiques d'aucune sorte toutes les grandes traditions intellectuelles à vocation universelle: de la Kabbale au christianisme, des Celtes à l'hindouisme, du monde gréco-latin au bouddhisme. Fervent adepte du Tao, étudiant passionné de mysticisme, disciple lointain du vieux Zoroastre, son œuvre est l'équivalent hispanique de celle d'Ananda Coomaraswamy ou de Roberto Calasso, lui aussi récemment décédé. Medrano appartient à cette race rare de philosophes qui réinventent le difficile en facile, pour mieux le transmettre aux autres.
La conséquence vitale d'une lecture d'Antonio Medrano (pour qui "l'aventure de la vie, c'est de faire"), à tous les niveaux, d'une confrontation avec ses idées, était évidente pour tous ceux qui, comme ce fut mon cas, ont eu la chance de le connaître au moins un peu pour découvrir qu'en plus d'être un homme sage, il était aussi un gentleman courtois et généreux dans la sphère personnelle. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de l'interviewer et Medrano m'a livré l'un des dialogues dont, je l'avoue sans honte, je suis le plus fier. Assis par terre, suivant une posture de yoga bien connue, tandis qu'il parlait avec l'humilité et le ton didactique qui caractérisaient le Maître, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une émotion touchante: la même qui me submerge maintenant lorsque je me souviens de lui par écrit. Ce n'était pas la dernière fois que nous nous parlions, mais nous n'avions ni le temps ni l'occasion d'approfondir notre relation. Je laisse ici, pour ceux qui sont intéressés, le lien vers la discussion instructive que nous avons eue sur ma chaîne Youtube : La voie de la sagesse active avec Antonio Medrano.
Je voudrais maintenant compiler quelques citations de Maître Medrano, pour ceux qui souhaitent commencer à se lancer dans son œuvre, maintenant qu'elle est achevée: "Dans toute la littérature chrétienne, cet argument du combat spirituel apparaît comme un thème récurrent. A toutes les époques et dans toutes les langues dans lesquelles la pensée chrétienne s'est exprimée, les allégories de l'âme comme champ de bataille abondent, qu'elle soit décrite comme combattant durement en rase campagne avec ses ennemis ou assiégée dans son château par les vices. L'Esprit est le Royaume des Cieux en nous, la Présence divine au plus profond de l'être humain. Le Soi ou le Moi éternel qui constitue notre identité propre (moi-même), et qui me permet de dire: je suis. Deux dimensions opposées sont présentes en l'homme: la relativité et l'absolu, le relatif et l'absolu, le fini et l'infini, l'immanent et le transcendant, le céleste et le terrestre, l'éternel et le temporel (périssable et éphémère). Il est un être fini, conditionné et limité, plongé dans la relativité, en qui réside l'Absolu, l'Infini, l'Illimité et l'Inconditionné. L'homme est le roi de la création, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En lui sont présents les deux aspects essentiels de la Réalité divine: la Sagesse et l'Amour, l'Intelligence et la Compassion ou la Clémence (la Bonté). En tant que Roi, il est responsable du bien, de l'harmonie, de la stabilité, de l'équilibre et du bon fonctionnement de la Création. L'homme est un microcosme, un reflet du macrocosme, et, comme le macrocosme, un temple vivant de Dieu. Il ne peut être en conflit avec le Macrocosme, dont il fait partie et qui se reflète dans son être même. La mission de l'homme : servir d'intermédiaire entre le Ciel et la Terre, entre la Divinité et la Nature. Fonction pontificale, sacerdotale, cosmique et cosmisante (co-créatrice). Collaborer avec le Créateur pour parfaire la Création et maintenir l'Ordre face aux menaces des forces du chaos et des ténèbres".
Autre citation d'Antonio Medrano: "La vie de l'homme traditionnel se distingue avant tout de celle de l'homme moderne par ce critère doctrinal, par cette soumission à la vérité et aux principes : tandis que la vie du premier est entièrement inspirée par une doctrine qui oriente, ordonne et donne un sens à tous les aspects de son existence (une doctrine authentique) : sacrée, sapientielle, supra-humaine, d'origine transcendante, située au-dessus des critères et des opinions individuelles), la vie de ce dernier se développe indépendamment de toute orientation doctrinale, en dehors de toute doctrine, ignorant même ce que ce mot signifie. En l'absence de ligne directrice normative pour guider sa vie, l'homme moderne vit comme il l'entend, il fait ce qu'il veut. L'homme traditionnel, en revanche, vit comme il le devrait, il ne fait pas ce qui lui plaît ou lui fait plaisir, mais ce qui est juste et nécessaire".
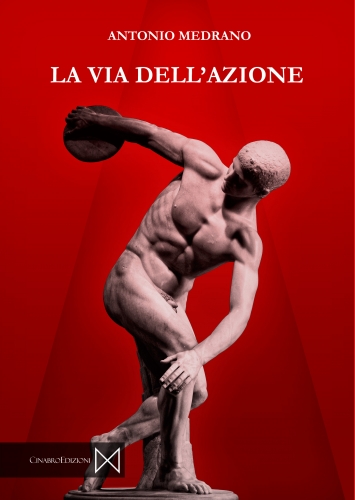
Plus de citations d'Antonio Medrano: "La vie est un mystère que nous ne pouvons dévoiler ou comprendre (relativement parlant, dans la mesure où il est compréhensible) qu'en mettant en jeu nos plus hautes facultés intellectuelles (intuitives et supra-rationnelles), c'est-à-dire en regardant au-delà des schémas pauvres et limités du rationalisme ou de l'empirisme scientiste et biologiste. Nous nous trouvons devant un mystère dans lequel, de manière voilée mais éloquente, l'Éternité se révèle et se manifeste, ce que certaines traditions spirituelles appellent le Grand Mystère, le Mystère suprême qui soutient l'Ordre universel, avec toute la force sacrée qui imprime sur le réel cette présence du Mystère, de l'Infini et de l'Éternel. À mon avis, c'est là que réside la force et la pertinence de la vie. C'est ce qui l'entoure d'un attrait irrésistible et la rend si précieuse, puisqu'il s'agit d'une valeur fondamentale, basique et primaire dans laquelle se manifeste et transparaît la Valeur suprême, source et racine de toutes les valeurs, ce que Dante appelait il primo ed ineffabile Valore".
Une dernière série de citations d'Antonio Medrano: "La Doctrine traditionnelle est l'expression de la seule et unique Vérité, la Vérité suprême et éternelle (Paramartha-Satya), source et origine de toute vérité. Elle est fondée sur la Vérité absolue qui sous-tend et soutient toutes les vérités que nous pouvons trouver, connaître ou découvrir, nécessairement relatives (samvriti-satya), avec un degré plus ou moins élevé de relativité (aussi basiques, fondamentales, importantes, élevées et sacrées soient-elles). La Doctrine ou la Sagesse traditionnelle peut revêtir de nombreuses formes différentes, présentant de multiples approches et perspectives, qui sont adaptées aux conditions de temps et de lieu (selon les différentes époques et les différents contours géographiques, ethniques et raciaux), ainsi qu'aux différents types humains (leur vocation, leur mentalité, leurs inclinations, leurs tendances de base, leurs qualifications et leur niveau intellectuel). Mais l'unité domine toujours la diversité et les différences légitimes, nécessaires et indispensables : la multiplicité dans l'Unité et l'Unité dans la multiplicité".
Et : "D'une manière générale, nous ne nous connaissons pas du tout. Nous vivons perdus, inconscients de notre propre réalité, nous nous ignorons, nous attirant ainsi toutes sortes de problèmes et de difficultés. Pour trouver la voie du bonheur et de la liberté, il est primordial de suivre l'injonction de Delphes Gnothi seauton, "Connais-toi toi-même", qui figurait sur le sanctuaire d'Apollon dans la Grèce antique. Mais pour suivre cette injonction, je dois me poser un certain nombre de questions. Des questions de différents niveaux, plus ou moins profondes, mais toutes vitales pour me connaître, pour découvrir mon essence la plus profonde, pour me trouver et sortir de la panne ou du labyrinthe d'inconscience, d'étourdissement, de dissipation et d'auto-ignorance dans lequel je vis".
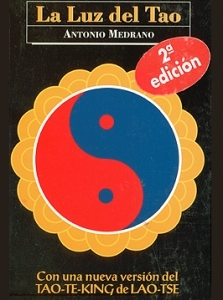 Nous pouvons résumer la profonde philosophie d'Antonio Medrano en disant que la vie est une lutte constante entre le Bien et le Mal, où à chaque instant nous sommes obligés de choisir à travers les actes qui composent notre Être. S'améliorer dans ce processus incessant d'essais et d'erreurs constitue la sagesse active: "Le mythe de la lutte avec le dragon nous parle de cette lutte. Mais ici, la lutte a surtout une projection intérieure : c'est une guerre contre soi-même, un combat contre les entraves de son propre être, une lutte acharnée contre l'ego. Il s'agit d'une guerre interne dans laquelle ce qui compte le plus pour nous - ou du moins devrait compter le plus pour nous - est en jeu : notre liberté, notre dignité et notre bonheur. Une lutte intérieure qui sera d'autant plus intense que la personne est noble, que ses aspirations sont élevées et nobles. Celui qui ne se bat pas intérieurement, perd sa vie. Celui qui ne veut pas se battre, sera condamné à vivre comme une épave vivante, comme un perpétuel vaincu, comme une pièce inerte secouée par les événements et par la fatalité du destin. Le devoir plonge ses racines dans le monde de l'être et ouvre la voie qui mène à l'être. En tant que puissance affirmative, auto-affirmante et séridienne, en tant que puissance ennoblissante et essentialisante, le devoir nous donne l'être, nous fait être dans le plein sens du terme, nous enracine dans l'être d'où jaillit l'action juste et, avec elle, le fruit mûr de la vie bonne, pleine, libre et heureuse. Elle est l'ancre qui nous amarre aux profondeurs insondables et inébranlables de l'Être qui soutient et fonde toute existence, nous libérant ainsi du naufrage dans la mer agitée de la vie".
Nous pouvons résumer la profonde philosophie d'Antonio Medrano en disant que la vie est une lutte constante entre le Bien et le Mal, où à chaque instant nous sommes obligés de choisir à travers les actes qui composent notre Être. S'améliorer dans ce processus incessant d'essais et d'erreurs constitue la sagesse active: "Le mythe de la lutte avec le dragon nous parle de cette lutte. Mais ici, la lutte a surtout une projection intérieure : c'est une guerre contre soi-même, un combat contre les entraves de son propre être, une lutte acharnée contre l'ego. Il s'agit d'une guerre interne dans laquelle ce qui compte le plus pour nous - ou du moins devrait compter le plus pour nous - est en jeu : notre liberté, notre dignité et notre bonheur. Une lutte intérieure qui sera d'autant plus intense que la personne est noble, que ses aspirations sont élevées et nobles. Celui qui ne se bat pas intérieurement, perd sa vie. Celui qui ne veut pas se battre, sera condamné à vivre comme une épave vivante, comme un perpétuel vaincu, comme une pièce inerte secouée par les événements et par la fatalité du destin. Le devoir plonge ses racines dans le monde de l'être et ouvre la voie qui mène à l'être. En tant que puissance affirmative, auto-affirmante et séridienne, en tant que puissance ennoblissante et essentialisante, le devoir nous donne l'être, nous fait être dans le plein sens du terme, nous enracine dans l'être d'où jaillit l'action juste et, avec elle, le fruit mûr de la vie bonne, pleine, libre et heureuse. Elle est l'ancre qui nous amarre aux profondeurs insondables et inébranlables de l'Être qui soutient et fonde toute existence, nous libérant ainsi du naufrage dans la mer agitée de la vie".
Un ami m'a récemment suggéré l'idée de réaliser un programme spécial commémorant Noël avec Antonio Medrano. Pour le philosophe né en 1946, cette période de l'année a toujours été un événement très particulier au symbolisme duquel il avait consacré plusieurs articles de très grande qualité: "Symbolisme du portail de Bethléem", "Le message intérieur de Noël", "Noël, naissance du Christ, Soleil du monde" et "La signification de Noël". Ils sont tous disponibles sur son site web, que je vous recommande de visiter : https://antoniomedrano.net/. Je regrette de ne pas l'avoir fait à temps, mais je me console en me disant qu'avant de l'emmener dans un endroit meilleur, Dieu lui a offert un dernier Noël en reconnaissance de toute une vie d'apprentissage et d'enseignement.
Qui est Guillermo Mas Arellano?
Né le 3 novembre 1998 à Madrid, il est étudiant en littérature générale et comparée à l'UCM et collabore également à divers médias numériques et audiovisuels dissidents. Avec une expérience de conférencier et de critique de cinéma, il défend l'héritage incomparable de la culture hispanique au sein de l'Occident et la connaissance pérenne de la philosophie traditionnelle à travers la littérature comme un bastion de défense contre le monde moderne. Ses ennemis sont les ennemis mêmes de l'Espagne, ainsi que tous ceux qui cherchent à changer le cours de l'histoire et le caractère des peuples par des mesures d'ingénierie sociale. En bref, c'est un réactionnaire.
10:58 Publié dans Hommages, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio medrano, hommage, tradition, traditionalisme, espagne, sagesse active |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 07 janvier 2022
Guillaume Faye et la vision de l'archéofuturisme

Guillaume Faye et la vision de l'archéofuturisme (I)
par Adriano Erriguel
Source: https://posmodernia.com/guillaume-faye-y-la-vision-del-arqueofuturismo-i/
Des temps nouveaux, des temps sauvages.
L'avenir est un pays étrange : les choses s'y font différemment. Cette phrase - inspirée d'un célèbre roman - est plus vraie aujourd'hui que jamais [1].
Juin 1914
Juin 1914, le dernier été de la Belle Époque. Une ère de science et de progrès. À Aulnay-sous-Bois, charmant village des environs de Paris, un groupe de jeunes aristocrates et bourgeois désœuvrés - la "jeunesse dorée" de l'époque - s'adonne à un passe-temps à la mode : la consultation d'une voyante. Que sera ce lieu - ce café, cette petite place paisible - dans vingt-cinq, cinquante ou cent ans ?
La voyante, dont la réputation repose sur le fait de ne pas garder pour elle les choses désagréables, est à la hauteur de sa réputation. Dans trois ans, il ne restera qu'un squelette de l'une des personnes présentes, à cinq mètres sous terre dans la campagne de Verdun. Un début peu prometteur. Les visions se succèdent les unes après les autres. Dans quinze ans (1930), tout le monde semble heureux : il y a une danse sur la place et des modèles de voitures inconnus envahissent le terrain. Dix ans plus tard (1940), une grande colonne de réfugiés semble traverser l'endroit. En juin 1964 - cinquante ans après les retrouvailles insouciantes - les choses semblent avoir changé : les anciennes maisons ont été démolies et de gigantesques blocs de béton - des masses grises en forme de cube avec une multitude de trous - sont érigés à leur place.
A partir de là, les visions deviennent plus étranges. En juin 2014 - cent ans après la rencontre - une mosquée a été érigée sur le site du café. Les femmes portent un foulard ou se couvrent le visage d'un tissu noir, au milieu de nuées d'enfants à la peau sombre. À proximité se trouve un bâtiment ressemblant à un marché, dont les fenêtres sont brisées, comme s'il avait été pillé. Il y a des hululements, comme des sirènes d'alarme. ....
"Une mosquée, des femmes voilées, vous parlez de la France ou des colonies ? ". - s'exclame l'un des jeunes hommes présents. Définitivement, l'humeur du groupe semble être ruinée.
Juin 2114, deux cents ans plus tard. Le soleil brille au milieu du murmure des oiseaux. La végétation s'élève au-dessus de ce qui semble être d'immenses ruines. Sur ce qui devait être la petite place d'Aulnay-sous-Bois se dressent des habitations rudimentaires, une sorte de bicoque faite de bois et de tôle. Des groupes bruyants de personnes à la peau très foncée prennent racine parmi eux.
"Sont-ils... noirs ?" demande l'une des femmes présentes.
"Oui, Madame la Vicomtesse ; ils sont noirs".
C'est le début du livre "Archéofuturisme 2.0", de l'écrivain et théoricien français Guillaume Faye. Un damné parmi les damnés, dans une "famille" de pensée déjà damnée.
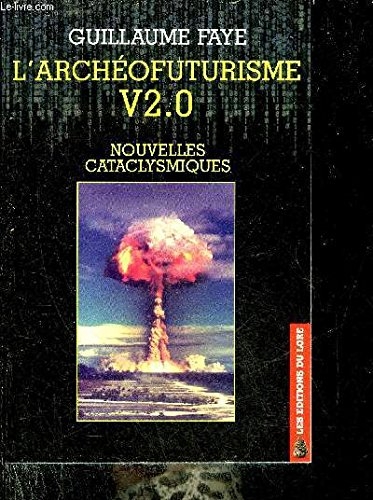
Total sinistre
Le monde moderne ressemble à un train de munitions fonçant dans le brouillard par une nuit sans lune, toutes lumières éteintes.
ROBERT ARDREY
Dans la pensée critique, anticiper l'avenir est toujours la chose la plus risquée à faire: soit vous vous ridiculisez, soit vous gagnez l'aura d'un prophète, généralement à titre posthume. Pour éviter ce risque, les écrivains visionnaires se réfugient dans les domaines permissifs de la science-fiction. Georges Orwell (1984), Aldous Huxley (Brave New World) et Ray Bradbury (Fahrenheit 451) en sont les exemples les plus marquants. Qu'il s'agisse d'essai ou de fiction, notre époque est propice à de tels exercices. Quels sont les scénarios récurrents?
D'une part, l'invasion de la technologie dans toutes les sphères de la vie laisse entrevoir un futur transhumaniste, définitivement géré, régulé par des algorithmes prédictifs, gouverné par un dôme de contrôle des big data. D'autre part, les prévisions sur le changement climatique ont donné naissance à la collapsologie: une "science de l'effondrement" aux accents apocalyptiques. Pour compléter le tableau, la crainte que le capitalisme ne dépasse les limites physiques de la planète a conduit certains à envisager un avenir post-capitaliste. Ici, les cauchemars dystopiques des uns - une planète dévastée, gouvernée par une élite extractive - alternent avec les désirs utopiques des autres : un "écosocialisme" aux accents moralisateurs, ou - dans les cas d'optimisme aigu - un scénario d'automatisation totale, de transhumanisme émancipateur et de revenu de base universel ; un "communisme de luxe", en somme [2]. Dans ce contexte varié, où se situe l'œuvre de Guillaume Faye ?
Guillaume Faye est connu pour son idée d'"archéofuturisme", qui est souvent catégorisé comme "une utopie d'extrême droite". Cependant, il est très difficile de considérer le monde décrit par Faye comme une "utopie". Aucune personne saine d'esprit - aussi extrémiste de droite soit-elle - ne voudrait connaître un tel monde. Les visions de Faye ne sont pas faites pour les peureux, et elles ne sont pas à prendre à la légère. Il s'agit en fait d'une dystopie carrément sinistre qui, si l'on devait noter l'échelle apocalyptique sur une échelle de un à dix, serait un vingt ou un trente. Mais l'approche de Faye n'est ni pessimiste ni optimiste. Son point de vue est celui de l'accélérationnisme, qui signifie en termes vulgaires "le pire, le meilleur". L'accélérationniste part du principe que, lorsqu'une situation est pourrie, il est préférable qu'elle explose le plus rapidement possible. Une ligne d'argumentation - celle des accélérationnistes - qui suscite la méfiance.

La position de Faye n'est-elle pas une forme de millénarisme, un aveu d'impuissance ? Pour l'essayiste français Romain D'Aspremont, l'attitude de Faye dénote "l'impuissance de l'homme de droite qui déteste tellement ce monde - l'image de sa défaite perpétuelle - qu'il a le fantasme de sa destruction apocalyptique, d'une sorte de déluge universel qui balayerait la civilisation de gauche de la surface de la terre, lui permettant de faire triompher son programme réactionnaire" [3]. Une explication psychologique qui semble plausible. Suffisant pour nous faire oublier Faye ?
En fait, lorsqu'un prophète a raison une fois, cela peut être une coïncidence, mais lorsqu'il a raison plusieurs fois, cela peut nous faire réfléchir. Guillaume Faye a publié son livre "Archéofuturisme" en 1999, dans l'intervalle optimiste de la "mondialisation heureuse". Deux ans plus tard, les attentats du 11 septembre (2001) ont eu lieu ; 2008 a vu la crise financière mondiale ; en 2015, une crise migratoire sans précédent a éclaté ; dans le même temps, la montée du populisme a commencé à récupérer des valeurs "fortes" dans un contexte marqué par le conflit entre l'Islam et l'Occident, par un retour de la géopolitique et par un retour du leadership charismatique. Au cours de ces années, les preuves du changement climatique se sont accentuées et, en 2020, la pandémie de COVID a éclaté. D'une manière ou d'une autre, tous ces phénomènes avaient été prédits par Guillaume Faye depuis les années 1990. Mis en perspective : qui s'est avéré être le meilleur prophète, Guillaume Faye ou Fukuyama ?
Le cœur des ténèbres
Penseur "culte", à l'écart des modes et du grand public, Guillaume Faye est, depuis les années 1970, une référence pour le monde intellectuel que l'on a appelé la "Nouvelle Droite" française. Faye était un penseur aux intuitions fulgurantes, aux idées chocs dans lesquelles il alliait la provocation et un certain caractère prémonitoire. Favorisée par une indéniable accroche personnelle - un dandy à la française - Faye combine le sens de la formule, un don d'éloquence et une large formation intellectuelle. Mais comme cela arrive parfois, une surabondance de cadeaux peut être une malédiction. Il est difficile de savoir ce qui lui est arrivé, peut-être a-t-il été victime de son désintérêt pour "faire carrière", ou peut-être a-t-il appliqué à la lettre la maxime de William Blake - "le chemin de l'excès mène au temple de la sagesse" - et en a-t-il fait trop. Quoi qu'il en soit, dans les années 1980, il a quitté la Nouvelle Droite - qu'il avait modulée de manière décisive - et s'est lancé dans diverses activités. Il était animateur sur la radio Skyrock, où il est devenu populaire pour ses farces outrancières (canulars, en français) basées sur des fake news (précurseurs des fake news actuelles) et des imitations irrévérencieuses [4].

Il était également scénariste comique et - à l'en croire - acteur porno occasionnel, mais on ne sait jamais ; sa facette situationniste l'a conduit vers le théâtre et la farce. À la fin des années 1990, il est revenu à l'écriture politique et l'a fait sans gants de velours ; l'un de ses livres a été condamné par une décision de justice. Aujourd'hui, il est plus facile de le lire en anglais. Ses anciens camarades de la Nouvelle Droite prétendaient qu'il était devenu fou (comme une sorte de Kurtz dans Au cœur des ténèbres). Ses proches ont dit qu'il n'était pas un intellectuel typique, mais ce que les Français appellent un éveilleur, ce qui se traduit en anglais par awakener et en espagnol par quelque chose comme un "réveilleur" ou un "gardien". Le terme le plus approprié est peut-être celui d'"inspirateur".
"Les inspirateurs, écrit un ami de Faye, sont des hommes qui viennent d'un monde immuable, immanent et permanent, d'une sorte d'"autre monde" parallèle au nôtre, et qui ont une mission à accomplir. Ces hommes n'ont d'autre souci que de transmettre leur savoir et leur énergie, toute leur vie est consacrée à cette transmission (...) Un inspirateur est un réaliste, même s'il peut apparaître comme un mystique. Il est normalement un homme simple et modeste, il n'est pas vaniteux et ne souffre pas de narcissisme ou d'un ego démesuré" [5]. Quelle mission Guillaume Faye s'est-il fixé ? Sans doute celui de secouer, de bousculer, de faire honte aux consciences de ses compatriotes européens ; celui de dénoncer la maladie de l'âme qui ronge leur civilisation. Peut-être pour les préparer à quelque chose.
Malheureusement, de nombreuses intuitions de Faye sont trop bien adaptées au climat vital - au Zeitgeist - de notre époque : comme dans le film "A Clockwork Orange", Faye nous oblige à garder les paupières ouvertes sur des choses que nous préférerions ne pas voir.
Les prophéties de Corvus
In girum imus nocte et consumimur igni [6]
Attribué à VIRGIL
Le livre le plus proprement "prophétique" de Faye s'intitule "La convergence des catastrophes", et a été publié en 2004 sous un pseudonyme inquiétant (Guillaume Corvus) [7]. Dans le sillage du mathématicien René Thom - spécialiste des effondrements systémiques - Faye a mis en garde contre la conjonction d'une série de lignes dramatiques qui couvaient depuis longtemps, et qui aboutiront à une rupture décisive dans l'histoire humaine. Quelque chose de dix fois plus terrible que la chute de l'Empire romain.
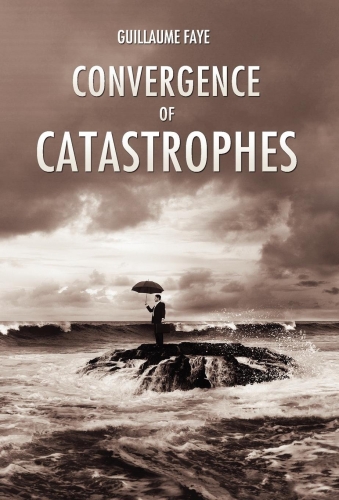
Guillaume Faye prend la question du changement climatique très au sérieux, même si, selon lui, ce n'est pas la seule catastrophe qui se profile à l'horizon, ni même la plus grave. L'explosion d'une économie financière fondée sur l'endettement marquera, selon lui, l'effondrement de la mondialisation, ainsi qu'une récession économique sans précédent à laquelle s'ajoutera une escalade de crises parallèles : le retour des épidémies à l'échelle mondiale, la crise énergétique et la raréfaction des combustibles fossiles, l'insuffisance des ressources agricoles et halieutiques, les crises migratoires de grande ampleur, la montée des nationalismes, la prolifération du terrorisme, le déclenchement de conflits armés - peut-être nucléaires - et une inimitié croissante entre l'Islam et l'Occident. En Europe, les perspectives sont particulièrement sombres : une population dramatiquement vieillissante facilitera une invasion migratoire qui débouchera - pour le dire crûment et simplement - sur une série de guerres civiles raciales sur le continent. Contrairement aux collapsologues qui se concentrent sur le changement climatique et l'épuisement des ressources énergétiques, Faye considère les conflits ethniques comme l'un des principaux scénarios d'effondrement. Principalement en Europe.
Une guerre civile raciale ? Le paradigme du "métissage universel" et du "citoyen du monde", selon Faye, ne verra jamais le jour. L'avenir sera celui d'une géopolitique faite de blocs ethniques se disputant les terres, les mers et les ressources rares de la planète. L'Europe péninsulaire est un morceau convoité par les Etats-Unis, mais aussi par le Sud, sous la bannière de l'Islam. Les jeunes issus de l'immigration ne soutiendront pas les progressistes qui leur ouvrent aujourd'hui la porte - vaine illusion de la "belle gauche" - mais les partis confessionnels de leur propre camp. Le choc des civilisations (prédit par Huntington) aura lieu au sein de l'Europe : une catastrophe bien plus grande que tous les fléaux et les guerres qu'elle a connus jusqu'à présent.
Il y a des petits détails chez Faye qui surprennent parfois ; comme le fait qu'en 2002, il avait prédit une vague de camions-kamikazes dans les villes européennes, et avait recommandé de placer des cairns dans les zones fréquentées (une mesure généralisée depuis 2016). À cheval entre l'essai et le roman d'anticipation, Faye déroule son catalogue particulier d'horreurs : gazage de tunnels de métro, déraillement de trains à grande vitesse, attaques d'installations électriques, attaques d'aéroports avec des dards portables, bombes radiologiques dans les capitales, cyber-attaques... tous les scénarios de l'apocalypse, du macro-terrorisme sans explosifs au terrorisme avec objets incendiaires, en passant par les attaques avec des moyens balistiques, les avions suicides et le giga-terrorisme nucléaire. Qui oserait aujourd'hui dire qu'aucun de ces scénarios n'est possible?
La grande rupture, selon Faye, ne se produira pas brusquement, mais sera une réaction en chaîne de plusieurs années. Dans un exercice d'anticipation risqué, Faye propose plusieurs scénarios alternatifs. Dans le plus dur des cas, il prévoit une contraction démographique mondiale, une régression technologique brutale et une économie de subsistance en dehors des villes (qui disparaissent pour l'essentiel). Il y aura alors une coexistence de "niveaux de civilisation": un retour au néolithique dans une grande partie du monde, un retour à une sorte de haut Moyen Âge (scénario européen) et la persistance de quelques "îlots de civilisation", avec une technologie proche de celle du début du XXe siècle. Ce scénario "Mad Max" aboutit à une stabilisation de plusieurs centaines de millions d'habitants sur la planète ; l'humanité est confirmée comme une "variante ajustable" dans la transition d'un système non viable à un système viable. Une conclusion qui n'est pas sans rappeler la célèbre "hypothèse Gaia", mais sans la dimension mystique et les artifices du New Age.
Comme le dirait Lénine, que faire ?
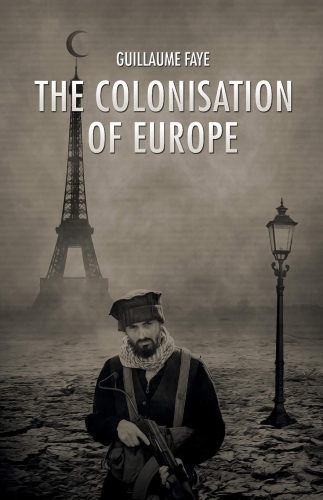
L'ère du citoyen-soldat
Ce qui est intéressant chez Guillaume Faye, ce n'est pas le péplum apocalyptique qu'il propose, mais les petits caractères qui l'entourent. Son point fort réside dans la dénonciation des maux qui, selon lui, rongent la civilisation européenne - vieillissement, ethnomasochisme, migration de repeuplement, dissolution de son tissu social, entre autres - et la laissent sans défense face aux épreuves à venir. Parmi les scénarios qu'il traite, celui de la guerre se détache : guerre des rues, guerre civile ethnique, guerre terroriste généralisée, guerre des civilisations, conflits nucléaires peut-être... Illusions d'un extrémiste de droite éclairé ? On pourrait le voir comme tel. Mais en soulevant toutes ces questions, il ne faisait qu'anticiper un état d'esprit qui allait se répandre dans les décennies à venir.
France, avril 2021. Une vingtaine de généraux à la retraite - avec le soutien supposé d'une centaine de commandants en activité - publient une lettre commune dénonçant le communautarisme ethnique, la désintégration progressive du pays et le danger d'une guerre raciale. La réaction du gouvernement et de la presse grand public est prévisible : "discours d'extrême droite visant à attiser la haine". Des sanctions sont annoncées contre les responsables. Un mois plus tard - en mai 2021 - une nouvelle lettre, émanant cette fois de militaires actifs anonymes, réitère qu'"une guerre civile se prépare". Les soldats rappellent leurs sacrifices à l'étranger "pour détruire cet islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol" et annoncent une "période de chaos et de violence" qui "ne viendra pas d'une déclaration militaire mais d'une insurrection civile". Plus de 160.000 signatures soutiennent la lettre. Le scandale politique et médiatique - en France et à l'étranger - est énorme. Le tout dans le contexte d'une controverse nationale déclenchée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après avoir assuré que "la France est malade de l'insécurité" et que sa société se dirige vers "l'ensauvagement". Des mots qui, selon les progressistes, "font le jeu de l'extrême droite". Peut-être que certains d'entre eux se sont souvenus de ce qu'un certain Guillaume Faye disait depuis longtemps. Il l'a dit dans des livres tels que "La colonisation de l'Europe" (condamné en 2000 pour "incitation à la haine raciale") et "Avant-guerre : chronique d'un cataclysme annoncé" (2002). Ces livres avaient des années d'avance sur les best-sellers de journalistes réputés tels que Walter Laqueur, Christopher Caldwell et Douglas Murray [8], à une différence près : Faye ne nourrit pas l'illusion que, par une sorte de miracle final, la situation peut être réglée à la satisfaction de tous. Son pronostic est sombre : le problème n'est pas celui de l'"immigration" ou de l'"invasion", mais celui de la colonisation : le processus par lequel des personnes allogènes repeuplent un territoire et en délogent les autochtones. La démographie est implacable : tôt ou tard, un pouvoir islamique s'installera en France, d'abord au niveau municipal, puis - éventuellement - au niveau national. Ce qui est pieusement dissimulé sous le nom de "délinquance juvénile" n'est que le prolégomène d'une guerre civile ethnique. Guillaume Faye a écrit ce texte plusieurs années avant que Michel Houellebecq ne publie "Soumission". Incitation à la haine ?
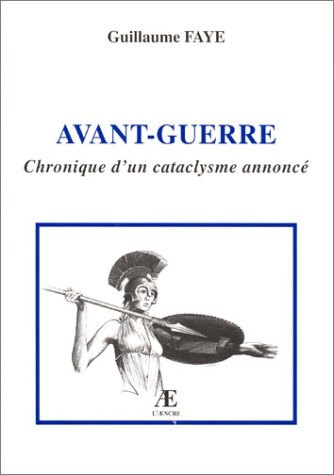 La libanisation violente du continent est un scénario envisagé depuis des années dans les perspectives stratégiques des deux côtés de l'Atlantique. Cette thèse a inondé le débat public et a même donné naissance à un genre littéraire : le roman dystopique de guerre civile. Sans parler des innombrables essais décrivant un avenir de sang et de chaos [9]. L'Europe entre - écrit Bernard Wicht, professeur à l'Université de Lausanne - "dans une spirale de conflits chaotiques et de violence anarchique à la manière africaine". C'est ce que l'historien Ferdinand Braudel appelait les "zones de désordre prolongé" [10]. Un scénario que l'Allemand Hans Magnus Enzensberger a esquissé en 1992, lorsqu'il a annoncé que la mondialisation des marchés entraînerait une mondialisation des migrations [11]. En 1998, le politologue suisse Eric Werner dénonçait la complicité du pouvoir dans la propagation du désordre, une thèse développée à sa manière par Naomi Klein dans "The Strategy of Shock" (2008) (12).
La libanisation violente du continent est un scénario envisagé depuis des années dans les perspectives stratégiques des deux côtés de l'Atlantique. Cette thèse a inondé le débat public et a même donné naissance à un genre littéraire : le roman dystopique de guerre civile. Sans parler des innombrables essais décrivant un avenir de sang et de chaos [9]. L'Europe entre - écrit Bernard Wicht, professeur à l'Université de Lausanne - "dans une spirale de conflits chaotiques et de violence anarchique à la manière africaine". C'est ce que l'historien Ferdinand Braudel appelait les "zones de désordre prolongé" [10]. Un scénario que l'Allemand Hans Magnus Enzensberger a esquissé en 1992, lorsqu'il a annoncé que la mondialisation des marchés entraînerait une mondialisation des migrations [11]. En 1998, le politologue suisse Eric Werner dénonçait la complicité du pouvoir dans la propagation du désordre, une thèse développée à sa manière par Naomi Klein dans "The Strategy of Shock" (2008) (12).
Dans ces scénarios, les mégapoles sont configurées - comme en Bosnie et au Liban - comme le champ de bataille par excellence. La division mafieuse des zones urbaines et la division en territoires ethniques deviendront irréversibles, tandis que l'État perdra son monopole de la violence légitime et que les citoyens s'organiseront en groupes d'autodéfense. C'est la notion de "citoyen-soldat 2.0" (Bernard Wicht) [13]. C'est l'idée de "guerre civile moléculaire" (H.M. Enzensberger) qui prend la forme d'une violence permanente dite de "basse intensité" en raison de son caractère diffus. À long terme, des confrontations entre États et ONG de plus en plus agressives, ainsi que l'utilisation d'armes nucléaires de faible intensité, ne sont pas exclues. Dans ces scénarios limites, les zones qui n'ont pas une culture locale solidaire et homogène (comme le Japon, qui s'est comporté de manière exemplaire lors du tsunami de janvier 2011) seront pénalisées. Dans les zones "multiculturelles", le pillage sera à l'ordre du jour et les grandes villes deviendront des pièges mortels.
L'avenir est archaïque
Pour situer le contexte, il faut savoir que, si les tendances démographiques ne changent pas, en 2060, les Européens autochtones seront minoritaires et en 2100, la population européenne autochtone - y compris la Russie - représentera moins d'un tiers sur le vieux continent: 170 millions d'individus contre une écrasante majorité d'origine allogène [14]. Dans un monde de pénurie et d'indigence, les constantes anthropologiques se manifesteront dans toute leur crudité: lutter pour les ressources, contrôler le territoire, assurer la reproduction, protéger la progéniture. Les valeurs que la modernité avait cherché à éliminer vont revenir en force. Nous allons assister à une ethnicisation définitive des relations sociales. Le paradigme libéral sera impuissant à penser les temps nouveaux. Dans la phase actuelle, le lien social continue de se fragmenter et la société se tribalise selon des lignes néolibérales. Mais cette diversité postmoderne - les "minorités sexuelles" en premier lieu - est un artifice. La fausse diversité ne résistera pas à l'assaut des vraies "tribus", celles organisées selon des critères ethniques et religieux (et non sociologiques). La tribu qui connaît la croissance la plus rapide, souligne Faye, est l'islam.
Quelle est la recette officielle ? Nous ne le connaissons que trop bien: égalité devant la loi, tolérance, laïcité, "la diversité est notre force", etc. En d'autres termes: le recours à des valeurs abstraites qui cimentent la coexistence. La prospérité individuelle et le culte de la consommation sont censés faire le reste. Mais cela cache une vérité essentielle : il n'y a pas de "valeurs" si elles ne sont pas sous-tendues par un sentiment d'appartenance commune, une conscience nationale, une culture. Si tout ce qui nous lie est une promesse de consommation illimitée, que se passera-t-il lorsque cette promesse ne pourra être tenue ?
Le temps passe et les masques tombent. Les critiques "conservateurs" posent souvent le bon diagnostic, mais ils s'obstinent à nourrir une illusion: que tout le monde peut être "occidental" s'il le veut, que tout le monde veut être occidental, sans autre horizon que celui de la consommation. C'est un déni de la réalité au sens freudien du terme. Il y a des années, l'essayiste espagnol Álvaro Delgado-Gal écrivait: "la terrible notion d'un ennemi mortel entre les formes de vie bouche l'horizon. Elle nous laisse littéralement abasourdis et stupéfaits (...) Les Occidentaux aiment à penser que leurs ennemis acharnés sont victimes d'un malentendu. Mais la douleur finira par les éveiller à la réalité" [15].
Discours de haine ? En lisant Faye, il faut souligner qu'il n'y a aucun appel à la haine, aucun dénigrement des ethnies ou des croyances, mais une froide observation éthologique. Nous ne devons dénier à l'ennemi ni sa noblesse ni sa cohérence humaine", souligne Faye, "il ne fait qu'occuper le terrain que les autres abandonnent". L'avenir sera plus archaïque, c'est-à-dire plus humain au sens éthologique du terme, que le passé récent.
Un autre scénario est-il possible ? Faye appelle ça une "symphonie espagnole". De la résistance à la reconquête.
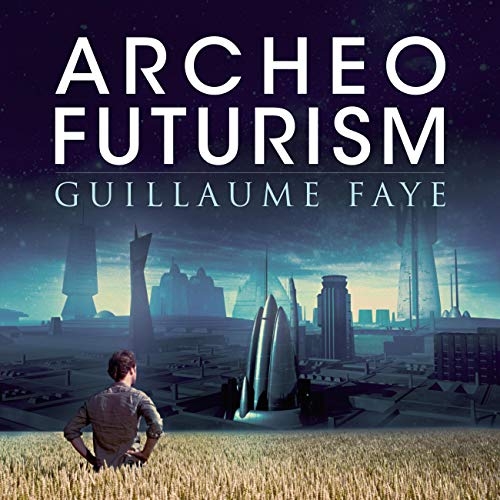
Métapolitique de la fin-de-siècle
Que faire des trompettes de l'apocalypse ? Que faire de Guillaume Faye et de sa "convergence des catastrophes" ?
La "fin du monde" est à la mode. Le catastrophisme climatique et la crise du COVID n'ont fait qu'accélérer cette vague de pessimisme. Avec sa théorie de la convergence des catastrophes, Guillaume Faye anticipe un débat qui, dix ans plus tard, s'installera en France sous le nom de "collapsologie" ou "science des effondrements". L'idée, promue par les chercheurs Pablo Servigne et Raphaël Stevens, est d'agréger toutes les données fiables sur l'évolution des écosystèmes terrestres afin d'anticiper les catastrophes (16). Leur champ de vision est élargi en intégrant la théorie dite de la "complexité", qui étudie les vulnérabilités systémiques résultant de l'interaction de différents facteurs. Cette théorie nous dit que plus une société devient complexe, plus elle devient vulnérable. À cet égard, le passé regorge d'exemples.

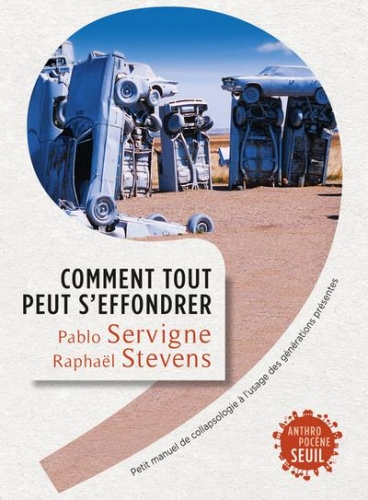
Appliquant la "théorie de la complexité" à l'histoire, l'anthropologue américain Joseph Tainter a étudié - dans un ouvrage désormais classique - l'effondrement de l'Empire romain, de la civilisation maya et de la civilisation Chaco, entre autres (17). Plus récemment, le biologiste évolutionniste Jared Diamond a développé cette analyse dans un livre à succès (18). De son côté, l'historien américain Eric H. Cline souligne qu'à l'âge du bronze tardif, il existait déjà "un système mondialisé avec de multiples civilisations en interaction, partiellement dépendantes les unes des autres (...) Les parallèles - ou comparaisons - entre cette époque et la nôtre peuvent être intrigants". L'effondrement final de cette époque s'est produit vers 1177 avant J.-C. (19). Eric H. Cline écrit qu'en travaillant à la révision de son livre (2020), il a été frappé par un titre du Guardian : "L'humanité est menacée par une tempête de crise parfaite". Selon une enquête menée auprès de 22 scientifiques de 52 pays", écrit la journaliste scientifique Fiona Harvey, "la combinaison d'une série d'urgences (pénurie d'eau, changement climatique, disparition d'espèces, crise de la production alimentaire) pourrait culminer en une "tempête parfaite" qui engloutirait l'ensemble de l'humanité". M. Cline souligne que "la question n'est pas tant de savoir si tout cela peut arriver, mais quand cela arrivera". Quelques mois plus tard, la crise du COVID a éclaté [20].
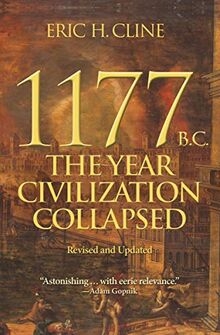 Les estimations de la collapsologie se heurtent à de multiples objections. Par exemple, ceux qui dénoncent les erreurs de calcul dans la corrélation des facteurs. La vulnérabilité - disent ces critiques - coexiste avec la résilience, et les systèmes complexes ont toujours tendance à se rééquilibrer : tout le contraire de ce que disent les collapsologues. Ils sont également accusés de faire un usage sélectif des données, de ne choisir que celles qui soutiennent leur thèse. La pertinence de certaines prévisions est également contestée (par exemple, la controverse sur le changement climatique n'est pas close). Ces objections sont fondées. Mais en tout état de cause, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune civilisation dans l'histoire qui ne se soit effondrée, et il n'y a aucune raison de croire que la nôtre devrait faire exception. La différence aujourd'hui réside dans le fait que la mondialisation enferme tous les peuples du monde dans un système complexe. Le plus grand danger - selon Nassim N. Taleb, auteur de la célèbre théorie du "cygne noir" - survient lorsque la connectivité est trop importante. Tout événement négatif peut créer une réaction aux conséquences fatales [21]. Selon cette idée, nous vivons à l'ère du plus grand danger. Devons-nous en être obsédés ?
Les estimations de la collapsologie se heurtent à de multiples objections. Par exemple, ceux qui dénoncent les erreurs de calcul dans la corrélation des facteurs. La vulnérabilité - disent ces critiques - coexiste avec la résilience, et les systèmes complexes ont toujours tendance à se rééquilibrer : tout le contraire de ce que disent les collapsologues. Ils sont également accusés de faire un usage sélectif des données, de ne choisir que celles qui soutiennent leur thèse. La pertinence de certaines prévisions est également contestée (par exemple, la controverse sur le changement climatique n'est pas close). Ces objections sont fondées. Mais en tout état de cause, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune civilisation dans l'histoire qui ne se soit effondrée, et il n'y a aucune raison de croire que la nôtre devrait faire exception. La différence aujourd'hui réside dans le fait que la mondialisation enferme tous les peuples du monde dans un système complexe. Le plus grand danger - selon Nassim N. Taleb, auteur de la célèbre théorie du "cygne noir" - survient lorsque la connectivité est trop importante. Tout événement négatif peut créer une réaction aux conséquences fatales [21]. Selon cette idée, nous vivons à l'ère du plus grand danger. Devons-nous en être obsédés ?
Le thème de la "fin du monde" est aussi vieux que l'humanité. Ceux qui insistent trop sur ce sujet doivent être suspectés. Le catastrophisme véhicule trop souvent une "rage contre le monde" très caractéristique des perdants de l'histoire: la "catastrophe rédemptrice, purificatrice, refondatrice, présente dans les grands récits religieux" (22). Le problème de cette pensée réside dans son caractère anti-politique: "En pariant trop sur la catastrophe, écrit François Bousquet, on l'érige en un absolu indépassable et on la condamne ainsi à n'avoir aucune application pratique". En d'autres termes, l'obsession de l'effondrement réduit à néant le sens de la politique, qui est l'art du possible appliqué aux situations réelles. Les "préparationnistes" (qui attendent une apocalypse qui ne viendra jamais), les accélérationnistes (qui souhaitent que la catastrophe arrive), les moralistes (qui se réfugient dans des modes de vie utopiques): tous sont des exemples extrêmes d'anti-politique. Mais rien n'est écrit dans l'histoire. Même si les scénarios d'Armaggeddon sont possibles, le rôle de la politique est d'essayer de les éviter [23]. Guillaume Faye les connaissait certainement tous.
Guillaume Faye savait sûrement tout cela. Il savait probablement aussi que notre civilisation technologique est trop résiliente, que les connaissances accumulées sont trop importantes, qu'il est très difficile d'envisager - même en cas de cataclysme majeur - une régression de l'ampleur qu'il envisageait (et qu'il prévoyait pour 2010-2025). Même s'il s'est laissé emporter par son imagination, il est étrange qu'à un moment donné, il n'en ait pas eu conscience. Quelle était alors son intention ?

Apollo reviendra
Grèce, été 1979. Une scène insolite se déroule dans le sanctuaire de Delphes, devant les ruines de la Stoa. Un groupe de jeunes gens, venus de différentes régions d'Europe, prononcent un étrange serment. Le ton est solennel et résolu. "Nous jurons de travailler, de toute notre énergie et de toute notre volonté, à la renaissance de la culture européenne (...). Nous jurons d'être fidèles à la plus longue mémoire pour construire le plus grand avenir (...) par la lyre d'Apollon, dont le chant accompagne nos pas: le Soleil reviendra". La formule n'est pas sans rappeler la dernière prophétie attribuée à la Pythie de Delphes au VIe siècle de notre ère: "Un jour, Apollon reviendra, et ce sera pour toujours". Le jeune Guillaume Faye - l'un des meneurs du groupe - sera marqué par ces mots. La scène - avec sa vague saveur sectaire - illustre une impulsion idéologique qui a pris beaucoup de poids dans la droite radicale de l'époque: le (néo-) paganisme. Le "serment de Delphes", promu par l'association culturelle GRECE (le noyau de la soi-disant "Nouvelle Droite" française), a solennisé l'affiliation culturelle néo-païenne d'une génération de cadres et de militants. C'est le contexte idéologique qui permet d'interpréter la vision post-apocalyptique de Faye, de l'encadrer philosophiquement.
Le "néo-paganisme" de droite a été une grande erreur métapolitique: il n'y a pas de pire "guerre culturelle" que celle qui se réfugie dans des univers parallèles. Dans sa pire version, le néo-paganisme de droite n'était qu'un antichristianisme déguisé, ou un kitsch culturel confinant au folklorisme du plus mauvais goût. Issu d'un milieu très positiviste, Faye s'intéressait à la sociologie, à la philosophie, à l'économie, aux sciences politiques, domaines bien éloignés des aléas ésotériques qu'il méprisait ouvertement. Pourtant, son travail véhicule une attitude clairement païenne. Quel genre de paganisme était-ce ?
Le paganisme de Guillaume Faye est lié à une tradition classique de scepticisme et de réalisme politique. "Aux yeux de Faye", écrit son ami Robert Steuckers, "le seul paganisme viable est celui qui renoue avec l'antiquité grecque et sa philosophie bien structurée: l'ardeur dynamique d'Héraclite, l'élitisme de Platon, la logique et la rigueur affichées dans la Politique d'Aristote" (24). Un paganisme sobre, rationnel, philosophique, très proche de Thucydide, Machiavel et Nietzsche ; une attitude vitale à des années-lumière de l'"Empire du Bien" post-moderne. Face au normativisme moral qui envahit l'espace politique, le paganisme revendique le "bien" comme ce qui renforce l'individu, comme ce qui facilite à la fois sa survie et celle du groupe, surtout dans les temps de fer et de feu. Dans la vision de Faye, un jour viendra où les fétiches idéologiques d'aujourd'hui - l'idéologie de l'émancipation, de la communication illimitée, du métissage sans limite, des identités fluides - disparaîtront du jour au lendemain dans les poubelles de l'histoire. Le progressisme des Lumières se révèlera alors comme ce qu'il a toujours été: un stade éphémère, une illusion, comme l'ont été en leur temps le libéralisme et le marxisme, avec leur prétention à faire de la rationalité économique la source de toute raison. Nous n'aurons pas un monde pacifié par la déesse Raison, mais la "guerre des dieux" annoncée par Max Weber (La politique comme profession, 1919). Nous n'assisterons pas à la "fin de l'histoire" mais au début d'un nouveau cycle. Les lignes de conflit seront ethno-culturelles, religieuses, territoriales. Le "monde d'hier" perdurera sous la forme d'un mythe: celui d'un "âge d'or" qui aurait précédé l'âge des ténèbres.
Évidemment, il y a toute une épopée dans tout cela, une certaine poésie post-apocalyptique. Ce n'est pas un "intellectuel" mais un "inspirateur" qui parle ici. Ce qui intéresse le plus Faye, ce n'est pas que nous croyions ses pronostics, mais que nous générions une certaine attitude mentale: celle d'un ethos païen. À partir de cette attitude, le pessimisme n'est pas une option, pas plus que le désespoir, mais plutôt un optimisme tragique. "La vie - écrit Faye - est un jeu tragique mais nécessaire ; le "salut" dans la fin de l'histoire et dans la paix perpétuelle ne sont que des illusions" [25]. Faye s'adresse à ses compatriotes européens, les appelant à réagir in extremis, comme ils l'ont fait à d'autres moments de leur histoire. En fin de compte : Amor fati, acceptation résolue du destin. C'est le stoïcisme d'un Marc Aurèle. La préparation à l'Ernstfall dont parlait Carl Schmitt : la manifestation de ce qui est vital et catastrophique.
"Le terme de catastrophe - écrit Faye - ne doit pas être perçu en termes d'apocalypse, mais de transformation ou de métamorphose (...) Se préparer à la catastrophe et à la renaissance implique de commencer à se transformer de l'intérieur"(26). Dans un ultime rebondissement spenglérien, Faye rend hommage aux conceptions cycliques de l'histoire, celles qui savaient qu'après la fin de la nuit, le soleil revient toujours: Sol Invictus, comme dans l'Iliade, les dieux jouent indifféremment avec le destin des hommes, mais ne les anéantissent jamais complètement. Après tout, que seraient les dieux sans les hommes ?

Un mythe sorelien
Dans un enregistrement privé qui a circulé il y a des années, Faye a affirmé qu'il n'avait jamais pensé qu'il était possible d'expulser les immigrants d'Europe, que tout cela n'était qu'une blague (un canular) destinée à un public de "mongoliens": des militants d'extrême droite. Implicitement, Faye s'est reconnu comme un producteur de "biens culturels" destinés à un public spécifique. Faye était-il lui-même victime d'un canard radio ? Il a ensuite affirmé qu'il avait simplement joué le jeu de ses interlocuteurs, sachant que l'interview était un piège. Une explication confuse. Avec Faye, on ne sait jamais. Mais franchement, il est difficile de voir ce qu'il recherchait en produisant tous ces "biens culturels" qui ne lui ont apporté aucun gain matériel, et pas mal de désagréments. Que voulait-il vraiment ? Croyait-il à tout ce qu'il disait ?
Guillaume Faye se déclare admirateur de l'antiquité classique et des catégories de la pensée aristotélicienne: modération, expérience et bon sens. C'est pourquoi il est surprenant qu'il ait insisté avec autant de force sur quelque chose d'aussi anti-politique - aussi éloigné de toute modération - que la "convergence des catastrophes". Que faire de ses visions apocalyptiques ?
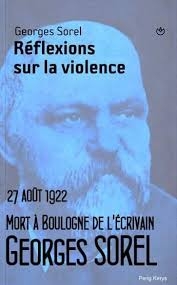 On peut penser que la "convergence des catastrophes" est, avant tout, une provocation. Que ce qu'il visait était de forger un "mythe" mobilisateur, au sens, par exemple, du mythe de la "grève générale révolutionnaire" dans l'œuvre de Georges Sorel. Ce n'est pas pour rien que Sorel lui-même a écrit sur l'importance du mythe apocalyptique pour les premiers chrétiens, un mythe qui les a aidés à supporter la persécution et le martyre. Les mythes politiques mesurent leur importance non pas à leur fausseté ou à leur certitude, mais aux images qu'ils génèrent et inspirent aux gens. En plaçant les Européens face à une épreuve existentielle suprême, Faye les incite à mettre les pieds au mur, à corriger - ici et maintenant - une série de tendances qui laissent présager le pire des avenirs.
On peut penser que la "convergence des catastrophes" est, avant tout, une provocation. Que ce qu'il visait était de forger un "mythe" mobilisateur, au sens, par exemple, du mythe de la "grève générale révolutionnaire" dans l'œuvre de Georges Sorel. Ce n'est pas pour rien que Sorel lui-même a écrit sur l'importance du mythe apocalyptique pour les premiers chrétiens, un mythe qui les a aidés à supporter la persécution et le martyre. Les mythes politiques mesurent leur importance non pas à leur fausseté ou à leur certitude, mais aux images qu'ils génèrent et inspirent aux gens. En plaçant les Européens face à une épreuve existentielle suprême, Faye les incite à mettre les pieds au mur, à corriger - ici et maintenant - une série de tendances qui laissent présager le pire des avenirs.
Les livres récents de Faye sont décousus. Son langage est clair et parfois ampoulé, plus pour être entendu que pour être lu. Les idées coulent avec éloquence, à la hâte et en rafales. Ce sont les œuvres d'une personne dénuée de vanité. Sans doute aurait-il été capable de produire des textes soignés, de beaux essais. S'il avait adopté une approche académique pour ses premiers textes, il aurait pu s'imposer comme un intellectuel prestigieux. Mais cela n'en valait pas la peine pour lui. Faye n'était pas un penseur du "système" - le genre qui passe sa vie à gloser sur la "doctrine" ou à commenter le "maître". Il était un partisan, un partisan des pistes, pas des dogmes. Il ne voulait pas imposer ses thèses, mais provoquer un débat. Il était un forgeur de concepts, d'idées-force, de provocations. Il procédait par intuition, par approches indirectes, par éclairs. Son objectif : briser la "pensée faible" post-moderne et se concentrer sur les questions essentielles.
Son intuition la plus retentissante - le mythe qu'il a cherché à forger - est l'archéofuturisme. Son contenu - écrivait-il - "peut sembler idéologiquement criminel aux yeux de l'idéologie hégémonique et au cœur pseudo-virginal des bienpensants. Ils le sont".
Notes de la première partie:
[1] "Le passé est un pays étranger, on y fait les choses différemment". Début du roman de L. P. Hartley, The Go-Between (1953).
[2] Aaron Bastani, Fully Automated Luxury Communism : A Manifesto. Verso Books 2020. James Bridle, New Dark Age : technology and the End of the Future. Verso Book 2019. Peter Frase, Four Futures : Life after Capitalism. 2016 Verso Book. Murray Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, AK Press 2004.
[3] Romain D'Aspremont, "Archéofuturisme ou droite prométhéenne ?", https://rage-culture.com/archeofuturisme-ou-droite-prometheenne-partie-1/.
[4) Dans l'un de ses canulars les plus célèbres, Faye se rend avec deux amis dans une prestigieuse galerie d'art contemporain, se faisant passer pour un artiste-performeur lituanien, ami du président de cette République. Faye et ses acolytes - inspirés par l'alcool - ont peint vingt tableaux de pénis en érection en une seule journée, qui ont été exposés et vendus à des prix élevés les jours suivants. Un scandale retentissant qui a mis une fois de plus en évidence l'imposture de l'art contemporain.
[5] Pierre-Émile Blairon, "Guillaume Faye, un éveilleur du XXIe siècle", in Guillaume Faye, vérités et hommages. Arktos 2020, p. 123-124.
[6] "Nous tournons en rond dans la nuit et brûlons dans le feu".
[7] Nous utilisons ici l'édition anglaise : Guillaume Faye, Convergence of Catastrophes. Arktos Media 2012.
[8] Walter Laqueur, Les derniers jours de l'Europe. Epitaph for an old continent, St Martin Press 2007. Christopher Caldwell : Reflections on the Revolution in Europe : Immigration, Islam and the West- Allen Lane 2009. Douglas Murray, The Strange Death of Europe : Immigration, Identity, Islam, Bloomsbury Continuum 2017. Guillaume Faye, La colonisation de l'Europe. Discours vrai sur l'immigration et l'Islam. L'Aencre 2000. Avant-Guerre. Chronique d'un cataclysme annoncé. L'Aencre 2002.
[9] Jean Rolin, Les Événements(Folio-Gallimard 2016) ; Laurent Obertone, Guerilla, Le Jour où tout s'embrasa(La mécanique générale 2018) ; Franck Poupart, Demain les Barbares. Chroniques du grand effondrement (Amazon 2021). Yvan Riouffol, La guerre civile qui vient (Pierre-Guillaume de Roux 2016).
[10] Bernard Wicht, Europe Mad Max demain ? Retour à la défense citoyenne, Favre 2013.
[11] Hans Magnus Enzensberger, La grande migration. Vues sur la guerre civile, Gallimard 1995.
[12] Eric Werner, L'avant-guerre civile. Le chaos sauvera-t-il le système ? Xenia 2015 (deuxième édition).
[13] Bernard Wicht et Alain Baeriswyl, Citoyen-soldat 2.0. Astrée 94.
[14] "Enquête sur le tabou de l'immigration. Laurent Obertone enterre le "vivre ensemble". In Éléments por la civilisation européenne n° 174, octobre-novembre 2018, p. 6-9.
[15] Álvaro Delgado-Gal, "Occidente Ignaro". ABC 10/7/2005.
[16] Alexandre Lacroix, "La fin du monde, vous la voulez comment ?" In Philosophie Magazine n° 136, février 2020.
[17] Joseph A. Tainter, The Collapse of Complex Societies. Cambridge University Press 1990.
[18] Jared Diamond, Colapso, Por qué algunos sociedades perduran y otras desaparecen. Debolsillo 2007
[19) Eric H. Cline retient la date symbolique de 1177 avant J.-C. comme date de l'invasion des "peuples de la mer" sur le royaume d'Égypte, qui a marqué le début d'un enchaînement de circonstances qui ont provoqué l'effondrement dramatique de la civilisation de l'époque.
[20] Eric H. Cline, 1177 B.C., L'année où la civilisation s'est effondrée. Edition révisée et mise à jour 2020. Pp.xv-xvii (introduction).
[21] Conversation entre N.N. Taleb et B. Avishai. Avishai : "La pandémie n'est pas un cygne noir mais le présage d'un système mondial plus fragile". New Yorker, avril 2021
[22] François Bousquet, "Impolitique de la catastophe. La fin du monde, une histoire sans fin". In Éléments pour la civilisation européenne n° 175, décembre-janvier 2019, p. 69-72.
[23) Si une apocalypse devait se produire - comme le souligne Romain D'Aspremont - elle pourrait plutôt correspondre au sens grec du terme ("Révélation"), comme une révolution scientifique qui nous ouvrirait à de nouvelles perceptions de la nature de notre réalité (l'espace-temps comme illusion, par exemple).
[24] Robert Steuckers, "Adieu, Guillaume Faye, après quarante-quatre ans de lutte commune", in Guillaume Faye, vérités et hommages. Arktos 2020, p.50.
[25] Guillaume Faye, Avant-Guerre. Chronique d'un cataclysme annoncé. Éditions de L'Aencre 2002, p. 303.
[26] Guillaume Faye, Convergence des Catastrophes. Arktos Media 2012, p. 216.
Guillaume Faye et la vision de l'archéofuturisme (II)
Adriano Erriguel
"Dans le monde que je vois, tu traqueras l'élan dans les bois humides du canyon autour des ruines du Rockefeller Center. Tu porteras des vêtements en cuir qui dureront toute ta vie. Vous escaladerez les vignes de kudzu de l'épaisseur d'une poupée qui s'enroulent autour de la Sears Tower. Et quand vous regarderez en bas, vous verrez de minuscules silhouettes écrasant du maïs, des bandes de cerfs suspendues dans la voie vide d'une super-autoroute abandonnée".
 Ces lignes tirées du film Fight Club - adapté d'un roman de Chuck Palahniuk - expriment un Zeitgeist apocalyptique très actuel. Ils sont une image de l'année zéro, du big bang vers un monde nouveau. Le monde de l'archéofuturisme.
Ces lignes tirées du film Fight Club - adapté d'un roman de Chuck Palahniuk - expriment un Zeitgeist apocalyptique très actuel. Ils sont une image de l'année zéro, du big bang vers un monde nouveau. Le monde de l'archéofuturisme.
Paradigme ou mythe ?
L'idée de l'"archéofuturisme" peut sembler grotesque au premier abord. Comme dans toute coïncidence des contraires (coincidentia oppositorum), cette idée nécessite une perspective radicale, une perspective de rupture avec l'idéologie hégémonique. La pensée radicale n'est pas nécessairement une pensée "extrémiste" - d'idées fixes et de tranchées doctrinales - mais une remise en question des piliers de l'ordre existant. Une pensée radicale aspire à créer son propre langage, car elle est consciente que les mots - comme l'a souligné Foucault - "sont le fondement des concepts qui sont, en eux-mêmes, l'impulsion sémantique des idées, et ceux-ci forment le moteur des actions. Nommer et décrire, c'est déjà construire" [1]. L'archéofuturisme aspire non seulement à interpréter la réalité, mais aussi à la construire, et a les contours d'un mythe.
La science politique officielle tourne normalement le dos au mythe. Il sait que les mythes sont au-delà de la démonstration logique, qu'ils sont au-delà du vrai et du faux. C'est pourquoi, plutôt que de prouver leur fausseté, ils tentent de les dépouiller de leur aura. Ils essaient de les déconstruire. Mais les mythes ont une vie difficile. Ils peuvent disparaître pendant un certain temps, mais seulement pour réapparaître sous de nouvelles formes. "Les mythes éclatent généralement à des moments critiques de la vie sociale de l'homme, lorsque les forces rationnelles qui résistent à la résurgence des anciennes conceptions mythiques perdent confiance en elles-mêmes. A ces moments-là, l'occasion du mythe se présente à nouveau" [2]. C'est le moment archéofuturiste.
Tous les grands mythes reposent sur un couple antithétique : le déclin et le progrès, le civilisateur et le bon sauvage, l'élu et le réprouvé, l'espace et le temps, le vrai et le faux. Le mythe archéofuturiste unit l'archaïque et le futur. Il nous dit que les valeurs "archaïques" - celles que la modernité avait tenté d'éradiquer - reviennent toujours en force. Et il exprime - comme tous les mythes - ce que beaucoup de gens ressentent et désirent sous une forme vague, inconcrète et diffuse. L'archéofuturisme fournit une clé d'interprétation - un paradigme - de l'époque dans laquelle nous vivons.
Archéofuturisme : signes précurseurs
Pour aborder l'archéofuturisme, il est nécessaire de commencer par une précision sémantique. Le mot "archaïque" vient du grec Arché, qui ne désigne pas quelque chose d'ancien, de vieux ou de périclité, mais signifie à la fois "fondement" et "commencement"; en d'autres termes, "élan fondateur". L'archaïque renvoie à des constantes anthropologiques qui assurent la continuité des communautés humaines, au moins depuis que l'homme a cessé d'être un chasseur-cueilleur. L'archéofuturisme n'est donc pas la formulation d'une nostalgie, d'une idéologie ultra-conservatrice ou d'une pulsion réactionnaire. Est-ce une forme de traditionalisme? Seulement dans la mesure où elle favorise la transmission de valeurs "fondamentales", mais elle considère aussi qu'il y a des traditions qu'il vaut mieux jeter par-dessus bord. L'archéofuturisme n'est pas synonyme de tradition mais de vitalité. Elle ne fait pas appel à un retour du passé, mais à l'émergence de configurations "archaïques" dans un nouveau contexte. "L'archéofuturisme - écrit Faye - est une vision métamorphique du monde. Projetées dans le futur, les valeurs de l'arché sont réactualisées et transfigurées. L'archéofuturisme est aussi une pensée de l'ordre (...) mais selon la vision platonicienne exprimée dans La République : l'ordre n'est pas l'injustice, toute pensée de l'ordre est révolutionnaire, et toute révolution est un retour à la justice de l'ordre" [3].
Des signes précurseurs de l'archéofuturisme ? La révolution iranienne de 1979 a marqué le début d'un nouveau cycle : celui du retour intempestif des valeurs archaïques. L'idole du progrès - l'idée que les valeurs séculaires des Lumières allaient se répandre dans le reste du monde - a été brisée. Un fossé qui n'a fait que se creuser. L'Islam est aujourd'hui un bélier d'archaïsme à l'échelle mondiale ; une religion théocratique, prosélyte et communautaire, contrairement au harakiri théologique de l'Eglise catholique. Ce phénomène est également palpable dans la racialisation des discours culturels, qui prend aujourd'hui la forme postmoderne du wokisme. Le communautarisme ethnique - écrit Faye - injecte une logique archaïque dans le monde postmoderne : "séparation des rôles sexuels, transmission des traditions ethniques et populaires, spiritualité et organisation sacerdotales, hiérarchies sociales visibles et vertébrales, culte des ancêtres, rites de passage et épreuves initiatiques, désindividualisation du mariage - comme affaire de la communauté et des époux - et fin de la confusion entre mariage et érotisme". Spontanément, "les Maghrébins et les Noirs légalement français qui raisonnent en termes d'ethnicité (et non de nationalité) sont des archaïsants sans le savoir" [4]. Ce n'est pas pour rien que le sociologue français Michel Maffesoli a défini la post-modernité comme "la synergie de l'archaïsme et du développement économique". Pour le dire très simplement, la synergie, c'est la multiplication des effets entre l'archaïque (la tribu) et l'Internet" [5].
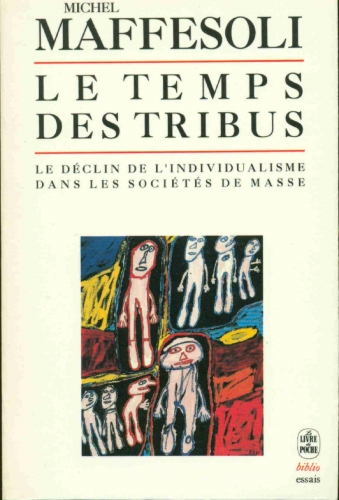
D'autres exemples ? Nous assistons à une réémergence du prestige des castes guerrières, bien que sous une forme chaotique et antisociale. A l'heure où l'Etat n'est plus qu'un distributeur d'aides et de subventions - explique le politologue suisse Bernard Wicht - "le capital guerrier des jeunes n'est plus investi dans les institutions étatiques (principalement l'armée) mais tend à migrer vers des activités et des groupes marginaux, où ils trouvent un code de valeurs, une forte discipline, la loyauté envers un leader et d'autres éléments de socialisation similaires" (6). L'aura sociale de certaines organisations criminelles, des djihadistes et des groupes extrémistes de toutes sortes sont des exemples de cette pulsion tribale de violence qui ne trouve aujourd'hui d'autre forme d'expansion que le recours à la marginalité. Mais c'est dans le domaine de la géopolitique que l'on assiste à un retour des pulsions archaïques par la grande porte.
Règles de survie
Lorsque Huntington a proposé le paradigme du "choc des civilisations" (en 1993), il décrivait déjà, sans le nommer, le monde archéofuturiste. Après le mirage de la "fin de l'histoire", les tensions idéologiques de la guerre froide ont été remplacées par la rivalité séculaire entre blocs ethnoculturels, par une course aux territoires et aux ressources. En effet, l'essence de l'histoire n'est pas une lutte d'idéologies ou une lutte des classes - comme on l'a cru au XXe siècle - mais "la lutte multiforme des peuples - contestataires ou non - sous les angles superposés de l'ethnicité, de la religion, de la territorialité et de l'économie" (7). Le défi religieux de l'Islam ; les batailles pour les ressources agricoles, pétrolières, minérales et halieutiques ; le conflit Nord-Sud ; la ruée migratoire vers l'hémisphère nord ; la rivalité géostratégique dans l'Arctique ; la pollution de la planète ; le choc entre les désirs de l'idéologie du développement et les réalités physiques : autant de questions immémoriales qui laissent les débats quasi théologiques des 19e et 20e siècles insignifiants. La prolifération de leaderships forts - Russie, Chine, Turquie, Inde, Amérique (Trump), pays de Visegrad - témoigne de cette nécessité de penser en termes stratégiques et à long terme, au-delà du court-termisme des politiciens libéraux.

L'archaïsme n'est pas d'hier mais de toujours, et il a plus d'avenir que l'idéologie progressiste. Le philosophe français Raymond Ruyer (photo, ci-dessus) expliquait dans les années 1970 que les peuples "religieux" l'emporteront sur les peuples "émancipés", et les empires "vénérateurs" sur les démocraties libérales. Sans surprise, les acteurs et les institutions des premiers sont orientés vers la durée dans le temps, tandis que les seconds sont orientés vers l'utilité quotidienne et immédiate. Mais la vie complexe des êtres vivants - rappelle Ruyer - est au service de la reproduction, et ce qui est vrai pour une plante ou un animal l'est aussi pour les sociétés humaines. Un peuple obsédé par son confort et sa préservation plutôt que par sa reproduction "n'est rien d'autre qu'une multitude ("population") sur le chemin de la destruction ; un peuple assassiné ou suicidaire". Assurer la reproduction est la première règle de survie, une règle qui se moque des idéologies, des morales et des "anti-morales" contemporaines. Les valeurs archaïques découlent de cet impératif de sélection naturelle qui sera toujours plus fort que les sélections - ou anti-sélections - artificielles ; en d'autres termes, les questions soulevées par Darwin et Malthus l'emporteront sur toutes les autres idéologies qui finissent en "ismes" [8].
Guillaume Faye écrit : "la parenthèse des 19e et 20e siècles se referme, et après les hallucinations de l'égalitarisme - qui ont plongé le monde dans la catastrophe - l'humanité revient à des valeurs archaïques, c'est-à-dire biologiques et humaines au sens anthropologique. Les valeurs archaïques "sont justes - au sens des Grecs anciens - parce qu'elles prennent l'homme pour ce qu'il est : un zoon politikon ("animal social intégré dans une cité communautaire") et non pour ce qu'il n'est pas : un atome asexué et isolé doté de pseudo-droits universels et imprescriptibles. Les valeurs anti-individualistes permettent l'épanouissement personnel, la solidarité active et la paix sociale, là où l'individualisme pseudo-émancipateur des doctrines égalitaristes ne mène qu'à la loi de la jungle" [9]. Pas étonnant que, expulsé par la porte, l'archaïsme rentre par la fenêtre.
Archaofuturisme et Islam
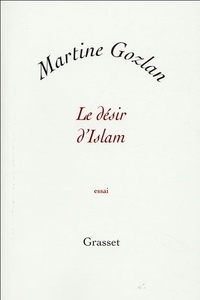 Dans un brillant essai publié en 2005, l'islamologue française Martine Gozlan s'interrogeait sur le "désir d'islam" qui semble triompher chez tant d'individus éduqués et tant de jeunes occidentaux en crise d'identité [10]. Un exemple anecdotique: il est curieux que le port du voile prenne une patine libératrice dans le discours de certaines féministes. Ils semblent désireux de disculper l'Islam de toute charge patriarcale, au nom de la lutte contre le "mâle blanc colonial et raciste". L'idéologie décoloniale, avec sa mascarade académico-foucaldienne, se consolide comme un alibi (plus ou moins conscient) à ce "désir d'islam" qui se niche dans le cœur de tant de progressistes, et qui semble véhiculer un désir de soumission non avoué [11]. Un phénomène qui se prête à une analyse quelque part entre le freudisme et l'archéofuturisme. Martine Gozlan note que le "désir d'islam" répond au "sentiment d'immersion" qu'il procure, à ce "désir d'appartenance" que nos sociétés désenchantées et nihilistes ne parviennent pas à satisfaire. Une réponse, en somme, au déficit d'archaïsme dans les sociétés post-modernes.
Dans un brillant essai publié en 2005, l'islamologue française Martine Gozlan s'interrogeait sur le "désir d'islam" qui semble triompher chez tant d'individus éduqués et tant de jeunes occidentaux en crise d'identité [10]. Un exemple anecdotique: il est curieux que le port du voile prenne une patine libératrice dans le discours de certaines féministes. Ils semblent désireux de disculper l'Islam de toute charge patriarcale, au nom de la lutte contre le "mâle blanc colonial et raciste". L'idéologie décoloniale, avec sa mascarade académico-foucaldienne, se consolide comme un alibi (plus ou moins conscient) à ce "désir d'islam" qui se niche dans le cœur de tant de progressistes, et qui semble véhiculer un désir de soumission non avoué [11]. Un phénomène qui se prête à une analyse quelque part entre le freudisme et l'archéofuturisme. Martine Gozlan note que le "désir d'islam" répond au "sentiment d'immersion" qu'il procure, à ce "désir d'appartenance" que nos sociétés désenchantées et nihilistes ne parviennent pas à satisfaire. Une réponse, en somme, au déficit d'archaïsme dans les sociétés post-modernes.
L'Islam est une force archéofuturiste, dit Guillaume Faye. "Comprendre l'islam", écrit-il, "c'est admettre son pouvoir historique, fondé sur des siècles d'intimidation et de conquête" [12]. Contrairement à ceux qui le méprisent en le qualifiant d'"archaïque" et de "rétrograde", Faye affirme qu'il n'y a rien de méprisable dans l'islam, mais beaucoup de choses dangereuses. Ce qui pour certains sont des défauts sont pour Faye les qualités qui la rendent forte, du moins pour le moment. L'Islam se radicalise, et cette radicalisation n'est pas un extrémisme mais un retour aux sources. Il existe certes des musulmans "modérés", mais ils donnent l'impression de prôner une religion réformée, interprétative, européanisée, en rupture philosophique avec la majorité de l'umma. Nous devons leur souhaiter bonne chance, mais l'Islam dans son ensemble est autre chose. Contrairement aux illusions des progressistes occidentaux, "l'islam s'est engagé dans un vaste mouvement de désoccidentalisation des esprits et des modes de vie. C'est l'inverse du mouvement qui a eu lieu tout au long du 20ème siècle". Mais les élites occidentales entretiennent un esprit d'apaisement, qui rappelle celui des démocraties face au nazisme dans les années 1930.
Comme dans une loi pendulaire du développement historique, les valeurs archaïques sont de retour. L'alternative - pour Faye - est la suivante : soit laisser l'Islam les imposer à l'Europe (ce qui se produit déjà subrepticement), soit laisser les Européens se les imposer à eux-mêmes, en s'appuyant sur leur propre bagage culturel. Une partie décisive est sur le point de se jouer et les Européens ne sont pas au mieux de leur forme. Le déclin démographique mis à part, leur principale faiblesse réside dans un état avancé de ramollissement et de crétinisation de l'esprit. Le diagnostic de Faye ne pardonne pas. L'archéofuturisme est sa thérapie de choc [14].

Dé-virilisation
Nous vivons sous la dictature du superflu. Le charabia idéologique masque les vrais problèmes. Le système promeut une panoplie de mesures symboliques qui touchent de très petites couches de la population, mais qui captent le bruit des médias et l'attention du public. C'est le dernier recours d'un système privé d'idées, épuisé de propositions, qui ne peut compter que sur la sidération collective pour masquer sa vacuité. Quelle meilleure forme de sidération que de placer les questions de l'ombre au centre du débat public ? Les "guerres culturelles" de la gauche postmoderne ont une fonction : imprégner les imbéciles d'un sens de la mission, leur donner l'impression d'être de dangereux subversifs, les aider à monopoliser le centre du débat. Mais les pseudo-réformes progressistes et le charabia culturel des universités anglo-saxonnes disparaîtront dans les égouts, lorsque les vraies questions déborderont. Viendra alors ce que les polémologues appellent "le point de rupture", le moment où tout se rejoint à un moment critique. L'avenir appartiendra alors à ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, à ceux qui soulèvent les vraies questions.
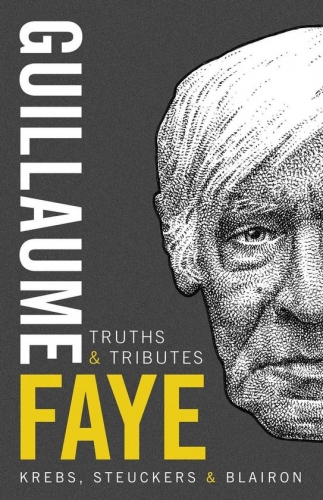
Quels sont les "vrais problèmes" ? Parmi les "lignes de catastrophe" identifiées par Faye, il y a tout d'abord ce qu'il appelle "la cancérisation du tissu social européen". Il s'agit de facteurs tels que l'échec de la société multiraciale, la métamorphose ethno-anthropologique de l'Europe (en raison des politiques migratoires), le retour de la pauvreté, l'augmentation de la criminalité et de la consommation de drogues, la dissolution des structures familiales, le déclin de l'éducation et de la qualité des programmes scolaires, la disparition de la culture populaire, l'imbroglio audiovisuel, le manque de transmission des disciplines sociales et la corruption politique endémique.
Tout cela dans le cadre d'un modèle fiscal extractif et d'un système de surveillance généralisée qui - comme le souligne l'essayiste français Guillaume Travers - n'est rien d'autre que le stade ultime du libéralisme (15). Petit à petit, une société de plus en plus égoïste et sauvage se dessine, de plus en plus infantile et primitive, droguée par le sirop de la morale empathique, angélique et pseudo-humaniste. Il s'agit, en somme, d'un processus de décivilisation (Renaud Camus) qui continuera - s'il n'y a pas de changements majeurs - à atteindre un point de rupture.
Un aspect non négligeable de "l'adoucissement de l'esprit" évoqué plus haut est ce que Guillaume Faye appelle "la féminisation et la dévirilisation de la société". Ce phénomène a déjà été dépeint par une série de penseurs tous plus maudits et sulfureux les uns que les autres (Philippe Muray, Alain Soral, Eric Zemmour). Pour le philosophe Peter Sloterdijk, la féminisation de la société "va de pair avec l'évolution du système politique vers la primauté des fonctions thérapeutiques" [16]. C'est parfaitement logique : dans une société de plus en plus infantilisée et violente, il est normal que le pouvoir prenne la forme soit d'une nourrice maternelle et empathique, soit d'un souverain strict et castrateur.
Il faut préciser que la féminisation de la société n'est pas le résultat de l'accès des femmes aux postes de pouvoir, ni des progrès de l'homosexualité, mais de la dévirilisation des hommes. Cette féminisation est en réalité une caricature des valeurs féminines, et consiste en la promotion hypocrite des valeurs de fragilité, de tolérance, d'émotivité et d'empathie, avec le culte de la "victime" comme couronnement de l'idéologie post-moderniste. Les ateliers sur les "nouvelles masculinités" et la lutte contre la "masculinité toxique" témoignent du fait que la dévirilisation devient une véritable politique d'État. La féminisation est une domestication idéologique qui promeut une pensée "intuitive", empathique et psychologisante, basée sur les sentiments individuels, dépourvue de vision collective, visant à nourrir la confiance dans les vertus balsamiques du système. Curieusement - et c'est là le poison caché de l'archaïsme - tout cela s'accompagne d'une résignation (voire d'une fascination non avouée) face aux attitudes machistes et testostéroniques de nombreux migrants extra-européens, souvent pratiquants d'une religion virile s'il en est. Il est compréhensible qu'ils ne veuillent pas s'intégrer dans un système où les hommes deviennent fluides et les femmes plus masculines que les hommes. Dé-virilisation, ethno-masochisme et xénophilie : les trois grumeaux mentaux qui annoncent la mort de l'Europe.
Guillaume Faye écrit: "Les Européens n'ont jamais été aussi peu préparés à l'approche des tempêtes: envahis, dévirilisés, physiquement et moralement désarmés, prisonniers d'une culture de l'insignifiance et de la culpabilité masochiste. Les Européens n'ont jamais été aussi faibles qu'en ce moment, alors que la grande menace se profile à l'horizon".

Un monde hyper-technologique et inégalitaire
Nous avons souligné plus haut que l'archéofuturisme n'est pas une perspective rétrograde. Une caractéristique constante de la mentalité européenne - écrit Faye - est son rejet de tout ce qui est immobilisant. L'Europe est "faustienne" (Spengler), c'est une création et une invention incessantes, c'est un élan inépuisable vers de nouvelles formes de civilisation. Le fond culturel européen est aventureux, volontariste, transformateur, une mentalité de projets et de représentations anticipatrices du futur. "Quelle est l'essence du futurisme ? Celle de tracer l'architecture du futur, pas celle de faire table rase du passé. Le futurisme, c'est penser la civilisation comme une œuvre en mouvement" [17]. Mais le futurisme comporte un danger : celui de donner lieu à des dérives utopiques. C'est l'idée progressiste du "changement pour le changement", c'est l'hybris de l'absence de limites, qui s'avère finalement suicidaire. "Le futurisme", conclut Faye, "doit donc être modéré par l'archaïsme ; en d'autres termes, l'archaïsme doit purifier le futurisme" [18]. On peut aussi penser à l'inverse : le futurisme doit purifier l'archaïsme. Il ne peut y avoir de place en Europe pour les normes archaïques qui sapent l'égalité juridique (comme celles qui subordonnent les femmes aux hommes), ni pour celles qui suppriment les libertés fondamentales de l'individu. L'égalité devant la loi et les libertés individuelles sont aussi des règles de survie de la communauté, clés des sociétés créatives et compétitives de l'Occident. L'archéofuturisme européen exige une voie qui lui est propre.

L'archéofuturisme est une pensée du concret. Dans ses livres, Guillaume Faye déballe une batterie de propositions pour donner chair à l'idée, pour l'appliquer aux défis de la civilisation européenne. Il y a un peu de tout dans ce brainstorming : des intuitions suggestives et des spéculations risquées, des approches raisonnables et des divagations chimériques. Dans sa vision de la "convergence des catastrophes", Faye tombe dans une sorte de déterminisme. Il ne tient pas compte du fait que, si une crise économique majeure est hautement probable, le capitalisme est après tout construit sur des cycles de croissance, de crise et de dépression (les cycles de Kondratiev et la "destruction créatrice" de Schumpeter). Elle déprécie également la capacité des avancées technologiques à contrer les limites physiques de la croissance. En cela, il est incohérent, étant donné son exaltation enthousiaste de la techno-science. Faye s'insurge contre la "technophobie" qui affecte historiquement la pensée de droite. Dans ce domaine, il avait des idées brillantes.
L'expansion des hypertechnologies - selon Faye - ne nous conduit pas vers un monde plus égalitaire, mais vers des modèles sociaux plus archaïques et hiérarchiques. Il écrivait cela en 1998, à l'apogée de l'ère optimiste des idéologues de l'internet. Aujourd'hui, nous pouvons déjà constater que les technologies conduisent non seulement à une "démocratisation de la connaissance", mais aussi à des formes spécifiques d'aliénation, voire à une brutalisation généralisée. En revanche, une véritable éducation de qualité est de plus en plus inaccessible pour les gens ordinaires. Dans le monde hyper-technologique, les personnes ayant les "blocs d'élite" les plus forts et les mieux sélectionnés et les masses les plus organiquement intégrées gagneront. La concurrence technologique et la guerre pour les ressources rares favoriseront les sociétés les plus traditionnelles et holistiques, celles capables de produire en masse des produits de haute technologie comme tremplin vers l'innovation. N'est-ce pas déjà le cas en Chine ? Dans tous les cas, il faudra se libérer de l'orgueil de la modernité : de cette illusion égalitaire qui distribue titres et diplômes et fait croire à chacun qu'il peut s'élever au sommet. Cependant, les jours de cette illusion sont comptés. La nouvelle ère numérique va accélérer le processus. A ce stade, nous entrons pleinement dans "l'utopie d'extrême-droite" de Guillaume Faye.

"Le monde que voit Faye est un monde de grands États, d'empires qui englobent les grandes régions de la civilisation. Après la catastrophe, la science et la technologie n'auront d'autre choix que d'être confinées à certaines zones géographiques, abandonnant le rêve égalitaire d'une civilisation universelle. Les élites de ces empires "bénéficieraient de toutes les technologies hypermodernes et les utiliseraient comme instruments pour établir une puissance planétaire indestructible. Le reste de la population renouera avec la terre, aura un mode de vie agraire et développera une culture populaire, stable et éternelle. L'archéofuturisme est donc archaïque, agraire et écologique pour la grande masse des gens, et hyper-technique et futuriste pour les élites" (Robert Steuckers) [19]. Une vision brutale d'une humanité à deux vitesses, qui contraste avec la vision alternative - également inquiétante - d'une société de consommation illimitée pour 10 milliards de personnes dans le monde.
Rêves pour certains, cauchemars pour d'autres.
Du côté des Titans
Guillaume Faye ouvre une porte qui passe rarement par la pensée "de droite", et le fait avec un coup de pied. La droite doit penser techno-science: cette "alliance infernale" entre informatique et biologie, biotechnologie et biogénétique. Un monde qui est à notre porte et qui entraînera une impuissance éthique sans précédent, aux effets dévastateurs. C'est cette réalité qui mettra fin à la modernité (et non le post-modernisme bon marché des universités anglo-saxonnes). La communauté scientifique est désormais prise dans un dilemme : aller jusqu'au bout ou céder au "terrorisme intellectuel de l'égalitarisme", qui cherche à maintenir "les mythes canoniques de la religion des droits de l'homme, comme celui de l'égalité génétique des groupes humains". La cartographie complète du génome humain a annoncé la démolition de ces mythes il y a plusieurs décennies. Pour résister au choc global de la génétique du futur, écrit Faye, "il faudra une mentalité archaïque" [20]. La science et la technologie sont pour lui les alliées de l'archaïsme.
La méditation sur la technologie est le cœur même de la conception archéofuturiste. Dans une étude éblouissante sur Heidegger - publiée en 1982 - Faye a offert une réinterprétation originale du maître de la Forêt-Noire, généralement considéré comme un penseur peu enclin à la technique. Il y a écrit :
"C'est par un projet fier et assumé d'un monde hyper-technifié - et non par une régression vers une civilisation non-technique - que l'Europe, pour Heidegger, redonnera un sens à son existence historique. Une spiritualité immanente prendra alors le relais d'une spiritualité transcendante, devenue impossible dans la mesure où elle est épuisée". Faye croit avoir décelé un moyen de réintroduire la technique - de manière positive - dans le système de Heidegger [21]: "la science au service de la technique : cette dernière constitue un destin historique dont l'objet n'est pas la connaissance, mais l'action". L'essence de la technologie révèle une caractéristique historique de la civilisation européenne: la maîtrise est plus importante que la connaissance". Selon cette interprétation, la technologie entraînerait un réenchantement du monde et un dépassement du nihilisme: "au monde désespérant de l'humanisme rationnel, Heidegger oppose l'avènement, au cœur de la science moderne, du sacré (das Heilige)". Comme le soulignait Hölderlin: "là où il y a du danger (dans la technique), il y a aussi ce qui sauve" [22]. Une interprétation de Heidegger qui n'est peut-être pas philologiquement correcte, mais qui est pleinement cohérente, et qui contient potentiellement toute la conception de l'archéofuturisme.
Guillaume Faye a franchi un seuil que d'autres, de "droite", ont depuis suivi. Évidemment, ce seuil mène à un abîme. Pour la première fois de son histoire, l'humanité a accès aux moyens de se transformer en tant qu'espèce. Les risques sont immenses. Celles de la réification des personnes - à travers, par exemple, la création de brevets sur les êtres humains - en font partie, surtout dans un système qui n'est mû que par la logique de l'argent. C'est un débat difficile et immense, surtout pour les familles de pensée fondées sur une tradition religieuse. Mais qu'on le veuille ou non, la question "biopolitique" est déjà au cœur du débat idéologique. Il serait souhaitable de l'aborder au-delà des jugements sommaires et des admonestations sentencieuses. L'essayiste Romain d'Aspremont - également très critique à l'égard de Faye - prône un "droit prométhéen" résolument engagé dans le génie génétique. Le transhumanisme ne peut être arrêté", écrit-il, "et ce seront les pays les plus audacieux qui en prendront le contrôle, laissant derrière eux les plus timorés et les plus conservateurs" (23).
Un autre intellectuel de droite, Julien Rochedy, affirme que " la clé du transhumanisme réside avant tout dans le sens dans lequel l'humanité doit l'utiliser, plutôt que dans la question de savoir s'il faut l'interdire ou non (...) Si la pensée traditionaliste ne lui donne pas ce sens, si elle échappe au débat et ferme les yeux, ce seront des individus aux instincts médiocres qui se le procureront, des apprentis sorciers aux instincts médiocres" (24). Le débat est lancé sur un terrain - celui de la droite dissidente - qui n'était a priori pas très fertile.
Des objections importantes sont soulevées dans ce débat. À propos de l'archéofuturisme, Alain de Benoist écrivait: "il est frappant de constater que la seule chose que l'on puisse opposer à l'époque actuelle est une intensification de toutes ses tendances: plus de volonté de domination ; plus de frénésie technologique ; plus d'exclusion ; plus de fuite en avant". Un processus accéléré avec tous les ingrédients de l'autodestruction. Prométhée contre Zeus ; prendre le parti des Titans" [25].
Mettre fin au conservatisme
Guillaume Faye oblige le lecteur à changer constamment de registre. On ne sait pas très bien ce qu'il est : un visionnaire, un prophète, un pamphlétaire, un journaliste, un philosophe social ou un auteur de science-fiction. Avec son talent pour la formule et la synthèse, il est capable de glisser, en une seule phrase, une leçon complète de philosophie politique. Il est peut-être l'inventeur d'un nouveau genre: la fan-science politique. Il est facile de le rejeter comme un droitier éclairé, ou comme l'idéologue d'une utopie sinistre. Mais c'est une fausse fermeture, car les stigmates ne sont pas des arguments. Indifférentes aux condamnations morales, les idées maudites continuent leur course. Que faire des idées et des visions de Guillaume Faye?
Comme c'est souvent le cas en science-fiction, Guillaume Faye a travaillé avec la matière à partir de laquelle les mythes sont forgés. Ayant rompu ses amarres avec la pensée conventionnelle, Faye a formulé un diptyque - la "convergence des catastrophes" et l'"archéofuturisme" - qui est mal assemblé et dans lequel les contradictions abondent. De plus, son exaltation de la techno-science est idéaliste et accélérée. Il est inutile de chercher une réflexion sérieuse sur les dangers du transhumanisme. Mais il faut toujours s'attendre à des incohérences de la part des artistes. Qui se soucie du fait que la chronologie d'Orwell dans 1984 était fausse, ou que l'"État mondial" prophétisé par Huxley ne se réalisera jamais? Cela n'enlève rien à la nature prémonitoire de ses visions, dont beaucoup se réalisent avec une précision étonnante. Les visions de Faye peuvent sembler absurdes, parfois délirantes, mais elles sont pleines d'intuitions valables et de vérités dures. "Les choses doivent être dites une fois pour toutes", a-t-il écrit, "car il n'y a pas de temps à perdre". Faye dit tout ce que presque personne d'autre n'ose dire aujourd'hui - y compris ceux qui se présentent comme "politiquement incorrects" - et le fait sans euphémisme ni complaisance. Les dogmes de l'idéologie occidentale sont décortiqués comme une collection d'absurdités pieuses, comme une propagande intimidante face à la nature et à la vie. Universalisme, égalitarisme, pacifisme, multiculturalisme, théorie du genre, métissage, déconstruction, postmodernisme... Faye ne fait pas de prisonniers. Quelques conclusions peuvent être tirées de ce feu de joie purificateur.
D'abord, que les illusions politiquement correctes devront céder la place, à plus ou moins brève échéance, à une série de réalités primordiales. Un test de réalité attend ce modèle économique, social et culturel qui se croyait à l'abri du vent de l'histoire, comme s'il pouvait marcher sur l'eau. Mais l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille, mais un courant tumultueux prêt à déborder dans une direction ou une autre.
Deuxièmement, l'intuition que l'archaïsme est toujours à l'affût et revient tôt ou tard en force. Civilisation et archaïsme entretiennent une sorte de relation dialectique. Ce que nous gagnons en civilisation - en maximisant le confort individuel - nous le payons en instincts de survie fondamentaux, y compris l'instinct de reproduction. Mais comme l'a souligné Raymond Ruyer, la nature est instinctive, non hédoniste. Seul l'instinct - et non le "désir" - est "naturel" au sens strict. C'est pourquoi toutes les civilisations, dans la mesure où elles privilégient la raison calculatrice, sont en un certain sens "dysgéniques" (elles contredisent les schémas de la sélection naturelle) et sont en un certain sens "suicidaires". Il y a alors un moment de rééquilibrage - le retour de l'archaïsme - qui pourrait bien être une "invasion des barbares". Guillaume Faye propose de ne pas attendre les barbares. Les Européens - souligne-t-il - doivent se tourner vers leur fond ancestral, le métamorphoser et le projeter dans l'avenir.
Troisièmement, Faye - qui se trouve être "de droite" - propose de faire table rase des grandes familles de droite: "traditionalistes", "réactionnaires" et "conservateurs". Surtout ces derniers. Se proclamer "conservateur" dénote, dès le départ, une attitude médiocre. Toute personne qui n'a que le désir de "conserver" mérite de perdre pour cette seule raison. La vie est une invention, un défi, un saut dans l'inconnu. Dans le domaine culturel, c'est presque toujours la gauche qui innove - bien que dans des directions désastreuses - et les conservateurs se contentent de suivre, généralement au ralenti. L'éternelle dynamique du conservatisme: le "progressiste" d'aujourd'hui sera le "conservateur" de demain. Le conservateur est un progressiste à effet retard. Comme le disait Chesterton, "l'occupation des progressistes est de faire des erreurs, et l'occupation des conservateurs est de les empêcher d'être corrigées". Être conservateur - a écrit Michael Oakeshott - est "une façon de nous accommoder aux changements et aux activités qui sont imposés à tous les hommes" [26]. Y a-t-il une plus grande déclaration de passivité? Une question d'adaptation, donc. Aucune philosophie politique ne s'enorgueillit d'autant de blasons dorés que le conservatisme: une philosophie d'éminents doctrinaires et de polémistes étincelants, à déguster dans la chaleur d'une cheminée en fumant une pipe et en étant vêtu de tweed. Mais le paysage extérieur n'est pas celui d'une paisible campagne anglaise, mais un paysage post-industriel sous les pluies acides, avec des gangs ethniques qui se bousculent pour le territoire. C'est le monde de l'archéofuturisme.
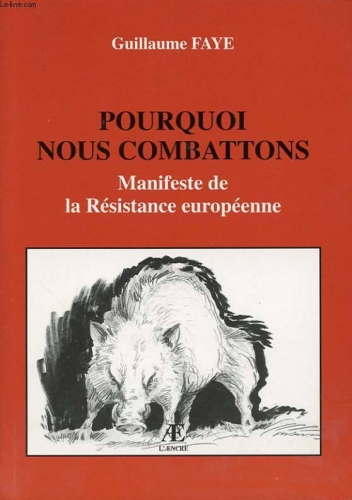
D'un autre point de vue, l'archéofuturisme pourrait être considéré comme une radicalisation des "conservateurs-révolutionnaires" du XXe siècle, ceux qui, plutôt que de "conserver", voulaient transformer les valeurs ancestrales en une synthèse révolutionnaire.
En définitive - et malgré ses sinistres prédictions - Guillaume Faye n'était pas un pessimiste, bien au contraire. Il est diamétralement opposé, par exemple, au fatalisme de Michel Onfray, qui prétend que les jours de la civilisation occidentale sont comptés, que le "judéo-christianisme" ne survivra pas à la menace islamique et qu'il ne reste plus qu'à "disparaître avec style et élégance" [27]. Bien au contraire : l'archéofuturisme est un cri d'insurrection contre la fatalité, un appel à la confiance: en la Providence, en la Fortuna romaine, en la Moira grecque. L'archéofuturisme est conscient que, finalement, l'histoire est tragique et incertaine, que les mouvements sociaux ne sont pas rationnels et que la volonté humaine peut pousser l'histoire dans de multiples directions. Guillaume Faye avait une confiance absolue dans la capacité de réaction de l'homme européen. Mais nous n'en sommes pas encore là. L'homme européen est trop attaché aux biens de la civilisation, trop bourgeois, trop mou. Ce n'est que lorsqu'il n'aura presque plus rien à perdre qu'il réagira.
Pourquoi lire Guillaume Faye aujourd'hui ?
Pour le meilleur ou pour le pire, nous vivons un "printemps des idéologies". Populisme, extrême gauche, extrême droite, islamisme, néo-féminisme, wokisme... les visions les plus étranges et les propositions les plus incroyables prolifèrent partout. Ce qui semble clair, c'est que l'ordre d'après-guerre garanti par l'hégémonie américaine appartient au passé, et ne reviendra jamais. Dans ce contexte, écrit le journaliste britannique Aris Roussinos, nous devons accepter l'idée qu'une idéologie émergera tôt ou tard pour succéder à un ordre libéral de plus en plus déconnecté de la réalité. Peut-être une telle idéologie existe-t-elle déjà, tapie dans un obscur secteur marginal (comme le communisme a existé avant de prendre le pouvoir). Il convient donc de garder un œil sur ce qui bouge en marge, là où pourrait se trouver le véritable ferment idéologique du XXIe siècle. Dans cette atmosphère de changement d'époque, "l'existence d'excentriques est cependant largement positive, car elle montre qu'il y a des gens qui réfléchissent sérieusement à ce qui devrait remplacer le cadre intellectuel et politique qui se meurt autour de nous" [28].
Y a-t-il un plus grand excentrique que Guillaume Faye ? Son "archéofuturisme" est présenté comme un mythe, mais avec un contenu extraordinairement politique. Si l'on s'en tient à la littéralité de ses visions, beaucoup d'entre elles paraîtront farfelues et absurdes. Mais le "mythe" qu'ils présentent n'en est pas un du tout, pour ceux qui savent le comprendre. C'est là que résident l'ambiguïté et la puissance du mythe, ainsi que sa capacité à créer un langage qui lui est propre, ce que fait Guillaume Faye. Après tout, la "vérité" peut prendre une multiplicité de formes, et les grands projets sont souvent annoncés sous la forme d'une vision ou d'un mythe [29]. En définitive, les mythes ne sont pas des descriptions des choses, mais l'expression d'une volonté d'agir.

Pour qui Guillaume Faye écrivait-il ? Principalement pour les jeunes. Il avait déjà annoncé que le système les enfermerait dans une cage: celle des sous-cultures juvéniles, de la fausse rébellion, du cirque des identités [30]. C'est le monde artificiel de "la nouvelle bourgeoisie sauvage, dont l'esprit est limité par le pragmatisme technologique, et dont la sensibilité est émoussée par le contact avec une sous-culture américaine". Et il a écrit :
"Mais l'artifice peut se retourner contre son propre maître. Que les créateurs de fausse jeunesse se méfient : tant qu'il y a des "inspirateurs", tout est possible. Peut-être qu'un jour les jeunes pourront les écouter. Comme le "fleuve de la vie", la jeunesse revient toujours avec chaque nouvelle génération. Et les "inspirateurs" sèment. Pas pour ce monde. Non pas pour cette jeunesse, mais pour la jeunesse à venir" [31].
Guillaume Faye est mort en mars 2019 ; un an avant une catastrophe qu'il avait annoncée: le retour des pandémies. Dans les jours qui ont suivi sa mort, une rumeur surprenante a été lancée. Dans un texte émouvant, l'un de ses amis a rapporté que, durant ses derniers jours, Faye a reçu l'aide spirituelle d'un prêtre dominicain et qu'il est mort - selon les termes de ce dernier - "dans la foi de son enfance et en toute simplicité de cœur" [32]. Certains de ceux qui l'ont connu ont déclaré que cela ne pouvait pas être possible. Un canular posthume ? Avec Guillaume Faye, on ne sait jamais....
Notes de la deuxième partie:
[1] Guillaume Faye, L'Archéofuturisme. Techno-science et retour aux valeurs ancestrales, L'Aencre 2011, p. 55.
[2] Ernst Cassirer, Le mythe de l'État (1947). Cité par Manuel García Pelayo dans Los Mitos Políticos. Alianza Editorial 1981, p. 19.
[3] Guillaume Faye, L'Archéofuturisme. Techno-science et retour aux valeurs ancestrales. L'Aencre 2011, p. 73. Le terme grec Archés signifie " commencement/origine " mais aussi " mandat " ou " ordre ", ainsi que la relation nécessaire établie entre les deux termes. En effet, l'"origine" est toujours la source de l'autorité, et elle marque de son empreinte tout ce qui suit. Ce n'est pas pour rien que la notion d'Arché - rappelle le philosophe Baptiste Rappin - est au cœur de tout le système métaphysique conçu par les Grecs anciens. L'Arché est donc la cible principale à détruire par les tenants de l'an-archie, c'est-à-dire par ceux qui prônent une pensée déconstruite, sans origine ni autorité. En tant que revendication de l'Arché, l'archéofuturisme apparaît ainsi comme un ennemi absolu de la pensée postmoderniste et de son idée de déconstruction. (Baptiste Rappin, Abécédaire de la Déconstruction. Les Editions Ovadia 2021, pp. 13-20).
[4] Guillaume Faye, L'Archéofuturisme. Techno-science et retour aux valeurs ancestrales, L'Aencre 2011, pp. 67 et 151.
[5] "Max Weber : entre relativisme et individualisme méthodologique. Entre vista con Michel Maffesoli". Rafael Arriaga Martínez. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912012000200006
[6] "Aux armes, citoyens ! L'autodéfense 2.0 selon Bernard Wicht et Alain Baeriswyl". Éléments por la civilisation européennenº 173, août-septembre 2018, p. 69.
[7] Guillaume Faye, Comprendre l'Islam, Éditions Tatanis 2015, p. 277.
[8] Raymond Ruyer, Les cent prochains siècles : le destin historique de l'homme selon la nouvelle gnose américaine. Fayard 1977.
[9] Guillaume Faye, L'Archéofuturisme. Techno-science et retour aux valeurs ancestrales, L'Aencre 2011, p. 68.
[10] Martine Gozlan, Le désir d'Islam. Grasset 2005.
[11) En novembre 2021, le Conseil de l'Europe - sancta sanctorum des "valeurs européennes" - a fait l'éloge du port du voile islamique comme symbole de "liberté" dans une campagne publicitaire (bien qu'il ait dû se rétracter partiellement face aux protestations de plusieurs femmes musulmanes). Cette campagne du Conseil de l'Europe - une sinécure bien rémunérée pour des politiciens amortis - illustre la pusillanimité des institutions européennes, qui trouveront toujours un moyen de s'abandonner à des valeurs archaïques lorsqu'elles estiment avoir le dessus.
[12] Guillaume Faye, Comprendre l'Islam. Éditions Tatamis 2015, p. 10.
[13] Guillaume Faye, Comprendre l'Islam. Dans cet ouvrage, Guillaume Faye décrit la fascination réciproque entre l'islam et le nazisme : culte de la violence guerrière, antijudaïsme, antichristianisme et goût pour une société unidimensionnelle et totalitaire. Contrairement à ceux qui associent le néonazisme à l'islamophobie, Faye rappelle l'islamophilie qui prévaut chez de nombreux néonazis (comme on peut le voir, par exemple, dans les travaux de l'islamologue allemande Sigrid Hunke : The Sun of Allah Shines on the West) et leur utilisation de l'atout pro-palestinien pour attaquer les Juifs. Comme le raconte Albert Speer dans ses mémoires, Hitler a affirmé que l'Islam était "parfaitement adapté au tempérament allemand" en tant que religion "qui glorifie l'héroïsme et ouvre les portes du ciel aux guerriers audacieux" et sous laquelle "les races germaniques auraient conquis le monde". Guillaume Faye a été attaqué par l'extrême droite comme "pro-sioniste".
[14) La vision de Faye de l'Islam est, à long terme, concluante : même si aujourd'hui il navigue à la faveur de l'histoire - écrit-il - il finira par être victime de lui-même : de sa rigidité morale, de son manque de solutions, du fait qu'il se situe en dessous du niveau intellectuel et culturel moyen de l'humanité. Il y aura alors " un mouvement de désaffection, de lassitude, de déception et de révolte (...) son flux sera éphémère et finira par se dessécher dans les sables dont il est issu " (Comprendre l'Islam. Editions Tatamis 2015, pp. 286-287). Cette conclusion semble s'accommoder d'une vision " progressiste " de l'histoire qui, curieusement, serait en contradiction avec les prémisses idéologiques de Faye. D'autre part, son identification de l'islamisme à l'islam est également problématique. Il ne fait aucun doute que l'aversion de Faye pour l'islam européen le fait tomber dans une vision simpliste, dans la mesure où il semble ignorer la pluralité du monde islamique et les réalisations de sa civilisation.
[15] Guillaume Travers, La société de surveillance, stade ultime du libéralisme, La Nouvelle Librairie 2021. Shoshana Zuboff, L'ère du capitalisme de surveillance. Le combat pour un avenir humain à la nouvelle frontière du pouvoir.Profile Books 2019.
[16] Peter Sloterdijk, interview pour Point (avril 2007). Cité par Guillaume Faye dans Sexe et déviance. Arktos 2011, p. 90-91.
[17] Guillaume Faye, L'Archéofuturisme. Techno-science et retour aux valeurs ancestrales, L'Aencre 2011, p. 69.
[18] Guillaume Faye, L'Archéofuturisme. Techno-science et retour aux valeurs ancestrales, L'Aencre 2011, p. 70.
[19] "Guillaume Faye et l'Archéofuturisme". Entretien avec Robert Steuckers, par Philip Stein". En version espagnole: https://www.elinactual.com/p/guillaume-faye-y-el-arqueofuturismo.html
[20] Guillaume Faye, L'Archéofuturisme. Techno-science et retour aux valeurs ancestrales, L'Aencre 2011, p. 108-109.
[21] Robert Steuckers, "Adieu, Guillaume Faye, après quarante-quatre ans de lutte commune", in : Guillaume Faye, Vérités et hommages, Arktos 2020, pp. 52-53.
[22] Guillaume Faye et Patrick Rizzi, "Pour en finir avec le nihilisme. Lectures de Heidegger". Nouvelle Ecole n° 37, printemps 1982, pp. 12-46.
[23] Romain D'Aspremont, Penser L'Homme nouveau. Pourquoi la droite perd la bataille des idées.Amazon 2018, p. 235.
[24] Julien Rochedy, "Penser le transhumanisme à partir de la tradition". Elinactual.com
https://www.elinactual.com/p/blog-page_615.html
[25] Alain de Benoist, Dernière Année. Notes pour conclure le siècle. L'Age d'Homme 2001, p. 183.
[26] Michael Oakeshott, "On being Conservative", in : Rationalism in politics and other essays.Liberty Fund 1992, p.410.
[27] Michel Onfray, Décadence : vie et mort de l'Occident, Éditions Paidós 2018.
[28] Aris Roussinos, "L'homme qui a prédit 2020".
https://unherd.com/2020/05/the-man-who-predicted-2020/
[29] Michael O'Meara, "Pourquoi lire Guillaume Faye", in : Guillaume Faye et la bataille de l'Europe. Arktos 2013, édition Kindle.
[30] Guillaume Faye, La Nouvelle Société de consommation, Le Labyrinthe 1984,
[31] Guillaume Faye "Les héros sont fatigués". Dans : Alain de Benoist-Guillaume Faye, Les idées de la "Nouvelle Droite". Une réponse au colonialisme culturel, Editions Nouveau Art Thor 1986, p. 324.
[32] http://www.contre-info.com/la-mort-chretienne-de-guillaume-faye
15:33 Publié dans Hommages, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, nouvelle droite, hommage, archéofuturisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 26 décembre 2021
Profil: Antonio Medrano

Profil: Antonio Medrano
Ex: https://www.azionetradizionale.com/2021/12/02/profili-antonio-medrano/
(de www.heliodromos.it) - À l'occasion de la récente publication du texte La Via dell'Azione d'Antonio Medrano, qui vient d'être imprimé par "CinabroEdizioni", nous pensons qu'il est utile de proposer à nos lecteurs ce "profil" de l'auteur, qui aurait dû à l'origine faire partie de la présentation que nous avions préparée, et qui a été supprimée pour des raisons d'espace et pour ne pas surcharger le texte. Les informations biographiques contenues dans ce document sont pour la plupart le résultat d'une longue connaissance et d'une correspondance approfondie que nous avons partagée avec l'auteur au fil des années.
* * *
Antonio Medrano est né le 6 mars 1946 à Badajoz, l'ancienne Pax Augusta des Romains, à 6 km de la frontière portugaise, donc dans la principale ville d'Estrémadure, une région éminemment paysanne, dédiée à l'agriculture et à l'élevage, connue comme la "terre des conquérants" (car la plupart des conquérants des Amériques y sont nés : Hernán Cortés, Pizarro, Valdivia, Orellana, Alvarado, Núñez Cabeza de Vaca, Núñez de Balboa, Hernando de Soto, García de Paredes, etc.) ). Une terre rude et extrême, qui constituait la frontière avec les zones encore sous contrôle musulman ; "la terre où les dieux sont nés", comme l'a appelé un écrivain espagnol dans un livre portant ce titre. Un autre auteur a résumé l'essence de l'Estrémadure par les mots "heroic fantasy".


L'écrivain américain James Albert Michener, qui a remporté le prix Pulizer en 1948, a consacré un magnifique ouvrage à la terre et à la ville natale de Medrano (Iberia. Spanish travels and reflections, Londres, 1983, en 2 volumes), effectuant un voyage en sens inverse sur les traces des conquérants espagnols du Mexique et des futurs États-Unis. Michener commence son voyage en Espagne par une visite à Badajoz, apparemment dépourvue de tout attrait touristique ou artistique particulier, expliquant son étrange décision par le fait qu'il s'intéresse à "l'Espagne héroïque", dont la représentation la plus pure à ses yeux est l'Estrémadure. "Quand je pensais à l'Espagne, je pensais surtout à l'Estrémadure, la région brutale de l'ouest, dont Badajoz était la ville principale". Il explique qu'il a découvert l'Espagne et son influence au Nouveau-Mexique, en Arizona, au Texas et en Californie : "L'Espagne que j'ai connue dans l'ouest des États-Unis était une Espagne héroïque". Et il est arrivé à la conclusion que "l'approximation la plus directe de cette Espagne dans la patrie était l'Estrémadure".
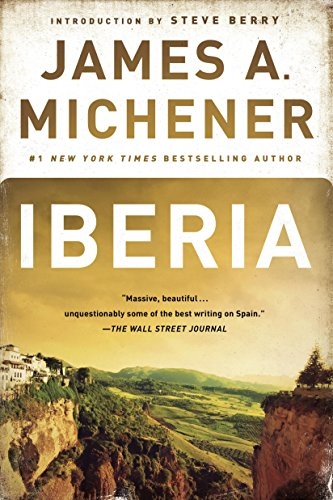 Louant les prouesses de ces hommes féroces venus de l'une des régions les plus pauvres de la péninsule ibérique, Michener affirme que le bien le plus précieux que les galions espagnols ont apporté au Nouveau Monde était "leur courage d'Estrémadure". "L'Estrémadure était mon Espagne". Debout dans l'ancienne Pax Augusta, voyant autour de moi "les Extremadurans austères, têtus et méfiants, dont les ancêtres ont conquis non pas des villes mais des nations et des continents entiers, j'ai senti que j'étais arrivé dans ma vraie patrie". Il a également affirmé que la meilleure façon de connaître le mystère de l'espagnol (ou de l'hispanique) est de connaître la capitale de l'Estrémadure, "cette ville maladroite et négligée" ; "si l'on comprend Badajoz, on comprendra l'Espagne".
Louant les prouesses de ces hommes féroces venus de l'une des régions les plus pauvres de la péninsule ibérique, Michener affirme que le bien le plus précieux que les galions espagnols ont apporté au Nouveau Monde était "leur courage d'Estrémadure". "L'Estrémadure était mon Espagne". Debout dans l'ancienne Pax Augusta, voyant autour de moi "les Extremadurans austères, têtus et méfiants, dont les ancêtres ont conquis non pas des villes mais des nations et des continents entiers, j'ai senti que j'étais arrivé dans ma vraie patrie". Il a également affirmé que la meilleure façon de connaître le mystère de l'espagnol (ou de l'hispanique) est de connaître la capitale de l'Estrémadure, "cette ville maladroite et négligée" ; "si l'on comprend Badajoz, on comprendra l'Espagne".
Viriato, terreur des Romains
L'actuelle Estrémadure occupe la partie orientale de ce qui était autrefois la Lusitanie, l'une des régions de la péninsule ibérique dont la conquête et la pacification ont coûté le plus cher aux Romains (et qui comprenait également la majeure partie de l'actuel Portugal, tout comme plus tard, au Moyen Âge, les terres portugaises faisaient partie du royaume arabe de Badajoz, l'un des plus grands et des plus importants de l'Espagne musulmane, dont les frontières s'étendaient jusqu'à Lisbonne et la côte atlantique). Les Lusitaniens, peuple guerrier et amoureux de leur terre, opposent une résistance ferme et tenace aux légions de Rome, notamment sous la conduite de leur célèbre chef Viriato, appelé Terror romanorum. Les défaites que Viriato inflige aux Romains sont telles que le consul Quintus Servilius Cepion, craignant un échec définitif de ses campagnes militaires, décide de l'assassiner par traîtrise, en impliquant les trois émissaires que les Lusitaniens avaient envoyés pour négocier la paix. Revenant au camp du chef lusitanien, les traîtres l'ont tué dans son sommeil. Lorsqu'ils demandèrent la récompense promise pour leur perfidie, ils reçurent en réponse les mots célèbres : "Rome ne paie pas les traîtres".
Medrano déclare : "Pour moi, en tant qu'Espagnol et natif d'Estrémadure, Viriato a toujours été - avec El Cid - une figure admirée, étudiée avec sympathie et vénération, digne d'émulation et de la plus haute estime. Dès mon plus jeune âge, Viriato a personnifié les plus hautes vertus de la race, incarnant la grandeur et la dignité de nos ancêtres lusitaniens. À mes yeux d'enfant et de jeune, il est apparu comme l'incarnation suprême de l'héroïsme, comme le grand héros défenseur de l'indépendance nationale, comme le prototype du chef politique et militaire qui offre sa vie pour son peuple. Le "caudillo" lusitanien héroïque était mon idéal, le modèle auquel j'aurais voulu ressembler, au prix de subir le même sort final (hormis l'épisode de la trahison, triste, déplorable et infamant pour la lignée). Dans la lutte de Viriato, j'ai toujours vu l'un des chapitres les plus importants et les plus significatifs de l'histoire de l'Espagne. Souvent, en parcourant la campagne de ma terre, assis à l'ombre de ses chênes séculaires (qui ont été mes premiers maîtres et mes compagnons inséparables), j'ai imaginé que le cheval de Viriato avait peut-être chevauché là, à l'endroit où je me trouvais, et j'ai senti avec fierté que le même sang coulait dans mes veines, palpitant à travers les siècles avec la même force, avec le même élan héroïque. Je me disais : "J'ai du sang lusitanien, je suis de la lignée des Viriato ; je dois vivre en accord avec ce noble et haut héritage"".
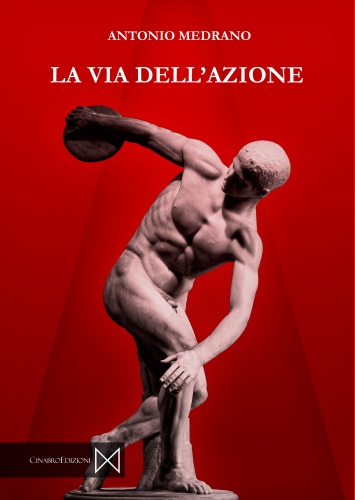
Antonio Medrano est né dans une famille aux convictions religieuses fermes, dont il a reçu les premiers fondements de ce qui est aujourd'hui sa vision du monde et son attitude face à la vie. Sa mère, issue d'une famille d'éleveurs et d'agriculteurs d'Estrémadure, très attachée à la terre, a connu la Phalange en tant qu'infirmière volontaire pendant la guerre civile. Son père, Luis Medrano, était l'un des as de l'armée de l'air espagnole. Il a combattu héroïquement pendant la croisade de libération de 1936, en tant que membre de l'escadron légendaire de García Morato, le pilote le plus célèbre d'Espagne, et a ensuite combattu en Russie avec l'"Escadron bleu", où il a réalisé des exploits mémorables contre des avions soviétiques. Il a reçu de nombreuses décorations espagnoles, italiennes ("Merito di Guerra") et allemandes ("Croix de Fer"). Un autre membre militaire éminent de la famille était le frère cadet de son père, un amiral réputé de l'Armada espagnole, la marine.
Il a reçu le nom d'Antonio en souvenir de son oncle, Antonio Espárrago, un jeune homme idéaliste, frère cadet de sa mère, qui s'est engagé comme volontaire dans la milice de la Phalange et a été tué lors des premières batailles de la guerre civile, quelques jours après la libération de Badajoz, dans un village proche de la ville, alors qu'il n'avait que 17 ans. En raison de l'idéalisme qui l'a guidé dès son plus jeune âge, certains membres de sa famille ont vu dans cet Antonio (Medrano) une copie de l'autre Antonio qui a donné sa vie pour son pays, comme si son esprit revivait en lui. Antonio Medrano est fermement convaincu d'avoir vécu sous l'influence, la direction et la protection de son oncle, un jeune homme naïf et généreux, qu'il n'a jamais pu connaître et dont il voyait chaque jour la photo, au visage rayonnant et portant un uniforme phalangiste, dans la maison de ses grands-parents maternels.
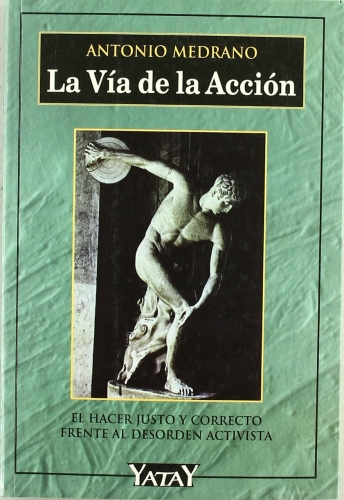
Medrano raconte que, étant né au pays des conquistadors, lorsqu'il était enfant, à l'internat, ses professeurs lui demandaient parfois "qu'est-ce que tu veux conquérir ?". "Je suppose que ma réponse les a laissés plutôt surpris. Depuis mon enfance, j'avais l'idée claire que dans la vie, je devais conquérir quelque chose : mon pays, une partie plus ou moins grande du monde, l'âme des hommes. Et j'ai senti que, en tant qu'extrémadurien, cet impératif de conquête me concernait particulièrement. Une vie dans laquelle il n'y avait rien à conquérir semblait absurde, mesquine et insupportable.
 Diplômé en sciences de l'entreprise de l'ICADE (Instituto Católico de Dirección de Empresas), il a travaillé dans l'industrie (dans des rôles techniques et de gestion), principalement dans le contrôle de gestion, la planification stratégique, le conseil, la motivation du personnel, l'assistance et la coopération avec la direction, et dans des associations publiques et privées pendant plus de 20 ans. Il a derrière lui un long militantisme politique et culturel, qui l'a amené à vivre diverses expériences en Espagne en tant que protagoniste, ayant été le promoteur d'initiatives (groupes, publications, maisons d'édition : Centro Librario Aztlán, Circolo Culturale Imperium, revue Traditio, Maison d'édition YATAY) qui ont contribué de manière décisive à la diffusion de la pensée traditionnelle dans la péninsule ibérique. Il a également une grande expérience en tant que traducteur de livres, d'articles et de documents officiels, avec une connaissance de plusieurs langues. Il a eu des contacts et des relations avec d'éminentes personnalités internationales : hommes politiques et hommes de culture, artistes et sportifs, soldats et hommes d'affaires, autorités religieuses et maîtres spirituels.
Diplômé en sciences de l'entreprise de l'ICADE (Instituto Católico de Dirección de Empresas), il a travaillé dans l'industrie (dans des rôles techniques et de gestion), principalement dans le contrôle de gestion, la planification stratégique, le conseil, la motivation du personnel, l'assistance et la coopération avec la direction, et dans des associations publiques et privées pendant plus de 20 ans. Il a derrière lui un long militantisme politique et culturel, qui l'a amené à vivre diverses expériences en Espagne en tant que protagoniste, ayant été le promoteur d'initiatives (groupes, publications, maisons d'édition : Centro Librario Aztlán, Circolo Culturale Imperium, revue Traditio, Maison d'édition YATAY) qui ont contribué de manière décisive à la diffusion de la pensée traditionnelle dans la péninsule ibérique. Il a également une grande expérience en tant que traducteur de livres, d'articles et de documents officiels, avec une connaissance de plusieurs langues. Il a eu des contacts et des relations avec d'éminentes personnalités internationales : hommes politiques et hommes de culture, artistes et sportifs, soldats et hommes d'affaires, autorités religieuses et maîtres spirituels.
En 1970, il rencontre son épouse Maria Antonia, qui devient sa précieuse collaboratrice dans ses travaux, activités et initiatives. Une épouse-secrétaire qui a composé ses livres et ses articles, organisé ses voyages, géré ses finances, son équipement technique (machines à écrire, ordinateurs et Internet) ; intervenant dans ses initiatives sociales et culturelles : conférences, concerts, correspondance, sports, cours, contacts, relations diplomatiques et visites en Europe, recevant des jeunes qui venaient lui rendre visite même de Russie.
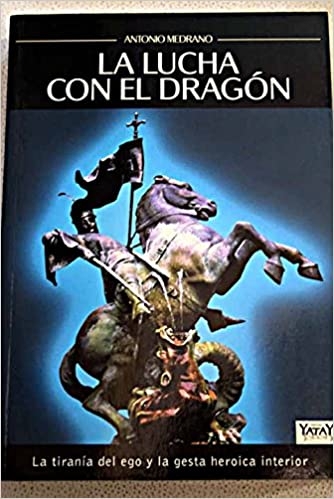 Un exemple de l'esprit, mêlé d'insouciance et de courage, qui animait le jeune Medrano se trouve dans un épisode raconté par sa femme. Le 23 février 1981, alors que la tentative de coup d'État menée par le colonel Tejero - qui avait occupé le Parlement espagnol avec ses hommes et tenait en joue le gouvernement et les parlementaires - était en cours, Medrano et Maria Antonia tentaient de se rendre à leur travail, traversant le centre de Madrid complètement isolé par les forces de police. Il était impossible de passer, une garde civile lourdement armée les empêchant d'accéder à leur lieu de travail. Antonio l'a affrontée, lui disant qu'ils devaient entrer coûte que coûte, même s'ils devaient marcher sur son cadavre, et que s'il avait un devoir à accomplir, ils avaient un devoir à accomplir et n'étaient pas prêts à rentrer chez eux comme des idiots après s'être levés tôt et avoir parcouru plusieurs kilomètres pour aller travailler. À la surprise de sa femme, le garde les laisse passer sans sourciller.
Un exemple de l'esprit, mêlé d'insouciance et de courage, qui animait le jeune Medrano se trouve dans un épisode raconté par sa femme. Le 23 février 1981, alors que la tentative de coup d'État menée par le colonel Tejero - qui avait occupé le Parlement espagnol avec ses hommes et tenait en joue le gouvernement et les parlementaires - était en cours, Medrano et Maria Antonia tentaient de se rendre à leur travail, traversant le centre de Madrid complètement isolé par les forces de police. Il était impossible de passer, une garde civile lourdement armée les empêchant d'accéder à leur lieu de travail. Antonio l'a affrontée, lui disant qu'ils devaient entrer coûte que coûte, même s'ils devaient marcher sur son cadavre, et que s'il avait un devoir à accomplir, ils avaient un devoir à accomplir et n'étaient pas prêts à rentrer chez eux comme des idiots après s'être levés tôt et avoir parcouru plusieurs kilomètres pour aller travailler. À la surprise de sa femme, le garde les laisse passer sans sourciller.
Convaincu de l'importance de la formation intégrale de l'être humain, il a personnellement pratiqué plusieurs sports (haltérophilie, rugby, natation, lutte gréco-romaine), ainsi que les arts martiaux, le yoga et les techniques orientales. Amateur d'art, passionné par la beauté, il a toujours su apprécier le pouvoir formateur des grandes créations artistiques de l'humanité. L'empreinte que l'art a laissée sur sa vie est incontestable, la musique et la poésie jouant notamment un rôle décisif. Sa mentalité et sa sensibilité ont été forgées au feu de l'architecture médiévale (romane et gothique), du chant grégorien, de la poésie de Victor Hugo ou de Fray Luis de León, des vers de Dante, du haïku japonais, de la peinture zen, des idéogrammes chinois, des tableaux de Zurbarán et de Dürer (l'un des meilleurs souvenirs de notre association avec Antonio Medrano fut une visite en sa compagnie du musée du Prado à Madrid), les dessins et poèmes de William Blake, les couleurs vives des préraphaélites anglais, la sculpture hindoue et bouddhiste, les sculptures d'images sacrées des sculpteurs castillans (Hernández, Berruguete, Siloé), la musique de Mozart et de Beethoven, les cantates et passions de Bach, les oratorios de Händel, les tragédies de Shakespeare et de Calderón, les drames musicaux de Wagner, la musique du baroque français et italien, etc.
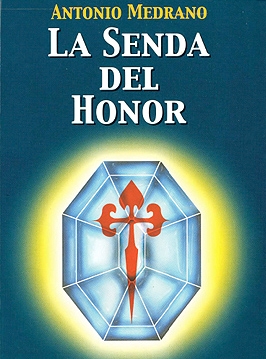 Deux courants fondamentaux convergent dans sa pensée et son œuvre : la tradition occidentale, tant dans sa version chrétienne que pré-chrétienne (grecque, romaine, celtique et germanique), et les traditions orientales (hindouisme, bouddhisme, taoïsme, shintoïsme), auxquelles il convient d'ajouter d'autres doctrines et courants traditionnels, tels que le zoroastrisme, la spiritualité amérindienne, le soufisme islamique ou la kabbale et l'hassidisme (mystique et ésotérisme juifs). Bon connaisseur des trois branches du christianisme (catholique, protestant et orthodoxe), on retrouve dans ses écrits des phrases de mystiques, saints, théologiens, penseurs et poètes chrétiens de tous âges et de toutes nationalités. En même temps, les enseignements des maîtres de l'Inde, de la Chine, du Japon, du Tibet, de la Birmanie, de la Thaïlande, du Sri Lanka, de la Corée et du Vietnam s'y rencontrent. Cette fusion de l'Orient et de l'Occident, notamment du christianisme et du bouddhisme-hindouisme, très similaire à celle que l'on retrouve dans l'œuvre de Coomaraswamy, a conduit certains à le surnommer "le Coomaraswamy espagnol". Et il a d'autres points communs avec Coomaraswamy : l'importance accordée à la beauté et à l'art ; l'attention portée aux symboles et aux mythes ; la citation d'auteurs qui ne sont pas strictement traditionnels (ou pas du tout) ; l'abondance de citations ; l'impact de certains auteurs anglo-saxons qui ont influencé les deux (comme William Blake ou Eric Gill).
Deux courants fondamentaux convergent dans sa pensée et son œuvre : la tradition occidentale, tant dans sa version chrétienne que pré-chrétienne (grecque, romaine, celtique et germanique), et les traditions orientales (hindouisme, bouddhisme, taoïsme, shintoïsme), auxquelles il convient d'ajouter d'autres doctrines et courants traditionnels, tels que le zoroastrisme, la spiritualité amérindienne, le soufisme islamique ou la kabbale et l'hassidisme (mystique et ésotérisme juifs). Bon connaisseur des trois branches du christianisme (catholique, protestant et orthodoxe), on retrouve dans ses écrits des phrases de mystiques, saints, théologiens, penseurs et poètes chrétiens de tous âges et de toutes nationalités. En même temps, les enseignements des maîtres de l'Inde, de la Chine, du Japon, du Tibet, de la Birmanie, de la Thaïlande, du Sri Lanka, de la Corée et du Vietnam s'y rencontrent. Cette fusion de l'Orient et de l'Occident, notamment du christianisme et du bouddhisme-hindouisme, très similaire à celle que l'on retrouve dans l'œuvre de Coomaraswamy, a conduit certains à le surnommer "le Coomaraswamy espagnol". Et il a d'autres points communs avec Coomaraswamy : l'importance accordée à la beauté et à l'art ; l'attention portée aux symboles et aux mythes ; la citation d'auteurs qui ne sont pas strictement traditionnels (ou pas du tout) ; l'abondance de citations ; l'impact de certains auteurs anglo-saxons qui ont influencé les deux (comme William Blake ou Eric Gill).
Depuis sa jeunesse, il essaie de suivre les conseils de Platon, qui recommande que l'élite ou la caste dirigeante de la cité idéale soit formée et éduquée à l'aide de deux piliers fondamentaux : la gymnastique et la musique. Et lorsque Platon parle de "musique", ce concept inclut la poésie, car dans la culture grecque, la musiké, qui est l'activité inspirée par les muses, comprend à la fois la composition musicale et poétique, toutes deux unies dans le chant, le rythme et l'harmonie. Pour la mentalité hellénique, musique et poésie se confondent, comme l'a souligné Walter Otto. De plus, il ne faut pas perdre de vue que dans la pensée platonicienne, la gymnastique et la musique correspondent à l'action et à la contemplation. Les deux visages de l'homme intégral : d'une part, l'athlète, le guerrier, le combattant, l'homme d'action ; d'autre part, le poète (capable de capter la musique du cosmos), le moine, le prêtre, le contemplatif, le voyant ou le sage (ouvert à la Vérité, fusionné avec la Vérité).
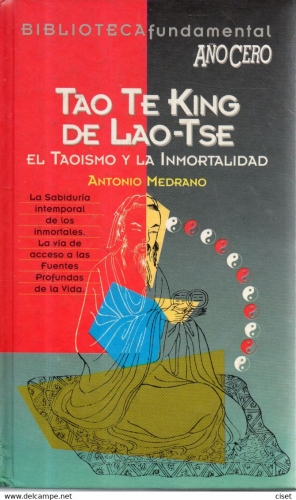 Et voici ce que Medrano lui-même dit du rôle de la beauté : "En ce qui concerne la beauté, je suis chaque jour davantage convaincu de l'importance de la beauté pour la vie humaine, je découvre chaque jour de nouveaux aspects de la beauté de la réalité, reflet et manifestation de la Beauté suprême. Je suis fasciné, étonné et émerveillé par la beauté sous toutes ses formes : la beauté de la Création, la beauté de la nature, la beauté des animaux et des plantes, la beauté de chaque lever de soleil, la beauté de la lumière, la beauté des femmes, la beauté des différentes langues et de ce que l'on dit avec elles, la beauté morale des personnes bonnes et nobles qui m'entourent, la beauté des grandes œuvres d'art, la beauté des grandes œuvres d'art, la beauté des symboles et des rites sacrés, la beauté des idées bien présentées et de celles qui nous transmettent la vérité, la beauté de tant de pages bien écrites qui nous instruisent et illuminent nos vies, la beauté des bonnes actions, la beauté de l'amitié, la beauté du sport, la beauté de l'esprit athlétique et olympique. Face à une telle beauté, on ne peut s'empêcher d'adorer, de vénérer et de se soumettre respectueusement à Celui qui l'a conçue et créée".
Et voici ce que Medrano lui-même dit du rôle de la beauté : "En ce qui concerne la beauté, je suis chaque jour davantage convaincu de l'importance de la beauté pour la vie humaine, je découvre chaque jour de nouveaux aspects de la beauté de la réalité, reflet et manifestation de la Beauté suprême. Je suis fasciné, étonné et émerveillé par la beauté sous toutes ses formes : la beauté de la Création, la beauté de la nature, la beauté des animaux et des plantes, la beauté de chaque lever de soleil, la beauté de la lumière, la beauté des femmes, la beauté des différentes langues et de ce que l'on dit avec elles, la beauté morale des personnes bonnes et nobles qui m'entourent, la beauté des grandes œuvres d'art, la beauté des grandes œuvres d'art, la beauté des symboles et des rites sacrés, la beauté des idées bien présentées et de celles qui nous transmettent la vérité, la beauté de tant de pages bien écrites qui nous instruisent et illuminent nos vies, la beauté des bonnes actions, la beauté de l'amitié, la beauté du sport, la beauté de l'esprit athlétique et olympique. Face à une telle beauté, on ne peut s'empêcher d'adorer, de vénérer et de se soumettre respectueusement à Celui qui l'a conçue et créée".
Depuis quelque temps, Medrano a pris la décision de quitter son travail pour se consacrer entièrement à ses études et à la compilation des nombreux ouvrages qu'il a prévus. Voici comment il décrit ce choix dans une lettre datée de janvier 1996 : "Jusqu'à il y a quelques années, j'exerçais ma profession - en tant qu'employé dans le monde des affaires - avec laquelle je pouvais subvenir à mes besoins, ainsi que financer ma vocation, mon travail intellectuel et mon combat au service de la Tradition. Avec l'argent que je gagnais de mon travail d'employé, je pouvais payer mes études et mes recherches: livres, voyages, correspondance, matériel, ordinateurs, etc. Je vivais d'un travail qui n'était pas fait pour moi. Je vivais d'un travail qui ne m'intéressait pas beaucoup, mais qui me permettait de vivre pour un autre type d'activité qui était et reste la raison de ma vie, ma mission et mon destin. Mais à un certain moment, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de me consacrer pleinement à ce pour quoi je vis, car alors le résultat serait meilleur à tous points de vue. Il s'agissait d'essayer de vivre en fonction de ce pour quoi on vit. Il s'agissait de suivre le conseil de Platon : "que l'artisan vive de son travail". J'ai abandonné mon emploi, c'est-à-dire mon gagne-pain, et j'ai commencé à m'occuper exclusivement de travaux intellectuels : livres, articles, conférences. Le chemin n'a pas été facile, il ne l'est pas aujourd'hui et ne le sera probablement pas à l'avenir, d'autant plus que je ne peux pas écrire sur tout ce qu'on me demande, ni faire beaucoup de concessions, car je dois toujours m'adapter aux exigences de ma fonction. À cela s'ajoute le manque de sérieux des personnes et des initiatives sur lesquelles on comptait au départ, mais qui, au moment de la vérité, nous mettent en difficulté. Toutefois, l'horizon semble maintenant s'éclaircir un peu et certaines possibilités se présentent. (...) Mais le fait que je doive vivre de mon travail ne signifie pas que j'en oublie le sens fondamental. J'ai des idées claires : l'important, c'est le travail qui est fait, qu'il soit bien fait et serve le but qui est sa raison d'être, les principes auxquels il est subordonné et qui l'inspirent ; la question des bénéfices, des ventes, des gains, est secondaire, qu'il faut garder à l'esprit parce qu'on ne peut pas s'en passer, mais qui en soi n'a aucun intérêt. Si ce dernier est si nécessaire, soit, mais c'est l'autre qui compte".
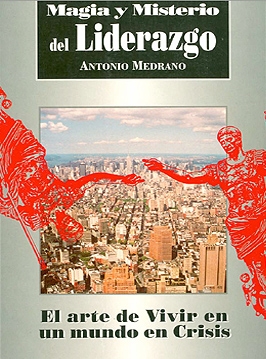 Le résultat de ce choix courageux (qu'il considère comme "inévitable" : "Le destin m'avait fermé toutes les autres portes. Je me suis limité à accepter la seule voie qui m'était offerte et qui semblait être celle que je devais suivre, celle que la "société" attendait de moi") de se consacrer totalement et exclusivement à sa "vocation" est représentée par les œuvres déjà réalisées et celles en préparation. En plus de La voie de l'action, enfin disponible dans sa traduction italienne, Medrano a déjà publié en Espagne : Sabiduría Activa (deuxième volume consacré à l'action) ; La Lucha con el Dragón (le symbolisme du dragon vu, avant tout, comme une représentation de l'ego qui nous domine et nous opprime) ; Magia y Misterio del Liderazgo - El arte de vivir en un mundo en crisis (la figure du leader comme être humain intégral et complet, comme idéal de noblesse et comme objectif auquel nous devons tous aspirer) ; La Luz del Tao (le Tao-Te-King de Lao-Tse traduit et commenté dans un exposé vaste et approfondi) ; La Senda del Honor ("Le chemin de l'honneur", présentation de l'une des valeurs fondamentales de toute société traditionnelle).
Le résultat de ce choix courageux (qu'il considère comme "inévitable" : "Le destin m'avait fermé toutes les autres portes. Je me suis limité à accepter la seule voie qui m'était offerte et qui semblait être celle que je devais suivre, celle que la "société" attendait de moi") de se consacrer totalement et exclusivement à sa "vocation" est représentée par les œuvres déjà réalisées et celles en préparation. En plus de La voie de l'action, enfin disponible dans sa traduction italienne, Medrano a déjà publié en Espagne : Sabiduría Activa (deuxième volume consacré à l'action) ; La Lucha con el Dragón (le symbolisme du dragon vu, avant tout, comme une représentation de l'ego qui nous domine et nous opprime) ; Magia y Misterio del Liderazgo - El arte de vivir en un mundo en crisis (la figure du leader comme être humain intégral et complet, comme idéal de noblesse et comme objectif auquel nous devons tous aspirer) ; La Luz del Tao (le Tao-Te-King de Lao-Tse traduit et commenté dans un exposé vaste et approfondi) ; La Senda del Honor ("Le chemin de l'honneur", présentation de l'une des valeurs fondamentales de toute société traditionnelle).
Mais en plus de celles déjà disponibles, il y a beaucoup d'autres œuvres sur lesquelles Medrano travaille dans son "buen retiro" : Shinto y Zen. Raíces metafísicas de la cultura japonesa ; El valor de la persona ; Vivir con inteligencia ; Mente, espíritu y libertad ; El sendero de la felicidad ; La revolucíon poética ; La accíon heroica ; El camino de la vida noble ; El Grial en Oriente y Occidente ; El mito de Hércules y el destino del hombre occidental ; Kali-Yuga. La crisis de Occidente y el fin del milenio ; La Tradición como Sabiduría Universal ; El Simbolismo del Sol ; La revolución de la Cruz Gamada (analyse critique de l'idéologie nationale socialiste) ; Wakan-Tanka ; El Imperio, forma suprema de la unidad de Europa ; El arte de leer ; Orden y desorden. Los fundamentos de la vida humana ; El Deber, fuerza liberadora y forjadora de la persona.
Récemment, il s'est particulièrement impliqué dans le projet de création de la "Fundación Antonio Medrano", une institution qui vise à reconnaître officiellement, à valoriser et à gérer son énorme bibliothèque et les innombrables volumes sur tous les sujets de la connaissance humaine qu'elle contient, orientée vers l'éducation des jeunes, la défense et la promotion de la culture, de la spiritualité, des idéaux et des valeurs qui font que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Il existe également un site web en espagnol qui lui est consacré (https://antoniomedrano.net/), où l'on peut trouver une sélection actualisée de ses écrits et des nouvelles utiles, constamment mises à jour, pour suivre en temps réel ses innombrables activités.
13:12 Publié dans Biographie, Hommages, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio medrano, hommage, tradition, biographie, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 août 2021
Manuel Ochsenreiter, rédacteur en chef de ZUERST !, est mort

Manuel Ochsenreiter, rédacteur en chef de ZUERST !, est mort
À seulement 45 ans, le rédacteur en chef du magazine d'information allemand ZUERST ! Manuel Ochsenreiter est décédé avant-hier, le 18 août.
Né le 18 mai 1976 dans l'Allgäu, il a d'abord rejoint la Junge Union (JU) dans sa jeunesse, mais en tant que patriote, il n'y a pas trouvé sa place. À partir de 1994, il écrit pour Junge Freiheit (JF), qu'il quitte en tant que chef de service en 2004 pour devenir rédacteur en chef de la Revue militaire allemande (DMZ - Deutsche Militär Zeitschrift).


En 2010, il a participé, avec le rédacteur en chef Günther Deschner et l'éditeur Dietmar Munier, à la création du magazine d'information allemand ZUERST ! et en est devenu lui-même le rédacteur en chef en 2011. Il a occupé ce poste jusqu'à sa mort.


Depuis une crise cardiaque subie en 2014 lors d'un reportage de guerre de ZUERST ! en Syrie, Ochsenreiter avait fait face à plusieurs reprises à de sérieux problèmes de santé. Depuis 2019, il a séjourné la plupart du temps à Moscou, où il est décédé après une semaine de coma suite à une nouvelle crise cardiaque. L'amitié germano-russe était un sujet qui lui tenait à cœur.

Manuel Ochsenreiter avec Alexandre Douguine, dont il fit traduire un ouvrage sur la géopolitique.
Manuel Ochsenreiter s'est distingué par son attitude joyeuse et optimiste face à la vie. Dans le cercle de ses camarades, collègues et auteurs, il était toujours le centre d'attention et, à ce titre, idolâtré. D'une grande rectitude idéologique et doté de connaissances politiques et militaires approfondies, il était capable de classer immédiatement chaque événement, qu'il soit national ou international, et de le commenter d'une plume acérée.
Manuel Ochsenreiter a été un confident proche et un ami toujours fidèle de son éditeur Dietmar Munier pendant 27 ans. L'ambition d'apporter une contribution précieuse et passionnante à l'actualité dans chaque numéro de ZUERST ! les a réunis tous les deux. Manuel Ochsenreiter était un journaliste passionné et inlassablement actif. Notre seule consolation est que notre ami, qui a vécu plus d'une vie grâce à son activisme effréné, puisse maintenant se reposer de son remarquable marathon terrestre. Manuel, tu t'es rendu immortel parce que tu avais le sens de l'amitié et que tu étais un patriote allemand inébranlable.
Les rédacteurs et éditeurs du magazine d'information allemand ZUERST !
11:17 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, hommage, manuel ochsenreiter, allemagne, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 août 2021
La pertinence pragmatique de Dominique Venner dans la lutte contre la technocratie

La pertinence pragmatique de Dominique Venner dans la lutte contre la technocratie
Mario De Fazio
Le penseur français a élaboré une synthèse européenne du rationalisme et de la tradition. En pratique : plus de rigueur et un effort pour comprendre la réalité, moins de rebelles qui se sentent rebelles juste parce qu'ils ne portent pas de masque.
SOURCE : https://www.barbadillo.it/100237-lattualita-pragmatica-di-dominique-venner-nella-lotta-alla-tecnocrazia/
En des temps sans fioritures qui font de l'opposition stérile et criarde une règle, et de la fausse polarisation (a)sociale une nécessité pour anesthésier toute interprétation critique de la réalité, redécouvrir la valeur d'une synthèse est un acte de prophylaxie. Si l'on ajoute à cela le rappel des lointaines et profondes origines de nos cultures et des exemples donné par ceux qui font suivre leurs mots par des actions, la réflexion devient un moyen de forger une éthique de la résistance.
Qu'est-ce que le nationalisme ? de Dominique Venner est l'un de ces livres qu'il faut manipuler avec un télescope idéal, pour voir de près ce qui semble lointain et observer de loin ce qui peut paraître différent à nos yeux. Complémentaire à Pour une critique positive, paru en annexe de la revue Europe Action en 1963, ce texte a été récemment remis au goût du jour par la maison d'édition Passaggio al Bosco.

Qu'est-ce que le nationalisme, le dernier essai de Dominique Venner publié par Passaggio al Bosco
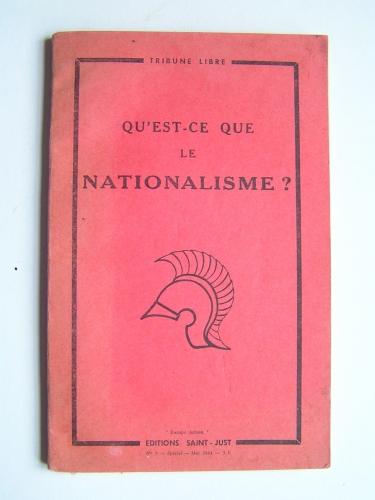
Un livre sec, agile, parfois surprenant par les résultats auxquels il aboutit, même pour ceux qui sont habitués aux sommets des samouraïs d'Occident. L'essai introductif, écrit par Marco Scatarzi, est particulièrement précieux pour le lire et éviter les confusions sémantiques et les malentendus idéaux. Le nationalisme auquel Venner se réfère n'est certainement pas le produit petit-bourgeois de la Révolution française, tout comme l'adjectif "occidental" ne fait certainement pas référence à l'empire du soleil déclinant, dirigé par les Yankees, qui étouffe et comprime le patriotisme européen. Venner parle de l'Europe, un destin qui nous a toujours appartenu, sans les fixations des chauvins du dimanche.
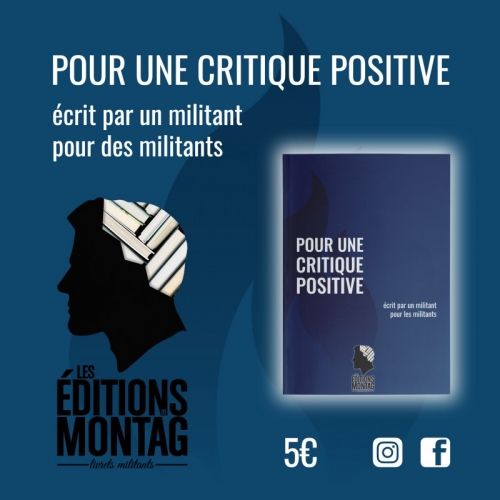
Entre science et esprit
L'une des interprétations les plus originales et les plus actuelles du livre concerne le rapport entre la tradition et le rationalisme, entre la science et l'esprit. Un lien souvent méconnu, en raison des distorsions auxquelles un certain rationalisme a conduit, mais qui fait aussi partie de l'héritage européen qui nous innerve. À cet égard, Scatarzi utilise une expression icastique pour reprendre l'un des leitmotivs du texte, lorsqu'il décrit l'Européen comme quelqu'un qui a
"ses yeux tournés vers le ciel mais ses pieds fermement plantés sur le sol".

Venner trouve également dans le genius loci du continent une prédisposition prométhéenne innée de ceux qui "marchent sur les traces de leurs ancêtres grecs qui, en ouvrant la voie de la pensée rationnelle, ont permis à l'homme de se libérer de la superstition et de prendre possession du monde par la connaissance de ses lois (...) Si l'Europe est la patrie des scientifiques, des explorateurs et des bâtisseurs, elle est aussi celle des artistes, des poètes et des saints". La particularité de l'Europe est qu'elle n'a jamais opposé la pensée à l'action.
Cela peut sembler une considération banale, mais la tendance à se réfugier dans un romantisme irrationnel qui fuit la technologie au lieu de l'affronter et de l'utiliser est réelle. Aujourd'hui, peut-être encore plus qu'à l'époque où Venner a écrit et lancé un appel "à l'esprit absolu de l'Europe, symbolisé par le mythe de Prométhée, le titan qui a pris aux dieux le feu du ciel pour donner à l'homme la connaissance et la domination du monde".
C'est une leçon à retenir, car si nous nions la valeur de la connaissance scientifique, nous risquons de passer à côté d'un élément essentiel de ce qui nous a été transmis, et de donner lieu à une dégénérescence potentielle qui n'a rien à voir avec l'héritage des Européens que nous avons le devoir de maintenir vivant en chacun de nous. Il s'agit d'un réel danger, si l'on considère les événements actuels tels que l'attitude à l'égard de la gestion de la pandémie actuelle. Il est sacro-saint de contester les déformations induites par l'imposition du Pass Vert ou de dénoncer les éventuelles tentatives d'expérimentation de formes de contrôle social sous prétexte du virus. Mais de là à crier à la conspiration, à épouser les folies de la foule qui scande "no-vax" et à se sentir comme un anarque jüngerien simplement parce qu'on refuse une injection, il y a un long chemin à parcourir. Et peut-être sera-t-il utile - même pour une partie du notre monde qui voudrait se poser comme identitaire - de se rappeler que le fait d'invoquer continuellement des violations de la liberté individuelle et d'appeler à un État policier est l'attitude des libéraux, certainement pas en accord avec ceux qui savent que la valeur de la personnalité reçoit son sens dans la communauté. En bref: plus de poigne et d'efforts pour comprendre la réalité, moins de rebelles qui se sentent rebelles juste parce qu'ils ne portent pas de masque.
La lutte contre le mondialisme
Cela dit, il est clair que récupérer un pan de la culture européenne pour en faire la synthèse ne signifie pas éviter l'un des moments cruciaux de l'époque, cette lutte contre le mondialisme qui passe aussi par la contestation incessante de la technocratie. Parce que, argumente Venner: "si nous sommes fiers des réalisations de la science et de la technologie, nous nous révoltons contre l'utilisation aberrante qui en est trop souvent faite".
Réflexions prémonitoires
À cet égard, le texte devient prophétique, préfigurant des décennies à l'avance des scénarios et des dynamiques qui se sont imposés dans l'évolution du capitalisme transnational.
Le capitaliste individuel, propriétaire de la tradition initiale, a disparu", écrit Venner en 1963, "à sa place se trouve un capitalisme dépersonnalisé, dispersé, anonyme (...) Ce ne sont plus les propriétaires du capital qui dirigent et contrôlent les entreprises, mais des spécialistes des mécanismes financiers, des hauts fonctionnaires des holdings et des banques, recrutés par cooptation dans le milieu très fermé de la grande bourgeoisie. Un milieu que l'on devrait appeler par son nom: la caste des technocrates.
Il n'y a pas de rupture dans la transition, suggère l'historien français, mais une transformation naturelle car: "Les technocrates d'aujourd'hui ne sont pas différents des capitalistes d'hier. Ce sont les profiteurs du travail des autres, les réactionnaires de l'époque moderne (...) Pour eux, les communautés humaines ne sont que d'immenses sociétés anonymes dont le fonctionnement anarchique doit être ordonné par la création d'un grand marché mondial rationnel et normalisé".
Venner sent que la fracture définitive entre le pays réel et le pays légal s'est faite à l'avantage évident de ce dernier, mais aussi que "la méchanceté du régime provoquera à l'avenir de nouvelles explosions populaires". Si elles sont désorganisés, ces révoltes finiront comme les précédentes. Toute notre action doit donc viser à introduire la levure dans la pâte". Toute référence aux protestations - les Gilets jaunes en France, ou les "no-passers" d'aujourd'hui - semble délibérée. "Ceux qui croient à la spontanéité croient à la résurrection des morts", juge l'écrivain transalpin.
L'inspiration pour la milice
Est-il possible d'adopter une attitude régressive et réactionnaire face à un tel scénario, en se réfugiant dans le bon vieux temps ou dans un conservatisme générique ? Aujourd'hui comme hier, c'est le choix des vestiges de l'histoire. "Que devons-nous conserver dans cette société ? Son idéologie ? Sa hiérarchie sociale ? Ses coutumes ? Tout cela, nous voulons le renverser. Alors ? Il ne doit pas y avoir de confusion. Ce que nous devons former n'est pas un parti conservateur, mais un mouvement révolutionnaire", écrit Venner en introduisant la dernière partie de son ouvrage, consacrée au militantisme. Ici aussi : pas de place pour les bouffons parodiques et les boulets humains, car: "zéro plus zéro est toujours égal à zéro. La somme des mythomanes, des comploteurs, des nostalgiques, des carriéristes, des "nationaux", ne donnera donc jamais une force cohérente. S'accrocher à l'espoir d'unir les incompétents, c'est persévérer dans l'erreur".

Le militant, en revanche, doit avoir ce que de Benoist appelle "une éthique de la résistance", afin que ceux qui s'élèvent contre le fatalisme retrouvent l'esprit de la tradition européenne dans une praxis quotidienne qui la renouvelle sans la dénaturer. Former des hommes qui, écrit Venner, "ont tout connu: l'indifférence qu'on ne peut ébranler, l'insulte qu'on ne peut encaisser, les coups qu'on ne peut rendre, l'ami qui cède, celui qui s'éloigne", écrit Venner. "Et puis d'autres sont venus. La poignée d'hommes s'est multipliée. Au contact des premiers, les nouveaux ont appris à être durs, lucides, tenaces : à être des militants".
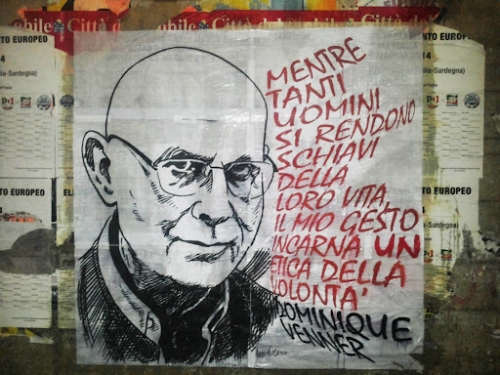
Le défi est énorme, la synthèse nécessaire. Le samouraï d'Occident, depuis son éternité, nous montre une voie, celle de l'engagement.
"Il y avait en nous une force que nous n'avions pas le droit de dilapider dans l'amertume, le ressentiment ou la nostalgie".
Mario De Fazio
16:35 Publié dans Hommages, Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique venner, nouvelle droite, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 31 juillet 2021
De Nietzsche à Mitteleuropa, l'univers culturel de Roberto Calasso

De Nietzsche à la Mitteleuropa, l'univers culturel de Roberto Calasso
Hommage à l'éditeur Roberto Calasso (1941-2021)
Andrea Muratore
Roberto Calasso, décédé ce 28 juillet, était, en fin de compte et tout simplement, un homme cultivé et libre. Et cela suffit pour comprendre l'incisivité de son travail dans le monde de l'édition italienne des XXe et XXIe siècles. Dans ce cas, ce n'est pas le caractère extraordinaire de l'ordinaire qui est frappant, mais plutôt la capacité de Calasso à façonner une structure éditoriale capable de donner l'exemple en Europe, une maison d'édition à l'image et à la ressemblance de sa vision du monde et de la culture.
En tant que directeur éditorial de la célèbre maison d'édition italienne Adelphi, Roberto Calasso a donné la parole à un éventail large et pluriel d'auteurs. De son époque et du passé. Parfois, on peut dire, de l'avenir, car il a anticipé la célébrité de certains auteurs ou a permis la transposition d'écrivains et d'essayistes en icônes "pop" grâce à ses intuitions réfléchies. Ce qui est particulièrement frappant, cependant, c'est l'ampleur des sujets sur lesquels s'est penchée la bibliothèque Adelphi, qui a rassemblé plus de 700 titres depuis 1965.
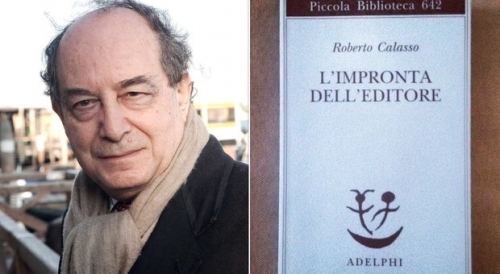
Une ampleur qui reflète la profonde curiosité culturelle du deus ex machina qui règnait sur Adelphi. Ethologie (Konrad Lorenz) et littérature du fantastique (J.R.R. Tolkien), ésotérisme (Gurdjeff et Guénon) et foi (Ignace de Loyola), penseurs séculiers (Benedetto Croce) et vrais mystiques (Simone Weil). Un courant de conscience continu, polymorphe, capable de s'adapter aux nombreux stimuli que Calasso et la maison Adelphi ont su saisir et transmettre, donnant naissance à des textes qui "risquaient de ne jamais devenir des livres", comme il l'écrivit en 2013 dans L'impronta dell'editore.
Calasso et Adelphi entre le sacré et le profane
Calasso était un personnage sui generis, qui ne pouvait être classé dans des groupes, des courants d'expression ou des domaines politiques précis. Il était le Franco Battiato de l'édition, capable de créer un univers de référence capable de visiter métaphoriquement des mondes lointains et de recevoir des stimuli hétérogènes de la part de ceux qui ont la bonne prédisposition pour y entrer. Parmi les auteurs publiés par Calasso figure Manlio Sgalambro, un philosophe dont la collaboration avec le maître sicilien est à l'origine de certains de ses textes les plus profonds ; il y avait aussi de la place pour un grand hérétique de la culture italienne comme Curzio Malaparte, un opposant à tous les conformismes; et les voyages dans des terres lointaines et les épopées culturelles, historiques, naturalistes et ethnographiques du britannique Bruce Chatwin, inaugurées par En Patagonie, un texte ayant la capacité profonde de mener à la découverte d'une accumulation profonde d'histoires et de récits humains, racontant une terre rude, glacée et inhospitalière aux antipodes de notre Europe.
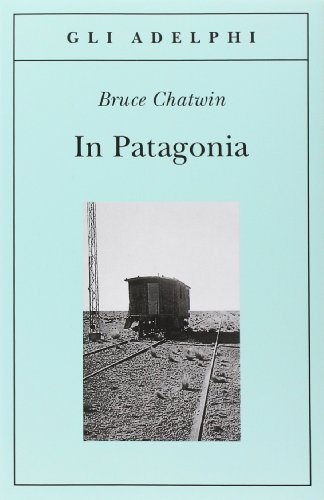
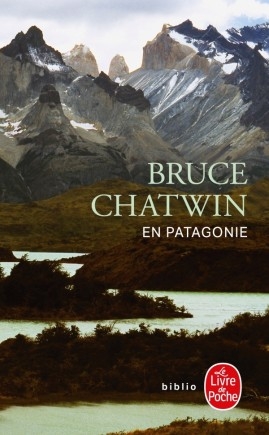
Chez Adelphi, sous la houlette de Calasso, le fleuve de la connaissance coule à un rythme inhabituel à l'ère de la société de l'information de masse. Et les protagonistes de ses collections sont souvent les grands hérétiques, les libres penseurs, les voix hors du chœur. Cela permet d'apprécier plus profondément le travail d'une maison d'édition qui, comme le rappelle Pangea, a su se distinguer par son autonomie, et a continué à le faire au cours du dernier demi-siècle, dans une phase où " les grands éditeurs, étourdis par le climat de l'après-guerre, pressés par les exigences moralisatrices et pédagogiques, par les préjugés politiques et culturels de la société bourgeoise naissante, ont publié des œuvres évidentes, laissant de côté "une grande partie de l'essentiel". Le sectarisme laïc, l'afflux catholique ou marxiste, semblaient obliger les éditeurs à n'accepter que des auteurs alignés, catalogués en grappes".
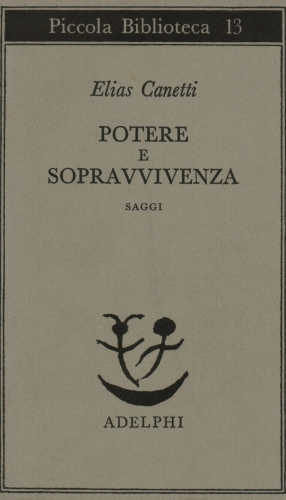
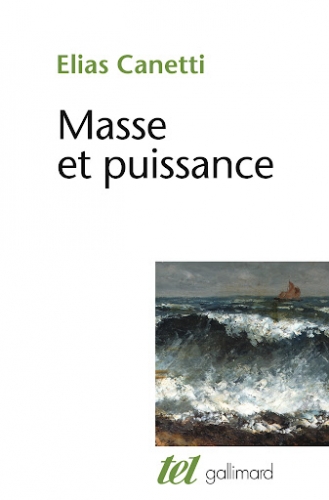
Qui d'autre, après tout, aurait pu apporter en Italie la meilleure version de Masse et puissance, le texte analysant le rapport entre les sociétés et l'autorité écrit par le penseur germano-britannique Elias Canetti, prix Nobel de littérature en 1981, une critique désacralisante des principales idéologies du vingtième siècle? Qui, dans les années 1970, redécouvrait Joseph Roth et, avec des romans fondamentaux tels que La crypte des capucins, un afflux considérable d'oeuvres venues d'Europe centrale, avec une belle nostalgie d'une Europe qui pouvait encore être considérée comme le centre du monde? Qui voudrait entreprendre un voyage culturel à la découverte des grandes religions du monde, en abordant l'hindouisme (avec une édition de la Bhagavadgita), le bouddhisme (avec Les actes du Bouddha du moine et poète Asvaghosa), le canon biblique et la traduction chrétienne?
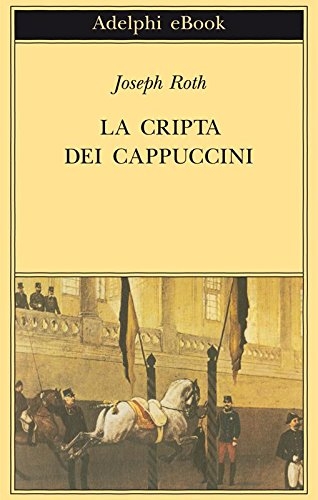

Dans ce dernier domaine, la maison Adelphi de Calasso a publié des versions éditées et commentées du Livre de Job, "nourriture, vêtement et baume pour ma pauvre âme" pour Soren Kierkegaard, et du Cantique des Cantiques de Saint François, en confiant l'édition au philosophe Guido Ceronetti, répondant avec la simplicité de la sagesse antique aux appels pompeux de l'hégémonie culturelle de l'époque ?
La redécouverte de Nietzsche
Calasso était un éditeur, mais aussi une énigme. On peut se demander si, en fin de compte, il n'a pas fait tout cela juste pour s'amuser. Pour le plaisir intellectuel de montrer que la culture est la culture, sans adjectifs, et par conséquent de se moquer des guerres tribales mises en scène par les "hégémons", les fidèles des partis et les écrivains du courant dominant. Profondeur et simplicité se rejoignent là où les auteurs "Adelphistes", les frères unis dans une vision culturelle commune, laissent leur empreinte en montrant les risques inhérents à un catalogage excessif des œuvres littéraires dans des schémas idéologiques et politiques. Irrévérencieux à l'égard des censeurs qui entendaient biffer des auteurs tels que Ernst Junger, qu'il a porté à l'attention du public italien à juste titre, Calasso a pu construire son opera omnia en restituant Friedrich Nietzsche à la culture italienne, dont la traduction presque intégrale représente une opération visant à rendre une justice culturelle et philologique à la mémoire d'un auteur controversé, trop souvent mal interprété dans notre contexte national.
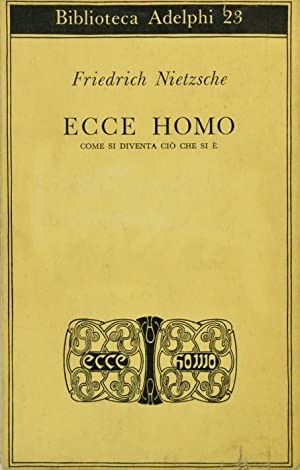
En particulier, dans la traduction et le commentaire de l'Ecce Homo de Nietzsche, qu'il réalise en 1969 à l'âge de 28 ans, on retrouve toute la curiosité, le flair et le sens culturel de Calasso. Comme pour s'acquitter d'une dette envers le grand philosophe rococo, Calasso traduit l'œuvre et la commente pour inverser la traditionnelle interprétation "dégénérative", en lisant, en fin de compte, dans le "Christ ou Dionysos ?" avec lequel se termine l'œuvre la plus autobiographique de Nietzsche, non pas la question irrésolue devant le déclin de son esprit mais le grand dilemme existentiel de l'homme contemporain, dont le démêlage est peut-être le grand don du penseur allemand. Il était conscient que l'Europe du 20e siècle serait perpétuellement imprégnée du dualisme entre sa vocation traditionnelle et un mouvement systémique vers l'entropie. Le fait même de rendre justice à la traduction littérale du terme "Übermensch", en balayant les éventuels qualificatifs obscurs inhérents au sulfureux "Superman", témoigne d'une telle attention et d'un tel soin pour les détails culturels et la pensée d'un auteur, même décédé, que cela dénote le profond respect de Calasso pour toutes les formes d'expression culturelle. Comme un véritable intellectuel libre. Capable de s'adresser au monde dans plusieurs langues, dans plusieurs styles et dans plusieurs modes d'expression. Avec la force perturbatrice des livres.
Source: https://it.insideover.com/societa/da-nietzsche-alla-mitteleuropa-luniverso-culturale-di-roberto-calasso.html
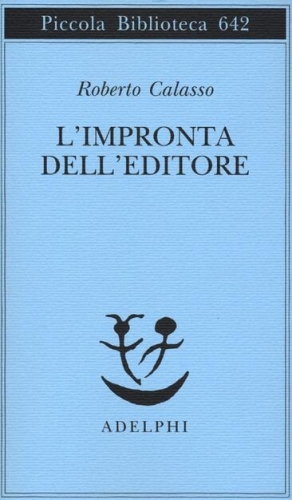
11:39 Publié dans Actualité, Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : édition, éditeurs, roberto calasso, italie, hommage, actualité, littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 juillet 2021
À la mémoire de Hans Werner Neulen

À la mémoire de Hans Werner Neulen
Une petite parenthèse dans notre programmation régulière, pour commémorer la figure de l'historien allemand Hans Werner Neulen, décédé il y a quelques jours. Spécialiste attentif, méticuleux et, surtout, sans tabou du fascisme européen et de la Seconde Guerre mondiale, il s'est également occupé de Julius Evola, en particulier de ses relations avec l'Allemagne nationale-socialiste, dans le célèbre ouvrage Julius Evola dans les documents secrets du Troisième Reich, écrit avec Nicola Cospito, dont nous publions ci-dessous l'article à la mémoire de Neulen, publié dans Il Secolo d'Italia.
***
L'historien allemand Neulen est décédé. Chercheur sur le fascisme européen et les relations entre Evola et Berlin
par Nicola Cospito
Extrait de Il Secolo d'Italia
L'écrivain et historien allemand Hans Werner Neulen, connu pour ses écrits destinés également au public italien de la mouvance national-patriotique, est décédé le 3 juillet à Cologne. H. W. Neulen est né à Eschweiler, en Westphalie, le 20 février 1948. Jeune homme, lors d'un voyage scolaire à Rome en 1966, il avait décidé d'assister à la manifestation organisée par Arturo Michelini au Colisée, mais il a été pris dans les incidents qui s'ensuivirent et a subi les accusations de la police.
Neulen et la rencontre avec les dirigeants et militants de droite
Dans ces circonstances, il a fait la connaissance d'un grand groupe de militants de droite, parmi lesquels Antonello Sterpetti, futur secrétaire de la section de Prati de la Via Ottaviano, Maurizio Messina, Giuliano Marchetti et Ernesto Roli, chef du groupe spéléologique de l'URRI, avec qui il a noué une relation qui a duré toute une vie. Auteur de plusieurs essais historiques dont Feldgrau in Jerusalem, sur l'ancienne alliance entre les Turcs et les Allemands, An deutscher Seite, sur les volontaires de toutes les nations du vieux continent qui ont combattu pour défendre la forteresse Europe, Neulen avait également publié un essai chez l'éditeur Giovanni Volpe, L'eurofascismo e la seconda guerra mondiale.
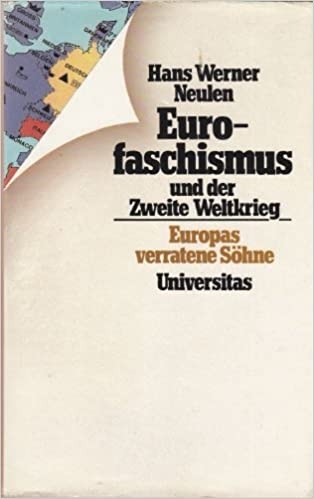
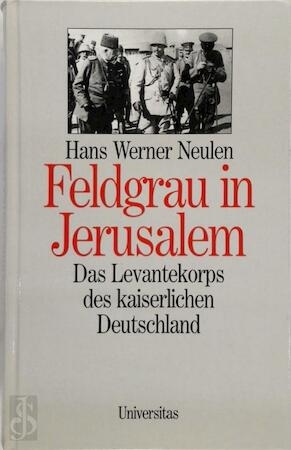
Essais sur Salò, Evola et le Troisième Reich
Auprès des Edizione Europa d'Enzo Cipriano, Neulen a publié, en collaboration avec Nicola Cospito, Julius Evola nei documenti segreti del Terzo Reich (Julius Evola dans les documents secrets du Troisième Reich) et, toujours avec Cospito, il publie chez l'éditeur Mursia l'important essai Salò-Berlin, l'alleanza difficile (Salò-Berlin, l'alliance difficile), qui est notamment cité par Renzo De Felice dans son ouvrage publié à titre posthume Mussolini l'alleato (Mussolini l'allié). Dans ce livre sur le rapport Salo-Berlin, Neulen avait rassemblé une série de documents inédits de la Wehrmacht trouvés dans les archives allemandes qui traitaient de la présence des troupes allemandes sur le territoire italien dans les mois de la CSR et des relations entre les autorités républicaines fascistes et les commandements envoyés par Berlin.

Ces relations furent compliquées par la question des 600.000 soldats italiens internés en Allemagne après le 8 septembre, par l'administration allemande dans les deux territoires de la côte adriatique et du Tyrol du Sud, et par la méfiance constante des Allemands envers les Italiens.
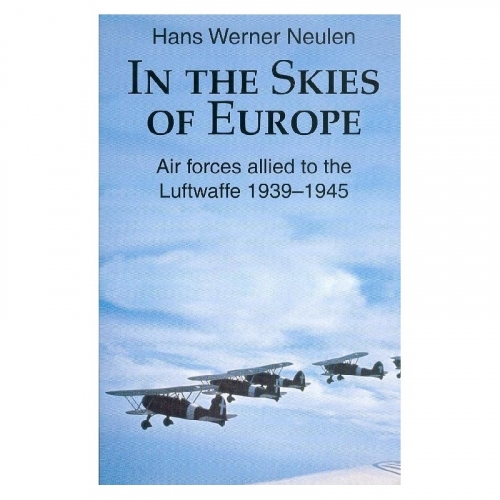
Neulen s'est spécialisé dans l'étude de la puissance aérienne
Dans les dernières années de sa vie, Neulen s'est spécialisé dans l'étude des forces aériennes des différents pays européens pendant la Seconde Guerre mondiale, en se concentrant particulièrement sur la Force aérienne nationale républicaine italienne et son rôle important dans la lutte contre les bombardiers alliés. Il avait, entre autres, fait des recherches sur les épisodes héroïques de la Patrouille des Bonnets. Neulen laisse un vide profond dans le domaine de l'historiographie et parmi tous ceux, y compris de nombreux amis italiens, qui l'ont connu personnellement ou à travers ses œuvres.
Source : https://www.azionetradizionale.com/2021/07/26/in-ricordi-di-hans-werner-neulen-storico-coraggioso/
14:44 Publié dans Histoire, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hans werner neulen, histoire, allemagne, italie, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 mai 2021
En mémoire de Dominique Venner (16 avril 1935 - 21 mai 2013)

En mémoire de Dominique Venner
(16 avril 1935 - 21 mai 2013)
Un européiste identitaire
Dominique Venner a choisi en conscience ce 21 mai 2013 la lumière du soleil olympien, ce soleil à la fois invaincu et invincible, quittant le monde des hommes pour choisir celui des ombres. Depuis la prairie d’Elysion, il contemple son monde, notre monde, cette Europe qu’il a chérie plus que tout au monde et qui continue, sans lui, d’aller vers son trépas, sauf si la flamme de l’espérance sort les hommes d’Europe de cette insupportable dormition qui les domine et les éteint.
Sans sacrifice, il n’y a aucune victoire. Sans courage, il n’y a aucune récompense. Sans volonté, il n’y a que la tombe comme seul avenir.
Son héritage, c’est vous, vous les éveillés, vous les éveilleurs, je dirais même les réveilleurs. Que son combat qui est vôtre désormais vous anime comme il l’a animé. Que son nom soit comme le signal du retour d’une pensée archaïque en mode futur et l’annonce de la renaissance de l’Europe.
A l’origine de l’Europe, il y a l’Action. Pour sa renaissance, il y aura Réaction. Celle des Européens de demain à nouveau intransigeants. Car n’est respectable que celui qui sait se faire respecter et surtout se fait effectivement respecter. Le respect ne se mendie pas. Il s’exige. Mieux il s’impose.
Que l’Europe redevienne brave, ce terme qui était aussi son auto-ethnonyme il y a des milliers d’années, les braves et nobles *Aryōs !
Thomas FERRIER
Président du Parti des Européens (LPE).
17:55 Publié dans Hommages, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique venner, thomas ferrier, nouvelle droite, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 mars 2021
Vaart wel, Francis!

Waar men ging langs Vlaams-nationale wegen, kwam men Francis tegen: hoeveel zangavonden heeft hij geleid? Hoeveel studenten heeft hij wegwijs gemaakt in de Ierse rebellenliederenschat? Of het nu voor de Marnixring Adriaen Willaert was, of voor een VNJ-, NSV- of KVHV-afdeling: vormingsavonden gaf hij als de beste. Jongeren kon hij boeien met zijn verhalen, gelardeerd met liederen en kwinkslagen. Hij was een vaste waarde voor deze Nieuwsbrief en voor TeKoS, waar hij na zijn partijpolitieke jaren zijn stek had gevonden.
Twee thema’s hielden zijn aandacht gaande: Het Europa der Volkeren en de heel-Nederlandse dimensie van ons Vlaams-nationalisme aan de ene kant (“Het Vlaams nationalisme is een deel van de groter geheel”) en de inhoudelijke uitdieping van ons nationalisme, in een jeugdige, rechts non-conformistische stijl. In die jaren ’70 en vooral ’80 en volgende van de vorige eeuw maakten wij in Europa deel uit van die nieuwe, rechtse jeugd die er overal wortel schoot. Er werden kameraadschappen gesmeed die er na 40 jaar nog altijd staan!
Francis gaf vorm aan die rechtse revolte, hij was er de eerste militant van. Of het nu in een pub in het Ierse Clifden was waar hij met de rebelsong “Kevin Barry” de dames (en niet alleen de dames) tot tranen toe bewoog, of in het Italiaanse Napels een cantus bovenop een chic appartementsgebouw leidde met een groep enthousiaste Napolitanen, of in het zuiden van Frankrijk vorming gaf of in zijn beste Frans tussenkwam op de zomeruniversiteit van GRECE: Francis gaf zichzelf altijd voor de 100 volle percent. En dan vergeet ik nog de zangavonden van Voorpost aan de vooravond van de IJzerbedevaart.
Hij was, hij is mijn oudste kameraad, en nu is hij er niet meer. In het Duitse afscheidslied “Ich hatt’ einen Kameraden” zongen we: “Er liegt vor meinen Füssen, als wärs ein Stück von mir”. Sinds vandaag besef ik het: Francis was een stuk van mij, Francis was een stukje van ons allemaal. Ik zal dit lied nooit meer kunnen zingen, zoals ik zovele liederen nooit meer zal kunnen zingen zonder aan Francis te denken. Hij is er niet meer, maar ik ben overtuigd dat deze, zijn belangrijke les aan de Vlaamse Beweging overeind zal blijven: de les dat kameraadschap het bindmiddel is van die beweging, en dat niemand die beweging kapot krijgt als het bindmiddel er maar is.
Het woord van auteur J.R.R. Tolkien is meer dan ooit op zijn plaats: “I will not say: do not weep; for not all tears are an evil.” Vaart wel, Francis, ik mis je heldere stem nu al, en onze maandelijkse Nieuwsbrief mist jouw heldere, scherpe maar correcte pen.
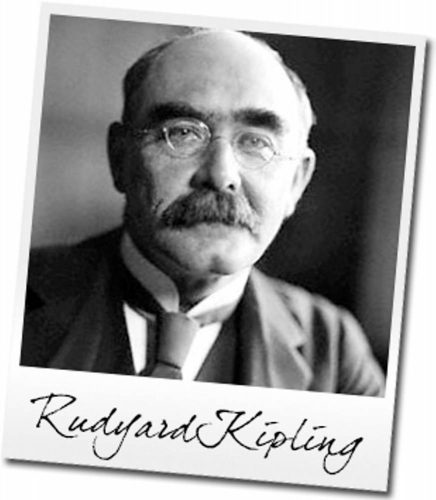
Als je je levenswerk vernietigd kunt zien en zo weer aan de slag kunt gaan.
Als je kan hard zijn en nooit woedend.
Als je kan trouw blijven wanneer alle anderen dat niet zijn.
Als je kan stand houden wanneer er niets mee overblijft
dan je eigen wil die zegt 'hou stand'
Tweede en derde strofe uit IF van Kipling
Vertaald door Francis Van den Eynde en tekst op zijn doodsprentje
00:19 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis van den eynde, flandre, belgique, mouvement flamand, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



