samedi, 21 février 2026
La Noomachie comme alchimie politique selon Evgueni Golovine

La Noomachie comme alchimie politique selon Evgueni Golovine
Martin Kovac
Bron: https://www.facebook.com/martin.kovac.3511
L'œuvre monumentale de Douguine, Noomachie (la Guerre des logos), n'est pas seulement une théorie des relations internationales, mais une tentative d'opérations magiques à l'échelle des civilisations. En y regardant de plus près, on constate que l'architecture de ce temple de la pensée est une systématisation des visions ésotériques de « l'Amiral » de l'underground soviétique, Evgueni Golovine.

La guerre qui précède l'histoire
Pour l'homme moderne, la guerre est un conflit pour les ressources, les territoires ou les sphères d'influence. Pour Alexandre Douguine, la véritable guerre ne se déroule pas sur le terrain, mais dans le Nous – dans l'Intellect. Le concept de Noomachie chez Douguine repose sur l'hypothèse qu'il n'existe pas une seule vérité ni un seul esprit humain. Il y a trois « Logos » inconciliables – trois façons de créer le monde – qui s'affrontent dans une lutte éternelle à la mort et à la vie.
L'histoire n'est pas un progrès linéaire de la barbarie aux Lumières, mais un drame cyclique où domine l'un de ces principes. Pour comprendre ce conflit métaphysique, il faut revenir aux idées du Cercle Južinskij (Youjinski).

Evgueni Golovine et Alexandre Douguine en 2003.
La figure centrale de ce groupe, auquel Alexandre Douguine a adhéré en 1980, était Evgueni Golovine (1938–2010). Poète, alchimiste et mystique, surnommé « l'Amiral » par ses disciples, il était le centre silencieux d'une tempête intellectuelle. C'est lui qui a apporté au cercle les idées de l'ésotérisme traditionnel, de l'alchimie et du mythe de l'Hyperborée – la patrie originelle de l'esprit du Nord. Pour Golovine, le monde n'était pas une «réalité objective», mais un texte ou une alchimie à retentir, qu'il faut lire ou briser correctement.
Trois Logos : Apollon, Cybèle et Dionysos
La Noomachie de Douguine repose sur une triade, qui est une application directe des leçons hermétiques de Golovine sur l'histoire de la philosophie:

- Logos d'Apollon (Père Céleste): lumière, verticalité, ordre, distance. C'est le monde des idées platoniciennes, où l'essentiel est en haut et la matière en bas n'est qu'une ombre. C'est le principe de « l'exclusion » – la vérité n'est qu'une.

- Logos de Cybèle (Grande Mère) : obscurité, horizontalité, matière, chair. C'est le monde du matérialisme, où « tout vient d'en bas ». L'homme n'est qu'un animal intelligent, l'esprit n'est qu'une chimie du cerveau. Cybèle gouverne par la masse, le marché et la technologie.

- Logos de Dionysos (Logos Obscur) : la clé se trouve ici. Dionysos est l'intermédiaire. Il n'est ni la lumière stérile d'Apollon, ni la boue de Cybèle. C'est le « soleil de minuit », un dieu qui meurt et ressuscite. C'est le principe du paradoxe.
Le diagnostic de la modernité chez Douguine est impitoyable: nous vivons à l'époque du Triomphe de Cybèle. La civilisation occidentale, le libéralisme, le capitalisme et le matérialisme scientifique sont des manifestations de la domination du Logos Noir de la Mère Terre. L'esprit a été englouti par la matière. La verticalité a été renversée et remplacée par l'horizontalité.
L'alchimie de l'eau noire: la clé de Golovine
L'originalité de la conception de Douguine – et l'endroit où elle correspond le plus avec celle de Golovine – réside dans la distinction entre « Ténébreux » et « Noir ». La plupart des penseurs occidentaux (y compris Nietzsche) avaient tendance à tout jeter dans un même sac, irraisonnable et ténébreux. Golovine enseignait cependant une fine distinction d'ordre alchimique. Il y a la Nigredo – le noir fécond, l'obscurité de la terre dont naît la vie (Dionysos). Et il y a l'Aqua Nigra – l'eau noire, liquide putréfié qui dissout les formes et mène à la destruction de l'esprit dans la boue de la matière. Golovine soutenait que la modernité n'était pas dionysiaque (comme certains romantiques le pensaient), mais une magie de l'Aqua Nigra. C'est un processus de décomposition, non d'extase. Douguine a emprunté cette idée pour purifier Dionysos. La Russie, dans son rôle géopolitique, ne doit pas être « l'empire de la lumière » (ce qui serait naïf), mais le porteur d'une force capable de descendre dans l'enfer de la modernité sans s'y dissoudre.

Reine des Neiges et Sujet Radical
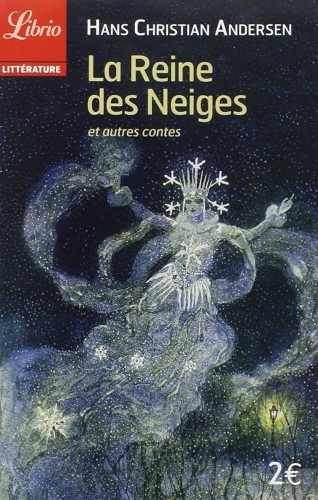 L'apogée de cette référence ésotérique est le concept de « Sujet Radical », que Douguine a tiré de l'interprétation de Golovine de la Reine des Neiges d'Andersen. Golovine inverse la signification de cette histoire: la Reine des Neiges n'est pas un mal absolu. Elle symbolise l'Intellect pur, cristallin, de l'Extrême Nord. Le petit Kay, dont un éclat de miroir a pénétré l'œil, ne voit pas le monde « déformé », comme le prétend le conte. Il le voit véritablement – il perçoit le vide et la laideur du monde bourgeois et chaud des hommes (le monde de Cybèle). Gerda, qui le « sauve » avec ses larmes et sa chaleur, le ramène en réalité dans la boue de la banalité, dans le monde des « couples et de la bière ». Le porteur du « Sujet Radical » est celui qui porte dans son cœur un éclat glacial du Nord. C'est l'homme qui refuse le diktat de la matière, du confort et des valeurs libérales. C'est l'aristocrate de l'esprit au milieu du marché.
L'apogée de cette référence ésotérique est le concept de « Sujet Radical », que Douguine a tiré de l'interprétation de Golovine de la Reine des Neiges d'Andersen. Golovine inverse la signification de cette histoire: la Reine des Neiges n'est pas un mal absolu. Elle symbolise l'Intellect pur, cristallin, de l'Extrême Nord. Le petit Kay, dont un éclat de miroir a pénétré l'œil, ne voit pas le monde « déformé », comme le prétend le conte. Il le voit véritablement – il perçoit le vide et la laideur du monde bourgeois et chaud des hommes (le monde de Cybèle). Gerda, qui le « sauve » avec ses larmes et sa chaleur, le ramène en réalité dans la boue de la banalité, dans le monde des « couples et de la bière ». Le porteur du « Sujet Radical » est celui qui porte dans son cœur un éclat glacial du Nord. C'est l'homme qui refuse le diktat de la matière, du confort et des valeurs libérales. C'est l'aristocrate de l'esprit au milieu du marché.
Conclusion: la politique comme magie noire
La Noomachie révèle que le projet politique de Douguine (la Quatrième Théorie Politique) n'est pas une science politique, mais une théologie de la guerre. Douguine a rassemblé les perles hermétiques de son maître Golovine – destinées à un cercle restreint d'initiés – et, avec celles-ci, il a forgé une arme. Tandis que Golovine restait « Amiral » du navire qui naviguait sur les eaux du monde et ignorait totalement le monde politique, sans même chercher à le changer, Douguine a décidé d'y faire couler cette «eau noire». Sa lutte contre «l'Occident» est essentiellement une tentative d'expulser Cybèle, une gigantomachie, une collision entre continents invisibles de l'esprit. Comprendre Douguine, c'est réaliser que son combat métaphysique dure tant que Cybèle règne. Cette guerre est pour lui une nécessité ontologique, un chemin vers la restauration de la verticalité.
20:17 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, evgueni golovine, alexandre douguine, noomachie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 février 2026
Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien

Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien
Martin Kovac
Source: https://www.facebook.com/martin.kovac.3511
Fissure ontologique au cœur du Monde
La guerre que nous observons sur le plan physique (Hylé – la matière) n’est pas simplement un affrontement d’intérêts nationaux ou de stratégies géopolitiques. C’est une résonance nécro-mantique, une ombre matérielle projetée par une fracture géante vieille de mille ans dans la noosphère de l’humanité. Ce que nous appelons « Occident » et « Orient » ne sont pas des directions géographiques, mais deux systèmes opérationnels fondamentaux inscrit dans la réalité, qui ont perdu la capacité de partager un protocole commun de l’Être.
1. L'OUEST : Architecture du Contrat et Désacralisation (Domination du Logos)
L’ontologie occidentale, issue du droit romain et de la définition scolastique de Dieu, est une structure linéaire et contractuelle. En introduisant le Filioque (l’Esprit qui procède du Fils), l’Occident a rationalisé le Mystère. L’Esprit est devenu compréhensible, donc manipulable par la raison humaine (Ratio).
- Conséquence pour la réalité: le monde est devenu un « projet » à achever. La sacralité a été séparée du profane, ce qui a permis l’émergence de la science et de la technique – des outils pour dominer la matière.
- Manifestation géopolitique: la civilisation occidentale est une technocratie expansive. Son essence est le Progrès (le mouvement en avant dans le temps). La paix est pour elle un état où les « Règles » (Contrat) sont respectées. Quiconque refuse ces règles n’est pas seulement un ennemi, mais une « erreur dans le code » qu’il faut corriger (démocratiser, éduquer, intégrer). Le modèle occidental est centripète – il veut transformer le monde entier à son image par la standardisation.
2. L'EST : Architecture de l’Icone et du Katechon (Domination du Noos)
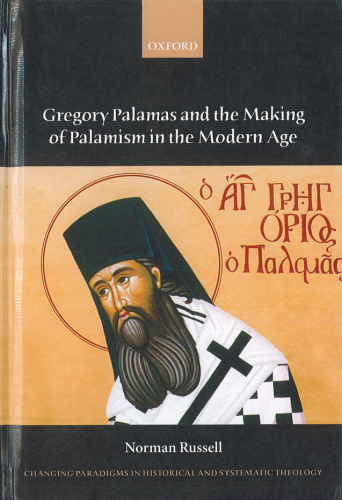 L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).
L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).
- Conséquence pour la réalité: le monde n’est pas une machine à améliorer, mais une «Icône» à vénérer et à protéger. Le temps n’est pas un progrès, mais une entropie (déchéance), à laquelle il faut résister.
- Manifestation géopolitique: la civilisation orientale (Eurasie) est comprise comme le Katechon – «Celui qui retient» (l’arrivée de l’Antichrist/du Chaos). Son essence est la Tradition (l’arrêt du temps). La paix n’est pas la conformité aux règles, mais un état de Symphonie (harmonie spirituelle), souvent acquis par la souffrance ou la soumission à une hiérarchie. La guerre pour l’Orient n’est pas un échec diplomatique, mais une fièvre métabolique nécessaire pour brûler une infection étrangère (modernisme, libéralisme) qui menace l’âme de l’organisme.
COLLISION MORTELLE : La confrontation entre le Temps et l’Éternité
La tragédie du moment présent réside dans le fait que ces deux systèmes ont perdu leur langage commun.
- Pour l’Occident, l’Orient est une anomalie pathologique — un vestige archaïque et irrationnel du passé qui refuse la «fin de l’histoire» et le bonheur du consommateur. L’Occident y voit la Tyrannie.
- Pour l’Orient, l’Occident est une hérésie ontologique – une machine froide qui dévore les âmes, brise les familles et les clans en atomes (individus), et remplace Dieu par un Algorithme. L’Orient y voit l’Apocalypse.
En Ukraine et dans d’autres lignes de fracture, nous voyons non pas une lutte pour le territoire, mais une collision de deux métaphysiques. C’est une guerre entre la Forme (l’Occident), qui cherche à imposer un ordre au monde, et l’Énergie (l’Orient), qui se défend contre la pétrification. Jusqu’à ce que cette union alchimique de ces principes – la guérison du schisme entre la Tête (Logos) et le Cœur (Noos) – ait lieu, le Hylé (la matière) continuera de saigner. Le monde est malade parce que ses deux hémisphères se battent pour contrôler le corps, tandis que l’âme reste silencieuse au milieu du feu croisé.

RETRAITE DU LOGOS ET RETOUR DU JUGE
La chute occidentale sous la gravité de la Loi
Le paradoxe du cercle civilisateur occidental en 2026 est qu’il, dans son orgueil de «progrès» et de «liberté», revient inconsciemment dans le temps. L’Occident, né du mystère de l’Évangile — donc de la radicale surmontée de la loi par l’amour et la grâce — a abandonné cette source fondamentale. Dans sa quête de sécularisation et de rationalisation, il a effectué un changement ontologique fatal: il a rejeté le Christ (le Pardonneur) et a inconsciemment réinstallé l’archétype de l’Ancien Testament dans sa forme la plus rigide et pharisienne.
a) Hypertrophie de la Loi et atrophie de la Grâce
La société occidentale est devenue une Communauté du Contrat, pas du Spiritus.
- Diagnostic: l’Évangile a apporté au monde le concept de Metanoia (changement de mentalité) et de Pardon. Le pardon est la seule force capable de briser la chaîne causale de la culpabilité et de la punition (karma). Cependant, avec la «mort de Dieu», l’Occident a perdu la verticale d’où vient la grâce.
- Manifestation: ce qui reste, c’est la Loi horizontale. Le libéralisme moderne, la correction politique et la «cancel culture» ne sont pas des expressions de tolérance, mais de nouveaux Lévitiques séculiers. Ce sont des codes de pureté. Quiconque touche à la «propreté» (mauvaise opinion, péché historique) est rituellement exclu de la société. Il n’y a pas de pénitence, seulement une élimination ou une ostracisation sociale. L’Occident est devenu un Grand Inquisiteur, tenant dans sa main l’épée des lois et des droits de l’homme, mais sans Caritas (Amour) dans le cœur.
b) Mécanisation de la Justice: Œil pour œil, sanction pour sanction
La perte de l’aspect évangélique a replongé l’Occident dans la causalité.
- Piège ontologique: sans le principe de la Grâce, la réalité devient un mécanisme impitoyable de «flux et reflux». La géopolitique et la politique intérieure occidentale fonctionnent selon le principe de la rétribution. C’est un retour à la Lex Talionis archaïque, mais sophistiqué par le langage bureaucratique des tribunaux internationaux.
- Conséquence: l’Occident ne sait plus guérir, il ne sait que juger. Face à l’Orient (et au reste du monde), il agit comme un Procureur qui lit une liste d’infractions et réclame satisfaction. En cela, il se prive de la possibilité d’être le «Sel de la Terre». Le sel conserve et donne du goût; l’Occident est devenu une acide qui veut tout ronger jusqu’à ce que tout corresponde à la norme.

c) La cristallisation du Cœur: la fin de l’histoire du Salut
En absolutisant les «Règles» (rules-based order), l’Occident s’est enfermé lui-même dans l'Hylé (la matière) et le Logos (la raison), mais s’est coupé du Pneuma (l’Esprit).
- Effondrement: une société qui a remplacé l’Amour du prochain par l’obligation envers le système tend inévitablement vers le totalitarisme. Il s’agit d’un totalitarisme du «Bien», mais défini par des juristes et des technocrates, pas par des saints. L’Occident construit un «Palais de Cristal» — parfaitement transparent, hygiénique, sûr, mais froid et sans vie.
- Diagnostic final: l’Occident meurt par sous-nutrition spirituelle. Il a échangé la liberté inconfortable et risquée de l’Évangile contre la cage sécurisante mais étouffante de la Loi. Il devient ce contre quoi Christ a autrefois lutté: un temple où l’on marchandise la culpabilité, où la lettre de la loi tue l’Esprit. Et tant que l’Occident ne retrouvera pas la force de la Grâce — c’est-à-dire la capacité de voir, au-delà des contrats et des normes, le vivant — sa construction civilisationnelle s’effondrera sous le poids de sa propre justice impitoyable.
17:42 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orient, occident, philosophie, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 février 2026
Le paganisme de Tolkien
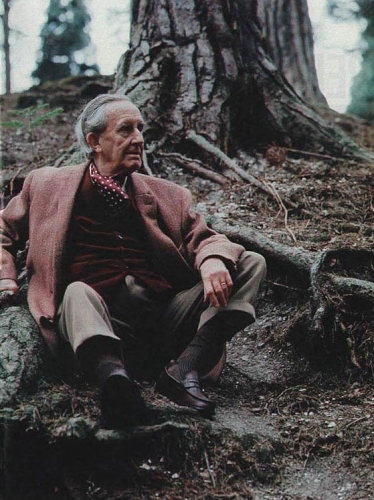
Le paganisme de Tolkien
Sergio Valero Ruiz
L'œuvre de Tolkien est catholique, aussi catholique que l'âme elle-même. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un paganisme réinterprété et recouvert de christianisme. Dans ses propres lettres, l'auteur affirme que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre religieuse et catholique, mais qu'il n'en a pris conscience qu'après l'avoir écrite et révisée.
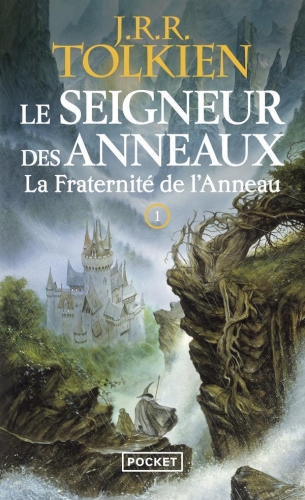 « Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »
« Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »
Et en effet, son œuvre est catholique. Juste qu'il faut rappeler ce qu'est le catholicisme: un paganisme revêtu a posteriori de christianisme. Un paganisme qui transparaît à travers l'histoire, l'art et le symbolisme. Le religieux est implicite, comme il le souligne lui-même, car cet héritage païen est inconscient. Il y a une spiritualité, une religiosité fusionnée dans l'intrigue et la symbolique — mais ce n’est pas celle du récit hébraïque, mais celle d'une épopée européenne et d'une métaphysique propre à l'Antiquité pré-chrétienne. Seulement, cette dernière est reformulée dans le contexte chrétien, comme l'ont fait les premiers chrétiens de leur temps.
Tolkien croyait, tout comme certains des premiers chrétiens qui se nourrissaient de sources païennes, que le paganisme était une moitié de vérité, où pouvait se deviner la véritable vérité chrétienne ultérieure. Et ainsi, ils percevaient le paganisme comme un antécédent, une préparation au message du Christ. À l’image de Nicolás Gómez Dávila, qui disait que le christianisme possédait deux anciens testaments: la Bible juive et l’Antiquité classique. De cette façon, son christianisme conscient et son paganisme inconscient s'harmonisaient, tout en justifiant la consommation de la coupe des démons (comme on disait boire aux sources classiques). Cependant, la réalité nous montre qu’au sein de la vision du monde spirituelle européenne, le paganisme a été nécessaire, tandis que le christianisme est contingent.
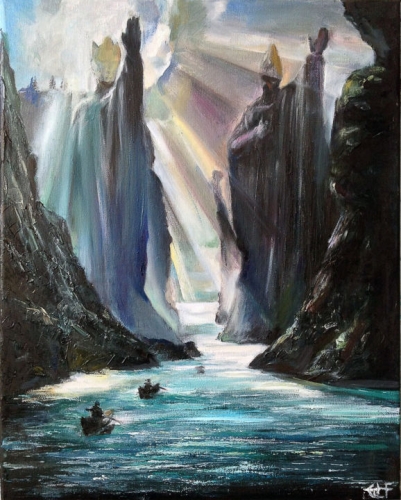
Le débat ne porte pas sur le fait que l'œuvre de Tolkien soit catholique ou non, ni même si Tolkien lui-même était très religieux. La réponse à ces deux questions est un oui profond et catégorique. La véritable question est bien plus ancienne et a été discutée dès l'époque de Celse, Porphyre et Julien l’Apostat: que le christianisme puise dans le paganisme sa théologie, son anthropologie et sa métaphysique. Le paganisme existe par lui-même, mais le christianisme, en particulier dans sa forme catholique, ne peut exister que grâce au paganisme. Car sans le paganisme, celui que les Pères de l’Église méprisaient tout en en buvant le nectar, le christianisme ne serait qu’une des nombreuses sectes juives. Et ce que l'œuvre de Tolkien expose a peu de choses à voir avec une secte juive du Moyen-Orient, et beaucoup avec une vision du monde européenne archaïque.
Tout catholique a, qu'il le sache ou non, une âme païenne (littéralement, car le concept d'âme immortelle provient du platonisme). Et que, par conséquent, l'âme de Tolkien, ainsi que son œuvre, parce qu’elle est imprégnée de catholicisme, est essentiellement païenne. Tolkien, comme tout catholique, est un païen inconscient.
21:48 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, catholicisme, paganisme, j. r. r. tolkien, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 février 2026
La querelle du Groenland et la méditation d’Evola sur le mythe polaire

La querelle du Groenland et la méditation d’Evola sur le mythe polaire
Et si le mythe nordique raconte Mitgard, la Terre du Milieu, comme un pays vert, on pense immédiatement à la terre des Inuits : vert parce que le nom le suggère, dans un temps ancien, avant que la nuit et la glace ne la recouvrent, ne nous recouvrent.
par Luca Negri
Source: https://www.barbadillo.it/127643-la-querelle-groenlandia-...
Il y a toujours et en tout cas un Groenland à conquérir. Un pôle Nord, une demeure arctique dont nous venons peut-être et qui attend notre retour.
En somme, nous comprenons Donald Trump, qui veut mettre la main là-haut, dans le Grand Nord. Et nous comprenons le Danemark, qui défend une colonie conquise à une époque viking, brumeuse et épique. Nous comprenons l’UE, qui montre enfin un peu de fierté contre le nouveau continent, qui est le vrai adversaire géopolitique, tandis que la Russie est un allié naturel. Et nous comprenons aussi Poutine, qui ne serait pas contre le contrôle de l’île, car il n’y a jamais trop de glace. Nous comprenons surtout les raisons stratégiques, politiques et énergétiques des puissants qui veulent le Groenland. Nous les comprenons surtout sur le plan symbolique.

Nous les comprenons parce que nous avons lu et relu Révolte contre le monde moderne de Julius Evola, et le chapitre sur le mythe polaire nous a toujours fasciné. L’île ou la terre ferme arctique, écrivait l’ésotériste et philosophe italien, « représente la stabilité spirituelle opposée à la contingence des eaux ». Le centre de gravité permanent, pour parler comme Battiato, et donc avec Gurdjieff. Image du Soi, de l’ego absolu, de l’Atman hindou. De ce non-lieu en dehors de notre corps, qui en est pourtant l’origine et qui reste imperturbé, non blessé, non touché par les contingences, par la douleur de la vie incarnée.
Le Pôle est « le siège des hommes transcendents », écrivait encore Evola, en citant des traditions et enseignements archaïques. Et nous pouvons tous transcender.
Et si le mythe nordique raconte Mitgard, la Terre du Milieu, comme un pays vert, on pense immédiatement à Groenland : vert parce que le nom le suggère, dans un temps ancien, avant que la nuit et la glace ne la recouvrent, ne nous recouvrent.
« Source de races et de peuples », tel était-il encore considéré au Moyen Âge, dernière époque organique et traditionnelle.
De là, peut-être, nous venons tous. Comme d’un pôle métaphysique, nous descendons dans les vicissitudes de la matière et de l’Histoire.
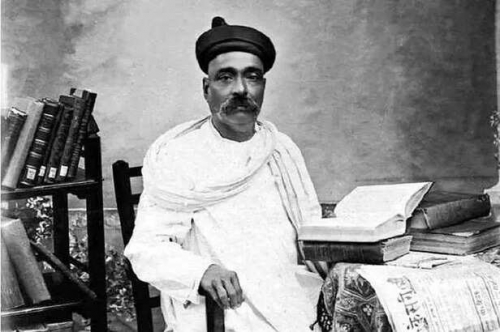
Cette « île de la splendeur » dans l’extrême nord, serait aussi une « demeure arctique » dans les Védas, selon l’enseignement de Bâl Gangâdhar Tilak (photo), nationaliste indien de confession shivaïte.
C’est peut-être l’ancienne Thule, rêvée et chantée par les Grecs. Île blanche dans la partie septentrionale de l’Atlantique, recherchée par le journaliste, essayiste et militant néo-païen Jean Mabire.
La terre des Hyperboréens, où Nietzsche se sentait idéalement chez lui, invitant ses lecteurs — qui sont tous et personne.
Car ni par la terre ni par la mer, on n'atteint Hyperborée, chantait Pindare. La Voie du Nord, l’« Uttara » hindoue, est dans le monde mais n’appartient pas au monde. Comme le centre géométrique non mesurable, il ne fait pas partie de la géométrie mais permet toute géométrie.
Donc, nous nous engageons surtout à reconquérir ce Pôle Nord.
Mais nous comprenons Trump et les autres puissants, qui peut-être inconsciemment, poussés par l’inconscient collectif, cherchent un peu de terre ferme dans ce monde de plus en plus liquide.
Ce serait une bonne et juste chose si, à partir de cette crise arctique, tout le monde était encouragé à conquérir un Groenland qui lui appartient.
En sortant du symbolique, en revenant à l’actualité, nous espérons néanmoins que la crise se résoudra pacifiquement. De préférence avec la fin de l’OTAN, l’Amérique aux Américains, l’Europe aux Européens (y compris les Russes) et le Groenland aux Groenlandais.
19:51 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, groenland, mitgard, mythe polaire, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 28 janvier 2026
Vers une stratégie traditionaliste globale

Vers une stratégie traditionaliste globale
Par Alexandre Douguine
Le problème ne réside pas dans le conflit entre les élites et les masses. Ce n’est pas si simple. Il existe deux types d’élites: l’élite spirituelle et l’élite satanique. Les deux tentent de diriger les masses dans des directions opposées. La modernité occidentale constitue l'apex de l’ascension des élites sataniques. Elles détiennent le pouvoir et répriment leurs ennemis, c’est-à-dire nous.
Les masses ne constituent pas un argument. Elles acceptent ce qu’on leur donne ; elles ne peuvent pas faire autrement. Elles ne font que refléter la sagesse réelle ou satanique de quelques-uns. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, comme la matière. C’est l’esprit qui décide de tout, et le diable est aussi esprit.
Tout le mal auquel nous faisons face aujourd’hui est très ancien. Il y a cent ans, il était déjà si évident que de grandes puissances et mouvements politiques ont commencé à le combattre. Mais ils ont perdu. Le mal a gagné en force. Nous vivons avec ses conséquences.
La démocratie consiste à ce que les masses votent et choisissent. Mais elles ne font que voter et choisir ce que les élites leur suggèrent. Les élites contrôlent la démocratie. C’est leur outil, leur machine. Qui contrôle l’élite contrôle tout le reste, y compris la démocratie.

Le globalisme est la conspiration mondiale des élites sataniques. Elles ont adopté sa forme définitive avec l’avènement de la modernité occidentale. Aujourd’hui, leur contrôle est presque total. Tel que le disent les Écritures. Mais choisir le bon camp dans cette bataille apocalyptique est le devoir de l’homme.
Les masses ne peuvent pas choisir. Elles suivent et obéissent. Seul l’homme d’élite choisit vraiment. Ce choix est réel, libre et toujours possible dans toutes circonstances, quelle qu’elle soit. Nous devons viser les élites sataniques si nous ne sommes pas d’accord avec leurs gouvernements sataniques. C’est la Révolution. Il n’y a pas d’autre option.
L’élite satanique est globale, unifiée, et totalement solidaire avec son siège central. C’est pourquoi tous les médias et réseaux qu’elle possède suivent exactement la même narration. L’élite mondiale est petite et très disciplinée. L’élite spirituelle qui lutte contre les mondialistes est divisée.
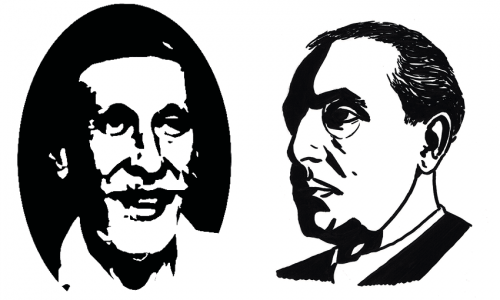
L’élite spirituelle est locale et limitée par la nation et la religion. Elle ne peut pas comprendre l’étendue réelle de l’ennemi mondial, l’Antikeimenos. Elle est faible et dispersée. Mais si elle est vraiment spirituelle, elle reconnaît tous ceux qui portent la marque de l’Esprit. Guénon et Evola ont préparé le terrain.
Le traditionalisme doit devenir une réalité stratégique concrète, un réseau révolutionnaire. Ce ne peut pas être un mouvement ou un parti. Il doit devenir autre chose. Nous pouvons imaginer ce qu’il devrait être en comparant ce que nous rejetons le plus dans toutes les questions régionales.
Ce que nous haïssons le plus dans tous les pays nous unit et prépare le terrain pour un niveau supérieur de pensée. Le traditionalisme doit devenir une stratégie globale. C’est la volonté d'aller résolument vers l’Ordre Civilisationnel. La civilisation signifie essentiellement la tradition.

En luttant concrètement pour notre civilisation contre la civilisation mondiale satanique, nous aidons d’autres civilisations à faire de même. Nous devons comprendre cela. C’est le point qui change les règles du jeu. Nous devons mettre en place l’Internationale Traditionaliste: futuriste et offensive, pas défensive.
Le principal problème des Blancs est qu’ils se sont identifiés à l’Occident, à la modernité, au colonialisme, au matérialisme, au capitalisme, à la technologie. Et tout cela tue (ou a déjà tué) la tradition sacrée que les Blancs possédaient depuis longtemps.
La tradition sacrée des Blancs a été détruite par eux-mêmes. Sans tradition, il n’y a pas de Blancs. Ce n’est pas un homicide, c’est un suicide. Les Blancs ont choisi le suicide, et ils l’ont reçu.
Que signifie être blanc ? Presque rien, sauf l’apparence physique. Sans valeurs sacrées, sans religion, sans racines. Seulement le succès économique et la cupidité capitaliste. Il n’y a plus aucune raison d’être blanc. Le globalisme a été créé et mis en œuvre par les Blancs.
Les Blancs globalistes voulaient que l’humanité soit exactement comme eux, et en partie, ils ont réussi. Mais à un moment donné, ils ont réalisé qu’il n’y avait plus aucune raison de rester blancs. Nous devions tous devenir des « universels ». Et c’est alors que la autodestruction des Blancs a commencé.
Blancs, ne blâmez pas les non-blancs pour votre propre extinction. Blâmez-vous vous-mêmes. Blâmez l’Occident. Blâmez la modernité.
15:25 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, tradition, traditionalisme, traditionalisme révolutionnaire, nouvelle droite, nouvelle droite russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 11 janvier 2026
Pierre Le Vigan: Entretien sur Mircea Eliade

Pierre Le Vigan: Entretien sur Mircea Eliade
Entretien paru dans la revue Ecrits de Rome n°24, consacré à Mircea Eliade, 2025.
1. Comment Mircea Eliade articule-t-il la notion de « sacré » dans ses travaux, et en quoi cette conception se distingue-t-elle des approches purement sociologiques ou phénoménologiques du religieux?
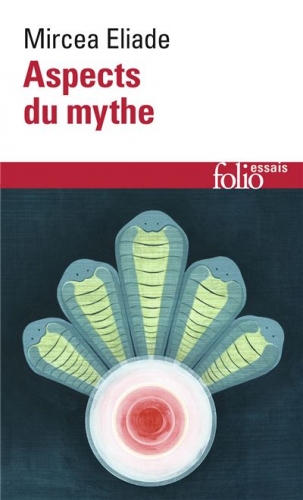 En tant qu’historien des religions, Eliade utilise la notion de sacré comme fil conducteur de son enquête. Pour lui, le sacré consiste en un lien permanent, au-delà de la mort, entre l’homme et le collectif. Le sacré suppose le « nous ». C’est pourquoi il n’y a que les sociétés individualistes qui peuvent prétendre se passer de sacré. Le lien du sacré consiste à être relié par quelque chose qui dépasse le domaine de l’immédiat. Cet au-delà de l’immédiat n’est pas pour autant le contraire du sensible. C’est un sensible qui passe par des archétypes. C’est un sensible au-delà du naturel – surnaturel – qui dévoile quelque chose. C’est pourquoi le sacré se manifeste par une épiphanie. La conception d’Eliade est avant tout mythologique. « Le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des ‘’commencements’’. » (Aspects du mythe, 1962). Images et mythes donnent sens à l’espace, au temps, et rendent compte de ce qui est originel dans le monde. C’est ce qui est à l’origine qui a le plus de force.
En tant qu’historien des religions, Eliade utilise la notion de sacré comme fil conducteur de son enquête. Pour lui, le sacré consiste en un lien permanent, au-delà de la mort, entre l’homme et le collectif. Le sacré suppose le « nous ». C’est pourquoi il n’y a que les sociétés individualistes qui peuvent prétendre se passer de sacré. Le lien du sacré consiste à être relié par quelque chose qui dépasse le domaine de l’immédiat. Cet au-delà de l’immédiat n’est pas pour autant le contraire du sensible. C’est un sensible qui passe par des archétypes. C’est un sensible au-delà du naturel – surnaturel – qui dévoile quelque chose. C’est pourquoi le sacré se manifeste par une épiphanie. La conception d’Eliade est avant tout mythologique. « Le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des ‘’commencements’’. » (Aspects du mythe, 1962). Images et mythes donnent sens à l’espace, au temps, et rendent compte de ce qui est originel dans le monde. C’est ce qui est à l’origine qui a le plus de force.
2. Dans quelle mesure la théorie de l’ « éternel retour » chez Eliade peut-elle être interprétée comme une réponse à la désacralisation du temps historique et plus généralement à la crise de la Modernité?
 Dans sa recherche pour faire apparaitre la morphologie du sacré, Eliade rencontre partout le thème de l’éternel retour. Le sacré consiste dans la célébration de l’éternel retour des commencements. Un retour qui se fait par la réactivation d’archétypes, c’est-à-dire par la répétition des mythes d’origine, non sans métamorphoses et variantes. « Un objet ou acte ne devient réel que dans la mesure où il imite ou répète un archétype. L’homme des cultures traditionnelles ne se reconnait comme réel que dans la mesure où il cesse d’être lui-même et se contente d’imiter et de répéter le geste d’un autre. » (Le mythe de l’éternel retour, 1949). Il s’agit ainsi de redevenir périodiquement le contemporain des dieux, en partageant avec eux l’accès à l’Etre qui nous est commun, aux hommes et aux dieux.
Dans sa recherche pour faire apparaitre la morphologie du sacré, Eliade rencontre partout le thème de l’éternel retour. Le sacré consiste dans la célébration de l’éternel retour des commencements. Un retour qui se fait par la réactivation d’archétypes, c’est-à-dire par la répétition des mythes d’origine, non sans métamorphoses et variantes. « Un objet ou acte ne devient réel que dans la mesure où il imite ou répète un archétype. L’homme des cultures traditionnelles ne se reconnait comme réel que dans la mesure où il cesse d’être lui-même et se contente d’imiter et de répéter le geste d’un autre. » (Le mythe de l’éternel retour, 1949). Il s’agit ainsi de redevenir périodiquement le contemporain des dieux, en partageant avec eux l’accès à l’Etre qui nous est commun, aux hommes et aux dieux.
L’éternel retour suppose ainsi une conception cyclique du temps. Dans cette conception, il peut y avoir coïncidence des contraires, un thème qui a passionné le jeune Eliade lors de ses études, en 1928, sur Marcile Ficin, Giordano Bruno et la Renaissance italienne. Il y a néanmoins des exceptions à la conception cyclique du temps. Ce sont les monothéismes (judaïsme, christianisme, islam). Ces derniers adoptent une conception linéaire du temps. Toutefois, le caractère cyclique des rites corrige cet aspect. Si le mouvement du temps, cyclique ou linéaire, est ce qui laisse apparaitre le sacré (hiérophanie), c’est dans le registre de l’éternel, du permanent, de ’’ce qui ne passe pas’’, que se situe le sacré. Celui-ci est verticalité, axe du monde et arbre du monde. Ce sens de la verticalité est universel. On retrouve partout les prières au Père céleste. Le ciel tient toujours une place éminente dans le sacré. Le mythe serait que Dieu, après avoir créé la terre et les hommes, aurait, dans tous les sens du terme, pris de la hauteur et serait monté au ciel.
En tout état de cause, le recours au sens de la verticalité (et du Père) est l’antidote à l’horizontalisation qui est le propre du monde moderne. A une condition toutefois : ne pas nier l’importance du sensible, de l’immédiat, du terrestre, du quotidien. Car si le quotidien n’est pas le sacré, c’est le terreau du sacré. Aussi, l’opposition entre le sacré et le profane est-elle, en fait, plutôt une complémentarité. « Lorsque quelque chose de "sacré" se manifeste (hiérophanie), en même temps, quelque chose "s'occulte", devient cryptique. Là est la vraie dialectique du sacré : par le seul fait de se montrer, le sacré se cache ». (Fragments d’un journal, 1973). Sachant que, en outre, dans certaines conditions, le profane peut devenir le sacré (avant-propos à Le sacré et la profane, 1965). Sacré et profane sont ainsi deux modes d’être au monde. « En dernière instance, les modes d'être sacré et profane dépendent des différentes positions que l'homme a conquises dans le Cosmos ; ils intéressent aussi bien le philosophe que tout chercheur désireux de connaître les dimensions possibles de l'existence humaine. »
3. Comment Eliade justifie-t-il sa méthode comparatiste dans l'étude des mythes et des symboles ? Cette méthode ne suppose-t-elle pas de postuler l'existence de structures fondamentales du religieux?
 Comparer suppose une échelle de comparaison, donc un étalon universel. Pour Eliade, c’est l’universalité de l’aspiration au sacré. Dans son enquête comparative sur les différentes manifestations du fait religieux, Eliade ne se contente pas de montrer l’influence de l’histoire et la culture. Bien entendu, le fait religieux est historico-culturel. (Exemple : le culte de la Terre-Mère a un lien, souligne Eliade, avec la découverte de l’agriculture). Mais il n’est pas que cela. Il est anthropologique. Il relève d’une exigence universelle de produire des mythes, des symboles, des images. De faire vivre un imaginaire. Si l’idée du divin est universelle, elle se manifeste sous des formes spécifiques selon les peuples. « Les formes historico-religieuses ne sont que les expressions infiniment variées de quelques expériences religieuses fondamentales. » (Fragments d’un journal). Le sacré est le passage entre l’Idée et la forme, pour le dire avec les mots de Platon. Mais selon Eliade, l’homme moderne post-religieux s’est débarrassé de l’idée du divin. L’homme moderne ne donne plus sens au monde à partir du divin, c’est à partir de l’idée d’une harmonie cosmique qui englobe les hommes, la nature et transcende le temps historique. Le temps : image mobile de l’immobile éternité. Au contraire, l’homme moderne donne un sens au monde uniquement à partir de sa liberté inconditionnée. L’homme se désacralise lui-même et « ne sera véritablement libre qu’après qu’il aura tué le dernier Dieu » (Le sacré et le profane). Il y a ici une proximité entre ce que dit Eliade et les propos de Nietzsche et d’Heidegger. Or, même le plus acharné des positivistes n’échappe pas à la quête de l’origine et au souci d’élucider la généalogie de l’homme, souci à la fois scientifique et métaphysique. « La science du côté du jour, la poésie du côté de la nuit », dit Eliade (L’épreuve du labyrinthe, 1978). Même les scientismes sont des mythologies laïcisées. Même les idéologies messianiques se voulant laïques sont des formes de théologie politique. Eliade suit ici Carl Schmitt plutôt que Hans Blumenberg ou Erik Peterson.
Comparer suppose une échelle de comparaison, donc un étalon universel. Pour Eliade, c’est l’universalité de l’aspiration au sacré. Dans son enquête comparative sur les différentes manifestations du fait religieux, Eliade ne se contente pas de montrer l’influence de l’histoire et la culture. Bien entendu, le fait religieux est historico-culturel. (Exemple : le culte de la Terre-Mère a un lien, souligne Eliade, avec la découverte de l’agriculture). Mais il n’est pas que cela. Il est anthropologique. Il relève d’une exigence universelle de produire des mythes, des symboles, des images. De faire vivre un imaginaire. Si l’idée du divin est universelle, elle se manifeste sous des formes spécifiques selon les peuples. « Les formes historico-religieuses ne sont que les expressions infiniment variées de quelques expériences religieuses fondamentales. » (Fragments d’un journal). Le sacré est le passage entre l’Idée et la forme, pour le dire avec les mots de Platon. Mais selon Eliade, l’homme moderne post-religieux s’est débarrassé de l’idée du divin. L’homme moderne ne donne plus sens au monde à partir du divin, c’est à partir de l’idée d’une harmonie cosmique qui englobe les hommes, la nature et transcende le temps historique. Le temps : image mobile de l’immobile éternité. Au contraire, l’homme moderne donne un sens au monde uniquement à partir de sa liberté inconditionnée. L’homme se désacralise lui-même et « ne sera véritablement libre qu’après qu’il aura tué le dernier Dieu » (Le sacré et le profane). Il y a ici une proximité entre ce que dit Eliade et les propos de Nietzsche et d’Heidegger. Or, même le plus acharné des positivistes n’échappe pas à la quête de l’origine et au souci d’élucider la généalogie de l’homme, souci à la fois scientifique et métaphysique. « La science du côté du jour, la poésie du côté de la nuit », dit Eliade (L’épreuve du labyrinthe, 1978). Même les scientismes sont des mythologies laïcisées. Même les idéologies messianiques se voulant laïques sont des formes de théologie politique. Eliade suit ici Carl Schmitt plutôt que Hans Blumenberg ou Erik Peterson.
Toutefois, ces théologies politiques modernes sont strictement adossées à l’histoire (le Reich pour 1000 ans, la succession inéluctable des modes de production jusqu’à l’étape finale du communisme), ou, pire, à une vision de l’homme post-politique, donc revenant sur les acquis d’Aristote, comme l’eschatologie libérale d’un homme totalement déconditionné de ses invariants historiques, culturels et même anthropologiques. Avec le transhumanisme comme point d’aboutissement de l’aventure humaine. Ultime grand récit progressiste. Un homme transhistorique et transgenre. Or, ces théologies politiques modernes (même quand elles se veulent post-politiques, ce qui revient à transférer le politique dans l’économique) ne sont pas de nature à chasser l’angoisse de l’homme, nous dit Eliade. Elles sont trop fragiles. C’est pourquoi l’homme moderne n’échappe pas au sentiment de l’absurde (Albert Camus) et à l’angoisse, voire à la terreur existentielle qui l’accompagne. C’est la rançon, dit Sartre, de la plus totale liberté. Totale liberté ou liberté illusoire ? C’est là la question.
 Dans son constat de ce que l’éloignement de la religion provoque une augmentation de l’angoisse de l’homme face à une histoire qui perd son sens et apparait, dès lors, chaotique, Eliade postule l’existence de structures fondamentales du religieux. Elles permettent d’opposer le monde traditionnel, même si les formes religieuses qui l’innervent sont très variées, au monde moderne, qui a laissé dépérir ces formes. On ne s’étonnera donc pas du fait qu’Eliade admirait René Guénon. Toutefois, dans ces structures du religieux, nous savons que les monothéismes occupent une place à part par la conception linéaire du temps. Le christianisme est lui-même très singulier au sein des monothéismes. Il accepte que le sacré entre dans l’histoire. ’’Dieu s’est fait homme’’ est un événement à la fois historique et ontologique. Cela doit permettre à l’homme de sortir de l’angoisse de l’histoire. Mais dans le même temps, Eliade montre que le christianisme est la religion de l’homme qui ne croit plus à l’éternel retour ni aux archétypes primordiaux. C’est en ce sens, dit Eliade, la religion de l’ « homme déchu » (le thème du péché originel y est bien sûr pour quelque chose).
Dans son constat de ce que l’éloignement de la religion provoque une augmentation de l’angoisse de l’homme face à une histoire qui perd son sens et apparait, dès lors, chaotique, Eliade postule l’existence de structures fondamentales du religieux. Elles permettent d’opposer le monde traditionnel, même si les formes religieuses qui l’innervent sont très variées, au monde moderne, qui a laissé dépérir ces formes. On ne s’étonnera donc pas du fait qu’Eliade admirait René Guénon. Toutefois, dans ces structures du religieux, nous savons que les monothéismes occupent une place à part par la conception linéaire du temps. Le christianisme est lui-même très singulier au sein des monothéismes. Il accepte que le sacré entre dans l’histoire. ’’Dieu s’est fait homme’’ est un événement à la fois historique et ontologique. Cela doit permettre à l’homme de sortir de l’angoisse de l’histoire. Mais dans le même temps, Eliade montre que le christianisme est la religion de l’homme qui ne croit plus à l’éternel retour ni aux archétypes primordiaux. C’est en ce sens, dit Eliade, la religion de l’ « homme déchu » (le thème du péché originel y est bien sûr pour quelque chose).
4. Quelle est la place de l’expérience personnelle et autobiographique dans la construction de la pensée religieuse d’Eliade ?
 On ne peut dissocier les analyses d’Eliade des questions qui le hantent. Celles-ci tournent autour de l’histoire et du cortège de malheurs qu’elle véhicule. D’où son rejet de l’historicisme. Sa conception de l’histoire comme source d’angoisse est proche de celle de Walter Benjamin. Le sacré est re-création du monde. Contre les malheurs de l’histoire. Contre l’histoire comme malheur. Eliade écrit : « Que peut signifier ’’incipit vita nova’’ ? La reprise de la Création. Le combat de l’homme contre l’ ’’histoire’’, contre le passé irréversible. » (Journal, 5 septembre 1943). Eliade est un esprit inquiet. Très marqué par son enfance, il publie tôt un roman autobiographique, « Le roman de l’adolescent myope ». La question de l’identité, personnelle et collective, est très vite son thème principal. Il n’hésite pas à l’explorer en « se quittant lui-même », par des voyages, par le yoga, et aussi par des amours passionnés. Ses divers écrits littéraires témoignent de son intérêt pour une alchimie de l’érotisme. C’est bien entendu en fonction de cet éclairage – la fascination pour ce qui est initial – qu’il faut comprendre ses sympathies pour la Garde de Fer, aussi appelé le « mouvement légionnaire » de Codreanu (Ce dernier sera assassiné en 1938), des sympathies du reste partagées par nombre de grands intellectuels roumains comme le philosophe Nae Ionescu et le jeune Cioran. Il s’agit pour Eliade de viser à une résurrection de la Roumanie. Ses sympathies, non inconditionnelles, pour ce mouvement nationaliste profondément mystique, sont une manifestation de son rejet de la modernité. Il n’oppose toutefois pas la spiritualité au corporel. C’est le dualisme corps–âme qu’il rejette.
On ne peut dissocier les analyses d’Eliade des questions qui le hantent. Celles-ci tournent autour de l’histoire et du cortège de malheurs qu’elle véhicule. D’où son rejet de l’historicisme. Sa conception de l’histoire comme source d’angoisse est proche de celle de Walter Benjamin. Le sacré est re-création du monde. Contre les malheurs de l’histoire. Contre l’histoire comme malheur. Eliade écrit : « Que peut signifier ’’incipit vita nova’’ ? La reprise de la Création. Le combat de l’homme contre l’ ’’histoire’’, contre le passé irréversible. » (Journal, 5 septembre 1943). Eliade est un esprit inquiet. Très marqué par son enfance, il publie tôt un roman autobiographique, « Le roman de l’adolescent myope ». La question de l’identité, personnelle et collective, est très vite son thème principal. Il n’hésite pas à l’explorer en « se quittant lui-même », par des voyages, par le yoga, et aussi par des amours passionnés. Ses divers écrits littéraires témoignent de son intérêt pour une alchimie de l’érotisme. C’est bien entendu en fonction de cet éclairage – la fascination pour ce qui est initial – qu’il faut comprendre ses sympathies pour la Garde de Fer, aussi appelé le « mouvement légionnaire » de Codreanu (Ce dernier sera assassiné en 1938), des sympathies du reste partagées par nombre de grands intellectuels roumains comme le philosophe Nae Ionescu et le jeune Cioran. Il s’agit pour Eliade de viser à une résurrection de la Roumanie. Ses sympathies, non inconditionnelles, pour ce mouvement nationaliste profondément mystique, sont une manifestation de son rejet de la modernité. Il n’oppose toutefois pas la spiritualité au corporel. C’est le dualisme corps–âme qu’il rejette.
5. Finalement, peut-on considérer l’œuvre d’Eliade comme une tentative de réenchantement du monde?
 Max Weber a parlé du désenchantement du monde (Entzauberung der Welt) comme conséquence du rationalisme et de la technique. Eliade aspirait à un réenchantement du monde. Mais il pensait qu’il n’y a religion que quand Dieu n’est plus là. « (...) les mythes et les ’’religions’’, dans toute leur variété, sont le résultat du vide laissé dans le monde par la retraite de Dieu, sa transformation en deus otiosus [un Dieu qui crée le monde mais ne s’occupe pas de son destin, d’où son nom de ‘’dieu oisif’’] et sa disparition de l'actualité religieuse. (...) A-t-on compris que la ’’vraie’’ religion ne commence qu'après que Dieu s'est retiré du monde ? Que sa ’’transcendance’’ se confond et coïncide avec son éclipse ? » (Fragments d’un journal). Eliade espérait moins le renouveau des religions qu’il ne visait le retour du sacré.
Max Weber a parlé du désenchantement du monde (Entzauberung der Welt) comme conséquence du rationalisme et de la technique. Eliade aspirait à un réenchantement du monde. Mais il pensait qu’il n’y a religion que quand Dieu n’est plus là. « (...) les mythes et les ’’religions’’, dans toute leur variété, sont le résultat du vide laissé dans le monde par la retraite de Dieu, sa transformation en deus otiosus [un Dieu qui crée le monde mais ne s’occupe pas de son destin, d’où son nom de ‘’dieu oisif’’] et sa disparition de l'actualité religieuse. (...) A-t-on compris que la ’’vraie’’ religion ne commence qu'après que Dieu s'est retiré du monde ? Que sa ’’transcendance’’ se confond et coïncide avec son éclipse ? » (Fragments d’un journal). Eliade espérait moins le renouveau des religions qu’il ne visait le retour du sacré.
20:42 Publié dans Entretiens, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mircea eliade, traditions, entretiens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 janvier 2026
Inquiet et inquiétant mois de janvier
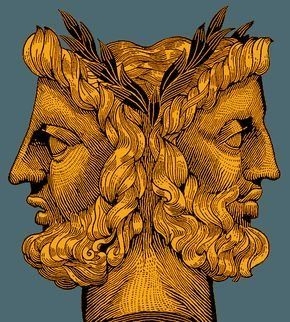
Inquiet et inquiétant mois de janvier
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/inquieto-e-inquietante-gennaio/
En somme, le mois de janvier a commencé. Il y a peu de temps, mais cela a suffi. L’euphorie, pour dire la vérité, assez fausse et un peu forcée, de la veille, a laissé la place aux cendres. À une saveur amère dans la bouche.
C’est un mois froid, même si les jours commencent à rallonger. Froid et inhospitalier. À tel point qu’autrefois, il était le premier des deux mois intercalaires. Même pas indiqué sur le calendrier antique que, par convention, nous appelons le calendrier de Romulus. Qui, cependant, remonte à une époque bien plus ancienne. À une époque où les ancêtres des Latins vivaient bien plus au Nord. Dans des régions subpolaires.
À cette époque, la vie s’arrêtait. Elle stagnait pendant deux mois. Jusqu’à la fin février, mois des fièvres et de la purification.
Et janvier était un mois mort. Un mois d'absence. Cachés dans des huttes, les ancêtres des Latins laissaient le temps s’écouler. Et espéraient le présage de renaissance annoncé par le solstice.
Il n’est pas étonnant que, lorsqu’on lui donna un nom, ce mois fut consacré à Janus. Le dieu Bifrons. Dieu de la fin et Dieu du début.
Un visage vieux, vénérable… et un autre, au contraire, jeune et frais.
Janus représente, entre autres choses, le présent. La pause, qui est bien rare à saisir et qui, en réalité, nous échappe toujours, entre le passé et le futur. Entre regrets et peur.

Une simplification, bien sûr. Parce que Janus est un Numen difficile à déchiffrer, toujours mystérieux. Et, de plus, il existe des bustes qui le représentent comme Tetrafrons, c’est-à-dire avec quatre visages différents. Orientés vers les quatre points cardinaux.
Et pourtant, je ne veux pas ici analyser un mythe ou une iconographie. Je veux simplement évoquer, autant que possible, la présence de ce Numen, qui donna son nom au mois que nous vivons actuellement: janvier. Et qui, avec le calendrier de César – un calendrier solaire, basé sur le modèle égyptien – est devenu le premier mois de l’année.
Le grand, long gel qui suit les fêtes du solstice. Et qui enveloppe tout dans un silence soudain.
Tout en laissant vivre l’espoir, dans les rayons du Soleil qui commencent à se faire sentir d’abord à l’aube. Et plus tard jusqu’au crépuscule.
Bien sûr, c’est un Soleil froid. Qui, lorsqu’il apparaît, illumine, mais ne procure aucune chaleur.
Pourtant, c’est le Soleil. Et il maintient vivante la promesse du solstice.
Janus, janvier… Les vitrines illuminées et décorées de Noël disparaissent déjà.
Certains, bien sûr, garderont leurs décorations jusqu’à l’Épiphanie. Mais de moins en moins, car cette fête est archaïque et, en fin de compte, mystérieuse. Qui n’a presque rien, voire rien, à voir avec Noël, cette fête de la consommation effrénée et des décorations scintillantes.
Et puis, l’Épiphanie tombe en janvier. Dans le gel et le silence de ce mois, qui nous paraît long. Très long.
Une attente infinie. Un espoir. Une étincelle de lumière dans l’obscurité.
16:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, hiver, janvier, janus |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 janvier 2026
Epiphanie, rois et galettes






19:04 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : épiphanie, galette des rois, traditions, rois mages |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 décembre 2025
Les influences celtes dans la littérature moderne
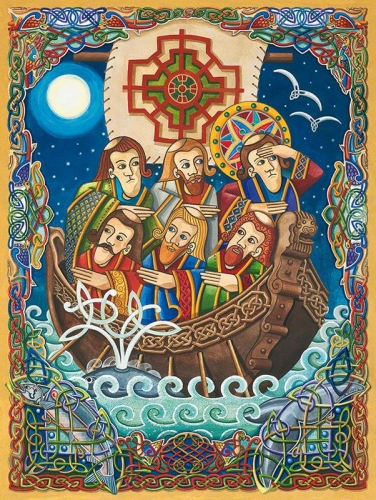
Les influences celtes dans la littérature moderne
Source: https://www.facebook.com/groups/269177069889276
Les Celtes, avec leur riche héritage mythologique, leurs légendes envoûtantes et leur culture profondément ancrée dans la nature et le surnaturel, ont laissé une empreinte indélébile sur la littérature moderne. Leur univers, peuplé de héros comme Cú Chulainn, de fées, de druides et de quêtes magiques, continue d’inspirer les auteurs du monde entier. Que ce soit à travers le fantastique, la fantasy ou même la poésie contemporaine, les motifs celtiques apportent une dimension mystique et intemporelle aux récits.
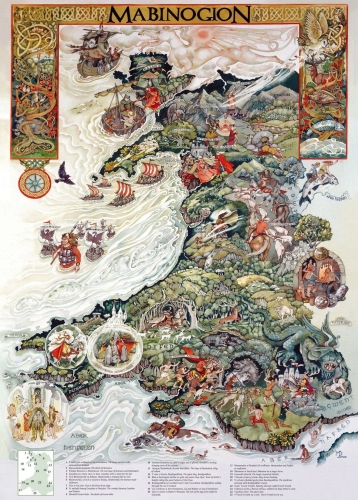
Un héritage mythologique riche
Les mythes celtes, transmis oralement avant d’être consignés par écrit, regorgent de récits épiques et de symboles puissants. Des œuvres médiévales comme les Mabinogion gallois ou les cycles irlandais (comme le Cycle d’Ulster ou le Cycle du Graal) ont posé les bases d’une narration où se mêlent aventure, magie et moralité. Ces récits ont influencé des générations d’écrivains, notamment au 19ème siècle, lors du renouveau celtique. Des auteurs comme William Butler Yeats ont puisé dans le folklore irlandais pour créer une poésie mystique, mêlant mythologie et nationalisme culturel. Ses poèmes, comme The Stolen Child ou The Wanderings of Oisin, évoquent un monde où les frontières entre le réel et l’autre monde (Tir na nÓg) sont ténues, un thème récurrent dans la littérature moderne.
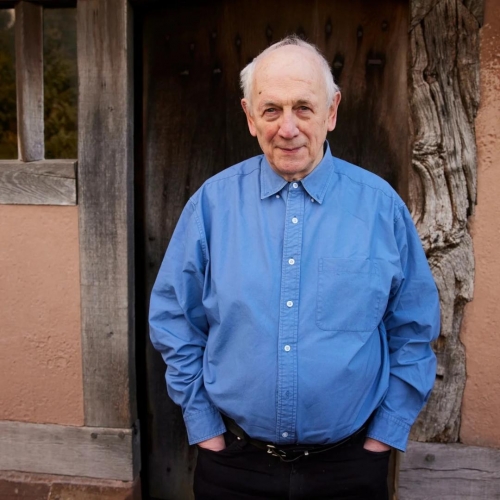
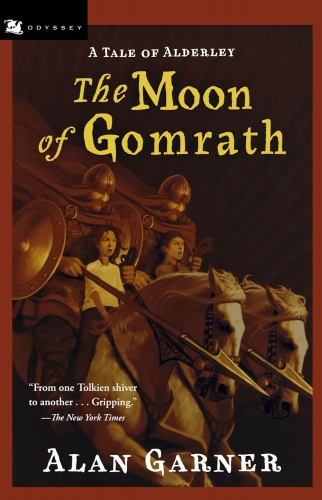
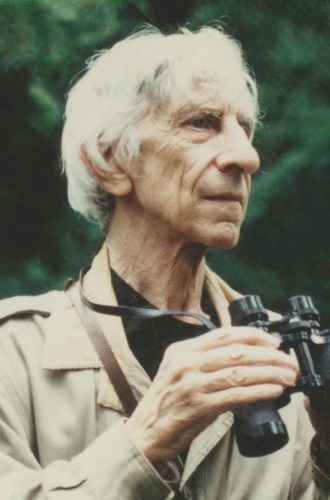
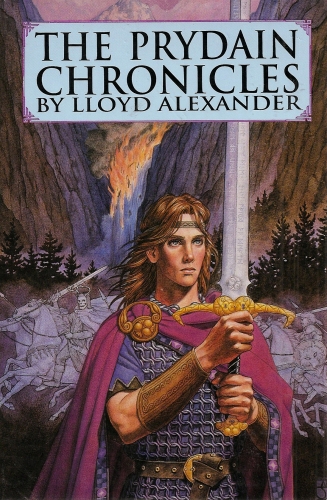
La fantasy : un terrain de prédilection
Le genre de la fantasy doit beaucoup aux Celtes. J.R.R. Tolkien, par exemple, s’est inspiré des langues et des légendes celtiques pour façonner l’univers de La Terre du Milieu. Bien qu’il ait surtout puisé dans la mythologie nordique, des éléments comme les elfes, les quêtes héroïques et les forêts enchantées trouvent des échos dans les récits celtes. Plus directement, des auteurs comme Alan Garner (The Moon of Gomrath) ou Lloyd Alexander (Les Chroniques de Prydain) ont puisé dans les Mabinogion pour créer des mondes où la magie celtique est omniprésente.
La série Harry Potter de J.K. Rowling n’est pas exempte d’influences celtiques: le choixpeau magique rappelle les objets enchantés des légendes, tandis que les créatures comme les farfadets ou les kelpies sont directement issus du folklore celtique. Même Game of Thrones de George R.R. Martin emprunte aux Celtes, avec des personnages comme les "Enfants de la Forêt", qui évoquent les Tuatha Dé Danann, le peuple féerique irlandais.
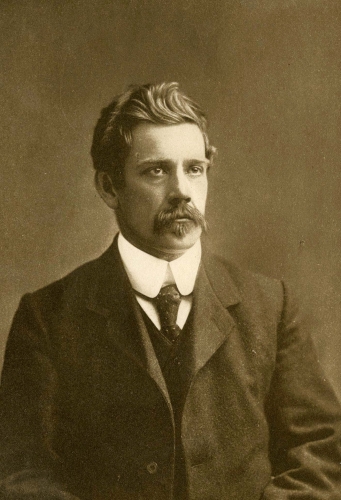
Le réalisme magique et le surnaturel
Les Celtes ont aussi marqué le réalisme magique, un genre où le surnaturel s’immisce dans le quotidien. Des écrivains irlandais comme Lady Gregory ou John Millington Synge (photo) ont retravaillé les contes traditionnels pour les adapter à une audience moderne. Aujourd’hui, des romanciers comme Alice Hoffman (La Prophétie des sorcières) ou Juliet Marillier (La Fille du brouillard) intègrent des éléments celtes pour créer des atmosphères où la magie est palpable. Les fées, les malédictions et les métamorphoses, thèmes chers aux Celtes, y occupent une place centrale.

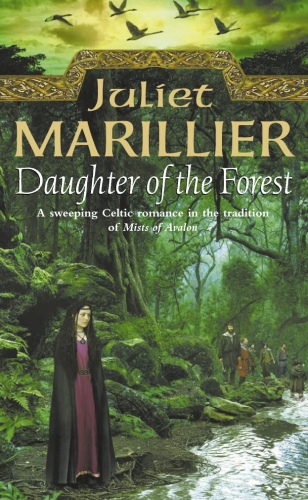
La poésie et la quête identitaire
La poésie moderne, notamment en Irlande et en Bretagne, a souvent utilisé les symboles celtes pour explorer des questions d’identité et de résistance culturelle. Seamus Heaney, prix Nobel de littérature, a réinterprété les mythes irlandais dans des recueils comme North, où la légende de Sweeney Astray devient une métaphore de l’exil et de la quête de soi. En Bretagne, des poètes comme Xavier Grall ou Anjela Duval ont célébré la langue et les paysages breton en s’inspirant des anciens récits.
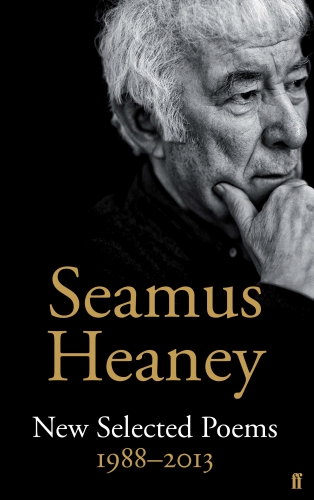
Les héros et les archétypes celtiques
Les héros celtes, comme le roi Arthur (dont la légende est en partie d’origine celtique) ou Finn MacCool, incarnent des archétypes universels: le guerrier noble, le sage, le trickster. Ces figures réapparaissent dans des œuvres contemporaines, comme Les Brumes d’Avalon de Marion Zimmer Bradley, qui réinterprète la légende arthurienne sous un angle féminin et celtique. Même les super-héros modernes, comme Thor dans les comics Marvel, empruntent des traits aux dieux celtes (comme le marteau de Thor, qui rappelle celui du dieu celtique Sucellos).

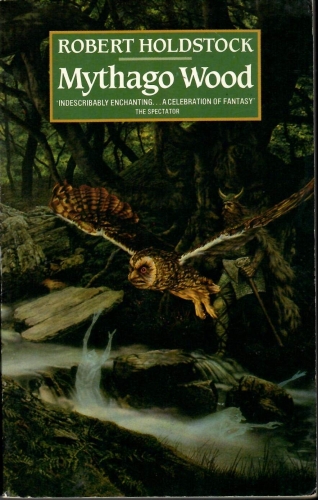
La nature et le sacré
Les Celtes vénéraient la nature, et cette spiritualité se retrouve dans des œuvres écologistes ou animistes. Robert Holdstock, dans Mythago Wood, explore une forêt où les mythes prennent vie, un thème typiquement celtique. De même, Diana Gabaldon (Outlander) mêle histoire et légendes écossaises, où les pierres dressées et les cercles de mégalithes jouent un rôle clé.
Un héritage vivant
Aujourd’hui, les influences celtes se retrouvent aussi dans la littérature jeunesse (Les Chroniques de Spiderwick de Tony DiTerlizzi) ou les romans graphiques (Sláine, de Pat Mills, inspiré des guerriers celtes). Les jeux vidéo (The Witcher, Dragon Age) et les séries (The Witcher, Cursed) perpétuent cette tradition, prouvant que les récits celtes continuent de captiver.
En conclusion, les Celtes ont offert à la littérature moderne un réservoir inépuisable de symboles, de récits et de magie. Leur héritage, à la fois poétique et sauvage, permet aux auteurs d’explorer des thèmes universels : la quête, la frontière entre les mondes, et la connexion profonde entre l’humain et la nature. Que ce soit pour évoquer un passé mythique ou pour créer des mondes imaginaires, leur influence reste vivace, témoignant de la puissance intemporelle de leurs légendes.
18:45 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, lettres, celtisme, traditions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 décembre 2025
Pickeresel, Julbock, figures anthropomorphes hivernales dans les traditions germaniques
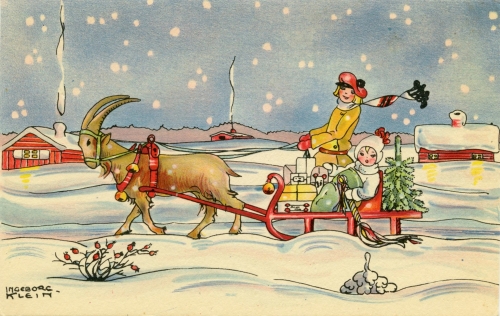










20:09 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditions hivernales, julbock, bickeresel |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 décembre 2025
Figures féminines et masculines du temps liminal de l'hiver

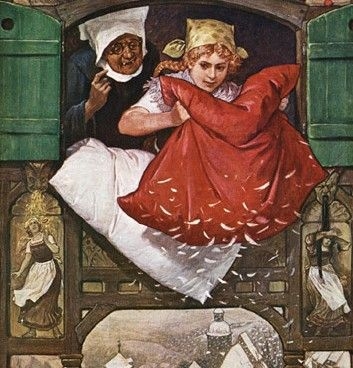


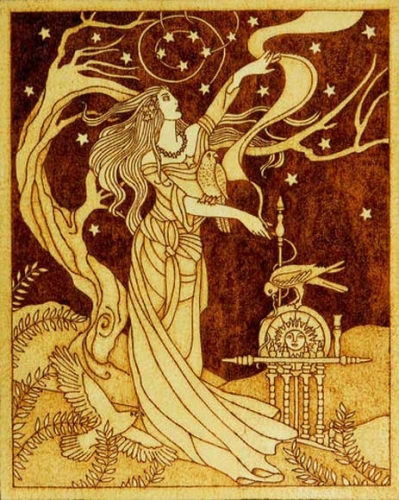












15:28 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, hiver, période solsticiale, chasse sauvage, krampus, frau holle, perchta |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 décembre 2025
Christkindl et Sainte Lucie







19:27 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christkindl, sainte lucie, tradition, noël, période solsticiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Weihnachten, Rauhnächte, Loostagen, 's kleine Johr: Aux origines des coutumes de Noël en Alsace, une affaire de calendrier






19:07 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, noël, solstice, alsace |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La doctrine indo-européenne du combat et de la victoire

La doctrine indo-européenne du combat et de la victoire
Julius Evola sur la guerre, l'héroïsme et « l'ascèse de l'action »
par Ralf Van den Haute
Introduction : histoire du texte et contexte
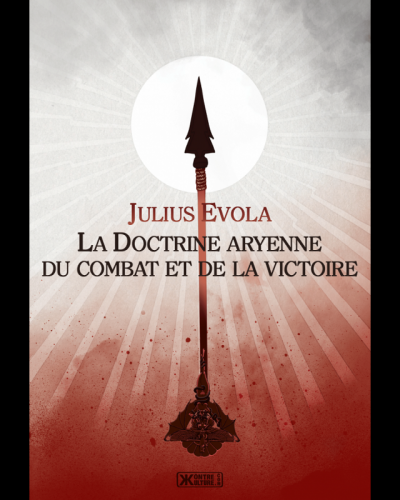 La réflexion qui suit résume l'essai de Julius Evola La doctrine indo-européenne de la lutte et de la victoire et harmonise le ton avec votre traduction. Le texte s'articule autour d'une distinction centrale entre une vision moderne et sécularisée de la guerre et une vision indo-européenne traditionnelle dans laquelle la lutte revêt une importance rituelle, initiatique et métaphysique. Historiquement, l'ouvrage a été publié en italien chez Edizioni del Ar (1970) ; une édition française a suivi chez Pardès (1996). Le matériel s'appuie sur des conférences et des notes développées par Evola dès les années 1940. Dans ce qui suit, l'accent est mis sur le fondement symbolique, religieux et métaphysique de l'action, avec quatre sous-titres thématiques.
La réflexion qui suit résume l'essai de Julius Evola La doctrine indo-européenne de la lutte et de la victoire et harmonise le ton avec votre traduction. Le texte s'articule autour d'une distinction centrale entre une vision moderne et sécularisée de la guerre et une vision indo-européenne traditionnelle dans laquelle la lutte revêt une importance rituelle, initiatique et métaphysique. Historiquement, l'ouvrage a été publié en italien chez Edizioni del Ar (1970) ; une édition française a suivi chez Pardès (1996). Le matériel s'appuie sur des conférences et des notes développées par Evola dès les années 1940. Dans ce qui suit, l'accent est mis sur le fondement symbolique, religieux et métaphysique de l'action, avec quatre sous-titres thématiques.
Tradition contre modernité : la lutte comme rituel
Evola commence par critiquer deux extrêmes modernes: le patriarcat romantique et vitaliste d'une part, et le pacifisme humanitaire d'autre part. Bien que contraires, ils partagent selon lui un même préjugé: la guerre serait dépourvue de toute signification spirituelle supérieure. Ainsi, tant l'apologiste nationaliste que le défaitiste réduisent le combat à un fait purement matériel et bestial.
Face à ce schéma moderne, la vision indo-européenne traditionnelle présente la lutte comme un symbole et un rituel: un épisode terrestre dans le cadre d'une confrontation surnaturelle entre les forces du Cosmos (Κόσμος), de la Forme et de la Lumière, et celles du Chaos (Χάος), de la nature et des ténèbres. L'héroïsme n'est alors pas l'ivresse de la recherche du danger, mais un chemin (via la gloire et la victoire) vers la transcendance et le dépassement de la condition humaine. Dans cette optique, la guerre, la lutte et le divin peuvent coïncider.
Action et contemplation dans l'héritage indo-européen
Dans la lignée du diagnostic de Guénon sur le déclin occidental, Evola nuance l'opposition entre activisme et connaissance intérieure. Par «connaissance», il n'entend pas le rationalisme, et par «contemplation», il n'entend pas la fuite du monde. Dans l'horizon indo-européen originel, l'action et la contemplation sont deux voies vers la même réalisation. La décadence survient lorsque l'action est sécularisée et matérialisée — «faire pour faire» de manière fébrile — tandis que les valeurs ascétiques et contemplatives véritables s'estompent pour devenir des conventions. Une renaissance nécessite donc un retour au sens originel de l'action: l'acte comme transfiguration, comme discipline qui élève l'individu au-dessus de la contingence.
 Le combat sacré et la «double âme»: résonances nordiques, indo-iraniennes, islamiques et chrétiennes
Le combat sacré et la «double âme»: résonances nordiques, indo-iraniennes, islamiques et chrétiennes
Des variantes de la guerre sainte reviennent dans tout le monde indo-européen.
- Monde nordique: le Valhalla comme siège de l'immortalité céleste pour ceux qui sont tombés au combat ; Odin/Wotan comme souverain qui montre la voie à Yggdrasil par le sacrifice de soi; les Walkyries qui choisissent et guident les guerriers; le motif eschatologique du ragnarök comme aboutissement de la lutte métaphysique.
- Monde indo-iranien: Mithra, le «guerrier insomniaque», à la tête des fravaši/fravashi, à la fois force intime de chaque être humain, force tribale/populaire et déesse guerrière qui apporte bonheur et victoire.
- Monde islamique: distinction entre le petit jihād (extérieur) et le grand jihād (intérieur). Le premier est le moyen et le chemin vers le second: la victoire sur les ennemis intérieurs (le désir, le chaos, la passivité) est la condition préalable à la libération; celui qui combat «sur le chemin de Dieu» peut réaliser la mors triumphalis, la mort victorieuse comme percée spirituelle.
- Christianisme/croisades: sous un nouveau masque, le même enseignement résonne. Les prédicateurs qualifient la croisade de purification; Bernard de Clairvaux promet au guerrier «une couronne immortelle» et «une gloire absolue». La «Jérusalem sacrée» a une double fonction (ville terrestre et céleste): ce qui est déterminant, c'est l'intention et la consécration intérieure de l'acte, et non son déroulement extérieur.

Ces exemples trouvent leur aboutissement dans la Bhagavad Gītā: Kṛṣṇa réprimande l'hésitation sentimentale d'Arjuna et lui ordonne de combattre sans attachement: «que chaque acte me renvoie... libre de tout espoir et de tout intérêt». L'acte doit être pur — au-dessus du gain/de la perte, du plaisir/de la souffrance, de la victoire/de la défaite — permettant ainsi au moi d'accéder à la force supra-personnelle qui libère. Dans cette optique, les images classiques du daimōn (δαίμων), du fylgja/Walküre et du fravashi éclairent la notion de «double âme»: la conscience ordinaire et conditionnée contre une force individualisante et supra-individuelle qui transcende la naissance et la mort et se manifeste dans les moments de crise et de combat.
Victoire, gloire et mission de l'homme moderne
Lorsque l'acte guerrier éveille et ordonne cette force supra-individuelle, les plans intérieur et extérieur coïncident : la victoire matérielle est alors le signe et le sceau d'une consécration. D'où le statut sacré du triomphe dans l'Antiquité, le motif de la gloire comme feu céleste (hvarenah), la couronne comme symbole solaire, et Nikè (Νίκη) qui couronne le héros: images d'un état lumineux et impérissable qui scelle le combat.

Dans la conclusion, Evola relie cet enseignement à la crise actuelle : une époque touche à sa fin, et l'alternative à la violence matérialiste et à l'humanitarisme mou est «l'ascèse de l'action» — la lutte comprise comme une catharsis, comme un travail intérieur qui donne forme et sens à l'ordre après la victoire. La paix n'est alors pas un retour à la torpeur bourgeoise, mais l'aboutissement de cette tension. L'ancien credo selon lequel «le sang des héros est plus sacré que l'encre des sages et les prières des pieux» est ici lu comme une métaphore: dans une guerre sainte, ce sont les forces primitives qui agissent — et non les caprices des individus — et ce n'est que lorsque l'acte est spirituel qu'il devient légitime.
Note finale (style et terminologie)
- Pour les concepts clés issus du grec (Kosmos, Chaos, Ouranos, daimōn), l'orthographe grecque a été ajoutée.
- Lorsque la réception originale parle de registres « nationalistes », cela est systématiquement traduit par discours nationaliste d'État lorsque cela est pertinent.
- Le ton est resté essayistique et historique; les images de batailles et de mythologie fonctionnent comme des symboles de transformation intérieure, et non comme des prescriptions littérales.
14:19 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sur le Baron Julius Evola: la monumentale biographie d'Andrea Scarabelli

Sur le Baron Julius Evola: la monumentale biographie d'Andrea Scarabelli
par Georges Feltin-Tracol
Quel ouvrage imposant ! 740 pages ! Une masse proche du kilogramme ! Une épaisseur de 4,5 cm, une largeur de 21 cm et une longueur de 29,5 cm ! Son prix s’élève à 52 €. La vie aventureuse de Julius Evola (Ars Magna, coll. « Evoliana », 2025) est sans conteste la biographie la plus riche de Giulio Cesare Evola (1898–1974).
Pour commander l'ouvrage: https://www.editions-ars-magna.com/livre/scarabelli-andre...
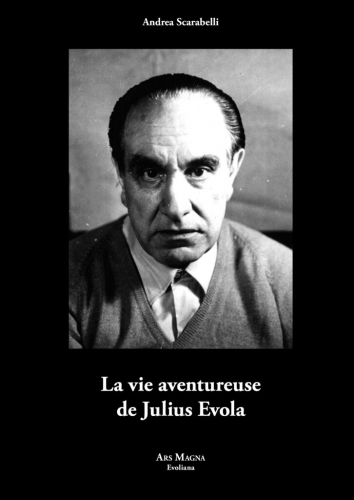 Ce travail colossal revient à Andrea Scarabelli. Vice-secrétaire de la Fondation Julius-Evola, il offre au public francophone une édition revue, corrigée et augmentée par rapport à l’édition initiale. Traduit par Istvàn Leszno et préfacé par Alian de Bneoist, le livre contient plusieurs cahiers photographiques, un appareil critique de notes sur quatre-vingt-deux pages, la liste intégrale des livres originaux d’Evola, une bibliographie exhaustive de dix-huit pages suivie de la bibliographie française des ouvrages évoliens parus dans l’Hexagone réalisée par le préfacier, soit quinze pages, et un index de noms propres mentionnés. Très impressionnant !
Ce travail colossal revient à Andrea Scarabelli. Vice-secrétaire de la Fondation Julius-Evola, il offre au public francophone une édition revue, corrigée et augmentée par rapport à l’édition initiale. Traduit par Istvàn Leszno et préfacé par Alian de Bneoist, le livre contient plusieurs cahiers photographiques, un appareil critique de notes sur quatre-vingt-deux pages, la liste intégrale des livres originaux d’Evola, une bibliographie exhaustive de dix-huit pages suivie de la bibliographie française des ouvrages évoliens parus dans l’Hexagone réalisée par le préfacier, soit quinze pages, et un index de noms propres mentionnés. Très impressionnant !
Au terme de longues et fructueuses recherches, Andrea Scarabelli résout certaines énigmes et écarte des légendes forgées autour de cette personnalité majeure de la vie intellectuelle du XXe siècle. Par exemple, Julius Evola n’a jamais été noble sicilien. Sa famille avec qui il entretient des rapports distants ne descend nullement de seigneurs normands venus en Sicile à l’appel du conquérant Robert Guiscard de Hauteville. Plus favorable à une aristocratie spirituelle qu’à une aristocratie héréditaire, il adopte le titre de «baron». Ce n’est pas anecdotique! Julius Evola déteste être appelé «Maître». Andrea Scarabelli rapporte un entretien entre Placido Procesi et Evola qui déclare: «Je ne suis pas un Maître. Constatez les conditions qui sont les miennes. Même si j’en étais un, je ne pourrais pas me présenter comme tel. J’ai tout écrit parce que je me souviens.» Certains l’appellent «Professeur» bien qu’il n’ait jamais obtenu le moindre diplôme universitaire. Le désigner comme «Baron» pendant les conversations lui convient mieux.
Andrea Scarabelli insiste beaucoup sur l’influence de l’alpinisme dans l’affirmation de sa personnalité. Pratiquer ce sport exigeant développe une vive complémentarité entre la volonté de puissance, la recherche de l’effort et le sens du défi. Méditations du haut des cimes exprime cette grande passion vitale chère à l’écrivain romain. Régulièrement, il part, seul ou accompagné d’une autre personne, dans des courses réputées difficiles, voire dangereuses… Plus tard paralysé des membres inférieurs, son regard s’illumine dès que son interlocuteur évoque ce sujet. Exercer l’alpinisme témoigne d’un solide caractère. Ainsi se montre-t-il désagréable, agacé et irritable à l’égard du personnel médical hospitalier. Ce comportement varie selon les circonstances. «Pour certains, il est froid et distant, pour d’autres, il est empathique et ouvert, sans oublier, poursuit Andrea Scarabelli, ceux qui le voient comme désinvolte et prêt à se jouer de lui-même.»
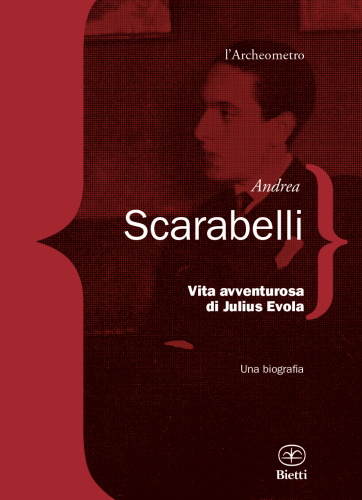 Toute sa vie, Julius Evola exècre la bourgeoisie. Outre la promotion de la Droite spirituelle hostile à la modernité, il critique la morale commune des communistes et des catholiques qui plombe les années 1950. Il déplore l’interdiction des maisons closes. Il considère les prostituées plus honorables que les bourgeoises et se gausse de la bigoterie gouvernementale. À propos de la prostitution, à travers divers articles, il «propose […] l’institution de structures syndicales visant à protéger et à défendre les prostituées». Il défend aussi les filles–mères célibataires. Ce supposé misogyne tance les hommes qui se défilent de leurs responsabilités paternelles.
Toute sa vie, Julius Evola exècre la bourgeoisie. Outre la promotion de la Droite spirituelle hostile à la modernité, il critique la morale commune des communistes et des catholiques qui plombe les années 1950. Il déplore l’interdiction des maisons closes. Il considère les prostituées plus honorables que les bourgeoises et se gausse de la bigoterie gouvernementale. À propos de la prostitution, à travers divers articles, il «propose […] l’institution de structures syndicales visant à protéger et à défendre les prostituées». Il défend aussi les filles–mères célibataires. Ce supposé misogyne tance les hommes qui se défilent de leurs responsabilités paternelles.
Longtemps marginalisé, Julius Evola se surprend qu’après 1945, de nouveaux et précoces activistes au sein de la FUAN (Front universitaire d’action nationale) et du Front de la Jeunesse du MSI (Mouvement social italien) le lisent avec passion. Si le Baron se félicite de cet enthousiasme, il s’agace parfois de leur «évolomanie». Lui qui polémique avec des «guénolâtres» calfeutrés dans une morne adoration, se moque de certains de ses admirateurs dont le comportement moutonnier l’insupporte. Andrea Scarabelli cite Adriano Romualdi, auteur de Julius Evola, l’homme et l’œuvre: «Un jour, entendant qu’un groupe de ses admirateurs consacrait le lundi à la lecture des Hommes au milieu des ruines, le mercredi à celle de Révolte contre le monde moderne et le vendredi à Chevaucher le tigre, Evola les interrompit pour demander non sans malice: “Et quel jour consacrez-vous à la Métaphysique du sexe?”».
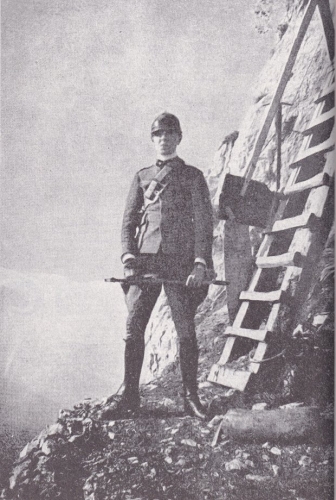 Les relations sont loin d’être au beau fixe avec ses correspondants réguliers. René Guénon ne cache pas son scepticisme envers l’Italien qui s’investit un peu trop à son avis dans le fracas du monde moderne. Il oublie cependant que Julius Evola a participé à la Grande Guerre (1915 – 1918) en tant qu’officier d’artillerie. Il recevra au nom de ce passé en 1969 le titre de « chevalier de Vittorio Veneto » signé par le président de la République italienne…
Les relations sont loin d’être au beau fixe avec ses correspondants réguliers. René Guénon ne cache pas son scepticisme envers l’Italien qui s’investit un peu trop à son avis dans le fracas du monde moderne. Il oublie cependant que Julius Evola a participé à la Grande Guerre (1915 – 1918) en tant qu’officier d’artillerie. Il recevra au nom de ce passé en 1969 le titre de « chevalier de Vittorio Veneto » signé par le président de la République italienne…
Une incompatibilité d’intention se produit avec Ezra Pound. Le contempteur de l’usure n’adhère pas à la vision du monde évolienne qui récuse toute hégémonie de l’économie. De son côté, l’ancien dadaïste s’interroge sur la poétique poundienne. Il la juge plus que surfaite…
La vie aventureuse de Julius Evola décrit donc les nombreuses facettes de l’auteur de Chevaucher le tigre. Certes, comme l’admet volontiers Andrea Scarabelli, le chantre de l’impersonnalité active n’aurait pas approuvé cette ambitieuse biographie. Qu’importe ! Elle témoigne de la singularité d’un très «bon Européen».
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 178, mise en ligne le 15 décembre 2025 sur Radio Méridien Zéro.
12:48 Publié dans Biographie, Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, andrea scarabelli, livre, tradition, traditionalisme, biographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 décembre 2025
Le Sapin de Noël, très ancien symbole de mort et de renaissance

Le Sapin de Noël, très ancien symbole de mort et de renaissance
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063508030909
De l’Antiquité jusqu’au christianisme médiéval, en passant par la mythologie germanique et les rites du solstice, l’arbre dressé au cœur de l’hiver est demeuré un symbole de l’espérance et de la victoire sur les forces des ténèbres et de la mort.
Aujourd’hui devenu le sapin de Noël, il fut longtemps bien plus qu’un simple décor : il représentait une véritable colonne cosmique, un axe du monde permettant de traverser la période la plus sombre de l’année.
Pour comprendre sa symbolique profonde, il faut remonter à l’arbre le plus vénéré des anciens Germains : l’if, cet arbre sombre et ambigu, associé à la fois à la mort et à la vie, à la magie et à la renaissance, aux mystères du destin, et à la survie au cœur du froid.

L’if, arbre magique par excellence, symbolise à la fois la mort et l'immortalité.
Toute sa matière est extrêmement toxique, seule la pulpe rouge de ses fruits est douce et comestible ; ses graines tuent, mais son tronc peut vivre plusieurs milliers d’années ; il ne perd jamais son feuillage, même en plein hiver.
Cette ambivalence absolue, où mort et vie se touchent, où la destruction contient la promesse d’un renouveau, en faisait pour les anciens Germains un symbole idéal du solstice d’hiver, moment où le monde semble basculer dans l’obscurité avant de renaître.
C'est Yggdrasil, l’Arbre cosmique, axe des Mondes, souvent traduit par “frêne” mais que les indices philologiques, mythologiques et symboliques désignent plutôt comme un if.
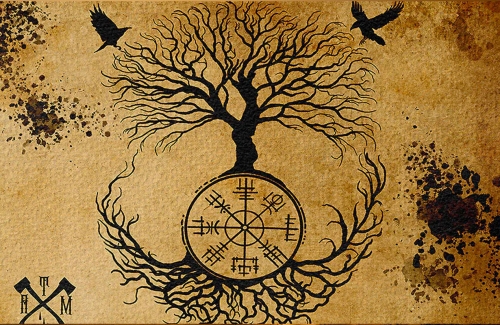
Yggdrasil relie les trois plans de l’univers : les hauteurs célestes, le monde des hommes, et les profondeurs où résident les morts et les puissances du destin.
Suspendu neuf nuits à cet arbre, Odin accède aux runes par une mort initiatique qui le transforme.
Le seiðr, cette magie visionnaire, extatique, sombre, liée à la divination, à la nécromancie, aux passages entre les mondes, trouve dans l’if son arbre tutélaire.
La rune Eihwaz, qui signifie précisément "if”, est celle du passage, de la connaissance interdite, de la vie logée au cœur de la mort. La structure même du cosmos germanique repose donc sur un arbre qui est à la fois funéraire et immortel, verticalité pure et seuil vers l’invisible.
Ce rôle de pivot cosmique se retrouve dans les rites hivernaux des Douze Nuits, ces "Rauhnächte" ou "Weihnachten" où le temps semblait se suspendre.
Dès le solstice d'hiver (aujourd'hui du 24 décembre au 6 janvier), les anciens Germains vivaient une “non-année”, un intervalle où les frontières entre les mondes s’effaçaient et où la maison devenait vulnérable aux forces errantes des ténèbres.
Les femmes cessaient de filer, laissant cette tâche à la déesse Frigg, la fileuse du destin.
Pour traverser cette période de mort, on introduisait dans l’habitation un arbre toujours vert : une image d’Yggdrasil, destiné à maintenir l’ordre cosmique dans le foyer.
Cet arbre, un sapin (substitut plus maniable de l’if sacré), entrait le premier soir et ressortait après la douzième nuit.
Pendant cette période liminale, il représentait pour la maison un point d’ancrage au monde vivant, une colonne verticale empêchant l’obscurité de triompher.

On décorait cet arbre de fruits : des pommes et des noix.
Ces décorations, aujourd’hui anodines, condensent pourtant toute la profondeur du mythe.
Les pommes renvoient à la déesse Idunn, gardienne des fruits d’immortalité.
Lorsque la déesse est enlevée par le géant Thjazi, les dieux vieillissent : le monde se fige, l’hiver gagne.
Les géants sont liés à la glace, à l'hiver.
Et quand Loki la retrouve, elle est transformée en noix - métamorphose essentielle, car la noix représente la vie repliée dans la mort, l'utérus, la germination enfermée dans sa coque dure, la promesse du renouveau contenue dans une coque dure.

Suspendre des pommes et des noix à l’arbre hivernal n’était donc pas un geste décoratif, mais un rite de survie symbolique : les pommes affirmaient la vitalité manifeste, les noix en représentaient le principe caché.
Ensemble, elles formaient les deux faces de l’immortalité : la lumière et la graine, la vie éclatante et la vie enfouie, l’espérance visible et l’espérance secrète.
Lorsque le christianisme se superposa à ces anciennes coutumes, la convergence symbolique fut immédiate.
Dès l'époque médiévale, dans les pays germaniques, on associait Noël et Adam et Ève en dressant un Arbre du Paradis orné de pommes rouges : l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, celui au centre du jardin d'Eden, celui par lequel l’homme chute mais aussi celui qui annonce la possibilité de la rédemption par le Christ.
Ce symbole chrétien, loin de s’opposer au rite germanique, lui correspond parfaitement : il est lui aussi un arbre central, un axe du monde, un arbre d’épreuve et de transformation, un arbre où la mort conduit à la vie.
La tradition médiévale voyait dans ce même arbre la préfiguration de la Croix du Christ, nouvel Adam, dont le bois relie le monde des hommes à Dieu et dont la verticalité restaure l’axe rompu du destin humain.
Pour les germains christianisés, la Croix devient alors l’Yggdrasil chrétien, l’arbre de mort qui porte la vie, le bois dressé qui relie ciel et terre, le pivot par lequel la nuit du monde débouche sur la lumière de la résurrection.
C’est ainsi que le sapin domestique, introduit au cœur des Douze Nuits, a pu devenir sans heurt le symbole chrétien de Noël.
Arbre vert dans la nuit de l’hiver, arbre du Paradis réinterprété, arbre de la Croix et de la résurrection, il conserve sous sa parure moderne les strates successives de toutes ces traditions.
Sous les guirlandes et les lumières électriques se superposent encore aujourd’hui l’ombre de l’if antique, la magie du seiðr, le souffle d’Odin suspendu à l’arbre cosmique, les fruits d’Idunn, la chute d’Adam et Ève, et la Croix du Christ, nouvel axe du monde chrétien.
Le sapin de Noël résume ainsi toute une histoire spirituelle : celle d’un arbre dressé dans la nuit pour que l’homme, traversant le solstice, puisse accéder à la lumière renaissante.
22:17 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, paganisme, sapin de noël, noël |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La transmission des mythes par les textes mythologiques irlandais
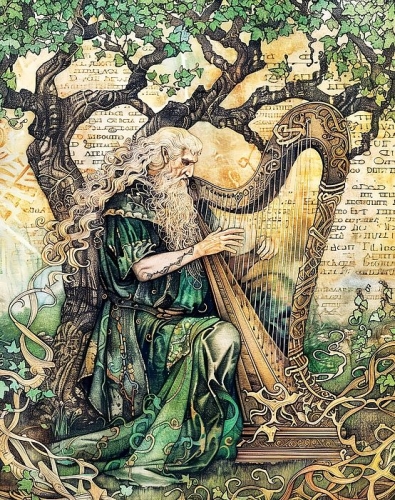
La transmission des mythes par les textes mythologiques irlandais
Source: Celtes , Gaulois fierté autochtone | Facebook
L’Irlande, terre de légendes et de mystères, a préservé à travers les siècles un patrimoine mythologique d’une richesse inégalée. Les textes mythologiques irlandais, rédigés principalement entre le VIIe et le XIIe siècle, jouent un rôle central dans la transmission des récits fondateurs, des croyances et des valeurs de la culture celtique. Ces écrits, souvent compilés par des moines chrétiens, sont le fruit d’une tradition orale bien plus ancienne, remontant à l’âge du bronze et à l’époque pré-christienne. Ils offrent une fenêtre unique sur l’imaginaire, la spiritualité et la vision du monde des anciens Irlandais.
1. Les Sources des Mythes Irlandais : de l’Oral à l’Écrit
Avant d’être consignés par écrit, les mythes irlandais se transmettaient oralement, de génération en génération, par le biais des filid (poètes) et des seanchaí (conteurs). Ces gardiens de la mémoire collective avaient pour mission de perpétuer les récits héroïques, les généalogies des dieux et des rois, ainsi que les explications des phénomènes naturels. Avec l’arrivée du christianisme en Irlande au Ve siècle, les moines, soucieux de préserver la culture locale tout en l’adaptant à leur nouvelle foi, ont commencé à transcrire ces récits. Les manuscrits les plus célèbres, comme le Lebor Gabála Érenn (Le Livre des Conquêtes de l’Irlande), le Táin Bó Cúailnge (La Rafle des Vaches de Cooley) ou encore les Dindsenchas (Lore des Lieux), sont ainsi nés de cette rencontre entre deux mondes.
Ces textes, bien que réécrits sous une influence chrétienne, conservent des traces évidentes des croyances païennes. Par exemple, les Tuatha Dé Danann, souvent présentés comme une race mythique ou des dieux, sont parfois dépeints comme des êtres surnaturels ou des ancêtres glorifiés, afin de les intégrer dans une vision chrétienne de l’histoire. Cette superposition de couches culturelles rend les textes irlandais particulièrement fascinants : ils mêlent mythes pré-christiens, symboles païens et réinterprétations chrétiennes.
2. Les Cycles Mythologiques : une Structure Narrative Unique
Les mythes irlandais sont traditionnellement organisés en quatre grands cycles
- Le Cycle Mythologique : Il raconte l’histoire des dieux et des créatures surnaturelles, comme les Tuatha Dé Danann, les Fomoriens et les Fir Bolg. Ces récits expliquent la création du monde, les batailles cosmiques et l’origine des paysages irlandais.
- Le Cycle d’Ulster : Centré autour du héros Cú Chulainn, ce cycle met en scène des exploits guerriers, des tragédies et des quêtes épiques. Le Táin Bó Cúailnge, joyau de ce cycle, illustre la lutte entre l’Ulster et le Connacht, tout en explorant des thèmes universels comme l’honneur, la loyauté et la fatalité.
- Le Cycle de Fenian : Il suit les aventures de Finn Mac Cumhaill et de ses guerriers, les Fianna, dans un monde où magie et réalité s’entremêlent.
- Le Cycle des Rois : Ce cycle relate les exploits des souverains historiques ou semi-légendaires, comme Conchobar ou Cormac Mac Art, et aborde des questions de pouvoir, de justice et de destin.
Chaque cycle reflète des valeurs et des préoccupations spécifiques, tout en partageant des motifs récurrents : les voyages dans l’Autre Monde (le Tir na nÓg), les objets magiques (comme la Lance de Lug ou la Pierre de Fal), et les figures de druides et de guerriers.

3. La Transmission des Mythes : entre Symbolisme et Enseignement
Les textes mythologiques irlandais ne se contentent pas de divertir : ils enseignent. Ils transmettent des leçons sur la nature humaine, la relation entre les hommes et les dieux, et l’équilibre entre ordre et chaos. Par exemple, le mythe de la Deuxième Bataille de Mag Tuired symbolise la victoire de la lumière (les Tuatha Dé Danann) sur les forces obscures (les Fomoriens), une allégorie de la lutte entre civilisation et barbarie. De même, les récits mettant en scène des héros comme Cú Chulainn ou Finn Mac Cumhaill soulignent l’importance du courage, de la sagesse et du respect des traditions.
Les lieux mythiques, comme la colline de Tara ou le lac de Derryclare, sont souvent associés à des événements surnaturels, renforçant le lien entre le paysage et la mémoire collective. Les Dindsenchas, en particulier, expliquent l’origine des noms de lieux à travers des légendes, créant une géographie sacrée où chaque rocher ou rivière a une histoire.
4. L’Influence Chrétienne et la Réinterprétation des Mythes
Avec la christianisation, certains dieux païens ont été transformés en saints ou en figures bibliques. La déesse Brigid, par exemple, est devenue Sainte Brigitte, tandis que des fêtes païennes comme Samhain (l’ancêtre d’Halloween) ont été intégrées au calendrier chrétien. Cette assimilation a permis aux mythes de survivre, tout en les adaptant aux nouvelles croyances. Les moines irlandais, en copiant ces textes, ont ainsi sauvé de l’oubli une partie de la tradition orale, même si certains éléments ont été édulcorés ou réinterprétés.

5. La Postérité des Mythes Irlandais
Aujourd’hui, les textes mythologiques irlandais continuent d’inspirer la littérature, la musique et les arts. Des auteurs comme W.B. Yeats ou J.R.R. Tolkien se sont nourris de ces récits pour créer leurs propres univers. Les festivals celtiques, les reconstitutions historiques et même le tourisme culturel en Irlande s’appuient sur ces légendes pour célébrer l’identité irlandise.
En conclusion, la transmission des mythes irlandais par les textes médiévales est un témoignage remarquable de la résilience d’une culture. Grâce à l’écrit, des récits qui auraient pu disparaître ont traversé les siècles, offrant aux générations futures un héritage à la fois poétique, philosophique et spirituel. Ces textes rappellent que les mythes ne sont pas de simples histoires : ils sont le reflet de l’âme d’un peuple, un pont entre le passé et le présent.
21:55 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : traditions, mythologie, mythologie celtique, paganisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 27 novembre 2025
Le « Mal » dans la cosmogonie de Tolkien
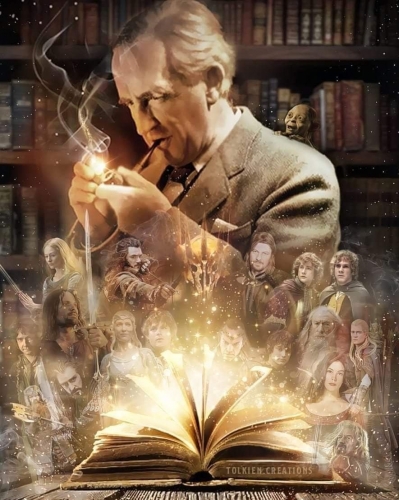
Le « Mal » dans la cosmogonie de Tolkien
par Ralf Van den Haute
La lecture de l'épopée Le Seigneur des Anneaux[1] ne révèle pas toute la portée mythique de l'œuvre de J. R. R. Tolkien, qui fournit dans Le Silmarillion[2] la véritable clé de son univers. On y trouve une description de l'origine du monde, des dieux et du « Mal ». Le statut de ce dernier dans l'œuvre de Tolkien correspond à plusieurs égards aux différentes manifestations du Mal dans la mythologie germanique. Le but de cet article est d'examiner cet aspect et de retracer certaines similitudes entre le Mal dans l'œuvre de Tolkien et la mythologie germanique telle qu'elle nous est transmise par les Eddas[3] .
Le « Mal » dans l'œuvre de Tolkien ne correspond pas à la définition qui nous a été transmise par le monothéisme chrétien: il faut plutôt le considérer comme un ensemble de forces destructrices qui défient la vie et l'ordre divin, comme on le retrouve dans l'Edda.
Dans la littérature fantastique, et plus particulièrement dans le genre appelé « fantasy héroïque », Tolkien jouit indéniablement d'une popularité inégalée. Éminent philologue, spécialiste de la grammaire comparée des langues germaniques et indo-européennes, il n'est pas seulement l'auteur d'un récit merveilleux et d'une épopée. Contrairement aux innombrables livres et productions cinématographiques pseudo-mythiques — qui sont dépourvus de toute dimension tragique —, l'œuvre de Tolkien constitue un système mythologique véritablement cohérent, basé sur un mythe cosmogonique et doté d'un cadre dans lequel peut se dérouler une épopée quasi homérique.
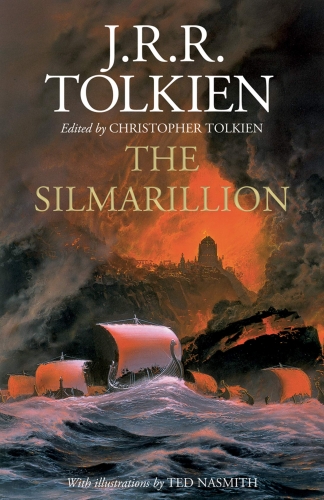
Le Silmarillon, clé de l'œuvre de Tolkien
Tout dans cette œuvre — des anneaux aux épées magiques, des représentants du « Bien » et du « Mal » — est l'expression d'un ordre intérieur propre à l'être humain, tant à l'individu qu'à la communauté du destin. Il s'agit d'un ordre immanent à ce monde, dont l'essence ne peut être comprise en lisant uniquement Le Hobbit[4] - qui a commencé comme une histoire que Tolkien a écrite pour ses enfants - et Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Silmarillion, le lecteur séduit par la Terre du Milieu trouvera les clés indispensables. Bien qu'il ait été publié après Le Seigneur des Anneaux, l'auteur a commencé à écrire le texte dès son retour des tranchées en 1916. Initialement destiné à être inclus dans Le Livre des contes perdus[5] , le manuscrit partiellement inachevé a finalement été publié en 1977 par Christopher Tolkien, le fils de l'auteur.
Dès le départ, Le Silmarillion apparaît comme un livre moins accessible que l'épopée de Tolkien : c'est l'histoire des origines, du commencement lointain – la nuit des temps – qui n'est pas sans rappeler la Völuspá, dans laquelle la mystérieuse Völva raconte les origines et le destin du monde. Le Silmarillion contient tout le contenu mythique qui permet de mieux comprendre Le Seigneur des Anneaux, d'autant plus que les événements du Silmarillion précèdent chronologiquement ceux du Seigneur des Anneaux et en décrivent les causes en détail. Le lecteur y découvre l'élaboration d'un véritable mythe cosmogonique originel, la présence d'un panthéon — dont les fonctions des divinités ne sont pas toujours complètement élaborées — et une vision de la fonction du « Bien » et du « Mal », qui atteindra son apogée dans Le Seigneur des Anneaux.
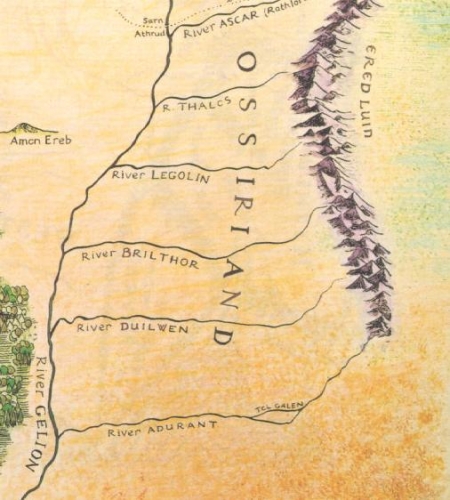
Certains ont voulu voir dans cette dynamique entre deux forces opposées une allégorie — comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Tolkien lui-même a rejeté cette interprétation. Il nous semble plus intéressant d'étudier le statut du « Mal » dans l'œuvre de Tolkien à la lumière de la mythologie germanique telle qu'elle est représentée dans l'Edda. Pourquoi spécifiquement la mythologie germanique ? Germaniste, Tolkien connaissait particulièrement bien plusieurs langues germaniques anciennes telles que le vieux norrois, le vieil anglais et le gothique, et a lui-même traduit et commenté plusieurs textes épiques et mythologiques. Sa connaissance des mythes et légendes germaniques était pour le moins très approfondie. Cette tentative d'analyse succincte n'exclut pas l'existence d'autres influences : certains noms dans le Silmarillon semblent notamment être tirés de l'épopée finlandaise Kalevala. Le quenya et le sindarin, langues elfiques créées par Tolkien, sont quant à elles basées sur le finnois et le gallois. Il est difficile de se prononcer de manière catégorique sur les parallèles entre le Silmarillion et le mythe de la création dans le Mahabarata, car on ne sait pas dans quelle mesure Tolkien connaissait le contenu de ce texte. Certains suggèrent que les sept rivières d'Ossiriand seraient inspirées des sapta sindhu, les sept rivières du Rigveda. Quoi qu'il en soit, il est possible de démontrer de manière convaincante que Tolkien a rédigé un mythe de la création, une mythologie et une épopée héroïque à part entière, qui s'inscrivent dans la lignée de la mythologie germanique et indo-européenne au sens large.
Le mythe fondateur
Le problème du « Mal » ne peut être dissocié de l'ensemble de la cosmogonie. Le mythe tolkienien de la création en fournit lui-même l'explication : il ne s'agit pas d'une création comme acte unique émanant d'une divinité unique et toute-puissante. Cette cosmogonie s'inscrit plutôt dans une conception de l'origine telle que l'a formulée Ernst Jünger dans Besuch auf Godenholm[6] : « La création (...) était possible à chaque point où les flammes de l'inétendu éclataient. »

Dans le Silmarillion, Eru, ou Ilúvatar (illustration) — un nom apparenté à l'allemand Allvater, l'un des nombreux noms d'Odin — crée les Ainur et leur donne trois thèmes musicaux qu'ils doivent élaborer et développer. Ils donnent ainsi forme à Arda, la Terre, et à Eä, le « monde qui est », l'univers.
Ilúvatar ne possède aucune des caractéristiques du dieu jaloux de la Bible ; au contraire, il semble incarner le principe du Devenir. N'envoie-t-il pas ses flammes éternelles à travers l'espace — les flammes de l'inétendu de Jünger —, flammes qui sont à l'origine des mélodies infinies, véritables sculptures musicales ? C'est ainsi que la Terre et l'univers deviennent réalité.

Les Valar, les dieux de la cosmogonie tolkienienne, sont les meilleurs parmi les Ainur. Ils sont quatorze et leurs fonctions sont multiples. Certains Valar présentent des similitudes avec les dieux de notre panthéon familier : il y a ainsi un dieu de la mer (et des eaux en général). Ils correspondent à des forces de la nature, et l'on pourrait ici utiliser le terme de « religion naturelle », si Tolkien ne semblait pas veiller soigneusement à ne jamais inclure de culte religieux ou de forme quelconque d'eschatologie dans son œuvre.
Les Valar, qui participent au chant éternel des Ainur, représentent en quelque sorte les forces de la nature qui façonnent et refaçonnent sans cesse le visage du monde. Ce chant symbolise le devenir : seuls des éléments créateurs peuvent exister. Un monde sans éléments destructeurs serait statique, incomplet et, en l'absence d'une dimension tragique, totalement inintéressant.
Friedrich Gundolf, membre éminent du cercle de poètes autour de Stefan George, suggère que « les dieux subliment toutes les tensions humaines en forces créatrices ».[7] Ces tensions existent également dans l'œuvre de Tolkien ; elles en constituent même le fondement. Quels sont donc les éléments destructeurs nécessaires pour rendre possibles les tensions créatrices ? Le « Mal », en tant que force opposée au « Bien », apparaît déjà dans l'Ainulindalë, où Tolkien raconte le développement des mélodies par les Ainur.

Alors que les Ainur et les Valar façonnent le monde et la vie à travers leur musique, Melkor — lui-même un Valar — développe ses propres mélodies, dissonantes et violentes, qui semblent consister en une négation des harmonies créées par les autres Valar. Les mélodies de Melkor s'ajoutent à l'ensemble des mélodies des Valar : à certains moments, les tonalités harmoniques prédominent, non sans difficulté ; à d'autres moments, c'est la musique dissonante de Melkor qui domine.
Cet antagonisme, mais aussi cette alternance entre les deux forces, reflète la lutte entre les dieux et les Titans, entre l'ordre et le chaos, entre la vie et la mort. Les Valar sont ainsi constamment confrontés à la destruction de leur œuvre, voire à leur propre destruction. Les deux forces sont engagées dans une lutte éternelle, dans laquelle aucune des deux ne peut jamais se vanter d'une victoire définitive.
L'eucatastrophe
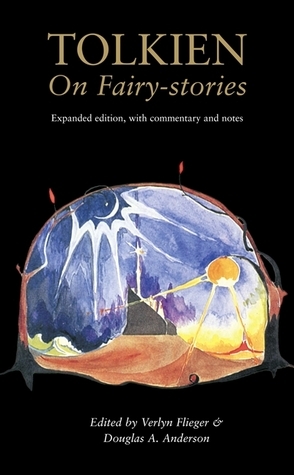 Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »
Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »
Dans cet essai, Tolkien décrit comment la structure du conte de fées, notamment à travers l'eucatastrophe, trouve un écho lointain dans l'histoire du salut chrétien. Tolkien, qui a écrit cet essai une dizaine d'années avant de commencer ses récits, relativise lui-même cette notion lorsqu'il affirme que l'eucatastrophe n'est pas la seule fin possible. Cet essai traite des contes de fées en général, et non spécifiquement du Seigneur des Anneaux, dont la rédaction n'a commencé qu'une dizaine d'années plus tard.
Dans l'eschatologie chrétienne, le Mal est définitivement vaincu lors du Jugement dernier, qui marque la fin de l'Histoire (qui, dans la tradition judéo-chrétienne, a commencé avec l'expulsion d'Adam et Ève du Paradis). Si l'œuvre de Tolkien contient des éléments chrétiens, c'est plutôt dans le personnage de Nienna, une déesse (Valar) qui présente certains attributs de Notre-Dame et plus précisément de la Mater dolorosa, à savoir la tristesse, la compassion et la miséricorde.
Cependant, de nombreux indices suggèrent que le « Mal » n'est pas définitivement vaincu à la fin de la grande bataille dans Le Seigneur des Anneaux. Comme le fait remarquer Paul Kocher dans Master of Middle-Earth[9] : « À en juger par les Âges précédents, le Mal reviendra bientôt. » Lors du dernier conseil avant la bataille, Gandalf, personnage emblématique de l'épopée, déclare que même si Sauron était vaincu et qu'un grand mal était ainsi banni du monde, d'autres se lèveraient.
Par l'intermédiaire de Gandalf, l'auteur relativise davantage l'eucatastrophe, un concept qu'il définit et décrit certes dans un essai, mais dont les perspectives chrétiennes sont finalement absentes tant dans son récit cosmogonique que dans son épopée.

Histoire cyclique
Le « soleil invaincu » est un autre thème récurrent dans l'œuvre de Tolkien : vers la fin du Seigneur des anneaux, le soleil renaît à l'horizon. Tout cela indique que la vision de l'histoire n'est pas linéaire ici : tant que le soleil se lèvera le matin, les grands midis seront inévitablement suivis de crépuscules. La victoire du soleil sur les ténèbres, de l'ordre sur le chaos, est elle-même de nature cyclique.

Le risque et le défi sont donc étroitement liés : la lutte entre les peuples libres (the free people) et les autres — les esclaves des ténèbres, porteurs de destruction et de chaos (les Orques, les Nazgûl, etc.) — revêt ici une dimension véritablement cosmique, mythique et intemporelle. On retrouve cette lutte dans la chasse effrénée du Vala Oromë (ill.), un dieu qui ressemble à Odin à plus d'un titre : le martèlement des sabots de son cheval annonce l'aube et chasse les ténèbres, qui réapparaissent immédiatement derrière lui.
La guerre entre Melkor et les Valar est sans fin et de nature cyclique. Selon Mircea Eliade[10] , la notion de temps chez les peuples archaïques ou les sociétés indo-européennes traditionnelles n'est pas vécue de manière linéaire, mais cyclique. Les rites, les mythes et les fêtes reproduisent les actes originels des dieux, des héros ou des ancêtres mythiques et permettent aux participants de revenir à chaque fois à l'époque primitive (illud tempus).
Eliade fait notamment référence à la tradition védique : les kalpas y sont des époques qui se succèdent à l'infini ; le rituel (agnihotra) permet la régénération du cosmos (au sens de l'Ordre). Eliade estime que le renouvellement périodique du pouvoir royal (dans les traditions iranienne et romaine) constitue une variante indo-européenne de la régénération cosmique.
Lutte éternelle
Peut-on alors compter Le Silmarillio parmi la tradition indo-européenne et plus précisément germanique, dont on sait qu'elle fut l'une des principales sources d'inspiration de l'auteur ? L'Edda nous raconte l'histoire des géants qui ont tué le géant primitif Ymir et ont utilisé les différentes parties de son corps pour façonner l'Univers et le Monde, avant d'être bannis aux confins du Monde par les dieux. Les géants se sont sentis humiliés, et c'est ainsi qu'a commencé une guerre sans fin entre les géants — représentants des forces brutes du commencement du monde et du chaos destructeur — et les dieux, symboles de l'ordre.

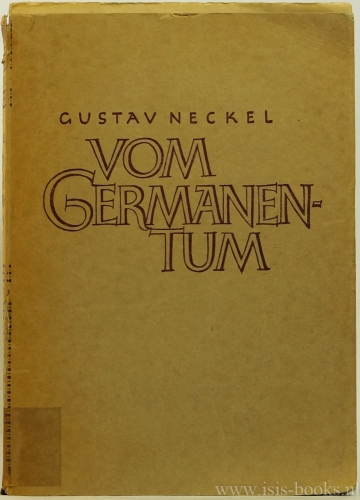
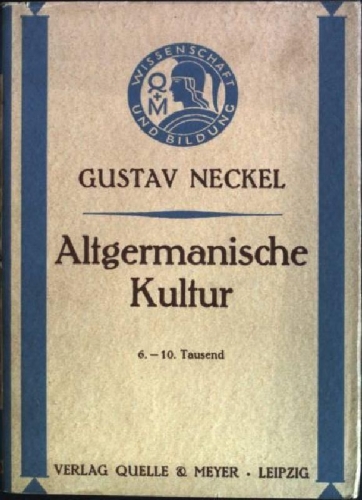
Gustav Neckel y voit un élément mythique très ancien et démontre sa présence dans les récits perses, helléniques et celtiques (principalement irlandais). Dans Vom Germanentum[11] , Neckel parle de l'«*ewigen Kampf dieser entgegengesetzten Gewalten*» (lutte éternelle entre ces forces opposées), dans le même contexte que celui que l'on retrouve dans l'œuvre de Tolkien.
La vision du monde des Indo-Européens considère la vie comme une lutte éternelle entre des forces qui s'opposent et qui constituent ensemble le Devenir. Tolkien oppose le monde ensoleillé des forêts et des paysages verdoyants et vallonnés, avec ses sources et sa magie, aux déserts, à la désolation des terres arides couvertes de nuages sombres.
En ce sens, la cosmogonie et la mythologie de Tolkien, qui se déploient autour de ce *Streit der aufbauenden mit den niederreißenden Gewalten* (lutte entre les forces constructrices et destructrices, selon Neckel), sont à la fois crédibles et cohérentes.
Les arbres de Yavanna
Dans Le Silmarillion, Tolkien illustre ce cycle à travers l'histoire des deux arbres de Yavanna. Ces deux arbres sont étroitement liés à la mythologie germanique, et plus particulièrement à Yggdrasil, l'if sacré des Germains. Yavanna, tantôt déesse, tantôt arbre sacré reliant la terre et le ciel, veille sur Laurelin et Telperion, deux arbres qui partagent avec l'if sacré des Germains la notion de fertilité et de croissance, ainsi que la menace de leur destruction.
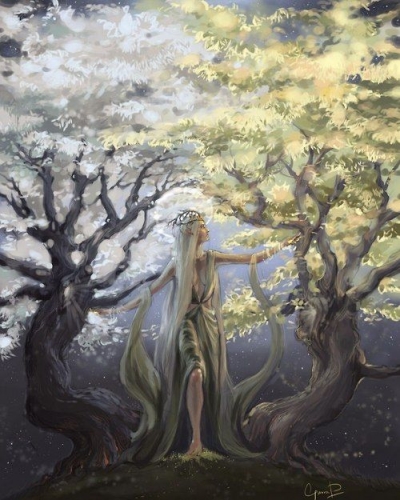
Yggdrasil est en effet constamment menacé par un cerf qui broute son feuillage et par des serpents qui rongent ses racines. Grâce à la présence des Nornes du destin, qui vivent sous ces racines, il ne succombera pas aux attaques sans cesse renouvelées avant le Ragnarök. Yggdrasil reflète la condition humaine et celle du monde dans la mythologie germanique.
Les deux arbres sous la protection de Yavanna finiront par périr, empoisonnés par Melkor : leur disparition marquera la fin de l'ère solaire et le début d'une période sombre, qui ne prendra fin que lorsqu'une des précieuses graines de Telperion redeviendra un arbre. Cela ne se produira qu'au moment où un roi légitime, héritier de l'épée de ses ancêtres les plus lointains et divins, aura reconquis le trône ancestral.
Il s'agit bien sûr d'un mythe de régénération, qui n'est pas sans rappeler le cycle arthurien et les récits de la quête du Graal (Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, mais aussi T. S. Eliot dans The Waste Land[12] ). Le rôle de ces arbres sacrés montre à quel point Tolkien nous plonge dans un univers qui nous est familier.
Loki
Quant au personnage de Melkor, lui aussi semble avoir ses homologues du côté germanique. Tout comme les géants, il a été banni de leur demeure par les dieux. Humilié, il ne cesse de penser à se venger. Il existe une parenté tout aussi évidente entre Melkor, qui est particulièrement rusé, et Loki, le dieu germanique du feu, que Felix Genzmer décrit dans Die Edda[13] comme un fauteur de troubles, un instigateur de tous les malheurs qui frappent les dieux.
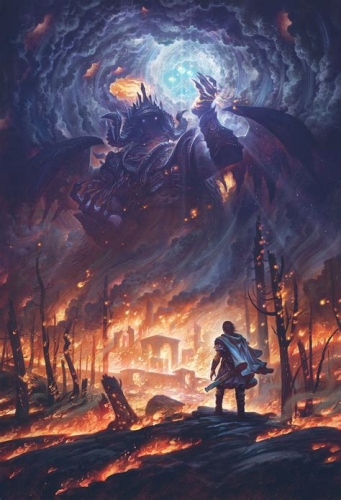
Georges Dumézil a consacré une étude approfondie[14] à ce dieu aux multiples facettes. Loki est en effet associé à la ruse et au mensonge. Il est après tout le père de la géante Hel, du serpent Midgard et du loup Fenrir, qui joueront un rôle important dans le Ragnarök. Melkor s'est également forgé une réputation de menteur qui trompe ses victimes par la ruse, la peur, la tromperie et la violence. Les Valar parviennent un jour à le précipiter dans le Néant (nothingness), mais sa place est immédiatement prise par Sauron. Il s'agit clairement d'une fonction essentielle, sinon il n'y aurait eu aucune nécessité de le remplacer.

Loki a engendré des créatures monstrueuses : Melkor fait de même et forme, à partir d'êtres vivants capturés ou enlevés, des races dégénérées, primitives et laides. Les Orques, son chef-d'œuvre — une race monstrueuse et cruelle — sont en effet une dégénérescence de la noble race des Elfes.
La parenté ainsi établie entre Melkor et Loki soulève une question pertinente: alors que Loki vit parmi les Ases à Asgard, Melkor est banni aux confins du monde. Pourquoi les dieux ne se débarrassent-ils jamais complètement de Loki, qui sera finalement responsable de la mort de Balder, le dieu germanique du soleil — un événement qui annonçait le début du Ragnarök et correspond à l'empoisonnement des arbres sacrés par Melkor ?
Après la mort de Balder, les dieux soumettent Loki à d'horribles tortures. À une autre occasion, lorsque Loki se moqua et insulta les dieux, Thor menaça de lui fracasser le crâne avec son marteau. Dans les deux exemples cités, Loki réussit toutefois à échapper à cette punition.
Il en va de même pour Fenrir : bien qu'Odin sache qu'il sera dévoré par ce loup au moment du Ragnarök, il ne le tue pas, mais l'enchaîne. Thor et un géant réussirent un jour à capturer le serpent Midgard ; eux non plus ne le tuèrent pas, mais le laissèrent au contraire libre dans les profondeurs de l'océan, afin qu'il puisse accomplir sa tâche fatidique lors du Ragnarök.
Dans chacun des cas mentionnés, le représentant du Mal — dans toute sa dimension cosmique — parvient à chaque fois à s'échapper alors qu'il est sous le pouvoir des dieux.
Dans le chapitre du Silmarillion intitulé « De la venue des Elfes et de la captivité de Melkor », les Valar capturent Melkor et lui lient les mains avec une corde magique, qui rappelle les chaînes de Fenrir. Pourtant, en échange de quelques vagues promesses, les Valar ne font rien de mieux que de lui rendre sa liberté.
Quand, bien plus tard, ils parviennent enfin à se débarrasser de lui, un successeur endosse immédiatement le même rôle.

Melkor, Loki, Fenrir et le Serpent de Midgard ne sont rien d'autre que les adversaires nécessaires, les ennemis qui confèrent aux dieux leur dimension tragique. Ce sont ces adversaires indispensables qui créent les tensions nécessaires à l'élan créateur du monde.
Gustav Neckel voit dans cette tendance à épargner un ennemi qui s'avérera mortel à l'avenir l'expression mythique d'un ordre cosmique nécessaire, car imposé par le Destin. Même si les dieux avaient voulu détruire ces acolytes du Chaos, ils n'y seraient pas parvenus, car, précise Neckel, le destin est scellé.
Paul Kocher remarque que la survie des héros dans Le Seigneur des anneaux dépend de la chance, de la providence et du destin. Certains personnages de cette épopée connaîtront un destin tragique et héroïque et mèneront une vie risquée.
Quête de régénération
Melkor incarne donc plusieurs aspects du Mal, tels qu'ils sont exprimés dans l'Edda. Soulignons tout d'abord la place du Mal dans la cosmogonie germanique et tolkienienne, telle qu'elle est exposée dans l'Ainulindalë, le premier chapitre du Silmarillion. Il existe ensuite des similitudes indéniables entre la fonction de Melkor et celle de Loki au sein de leurs panthéons respectifs. Melkor n'est pas le diable du monothéisme, mais plutôt un démiurge tragique, sans doute apparenté à Loki, voire à Prométhée.
Ce point de vue est diamétralement opposé à la réinterprétation catholique de l'œuvre de Tolkien. Bien qu'il soit incontestable que Tolkien lui-même était catholique, toute trace d'eschatologie chrétienne est absente de son œuvre.
Dans l'œuvre de Tolkien, on ne trouve aucune trace d'une création du monde ex nihilo. Tout tourne autour d'un mythe de la création dans lequel le Devenir prend forme à travers l'harmonie (l'Ordre), la disharmonie (le Chaos) et la lutte éternelle entre les deux. Melkor, comme Ymir dans la cosmogonie germanique, fait partie des êtres qui précèdent les dieux et n'est pas un ange déchu. Melkor, qui est doté de tous les dons, aspire à l'autonomie et à la domination. Il est le créateur du Chaos, comme les Titans et autres géants dans la tradition indo-européenne.
Et ce Chaos, composante indispensable du devenir, en fait partie intégrante. Melkor confère au monde une dimension tragique qui rend possible l'apparition du héros — une notion qui fait défaut au christianisme, qui préfère vénérer les martyrs qui aspirent à une récompense transcendante.
Nous pouvons conclure que la mythologie créée par Tolkien — même s'il était lui-même catholique — n'a pas un caractère théologique, mais véritablement mythologique, caractérisé par la lutte éternelle entre des forces à la fois opposées et complémentaires: l'Ordre et le Chaos, comme dans les mythes de la création de la tradition indo-européenne.
Le Bien et le Mal dans l'œuvre de Tolkien n'ont pas une dimension morale, mais purement ontologique. Le christianisme aspire au salut ; dans le monde de Tolkien, nous assistons à une quête de régénération, de rétablissement d'un équilibre entre les forces cosmiques. Tout comme dans le Ragnarök, la destruction et la renaissance sont ici indissociables.
Ralf Van den Haute
Notes:
[1] Tolkien, J. R. R. Le Seigneur des anneaux. Londres : George Allen & Unwin, 1955.
[2] Tolkien, J. R. R. Le Silmarillion. Éd. Christopher Tolkien. Londres : George Allen & Unwin, 1977.
[3] Ralf Van den Haute. Indo-European and traditional mythological elements in Tolkien: A comparative study of the pantheon in « The Silmarillion » and « The Edda », Université libre de Bruxelles, 1984.
[4] Tolkien, J. R. R. Le Hobbit ; ou, Aller et retour. Londres : George Allen & Unwin, 1937.
[5] Tolkien, J. R. R. Le Livre des contes perdus. Partie I. Édité par Christopher Tolkien. Londres : George Allen & Unwin, 1983.
[6] Ernst Jünger. Besuch auf Godenholm. Francfort-sur-le-Main : Vittorio Klostermann, 1952
[7] Gundolf, Friedrich. Goethe. Berlin : Georg Bondi, 1916.
[8] Tolkien, J. R. R. « On Fairy-Stories ». Dans Essays Presented to Charles Williams, édité par C. S. Lewis, 38–89. Oxford : Oxford University Press, 1947.
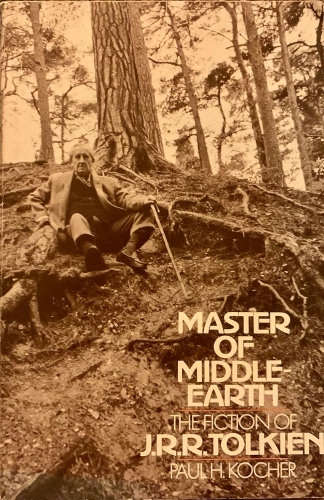
[9] Kocher, Paul H. Master of Middle-earth: The Fiction of J. R. R. Tolkien. Boston : Houghton Mifflin, 1972.
[10] Eliade, Mircea. Le Mythe de l’éternel retour : Archétypes et répétition. Paris : Gallimard, 1949
[11] Neckel, Gustav. Vom Germanentum : Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Leipzig : Harrassowitz, 1944.
[12] Eliot, T. S. The Waste Land. New York : Boni and Liveright, 1922.
[13] Genzmer, Felix (trad.). Die Edda. Iéna : Eugen Diederichs, 1912-1920.
[14] Dumézil, Georges. Loki. Paris : G. P. Maisonneuve, 1948
17:26 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j. r. r. tolkien, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise, mythologie, traditions, mythologie germanique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 novembre 2025
Le guerrier impie

Le guerrier impie
Ralf Van den Haute
Le guerrier impie ignore les présages qui mènent à sa perte, après avoir commis les trois péchés du guerrier.
C’est Georges Dumézil qui, par son travail monumental en mythologie comparée, a donné à cette discipline ses lettres de noblesse scientifiques, encourageant les jeunes chercheurs Claude Sterckx et Frédéric Blaive [1] à suivre leur intuition et à démêler le mythe indo-européen du «guerrier impie».
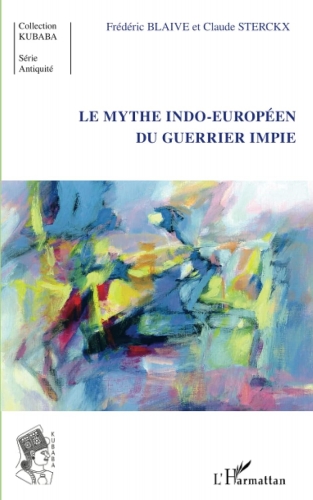 La pertinence de ce thème, largement abordé dans la revue Ollodagos – Actes de la Société belge d’études celtiques, dans Studia Indo-Europaea et dans Latomus – revue d’études latines, se reflète dans le nombre de philologues qui ont poursuivi la recherche académique sur ce sujet, principalement du côté francophone : Alexandre Tourraix, Dominique Briquel, Marcel Meulder et Bernard Sergent.
La pertinence de ce thème, largement abordé dans la revue Ollodagos – Actes de la Société belge d’études celtiques, dans Studia Indo-Europaea et dans Latomus – revue d’études latines, se reflète dans le nombre de philologues qui ont poursuivi la recherche académique sur ce sujet, principalement du côté francophone : Alexandre Tourraix, Dominique Briquel, Marcel Meulder et Bernard Sergent.
Le mythe du guerrier impie est partagé par plusieurs peuples parlant une langue indo-européenne et semble totalement absent en dehors de cette aire linguistique. Blaive et Sterckx ont d’abord trouvé de nombreux exemples indiens, iraniens, scandinaves et latins de ce mythe. Plus tard, des exemples ont été découverts dans la plupart des langues indo-européennes, même celles dont les plus anciens documents manquent, comme l’antiquité slave, les ballades ossètes, certains textes de la littérature médiévale. Ce mythe ne semble en tout cas pas exister en dehors de l’aire indo-européenne : aucun exemple chinois, arabe, berbère, ouralien ou turco-mongol n’est connu.
Une autre particularité de ce mythe : Blaive et Sterckx, familiers de la structure trifonctionnelle de la mythologie indo-européenne, constatent que les trois avertissements ou erreurs qui précèdent la fin du guerrier impie ne peuvent être assimilés à cette structure trifonctionnelle. La triade, en tant que telle, se retrouve en effet, indépendamment de la structure trifonctionnelle propre aux mythes indo-européens, aussi fréquemment ailleurs.
Outre le mythe du guerrier impie, il existe aussi un mythe autour des trois péchés du guerrier, qui sont liés aux trois fonctions de Dumézil [2] : un meurtre, un viol (ou rapt ?) et un sacrilège, qui reflètent respectivement la deuxième, la troisième et la première fonction. Les trois péchés du guerrier précèdent le mythe du guerrier impie, qui commet d’abord ces trois péchés, s’attire ainsi une malédiction, puis est confronté aux présages de cette malédiction, les ignore et finit par mourir.

L’un des plus anciens exemples connus d’un tel héros négatif est Ravana, dans l’épopée hindoue du Ramayana. Ravana tue un messager, enlève une femme et défie les dieux. S’ensuivent les présages de sa mort : une pluie de sang, des chevaux qui trébuchent et pleurent. Le cheval apparaît d’ailleurs fréquemment dans les différentes manifestations de ce mythe.

Dans la mythologie grecque, le héros Achille de l’Iliade semble, après examen, répondre à plusieurs critères du guerrier impie. Son cheval ne prédit-il pas sa mort devant les portes de Troie s’il tue Hector ? Mais il y a plus : Achille est connu pour ses accès de colère incontrôlables, d’abord contre Agamemnon, puis contre Hector, et il menace à plusieurs reprises le dieu Apollon.
L’une des traditions indo-européennes les plus archaïques, la celtique, connaît une variante particulière de ce mythe: les Celtes impies commettent évidemment aussi les erreurs qui mènent à leur perte, mais les commettent à contrecœur et sous la contrainte absolue d’une obligation supérieure. Dans la légende irlandaise Togail Bruidhne Dhadhearga, le haut roi Conaire Mor est soumis à une série de tabous qu’il ne peut que transgresser progressivement jusqu’à sa chute finale.
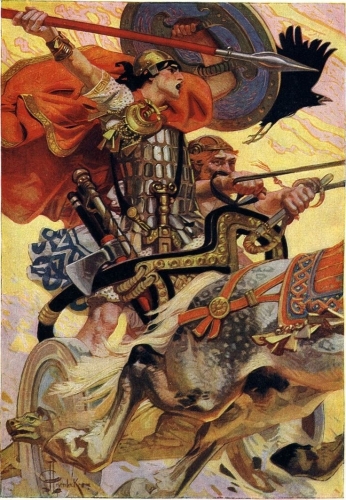
Le plus célèbre héros celtique, Cuchulainn, subit un destin similaire le dernier jour de sa vie: il ignore les incantations des femmes qui sentent sa mort approcher et d’autres présages sombres, comme sa propre fibule qui tombe de ses mains et blesse son pied, son cheval Liath Macha qui refuse d’être attelé et lui montre trois fois son flanc gauche. Il part néanmoins combattre l’armée ennemie qui ravage l’Ulster. En chemin, il rencontre trois sorcières qui font rôtir un chien sur un feu de branches de sorbier. Elles aspergent le chien de poison et prononcent des malédictions. Cuchulainn est soumis à un geis, un tabou qui lui interdit de passer devant un feu sans partager le repas qui y est préparé. Un autre tabou lui interdit de manger la viande de son homonyme : or, le surnom du héros irlandais est justement « chien de Culann ». Cuchulainn fait mine de ne pas remarquer les sorcières, mais elles l’interpellent et lui offrent de la main gauche – autre mauvais présage – un morceau du chien. Cuchulainn ne peut que l’accepter, ce qu’il fait de la main gauche, et le mange. Il perd aussitôt la moitié de sa force. Il part tout de même au combat, mais ses ennemis parviennent à le placer à nouveau devant un dilemme fatal, et il succombe finalement, désarmé.
La plupart des épopées mythiques indo-européennes connaissent un héros négatif sous la forme d’un guerrier au caractère excessif et arrogant, pour qui rien ni personne n’est sacré et qui ne respecte aucun ordre, même divin. La vie d’un tel guerrier ne peut être que criminelle jusqu’à ce que le champion du camp opposé le vainque et rétablisse l’ordre du monde.
La nature fatale et prophétique du cheval dans différentes cultures indo-européennes a déjà été décrite à la fin du XIXe siècle, principalement par des philologues allemands. Le présage du cheval qui pleure ou trébuche (tombe) est fréquent et annonce la mort du guerrier impie. Meulder a constaté que l’absence totale de ce motif dans d’autres cultures, comme la tradition populaire hongroise ou chez les Kirghizes où c’est au contraire un bon présage, confirme qu’il s’agit d’un mythe purement indo-européen.

Le mythe du guerrier impie a des prolongements dans la littérature européenne. Chez Jacob Grimm, par exemple, le faux pas du cheval annonce un malheur. Dans la Njallsaga norvégienne, la saga de l’incendie de Njall, cela arrive à Gunnar, un guerrier impie. Mais aussi dans la Saga du roi Harald de la Heimskringla, le cheval du roi Harald se cabre au moment où celui-ci veut attaquer l’Angleterre. Le roi d’Angleterre espère à haute voix que cela signifie la fin de la chance de Harald. Et en effet, celui-ci est mortellement touché par une flèche.
Il existe encore de nombreux exemples où le motif du guerrier impie semble pertinent : l’empereur païen Julien dans sa lutte contre les Parthes, Charlemagne, Jules César. Tout guerrier qui semble impie ne l’est pas forcément : il convient de noter que les historiens romains étaient particulièrement habiles à noircir les dernières années de vie de leurs adversaires politiques, ce qui peut donner l’impression que le mythe du guerrier impie est très présent dans la culture latine – alors que les formes archaïques de la mythologie indo-européenne étaient à peine encore présentes dans l’Empire romain.
Cette contribution n’est rien de plus qu’une brève introduction à ce mythe indo-européen fascinant. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet devront principalement se tourner vers la littérature francophone des auteurs mentionnés plus haut. Une certaine familiarité avec le mythe du guerrier impie et celui des trois péchés du guerrier devrait permettre de découvrir soi-même ces motifs dans les textes archaïques.
Source: Traduction d’un texte paru dans Traditie, Jaarboek voor traditionele erfgoedbeleving in de lage landen, Brasschaat 2025. ISBN 9789491436260
Notes:
[1] Frédéric Blaive en Claude Sterckx : Le mythe Indo-européen du guerrier impie, L’Harmattan, Parijs 2014
[2] Georges Dumézil (1898-1986) a réussi, grâce à la mythologie comparée, à ouvrir une nouvelle voie et à mettre au jour les structures idéologiques sous-jacentes des mythes auxquelles ceux-ci doivent leur cohérence interne. Le résultat en est la découverte du système trifonctionnel comme idéologie principale dans la pensée indo-européenne archaïque. Dumézil a principalement étudié des textes sources de l’Inde archaïque, de Rome et de la Scandinavie : ces textes sont accessibles et contiennent des couches mythologiques très anciennes et bien conservées.
16:16 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tradition, mythologie, guerrier, guerrier impie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 19 novembre 2025
Emanuele La Rosa: “Julius Evola en Mitteleuropa et les contacts avec le monde völkisch”
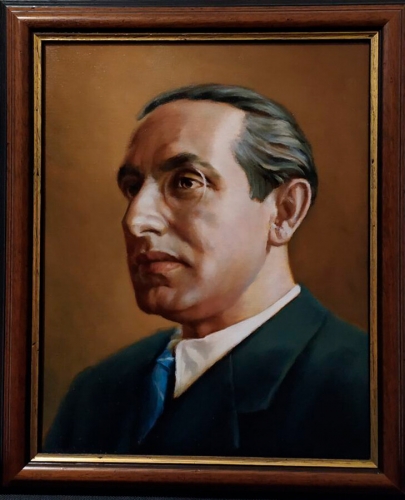
Emanuele La Rosa: “Julius Evola en Mitteleuropa et les contacts avec le monde völkisch”
Brève conversation avec l'éditeur de l'anthologie des textes d"Evola, intitulée De la Méditerranée à l'Olympe nordique - articles et conférences en Mitteleuropa
par les Edizioni Mediterranee
Source: https://www.barbadillo.it/125426-emanuele-la-rosa-julius-...
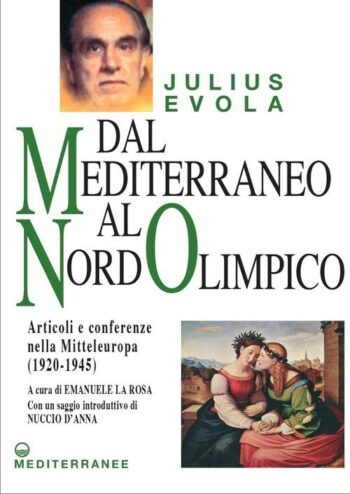 Dans la première moitié des années trente, Julius Evola entama de longs séjours en Allemagne et en Autriche. Son intervention dans divers domaines culturels, à travers des conférences, des collaborations avec des périodiques et des revues scientifiques, ainsi que les propositions qui lui furent faites de publier écrits et livres, s'avère, avec le recul, d’une importance fondamentale. À partir de la recherche et de l’analyse de ce matériau est née l'anthologie intitulée De la Méditerranée à l'Olympe nordique - articles et conférences en Mitteleuropa (1920-1945). Que représente cette période pour le philosophe romain? Nous en avons discuté avec l'éditeur de ce volume, Emanuele La Rosa, que nous remercions pour cet aimable entretien.
Dans la première moitié des années trente, Julius Evola entama de longs séjours en Allemagne et en Autriche. Son intervention dans divers domaines culturels, à travers des conférences, des collaborations avec des périodiques et des revues scientifiques, ainsi que les propositions qui lui furent faites de publier écrits et livres, s'avère, avec le recul, d’une importance fondamentale. À partir de la recherche et de l’analyse de ce matériau est née l'anthologie intitulée De la Méditerranée à l'Olympe nordique - articles et conférences en Mitteleuropa (1920-1945). Que représente cette période pour le philosophe romain? Nous en avons discuté avec l'éditeur de ce volume, Emanuele La Rosa, que nous remercions pour cet aimable entretien.
Dans les années trente et quarante, Evola fut une référence pour d’importants cercles intellectuels mitteleuropéens, souvent très élitistes: aristocrates, fonctionnaires d’État, personnalités “imperméables” aux influences culturelles extérieures. Comment parvint-il à effectuer cette percée?
“L’action d’Evola est essentiellement machiavélique, elle repose sur le principe de la Realpolitik. En laissant de côté la prémisse de son action métapolitique – la désintégration de l’esprit aryen en Occident – et l’objectif qu’elle vise – le rétablissement des lois de la Tradition –, Evola sait qu’il ne peut pas utiliser le même ‘vocabulaire’ que celui qu’il emploie en Italie pour pénétrer dans le monde culturel des élites allemandes. C’est dans cette optique qu’il faut interpréter le passage du monde aryo-méditerranéen d’Impérialisme païen à celui de l’Heidnischer Imperialismus, où – presque pour créer un rapport d’empathie avec le public allemand – les fasces sont remplacés par l’aigle d’Odin. À cela s’ajoutent la manière aristocratique de faire et de se présenter d’Evola, sa pensée élitiste tournée vers l’individu plutôt que vers la masse, et ce que nous appellerions aujourd’hui une opération de marketing habile, où le philosophe romain n’est pas seulement baron, mais aussi descendant d’une noble famille normande.”
Quel est le sens de l’action culturelle menée par le philosophe durant ces années, principalement à travers des conférences et des articles ?
“Plus qu’un sens unique, je parlerais plutôt de sens qui s’entrelacent de manière synchrone. Le premier consiste, comme déjà mentionné, à faire revivre dans le monde moderne les structures et l’esprit de la Tradition à travers la réappropriation et la réutilisation de concepts, mythes et symboles qui y sont liés. Le second est celui de créer une élite politico-spirituelle qui puisse guider l’Occident dans une fonction anti-communiste et anti-matérialiste (c’est-à-dire anti-soviétique et anti-américaine). Le troisième consiste à ‘corriger’ ce qui, dans les mouvements de renouveau germanique, était faux, dégénéré et diviseur, et de placer le tout dans une optique d’alliance italo-allemande qui pourrait être symbolisée par l’union de l’aigle impérial romain et celui d’Odin.”
Comment évolue la contribution d’Evola durant cette période particulière ?
“Le premier article que Julius Evola publie en allemand date de 1928 et paraît dans la revue Die Eiche. Viennent ensuite une quinzaine d’autres articles, jusqu’à ce qu’en mai 1934, le philosophe soit invité à donner une série de conférences à Brême et à Berlin, ce qui lui permet d’établir des contacts directs avec le monde völkisch (folciste), dont il voulait devenir l’interlocuteur principal en Italie. Jusqu’à cette date, il est principalement connu dans des cercles révolutionnaires-conservateurs, mais à mesure que ses activités de journaliste et de conférencier entre l’Allemagne et l’Autriche s’intensifient et que ses œuvres sont traduites en allemand, son nom commence aussi à circuler dans les cercles nationaux-socialistes. La série de trois conférences qu’il donna à Berlin en juin 1938, sur invitation de Heinrich Himmler, devant la SS et plusieurs personnalités de l’Ahnenerbe, est particulièrement significative. Les thèmes abordés couvrent tous les domaines d’intérêt du philosophe: la morphologie du mythe, la question de la race et du judaïsme, les réflexions sur l’éthique héroïque-guerrière, ainsi que les ‘affinités et divergences’ entre Nord et Sud occupent une place centrale.”
 Qui étaient les figures proches du philosophe à cette époque ?
Qui étaient les figures proches du philosophe à cette époque ?
“Les principaux interlocuteurs d’Evola étaient le baron Heinrich von Gleichen-Rußwurm (photo), fondateur du Herrenklub à Berlin et éditeur de Der Ring; le prince autrichien Karl Anton von Rohan, directeur de la Europäische Revue et animateur du Kulturbund viennois ; les révolutionnaires-conservateurs Wilhelm Stapel et Ernst Niekisch, éditeurs respectivement de Deutsches Volkstum et Widerstand; et le comte Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, fondateur du mouvement paneuropéen. La relation avec la comtesse hongroise Antonia Zichy, qui l’introduisit dans les milieux conservateurs hongrois, est également à noter. En revanche, la relation avec Alfred Rosenberg, idéologue du NSDAP et éditeur des Nationalsozialistische Monatshefte et du Völkischer Beobachter, était plutôt fluctuante.”
En ce qui concerne le “problème de la modernité”, que met en évidence le rôle d’Evola dans ce cycle mitteleuropéen d’articles et de conférences?
“À première vue, cela peut sembler contradictoire, mais Julius Evola — un philosophe archaïsant, car ses catégories appartiennent à un monde très éloigné dans le temps et l’espace — ne pourrait exister en dehors de la modernité. C’est un penseur de la décadence, et cela correspond à la condition de notre époque: sans cela, il n’y aurait pas de sens à parler d’un recouvrement des valeurs de la Tradition. Sa réaction est une réponse à la dégénérescence de la civilisation et de l’homme moderne, éloigné de lui-même et esclave de facteurs externes, pris au piège dans le matérialisme comme moteur du monde, aveuglé par la manie du collectivisme comme synthèse de la société, et habitué à l’utilitarisme comme base de la conception de l’État. En ce sens, en reprenant une formule qu’il a utilisée il y a quelque temps, sa pensée est vraiment celle de quiconque veut survivre ‘droit et debout’ sur les ruines du Troisième Millénaire.”
17:40 Publié dans Entretiens, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, tradition, entretien, traditionalisme, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 14 novembre 2025
La fête d’Halloween et la destruction du patrimoine chrétien: les forces obscures en pleine offensive!

La fête d’Halloween et la destruction du patrimoine chrétien: les forces obscures en pleine offensive!
Pierre-Emile Blairon
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ; pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés ».
Antonio Gramsci
Non, je ne me suis pas rallié au christianisme; je suis resté fidèle à nos plus vieilles racines gauloises, celtes, indo-européennes et, au-delà, hyperboréennes : je suis toujours primordialiste, adepte de la plus ancienne spiritualité de la planète que les premiers chrétiens arrivés à Rome ont appelée, en dérision, « paganisme », terme qui est issu du mot latin pagani, paysans, qui cultivent la terre.
Je sais: je me débrouille toujours pour ne plaire à personne: ni à la «gauche», ni à la «droite» (1), ni aux chrétiens, ni aux «païens»; je ne revendique pas ce dernier terme, imposé péjorativement par les chrétiens des origines aux paysans européens, aux fellahs, comme dirait Oswald Spengler (2) qui considérait tous les travailleurs de la terre comme une entité planétaire avec les mêmes comportements et le même attachement à leur sol, quel que soit leur pays d’origine (3), en complémentarité, voire en opposition aux nomades-éleveurs du désert, ce qui explique ce dédain originel des premiers chrétiens à l’encontre des travailleurs de la terre et des habitants des forêts européennes. Ce qui explique aussi la prédisposition du christianisme à l’universalisme qui constituera plus tard la clef de son succès.
D’autre part, je récuse aussi ce terme de « païen » parce que je considère qu’on ne peut pas faire revivre une époque qui avait une tout autre approche de la spiritualité et de ses rapports avec ses dieux que nos contemporains qui vivent depuis longtemps dans le mensonge qui leur a été imposé (processus qui a subi une forte accélération avec la catastrophe représentée par la Révolution française), et qui vivent aussi dans le virtuel moderne (une vie fantasmée), dont peu d’entre eux sont parvenus à s’extraire (à la fois du mensonge et du virtuel).

Halloween, un détournement parodique de l’ancienne fête celtique de la Samain
Une fête essentiellement commerciale
La France, mais aussi une partie de l’Europe, a été conquise ces dernières années par la célébration d’une fête étrange, exubérante et bruyante, mélange de satanisme puéril – ce sont les enfants qui sont à la manœuvre, quelquefois encadrés par certains de leurs parents chargés de contenir les débordements de leur progéniture – et de soumission au culte du commerce qui dicte les comportements de la société américaine, d’où nous parvient cette nouvelle lubie juteuse à souhait pour les affaires. Il faut savoir que la période choisie pour l’organisation de ces festivités n'est pas due au hasard : « Dès 1998, Halloween est adoptée par les commerçants et certains médias, la fête tombant juste au moment de la « période creuse » entre la rentrée scolaire et les fêtes de Noël […] Coca-Cola, en partenariat avec d'autres marques, crée l'événement en 1999 en organisant une Halloween Party au Zénith de Paris réservé aux jeunes de 15 à 25 ans. La marque organise par la même occasion plus de 400 opérations dans les bars et discothèques de France. D'autres marques importantes, comme Orangina, Haribo, Materne, BN, M&M's ou encore McDonalds tentent eux aussi de profiter de la popularité de la fête pour lancer diverses gammes de produits aux couleurs d'Halloween (4) ». (Wikipedia, article Halloween)
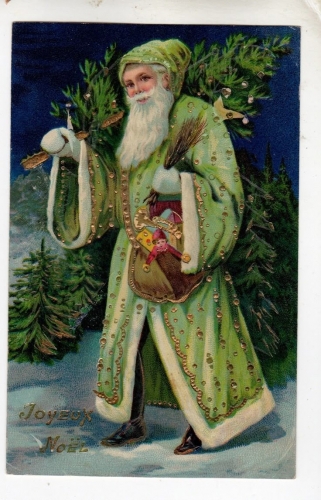

Un Père Noël qui vire du vert au rouge grâce à Coca-Cola
Rappelons que le Père Noël revêtu de sa belle houppelande rouge auquel nous avons droit depuis les années 30 du siècle précédent a été publicitairement promu, et avec un plein succès, par Coca-Cola en 1931 ; certes, depuis la fin du XIXe siècle, certaines représentations du Père Noël apparaissaient en rouge comme le personnage de Saint Nicolas, mais les premiers Pères Noëls païens étaient verts car il s’agissait d’évoquer l’espoir du renouveau de la végétation au début de l’hiver, nos ancêtres ayant toujours été attentifs au rythme des saisons.

La plupart de leurs fêtes avaient une signification en lien avec la fertilité et la fécondation. Les plus anciennes représentations du Père Noël sont d’origine germanique et nordique comme Saint Nicolas qui «a remplacé le vieux dieu germanique des eaux, Hnikar (ou Nikuz), un surnom d'Odin (5) ». La légende de Saint Nicolas, que l’on fête le 6 décembre en Belgique et aux Pays-Bas depuis le Moyen-Âge, a aussi des racines romaines avec les Saturnales qui avaient lieu au solstice d’hiver, qui fêtaient le « Dies Natalis Solis Invicti, le jour de naissance de Sol Invictus, le retour du Soleil, le rallongement du jour », une date qui se comprend mieux quand on sait que Saint Nicolas était certes célébré le 6 décembre du calendrier grégorien mais selon le calendrier julien qui le précédait, ce jour tombe le 19 décembre.
L’origine d’Halloween: une fête celtique
Les Celtes l’appelaient la Samain ou Samhain, les Gaulois, tout aussi celtes que leurs voisins bretons et grands-bretons, l’appelaient Samonios.

En effet, « La fête de Samain apparaît inscrite sous le nom de Samonios dans le Calendrier de Coligny, un calendrier daté du 1er siècle avant J.-C, d'origine gauloise, qui divisait l'année en deux moitiés, la moitié sombre qui débutait au mois de Samonios (lunaison ou nuit de Samhain), et la demi-lumière, qui commençait au mois de Giamonios (lunaison d'avril-mai ou nuit de Walpurgis). Les Celtes considéraient que l'année commençait par la moitié sombre, tout, comme pour les Vikings, le passage d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre était produit par le rythme des lunaisons. La célébration de la nouvelle année durait pendant les « trois nuits de Samonios », la pleine lune la plus proche entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver et qui donnait lieu aux célébrations.
La Samhain était une période de deuil rituel et symbolique pour marquer la mort de l'été et un moment de grand danger pour les Celtes, puisque les forces spirituelles les plus puissantes correspondaient alors avec l'au-delà. Les barrières temporelles disparaissaient provisoirement et un déséquilibre spatial se produisait ; une frontière entre deux périodes où le temps et l'espace étaient temporairement gelés et les lois normales suspendues. Les barrières se brisaient et la porte du royaume des morts s’ouvrait ; c'était le moment où ce passage était emprunté par les vivants pour rencontrer leurs parents décédés […]

Mais comment, d'une fête celtique et païenne, en sommes-nous arrivés à un Halloween américain ? Après la conquête par les Romains d'une grande partie des territoires celtiques et la romanisation conséquente de ces peuples, le monde celtique fut inévitablement influencé par les traditions romaines, d'abord également païennes, comme les fêtes dédiées à la déesse romaine de la moisson, Pomona (illustration). Plus tard, avec la christianisation de l'Empire romain, les chrétiens ont qualifié les fêtes celtiques et païennes en général de pratiques « hérétiques » et les ont unifiées, adaptées et transformées en fêtes chrétiennes ; c’est ainsi que la Celtic Samhain ou le Freysblót Viking (vers le 15 octobre et avec la même signification que la fête celtique) est devenu la fête de la Toussaint, le 1er novembre, qui en anglais a été traduit par All Hallow's Eve, ou ce qu'elle est aujourd'hui : Halloween (6).»
Même si Halloween - version américaine, c’est-à-dire mercantile sans aucune once de spiritualité, si ce n’est une spiritualité à l’envers - demeurait encore une fête plus ou moins enfantine où les enfants y trouvaient leur comptant et leur compte en bonbons extorqués aux habitants de leur rue ou de leur village, la bonhomie restait de mise.

Ce n’est plus le cas depuis quelques années ; depuis le début des années 2020 plus précisément, lorsque les psychopathes qui ont pris le contrôle de la planète ont voulu imposer leur conception du monde et le dieu auquel il rendent un culte fervent: Satan; les masques se sont durcis et apparaissent de plus en plus effrayants, tombant dans une caricature grand-guignolesque, pleine de sang, de monstres et de gadgets démoniaques qui conviennent mal à l’esprit d’innocence qui devrait être la marque qui sied à des manifestations enfantines. Mais ceci rentre dans le processus de satanisation du monde ; les « esprits forts » se gausseront: mais ce n’est pas moi qui ai inventé cette nouvelle religion. Les adeptes du « satanisme » étaient en place bien avant l’avènement de ces religions abrahamiques, ils n’ont fait que récupérer le fruit de leur travail en récupérant le personnage de Satan, l’ »ange rebelle », le « prince de notre monde », exclu du paradis parce qu’il voulait se mesurer à Dieu (7) , une créature qu’on dirait fabriquée afin qu’elle mette en œuvre les projets radicaux de ces personnages occultes qui veulent s’emparer de notre monde et qui ne paraissent guère loin d’y parvenir ; la France semble constituer une base – ou une cible - importante pour ces énergumènes (8) qu’ils s’emploient à détruire méthodiquement, à commencer par ses fondements religieux et le patrimoine bâti qui en constitue l’aspect visible et concret sur lesquels ils ne cessent de s’acharner.
Le projet des satanistes: du passé, faisons table rase
Fête de la musique
C’est le passé dans son ensemble qui est attaqué par les satano-mondialistes avec toujours la même méthode : récupérer et détourner à leur profit des événements marquants de ce que ces gens considèrent comme l’ancien monde : ainsi, la Fête de la musique fut organisée pour la première fois le 21 juin 1982 sous le patronage du ministre de la Culture de l’époque, Jack Lang, et a permis de court-circuiter l’une des plus importantes fêtes du paganisme alors en pleine renaissance sous l’égide de la Nouvelle droite: le solstice d’été.
C’est qu’il s’agit de détruire toutes les anciennes structures traditionnelles qui régissaient jusqu’alors le monde plutôt que de les réhabiliter.
Depuis, cette fête s’est internationalisée et a lieu dans 110 pays à travers la planète.

Monuments religieux incendiés
Depuis la grande offensive des satano-mondialistes contre les peuples, au début des années 2020, il ne se passe pas un mois en France sans qu’une église ne soit détruite par un acte malveillant (9), Notre-Dame de Paris ayant inauguré ce processus le 15 avril 2019.

Encore ce dimanche 2 novembre 2025, « un incendie s'est déclenché à l'ancien monastère des moines chartreux du Mont-Dieu dans les Ardennes. Près de 50 pompiers intervenaient sur place au plus fort du sinistre, qui a frappé un monument irremplaçable du patrimoine ardennais et national. » (France Info). Le bâtiment n’était pas occupé ; les moines qui y logeaient ont été chassés par la Révolution française. Il est classé Monument historique.
La religion chrétienne reste la première religion dans le monde par le nombre de ses adeptes (10), mais elle ne progresse pas en France ; il faut dire qu’elle a subi, au cours de son histoire, de nombreuses vicissitudes comme les guerres de religion, la Révolution française, la philosophie des Lumières, la laïcisation républicaine, le « progressisme » qui s’entend si bien avec le « darwinisme » : la théorie absurde de « l’évolution » qui va à l’encontre de tout ce que l’on observe des lois de la nature et celles de nos propres vies : le monde terrestre suit un chemin involutif et non évolutif (11).
La désacralisation
La baisse de fréquentation des églises se traduit par une « désacralisation » des bâtiments qui sont pour la plupart classés « Monuments historiques ».
Cette désactivation tout à fait artificielle d’un bâtiment qui conserve, au-delà de son statut et de son utilisation, sa fonction originelle qui est avant tout spirituelle, de ses parois qui suintent du travail méticuleux de ses bâtisseurs, de leur foi, leur abnégation, de leur intelligence, de tout ce qui en a fait un chef-d’œuvre architectural, au-delà même du sens religieux de son érection, est une ignominie ; ces bâtiments appartiennent à tout le peuple français ; les révolutionnaires « français » en ont fait des casernes, des hangars de stockage de foin et de matériaux de toutes sortes, des étables, des écuries, des porcheries, quand ils n’étaient pas détruits pour en récupérer les pierres.
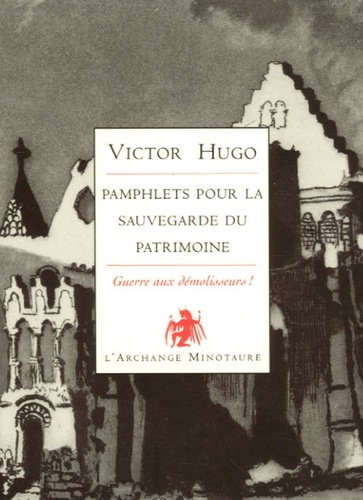
Victor-Hugo disait : « Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait. Qu'on la fasse. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à d'ignobles spéculateurs que leur intérêt imbécile aveugle sur leur honneur ; misérables hommes, et si imbéciles qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont des barbares ! Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit (12)."
Ce concept de « désacralisation » vient à point pour permettre aux imposteurs de « l’art contemporain » de s’implanter dans ces lieux prestigieux en toute impunité.
Il s’agit d’humilier et de ridiculiser le peuple français dans son ensemble, d’effacer toute trace de son ancienne grandeur, à commencer par ce patrimoine architectural unique au monde, et de remplacer cet océan de beauté par un désert peuplé de robots.
Dans un article daté du 23 septembre 2018, l’art de la provocation, je tentais de démonter les rouages pernicieux qui nous sommaient de préférer la laideur et l’absurdité:
« Les super‐riches de l’Ordre mondial n’ont pas mis beaucoup de temps à comprendre que cette arnaque qu’ils ont eux‐mêmes initiée pouvait être également utile à leurs portefeuilles ; comme l’art provocateur est virtuel, ils ont créé une monnaie adéquate : l’art provocateur lui‐même.
Ainsi donc, les tableaux, sculptures, installations et autres performances ne sont rien d’autre qu’une monnaie virtuelle dont ils se servent avec profit puisqu’ils se sont débrouillés pour faire en sorte que les œuvres d’art soient défiscalisées quand leurs entreprises achètent des œuvres d’artistes vivants. On comprend bien que la qualité des œuvres n’a aucune importance dans la mesure où l’artiste a su les vendre avec le maximum de publicité, les publicitaires et les médias, appartenant eux aussi aux super‐riches, assurant le service après‐vente (13).»
Voici un court dialogue que j’ai eu sur Facebook, il y a quelques jours, avec l’un de ces « désacralisateurs » :
- Moi : « Ridiculiser le patrimoine et la religion, vous trouvez ça bien ? »
- Le désacralisateur :-« L’abbaye d’Arthous n’est plus vouée au culte catholique depuis la Révolution française ! Elle est désacralisée depuis des siècles, c’est-à-dire qu’il n’y a plus aucun objet de culte présent dans les lieux ni aucune célébration à caractère religieux. Le site à l’abandon a été acquis par le baron d’Artigues, et sa fille en a fait don au département en 1964, et après de nombreux travaux, le site est devenu en 2003 le Site départemental du patrimoine (des Landes, ndlr) et abrite dans ces bâtiments le musée départemental d’histoire et d’archéologie. Quant à votre appréciation sur l’exposition temporaire elle n’engage que vous. »






Vous trouverez ci-joints quelques exemplaires des « œuvres » de l’artiste présentées dans cette abbaye « désacralisée » ainsi que d’autres photos d’autres œuvres contemporaines présentées dans d’autres lieux de culte ou, plus largement, appartenant à notre patrimoine.
C’est notre « projet » !
Nous pouvons retirer un constat de tout ce qui vient d’être dit : ce n’est pas la philosophie des « Lumières » ni la « démocratie » qui remplacera le christianisme, ce n’est pas non plus le concept de « République » qui leur a succédé (le terme « France » pour désigner notre pays n’est plus utilisé par nos gouvernants, nous vivons en République, pas en France), ce n’est pas plus le darwinisme dont j’ai craint il y a quelques années qu’il puisse s’ériger en nouvelle religion du « progrès ».
Non: la nouvelle religion qu’on nous propose est conçue par une puissance qu’on n’attendait pas et dont on a peine encore à imaginer qu’elle puisse réellement exister, c’est un concept dont l’élaboration est primaire, fruste, simpliste, sorti à la fois d’un lointain passé, des bas-fonds du bas-astral, avec son cortège de morts-vivants se nourrissant de sang juvénile, et « en même temps » le produit d’un « projet » futuriste - « C’est notre projet ! » hurlait Macron lors de son accession au pouvoir – un « projet » qui fait appel aux plus récentes techniques de la science, de la communication et de la manipulation pour transformer les humains en machines robotisées : le transhumanisme, issu tout droit du monde des Titans.
Cette nouvelle puissance qui gouverne notre planète (pour l’instant) est le fruit de l’alliance maléfique des anciens maîtres de ce monde qui n’en finit pas de mourir : c’est le pacte de sang qui lie Titan et Satan réunis dans le but de remplacer Dieu.
Ils n’arriveront pas à leurs fins.
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ; pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés ».
Pierre-Emile Blairon
Notes:
(1) Voir mon article du 18 octobre 2025: Le consternant dilemme d’un peuple à l’agonie: s’acoquiner avec les islamo-gauchistes ou se prostituer avec les sionisto-droitards?
(2) Le déclin de l’Occident, NRF Gallimard
(3) Une sorte d’« internationale » paysanne à l’image de « l’Internationale » ouvrière, laquelle a piteusement échoué dans ses objectifs car dénuée de toute racine mais aussi parce que l’ouvrier n’aspire qu’à un but : s’extraire le plus rapidement possible de sa condition pour devenir un bourgeois.
(4) Orange, la couleur de la courge, et noire, la couleur de la mort.
(5) http://racines.traditions.free.fr/
(6) https://www.terreetpeuple.com/paganisme-memoire-35/164-fe... .
(7) Voir mon article du 21 septembre 2025 : Quelle est donc cette « civilisation judéo-chrétienne » à laquelle nous appartiendrions ?
(8) Voir mon article du 3 octobre 2023 : La France, laboratoire de la Secte mondialiste.
(9) Voir mon article du 6 décembre 2024 : Pourquoi les monuments français brûlent-ils ?
(10) Avec 2,3 milliards de personnes (+122 millions), "les chrétiens restent le plus important groupe religieux dans le monde" et ils représentent 28,8% de la population mondiale.
(11) Lire à ce sujet les ouvrages du professeur Didier Raoult, Dépasser Darwin, Plon, 2010 et Homo chaoticus, Michel Lafon, 2024 et, bien sûr, Evola, Guénon, Nietzsche, Eliade.
(12) Victor Hugo, "Guerre aux démolisseurs", Revue des deux mondes, 1° mars 1832
(13) Aude de Kerros, Exposition Kermit, plug anal : une esthétique au service de l’hyper-classe https://www.youtube.com/watch?v=OKFyHtigiw
11:58 Publié dans Actualité, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, traditions, halloween |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 13 novembre 2025
Douguine et la Kabbale - Les racines sacrées que le libéralisme veut oublier

Douguine et la Kabbale
Les racines sacrées que le libéralisme veut oublier
Constantin von Hoffmeister
Constantin von Hoffmeister examine comment un débat mal cité montre un Alexandre Douguine invoquant la Kabbale pour tenter d'expliciter le rejet du sacré par la modernité libérale.
Peu de penseurs contemporains ont été aussi systématiquement mal interprétés qu’Alexandre Douguine. Ses détracteurs n’abordent que rarement ses véritables propos. Au lieu de cela, ils se basent sur des fragments extraits d’échanges plus longs, présentés isolément pour donner l’illusion qu'il répand de l'irrationalité ou du fanatisme. Un exemple récent concerne son supposé « éloge de la Kabbale ». En réalité, cette phrase provient d’un débat de 2017 entre Douguine et l’intellectuel juif américain libéral Leon Wieseltier, et lorsqu’on l'examine dans son contexte complet, la signification s'avère tout autre.
Voici la vidéo :
Le débat a eu lieu devant un public d’universitaires occidentaux, dont plusieurs penseurs juifs libéraux, parmi lesquels le futur secrétaire d’État américain Antony Blinken. La tâche de Douguine dans ce cadre était d'ampleur formidable: défendre l’idée de Tradition, d’ordre métaphysique, et de dignité spirituelle des peuples face à un public profondément emberlificoté dans l’universalisme des Lumières.
Wieseltier commence par déclarer l’obsolescence de toute sagesse traditionnelle:
"Il n’y a absolument rien de nouveau dans le populisme, et il n’y a absolument rien de nouveau dans la foi mystique et la sagesse du peuple. Ce sont des idées très anciennes et, à mon avis, de très vieilles erreurs, parce qu’une des choses que montre l’histoire…". Etc.
Dans cette introduction, Wieseltier rejette à la fois le populisme et la tradition mystique comme des erreurs dépassées, des reliques d’une époque pré-rationnelle. Son argumentation implique que tous les appels à « la sagesse du peuple » ou à l’héritage sacré doivent en fin de compte conduire à la tyrannie ou à la folie. C’est la thèse libérale classique: que la liberté est sauvegardée par le scepticisme, par la raison procédurale, et par la neutralisation délibérée de l’âme collective.
Douguine l’interrompt avec une déclaration provocante, qui touche aux racines de la civilisation même de son adversaire:
"La tradition de la Kabbale est la plus grande réalisation de l’esprit humain".
La phrase, si souvent citée contre lui, n’était pas un sermon mais un défi. Douguine invoquait la tradition cabalistique — si profondément ancrée dans la métaphysique juive — comme l'exemple d’un héritage spirituel vivant. Ce faisant, il forçait Wieseltier à faire face à un paradoxe: comment peut-on nier la valeur de la Tradition tout en appartenant à un peuple dont le système mystique a inspiré des siècles de vie intellectuelle et religieuse?
Wieseltier répond en insistant, avec l’autorité calme d’un rationaliste libéral:
"Mon ami, j’ai étudié la Kabbale toute ma vie en hébreu, et je dois vous dire que cela n’a absolument rien à voir avec la sagesse du peuple. Ce que montre l’histoire, c’est que la sagesse du peuple devient souvent une justification pour des crimes terribles. Et que ce qui est présenté comme la sagesse du peuple peut conduire directement au mal. Et si nous nous référons au système américain, assurément, lorsque les Pères fondateurs ont écrit notre Constitution, ils ont pris le populisme en considération. Ils l’ont appelé démocratie directe. Et ils l’ont rejeté au profit de la démocratie représentative, précisément pour permettre la délibération et la prise en considération rationnelle des questions auxquelles le pays est confronté".
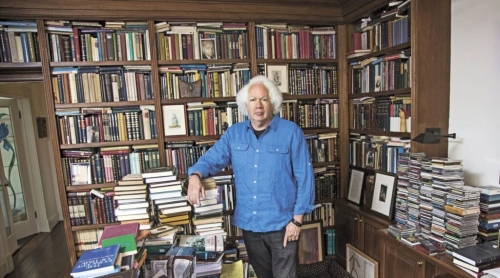
Cette réponse est révélatrice. Wieseltier (photo) rejette explicitement toute association entre la sagesse kabbalistique et l’esprit collectif d’un peuple. Il met en garde que ce qu’on appelle « la sagesse du peuple » peut devenir «une panoplie de justifications pour des crimes terribles». Pour lui, les pères fondateurs de la démocratie (américaine) avaient raison de supprimer la participation directe au profit d’un ordre médiatisé et technocratique: un ordre de raison oblitérant l’âme, un ordre de délibération dominant toute passion, et un ordre universaliste bridant tout réflexe identitaire.
L’intervention brève de Douguine, lorsqu’elle est replacée dans son contexte, prend toute sa portée philosophique. Il ne « promeut pas la Kabbale » pour les Russes orthodoxes ni ne loue le mysticisme juif. Il confronte son adversaire avec son propre héritage sacré, en l’utilisant comme un prisme pour révéler ce que le libéralisme moderne a perdu. La remarque de Douguine, « La tradition de la Kabbale est la plus grande réussite de l’esprit humain », est un appel ironique mais sérieux à la réalité de la transcendance—un appel à l’idée que l’humanité a un jour cherché à comprendre la structure divine de l’être, et que cette aspiration est supérieure au pragmatisme gestionnaire de la modernité.
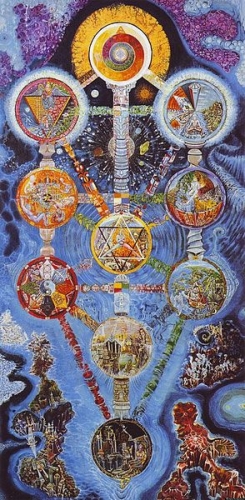
Pourtant, isolée, cette seule ligne, extraite du flot de ses paroles, a été instrumentalisée pour dépeindre Douguine comme un crypto-mystique prêchant déraisonnablement des doctrines ésotériques aux masses. La vidéo complète réfute cela. Elle montre un philosophe rigoureux utilisant la rhétorique stratégiquement, poussant son adversaire à reconnaître qu’au sein même de la tradition juive, il y eut autrefois une hiérarchie de sens et une conception de l’ordre cosmique totalement étrangère à l’égalitarisme libéral.
Nous avons là l’essence de la confrontation de Douguine avec la pensée occidentale: la défense de la Tradition contre la réduction de toutes les valeurs à une neutralité procédurale. Dans le même débat, il parle de Trump, du retour de l’histoire, du besoin de pluralité civilisationnelle, et on peut percevoir un réel malaise dans le public. Les intellectuels libéraux, habitués à parler depuis le sommet moral du « progrès », rencontrent soudain un homme qui rejette totalement leur cadre conceptuel.
Le débat de 2017 reste l’une des rencontres les plus illustratives entre deux visions du monde: l’une qui vénère le sacré, et l’autre qui idolâtre l’autosuffisance de la raison. Lorsqu’il parle de la Kabbale, Douguine n’abandonne pas l’orthodoxie ou la Russie. Au contraire, il rappelle à ses auditeurs et critiques que même leurs propres traditions religieuses ont autrefois aspiré à l’Absolu. Ce geste — philosophique, rhétorique et civilisationnel — reste entièrement fidèle à son projet plus large: ressusciter un monde où l’esprit, et non l’abstraction, détermine le destin des peuples.
Le populisme, dans son sens le plus profond, transcende la division conventionnelle gauche/droite. C’est le pouls de la volonté collective: le cri d’un peuple en quête de sens contre la stérilité corporatiste. Qu’il soit habillé de couleurs socialistes ou nationalistes, le populisme affirme que la politique n’est pas une simple gestion, mais une destinée, la renaissance de l’esprit dans l’histoire.
La Kabbale est une manière ancienne du judaïsme de voir le monde comme une chaîne vivante entre Dieu et l’homme. Des fragments tombent, des lettres se réagencent, et la lumière perce le code. La Kabbale enseigne que toute la création coule à travers dix étapes d’énergie divine, reliant le ciel et la terre. Des griffonnages dans les marges, des circuits de souffle, le courant divin reconfiguré. Chaque partie de la vie reflète ce motif, des mouvements des étoiles aux pensées d’une personne. Un nom se plie en un autre, des étincelles tombent à travers l’alphabet. Étudier la Kabbale, c’est rechercher comment l’esprit se déplace à travers le monde et en soi, donnant ordre, sens et direction à l’existence. Tout se connecte, se disperse et revient, tout se réécrit dans la lumière.
12:12 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 octobre 2025
Sacré & consumérisme: des célébrations de Samhain à Halloween

Sacré & consumérisme: des célébrations de Samhain à Halloween
La comparaison entre les deux interprétations de la fête de passage met en évidence la dégénérescence des liturgies dans le calendrier de la matérialité économique
par Riccardo Mulas
Source: https://www.barbadillo.it/125538-sacro-consumismo-dalle-c...
Samhain, le Nouvel An celtique
Nous l’admettons. La “fête” d’Halloween ne nous a jamais enthousiasmés. Au contraire, nous ne cachons pas une certaine méfiance envers une date que nous n’avons jamais vraiment ressentie comme étant celle qui révèlerait une identité propre. À vrai dire, les préjugés ont toujours été nombreux. Si nous devions écrire les mots qui viennent à l’esprit en pensant au 31 octobre, ce seraient avant tout: “costumes effrayants”. Ensuite, nous penserions à des fêtes déguisées, des soirées à thème, des locaux décorés, des étagères de supermarchés envahies par des citrouilles en plastique et des déguisements. Et à peu d’autres choses.
En somme, dans l’imaginaire, Halloween s’est toujours présenté comme une sorte de carnaval automnal, peut-être plus sombre, plus macabre, mais toujours dépourvu de substance. De même que nous n’attribuons pas de signification particulière aux œufs de Pâques ou aux bas de la Befana, symboles vidés à cause de leur commercialisation excessive; nous pensons que le 31 octobre est également devenu une mise en scène de style capitaliste, réduite au spectacle et à la consommation, privée de toute valeur spirituelle originelle.
Nous utilisons volontairement le mot “dégénéré” parce qu’animés par la curiosité de comprendre ce que jusqu’alors nous avions seulement jugé, nous avons découvert que derrière Halloween se cache en réalité une célébration très ancienne, dotée d’un sens symbolique et spirituel profond: le Samhain des peuples celtes. En laissant de côté les apparences et les préjugés, nous avons approfondi ses origines et sommes tombés sur une histoire qui fascine et surprend, faite de mythes, de légendes et de rites nés dans la mystérieuse et verte Irlande.
Les racines celtiques d’une fête de “passage”
Les Celtes, peuples de bergers intimement liés aux rythmes de la nature, fondaient leur existence sur une relation sacrée avec la terre, source de vie et de prospérité. Pour eux, chaque saison avait une signification précise, et le passage du temps coïncidait avec le renouvellement cyclique de la nature. La fin de l’été, qui tombait précisément le 31 octobre, marquait la fin des pâturages et des récoltes, ainsi que le début de l’hiver, saison d’obscurité et de repos. En gaélique, Samhuinn signifiait “fin de l’été”.
Halloween naît donc de ces fêtes de passage, où la communauté célébrait non seulement la clôture d’un cycle, mais aussi le début de la nouvelle année naturelle. C’était un temps de transition, chargé d’ambivalence, de joie et de peur, de gratitude et d’incertitude, de fête et d’introspection. Le Samhain représentait le moment où les liens sociaux et spirituels se renforçaient, et où les rites de protection et de purification servaient à conjurer les peurs collectives et à invoquer la bienveillance des dieux.

Avec le christianisme
Avec l’avènement du christianisme, ces traditions ne disparurent pas complètement ; au contraire, elles furent en partie intégrées, superposées ou réinterprétées. Le culte des esprits et de la mort se fondit avec celui des défunts et des saints, en maintenant vive la même tension spirituelle : l’idée que la “mort de l’été” n’était pas la fin, mais le début d’un nouveau cycle vital. En hiver, en effet, la nature semble mourir, mais en réalité elle se renouvelle dans le silence de la terre, où reposent les graines et les morts. De cette analogie naît le lien profond entre Samhain et le culte des défunts : la croyance que, dans la nuit entre la vieille et la nouvelle année, les esprits pouvaient franchir le seuil entre les mondes, unissant pour un instant l’au-delà et la vie terrestre.
Cette nuit-là, les Celtes allumaient le Feu Sacré sur les collines, symbole de purification et de protection. Pendant trois jours, on dansait, on festoyait, on se déguisait avec la peau des animaux sacrifiés pour effrayer les esprits maléfiques, et on laissait en dehors des maisons de la nourriture et du lait pour les esprits bienveillants.

C’était une fête qui parlait de peur et d’espoir, de fin et de renaissance, de nuit et de lumière. Un moment d’unité, où la communauté retrouvait sa propre essence face au plus grand mystère : celui du temps et de la mort.
La déformation d’Halloween
Si l’on met en parallèle les deux visions de la fête en question, l’ancienne et la moderne, on voit plus clairement l’évolution, ou plutôt, la dégénérescence, de la société: d’un monde où l’esprit dominait la matière, à un monde où la matière a fini par étouffer l’esprit; d’une communauté qui, en se rassemblant autour d’un feu sacré, affirmait son unité, à la société moderne qui exploite chaque occasion pour alimenter le consumérisme et remplir les poches de la caste marchande.
Halloween représente donc le miroir de notre temps, une métaphore d’une époque perdue et d’une société, qui n'est plus communauté, une époque qui erre entre la dissolution de la tradition, du sacré et de la mémoire, et l’émergence du monde illusoire de la consommation et de la matière.
23:20 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, samhain, automne, traditions celtiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 22 octobre 2025
La lecture dialectique initiale de l’œuvre d’Evola selon Douguine
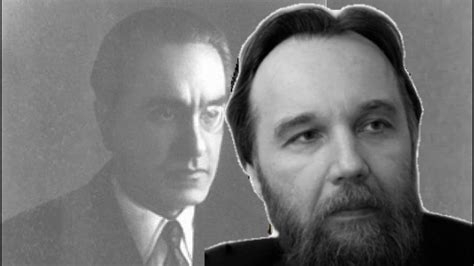
La lecture dialectique initiale de l’œuvre d’Evola selon Douguine
Raphael Machado
L’étude de la dimension politique de l’œuvre du philosophe traditionaliste italien Julius Evola se heurte toujours au « mur » représenté par sa phase tardive — celle qui se définit par le célèbre (et peu lu) livre Cavalcare la Tigre (= Chevaucher le Tigre).
L’œuvre en question tire son nom d’une parabole orientale qui raconte la terreur causée par un grand tigre dans une région désertique. La seule solution, que trouve le « héros », le cas échéant, est, au lieu d’affronter directement le tigre, de sauter sur son dos, de l’agripper et de s’y tenir jusqu’à ce que la bête s’épuise. Ce n’est qu’alors qu’il devient possible de donner le « coup de grâce ».
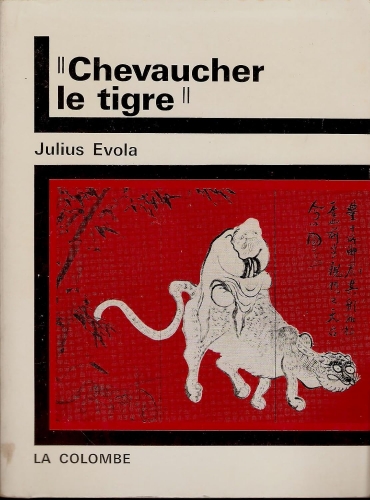
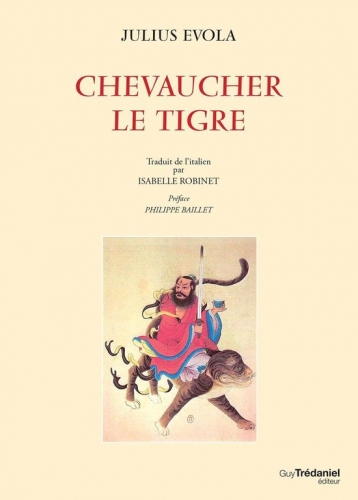
Ce que cela signifie politiquement, pour Evola, fait l’objet d’innombrables interprétations divergentes.
La période tardive d’Evola est habituellement décrite comme une période de «lassitude» face à l’engagement politique — surtout celui de ses «disciples», puisque lui-même n’a eu que quelques années pour tenter d'influencer positivement les régimes fascistes européens des années 30-40.
Cependant, l’Italie des années 50 et du début des années 60 représentait le nadir spirituel de la nation. Elle était occupée militairement par une puissance étrangère, culturellement corrompue par l’invasion de produits de l’industrie culturelle américaine, psychologiquement fracturée par le chaos démocratique, et dans le panorama politique intérieur, Evola voyait que même le nationalisme anti-libéral et anti-communiste s’était rendu conforme à l’ordre hégémonique de manière qui n’était pas simplement superficielle.

En sous-main, de plus, les plus exaltés commençaient à recourir au terrorisme et à la guérilla urbaine comme tactique de déstabilisation de l’ordre libéral-démocratique. Aux yeux d’Evola, une aventure vouée à l'échec.
Dans ce contexte, la posture à adopter par « l’homme différencié » est celle de l’apolitisme (l'apoliteia).
À partir de ce point, cependant, il est possible d’offrir une vision peut-être plus profonde; la question pourrait être la suivante: dans le stade actuel du cycle civilisationnel, tout effort pour inverser ou contenir la déchéance par l’action politique serait voué à l’échec — le cycle étant trop avancé, et la pourriture intérieure du fascisme et son échec inévitable en étant la preuve évidente.
Selon cette lecture, assez répandue, aucune action politique n’est plus utile ou nécessaire jusqu’à la fin du Kali Yuga. Cavalcare la Tigre représente l’attitude de ceux qui, simplement, « vivent parmi les ruines » en attendant la Fin. D’où l’apolitisme. Naturellement, il ne s’agit pas d’une attente passive, mais d’une attente dans laquelle « l’homme différencié » entreprend le chemin de la lutte spirituelle, cherchant à atteindre sa libération — ou, selon la phase philosophique d’Evola, à devenir « l’individu absolu ».

Certains disciples d’Evola ont toutefois compris l’apolitisme non comme un abandon de tout engagement politique extérieur, mais comme une disposition intérieure impliquant un double engagement: 1) ne pas se soumettre aux règles politiques du système hégémonique; 2) ne pas s’impliquer émotionnellement dans tout engagement politique extérieur (d’où l’appel au dialogue entre Krishna et Arjuna dans la Bhagavad Gita, comme modèle d’un ethos de l'« action désintéressée »). Pour l’« homme différencié », il restait, selon cette lecture plus radicale, le chemin de la « milice » et de la « guerre sainte ».
Ce dernier point est resté marginal dans l’école évolienne, la majorité ayant toujours interprété l’apolitisme comme une abandon total de l’engagement politique et une focalisation complète sur la « jihad intérieur », avec un autre courant adoptant une posture « modérée » à l’égard de l’engagement politique.
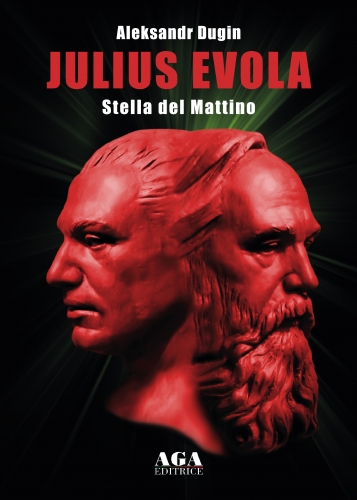
Le « premier Douguine » propose une lecture particulière de cette question.
Plus récemment, Douguine s’est longuement replongé dans la pensée d’Evola et lui a consacré un livre entier — Julius Evola : Stella del Mattino (= Étoile du Matin), publié jusqu’à présent en Italie uniquement. Dans cette œuvre, notre ami russe propose une lecture essentiellement métaphysique et alchimique de la métaphore du Cavalcare la tigre, en se concentrant sur le caractère yang/yin de la métaphore (puisque Douguine fait remonter la maxime jusqu’à la Chine ancienne), où le tigre représente les forces déchaînées du yin, et le chevaucheur, qui est sous-entendu dans la parabole, n’est pas proprement le yang (qui serait, en réalité, affaibli, déchu à l’ère présente), mais le représentant terrestre du yang.
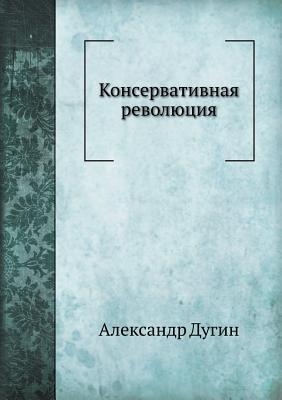 Mais 35 ans auparavant, en 1990, Douguine avait formulé quelques réflexions politiques significatives sur l'ouvrage Cavalcare la Tigre, qui furent peu après publiées dans son livre intitulé Révolution conservatrice (Konservativnaïa Revolioutsia). Le penseur russe le situe spécifiquement dans une sorte d’antipode apparent de l’« impérialiste païen ».
Mais 35 ans auparavant, en 1990, Douguine avait formulé quelques réflexions politiques significatives sur l'ouvrage Cavalcare la Tigre, qui furent peu après publiées dans son livre intitulé Révolution conservatrice (Konservativnaïa Revolioutsia). Le penseur russe le situe spécifiquement dans une sorte d’antipode apparent de l’« impérialiste païen ».
Le terme désigne le sujet hypothétique de l’ouvrage Impérialisme païen, un texte de jeunesse dans lequel Evola propose une critique programmatique du fascisme à partir de la perspective d’une pensée politique « conservatrice révolutionnaire » fondée sur une tradition impériale à la fois romaine et gibeline. Là, Evola esquisse — parfois de façon générale, parfois en détail — sa conception de l’État idéal, sa « Platonopolis ». L’œuvre représente, peut-être, le « degré maximal » de politisation de la Tradition, et c’est dans ce sens que Douguine le pose comme la contrepartie de Cavalcare la Tigre.
Tandis que la posture prônée dans Cavalcare la Tigre ressemble à celle de l’anarque jüngerien qui amorce son « Waldgang » — ou, en d’autres termes, la figure de l’« anarchiste de droite » — 30 ans auparavant, Evola offrait au monde la perspective de l’« impérialiste païen ». Changement d’avis ? Maturité ?
Douguine nie toute chose de ce genre. Au contraire, dans la lecture douguinienne, l’« homme différencié » reste toujours le même, ce qui change est le monde du devenir, constamment affecté par les mouvements cycliques et les chocs entre volontés de pouvoir.
Et dans la mesure où le monde change, l’« homme différencié » aborde le monde de différentes manières, selon la phase dans laquelle il se trouve. En ce sens, l’« impérialiste païen », le « gibelin radical », le « conservateur révolutionnaire » devient « anarchiste » et « se retire dans la forêt » lorsque les conditions deviennent défavorables, et que la lutte politique devient infructueuse. La seule chose que l’« homme différencié » a à offrir au monde dominé par les forces de la Contre-Institution est son « Non ».
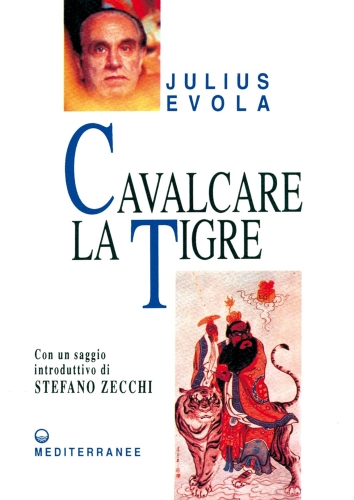
Mais dans la mesure où le monde n’est pas, encore une fois, statique, l’«anarchiste» évolien est toujours prêt à «prendre d’assaut les cieux» lorsque les conditions objectives redeviennent favorables à l’action politique (désintéressée).
En réalité, toute la période de la « jihad intérieur » est aussi une préparation à la conquête extérieure du monde, à la «jihad extérieure», «lorsque les étoiles seront alignées».
La lecture douguinienne de cette question offre la sortie la plus adaptée à l’impasse de la «scolastique évolienne» concernant les possibilités d’action dans les phases finales du Kali Yuga.
14:04 Publié dans Nouvelle Droite, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, traditionalisme révolutionnaire, nouvelle droite, alexandre douguine, julius evola, nouvelle droite russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 octobre 2025
Le pape de glace et la longue désintégration du catholicisme

Le pape de glace et la longue désintégration du catholicisme
Par Nicolas Bonnal
Le nouveau pape américain, qui devait nous faire oublier Bergoglio, bénit les glaçons et prêche un grand remplacement plus rapide de ses ouailles blanches. Voilà où nous en sommes. Le prêchi-prêcha humanitaire évoque depuis Vatican II (au fait ses prêtres ne valent rien, découvrez ou relisez Rama Coomaraswamy pour comprendre) les abeilles, les migrants, et désire ardemment le grand remplacement de l’Europe et des pays blancs. La pauvreté pour tous est un bel objectif qui rime avec les objectifs de Fink et des mondialistes. C’est le Grand Reset pour tous mené par une poignée de manipulateurs de symboles (expression de Robert Reich) qui ont pris la place de la hiérarchie cléricale adoratrice du pauvre et du soumis. Le but reste bien catholique : pauvreté, chasteté et obéissance…
Mais je ne veux pas ici évoquer une déchéance chrétienne. Je veux évoquer un problème chrétien, que des éclaireurs courageux comme Laurent Guyénot (photo, ci-dessous) ont enfin souligné. Laurent a rejoint de grands esprits intuitifs comme Nietzsche et Céline et il a étayé leurs propos incisifs.
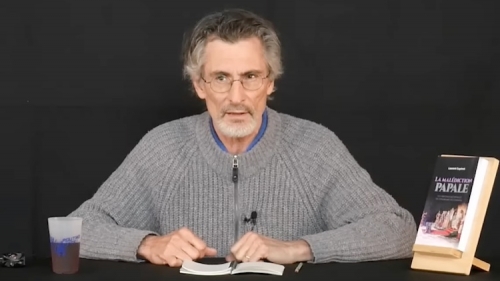
L’autodestruction est devenue une obsession catholique, pendant que les sectes protestantes s’étiolent ou deviennent de plus en plus dangereuses, à commencer comme toujours par l’Angleterre. Après on accuse les juifs mais avec des chrétiens comme ça… certes on pourra toujours fonder une communauté fanatique et désireuse de résister, mais on sait que cela ne dure pas longtemps. L’Etat moderne ou la faiblesse humaine en viennent vite à bout. Et la natalité chrétienne ne tient plus depuis longtemps sur le long terme, contrairement à l’israélienne, plus en forme que jamais.
Il faut en revenir aux origines et bien comprendre qu’on est face finalement à une secte à la fois juive et antisémite qui a connu un succès incroyable. On comprend dès lors pourquoi les Juifs victimes de cet antisémitisme religieux ridicule ne supportaient pas ce cadre dans lequel ils ont survécu impeccablement et qui les a rendus plus forts. Jamais le mot de Nietzsche ne s’est mieux appliqué qu’à eux : ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Le judéo-christianisme actuel qui rime avec judéo-crétinisme ne fait que rendre à César ce qui est à César : c’est le Dieu juif que nous adorons, assez maladroitement, depuis deux mille ans. Là-dessus Céline comme Nietzsche avaient raison. Nietzsche décrit ce Triomphe du peuple sacerdotal dans généalogie de la morale qui est passé par un prophète persécuté par les juifs eux-mêmes, et Céline regrette la défaite des dieux aryens qui annonce la « victoire des douze juifs » et l’engloutissement de l’Europe par le « lupanar afro-asiate » (Céline toujours). Mais certains dont je suis observent justement que cette invasion se produit depuis que nous ne sommes plus du tout chrétiens.
Dans le même élan les grands écrivains catholiques antimodernes se sont rendu compte de la catastrophe : Bernanos a parlé d’une administration cléricale en accord avec les diktats de l’Etat moderne (voir citations plus bas) ; Léon Bloy a parlé de la fin des agonies et de l’atrophie générale de l’esprit chrétien ; enfin Chesterton a parlé de ces idées chrétiennes devenues folles parce qu’elles l’étaient déjà au départ. Mais je mets au défi qui que ce soit de trouver dans l’enseignement de Jésus fils de Joseph un pilier pour établir une civilisation sereine et solide (refus de la famille, des élites, de l’État, de la culture, de l’argent, etc.).
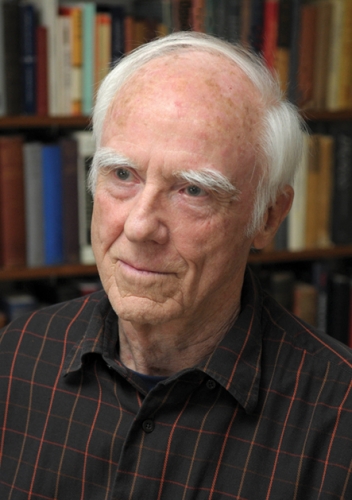
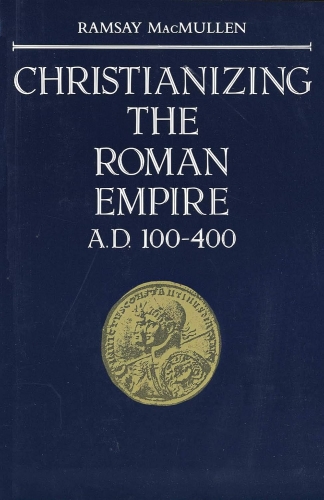
Le christianisme s’est construit ensuite et assez mal comme on a pu le constater au bout de siècles de guerres, de compromissions et d’hérésies. Enfin on ne devient pas chrétien par l’opération du Saint-Esprit mais par la propagande (mot inventé par le Vatican) et par la persécution. Il fallut attendre longtemps pour le comprendre, voyez Laurent Guyénot et quelques autres comme Ramsey MacMullen (photo, ci-dessus). Seule la Renaissance et le boom scientifique de l’époque des Lumières nous ont arrachés (pour le meilleur et pour le pire, mais c’est une autre question) à l’arriération antérieure. Nietzsche a adoré la Renaissance mais regretté Luther et la contre-réforme.
D’un autre côté cette clochardisation chrétienne revient avec le Grand Reset, le prodigieux appauvrissement actuel et la bêtise incroyable qui règne en Occident pour des questions morales et humanitaires. Tout pourrait se terminer par cette apocalypse molle et médiocre, celle que devinait et décrivait brillamment T. S. Eliot dans son texte (texte plus que poème) sur les hommes creux. Mais l’atmosphère de croisade qui règne contre la Russie et le reste du monde ne nous garantit pas non plus un futur équitable. Cet esprit de missionnaire et de croisade morale qui est le fondement du christianisme géopolitique aura été un désastre permanent.
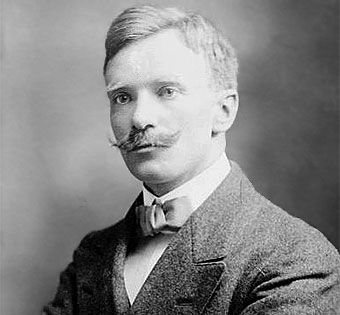
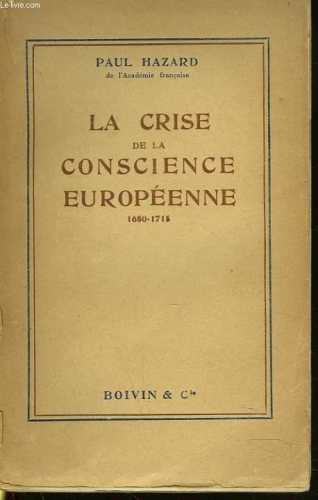
A dire vrai donc la catastrophe chrétienne est ancienne : dans son grand livre sur la crise de la conscience européenne, l’historien Paul Hazard citait Swift qui avec son ironie coutumière se demandait par quoi on allait remplacer le christianisme au siècle du libertinage et du capitalisme qui commençait. On était en 1707 et toutes les Lumières liquidaient déjà le christianisme. La France des lettres persanes et de Manon Lescaut n’est plus chrétienne dès le début du XVIIIème siècle et elle attend son coup de grâce qui s’est passé sans coup férir comme l’observait le RP Bruckberger. Léon Bloy a même vu que la révolution n’avait pas produit de martyrs ; elle a juste rétréci et raccourci les hommes. Même Victor Hugo, qui est parfois un Nietzsche de gauche, remarque dans son Quatre-Vingt-Treize un rétrécissement des hommes depuis la Révolution Française.
Le christianisme écrasé et rétréci par la Révolution et l’Empire (l’agent Napoléon a détruit Espagne catholique et la Russie orthodoxe) a subsisté comme on sait ensuite mais il a été remplacé par son masque comme disait Feuerbach vers 1850. La religion déchoit. Gustave de Beaumont l’ami de Tocqueville remarque que le prêcheur a un business aux Etats-Unis. On est déjà dans un « pays juif » dont le dieu est l’argent comme dit Marx dans son texte célèbre sur la question juive : c’est Marx qui a compris que peut-être Beaumont est plus important que Tocqueville pour comprendre le monde moderne. Tocqueville est surtout important dans son tome II quand il pressent et décrit l’esprit socialiste et égalitaire français (plus qu’américain)…

Dieu est mort mais on fait semblant de continuer. L’historien républicain Michelet (portrait) le voit aussi, qui explique qu’une spiritualité morte (zombie, dit Emmanuel Todd de nos jours) peut continuer de durer par habitude et par éducation, il oublie de dire par intérêt, le catholicisme étant devenu depuis le dix-neuvième siècle une religion exclusivement bourgeoise, surtout depuis la disparition de la classe paysanne, que les bourgeois modernes ont mis tant de cœur à exterminer pendant qu’ils modernisaient leurs pays et les déracinaient physiquement et spirituellement. Les petits bergers de Fatima ne reviendront pas, comme le montrait Fellini dans une scène célèbre de Roma.
On a eu des copies de christianisme et on a eu un christianisme bourgeois et conservateur (celui qui a bâti l’Europe totalitaire de von der Leyen avec les socialistes et les informaticiens américains) et on a eu un christianisme apocalyptique réservé à des esprits catastrophés comme l’amusant Léon Bloy qui plaisait bien à Kafka (son livre sur les juifs dit-il est surtout un livre contre les antisémites de son temps comme Drumont). C’est ce christianisme qui annonce les cosaques et le Saint-Esprit en 1917 et qui récupère les bolcheviques et le communisme, en attendant de déboucher sur un mondialisme de marché qui, à tout point de vue, est pire que le communisme (ce dernier garantissait comme le franquisme néo-catholique natalité, éducation, santé et éducation gratuite…). Mais c’est celui que veulent les catholiques et les chrétiens un peu partout dans le monde, avec leurs partis de droite ou de centre-droit. La religion climatique s’est agrégée à ce train de la mort et du nihilisme ambiant.
Certains enfin croient toujours à une solution finale, à un réveil chrétien ultime mais ils ignorent l’histoire du christianisme telle qu’on devrait l’enseigner. La destruction de l’empire romain, l’invasion migratoire sous Théodose et la dépopulation qui s'en est suivie suite à l’application du christianisme (les âges sombres, comme on dit justement) au cours du premier millénaire, les invraisemblables génocides, persécutions, croisades génocidaires et inutiles, guerres civiles et totalitarismes papistes (voyez Luchaire ou notre ami Guyénot) et enfin pour finir une cauchemardesque atmosphère de vacance fatiguée et de fumet bourgeois qui se dégagent des chrétiens de la fin, tout cela ne donne pas du paquet-cadeau une haute image. Mais ce n’est grave : - continuons, comme dit un personnage de Sartre aux enfers.
On va donner la dizaine de citations indispensables qui serviront à éclairer ce que nous venons de dire. Commençons par les écrivains chrétiens qui ont compris la catastrophe chrétienne moderne :
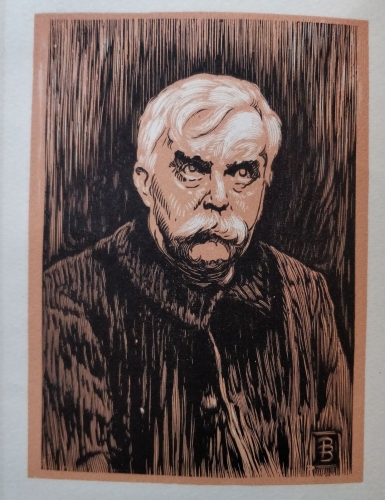
Léon Bloy :
« Le christianisme, quand il en reste, n’est qu’une surenchère de bêtise ou de lâcheté. On ne vend même plus Jésus-Christ, on le bazarde, et les pleutres enfants de l’Église se tiennent humblement à la porte de la Synagogue, pour mendier un petit bout de la corde de Judas qu’on leur décerne, enfin, de guerre lasse, avec accompagnement d’un nombre infini de coups de souliers. »
Autre envolée magnifique :
« On est bien forcé d’avouer que c’est tout à fait fini, maintenant, le spiritualisme chrétien, puisque, depuis trois siècles, rien n’a pu restituer un semblant de verdeur à la souche calcinée des vieilles croyances. Quelques formules sentimentales donnent encore l’illusion de la vie, mais on est mort, en réalité, vraiment mort. Le Jansénisme, cet infâme arrière-suint de l’émonctoire calviniste, n’a-t-il pas fini par se pourlécher lui-même, avec une langue de Jésuite sélectivement obtenue, et la racaille philosophique n’a-t-elle pas fait épouser sa progéniture aux plus hautes nichées du gallicanisme ? La Terreur elle-même, qui aurait dû, semble-t-il, avoir la magnifiante efficacité des persécutions antiques, n’a servi qu’à rapetisser encore les chrétiens qu’elle a raccourcis. »
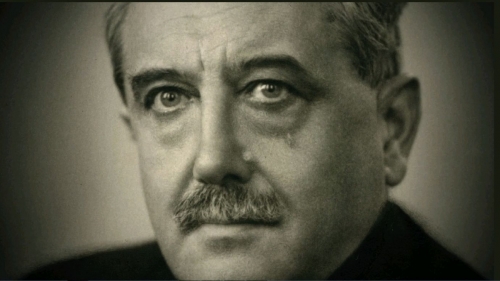
Bernanos :
« Les puissantes démocraties capitalistes de demain, organisées pour l’exploitation rationnelle de l’homme au profit de l’espèce, avec leur étatisme forcené, l’inextricable réseau des institutions de prévoyance et d’assurances, finiront par élever entre l’individu et l’Église une barrière administrative qu’aucun Vincent de Paul n’essaiera même plus de franchir. Dès lors, il pourra bien subsister quelque part un pape, une hiérarchie, ce qu’il faut enfin pour que la parole donnée par Dieu soit gardée jusqu’à la fin, on pourra même y joindre, à la rigueur, quelques fonctionnaires ecclésiastiques tolérés ou même entretenus par l’État, au titre d’auxiliaires du médecin psychiatre, et qui n’ambitionneront rien tant que d’être traités un jour de « cher maître » par cet imposant confrère… Seulement, la chrétienté sera morte. Peut-être n’est-elle plus déjà qu’un rêve ? »
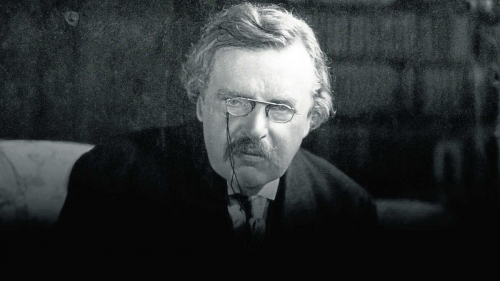
Chesterton :
« Le monde moderne n’est pas méchant ; à certains égards il est beaucoup trop bon. Il est rempli de vertus farouches et gaspillées. Quand un certain ordre religieux est ébranlé – comme le Christianisme le fut sous la Réforme – les vices ne sont pas seuls à se trouver libérés. Certes les vices sont libérés et ils errent à l’aventure et ils font des ravages. Mais les vertus aussi sont libérées et elles errent, plus farouches encore, et elles font des ravages plus terribles encore. Le monde moderne est envahi des vieilles vertus chrétiennes devenues folles. Les vertus sont devenues folles pour avoir été isolées les unes des autres, contraintes à errer chacune en sa solitude. »
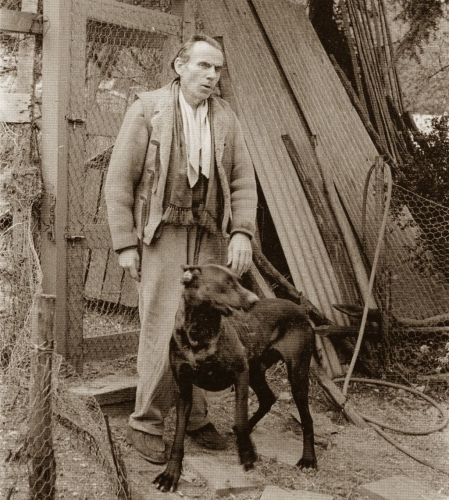
Passons aux antichrétiens :
Céline :
« Drumont et Gobineau se raccrochent à leur Mère l’Église, leur christianisme sacrissime, éperdument. Ils brandissent la croix face au juif, patenté suppôt des enfers, l’exorcisent à tout goupillon. Ce qu’ils reprochent surtout au youtre, avant tout, par-dessus tout, c’est d’être le meurtrier de Jésus, le souilleur d’hostie, l’empêcheur de chapelets en rond… Que ces griefs tiennent peu en l’air ! La croix antidote ? quelle farce ! Comme tout cela est mal pensé, de traviole et faux, cafouilleux, pleurard, timide. L’aryen succombe en vérité de jobardise. Il a happé la religion, la Légende tramée par les juifs expressément pour sa perte, sa châtrerie, sa servitude. Propagée aux races viriles, aux races aryennes détestées, la religion de “Pierre et Paul” fit admirablement son œuvre, elle décatit en mendigots, en sous-hommes dès le berceau, les peuples soumis, les hordes enivrées de littérature christianique, lancées éperdues imbéciles, à la conquête du Saint Suaire, des hosties magiques, délaissant à jamais leurs Dieux, leurs religions exaltantes, leurs Dieux de sang, leurs Dieux de race. Ce n’est pas tout. Crime des crimes, la religion catholique fut à travers toute notre histoire, la grande proxénète, la grande métisseuse des races nobles, la grande procureuse aux pourris (avec tous les saints sacrements), l’enragée contaminatrice. La religion catholique fondée par douze juifs aura fièrement joué tout son rôle lorsque nous aurons disparu, sous les flots de l’énorme tourbe, du géant lupanar afro-asiate qui se prépare à l’horizon. Ainsi la triste vérité, l’aryen n’a jamais su aimer, aduler que le dieu des autres, jamais eu de religion propre, de religion blanche. »

Nietzsche :
« Allons droit à l'exemple le plus saillant. Tout ce qui sur terre a été entrepris contre les « nobles », les « puissants », les « maîtres », le « pouvoir », n'entre pas en ligne de compte, si on le compare à ce que les Juifs ont fait : les Juifs, ce peuple sacerdotal qui a fini par ne pouvoir trouver satisfaction contre ses ennemis et ses dominateurs que par une radicale transmutation de toutes les valeurs, c'est-à-dire par un acte de vindicte essentiellement spirituel. Seul un peuple de prêtres pouvait agir ainsi, ce peuple qui vengeait d'une façon sacerdotale sa haine rentrée. Ce sont clés Juifs, qui, avec une formidable logique, n’ont osé le renversement de l'aristocratique équation des valeurs (bon, noble, puissant, beau, heureux, aimé de Dieu). Ils ont maintenu ce renversement avec l'acharnement d'une haine sans borne (la haine de l'impuissance) et ils ont affirmé : « Les misérables seuls sont les bons; les pauvres, les impuissants, les petits seuls sont les bons; ceux qui souffrent, les nécessiteux, les malades, les difformes sont aussi les seuls pieux, les seuls bénis de Dieu…
On sait qui a recueilli l'héritage de cette dépréciation judaïque… Je rappelle, à propos de 1'iniliative monstrueuse et néfaste au-delà de toute expression que les Juifs ont prise par cette déclaration de guerre radicale entre loules, la conclusion à laquelle je suis arrivé en un autre endroit (Par-delà le bien et le mal, aph. 196). — Je veux dire que c'est avec les Juifs que commence le soulèvement des esclaves dans la morale : ce soulèvement qui traîne à sa suite une histoire longue de vingt siècles et que nous ne perdons aujourd'hui de vue que —parce qu'il a été victorieux... »
Plus important encore sur la fabrication du Christ, sujet tabou entre tous :
« N'est-ce pas par l'occulte magie noire d'une politique vraiment grandiose de la vengeance, d'une vengeance prévoyante, souterraine, lente à saisir et à calculer ses coups, qu'Israël même a dû renier et mettre en croix, à la face du monde, le véritable instrument de sa vengeance, comme si cet instrument était son ennemi mortel, afin que le « monde entier », c'est-à-dire tous les ennemis d'Israël, eussent moins de scrupules à mordre à cet appât? »
19:19 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, catholicisme, christianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



