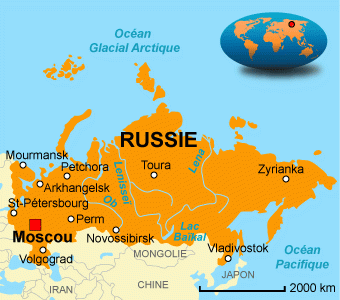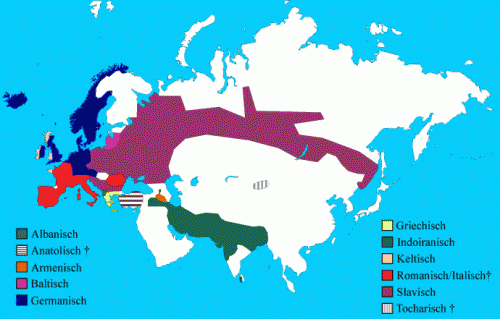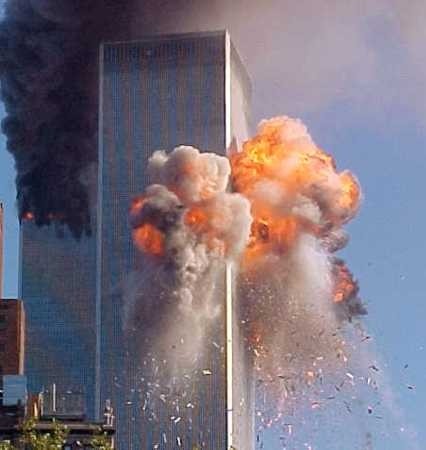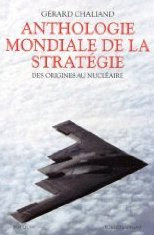
samedi, 04 avril 2009
El problema geostrategico del Islam
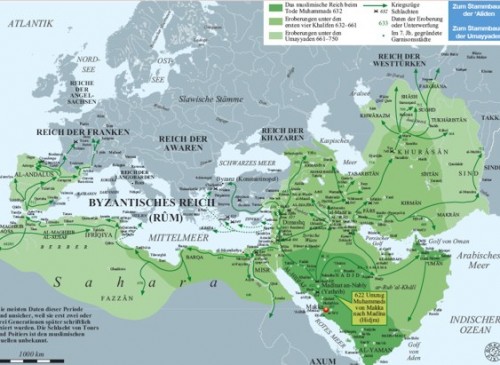 El problema geoestratégico del Islam
por Francisco Torres García / http://www.arbil.org/ La tesis del choque de civilizaciones ha cobrado especial relevancia en conflictos localizados (Chechenia, Yugoslavia, nuevas naciones surgidas tras la desmembración de la URSS); el Islam se está configurando como el gran opositor a la imposición a escala planetaria del modelo occidental; los países musulmanes presentan en su seno graves tensiones que están creando una nueva distribución geoestratégica del mundo; el Islam está en un proceso de expansión que lleva el choque de civilizaciones e el interior de las sociedades occidentales. Todos estos problemas afloran hoy y tendrán imprevisibles e impredecibles consecuencias en las próximas décadas
| |
| El mundo tiene planteados, en el siglo XXI, una serie de problemas globales heredados, en gran medida, de las consecuencias del crecimiento económico iniciado por los países, hoy desarrollados, a finales del siglo XVIII, raíz de la diferenciación económica actual; de la expansión imperialista de las potencias industriales en el siglo XIX; de las injusticias propiciadas por ese crecimiento y esa expansión; de unos procesos de descolonización realizados, en la segunda mitad del siglo XX, en función de los intereses, económicos y estratégicos, de las antiguas potencias coloniales y no de la realidad, fundamentalmente étnica, de las poblaciones afectadas. Circunstancias que han afectado y condicionado la existencia de lo que hoy conocemos como Tercer y Cuarto Mundo. Un bloque de la humanidad caracterizado por el analfabetismo, la enfermedad, la pobreza y el hambre, pero también por la existencia de regímenes políticos oligárquicos disfrazados, en muchas ocasiones, de corruptas democracias. Un bloque sacudido, en una gran parte, por irresolutos conflictos. Un mundo con escasas alternativas y opciones que languidece al quedar enmascarada su dramática realidad bajo los eufemismos analísticos de la dialéctica Norte-Sur, Pobreza-Riqueza y Capital-Trabajo. Ese Tercer y Cuarto Mundo, que no es una realidad global y que carece, pese a las reiteradas declaraciones, de conciencia común, es, en realidad, un conjunto deslavazado de naciones, muy desestructuradas tanto política como económicamente; sumido, en muchos casos, como sucede en al mayor parte del África Negra, en tan ignoradas como permanentes guerras civiles que a nadie interesan y bajo las que subyace el problema del dominio real de los inmensos recursos naturales del continente negro. Un grupo de naciones, mayoritariamente creadas en sus fronteras por las potencias occidentales, que han visto esos problemas genéricos a los que inicialmente hacíamos referencia, agravados por un erróneo y dislocado proceso de descolonización, realizado y dirigido por Occidente para, en muchos casos, continuar, las antiguas o nuevas potencias, detentando el dominio efectivo sobre los recursos y la explotación económica de las nuevas naciones. Un panorama que ha servido, sobre todo en la tres últimas décadas del siglo XX, para dar entidad, en gran parte de esas naciones, especialmente en la más reacias a la occidentalización, a un sentimiento generalizado de animadversión sobre Occidente en general y, debido a su función rectora en el proceso de globalización, a los EEUU en particular. Los cambios experimentados en la definición geopolítica del mundo en la década de los ochenta, con la subsiguiente desaparición de las férreas dictaduras comunistas en gran parte del globo (excepción hecha de Cuba, Vietnam y China); con la expansión de los regímenes democráticos, al menos formalmente, auspiciada por los EEUU tras la caída del comunismo, tanto para el Este de Europa, el África Negra o la América del Centro y del Sur, han creado para el mundo del siglo XXI un escenario muy diferente al del siglo XX. En gran medida, frente a la potencia hegemónica, frente a un sistema económico mundializado al que los restos comunistas no hacen sino ir caminando hacia una pausada integración, frente a un modelo político único, sólo queda, desde un punto de vista estrictamente geopolítico, como elemento disrruptor, el Islam. El Islam, que no existe como una única realidad política y religiosa desde los tiempos del Califato o desde los decenios del amenazante Imperio Turco que logró aglutinar, de una forma ofensiva, a pesar de los continuos levantamientos tribales, a una parte del mismo, continua manteniendo, a pesar de todo, una cierta vinculación religioso-política que se torna efectiva, sobre todo como sentimiento popular, frente al exterior, frente a Occidente. Los cambios geopolíticos de finales del siglo XX, a duras penas si hicieron mella en el mundo musulmán continuando éste ajeno a los procesos de democratización; alejándose, al mismo tiempo, de los procesos abiertos, en algunos países, de occidentalización (Irán, Egipto, Argelia). La caída del comunismo supuso, también para ellos, una cierta liberalización. El apoyo de la URSS a los procesos de descolonización hizo surgir movimientos pro-comunistas o pro-socialistas, defendiendo una especie de socialismo o comunismo islámico en algunos de estos países, aunque, al mismo tiempo, la URSS reprimiera las repúblicas de raíz islámica que había en su seno; así como una cierta tutela y utilización de las organizaciones del Tercer Mundo como el Movimiento de los No Alineados, durante la segunda mitad de la Guerra Fría. Apareciendo también, en este esquema de los años sesenta, el intento de crear, de la mano de Gamel Abdel Nasser la República Árabe Unida que englobaría Egipto, Siria y Yemen del Sur de orientación pro-socialista. O el régimen, también pro-socialista, del partido de Sadam Hussein en Irak. Viejos enemigos de Israel y de Occidente (aun cuando Sadam evolucionara hacia la otra orilla) hoy prácticamente neutralizados por la nueva política egipcia como aliada de los EEUU tras la desaparición de Nasser, los cambios en Siria, la demonización de Irak o la adscripción del Yemen al denominado "eje del mal". Todos estos factores, todos estos cambios, hacen que la imagen real del Islam esté más próxima al modelo geopolítico que nos presentan, para las próximas décadas, los defensores de la tesis del "choque de civilizaciones", como elemento clave en las relaciones internacionales, que del modelo idílico da la aldea global, multicultural y con tensiones puntuales. Choque de civilizaciones, choque de culturas, de concepciones políticas, porque el Islam, desde el punto de vista cultural y religioso, aunque entre ambos es imposible establecer en este mundo una clara disociación, es un espacio en constante expansión que hoy presenta, mereced al fenómeno migratorio, una importante capacidad de penetración en Occidente; donde es imposible calcular hoy la capacidad de influencia política que tendrá en un futuro más o menos inmediato debido a su incapacidad para integrarse masivamente en los modelos culturales y sociales de sus países de acogida, reconstruyendo en ellos, en cambio, sus propias entidades culturales y sociales (gracias, sobre todo, a las inyecciones monetarias del movimiento, de origen y financiación saudí, wahabí). La expansión del Islam se ha hecho evidente con la desmembración de la URSS (Azerbaiyán, Turkmenistán, Kirguizistán o Kazajstán); con la guerra en los Balcanes o el conflicto de Chechenia, lugares donde ha aflorado salvajemente la cuestión religiosa; pero que también existía en el mundo musulmán con el proceso de destrucción del Líbano y la previsible persecución que se desate contra los cristianos maronitas en caso de la disolución, con el estallido de una guerra civil, del Irak. Expansión que tiene como grandes áreas de acción la propia Europa, la antigua Unión Soviética y el África Negra. Expansión que conlleva la difusión doctrinal que tiene inmediatas repercusiones políticas, porque en este mundo, donde los regímenes laicos son una excepción, donde la alianza entre el Trono y la Mezquita es más que una mera imagen retórica o una reliquia heredada del pasado que se conserva para el ritual simbólico del Estado, no existe separación real entre ambas esferas, la política y la religiosa, y allá donde se ha producido los poderes públicos viven acosados por la expansión del integrismo islámico y la continua cesión a sus planteamientos. Un mundo en el que los procesos de secularización, aparentemente una de las señas de identidad del mundo moderno y actual, en vez de avanzar o consolidarse han retrocedido. En gran parte del mundo islámico existe, en las esferas políticas, un claro divorcio entre la clase dirigente, en la mayor parte de los casos, occidentalizada o con claros deseos de serlo, y la inmensa mayoría de la población. Muchos de estos dirigentes, ya sean monarquías, dictaduras u oligárquicas democracias, se han transformado en auténticos esquilmadores de sus pueblos, aupados y sostenidos por Occidente. El ejemplo más claro es el de las llamadas petromonarquías de Kuwait, Qatar (donde se sitúa el mando americano en la zona) y Arabia Saudí, pero también lo son la monarquía marroquí o las monarquía jordana, que experimenta un claro proceso de reubicación. Gobernantes que mantienen enormes bolsas de pobreza paralizando cualquier reforma social. Frente a los problemas internos, muy similares en todos los países del Islam, las minorías dirigentes, sobre todos las últimas generaciones universitarias, que han abandonado la tentación del socialismo islámico, como el promocionado por el dirigente Libio en su difundido "Libro Verde", han vuelto la cara hacia las raíces de su propia civilización predicando un antioccidentalismo a ultranza que ha prendido en amplias capas de la población desde Pakistán a Marruecos. Es el fenómeno del integrismo, que no ha alcanzado mayores logros por su propia división. Frente al fenómeno del integrismo, la mayor parte de los gobiernos del Islam, sólo han podido recurrir al mantenimiento de la situación mediante la represión (por ejemplo, se estima que más de 40.000 fundamentalistas se encuentran encarcelados sin juicio en Egipto), la suspensión de los derechos reconocidos en sus constituciones, y el establecimiento respecto a las manifestaciones públicas de un estado policial (Egipto o Jordania). No ha surgido en estos países, sin embargo, un movimiento, con implantación reseñable, que abogue por la puesta en marcha de regímenes democráticos siguiendo el modelo occidental. Quienes defienden esta postura lo hacen, usualmente, desde los países occidentales, no siendo ni tan siquiera una minoría con un mínimo de recepción en sus países de origen. La defensa de un sistema laico o de la implantación de los Derechos Humanos a la occidental es considerada una herejía por los islamistas. Por otro lado, cada vez que se han producido votaciones, con un mínimo de garantías democráticas, lo que se ha producido ha sido el crecimiento de los partidos islámicos, teniéndose que recurrir a la intervención militar para mantener el sistema (Turquía o Argelia). El sistema de control que ejerce el poder sobre las gentes resulta cada vez más débil; las clases dirigentes se han mantenido en el poder gracias al mantenimiento de fuertes ejércitos para mantener la paz interior, a la alianza con el poder religioso y al dominio de los medios de comunicación. El panorama ha cambiado de forma acelerada en las dos últimas décadas. Hoy, los nuevos medios de comunicación, han permitido que la cadena de televisión Al Yazira, vehículo de difusión del integrismo, se haya convertido en el nuevo Corán para millones de musulmanes. También nos encontramos con la existencia de toda una generación de imanes, transformados en nuevos profetas, que han hecho del integrismo y del antioccidentalismo bandera de movilización. Quedan, finalmente, los instrumentos supranacionales, la Liga Árabe y la Conferencia Islámica, pero conviene recordar que la primera fue creada y tutelada, durante décadas, por el Foreing Office británico, y que son organizaciones cada vez más desacreditadas, por su actitud en las cuestiones palestina e irakí, entre las masas musulmanas. Todos estos factores, brevemente apuntados pero, evidentemente, mucho más complejos, han dado lugar a la aparición de un nuevo espacio geopolítico. Una zona, desde el punto de vista de los intereses occidentales, claramente inestable y que puede constituir, en el futuro, en función de su evolución, una clara amenaza para la estabilidad global del planeta. Si se mira con atención un planisferio, el Islam presenta, pese a su fragmentación política, un bloque continuo de países que va desde la ribera oeste africana hasta el sureste asiático, penetrando, además, en una parte considerable del África Central. Este mundo tiene una envidiable posición estratégica sobre el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Rojo, el Mar Caspio, el Mar Arábigo y el Océano Índico. Está presente en una importante área de intercambios mundiales, y, lo que es más importante, domina las vitales rutas del petróleo así como los principales yacimientos del mundo. Y el petróleo puede ser, tal y como sucedió en la crisis de los setenta, un arma tan eficaz, en el siglo XXI, como las fuerzas armadas americanas. El Islam es, también, un espacio en conflicto. Dejando a un lado el tema del fundamentalismo, pero sin obviar su importancia y sin olvidar su presencia en todos los puntos de tensión, nos encontramos con:
Una zona caliente donde quienes si tienen programas desarrollados de armas de destrucción masiva son Israel, Pakistán e Irán. Puntos de fricción a los que sumar las interminables guerras africanas |
00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, islam, stratégie, religion, religion islamique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 avril 2009
Letribunal administratif suspend la d&écision du ministre contre Ayméric Chauprade
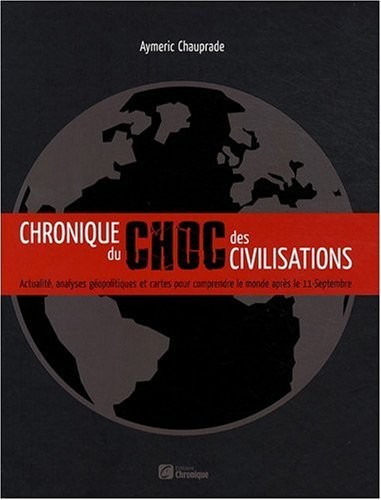
Le tribunal administratif suspend la décision du ministre contre Aymeric Chauprade
SOURCE : SECRET DEFENSE
Le tribunal administratif de Paris, saisi dans le cadre d'un référé-liberté, a suspendu ce lundi après-midi la décision du ministre de la Défense (ndlr : Hervé Morin, en photo) mettant fin à la collaboration d'Aymeric Chauprade avec les organismes de formation, en particulier le Collège interarmées de défense (CID). La justice demande au ministère d'organiser une procédure disciplinaire contradictoire. "C'est une belle victoire", se réjouit Aymeric Chauprade.
Le 5 février dernier, cet enseignant de géopolitique a été congédié par le ministre de la Défense à la suite d'un article paru dans Le Point. Chauprade est l'auteur d'un livre, "Chronique du choc des civilisations", dans lequel il présente avec complaisance les thèses qui attribuent les attentats du 11 septembre à un complot américano-israélien. Chauprade, qui se définit comme appartenant à la "droite conservatrice", enseignait au CID depuis dix ans.
Un premier référé avait été rejeté au début du mois, au motif que la décision ne portait pas une "atteinte grave à son niveau de revenu". Ce jugement se basait sur les déclarations orales du ministre, mais Aymeric Chauprade a reçu, le 25 février, un courrier officiel du ministère de la Défense lui annonçant la suppression de toutes ses vacations. Chauprade n'enseignait pas qu'au CID, mais dans de nombreuses autres institutions de la Défense : Cesa, Ensom, Gendarmerie, Marine, etc. Il estime que cela représente près des deux tiers de ses revenus.
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, affaire chauprade, france, censure, totalitarisme, arbitraire, défense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 31 mars 2009
L'India, nuova potenza marittima

L’India, nuova potenza marittima |
| Riflessioni sulla costruzione della nuova portaerei della marina indiana |
00:36 Publié dans Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, inde, marine, marines de guerre, flottes, armées, océan indien, thalassocratie, puissance maritime, asie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 mars 2009
P. Scholl-Latour: l'homme qui nous explique la marche du monde

Peter Scholl-Latour: l’homme qui nous explique la marche du monde
Hommage à l’occasion de ses 85 ans
Pour son vaste public, Peter Scholl-Latour est le dernier auteur capable de nous expliquer la marche du monde. Depuis son voyage dans l’île de Timor-Est l’an passé, Peter Scholl-Latour a désormais visité les 193 pays que compte la Terre et est devenu, au fil des années, l’essayiste le plus publié et le plus lu dans l’espace linguistique allemand. Pour les téléspectateurs et pour ses lecteurs, il est l’incarnation du véritable journalisme. Il n’y en a pas deux comme lui qui soient capables de fusionner expérience personnelle, savoir historique et culturel et puissance narrative percutante. Dans les films qu’il a produits pour la télévision et dans ses “best-sellers” politiques, il jette toujours un regard pertinent sur les points chauds de l’actualité internationale, explique les tenants et aboutissants des vicissitudes politiques, montre les liens entre les événements. Ceux qui l’appellent aujourd’hui, vingt ans après qu’il ait pris sa retraite, s’entendent parfois dire: “Téléphonez-moi dans deux semaines parce que je suis à la bourre”. Comme s’il était en permanence sur un tapis volant, il est en voyage s’il n’a pas une émission de télévision à finir ou un ouvrage à terminer, qui le forcent à la sédentarité.
Le 9 mars 2009, cet esprit bouillonnant, toujours en alerte, a eu 85 ans [...]. Il est né dans la famille d’un médecin aux ascendances lorraines et sarroises, à Bochum en 1924. Il a grandi sur les rives de la Ruhr et de la Sarre ainsi qu’à Metz. Ses années d’écolier, il les a passées dans un collège de jésuites en Suisse et a ainsi bénéficié d’une éducation catholique solide, pétrie d’une culture européenne, hissée bien au-dessus des nations vernaculaires. Bien que son père fut membre du Stahlhelm national-allemand, Scholl-Latour est parvenu à échapper à l’incorporation dans la Wehrmacht, ce qui ne l’a pas empêché, après 1945, de s’enrôler, par esprit d’aventure et goût du voyage, dans le corps expéditionnaire français en partance pour l’Indochine, et non pas dans la Légion Etrangère, comme on le colporte souvent en Allemagne.
Il revient désillusionné de cette guerre lointaine, entreprend des études en Allemagne, à Paris et à Beyrouth, où il décroche un diplôme de philologie orientale. Après un bref intermède en 1954-55, où il fut porte-paroles du gouvernement de la Sarre, il devient le correspondant de l’ARD en Afrique et en Asie du Sud-Est, puis directeur de studio à Paris, ensuite, pendant quelques années, le directeur de la chaîne WDR et l’éditeur de l’hebdomadaire “Stern”.
Bien que ce ne fut pas son premier livre, son “best-seller” sur le Vietnam, intitulé “Der Tod im Reisfeld” (= “Mort dans la rizière”), publié en 1979, amorça sa carrière d’écrivain à succès et tissa sa légende. Depuis longtemps, Scholl-Latour est un mythe mais aussi un esprit rare, capable de comprendre le destin de l’Allemagne, de la France et de l’Europe. Il voit que, désormais, l’homme blanc est fatigué, que les identités héritées sont en voie de dissolution, que la substance ethnique et culturelle des peuples européens part en quenouille: et ce sont là des phénomènes qui le préoccupent davantage que les petites mesquineries du journalisme. Plus il avance en âge, plus il ajoute à son style journalistique qui confine à la perfection, ce cachet unique, cette marque qui est la sienne et qui consiste en ce mélange de spiritualité et de sens de l’histoire. Cet élixir commence à donner des fruits, à influencer la politque. Quelle aubaine ce serait, pour nous tous, si ce sacré Peter Scholl-Latour parvenait encore, pendant de nombreuses années, à le distiller dans les esprits.
Günther DESCHNER.
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°11/2009; traduction française: Robert Steuckers).
00:31 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, journalisme, médias, anniversaires, géopolitique, politique internationale, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 mars 2009
Tiberio Graziani: "Les Etats-Unis utilisent l'Europe comme tête de pont pour attaquer l'Eurasie"
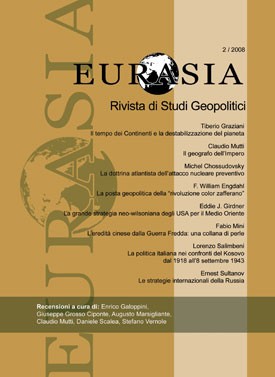
Tiberio Graziani:
“Les Etats-Unis utilisent l’Europe comme tête de pont pour attaquer l’Eurasie”
Entretien accordé à http://russiatoday.ru/
La crise financière mondiale ne concerne pas uniquement l’argent, même si elle a commencé à Wall Street”, nous explique Tiberio Graziani, éditeur du magazine italien “Eurasia”, qui se spécialise dans les études géopolitiques. Tiberio Graziani est également l’auteur de plusieurs ouvrages de géopolitique.
Q.: Dans le monde entier, les gouvernements ont adopté des mesures protectionnistes. Celles-ci touchent tous les niveaux de la société. En Italie, nous voyons que la population apporte son soutien aux politiques anti-immigrationnistes, qualifiées d’extrême-droite. Comment l’Italie peut-elle, comment pouvons-nous, tous autant que nous sommes, survivre à cette crise financière mondiale?
TG: D’abord, nous devrions réflechir aux raisons de cette crise financière qui a aussi touché la production au niveau industriel, aux Etats-Unis dans un premier temps, et ensuite dans tout le monde occidental, lequel se compose de tris piliers, les Etats-Unis, l’Europe et le Japon. La crise a touché l’ensemble du marché mondial. Pour l’Italie, les effets de la crise se sont manifestés un peu plus tard et, à mes yeux, ne s’afficheront dans toute leur netteté qu’en 2009 et en 2010.
Parce que l’économie italienne repose essentiellement sur des petites et moyennes entreprises, nous n’avons pas affaire, chez nous, à de fortes concentrations industrielles, raison pour laquelle l’Italie fait montre de davantage de flexibilité pour affronter et contenir la crise. Quoi qu’il en soit, la crise sera fort profonde.
Nous serons en mesure de surmonter la crise financière si nous parvenons à oeuvrer dans un contexte géo-économique continental. Cela signifie que nous devrons concevoir des modes de fonctionnement économique où les économies de pays émergents comme la Russie, la Chine et l’Inde joueront un rôle. La crise ne pourra se résoudre seulement à l’aide de recettes étroitement nationales ou par les effets de recettes concoctées uniquement à Bruxelles par la seule Union Européenne.
Q.: Parlons un peu de la récente crise gazière, où l’Italie a été bien moins touchée que les Balkans ou l’Europe orientale, mais a néanmoins été prise, elle aussi, en otage. La vérité sur cette crise a été occultée. Quelle est l’origine de la querelle?
TG: L’origine de la querelle gazière entre Kiev et Moscou? Elle est en réalité un effet de l’élargissement de l’OTAN en direction de l’Europe de l’Est et de l’extension de l’UE dans la même région. Ces deux élargissements parallèles ont été perçus à Moscou comme une agression occidentale contre son “voisinage proche”.
Ce type d’élargissement a commencé dès 1989, immédiatement après la chute du Mur de Berlin. A partir de ce moment-là, les Etats-Unis ont décidé de gérer à eux seuls l’ensemble de la planète. Dans cette optique, ils ont choisi l’Europe occidentale comme base de départ pour avancer leurs pions en direction de la Russie et de l’Asie centrale, car, comme chacun sait, l’Asie centrale possède d’immenses ressources en gaz naturel et en pétrole. Les Etats-Unis ont commencé par étendre leur influence sur les pays de l’ancien Pacte de Varsovie et sur quelques pays ayant auparavant fait partie de l’Union Soviétique, comme l’Ukraine.
A partir de 1990, l’Ukraine a entamé un processus de séparation, a cherché à détacher son avenir géopolitique de son environnement naturel et donc à s’éloigner de Moscou et de la Russie. Si nous analysons bien la “révolution orange”, nous constatons tout de suite que derrière les réalisations de cette soi-disant “société civile” ukrainienne, se profilaient des intérêts venus en droite ligne d’au-delà de l’Atlantique, téléguidés depuis Washington. Dans ce contexte, nous ne devons pas oublier l’influence de quelques “philanthropes” auto-proclamés tels George Sörös qui ont contribué à déstabiliser l’Ukraine et aussi les républiques de l’ex-Yougoslavie.
Lorsque l’Ukraine a abandonné, ou tenté d’abandonner, son environnement géopolitique naturel, qui lui assignait la mission d’être le partenaire privilégié de Moscou, il devenait évident que, pour les livraisons de gaz, Moscou allait imposer à l’Ukraine les prix du marché, puisque Kiev ne pouvait plus être considéré comme un client à privilégier mais comme un client pareil à n’importe quel autre. Les prix du gaz ont donc augmenté, une augmentation qui a également touché l’Europe, parce que les dirigeants ukrainiens se sont privés d’une souveraineté propre et ne sont mus que par des intérêts occidentaux. Au lieu d’envisager un accord économique, comme on le fait généralement entre pays souverains, l’Ukraine a aggravé la situation en siphonnant le gaz destiné aux nations européennes.
Cette véritable raison de la crise a été délibérément ignorée par la presse des pays de l’Europe de l’Est, mais aussi par la presse italienne. Dans la querelle du gaz, la plupart des journalistes italiens n’ont pas focalisé leur attention sur les causes réelles du conflit mais se sont complus à diaboliser le gouvernement russe, en l’accusant d’utiliser les ressorts de la géopolitique comme une arme dans le conflit gazier; or le Président Medvedev et le Premier Ministre Poutine n’ont fait que facturer au prix du marché les transactions gazières, selon les règles de la normalité économique.
Q.: Mais l’Ukraine est sur le point de défaillir. Les Russes ne doivent pas escompter que l’Ukraine paiera le prix du marché l’an prochain...
TG: Je crois qu’il est toujours possible de trouver un accord économique. Moscou et Kiev peuvent négocier un moratoire. J’aimerais bien rappeler qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème économique, d’un problème d’import-export, mais d’un enjeu géopolitique majeur. A l’évidence, si l’Ukraine choisit de rejoindre le camp occidental sous le “leadership” de Washington, cette option atlantiste affectera dans l’avenir non seulement les transactions gazières, mais toutes les autres relations économiques. De ce fait, je crois qu’il sera possible, à terme, de trouver une solution économique mais l’obstacle vient de Kiev, parce que Kiev est inféodé aux intérêts de Washington.
Q.: Tournons nos regards vers Washington et évoquons les bases américaines sur le sol italien: qu’en dit l’opinion publique dans votre pays?
TG: La plupart des gens sont conscients que la présence effective de bases militaires américaines en Italie mais n’en tirent aucune conclusion politique. Ainsi, quand nous avons eu le cas de l’agrandissement de la base de Vicenza dans le nord de l’Italie, les arguments des adversaires de ces travaux étaient essentiellement d’ordre écologique. L’argument principal, qu’il aurait fallu développer, est demeuré occulté; en effet, l’agrandissement de cette base sert les forces armées américaines dans la mesure où elles auront l’occasion, dans l’avenir, d’entrer plus facilement en contact avec une base proche, située en Serbie, qui dépend aussi directement de Washington. Dans l’avenir, à partir de ces bases, les Américains pourront intervenir dans la périphérie de l’Europe et au Proche et au Moyen-Orient, contre des Etats comme la Syrie ou l’Iran et aussi, dans une certaine mesure, contre la Russie. La nation yougoslave, en l’occurrence la Serbie, n’a pas été choisie par hasard, mais parce qu’elle a des accointances culturelles et ethniques avec la Russie.
Q.: La crise gazière a tendu les rapports entre la Russie et l’UE car bon nombre de pays de l’UE sont en train de chercher des fournisseurs alternatifs. La Russie doit-elle s’en inquiéter?
TG: Non, je ne pense pas que la Russie doit s’en inquiéter. Je pense que chaque pays doit chercher les meilleures opportunités qu’offre le marché des ressources et viser l’autonomie énergétique. Dans un contexte géopolitique plus vaste, celui de l’Eurasie, je pense que les relations entre la Russie et l’Europe, entre la Russie et l’Italie, devrait reposer sur les intérêts économiques. Nous devons échanger de la haute technologie, des technologies militaires, des ressources énergétiques et, bien entendu, procéder à des échanges culturels. Je pense que les échanges culturels entre, d’une part, l’UE et l’Italie, et, d’autre part, la Fédération de Russie devraient être renforcés.
Après la seconde guerre mondiale, il y a plus de soixante ans, les relations culturelles entre l’Europe occidentale et la Russie se sont considérablement amenuisées parce qu’elles ont été sabotées par la classe intellectuelle dominante en Europe, qui soutenait le processus d’occidentalisation ou plutôt d’américanisation de la culture européenne. Si nous comparons les littératures européenne et italienne de ces récentes années avec celles des années 30, par exemple, nous constatons que beaucoup d’écrivains italiens utilisent désormais une langue viciée, incorrecte, avec trop d’emprunts à l’anglais. C’est l’un des résultats de la colonisation culturelle que nous a imposée Washington depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Mais il serait tout aussi pertinent de remarquer que cette tendance au déclin se perçoit également dans les pays de l’ex-bloc soviétique.
Q.: Quelle est l’attitude globale de l’Italie à l’égard de la Russie? Les Russes peuvent-ils compter sur l’Italie pour qu’elle joue un rôle important dans l’amélioration des relations entre l’UE et la Russie?
TG: L’Italie est certainement, avec d’autres pays de l’UE, un partenaire potentiel de la Russie mais, pour devenir un partenaire réel et non plus seulement potentiel, l’Italie doit acquérir davantage de liberté et obtenir une souveraineté politique totale, qu’elle ne possède pas actuellement. J’aime répéter qu’il existe en Italie aujourd’hui plus de cent sites militaires dépendant directement des Américains, des sites qui sont partie prenante du projet américain d’étendre l’influence de Washington sur l’ensemble de la péninsule européenne. Dans de telles conditions, l’Italie et les autres pays européens se heurtent à des limites et ne peuvent exprimer sans filtre leurs intérêts propres sur les plans politique et économique. Il faut cependant reconnaître qu’au cours de ces dernières années, la politique économique des présidents russes successifs, Poutine et Medvedev, a jeté les bases qu’il faut pour que l’Italie devienne un véritable partenaire de la Russie, non seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan politique et même, à mon avis, sur le plan militaire. L’Italie est au centre de la Méditerranée et occupe de ce fait une position stratégique importante. En outre, la position centrale de l’Italie est vitale au niveau géopolitique. Et ce serait une bonne chose si elle jouait de cet atout dans l’optique d’une intégration eurasienne.
Je crois que les relations entre l’Italie et la Russie s’améliorent; j’en veux pour preuve les initiatives d’entrepreneurs italiens, qui vont dans le bon sens, parce qu’ils contournent les limites imposées par un pouvoir politique qui réside, in fine, à Washington ou à Londres.
Q.: Vos critiques à l’endroit de Washington sont particulièrement sévères; vous décrivez les Etats-Unis comme une nation impériale alors que notre monde actuel n’est plus du tout unipolaire...
TG: Mes critiques à l’endroit de Washington sont sévères parce que les Etats-Unis ont inclu l’Europe dans leur propre espace géopolitique et la considèrent comme une tête de pont pour attaquer l’ensemble du territoire eurasien. C’est là la raison majeure de mes positions critiques. Mais, vous avez raison, il faut tenir compte de la situation réelle des Etats-Unis dans le monde actuel. Ceux-ci devraient se rendre compte que l’époque, où ils étaient la seule superpuissance, est révolue. Aujourd’hui, dans la première décennie du 21ème siècle, nous avons affaire, du point de vue géopolitique, à un système multipolaire avec la Russie, la Chine, l’Inde, les Etats-Unis et certains Etats d’Amérique du Sud, qui sont en train de créer une entité géopolitique propre; je pense au Brésil, à l’Argentine, au Chili, au Venezuela et, bien sûr, à la Bolivie. En effet, au vu des libertés que se permettent ces pays sud-américains, en constatant leurs audaces, l’UE devrait s’en inspirer pour quitter le camp occidental dominé par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
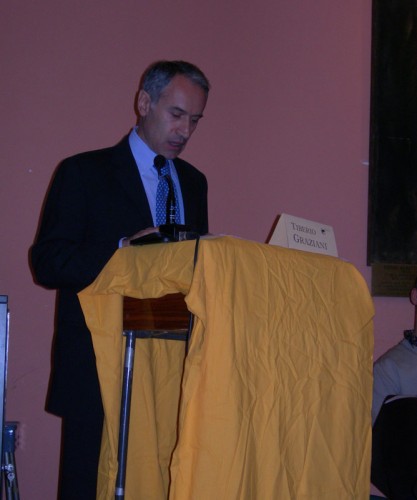
Q.: Vous voyagez beaucoup dans toute l’Europe et surtout dans les régions agitées et dans les points chauds. Vous avez participé à l’organisation des élections en Transnistrie. Il y a une île au large de la Sardaigne, qui faisait partie du territoire italien, et qui vient de déclarer son indépendance, en se disant inspirée par l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. Existe-t-il une formule universelle pour affronter le problème des séparatismes?
TG: Chacun de ces problèmes est foncièrement différent de l’autre. En Sardaigne, il y a un mouvement politique séparatiste depuis quelques années mais les gens qui le formaient font partie du gouvernement italien aujourd’hui. Pour la Transnistrie, il faut voir la situation sous l’angle géostratégique. Des pays comme la Moldavie et la Roumanie subissent le poids des Etats-Unis et de l’OTAN. La Transnistrie représente ce que l’on appelle un “conflit gelé”. Je pense que l’indépendance de la Transnistrie serait intéressante car nous aurions, dans ce cas, un territoire auquel les Etats-Unis n’auraient pas accès. Ce serait un territoire de liberté du point de vue eurasien parce que cette Transnistrie serait souveraine. Je n’analyse pas le fait que constitue cette république au départ des attitudes ou de l’idéologie du gouvernement qu’elle possède. J’analyse son existence dans le contexte géopolitique et géostratégique général. De ce fait, je prends acte que la Transnistrie est une république souveraine et que sur son territoire réduit il n’y a aucune base de l’OTAN.
(entretien paru sur http://russiatoday.ru/ ; 16 mars 2009; traduction française: Robert Steuckers).
00:38 Publié dans Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasisme, eurasie, politique, géopolitique, crise, gaz, énergie, ukraine, russie, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 mars 2009
Atlantisme, occidentalisme. Pourquoi N. Sarkozy veut que la France réintègre le commandement de l'OTAN
| ||||
|
Le Général de Gaulle se retourne dans sa tombe. 43 ans après sa décision de retirer Paris du commandement militaire intégré de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN, créée en 1949, 22.000 employés et 60.000 militaires permanents), son dangereux successeur à l'Elysée multiplie les déclarations (1) pour que la France y reprenne désormais "toute sa place". "Toute sa place" est une formule qui, dans l'approche de Nicolas Sarkozy, signifie clairement un engagement sans réserve aux côtés des Etats-Unis. Fidèle à sa méthode autocratique du "J'écoute mais je ne tiens pas compte", il fait fi des voix de plus en plus nombreuses qui s'opposent à sa décision (2) et fait dire qu'il n'y aura ni référendum ni même de vote au Parlement sur la question.
Il entend bien concrétiser seul son choix stratégique et balayer d'un coup d'un seul un demi-siècle de politique étrangère et d'indépendance française dès les 3 et 4 avril prochain, lors des cérémonies du 60e anniversaire de l'OTAN à Strasbourg et Kehl.
Histoire de confirmer sa volonté d'intégrer la France dans les hautes sphères politico-militaires de l'OTAN, Nicolas Sarkozy a d'ores et déjà pris l'année dernière deux initiatives très applaudies par son ami George W. Bush. Un, il a doublé la présence militaire française en Afghanistan en envoyant un millier de soldats combattre avec les américains contre les Taliban, alors que chacun sait que cette guerre est déjà perdue et que l'enlisement des troupes y est assuré (le nombre de soldats français morts sur le terrain depuis est déjà suffisamment éloquent).
Deux, il a soutenu activement le projet de déployer un bouclier antimissile américain en Europe centrale, quitte à braquer sérieusement la Russie (Heureusement Barack Obama semble être en train de déminer cette énième provocation bushiste aux relents de Guerre froide). La récente volonté affichée de rapprocher Paris et Londres, principal allié des Etats-Unis dans ses guerres en Irak et en Afghanistan, est également un signe plus discret, mais tout aussi fort, d'allégeance à Washington.
Seule contrariété pour le néo-conservateur de l'Elysée, ce n'est plus son ami fauteur de guerres George W. Bush qui est au pouvoir, mais Barack Obama, à l'évidence moins enclin à semer la terreur partout dans le monde au nom de la lutte anti-terroriste.
Cette rupture dans la politique d'indépendance de la France se drape bien entendu d'arguments à usage médiatique du type "Amis, alliés, mais non inconditionnels", ou "nécessaire rénovation car nous ne sommes plus en 1966", ou encore "La France ne perdra rien de sa souveraineté" (3). Nicolas Sarkozy dit vouloir développer avec l'OTAN une "Europe de la Défense efficace". Depuis son élection, il ne cesse de répéter qu'une Europe de la Défense indépendante et l'ancrage atlantique sont les deux volets d'une même politique de sécurité. Mais quelle OTAN, pour quelle mission de défense européenne ? et la France a-t-elle quelque chose à gagner à réintégrer le commandement militaire de l'organisation, avec lequel elle coopère déjà très bien ? Elle fournit déjà 2.800 soldats pour l'occupation de l'Afghanistan, et maintient actuellement 36.000 soldats dans divers autres pays (Kosovo, Côte d'Ivoire, etc.).
Il est bien illusoire d'imaginer que les Etats-Unis donneront plus de place aux Européens et aux Français dans la nouvelle Alliance. Jaap De Hoop Scheffer a d'ailleurs bien précisé le 12 février 2009 à Paris que, si la France réintégrait le Commandement militaire intégré de l'Alliance atlantique, ce serait de toutes façons toujours à lui qu'il revenait "de gérer les choses au sein de l'OTAN, comme la position française au sein des structures de commandement, les généraux, etc". Tout au plus les Etats-Unis accorderont-ils quelques commandements militaires sans importance à un ou deux généraux français -- on parle vaguement d'un poste à Norfolk (Virginie, USA) ou à Lisbonne (Portugal) -- sans que cela puisse réellement permettre à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) de s'affirmer et de de peser significativement sur les décisions de l'OTAN.
Dans tous les conflits (Afghanistan, Serbie, Kosovo, etc) où la France s'est retrouvée engagée aux côtés des militaires américains, ce sont systématiquement ces derniers qui décident et contrôlent de façon unilatérale toutes les opérations, en particulier les frappes, reléguant la France et les autres pays alliés au rang de simples exécutants. On ne les imagine guère se plier aux décisions des français dans l'avenir. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que si de Gaulle est sorti de l'OTAN, c'est notamment parce qu'il demandait un directoire partagé de l'Organisation, ce que les Américains lui ont refusé.
Et la suite a montré que la France, puissance moyenne disposant de l'arme nucléaire et d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, existait finalement plus à l'échelle mondiale en s'affirmant de façon autonome qu'en s'effaçant dans ce qu'il appelait le "machin" atlantiste.
Autre risque, la réintégration de Paris dans une OTAN qui sert de plus en plus de caution et de bras armé à l'impérialisme américain, sera sans nul doute perçu dans les grandes capitales du monde non-occidental comme un affaiblissement et un alignement sur les Etats-Unis, ce qui lui fera perdre le peu d'influence qui lui reste encore.
Quant à la "Voix de la France", qui selon Nicolas Sarkozy deviendrait plus forte dans le concert des Nations si elle réintègre l'OTAN, elle semble jusqu'à présent avoir moins souffert des discours et des choix du Général de Gaulle -- ou même de ceux de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, par exemple en 2003 à l'ONU lors du refus de la France de suivre les Etats-Unis dans l'invasion de l'Irak -- que ceux des "caniches" européens de George W. Bush (Tony Blair, José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, José-Maria Aznar,...).
Mais l'essentiel n'est pas là.
Le projet de Nicolas Sarkozy, cet anti de Gaulle, ne consiste pas en un renforcement de la défense européenne, ou du moins pas pour lui donner plus de pouvoir et d'indépendance comme il le prétend. A travers ses choix diplomatiques et stratégiques il est à l'évidence tout à sa "vision" purement occidentaliste de la France et de l'Europe. Pour lui, la France doit s'affirmer "dans sa famille occidentale" et dans "les valeurs occidentales qui sont pour elle essentielles" (Discours de janvier 2008 devant le corps diplomatique français). Il partage avec son mentor George W. Bush une idéologie qui se fonde avant tout sur la défense d'une civilisation occidentale qui serait aujourd'hui attaquée par le monde islamiste. Lorsqu'il déclare faire en sorte que "Paris et l'ensemble des capitales occidentales parlent désormais toutes d'une seule voix", c'est surtout pour défendre les causes occidentales que les discours et les aventures guerrières de Bush "contre l'Axe du Mal et la Barbarie" ont totalement galvaudées: la Démocratie, la Liberté, l'universalisme des Droits de l'Homme, la lutte contre le terrorisme.
Comme George W. Bush et comme tous les néo-conservateurs islamophobes, Nicolas Sarkozy est dans une logique de guerre contre tout ce qui ne relève pas des "valeurs occidentales" judéo-chrétiennes, tant en matière d'économie que de politique et de religion. Il exècre et ne cesse de diaboliser les partis islamistes qualifiés de terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas, n'imaginant pas que son propre occidentalisme est à l'Occident ce que le fondamentalisme islamiste est à l'Islam.
Il est au plus près des cercles israélo-américains d'extrême-droite qui, afin de "garantir la paix et la sécurité", prônent une domination occidentale du monde, quitte pour cela à passer à l'offensive et à se lancer dans une guerre de civilisation "globale". Pour Nicolas Sarkozy il s'agit de défendre mais aussi désormais d'imposer par tous les moyens, et notamment par la guerre, un nouvel ordre occidental soi-disant "moral" (comprendre surtout "néo-libéral") qui doit régner sur l'ensemble de la planète.
Cette idéologie d'autodéfense agressive se nourrissant du conflit avec l'islamisme autorise ainsi l'OTAN -- qui à l'origine n'a qu'une mission de défense limitée aus territoires occidentaux -- à aller porter la guerre aux confins de la planète pour défendre des intérêts géostratégiques essentiellement américains, quand ce n'est pas parfois purement israéliens, à titre d'une soi-disant "légitime défense" contre le terrorisme islamiste. De hauts stratèges et chefs d'état-major de l'OTAN planchent même actuellement sur de réjouissantes nouvelles options militaires.
Ces docteurs Folamour réclament en effet le droit d'effectuer des frappes préventives, y compris avec l'arme nucléaire, sans autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Lorsque l'on connaît le désir insensé des Israéliens et de leurs amis américains -- Même avec Barack Obama, il y a peu de chances que les Etats-Unis modifient leur politique de soutien inconditionnel à l'Etat d'Israël -- d'aller bombarder l'Iran, on imagine aisément à quoi la sainte alliance transatlantique risque bientôt de servir.
C'est avec cette "vision" guerrière et occidentaliste du monde, ruineuse et extrêmement dangereuse pour la France, que Nicolas Sarkozy entend jouer un rôle international. En infléchissant la doctrine militaire française pour mieux s'aligner sur la politique étrangère américaine, dont on connaît pourtant les errements et l'agressivité aussi inefficace que désastreuse, il commet une erreur diplomatique et stratégique majeure.
------------
Notes
1) Annoncé dès la campagne électorale de 2007, ce projet sarkozyste n'a cessé d'être remis sur la table, tant par Nicolas Sarkozy que par Bernard Kouchner (Ministre des Addaires étrangères) et Hervé Morin (Ministre de la Défense) afin d'y "préparer l'opinion", notamment pour le Président de la République à travers le Discours de janvier 2008 devant le corps diplomatique français, lors du Sommet de l'OTAN à Bucarest en avril 2008 et la semaine dernière encore lors d'une conférence sur la sécurité à Munich.
2) Parmi les responsables politiques qui s'opposent à la décision autocratique de Nicolas Sarkozy, on note celles de François Bayrou pour qui la réintégration dans le commandement militaire de l'OTAN serait "une défaite pour la France" et un "un aller sans retour" [...] "En nous alignant, nous abandonnons un élément de notre identité, une part de notre héritage, et nous l'abandonnons pour rien". Il demande que le choix fait par le Général de Gaulle en 1966 "ne soit pas bradé et jeté aux orties", ajoutant qu'un tel choix ne peut aujourd'hui être modifié "que par un référendum du peuple français". Dans un entretien au Nouvel Observateur, François Bayrou précise sa pensée. Pour lui, en réintégrant l'OTAN, la France se range "aux yeux du monde" dans un "bloc occidental" [...] "euro-américain d'un côté, le reste du monde de l'autre. Ceci, pour la France et son histoire, son universalité, est un renoncement". Il affirme que "ce que nous sommes en train de brader, ce n'est pas seulement notre passé mais aussi notre avenir, une partie du destin de la France et de l'Europe". Pour le Parti Socialiste, qui demande un débat et un vote parlementaire sur la question, "Aucune explication recevable n'est apportée sur l'intérêt pour la France de ce retour" et les "conditions et contreparties de cette réintégration ne sont pas connues". Jean-Marc Ayrault, chef de file des députés PS, estime que "La France doit garder son autonomie de décision" et que celle-ci "ne peut pas être prise par le président seul". Les anciens ministres socialistes de la Défense Paul Quilès et Jean-Pierre Chevènement ont également publié des tribunes dans la presse pour exprimer leur rejet de cette décision "très dangereuse pour la sécurité de la France". [...] "Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres", affirment-ils. "Si la France entre dans l'OTAN, il n'y a plus d'espoir de politique étrangère et de sécurité commune, plus d'Europe de la défense", affirme également le socialiste Jean-Michel Boucheron. La réintégration "limiterait notre souveraineté et serait le signe d'un alignement sur l'administration américaine qui banaliserait la singularité de la France", estiment pour sa part le Parti Communiste. Du côté de l'UMP, une partie des députés exprime aussi son opposition: Jacques Myard proteste contre ce "retour qui va lier les mains de la France et l'arrimer à un bloc monolithique occidental dirigé par les Etats-Unis" tandis que Lionnel Luca explique que "Pour un grand nombre de pays arabes, le fait que la France soit dans l'OTAN est un mauvais signal". Jean-Pierre Grand regrette cet "arrimage plein et entier aux Etats-Unis". "Il y a dans le monde entier des pays qui attendent de la France qu'elle demeure une transition, une passerelle, et qu'elle ne s'aligne pas sur les Etats-Unis", renchérit Georges Tron. Le gaulliste ex-UMP Nicolas Dupont-Aignan s'engage lui dans une quasi campagne contre le projet et exige un débat parlementaire. Daniel Garrigue, député ex-UMP de la Dordogne, s'est de son côté fendu d'une tribune intitulé "Bonjour, messieurs les traîtres !". Pour lui, "Rien ne justifie le retour de la France dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et la remise en cause de l'un des rares consensus forts de notre pays -- voulu en l'occurrence par le général de Gaulle avec la sortie de l'Otan en 1966 et confirmé par ses successeurs, y compris par le socialiste François Mitterrand. Nous y perdrons la considération que nous avions sur la scène internationale et particulièrement notre capacité à être entendus dans un certain nombre de conflits, notamment au Proche et au Moyen-Orient. [...] "Pour tous ceux qui croient en la France et en la construction de l'Europe, cette décision de rejoindre l'Otan qui n'a été ni concertée, ni discutée, ni approuvée par les Français ou par le Parlement, constitue bien une véritable trahison". Alain Juppé, ancien Premier Ministre de Jacques Chirac, renouvelle lui aussi ses critiques en demandant si la France n'était pas en train de "faire un marché de dupes en rentrant sans conditions" dans le commandement de l'OTAN. Mais le plus farouche opposant à Droite est l'ancien Premier Ministre Dominique de Villepin. Pour lui, la France "va se trouver rétrécie sur le plan diplomatique" et sera plus vulnérable au terrorisme. "Alors que le Sud est en train de s'affirmer, dans un monde qui est en train de basculer, faut-il donner le sentiment de se crisper sur une famille occidentale ?", s'interroge-t-il. Comme François Bayrou, il estime que si la France avait été intégrée aux structures de commandement de l'OTAN en 2003, elle aurait été obligé de suivre les Etats-Unis de Geoorge W. Bush dans la guerre contre l'Irak.
3) Discours de Jaap De Hoop Scheffer, Secrétaire général de l'OTAN, devant les parlementaires français le 12 février 2009.
_______________
*http://www.republique-des-lettres.fr/journal.php
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, france, otan, atlantisme, occidentalisme, etats-unis, gaullisme, géopolitique, stratégie, défense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 mars 2009
Sarkozy battles General De Gaulle's NATO retreat
Sarkozy battles General de Gaulle's NATO retreat
16 March, 2009, http://russiatoday.ru/
French President Nicolas Sarkozy has gone against the late General Charles de Gaulle’s decision in 1966 to remove France from NATO, but that move promises to be something of a public relations disaster.
Intensive security measures are planned as tens of thousands of anti-NATO demonstrators plan to block the summit during the military organization’s 60th Anniversary conference in Strasbourg in April.
Sarkozy is pulled in different directions over reintegrating with the NATO military machine. He believes France needs US friendship to do business worldwide and wants to benefit from the US military umbrella. He has worked hard to overcome the violent hostility to France that dates back to the quarrel over the war in Iraq, which saw Americans pouring French wine into the Potomac River, but he also wants a European defence policy for Europe and does not want to follow the US into Vietnam style quagmire in Afghanistan.
Above all, the French want to keep their independence and have no intention of seeming to become the next British style US poodle. Yet much of the world sees NATO as the military arm of US foreign policy. Sarkozy thinks that he can achieve these contradictory aims from within the alliance but the result is that different levels of the French government are giving off conflicting messages.
The administration is playing up two opinion polls that show a small majority of French people in favour of reintegration. Much of the press have dutifully echoed the result. Little attention has been paid to the high figure of 21% of ‘don’t knows’. Equally the French press has ignored completely the Angus Reid poll that shows that only a tiny 12% of French people think that the engagement in Afghanistan boosted by Sarkozy, ‘has been mostly a success’ – the lowest figure for six comparable western European nations.
Faced with this President Sarkozy has appointed a personal envoy to Afghanistan and Pakistan, Pierre Lellouche. In so doing he reinforces France’s diplomatic presence in the region at a time when policy is under review by the United States and its NATO allies. The move follows similar appointments by Britain and Germany, which in turn were triggered by the appointment of the veteran diplomat Richard Holbrooke to head up a similar US diplomatic mission. For the moment, despite US pressure, there is no question of sending more troops.
It is likely that the appointment of Lellouche has been made after consultation with the Americans. His career path confirms this. He has close links with America and achieved a doctorate in law at Harvard University. In his political career he has specialised in foreign relations and in particular NATO. He is President of the French parliamentary delegation to NATO and was President of the NATO Parliamentary Assembly from 2004 -2006. Last year he conducted a cross-party parliamentary enquiry into conditions in Afghanistan. He worked with Holbrooke in Bosnia in the 1990s.
The importance of the appointment of Holbrooke, linked to that of his French, German and British counterparts, to a hard pressed President Obama is clear from the fact that it came only two days into his presidency. Any support for him by France is welcome. President Sarkozy has appointed an envoy very much to the taste of his allies and has talked of staying in Afghanistan ‘as long as is necessary’. However, in Washington, recently his Minister of Defence Hervé Morin put it differently:
“We will have to stay as long as is needed… Our aim is not to stay there for ever. That is what the President of the Republic has reminded us several times.”
And he went so far as to pose the question: “Why not set, quite rapidly, a date for the beginning of the withdrawal of the alliances forces?”
Lellouche himself was more blunt:
“It is right that we operate as co-pilots in the international strategy in Afghanistan. There must not be a repetition of unilateral excesses of the Bush era, which provoked a deep gulf between the United States and its NATO allies”.
He said that the French government would ‘test’ the dialogue proposed by President Obama. “Let us hope that it works. We will not stay in Afghanistan indefinitely”. He stressed that the conflict there “was a war and not an international police operation. The proof is that France spends nearly €200 million a year on its army in Afghanistan whilst spending only €11 billion on civilian aid”. He pin pointed the withdrawal of all but 7,000 US troops at the time of the invasion of Iraq in 2003, as the main cause of the deterioration of the allied position in Afghanistan. But he said “The game is not lost. Studies show that if there is a lack of support for the Karzai government, the people do not want a return to the rule by the Taliban.”
By fully rejoining NATO, France removes a thorn from the US diplomatic flesh and adds the full support of the world’s second biggest diplomatic service backed up by Western Europe’s only genuinely independent nuclear deterrent plus experienced and respected military forces. Even so, quite how much influence France will really have over policy in Afghanistan, with a total of only 3,300 troops deployed, remains to be seen. The United States now has 38,000 present with a further 15-30 thousand to arrive shortly.
The point is underlined by the announcement that French troops there are now to come directly under US command whereas before they operated as an independent unit. This will be grist to the mill of those in France who claim NATO reintegration means loss of national control. It will not help Prime Minister François Fillon, who after some hesitation, decided to call for a vote of confidence on the question in the French National Assembly. By putting the survival of the government on the line he will win easily and it gives him a chance to counter the arguments of those within his own party and in the opposition who oppose the move.
Despite this neat political manoeuvre, the reality is that the French President is confronted by real opposition from many in the French political class over NATO reintegration and in particular involvement in Afghanistan. They argue, often privately, that this is more a colonial war to control pipeline routes from central Asia to the sea coast of Pakistan than about democracy. Worse they suggest it may be an excuse to establish a long term presence in the region with no other real military aim.
They point to the coincidence that the US led invasion followed one month after the award by the Taliban government of a key energy contract to an Argentinean company rather than American Unocal and that before becoming President, Hamid Karzai was an oil consultant to Chevron in Kazakhstan. The same Afghan President requires a twenty four hour a day American body guard of over 100 men to stay alive, unlike his much criticised Communist predecessor.
They question why after seven years, the US security services that employ 100,000 people and spend an astounding $50 billion a year, cannot find Osama Bin Laden. They note that Afghanistan has become the world’s biggest producer of heroin under Western occupation.
Finally they do not think the war can be “won” in any meaningful sense. They echo the view of Canadian Prime Minister Stephen Harper, who told CNN:
“Quite frankly, we are not going to ever defeat the insurgency. Afghanistan has probably had – my reading of Afghanistan history is – it’s probably had an insurgency forever of some kind.” The Canadian parliament has voted to withdraw all troops by 2011.
Despite all this there are indications that President Sarkozy will eventually take the risk of sending more troops. Under the French constitution it is his decision alone, but this will not happen before the controversial NATO summit in Strasbourg in April and the vote in parliament. In any event he will do what he can to prevent the alliance from failing in Afghanistan because he believes that such an outcome would damage NATO credibility perhaps fatally. This is especially the case in the light of the recent humiliation of Western financial institutions.
All this leaves the United States and its NATO allies confronting the classic military dilemma well summarized by Winston Churchill over a hundred years ago:
“It is one thing to take the decision not to occupy a position. It is quite another to decide to abandon it once occupied.”
More troops may just make it possible in one form or another to ‘declare a victory and go home’ to the great relief of the French electorate and government. This process is likely to be accelerated by the bankrupt finances of the NATO governments.
Robert Harneis for RT
00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, otan, gaullisme, sarkozy, france, affaires européennes, politique, géopolitique, atlantisme, occidentalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Eurasisme et atlantisme: quelques réflexions intemporelles et impertinentes
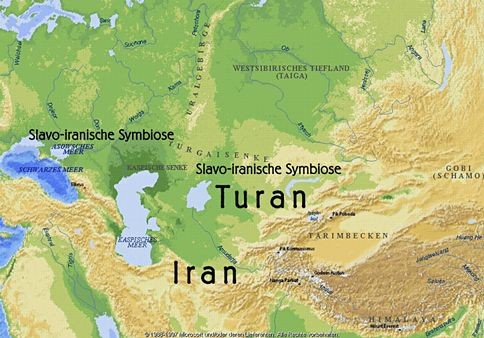
Robert STEUCKERS:
Eurasisme et atlantisme: quelques réflexions intemporelles et impertinentes
Préface à un ouvrage de Maître Jure Vujic (Zagreb, Croatie)
Il y a plusieurs façons de parler de l’idéologie eurasiste, aujourd’hui, après l’effondrement du bloc soviétique et la disparition du Rideau de Fer: 1) en parler comme s’il était un nouvel avatar du soviétisme; 2) en faisant référence aux idéologues russes de l’eurasisme des années 20 et 30, toutes tendances idéologiques confondues; 3) en adoptant, par le truchement d’un eurasisme synthétique, les lignes de force d’une stratégie turco-mongole antérieure, qui deviendrait ainsi alliée à la spécificité russe; un tel eurasisme est finalement une variante du pantouranisme ou du panturquisme; 4) faire de l’idéologie eurasiste le travestissement d’un traditionalisme révolutionnaire, reposant in fine sur la figure mythique du “Prêtre Jean”, évoquée par René Guénon; cet eurasisme-là prendrait appui sur deux pôles religieux: l’orthodoxie russe et certains linéaments de l’islam centre-asiatique, mêlant soufisme et chiisme, voire des éléments islamisés du chamanisme d’Asie centrale. Ces quatre interprétations de l’eurasisme sont certes séduisantes sur le plan intellectuel, sont, de fait, des continents à explorer pour les historiens qui focalisent leurs recherches sur l’histoire des idées, mais d’un point de vue realpolitisch européen, elles laissent le géopolitologue, le stratège et le militaire sur leur faim.
L’eurasisme, dans notre optique, relève bien plutôt d’un concept géographique et stratégique: il tient compte de la leçon de John Halford Mackinder qui, en 1904, constatait que l’espace centre-asiatique, alors dominé par la Russie des Tsars, était inaccessible à la puissance maritime anglaise, constituait, à terme, un môle de puissance hostile aux “rimlands”, donc, du point de vue britannique, une menace permanente sur l’Inde. L’eurasisme des géopolitologues rationnels, s’inscrivant dans le sillage de John Halford Mackinder, n’est pas tant, dans les premières expressions de la pensée géopolitique, l’antipode d’un atlantisme, mais l’antipode d’une puissance maritime centrée sur l’Océan Indien et possédant le sous-continent indien. Si l’Angleterre est, dès l’époque élisabéthaine, une puissance nord-atlantique en passe de conquérir toute l’Amérique du Nord, au faîte de sa gloire victorienne, elle est essentiellement une thalassocratie maîtresse de l’Océan Indien. La clef de voûte de son empire est l’Inde, qui surplombe un “arc” de puissance dont les assises se situent en Afrique australe et en Australie et dont les points d’appui insulaires sont les Seychelles, l’Ile Maurice et Diego Garcia.
Le premier couple de concepts antagonistes en géopolitique n’est donc pas le dualisme eurasisme/atlantisme mais le dualisme eurasisme/indisme. L’atlantisme ne surviendra qu’ultérieurement avec la guerre hispano-américaine de 1898, avec le développement de la flotte de guerre américaine sous l’impulsion de l’Amiral Alfred Thayer Mahan, avec l’intervention des Etats-Unis dans la première guerre mondiale, avec le ressac graduel de l’Angleterre dans les années 20 et 30 et, enfin, avec l’indépendance indienne et la relative neutralisation de l’Océan Indien. Qui ne durera, finalement, que jusqu’aux trois Guerres du Golfe (1980-1988, 1991, 2003) et à l’intervention occidentale en Afghanistan suite aux “attentats” de New York de septembre 2001.
Route de la Soie et “Greater Middle East”
Avec l’indépendance des anciennes républiques musulmanes de l’ex-URSS, la Russie cesse paradoxalement d’être une véritable puissance eurasienne, car elle perd les atouts territoriaux de toutes ses conquêtes du XIX° siècle, tout en redécouvrant le punch de l’idéologie eurasiste. Donc la fameuse “Terre du Milieu”, inaccessible aux marines anglo-saxonnes, comprenant le Kazakhastan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan, est théoriquement indépendante de toute grande puissance d’Europe ou d’Asie. Un vide de puissance existe ainsi désormais en cette Asie centrale, que convoitent les Etats-Unis, la Chine, l’Iran et la Turquie, au nom de concepts tour à tour anti-russes, panasiatiques, panislamistes ou pantouraniens. Les Etats-Unis parlent tout à la fois, avec Zbigniew Brzezinski, de “Route de la Soie” (“Silk Road”), et, avec d’autres stratégistes, de “Greater Middle East”, comme nouveau débouché potentiel pour une industrie américaine enrayée dans ses exportations en Europe, avec l’émergence d’une UE à 75% autarcique, et en Amérique ibérique avec l’avènement du Mercosur et d’autres regroupements politico-économiques.
Vu la population turcophone des anciennes républiques musulmanes d’Asie centrale, cet espace, hautement stratégique, ne partage plus aucune racine, ni culturelle ni linguistique, avec l’Europe ou avec la Russie. Un barrage turcophone et islamisé s’étend de l’Egée à la Muraille de Chine, empêchant le regroupement de puissances à matrice européenne: l’Europe, la Russie, la Perse et l’Inde. La conscience de ce destin raté n’effleure même pas l’immense majorité des Européens, Russes, Perses et Indiens.
L’idée-force qui doit, tout à la fois, ressouder l’espace jadis dominé par les Tsars, de Catherine II à Nicolas II, et donner une conscience historique aux peuples européens, ou d’origine européenne, ou aux peuples d’aujourd’hui qui se réfèrent à un passé historique et mythologique européen, est celle d’un eurasisme indo-européanisant. Cet eurasisme trouve son origine dans la geste des vagues successives de cavaliers et de charistes, dites “proto-iraniennes”, parties de l’ouest de l’Ukraine actuelle pour se répandre en Asie centrale entre 1800 et 1550 avant J. C. Deux historiens et cartographes nous aident à comprendre cette dynamique spatiale, à l’aurore de notre histoire: le Britannique Colin McEvedy (1) et le Suisse Jacques Bertin (2).
L’aventure des cavaliers indo-européens dans la steppe centre-asiatique
Pour McEvedy, la césure dans le bloc indo-européen initial, dont le foyer primordial se situe en Europe centrale, survient vers 2750 av. J. C. quand le groupe occidental (cultures de Peterborough et de Seine-Oise-Marne) opte pour un mode de vie principalement sédentaire et le groupe oriental, de l’Elbe à la Mer d’Aral, pour un mode de vie semi-nomade, axé sur la domestication du cheval. Bien que la linguistique contemporaine opte pour une classification des langues indo-européennes plus subtile et moins binaire, reposant sur la théorie des ensembles, McEvedy retient, peu ou prou, l’ancienne distinction entre le groupe “Satem” (oriental: balto-slave, aryen-iranien-avestique, aryen-sanskrit-védique) et le groupe “Centum” (occidental: italique, celtique, germanique), selon le vocable désignant le chiffre “100” dans ces groupes de langues. Pour McEvedy, à cette même époque (-2750), un bloc hittite commence à investir l’Asie Mineure et l’Anatolie; le groupe tokharien, dont la langue est “indo-européenne occidentale”, s’installe en amont du fleuve Syr-Daria, en direction de la “Steppe de la Faim” et à proximité des bassins du Sari-Sou et du Tchou. Récemment, l’archéologie a exhumé des momies appartenant aux ressortissants de ce peuple indo-européen d’Asie centrale et les a baptisées “Momies du Tarim”. A cette époque, les peuples indo-européens orientaux occupent toute l’Ukraine, tout l’espace entre Don et Volga, de même que la “Steppe des Kirghiz”, au nord de la Caspienne et de la Mer d’Aral. De là, ils s’élanceront vers 2250 av. J. C. au delà de l’Aral, tandis que les Tokhariens entrent dans l’actuel Sinkiang chinois et dans le bassin du Tarim, à l’époque assez fertile. La “Terre du Milieu” de John Halford Mackinder a donc été d’abord indo-européenne avant de devenir altaïque et/ou turco-mongole. A partir de 1800 av. J. C., ils font mouvement vers le Sud et pénètrent en Iran, servant d’aristocratie guerrière, cavalière et chariste, à des peuples sémitiques ou élamo-dravidiens. Vers 1575 av. J. C., ils encadrent les Hourrites caucasiens lors de leurs conquêtes au Proche-Orient et en Mésopotamie, pénètrent dans le bassin de l’Indus et dans le Sinkiang et le Gansou.
Ces peuples domineront les steppes centre-asiatiques, des Carpathes à la Chine jusqu’à l’arrivée des Huns d’Attila, au IV° siècle de l’ère chrétienne. Cependant, les empires sédentaires et urbanisés du “rimland”, pour reprendre l’expression consacrée, forgée en 1904 par Mackinder, absorberont très tôt le trop plein démographique de ces cavaliers de la steppe: ce seront surtout les Perses, Parthes et Sassanides qui les utiliseront, de même que les Grecs qui auront des mercenaires thraces et scythes et, plus tard, les Romains qui aligneront des cavaliers iazyges, roxolans et sarmates. Cette réserve militaire et aristocratique s’épuisera progressivement; pour Jacques Bertin, l’expansion vers l’Océan Pacifique de ces peuples cavaliers sera contrecarrée par des bouleversements climatiques et un assèchement graduel de la steppe, ne permettant finalement plus aucune forme, même saisonnière, de sédentarité. A l’Est, le premier noyau mongol apparaît entre 800 et 600 av. J. C., notamment sous la forme de la culture dite “des tombes à dalles”.
Le reflux vers l’ouest
Les peuples cavaliers refluent alors principalement vers l’Ouest, même si les Yuezhi (on ne connaît plus que leur nom chinois) se heurtent encore aux Mongols et à la Chine des Qin. La pression démographique des Finno-Ougriens (Issédons) et des Arimaspes de l’Altaï et la détérioration générale des conditions climatiques obligent les Scythes à bousculer les Cimmériens d’Ukraine. Quelques éléments, après s’être heurtés aux Zhou chinois, se seraient retrouvés en Indochine, à la suite de ce que les archéologues nomment la “migration pontique”. De 600 à 200 av. J.C., la culture mongole-hunnique des “tombes à dalles” va accroître, graduellement et de manière non spectaculaire, son “ager” initial. Vers –210, les tribus mongoles-hunniques forment une première confédération, celle des Xiongnu, qui font pression sur la Chine mais bloquent définitivement l’expansion des cavaliers indo-européens (Saces). C’est là que commence véritablement l’histoire de l’Asie mongole-hunnique. Vers 175 av. J.C., les Xiongnu dirigés par Mao-Touen, véritables prédécesseurs des Huns, s’emparent, de tout le Gansu, chassent les Yuezhi indo-européens et occupent la Dzoungarie. La vaste région steppique entourant le Lac Balkach cesse d’être dominée par des peuples indo-européens. La Chine intervient et bat la Confédération des Xiongnu, donnant aux empires romain et parthe un répit de quelques centaines d’années.
Le potentiel démographique indo-européen des steppes se fonde dans les empires périphériques, ceux du “rimland”: les Sarmates de l’Ouest, connus sous les noms de Roxolans et de Iazyges s’installent en Pannonie et, après un premier choc avec les Légions de l’Urbs, deviendront des “foederati” et introduiront les techniques de la cavalerie dans l’armée romaine et, partant, dans toutes les régions de l’Empire où ils seront casernés. L’épopée arthurienne découlerait ainsi d’une matrice sarmate. Les Alains, ancêtres des Ossètes, entrent en Arménie. Les Yuezhi envahissent l’Inde et y fondent l’Empire Kusana/Kouchan. De l’an 1 à l’an 100, trois blocs impériaux de matrice indo-européenne se juxtaposent sur le rimland eurasien, face aux peuples hunniques désorganisés par les coups que lui ont porté les armées chinoises de Ban Chao, qui poussent jusqu’en Transoxiane. Nous avons l’Empire romain qui inclut dans ses armées les “foederati” sarmates. Ensuite, l’Empire perse qui absorbe une partie des peuples indo-européens de la steppe centre-asiatique, dont les Scythes, qu’il fixera dans la province du Sistan. Enfin l’Empire kouchan, sous l’impulsion des tribus yuezhi réorganisées, englobe toutes les terres de l’Aral au cours moyen du Gange, l’Afghanistan et le Pakistan actuels et une vaste portion de l’actuel Kazakhstan.
Les Huns arrivent dans l’Oural et dans le bassin de la Volga
Au cours du II° siècle de l’ère chrétienne, les Xianbei, issus des forêts, deviennent le peuple dominant au nord de la Mandchourie, provoquant, par la pression qu’ils exercent sur leur périphérie occidentale, une bousculade de peuples, disloquant les restes des Xiongnu qui, d’une part, entrent en Chine, et d’autre part, se fixent en Altaï, patrie des futurs peuples turcs (les “Tujue” des chroniques chinoises). Les Huns arrivent dans l’Oural, approchent du bassin de la Volga et entrent ainsi dans les faubourgs immédiats du foyer territorial originel des peuples indo-européens que l’archéologue allemand Lothar Kilian situe du Jutland au Don, les peuples préhistoriques et proto-historiques se mouvant sur de vastes territoires, nomadisme oblige. Thèse qu’adopte également Colin McEvedy.
En 285, les derniers Tokhariens font allégeance aux empereurs de Chine. Sassanides zoroastriens et Kouchans bouddhistes s’affrontent, ce qui conduit au morcellement de l’ensemble kouchan et, ipso facto, à la fragilisation de la barrière des Empires contre les irruptions hunniques venues de la steppe. Chahpour II, Empereur perse, affronte les Romains et les restes des Kouchans. L’Empereur Julien meurt en Mésopotamie en 373 face aux armées sassanides. Dans la patrie originelle des peuples hunniques-mongols, les Ruan Ruan bousculent les Xianbei qui refluent vers l’ouest, bousculant les Turcs, ce qui oblige les Huns à franchir la steppe sud-ouralienne et à se heurter en 375 aux Alains et aux Goths. Le glas de l’Empire romain va sonner. Les Huns ne seront arrêtés qu’en Champagne en 451 (Bataille des Champs Catalauniques). Les Kouchans, désormais vassaux des Sassanides, doivent céder du terrain aux Hephtalites hunniques. Les Tokhariens se soumettent aux Gupta d’Inde.
D’Urbain II à l’échec de la huitième Croisade
La chute de l’Empire romain, les débuts chaotiques de l’ère médiévale signalent un ressac de l’Europe, précisément parce qu’elle a perdu l’Asie centrale, le contact avec la Perse et la Chine. L’émergence de l’islam va accentuer le problème en donnant vie et virulence à la matrice arabique des peuples sémitiques. L’invasion de l’Anatolie byzantine par les Seldjouks au XI° siècle va provoquer une première réaction et enclencher une guerre de près de 900 ans, brièvement interrompue entre la dernière guerre de libération balkanique en 1913 et l’ère de la décolonisation. Le pape Urbain II, dans son discours de Clermont-Ferrand (1095) destiné à galvaniser la noblesse franque pour qu’elle parte en croisade, évoque nettement “l’irruption d’une race étrangère dans la Romania”, prouvant que l’on raisonnait encore en terme de “Romania”, c’est-à-dire d’impérialité romaine, cinq ou six cents ans après la chute de l’Empire romain d’Occident. En 1125, Guillaume de Malmesbury, dans sa “Gesta Regum”, déplore que la “chrétienté”, donc l’Europe, ait été chassée d’Asie et d’Afrique et que, petite en ses dimensions, elle est constamment harcelée par les Sarazins et les Turcs, qui veulent l’avaler toute entière. Les propos de Guillaume de Malmesbury expriment fort bien le sentiment d’encerclement que ressentaient les Européens de son époque, un sentiment qui devrait réémerger aujourd’hui, où les peuples de la périphérie ne cachent pas leur désir de grignoter notre territoire et/ou de l’occuper de l’intérieur par vagues migratoires ininterrompues, en imaginant que notre ressac démographique est définitif et inéluctable.
L’épopée des Croisades ne s’achève pas par l’échec total de la huitième croisade, prêchée par Urbain IV en 1263 et où meurt Saint Louis (1270). La chute d’Acre en 1291 met fin aux Etats latins d’Orient: seul ultime sursaut, la prise de Rhodes en 1310, confiée ensuite aux Hospitaliers. Détail intéressant: en 1274, Grégoire X, successeur d’Urbain IV, tentera en vain d’unir les empires du rimland en un front unique: les Mongols de Perse, les Byzantins et les Européens catholiques (3). Les guerres contre les Ottomans à partir du XIV° siècle et le fiasco de Nicopolis en 1396, à la suite de la défaite serbe du Champs des Merles en 1389, sont des guerres assimilables à des croisades. Le XV° siècle ne connaît pas de répit, avec la défaite européenne de Varna en 1444, prélude immédiat de la chute de Constantinople en 1453. Les XVI° et XVII° siècles verront l’affrontement entre l’Espagne d’abord, l’Autriche-Hongrie ensuite, et les Ottomans. La défaite des Turcs devant Vienne en 1683, puis la Paix de Karlowitz en 1699, scellent la fin de l’aventure ottomane et le début de l’expansion européenne. Ou, plus exactement, le début d’une riposte européenne, enfin victorieuse depuis les premiers revers des Saces.
Les Portugais contournent l’Afrique et arrivent dans l’Océan Indien
Deux réactions ont cependant été déterminantes: d’abord, l’avancée des Russes sur terre, séparant les Tatars de Crimée du gros de la Horde d’Or et du Khanat de Sibir par la conquête du cours de la Volga jusqu’à la Caspienne. Le réveil de la Russie indique le retour d’un peuple indo-européen dans l’espace steppique au sud de l’Oural et un reflux des peuples hunniques et mongols. La Russie poursuivra la conquête jusqu’au Pacifique en deux siècles. Puis reprendra toute l’Asie centrale. Nous avons affaire là au même eurasisme que celui des Proto-Iraniens à l’aurore de notre histoire. Ensuite, deuxième réaction, la conquête portugaise des eaux de l’Atlantique sud et de l’Océan Indien. Elle commence par une maîtrise et une neutralisation du Maroc, d’où disparaissent les Mérinides, remplacés par les Wattasides qui n’ont pas eu les moyens d’empêcher les Portugais de contrôler le littoral marocain. A partir de cette côte, les Portugais exploreront tout le littoral atlantique de l’Afrique avec Cabral et franchiront le Cap de Bonne Espérance avec Vasco de Gama (1498). Les Européens reviennent dans l’Océan Indien et battent la flotte des Mamelouks d’Egypte au large du Goujarat indien. La dialectique géopolitique de l’époque consiste, peut-on dire, en une alliance de l’eurasisme européanisant des Russes et de l’indisme thalassocratique des Portugais qui prennent un Empire musulman du rimland en tenaille, une empire à cheval sur trois continents: l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Le tandem Ottomans-Mamelouks disposait effectivement de fenêtres sur l’Océan Indien, via la Mer Rouge et le Golfe Persique et était en quelque sorte “hybride”, à la fois tellurique, avec ses armées de janissaires dans les Balkans, et thalassocratique par son alliance avec les pirates barbaresques de la côte septentrionale de l’Afrique et avec les flottes arabe et mamelouk de la Mer Rouge. Les Portugais ont donc réussi, à partir de Vasco de Gama à parfaire une manoeuvre d’encerclement maritime du bloc islamique ottoman et mamelouk, puisque les entreprises terrestres que furent les croisades et les expéditions malheureuses de Nicopolis et de Varna avaient échoué face à l’excellence de l’organisation militaire ottomane. Les héritiers d’Henri le Navigateur, génial précurseur du retour des Européens sur les mers du monde, ont réduit à néant, par leur audace, le sentiment d’angoisse des Européens devant l’encerclement dont ils étaient les victimes depuis l’irruption des Seldjouks dans cette partie de la Romania, qui était alors byzantine.
L’indisme thalassocratique et l’eurasisme tellurique/continental sont alors alliés, en dépit du fait que les Portugais sont catholiques et honorent le Pape de Rome et que les Russes se proclament les héritiers de Byzance, en tant que “Troisième Rome”, depuis la chute de Constantinople en 1453. Après les succès flamboyants d’Albuquerque entre 1503 et 1515 et la pénétration du Pacifique, les Portugais s’épuiseront, ne bénéficieront plus de l’apport de marins hollandais après le passage des Provinces-Unies des Pays-Bas au calvinisme ou au luthérisme; les Hollandais feront brillamment cavaliers seuls avec leur “Compagnie des Indes Orientales” fondée en 1602, s’empareront de l’Insulinde, deviendront pendant les deux tiers du XVII° une puissance à la fois “indiste” et atlantiste, et même partiellement pacifique vu leurs comptoirs au Japon, mais ne disposant que d’une base métropolitaine bien trop exigüe, ils cèderont graduellement le gros de leurs prérogatives aux Anglais dans l’Océan Indien et autour de l’Australie.
Le premier “atlantisme” ibérique: un auxiliaire du dessein “alexandrin”
L’atlantisme naît évidemment de la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492. Mais l’objectif premier des puissances européennes, surtout ibériques, sera d’exploiter les richesses du Nouveau Monde pour parfaire un grand dessein romain et “alexandrin”, revenir en Méditerranée orientale, reprendre pied en Afrique du Nord, libérer Constantinople et ramener l’Anatolie actuelle dans le giron de la “Romania”. Le premier atlantisme ibérique n’est donc que l’auxiliaire d’un eurasisme “croisé” ibérique et catholique, allié à la première offensive de l’eurasisme russe, et portée par un dessein “alexandrin”, qui espère une alliance euro-perse. Une telle alliance aurait reconstitué le barrage des empires contre la steppe turco-hunnique, alors que les empires antérieurs, ceux de l’antiquité, se nourrissaient de l’énergie des cavaliers de la steppe quand ceux-ci étaient indo-européens.
L’atlantisme proprement dit, détaché dans un premier temps de tout projet continentaliste eurasien, nait avec l’avènement de la Reine Elisabeth I d’Angleterre. Elle était la fille d’Anne Boleyn, deuxième épouse d’Henri VIII et pion du parti prostestant qui avait réussi à évincer la Reine Catherine, catholique et espagnole. Après la décollation d’Anne Boleyn, la jeune Elisabeth ne devait pas monter directement sur le trône à la mort de son père: son demi-frère Edouard VI succède à Henri VIII, puis, à la mort prématurée du jeune roi, sa demi-soeur Marie Tudor, fille de Catherine d’Espagne, qui déclenche une virulente réaction catholique, ramenant l’Angleterre, pendant cinq ans dans le giron catholique et l’alliance espagnole (1553-1558). Le décès prématuré de Marie Tudor amène Elisabeth I sur le trône en 1558; elle y restera jusqu’en 1603: motivée partiellement par l’ardent désir de venger sa mère, la nouvelle reine enclenche une réaction anti-catholique extrêmement violente, entraînant une cassure avec le continent qui ne peut être compensée que par une orientation nouvelle, anglicane et protestante, et par une maîtrise de l’Atlantique-Nord, avec la colonisation progressive de la côte atlantique, prenant appui sur la réhabilitation de la piraterie anglaise, hissée au rang de nouvelle noblesse après la disparition de l’ancienne aristocratie et chevalerie anglo-normandes suite à la Guerre des Deux Roses, à la fin du XV° siècle (4).
L’expansion anglaise en Amérique du Nord
C’est donc une vendetta familiale, un schisme religieux et une réhabilitation de la piraterie qui créeront l’atlantisme, assorti d’une volonté de créer une culture ésotérique différente de l’humanisme continental et catholique. Elle influence toujours, dans la continuité, les linéaments ésotériques de la pensée des élites anglo-saxonnes (5), notamment ceux qui, en sus du puritanisme proprement dit, sous-tendent la théologie politique américaine. Sous le successeur faible d’Elisabeth commence la colonisation de l’Amérique du Nord, par la fondation d’un premier établissement en 1607 à Jamestown. Elle sera complétée par l’annexion des comptoirs hollandais en 1664, dont “Nieuw Amsterdam” qui deviendra New York. L’inclusion du Delaware et des deux Carolines permet l’occupation de tout le littoral atlantique des futurs Etats-Unis. En 1670, l’Angleterre patronne la fondation de l’Hudson Bay Company qui lui permet de coincer la “Nouvelle-France”, qui s’étend autour de Montréal, entre les Treize colonies et cette portion importante de l’hinterland du futur territoire canadien. Les liens avec l’Angleterre et l’immigration homogène et massive de Nord-Européens font de l’Atlantique-Nord un lac britannique et le socle d’une future puissance pleinement atlantique.
L’Angleterre en s’emparant de la totalité du Canada par le Traité de Paris en 1763 consolide sa puissance atlantique. Mais les jeux ne sont pas encore faits: lors de la révolte des “Treize colonies” en 1776, les flottes alliées de la France, de l’Espagne et de la Hollande volent au secours des insurgés américains et délogent les Anglais qui, dans les décennies suivantes, redeviendront une puissance principalement indienne, c’est-à-dire axée sur la maîtrise de l’Océan Indien. A partir du développement de la flotte russe sous Catherine la Grande, la Russie devient une menace pour l’Inde et surtout pour la route maritime qui y mène. Quand le Tsar Paul I propose à Napoléon Bonaparte de marcher de conserve, à travers la steppe, vers l’Inde, source de la puissance anglaise, en bousculant la Perse, Londres focalise toute son attention sur le maintien de son hégémonie sur le sous-continent indien et met en sourdine son ancienne vocation atlantique. C’est le “Grand Jeu”, le “Great Game” disent les historiens anglo-saxons, qui oppose, d’une part, une thalassocratie maîtresse de l’Océan Indien et de la Méditerranée, avec un appendice atlantique, comprenant le Canada comme réserve de matières premières et quelques comptoirs africains sur la route des Indes avant le creusement du Canal de Suez, et, d’autre part, une puissance continentale, tellurique, qui avance lentement vers le Sud et reconquiert la steppe d’Asie centrale sur les peuples turcs qui l’avaient enlevée aux Yuezhi, Saces, Tokhariens et Sarmates. Du coup, la Russie des Tsars devient l’héritière et la vengeresse de ces grands peuples laminés par les invasions hunniques, turques et mongoles. La Russie des Tsars développe donc un eurasisme indo-européanisant et se heurte à une thalassocratie qui a hérité de la stratégie de contournement des Portugais de la fin du XV° et du début du XVI° siècle. Mais cette stratégie de contournement est nouvelle, n’a pas de précédent dans l’histoire, ne s’identifie ni à l’Europe continentale ni à une Romania, disparue mais hissée au rang d’idéal indépassable, ni à un catholicisme qui en exprimerait l’identité sous des oripeaux chrétiens (comme dans le discours d’Urbain II ou le texte de Guillaume de Malmesbury). Le choc de cette thalassocratie et du continentalisme russe va freiner, enrayer et empêcher le parachèvement plein et entier d’un eurasisme indo-européanisant.
L’affrontement entre l’Empire continental des Tsars et l’Empire maritime des Britanniques
L’affrontement entre la thalassocratie anglaise et le continentalisme russe débute dès les premières conquêtes de Nicolas I, qui règna de 1825 à 1855 et consolida les conquêtes d’Alexandre I dans le Caucase, tout en avançant profondément dans les steppes du Kazakhstan, entre 1846 et 1853. Nicolas I désenclave également la Mer Noire, en fait un lac russe: alarmée, l’Angleterre fait signer une convention internationale en 1841, interdisant le franchissement des détroits pour tout navire de guerre non turc. Elle avait soutenu le Sultan contre le Pacha d’Egypte, Mehmet Ali, appuyé par la France. En 1838, elle s’installe à Aden, position stratégique clef dans l’Océan Indien et à la sortie de la Mer Rouge. C’est le début d’une série de conquêtes territoriales, en réponse aux avancées russes dans le Kazakhstan actuel: sont ainsi absorbés dans l’Empire thalassocratique anglais, le Baloutchistan en 1876 et la Birmanie intérieure en 1886. Pour contrer les Russes au nord de l’Himalaya, une expédition est même lancée en direction du Tibet en 1903.
Dans ce contexte, la Guerre de Crimée (1853-1855), suivie du Traité de Paris (1856), revêt une importance toute particulière. L’Angleterre entraîne la France de Napoléon III et le Piémont-Sardaigne dans une guerre en Mer Noire pour soutenir l’Empire ottoman moribond que la Russie s’apprête à absorber. Les intellectuels russes, à la suite de cette guerre perdue, vont cultiver systématiquement une méfiance à l’égard de l’Occident, posé comme libéral, “dégénéré” et “sénescent”, sans pour autant abandonner, dans les cinq dernières décennies du XIX° leur eurasisme indo-européanisant: l’obsession du danger “mongol”, qualifié de “panmongoliste”, demeure intacte (6). L’Orient de ces intellectuels orthodoxes et slavophiles est russe et byzantin, les référents demeurent donc de matrice grecque-chrétienne et européenne. Dans ce contexte, Vladimir Soloviev prophétise une future nouvelle invasion “mongole” en 1894, à laquelle la Russie devra faire face sans pouvoir compter sur un Occident décadent, prêt à trahir son européanité. Neuf ans plus tard, la défaite russe de Tchouchima laisse entrevoir que cette prophétie était juste, du moins partiellement.
La thématique du “péril panmongol” dans la littérature russe
Gogol, dans deux récits fantastiques, “Le portrait” et “Une terrible vengeance”, aligne des personnages de traîtres, dont l’anti-héros Petromihali, qui infusent dans l’âme russe des perversités asiatiques et les préparent ainsi à la soumission. Dostoïevski, dans “La légende de l’Antéchrist”, faire dire à son “Grand Inquisiteur” que le Christ, auquel la Russie doit s’identifier jusqu’à accepter le martyre, a eu tort de refuser une “monarchie universelle” à la Gengis Khan ou à la Tamerlan. Satan l’a proposée au Christ, et le “Grand Inquisiteur” qui est une incarnation du Malin sous le déguisement d’un dignitaire de l’Eglise du Fils de Dieu, reproche au Christ, revenu sur Terre et qu’il va juger, d’avoir refusé ce pouvoir absolu, séculier et non spirituel. La Russie doit donc refuser un pouvoir de type asiatique, rester fidèle à ses racines européennes et chrétiennes, c’est-à-dire à une liberté de l’âme, à une liberté intérieure qui se passe de l’Etat ou, du moins, ne le hisse pas au rang d’idole absolue car, sinon, l’humanité entière connaîtra le sort peu enviable de la “fourmilière rassassiée”. La liberté scythe et cosaque, en lutte contre les ténèbres asiatiques, doit prévaloir, se maintenir envers et contre tout, même si elle n’est plus qu’une petite flamme ténue. Plus tard, le “totalitarisme” communiste et les dangers impitoyables du “panmongolisme”, annoncés par Soloviev, fusionneront dans l’esprit de la dissidence, jusqu’à l’oeuvre de Soljénitsyne. Dimitri Merejkovski ira même plus loin: le monde “s’enchinoisera”, l’Europe sombrera dans la veulerie et la léthargie et le monde entier basculera dans un bourbier insondable de médiocrité. “L’enchinoisement”, craint par Merejkovski, peut certes s’interpéréter de multiples manières mais une chose est certaine: il implique un oubli dramatique de l’identité même de l’homme de qualité, en l’occurrence de l’homme russe et européen, oubli qui condamne l’humanité entière à une sortie hors de l’histoire et donc à une plongée dans l’insignifiance et la répétition stérile de modes de comportement figés et stéréotypés. En ce sens, la figure du “Chinois” est métaphorique, tout aussi métaphorique qu’elle le sera chez un Louis-Ferdinand Céline après 1945.
Jusqu’à la révolution bolchevique, l’eurasisme russe demeure indo-européanisant: il reste dans la logique de la reconquête de l’espace scythique-sarmate, “proto-iranien” dirait-on de nos jours. La Russie est revenue dans les immensités sibériennes et centre-asiatiques: ce n’est pas pour en être délogée comme en furent délogés les peuples cavaliers, à partir du déploiement de la puissance de la Confédération des Xiongnu. Toutefois cet anti-asiatisme, réel ou métaphorique, et cette volonté d’être européen sur un mode non plus repu, comme les Occidentaux, mais sur un mode énergique et héroïque, ne touche pas l’ensemble de la pensée stratégique russe: au lendemain de la Guerre de Crimée, où le Tsar Nicolas I avait délibérément voulu passer sur le corps de l’Empire Ottoman pour obtenir une “fenêtre” sur la Méditerranée, Konstantin Leontiev suggère une autre stratégie. Il vise une alliance anti-moderne des chrétiens orthodoxes et des musulmans contre le libéralisme et le démocratisme modernes, diffusés par les puissances occidentales. On ne déboulera pas sur les rives de l’Egée par la violence, en allant soutenir des nationalismes balkaniques ou helléniques entachés de modernisme occidental, mais en soutenant plutôt la Sublime Porte contre les subversions intérieures qui la minent, de façon à apaiser toutes les tensions qui pourraient survenir dans le vaste espace musulman et turcophone fraîchement conquis en Asie centrale et à obtenir des concessions portuaires et navales en Egée et en Méditerranée orientale, tout en annulant les contraintes des traîtés fomentés par l’Angleterre pour bloquer le passage des Détroits. Leontiev suggère dès lors une alliance entre Russes et Ottomans, qui constituerait un bloc de Tradition contre le modernisme occidental. Cette idée, conservatrice, est reprise aujourd’hui par les néo-eurasistes russes.
L’idée de Leontiev peut bien sûr se conjuguer à certaines visions de l’anti-mongolisme littéraire, surtout si elle vise, comme ennemi premier, le libéralisme et le positivisme occidentaux, pendants néo-kantiens de l’immobilisme “jaune”, qui engourdissent les âmes. Avec la révolution bolchevique et la rupture avec l’Occident qui s’ensuivit, l’anti-asiatisme va s’estomper et, comme la nouvelle URSS est de facto une synthèse d’Europe et d’Asie, on élaborera, dans un premier temps, “l’idée scythe”. Les “Scythes”, dans cette optique, sont les “Barbares de l’Ouest” dans l’espace russo-sibérien, tandis que les “Barbares de l’Est” sont les cavaliers turco-mongols. On ne spécule plus sur les différences raciales, posées comme fondamentales dans l’eurasisme indo-européanisant, mais sur les points communs de cette civilisation non urbanisée et non bourgeoise, qui abhorre la quiétude et portera l’incendie révolutionnaire dans le monde entier, en balayant toutes les sociétés vermoulues. Du “scythisme”, dont le référent est encore un peuple indo-européen, on passe rapidement à un idéal fusionniste slavo-turc voire slavo-mongol, qui unit dans une même idéologie fantasmagorique tous les peuples de l’URSS, qu’ils soient slaves-scythes ou turco-mongols.
Du scythisme des années 20 au néo-eurasisme actuel
Jusqu’à l’effondrement de l’Union Soviétique, l’élément slave et scythe reste implicitement dominant. Quand les républiques musulmanes centre-asiatiques de l’éphémère CEI obtiennent une indépendance pleine et entière, la Russie perd tous les glacis conquis par les Tsars de Catherine la Grande à Nicolas II. Le néo-eurasisme est une réaction face à la dislocation d’un bloc qui fut puissant: il cherche à rallier tous ceux qui en ont fait partie au nom d’une nouvelle idéologie partagée et à constituer ainsi un ersatz à l’internationalisme communiste défunt.
D’un point de vue eurasiste indo-européanisant, cette position peut se comprendre et s’accepter. Le néo-eurasisme refuse de voir se reconstituer, dans les steppes centre-asiatiques, un môle anti-russe, porté par un nouveau panmongolisme, un pantouranisme, un panislamisme ou une idéologie occidentaliste. L’eurasisme indo-européanisant, le “scythisme” des premières années du bolchevisme et le néo-eurasisme actuel, dont la version propagée par Alexandre Douguine (7) ont pour point commun essentiel de vouloir garder en une seule unité stratégique l’aire maximale d’expansion des peuples indo-européens, en dépit du fait qu’une portion majeure, stratégiquement primordiale, de cette aire soit occupée désormais par des peuples turcophones islamisés, dont le foyer originel se trouve sur le territoire de l’ancienne culture dite des “tombes à dalles” ou dans l’Altaï et dont la direction migratoire traditionnelle, et donc la cible de leurs attaques, porte dans l’autre sens, non plus d’ouest en est, mais d’est en ouest.
L’idéologie néo-eurasienne, avec sa volonté de consolider un bloc russo-asiatique, s’exprime essentiellement dans les stratégies élaborées par le Groupe de Changhaï et dans les réponses que celui-ci apporte aux actions américaines sur la masse continentale eurasienne.
L’expansion “bi-océanique” des Etats-Unis au XIX° siècle
Face à cet eurasisme, qui se conjugue en trois modes (indo-européanisant, scythique et russo-turco-mongol), qu’en est-il exactement de l’atlantisme, posé comme son adversaire essentiel sinon métaphysique? A l’aube du XIX° siècle, les “Treize colonies” américaines, qui ont fraîchement acquis leur indépendance face à l’Angleterre, ne possèdent pas encore un poids suffisant pour s’opposer aux puissances européennes. Leur premier accroissement territorial vient de l’acquisition de la Louisiane, qui leur donne une plus grande profondeur territoriale sur le continent nord-américain. En Europe, l’effondrement du système napoléonien fait éclore, avec le Traité de Vienne de 1815, qui ménage la France redevenue royale, une “Sainte-Alliance” ou une “Pentarchie” qui est, ipso facto, eurasienne. La “Pentarchie” s’étend, de fait, de l’Atlantique au Pacifique, puisque la Russie du Tsar Alexandre I en fait partie, en constitue même la masse territoriale la plus importante. On oublie trop souvent que l’Europe a été eurasienne et que l’eurasisme n’est pas une lubie nouvelle, imaginée par des intellectuels en mal d’innovation à la suite de la chute du Mur de Berlin et de la disparition du système soviétique. La Pentarchie, système unifiant l’Europe, n’a pas duré longtemps mais elle a existé et rendu notre sous-continent et la Russie-Sibérie inviolables et invincibles. Elle est par conséquent un modèle à imiter, une situation idéale à restaurer.
Face à ce bloc euro-pentarchique, en apparence inexpugnable, les Etats-Unis se sentent minorisés, craignent pour leur subsistance et, par une audace inouïe, leur Président, James Monroe proclame sa célèbre Doctrine en 1823 en imaginant, dans un premier temps, que le monde sera divisé en un “ancien monde” et un “nouveau monde”, dont il s’agira d’interdire l’accès à toutes les puissances de la Pentarchie et à l’Espagne, où elle était intervenue pour rétablir l’ordre (8). La proclamation de la Doctrine de Monroe est un premier grand défi au bloc pentarchique eurasiatique, avant même que les Etats-Unis ne soient devenus une puissance bi-océanique, à la fois atlantique et pacifique. Ils ne possèdent pas encore, en 1823, le Texas, le Nouveau-Mexique, la Californie et l’Alaska. En 1848, suite à la défaite du Mexique, ils deviennent bi-océaniques, ce qui revient à dire qu’ils ne sont pas exclusivement “atlantistes” mais constituent aussi une puissance intervenante dans les immensités du plus grand océan de la planète. Déjà, certains sénateurs envisagent de réorganiser la Chine pour qu’elle devienne le premier débouché des Etats-Unis et de leur industrie naissante. Le Commodore Matthew C. Perry, dès 1853-54, force, sous la menace, le Japon à s’ouvrir au commerce américain: première manifestation musclée d’une volonté claire et nette de dominer le Pacifique, contre les pays riverains du littoral asiatique de ce grand océan. Il faudra attendre la guerre hispano-américaine de 1898 pour que les Etats-Unis s’emparent d’un territoire insulaire face à l’Asie, en l’occurrence les Philippines, pour donner du poids à leurs revendications. Sous la présidence de Théodore (Teddy) Roosevelt, les Etats-Unis jettent les bases, non d’un atlantisme, mais d’un mondialisme offensif. L’instrument de cette politique mondialiste sera la flotte que l’Amiral Alfred Thayer Mahan appelle à constituer pour que les Etats-Unis puissent faire face, avec succès, au reste du monde. En 1912, Homer Lea, officier américain formé à Westpoint mais démis de ses fonctions pour raisons de santé, théorisera, immédiatement après John Halford Mackinder, les règles de l’endiguement de l’Allemagne et de la Russie, avant même que l’alliance anglo-américaine ne soit devenue une réalité.
Une thalassocratie pluri-océanique
Avec Teddy Roosevelt et avec Mackinder, nous avons affaire, dans la première décennie du XX° siècle à un mondialisme thalassocratique américain, maître depuis 1898 des Caraïbes et de la “Méditerranée américaine”, mais sans aucune présence dans l’Océan Indien, et à une thalassocratie britannique, présente dans l’Atlantique Nord, dans l’Atlantique Sud (où l’Argentine est un de ses débouchés), dans l’Océan Indien et dans le Pacifique Sud. La puissance découle des capacités des marines de guerre et des fameux “dreadnoughts”, mais elle est toujours au moins bi-océanique, sinon pluri-océanique. Les Centraux en 1918 et l’Axe en 1945 perdent la guerre parce qu’ils ne maîtrisent aucune mer, même pas la Méditerranée, la Mer du Nord et les zones chevauchant l’Atlantique Nord et l’Océan Glacial Arctique, puisque Malte, Gibraltar, Chypre et l’Egypte (avec Suez) resteront toujours aux mains des Britanniques et que le trafic maritime des “liberty ships”, en dépit des pertes infligées par les sous-marins allemands, ne sera jamais interrompu entre l’Amérique du Nord et le port soviétique de Mourmansk. La seconde guerre mondiale est une lutte entre, d’une part, les thalassocraties anglo-saxonnes maîtresses des océans et alliées à la puissance eurasiatique soviétique, et, d’autre part, une péninsule européenne riche mais dépourvue d’une réelle puissance navale, alliée à un archipel du Pacifique, surpeuplé et dépourvu de matières premières.
Le terme d’atlantisme apparaît lors des accords entre Churchill et Roosevelt, scellés au beau milieu de l’Océan en 1941. En 1945, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale forment un ensemble, qui deviendra l’OTAN, une alliance centrée sur l’Atlantique-Nord, que l’on qualifiera rapidement, dans les écrits polémiques, d’ “atlantisme”. Mais l’Atlantique, en tant qu’espace océanique, est-il si déterminant que cela dans les atouts, multiples et variés, qui confèrent aujourd’hui la puissance aux Etats-Unis? Non. Car, si la puissance de la Russie, des Tsars à la perestroïka, repose, comme l’avait constaté Mackinder en 1904, sur la possession de la “Terre du Milieu”, celle de l’Empire britannique reposait sur la maîtrise complète de l’ “Océan du Milieu”, l’Océan Indien. En 1947, quand l’Inde accède à l’indépendance mais subit simultanément une partition dramatique, opposant une Inde nouvelle majoritairement hindoue à un Pakistan presque totalement musulman, l’Océan Indien, débarrassé de ses maîtres britanniques épuisés par deux guerres mondiales, entre dans une phase de neutralisation provisoire. Il est alors l’espace du non-alignement. L’Inde de Nehru, clef de voûte géographique de l’ancien arc de puissance britannique (du Cap à Perth), propage une logique politique détachée des blocs issus de la bipolarisation de la Guerre Froide. Dès les années 60, Mohammed Reza Pahlavi, Shah d’Iran, théorise l’idéal d’une “Grande Civilisation” dans l’Océan Indien, tout en multipliant les démarches diplomatiques pacifiantes avec ses voisins, y compris soviétiques. A Washington, on comprend rapidement que la Guerre Froide ne se gagnera pas en Europe, sur un front qui correspond au Rideau de Fer, mais qu’il faut endiguer l’URSS, en renouant avec la Chine, comme le fit le tandem Nixon-Kissinger au début des années 70; en tablant sur les peuples installés le long de la Route de la Soie et en éveillant les forces centrifuges au sein même de l’Union Soviétique, comme l’envisageait Zbigniew Brzezinski; en entraînant l’URSS dans le bourbier afghan; en tablant sur le fanatisme musulman pour lutter contre l’athéisme communiste et pour briser l’alternative locale proposée par le Shah d’Iran, car, en dépit des affrontements irano-américains largement médiatisés depuis la prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran au début de l’ère khomeyniste, il ne faut pas oublier que la “révolution islamiste” d’Iran a d’abord été une création des services américains, pour briser la politique énergétique du Shah, casser les relations qu’il entretenait avec l’Europe et mettre l’Iran et ses potentialités au “frigo”, le plus longtemps possible. Ces stratégies avaient toutes pour but de revenir dans l’Océan Indien et dans le Golfe Persique. Elles ont contribué à la reconquête de l’Océan Indien et fait des Etats-Unis une puissance désormais tri-océanique.
La maîtrise de l’Océan Indien reste la clef de la puissance mondiale
La dialectique atlantisme/eurasisme, dont les néo-eurasiens russes actuels font usage dans leurs polémiques anti-américaines, oublie que l’Amérique ne tient pas sa puissance aujourd’hui de sa maîtrise de l’Atlantique, océan pacifié où ne se joue pas l’histoire qui est en train de se faire, mais de son retour offensif dans l’Océan du Milieu. L’abus du vocable “atlantiste” risque de provoquer une sorte d’illusion d’optique et de faire oublier que ce n’est pas la maîtrise des Açores, petit archipel portugais au centre de l’Atlantique, qui a provoqué la désagrégation de l’URSS, puissance eurasienne, mais la maîtrise de Diego Garcia, île au centre de l’Océan Indien, d’où partaient les forteresses volantes qui bombardaient l’Afghanistan et l’Irak. C’est au départ des forces aéronavales massées à Diego Garcia qu’adviendra peut-être le “Greater Middle East”. Si c’est le cas, l’Europe et la Russie seront condamnées à l’isolement, à n’avoir aucune fenêtre sur les espaces où s’est toujours joué, et se joue encore, le destin du monde.
Certes, l’atlantisme est, pour les Européens, une idéologie engourdissante, aussi engourdissante, sinon plus, que “l’enchinoisement”, réel ou métaphorique, dénoncé par Soloviev ou Merejkovski: Danilevski, lui, parlait de l’Occident comme d’un cimetière pour les plus sublimes vertus spirituelles humaines et l’écrivain russe provocateur et contemporain, Edouard Limonov, parle, lui, d’un “Grand Hospice occidental”. Mais ce n’est pas là un problème géopolitique, c’est un problème théologique, métaphysique, philosophique et éthique. Qu’il convient d’aborder avec force et élan. Pour dégager l’humanité des torpeurs et des enlisements du consumérisme.
Robert STEUCKERS.
(fait à Forest-Flotzenberg, du 11 au 15 février 2009).
Notes:
(1) Cf. Colin McEVEDY, “The New Penguin Atlas of Ancient History”, Penguin, London, 2nd ed., 2002.
(2) Cf. Jacques BERTIN, “Atlas historique universel – Panorama de l’histoire du monde”, Minerva, Genève, 1997.
(3) Robert DELORT (Éd.), “Les croisades”, Seuil, coll. “Points”, 1988.
(4) Vicente FERNANDEZ & Dionisio A. CUETO, “Los perros de la Reina – Piratas ingleses contra España (s. XVI)”, Almena Ed., Madrid, 2003.
(5) Frances A. YATES, “Cabbala e occultismo nell’età elisabettiana”, Einaudi, Torino, 1982.
(6) Cf. Georges NIVAT, “Vers la fin du mythe russe – Essais sur la culture russe de Gogol à nos jours”, Lausanne, L’Age d’Homme, 1988.
(7) Cf. Mark J. SEDGWICK, “Contre le monde moderne – Le traditionalisme et l’histoire intellectuelle secrète du XX° siècle”, Ed. Dervy, Paris, 2008.
(8) Dexter PERKINS, “Storia della Dottrina di Monroe”, Societa Editrice Il Mulino, Bologne, 1960.
00:35 Publié dans Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasisme, atlantisme, histoire, géopolitique, stratégie, eurasie, eurasisme, asie, affaires asiatiques, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 18 mars 2009
L'implication des Etats-Unis en Europe de l'Est à travers les conflits yougoslave et kosovar
L’implication des Etats-Unis en Europe de l’Est à travers les conflits yougoslave et kosovar
Durant l’été 98, suite à des accrochages avec la police serbe et des actions de représailles de celle-ci, l’UçK lance des opérations militaires dans la province. Ces opérations vont déboucher sur un état de guerre, des campagnes de purification ethnique (celles-ci furent menées par la Serbie, aujourd’hui elles sont menées par les albanais du Kosovo) et les frappes aériennes de l’OTAN.
Le premier interlocuteur envoyé auprès des autorités serbes n’est pas formellement de l’ONU mais est le « groupe de contact » représenté par les délégués américains Richard Holbrooke et Christopher Hill. Le groupe qui tente de s’imposer dans un premier temps pour une médiation va par la suite (malgré des divergences avec la Russie) joindre son action diplomatique aux pressions et actions militaires de l’Alliance Atlantique. Dans le mois de juin 98, alors que Richard Holbrooke rencontrait des officiers de l’UçK au Kosovo à l’initiative du premier ministre albanais, Bill Clinton pris une décision qui allait avoir une influence sur la suite des évènements. William Cohen son ministre de la Défense avait demandé aux experts et au comité militaire de l’OTAN de préparer une intervention militaire, ce à quoi Clinton donna son soutien et son autorisation.
A ce stade du conflit, deux acteurs majeurs émergent, les Etats-Unis et l’OTAN, l’ONU a pour sa part une implication qui paraît bien plus superficielle. Le poids des Etats-Unis se renforce : d’un côté par ses médiateurs envoyés à Belgrade formant l’essentiel de l’action diplomatique, de l’autre par des contacts entre le Pentagone, la CIA et l’UçK. Les tractations menées par le premier ministre albanais Fatos Nano avec son allié américain semblent être assez fructueuses, les Etats-Unis commencent à prendre en compte l’UçK comme acteur à part entière. L’organisation kosovare jouira d’un soutien mais limité dans un premier temps.
La cause de la limitation de ce soutien vient de divergences dans le gouvernement américain. Madeleine Albright (secrétaire d’Etat) et William Cohen ne s’entendent pas sur les buts de l’OTAN, l’utilité de frappes aériennes ou encore le rôle à donner à l’UçK. Ces débats internes ne doivent pas masquer un fait essentiel : même si l’action militaire de l’OTAN était discutée, elle l’était seulement sur ses modalités et n’était aucunement remise en question. L’OTAN dans ses préparatifs et évaluations a recours à des informations prises sur le terrain par l’UçK elle-même. Les informations sur les positions ou mouvements de troupes serbes étaient transmises par des téléphones cellulaires fournis aux officiers kosovars par l’Alliance Atlantique.
La stratégie adoptée vise à terme la marginalisation de l’ONU. Les Etats-Unis ne peuvent passer par l’ONU et son Conseil de Sécurité qui risqueraient de freiner voire stopper son action. Le veto russe est envisagé et la France a déclaré qu’une intervention de l’OTAN ne devrait se faire que dans le cadre d’un mandat du Conseil de Sécurité L’offensive serbe reprit durant l’été 98, l’ONU avait peu de prise sur la situation aussi bien que sur les négociations. Le groupe de contact sert d’émissaire officiel auprès de Milošević et jouit du total soutien de l’OTAN dans ses négociations. Cela signifie plus nettement que l’accord provisoire et ceux qui suivraient s’accompagneraient de pressions militaires s’ils devaient s’imposer par la force. Durant le mois de janvier 99, une réunion se tint à Bruxelles au siège de l’Alliance Atlantique et portait encore sur les conditions d’exercice de l’OTAN, les Etats-Unis plaidant l’autonomie et la France défendant une implication majeure de l’ONU et du Conseil de Sécurité.
Parallèlement aux réunions, le 30, Robin Cook (le ministre britannique des Affaires Etrangères), se rendait auprès de Milošević et des leaders albanais du Kosovo afin de leur remettre une convocation pour venir négocier à Rambouillet la semaine suivante.
Les négociations se tenaient du 6 au 23 février puis du 15 au 20 mars à Paris sans qu’on aboutisse à un quelconque résultat. La délégation albanaise accepta la constitution d’une force multinationale sous commandement de l’OTAN. Parallèlement le 23 février le rôle primordial de l’OTAN était réaffirmé par Madeleine Albright et suscitait la désapprobation de la Russie. L’accord était placé sous la menace de sanctions militaires si une des parties ne signait pas. Le refus serbe de signer et la signature tactique des délégués kosovars amenait l’OTAN à intervenir par le biais de frappes aériennes le 24 mars et ce, pour plus de deux mois.
Le retrait des troupes serbes et la « fin » du conflit s’amorcent durant le mois de juin 99. Le Conseil de Sécurité de l’ONU adopte le 10 juin la résolution 1244. Comme le rappelle Evette Guendon, cette résolution 1244 « …a officialisé la mission de la présence de sécurité internationale fournie par la KFOR et celle de la présence civile internationale provisoire ou MINUK… ».
Pour la MINUK qui est l’administration civile des Nations Unies envoyée dans la province il est tout à fait normal que son action soit légitimée par une résolution du Conseil de Sécurité. En revanche pour la KFOR cette situation est un peu plus particulière. Etant un contingent multinational sous commandement de l’OTAN et du siège de l’Alliance Atlantique à Bruxelles (donc aucun lien avec l’ONU), l’organisation atlantique est fortement intégrée et influencée par le gouvernement américain et son administration dans les prises de décisions stratégiques. La résolution revient à légitimer dans ce cas une action unilatérale qui dès le début a tendu à marginaliser le système des Nations Unies et contourner le Conseil de Sécurité pourtant seul acteur légitime.
Le 12 juin 1999, la KFOR rentrait au Kosovo et le 21 juin, l’UçK s’engageait par un accord (signé au quartier général de la KFOR à Priština) à déposer les armes et changer de statut. L’OTAN s’était imposé de manière décisive dans le conflit par le groupe de contact au début, par l’action diplomatique américaine menée à l’ONU ou auprès de certains Etats (soutien britannique, alliances, déploiements de troupes en Grèce, Albanie) et n’avait pas hésité à user de la force.
Durant les attaques aériennes de l’OTAN sur différents objectifs en Serbie (usines de Pančevo, sites industriels, officiels ou symboliques de Belgrade) et au Kosovo (sur les troupes serbes ou les frappes sur des colonnes de réfugiés qualifiées de « dommages collatéraux ») Brzezinski exposait au journal Le Monde du 17 avril 1999 l’enjeu du conflit et la stratégie employée: « Le fait est que l’enjeu dépasse infiniment désormais, le simple sort du Kosovo. Il n’est pas excessif d’affirmer que l’échec de l’OTAN signifierait tout à la fois la fin de la crédibilité de l’Alliance et l’amoindrissement du leadership mondial américain. »
Aussi bien en Bosnie qu’au Kosovo, l’OTAN fut à la tête de chaque intervention soit en parallèle avec l’ONU soit de manière très autonome. Cette coopération militaire transatlantique semble être de plus en plus préjudiciable à la crédibilité de l’ONU et aux gouvernements européens, à leurs intérêts et à leur capacité de gérer des crises. Le général Jean Cot souligne que l’action militaire menée par l’OTAN avait donné au début l’illusion d’une coopération entre les Etats-Unis et leurs alliés européens mais ce sentiment changea suite à des déconvenues. Un rapport du ministre français de la Défense se plaignait du fait que les américains définissaient souvent des cibles de manière unilatérale sans en informer leurs alliés européens. Cet exemple est révélateur et illustre le problème qui est posé à l’Europe, notamment en matière de défense : elle semble être privée de toute initiative au profit d’un Etat tiers (les Etats-Unis) ou d’une coalition dirigée par ce même Etat et ses intérêts dans la résolution d’un conflit ne sont pas pris en compte alors qu’il s’agit de la stabilité, de l’avenir et de l’unité de notre continent européen.
L’émergence d’un véritable organisme de défense européenne ne peut qu’être freinée par cet état de fait. Les 23 et 24 avril 1999, le Conseil de l’Atlantique du Nord réaffirmait les buts de l’OTAN et les liens entre Etats-Unis et Europe dans la Déclaration de Washington. Ceci n’est pas fait pour aller dans le sens d’un véritable système européen de défense indépendant, donc apte à gérer les crises survenant en Europe sans que les intérêts d’une puissance tierce n’interfèrent. L’hostilité américaine au concept de défense européenne est assez marquée au point que Richard Holbrooke ne réduise les conflits européens et leur résolution qu’à la volonté des Etats-Unis : « Que nous le voulions ou non, nous sommes une puissance européenne. L’histoire de ce siècle nous démontre que lorsque nous nous désengageons, l’Europe verse dans une instabilité qui nous oblige à y retourner ».
Du point de vue de la politique extérieure (et d’actions militaires qui peuvent parfois y être liées) de l’Union Européenne, la présence d’une entité a là aussi des conséquences néfastes. Le dossier irakien en est le meilleur exemple et illustre la division de l’Europe qui n’a pas pu adopter de vraie position sur le sujet. Les trois pays baltes, la Pologne (le plus gros contributeur de ce groupe de pays membres de l’OTAN), la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ont envoyé des troupes en Irak. Comme l’analyse Jacques Rupnik dans Le Point du 16 janvier 2004 le lien entre la « nouvelle Europe » et les Etats-Unis a été permis par «… la peur d’un couple franco-allemand trop puissant. » Le concept d’Europe indépendante, jouant le rôle de contrepoids aux Etats-Unis et menée par le tandem franco-allemand n’intéresse pas l’Europe de l’Est bien au contraire. Les pays d’Europe de l’Est craignent que leurs voix et leurs intérêts soient mineurs dans un tel système (on peut repenser à la réaction peu diplomatique de Jacques Chirac concernant ces pays suite à leurs choix pro-américains).
L’identité de l’Europe est remise en cause tout comme sa stabilité dans un contexte international qui a changé. Depuis la Guerre Froide, les relations entre les Etats-Unis et l’Union Européenne ont muté au point que Jacques Rupnik affirme de manière révélatrice : « Pour la première fois depuis la guerre, l’administration américaine ne considère plus son soutien à l’intégration européenne comme une priorité. Au contraire, elle érige la division européenne en vertu de la relation transatlantique ».
Sur ce sujet on pourra notamment se référer aux ouvrages suivants :
* Bianchini, Stefano (1996). La question yougoslave. Firenze : Giunti/ Casterman.
* Brzezinski, Zbigniew (1997). Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde. Paris : Hachette/Pluriel.
* Laurent, Eric (1999). Guerre du Kosovo. Le dossier secret. Paris : Plon.
* Volkoff, Vladimir (1999). Désinformation- flagrant délit. Monaco : Editions du Rocher.
* Sous la direction de Chiclet, Christophe(1999). Kosovo- n°30 de Confluences Méditerranée. Paris : L’Harmattan.
* Sous la direction du Général Gallois, Pierre-Marie (2002). Guerres dans les Balkans. La nouvelle Europe germano-américaine. Paris : Ellipses.
* Gubert, Romain et Bran, Mirel (16 janvier 2004).Europe de l’Est, l’OPA américaine et entrevue avec Jacques Rupnik. Le Point n°1635.
Rodion Raskolnikov
00:40 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, etats-unis, otan, yougoslavie, serbie, kosovo, balkans, géopolitique, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 mars 2009
Kirguistan : epicentro de intereses geopoliticos en Asia central
Kirguistán: epicentro de intereses geopolíticos en Asia central
 La decisión de Kirguistán de cerrar la base militar de Manas para Estados Unidos y la OTAN en sus operaciones intervencionistas en Afganistán sitúa hoy a ese país en el centro de la geopolítica en Asia central.
La decisión de Kirguistán de cerrar la base militar de Manas para Estados Unidos y la OTAN en sus operaciones intervencionistas en Afganistán sitúa hoy a ese país en el centro de la geopolítica en Asia central.
El enclave aéreo que ocupa un aérea de 224 hectáreas en las afueras de Bishkek, dejará de ser en los próximos 180 días un puente para el trasiego de tropas del Pentágono y de la coalición occidental que apoya a Washington hacia suelo afgano, de cumplirse una resolución del gobierno kirguiz, aprobada por el parlamento.
La comunidad parlamentaria, con respaldo mayoritario del gobernante partido Ak Zhol del presidente Kurmanbek Bakíev, dio el visto bueno el 19 de febrero a un proyecto del Ejecutivo para anular el pacto bilateral con el gobierno estadounidense, rubricado en diciembre de 2001.
Con igual apoyo el legislativo adoptó el pasado viernes la propuesta oficial para dejar sin efecto legal los respectivos convenios con 11 países de la OTAN.
Tras firmar un pacto base con Estados Unidos, el gobierno kirguiz extendió por separado las prerrogativas para el emplazamiento de tropas de Australia, Dinamarca, España, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Francia y Turquía, cuyos gobiernos se sumaron al Pentágono en la cruzada contra Afganistán.
Para dejar claridad en la posición de Kirguistán, Bakíev declaró recientemente a la corporación británica BBC que la decisión de cerrar la base de Manas era irreversible, aunque dio pie a pensar en posibles negociaciones con Washington.
De hecho, varios funcionarios del gobierno estadounidenses mostraron confianza en que hallarán una solución con Bishkek.
Tanto es así que el vocero del Pentágono Geoff Morrell declaró que aún quedaba mucho tiempo para cerrar Manas o encontrar una base sustituta. Con formulaciones repetidas, Morrell también admitió que la Casa Blanca estudiaba otras variantes de rutas para el traslado de tropas y avituallamiento logístico.
Al parecer la administración norteamericana no quiere admitir públicamente el revés implícito en la pérdida de Manas para los intereses geopolíticos y militares del Pentágono en Asia central. La embajadora de la norteña nación en Tayikistán, Treisi Enn Jackobson, se apresuró a aclarar que no existen planes en la cúpula castrense de abrir otra base militar en la región.
No he oído una sola palabra de quienes trabajan en el Pentágono sobre las intensiones de crear en Asia central otro enclave alternativo, dijo al periódico tayiko Acontecimientos.
Sí se conoce que desde fines del pasado año la diplomacia norteamericana trabaja con intensidad para sellar acuerdos con Rusia, Uzbekistán, Tayikistán y Kazajstán para la transportación de cargamentos civiles hacia Afganistán, según la publicación digital uzbeka Fergana.ru.
El jefe del Estado Mayor ruso, Nikolai Makarov, aseveró en diciembre que el gobierno saliente de George W. Bush se estaba jugando las últimas cartas en Asia central con sus presiones sobre Tashkent y Astaná, para garantizar las rutas de suministro a las fuerzas de ocupación.
Según notificó el cotidiano ruso Kommersant a mediados de diciembre, las pláticas de misioneros estadounidenses en Asia central corroboran que existen tales planes. Dos meses después el parlamento kazajo aprobó un memorando que permite el acceso al aeropuerto de Almaty para el aterrizaje de emergencia de aviones del Pentágono.
El director del centro analítico sobre estudios de procesos en el espacio postsoviético de la Universidad Estatal Lomonosov, de Moscú, Alexei Vlasov, sostuvo durante una mesa redonda que la crisis económica actual ha puesto a los socios de Rusia en esa región al borde de la cesación de pagos (default).
Para Kirguistán, uno de los aliados claves de Moscú en Asia central, la situación es hoy bastante crítica y no se descartan presiones de todo tipo sobre Bishkek, afirma el politólogo ruso, en alusión a decisiones de carácter geopolítico.
Vlasov aludió que no son pocos los analistas que asocian la postura del gobierno kirguiz respecto a la clausura de Manas con el ofrecimiento de un crédito ruso de 300 millones de dólares y posibles inversiones en ese país calculadas en mil 700 millones de dólares.
Unido a ello, el presidente Bakíev firmó en febrero un convenio con Moscú sobre la concesión de 150 millones de dólares en calidad de donativos y un esquema concertado de reestructuración de la deuda con Rusia.
Con todo ello Kirguistán es pieza clave dentro del tablero geopolítico centro- asiático de Estados Unidos, cuya prioridad sigue siendo obtener el control de los recursos naturales, con el ojo en los hidrocarburos en el Mar Caspio, del antiguo camino de la seda.
Odalys Buscarón Ochoa
Extraído de Prensa Latina.
00:34 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asei, asie centrale, eurasisme, eurasie, affaires asiatiques, kirghizistan, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Anthologie mondiale de la stratégie
Présentation de l'éditeur
Comment Hannibal a-t-il procédé pour vaincre, à la bataille de Cannes, une armée romaine plus nombreuse que la sienne ? En quoi le feu nucléaire modifie-t-il toutes les données d'un art de la guerre dont l'usage a été constant au cours des millénaires ? Sur le plan géopolitique, l'opposition entre nomades et sédentaires n'est-elle pas un antagonisme historique plus durable que celui existant entre puissances maritimes et continentales? Autant de questions auxquelles répond cette anthologie. Premier recueil réunissant les écrits militaires de l'Antiquité gréco-latine, ceux des stratèges occidentaux modernes et contemporains, mais aussi les contributions théoriques des Chinois, des Indiens, des Byzantins et des musulmans (Arabes, Persans, Turcs), cette nouvelle édition d'un des classiques de la collection « Bouquins» est un instrument pour la recherche, un guide pour l'amateur, et une remise en perspective de l'art de la guerre.
Gérard CHALIAND, Anthologie mondiale de la stratégie : Des origines au nucléaire, R. Laffont, 2009.
Gérard CHALIAND, Anthologie mondiale de la stratégie : Des origines au nucléaire, R. Laffont, 2009.
00:24 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stratégie, géopolitique, armées, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 mars 2009
Turkey is not Europe

TURKEY IS NOT EUROPE
by Robert Edwards
Many mainstream politicians throughout Europe hold very serious reservations concerning the Turkish application to become a member state of the European Union and so it is vital that a serious debate is stimulated now without any fear or favour to partisan thinking.
Has the EU lost all sense of the true historical meaning of being European or has it become a willing tool of a bankers’ racket tied to the globalist monoculture? We believe that in order to be a true European, it is necessary to feel as such. That is to say, our identity must be one based on an ancestral kinship, with each of us aware of being an unbroken link in the eternal chain of European history. This aspect of Europeanism is not being promoted by the bureaucrats and time-servers of the EU ... and this is where we differ profoundly and fundamentally. So all the old claptrap concerning “racism” and all sorts of imagined phobias are trotted out to prevent opposition to this proposed anomaly within the EU, that Turkey should somehow become part of Europe.
Before anyone thinks I am going to go on about a “clash of civilisations” or the “evils of Islam”, this question of the meaning of being European is not so much about what we are against or what threatens us, as is the way of some nationalistic people, but it is more a question of what we embrace, love and hold dear. Let us make that clear from the very beginning. Our political creed is a purely positive Europeanism that regards all other cultures and religious systems as equally valid in their own right. There is no place for supremacism in our political outlook.
We regard the Islamic world as the natural ally to our Europe a Nation ... more so than the United States could ever be, which has been rampaging around the world trying to recruit all and sundry into its apocalyptic mission to “democratise” the world in the interests of the prices at the petrol pumps at home.
If anything, it is the resistance to the global American culture that will assist to define a European of the future and if there is a clash of cultures it is between our Europe and the distinctly alien values of American super-capitalism with its total disregard for human values where money is concerned. As result, we are in danger of going down that same road as Europe adopts the principle that everything has its price and where nothing has any real value. As true National Europeans we stand opposed to these alien values.
To the East, stands a world of very many other values and we do not oppose them simply because they are of another world other than that of Europe. They have existed throughout the entire history of Europe, from those earliest stirrings of classic Greece to the present day.
When Islam emerged, it spread across the north of Africa and into Spain ... at the same time reaching India and China. Its impact on Spain was far from malevolent and the rest of Europe would have been the poorer if it had not benefited from the mass of science, mathematics, medicine, philosophy and much more that the Arab Empire bestowed on Europe in the Dark Ages and long after. That has to be said in order to maintain a sense of proportion. Much of classic Greek learning would have been lost without the intervention of Islam.
The world of Islam has been in a state of flux and turmoil for many centuries, always very close and near to Europe, so that each eruption and upheaval has never failed to leave its impact upon us. This relationship with Europe goes back to the time of the creation of Andalusia in Spain lasting centuries with the eternal vigilance of a Europe fearful of the further encroachment of Islam upon our continent. The Christian church had its interests to preserve, of course, and its contribution to science was occasionally one of obstruction and proscription ... Galileo springing to mind.
Turkey is one of the nearest nations to Europe with an overwhelmingly Muslim population and was one of the largest expressions of modern Islamic imperialism in the form of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire was never regarded as European even though Hungary and Serbia were once vassal states ... European states that were eventually liberated.
In the 1930s, Kemal Ataturk attempted a Westernisation of Turkey, dragging her into the Twentieth Century, adopting the Roman script, banning the fez, adopting Western standards of dress for both men and women and constructing the secular state.
Yet, with all that, it remains Asiatic and essentially so. It never pretended to be European ... until the European Union of the bankers and the globalists suggested that Europe was nothing more than a money market and an economic orbital planet around the sphere of global capitalism.
To these capitalists, there is no Europe as an identifiable cultural entity with a people inextricably linked to history through ancestry and blood. To them, it is a trade name for a bankers’ racket that neither desires nor will permit such a thing as a national consciousness and therefore an awareness of what these parasites are doing.
Turkey is slowly being invited into our continent at the expense of our very identity and by that very act it is denying that Europe, as we know and love it, ever existed.
On the more mundane level, it leaves open the question of why Israel or even Canada should be participants in the Eurovision Song Contest ... and why no one has the guts to challenge these plainly absurd anomalies.
At least there are some voices of protest within mainstream European politics but, I fear, not enough. That is the reason the process of Turkish entry has been slowed down rather than being terminated altogether, as it should have been.
Just as Europe a Nation should be created as a federation of existing nation-states within Europe, with Britain playing a leading role, then so should Turkey be a leading player in a Central Asian federation of existing nation-states within that region. That would very easily solve the problem of the proposed current anomaly. Such federations would be allied to Europe but not submerged into it.
We in European Action have always maintained the principle that national consciousness is the first consideration in politics and that this national consciousness entails placing the greatest value on our own people regardless of class, party allegiance or religious faith.
All we ask is that the people of Europe recognise this sense of communion and embrace it in the fullest meaning of European brotherhood. Because it is only solidarity in action that can guarantee our survival, acting together in common interest.
This does not mean antagonism towards people outside Europe, as with a siege mentality ever suspicious of the movements of others. Once America is forced back within its own borders then the rest of the world can be organised on the similar lines to Europe a Nation ... large, self-sufficient economies composed of similar peoples, totally free of the caprice of free-for-all international trading and able to organise the creation and growth of wealth within its own economic sphere without outside interference. These large federations would replace the United Nations and make the World Bank and the International Monetary Fund totally redundant. The “global economy” would be a thing of the past.
Therefore, our opposition to Turkish entry into Europe is not one based on aggressive antagonism towards a different culture or even a religion. It is simply a matter of defining Europe and placing all these questions into their proper context.
Turkey does not belong here ... it belongs elsewhere. That is the essence of what it means to be European and what it means to be Turkish. Our place in the world must be determined by that very sense of kinship that connects us to history, culture and the sacred soil of our ancestors, made red with the blood of its defenders and made fertile by the creative energy of the European.
Europe is not at war with Islam. It is America that embarked on this insane “crusade” for its own selfish interests and by so doing embroiled Britain and other countries in a “war against terrorism” that positively reeks of Zionist manipulation.
It follows that Europe should be a power unto itself with all the conditions that go with a major force in the world, Such a power bloc shall determine its own foreign policy and world agenda, totally independent of the Neo-cons in Washington and the predatory manoeuvring of the World Bank, whose president was once a principal player in White House war games.
When Europe stretches out the hand of friendship to the Islamic world, it will be a gesture of mutual respect and understanding ... knowing that we have different roots to preserve and nurture but, also, to accept a responsibility to world peace.
Many mainstream politicians throughout Europe hold very serious reservations concerning the Turkish application to become a member state of the European Union and so it is vital that a serious debate is stimulated now without any fear or favour to partisan thinking.
Has the EU lost all sense of the true historical meaning of being European or has it become a willing tool of a bankers’ racket tied to the globalist monoculture? We believe that in order to be a true European, it is necessary to feel as such. That is to say, our identity must be one based on an ancestral kinship, with each of us aware of being an unbroken link in the eternal chain of European history. This aspect of Europeanism is not being promoted by the bureaucrats and time-servers of the EU ... and this is where we differ profoundly and fundamentally. So all the old claptrap concerning “racism” and all sorts of imagined phobias are trotted out to prevent opposition to this proposed anomaly within the EU, that Turkey should somehow become part of Europe.
Before anyone thinks I am going to go on about a “clash of civilisations” or the “evils of Islam”, this question of the meaning of being European is not so much about what we are against or what threatens us, as is the way of some nationalistic people, but it is more a question of what we embrace, love and hold dear. Let us make that clear from the very beginning. Our political creed is a purely positive Europeanism that regards all other cultures and religious systems as equally valid in their own right. There is no place for supremacism in our political outlook.
We regard the Islamic world as the natural ally to our Europe a Nation ... more so than the United States could ever be, which has been rampaging around the world trying to recruit all and sundry into its apocalyptic mission to “democratise” the world in the interests of the prices at the petrol pumps at home.
If anything, it is the resistance to the global American culture that will assist to define a European of the future and if there is a clash of cultures it is between our Europe and the distinctly alien values of American super-capitalism with its total disregard for human values where money is concerned. As result, we are in danger of going down that same road as Europe adopts the principle that everything has its price and where nothing has any real value. As true National Europeans we stand opposed to these alien values.
To the East, stands a world of very many other values and we do not oppose them simply because they are of another world other than that of Europe. They have existed throughout the entire history of Europe, from those earliest stirrings of classic Greece to the present day.
When Islam emerged, it spread across the north of Africa and into Spain ... at the same time reaching India and China. Its impact on Spain was far from malevolent and the rest of Europe would have been the poorer if it had not benefited from the mass of science, mathematics, medicine, philosophy and much more that the Arab Empire bestowed on Europe in the Dark Ages and long after. That has to be said in order to maintain a sense of proportion. Much of classic Greek learning would have been lost without the intervention of Islam.
The world of Islam has been in a state of flux and turmoil for many centuries, always very close and near to Europe, so that each eruption and upheaval has never failed to leave its impact upon us. This relationship with Europe goes back to the time of the creation of Andalusia in Spain lasting centuries with the eternal vigilance of a Europe fearful of the further encroachment of Islam upon our continent. The Christian church had its interests to preserve, of course, and its contribution to science was occasionally one of obstruction and proscription ... Galileo springing to mind.
Turkey is one of the nearest nations to Europe with an overwhelmingly Muslim population and was one of the largest expressions of modern Islamic imperialism in the form of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire was never regarded as European even though Hungary and Serbia were once vassal states ... European states that were eventually liberated.
In the 1930s, Kemal Ataturk attempted a Westernisation of Turkey, dragging her into the Twentieth Century, adopting the Roman script, banning the fez, adopting Western standards of dress for both men and women and constructing the secular state.
Yet, with all that, it remains Asiatic and essentially so. It never pretended to be European ... until the European Union of the bankers and the globalists suggested that Europe was nothing more than a money market and an economic orbital planet around the sphere of global capitalism.
To these capitalists, there is no Europe as an identifiable cultural entity with a people inextricably linked to history through ancestry and blood. To them, it is a trade name for a bankers’ racket that neither desires nor will permit such a thing as a national consciousness and therefore an awareness of what these parasites are doing.
Turkey is slowly being invited into our continent at the expense of our very identity and by that very act it is denying that Europe, as we know and love it, ever existed.
On the more mundane level, it leaves open the question of why Israel or even Canada should be participants in the Eurovision Song Contest ... and why no one has the guts to challenge these plainly absurd anomalies.
At least there are some voices of protest within mainstream European politics but, I fear, not enough. That is the reason the process of Turkish entry has been slowed down rather than being terminated altogether, as it should have been.
Just as Europe a Nation should be created as a federation of existing nation-states within Europe, with Britain playing a leading role, then so should Turkey be a leading player in a Central Asian federation of existing nation-states within that region. That would very easily solve the problem of the proposed current anomaly. Such federations would be allied to Europe but not submerged into it.
We in European Action have always maintained the principle that national consciousness is the first consideration in politics and that this national consciousness entails placing the greatest value on our own people regardless of class, party allegiance or religious faith.
All we ask is that the people of Europe recognise this sense of communion and embrace it in the fullest meaning of European brotherhood. Because it is only solidarity in action that can guarantee our survival, acting together in common interest.
This does not mean antagonism towards people outside Europe, as with a siege mentality ever suspicious of the movements of others. Once America is forced back within its own borders then the rest of the world can be organised on the similar lines to Europe a Nation ... large, self-sufficient economies composed of similar peoples, totally free of the caprice of free-for-all international trading and able to organise the creation and growth of wealth within its own economic sphere without outside interference. These large federations would replace the United Nations and make the World Bank and the International Monetary Fund totally redundant. The “global economy” would be a thing of the past.
Therefore, our opposition to Turkish entry into Europe is not one based on aggressive antagonism towards a different culture or even a religion. It is simply a matter of defining Europe and placing all these questions into their proper context.
Turkey does not belong here ... it belongs elsewhere. That is the essence of what it means to be European and what it means to be Turkish. Our place in the world must be determined by that very sense of kinship that connects us to history, culture and the sacred soil of our ancestors, made red with the blood of its defenders and made fertile by the creative energy of the European.
Europe is not at war with Islam. It is America that embarked on this insane “crusade” for its own selfish interests and by so doing embroiled Britain and other countries in a “war against terrorism” that positively reeks of Zionist manipulation.
It follows that Europe should be a power unto itself with all the conditions that go with a major force in the world, Such a power bloc shall determine its own foreign policy and world agenda, totally independent of the Neo-cons in Washington and the predatory manoeuvring of the World Bank, whose president was once a principal player in White House war games.
When Europe stretches out the hand of friendship to the Islamic world, it will be a gesture of mutual respect and understanding ... knowing that we have different roots to preserve and nurture but, also, to accept a responsibility to world peace.
00:20 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, europe, affaires européennes, géopolitique, histoire, proche orient, asie mineure, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 mars 2009
Un nouvel écrit libre dirigé par A. Chauprade
Un nouvel écrit libre dirigé par Aymeric Chauprade

00:25 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, iran, moyen-orient, conflits, guerres, stratégie, asie, affaires asiatiques, eurasie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 mars 2009
When American Imperialism chased Spain out of Cuba
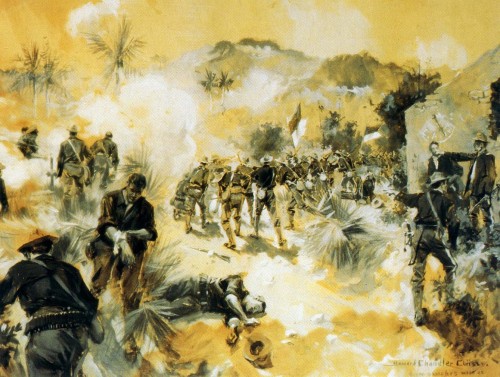
When American Imperialism chased Spain out of Cuba
by Philippe Conrad
A century ago, in 1898, the Cuban war broke out against Spain. It was an American war that was «altruistic and moral». Through this war, which called on the resources of misinformation and brainwashing, the United States began its career as a world power.
«All is quiet here; there are no problems and there’ll be no war, I want to come back»…«Stay where you are please and send us pictures, I am responsible for preparing the war…» This exchange of telegrams between Frederic Remington, the reporter-artist of the New York Journal, and his boss, William Randolph Hearst, on the eve of the Spanish-American conflict of 1898, just about sums up the situation at the moment. It shows the part that the manipulation of American public opinion played in unleashing this war. We shall have to wait until the First World War before governments, those of the Anglo-Saxon countries in the first place, have recourse on a such a grand scale to these propaganda tricks. But the stakes were considerable, for it was a question of chasing Europe – or more precisely a Spain that was only a shadow of its former self – from the American hemisphere in order to perfect the hegemony of the United States over the New World as a whole.
The right to possession of the world
America’s designs on Cuba and on the Caribbean sea simply and quite naturally completed the geopolitical grand design which was to make the new state into a continental power, opening onto the two oceans and able to impose its domination over the whole western hemisphere. These designs were clear even in the 1820s when John Quincy Adams considered that Cuba was the key to the Caribbean and that its proximity to Florida and the mouth of the Mississippi would one day make it necessary, «through the simple law of political gravitation», for America to seize it. What held Washington back at that time was fear of English reaction, for London might worry about the fate in store for Jamaica. For American officials, it was better to be patient and leave Cuba in the hands of an enfeebled Spain rather than engage in an action likely to justify British opposition. It was enough to wait for the right moment or for circumstances to appear most favourable for the realisation of what John Fiske called, in 1885, the «manifest destiny» of the United States.
In those last years of the century, projects for driving a canal through the Central American isthmus at Nicaragua or Panama gave new life to the already old desires of the Washington government. Several theorists at that time justified America’s ambitions, and in their wake their formed in Congress a whole «imperialist» clan demanding a foreign policy in keeping with the industrial dynamism which was making of the USA a world economic power. In 1885, Pastor Joshua Strong wrote Our country in which he exalted «the superiority of the Anglo-Saxon race». Five years later, John W Burgess, professor of political sciences at the University of Columbia, insisted on the rights possessed by the Anglo-Saxons to world dominion: «Their mission is to lead political civilisation in the modern world and to bring this civilisation to the barbarous races […] since it is in the interest of world civilisation that law, order and true liberty, which is its corollary, should reign throughout the world…» That same year, Admiral T Mahan published his book The influence of Sea Power upon History, which foretells an impressive rise in the strength of America’s naval power. The United States must take control of the Caribbean Sea and of the future canal that will join the Atlantic to the Pacific. They must also push their expansion into the Pacific, notably into the Hawaiian archipelago. Under the presidency of the republican Benjamin Harrison (1889-1893), the secretary of State James Blaine was preparing the way for these various projects, but the election of the democrat Stephen G Cleveland seems to have put a stop to them, at least temporarily. However, his republican opponents were not put off, and Henry Cabot Lodge, the naval commission’s spokesman at the House of representatives, made a speech in 1895, wherein he claimed Cuba and the Hawaiian islands for the United States. There thus came into being a thoroughgoing «imperialist» movement inspired by that «jingoism» which, at the same period, lay behind the politics of a Joseph Chamberlain in England.
At the heart of this movement, the young Theodore Roosevelt was already there, writing to Cabot Lodge, his mentor in politics, that «the country needs a war». The elections in 1897, which bring the republican William Mac Kinley to power, enable the young Roosevelt to become Under-Secretary of State for the Navy, in 1897. Two months later, he explained to the officer cadets at the Naval College «that the diplomat must be the servant and not the master of the soldier». In November of the same year, he wrote to a naval officer to say that he hoped for a war against Spain «to aid the Cubans in a humanitarian concern». But above all «to guarantee complete liberty for America from European domination… This war will be a great lesson, and we shall profit greatly from it». In December 1897, when commercial circles and the economic press were showing their opposition to a war for Cuba, the hot-headed under-secretary of State affirmed that «we shall have this war for the liberty of Cuba despite the timidity of commercial interests…»
Press campaigns and sending of weapons
The United States had already offered on several occasions since 1843 to buy from Spain the main island of the Caribbean, but each time the government of Madrid had amiably turned down these offers. In 1850, therefore, the American administration encouraged the installation in New York of a Cuban council favourable to the island’s independence, and from 1865 Washington supported these rebels by supplying them with arms and money. Between 1868 and 1878, the first war of independence came to nothing. The United States’ interest in the island did not wane, however, for it was they who bought nearly all the sugar exported from the island, and American capital investments in this market amounted to fifty million dollars of the island’s economy. Founded in 1892, José Martí’s Cuban revolutionary party was supported financially by Edwin F Atkins, the American sugar «king».
When a fresh insurrection broke out on the island in February 1895, the democrat president Cleveland and his Secretary of State Bryan had no wish to intervene directly. The death of Martí, killed in the fighting in May, did not put an end to the rebellion. The North American press then undertook to set public opinion against Spain. It sounded off against the death of several Cuban revolutionaries, denounced the fact that American citizens were in jail on the island, and exalted the courage of Evangelina Cisneros, the daughter of a rebel leader, whom W R Hearst had removed from Cuba so that she might be given a triumphant welcome in New York… It finally published a false letter from Dupuy de Lôme, the Spanish ambassador to Washington, in which Mac Kinley was presented as a «low level politician». During that time, from June 1895 to May 1897, forty-two naval convoys brought arms to the insurgents from the American coasts.
On the island itself, however, Spain’s new representative, General Blanco, succeeded in forming a government by uniting the reformists and autonomists, but excluding those in favour of independence who were supported by the USA. It was a few days later, following the riots in Havana, that the battleship Maine entered the port, on a «courtesy» visit.
It is now known very precisely that the decision to go to war against Spain, if she persisted in her refusal to sell Cuba, was taken in 1896. A recent military history congress, held in March 1998, has revealed the detail of the plans prepared for this eventuality. The scenario was then written down. On 25 January 1898, the battleship Maine, therefore, entered the port of Havana, followed fifteen days later by the cruiser Montgomery which had just laid anchor in the port of Matanzas. Three weeks later, on 15 February, the accidental explosion of a submarine mine sank the Maine in the port of Havana. Two hundred and sixty American sailors were killed in the explosion, which everyone now recognises as having been purely accidental, and some even think it was plainly provoked by the Americans (it is interesting to note that no officer was among the victims; they were all at a reception in the town). The official American report is no less accusatory of Spain. Madrid proposed entrusting the enquiry to a mixed commission, but Washington refused. The Spanish government then turned towards its European counterparts and solicited the arbitration of Pope Leo XIII, but obtained nothing, even though it accepted the immediate armistice imposed by Mac Kinley on 10 April. The American senate will soon vote for the necessary funding for «an altruistic and moral war which will bring about the liberation of Cuba», and war was declared on 24 April. A «splendid little war» for the Secretary of State John Hay, a war which rekindled that led by Spain against the Cuban rebels, a conflict which, according to General Blanco «would have come to an end, had it not been for American malevolence».
It was in the Philippines that the Americans struck their first blows since Admiral Dewey destroyed Admiral Montojo’s fleet in the harbour of Manila, outside Cavite. The conquest of Porto Rico was a military walkover and, at Cuba, Admiral Cervera’s fleet was totally outstripped on the technical level by the American ships, and destroyed on 3 July outside Santiago. Fifteen thousand Americans landed at the end of the month of June, but still Colonel Theodore Roosevelt’s Rough Riders had to put up a furious fight against the troops of Generals Linares and Vara del Rey, on 16 July, and overcame the defences of the hill of San Juan. In coming to take part in the battle himself, Roosevelt put his deeds in line with his words. On 17 July, Santiago de Cuba capitulated. On 12 August, through French mediation, an armistice was concluded prior to peace negotiations which ended in the Treaty of Paris, signed on the following 10 December.
Spain was made to abandon all sovereignty over Cuba, she also lost Puerto Rico and had to yield the Philippines and Guam to the USA for twenty million dollars. A little later, she also had to cede to the conqueror – who had seized the Hawaiian Islands during the month of August – those of the Mariannas, the Carolinas and the Palaos. It was a peace that seemed like a second death of the Spanish Empire and which opened the way to a spectacular rise in the power of the United States. Theodore Roosevelt will be able to wave his big stick in the Caribbean. Cuba, San Domingo, Nicaragua and the Panama, separated from Columbia in 1903, will become American quasi-protectorates. Once annexed, the Philippines will become the theatre of a revolt, which will last four years at a cost of five thousand dead to the new occupants. Cuba will endure a four-year military occupation, and it is only after accepting a treaty placing her in a state of total subjection to Washington that the island will be able to have its «sovereignty» recognised. The «corollary» is Roosevelt with his Monroe doctrine henceforth reserving the right of the United States to intervene in the affairs of neighbouring countries if deemed necessary for the re-establishment of order. Senator Beaveridge, from Indiana, can now consider that «God has not prepared the peoples of English and Teutonic tongue over a thousand years simply for them to admire themselves vainly and passively. No, he made us to be the organising masters of the world in order to establish order where chaos reigns. He has given us the spirit of progress in order to conquer the forces of reaction throughout the whole world. He has placed within us the gift of governing so that we may give government to savage and senile peoples. Without such a force, the world would relapse into barbarity and the night. And of all our race, he has designated the American people as his chosen nation to begin the regeneration of the world.»
To justify intervention, all means are good!
Arnaud Imatz
Certain papers of the New York press played a decisive role in preparing public opinion to accept American intervention in Cuba. The main papers here were the New York Journal, bought by William Randolph Hearst in 1895 and the World, owned by Joseph Pulitzer, to which we should add the Sun and the Herald. This press cultivated sensationalism to the point of practising a veritable disinformation campaign as a way of «advancing the event». […]
For this popular press, avid for spectacular events likely to appeal to the imagination of the masses, Cuba will provide particularly rich material. A most rudimentary kind of manichaeism thus presents the Spaniards as uncouth and sadistic brutes, representatives of a backward country, subjects of an anachronistic and corrupt monarchy. They were attributed with every kind of crime and atrocity, which happily completed the «black legend» developed by Anglo-Saxon historiography regarding the conquest of America by the subjects of Charles V and of Philippe II. It was a very useful way for the Anglo-Saxon colonisers of North America to have their own treatment of the Indians forgotten. Terror, violence and famine were the rule in Cuba for a press all too content to reproduce the communiqués from the Junta Cubana, the council of exiles installed in New York. The «testimonies» of victims filled up entirely fabricated dossiers, containing detailed accounts of Spanish depravity. […]
The reassembling and regrouping of whole populations into camps led to a heavy mortality rate among the prisoners, as a result of epidemics, which also struck the Spanish soldiers. But Hearst and his journalists did not skimp over the figures. Six hundred thousand dead, not one less, more or less one third of the island’s population, in other words a veritable genocide before the word was coined. In fact, the most serious studies undertaken by American research workers in the course of the following decades have revealed that human losses for the period 1895-1898, including the Spanish victims, did not exceed the number one hundred thousand. The lie was exposed with the publication in 1932 of a work initiated by the Baton Rouge University in Louisiana, called Public Opinion and the Spanish-American War. A study in war propaganda. None of which was of much importance forty or so years later. By blowing American popular opinion white hot, by exploiting the false letter from Ambassador Dupuy de Lôme, by giving credit to the myth of an attack responsible for the explosion of the Maine, Hearst and Pulitzer had played their part and made it possible to justify America’s control over Cuba.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, etats-unis, cuba, espagne, amérique latine, amérique du sud, amérique, impérialisme, génocide, crimes de guerre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 mars 2009
Qui a peur de la géopolitique?

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1994
Qui a peur de la géopolitique?
Un spectre hante l'Europe d'aujourd'hui. Des conseillers politiques de la Maison Blanche, d'anciens agents du KGB cherchant à se recycler, des publicistes libéraux défendant de troubles et occultes intérêts réactionnaires, des professeurs gauchistes amateurs de liaisons dangereuses avec les droites, tentent désespérément d'en trouver la trace. Ce spectre, c'est la géopolitique.
Eh oui, elle revient au grand galop, cette géopolitique condamnée à une damnatio memoriae depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dont on a nié la validité sans lui permettre de se défendre et d'apporter les preuves de sa pertinence, que l'on a réduite au silence pendant toute la guerre froide qui avait imposé au monde une lecture strictement idéologique et socio-économique des conflits. Pour satisfaire au rituel du langage dominant, il fallait dire qu'elle était une “pseudo-science”, fondée par deux pères historiques: l'embarrassant Friedrich Ratzel, auteur, entre 1882 et 1991, d'une Anthropogeographie évolutionniste et déterministe (que l'on a longtemps considérée comme l'antécédent wilhelmien du racisme hitlérien) (1), et le général, diplomate et érudit Karl Haushofer, qui avait caché Rudolf Hess dans sa maison après le putsch raté de Munich en 1923 et dont le fils, poète ésotérique, fidèle, comme son père, à l'idée d'une alliance nord-européenne entre l'Allemagne et l'Angleterre, sera massacré par la police nazie le 23 avril 1945 à l'âge de 42 ans.
Les noms de Ratzel et de Haushofer ont servi à démoniser la géopolitique, considérée pendant trop longtemps comme une “fausse science”, dont le but aurait été de chercher le rapport existant entre les circonstances géographiques d'un pays et les choix politiques du peuple qui l'habite. Mais force est bien de noter que les géopolitiques de Ratzel et de Haushofer, en réalité, ont constitué une géographie politique fonctionnelle, à l'ère des grands impérialismes et des entreprises coloniales, entre 1870 et 1914, quand ont eu lieu les affrontements entre la France et l'Allemagne, entre l'Autriche et la Russie, entre la Russie et la Turquie.
En cela, plutôt que d'être une rupture par rapport au passé, les grands impérialismes ont montré qu'ils étaient les héritiers directs des conflits du 19ième et de l'idéologie évolutionniste: «La géographie est une donnée immuable qui conditionne la vie des peuples» aimait à dire le condottiere Mussolini, oubliant ainsi l'autre aspect du problème: les peuples manipulent et modifient très souvent les scenarii géographiques.
Même si sont encore bien ancrés tous les “a priori” idéologiques mis en place pour interpréter les conflits selon un schéma “scientifique”, mettre au rencart les “vieilleries” ethniques et religieuses, légitimer l'unique mode explicatif toléré, c'est-à-dire celui qui évoque la raison socio-économique, depuis la fin de la guerre froide, bon nombre de signes avant-coureurs nous annonçaient le retour de conflits qui ne pouvaient s'expliquer que par d'autres motivations que celles que retenait comme seules plausibles le conformisme idéologique. Mieux: rien n'est revenu et un fait est certain, les tensions et les conflits à caractère ethnique et religieux ont toujours existé, rien n'est venu les atténuer, au contraire, les retombées tumultueuses du colonialisme et de l'hégémonisme européens les ont exaspérés. Il suffit de penser au Kurdistan qui, par l'effet de la politique de containment forcenée qu'ont pratiquée les Anglais et les Français au Moyen-Orient entre 1917 et 1920, est devenu un facteur de déstabilisation. Ou à la “guerre oubliée” entre l'Irak et l'Iran, et à ses rapports complexes avec la guerre civile en Afghanistan, ou encore, au front composite de la résistance afghane en lutte contre l'Armée Rouge.
Les temps sont mûrs, pourtant, pour dresser l'ébauche d'une nouvelle géopolitique, comprise non plus comme une “science” ou une “pseudo-science” mais plutôt comme une méthode proprement interdisciplinaire —dans laquelle convergeraient la géographie, l'histoire, la politologie, l'anthropologie, etc.— visant à comprendre et à expliquer rationnellement les tensions à l'œuvre sur certains territoires. Cette méthode se distancierait bien entendu de toutes les formes de moralisme, sans pour autant observer une “neutralité axiologique” rigide et incapacitante: cette méthode existe, elle a déjà été hissée au niveau scientifique, elle a été forgée au milieu des années 70 par les animateurs de la revue parisienne Hérodote et par le groupe de chercheurs rassemblés autour du géographe Yves Lacoste. En Italie, un groupe d'intellectuels de gauche vient de fonder la revue Limes (titre schmittien!) et s'aligne sur Hérodote; à ce corpus géopolitique de base, qui, sous bien des aspects, constitue une “anthropopolitique” (ou une “géoanthropologie”?), le célèbre philosophe Massimo Cacciari propose d'ajouter une fascinante “géophilosophie de l'Europe”, dont il a jeté les fondements en publiant un livre chez l'éditeur Adelphi. L'Europe, à ses yeux, est une idée —et un continent— “malade” au sens nietzschéen, instable, incertain sur ses confins, qui ne peut progresser qu'à coup de “décisions” fatidiques, un continent sur lequel pèse le poids d'innombrables impondérables et d'hérédités mêlées, entrecroisées.
Les assises et la structure du monde pèsent évidemment sur le destin des hommes. Mais les hommes, à leur tour, posent des choix et imposent des géostratégies. Quand, en 1867, le gouvernement américain achète au gouvernement russe les terres de l'Alaska, le Secrétaire d'Etat William Seward déclare: «L'Océan Pacifique deviendra le grand théâtre des événements du monde... le commerce européen, la pensée européenne, la puissance des nations européennes sont destinés à perdre leur importance». C'est ainsi que les Etats-Unis ont lancé l'idée d'un “Occident”, non plus synonyme mais bien antonyme de l'idée d'“Europe”. Or, sur ce chapitre, un pas nouveau vient d'être franchi avec le sommet des pays du Pacifique tenu en novembre 1993 à Blake Island près de Seattle: on y a esquissé les grandes lignes d'une nouvelle stratégie américaine, visant à faire du Japon un “Extrême-Occident” et à recentrer sur le Pacifique une intense activité dirigée vers la Chine, le Japon et l'Australie, impliquant l'exploitation intensive des mers, des fonds marins, du sous-sol de l'Océan, afin d'acquérir des protéines (à partir du planton) ou d'exploiter de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz naturels.
Reste à savoir comment réagira le bloc “eurasiafricain” face à cette hégémonie nouvelle, à ce continent immense et richissisme qui va de l'Alaska à l'Australie et de la Chine à la Californie, qu'a parfaitement conceptualisé le bon génie du MIT (Massachussets Inbstitute of Technology), Noam Chomsky, qui prévoit un isolement définitif de l'Eurasie par rapport au “Centre de l'Empire” américain? Allons-nous vers un nouveau brigandage déterministe et planétaire, vers une nouvelle entreprise impérialiste qui, comme toutes les entreprises impérialistes, ne rougit pas en se définissant comme “nécessaire”?
Franco CARDINI.
(article extrait de L'Italia Settimanale, n°34/1994).
(1) Pour nuancer ce jugement et découvrir la grande variété de l'œuvre de Ratzel, cf. Robert Steuckers, «Friedrich Ratzel», in Encyclopédie des Œuvres philosophiques, PUF, Paris, 1992.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, histoire, géopolitique, politique internationale, politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 mars 2009
"Continente Indiano" - Entre Nomos y Anomos
| |
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, amérique latine, amérique du sud, amérique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 mars 2009
La mort du leadership américain
Un pays discrédité et en faillite/La mort du leadership américain
Une fois encore, Paul Craig Roberts présente une analyse pessimiste sur l’avenir américain. Il ne voit pas comment les Etats-Unis retrouveraient leur leadership et il ne peut s’empêcher d’observer l’ancien rival pour se demander si le monde n’assiste pas à l’avènement d’une nouvelle ère « Poutine ». Polémia
Un nombre incroyable de personnes, aux Etats-Unis et à l’étranger, espère que le Président Obama mettra fin aux guerres illégales de l’Amérique, qu’il mettra un terme au soutien de l’Amérique aux massacres de Libanais et de Palestiniens commis par Israël et qu’il punira, au lieu de les récompenser, les banquiers gangsters (ou les « banksters escrocs »), dont les instruments financiers frauduleux ont détruit l’économie et imposé une souffrance massive à tous les gens dans le monde. Si les nominations d’Obama sont une indication, tous ces gens qui espèrent vont être déçus. (…)
Ce qui est décourageant est le fait que, même confronté à une crise économique et à une crise de politique étrangère, le système politique américain est incapable de produire le moindre leadership. Nous nous trouvons dans la pire crise économique de toute une vie, peut-être de notre histoire, et à la veille d’une guerre au Pakistan et en Iran, alors que la guerre en Afghanistan s’escalade. Et tout ce que nous obtenons est un gouvernement constitué de ces mêmes personnes qui nous ont amenés ces crises.
L’ère du leadership américain est révolue. Le système financier d’escrocs de l’Amérique a plongé le monde entier dans la crise économique. Les guerres d’agression de l’Amérique sont vues comme servant d’autres buts, comme l’enrichissement des industries militaires associées à Dick Cheney. Le monde est à la recherche d’un autre leadership.
Vladimir Poutine a bien joué à Davos pour endosser ce rôle. Son discours, lors de la cérémonie d’ouverture, était le plus intelligent de tout l’évènement. Poutine a rappelé au Forum Economique Mondial que les délégués américains qui s’exprimaient depuis cette tribune, il y a tout juste un an, avaient insisté sur la stabilité fondamentale de l’économie américaine et ses perspectives limpides. Aujourd’hui, les banques d’investissement, la fierté de Wall Street, ont virtuellement cessé d’exister. En 12 mois exactement, elles ont publié des pertes excédant les profits qu’elles ont réalisés au cours des 25 dernières années
Poutine a défendu l’idée selon laquelle le système financier existant, basé sur le dollar et l’hégémonie financière américaine, avait échoué.
Poutine a démontré que sa compréhension de l’économie était supérieure à celle de l’équipe d’Obama, lorsqu’il a déclaré que créer plus de dettes venant s’ajouter à des « dettes inextricables », comme le fait Obama, « prolongerait la crise ».
Dans une autre pique visant le leadership économique raté de l’Amérique, Poutine a déclaré qu’il est temps de se débarrasser de l’argent virtuel, des faux rapports financiers et des notations de crédit douteuses. Poutine a proposé un nouveau système de devise de réserve pour « remplacer le concept mondial unipolaire obsolète. » Poutine a dit qu’un monde en sécurité nécessitait la coopération, qui elle-même nécessite la confiance. Il a bien fait comprendre que les Américains avaient prouvé qu’on ne peut pas leur faire confiance.
Ce fut un message puissant qui a été beaucoup applaudi..
Par Paul Craig Roberts
CounterPunch, 3 février 2009
article original : "The Death of American Leadership"
Traduction : [JFG-QuestionsCritiques]
http://questionscritiques.free.fr/
Correspondance Polémia
12/02/09
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, politique, politique internationale, etats-unis, géopolitique, sociologie, obama, atlantisme, occidentalisme, otan |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 février 2009
Le monde comme système

Archives de Synergies européennes - 1990
Le Monde comme Système
«Mondes nouveaux» (Géographie universelle dirigée par Roger Brunet, T. I)
Livre II Le système Monde
Olivier Dollfuss
Hachette/Reclus, 1990.
Si le substantif de géopolitique n'est pas la simple contraction de géographie politique, cette méthode d'approche des phénomènes politiques s'enracine dans la géographie; elle ne peut donc se désintéresser de l'évolution. Réputée inutile et bonasse (1), la géographie est un savoir fondamentalement politique et un outil stratégique. Confrontée à la recomposition politique du monde, elle ne peut plus se limiter à la description et la mise en carte des lieux et se définit comme science des types d'organisation de l'espace terrestre. Le premier tome de la nouvelle géographie universelle, dirigée par R. Brunet, a l'ambition d'être une représentation de l'état du Monde et de l'état d'une science. La partie de l'ouvrage dirigée par O. Dollfuss y étudie le Monde comme étant un système, parcouru de flux et structuré par quelques grands pôles de puissance.
O. Dollfuss, universitaire (il participe à la formation doctorale de géopolitique de Paris 8) et collaborateur de la revue «Hérodote», prend le Monde comme objet propre d'analyses géographiques; le Monde conçu comme totalité ou système. Qu'est-ce qu'un système? «Un système est un ensemble d'éléments interdépendants, c'est-à-dire liés entre eux par des relations telles que si l'une est modifiée, les autres le sont aussi et par conséquent tout l'ensemble est transformé» (J. Rosnay).
Nombre de sciences emploient aujourd'hui une méthode systémique, les sciences physiques et biologiques créatrices du concept, l'économie, la sociologie, les sciences politiques… mais la démarche est innovante en géographie.
Le Monde fait donc système. Ses éléments en interaction, sont les Etats territoriaux dont le maillage couvre la totalité de la surface terrestre (plus de 240 Etats et Territoires), les firmes multinationales, les aires de marché (le marché mondial n'existe pas), les aires culturelles définies comme espaces caractérisés par des manières communes de penser, de sentir, de se comporter, de vivre. Les relations entre Etats nourrissent le champ de l'international (interétatique serait plus adéquat) et les relations entre acteurs privés le champ du transnational. Par exemple, les flux intra-firmes qui représentent le tiers du commerce mondial. Ces différents éléments du système Monde sont donc «unis» par des flux tels qu'aucune région du monde n'est aujourd'hui à l'abri de décisions prises ailleurs. On parle alors d'interdépendance, terme impropre puisque l'Asymétrie est la règle.
L'émergence et la construction du système Monde couvrent les trois derniers siècles. Longtemps, le Monde a été constitué de «grains» (sociétés humaines) et d'«agrégats» (sociétés humaines regroupées sous la direction d'une autorité unique, par exmple l'Empire romain) dont les relations, quand elles existaient, étaient trop ténues pour modifier en profondeur les comportements. A partir du XVI° siècle, le désenclavement des Européens, qui ont connaissance de la rotondité de la Terre, va mettre en relation toutes les parties du Monde. Naissent alors les premièrs «économies-mondes» décrites par Immanuel Wallerstein et Fernand Braudel et lorsque toutes les terres ont été connues, délimitées et appropriées (la Conférence de Berlin en 1885 achève la épartition des terres africaines entre Etats européens), le Monde fonctionne comme système (2). La «guerre de trente ans» (1914-1945) accélèrera le processus: toutes les humanités sont désormais en interaction spatiale.
L'espace mondial qui en résulte est profondément différencié et inégal. Il est le produit de la combinaison des données du milieu naturel et de l'action passée et présente des sociéts humaines; nature et culture. En effet, le potentiel écologique (ensemble des éléments physiques et biologiques à la disposiiton d'un groupe social) ne vaut que par les moyens techniques mis en œuvre par une société culturellement définie; il n'existe pas à proprement parler de «ressources naturelles», toute resource est «produite».
Et c'est parce que l'espace mondial est hétérogène, parce que le Monde est un assemblage de potentiels différents, qu'il y a des échanges à la surface de la Terre, que l'espace mondial est parcouru et organisé par d'innombrables flux. Flux d'hommes, de matières premières, de produits manufacturés, de virus… reliant les différents compartiments du Monde. Ils sont mis en mouvement, commandés par la circulation des capitaux et de l'information, flux moteurs invisibles que l'on nomme influx. Aussi le fonctionnement des interactions spatiales est conditionné par le quadrillage de réseaux (systèmes de routes, voies d'eau et voies ferrées, télécommunications et flux qu'ils supportent) drainant et irriguant les différents territoires du Monde. Inégalement réparti, cet ensemble hiérarchisé d'arcs, d'axes et de nœuds, qui contracte l'espace terrestre, forme un vaste et invisible anneau entre les 30° et 60° parallèles de l'hémisphère Nord. S'y localisent Etats-Unis, Europe occidentale et Japon reliés par leur conflit-coopération. Enjambés, les espaces intercalaires sont des angles-morts dont nul ne se préoccupe.
L'espace mondial n'est donc pas homogène et les sommaires divisions en points cardinaux (Est/Ouest et Nord/sud), surimposés à la trame des grandes régions mondiales ne sont plus opératoires (l'ont-elles été?). On sait la coupure Est-Ouest en cours de cicatrisation et il est tentant de se «rabattre» sur le modèle «Centre-Périphérie» de l'économiste égyptien Samir Amin: un centre dynamique et dominateur vivrait de l'exploitation d'une périphérie extra-déterminée. La vision est par trop sommaire et O. Dollfuss propose un modèle explicatif plus efficient, l'«oligopole géographique mondial». Cet oligopole est formé par les puissances territoriales dont les politiques et les stratégies exercent des effets dans le Monde entier. Partenaires rivaux (R. Aron aurait dit adversaires- partenaires), ces pôles de commandement et de convergence des flux, reliés par l'anneau invisible, sont les centres d'impulsion du système Monde. Ils organisent en auréoles leurs périphéries (voir les Etats-Unis avec dans le premier cercle le Canada et le Mexique, au delà les Caraïbes et l'Amérique Latine; ou encore le Japon en Asie), se combattent, négocient et s'allient. Leurs pouvoirs se concentrent dans quelques grandes métropoles (New-York, Tokyo, Londres, Paris, Francfort…), les «îles» de l'«archipel métropolitain mondial». Sont membres du club les superpuissances (Etats-Unis et URSS, pôle incomplet), les moyennes puissances mondiales (anciennes puissances impériales comme le Royaume-Uni et la France) et les puissances économiques comme le Japon et l'Allemagne (3); dans la mouvance, de petites puissances mondiales telles que la Suisse et la Suède. Viennent ensuite des «puissances par anticipation» (Chine, Inde) et des pôles régionaux (Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Nigéria…). Enfin, le système monde a ses «arrières-cours», ses «chaos bornés» où règnent la violence et l'anomie (Ethiopie, Soudan…).
La puissance ds «oligopoleurs» vit de la combinatoire du capital naturel (étendue, position, ressources), du capital humain (nombre des hommes, niveau de formation, degré de cohésion culturelle) et de la force armée. Elle ne saurait être la résultante d'un seul de ces facteurs et ne peut faire l'économie d'un projet politique (donc d'une volonté). A juste titre, l'auteur insiste sur l'importance de la gouvernance ou aptitude des appareils gouvernants à assurer le contrôle, la conduite et l'orientation des populations qu'ils encadrent. Par ailleurs, l'objet de la puissance est moins le contrôle direct de vastes espaces que la maîtrise des flux (grâce à un système de surveillance satellitaire et de misiles circumterrestres) par le contrôle des espaces de communication ou synapses (détroits, isthmes…) et le traitemebn massif de l'information (4).
Ce premier tome de la géographie universelle atteste du renouvellement de la géographie, de ses méthodes et de son appareil conceptuel. On remarquera l'extension du champ de la géographicité (de ce que l'on estime relever de la discipline) aux rapports de puissance entre unités politiques et espaces. Fait notoire en France, où la géographie a longtemps prétendu fonder sa scientificité sur l'exclsuion des phénomènes politiques de son domaine d'étude. Michel Serres affirme préférer «la géographie, si sereine, à l'histoire, chaotique». R. Brunet lui répond: «Nou n'avons pas la géographie bucolique, et la paix des frondaisons n'est pas notre refuge». Pas de géographie sans drame!
Louis Sorel
1) Cf. Yves Lacoste, «La géographie, ça sert, d'abord à faire la guerre», petite collection Maspero,1976.
2) Cf. I. Wallerstein, «The Capitalist World Economy», Cambridge University Press, 1979 (traduction française chez Flammarion) et F. Braudel, «Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme», Armand Colin, 1979. Du même auteur, «La dynamique du capitalisme» (Champs Flammarion, 1985) constitue une utile introduction (à un prix poche).
3) I. Ramonet, directeur du Monde diplomatique, qualifie le Japon et l'Allemagne de «puissances grises» (au sens d'éminence…). Cf. «Allemagne, Japon. Les deux titans», Manières de voir n°12, le Monde diplomatique. A la recherche des ressorts communs des deux pays du «modèle industrialiste», les auteurs se déplacent du champ économique au champ politique et du champ politique au champ culturel tant l'économique plonge ses racines dans le culturel. Ph. Lorino (Le Monde diplomatique, juin 1991, p.2) estime ce recueil révélateur des ambiguïtés françaises à l'égard de l'Allemagne, mise sur le même plan que le Japon, en dépit d'un processus d'intégration régionale déjà avancé.
4) Les «îles» de «l'archipel-monde» (le terme rend compte tout à la fois de la globalité croissante des flux et des interconnexions et de la fragmentation politico-stratégique de la planète) étant reliée par des mots et des images, Michel Foucher affirme que l'instance culturelle devient le champ majeur de la confrontation (Cf. «La nouvelle planète, n° hors série de Libération, déc. 1990). Dans le même recueil, Zbigniev Brzezinski, ancien «sherpa» de J. Carter, fait de la domination américaine du marché mondial des télécommunications la base de la puissance de son pays; 80% des mots et des images qui circulent dans le monde proviennent des Etats-Unis.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, géographie, géostratégie, stratégie, militaria, théorie politique, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 février 2009
Affaire Chauprade: lettre ouverte à Hervé Morin
Lettre ouverte à Hervé Morin,
ministre de la Défense euro-atlantiste
par Georges Feltin-Tracol - http://www.europemaxima.com/
Monsieur le ministre de la Défense de l’Occident,
Je m’autorise de vous interpeller avec un titre erroné puisque, renouant avec une mauvaise habitude pratiquée sous le septennat giscardien, le terme « nationale » a été supprimé de l’intitulé officiel de votre ministère. Permettez-moi par conséquent de vous désigner tour à tour comme le ministre de la Défense euro-atlantiste ou celui de la Défense de l’Occident, tant ces deux appellations me paraissent vous convenir à merveille.
Si je vous adresse aujourd’hui la présente algarade, sachez au préalable que je ne vise nullement l’élu local normand que vous êtes par ailleurs. L’adhérent au Mouvement Normand que je suis, soutient, tout comme vous, l’indispensable (ré)unification normande des deux demi-régions. Notre désaccord concerne l’avenir de la France, de son armée et de l’Europe de la défense.
Je vous dois d’être franc. Quand en mai 2007, vous avez été nommé au ministère de la rue Saint-Dominique, j’ai immédiatement pensé à une erreur de recrutement : vous n’êtes pas fait pour occuper ce poste, faute d’une carrure suffisante. Comment cela aurait pu être autrement avec un Premier ministre qui, lui, est un fin connaisseur de la chose militaire depuis de longues années ? Il s’agissait surtout de vous récompenser pour avoir abandonné (trahi, diraient de mauvaise langues) entre les deux tours de la présidentielle votre vieil ami François Bayrou et rallié le futur président.
D’autres, tout aussi non préparés aux fonctions de ce ministère éminemment régalien, auraient acquis au contact des militaires une stature politique afin de viser, plus tard, bien plus haut. Hélas ! Comme l’immense majorité de vos prédécesseurs depuis 1945, voire depuis l’ineffable Maginot, et à l’exception notable d’un Pierre Messmer, d’un Michel Debré ou d’un Jean-Pierre Chevènement, vous êtes resté d’une pâleur impressionnante. Pis, depuis votre nomination, vous avez démontré une incompétence rare qui serait risible si votre action ne nuisait pas aux intérêts vitaux de la France et de l’Europe.
À votre décharge, je concède volontiers qu’il ne doit pas être facile de diriger un tel ministère à l’ère de l’« omniprésidence omnipotente » et de sa kyrielle de conseillers, véritables ministres bis. Faut-il en déduire qu’une situation pareille vous sied et que vous jouissez en fait des ors de la République ?
Je le croyais assez jusqu’à la survenue d’un événement récent. Depuis, j’ai compris que loin d’être indolent, vous effectuez un véritable travail de sape, pis une œuvre magistrale de démolition systématique qui anéantit quarante années d’indépendance nationale (relative) au profit d’une folle intégration dans l’O.T.A.N. américanocentrée, bras armé d’un Occident mondialiste globalitaire.
Vous vous dîtes partisan de la construction européenne alors que vous en êtes l’un de ses fossoyeurs les plus déterminés. L’Europe, sa puissance sous-jacente, ses peuples historiques vous indiffèrent, seule compte pour vous cette entité despotique de dimension planétaire appelée « Occident ».
Qu’est-ce qui m’a dessillé totalement les yeux en ce 6 février 2009 ? Tout simplement votre décision inique et scandaleuse de congédier sur le champ Aymeric Chauprade de son poste de professeur au Collège interarmées de Défense (C.I.D.). Brillant spécialiste de géopolitique, Aymeric Chauprade présente, dans un nouvel ouvrage Chronique du choc des civilisations, des interprétations alternatives à la thèse officielle des attentats du 11 septembre 2001. Exposer ces théories « complotistes » signifie-t-il obligatoirement adhérer à leurs conclusions alors qu’Aymeric Chauprade, en sceptique méthodique, prend garde de ne pas les faire siennes ?
Peu vous chaut l’impartialité de sa démarche puisque, sur l’injonction du journaliste du Point, Jean Guisnel, auteur d’un insidieux article contre lui, vous ordonnez son exclusion immédiate de toutes les enceintes militaires de formation universitaire. Mercredi dernier - 11 février -, l’infâme Canard enchaîné sortait une véritable liste d’épuration en vous enjoignant d’expulser d’autres intervenants rétifs au politiquement correct. Auriez-vous donc peur à ce point (si je puis dire) de certains scribouillards pour que vous soyez si prompt à leur obéir, le petit doigt sur la couture du pantalon ? Faut-il comprendre que Jean Guisnel et autres plumitifs du palmipède décati sont les vrais patrons de l’armée française ?
Avez-vous pris la peine de lire l’ouvrage incriminé ? Votre rapidité de réaction m’incite à répondre négativement. Il importe par conséquent de dénoncer votre « attitude irresponsable, irrespectueuse et indigne », car « nier la réalité est une attitude particulièrement inquiétante pour un ministre et qui n’atteste pas du courage que chacun est en droit d’attendre d’un haut responsable politique ». Qui s’exprime ainsi ? M. Jean-Paul Fournier, sénateur-maire U.M.P. de Nîmes, irrité par la fermeture de la base aéronavale de Nîmes - Garons, cité par Le Figaro (et non Libé, Politis ou Minute) du 9 février 2009. Le sénateur Fournier a très bien cerné votre comportement intolérable et honteux.
Aymeric Chauprade interdit de tout contact avec le corps des officiers d’active, vous agissez sciemment contre l’armée française, contre la France. En le renvoyant, vous risquez même de devenir la risée de l’Hexagone. En effet, le 12 juillet 2001, Aymeric Chauprade publiait dans Le Figaro un remarquable plaidoyer en faveur d’un « bouclier antimissile français ». Et que lit-on dans Le Figaro du 13 février 2009 ? « La France se lance dans la défense antimissile »… Certes, nul n’est prophète en son pays, mais quand même, ne peut-il pas y avoir parfois une exception ?
Votre action injuste me rappelle d’autres précédents quand l’Institution militaire sanctionnait des officiers coupables de penser par eux-mêmes et de contester ainsi le conformisme de leur temps : le général Étienne Copel, le colonel Philippe Pétain, le lieutenant-colonel Émile Mayer, le commandant Charles de Gaulle.
Anticonformiste, Aymeric Chauprade l’est avec talent et intelligence ; il s’inscrit dans la suite prestigieuse des Jomini, Castex et Poirier. Voilà pourquoi le réintégrer au C.I.D. serait un geste fort pour l’indispensable réarmement moral d’une armée qui en a grand besoin.
Je doute fort, Monsieur le ministre de la Défense euro-atlantiste, que ma missive vous fera changer d’avis. Qu’importe ! Libre à vous de rester insignifiant et de figurer dans les chroniques comme le Galliffet de la réflexion stratégique.
Recevez, Monsieur le Ministre, mes salutations normandes.
Georges Feltin-Tracol,
rédacteur en chef du site Europe Maxima,
membre du Mouvement Normand,
signataire de la pétition de soutien à Aymeric Chauprade.
00:48 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : censure, france, géopolitique, polémique, totalitarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 février 2009
A Geopolitica russa
A Geopolítica Russa: De Pedro “O Grande” a Putin, a “Guerra‑Fria”, o Eurasianismo e os Recursos Energéticos
Tenente‑General PilAv Eduardo Eugénio Silvestre dos Santos
“A política de um Estado está na sua geografia”.
Napoleão1
“A Rússia é uma charada, embrulhada num mistério, dentro de um enigma”
Winston Church
Introdução
Apesar do termo “Geopolítica” ter sido utilizado pela primeira vez pelo cientista político sueco Johan Rudolph Kjellen, apenas no final do século XIX, vários intelectuais importantes tinham já escrito sobre a influência da geografia na conduta da estratégia global das nações, e os confrontos pelo domínio de territórios e populações perdem‑se na neblina dos tempos. O termo surgiu na era da rivalidade imperialista entre 1870 e 1945, quando os impérios em competição travavam inúmeras guerras, gerando, alterando e revendo as linhas de poder que eram as fronteiras do mapa político mundial.2
Existem inúmeras definições de “Geopolítica”. Aqui se deixam algumas que, na opinião do autor, melhor reflectem e abrangem o pleno âmbito do termo:
Kjellen definiu‑a como o “estudo da influência determinante do ambiente na política de um Estado”. Para a Escola de Munique de Haushofer é “a ciência da vinculação geográfica dos fenómenos políticos”. Para N. Spykman, era “o planeamento da política de segurança de um país em termos dos seus factores geográficos”.3 Mais modernamente, G. O’Tuathail afirma que é “o modo de relacionar dinâmicas locais e regionais com o sistema global como um todo”4 e, em conjunto com J. Agnew, o mesmo autor escreve que “estuda a geografia da política internacional, particularmente a relação entre o ambiente físico (localização, recursos, território, etc.) e a conduta da política externa”.5
Na história do mundo, existem, em competição constante, duas aproxi mações às noções de espaço e terreno – a terrestre e a marítima. Na História antiga, as potências que se tornaram em símbolos da “civilização marítima” foram a Fenícia e Cartago. O império terrestre que se lhes opunha era Roma. As Guerras Púnicas foram a imagem mais clara da oposição “terra‑mar”. Mais modernamente, a Grã‑Bretanha tornou‑se o “pólo” marítimo, sendo poste riormente substituído pelos EUA. Tal como a Fenícia, a Grã‑Bretanha utilizou o comércio marítimo e a colonização das regiões costeiras como o seu instrumento básico de domínio. Criaram um padrão especial de civilização, mercantil e capitalista, baseada acima de tudo nos interesses materiais e nos princípios do liberalismo económico. Portanto, apesar de todas as variações históricas possíveis, pode dizer‑se que a generalidade das civilizações marítimas tem estado sempre ligada ao primado da economia sobre a política.
Por seu lado, Roma representava uma amostra de uma estrutura de tempo de guerra, autoritária, baseada no controlo civil e administrativo, no primado da política sobre a economia. É um exemplo de um tipo de colonização puramente continental, com a sua penetração profunda no continente e assimi lação dos povos conquistados, automaticamente romanizados após a conquista. Para os Eurasianistas, na História moderna, os seus sucessores são os Impérios Russo, Austro‑Húngaro e Alemão.
2. Retrospectiva Histórica da Ásia Central
A história da Ásia Central foi condicionada pelas migrações de pastores nómadas das estepes desde muito cedo, provavelmente 4000 AC. Segundo Mehdi Amineh, podem considerar‑se cinco períodos históricos: o pré‑islâmico (Ciro, Alexandre e a dinastia Sassanida; remonta ao século II AC a “rota da seda”, que tornou possível o comércio entre o Ocidente e o Oriente, o Norte e o Sul da Ásia), o islâmico (dinastias Ummayad e Abbasid), o mongol (Genghis Khan e sucessores), o dos séculos XVI ao XIX, e o russo‑soviético.6 No âmbito deste trabalho interessam particularmente os dois últimos.
Para entender mais completamente o que se pretende expor neste trabalho, temos de recuar na história russa até ao início do século XIII, pois nessa época teve lugar um acontecimento catastrófico que deixou marcas indeléveis no carácter nacional russo. Em 1206, um génio militar analfabeto de nome Teumjin, conhecido para a posteridade como Genghis Khan, teve o sonho de conquistar o mundo, tarefa que ele cria lhe ter sido confiada por Deus para executar. Nos 30 anos seguintes, ele e os seus sucessores quase o conseguiam. Nessa época, a Rússia consistia apenas em cerca de uma dúzia de principados, frequentemente em guerra uns com os outros. Entre 1223 e 1240, não tendo conseguido unir‑se para combater o inimigo comum, caíram um a um perante a implacável máquina de guerra mongol. O sistema político que o domínio mongol criou era muito descentralizado (sistema de “khanatos” – semelhantes a principados – onde o “khan” era uma espécie de senhor feudal, sujeitos a tributos obrigatórios pesadíssimos pelos mongóis), e o resultado inevitável foi um jugo tirânico dos príncipes vassalos sobre os seus súbditos, cuja sombra ainda hoje se faz sentir na Rússia.
Durante cerca de 250 anos, os russos estagnaram e sofreram a opressão da “Horda Dourada”, termo pelo qual os mongóis ficaram conhecidos. Entre tanto, aproveitando as circunstâncias e a fraqueza militar, os vizinhos europeus da Rússia (principados alemães, Lituânia, Polónia e Suécia) foram ocupando partes do seu território.
Raramente uma experiência deixou cicatrizes tão profundas e perenes na psicologia de uma nação, explicando grande parte da sua xenofobia, a sua política externa muitas vezes agressiva, e a histórica aceitação da tirania interna.7 Para George Kennan, encarregado de negócios dos EUA em Moscovo no início da “guerra‑fria” e estudioso da política externa soviética, as fontes principais da conduta soviética eram determinadas pela história e geografia russas. “A cautela e a flexibilidade soviéticas são atitudes solidificadas nas lições da história russa: séculos de batalhas entre forças nómadas na vastidão de planícies desprotegidas”.8
O homem a quem os russos devem a sua liberdade face à opressão mongol foi Ivan III, “o Grande”, príncipe de Moscovo, no final do século XV. A máquina de guerra mongol, tão temida no início, tinha entretanto perdido a vontade e o gosto de lutar, acomodando‑se e não sendo já invencível. O poderoso império de Genghis Khan colapsou no Ocidente, ficando reduzido apenas a três “khanatos” dispersos: Kazan (2, Fig. 1), Astrakhan (1, Fig. 1) e Crimeia. Ivan IV, “o Terrível”, um dos sucessores de “o Grande”, reconquistou os dois primeiros (1553 e 1555), anexando‑os a Moscovo, que se expandia rapidamente, com a finalidade de evitar invasões, recolher as produções e capturar populações para vender como escravos. Apenas restou a Crimeia como último reduto tártaro, em virtude de ter a protecção do Império Otomano, que via nele um importante baluarte contra os russos. Foi a partir do Principado de Moscovo que, a partir de meados do século XIV, com a derrota dos tártaros na batalha do rio Ugra (5, Fig. 1), se foi cimentando e alargando o Império Russo. A ameaça mongol tinha assim sido eliminada, deixando o caminho aberto para uma das maiores empresas coloniais da história: a expansão da Rússia para Oriente, na Ásia. A partir de 1580, o comércio de peles começou a atrair os russos para a Sibéria, bem para além dos Urais. A expansão russa só terminou quando o Oceano Pacífico foi atingido, sendo comparável em muitos aspectos à conquista americana do Oeste.9 No seu apogeu o Império Russo incluía, além do território russo actual, os estados bálticos (Lituânia, Letónia e Estónia), a Finlândia, Cáucaso, Ucrânia, Bielorússia, boa parte da Polónia (antigo reino da Polónia), Moldávia (Bessarábia) e quase toda a Ásia Central. (Fig. 2) “A História prova que o espaço e a posição têm influído no destino político de cada território (...) O espaço, quando existe, cria a grande potência.”10
Durante o século XVI, o Império Persa tentou impedir o Império Otomano de ter acesso à “Rota da Seda” e ganhar o monopólio desta fonte de riqueza. A guerra entre estes dois impérios fez com que os “khanatos” asiáticos perdessem o seu poder e ressurgissem as forças tribais, causando o declínio económico da Ásia Central no século XVII. No fim do século XVIII, devido ao crescente comércio entre as tribos da Ásia Central e a Rússia, deu‑se uma nova dinâmica à vida económica e política. É também nesta altura que se dá a progressiva sedentarização das tribos nómadas, o que contribuiu bastante para a centralização política da região.
3. A Expansão Russa
Pode recuar‑se na “geopolítica” russa até finais do século XVII, e afirmar que, pelo menos desde essa época, a Rússia perseguiu dois objectivos estratégicos:
– um, Constantinopla, levada por um lado pelo sonho da libertação dos cristãos ortodoxos, mas que lhe daria também o controlo do Bósforo e dos Dardanelos e, logo, o acesso ao Mediterrâneo;
– o outro, tentar chegar à Índia; alguns políticos britânicos continuavam contudo a pensar que “o objectivo real da Rússia era, não a Índia, mas Constantinopla: para manter a Grã‑Bretanha sossegada na Europa, devia mantê‑la ocupada na Ásia”.11
O primeiro dos Czares a tentar modernizar a Rússia foi Pedro “o Grande”, já da dinastia Romanov, na transição do século XVII para o XVIII. Para tal, enviou uma embaixada diplomática à Europa Ocidental e construiu S. Petersburgo, que imaginou como uma porta de ligação comercial e cultural com a Europa. Porém, tendo esgotado o tesouro combatendo simultaneamente a Suécia e o Império Otomano, chegaram‑lhe notícias, no início do século XVIII, da descoberta de ricos jazigos de ouro na Ásia Central, nas margens do Amu‑Darya, o que o fez virar a atenção para aí e para a Índia. Cerca de 50 anos mais tarde, Catarina “a Grande” voltou a dar sinais de interesse pela Índia. Catarina era uma expansionista e não era segredo que sonhava em expulsar os turcos de Constantinopla e controlá‑la. Não conseguiu conquistar nem Constantinopla nem a Índia, mas apoderou‑se do “khanato” da Crimeia nos finais do século XVIII, e o seu sucessor Alexandre I recuperou à Pérsia os territórios do Cáucaso. Em 1801, anexou o antigo e independente reino da Geórgia, que a Pérsia considerava estar na sua esfera de influência. Em 1804, avançou ainda mais para Sul, cercando Yerevan, capital da Arménia (Fig. 3), uma possessão cristã do Xá, ameaçando Constantinopla.
O Mar Negro tinha deixado de ser um “lago turco” e os russos começaram a construir uma gigantesca base naval em Sebastopol (4, Fig. 1), ficando os seus vasos de guerra a dois dias de Constantinopla. A presença da Rússia no Próximo Oriente e no Cáucaso começava a preocupar ao Império Britânico. Porém, entretanto, surgiu Napoleão! Este ofereceu ajuda ao Xá para rechaçar os russos, em troca da utilização da Pérsia como caminho de passagem para invadir a Índia, o que fez parar o avanço russo. Em 1807, após subjugar a Áustria e a Prússia, derrotou os russos em Friedland, forçando‑os a aderir ao “bloqueio continental”, destinado a isolar e a derrotar a Grã‑Bretanha.12
Após a derrota de Napoleão em 1812, o Czar Alexandre solicitou, no Congresso de Viena, a modificação do mapa político da Europa, exigindo o controlo da Polónia. Perante a forte oposição britânica, Alexandre I concordou em dividi‑la com a Áustria e a Prússia, ficando contudo com a parte de leão. No século XIX, as guerras na Europa para fomentar revoluções ou conquistar território, eram vistas como ameaças ao “equilíbrio de poder” entre os Estados dominantes, as grandes potências. Mas a dicotomia entre a Europa e os outros continentes era reforçada pela combinação frequente entre uma “terra‑mãe” e uma periferia trazendo uma experiência colonial para perto de “casa”. Nos EUA e na Rússia, por exemplo, não existia uma separação clara nem fronteiras físicas óbvias.13
A trégua entre a Rússia e a Pérsia no Cáucaso (a Pérsia acabou por aceitar a soberania russa entre o Cáucaso e o Mar Cáspio e em grande parte do Azerbaijão), fez virar as atenções de S. Petersburgo para a Ásia Central. O “Grande Jogo”, a luta subtil mas persistente pelo controlo das vastas terras situadas entre o Mar Cáspio, a Pérsia e a Índia, “a jóia da coroa” do Império Britânico, a Sul, tinha começado.
O “Grande Jogo” é um termo atribuído a Arthur Connolly, utilizado para descrever a rivalidade e o conflito estratégicos entre os Impérios Britânico e Russo, pela supremacia na Ásia Central. O termo foi popularizado posteriormente por Rudyard Kipling, na sua obra “Kim”. O período clássico do “Grande Jogo” decorre desde aproximadamente 1815 até à Convenção Anglo‑Russa de 1907. Após a revolução bolchevique de 1917, existiu uma segunda fase.14
Existiam apenas duas rotas possíveis para um exército russo, suficientemente grande para ter sucesso, atingir a Índia:
– uma seria partindo de Orenburg (3, Fig. 1 e 3), capturar Khiva (2, Fig. 3) e Balkh (6, Fig. 3), atravessar o Hindu Kush, como tinha feito Alexandre “o Grande”, e dirigir‑se a Kabul; daí marcharia para Jalalabad, atravessaria o Desfiladeiro Khyber (K, Fig. 4) para Peshawar e chegaria ao rio Indo; esta rota, embora mais longa, tinha mais água que a rota alternativa, através do Karakorum, e evitava os confrontos com os perigosos Turcomenos;
– a outra rota possível implicava a captura de Herat (7, Fig. 3), que seria utilizada como ponto de apoio logístico. Daí marchariam por Kandahar (Z, Fig. 4) e Quetta (Q, Fig. 4) para o Desfiladeiro Bolan (B, Fig. 4). Herat poderia ser atingida através de um acordo com a Pérsia, ou atravessando o Cáspio para Astrabad.
Em qualquer dos casos, um invasor teria de passar pelo Afeganistão! No século IV DC, Alexandre, o Grande, conquistou todo o império persa, à excepção da província Bactro‑Sogdiana, o Afeganistão de hoje. No século XIII, Genghis Khan abandonou a campanha no Afeganistão, em virtude da resistência tenaz e das pesadas baixas sofridas.15 Desde o colapso do grande império Durrani, fundado em meados do século XVIII, que o Afeganistão estava no centro de uma intensa e incessante luta pelo poder. Não existia unidade real entre os afegãos, meramente alianças temporárias, quando e onde era vantajoso para os respectivos líderes tribais. O Império Britânico sentiu isso bem na pele. “Se os afegãos, como nação, estiverem determinados a resistir aos invasores, as dificuldades tornar‑se‑iam intransponíveis”, afirmou um oficial britânico em serviço na Índia. Esta frase explica o interesse britânico em manter o Afeganistão forte e unido por um líder central em Kabul.16 Explica ainda uma grande parte da história mais moderna deste país.
Em 1833, uma enorme frota de navios de guerra russos posicionou‑se perto de Constantinopla, encerrando uma cadeia de acontecimentos iniciada dois anos antes, com uma revolta do governador do Egipto, então nominalmente parte do Império Otomano. Cercou Damasco e avançou pela Anatólia na direcção de Constantinopla com um poderoso exército, querendo destronar o sultão. Este apelou ao auxílio britânico, cujos governantes hesitaram. Mais lesto foi o Czar Nicolau I, que lhe ofereceu prontamente auxílio. Perante a situação, o sultão teve de aceitar reconhecido esse auxílio, que veio por termo à rebelião. A armada russa retirou, mas os turcos passaram a ser pouco mais do que um protectorado do Czar e, nos termos do tratado de paz, poderiam fechar os Dardanelos a todos os navios de guerra estrangeiros, se S. Petersburgo assim o desejasse. Estes desenvolvimentos colocaram de sobreaviso o Império Britânico, que via no alargamento da armada russa e nas suas posições no Cáucaso uma cabeça‑de‑ponte para lançar investidas posteriores contra a Turquia e contra a Pérsia.
Até então, os estrategistas consideravam que o poder da Rússia era apenas defensivo, a coberto da fortaleza inexpugnável com que a natureza a tinha contemplado – o seu clima e os seus desertos – conforme Napoleão tinha descoberto à sua própria custa. Mas, na realidade, desde o reinado de Pedro “o Grande”, os súbditos do Czar tinham aumentado quatro vezes, de 15 para quase 60 milhões. Ao mesmo tempo, as fronteiras da Rússia tinham avançado cerca de 800 km em direcção a Constantinopla e cerca de 1 500 em direcção a Teerão, a uma razão de mais de 50 000 km2 por ano. Na Europa, as conquistas russas sobre a Suécia montavam a metade da área original daquele reino, e sobre a Polónia eram quase iguais à área de todo o Império Austríaco. Todo este território tinha sido conseguido furtivamente, através de astúcia e pequenas invasões sucessivas, nenhuma delas suficientemente importante para causar fricções importantes com os outros poderes europeus.17
No início do século XIX, a maior parte das paragens da Ásia Central não estava cartografada. As cidades de Bukhara (10, Fig. 3), Khiva, Merv e Tashkent (12, Fig. 3) eram praticamente desconhecidas dos estrangeiros. No final do referido século, a expansão imperial czarista ameaçava colidir com o domínio e a ocupação crescentes do sub‑continente indiano, e os dois impérios jogaram um jogo subtil de exploração, espionagem e diplomacia imperialista, o já referido “Grande Jogo”, em toda a Ásia Central. O conflito ameaçou sempre uma eventual guerra entre as partes, sem contudo nunca ter chegado a um confronto directo. O ponto nevrálgico da actividade foi, como já foi dito, o Afeganistão.
Da perspectiva britânica, a expansão czarista ameaçava a Índia. À medida que as tropas russas começaram a conquistar “khanato” após “khanato”, os britânicos temeram que o Afeganistão se tornasse numa área de preparação para uma invasão russa da Índia. Mas, em vez de tentar estabelecer uma liderança forte e amistosa que pudesse proteger a Índia contra invasões russas, levou mesmo a um dos piores desastres da história militar britânica. Em 1838, a Grã‑Bretanha lançou um ataque ao Afeganistão (1.ª Guerra Anglo‑Afegã), e impôs um regime “fantoche”. O regime durou pouco tempo, insustentável sem apoio militar britânico significativo. Em 1842, a multidão atacou as tropas inglesas nas ruas de Kabul e a guarnição acordou uma retirada protegida. Infelizmente para os britânicos, os afegãos não cumpriram o acordado e cerca de 4 500 militares e 12 000 apoiantes pereceram durante a retirada. A 1.ª Guerra Anglo‑Afegã foi um golpe devastador no seu orgulho e prestígio. O desastre russo em Khiva (1839) não se pode comparar a este. No seguimento desta humilhante derrota, os britânicos refrearam as suas ambições sobre o Afeganistão.18
Entre meados de 1857 e meados de 1858, os britânicos viram‑se a braços com a “Revolta da Índia”, amotinação dos cipaios indianos. Após essa rebelião, os sucessivos governos britânicos passaram a ver o Afeganistão como um estado‑tampão. Porém, os russos continuaram a avançar para Sul, em direcção àquele estado e, em 1865, anexaram formalmente Tashkent e, três anos depois, Samarcanda (11, Fig. 3) e Bukhara. Em 1870, foi a vez de Khiva. O controlo russo estendia‑se então até à margem Norte do rio Amu‑Darya.19
O Czar Nicolau I visitou a Rainha Vitória, então com 25 anos, em Londres em 1844. A sua principal preocupação era o futuro do Império Otomano, “o homem doente da Europa”, como lhe chamava. Confessou estar muito preocupado com o que poderia acontecer quando ele se desfizesse, algo que temia estar eminente. As duas partes concordaram que o sultão deveria ser mantido no trono enquanto tal fosse possível. Concordaram também em consolidar as suas fronteiras, subjugando vizinhos problemáticos. No período de “détente” que se seguiu, os russos avançaram as suas praças‑fortes através das estepes cazaques até às margens do Syr‑Darya, cerca de 400 km a leste do Mar de Aral. Os britânicos, por seu turno, conseguiram anexar o Sind e colocar líderes favoráveis a governar o Punjab e a Caxemira.
Porém, em 1853, as boas relações cessaram. Em 1848, tinham estalado revoluções nacionalistas em várias capitais europeias (Paris, Berlim, Viena, Roma, Praga, Budapeste, etc.) entre governantes e governados, entre lei e desordem, entre aqueles que tinham e aqueles que queriam ter.
Considerando‑se o guardião dos locais santos do Cristianismo na Terra Santa, então parte integrante do Império Otomano, o Czar Nicolau invadiu as províncias setentrionais dos Balcãs, alegadamente para proteger os cristãos eslavos daquela região, ignorando um ultimato dos turcos para retirar, pondo uma vez mais os dois países em guerra. Os britânicos e os franceses, determinados a manter os russos afastados do Próximo Oriente, aliaram‑se ao sultão. A Guerra da Crimeia, que ninguém queria e que poderia facilmente ser evitada, tinha começado.
No Outono de 1854, franceses e britânicos sitiaram Sebastopol, a grande base naval russa no Mar Negro, considerando que a sua captura e destruição asseguraria a independência da Turquia. O cerco durou quase um ano e a rendição russa tornou‑se inevitável, ao mesmo tempo que o Czar Nicolau I adoecia e morria em Março de 1855. Após a rendição de Sebastopol, a Áustria ameaçou juntar‑se à coligação e o novo Czar, Alexandre III, acedeu a assinar um acordo preliminar de paz. Os russos foram fortemente penalizados na região do Mar Negro, banidas que foram todas as bases e navios de guerra daquele mar, cederam a foz do Danúbio e várias cidades capturadas aos turcos. O Mar Negro ficou desmilitarizado e a independência e integridade da Turquia garantidas. As ambições da Rússia na Europa e no Próximo Oriente tinham sido bloqueadas. Passaram 15 anos até que a Rússia denunciasse o acordo de paz e reiniciasse a construção de uma frota do Mar Negro. Ao derrotar os russos na Crimeia, a Grã‑Bretanha esperava não só afastá‑la do Próximo Oriente, mas também fazer parar a sua expansão na Ásia Central. O efeito foi, todavia, o oposto. A seguir à derrota na Guerra da Crimeia, a Rússia olhou para a Ásia Central como uma região onde a rivalidade com a Grã‑Bretanha lhe poderia ser mais favorável.20
Entretanto, o Afeganistão voltou a ser notícia. O Xá da Pérsia, aproveitando a Guerra da Crimeia, reclamou a cidade de Herat e ocupou‑a no final de 1856. Em 1863, o líder afegão reconquistou‑a.
Na década de 1850’s, os russos continuaram a expandir‑se para Leste, ao longo do rio Amur, e para Sul, em direcção à costa do Pacífico, onde hoje é Vladivostok (Fig. 5). O imperador chinês, a contas com a rebelião Taiping no Sul e, ao mesmo tempo, com as exigências francesas e britânicas para concessões de terras e outros privilégios, que degeneraram em 1856 na Segunda Guerra do Ópio, entre a China e a Grã‑Bretanha, não estava em posição de os impedir. Os russos acrescentaram assim uma enorme porção de territórios, do tamanho da França e da Alemanha juntas, ao seu já gigantesco império asiático. Em 1859, conseguiram também submeter finalmente a quase totalidade da Circassia, no Cáucaso. Em 1860 chegaram ao Pacífico, fundando Vladivostok.
Faltavam contudo os três “khanatos” independentes da Ásia Central. Aquilo que finalmente decidiu o Czar a agir, foi a Guerra da Secessão nos EUA, cujos estados sulistas tinham sido a principal fonte de abastecimento de algodão. Como resultado da guerra, o abastecimento foi cortado, afectando seriamente toda a Europa. A Rússia sabia, no entanto, que a região de Khokand (4, Fig. 3) na Ásia Central, especialmente o fértil vale de Fergana, era particularmente favorável à cultura do algodão, com potencial para produzir quanti dades substanciais desse têxtil. O Czar Alexandre III estava decidido a conquistar esses campos de algodão o mais rapidamente possível. Em 1863, a Rússia estava preparada para penetrar na Ásia Central, se bem que gradualmente. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Czar declarou no final de 1864, num memorando para os seus embaixadores na Europa: “A posição da Rússia na Ásia Central é idêntica à de todos os estados civilizados que entram em contacto com populações nómadas e semi‑selvagens, que não possuem uma organização social estável. Nesses casos, acontece sempre que o estado mais civilizado é forçado, no interesse da segurança das suas fronteiras e das suas relações comerciais, a exercer uma certa ascendência sobre os vizinhos com um carácter mais turbulento e agressivo, que os torna indese jáveis”. É interessante verificar a semelhança entre esta posição e a expressa no final do século XIX por Theodore Roosevelt, presidente dos EUA e conhecido pelo “corolário Roosevelt”.
Os “khanatos” de Khiva, Bokhara e Khokand dominavam, entre eles, uma vasta região de desertos, oásis e montanhas, com o tamanho de metade dos EUA, que se estendia da margem oriental do Mar Cáspio até ao Pamir. Mas, para além destas três cidades‑estado, existiam outras cidades importantes: uma era Samarcanda, capital do extinto império de Tamerlane, agora parte dos domínios de Bokhara; outra era Kashgar (5, Fig. 3), sob o domínio chinês, separada das outras por altas montanhas; finalmente, Tashkent, anteriormente independente, com os seus pomares, vinhas, pastagens e uma população de 100 000 pessoas, a cidade mais rica da Ásia Central, possessão de Khokand.21 Em 1862, Samarcanda foi absorvida pelo Império Russo, deixando apenas o “khanato” de Khiva a fazer frente ao Czar. Em 1865 ocuparam Tashkent, declarando que a ocupação era temporária, o que se sabia não ser verdade pois, algum tempo depois, foi constituído o novo “Governo Geral” do Turquestão, o que significava que os “khanatos” tinham os dias contados. Existiam três razões principais para isso:
– antes de tudo, o receio que os britânicos chegassem ali primeiro, vindos do Sul, e monopolizassem o comércio;
– depois vinha a razão do orgulho imperial; bloqueados na Europa e no Próximo Oriente, pretendiam a frustração demonstrando o seu valor militar na conquista militar da Ásia;
– finalmente, o factor estratégico; tal como o Báltico era o “calcanhar de Aquiles” da Rússia, no caso de disputa com a Grã‑Bretanha, há muito que se sabia que o ponto mais vulnerável do Império Britânico era a Índia; Tashkent era considerada a chave para a conquista e o domínio da Ásia Central.
Começaram também a melhorar significativamente as suas comunicações na Ásia Central: uma nova linha férrea vinha de S. Petersburgo até Gorki (antiga Nijni Novgorod), no Volga, onde circulavam cerca de 300 barcos a vapor até ao Mar Cáspio. O modo mais óbvio de ligar a Ásia Central à Rússia europeia era construir um porto na margem oriental do Cáspio. Eventual mente, quando Khiva fosse conquistada e os perigosos Turcomenos pacificados, uma linha férrea podia ser construída através do deserto ligando Bokhara, Samarcanda, Tashkent e Khokand.22
Em 1867, a Rússia vendeu o Alasca aos EUA por sete milhões de dólares, em virtude de, segundo eles, não ser facilmente defensável nem economicamente viável!...23
Em 1870, renunciou unilateralmente às cláusulas do acordo de paz sobre o Mar Negro, após a Guerra da Crimeia, o primeiro de uma série de movimentos que iriam fortalecer grandemente a sua posição política e estratégica na região.
No verão de 1871, ocupou o território muçulmano de Ili (8, Fig. 3), que dominava importantes passagens para a Sibéria meridional, e que se tinha recentemente rebelado contra a soberania chinesa. Tinha sido através destes desfiladeiros que as hordas de Genghis Khan tinham, séculos antes, invadido a Rússia. Este território era também rico em minérios e servia como celeiro daquela desolada região.
Em 1873, o Czar Alexandre II decidiu efectuar um ataque demolidor a Khiva. Após os revezes anteriores, em 1717 e 1839, a Rússia não queria falhar, e lançou um ataque de três direcções diferentes: de Tashkent, de Orenburg e de Kransnovodsk (13, Fig. 3) (hoje Turkmenbashi). Khiva finalmente capitulou.
Com esta acção, a Rússia adquiriu o controlo da navegação no baixo Amu‑Darya, com os correspondentes benefícios comerciais e estratégicos, bem como o domínio total da margem oriental do Cáspio. Conseguiu também uma base a partir da qual poderia ameaçar a independência da Pérsia e do Afeganistão e, à distância, a Índia. Num período de 10 anos, a Rússia tinha anexado um território com a área de metade dos EUA e conseguido uma barreira defensiva em toda a Ásia Central, do Cáucaso a Khokand, ocupada em 1875.24
Entretanto, na Europa, a Rússia voltou a envolver‑se com as outras potências, devido a divergências sobre as possessões do Império otomano nos Balcãs. O problema iniciou‑se em 1875 na Bósnia‑Herzegovina, de onde se espalhou rapidamente à Sérvia, ao Montenegro e à Bulgária. Tropas turcas mataram e massacraram alguns milhares de cristãos búlgaros. Este massacre levou o Czar, que se proclamava protector dos cristãos sob soberania turca, a um conflito latente com o Sultão. Em 1877 os russos declararam guerra à Turquia e iniciaram o avanço para Constantinopla, através dos Balcãs e, simultaneamente, da Anatólia Oriental. A resistência turca fracassou e, em 1878, os exércitos russos estavam às portas de Constantinopla, prestes a realizar o seu sonho de séculos. Porém, encontraram também a esquadra britânica fundeada nos Dardanelos, o que fez o Czar Alexandre II recuar e aceitar uma trégua com os turcos. A Bulgária adquiriu a sua independência do Império Otomano, contra a opinião britânica, e a Rússia conseguiu territórios na Anatólia Oriental. A Áustria‑Hungria aliou‑se à Grã‑Bretanha sobre o problema da Bulgária, ocupando a Bósnia‑Herzegovina, e os britânicos colocaram tropas em Malta e ocuparam Chipre, numa tentativa de fazer recuar as tropas russas de Constantinopla. No final, a crise resolveu‑se sem recurso à guerra, tendo o Sultão conseguido recuperar dois terços do território perdido.25
A tensão voltou a crescer em 1878, quando a Rússia enviou uma missão diplomática a Kabul, sem convite prévio. A Grã‑Bretanha exigiu que o homem forte do Afeganistão, Sher Ali, aceitasse também uma missão britânica. Esta foi recusada e, em retaliação, uma força de 40 000 homens atravessou a fronteira, iniciando a 2.ª Guerra Anglo‑Afegã. Esta incursão foi quase tão desastrosa como a primeira e em 1881 os ingleses voltaram a retirar de Kabul. O trono foi oferecido a Abdur Rahman, que aceitou que a Grã‑Bretanha orientasse a sua política externa enquanto ele consolidava a sua posição interna. Conseguiu dominar as rebeliões internas com eficácia brutal e reunir a maior parte do país sob o governo central.26 Os britânicos tinham conseguido assim estabelecer um estado‑tampão razoavelmente estável e com um líder amis toso, ao mesmo tempo que tinham erradicado a influência russa em Kabul.
Em 1879, quatro anos após ter anexado Khokand, a Rússia tentou atacar a cidade turcomena de Geok‑Tepe (9, Fig. 3), no limite Sul do deserto Karakum, a meio caminho entre o Cáspio e Merv, mas foi rechaçada. Foi a sua pior derrota na Ásia Central desde o ataque de má memória a Khiva, em 1717.27
Em 1881, os russos cercaram Geok‑Tepe de novo, desta vez com êxito. Em 1884 tomaram Merv, formalmente pertencente à Pérsia, levando finalmente as tribos turcomenas à capitulação e à submissão à soberania de S. Petersburgo. A rendição de Merv, conseguida de modo considerado militarmente pouco ortodoxo, foi considerada pelas autoridades britânicas, na Índia e em Londres, como sendo “de longe o passo mais importante dado pela Rússia para ameaçar a Índia”. Estas preocupações britânicas baseavam‑se na linha férrea que os russos tinham começado a construir na direcção de Merv, que quando completada, podia facilmente fazer a ligação entre as cidades e guarnições da Ásia Central e transportar tropas até à fronteira afegã. Após uma longa correspondência diplomática, representantes das duas potências (Comissão Conjunta da Fronteira Afegã) reuniram‑se perto de Merv, com a finalidade de delinear cientificamente a fronteira entre a Transcáspia russa, a Pérsia e o Afeganistão.28
Em 1884, a expansão russa despoletou nova crise quando ocupou o oásis de Pandjeh, a meio caminho entre Merv e Herat, no Afeganistão. O Xá da Pérsia, profundamente alarmado pela agressividade russa, pediu à Grã‑Bretanha para ocupar Herat antes dos russos. À beira da guerra, a Comissão Conjunta acordou que a Rússia devia abandonar Merv, mas podia reter Pandjeh. O acordo estabelecia a fronteira Norte do Afeganistão no Amu‑Darya, com perdas substanciais de território.29 A Rússia tinha conseguido mais uma vez aquilo que queria, demonstrando ser mestre na arte do “facto consumado”.
Em 1895, Londres e S. Petersburgo chegaram finalmente a acordo sobre a fronteira entre a Ásia Central russa e o Afeganistão oriental. A “falha” do Pamir estava finalmente fechada.
Em 1907, a Convenção Anglo‑Russa finalizou o período clássico do “Grande Jogo”, com a aceitação russa de que a política do Afeganistão ficava sob controlo britânico, e que conduziria todas as suas relações com aquele país através da Grã‑Bretanha, desde que esta garantisse a permanência do regime. As fronteiras manter‑se‑iam.
O Caminho‑de‑Ferro Transcaspiano foi iniciado em 1880. Em 1888 atingiu Bokhara e Samarcanda e encontrava‑se a caminho de Tashkent. A linha férrea corria paralela à fronteira com a Pérsia durante cerca de 500 km, represen tando, com a sua capacidade de transportar tropas e artilharia, uma “espada de Damócles” sobre a cabeça do Xá. Alterava drasticamente o equilíbrio estratégico na região.30
Mas a Rússia continuava a sonhar abrir para si todo o Extremo Oriente, com os seus recursos e mercados, antes dos outros “predadores” o conse guirem. O plano envolvia a construção do maior caminho‑de‑ferro jamais visto, o Trans‑Siberiano (Fig. 6). Teria mais de 7 200 km de Moscovo a Vladivostok e seria capaz de transportar mercadorias e matérias‑primas em ambos os sentidos em menos de metade do tempo que demorariam por via marítima, causando assim sérios embaraços à hegemonia da Grã‑Bretanha sobre as rotas marítimas.
Por esta altura, as maiores potências europeias estavam já empenhadas numa corrida desenfreada para conseguirem a sua parte do moribundo Império Manchu e do que lhe estava associado. Os alemães, apesar de terem partido tarde na corrida colonial, foram os primeiros a solicitar uma base naval e uma estação de carvão, algures na costa Norte da China para a sua frota do Extremo Oriente. Nas escaramuças que se seguiram, a França e a Grã‑Bretanha obtiveram outras concessões, enquanto a Rússia, fazendo o papel de protectora da China, obteve o porto de águas quentes de Port Arthur (hoje Dalian) (1, Fig. 5) e as terras em redor. Os EUA juntaram‑se também ao “leilão”, e adquiriram em 1898 o Hawai, Guam, Wake e as Filipinas, cobiçadas também por outras potências.
Em 1900, as potências europeias foram apanhadas de surpresa pela “Revolta dos Boxers”, um sentimento de forte ressentimento contra os “diabos estrangeiros” que, tirando partido da fraqueza da China, estavam a conseguir portos e outros privilégios comerciais e diplomáticos. Foram massacrados missionários cristãos, o Cônsul francês foi linchado, tendo a revolta sido dominada por uma força de intervenção de seis países que ocupou Pequim. Porém, a revolta, apesar de dominada, viria a ter consequências importantes na Manchúria, onde os russos temiam pelo seu novo caminho‑de‑ferro e onde, devido a isso, colocaram 170 000 homens.
S. Petersburgo foi fortemente pressionada para retirar esta força após a revolta ter sido dominada, mas apenas retirou cerca de um terço dela, e com grande relutância. Ficou claro que, uma vez mais, os russos jogaram no “facto consumado”.
O Japão tomou consciência, em meados do século XIX, de que se não quisesse ser colonizado como a Índia ou despedaçado como a China, devia ter um exército europeu e construir um império pela guerra.31 Tinha observado com grande apreensão o crescimento militar e naval da Rússia no Extremo Oriente, que ameaçava directamente os seus próprios interesses na região. Tinha notado particularmente a infiltração russa na Coreia, o que a colocava perigosamente perto do seu território. O Japão tinha ainda consciência que o tempo jogava contra si, pois quando o caminho ‑de‑ferro Trans‑Siberiano estivesse concluído, os russos poderiam trazer tropas em grande número, artilharia pesada e outro material de guerra. Por estas razões, os responsáveis japoneses decidiram enfrentar a ameaça russa e, em 1904, atacaram sem aviso a base naval russa de Port Arthur. A Guerra Russo‑Japonesa tinha começado.
Brilhantemente liderada pelo Almirante Togo, a frota japonesa, apesar de inferior em número e do fogo cerrado das baterias de artilharia de terra russa, conseguiu infligir baixas importantes à frota russa e minar‑lhe o moral. Tudo correu mal aos russos. Encontraram‑se sitiados e prisioneiros na base naval fortemente defendida, à medida que os japoneses, tacticamente superiores e melhor comandados, dominavam o mar. O Czar Nicolau II decidiu então enviar a frota do Báltico para o Extremo Oriente, à volta de três continentes, numa tentativa desesperada de terminar o bloqueio a Port Arthur. O conflito durou 18 meses e, no início de 1905, Port Arthur capitulou. Um mês depois, caiu o fortemente defendido centro ferroviário de Mukden (hoje Shenyang) (2, Fig. 5), 400 km a Norte de Port Arthur, que os peritos russos consideravam praticamente inexpugnável. A perda das suas praças‑fortes no Oriente para os “macacos amarelos” abalou profundamente o prestígio russo no mundo, especialmente na Ásia. As más notícias chegaram à esquadra do Báltico quando esta se encontrava ainda em Madagáscar. Apesar disso, foi determinado que esta prosseguisse com a finalidade de reconquistar os mares do Oriente aos japoneses. Estes, contudo, estavam à sua espera nos Estreitos de Tsushima, entre a Coreia e o Japão, e infligiram‑lhe uma derrota catastrófica. A humilhação russa foi total e o sonho do Czar Nicolau II de construir um novo império no Oriente pereceu para sempre. A paz foi mediada pelos EUA e assinado um acordo de paz. Ambos os países acordaram em abandonar a Manchúria, que foi devolvida à soberania chinesa. Port Arthur e o controlo de partes do Trans‑Siberiano foram transferidos para o Japão. A Coreia foi declarada independente, apesar de ficar na esfera de influência japonesa. Indirectamente, a Guerra Russo‑Japonesa levou à queda, 13 anos depois, da monarquia russa.
Em Outubro de 1917, a revolução russa levou ao colapso de toda a frente oriental da 1.ª Guerra Mundial, do Cáucaso ao Báltico. Os bolcheviques rasgaram todos os tratados assinados pelos seus predecessores. Longe de estar terminado, o “Grande Jogo” recomeçaria com renovado vigor e uma nova face, pois Lenine pretendia “pegar fogo ao Oriente” com o “evangelho” do Marxismo.32
Os Czares tinham permitido e apoiado as religiões e as instituições sociais existentes, bem como jornais e escritos em línguas turcas e persa. Esta descentralização foi destruída pela revolução bolchevista em 1917, que introduziu novas noções de nacionalidade e dividiu os territórios etnicamente heterogé neos em regiões administrativas que não respeitaram as etnias existentes. Em 1936, foram criadas as “Repúblicas Socialistas Soviéticas” da Arménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Geórgia, Quirguizistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.33
A revolução bolchevique de 1917 anulou os tratados existentes e deu início a uma segunda fase do “Grande Jogo”. A 3.ª Guerra Anglo‑Afegã (1919) foi precipitada pelo assassinato do líder de então, Habibullah Khan. O seu sucessor, Amanullah, declarou independência total e atacou a fronteira Norte da Índia britânica, embora com pouquíssimos resultados. O Acordo de Rawalpindi concedeu autodeterminação completa ao Afeganistão em política externa. Em Maio de 1921, o Afeganistão e a URSS assinaram um tratado de amizade. A URSS fornecia a Amanullah ajuda monetária, tecnológica e militar, fazendo desvanecer a influência britânica. Apesar disto, as relações soviético‑afegãs continuaram equívocas, tendo Amanullah oferecido abrigo aos muçulmanos fugidos da URSS, bem como aos nacionalistas indianos exilados.
O Reino Unido impôs sanções económicas e diplomáticas insignificantes, temendo que Amanullah escapasse à sua esfera de influência e percebendo que a política do governo afegão era controlar todas as tribos de língua pashtu, de ambos os lados da fronteira.
Com o advento da 2.ª Guerra Mundial, em 1940, os interesses da URSS e do Reino Unido convergiram na expulsão de um grande contingente não diplomático alemão, tido como envolvido em actividades de espionagem.
Com o fim da 2.ª Guerra Mundial e o início da “guerra‑fria”, os EUA substituíram o Reino Unido como poder global, afirmando a sua influência no Médio Oriente na extracção de petróleo, contenção da URSS e acesso a outros recursos. Este período foi baptizado por vários analistas no início dos anos 1990’s, como uma luta mais abrangente, o “Novo Grande Jogo”, face à analogia dos acontecimentos envolvendo a Índia, o Paquistão, o Afeganistão e, mais recentemente, as novas repúblicas da Ásia Central. Segundo Lutz Kleveman, a campanha russa no Afeganistão foi apenas mais um mero episódio desse “Novo Grande Jogo”.34
Hoje, os actores são diferentes e as regras do jogo neocolonial são muito mais complexas do que as de há um século atrás. Centraliza‑se nas reservas energéticas do Mar Cáspio (petróleo e gás natural). Nas suas margens e nos seus fundos, estão as maiores reservas inexploradas de combustíveis fósseis.
4. O Eurasianismo
Na geopolítica russa do final do século XIX, o Eurasianismo lutava por se sobrepor às tendências reformistas pró‑ocidentais e ao movimento eslavófilo. O papel ímpar da Rússia era juntar a rica diversidade da Eurásia numa “terceira via”, consistente com a cultura e as tradições da Ortodoxia e da Rússia.35
Baseado nas ideias de Mackinder, o Eurasianismo procurava estabelecer a identidade ímpar da Rússia, distinta da Ocidental e focava a sua atenção para Sul e Leste, sonhando numa fusão entre as populações ortodoxas e muçul manas.36 Rejeitava categoricamente o projecto do Czar Pedro para “europeizar” a Rússia, mas os termos em que se idealizava o país eram idênticos aos de um império europeu, pela simples circunstância que englobava territórios, a maioria dos quais se localizavam na Ásia, em que um grupo nacional dominava outras nacionalidades subordinadas. Defendia que a Rússia era claramente não europeia porque a vasta região ocupada, apesar de situada entre os dois continentes – Europa e Ásia – era geográfica e, logo, objectivamente separada de ambos. Era um continente em si mesmo, denominado Eurásia; além disso, a cultura russa tinha sido maioritariamente moldada por influências vindas da Ásia.37
Durante a 1.ª Guerra Mundial, surgiram os primeiros dilemas e ambiguidades, quando a Rússia se aliou à Grã‑Bretanha, à França e aos EUA, lutando contra os seus aliados geopolíticos naturais – Alemanha e Áustria – com o intuito de libertar os seus “irmãos eslavos” do domínio turco, mas também mergulhando numa revolução e numa guerra civil catastróficas.38
Estas ideias acerca da geopolítica da Eurásia e do destino do Império Russo, foram retomadas no período a seguir à 1.ª Guerra Mundial pelo etnólogo e filólogo Nikolai S. Trubetskoy, nobre russo branco, pelo historiador Peter Savitsky, pelo teólogo ortodoxo G.V. Florovsky e, posteriormente, pelo geógrafo, historiador e filósofo Lev Gumilev, defendendo a luta cultural e política entre o Ocidente e o distinto sub‑continente da Eurásia, liderado pela Rússia. Aqueles teóricos da geopolítica eurasiana analisaram com profundi dade e atenção os impérios de Genghis Khan e Otomano, entre outros, tendo‑se encontrado várias vezes em Praga com Karl Haushofer.39 Gumilev foi o criador da “teoria da etnogénese”, pela qual as nações são originárias da regularidade do desenvolvimento da sociedade, e da “teoria da paixão”, a capacidade humana para se sacrificar em prol de objectivos ideológicos. Esteve 16 anos presos no tempo de Estaline, combateu na 2.ª Guerra Mundial, esteve num campo de concentração nazi e voltou a cumprir uma sentença de 10 anos no Gulag, por actividades contra a ideologia marxista‑leninista.40
A revolução de 1917 tinha terminado com a existência formal do Império Russo, e Trubetskoy adaptou o seu pensamento ao novo estado de coisas. Os russos, antes considerados como os “donos e proprietários” de todo o território, passaram a ser “um povo entre outros” que partilhavam a autoridade. O conceito de separatismo não era aceitável para Trubetskoy, que insistia na indivisibilidade da grande região que correspondia à Eurásia, uma ideia de integralidade geográfica, económica e étnica, distinta quer da Europa, quer da Ásia. Segundo Savitsky, a Eurásia tinha sido modelada pela Natureza, que tinha condicionado e determinado os movimentos históricos e a interpenetração dos seus povos, cujo resultado tinha sido a criação de um único Estado. Devido à unidade da região derivar da Natureza, possuía a qualidade transcendente dessa mesma Natureza.41
Trubetskoy afirmava que “o substrato nacional do antigo Império Russo e actual URSS, só pode ser a totalidade dos povos que habitam este Estado, tido como uma nação multiétnica peculiar e que, como tal, possuía o seu próprio nacionalismo. Chamamos a essa nação Eurasiana, o seu território Eurásia e o seu nacionalismo Eurasianismo.”42
Para Alexander Dugin, o principal ideólogo eurasianista da actualidade, as civilizações marítimas estiveram sempre ligadas ao “primado da economia sobre a política”. Segundo ele, Mackinder demonstrou claramente que, nos últimos séculos, a cultura marítima foi sinónimo de “Atlantismo”, personifi cado no Reino Unido e nos EUA, defendendo a prioridade do individualismo, do liberalismo e da “democracia protestante”. Ao contrário, o Eurasianismo pressupunha autoritarismo, hierarquia e comunitarismo, colocando o Estado nacional acima dos interesses individuais e económicos. Dugin afirmou que a liderança de Lenine tinha um substrato eurasiano pois, contrariamente à doutrina marxista, preservou a grande unidade do espaço eurasiano do Império Russo. Por seu lado, Trotsky insistia na exportação da revolução, na sua mundialização, e considerava a URSS como algo efémero e transitório, algo que desapareceria perante a vitória planetária do comunismo; as suas ideias traziam, por isso, a marca do “Atlantismo”! Para o mesmo autor, “a grande catástrofe eurasiana foi a agressão de Hitler contra a URSS. Após a guerra fratricida e terrível entre dois países geopolítica, espiritual e metafisicamente chegados, a vitória da URSS foi de facto equivalente a uma derrota”.43
5. A “Guerra‑Fria”
Apesar da “guerra‑fria” ter sido primária e fundamentalmente um confronto entre ideologias e não sobre geopolítica – alguns autores chamam‑lhe “geopolítica ideológica” – a Geopolítica desenvolvida pelos pensadores europeus do final do século XIX foi uma matéria importante para Estaline. O Pacto de Varsóvia, integrando os países da Europa de Leste na esfera soviética, insere‑se nesse projecto geopolítico como oposição à OTAN, criando uma “zona tampão” (“buffer zone”) de estados‑satélite que impedissem a repetição dos traumas causados pelas invasões de Napoleão e de Hitler. A “guerra‑fria” fez com que a URSS utilizasse meios militares na sua zona geopolítica para fazer face a levantamentos populares na Polónia, na Hungria, na Checoslováquia e no Afeganistão, com justificações equivalentes à teoria americana do “dominó”44.
A justificação para esta atitude ficou conhecida como a “doutrina Brezhnev” (1968), onde se articulavam os limites dentro dos quais os Estados‑satélite comunistas da Europa Oriental podiam operar. Qualquer decisão desses Estados que pudesse por em causa o socialismo nesse país, os interesses fundamentais do socialismo noutros países, ou o movimento comunista a nível mundial, justificavam a intervenção militar soviética, estando o exército vermelho apenas a ajudar o povo a exercer a sua autodeterminação num sentido ideológica e geopoliticamente correcto.45 “Cada Partido Comunista é responsável não só perante o seu povo, mas também perante todos os países socialistas e o inteiro movimento comunista. (...) A soberania individual de países socialistas não se pode sobrepor aos interesses do socialismo e do movimento revolucionário mundiais. (...) Cada Partido Comunista é livre de aplicar os princípios do Marxismo‑Leninismo e do socialismo no seu país, mas não se pode desviar desses princípios”46
O “encarregado de negócios” americano em Moscovo em 1946, George Kennan, expôs o seu conceito sobre a URSS como sendo uma potência com uma determinação e uma necessidade, históricas e geográficas, de se expandir. Esta era a essência da URSS e nada podia ser feito contra tal; não se podiam estabelecer acordos com a URSS.47
A partir de 1937, como em muitos outros domínios, a reflexão estratégica deixou de existir na URSS. A URSS devia ser uma fortaleza, simultaneamente esquadrinhada, fechada no seu interior (Gulag), e hermeticamente fechada sobre o exterior. O ensino da Geopolítica foi interdito na URSS, por ser a disciplina maldita de uma Alemanha malévola.48 Toda a ciência se tornou marxista‑leninista, sendo Estaline o grande mestre. Durante os últimos anos do estalinismo, apesar do aparecimento do átomo e dos foguetões, a reflexão continuou bloqueada. De facto, o que poderiam pesar tais evoluções nos armamentos face às teorias enunciadas pelo “genial” Estaline? Apenas após a sua morte se retomou, timidamente, a reflexão sobre uma eventual guerra futura.
A ideia da não‑inevitabilidade das guerras entre os dois sistemas políticos foi aflorada por Estaline apenas na sua última intervenção pública, em Outubro de 1952, provavelmente influenciado pelas ideias de Malenkov, o seu delfim. Foi a partir dessa altura que os soviéticos aceitaram o dogma da coexistência pacífica, que iria ser retomado mais tarde, face à evolução da relação de forças entre os dois sistemas, na qual a arma atómica tinha um lugar de destaque. Contudo, durante a primeira metade da década de 50, antes de conseguir capacidade nuclear intercontinental, a URSS viveu aterrorizada pela eventualidade de uma ofensiva ocidental.49
Desde o final da 2.ª Guerra Mundial, uma figura chave na geopolítica soviética foi o General Sergey M. Shtemenko, que chegou a ser, durante os anos 60’s, comandante das forças armadas do Pacto de Varsóvia e Chefe do Estado‑Maior General da URSS. Nos seus planos estratégicos, estava, desde 1948, a penetração económico‑cultural no Afeganistão, afirmando que aquele país tinha um papel geopolítico especial, permitindo o acesso soviético ao Índico. Khrutschev tinha conceitos geoestratégicos exclusivamente baseados no emprego de mísseis intercontinentais, em detrimento das outras armas. Estava preocupado com a América Latina e insistia no conceito de “guerra nuclear intercontinental relâmpago”. Ao contrário, Shtemenko já tinha alertado que não seria sensato basear a segurança da URSS apenas em mísseis balísticos intercontinentais.50
Entre o fim dos anos 60’s e a metade dos anos 80’s, a marinha soviética conheceu uma ascensão considerável, resultado da conjugação de um projecto político, de uma visão estratégica para fazer da URSS uma potência mundial e de uma conjuntura internacional favorável a esse projecto. “Khrutschev teve bastante pena de não ter porta‑aviões durante a crise de Cuba”, dizia‑se em Moscovo. Exigiu por isso uma modernização das forças navais e o desenvolvimento de uma frota de alto mar. Por essa altura, a descolonização criou, principalmente em África, uma série de vazios políticos que interessava preencher. Este programa de construção naval reforçou o empenhamento da URSS numa política realmente mundial.
Porém, a própria configuração do território soviético não permitia o acesso permanente a mares abertos, quer por razões climatéricas (Murmansk e Vladivostok), quer por estarem “fechados” por estreitos controlados pela OTAN (estreitos turcos e dinamarqueses). Além disso, a qualidade dos navios não podia rivalizar com a dos EUA. Por isso, apesar do esforço enorme de aumento da capacidade naval, a URSS nunca conseguiu apresentar‑se como uma potência marítima capaz de conseguir obter o controlo dos mares.51
Um dos herdeiros das ideias geopolíticas e geoestratégicas de Shtemenko foi o Marechal N. V. Ogarkov, Chefe do Estado‑Maior General das forças armadas soviéticas entre 1977 e meados dos anos 80’s. Foi ele o responsável pela operação contra a Checoslováquia, em que os serviços de informações da OTAN foram confundidos por uma desinformação excelentemente conduzida, e também pela adopção de uma opção doutrinária de guerra convencional limitada na Europa, como objectivo de planeamento e modernização dos armamentos convencionais.52 Ele afirmava que a função dissuasora das armas nucleares estratégicas era um assunto arrumado e que era conveniente modernizar os armamentos clássicos. “Uma guerra mundial pode começar a ser travada, por um tempo determinado, apenas com armamentos convencionais”. Vislumbra‑se aqui uma nova concepção estratégica, um conflito desenrolado exclusivamente na Europa com armas convencionais, justificação para o acréscimo do poder militar convencional no teatro europeu. Esta dissociação entre guerra total e guerra limitada, fez com que os soviéticos aceitassem sentar‑se à mesa das negociações SALT a partir de 1968. As negociações sobre a limitação de armas estratégicas contribuíram para o aparecimento de uma nova geração de pensadores estratégicos militares na URSS.
Mas, para levar a cabo tais operações em profundidade, os soviéticos tinham de contar com o desenvolvimento muito rápido da tecnologia ocidental de armamentos de nova geração, nos anos 70’s e 80’s. Ora, a indústria soviética de armamento não parecia estar à altura dessa “revolução industrial”, face à obsolescência do seu aparelho de produção e dos seus métodos de gestão. Daí, o grito de alarme de Ogarkov em 1984.
O debate foi pois geopolítico e geoestratégico mas, ao mesmo tempo, orçamental e estrutural, e surgiu bem antes da SDI.
O discurso de Brezhnev de 18 de Janeiro de 1977 marcou a adopção formal do conceito de dissuasão na doutrina estratégica soviética. A partir de 1979, multiplicaram‑se as referências, não só à dissuasão, mas também à ideia do absurdo de uma guerra nuclear e à impossibilidade de obter uma vitória numa tal guerra. Em 1981, Brezhnev afirmou que “o equilíbrio estratégico‑militar entre a URSS e os EUA, entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, servia objectivamente a manutenção da paz no planeta”.
O reconhecimento da dissuasão pelo poder soviético teve como resultado a inércia de nada fazer em matéria de modernização dos armamentos convencionais e, portanto, indirectamente, em reformar o conjunto da economia soviética. Mas os dados estratégicos modificaram‑se consideravelmente a partir de 1983, após o lançamento da SDI.53 Na década de 80’s, tinha surgido uma nova geração de burocratas soviéticos, ansiosos por salvar o sistema comunista da estagnação, da corrupção e da hiper‑extensão imperial (por demais evidente na campanha militar desastrosa no Afeganistão). O nome mais sonante dessa geração foi Mikhail Gorbachev. Ao declarar que “nenhum país detém o monopólio da verdade”, assinalou o fim da “doutrina Brezhnev” como o princípio geopolítico orientador das relações entre a URSS e os regimes comunistas da Europa Oriental.54
A sua chegada ao poder, em 1985, apressou a mudança das atitudes. Para os líderes ocidentais, a vontade soviética de renunciar à “Doutrina Brezhnev” e de desistir da “luta anti‑imperialista” no Terceiro Mundo, eram sinais evidentes de que a “perestroika” era um facto real.
Quando o comunismo soviético entrou em colapso, Gorbatchev e os seus sucessores lideravam um Estado suficientemente poderoso para controlar um povo ainda amedrontado, mas demasiado fraco para administrar uma economia aberta. A evolução que se tem verificado na Rússia, sobre os escombros do regime comunista, é um processo em que as transformações políticas e económicas têm acontecido simultaneamente, mas com primazia para as políticas, tornando‑o assim ainda mais difícil. A realidade é que não existe cultura democrática na Rússia. Há muitos séculos que é um Estado imperial, muito antes de ser comunista. Este facto é fundamental para se poder analisar com rigor a sua possível evolução.
6. O “Novo” Eurasianismo
O que irá ser a Rússia? Um Estado‑Nação ou um império multinacional? Zbigniew Brzezinski afirma que “a Rússia será um império ou um estado democrático, mas nunca ambos ao mesmo tempo”.55
A evolução da orientação geopolítica da Rússia liga‑se à busca de uma identidade pós‑soviética e ao seu lugar no mundo após o colapso do comunismo.
Em grandes linhas, existem duas aproximações quanto às opções geopolíticas da Rússia: os internacionalistas liberais ou “ocidentalizadores” e os eurasianistas. Os primeiros (Gorbatchev, Kozyrev, Yeltsin, Trenin, etc.) crêem que os valores ocidentais do pluralismo e da democracia são universais e aplicáveis à Rússia. Os segundos (Dugin, Zhirinovsky, Zyuganov, Solzhenitsyn, etc.) têm linhas ideológicas nacionalistas e patrióticas que acreditam que, devido às particularidades geográficas, históricas, culturais e mesmo psicológicas, a Rússia não pode ser classificada como Ocidental ou Oriental, sendo um Estado forte e dominante na Eurásia. O Eurasianismo conseguiu reconciliar filosofias muitas vezes contraditórias como o comunismo, a religião ortodoxa e o fundamentalismo nacionalista, conquistando adeptos ao longo de todo o espectro político.
Contra o “Atlantismo”, personificando o primado do individualismo, liberalismo económico e democracia protestante – representado primariamente pelo bloco anglo‑saxónico – ergue‑se o “Eurasianismo”, personificando princípios de autoritarismo, hierarquia e o estabelecimento de um comunitarismo, sobrepondo‑se às preocupações de índole individualista e económica.56
O Partido Eurasianista foi fundado por Alexander Dugin em Maio de 2002, supostamente com apoio organizacional e financeiro do Presidente Putin que, desde que assumiu a presidência da Rússia, em Dezembro de 1999, alterou o rumo da política externa de Moscovo. De facto, o Eurasianismo, essa obscura e velha moldura geopolítica e ideológica, ganhou rapidamente impor tância, emergiu como uma força maioritária nos meios da política externa russa e, mais significativo ainda, é cada vez mais evidente na conduta daquela política pelo Presidente. Grande parte deste novo alento do Eurasianismo deve‑se a Dugin, seu principal ideólogo. Apesar do seu passado obscuro (antigo membro duma organização radical anti‑semita e, posteriormente, da Revolução Conservadora racista, Dugin é hoje considerado o principal geopolítico russo e é conselheiro de assuntos internacionais de várias figuras proeminentes da Duma. As suas ideias têm influenciado o líder do Partido Comunista, Gennady Zyuganov, o ex‑ministro da defesa Yevgeny Primakov, Vladimir Zhirinovsky e outros altos dignatários.
Dugin analisou com profundidade e atenção os trabalhos de Trubetskoy, Savitsky e Florovsky, adaptou as teorias tradicionais de Mahan e Mackinder e postulou uma luta pelo domínio internacional entre as potências terrestres – personificadas na Rússia – e as potências marítimas – principalmente os EUA e o Reino Unido. Como resultado, Dugin crê que os interesses estratégicos da Rússia devem ser orientados de um modo anti‑ocidental e para a criação de um espaço Eurasiático de domínio russo. Por outras palavras, a Rússia não poderá subsistir fora da sua essência imperial, pela sua localização geográfica e caminho histórico.57 A Rússia é uma civilização distinta, diferente do Ocidente nos seus valores culturais, bem como nos interesses e preocupações de segurança.
A ideia de Mackinder sobre a oposição geopolítica entre potências marítimas e terrestres, foi levada ao extremo por Dugin, que postulou que os dois mundos não são apenas regidos por imperativos geoestratégicos antagónicos, mas também são opostos culturalmente. As sociedades terrestres, teoriza ele, tendem normalmente a ter sistemas de valores e tradições absolutas e centralizadoras, enquanto que as sociedades marítimas são inerentemente liberais.
Muitos intelectuais russos que um dia pensaram que a vitória da sua pátria seria um resultado inevitável da história, colocam agora a sua esperança em ver regressar a Rússia à grandeza numa teoria que é, em muitos aspectos, o oposto do materialismo dialéctico. A vitória será encontrada na geografia, não na história; no espaço, não no tempo.58
“O novo império eurasiano será construído no princípio fundamental do inimigo comum: a rejeição do ‘Atlantismo”, controlo estratégico dos EUA e na recusa em aceitar valores liberais para nos dominar. Este impulso civilizacional comum será a base de uma união política e estratégica”. Dada a presente situação internacional pouco influente da Rússia, Dugin reforça a necessidade de construir alianças que sirvam para aumentar o domínio político e económico. Assim, põe ênfase num eixo Moscovo‑Teerão e na criação de uma zona de influência iraniana no Médio Oriente. Na Europa, advoga um eixo Moscovo‑Berlim, que vê como essencial para a criação de um “cordão sanitário” contra a influência ocidental no antigo bloco soviético.59
Por outro lado, o Eurasianismo opõe‑se também ao “wahabismo satânico”, que ameaça e põe em risco a sua fronteira Sul, aquilo a que W. Churchill chamou “o baixo‑ventre da Rússia”, para onde se dirigem as suas actuais aspirações de hegemonia.60 No respeitante à política externa, o Eurasianismo defende que o caminho que o Ocidente tomou é destrutivo; a sua civilização é espiritualmente vazia, falsa e monstruosa; por detrás da prosperidade económica, está uma degradação espiritual total. Os EUA exploraram a mágoa pelos ataques terroristas de 11 de Setembro, e sob a capa da luta contra o terrorismo, para fortalecer as suas posições na Ásia Central, zona de influência russa. A Europa, apesar de ser cultural, social e politicamente chegada aos EUA, tem preocupações geopolíticas, geoestratégicas e económicas semelhantes à Rússia e à Eurásia.
Quanto à política interna, pretende reforçar a unidade estratégica da Rússia, a sua homogeneidade geopolítica e a linha vertical de autoridade, reduzir a influência dos clãs oligárquicos, combater o separatismo e o extremismo, e apoiar a economia nacional.61
O que torna Dugin notório e preocupante é que o seu pensamento faz lembrar, em certos aspectos, Hitler: fala sobre capitalismo, baseado numa combinação de nacionalismo e socialismo. As suas teorias foram banidas durante a época soviética pelas suas ligações ao Nazismo, mas são hoje aceites sem relutância pelo Partido Comunista.62
O colapso da URSS e o fim da Guerra fria levou a uma alteração dramática na configuração da geopolítica da Eurásia. Uma das consequências mais importantes dessa alteração foi a aparição de novas repúblicas independentes na Ásia Central, ao longo da fronteira Sul da Rússia: Cazaquistão, Quirguizistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão na Ásia Central; Arménia, Azerbaijão e Geórgia no Cáucaso.
Dada a posição geoestratégica da região, uma área de ligação natural e de trânsito entre a Europa, o Médio Oriente e a Ásia, ela constitui um elo importante de comércio. Ao mesmo tempo, os enormes recursos petrolíferos e de gás natural da região, transformaram‑na num local de enorme competição/cooperação.
As determinantes fundamentais da postura russa presentemente, tão evidentes na governação do Presidente Putin, são o declínio acentuado do seu poder nacional na primeira metade da década de 90’s, a enorme prioridade dos problemas económicos e sociais internos, especialmente durante a presidência de Yeltsin, o conflito na Tchetchénia, o alargamento da OTAN, e o grande retraimento das suas aspirações externas, juntamente com o fim da “missão de grande potência”, e a prudente avaliação dos “objectivos/capacidades” e dos “custos/benefícios”.63
Estas considerações são fundamentais na posição da Rússia face à Ásia Central. A Rússia sempre considerou a região como o seu “quintal” estratégico, mas não teve os recursos políticos, económicos e militares para manter a sua influência na década que se seguiu ao colapso da URSS. De qualquer modo, a Rússia espera manter a sua influência na Ásia Central. A limitada definição dos seus requisitos de segurança leva a Rússia a ver aquela região como uma “zona tampão” (“buffer zone”), em especial das forças do revivalismo islâmico.64
A doutrina consensual da “vizinhança próxima” define que a Rússia quer manter um papel político, económico e estratégico preponderante naquelas ex‑repúblicas da URSS, legitimando uma intervenção militar, se necessário. Contudo, a incapacidade da Rússia implementar as necessárias reformas nas suas Forças Armadas e na sua economia, em conjunto com a hostilidade com que a sua presença é vista, limita as suas possibilidades de cooperação e faz diminuir a sua influência, em especial no Cáucaso, em detrimento dos EUA. A Rússia vê assim a sua posição na região ameaçada pela expansão militar americana e da OTAN, bem como pelos seus próprios problemas internos (a guerra na Tchechénia fez com que as relações com a Geórgia, a quem acusa abertamente de abrigar terroristas tchetchenos, se deteriorasse muito). Para contrabalançar esta situação, propôs uma cooperação triangular com a China e com a Índia através da Organização de Cooperação de Xangai (com Cazaquistão, Quirguizistão e Tadjiquistão) e estabeleceu uma relação privilegiada com o Irão.
Feng Shaolei afirma que durante a primeira fase do período pós‑guerra‑fria (1991‑1993), o vácuo geopolítico criado deveu‑se à política russa para a região. Fazendo um esforço enorme para ter relações mais estreitas com os EUA e o Ocidente, a Rússia desperdiçou muitas oportunidades de preservar a sua influência na Ásia Central, e alcançar a integração económica, política e militar, pois a maioria dos líderes da região eram antigos colegas de Boris Yeltsin no Comité Central do Partido Comunista ou tinham obtido as suas posições com a sua ajuda. Mesmo assim, apesar desta política oficial, a Rússia manteve grande influência.
Na fase seguinte, de 1994 a 1996, a Rússia perdeu o controlo sobre os acontecimentos. As ex‑repúblicas da Ásia Central evoluíram de proto‑estados para estados plenos, com os respectivos atributos.
Uma terceira fase da política russa para a Ásia Central começou na segunda metade de 1996, quando a orientação pró‑ocidental do Ministro dos Negócios Estrangeiros Andrei Kozyrev deu lugar à orientação eurasianista de Yevgenyi Primakov. A Rússia fez então esforços titânicos para restaurar a sua influência e teve um papel importante no problema dos oleodutos e gasodutos da região.
A política russa para esta região não se alterou radicalmente até 1999/2000, quando as relações com o Ocidente caíram para o nível mais baixo, em virtude da crise do Kosovo, dos ataques extremistas no Quirguizistão e no Uzbequistão e, especialmente, da ascensão de Vladimir Putin à presidência.
Entretanto, reforçava o seu controlo sobre os oleodutos e gasodutos, utilizando por vezes esse controlo como um mecanismo para controlar os Estados da região.65
A resposta dos EUA aos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, fez alterar a geopolítica global. Segundo D. Trenin, a política externa seguida por Putin a partir dessa data caracterizou‑se por uma inflexão nas suas escolhas estratégicas, dando a sua concordância à colocação de forças americanas em antigas bases soviéticas na Ásia Central, e apoiando o Ocidente na sua “guerra contra o terrorismo internacional”.66 No pensamento de Putin, a versão extremista do Islão é uma das maiores ameaças para a Rússia.
Apesar disto, nos seus esforços para manter os EUA longe da região do Cáspio, o Irão encontrou um aliado inesperado na Rússia. Ambos puseram temporariamente as suas divergências de lado, para fazer frente às actividades americanas na área. A aliança russo‑iraniana pode aliás considerar‑se um dos mais importantes factos geopolíticos do pós‑guerra‑fria. Para a Rússia, uma relação estreita com o Irão pode considerar‑se como uma reacção à expansão da OTAN para a Europa Oriental. O fornecimento de material militar convencional e de tecnologia nuclear russa ao Irão é um dos aspectos fulcrais desta aliança, já que muito poucos países estão interessados em fornecer armas ao regime dos “ayatollahs”. O Irão confia na Rússia como fornecedor de armamento, dado não existirem muitos países que o queiram fazer; a Rússia também vê vantagens e lucros no fornecimento de armamento, nuclear inclusive, ao Irão.
A possível influência iraniana no fundamentalismo islâmico, na opinião pública russa, é bastante limitada e claramente exagerada pelos políticos ocidentais. Em primeiro lugar, os iranianos são etnicamente Indo‑Arianos e, portanto, bastante diferentes de outras etnias da região Sul da ex‑URSS, que são de origem turca ou caucasiana, à excepção dos Tadjiques. Em segundo lugar, o Irão pertence à facção Shiita do Islão, ao passo que a maioria da população muçulmana da Ásia Central (à excepção do Azerbaijão) é Sunita. Em terceiro lugar, as elites locais não pretendem adoptar a forma de governo teocrática imposta no Irão. Em quarto lugar, o Irão não está economicamente em posição de iniciar uma modernização estrutural na Ásia Central e no Cáucaso, apesar de possuir divisas dos petro‑dólares.
Muitos políticos e peritos russos estão bastante mais alarmados com a Turquia, devido à sua proximidade geográfica, cultural, étnica e religiosa à maioria das ex‑repúblicas soviéticas, bem como o seu potencial económico e apoio político ocidental. Além disso, o modelo secular de desenvolvimento turco pode atrair os regimes da Ásia Central que procuram exemplos para seguir.67
7. O Petróleo
Sabia‑se da existência de petróleo no Cáucaso e na Ásia Central desde o século XIII e foi factor importante no “Grande Jogo” do século XIX. No final deste século, com as capacidades tecnológicas aumentadas, a exploração das reservas petrolíferas emergiram como um factor primordial na competição, e o Jogo intensificou‑se.
Até ao início do século XX, a principal actividade económica da Ásia Central estava ligada ao algodão, ao curtimento de couro, ao processamento da lã e à fiação da seda. Durante a 1.ª Guerra Mundial, os alemães tentaram conquistar a região petrolífera de Baku, na margem ocidental do Mar Cáspio, para continuar a alimentar o esforço de guerra, o que não conseguiram. Na 2.ª Guerra Mundial, Hitler parece ter tido a mesma determinação, estando consciente em 1942 que, se falhasse o controlo do petróleo do Cáucaso, perderia a guerra.68
A data crítica para o petróleo deu‑se em 1912, quando a Marinha Inglesa decidiu converter a propulsão dos navios de combate do carvão para o petróleo. Esta transição deu aos navios britânicos uma vantagem significativa em velocidade e autonomia sobre os seus adversários, em especial a Alemanha. Mas, por outro lado, colocou a Londres um outro dilema: se bem que bastante rica em carvão, a Grã‑Bretanha tinha poucos recursos petrolíferos domésticos e ficava dependente de importações.
Expandiu os seus interesses petrolíferos ao Golfo Pérsico e fortaleceu a sua posição na Pérsia (hoje Irão). A França, por seu turno, conseguiu concessões importantes em Mosul, no Noroeste do Iraque, enquanto a Alemanha e o Japão planeavam abastecer‑se na Roménia e nas Índias Orientais Holandesas (hoje Indonésia). A tentativa japonesa de se abastecer nas Índias Orientais Holandesas levou à imposição de um embargo de exportações para o Japão o que, por seu turno, persuadiu os japoneses que uma guerra com os EUA era inevitável, levando‑os ao ataque de surpresa a Pearl Harbor. No teatro europeu, a desesperada necessidade da Alemanha em obter petróleo, levou à invasão da Rússia em 1941, para alcançar Baku.
A riqueza mineral da Ásia Central só foi, na realidade, apenas descoberta a partir de meados do século XX pois, até aí, estava restrita à margem ocidental do Mar Cáspio, junto ao Cáucaso.69
As reservas de petróleo e de gás natural da região do Mar Cáspio são sem dúvida significativas. Nos cinco países que circundam aquele mar (Azerbaijão, Cazaquistão, Irão, Rússia e Turcomenistão) estão comprovados cerca de 154x109 de barris de petróleo70 e cerca de 76,5x1012 de metros cúbicos de gás natural. Em termos de percentagem, aqueles cinco países possuem cerca de 15% das reservas mundiais comprovadas de petróleo, e cerca de 50% das de gás natural.71
Estes vastos recursos energéticos transformaram a região numa área de grande competição e de cooperação, entre actores estatais e não‑estatais, pelo controlo daqueles recursos. O fim da “guerra‑fria”, o processo de globalização e a internacionalização das actividades do Estado como consequência principal daquela, transformaram o modo como o mundo pode ser compreendido, levando a uma reformulação do conceito de geopolítica. Este contexto “pós‑guerra‑fria” é pertinente para compreender a actual geopolítica da Ásia Central.72 Novos Estados, sem experiência anterior de independência, numa região onde a dissolução da URSS criou um vazio de poder.73 De facto, a conquista da soberania alcançada pelas ex‑repúblicas soviéticas não foi apoiada e baseada em regras, normas e mecanismos políticos apropriados que assegurem uma coabitação civilizada entre a Rússia e os novos estados.
8. O Futuro
As orientações políticas russas emergentes ligam‑se à busca de uma identidade nacional renovada e do seu lugar no mundo e nos assuntos internacionais, após o colapso soviético. Daí o ressurgimento de um discurso Eurasianista na política externa, após a chegada de Putin à presidência. Esta alteração foi posteriormente acentuada com as alterações geopolíticas introduzidas pela administração Bush como resposta aos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001. Parece óbvio que a Rússia fez uma “escolha estratégica” ao emparceirar com o Ocidente na “guerra contra o terrorismo internacional”.
As maiores preocupações da Rússia dizem respeito ao controlo das rotas de exportação dos recursos energéticos. O maior objectivo de Moscovo é assegurar que uma parte significativa dos recursos energéticos do Cáspio seja transportada pelo sistema russo de oleodutos para o Mar Negro e, daí, para a Europa. Porém, o sistema existente de oleodutos e gasodutos da era soviética é considerado como obsoleto, feitos com materiais de qualidade duvidosa e com manutenção de má qualidade técnica, que se estão a deteriorar com o tempo. As novas repúblicas procuraram por isso outras opções para se distanciar e não depender da Rússia, e serem capazes de alcançar mercados diversificados.
Para tentar manter a sua influência nas exportações dos produtos energéticos, a Rússia apoia apenas oleodutos que passem através do seu território.74 Todavia, as tentativas russas para retardar os projectos de desenvolvimento liderados por outras potências, levaram ao estudo de rotas alternativas para levar os recursos até aos mercados, prejudicando a posição da Rússia como potência dominante na região e fazendo‑a perder o controlo sobre os recursos energéticos da região e do seu transporte.75
Para a Rússia, os alvos geopolíticos primários para a subordinação política parecem ser o Cazaquistão e o Azerbaijão. A subordinação deste último ajudaria a “selar” a Ásia Central do Ocidente, especialmente da Turquia. O Azerbaijão, encorajado pela Turquia e pelos EUA, rejeitou os pedidos russos para a manutenção de bases militares no seu território e desafiou também as exigências daquele país para um único oleoduto com terminal no porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro. A acrescentar ao oleoduto de Baku para Supsa, na Geórgia, a Turquia, o Azerbaijão e a Geórgia assinaram em 1999 um acordo para a construção de um oleoduto ligando Baku ao porto turco de Ceyhan, no Mediterrâneo, evitando assim definitivamente o território russo. Moscovo sentiu isso como uma humilhação geopolítica que prenunciava uma grave perda de influência no Cáucaso.76 É neste contexto que se encontra a explicação mais plausível para os recentes problemas de fornecimento de gás natural à Geórgia e para o diferendo com a Ucrânia sobre o mesmo combustível.
A vulnerabilidade étnica do Cazaquistão (cerca de 40% da população é russa) torna quase impossível uma confrontação aberta com Moscovo, que pode também explorar o receio do Cazaquistão sobre o crescente dinamismo da China. Para tentar diminuir as iniciativas unilaterais de desenvolvimento das novas repúblicas, nomeadamente as duas referidas atrás, tem utilizado também a incerteza quanto ao regime legal do Mar Cáspio, ainda por acordar.
Ao bloquear ou atrasar novos projectos de oleodutos, a Rússia conseguiu vencer praticamente todos os negócios energéticos, com investimentos pequenos. Porém, o actual sistema de oleodutos não possui a capacidade para o aumento de produção que se prevê para o Cazaquistão e para o Azerbaijão e, se tiverem de construir mais, a Rússia gostaria que passassem por território seu.77
A Tchetchénia era uma região autónoma gozando já de uma larga autonomia, quando declarou unilateralmente a sua independência em 1994. A Rússia decidiu resolver o assunto pela força por duas razões principais: em primeiro lugar porque, se a Tchetchénia fosse autorizada a sair da Federação Russa, seria um perigoso precedente que outras repúblicas predominante mente islâmicas do Norte do Cáucaso (Tcherkessia, Dagestão, Kabardin‑Balkar, etc.) poderiam querer seguir; em segundo lugar, a Tchetchénia é um ponto nevrálgico na rede de oleodutos vindos do Cáspio.
Se a materialização dos planos do oleoduto para Oeste falhar, todo o petróleo do Azerbaijão irá continuar a ser transportado pelo único oleoduto existente para o mar Negro, e esse atravessa a Tchetchénia. Se a Rússia quiser lucrar com o aumento de produção no Azerbaijão, tem de manter o controlo da república a todo o custo. Grozny, capital da Tchetchénia, é o centro de uma importante rede de oleodutos que liga a Sibéria, o Cazaquistão, o Cáspio e Novorossiysk.78
Outra ameaça séria à Rússia é o trânsito, importação e consumo de droga. De acordo com estimativas da ONU, dois ou três toneladas de heroína pura são transportadas anualmente da Ásia Central. Apenas há seis ou sete anos, a Rússia era principalmente um país de passagem no fornecimento de droga à Europa. Actualmente, é já um consumidor importante.79
Neste contexto, as prioridades de Putin parecem ser: a recuperação da economia russa; a restauração da Rússia enquanto grande potência; combater o fundamentalismo islâmico; controlar e eliminar as rotas do tráfico de estupefacientes; estabelecer um novo relacionamento de segurança com a Europa e com a OTAN; e resolver a questão nuclear estratégica com os EUA.
No plano político, a Rússia tentou avançar primeiro e rapidamente para a reforma política e chegou a um presidencialismo “inflacionado”, reduzindo os poderes das outras instituições governativas.
No plano económico, a Rússia não aprendeu as duas lições fundamentais que se podem extrair da experiência histórica da evolução da democracia: promover um desenvolvimento económico autêntico e sustentado e construir instituições políticas transparentes e equilibradas. A Rússia falhou em ambos os aspectos. Está a fazer o contrário da China, que está a reformar a sua economia antes do sistema político.80
No âmbito da política de segurança, o fundamentalismo islâmico constitui a maior preocupação da Rússia. Os líderes russos consideram os “talibans” do Afeganistão e movimentos similares como ameaças ao Cáucaso e às recém‑independentes repúblicas da Ásia Central, antigas repúblicas soviéticas e ainda regiões de grande relevância para a segurança da Rússia.
Estas preocupações levaram Putin a tratar os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 como uma oportunidade para cooperar com o Ocidente relativamente ao desafio fundamentalista que, de qualquer modo, sentia já estar no seu caminho.81 Após aquele evento, a Rússia começou a ajudar os EUA no problema afegão, passando toda a informação que possuía sobre terroristas islâmicos e a sua experiência no montanhoso país. Pela primeira vez desde o início da 2.ª Guerra Mundial, ambos os países tinham um inimigo comum! A Rússia concordou mesmo com a presença de tropas americanas no Uzbequistão e no Quirguizistão, porque Washington não conseguiu arranjar uma infra‑estrutura militar no Paquistão.82
Por outro lado, todavia, não hesitou em entrar em conflito com a Ucrânia, ameaçando cortar o fornecimento de gás natural, facto que não deixa de conter dois alertas: a afirmação de que não prescinde de continuar a manter a Ucrânia na sua esfera de influência, e um sério aviso à UE, face à profunda dependência energética desta.
Porém, para a Rússia, a política internacional ainda é um “jogo de soma zero”: se houver vencedores, tem de haver vencidos.
As elites ocidentais têm ultimamente empreendido uma intensa campanha na opinião pública contra Putin, desde que ele nacionalizou a Yukos Oil – após a declaração de falência desta em 2006 – e a colocou sob o controlo da Gazprom (empresa controlada pelo Estado, que detém 51% das acções), que se está a tornar numa das maiores empresas petrolíferas do mundo.
Esta medida deu‑lhe grande popularidade interna (mais de 70% de concordância com a decisão) e teve um efeito benéfico na estabilização do rublo e no aumento do nível de vida. Muitos russos recordam ainda as experiências falhadas de “mercado livre” de Yeltsin, que desbarataram a riqueza nacional e que contribuíram bastante para o declínio económico e para a perda de prestígio internacional da Rússia.
Putin está a abrir os mercados russos e a procurar satisfazer as grandes empresas petrolíferas, fazendo, ao mesmo tempo, crescer a economia russa. Crê que “a dependência mútua fortalece a segurança energética do continente europeu, criando boas perspectivas para a aproximação noutras áreas”.
O Ocidente tem criticado Putin por ter utilizado o petróleo e o gás natural para enviar “mensagens” à Geórgia e à Ucrânia. O vice‑presidente americano, Dick Cheney, chamou‑lhe mesmo “chantagem”. De qualquer modo, não é sensato irritar o homem que aquece as nossas casas e que abastece os nossos carros.
Tem razão, mas não estará a ser um pouco ingénuo? Várias civilizações têm sido trituradas para satisfazer a gula e a cobiça mundiais pelo petróleo. Poderá a Rússia ser poupada?83
Por seu lado, a Rússia tem‑se oposto tenazmente à política externa dos EUA, em assuntos que vão do Irão ao Sudão, ao Kosovo e à Coreia do Norte. Putin tem declarado que pretende um número multipolar, em vez de um unipolar. Contudo, nem a Coreia do Norte, nem o Sudão, nem o Irão têm importância estratégica fundamental para a Rússia; servem apenas para que possa ter uma voz de oposição oficial à política externa intervencionista americana. O objectivo de longo prazo é reestabelecer a influência internacional da Rússia.
A Cimeira UE‑Rússia, realizada em Outubro de 2007 em Lisboa, veio desbloquear alguns problemas existentes, tais como garantias quanto ao abastecimento energético à Europa e o levantamento do embargo da Rússia sobre carne e frescos da UE, nomeadamente da Polónia.
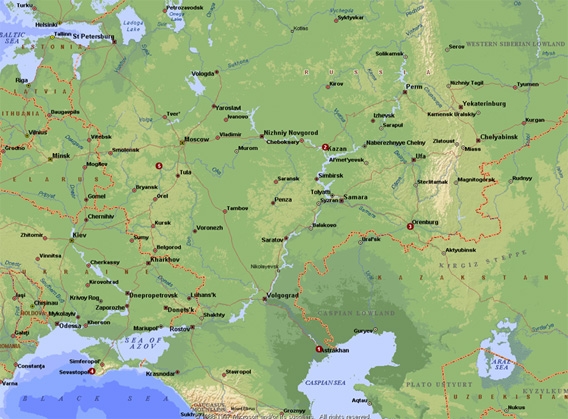
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
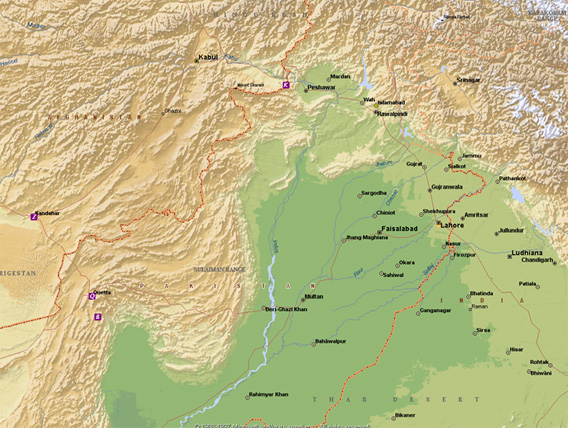
Fig. 4
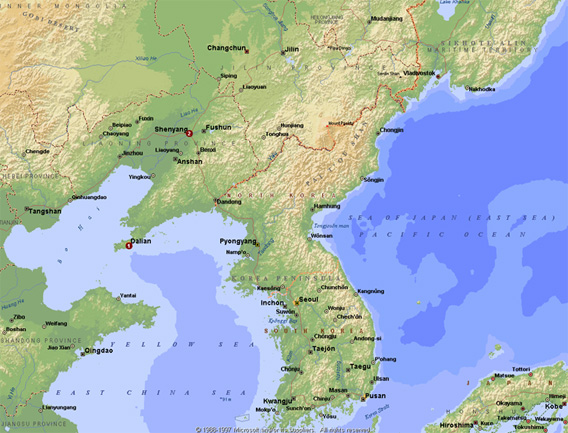
Fig. 5
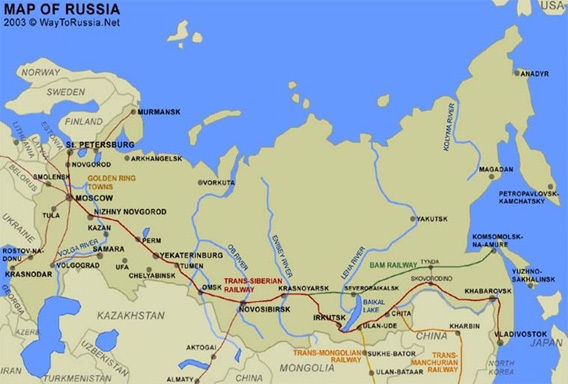
Fig. 6
AGNEW, John – “Geopolitics – Re‑visioning world politics”, Routledge, London, 1997.
AMINEH, Mehdi Parvizi – “Globalization, geopolitics and energy security in Central Asia and the Caspian region”, CEP, The Hague, 2003.
BRZEZINSKI, Zbigniew – “The grand chessboard”, Basic Books, New York, 1997.
CANAS, Vitalino – “Segurança e droga no Afeganistão: Chegou a altura de novas alternativas”, em “Segurança e Defesa”, n.º 1, Diário de Bordo, Novembro de 2006.
CLOVER, Charles – www.geocities.com/eurasia_uk/heartland.html
DAVIS, Elizabeth Van Wie & AZIZIAN, Rouben (editores) – “Islam, oil and geopolitics”, Rowman & Littlefield, Plymouth, 2007.
DUGIN, Alexander – “The great war of continents”, em www.bolsheviks.org/DOCUMENTS/THE%20GREAT%20WAR%20I.htm
DUGIN, Alexander – “The great war of continents”, em www.bolsheviks.org/DOCUMENTS/THE%20GREAT%20WAR%20II.htm
FORSYTHE, Rosemarie – “The geopolitics of oil in the Caucasus and Central Asia: Prospects for oil exploitation and export in the Caspian basin”, Adelphi Paper 300, IISS, Oxford University Press, 1996.
HAHN, GORDON M. – “The rebirth of Eurasianism”, 12Jul2002, em www.therussiajournal.com/index.htm?obj=6041
HANSEN, Sander – «Pipeline politics – The struggle for control of the Eurasian energy resources», Clingendael Institute, The Hague, 2003 HOPKINS, Peter – “The great game – The struggle for empire in Central Asia”, Kodansha International, New York, 1990.
ILAN BERMAN – “Slouching toward Eurasia?”, Outubro de 2001, em www.bu.edu/iscip/vol12/berman.html
KENNAN, George – “The sources of soviet conduct”, em “Foreign Affairs” n.º 25, 1947.
KLARE, Michael T. – “Resource wars – The new landscape of global conflict”, Owl Books, New York, 2001.
KLEVEMAN, Lutz, “The new great game: Blood and oil in Central Asia”, Atlantic Monthly Press, New York, 2003.
KLEVEMAN, Lutz, “The new great game: Blood and oil in Central Asia”, Atlantic Monthly Press, New York, 2003.
MARKETOS, Thrassy – “Eurasianist theory: Consequences to the strategic security of the russian muslim South”, em www.cacianalyst.org/view_article.php?articleId=3281
MOREAU‑DEFARGES, Philippe – “Introdução à Geopolítica”, Gradiva, Lisboa, 2003.
O’LOUGHLIN, John; O’TUATHAIL, Gearóig; e KOLOSSOV, Vladimir – “Russian geopolitical culture and public opinion: The masks of Proteus revisited”, em www.colorado.edu/ibs/PEC/johno/pub/Proteus.pdf
O’TUATHAIL, Gearóid; DALBY, Simon & ROUTLEDGE, Paul (editores) – “The geopolitics reader”, Routledge, London, 1998.
RAMONET, Ignácio – “Guerras do século XXI – Novos medos, novas ameaças”, Campo das Letras, Porto, 2002.
REIS RODRIGUES, Alexandre – “Energia: Uma questão candente de segurança”, em “Segurança e Defesa”, n.º 1, Diário de Bordo, Novembro de 2006.
SMITH, Graham – “The post‑soviet states: Mapping the politics of transition”, Edward Arnold, London, 1999.
SMITH, Graham – “The masks of Proteus: Russia, geopolitical shift and the new Eurasianism”, Transactions, Institute of British Geographers, 1999.
TOSTE, Octávio – “Teorias Geopolíticas”, Biblioteca do Exército, Rio de Janeiro, 1993.
TRUBETSKOY, Nikolai – “Pan‑Eurasian Nationalisms”, Ann Arbor, 1991. WHITNEY, Mike – “Energy politics: Putin gets mugged in Finland”, “Global Research”, October 22, 2006.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dugin
http://en.wikipdia.org/wiki/Eurasia_Party
http://perspectivesonrussia.wordpress.com/2007/09/25/russian‑geopolitics‑of‑20007
www.globalresearch.ca/index.php?
context=viewArticle&code=WHI20061022& articleId=3574 www.vor.ru/culture/culturarch235_eng.html www.tellur.ru/~historia/archive/06‑00/puskas.htm
___________
* Mestre em Estratégia pelo ISCSP.
___________
1 TOSTE, Octávio – “Teorias Geopolíticas”, Biblioteca do Exército, Rio de Janeiro, 1993, p. 1.
2 O’TUATHAIL, Gearóid – “Thinking critically about geopolitics”, em “The geopolitics reader”, Routledge, London, 1998, pp. 9, 15.
3 TOSTE, Octávio – obra citada, p. 31.
4 O’TUATHAIL, Gearóid – obra citada, p. 1.
5 O’TUATHAIL, Gearóid & AGNEW, John – “Geopolitics and discourse: Pratical geopolitical reasoning in american foreign policy”, em “The geopolitics reader”, p. 79.
6 AMINEH, Mehdi Parvizi – “Globalization, geopolitics and energy security in Central Asia and the Caspian region”, CEP, The Hague, 2003, p. 29.
7 HOPKINS, Peter – “The great game – The struggle for empire in Central Asia”, Kodansha International, New York, 1990, pp. 8‑13.
8 KENNAN, George – “The sources of soviet conduct”, em “Foreign Affairs” n. º 25, 1947, p. 576.
9 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 14‑15.
10 TOSTE, Octávio – obra citada, p. 9.
11 HOPKINS, Peter – obra citada, p. 446.
12 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 19‑33.
13 AGNEW, John – “Geopolitics – Re‑visioning world politics”, Routledge, London, 1997, pp. 87‑93.
14 HOPKINS, Peter – obra citada, p. 118.
15 CANAS, Vitalino – “Segurança e droga no Afeganistão: Chegou a altura de novas alternativas”, em “Segurança e Defesa”, n.º 1, Diário de Bordo, Novembro de 2006, p. 41.
16 HOPKINS, Peter – obra citada, p. 131.
17 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 149‑164.
18 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 168, 253, 270. 19 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Game, 2006‑08‑05.
20 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 281‑292.
21 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 301‑306.
22 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 312‑317.
23 HOPKINS, Peter – obra citada, p. 409.
24 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 351‑353.
25 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 377‑381.
26 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Game, 2006‑08‑05.
27 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 388‑389.
28 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 401‑416.
29 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Game, 2006‑08‑05.
30 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 438‑445.
31 MOREAU‑DEFARGES, Philippe, “Introdução à Geopolítica”, Gradiva, Lisboa, 2003, p. 107.
32 HOPKINS, Peter – obra citada, pp. 502‑522.
33 FORSYTHE, Rosemarie – obra citada, pp. 9‑10.
34 KLEVEMAN, “The new great game: Blood and oil in Central Asia”, Atlantic Monthly Press, New York, 2003, p. 2.
35 HAHN, Gordon M. – “The rebirth of Eurasianism”, 12Jul2002, em www.therussiajournal.com/index.htm?obj=6041, 2005‑01‑10. 36 HAHN, Gordon M. – obra citada.
37 BASSIN, Mark – “Classical Eurasianism and the geopolitics of russian identity”, em www.dartmouth.edu/~crn/crn_papers/Bassin.pdf, 2005‑01‑10.
38 DUGIN, Alexander – “The great war of continents”, em www.bolsheviks.org/DOCUMENTS/THE%20GREAT%20WAR%20I.htm, p. 7, 2005‑01‑10.
39 DUGIN, Alexander, obra citada, p. 4, 2005‑01‑10.
40 www.vor.ru/culture/cultarch235_eng.html, 2005‑01‑10.
41 BASSIN, Mark‑ obra citada, 2005‑01‑10.
42 Ibidem.
43 DUGIN, Alexander – obra citada, pp. 2‑8, 2005‑01‑10.
44 A teoria do “dominó” (William Bullit, 1947) postulava o medo do comunismo monolítico avançar no mundo através da China e da Ásia de Sudeste. Eisenhower defendeu‑a, afirmando que a perda da Indochina causaria a queda da Ásia de Sudeste como as pedras de um jogo de dominó. Serviu como base teórica para a intervenção americana no Vietname.
45 O’TUATHAIL, Gearóid – “Cold War geopolitics – Introduction”, em “The geopolitics reader”, Routledge, Londres, 1998, pp. 52‑53.
46 BREZHNEV, Leonid – “Soberania e a obrigação internacionalista dos países socialistas”, Pravda, 1968, citado em “The geopolitics reader”, pp. 74‑75.
47 O’TUATHAIL, Gearóid – “Cold War geopolitics – Introduction”, em “The geopolitics reader”, Routledge, Londres, 1998, p. 47.
48 MOREAU‑DEFARGES, Philippe – obra citada, pp.109‑110.
49 ROMER, Jean‑Christophe – “La pensée strategique russe au Xxe siècle”, em www.stratisc.org/pub/pub_ROMER_STRU_tdm, 2005‑01‑10.
50 DUGIN, Alexander – “The great war of continents”, em www.bolsheviks.org/DOCUMENTS/THE%20GREAT%20WAR%20II.htm, pp. 2‑4, 2005‑01‑10.
51 ROMER, Jean‑Christophe – obra citada, 2005‑01‑10.
52 DUGIN, Alexander – “The great war of continents”, em www.bolsheviks.org/DOCUMENTS/THE%20GREAT%20WAR%20II.htm, pp. 7, 2005‑01‑10.
53 ROMER, Jean‑Christophe – obra citada, 2005‑01‑17.
54 WALKER, M. – “The cold war: A history”, Holt, New York, 1993, p. 290.
55 BRZEZINSKI, Zbigniew – “The premature partnership”, em “Foreign Affairs”, Vol. 73, n.º 2, JAN/FEV 1994, p. 72.
56 DUGIN, Alexander – “The great war of continents”, em www.bolsheviks.org/DOCUMENTS/THE%20GREAT%20WAR%20I.htm, 2005‑01‑10.
57 BERMAN, Ilan – “Slouching toward Eurasia?”, em www.bu.edu/iscip/vol12/berman.html, 2005‑01‑25. 58 CLOVER, Charles – “Dreams of the Eurasian heartland”, em www.geocities.com/eurasia_uk/heartland.html, 2005‑01‑25.
59 BERMAN, Ilan – obra citada, 2005‑01‑25.
60 MARKETOS, Thrassy – “Eurasianist theory: Consequences to the strategic security of the russian muslim South”, em www.cacianalyst.org/view_article.php?articleId=3281, 2007‑01‑26.
61 http://en.wikipedia.org/wiki/Eurasia_Party, 2007‑01‑27.
62 HAHN, Gordon M. – obra citada, 2005‑01‑25.
63 SHI Yinhong – “Great power politics in Central Asia today: A chinese assessment”, em “Islam, oil and geopolitics”, Rowman & Littlefield, Plymouth, 2007, p. 165.
64 DAVIS, Elizabeth Van Wie & AZIZIAN, Rouben – “Islam, oil and geopolitics in Central Asia after September 11”, em “Islam, oil and geopolitics”, p. 7.
65 FENG Shaolei – “Chinese‑Russian relations: The Central Asia angle”, em “Islam, oil and geopolitics”, pp. 203‑206.
66 TRENIN, Dimitri – “From pragmatism to strategic choice: Is Russia’s security policy finally becoming realistic?”, citado por O’LOUGHLIN, John, O’TUATHAIL, Gearóig & KOLOSSOV, Vladimir – “Russian geopolitical culture and public opinion: The masks of Proteus revisited”, em www.colorado.edu/ibs/PEC/johno/pub/Proteus.pdf
67 LOUNEV, Sergey – “Russian‑Indian relations in Central Asia”, em “Islam, oil and geopolitics”, p. 77.
68 FORSYTHE, Rosemarie – “The geopolitics of oil in the Caucasus and Central Asia: Prospects for oil exploitation and export in the Caspian basin”, Adelphi Paper 300, IISS, Oxford University Press, 1996, pp. 9‑10.
69 FORSYTHE, obra citada, p. 9.
70 Um barril de petróleo é equivalente a 159 litros, 42 galões americanos, ou 35 galões imperiais.
71 AMINEH, Mehdi Parvizi – obra citada, p. 1.
72 Ibidem
73 HANSEN, Sander – «Pipeline politics – The struggle for control of the Eurasian energy resources», Clingendael Institute, The Hague, 2003, p. 1.
74 AMINEH, Mehdi Parvizi – obra citada, pp. 74‑81.
75 CUTLER. Robert – “Cooperative energy security in the Caspian region: A new paradigm for sustainable development?”, em www.robertcutler.org/ar99gg3b.htm – 2005‑01‑25.
76 RAMONET, Ignacio – “Guerras do século XXI – Novos medos, novas ameaças”, Campo das Letras, Porto, 2002, p. 127.
77 FORSYTHE, Rosemarie – obra citada pp. 13‑17.
78 KLEVEMAN, Lutz – obra citada, pp. 53‑57.
79 LOUNEV, Sergey – obra citada, p. 181.
80 ZAKARIA, Fareed – “O futuro da liberdade – A democracia iliberal nos Estados Unidos e no mundo”, Gradiva, Lisboa, 2003, pp. 87‑90.
81 KISSINGER, Henry – obra citada, p. 296.
82 LOUNEV, Sergey – obra citada, p. 183.
83 WHITNEY, Mike – “Energy geopolitics: Putin gets mugged in Finland”, em “Global Research”, October 22, 2006.
Bibliografia
00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : géopolitique, stratégie, russie, eurasie, eurasisme, histoire, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 18 février 2009
Europe eurasiste contre Europe atlantiste: à nous de choisir!
EUROPE EURASISTE CONTRE EUROPE ATLANTISTE : A NOUS DE CHOISIR !
Trouvé sur: http://unitepopulaire.org
« Le Financial Times du 25 août 2008 notait amèrement que "Washington en est réduit à regarder d'autres puissances modifier le réel". Dans une édition du Financial Times de 1991, une telle assertion aurait sans doute seulement trouvé sa place dans une rubrique "scénario catastrophe pour l'avenir " ou "science fiction". Il est vrai que la presse américaine de 1991 titrait sur d'autres évènements : l'URSS venait de s'écrouler, et avec elle le mur de Berlin. Dans les sables d'Irak, Bush père promettait à l'humanité un Nouvel Ordre Mondial, juste, merveilleux et surtout unilatéral sous protection de la bannière étoilée pendant que l'Europe entamait son processus de réunification. Nous étions rentrés dans l'ère soit disant éternelle de la Pax Americana avec tous ces corollaires, qu'ils soient militaires, financiers ou encore économiques. Certains nous prédirent même la fin de l'histoire, l'histoire nous a appris qu'ils se trompaient. La "saison unipolaire" fut pourtant de courte durée. Il ne fallut que 10 ans pour qu'un improbable attentat de grande ampleur survienne sur le territoire américain. De la, l'empire déclencha deux conflits militaires en Afghanistan et en Irak, au nom de l'OTAN, entrainant au nom de la lutte contre le terrorisme la plupart des nations Européennes. Europe qui par deux fois, en 2004 et 2005, paya le prix lourd pour sa collaboration avec l'OTAN.
Moins de 20 ans après l'effondrement de l'URSS, force est pourtant de constater que le titre du Financial Times est plus que d'actualité alors que le pays se prépare a choisir ses nouveaux dirigeants. Une guerre défensive de cinq jours, habilement gagnée par la Russie dans le sud Caucase suffit a totalement enrayer le processus d'extension de l'OTAN. Pour la première fois, une puissance contrecarrait militairement les Etats-Unis d’Amérique. En ce mois d'août 2008, les tanks russes qui défendirent Tsinvali venaient de faire chanceler le vieux monde, unilatéral et néo-libéral. (...)
Depuis la chute de l'URSS et du mur de Berlin, l'OTAN n'a plus lieu d'être. Incapable de venir a bout des "terroristes" et du trafic d'opium afghan, l'OTAN est devenue une organisation désuète, frappée du sceau de l'échec et qui ne reflète plus les intérêts européens. En effet la menace soviétique et le pacte de Varsovie ayant disparus et la nouvelle menace terroriste (due a un Ben Laden formé par la CIA) considérablement moins élevée (voir inexistante) sans une participation récurrentes aux actions de l'OTAN a travers le monde. Les Européens doivent aujourd'hui se rendre compte que leurs soldats font office de supplétifs de l'armée américaine, se faisant tuer pour des guerres qui ne sont pas les leurs ! Pire, en collaborant avec l'OTAN, l'Europe se met en position conflictuelle avec des acteurs essentiels a la stabilité et la paix que cela soit dans le monde musulman (où l'OTAN est perçue comme une alliance de croisés modernes) mais également dans le monde eurasiatique, ou l'OTAN est vue comme un outil Américain, facteur de trouble, par les grandes puissances de demain comme la Russie, la Chine, l'Inde ou l'Iran, toutes ces puissance étant liées entre elles au sein de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS).
Ce nouvel ordre multipolaire semble se configurer via l'émergence de grands ensembles civilisationnels et identitaires (UE, Chine, Russie, Inde). Ce phénomene de regroupement sur-régional est a l'opposé du mouvement de morcellement auquel œuvre l'Amérique en Europe, morcellement destiné a la constitution de petits ensembles facilement contrôlables économiquement et dépendants militairement (Yougoslavie, Tchécoslovaquie, projet de morcellement en trois de la Russie..). Morcellements au passage fomentés par l'OTAN et dogmatiquement attribués à l'effondrement post-soviétique. Ces nouveaux regroupements auto-centrés n'ont pas lieu qu'en Eurasie mais bel et bien sur tous les continents, que ce soit en Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Venezuela et Bolivie), sur le continent africain, ou dans le monde musulman, arabe ou pan-turc. Ces regroupements s'opèrent via des cœurs historiques, civilisationnels et économiques. Ces cœurs impériaux sont de facon très génerale les grandes capitales ethno-culturelles des zones concernées, à savoir Pékin pour la Chine, Tokyo pour les Japonais, Caracas ou Rio pour l'Amérique du sud, les musulmans hésitants depuis longtemps entre La Mecque, Téhéran et Istanbul, avec une montée en puissance des musulmans d'Asie. Il est à noter la place absolument unique de la Russie, au carrefour de tous les mondes, islamique via sa position a l'OCI, occidental via le COR, européen par essence ou encore asiatique de par sa géographie et sa participation a l'OCS.
De ces ensembles qui représentent de potentiels concurrents économiques voir militaires, l'Amérique en craint un bien plus que les autres : la grande Europe, ce front continental, colosse économique et militaire, gigantesque empire de Reykavik a Vladivostok, étalé sur onze fuseaux horaires et potentiel leader économique et militaire planétaire. La division voulue et souhaitée par les stratèges américains date et va dans ce sens : tout faire pour empêcher tout unité pan-européene ! De John O'Sullivan qui en 1845, dans "Our Manifest Destiny" écrivait : "Avec l'anéantissement de l'Europe, l'Amérique deviendra la maîtresse du monde" ou l'ouvrage de 1890, "Our Country" qui précise que "l'Europe vieillissante n'a plus les moyens de sauvegarder les valeurs civilisatrices de l'Occident, reprises par une Amérique dynamique émergente" et conclut par la fameuse formule "Europe must perish ! " soit l'Europe doit périr. (...)
La Russie endormie sous Eltsine s'est réveillée, devenant aujourd'hui l'hyper-centre de résistance à l'américanisation forcée et à l'extension agressive et criminelle de l'OTAN. La Russie nous a prouvé récemment qu'elle était prête à défendre ses intérêts mais également à collaborer avec l'Europe et à participer activement à un projet de société pacifique, multilatéral et fondé sur la concertation. Comme les Russes de 1999, les Européens de 2008 doivent sortir de leur sommeil et se libérer, tout d'abord des chaines de l'OTAN, qui s'étendent jusqu'aux frontières ukrainiennes et biélorusses et pourrait les mener a un conflit avec leurs frères Russes.
L'Europe se situe sur le continent eurasien, dont elle occupe la façade atlantique, tandis que la Russie elle occupe la majorité des terres, et la façade pacifique. L'Europe et la Russie sont intrinsèquement liés et appartiennent au même continent, l'Eurasie ! L'Eurasie est la maison commune des Européens et des Russes, de Reykavik à Vladivostok. Grâce à la Russie, une autre Europe, eurasiatique se dresse face à la Petite-Europe atlantiste de Bruxelles. Apres Athènes, Byzance, Aix la Chapelle et Constantinople, Moscou est la nouvelle capitale de l'Europe. »
Alexandre Latsa, Dissonance, 29 novembre 2008
00:40 Publié dans Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, atlantisme, eurasisme, eurasie, europe, affaires européennes, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 février 2009
Chauprade porte plainte
CID : Chauprade porte plainte contre Morin pour "discrimination" devant la Cour de Justice de la République
 "Aymeric Chauprade, qui a été congédié le 5 février du Collège interarmées de Défense à la suite de la parution d'un texte mettant en doute ce qu'il appelle la "version officielle" des attentats du 11 septembre, estime que le ministre de la Défense Hervé Morin "a commis un acte de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-2 du Code Pénal qui punit de trois ans de prison le fait de sanctionner autrui pour ses idées". Son avocat, Maître Antoine Beauquier va saisir la Cour de Justice de la République pour obtenir des sanctions à l’encontre du ministre de la Défense.
"Aymeric Chauprade, qui a été congédié le 5 février du Collège interarmées de Défense à la suite de la parution d'un texte mettant en doute ce qu'il appelle la "version officielle" des attentats du 11 septembre, estime que le ministre de la Défense Hervé Morin "a commis un acte de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-2 du Code Pénal qui punit de trois ans de prison le fait de sanctionner autrui pour ses idées". Son avocat, Maître Antoine Beauquier va saisir la Cour de Justice de la République pour obtenir des sanctions à l’encontre du ministre de la Défense.Se définissant lui-même comme appartenant à la "droite conservatrice", très hostile au courant "néo-conservateur", Aymeric Chauprade affirme que "ses opinions politiques et ses convictions religieuses déplaisaient à Hervé Morin. Croyant plaire à l’entourage du Président de la République, monsieur Morin, qui n’a pas caché que sa décision avait été prise en considération de ce que monsieur Chauprade, de religion catholique, était critique à l’égard de la politique américaine devra répondre de son comportement devant la juridiction compétente" peut-on lire dans un communiqué qu'il publie ce matin. Il ajoute qu'Hervé Morin "a manqué à ses devoirs de ministre, au mépris des principes élémentaires qui gouvernent notre droit public, notamment le droit au débat contradictoire".
Par ailleurs, Chauprade devrait attaquer Le Point en diffamation. La décision du ministre a été prise à la suite de la lecture d'un article de Jean Guisnel sur le site Défense ouverte du Point.fr. Cette affaire devrait également avoir un volet devant le tribunal administratif.
Source
A écouter :
>>> Aymeric Chauprade sur Radio-Courtoisie
11:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : censure, france, géopolitique, liberté d'expression, discrimination, 11 septembre 2001 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 février 2009
Ayméric Chauprade contre-attaque...
Aymeric Chauprade contre-attaque...
SOURCE : LE SALON BEIGE
 Interrogé dans le Libre Journal d’Emmanuel Ratier sur Radio Courtoisie, le professeur de géopolitique des officiers supérieurs de l'Armée française a déclaré qu'il n'adhérait pas aux théories alternatives sur le 11 septembre. Néanmoins, dans le cadre de son ouvrage sur le choc des civilisations, il avait estimé que ces théories, scientifiquement intéressantes, avaient leur place. De plus, en tant qu'analyste, il se permet librement de douter du rapport officiel américain sur les attentats, doute qui ne le fait toutefois pas adhérer aux théories pour lesquelles il a été brutalement exclu. Il fait remarquer que les Américains sont capables de mentir pour arriver à leurs fins, comme l'a montré la fausse accusation à l'égard de l'Irak de Saddam Hussein concernant les armes de destructions massives. En outre, il rappelle qu'aux Etats-Unis, ce débat est ouvert et libre. Et de constater, mais on le savait, que la liberté d'expression n'existe plus en France.
Interrogé dans le Libre Journal d’Emmanuel Ratier sur Radio Courtoisie, le professeur de géopolitique des officiers supérieurs de l'Armée française a déclaré qu'il n'adhérait pas aux théories alternatives sur le 11 septembre. Néanmoins, dans le cadre de son ouvrage sur le choc des civilisations, il avait estimé que ces théories, scientifiquement intéressantes, avaient leur place. De plus, en tant qu'analyste, il se permet librement de douter du rapport officiel américain sur les attentats, doute qui ne le fait toutefois pas adhérer aux théories pour lesquelles il a été brutalement exclu. Il fait remarquer que les Américains sont capables de mentir pour arriver à leurs fins, comme l'a montré la fausse accusation à l'égard de l'Irak de Saddam Hussein concernant les armes de destructions massives. En outre, il rappelle qu'aux Etats-Unis, ce débat est ouvert et libre. Et de constater, mais on le savait, que la liberté d'expression n'existe plus en France.
Convaincu d'avoir été écarté en raison de ses idées, il poursuivra le ministre de la Défense en justice pour discrimination. Il a en outre accusé un lobby de type "néo-conservateur" français, proche des intérêts américains, d'avoir voulu lui nuire en raison de ses critiques à l’égard de l’hégémonie américaine..
Michel Janva
15:16 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, censure, totalitarisme, liberté d'expression, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le déclin et la chute du droit international

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2002
Nikolaj-Klaus von KREITOR :
Le déclin et la chute du droit international
Les partitions de la Yougoslavie étaient en fait des vols de territoires, dissimulés et justifiés par le droit international. Les Etats-Unis, dans ce processus d'appropriation du territoire de ce pays souverain qu'était la Yougoslavie, ont commis, et commettent encore et toujours, un «délit d'ordre territorial».
Les références au droit international, noyau du discours habituel de Washington, ne sont rien d’autre que l’idéologie justifiant une expansion impérialiste. Le fait de justifier ces actes d'accroissement impérialiste flagrant par le droit international, fait du droit la servante prostituée de la politique. Carl Schmitt avait —ô combien— raison lorsqu’il écrivait: «Derrière la façade des normes générales du droit international, se cache, en réalité, le système de l’impérialisme anglo-saxon». Plus que jamais dans le passé, dans le “Nouvel Ordre Mondial”, derrière la façade du droit international, se cache, en réalité, le système de l’impérialisme américain.
Les Américains font de leur droit interne un droit international à leur dévotion
En fait, la doctrine américaine traditionnelle, comme on le voit dans le comportement international des Etats-Unis, montre que le droit international n’existe pas, que le fond du prétendu droit international est à peine un droit étatique externe, sujet à la puissance souveraine de l’Etat. Le droit interne de l’Etat a une priorité sans limite sur le droit international. Ce dernier est valable seulement dans la mesure où il fait partie du système légal interne, et c’est l’Etat seul qui détermine cette validité. La doctrine est bien explicitée par Dean Acheson qui dit : «La plupart des éléments juridiques dans ce que l’on appelle “droit international” est un corpus véhiculant une éthique, et il faut faire attention de ne pas confondre cette éthique avec le droit». Et Dean Acheson continue: «Tout simplement, le droit ne traite pas de ces questions concernant le pouvoir ultime —c'est-à-dire le pouvoir venant des sources de la souveraineté». [Dean Acheson (1963 Proceedings of the American Society of International Law 13, réimprimé chez Noyes E. Leech, Covey T. Oliver et Joseph Modeste Sweeney “The International Legal System” (The Foundation Press, Mineola, New-York, 1973) p. 105].
Les traités n'ont qu'un but : promouvoir les intérêts des Etats-Unis
La circulaire du département d’Etat, n°175, du 13 décembre 1955, réimprimée dans “50 Am. J. Intl. L. 784 (1956)”, citée comme élément de politique concrète, constate : «Les traités devraient être destinés à promouvoir les intérêts des Etats-Unis par le biais d’une action sécurisante entreprise par les gouvernements étrangers dans une optique jugée avantageuse pour les Etats-Unis. Les traités ne sont pas censés être utilisés comme moyen pour effectuer les changements sociaux internes ou pour essayer de contourner les procédures constitutionnelles établies en relation avec ce qui concerne principalement les affaires intérieures». Les traités ne devraient pas imposer d’obligations internationales aux Etats-Unis ou en aucun cas ne devraient interférer avec la législation interne des Etats-Unis. Et les Etats-Unis se définissent eux-mêmes comme étant les seuls juges à légiférer «en matière d’affaires intérieures». Ainsi, pour chacun des traités auxquels les Etats-Unis ont adhéré, le but était de contraindre les autres Etats à agir en faveur de la politique étrangère des Etats-Unis (William W. Bishop, Jr., International Law, Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1953, 1971, p. 101).
La Cour Suprême des Etats-Unis est arrivée à une conclusion semblable lors du cas précédent de la «Banque Nationale de Cuba vs. Sabbatino (1964)»: «La loi adoptée par la doctrine de l’Etat est applicable, même si le droit international a été violé».
Seule domine la volonté des Etats-Unis
Depuis les “corollaires” d'Olney (1895) et de Roosevelt (1904) à propos de la Doctrine Monroe, il n’existe pas de droit international en vigueur dans l’hémisphère occidental, mais seule domine la volonté des Etats-Unis, en tant que seul et omniprésent souverain dans l’hémisphère occidental. Les Etats-Unis ont décidé qu’ils sont les seuls créateurs de leur propre droit international pour leur propre espace impérial, défini dans l’espace par le périmètre de la Doctrine Monroe. Et ainsi le “Nouvel Ordre Mondial” est la base des prémisses du corollaire de Roosevelt, appliqué au monde dans son ensemble —c’est-à-dire la doctrine Albright, prononcée juste avant le début de la guerre d’agression contre la Yougoslavie, qui doit être perçue comme étant l'équivalent du corollaire de Roosevelt, cette fois pour le monde entier.
Dans cette conjoncture, il faut se rappeler la formulation de l’Amiral Stansfield Turner, alors directeur de la CIA, qui a défini la vraie finalité de la Guerre du Golfe; il est même allé plus loin en déclarant lors d’un programme de la chaîne CNN en juillet 1991: «Nous avons un objectif bien plus grand. Nous devons voir plus loin dès à présent. Voici un exemple : la situation entre les Nations Unies et l’Irak, où les Nations Unies s’imposent délibérément dans la souveraineté d’une nation souveraine… C’est maintenant un formidable précédent à utiliser dans tous les pays du monde…».
(cf. http://www.srpska-mreza.com/lirary/facts/kent.html)....
Le traité instituant l'OTAN est sans substance normative
Il a été souligné, à juste titre, dans le débat allemand, que l’OTAN est un «traité à roulettes»; il n’a aucune substance normative dans le droit international mais sert simplement les convenances de l’expansionnisme américain. Ainsi l’agression menée par les forces de l’OTAN contre la Yougoslavie était clairement une violation de la charte même de l’OTAN. Le concept de la «jurisprudence ambulatoire» ou des « lois sur roulettes» (ou traité omnibus) a été introduit par l’éminent juriste allemand Carl Schmitt pour qui cela signifiait la forme de l’approche décisionniste et volontariste des normes légales par le souverain. Et à l'évidence, la majeure partie de l'ancien droit international a été transformée par les Etats-Unis en «normes à roulettes», pour être complétée par une nouvelle substance selon les convenances de la volonté américaine d’expansionnisme. Ainsi, la substance normative même du droit international a disparu.
Par respect pour le droit international, il est important de se rappeler les quelques mots qu’a eus Lassa Oppenheim: «Un Droit des Nations peut exister à la seule condition qu’il y ait une stabilité, un équilibre des pouvoirs, entre les membres de la famille des Nations. Si les Puissances ne peuvent pas se surveiller mutuellement, aucune loi n’aura de force, vu qu’un Etat superpuissant tentera naturellement d’enfreindre la loi. Etant donné qu’il n’y a pas et qu’il ne peut jamais y avoir une autorité politique centrale au-dessus des Etats souverains, qui pourrait faire respecter la loi inhérente au Droit des Nations? Un équilibre du pouvoir doit empêcher tout membre de la famille des Nations de devenir omnipotent» (Lassa Oppenheim International Law. A Treatise, Longmans, Green, 1905-06, l, pp. 73-74).
Apparemment, dans le paysage unipolaire du “Nouvel Ordre Mondial”, aucune loi et norme du droit international ne fait force hormis ces normes et lois qui émanent de la volonté hégémonique des Etats-Unis. Par conséquent, le droit interne américain a effectivement remplacé les normes du droit international et ce qui est prétendument le droit international n'est plus rien d'autre qu'un éventail d'apparences qui dissimule, tant bien que mal, la volonté de l’impérialisme américain. Le droit international est devenu un déguisement de l’impérialisme américain.
Les Etats-Unis entendent modeler le monde à leur image
Bien que les Etats-Unis prétendent utiliser leur statut de superpuissance pour favoriser la stabilité générale et les droits universels, beaucoup d’observateurs internationaux n’y voient là qu’une vulgaire intention d’autosatisfaction en modelant le monde à leur propre image —et piétinant tout ce qui se met en travers de leur chemin, écrit Atman Trivedi dans le Foreign Policy Journal, révisant l’article du Professeur Etaju Thomas, publié dans la revue World Affairs (n°1, 1999): «Le Professeur Etaju Thomas, professeur de sciences politiques à l’Université de Marquette, montre tout particulièrement Washington du doigt parce que les Etats-Unis mènent une politique étrangère de «bombardements, de sanctions et de destruction d’Etat». Il soutient que la soi-disant doctrine Albright a donné aux Etats-Unis l’autorisation de se livrer à des «saccages expansionnistes» dans l’ex-Yougoslavie, en Irak et ailleurs, en commettant des agressions sans provocation. Selon Thomas, l’armée américaine pourrait, soutenue par la puissance des sanctions économiques ou des récompenses, transformer les Nations Unies en un appendice docile des Etats-Unis; les sanctions ont déjà donné la possibilité à Washington de tourner le droit international en farce. Les Serbes, par exemple, «ont plus de droit moral, politique et international sur le Kosovo que les Etats-Unis sur la Californie et le Texas». En outre, il note qu'un million à 1,7 million d’Irakiens innocents sont morts à la suite des sanctions «sponsorisées par l’Amérique», y compris plus d’un demi million d’enfants.
Que dire de plus? Dans le passé, le Ministre des Affaires étrangères allemand avait déclaré à l’égard de la doctrine américaine de Monroe que «par principe, aucune ingérence de la part des Etats européens dans les affaires du continent américain ne reste injustifiée à moins que les Etats d’Amérique, pour leur part, s’abstiennent également d’intervenir dans les affaires du continent européen». C’est un bon point de départ: une doctrine Monroe pour l’Europe comme réponse au “Nouvel Ordre Mondial” et aux ambitions totalitaires américaines d'exercer la Weltherrschaft. Ou comme l’avait un jour dit le Général De Gaulle: «Une Europe vraiment libre est une Europe libre de l’hégémonie américaine».
Les USA ne sont pas les gouverneurs du monde! Et jamais ils ne le seront!
Nikolaj-Klaus von KREITOR.
(http://disc.server.com/discussion.cgi?id=57779&articl... ; trad. franç. : LA).
00:05 Publié dans Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, etats-unis, impérialisme, globalisation, droit international, droit des gens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 février 2009
Encore un mauvais coup contre la liberté de recherche et la liberté d'expression
Encore un mauvais coup contre la liberté de recherche et la liberté d'expression
Trouvé sur: http://www.polemia.com/
Aymeric Chauprade, chargé du cours de géopolitique au Collège interarmées de défense (CID, l'ancienne Ecole de guerre) a été brutalement congédié ce matin par le ministre de la Défense Hervé Morin, à la suite d'un article paru dans « Le Point ». Hervé Morin lui reproche d'être l'auteur d'un « texte au travers duquel passent des relents inacceptables » consacré aux attentats du 11 septembre, présentés comme le fruit d'un complot israélo-américain. Aymeric Chauprade vient de publier une « Chronique du choc des civilisations » aux éditions Chronique-Dargau, dont « Le Point » cite quelques expressions choc :
« L'attaque des tours jumelles du World Trade Center de New York et du
Pentagone par des terroristes préparés par al-Qaïda ? »
« Le nouveau dogme du terrorisme mondial »,
« Une « version officielle ».
Au World Trade Center, « l'incendie n'a pas été si violent que le prétend la commission d'enquête ».
« L'onde de choc n'a pas pu provoquer l'effondrement. (...) Seule une démolition contrôlée par des explosifs permet d'obtenir un effondrement aussi rapide et parfait. »
Rien que du politiquement incorrect !
Quelques heures après la parution de cet article, le professeur est débarqué par le ministre de la Défense qui l'explique :
« J'ai découvert un texte au travers duquel passent des relents inacceptables. Sur onze pages, on nous parle d'un complot israélo-américain imaginaire visant à la conquête du monde. Quand j'ai appris cela mardi soir, j'ai donné pour consigne au général Desportes, le directeur du Collège interarmées de défense [le supérieur de M. Chauprade], de ne pas conserver ce monsieur Chauprade dans son corps enseignant. Il n'a absolument rien à faire à l'École militaire ».
Interrogé par Libération/Secret défense, Aymeric Chauprade, 40 ans, se déclare « stupéfait »:
« On me coupe la tête. Je n'ai eu aucun contact avec le cabinet du ministre, qui n'a pas cherché à m'entendre avant de prendre cette décision à la suite de la parution d'un seul article ». « Très fâché », Chauprade entend se défendre.
Sur le fond de ce qui lui est reproché, il s’explique à son tour :
« Je présente la thèse [du complot américano-israélien], certes de manière avantageuse, mais sans la faire mienne. Je souhaitais mettre en opposition deux façons de voir le monde, sachant que la moitié de l'humanité pense que les attentats du 11 septembre sont le fruit d'un tel complot » et non l'oeuvre des islamistes d'Al Qaïda. »
Dès ce jeudi après-midi, des élèves du CID s'élevaient contre ce qui s'apparente, à leurs yeux, à une « chasse aux sorcières » au nom de « la pensée unique ».
Aymeric Chauprade, qui enseignait cette semaine aux officiers de l'armée marocaine, à Kenitra, sera reçu demain matin par le directeur du CID, le général Vincent Desportes. Il lui a été demandé de cesser immédiatement ces activités et n'assurera donc pas le séminaire « Energie et développement durable » qu'il devait animer ce vendredi. Aymeric Chauprade enseigne au CID depuis 1999 et dirige le cours de géopolitique depuis 2002. (…). [Il est] officier de réserve de la marine. Outre son séminaire, son cours porte sur les méthodes d'analyse géopolitique, destiné à des officiers d'environ 35 ans. Ses activités au CID représente environ un tiers de ses activités et donc de ses revenus. Il est par ailleurs éditeur et auteur de plusieurs ouvrages, dont une « Géopolitique, constantes et changements dans l'histoire » aux éditions Ellipses.
« Il n'a jamais fait de prosélytisme dans ces cours, n'a jamais exprimé sa vision du monde, mais en faisant état de ses fonctions au CID dans ces livres, il engage l'institution militaire avec des thèses qui ne sont pas les nôtres » assure le général Vincent Desportes, qui commande le CID.
Le général Desportes, qui est l'une des têtes pensantes des armées et l'auteur de nombreux livres, s'affirme « intellectuellement en opposition avec les thèses défendues par Chauprade, qui sont assez peu recevables ».
Dans ces livres et ses articles, Chauprade défend une théorie du choc des civilisations, au travers notamment d'une opposition entre l'Europe (incluant la Russie) et l'Islam.
Et « Le Point » de présenter Aymeric Chauprade dans l’introduction de l’article :
« Aymeric Chauprade est un géopoliticien qui ne cache pas ses convictions. Directeur de campagne de Philippe de Villiers aux européennes de 2004, en charge de la Revue française de géopolitique, il est très réservé sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.(…). Il s'est montré critique sur le récent « Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale », ce qui ne manque pas de courage pour un enseignant censé se trouver en phase avec la politique de défense nationale »..
Sources :
http://secretdefense.blogs.liberation.fr/defense
et
http://lesalonbeige.blogs.com/
5/02/09
Correspondance Polémia
05/02/09
« Chronique du choc des civilisations »
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_ss_w?__mk_fr_FR=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&fieldkeywords=Chronique+du+choc+des+civilisations&x=14&y=19
« Géopolitique, constantes et changements dans l'histoire »
http://www.amazon.fr/Géopolitique-Constantes-changements-dans-lhistoire/dp/2729811222/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1233938778&sr=8-2
Correspondance Polémia
00:53 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : censure, dicature, terreur, géopolitique, france, choc des civilisations, 11 septembre 2001 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook