jeudi, 19 mai 2011
De uitweg: een nieuw Confederaal Diets Imperium

De uitweg: een nieuw Confederaal Diets Imperium
Ex: http://www.kasper-gent.org/
In 2007 gaf Prof. Dr. Wim Couwenberg aan dat het een interessant alternatief zou kunnen zijn om de Benelux op termijn om te vormen tot een confederaal samenwerkingsverband tussen Nederland, Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Luxemburg[1]. Zulk een confederatie zou het einde van België impliceren, iets wat volgens Couwenberg ook zonder een dergelijke confederatie een reële optie is geworden.
Dit voorstel vormt het vertrekpunt van onderstaand opiniestuk. Nu het einde van België steeds reëler is geworden, niet in het minst door de voortschrijdende communautaire spanningen en crisissen in België, komt steeds meer de vraag naar voor wat nu juist het alternatief dient te zijn. De ene wil een Vlaamse staat, de andere wil een unitair België, een derde wil Groot-Nederland terwijl nog een andere Heel-Nederland wil. En wellicht vergeten we hierbij nog enkele andere meningen.
De Gentse studentenvereniging KASPER is Heel-Nederlands, zonder hierbij standpunt in te nemen over de concrete vorm. Zowel unitarisme, federalisme, confederalisme, provincialisme, etc. kunnen een concrete veruiterlijking van het Heel-Nederlandse streven impliceren. In wat volgt zal gepleit worden voor een nieuw Confederaal Diets Imperium als concrete invulling van het Heel-Nederlandse streven. De invalshoek van deze tekst is voornamelijk economisch, vanuit een post-EU kader. Vele andere argumentaties zijn ook mogelijk.
1. Historische context voor Heel-Nederland
De geschiedenis zal zichzelf nooit op exact dezelfde manier herhalen. Tevens dienen hedendaagse problemen niet door geschiedenis opgelost te worden. Oplossingen dienen aangereikt te worden die vertrekken vanuit de actualiteit en de hedendaagse maatschappij. Het is dan ook van groot belang dat bestaande politieke, culturele, sociologische, economische, identitaire en geopolitieke realiteiten aanvaard worden om vanuit deze realiteit een concrete toekomstvisie te ontwikkelen. Aan dit soort van probleemoplossend denken ontbreekt het wel eens bij romantische Vlaamse bewegers of Belgisch unitaristen. Een actueel staatkundig probleem willen oplossen door een kaart uit de 17e eeuw boven te halen, dat is inderdaad kinkklare onzin.
Desondanks mag de geschiedenis geen onrecht aangedaan worden. Historische feiten dienen niet vervormd of vergeten te worden omdat het niet zou passen in de hedendaagse analyse. De geschiedenis kan zelfs een belangrijk aanknopingspunt vormen om actuele oplossingen voor te stellen, zonder hierbij nostalgisch terug te willen grijpen naar een exacte kopie. Zo is een exacte restauratie van de 17 Provinciën van 1543 – 1581 een nogal romantisch denkbeeld. Hoe dan ook: geschiedenis is en blijft belangrijk en kan inspiratie bieden voor de toekomst. Daarom blijven we (zeer) kort even stilstaan bij de Heel-Nederlandse geschiedenis vanaf de 12e eeuw.
Van 1384 tot 1482 waren grote delen van de Lage Landen verenigd in de zogenaamde Bourgondische Nederlanden. De hertogen van Bourgondië regeerden over de verschillende gebieden die verenigd worden door een personele unie. In 1463 werd door Filips De Goede een Staten-Generaal opgericht, een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de verschillende Provinciën. Dit zorgde voor meer coördinatie en centralisatie, wat op termijn ook een supranationaal samenhorigheidsgevoel deed ontstaan bij elite en bevolking. Boven bijvoorbeeld de Brabantse vaderlandsliefde kwam het Bourgondisch samenhorigheidsgevoel te staan. Na een machtswissel met de Habsburgers waren de Nederlanden van 1482 tot 1581/1795 gekend als de Habsburgse Nederlanden. Na enkele uitbreidings- en annexatierondes onder Karel V vormden de Nederlanden in 1543 een min of meer aaneengesloten geheel. De periode 1543 tot 1581 staat dan ook gekend als de periode van de 17 Provinciën. In 1581 scheidde het Noorden zich af met de Acte van Verlatinghe, met de Vrede van Münster (1648) internationaal erkend. De resterende deel van de Nederlanden bleef nog twee eeuwen verder bestaan, tot het in 1795 door de Napoleontische expansie geïncorporeerd werd in Frankrijk. Zowel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als de Zuidelijke Nederlanden zijn slechts in beperkte mate vergelijkbaar met het hedendaagse België en Nederlanden. Ofschoon er vrij grote overlapping bestaat lagen de grenzen toch nog anders, bijvoorbeeld voor wat betreft Limburg en de Landen van Overmaas, Frans-Vlaanderen, … .
In de periode 1815-1830 werd de voorlopig laatste hereniging der Nederlanden gerealiseerd door het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (heden: België + Nederland), onder leiding van Willem I. Het Groothertogdom Luxemburg werd door een personele unie verbonden met het Koninkrijk. Willem I wou een complete hereniging naar Bourgondisch voorbeeld, maar tijdens het Congres van Wenen werd echter beslist dat Frans-Vlaanderen bij Frankrijk zou blijven behoren. Voor het eerst in de geschiedenis zouden de Nederlanden ook centralistisch verbonden. Dit zou de jammerlijke Belgische revolutie van 1830 deels kunnen verklaren, samen met andere factoren waar we hier niet verder op ingaan. Tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden waren er twee bestuurlijke centra (Brussel en Den Haag) waartussen men jaarlijks wisselde. Ook economisch en financieel ging het de nieuwe staat voor de wind dankzij de synergetische effecten van de eenmaking. Dit is iets wat vandaag weer mogelijk zou kunnen zijn indien de Nederlanden herenigd zouden worden!
2. Een onafhankelijk Vlaanderen?
De populairste oplossing voor de Belgische crisis lijkt heden de Vlaamse onafhankelijkheid. Een grote meerderheid van de Vlaamse publieke opinie is voorstander van meer Vlaamse autonomie, eventueel zelfs van onafhankelijkheid. Ook de sociologische context is langsheen de taalgrens bipolair geëvolueerd sinds het federaliseren van België. De economische situatie in het Noorden en het Zuiden van België zijn verschillend en beiden vergen een andere aanpak. De publieke opinie in Vlaanderen is centrum-rechts, in Wallonië centrum-links. En zo kan men nog honderden verschilpunten aanhalen. Wie deze sociologische en economische bipolaire context ontkent, die ontkent de realiteit en leeft in een droomwereld.
Rekening houdend met de (summier) geschetste context lijkt een onafhankelijk Vlaanderen op het eerste zicht een logische oplossing. Op vlak van relatieve homogeniteit van de publieke opinie scoort Vlaanderen goed en zal het perfect zelfstandig kunnen overleven. Men spreekt in Vlaanderen dezelfde taal en de verschillen die de relatie Vlaanderen-Wallonië kenmerken zijn grotendeels afwezig binnen Vlaanderen.
De situatie verandert echter als we er twee cruciale elementen voor het overleven van een staat en een volk bijhalen: economie en geopolitiek. Vlaanderen zal als kleine en exportgerichte Europese regio economisch alleen maar kunnen overleven onder de paraplu van een liberaal-kapitalistische Europese Unie. De liberalen in de Vlaamse beweging hebben dit natuurlijk ook door en men kiest niet voor niets voor slogans als ‘Vlaanderen, Staat in Europa’, en men gaat niet voor niets verkiezingsspeeches geven voor de achtergrond van een Europese vlag. Dit wekt natuurlijk geen verbazing op als we de verkiezingsprogramma’s van pakweg de N-VA of het VB gaan bekijken: op economisch vlak zijn het kampioenen van het rechts-liberalisme en kan zelfs Open VLD er nog een puntje aan zuigen. Wij kunnen liberale Vlaams-nationalisten dan ook moeilijk verwijten dat ze een onafhankelijk Vlaanderen willen. We kunnen ons misschien wel afvragen waarom ze als nationalisten hun soevereiniteit willen afstaan aan een supranationaal Europees ding, maar dat is een andere vraag. Dit Eurregionalistische discours kent trouwens aanmoediging vanuit Europa zelf. Niet dat dit verbazing opwekt: hoe meer macht kleine en onbeduidende regio’s krijgen binnen de EU krijgen ten opzichte van (grote) lidstaten, hoe meer macht de EU natuurlijk zelf naar zich kan toetrekken. Al dat regionaal en provinciaal nationalisme dat de kop opsteekt in Europa is dan ook geen enkel probleem voor Barosso, Van Rompuy en hun eurofiele vrienden.
Vanuit een nationale en solidaristische economische visie valt dit alles natuurlijk nog maar moeilijk te kaderen. Indien men pleit o.a. voor strategische verankering van sectoren van nationaal belang, hoge importtarieven voor producten uit sectoren die sterk aanwezig zijn in eigen land, taksen op internationale kapitaalsstromen, nieuw-corporatisme, aan banden leggen van multinationals, herinvoering van de nationale munt, … moet de EU als liberaal-kapitalistische machine natuurlijk verdwijnen. Indien men deze economische visie dan ook nog eens gaat combineren met een nationalistische visie op de maatschappij, dan zou men nog meer overtuigd moeten zijn van de noodzaak van het opdoeken van de EU. Twee grondslagen voor euroscepticisme zijn dan immers aanwezig, de noodzakelijke conclusie volgt vanzelf.
De vraag die zich vanuit de solidaristische visie stelt is duidelijk: kan een onafhankelijk Vlaanderen overleven zonder de liberaal-kapitalistische paraplu van de EU? Het antwoord is niet ondubbelzinnig ja of nee. Maar laten we nu even de post-EU economische realiteit beschouwen. Gekneld tussen twee Europese economische grootmachten (Frankrijk en Duitsland), die elk perfect autarkisch en protectionistisch kunnen overleven, zal een onafhankelijke regio ter grote van een Frans departement of een Duits Länder het heel erg moeilijk krijgen. Bovendien krijgen deze twee grootmachten het dan wel zeer makkelijk om alle kleine tussenliggende staten tegen elkaar uit te spelen. Twee plaatsnamen zeggen vermoedelijk voldoende: Antwerpen en Rotterdam. Beide havens zal men maar al te graag tegen elkaar uitspelen. Een verstandig lezer heeft geen verdere illustratie nodig en zal beseffen dat een onafhankelijk Vlaanderen in een post-EU en (nationaal-)solidaristische logica geen enkele degelijke kans maakt op economisch ook maar enige rol van betekenis te gaan spelen.
Op geopolitiek vlak zijn de post-EU conclusies hetzelfde. Daar waar Vlaanderen, en België bij uitbreiding, zich nu quasi continu vasthaakt aan de EU (op buitenlands beleid is dit doorgaans het compromis van de Frans-Duitse as) en geen enkel substantieel eigen geopolitiek beleid (kan) ontwikkelen, zal dit er in een post-EU scenario al helemaal niet op verbeteren.
De fundamentele vraag is duidelijk: wat is dan wel leefbaar? Hoe moeten we de regionalistische tendens overstijgen om te komen tot een groot en groots staatsideaal om de welvaart en het overleven van ons volk veilig te stellen? Het antwoord is reeds terug te vinden in de geschiedenis en biedt ook vandaag een reële uitweg uit de chaos en de wanorde: een hereniging der Nederlanden. Een Unie van alle territorialiteit aan de Noordzee die gekneld zit tussen Frankrijk en Duitsland: een nieuw Diets Imperium. De potentiële synergetische effecten hiervan op economie en politiek vallen allerminst te ontkennen.
3. Groot- of Heel-Nederland?
 Gelukkig zijn er ook Vlaams-nationalisten die dit inzien. Vanuit Vlaanderen en de bipolaire Belgische situatie zijn er dan ook heel wat pleitbezorgers voor een Groot-Nederlandse hereniging (dit is uiteraard niet alleen gebaseerd op bovenstaande redenering, maar ook bijvoorbeeld op cultuur, identiteit, taal, historie, …).
Gelukkig zijn er ook Vlaams-nationalisten die dit inzien. Vanuit Vlaanderen en de bipolaire Belgische situatie zijn er dan ook heel wat pleitbezorgers voor een Groot-Nederlandse hereniging (dit is uiteraard niet alleen gebaseerd op bovenstaande redenering, maar ook bijvoorbeeld op cultuur, identiteit, taal, historie, …).
Een Groot-Nederlandse hereniging is natuurlijk al een goed begin. Het laat echter twee autonoom onleefbare regio’s over: Wallonië en Luxemburg. Men zegt dan maar snel dat zij maar moeten aansluiten bij Frankrijk, of dat ze ook zelfstandig kunnen overleven (dit laatste is alweer een liberale pro-EU denkwijze, aangezien dit dan dezelfde economische en geopolitieke kritieken opwerpt als hierboven beschreven).
Laten we nu echter even enkele objectief vaststaande feiten in beschouwing nemen. Ten eerste, historisch gezien zijn de Walen ook Nederlanders. Nooit hebben de gebieden die heden Wallonië en Luxemburg uitmaken toebehoord tot Frankrijk, tenzij enkele jaren tijdens Napoleontische bezetting. Waarom zouden wij plots beslissen om een deel van ons eigen volk en grondgebied vrijwillig af te staan? Ten tweede, het Waals, een met uitsterven bedreigde taal, is een Nederlands dialect net zoals het Fries er een is. Het feit dat Wallonië heden compleet verfranst is doet hier geen afbreuk aan. Ten derde, zal Duitsland het accepteren dat Frankrijk zijn grondgebied zal uitbreiden? Ik dacht het niet. Ten vierde, zijn er nog niet genoeg gebieden van de historische Nederlanden geannexeerd en geïncorporeerd door Frankrijk? De jubelzang van de Vlaamse beweging tegenover Frans-Vlaanderen ten spijt, demoniseren ze tegelijkertijd een streek die ze ook Franse eigenschappen toeschrijven. Niet echt consequent, maar dat we zulks niet mogen verwachten van het overgrote deel de Vlaamse beweging wisten we al wel langer.
De situatie is bijgevolg eenvoudig: als de Walen niet willen toetreden tot de hernieuwde Nederlandse Unie, dan zullen zij de separatisten zijn. En dan zullen zij daar de consequenties van moeten dragen, én daar ook mee moeten leren leven. Indien zij beslissen dat ze liever zelfstandig doorgaan, zal de politieke en socio-economische situatie hun er snel genoeg toe nopen contact te zoeken met de Nederlanden. Indien zij liever tot Frankrijk behoren en dit probleemloos kan verlopen, dan zou dat jammer zijn, maar kunnen wij ze niet tegenhouden en zal de Groot-Nederlandse hereniging het maximaal bereikbare worden. Het is echter zo dat, indien zij willen toetreden tot het hernieuwde Dietse Imperium, tot de nieuwe Gouden Delta aan de Noordzee, zij dit moeten kunnen. De Walen behoren immers tot dezelfde volksstam als de rest van de Dietsers, zoveel is historisch wel duidelijk.
De conclusie: Heel-Nederland als het kan, Groot-Nederland als het moet.
4. Confederaal Diets Imperium
Vooraleer de doorwinterde Vlaamse beweger begint te huiveren van deze stellingname dient er wat nuance aangebracht te worden. De titel van dit opiniestuk geeft immers aan dat er gepleit zal worden voor een nieuw Confederaal Diets Imperium. Dit impliceert allereerst een breuk met het bij Vlaams-nationalisten sterk aanwezige centralistische denken over de staat. Een confederatie heeft niet één, maar meerdere machtscentra. De centralistische staat (naar Frans model) dient bijgevolg afgezworen te worden.
 Waarom nu pleiten voor een Confederatie en een Imperium? De redenen hiervoor zijn duidelijk en legio. Zoals reeds in het begin van dit stuk geschreven is er de gegroeide actuele context die men niet mag vergeten. Vlaanderen verschilt van Wallonië, net zoals beiden verschillen van Nederland. Tevens hebben er zich in elk van deze regio’s afzonderlijke ontwikkelingen voorgedaan en is het soms beter om bepaalde zaken op een lager niveau op te lossen (subsidiariteit). Hier moeten we dan ook rekening mee houden, zoveel is duidelijk. Een Confederaal Imperium vormt hierop het perfecte antwoord: het zwaartepunt van de bevoegdheden ligt bij de deelstaten van het Imperium, terwijl hetgeen men samen wil doen op het hogere (Dietse) niveau komt te liggen. Economie en geopolitiek zijn de twee typevoorbeelden van Dietse bevoegdheden in een post-EU scenario.
Waarom nu pleiten voor een Confederatie en een Imperium? De redenen hiervoor zijn duidelijk en legio. Zoals reeds in het begin van dit stuk geschreven is er de gegroeide actuele context die men niet mag vergeten. Vlaanderen verschilt van Wallonië, net zoals beiden verschillen van Nederland. Tevens hebben er zich in elk van deze regio’s afzonderlijke ontwikkelingen voorgedaan en is het soms beter om bepaalde zaken op een lager niveau op te lossen (subsidiariteit). Hier moeten we dan ook rekening mee houden, zoveel is duidelijk. Een Confederaal Imperium vormt hierop het perfecte antwoord: het zwaartepunt van de bevoegdheden ligt bij de deelstaten van het Imperium, terwijl hetgeen men samen wil doen op het hogere (Dietse) niveau komt te liggen. Economie en geopolitiek zijn de twee typevoorbeelden van Dietse bevoegdheden in een post-EU scenario.
Een confederale samenlevingsvorm is trouwens perfect in lijn met het historische voorbeeld dat de Nederlanden zo lang verenigd heeft. Ook ten tijde van de Bourgondiërs en de Habsburgers waren de Provincies slechts verbonden door een personele unie, waarbij men naast de provinciale ook de Nederlandse identiteit had en ontwikkelde. De Nederlanden zijn nooit gewend geweest aan centralisme, maar hebben steeds hun rijke onderlinge eigenheid en verscheidenheid gehad. Maar ook hun eenheid! Alle Nederlanden zijn deel van één ondeelbare territoriale entiteit, alle Dietser zijn deel van één onverwoestbaar en ondeelbaar volk der Lage Landen!
Een confederale eenheid bestaande uit de huidige (deel)staten van België, Luxemburg en Nederland is dan ook een levensnoodzakelijke noodzaak voor ons volk. Hoe deze unie nadien evolueert, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Blijvend Confederaal? Federaal? Unitair? 17 x Provinciaal? … Hoe dan ook: één!
Een nieuw Diets Imperium zal moeten opstaan om ons volk vrij, groot en groots te maken. Een nieuwe Gouden Delta aan de Noordzee dringt zich op en ZAL zich op natuurlijke wijzen MOETEN vormen zodra het onding van de EU definitief tot de geschiedenisboeken zal behoren. Moge de aloude lokroep hard en krachtig weerklinken: DE NEDERLANDEN ÉÉN!
5. Confederale eenheid in de Lage Landen als synthese
 De hernieuwde confederale eenheid in de Lage Landen vormt aldus de perfecte synthese tussen het streven naar meer Vlaamse autonomie en het streven naar een hereniging der Lage Landen. Eenheid in verscheidenheid, zoals het altijd al geweest is. Het vormt een logische, quasi natuurlijke, stap in het post-EU tijdperk dat er hopelijk zo snel mogelijk aankomt. De territoriale confetti van het eurregionalistische discours zal verdwijnen naar de geschiedenisboeken … en zal plaats maken voor leefbare, grote en hernieuwde Europese Staten.
De hernieuwde confederale eenheid in de Lage Landen vormt aldus de perfecte synthese tussen het streven naar meer Vlaamse autonomie en het streven naar een hereniging der Lage Landen. Eenheid in verscheidenheid, zoals het altijd al geweest is. Het vormt een logische, quasi natuurlijke, stap in het post-EU tijdperk dat er hopelijk zo snel mogelijk aankomt. De territoriale confetti van het eurregionalistische discours zal verdwijnen naar de geschiedenisboeken … en zal plaats maken voor leefbare, grote en hernieuwde Europese Staten.
Indien de landen van de BENELUX erin slagen om de unificerende factoren en hun historisch gewortelde identiteit te omhelsen, maar ook om rekening te houden met hun onderlinge verscheidenheid, dan zal de nieuwe Gouden Delta aan de Noordzee zich onherroepelijk vormen. Een stromende levensader te midden van het oude Continent!
Dit ‘out of the box’ denken overstijgt het romantische Vlaams-nationale, Belgicistische en eurofiele denken. Het gaat uit van concrete materiële belangen die zich onherroepelijk zullen opwerpen in het post-EU tijdperk. Het houdt rekening met de identiteit en de historische wortels van ons eigen volk. Niet alleen zijn wij Vlamingen, Walen of Nederlanders … ALLEN zijn wij Dietsers. In het herenigde Rijk der Lage Landen is het trouwens perfect denkbaar dat de historische provincies hun banden weer aanhalen. Binnen een confederale en dynamische logica dient hier zeker ruimte voor te zijn.
6. Andere zienswijzen
Bovenstaande redenering is niet de enige logica die pleit voor een Heel-Nederlandse oplossing. Ze maakt echter duidelijk dat solidarisme en Heel-Nederlandisme geen twee losse idealen zijn, maar dat ze fundamenteel aan elkaar vastgehaakt zijn als 1 coherent geheel.
Het is perfect mogelijk om een hereniging der Lage Landen ook te gaan argumenteren binnen het kader van de EU, vanuit identitaire overwegingen, vanuit pure historische overwegingen, vanuit culturele overwegingen, etc. . Deze redeneringen vallen buiten het bestek van dit opiniestuk, maar vormen uiteraard een waardevolle aanvulling en een extra basis om alle Nederlanden te herenigen tot 1 bloeiende en groeiende levensader.
Zo is het perfect mogelijk om vanuit een intergouvernementele kijk op de EU sterke argumenten te ontwikkelen pro BENELUX-Unie. De BENELUX als geheel heeft immers een even groot stemmengewicht in de Raad van Ministers dan de grote Europese Naties. De Beneluxeconomie is de vierde grootste van Europa. Bovendien laat Europa verdragsrechtelijk toe dat de BENELUX zoveel mag integreren als ze zelf willen. Dit, en vele andere mogelijk argumenten, vormen een interessante aanvulling op het streven naar Heel-Nederlandse eenheid, waarbij besloten kan worden dat dit streven een veel groter deel van de bevolking kan aanspreken dan enkel solidaristen en eurosceptici. Men moet het enkel als dusdanig durven verkopen, en vooral … buiten de bestaande tegenstellingen en breuklijnen durven denken.
‘t Is te kleen om ghedeelt te blijven!
De Nederlanden één!
Geschreven door Thomas B.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Belgicana | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pays-bas, flandre, wallonie, belgique, belgicana, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 18 mai 2011
Pour une géopolitique européenne

Pour une géopolitique européenne
Il serait donc utile que l'Union Européenne crée en son sein un véritable réseau de réflexion géopolitique, selon une forme à définir faisant un large appel aux technologies de l'information.
Il s'agirait en priorité de rédiger des documents d'analyse critique et des notes de propositions.
On limiterait l'horizon aux 10 prochaines années.
Ces documents seraient diffusés par Internet via une liste aussi large que possible de parlementaires européens et nationaux, de responsables européens et de responsables nationaux. Ils seront diffusés aussi aux medias et à différentes organisations politiques et syndicales .
Voici une première liste des thémes qui paraissent pouvoir être abordés sans attendre. Il faudra faire un tri en fonction des moyens disponibles, mais garder en tête qu'il s'agit de questions existentielles liées, c'est-à-dire mettant en jeu l'existence même de l'Europe en tant que mariant une civilisation, des populations et des territoires.
Evaluer les risques menaçant l'Europe: impacts, réactions possibles
* Démographie (effectifs et vieillissement). Immigration non contrôlée
* Croissance des inégalités sociales et géographiques. Chômage des jeunes. La question des banlieues. Violences urbaines
* Perte de formation et de culture scientifique et technique. Brain drain
* Guerres et contre-guerres économiques. Le renseignement
* Nouvelles formes de terrorisme et de guerre: G4G, cyber-guerre, guerillas urbaines, subversion des frontières par des réfugiés économiques et climatiques, pénétration par les fondamentalismes religieux de combat (islamisme et dans une certaine mesure christianisme évangélique)
* Perte des valeurs européennes: démocratie, droits civiques, statut de la femme, laïcité, tolérance, contre-pouvoirs, etc.
* Au plan économique: désindustrialisation, délocalisations, carences en matières premières
* Au plan diplomatique interne, rivalités entre Etats-membres allant jusqu'à la rupture.
Evaluer les grands ensembles géopolitiques concurrents. Définir des stratégies: défense, contre-attaques, alliances
* Etats-Unis: nouvelles formes de pénétration
* Le cas particulier de la Russie. Perspectives d'une alliance euro-russe.
* Renforcer les instruments de la diplomatie européenne. Développer les partenariats stratégiques
Evaluer et protéger les potentiels européens
* Services publics et administrations publiques
* Au plan humain et sociétal: Compétences professionnelles. Valeurs européennes (cf ci-dessus)
* Les épargnes mobilisables pour des investissements localisés en Europe
* Les secteurs des industries de l'infrastructure et du bâtiment
* Le secteur agricole et agro-alimentaire
* Le secteur des services. Le tourisme (?)
* Littoraux et mers continentales
Définir des stratégies économiques
* Peut-on, dans quels domaines et comment mêler libre échange, protectionnisme et économie dirigée?
* Elaborer ou diffuser une nouvelle pensée économique, vis-à-vis de la crise, de la dette et des marchés financiers. Voir par exemple nos commentaires au Manifeste des économistes atterrés http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=626&r_id=
* Exportation. Comment exporter tout en préservant la capacité d'innovation? La question des transferts de technologie
* Evaluer et commencer à prendre en compte les externalités internes et externes, positives et négatives (données que ne connaissent pas les comptabilités nationales et budgétaires)
Politiques de développement économiques et de lutte pour l'emploi
* Liste des domaines d'investissement et des politiques industrielles prioritaires dans les secteurs des technologies avancées et des recherche fondamentales et appliquées.
* Modalité de sélection et de financement des programmes de recherche dans les sciences émergentes
* Politique européenne de l'environnement: lutte contre le réchauffement, protection de la biodiversité terrestre et marine
* Politique monétaire et financière. Zone euro et extension à d'autres monnaies (£?) Rôle de la BCE et européanisation de la Dette. Fonds monétaires européen. Relations avec le secteur banque-assurance. Politique à l'égard des paradis fiscaux (notamment européens).
* Comment mobiliser l'épargne européenne? Fonds d'investissement stratégique européen
* Limites des politiques budgétaires dites d'austérité (ou de réforme)
* Le soft-power des puissances non européenne. Détecter et combattre les dépendances culturelles, notamment au regard de l'atlantisme
* Aides à la création et à la diffusion tous médias et supports. Traduction assistée. Intelligence artificielle
* Chaines TV et films plurilinguistiques (sur le modèle de Arte?)
* Politique de reconquête de souveraineté dans l'Internet et l'édition en ligne
Mettre en place et financer de grands programmes de souveraineté
* Technologies et matériels de défense et sécurité
* Technologies de l'information et du calcul
* Robotique autonome
* Neurosciences st sciences cognitives
* Espace
Réforme des institutions européennes
* Le moteur franco-allemand. Faut-il le conserver? L'élargir à d'autres?
* Faut-il développer les coopérations renforcées. Dans quels domaines?
* Un gouvernement économique et financier de la zone euro
* Comment et où harmoniser les droits fiscaux, sociaux et du travail, ainsi que les normes industrielles européennes. Comment définir une protection aux frontières correspondante.
* Faut-il renforcer et dans quels domaines les compétences de la présidence de l'UE et de la Commission? Faut-il augmenter les transferts budgétaires des Etats vers l'UE
Vers une Europe fédérale au service d'un souverainisme européen ?
* Comment définir un souverainisme européen et ses relations avec les souverainismes nationaux?
* Engager un débat et faire des propositions concernant la mise en place d'une Europe véritablement fédérale au service d'un tel souverainisme
* Proposer les grandes lignes d'une constitution fédérale pour l'Europe (Fédération des Etats européens)
Contributions européennes à une future économie-monde
* La question de la décroissance
* Participer à l'évaluation des externalités positives et négatives
* Les questions fiscales: impôt universel. Qui paierait et pour quoi?
* Les questions de revenu: revenu universel de solidarité. Qui paierait et pourquoi?
* Dans quels domaines conserver une aide européenne aux pays pauvres, compte tenu de son inefficacité croissante ? Santé, éducation (?) alimentation (?)
* Nouvelles formes d'aides au développement
11/01/2011
Red Europea de Reflexión Geopolítica. Réseau européen de réflexion géopolitique.
Session inaugurale. Ile de San Simon. 27 avril 2011.
Rappelons que la géopolitique est généralement considérée comme une science. Elle reste cependant encore très éloignée des sciences exactes. D'où l'intérêt de l'aborder avec le maximum d'objectivité, afin d'en éliminer des approches trop partisanes. Il est impossible cependant de ne pas se référer aux grandes options politiques sous-jacentes au choix des questions ou des solutions qui sont évoquées. Une démarche géopolitique bien conçue impose un esprit critique permanent. Elle suscite donc des débats. D'où son intérêt.
Automates Intelligents propose ici une première liste de thèmes paraissant importants pour les futurs travaux du Réseau européen de Réflexion géopolitique. Il sera possible d'en tirer des articles, des sujets d'étude, voire des dossiers à l'attention des décideurs économiques et politiques. Il faudra faire un tri en fonction des moyens d'approfondissement disponibles. Mais il nous semble qu'il s'agit de questions existentielles mettant en jeu la survie même de l'Europe en tant qu'entité géopolitique indépendante.
Plan
1. Evaluation des risques et des ressources
2. Définition de politiques stratégiques
3. Evolution des institutions européennes
4. Conclusion
1. Evaluation des risques et des ressources
Evaluation des risques menaçant le monde global
L'Europe n' échappera évidemment pas à ces risques. Elle devra mettre en oeuvre pour les prévenir, dans son propre intérêt comme dans celui du reste du monde, des politiques aussi efficaces que possible.
* Le changement climatique et ses conséquences: désertification, inondations, phénomènes météorologiques violents...D'une façon générale, les scientifiques prévoient pour 2050 et au delà une montée du niveau des mers et un déplacement vers les pôles (notamment l'arctique) des régions tropicales et tempérées.
* L'effondrement, au détriment de beaucoup d'espèces déjà menacées, de la biodiversité terrestre et océanique.
* La possibilité d'une croissance démographique mondiale supérieure aux plafonds actuellement estimés. La demande en produits alimentaires pourrait alors dépasser les prévisions actuelles.
* L'épuisement progressif de certaines ressources vitales: eau, terres arables, air non pollué, matières premières rares.
* Les catastrophes de type technologique, pouvant survenir partout y compris dans les pays développés. Avec l'accident de Fukushima au Japon, l'exemple du nucléaire de fission est aujourd'hui présent dans tous les esprits. Mais on doit évoquer aussi certains risques tenant notamment aux biotechnologies.
* Le maintien ou le développement, au niveau mondial, des inégalités de niveau de vie et d'éducation entre pays pauvres et pays riches. Il en résulte une dégradation croissante des services publics et des équipements dans de nombreux pays. Différentes tensions, pouvant prendre des formes violentes, en découleront nécessairement.
* La faiblesse persistantes des institutions internationales, au moment où la mondialisation des dangers demanderait une grande efficacité des organisations destinées à les combattre.
* La géopolitique du crime organisé et de l'illicite dans le monde (voir Revue Diplomatie, n° 50)
Evaluation des risques menaçant plus particulièrement l'Europe
Ces risques découlent des précédents. Mais certains sont inhérents à l'histoire ou à l'organisation de l'ensemble pan-européen.
* Le risque démographique: baisse de la natalité, vieillissement. L'appel à l'immigration ne permettra pas de résoudre les insuffisance de population active prévisibles. Des mesures de redressement de la natalité s'imposeraient donc sans attendre.
* L'insuffisance marquée de la plupart des matières premières énergétiques et industrielles jugées stratégiques.
* La perte progressive, par manque d'investissement et par délocalisation hors d'Europe, du potentiel scientifique, technologique et industriel ayant fait jusqu'à présent la puissance de l'Europe. Il en résulte un chômage de moins en moins supportable par les structures de l'Etat providence.
* Le maintien sinon la croissance des inégalités sociales et géographiques. Le sous-investissement dans les banlieues affecte toutes les villes européennes. Les transferts de ressources des pays européens riches vers les pays plus pauvres semblent bloqués.
* La tentation qu'éprouve, face à ces difficultés comme face à la crise, chaque Etat ou ensemble régional à se replier sur lui-même, au détriment de l'idéal européen. Ceci peut se traduire à l'extrême par un retour des nationalismes de type populiste.
* La perte d'influence des valeurs dont l'Europe était jusqu'à ces derniers temps le berceau: droits de l'homme, égalité entre les sexes, laïcité, démocratie politique et contre-pouvoirs, Etat régulateur et Etat-providence.
* L'abandon systématique des efforts de défense.
* D'une faon générale, l'absence d'une coordination politique suffisante. L'Union européenne, face aux grands empires, se présente comme un ectoplasme politique.
* La géopolitique du crime organisé et de l'illicite en Europe (voir Revue Diplomatie, n° 50)
Evaluation des ensembles géopolitiques concurrents
Dans un monde désormais multipolaire, la naïveté n'est pas de mise. Il faut connaitre les concurrents susceptibles de se transformer en adversaires. Il faut définir des stratégies globales de résistance à leur égard. Il faut aussi parallèlement identifier les partenaires occasionnels ou de long terme, afin de coopérer efficacement avec eux. Pour cela, des services efficaces de guerre et contre-guerre économique s'imposent, non seulement dans les principaux Etats mais au niveau européen.
* Les Etats-Unis. Indéniablement en perte d'influence face aux nouvelles puissances (dites émergées plutôt qu'émergentes), les Etats-Unis conservent des potentiels de compétitivité considérables, dont l'Europe doit s'inspirer. Ceci notamment dans le domaine scientifique et technologique, comme dans celui des technologies de puissance (défense, espace) et des industries culturelles (soft power). Cependant les Européens, trop souvent fascinés par la puissance américaine, oublient que l'Amérique n'a jamais encouragé l'émergence d'une puissance européenne autonome. Elle a toujours considéré l'Europe comme un instrument et avant-poste au service de ses propres stratégies. Sans tomber dans l'anti-américanisme, l'Europe doit se débarrasser d'un atlantisme naïf et se méfier de tous les réseaux d'influence actifs en son sein et travaillant au service des politiques américaines;
* La Chine. Deuxième, bientôt sans doute première puissance économique mondiale, la Chine sera de plus en plus en compétition sur la plupart des domaines avec l'Europe. Ceci ne justifie pas d'en faire un adversaire politique. L'Europe doit apprendre à mieux la connaître (dans ses forces comme dans ses faiblesses) et surtout adopter les moyens de se comporter elle-aussi en puissance vis-à-vis d'elle. Autrement dit pratiquer sans états d'âme la politique du donnant-donnant ou de la réciprocité. Mais pour cela l'Europe devra se renforcer considérablement.
* L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et les autres puissances émergentes. L'Europe devra dans l'ensemble adopter à leur égard des politiques sans naïveté, elles-aussi sur la base du donnant-donnant. Dans de nombreux cas, des partenariats stratégiques limités pourront être envisagés.
* La Russie. Malgré ses faiblesses actuelles, la Russie représente (pensons-nous) pour l'Europe un prolongement géographique, linguistique et culturel qu'il conviendrait de valoriser dans de nombreux domaines. L'inverse est également vrai. Des partenariats stratégiques euro-russes, voire de véritables accords industriels, scientifiques et économiques s'imposeront de plus en plus. Ils pourront être déterminants, tant pour l'avenir de la Russie que de l'Europe.
* L'Amérique latine et le continent africain. L'Europe ne peut se désintéresser de ces pays, malgré leurs difficultés actuelles. Il s'agit souvent, notamment pour les Etats européens du Sud, de véritables prolongements territoriaux ou civilisationnels. Les négliger représenterait une perte d'influence notable pour l'Europe, y compris pour les Etats de l'Europe centrale et orientale davantage tournés vers l'est. Ceci ne voudra pas dire une ouverture sans précautions, mais plutôt des co-investissements, dépourvus d'esprit néocolonialiste, dans les domaines économiques et techno-scientifiques essentiels. Dans cette perspective, on attachera désormais un intérêt particulier à ce que l'on nomme les « révolutions » dans le monde arabo-musulman, qui paraissent riches de promesses.
Evaluation et protection des potentiels européens
L'Europe dispose de potentiels exceptionnels, que par euro-pessimisme elle a tendance à négliger. Ils doivent au contraire faire l'objet de valorisation systématique, y compris dans le cadre de partenariats stratégiques avec les pays non-européens alliés de l'Europe.
* L'existence de structures étatiques et administratives solides, sans lesquelles s'installe ou demeure le désordre sociétal (on peut lire à cet égard ce qu'en dit Francis Fukuyama dans son dernier ouvrage « The origines of political order », 2011).
* L'existence de services publics et d'administrations publiques intervenant dans le domaine social (droit du travail, protection sociale, santé publique) et dans de nombreux secteurs relevant des « public utilities » (recherche scientifique désintéressée, transports, aménagement du territoire...). Les intérêts financiers globalisés mènent contre les structures étatiques et les services publics européens des offensives permanentes afin de les « privatiser » autrement dit afin de se les approprier. Ils ont réussi jusqu'à présent à le faire, avec l'appui de la Commission européenne et de gouvernements libéraux ou ultra-libéraux. Mais ce faisant l'Europe est en train de se priver des bases de sa puissance au plan mondial, comme de nombreux thèmes qu'elle pourrait « exporter » au bénéfice des jeunes Etats se tournant vers elle.
* Au plan humain et sociétal, l'existence d'une grande diversité de langues et de cultures, ainsi que de compétences professionnelles, rendant l'Europe capable de s'adapter rapidement, sur le mode biologique, à des changements dans les contraintes globales. Les valeurs européennes, évoquées précédemment pour en déplorer la perte d'influence, font partie de ces potentiels.
* La présence de nombreuses épargnes mobilisables, notamment au profit d'investissements localisés en Europe. Ceci fait contraste dans un monde où généralement les dettes publiques et privées paralysent les perspectives d'investissement.
* L'existence de secteurs économiques dynamiques, potentiellement au service du développement européen et des exportations: secteur agricole et agro-alimentaire, industries de l'infrastructure et du bâtiment, secteurs des technologies avancées (aéronautique et espace, transports terrestres, applications des NBIC), secteur des services. On mentionnera aussi le tourisme, qu'il ne faut pas négliger.
* Au plan géographique, l'Europe dispose d'un potentiel important en termes de facilités climatiques, de terres agricoles, de ressources fluviales, littorales et océaniques, dont il convient d'assurer la protection contre les tentations de sur-exploitations.
2. Définition de politiques stratégiques
Appelons ainsi des politiques intéressant le plus de partenaires européens possible, visant de préférence le moyen et le long terme, et impliquant, dans la tradition européenne, le plus grand nombre possible de ressources et de moyens publics.
Stratégies globales
Les choix quasiment philosophiques faits dans ces domaines impliquent de véritables options de société.
* Comment définir les domaines respectifs du libre-échange ou libéralisme économique et de l'économie régulée par la puissance publique (ou dirigée)? Peut-on envisager des économies mixtes, et sous quelles formes?
* Peut-on aujourd'hui en priorité élaborer ou diffuser une nouvelle pensée économique, vis-à-vis de la crise économique, de l'endettement et du recours aux marchés financiers. Notre réponse est affirmative. Voir par exemple nos commentaires au « Manifeste des économistes atterrés » http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=626&r_id= )
* Comment définir et financer les besoins de développement des laboratoires et universités en Europe, notamment dans les pays encore mal représentés à cet égard?
* Comment évaluer et commencer à prendre en compte les externalités internes et externes, positives et négatives. Il s'agit de données économiques que ne connaissent pas les comptabilités nationales et budgétaires mais qui représentent des actifs et des passifs déterminants pour la survie des populations et des sociétés).
Politiques de développement économiques et de lutte pour l'emploi
Le développement économique et le soutien à l'emploi ne signifient pas nécessairement la croissance systématique de la consommation, qui serait impossible. Ils doivent au contraire s'accompagner de décroissance dans un grand nombre de secteurs inutilement gaspilleurs, mais aussi de croissance dans ce que l'on nomme parfois le « capital cognitif ».
* Liste des domaines d'investissement et des politiques industrielles prioritaires dans les secteurs des technologies avancées et des recherche fondamentales et appliquées. Comment financer et protéger les investissements stratégiques? Le patriotisme industriel. Le protectionnisme sélectif.
* Comment contrôler les dérives actuelles du secteur des banques et des assurances? Comment lutter efficacement contre les paradis fiscaux?
* Comment exporter tout en préservant la capacité d'innovation? La question des transferts de technologie.
* Comment sélectionner et financer les programmes de recherche dans les sciences émergentes.
* Dans quels domaines et comment définir une politique européenne de l'environnement: lutte contre le réchauffement, protection de la biodiversité terrestre et marine.
* Dans quels domaines et comment définir une politique européenne de l'énergie (mix énergétique, production, transport, économies).
* Comment améliorer le fonctionnement de la zone euro? Faut-il chercher à l'étendre ou au contraire à la réduire?
* Comment augmenter les ressources publiques? Augmentation des impôts. Mobilisation et protection de l'épargne européenne? Faut-il créer un Fonds d'investissement stratégique européen?
* Quelles limites donner aux politiques budgétaires dites d'austérité (ou de réforme)
Le domaine particulier des grands programmes impliquant les technologies de souveraineté
Ce terme désigne des secteurs d'investissement dont aucune puissance mondiale ne peut prétendre aujourd'hui se passer sauf à aliéner son indépendance. On y retrouve les questions précédentes, appliquées à des recherches et applications imposant des politiques publiques spécifiques
* Technologies et matériels de défense et sécurité (de préférence duales).
* Technologies de l'information et du calcul.
* Robotique autonome et intelligence artificielle générale.
* Neurosciences et sciences cognitives.
* Espace civil et militaire, sous leurs diverses formes.
* Energies nouvelles.
* Biotechnologies et Industries pharmaceutiques
Politiques culturelles
Il s'agit de ce que les Etats-Unis ont nommé le soft-power. Le domaine recoupe ce dont l'Europe a longtemps été un symbole mondial: la création philosophique, artistique, culturelle. La généralisation des réseaux et outils numériques y exige une créativité et une adaptation continue. Des investissements permanents sont nécessaires, engageant les particuliers, les associations mais aussi les Etats. Pour l'Europe, il s'agit aussi de détecter et le cas échéant combattre les dépendances politiques à forme culturelle, notamment au regard de l'atlantisme dont la pénétration est mondiale. On évoquera également sous cette rubrique le développement des universités européennes et leur large ouverture aux étudiants étrangers qui contribuent éminemment à l'influence européenne dans le monde.
* Peut-on ou doit-on définir un soft-power européen. Qui doit s'en charger? Comment en préciser les cibles, les acteurs et les modes de diffusion?
* Dans quels domaines affecter des ressources publiques aux investissements culturels? Aides à la création et à la diffusion tous médias et supports. Développement de la traduction assistée et des programmes de gestion des compétences par l'intelligence artificielle.
* Doit-on encourager la production d'émission et la mise en place de chaînes plurilinguistiques (sur le modèle de Arte) ? Faut-il encourager l'édition en ligne? Faut-il limiter par voie réglementaire la publicité commerciale sur les réseaux culturels?
* Faut-il soutenir par des investissement publics la numérisation non commerciale des Bibliothèques et musées européens?
3. Evolution des institutions européennes
Beaucoup des reproches faits à l'Union européenne et plus généralement à l'Europe, tiennent à l'obsolescence de ses institutions laissant place parfois à une inadaptation de plus en plus criante. Ces institutions, définies au temps du libéralisme et dans l'optique d'éviter la mise en place en Europe d'une puissance mondiale indépendante, doivent aujourd'hui être profondément modifiées. La difficulté de la tâche ne devrait pas empêcher d'en faire une priorité. Les changements pourront être relativement ponctuels, mais dans une approche plus ambitieuse, ils pourront conduire (perspective que nous préconisons pour notre part) à la mise en place d'un véritable Etat Fédéral européen, proche de ce que sont les Etats-Unis d'Amérique.
Réforme des institutions européennes
On mentionnera dans cette rubrique les différents techniques permettant de donner plus de poids aux institutions européennes actuelles, sans modifier radicalement (par une constitution fédérale) leurs domaines de compétences et pouvoirs respectifs.
* Les frontières de l'Europe. Ce terme désigne la question complexe de l'élargissement possible de l'Union, mais aussi éventuellement de la sortie, sur leur demande, de certains Etats membres.
* Les « moteurs bi-nationaux». Le « moteur franco-allemand ». Faut-il le conserver? L'élargir à d'autres pays ? En encourager d'autres ? Faudrait-il envisager un statut particulier pour le Royaume-Uni, si celui-ci persistait à se considérer, au moins partiellement, comme « en dehors » de l'Europe ?
* Les coopérations renforcées. Comment les développer? Dans quels domaines? La défense constitue sans doute la première priorité, au delà des actions de défense européenne existantes. On étendra à cette fin les compétences et ressources de l'Agence européenne de défense.
* Les Agences. Celles-ci constituent des formes souples et efficaces d'association entre gouvernements, administrations et entreprises européennes. On citera l'Agence spatiale européenne, les agences de sécurité alimentaire ou de pharmacovigilance, l'Agence Eurocontrol. Nous proposons pour notre part d'en créer de nouvelles, avec des pouvoirs étendus: Agence européenne de l'énergie, Agence européenne de l'environnement...On renforcera parallèlement les services européens en charge de la coopération avec les pays pauvres.
* Le renforcement du gouvernement économique et financier de la zone euro. Il s'agit d'une priorité absolue, afin de doter l'ensemble des pays de la zone euro des moyens d'harmonisation fiscale, douanière, réglementaire sans lesquels aucune gestion commune de la monnaie unique n'est viable. Il s'agira pratiquement d'un premier pas vers une Europe fédérale plus étendue.
* Comment augmenter et dans quels domaines les compétences de la présidence de l'Union et de la Commission? Il serait indispensable en priorité d'accroître les transferts budgétaires des Etats vers l'Union, de façon à ce que le budget communautaire atteigne au moins 10 à 15% de l'ensemble des budgets européens.
Vers une Europe fédérale au service d'un souverainisme européen
Appelons souverainisme européen la capacité de l'Union européenne de se comporter globalement comme un Etat souverain, analogue aux Etats-Unis, à la Chine et à bien d'autres. Cela ne serait pas possible sans la transformation de l'Union. en faisant non plus une confédération d'Etats nationaux mais une Fédération d'Etats fédérés. Vu l'importance des résistances probables, une démarche en plsieurs temps, accompagnée de simulations sur Internet, pourrait être envisagée.
* Mise en place d'une Assemblée constituante et adoption d'une première constitution fédérale.
* Election d'une chambre des députés et d'une chambre des Etats-membres.
* Election d'un Président
* Développement d'une administration fédérale avec transfert progressif de compétences, moyens budgétaires et ressources humaines.
4. Conclusion
Comment mobiliser les opinions publiques au service de la construction européenne?
Cette question est essentielle, mais souvent perdue de vue. Des sacrifices importants s'imposeront avec l'aggravation et la conjonction des crises. Comment les faire accepter? En dehors des mobilisations spontanées, les futurs responsables de l'approfondissement de la construction européenne pourront compter sur plusieurs facteurs simultanés.
* La peur devant l'aggravation des risques, poussant à l'union (fear factor).
* L'enthousiasme face à des objectifs difficiles, de grands enjeux technologiques, la conquête de nouveaux territoires (spatial, intelligence artificielle...)
*La volonté de ne pas se laisser dépasser par des compétiteurs non européens.
* La production de l'adhésion par la multiplication des débats et controverses, utilisant notamment les réseaux interactifs.
00:31 Publié dans Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, affaires européennes, politique internationale, union européenne, parlement européen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 mai 2011
L'usuraio Strauss Kahn inciampa nell'economia reale
L’usuraio Strauss Kahn inciampa nell’economia reale
La caduta del direttore generale del Fmi rimescola i poteri e la distribuzione delle poltrone dei poteri forti mondiali
Filippo Ghira  Anche gli usurai sono uomini, con tutte le loro pruderie sessuali che a causa dell’età non riescono a tenere adeguatamente sotto controllo. Come italiani non possiamo quindi che essere grati a Dominique Strauss Kahn, direttore generale del Fondo monetario internazionale, per aver dimostrato che certi fenomeni, ai piani alti o ai piani bassi del potere, non sono una peculiarità solo italiana. Così i mangia ranocchie di oltralpe la smetteranno di sfotterci per le disavventure erotiche di Berlusconi.
Anche gli usurai sono uomini, con tutte le loro pruderie sessuali che a causa dell’età non riescono a tenere adeguatamente sotto controllo. Come italiani non possiamo quindi che essere grati a Dominique Strauss Kahn, direttore generale del Fondo monetario internazionale, per aver dimostrato che certi fenomeni, ai piani alti o ai piani bassi del potere, non sono una peculiarità solo italiana. Così i mangia ranocchie di oltralpe la smetteranno di sfotterci per le disavventure erotiche di Berlusconi.
L’usuraio francese doveva essere così abituato ad imporre condizioni capestro dal punto di vista finanziario a Paesi come Portogallo, Irlanda e Grecia, beneficiati (si fa per scrivere) dei suoi aiuti (al tasso di interesse del 6,2% annuo) da non riuscire più a comprendere quale sia il confine con l’economia reale e con la legge della domanda e dell’offerta. Fosse stato in Italia, avrebbe dovuto toccare con mano che ogni cosa ha un suo preciso valore e il più delle volte ha anche un prezzo. Un principio ancora più vero negli Stati Uniti come è certificato dalla sempre verde considerazione in merito fatta oltre un secolo fa da Oscar Wilde. Strauss Kahn avrà quindi compreso che anche nel Paese dove i sogni possono diventare realtà, anche nella città dove la fiaccola della Statua della Libertà indica la strada del successo e del guadagno ai nuovi immigrati, bisogna rispettare certe regole. Bisogna in primo luogo pagare perché non tutto è concesso gratis ai potenti di turno. Soprattutto per quelli che come lui hanno fama di essere ossessionati dalle donne e ai quali, in questi frangenti, giurie e giudici daranno torto sempre e comunque.
La vicenda del tecnocrate socialista francese, al di là dei risvolti penali che dovranno essere accertati in sede giudiziaria, rischia però di comportare conseguenze non da poco a livello internazionale, sia per gli equilibri politici in senso stretto che per quelli economico-finanziari. Qualunque sarà la conclusione del bunga bunga di New York, appare infatti chiaro che la carriera di Strauss Kahn è stata definitivamente stroncata. Si sono dissolte così in poche ore tutte le speranze di essere nominato candidato ufficiale del Partito Socialista alla presidenza della Repubblica e di arrivare l’anno prossimo all’Eliseo dopo uno vittorioso scontro al ballottaggio con Nicolas Sarkozy che nel 2007, con rara sensibilità, lo aveva fatto salire alla guida del Fmi. Erano gli stessi sondaggi d’opinione a dare infatti come certa la sua designazione a candidato socialista e a dare come più che probabile un suo successo contro l’attuale presidente post gollista che non gode più del favore di un tempo ma che comunque rappresenterà lo schieramento di centrodestra. Una lotta che in ogni caso avrebbe lasciato inalterati i rapporti di forze all’interno del sistema economico-industriale e finanziario francese. Sarkozy e Strauss Kahn sono infatti pienamente funzionali a tali interessi, la difesa dei principi del Libero Mercato (ossia delle banche e degli speculatori) rappresenta una costante per entrambi, e una eventuale presidenza del secondo si sarebbe differenziata da quella del suo predecessore soltanto per questioni di dettaglio. Quelle per intenderci, legate ai diritti civili, come è tradizione del partito francese della rosa nel pugno.
La caduta di Strauss Kahn rappresenta quindi una fortuna e allo stesso tempo un colpo per Sarkozy. Una fortuna perché gli toglie dai piedi un pericoloso concorrente. E in questo qualche osservatore smaliziato ha lanciato l’ipotesi di una “manina” dei servizi segreti Usa per aiutare Sarkozy a liberarsi di un pericoloso concorrente. Forse, un ringraziamento di Obama per il nuovo asse Washington-Londra-Parigi che tanto buona (!) prova di sé ha dato nell’aggressione alla Libia e nel tentativo di creare un nuovo ordine mediterraneo?
Ma rappresenta pure un colpo perché taglia molte possibilità al progetto di portare un altro francese alla direzione generale del Fmi l’anno prossimo, quando sarebbe scaduto il mandato di Dsk, come lo chiamano ormai i giornali. L’Eliseo aveva infatti pensato a Christine Lagardère, attuale ministro delle Finanze, che è gradita sia a Washington che a Londra che, in virtù del peso delle rispettive quote versate al Fmi come fondi di dotazione, possono esprimere il nome di un loro candidato di fiducia e farlo accettare dagli altri. Non è così un caso che ad appena 24 ore dall’arresto di Dsk, venga già fatto circolare il nome di un suo possibile successore che secondo i bookmaker britannici potrebbe essere Shri S.Sridhar, attuale presidente e direttore operativo della Banca centrale indiana, dato a 3,50. Una nomina che sarebbe la presa d’atto della nuova forza economica e politica assunta da Nuova Delhi sugli scenari internazionali.
La fine della carriera di Dsk potrebbe, qui però il condizionale è d’obbligo perché i giochi sono ormai fatti, costituire un handicap per la nomina di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale europea, in sostituzione di un altro francese, Jean Claude Trichet, il cui mandato scade in ottobre. Sia Sarkozy che il cancelliere tedesco, Angela Merkel, si erano già espressi ufficialmente per Draghi ma adesso la Francia rischia di trovarsi senza propri rappresentanti alla guida di due fra i principali organismi internazionali, due centri di potere enormi attraverso i quali incidere pesantemente sulla finanza, sull’economia e sulla politica. A Parigi resterebbe soltanto, ma non è poco, Pascal Lamy che nel 2005 è stato eletto alla guida dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ed è stato poi confermato nel 2009 per altri 4 anni.
Questo tipo di umori hanno fatto da cornice ieri ai lavori dell’Eurogruppo a Bruxelles, nel corso dei quali si è parlato di tre questioni. Il via libera all’aiuto di 78 miliardi di euro al Portogallo. La definizione dell’Esm, il fondo permanente salva Stati che dal 2013 sostituirà quello provvisorio (Efsf). E infine il via libera alla nomina di Draghi alla Bce.
In assenza di Dsk, a rappresentare il Fmi a Bruxelles c’era il numero due, lo statunitense John Lipsky, nominato direttore generale ad interim, definito da un comunicato come “un uomo capace, di grande esperienza e un forte economista”. In concreto, si tratta di un usuraio che è stato capo economista alla JP Morgan, alla Chase Manhattan dei Rockefeller e alla Salomon Brothers. Davvero una bella scuola nella quale fare la giusta esperienza ed essere poi in grado di taglieggiare i popoli in quello che è lo sport preferito del Fmi.
17 Maggio 2011 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=8287
17:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fmi, économie, europe, affaires européennes, france, dominique strauss-kahn, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 mai 2011
Quand les Belges partent à la conquête de la Chine...
Quand les Belges partent à la conquête de la Chine…
Une ligne ferroviaire ayant pour point de départ le port d'Anvers, qui, via l'Allemagne et la Pologne, puis l'Ukraine, la Russie et la Mongolie, ralliera la Chine jusqu'à la plus grande ville chinoise (Chongqing, 32 millions d'habitants), soit près de 11.000 kilomètres. Le projet va cependant plus loin : les voies fluviales et ferroviaires chinoises feront de Chongqing un hub relié directement à l'Europe. Un projet qui, cependant, en dehors du port d'Anvers, ne sera pas aux mains d'opérateurs belges, au grand dam de la SNCB. C'est la société suisse, HUPAC, un des leaders européens du fret par rail, déjà en contrat avec le port d'Anvers, qui assurera la liaison Belgique-Chine, en association avec deux partenaires russes (Russkaya Troyka et Eurasia Good Transport).
Il peut paraître surprenant qu'une institution portuaire soit au coeur d'un projet ferroviaire transcontinental. Le doute se lève dès lors qu'en termes de temps, le fret acheminé d'Anvers à Chongqing le sera en deux fois moins de temps que par voie maritime (environ 20 jours contre 40). Malgré les problèmes récurrents en matière de transport international par rail, dont l'écartement des rails, un gain considérable de temps est à la clé du projet. L'argument environnemental vient compléter le projet. Un transport ferroviaire, deux fois plus rapide que le transport maritime serait moins consommateur en énergie. Quant au volet administratif, il ne serait pas en reste. Une coopération et surtout la mise en place d'un système d'échange d'informations entre les services douaniers des pays concernés seront nécessaires. Bref, une « Green Train Line » entre la Chine et l'Europe, une première mondiale attractive… Le port d'Anvers se verrait ainsi devenir « le hub » européen pour le transit de marchandises à destination de la Chine. Largement aidé par son hinterland, Anvers deviendrait le passage obligé des marchandises, non seulement européennes mais également du Nord de l'Amérique, du l'ouest Africain, etc… Anvers accueillera certainement aussi de nombreuses entités économiques ou autres de l'Empire du Milieu. Les retombées économiques pour la région pourraient être considérables.
La Belgique, et plus particulièrement la Région flamande, est, semble-t-il, en train de modifier, ou en tout cas de tenter de modifier, les cartes géostratégiques et géoéconomiques actuelles. Réduire le trafic maritime à destination de la Chine au profit d'une liaison ferroviaire implique une vision géoéconomique nouvelle. La Russie est au coeur de cette nouvelle vision (et participe d'ailleurs pleinement au projet). Il en va de même de la place de l'Ukraine. Concernant la Chine, actuellement focalisée sur le développement d'Est en Ouest de son territoire, elle pourrait se libérer de cette contrainte. Au sein même de l'Europe, une modification des équilibres de puissance (en terme de flux et d'acheminement de marchandises tout au moins et donc de création de valeur) pourrait s'opérer au profit de l'Europe du Nord (Benelux, Nord-Ouest de l'Allemagne,…). Ces glissements d'équilibres ne semblent pas se faire au profit de la France. Aucun partenaire français n'est évoqué dans le projet ferroviaire entre le port d'Anvers et Chongqing. De plus, le grand chantier du canal « Seine-Nord Europe », une fois terminé, sera une autoroute fluviale reliant l'Ile de France au port d'Anvers (et sa nouvelle gare) ; probablement au détriment du port du Havre (Lire La guerre des puissances portuaires en Europe). Faut-il être aujourd'hui un petit pays, sans gouvernement fédéral qui plus est, pour avoir des idées de développement ambitieuses?
00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasisme, eurasie, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, eurosibérie, anvers, belgique, flandre, communications continentales, chemins de fer, infrastructures, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La fine dell'Europa
La fine dell’Europa
Ex: http://www.centrostudilaruna.it/
 L’Europa sta vivendo il momento più tragico della sua storia trimillenaria. Siamo dinanzi a eventi di portata epocale che, secondo tutte le previsioni, condurranno nel giro di pochi decenni alla pura e semplice estinzione fisica dei nostri popoli. Questa drammatica situazione sta precipitando lungo un piano inclinato, privo di ostacoli e a velocità crescente. L’Europa, quale è esistita dal Neolitico agli anni Sessanta-Settanta del Novecento, sta rapidamente scomparendo sotto i nostri occhi. L’Europa della nostra nascita, della nostra cultura, delle nostre città, di tutti i nostri valori, non è più già oggi la stessa. E nel breve volgere di una generazione sarà un ricordo del passato. Sarà diventata un’altra cosa. A leggere il recente libro di Walter Laqueur Gli ultimi giorni dell’Europa. Epitaffio per un vecchio continente (Marsilio) c’è davvero da rabbrividire. Nessun allarmismo a effetto, intendiamoci, non si tratta di un instant book a sensazione. È semplicemente una riflessione basata sui fatti. Che atterrisce per le prospettive che squaderna, solo osservando i dati già acquisiti e quelli in dinamica evoluzione. La questione di vita o di morte si riduce a due semplici, ma esplosivi fattori: denatalità e immigrazione.
L’Europa sta vivendo il momento più tragico della sua storia trimillenaria. Siamo dinanzi a eventi di portata epocale che, secondo tutte le previsioni, condurranno nel giro di pochi decenni alla pura e semplice estinzione fisica dei nostri popoli. Questa drammatica situazione sta precipitando lungo un piano inclinato, privo di ostacoli e a velocità crescente. L’Europa, quale è esistita dal Neolitico agli anni Sessanta-Settanta del Novecento, sta rapidamente scomparendo sotto i nostri occhi. L’Europa della nostra nascita, della nostra cultura, delle nostre città, di tutti i nostri valori, non è più già oggi la stessa. E nel breve volgere di una generazione sarà un ricordo del passato. Sarà diventata un’altra cosa. A leggere il recente libro di Walter Laqueur Gli ultimi giorni dell’Europa. Epitaffio per un vecchio continente (Marsilio) c’è davvero da rabbrividire. Nessun allarmismo a effetto, intendiamoci, non si tratta di un instant book a sensazione. È semplicemente una riflessione basata sui fatti. Che atterrisce per le prospettive che squaderna, solo osservando i dati già acquisiti e quelli in dinamica evoluzione. La questione di vita o di morte si riduce a due semplici, ma esplosivi fattori: denatalità e immigrazione.
Laqueur dà qualche cifra e avanza osservazioni elementari su dati che sono pubblici, alla portata di tutti, ma che nessuno divulga: «Fra cent’anni la popolazione dell’Europa sarà solo una minima parte di quello che è ora e in duecento anni alcuni paesi potrebbero scomparire». E aggiunge che «alcuni hanno sostenuto che se l’Europa sarà ancora un continente di qualche importanza duecento anni da adesso, sarà quasi certamente un continente nero». Poiché i bianchi sono sterili, non fanno e non vogliono fare figli, mentre gli immigrati di colore sono fertilissimi e si riproducono a tassi esponenziali. Tutto vero, si dirà, ma insomma si tratta di proiezioni parecchio lontane, nulla di cui preoccuparsi oggi… Non esattamente. La catastrofe è già in pieno svolgimento e il cappio si chiuderà tra breve. E nel corso della nostra stessa vita avremo modo di verificarlo non per sintomi, magari anche gravi come sta già accadendo, ma per una travolgente evidenza. Secondo le stime della Comunità Europea e delle Nazioni Unite, che l’autore riporta, la Francia, nel corso del secolo XXI, passerà dagli attuali 60 milioni di abitanti a 43, il Regno Unito da 60 a 45, la Germania da 80 a 32, la Spagna da 39 a 12…
 L’Italia poi, dagli odierni 57 milioni, si troverà a contarne 15 verso la fine del secolo. Occorre ovviamente considerare che i dati riferiti a queste proiezioni sulle popolazioni europee dei prossimi decenni contengono il fatto che moltissimi di quei cittadini non saranno altri che i figli di recente e recentissima immigrazione. Tanto che le popolazioni europee in calo vedranno velocemente elevarsi il numero dei propri concittadini di origine non europea: maghrebini, mediorientali, asiatici, africani… Laqueur attira non a caso l’attenzione sul fatto che il declino demografico relativamente contenuto che si rileva nei casi di Francia e Gran Bretagna dipende essenzialmente dal «tasso di fertilità relativamente alto nelle comunità di immigrati, neri e nordafricani in Francia, pakistani e caraibici in Gran Bretagna». Cioè: le previsioni sulle popolazioni europee del prossimo futuro non riguardano la popolazione bianca che in una parte sempre meno numerosa… I bianchi europei, come già accade negli Stati Uniti – che nel 2050 vedranno il gruppo ispanico prevalere su quello anglosassone, e quello nero avvicinarglisi sensibilmente –, vittime della loro denatalità conculcata dalla società del benessere e del profitto, stanno andando incontro a un rapido inabissamento, che presto ne farà una minoranza minacciata di estinzione sul suolo europeo.
L’Italia poi, dagli odierni 57 milioni, si troverà a contarne 15 verso la fine del secolo. Occorre ovviamente considerare che i dati riferiti a queste proiezioni sulle popolazioni europee dei prossimi decenni contengono il fatto che moltissimi di quei cittadini non saranno altri che i figli di recente e recentissima immigrazione. Tanto che le popolazioni europee in calo vedranno velocemente elevarsi il numero dei propri concittadini di origine non europea: maghrebini, mediorientali, asiatici, africani… Laqueur attira non a caso l’attenzione sul fatto che il declino demografico relativamente contenuto che si rileva nei casi di Francia e Gran Bretagna dipende essenzialmente dal «tasso di fertilità relativamente alto nelle comunità di immigrati, neri e nordafricani in Francia, pakistani e caraibici in Gran Bretagna». Cioè: le previsioni sulle popolazioni europee del prossimo futuro non riguardano la popolazione bianca che in una parte sempre meno numerosa… I bianchi europei, come già accade negli Stati Uniti – che nel 2050 vedranno il gruppo ispanico prevalere su quello anglosassone, e quello nero avvicinarglisi sensibilmente –, vittime della loro denatalità conculcata dalla società del benessere e del profitto, stanno andando incontro a un rapido inabissamento, che presto ne farà una minoranza minacciata di estinzione sul suolo europeo.
 L’Europa orientale, sulla quale qualcuno si poteva fare delle illusioni di tenuta demografica, è investita da una sterilità ritenuta addirittura più micidiale, “catastrofica” la definisce Laqueur, con percentuali di decrescita spaventose. La Russia in cinquant’anni vedrà ridursi la sua popolazione dei due terzi. L’Ucraina viaggia a un ritmo di perdita di popolazione stimato al 43%, la Bulgaria al 34%, la Croazia al 20%… Lo studioso di statistica demografica Paul Demeny, nella rivista Population and Development Review, ha osservato che «non c’è alcun precedente di un crollo demografico così rapido in tutta la storia umana». Questo veniva segnalato nel 2003. In cinque-sei anni le cose sono ulteriormente precipitate. A fronte di questa inaudita contrazione delle nascite, si erge un contro-dato terribilmente minaccioso: l’esplosività demografica del Terzo Mondo, e in particolare di quella fascia territoriale che sta a diretto contatto con le frontiere meridionali dell’Europa: Nord Africa, Africa sub-sahariana, Medio Oriente. Esistono studi e previsioni semplicemente agghiaccianti. Un solo esempio: lo Yemen, che oggi conta 20 milioni di abitanti, ne avrà oltre cento nel 2050. Cento milioni di yemeniti, in un Paese povero di tutto e privo di strutture agricole e industriali, evidentemente non rimarranno mai a casa loro. Si sposteranno in massa. Sì, ma dove? Laqueur risponde con eufemistica pacatezza: «ci sarà una pressione demografica sull’Europa ancora più forte». Il solo Yemen – uno dei Paesi più piccoli – ben presto avrà dunque un esubero di ottanta milioni di persone da indirizzare verso l’Europa.
L’Europa orientale, sulla quale qualcuno si poteva fare delle illusioni di tenuta demografica, è investita da una sterilità ritenuta addirittura più micidiale, “catastrofica” la definisce Laqueur, con percentuali di decrescita spaventose. La Russia in cinquant’anni vedrà ridursi la sua popolazione dei due terzi. L’Ucraina viaggia a un ritmo di perdita di popolazione stimato al 43%, la Bulgaria al 34%, la Croazia al 20%… Lo studioso di statistica demografica Paul Demeny, nella rivista Population and Development Review, ha osservato che «non c’è alcun precedente di un crollo demografico così rapido in tutta la storia umana». Questo veniva segnalato nel 2003. In cinque-sei anni le cose sono ulteriormente precipitate. A fronte di questa inaudita contrazione delle nascite, si erge un contro-dato terribilmente minaccioso: l’esplosività demografica del Terzo Mondo, e in particolare di quella fascia territoriale che sta a diretto contatto con le frontiere meridionali dell’Europa: Nord Africa, Africa sub-sahariana, Medio Oriente. Esistono studi e previsioni semplicemente agghiaccianti. Un solo esempio: lo Yemen, che oggi conta 20 milioni di abitanti, ne avrà oltre cento nel 2050. Cento milioni di yemeniti, in un Paese povero di tutto e privo di strutture agricole e industriali, evidentemente non rimarranno mai a casa loro. Si sposteranno in massa. Sì, ma dove? Laqueur risponde con eufemistica pacatezza: «ci sarà una pressione demografica sull’Europa ancora più forte». Il solo Yemen – uno dei Paesi più piccoli – ben presto avrà dunque un esubero di ottanta milioni di persone da indirizzare verso l’Europa.
Ma gli scenari tratteggiati da Laqueur riguardano anche altro. L’immigrazione in atto. Si tratta di una pietra tombale di fabbricazione mondialista, sotto la quale sta per essere tumulata l’idea stessa di Europa. Quella che dal dopoguerra in poi è stata prima un’emigrazione per lavoro, cui seguì il ritorno quasi generale in patria, dagli anni Ottanta è diventata una crescente infiltrazione, infine assumendo, in questi anni, i contorni dell’incontrastato arrembaggio di massa. Non diciamo frenato o regolamentato, ma neppure deplorato. Al contrario: i governi, la stampa, gli esponenti della letale “società civile” asservita ai suoi tabù, l’alimentano di continuo. A questi ambienti della sobillazione tengono dietro gli esecutori materiali. Cosche criminali, agenzie umanitarie, volontariati onlus debitamente sovvenzionati, Chiese: ecco i protagonisti di quella potente lobby – come la definisce Laqueur – che ha per tempo individuato nella sollecitazione della disperazione di massa e nel suo incanalamento verso l’Europa il business del secolo. Un neo-schiavismo che sradica il nero o il giallo, lo stipa nelle periferie degradate delle città portuali del Terzo Mondo, infine lo dirige verso le centrali dello sfruttamento turbocapitalistico di ultima generazione, operando la devastazione di ogni comunitarismo, sia nell’ospitante che nell’ospitato: con una criminalità reale e un umanitarismo di facciata (spesso unendo le due cose in un’unica intrapresa industriale), si ottiene così la spaventosa tratta, che ha come conseguenza matematica due avvenimenti simultanei: l’annientamento dei tessuti etnico-sociali delle millenarie culture europee; lo sgretolamento e la disumanizzazione delle stesse realtà terzomondiste attirate in Europa.
 Laqueur fornisce prove a getto continuo. Per dire, anziché la tanto sbandierata integrazione – maniacale fissazione degli utopisti – presso le moltitudini immigrate si hanno delinquenza, asocialità, diserzione dallo studio e dal lavoro (massicciamente offerti dai governi, secondo binari preferenziali stabiliti dalle istituzioni europee a discapito secco delle popolazioni autoctone) e alla fine un oceano di odio. Un odio aggressivo e inestinguibile, che gli immigrati – specialmente i giovani – nutrono per tutto quanto è europeo. Ad esempio, le rivolte della banlieu parigina del 2005 furono causate da «l’odio per la società francese». La banda etnica delle periferie metroplitane arricchisce il quadro dei paradisi multiculturali. In Gran Bretagna si tratta di neri contro indo-pakistani, a Bruxelles di turchi contro africani, a Parigi di islamici contro ebrei… Il risultato delle politiche immigratorie, sottolinea Laqueur, è che ovunque «si è sviluppata una cultura dell’odio e del crimine».
Laqueur fornisce prove a getto continuo. Per dire, anziché la tanto sbandierata integrazione – maniacale fissazione degli utopisti – presso le moltitudini immigrate si hanno delinquenza, asocialità, diserzione dallo studio e dal lavoro (massicciamente offerti dai governi, secondo binari preferenziali stabiliti dalle istituzioni europee a discapito secco delle popolazioni autoctone) e alla fine un oceano di odio. Un odio aggressivo e inestinguibile, che gli immigrati – specialmente i giovani – nutrono per tutto quanto è europeo. Ad esempio, le rivolte della banlieu parigina del 2005 furono causate da «l’odio per la società francese». La banda etnica delle periferie metroplitane arricchisce il quadro dei paradisi multiculturali. In Gran Bretagna si tratta di neri contro indo-pakistani, a Bruxelles di turchi contro africani, a Parigi di islamici contro ebrei… Il risultato delle politiche immigratorie, sottolinea Laqueur, è che ovunque «si è sviluppata una cultura dell’odio e del crimine».
Mentre i nostri governi applicano il principio dell’autolesionismo sistematico, dando privilegi sociali (sussidi, alloggi, lavoro, depenalizzazione dei reati, permissivismo sempre e ovunque), gli immigrati sfruttano i congegni legali offertigli su un vassoio d’argento. L’esempio tedesco: gli assistenti sociali «hanno insegnato ai turchi come approfittare delle rete di protezione sociale, il che significa ottenere dallo Stato e dalle amministrazioni locali il massimo possibile di assistenza economica e di altro genere con il minimo contributo possibile al bene comune». Integrazione? Per milioni di immigrati, ovunque in Europa, «i problemi sono gli stessi: ghettizzazione, re-islamizzazione, alta disoccupazione giovanile e scarso rendimento nelle scuole».
Le organizzazioni degli immigrati del tipo della potente Muslim Brotherhood – incoraggiate dagli europei e cavalcate da sciami di imam, leader etnici, predicatori – finiscono prima o dopo per «ottenere ciò che vogliono». E, mentre gli europei perdono mano a mano la loro identità, accade al contrario che gli immigrati rafforzino la loro: «I turchi in Germania rimangono turchi anche se hanno adottato la cittadinanza tedesca; il governo di Ankara vuole che essi votino alle elezioni turche, e allo stesso tempo che essi, ovunque vivano, difendano gli interessi della Grande Turchia che rimane la loro patria».
 Nel frattempo, irresponsabili politici di tutte le sponde – ne sappiamo qualcosa noi in Italia – spingono per offrire al più presto il diritto di voto agli immigrati. Vogliono la fine dell’Europa. Vibrano di quella febbre suicida di cui parlò Spengler a proposito delle società corrotte, senili, morte dentro. Laqueur parla di declino irreversibile per l’Europa. Ci invita a fare un giro per Neukölln, La Courneuve o Bradford, concentrazioni urbane completamente extra-europee. E si chiede come mai «ci si sia resi conto così tardi di questo stato di cose». Ma noi chiediamo a lui: è sicuro che gli europei abbiano capito in che situazione si trovano? Ottenebrati dalla propaganda mondialista e dalla paura di incorrere nel tabù del “razzismo”, sapientemente evocato, gli europei guardano dall’altra parte. Questo bel capolavoro umanitario che è l’Europa multiculturale viene infatti perseguito agitando come bastoni alcune infernali parolette, dietro alle quali si ripara il trafficante europeo di uomini e di ideali: accoglienza, solidarietà, diritti umani, etnopluralismo… Queste parole ipocrite nascondono la violenza del senso di colpa instillato a forza nella nostra gente. Hanno il rintocco della campana a morto per l’Europa.
Nel frattempo, irresponsabili politici di tutte le sponde – ne sappiamo qualcosa noi in Italia – spingono per offrire al più presto il diritto di voto agli immigrati. Vogliono la fine dell’Europa. Vibrano di quella febbre suicida di cui parlò Spengler a proposito delle società corrotte, senili, morte dentro. Laqueur parla di declino irreversibile per l’Europa. Ci invita a fare un giro per Neukölln, La Courneuve o Bradford, concentrazioni urbane completamente extra-europee. E si chiede come mai «ci si sia resi conto così tardi di questo stato di cose». Ma noi chiediamo a lui: è sicuro che gli europei abbiano capito in che situazione si trovano? Ottenebrati dalla propaganda mondialista e dalla paura di incorrere nel tabù del “razzismo”, sapientemente evocato, gli europei guardano dall’altra parte. Questo bel capolavoro umanitario che è l’Europa multiculturale viene infatti perseguito agitando come bastoni alcune infernali parolette, dietro alle quali si ripara il trafficante europeo di uomini e di ideali: accoglienza, solidarietà, diritti umani, etnopluralismo… Queste parole ipocrite nascondono la violenza del senso di colpa instillato a forza nella nostra gente. Hanno il rintocco della campana a morto per l’Europa.
* * *
Tratto da Linea del 9 gennaio 2009.
Luca Leonello Rimbotti
00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, immigration, problèmes contemporains, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 mai 2011
L'implosion de l'Union Européenne est programmée

L'implosion de l'Union européenne est programmée
par Georges-Henri Bricet des Vallons
« Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Cette sentence biblique a inspiré le tableau de Bruegel l’Ancien, où l’on voit une procession d’aveugles liés les uns aux autres s’entraîner mutuellement vers le précipice. La parabole de Bruegel vaut pour le destin de l’Union Européenne, qui n’a jamais paru aussi précaire.
Notre inconscient collectif nous le murmure : l’UE, dans son organisation actuelle, est condamnée. Certains experts le savent et le disent, à l’instar de Joseph Stiglitz, de Jacques Sapir, de Christian Saint-Etienne, de Jean-Luc Gréau, d’Alain Cotta, de feu Maurice Allais, Nobel d’économie symptomatiquement dédaigné par notre intelligentsia pour crime de lèse-béatitude envers l’euro. Notre élite politique aussi le sait, mais elle le tait soigneusement. Il faut la comprendre, faire pièce à la vérité signifierait sa chute
L’euro, ce moteur de croissance zéro
L’euro, ce moteur de croissance zéro, ne sera bientôt plus qu’une poudre de comète, abîmée dans le vaste charnier d’une oligarchie supranationale qui s’est trop tôt rêvée toute-puissante. Se corrompre dans de telles illusions d’omnipotence et d’expansion indéfinie, c’est la justice que l’histoire réserve à tous les projets impériaux, même les plus technocratiques et les moins séduisants. L’extraordinaire revitalisation des mouvements populistes européens, que la doxa nous affirmait enterrés dans les sables de la Fin de l’histoire, souligne assez la marche à la mort de l’illusion euratlantique.
La fable « crisiste » n’empêchera pas les grands mensonges de tomber
Certes, la crise de 2008 a été un effet d’aubaine pour une partie de la classe politique qui s’est ingéniée à masquer sous les traits de la conjoncture ce qui relève en réalité de failles structurelles, systémiques, propres à l’architecture de l’Union. Il faut bien être naïf pour avaler la fable crisiste qu’on tente de nous vendre : avons-nous attendu 2008 pour subir la stagflation, les délocalisations, la désindustrialisation massive, le chômage de masse, une politique d’élargissement aberrante, une immigration massive qui a explosé à la fin du siècle dernier, c’est-à-dire au moment même où la lutte contre l’immigration devenait l’omega du discours gouvernemental, plongeant le débat médiatique dans une schizophrénie ravageuse, où le durcissement des paroles va de pair avec l’impuissance des actes ? 2008 n’aura fait que révéler ces lignes de failles, dont aucune n’a été colmatée. La machine s'épuisera dans des annonces de réforme impossibles à mener et pour cause, l’ordre même de l’Union l’interdit. L’épreuve d’enfumage aura duré deux décennies. Une durée de vie remarquable pour une malversation aussi patente. L’Union semble désormais aussi fragile qu’un enfant atteint de progéria. Voici venu le temps où vont tomber les grands mensonges.
Trou noir des dettes souveraines et faillite civilisationnelle
Le trou noir des dettes souveraines travaille à leur perte fatale les économies européennes. Deux événements survenus dernièrement soulignent l’effet d’accélération : d’abord la rétrogradation de la note des Etats-Unis par Standard & Poor’s, qui signifie que le séisme financier mondial n’a pas encore épuisé ses capacités de réplique, puis l’annonce, tout aussi inédite, par le gouvernement français de sa volonté de suspendre les accords de Schengen pour tenter de juguler, vainement, l’afflux de dizaines de milliers de jeunes Tunisiens. L’édifice craque de partout. La pitoyable querelle avec l’Italie dit la faillite civilisationnelle dans laquelle nous sommes engagés. Sur le plan économique, maintenant que les pions sont tombés (Grèce, Irlande, Portugal), le cercle du désastre s’élargit et ce sont les pièces de choix qui vont être mises en jeu. L’Espagne sera la prochaine à offrir sa tête au billot du Fonds de solidarité. Gageons que le couple franco-allemand, roi et reine de ce sombre échiquier, feront tout pour proroger la demande de soutien des ibériques, qui entraînerait inéluctablement l’effondrement de l’union monétaire.
Euro et Schengen : vers la fin de l’utopie sans frontiériste
Formidable entropie qui engloutira tout de l’utopie sans-frontiériste : l’euro et Schengen imploseront simultanément. L’effet de sidération qu’engendrera cette implosion dans les opinions publiques se traduira par une série de révolutions politiques internes. Un basculement que tous les sondages annoncent et dont 2012 va dramatiquement préciser les contours.
La coque du vaisseau amiral est trouée
On aimerait ne pas avoir à se réjouir de telles perspectives. Et pourtant, nombre de politiques avisés, défaits par le référendum de Maastricht, nous avaient mis en garde : cette autodestruction était inscrite dans le programme génétique même de l’UE et de l’idéologie supranationale. Nous serions nous bornés à une Europe des Douze, fondée sur des coopérations bilatérales, seule solution pour aboutir à terme à un ensemble politique et économique stable et cohérent, que nous n’aurions pas eu à redouter un naufrage aussi radical. Persistance des Cassandres. Inutile désormais de chercher à sauver un vaisseau-amiral dont la coque est trouée. La situation ne nous laisse d’autre choix que de nous préparer à abandonner l’embarcation. L’épreuve sera douloureuse à court terme mais salvatrice à moyen terme. La plaie a de toute façon suffisamment suppuré. Il est temps de parapher l’acte de décès et d’achever cette chimère malade ou c’est elle qui nous achèvera.
Georges-Henri Bricet des Vallons
Chercheur en science politique 6/05/2011
Correspondance Polémia – 10/05/2011
Image : implosion de l’Union européenne
Georges-Henri Bricet des Vallons
00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, union européenne, parlement européen, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 mai 2011
Mayotte, département français: une calamité!
Par Robert Spieler (*)
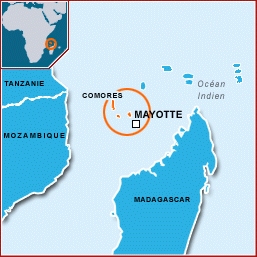 Mayotte, ce confetti situé dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l’Afrique, est devenue le 101ème département français, le 4 avril 2011, suite au référendum du 29 mars 2009 : une calamité…
Mayotte, ce confetti situé dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l’Afrique, est devenue le 101ème département français, le 4 avril 2011, suite au référendum du 29 mars 2009 : une calamité…
Un peu d’histoire :
Mayotte, située dans l’archipel des Comores ne représente qu’une surface minuscule (374 km2) : deux îles entourées d’un récif corallien et d’un magnifique lagon. On la surnomme l’île aux parfums, tant la présence de l’ylang-ylang, utilisé en parfumerie, est abondante. Les Comores sont, au XIXème siècle, l’objet de luttes incessantes entre roitelets locaux. Elles survivent avec peine grâce au trafic d’esclaves à destination du Moyen-Orient. Un sultan malgache, qui règne sur Mayotte, appelle au secours un Français, le commandant Pierre Passot. Et cède son île à la France pour la modique somme de 1 000 piastres. L’archipel ne représente en réalité aucun intérêt pour la métropole : éloigné des grandes routes maritimes, pauvre, sans ressources, il n’intéresse guère l’administration coloniale. Mayotte, une des îles de l’archipel (il y a aussi Anjouan, Grande Comore et Mohéli) ne compte que 3 000 habitants.
La situation administrative des Comores perdurera jusqu’en 1968, où la France lui concède une large autonomie interne, prélude à l’indépendance. Mais les maladresses vont succéder aux maladresses. Jacques Foccart, l’homme ‘Afrique ‘ de De Gaulle choisit un riche commerçant, Ahmed Abdallah, de l’île d’Anjouan, concurrente de Mayotte pour diriger le pays. Les Mahorais ont peur de ce tyranneau et, pour s’en protéger, proclament leur attachement indéfectible à la France. Un référendum décisif a lieu le 22 décembre 1974. Les Mahorais se prononcent à 63% contre l’indépendance, les autres Comoriens votent à 95% pour. Dès lors, le problème devient inextricable. La grande majorité des Comoriens a voté pour l’indépendance. On arrête là ? Non, au mépris du droit international, et aussi sur la pression de groupes « nationalistes » français, notamment royalistes (Pierre Pujo et Aspects de la France furent très actifs dans ce lobbying), qui s’émerveillent de voir le drapeau tricolore flotter sur tous les continents, la calamité nationale Giscard d’Estaing, deux ans avant le « regroupement familial », décide de reconnaître à Mayotte le droit de vivre sa vie. Sa vie au sein de la France. Le 8 février 1976, les habitants de Mayotte votent par référendum à 99% en faveur de l’intégration à la France.
Depuis lors, Mayotte est administrée par des fonctionnaires venus essentiellement de métropole.
Les conséquences
Mayotte, qui comptait en 1841, 3000 habitants, en compte aujourd’hui 200.000, tous musulmans. Toutes les nuits, à partir de l’île d’Anjouan, distante de cinquante kilomètre, des comoriennes sans papier embarquent, enceintes, dans des embarcations de fortune, les kwassa-kwassa pour venir accoucher à Mayotte, c'est-à-dire en France. Et c’est à Mamoudzou, chef-lieu de la collectivité territoriale, que se trouve la plus grande maternité de France : 5000 naissances par an sur un total de 8000. Les comoriennes ne sont, au demeurant, pas les seules à débarquer. Des malgaches, des africaines qui viennent faire bénéficier leurs enfants du droit du sol … Inutile de relever qu’il y a un fossé culturel entre Mayotte et la France. Il y a quelques années, on pouvait lire sur les feuilles d’impôts de l’île « première femme », « deuxième femme » dans la liste des personnes à charge à déclarer…
Grâce à Mayotte, le Ministère de l’Intérieur peut se targuer de chiffres quelque peu valorisants de reconduite à la frontière de clandestins. Mais ces chiffres n’ont aucune signification. Tous les matins, la police procède à l’arrestation de clandestins dans les villages de brousse. Qui sont expulsés et reviennent tranquillement dans les semaines qui suivent. On en voit même qui, désireux de retourner à Anjouan, pour un décès ou une fête de famille, se rendent d’eux-mêmes à la gendarmerie pour réclamer leur rapatriement en avion ou en bateau. Tous frais payés. Et qui reviennent derechef…
Quant au système éducatif, il est en toute première ligne pour encaisser le choc de cette natalité considérable et de cette immigration massive. Beaucoup ne sont pas francophones. On bricole pour faire face. On recrute des instituteurs au niveau du bac. On instaure un système de rotation : la moitié des classes viennent de 7 à 12h20, l’autre moitié de 12h30 à 17h40. Pour suivre, il faudrait construire trois collèges par an ! Et combien de lycées demain ?
La délinquance progresse, quant à elle, de façon spectaculaire. On envisage la construction d’une deuxième prison. Le nombre d’enfants ou d’adolescents livrés à eux-mêmes est énorme. Les conditions d’hébergement du centre de rétention épouvantables. Un apartheid de fait existe à Mayotte : des quartiers habités par les blancs, ultra protégés. Quant aux autres…
Mayotte est de fait, en état de faillite. Prendre en charge cette île va coûter des sommes astronomiques. Il y a certes, sans doute, de l’argent à faire, au profit de certains privilégiés, à Mamoudzou. Pour des banquiers, des entrepreneurs de travaux publics, des fonctionnaires. On s’apprête à construire un hôtel de luxe… Et des écoles, et des prisons, et sans doute demain un somptueux Hôtel du Département… L’essentiel de cette « richesse » qui se déversera sur l’île proviendra, bien sûr, de la poche des contribuables français.
Quelle folie que Sarkozy se soit engagé dans la départementalisation ! En ce 35ème anniversaire du regroupement familial, voulu par Chirac et Giscard d’Estaing, désignons cette droite méprisable, collaborationniste, qui trahit les intérêts de notre Peuple. Et considérons que c’est elle, l’ennemi principal…
(*) Tribune libre publiée dans Rivarol n°2995 (30 avril 2011)
Source : le blog de Robert Spieler, cliquez ici
00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mayotte, france, europe, affaires européennes, afrique, affaires africaines, océan indien, politique internationale, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 mai 2011
Sept questions au Président Abdullah Gül

Andreas MÖLZER :
Sept questions au Président Abdullah Gül
A l’occasion de la visite en Autriche du président turc
Monsieur le Président,
En tant que Chef d’Etat d’un grand pays important, vous nous honorez aujourd’hui, nous les Autrichiens, d’une visite d’Etat. Monsieur le Président Gül, l’Autriche et la Turquie ont derrière elles une histoire complexe, qui a connu des hauts et des bas. Par deux fois, les Turcs ont assiégé Vienne ; ensuite, le Prince Eugène, en menant ses « guerres turques » les a repoussés de manière décisive. Lors de la Première Guerre mondiale, nous étions alliés. Et, pour la première fois depuis des siècles, des centaines de milliers de Turcs arrivent en Autriche pour y travailler et pour y rester à demeure.
· Quelle est votre position, Monsieur le Président, quant à l’intégration de vos compatriotes en Autriche ? Croyez-vous, à l’instar de votre Premier Ministre Erdogan, qu’ils doivent en toute première instance conserver leur identité turque ou, au contraire, pensez-vous qu’il convient, pour tout immigrant, d’accepter la culture dominante du pays hôte ? Et que pensez-vous faire de votre ambassadeur qui a affirmé, en public, que les Autrichiens ne songent qu’à faire subir des discriminations aux immigrés turcs ?
· Et, Monsieur le Président, quelle position tenez-vous quant à l’islam ? Vous avez, de fait, été hissé à la dignité de Président de la République turque par la grâce d’un parti islamiste, ce qui a pour corollaire qu’avec le concours de vos amis politiques, vous procédez à une islamisation de la Turquie créée comme Etat laïque par Kemal Atatürk. Militez-vous aussi pour que l’islam se renforce en Europe ? Et quelle position adoptez-vous quant aux libertés religieuses des chrétiens dans votre pays ? Si de nombreuses nouvelles mosquées, avec minarets, doivent selon vous s’élever sur le sol européen, pourquoi ne pourrait-on pas bâtir de nouvelles églises chrétiennes en Turquie, avec clochers et magnifiques tintements de cloches ?
· A propos, Monsieur le Président, qu’en est-il des droits de l’homme dans votre pays ? Et quant aux droits de la femme ? Que pourriez-vous bien nous dire à propos des mariages forcés et des assassinats commis au nom de l’ « honneur » familial ? Pourquoi, dans votre beau pays, est-on poursuivi pénalement dès que l’on émet une critique sur la politique turque ?
· Toujours dans le même ordre d’idées, Monsieur le Président, je me vois quelque peu contraint de vous poser la grande question : quelle est donc votre position relative aux droits du peuple kurde ? Ce grand peuple historique voit-il toujours ses droits politiques limités à grande échelle, ainsi que la possibilité de cultiver sa propre langue ?
· Et puisque nous en sommes à parler d’histoire, Monsieur le Président, quelle est votre position quant au génocide qu’ont subi les Arméniens ? Pensez-vous aussi que la moindre allusion à ce génocide constitue une « insulte au peuple turc » ? Et pensez-vous également qu’il faille raser les monuments qui rappellent ces actes inhumains ?
· Finalement, Monsieur le Président, quelle pourrait donc bien être votre position quant à cette République de Chypre-Nord ? Pensez-vous que l’on puisse défendre le fait que des centaines d’églises orthodoxes grecques soient là-bas entièrement dévastées et que l’on brade des icônes et des mosaïques byzantines sur le marché noir des œuvres d’art ? Ne pensez-vous pas que Chypre, en tant qu’Etat de l’Union Européenne, mérite la reconnaissance et le respect que la Turquie lui refuse, surtout que votre pays semble accorder beaucoup de valeur à une adhésion à cette même Union ?
· Et, enfin, Monsieur le Président, que pensez-vous de l’Europe dans son ensemble ? Pensez-vous vraiment que la Turquie, dont 90% du territoire se trouvent sur le continent asiatique, qui est un pays musulman dont les valeurs sont assez éloignées de celles de l’Europe, doive absolument devenir un membre à part entière de l’Union Européenne ?
· Ne pensez-vous pas que, dans une ambiance de respect mutuel, nous ne devrions pas créer plutôt « un partenariat privilégié » ? Un partenariat par lequel les Européens verraient les Turcs comme des alliés, respecteraient leur culture et leur religion, où Turcs et Européens œuvreraient de concert pour la paix, la liberté et le bien-être, où les Turcs resteraient dans leur patrie, ne tenteraient pas d’immigrer au sein même des systèmes sociaux européens (et autrichiens) et ne chercheraient pas à importer graduellement leur religion dans les contrées du Ponant chrétien ?
· Ne pensez-vous pas, cher Président Abdullah Gül, que ce serait là une voie raisonnable qu’il conviendrait d’emprunter ?
Andreas MÖLZER, député européen, FPÖ, Autriche.
(texte paru dans la revue « zur Zeit », Vienne, n°18/2011 ; http://www.zurzeit.at/ ).
00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autriche, turquie, europe, affaires européennes, adhésion turque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 mai 2011
Schengen et Maastricht en crise
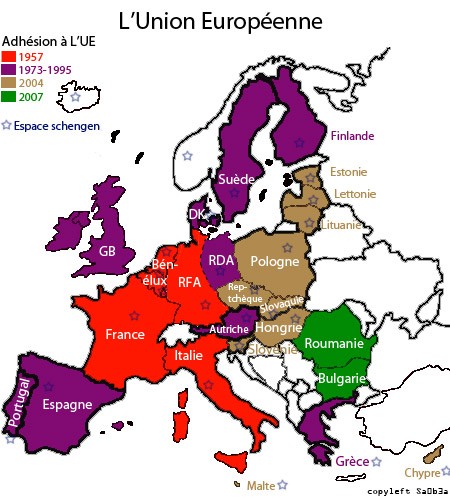
Schengen et Maastricht en crise
par Jean-Gilles MALLIARAKIS
On éprouve quand même un relatif malaise en constatant à la fois le discord franco-italien face à l'afflux des réfugiés tunisiens et les pressions opérées sur les opinions publiques par les marchands de mauvaise conscience.
Dès le commencement des révolutions arabes nous pouvions tous savoir le type de problèmes qui allaient advenir. Quand je dis nous je pense aux citoyens et contribuables ordinaires. Inéluctablement, les Européens devraient prendre des dispositions communes pour faire face à un phénomène migratoire. Celui-ci ne peut être jugé qu'inopportun, inapproprié au regard des agendas démocratiques internes de la plupart de nos pays.
Tout lecteur du roman "Le Camp de saints" publié par Jean Raspail en 1973 pouvait comprendre à quel type de scénario seraient confrontés, un jour ou l'autre, nos pays.
Or aucun de nos dirigeants n'a manifesté le courage ou la lucidité de tirer la sonnette d'alarme. Pourtant les accords de Schengen signés par 5 pays en 1985, s'appliquent désormais dans la plupart des États-Membres de l'UE, et même à la Suisse. Dès le traité d'Amsterdam de 1997 les dispositions administratives des politiques d'immigration étaient incorporées à la compétence de l'eurocratie.
Rien de tout cela n'a été appliqué.
Et pourtant on remarquera que la "convention Schengen" ratifiée en 1990 comporte 142 articles. Les technocrates prétendent tout prévoir à l'avance. Tout, sans doute, sauf les crises.
Déjà en 2010, une crise d'un autre ordre, portant sur les finances publiques des pays du sud de l'Europe, prévisible depuis longtemps, et particulièrement à partir de l'été 2009 avait montré l'inadaptation des institutions actuelles.
Celles-ci découlent pourtant du traité de Maastricht négocié en 1991, rédigé par les équipes de Jacques Delors et de son collaborateur Pascal Lamy. Cet énorme document était lui aussi conçu pour répondre à toutes les questions, dans la plus pure tradition des énarques et autres polytechniciens français. On avait ainsi disposé que les déficits publics ne dépasseraient pas 3 % du PIB, que la dette des États n'excéderait pas 60 % de la richesse produite annuellement par les nations. Ceci tenait un compte approximatif d'une théorie fausse, plus ou moins formulée par Keynes 30 ans plus tôt. Mais tout en représentant des centaines de pages imprimées ces accords ne prévoyaient pas leur propre mise en œuvre disciplinaire.
Tout l'échafaudage eurocratique postérieur à l'Acte Unique ratifié en 1987 peut tomber légitimement sous le coup des mêmes critiques. De ce fait, et pour des raisons d'incapacité politique observables dans la plupart de nos pays on a perdu de vue les raisons mêmes qui ont poussé les fondateurs à s'unir du traité de Rome, signé en 1957, et mis en application par la Cinquième république. Certes les chars soviétiques ne constituent plus la menace essentielle perçue par les opinions publiques. Mais d'autres périls se sont accumulés
On ne peut pas esquiver la question de la faiblesse de nos moyens de défense. La France se targue de compter parmi les deux ou trois États qui, parmi vingt sept nains sans Blanche Neige, accomplit un effort crédible dans ce domaine régalien par excellence. Hélas cela ne se vérifie que relativement à la plupart de ses partenaires. Peut-on considérer par exemple que le seul Charles-De-Gaulle suffit aux besoins de protection du second domaine maritime mondial. La Royal Navy, pour sa part, dispose de trois porte-avions.
Que la défense de l'Europe soit assumée, hélas de manière quasi exclusive dans le cadre de l'Otan chagrine les nostalgiques du gaullisme. Mais qu'ont-ils fait, en plus de 50 ans, sinon réduire l'armée française à un effectif désormais squelettique ? On exagère à peine en imaginant de la rassembler tout entière, ou du moins la quasi-totalité des 88 000 hommes de l'armée de terre, dans les 81 000 places du Stade de France. Or cela est directement lié à la prétendue doctrine tous azimuts, à l'idée même de la priorité à la dissuasion nucléaire, à l'illusion de la guerre presse-bouton.
Ayant renoncé à l'esprit de défense, on a donc rogné progressivement les moyens militaires et on l'a fait d'autant plus volontiers que le gaspillage social devenait la première préoccupation des budgétivores.
Un État qui refuse de se reconnaître des ennemis, ne saurait concevoir ni la nécessité de ses alliances ni les perspectives d'aucun conflit.
Une Europe digne de ce nom prendrait en considération, au contraire, que 495 millions d'Européens devraient pouvoir se défendre, l'affirmer et le rendre progressivement possible, osons alors le dire : sans nécessairement recourir au parapluie de 305 millions d'Américains.
Nous nous trouvons contraint hélas de penser cela au conditionnel.
Ceci veut donc bien dire que les accords technocratiques intergouvernementaux de Schengen et de Maastricht ne peuvent plus suffire à l'illusion de notre liberté. La calamiteuse opération référendaire de Chirac en 2005 n'a certainement pas contribué au renforcement d'institutions devenues illisibles et lointaines.
Il semble désormais grand temps de choisir et de poser honnêtement les vraies questions, à commencer par celle du ministre italien de l'Intérieur Roberto Maroni qui en arrive même à se demander "si cela a un sens de rester dans l'Europe." "Personne ne veut que l'Italie quitte l'Union européenne" lui a répondu Cecilia Malmstrom commissaire aux Affaires intérieures. Reste à passer aux actes.
JG Malliarakis
Apostilles
1.Qu'on me permette de renvoyer le lecteur à L'Insolent du 14 février "Les Tunisiens votent déjà avec leurs pieds"
2.Sur la crise non moins prévisible de la zone euro cf. → L'Insolent du 19 octobre 2010 "La crise grecque sans mythologie"
→ L'Insolent du 3 juin 2010 De la banqueroute et de ses formes modernes"
→ L'Insolent du 27 novembre 2009 "La redécouverte du risque souverain"
→ L'Insolent du 25 novembre 2009 "Donnez nous notre emprunt quotidien" /li>
3."Ha senso restare in Europa ?" cf. La Repubblica du 11 avril
"L'Alliance Staline Hitler"
Sous ce titre paraîtra un ouvrage de l'auteur de ces lignes retraçant le contexte de la politique soviétique pendant toute l'entre deux guerres. Il comprend en annexe, et expliquant, plus de 80 documents diplomatiques, caractéristiques de cette alliance. Il sera en vente à partir du 15 mai au prix de 29 euros. Les lecteurs de L'Insolent peuvent y souscrire jusqu'au 30 avril au prix de 20 euros, soit en passant par la page spéciale sur le site des Éditions du Trident, soit en adressant directement un chèque de 20 euros aux Éditions du Trident 39 rue du Cherche Midi 75006 Paris. Tel 06 72 87 31 59.
00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : schengen, maastricht, europe, affaires européennes, politique internationale, eurocratie, parlement européen, union européenne, crise européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Soft Power - der kulturelle Krieg der USA gegen Russland - 1991-2010

Soft Power – der kulturelle Krieg der USA gegen Russland, 1991–2010
Die neue Strategie und ihre Zentren
von Peter Bachmaier
In den letzten zwei Jahrzehnten hat eine Umorientierung des amerikanischen strategischen Denkens stattgefunden: Der Krieg wird nicht mehr rein militärisch definiert, sondern findet auch mit nicht militärischen, informativen und psychologischen Methoden statt, die man als «psychologische Kriegführung» [psychological warfare] oder «kulturellen Krieg» bezeichnet. Diese Methoden haben eine lange Vorgeschichte. Der amerikanische Militärstratege Liddell Hart entwickelte bereits vor dem Zweiten Weltkrieg die Strategie der indirekten Einwirkung [the strategy of indirect approach].1 Während des Zweiten Weltkriegs wandten die amerikanischen und britischen Streitkräfte die «psychologische Kriegführung» gegen Deutschland an, die nachher zur Umerziehung [re-education] des deutschen Volkes eingesetzt wurde. Nach dem Ende des Krieges gründeten die CIA und das Verteidigungsministerium nach dem Vorbild des Tavistock Institute of Human Relations, eines spezialisierten Instituts für den psychologischen Krieg in England, Denkfabriken [think tanks] wie die RAND Corporation, das Hudson Institute von Herman Kahn, und andere, die in erster Linie gegen die Sowjetunion gerichtet waren.
Die Methoden in diesen Zentren wurden von einer Reihe von sozialwissenschaftlichen Instituten entwickelt. Die amerikanischen empirischen Sozialwissenschaften, d.h. Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Anthropologie, Kommunikationswissenschaft [communication studies] u.ä. entstanden in ihrer gegenwärtigen Form durch die Initiative und Finanzierung militärischer und nachrichtendienstlicher Agenturen in den 40er und 50er Jahren.2 Eine weitere Quelle waren die grossen Stiftungen wie die Carnegie Corporation, die Ford Foundation und die Rockefeller Foundation. Es waren berühmte wissenschaftliche Zentren wie die New School for Social Research in New York, das Bureau of Applied Social Research in Princeton (von Paul Lazarsfeld geleitet), das Institut für Sozialforschung (geleitet von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, das 1949 nach Frankfurt zurückkehrte), das Center for International Studies (CENIS) am Massachusetts Institute of Technology, aber auch das von Michael Murphy und Gregory Bateson gegründete alternative Esalen Institut in Kalifornien – ein Zentrum der Gegenkultur, das auch an der Organisation des Woodstock-Festivals 1968 beteiligt war –, die diese Aufträge erhielten. Insbesondere die führenden Institute der Kommunikationswissenschaften waren durch die Programme für psychologische Kriegführung geprägt.
Diese Institute gaben Zeitschriften wie das Public Opinion Quaterly (POQ), die American Sociological Review, die American Political Science Review u.ä. heraus. An diesen Instituten arbeiteten Experten, meist Emigranten aus Deutschland und Österreich, die sich später grosse Namen in der Wissenschaft erwarben wie Paul Lazarsfeld, Oskar Morgenstern, Leo Loewenthal, Herbert Marcuse, Walter Lippmann, Harold Lasswell, Gabriel Almond, Daniel Lerner, Daniel Bell, Robert Merton u.v.a. Es waren dieselben Experten und Institute, die auch für die Umerziehung des Volkes in Deutschland verantwortlich waren. Einige dieser Projekte waren auch mit der Vorbereitung der Kulturrevolution der sechziger Jahre mit ihren Begleiterscheinungen Rockmusik, Drogenkultur und Sexuelle Revolution beschäftigt.
In besonderer Weise waren natürlich die «Soviet Studies» von der Regierung abhängig. Das Russian Research Project in Harvard, geleitet von Raymond Bauer und Alex Inkeles, war ein gemeinsames Unternehmen der CIA, der U.S. Airforce und der Carnegie Corporation. Das Institut veröffentlichte 1956 eine Studie mit dem Titel «How the Soviet System Works», die ein Standard-Lesebuch in Soviet Studies wurde.3 Zur psychologischen Kriegführung gehörten auch Radiosendungen der CIA nach Osteuropa, «eines der billigsten, sichersten und effektivsten Werkzeuge der U.S.-Aussenpolitik», wie Jean Kirkpatrick später erklärte, nämlich die Voice of America. RIAS Berlin, Radio Free Europe und Radio Liberty, die bis heute auf russisch und in den Sprachen der GUS senden.4 Diese Sender unterstanden dem Kongress für kulturelle Freiheit, der 1950 mit 400 Mitarbeitern in Paris von der CIA gegründet worden war.5
Der Sieg über die Sowjetunion wurde vor allem mit Hilfe dieser nicht militärischen Methoden erreicht. Die Strategie, die als Ziel keine Koexistenz mit der Sowjetunion, sondern eine «Demontage» des sowjetischen Systems vorsah, wurde von der Reagan-Administration 1982 ausgearbeitet.6 Der Plan umfasste sieben strategische Initiativen, darunter als Punkt 4: Psychologischer Krieg, gerichtet auf die Erzeugung von Angst, Unsicherheit, Verlust der Orientierung sowohl bei der Nomenklatura als auch bei der Bevölkerung.7 Dieser Krieg wurde nicht nur gegen den Kommunismus, sondern gegen Russland geführt, wie die direkten Aussagen Brzezinskis bezeugen: «Wir haben die UdSSR zerstört, wir werden auch Russland zerstören.» «Russland ist überhaupt ein überflüssiger Staat.» «Die Orthodoxie ist der Hauptfeind Amerikas. Russland ist ein besiegtes Land. Es wird aufgeteilt und unter Vormundschaft gestellt werden.»8
Im Jahr 1990 prägte Joseph Nye, ein Mitarbeiter des Council on Foreign Relations und Verbündeter von Zbigniew Brzezinski, für diese Methoden den Begriff «Soft Power» oder «Smart Power», der auf dieselbe Wurzel wie das «Social Engineering» zurückgeht.9 Er veröffentlichte im Jahre 2005 sein Buch «Soft Power: The Means to Success to World Politics», in dem er den Vorschlag machte, Amerika müsse durch seine Kultur und seine politischen Ideale attraktiv werden. Das Center for Strategic and International Studies in Washington, eine neokonservative Denkfabrik, in dessen Aufsichtsrat Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski sitzen, gründete 2006 eine Commission on Smart Power, von Joseph Nye und Richard Armitage geleitet, die 2009 ein Memorandum «A Smarter, More Secure America» vorlegt e, die das Ziel verfolgte, Amerikas Einfluss in der Welt mit «weichen» Methoden zu verstärken.10
Erste erfolgreiche Anwendung der neuen Strategie: die Perestrojka
Zum ersten Mal wurden diese neuen Methoden als Strategie in der Perestrojka eingesetzt, als Michail Gorbatschow an die Macht kam. Die Perestrojka hatte ihre positiven Seiten, sie stellte die Meinungs- und Bewegungsfreiheit wieder her, aber sie war auch eine massive Einflussnahme des Westens.11 Innerhalb des Zentralkomitees der KPdSU und der Nomenklatura bildete sich eine Gruppe, die auf die Positionen des Westens überging und das westliche neoliberale System einführen wollte.
Der eigentliche Architekt der Perestrojka war Alexander Jakowlew, seit 1985 Sekretär des ZK der KPdSU für Ideologie, der in den 50er Jahren in Washington studiert hatte und seit damals ein überzeugter Anhänger des Neoliberalismus war, wie er mir bei einem Gespräch in Wien am 9. November 2004 erklärte. Zu seinem Netzwerk gehörten Leute wie Jegor Gajdar, Grigorij Jawlinskij, Boris Nemzow, Viktor Tschernomyrdin, German Gref und Anatolij Tschubajs. Jakowlew schuf mit ihnen in der UdSSR eine fünfte Kolonne des Westens, die bis heute im Hintergrund die Fäden zieht. Auch Boris Jelzin war ein Mann der Amerikaner, der im September 1989 auf Einladung des Esalen-Instituts in Kalifornien, das seit 1979 ein amerikanisch-sowjetisches Austauschprogramm unterhielt, bei einem Besuch in Washington direkt im amerikanischen Kongress angeworben wurde und 1991 mit ihrer Hilfe die Macht übernehmen konnte.12
Gorbatschow wurde durch Vermittlung von George Soros zum Mitglied der Trilateralen Kommission, die im Jänner 1989 in Moskau eine Konferenz abhielt, an der auch Henry Kissinger und Valéry Giscard d’Estaing teilnahmen.
Westliche Organisationen zur kulturellen Beeinflussung in Russland
In der Zeit der Perestrojka wurden auch die Logen und ihre Vorfeldorganisationen wieder zugelassen.13 Auf Ersuchen Kissingers erlaubte Gorbatschow im Mai 1989 die Gründung der B’nai Brith Loge in Moskau. Seit damals wurden in Russland etwa 500 Logen durch die Grosslogen von England, Frankreich, Amerika u.a. gegründet. Gleichzeitig wurden aber für Politiker, Unternehmer und Angehörige der freien Berufe, die keine Beziehung zu den Ritualen hatten, aber die Prinzipien der Logen teilten, offenere Organisationen, Klubs, Komitees und Stiftungen geschaffen. Es gibt einige tausend Logenmitglieder in Russland, die sich an den Ritualen beteiligen, aber darüber hinaus gibt es zehnmal so viele Mitglieder der «maçonnerie blanche», die keine Rituale benützen, aber die Prinzipien akzeptieren und von Logenbrüdern geleitet werden. Solche Organisationen sind der Klub Magisterium, der Rotaryklub, der Lionsklub, die Soros-Stiftung u.v.a. Diese Mitglieder halten sich für eine Elite, die besondere Rechte hat zu regieren.14
Um die Literaturszene zu kontrollieren, wurde das russische PEN-Zentrum gegründet, eine weitere Vorfeldorganisation. Zu seinen Mitgliedern gehörten bekannte Schriftsteller und Dichter wie Bella Achmadulina, Anatolij Pristawkin, Jewgenij Jewtuschenko, Wassilij Aksjonow und Viktor Jerofejew.
Die Stiftung «Offene Gesellschaft» von George Soros, bereits 1988 in Moskau gegründet, war in den 90er Jahren der mächtigste Mechanismus der Destabilisierung und Zerstörung in den Händen der Hintergrundmächte. Soros richtete seine Tätigkeit auf die Änderung der Weltanschauung der Menschen im neoliberalen Geist, die Durchsetzung des American way of life und die Ausbildung von jungen Russen in den USA. Mit den Mitteln der Soros-Stiftung wurden die wichtigsten russischen Zeitschriften finanziert und für die Unterstützung der Literatur spezielle Preise vergeben.15
Im Rahmen seines Programms gab die Stiftung Lehrbücher heraus, in denen die russische Geschichte im neoliberalen, kosmopolitischen Sinne dargestellt wurde. Im September 1993, während das Parlament beschossen wurde, hatte ich Gelegenheit, an einer Preisverleihung im russischen Bildungsministerium teilzunehmen. George Soros verteilte Preise an die Autoren russischer Lehrbücher für Geschichte und Literatur, und der russische Bildungsminister Jewgenij Tkatschenko erklärte, was das Ziel der neuen Schulbücher war: «Es geht darum, die russische Mentalität zu zerstören.»
Die Programme von Soros waren im kulturellen Bereich so vielfältig, dass praktisch der gesamte nichtstaatliche Sektor von der Finanzierung durch die «Offene Gesellschaft» abhing. Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), 1983 in Wien gegründet und ebenfalls von Soros unterstützt, förderte die Reform des Bildungswesens und der Universitäten in Russland und den postsozialistischen Ländern. Allein zwischen 1997 und 2000 vergab die Stiftung 22 000 Stipendien in der Höhe von 125 Millionen Dollar.16
Ein weiterer amerikanischer Think tank ist die Nationale Stiftung für Demokratie (NED), 1982 von Reagan gegründet, die ihrerseits wieder die Institute der Demokratischen und der Republikanischen Partei der USA und ihre Büros in Moskau finanziert. Sie unterstützt vor allem private Medien und prowestliche politische Parteien und Bewegungen. Das Budget der NED wird vom Kongress der USA als Unterstützung für das State Department beschlossen. Dem Vorstand gehören prominente Politiker an wie John Negroponte, Otto Reich, Elliot Abrams. Die NED ist die Fortsetzung der Operationen der CIA mit anderen Mitteln. Die NED finanzierte u.a. folgende russische Organisationen (2005): Gesellschaft «Memorial» für historische Bildung und den Schutz der Menschenrechte, Moskauer Helsinkigruppe, das Sacharowmuseum, Mütter Tschetscheniens für den Frieden, die Gesellschaft für russisch-tschetschenische Freundschaft, das Tschetschenische Komitee der nationalen Rettung (in einem Jahr insgesamt 45 Organisationen).17
Das Moskauer Carnegie-Zentrum wurde 1993 als Abteilung der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden, errichtet 1910 von Andrew Carnegie als unabhängiges Forschungszentrum für internationale Beziehungen, gegründet. Die Spezialisten des Moskauer Zentrums befassen sich mit den wichtigsten Fragen der Innen- und Aussenpolitik Russlands. Es gibt eine Sammlung von Informationen über die problematischen Punkte der Entwicklung des Landes. Das Zentrum publiziert Sammelbände, Monographien, Periodika und Nachschlagewerke sowie eine Vierteljahreszeitschrift «Pro et contra», die Serie «Working Papers» und führt regelmässig Vorträge und Konferenzen durch. Die Stiftung wird von grossen Firmen wie BP, General Motors, Ford, Mott sowie von Soros, Rockefeller, dem Pentagon, dem State Department und dem britischen Aussenministerium finanziert. Die Direktorin war bisher Rose Goettemoeller, frühere Mitarbeiterin der RAND Corporation, die derzeit stellvertretende Aussenministerin der USA ist.
Die Vertreter der russischen Geschäftswelt im Aufsichtsrat sind Pjotr Awen, Sergej Karaganow, Boris Nemzow, Grigorij Jawlinskij und Jewgenij Jasin, der Präsident der Moskauer Wirtschaftsuniversität. Führende Mitarbeiter sind Dmitrij Trenin, der auch für Radio Free Europe und Radio Liberty arbeitet, und Lilija Schewzowa, die beide regelmässig in den Westen eingeladen werden, um dort zu erklären, dass Russland die demokratischen Freiheiten einschränkt. Die Forschungen des Zentrums werden von der politischen Klasse Russlands und auch des Westens umfangreich benützt. Die Arbeit des Moskauer Zentrums wird von der Zentrale in Washington durch ein «Russland- und Eurasien-Programm» unterstützt.18
Die Stiftung Freedom House, 1941 auf Initiative von Eleanor Roosevelt gegründet, entstand aus dem Kampf gegen den Isolationismus in den USA. Offizielles Ziel war der Kampf gegen den Nationalsozialismus und Kommunismus, heute wird sie von Soros und der Regierung der USA finanziert. In den 90er Jahren gründete Freedom House Büros in fast allen GUS-Staaten und das Amerikanische Komitee für Frieden in Tschetschenien (Mitglieder: Brzezinski, Alexander Haig, James Woolsey – früherer CIA-Chef). Das bekannteste Projekt ist heute «Freiheit in der Welt», das seit 1972 jährlich alle Staaten der Welt analysiert, wo sie in «freie», «teilweise freie» und «unfreie» eingeteilt werden.19
Im Jahr 1992 wurde die russische Filiale der Rockefeller-Stiftung Planned Parenthood Federation in Moskau und 52 weiteren russischen Städten gegründet. Die Stiftung machte den Versuch, das Fach «Sexualkunde», das in Wirklichkeit die Auflösung der Familie und die Erziehung eines neuen Menschen zum Ziel hat, in allen russischen Schulen einzuführen. Dazu kam es jedoch nicht, da die Beamten des Bildungsministeriums, die Lehrer, die Eltern und die orthodoxe Kirche Widerstand leisteten und das Projekt auf einer Konferenz der Russischen Akademie für Bildungswesen im Jahr 1997 abgelehnt wurde.20
Die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) gelten im Westen als die Bausteine der Zivilgesellschaft. Im Falle Russlands haben sie nichts mit dem Aufbau einer direkten Demokratie zu tun, sondern sind Agenturen, die vom Westen finanziert und gesteuert werden.
Die westliche Einflussnahme auf das Bildungswesen und die Medien
Ein wichtiges langfristiges Ziel der westlichen Einflussnahme ist das Bildungs- und Hochschulwesen. Zunächst wurden nach der Wende von 1991 mit Hilfe westlicher Berater der Zentralismus und die marxistische Ideologie aufgelöst. Das Bildungsgesetz von 1992 und die Verfassung der Russischen Föderation von 1993 schrieben eine tiefgreifende Umorientierung des Bildungswesens im Zeichen eines neoliberal-demokratischen Paradigmas nach westlichem Vorbild fest. Es umfasste den Einbau marktwirtschaftlicher Elemente im Bildungswesen und den Aufbau einer Zivilgesellschaft.21
Die Vergabe von westlichen Krediten an das Bildungswesen war an die Erfüllung der Vorgaben gebunden. Auf diese Weise wurde das Bildungswesen im Sinn des neoliberalen Systems umgestaltet. Ein nichtstaatlicher Sektor mit teuren Privatschulen etablierte sich. Die privaten höheren und Hochschulen waren gewinnorientiert und verlangten Schul- und Studiengebühren. Durch die PISA-Studien der OECD wurde das Bildungswesen auf die Wirtschaft ausgerichtet. Viele Schulen in ländlichen Gebieten, die nicht mehr «rentabel» waren, wurden geschlossen. Viele Kinder gehen nicht mehr in die Schule oder schliessen sie nicht ab. Im Jahr 2000 gingen nach einem Unesco-Bericht 1,5 Millionen Kinder in Russland nicht in die Schule. Der Drogenkonsum der Schüler, der früher unbekannt war, breitete sich aus.22
Am bedeutendsten war die Reform des Hochschulwesens, das gleich nach der Wende von Weltbank und Internationalem Währungsfonds evaluiert wurde, die dann ein Programm für eine Umstrukturierung nach angloamerikanischem Vorbild ausarbeiteten. Im Jahr 2004 wurde die Bologna-Deklaration gesetzlich beschlossen: d.h. der Übergang zum vierjährigen Bakkalaureat und zum anschliessenden zweijährigen Magisterstudium sowie eine Präsidialverfassung mit Hochschulräten, in denen Vertreter der Wirtschaft sitzen. Viele russische Bildungsexperten sehen darin eine Zerstörung der Tradition der russischen Universität, weil der Bildungsprozess auf die Weitergabe von Informationen reduziert wird. Von den etwa 1000 Hochschulen und Universitäten in Russland sind heute 40% privat, viele davon vom Westen errichtet, an denen eine neue Elite herangebildet wird.23
Ein weiterer Sektor, der vom Westen mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt wird, sind die Medien, die nach 1991 die grösste Wandlung durchgemacht haben. Sie wurden durch die neoliberalen Reformen nach 1991 privatisiert und von Oligarchen oder vom Ausland übernommen. Viele Fernsehstationen, Zeitungen und Zeitschriften erhielten ausländische Eigentümer wie die News Corporation von Rupert Murdoch, die heute die Zeitung «Vedomosti», die führende Finanzzeitung Russlands gemeinsam mit der «Financial Times» herausgibt und die News Outdoor Group, die grösste Werbeagentur, die in etwa 100 Städten Russlands aktiv ist, besitzt. Die Bertelsmann AG, die über das grösste europäische Fernsehunternehmen RTL verfügt, betreibt in Russland den landesweiten Sender Ren TV.24 Die Bertelsmann-Stiftung, 1977 von Reinhard Mohn gegründet, eine der mächtigsten Denkfabriken der EU, arbeitet mit der Gorbatschow-Stiftung zusammen, die ihren Sitz in Moskau hat, aber auch eine Zweigstelle in Deutschland und in den USA unterhält.
Die Medien waren unter Jelzin fast vollständig in den Händen der neuen Oligarchie, die wiederum mit den westlichen Finanzzentren verbunden ist. Gusinskij besass den grössten Fernsehsender NTW, und Boris Beresowskij kontrollierte die Zeitungen. Als Putin begann, den russischen Staat wieder zu stabilisieren, stellte sich als vordringlichste Aufgabe die Kontrolle der Medien, weil die Regierung sonst gestürzt worden wäre.
Zur Amerikanisierung muss man last not least die Alltagskultur rechnen, die mit Rockkonzerten, Internet, Privatfernsehen, Kinopalästen, Discotheken, Musik-CDs, DVDs, Comics, Werbung und Mode fast dieselbe wie im Westen ist.
Das Ziel der amerikanischen Strategie ist der Transfer des westlichen Wertesystems auf die russische Gesellschaft. Der russische Staat soll entideologisiert werden. In der Verfassung von 1993 wurde die staatliche Ideologie als Kennzeichen des Totalitarismus desavouiert und im Art. 13 verboten.25
Die offizielle sowjetische Ideologie beruhte auf einer materialistischen Philosophie, aber hatte Elemente einer nationalen Idee und war die Klammer, die den Staat zusammenhielt. Durch dieses Verbot wurde der Staat der Wertorientierungen der nationalen Idee beraubt. Die geistige Leere wird heute durch die westliche Populärkultur ausgefüllt.
Die kulturelle Offensive der USA hat das Ziel, in Russland eine multikulturelle, d.h. kosmopolitische, pluralistische und säkulare Gesellschaft zu schaffen, in der die einheitliche russische Nationalkultur aufgelöst ist. Das Volk, die Gemeinschaft der Bürger mit einer gemeinsamen Geschichte und Kultur, soll in eine multinationale Bevölkerung umgewandelt werden.
Der Widerstand des russischen Staates und der Intelligenzia
Das unter Staatspräsident Wladimir Wladimirowitsch Putin seit dem Jahr 2000 durchgesetzte Staatskonzept, insbesondere die Forderung nach einem starken Staat, beinhaltete eine teilweise Rezentralisierung, den Übergang von einem multinationalen zu einem nationalrussisch geprägten Staatsverständnis sowie die Tendenz, der russisch-orthodoxen Kirche und Religion eine Sonderstellung im Staat einzuräumen.
Im April 2001 übernahm der staatliche Energiekonzern Gasprom die Kontrolle über den Fernsehsender NTW. Die Tageszeitung «Sewodnja» (Heute) wurde eingestellt, der Chefredakteur des Wochenmagazins gekündigt. Boris Beresowskis Fernsehsender TW-6 wurde im Jänner 2002 geschlossen und Beresowski emigrierte nach England.
Im September 2003 wollte der Ölmagnat Michail Chodorkowski die liberale Wochenzeitung Moskowskije Nowosti übernehmen, um die liberalen Oppositionsparteien «Union rechter Kräfte» und «Jabloko» im bevorstehenden Wahlkampf zu unterstützen. Dieses politische Engagement war ein wichtiger Grund für die Verhaftung Chodorkowskis im Oktober 2003. Diese Massnahmen waren notwendig, weil es der Oligarchie sonst gelungen wäre, mit Hilfe der Medienmacht die Regierung selbst unter ihre Kontrolle zu bringen. Die drei wichtigsten Fernsehsender – ORT, Rossija und NTW – sowie ein bedeutender Teil der Druckmedien werden heute durch staatliche Konzerne (Gasprom und Wneschtorgbank) oder durch den Staat direkt (RTR) kontrolliert.
Der Oligarch Wladimir Potanin kontrolliert aber weiterhin die Tageszeitungen «Izwestija» und «Komsomolskaja Prawda». Derzeit gelten die «Nowaja Gaseta» (unter Kontrolle des Oligarchen Alexander Lebedew und des ehemaligen sowjetischen Präsidenten Gorbatschow) und die Tageszeitung «Wedomosti» (ein Projekt des «Wall Street Journal» und der «Financial Times») als von der Regierung unabhängige Medien.26 Seit dem Jahr 1993 wurden in Russland gemäss einer Statistik 214 Journalisten ermordet, darunter 201 Journalisten in der Jelzin-Ära und 13 seit dem Amtsantritt Putins, darunter aber die meisten in seiner ersten Amtszeit, während es in der zweiten Amtzeit nur mehr drei waren.27
Die nationale Doktrin für Bildung 1999 und die Konzeption 2001 führten im inhaltlich-ideologischen Bereich das nationalpatriotische Gedankengut wieder ein. Eine Hinwendung zu Werten der Zarenzeit traf mit dem Postulat zusammen, die Vorzüge des Bildungssystems der Sowjetunion zu erhalten. Eine Sonderstellung haben die von der russisch-orthodoxen Kirche getragenen Privatschulen und Geistlichen Akademien inne, die seit 2007 staatlich anerkannt sind. In den Lehrprogrammen der Schulen wurden neue Gegenstände wie seit 1999 die obligatorische Vorbereitung auf den Wehrdienst und seit 2007 das Schulfach «Grundlagen der orthodoxen Kultur» eingeführt.28
Zum kulturellen Krieg gehört auch die Kampagne der westlichen Medien gegen Russland, die seit zehn Jahren, vor allem aber seit der Verhaftung Chodorkowskijs 2003 geführt wird unter dem Schlagwort «Russland auf dem Weg zurück zum Sowjetsystem!» Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Verfolgung progressiver Künstler, die darin bestehen soll, dass blasphemische und pornographische Werke aus öffentlichen Ausstellungen entfernt wurden. Es handelte sich in der Regel um Provokationen westlich finanzierter NGOs. Das Sacharow-Zentrum, das sich die Durchsetzung der offenen Gesellschaft zum Ziel setzt, organisierte 2003 eine Ausstellung «Vorsicht! Religion», auf der auch blasphemische antichristliche Exponate ausgestellt waren. Daraufhin forderte die Duma die Staatsanwaltschaft auf, gegen die Leitung des Zentrums tätig zu werden. 2005 wurden die Organisatoren zu einer Geldstrafe verurteilt.
Im Jahr 2005 führte die Regierung einen neuen Staatsfeiertag am 4. November ein, in der Nähe des alten Feiertags der Oktoberrevolution am 7. November. Diesmal sollte aber der Sieg über die polnischen Invasionstruppen im Jahre 1612 gefeiert werden. Im Jahr 2006 wurde ein neues Gesetz über die Nichtregierungsorganisationen verabschiedet, nach dem sich alle neu registrieren mussten und die ausländische Finanzierung genauer kontrolliert wurde. Anfang 2008 wurden alle regionalen Büros des British Council mit Ausnahme des Moskauer Büros geschlossen, weil man dem Council antirussische Tätigkeit vorwarf.29
Im Unterschied zu der Zeit der Perestrojka und der Jelzin-Ära ist die russische Intelligenzia seit dem Nato-Angriff auf Jugoslawien 1999 nicht mehr neoliberal, sondern nationalpatriotisch eingestellt. Die Schriftsteller, Künstler, Filmschaffenden und Theaterleute sind heute Patrioten und werden vom Kreml unterstützt. Die Regierung kontrolliert auch die politische Berichterstattung der Medien, vor allem im Fernsehen, etwas weniger in den Zeitungen.
Die Hauptfigur der Traditionalisten war früher Alexander Solschenizyn, dem aber seine ungenügende Kritik des Westens vorgeworfen wurde. Die führende Gruppe sind heute die «Bodenständigen» [po venniki], sie sind christlich-orthodox, aber sehen die sowjetische Periode in der Tradition der russischen Geschichte. Ihre Ideologen sind Dorfschriftsteller wie Walentin Rasputin, Wassilij Below und Wiktor Astafjew. In den Zeitschriften «Nasch sowremennik», «Moskwa» und «Molodaja gwardija» wurde seit den 70er und 80er Jahren die patriotische Ideologie ausgearbeitet.
Die «Stiftung der historischen Perspektive», die von der ehemaligen Duma-Abgeordneten Natalia Narotschnizkaja geleitet wird, vertritt ein patriotisches und christliches Programm, verfügt über die Schriftenreihe «Zvenja», die Internetzeitschrift «Stoletie» und organisiert Vorträge und Tagungen. Die nationalpatriotische Intelligenz diskutiert eine grundsätzliche Änderung des Systems, die einen starken Staat und eine Schliessung der Grenzen vorsieht. Die Verbände der Kulturschaffenden wie der Schriftstellerverband, der Künstlerverband, der Verband der Filmschaffenden verfügen über Kulturhäuser, Galerien, Kinozentren und Zeitschriften und organisieren ein dichtes Programm von Veranstaltungen. Es gibt in Moskau 150 Theater, Opernhäuser und Konzertsäle, die überwiegend klassische Stücke aufführen. Regietheater, abstrakte Kunst und atonale Musik sind ein Minderheitenprogramm.30
Österreich und Deutschland werden positiv gesehen, man sieht vor allem die alte deutsche Kultur, man hat ein Bild davon, das aus der Vergangenheit kommt, aber man weiss nicht wirklich, was in Deutschland heute vor sich geht. Alexander Solschenizyn hat immer gehofft, Deutschland werde eine Art Brücke zwischen Russland und dem Rest der Welt sein, weil sich Deutschland und Russland gegenseitig zueinander hingezogen fühlen.31 Die deutschen Medien zeichnen aber ein verzerrtes Bild von Russland: dass Russland auf dem Weg zurück zum Sowjetsystem ist und die neoliberalen Intellektuellen einen verzweifelten Abwehrkampf führen. Als Beispiel präsentiert man den Pornoschriftsteller Viktor Jerofejew, der von der Hamburger «Zeit» nach Deutschland eingeladen wurde.32 Die entscheidende Frage ist heute in Russland aber nicht, ob es wieder eine kommunistische Diktatur wird, sondern ob es eine «Diktatur des Relativismus» nach westlichem Vorbild oder eine christliche Gesellschaft wird.33
Die religiöse Erneuerung
Der entscheidende Widerstand gegen die Verwestlichung kommt heute von der orthodoxen Kirche, die antimodernistisch und traditionalistisch eingestellt ist. Die Orthodoxie tritt für traditionelle Werte wie Ehe, Familie und Mutterschaft ein und lehnt die Homosexualität ab. Die Kirchen sind voll, überwiegend mit jungen und jüngeren Menschen. Die Jugend bekennt sich mehrheitlich zur Orthodoxie, d.h. zum Christentum, und heiratet wieder in der Kirche. Es gibt wieder 100 Millionen Gläubige, 30 000 Priester und 600 Klöster. Die Geistliche Akademie in Sergijew Possad ist voll, es gibt vier Bewerbungen für einen Platz. Es gibt eine orthodoxe Radiostation, einen Verlag, eine Reihe von Zeitschriften, Militärgeistliche in der Armee sowie eine Spitals- und Gefängnisseelsorge, und in den Schulen wurde de facto Religion als Unterrichtsfach zum ersten Mal seit 1917 wieder eingeführt. Nach den Umfragen bezeichnen sich 70% der Russen als religiös.34
Im Jahr 2007 beschlossen die russisch-orthodoxe Kirche und der Vatikan, Gespräche aufzunehmen, um ihre langjährigen Differenzen zu beseitigen. Erzbischof Ilarion, Leiter des Aussenamts des Patriarchats, früher russisch-orthodoxer Bischof von Wien, sagte dazu: «Wir sind Bündnispartner und stehen vor der gleichen Herausforderung: einem aggressiven Säkularismus.»35
Die Orthodoxie wird in Russland als die «Religion der Mehrheit» bezeichnet. Am 4. November, dem Tag der Nationalen Einheit in Russland, konnte ich eine ungewöhnliche Prozession auf dem Roten Platz beobachten. Der Patriarch ging in der ersten Reihe, die Spitzen des Islams, der jüdischen Gemeinde und der Buddhisten in der zweiten. Das war als sichtbares Symbol gedacht: «Der Patriarch ist das Oberhaupt der vorherrschenden Religion. Er eint die Gläubigen und fördert die Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften. Der Patriarch ist der geistige Führer des ganzen Volkes, nicht nur der orthodoxen Gläubigen.»36
Schlussfolgerungen
Russland ist heute in einer Krise, die zunächst im Finanz- und Währungssystem zum Ausdruck kommt, aber genauso den Kulturbereich erfasst, ja sogar dort ihre tiefere Ursache hat, die darin besteht, dass pluralistische säkulare Gesellschaft den Menschen keine wirkliche Gemeinschaft, keine Weltanschauung und keinen Sinn gibt.
Russland braucht nicht die «materialistische und egoistische Kultur» der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft, sondern eine universelle nationale Ideologie, die alle Seiten des Lebens des Volkes erfasst, das Land entwickelt und alles abwehrt, was die Existenz des Volkes bedroht.37
Die «Neufassung» [reset] der russisch-amerikanischen Beziehungen seit zwei Jahren ändert jedoch nichts an der langfristigen antirussischen Ausrichtung der amerikanischen Politik und hindert die CIA nicht daran, wieder aktiver in Russland zu werden. Auch Hillary Clinton betonte nach dem Besuch Obamas in Moskau, dass die USA am Konzept des absoluten Weltführers festhalten. Russland wird daher früher oder später vor der Wahl stehen, entweder einen souveränen Staat aufzubauen, der die Grenzen schliesst und die Unterminierung seiner Kultur abwehrt, oder zu kapitulieren und eine Provinz des Westens zu werden. •
Dr. Peter Bachmaier, geb. 1940 in Wien, Studium in Graz, Belgrad und Moskau, 1972–2005 Mitarbeiter des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts, seit 2006 Sekretär des Bulgarischen Forschungsinstituts in Österreich, 2009 dreimonatiger Forschungsaufenthalt in Moskau. Vortrag, gehalten auf dem Kongress «Mut zur Ethik» in Feldkirch, 3. September 2010.
1 Basil Liddell Hart, Strategy: The Indirect Approach, 1. Aufl. 1929, 2. Aufl. 1954.
2 Christopher Simpson, Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945–1960, New York, Oxford U.P. 1994, p. 4.
3 Simpson, Science of Coercion, p. 87.
4 A. Ross Johnson, R. Eugene Parta, Cold War Broadcasting: Impact on the Soviet Union and Eastern Europe, Woodrow Wilson International Center, Washington 2010.
5 Frances Stonor Saunders, Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War, London 1999, dt. Ausgabe: Wer die Zeche zahlt … Der CIA und die Kultur im Kalten Krieg, Berlin 2001; Simpson, Science of Coercion, p. 68.
6 Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administration’s Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union, New York 1994.
7 S.G. Kara-Murza, A.A. Aleksandrov, M.A. Muraškin, S.A. Telegin, Revolucii na eksport [Revolutionen für den Export], Moskva, 2006.
8 Zitiert nach: V.I.Jakunin, V.Bagdasarjan, S.S.Sulakšin, Novye technologii bor’by s rossijskoj gosudarstvennost’ju [Neue Technologien des Kampfes gegen den russischen Staat], Moskva, 2009, str. 50.
9 oseph Nye, Bound to Lead: the Changing Nature of American Power, Basic Books 1990; Joseph Nye, Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy, Foreign Affairs, vol. 85, No. 4, July/August 2006, pp. 139–148.
10 Richard Armitage, Joseph S. Nye, A Smarter, More Secure America, CSIS Commission on Smart Power, 2009.
11 Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administrations’s Secret Strategy That Hastened the Collapse oft he Soviet Union, New York 1994.
12 Das steht in der offiziellen Jelzin-Biographie von Wladimir Solowjow, Elena Klepikowa, Der Präsident. Boris Jelzin. Eine politische Biographie, Berlin 1992. Nach der Anhörung Jelzins in einem Ausschuss des Kongresses sagte David Rockefeller: «Das ist unser Mann!»
13 O. A. Platonov, Rossija pod vlast’ju masonov [Russland unter der Macht der Freimaurer], Moskva 2000, S. 35.
14 Platonov, Rossija, str. 3.
15 Platonov, Rossija, str. 15.
16 Jakunin, Novye techologii, S. 81.
17 Jakunin, Novye technologii, S. 90.
18 Jakunin, Novye technologii, S. 94f.
19 Jakunin, Novye technologii, S. 92.
20 www.pravda.ru 03.19.2008.
21 Gerlind Schmidt, Russische Föderation, in: Hans Döbert, Wolfgang Hörner, Botho von Kopp, Lutz R. Reuter (Hrsg.), Die Bildungssysteme Europas, Hohengehren 2010 ( = Grundlagen der Schulpädagogik, Bd. 46, 3. Aufl.), S. 619.
22 Schmidt, Russische Föderation, S. 635.
23 Schmidt, Russische Föderation, S. 632.
24 Pierre Hillard, Bertelsmann – un empire des médias et une fondation au service du mondialisme, Paris 2009, p. 27.
25 «In der Russischen Föderation ist die ideologische Vielfalt anerkannt. Keine Ideologie darf als staatliche oder verbindliche festgelegt werden.» Art. 13 der Verfassung der Russischen Föderation, Dezember 1993.
26 A. Cernych, Mir sovremennych media [Die Welt der gegenwärtigen Medien], Moskva 2007.
27 Roland Haug, Die Kreml AG, Hohenheim 2007.
28 Schmidt, Russische Föderation, S. 639.
29 Das Feindbild Westen im heutigen Russland, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin 2008.
30 Vladimir Malachov, Sovremennyj russkij nacionalizm [Der gegenwärtige russische Nationalismus], in: Vitalij Kurennoj, Mysljaškaja Rossija: Kartografija sovremennych intellektual’nych napravlenij [Das denkende Russland: Kartographie der gegenwärtigen intellektuellen Richtungen], Moskva 2006, str. 141 ff.
31 nterview mit Alexander Solschenizyn, Der Spiegel Nr. 30, 23.07. 2007; Marc Stegherr, Alexander Solschenizyn, Kirchliche Umschau, Nr. 10, Oktober 2008.
32 Nikolaj Plotnikov, Russkie intellektualy v Germanii [Russische Intellektuelle in Deutschland], in: Kurennoj, Mysljaškaja Rossija, a.a.O., str. 328.
33 Westen ohne Werte? Gespräch mit Natalja Alexejewna Narotschnizkaja, Direktorin des russischen Instituts für Demokratie und Zusammenarbeit in Paris, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 51, 29.02.2008.
34 Jakunin, Novye technologii, str. 196ff.
35 Interview in: Der Spiegel.
36 Der Spiegel, Nr. 51, 14.12.2009.
37 Papst Benedikt XVI. Enzyklika «Spe salvi», Rom 2007, in der er von einer «Diktatur des Relativismus» spricht; Jakunin, Novye technologii, str. 174f.
«Zukunftwerkstätten» in Russland
Im Juli 2010 fand in Jekaterinburg die 21. deutsch-russische Zukunftswerkstatt mit etwa 40 Teilnehmern im Rahmen des Petersburger Dialogs zwischen Deutschland und Russland statt. Diese Seminare, zu denen junge russische Führungskräfte eingeladen werden, wurden im September 2004 von der Deutschen Gesellschaft für Aussenpolitik begründet, die die erste «Zukunftswerkstatt» mit dem Thema «Deutschland und Russland in der globalen Welt» in den Räumen des Bertelsmann-Verlags Gruner und Jahr in Hamburg organisierte. Das Ziel der Seminare, die heute von der Körber-Stiftung unterstützt werden, ist die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit und die Verbreitung der Idee der demokratischen Zivilgesellschaft. Die deutschen Vortragenden erklären den jungen Russen, dass eine strategische Partnerschaft mit Russland nur auf der Basis gemeinsamer westlicher Werte möglich wäre. Sie geben ihnen den Rat, das imperiale Erbe Russlands zu beseitigen und sich den Spielregeln der Globalisierung zu unterwerfen.
Die Deutschen sagen den Russen, dass sie in Deutschland seit den 60er Jahren die Auseinandersetzung mit dem Krieg und dem Nationalsozialismus geführt und die Vergangenheit aufgearbeitet hätten, und werfen den Russen vor, mit der Erinnerung an den Sieg im Zweiten Weltkrieg an die sowjetische Identität anzuknüpfen und nicht bereit zu sein, den Totalitarismus umfassend aufzuarbeiten, womit sie eine weitere Demokratisierung der Gesellschaft verhindern würden. Die russischen Teilnehmer antworten, dass sich 1991 ein Bruch in ihrem historischen Bewusstsein vollzog, der zum Zerfall der fundamentalen Werte in der Gesellschaft führte. Die Russen sind bisher nicht bereit, sich vollständig «von der Vergangenheit zu lösen» und die «universalen Werte» zu akzeptieren.
Quelle: Newsletter, DGAP, 20.7.2010
00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, etats-unis, russie, soft power, europe, affaires européennes, actualité, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 mai 2011
Risikofaktor Deutsdchland
Risikofaktor Deutschland
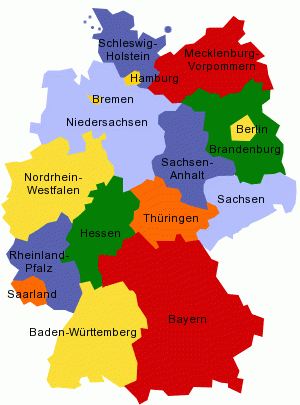 Michael WIESBERG
Michael WIESBERG
Ex: http://www.jungefreiheit.de/
Seit dem letzten Treffen der G-20 in Washington gehört nun auch Deutschland aufgrund seines „Export-Booms“ zu den „Risikofaktoren“ der Weltwirtschaft. Auf dieser Liste finden sich laut einem Bericht von Welt-Online jene Staaten wieder, deren Größe für die Weltwirtschaftschaft sehr wichtig sei und deren „Schieflage“ damit auch „große Probleme bereiten würde“. Im Falle Deutschlands sei es der „Exportüberschuß“, der bei „einigen Partnern für Verdruß sorgt“.
Auf der Liste stehen neben Deutschland noch China, die USA, Japan, Frankreich und Großbritannien. Um die Entwicklung von Ungleichgewichten zu verhindern, sollen „Indikatoren“ entwickelt werden, bei deren Überschreitung Gegenmaßnahmen einzuleiten seien. Angeblich versuchten die Teilnehmer dieses Treffens dessen Ergebnisse herunterzuspielen, so berichtete die Welt weiter; nach dem Motto: Außer Spesen nichts gewesen. Das hieße aber den Charakter dieses dubiosen Treffens, das in den deutschen Medien bemerkenswert tief gehängt wurde, zu verkennen.
Es mag zwar sein, daß die hier aufgebaute Kulisse im Falle Chinas nicht greift; gegenüber Deutschland, dem vorgeworfen wird, angeblich eine „wachstumsfeindliche Sparpolitik“ zu betreiben, werden sich aber schon Mittel und Wege finden lassen, „Ungleichgewichte“ durch den deutschen Exportüberschuß zu „sanktionieren“.
Herrschaft der „EU-Fronvögte“
Daß Finanzminister Schäuble „keine Probleme“ damit hat, daß sich Deutschland auf einer derartigen Liste wiederfindet, ist ein weiterer Beleg für die tatsächliche oder zur Schau getragene Unbedarftheit, mit der die „Politiker in Deutschland“ auf strategische Schachzüge ihrer vermeintlichen „Partner“ reagieren. Das zeigt schon die Art und Weise, wie sich die Bundesregierung im Hinblick auf die Euro-Krise von Frankreich am Nasenring durch die Arena ziehen läßt.
Genau dafür war diese europäische Gemeinschaft aus französischer Sicht ja auch konzipiert: als eine Herrschaft einer parasitären Klasse von „EU-Fronvögten“ (Wilhelm Hankel) auf deutsche Kosten. Deutschland zahlt, das zur Erinnerung, rund ein Drittel der Haftungssumme des EU-Rettungsschirm. Doch nicht nur das: Sollten andere Zahler ausfallen, wird Deutschland auch hier einspringen (im Fachjargon als „Arrosionszusage“ bezeichnet).
„Wachstumsfeindliche Sparpolitik“
Was steht nun hinter dem Argument von der „wachstumsfeindlichen Sparpolitik“? Auch hier zeigen sie sich die Früchte französischer Wühlarbeit; Deutschland solle doch bitteschön nicht nur zahlen, sondern gleichzeitig auch eine Art Inflationspolitik betrieben (z. B. die Löhne erhöhen, ohne die Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit zu beachten), womit die Konjunktur und die Exporte unserer geschätzten Euro-Partner verbessert werden könnte.
Hierfür hat Frankreich mit dem Chefökonomen der Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) und ehemaligen Lafontaine-Intimus Heiner Flassbeck auch noch einen lautstarken deutschen Anwalt gefunden, der seine kruden Thesen in den deutschen Medien im entsprechenden Anklageton „kommunizieren“ darf.
Druck auf China und Deutschland
Daß mit dieser „Risikoliste“ finanziell marode Staaten wie die USA, Frankreich und Großbritannien exportstarke Staaten wie China und Deutschland unter Druck zu setzen versuchen, ist kaum übersehbar. Ihr Interesse gilt nicht einer tatsächlichen Reform des internationalen Finanzsystems; vielmehr soll China genötigt werden, seinen Yuan endlich aufzuwerten – anstatt daß die USA endlich das tun, was für die Weltwirtschaft tatsächlich notwendig ist: nämlich ihren katastrophalen Staatshaushalt in Ordnung zu bringen.
Statt dessen pumpt die „Fed“ im Zuge der Politik der „Quantitativen Lockerung“ Abermilliarden von Dollar in das internationale Finanzsystem und ist damit der größte Verursacher von „Ungleichgewichten“, der nur denkbar ist. Und Frankreich wittert mit dieser Liste von „Risikostaaten“ eine weitere Gelegenheit, sich in deutsche Angelegenheiten einmischen zu können; und zwar jetzt in die deutsche Geld-, Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik, dem Hauptangriffspunkt bei seinen Bemühungen, den deutschen Riesen endlich zu kupieren.
Und mit all dem hat unser amtierender Finanzminister „kein Problem“. So kann wohl nur ein Politiker reden, von dem man schon seit längerem den Eindruck hat, daß er alle mögliche Interessen vertritt, nur eben keine deutschen.
00:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, politique internationale, allemagne, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 mai 2011
Presseschau - Mai 2011/01

Presseschau
Mai 2011 / 01
Hallo,
einige Links. Bei Interesse anklicken...
###
AUßENPOLITISCHES
Mindestens ein Toter - Oppositionsführer um Deeskalation bemüht
Schwerste Zusammenstöße auf Tahrir-Platz seit Mubaraks Sturz
http://www.op-online.de/nachrichten/politik/schwerste-zusammenstoesse-tahrir-platz-seit-mubaraks-sturz-1197913.html
Jürgen Elsässer spricht:
Libyen verteidigen heißt JETZT Gaddafi unterstützen!
http://juergenelsaesser.wordpress.com/2011/04/21/libyen-verteidigen-heist-jetzt-gaddafi-unterstutzen/#more-3145
Hiwis für Nicolas
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5b4fc1e22af.0.html
Friedrich: "Italien muss Flüchtlingsproblem selbst regeln"
http://www.op-online.de/nachrichten/politik/friedrich-italien-muss-fluechtlingsproblem-selbst-regeln-1198225.html
Nach Massenausbruch in Afghanistan
Noch immer über 400 Taliban auf der Flucht
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/Noch-immer-ueber-400-Taliban-auf-der-Flucht_aid_991319.html
Wirtschaft
Risikofaktor Deutschland
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5bd7d36069e.0.html
Die Transferunion beginnt am Wasserhahn
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5d4e4ea0664.0.html
„Wahre Finnen“ triumphieren bei Parlamentswahl (in Finnland)
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5caa9431395.0.html
Regierungswechsel in Andorra (Mitte-Rechts hat gesiegt)
http://www.faz.net/s/RubA24ECD630CAE40E483841DB7D16F4211/Doc~E54D2734941684049B126300C32A677B0~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Japan: Das Militär und die Aufräumarbeiten Kampf gegen Trümmer und Schlamm
http://www.sueddeutsche.de/politik/japan-das-militaer-und-die-aufraeumarbeiten-kampf-gegen-truemmer-und-schlamm-1.1079004
Mahnung der Vorfahren
Wegsteine in Nordjapan warnten vor Tsunamis
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,756622,00.html#ref=top
US-Deserteur drängt auf Asyl
http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/shepherds-anwalt-klagt/
British National Party stellt Bürgermeister
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5c7e31e3b23.0.html
Schweden: Mehr Zuwanderung
http://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/schweden-mehr-zuwanderung.html
Großbrand in Elendsviertel in Manila
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h9h3gyLwXFdLBdCKS-ujI10n0QZQ?docId=CNG.8038f99cc655f53ed7233e1d82be931e.1e1
Forscher warnt vor Staudamm-Bauten am Mekong
http://www.morgenpost.de/printarchiv/wissen/article1596675/Forscher-warnt-vor-Staudamm-Bauten-am-Mekong.html
Umweltzerstörung in Peru
Goldsuche vernichtet den Regenwald
http://www.sueddeutsche.de/wissen/umweltzerstoerung-in-peru-goldsuche-vernichtet-den-regenwald-1.1087378
Japan errichtet 20 km-Sperrzone um Fukushima
http://www.iwr.de/re/iwr/11/04/2106.html
Konservative Ansichten in Malaysia
Umerziehungscamp für „feminine“ Jungen
http://www.fr-online.de/panorama/umerziehungscamp-fuer--feminine--jungen/-/1472782/8366280/-/index.html
INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK
EU-Freizügigkeit
Polen verhelfen ostdeutschem Dorf zu neuer Blüte
http://www.welt.de/wirtschaft/article13277174/Polen-verhelfen-ostdeutschem-Dorf-zu-neuer-Bluete.html
Alarm-Papier aus Verteidigungsministerium
Bundeswehr wird kaputtgespart!
In einem vertraulichen Papier des Verteidigungsministeriums werden die Folgen von Bundeswehrreform und Sparplänen untersucht. Ergebnis: Bleiben die Pläne unverändert, gehen „Bündnis- und Einsatzfähigkeit absehbar verloren“.
http://www.bild.de/politik/inland/bundeswehrreform/einsatzfaehigkeit-kaputtgespart-158000-statt-185000-soldaten-17527866.bild.html
Rekrutenmangel
Freiwillig zum Bund? Nein, danke!
Nachwuchsprobleme bei der Bundeswehr: Noch nicht einmal jeder zweihundertste junge Mann hat Interesse am freiwilligen Wehrdienst. Das zeigen Reaktionen auf eine Briefaktion des Verteidigungsministeriums.
http://www.spiegel.de/schulspiegel/abi/0,1518,758641,00.html
(Oder einfach keinen Bock?...)
Zeit- und Leistungsdruck
Jugend hat weniger Zeit fürs Ehrenamt
http://www.bbv-net.de/aktuelles/nrw/1537447_Jugend_hat_weniger_Zeit_fuers_Ehrenamt.html
Aus Asservatenkammer
Polizisten sollen Geld und Drogen gestohlen haben
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,758230,00.html
Rettungsschirm für den Euro
Tickende Zeitbombe
http://www.sueddeutsche.de/geld/rettungsschirm-fuer-den-euro-tickende-zeitbombe-1.1080370
Wo sind die Konservativen in Deutschland?
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article13041095/Wo-sind-die-Konservativen-in-Deutschland.html
Sarrazin bleibt SPD-Mitglied
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5466ba2a503.0.html
Jüdischer SPD-Mann Lagodinsky verläßt seine Partei, weil Sarrazin bleiben darf
http://www.blauenarzisse.de/index.php/aktuelles/2480-juedischer-spd-mann-lagodinsky-verlaesst-seine-partei-weil-sarrazin-bleiben-darf
Sarrazin-Bestseller
NPD soll Raubkopien versendet haben
http://www.focus.de/politik/deutschland/sarrazin-bestseller-npd-soll-raubkopien-versendet-haben_aid_601356.html
Sachsen
Verfassungsrichter kippen Versammlungsgesetz
http://www.mdr.de/sachsen/8485497.html
Ein Furz der Geschichte
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M538e14b7ad8.0.html
Über Wut- und Angstbürger
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M50da2c936ea.0.html
Konsens und Empörung: Warum die parlamentarische Demokratie am Ende ist
http://www.blauenarzisse.de/index.php/gesichtet/2479-konsens-und-empoerung-warum-die-parlamentarische-demokratie-am-ende-ist
Peter Sloterdijk
"Japan hätte eine Dosis deutsche Angst gut getan"
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13128797/Japan-haette-eine-Dosis-deutsche-Angst-gut-getan.html
Putenmastskandal in Niedersachsen: Landwirtschaftsminister kündigt 38-Punkte-Plan an / PETA: „Reine Absichtserklärungen, die nichts wert sind!“
http://www.blauenarzisse.de/index.php/aktuelles/2475-putenmastskandal-in-niedersachsen-landwirtschaftsminister-kuendigt-38-punkte-plan-an--peta-reine-absichtserklaerungen-die-nichts-wert-sind
Stuttgarter Oberbürgermeister übernimmt Schirmherrschaft für Schwulenparade
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M59bf5d5d0ba.0.html
(wäre er es doch geworden…)
Christian Wulff wollte eigentlich Busfahrer werden
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/politik/christian-wulff-wollte-eigentlich-busfahrer-werden-1.1159577
Ostfriesenwitze: Radiohörer erstattet Anzeige wegen Volksverhetzung
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5f9e6dc54bd.0.html
Diskussion um Tanzverbote an Ostern
http://www.fuldainfo.de/index.php?area=1&p=news&newsid=15944
FDP versus Grüne
Oster-Tanzverbot: Wie die Politik reagiert
http://www.journal-frankfurt.de/?src=journal_news_einzel&rubrik=9&id=12919
(Kommentar zu Tanzverbot an Ostern)
Nicht mehr zeitgemäß
http://www.op-online.de/nachrichten/politik/nicht-mehr-zeitgemaess-1207516.html
Die Inkonsequenz der Oster-Tanzwilligen
Angriffe gegen Ordnungsdezernent Stein unberechtigt
http://www.freie-waehler-frankfurt.de/artikel/index.php?id=96
Mit Partylaune gegen das Verbot
Demonstranten tanzen unbehelligt
http://www.fnp.de/fnp/region/lokales/frankfurt/mit-partylaune-gegen-das-verbot_rmn01.c.8857938.de.html
(die mit dem Rollstuhl und dem Pierre Vogel-Maske-Bezug waren mit ziemlicher Sicherheit Antifanten (man erkennt auch ein paar der typischen Sonnenbrillen-Gesichter), die sich der Sache organisatorisch angehängt haben. Der gewöhnliche und völlig unpolitische Spaß-Tanzende, den man mehrheitlich im Video sehen kann, wäre viel zu stupid und desinteressiert, um solche politischen Bezüge herzustellen. So trifft sich, was auch irgendwie zusammengehört, Antifantentum und kulturelle Respektlosigkeit, ja Kulturlosigkeit, Fixierung auf pure Befriedigung von eigenen Bedürfnissen. Es sind eben einfach nur die jungen Produkte dieser Gesellschaft. Einen Pierre Vogel macht das einem insgesamt aber nicht noch unsympathischer.)
Frankfurt
Flashmob tanzt trotz Verbot vor dem Rathaus
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,758761,00.html
(mit Musik unterlegtes Video)
22.04.2011 - Tanzverbot Flashmob Frankfurt Römerplatz
http://www.youtube.com/watch?v=VizP6Mvf8fk
Die Zappelprozession der grün-linken Dekadenz
Karfreitag: Tanz-Demo für kulturelle Verwahrlosung
http://www.freie-waehler-frankfurt.de/artikel/index.php?id=98
Flashmob: Anwalt zeigt Tänzer an
http://www.op-online.de/nachrichten/frankfurt-rhein-main/strafanzeige-reaktion-flashmob-1223219.html
Verein fordert Umbenennung des „christlichen Garten“ in Berlin
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5861254ba8b.0.html
Treitschkestraße in Heidelberg wird umbenannt
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5f327d899ea.0.html
Streit über "Das Amt"
Historiker zerpflückt Bestseller
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,754558,00.html
Holocaust
"Eichmann zog in Jerusalem eine perfide Show ab"
http://www.welt.de/kultur/history/article13063495/Eichmann-zog-in-Jerusalem-eine-perfide-Show-ab.html
Neue Kampagne gegen die Wehrmacht
Nicht ehrenhaft, aber grausam
Der Mythos der Wehrmacht wird entzaubert
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1305276/Wie-grausam-war-die-Wehrmacht%253F#/beitrag/video/1305276/Wie-grausam-war-die-Wehrmacht%3F
Mittlerweile Verkaufsrang 2 bei Amazon ...
Soldaten: Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben
http://www.amazon.de/gp/product/3100894340/ref=s9_simh_gw_p14_d0_i2?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-1&pf_rd_r=04FSMPKX653WBYNZF503&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375193&pf_rd_i=301128
Mannheim ehrt Reemtsma
http://www.zuerst.de/archives/1521#more-1521
Treitschke oder „Die Juden sind unser Unglück“
http://www.sezession.de/24510/treitschke-oder-die-juden-sind-unser-ungluck.html#more-24510
(Die „Vergangenheitsbewältigung der 68er auf ihrem Höhepunkt… Nun ist die nächste Institution dran…)
NS-Kriminalisten im BKA
Die braunen Wurzeln von Wiesbaden
http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/die-braunen-anfaenge-von-wiesbaden/
(interessant die Leserkommentare. Man sieht, dass bisweilen eine Kluft zwischen den (aktiven) Lesern und den jüngeren, oft unbedarften Autoren der JF aufreißt…)
Das Hamsterrad der Geschichtsbewältigung
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5244f76043f.0.html
TV-Vorschau: "Liebe deinen Feind" Sommer nach dem Krieg
http://www.sueddeutsche.de/medien/tv-vorschau-liebe-deinen-feind-sommer-nach-dem-krieg-1.1086481
"Liebe deinen Feind"
Packender ZDF-Fernsehfilm der Woche von Niki Stein
http://www.presseportal.de/pm/7840/2026870/zdf
Deutsches Filmwunder. Nazis immer besser - von Dietrich Kuhlbrodt
http://www.shoa.de/index.php?option=com_content&task=view&id=757&Itemid=389
Der Hitlerspiegel
http://blogs.taz.de/hitlerblog/2007/06/12/der-hitlerspiegel/
Deutschland erhöht Zahlungen für Holocaustüberlebende
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M50645939506.0.html
LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS
Wie schüchtern Linksextremisten Gastwirte ein - eine Dokumentation
http://www.npd-bayern.de/index.php/menue/24/thema/939/id/2868/anzeigemonat/03/anzeigejahr/2011/infotext/Wie_schuechtern_Linksextremisten_Gastwirte_ein-eine_Dokumentation/Aktuelles.html
Linksextremismus: Studenten besetzen Evangelische Hochschule
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M57c29619a07.0.html
Streit um neuen Sarrazin-Auftritt in Halberstadt
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5db67725ee2.0.html
(Interessant, dass hier keine Diskriminierung aufgrund politischer Auffassungen gesehen wird. Könnte also ein deutscher 4-Sterne-Hotelier zukünftig auch einem Schwarzen aufgrund dessen Hautfarbe das Hotelzimmer verweigern, weil sich andere Gäste beeinträchtigt fühlen könnten und ein Schwarzer ja ohnehin nicht unbedingt in ein Luxushotel einkehren müsste, um ein Nachtlager zu haben?...)
NPD-ChefVoigt muss Hausverbot in Hotel hinnehmen
http://www.focus.de/politik/deutschland/npd-chef-voigt-muss-hausverbot-in-hotel-hinnehmen_aid_619528.html
Kein Wellnessurlaub für den NPD-Chef in Bad Saarow
http://www.morgenpost.de/printarchiv/brandenburg/article1613503/Kein-Wellnessurlaub-fuer-den-NPD-Chef-in-Bad-Saarow.html
Sachsen-Anhalt bereitet neuen NPD-Verbotsantrag vor
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5f5713fa535.0.html
Der weiche Plan der Stadt Dortmund gegen Nazis
http://de.altermedia.info/general/der-weiche-plan-der-stadt-dortmund-gegen-nazis-01-04-11_63032.html#more-63032
„Marsch für die Freiheit": Polizeigewerkschaft ruft zu Blockade auf
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M58b8d7f2fb1.0.html
Großrazzia bei Linksradikalen in zwei Bundesländern
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5ac0fa2c82f.0.html
Linksextremisten greifen Polizeiwache an
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M532e607a2cc.0.html
Linksextremisten bekennen sich zu Anschlag auf Polizeiwache
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M585d1509f1f.0.html
Christoph Ruf – Was ist links? Das wissen wir auch nicht, aber derzeit sind wir erfolgreich damit
http://www.blauenarzisse.de/index.php/gesichtet/2427-christoph-ruf-was-ist-links-das-wissen-wir-auch-nicht-aber-derzeit-sind-wir-erfolgreich-damit
Cohn-Bendit will seine politische Karriere beenden
http://www.welt.de/politik/ausland/article13182793/Cohn-Bendit-will-seine-politische-Karriere-beenden.html
(Wer sich unterhalten möchte, kann auch mal ein wenig in den Leserkommentaren blättern…)
(Vorher hat Dany aber mal wieder eine seiner konstruktiven Ideen…)
Cohn-Bendit will Özdemir als Kanzlerkandidaten
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13268133/Cohn-Bendit-will-Oezdemir-als-Kanzlerkandidaten.html
(auch hier eindeutige Kommentare der Leser…)
Vesper, Ensslin, Baader revisited
http://www.sezession.de/24165/vesper-ensslin-baader-revisited.html#more-24165
Marsch der Melonen
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5579ed51175.0.html
Linke: Partei ist offenbar knapp bei Kasse
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12065181/492531/Partei-ist-offenbar-knapp-bei-Kasse-linke.html
(Fragt sich nur, von wem die Dresdner Barrikade auf dem Foto in diesem Zeitungsartikel eigentlich errichtet worden ist…)
Verfassungsschutz
Rechtsextremismus: Gewaltbereitschaft der Neonazis nimmt zu
http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Rechtsextremismus-Gewaltbereitschaft-der-Neonazis-nimmt-zu-id14762721.html
Polizeigewerkschaft fordert vom DGB mehr Distanz gegenüber Linksextremisten
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5b3c06b536d.0.html
Zu Volkmar Wölk…
Endstation Zickenkrieg?
http://www.sezession.de/23907/endstation-zickenkrieg.html
Wölkische Ideologie und ablenkende Diskurse
http://www.sezession.de/24231/wolkische-ideologie-und-ablenkende-diskurse.html#more-24231
Politische Prozesse: Wenn die „Polizei des Deutschen Bundestages“ gegen einen Blaue Narzisse-Autor ermittelt und die Linke Ulla Jelpke verliert
http://www.blauenarzisse.de/index.php/anstoss/2448-politische-prozesse-wenn-die-polizei-des-deutschen-bundestages-gegen-einen-blaue-narzisse-autor-ermittelt-und-die-linke-ulla-jelpke-verliert
(auch zu Jelpke…)
CSU-Innenexperte Mayer attackiert Linkspartei
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M54b4b84d8dd.0.html
Extremismusdebatte: Bayerns Innenminister greift SPD an
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M52041222acb.0.html
Herrmann wirft München Förderung der linksextremen Szene vor
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M53090670196.0.html
Die Diffamierung funktioniert nicht mehr richtig: Über die schlechte Konjunktur von „Eigentlich sind alle Nazis“
http://www.blauenarzisse.de/index.php/gesichtet/2440-die-diffamierung-funktioniert-nicht-mehr-richtig-ueber-die-schlechte-konjunktur-von-eigentlich-sind-alle-nazis
BJV distanziert sich von jeglicher rechtsextremer Publikation
Feldkirchen/München - Der Bayerische Jagdverband (BJV) distanziert sich aufs Schärfste von der Werbebroschüre der „Jungen Freiheit“, die der gerade ausgelieferten Mitgliederzeitung „Jagd in Bayern“ (Ausgabe April 2011) beiliegt.
http://www.jagd-bayern.de/bjv-nachrichten-einzelanzeige.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=236&cHash=fb22a15ba397e843eb2b9c8f59df5c82
Zum Urheber Dr. MdL Prof. Dr. Jürgen Vocke:
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Vocke
http://www.oejv.de/blog/?p=218
http://www.wildland-bayern.de/00000198670090b1b/03393c98990cc8a04/index.html
(soll man „das war zu erwarten“ oder „besser so“ sagen?)
Ex-Arbeitsloser
Henrico Frank macht Alkohol-Therapie statt Politik
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13033821/Henrico-Frank-macht-Alkohol-Therapie-statt-Politik.html
Lausitz
Protest gegen "Schoko-Traum"-Werbung einer Bäckerei
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/protest-gegen-schoko-traum-werbung-einer-baeckerei/4015128.html
Österreich
Bäcker verkauft Torten mit Nazi-Symbolen
http://web.de/magazine/nachrichten/panorama/12526542-baecker-verkauft-torten-mit-nazi-symbolen.html#.A1000107
EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT
Wir machen uns ein neues Volk – Teil I
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M59ae58e9774.0.html
(Qualitätssender „Pro7“ macht auf Wallraff…)
„Tolerance Day“ Wie weltoffen sind die Deutschen?
http://www.news.de/medien/855154987/wie-tolerant-sind-die-deutschen/1/
Unermeßliche Wohltaten
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M518efee16af.0.html
Deutschland nimmt afrikanische Flüchtlinge aus Malta auf
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M54d1b456ace.0.html
Aufhebung der Residenzpflicht
Freie Fahrt für Asylbewerber
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M57e7c636e89.0.html
Österreich beschließt umstrittenes Fremdenrecht
http://www.op-online.de/nachrichten/politik/oesterreich-beschliesst-umstrittenes-fremdenrecht-1223405.html
Nichtwestliche Ausländer kosten Dänemark 2,1 Milliarden Euro im Jahr
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M553e71fb752.0.html
Berliner Landesbank verkauft Scharia-konformen Fonds
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5536123bcf6.0.html
(Burka voraus…)
Urteil: Hochzeit ohne Sichtkontakt gültig
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1137047
Türkischstämmiger Ministerkandidat warf Deutschen Völkermord an Türken vor
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5eacda3da9c.0.html
Schriftsteller Senocak
"Deutschland ist ein gescheiterter Staat"
http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article12956773/Deutschland-ist-ein-gescheiterter-Staat.html?fb_ref=artikelende&fb_source=profile_oneline
Afghanistan: Linkspartei gibt Innenminister Mitschuld an Ausschreitungen
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M596453ad57e.0.html
Dreieicher Bilderstreit: Kontroverse um abgehängtes Bild mit Öcalan-Gesicht geht weiter
http://www.op-online.de/nachrichten/dreieich/kunst-darf-unbequem-sein-1201173.html
Film "Four Lions"
Die unfreiwillige Komik der Selbstmordattentäter
http://www.welt.de/kultur/kino/article13204522/Die-unfreiwillige-Komik-der-Selbstmordattentaeter.html
Frankfurt
Linke und Rechte gegen Islam-Prediger Pierre Volgel
http://www.focus.de/panorama/vermischtes/deutschland-linke-und-rechte-gegen-islam-prediger-pierre-volgel_aid_620314.html
Extremismus: Islamisten-Prediger muss Deutschland bis heute Abend verlassen / Veranstaltung in Frankfurt verläuft friedlich
Nach Kundgebung ausgewiesen
http://www.morgenweb.de/nachrichten/politik/20110423_mmm0000001567593.html
Pierre Vogel und die Hilflosigkeit der Beschwichtiger
Der Islam-Boxer knockt Verbot mühelos aus
http://www.freie-waehler-frankfurt.de/artikel/index.php?id=97
Bremen schafft sich ab - der Miri-Clan
http://www.youtube.com/watch?v=7lFbGXyAfxw
Offenbach
Jugendliche überfallen Seniorin
http://www.op-online.de/nachrichten/offenbach/raub-seniorin-goldkette-1195579.html
Dietzenbach
Spektakulärer Raubüberfall aufgeklärt
http://www.op-online.de/nachrichten/dietzenbach/raubueberfall-spektakulaer-dietzenbach-aufgeklaert-1194343.html
(nicht online, aber in der Printausgabe der Offenbach-Post vom 8.4.2011 steht folgender Hinweis auf die Täter: „Die Täter stammen aus intakten Familien; die Eltern hätten bestürzt reagiert. Da schnell klar war, dass es sich bei den Tätern - drei Deutsch-Marokkaner und zei Türken - um Ortskundige handeln musste, konnten die Beamten ihre täterorientierte Arbeit aufnehmen.“)
Hanau
Messer an den Hals gesetzt
http://www.op-online.de/nachrichten/hanau/messer-hals-gesetzt-1181735.html
„Frankfurter Rundschau“ natürlich ohne ethnische Kennung…
http://www.fr-online.de/rhein-main/hanau/messerstecher-verurteilt/-/1472866/8287844/-/index.html
Hanau
Schüler überfallen
http://www.osthessen-news.de/beitrag_A.php?id=1196256
(nicht online, aber in der Printausgabe der Offenbach-Post vom 8.4.2011 steht folgender Hinweis auf die Täter: „…forderten zwei etwa 15 Jahre alte Jugendliche Zigaretten. Da ihr Opfer keine hatte, schlug einer der Räuber - angeblich ein türkisch wirkender dicker Junge mit scharzem, lockigem Irokesenschnitt - auf den 14-Jährigen ein. Der andere Angreifer, ein Südländer mit Irokesenschnitt, stach dem Schüler mit einem Messer in den Oberarm.“ Zum zweiten Überfall heißt es dort: „Er wurde von fünf jungen Südländern umringt und musst ihnen Geld und Handy herausgeben.“)
Wuppertal
Tritt hätte Polizisten töten können
http://www.wz-newsline.de/lokales/moenchengladbach/tritt-haette-polizisten-toeten-koennen-1.630893
Ausländerkriminalität: Türkischer Exhibitionist, Türke ersticht Mutter, Versuchte Entführung von Südländern, Versuchte Vergewaltigung einer 13-Jährigen durch Iraker
http://www.blauenarzisse.de/index.php/aktuelles/2452-auslaenderkriminalitaet-tuerkischer-exhibitionist-tuerke-ersticht-mutter-versuchte-entfuehrung-nach-gescheiterter-ehe-von-suedlaendern-versuchte-vergewaltigung-einer-13-jaehrigen-durch-iraker
KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES
Gottfried Benn für Arme
Ein bitteres Adieu zum 100. Geburtstag: E.M. Ciorans brünstig-inbrünstige Aufsätze aus den Dreißigerjahren entlarven den Philosophen als braunen Schwärmer
http://www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article13045823/Gottfried-Benn-fuer-Arme.html
José Sánchez de Murillo: Luise Rinser
Nie sollst du mich befragen
Denn wir sind treu: Luise Rinser hat ihr Leben und Wirken zwischen 1932 und 1945 systematisch umgeschrieben. Das verschweigt auch eine neue, von ihrem Freund und Kollegen José Sánchez de Murillo verfasste Biographie nicht.
http://www.faz.net/s/Rub79A33397BE834406A5D2BFA87FD13913/Doc~E8B23097127234EA897F42CD31D367B1E~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Gerd-Klaus Kaltenbrunner gestorben
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M528f666438d.0.html
Panorama, Gesellschaft
Rainer Langhans: „Ihr seid die neuen 68er!“
http://www.freie-allgemeine.de/artikel/news/rainer-langhans-ihr-seid-die-neuen-68er/
(Man betrachte mal die Wortwahl für die kommunistischen Putschisten des Augustputsches 1991 in Moskau bei wikipedia. Man glaubt sich bei einer trotzkistischen Gruppe:
„Die Führer des Putschversuches waren Mitglieder einer konservativen [1] Junta [2] des reaktionären Flügels der KPdSU[3][4]…“)
Augustputsch in Moskau
http://de.wikipedia.org/wiki/Augustputsch_in_Moskau
Religion
Meine Freundin, die Nonne
http://www.zeit.de/2008/15/Nonne-15
Einheitsdenkmal in Berlin
Demokratie zum Schaukeln
http://www.sueddeutsche.de/kultur/zum-entwurf-des-einheitsdenkmals-demokratie-zum-schaukeln-1.1084869
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1310932/Einheitsdenkmal-Entscheidung-gefallen?bc=sts;sta#/beitrag/video/1310932/Einheitsdenkmal-Entscheidung-gefallen
Berliner Einheits-Denkmal
Ehrlich verschaukelt
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,756941,00.html
Einheitsdenkmal in Berlin: Die Freiheit in der Salatschüssel
http://www.stern.de/kultur/kunst/einheitsdenkmal-in-berlin-die-freiheit-in-der-salatschuessel-1674780.html
Einfach wieder aufbauen - darf und soll man das?
Pro und contra Rekonstruktion verlorener Bauwerke
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/34/34372/1.html
Bürger sehnen sich nach der guten, alten Stadt
Initiativen setzen sich für bauliche Rekonstruktionen ein. Ausgerechnet der Denkmalschutz warnt aber vor Beliebigkeit
http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article7045747/Buerger-sehnen-sich-nach-der-guten-alten-Stadt.html
Sanierung
Bürokratie lässt Schloss Prötzel zerfallen
http://www.morgenpost.de/brandenburg/article1584684/Buerokratie-laesst-Schloss-Proetzel-zerfallen.html
Prötzel
Grünes Licht für Schlossherrn
http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/1/286082/
Niedergang eines Monuments
Mit dem Marinekraftwerk in Wilhelmshaven droht ein bedeutender Industriebau zu verschwinden
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/kunst_architektur/niedergang_eines_monuments_1.10259533.html
Bildung im Nordosten: Abitur auf Knopfdruck
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M52aea61fa32.0.html
(Eine weitere Absurdität…)
Wikimedia Deutschland: Wikipedia soll Weltkulturerbe werden
http://www.netzwelt.de/news/86323-wikimedia-deutschland-wikipedia-weltkulturerbe.html
Big Brother Awards 2011: „Oscars für Datenkraken“ gehen u.a. an Facebook und Apple
http://www.blauenarzisse.de/index.php/aktuelles/2431-big-brother-awards-2011-oscars-fuer-datenkraken-gehen-ua-an-facebook-und-apple
Buch über die Generation Facebook
Die effektvolle Scheißegal-Revolution
http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/die-effektvolle-scheissegal-revolution/
Google-Suche in Deutschland häufig zensiert
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5c220c1baba.0.html
Apple speichert heimlich Geodaten von iPhone und iPad
http://www.mobilfunk-talk.de/news/33864-apple-speichert-heimlich-geodaten-von-iphone-und-ipad/
Neben Apple speichert auch Google Ortsdaten am Handy
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3930&cob=557193
Handy-Osteraufzeichnung
Kommentar: Warnschuss aus den USA
http://www.op-online.de/nachrichten/politik/kommentar-hady-aufzeichnung-usa-1220332.html
re:publica 2011 Gunter Dueck - Das Internet als Gesellschaftsbetriebssystem
http://www.youtube.com/watch?v=MS9554ZoGu8
Umwelt: Aus Energiesparlampen strömen giftige Dämpfe
http://www.derwesten.de/nachrichten/wirtschaft-und-finanzen/Aus-Energiesparlampen-stroemen-giftige-Daempfe-id4552929.html
Gegen die Illegalisierung und Abschaffung natürlicher Heilmittel durch multinationale Pharmakonzerne und die Europäische Union
http://www.savenaturalhealth.de/
Zu Vertiefung:
ANH Europe
http://www.anh-europe.org/
THMP-Direktive
Heilpflanzen werden in der EU verboten
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/09/heilpflanzen-werden-in-der-eu-verboten.html
Petition
2 Tage zur Rettung von pflanzlichen Heilmitteln
http://www.avaaz.org/de/eu_herbal_medicine_ban/97.php?cl_tta_sign=c72a3f7fdc0642a2e084263e1ca5b63f
Klage
Jesus-Gruß bei QVC unerwünscht
http://www.derwesten.de/staedte/duesseldorf/Jesus-Gruss-bei-QVC-unerwuenscht-id4544021.html
Memminger Wirt verliert
Rauchen ist doch keine Kunst
http://www.br-online.de/aktuell/rauchverbot-memmingen-wirt-ID1301651414197.xml
(Problem verwilderter Hunde)
Rußland
Streunende Hunde bissen Jungen zu Tode
http://www.news.at/articles/1115/15/294291/streunende-hunde-jungen-tode-fuenfjaehriger-grossmutter
Das karlsruher//netzwerk fragt nach: Interview mit Enesess (n'Socialist Soundsystem)
http://www.youtube.com/watch?v=7hhi-PpmhVM&feature=player_embedded
Christenbashing aus den USA: „Paul – Ein Alien auf der Flucht“ kommt nach Deutschland
http://www.blauenarzisse.de/index.php/rezension/2471-christenbashing-aus-den-usa-paul--ein-alien-auf-der-flucht-kommt-nach-deutschland
Bollywood goes Action-Kino
Game: Sarah Jane Dias im sexy Debüt neben Abhishek Bachchan
http://www.vip-chicks.de/game-sarah-jane-dias-im-sexy-debut-neben-abhishek-bachchan-13682.html
--
00:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journaux, affaires européennes, europe, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Krantenkoppen - Mei 2011/01
 Krantenkoppen
Krantenkoppen
Mei 2011 / 01
BITTERE UITKOMST CACAO-OORLOG IN IVOORKUST:
"Gelukkig voor ons dat Frankrijk nog altijd haar Vreemdelingenlegioen achter de hand heeft. Rebellerende stammen in het noorden werden gerekruteerd en van wapens voorzien; stembussen volgestopt met vervalste stembiljetten, en ziedaar, hoera, Ouattara, de harlekijn van de multinationals, heeft de recente presidents verkiezingen eerlijk gewonnen."
http://www.ftm.nl/followleader/bittere-uitkomst-cacoa-oorlog-in-ivoorkust.aspx
'NEDERLANDSE' PIJPLIJN TUSSEN LIBIË EN ITALIË:
"Greenstream B.V. is een Libisch/Italiaanse joint venture. Een dochter van het Italiaanse energiebedrijf ENI - het eveneens in het WTC gevestigde ENI North Africa BV, en het Libische staatsoliebedrijf National Oil Corporation of Libya (NOC), bezitten ieder 50 procent van de aandelen van Greenstream. Deze vennootschap bezit en exploiteert de langste onderwater pijplijn van de Middellandse zee. De gaspijplijn loopt van de kust van Libië naar Sicilië en zorgt voor een zeer voornaam deel van de Italiaanse energievoorziening."
http://www.ftm.nl/followleader/nederlandse-pijplijn-in-libië.aspx
WELKE ECONOMISCHE WERELDORDE GAAT HET WORDEN?
"Toevallig de monetaire conferentie van Bretton Woods in 1944 gemist? De kans is groot dat u ook de reprise van deze historische bijeenkomst die afgelopen weekeinde werd gehouden, mis heeft gelopen."
http://www.ftm.nl/original/welke-economische-wereldorde-gaat-het-worden.aspx
BETER BOER DAN BANKIER
"De Voedselcrisis van 2011 is nog niet verdwenen, integendeel. Het gaat er nu pas om spannen. (...) Inmiddels "investeren" hedgefunds, maar ook pensioenfondsen, steeds meer in landbouwgrond en boerderijen. Het is niet voor niets dat Jim Rogers onlangs in Amsterdam verkondigde dat u beter per direct boer kan worden dan bankier. De boer van de toekomst zal in een Lamborghini (sportauto) rijden en de bankier moet lijdzaam toezien dat zijn bonus stap voor stap verder wordt ingeperkt."
http://www.ftm.nl/followleader/beter-boer-dan-bankier.aspx
USDA: "Rusland nieuwe graanschuur van de wereld"
De VS domineert sinds 1945 de tarwemarkt. Analisten voorspelden een paar jaar geleden al dat de VS niet langer de grootste leverancier van tarwe zou blijven op de wereldmarkt. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) heeft dat nu in een eigen rapport bevestigd. Het USDA verwacht dat Rusland in 2019 de grootste tarwe-exporteur ter wereld wordt.
http://www.vilt.be/USDA_Rusland_nieuwe_graanschuur_van_de_wereld
IN DE TIJD VAN DE MARTELAREN:
"Dat Nietzsche al zijn academische aanhangers zou hebben uitgelachen, lijdt geen twijfel. Voor hem hoorde de denker onafhankelijk te zijn. De gezaghebbende Kant verweet hij een loonslaaf van de staat te zijn; wie hij hoogachtte was Schopenhauer, die onderscheid maakte tussen filosofen en professoren filosofie. Om een gesprekspartner van Nietzsche te zijn, hoort men vrij de heersende opvattingen te bekritiseren. Socrates, Paulus of Spinoza komen in aanmerking. Voorts moet men aan de vakspecialismen, de literatuur en de journalistiek ontstijgen. Feiten, informatie, archiefmuizerij zijn voor de geschiedschrijver niet genoeg. Alleen de profeet telt. En dat is wat Nietzsche zich voelde. Voor hem was het christendom schuldig aan onderdrukking van de gezonde levenslust; de naastenliefde was een uiting van ziekelijk naar de dood hunkerende kruipers. De christelijke beschaving gijzelde de sterken ten behoeve van de zwakken."
http://www.catholica.nl/archief/11458/de-tijd-van-de-martelaren
00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, journaux, médias, europe, affaires européennes, pays-bas, flandre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Gabriele Adinolfi à Gand - 6 avril 2011

Gabriele Adinolfi à Gand !
Mercredi 6 avril 2011
Introduction
C’est la toute première fois que Gabriele Adinolfi a pris la parole dans une université de l’Europe du Nord-Ouest. Parmi les étudiants gantois, qui l’ont invité, on trouve quelques personnalités séduites par le projet « Casa Pound », qui multiplie les foyers identitaires dans toutes les villes d’Italie. A Rome, sept à huit maisons accueillent les identitaires qui ont décidé de rompre avec le système. Gabriele Adinolfi s’est adressé aux étudiants flamands, pour la plupart membres du groupe catholique KVHV, en langue française, ce qui est inhabituel au sein d’un mouvement soucieux de préserver la langue populaire face aux assauts du français des fausses élites dominantes, mais ce discours en français a été accepté avec joie, vu l’intérêt nouveau pour les initiatives italiennes, dont « Casa Pound », et pour l’itinéraire de Gabriele Adinolfi, commencé, fin des années 70, dans le groupe, désormais mythique, que fut « Terza Posizione » (« 3P »).
Sollicité par les étudiants, Gabriele Adinolfi évoque les années de plomb et l’émergence de « Terza Posizione » (« 3P »). Il rappelle qu’il s’agit d’une époque bien révolue, tout à fait différente de celle que nous vivons (et subissons) aujourd’hui. La situation a totalement changé, tant du point de vue social que du point de vue international. L’époque de « Terza Posizione » était certes plus violente —on risquait sa vie en optant pour les idées de 3P— mais les hommes étaient plus libres d’exprimer leurs opinions qu’ils ne le sont aujourd’hui. Les changements ont donc été radicaux mais, de ces mutations, on doit retenir la diminution drastique de liberté.
Le mouvement 3P remonte à trente-cinq ans environ, à une époque où son public d’étudiant gantois n’était pas encore né et où leurs parents étaient des adolescents. Gabriele Adinolfi sait que la situation italienne est quasi inconnue en dehors de la péninsule : il rappelle que, pendant la deuxième guerre mondiale, l’Italie fut un Etat qui résistait à la tentative anglo-saxonne de faire main basse sur l’Europe et sur le monde. Envahie au départ de la Sicile et du Sud, l’Italie a résisté pendant deux ans aux envahisseurs, dans le cadre de ce que l’on appelait à l’époque la « République Sociale Italienne ». L’Italie a subi une guerre civile entre 1943 et 1945, d’où a émergé un « Parti Communiste italien » (PCI), qui deviendra le plus fort de toute l’Europe occidentale. Mais la violence n’a jamais été vraiment éradiquée : après 1945, la guerre civile s’est poursuivie, si bien que l’on peut dire qu’elle se poursuit encore aujourd’hui mais à feu beaucoup plus doux.
A la fin des années 60, l’Europe a été secouée par les révoltes étudiantes, qui entendaient traduire dans la réalité le « rêve de 68 » (en gros l’idéologie de Marcuse, exprimée pour l’essentiel dans « Eros et la civilisation », qui deviendra le fondement idéologique de l’ère festiviste, telle que définie par le regretté Philippe Muray - ndlr). A la différence de l’Allemagne ou de la France, le mouvement contestataire étudiant en Italie recelait une plus forte composante nationaliste, qui a su tenir le coup face à la contestation de types communiste et gauchiste. Vainqueurs de la guerre civile en 1945, les communistes italiens pouvaient tout faire au niveau intérieur : personne n’osait s’opposer à leurs exactions. Des dizaines de militants ont été assassinés sans que jamais un coupable n’ait été arrêté ou condamné. Face à cette terreur, étudiants et intellectuels critiques cherchaient un espace de liberté, à partir duquel ils pouvaient « tenir ». Le mouvement 3P fut l’un de ces espaces de liberté, fut une tentative pour sortir de l’étau. Il était composé de jeunes âgés entre 16 et 22 ans, qui ont subi la répression de plein fouet. La persécution fut féroce. Certains d’entre eux furent jetés pendant quatre ou cinq ans en prison avant d’être relâchés sans jamais avoir été jugés ni condamnés. D’autres ont été tués. D’autres se sont exilés.
Le mouvement 3P constituait un danger au regard du système parce qu’il lançait des idées nouvelles, qui sont aujourd’hui parfaitement réactualisables. Gabriele Adinolfi en cite trois faisceaux : 1) Ne pas accepter les manipulations, courantes dans la situation de la guerre froide, caractérisée par le dualisme de Yalta ; les militants de 3P ne croyaient pas au duopole de Yalta : pour eux, les ennemis apparents d’alors créaient un faux antagonisme, ils restaient en réalité les alliés de 1941-45 ; 2) Croire à la liberté des peuples. Dans le cadre de cette idée-force, les militants de 3P se référaient à Peron (Argentine) et à Nasser (Egypte), deux figures plus ou moins liées aux perdants de la seconde guerre mondiale ; Peron et Nasser ont mené des luttes de libération réelles contre le système bancaire international et contre les réseaux criminels ; 3) Il ne faut pas tenter de faire la conquête de l’Etat, qui, en fait, n’existe plus, est réduit à une fiction. Ce qu’il faut faire, c’est créer un espace réellement libre au sein de la société italienne réellement existante.
Ces trois postulats majeurs du mouvement 3P conduisirent à l’analyse suivante : l’Italie était au beau milieu d’une guerre visant la conquête définitive et totale de la Méditerranée ; c’est le cas aujourd’hui encore et même plus qu’hier, vu les événements de Palestine, de Chypre, d’Egypte, de Tunisie et de Libye. Le terrorisme est un instrument utilisé dans cette guerre. Les services de puissances comme la Grande-Bretagne, la France et Israël manipulent le terrorisme. Exemple : à Londres existe une « école de langues » où s’inscrivent les terroristes de gauche protégés par les services secrets occidentaux et orientaux. L’objectif est d’utiliser ce potentiel pour faire la guerre aux peuples réels. Ce modus operandi existe depuis longtemps : rien n’a jamais changé, sauf peut-être certaines formes.
En 1989, quand tombe le Mur de Berlin, nous constatons un enlisement de la situation, un recyclage de certains terroristes dans le trafic de drogues et nous assistons à un nouvel asservissement des peuples, non plus à des Etats ou à des machines politiques de forme conventionnelle, mais aux multinationales qui n’ont plus leur « ennemi » communiste ou soviétique, avec lequel il fallait composer ou faire semblant de composer : le champ est désormais totalement libre pour les exactions des circuits économiques multinationaux. Dès 1960, un journal économique américain constatait que « les usages et les coutumes des peuples étaient un frein au développement économique ». Il préconisait dans la foulée de modifier les styles de vie, de susciter une perpétuelle « conscience malheureuse », de susciter le désir (de consommer), ce qui, à terme, devait provoque un développement économique illimité. C’est cette société-là qui est advenue de nos jours. Elle a émergé dans un contexte différent de celui des années 70, où était apparu 3P. La marche de la politique mondiale est aujourd’hui gérée par quelques grandes puissances qui veulent contrôler essentiellement deux choses : le pétrole et le narco-trafic. Seul pierre d’achoppement : la Chine. La question demeure ouverte : va-t-on partager le pouvoir avec elle ou la posera-t-on comme nouvel ennemi du « genre humain » ?
Le contexte actuel est celui de la disparition progressive des Etats, à l’exception de ceux qui vendent des armes ou organisent le trafic des drogues. Le monde actuel est caractérisé par une absence de « point ferme », de « lieu fixe », ce qui conduit à une logique d’avachissement généralisé, qui n’est rien d’autre qu’une logique économique anti-civilisationnelle. C’est le résultat du mai 68 gauchiste et de l’idéologie néolibérale. L’Etat est réduit à ses fonctions désagréables : l’administration, le fisc, la répression ; il n’a plus aucune fonction de protection, de solidarité, d’éducation. Il n’élève plus le niveau, ne fait pas accéder les humbles parmi les siens à la dignité. Il écrase et réprime.
L’Europe dans un tel contexte n’est plus un continent qui se consacre à la production. En 2030, l’Afrique comptera 900 millions d’habitants (dont 300 millions auront entre 15 et 24 ans) ; l’Inde comptera 250 millions d’habitants entre 15 et 24 ans ; la Chine comptera 900 millions de citoyens entre 15 et 59 ans (elle connaîtra également un ressac démographique) ; l’Europe, elle, ne comptera plus que 450 millions d’habitants entre 15 et 59 ans, dont 75 millions seulement auront entre 15 et 24 ans. Avec une situation démographique aussi désastreuse et sans la structure d’un Etat protecteur, les salaires seront sans cesse à la baisse et les lois répressives se multiplieront. L’Europe risque de subir le sort de l’Argentine, pays potentiellement riche (grâce notamment à son élevage) mais détruit par le FMI. En Argentine, les gens sont descendus dans la rue et ont protesté. Mais, ici, en Europe, avec le chaos mental qui caractérise nos sociétés, à qui s’en prendre ? Car les réactions potentielles sont inhibées par les faux débats.
Le débat sur l’islam, l’islamisme et l’immigration est l’un de ces débats que l’on fausse systématiquement. On parle d’invasion islamique, en nous disant que cette invasion islamique et islamiste est hostile à l’Occident : or le Hamas comme les Frères musulmans ont reçu armes et soutiens des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et d’Israël. Bon nombre d’immigrés sont certes musulmans mais s’ils étaient chrétiens ou animistes, le problème que pose toute masse allochtone (non intégration, irrespect pour la culture hôte, méconnaissance des us et coutumes des uns et des autres) resterait le même. Jadis, pendant la « Guerre Froide », l’URSS et les Etats-Unis étaient soi-disant ennemis, en réalité, ils étaient toujours les alliés de 1941. Aujourd’hui, les fondamentalistes islamistes disent qu’ils sont les ennemis des Etats-Unis : en réalité, ils sont leurs alliés.
On dit souvent que les votes de protestation peuvent servir à modifier la situation déplorable dans laquelle nous nous trouvons. C’est sans doute vrai, ou partiellement vrai. Mais, souvent, l’accession de protestataires, désignés comme tels par les médias aux ordres, à des postes de décision ne sert à rien : ils entérinent trop souvent ce que leur dictent les bureaucrates, à l’échelon de l’Etat national comme à l’échelon européen. Nous devons toujours nous rappeler que nous n’avons aucune liberté politique, nous n’avons que la liberté de consommer : nous ne sommes plus des « zoon politikon », nous n’appartenons plus à des peuples politiques, nous ne sommes plus les acteurs de notre destin, nous sommes tous devenus des consommateurs passifs. Nous n’avons plus aucun pouvoir d’agir réellement et efficacement.
Que faire dans un cas pareil ?
Nous pouvons viser l’émergence d’une Europe différente, autre, dé-bureaucratisée. Nous pouvons parier sur le régionalisme ou le localisme : dans ce cas, nous nous renforcerons, si notre action est bien agencée ; mais nous courons un réel danger si nous sommes manipulés. Ce qu’il faut viser par-dessus tout, c’est l’AUTONOMIE. Dans cette perspective, nous devons nous dire que la LOI est en nous : elle existe comme fait de monde positif mais elle est battue en brèche par le système, elle est attaquée de partout par les tenants du nouveau totalitarisme mou, plus insidieux, moins visible que les totalitarismes durs de jadis. Il faut faire vivre la LOI en soi. Pour ce faire, il faut créer des réseaux alternatifs qui permettront aux nôtres d’échapper aux réseaux du système, à ceux des banques, des lobbies et des mafias. Nous créerons ainsi derechef un nouvel antagonisme : celui qui opposera les lobbies des catégories sectorielles aux lobbies du peuple réel. Ndlr : « Adinolfi serait-il un Toni Negri de ‘Troisième Position’ ? ». Pour mettre sur pied ce réseau de lobbies émanant du peuple réel, il faut faire vite, il faudra les renforcer et les étayer en quelques décennies à peine. Le point d’appui pour faire basculer les hésitants, les égarés, les désorientés, c’est la CULTURE. La CULTURE est la grande laissée pour compte du système : celui-ci a pu s’établir, devenir ce « talon d’acier », cet « Iron Heel », seulement au détriment de la culture générale, de la culture propre aux peuples, qu’ils soient européens ou autres. La CULTURE, dans toutes ses facettes, recèle implicitement la LOI, le « Nomos » d’Hérodote (ndlr : voir ce qu’en a dit l’ancien Recteur François Ost, des facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles). La LOI, le « Nomos », revivra en chacun d’entre nous si la CULTURE redevient vivante en nos cœurs. Nous devons donc multiplier les initiatives culturelles, en dehors de la fausse culture, fabriquée et abstraite, que diffuse le système pour donner le change et camoufler ses intentions anti-culturelles, sa volonté de détruire la LOI en détruisant la culture qui sert de terreau à celle-ci.
Faire revivre la CULTURE, minée par le système, et faire triompher ainsi la LOI, tel est l’objectif du mouvement CASA POUND. Ce dernier se veut un lobby populaire et « re-culturant », qui vise à parfaire une « révolution » de ce type. L’instrument le plus efficace du mouvement CASA POUND, dans cette optique, est son aile étudiante, le BLOCO STUDENTESCO. Ce « Bloc étudiant » s’est surtout distingué en Italie par sa protestation véhémente contre les privatisations qui menacent l’institution universitaire, comme partout ailleurs en Europe. Les gouvernements européens sabrent dans les budgets habituellement consacrés à l’école et à l’université au détriment de la qualité de l’enseignement classique et au bénéfice des études à la carte, taillées exclusivement pour les besoins immédiats de l’économie. C’est de cette façon que l’on tue et la CULTURE et la LOI : c’est donc là qu’il faut porter le fer. Nous avons la satisfaction de constater que le BLOCO STUDENTESCO est aujourd’hui, en Italie, le mouvement étudiant le plus représentatif, comptant le plus de membres, tant au niveau des écoles et des lycées que des universités. Entre 12 et 18 ans, le jeune lycéen italien d’aujourd’hui va plus spontanément vers le BLOCO STUDENTESCO que vers n’importe quel autre mouvement étudiant.
Le succès de CASA POUND et de BLOCO STUDENTESCO est dû à la personnalité de Gianluca Ianone. Il a compris que la défense de la culture ne devait pas se limiter à évoquer les pages sublimes de nos héritages littéraires, politiques, historiques et culturels, effacées des mémoires par le système, mais aussi à redonner de la dignité à ceux que le système avait marginalisés. Son objectif initial a été de donner un logement à bas prix aux familles qui, autrement, auraient été réduites à la précarité, à vivre dans des taudis abjects, avec le risque permanent d’en être expulsés. Les autres sphères politiques, les partis traditionnels, les syndicats inféodés au système ne savent plus quoi faire face aux dégâts que celui-ci a provoqués dans la société ; intellectuellement, les instances liées au système n’ont plus aucune orientation, n’offrent plus aucune possibilité d’échapper au déclin social généralisé, amorcé dès le début des années 80 par l’avènement du néolibéralisme, avec son cortège de mesures antisociales comme les privatisations, les restrictions budgétaires, les mesures d’austérité et les délocalisations. Par voie de conséquence, certaines strates de la population sont désormais sensibles à ce que peut dire ou énoncer une instance perçue comme étrangère au système, donc une instance qui est lobbyiste mais émane cette fois du peuple réel et non plus de l’Etat démonétisé ou du système.
Dans un tel contexte, la population, abandonnée par le système qui lui a pourtant promis monts et merveilles, est en droit et en mesure de créer des organisations ludiques, culturelles, sportives et caritatives (notamment au bénéfice des handicapés) sans passer par l’Etat, les pouvoirs publics à tous niveaux ou le « sponsoring » économique des banques, des grandes compagnies d’assurance ou des entreprises aux bénéfices plantureux qui cherchent à échapper à l’impôt. Ces organisations sont en prise avec la vie quotidienne : elles visent à résoudre des problèmes réels en toute autonomie, sans argent public et sans l’intermédiaire du fonctionnariat prévu à ces effets, car ce fonctionnariat ne résout plus rien, tout en n’utilisant les biens publics que pour sa seule survie et non plus pour soulager ceux pour lesquels, initialement, cet argent public était destiné.
Si on veut que ça change, il faut en effet multiplier ces zones d’autonomie, appelées à prendre le relais des institutions en faillite. L’objectif est de « privatiser », comme l’annonce aussi le néolibéralisme, mais de privatiser ce que le privé néolibéral a cherché à étouffer et à effacer au cours de ces dernières décennies, notamment l’héritage culturel européen, fruit de plusieurs siècles voire de plusieurs millénaires de culture et de civilisation. L’objectif du réseau de Ianone est de créer du « privé social » car la vague déferlante des privatisations néolibérales n’a généré que du « privé antisocial ».
Cette multiplication volontariste d’autonomies de tous genres va de paire avec la création d’un centre d’études, apte à innerver ce réseau d’autonomies. Car force est de constater que le système ne produit plus rien, sinon de la précarité sociale. Les forces politiques conventionnelles, les syndicats et le monde économique ne produisent plus d’idées capables d’être traduites dans le réel au bénéfice de la population. Cette production d’idées et de projets exige beaucoup de travail et d’investissement personnel. Celui qui dit aujourd’hui qu’il est non conformiste, qu’il rejette le système, ne peut donc plus jouer aux esthètes en chambre comme ce fut le cas dans bon nombre de partis, groupuscules ou cénacles considérés par le système comme « extrémistes ». Plotin nous disait : « Aucun Dieu ne prend les armes à la place de ceux qui doivent se défendre ». Rien n’est donné, tout doit être conquis.
(Résumé réalisé par Denis Ilmas, Gand, 6 avril 2011).
00:16 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mouvement étudiant, flanbdre, italie, europe, affaires européennes, événement, gand, mouvement flamand, mouvement étudiant, terza posizione |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lampedusa - Exodus nach Europa
|
00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, lampedusa, immigration, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 mai 2011
L'Afrique face à l'Europe: du choc démographique au choc culturel
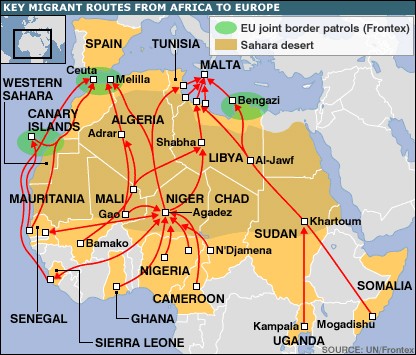
L'Afrique face à l'Europe : du choc démographique au choc culturel
Communication de Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia
Au Colloque de l’Institut de géopolitique des populations
sur : « Les prochaines guerres seront-elles démographiques ? » - 28 avril 2011
Choc démographique
Un peu de géographie d’abord. Trois espaces doivent être distingués : –
L’Europe : elle a connu un baby-boom de 1945 à 1973 ; elle connaît un papy-boom aujourd’hui ; aucun pays n’y atteint plus, depuis de longues années, le taux de fécondité de 2,1 enfants par femme, nécessaire au simple renouvellement des générations.
– Le Maghreb : Maroc, Tunisie et Algérie ont connu un baby-boom jusque dans les années 1990 ; ils sont actuellement en situation de transition démographique, avec des taux de fécondité proches de 2. La proportion de jeunes actifs dans la population reste très forte.
En Algérie, 50% des 34 millions d’habitants ont moins de 25 ans. Au Maroc, 50% des 32 millions d’habitants ont moins de 27 ans. En Tunisie, 50% des 11 millions d’habitants ont moins de 30 ans. Il y a donc là les conditions démographiques de ce qu’Alfred Sauvy a appelé, dans un livre célèbre, « La Révolte des jeunes » – un élément majeur d’explication de ce que les grands médias ont baptisé les « révolutions arabes » et qui jusqu’ici n’ont été en fait que des révoltes déstabilisatrices.
Ainsi de la Tunisie, pays du Maghreb le plus développé, où le taux de chômage va passer, de 2010 à 2011, de 11% à 17%, selon le ministre tunisien de l’emploi – avec les conséquences que l’on constate de Lampedusa à Vintimille sur les flux migratoires.
– L’Afrique : la fécondité subsaharienne reste la plus élevée de la planète ; encore de 6,2 enfants par femme en 1990, elle a été ramenée en 2008 à 4.9 enfants par femme.
Le nombre des naissances de l’Afrique subsaharienne qui, en 1950, était encore comparable à celui de l’Union européenne dans ses limites actuelles, lui est aujourd’hui près de 7 fois supérieur : tous les ans, 33 millions de naissances contre 5 millions, selon les travaux de Philippe Bourcier de Carbon.
Les flux d’immigrants (réguliers et irréguliers) dans les pays de l’Union européenne en provenance de l’Afrique subsaharienne sont aujourd’hui essentiellement composés de jeunes adultes âgés de 20 à 40 ans et plus de 40% de ces flux sont désormais constitués de jeunes femmes de ces tranches d’âge. Les effectifs de ces jeunes adultes âgés de 20 à 40 ans sont donc appelés à doubler d’ici à 2040 en Afrique subsaharienne, passant de 250 millions à 500 millions en trente ans. Cela signifie – toutes choses égales par ailleurs, en particulier si la probabilité d’émigrer dans l’Union reste ce qu’elle est aujourd’hui – que la pression migratoire des jeunes adultes en provenance de l’Afrique subsaharienne sur les frontières de l’Union est appelée à doubler au cours des trois prochaines décennies.
Ce face-à-face de l’Europe (y compris la Fédération de Russie) ou de l’Union européenne avec l’Afrique subsaharienne peut donc se résumer ainsi en ce début du XXIe siècle :
- – La zone la plus urbaine de la planète fait à présent face à la zone la plus rurale ;
- – La zone la plus riche de la planète fait à présent face à la zone la plus pauvre ;
- – La zone la plus stérile de la planète fait à présent face à la zone la plus féconde ;
- – La zone où la vie est la plus longue fait à présent face à celle où elle est la plus courte ;
- – La zone la plus âgée de la planète fait à présent face à celle où elle est la plus jeune ;
- – La zone où le nombre des décès excède celui des naissances fait face à celle où la croissance naturelle de la population est la plus rapide.
Le constat d’échec des politiques migratoires
Depuis les années 1960, la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Benelux subissent des vagues migratoires : de travail pour faire baisser les salaires, familiales pour des raisons « humanitaires ».
Au cours de la dernière décennie, ces migrations se sont amplifiées :
- – tous les pays de l’Europe à quinze sont désormais concernés : les pays scandinaves et l’Irlande, au nord ; l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce, au sud ;
- – les mouvements d’entrées se sont accrus : 500 000 étrangers ont été régularisés en Espagne en 2005 ; de 500 000 à 800 000 en Italie depuis 2008 ; en Grande-Bretagne le solde migratoire de 1997 à 2009 s’est élevé à 2,2 millions de personnes, selon le premier ministre David Cameron ; en France, c’est plus de 1,5 million de personnes qui sont entrées de 2002 à 2010.
Dans le même temps les politiques suivies à l’égard des populations immigrées ne donnent pas les résultats attendus : qu’il s’agisse du multiculturalisme assumé de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, ou de l’assimilation/intégration à la française, l’échec est au rendez-vous. Et il est constaté par les principaux acteurs qui ont conduit ces politiques.
Angela Merkel a déclaré à Potsdam le 16 octobre 2010 devant les jeunes militants de la CDU et de la CSU : « L’instauration d’une société multiculturelle, où chacun prendrait plaisir à vivre côte à côte, a fait faillite. » « Nous nous sentons liés aux valeurs chrétiennes. Celui qui n’accepte pas cela n’a pas sa place ici », ajoutait-elle. La veille, le dirigeant des conservateurs bavarois, Horst Seehofer, avait lancé : « Le Multikulti est mort »
Le premier ministre belge Yves Leterme a suivi ses collègues allemands en affirmant sur RTL Belgique : « Mme Merkel a raison, en ce sens que les politiques d'intégration n'ont pas toujours eu les effets bénéfiques qu'on attendait d'elles. »
Le 5 février 2011, David Cameron, s'exprimant devant la 47e Conférence sur la sécurité, a dénoncé le multiculturalisme tel que l'a pratiqué le Royaume-Uni : « Le multiculturalisme a conduit à ce que des communautés vivent isolées les unes des autres. Ces sociétés parallèles ne se développent pas selon nos valeurs. Nous ne leur avons pas donné une vision de ce qu'est notre société. »
Vendredi 15 avril 2011, c’est au tour du ministre de l’Intérieur français Claude Guéant d’affirmer : « L’intégration est en panne » – une opinion partagée par 76% des Français qui, selon un sondage Harris interactive du 20 avril 2011, estiment que « les étrangers ne font pas suffisamment d’efforts pour s’intégrer ».
Certes, l’analyse n’est pas nouvelle : les plus lucides l’avaient déjà fait depuis… trente ans. Ce qui est nouveau, c’est que le constat émane des hommes au pouvoir, de ceux qui servent la superclasse mondiale (SCM) et dont les politiques ont consisté à promouvoir la mondialisation.
Dans la revue Le Débat de mars–avril 2011, l’essayiste André Grejbine commente ainsi la montée, à ses yeux parallèle, de l’islamisme et du populisme en Europe : « Derrière les beaux discours sur le dialogue des civilisations et la diversité des cultures, c’est un engrenage de ressentiment et de rejet réciproque qui se développe. » C’est reconnaître le choc des cultures.
Minorités visibles, minorités qui se rendent visibles
Les Américains ont créé dans les années 1960 la notion de minorités visibles pour qualifier des populations qui, même lorsqu’elles sont intégrées, apparaissent visiblement différentes : c’est le cas des Afro-Américains aux Etats-Unis ou, en France, des Antillais.
Mais en Europe, on a assisté à un phénomène différent, celui de minorités se rendant visibles, c'est-à-dire de Turcs et de Maghrébins, hommes pourtant de race blanche mais choisissant d’accentuer leurs différences par rapport aux populations d’accueil par leurs comportements et leurs exigences, tels que le voile islamique, les interdits alimentaires, les revendications religieuses ou simplement culturelles.
Choc culturel
Le choc culturel prend des formes multiples tant en raison des différences d’origine des cultures et des civilisations que des différences d’évolution historique et sociologique des sociétés.
Orient versus Occident
La fracture entre l’Orient et l’Occident est aussi profonde qu’ancienne : elle remonte aux guerres Médiques et aux guerres Puniques. Elle oppose la personne aux masses, les libertés individuelles à la soumission collective. Cette opposition se retrouve dans l’Empire romain avec la victoire de l’Occident à Actium puis la division du IIIe siècle entre Empire d’Orient et Empire d’Occident.
Islam versus Europe
L’opposition entre l’Islam et l’Europe est une structuration géopolitique majeure de l’espace euro-méditerranéen. Elle s’étend sur douze siècles : de la bataille de Covadonga (722) à la libération de la Grèce (1822/1832). Mais plus encore qu’un choc militaire, c’est un choc de mentalités : l’Islam, c’est la « soumission », l’Europe, c’est l’exercice du libre-arbitre et de la liberté. La théorie des trois « religions monothéistes » dont les sources seraient identiques fait l’impasse sur l’hellénisation et l’européanisation du christianisme.
Les différences entre l’Islam et l’Europe sont nombreuses et majeures :
- - dans la relation avec le divin ;
- - dans la séparation, d’un côté, la soumission, de l’autre, entre le domaine de Dieu et celui de César ;
- - dans la représentation de la figure divine et de la figure humaine ;
- - dans la conception et la représentation de la femme ;
- - dans le lien avec la nature ;
- - dans l’existence ou non d’une multitude d’interdits ;
- - dans les pratiques et les rituels alimentaires ;
- - dans les configurations architecturales.
Société intolérante versus société tolérante
L’Europe – et singulièrement l’Europe moderne – s’est construite autour de la liberté d’expression. L’Islam n’admet ni l’étude critique de l’histoire du prophète, ni la représentation de Mahomet (sauf chez les Persans). L’Islam exige l’application de lois sur le blasphème, ce qui heurte profondément la sensibilité européenne, comme l’a montré l’affaire des caricatures danoises de Mahomet.
Plus gravement, il est difficile de faire cohabiter sur le même sol une culture de la tolérance et une culture de l’intolérance :
- - Que certaines femmes puissent porter le voile islamique, pourquoi pas ? Mais quand dans un quartier une majorité de femmes porte le voile islamique, il est très difficile pour les autres de ne pas en faire autant, sauf à accepter de passer pour des proies ;
- - Que des musulmans veuillent faire ramadan, c’est leur choix ; que ceux qui veulent s’en abstenir y soient contraints, c’est insupportable ;
- - Que des musulmans veuillent manger halal, pourquoi pas ? Mais que de plus en plus de non-musulmans soient contraints d’en faire autant, ce n’est pas acceptable ;
- - Qu’il y ait des mariages mixtes (au regard de la religion ou de la culture), pourquoi pas ? Mais comment trouver normal que la conversion s’opère systématiquement dans le même sens, c'est-à-dire vers l’Islam ?
En fait, les relations entre une culture tolérante et une culture intolérante sont dissymétriques : car la culture intolérante finit par imposer ses règles à la culture tolérante. C’est la négation de la règle de réciprocité.
Il est d’ailleurs significatif de voir les nations européennes et chrétiennes poussées à abandonner leurs repères symboliques : crèches de Noël, œufs de Pâques, fêtes du cochon.
Afrique versus Europe : société individualiste/rationaliste versus société instinctive et tribale
Une partie des Africains noirs sont musulmans. Mais, indépendamment de leur religion – musulmane, catholique ou pentecôtiste – les Africains noirs ont généralement un rapport au monde différent de celui du rapport européen. Le collectif y pèse plus que l’individuel. Le froid rationalisme y joue un rôle moins important. Il ne s’agit pas ici de dire où est le bien, où est le mal, mais de souligner des différences de comportement qui pèsent dans la vie collective, la capacité de développement économique et la vitalité démographique.
D’autres distinctions méritent d’être abordées : indépendamment de leurs constructions mythologiques et de leur histoire, les sociétés musulmanes et africaines d’un côté, européennes de l’autre sont à des stades différents de leur évolution.
Société traditionnelle versus modernité
Depuis le XVIIIe siècle, l’Europe est entrée dans une modernité individualiste. Pour le meilleur et pour le pire. Les sociétés africaines et musulmanes – même si elles sont touchées par la modernité, surtout lorsqu’elles sont transposées en Occident – sont restées davantage holistes et traditionnelles : le salut collectif, l’attachement à la lignée, le respect des valeurs ancestrales, le maintien de codes d’honneur y jouent encore un rôle important. Or ce qui peut paraître « archaïque » à l’Européen moderniste peut être un avantage évolutif dans la compétition entre sociétés ; c’est incontestablement le cas en termes d’expansion démographique.
Droit du sol versus droit du sang
Dans leur logique « d’intégration » des immigrés, les pays européens ont tous adopté le droit du sol ou le double droit du sol. Né en Europe, l’enfant d’immigrés a donc juridiquement vocation à acquérir la nationalité du pays de son lieu de naissance. Mais cela ne l’empêche pas, lui et ses descendants, de garder la nationalité de ses pères. En terre d’Islam, nationalité et religion sont liées : acquérir la nationalité du pays d’accueil ne dispense pas de conserver la nationalité du pays d’origine, qui est irrévocable, tout comme l’apostasie est impossible. D’où l’explosion dans tous les pays européens de doubles nationaux pratiquant la double allégeance (dans le meilleur des cas !)
Société individualiste versus société communautaire
En premier lieu, l’Occidental individualiste a placé au sommet de ses valeurs : « le droit de l’enfant ». C’est au nom du droit de l’enfant (et de son intérêt supposé) que les jurisprudences européennes – et singulièrement les jurisprudences françaises – ont imposé le regroupement familial dans le pays d’accueil et non dans le pays d’origine. En France, en 1978, c’est le Conseil d’Etat, par l’arrêt GISTI, qui décide que « Les étrangers qui résident régulièrement en France ont le droit de mener une vie familiale normale, et en particulier celui de faire venir leur conjoint et leur enfant mineur. » C’est ainsi une interprétation individualiste de textes généraux qui prévaut.
En second lieu, c’est la même logique qui prévaut pour le mariage. Au nom du « mariage d’amour » entre deux individus, on autorise le déplacement de blocs de population. Deux grandes catégories de cas sont ici à distinguer :
- - l’étranger qui cherche à venir en France ou bien le clandestin déjà présent sur le territoire qui veut obtenir une régularisation peuvent recourir à la voie du mariage : mariage arrangé, mariage gris ou simple escroquerie sentimentale ; les bénéficiaires en sont souvent des hommes jeunes ;
- - l’immigré de deuxième génération, français au regard de la nationalité plus qu’au regard de la culture, qui veut se marier au « bled », c'est-à-dire dans le pays d’origine de sa famille ; il s’agit généralement de jeunes hommes qui se marient avec des filles du pays réputées plus respectueuses des mœurs traditionnelles ; cela concerne aussi des jeunes filles pas toujours mariées selon leur gré.
Ce comportement qui peut s’analyser comme un refus de l’intégration est un puissant facteur d’accélération de l’immigration. C’est là que se niche la cause majeure de l’immigration de peuplement subie par l’Europe : « l’immigration nuptiale ».
Société à famille nucléaire versus société à famille élargie
Les mentalités et le droit français s’inscrivent dans une vision nucléaire de la famille. Or les pays du sud de la Méditerranée ont une vision élargie de la famille. Il est encore normal de vivre avec sa belle-famille, d’où le regroupement familial des ascendants. Quant aux descendants, la vision est large : la jurisprudence française reconnaît la pratique de la Kafala (quasi-adoption) au moins pour les Algériens. Les Africains ont une conception souple de la parenté qui n’est pas uniquement biologique. D’où l’élargissement du regroupement familial aux bâtards et aux neveux (ce qu’aurait empêché le contrôle génétique) – regroupement familial d’autant plus facilement élargi que la qualité des états civils africains reste imparfaite… pendant que le système social français est généreux et donc incitatif à l’arrivée de nouveaux bénéficiaires.
Choix communautaires et cascades d’immigration…
L’immigration familiale a représenté 82 762 entrées régulières en 2009. Les dix premiers pays concernés étant l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Chine, le Congo (RDC).
La dynamique migratoire la plus commune est la suivante : un immigré de deuxième génération se marie avec quelqu’un de même origine que lui – un phénomène en voie d’accélération rapide : il y a eu 23 546 transcriptions d’actes de mariage établis par les postes français à l’étranger en 1995, 48 301, soit plus du double, en 2009. Le nouveau, plus souvent la nouvelle mariée rejoint ensuite la France, ce qui peut lui permettre d’acquérir la nationalité française et de faire venir des membres de sa famille.
Par ailleurs, ces arrivées concernent des jeunes femmes en âge d’être fécondes et dont le taux de fécondité en France est supérieur à celui des femmes nées en France, bien sûr, mais aussi à celui des femmes étrangères restées à l’étranger. Il y a donc un effet multiplicateur des populations immigrées. En 2009, d’après les chiffres du Haut Conseil à l’intégration, 7,0% des naissances provenaient de deux parents étrangers, 13,1% d’un parent français et d’un parent étranger : une « nuptialité mixte » au regard de la nationalité mais rarement mixte au regard de l’origine et de la culture. A ces naissances il faudrait ajouter les naissances d’enfants d’immigrés de la deuxième génération pour pleinement mesurer ce qui est en train de se passer en termes de substitution, au moins partielle, de population.
Quelles solutions ?
Nous sommes en face d’un choc démographique doublé d’un choc de civilisations. Un choc de civilisations qui se passe à l’intérieur des frontières des Etats. Les solutions ne sont pas techniques. Elles sont tributaires des valeurs dominantes. Plus précisément, les solutions supposent un changement radical des dogmes dominants tels qu’ils sont imposés par la superclasse mondiale à travers les médias.
Préférence de civilisation versus Big Other
L’écrivain Jean Raspail a remarquablement résumé l’idéologie dominante de l’Europe : Big Other, ce qui revient à placer l’autre – sa religion, ses mœurs, ses pratiques – au-dessus de tout. Là est la source de la formidable asymétrie dont les peuples européens souffrent. Changer, c’est revenir à la préférence de civilisation ; à la préférence pour sa civilisation ; soit parce que nous la trouvons meilleure dans l’absolu, soit tout simplement, dans une perspective plus relativiste, parce qu’elle est la nôtre. Il ne s’agit pas de haïr l’autre mais d’en finir avec la haine de soi. Il s’agit de cesser d’opposer une société innocente (celle des immigrés) à des nations européennes coupables.
Droit à la défense des libertés individuelles
Nous vivons une époque où ce n’est pas la majorité qui opprime les minorités mais des minorités communautaristes qui prétendent imposer leurs lois à la majorité. Les libertés individuelles sont au cœur de la civilisation européenne : liberté d’expression, liberté de recherche, liberté de débat, liberté de circulation, liberté de consommer, liberté de s’habiller, liberté d’ignorer le licite et l’illicite des autres, liberté de boire de l’alcool et de manger du cochon, y compris dans les transports et les cantines. Lorsque des libertés sont menacées, elles doivent être défendues. Rappelons-nous la phrase de Royer-Collard : « Les libertés ne sont pas autre chose que des résistances. »
Droit à la défense des libertés collectives
Mais ces libertés individuelles sont inséparables des libertés collectives. Sans défense des libertés collectives aujourd’hui, sans défense du modèle de civilisation européenne, il n’y aura pas de libertés individuelles demain. Les nations européennes doivent donc réaffirmer – y compris dans leur Constitution comme viennent de le faire les Hongrois – leur droit à l’identité, leur droit à des frontières, leur droit à rester eux-mêmes.
Droit à l’identité des peuples versus droit des individus à immigrer
Allons plus loin : face au choc démographique et au choc migratoire, il faut mettre en œuvre le principe de précaution, et bloquer toute immigration en provenance de pays dont beaucoup de ressortissants – même de nationalité française – sont peu ou pas assimilés. Ici le droit collectif à l’identité des peuples doit l’emporter sur le droit des individus à immigrer.
Le populisme contre le putsch des médias et des juges
En matière d’immigration (et de politique familiale), le pouvoir n’appartient plus aux hommes politiques. Il appartient aux médias et aux juges : au tribunal médiatique qui fixe les limites du licite et de l’illicite dans les discours ; aux cours internationales et aux cours suprêmes qui interprètent les principes fondamentaux des droits de l’homme à leur manière : pour le droit des étrangers contre le droit des peuples ; pour le politiquement correct contre les libertés individuelles. Mais partout en Europe de puissants courants populistes s’expriment. Ils demandent un retour aux frontières car ils savent que le sort de la civilisation européenne ne se joue pas à Benghazi mais à Lampedusa.
Jean-Yves Le Gallou
Polémia
28/04/2011
Texte en PDF cliquer ici
Voir aussi les articles Polémia :
Une lecture très protectrice des droits des étrangers par les juridictions françaises restreignant les possibilités de réaction du gouvernement face à la pression migratoire accrue à laquelle est confronté notre pays
« Eloge des frontières », de Régis Debray
L'immigration par escroquerie sentimentale
L'immigration noire africaine : un phénomène qui s'amplifie
L'Implosion démographique européenne face à l'explosion démographique africaine : l'Afrique déborde-t-elle sur l'Europe ?
et
Image : démographie en Afrique
Jean-Yves Le Gallou
00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, europe, affaires africaines, affaires européennes, choc des civilisations, politique internationale, actualité, démographie, immigration, islam, tolérance, intolérance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 mai 2011
Kroatien: Proteste gegen die Verurteilung Ante Gotovinas
Kroatien: Proteste gegen die Verurteilung Ante Gotovinas
 ZAGREB. Das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag gegen den kroatischen Ex-General Ante Gotovina hat in seiner Heimat für Empörung gesorgt. Tausende Kroaten protestierten am Wochenende auf dem Großen Platz in der kroatischen Hauptstadt. Gotovina gilt in seiner Heimat als Kriegsheld, der Kroatien von der serbischen Aggression seit 1991 zu befreien half. Da seine Festnahme Bedingung für die Beitrittsverhandlungen Kroatiens mit der EU war, richtet sich die Stimmung der Demonstranten vor allem gegen die EU.
ZAGREB. Das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag gegen den kroatischen Ex-General Ante Gotovina hat in seiner Heimat für Empörung gesorgt. Tausende Kroaten protestierten am Wochenende auf dem Großen Platz in der kroatischen Hauptstadt. Gotovina gilt in seiner Heimat als Kriegsheld, der Kroatien von der serbischen Aggression seit 1991 zu befreien half. Da seine Festnahme Bedingung für die Beitrittsverhandlungen Kroatiens mit der EU war, richtet sich die Stimmung der Demonstranten vor allem gegen die EU.Auch die kroatische Führung zeigte sich schockiert. Premierministerin Jadranka Kosor (HDZ) erklärte, das Urteil sei für die Regierung nicht hinnehmbar. Man werde alle rechtstaatlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um eine Revision des Urteils zu erreichen. Kroatiens sozialdemokratischer Staatspräsident, der Rechtsprofessor Ivo Josipović, wies vor allem die These der kriminellen Vereinigung zurück.
24 Jahre Haft für den kroatischen Volkshelden
Gotovina stand zusammen mit den Generalen Mladen Markač und Ivan Čermak vor dem UN-Tribunal. Während er und Markač zu 24 Jahren beziehungsweise 18 Jahren Haft verurteilt wurden, erhielt Čermak einen Freispruch. Die Richter warfen Gotovina vor, er habe sich beim Vorgehen gegen die serbische Bevölkerung im Jahr 1995 Kriegsverbrechen schuldig gemacht und sei verantwortlich für den Tod von 324 Zivilisten beziehungsweise gefangenen serbischen Soldaten. Zudem wurden ihm Plünderungen, Mißhandlungen sowie die Verfolgung und Vertreibung von 200.000 Serben aus der Region angelastet.
Anfang August 1995 war Gotovina in der Militäroperation Oluja (Sturm) die Rückeroberung der noch serbisch besetzten Gebiete Kroatiens mit Ausnahme Ostslawoniens gelungen. Damit endete die Existenz der sogenannten „Republik Serbische Krajina“, die 1991 von serbischen Separatisten errichtet wurde und in den folgenden Jahren immer wieder den Ausgangspunkt für Raketenangriffe auf kroatische Städte wie Zagreb, Sisak oder Karlovac bildete.
Akt der Ungerechtigkeit gegen das kroatische Volk
Die Operation Oluja hatte jedoch noch eine wichtige Bedeutung, die über die Wiederherstellung der territorialen Integrität Kroatiens hinausging: Unter Ausnutzung des Angriffsschwunges wurde die von serbischen Truppen umstellte, kurz vor dem Fall stehende bosnisch-muslimische Enklave Bihać befreit und damit nur wenige Wochen nach dem Massaker von Srebrenica eine erneute Tragödie verhindert.
Der Vorsitzende des Kroatischen Weltkongresses in Deutschland (KWKD), Mijo Marić, kritisierte das Gerichtsurteil als einen „Akt der Ungerechtigkeit gegen das gesamte kroatische Volk“. Mit dem Urteil werde der entscheidenden Säule der kroatischen Eigenstaatlichkeit die Legitimität entzogen. Die Deklarierung der Operation Oluja als Kriegsverbrechen, die Bewertung der Verteidigung des eigenen Landes als verbrecherische Aktion dürfe nicht hingenommen werden, so Marić.
Für Mittwoch sind Protestveranstaltungen kroatischer Organisationen in Berlin und New York angekündigt.
00:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : croatie, ex-yougoslavie, europe, europe centrale, mitteleuropa, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Clio et les dessous de la justice internationale

Clio et les dessous de la justice internationale
par Jure G. VUJIC
Jure Vujic, contributeur de Polémia et auteur de nombreux articles dans des revues philosophiques et de politique internationale telles que Krisis, nous propose, à l'occasion de la récente condamnation du général croate Ante Gotovina, une tribune sur les mécanismes du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et ses véritables motivations à l'égard des intérêts géostratégiques anglo-américains.
Polémia
La condamnation par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ( TPY) à 24 ans de prison de l'ancien général croate Ante Gotovina pour «crimes de guerre» lors de l'offensive en 1995 dans l'enclave serbe de la Krajina, confirme une fois de plus que la justice internationale n'existe pas et qu'elle n'a jamais existé. Comme l'affirmait Hobbes: «Auctoritas non veritas facit legem» (C’est l’autorité et non la vérité qui fait la loi/la norme). Nous pourrions, au seuil de ce XXIe siècle, qui s’annonce comme un siècle de catastrophes, tout comme le XXe, étendre cette réflexion de Hobbes et dire : «Auctoritas non lex facit imperium», soit «C’est l’autorité et non la loi/la norme qui fait l’empire». En effet la justice internationale et le TPY de surcroit constituent les instruments de légitimisation de l'autorité globale anglo-américaine dans le monde ce qui explique bien que la loi et la justice sont absentes des considérations purement politiques de juges hollandais ou scandinaves qui ne savent même pas situer sur une carte géographique les pays des bélligerants qu' ils entendent pacifier ou purifier de prétendus crimes barbares. Dans le cas de la guerre ex-yougoslave et plus particulièrement dans le cas croate, il s'agit non seulement d'un déni de justice flagrant ( le TPY a volontairement dénié de juger l'agression de la Croatie en 1991 par l'armée yougoslave grande-serbe ainsi que les crimes contre l'humanité commis á Vukovar), mais aussi d'une parodie de justice qui enterrine bien les intérêts géopolitiques anglo-amércains dans la région du sud-est européen.
Le Tribunal de La Haye, porte-parole des intérêts géostratégiques anglo-américains
En effet, le Tribunal de La Haye s'est fait le porte parole de ces mêmes intérêts lorsque «il a, contre et envers toutes les dispositions en vigueur du droit international classique, motivé sa condamnation du général Gotovina par une incrimination montée ad hoc et de toute pièce » á savoir : avoir contribué á une entreprise criminelle dont le but était de nettoyer la Krajina de sa population serbe. En outrepassant ses compétences juridiques, le TPY s'est constitué ainsi en véritable tribunal de l'Inquisition et démonisant l'ensemble de l'élite politique, étatique et militaire croate de l'époque du premier président croate Franjo Tudjman en 1991. En un mot, le TPY s'arroge unilatéralement le droit de criminaliser la Croatie, un Etat souverain reconnue internationalement. Ne prenant pas en compte qu'il s'agissait en l'occurence et indiscutablement d'une guerre internationale classique et que la Croatie en 1991 a tout bonnement été agressée par l'armée yougoslave communiste et ses auxiliaires paramilitaires grands-serbes, le Tribunal a décidé de mettre sur un même pied d'égalité les parties bélligerantes : Serbes, Croates et Bosniaques. Le procédé est rôdé et classique, car il permet de diviser pour régner, faire table rase da la volonté des peuples et de la souveraineté étatique qu'elle soit croate, serbe ou bosniaque afin de consolider les intérêts géopolitiques anglo-américains dans ce que Buxelles appelle «les Balkans occidentaux».
En Croatie la guerre avec la Serbie d'il y a plus de dix ans laisse encore des cicatrices et l'opinion publique désapprouve á l'unanimité la condamnation d'Ante Gotovina, considéré comme un héros de guerre. Les 24 ans de prison pour Ante Gotovina ont suscité une levée de boucliers et des manifestations dans la capitale croate, Zagreb, où des milliers de personnes sont rassemblées, ainsi que dans beaucoup de villes de Croatie. Beaucoup de Croates espéraient, en effet, un acquittement du général Gotovina - ou une condamnation à une peine légère qui aurait permis sa remise en liberté. Le fossée se creuse entre une opinion publique de plus en plus eurosceptique et les élites politiques croates qui s'acharnent de rejoindre le plus vite possible l'UE et sans égard aux aspirations souverainistes de son peuple. En effet cette condamnation est vécu par le peuple comme un véritable coup de poignard dans le dos, et comme une trahison de la politique croate aux ordres de Londres et de Bruxelles. Le cas croate illustre très bien l'histoire des victoires militaires trahis par les politiciens, ou mieux encore la criminalisation des guerres justes de libération nationale. Le verdict injuste et inéquitable du TPY démontre une fois de plus que l’ordre international actuel sert les intérêts des «Plus forts» et en particulier les intérêts géostratégiques anglo-américains dans le monde. Loin d'en finir avec l’anarchie des traités de Westphalie (1648) qui reconnaissaient aux États souverains le droit de se faire la guerre, tout en l'«humanisant», la justice internationalle, en passant par la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies qui soit disant mettaient la la guerre hors la loi, reste aujourd'hui un moyen privilégié pour les États ploutocrates et les oligarchies financières apatrides de dominer le monde et un moyen insidieux d’arriver à leurs fins, au mieux, a une justification a posteriori de leurs actes d'agression et d'occupation.
Les aberrations juridiques
Au palmarés des aberrations juridiques de la justice internationale, il faut rappeler que le droit international ne reconnaît traditionnellement que les États comme sujets, et que pourtant il a justifié l’arrestation, la condamnation et l’exécution de Saddam Hussein et, avant lui, de tous ceux qui ont été jugés et condamnés par les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Ainsi La guerre, crime contre la paix, est ainsi alignée sur le même plan que le crime contre l’humanité. Dans le cas croate, on renvoie dos á dos l'agresseur et l'agressé, la guerre défensive légitime et la guerre d'agression illégale, tout en inculpant les bélligerants d'organisation criminelle, comme si les Etats souverains constituaient des mafias du crime organisé. D'autre part il convient de rappeler une autre aberration juridique constitutive et fondatrice, c'est celle de la primauté du droit anglo-saxon dans la justice internationale, qui est inapplicable et non conforme á la tradition juridique continentale européenne et qui fait une confusion manifeste entre la souveraineté des États, reconnue et la subjectivité internationale attribuée aux individus, entre l’universalisme et le particularisme, deux notions juridiques antagoniques mais réunies ici au sein du même système anglo-saxon.
Cela explique le fait que l’agression ne soit pas jugée selon la même norme que les autres crimes. Le tribunal ad hoc, financé par les États-Unis, a refusé de mettre en cause les agissements de l'armee yougoslave populaire à Vukovar en 1991 et l'appui logistique et politique de Belgrade á la guerre d'agression contre la Serbie. D'autre par le TPY a refusé de prendre en compte les agissements out of area et illégaux de l’O.T.A.N., comme s’il y avait une hiérarchie entre les victimes dues aux violations des droits de l’homme et les victimes dues à la guerre d’agression. Pour éviter la menace que constitue la possibilité de tels jugements, les États-Unis n’ont toujours pas ratifié les statuts de la Cour pénale internationale, en exercice depuis 2003. La guerre humanitaire, qui résulte du droit d'ingérence, concept juridique et hybride flou créé ad hoc en dehors du droit international classique, en contradiction avec le principe même de notre droit international, a permis les pires bavures de ce droit international. Parce que les droits de l’homme sont placés au-dessus de la paix, leur violation peut légitimer une guerre d’agression, y compris sans l’autorisation des institutions internationales, comme nous l’avons vu au Kosovo en 1999, et aujourd'hui en Lybie. Force est de constater que le plan moral, éthique est distingué ici du plan juridique. Le travail du TPY dans l'épisode ex-yougoslave s'inscrit tout droit dans le cadre d'un conflit néo-colonialiste opposant l’Occident anglo-américain aux pays qui résistent à son ambition d’hégémonie planétaire. Les peuples européens aujourd'hui déshonorés et humiliés tout comme le sont les peuples croates, serbes et bosniaques vivent dans cet état de menace permanente, qui rend possible une «industrie de la mort collective», illustrée par des condamnations judiciaires infâmantes et des bombardements lâches et ignobles de population civiles. Cette réalité conflictuelle permet de réintroduire un antagonisme ami/ennemi inspiré de Carl Schmitt, dans un monde officiellement gouverné par une visée pacifiste universelle, dont Clio, la muse de l'histoire universelle, se moque et n'a que faire.
Jure Georges Vujic
19/04/2011
L'auteur : Jure Vuji, est avocat, diplomé de droit à la Faculté de droit d'Assas Paris II. Géopoliticien et écrivain franco-croate, il est diplomé de la Haute Ecole de Guerre Ban Josip Jela_i_ des Forces Armées Croates et de l'Académie diplomatique croate où il donne des conférences regulières en géopolitique et géostratégie.
Les intertitres sont de la rédaction
Voir les articles de Polémia :
« Bloody Sunday »ou le modèle global de la contre-insurrection
Krisis, « La Guerre ? »
L'Occident : une Yougoslavie planétaire
Correspondance Polémia 19/04/2011
00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, mitteleuropa, europe centrale, croatie, ex-yougoslavie, tribunal international, ante gotovina |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 avril 2011
Nationalistes autonomes d'Ukraine de l'Ouest
Entretien avec les nationalistes autonomes d’Ukraine de l’Ouest du site opir.info
Article original mis en ligne le 11 février 2011 : http://opir.info/category/publikacii/ideolohia/ et publié initialement le site molotoff.info
 En préambule
En préambule
Ukraine, un rapide état des lieux
par Pascal Lassalle
La situation singulière de ce grand pays, pivot géopolitique dont l’histoire, plus que celle d’un état, est celle « d’une identité enracinée sur un territoire » (Iaroslav Lebedynsky in Ukraine, une histoire en questions, L’Harmattan, 2008), n’est pas toujours intelligible pour le public francophone qui perçoit trop souvent cette question au travers du prisme érigé et diffusé par le « grand-frère » russe. L’Ukraine est presque un cas d’école et possède le triste privilège de cumuler plusieurs problématiques et paramètres qui retardent l’émergence d’une conscience identitaire et nationale unifiée :
-Les Ukrainiens s’inscrivent dans ces patries charnelles « sans état » (comme l’Irlande, la Croatie, la Slovaquie ou la Lettonie), ou plutôt dont la construction étatique fut trop brève et maintes fois contrariée au cours d’une histoire tourmentée. Ce peuple fut donc partagé entre plusieurs entités politiques voisines parmi lesquelles on peut surtout citer la Pologne et la Moscovie/Russie/URSS. Ce qui fait qu’aux yeux des élites Françaises ayant vécu plusieurs siècles d’une réalité stato-nationale centralisatrice, les peuples « sans états » ne possèdent souvent pas à leurs yeux d’histoire propre et légitime, sans parler dans ce cas précis des effets d’un tropisme traditionnel vers la « Sainte Russie » ou la défunte URSS d’un parti communiste trop présent, singulière « passion française » (Marc Lazar)
-Une « Trahison » des couches aristocratiques, largement acculturées aux modèles politiques et culturo-religieux dominants du moment (catholicisme et uniatisme polonais, orthodoxie moscovite, agrémentés d’une polonisation ou d’une russification culturelles et linguistiques). Une conscience identitaire proto-nationale s’est maintenue au sein du monde paysan avec toutes les limites et carences que cela implique, conscience ayant ressurgi au cours de la vague romantique du XIXème siècle.
-Soviétisation en profondeur, variable selon les régions (plus grandes résistances en Galicie, où ce modèle politico-économique fut toujours considéré comme une greffe étrangère, n’ayant été subie que pendant 45 années). Permanence d’un mental renvoyant à l’homo sovieticus dépeint par Alexandre Zinoviev, avec son cortège de nostalgies idéalisées et déréalisantes, de cynisme, d’anomie sociale et politique, de corruption généralisée, de pesanteurs et d’inerties.
-Russification en profondeur d’une bonne partie du pays, accélérée dès la deuxième moitié du XIXème siècle (Alexandre II et surtout Alexandre III, suivis par Nicolas II), prolongée à l’ère soviétique sous Staline, puis Brejnev, facilitée par une certaine proximité culturelle et religieuse, mais surtout par une répression parfois féroce de toute forme d’ ukrainité et par des transferts de populations russes importants surtout dans l’est et le sud du pays (antérieurs et postérieurs à la saignée démographique provoquée par le Holodomor, la famine-génocide de 1932-1933). Le plus grave réside dans l’aliénation psychologique et culturelle de plusieurs générations d’Ukrainiens qui ont profondément et durablement intériorisés les stéréotypes infériorisants du colonisateur russo-soviétique (l’infraculture provinciale et la langue ukrainiennes comme manifestation d’un monde de « ploucs » paysans qui doivent se « civiliser » au contact d’une culture supérieure, celle du « grand-frère » du nord).
-Permanence de crispations de la part du voisin russe qui persiste plus que jamais à nier la réalité d’une spécificité ukrainienne et mène inlassablement toutes formes de pressions et d’actions d’ordre politique, économique ou culturel allant dans ce sens (une « guerre virtuelle » menée contre l’Ukraine selon les nationalistes ukrainiens du parti Svoboda). L’Ukraine est considérée comme une « Petite-Russie », perçue comme une variante locale et « polonisée » de l’identité russe. La sempiternelle question ukrainienne (« les Ukrainiens ont toujours aspiré à êtres libres » disait Voltaire) renvoie les Russes à la lancinante et très actuelle question existentielle de leur propre identité, par ailleurs fort problématique, comme le montrent de multiséculaires et persistants débats, sans parler des moments historiques mythifiés véhiculés par un « impérialisme historiographique » très en vogue du côté du Kremlin (« Russie de Kiev », « Grande Guerre Patriotique », etc.).
-Absence d’une société civile au sens positif du terme, d’un certain sens de la communauté (trop souvent assimilée au collectivisme soviétique, largement discrédité surtout à l’ouest et au centre du pays), atavisme individualiste et arnarchique typiquement « cosaque » (se rappeler Nestor Makhno), passivité relative d’une bonne partie de la population qui facilite la confiscation du pouvoir par des oligarchies prédatrices post-communistes, Nombreux partis politiques qui ne représentent généralement que la coalition d’intérêts privés déclinée sur un mode clanique et népotiste, ce qui contribue à maintenir un état virtuel et privatisé, actuellement en proie à la gouvernance néo-soviétique de Viktor Ianoukovytch, l’homme lige des plus puissants oligarques de l’est du pays. Le politicien de Donetsk ambitionne de mettre en place une « stabilité » politique qui tente de plagier la « verticale du pouvoir » poutinienne afin de le maintenir durablement à son poste. Russifié et soviétisé, plus que véritablement « pro-russe », il tente de louvoyer entre une Union Européenne attentiste et une Russie plus que jamais déterminée à accélérer une intégration accrue de l’Ukraine dans son orbite. Ianoukovytch et ses puissants soutiens/commanditaires, ne sont cependant pas disposés à laisser les grands frères russes leur ravir une trop grande part du « gâteau » ukrainien.
-Occidentalisation accélérée de la société et de sa jeunesse au moyen de la séduction exercée par les modes, moeurs et habitudes de consommation occidentales qui viennent aggraver les fractures déjà existantes avec des écarts de richesse hallucinants. Menées géopolitiques américaines (« stratégie de l’anaconda ») visant à instrumentaliser les fractures existantes et intégrer l’Ukraine dans l’OTAN comme pion et levier d’une politique anti-russe, politique facilitée par les crispations contre-productives précitées de la part de la Russie qui contribuent à jeter nombre d’Ukrainiens sincèrement attachés à leur identité et à leur indépendance dans les bras des Américains. Absence cruelle d’une Europe-puissance souveraine et enracinée dans sa tradition la plus immémoriale capable d’intégrer une Ukraine, berceau de l’indo-européanité (selon la théories des Kourganes) qui s’est toujours révélée connectée aux grands moments de la civilisation européenne (à la différence de son voisin russe) au cours de son histoire tourmentée.
Le député nationaliste Iouriy Mikhaltchichin membre du parti nationaliste Svoboda (Liberté ) d’Oleh Tiahnybok a dressé un état des lieux assez pertinent des fractures identitaires internes de son pays dans un entretien donné au journal Glavkom (27 janvier 2011 : www.regnum.ru/news/polit/1368975.html)
Il affirme ainsi que « le véritable conflit en Ukraine concerne le droit à l’existence d’un des trois projets nationaux existants : une nation ukrainienne contemporaine, une nation petite-russienne et une nation néo-soviétique (dont les représentants sont communément qualifiés de « sovki » ).
La nation ukrainienne contemporaine est cette composante de la vieille base ethnique ukrainienne qui se considère consciemment ukrainienne, admet un schéma continu et ininterrompu d’étaticité ukrainienne , de la Rou’s kyivienne jusqu’à l’Ukraine de 1991 et désire un développement de l’état ukrainien dans ses frontières ethniques.
Le groupe « petit-russien » représente la partie la plus politiquement amorphe des Ukrainiens ethniques qui a été l’objet d’une forte dénationalisation, résultant notamment de la répression de masse, de la collectivisation et des conséquences de la Seconde Guerre Mondiale pour l’Ukraine centrale et septentrionale. Les membres de ce groupe reconnaissent leurs liens de sang avec les Ukrainiens qui se positionnent en tant que nation ukrainienne clairement consciente, mais sont très majoritairement indifférents à son avenir. Ils constituent cette part de la société ukrainienne actuelle qui, de par sa passivité et son absence d’une vision nette du développement de l’Etat, équilibre les deux pôles opposés symbolisés sur la carte par les deux « points chauds », L’viv et Donetsk.
La troisième composante est représentée par la nation néo-soviétique, cette part de la population de l’Ukraine qui est notamment le résultat des nombreux mariages mixtes entre Ukrainiens, Russes et représentants d’autres peuples de la défunte Union soviétique. Elle est le résultat de la politique soviétique des nationalités et de ses efforts pour engendrer un peuple soviétique unique. De telles personnes considèrent la liquidation de l’Union soviétique comme une catastrophe existentielle. Et continuent à s’identifier à l’unique centre d’influence de toute l’Union, Moscou. Culturellement (russophonie notamment), spirituellement (Eglise orthodoxe ukrainienne dépendante du Patriarcat de Moscou), et économiquement, ils continuent à s’identifier, non pas nécessairement aux Russes, mais à la période historique soviétique, la considérant comme un modèle pour l’avenir. Ils sont extraordinairement hostiles à la simple idée de l’existence de l’Ukraine comme un état unitaire séparé, sur la carte géopolitique de la planète.
L’Ukraine n’est pas divisée selon une ligne géographique est-ouest, mais plus selon une séparation de caractère spirituel et ethnique.
Chacun des trois groupes comprend environ 30% de la population, ce qui fait qu’aucun d’entre n’est capable jusqu’à ce jour d’occuper une position prédominante ».
Il apparaît aujourd’hui que Moscou et Kyiv sous la présidence Ianoukovytch travaillent pour promouvoir le troisième groupe, au détriment des deux autres, représenté politiquement au sein du Parti des Régions, le Parti Communiste Ukrainien de Petro Symonenko ou le Parti Socialiste Progressiste d’Ukraine de la passionaria Nataliya Vitrenko.. On a pu le voir notamment au mois de décembre avec les perquisitions du FSB dans la bibliothèque ukrainienne de Moscou, épurée, au nom de la loi contre « l’extrémisme », de tous ses revues et ouvrages considérés comme « nationalistes » ou avec la liquidation programmée des associations culturelles ukrainiennes par la justice russe ( Union des Ukrainiens en Russie et Autonomie Culturelle Nationale Fédérale des Ukrainiens de Russie) , devant être remplacées par des structures à la « botte », avec la complicité tacite ( ?) du nouveau pouvoir « ukrainien » (www.ng.ru/politics/2011-01-28/100_ukraina.html). On ne s’étendra pas non plus sur les déclarations provocatrices répétées et les agissements du ministre de l’éducation Dmytro Tabatchnyk, ukrainophobe notoire .
Face à cela, la galaxie nationaliste et identitaire ukrainienne est fortement fragmentée, voire éclatée et divisée, même si ses diverses composantes se retrouvent régulièrement côte à côte au cours de manifestations communes.
On peut citer tout d’abord la mouvance nationaliste directement affilié à l’Organisation des Nationalistes Ukrainiens créée en 1929 , qui s’est scindée dix ans plus tard en deux groupes rivaux, pour des questions générationnelles et de stratégie : la branche d’Andriy Melnyk (OUN-M) et la branche révolutionnaire de Stepan Bandera (OUN-R ou B, « bandéristes »). Acquise dans les années trente à l’idée de natiocratie (Etat-parti autoritaire et corporatiste centré autour de l’ethnos ukrainien, nation « titulaire »), cette vénérable organisation souchée après-guerre sur la diaspora émigrée en Amérique du nord (Etats-Unis et Canada) et en Europe occidentale (principalement Royaume-Uni et Allemagne de l’Ouest), a considérablement « modéré » sa ligne idéologique pour se situer aujourd’hui sur une ligne clairement nationale-démocrate. Anticommuniste et occidentaliste, celle-ci n’implique donc pas un rejet de la démocratie parlementaire, de l’économie de marché, ni du capitalisme et se montre généralement favorable à une intégration euro-atlantique.
Les formations qui se situent aujourd’hui dans la filiation des deux OUN font en général un excellent travail de promotion et de défense des fondamentaux de l’identité ukrainienne, de son histoire et de sa mémoire nationale au travers notamment de l’ukrainophonie, des grandes figures historiques comme Evhen Konovalets, Stepan Bandera, Roman Choukhevytch ou le « Maurras » ukrainien, Dmytro Dontsov, de la question de la famine-génocide de 1932-33 (Holodomor) ou l’Armée Insurrectionnelle Ukrainienne (UPA, qui a lutté contre les Allemands, les Soviétiques et les Polonais au cours de la Seconde guerre mondiale). On peut citer notamment le Congrès des Nationalistes Ukrainiens (KUN, parti politique naguère membre de la coalition « orange » Notre Ukraine), le Congrès des Jeunes nationalistes (MNK), voire dans une certaine mesure l’organisation paramilitaire Tryzub « Stepan Bandera » (dont une quinzaine de militants ont été arrêtés et maltraités par la police en janvier dernier, accusés d’avoir détruit une statue de Staline érigée par les caciques du parti communiste local dans la région de Zaporijia).
En vogue depuis plusieurs années, le courant qui se qualifie généralement de « social-national », plus radical, se rattache aux fondements de la pensée des grands ancêtres de l’OUN, trahis selon eux par les « pseudonationalistes ».
Il est réapparu dans les années 90 avec, d’une part, la mythique UNA-UNSO (Assemblée Nationale Ukrainienne-Autodéfense Nationale Ukrainienne), qui a eu son « heure de gloire » (plusieurs militants de l’UNSO ont combattu en Transnistrie et dans le Caucase), aujourd’hui moribonde après s’être scindée en plusieurs formations du même nom, d’autre part, le SNPU (Parti Social-National Ukrainien), fondé en 1991, dominé dès la décennie 2000 par la figure charismatique d’Oleh Tiahnybok qui l’a métamorphosé en une sorte de FN ukrainien, L’Union Panukrainienne Svoboda (Liberté). Cette formation entretient des relations avec plusieurs partis européens similaires au sein de l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux (dont le Front National) et a remporté dernièrement de relatifs succès électoraux notamment en Ukraine occidentale au sein des conseils municipaux et des assemblées régionales (L’viv, Ternopil’, Ivano-Frankivsk).
Cette filiation idéologique est toujours revendiquée, notamment par un des jeunes espoirs du parti à Kyiv, Andriy Illienko, fils du cinéaste Iouriy Illienko, qui ne se prive pas d’évoquer dans ses articles et déclarations la révolution sociale-nationale :http://orientyry.com/analityka/notatky-pro-sotsial-natsionalnu-revolyutsiyu.html, en villipendant les pseudonationalistes : http://orientyry.com/lyudysotsium/natsionalizm-i-psevdonatsionalizm.html. La thématique sociale-nationale a été reprise par d’autres organisations extra-parlementaires comme le Patriote d’Ukraine (créé à Kharkiv, avec des thématiques ethno-racialistes assez prononcées…), Le Patriote d’Ukraine-Centuries galiciennes (à L’viv) ou surtout la mouvance nationaliste autonome. Chez ces derniers, anticommunisme, thématiques identitaires, historiques et mémorielles « traditionnelles »restent fortement présentes, principalement au sein des groupes d’Ukraine de l’Ouest, mais s’y ajoutent des schémas de pensée et d’actions plus familiers, sur le plan social notamment, qui dénotent une influence paneuropéenne, comme nous allons pouvoir le constater avec l’entretien qui suit.
-Dans quelles conditions les nationalistes autonomes ukrainiens sont-ils apparus en Ukraine de l’Ouest ?
Tout a commencé avec la création de la confrérie de L’viv le 15 juillet 2009, lors de la première réunion au cours de laquelle nous avons pris la décision de développer la résistance autonome dans la région de l’Ouest.
À ce moment-là, même les personnes éloignées de la politique ont compris que le pouvoir des soi-disant nationaux-démocrates (ndt : la présidence de Viktor Iouchtchenko) touchait à sa fin et qu’il allait être repris par des ukrainophobes convaincus. Il y avait un risque que l’histoire vieille de six ans se répète, c’est-à-dire l’apparition des différents acteurs « anti-régime » touchant des subsides, les mouvances libérales comme Pora, financées par l’impérialisme américain et les capitalistes locaux de l’ancien pouvoir. Ils se seraient mis à duper et instrumentaliser la jeunesse patriotique en proposant des actions dans le cadre « de la démocratie occidentale et de la tolérance ». La jeunesse aurait marché une fois de plus sur le même râteau et cela aurait abouti à la déception de milliers de patriotes. Nous n’avions pas le droit de rester à l’écart. Et nous ne sommes pas trompés. L’Ukraine avait besoin depuis longtemps de nouvelles tendances révolutionnaires dans la jeunesse. Nous éprouvions le besoin d’une alternative nouvelle, belle, créative et intéressante, une mouvance cultivant un mode de vie sain, posant la problématique nationale, écologique et sociale.
-Quels objectifs pratiques vous fixez-vous ?
Créer une communauté, c’est-à-dire une société dans la société, unissant des hommes et des femmes jeunes, camarades, qui sauront faire la différence entre le bien et le mal et deviendront une nouvelle génération de leaders politiques pour mener la lutte pour un meilleur avenir. Un des objectifs principaux de la mouvance consiste en un activisme de propagande pour populariser nos idées dans les masses populaires et attirer de nouveaux membres. À la condition d’avoir une masse critique de membres actifs et le soutien du peuple, nous pourrons prétendre faire la révolution.
-Avez-vous des relations avec des organisations ou des partis politiques ?
Notre mouvance ne dépend d’aucune organisation ou parti. Pourtant, il existe des personnes qui nous soutiennent et qui sont membres d’un parti ou d’une organisation.
Nous travaillons avec les gens, non avec les organisations. Nous essayons d’organiser des actions de telle manière que les participants ressentent des émotions positives afin d’avoir le sentiment d’avoir été utiles. Les organisations sont en compétition entre elles. Nos actions sont extra-organisationnelles et permettent donc aux personnes de différentes organisations d’y participer. Nous ne faisons la publicité à aucun parti, nous avons nos propres bannières.
-Les activistes de la résistance autonome de l’Ouest sont connus pour plusieurs actions extraordinaires. L’une d’elles est la marche qui a lieu le 29 janvier à L’viv et a attiré quelques milliers de participants. Parlez, s’il vous plait, de vos autres actions à nos lecteurs.
Vous pouvez lire les informations concernant nos actions sur le site opir.info ou bien en vous connectant au groupe « contact » (http://vkontakte.ru/club14858412). La dernière action en date du 29 janvier était très importante pour nous puisqu’elle a nécessité un gros travail de préparation (en hommage au combat héroïque mené par 500 cadets de l’armée de la République Populaire Ukrainienne face aux troupes bolcheviques à Krouty le 29 janvier 1918, ndt (http://opir.info/2011/02/07/video-zi-smoloskypnoho-marshu-u-lvovi/ et http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Krouty ). Elle représente une conclusion de nos efforts de l’année. Il y a un an, nous avons pu réunir à peu près mille personnes et la marche de cette année a montré notre force dans ce domaine. Il s’est avéré que le nombre de participants a doublé. C’est très agréable de voir que les choses avancent.
-En quoi repose le secret de la réussite des nationalistes autonomes ? Comment avez-vous réussi à organiser des actions intéressantes et à attirer un nombre important de participants ?
Grâce au travail mené auprès des gens dans les réseaux sociaux et autres sur la toile, ainsi qu’aux actions de propagande menées dans la rue : collages, distributions régulières de tracts. La situation politique du moment a également joué un rôle important, c'est-à-dire l’occupation du pouvoir par des éléments antisociaux et xénophobes, ce qui n’était même pas le cas à l’époque Koutchma (Léonid Koutchma, président de 1994 à 2004, déboulonné par la « Révolution orange », ndt). Le nouveau pouvoir (celui de Viktor Ianoukovytch depuis 2010, ndt) a constitué une thérapie de choc pour la société. Grâce à cela, les nationalistes ont remporté la majorité dans les trois assemblées locales (les régions de L’viv, Ivano-Frankivsk et Ternopil’ en Ukraine occidentale, ndt). La société, jusqu’alors passive, a commencé à bouger.
Mais, malgré cela, il ne faut pas oublier l’aspect technique. Il faut poursuivre le travail avec la population et inlassablement trouver de nouvelles thématiques, toujours actuelles. Il faut être réactif par rapport à l’évolution de l’environnement politique et expliquer notre position sur les problèmes du moment. Aujourd’hui, nous bénéficions d’un certain acquis pratique, mais quand nous nous sommes lancés, nous n’avions que quelques articles à disposition : « La résistance autonome » de Bima, « L’histoire des nationalistes autonomes allemands » du camarade Max, ainsi que le site reaktor.org.ua qui fut le point de départ de la mouvance nationaliste autonome en Ukraine.
-Vous avez organisé une initiative caritative durable intitulée « cœur sincère » auprès d’un orphelinat. Que pouvez-vous conseiller à ceux qui veulent mettre en place des initiatives semblables ?
C’est une affaire qui implique beaucoup de responsabilités. Si vous voulez mener une telle activité, vous devez vous rendre compte de votre responsabilité parce que les enfants s’habituent à vous. Vous devenez pour eux comme des parents adoptifs. Ils s’ouvrent à vous et si vous ne venez plus les voir, vous ne vaudrez pas mieux que les parents biologiques qui les ont abandonnés auparavant. Cela pourrait rendre les enfants encore plus agressifs. Vous ne pouvez pas visiter quelques fois un orphelinat pour abandonner ensuite en disant que vous n’êtes plus disponibles pour ça. Ce n’est qu’une manière de justifier votre propre égoïsme. En réalité, seul un petit nombre de personnes est prêt à mener une activité soutenue sur la durée. Il ne reste que quelques personnes de l’équipe initiale qui a commencé cette action difficile. La quantité s’est transformée en qualité. Les gens qui s’occupent des enfants prennent leur activité très à cœur.
-En quoi les autonomes diffèrent-ils des organisations et de partis classiques ?
En tout ! Dans la structure, le style, le mode de réflexion, la propagande, la manière de travailler avec la population, la politique interne, la manière de préparer les actions. On a adopté le principe du comité de « voix libres », et les membres obtiennent l’autorité au sein de notre organisme selon leur degré d’investissement et les résultats obtenus, et non selon leur tranche d’âge et leur échelon, comme c’est le cas dans les partis ou toute sorte d’organisation.
Ces derniers mènent des actions pour cocher les cases, faire des rapports devant leurs supérieurs , pour des publications dans la presse, tandis que nous menons nos action pour faire une bonne impression sur la population qui s’en rappellera encore longtemps et popularisera ainsi nos idées. Nous n’avons pas un leader parce que nous n’avons pas besoin de lui. La jeunesse a appris à s’auto-organiser. Un de nos camarades a dit que « seuls les Papous ont besoin d’un maître « (Vojd en vo, ndt).
-Votre mouvance compte parmi ses membres, des représentants de subcultures différentes, notamment les supporteurs de foot, des skinheads, des punks, des hardcore, des rappeurs, etc. Quelle importance donnez-vous à ces subcultures et à leur rôle au sein de votre mouvance ?
La résistance autonome est une mouvance qui surplombe le niveau subculturel. Le nationalisme social inclut au sein de la nation toutes les personnes professionnellement actives qui sont nationalement conscientes, indépendamment de leur de leur subculture et de leurs choix musicaux. Il faut travailler avec les représentants des subcultures puisqu’un nombre important d’entre eux sont prêts à mener des actions contre le système, parce que la nature des subcultures implique le non-conformisme, avec parfois des aspects antimatérialistes ou la négation de la société de consommation. Ces jeunes gens deviennent sans problème nos sympathisants, puis nos activistes.
-Nombre de vos actions ont été consacrées à la propagande en faveur d’un mode de vie sain et la défense écologique. Pouvez-vous nous donner plus de détails ?
Nous avons organisé une série d’actions écologiques, par exemple le nettoyage du parc Znesinnia, dans lequel on a ramassé assez de déchets pour remplir deux camions Kamaz ! Il faut savoir que cette zone est sous la responsabilité d’un organisme d’entretien. Nous avons également organisé une série de « marches de la jeunesse saine ». La dernière action de ce type a eu lieu le 29 janvier quand nous avons participé à l’organisation de compétitions, de combats réalistes intitulés Idou na vy ? Zakhid (ndt : d’après le célèbre cri poussé par le prince ruthène païen Sviatoslav qui a régné de 957 à 972). Notre équipe a remporté les quatre premières places. Les tracts thématiques sont distribués régulièrement, le travail éducatif est mené au sein des activistes et on récolte les premiers fruits, à savoir que nous avons de moins en moins de fumeurs et de consommateurs d’alcool. De toutes nos forces, nous cultivons un mode de vie sain, nous aidons à l’organisation de salles de sport. L’année dernière avec l’aide de bonnes volontés, nos gars ont commencé à pratiquer le sport dans une salle gérée par la fédération de boxe. Dans la mouvance des supporters de foot, on trouve beaucoup de nos sympathisants qui pratiquent un mode de vie sain. Bénéficiant d’une autorité certaine auprès des autres supporteurs, ces derniers sont devenus un exemple à suivre. Nous sommes plus que jamais convaincus que dans un corps sain réside un esprit sain.
-Maintenant quelques questions d’ordre idéologique, quel site d’idées consultez-vous le plus souvent ?
Primo, c’est la revue Vatra (littéralement, « le feu qui brûle tout l’été » lors des transhumances des troupeaux des bergers houtsouls dans les Carpathes ukrainiennes, ndt) qu’on peut consulter sur le site vatra.org.ua, secondo, il y a beaucoup d’informations intéressantes dans la revue Strike sur le site ntz.org.ua, et enfin, nous avons créé notre propre source d’informations et de documents intitulée Orientyry (orientyry.com).
-Vous situez-vous à gauche ou à droite ?
En guise de réponse, nous dirons que nous sommes des nationalistes sociaux-révolutionnaires. Cela implique l’union des idées du nationalisme de libération et du socialisme révolutionnaire. Ceci nous suffit pour nous auto-identifier.
-Quand vous parlez du «socialisme », il se trouve que cette notion ne s’inscrit pas dans l’image traditionnelle du « bandériste », le « nationaliste bourgeois » d’Ukraine occidentale qui lutte contre « le pouvoir soviétique ». Comment expliqueriez-vous cela ?
Cette image pseudo-patriotique a été créée par la propagande des impérialistes russes, et est actuellement alimentée en Ukraine par les nationalistes bourgeois benêts qui prétendent sans aucun fondement à l’héritage de Bandera. En réalité, l’Ukraine de l’Ouest, et en particulier la Galicie, a une ancienne tradition de nationalisme social, ouvrier et paysan et non celle d’un nationalisme bourgeois. Ce n’est pas par hasard que l’UPA (Armée Insurrectionnelle Ukrainienne, ndt), composée de paysans, d’ouvriers et de l’intelligentsia des travailleurs, s’est manifestée sous les slogans du combat contre l’exploitation de l’homme par l’homme, pour la propriété sociale, l’égalité sociale et la création de la société sans classes. Dans leurs vecteurs officiels de la propagande, les bandéristes indiquaient les objectifs de leur combat, « pour un vrai socialisme ». Tout un chacun qui se réfère aux sources primaires émanant des bandéristes verra que l’UPA avait mené le combat pour le droit des masses travailleuses contre la bourgeoisie bureaucratique qui a usurpé le pouvoir en Union soviétique. En guise d’exemple, citons l’un des principaux textes idéologiques contemporains des combats menés par l’UPA, intitulé « Qui sont les bandéristes, pour quoi combattent-ils ? ». On y trouvait le passage suivant : « Nous, bandéristes, combattants pour les intérêts des masses travailleuses et non pour les classes exploiteuses, sommes contre le retour des grands propriétaires terriens et des capitalistes en Ukraine. Nous sommes pour la propriété sociale des outils et moyens de production. Nous sommes pour la construction au sein de l’Etat ukrainien indépendant d’une société sans classes, pour une vraie liquidation de l’exploitation de l’homme par l’homme, pour la victoire de l’idée de la société sans classe parmi tous les peuples. Nous sommes pour la liberté des peuples et de l’Homme ! À bas le système exploiteur et oppresseur ! Vive la lutte nationale, sociale, révolutionnaire et libératrice des peuples opprimés ! Vive la lutte révolutionnaire des masses travailleuses pour la justice et l’égalité sociale pour une vraie société sans classes ! ».
La sœur de Stepan Bandera se rappelle qu’il était « partisan du socialisme ». Voilà l’image du bandéristes qui doit devenir traditionnelle et prévaloir dès aujourd’hui. Et c’est l’image véritable. Au fait, cette année, les nationalistes fêteront à grande échelle, la fête du 1er mai, jour de solidarité et de lutte pour la libération des classes travailleuses en Ukraine de l’Ouest.
-Sur le site opir.info, vous parlez du sens à donner à la notion de la lutte anticapitaliste pour la construction de la société socialiste, mais vous ne développez pas assez. Il y est question d’une opposition aux bénéfices non productifs, de l’exploitation, d’une idée de la société sans classes, de l’égalité et du partage des bénéfices. Quelle signification donnez-vous à ces notions ?
Nous voulons que les gens obtiennent des bénéfices résultant exclusivement de leur activité laborieuse personnelle, sans spéculation et sans exploitation de l’homme par l’homme, ceci impliquant une liquidation du travail salarié. Les bénéfices doivent être partagés entre les travailleurs et non pas appropriés par des personnes privées. La société sans classes signifie l’absence de groupes sociaux, car chacun d’entre eux peut s’approprier le fruit du travail d’un autre, La propriété appartient à la nation et à ses communautés dont les membres ont des possibilités et des droits égaux.
-Revenons sur la question des stéréotypes. Dans la conscience des masses, on trouve encore cette image du bandériste : nationaliste de l’Ukraine de l’Ouest, chauviniste aveuglé par la haine envers les peuples voisins russes et polonais .En se basant sur vos activités, on constate que vous entretenez des relations amicales avec les représentants d’autres pays. Ainsi, on trouve exprimée sur votre site l’idée d’une lutte contre l’impérialisme et pour le droit égal des peuples à leur propre identité. À votre avis, comment peuvent se corréler les notions de nationalisme, d’internationalisme et de cosmopolitisme ?
Ce stéréotype est également erroné. De facto, c’est un élément de la guerre cognitive menée contre le nationalisme ukrainien qui, en réalité, était et reste aujourd’hui un nationalisme de libération, anti-impérialiste et anti-chauviniste, et non un nationalisme de domination. Nous essayons de suivre le slogan principal du mouvement bandériste, « liberté pour le peuple, liberté pour l’homme ». Il ne faut pas lutter contre d’autres peuples, mais contre le chauvinisme et l’impérialisme émanant d’un certain peuple ou de ses représentants. Dans les documents de l’OUN-R et de l’UPA, il est écrit que « les nationalistes ukrainiens ne sont ni chauvinistes, ni impérialistes. Nous apprécions et respectons tous les peuples, y compris les peuples russes et polonais, et recherchons leur amitié et leur coopération. Nous haïssons et combattons seulement les forces impérialistes qui nous oppriment ou veulent nous dominer. Nous sommes pour la réalisation complète des idées de liberté des états nationaux des peuples du monde entier ».Aujourd’hui, la globalisation est l’ennemi principal de tous les peuples. Elle est menée par l’internationale « dorée » exploiteuse. Seule l’internationale libératrice comprenant les mouvances révolutionnaires des peuples du monde entier pourra la combattre. En ceci consiste une bonne corrélation du nationalisme et de l’internationaliste excluant le cosmopolitisme lequel nie l’amour pour la patrie et la nation et exprime le désir du globalisme pour la domination mondiale. Pour lui barrer la route, il y a l’identité nationale et la lutte pour l’indépendance.
-Les nationalistes autonomes constituent une mouvance paneuropéenne, votre rhétorique est enrichie par des slogans paneuropéens, dites-nous comment vous comprenez les notions d’Europe et d’Européens ?
Nous partageons la conception des trois strates de l’identité. L’Europe est un niveau d’identité supranational, l’Ukraine en constitue le niveau national et la Galicie (ou bien une autre région), en est la petite patrie. Nous considérons l’Europe comme une notion civilisationnelle, la source principale de la culture humaine. Les Européens représentent une notion ethnico-politique qui englobe tous les peuples européens indigènes. Nous sommes convaincus que l’anéantissement de l’Europe et des Européens constituerait la fin du progrès et entraînerait la mort de l’humanité en général. Nous devons empêcher que cela arrive. Les Ukrainiens représentent une partie de la communauté des peuples européens et doivent jouer leur rôle dans l’entreprise de préservation et de renouvellement de l’Europe, qui doit préserver la diversité ethnique de ses peuples de souche, mais aussi retrouver sa conscience politique commune. Cette dernière permettrait de réaliser la révolution paneuropéenne et mondiale.
-Quel est votre point de vue concernant le régime autoritaire qui se met rapidement en place en Ukraine ? Pourrait-il renforcer la mouvance libératrice et déclencher la révolution ou au contraire étouffer les aspirations des gens pour la liberté ?
Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises dans notre propagande qu’une dictature ouvertement terroriste a été restaurée en Ukraine, reposant sur les éléments les plus réactionnaires, ukrainophobes et criminels du capital financier. Cela est triste, mais du pire peut naître le meilleur. Afin de mobiliser le peuple pour une révolution libératrice nationale et sociale, il faut un déclic et une image nette de l’ennemi. Ce dernier, pour le peuple ukrainien, est l’Etat et la classe oligarchique qui le dirige. Une évolution accélérée de la conscience s’effectue dans de telles conditions, avec un tri sélectif dans la mouvance. Restent les meilleurs qui feront la révolution, partent les boulets qui freinaient le développement de la mouvance et n’étaient pas prêts pour l’action révolutionnaire. Sans doute, la politique antinationale et antisociale renforce la mouvance libératrice et sélectionne les meilleurs éléments issus des masses populaires destinées à rejoindre notre combat. Ce fut ainsi et ce sera ainsi. Nous devons profiter de la situation.
Selon vous, par quels moyens se réalisera la révolution nationale et sociale en Ukraine ? Dans quelle mesure pensez-vous une guerre civile possible et est-ce que la mouvance libératrice y est préparée ?
Les maidan oranges (littéralement « la place », de maidan nejalenosti, la place de l’indépendance à Kyiv qui a servi de lieu principal de rassemblement lors des événements de la « révolution orange » fin 2004, ndt) et les autres rassemblements libéraux de même type ne se reproduiront plus. On l’a compris après les protestations contre le nouveau code fiscal au cours de l’automne dernier. Les changements sérieux sont proches et pourront se réaliser assez rapidement. Ceci est envisagé sérieusement par plusieurs politologues connus. Ils prophétisent qu’une révolte embrayant le pas sur la Tunisie et l’Egypte aura lieu en Ukraine. Nous voulons y croire et nous ferons en sorte que celle-ci débute dès que possible et qu’elle se transforme en révolution. Il n’y a pas de changement qualitatif sans processus douloureux. Pour construire le nouveau, il faut éradiquer l’ancien.
Que pouvez-vous souhaiter à nos lecteurs ?
Ne pas être indifférents, parce que l’indifférence est un crime ! Prenez régulièrement votre poul !
Traduit de l’Ukrainien par Nataliya Stepanenko et Pascal Lassalle
Quelques liens :
http://opir.info: Nationalistes autonomes d’Ukraine de l’Ouest
http://www.reactor.org.ua: Nationalistes autonomes de Kyiv
http://ptawka.blogspot.com/: Blog avec de nombreuses photos des actions menées par les militants nationalistes autonomes de Galicie
http://www.vatra.org.ua/: Textes et documents d’orientation nationaliste-révolutionnaire, sociale-nationale et révolutionnaire conservatrice.
http://orientyry.com/: Base de documentation et de propagande sociale-nationaliste avec de nombreux textes dignes intérêt (ceux d’Andriy Illienko, étoile montante de Svoboda par exemple), sur le localisme ou des traductions d’entretiens avec la Casa Pound et Zentropa ou d’articles de Pierre Krebs et Guillaume Faye .
http://ntz.org.ua/: Journal « national-travailliste » Strike avec de nombreux textes européens traduits en ukrainiens grâce notamment aux efforts du camarade Oleksandr de Kyiv. Les sensibilités nationalistes-révolutionnaires , nationales-syndicalistes, nationales-bolcheviques, révolutionnaires-conservatrices, néo-droitistes ou anarcho-fascistes, allant d’ Alain de Benoist à la Casa Pound italiennes sont représentées.
http://www.patriotofukraine.org.ua/: Le Patriote d’Ukraine- Centuries galiciennes
http://www.sokil.org.ua/: Organisation de jeunesse Faucon, sociale –nationaliste en Galicie http://rid.org.ua/
http://patriotukr.org.ua/: Le Patriote d’Ukraine (fondé à Kharkiv , en Ukraine majoritairement russophone), qui reprend le nom et le logo (rune « Wolfsangel » inversée) de la branche paramilitaire du SNPU formée initialement en 1996 et se réclame de son héritage. Il est difficile de dire si cette initiative est sincère ou s’il s’agit comme cela est fréquent dans les pays post-soviétiques, d’ un mouvement sous « faux drapeau » monté par les services, (on peut citer à cet égard la pseudo-UNA d’Edouard Kovalenko qui avait tenu un défilé provocateur dans Kyiv en 2004 visant à discréditer la coalition « Notre Ukraine » de Viktor Iouchtchenko).
http://sna.in.ua/: L’Assemblée Sociale-Nationale qui inclut le Patriote d’Ukraine
http://rid.org.ua/: Site social-nationaliste
http://sd.org.ua/: Journal électronique Narodniy Ohliadatch (l’Observateur du peuple) animé par le sociologue Ihor Kahanets, auteur notamment de l’ouvrage Ariyskiy Standart (Standart aryen), rédacteur en chef du journal ésotérico-métapolitique Perehid IV (Le Quatrième Passage) et leader de la Communauté Nationale Ukrainienne (UNH). On y trouve notamment la défense d’un christianisme aryen et l’évocation d’un Troisième hetmanat comme forme de gouvernement plus conforme aux traditions politiques ukrainiennes.
http://una-unso.in.ua/: L’UNA-UNSO résiduelle
http://www.bratstvo.info/; Le site de la Fraternité du « Limonov » ukrainien, Dmytro Kortchinskiy, ex-leader de l’UNA-UNSO dans les années 90, activiste et provocateur talentueux, enfant terrible de la bohême politique ukrainienne dont on ne saurait dire s’il est manipulé par de multiples officines ou s’il gère habilement un fond de commerce entouré de ses « groupies ».
http://untp.org.ua/: Parti National-Travailliste Ukrainien
http://www.run.org.ua/: Nationalisme Radical Ukrainien
http://www.svoboda.org.ua/: Le site officiel du parti politique nationaliste qui monte lentement mais sûrement, l’Union panukrainienne Svoboda
http://www.tyahnybok.info/: Site d’Oleh Tiahnybok,leader charismatique de Svoboda
http://www.ukrnationalism.org.ua/: Portail de l’OUN-R animé par les jeunes du Congrès des Jeunes Nationalistes (MNK)
http://www.ukrpohliad.org/: Un Novopress/Altermedia ukrainien animé par les précédents
http://banderivets.org.ua/: Le site des « purs et durs » de l’organisation paramilitaire Tryzub « Stepan Bandera »
http://www.cun.org.ua/ukr/: Site du Congrès des Nationalistes Ukrainiens (KUN)
http://oun-upa.org.ua/main/: Site sur l’histoire de l’OUN-UPA
http://dontsov-nic.org.ua/: Site consacré à l’idéologue et penseur politique Dmytro Dontsov, théoricien du « nationalisme intégral » ukrainien, auteur du célèbre « Nationalisme ». Toujours lu et réédité (grâce aux efforts du MNK notamment et d’un de ses infatigables animateurs à Kyiv, Viktor Roh)
http://www.aratta-ukraine.com/: Portail National Ukrainien Aratta, dont le nom rappelle que l’Ukraine est « l’espace des Aryens », très probablement le foyer originel des peuples boréens, sinon secondaire, si l’on tient compte de l’hypothèse circumpolaire et hyperboréenne.
http://nation.org.ua/: Site de l’Alliance Nationale, mouvement plus modéré de tendance nationale-démocrate, créé à Louts’k, capitale de la Volhynie au nord-ouest du pays, par un ancien du MNK, aujourd’hui élu local.
http://www.lne-ua.narod.ru/: La Nation eurasienne, revue atypique d’orientations traditionnelles et néo-droitiste éditée jusqu’en 2005 par un universitaire d’Ivano-Frankivsk en Galicie, ancien de l’UNA-UNSO.
http://www.komuvnyz.com/: Le groupe de rock gothique culte et talentueux animé par Andriy Sereda, le Gianluca Iannone ukrainien. Associé à la revue Perehid IV qui a édité leur dernier album dans son n°13 de l’année 2009.
http://uktk.org/: Le Club traditionaliste ukrainien de Kyiv, de sensibilité monarchiste animé notamment par le jeune Andriy Volochin.
http://rozum.info/: Site notamment animé par les précédents.
http://www.hors.org.ua/: Le Boyoviy Hopak, l’art martial ukrainien tiré de la danse traditionnelle du même nom, revivifié dans les années 80 par Volodymyr Pylat, aujourd’hui à la tête de la Fédération Internationale de Combat Hopak, spectaculaire et certainement efficace
http://oru.org.ua/: Organisation de la Foi Native Ukrainienne (ORU), dirigée par l’universitaire Halyna Lozko, auteur de nombreux ouvrages, dont un sur le renouveau du paganisme en Europe. Une des organisations néo-païennes ukrainiennes les plus intéressantes. Résolument identitaire, de sensibilité néo-droitiste (Lozko a jadis rencontré Guillaume Faye, Pierre Vial ou Pierre Krebs). Édite le journal Svaroh.
http://www.svarga.kiev.ua/: Groupe proche de l’ORU.
http://alatyr.org.ua/: Autre groupe païen de sensibilité plus panslave
http://www.vinec.org.ua/: Groupe païen de Vinnytsia
http://www.ukrstyle.com/: Esthétique est notre intuition du monde : un peu de fringues pour terminer !
Pascal Lassalle
00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ukraine, europe, affaires européennes, nationalisme, monde slave |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 25 avril 2011
Lezing Frans Crols - Deltastichting / 2 April 2011
Lezing aan het colloquium van de Deltastichting op 2 april. Ditmaal door Frans Crols.
Beminde gelovigen van de rechtse kerk,
De trotskist en hoogleraar Jan Blommaert ontkent het licht van de zon in zijn essay “Links van de kerk” in Knack van 16 maart en op de webstek kifkif.be. Een boek over zijn verzinsel is op komst bij uitgever EPO, het gauchistische uitgeefhuis. Wat is het verzinsel? Het essay “Links van de kerk” weerlegt dat er een linkse kerk is en ontkent dat de progressieven jarenlang het debat over de multiculturele samenleving hebben gedomineerd. Neen, beminde gelovigen, het is rechts dat het debat over de multiculturele samenleving naar zijn hand heeft gezet; wij, conservatieven, rechtsen hebben het hoogste gekraaid, en kregen de meeste steun, over standpunten als Vlaanderen voor de Vlamingen, selectieve inwijking, voorrang voor de Europese Leitkultur. Blommaerts polemiek is van een haast Goebelliaanse gotspe. Of er een linkse kerk, een verzameling van linkse kapelletjes of een linkse oecumene is, is een kwestie van woorden, van semantiek. Feit is en blijft dat tot voor een korte tijd de vooruitstrevenden, zoals het apostelen van Gramsci past, ALLE, ALLE sleutelposities innamen in de media en daardoor ALLE debatten naar hun hand konden zetten. Ik denk aan de recente en schitterende essaybundel “De Islam” van Wim Van Rooy en Sam Van Rooy waar ik op terugkom. De Van Rooys hebben daarover sinds november 2010 interviews weggeven in de Nederlandse kwaliteitskranten, waren te gast in De Balie in Amsterdam, kwamen er mee op de Nederlandse televisie. In Vlaanderen dat geen linkse kerk, geen linkse censuur heeft volgens Jan Blommaert, is “De Islam” tot vandaag doodgezwegen door De Standaard (buiten een akkefietje van Mia Doornaert in haar column), De Morgen, Knack, de VRT, VTM en noem maar op.
Intellectueel is een sappig en heerlijk woord. Een intellectueel maakt deel uit van een intellocratie en daarin is het goed toeven: gekeken wordt in de huiskring van de ïntellocraat naar Canvas, geluisterd wordt naar Klara, gelezen wordt in De Morgen of Humo, en ver is men van de hufters die zich verlustigen aan pulp als Goedele, Familie, Thuis en Big Brother. Onder intellectuelen was het, zeker in Vlaanderen, tot voor kort mega-tof.
Iedereen dacht Politiek Correct en wie niet PC was bestond niet, verdiende verdelging door de malcontent dood te zwijgen, publicatierecht te ontnemen, een uitgever af te pakken, een professoraat of een mediajob te weigeren.
De heren en dames intellectuelen ankeren sedert mei ’68 gemoedelijk en exclusief ter linkerzijde. Simpel. Een rechtse intellectueel is een contradictie, kan niet bestaan, heeft niks te vertellen. Johan Huizinga, Leo Strauss, C.S. Lewis, Ludwig Witgenstein, Roger Scruton, Andreas Kinneging, Theodore Dalrymple, om slechts enkele behoudende, rechtse mensen op te sommen, missen geloofsbrieven in de ogen van de Politiek Correcten. Evenzeer als de mindere goden Pim Fortuyn, Martin Bosma, en recente bekeerlingen van links: Jean-Pierre Rondas, Wim van Rooy, Benno Barnard, Siegfried Bracke en we vergeten er. Het beekje van progressieve kameleons die rechts, centrum, conservatief vervellen wordt een riviertje.
Je moet van goeden huize zijn om de Deltastichting te kennen, Tekos te kennen, publieke intellectuelen te kennen als Luc Pauwels, Johan Sanctorum, Paul Belien, Koen Eist, de genoemde Van Rooy’s (mensen met een linkse en loge-achtergrond). Het cordon sanitaire heeft op een haar na zijn antidemocratische muren niet meer kunnen optrekken rond de zelfverklaarde conservatief Bart De Wever. Dat is Vlaanderen, en dat is het effect van de onbestaande linkse kerk.
Nooit zal ik vergeten wat de Nederlandse socioloog en historicus, J.A.A. van Doorn bewees in zijn schitterende “Duits socialisme, het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme” (2007): het verraad van het Duitse volk door de klerken van de sociaal-democratie opende de deuren voor een variant van het socialisme, het nationaal-socialisme. Geert Wilders en Filip De Winter zouden niet bestaan, zonder het nuffige discours van de heren en dames van stand van links.
WIE ZIJN WIJ? Wat is onze identiteit?
Ik kijk naar u en mij, naar ons in de spiegel van kutmarokkaantjes in Brussel, van allochtone jongeren die meewerken aan de zender Kif. Zij noemen zich les Borromites, zeven jongens en vier meisjes en stappen rond met micro’s en opnameapparatuur in het Brusselse Allochistan. De Vlaming is voor de jonge allochtoon in de eerste plaats “une victime”, een slachtoffer, de “seut”, de zwakkeling. Het is iemand die je voor je kar kunt spannen, bijvoorbeeld op school. Je kunt er geld van aftroggelen, hij is genereus en naïef. Een geïnterviewde zegt: “Een Vlaming? Dat is iemand die altijd het onderspit delft. “Quand ils passent dans Ie quartier, on les rackette”. We geven die af en toe meppen, “des tartes” in het Frans, om de oren… De jongeren hebben het niet over taal. Een Flamand kan in hun ogen net zo goed een Franstalige Brusselaar zijn. Als hij maar “studieux” is, ijverig op school. Vlaming-zijn wordt door allochtonen geassocieerd met sociale status. Met rijkdom. Een Vlaming is geslaagd in het leven. “C’est quelqu’un qui fait les choses bien”. Het levert de merkwaardige uitdrukking op “devenir un flamand”, wat zoveel wil zeggen als: opklimmen op de sociale ladder. De Vlaming is gedisciplineerd, is op school met alles in orde, heeft altijd zijn vieruurtje bij, betaalt zijn busabonnement, eet met zijn familie op vaste uren. Enzovoort.
DAT ZIJN WIJ, en geef toe die kutmarokkanen zijn volleerde en slimme sandalendragende sociologen.
IK HEB HET ondanks de intelligente waarnemingen van de Brusselse allochtoontjes gehad met het multiculturele verhaal.
Voor kort had ik een boeiend gesprek met monseigneur Bonny, bisschop van Antwerpen. Het woord Leitkultur viel niet, maar een van zijn meningen, en ik deel die volledig, heeft er alles mee te maken.
De Vlaamse dagbladen klagen op hun voorpagina’s over een hoofddoekje in de Hema. Diezelfde Vlaamse dagbladen verstoppen op hun achterpagina’s dat christelijke kerken branden in Egypte, Irak, Ethiopië, Indonesië. Mensen die onze cultuur en christelijke traditie delen worden er vermoord. De islam vervolg de christenen in hun geboorteregio: het Midden-Oosten.
De Antwerpse bisschop Bonny werkte twaalf jaar vanuit Rome als ambassadeur voor de oosterse kerken. Hij bereisde alle moslimlanden van het Midden-Oosten en kent door en door de oerbewoners van die regio, dus de christenen en de latere moslims van diezelfde regio, die als soldatengodsdienst de macht veroverden over de voorbije 1500 jaar. Een jaar of drie geleden toen duizenden christelijke Irakezen zonder toekomst samengepakt zaten in Jordanië, Syrië en het noorden van Irak heeft men aangedrongen bij westerse regeringen, regeringen uit landen met christelijke wortels om deze verdrevenen een zekere prioriteit te geven. Dat is toen door bepaalde landen brutaal geweigerd met de melding: godsdienst is voor ons geen factor. Je moet uiteraard in een noodsituatie mensen niet enkel selecteren op godsdienst, maar correct en verdedigbaar is om zij die al 1500 jaar aan onze kant staan, onze cultuur delen en bondgenoot zijn van Europa, voorrang te geven. Of is het christendom voor ons van geen tel meer? Zweden, Duitsland en Oostenrijk hebben contingenten opgenomen. België geen. Ondanks een zogenaamde christelijke CD&V en een weliswaar gelaïciseerd maar van christelijke cultuur doordrenkt Vlaanderen. Wij stellen met zijn allen de integratievraag, als je mensen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar hier haalt, kunnen zij zich dan integreren? Met de christelijke Irakezen, Syriërs, Egyptenaren is de integratie eenvoudig. Zij deden vaak middelbare en hogere studies op scholen die zij zelf of westerse christenen gesticht hebben. De Arameeërs, de Maronnieten, de Kopten en de Armeniërs konden onder de Ottomanen genieten van een zekere bescherming, mits het betalen van een belasting. Zij hadden vaak geen rechten op grondbezit en hebben zich dus, zoals de joden in onze Middeleeuwen, toegespitst op de studie en de intellectuele beroepen. De christenen van het Midden-Oosten vormen zo tot en met vandaag de middenklasse met geneesheren, leraren, architecten, apothekers, muzikanten, ingenieurs die zich hier qua denken en doen perfect thuis zullen voelen.
IK HEB HET het gehad met het eensluidende ophemelen van alles wat de Verlichting ooit zou gebracht hebben, er zijn elementen in de anti-Verlichting, de anti-Lumières die een debat waard zijn.
Is het een symbool voor het colloquium van vandaag hier in Antwerpen? Een toeval? Ik geloof niet in dat soort toevalligheden. Op een ogenblik dat de Europese Unie in haar zoveelste existentiële crisis zit verschijnt een Nederlandse vertaling van “Journal meiner Reise in 1769″ van Johann Gotfried Herder. Deze Lutheraanse predikant van Riga in Letland, toen een Duitse stad en een Duits wingebied, wordt nog amper gelezen en toch oordeelt uitgever Klement dat het opportuun is om een sleutelwerk van hem op de markt te brengen. Men leest vooral over Herder. Hij schreef pertinente gedachten neer over het multiculturalisme. Herder is de geestelijke vader van het nationalisme, de scherpste polemist van de zogenaamde anti-Lumières-stroming. Hij zag de mensheid als een lappendeken van verschillende, in principe gelijkwaardige naties en culturen. Zij hebben in elke tijd een eigen, onvervreemdbaar karakter. Ten onrechte werd Herder, vandaag weliswaar minder, een grondlegger van het fascisme en nationaal-socialisme genoemd. Duitsland was in Herders tijd geen eenheidsstaat, en hij pleitte voor een cultureel nationalisme tegen de overheersing van de Franse invloed. Aan de Duitse dichters stelde hij Shakespeare als voorbeeld. Herder verdedigde de Franse Revolutie, en verwierp het racisme en het imperialisme. Zijn mensbeeld stelde Isaac Newton en een Hottentot, op gelijke hoogte.
Herder is een aanhanger van de “organicistische opvatting van de staat”. Hij hanteerde de organicistische metafoor om er de opkomst, groei, bloei en het sterven van beschavingen en staten mee aan te duiden. Staten werden door Herder gezien als individuen, als individualiteiten met een eigen identiteit.
Herder is een cultuurrelativist, niet elke cultuur en elke cultuurgemeenschap staat op hetzelfde peil, heeft dezelfde voorbeeldrol en dezelfde dynamiek, toch is er in al die verschillende culturen één trend werkzaam: een evolutie naar humaniteit, Humanität in zijn moedertaal. Chauvenisme was hem vreemd.
Wie zich met de Vlaamse en de Nederlandse identiteit bezighoudt, kan nog steeds niet om een rede heen die Ernest Renan in 1883 in Parijs hield onder de titel: “Qu’est-ce que’une nation”. Kernpunt in het betoog van Renan is dat het bestaan van een natie geen objectief gegeven is, maar een keuze. Een volk moet bereid zijn om voor een gemeenschappelijke identiteit te kiezen. De basis voor die identiteit ligt in het verleden, in de grootse daden van de voorouders, maar het volk moet zich door die daden willen laten inspireren, moet in het heden als een gmeenschap willen leven.
Opvallend in het betoog van Renan is de nadruk op het willen. Een natie, stelt Renan, is ondenkbaar zonder het geloof in het bestaan ervan, maar het is een geloof dat voortdurend gevoed moet worden, sterker nog, het is een geloof dat je moet willen. Bepaalde zaken vergeten, de zwarte bladzijden van je geschiedenis, is volgens Renan een essentiële factor in de vorming van de nationale identiteit. Maar willen wij dat vandaag nog wel?
IK HEB HET het gehad met dat grote, bureaucratische, onwerkbare, leuterende Europa. Mijn hart en geest gaan naar de Nederlanden en een Rijnbond.
In de negentiende eeuw bestonden er slechts een drietal grote verzamelingen van theorieën over de internationale betrekkingen. Ten eerste, de Realpolitik (met als bekendste begrip, het Concert van Europa), ten tweede, de “wereldgemeenschapsbenadering” (door de stelselmatige groei van internationale belangengroepen, bemiddelingen en vredesconferenties) en ten derde, de structurele benaderingen (Marxisme-Leninisme en de Klassieke Geopolitiek a la Haushofer). De wereldgemeenschapsbenadering heeft het in de twintigste eeuw gewonnen door de eliminatie, onder de absolute voorrang die de vredesdoelstelling van de internationale politiek kreeg, van de Realpolitik en de structurele benadering.
In alle Nederlandse boekhandels, en een enkele Vlaamse uitzondering, glorieert de haven van Nieuwpoort met haar kaden, kranen, stadsmuren en torens in de vijftiende eeuw op een kleurige omslag. Raar? De nieuwste aflevering van het tiendelige De Geschiedenis van Nederland, van de Nederlandse uitgeverij Bert Bakker, heet “Metropolen aan de Noordzee” (1100-1560) en is geschreven door Wim Blockmans (65), de Vlaamse emeritus-hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden en rector van het Netherlands Institute of Advanced Studies, een kind van het Institute of Advanced Studies van Princeton (VS) waar Albert Einstein nadacht.
De historicus graaft niet in het verleden om een mededeling voor nu boven te spitten, maar soms lukt het wel. Wim Blockmans noemt bij het achterom kijken de Nederlanden, in hun wijdste betekenis, dus met de Noord-Franse steden Atrecht (nu Arras), Bavay, Bapaume, Grevelingen “een gebied met beloften”. Zonder zijn woorden en vondsten, want hij doet vondsten, brutaal naar 2011 te buigen, is Blockmans stelling een vermoeden van toekomst. België verdampt, verkruimelt, lost op. “Een gebied met beloften” schildert de interactie tussen de steden van Vlaanderen en Nederland rond de mondingen van Schelde, Maas en Rijn. Blockmans her-ijkt bakens en kijkt ongewild ver in de huidige eeuw.
Wat is Vlaanderen? Een van de kerngebieden van een territorium dat van in de twaalfde eeuw tot halverwege de zestiende eeuw, of 450 jaar, een zinvol geheel vormde. Wat niet beduidt, beklemtoont Wim Blockmans, dat het de hele tijd, of nadien, een politieke eenheid was. Het land dat hij beschrijft heeft amper bestaan, althans in politiek opzicht. Het is geen vaderland en wordt niet als zodanig aangevoeld door zijn bewoners. Toch is het in zijn boek gekozen kader het enig verantwoorde, omdat de werkelijkheid niet steeds en overal primair door politieke grenzen bepaald wordt en er in de 450 jaar die hij beschrijft meer onderlinge verbanden, tot in de uithoeken van Artesië, Luxemburg en Friesland toe, bestaan dan met de omringende gebieden.
Blockmans verwerpt de geschiedschrijving die zich blind staart op de grenzen van bestaande staten. Stedelijke netwerken in het verleden worden heden internationaal als zeer vruchtbaar beschouwd voor de analyse van hun eenheid. “Juist voor de Lage Landen is dit zeer steekhoudend”, vindt Wim Blockmans. “Na Noord- en Midden-Italië in de Late Middeleeuwen behoorden de Lage Landen tot de meest verstedelijkte delen van Europa, en ook al in 1500 met de hoogste bevolkingsdichtheid, en de opmerkelijke dynamiek van het stedelijk systeem is een stevig uitgangspunt.” Tijdens de twaalfde en de dertiende eeuw lag het zwaartepunt in het huidige Noordwest-Frankrijk, met Atrecht als centrum, in de veertiende en de vijftiende eeuw neemt Brugge de kernfunctie over en vanaf 1480 pakt Antwerpen de overhand, een proces dat zich twee eeuwen later herhaalt in Amsterdam.
Meervoudsvormen symboliseren de virtuele unie van Noord-Frankrijk tot Noord-Friesland. De Nederlanden, de XVII provinciën? Wim Blockmans: “De buitenwereld zag een vorm van economisch-geografische eenheid in het dichtbevolkte, strategische, economisch belangrijke _ én door open grenzen kwetsbare _ mondinggebied van de grote Vlaams-Nederlandse rivieren. Italianen en Spanjaarden noemden tot rond 1600 de hele regio nog naar het voorheen dominante gewest Fiandra, Flandes.”
IK HEB HET gehad met de verwerping van de geopolitiek en nieuwere begrippen als geo-economie om mensen en klemtonen van honderd jaar geleden. Want geo-economie is voor Vlaanderen en Nederland een geopolitiek bindmiddel.
Geopolitiek was decennia een besmet begrip door zijn deels laakbare identificatie met het nazisme. De bekendste theoreticus van de klassieke geopolitiek, Karl Haushofer, werd onaanraakbaar door die voor een flink part valse, foute vereenzelviging. Zijn intellectuele concurrent de Oostenrijkse-Amerikaanse politocoloog noemde Haushofer ronduit de “Nazi-Machiavelli”. Wie gruwelt niet bij het woord dat iedereen associeert met de Hitlerianen: “Lebensraum”, geopolitieker kan niet.
Henry Kissinger, Amerikaan van joods-Duitse komaf, theoreticus van het internationale beleid, en buitenlandminister van de VS heeft jaren later het begrip geopolitiek opnieuw toegang verschaft tot de salons van de bien-pensants. Een zus van de geopolitiek is de geo-economie, en een van de vaders van de term is Edward Luttwak, een heuse Amerikaanse “defense intellectual”, een intellectueel die scherp nadenkt over internatonale betrekkingen, veiligheid, landsverdediging en nieuwe politieke paradigma. De stelling van Luttwak luidt: “the logic of war is the grammar of commerce”, vertaald “de logica van de oorlog (in traditionele termen) is de spraakkunst van de economie”. Voor Luttwak bestaat onverminderd de wedijver in het internationaal politieke veld, maar die wordt meer en meer afgewikkeld via een economische strijd tussen nationale staten, dit in tegenstelling tot de stelling van het grenzenloos kapitalisme.
Geo-economie in de Delta van Maas, Schelde en Rijn betekent concreet Benelux. Een Benelux, en ik haal de communicatiewetenschapper Jaap van Ginniken aan, ontspruit uit een typische identiteit van de Nederlanden, zie de stelling van professor Blockmans, die er altijd prat op gingen dat zij niet-nationalistisch en zeer tolerant waren. Beide pretenties zijn wellicht maar ten dele waard en bovendien geen prestatie om ons op de borst te kloppen. Want dergelijke eigenschappen vloeien rechtstreeks voort uit de geografische voorbestemming van een deltagebied dat ingeklemd ligt tussen de drie grootste mogendheden van het continent, en dat daardoor per definitie georiënteerd is op scheepvaart en doorvoer, op handel, en daarvoor is tolerantie, pacifisme noodzakelijk.
In Vlaanderen is geopolitiek een ondergeschoven kind in het nadenken over onze toekomst. Eerder pragmatisch, zonder diepe reflectie, wat zou mogen, is een geopolitieke dimensie, of beter een geo-economische dimensie, onder minister-president Van den Brande, boven water gekomen in het Vlaamse beleid en het Vlaamse buitenlandbeleid. Vlaanderen heeft vanaf Van den Brande een geo-economische strategie ontwikkelt die de unieke geografische ligging van onze gewesten wil verzilveren; de haven van Antwerpen is van alle West-Europese groothavens het meest landinwaarts gelegen en heeft een Hinterland dat in het oosten reikt tot diep in het Duitse grondgebied, in het bijzonder het Ruhr-gebied, maar ook in zuidelijk Europa uitstraalt. Denk aan het Vlaamse beleid van de containertrafïek over de binnenvaart, want Vlaanderen wil geo-economisch excelleren als logistieke draaischijf van West-Europa. Vlaanderen zoekt hiervoor zachtjesaan verwevenheid met de Nederlandse transport- en haventraditie. De Benelux-havens zijn de Grote Poort voor het hartland van Europa, tot in Rusland.
Duitsland
Een nieuwe Rijnbond. In snel tempo wordt duidelijk dat de Europese Unie splitst. Duitsland domineert het noorden, Frankrijk loopt hijgend het zuiden achterna. Vlaanderen moet uit economisch belang aansluiten bij de Rijnlanden.
Zelfs Paul Magnette (PS), la voix de son maître di Rupo, weet het. Hij ziet een verwantschap tussen België en Duitsland en sprak over toenadering. Die stelling gaat nog meer op voor Vlaanderen. Of er een grote of een kleine breuk komt door confederalisme of independentisme maakt voor dit thema niet uit: Vlaanderen dient kleur te bekennen en zich te openlijker dan ooit te wenden naar Duitsland. Dat is de economische en politieke motor van de Europese Unie, of wat er van zal overblijven als de zuidelijke leden verder kwakkelen. De berichten blijven eensluidend: Duitsland doet het prima. Frankrijk dat economisch tien jaar verloor, kijkt naar de oosterbuur. In 2000 bedroeg de Franse uitvoer 55% van de Duitse, vandaag 40%. Eurocommissaris voor Economie, Olli Rehn, bevestigde op 1 maart dat de noordelijke landen met een sterke exportsector, het nummer 1 is Duitsland, in 2011 sneller groeien dan de zuidelijke lidstaten. En dat is geen toeval, maar een constante door de Duitse noestheid en nuchterheid.
Dr. Dirk Rochtus, expert Duitsland, docent Diplomatieke Geschiedenis van de Lessius Hogeschool (Antwerpen), ex-beleidsmedewerker van Vlaams minister Geert Bourgeois (toen bevoegd voor het buitenlandbeleid, nu is Kris Peeters chef buitenland in zijn Vlaamse regering): “Jarenlang heb ik in Antwerpen het Centrum voor Duitslandkunde van de Lessius Hogeschool mee geleid. Dat is economisch en politiek belangrijk voor de haven en voor Vlaanderen. De economische temperatuur van Duitsland bepaalt voor een groot deel de economische temperatuur van Vlaanderen. Dan heb ik het nog niet over de specifieke verbindingen tussen de chemienijverheid van Vlaanderen en haar, dikwijls, Duitse moederbedrijven, en de auto-industrie. Duitsland zal in de toekomst belangrijker worden voor ons.”
Rochtus pleit voor een meer open en gedurfde band tussen Vlaanderen en Duitsland. Vlaanderen is een goed partnerland met Nederland en Duitsland langs de delta van Schelde, Maas en Rijn en mits wij meer eigen beleid kunnen voeren hebben wij veel affiniteit met een gezonde euro, of neuro _ een noordelijke euro of DM-euro.
In de hoofden van de Europese leiders, en dat zijn niet de premiers van de kleine landen, wel van hun confraters van de grote landen, zit een onzichtbare grens. Die loopt langs de noordgrens van België en scheidt Nederland, Duitsland en de noordelijke EU van het zuiden. Dat houdt in, dat er een stille eensgezindheid is bij de hoogste Europese beslissers om Vlaanderen te blijven toewijzen aan Frankrijk. Parijs speelt enthousiast mee. België en Vlaanderen zijn Franse economische koloniën, ook in 2011. De Paribas BNP Fortis-affaire is de laatste bevestiging van deze trend. Wie twijfelt moet enkel uit zijn boekenrek, of uit de bibliotheek, twee reeksen essays, samengebracht door Hans Brockmans, halen en doorbladeren: “Vlaanderen, Een Franse kolonie” (Davidsfonds, 1993) en “200 jaar filiaal, De Franse greep op de Vlaamse economie” (Davidsfonds, 1995). De eerste reactie van de Franstalige media en elite op die boeken was: “Dit is verwerpelijke ethno-economie”. De sfeer draaide toen hun eigen Brusselse of Waalse voormannen door de Franse bazen bij het huisvuil werden gezet: burggraaf Davignon verpieterde tot een lakei van Parijs om zijn hachje te redden, Philippe Bodson verloor het gevecht om Tractebel uit de greep van Suez te houden. De situatie is er, zie onder meer het bancaire plaatje, niet op verbeterd.
Vlaanderen heeft talent om op het economische vlak de band aan te snoeren met Duitsland. Thomas Leysen (50), zoon van André Leysen, in de herfst voorzitter van KBC, en redder, met Karei Vinck, van Union Minière, kort nadien herdoopt tot Umicore, is een symbool van de relaties tussen Vlaanderen en Duitsland. Hij is onder meer Duitstalig van huis uit, beweegt bekwaam en met gezag in hoge Belgische en internationale zakelijke kringen, woont in Antwerpen, leidt het VBO tot april 2011, is bestuurder bij de Duitse bank Metzier en voorzitter van Corelio (De Standaard, Het Nieuwsblad, enz.). KBC heeft jarenlang KBC’tjes gemaakt of opgekocht in Midden-Europa. De blik naar het oosten zit ingesleten in de bankstrategie.
IK HEB HET gehad met de onwaarheden in Europa over de niet-westerse inwijking en de werkelijkheid van de islam.
‘t Gebeurde in Boekhandel De Zondvloed in het aartsbisschoppelijke Mechelen. De naam van de doopvont is symbolisch. De islam is een zondvloed tegen de waarden van de Verlichting, de grondslagen van het huidige Europa. “De islam, kritische essays over een politieke religie”, van samenstellers Wim en Sam van Rooy, vader en zoon, is er van in november 2010. Op zijn Vlaams, dus achterbaks, met angstdiarree en schijnheilig, is de kans groot dat “De islam” weggefoefeld zal worden want de meningen van de 30 schrijvers in hun 34 essays over de islam zijn strijdlustig. Standaard Boekhandel biedt het werk wel aan in al zijn winkels, ook de papierwarenboetieks in de provinciesteden en grootdorpen. Je kan niet naast het superpamflet kijken. Met een knots van 784 bladzijden klop je een kalief van een Arabische hengst. De grootste vaststelling van de samenstellers en de auteurs is: verbijstering. Met name verbijstering over de gretigheid waarmee de linkse kerk, die dus onbestaande is, dixit Jan Blommaert, _ de falanx van mei ’68 met haar open of verdoken medestanders bij VRT, VTM, de kranten, de weekbladen, de blogs _ de onderdrukkende, antimoderne islam omarmt. Wim van Rooy zegt: “Allicht komen sommige postmoderne verlangens overeen met de naïeve dromen van dertig jaar geleden: zoals progressieven ooit hoopten op een zogenaamd eurocommunisme, zo duimen westerse linkse fellowtravellers vandaag voor een euro-islam. Maar net zoals het communisme haaks stond op de waarden van het Westen, zo kan ook de islam, die zoals elk ander stelsel een onwrikbare essentie heeft, nooit in overeenstemming zijn met de liberale rechtsorde. Anders dan de politiek correcte intellectuelen die de islam omarmen met dezelfde kracht waarmee zij ooit het katholicisme bekampten, zijn de auteurs van “De Islam” geen dhimmi’s (nvdr. niet-moslims die de islam ondergaan, dulden, verdragen) maar rationele onderzoekers met een open geest.”
In 2008 scherpt Wim van Rooy de eerste maal de pen tegen de islam in “De Malaise van de Multiculturaliteit” (Acco). Een langgerekte woedekreet én een uitbarsting van slimheid tegen dat extreme theïsme uit de woestijn van Arabië. Van Rooy verwijt bladzijdenlang, met uitvoerige citaten van moslims die in het verzet staan tegen hun geloofsgenoten of ex-geloofsgenoten, zijn linkse broeders en zusters dat zij mak en onintellectueel een achterlijke godsdienstleer tolereren tot promoveren. Een godsdienst die niet enkel religie is maar mensen van wieg tot graf wikkelt in wetten, gebruiken en voorschriften op seksueel, politiek, economisch, sociaal vlak. De islam heeft autoritaire tot totalitaire kenmerken en staat haaks, aldus van Rooy in 2008, op wat de Verlichting ons na eeuwen strijd tegen de kroon, de papen en de feodalen gebracht heeft. “De Malaise van de Multiculturaliteit” leeft na twee jaar halvelings verder onder de toog en blijft een samizdat-geschrift ondanks zijn derde oplage en 3000 verkochte exemplaren. In de ogen van politiek correct is het een vuil boekske dat verdiende/verdient “ausgerottet” te worden. Het heeft wel Benno Barnard en Geert van Istendael mee overtuigd dat van Rooy gelijk heeft en alle steun van progressieven dik verdient.
“De Islam” is anders getoonzet en gecomponeerd dan “Deutschland schafft sich ab” van de socialistische ex-Bundesbankbestuurder Thilo Sarrazin (1 miljoen exemplaren verkocht, een veertiende uitgave ligt in de boekhandel), maar de kern is dezelfde: de islam is een religie van stilstand, van onderworpenheid, van afkeer van dar al-harb (huis van de oorlog, uw en mijn wereld). Koppel deze vaststelling aan de demografische impact van moslims in Duitsland (of België), aan de slome tot afgewezen coëxistentie bij moslims hier, aan hun zwakke prestaties op wetenschappelijk gebied. Harvard publiceert jaarlijks even veel wetenschappelijke teksten, rond 14.000, als de Arabische wereld. De enige Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde van het moslimse Midden-Oosten is de jood Claude Cohen-Tannoudji (1997), die zijn carrière opbouwde in Frankrijk. De bundel van de Van Rooy’s etaleert dat de islam in anderhalf millennium nergens Verlichting bracht, op elke cultuur parasiteerde en die ten slotte volledig of gedeeltelijk verwoestte.
Voka en andere vriendelijke werkgeversverenigingen die uit overtuiging, uit sociale schrik, uit een langgerekte aanval van politiek correctheid leuke woorden spreken over de diversiteit (codetaal voor niet-westerse immigratie), zouden zich beter inspireren op staten die deskundiger omspringen met inwijking: de VS, Canada, Denemarken, en over kort Nederland, om slechts vier voorbeelden aan te halen. Kan het niet in België, en zo ziet het ernaar uit, begin dan in Vlaanderen.
Wat werkgevers zeker ter harte moeten nemen, is de volslagen afwezigheid in België van zinnige studies over de kosten van de niet-westerse inwijking. In Nederland is er dankzij het doctoraat van Jan van de Beek, verdedigd in de lente 2010 aan de Universiteit van Amsterdam, een antwoord voor de even grote lacune aldaar. “De productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005″, is een lange en taaie aanklacht tegen de moral reading van de migratie. Moral reading is de geneigdheid om cijfers en kennis vooral te beoordelen op hun sociale en politieke gevolgen. Vandaar een overdaad aan politologen die schrijven over de inwijking en de zelfgekozen, want veiliger, onthouding van de economen. Ontbrak het de economen, hier en rond de Moerdijk, aan statistische gegevens of is politieke correctheid het antwoord? Het eerste speelde een rol, het tweede is de kern van het antwoord van dr. Van de Beek. Het onderbuikgevoel dat allochtonen de maatschappij meer kosten dan autochtone Belgen/Nederlanders zou wel eens kunnen waar zijn. De neiging van elites, en we zitten op te veel plekken in Vlaanderen nog opgescheept met vrienden van mei ’68, om het volk te beschermen tegen gevaarlijke kennis, is evident. Dat geldt ook voor de problematiek van de transfers tussen noord en zuid in België en speelt een rol bij de bekvechterij over de herijking van de financieringswet. De roep om solidariteit en diversiteit mag nooit een reden zijn om iets niet te onderzoeken.
Zijn er dus geen brave, sympathieke moslims hier en elders? Uiteraard, maar dat argument is prietpraat. In 1929 had de nazipartij 178.000 leden, 0,25 procent van de Duitsers. Een zwijgende meerderheid is klei in de handen van elke gemotiveerde en gefrustreerde voorhoede.
IK HEB HET gehad met de onkunde, het onbegrip over het conservatisme in Vlaanderen.
We hoeven ons niet te verontschuldigen, te verdedigen, te verloochenen. Toch wil ik voor zover nodig in deze kringen beklemtonen dat conservatief niet het contrast is van progressief, wel van revolutionair. Een mooi, vrij recent en aanbevelingswaardig boek, “Conservatieve Vooruitgang”, van de knappe jonge Nederlandse intellectuelen, Thierry Baudet en Michiel Visser, zegt terecht dat conservatisme de keuze is voor een bepaalde methode van voortgaan in de tijd, een type progressie: niet met grote sprongen, maar stapje voor stapje. Waarom? Vanuit de scepsis voor utopische projecten die al zo vaak in de geschiedenis zijn uitgemond in verschrikkingen.
In die trant pleit ik voor het herontdekken en consacreren van de inzichten van de conservatieve Duitse econoom Wilhelm Röpke (1899-1966). Hij zocht naar alternatieven voor enerzijds de woekeringen van de bureaucratische verzorgingsstaat en anderzijds het ongebreidelde laissez-faire-kapitalisme dat roofbouw pleegt op de sociale en politieke cohesie. Ik was jaren geleden een van de gangmakers van het debat over de verankering van Vlaamse en Belgische bedrijven in de periode dat Suez en andere Franse multinationals met steun van Franstalig België hier de ene na de andere sleutelonderneming kwamen opkopen. De problemen vandaag met de nucleaire rente van Electrabel hebben alles te maken met de rol van kassa-koe van deze energiemaatschappij voor haar Franse aandeelhouders, de halve staatskapitalisten van Suez GDF (Gaz de France). Wilhelm Röpke was de inspirator van Konrad Adeanauer en Ludwigh Erhard die West-Duitsland na 1945 weer op de been hebben geholpen met hun Sociale Markteconomie of wat later gedoopt werd het Rijnlandmodel. Het belang van de menselijke maat is de kern van Röpkes denken. In zijn boek Internationale Ordnung van 1945 liet Röpke de sociologische en maatschappelijke keerzijde zien van de economische wetenschap. En sedert de financiële en maatschappelijke crisis van 2008-2009 is dat boek nog profetischer dan voordien. Het ideaal van Röpke was de geordende, open “civel society”, waarin zowel de bourgeois _ de handel drijvende burger _ als de citoyen _ de maatschappelijk-politiek actieve burger _ een plaats heeft.
Röpke betreurde het uiteendrijven van de bourgeois en de citoyen. David Cameron, de conservatieve premier van Groot-Brittannië en de goede vriend van de conservatieve Vlaamse partijleider Bart De Wever, reageerde op de misbegrepen en uit haar verband gerukte uitspraak van Margareth Thatcher “There is no such thing as society”, met de mooie boutade, “There is such a thing as society, it’s just not the same as the state”. Cameron is een Röpkiaan. De Duitser heeft ook de juiste en door mij volledig gedeelde visie op de Europese Unie. Hij verzet zich tegen de cultus van het kolossale en de verafgoding van de politieke en economische “Vermassung” en schaalvergroting. De wezenlijke karakteristiek van Europa, waar wij het hier vandaag keer op keer over hebben, is juist decentralisatie en eenheid in verscheidenheid. Maar wat krijgen wij ook weer in de jongste dagen op ons bord? Een centraal blok met een planachtige bureaucratie en precies de “Vermassung” van het economisch beleid vanuit één punt, de eurokratenstad Brussel. Weg daarmee. Laten wij als conservatieven geleidelijk, onbrutaal, onautoritair toeleven naar een Europa dat ooit een samenhangende Verenigde Staten kan worden, maar zonder die te verafgoden of utopisch te bruskeren.
Mijn slot is dubbel:
Ik pleit voor politieke stappen: Fase 1 is Vlaamse onafhankelijkheid, Fase II is een Confederatie van de Lage Landen, Fase III is een Rijnbond van Duitsland, Nederland en Vlaanderen, en Fase IV is een archipel van substructuren à la een Rijnbond binnen een Europese Gemeenschap van de Atlantische Oceaan tot de Oeral.
Ik pleit om die fases intellectueel te ondersteunen door: klassieker middelbaar en hoger onderwijs, afremming en omkering van de niet-westerse immigratie en het herstel van een door christelijke en conservatieve idealen doordesemde Europese Leitkultur.
00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Belgicana | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benelux, allemagne, pays-bas, flandre, europe, affaires européennes, politique internationale, belgique, belgicana |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 avril 2011
Wie Nordafrikas Kriege und Krisen nun Europas Problem werden
Wie Nordafrikas Kriege und Krisen nun Europas Problem werden
Eva Herman
Dass sich in Nordafrika und der arabischen Welt grandiose Flüchtlingskrisen abzeichnen, hat sich bereits herumgesprochen. Dass Italien dabei derzeit eine Schlüsselrolle zukommt, die niemand dem Land gerne abnehmen möchte, will auch niemand leugnen. Die kleine italienische Flüchtlingsinsel Lampedusa, die im Mittelmehr zwischen Tunesien und Sizilien liegt, erzählt täglich aufs Neue grässliche Geschichten von Elend, Not, Angst und Sorge vor der Zukunft. Bisher schauen die Nachbarländer mit wohligem Grausen dem Treiben zu: Täglich landen neue Boote mit Hunderten Flüchtlingen. In Italien – und nicht etwa bei ihnen, in Frankreich, Österreich, der Schweiz oder in Deutschland. Italien ist weit. Noch.

00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tunisie, egypte, libye, monde arabe, monde arabo-musulman, afrique, afrique du nord, affaires africaines, europe, affaires européennes, géopolitique, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
MINERVE: communiqué sur la guerre en Libye
M. I. N. E. R. V. E.
7, Rempart St. Thiébault –F 57000 METZ
Mars 2011
Communiqué sur la guerre en Libye :
En tant qu’association pour la promotion de l’intégration européenne, MINERVE a exprimé sa satisfaction quand à la signature et à la ratification du Traité de Lisbonne, pas décisif du fait qu’il structure l’Union européenne, déjà première puissance économique et commerciale du monde, pour en faire une puissance politique et diplomatique capable d’imposer ses intérêts sur la scène internationale en parlant d’une voix unique commune à tous ses Etats membres.C’est une raison de plus pour MINERVE d’estimer particulièrement déplorable que la France, la Grande Bretagne et d’autres états membres de l’Union européenne qui les appuient aient décider d’agir militairement en Libye pour leur propre compte . Non seulement cette action belliqueuse n’est pas justifiable en droit international, étant qu’il s’agit d’une ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat souverain qui, par ailleurs, ne les menaçait ni elles mêmes, ni quelque autre Etat de l’Union européenne, mais encore et surtout qu’elle ne prend pas en considération les dispositions du Traité de Lisbonne relatives à la politique extérieure et de défense. En effet le Traité de Lisbonne précise qu’en ce qui concerne les décisions de politique extérieure et de défense, la neutralité de certains Etats membres ne saurait être mise en question et qu’en conséquence l’unanimité doit être la règle. L’action militaire unilatérale de la France, de la Grande Bretagne et d’autres Etats membres porte atteinte à la cohésion de l’Union européenne en tant que grande puissance diplomatique unique, constitue un préjudice aux intérêts et aux valeurs des peuples européens unis dans l’Union européenne et ne peut que favoriser les menées des soi-disants « eurosceptiques » qui ne se sont jamais résignés à accepter le processus de l’intégration européenne.
M I N E R V E FRA N C E : KEIL Robert 2, rue Paul Ferry F 57 000 METZ
00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, libye |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 avril 2011
Une étude universitaire sur François Duprat
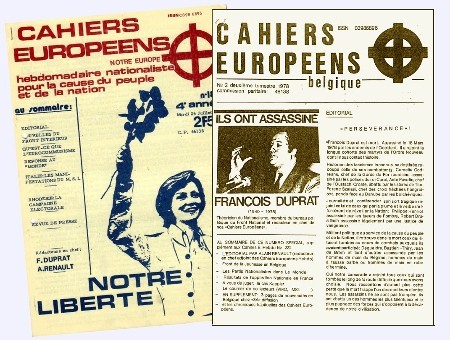
Une étude universitaire sur François Duprat
 Ci-joint l'URL d'une étude universitaire récente sur la figure de François Duprat, rénovateur audacieux du corpus doctrinal du néo-nationalisme français, avant l'avènement de J. M. Le Pen.
Ci-joint l'URL d'une étude universitaire récente sur la figure de François Duprat, rénovateur audacieux du corpus doctrinal du néo-nationalisme français, avant l'avènement de J. M. Le Pen.
Rappelons-nous que François Duprat, dans ses "Cahiers Européens" recensait chaque semaine les événements du "camp nationaliste" dans toute l'Europe (et aussi en dehors de notre sous-continent). Ce travail était énorme, inimaginable pour un seul homme à l'époque où l'informatique était inexistante dans le quotidien. Songeons aussi, du moins pour ceux qui l'ont connu, à son correspondant en Wallonie, Alain Derriks, qui a choisi une mort volontaire en 1987. Derriks avait assisté à ses obsèques. La mort de Duprat l'avait bouleversé.
Les "Cahiers" de Duprat, et les pages consacrées aux mouvements nationalistes dans les colonnes de "Nation Europa" (Coburg, Allemagne) et DESG-Inform (Hamburg, Allemagne) sont les véritables sources documentaires directes pour ceux qui voudraient entreprendre une étude approfondie de cet univers politique, en marge des grands partis et courants de la politique politicienne.
Cette étude, comme toutes les études de ce genre, est à prendre avec les pincettes habituelles, la malveillance gratuite n'étant jamais loin dans ce genre d'entreprise qui multiplie souvent les "omissions" dans l'analyse des textes.
A lire, avec circonspection:

00:09 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, françois duprat, france, nationalisme, nationalisme européen, nationalisme français, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 avril 2011
Türkei von EU-Reife meilenweit entfernt...

Spezialinformation: Türkei von EU-Reife meilenweit entfernt – „EU-Fortschrittsberichte“ entpuppen sich regelmäßig als Mängelberichte
Seit neun Jahren gibt die regierende Partei Erdogans, die AKP, in der Türkei rigide den Takt vor und die politische Stabilität ging Hand in Hand mit wirtschaftlichem Aufschwung. Erdogan und seiner Partei wird der alleinige Verdienst des Absenkens der Inflation von 77 Prozent im Krisenjahr 2001 auf knapp fünf Prozent Anfang dieses Jahres zugeschrieben – nicht dem Internationale Währungsfonds (IWF) der damals als Retter eingriff und auch nicht den Milliarden, welche von der EU seit Jahren an den Bosporus fließen (allein 1996-2005 waren es 1,3 Milliarden).
Türken wollen gar nicht zur EU
Jüngsten Umfragen zufolge glauben nur noch 35 Prozent der Türken an einen EU-Beitritt, 60 Prozent der Befragten lehnten einen Beitritt gar dezidiert ab.
Als Grund für die festgefahrenen Verhandlungen und mangelnde Fortschritte sehen die Türken jedoch nicht die mangelnden tatsächlich umgesetzten Reformen, sondern Frankreich und Deutschland werden als „Verhinderer“ wahrgenommen. Für türkische Experten liegt die Ursache im „Tiefpunkt der deutsch-türkischen Beziehungen“ und der „grassierenden Turkophobie“
Bestenfalls symbolische Fortschritte der Türkei
Und weil unter Erdogan zwar viele symbolische Gesten und Bekundungen des guten Willens erfolgten, jedoch Reformen oft ohne konkrete Umsetzung verblieben, rücken die Aussichten auf einen EU-Beitritt von Tag zu Tag in immer unerreichbarere Ferne. Damit wiederum werden notwendige Gesetzesänderungen erst recht vor sich hergeschoben und kehren alte, autoritäre Gewohnheiten im Justiz- und Polizeiapparat zurück. Dann zeigt sich die EU wieder „besorgt über eine hohe Zahl von Berichten über Folter und Missbrauch außerhalb offizieller Hafteinrichtungen in der Türkei“.
Als im jüngsten „Fortschrittsbericht“ der EU (aus dem klar ersichtlich ist, dass die Verhandlungen eigentlich feststecken) die Mängel aufgezählt und einige mit – für EU-Verhältnisse – recht deutlichen Worten ausgedrückt wurden, da ging der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan auf die Autoren des EU-Berichts los. Es gäbe keine „Ausgewogenheit“ im Bericht, ja dieser sei überhaupt „auf Bestellung“ von Gegnern der Türkei verfasst worden.
Selbst bei hartnäckigen Türkei-Lobbyisten scheint sich angesichts soviel Ignoranz langsam die Einsicht durchzusetzen, dass es der Türkei an einem grundlegenden Verständnis der Menschenrechte, der Pressefreiheit, der Religionsfreiheit, der Minderheitenrechte und auch Rechte der Frau mangelt. Im Gegensatz zur dem was Ankara glaubt, kann die EU der Türkei innerhalb der Beitrittsverhandlungen nur minimal entgegenkommen, denn die Voraussetzungen sind in den Kopenhagener Kriterien genau fixiert und diese stellen nun einmal keine Verhandlungsbasis dar. Es zeigt sich also nun genau das, was Kritiker von Anbeginn gesagt haben: die Türkei ist weder historisch noch kulturell ein Teil Europas.
Kritische Journalisten werden mundtot gemacht
Nach wie vor ist die Meinungsfreiheit erheblich eingeschränkt, wobei die kürzlich erfolgte Journalisten-Verhaftung wegen angeblicher Mitgliedschaft im Ergenekon-Geheimbund nur die Spitze des Eisbergs ist. Absurderweise wurden dabei ausgerechnet zwei namhafte Autoren verhaftet, die entscheidend zur Aufdeckung von Ergenekon beigetragen haben. Beide brachten deutlich zum Ausdruck, dass sie den Prozess richtig finden, wagten es aber auch, die Regierung zu kritisieren. Ahmet Sik etwa thematisierte Menschenrechtsverletzungen innerhalb des militärischen Sicherheitsapparats und kritisierte, dass die Ergenekon-Anklageschriften zum Teil dilettantisch formuliert seien und viel zu viele Verdächtige in Haft sind. Nedim Sener, der den Mord am armenischen Journalisten Hrant Dink recherchierte, zog das Fazit, dass viele Hintermänner des Attentats von staatlicher Seite gedeckt wurden.
Selbst die Europäische Union kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass mit dem Putschvorwurf kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden sollen. Schon Anfang des Vorjahres beklagte zudem die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), dass die Türkei fast 4.000 Internetseiten aus „willkürlichen und politischen Gründen“ blockiert und dass das türkische Internet-Gesetz keine freie Meinungsäußerung zulasse. Das türkische Strafrecht bietet genügend Gummiparagraphen, um Journalisten zum Schweigen zu bringen. Einmal ist es die Herabwürdigung des Türkentums, und ein anderes Mal ist es die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Und auch Premier Erdogan hat erkannt, welch geeignetes Instrument das Strafrecht ist, um gegen kritische Medien vorzugehen. Kein Wunder also, das Türkei bezüglich der Pressefreiheit in der Rangliste der Organisation Reporter ohne Grenzen auf Rang 138 von 178 Staaten liegt. Die Journalisten-Verhaftungen rücken den türkischen Demokratisierungsprozess – und gerade in diesem Bereich sieht die Türkei sich gerne als Vorbild für die arabische Welt – jedenfalls in ein zweifelhaftes Licht. Die türkische Regierung beeilte sich, auf Distanz zur Staatsanwaltschaft zu gehen. Erdogan meinte gar, er als Politiker, der selbst wegen der öffentlichen Verlesung eines Gedichts im Gefängnis gesessen habe, werde „die Meinungsfreiheit bis zum Ende verteidigen“. Das klingt großspurig von einem Mann, der Kritiker nur allzu rasch mit Verleumdungsklagen zum Schweigen bringt. Bei 60 Journalisten die derzeit in Haft sind, 2.000 die in Gerichtsverfahren stehen und 4.000 gegen die Ermittlungen laufen, gäbe es viel für ihn zu tun – wenn er es nur wirklich ernst meinte…
Ergenekon: Schuss ging nach hinten los
Zu Beginn galt der sogenannte Ergenekon-Prozess, bei dem die Justiz erstmals gegen hochrangige Militärs wegen angeblicher Putschpläne vorging, als Zeichen dafür, dass die Türkei „auf dem richtigen Weg“ ist. In der Vergangenheit wurden vorwiegend Militärs und Akademiker unter Ergenekon-Verdacht verhaftet. Ins Visier der Ermittler rückten in jüngster Zeit aber auch Medienvertreter. Die Staatsanwaltschaft wies den Vorwurf zurück, die Festnahmen würden die Pressefreiheit antasten und erließ fast im gleichen Atemzug Haftbefehle gegen Mitarbeiter einer regierungskritischen Internetseite.
Weder Religionsfreiheit noch Minderheitenschutz
Auch hat sich an der Diskriminierung ethnischer und religiöser Minderheiten wie Kurden und Christen nichts geändert. Heuchlerisch vorwirft Erdogan europäischen Staaten „Islamophobie“ vor, obgleich Muslime ihre Religion frei ausüben können – ganz im Gegensatz zu Christen in der Türkei, die Enteignung des Klosters Mor Gabriel bezeugt dies einmal mehr.
Von dem für einen EU-Beitritt nötigen Grundwerte-Schutz wie Minderheitenschutz und Religionsfreiheit ist die Türkei meilenweit entfernt. Jährlich sollen mehrere hundert Muslime in der Türkei zum Christentum übertreten. Dennoch ist es der christlichen Gemeinschaft nach wie vor nicht erlaubt, ihre Geistlichen auszubilden und Unterricht in der Sprache der Minderheiten zu erteilen. Nach wie vor fehlt es den christlichen Kirchen an einem gesicherten Rechtsstatus und bleiben Nicht-Muslimen Jobs als Beamte verwehrt. Bestenfalls gibt es symbolische Fortschritte im Bereich Religionsfreiheit und Minderheitenschutz. Die Regierung Erdogans rühmte sich beispielsweise lange Zeit, einen politischen Dialog mit den Kurden eröffnet zu haben, aber auch diese Initiative verlief im Sand – ähnlich wie jene zur Normalisierung mit Armenien und zur Religionsfreiheit. Für das Land am Bosporus ist auch der im Fortschrittsbericht enthaltene Hinweis auf die ausstehende Unterzeichnung und Ratifizierung des „Rahmenabkommens zum Schutz nationaler Minderheiten“ des Europarats aus dem Jahr 1995 peinlich.
Enteignung des Klosters Mor Gabriel
Nach jahrelangem Rechtsstreit sollen dem Kloster Mor Gabriel, eines der ältesten Klöster der Christenheit, große Teile seines Grunds entzogen werden. Dabei wird gegen Religionen bzw. Minderheiten vorgegangen und etwa behauptet, dass mit dem landwirtschaftlichen Ertrag der Grundstücke antitürkische Aktivitäten finanziert würden. Weitere Rechtsstreitigkeiten stehen noch an, etwa einen Prozess über ein Waldstück, das über viele Jahre nach dem Exodus unzähliger syrisch-orthodoxer Christen, nicht mehr bewirtschaftet wurde.
Knackpunkt Zypernstreit
Verhältnismäßig deutlich brachte das Europäische Parlament im Zuge des jüngsten Fortschrittsberichts zum Ausdruck, dass die Türkei sich im Zypern-Streit sperre. Seit fünf Jahren ratifiziert die Türkei das sogenannte Ankara-Protokoll nicht, das die Öffnung der See- und Flughäfen in der Türkei für die Republik Zypern vorsieht. Gefordert werden zudem der Abzug türkischer Truppen aus Zypern und ein Stopp der Neuansiedelung türkischer Bürger im besetzten Nordteil. Die Türkei hingegen beharrt auf dem Standpunkt, dass die EU erst die zugesagte Beendigung der Isolation des von Türken bewohnten Nordens der Insel umsetzen müsse. Ein entsprechender EU-Beschluss aus dem Jahr 2004 wurde noch nicht umgesetzt. Gerade diese starre türkische Haltung führt aber dazu, dass viele Verhandlungskapitel eingefroren wurden. Warum überhaupt jemals Beitrittsgespräche mit einem Land aufgenommen wurden, das Teile des Territoriums eines EU-Mitgliedsstaates besetzt hält, bleibt unverständlich.
Türkische AKWs in Erdbeben-Gebiet
Wie unbelehrbar die türkische Regierung ist, zeigt sich auch an ihrem Festhalten an den Atomplänen. Obgleich das Beispiel Japan gezeigt hat, dass es keine Garantien hinsichtlich der Sicherheit von AKWs gibt, will die Türkei, eines der erdbebengefährdetsten Länder der Erde, den steigenden Energiebedarf mit neuen Atomkraftwerken decken.
Streit um Visafreiheit für Rückübernahmeabkommen
Jährlich nutzen mehrere zehntausend illegale Einwanderer die Türkei als Transitland. Das Rückführungsabkommen mit der Türkei wird daher aus europäischer Sicht als wichtiger Schritt bei der Bewältigung der Migrationsströme in die EU erachtet. Im Gegenzug dafür, dass künftig wer illegal über die Türkei in die EU einreist wieder dorthin zurück geschickt werden kann, verlangt Ankara Gespräche über visafreie Einreise von Türken. Hinsichtlich der Visaerleichterungen pocht der türkische Außenminister auf eine Gleichbehandlung mit den Balkanstaaten und Russland.
Gerade mit den Balkanstaaten haben einige EU-Länder jedoch schlechte Erfahrungen gemacht. Nach den Visa-Erleichterungen für Bosnien-Herzegovina, Serbien, Mazedonien oder Albanien wurde en gros versucht, die neue Reisefreiheit zu nutzen, um – statt der vorgesehenen drei Monate – dauerhaft im Land zu bleiben. Reisebüros spezialisierten darauf und einzelne Asylantragsstellen wurden gestürmt, obgleich gar kein Asylgrund vorliegt. Gebracht haben die Visa-Erleichterungen aber auch unzählige Roma, die es in die Staaten mit gut ausgebautem Sozialsystem zog. Das nährt natürlich die Befürchtung, dass ganze Heerscharen an Türken die neue Reisefreiheit nutzen werden, um dauerhaft im Unionsgebiet zu verbleiben.
Während das Europäische Parlament bekräftigt, dass erst nach einer tatsächlichen Umsetzung des Rückübernahmeabkommens über die Visafrage diskutiert werden kann und sich damit auf die Seite der skeptischen EU-Staaten schlägt, ist die Europäische Kommission der Ansicht, eine Visumpflicht könne ja jederzeit wieder eingeführt werden, wenn die Türkei es nicht schafft, illegale Migration ihrer Landsleute einzudämmen. Die zuständige Kommissarin Malmström will die Visafreiheit der Türken forcieren.
AKP will Auslandstürken einfangen
Von den gut fünf Millionen im Ausland lebenden Türken sind etwa drei Millionen wahlberechtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Mehrheit der Auslandstürken konservativ, also potentielle AKP-Wähler sind. Angesichts der im Juni 2011 bevorstehenden Wahlen versuchte die Erdogan-Regierung Auslandstürken die Stimmabgabe per Brief, Email zu ermöglichen, um dieses beachtliche Wählerpotential für die AKP auszuschöpfen.
Ein entsprechendes Gesetz wurde vom Türkischen Verfassungsgericht 2008 annulliert und die Wahlbehörde winkte nun hinsichtlich der Stimmabgabe an den türkischen Botschaften und Konsulaten ab, da nicht mehr genügend Zeit bliebe, bis zum Wahltermin die technischen und sicherheitsrelevanten Vorkehrungen zu treffen.
Ein Türke wird sich immer als Türke fühlen
Wie stark das Nationalbewusstsein der Türken ausgeprägt ist und wie dieses seitens des Heimatlandes bei ausgewanderten Landsleuten immer wieder geschürt wird, zeigt sich darin, dass Premierminister
Erdogan und hochrangige Vertreter der Türkei den türkischen Migranten im Ausland regelmäßig zurufen, sie sollen, ja müssten gar Türken bleiben. Im Februar 2008 bezeichnete Erdogan bei einem Deutschlandbesuch eine allfällige Assimilierung von Auslandstürken gar als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, um im Februar 2011, bei seinem nächsten Besuch, dem Türkischlernen absoluten Vorrang gegenüber dem Deutschlernen einzuräumen. Als schließlich der türkische Integrationsberater meinte, in der Türkei zu absolvierende Deutschkurse werden in der Türkei als Provokation aufgefasst, sah er sich – wohl zu seiner Verwunderung – von einigen Widerspruch aus Österreich konfrontiert.
Es braucht wohl nicht extra betont zu werden, dass alle Integrationsbemühungen eines Landes torpediert werden, wenn Zuwanderer seitens ihres Heimatlandes darin bestärkt werden, ja nicht zu viel Integrationsbereitschaft an den Tag zu legen und die Sprache des Gastlandes als zweitrangig anzusehen. Mit Sprachkursen würde die türkische Regierung migrationswilligen Türken bessere Chancen eröffnen. Aber
daran ist man gar nicht interessiert. Institutionen wie das eigene Amt für Auslandstürken oder das Religionsamt sollen – ebenso wie die Aussagen Erdogans bei seinen Deutschlandbesuchen – Einfluss auf Auslandstürken ermöglichen.
Türkischer OSZE-Generalsekretär?
Mit einem eigenen Kandidaten wollte Ankara die Wahl der früheren ÖVP-Außenministerin Ursula Plassnik zur OSZE-Generalsekretärin zu verhindern. Wenn ein Türke OSZE-Generalsekretär werden sollte, hieße dies, den Bock zum Gärtner machen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist der Friedenssicherung wie auch der Achtung der Menschenrechte verpflichtet.
Ein Generalsekretär aus einem Land, das in den vergangenen Jahren immer wieder Luftangriffe gegen kurdische Stellungen im Nordirak geflogen hat, diskriminiert ethnische und religiöse Minderheiten im eigenen Land systematisch, missachtet grundlegende Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit und lässt zu, dass im 21. Jahrhundert Frauen immer noch als rechtlose Menschen zweiter Klasse gelten, wäre eine Verhöhnung europäischer Werte.
Abbruch der Beitrittsgespräche längst überfällig
Mit reinen Absichtsbekundungen wird sich die EU wohl nicht länger abspeisen lassen. Wie genau sich die Europäische Union die Anklageschrift gegen die Journalisten und die Urteile rund um die Klosterenteignung anschauen wird und ob dann gegebenenfalls der Ton gegenüber der türkischen Regierung verschärft wird, bleibt abzuwarten. Für die Europäische Union steht mit der systematischen Missachtung der Presse- und Religionsfreiheit in der Türkei die Glaubwürdigkeit der EU als sogenannter Wertegemeinschaft auf dem Spiel.
Kein Verständnis darf für Erdogans Gleichsetzung von Islamophobie und Antisemitismus gelten. Hier werden zwei Dinge in Verbindung gebracht, die miteinander absolut nichts zu tun haben. Außerdem ist Erdogan gut beraten, zuerst einmal in der Türkei die systematische Diskriminierung der christlichen Konfessionen zu beenden, bevor er in Europa den Moralapostel in Sachen Religionsfreiheit spielt. Und wenn Erdogan angesichts der Toten unter den Uiguren nach Protesten in China 2009 von „Völkermord am uigurischen Brudervolk“ spricht, dann sollte in der Türkei zunächst der Völkermord an den Armeniern aufgearbeitet werden. Nicht zuletzt wäre es an der Zeit, dass sich die EU-Staaten die Einmischung der türkischen Regierung in innerstaatliche Angelegenheiten wie Integration der Auslandstürken verbieten. An eine Lösung des Zypernkonflikts mag wohl keiner mehr glauben.
Entgegen aller Lippenbekenntnisse treibt die Erdogan-Regierung die Islamisierung voran. Wenn Erdogan sogar von einer „islamischen Union“ träumt, muss man ernsthaft fragen, warum die EU die Beitrittsverhandlungen mit Ankara überhaupt fortsetzt. Sinnvoller wäre ein sofortiger Abbruch der Beitrittsverhandlungen und die Aufnahme von Gesprächen über die Bildung einer privilegierten Partnerschaft. Schließlich beweist die Türkei ihre EU-Unreife stets aufs Neue.
![]()
00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, politique internationale, turquie, proche orient, asie mineure, asie, affaires asiatiques, europe, affaires européennes, union européenne, adhésion turque, andreas mölzer, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 14 avril 2011
Die Mafia im Kosovo
Die Mafia im Kosovo: Warum die USA und ihre Verbündeten das Organisierte Verbrechen ignorierten
Matt McAllester / Jovo Martinovic
Im Herbst des Jahres 2000, etwas mehr als ein Jahr nach dem Ende des Kosovo-Krieges, legten zwei Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes der NATO den ersten bekannt gewordenen Bericht über die dortige organisierte Kriminalität (OK) vor. Darin erklärten sie, der frühere politische Führer der Befreiungsarmee des Kosovo (UÇK) Hashim Thaci verfüge »über Einfluss auf die lokalen Strukturen der organisierten Kriminalität, die [einen] Großteil des Kosovo kontrollieren«.

00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : criminalité, albanie, kosovo, balkans, ex-yougoslavie, europe, affaires européennes, politique internationale, otan, atlantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



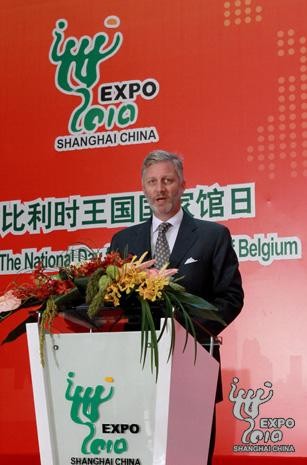 Dans le contexte épineux de la déréglementation européenne du transport ferroviaire, les Belges lancent un projet que plus d'un pourrait qualifier de « fou »! Il s'agit simplement d'une liaison ferroviaire entre le port d'Anvers et la ville de Chongqing en Chine, destinée au transport de fret. Ce projet a été instigué en 2010 lors d'une mission économique de la Société de développement de la province d'Anvers à Chongqing. Figuraient également dans cette mission, les représentants du port d'Anvers et de l'Administration belge des Douanes et Accises.
Dans le contexte épineux de la déréglementation européenne du transport ferroviaire, les Belges lancent un projet que plus d'un pourrait qualifier de « fou »! Il s'agit simplement d'une liaison ferroviaire entre le port d'Anvers et la ville de Chongqing en Chine, destinée au transport de fret. Ce projet a été instigué en 2010 lors d'une mission économique de la Société de développement de la province d'Anvers à Chongqing. Figuraient également dans cette mission, les représentants du port d'Anvers et de l'Administration belge des Douanes et Accises.