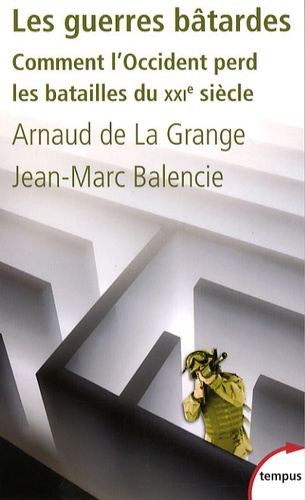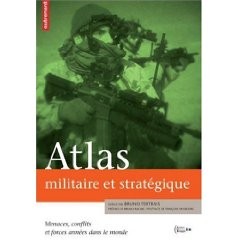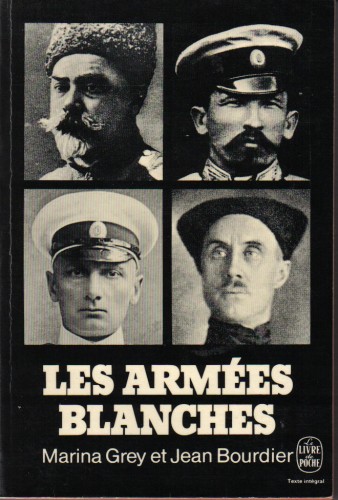| + In memoriam Aita Teodoro Garralda Goyena (Ochagavía, Valle de Salazar, Navarra), Ama María Luisa Arizcun Zozaya (Errazu, Valle de Baztán, Navarra). Sumario: 1. Introducción 2. La insurrección antinapoleónica de 1808:
2.1. La crisis como marco histórico
2.2. El Dos de Mayo en Madrid
2.3. Llamamiento a las armas y alzamiento general:
- 2.3.1. El Bando de Móstoles
- 2.3.2. Las abdicaciones de Bayona
- 2.3.3. El levantamiento general
- 2.3.4. El aparato organizado
3. Nuevas instituciones y mantenimiento de la legitimidad monárquica: de las Juntas Provinciales a la Regencia.
3.1. Tendencias políticas
3.2. Surgimiento de las Juntas locales y provinciales
3.3. La iniciativa regia de la convocatoria a Cortes
3.4. Surge la Junta Central Suprema
3.5. De la Junta Central a la Regencia
4. El Reino de Navarra:
4.1. Mantenimiento de la Constitución histórica del Reino de Navarra
4.2. Colaboración con los franceses, defensa del Fuero y oposición abierta a Bonaparte:
- 4.2.1. Las proclamaciones
- 4.2.2. Los primeros alzamientos populares
- 4.2.3. La Asamblea de Bayona
- 4.2.4. Expulsión del virrey
- 4.2.5. La Diputación huye a Tudela
4.3. La Diputación y la Junta Central
4.4. ¿Relacionarse con la Junta Central fue un contrafuero?
4.5. Las Cortes generales de Cádiz como contrafuero
4.6. Restauración de la Diputación legítima
5. Colofón 1. Introducción También en nuestros días el conocimiento científico de la Historia tiene una gran actualidad. Interesa a las Humanidades y al pensador profundo, es decir, al “no productor” de bienes económicos. Digamos que este tema interesa al profesional poco valorado (“pero, dígame, ¿Vd. se dedica a esto?”), y poco retribuido (“¿qué intereses esconde Vd.?, porque materialmente no aprecio que los pueda tener”). Interesa a aquella persona cuyos coetáneos paradójicamente tanto necesitan. No obstante, a veces aportar algo con un esfuerzo gratuito y silencioso –que sólo se entiende “por vocación”- casi exige pedir permiso a los conciudadanos, ofrecer gratis la investigación, y aún dar las gracias cuando la sociedad te considera “alguien” a ser tenido en cuenta. Sea lo que fuere, el conocimiento histórico, aparentemente tan “inútil” (y de ahí su salvaguarda), también interesa al periodista, al ámbito del ocio y la cultura de masas (hoy superficial, ocasional y vinculada al entretenimiento) y a la actual política, que sigue buscando símbolos, recuerdos y conmemoraciones, lo que demuestra la coherencia interna y tradicional del hombre. Digo que también interesa al gran público. Hoy, se rememora el pasado con fruición, hasta teatralmente y con torneos medievales durante verano, por ejemplo en el VIII Encuentro Histórico de Artajona (Navarra), y en tantos otros lugares. También los carlistas han solicitado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) permiso para colocar, en la calle Corredera del Cristo nº 11, y en septiembre de 2008, una lápida en recuerdo a Don Manuel María González, el primer alzado por Don Carlos V en 1833. En resumen, digamos que basta conocer lo que hoy se investiga y escribe, visitar las librerías, asistir a universidades de curso reglado o bien de verano, romper la rutina con la cultura transmutada en ocio, y tomar nota de los gestos y actitudes de la actual clase política, y de otros políticos que no forman “clase”… para darse cuenta de la importancia de la Historia como disciplina y conocimiento. En este año de conmemoraciones con ocasión del segundo centenario del alzamiento antinapoleónico de España en 1808, es labor de los historiadores aclarar el marco y los hechos históricos a partir de las fuentes históricas primarias, así como de diferentes aportaciones historiográficas, para poder actualizar aquellas hipótesis no carentes de brillantez, fundamento y originalidad que, a pesar de ser planteadas hace algunas décadas, algunos han dejado -por diversos motivos- caer en el olvido. Ante el carácter simplista de algunas afirmaciones actuales, según las cuales el alzamiento popular antinapoleónico fue sinónimo de vacío de legitimidad, de soberanía nacional según el liberalismo, y expresión natural y espontánea de los principios ideológicos liberales, el trabajo que ahora presentamos va más allá de reafirmar hechos más o menos conocidos. En efecto, en él se analizan las circunstancias de 1808, diversos planteamientos sugerentes sobre la génesis de esta insurrección popular, y las causas del levantamiento antinapoleónico. También se analiza la situación de la legitimidad monárquica en España –y en ella del Reino de Navarra-, y se muestra la tendencia afrancesada como ruptura de la tradición española. Como afirmaba Rodríguez Garraza, todos los historiadores han elogiado la espontaneidad del pueblo español al levantarse unánimemente frente a la invasión de España por Napoleón, y han insistido en el “carácter nacional y tremendamente popular de esta guerra”. Interesa recordar que, además de luchar por la independencia, el pueblo o nación española luchó contra la ideología revolucionaria y antirreligiosa . Los motivos de la sublevación no sólo fueron la defensa de la independencia de los españoles como pueblo organizado, sino también su religiosidad católica, el mantenimiento de la tradición histórica, la afirmación monárquica basada en la legitimidad de origen y de ejercicio, y una dimensión social o populista. Toda esta es una temática muy actual. Por ejemplo, hoy, Aurelio Arteta, teórico y portavoz del partido socialista de Rosa Díez (UPyD) en Navarra, efectúa una crítica a un aspecto (no entro en sus contenidos) de lo que queda de los Fueros de Navarra, remitiéndose a lo que llama legitimidad racional –bandera de enganche muy propia de los liberales de 1812- frente a la legitimidad tradicional (“Diario de Navarra” 28-VIII-2008), ignorando así –entre otras cosas- que la razón y el racionalismo no se identifican. También ignora que hay aspectos de la vida muy razonables que no son producto de la razón teórica, así como la importancia de las costumbres hechas ley, y la misma tradición familiar y comunitaria. Desde luego, eso no significa que los actuales contrincantes liberal-conservadores del sr. Arteta sean verdaderos foralistas, ya que pueden ser todo lo contrario. Advertida la actualidad de este trabajo, digamos que la guerra de 1808 fue -sobre todo- de principios religiosos, sociales y políticos. Por entonces, el pueblo español no era preliberal, ni constitucionalista a la moderna, aunque sí lo fuesen algunas élites (Constituciones de Bayona en 1808 y Cádiz en 1812), herederas de esas otras que -en su día- ocuparon el poder con Carlos III, y que respondían a lo que dijo Sarrailh: “En verdad, nadie habla en España de despotismo o de absolutismo. Los hombres de la minoría ilustrada están convencidos de que viven bajo una monarquía moderada y casi liberal, tanto más cuanto que su rey se llama Carlos III, y sus principales ministros o consejeros son también “filósofos” a su manera” . El pueblo español, en todos sus estamentos sociales, era católico, lo que también afectaba a la política. Era tradicional y no prerrevolucionario. Deseaba conservar la religión de sus antepasados, defender al rey, mantener las instituciones tradicionales así como su independencia de Francia y, allí donde existían, afirmar los Fueros. Los españoles deseaban que el rey fuese la verdadera cabeza jurídica y moral de la monarquía, poseyese la suprema potestas, y no sabían qué era eso de la soberanía nacional. Eran comunitarios y no individualistas, no desamortizadores ni regalistas, ni afectos a otros aspectos del liberalismo, y afirmaban el marco social de la libertad individual. La guerra fue esencialmente popular. Sobre la participación del pueblo, además de los muchos sucesos de “feliz recuerdo”, piénsese en los antecedentes esporádicos y conflictivos de los comuneros y germanías de 1521, la revueltas de 1640, la Guerra de Sucesión (1705-1714), y, sin remontarse tan lejos, en los motines contra Esquilache en 1766 y de Aranjuez en 1808, la guerra contra la Convención francesa (1793-1795), y lo que serán los importantes conflictos posteriores a 1814. En esta aportación quisiéramos dar respuesta, desde el conocimiento histórico, a varias preguntas: 1. ¿Qué significó el príncipe Fernando ante la crisis del despotismo ministerial y cómo llegó a ser rey? 2. ¿Cómo fue el Dos de Mayo en Madrid y los alzamientos posteriores del resto de España hasta mediados de junio de dicho año? 3. Los alzamientos de 1808, ¿fueron organizados y liderados por los llamados antigodoístas, fernandinos, napolitanos o camarilla del Príncipe, o bien debe mantenerse la tesis populista de su absoluta espontaneidad? 4. Estos alzamientos, ¿supusieron en el pueblo una ruptura de la legitimidad por convertirse en soberano, o bien reforzaron las instituciones que regían a los españoles para que, en adelante, aquellas mantuviesen la protesta y la guerra contra Napoleón? Entre los navarros, ¿hubo minorías que aspirasen a un cambio o ruptura revolucionaria en sus instituciones? 5. ¿Se mantuvo la legitimidad monárquica en las instituciones, desde que Fernando VII salió de Madrid en 1808 hasta su regreso a España en 1814? ¿Se mantuvo en el milenario Reino de Navarra, incorporado a Castilla en 1513 y 1515? 6. ¿Cuáles eran las tendencias políticas existentes entre las élites del pueblo español, tradicional en su casi totalidad? Estas páginas son de Historia y están escritas desde una perspectiva científica. Se basan en fuentes bibliográficas y en el análisis de diversas hipótesis, y se continúan en un reciente estudio de mi autoría sobre el profundo afrancesamiento –nada de constitución histórica y de cultura política castiza y a la española para españoles- de la Constitución de Cádiz de 1812 . 2. La insurrección antinapoleónica de 1808 La gran eclosión española contra los franceses ocurrida en Madrid el Dos de Mayo, fracasó y acabó en una dura represión por las tropas francesas. Sin embargo, sus consecuencias inmediatas fueron muy favorables para la España sublevada. El marco histórico y los hechos ocurridos son claros. La complejidad surge cuando se profundiza sobre la espontaneidad o bien la organización del Dos de Mayo y de las insurrecciones posteriores, efectuadas hasta el 15 de junio, así como en el método y modelo que el Dos de Mayo supuso para dichos alzamientos. 2. 1. La crisis como marco histórico Para entender los hechos de 1808-1814 es necesario conocer el marco histórico. El reinado de Carlos IV estuvo marcado por los sucesos revolucionarios de Francia, y por la profunda crisis interna y de política exterior que atravesaba España. La crisis interna afectaba a la política y las ideas, a la hacienda y las finanzas (emisiones de deuda pública, desamortizaciones…) del Gobierno absolutista. El modelo absolutista había culminado en el despotismo ilustrado ministerial. A ello se sumó la crisis económica española, producida por las malas cosechas, y la crisis comercial y manufacturera que, en 1803 y 1804, se reflejó en las series de precios. El estallido político revolucionario ocurrido en Francia con ocasión de la crisis múltiple de subsistencias, la hacienda real, y el absolutismo -que no convocaba Estados Generales desde 1624-, también pudo estallar en España. Ahora bien, ¿por qué la génesis y dinámica del caso francés no se repitió en España con ocasión de las Cortes de 1789 y los sucesos de 1808? Pueden ofrecerse varias explicaciones. Por ejemplo, el pueblo español vivía la religión y sus tradiciones con un gran arraigo. Además, las ideas revolucionarias estaban poco extendidas, el centralismo del modelo absolutista no había cuajado entre los españoles, y se tenía en mente los motines de Esquilache y Aranjuez (en la Francia de 1789 la rebelión de la Fronda quedaba muy lejos). Por otra parte, en España la política se presentaba distinta de gobernar Godoy o bien el príncipe Fernando (VII), existiendo además varias tendencia políticas (conservadores, renovadores e innovadores…) y no sólo la absolutista (continuista) y la revolucionaria (rupturista), formando ambas un falso dualismo, que sin embargo es muy útil para los esquemas de las ideologías liberal y marxista. Por último, todos los españoles se unieron con energía en 1808, como un solo hombre, en lo más básico y universal que les unía, con excepción de las minorías afrancesada y liberal autocalificada patriota. A los liberales españoles les resultaba difícil hacer su revolución, a diferencia del caso francés de 1789, aunque lograron algunos de sus objetivos en 1812, que sólo tuvieron verdadero éxito proyectados a largo plazo. En relación con la historia de las ideas, creencias y mentalidades, en España existían diversas tendencias: algunos enciclopedistas (León de Arroyal, Urquijo, Cabarrús, la primera etapa de Olavide...), otros más o menos rupturistas y afrancesados, y un importante sector ilustrado que –siguiendo un concepto general- no era enciclopedista, ni afrancesado, sino amante de la tradición y religiosidad del país, y de reformas prácticas relativas al urbanismo, los caminos, la enseñanza, una mayor organización etc… Lo he podido comprobar por lo que respecta al Ayuntamiento de Pamplona en el siglo XVIII, en mi tesis doctoral defendida en la Universidad de Navarra (España, 1986). También se encontraba la masa de la población que confiaba en unos dirigentes, por otra parte vinculados a unas concretas estructuras sociales. Sobre unas y otras tendencias, y desde un punto de vista histórico, puede leerse como bibliografía la perenne obra de Menéndez Pelayo (Historia de los heterodoxos españoles), y los estudios de Jean Sarrailh , Richard Herr , Miguel Artola, Carlos Corona Baratech, José Manuel Cuenca Toribio, José Luis Comellas, Federico Suárez Verdeguer, José Andrés-Gallego, Fco. José Fernández de la Cigoña y un largo etc. Aunque, según Menéndez Pelayo, las tensiones entre los españoles comenzaron con la política de Carlos III, Herr precisa que es con la Revolución francesa, y las guerras subsiguientes, cuando se “avivaron discordias intestinas existentes, aumentaron el contraste entre la corte de Carlos IV y la de su padre e inculcaron nuevas ideas en España” Pues bien, a esta crisis múltiple se le sumó la subordinación política hacia Francia, llevada a cabo por el todopoderoso Godoy, protegido de Carlos IV. En los dos Tratados de San Ildefonso (1796 y 1800), en otros posteriores, y en el Tratado de Aranjuez (1801), España unía su destino a Francia contra Inglaterra y Portugal. Luego vino el desastre de Trafalgar con la destrucción de la Armada española (1805). Según Gonzalo Anes, la colaboración militar franco-española “hacía prever una sumisión total a los planes del emperador” . La ocasión era propicia para Napoleón, pues tanto Fernando VII como Carlos IV le buscaban para alcanzar su confirmación o reposición respectivamente en el trono de España, según los sucesos que luego se explicarán. Los planes de Napoleón fueron variados, según la oportunidad: 1º Intervenir en España manejando a Godoy; 2º Desmembrar el territorio español quedándose con parte del mismo; 3º Suplantar a los Borbones. Una de las respuestas de Godoy a estas presunciones fue: “España está dispuesta a hacer, aun a expensas de sus intereses, cuanto sea agradable a su Majestad imperial (…)”. En 1806, la opinión pública española era cada vez más favorable a una mayor independencia respecto a Francia. En el Tratado de Fontainebleau (27-X-1807), se acordó que España se quedaría con una parte de Portugal si dejaba pasar a 28.000 soldados franceses –en cinco cuerpos de ejército- hacia Lisboa aunque, el 1-II-1808, el mariscal Junot proclamará en Lisboa la anexión de Portugal al Imperio Francés, burlando así dicho Tratado. Según Anes, el paso de dichas tropas “no cabe duda de que llevaba implícita la idea de destronar a los borbones de España, cosa factible, dadas las intrigas de las camarillas palaciegas que facilitaban el cumplimiento de los planes del emperador, aunque tal idea no llegó a cuajar plenamente hasta finales de 1807” . Todo indicaba que los españoles eran conscientes de la necesidad de la renovación de su forma de gobernar, de hacer política, y de sus políticos. Manuel Godoy era tremendamente impopular y, el buen Carlos IV -verdaderamente querido como rey-, se había querido vincular a él. Ahora bien, ¿cómo renovar la política? Fernando (VII), Príncipe de Asturias, “el Deseado” en los difíciles años del favorito Godoy –que había sido elevado a la categoría de “Príncipe de la Paz”- y después durante la guerra de la Independencia, tendrá el objetivo de desbancar a Godoy para enderezar así “la monarquía envilecida por el infamado Príncipe de la Paz”, según Corona Baratech. Ello provocó una aguda crisis en la Corte y en la Familia Real. El 27-X-1807, el Príncipe Fernando realizó la conjura llamada el “proceso de El Escorial”, fallida al ser descubierta por su padre Carlos IV. A continuación, el 31-X Carlos IV dirigió un manifiesto a los españoles “en el que informaba del complot de su hijo para destronarlo” (Anes) . Fernando fue perdonado tras descubrir a sus cómplices. Sobre éste proceso de “El Escorial” y el motín de Aranjuez, que mencionaremos, hay dos interesantes trabajos del dr. Francisco Martí Gilabert (Pamplona, Ed. Eunsa). Poco después, “la llegada de las tropas francesas y la clarificación de los proyectos reales de Napoleón hicieron ver a Godoy que era necesario oponerse a tales proyectos, y a adoptar las medidas necesarias para negar con firmeza la entrada de más tropas” (Anes). Más tropas francesas conllevarían la caída de Godoy y el secuestro de la familia real. La clarividencia tardía de Godoy ante la perfidia de Napoleón, “fue la causa inmediata de su caída” (Anes). Más tarde, el 17-III-1808, los fernandinos provocaron el motín de Aranjuez, por el que Godoy fue depuesto y luego apresado en el castillo de Villaviciosa. Para ello, los amotinados, que no eran espontáneos sino que estaban dirigidos por conspiradores, aprovecharon la gran impopularidad del Príncipe de la Paz. En< realidad, nada tenían que temer porque gozaban del apoyo del Ejército, la alta nobleza y el Consejo de Castilla. Dos días después, Carlos IV abdicará en su hijo Fernando VII, quien entró triunfalmente en Madrid el 24 de marzo. En abril, Carlos IV se retractaba de dicha abdicación, y luego informará a su hijo, el ya Fernando VII –lógicamente éste le manifestó su total extrañeza (4-V)-, que la abdicación había sido temporal. Sobre el motín de Aranjuez, es común la tesis (Corona, Vicens Vives, Gil Munilla…) de que se evidenciaba “un cambio de ánimo político y social: patentizada la crisis del Antiguo Régimen, ciertos grupos dirigentes se lanzan a una lucha abierta para instaurar un orden nuevo. Pero el incendio estalla mes y medio después, con la invasión napoleónica, que ocasiona el hundimiento del aparato institucional y determina un ‘vacío de poder’ que reclama su apresurada sustitución” (Gil Munilla) . Luego responderemos si este “vacío de poder” fue momentáneo o real, y si la institucionalización propiamente española o antibonapartista se hizo con rapidez, aunque con las imperfecciones jurídicas propias de la emergencia y la acción callejera popular. También explicaremos si se actuó en nombre de Fernando VII o bien de una soberanía nacional que, poco después, una minoría liberal de élite bien organizada “hará colar” en las anómalas Cortes de 1812. 2.2. El Dos de Mayo en Madrid Planteemos, en este punto y en el siguiente, si hubo una organización en el alzamiento del Dos de Mayo y en los levantamientos ocurridos durante todo este mes hasta mediados de junio, o bien si debe mantenerse la tesis populista de su absoluta espontaneidad . La situación, que cuajaba lentamente desde la paz de Basilea (1795) hasta 1808, se resolvió rápidamente. Fernando VII temió que el mariscal Joaquín Murat, gran duque de Berg y cuñado de Napoleón, con sus 35.000 soldados en Madrid, repusiera a su padre Carlos (IV). Buscó y siguió a Napoleón para ser confirmado en el trono, dejando en Madrid una Junta de Gobierno y al ministro de Guerra Gonzalo O’Farril, que luego será –y esto es significativo- un importante pilar del régimen afrancesado, al ocupar el cargo de ministro de Guerra con José (I) Bonaparte. Así las cosas, Fernando VII dispuso el viaje el 10 de abril y llegó a Bayona el día 20. Por su parte, Carlos IV también buscaba al gran corso para recuperar el poder entregado a su hijo en Aranjuez. Napoleón atrajo con engaños y perfidia a los Borbones hasta Bayona; así, el raptor de Europa secuestró a toda una Familia Real, símbolo viviente de una Dinastía centenaria y cabeza de una milenaria Monarquía. Poético pero cierto. En marzo de 1808, Murat entraba con sus tropas en Madrid. Las tropas francesas pasaron de la popularidad -cuando se les creía favorables al rey- a la impopularidad. En abril hubo incidentes previos en Carabanchel (día 12), Burgos, Toledo (día 21), y el día 26 en Madrid. La capital –Villa y Corte- estaba en ebullición, que aumentó al tenerse noticia del maltrato que Fernando recibía en Bayona. El pueblo tenía en su haber y como precedentes, los motines de Esquilache (1766) y de Aranjuez –éste era reciente-, ambos realizados con éxito. Podía preguntarse: ¿quién iba a poder contra la valerosa reacción de todo un pueblo decidido hasta el final? Antes del 1 de mayo, los barrios de Madrid pidieron armas. Los militares españoles de graduación media, Daoíz y Velarde, prepararon un proyecto de sublevación general sólo militar que únicamente tuvo ramificaciones en el Cuerpo de Artillería, y que, según el historiador Pérez Guzmán, fue desautorizado por el ministro de Guerra O’Farril. El historiador Corona dice que los madrileños conocían los grandes problemas que Murat -mariscal de Napoleón- planteó a la ya citada Junta de Gobierno el 30-IV. A las 9 de la mañana del día 2 de mayo, los madrileños conocían la decisión que la Junta tomó en su sesión nocturna del día 1, de acatar la orden de Murat y así permitir que el hermano menor de Fernando VII -Francisco de Paula- y su hermana María Luisa –la desposeída reina de Etruria-, viajasen a Bayona donde estaba el resto de la familia real. Todavía no se habían realizado las abdicaciones. El pueblo estaba dispuesto a impedirlo, y a intervenir con independencia de la Junta de Gobierno de la nación, cuyos miembros “habían sido reducidos al papel de ministros de la Administración francesa” (Lovett). De ésta manera, Murat se había hecho, en la práctica, con el gobierno de España. No obstante, dicha Junta de Gobierno “consideró entonces la idea de resistirse a los franceses por la fuerza”, descartándolo debido a la implacable superioridad militar francesa (Lovett); ni O’Farril ni otros ministros querían una resistencia armada que consideraban inviable. Sabemos que luego varios miembros de esta Junta ocuparán altos cargos con José (I) Bonaparte. El día 2 llegaron muchos forasteros madrugadores. Se desató el tumulto o levantamiento popular. El historiador Corona Baratech (1959) muestra que hubo una conspiración y un estado de alerta previo, aunque, según Espadas Burgos (1992), no hay constancia documental sino conjeturas de que fuese premeditado. Sin embargo, añadamos que los datos sobre una organización son abundantes y más que sugestivos. La historia no se escribe sólo con documentos firmados y sellados. Incluso a veces lo más evidente en vida ni siquiera se escribe. Es muy posible que confluyeran la organización y la espontaneidad, pues la existencia de agentes fernandinos que fomentasen la sublevación no justificaba del todo la reacción popular. Corona Baratech parte de los abundantes datos ofrecidos - entre otros - por la historia clásica de Pérez de Guzmán. A diferencia de la hipótesis populista de éste último, Corona Baratech, historiador de nuestros días, lanza una bien fundada hipótesis sobre la organización básica del motín, cuyo método plantea Agustín Cochin, cuando negaba la espontaneidad de los sucesos revolucionarios. Sobre el momento del estallido, Corona recoge lo siguiente: “En la mañana del día 2, apenas había un pequeño grupo de mujeres cuando salió de Palacio la Reina de Etruria; después apareció un hombre del pueblo, (José Blas) Molina y Soriano, que hizo el relato de sus méritos en 1816, en términos harto curiosos y abundantemente avalado; luego, grita: ¡Traición!, ¡traición!, y llegan en seguida 60 personas, después de 200 a 400, inmediatamente después de 2.000 a 3.000. “Sólo en las puertas y portillos que franqueaban a los de fuera el paso a la Villa –escribe Pérez de Guzmán-, se notaba desde que vino el día mayor animación que la de costumbre, aunque aquellas eran las horas en que ordinariamente afluían de los pueblos inmediatos los abastecedores con sus cargamentos y vituallas. Esta larga y no interrumpida procesión de forasteros no cesó en toda la mañana. Parecían convocados a voz de bocina o concurrentes a algún suceso extraordinario. Se notó que de los Sitios y los lugares contiguos a todas las posesiones reales venían casi en masa toda su población de hombres robustos y ágiles, capaces de acometer cualquier empresa de valor; muchos traían sus hijos en su compañía. A las primeras horas por todas partes reinaba una completa calma y tranquilidad. A las siete “…vinieron dos carruajes de camino”. No hay sino comprobaciones del gran prestigio que gozaba el Cuerpo de Artillería; sin embargo, parece que Daoíz, con dicho Cuerpo, se consideraba con fuerza suficiente para levantar secretamente a toda España, sin necesidad de ninguna colaboración extraña a los miembros del Cuerpo; Pérez de Guzmán así lo propone; también es singular la noticia de la concentración silenciosa de forasteros desde temprana hora, que guarda una curiosa analogía con la llegada de forasteros al Real Sitio de Aranjuez el 16 y 17 de marzo” . La detallada descripción, efectuada por la historia narrativa, sobre los sucesos anteriores y posteriores al Dos de Mayo, es apasionante; pero hemos de abreviar. Me remito a autores como Pérez de Guzmán, Corona, Lovett y a otros recogidos en las notas de este trabajo. Aunque son muchos los detalles y hechos significativos que, según Corona, expresan la organización del motín, no los precisaremos aquí con detalle, pues el lector tiene sus trabajos para profundizar. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos?. Muchos madrileños habían dejado de trabajar aquel día, sospechando graves acontecimientos. A las siete de la mañana, la exreina de Etruria –María Luisa, hija de Carlos IV- subió a la primera carroza ante cierta indiferencia del público. La segunda carroza era para el infante. He ahí “La voz del pueblo la hace oír una mujer, conmovida por los llantos del Infante Francisco de Paula, que no se quiere ir” (Corona). El pueblo estalló con mucha más energía, unanimidad y necesidad que con ocasión del motín madrileño contra Esquilache (1766). El capitán general de Madrid, Fco. Javier Negrete y Adorno, conde de Campo Alange –afrancesado que el 8-IX-1808 será nombrado virrey de Navarra por el llamado José I Bonaparte-, había confinado a la exigua tropa española en los cuarteles, ante los 35.000 soldados imperiales que, bien armados, rodeaban la ciudad. Esta es la segunda gran defección tras la del general O’Farril. Si O’Farril será ministro de la Guerra con José (I), otros absolutistas y afrancesados como Urquijo, Cabarrús, Azanza, Piñuela, Mazarredo, Negrete y Adorno… ocuparán cargos políticos de Gobierno. Pues bien, ninguno de ellos, que ocupaban cargos en el Gobierno fernandino, podrá paralizar al pueblo en masa y a sus élites tradicionales, ya naturales (sociológicas) ya de la administración pública, en las sublevaciones ocurridas en España. Los franceses entraron a raudales por varios puntos. Se luchaba en muchos barrios conocidos. Del Ejército español sólo se sublevaron los capitanes jefes de Artillería, Pedro Velarde y Luís Daoíz quienes, con el teniente Ruiz y un puñado de soldados más unos 100 civiles, resistieron a miles de soldados franceses en el parque de Artillería de Monteleón, en el barrio de las Maravillas. Dice Díaz-Plaja que el general O’Farril, ministro de la Guerra de Fernando VII, traicionó a Pedro Velarde, quien quiso “obtener el permiso o, al menos, la aceptación tácita de los representantes de Fernando VII en Madrid” . Sea lo que fuere, los madrileños lucharon hasta el fin. Es cierto que las fuerzas participantes en la lucha callejera fueron muy desiguales. Pero -podía pensarse-, ¿quién iba a vencer la valerosa reacción de todo un pueblo verdaderamente decidido? Pudo considerarse que el pueblo madrileño podía ganar en la insurrección. De lograrlo, sin duda hubiera significado la eclosión antinapoleónica, popular e irresistible, en toda Europa. Sólo a posteriori es fácil apreciar que, en el Madrid sublevado –no todos los que hubieran podido alzarse-, los españoles carecían de posibilidades de éxito. También pudo considerarse que la cabeza de un cuerpo social debía hacer todo lo posible para dar un ejemplo decisivo al resto de los españoles. En la villa y Corte, las agitaciones primero, y los combates después, duraron siete horas, y concluyeron hacia las dos de la tarde. Desde luego, el fracaso material del Dos de Mayo se convirtió en un éxito psicológico y espiritual en toda España. En adelante, lo que ocurra en España convulsionará la Europa sojuzgada, y, junto a la campaña de Rusia, coadyuvará definitivamente a la caída y fin del emperador Napoleón. Considero que, debido al tipo de víctimas que hubo en Madrid -según diremos-, no puede decirse que sólo se alzase el pueblo sencillo o bajo –el populacho según los franceses-, aunque sea cierto que entre los sublevados no hubiese nobleza titulada, ni militares de alta graduación, ni eclesiásticos con cargos jerarquía, que es a quienes Díaz-Plaja echa en falta. A continuación, ese mismo día 2, Murat fijó un Bando de 7 artículos que contenían unas medidas draconianas contra “el populacho de Madrid” (Orden del día, vid. “Gaceta de Madrid”, viernes, 6-V-1808). En él, Murat dice: “bien sé que los españoles que merecen el nombre de tales, han lamentado tamaños desórdenes y estoy muy distante de confundir con ellos a unos miserables que sólo repitan robos y delitos. Pero la sangre francesa vertida clama venganza”. El mariscal francés confundía a los amotinados con delincuentes comunes, aunque el Art. 2 hable de “rebelión”; por otro lado, más que fijarse en la gran mayoría silenciosa, él, como soldado bravo y agredido pero como pésimo político, clamaba venganza. ¿O la venganza era un término retórico al estilo de las proclamas de Napoleón? Digamos que el motín será un gran aldabonazo en la conciencia del país y, de alguna manera, también en los soldados franceses. Si la lucha fue sangrienta, también lo fue la represión posterior de aquellas personas juzgadas por las comisiones militares creadas “sobre la marcha”. La noche de la represión del día 2 al 3, cayeron fusiladas cientos de personas en el Prado, Puerta del Sol, las iglesias de la Soledad y del Buen Suceso, Casa de Campo y Buen Retiro, los altos de la Florida y de Amaniel, montaña del Príncipe Pío, a las afueras de la puerta de Segovia etc. Ofrezcamos tan sólo algunas cifras de un tema no concluido por la historiografía. Refiriéndose a la represión en el Prado y sus inmediaciones, Fernando Díaz-Plaja comenta que 320 arcabuceados es una cifra muy alta. “Sin embargo –continúa- hay que recordar los nueve carros de cadáveres que en la mañana del 3 fueron conducidos a enterrar en el cementerio general, a pesar de que, como es sabido, gran número de los infelices fusilados en el Prado y sus inmediaciones recibieron tierra en la misma subida del Retiro, en el llamado Campo de la Lealtad donde hoy se encuentra el monumento a los héroes del Dos de Mayo” . Cada cual valoró el total de víctimas según su conveniencia. Napoleón escribía a sus hermanos el 6 de mayo que del “populacho” murieron más de dos mil entre los 40 a 50.000 sublevados. El conde de Toreno –conspicuo liberal- estimará que en total fueron 1.200 españoles muertos. Sin embargo, el investigador Pérez de Guzmán (1908), que fue el primero en estudia esta cuestión con rigor, menciona 409 muertos y 171 heridos, que Horta Rodríguez (1975) aumenta a 526 muertos. Por su parte, el citado García Fuertes señala los nombres y circunstancias de los 410 muertos y 171 heridos. Entre las víctimas de los combates y posteriores fusilamientos, y sólo entre los que han sido identificados, se observa el perfil sociológico siguiente: personas sin oficio declarado y pueblo llano, 75 muertos y 24 heridos; mujeres, 57 y 22 respectivamente; sin oficio declarado y con Don, 22 y 11; militares, 40 y 28; niños, 13 y 2; y eclesiásticos, 3 muertos y 6 heridos. Según esto, entre los sublevados se encontraba el pueblo bajo y la menguada clase media de la época, y llama la atención la singular presencia de mujeres y niños. Aunque sólo había pueblo llano, sin dirigentes ni intelectuales (Alonso Báquer) , y sea evidente la pasividad o sumisión en las élites políticas, sociales, e instituciones políticas, quiero apostillar la crítica de Díaz-Plaja a los madrileños situados en los peldaños más altos de la escala social, al clero más distinguido, y a los vecinos pudientes de Madrid. No pretendo juzgar sino tan sólo situar los datos en el contexto. En efecto: 1º) La inhibición de las clases altas el Dos de Mayo no significa una definición (por otro lado arbitraria) y oposición de clases (popular y dirigente), pues hay sectores socialmente distinguidos –y de alguna forma intermedios- entre los sublevados. Así, los “don” (“dones”) serían hidalgos –es decir, nobles-, o bien licenciados en Derecho que ejercían como abogados y procuradores. Ahora bien, no pocos de estos –junto con los escribanos reales o notarios-, también eran hidalgos en esa época. 2º) Por otra parte, es imposible conocer los planes, y la valoración prudencial de quienes no “saltaron” a la calle. Es comprensible que la clase alta no saliese a la lucha callejera; creer que lo iba a hacer sería desconocer las formas sociales de una época “aturdida” por la casaca y el pelucón blanco, pues podía considerar impropia de ellos una actitud callejera. Tampoco se debe ignorar la importancia de ocupar la administración y los cargos públicos, fuese uno u otro el resultado de la insurrección. Pongamos un ejemplo. En Navarra, concretamente en la Pamplona de 1821 y 1822, sólo salieron como voluntarios a la guerrilla realista los hijos de las clases populares y no los hijos de los realistas que ocupaban cargos públicos municipales y en la administración municipal, provincial o bien real. Ocultarse para controlar desde dentro puede ser una práctica de los sectores dirigentes en momentos críticos. Desde luego, si algún miembro del clero bajo participó en la lucha, tomar las armas no era su función. Pensemos también lo utópico que sería imaginar a un obispo –por ejemplo- liderando a los amotinados de una ciudad (que no es lo mismo que un ejército regular o de un extenso país). 3º) Por último, una cosa son quienes se insurreccionan el Dos de Mayo, y otra quienes participan en una larga guerra de seis años. No en vano, muchos miembros de las clases altas se opondrán con eficacia a los franceses hasta 1814. Si fueron pocos los clérigos que participaron en la lucha callejera el Dos de Mayo, podrán ser muchos los que se opusieron a los franceses en los seis años de lucha. Por ejemplo, y de forma similar al resto de España, parte del clero navarro participó de diversas formas en la guerra y sufrió la represión francesa, como explica el historiador Marcellán . Nada de lo dicho impide que cada cual fuese responsable ante el resto de la sociedad de su forma personal de participación, colaboración, inhibición o rechazo del alzamiento de Madrid o de las sublevaciones ocurridas en el resto de España. Los procesos de purificación (infidencia) realizados en los Tribunales de justicia en 1814 pueden dejar huella de dichas responsabilidades. Digamos que Murat cumplió muy bien con su anuncio a Napoleón del día 1 de mayo -”Estoy dispuesto a dar una lección al primero que se mueva”- y en su bando del día 2 del mismo mes. Como soldado que era, y quizás sobre todo mal político, en esas circunstancias lo hizo con sangre. El día 3 escribía a Napoleón: “La tranquilidad no será ya turbada, todo el mundo está ya resignado”, “La victoria que acabo de obtener sobre los insurrectos de la capital nos abre la posesión pacífica de España”. Pero se equivocaba. Son interesantes los recientes libros de autores como José Manuel Cuenca Toribio en 2006 y, en 2008, de Emilio de Diego, Jean-René Aymes, José Sánchez-Arcilla, Jorge Vilches, J. Gregorio Torrealba, J. Álvarez Barrientos (dir.), Antonio Moliner Prada, Arsenio García Fuertes etc. En ellos se narra el Dos de mayo y la guerra de la Independencia, y también a ellos remito al amable e interesado lector. 2. 3. Llamamiento a las armas y alzamiento general El Infante Fco. de Paula salió de Madrid hacia Francia en la mañana del 3 de mayo. La familia Real estaba secuestrada en Bayona, el pueblo era valiente y osciló desde los pequeños gozos por las buenas relaciones de España con Napoleón, hasta el gran desengaño, para quedar “exasperado hasta el último punto” (José Bonaparte). El levantamiento del Dos de Mayo y la represión del 2 al 3 fueron el pistoletazo de salida para la insurrección general en los lugares no ocupados por los franceses. Sí; la chispa se convirtió en la hoguera nacional donde se consumirá el mejor Ejército de la imposible Europa de los tres Imperios, ante el imperialismo revolucionario liderado entonces por Francia. Ya dijo Napoleón en sus Memorias de Santa Elena: “Esta desgraciada guerra (de España) me ha perdido (…) Los españoles en masa se comportaron como un hombre de honor”. El sacrificio aparentemente sin sentido del pueblo de Madrid, dio un fruto granado en toda España hasta mediados de junio. El efecto psicológico y espiritual del Dos de Mayo, fue importantísimo para los españoles. Ello se proyectó sobre el general francés barón de Marbot, que reconocerá la inmoralidad de la causa francesa en España, y decía que como él pensaba la mayor parte del Ejército imperial, aunque obedeciesen como soldados del amo de Europa. 2.3.1. El Bando de Móstoles. Los alcaldes de Móstoles, un pequeño pueblo junto a Madrid, dirigieron su Bando a los justicias de los pueblos el mismo día del dos de mayo. Este Bando, sin pretenderlo, hizo de puente entre el alzamiento de Madrid y los de toda España, efectuados en mayo y hasta mediados de junio. Expresaba la postura popular contraria a la colaboración con los franceses, seguida por las instituciones más importantes de la nación, incluida la Junta de Gobierno nombrada por Fernando VII al ausentarse siguiendo los pasos de Napoleón. Este Bando inició la resistencia armada general, aunque sólo pedía ayuda a los pueblos del entorno de Madrid y la carretera de Extremadura. Su texto informaba que “en Madrid está corriendo a esta hora mucha sangre”, y pedía que se ayudase a los leales y valientes que luchaban en defensa del Rey y la Patria, enfrentados a quienes se habían apoderado de la persona del monarca, y cambiaban la amistad o alianza por “un pesado yugo”. El famoso y lacónico Bando del pueblo castellano de Móstoles, decía así: “Señores Justicias de los pueblos a quienes se presentase este oficio de mí, el alcalde de Móstoles: / Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la Corte, han tomado la defensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas; de manera que en Madrid está corriendo a esta hora mucha sangre; como españoles es necesario que muramos por el Rey y por la Patria, armándonos contra unos pérfidos que so color de amistad y alianza nos quieren imponer su pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del Rey; procedamos, pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándolos, pues no hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios guarde a usted muchos años. / Móstoles, 2 de Mayo de 1808. / Andrés Torrejón. Simón Hernández”. Torrejón y Hernández firmaron el bando, aunque parece ser que el texto lo redactó Esteban Fernández de León (intendente de Correos), y su amigo Juan Pérez de Villamil, que no era un hombre común sino fiscal del Supremo Consejo de Guerra, secretario del Almirantazgo, y miembro de la Junta que podía sustituir a la Junta de Gobierno establecida por Fernando - “llegado el caso de carecer ésta de libertad” (Toreno) -, con “todas las (facultades) que residían en la formada por el Rey Fernando”. 2.3.2. Las abdicaciones y farsa de Bayona. Mientras tanto, ¿qué ocurría en Bayona? El día 1 de mayo, Fernando propuso a su padre la solución del problema dinástico: la reunión de Cortes en Madrid –o mejor, de los tribunales y diputados de los Reinos, convocatoria ésta que podía ser más fácilmente aceptada por Carlos IV-, y su renuncia a la Corona, exigiendo no obstante a Carlos IV que no confiase en las “personas que justamente se han concitado el odio de la nación”. Carlos IV rechazó la propuesta. El 5 de mayo, Napoleón obtuvo la abdicación, no sin resistencia y con presiones, de Carlos IV. Tan sólo al día siguiente, Fernando VII, amenazado por Napoleón de ser tratado como rebelde, entregó la corona a su padre. En el texto de su abdicación, Carlos IV se declaraba rey, y condicionaba su abdicación al mantenimiento de la integridad del Reino (luego vulnerada por Napoleón), y a que “La religión católica, apostólica y romana será la única en España. No se tolerará en su territorio religión alguna reformada y mucho menos infiel según el uso establecido actualmente”. Aunque esto último se reflejó en el Art. 1 de la Constitución de Bayona de 1808, los actos estatistas, regalistas y anticristianos de José Bonaparte lo contradijeron. Digamos que si el rey Carlos rendía tributo a Dios y al Reino en su citada declaración solemne, el pueblo español luchará por su rey –aunque en éste caso fuese Fernando VII- y la integridad e independencia de la Patria, y, con más motivo, por su Religión. Carlos IV, con su abdicación forzada, se proponía poner fin a la anarquía, a las facciones y a la guerra, y aspiraba a la debida seguridad y sosiego político que permitiese mantener la integridad territorial, los territorios de ultramar, y -apoyada España por Francia- alcanzar la paz en el mar. Lógicamente, Napoleón, con singular cinismo, se presentaba como único valedor de estas buenas intenciones. El buen Carlos IV y el desafortunado Godoy, residirán en Marsella y luego llegarán a Roma el 16-VII-1812. La reina moría en la Ciudad Eterna el 2-I-1819, y el buen Carlos IV fallecerá en Nápoles el 19 de diciembre. Una vez más, se demostraba que no había rey sin pueblo, ni pueblo español sin rey. Este pueblo tuvo la gloria de mantener la corona en las sienes de su rey, aunque éste fuese coaccionado en Bayona, por el ladrón de Europa, a renunciar a la corona. Este acto de fuerza invalidará jurídicamente la renuncia. El 11-VIII-1808, el Consejo de Castilla, inicialmente colaboracionista con los franceses, se instituyó en gobierno de Madrid una vez liberada la Villa y Corte tras la batalla de Bailén, donde las tropas españolas de Castaños resultaron triunfantes. Dicho Consejo declarará nulos y sin valor los decretos de abdicación y cesión de la corona de España firmados en Bayona, lo que es importante porque ello demuestra la continuidad de la legitimidad. Otra cosa es que, algo después, las Juntas Provinciales siguiesen la propuesta de crear una Junta Central debido al colaboracionismo inicial de dicho Consejo de Castilla con los franceses. En todo caso, el pueblo y las instituciones no sujetas a los franceses, mantuvieron la corona del rey, “desposeído” con los atropellos de Bayona. Para entonces, la Junta de Gobierno nombrada por Fernando VII al irse de Madrid, que siempre estuvo intervenida por Murat, había dejado de existir. 2.3.3. El levantamiento general. La gran revuelta antifrancesa fue simultánea y espontánea en toda la península, aunque tuvo una canalización oculta. El Alzamiento nacional fue organizado mal y de forma precipitada, y no precisamente por el pueblo sino por minorías capacitadas (Corona). En él participaron todos los sectores sociales. Aunque la planificación fernandina se apunta para toda España, ello no quita importancia al “gesto de supervivencia” de los españoles (Cuenca Toribio), al explotar el “resentimiento largamente acumulado contra la traición y la agresión de Napoleón” (Lovett). Entre del Dos de Mayo y los primeros días de junio, la insurrección prácticamente se generalizó: Asturias (día 9-V y 24); Valencia, Murcia, Cartagena (24); Zaragoza (26); Santander y Sevilla (27); Cádiz, Córdoba y Jaén (29); Granada, Badajoz y La Coruña (30) etc. Les siguieron toda Castilla la Vieja, Cataluña, Baleares y Canarias. En Cataluña, cuya Junta se creó el 18 de junio, hubo sublevaciones desde Tortosa a Puigcerdá y desde Lérida a Rosas (Gómez de Arteche) al grito de: “¡Viva la Religión, viva Fernando VII, viva la Patria!” durante todo el mes de junio. 2.3.4. El aparato organizado. Sobre cómo se desarrolló el Dos de Mayo, la hipótesis populista afirma la total espontaneidad de los sucesos como fruto del sentimiento popular (Pérez de Guzmán). Por ejemplo, de ella se hace eco el historiador Jaime del Burgo Torres, al negar que la conspiración estuviese preparada de antemano por los elementos del partido fernandino, “ya que –dice- hubieran recurrido primero a los elementos militares, y lo cierto es que fue el pueblo el que, sin pensar en las circunstancias ni considerar su indefensión, se lanzó a la lucha contra los imperiales considerados invencibles. La actitud de las autoridades constituidas no fue más que una permanente muestra de cobardía” . Digamos que del Burgo podría reconsiderar la hipótesis de la conspiración, pues el fundamento de ésta es sólido, advirtiéndose que lo mismo que piensa él, pudieron pensar los organizadores fernandinos. La hipótesis de Corona Baratech expone la existencia de un aparato organizado por los fernandinos y antigodoístas, preparado con ocasión del motín de Aranjuez, aunque el éxito de éste último no hiciese necesario su funcionamiento. Recordemos la expulsión de Madrid que sufrieron los fernandinos tras la conjura fallida de Fernando VII (“proceso de El Escorial”) el 27-X-1807. También Gil Munilla afirma que desde el 2 de mayo y en junio: “triunfa un levantamiento popular, conscientemente provocado, según todas las apariencias, por personas influyentes –en el ámbito nacional o local- que ya en marzo manifestaron su propósito de conducir la Monarquía por derroteros que hicieran inviable el vilipendiado despotismo ministerial” . En realidad, la dinámica o método del Dos de Mayo se repitió en muchos alzamientos posteriores. Dicho aparato o máquina política -extendida por el resto de España-, primero quiso evitar que Murat restaurase a Carlos IV, luego se propuso difundir la sublevación de forma radial, y, tras ello, garantizar Juntas locales y provinciales, siendo enseguida la política de éstas últimas absorbida por el problema militar. Pensemos que los desterrados de la conjura fallida de Fernando VII en octubre, marcharon a ciudades como Zaragoza, y que ahí siguieron actuando. ¿Cuál fue el método seguido en los diferentes alzamientos que, simultáneos y ocurridos en lugares muy distantes, desorientaron a los franceses y dieron la sensación de un alzamiento generalizado, que es lo que era en realidad? Según Corona Baratech, fue el siguiente: “(…) 1º), un mismo y único protagonista “el pueblo”, que actúa y decide espontáneamente, como movido por un resorte a la noticia de los sucesos del dos de mayo, y de las abdicaciones de Bayona; la voz del pueblo la hace oír una mujer (Madrid), conmovida por los llantos del Infante Francisco de Paula, que no se quiere ir; un pajuelero (Valencia); un practicante cirujano (Zaragoza); un desconocido Sr. Tap (Sevilla); en Santander el pueblo se enardece ante la disputa entre un francés y el padre de un niño a quien el francés había reprendido, etc.; 2º), el pueblo enfervorizado de patriotismo y de irritación se dirige a las autoridades y les obliga a dimitir; 3º), el pueblo obliga a constituir una Junta con personas que le merecen confianza, para organizar la guerra contra el francés; 4º), el pueblo logra imponerse a las autoridades antiguas, no sólo mediante el clamor de una gran masa, sino también mediante la violencia y la fuerza de las armas que ha obtenido de los parques militares; el pueblo se ha armado; 5º), constituido un nuevo gobierno regional o local, el pueblo se sosiega instantáneamente; “se somete dulcemente a su imperio” . Según este modelo o método, que después se desarrolló en toda España, la noticia que impulsa al pueblo es la misma, el pueblo reaccionó de manera similar, hay una clara consigna, y ésta es recibida por una célula de un aparato preexistente. Desde Madrid se preparó la consigna general. “El chispazo que desencadenó la tragedia del dos de mayo fue provocado por un grupo, decidido a levantar al pueblo contra los franceses, saltando por encima de la parsimonia mostrada por la Junta Suprema Delegada, que según Azanza y O’Farril, acordó preparar el alzamiento con más cautela y prudencia” (Corona). Su difusión del alzamiento por España fue radial desde Madrid, y se realizó a partir del Dos de Mayo. Se imitó el mecanismo y el plan seguido en Madrid, y el propósito de crear Juntas locales y Provinciales claramente antifrancesas, ya sea destituyendo las autoridades del régimen anterior ya constituyendo unas nuevas autoridades, “con participación de los tres Estados del Reino, nobleza, clero y Estado llano” (Corona). La hipótesis de Corona sobre la existencia de núcleos políticos en las principales ciudades, que “pusieron en movimiento al pueblo y que dictaron los nombres de las nuevas autoridades”, es muy sugerente, está bien fundada, y hasta puede transformarse en tesis al ser adoptada por otros autores. 3. Nuevas instituciones y mantenimiento de la legitimidad monárquica: de las Juntas Provinciales a la Regencia Si la guerra era una vivencia desconocida en el territorio español desde la guerra de Sucesión (1705-1714), ahora será una vivencia cotidiana durante 6 años. En 1808 la tragedia será mayor que en 1705, debido al mayor enconamiento entre las partes en conflicto, y a los mayores excesos, expresados por Goya en la serie de grabados titulados Los Desastres de la guerra. 3.1. Tendencias políticas A comienzos del s. XIX español, en las élites o grupos dirigentes pueden observarse diferentes tendencias o sectores políticos. Tales son: conservadores (absolutistas), tradicionales (renovadores), e innovadores (liberales o patriotas o bien afrancesados o bonapartistas). En estos últimos se incluyen los que se encontraban próximos al sistema político inglés. Sobre ellos han escrito autores como Suárez Verdaguer , Carlos Corona , Gil Munilla , José Andrés-Gallego, Fernández de la Cigoña etc. Sin embargo, estas tendencias no agotaban la realidad política de España, pues el pueblo no era el encargado de solucionar los problemas institucionales producidos por el despotismo ilustrado, tenía una mentalidad y valores arraigados en vez de ideología, desconocía la lucha de las camarillas por el poder, y no racionalizaba la realidad básica que vivía. En España dominaba una gran masa nacional como soporte vital del país, diríamos que políticamente poco cualificada (Corona), pero fiel a la Religión y al rey Fernando, contraria al impopular Godoy, y muy preocupada por los sucesos revolucionarios franceses. Si los sectores conservadores y renovadores citados estaban cerca de este pueblo por coincidir con sus principios básicos, el giro de los absolutistas (no de los renovadores) hacia el afrancesamiento, alejaba a estos del pueblo español. A diferencia del resto de España, en el Reino de Navarra y los territorios forales vecinos (el Señorío de Vizcaya y las Provincias –con mayúscula- de Guipúzcoa y Álava), toda la población vivía la monarquía tradicional (efectiva y preeminencial) no absolutista, ejemplo para los renovadores o tradicionales, aunque en estos lugares también hubiese algunas élites absolutistas residentes en Madrid y relacionadas con la Corte partidarias del despotismo ilustrado. Por mi parte, tengo preparada una síntesis relativa a Navarra . Pues bien, la existencia de dichas tendencias de élite y populares, impiden reducir la situación política a dos sectores -absolutista y liberal- en la que caen los autores ideologizados y dialécticos, que miran más a modelos que a realidades, y más a lo foráneo que a la especificidad española. Los liberales o innovadores de Cádiz se autocalificaron de “patriotas”, de una patria formada por individuos y con un Rey como primer funcionario. Aprovecharon bien la ocasión para realizar una ruptura institucional con formas de aparente continuidad. La ocasión eran los aparentes cambios sociales fruto de la guerra, pero sobre todo las circunstancias bélicas, unidas a la audacia, organización e irregularidades cometidas por la minoría liberal en la preparación de las Cortes y durante el desarrollo de estas. El pueblo español no era liberal. Más tarde, reflexionando sobre el pasado y desde los hechos consumados, será fácil pretender justificar la ruptura de 1812, aunque más desde supuestos ideológicos liberales que desde la realidad y el deseo del pueblo español. He aquí algunos de estos aparentes cambios: 1º) El reforzamiento de las antiguas autoridades claudicantes ante los franceses, y el monarca preso en Bayona, quebrará en apariencia la continuidad de la propia autoridad o legitimidad de origen. 2º) El presentismo del momento, debido a la excitación que originó el levantamiento, la tensión y crueldad de la guerra, así como la novedad de un conflicto interno, quebrará en apariencia la continuidad vital de una comunidad. 3º) La transformación del súbdito en héroe, quebrará en apariencia la continuidad del yo individual y comunitario. 4º) La liberación física y moral que supone el triunfo militar en la Guerra, quebrará en apariencia el marco real de referencia –comunitario, de costumbres e institucional- consistente en jurisdicciones, libertades, obligaciones y derechos. Una Guerra destructiva de seis largos años, fue la gran ocasión que tuvo la decidida minoría innovadora (liberal), reunida en unas Cortes anómalas como las de 1812, aunque su planteamiento no fuese aparentemente tan aberrante como la convocatoria de la Asamblea de Notables en Bayona del año 1808. Esta actividad de retaguardia, solicitaba y exigía al pueblo español -tradicionalista en su mayoría- pensar en otra cosa que en la expulsión de los franceses, y argumentar una justificación general de su ser comunitario. Ahora bien, como era comprensible, este pueblo no lo hizo, porque la ocasión era totalmente inoportuna, no existía una adecuada vertebración política, las Juntas provinciales carecían de la debida conexión con las instituciones sociales, y los solicitantes eran poco o nada representativos. Hasta se ignora cómo fueron elegidos los dos diputados que decían representar al Reino de Navarra, mientras que otros diputados fueron nombrados de forma arbitraria, formando los diputados suplentes un tercer grupo sujeto a análisis. Pero, sobre todo, el pueblo estaba al margen de dicha reunión a Cortes, y era ajeno a la naturaleza soberanista que éstas adquirieron desde sus primeras sesiones, tan opuesta a lo que el Rey o la Junta Central desearon. 3.2. Surgimiento de las Juntas Locales y Provinciales La Junta de Gobierno, nombrada por Fernando VII antes de ir tras los pasos de Napoleón, estaba presidida por el infante don Antonio y las más prestigiosas instituciones, tales como el Consejo de Castilla, las Capitanías Generales y las Audiencias, que aceptaron en parte los hechos consumados de Bayona, e inicialmente colaboraron con las autoridades imperiales y el rey intruso José. En toda España, muchas altas esferas de la administración y del ejército estaban atemorizadas por el dominio francés durante las semanas siguientes al 2 de mayo. Así, “las Audiencias provinciales y los distintos capitanes generales habrían estado justificados al invitar a la revuelta, pero no hubo llamamiento alguno de esta índole. El ejemplo de la tímida Junta de Gobierno de Madrid fue seguido por muchos otros encumbrados individuos, y la resistencia que surgió serían en muchos casos obra de las masas populares” (Lovett). Pronto las autoridades legítimas de origen se vieron desbordadas por los españoles (élites y pueblo) que defendieron aquellos principios básicos implícitos en la legitimidad de ejercicio, aunque en realidad no sustituyeron a dichas autoridades sino que las reforzaron. Como ya se ha dicho, el Dos de Mayo, y el conocimiento de las abdicaciones de Bayona cuando tuvieron lugar, produjeron una eclosión de levantamientos populares, creándose por todas partes Juntas locales y provinciales, ya como desafío colectivo a Napoleón, ya para dirigir la resistencia española. Estas Juntas formaron parte del mecanismo, modelo y plan establecido ya citado, y se desmarcaron de la Junta de Gobierno nombrada por Fernando VII antes de marchar de Madrid. No en vano, esta última Junta estaba mediatizada por Murat, y sus miembros parecían ministros de la Administración pública francesa, optando por una posición inactiva y colaboracionista con los franceses ante el Dos de Mayo. En realidad, cuando algunos de los miembros de la Junta de Gobierno (O’Farril etc.) reconocieron a José Bonaparte como rey tras conocer las abdicaciones de Bayona, la legitimidad de dicha Junta de Gobierno será retomada por la Junta Central. Sabemos que “en toda España surgieron las Juntas Provinciales, como movidas por un resorte y con arreglo a un mecanismo sospechosamente preestablecido” (Corona Baratech). Muchas Juntas Provinciales (Oviedo…) se consideraron delegadas de Fernando VII (único depositario de la soberanía política), mientras algunas otras recabaron la soberanía para sí mismas, según la personalidad de sus componentes. Sólo en algunos casos (Torre del Fresco en Badajoz, y Solano en Cádiz), la sublevación popular se realizó contra la voluntad de las autoridades del llamado Antiguo Régimen. Lo habitual fue la “integración en las Juntas Provinciales de las autoridades antiguas reforzadas por otras personalidades prestigiosas y ratificadas todas por el clamor popular” (Palacio Atard). Tal como hemos dicho, las Juntas provinciales “estaban integradas por las antiguas autoridades más alguna otra personalidad de prestigio, todas las cuales fueron ratificadas por el clamor popular: así aparecen doblemente legitimadas, al ser herederas de las autoridades constituidas y contar con el respaldo del pueblo” . Así fue, salvo excepciones, cuando en algún caso las Juntas, “angustiadas, vacilaban en lanzar a sus súbditos a un combate sin esperanzas”. Así, aunque Juntas locales o Provinciales no estaban previstas por la ley, su aparición mantuvo una “continuidad legal” (Palacio Atard), que se vio fortalecida por la influencia del pueblo en unas extraordinarias circunstancias de guerra. La actividad de las Juntas será absorbida por la guerra. Sobre el significado de las Juntas Provinciales, el jurista Jaime Ignacio del Burgo afirma: “(…) es curioso que, a pesar de que el país, salvo Navarra y Vascongadas, llevaba más de cien años de centralismo, el instinto de defensa popular hizo revivir las antiguas instituciones, que pudiéramos denominar forales. Así, por ejemplo, Asturias convirtió la Junta del Principado, entidad meramente económica, en el organismo superior de la región; Galicia hizo renacer la Diputación General del Reino; Lérida organizó su Junta sobre la base de los antiguos corregimientos de la ciudad, y Aragón recurrió a la convocatoria de las cortes del reino (…)” (Cárcer de Montalbán) . 3.3. Iniciativa regia de la convocatoria a Cortes El 1 y 4 de mayo Fernando VII mostró su voluntad de convocar Cortes, que dispuso en sus dos decretos del día 5. En uno, mandaba a la Junta de Gobierno que se trasladase a un lugar seguro, asumiese la soberanía, y declarase la guerra a Napoleón. En otro, ordenaba al Consejo Real o, en su defecto, a cualquier Chancillería o Audiencia no mediatizada por los franceses, que “se convocasen las Cortes (…) (para que) se ocupasen únicamente en proporcionar los arbitrios y subsidios necesarios para atender a la defensa del Reino, y que quedasen permanentes para lo demás que pudiese ocurrir”. La Junta de Gobierno conoció ambos decretos pero no los atendió, ni los hizo circular, siendo Pedro Cevallos, que había acompañado a Fernando VII a Bayona, quien los reconstruyó e hizo saber tan pronto como regresó de Francia. Por no obedecer al monarca, la Junta de Gobierno fue sustituída por la Junta Central. 3.4. Surge la Junta Central Suprema Las Juntas Provinciales se plantearon un poder efectivo central para evitar un posible vacío de poder y legitimidad. El móvil fue la prisión del rey y la mayor o menor claudicación de altas instituciones del Reino ante Bonaparte, como era el caso de la Junta de Gobierno conocedora de las abdicaciones de Bayona y del Consejo de Castilla. La Junta Central como institución era históricamente una novedad, fruto de un caso de emergencia, y conducirá a la Regencia algo más de un año después. Las aspiraciones de las Juntas eran diversas, pues según reconoce Forcada Torres: “Algunas de las Juntas provinciales, considerándose “más Supremas” que las demás, pretendían que el país entero las reconociese como sucesoras del Rey y su Gobierno (añado que por ejemplo la de Sevilla). Otras, más modestas, contentábanse con regir su propia jurisdicción con plena independencia de cualquier poder central; otras, finalmente, decidieron unirse con sus vecinas para constituir una sola, bajo un solo mando. Este fue el partido que eligieron y pusieron en práctica las Juntas de Castilla la Vieja, León y Galicia, quienes escogieron como sede de sus reuniones la ciudad de Lugo” . El proyecto más razonable lo propuso la Junta de Murcia el 22 de junio, que propugnaba la constitución de una Junta Central Suprema, donde tuviesen cabida las Juntas existentes. En dicha Junta Central, todas las Juntas provinciales tendrían la misma importancia, y se repartirían la responsabilidad de Gobierno. El 16 de julio, la Junta de Valencia se adhirió a esta propuesta. Por su parte, el 11 de agosto, el Consejo de Castilla declaró nulas las abdicaciones de Bayona, y decretó la nulidad de cualquier decreto de Napoleón y su hermano José. Además, dicho Consejo alegará tener más derechos que ninguna otra institución para regir el país, mientras el Rey estuviese ausente. Sin embargo, su pasada actitud, sumisa ante los franceses durante los tres meses y pico en los que estos dominaron Madrid, hizo que Juntas provinciales pusieran fin a sus vacilaciones y aceptasen el proyecto de la Junta Central Suprema. El 23-VIII-1808, las tropas españolas, vencedoras de Bailén, entraron victoriosas en Madrid. Imaginemos la vibración de los madrileños insurreccionados el Dos de Mayo, y la mayor o menor vergüenza de quienes dicho día quedaron -por uno u otro motivo-, en la inacción o bien al margen de los acontecimientos ya descritos. Cuando, después de unos meses, el 2-XII-1808 Napoleón llegue a las puertas de Madrid, la ciudad se resistirá con las armas el día 3 para capitular el 4, dispensando inmediatamente al emperador un frío recibimiento. Era comprensible. A continuación, el francés apresará a los miembros del Consejo de Castilla por el citado decreto que éste promulgó en el mes de agosto y, más tarde, su presidente (Arias Mon) y otros dos miembros fueron trasladados -presos y bajo custodia- a Francia. El 25-IX-1808, se constituyó en Aranjuez la Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias, haciéndolo “en nombre del Rey nuestro” Fernando VII. En Aranjuez, la nueva Junta estaba libre de las posibles intromisiones del mencionado Consejo de Castilla. La presidía el anciano conde de Floridablanca, que tenía 84 años, y contaba en su seno nada menos que con Gaspar Melchor de Jovellanos. Una vez constituidas las Juntas Provinciales, cada Junta envió dos miembros para formar parte de la Junta Central. Aunque, al principio, esta Junta estuvo formada por 24 miembros, más tarde ascendieron a 35. Su talante era conservador. Al morir Floridablanca el 30-XII-1808, fue elegido el marqués de Astorga. Es importante que la Junta se atribuyese el tratamiento de “majestad”, y su presidente el de “alteza”, pues actuaba en nombre de Fernando VII, a quien sustituía en el ejercicio de sus facultades por su forzada ausencia. La Junta no tenía la soberanía política, sino que se justificaba para ganar la guerra y liberar al monarca preso. La mayor parte de la nación española, opuesta a los franceses, reconoció a la Junta Central. Por su parte, el Reino de Navarra tenía instituciones propias según Derecho (el virrey y la Diputación del Reino) que impedían el vacío de autoridad. Por eso, cuando su Diputación acepte a la Junta Central, esta aceptación tendrá un carácter diferente a la realizada por el resto de la monarquía. No obstante, al fin, ante la forzada dispersión de sus miembros (no su disolución como institución), la Diputación enviará dos representantes a la Junta Central, aunque luego precisemos si esto era o no un contrafuero. El 28-X-1808 la Junta Central se señaló los siguientes objetivos: “Expeler a los franceses, restituir a su libertad y a su trono a nuestro adorado rey y establecer bases sólidas y permanentes de buen gobierno”. Ahora bien, como “Nada es la independencia política sin la felicidad y la seguridad interior (…) el gobierno cuidará de que se extiendan y controviertan privadamente los proyectos de reformas y de instituciones que deben presentarse a la sanción nacional (…) Conocimiento y dilucidación de nuestras antiguas leyes constitutivas, alteraciones que deben sufrir en su restablecimiento por la diferencia de las circunstancias; reformas que hayan de hacerse en los códigos civil y criminal y mercantil; proyectos para mejorar la educación pública tan atrasada entre nosotros; arreglos económicos para la mejor distribución de las rentas públicas y su recaudación (…)”. Lógicamente, el Reino de Navarra sólo podía colaborar con la Junta Central en la expulsión de los franceses y la liberación del rey y, conforme a sus antiguas leyes constitutivas, exigirle el reconocimiento de su naturaleza como Reino “de por si”. En el seno de la Junta, Jovellanos –de pensamiento político tradicional renovador casi hasta su fallecimiento- fue el primero en proponer, el 7-X-1808, la convocatoria de Cortes, para que estas designasen una Regencia que asumiera el lugar del Rey. Hasta entonces, la Junta Central debería nombrar una Regencia provisional. La propuesta de Jovellanos se basaba en principios de Derecho público español, expresado por entonces como Leyes Fundamentales. Sin embargo, la Junta rechazó la propuesta. También rechazará otra diferente del general Calvo de Rozas (15-IV-1809), que actuaba inspirado por el liberal José Quintana. Las graves anomalías de la organización de la convocatoria a Cortes, la convocatoria misma, y el desarrollo de las sesiones, son otra cuestión, dilucidada por Federico Suárez Verdeguer, entre otros autores. 3.5. De la Junta Central a la Regencia Las Juntas provinciales estaban respaldadas por la aclamación popular debido a las circunstancias del momento contra los franceses. Interesa recoger aquí que ellas mismas se sintieron herederas de la autoridad antigua. El régimen y concepción antigua de la autoridad se transmitió a la Junta Suprema Central, que actuó en nombre del monarca preso. Al fin, esta Junta transmitió su autoridad a un Supremo Consejo de Regencia el 29-I-1810. Así, con la Junta Central actuando en nombre de Fernando VII, y con el Supremo Consejo de Regencia –tan mal visto por los liberales- sustituyendo a la persona del rey, se volvió “a la institucionalización de la autoridad dentro del marco de la legalidad tradicional” (Palacio Atard). Como la Regencia suplía la persona de Rey y actuaba en su nombre, los liberales, presentes en las anómalas Cortes de Cádiz, presionaron a dicha Regencia, hasta “que su autoridad fuera, en ciertos aspectos, prácticamente nula” (Suárez Verdeguer) . A continuación, las Cortes liberales proclamaron la llamada soberanía nacional, de manera que una cosa fue la primera Regencia constituida en nombre del rey, y otra esencialmente diferente la derivada de dichas Cortes soberanistas. El 23-IX-1810, la Regencia había convocado Cortes, pero haciendo tabla rasa de lo dispuesto por la Junta Central. Dichas Cortes eran anómalas, carecían de raíces en la tradición, y de reglas que limitaran su poder y les indicaran el camino que deberían seguir (Suárez). En ningún momento, desde la ausencia de Fernando VII de Madrid hasta la reunión de las Cortes, hubo vacío de autoridad o de poder, porque si bien el titular de la “soberanía” política era el Rey, ésta era limitada, y el ejercicio de su poder recayó, en cada caso, en las instituciones superiores en nombre del monarca. Así, recayó en la Junta de Gobierno creada al efecto por el rey, en las Juntas Provinciales antifrancesas originadas novedosamente según las excepcionales circunstancias, en la Junta Central y luego en la Regencia. No hubo asunción “popular” de la soberanía regia, y, en general, se actuó en nombre del rey. Otra cosa eran las Cortes liberales como anomalía y problema en los años 1812-1813. En 1814 debe hablarse de Restauración en España porque las Cortes reunidas en Cádiz se atribuyeron la soberanía política propia del monarca, bajo el término de soberanía nacional. Aunque analizar las Cortes tiene cabida en el título de este trabajo, nos remitimos a otra aportación de nuestra autoría señalada en notas. Además, la soberanía nacional no era exigida ni reconocida por la sociedad española, vulneraba la Constitución histórica de España, y al fin el monarca preso regresó de Francia. En 1813, y antes del Tratado de Valençay, Fernando VII aludió varias veces a la Regencia como representante de la nación española, sin la menor alusión a las Cortes (Comellas), a pesar de conocer todo lo ocurrido en España. 4. El Reino de Navarra 4.1. Mantenimiento de la constitución histórica del Reino de Navarra Navarra, pequeño Reino situado a los pies de los Pirineos occidentales, estuvo afectada por la crisis como el resto de España. Sin embargo, Godoy agravó esta crisis, según explica Rodríguez Garraza , al vulnerar muy gravemente los Fueros del Reino. Este momento fue el de mayor peligro para los Fueros desde 1778, fecha que es cuando ”el régimen monárquico, absoluto y centralista, desafía abiertamente las instituciones particulares de Navarra”. Quizás los Fueros del Reino milenario de Navarra se salvaron porque, en 1808, el pueblo navarro entró en acción frente al invasor francés, afirmando sus aspectos fundamentales y su constitución histórica. Sabemos que Napoleón torció su promesa de enviar tropas hacia Portugal y que las fue colocando en las principales plazas fortificadas de España, una de los cuales era la ciudad de Pamplona, “antemural de la Patria frente a Francia” a decir del s. XVIII. Se sabe que, la noche del 16 al 17-II-1808, el general francés D’ Armagnac ocupó por sorpresa la ciudadela inexpugnable de Pamplona, con el premeditado truco de mandar a unos soldados franceses acercarse a la guardia jugando con bolas de nieve, lo que es referido fidedignamente por los historiadores. Entre 1808 y 1814, se hizo abstracción del Reino de Navarra en la Constitución de Bayona de 1808. Por otra parte, la minoría liberal suprimió el milenario Reino de Navarra en las Cortes de Cádiz de 1812. Por lo que a esto respecta, y respecto a los textos legales, la Constitución de Cádiz fue más antiforal que la de Bayona. Francisco Miranda Rubio concluye que la ocupación francesa supuso en Navarra “una total transformación institucional, sobre todo a partir de febrero de 1810 con los Gobiernos Militares” franceses posteriores a los Decretos de Napoleón. Si la transformación la impusieron los generales franceses, lo cierto es que la Diputación del Reino de Navarra (las Cortes no se reunieron), rechazó a José Bonaparte, después de haber intentado amoldarse a las especiales circunstancias de la ocupación francesa. También la sociedad navarra rechazó las instituciones impuestas por los franceses, pues “muchos navarros fueron reacios a participar en las mismas y gran parte del pueblo no las comprendía” (Miranda). De ésta manera, gobernantes (la Diputación del Reino) y gobernados fueron en una misma dirección política. Los navarros estuvieron lejos de cualquier reforma o supresión de sus instituciones mantenidas durante siglos. Rechazaron las reformas emprendidas por los franceses, y no tuvieron la ocasión de considerar aquellos otros cambios planteados por algunos españoles, en un sentido liberal, con ocasión de la insurrección general de 1808. En realidad, con ocasión de los levantamientos de mayo y junio, en Navarra no se nombró Junta alguna, fuese local, provincial o del Reino. La actitud de las instituciones del Reino y de la sociedad navarra era un continuo “no querer” modificar sus Fueros e instituciones históricas. Para las instituciones navarras, las circunstancias eran complicadas, sobre todo al comienzo de 1808, pues los franceses se presentaron como aliados de Carlos IV aunque, luego, paulatinamente y desde una posición de fuerza, empezaron a presionar sobre las instituciones del Reino navarro. También lo hicieron en el resto de España. Ante estas imposiciones, la táctica de las instituciones navarras fue amoldarse hasta donde podían hacerlo, dar largas, y aprovechar los muchos trámites jurídico-políticos que obstaculizaban los paulatinos contrafueros. Dijeron “no” como podían y convenía hacerlo. Cito al respecto los tres casos más importantes que analizaremos a continuación. 1º) Enviar tres representantes a la Asamblea de Notables celebrada en Bayona, no significaba aceptar de antemano la pérdida de las propias Cortes. 2º) Enviar dos representantes a la Junta Central no significaba que la Diputación reconociese –contradictoriamente con el Fuero- una institución superior y foránea a Navarra, situada entre las instituciones propias del Reino navarro y el monarca, que siempre era el que reinaba en Castilla. 3º) Más complicado para la Diputación era eludir el nombramiento de diputados a las Cortes generales que se iban a celebrar en Cádiz. Sin embargo, no podía nombrarlos toda vez que Navarra tenía Cortes propias. En este caso, la Diputación dejó la elección de diputados a la Junta Central, “íntimamente persuadidos (decía la minoría de sus miembros reunidos) de que la elección de V.E. será la de nuestro deseo”. Más adelante desarrollaremos estos tres puntos. Es importante resaltar de antemano al lector, que en Navarra no hubo vacío de poder, ni de autoridad entre 1808-1814, y aunque los miembros de la Diputación del Reino se dispersaron por seguridad a finales de 1809, aunque estaban fuera del territorio navarro, la Diputación no se disolvió. La situación era contradictoria toda vez que la autoridad debía ir pareja al ejercicio del poder y, desde luego, las circunstancias bélicas suponían un caso límite. Fruto de dicha dispersión de los miembros de la Diputación, la falta de ejercicio de ésta en materia militar fue suplida por el ejercicio de la Junta Central, a la que, al fin, la Diputación envió dos personas para ser convocadas en caso de necesidad. En la Restauración de 1814, la Diputación legítima retomará sus funciones. Es difícil dudar del conocimiento y respeto a los Fueros por parte de la Diputación, pues ésta dio sobradas muestras de ello durante el siglo XVIII. No obstante, además de escrupuloso respeto a los Fueros, las circunstancias exigían una importante dosis de habilidad política. Habilidad para conjugar el mantenimiento de las propias instituciones tradicionales (Cortes y Diputación) y no aislarse en la guerra generalizada que los españoles mantenían contra los franceses, máxime en unas circunstancias límites, en las que la Diputación del Reino de Navarra carecía totalmente de recursos y se había refugiado fuera del territorio navarro, en la actual La Rioja. ¿Y los personajes que a veces, como agentes de la historia, son los grandes olvidados? Digamos que, en esta Diputación del Reino y hasta la dispersión de sus componentes, don Miguel Escudero se encontraba entre los siete diputados que formaban la Diputación del Reino, institución ésta entre Cortes. En 1801, Escudero asistió a las Cortes de Navarra por el Brazo militar. En 1808, la Diputación le enviará a la Asamblea de Bayona, y, en 1813, será jefe político (institución liberal) interino de Navarra. Quizás dicho Escudero careciese de firmeza en la defensa de los Fueros, e influyese en el envío de representantes de la Diputación a la Junta Central, así como de diputados a las Cortes generales reunidas en Cádiz. De todas maneras, volvió a ser diputado en la Diputación legítima -restaurada en 1814 a petición de la Diputación provincial de Navarra creada por las Cortes de 1812- aunque es cierto que, en esa época, la legalidad se respetaba sobremanera en el nombramiento de cargos públicos y no se le desplazaba a nadie sin motivos jurídicos más que suficientes. El caso de Escudero no será el único, pues Carlos Amatriáin será diputado en 1808, representante de la Diputación en la Junta Central, y de nuevo diputado en 1814. Junto a él y como representante en la Junta Central, se nombró a Miguel de Balanza, que también será elegido diputado de la Diputación del Reino en 1814. En resumen; el pueblo, las élites y los políticos navarros quisieron conservar las instituciones seculares del Reino, en el viejo solar navarro no hubo vacío de poder o autoridad (ni de legitimidad), y casi la totalidad de los navarros –en los pueblos y ciudades como Pamplona (Garralda)- era tradicionalista, siendo una exigua minoría de afrancesados o liberales (Miranda) los que podían desear una modificación institucional. 4.2. Colaboración con los franceses, defensa del Fuero y oposición abierta a Bonaparte. Señalemos los hitos más importantes por los que atravesó el virrey de Navarra y -sobre todo- la Diputación del Reino. Sigo al cronista de Navarra Hermilio de Olóriz (+ 1919), a los historiadores Jaime del Burgo Torres, Francisco Miranda, y Rodríguez Garraza, y al jurista Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, entre otros. Si estos autores analizan cómo la Diputación mantuvo los Fueros todo lo que pudo en unas circunstancias límite, la síntesis efectuada por Izu Belloso, imprecisa por varios aspectos, tiende a resaltar la claudicación de la Diputación del Reino en su obligada defensa de los Fueros . Por su parte, Olóriz, como buen postromántico, exagera la independencia de la Diputación en relación con las instituciones del resto de España. Inicialmente, y durante unos meses, el virrey y la Diputación sufrieron la desorientación propia del momento. En esta etapa inicial, a veces ambos se supeditaron a las presiones francesas según las circunstancias, aunque respetando el Fuero. Las críticas de algunos historiadores hacia el virrey y la Diputación del Reino –no creo que hacerlas sea propio del historiador- pueden pecar de un purismo infundado, pues es preciso distinguir la relativa colaboración práctica por un lado de la actuación jurídica institucional por otro. Quizás, a posteriori, un ardiente foralista quisiera más de dichas instituciones, pero las cosas pudieron verse de otra manera desde la realidad del momento. En realidad, ambas instituciones, virrey y Diputación, mantuvieron el Fuero de Navarra. Ahora bien, a pesar de esta inicial colaboración, adelantamos que, a finales de agosto de 1808, la Diputación se inclinó por oponerse públicamente y de una forma absoluta a los Bonaparte, y que, a comienzos de septiembre, el virrey nombrado anteriormente a José (I) fue destituido, apresado y enviado a Francia. 4.2.1. Las proclamaciones. Hemos dicho que en marzo y abril todo era confusionismo. En ambos meses, la Diputación de Navarra afirmó dos veces que carecía de poderes para reconocer a Fernando VII, porque hacerlo correspondía a las Cortes. Por lo mismo, el 8 de junio se negó a reconocer la renuncia de Carlos IV en la persona de Napoleón, y luego a proclamar a José (I) Bonaparte. El 26-X, una vez refugiada la Diputación en la ciudad de Tudela a finales de agosto, la Diputación prestó juramento de fidelidad a Fernando VII aunque no se celebrasen Cortes, debido a las excepcionales circunstancias de huída de Pamplona y declaración de guerra a los Bonaparte. 4.2.2. Los primeros alzamientos populares. Después de las noticias procedentes de Bayona y, sobre todo, del alzamiento de la ciudad de Zaragoza, en Navarra se sublevaron muchas localidades. Los primeros en rebelarse fueron los pueblos de la ribera del Ebro y la merindad de Sangüesa. La sublevación de Estella, realizada el 1 de junio, “fue estimulada por las noticias que venían de Aragón” . Lo mismo ocurrió en Tudela, lo que provocó el alzamiento del día 2, prolongado hasta los combates del día 8 . La sublevación de Tudela fue la más importante del pequeño Reino pirenaico. Los restantes alzamientos fueron simultáneos a los de las diferentes provincias españolas, a pesar de las malas comunicaciones terrestres de aquel entonces. Según Miranda Rubio, ello corrobora que la insurrección no fue tan espontánea como a primera vista pudiera apreciarse, aparte de existir otras razones de peso que justifican la existencia de preparativos en el bando fernandino. Sobre la falta de espontaneidad de los alzamientos de 1808, Francisco Miranda , aunque no aporte pruebas al efecto, afirma lo siguiente: “Participamos de la misma opinión que el coronel Priego, cuando insinuamos que el levantamiento no fue totalmente espontáneo, y así mientras existió la posibilidad de que Napoleón reconociese a Fernando como rey; sus partidarios trataron en todo momento de apaciguar las sospechas y recelos que pudiesen aparecer a la vista de los españoles. Sin embargo, cuando las noticias procedentes de Bayona frustraron tales esperanzas, estos círculos afines al Príncipe Fernando prepararon y precipitaron moral y materialmente al alzamiento nacional. Tampoco hay que negar que la participación del pueblo fuese sincera, puesto que siempre el soldado francés fue mal visto, ya que representaba la antítesis de los principios más sagrados para el pueblo español: Dios, Patria y Rey”. (o. cit. pág. 54). Como causas de la guerrilla en Navarra, Fco. Miranda menciona la traición de Napoleón, el espíritu de independencia, el “movimiento instintivo de patriotismo, frente a la ocupación militar y el rapto de la familia real”, la ideología revolucionaria contra la que se luchó en la guerra contra la Convención y, “por último, podríamos anotar el choque que produjo ante la España profundamente religiosa, la burla de algunos soldados franceses, ateos y depravados ante lo más sagrado y fundamental del pueblo español, su Dios, su Rey y su Patria”. En fin, como en la guerra realista (1821-1823) y después las guerras carlistas -o anticarlistas según se mire-. A pesar de los levantamientos populares ocurridos en Navarra contra las imposiciones francesas, las instituciones del Reino intentaron coexistir con las presiones del poder militar francés. Ya hemos dicho que Navarra careció de una Junta, a modo de las Juntas locales y provinciales establecidas en los diferentes territorios españoles. Esta carencia se debió a que la Diputación del Reino era legítima, a fines de agosto huyó de Pamplona, y los navarros se fiaban de ella por su eficaz defensa del Fuero efectuada durante el siglo XVIII, y porque la Diputación hacía todo lo que podía en las difíciles circunstancias del momento. No en vano, una Circular anónima dirigida a los navarros, y que recoge Miranda, decía así: “NAVARROS. / Es indubitable que nuestro Virrey, y nuestros Diputados se hallan amenazados, y con la espada á la garganta para firmar disposiciones que impidan los movimientos populares del Reyno de Navarra; pero porque nuestro Gefe militar, y nuestros representantes esten sin libertad, y oprimidos ¿los Pueblos vecinos á la valiente y militar Nacion Aragonesa, y que baña el caudaloso Ebro, deberan estar tranquilos en el seno de sus hogares mirando con indiferencia derramar la sangre de sus hermanos, hollar su Religión, y alejar del trono artificiosamente á nuestro amado Rey Dn. Fernando el VII, á quien á manos llenas han colocado en el alto asiento, mayormente teniendo á la vista la conducta de los catalanes, que se hallaban en igual caso? (…)” (o., cit. pág. 328, grafía original). 4.2.3. La Asamblea de Bayona. Según Jaime del Burgo, la Diputación puso objeciones a la convocatoria de la asamblea de Bayona efectuada el 19 de mayo. Esta asamblea se reunió el 15-VI-1808. Por su parte, la Diputación alegaba “que el nombramiento de diputados correspondía a las Cortes, y que éstas no se habían reunido desde 1801. A ella sólo le correspondía mantener las leyes y fueros del reino”. Al fin, la Diputación transigió y envió como representantes a don Miguel Escudero y don Luís Gainza, aunque también acudió don Joaquín Javier Uriz y Lasaga (pbro. y prior de la Colegiata de Roncesvalles) en sustitución del obispo Arias Teixeiro, que siempre será antiliberal y por entonces pretextó hallarse enfermo. Jaime del Burgo indica que los elegidos “habían asistido a las sesiones de las cortes en que se votó la constitución de Bayona, pero en ningún caso ostentaban una representación legítima, como tampoco la tendrían los que después votarían la constitución de Cádiz de 1812” . No en vano, la Diputación tenía la representación del Reino aunque subordinándose, en última instancia, a las Cortes. A pesar de ello, y a decir de Rodríguez Garraza: “Es la primera vez que Navarra recibía semejante invitación, que destruía por completo su estado político. Y fue la Diputación legítima del Reino la que transigió en enviar diputados a las Cortes de Bayona. Esta actitud, tan poco vigorosa, la determinaban, sin duda, las circunstancias del momento” . Quizás este autor tome los términos con un excesivo rigor, porque la reunión de Bayona se planteó como una Asamblea de Notables (no propiamente como Cortes), en ella todo eran expectativas, y el texto que se iba a redactar podría respetar todos los derechos del Reino de Navarra y los restantes territorios forales. No en vano, la Diputación de Navarra objetó, antes del envío de representantes, que nombrar diputados era labor de las Cortes, y que ella no debía hacerlo toda vez que sus obligaciones se reducían a mantener las leyes y fueros del Reino. Esta afirmación era clave, porque modificar el estatus del Reino correspondía directa y expresamente a las Cortes de Navarra y no a los enviados de la Diputación del Reino. Un representante (para evitar equívocos hablo de enviado) no tenía la naturaleza, ni la categoría, ni las atribuciones de un miembro de las Cortes de Navarra, y menos todavía de la propia institución de las Cortes. Por otra parte, la Diputación no podía sustituir a las Cortes, ni nombrar diputados que representasen al Reino, y sí sólo representantes (enviados) suyos (de la Diputación), lógicamente con atribuciones limitadas. Insisto en que os enviados no eran representantes del Reino sino de la Diputación, y que sus capacidades eran bastante limitadas. Otra cosa es lo que quisieron enredar el positivismo y voluntarismo revolucionarios, y los engaños napoleónicos. Cuando el pueblo navarro tomó las armas, es porque Napoleón imposibilitaba, hasta el retorcimiento, toda posible salida, manipulando todo y a todos al servicio de su voluntad de hierro. Entrar en el juego afrancesado arrastraba, a quien lo hacía, a cumplir al pie de la letra los planes de Napoleón. Una cosa era acudir a la convocatoria a la Asamblea de Bayona, otra lo que podía ocurrir en la reunión, y una tercera la posterior culminación de lo dictado por Napoleón y aceptado -del todo o en parte- por los asistentes. Añadamos que el 27-VI, y a iniciativa del Señorío de Vizcaya, los representantes de Navarra y los restantes territorios forales propusieron la abstención en el caso de no conservarse sus respectivos Fueros. No obstante, y quizás por el Art. 144, al final juraron el texto legal. ¿Qué decía el texto aprobado el 7 de julio? En realidad, la letra de la llamada Constitución de Bayona anulaba los Fueros de Navarra, al reducir al milenario Reino de Navarra a una provincia administrativa. En efecto, el art. 144 decía: “Los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se examinarán en las primeras córtes para determinar lo que se juzgue mas conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación” (respeto la grafía original). Ahora bien, puede señalarse que tratar a todos los territorios como provincias podía ser por el momento un término genérico que no determinaba si Navarra perdía su naturaleza de Reino, Vizcaya la del Señorío y Guipúzcoa y Álava el ser Provincias con mayúscula. Desde luego, suponía más que una peligrosa falta de respeto. En apoyo a ello, obsérvese que el orden de territorios sigue la importancia tradicional: Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias (con mayúscula) de Guipúzcoa y Álava. De todas maneras, la letra del texto legal debía de ser suficiente y no permitir suposiciones inexistentes, más que arriesgadas y, en cuanto tales, contrarias al sentido político más elemental. Aunque dicho artículo 144 (no el 64 que dice Izu Belloso) reservaba para las próximas Cortes el futuro político de Navarra, sin anular por ello toda esperanza de respetarse los Fueros íntegramente, los artículos 96 y 98 establecían un único código civil y criminal para toda España e Indias, y suprimían los tribunales y jurisdicciones privativas. Seguimos en 1808. El 8 de junio, la Diputación del Reino afirmó no tener poderes para reconocer las renuncias de Bayona en Napoleón, porque cambiar de dinastía era asunto propio de las Cortes. Aunque, el 2 de julio y desde Bayona, José Bonaparte ordenó a la Diputación que le reconociese como monarca en un breve plazo de cuatro días, el día 4 la Diputación acordó suspender la aceptación de la Constitución de Bayona y de efectuar dicha proclamación, porque para proclamar a José (I) como rey se tenían que reunir las Cortes, máxime cuando al no reunirse éstas todavía no se había reconocido a Fernando VII. La Diputación encargó a sus representantes Sres. Escudero y Gainza, que seguían en Bayona parar estar al tanto de los acontecimientos, que transmitiesen su resolución a José Bonaparte, aunque su contenido no llegó a conocimiento de José (I) por culpa de los ministros josefinos Urquijo (vizcaíno) y Azanza (navarro), que consideraban peligrosas las razones de la Diputación. 4.2.4. Expulsión del virrey. Me refiero al virrey nombrado legítimamente y anterior al virrey impuesto por José (I) Bonaparte. Durante unos meses, el virrey, marqués de Vallesantoro (Leopoldo de Gregorio y Paterno, titular de un hermosísimo palacio en Sangüesa), optó por alguna subordinación a los franceses. Aclaremos las fechas en relación con el cese, prisión y posterior traslado del marqués a Francia. Para unos historiadores, el 8-IX-1808, el marqués de Vallesantoro fue sustituido por el teniente general Fco. J. Negrete y Adorno, conde de Campo Alange, aunque Jaime del Burgo suponga que fue el 8 de agosto. Aclaramos que la fecha es el 8 de septiembre, pues ésta es la del Decreto de José I en el que informa de dicha sustitución al Ayuntamiento de Pamplona. Dos hechos lo corroboran. El primero es decisivo, pues la corporación municipal recibió dicho Decreto en su sesión del 20 de septiembre. El segundo apoya el anterior por las fechas -aquí dice bien Jaime del Burgo-, pues el 8-IX el general d’Agoult reconoció, en su carta dirigida a la Cámara de Comptos de Navarra, que había enviado al marqués preso a Francia, porque el rey José estaba descontento con su conducta política. Por su parte, Fco. Miranda, afirma que el marqués fue detenido durante los primeros días de septiembre y enviado a Francia como preso político, sustituyéndole el citado Negrete como virrey el 8-IX. Como valoración, digamos que, para Jaime del Burgo, el marqués Vallesantoro no se distinguió “por su energía frente a las exigencias francesas, pero al menos representaba la legalidad del antiguo régimen, cosa que no ofrecía el nuevo virrey” ya que satisfacía plenamente las aspiraciones de los invasores. Pasemos a un segundo dato. Equivocándose Jaime del Burgo en la fecha, se equivoca también en el nombre del virrey, cuando dice que fue el conde de Campo Alange quien, el 24-VIII-1808, hizo público el nombramiento del general francés d’Agoult como gobernador militar del reino de Navarra. Su hijo Jaime Ignacio del Burgo corrige el dato sustituyendo al conde de Campo Alange por el virrey marqués de Vallesantoro, que todavía no había sido cesado. Claro está que nada de esto empaña la Historia General de Navarra de Jaime del Burgo. 4.2.5. La Diputación huye a Tudela. Los días 29 y 30 de agosto, la Diputación del Reino, que hasta entonces había intentado la coexistencia pacífica con los franceses –inicialmente aliados de España-, abandonó sigilosamente (adverbio éste usado por varios historiadores) la ciudad de Pamplona en dirección a Tudela. Ella misma informó a los navarros de este traslado o huída en su manifiesto del 3 de octubre. Una de las primeras preocupaciones posteriores de esta Diputación, será organizar la guerra contra los franceses. Piénsese en la petición de armas a los ingleses el 11-IX para luchar en el Reino de Navarra, y el Plan militar propuesto a la Junta Central el 13-X. El 26-X, la Diputación, que estaba en la ciudad de Tudela, prestó juramento de fidelidad a Fernando VII, para evitar vacío de poder y por tener éste el máximo poder militar. En esta situación de emergencia, la Diputación se adelantó a las Cortes, aunque no cabe duda que el pueblo ya le había proclamado con los hechos y las Cortes no podían reunirse. En adelante, la Diputación aceptará a la Junta Central suprema y gubernativa, instalada el 25-IX y encargada de luchar contra Napoleón, aunque inicialmente no envió a ella representantes. Por ejemplo, la Diputación solicitó a la Junta Central que la Real Hacienda se ocupase de los gastos militares en Navarra. Para la Diputación, esta Junta era el Gobierno supremo en nombre del rey y, en ese sentido, sustituía al monarca en el ejercicio. El 28-X, y aunque carecía de atribuciones para ello, la Diputación declaró la guerra a los franceses, haciéndolo por “la Religión, el Rey y la Patria”, según repitió dos veces en su Declaración del 7-XI, e informando de dicha Declaración a la Junta Central. Desde el punto de vista francés, el general imperial Monçey pretendió suplantar a los diputados huidos a Tudela, pero sin éxito. Algo después, el 4-VIII-1810, su sucesor el general conde de Reille, restableció una Diputación (ilegítima según los navarros), nombrada y controlada por él, con la principal función de repartir contribuciones extraordinarias de guerra. Ahormada en la Constitución de Bayona, ésta Diputación afrancesada (ilegítima, impuesta y provincial) no tendrá relación alguna con la Diputación legítima del Reino que estaba en activo, aunque perseguida por el francés. 4.3. La Diputación y la Junta Central Respondamos a estas preguntas: ¿Cuál fue la relación entre la Diputación legítima y la Junta Central? ¿Cómo se dispersaron los miembros de la Diputación del Reino (legítima y no disuelta), que estuvo activa en 1808 y 1809, como institución que enlazaba las reuniones de Cortes celebradas en Navarra? Esta Diputación, ¿trasladó la legitimidad, que mantuvo a salvo, a la Diputación restaurada el 28-V-1814, una vez que Fernando VII no quiso aprobar la Constitución liberal redactada en 1812? Esta Diputación, ¿vió interrumpido este proceso por la Diputación Provincial elegida el 26-IX-1813, y constituida el 1-X-1813 según disponía la Constitución de 1812? Hemos dicho que el virrey, marqués de Vallesantoro, fue hecho prisionero a comienzos de septiembre de 1808, y que la Diputación huyó de Pamplona a Tudela –cuyo Ebro riega la fértil huerta de La Mejana-, como segunda ciudad del Reino. También hemos afirmado que, según el jurista del Burgo Tajadura , la Diputación de Navarra no envió inicialmente representante alguno a la Junta Central creada en 25-IX. Llama la atención que los documentos que señalamos a continuación estén firmados por unos pocos miembros de la Diputación y que, en todos ellos, aparezca el ya citado Miguel Escudero. No consideraremos aquí la validez jurídico-política o representatividad de una Diputación tan mermada en sus componentes. Otra pregunta es si dicho Escudero, que estará en las Diputaciones del Reino de 1808, Provincial de 1813 (como jefe político) y nuevamente en la del Reino de 1814, inclinó, a los demás miembros de la Diputación, a aceptar y subordinarse a la Junta Central en 1808-1809 y en qué sentido. El 13-X-1808, la Diputación del Reino informó -con 3 de sus 7 miembros- a la Junta Central sobre el Plan que aquella tenía de formar batallones navarros. Al final dice: “No me resta sino el ponerlo todo en noticia de V.A. para que se digne a manifestarme si es de su aprobación q(u)e me será lo mas lisongero, pues me parece que siguiendo el espiritu de mi constitución no puedo obrar de otro modo en los urgentes acontecimientos del día; sujetándome á las ordenes y preceptos que V.A. tenga á bien dispensarme” (Miranda, o. cit. pág. 332). También informó a la Junta Central desde Tudela que, el 7-XI, había declarado de guerra a los franceses y convocado a los navarros a las armas con arreglo al Fuero. La Diputación dijo haberlo hecho “conforme al espíritu de la Constitución del Reino”, manteniendo “el conducto de la ley, de que (los navarros) son celosísimos” cuando se trataba de cumplir sus deberes militares para con el Rey y la Patria. Esto implica que la Diputación no renunciaba ante la Junta Central a Fuero alguno del Reino. Después de la batalla de Tudela, que tuvo lugar el 23-XI-1808 , y tras la ocupación militar de esta ciudad por los franceses, la Diputación huyó al término de Tauste, donde informó (2 de sus 7 miembros) a la Junta Central (25-XI-1808), tratándole como si fuese el Rey: se dirige al “Señor” y a “V.M.”, y habla del “servicio de V.M.”, añadiendo que -con esta carta- informa “a la R(ea)l. noticia”. Desde ahí, el 4-XII, la Diputación se estableció en Huesca, donde de nuevo informó (3 de sus 7 miembros) a la Junta Central, otorgándole el mismo tratamiento. Y de nuevo huyó hacia otros lugares de Aragón. Más tarde, el 13-IV-1809, la Diputación envió una carta a la Junta Central desde Arnedo (Logroño), tratándole de “Señor” y “V.M.”, y mostrando su “homenaje debido exclusivo á su legitimo soberano el Sor. Dn. Fernando VII”. Aunque Francisco Miranda afirme: “Suponemos que aquí se disolvería definitivamente la legítima Diputación”, Jaime del Burgo Torres muestra diversas actividades de la Diputación entre el 8-VIII-1809 (Préjano, cerca de Arnedo) y el 18-XI-1809 (Arnedo). Es por entonces cuando, según Jaime del Burgo Torres, “teniendo en cuenta las circunstancias, los diputados acordaron refugiarse donde pudiera cada uno, enviando a la Junta Suprema Central representantes para que les convocaran en caso de necesidad. Parece lógico pensar que estos representantes fueran los ya miembros de la Junta, Miguel de Balanza y Carlos Amatria”, que habían pertenecido a la Diputación del Reino del 13-VI-1801 . Además de ignorarse en concepto de qué ambos estaban en la Junta Central, no queda claro cuándo -por uno u otro motivo- ingresaron en dicha Junta. Izu Belloso se limita a constatar que la Diputación envió a dos miembros para asistir a la constitución de la Junta Suprema Central en septiembre de 1808, lo que no admiten Del Burgo Tajadura y Del Burgo Torres, pues éste último se refiere a las tardías circunstancias de finales de 1809. Así pues, Izu Belloso parece adelantarse un año completo. 4.4. ¿Relacionarse con la Jjunta Central fue un contrafuero? Este aspecto no ha sido profundizado por los historiadores. Planteemos esta importante cuestión: ¿la Diputación actuó conforme a los Fueros al enviar a dos representantes suyos a la Junta Central? Esta es la primera vez que Navarra tuvo la ocasión -e incluso la necesidad- de participar o relacionarse con una institución común al resto de españoles diferente a la persona del monarca. Realmente, las circunstancias de guerra eran graves, y Navarra no podía actuar aisladamente contra los franceses, ni debía si es que quería conservar sus Fueros (recordemos la ofensiva centralista y antiforal de Godoy). También era la primera vez que surgió en España una institución con el perfil de la Junta Central. Según el Fuero, Navarra no podía estar propiamente representada en la Junta Central. ¿Por qué?: porque la Junta Central no era un organismo navarro, y algunas de sus atribuciones solapaban las propias de las instituciones navarras. Por lo mismo, Navarra tampoco podía estar representada en las Cortes generales de España en 1812 por tener Cortes propias al ser “Reino de por si”. La respuesta a la pregunta de este epígrafe es negativa. Por mi parte, adelanto varias posibilidades que permitían a la Diputación enviar representantes –o legados y enviados, que tenían una categoría superior a los meros agentes- a dicha Junta Central: 1ª) Sobre la naturaleza de la representación. Aunque esta representación era institucional de la Diputación de Reino, los representantes (aquí les llamaré legados) no sustituían a dicha institución como tal. Una cosa es que la Diputación enviase legados a la Junta Central y otra muy distinta que estos sustituyesen a la Diputación y, más todavía, al Reino. Por otra parte, más que la representación importan las atribuciones que tiene el representante o legado. En esta ocasión, la Diputación decidió el envío voluntariamente, sólo algunos de sus siete diputados estaban presentes para tomar la decisión, y lo hizo para evitar un vacío de poder al dispersarse los miembros de la institución. Recordemos que la Diputación tenía como objetivo la guerra en Navarra contra Napoleón, de manera que el móvil para el envío de representantes (o legados) era algo práctico, temporal y de extrema necesidad como era la lucha contra el francés, máxime al carecer Navarra de fuerzas propias. A ello se añadía que los miembros de la Diputación se encontraban fuera de Navarra, y que la persecución sufrida por los franceses les abocó a su dispersión. Idéntica motivación militar tuvo la Diputación en sus relaciones con la Junta Central antes de huir aquella de Tudela. Después de valorar esta cuestión, se observa la gran importancia que tiene el que la Diputación nombrase representantes para que se les convocara en caso de necesidad, y no de forma ordinaria y permanente. Según esto, la Diputación de Navarra mantenía su autoridad, y le interesaba que la Junta Central contase con ella por motivos de guerra. 2ª) La Junta Central reunía a las Juntas Provinciales y no era una Regencia. Como en Navarra no había Junta Provincial sino Diputación del Reino, difícilmente ésta podía situarse al nivel de dichas Juntas y provincias. La Diputación debía conformarse con tener unos enviados (legados) que tratasen o cooperasen con la Junta Central sobre algunos temas. Esto era necesario porque el principal propósito de la Junta Central era ganar la guerra contra los franceses, y convocar Cortes (en las que no podía estar Navarra) para ese mismo fin. 3ª) Sobre el carácter de la Junta Central. Más que estar en la Junta Central, los navarros enviados debían de trabajar con dicha Junta. Esta Junta sustituía a los ministros del monarca que actuaban a las órdenes del rey –no sustituía a la persona del monarca- cuya prisión le impedía ejercer los poderes regios. Ciertamente, la Junta Central no era una Regencia colegiada; la Regencia sólo se nombró al desaparecer la Junta Central, y tenía tres y no 35 miembros. La Junta Central se atribuyó el título de “V. M.” por conveniencia para subrayar su dependencia del monarca, para mandar en el nombre del rey en el ejercicio de las funciones que éste no podía realizar, y para solventar las dificultades que la Junta tenía para ser reconocida y obedecida desde antes de su formación hasta ser sustituída por la Regencia. Lógicamente, los representantes (legados) del Reino de Navarra podían participar en algunas cuestiones, libre y voluntariamente, en este Gobierno “federativo” de Provincias (en sentido amplio) autárquicas, en atención a la insuficiencia militar de los navarros, al tema concreto de defensa militar, y a la guerra generalizada contra el coloso de Europa. A falta de monarca, la relativa vinculación o relación de la Diputación del Reino con la Junta Central expresaba -de alguna manera- la especial incorporación de Navarra a Castilla –incorporación real y no sólo personal-, sobre todo tratándose de una guerra generalizada frente a Napoleón. En la Junta Central no había ministros, debido al elevado número de sus componentes, sino reparto de encargos. No es que los legados del Reino de Navarra tuviesen encargos, sino que al ser convocados sólo en caso de necesidad, participaron en el tema militar que interesaba a todos. Lo antiforal era que la Junta Central gobernase en temas privativos de Navarra, lo que no pudo hacer porque Navarra estaba en guerra y la Junta Central se centró en solucionar los problemas militares. El gran peligro era que la Junta Central, al convocar Cortes generales, incluyese en ellas al Reino Navarra –que tenía sus propias Cortes-, que es lo que ocurrió. Si estar en una institución no Foral de la manera que hemos señalado no suponía actuar contra los Fueros, sin duda las posibles decisiones antiforales de la Junta Central se pensaban solventar en cada caso concreto. Debido a la polarización en la guerra, éstas últimas ocasiones no llegaron. La salvaguardia del Fuero estaba asegurada por el momento, aunque era frágil, tanto como las circunstancias de guerra. 4º) La Junta Central no era una institución política subalterna. Había tomado el título de “Majestad”, y así le reconoció la Diputación del Reino aunque, en un principio, el 13-X-1808 le tituló “Ilustrísima” y “Vuestra Alteza”. Este tratamiento no suponía un espíritu revolucionario de soberanía nacional, precisamente porque dicha Junta Central sustituía el ejercicio de los derechos de un rey que estaba preso, actuando en su nombre. No en vano, la Junta Central será sustituida después por la Regencia, propuesta antes por Jovellanos en cumplimiento de las Leyes Fundamentales de la monarquía. Aclaremos que la Junta Central y la Regencia no se identificaban, pues la primera funcionó de forma participativa con los representantes de las Juntas Provinciales, expresión de una sociedad española en Armas, mientras que la Regencia era colegiada de tres miembros. Desarrollemos este punto que tiene como núcleo principal la peculiar importancia de la Junta Central. Sobre la Diputación del Reino (y las Cortes de Navarra) sólo estaba el rey o, en las circunstancias y condiciones que tratamos, aquella institución que sustituía el ejercicio de los poderes del monarca, esto es, la Junta Central, y luego aquella otra que sustituía su persona, es decir, la Regencia en sus atribuciones de “Majestad” con un poder limitado por los Fueros. Ahora bien, tanto lo dicho anteriormente, como el hecho de sustituir tan sólo el ejercicio de los poderes regios, indica que la Junta Central no estaba sobre las instituciones del Reino de Navarra. Sobre todo es importante que la Junta Central no se atribuyese derecho a la summa potestas (“soberanía” regia) sino al ejercicio de dicha potestas. Y, además, un ejercicio limitado a las atribuciones arriba señaladas. Desde luego, el monarca preso no podía ejercitar la potestas de cuyo ejercicio era él titular, sino que era la sociedad organizada, la otra parte del pacto tradicional, realizado entre el rey y la comunidad orgánica y representada en Cortes, la que podía –y por ello debía- hacerlo en plenitud, precisamente a través de las instituciones al efecto según Derecho. ¿No era la sociedad española la que se ejercitaba con las Armas frente a Napoleón y el usurpador José? Sí, y la Diputación envió a dos navarros a la Junta Central para que les convocaran en caso de necesidad -es decir, no ordinariamente-, aunando los esfuerzos bélicos de todos para luchar contra el enemigo común Napoleón. La Diputación les envió junto a una institución como la Junta Central que, sin ser rey, ejercía interina y excepcionalmente algunas de las funciones del rey preso, sobre todo las militares. Les envió al lado de la Junta Central que sustituía al rey en el ejercicio de sus funciones, manteniendo los derechos del monarca. Nada de esto era revolucionario, sino típicamente tradicional. Nada era práctica absolutista. Parece acertado el juicio de Del Burgo Tajadura, según el cual, “por vez primera Navarra quedó así representada en un organismo de gobierno común a toda la monarquía” , si entendemos esta presencia como un “organizar con otros” la guerra frente a Napoleón, pero sin perder Navarra sus propias atribuciones. Las instituciones propias de Navarra no estaban incluidas en otras instituciones generales, pues Navarra siguió siendo Reino “de por sí”. En realidad, no había propiamente representación del Reino de Navarra en la Junta Central, sino enviados o legados de la Diputación, con carácter ocasional, en circunstancias críticas para las instituciones de Navarra (la Diputación dispersa), y por motivos de guerra. La otra afirmación de Del Burgo, según la cual con la Regencia que sustituía a la Junta Central desapareció “la representación de Navarra de la escena política y, por tanto, el enlace entre los organismos nacionales y los miembros de la Diputación del Reino que se hallaban dispersos” , debe entenderse en el marco de que era la Regencia -y no la Junta Central-, la que sustituía interinamente a la persona del monarca ausente. Navarra podía estar con el resto de la monarquía junto a una institución puntual y de emergencia como era la Junta Central, aunando esfuerzos para hacer la guerra a Napoleón –Navarra tenía competencias exclusivas en los restantes temas-, mientras que, evidentemente, no podía formar parte de la Regencia porque ésta sustituía la persona del rey. Desde luego, Navarra tenía su Fuero militar que debía de ser –y de hecho lo fue- respetado. La gran tentación era que, una vez desaparecida la Junta Central como plasmación institucional de la solidaridad entre todos los españoles –incluidos lógicamente los navarros-, se buscase otra institución como las Cortes convocadas por la Junta Central –poco antes de dar ésta paso a la Regencia-, y se prolongase en ellas la anterior solidaridad, hasta llegar a pedir o exigir la presencia del Reino de Navarra, a pesar de tener éste Reino Cortes propias. Para terminar, recordemos que, el 10-VIII-1810, el general francés Reille creó una Diputación provincial sujeta al mando militar francés, sin carácter representativo, y con escasas prerrogativas (sobre todo actuaba en materia de contribuciones). Pero esta no era la Diputación legítima y del Reino. Según las leyes e instituciones navarras, tampoco será legítima la Diputación Provincial, elegida el 26-IX-1813 conforme a la Constitución de Cádiz. 4.5. Las Cortes Generales de Cádiz como Contrafuero El 4-XI-1809 se publicó el Decreto que convocaba Cortes generales para el 1-I-1810. La Diputación del Reino (muy incompleta en sus miembros) recibió el encargo de la Junta Central de nombrar al diputado navarro que debiera asistir a las Cortes generales (Arnedo, 18-XI-1809). La Junta Central lo solicitó antes que los miembros de la Diputación se dispersasen y enviasen representantes a la Junta Central para que les convocaran en caso de necesidad (del Burgo Torres). Era comprensible (aunque según el Fuero de Navarra fuese inadmisible) que la Junta Central pidiese el envío de diputados, debido a los precedentes centralistas la misma Corte de Madrid, donde habitualmente se desconocían los Fueros de Navarra, según el agente de la Diputación en Madrid decía a ésta última hacia 1775. El envío de diputados a las Cortes vulneraba directamente los principios constitucionales del Reino de Navarra. Según Jaime del Burgo: “La Diputación quedó perpleja, pues si acudía a las mismas, parecía renunciar a la autonomía parlamentaria de que gozaba, y si no lo hacía en aquellas circunstancias extraordinarias, se despegaba del esfuerzo común de los españoles en la guerra contra el invasor francés. / La Diputación de Navarra, como ocurrió en otras ocasiones, trató de eludir el compromiso, en lo que siempre había demostrado su habilidad diplomática, y contestó que el reino se hallaba en una grave situación, sojuzgado por el enemigo, bajo cuyo poder yacen todos sus moradores” . Así pues, en Navarra no hubo elecciones para el nombramiento de diputados a las Cortes de Cádiz. Por ser algo antiforal, toda vez que Navarra tenía Cortes propias, la Diputación no quiso nombrarlos, y trató de eludir el compromiso con habilidad diplomática. Nos es desconocida la manera como fue nombrado el diputado Fco. de Paula Escudero. El resultado de las Cortes de Cádiz fue rechazado por la generalidad de los navarros . 4.6. Restauración de la Diputación legítima La pregunta es si, en 1814, hubo reagrupación de los componentes de la Diputación del Reino (la legítima, no la nombrada por los franceses) dispersos a finales de 1809 (la Diputación no se disolvió propiamente), o bien si la Diputación del Reino se restauró en dicho año 1814. En caso afirmativo, la legitimidad de la primera Diputación pasaría a la segunda sin solución de continuidad. Pero, en sentido estricto, no fue así. Durante la guerra contra Napoleón, los navarros se confundieron con el resto de la nación española, entendida ésta en sentido amplio. No se demuestra, y creo que no puede saberse, si como dice Rodríguez Garraza el pueblo “perdió, en gran parte, la conciencia de su independencia y de su personalidad”, aunque la causa de los navarros fuese la misma que la del resto de españoles. Al parecer, en los años de la guerra “era imposible aplicar la propia Constitución Navarra”, pues en toda Navarra, salvo Pamplona que estaba ocupada por los Bonaparte, no había otra ley que la del guerrillero Fco. Espoz y Mina. Recordemos que éste mandará fusilar la Constitución de 1812, y que sólo tras 1814 se hará liberal por despecho hacia Fernando VII, que había preferido como virrey de Navarra al conde de Ezpeleta en vez de nombrar a este labrador de Idocin (tal era el origen de Espoz y Mina) que, por méritos, había llegado al rango de general. En realidad, el nuevo régimen liberal, constituido en 1812, tuvo muy poca vigencia en Navarra. Lo he estudiado con detalle aplicado al Ayuntamiento de Pamplona . El 26-IX-1813 se eligió la Diputación provincial y, el 1-X-1813, ésta se constituía con el ya citado Miguel Escudero como jefe político en calidad de presidente. La Diputación legítima del Reino (no la francesa), dispersa en 1809, no tuvo continuidad en la Diputación Provincial del 1-X-1813, pues ésta última rompió con la tradición y las leyes del Reino navarro por seguir la Constitución de 1812. A pesar de eso, y aparentemente de forma contradictoria, los mismos miembros de la Diputación Provincial trabajaron por la restitución, reposición o reintegración de los Fueros seculares, como deseaba la generalidad de los navarros. Y tuvieron un fácil éxito. Así, en 1813, el mismo jefe político Miguel Escudero será miembro de la Diputación restaurada en 1814. Aunque en sentido estricto, la Diputación de 1808-1809 pudiese transmitir su legitimidad a la nombrada (o restaurada) en 1814, en éste último año es mejor hablar de restauración que de reagrupamiento de los diputados dispersos en 1809. Diremos el por qué. En primer lugar, es conforme a los testimonios de la Diputación de 1814. Asímismo, el vacío de instituciones y de legitimidad que de hecho sufrió Navarra desde finales de 1809 hasta finales de 1813, fue común al de toda España, pues en Navarra no existían las instituciones propias de su constitución histórica a causa la presencia militar francesa, mientras que las Cortes de reunidas en Cádiz no podían legislar sobre Navarra, siendo su liberalismo contrario a la Constitución histórica de Navarra o del resto de España. En tercer lugar, los miembros de la Diputación de 1808-1809 no hicieron acto de presencia en 1814 y sí, sin embargo, los de la Diputación Provincial. El 4-V-1214 el Rey Fernando declaraba nula la Constitución de 1812. El 28-V-1814, se restauró en Pamplona la antigua Diputación del Reino de Navarra. No se hizo por decreto del monarca, sino antes que éste restableciese las instituciones del Reino el 17 de julio y 14 de agosto. Así, “la transmisión de poderes se efectuó por la propia Diputación Provincial y el Jefe Político, por haber considerado que al derogar Fernando VII la Constitución de 1812 y dado por nulas sus actuaciones ‘como si no hubiesen pasado jamás tales actos’, la primitiva Constitución de Navarra quedaba restablecida ‘ipso facto’ “ . Formaban parte dos antiguos diputados de 1808, Miguel Escudero y Carlos de Amátria (o Amátria) –lo que muestra la continuidad de la Diputación-, más otros cinco diputados, entre ellos el obispo de Pamplona fray Veremundo Arias Teixeiro, que tan briosamente se opuso a los franceses y al liberalismo. 5. Colofón Terminemos. La concepción del pueblo español sobre la religión católica, la monarquía, y la sociedad y nación española, fueron la causa de las contradicciones y del triple error de Napoleón –religioso, monárquico, y nacional-, que “acarre(ó) la ruina del Imperio” (Pabón). En España se generalizó el convencimiento de que los franceses, además de enemigos de España y del Rey, lo eran de la Religión. Baste citar el Catecismo popular leído en la zona no ocupada por los franceses, el libro Despertar cristiano, los destrozos y sacrilegios cometidos por las tropas francesas, la política de José (I), los escritos de –por citar sólo un ejemplo- don José de Larrea en el Libro Parroquial de Berrosteguieta (21-VI-1813) , y la prisión y destierro del Papa S.S. Pío VII. Digamos que esto último no obligaba al alto clero a incitar por Decreto episcopal a los españoles a favor de la insurrección, a diferencia de lo que parece suponer Díaz-Plaja. También Fugier subrayó el error de España del Emperador Bonaparte. Si seguimos las denominaciones ofrecidas por Alonso Báquer (1983), el Dos de Mayo se trató de un levantamiento popular debido a producirse al margen de la fuerza armada (me refiero a los mandos militares superiores). Ahora bien, su prolongación en España fue un alzamiento nacional, en el que actuaron el pueblo, dirigentes y mandos militares. En España y, dentro de ella, en Navarra, no hubo vacío de poder y autoridad. Así pues, los argumentos utilizados por los defensores de la soberanía nacional, quedaban fuera de la realidad española del momento. ¿Qué paralelismos pueden señalarse entre Castilla y el Reino de Navarra, -incorporado a la Corona de Castilla en 1513-1515- ante la invasión francesa en 1808?: 1º) Napoleón buscaba la sumisión, luego utilizó el engaño y, al fin, sustituyó a los gobernantes españoles –tanto en Castilla como en Navarra- por naturales que se plegasen a sus intereses. Si los naturales, que ocupaban las más altas instituciones políticas, siguieron manteniendo su inicial colaboración con los franceses una vez transcurridos los conflictivos meses de mayo a diciembre de 1808, se les puede considerar afrancesados. Seguramente estos, tras 1814, deberán limpiar de infidelidad su ejecutoria en los procesos llamados de infidencia. 2º) En ambos casos, en Castilla y Navarra, sus instituciones propias fueron inicialmente posibilistas ante la fuerza francesa. Lo fueron hasta que la victoria de Bailén y la consiguiente liberación de Madrid en el caso de Castilla, y hasta la sublevación de diversas poblaciones y las excesivas presiones francesas sobre la Diputación del Reino en el caso de Navarra. Durante unos meses, el virrey de Navarra y los organismos forales colaboraron con la monarquía de José (I) Bonaparte. Cada uno por sus circunstancias concretas, a finales de agosto de 1808 trocaron la relativa subordinación por la resistencia, y además mediante una oposición activa. 3º) En Castilla y Navarra las sublevaciones populares fueron casi simultáneas. En Castilla fueron en mayo y comienzos de junio, y Navarra en junio, siendo éstas últimas estimuladas por el ejemplo de Zaragoza. 4º) En Madrid una Junta de Gobierno suplía al monarca, aunque de hecho estuvo controlada por el mariscal Murat. Actuó de forma tímida ante el Dos de Mayo, algunos de sus componentes eran afrancesados, y las Juntas Provinciales la sustituirán por la Junta Central. En Navarra, el virrey marqués de Vallesantoro sustituía a la persona del rey; será inicialmente posibilista ante los franceses, fue cesado por estos para el 8 de septiembre de 1808, y después será apresado y enviado a Francia. El virrey de Navarra fue más libre, legal y firme, que la citada Junta de Gobierno radicada en Madrid. 5º) En Madrid el Consejo de Castilla, y en Navarra la Diputación del Reino (no el Consejo Real, que fue afecto a los franceses), colaboraron con los franceses hasta que se opusieron frontalmente a ellos en agosto de 1808. 6º) En Castilla, la representación de la legitimidad fue finalmente recogida por la Junta Central en septiembre de 1808, que hacía de Gobierno del monarca. Luego la Regencia sustituirá a dicha Junta el 29-I-1810. Por su parte, en Navarra, la legitimidad fue mantenida por el virrey y la Diputación del Reino, y, tras el cese del virrey, sólo por la Diputación, hasta la dispersión de sus miembros (no su disolución que no se produjo) un año más tarde, en noviembre de 1809. 7º) Dispersa la Diputación legítima de Navarra, ésta envió dos representantes a la Junta Central, hecho que, sin ser contrario a los Fueros, pudo ser imprudente, porque dicha Junta podía intervenir –aunque no lo hizo- en cuestiones que afectaban a Navarra, y después solicitó al Reino de Navarra participar en las Cortes generales, lo que era contrario a los Fueros del Reino de Navarra, que tenía Cortes propias como Reino “por sí”. 8º) La principal tesis de este trabajo es que en España, incluido particularmente el Reino de Navarra, no hubo vacío de poder y autoridad mientras Fernando VII estuvo preso en Bayona. Otra cosa es la ruptura producida por las Cortes de Cádiz, que hemos tratado en otro trabajo (revista digital “Arbil”, nº 116, junio 2008, 24 fols.). ·- ·-· -······-·
José Fermín Garralda Arizcun
ROGRÍGUEZ GARRAZA Rodrigo, Navarra de Reino a Provincia” (1828-1841), Pamplona, Eunsa, 1968, 516 pp., pág. 27 SARRAILH Jean, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, Fondo de Cultura Económica,1979, (1ª ed. 1954), 784 pp., pág. 579 GARRALDA ARIZCUN J. F. “Las Cortes de Cádiz de 1812, el ideario de la Revolución Francesa y la herencia política de España”, en Rev. Digital “Arbil. Anotaciones de pensamiento y crítica”, nº 116 (junio 2008). SARRAILH J., La España ilustrada… o. cit. HERR Richard, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1988 (1ª ed., 1960), 417 pp. ANES Gonzalo, Historia de España Alfaguara IV. El Antiguo régimen: los Borbones, Madrid, Alfaguara, 5ª ed., 1981 (1ª ed., 1975), 513 pp. ANES G., El Antiguo régimen… o. cit. pág. 432. ANES G., El Antiguo régimen… o. cit. pág. 433. GIL MUNILLA Octavio, “Hacia una nueva sociedad”, en Historia General de España y América, Madrid, Rialp, Tomo XII: Del antiguo al nuevo régimen. (Hasta la muerte de Fernando VII), 1992, 634 pp., pág. 14-82. PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, J., El dos de mayo de 1808 en Madrid, Madrid, 1908; MUÑOZ MALDONADO, José, Historia política y militar de la guerra de la Independencia de España contra Napoleón Bonaparte, desde 1808 a 1814, Madrid, 1833; LOVETT, Gabriel H., “El intento afrancesado y la guerra de Independencia”, en Historia General de España y América, Madrid, Rialp, Tomo XII: Del antiguo al nuevo régimen. (Hasta la muerte de Fernando VII), 1992, 634 pp., pág. 167-247. A los trabajos de Maximiano García Venero, Palacio Atard, Pabón, Jover, Juretschke y Carr etc., pueden añadirse los de Artola (Espasa-Calpe, 2007) y José Manuel Cuenca Toribio (Encuentro, 2006) sobre la guerra de la Independencia, de Fco. Martí Gilabert sobre el proceso de “El Escorial” y el motín de Aranjuez, Manuel Moreno Alonso sobre José Bonaparte, Sánchez Agesta y Enciso Recio sobre el despotismo ilustrado, y, sobre Godoy y Carlos IV, los de Bullón de Mendoza, Chastenet, Madol, Seco Serrano, y Taxonera etc. A continuación citaremos a otros autores. Entre los autores que vivieron los hechos, tienen un gran interés las memorias de Mesonero Romanos, Alcalá Galiano, y el conde de Toreno (los tres testigos de primera línea), las de Juan Escoiquiz (preceptor de Fernando VII), Azanza y Ofarril, Muñoz y Maldonado, Blanco White, Du Forest y el barón de Marbot, así como la correspondencia de Joaquín Murat. Una nueva edición del libro del Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución en España (1807-1809), León, Akrón, 2008, 2 vols., v. I: 490 pp, v.II: 468 pp. CORONA BARATECH Carlos, “Precedentes ideológicos de la guerra de la independencia”, Zaragoza, Librería General, 1959, 28 pp., Institución ”Fernando el Católico”, publ. nº 222, pág. 10. Víd. También Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, Rialp, 1957. Como trabajo dirigido al gran público, vid. DÍAZ PLAJA Fernando, Dos de mayo de 1808, Madrid, Espasa, 1996, 230 pp., pág. 45-46; véase también DÍAZ PLAJA F., Historia de España en sus documentos, Barcelona, Plaza y Janés, 1971. DÍAZ PLAJA F., Dos de mayo… o. cit. , pág. 194 ALONSO BÁQUER, Miguel, El modelo español de Pronunciamiento, Madrid, Rialp, 1983, 270 pp., pág. 29. MARCELLÁN EIGORRI José Antonio, El clero navarro en la guerra de la independencia, Pamplona, Eunsa, 1992, 210 pp., pág. 53-105. En 2006, José Manuel CUENCA TORIBIO publica, en una editorial de Madrid, La guerra de la Independencia: un conflicto decisivo (1808-1814). Algunos libros recientes de 2008 son: DIEGO Emilio de, España, el Infierno de Napoleón, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008, 591 pp.; DIEGO Emilio de, SÁNCHEZ-ARCILLA José, ¡España se alza!, Barcelona, Áltera, 2008, 430 pp.; VILCHES Jorge, Liberales de 1808, Madrid, Fundación, 2008, 347 pp. Como historia literaria de gran interés, véase GARCIA FUERTES Arsenio, Dos de mayo de 1808. El grito de una Nación, Barcelona, Inédita Editores, 2008, 694 pp. En el apéndice VI se recoge el listado de españoles muertos y heridos en los combates del dos de mayo de 1808 y de los prisioneros fusilados a continuación, pág. 529-629. BURGO Jaime del, Historia General de Navarra. Desde los orígenes hasta nuestros días, Madrid, Rialp, 1992, 3 vols, v.III: 911 pp., pág. 341. CORONA C., Revolución y reacción… o. cit.; “Precedentes ideológicos…” art. cit. en nota 11. GIL MUNILLA Octavio, “Hacia una nueva sociedad”, o. cit. en nota 9, pág. 47. CORONA, “Precedentes ideológicos”… art. cit., p. 16-18. SUÁREZ VERDEGUER, Federico, “Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen”, Pamplona, Publicaciones del Estudio General de Navarra, 1955; “Las tendencias políticas durante la guerra de la Independencia”, Zaragoza, 1959, en Actas del II Congreso Histórico Internacional de la guerra de la independencia y su época; La crisis política del antiguo régimen en España (1800-1840), Madrid, 1950. CORONA BARATECH C. en, “Precedentes ideológicos”…, en nota 11, señala como modelos la monarquía absoluta, la monarquía reformada (constitucionalismo histórico tradicional), la monarquía liberal, los admiradores del sistema político inglés y los del sistema napoleónico (p. 23). Este mismo autor, en “La ilustración”, dice así: “Reformismo y tradición llegan a tener un sentido profundo en la conciencia histórica española. Los términos no reflejan exactamente el contenido de las dos posiciones que se definen como antagónicas, pues los que en términos generales son llamados tradicionalistas son tan progresistas o reformistas, en términos generales, como quieren reservarse para sí sus antagonistas; así como entre éstos no es tanto el patrocinio de las reformas estructurales en el cuerpo de la nación, como la modificación sustancial del espíritu nacional, lo que, so capa de lo anterior, se les atribuye rotundamente. Con un criterio más razonable se han diferenciado grupos entre los ilustrados españoles del siglo de las “luces”, distinguiendo los reformadores de los renovadores y de los innovadores, entre los que se incluyen igualmente eclesiásticos y seglares de los distintos niveles sociales, desde jerarquía a clérigos y desde nobles a modestos funcionarios ilustrados. Con suma dificultad puede hallarse un ilustrado español en el que puedan concentrarse todos los conceptos que suelen atribuirse, en bloque compacto, a cada una de las facciones polémicas en el siglo de las “luces” y en el siguiente. Los conceptos culturales no son reducibles a guarismos con fracciones y signos positivos y negativos”. Vid. En Historia General de España y América, tomo X-1: La España de las Reformas hasta el final del reinado de Carlos IV, Madrid, Rialp, 2ª ed., 1989, 597 pp., pág. 3-53. Sobre los novadores, vid. p. 17-23 y sobre el reformismo y tradición, vid. CORONA p. 36-46. GIL MUNILLA Octavio, “Hacia una nueva sociedad”, o. cit. en nota 9 : “(…) al margen de los puros conservadores (nota: absolutistas), entre los reformistas, unos buscan consolidar la Monarquía patrimonial, que garantice sus fueros y particularismos; otros, manteniendo la fidelidad a la tradición, exigen transformaciones socioeconómicas; y, por último, los hay que tienden a asumir buena parte de la ideología francesa” (esto es, los “ ‘hijos díscolos de la Ilustración’ ” pág. 47. El ensayo de FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA Fco. José, se titula: “Liberales, absolutistas y tradicionales”, Rev. “Verbo”, Madrid, nº 157 (jul. Agosto 1977), pág. 965-984. De este y algunos de los trabajos anteriores se hace eco Miguel Ayuso en su ensayo: “El bicentenario, el ‘otro’ bicentenario y los ‘otros’ bicentenarios”, en Rev. “Verbo”, Madrid, nº 465-466 (mayo-julio 2008), pág. 363-374. GARRALDA ARIZCUN José Fermín, “El Reino de Navarra y la primera revolución liberal. La segunda crisis en Navarra: el despotismo ilustrado, y los ensayos de 1813 y 1820-1823”, 37 fols., para ofrecer a “Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada” (Madrid); ÍDEM. “Las Cortes de Cádiz de 1812, el ideario de la Revolución Francesa y la herencia política de España”, en Rev. Digital “Arbil. Anotaciones de pensamiento y crítica”, nº 116 (junio 2008), 24 fols. CORONA BARATECH C., “Precedentes ideológicos”… o. cit. pág. 6; GIL MUNILLA Octavio, “Hacia una nueva sociedad”, o. cit. pág. 47; IZQUIERDO HERNÁNDEZ M., Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII, Madrid, 1963; SUÁREZ VERDEGUER, Federico, “Génesis y obra de las Cortes de Cádiz”, en Historia General de España y América, Madrid, Rialp, Tomo XII: Del antiguo al nuevo régimen. (Hasta la muerte de Fernando VII), 1992, 634 pp., pág. 249-306; ÍD. El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), Pamplona, Rialp, 1982, 528 pp. Son imprescindibles los trabajos de Jovellanos, Memoria en defensa de la Junta Central, Quintana, Alcalá Galiano, el conde de Toreno y, modernamente, Juretschke (1955), Ángel Martínez de Velasco ( La formación de la Junta Central, Pamplona, Eunsa, 1972), Comellas, Fernández de la Cigoña, etc. BURGO Jaime Ignacio del, Origen y fundamento… nota 23, pág. 88. FORCADA TORRES Gonzalo, “Ingleses, españoles y franceses en los prelogómenos de la batalla de Tudela”, Pamplona, Rev. “Príncipe de Viana” nº 98-99” (1965), pág. 37-66. SUÁREZ VERDEGUER Federico, El proceso de la convocatoria a Cortes… nota 26, p. 444. RODRÍGUEZ GARRAZA Rodrigo, Tensiones de Navarra con la administración central (1778-1808), Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1974, 360 pp. MIRANDA RUBIO Fco., “Ocupación y levantamiento armado en Navarra durante la Guerra de la Independencia. Causas y trascendencia”, en VV.AA. La Guerra de la Independencia en el Valle Medio del Ebro, Tudela, Ed. Ayuntamiento de Tudela y Universidad SEK de Segovia, 2003, 278 pp., pág. 143-168. En esta obra colabora Javier Maestrojuán con un interesante trabajo, útil para quien desee profundizar en la historiografía, titulado “Bibliografía reciente sobre la Guerra de la Independencia” pág. 9-54. BURGO Jaime del, Historia General de Navarra..., o. cit., nota 17, pág. 333-486; MIRANDA nota 31; RODRÍGUEZ GARRAZA nota 1; BURGO Jaime Ignacio del, Origen y fundamento del Régimen Foral de Navarra, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1968, 550 pp.; IZU BELLOSO Miguel José, Navarra como problema. Nación y nacionalismo en Navarra, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, 461 pp. pág. 117-118. El autor de éste interesante libro, que es un ensayo de síntesis interpretativa, sólo trabaja con fuentes bibliográficas. ERCE EGUARAS, Juan, Navarra bajo Napoleón: el caso de Estella, Tafalla, Altaffaylla, 2005. MARÍN ROYO Luis María, La francesada en Tudela. Seis años de saqueos y ruina, Tudela, 2008, 295 pp.. MIRANDA RUBIO, Francisco, La guerra de la independencia en Navarra. La acción del Estado, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1977, 474 pp. , pág. 54 y 79. BURGO Jaime del, Historia General de Navarra..., o. cit., nota 17, p. 334 y 341. RODRÍGUEZ GARRAZA, o. cit. nota 1, pág. 28. BURGO Jaime Ignacio del, Origen y fundamento…o. cit., nota 32, pág. 88-89 CALAMA ROSELLÓN Argimiro, La guerra de la Independencia en Soria, La Rioja y Navarra. La batalla de Tudela: 23-XI-1808, Tudela, 1996; VV.AA. La Guerra de la Independencia… o. cit., nota 21; sobre la batalla de Tudela, vid., Gonzalo Forcada Torres, o. cit., p. 113-141. BURGO Jaime del, Historia General de Navarra..., o. cit., nota 17, pág. 349 y 363. BURGO Jaime Ignacio del. Origen y fundamento…o. cit., nota 23, pág. 89. BURGO Jaime Ignacio del, Origen y fundamento…, o. cit., nota 23, pág. 89; BURGO Jaime del, o.cit. pág. 382. BURGO Jaime del, Historia General de Navarra..., o. cit., nota 17, pág. 398. CARASATORRE VIDAURRE Rafael, Constitución o Fueros, Cintruénigo, Fundación Cultural Navarra, 2008, 594 pp. Este reciente libro recoge todos los textos legales sobre este tema, con algunas introducciones que sitúan el marco histórico. GARRALDA ARIZCUN José Fermín, "El primer ensayo liberal en Pamplona: las elecciones municipales de 1813”, en el Congreso Internacional “Guerra, sociedad y política (1808-1814). El Valle Medio del Ebro”, Universidad Pública de Navarra, Pamplona-Tudela, 21 al 24-XI-2007. BURGO Jaime Ignacio del, Origen y fundamento… o. cit. nota 23, pág. 91 y 101-102. LARREA José de, “Episodios de la Batalla de Vitoria”, en VV.AA. Conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de Vitoria. 1813-1963, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1963, 148 pp. + 9 s.n., pág. 127-143. |





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg Source :
Source :