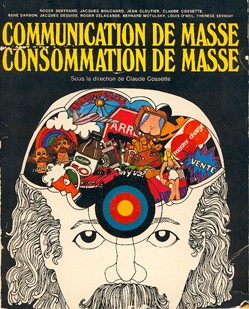Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - PUNTO Y COMA (Madrid) - ORIENTATIONS (Bruxelles) - Mars 1988
Contradictions et abîme de la communication de masses
par Javier ESPARZA
Traits caractéristiques de la modernité: exigence de communication, nécessité d'une transparence, demande d'un flux libre d'informations. A contrario, la post-modernité se caractérise, entre moults autres choses, par une critique à l'encontre de cette communication de masse, par des doutes à l'endroit de la transparence, par l'inquiétude face au débordement du flux informatif. Cette communication qui, depuis le XVIIIème siècle était considérée comme un facteur de libération, nous apparaît désormais comme un instrument de domination. D'énormes contradictions sociales et culturelles naissent de l'information de masse et surtout depuis l'application des techniques modernes de communication. La télévision s'assied sur le banc des accusés. Pourtant, jamais inculpé ne fut aussi sûr de se tirer si facilement d'affaire: l'Occident accuse la communication de masse tout en regardant un vidéo-clip. Narcisse est de retour mais cette fois il ne s'agit pas d'un jeune homme qui admire son reflet dans les eaux calmes d'un étang mais d'une masse informe qui égratigne l'écran de ses téléviseurs en essayant d'atteindre ce qui, pour elle, a déjà cessé d'exister: la réalité, l'histoire, la vie.
La société de l'information
Ce nouveau monde qui naît avec l'explosion des techni-ques de communication et la culture de masse a reçu le nom de "société de l'information". Les ter-mes contemporains "société post-industrielle" et "so-ciété post-moderne" ou "Nouvelle Société de Con-sommation" (Faye) sont peu à peu utilisés de-puis la moitié des années 70 pour désigner les so-ciétés occidentales en tant que réseaux de flux in-for-matifs: Daniel Bell, Alvin Toffler, S. Nora et Alain Minc, James Martin, J. McHale, Yoneji Misuda ou J.Naisbitt, entre autres, ont popularisé le concept.
En Espagne, l'un des premiers à introduire ce terme dans le monde universitaire en tant qu'objet d'étude —et à éditer des travaux à ce sujet— a été Francisco Javier Bernal. Salvador Giner accorde une cer-taine importance à ce terme; pour lui, "le faisceau de phénomènes évoqué par l'expression “société de l'information” est d'une telle ampleur qu'il faut se de-mander s'il n'est pas en train de se forger ce que, traditionnellement, on avait coutume d'appeler un “mo-de de production”, un mode de domination et un or-dre culturel distincts, sous ce nom, sous un terme proche ou sous un synonyme". Pour Giner, ce "fais----ceau de phénomènes" serait constitué de la télé-matique, de l'informatique, de la microélectronique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, etc. Il ne cite pas d'éléments aussi décisifs que la multipli-ca-tion de l'offre propre à la télévision (chaînes privées, antenne parabolique) ou la publicité. De toute façon, pour Giner, l'expression "société de l'information" n'est qu'"une candidate de plus, parmi d'autres expressions également attirantes, à la définition de ce qui est essentiel aux étapes futures de la modernité".
Bien que l'on puisse douter que la modernité (en tant que telle) soit encore à même de nous offrir des "pha-ses futures", l'importance croissante de l'information au sein des structures socio-économiques de l'Occident est indiscutable. D'après Román Gubern, au cours des trente dernières années de ce siècle, le sec-teur électronico-informatique a dépassé celui des in-dustries lourdes comme la pétrochimie et l'auto-mo-bile. Pour l'an 2000, on estime que, dans les pays développés, 90% de la population active tra-vaillera dans le secteur des services et la moitié de ces personnes dans des systèmes d'information ou des réseaux informatisés. Cette conséquence pra-ti-que de l'extension de l'univers médiatique se con-ju-gue, d'autre part, avec une légitimation sociale (et mê-me psychologique) de son utilisation: dans une so-ciété atomisée et individualiste, les média joue-raient le rôle (et c'est ce qu'ils font effectivement) de "thérapeutes sociaux" de l'individu, en essayant de compenser la carence d'une communauté réelle.
Universalisation et résistance
Comme l'écrivent Faye et Rizzi, "les média sont l'une des causes majeures de l'isolement individuel actuel mais, en même temps, leur fonction et leur pré-tention sont d'y apporter un remède. Facteurs d'a-tomisation -une atomisation dont la société de con-sommation a besoin pour survivre- ils se pré-sen-tent pourtant à nous comme des antidotes contre l'ato-misation". Nous pourrions dire que la "so-ciété de l'information" est celle dans laquelle la so-ciété est remplacée par l'information ou, plus pré-ci-sément, cel-le dans laquelle la transmission technique de l'in-for-mation joue le rôle que la société elle-même déte-nait auparavant: définition d'objectifs, normation de rè-gles de conduite, imposition culturelle de modè-les, de formes de production économique, d'échelles de valeurs morales…
Les conséquences sont évidentes: la société dispa-raît, s'évanouit dans le réseau technique de la com-mu-nication de masse. Les cosmovisions particu-lières et enracinées sont remplacées par une culture de masse homogène qui met fin aux cultures tradition-nel-les. La communication se met ainsi au service du néo-colonialisme post-industriel et de la cosmopolis marchande. Comme l'affirme le publicitaire David Vic-toroff, "grâce aux images de marque, la publicité tend à construire de nouvelles valeurs symboliques, communes à la totalité du groupe social, et ce, sur les ruines des systèmes de valeurs et de symboles ca-ractéristiques des sous-groupes particuliers". Un nou-vel imaginaire collectif, universaliste, s'ins-tal-le dans nos sociétés à l'abri de ce que Abraham Mo-les a appelé "l'opulence communicationnelle". Mais ce-la ne se passe pas sans résistances. Un fort cou-rant cri-tique verra dans la communication de masse —et concrètement dans la communication techni-que— un abîme insondable vers lequel notre so-ciété se précipite inéluctablement.
Le regard de la Méduse
Evidemment, les critiques qui s'adressent à la com-munication de masse prirent leur envol bien avant l'usage généralisé des moyens technologiques les plus sophistiqués. Dans les années 40 et 50, une cer-taine critique que, par convention, nous appele-rons "de gauche", a accusé la publicité et la propagande d'asservir les masses: Max Horkheimer, Theo-dor W. Adorno, Dwight MacDonald, Irving Ho--we ou Leo Löwenthal, voyaient, dans la cul-tu-re de masse, un facteur de création d'une "fausse cons-cience" dans les classes populaires, qui annulait leur puissance révolutionnaire et les intégrait dans un système d'exploitation; au fond, ils ne critiquaient pas la communication de masse mais son utilisation sociale.
La perspective de droite, qui leur était antérieure, était différente, elle ne critiquait pas tant la commu-nication que son caractère massif et technique, com-me on peut le voir chez Ortega y Gasset ou Carl Schmitt. Entre les années 60 et 70 et malgré ces cri-ti-ques, la communication de masse s'est développée à une vitesse incroyable et elle ne manqua pas de pro-tecteurs pour la légitimer: tantôt on alléguait la pos-sibilité d'une rétroaction et d'une rétroalimenta-tion (feed-back) qui affirmait que le récepteur pou-vait con-tester le message en agissant selon son libre ar-bitre; tantôt on disait que, grâce à la communi-ca-tion de masse, l'homme moderne pouvait se déta-cher de la terre à laquelle il était lié et entrer dans une société où il manifesterait librement ses goûts cultu-rels. Ce fut là la position défendue notamment par Edward Shils, Herbert Gans, Raymond Williams, Hans M. Enzensberger ou même Walter Benjamin. Parallèle-ment, et à partir du développement à grande échelle de moyens audiovisuels, des auteurs apparaissaient qui se montraient ouvertement criti-ques envers la TV: Jerry Mander écrivait ses célè-bres Quatre arguments pour éliminer la Télévision qui jouirent d'une influence notable. La télé-vi-sion devenait le prin-cipal accusé. Il y a quelques an-nées, David Mata identifiait l'effet paralysateur de la télé au regard terrifiant de la Méduse mythique.
La culture de masse serait intimement liée à la démocratie bourgeoise
Nonobstant, ses défenseurs continuent à insister: pour beaucoup d'entre eux, la culture de masse est in-timement liée à la modernité occidentale, à la civi-li-sa-tion marchande et à la démocratie bourgeoise. Dans cet agencement complexe, faire abstraction d'un élément impliquerait l'oubli des autres. De là, di-verses tentatives visant à concilier démocratie et technologie communicationnelle. C'est notamment l'ob-jectif poursuivi par Manuel Castelles sur le plan de l'informatique; pour cet auteur, les nouvelles techno-logies, qui, effectivement, favorisent le con-trô-le du citoyen par l'Etat, pourraient agir inver-sé-ment en informatisant les procédés de l'Admi-nis-tra-tion et en les ramenant au niveau du citoyen, favo-ri-sant ainsi une transparence publique toujours plus grande.
Pourtant, ces espoirs de "démocratisation" sont peu nombreux, que nous parlions de la TV, de l'infor-ma-tique ou de la publicité (tout cela forme la "société de l'information"). Christopher Lasch pense que la cul-ture de masse, propre des sociétés modernes, ho-mo-généisée comme elle l'est, n'engendre abso-lu-ment pas une mentalité éclairée et indépendante mais, au contraire, la passivité intellectuelle, la con-fu-sion et l'amnésie collective.
Le message de Baudrillard
En fait, le problème ne réside pas dans ce que dit l'ins-trument de masse mais dans la manière dont il agit et dans les effets qu'il crée. Comme l'écrit Jean Bau-drillard: "Le message de la TV n'est pas consti-tué des images qu'elle transmet mais des nouveaux modes de perception et de relation qu'elle impose: le changement dans les structures traditionnelles de la famille et du groupe. De plus, dans le cas de la TV et des mass-media modernes, ce qui est perçu, assi-mi-lé, consommé, n'est pas tant le spectacle que la vir-tua-lité de tous les spectacles. La vérité des moyens de masse est donc la suivante: sa fonction est de neu-traliser le caractère vivant, unique, événémentiel du monde pour le remplacer par un univers multiple de medias homogènes les uns par rapport aux autres en tant que tels, qui ont de la signification les uns pour les autres et qui renvoient les uns aux autres. En dernière instance, les médias deviennent le contenu réciproque les uns des autres -et c'est là que se trouve le message totalitaire d'une société de consommation".
C'est pour cette raison que toute analyse de la médiation technique ne peut se réduire à une simple posologie, ni se limiter à formuler son "utilisation idéale". Les média ne dépendent pas uniquement de la manière dont on les utilise. D'une certaine façon, c'est comme s'ils étaient supérieurs à leur propre instrumentalisation.
Information et inhibition
La fonction que, dans la culture politique dérivée de l'Il-luminisme (des "Lumières"), on attribuait à l'information, c'était de créer une opinion publique ca-pa-ble de discuter les problèmes de gouvernement, de choisir judicieusement ses gouvernants et de décider librement ce qui convenait ou non à la société. On pré-tendait ainsi créer un espace de liberté à la base, per-mettant la coexistence démocratique. Les lois ré-gis--sant la presse, en vigueur au siècle passé et au dé-but de ce siècle, obéissaient à cette logique. Jürgen Ha--ber-mas a rapporté tout cela de manière fort ex-haustive dans Strukturwandel der Öffentlichkeit .
Mais, tout comme la naissance de l'information est liée au commerce, à la banque et au pouvoir éco-no-mique, son développement a continué à dépen-dre de ce type ou d'autres types de pouvoir. Ainsi, au XXè-me siècle, l'information se met au service d'une relation "offre-demande" qui sature le récep-teur: d'abord, il l'inonde de discours au point de le transformer en automate, puis il le bombarde d'in-for-mations jusqu'au moment où il ne répond plus et se noie dans l'indifférence. On est passé du désir de participation, encore vivant dans la modernité, à l'in-hibition complète des masses.
L'hypersollicitation et l'implosion du sens
Et cette situation débouche sur une grave contra-dic-tion sociale: "Partout, on cherche à faire parler les mas-ses", écrit Baudrillard, "on les presse d'exister so-cialement, électoralement, syndicalement, sexuellement, dans la participation, dans la fête, dans l'ex-pression libre, etc. Il faut conjurer le spectre, et qu'il dise son nom. Rien ne montre avec plus d'éclat que le seul véritable problème aujourd'hui est le silence de la masse, le silence de la majorité silencieuse". Et plus on insiste, moins de résultats l'on obtient. La mas-se ne participe pas, non qu'elle ne le veuil-le pas mais parce que cela lui importe peu. L'in-formation n'a jamais connu un tel développement et pourtant le narcissime moderne, comme l'explique Li-povetski, "apparaît comme une forme inédite d'a-pathie, faite de sensibilisation épidermique au monde en même temps que d'une indifférence profonde en-vers celui-ci, paradoxe qui s'explique partiellement par la plé-tho-re d'informations qui nous accablent et par la rapidité avec laquelle les événements traités par les mass-média se succèdent, empêchant toute émo-tion durable". L'individu actuel est com-plè-tement indif-fé-rent au monde qui l'entoure, non parce qu'il ne le con-nait pas mais parce qu'il le connait trop: "L'in-dif-férence postmoderne -poursuit Lipo-vetski- l'est par excès, non par défaut, par hy-persollicitation, non par privation".
Ce comportement a une explication anthropologique. D'après Arnold Gehlen, l'excès d'informations en-traîne un effet de "sollicitation excessive" provoquant une insensibilité progressive; le procesus de per-te de sens ne cesse donc de s'accentuer. Toute l'in-géniosité dont l'homme fait preuve pour structu-rer le monde en fonction des signaux qu'il en per-çoit, finit par disparaître (ou s'amenuise considé-ra-ble-ment) lorsque ces signaux se succèdent à une vi-tese et dans une quantité telles qu'il ne peut plus les appréhender. Aussi toute possibilité de signification dis-paraît-elle devant l'omniprésence de ce que Kon-rad Lorenz a appelé la "formation indoctrinée" et qui constitue un de nos huit péchés capitaux (Cf. Les huit péchés capitaux de notre civilisation, Flam-ma-rion). Et ainsi, l'idée de la participation, issue des "Lu-mières" devient, à travers l'information, à l'ère de la technique, une pure chimère; l'indifférence dé-truit le vieux rêve de la raison. Pour parler comme Bau-drillard, le sens implose.
Sociabilité et narcissisme
On observe une contradiction lorsque nous passons au domaine des comportements en société et à la ré-per-cussion qu'a, sur eux, la communication de mas-se. Dans l'optique moderne de la communicaiton, c'est un lieu commun de dire que celle-ci sert à en-ve-lopper ce que l'on appelle en sociologie le "pro-ces-sus de socialisation"; en d'autres mots, il s'agit des pro-cessus grâce auxquels l'individu apprend à s'in-té-grer dans la société qui l'entoure. Les théories les plus récentes —surtout après la condamnation des to-ta-litarismes par l'Ecole de Francfort— prétendent que cette socialisation est libre et accroît le sens criti-que de l'individu vis-à-vis des valeurs sociales do-mi-nantes.
Dans cette perspective, l'information devrait jouer un rôle important puisqu'elle dote l'individu des élé-ments de jugement qui lui sont nécessaires pour se mouvoir de manière critique parmi les valeurs de sa société. Cependant, non seulement on n'observe pas une plus grande intégration de l'individu mais il sem-ble même que, plus l'individu reçoit d'infor-ma-tions, plus il ressent des difficultés à "se socialiser", à s'intégrer dans la vie sociale.
La critique développée par les conservateurs fait fré-quemment allusion à une "crise des valeurs" qui fe-rait de la société contemporaine un lieu indésirable et dangereux. Pour Lipovetski, une telle carence des va-leurs n'existe pas, on assiste plutôt à la prédo-mi-nan-ce d'une valeur suprême, celle de l'individu et de son "désir de se réaliser", d'"être libre dans la me-sure où les techniques de contrôle social déploient des dispositifs de plus en plus sophistiqués et hu-mains". C'est cette valeur suprême, née pré-ci-sément de l'hypervaloration du sens critique de l'in-dividu fa-ce à la société qui fait que l'individu s'isole et se fa-çonne une sorte de petit monde ambiant. "Le sen-ti-ment communautaire —écrivent Faye et Rizzi— dis-paraît. L'Autre devient une abstraction. Les capa-ci--tés de sociabilité s'évanouissent. De nombreuses en-quêtes ont démontré jusqu'à quel point la télé a con-tribué à l'extinction des formes de vie com-mu-nau-taires. L'homme moderne ne sait plus ce qu'est l'en-vironnement, cette communauté de proches qui lui est éthologiquement indispensable".
Culture de masses et infra-culture
Une des fonctions primordiales attribuée par la cri-ti-que illuministe à l'information était de faire parvenir la vérité (la raison, la lumière) au plus grand nombre possible d'êtres. Elle pourrait garantir le bonheur de l'homme dans la mesure où elle lui permettrait d'ac-cé-der, de plus en plus, à la connaissance du monde. Mais le résultat en a été fort différent. Non seule-ment on n'a pas accédé à la connaissance du monde mais plus on prétend accroître l'audience d'un mes-sa-ge, moins le niveau culturel en est élevé. Il existe une proportion inverse entre la hauteur des messages culturels et l'ampleur possible de l'audience. Plus le message est élevé, moins il y a de gens pour le com-prendre. Plus on veut jouir d'une large audience, moins le niveau du message devra être élevé. D'une cer-taine manière, il s'agit d'une incompatibilité entre ce qui est étendu et ce qui est intense.
De cette situation découle un abaissement général du niveau culturel. D'après Habermas, "les effets de la com-munication de masse sont culturellement régres-sifs". Pour Régis Debray, "les mass-media as-su-rent la plus grande socialisation de l'ignorance pri-vée". Bau-drillard conclut: "L'information, au lieu de trans-former la masse en énergie, produit en-core plus de masse".
L'origine de ces dysfonctions se trouve dans deux théo-rèmes du système de pensée moderne. Le pre-mier est la croyance que l'ordre naturel de la vie (et, partant, de la culure également) fonctionne comme un marché: le meilleur produit culturel, comme le meil-leur homme politique ou la meilleure brosse à dents, sera celui qui suscitera l'unanimité la plus gran-de dans le public.
De la Vox populi à "l'effet Coluche"
Le deuxième théorème (nous pourrions presque dire "mythème") est celui qui donne origine au premier, comme à toutes les constructions théoriques qui concernent l'"opinion publique" et que l'on peut résu-mer par une expression ancienne: Vox populi, vox dei, "la voix du peuple est la voix de Dieu", expres-sion qui possède un sens quand, par peuple, on en-tend communauté, mais également un sens fort dif-fé-rent si, par peuple, on entend classe productrice (en termes chers à Dumézil: la troisième fonction). La bourgoisie a fait ample usage de cette expression à partir du XVIIème siècle en lui attribuant un sens qui corresponde à ses aspirations. Comme dit Julio Ca-ro Baroja, "nous avons tant de raisons de penser que la voix du peuple est la voix de Dieu que d'esti-mer que c'est la voix du Diable ou la voix des imbéciles".
Nous connaissons bien le résultat de cette manipu-la-tion: quantitativement, l'opinion d'un acteur ou d'un présentateur suscite plus de considération que celle d'un professeur, d'un philosophe ou d'un scientifi-que, non en raison de la personnalité du sujet mais en raison de sa fonction sociale, qui consiste à di-vert-ir le particulier. En France, on a appelé ce phé-no-mène "l'effet Coluche", du nom de ce pitre qui, grâ-ce à un discours hyper-humanitaire, prétendit de-ve-nir Président de la République. Quand cette logi-que se transplante sur le terrain culturel, la culture, com-me le politique ou le social, devient une marchandise.
Transparences et stratégies
Le quatrième cauchemar qui angoisse la société mé-diatique provient du rêve irréalisé de la raison: l'im-possibilité de transparence dans la communicaiton entre êtres humains. Toutes les idéologies des XVIIIè-me et XIXème siècles soulignaient la néces-sité d'élucider, en prenant la raison comme base, le réseau complexe de la vie, en abandonnant les cro-yan-ces irrationnelles et superstitieuses et en accédant à un niveau supérieur, celui de la connaissance trans-parente, par le truchement de laquelle les hom-mes parviendront à la compréhension rationelle, tout en dialoguant sans aucun préjugé.
Sur le plan politique, cette situation s'est traduite dans la transparence administrative; sur le plan inter-per-sonnel, la transparence se manifeste dans l'ab-sence de formalités, dans le tutoiement, dans l'indis-crétion. On doit tout connaître; s'y opposer, c'est agir contre la raison. La société de la communication totale n'est que le stade ultime de cette soif de transparence; pour Baudrillard, le processus historique qui domine avec la société médiatique est "cette lon-gue voie vers une traductibilité totale", chemin qui est celui de "la transparence superficielle de toutes les choses, de leur publicité absolue".
Cependant, la vie n'est pas transparente, les hom-mes non plus et, par conséquent, la communication ne peut l'être. La psychologie (surtout la psycho-lo-gie jungienne et la néo-jungienne) a prouvé à quel point, dans l'esprit de chaque homme, on trouve des prédispositions déterminées qui rendent totalement opaque son intimité ultime; et, simultanément, ces prédispositions agissent de telle sorte que cet homme aborde l'autre interlocuteur de front comme s'il s'a-gissait d'un combat. Ces attitudes ont été appelées "stra-tégies" bien que la majorité d'entre elles soient inconscientes.
L'Ecole de Palo Alto
Les théoriciens de l'Ecole de Palo Alto (Bateson, Watz-lawick) ont démontré de quelle manière tout co-de de communication est en soi "un régulateur de relations de pouvoir" inséparable du système culturel auquel il appartient. Les éthologistes en ont donné une bonne explication. La transparence n'existe pas et encore moins dans les milieux de masse, où la règle est la stratégie du communicateur. De cette ma-nière, une stratégie faisant face à une stratégie, la com-munication dans la société de masses devient un flux circulaire de discours irréductibles. Le con-sen-sus est une illusion. Jürgen Habermas a essayé d'es-qui-ver cet écueil en proposant un "horizon commu-ni-catif" qui pourrait faciliter le consensus à l'ombre de la Raison Universelle. Cette attitude ne relè-ve que d'une pure accélération dans le vide car si quel-que chose démontre bien l'impossibilité de la trans-parence, ce quelque chose, c'est précisément l'inexis-tence d'une telle raison.
Expériences de seconde main
Le problème ne se situerait pas dans la communi-cation mais, comme on l'a noté auparavant, dans le canal technique de masses, dans la mesure où celui-ci isole l'individu de la réalité en l'empêchant de l'ex--périmenter. De cette façon, l'homme "technifié" est un autre type d'homme dont les capacités pour la perception et pour une assimilation de la réalité sont fort différentes de celles de l'homme qui vivait il y a seulement quelques générations. Cette mutation an-thro-pologique est facilement perceptible aujourd'hui chez les enfants. "L'enfant est abandonné dans un con-texte permissif, seul et libre face aux médias et aux appareils électroniques. Il erre parmi une jungle de signes, qu'il peut comprendre techniquement mais dont il n'obtient aucune sens. Il devient un néo-primitif. Drogué par les médias, il voit sans ces-se un écran artificiel dressé entre lui et le mon-de… Il faut craindre que les générations qui ont re-çu ce type d'éducation ne soient plus capables d'é-valuer la réalité, de décoder le monde extérieur: la pas-sivité collective naît de l'abrutissement individuel".
Serait-il saugrenu de mettre ceci en relation avec l'in-dice élevé d'échecs scolaires que l'on peut noter parmi les générations éduquées, dès leur plus jeune âge, devant le téléviseur? La communication média-ti-sée par la technique crée des expériences de seconde main dont l'effet se devine: culturellement involutif et individuellement domesticateur.
Déréalisation et fragilité
C'est l'anthropologue allemand Arnold Gehlen qui a vu à quel point l'hypermédiatisation ne laissait sub-sis-ter de la vie que ces expériences de seconde main. Gehlen signale que, sans expérimentation directe, l'hom-me cesse de s'auto-construire. Il tombe dans un état de dépendance psychologique. Les sociétés oc-ci-dentales, par conséquent, se trompent en se cro-yant mûres; elles ne se rendent pas compte de leur extraordinaire fragilité physiologique, fragilité qui les laisserait sans recours si, subitement, les techni-ques de médiatisation venaient à manquer. "Aujour-d'hui, tout est sens dessus dessous: les media sup-pri-ment facilement le vécu et le symbolisent de ma-niè-re incomplète. De là, une fragilité plus grande de l'homme contemporain face à la mort, le combat, la peine, la crise collective…".
Tout cela crée des mentalités très particulières. Une de celles-ci, peut-être la plus frappante, est l'attitude qui se situe à mi-chemin entre le nihilisme et le stoï-cisme que Mario Perniola croit discerner dans le mou-vement punk. Ce mouvement serait un ré-sul-tat du bombardement médiatique et de l'indifféren-ce qui en découle. Il naît ainsi un comportement de refus aveugle et passif, dépourvu de sens mais qui, de temps à autre, se fait bruyamment entendre. Tout ce-la provient de l'impossibilité du système mé-dia-tique à fabriquer la réalité et à la doter de sens. Comme l'explique Baudrillard, "la demande d'ob-jets et de ser-vices peut toujours être suscitée artifi-ciel-lement… mais le désir de signification, quand il est absent, le désir de réalité, quand il se met à man-quer de tous côtés, ne peuvent être comblés et cons-ti-tuent un abîme définitif". Nous sommes plon-gés dans cet abî-me. La technique nous y a mis; et la technique ne nous laisse pas en sortir. Le problème se situe-t-il dans la technique elle-même, dans son es-sence, dans son utilisation sociale ou, même, dans la manière de concevoir la technique et la commu-nication?
Le problème de la technique
Carl Schmitt disait que "culturellement, la technique aveugle". En effet, si elle ne rend pas aveugle, il est in-discutable que la technique moderne, appli-quée à la communication, amenuise considéra-ble-ment les ca-pacités de l'homme à appréhender le mon-de. Tout me-dia, tout élément que nous utilisons pour intercé-der entre nous et le monde, modifie no-tre perception de celui-ci et même la relation physio-lo-gique que nous entretenons avec lui. Le cerveau prend note de cette modification et la met en prati-que, il la fait se répercuter dans le comportement or-ga-nique.
Ce processus s'est déroulé avec la première hache en silex et se répète exactement de la même façon avec l'ordinateur: le nouveau système de médiation conti-nue à exercer des transformations sur l'organisme et le psychisme. En réalité, la différence se situe dans le fait que les nouveaux médiateurs ont remplacé les précédents avec une rapidité inouïe (il n'a fallu qu'une génération) et dans le fait que leur pouvoir quantitatif de transformation de l'organisme puisse toucher toutes les cultures d'un seul coup.
Konrad Lorenz a examiné ce phénomène avec une inquiétude explicite: "Si le développement culturel poursuit sa course à une vitesse supérieure à celle du développement phylogénétique et, malgré tout, obéit à des lois similaires, il est très probable qu'il (le dé-veloppement culturel) puisse mener à une phylogé-nè-se allant dans son sens, c'est-à-dire, dans une di-rec-tion similaire. Vu les circonstances de notre or-dre technocratique mondial, cette direction semble con-dui-re, sans nul doute, vers le bas".
L'analphabétisme informatisé des handicapés réceptifs
Ces nouvelles formes de mass-médiatisation accen-tuent la distance qui nous sépare de la "nature", mais, en plus, elles nous éloignent également de no-tre corps. Il ne s'agit pas seulement qu'apparaisse ce que Joseph Weizenbaum appelle l'"analphabétisme informatisé", c'est-à-dire, l'analphabétisme de ceux qui sont considérablement incultes sur le plan géné-ral mais très compétents en informatique —c'est ce qu'Ortega y Gasset a appelé la "barbarie du spécia-liste". Le problème ne se situe pas non plus unique-ment dans le fait que —comme l'écrit Ri-cheri— "l'usage de l'ordinateur favorise une repré-sentation linéaire et non dialectique de la réalité et in-hibe la capacité critique de celui qui l'utilise".
Le véritable problème, la question réellement préoc-cu-pante que soulève la technique d'information de mas-ses, en tant qu'intermédiaire entre nous et le mon-de, est qu'elle nous éloigne de notre propre cer-veau, de notre propre capacité à donner forme au mon-de que nous voyons et à créer les modèles permettant de l'appréhender. Faye et Rizzi écrivent: "Nous pouvons déjà voir à quel point les individus nés dans un environnement hyper-médiatisé (environnemental et audiovisuel) sont des handicapés ré-cep-tifs, équipés de gadgets technologiques qui leur per-mettent de survivre".
Nous avons créé des formes de connaissance qui se développent plus rapidement que nous, qui nous sup-plantent et qui nous convertissent en êtres limités par rapport à un état antérieur. La communication de masse, au sein d'une société dans laquelle dominent le quantitatif, l'hédonisme et la conception marchan-de de la connaissance, se transforme en un facteur me-naçant de décomposition. D'une certaine façon, c'est comme si nous devions reculer organiquement alors que nous sommes allés si loin d'un point de vue technologique. Qui a parlé de progrès?
La technique pour quelles valeurs?
Cependant et comme on l'a déjà signalé, il serait er-ro-né de faire endosser à la technique la respon-sa-bi-li-té de tous les maux. Toutes les théories définissant la technique comme un "mal", oublient que le fait techni-que est consubstantiel à la nature humaine et que l'homme ne serait pas homme sans ces éléments techniques, qu'il s'agisse du char à bœufs ou du té-les-cope. Pourtant, il serait naïf de croire, à l'instar de certains courants libéraux et marxistes, que la techni-que est un élément neutre en soi, et que tout dépend de son utilisateur et de ses objectifs, en pré-sup-poant que la technique sera bonne si on l'utilise au nom du progrès et mauvaise si on l'emploie pour exercer une domination ou quelque chose de sem-bla-ble. Ce point de vue est naïf car, d'abord, de nom-breux crimes ont été commis au nom du progrès et, ensuite, parce qu'un des traits caractéristiqes de la technique dans le monde moderne est d'être, en soi, un instrument de domination, en marge de celui qui l'utilise.
La solution serait peut être de voir dans la technique un fait de civilisation, la manifestation d'une manière déterminée de voir le monde; cette manifestation peut revêtir l'une ou l'autre forme ne dépendant pas de l'utilisateur mais de l'ordre des valeurs dominant. D'a-près Heidegger, dans le monde grec, la techni-que avait une fonction révélatrice de la réalité, de con-naissance, mais pas de domination du monde (ou du moins de faible domination, de domination sans possession); dans le monde moderne, au contraire, elle a une fonction exclusive de domination et toute connaissance s'y subordonne. Ce changement d'une conception à une autre est, de fait, parallèle à l'essor des conceptions modernes pour lesquelles toute l'his-toire est une ligne ascendante qui conduira l'hom-me à la domination du monde et au bonheur, dans une utopie universellmeent réalisée. C'est pré-ci-sément la même idéologie progressiste, indivi-dua-liste et universaliste qui a donné naissance à toutes les contradictions mentionnées ci-dessus.
En effet, toutes les dysfonctions qui affectent la so-ciété de l'information ne constituent pas tant un pro-duit direct de la communication à travers la techni-que, qu'un résultat, celui d'une manière déterminée de comprendre le monde. Une façon de comprendre le monde définie par l'individualisme, l'universa-lis-me, la tendance à l'homogénéisation, la foi aveugle dans la raison et la science, le sens quantitatif des cho-ses, la prétention progressiste à faire advenir une utopie rationnelle. Une manière de comprendre le mon-de qui, en termes généraux, correspond à ce que nous pourrions appeler "idéologie de la modernité" et qu'aujourd'hui, on nous désigne comme une idéologie largement hétérotélique où la distance en-tre l'objectif à atteindre et le but réellement atteint est énorme.
Vers l'implosion finale?
Et comme cet abîme est incontournable, la commu-ni-cation technique essaie de le surmonter en offrant des simulacres, des farces, le spectacle omniprésent de "ce qui devrait être". En vain. L'individu cher-che, dans les media, le "monde ouvert", la "so-ciété transparente" dont on lui parle. Il ne trouve rien. Et comme plus il se sent isolé, plus il s'a-bandonne aux media, "sa personne, disent Faye et Riz-zi, se ferme dans l'illusion dramatique de l'ouver-ture… Pareils à des mouches enfermées dans un bo-cal renversé, les individus s'efforcent de toucher ce monde extérieur, cette société ouverte, qu'ils voient mais qui n'existe pas".
Ainsi, il s'agit d'un problème de conception du mon-de. Et concrètement, la question de savoir com-ment dépasser la vision moderne du monde. Des solutions? Peut-être n'y en a-t-il pas. Peut-être cela exi-gerait-il des efforts et des volontés collectives qui ont déjà disparu de notre civilisation. Peut-être, par conséquent, serons-nous condamnés à voir, sur no-tre téléviseur, le simulacre gigantesque de ces socié-tés qui, dépourvues de tout sens historique et de tou-te capacité de mobilisation, ont perdu la possibilité de s'auto-représenter et attendent l'implosion finale comme ultime et définitif spectacle - mais qui sera peut-être le plus beau.
Javier ESPARZA.
(texte tiré de Punto Y Coma n°8, 1987. Traduction française de Nicole Bruhwyler).
Adresse de Punto y Coma, Apartado de Correos 50.404, E-28.080 Madrid.
Bibliographie:
Nous renvoyons le lecteur à l'édition originale de ce texte pour les références espagnoles. Ci-dessus, le lec--teur trouvera une bi--blio-graphie succincte, se rap-portant au thème et son exploi-ta-tion.
Daniel BELL, Les contradictions culturelles du capitalisme, PUF, Paris, 1979.
John NAISBITT, Megatrends. Ten New Directions Trans-for-ming Our Lives, Futura/Mac Donald, London/Sidney, 1984.
Régis DEBRAY, Le pouvoir intellectuel en France, Ramsay, Pa-ris, 1979.
Gilles LIPOVETSKY, L'ère du vide. Essais sur l'indivi-dua-lisme contemporain, Gallimard, Paris, 1983.
Jürgen HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Luch-ter-hand, 1962-80.
Jean BAUDRILLARD, La société de consommation, Galli-mard, coll. "Idées" n°316, 1974.
Jean BAUDRILLARD, A l'ombre des majorités silencieuses ou la fin du social, Utopie, Paris, 1978. 2ème éd.: Denoël/ Gon-thier, coll. Médiations n°226, Paris, 1982.
Christopher LASCH, Le complexe de Narcisse. La nouvelle sensibilité américaine, Robert Laffont, Paris, 1981.
Guillaume FAYE et Patrick RIZZI, "Vers la médiatisation totale", in: Nouvelle Ecole, n°39, automne 1982.
 Psicologia delle folle fu pubblicata nel 1895, andando a minare il positivismo di stampo illuministico che era alla base delle democrazie di fine ‘800: se si negavano infatti alle masse moderazione e raziocinio, l’ideale di regime democratico sostenuto dal popolo illuminato veniva ineluttabilmente meno. Le sue tesi furono poi raccolte e messe in pratica da due esempi paradigmatici di capo-popolo: Mussolini e Lenin.
Psicologia delle folle fu pubblicata nel 1895, andando a minare il positivismo di stampo illuministico che era alla base delle democrazie di fine ‘800: se si negavano infatti alle masse moderazione e raziocinio, l’ideale di regime democratico sostenuto dal popolo illuminato veniva ineluttabilmente meno. Le sue tesi furono poi raccolte e messe in pratica da due esempi paradigmatici di capo-popolo: Mussolini e Lenin.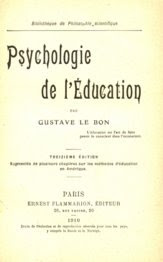 Gli studenti, dalle elementari sino alle facoltà universitarie, sono condannati all’apprendimento mnemonico di manuali che servirà loro unicamente alla “recitazione” in sede d’esame. Già di per sé il manuale rappresenta un accesso al sapere di seconda mano, poiché filtrato da colui che lo ha redatto, il quale ha già dato – per forza di cose – un’impronta personale alla materia che intende trattare. Lo studente non è quindi libero di trarre il nutrimento della propria cultura direttamente dalla fonte ma, impossibilitato al giusto sviluppo del suo senso critico, non fa che ripetere nozioni impostegli dall’alto. Ma la vera sciagura è che coloro che hanno buona memoria ma poca intelligenza vengono più spesso premiati a scapito degli altri più meritevoli.
Gli studenti, dalle elementari sino alle facoltà universitarie, sono condannati all’apprendimento mnemonico di manuali che servirà loro unicamente alla “recitazione” in sede d’esame. Già di per sé il manuale rappresenta un accesso al sapere di seconda mano, poiché filtrato da colui che lo ha redatto, il quale ha già dato – per forza di cose – un’impronta personale alla materia che intende trattare. Lo studente non è quindi libero di trarre il nutrimento della propria cultura direttamente dalla fonte ma, impossibilitato al giusto sviluppo del suo senso critico, non fa che ripetere nozioni impostegli dall’alto. Ma la vera sciagura è che coloro che hanno buona memoria ma poca intelligenza vengono più spesso premiati a scapito degli altri più meritevoli.
 Deve parimenti essere reintrodotta l’attività fisica, complementare a quella speculativa, di cui il regime fascista farà una bandiera, poiché, attraverso lo sforzo fisico, il discente deve temprare la propria volontà e il proprio senso del sacrificio in vista dell’obiettivo finale.
Deve parimenti essere reintrodotta l’attività fisica, complementare a quella speculativa, di cui il regime fascista farà una bandiera, poiché, attraverso lo sforzo fisico, il discente deve temprare la propria volontà e il proprio senso del sacrificio in vista dell’obiettivo finale.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
 Schmitt's meest invloedrijke werk en één van de belangrijkste werken van de politieke theorie van de twintigste eeuw is Der Begriff des Politischen1. Hierin ontwikkelde hij zijn vriend-vijand theorie. Typerend voor het complexe denken van Schmitt is dat het decisionistische karakter aanwezig in zijn denken drie onderscheidende subcategorieën bevat: soeverein decisionisme2, antagonistisch decisionisme en constitutioneel decisionisme3. Decisionisme is algemeen beschouwd een term die aanduidt dat de contextuele beslissing van het individuele subject een centrale positie inneemt als de bron van politieke/existentiële waarmerking en bekrachtiging m.a.w. het is de concrete beslissing die van belang is. Ten onrechte wordt het antagonistisch decisionisme in Der Begriff des Politischen als representatief beschouwd voor zijn volledige oeuvre. Schmitt's werk wordt vooral gekenmerkt door een gefundeerde kritiek op de liberale (parlementaire) democratie. Parlementaire democratie is, volgens Schmitt, een contradictio in terminis. De wil van het volk kan niet vertegenwoordigd worden door een technische orde van parlementair debat en compromissen. Voor Schmitt heeft het parlement de waarde van een verzekeringshuis voor de economische kapitalistische machthebbers. De vorming van het algemeen belang is in een moderne democratie niet waarachtig democratisch want door belangen gefragmenteerd alvorens deze nog maar gevormd kan worden. Liberale democratie, argumenteert Schmitt, kan aldus nooit een waarachtige democratie zijn aangezien het slechts een instrument is die de private belangen van machtige kapitalistische groepen inbrengt in de uitvoerende macht. Daardoor kan een liberale democratie nooit een werkelijk legitieme regering voortbrengen. Het kan in het beste geval overheidsinstellingen voortbrengen die zichzelf rechtvaardigen door de inferieure criteria van legaliteit.
Schmitt's meest invloedrijke werk en één van de belangrijkste werken van de politieke theorie van de twintigste eeuw is Der Begriff des Politischen1. Hierin ontwikkelde hij zijn vriend-vijand theorie. Typerend voor het complexe denken van Schmitt is dat het decisionistische karakter aanwezig in zijn denken drie onderscheidende subcategorieën bevat: soeverein decisionisme2, antagonistisch decisionisme en constitutioneel decisionisme3. Decisionisme is algemeen beschouwd een term die aanduidt dat de contextuele beslissing van het individuele subject een centrale positie inneemt als de bron van politieke/existentiële waarmerking en bekrachtiging m.a.w. het is de concrete beslissing die van belang is. Ten onrechte wordt het antagonistisch decisionisme in Der Begriff des Politischen als representatief beschouwd voor zijn volledige oeuvre. Schmitt's werk wordt vooral gekenmerkt door een gefundeerde kritiek op de liberale (parlementaire) democratie. Parlementaire democratie is, volgens Schmitt, een contradictio in terminis. De wil van het volk kan niet vertegenwoordigd worden door een technische orde van parlementair debat en compromissen. Voor Schmitt heeft het parlement de waarde van een verzekeringshuis voor de economische kapitalistische machthebbers. De vorming van het algemeen belang is in een moderne democratie niet waarachtig democratisch want door belangen gefragmenteerd alvorens deze nog maar gevormd kan worden. Liberale democratie, argumenteert Schmitt, kan aldus nooit een waarachtige democratie zijn aangezien het slechts een instrument is die de private belangen van machtige kapitalistische groepen inbrengt in de uitvoerende macht. Daardoor kan een liberale democratie nooit een werkelijk legitieme regering voortbrengen. Het kan in het beste geval overheidsinstellingen voortbrengen die zichzelf rechtvaardigen door de inferieure criteria van legaliteit.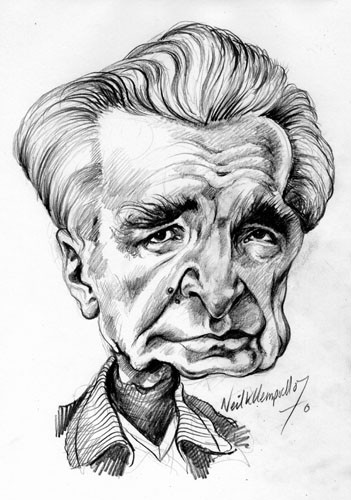
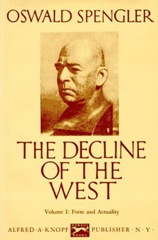
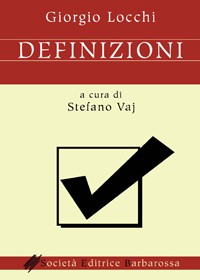

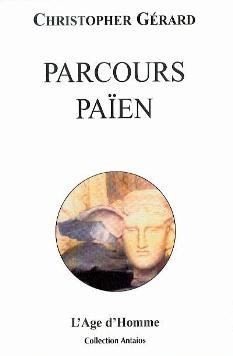
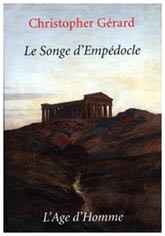
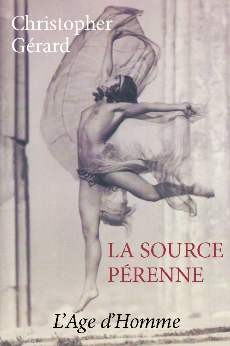








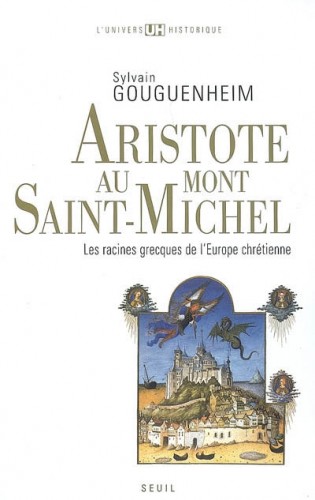








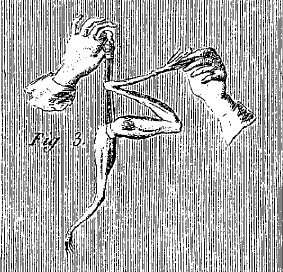

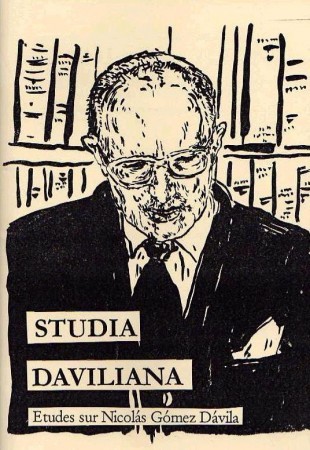
 « Il part vendre les manoirs bretons aux émirats », proclame Ouest-France du 8 décembre 2008. Et d’évoquer Sam Abi, « Riécois d’origine libanaise ». Celui-ci, agent immobilier à Riec-Sur-Belon, se dit, avec un associé de Dubai, « décidé à commercialiser aux EMIRS les magnifiques demeures bretonnes de son catalogue », car « beaucoup de riches Arabes cherchent à acquérir des châteaux et des manoirs ». Et, après Dubai, « un autre marché au parfum de pétrole et de gaz : la Russie ». « Si les acheteurs sont sur la Lune, j’irai sur la Lune ! »
« Il part vendre les manoirs bretons aux émirats », proclame Ouest-France du 8 décembre 2008. Et d’évoquer Sam Abi, « Riécois d’origine libanaise ». Celui-ci, agent immobilier à Riec-Sur-Belon, se dit, avec un associé de Dubai, « décidé à commercialiser aux EMIRS les magnifiques demeures bretonnes de son catalogue », car « beaucoup de riches Arabes cherchent à acquérir des châteaux et des manoirs ». Et, après Dubai, « un autre marché au parfum de pétrole et de gaz : la Russie ». « Si les acheteurs sont sur la Lune, j’irai sur la Lune ! »