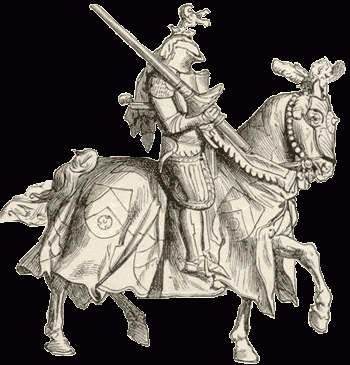Infokrisis.-Dentro de nuestra iniciativa de recopilar escritos elaborados hace años, hemos encontrado éste, inacabado, que debería haber formado parte de un estudio más amplio sobre la historia de España en el que intentábamos realizar una aproximación a nuestro pasado desde el punto de vista de la doctrina evoliana. Para esta doctrina el elemento central es el reconocimiento de la antítesis de dos fuerzas a las que Evola llama "Luz del Norte" de tipo viril, guerrero, masculino, solar y de otra la "Luz del Sur" de carácter femenino, telúrico, sacerdotal y lunar. Nos pareció que en el siglo XX, la antítesis desarrollada bajo el franquismo entre la Falange y el Opus Dei respondía con una precisión asombrosa a este esquema interpretativo. Ahora recuperamos el artículo escrito hace 15 años.
Estabilizada la España de la postguerra, resuelto el contencioso entre el nazismo y las democracias y aislados del resto del mundo, la vida siguió en nuestro numantino país. Aquella manifestación en la Plaza de Oriente que contestó el aislamiento internacional fue el desfío que lanzó la España vencedora en la guerra civil. "Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos". El humor de "La Codorniz", conducido por antiguos voluntarios de la "División Azul", humoristas próximos a la Falange y cínicas gentes de derecha, junto al surrealismo cultural, hizo posible aguantar las precariedades de la postguerra.
La España vencida desapareció en el exilio, las cárceles, los silencios y las sentencias de muerte, ejecutadas o no. El maquís representó poco, numérica y efectivamente. La "invasión" del Valle de Arán, fue una gesta apreciada solo para sus protagonistas. España permaneció indiferente. A principios de los sesenta los últimos maquisards fueron cazados como conejos sin que sus muertes merecieran algo más que escuetas notas de prensa en las que inevitablemente se hablaba de "bandoleros" y atracadores. La España republicana estuvo ausente durante 40 años ("Cien años de honradez y 40 de vacaciones", fue la irónica adaptacion del lema del PSOE en la transición) y solo los comunistas, con sus rígidos criterios organizativos, su esquematismo mental y utilizando la estrategia de la hormiga laboriosa consiguieron salir del franquismo con un activo político que, luego, Carrillo se encargó de dilapidar.
Estábamos en 1946. El régimen había sufrido una evolución desde que los militares se alzaran diez años antes apoyados por grupos activistas de derecha y extrema-derecha y con la adquiescencia de un sector de la sociedad y el apoyo de los fascismos internacionales. Mientras la victoria sonrió a las tropas del Eje, Franco, gallego él, apostó sin fanatismo por la alianza germano-italiana. Colocó en el tablero a los 18.000 voluntarios de la División Azul. Y subrayo lo de voluntarios; los he conocido bien y doy fe de que fueron los que quisieron, incluso los que lo hicieron no por idealismo sino para redimir su apellido de pasadas colaboraciones republicanas. Pero Franco se reservó alguna que otra carta. No entró en la guerra. La victoria de las armas aliadas, iniciada a partir del desembarco en el Norte de Africa, hubiera resultado imposible de estar las dos orillas de Gibraltar en manos de un Eje ampliado con España asociada. A partir de ahí todo fue coser y cantar y, por lo demás, los contingentes judíos asilados por España, justificaban el que, en caso de victoria de los aliados, Franco pudiera presentar algún as en la manga.
Venció el bando aliado. Hasta ese momento, Franco había utilizado la retórica imperial de la Falange para dar empaque y tono al régimen. Probablemente él mismo se sintiera atraído por este discurso ampuloso que hundía sus raíces en una parte de nuestra historia. Nadie cuestionaba -solo algunos falangistas- que el partido fundado por José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, era el "fascismo español". Si vencía el Eje, la carta de Franco era tener un partido único de características similares al fascismo y al nazismo. Al resultar derrotado, hubo que buscar una ideología de sustitución. Esa fue el nacional-catolicismo; con él la "Luz del Sur" prendió de nuevo en nuestro país.
Las críticas e ironías a las que se ha hecho acredor el franquismo proceden en buena medida de este giro ideológico. "El florido Pensil", el catecismo de Ripalda y los rosarios del Padre Peyton, la censura en manos eclesiales y la mojigatería, eran propias del nacional-catolicismo, no de la Falange. Un somero estudio sobre la Sección Femenina o sobre el carácter de los intelectuales falangistas, los hace muy distantes del espíritu sacerdotal y pacato de sus colegas nacional-católicos. Estos, surgidos del adaptacionismo de la derecha liberal (la CEDA) que, con los años, tras percibir que lo del franquismo iba para largo, se convirtieron en la cuarta fuerza del régimen (tras al falange, el carlismo y el ejército), con pretensiones hegemónicas. Los falangistas fueron recluidos en algunos ministerios arquetípicos y en consonancia con sus ideales sociales. Girón de Velasco instituyó la Seguridad Social y el grueso de la legislación laboral franquista; por más que antiliberales, tales leyes podrían ser hoy reivindicadas por las organizaciones obreras situadas más a la izquierda, en caso de que supieran algo de la historia social de éste país. En cuanto al carlismo, se le encasilló en el Ministerio de Justicia y poco más, a la espera de que se fuera desleyendo como un azucarillo, como así ocurrió. El ejército ya había tenido una guerra (la civil), algunos militares tuvieron dos (la civil y el frente del Este junto con la Wermatch) y los más veteranos, incluso tres (la civil, la División Azul y las anteriores campañas de Africa). Los hubo con cuatro (a las anteriores hubo que añadir la miniguerra del Ifni). Todos ellos querían tranquilidad y disfrutar los galones y condecoraciones ganadas. Los "propagandistas" católicos subieron enteros en el gobierno.
Y así llegamos a los años cincuenta cuando aparecen elementos nuevos. España tenía que salir, no solo del subdesarrollo, sino del hambre secular. Había restricciones eléctricas, racionamiento y carestía, estraperlo; miseria, en definitiva.
Cuando Franco e Eisenhower firman los acuerdos de cooperación, España entra en la recta del desarrollismo y, oh maravilla de maravillas, ni los carlistas, ni la falange, ni los propagandistas, ni mucho menos el ejército, estaban en condiciones de liderar la nueva etapa y facilitar una clase política tecnocrática. Un oscuro grupo, en cambio, sí: el Opus Dei. A partir de ese momento se instaló una contradiccion fundamental en el interior del régimen, entre los sectores de la Falange (no específicamente conservadores, sino dotados de ideales patrióticos y sociales) y el Opus Dei (no necesariamente progresista, sino simplemente tecnócratico). Todos ellos, como los carlistas, propagandistas y militares, eran "franquistas" en el sentido de que el adaptacionismo de Franco, permitió que en unos momentos del régimen se jugara con una alineación y en otros con otra; o incluso que en el mismo tiempo unos peones fueran puestos a trabajar en unas posiciones y otros en otras. Y la cosa duró hasta el último aliento del eufemísticamente llamado "anterior jefe del Estado".
Pero todas estas vivas muestras de pragmatismo, oportunismo de escasos principios, realpolitik y adaptacionismo, no pueden eludir el hecho fundamental, a saber, que entre la Falange y el Opus Dei existió una contradicción metafísica que hacía de ambos, quintaesencias de dos principios opuestos desde la fundación de nuestro país: el elemento guerrero y el sacerdotal, lo solar y lo lunar, lo guerrero y lo sacerdotal, lo viril y lo telúrico, la "Luz del Norte" y la "Luz del Sur", se manifestaron nuevamente e imprimieron carácter a esos años.
Influyente, primero, en la Corte del "anterior jefe de Estado", residual en el decenio de la rosa, el Opus Dei, en el momento de escribir estas líneas, cabalga de nuevo a lomos del centro-derecha [recordar que este artículo se escribió durante la primera legislatura del "aznarato"]. Por lo demás, Juan Pablo I, al buscar apoyos sobre los que reconstruir la Iglesia, tras la desbandada postconciliar, buscó y obtuvo sostén en "Comunión y Liberación" y el "Opus Dei". Agradecido, el polaco, tuvo a bien hacer aquello que iba mucho más allá del surrealismo religioso: intentar llevar a Escribá de Balaguer a los altares. Y uno se pregunta, si los santos de hoy son como son -y en el caso de Escribá, sabemos cómo son- ¿qué podremos pensar de los santos de ayer que, a lo peor, les concedieron tal título por cualquier componenda de baja estofa?.
No vemos gran cosa de santo en el Opus, como no sea la candidez de sus más abnegados miembros. Lo que vemos en el Opus es la quintaesencia acrisolada del Espíritu del Sur, oscuro, sufriente y lunar, telúrico y ginecocrático (a pesar de su misoginia), en la que se entremezclan lo peor del modus operandi masónico, la piedad más beata y, finalmente, los trucos de ilusionismo propios de cualquier espectáculo de "music hall".
Se diría que, con el Opus Dei estamos ante un tipo de espiritualidad femenina químicamente puro, enemigo jurado e irreconciliable de cualquier otra posición y que, a la postre, explica la conflictualidad con la Falange, e incluso con los jesuitas (los "soldados del papa") y otras órdenes religiosas de distinta inspiración. Difícilmente el Opus Dei podría entenderse con los Jesuitas. El hijo de comerciantes que era Escribá estaba espiritual y anímicamente alejado del espíritu militar de los hijos de Ignacio de Loyola y en cuanto a las órdenes mendicantes, Escribá no podía sino despreciarlas. Dios debía ser adorado con pompa, boato y ostentación.
Casi a modo de caricatura, el Opus Dei remite a los aspectos más problemáticos de la "Luz del Sur". Luz lunar, el Opus prefiere el secreto y la clandestinidad a los espacios abiertos y a las claridades solares. Para justificar tal opción gusta hablar de discrección y silencio. La máxima 970 del "Camino" dice: "Es verdad que he llamado a tu apostolado discreto "silenciosa y operativa misión" y no tengo nada que rectificar" y "que pase inadvertida vuestra condición como pasó la de Jesús durante treinta años". Hay otras muchas referencias más en el librito caótico, y en ocasiones delirante, escrito por Escribá; el mismo tema del secreto vuelve a repetirse en las Constituciones de la Obra: "Con el objeto de alcanzar su fin con eficacia, el Instituto como tal quiere vivir oculto"; más adelante especifican "Los miembros numerarios y supernumerarios deben estar convencidos de la necesidad de guardar un prudente silencio acerca del nombre de otros miembros y no revelar a nadie su propia filiación a la obra". En cuanto a las propias Constituciones "no han de divulgarse, ni siquiera han de traducirse a lenguas vulgares".
Junto al secreto, el desprecio por la naturaleza humana que se considera fuente de pecado en sí misma, remite igualmente a la temática propia de la "Luz del Sur", del ser caído, incapaz de superar por sí solo su miseria existencia y al que sólo la Gracia de Dios puede redimir. La Gracia es administrada por el sacerdote que opera en el Opus en forma de director espiritual y al que se le debe sumisión total. Las desafortunadas comparaciones entre el hombre y el borrico (una canción cantada a menudo en centros del Opus dice así "Vas a ser burro de noria, borrico siempre serás") que ya hiciera Lutero cuatro siglos antes ("El alma del hombre es como un asno que puede ser cabalgado por Dios o por el diablo"), el cerco de censuras y prohibiciones al que está sometido el miembro de la Obra (las revistas de información general están prohibidas), la falta de autonomía personal de los miembros que deben consultar cualquier pequeña decisión de sus vidas a su director espiritual al que le deben, no fidelidad, sino sumisión absoluta ("Ocultar algo personal a los directores era tener un pacto con el diablo" decía una ex-miembro del Opus), su consideración enfermiza de la sexualidad en la que los llamamientos a la castidad son todavía más desagradables que en lo más desagradable de la concepción evangélica, y, finalmente, la consideración mesiánica de que solo hay salvación posible en el interior de la institución y, fuera de ella, aguarda una irremisible condenación eterna ("El que se va de la Obra traiciona y vende a Jesús", "Nadie que se ha ido de la Obra ha sido feliz"), y finalmente, el papel atribuido a la Virgen en la fundación de la Obra (las biografías "oficiales" sostienen que la Virgen se apareció a Escribá con una rosa en la mano pidiéndole la fundación del Opus), todo ello definen un tipo de espiritualidad enfermiza idéntica a la que ha dado origen a otras manifestaciones de la "Luz del Sur".
En cuanto a la vida y a la personalidad del fundador, existe en él una apetencia de lujo y ampulosidad propias de una espiritualidad telúrica y lunar. No se recató de utilizar estrategias subrepticias y ladinas, callar, esconder, permanecer en la sombra, ocultos, estudiar cómo alcanzar más influencia y peso (tema titánico de la búsqueda de poder). Escribá dijo en cierta ocasión a un colaborador, "cuando tengamos las cátedras, todos tendrán sus carreras, sus doctorados, muchos títulos, porque eso atrae mucho a la gente (...) Nuestro fin es acaparar todas las carreras para que así podamos dar a los nuestros sus carreras hasta sin examinarse, muchos títulos y condecoraciones". Nosotros mismos nos hemos sorprendido de leer estas líneas y confirmar, por nuestros conocimientos directos, que efectivamente algunos miembros del Opus Dei están modelados en esta óptica. Hemos conocido incluso a uno que ha llegado a falsificar burdamente el título de periodista y a llenar las paredes de su despacho con decenas de títulos de dudosa catadura. Seguramente eso es lo que Escribá alababa en su "Camino" llamándolo "santa desvergüenza".
Junto a todo este cúmulo de despropósitos, la personalidad de Escribá se muestra pobre, justo en aquel punto en donde debería de aquilatar más riqueza el fundador de una Orden religiosa: en su espíritu. Ególatra despiadado, orgulloso y engreído, caprichoso, altivo, despreciativo incluso para con la figura del Papa y de la jerarquía ("He conocido siete papas, cientos de cardenales, miles de obispos. Pero fundadores del Opus solo hay uno"), altamente inmaduro (en una discusión intrascendente durante una comida, al verse sin argumentos contra su oponente, Escribá fue acalorándose y en un momento dado sacó la lengua a su oponente), esclavo de la gula (en una ocasión pidió la séptima tortilla porque las seis anteriores no estaban a su gusto) y de la avaricia (ya desde pequeño confiesa que le gustaba tocar las monedas que entraban en el comercio paterno), proclive a los accesos de ira (bastaba con que alguien no lo tratara como creía que merecía ser tratado o que ocurriera un error de protocolo para que se enfureciera. Ruiz Jiménez, entonces Ministro de Educación, al encontrárselo en Roma se dirigió a él diciéndole "¿Qué tal padre Escribá?". Escribá se volvió enfurecido y sin recoger la mano que Ruiz Jiménez le tendía. En efecto, quería que se le llamara Padre o Monseñor, pero no "Padre Escribá" como a cualquier otro sacerdote. Otros han dicho de él que sus maneras eran "bruscas y violentas", a la más mínima contrariedad perdía los estribos y empezaba a gritar), en cuanto a la envidia no podía evitar sentirla hacia los jesuitas (el padre Arrupe, General de la Compañía de Jesús hubo de llamarlo tres veces y por tres veces recibió la respuesta de que "el Padre no se encontraba en casa". Escribá jamás devolvió la llamada)... Escribá no ahorraba en demasía ninguno de los siete pecados capitales.
Desgraciadamente para el Opus Dei, la figura de Escribá de Balaguer está demasiado próxima a nuestro presente como para que podamos mitificarla y hacer de él un santo. Falta materia prima y sobran medios de comunicación. La característica de nuestro tiempo es la inmediatez en la transmisión de la información y esto va en detrimento de que nos podamos tomar en serio el proceso de beatificación y su presumible resultado final.
Las biografías oficialistas cuentan que la Virgen se apareció al joven Escribá de Balaguer, cuando aún no se llamaba así, y le pidió la fundación del Opus Dei, organización que, ya desde el principio, se sitúa bajo el signo de la Madre. Para colmo, en cierta correspondencia Escribá firma como "Mariano" detalle, ya de por sí, suficientemente significativo de su fe en la "Mediadora".
Es suficientemente conocido que nuestro hombre nació en Barbastro, pero mucho menos que fue bautizado con el nombre de José María Escriba Albás. Y decimos bien, Escriba y no Escribá. La sutileza del acento o no acento en la "a", marca la diferencia. Por algún motivo que se nos escapa, el "Padre", tal como gustan referirse al fundador del Opus sus miembros, desfiguró hasta tal punto su nombre que, con el paso de los años, este inicial se transformó en Josemaría Escribá de Balaguer. El segundo apellido, Albás, fue relegado al olvido; un "de Balaguer" que parecía otorgarle prosapia y patente de nobleza, vino de Dios sabe dónde y el José María se hizo uno, transformándose en Josemaría sin que se sepan los motivos exactos que justificaron la transformación.
Su juventud no fue ni edificante edificante ni aplicado. Estudiante más que irrelevante, vocación tardía, Jesús Ynfante llega a decir de él que fue "oscuro, introvertido, y con notable falta de agudeza, un hombre -concluye- de pocas luces". Hubo en 1920 una expulsión del seminario de Logroño por motivos no suficientemente aclarados. Algunos se imaginan lo peor que, por respeto a los muertos, preferimos silenciar. En el seminario de Zaragoza destacó, no por arriba, sino por abajo; Salvador Bernal lo califica de "inconstante y altivo".
La mitología del Opus explica que el 2 de octubre de 1928, en el momento de la consagración de la Hostia y el Cáliz, el curita tiene una visión: ve lo que Dios espera de él. Es el pistoletazo de salida del Opus Dei. Pero nadie se entera, ni siquiera sus amigos más íntimos de la época, para los que el único proyecto fundacional era una asociación universitaria que debería de haberse llamado "Caballeros Blancos". Ninguna crónica registra nada mas de tales caballeros. El nombre, en cualquier caso, sugiera que el gusto por los títulos y los nombres altisonantes le venía ya de lejos.
Pocos años después se sabe que Escribá utilizaba un látigo de nueve colas y cadena con púas para flagelarse. Las paredes del cuarto de baño estaban frecuentemente bañadas con su propia sangre que salpicaba las paredes. Cuando uno se azota es, fundamentalmente, por tres motivos: por perversión, porque le provoca placer o por trastorno psíquico. Los místicos pertenecen al segundo grupo; sinceramente, no sabemos en cuál de los tres situar a Escribá. Esta y otras costumbres y rumores que circulaban en aquellos años sobre su persona, nos dan de él un cuadro particularmente sombrío. Y desde luego, poco sano. A esto hay que añadir la misoginia. Escribá y su Opus opinan que el estado natural de la mujer de la Obra debe ser el embarazo y el padre Urteaga, uno de los mejores comunicadores de la Obra allá por los años sesenta, sostenía que "las mujeres se salvan teniendo hijos".
Esta misoginia, demasiado evidente, por lo demás, parece en contradicción el espíritu telúrico del Opus al cual ya hemos aludido. No es así. El telurismo está presente en toda la obra a y en todo el espíritu de Escribá. La "Luz del Sur" no exige fidelidad sino sumisión (Escribá aborrecía que le besaran solo el anillo pastoral, exigía que le besaran la mano de rodillas). La "Luz del Sur" se caracteriza en su arte por una frondosidad exuberante y desenfrenada, bien presente en los oratorios de la Obra y el de Escribá en particular, "opulento e inaccesible". Nada que ver con la austeridad olímpica de la "Luz del Norte". Escribá viajó siempre, a partir de sus años de gloria, acompañado de un séquito encargado de servirle. Una ex-miembro del Opus declaró que había tenido que dar por inservivle un colchón recién comprado por que no alcanzaba por 3 cm. las dimensiones establecidas. Cuando se desplazaba a América se hacía enviar los melones por avión. Comía siempre con platos de la mejor porcelana, cubiertos de plata. En Roma, durante el Concilio, un obispo invitado por Escribá se sintió sumamente incómodo comiendo con cubiertos chapados en oro. Todo eso que hoy se llama "imagen", que no es realidad sino reflejo de la realidad, pertenece a la concepción sudista del mundo, hoy en marcha triunfal hacia el precipicio. Escribá, para eso de la imagen, era único. Amaba los títulos universitarios y de nobleza, convencido de que podían atraer dinero e influencia. Tras la "Luz del Sur" y tras el Opus, en definitiva, lo que se percibe es un amor al dinero, no en tanto que tal, sino como vehículo de poder. Es el dominio de la naturaleza, una vez más, lo que interesa, incluso con un cierto desprecio sobre sí mismo. Escribá, por cierto, decía que "para fundador bueno, el que viene embotellado", refiriéndose a la conocida marca de coñac. A partir de 1968, cultivando su imagen, recibe -mejor, compra- el título de Marqués de Peralta. Ese gusto por la imagen alcanzó más allá de la muerte. Su proceso de beatificación hay que considerarlo como el maquillaje final de su imagen.
¿Dónde radica la fuerza del Opus Dei? ¿por qué sus afiliados están tan comprometidos con la asociación y tienen tanta fe en la obra del "Padre"? No basta con decir que se trata de un grupo de presión y que, por tanto, sus miembros extraen beneficios e influencia social. Esto equivaldría a dar la razón a quienes han comparado al Opus con una "masonería blanca". No es así, conozco bien a ambos bandos y puedo decir que mientras el compromiso masónico es extremadamente débil (un ágape, una tenida a la semana y poco más), el miembro del Opus Dei lo es desde que ingresa en la Obra hasta que muere, lo que se le exige es de tal calibre que nadie que no haya sufrido un lavado previo de cerebro, puede aceptar. Si a un masón se le pidiera que utilizara el cilicio y el flagelo veríamos donde quedaba su "compromiso con la humanidad". La masonería y el Opus, fuera de alguna coincidencia formal, son estructuras radicalmente diferentes y que, en absoluto, responden a una misma mentalidad. La fuerza del Opus radica en algo muy distinto que la convicción de que en sus filas se va a obtener promoción social. En cuanto a las similitudes formales, es cierto que los miembros del Opus se reconocen entre sí mediante palabras secretas ("Pax" dice uno para reconocer si hay algún miembro de la Obra; "in aeternum", se le responde), como también es cierto que en las reuniones de cúpula se llamen por un número y no por su nombre. En un momento dado hubo incluso un código secreto para la correspondencia en el que cada numeral o combinación de numeral con vocales tenía un significado. "El código se guardaba en un libro llamado de San Girolano", recuerda una ex-miembro de la Obra.
La lectura de algunas obras de místicos y sus biografías dan la sensación de que les ha sonado la flauta por casualidad. En el Siglo de Oro, ya hemos visto, hubo muchos de estos casos. Se trató de místicos autodidactas que sufrieron una experiencia paranormal trescientos años antes de que Aldoux Huxley escribiera "Las puertas de la percepción". En la historia y en las vivencias de algunos miembros del Opus se divisan los mismos elementos tratados por Huxley. ¿Espiritualidad? Más bien habría que hablar de trucos, meros trucos generados a partir de una alteración en la química de la sangre que producen visiones beatíficas. El sujeto interpreta tales visiones y las dramatiza en forma de experiencias místicas, pero en realidad se trata de fenómenos suficientemente conocidos y explicados, sobre los que no hay duda. Caso diferente de las auténticas experiencias místicas de, por ejemplo, San Juan de la Cruz o en nuestro siglo de Teresa Neumann que, efectivamente, se sitúan en un terreno más próximo a la experiencia trascendente.
Javier Ropero en su libro "Hijos del Opus Dei" profundiza brillantemente en este terreno y a él remito. Con todo, hay otros testimonios y rumores que corren por la "Obra" que abundan en la dirección interpretativa de Ropero.
España en los años 20 y 30 es un hervidero de espiritismo, mesmerismo, teosofía y doctrinas ocultistas. Incluso los medios anarquistas fueron un receptáculo de estas corrientes. Al leer "Camino", da la sensación de que Escribá de Balaguer estaba familiarizado con esta temática y, por lo demás, no hay que olvidar que las 999 sentencias de su libro han sido colocadas deliberadamente. El era consciente e ironizaba al respecto que 999 es el número de la Bestia, 666, invertido. Se decía, igualmente, que en el primer oratorio del Opus, Escribá, mediante un hábil juego de luces y espejos, daba la sensación de que levitaba. Más elementos, confirman que Escribá conocía algunos "trucos" que facilitaban el acceso a engañosas experiencias seudo-místicas.
Cito a Huxley: "Una mezcla -completamente no tóxica- se siete partes de oxígeno y tres de anhídriho carbónico produce en quienes la inhalan ciertos cambios físicos y psicológicos que han sido descritos minuciosamente. Entre estos cambio el más impotante, es un notable incremento en nuestra capacidad para "ver cosas" cuando los ojos están cerrados (...) Estas largas suspensiones de respiración llevan a una alta concentración de anhidrido carbónico en los pulmones y en la sangre y este aumento de la concentración de CO2 disminuye la eficiencia del cerebro como válvula reductora y permite la entrada a la conciencia de experiencias visionarias o místicas del más allá". Ropero, recuerda que los oratorios del Opus Dei son reducidos, cerrados, con escasa ventilación, hay en ellos velas, flores y se consume incienso, suelen utilizarse para sesiones de oración comunitaria, se entonan cánticos religiosos y oraciones decenas de veces repetidas. Es fácil intuir lo que sucede: la atmósfera del lugar se empobrece de oxígeno, mientras la proporción de CO2 crece. De manera monocorde se recitan jaculatorias que inhiben la consciencia. Tras un cuarto de hora de recitar una jaculatoria (frase breve), permaneciendo en silencio y con los ojos cerrados, con la química de la sangre alterada, se accede a un estadio diferente al de la conciencia ordinaria y, por tanto, se tiene tendencia a creer que se ha vivido una experiencia mística. Tal experiencia está además facilitada por las mortificaciones (el cilicio, las flagelaciones, el dormir poco cambiando incluso la almohada por una guía telefónica y el colchón por una tabla). Huxley escribe: "si se analizan los efectos de la autoflagelación resulta muy claro que provocaban experiencias visionarias. Para empezar, liberaban gran cantidad de adrenalina y gran cantidad de histamina, y ambas tienen efectos muy extraños sobre la mente. En el Medievo, cuando no se conocía el jabón ni los antisépticos, cualquier herida que pudiese infectarse lo hacía y los productos proteínicos de emergencia entraban en la sangre. También sabemos que estas cosas tienen efectos psicológicos muy interesantes y extraños. El cura de Ars, a quien un obispo prohibió las flagelaciones escribió nostálgicamente: "Cuando se me permitía hacer lo que quería con mi cuerpo, Dios no me negaba nada"".
La falta de alimento, los ayunos prolongados, unido a todo lo anterior, contribuyen a aumentar la facilidad para tener experiencias seudo-místicas que no son sino respuestas fisiológicas del cuerpo ante situaciones distintas de las habituales pero que nada tienen que ver con la verdadera espiritualidad. La "Luz del Sur" está plagada de estos casos en los que los coribantes, los sacerdotes de Atis, los flagelantes medievales, se azotaban hasta la saciedad o se castraban simplemente para alabar a la Diosa y obtener de ella visiones beatíficas. Stanley Krippner recuerda que "... algunas sectas judías también utilizaban los vapuleos rituales para obtener experiencias de éxtasis; tal era una de las grandes ceremonias del Día del Perdón. La flagelación voluntaria tuvo lugar como devoción extática o exaltada en casi todas las religiones. Los egipcios se azotaban a sí mismos durante los festivales anuales en honor de su diosa Isis; en Esparta, los niños eran flagelados ante el altar de Artemisa Ortia hasta hacerlos sangrar. En Alea, en el Peloponeso, se azotaba a las mujeres en el templo de Dionisos; y en el festival romano de las lupercalias se azotaba a las mujeres en una ceremonia purificadora"... Cultos femeninos (Artemisa, Isis) o telúricos (Dionisos, las lupercalias, el hebraismo), henos aquí en las antípodas de la serenidad olímpica que busca la experiencia trascendente en la serenidad y en la quietud, no por la vía del martirio del cuerpo, sino por el distanciamiento consciente y voluntario del mundo de los sentidos. La misma iglesia católica -y más en concreto la Regla de San Benito y el propio San Francisco- condenó la búsqueda de la experiencia mística si era, a la postre, una búsqueda del placer.
Habría que añadir que la abundancia de oro o de irisaciones doradas en las salas del Opus reservadas al culto, con sus reflejos, facilita el engaño de los sentidos. A partir de todo esto puede entenderse que los crucifijos -ricamente labrados en oro y piedras- vistos por gentes que han pasado por las pruebas descritas antes (cilicio, látigo, ayunos, jaculatorias, respirando atmósfera rica en CO2), crean ver que Cristo se mueve en su cruz, les habla o flota en el aire... Se trata de un simple "truco" del que Escribá no fue el único en beneficiarse. Hoy, buena parte de las sectas destructivas -entre las que el Opus figura para muchos- obtienen el control de sus miembros generando visiones de esta forma. Tal es la fuerza de atracción del Opus. En un mundo en el que la verdadera espiritualidad está ausente, cualquier "emoción fuerte" neoespiritualista, puede cautivar al más escéptico.
Junto a esto, hay algo en el Opus que no está complementamente clarificado. No me voy a referir a sus inextricables orígenes, a la imposibilidad histórica de confirmar la historia ideal del Opus dictada por Escribá, sino a las influencias que sufrió. No creo que tomara un modelo en la masonería, más bien creo que lo encontró en "El Abetal" (La Sapiniere, organización clandestina y secreta católica de finales del sgilo pasado y principios de este) de Monseñor Benigni y en los jesuitas. ¿Eso es todo?
Hay algo más que se escapa al analista pero que planea en los primeros años de la Obra. Hay algunos elementos tomados de la mística masónica ("sobre este aparente desorden cada uno tiene que construir su propio orden" escribía el opusdeista Salvador Bernal parafraseando el "Ordo ab Chao" masónico). Miguel Fisac, uno de los primeros afiliados al Opus, cuenta que cuando fue por primera vez al primer oratorio de calle Ferraz, 50, se alarmó. El confesor de Escribá, el padre Valentín Sánchez, vislumbró también aroma de herejía en el Opus y rompió con Escribá. Algún testimonio remite a la residencia de la calle Jenner de Madrid, donde existía un oratorio "adornado con signos cabalísticos y masónicos". Un profesor de Derecho Internacional afirmó que la palabra "SOCOIN" (Sociedad de Cooperación Intelectual, sigla con la que el Opus dió sus primeros pasos) corresponde a una secta hebraica. En 1941, tras crearse el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, Escribá debió compadecer al sospecharse que "bajo el nombre de Opus Dei se escondía una rama judaíca de la masonería"... Exajeraciones, quizás, pero todas van en la misma dirección y, por lo demás, me parece excepcionalmente sólida la opinión de quienes hacen de Escribá de Balaguer un judío converso, cuya psicología responde a la del "marrano" tal como ha sido acotada y definida por Julio Caro Baroja.
Ya hemos visto la portentosa historia de los criptojudíos españoles, veamos ahora las pistas que nos da la biografía de Escribá. Su propio nombre, aquel con el que fue bautizado, Escriba, delata su origen. Un escriba es un "doctor e intérprete de la ley judía". Caro Baroja, bromeando, decía que este apellido no era el mejor para pasar camuflado. El acento cambia poco, apenas transforma un apellido grave en agudo. Su padre, comerciante en paños, tenía la misma profesión que los judíos altoaragoneses. Barbastro, por lo demás, fue en el siglo XV una de las más prósperas juderías del reino. En el siglo XI, durante el reinado de Pedro I, ya se registraron falsas conversiones de Judíos en Huesca. El propio Escribá parecía querer delatar este origen: "somos el resto del pueblo de Israel" decía frecuentemente. Las sucesivas modificaciones del nombre de Escriba corresponde a la traducción judía. Mendizábal, el factotum de al desarmotización, era un judío converso de apellidos Alvárez Méndez. La costumbre judía de evitar que los muertos judíos o "marranos" reposaran en cementerios consagrados, fue seguida por Escribá al enterrar a sus progenitores en la cripta de la casa del Opus en la madrileña calle de Diego de León.
También es posible establecer vínculos con una especie de neo-templarismo adulterado del que existieron pequeños núcleos en España desde 1820 como ya hemos visto. Durante mucho tiempo los supernumerarios, para acentuar su carácter de pobreza, dormían en parejas en los pisos del Opus, lo que dió lugar a que la falange les acusara repetidamente de prácticas homosexuales. Quizás fuera en imitación de la leyenda templaria que mostraba a dos caballeros sobre una sola montura. El Opus y los templarios tienen como característica común utilizar cruces sin que aparezca el cuerpo de Cristo, ni la notación INRI. Y también la extraña tendencia a utilizar patas de oca. Se sabe que monseñor Escribá solía dibujar patos, e incluso en el Molino Viejo, en la provincia de Segovia, se conserva pintado un pato dibujado por él. Los templarios y las hermandades de constructores que de ellos dependieron utilizaban el grafiti de la pata de oca como símbolo de reconocimiento y firma. Otros han querido ver en la insistencia de la cruz sin la imagen de Cristo y la reiteración de rosas en toda la iconografía del Opus, una alusión a la secta de los rosacruces. ¿Dónde empieza la exageración y dónde termina la realidad?
En los primeros tiempos, Escribá acarició la la idea de forjar una orden católica y caballeresca, los "Caballeros Blancos", y siempre tuvo presente el deseo de entroncar con la nobleza. Caro Baroja recordaba que una característica de los conversos fue "buscar entronque con linajes aristocráticos". Dado el voto de castidad y su alejamiento de la nobleza tradicional, su único camino, como hemos visto, fue la adquisición del título nobiliario a buen precio.
Lo que más llama la atención en los encontronazos entre la Falange y el Opus es que los primeros, que contaban entre sus fundadores con una buena cantidad de títulos nobiliarios (como también existieron en el Partido Fascista y el en Partido Nazi, especialmente en las SS), quisieron proletarizarse, mientras que los miembros del Opus (y, muy en especial, su fundador) buscaron recubrirse del manto de nobleza. Ya hemos expuesto las razones de la ubicación del Opus Dei en las cotas iluminadas por la "Luz del Sur". Vayamos a por su oponente.
En la Falange distinguimos dos elementos perfectamente diferenciados; de un lado aquellos que le confieren un carácter excepcionalmente vitalista y aristocrático, frecuentemente enunciados a nivel simbólico y existencial, y de otro, un grado de confusionismo ideológico que, lejos de desaparecer, fue creciendo a medida que avanzaba en su andadura política. Estos dos elementos se contrarrestaron frecuentemente; ninguno de sus miembros estuvo en condiciones de superar la contradicción y las influencias opuestas, ni siquiera el mismo Primo de Ribera y mucho menos Manuel Hedilla. Así pues, oscilando entre las altas cimas de la metafísica y las más bajas cotas de la demagogia social, entre lo más vertical y lo horizontal por definición, la Falange supuso el último intento de encarnar la "Luz del Norte", de la que lo único que nos queda es un compendio de libros y escritos, buscados por los bibliófilos y coleccionistas y que, nadie hasta ahora, ha sabido "aggiornar".
Hemos hablado de símbolos. Mal que les pese a los falangistas, su organización jamás tuvo una ideología digna de tal nombre; como máximo una concepción del mundo y en absoluto cerrada. No, la Falange fue entre 1933 y 1936, entre su fundación y el desencadenamiento de la guerra civil, un estado de espíritu, en absoluto una ideología. Antes de esa fecha no existía y después estuvo combatiendo en los frentes. Entre ambas, las necesidades de la lucha política hicieron que no pudiera elaborarse ninguna doctrina coherente. Pero existieron símbolos, allí donde las teorías callan, que nos hablan de un impulso vital en el cual se reconocen, si bien que atenuados, confusos y de forma inconsciente, los rasgos de la "Luz del Norte".
El yugo y las flechas (la Y de Ysabel y la F de Fernando, blasón de los Reyes Católicos que herederá Carlos V), el hecho de que sean cinco las flechas (número de perfección y límite de las posibilidades humanas), el cisne (emblema del Frente de Juventudes y del Sindicato Español Universitario, ave solar por excelencia junto al aguila y el león, identificada con Helias, el caballero del Sol), el rojo y el negro de la bandera (símbolos de la dualidad, de la muerte y de la vida, de la tradición y la revolución), la garra irradiante (la garra del león, otro animal solar, de la que irradia el sol), el "Cara al Sol" (título suficientemente explícito del espíritu solar que animaba a la primera Falange), el recuerdo a los muertos, "presentes" (al igual que los antiguos pueblos nórdicos germánicos que se sentían acompañados por sus ancestros), las alusiones a la "guardia de los luceros" (entendida como la compuesta por aquellos camaradas que han muerto en circunstancias heroicas), las continuas referencias a un estilo austero y duro, desprovisto de lujo y oropeles, castellano, en definitiva, la valoración de la Edad Media como quintaesencia de lo español, los llamamientos a una vocación heroica, las asimilaciones del militante como "mitad monje mitad soldado", o de la sociedad ideal con "ángeles armados en las jambas de las puertas", todo esto, si bien no conforma una ideología en el sentido estricto de la palabra, si en cambio conforma una concepción del mundo emanada directamente de la "Luz del Norte".
No queremos entrar en las polémicas sobre las implicaciones reales o supuestas de la Falange en episodios indignos y rechazables; los años en los que dió a luz fueron turbulentos y precedieron la gran catástrofe de nuestro país en el siglo XX, la guerra civil. El fusilamiento de García Lorca (refugiado en casa de falangistas sevillanos), la represión contra los militantes republicanos, las "patrullas del amanecer", son solamente episodios aislados en la historia de la Falange y, más bien, forman parte de la historia de la guerra civil. Es suficientemente conocido que los entendimientos entre anarquistas y falangistas, incluso hasta los años sesenta, habían empezado con el trasvase de militantes de la CNT y del pestañismo a filas falangistas en los años de la preguerra. A efectos del presente estudio, lo que hace que podamos valorar un movimiento histórico como Falange Española, no es su participación en tal o cual episodio concreto, afortunado o desgraciado, sino lo que puede deducirse de su espíritu. A este respecto, incluso los más acérrimos detractores reconocerán que una élite falangista -en la que podemos situar a Dionisio Ridruejo- no solamente proclamaron unos valores y principios generales, sino que estuvieron dispuestos a vivir y a morir, inspirados en ellos. Eso les llevó a muchos de ellos a las estepas rusas enrolados como voluntarios en la División Azul y que solo recibieron una cruz de palo como recompensa; otros, prefirieron desligarse del régimen que nació de la sublevación de julio de 1936, y que, en su criterio, no se adaptaba a la imagen que se hacían de su estado ideal; muy pocos formaron organizaciones disidentes, inspiradas en Miguel Hedilla, segundo Jefe Nacional de Falange. Estos fueron los menos y, en una condiciones políticas muy favorables, no estuvieron en condiciones de completar los principios apenas enunciados por Primo de Rivera, Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma. Falange se fue extinguiendo poco a poco.
Respecto a los tres fundadores hay en ellos diferencias no desdeñables. Están, bien es cierto, unidos por lo que podríamos llamar "sentimiento imperial", la sensación de que el mejor momento de la hispanidad fue el período iniciado con los Reyes Católicos y concluido con los últimos austrias. Las ideas de centralidad, de ímpetu político-religioso, el carácter antiburgués, el culto a la juventud, el sentido de disciplina y sacrificio, esto es, el espíritu de milicia heroica, el gusto por la aventura y, finalmente, la síntesis entre la Tradición española y la Revolución, hacen de Falange Española, lo que algunos han llamado "Vía Solar". Pero, al margen de esto, Primo de Ribera, Ledesma y Redondo, sostenían orientaciones sensiblemente diferentes. Redondo era un castellano viejo; católico, antisemita, su austeridad y entereza fueron siempre proverbiales; cuando uno se aproxima a su biografía cree estar ante aquellos castellanos que combatieron a la morisma y tiene la sensación de que las gentes de Fernán González debieron estar, más o menos, cortadas con el mismo patrón. Onésimo es el católico militante de viejo estilo que tiene muy pocos puntos en común con Ramiro Ledesma, ateo impenitente, vitriólico, activista, intelectual frío que unos días colocaba un petardo y al día siguiente publicaba un ensayo en "La Revista de Occidente". Partidario de "nacionalizar a las masas anarcosindicalistas", hubo en él rasgos de populismo y demagogia que compartió con Primo de Rivera. Este, por su parte, hijo del General del mismo nombre, pertenecía a los círculos aristocráticos madrileños y estaba relacionado con una pléyade de intelectuales y artistas de vanguardia que constituyeron el núcleo fundacional de la Falange. Formado por Rafael Sanchez Mazas, Agustín de Foxá, Alvaro Cunqueiro, Eugenio Montes, Rafael García Serrano, Luys Santa Marina, Felipe Ximenez de Sandoval, Gonzalo Torrente Ballester, Dionisio Ridruejo, Ernesto Giménez Caballero, Mourlane Michelena, Víctor de la Serna, pintores como Alfonso Ponce de León o Cossío, Samuel Ros, José María Alfaro, con el patronazgo espiritual de Eugenio d’Ors, Maeztu y Ortega, estamos ante un grupo de intelectuales, más que ante el grupo activista que hoy recordamos.
Pero Falange Español no representaba la "Luz del Norte" en estado puro sino adulterado y con la tensión metafísica rebajada. Su "vocación imperial" no tuvo posibilidad de manifestarse en una opción política concreta, simplemente se tradujo en un nacionalismo extremo, al igual que la oposición a la burguesía y al capitalismo no llevó a fórmulas de superación, sino a una admiración indecorosa y acrítica hacia los movimientos sociales de izquierda, por igualitarios y uniformizadores que fueran. Ramiro Ledesma, desde su revista "La Conquista del Estado" pudo gritar "Viva la Alemania de Hitler, viva la Italia de Musolini, viva la Rusia de Stalin", y escribir luego que más le lucía la camisa roja de Garibaldi que la negra de Mussolini, expresiones desgarradas de un deseo de revancha social e igualitarismo uniformizador, en contradicción con los ideales jerárquicos que exhibía en otros escritos.
Especialmente, en Ramiro Ledesma se percibe la falta de sensibilidad hacia lo sagrado. Viendo en la Edad Media, una edad oscura, percibe en las formas renacentistas su estilo ideal. Alguién pudo decir con justicia que mientras Marx practicaba un materialismo económico, Ledesma profesaba un materialismo guerrero. La "idea imperial" no es tomada sino en función del poder que le atribuye para relanzar un nacionalismo español, un nacionalismo laico y de masas. Ledesma, pero también José Antonio y Onésimo Redondo, no dudan a la hora de utilizar y predicar la violencia para alcanzar los objetivos políticos. Se trata de un pragmatismo exajerado y de un activismo a ultranza derivados de su particular visión del mundo. Hubo en Falange una desviación titánica y prometeica, en ocasiones incluso fálica, única vía en la que supieron hacer desembocar la visión militar y heroica de la vida. Por lo demás, cuando José Antonio aludía a la "dialéctica de los puños y las pistolas" no hacía otra cosa más que abrir o insertarse en una espiral de violencia que terminó por anegarle a él y al propio movimiento.
Pero allí donde el espíritu de la Falange es más distante de la "Luz del Norte" es en la concepción del Estado. Ni Ramiro Ledesma, ni Primo de Rivera, consiguieron consolidar una teoría del Estado, pero las pocas frases, esparcidas aquí y allí, en sus escritos, dan pie a pensar que junto a la idealización del papel de las masas (la "nacionalización de las masas sindicales" que pedía Ramiro Ledesma), ambos perciben el Estado como un "instrumento totalitario". En sus escritos no se encuentran alusiones a la sociedad trifuncional, mucho menos a los cuerpos intermedios, tan solo vagas y preocupantes alusiones al papel de los sindicatos. Fueron los teóricos del franquismo quienes se encargaron de completar estos enunciados y dar forma a la "democracia orgánica" como alternativa a la "democracia liberal".
El elemento que permite situar a José Antonio Primo de Rivera por encima de los otros dos fundadores y ver en él al receptáculo de la "Luz del Norte" es su vocación poética. Solo José Antonio como figura central del grupo de intelectuales falangistas, supo apreciar el valor de la poesía en la formación de una visión del mundo.
Cuando faltaron los fundadores de la Falange y los elementos más representativos, poco dados a tareas de gobierno, prefirieron optar por enrolarse en la División Azul, nadie se preocupó de completar la doctrina falangista. El franquismo utilizó a la Falange como levadura de las masas; sus ideales sociales, su consigna mil veces repetida de "Patria, Pan, Justicia", podían constituir un reclamo, como de hecho así ocurrió durante veinticinco años, entre 1939 y 1964. Al cerrarse este ciclo, el Opus Dei ya despuntaba como la fuerza hegemónica en los gobiernos de Franco.
La lucha entre la Falange y el Opus Dei fue larvando durante los años 60 y estalló con el "affaire" MATESA. Por esas fechas la Falange ya estaba excepcionalmente debilitada y reducida a una mera cáscara sin vida. Los locales del Movimiento Nacional estaban vacíos, el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, los Sindicatos, la Guardia de Franco, no eran sino estructuras burocráticas esclerotizadas que apenas podían hacer nada frente al Partido Comunista y a la extrema-izquierda.
El Opus Dei, sus bancos y ministerios, sus industriales, sus tecnócratas, no preveyeron que al trabajar por la construcción de un capitalismo tardío, estaban generando una estructura económica de tipo liberal-capitalista que entraba flagrantemente en contradicción con la estructura política del Estado, autoritaria y paternalista. Cuando, para sobrevivir, esa estructura económica precisó impulsar un cambio para promover un mayor crecimiento, sacrificó a la estructura política. Eso ocurrió a mediados de los años 70.
En el momento que Franco muere, la derecha carece de organización política, está en el poder, es el poder, pero no tiene estructura de partido y, por tanto, no estará en condiciones de afrontar una etapa democrática formal. Es el período de las Asociaciones Políticas, el "espíritu del 12 de febrero" y la Ley de Reforma Política. La derecha intenta ganar tiempo, liderar el proceso de cambio. Ahí está el Opus Dei intentando no perder el tren. Sin embargo, a partir de 1977, los mayores éxitos los consigue en el extranjero y, a partir de la entronización de Juan Pablo II, en la propia Roma.
En cuanto a la Falange, llegó a la transición en un estado de total descomposición y con un alto grado de confusionismo político. Multifraccionada, perdidos los líderes e intelectuales que le dieron vida, habiendo dado la espalda incluso a los propios orígenes, sufrió un proceso continuado de empequeñecimiento y gropuscularización en el que todavía se encuentra hoy.
Lo que tuvo de "Luz del Norte" hace sesenta años, hace ya mucho que se extinguió.
© Ernest Milà – infokrisis – infokrisis@yahoo.es – http://infokrisis.blogia.com – Se prohíbe la reproducción de este artículo sin indicar procedencia
,[1] he detects in the universalist ideologies, those “of Rights, or Humanity, or Order, or Peace,” the project of transforming the planet into a kind of depoliticized economic aggregate which he compares to a “bus with its passengers” or a “building with its tenants.” And in this premonition of a world of the death of nations and cultures, the culprit is not Marxism but the liberal and commercial democracies. Thus Schmitt offers one of the most acute and perspicacious criticisms of liberalism, far more profound and original than the “anti-democrats” of the old reactionary right.
(1919),[4] is devoted to a critique of political romanticism which he opposes to realism. To Schmitt, the millennialist ideals of the revolutionary Communists and the völkisch reveries of the reactionaries seemed equally unsuitable to the government of the people. His second great theoretical work, Die Diktatur [Dictatorship
] (1921),[5] constitutes, as Julien Freund writes, “one of the most complete and most relevant studies of this concept, whose history is analyzed from the Roman epoch up to Machiavelli and Marx.”[6]
(1923),[7] Schmitt ponders the identification of democracy and parliamentarism. To him, democracy seems to be an ideological and abstract principle that masks specific modalities of power, a position close to those of Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca. The exercise of power in “democracy” is subject to a rationalist conception of the state which justified, for example, the idea of the separation of powers, the supposedly harmonious dialogue between parties, and ideological pluralism. It is also the rationality of history that founds the dictatorship of the proletariat. Against the democratic and parliamentarian currents, Schmitt places the “irrationalist” currents, particularly Georges Sorel and his theory of violence, as well as all non-Marxist critiques of bourgeois society, for example Max Weber.
, Schmitt’s most fundamental work, first published in 1928, revised in 1932, and clarified in 1963 by its corollary Theory of the Partisan
.[8] Political activity is defined there as the product of a polarization around a relation of hostility. One of the fundamental criteria of a political act is its ability to mobilize a population by designating its enemy, which can apply to a party as well as a state. To omit such a designation, particularly through idealism, is to renounce the political. Thus the task of a serious state is to prevent partisans from seizing the power to designate enemies within the community, and even the state itself.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg Christen als Freiwild
Christen als Freiwild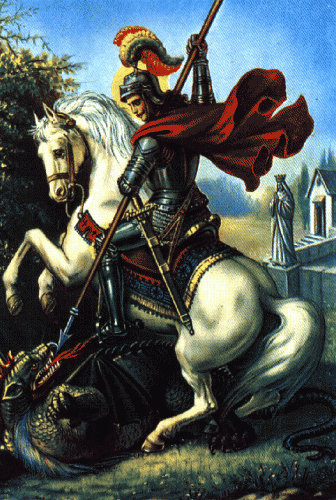 San Giorgio: Il Santo uccisor del Drago
San Giorgio: Il Santo uccisor del Drago The Lesson of Carl Schmitt
The Lesson of Carl Schmitt Wintergrau liegt auf der Heimat. Eisig fegen frostige Stürme über kahle Felder, darüber ziehen Krähenschwärme hin. Am Horizont versinkt ein matter Sonnenball ins Grau das über die Welt gekommen ist mit dem Fall der letzten Blätter - von ferne kündet Trommelschlag: SCHWERTZEIT bricht an!
Wintergrau liegt auf der Heimat. Eisig fegen frostige Stürme über kahle Felder, darüber ziehen Krähenschwärme hin. Am Horizont versinkt ein matter Sonnenball ins Grau das über die Welt gekommen ist mit dem Fall der letzten Blätter - von ferne kündet Trommelschlag: SCHWERTZEIT bricht an! Seit der Frühjahrsprospekt meines Verlags versandt ist, hat ein rundes Dutzend Leser angerufen, um zu erfragen, wieso ich gerade die Bücher Carl Schmitts in den Versand aufgenommen habe und warum ich ihn derzeit wieder intensiv lese. Meine Antwort:
Seit der Frühjahrsprospekt meines Verlags versandt ist, hat ein rundes Dutzend Leser angerufen, um zu erfragen, wieso ich gerade die Bücher Carl Schmitts in den Versand aufgenommen habe und warum ich ihn derzeit wieder intensiv lese. Meine Antwort: La Vita nuova (1292-1293) de Dante es el canto que prepara a la recta lectura de la Divina commedia. El lector atento sabe que el ejercicio necesario para la compresión del Amor dantesco en términos impersonales y político-religiosos, depende del soneto de la Vita nuova. Se trata, en este breve libro, de la compresión del dogma del Milagro como evento del Automaton (la casualidad), como la realización del evento excepcional en el accidente. En Dante el Automaton es la inmediatez ineluctable y subitánea del advenimiento en su Ahora perpetuo bajo la forma del saluto. Il saluto (saludo) irrumpe en el tiempo (lo crea más precisamente) para imponer su Salud: Beatrice (1). Se trata, en otras palabras, del advenimiento de un nuevo orden bajo la forma del acontecimiento fortuito: se trata del orden necesario
La Vita nuova (1292-1293) de Dante es el canto que prepara a la recta lectura de la Divina commedia. El lector atento sabe que el ejercicio necesario para la compresión del Amor dantesco en términos impersonales y político-religiosos, depende del soneto de la Vita nuova. Se trata, en este breve libro, de la compresión del dogma del Milagro como evento del Automaton (la casualidad), como la realización del evento excepcional en el accidente. En Dante el Automaton es la inmediatez ineluctable y subitánea del advenimiento en su Ahora perpetuo bajo la forma del saluto. Il saluto (saludo) irrumpe en el tiempo (lo crea más precisamente) para imponer su Salud: Beatrice (1). Se trata, en otras palabras, del advenimiento de un nuevo orden bajo la forma del acontecimiento fortuito: se trata del orden necesario 



 La Révolution mexicaine de 1912 est sans doute la première réaction notable à cette situation de pillage du pays par les capitalistes étrangers et leurs collaborateurs locaux. Le Mexique était en effet dépossédé de ses champs pétrolifères dont la concession était accordée aux compagnies anglo-saxonnes; tandis que lrs terres se concentraient entre les mains de quelques familles au détriment des communautés indiennes. Cette Révolution est l'aboutissement d'un mouvement pour l'émancipation des Indiens et contre le capital étranger, s'accompagnant de la lutte contre le clergé catholique qui est considéré comme le meilleur allié du régime. Le rôle de ce dernier a été déterminant dans les conflits qui ont ponctué l'histoire de l'Amérique latine, surtout au XXième siècle, période de remous et de mutations pour l'Église catholique.
La Révolution mexicaine de 1912 est sans doute la première réaction notable à cette situation de pillage du pays par les capitalistes étrangers et leurs collaborateurs locaux. Le Mexique était en effet dépossédé de ses champs pétrolifères dont la concession était accordée aux compagnies anglo-saxonnes; tandis que lrs terres se concentraient entre les mains de quelques familles au détriment des communautés indiennes. Cette Révolution est l'aboutissement d'un mouvement pour l'émancipation des Indiens et contre le capital étranger, s'accompagnant de la lutte contre le clergé catholique qui est considéré comme le meilleur allié du régime. Le rôle de ce dernier a été déterminant dans les conflits qui ont ponctué l'histoire de l'Amérique latine, surtout au XXième siècle, période de remous et de mutations pour l'Église catholique. La Théologie de la libération, impulsée par des intellectuels occidentaux et par des prêtres latino-américains venus étudier dans les universités européennes, a donc trouvé dans les réalités socio-politiques du continent le terreau favorable à son expansion. Dès le début des années 80, Jean-Paul II, pape farouchement anticommuniste, tente cependant de juguler ce mouvement. En 1984, une “instruction sur quelques aspects de la Théologie de la libération” fait le point sur ce phénomène en évitant de le condamner en bloc mais en critiquant certaines de ses dérives. Dans ce document, le cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation de la foi met en garde contre le risque de perversion de l'inspiration évangélique par la philosophie marxiste.
La Théologie de la libération, impulsée par des intellectuels occidentaux et par des prêtres latino-américains venus étudier dans les universités européennes, a donc trouvé dans les réalités socio-politiques du continent le terreau favorable à son expansion. Dès le début des années 80, Jean-Paul II, pape farouchement anticommuniste, tente cependant de juguler ce mouvement. En 1984, une “instruction sur quelques aspects de la Théologie de la libération” fait le point sur ce phénomène en évitant de le condamner en bloc mais en critiquant certaines de ses dérives. Dans ce document, le cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation de la foi met en garde contre le risque de perversion de l'inspiration évangélique par la philosophie marxiste.

 Manfred MÜLLER:
Manfred MÜLLER:

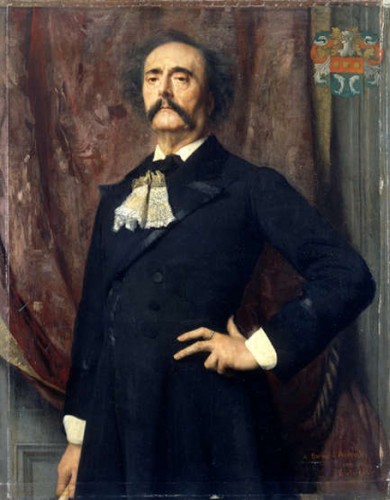


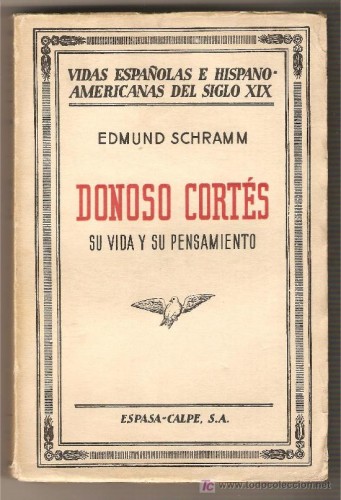




 petit dictionnaire raisonné
petit dictionnaire raisonné
 Antwoord: Men heeft lange tijd gedacht dat de muzelmanse verovering gemakkelijk gebeurde, maar dat is slechts een gemeenplaats. Het is waar dat de vervanging van de aristocratie van de Wisigoten door de Arabo-Berbers zeer vlug gebeurde, onder andere mogelijk gemaakt door de opportunistische bekering van tal van Gotische edellieden naar de islam. Dat leidde ertoe te denken dat de Spaanse bevolking geen weerstand zou hebben geboden aan de invasie, indien die er toch maar voor zorgde dat het ene gezag gewoonweg vervangen werd door een ander. Maar de bezetters waren erop uit hun religie en hun islamitische orde op te leggen in zowat alle gebieden, wat natuurlijk alles veranderde. De weerstand gebeurde vooral op “beschavings”-vlak. De uitdrukking “uitbreiding tot het gehele schiereiland” verdient nader bepaald te worden. Een goed deel van het noord-westen van Spanje werd nooit bezet. Dat gebied werd geconfronteerd met de islamitische militaire dreiging, maar werd nooit overheerst en kende een toestand van voortdurend verzet.
Antwoord: Men heeft lange tijd gedacht dat de muzelmanse verovering gemakkelijk gebeurde, maar dat is slechts een gemeenplaats. Het is waar dat de vervanging van de aristocratie van de Wisigoten door de Arabo-Berbers zeer vlug gebeurde, onder andere mogelijk gemaakt door de opportunistische bekering van tal van Gotische edellieden naar de islam. Dat leidde ertoe te denken dat de Spaanse bevolking geen weerstand zou hebben geboden aan de invasie, indien die er toch maar voor zorgde dat het ene gezag gewoonweg vervangen werd door een ander. Maar de bezetters waren erop uit hun religie en hun islamitische orde op te leggen in zowat alle gebieden, wat natuurlijk alles veranderde. De weerstand gebeurde vooral op “beschavings”-vlak. De uitdrukking “uitbreiding tot het gehele schiereiland” verdient nader bepaald te worden. Een goed deel van het noord-westen van Spanje werd nooit bezet. Dat gebied werd geconfronteerd met de islamitische militaire dreiging, maar werd nooit overheerst en kende een toestand van voortdurend verzet. Antwoord: Het ontdekken van het vermeende graf van Sint-Jacob kreeg een enorme echo in gans de christelijke wereld, vooral in het Karolingische Frankrijk. Vanaf de 9de eeuw betekende het Galicisch heiligdom voor heel Europa een legendarische band, wat de muzelmannen uiteraard wisten. Al Manssur bespaarde zich geen moeite om het heiligdom in 997 te verwoesten. Maar dat schaadde het belang van de cultus niet. Men bouwde een nieuwe kathedraal en de bedevaart naar Compostella werd een soort basis ritueel voor gans het christelijke Europa.
Antwoord: Het ontdekken van het vermeende graf van Sint-Jacob kreeg een enorme echo in gans de christelijke wereld, vooral in het Karolingische Frankrijk. Vanaf de 9de eeuw betekende het Galicisch heiligdom voor heel Europa een legendarische band, wat de muzelmannen uiteraard wisten. Al Manssur bespaarde zich geen moeite om het heiligdom in 997 te verwoesten. Maar dat schaadde het belang van de cultus niet. Men bouwde een nieuwe kathedraal en de bedevaart naar Compostella werd een soort basis ritueel voor gans het christelijke Europa. Morena lag, te doorbreken en de Castilliaanse hoogvlakte te bezetten. De bedreiging was zo sterk dat de koning van Castilië weinig moeite had van paus Innocentius III te bekomen dat die opriep tot een kruistocht. Zo kwam het dat in de lente van 1212 duizenden Iberische en Europese strijders – Duitsers, Bretoenen, Lombarden, Provençalen, Aquitaniërs, inwoners van de Langue d’Oc, enzovoort) in Toledo verzamelden om de Almohaden te stoppen. Een groot aantal van die Europese troepen verliet later de kruistocht, maar de Provençaalse ridders bleven tot het einde aan de zijde van de troepen die de Iberische vorsten hadden geleverd en deelden in de overwinning. Vanaf Las Navas de Tolosa zou men nooit meer meemaken dat muzelmanse overweldigers het Europese continent vanuit het zuiden militair zouden bedreigen.
Morena lag, te doorbreken en de Castilliaanse hoogvlakte te bezetten. De bedreiging was zo sterk dat de koning van Castilië weinig moeite had van paus Innocentius III te bekomen dat die opriep tot een kruistocht. Zo kwam het dat in de lente van 1212 duizenden Iberische en Europese strijders – Duitsers, Bretoenen, Lombarden, Provençalen, Aquitaniërs, inwoners van de Langue d’Oc, enzovoort) in Toledo verzamelden om de Almohaden te stoppen. Een groot aantal van die Europese troepen verliet later de kruistocht, maar de Provençaalse ridders bleven tot het einde aan de zijde van de troepen die de Iberische vorsten hadden geleverd en deelden in de overwinning. Vanaf Las Navas de Tolosa zou men nooit meer meemaken dat muzelmanse overweldigers het Europese continent vanuit het zuiden militair zouden bedreigen. Antwoord: Door hun verenigende en moderniserende werking. Onder hun bewind liep de Reconquista ten einde, het koninkrijk Navarra werd in het nieuwe Spanje geïncorporeerd, de moderne Castilliaanse taal werd gereglementeerd. De religieuze eenheid van het land werd verwezenlijkt met het uitdrijven van de joden. Er tekende zich een post-feodale macht af die meer rechten toekende aan de steden dan aan de edellieden.
Antwoord: Door hun verenigende en moderniserende werking. Onder hun bewind liep de Reconquista ten einde, het koninkrijk Navarra werd in het nieuwe Spanje geïncorporeerd, de moderne Castilliaanse taal werd gereglementeerd. De religieuze eenheid van het land werd verwezenlijkt met het uitdrijven van de joden. Er tekende zich een post-feodale macht af die meer rechten toekende aan de steden dan aan de edellieden.