Théoricien de la crise de la démocratie et directeur de recherches à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Marcel Gauchet, 63 ans, répond aux questions de Libération.
Quel bilan politique dressez-vous des deux premières années de Nicolas Sarkozy à l’Elysée ?
Le sarkozysme est difficile à analyser, car il est caméléonesque. Il manie la contradiction sans complexe. En jouant sur tous les tableaux, il se rend insaisissable, ce qui explique que les protestations de la gauche le laissent indemne. Néanmoins, si on doit faire un bilan, on peut dire que le sarkozysme a probablement épuisé son capital initial et que s’il continue de faire illusion, c’est paradoxalement grâce à la crise, qui le prend à contre-pied, mais justifie, pour quelque temps encore, son activisme. L’essence du sarkozysme, c’est, sous le titre de la «réforme», l’idée que le moment est venu de banaliser la France, en économie, en diplomatie, dans l’éducation… C’est un programme de pasteurisation européo-libérale du pays, dont les deux armes principales sont d’une part la communication, que Nicolas Sarkozy manie en virtuose, et d’autre part la vitesse et l’emballement du rythme : réformes annoncées à jet continu pour déstabiliser les opposants, qui n’ont pas le temps de se mobiliser qu’on en est déjà à la réforme suivante ; multiplication des fronts pour brouiller les cartes, etc.
Cette formule serait en train de toucher à ses limites ?
J’en ai l’impression. D’une part, une bonne partie des prétendues réformes sont pour la galerie. Sarkozy sait marier comme personne l’intransigeance verbale et une gestion très chiraquienne des compromis. C’est un bonapartisme pour la télévision, où l’affichage de la volonté l’emporte sur la réalité. Ca ne marche qu’un temps et les limites de l’entreprise commencent à se voir. Ensuite, l’effet de surprise ne joue plus. La démarche se heurte à la résistance de l’exception française. Or celle-ci est solide. Elle repose sur une culture politique républicaine ancrée dans une vision très forte de l’histoire du pays. Sarkozy a eu tort de croire qu’il pouvait se contenter de concessions rhétoriques à ce noyau dur, avec les discours de Guaino. Il a sous-estimé la vitalité de ce cadre historique et mental. Aussi son action s’enlise-t-elle. Nous sommes en train de passer de la guerre de mouvement à la guerre de tranchées. La crise lui offre un répit qu’il a saisi avec son intelligence et sa souplesse habituelles. Elle fragilise son discours sur le fond, mais elle met en valeur son pragmatisme et son volontarisme, qui sont bien adaptés à la situation.
Les Français ne l’ont-ils pas élu justement pour ce programme de réformes ?
Les Français sont ambigus et contradictoires. Ils aspirent au changement car ils ont les réflexes d’une ancienne grande puissance qui ne veut pas abdiquer. Ils entendent rester dans le peloton de tête - de ce point de vue, le discours de Sarkozy a rencontré un écho profond dans la société. Mais ils veulent aussi rester ce qu’ils sont. Voilà pourquoi ils sont si réactifs dès qu’ils ont l’impression que l’on risque de toucher à ce qui constitue le cœur de l’expérience politique française. Dans le discours, Sarkozy a essayé de jouer sur les deux tableaux, en annonçant le changement tout en invoquant la France éternelle, de Jeanne d’Arc à Guy Môquet. Mais dans la pratique, ce grand écart s’est révélé intenable. L’histoire a disparu en route, au profit d’un changement souvent très ignorant des réalités françaises.
Le sarkozysme incarne-t-il une étape de la crise de la démocratie telle que vous l’analysez dans vos essais ?
Ce serait lui faire beaucoup d’honneur que d’y voir un phénomène historique significatif en lui-même. Le sarkozysme n’est qu’une conjoncture française, mais qui met néanmoins en lumière un élément sous-jacent de la crise de la démocratie : une volonté de pouvoir dont l’effet est une dévitalisation du pouvoir. Typique, par exemple, est la place démesurée donnée par le chef de l’Etat à la communication, comme si agir sur les images était transformer la réalité. Caractéristique, également, son impossibilité de faire le départ entre l’homme privé et sa fonction publique. Or une telle distinction, c’est l’âme même de la démocratie, où le pouvoir est dans les institutions, non dans les personnes. Chez Nicolas Sarkozy, la dimension institutionnelle est absente. L’autorité qui compte, à ses yeux, c’est la sienne, pas celle de l’Etat, dont il n’a pas le souci. Par ce trait, il incarne à merveille ce que j’appelle «la démocratie du privé», qui est un processus de désarticulation de la démocratie sous l’effet de l’individualisation et de la privatisation du monde.
L’idée que nous sommes passés d’une «démocratie du public» à une «démocratie du privé» est au cœur de votre réflexion actuelle. Qu’entendez-vous par là ?
Pour le dire abruptement, la question est de savoir si le collectif jouit d’une existence indépendante de celle des êtres qui le composent. Si oui, on peut lui donner une expression institutionnelle, une expression publique, distincte de l’expression privée des individus, qui ont par ailleurs voix au chapitre. Historiquement, c’est cette idée qui a longtemps prévalu. Elle a eu de beaux jours politiques, spécialement en France, où elle a constitué l’âme de l’Etat républicain. Dans ce cadre, les libertés individuelles sont supposées s’accomplir par la participation à la chose publique. Parallèlement, il est vrai, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis avaient développé des modèles plaçant l’accent davantage sur les libertés individuelles que sur la chose publique, sans ignorer le rôle de celle-ci. Mais depuis une trentaine d’années, cette tradition anglo-américaine s’est radicalisée et diffusée partout. La pente du monde est de remettre en question toutes les formes de collectivisation de l’existence politique, au nom de l’idée qu’il n’existe que les individus réels et leurs intérêts particuliers, et que c’est de leur interaction que doivent surgir les compromis acceptables pour tout le monde. C’est ce qu’on appelle le néolibéralisme. La chose publique, dans ce cadre, n’a plus de consistance par elle-même, elle n’est plus que l’instrument des demandes émanées de la sphère privée. Les institutions collectives sont discréditées, parce qu’elles sont toujours suspectes de ne pas prendre en compte les personnes concrètes. Sous couvert des mêmes règles, l’esprit du fonctionnement de la démocratie a complètement changé.
Néanmoins, la démocratie américaine se caractérise par des valeurs collectives très fortes : patriotisme et religion.
En effet. C’est, pour le coup, l’exception américaine : les Etats-Unis sont dotés d’une identité politique très forte et le pays où les libertés privées ont le plus de place. C’est fonction de la foi dans la «destinée manifeste» de l’Amérique et dans son rôle de puissance à l’échelle du monde. L’Etat-nation américain est projeté vers l’extérieur ; il n’organise pas la société à l’intérieur. C’est ce qui fait que la démocratie du privé coexiste avec une dimension publique axée sur le rayonnement des Etats-Unis. Les Européens, au contraire, ont abandonné toute politique de puissance et, dans leur démocratie sociale, le poids des institutions publiques est grand. Aussi chez eux l’irruption de la démocratie du privé est-elle très perturbatrice pour l’identité collective. Ils ne savent plus très bien où ils en sont. Autant, pour les Américains, la démocratie du privé se complète par un Etat tourné vers le dehors, autant, pour les Européens et en particulier pour les Français, elle se solde par l’incapacité d’assumer un héritage historique dont ils ne savent plus trop que faire, tout en y restant attachés.
La «démocratie du privé» s’accompagne d’une «oligarchisation» de la société, dites-vous, mais aussi d’une montée en puissance de la protestation. N’est-ce pas contradictoire ?
La démocratie du privé, ce n’est pas du tout le repli des gens dans leur foyer, le cocooning, la passivité : c’est l’alignement de chacun sur son intérêt d’individu et la légitimation absolue de celui-ci, donc de sa défense inconditionnelle. C’est dire que l’effervescence protestataire, la revendication et le contentieux sont garantis d’avance. Mais ces revendications campent sur leur particularité, en se plaçant à l’extérieur du politique. La protestation s’en remet en fait aux responsables et leur dit : «Voilà ce que nous voulons, débrouillez-vous pour trouver les moyens». Le mot-clé est résister. Mais si vous ne formulez pas de propositions, si vous ne prenez pas en charge le point de vue de l’ensemble où votre réclamation doit s’inscrire, ce sont les gouvernants qui le font pour vous. Le problème de cette formule, c’est qu’elle ne permet pas de remonter au collectif. Elle exige, mais délègue aux hommes politiques le soin de décider : ainsi, la protestation secrète naturellement l’oligarchisation. Du reste, le personnel politique s’accommode de la situation. Il a compris que si elle est parfois inconfortable, elle lui laisse les cartes bien en main. Le divorce entre le haut et le bas se creuse. Car les citoyens continuent dans le même temps d’aspirer à une grande politique. On a vu à l’occasion de la dernière élection présidentielle que leur attente était intacte. Les électeurs aspirent à une puissance du politique que toute leur pratique au quotidien a pour effet de rendre impossible. D’où le sentiment général d’une dépossession incompréhensible.
Comment s’en sort-on ?
D’une part, il ne faut pas sous-estimer la prise de conscience par les individus des contradictions et de l’impasse dans laquelle ils sont. Les gens ne sont pas stupides, ils voient bien que quelque chose coince. Car cette équation impossible, on la trouve à tous les niveaux : dans la famille, à l’école, dans l’entreprise. L’évolution du syndicalisme, par exemple, est significative. Mais ce mouvement des mentalités ne suffit pas à faire bouger les choses à lui seul. C’est la rencontre avec les circonstances historiques qui précipite le changement, dans les moments de choix qui font apparaître la nécessité de reprendre en compte le collectif. En la matière, nous avons tout ce qu’il nous faut sous la main : la crise financière, le défi écologique, le blocage européen, le déséquilibre des systèmes sociaux. L’art du politique, c’est de conjuguer ces deux forces.
La crise financière est-elle un autre symptôme de la «démocratie du privé» ?
Elle est le symptôme économique de la dérive politique entraînée par la confiance illusoire dans l’autorégulation des intérêts individuels. Elle fait apparaître la vacuité de ce rêve d’agrégation automatique. La vérité est qu’un monde mondialisé a plus besoin que tout autre d’une organisation. Savoir laquelle va nécessiter du temps, mais tel est le but qu’il faut se fixer et c’est dans une telle optique qu’on peut par exemple parler de protection économique.
Est-ce le nouveau rôle historique de la gauche ?
Autant je ne vois pas de raison de désespérer à long terme, autant je suis obligé de constater, en ce qui concerne la France actuelle, que nous sommes au plus bas. Nous payons le prix du mitterrandisme, qui a été le visage sous lequel la France a défini pour longtemps son attitude face à ce changement de cap du monde. Elle a commencé par le refuser, sous Giscard. Puis, dans les années 80, tandis que le Royaume-Uni avait élu Thatcher et les Etats-Unis Reagan, est arrivé Mitterrand, qui a installé une culture de la dénégation, consistant à s’adapter à la nouvelle donne, mais sans le dire. Les socialistes français en sont toujours là : ils ont la particularité d’être à la fois très rigides doctrinalement et très cyniques en pratique. A leur décharge, il faut dire que Mitterrand avait cru trouver une échappatoire en jouant l’Europe : puisque le modèle français était condamné, il a voulu construire à un échelon européen une nouvelle synthèse du libéralisme et de l’Etat fort. Faire une Europe française, en somme. Dans les années 80, le projet européen a été le grand espoir de la société française. Mais il se trouve que le projet a échoué : l’Europe telle qu’elle s’est développée n’est pas française, on peut même dire qu’elle est anti-française, tout simplement parce qu’elle reflète la réalité d’un monde qui va spontanément à rebours de notre héritage historique. Le désenchantement qui s’en est suivi vis-à-vis de l’Europe a été spectaculaire. Depuis, personne n’a fait l’effort de reprendre le problème à la racine. Jospin, qui semblait l’avoir compris, n’a pas osé. Ségolène Royal est passée à côté. La panne est complète.
Les deux grands courants concurrents du PS - le pôle écologiste et libertaire et la gauche radicale - vous semblent-ils porteurs de promesses ?
Non, pas la moindre, hélas ! La gauche radicale est une rémanence de notre histoire. C’est la Révolution française qui revient, par-delà le communisme. Besancenot nous propose un néo-hébertisme et Badiou nous réinvente Babeuf et sa Conjuration des Egaux. Tout cela bouillonne, exprime des choses profondes, mais n’offre guère de perspectives opératoires. Quant à la liste commune Cohn-Bendit-José Bové, la contradiction de la nouvelle démocratie individualiste du privé y atteint son sommet. Il n’y a vraiment que sur le papier que le souci écologique et la radicalisation des droits personnels collent ensemble !
Critiquer les droits de l’homme, n’est-ce pas encourager des formes politiques autoritaires ?
Je ne critique pas les droits de l’homme, je critique l’usage qu’on en fait, ce qui est fort différent. Ils sont indiscutables dans leur ordre, mais ne fournissent en rien une réponse générale, immédiate et totale aux questions qui nous sont posées. Ils établissent la base de légitimité du pouvoir dans nos sociétés ; ils énoncent ce qu’on ne doit en aucun cas violer et ce vers quoi nos sociétés doivent tendre, en tant que sociétés d’individus. Mais en aucun cas ils ne définissent le système politique ou l’organisation sociale qui permettront d’assurer leur développement. Les droits de l’homme sont le fondement et le but, pas le moyen. Ils ne nous dispensent pas, comme l’illusion du moment le fait croire, de réfléchir sur l’ordre politique et sur le fonctionnement de la société en tant que tels. Si l’idée de socialisme doit retrouver un sens vivant, c’est du côté de cette conjonction qu’il faut le chercher.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg










 Unsere großen Töchter wurden jetzt ungefragt (logisch!) mit der neuen Anti-Aids-Reklame der Bundesbehörde (dem Gesundheitsministerium unterstehend) konfrontiert. In deren Zentrum stehen nach offizieller Verlautbarung „Jugendliche und nicht-monogam lebende Erwachsene, Männer, die Sex mit Männern haben [also: keinesfalls nur sogenannte Schwule!], Freier und andere Gruppen.“
Unsere großen Töchter wurden jetzt ungefragt (logisch!) mit der neuen Anti-Aids-Reklame der Bundesbehörde (dem Gesundheitsministerium unterstehend) konfrontiert. In deren Zentrum stehen nach offizieller Verlautbarung „Jugendliche und nicht-monogam lebende Erwachsene, Männer, die Sex mit Männern haben [also: keinesfalls nur sogenannte Schwule!], Freier und andere Gruppen.“

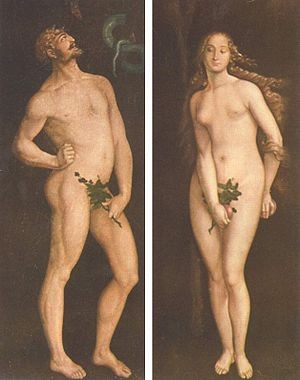


 "La modernité s'est construite au 18ème siècle en mettant en place trois grands systèmes les droits de l'homme et la démocratie, le marché, et enfin la dynamique de la techno-science, le problème c'est que pendant deux siècles et demi ces 3 systèmes ont été fortement attaqués par des systèmes qui les rejetaient, par exemple le totalitarisme qui rejetait à la fois le marché et la démocratie. Aujourd'hui se fait sentir moins le besoin d'un contre modèle qu'une nouvelle régulation qui met au centre l'individu."
"La modernité s'est construite au 18ème siècle en mettant en place trois grands systèmes les droits de l'homme et la démocratie, le marché, et enfin la dynamique de la techno-science, le problème c'est que pendant deux siècles et demi ces 3 systèmes ont été fortement attaqués par des systèmes qui les rejetaient, par exemple le totalitarisme qui rejetait à la fois le marché et la démocratie. Aujourd'hui se fait sentir moins le besoin d'un contre modèle qu'une nouvelle régulation qui met au centre l'individu."







 Obwohl offizielle Statistiken oftmals kaum aussagekräftig sind, da aus Angst vor vermeintlich rassistischer Diskriminierung viele Differenzierungen unter den Teppich gekehrt werden, geht man laut dem Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland Stiftung e.V. (ZIAD) in Soest davon aus, daß es in der Bundesrepublik Deutschland heute etwa 3,5 Millionen Muslime gibt – 6,5 Prozent mehr noch als im Jahr 2006. Ein unglaublicher Geburtenüberschuß und Familiennachzug machen es möglich. Doch nicht alle Muslime müssen aus dem islamischen Kulturbereich stammen: Jedes Jahr sind es mehrere tausend Konvertiten, die in der Religion des Propheten Mohammed den wahren Sinn und den richtigen Weg sehen.
Obwohl offizielle Statistiken oftmals kaum aussagekräftig sind, da aus Angst vor vermeintlich rassistischer Diskriminierung viele Differenzierungen unter den Teppich gekehrt werden, geht man laut dem Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland Stiftung e.V. (ZIAD) in Soest davon aus, daß es in der Bundesrepublik Deutschland heute etwa 3,5 Millionen Muslime gibt – 6,5 Prozent mehr noch als im Jahr 2006. Ein unglaublicher Geburtenüberschuß und Familiennachzug machen es möglich. Doch nicht alle Muslime müssen aus dem islamischen Kulturbereich stammen: Jedes Jahr sind es mehrere tausend Konvertiten, die in der Religion des Propheten Mohammed den wahren Sinn und den richtigen Weg sehen. dem Islam zugewendet haben, haben sich zuvor auch mit dem Christentum, der Religion in die sie hineingeboren wurden, auseinandergesetzt. Doch für kaum einen versprühen mausgraue Kirchengemeinden noch einen attraktiven Charme, geschweige denn einen Ausweg aus der inneren Depression. Viele Konvertiten begründen ihren Schritt damit, daß sie Probleme mit dem christlichen Dogma der Dreifaltigkeit Gottes hätten sowie mit den klaren religiösen Vorschriften im Islam, so Muhammad Salim Abdullah, Seniordirektor des Islam-Archives. Und wie soll man als Deutscher oder Nicht-Deutscher eine Kultur respektieren oder für sich beanspruchen, die sich gerade mitten in ihrer kulturellen Selbstaufgabe befindet?
dem Islam zugewendet haben, haben sich zuvor auch mit dem Christentum, der Religion in die sie hineingeboren wurden, auseinandergesetzt. Doch für kaum einen versprühen mausgraue Kirchengemeinden noch einen attraktiven Charme, geschweige denn einen Ausweg aus der inneren Depression. Viele Konvertiten begründen ihren Schritt damit, daß sie Probleme mit dem christlichen Dogma der Dreifaltigkeit Gottes hätten sowie mit den klaren religiösen Vorschriften im Islam, so Muhammad Salim Abdullah, Seniordirektor des Islam-Archives. Und wie soll man als Deutscher oder Nicht-Deutscher eine Kultur respektieren oder für sich beanspruchen, die sich gerade mitten in ihrer kulturellen Selbstaufgabe befindet?