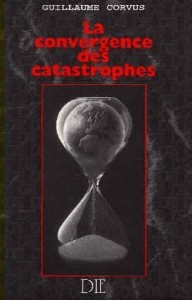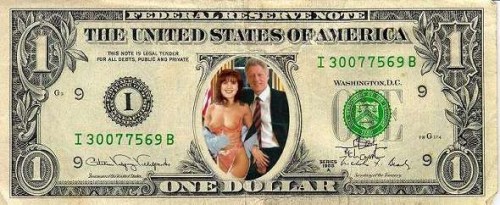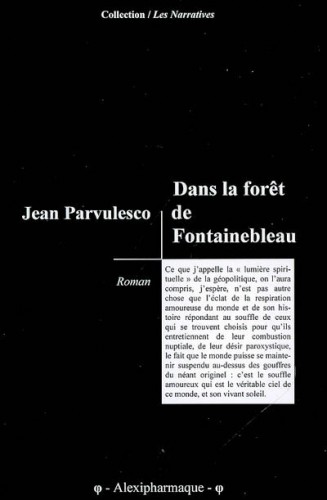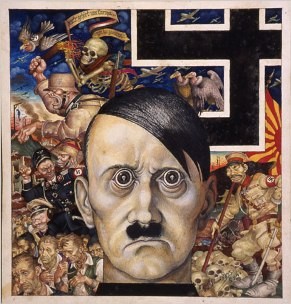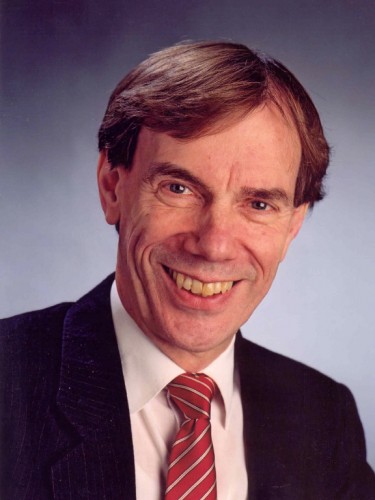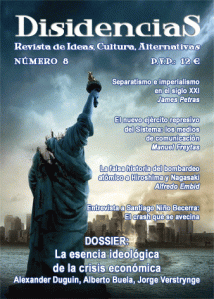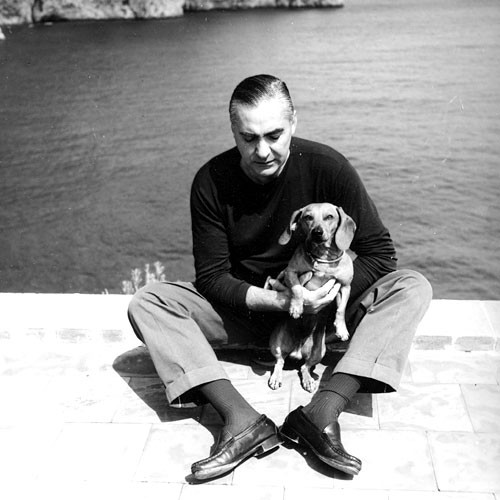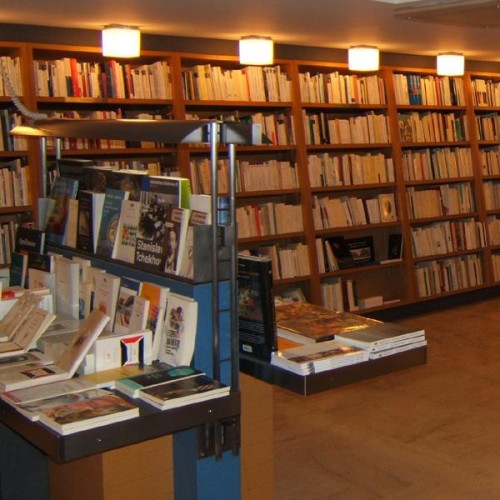Il est des gens qui n'ont pas accès aux médias officiels Francais, parmi eux, Ilya Gorachev, leader de la principale organisation ultra-nationaliste Russe "Obraz Russie".
Depuis la reprise en main de la Russie par l'équipe Poutine-Medvedev, les mouvements ultra-nationalistes ont toujours été très présents sur la scène politique Russe mais également souvent marginalisés. Pire, la plus grande partie de ces mouvements (DPNI en tête) est allé se fourvoyer dans une opposition sans borne au Kremlin, allant même jusqu'à soutenir les libéraux et participer avec les groupes néo-nazis Ukrainiens à la révolution Orange en Ukraine.
Au contraire, depuis 4 ans, Obraz se structure comme la principale force nationaliste d'opposition réelle, et se définit comme l'aile droite des mouvements de jeunesse, un mouvement de jeunesse qui s'affirme prêt à résister sur le terrain à une éventuelle révolution Orange en Russie. Très proche du député à la douma Russe Maxim Mishenko (député du parti de Vladimir Poutine et accessoirement leader de l'organisation de jeunesse Poutinienne "Jeune Russie"), Ilya Goriachev a accepté de répondre à mes questions (entretien réalisé il y a quelques semaines) :

Ilya, peux tu te présenter et présenter Obraz Russie ?
Je m'appelle Ilya Gorachev. Je suis le président et le coordinateur de l'association «Obraz Russie» en fédération de Russie et ce depuis 6 ans. Officiellement nous existons depuis le 1ier mars 2003, depuis qu'est sorti le premier numéro de notre journal.
D'ou vient le concept de Obraz ? Il vient de Serbie, ou durant l'automne 2002 une organisation du nom de Obraz Serbie a été crée par un patriote du nom de Nebojsa Krstic. Celui ci était proche du SRS et de Seselj, de Arkan et d'autres patriotes de ces mouvances. Malheureusement, fin 2002 il mourut dans un accident de voiture. Le doute subsiste toujours de savoir s'il s'agit d'un accident réel ou d'un accident provoqué comme celui de Jorg Haider.
Dès lors l'organisation est tombée en désuétude en Serbie, pendant que sa soeur jumelle naissait en Russie. Aujourd'hui Obraz Russie collabore avec Obraz Serbie mais également avec d'autres organisations en Serbie qui nous semblent prometteuses comme le mouvement 1389 de Misa Vacic et Igor Marinkovic.
Obraz Russie s'est donc développé autour d'une revue à ses débuts et à la chance de compter dans sa sphère dirigeante près de 50% de gens issus d'un cursus universitaire historique, c'est un gros plus car nous estimons à Obraz que les gens qui s'engagent en politique doivent avoir de solides connaissances historiques.
Si nous parlons de la structure même de Russki Obraz, nous existons comme structure politique depuis 2 ans. Le coeur de notre mouvement est bien évidemment à Moscou, ou nous pouvons compter sur une centaine de militants actifs permanents. Notre plus grosse action publique à pour l'instant été la marche Russe de novembre 2008 qui a réuni plus de 1.500 nationalistes. Cela peut sembler peu pour un pays gros comme la Russie mais la société civile Russe est extrêmement peu politisée et il faut comparer avec les marches «anti pouvoir», ou de «libéraux» qui ne rassemblent jamais plus de 200 ou 300 personnes.
A côté de cela nous sommes bien sur présents ailleurs en Russie, nous avons actuellement une dizaine de bureaux structurés, principalement dans la partie Occidentale de la Russie, notamment à Kaliningrad, Saint pétersbourg ou encore Kalouga. Au centre du pays nos deux principales structures sont à Iekatérinbourg et Iejevsk, et en Sibéfie, à Tomsk et Abakan.
Dans de nombreuses villes nous n'avons pas de structures Obraz à proprement parler mais des réseaux. Enfin, le journal sort une fois par an, pour notre anniversaire.
Obraz Russie se veut avant tout un groupe de pression qui défend les intêrets des citoyens Russes dans les médias et dans les structures du pouvoir. Nous avons décidé de copier la tactique de lobbying et d'infiltration qu'utilisent les différentes diasporas ou encore les groupes «gauchistes» ou «libéraux». C'est une tactique qui fonctionne bien et est malheureusement trop peu répandue chez les patriotes. Pour ce faire, nous travaillons avec tous les individus qui défendent les mêmes valeurs que nous, peu importe leur étiquette politique. Nous n'appartenons à aucun parti politique, et ne sommes pas une marque achetable. Par exemple dans la dernière douma d'état nous travaillions beaucoup avec Nicolas Kurianovitch du LDPR (NDLR le parti de Vladimir Jirinovski ) et dans l'actuelle douma nous travaillons avec Maxime Mishenko de Russie Unie (le parti du premier ministre Vladimir Poutine). Pour nous l'individu et les valeurs priment sur le parti, nous pourrions très bien travailler avec quelqu'un membre du parti communiste de Russie par exemple.
Enfin nous nous servons de la musique pour diffuser nos idées, via notre groupe de musique «Hook Sprava». Le groupe est récent et vient d'enregistrer son premier album à l'occasion du dernier anniversaire de Obraz Russie. Il a également effectué une série de concerts. La société en Russie étant passive politiquement, nous tentons de développer nos idées via la musique et cela fonctionne plutôt bien.
La scène politique en Europe est très lisible, qui est de droite, qui est de gauche, qui est pro Américain ... Qu'en est t'il en Russie ? Qui est qui ?
Voila comment on peut décrire la situation : ces dernières années ce sont fortement développées en Russie des manifestations d'opposants au pouvoir en place. Particulièrement des marches regroupants des groupuscules libéraux et d'extrême gauche qui défilent ensemble lors des célèbres «marches du désaccord». Ces marches ont quelque peu préocuppé le Kremlin, dans une atmosphère de révolutions de couleurs dans les pays voisins.
Par conséquent le pouvoir a en réaction toléré la «marche Russe» de 2005 qui a été la première marche nationaliste officielle sous l'ère Poutine. Celle ci à eu un succès phénoménal, et les marches se sont multipliées dans les annés qui ont suivies et ce en plein centre de Moscou et ont fait beaucoup parlé d'elle, effrayant le public. Le pouvoir s'est alors fendu d'une loi interdisant toutes les marches ou manifestations hormis à un seul endroit de Moscou. Dès lors de nombreux «dissidents» se servent de cette loi pour pouvoir faire filmer une manifestation réprimée devant les caméras, manifestation dès lors réprimée uniquement car tout simplement légalement interdite à l'endroit ou ces dissident prétendent l'organiser.
A ce sujet il me semble utile de préciser ceci : nombre de patriotes en Russie et ailleurs pensent qu'il serait utile de rallier les protestations anti pouvoir, ou au moins de copier leurs méthodes coup de poings. Ceux la mêmes pensent qu'après une éventuelle révolution orange aboutie, ils auraient en tant que nationalistes la possibilité de participer au pouvoir dans une situation démocratique politique nouvelle. Hors si les opposants internationalistes (regroupant la gauche et les libéraux) venaient à prendre le pouvoir en Russie, ceux ci, parfaitement conscients de la popularité des idées nationales dans le peuple Russe, ne toléreraient jamais d'équitables élections et une participation des nationalistes à la vie politique. L'intolérance à l'égard des idées nationales serait la même avec cette alliance «libéralo-gauchiste» que sous Eltsine ou sous le régime Communiste. Cela doublé d'une collusion avec les «orangistes» et leurs soutiens en Europe et en Amérique, soutiens ouvertements incamicaux à l'égard des citoyens Russes et la de la Russie en général.
Nous autres, patriotes de Obraz, affirmont catégoriquement notre opposition à ces «dissidents» et affirmons que les patriotes qui soutiennent ces opposants se trompent. Nous ne sommes absolument pas satisfaits de la «tolérance» à l'Européene comme modèle politique et pensons que un tel régime (libéral) en Russie et à la Russe ne serait pas aussi doux qu'en Europe, comme l'histoire récente de notre pays nous l'a montré au cours du siècle dernier.
Lors de notre dernière marche, nous avons eu le droit de légalement défiler selon un itinéraire permis et toléré par la mairie, pendant que d'autres marches ont elles été interdites et sanctionnées par le pouvoir (arrestations de militants et etc). Il est curieux que ces marches interdites aient tenté le coup de force, comme la marche du DPNI sur Arbat On peut légitimement se demander les motivations de ceux qui ont envoyés des patriotes au «casse pipe» aussi ouvertement alors qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent tout au plus mobiliser que quelques centaines de personnes alors que les OMON seraient eux en très grand nombre.
Obraz souhaite travailler dans un cadre légal avec les authorités du moment car il n'est possible de menacer et d'utiliser des ultimatums seulement si vous disposez de dizaines de milliers de partisans ou de grosses ressources financières. Nous n'avons pour l'instant ni l'un ni l'autre. Aller au clash avec le régime et se plaindre des violences policières derrières n'a aucun intérêt pour les patriotes Russes car ceux ci ne bénéficieront pas de couverture médiatique ni en Russie, ni dans la presse Occidentale pour qui ils représentent ce qu'il y a de pire.
Cela a été démontré lors de la dernière marche du 4 novembre ou la forte représsion contre les manifestants nationalistes n'a au aucun écho favorable tel que les organisateurs escomptaient obtenir. A l'inverse, les quelques manifestations coup de poings des libéraux à Moscou ont un écho énorme dans la presse notamment Occidentale, de par les passerelles médiatiques communicantes Russie/occident, via la sphère libérale.
Je suis un multilatéraliste, si certains veulent organiser une marche coup de poing, sans l'accord du pouvoir, qu'ils le fassent mais que l'on ne nous demande pas d'y participer. Un centre unique est toujours plus facile à détruire et à diviser pour le système, l'expérience de «l'unité nationale Russe», du «front national Francais» ou du «parti radical serbe» devraient nous servir de leçon.
Quels sont les liens de Obraz Russie avec des mouvements Europeéns ?
Actuellement nous avons des liens très étroits avec divers mouvements dans le sud-est de l'Europe, en Macédoine, Serbie, Bosnie Serbe et Roumanie. Nous souhaiterions développer nos liens avec des mouvements en Europe occidentale et en Amérique mais actuellement nous n'avons pas de contacts réellement établis.
Il faut bien comprendre que le mouvement nationaliste en Russie si il est assez fort est tout récent, et encore peu structuré en profondeur. Il ne date que des années 90 pouvez vous l'imaginer ?
Enfin nous rencontrons également des difficultés de relation avec les médias, tout comme en Europe et même en Russie de nombreux citoyens ne savent pas qu'existent des associations nationalistes comme la nôtre. Les médias, partout dans le monde, façonnent la vision du monde nouveau, et donnent parfois des images erronées. La vision erronée de nationalistes en uniformes noirs (RNE) reste dans les esprits mais cela n'est plus comme ca depuis longtemps en Russie! Ce type de mouvement n'est plus, les gens ne sont plus les mêmes !
Nous souhaitons dire à nos collègues européens que principalement nous souhaitons collaborer avec eux dans le domaine de l'échange d'information, d'opinion et de connaissance, mais aussi dans l'organisation d'activités communes. Enfin il y a une volonté d'organiser une conférence des nationalistes Européens à Moscou, mais pour l'instant cela est au point mort car nous n'avons pas encore les bons contacts, éprouvés, avec des responsables d'organisations Européennes sérieuses.
Bien sur nous souhaiterions plus de contacts avec la France, l'Allemagne et l'Italie. En France l'expérience pratique de Jean Marie Le Pen au sens électoral (cumul de direction d'un parti nationaliste et de poste de député Européen) est pour nous intéressante, tout comme l'est celle des Italiens,qui font un gros travail de prise et de gestion du pouvoir. Mais malheureusement nous n'avons aucun contact direct avec les Italiens, ce que nous souhaiterions pourtant.
Question à propos du conflit 'Israelo-Palestinien' ?
Nous avons à Obraz organisé deux manifestations devant les consulats des deux parties au conflit en les incitant à intensifier leurs activités militaires. En effet, nous pensons que nous n'avons pas à prendre partie d'un côté ou de l'autre, en tant que nationalistes Russes nous nous soucions tout d'abord de la Russie et des Russes. Pour nous Russes, ce conflit ne nous dérange pas, au contraire, plus il durera, plus cela nos sera profitable, par exemple pour développer la vente d'armes aux bélligérants ? Nous pensons exactement la même chose de tout autre conflit auquel la Russie n'est pas mêlée, par exemple le conflit entre les Hutus et les Tutsis.
Encore une fois, pour nous les problèmes les plus principaux sont ceux concernants la Russie.
En France ce conflit a soulevé de grosses questions et créé d'importantes tensions dans toutes les sphères politiques, y compris chez les patriotes.
Je pense que c'est une caractéristique des nationalistes du monde entier que d'être rigide doctrinalement contrairement aux gauchistes qui cherchent avant tout la tolérance et le compromis. De par le grand nombre de ressortissants de cette zone du monde, la france est plus concernée que la Russie par ce conflit. Pour nous en Russie, ce n'est qu'un petit conflit local et nous avons également «déjà» nos conflits. Nous avons déjà nos problèmes religieux en Russie. Par conséquent nous ne sommes pas concernés plus que cela par le proche orient.
A quel niveau Obraz s'interesse t'il à ce qui se passe en Europe ? Il y a cette idée que les Russes en général s'interessent avant tout à ce qui se passe chez eux, et moins à par exemple les évenements en France ou en Europe ...
Cette impression est correcte de l'extérieur car le Francais est la langue européenne la moins parlée en Russie désormais, enfin moins que l'Allemand ou l'Anglais. Une petite quantité de gens le savent. En Serbie par exemple les contacts datent d'il y a très longtemps, pour des raisons historiques que l'on comprend facilement. Les contacts sont par contre très établis avec les Polonais via le football et la subculture, nous avons donc des contacts permanents avec eux et savons bien ce qu'il se passe en Pologne. C'est plus dur avec l'Europe dont les gens ne puisent l'information que par le biais de la presse grand tirage Russe. Les patriotes sont en général satisfaits du résultat des élections en Europe avec les bons scores des partis «nationalistes» en Bulgarie, Autriche ou en Suisse. L'affiche du mouton blanc qui chasse le mouton gris a été très populaire en Russie. En ce qui concerne la France, Obraz a publié deux textes : le premier sur les pogroms afro-arabes anti blancs de 2005 et demandant pourquoi les francais de souches ne se sont ils pas plus défendus et le second sur l'OAS.
En règle général nous sommes ouverts au monde, par exemple les émeutes de 2005 en Australie contre les libanais qui empêchaient des australiennes de bronzer topless. J'ai entendu dire que en France un débat avait éclaté pensant sur la nécéssité d'un tel homme fort (le premier ministre John Howard) au pouvoir, alors qu'en Australie au contraire on l'accusait de lois restreignant la vente d'armes dans le pays, alors que ce pays en a une très grande tradition comme en Amérique.
Les nationalistes Russes s'intéressent énormément aux associations européennes c'est un fait. Par exemple des contacts ont été établis de facon sérieuse avec les allemands du NPD, certaines de leurs pages étant traduites en Russe par le grand nombre d'adhérents Russes de chez eux. Grâce à cela nous avons procédé à une présentation des livres de l'historien Dmitri Tatatorin sur l'histoire des nationalismes en Russie. Malheureusement cette présentation à Saint Pétersbourg n'a pas eu le succès escompté car nombre de nationalistes Russes avaient joints une marche nationaliste en Suède, dans la petite ville de Salem. Par conséquent il y a des contacts, mais pas forcémment publics, ce qui laisse effectivement penser que nous ne communiquons pas entre Russes et Européens.
Quelle est pour toi, en tant que nationaliste Russe la frontière «est» de l'Union Européenne ?
Je sais quel rapport ont les nationalistes avec l'UE, comme en Serbie par exemple ou cette question de l'UE est très délicate et la société très divisée à ce sujet. En Russie l'UE n'est que peu appréciée et pas respectée. Chez les nationalistes Russes il n'y a en général pas d'opinion tranchée, si ce n'est que : « l'UE est remplie d'immigrés», ce qui d'ailleurs n'est pas faux.
Je pense que la Russie pourrait être amenée à intégrer l'UE mais a condition que les forces libérales se soient au préalable imposée et que la Russie est définitivement basculée, et soit devenue une société libérale molle à l'occidentale, comme est en train de le devenir la Pologne. A ce moment, la Russie serait toute prête à intégrer l'union européenne. Mais tout cela est virtuel car la Russie d'aujourd'hui, avec sa réalité archaique et son pouvoir aux ambitions impériales ne peut absolument pas intégrer l'UE. Si la Russie en l'état devait intégrer l'UE cela ferait le même résultat que d'unifier la corée du nord et du sud. Cela serait un choc terrible pour l'UE que de devoir intégrer 140 millions de citoyens avec leurs conflits, leur économie différente, etc etc
L'UE modifie les politiques des pays, et créé des problèmes de réglementation en imposant au pays des réglementations indésirables. Par exemple en Bulgarie, qui était un gros producteur de pommes, les normes Européennes ont fait cessé toute production et depuis les pommes sont importées d'Iran, tout cela pour protéger les pays comme la France, l'Espagne ou l'Italie et leur monopole au sein de l'Europe. Lorsque l'UE a commencé à taper sur la bourse des gens, les partis contestataires se sont développés, en premier lieu desquels le parti nationaliste Ataka, qui surfe sur la vague eurosceptique et contre l'entrée de la Bulgarie dans l'OTAN. Les gens ne comprennent pas en Bulgarie pourquoi tout est arrivé en même temps.
Aujourd'hui avec la crise mondiale, les théories libérales nous disent que nous ne sommes pas allés assez vite et que il faut plus globaliser et aller rapidement vers un gouvernement mondial. Cela signifierait que dans ce scénario certains trouveraient les moyens de continuer à diriger de façon efficace. Dans ce scénario négatif, certes la Russie pourrait intégrer n'importe quel nouvel ensemble mais dans tous les cas l'UE ne digèrerait pas la Russie. Ou alors il faudrait un système à deux vitesses, peut être avec une sorte d'apartheid interne à l'UE (schengen ne s'étendant pas à la Russie) ou encore un «euro» propre à la Russie. Dans ces cas la peut être. Il faut bien être conscient que l'appareil administratif Russe ne «subiste» que par la corruption, et cela ne ferait sans doute pas plaisir à l'UE d'intégrer un ensemble aussi compliqué.
Enfin il y a l'obsession fétiche libéral des droits de l'homme, hors on imagine mal comment l'UE pourrait résister au déferlement de bandes organisées criminelles de l'ex URSS tout en maintenant ses dogmes «humanistes». Face aux problèmes que lui créérait cette situation d'intégration de la Russie, l'UE ne saurait quoi faire. C'est pour cela que les Russes ne craignent pas l'UE, parce que si elles devaient nous intégrer, nous la détruirions de l'intérieur.
En France il se dit que l'Ukraine pourrait éclater en deux entités ...
Et cela serait parfait ! Qu'est donc l'Ukraine ? Les Ukrainiens sont des Slaves de l'empire Austro-Hongrois et aujourd'hui, la langue et les moeurs de ce groupe ethnique qui représente ¼ du territoire cherche à l'imposer aux ¾ restants. Ce faisant se heurte aux protestations dans le sud est du pays, longtemps zone internationale. Mais il ne faut pas oublier que il y avait aussi des colonies Grecques le long de la mer noire dans l'antiquité, et dans la période médiévale des colonies génoises et vénitiennes. Et il y avait surtout de nomberux nomades. La steppe Ukrainienne a été longtemps occupée de voyageurs variés. Lorsque les troupes Russes occupèrent ce territoire, la colonisation fut Russe. Aujourd'hui on veut imposer l'Ukrainien aux populations qui résident en Ukraine. Naturellement il y a du rejet. Je vais souvent en Ukraine, j'ai été à Kiev par exemple l'année dernière. Que puis je dire ? On y parle Russe, mieux qu'à Moscou et comme dans la plupart des grandes villes de crimée. Je ne m'attendais pas que l'idée de l'implosion de l'Ukraine en deux soit déjà en Europe. Il est probable que la partie Occidentale de l'Ukraine rejoigne l'UE, voir la Pologne (des revendications en ce sens existent déjà) et que l'autre partie (orientale) deviennent une sorte de «Ukraine russe».
Voila la question, souhaiterions nous éventuellement alors intégrer cette «Ukraine Russe» à la fédération de Russie ? Certainement non, il est plus cohérent de souhaiter que ce nouvel état éventuel commence son histoire de zéro, seul et souverainement.
Pourquoi ? Prenons l'exemple de la Serbie, celle ci traine en elle les bagages de trois yougoslavies différentes : royale, communiste, et moderne. Elle en a hérité la structure et la nomenclature. Et même lorsque celle ci n'était plus que la Serbie et le Monténégro, il y avait encore deux niveaux d'organisations, le niveau fédéral et celui de chaque république. Exemple inverse en Croatie ou l'état a été directement créé de zéro, il y a été beaucoup plus facile d'y définir les identités et les nationalités. Autre exemple parlant, l'Amérique, les colons y ont créé un état à partir de zéro, avec de grandes libertés «nouvelles», comme ce second amendement permettant librement de s'exprimer ou encore la possibilité de possession et stockage d'armes à feu. C'est la constitution la plus libre du monde car elle donne de très grands droits et de très grandes libertés aux citoyens.
La France, au contraire, comme toute l'Europe, traîne des bagages négatifs. La France est le premier état à avoir renié les valeurs traditionelles au profit d'abord du pouvoir absolu d'un homme, puis au profit des chimères d'universalisme et d'égalitarisme, ce sont ces superpositions et l'absence de liberté individuelles qui en découle qui ont entrainé son déclin, comme dans nombres de pays d'Europe. Nous trainons nous aussi en Russie notre bagage historique pénalisant, il s'agit de celui de l'URSS et de ses républiques, ici et la, dont nous ne pouvons ni espérer un changement profond, ni nous en débarasser, sans que cela n'entraine de conflits sanglants.
Voila pourquoi la perspective de création d'un état Russe d'Ukraine, serait intéressant comme exemple d'auto création d'un état neuf sans bagages historiques pénalisants. Voila quel serait à mon sens le seul intêret de créer un nouvel état Russe d'Ukraine, partant de zéro, et au sein duquel des «colons» pourraient y établir un ordre nouveau et juste. Mais ce ne sont que des rêves pour l'instant, la nouvelle élite Ukrainienne n'a pas besoin de Moscou.
Nous autres nationalistes Russes regardons attentivement d'autres sociétés, par exemple la Biélorussie (qui pour nous est un modèle de nouvel état avec un mode de fonctionnement national intéressant) ou la Transnistrie. Il y a aussi l'Estonie dont l'est est peuplé majoritairement de Russes et qui a des lois extrêmement libérales sur l'achat et la possession d'armes. En Russie il y a une très grosse revendication à ce sujet. Certains groupes sont ouvertement contre en Russie, affirmant que la légalisation des armes aménerait à l'anarchie et que les gens se tireraient tous dessus. Mais l'exemple de l'Estonie ou de nombreux Russes et Estoniens, habitants ensemble dans des zones très compactes, possèdent des armes prouve que ce n'est pas le cas. Le nombre d'affaires criminelles en Estonie via des armes à feu mêle un nombre égal de Russes et d'Estoniens, et les statistiques criminelles ne mentent pas.
En France les nationalistes ont longtemps regardé l'URSS comme l'empire du mal absolu, quelle est ton opinion à ce sujet ?
Lorsque l'URSS existait, le monde était bipolaire, et les communistes Francais cherchaient le soutien de l'URSS. C'était un réel danger pour le pouvoir Francais de voir les revendications des travailleurs se radicaliser et gagner le soutien «pratique» de Moscou. Le pouvoir ne pouvait par conséquent ignorer les revendications de ces travailleurs, revendications dirigées en sous main par Moscou. Lorsque l'URSS a disparue, le projet libéral à pu se développer sans aucune restriction, sans rencontrer aucun obstacle. J'ai été en France en 1997 et déjà il y avait de nombreux immigrants, dans les années 80 la situation n'était pas aussi désastreuse c'est certain. Voila la conséquence du libéralisme.
Quand à l'URSS, son principal problème est qu'elle portait en elle les germes de son échec en ne pouvant se détacher du système «marxo-communiste» pur. L'URSS n'a pas su dépasser son «cadre» communiste propre, Staline n'y est pas arrivé, et par conséquent après lui personne d'autre. Si cela avait été le cas, peut être que les choses auraient été différentes. L'URSS ne pouvait muter et donc après la mort de Staline son effondrement a commencé, cela était clair à l'ouest, mais cela c'est fait lentement, pas en 2 ou 10 ans mais en 40 ans. Cet effondrement était aussi certain que ne l'était la victoire de l'URSS durant le second conflit mondial.
Hors communisme et libéralisme sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Il n'y avait pas d'alternative mais les deux systèmes ne pouvait que mener au même résultat.
Pour Obraz, la Russie est ce l'Europe ou l'Eurasie ?
Nous sommes en harmonie avec la phrase de De Gaulle sur la grande Europe de Dublin à Vladivostock! Tout d'abord qu'est ce que l'Eurasisme ? D'ou vient elle ?
C'est une théorie développée par les officiers blancs en exil après la guerre civile et à bien des égards elle est construite sur un ressentiment anti Européen et anti Occidental car ces théoriciens de l'Eurasisme (qui sont tous des Russes blancs) ont un sentiment d'abandon (justifié) de la part des Européens de l'entente. Donc la théorie Eurasienne est né dans le coeur d'officiers russes blancs, humiliés par l'Europe et cette théorie a été basée sur une necessité de la Russie de développer sa propre civilisation et selon sa propre voie.
L'Eurasisme qui renait aujourd'hui en Russie, principalement par le travail de Alexandre Douguine et du mouvement Eurasien, implique non seulement que la Russie se développe selon «sa» voie historique mais elle implique également une forme d'unité avec les peuples «asiatiques», notamment à l'intérieur de la Russie contre l'Ouest (Amérique et Europe). En tant que nationaliste Russe, je refuse de "m'allier" avec les Tadjiks ou les Chinois contre les Européens. L'eurasisme aujourd'hui nous la voyons en surnombre dans les rues de Moscou! Pour nous l'immigration asiatique à Moscou ou en Russie peut à terme présenter une menace sérieuse, et non l'immigration Européenne, bien au contraire. Nous pensons que le peuple Russe a plus de points communs avec les Européens qu'avec les Asiatiques. C'est pourquoi nous défendons l'idée de grande Europe, de Dublin à Vladivostock.
La position de Obraz sur «l'Amérique» ?
L'image de l'amérique en Russie est issue de la culture Soviétique : «Ha l'Amérique c'est l'empire de l'autre côté de l'océan, c'est l'empire du mal» etc etc
Mais les Russes qui pensent comme cela ne pensent jamais aux citoyens Américains qui par exemple sont en désaccord avec leur propre gouvernement. Par exemple les milliers d'Américains d'origine européene qui étaient contre les bombardements sur la Serbie. Nous à Obraz prônons de différencier le peuple des gouvernements. Il n'y a pas fondamentalement que des choses mauvaises en Amérique comme nous avons déjà parlé de la grande liberté d'expression mais regardez également l'existence d'asociations citoyennes comme la NRA, qui regroupe des centaines de milliers de gens! Il n'y a rien de tel ni en Europe ni en Russie! Nous n'avons pas de tels lobbyes aussi puissant pour défendre nos intêrets car nos lois ne le permettent pas, et en ce sens nous sommes moins libres d'un certain point de vue qu'en Amérique.
Si l'on parle de l'amérique comme état, il ne faut pas oublier que l'amérique a été créé par des colons religieux européens qui ne «pouvaient» plus vivre en Europe. Ils ont traversé les océans, se sont imposés sur la nature et les indigènes, et ont créé un monde à partir de zéro. Cet esprit subsiste encore en amérique aujourd'hui. Et puis soyons objectifs, au vu du nombre d'armes à feu par habitants, il serait très dur aujourd'hui de contraindre les habitants de ce pays à quoi que ce soit, très dur de leur imposer un régime totalitaire par exemple! Croyez vous que des pogroms type les pogroms Francais de 2005 pourraient arriver en amérique ? Non, les américains eux auraient largement les moyens de régler le problème sans même la police. Et c'est bien ce que nous pensons à Obraz, que les lois restrictives anti armes sont avant tout des lois anti-citoyennes, pour les empêcher de se défendre. En Russie la police c'est l'arbitraire, et en Europe c'est l'état, mais en Amérique il y a le shériff qui est responsable des citoyens de sa zone, c'est une conception totalement différente.
Pour nous à Obraz, un pays ou le citoyen à droit à être armé, et à le droit à l'auto défense, ne peut pas être considéré comme entièrement mauvais.
En outre, qui connait des américains sait leur propension à la violence, et en cela ils sont beaucoup plus proches des Slaves, des Serbes notamment que des Européens de l'ouest. Enfin, je voudrais rajouter que l'amérique va sans doute très prochainement faire face à des larges conflits internes, opposants gangs mafieux et ethniques, et qu'il est probable que l'état fédéral perde de plus en plus le contrôle sur de plus en plus larges pans de territoire. En outre, la natalité des populations européennes en amérique ne baisse pas contrairement à l'europe et la russie, l'amérique reste donc un laboratoire «ouvert» et à observer.
Qui sont les nazbols ?
Les «nazbols» sont les menbres d'une organisation qui s'appelle le NBP Leur chef, édouard limonov malgré ces 65 ans reste assez jeune dans sa tête. Celui ci à une grande carrière «politique» en Russie, il a même participé à des guerres (au côté d'Arkan en Serbie par exemple) et est devenu réellement célèbre en Russie lorsqu'il à co-créé le NBP avec Alexandre Douguine. Le NBP était un parti d'opposition sous Eltsine mais avec l'élection de Poutine, Alexandre Douguine a vu la possibilité de participer activement au mainstream de la vie politique Russe et dans un sens cesser d'être marginal. Il est donc devenu un «légaliste» , Limonov lui a continué (et continue) de vouloir faire tomber le régime.
Le NBP à toujours et est encore avant tout une organisation de protestation, mais une organisation politique ne «peut pas» vivre sur le vide et l'unique protestation. Hors le régime a toujours empêche le NBP de légalement exister sur la scène politique. Limonov a même été en conflit avec le parti communiste de Russie pour l'utilisation des symboles communistes. Les nazbols sont avant tout des contestataires et non des nationalistes à proprement parler, ils utilisent le drapeau rouge, la croix et la faucille. Leur rhétorique n'est pas non plus réllement nationale.
Peut on parler de narionalisme Rouge ?
En quelque sorte oui ! Leur idéologie est très variée et très souple. Dans certains cas ils sont très proches des communistes, dans d'autres plutôt légalistes et proches du pouvoir, et par exemple ailleurs (smolensk) ils sont avant tout anti-fascistes. Pour nombre de «libéraux» Limonov est un fasicte pur et dur ! Et en fait nombre de nationalistes auraient été disposés à des alliances politiques avec Limonov, si celui ci n'avait pas décrit dans son journal ses «sauteries» homosexuelles avec un black de Harlem! Cela a vraiment indisposé nombre de nationalistes en Russie mais lorsque celui ci a fait de la prison pendant deux ans pour «tentative de coup d'état», les détenus qui ne sont en général pas tendres avec les homosexuels en Russie n'ont eu aucun problème avec lui, je le sais car nous avons communiqué un temps ensemble. Par conséquent il est fort possible que cette page ait été écrite lors d'un moment de vie de bohème, ou même que cela soit une fiction complète, qui sait ?
Suite à cet période carcérale, limonov s'est radicalisé contre le régime et à commencé à chercher à participer de facon active à la vie politique. Sans ressources financières ni soutien médiatique, celui ci à conduit ses effectifs aux troubles de rues et à rejoindre les «marches du désaccord», principal groupe d'opposition au régime du Kremlin regroupant les libéraux et la gauche. Limonov pense réellement que en cas de renversement du régime, il pourra avec son parti participer à des élections librement. Je n'y crois pour ma part absolument pas. Je ne crois pas à des quelconques élections ou les nationalistes auraient librement le droit de s'exprimer. Si de réelles élections «libres» devaient avoir lieu, ce serait Mikael Kodorkovski qui les gagnerait, tout simplement parce qu'il couvrirait les murs d'affiches géantes, monopoliseraient les télés et les radios, et ainsi l'emporteraient. Et même si les gens ne votaient pas pour lui, les «libéraux» et autres affiliés truqueraient les bulletins afin d'attribuer la victoire à qui ils souhaitent. Voila à quoi ressemblerait une élection libre après une révolution orange.
Voila également pourquoi limonov fait alliance avec les libéraux, qu'il combattait auparavent, parce que notre système politique traine en lui l'héritage du soviétisme avec toutes ses lourdeurs et n'est pas capable d'offrir des corridors de développement suffisant à nombre de partis, dont le NBP. Voila pourquoi limonov et les «libéraux» font alliance, parcequ'ils pensent que unis, ils ont plus de chances de l'emporter.
Peut on nous dire en tant que nationaliste Russe quel problème te semble prioritaire ?
Le proncipal problème, en Russie comme ailleurs est l'involution démographique et la réduction du capital santé de la population de souche. C'est à dire une diminution quantitative de cette population mais également une baisse de sa vitalité et une détérioration de sa qualité. Ce problème existe en Russie mais également en France, il n'y a qu'à regarder votre équipe de football pour en être convaincu.
Si l'on parle du problème des forces et du pouvoir en Russie on peut imaginer trois variantes crédibles de contrôle de notre pays : une première possibilité est la prise de pouvoir par les nationalistes, une seconde est la prise du pouvoir par une quelconque coalition «libéralo-orange» et enfin la dernière un basculement à moyen terme de notre pays sous la bannière de l'Islam, soit après une guerre civile perdue, soit par volonté d'un régime libéral au pouvoir de définitivement détruire l'identité Russe en favorisant la prise de pouvoir de minorités (musulmanes) par le haut.
A mon sens, voilà ou se situe la lutte réelle pour la prise du pouvoir en Russie, entre les jeunes nationalistes et les jeunes groupes antifa, qui oeuvrent inconsciement pour les libéraux. C'est bien une des clefs à comprendre, l'ennemi est plus l'agent de la gauche que l'étranger musulman asiatique d'asie centrale, qui même si en surnombre est facilement contrôlable par un état fort et volontaire.
L'essentiel aujourd'hui est la lutte pour le pouvoir, et cette lutte ne passe pas par le Kremlin, car nous ne parlons pas de la même génération. Les gens de 20 ans ne vont pas avec les gens de 50 ans. Voyez le parallèle avec la France ou en 1968 tous ces étudiants d'extrême gauche s'opposait au pouvoir. Que voit t'on aujourd'hui ? Que ceux la même sont au pouvoir, tous ces anciens «ultras de gauche» sont au pouvoir au sein de coalitions libérales anti nationales. Il n'y a pas longtemps j'ai lu un livre de Alexei Tsvetkov, cet ancien anarchiste de gauche, raconte comment il a rencontré des écologistes du parlement Européen à Moscou et à pu «entrer» dans le système et distiller ses idées. Il a cependant été sifflé par ses partisans. Voila le même problème touche nombre de nationalistes, de patriotes en Russie aujourd'hui, ils refusent d'entrer ouvertement dans le système et ce faisant seront encore dans 20 ans à siffler le pouvoir plutôt que d'en faire partie et d'influer sur celui ci.
Les «gauchistes de 1968» ont été formés à l'école politique Allemande de Frankfort (markuse) et ont réussi à intégrer le système et le remodeler selon «leurs» façons de voir, selon leurs idées. Ils ont réussis à changer la face politique de l'Europe pour les 100 ans à venir. Naturellement vous avez toujours les éternels «puristes» qui vous diront : «vous avez renié, vous avez trahi, vous avez collaboré avec le système» mais en fait au global c'est totalement faux, cette génération de révolutionnaires nous a montré qu'on pouvait quasimment réaliser ses rêves, même si il existe évidemment une différence entre ses rêves et la réalité.
Nous pouvons dire qu'en Russie la situation est la même aujourd'hui qu'en 1968 en Europe, Celui qui «entre» dans le système à une chance de le modifier et d'influer sur l'évolution de notre pays. Si ce n'est pas nous qui prenons les places aujourd'hui, ce sera les «autres» et s'ils ont le pouvoir ils modèleront la Russie d'une façon qui ne nous convient pas. Par conséquent nous devons, comme les révolutionnaires de 1968 devenir une classe politique qui influe sur le développement du pays. Pour cela, il faut tout simplement, pas à pas accéder à tous les leviers du pouvoir.
Beaucoup de nationalistes en Russie ne savent pas comment «influer» sur le pouvoir, beaucoup attendent un grand soir, une sorte de 1917 bis mais ceux la se leurrent. Les bolcheviks par exemple n'ont pas attendu la révolution, ils l'ont déclenchée, et l'ont gagnée. Plus que cela, ils ont sacrifié leur vie à arriver à leur fin. Les bolcheviks étaient 100.000 au début et faisaient face à des partis politiques avec bien plus de membres mais c'était eux les plus motivés. A l'époque ils n'avaient pas en face d'eux un parti comme «Russie Unie» rempli de businessmen et de fonctionnaires, inscrits mais peu «militants» au demeurant. Les bolcheviques ont tout fait, ils ont créé une armée secondaire, ils ont modifié leur mode de vie, leur style de vie «pour» leur arriver à leur but, ils sont allés en prison, ils ont créé une société parallèle. Il n'y a aujourd'hui en Russie aucun parti, aucun mouvement avec de telles ressources. Qui ferait la révolution si elle arrivait demain ?
Aujourd'hui pour un nationaliste il y a a mon sens deux façons de se battre : soit mettre en place une structure révolutionnaire et la diriger jusq'au bout, soit intégrer une structure existante et la modifier de l'intérieur.
Merci Ilya d'avoir répondu à mes questions, je précise que le site d'Obraz comprend désormais une présentation en langue Française ici.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg



 Im agitatorischen Stil kommt der unter Herausgeberschaft von Hartmut Plaas’ 1928 erschienene Sammelband: „Wir klagen an! Nationalisten in den Kerkern der Bourgeoisie“ daher. Als einen der ersten Faksimiles druckte der Uwe-Berg-Verlag die Schrift in seiner Reihe „Quellentexte zur Konservativen Revolution“ unter der Kategorie „Die Nationalrevolutionäre“ ab. Was der Einband nicht verrät: der Herausgeber wurde 1944 im Zuge des Stauffenberg-Attentats hingerichtet.
Im agitatorischen Stil kommt der unter Herausgeberschaft von Hartmut Plaas’ 1928 erschienene Sammelband: „Wir klagen an! Nationalisten in den Kerkern der Bourgeoisie“ daher. Als einen der ersten Faksimiles druckte der Uwe-Berg-Verlag die Schrift in seiner Reihe „Quellentexte zur Konservativen Revolution“ unter der Kategorie „Die Nationalrevolutionäre“ ab. Was der Einband nicht verrät: der Herausgeber wurde 1944 im Zuge des Stauffenberg-Attentats hingerichtet. mit ihr! Ihr führet Krieg und heulet derweil um Frieden! Wir klagen euch an.“ Die Zeilen lesen sich oftmals als prägende Leidensgeschichten aus den Gefängnissen der Weimarer Republik. Aber auch eine gewisse Zynik spricht aus vielen Zeilen. So etwa hier bei Roderich Zoeller: „Und ich verließ nach sechsmonatigem Nachdenken hinter Gitterfenstern das Gefängnis natürlich als sittlich gebesserter Mensch.“
mit ihr! Ihr führet Krieg und heulet derweil um Frieden! Wir klagen euch an.“ Die Zeilen lesen sich oftmals als prägende Leidensgeschichten aus den Gefängnissen der Weimarer Republik. Aber auch eine gewisse Zynik spricht aus vielen Zeilen. So etwa hier bei Roderich Zoeller: „Und ich verließ nach sechsmonatigem Nachdenken hinter Gitterfenstern das Gefängnis natürlich als sittlich gebesserter Mensch.“