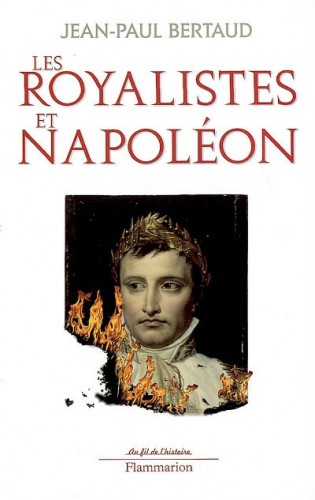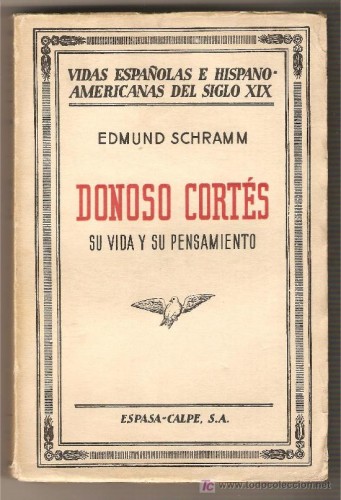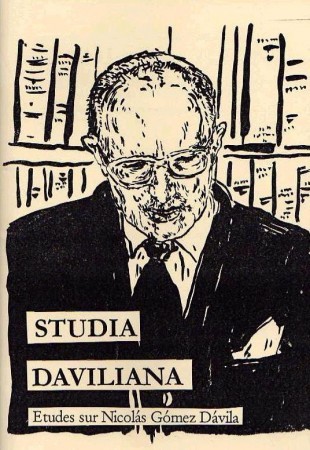Ex: http://eisernekrone.blogspot.com/
Ex: http://eisernekrone.blogspot.com/jeudi, 18 juin 2009
Sobre a Autoridade
Sobre a Autoridade

Um dos pontos débeis do pensamento politicamente correcto é esquecer, ignorar ou não considerar certos temas de todos os dias como a dor, o envelhecimento, a morte, a hierarquia, a ordem, a autoridade.
A respeito deste último tema, sabemos que desde o iluminismo (século XVIII) até ao progressismo dos nossos dias deu-se a negação sistemática da autoridade para substitui-la por critérios meramente racionalistas. Sem notar que não pode existir nenhum conhecimento livre da autoridade, pois ela é um seu elemento constitutivo. Ainda que a autoridade não possa substituir o juízo próprio, ele não exclui que a autoridade seja fonte de verdade.
Por outro lado, nenhum homem pode pensar a partir “somente da sua razão”, mas antes começa a pensar no seio de uma determinada tradição de pensamento ou cultura. Todo o homem nasce dentro de grandes ecúmenos culturais que condicionam o seu sentido de ser no mundo.
Qualquer um que oiça a palavra autoridade associa-a imediatamente com a figura do que manda sendo o seu correlativo aquele que obedece. A relação mando-obediência impõe-se de início como a dupla a partir da qual começamos a entender aquilo que enforma o conceito de autoridade. Esta última podemos caracterizá-la, numa primeira definição, como a imposição da vontade de um homem sobre outro.
Mas assim que nos detemos sobre ela vemos que esta definição não é de todo suficiente porque nos fala mais sobre a consequência do exercício da autoridade do que da autoridade propriamente dita. E as definições para serem completas e acabadas têm de apanhar a essência do que pretendem definir e não somente a sua finalidade.
A versão autoritária da autoridade vincula-a com a obediência, à priori, cega ou mecânica. De facto, esta concepção da autoridade esteve ligada às ordens militares ou religiosas, sobretudo no período de formação dos seus membros. Autoritário é aquele que exerce o seu poder para obter a obediência de outro.
Mas, como dizíamos, a natureza da autoridade não se esgota na obediência mas antes há que encontrá-la a partir do acto de reconhecimento de um saber superior, em qualquer aspecto da vida, que um homem constata noutro. A superioridade do saber do outro sobre o nosso é a origem da autoridade.
A autoridade não se recebe mas antes é concedida por um homem a outro. É concedida por aquele que reconhece no outro um saber ou conhecimento superior ao que ele possui na matéria ou tema de que se trate. Ninguém é autoridade em tudo, é-se sempre autoridade nalguma ordem de coisas, domínios ou disciplinas, ainda que nenhum de nós esteja livre dos “tudólogos”, os que “tudo-sabem”. A única “tudologia” aceitável é aquela dos pais sobre os filhos, e só até aos seis ou sete anos de idade.
A autoridade funda-se sobre o saber reconhecido de alguém e na necessidade que esse conhecimento gera. O centenário filósofo Hans Gadamer (1900-2002) escreveu: a autoridade correctamente entendida tem a ver, não com a obediência, mas com o conhecimento.
O homem, a partir do momento em que reconhece outro como autoridade, confia no que este diz como sendo verdade. É por isso que a autoridade pressupõe o conhecimento ou o saber daquele que a exerce, enquanto a obediência revela o poder, indica-nos o exercício concreto de autoridade de quem a exerce.
Assim, a autoridade, que como exercício se manifesta no campo político-social pôde ser definida, muito acertadamente, pelo filósofo céptico Giuseppe Rensi (1871-1941), na sua obra Filosofia da Autoridade (1920) como:”o acto que determina o que de facto vale como justiça e moral…entre opostas verdades teóricas racionalmente possíveis é a autoridade que decide o que de facto deve valer como se fosse a justiça, o bem, a verdade”
A objecção que nasce da politologia e da sociologia ao observar que nas nossas sociedade nem todas as autoridades dizem a verdade, pois existem autoridades que infundem conhecimentos falsos para manipular as pessoas, objecção que também pode aplicar-se à manipulação de grupos sociais menores, é difícil de contestar. Há que fazer a distinção entre “potestas” e “auctoritas”. A autoridade entendida como poder pode mentir, e de facto mente, para alcançar a obediência, mas a autoridade enquanto “auctoritas”, ou seja, em si mesma, funda-se sobre a verdade. Pois o conhecimento é sempre verdadeiro, um falso conhecimento é um desconhecimento.
Ainda que a autoridade gere obediência, ela não é obediência, essa é a consequência do exercício da autoridade. Mas, a autoridade tem como finalidade somente alcançar a obediência ou procura, e pode, aspirar a algo mais?
Uma vez mais temos que aplicar o velho princípio metodológico da filosofia clássica “distinguere ut iungere” (distinguir para unir) e assim discriminar entre bens externos e bens internos. A autoridade, no campo dos bens externos, pode, numa prática mal feita (uma pseudo-investigação) lograr prestígio, fama e dinheiro. Há tansíssimos académicos de pacotilha hoje em dia. Mas, pelo contrário, a autoridade, nos bens intrínsecos, só se pode afirmar realizando bem a prática em questão. Os bens internos a determinada prática só se podem obter realizando bem essa prática.
Assim, pôde afirmar o grande filósofo escocês Alasdair MacIntyre (1929- ) que a virtude (analogicamente a autoridade) só pode ser definida em relação com as práticas e com os seus bens internos.
E estes bens internos não são só para quem os realiza mas são bens para toda a comunidade. Uma autoridade, mesmo a mais isolada, é sempre uma autoridade socialmente reconhecida.
Assim, o pseudo-investigador do exemplo, esses especialistas das Comissões e das Academias, usurpadores de bolsas, prestígios e cânones, poderão ter um currículo alargado e ganhar bom dinheiro, mas o que nunca terão é a satisfação de ter podido ampliar os conhecimentos das suas disciplinas, metodologicamente garantidos pela prática de investigar e a autoridade que os guia.
Vemos, então, como a natureza ou essência da autoridade se revela de duas formas: por um lado no reconhecimento do superior por parte do inferior, e por outro no serviço do superior ao inferior por meio de uma boa prática. A finalidade última da autoridade é o progresso existencial dos que a acatam. Dá-se, assim, por cumprido, o último sentido etimológico de “auctoritas”, que os romanos entendiam como reconhecimento, respeito e aceitação, que deriva do substantivo “auctor” = criador, autor, instigador, por sua vez derivado do verbo “augere”, que significa aumentar, fazer progredir.
Alberto Buela, Arbil nº118
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : théorie politique, philosophie, politologie, sciences politiques, autorité, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 juin 2009
2015
Karlheinz WEISSMANN - http://www.sezession.de/
Propheten sind im allgemeinen vorsichtig mit genauen Zeitangaben. Zu groß ist die Gefahr, daß eine Prognose nicht pünktlich eintrifft und die Skeptiker das Lachen haben und die Anhänger verunsichert oder abtrünnig werden. Das Gebot der Vorsicht gilt auch für Ökonomen und Sozialwissenschaftler.
Man wird deshalb besonders aufmerksam, wenn ein Meinhard Miegel im Interview der FAZ sagt, daß wir „2015″ mit einer „Totalkrise“ zu rechnen hätten, die nicht nur einige Banken und Unternehmen betreffen würde, auch nicht nur die Arbeitslosenzahl und die Wählerstimmen für die Linke nach oben treiben, sondern den Staat insgesamt erfassen dürfte.
Jemand wie Miegel muß seiner Sache ziemlich sicher sein, wenn er sich so weit vorwagt. Er gehört weder zu den professionellen Kassandren, noch ist er in der Vergangenheit durch rabenschwarzen Pessimismus aufgefallen. Eher hat er es mit Ermutigung der „Gesellschaft“ versucht, indes war zuletzt eine zunehmende Gereiztheit des Tonfalls und Ungeduld angesichts der Schwerfälligkeit aller Korrekturversuche zu bemerken.
Jetzt scheint Miegel aus seiner Beobachtung der Strukturschwächen des Gesamtsystems die Konsequenzen gezogen zu haben und formuliert eine Art Generalkritik:
- Die Fixierung auf Wachstum ist ein grundsätzlicher Fehler, wir müssen lernen mit weniger auszukommen,
- die Ausweitung des westlichen Lebensstils im globalen Maßstab kann nicht als wünschenswert betrachtet werden,
- auf die kommende Krise ist niemand vorbereitet: weder die Politische Klasse, die die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat, noch die „Gesellschaft“, die im Grunde nur die Aussicht auf Teilhabe am materiellen Wohlstand zusammenhält.
- Daß die drohende Gefahr nicht erkannt wird, ist kein Gegenargument, die Mächtigen sind immer blind, wenn ihr Untergang bevorsteht.
Man muß dankbar sein, daß jemand wie Miegel an so einflußreicher Stelle seine Stimme erheben kann, wenngleich man sich den Ton noch schärfer und die Folgerungen weniger vorsichtig formuliert gewünscht hätte. Aber vielleicht fürchtet Miegel nicht nur um seine Veröffentlichungsmöglichkeiten, sondern auch um die seelische Belastbarkeit seines Publikums.
Das wird dann von anderen auf andere Weise auf weitere Bedrohungen vorbereitet. Am kommenden Sonnabend strahlt SAT 1 die deutsche Fassung des französischen Spielfilms Banlieue 13 aus, ein eher mäßiges Produkt, aber nicht ohne realistische Momente. Der Streifen behandelt die Machtübernahme des Bandenführers Taha in einem Pariser Vorort, der wegen der hohen Kriminalität mit einer Mauer abgeriegelt wurde. Der Staat hat die banlieue geräumt und die nach Millionen zählende Einwohnerschaft den gangs ausgeliefert. Die Situation eskaliert, als der örtliche Machthaber in den Besitz einer „schmutzigen Bombe“ kommt und die Regierung erpreßt. Die Geschehnisse sind übrigens ins Jahr 2010 verlegt.
00:24 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : crise, philosophie, moeurs contemporaines, sociologie, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 juin 2009
La révolution conservatrice en Allemagne (1918-1932)
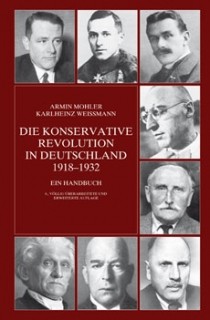
SYNERGIES EUROPÉENNES - Novembre 1989
La "Révolution Conservatrice" en Allemagne (1918-1932)
A propos de la réédition tant attendue du célèbre manuel d'Armin Mohler
par Robert STEUCKERS
L'ouvrage d'Armin Mohler sur la "Konservative Revolution" (KR) a été si souvent cité, qu'il est de-venu, dans l'espace linguistique francophone, chez ceux qui cultivent une sorte d'adhésion affective aux idées vitalistes allemandes déri-vées de Nietzsche, une sorte de mythe, de ré-férence mythique très mal connue mais souvent évoquée. Cette année, une réédition a enfin vu le jour, flanquée d'un volume complémen-taire où sont consignés les commentaires de l'auteur sur l'état actuel de la recherche, sur les nou-veaux ou-vrages d'approfondissement et surtout sur les re-cherches de Sternhell (1).
Comment se présente-t-il, finalement, cet ou-vrage de base, ce manuel si fondamental? Il se compose d'abord d'un texte d'initiation, com-mençant à la page 3 de l'ouvrage et s'achevant à la page 169; ensuite d'une bibliographie ex-haustive, recensant tous les ouvrages des au-teurs cités et tous les ouvrages pa-noramiques sur la KR: elle débute à la page 173 pour se ter-miner à la page 483. Suivent alors les annexes, avec la liste des abréviations utilisées pour les lieux d'édition et les maisons d'édition, puis les registres des personnes, des périodiques et des organisations.
Un ouvrage destiné à la recherche
L'ouvrage est donc de prime abord destiné à la re-cherche. Mais comme la thématique englobe des idées, des leitmotive, des affirmations poli-tiques qui ont enthousiasmé de larges strates de l'intelligentsia alle-mande voire une partie des masses, il est évident qu'aujourd'hui encore elle enregistrera des retentis-sements divers en de-hors des cénacles académiques. A Bruxelles, à Genève, à Paris ou à Québec, il n'y a pas que des professeurs qui lisent Ernst Jünger ou Tho-mas Mann... La recension qui suit s'adressera dès lors essentiellement à ce public extra-aca-démique et se con-centrera sur la première partie de l'ouvrage, le texte d'initiation, avec ses défini-tions de concepts, sa clas-sification des diverses strates du phénomène que fut la KR. Mohler, dans ces chapitres d'une densité inouïe, définit très méticuleusement des mouvements politico-idéologiques aussi marginaux que fascinants: les "trots-kystes du national-socialisme", la "Deutsche Be-wegung" (DB), le national-bolché-visme, le "Troi-sième Front" (Dritte Front, en abrégé DF), les Völkischen, les Jungkonser-vativen, les nationaux-révolutionnaires, les Bündischen, etc. ainsi que des concepts comme Weltanschauung, nihilisme, Umschlag, "Grand Midi", réalisme héroïque, etc.
"Konservative Revolution" et national-socialisme
Le premier souci de Mohler, c'est de distinguer la KR du national-socialisme. Pour la tradition antifasciste, souvent imprégnée des démon-strations du marxisme vulgaire, le national-so-cialisme est la continuation politique de la KR. De fait, le national-socialisme a affirmé pour-suivre dans les faits ce que la KR (ou la "Deutsche Bewegung") avait esquissé en esprit. Mais nonobstant cette revendication nationale-socialiste, on est bien obligé de constater, avec Mohler, que la KR d'avant 1933 recelait bien d'autres possibles. Le national-socialisme a constitué un grand mouvement de masse, impres-sionnant dans ses dimensions et affublé de toutes les lourdeurs propres aux appareils de ce type. Face à lui, foisonnaient des petits cercles où l'esprit s'épanouissait indépendamment des vicis-situdes politiques du temps. Ces cénacles d'intel-lec-tuels n'eurent que peu d'influence sur les masses. Le grand parti, en revanche, écrit Mohler, "gardait les masses sous son égide par le biais des liens orga-ni-sationnels et d'une doctrine adaptée à la moyenne et limitée à des slogans; il n'offrait aux têtes supérieures que peu d'espace et seulement dans la mesure où elles voulaient bien participer au travail d'enré-gimentement des masses et limitaient l'exercice de leurs facultés intellectuelles à un quelconque petit domaine ésotérique" (p.4).
Peu d'intellectuels se satisferont de ce rôle de "garde-chiourme de luxe" et préfèreront rester dans cette cha-leur du nid qu'offraient leurs petits cénacles élitaires, où, pensaient-ils, l'"idée vraie" était conservée intacte, tandis que les partis de masse la caricaturaient et la tra-his-saient. Ce réflexe déclencha une cascade de rup-tures, de sécessions, d'excommunications, de conju-ra-tions avec des éléments exclus du parti, si bien que plus aucune équation entre la NSDAP et la KR ne peut honnêtement être posée. Bon nombre de figures de la KR de-vinrent ainsi les "trotskystes du national-so-cialisme", les hérétiques de la "Deutsche Be-wegung", qui seront poursuivis par le régime ou opteront pour l'"émigration intérieure" ou s'insinueront dans cer-taines instances de l'Etat car le degré de la mise au pas totalitaire fut nettement moindre en Allemagne qu'en Union Soviétique. Des représentants éminents de la KR, comme Hans Grimm, Oswald Spengler et Ernst Jünger purent compter sur l'appui de la Reichswehr, des cercles diplomatiques "vieux-conservateurs" ou de cénacles liés à l'industrie. Ne choisissent l'émi-gration que les figures de proue des groupes sociaux-révolutionnaires (Ot-to Strasser, Paetel, Ebeling) ou certains natio-naux-socialistes dissidents comme Rausch-ning. La plupart restent toutefois en Alle-magne, en es-pérant que surviendra une "seconde ré-volution" entièrement conforme à l'"Idée". D'autres se taisent définitivement (Blüher, Hielscher), se ré-fugient dans des préoccupations totalement a-politi-ques ou dans la poésie (Winnig) ou se tournent vers la phi-losophie religieuse (Esch-mann). Très rares seront ceux qui passeront carrément au national-socialisme comme Bäum-ler, spécialiste de Bachofen.
La thèse qui cherche à prouver la "culpabilité an-ticipative" de la KR ne tient pas. En effet, les idées de la KR se retrouvent, sous des formes chaque fois spé-cifiquement nationales, dans tous les pays d'Eu-rope depuis la moitié du XIXième siècle. Si l'on re-trouve des traces de ces idées dans le national-so-cia-lisme allemand, celui-ci, comme nous venons de le voir, n'est qu'une manifestation très partielle et in-com-plète de la KR, et n'a été qu'une tentative parmi des dizaines d'autres possibles. Raisonner en termes de causalité (diabolique) constitue donc, expli-que Moh-ler, un raccourci trop facile, occultant par exemple le fait patent que les conjurés du 20 juillet 1944 ou que Schulze-Boysen, agent so-viétique pendu en 1942, avaient été influencés par les idées de la KR.
L'origine du terme "Konservative Revolution"
Pour éviter toutes les confusions et les amalgames, Mohler pose au préalable quelques définitions: celle de la KR proprement dite, celle de la "Deutsche Be-wegung", celle de la "Weltanschauung" en tant que véhicule pédago-gique des idées nouvelles. Les termes "konser-vativ" et "revolutionär" apparaissent accolés l'un à l'autre pour la première fois dans le journal berlinois Die Volksstimme du 24 mai 1848: le po-lémiste qui les unissait était mani-festement mu par l'intention de persifler, de se gausser de ceux qui agitaient les émotions du public en affirmant tout et le contraire de tout (le conservatisme et la révolution), l'esprit troublé par les excès de bière blanche. En 1851, le couple de vocables réapparait —cette fois dans un sens non polémique— dans un ouvrage sur la Russie attribué à Theobald Buddeus. En 1875, Youri Sa-marine donne pour titre "Re-volyoutsionnyi konser-vatizm" à une plaquette qu'il a rédigée avec F. Dmi-triev. Par la suite, Dostoïevski l'utilisera à son tour. En 1900, Charles Maurras l'emploie dans son Enquête sur la Monarchie. En 1921, Thomas Mann l'utilise dans un article sur la Russie. En Allemagne, le terme "Konservative Revolution" acquiert une vaste no-to-riété quand Hugo von Hoffmannsthal le prononce dans l'un de ses célèbres discours (Das Schriftum als geistiger Raum der Nation — La littérature comme espace spirituel de la nation; 1927). Von Hoff-manns-thal désigne un processus de maturation intellectuel caractérisé par la recherche de "liens", prenant le relais de la recherche de "liberté", et par la recherche de "totalité", d'"unité" pour échapper aux divi-sions et aux discordes, produits de l'ère libérale.
Chez Hoffmannsthal, le concept n'a pas encore d'im-plication politique directe. Mais dans les quelques ti-mi-des essais de politisation de ce concept, dans le con-texte de la République de Weimar agonisante, on per-çoit très nettement une volonté de mettre à l'avant-plan les ca-ractéristiques immuables de l'âme humaine, en réaction contre les idées de 1789 qui pariaient sur la perfectibilité infinie de l'homme. Mais tous les cou-rants qui s'opposèrent jadis à la Révolution Française ne débouchent pas sur la KR. Bon nombre d'entre eux restent simplement partisans de la Restauration, de la Réaction, sont des conservateurs de la vieille école (Altkonservativen).
"Konservative Revolution" et "Deutsche Bewegung"
Donc si la KR est un refus des idées de 1789, elle n'est pas nostalgie de l'Ancien Régime: elle opte con-fusément, parfois plus clairement, pour une "troisième voie", où seraient absentes l'anarchie, l'absence de valeurs, la fascination du laissez-faire propres au li-béralisme, l'immoralité fondamentale du règne de l'ar-gent, les rigidités de l'Ancien Régime et des abso-lutismes royaux, les platitudes des socialismes et com-munismes d'essence marxiste, les stratégies d'a-ra-sement du passé ("Du passé, faisons table rase..."). A l'aube du XIXième siècle, entre la Révolution et la Restauration, surgit, sur la scène philoso-phique euro-péenne, l'idéalisme allemand, réponse au rationalisme français et à l'empirisme anglais. Parallèlement à cet idéalisme, le roman-tisme secoue les âmes. Sur le ter-rain, comme dans le Tiers-Monde aujourd'hui, les Al-le-mands, exaltés par Fichte, Arndt, Jahn, etc., pren-nent les armes contre Napoléon, incarnation d'un co-lo-nialisme "occidental". Ce mélange de guerre de li-bé-ration, de révolution sociale et de retour sur soi-même, sur sa propre identité, constitue une sorte de préfiguration de la KR, laquelle serait alors le stade atteint par la "Deutsche Bewegung" dans les années 20.
Pour en résumer l'esprit, explique Mohler, il faut mé-diter une citation tirée du célébrissime roman de D.H. Lawrence, The plumed Serpent (= Le serpent à plu-mes, 1926). Ecoutons-la: "Lorsque les Mexicains apprennent le nom de Quetzalcoatl, ils ne devraient le prononcer qu'avec la langue de leur propre sang. Je voudrais que le monde teutonique se mette à repenser dans l'esprit de Thor, de Wotan et d'Yggdrasil, le frêne qui est axe du monde, que les pays druidiques comprennent que leur mystère se trouve dans le gui, qu'ils sont eux-mêmes le Tuatha de Danaan, qu'ils sont ce peuple toujours en vie même s'il a un jour sombré. Les peuples méditerranéens devraient se réapproprier leur Hermès et Tunis son Astharoth; en Perse, c'est Mithra qui devrait ressusciter, en Inde Brahma et en Chine le plus vieux des dragons".
Avec Herder, les Allemands ont élaboré et conservé une philosophie qui cherche, elle aussi, à renouer avec les essences intimes des peuples; de cette philosophie sont issus les nationalismes germaniques et slaves. Dans le sens où elle recherche les essences (tout en les préservant et en en conservant les virtualités) et veut les poser comme socles d'un avenir radicalement neuf (donc révolutionnaire), la KR se rapproche du na-tionalisme allemand mais acquiert simultanément une valeur universelle (et non universaliste) dans le sens où la diversité des modes de vie, des pensées, des âmes et des corps, est un fait universel, tandis que l'univer-salisme, sous quelque forme qu'il se présente, cherche à biffer cette prolixité au profit d'un schéma équarisseur qui n'a rien d'universel mais tout de l'ab-straction.
La notion de "Weltanschauung"
La KR, à défaut d'être une philosophie rigoureuse de type universitaire, est un éventail de Weltan-schau-ungen. Tandis que la philoso-phie fait partie intégrante de la pensée du vieil Occident, la Weltanschauung apparaît au moment où l'édifice occidental s'effondre. Jadis, les catégories étaient bien contingentées: la pensée, les sentiments, la volonté ne se mêlaient pas en des flux désordonnés comme aujour-d'hui. Mais désormais, dans notre "interrègne", qui succède à l'ef-fondrement du christianisme, les Weltan-schau-ungen mêlent pensées, senti-ments et volontés au sein d'une tension perpé-tuelle et dynamisante. La pensée, soutenue par des Weltanschauungen, détient désor-mais un caractère instrumental: on sollicite une mul-titu-de de disciplines pour illustrer des idées déjà pré-alablement conçues, acceptées, choisies. Et ces idées servent à atteindre des objectifs dans la réalité elle-même. La nature particulière (et non plus universelle) de toute pensée nous révèle un monde bigarré, un chaos dynamique, en mutation perpétuelle. Selon Mohler, les Weltanschauungen ne sont plus véhicu-lées par de purs philosophes ou de purs poètes mais par des êtres hybrides, mi-penseurs, mi-poètes, qui savent conjuguer habilement —et avec une cer-taine cohérence— concepts et images. Les gestes de l'existence concrète jouent un rôle primordial chez ces penseurs-poètes: songeons à T.E. Lawrence (d'Ara-bie), Malraux et Ernst Jünger. Leurs existences enga-gées leur ont fait touché du doigt les nerfs de la vie, leur a communiqué une expérience des choses bien plus vive et forte que celle des philosophes et des théologiens, même les plus audacieux.
L'opposition concept/image
Les mots et les concepts sont donc insuffisants pour cerner la réalité dans toute sa multiplicité. La parole du poète, l'image, leur sont de loin supérieures. L'ère nouvelle se reflète dès lors davantage dans les travaux des "intellectuels anti-intellectuels", de ceux qui peu-vent, avec génie, manier les images. Un passage du journal de Gerhard Nebel, daté du 19 novembre 1943, illustre parfaitement les positions de Mohler quand il sou-ligne l'importance de la Weltanschauung par rap-port à la philosophie classique et surtout quand il en-tonne son plaidoyer pour l'intensité de l'existence contre la grisaille des théories, plaidoyer qu'il a ré-sumé dans le concept de "nominalisme" et qui a eu le reten-tissement que l'on sait dans la maturation intel-lectuelle de la "Nouvelle Droite" française (3).
Ecoutons donc les paroles de Gerhard Nebel: "Le rap-port entre les deux instruments méta-physiques de l'homme, le concept et l'image, livre à ceux qui veu-lent s'exercer à la com-paraison une matière inépui-sable. On peut dire, ainsi, que le concept est impro-ductif, dans la mesure où il ne fait qu'ordonner ce qui nous tombe sous le sens, ce que nous avons déjà dé-couvert, ce qui est à notre disposition, tandis que l'image génère de la réalité spirituelle et ramène à la surface des éléments jusqu'alors cachés de l'Etre. Le concept opère prudemment des distinctions et des re-groupements dans le cadre strict des faits sûrs; l'image saisit les choses, avec l'impétuosité de l'aventurier et son absence de tout scrupule, et les lance vers le large et l'infini. Le concept vit de peurs; l'image vit du faste triomphant de la découverte. Le concept doit tuer sa proie (s'il n'a pas déjà ramassé rien qu'un cadavre), tandis que l'image fait apparaître une vie toute pétil-lante. Le concept, en tant que concept, exclut tout mys-tère; l'image est une unité paradoxale de contraires, qui nous éclaire tout en honorant l'obscur. Le concept est vieillot; l'image est toujours fraîche et jeune. Le concept est la victime du temps et vieillit vite; l'image est toujours au-delà du temps. Le concept est subor-donné au progrès, tout comme les sciences, elles aussi, appartiennent à la caté-gorie du progrès, tandis que l'image relève de l'instant. Le concept est écono-mie; l'image est gaspillage. Le concept est ce qu'il est; l'image est toujours davantage que ce qu'elle semble être. Le concept sollicite le cerveau mais l'image solli-cite le cœur. Le concept ne meut qu'une périphérie de l'existen-ce; l'image, elle, agit sur l'ensemble de l'existence, sur son noyau. Le concept est fini; l'image, infinie. Le concept simplifie; l'image honore la diversité. Le concept prend parti; l'image s'abstient de juger. Le concept est gé-néral; l'image est avant tout individuelle et, même là où l'on peut faire de l'image une image générale et où l'on peut lui subordonner des phénomènes, cette action de subordonnance rap-pelle des chasses passionnantes; l'ennui que suscite l'inclusion, l'enfermement de faits de monde dans des concepts, reste étranger à l'image...".
Les idées véhiculées par les Weltanschauungen s'incarnent dans le réel arbitrairement, de façon impré-visible, discontinue. En effet, ces idées ne sont plus des idées pures, elles n'ont plus une place fixe et immuable dans une quelconque empyrée, au-delà de la réalité. Elles sont bien au contraire imbriquées, pri-sonnières des aléas du réel, soumises à ses mutations, aux conflits qui forment sa trame. Etudier l'impact des Weltan-schauungen, dont celles de la KR, c'est poser une topographie de courants souterrains, qui ne sau-tent pas directement aux yeux de l'obser-vateur.
Une exigence de la KR: dépasser le wilhelminisme
Quand Arthur Moeller van den Bruck parle d'un "Troisième Reich" en 1923 (4), il ne songe évidem-ment pas à l'Etat hitlérien, dont rien ne laisse alors prévoir l'avènement, mais d'un système politique qui succéderait au IIième Reich bismarcko-wilhelminien et où les oppo-sitions entre le socialisme et le nationa-lisme, en-tre la gauche et la droite seraient sublimées en une synthèse nouvelle. De plus, cette idée d'un "troisième" Empire, ajoute Mohler, renoue avec toute une spéculation philosophique christiano-européenne très ancienne, qui parlait d'un troisième règne comme du règne de l'esprit (saint). Dès le IIième siècle, les montanistes, secte chrétienne, évoquent l'avènement d'un règne de l'esprit saint, successeur des règnes de Dieu le Père (ancien testament) et de Dieu le Fils (nouveau testament et incarnation), qui serait la syn-thèse parfaite des contraires. Dans le cadre de l'histoire allemande, on repère une longue aspiration à la syn-thèse, à la conciliation de l'inconciliable: par exemple, entre les Habs-bourg et les Hohenzollern. Après la Grande Guer-re, après la réconciliation nationale dans le sang et les tranchées, Moeller van den Bruck est l'un de ces hommes qui espèrent une synthèse entre la gauche et la droite par le truchement d'un "troisième parti". Evidemment, les hitlé-riens, en fondant leur "troisième Reich", prétendront transposer dans le réel toutes ses vieilles aspirations pour les asseoir définiti-ve-ment dans l'histoire. La KR et/ou la "Deutsche Be-wegung" se scinde alors en deux groupes: ceux qui estiment que le IIIième Reich de Hitler est une falsifi-cation et entrent en dissidence, et ceux qui pensent que c'est une première étape vers le but ultime et acceptent le fait accompli.
Sous le IIième Reich historique, existait une "opposition de droite", mécontente du caractère libé-ral/darwiniste de la révolution industrielle allemande, du rôle de l'industrie et du grand capital, de l'étroitesse d'esprit bourgeoise, du façadisme pompeux, avec ses stucs et son tape-à-l'oeil. Le "conservatisme" officiel de l'époque n'est plus qu'un décor, que poses mata-mores-ques, tandis que l'économie devient le destin. Ce bourgeoisisme à colifichets militaires suscite des réactions. Les unes sont réformistes; les autres exigent une rupture radicale. Parmi les réfor-mistes, il faut compter le mouvement chrétien-social du Pasteur Adolf Stoecker, luttant pour un "Empire social", pour une "voie caritative" vers la justice sociale. Les élé-ments les plus dynami-ques du mouvement finiront par adhérer à la sociale-démocratie. Quant au "Mouvement Pan-Ger-maniste" (Alldeutscher Verband), il sombre-ra dans un impérialisme utopique, sur fond de roman-tisme niais et de cliquetis de sabre. Les autres mouve-ments restent périphériques: les mouvements "artistiques" de masse, les mar-xistes qui veulent une voie nationale, les pre-miers "Völkischen", etc.
A l'ombre de Nietzsche...
Face à ces réformateurs qui ne débouchent sur rien ou disparaissent parce que récupérés, se trouvent d'abord quelques isolés. Des isolés qui mûrissent et agissent à l'ombre de Nietzsche, ce penseur qui ne peut être classé parmi les prota-gonistes de la "Deutsche Bewe-gung" ni parmi les précurseurs de la KR, bien que, sans lui et sans son œuvre, cette dernière n'aurait pas été telle qu'elle fut. Mais comme les isolés qu'a-limente la pensée de Nietzsche sont nombreux, très différents les uns des autres, il s'en trouve quelques-uns qui amorcent véritablement le processus de maturation de la KR. Mohler en cite deux, très importants: Paul de Lagarde et Julius Langbehn. L'orientaliste Paul de La-garde voulait fonder une religion allemande, appelée à remplacer et à renforcer le message des christia-nismes protestants et catholiques en pariant sur la veine mys-tique, notamment celle de Meister Eckhart le Rhénan et de Ruusbroeck le Bra-bançon (5). Julius Langbehn est surtout l'homme d'un livre, Rembrandt als Erzieher (1890; = Rembrandt éducateur) (6). A partir de la person-nalité de Rembrandt, Langbehn chante la mysti-que profonde du Nord-Ouest européen et sug-gère une synthèse entre la rudesse froide mais vertueuse du Nord et l'enthousiasme du Sud.
Mouvement völkisch et mouvement de jeunesse
En marge de ses deux isolés, qui connurent un succès retentissant, deux courants sociaux contri-buent à briser les hypocrisies et le matérialisme de l'ère wilhelmi-nienne: le mouvement völkisch et le mouvement de jeunesse (Jugendbewe-gung). Par völkisch, nous ex-plique Mohler, l'on entend les groupes animés par une philosophie qui pose l'homme comme essentiellement dépen-dant de ses origines, que celles-ci proviennent d'une matière informelle, la race, ou du travail de l'histoire (le peuple ou la tribu étant, dans cette op-tique, forgé par une histoire longue et com-mune). Proches de l'idéologie völkische sont les doctrines qui posent l'homme comme déterminé par un "paysage spirituel" ou par la langue qu'il parle. Dans les années 1880, le mouvement völkisch se constitue en un front du refus assez catégorique: il est surtout antisémite et remplace l'ancien antisémitisme confessionnel par un antisémitisme "raciste" et déterministe, lequel prétend que le Juif reste juif en dépit de ses options person-nelles réelles ou affectées. Le mouvement völkisch se divise en deux tendan-ces, l'une aristocratique, dirigée par Max Lieber-mann von Sonnenberg, qui cherche à rapprocher certaines catégories du peuple de l'aristocratie conservatrice; l'autre est radicale, démo-cratique et issue de la base. C'est en Hesse que cette pre-mière radicalité völkische se hissera au niveau d'un parti de masse, sous l'impulsion d'Otto Böckel, le "roi des paysans hessois", qui renoue avec les souvenirs de la grande guerre des paysans du XVIième siècle et rêve d'un soulève-ment généralisé contre les grands capitalistes (dont les Juifs) et les Junker, alliés objectifs des premiers.
Le mouvement de jeunesse est une révolte des jeunes contre les pères, contre l'artificialité du wilhelminisme, contre les conventions qui étouf-fent les cœurs. Créé par Karl Fischer en 1896, devenu le "Wandervogel" (= "oiseau migra-teur") en 1901, le mouvement connait des dé-buts anarchisants et romantiques, avec des éco-liers et lycéens, coiffés de bérets fantaisistes et la gui-tare en bandoulière, qui partent en randon-née, pour quitter les villes et découvrir la beauté des paysages (7). A partir de 1910-1913, le mou-vement de jeunesse acquerra une forme plus stricte et plus disciplinée: la principale organisation porteuse de ce renouveau fut la Frei-deutsche Jugend (8).
Le choc de 1914
Quand éclate la guerre de 1914, les peuples croient à une ultime épreuve purgative qui pulvérisera les bar-rières de partis, de classes, de confessions, etc. et conduira à la "totalité" espé-rée. Thomas Mann, dans les premières semaines de la guerre, parle de "purification", de grand nettoyage par le vide qui ba-laiera le bric-à-brac wilhelminien. Peu importaient la victoire, les motifs, les intérêts: seule comptait la guerre comme hygiène, aux yeux des peuples lassés par les artifices bourgeois. Mais les enthousiasmes du début s'enliseront, après la bataille de la Marne, dans la guerre des tranchées et dans l'implacable choc mé-canique des matériels. "Toute finesse a été broyée, piétinée", écrit Ernst Jünger. Le XIXième siècle périt dans ce maelstrom de fer et de feu, les façades rhéto-riques s'écroulent pulvérisées, les contingente-ments proprets perdent tout crédit et deviennent ridicules.
De cette tourmente, surgit, discrète, une nouvelle "totalité", une "totalité" spartiate, une "totalité" de souffrances, avec des alternances de joies et de morts. Une chose apparaît certai-ne, écrit encore Ernst Jünger, c'est "que la vie, dans son noyau le plus intime, est indestructi-ble". Un philosophe ami d'Ernst Jünger, Hugo Fischer, décrit cet avènement de la totalité nou-velle, dans un essai de guerre paru dans la revue "nationale-bolchévique" Widerstand (Janvier 1934; "Der deutsche Infanterist von 1917"): "Le culte des grands mots n'a plus de raison d'être aujourd'hui... La guerre mondiale a été le dai-mon qui a fracassé et pulvérisé le pathétisme. La guerre n'a plus de com-mencement ni de fin, le fantassin gris se trouve quelque part au mi-lieu des masses de terre boueuse qui s'étendent à perte de vue; il est dans son trou sale, prêt à bondir; il est un rien au sein d'une monotonie grise et désolée, qui a toujours été telle et sera toujours telle mais, en même temps, il est le point focal d'une nou-velle souveraineté. Là-bas, quelque part, il y avait ja-dis de beaux systèmes, scrupuleusement construits, des systèmes de tran--chées et d'abris; ces systèmes ne l'intéres-sent plus; il reste là, debout, ou s'accroupit, à moitié mort de soif, quelque part dans la campagne libre et ouverte; l'opposition entre la vie et la mort est repoussée à la lisière de ses souvenirs. Il n'est ni un individu ni une com-munauté, il est une particule d'une force élé-mentaire, planant au-dessus des champs rava-gés. Les concepts ont été bouleversés dans sa tête. Les vieux concepts. Les écailles lui tombent des yeux. Dans le brouillard infini, que scrutent les yeux de son esprit, l'aube semble se lever et il commence, sans sa-voir ce qu'il fait, à penser dans les catégories du siècle prochain. Les ca-nons balayent cette mer de saletés et de pourriture, qui avait été le domaine de son exis-tence, et les entonnoirs qu'ont creusés les obus sont sa demeure (...) Il a survécu à toutes les formes de guerre; le voilà, incorruptible et immortel, et il ne sait plus ce qui est beau, ce qui est laid. Son regard pénètre les choses avec la tranquillité d'un jet de flamme. Avec ou sans mérite, il est resté, a survécu (...) L'"intériorité" s'est projetée vers l'extérieur, s'est transformée de fond en comble, et cette extériorité est devenue totale; intériorité et extériorité fusion-nent; (...) On ne peut plus distinguer quand l'extériorité s'arrête et quand l'homme com-mence; celui-ci ne laisse plus rien derrière lui qui pourrait être réservée à une sphère privée".
La défaite de 1918: une nécessité
En novembre 1918, l'Etat allemand wilhelminien a cessé d'exister: la vieille droite parle du "coup de cou-teau dans le dos", œuvre des gau-ches qui ont trahi une armée sur le point de vaincre. Dans cette perspective, la défaite n'est qu'un hasard. Mais pour les tenants de la KR, la défaite est une nécessité et il convient main-tenant de déchiffrer le sens de cette défaite. Franz Schauwecker, figure de la mouvance na-tio-nale-révolu-tionnaire, écrit: "Nous devions perdre la guerre pour gagner la Nation". Car une victoire de l'Allemagne wilhelminienne aurait été une défaite de l'"Allemagne secrète". L'écrivain Edwin Erich Dwin-ger, de père nord-allemand et de mère russe, engagé à 17 ans dans un régiment de dragons, prisonnier en Si-bérie, combattant enrôlé de force dans les armées rouge et blanche, revenu en Allemagne en 1920, met cette idée dans la bouche d'un pope russe, personnage de sa trilogie romanesque consacrée à la Russie (9): "Vous l'avez perdue la grande Guerre, c'est sûr... Mais qui sait, cela vaut peut-être mieux ainsi? Car si vous l'aviez gagnée, Dieu vous aurait quitté... L'orgueil et l'oppres-sion [du wilhelminisme, ndt] se seraient multi-pliées par cent; une jouissance vide de sens aurait tué toute étincelle divine en vous... Un pourrissement rapide vous aurait frappé; vous n'auriez pas connu de véritable ascension... Si vous aviez ga-gné, vous seriez en fin de course... Mais maintenant vous êtes face à une nouvelle aurore...".
Après la guerre vient la République de Weimar, mal aimée parce qu'elle perpétue, sous des ori-peaux répu-blicains, le style de vie bourgeois, celui du parvenu. Cette situation est inaccepta-ble pour les guerriers reve-nus des tranchées: dans cette république bourgeoise, qui a troqué les uniformes chamarrés et les casques à pointe contre les fracs des notaires et des banquiers, ils "bivouaquent dans les appartements bourgeois, ne pouvant plus renoncer à la simplicité virile de la vie militaire", comme le disait l'un d'eux. Ils seront les recrues idéales des partis extrémistes, communiste ou national-socialiste. La Républi-que de Weimar se dé-ploiera en trois phases: une phase tumultueuse, s'étendant de novembre 1918, avec la proclamation de la République, à la fin de 1923, quand les Français quittent la Ruhr et que le putsch Hitler/Ludendorff est maté à Munich; une phase de calme, qui durera jus-qu'à la crise de 1929, où la République, sous l'impulsion de Stresemann, jugule l'inflation et où les passions semblent s'apaiser. A partir de la crise, l'édifice répu-blicain vole en éclats et les nationaux-socialistes sortent vainqueurs de l'arène.
Le débourgeoisement total
La République de Weimar a connu des débuts très dif-ficiles: elle a dû mater dix-huit coups de force de la gauche et trois coups de force de la droite, sans compter les manœuvres séparatistes en Rhénanie, fo-mentées par la France. Dans cette tourmente, on en est arrivé à une situation (apparemment) absurde: un gou-vernement en majorité socialiste appelle les ouvriers à la grève générale pour bloquer le putsch d'extrême-droite de Kapp; cette grève générale est l'étincelle qui déclenche l'insurrection communiste de la Ruhr et, pour étrangler celle-ci, le gouvernement ap-pel-le les sympathisants des putschistes de Kapp à la rescousse! La situation était telle que l'esprit public, secoué, pre-nait une cure sévère de dé-bourgeoisement.
Bien sûr, le débourgeoisement total n'affectaient qu'une infime minorité, mais cette minorité était quand même assez nombreuse pour que ses attitudes et son esprit déteignent quelque peu sur l'opinion publique et sur la mentalité générale de l'époque. La guerre avait arraché plusieurs clas-ses d'âge au confort bourgeois, lequel n'exerçait plus le moindre attrait sur elles. Pour ces hommes jeunes, la vie active du guerrier était qua-litativement supérieure à celle du bourgeois et ils haïs-saient l'idée de se morfondre dans des fauteuils mous, les pantoufles aux pieds. C'est pourquoi l'ardeur de la guerre, ils allaient la rechercher et la retrouver dans les "Corps Francs", ceux de l'intérieur et ceux de l'ex-térieur. Ceux de l'intérieur se moulaient dans les structures d'auto-défense locales (Einwohner-wehr) et permettaient, en fin de compte, un retour progressif à la vie civile, assorti quand même d'une promptitude à reprendre l'assaut dans les rangs communistes ou, surtout, na-tionaux-socialistes. Ceux de l'extérieur, qui combattaient les Polonais en Haute-Silésie et avaient arraché l'Annaberg de haute lutte, ou affrontaient les armées bolchéviques dans le Baltikum, regroupaient des soldats perdus, de nouveaux lansquenets, des irré-cupérables pour la vie bourgeoise, des pélérins de l'absolu, des vagabonds spartiates en prise directe avec l'élé-mentaire. Dans leurs âmes sauvages, l'esprit de la KR s'incrustera dans sa plus pure quin-tessence.
Parallèlement aux Corps Francs, d'autres structures d'accueil existaient pour les jeunes et les soldats fa-rouches: les Bünde du mouvement de jeunesse, lequel, avec la guerre, avait perdu toutes ses fantaisies anar-chistes et abandonné toutes ses rêveries philoso-phiques et idéalistes. Ensuite les partis de toutes obé-diences recru-taient ces ensauvagés, ces inquiets, ces cheva-liers de l'élémentaire pour les engager dans leurs formations de combat, leurs services d'ordre. Avant le choc de la guerre, le révolutionnaire typique ne renon-çait par radicalement aux for-mes de l'existence bour-geoise: il contestait simplement le fait que ces formes, assorties de richesses et de positions sociales avanta-geuses, étaient réservées à une petite minorité. L'engage-ment du révolutionnaire d'avant 1914 visait à généraliser ces formes bourgeoises d'existence, à les étendre à l'ensemble de la société, classe ouvrière comprise. Le révolutionnaire de type nou-veau, en re-vanche, ne partage pas cet uto-pisme eudémoniste: il veut éradiquer toute référence à ces valeurs bour-geoises haïes, tout sentiment positif envers elles. Pour le bourgeois frileux, convaincu de détenir la vérité, la formule de toute civilisation, le révolutionnaire nouveau est un "nihiliste", un dangereux mar-ginal, un personnage inquiétant.
Les lansquenets modernes
Mais les partis bourgeois, battus en brèche, incapables de faire face aux aléas qu'étaient les exigences des Al-liés et les dérèglements de l'économie mondiale, la violence de la rue et la famine des classes défavori-sées, ont été obligés de recourir à la force pour se maintenir en selle et de faire appel à ces lansquenets modernes pour encadrer leurs militants. Ces cadres issus des Corps Francs se rendent alors incontour-nables au sein des partis qui les utilisent, mais conservent toujours une certaine distance, en marge du gros des militants.
Ce processus n'est pas seulement vrai pour le national-socialisme, avec ses turbulents SA. Chez les commu-nistes, des bandes de solides bagarreurs adhèrent au Roter Kampfbund. Cer-taines organisations restent in-dépendantes for-mellement, comme le Kampfbund Wi-king du Capitaine Hermann Ehrhardt, le Bund Ober-land du Capitaine Beppo Römer et du Dr. Friedrich Weber, le Wehrwolf de Fritz Kloppe et la Reichs-flagge du Capitaine Adolf Heiß. Le Stahl-helm, orga-nisation paramilitaire d'anciens com-battants, dirigée par Seldte et Duesterberg, est proche des Deutschna-tionalen (DNVP). Le Jungdeutscher Orde (Jungdo) de Mahraun sert de service d'ordre à la Demokratische Partei. Quant aux sociaux-démocrates (SPD), leur or-ganisation paramilitaire s'appelait le Reichs-ban-ner Schwarz-Rot-Gold, dont les chefs étaient Hörsing et Höltermann.
La quasi similitude entre toutes ses formations faisait que l'on passait allègrement de l'une à l'autre, au gré des conflits personnels. Beppo Römer quittera ainsi l'Oberland pour passer à la KPD communiste. Bodo Uhse (10) fera exacte-ment le même itinéraire, mais en passant par la NSDAP et le mouvement révolution-naire pay-san, la Landvolkbewegung. Giesecke passera de la KPD à la NSDAP. Contre les Français dans la Ruhr, les militants communistes sabotent instal-lations et voies ferrées sous la conduite d'of-ficiers prussiens; SA et Roter Kampfbund colla-borent contre le gouver-nement à Berlin en 1930-31.
Dans ce contexte, Mohler souligne surtout l'apparition et la maturation de deux mouve-ments d'idées, le fa-meux "national-bolché-visme" et le "Troisième Front" (Dritte Front). Si l'on analyse de façon dualiste l'affrontement majeur de l'époque, entre nationaux-so-cialistes et communistes, l'on dira que l'idéologie des forces communistes dérive des idées de 1789, tan-dis que celles du national-socialisme de cel-les de 1813, de la Deutsche Bewegung. Il n'em-pêche que, dans une plage d'intersection réduite, des contacts fructueux entre les deux mondes se sont produits. Dans quelques cerveaux perti-nents, un socialisme ra-dical fusionne avec un nationalisme tout aussi radical, afin de sceller l'alliance des deux nations "prolétariennes", l'Allemagne et la Russie, contre l'Occident capitaliste.
Trois vagues de national-bolchévisme
Trois vagues de "national-bolchévisme" se suc-céde-ront. La première date de 1919/1920. Elle est une ré-action directe contre Versailles et atteint son apogée lors de la guerre russo-polonaise de 1920. La section de Hambourg de la KPD, dirigée par Heinrich Lauf-fenberg et Fritz Wolffheim, appelle à la guerre popu-laire et nationale contre l'Occident (11). Rapidement, des contacts sont pris avec des nationalistes de pure eau comme le Comte Ernst zu Reventlow. Quand la cavalerie de Boudienny se rapproche du Corridor de Dantzig, un espoir fou germe: foncer vers l'Ouest avec l'Armée Rouge et réduire à néant le nouvel ordre de Versailles. Weygand, en réorganisant l'armée polo-naise en août 1920, brise l'élan russe et annihile les espoirs allemands. Lauffenberg et Wolffheim sont ex-communiés par le Komintern et leur nouvelle organi-sation, la KAPD (Kommunisti-sche Arbeiterpartei Deutschlands), se mue en une secte insignifiante.
La seconde vague date de 1923, quand l'occupation de la Ruhr et l'inflation obligent une nouvelle fois natio-nalisme et communisme à fusionner. Radek, fonction-naire du Komintern, rend un vibrant hommage à Schlageter, fusillé par les Français. Moeller van den Bruck répond. Un dialogue voit le jour. Dans le jour-nal Die Rote Fahne, on peut lire les lignes suivantes, parfaitement à même de satisfaire et les natio-nalistes et les communistes: "La Nation s'effrite. L'héritage du prolétariat allemand, créé par les peines de générations d'ouvriers est menacé par la botte des militaristes fran-çais et par la faiblesse et la lâcheté de la bourgeoi-sie alle-mande, fébrile à l'idée de récolter ses petits pro-fits. Seule la classe ouvrière peut désormais sauver la Nation". Mais cette seconde vague natio-nale-bol-chéviste n'est restée qu'un symptôme de fièvre: d'un côté comme de l'autre, on s'est contenté de formuler de belles proclamations.
Plus sérieuse sera la troisième vague nationale-bolchéviste, explique Mohler. Elle s'amorce dès 1930. A la crise économique mondiale et à ses effets sociaux, s'ajoute le Plan de réparations de l'Américain Young qui réduit encore les maigres ressources des Alle-mands. Une fois de plus, les questions nationale et so-ciale se mêlent étroite-ment. Gregor Strasser, chef de l'aile gauche de la NSDAP, et Heinz Neumann, tacti-cien commu-niste du rapprochement avec les natio-naux, parlent abondamment de l'aspiration anti-capita-liste du peuple allemand. Des officiers natio-nalistes, aristocratiques voire nationaux-socia-listes, passent à la KPD comme le célèbre Lieutenant Scheringer, Ludwig Renn, le Comte Alexander Stenbock-Fermor, les chefs de la Landvolkbewegung comme Bodo Uhse ou Bruno von Salomon, le Capitaine des Corps Francs Beppo Römer, héros de l'épisode de l'Annaberg. Dans la pratique, la KPD soutient l'initiative du Stahl-helm contre le gouvernement prussien en août 1931; communistes et natio-naux-socialistes organisent de concert la grève des transports en commun berlinois de novem-bre 1932. Toutes ces alliances demeurent ponc-tuel-les et strictement tactiques, donc sans lendemain.
La tendance anti-russe de la NSDAP munichoise (Hitler et Rosenberg) réduit à néant le tandem KPD/NSDAP, particulièrement bien rodé à Berlin. L'URSS signe des pactes de non-agression avec la Pologne (25.1.1932) et avec la France (29.11.1932). Au sein de la KPD, la tendance Thälmann, internatio-naliste et anti-fas-ciste, l'emporte sur la tendance Neu-mann, socia-liste et nationale.
Mais ce national-bolchévisme idéologique et militant, présent dans de larges couches de la population, du moins dans les plus turbulentes, a son pendant dans certains cercles très influents de la diplomatie, regrou-pés autour du "Comte rouge", Ulrich von Brockdorff-Rantzau, et du Baron von Maltzan. La position de Brockdorff-Rantzau était en fait plus nuancée qu'on ne l'a cru. Quoi qu'il en soit, leur optique était de se dé-gager des exigences françaises en jouant la carte russe, exactement dans le même esprit de la politique prussienne russophile de 1813 (les "Accords de Taurog-gen"), tout en voulant reconstituer un équilibre euro-péen à la Bis-marck.
Le "troisième front" (Dritte Front)
Pour distinguer clairement la KR du national-socia-lisme, il faut savoir, explique Mohler, qu'avant la "Nuit des Longs Couteaux" du 30 juin 1934, où Hit-ler élimine quelques adversai-res et concurrents, inté-rieurs et extérieurs, le national-socialisme est une idéologie floue, re-celant virtuellement plusieurs pos-sibles. Ce fut, selon les circonstances, à la fois sa force et sa faiblesse face à un communisme à la doc-trine claire, nette mais trop souvent rigide. Mohler énumère quelques types humains rassemblés sous la bannière hitlérienne: des ouvriers re-belles, des resca-pés de l'aventure des Corps Francs de la Baltique, des boutiquiers en colère qui veulent faire supprimer les magasins à rayons multiples, des entrepreneurs qui veulent la paix sociale et des débouchés extérieurs nouveaux. Sur le plan de la politique étrangère, les options sont également diverses: alliance avec l'Italie fasciste contre le bolchévisme; al-lian-ce de tous les pays germaniques avec mini-misation des rapports avec les peuples du Sud, décrétés "fellahisés"; alliance avec une Russie redevenue plus nationale et débarrassée de ses velléités communistes et internationalistes, afin de forger un pacte indéfectible des "have-nots" con-tre les nations capitalistes. De plus, la NSDAP des premières années du pouvoir, compte dans ses rangs des fédéra-listes bavarois et des centralistes prussiens, des catho-liques et des protestants convaincus, et, enfin, des mi-litants farouchement hostiles à toutes les formes de christianisme.
Cette panade idéologique complexe est le propre des partis de masse et Hitler, pour des raisons pratiques et tactiques, tenait à ce que le flou soit conservé, afin de garder un maximum de militants et d'électeurs. Avant la prise du pou-voir, plusieurs tenants de la KR avaient constaté que cette démagogie contribuerait tôt ou tard à falsifier et à galvauder l'idée précise, tranchée et argu-mentée qu'ils se faisaient de la nation. Pour éviter l'avènement de la falsification nationale-socialiste et/ou communiste, il fallait à leurs yeux créer un "troisième front" (Dritte Front), basé sur une synthèse cohérente et destiné à remplacer le système de Weimar. Entre le drapeau rouge de la KPD et les chemises brunes de la NSDAP, les dissidents optent pour le drapeau noir de la révolte paysanne, hissé par les révoltés du XVIième siècle et par les amis de Claus Heim (12). Le drapeau noir est "le dra-peau de la terre et de la misère, de la nuit allemande et de l'état d'alerte".
Le rôle de Hans Zehrer
L'un des partisans les plus chaleureux de ce "troisième front" fut Hans Zehrer, éditeur de la revue Die Tat d'octobre 1931 à 1933. Dans un article intitulé signifi-cativement Rechts oder Links? (Die Tat, 23. Jg., H.7, Okt. 1931), Zehrer explique que l'anti-libéralisme en Allemagne s'est scindé en deux ailes, une aile droite et une aile gauche. L'aile droite puise dans le réservoir des sentiments nationaux mais fait passer les questions sociales au second plan. L'aile gauche, elle, accorde le primat aux questions sociales et tente de gagner du ter-rain en matière de nationalisme. Le camp des anti-libéraux est donc partagé entre deux pôles: le national et le social. Cette opposition risque à moyen ou long terme d'épuiser les combattants, de lasser les masses et de n'aboutir à rien. En fin de course, les appareils dirigeants des partis communiste et national-socialiste ne défendent pas les intérêts fondamentaux de la po-pulation, mais exclusive-ment leurs propres intérêts. Les bases des deux partis devraient, écrit Zehrer, se détourner de leurs chefs et se regrouper en une "troisième communauté", qui serait la synthèse parfaite des pôles social et national, antagonisés à mau-vais escient.
Derrière Zehrer se profilait l'ombre du Général von Schleicher qui, lui, cherchait à sauver Weimar en atti-rant dans un "troisième front" les groupes socialisants internes à la NSDAP (Gre-gor Strasser), quelques syn-dicalistes sociaux-dé-mocrates, etc. Mais l'assem-bla-ge était trop hétéroclite: KPD et NSDAP ré-sistent à l'entre-prise de fractionnement. Le "troisième front" ne sera qu'un rassemblement de groupes situés "entre deux chaises", sans force motrice dé-cisive.
Robert STEUCKERS.
(La suite de cette recension, rendant compte d'un ouvrage abso-lument capital pour comprendre le mouvement des idées poli-tiques de notre siècle, paraîtra dans nos éditions ultérieures. Nous mettrons l'accent sur les fondements philosophiques de la KR et sur ses principaux groupes).
Armin MOHLER, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch (Dritte, um einen Ergänzungsband erweiterte Auflage 1989), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-stadt, 1989, I-XXX + 567 S., Ergänzungsband, I-VIII + 131 S., DM 89 (beide zusammen); DM 37 (Ergänzungsband einzeln).
00:09 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, weimar, années 20, années 30, conservatisme, droite, national-bolchevisme, national-communisme, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 31 mai 2009
Les aventuriers de la contre-révolution
Les aventuriers de la contre-Révolution
Paul-François Paoli
09/04/2009 | http://www.lefigaro.fr/
Nous sommes le 26 décembre 1799 dans un salon parisien où se croisent les intrigants de tous bords. Un homme jeune y entre, grand, mince, habillé comme un monsieur. Il s'appelle Jean-Guillaume Hyde de Neuville et, grâce à l'entremise de Talleyrand, s'apprête à rencontrer Bonaparte. Le premier consul, qui vient d'accéder au pouvoir après le coup d'État du 18 Brumaire, veut pacifier la Vendée et tend la main aux chouans. Le jeune aristocrate, qui, depuis la Terreur, est de tous les combats de la contre-Révolution, saisit l'occasion de parlementer. L'attente dure et l'émissaire royaliste songe à la finalité de sa mission qui va se révéler chimérique : installer Louis XVIII sur le trône avec l'aide d'un général que les jacobins considèrent désormais comme un traître à la République. Quand Bonaparte survient, Hyde de Neuville ne le reconnaît pas. « Petit, maigre, les cheveux collés sur les tempes, la démarche hésitante, il ne ressemble en rien au général qu'imagine Hyde. Sans doute, pense-t-il, est-ce là un serviteur. L'homme s'adosse à la cheminée, redresse la tête et regarde Hyde. Il le fixe avec une telle expression et une telle pénétration que celui-ci perd toute assurance, sous le feu de l'œil investigateur d'un homme qui grandit d'un coup de cent coudées. »
Racontée par l'historien Jean-Paul Bertaud dans Les Royalistes et Napoléon, cette scène digne des Chouans de Balzac donne la mesure de la tragédie qui déchire la France. Hyde de Neuville et Bonaparte se combattent, mais, d'une certaine manière, ils se ressemblent : ce sont des guerriers habités par le sens de l'honneur et l'ambition politique. D'ailleurs, ils se sont déjà affrontés. Le 5 octobre 1795, Hyde de Neuville faisait partie de la manifestation royaliste du 13 vendémiaire que le général corse a fait mitrailler pour sauver le Directoire. Depuis, Bonaparte a conquis ses galons, en Italie et en Égypte, avant de prendre le pouvoir. Il veut intégrer les aristocrates à son grand projet de refondation des élites et rêve de réussir une synthèse entre le meilleur de l'Ancien Régime, l'esprit chevaleresque, et l'acquis fondamental de la Révolution, dont il a lui-même bénéficié : la promotion par le mérite. Homme d'ordre, plutôt que jacobin, il tente de mettre un terme à la guerre civile qui déchire le pays. Malgré le ralliement de nombreux émigrés et le concordat avec le Pape qui restaure les droits de l'autel en 1801, il n'y parviendra jamais vraiment.
Un enracinement populaire
C'est l'histoire de cet échec que raconte Bertaud dans cet essai qui retrace la destinée de quelques hautes figures du royalisme français. Nul n'ignore l'existence de Cadoudal, que Bonaparte admirait pour sa bravoure, ou du duc d'Enghien dont l'exécution honteuse tache le règne napoléonien, mais qui connaît la vie haute en couleur de Jean-Guillaume Hyde de Neuville ou d'Armand Victor Le Chevalier, conspirateur qui sera fusillé après avoir multiplié les complots ? Au passage, Bertaud montre que la contre-Révolution ne peut être réduite à des groupuscules d'émigrés aigris stipendiés par les monarchies étrangères. Son enracinement populaire est patent dans le Midi et l'ouest de la France, mais aussi en Normandie. « Le Chevalier n'a jamais aimé les Anglais, leur assistance et leur influence toujours calculées lui sont insupportables. Il a décidé de ne pas les attendre et de recruter une armée parmi les paysans qu'il entretient depuis toujours dans l'esprit de révolte. » Incarcéré par Fouché, le ministre de la Police, il lui écrit : « J'ai projeté une insurrection contre Napoléon (…) mais l'idée d'un assassinat ne s'est jamais présentée à mon esprit et lorsqu'on me l'a offerte, je l'ai réprouvée avec indignation parce que je trouve indigne d'un homme d'honneur de se servir, contre ses ennemis, des moyens qu'ils trouveraient méprisables contre lui-même. »
Bertaud a raison d'affirmer que si les royalistes sont les témoins d'un monde révolu, ils sont aussi les visionnaires du monde à venir : où le pouvoir de l'État, le plus froid des monstres froids, va s'accroître aux dépens des libertés, et où l'idéologie ne fera plus très grand cas de la vie humaine. Les royalistes sont, pour beaucoup d'entre eux, des romantiques qui refusent la marche du temps. « Le retour à un âge médiéval, où le rêve l'emporte sur la réalité, est au cœur du modèle contre-révolutionnaire qui habite les royalistes depuis un quart de siècle. Pour eux la féodalité est l'âge d'or. Les hommes y vivaient selon le pacte passé entre le Ciel et la Terre et la chevalerie imposait à tous ses valeurs : courage et maîtrise de soi, respect de la parole donnée, désintéressement et protection des faibles », écrit Bertaud. Ce n'est pas pour rien que Chateaubriand, Vigny, Balzac et Barbey d'Aurevilly furent royalistes. La littérature, en somme, leur doit beaucoup. Quant à l'historiographie de la Révolution française, marquée chez nous par la prégnance de l'interprétation jacobine, elle les a trop souvent caricaturés en défenseurs d'un ordre ranci.
Les Royalistes et Napoléon de Jean-Paul Bertaud, Flammarion, 459p., 25 €.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : napoléon, bonaparte, contre-révolution, conservatisme, royalisme, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 mai 2009
Erik von Kuehnelt-Leddihn (1909-1999), der liberalkonservative Monarchist
Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn (1909-1999), der liberalkonservative Monarchist
Auch Julius Evola, ein brillanter, wenn auch perverser Denker der heidnischen Rechten, betrachtete den Faschismus als eine Bewegung der Linken, die nichts mit der wahren Rechten zu tun hatte.
(Eine Sprachregulierung: Was ist „faschistisch“?)
Allerdings hatte vieles was Kuehnelt-Leddihn in seiner persönlichen Gleichung lieb und rechts war, auch nichts mit der wahren Rechten zu tun. Dies gilt an erster Stelle für seinen ultrakapitalistischen Wirtschaftsliberalismus (der Freund Hayeks war auch in der Mont Pèlerin Society), der gerade die bürgerlichen Zerstörer der alten aristokratischen Ordnung abfeierte und den er gegen links verteidigte, nicht verstehend oder akzeptierend, daß die stets beklagte Proletarisierung und Egalitarisierung eben die Konsequenz dieser Freihandelsvergötzung war. Aber er war auch der Auffassung, die Monarchie würde den wirklichen Liberalismus (englisch und nicht französisch verstanden, empiristisch und nicht rationalistisch) schützen. Dazu kam sein Unverständnis für alle Konservative, die nicht katholisch sind. Wobei sein Katholizismus andererseits wiederum - entgegen gerade wieder verbreiteten Gerüchten - sehr liberal war (sein Verlag wirbt wohl zurecht mit einem Zitat des liberalkonservativen Paradetheologen Hans Urs von Balthasar), der Ökumene zugewandt, insbesondere philojudaistisch, nur nicht linkskatholisch (Befreiungstheologie, feministische Theologie, usw.), aber ganz gegen die "Traditionalisten" wie Marcel Lefebvre gerichtet, den er mit Martin Luther verglichen hat und dies nicht nur wegen des Ungehorsams, sondern auch weil er ihn als mittelalterlich empfand. (Tatsächlich war Kuehnelt-Leddihn ja wie die meisten "Konservativen" sehr fortschrittlich, er nannte dies "additiv"; siehe auch: Konservativismus und Subversion) Die "Tradition" in einem übergeordneten, integralen Sinne hat er wohl trotz seiner Begegnung(en) mit Evola nicht verstanden. Für ihn war nur ein christlicher Staat als Pyramide gedacht - entgegen dem ja gerade dem Christentum entstammenden Gleichheitsprinzip - akzeptabel, nicht-christliche "Pyramiden"-Gesellschaft, was wir als Kastensystem bezeichnen würden, waren für ihn so unakzeptabel wie egalisierte Gesellschaften:
Und ein heidnischer Vertikalismus kann furchtbar sein. Corruptio optimi pessima, hatte uns schon der Aquinate gewarnt. Das fühlte ich schon einmal in der Anwesenheit vom Baron Giulio Evola, der einer der brillantesten Verteidiger der atheistischen oder agnostischen Rechten war. Dieser Mann, der durch die Rachebombardierung der Alliierten auf Wien im März 1945 querschnittgelähmt war, redete zu mir in kalter Verachtung wie ein amerikanischer College-Professor zu einem Dshu-Dshu Praktiker am oberen Ubangi.
(Weltweite Kirche. Begegnungen und Erfahrungen in sechs Kontinenten 1909-1999; Stein am Rhein 2000; S. 502)
Das Bonmot, den adeligen Dandy mit einem US-College-Professor zu vergleichen, ist wieder Erik von Kuehnelt-Leddihn in einer Nußschale: so originell wie schief. Bei aller, kaum verdeckten Boshaftigkeit ("perverser Denker", "agnostische Rechte") war der Ritter, der im Juli vor 100 Jahren in Tobelbad geboren wurde und im Mai vor 10 Jahren in Lans gestorben ist, persönlich wohl liebenswert wie eine Figur aus einem Roman des Co-Wahltirolers Ritter Fritz von Herzmanovsky-Orlando: ein Dshu-Dshu Praktiker am oberen Ubangi der Tarockei.
15:04 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politique, théorie politique, conservatisme, droite, monarchisme, hommage, biographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
G. Maschke: Der Engel der Vernichtung

Dossier "Günter Maschke"
Der Engel der Vernichtung
Angriff gegen den aufklärerischen Optimismus, verdunkelt von Kraftworten: Zum 250. Geburtstag von Joseph de Maistre
Ex: http://www.jungefreiheit.de/
Günter Maschke
La neve sulla tosta, ma il fuoco nella bocca!", rief ein begeisterter Italiener aus, der das einzige überlieferte Portrait Joseph de Maistres betrachtete, das kurz vor dessen Tode entstand. Das Haupt weiß, wie von Schnee bedeckt und aus dem Munde strömt Feuer: De Maistre gehört zu den wenigen Autoren, die mit zunehmenden Jahren stets nur radikaler und schroffer wurden und sich der sanft korrumpierenden Weisheit des Alters entschlungen, gemäß der man versöhnlicher zu werden habe und endlich um die Reputation bemüht sein müsse. Fors do l'honneur nul souci, außer der Ehre keine Sorge, war der Wahlspruch des Savoyarden, und zu seiner Ehre gehörte es, immer unvermittelter, schonungsloser und verblüffender das Seine zu sagen.
Der Ruhm de Maistres verdankt sich seinen Kraftworten, mit denen er den ewigen Gutmenschen aufschreckt, der sich's inmitten von Kannibalenhumanität und Zigeunerliberalismus bequem macht. "Der Mensch ist nicht gut genug, um frei zu sein", ist wohl noch das harmloseste seiner Aperçus, das freilich, wie alles Offenkundige, aufs Äußerste beleidigt. Beharrliche Agnostiker und schlaue Indifferenzler entdecken plötzlich ihre Liebe zur Wahrheit und erregen sich über den kaltblütigen Funktionalismus de Maistres, schreibt dieser: "Für die Praxis ist es gleichgültig, ob man dem Irrtum nicht unterworfen ist oder ob man seiner nicht angeklagt werden darf. Auch wenn man damit einverstanden ist, daß dem Papste keine göttliche Verheißung gegeben wurde, so wird er dennoch, als letztes Tribunal, nicht minder unfehlbar sein oder als unfehlbar angesehen werden: Jedes Urteil, an das man nicht appellieren kann, muß, unter allen nur denkbaren Regierungsformen, in der menschlichen Gesellschaft als gerecht angesehen werden. Jeder wirkliche Staatsmann wird mich wohl verstehen, wenn ich sage, daß es sich nicht bloß darum handelt, zu wissen, ob der Papst unfehlbar ist, sondern ob er es sein müßte. Wer das Recht hätte, dem Papste zu sagen, daß er sich geirrt habe, hätte aus dem gleichen Grunde auch das Recht, ihm den Gehorsam zu verweigern."
Der Feind jeder klaren und moralisch verpflichtenden Entscheidung erschauert vor solchen ganz unromantischen Forderungen nach einer letzten, alle Diskussionen beendenden Instanz und angesichts der Subsumierung des Lehramtes unter die Jurisdiktionsgewalt erklärt er die Liebe und das Zeugnisablegen zur eigentlichen Substanz des christlichen Glaubens, den er doch sonst verfolgt und haßt, weiß er doch, daß diesem die Liebe zu Gott wichtiger ist als die Liebe zum Menschen, dessen Seele "eine Kloake" (de Maistre) ist.
Keine Grenzen mehr aber kennt die Empörung, wenn de Maistre, mit der für ihn kennzeichnenden Wollust an der Provokation, den Henker verherrlicht, der, zusammen mit dem (damals) besser beleumundeten Soldaten, das große Gesetz des monde spirituel vollzieht und der Erde, die ausschließlich von Schuldigen bevölkert ist, den erforderlichen Blutzoll entrichtet. Zum Lobpreis des Scharfrichters, der für de Maistre ein unentbehrliches Werkzeug jedweder stabilen gesellschaftlichen Ordnung ist, gesellt sich der Hymnus auf den Krieg und auf die universale, ununterbrochene tobende Gewalt und Vernichtung: "Auf dem weiten Felde der Natur herrscht eine manifeste Gewalt, eine Art von verordneter Wut, die alle Wesen zu ihrem gemeinsamen Untergang rüstet: Wenn man das Reich der unbelebten Natur verläßt, stößt man bereits an den Grenzen zum Leben auf das Dekret des gewaltsamen Todes. Schon im Pflanzenbereich beginnt man das Gesetz zu spüren: Von dem riesigen Trompetenbaum bis zum bescheidensten Gras - wie viele Pflanzen sterben, wie viele werden getötet!"
Weiter heißt es in seiner Schrift "Les Soirées de Saint Pétersbourg" (1821): "Doch sobald man das Tierreich betritt, gewinnt das Gesetz plötzlich eine furchterregende Evidenz. Eine verborgene und zugleich handgreifliche Kraft hat in jeder Klasse eine bestimmte Anzahl von Tieren dazu bestimmt, die anderen zu verschlingen: Es gibt räuberische Insekten und räuberische Reptilien, Raumvögel, Raubfische und vierbeinige Raubtiere. Kein Augenblick vergeht, in dem nicht ein Lebewesen von einem anderen verschlungen würde.
Über alle diese zahllosen Tierrassen ist der Mensch gesetzt, dessen zerstörerische Hand verschont nichts von dem was lebt. Er tötet, um sich zu nähren, er tötet, um sich zu belehren, er tötet, um sich zu unterhalten, er tötet, um zu töten: Dieser stolze, grausame König hat Verlangen nach allem und nichts widersteht ihm. Dem Lamme reißt er die Gedärme heraus, um seine Harfe zum Klingen zu bringen, dem Wolf entreißt er seinen tödlichsten Zahn, um seine gefälligen Kunstwerke zu polieren, dem Elefanten die Stoßzähne, um ein Kinderspielzeug daraus zu schnitzen, seine Tafel ist mit Leichen bedeckt. Und welches Wesen löscht in diesem allgemeinen Schlachten ihn aus, der alle anderen auslöscht? Es ist er selbst. Dem Menschen selbst obliegt es, den Menschen zu erwürgen. Hört ihr nicht, wie die Erde schreit nach Blut? Das Blut der Tiere genügt ihr nicht, auch nicht das der Schuldigen, die durch das Schwert des Gesetzes fallen. So wird das große Gesetz der gewaltsamen Vernichtung aller Lebewesen erfüllt. Die gesamte Erde, die fortwährend mit Blut getränkt wird, ist nichts als ein riesiger Altar, auf dem alles, was lebt, ohne Ziel, ohne Haß, ohne Unterlaß geopfert werden muß, bis zum Ende aller Dinge, bis zur Ausrottung des Bösen, bis zum Tod des Todes."
Im Grunde ist dies nichts als eine, wenn auch mit rhetorischem Aplomb vorgetragene banalité supérieure, eine Zustandsbeschreibung, die keiner Aufregung wert ist. So wie es ist, ist es. Doch die Kindlein, sich auch noch die Reste der Skepsis entschlagend, die der frühen Aufklärung immerhin noch anhafteten, die dem Flittergold der humanitären Deklaration zugetan sind (auch, weil dieses sogar echtes Gold zu hecken vermag), die Kindlein, sie hörten es nicht gerne.
Der gläubige de Maistre, der trotz all seines oft zynisch wirkenden Dezisionismus unentwegt darauf beharrte, daß jede grenzenlose irdische Macht illegitim, ja widergöttlich sei und der zwar die Funktionalisierung des Glaubens betrieb, aber auch erklärte, daß deren Gelingen von der Triftigkeit des Glaubens abhing - er wurde flugs von einem bekannten Essayisten (Isaiah Berlin) zum natürlich 'paranoiden' Urahnen des Faschismus ernannt, während der ridiküle Sohn eines großen Ökonomen in ihm den verrucht-verrückten Organisator eines anti-weiblichen Blut- und Abwehrzaubers sah, einen grotesken Medizinmann der Gegenaufklärung. Zwischen sich und der Evidenz hat der Mensch eine unübersteigbare Mauer errichtet; da ist des Scharfsinns kein Ende.
Der hier und in ungezählten anderen Schriften sich äußernde Haß auf den am 1. April 1753 in Chanbéry/Savoyen geborenen Joseph de Maistre ist die Antwort auf dessen erst in seinem Spätwerk fulminant werdenden Haß auf die Aufklärung und die Revolution. Savoyen gehörte damals dem Königreich Sardinien an und der Sohn eines im Dienste der sardischen Krone stehenden Juristen wäre wohl das ehrbare Mitglied des Beamtenadels in einer schläfrigen Kleinstadt geblieben, ohne intellektuellen Ehrgeiz und allenfalls begabt mit einer außergewöhnlichen Liebenswürdigkeit und Höflichkeit in persönlich-privaten Dingen, die die "eigentliche Heimat aller liberalen Qualitäten" (Carl Schmitt) sind.
Der junge Jurist gehörte gar einer Freimaurer-Loge an, die sich aber immerhin kirchlichen Reunionsbestrebungen widmet; der spätere, unnachgiebige Kritiker des Gallikanismus akzeptiert diesen als selbstverständlich; gelegentlich entwickelte de Maistre sogar ein wenn auch temperiertes Verständnis für die Republik und die Revolution. Der Schritt vom aufklärerischen Scheinwesen zur Wirklichkeit gelang de Maistre erst als Vierzigjährigem: Als diese in Gestalt der französischen Revolutionstruppen einbrach, die 1792 Savoyen annektierten. De Maistre mußte in die Schweiz fliehen und verlor sein gesamtes Vermögen.
Erst dort gelang ihm seine erste, ernsthafte Schrift, die "Considérations sur la France" (Betrachtungen über Frankreich), die 1796 erschien und sofort in ganz Europa Furore machte: Die Restauration hatte ihr Brevier gefunden und hörte bis 1811 nicht auf, darin mehr zu blättern als zu lesen. Das Erstaunliche und viele Irritierende des Buches ist, daß de Maistre hier keinen Groll gegen die Revolution hegt, ja, ihr beinahe dankbar ist, weil sie seinen Glauben wieder erweckte. Zwar lag in ihr, wie er feststellte, "etwas Teuflisches", später hieß es sogar, sie sei satanique dans sons essence. Doch weil dies so war, hielt sich de Maistres Erschrecken in Grenzen. Denn wie das Böse, so existiert auch der Teufel nicht auf substantielle Weise, ist, wie seine Werke, bloße Negation, Mangel an Gutem, privatio boni. Deshalb wurde die Revolution auch nicht von großen Tätern vorangetrieben, sondern von Somnambulen und Automaten: "Je näher man sich ihre scheinbar führenden Männer ansieht, desto mehr findet man an ihnen etwas Passives oder Mechanisches. Nicht die Menschen machen die Revolution, sondern die Revolution benutzt die Menschen."
Das bedeutete aber auch, daß Gott sich in ihr offenbarte. Die Vorsehung, die providence, leitete die Geschehnisse und die Revolution war nur die Züchtigung des von kollektiver Schuld befleckten Frankreich. Die Furchtbarkeit der Strafe aber bewies Frankreichs Auserwähltheit. Die "Vernunft" hatte das Christentum in dessen Hochburg angegriffen, und solchem Sturz konnte nur die Erhöhung folgen. Die Restauration der christlichen Monarchie würde kampflos vonstatten gehen; die durch ihre Gewaltsamkeit verdeckte Passivität der Gegenrevolution, bei der die Menschen nicht minder bloßes Werkzeug sein würden. Ohne Rache, ohne Vergeltung, ohne neuen Terror würde sich die Gegenrevolution, genauer, "das Gegenteil einer Revolution", etablieren; sie käme wie ein sich sanftmütig Schenkender.
Die konkrete politische Analyse aussparen und direkt an den Himmel appellieren, wirkte das Buch als tröstende Stärkung. De Maistre mußte freilich erfahren, daß die Revolution sich festigte, daß sie sich ihre Institution schuf, daß sie schließlich, im Thermidor und durch Bonaparte, ihr kleinbürgerlich-granitenes Fundament fand.
Von 1803 bis 1817 amtierte de Maistre als ärmlicher, stets auf sein Gehalt wartender Gesandter des Königs von Sardinien, der von den spärlichen Subsidien des Zaren in Petersburg lebt - bis er aufgrund seiner lebhaften katholischen Propaganda im russischen Hochadel ausgewiesen wird. Hier entstehen, nach langen Vorstudien etwa ab 1809, seine Hauptwerke: "Du Pape" (Vom Papste), publiziert 1819 in Lyon, und "Les Soirées de Saint Pétersbourg" (Abendgespräche zu Saint Petersburg), postum 1821.
Die Unanfechtbarkeit des Papstes, von der damaligen Theologie kaum noch verfochten, liegt für de Maistre in der Natur der Dinge selbst und bedarf nur am Rande der Theologie. Denn die Notwendigkeit der Unfehlbarkeit erklärt sich, wie die anderer Dogmen auch, aus allgemeinen soziologischen Gesetzen: Nur von ihrem Haupte aus empfangen gesellschaftliche Vereinigungen dauerhafte Existenz, erst vom erhabenen Throne ihre Festigkeit und Würde, während die gelegentlich notwendigen politischen Interventionen des Papstes nur den einzelnen Souverän treffen, die Souveränität aber stärken. Ein unter dem Zepter des Papstes lebender europäischer Staatenbund - das ist de Maistres Utopie angesichts eines auch religiös zerspaltenen Europa. Da die Päpste die weltliche Souveränität geheiligt haben, weil sie sie als Ausströmungen der göttlichen Macht ansahen, hat die Abkehr der Fürsten vom Papst diese zu verletzlichen Menschen degradiert.
Diese für viele Betrachter phantastisch anmutende Apologie des Papsttums, dessen Stellung durch die Revolution stark erschüttert war, führte, gegen immense Widerstände des sich formierenden liberalen Katholizismus, immerhin zur Proklamation der päpstlichen Unfehlbarkeit durch Pius IX. auf dem 1869 einberufenen Vaticanum, mit dem der Ultramontanismus der modernen, säkularisierten Welt einen heftigen, bald aber vergeblichen Kampf ansagte.
Die "Soirées", das Wesen der providence, die Folgen der Erbsünde und die Ursachen des menschlichen Leidens erörternd, sind der vielleicht schärfste, bis ins Satirische umschlagende Angriff gegen den aufklärerischen Optimismus. Hier finden sich in tropischer Fülle jene Kraftworte de Maistres, die, gerade weil sie übergrelle Blitze sind, die Komplexität seines Werkes verdunkeln und es als bloßes reaktionäres Florilegium erscheinen lassen.
De Maistre, der die Leiden der "Unschuldigen" ebenso pries wie die der Schuldigen, weil sie nach einem geheimnisvollen Gesetz der Reversibilität den Pardon für die Schuldigen herbeiführen, der die Ausgeliefertheit des Menschen an die Erbsünde in wohl noch schwärzeren Farben malte als Augustinus oder der Augustinermönch Luther und damit sich beträchtlich vom katholischen Dogma entfernte, der nicht müde wurde, die Vergeblichkeit und Eitelkeit alles menschlichen Planens und Machens zu verspottern, - er mutete und mutet vielen als ein Monstrum an, als ein Prediger eines terroristischen und molochitischen Christentum.
Doch dieser Don Quijote der Laientheologie - doch nur die Laien erneuerten im 19. Jahrhundert die Kirche, deren Klerus schon damals antiklerikal war! -, der sich tatsächlich vor nichts fürchtete, außer vor Gott, stimmt manchen Betrachter eher traurig. Weil er, wie Don Quijote, zumindest meistens recht hatte. Sein bis ins Fanatische und Extatische gehender Kampf gegen den Lauf der Zeit ist ja nur Gradmesser für den tiefen Sturz, den Europa seit dem 13. Jahrhundert erlitt, als der katholische Geist seine großen Monumente erschuf: Die "Göttliche Komödie" Dantes, die "Siete Partidas" Alfons' des Weisen, die "Summa" des heiligen Thomas von Aquin und den Kölner Dom.
Diesem höchsten Punkt der geistigen Einheit und Ordnung Europas folgte die sich stetig intensivierende Entropie, die, nach einer Prognose eines sanft gestimmten Geistesverwandten, des Nordamerikaners Henry Adams (1838-1918), im zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhundert zur völligen spirituellen, aber auch politischen und sittlichen Anomie führen würde.
Der exaltierte Privatgelehrte, der in St. Petersburg aufgrund seiner unbedeutenden Tätigkeit genug Muße fand, sagte als erster eine radikale, blutige Revolution in Rußland voraus, geleitet von einem "Pugatschev der Universität", was wohl eine glückliche Definition Lenins ist. Die Prophezeiung wurde verlacht, war Rußland doch für alle ein Bollwerk gegen die Revolution. Er entdeckte, neben Louis Vicomte de Bonald (1754-1840), die Gesetze politisch-sozialer Stabilität, die Notwendigkeit eines bloc des idées incontestables, Gesetze, deren Wahrheit sich gerade angesichts der Krise und des sozialen Atomismus erwies: Ohne Bonald und de Maistre kein August Comte und damit auch keine Soziologie, deren Geschichte hier ein zu weites Feld wäre. De Maistre, Clausewitz vorwegnehmend und Tolstois und Stendhals Schilderung befruchtend, erkannte als erster die Struktur der kriegerischen Schlacht und begriff, daß an dem großen Phänomen des Krieges jedweder Rationalismus scheitert; der Krieg war ihm freilich göttlich, nicht wie den meist atheistischen Pazifisten ein Teufelswerk; auch ihn durchwaltete die providence.
Endlich fand de Maistre den Mut zu einer realistischen Anthropologie, die Motive Nietzsches vorwegnahm und die der dem Humanitarismus sich ausliefernden Kirche nicht geheuer war: Der Mensch ist beherrscht vom Willen zur Macht. Vom Willen zur Erhaltung der Macht, vom Willen zur Vergrößerung der Macht, von Gier nach dem Prestige der Macht. Diese Folge der Erbsünde bringt es mit sich, daß, so wie die Sonne die Erde umläuft, der "Engel der Vernichtung" über der Menschheit kreist - bis zum Tod des Todes.
Am 25. Februar 1821 starb Joseph de Maistre in Turin. "Meine Herren, die Erde bebt, und Sie wollen bauen!" - so lauteten seine letzten Worte zu den Illusionen seiner konservativen Freunde. Das war doch etwas anderes als - Don Quijote.
Günter Maschke lebt als Privatgelehrter und Publizist in Frankfurt am Main. Zusammen mit Jean-Jacques Langendorf ist er Hausgeber der "Bibliothek der Reaktion" im Karolinger Verlag, Wien. Von Joseph de Maistre sind dort die Bücher "Betrachtungen über Frankreich", "Die Spanische Inquisition" und "Über das Opfer" erschienen.
00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, réaction, sciences politiques, théorie politique, france, révolution française, contre-révolution, conservatisme, catholicisme, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 mai 2009
Présentation des options philosophiques et politiques de "Synergies Européennes"

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Robert STEUCKERS:
Présentation des options philosophiques et politiques de “Synergies Européennes”
Lande de Lüneburg, 5 avril 1997
Pourquoi le terme “synergie”?
Pourquoi avons-nous choisi, pour désigner notre mouvement, d'adopter le terme de “synergie”, et non pas un autre terme, plus politique, plus ancré dans un champ idéologique clairement profilé? Pourquoi employons-nous un vocable qui ne laisse deviner aucun ancrage politique précis? En effet, la notion de “synergie” ne se laisse ancrer ni à droite ni à gauche. Au départ, “synergie” est un concept issu de la théologie, tout comme, d'ailleurs, tous les autres concepts politiques, même après la phase de neutralisation des effervescences religieuses qu'a connue la modernité à ses débuts, au XVIIième siècle. Pour Carl Schmitt, tous les concepts prégnants de la politique sont des concepts théologiques sécularisés. Dans le langage des théologiens, une “synergie” s'observe quand des forces différentes, des forces d'origines différentes, de nature différente, entrent en concurrence ou joignent leurs efforts pour atteindre en toute indépendance un objectif commun. Nos objectifs principaux, dûment inscrits dans notre charte, visent, d'une part, la liberté et la pluralité dans la vie quotidienne, d'autre part, la capacité de décider en cas de situation exceptionnelle. L'erreur des idéologies dominantes de ce siècle, c'est justement d'avoir pensé séparément la liberté de la décision.
- Ou bien l'on croyait, avec Kelsen notamment, que l'effervescence et les turbulences du monde cesseraient définitivement et qu'une ère de liberté éternelle s'ouvrirait sans que les hommes politiques n'aient plus jamais à prendre de décisions. Fukuyama a réactualisé ce vœu de “fin de l'histoire”, il y a six ou sept ans.
- Ou bien on ne croyait qu'à la seule décision virile, comme les fascismes quiritaires, et on voulait maximiser à outrance la quantité de décisions suivies d'effets “constructifs”; de cette façon, on a contraint certains peuples à vivre dans une tension permanente, obligé les strates paisibles de la société à vivre comme les élites conquérantes ou les soldats sur la brèche, on a négligé l'organisation du quotidien, qui ne postulait nullement cette perpétuelle effervescence de la mobilisation permanente et totale. Les fascismes quiritaires, le national-socialisme n'ont généré ni un droit propre (si ce n'est une opposition systématique aux “paragraphes abstraits”) ni une constitution ni restauré un droit jurisprudentiel à la façon anglaise (au grand dam d'un juriste comme Koellreutter, qui a oscillé entre le droit anglais et le national-socialisme!). Aucun corpus doctrinal de ce siècle, d'après 1919, n'a su ou voulu penser conjointement et harmonieusement ces deux impératifs, ces deux nécessités:
1) se tenir prêt pour faire face aux imprévus qui s'abattent sans cesse sur le monde et sur l'histoire des hommes (ce que voulaient les décisionnistes);
2) organiser le quotidien dans la cohérence, sur le long terme (ce que voulaient les constitutionnalistes).
Une bonne part du débat politique de fond a tourné autour de l'opposition binaire entre “décisionnistes” (assimilés aux fascistes ou aux conservateurs) et “quotidiennistes” (qui survalorisaient l'Alltäglichkeit, le “règne du on”, les jugeant plus “moraux“ parce que leur marque principale était la quiétude). La nécessité d'organiser le quotidien dans la cohérence et sur le long terme n'exclut pas la nécessité impérieuse de la décision, de faire face à l'imprévu ou à la soudaineté.
Un projet politique d'avenir doit donc nécessairement reposer sur une capacité d'appréhension à la fois de la décision et du quotidien. Comment décision et quotidien ont-ils été appréhendés dans les idéologies dominantes de la gauche et de la droite? Pourquoi les modes d'appréhension de ces droites et de ces gauches dominantes ont-ils été insuffisants?
A droite: un fusionisme sans souci des valeurs
Dans le camp des droites, du conservatisme ou du national-conservatisme, il n'y a pas d'homogénéité dans l'appréhension de la liberté (entendue au sens d'absence de mobilisation politique permanente) ou de la décision. Quelques exemples: au temps de la guerre froide, terminée avec l'effondrement du Mur de Berlin en 1989, la liberté, disait-on, surtout aux Etats-Unis, s'opposait au communisme, quintessence de la non-liberté et idéologie fortement mobilisatrice. Hannah Arendt écrivait que le stalinisme, au début des années 50, était l'incarnation de l'“autoritarisme”, qui avait pris, jadis, tour à tour, un visage clérical, militariste, fasciste, etc. A la fin des années 50, pour faire pièce aux gauches étatistes, communistes, socialistes ou keynésiennes, le monde politique américain lance l'expérience du “fusionisme”, soit l'alliance des conservateurs anti-communistes et des libertaires anti-autoritaires, c'est-à-dire des partisans d'une société civile sans élites mobilisatrices et quiritaires, axée sur l'économie, le commerce et la technique, et les partisans d'une sorte de “leisure society”, propre des rentiers et des artistes situés en dehors de tout circuit économique fonctionnant. Dans ce fusionisme, la question des valeurs reste sans solution. Parce que les valeurs habituellement attribuées au conservatisme, comme le sens du devoir, se marient mal avec les options des libertaires, on fait, par calcul politicien, l'impasse sur la valeur “devoir”, cardinale pour toute philosophie cohérente et stable de la Cité. On se rend forcément compte que la notion de devoir limite la liberté (du moins si on entend par liberté la licence ou la permissivité), ce que n'acceptent pas les alliés libertaires et anarchisants. Du fusionisme découle le conservatisme technocratique, qui se passe de toute référence à des valeurs mobilisantes et cimentantes et esquive de ce fait la question de la justice qui repose inévitablement sur une table de valeurs, située au-delà des intérêts matériels et économiques. Ainsi, les communautés ou les résidus de communauté perdent leur cohésion, en dépit des politiques conservatrices.
Fusionisme et conservatisme technocratique prennent le pas sur les conservateurs axiologiques (Wertkonservativen) ou les conservateurs décisionnistes, ruinant ainsi l'homogénéité de la droite et annonçant à plus ou moins long terme d'autres recompositions (même si elles se font encore attendre). Autres exemples: au niveau de la politique économique, axiologistes et décisionnistes chercheront généralement à inscrire des valeurs dans leur praxis économique. Ils s'opposeront dès lors forcément au néo-libéralisme ou à toute forme de globalisation inscrite sous le signe de cette idéologie strictement économique. Fusionistes et technocrates accorderont la priorité à l'efficacité et tolèreront les pratiques néo-libérales du profit à très court terme, considérant que la globalisation est inévitable et que la société qu'ils sont appelés à gérer n'aura pour seule originalité que d'être une niche particulière parmi d'autres niches particulières dans le processus général de globalisation, une niche qu'on nettoiera de ses particularités et où règneront, finalement, les mêmes principes que ceux de la globalisation.
Des idéologies qui donnent la priorité aux valeurs
En Europe, face à la problématique de l'unification européenne, si l'on donne la priorité aux valeurs, on sera:
- soit un nationaliste hostile à l'eurocratisme, dont le patriotisme nationalitaire sera fondé sur l'appartenance charnelle à une culture précise, héritée des générations précédentes et de l'histoire, cimentée par un jeu de valeurs de longue durée;
- soit un européiste qui considère l'ensemble des peuples européens comme un écoumène civilisationnel de facture chrétienne ou non chrétienne,
- soit un ordo-socialiste ou un socialiste acceptant les règles de l'ordo-libéralisme allemand (le modèle du “capitalisme rhénan” selon Michel Albert).
Le souci des valeurs postule donc implicitement l'alliance prochaine
1) des nationalistes qui auront la force de transcender les limites des Etats-Nations modernes conventionnels,
2) des européistes qui voient d'abord dans l'Europe à la fois un espace stratégique indissociable et un espace de civilisation et de valeurs spécifiques et, enfin,
3) des socialistes enracinés dans la culture industrielle de type “rhénan”, qui donne la priorité à l'investissement industriel par rapport au capital spéculatif, où les impératifs industriels locaux et les structures patrimoniales sont pris en compte concrètement, où les investissements dans l'appareil éducatif ne sont jamais rognés, et où l'on ne bascule pas dans les mirages délocalisés d'une culture économique axée principalement sur la spéculation boursière. La fusion de ces corpus politiques est l'impératif des premières décennies du XXIième siècle. A la fusion technocratisme conservateur/libertarianisme, née dans les années cinquante aux Etats-Unis puis importée en Europe, il faut opposer la fusion de ces trois forces politiques, au-delà de tous les faux clivages, désormais obsolètes.
Nationalistes patriotes, ordo-socialistes et européistes “axiologues” refusent pourtant l'eurocratisme actuel, car celui-ci ne tient nullement compte des valeurs et repose sur ce “relativisme des valeurs” et cet oubli des leçons de l'histoire qui provoquent la déliquescence des sociétés. Si l'européisme peut être un retour à des valeurs fondatrices, renforçant les ressorts de la Cité, l'eurocratisme ne peut que perpétuer le relativisme absolu et la déliquescence sociale.
Si l'on accorde la priorité à l'efficacité économique, on peut être en faveur de l'unification européenne, selon les critères critiquables d'aujourd'hui, mais on ne devra pas oublier que le chômage alarmant est un frein à l'efficacité économique et qu'il découle directement de l'application des principes néo-libéraux, issus du relativisme des valeurs et du refus des héritages historiques. En revanche, une volonté d'efficacité économique pourra s'avérer hostile à l'unification européenne dans les conditions actuelles, car le gigantisme eurocratique réduit l'efficacité là où elle est réellement présente et où elle constitue un barrage contre le chômage pandémique: dans certains tissus agricoles locaux (ce que n'a pas manqué de souligner la FPÖ autrichienne) ou dans certaines entreprises industrielles locales, bien ancrées dans le marché européen mais qui seraient incapables de faire face à une concurrence extra-européenne qui se nicherait dans notre continent, au nom d'un libre-échangisme planétaire ouvrant toutes les portes aux marchandises japonaises ou coréennes, dont le coût est plus bas car il n'inclut ni la sécurité sociale du personnel ni les taxes écologiques visant la protection du patrimoine “environnement” ni un certain réinvestissement dans les réseaux éducatifs.
Sur le plan géopolitique, opter pour le primat des valeurs implique de raisonner en termes de civilisation, de percevoir le monde comme un réseau d'espaces civilisationnels juxtaposés, différents mais pas nécessairement antagonistes. Ces espaces sont animés par une logique intérieure, c'est-à-dire par un système de valeur cohérent et accepté, impliquant pour les hommes harmonie et consensus. Le primat des valeurs implique aussi ipso facto que l'on respecte les valeurs qui animent les espaces voisins du nôtre. Cependant, opter comme les droites néo-libérales (voire les droites “hayekiennes”) pour un primat de l'efficacité, sans tenir compte des valeurs structurantes, ou ne considérer celles-ci que comme des reliquats en voie de disparition graduelle, c'est opter automatiquement pour le système des pseudo-valeurs occidentales modernes et relativistes. Une telle option implique le refus de toutes les valeurs structurantes des civilisations, quelles qu'elles soient, et impose le “relativisme des valeurs”, c'est-à-dire leur négation pure et simple (Benjamin Barber: McWorld contre Djihad!), et, partant, le refus de la valeur “justice” (Rawls).
La gauche tiraillée entre justice et relativisme
Dans le camp de la “gauche” (du moins pour les adeptes des systèmes de classification binaires qui se déclarent tels), il n'y a pas davantage d'homogénéité que dans le camp des droites (pour les binaires d'un autre genre...). Dans cette nébuleuse de gauche, aux contours flous, on est en faveur de l'unification européenne quand on imagine qu'elle est une étape vers l'“Internationale”, désormais mise en équation avec la parousie globaliste. Ou bien on est hostile à cette Europe de Bruxelles et de Strasbourg, parce qu'elle est une Europe capitaliste. Sur le plan géopolitique, face à l'émergence de “blocs civilisationnels”, une gauche sympathique mais en voie de disparition, approuve la consolidation des valeurs dans les aires civilisationnelles voisines des nôtres (islam, animisme africain, bouddhisme, indigénisme hispano-amérindien, etc.), tandis qu'une nouvelle gauche agressive et messianique fait sienne une vulgate militante basée sur les “droits de l'homme”, subtilement raciste car seule cette idéologie, née en Europe du Nord-Ouest, est jugée valable, le reste étant “tribalisme”, injure équivalant désormais de “para-nazisme”.
En conclusion, face à une droite tiraillée entre le sens des valeurs et le néo-libéralisme et face à une gauche tiraillée entre le sens de la justice et l'agressivité occidentaliste et relativiste, force est de constater que les vocables politisés de “gauche” et de “droite” ne recouvrent plus rien de précis, qu'ils ne parviennent plus à séparer réellement des options politiques antagonistes. La droite ou la gauche idéales, pour les uns comme pour les autres, n'existent pas: elles sont des “sites introuvables”, comme l'affirmait Marco Tarchi (in: «Destra e sinistra: due essenze introvabile», Democrazia e diritto, 1/1994, Ed. Scientifiche Italiane).
Sur le plan historique, effectivement, nous découvrons une flopée de figures et de théoriciens importants qui oscillent entre cette droite et cette gauche ou que l'on a fourré dans la boîte de gauche quand ils étaient vivants, pour les fourrer ensuite dans la boîte de droite, quand la mode a changé ou le vent a tourné. Ainsi, Georges Sorel, théoricien socialiste français du début du siècle, appartenait de son vivant à l'ultra-gauche syndicaliste et révolutionnaire. Mais ce syndicaliste-révolutionnaire inspire Mussolini, également classé dans la gauche socialiste et belliciste italienne. Mais, voilà, Mussolini, étatiste et volontariste, est contesté par la gauche parlementariste et déterministe: on le sort de sa boîte de gauche pour l'enfouir dans une boîte de droite, avec son Sorel, son fascisme et ses flonflons. Après 1919, les “révolutionnaires-conservateurs” allemands, Ernst Jünger et Carl Schmitt admirent chez Sorel son sens de la décision et sa théorie de la grève générale insurrectionnelle. Sorel reste donc, malgré son ouvriérisme foncier, dans la boîte de droite: il devient même une figure de la droite radicale en Italie, en France et en Allemagne, après 1945. En France, l'un de ses disciples, Hubert Lagardelle, devient même ministre de Vichy pendant la seconde guerre mondiale.
Il n'existe donc pas d'idées de droite qui n'aient pas été jadis à gauche. Le nationalisme est dans ce cas. Mais il n'existe pas davantage d'idées de gauche qui n'aient pas été ancrées un jour à droite. Cet état de choses doit nous conduire à formuler le jugement suivant: la gauche et la droite sont des concepts dépassés, dans la mesure où elles ne sont pertinentes que dans le cadre d'un régime précis mais uniquement tant que ce régime est accepté par les grandes masses et fonctionne efficacement, tant qu'il peut affronter les vicissitudes du monde en perpétuelle effervescence.
Représentations figées et guerre des looks
Mais tout régime s'use. L'usure de l'histoire est le lot de toutes les constructions politiques. Quand cette usure a fait son œuvre, les gauches et les droites institutionnelles voire leurs dérives plus radicales se figent, deviennent des phénomènes raidis dans un monde qui ne cesse de se mouvoir. A partir du moment où les gauches et les droites institutionnelles ne peuvent plus résoudre les problèmes de société comme le chômage et l'emploi, l'augmentation démesurée des dettes publiques, l'incompétence de la magistrature, la crise de l'enseignement, l'effondrement du consensus, elles ne sont plus que des “représentations” (pour reprendre le vocabulaire de Gilles Deleuze). Des sortes d'images platoniciennes figées que l'on agite comme s'il s'agissait de vérités révélées et immuables ou, plus prosaïquement, que l'on agite avec véhémence comme des pancartes revendicatrices lors de manifestations. Toute l'histoire des “grands récits” (Lyotard) de l'idéologie occidentale du XVIIIième au XXième siècles consiste en une succession de “représentations”: aux représentations conservatrices-cléricales puis bourgeoises, on a opposé la représentation ouvrière-socialiste ou la représentation fasciste ou nationale-socialiste ou verte-écolo. Quand une représentation ne convenait plus à une catégorie de la population, on en fabriquait une nouvelle et on l'opposait aux plus anciennes. Toute la vie politique a consisté ainsi en une guerre des représentations, une guerre des looks. Jusqu'au paroxysme des représentations totalitaires... et surtout jusqu'à la satiété des citoyens.
Cette guerre des looks ne résout rien: on s'en est aperçu et ce fut la fin des “grands récits” (théorisée par Lyotard). Ce type de conflit est insuffisant. Avec Deleuze et ses continuateurs, on s'aperçoit désormais que l'on ne peut pas sans cesse produire et reproduire des représentations, en n'y apportant que de légères retouches. Le monde n'est pas fractionné en camps fermés sur eux-mêmes et détenteurs théoriques de vérités définitives. Le monde, l'histoire, les arènes politiques, les héritages juridiques, les jurisprudences, etc. sont bien plutôt autant de réseaux denses et inextricables, de croissances vitales, d'effervescences organiques ordonnées ou désordonnées mais néanmoins bien présentes et bien réelles, concrètes. Dans ces réseaux, l'homme actif (politiquement, socialement ou existentiellement) doit se tailler, se frayer un chemin à la machette, sich eine Schneise durchhaken, disait Armin Mohler quand il tentait d'expliciter son existentialisme ou son réalisme héroïque (en l'appelant maladroitement “nominalisme”, vocable qu'a rapidement repris Alain de Benoist, son admirateur naïf, collectionneur -ânonneur de vocables non usuels, toujours vainement en quête d'une notoriété qu'il n'a jamais obtenue). La démarche vitale ne consiste donc plus à imposer au dense grouillement du réel des “représentations” figées et naïves, mais de repérer des forces et des opportunités, des passages et des trouées, pour cheminer le plus sûrement, le plus sereinement possible, en dépit des défis fusant de toutes parts.
Complexité, pluralité et démarche archéologique
Cette vision deleuzienne du réel, implique, sur le plan politique concret, de ne plus chercher à répandre des programmes rigides, à se balader dans la société avec sa pancarte ou son affiche sur le ventre, mais à retourner résolument à l'épais sous-bois de l'histoire, où les traits trop simples d'un look idéologico-politique ne valent que ce qu'ils valent: une mauvaise caricature, une gesticulation maladroite. Prendre position politiquement, aujourd'hui, c'est donc plonger plus profondément dans les tréfonds de notre histoire, aller fouiller sous l'humus qui ne recouvre le sol que sur une faible profondeur. Prendre position politiquement aujourd'hui, c'est procéder à une démarche archéologique, c'est faire l'archéologie de notre site de vie. Je vis dans une Cité politique précise qui s'est construite progressivement au fil du temps, qui a généré un appareil juridique/constitutionnel complexe, tenant compte des strates multiples qui composent cette société et récapitulant subtilement dans les méandres mêmes de ses textes et dans les arcanes de ses pratiques les oppositions, fusions et contradictions dont cette société est finalement le résultat mouvant et vivant. Cet entrelac compliqué est précisément le sous-bois auquel il faut retourner et sur lequel il ne faut pas plaquer d'idéologie toute faite. Toute véritable prise en compte de l'histoire du droit dans une Cité interdit les jugements binaires des gauches et des droites ainsi que les simplismes des faux savants qui manient l'idéologie (schématisante) comme d'autres la trique.
La pensée politique doit donc retourner à des œuvres fondamentales, injustement méconnues, comme celles d'Althusius, de Justus Möser, de Wilhelm Heinrich von Riehl et d'Otto von Gierke. Leurs travaux prennent en compte l'ensemble des sociétés, avec toutes leurs différences intérieures, toutes les symbioses qui s'y juxtaposent. Leur pensée juridique, sociale et politique ne peut nullement se résumer à un schématisme binaire, mais exprime toujours de denses complexités, tout en nous apprenant à les explorer sans les mutiler. Le drame de la civilisation occidentale, c'est justement de ne pas s'être mis à l'écoute de ses œuvres depuis deux ou trois cents ans. Pour ces auteurs, ce qui compte, c'est le fonctionnement harmonieux/symbiotique ou le développement graduel de la Cité, selon des rythmes éprouvés par le temps, et non pas sa correction forcée et son alignement contraignant sur les critères d'un programme abstrait. Le programme-représentation ne saurait en aucun cas, avec cette pensée politique organique, oblitérer le fonctionnement rythmé et traditionnel d'une société. Tout retour à ces corpus organiques postule de raviver des modèles liés à un site géographique, de faire revivre, vivre et survivre des héritages et non pas d'imposer des “choses faites”, des choses relevant de la manie moderne de la “faisabilité” (que Joseph de Maistre nommait plus élégamment l'“esprit de fabrication”). Le sous-bois épais et touffu de Deleuze, véritable texture de son “plan d'immanence”, est un héritage, non pas une fabrication. Le sous-bois est un tout mais un tout composé de variétés et de nuances à l'infini: l'attitude qui est pertinente ici n'est pas celle qui est pertinente là. L'homme qui chemine dans ce sous-bois (qui ne mène nulle part, si ce n'est sur la terre même, où il se trouve toujours déjà) doit être capable d'adopter rapidement et tour à tour plusieurs attitudes, de s'adapter plastiquement aux circonstances diverses qu'il rencontre au gré des imprévus: cette vision du monde comme un immense entrelac immanent d'abord, cette nécessité bien perçue de l'adaptation permanente ensuite, sont les deux principales garanties de la pluralité. Quand on pense simultanément entrelac et adaptation, on pense pluriel et on est vacciné contre les interprétations et les représentations unilatérales.
Symbiotique et subsidiarité
Autre avantage pratique: la vision deleuzienne et le recours au filon qui part d'Althusius pour aboutir à Gierke permettent, une fois qu'ils sont combinés, de donner un contenu concret à ce que l'on nomme la subsidiarité. Dans l'article 3b du Traité de Maastricht, les législateurs européens ont prévu le passage à la subsidiarité sur l'ensemble du territoire de l'Union. Mais la définition qu'ils donnent de cette subsidiarité reste imprécise. Et elle est interprétée de diverses façons. En effet, que signifie la subsidiarité pour différents acteurs politiques européens?
- Pour Madame Thatcher et ses successeurs, la subsidiarité n'était qu'un prétexte pour défendre exclusivement les intérêts britanniques dans le concert de l'UE. Certains gaullistes lui ont emboîté le pas, de même que le groupe De Villiers/Goldsmith.
- D'autres espèrent, par antipolitisme, que la subsidiarité va conduire à une balkanisation de l'Europe, à un retour à la Kleinstaaterei incapacitante, car, à leurs yeux, toute capacité politique est un mal en soi.
- Pour d'autres encore, elle n'est qu'un artifice de gouvernement dans un futur Etat européen hyper-centralisé. La subsidiarité conduira à l'intérieur d'une telle Europe à une régionalisation à la française, où les parlements régionaux sont purement formels et n'ont pas de pouvoir de décision réel.
- Pour nous, un projet continental de subsidiarité est un projet de rapprochement des gouvernants et des gouvernés dans tout l'espace européen, visant à instaurer des rapports de citoyenneté féconds, à redonner à la société civile un espace public, où ses dynamismes peuvent réellement s'exprimer et se répercuter dans la vie quotidienne de la Cité, sans rencontrer d'obstacles ou d'obsolescences incapacitantes. Ce projet continental de subsidiarité est indissociable de la question économique. Si l'ancrage politique au niveau des pays est une nécessité pour rétablir les consensus écornés par la déliquescence des valeurs, il doit être concomitant à une “recontextualisation” de l'économie. Si la volonté de “recontextualiser” l'économie, de réancrer les forces économiques sur le lieu même de leur déploiement, si cette recontextualisation redevient la caractéristique principale d'une économie saine, on ne pourra plus parler d'une césure gauche/droite mais d'un clivage opposant les orthodoxies économiques, voire les orthoglossies économiques (consistant à répéter inlassablement les mêmes discours idéologisés sur l'économie), aux hétérodoxies. Pour les historiens français de l'histoire des théories économiques, les orthodoxies sont: 1) l'économie classique (le libéralisme dévié d'Adam Smith, le manchesterisme), 2) le marxisme et 3) la synthèse keynésienne, du moins telle qu'elle est instrumentalisée par les sociaux-démocrates. Toutes ces pensées orthodoxes sont mécanicistes. Face à elles, les hétérodoxies sont très variées: elles ne prétendent pas à l'universalité; elles se pensent comme produits de contextes précis. Elles ont pour sources les réflexions posées par l'école historique (allemande) au XIXième siècle, pour laquelle l'économie se déployait toujours dans des espaces travaillés par l'histoire. Dans une telle perspective, aucune économie ne peut se développer dans un contexte dépourvu d'histoire. Outre l'école historique allemande, les hétérodoxies dérivent des socialistes de la chaire et des institutionalistes américains (dont Thorstein Veblen; les institutions déterminent l'économie, or les institutions, elles aussi, comme le droit, sont produites par l'histoire). Pour François Perroux qui, en France, a fait la synthèse de ces corpus variés, l'économie se déploie au sein de dynamiques de structures, dans des turbulences où s'entrechoquent des forces variées: nous retrouvons là, dans un langage scientifique, avec un appareil mathématique adéquat, ce que le philosophe-poète Deleuze avait appelé le “rhizome”, ce sous-bois, cette jungle du plan d'immanence, dans laquelle l'homme lucide doit repérer et capter des forces.
Parmi ces lucides qui repèrent et captent, il y a bien entendu des hétérodoxes que l'on classe à gauche et d'autres que l'on classe à droite. Mais ce qui importe, dans leurs théories et discours, ce n'est pas le label, mais, plus justement, ce qui fait leur hétérodoxie, soit la volonté de se démarquer du mécanicisme des orthodoxies, de se dégager des impasses politiques dans lesquelles elles ont fourvoyé nos sociétés.
Révolution conservatrice et “événement-choc”
Mais si les questions brûlantes de la politique sont celles de la subsidiarité, de la réorientation de la pensée économique vers les théories hétérodoxes, que reste-t-il de notre engouement pour la “révolution conservatrice”? N'est-il pas le dernier indice d'un ancrage que l'on pourrait labéliser de “droite”? N'est-il pas ce petit “plus” qui permettrait de nous ranger définitivement dans la “boîte de droite”? Premier élément de réponse: ce qui consitue l'essence de la “révolution conservatrice”, ce n'est pas tant la dimension proprement conservatrice, c'est-à-dire le maintien de formes anciennes ou la volonté de garder “fixes” et immuables certaines institutions, mais l'attention constante pour l'Ernstfall (le cas d'exception), l'éveil à tout ce qui est soudain (Das Plötzliche), inattendu (Das Unerwartete), l'événement choc vécu en direct et qui appelle une réponse rapide, une décision (Eine Entscheidung). Cette attention et cet éveil ont été considérés comme les marques les plus caractéristiques de la “révolution conservatrice”, rangée à droite dans l'univers des panoplies politiques. Mais l'éveil à ce qui est soudain n'est pas seulement ancré à “droite”. Tant les surréalistes, contestataires et hostiles à toute forme de conservation institutionnelle, que Walter Benjamin y ont été attentifs et lui ont accordé la priorité, le statut d'essentialité, par rapport à la simple et répétitive quotidienneté. On retrouve la même valorisation de l'instant crucial, marqué d'une forte charge d'intensité, chez Carl Schmitt, chez Ernst Jünger, chez Martin Heidegger. Chez Benjamin, le fait de vivre un choc et de gérer ainsi l'irruption de l'imprévu, de vivre sous l'emprise d'une logique du pire, évite le traumatisme incapacitant, permet de vivre et de naviguer dans un monde qui transite de catastrophe en catastrophe.
Focaliser l'attention du personnel politique d'élite sur la soudaineté et l'irréductibilité du particulier face aux prétentions de l'universel, permet justement de ne pas “perdre les pédales”, de ne pas “craquer” devant le constat que l'on est bien forcé de poser aujourd'hui: la fin de l'histoire (Fukuyama), l'advenance d'un temps hypothétique où les décisions seraient devenues superflues, n'arriveront pas. Jamais. Cette non-advenance bien constatable prouve l'inanité des thèses de Kelsen ainsi que des institutions et des pratiques politiques qui en découlent. Elle contraint à penser métaphoriquement le plan du politique comme un sous-bois touffu, comme une masse unique et toujours particulière de sédimentations multiples, inextricablement enchevêtrées, dont témoignent l'histoire du droit, l'histoire constitutionnelle et la jurisprudence. Dans l'enchevêtrement de pratiques juridiques non répressives mais codifiant, décodifiant et recodifiant la convivialité publique (pratiques qui sont de ce fait non punissantes et non surveillantes, pour rappeler ici le travail de Foucault), dans cet enchevêtrement donc, s'expriment des valeurs, sous des oripeaux qui se modifient et s'adaptent au fil du temps, tout en conservant l'essentiel de leur message.
Conclusion
Par conséquent, le projet de “Synergies Européennes” étaye sa revendication de subsidiarité par un recours aux corpus symbiotiques d'Althusius, Möser, Riehl, Gierke, etc. pour organiser et renforcer une quotidienneté organique, dégagée des simplismes politiciens et mécanicistes qu'ont véhiculés la plupart des idéologies du pouvoir en Europe. Cette quotidienneté doit pouvoir s'exprimer dans des assemblées élues par la population de régions historiques, expressions de substrats historiques, juridiques et économiques de longue durée. Ces substrats représentent des “contextes” économiques particuliers, dont la particularité ne saurait être ni altérée ni oblitérée ni éradiquée. Toute volonté d'altérer, d'oblitérer ou d'éradiquer ces substrats participent d'une volonté mécanique de “surveiller” et de “punir”, qui se camoufle souvent derrière des discours iréniques et moralisants. Ces particularités substratiques doivent donc être prises en compte telles qu'elles sont, dans leur complexité que le philosophe-poète compare volontiers à un sous-bois touffu ou à une forêt vierge. Cette complexité est organique et forcément rétive à toute logique mécanique, binaire ou simpliste. Sur le plan économique, elle ne peut être appréhendée que par une pensée de type historique, c'est-à-dire, selon la classification qu'ont opérée les historiens français contemporains de la pensée économique, une pensée “hétérodoxe”.
Mais ce réel pensé comme sous-bois peut le cas échéant subir l'assaut d'aléas mettant ses équilibres particuliers en danger. L'événement-choc, soudain, fortuit, terrible, peut bousculer des équilibres organiques pluriséculaires: ceux-ci doivent toujours être capables de faire face, de cultiver une logique du pire, pour que les chocs qu'ils affrontent ne les détruisent ni ne les traumatisent. Telle est la disposition d'esprit qu'il faut retenir des décisionnistes historiques (Sorel et ses disciples de la “révolution conservatrice”) et de l'œuvre de Walter Benjamin.
Deux pistes pour sortir des enfermements de gauche et de droite et pour accepter la diversité du monde et le divers en nos propres sociétés.
Robert STEUCKERS.
00:05 Publié dans Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : synergies européennes, politique, philosophie, nouvelle droite, conservatisme, avant-gardes, synergie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 mai 2009
200 Jahre Donoso Cortés
200 Jahre Donoso Cortés
von Marc Stegherr : Ex: http://www.sezession.de/
Kaum war die Exkommunikation der vier Bischöfe der »ultratraditionalistischen« Piusbruderschaft aufgehoben, ergossen sich über den Papst und die katholische Kirche, vor allem aus Deutschland, Fluten an unsachlichen, tendenziösen Kommentaren, die mit der Sache rein gar nichts mehr zu tun hatten.
Man mußte sich fragen, ob jene Theologen und Kirchenvertreter, die die katholische Kirche unablässig zum Frieden mit der Moderne drängen, nicht mit Blindheit geschlagen sind. Die Moderne ist in ihrem Ursprung eine Häresie gegen das Geoffenbarte, das Verbindliche. Der liberale Kulturhistoriker Peter Gay nannte nicht von ungefähr seine kürzlich erschienene Geschichte der Moderne die »Verlockung der Häresie« (The Lure of Heresy).
Die heftigsten Affekte der Moderne richten sich seit jeher gegen jene Institution, die die moderne Häresie, den Kult des Relativismus (Benedikt XVI.), nicht mitmachen will. Die jüngsten Ausfälle haben gezeigt, daß diese Affekte nur ruhten, sie sind keineswegs Vergangenheit, und sie werden sich im Zeichen des »neuen Atheismus« weiter verstärken. Der katholische Staatsmann und Geschichtsphilosoph Juan Francisco María de la Salud Donoso Cortés, Marques de Valdegamas, der 1809 das Licht Spaniens erblickte, hatte keinerlei Illusionen, was die Phobien und die aggressive Konsequenz der politischen Irrlehren der Moderne betraf.
Seine Ansicht, daß es zwischen der gottverleugnenden Moderne, ihren Ausgeburten Liberalismus und Sozialismus, und dem Katholizismus keinen Kompromiß geben könne, weil die Moderne de natura auf die Ablösung, ja Vernichtung des Katholischen angelegt sei, diese Radikalität des Spaniers beeindruckte nicht nur das katholische Europa seiner Zeit. Carl Schmitt, der Donoso »gesamteuropäisch« interpretierte, rühmte dessen Klarsicht und Radikalität. Treffend sei Donosos Erkenntnis, daß die modernen Ideologien Ersatzreligionen sind, ihre Begriffe säkularisierte theologische Begriffe. Nur der Liberalismus weiche jeder begrifflichen Festlegung aus.
Auch die Kirche war zu Donosos Zeit keinesfalls frei von dieser tödlichen Krankheit der »diskutierenden Klasse«, der »clasa discutidora«, die nicht weiß, ob sie es »mit Barabbas oder mit Jesus halten soll«. Während das revolutionäre Europa, die Mazzini und Proudhon, sofort erkannten, welches polemische Genie ihrem spanischen Todfeind eignete, hielten sich die Vertreter des liberalen Katholizismus, vor allem in Frankreich, an Detailfragen seiner Schriften auf. Sie irritierte die von keinem Zweifel angekränkelte Glaubensfestigkeit Donosos, während Rom über diesen glänzenden Anwalt heilfroh war, und sein Hauptwerk, den Essay, mit dem höchsten Segen bedachte.
Nicht anders heute: Ein österreichischer Geistlicher, der von Rom zum Weihbischof ausersehen ist, weil er den Glauben seiner Kirche ohne Abstriche verkündet, wird von seinen liberalen Amtsbrüdern solange gemobbt, bis er seine Berufung ablehnt. Die Kirche, für die Donoso Cortés stritt, hatte noch einen Klerus und eine Theologenzunft, die weitgehend immun waren gegen die Verlockungen der modernen Häresien. Heute haben sie ihren Marsch durch die Institution Kirche soweit abgeschlossen, daß selbst Personalentscheidungen am linkskatholischen Widerspruch gegen das Orthodoxe scheitern.
Donoso hat das vorhergesehen. In seinem Hauptwerk charakterisiert er den Liberalismus als ein Phänomen einer Gesellschaft in Auflösung: »Die Zeit ihrer Herrschaft ist jene flüchtige Übergangsperiode, in der die Menschheit hin- und herschwankt zwischen radikaler Negation und gläubiger Hinnahme der Offenbarung.« Dann ist ihr eine Schule gerade recht, bei der alles Für ein Wider hat. Der Reformtheologe Hans Küng, den der Papst im Sommer 2005 noch in Audienz empfangen hatte, mischte dieser Tage ätzende Galle mit verlogener Diplomatie. Wenn der Papst sicher auch selbst nicht antisemitisch sei, so hätte doch jeder gewußt, daß die vier Pius-Bischöfe antisemitisch eingestellt sind. Wie einst der Kreml schirme sich der Papst vor seinen Kritikern ab. Donoso hatte recht. Der atheistische Sozialismus hätte wenigstens den Mut zur Negation. »Für den Liberalismus hat er nur Verachtung.« Dem ist nichts hinzuzufügen.
Bücher von Donoso Cortés:
Über die Diktatur. Drei Reden
Essay über den Katholizismus, den Liberalismus und den Sozialismus und andere Schriften
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, espagne, conservatisme, catholicisme, 19ème siècle, réaction |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 mai 2009
Karl Ludwig von Haller en de restauratie gedachte
KARL LUDWIG VON HALLER EN DE RESTAURATIE GEDACHTE
door Willem van der Burcht - http://bitterlemon.eu/
De Zwitserse conservatieve staatstheoreticus en publicist Karl Ludwig von Haller werd op 1 augustus 1778 te Bern geboren in één van de voornaamste patriciërsfamilie van de trotse stadrepubliek. Hij was de kleinzoon van de grote natuurwetenschapper, arts, dichter en botanicus Albrecht von Haller (1708-1777) en de tweede zoon van de bekende staatsman, historicus, numismaticus en heruitgever van de “Bibliothek der Schweizergeschichte”, Gottlieb Emanuel von Haller (1735-1786). Hij liep school in de Academie van zijn geboortestad, maar de vroege dood van zijn vader en financiële problemen lieten universitaire studies niet toe, zodat hij op wetenschappelijk gebied geheel autodidact is gebleven.
Op amper zestienjarige leeftijd trad hij in dienst van de stad Bern – toen de grootste stadsstaat benoorden de Alpen – en maakte snel carrière door zijn bekende naam en zijn capaciteiten. Hij had goede vooruitzichten op een mooie loopbaan in dienst van de stad. Als twintigjarige was hij reeds Secretaris van de Commissie en politiek heel erg actief via politieke geschriften.
In juli 1790 maakte hij tijdens een reis naar Parijs persoonlijk kennis met de Franse revolutie. Hij zetelde in talrijke commissies en genootschappen en zijn toespraken en denkbeelden vielen bij velen in de smaak. Tussendoor schreef hij nog ontelbare verhandelingen, memoranda, tijdschrift- en krantenartikelen, enz.
Als delegatiesecretaris en in zijn talrijke publicaties, bemoeide hij zich ook met de Bernse buitenlandse politiek. Zo nam hij deel aan diplomatieke zendingen naar Genève (1792), Ulm (1795), Noord Italië -waar hij Napoleon ontmoette - en Parijs (1797); hij was aanwezig op het Congres van Rastatt (1797/1798) en in 1798 waarschijnlijk ook betrokken bij de onderhandelingen met de Franse generaal Brune, die met zijn revolutionaire troepen op het punt stond het Zwitserse Eedgenootschap binnen te trekken. Er werd nog voorgesteld dat de stad zelf met een progressief en liberaal “Projekt einer Constitution für die Schweizerische Republik Bern” op de proppen zou komen (maart 1798), maar het voorstel kwam te laat. Op 6 maart 1798 trokken de Fransen Bern binnen, wat het einde was van het oude Bern en ook van het oude Zwitserland dat, onder de benaming “Helvetische Republiek”, een Franse satellietstaat werd.
Anti-revolutionair verzet en eerste ballingschap
Albrecht Ludwig von Haller werd uit overheidsdienst ontslagen en met zijn tijdschrift Helvetische Annalen zette hij het verzet tegen het revolutionaire systeem voort. Algauw veroorzaakte hij een groot schandaal in de pers en ontkwam ter nauwer dood aan arrestatie vanwege de autoriteiten door naar Zuid-Duitsland te vluchten, waar hij zich aansloot bij de Zwitserse emigranten rond Nikolaus Friedrich von Steiger, de laatste verdedigers van een onafhankelijk Bern. Ondanks het feit dat ze ten gevolge van de krijgsgebeurtenissen niet lang op eenzelfde plaats konden blijven, spreidde hij een indrukwekkende literaire en propagandistische productiviteit ten toon.
In maart 1799 vond hij onderdak in het hoofdkwartier van het leger van Aartshertog Karel en in juni, tijdens de Eerste Slag van Zürich, was hij getuige van de eerste geallieerde zege op Napoleon, die echter algauw weer verloren ging door de Tweede Slag, die de Oostenrijkers ook dwong de terugtocht te aanvaarden. Vervolgens hield hij zich weer op in kringen van Zwitserse emigranten tot hij in juni 1801 als Hofkriegskonzipist in de Präsidialkanzlei van Aartshertog Karel in Wenen werd aangesteld.
De in 1803 tot Hofkriegssekretär bevorderde vluchteling werd – na de herinvoering van de kantonale soevereiniteit door de Mediatie Akte van Napoleon - in 1805 als professor in het staatsrecht aan de nieuw opgerichte Academie van Bern aangesteld. Hij moest echter alweer snel de benen nemen voor de oprukkende Franse troepen en hij vluchtte naar Agram in Kroatië.
Terug in Bern; academische loopbaan
Eind februari 1806 nam hij ontslag uit Oostenrijkse staatsdienst en keerde terug naar Bern om er zijn professoraat weer op te nemen. In hetzelfde jaar huwde hij de patriciërsdochter Katharina von Wattenwyl en bekleedde –naast talrijke andere ambten- de functies van Censor en Prorector aan de Academie van Bern. Hij begon zijn universitaire carrière met zijn openingsrede “Über die Notwendigkeit einer andern obersten Begründiging des allgemeinen Staatsrechts” (vert.: Over de noodzakelijkheid van een andere fundamentele grondslag van het algemene staatsrecht); het volgende jaar hield hij een rede “Über den wahren Sinn des Naturgesetzes, daß der Mächtige herrsche” (vert.: Over de ware betekenis van de natuurwet, dat de machtige heerse). In 1808 publiceerde hij zijn Handbuch der allgemeinen Staatenkunde [vert.: Handboek der algemene staatskunde], dat de basis vormde voor zijn lessen. Daarin worden zijn opvattingen over de staat - en in het bijzonder over het wezen en het ontstaan van de staatsgemeenschap - voor het eerst systematisch uiteengezet, en zodoende geldt het als voorloper van zijn grote werk, de Restauration der Staatswissenschaft (vert.: Restauratie der Staatswetenschap). Het Handbuch leverde hem roem en erkenning op, maar ook hoon en vijandschap.
Het "enfant terrible" van Bern
Von Haller kwam al gauw in conflict met zijn grote concurrent op de universiteit, Samuel Schnell. Nadat von Haller zijn ambt als Censor misbruikt had om zijn concurrent te benadelen, werd hij in 1809 verplicht zijn mandaat neer te leggen.
Dit verhinderde echter niet dat hij het jaar daarop lid van de Grote Stadsraad van Bern werd en in 1810 in de Kleine Stadsraad werd gekozen. In zijn opmerkelijke werk uit 1811: Politische Religion oder biblische Lehre über die Staaten (vert.: Politieke religie of Bijbelse leer over de staten) trachtte hij aan te tonen dat zijn nieuwe staatspolitieke opvattingen in alle opzichten in overeenstemming waren met wat de Bijbel daarover zegt. Hij bleek onvermoeibaar als politieke stokebrand, verklikker en intrigant in de Bernse stadspolitiek, en hij raakte betrokken bij enkele schandalen die een smet op zijn reputatie wierpen. Zo was hij de auteur van een (anonieme) recensie in de Göttingischen gelehrten Anzeigen waarin hij op een perfide wijze van leer trok tegen het levenswerk van Pestalozzi, waarmee hij de ongemeen harde hetze die tegen deze laatste gevoerd werd, nog aanwakkerde. Hij liet zich evenmin onbetuigd in de zogenaamde “Kreis der Berner Unbedingten” terwijl zijn rol in het “Waldshuter Komitee” nog steeds niet helemaal opgehelderd is. Voor zijn verantwoordelijkheid bij de onlusten in Nidwalden werd hij tot een celstraf veroordeeld, maar snel begenadigd. Wel leverde dit incident hem een blaam op vanwege de voorzitter van de Kleine Raad.
De door von Haller bejubelde doortocht van de geallieerde legers door Bern op 23 december 1813 en een algemene staking bij de overheid, leidden tot de val van de Mediatieregering, die werd opgevolgd door de Restauratieregering. Hij stelde zich kandidaat voor de verkiezingen voor de Grote (of “Soevereine”) Raad van de Republiek Bern, die op 12 januari 1814 gehouden werden, met een programma dat hij in twee propagandabrochures neerschreef: Was sind Untertanenverhältnisse? (vert.: Wat zijn onderdanenverhoudingen?) en Was ist die Alte Ordnung? (vert.: Wat is de oude orde?)
Zijn hoofdwerk: "Restauration der Staatswissenschaft"
Von Haller was co-auteur van de nieuwe Bernse grondwet van 1815 en lid van de commissie die de grondwet diende te herzien ten gevolge van de aansluiting van de Jura. In 1816 werd hij tot lid van de Geheime Raad gekozen, waar hij echter met zijn reactionaire voorstellen op niet veel steun kon rekenen.
Op de derde verjaardag van de Slag bij Leipzig voltooide hij het eerste deel van zijn magnum opus dat zijn naam zou geven aan een heel tijdperk: Restauration der Staatswissenchaft (vert.: Restauratie der Staatswetenschap). Dag op dag een jaar later, op 18 oktober 1817, werd het boek tijdens het Wartburgfest openbaar verbrand omdat het een Duitse grondwet niet genegen was.
De volgende delen van het monumentale werk (2: 1817; 3: 1818; 4: 1820; 5: 1834; 6:1825) kenden niet meer dezelfde weerklank als het eerste deel, ondanks de vele (negatieve) publiciteit die von Haller te beurt viel: in 1817 werd hij gedwongen “in allen Ehren” (sic) ontslag te nemen als professor aan de Bernse universiteit, en hoewel hij nog tal van ambten beklede, bleef hij vooral op een negatieve wijze in de belangstelling komen.
In zijn Über die Constitution der spanischen Cortes (vert.: Over de Constitutie van de Spaanse Cortes), betoonde hij zich een hartstochtelijke verdediger van de koninklijke rechten, tegen de usurpatoren van de Cortes-grondwet in. Het geschrift werd aanvankelijk door de bevriende censor toegelaten, maar kort daarop door de Kleine Raad van Bern verboden.
Karl-Ludwig von Haller -“cet extravagant”, zoals hij genoemd werd- maakte zich alsmaar minder en minder geliefd. Het enfant terrible van de Bernse politiek gold in die dagen niet alleen in Bern maar in heel Zwitserland als ultrareactionair. Die reputatie had hij ook te danken aan zijn engagement in wat de “Olry-Hallerschen Clique” werd geheten. Het grootste schandaal, dat de emmer ten slotte deed overlopen, stond echter nog te gebeuren.
Bekering tot het katholicisme en tweede ballingschap
Op 17 oktober 1820 legde de protestantse patriciër uit Bern – die later bekende “… in zijn hart reeds sedert 1808 katholiek te zijn geweest …” - op het landgoed van de familie de Boccard in Jetschwil (Freiburg), in het geheim de Katholieke Geloofsbelijdenis af. Tijdens een oponthoud op weg naar Parijs raakte zijn bekering echter bekend. Hij koos voor de vlucht naar voren en kondigde in een brief aan zijn familie zijn overstap naar het Katholieke geloof aan. Deze apologie, die meer dan 70 herdrukken beleefde en in vele talen werd vertaald, lokte een stortvloed aan reacties pro en contra uit! Zijn bekering zond een schokgolf doorheen Europa en ontketende een storm in de pers. Op voorstel van de Kleine Raad en na stormachtige debatten werd Von Haller door een overweldigende meerderheid in de Grote Raad uit al zijn ambten ontzet en voor immer en altijd van lidmaatschap van datzelfde orgaan uitgesloten.
Von Haller werd nu voor de tweede maal – en deze keer definitief – weggejaagd. Tevergeefs verzocht hij in Oostenrijkse, Pruisische of Spaanse dienst te kunnen treden; na afscheidsbezoeken aan Freiburg, Bern, Genève en Erlach te hebben gebracht, trok hij in mei 1822 met zijn familie – zonder zijn beide zonen, die tot 1823 hun studies in Gottstadt verderzetten – naar Parijs. Daar werd hij snel opgenomen in het gezelschap van gelijkgezinden, waaronder de Bonald, de Lamennais en anderen, en leverde hij talrijke bijdragen aan Franse ultraroyalistische en Duitse conservatieve bladen. In juli 1824, na het terugtreden van Chateaubriand, kreeg hij een aanstelling als “publiciste” verbonden aan het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
In Parijs vond hij ook de tijd en de energie om zijn familieleden tot het katholicisme te bekeren, achtereenvolgens de groep rond zijn dochter Cecilia, de bij hem inwonende Julie Mathilde von Erlach, zijn tweede zoon Albrecht (die later hulpbisschop van Chur zou worden), zijn oudste zoon Karl Ludwig (later publicist en politicus in Solothurn) en uiteindelijk ook zijn echtgenote.
Reeds in 1828 kocht von Haller in Solothurn het huidige bisschoppelijke paleis en in 1829 verwierf hij het burgerschap van deze stad. Kort na de Julirevolutie van 1830 trok hij weg uit Parijs om zich definitief in Solothurn te vestigen.
Voorvechter van de Restauratie tot het einde
In Solothurn stelde hij zich aan het hoofd van de ultraconservatieven en was vanaf 1834 drie jaar lang lid van de Grote Raad; in 1837 werd hij niet meer herkozen.
Koortsachtig richtte de reeds op pensioenleeftijd gekomen pamflettist zijn pijlen op de rampzalige tendensen van zijn tijd. In 1833 ontwierp hij het programma voor een “Bund der Getreuen zum Schutz der Religion, der Gerechtigkeit, und der wahren Freiheit” (vert.: Bond der getrouwen ter bescherming van de Godsdienst, de Gerechtigheid en de Ware Vrijheid), die zou uitgroeien tot een internationale strijdgroep tegen liberalisme, de vrijmetselarij en het revolutionaire systeem überhaupt. Met Satan und die Revolution (vert.: Satan en de revolutie) uit 1834 toonde hij aan dat de drijvende krachten achter de revolutie voortsproten uit het Kwade. In zijn Geschichte der Kirklichen Revolution oder protestantischen Reform (vert.: Geschiedenis van de kerkelijke revolutie of protestantse hervorming, 1836) ontmaskerde hij de reformatie als een tweede zondeval, en duidde haar als diepere oorzaak van en voorloper van de grote revolutie.
Met zijn geschriften tegen de vrijmetselarij (1840/41) wilde hij de “oerleugen” blootleggen die volgens hem aan de basis lag van de valse leerstellingen van die verderfelijke “sekte” en antistoffen aanreiken ter bestrijding ervan. Achter alle revolutionaire stromingen in Zwitserland vermoedde hij de hand van geheime genootschappen en hun ideeën van “gleichmacherei” (lett. vert.: “gelijkmakerij” of egalitarisme), van “onverschilligheid ten aanzien van iedere vorm van religiositeit”, van “exclusieve haat jegens de katholieke godsdienst en kerk”, van “afschaffing van iedere gedachte van een opperheerschappij” en van een “bevrijding van iedere hogere macht”. In zijn strijd tegen de revolutie, die bij wijlen extreme en obsessieve vormen aan nam, schreef hij ontelbare journalistieke bijdragen voor kranten en tijdschriften .
Hij ondernam ook nog meerdere reizen: in 1840 verbleef hij een tijdje in het Zuiden van Duitsland, meerbepaald in München; ook Freiburg, Luzern, Schwyz en Kienzheim in de Elzas deed hij aan. Op zijn reizen legde hij veel contacten en ook door middel van een uitgebreide correspondentie met iedereen van naam en faam in Europa, onderhield hij contacten met katholieken, bekeerlingen, ultramontanen, conservatieven en reactionairen.
Von Hallers werk gaf, samen met de activiteiten van de Jezuïeten, voedsel aan een antiprotestantse, traditionalistische en legitimistische politieke cultuur in Zwitserland, wat de spanningen aan de vooravond van de Sonderbundskrieg van 1847 aanzienlijk deed toenemen. De katholieke, conservatieve en overwegend landelijke kantons moesten het echter afleggen tegen de protestantse, liberale stadskantons; deze nederlaag én de revolutie die in 1848 door gans Europa trok, ervoer de bejaarde voorvechter als een persoonlijke nederlaag. Tijdens de laatste jaren van zijn leven zag hij zijn levenswerk instorten.
In hetzelfde jaar als de revolutie overleed zijn echtgenote, die al lange tijd zwaar ziek was. Op 20 mei 1854 volgde hij haar in het graf ten gevolge van een longontsteking. Drie dagen later werd hij op het kerkhof van Sint-Katharina van Solothurn bijgezet. Het kerkhof werd echter onder het radicale regime met de grond gelijk gemaakt, zodat er niets meer overblijft dat herinnert aan deze onvermoeibare strijder, wiens levenswerk gericht was tegen zijn eigen tijd.
Von Hallers reactionaire staatstheorie
Albrecht Ludwig von Haller was zijn hele leven lang vervuld van het profetisch zendingsbewustzijn, de kop van de slang van het jacobinisme te moeten verpletteren. Daarvoor ontwikkelde hij een restauratieve staatstheorie gebaseerd op de “natuurlijke gemeenschap”, als tegenpool voor Rousseau’s “kunstmatig-burgerlijke” leer van het “sociaal contract”. Tegenover deze zuiver speculatieve drogbeelden wilde hij een uit de Schepping en uit de Openbaring gedestilleerde, wetenschappelijk onderbouwde Waarheid plaatsen die universeel en absoluut geldig was.
Von Haller zag de basis van de maatschappelijke verhoudingen in de Natuurwet, waarbij de sterkere heerst en de zwakkere dient: “De machtige heerst, of hij wil of niet, terwijl de zwakke dient, of hij wil of niet”.
Tegenover de geconstrueerde, egaliserende filosofie van de revolutie, plaatste hij de door hem opnieuw naar voor gebrachte principes van de “eeuwige en onveranderlijke Goddelijke Ordening”: de fundamentele ongelijkheid, de “weldadige verscheidenheid” der “krachten en noden” en de superioriteit van de sterksten. Macht en heerschappij komen voort uit het Natuurrecht, het Goddelijke recht en het positieve recht.
Von Hallers doctrine wordt daarom vaak voor brutaal, materialistisch en utilitaristisch aanzien. Daar zijn leer ook de triomf van de sterke over de zwakke bejubelt en soms geweld verheerlijkt, wordt eveneens beweerd dat zijn ideeën op de “Uebermensch” van Nietzsche vooruitliepen of zelfs dat zijn stellingen – indien consequent doorgedacht – tot een toestand van anarchie zouden leiden.
De Staat als huishouding
De Staat is voor von Haller een oneindig uitgestrekte familie, één reusachtige huishouding. De heerschappijverhoudingen zijn over elkaar heen geordend en van een zuiver privaatrechterlijk karakter.
Zo wil hij dat het Staatsrecht, de opperste bekroning van de natuurlijke dienst- en maatschappelijke verhoudingen, wordt vervangen door een aggregaat van oneindig verschillende, vrije, private verdragen. Met andere woorden: staatsrecht en privaatrecht zijn voor hem identiek. Bijgevolg bestaat er binnen een staat ook geen gemeenschappelijk doel, maar is hij slechts een mengeling van talrijke verschillende private doelen. Dus dient de Staat uitsluitend de door God gewilde verhoudingen en toestanden te bewaren en garandeert hij zo de ware Vrijheid, de vrijheid der voorrechten en de natuurlijke ongelijkheid.
Deze opvatting die – consequent doorgedacht – de staat ontbindt tot op het niveau van de enkele individu, staat in schril contrast tot de ideeën over Staat en Natie die in die periode overal in Europa opgang maakten.
De Staat als patrimonium
De natuurlijke basis voor het uitoefenen van macht en heerschappij is grondbezit. De landsheer is niets anders dan de grootste eigenaar en de Staat is zijn patrimonium. In deze “Patrimonialstaat” (lett. vert.: patrimoniumstaat) – een uitvinding en woordkeuze van von Haller waarmee hij een soort van feodale standenstaat voor ogen had – is de vorst enkel tegenover God verantwoording verschuldigd. Zijn gezag wordt slechts beperkt door verdragen en het recht, door de eigendom en de autonomie van zijn onderdanen en door de uit de Natuur afgeleide morele wetten. Gerechtigheid moet het Kwade verhinderen terwijl Liefde het Goede moet bevorderen. De concrete vrijheid die ieder individu toekomt, wordt gemeten naar de relatieve macht die iemand op grond van zijn sociale positie binnen het kader van heerschappij en dienstbaarheid, toekomt.
Onafhankelijkheid zonder dienstbaarheid behoort tot de soevereiniteit van de vorst en staat op de hoogste spurt van het menselijke geluk. Dit voorrecht verplicht de vorst tot rechtvaardigheid en tot het goede. Deze premisse, dat slechts de zwakke misbruik zou maken van zijn macht en niet de sterke, heeft hem het verwijt opgeleverd op moreel vlak naïef te zijn.
Invloed en nawerking
Von Hallers ambitieuze voornemen om een totaalverklaring voor de gehele werkelijkheid te geven, kan gezien worden als een – enigszins laattijdige - poging om het Ancien Régime op rationalistische basis te legitimeren. Tegelijkertijd heeft hij echter een gefundeerde contrarevolutionaire doctrine en een monumentale uitdaging aan het adres van de moderniteit nagelaten!
Ondanks de vaak starre systematiek, de ongegeneerde wereldvreemdheid en de reeds in zijn tijd opgemerkte anachronismen, heeft von Hallers “politieke theologie” – hoewel slechts voor een korte tijd – een enorme weerklank in Europa gekend. Von Haller werd alom bewonderd (bijvoorbeeld door de jonge Achim von Arnim) en zijn Restauration der Staatswissenschaft verdrong Adam Müllers Elementen der Staatskunst als hoogste autoriteit op het gebied van de staatswetenschappen. Daarnaast was von Hallers denken – naast dat van de Maistre en de Bonald - van groot belang voor de ontwikkeling van de staatsleer van het politieke katholicisme.
Zijn onhistorische, rationalistische opvattingen over de staat werden in kringen van Pruisische Junkers hartstochtelijk verwelkomd en ze oefenden een grote invloed uit op de conservatieven van het laatromantische Berlijn, zoals op de Christelijk-germaanse kring rond de gebroeders Gerlch.
Voor de Pruisische koning Frederik Willem IV dan weer, was von Hallers idee van een op religieuze grondslagen gevestigde “patrimoniale standenstaat”, tot in de jaren vijftig van de 19de eeuw het te verwezenlijken ideaal. De invloed die von Haller op het Pruisische conservatisme uitoefende, werd slechts overtroffen door die van Friedrich Julius Stahl (1802-1861).
Ook in Wenen kon von Hallers Restauratie-idee op grote instemming rekenen. In Zwitserland zelf bleef zijn invloed eerder gering, hoewel toch enkele aanhangers in zijn voetsporen verder werkten. In Frankrijk, in Nederland, in Italië (en in het bijzonder in de Kerkelijke Staten) en in Spanje bekenden prominente geestelijken en politici zich tot von Hallers systeem. Dit uitte zich niet alleen in publieke stellingnamen, maar ook in de talrijke orden en onderscheidingen die hem verleend werden, alsook in zijn indrukwekkende briefwisseling.
De nawerking van von Hallers poging om de geestelijke premissen van de revolutie door een antitheorie in de kiem te smoren om zo de tijd terug te kunnen draaien, was echter van korte duur. De democratische, liberale en nationale krachten stormden over hem heen en bepaalden het verdere verloop van de geschiedenis tot in de 21ste eeuw.
"Restauratie” verwerd van een strijdkreet tot een scheldwoord, de reactionair werd ideologisch geïsoleerd en als verliezer van de geschiedenis uit het collectieve geheugen verbannen. Niettegenstaande, blijft deze eens zo toonaangevende “politieke Luther” of “Helvetische Bonald”, zoals hij wel eens genoemd werd, één der belangrijkste en eigenzinnigste conservatieve denkers van de 19de eeuw. Geen enkele zichzelf respecterende conservatief kan het zich veroorloven rond deze Zwitserse persoonlijkheid van Europees formaat heen te lopen.
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, restauration, droite, conservatisme, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 02 mai 2009
Portret C. S. Lewis (1898-1963)
Portret C.S. Lewis (1898-1963)
C.S. LEWIS
door Bart Jan Spruyt - http://bitterlemon.eu/
"Do not be scared by the word authority. Believing things on authority only means believing them because you have been told by someone you think trustworthy. Ninety-nine per cent of the things you believe are believed on authority. I believe there is such a place as New York. I have not seen it myself. I could not prove by abstract reasoning that there must be a place. I believe it because reliable people have told me so. The ordinary man believes in the Solar System, atoms, evolution, and the circulation of the blood on authority – because the scientists say so. (...) A man who jibbed at authority in other things as some people do in religion would have to be content to know nothing all his life."
Clive Staples Lewis werd op 29 november 1898 in Belfast geboren uit ouders die nominaal lid waren van de Anglicaanse Kerk. Zijn vader, waarmee Lewis een groot deel van zijn leven een problematische verhouding had, was advocaat en stamde uit een sociaal geëmancipeerd Engels arbeidersmilieu. Zijn moeder was van vaders kant afkomstig uit een Schots-Iers predikantengezin en van moeders kant stamde zij uit een oud Anglo-Normandisch geslacht dat zich onder Hendrik II in Ierland gevestigd had. Op dat laatste was Lewis als jongeman erg trots.
Samen met zijn drie jaar oudere broer Warren beleefde hij een gelukkige kindertijd. Centraal in hun bestaan stond een fantasiewereld, uitgedrukt in zelf geschreven sprookjes, tekeningen en sILLEtjes, al snel mede gevoed uit de omvangrijke ouderlijke boekerij waar de kinderen onbeperkte toegang toe hadden. Zo vermeldde Lewis als tienjarige in zijn dagboek: “Paradise Lost gelezen, erover nagedacht.” Daar is hij nog vele jaren mee doorgegaan, getuige het in 1942 verschenen A Preface to Paradise Lost. Aan deze gelukkige periode kwam abrupt een einde door de vroege dood van zijn moeder. Vervolgens bracht hij enkele jaren door op twee Engelse kostscholen die hem tot laat in zijn leven depressief makende herinneringen opleverden. In zijn autobiografie Surprised by Joy (1955) heeft hij maar liefst zeven hoofdstukken nodig om dit liefdeloze en intellectueel afstompende milieu te beschrijven.
In 1916 won Lewis een beurs voor University College in Oxford, maar moest al spoedig zijn studie afbreken om als negentienjarige officier zijn land te dienen in de Noord-Franse loopgraven. In april 1918 kwam er een eind aan zijn oorlogservaringen door een ernstige granaatwond die hij opliep tijdens de Slag bij Arras. Na de oorlog hervatte hij zijn studie in Oxford. Hij studeerde er cum laude af in de klassieke talen, in de klassieke filosofie en in de Engelse taal- en letterkunde. Vanaf 1925 was hij als fellow in de Engelse taal- en leterkunde verbonden aan Magdalen College. Nadat hij gedurende zijn jeugd langere tijd van het christendom vervreemd was geraakt, begon rond die tijd ook een proces van religieuze heroriëntatie. Onder andere onder invloed van de dood van zijn vader en als gevolg van gesprekken met gelovige collega's als J.R.R. Tolkien en Hugo Dyson bekeerde hij zich tot het christendom. Zoals hij later in Surprised by Joy zou beschrijven vond de eigenlijke bekering plaats op 22 september 1931 tijdens een tochtje in de zijspan van de motorfiets van zijn broer. Als eerste literaire neerslag van zijn bekering publiceerde hij The Pilgrim's Regress (1932), een geestrijke allegorie naar het model van John Bunyan's boek.
Een nationaal bekend figuur zou Lewis pas tijdens de Tweede Wereldoorlog worden. Die bekendheid kreeg hij enerzijds door een aantal druk beluisterde lezingen over filosofische en religieuze onderwerpen voor de BBC-microfoon. Een aantal van die lezingen werden later gebundeld onder de titel Mere Christianity (1952), nog steeds een van zijn meest gelezen boeken. Daarnaast verscheen in 1942 het eerste publiekssucces, The Screwtape Letters, dat in het eerste jaar negen drukken kende en een jaar later eenzelfde succes kende in de Verenigde Staten.
Tot 1954 werkte hij onafgebroken in Oxford. In dat jaar werd hij in Cambridge benoemd op een speciaal voor hem ingestelde leerstoel voor letterkunde. In 1956 trouwde hij met de Amerikaanse Joy Davidham Gresham, een gescheiden voormalige communiste die zich onder invloed van Lewis’ boeken tot het christendom bekeerd had. Vier jaar later al stierf zij. In een van zijn laatste boeken, A Grief Observed (1961), dat onder het pseudoniem N.W. Clerk verscheen, probeerde hij verslag te doen van dit verschrikkelijke verlies. C.S. Lewis stierf op 22 november 1963, de dag dat John F. Kennedy in Dallas werd neergeschoten. Hij ligt begraven op het kerkhof van de Holy Trinity Church in Headington, Oxford.
Volgens zijn levenslange vriend Owen Barfield zijn er in zekere zin drie “C.S. Lewissen” geweest. Tijdens zijn leven heeft Lewis aan drie verschillende roepingen succesvol beantwoord. Op de eerste plaats was daar de gerespecteerde Oxford-docent, literatuurgeleerde en literair criticus. Daarnaast de schrijver van romans en kinderboeken. En ten slotte was er de populaire en invloedrijke apologeet, filosoof en volkstheoloog die veel lezers (opnieuw) op een verfrissende wijze het christendom binnen leidde. Daarbij geldt echter ook dat in veel van zijn werk filosofie, theologie, literatuur en fictie niet scherp te scheiden zijn.
In 1936 publiceerde Lewis zijn baanbrekende The Allegory of Love. Lewis beschrijft in dit boek hoe in de vroege middeleeuwen de klassieke goden in allegorische vorm weer het christelijk denken binnenkomen. Streden de goden vroeger tegen elkaar, nu worden het personificaties van krachten in de mens zelf. In de loop van de eeuwen begint de kracht van de allegorie echter te verzwakken. Dit wordt veroorzaakt door het verzwakkende besef dat de stoffelijke wereld primair een afspiegeling is van de bovennatuur. Steeds meer gaan elementen als satire, alledaagsheid en liefdesperikelen overheersen en daarmee verdwijnt de kracht van de allegorie in de westerse literatuur. Een ander levenswerk op het gebied van de literatuurgeschiedenis was zijn English Literature in the Sixteenth Century (1954) dat als deel III verscheen van The Oxford History of English Literature.
In zijn zeven kinderboeken (The Chronicles of Narmia) en drie science fiction romans verwerkte Lewis ook tal van theologische en filosofische ideeën. Zo vindt men in de roman That Hideous Strength talloze ideeën in literaire vorm die men in The Abolition of Man (1943) in filosofische vorm uitgewerkt vindt. Zijn beroemdste literaire werk is ongetwijfeld het al eerder genoemde The Screwtape Letters. In dit boek schrijft een oudere duivel eenendertig brieven aan een jongere collega met talloze adviezen hoe een jonge gelovige het best verleid kan worden. Het boek weerspreekt het binnen de hedendaagse Nederlandse intelligentsia wijd verbreide vooroordeel dat christendom en humor elkaar niet verdragen.
C.S. Lewis vormde de belichaming van een natuurlijk soort conservatisme. In zijn levensstijl (zo weigerde hij pubs te betreden waar de radio aan stond), in zijn literaire opvattingen (pas heel laat kwam hij tot waardering voor het werk van T.S. Eliot) en in zijn politieke opvattingen was Lewis een conservatief pur sang. Voor wat betreft de politiek moet daarbij wel vermeld worden dat Lewis een groot scepticus was ten aanzien van politici en partijpolitiek. Winston Churchill bewonderde hij overigens zeer, maar dat verhinderde hem in 1951 niet de minister-president te laten weten dat hij afzag van een hem aangeboden titel. Lewis was bang dat zijn critici zo'n adellijke titel als bewijs zouden opvatten dat zijn religieus werk slechts verholen anti-progressieve propaganda was. Zijn onverschilligheid inzake de dagelijkse politiek weerhield hem er niet van over een breed scala aan politieke onderwerpen te schrijven: misdaad, censuur, pacifisme, doodstraf, dienstplicht, vivisectie enzovoorts. Ook over de verzorgingsstaat had hij uitgesproken opvattingen. In een artikel in The Observer schreef hij in 1958:
"The modern State exists not to protect our rights, but to do us good or make us good — anyway, to do something to us or to make us something. Hence the new name ‘leaders’ for those who were once ‘rulers’. We are less their subjects than their wards, pupils, or domestic animals. There is nothing left of which we can say to them, ‘mind your own business.’ Our whole lives are their business."
De staat kan ervoor zorgen dat mensen zich gedragen, maar uiteindelijk kan hij de mens niet goed maken. Deugd veronderstelt vrije keuze. Lewis was er vooral bang voor dat de verzorgingsstaat zich verder zou ontwikkelen tot een technocratie van het soort dat hij al in romanvorm had beschreven in That Hideous Strength.
Veel conservatieven zien in The Abolition of Man zijn belangrijkste filosofische werk. In dit werk geeft Lewis een zeer originele verdediging van de natuurrechtsleer. De meeste beschavingen, religies en denksystemen gingen in het verleden van dezelfde morele codex uit. Wanneer men die codex analyseert komt men vanzelf uit bij de bekende deugden als Rechtvaardigheid, Eerlijkheid, Bramhartigheid en Voorzichtigheid. Hij laat zien wat de consequenties zijn wanneer de moderne cultuur het idee van een objectieve morele orde verwerpt.
Lewis is in Nederland een bekend auteur. Een aantal belangrijke boeken van hem is vertaald en leverbaar.
Literatuur
Er is zoveel over Lewis geschreven dat het hier slechts mogelijk is een bescheiden selectie te geven.
Een mooie biografie werd geschreven door Roger Lancelyn Green en Walter Hooper: C.S. Lewis: A Biography (A Harvest Book).
De biografie Jack: A Life of C.S. Lewis van George Sayer werd ook in het Nederlands vertaald (Crossway Books).
In de bundel Ontijdige bespiegelingen van Robert Lemm is een korte lezenswaardige inleiding in het werk van Lewis opgenomen (Kok Agora).
Een interessante visie op het conservatieve mens- en geschiedbeeld van Lewis vindt men in het door Peter Kreeft geschreven C.S. Lewis for the Third Millennium. Six essays on the Abolition of Man (Ignatius Press).
Een kort essay over de politieke opvatingen van Lewis werd geschreven door John G. West, Jr.: Public Life in the Shadowlands. What C.S. Lewis Teach Us About Politics (Acton Institute), met een geannoteerde bibliografie van de boeken en essays van Lewis die handelen over politieke thema's.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres anglaises, littérature anglaise, conservatisme, droite, grande-bretagne, angleterre, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 04 avril 2009
Hommage à Armin Mohler
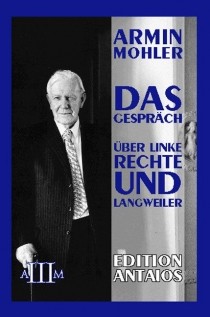
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
«Homme de droite à sa façon»
Hommage à Armin Mohler pour ses 75 ans
Journaliste, politologue, historien de l'art, directeur de fondation, polémiste et analyste, Armin Mohler a fêté ses 75 ans en avril. Ses adversaires en profiteront sans doute pour le dénigrer une fois de plus. Ce que Mohler acceptera avec une parfaite égalité d'humeur, voire avec satisfaction, car cette hostilité répond à ses attentes: «L'homme de droite est aujourd'hui le seul véritable trouble-fête dans notre société».
Mohler adore ce rôle de trouble-fête. Peut-être est-ce dû à ses origines helvétiques, dans la mesure où les Suisses aiment généralement le consensus et chassent par tradition les agitateurs hors du pays. Les Reisigen (du terme moyen-haut-allemand Reise, la campagne militaire) ont été appréciés par toutes les puissances européennes parce qu'ils savaient se battre. Günter Zehm, le célèbre journaliste de Die Welt, a un jour fait grand plaisir à Mohler en l'appelant le Reisiger, et, plus précisément le Reisläufer des Konkreten, c'est-à-dire “celui qui part en campagne dans les immensités de la concrétude”. Certes, les campagnes de Mohler dans les concrétudes de ce monde ont été moins dures et moins sanglantes que celles de ses compatriotes qui luttaient dans toutes les armées de mercenaires d'Europe: pendant de longues années, il a été correspondant de journaux importants en France, puis a dirigé la Fondation Siemens entre 1962 et 1985, a envisagé une carrière universitaire. Qu'il n'a pas obtenue. Parce que Mohler a choisi le chemin le plus ardu, le plus abrupt, le plus couvert de ronces. Un chemin privé. Un chemin à lui. A lui tout seul.
En se situant résolument à droite, Mohler n'en a pas moins gardé un profil tout-à-fait personnel; sans tenir compte de humeurs en vogue dans les droites, les bonnes comme les mauvaises, il cultivait ses sympathies pour des hommes aussi différents que Manfred Stolpe, Gerhard Schröder, Helmut Kohl et Franz Schönhuber, sans oublier le respect qu'il dit devoir à Gregor Gysi, parce que ce dernier défenseur du système de la RDA l'a beaucoup amusé. Dans ses conversations, on perçoit un respect très conservateur —pour ne pas dire vieux-franc— pour les institutions et les dignitaires, mais on s'étonne toujours de le voir changer brusquement d'attitude et de brocarder sans merci l'absence d'humour des conformistes.
Entre cette imprévisibilité idéologique et ses efforts constants pour tenter de définir intellectuellement ce qui est “de droite”, il y a une logique. Qui a démarré dès son célèbre livre Die Konservative Revolution in Deutschland jusqu'à son long essai sur le “style fasciste”, ses études sur la technocratie et ses innombrables articles sur des “thèmes de droite” (Sex in der Politik, Vergangenheitsbewältigung et Liberalenbeschimpfung) ou sur des auteurs (Oswald Spengler, Arnold Gehlen, Joachim Fernau). Dans tous ses écrits, Mohler se concentre sur ce problème: la définition de ce qui est “de droite”. Tous ses autres intérêts, notamment dans le domaine de l'histoire de l'art (Giorgio Morandi, Edward Hopper et la lutte contre la “mauvaise infinitude”) sont passés à l'arrière-plan.
Mohler a donc entamé une longue quête pour savoir ce qu'est ou devrait être l'“homme de droite” contemporain, qui a volontairement abandonné tous les costumes historiques, les bottes d'équitation des clubs d'officiers ou les escarpins de l'Ancien Régime. Cette quête, on la suit avec intérêt et enthousiasme, sans perdre son étonnement pour quelques-unes de ses idées ou de ses passions politiques. Cet étonnement s'accompagne de regrets quant aux livres que Mohler n'a pas eu le temps d'écrire: son “Traité de politique”, son ouvrage sur Georges Sorel, son travail sur les “anarchistes de droite”... Mais j'ai peut-être tort de lui faire ces reproches dans un hommage comme celui-ci... Car Mohler risque bel et bien de nous réserver une bonne surprise un de ces jours. Ad multos annos.
Karlheinz WEISSMANN.
(hommage issu de Junge Freiheit, n°16/95; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, nouvelle droite, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 avril 2009
Arthur Moeller van den Bruck

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Il y a 70 ans mourrait Arthur Moeller van den Bruck
«C'est une question que vous adressez au destin de l'Allemagne, lorsque vous me demandez qui fut Arthur Moeller van den Bruck», déclarait sa veuve Lucy en 1932, dans le seul et unique interview qu'elle a accordé pour évoquer la mémoire de son mari. En effet, la vie de Moeller van den Bruck, le protagoniste le plus significatif de la Révolution Conservatrice de l'entre-deux-guerres, reflète parfaitement l'esprit du temps. Mais si son époque l'a marqué, il l'a marquée tout autant. Le Juni-Klub qu'il avait fondé avec Heinrich von Gleichen en 1919 quand il devinait l'effondrement du Reich, la révolution spartakiste et les affres du Diktat de Versailles, devait devenir la cellule de base d'un mouvement “jeune-conservateur”. Un an plus tard, le Juni-Klub déménage et se fixe au numéro 22 de la Motzstraße à Berlin, pour déployer de nouvelles activités. Outre les soirées de débat, le Juni-Klub s'empressa de mettre sur pied un “collège politique” pour parfaire la formation politique des “nationaux”. En 1923, le Juni-Klub acquiert le droit de décerner des diplômes reconnus par l'Etat et entame une activité journalistique intense. Finalement jusqu'à 50 journaux importants ou revues au tirage plus restreint ont été chercher leurs éditoriaux ou leurs bonnes feuilles dans les locaux de la Motzstraße. Dans tout le territoire du Reich, ces structures de formation et de publication se multiplient et se donnent un nom, Der Ring (= L'Anneau), qui symbolise le mouvement national naissant, quadrillant le pays.
Le périodique le plus significatif des Jeunes-Conservateurs fut Gewissen, une revue rachetée en 1920, dont la forme fut entièrement remodelée par Moeller. La revue a tout de suite suscité un grand intérêt et a eu les effets escomptés, comme l'atteste une lettre de Thomas Mann à Heinrich von Gleichen (1920): «Je viens de renouveler mon abonnement à Gewissen, une revue que je décris comme la meilleure publication allemande, une publication sans pareille, à tous ceux avec qui je m'entretiens de politique». Moeller était véritablement le centre de toutes ces activités. En écrivant des brochures et d'innombrables articles, il façonnait le mouvement, lui donnait son idéologie, ses lignes directrices. Mais sa forte personnalité jouait un rôle tout aussi intense, rassemblait les esprits. Pourtant, jamais il n'écrivit de grande œuvre politique, mis à part des ouvrages de référence indispensables, comme Das Recht der jungen Völker [= Le Droit des peuples jeunes] (1919), puis l'ouvrage collectif écrit de concert, notamment avec Heinrich von Gleichen et Max Hildebert Boehm, et destiné à devenir la base d'un programme “jeune-conservateur”, Die Neue Front [= Le Front Nouveau] (1922) et, bien sûr, le plus connu d'entre tous ses livres, Das Dritte Reich (1923). Bien entendu, ce titre fait penser, par homonymie, au “Troisième Reich” des nationaux-socialistes, ce qui a nuit à la réputation de l'auteur et du contenu de l'ouvrage. Pourtant, Moeller émettait de sérieuses réserves à l'endroit de Hitler et de la NSDAP. Malgré son opposition, Hitler put parler un jour à la tribune du Juni-Klub en 1922, mais Moeller en tira une conclusion laconique, négative: «Ce gaillard-là ne comprendra jamais!». Après le putsch de Munich, Moeller commenta sévèrement l'événement dans Gewissen: «Hitler a échoué à cause de sa primitivité prolétarienne».
Le mouvement jeune-conservateur
L'influence prépondérante de Moeller van den Bruck peut parfaitement se jauger: en 1924, quand une grave maladie le frappe et le contraint à abandonner tout travail politique, les structures mises en place se défont. Le 27 mai 1995, après plusieurs mois de souffrances, Moeller met volontairement un terme à ses jours. Ce sera Max Hildebert Boehm qui prononcera le discours traditionnel au bord de sa tombe: «Le chef, le bon camarade, l'ami cher, auquel nous rendons aujourd'hui un dernier hommage, est entré comme un homme accompli, comme un homme “devenu”, dans notre cercle de “devenants” (... trat als ein Gewordener in unseren Kreis von Werdenden)».
Pour Moeller, comme pour tant d'autres, la Première Guerre mondiale et ses conséquences ont constitué un grand tournant de l'existence. En effet, quand Moeller s'est définitivement donné au travail politique, il était déjà un homme accompli, un “devenu”. Né le 23 avril 1876 à Solingen, il avait derrière lui un cheminement aussi extraordinaire que typique. Il appartenait à une génération qui n'avait plus pu s'insérer dans la société du tournant du siècle; adolescent, il avait interrompu sa formation scolaire et s'était installé d'abord à Leipzig, où il fit la connaissance du dramaturge et poète Franz Evers, qui l'accompagnera longtemps et marquera plusieurs stades cruciaux de son existence. Ses seuls intérêts, à l'époque, étaient littéraires et artistiques. Ce jeune homme très sérieux avait un jour suscité la remarque ironique d'un auditeur: «Vous avez-vous? Le jeune Moeller a ri aujourd'hui!». En 1896, il part pour le centre de la vie intellectuelle du Reich: Berlin.
Le style prussien
C'est dans la capitale allemande qu'il épousera un amour de jeunesse, Hedda Maase, qui partageait ses passions. Plus tard, elle a rédigé un mémoire détaillé sur son époque berlinoise, où elle décrit son mari: «Il s'habillait de façon très choisie et cherchait à exprimer l'aristocrate intérieur qu'il était à tous les niveaux, dans ses attitudes, dans les formes de son maintien, dans son langage». Un héritage leur permettait de vivre sans travailler; ainsi, ils pouvaient passer beaucoup de temps dans les cafés littéraires et dans les restaurants, et discuter des nuits entières avec des hommes et des femmes partageant leur sensibilité: parmi eux, Richard Dehmel, Frank Wedekind, Detlev von Liliencorn, le peintre et dessinateur Fidus, Wilhelm Lentrodt, Ansorge ou Rudolf Steiner. Ces réunions donnait l'occasion de pratiquer de la haute voltige intellectuelle mais aussi, assez souvent, comme Moeller l'avoue lui-même, de rechercher “le royaume au fond du verre”. Avec sa femme, il traduit, dans ces années-là, des ouvrages de Baudelaire, de Barbey d'Aurevilly, de Thomas de Quincey, de Daniel Defoë et surtout d'Edgar Allan Poe. Entre 1899 et 1902, il achève un ouvrage en douze volumes: Die moderne Literatur in Gruppen- und Einzeldarstellungen.
En 1902, Moeller quitte précipitamment Berlin sans sa femme, qui épousera plus tard Herbert Eulenberg. En passant par la Suisse, il aboutit à Paris. Il y restera quatre ans, parfois en compagnie d'Evers. Il édite plusieurs ouvrages, Das Variété (1902), Das Théâtre Français (1905) et Die Zeitgenossen (= Les Contemporains) (1906), flanqués de huit volumes, écrits entre 1904 et 1910, Die Deutschen. Unsere Menschengeschichte (= Les Allemands. Notre histoire humaine). A Paris, Moeller avait fait la connaissance de deux sœurs originaires de Livonie (actuellement en Lettonie), Less et Lucy Kaerrick, et de Dimitri Merejkovski. Ces amitiés ont permis l'éclosion du plus grand travail de Moeller: la première édition allemande complète de l'œuvre de Dostoïevski. Plus tard, Moeller épouse Lucy Kaerrick. En 1906, il voyage en Italie avec Barlach et Däubler, ce qui lui permettra de publier en 1913 Die italienische Schönheit [= La beauté italienne]. En 1907, il retourne en Allemagne et accomplit sur le tard son service militaire, pour exprimer son engagement en faveur de l'Allemagne qu'il n'avait jamais cessé de manifester à l'étranger. Ensuite, il voyage encore dans tous les pays d'Europe. Quand éclate la Première Guerre mondiale, il est affecté dans une unité territoriale (Landsturm). C'est à cette époque qu'il aura plusieurs longues conversations avec un jeune juriste, Carl Schmitt. En 1916, Moellers change d'affectation: il se retrouve dans le “département étranger” de l'état-major de l'armée de terre. La même année paraît un de ses meilleurs livres: Der preußische Stil [= Le style prussien], recueil d'articles et d'essais antérieurs mais dont la portée ne s'était nullement atténuée.
Guido FEHLING.
(article paru dans Junge Freiheit, n°21/1995).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, weimar, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, conservatisme, années 20 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 mars 2009
Revolutionary Conservative: Interview with Jonathan Bowden

REVOLUTIONARY CONSERVATIVE:
INTERVIEW WITH JONATHAN BOWDEN
Interviewed by Troy Southgate - http://www.rosenoire.org/
REVOLUTIONARY CONSERVATIVE: INTERVIEW WITH JONATHAN BOWDEN As conducted by Troy Southgate
Jonathan Bowden is the Chairman of the New Right and a man I am proud to regard both as a like-minded spirit and a friend. The following interview was conducted in the summer of 2007.
Q1: Your family background is a heady mix of Irish and Mancunian and you were brought up in rural Kent. Would you say that any of this helped to shape your intellectual development in any significant way?
JB: One’s origins obviously influence the way everything turns out in the end. I actually spent many of my formative years in the south Oxfordshire countryside, but I do admit that the Kent coast offers a certain draw. I was born in Pembury maternity hospital in mid-Kent in 1962 and the family later branched out into Bearstead after that. I remember a blue Volkswagen beetle, an extremely low-lying bungalow, roundabouts, that sort of thing… it was all very middle-class. I especially recall a Gothic moment from my own childhood; it concerned a mad woman or witch who lived up the way. She seemed to be a sort of Grendel’s mother – you know the kind. Anyway, rumour had it that she used to sit stark naked behind her letter box, dressed only in a black balaclava helmet, and any woman passing by would then be subjected to ferocious abuse. Scatology wasn’t the word for it, if you take my drift. Then, after a certain time had elapsed, the police would be called and she’d be sat there, dressed up to the nines, with cream teas and all the rest of it. It was essentially an elaborate attempt to flirt with, seduce or just fraternise with the local policemen. Then, as soon as they’d departed and she’d promised to behave, our wired sister would be back at the letter box fulminating. All other women were the object of her hate. No feminist sisterhood in evidence there, then. Its sexual hysteria and related screamings – I remember it all as if it were yesterday. My mother was terrified of her. We always had to go round the other way. Gothic or macabre things like that have always intrigued me – it’s the hint of chaos underneath bourgeois suburban conformism, you see. Life – when you stop to consider it – is really a painting through which people articulate their own death. What interests me is the artistry to it; it’s what our forebears, the Elizabethans, used to call the skull beneath the skin.
Q2: A few years ago now, you published a series of books under a different name. Tell us more about the themes involved and what you were trying to achieve at the time.
JB: Yes, I admit that your question is along the right lines. I’ve written a great deal down in the years and under various names – one of them happened to be John Michael McCloughlin, as I recall. I’ve certainly written between thirty and fifty books – depending on how you choose to look at it. At one level I’ve composed purely for myself – fiction, plays, non-fiction, memoirs, belle lettres, higher journalism, lyrics, prosody, experimental or stream-of-consciousness work, you name it. At present it’s all beginning to appear on the internet. My website – www.jonathanbowden.co.uk – contains one full manuscript. It’s an e-Book in PDF format. It’s entitled Apocalypse TV and consists of at least 100,000 words. It’s approximately 240 pages. A Platonic dialogue between a Christian and a pagan voice, it deals with Turner Prize art or the “Sensation” exhibition, criminology and the murders of Fred and Rose West, the concept of Political Correctness, all sorts of things. A short story, A Ballet of Wasps , also exists on the site. Hopefully – and before too long – a great deal of material will appear in this way. It’s essentially got to be scanned, edited, converted to PDF and then uploaded. A play which you have read, Troy, called Lilith Before Eve , has recently been added to the site. The following three short stories, Golgotha’s Centurion, Wilderness’ Ape and Sixty-foot Dolls , will appear relatively soon. There are also four more plays known as Glock’s Abattoir, We are Wrath’s Children!, Evolution X and ,i>Stinging Beetles, for example. Ultimately, one of my life tasks is to put all of it online and then see if publishers, small outfits, that sort of thing, would be willing to do hard copy versions. One point of interest: the publisher Integral Tradition Publishing has expressed an interest in possibly treating Apocalypse TV in the way I describe – although whether this will ever extend to a desire to publish full novels of mine, such as Al-Qa’eda Moth or The Fanatical Pursuit of Purity, is altogether another issue. But, rest assured, I will bring out everything I’ve ever done over time, even if it’s only in e-Book form on the internet. Politics is just a side-line, you see; artistic activity is what really matters. The one alters effects; the other changes the world. As Bill Hopkins once told me, one man sat writing alone in a room can alter the entire cosmos. It’s the ability – through a type-writer or whatever else – to radically transform the consciousness of one’s time. Cultural struggle is the most interesting diversion of all. There’s a Lancastrian truism that my mother retailed to me: “truth is a knife passing through meat”. Well, in this particular freeway one special coda stands out – you must become your own comet streaking across the heavens – all else is just a matter of flame, spent filament, rock or tissue, en passant, which slopes off to the side. Avoid those stray meteor shoals casting off to one’s left; they are just the abandoned waifs and strays of a spent becoming. Let your life resemble a bullet passing through screens: everything extraneous to one’s task recalls such osmotic filters. (I’d especially like to thank Daniel Smalley and Sharon Ebanks for their manifold assistance with these websites. Sharon’s earlier contribution was the following: www.jonathanbowdenart.co.uk). Do you wish to survey something I’ve just written? It’s a bit of a prosody based on a Futurist painting by Fortunato Depero called Skyscrapers & Tunnel (1930).
Do they make the most Of a tubular scene-scape Designed without cost And collapsing into date Crepe rape spate fate constant ingrate?
Q3: Please tell us how you came to be involved in the Western Goals Institute, a vociferously anti-liberal and anti-communist tendency which originated in 1989 as an offshoot of the American ultra-conservative group of the same name.
JB: Yes, the organisation known as Western Goals was a bit of a shape-shifting entity – it began as Western Goals UK and then transformed itself, eventually, into the Western Goals Institute. Later still it recomposed itself into the British chapter of the World League for Freedom and Democracy; a group which, as it didn’t believe in either freedom or democracy, was rather amusing. I gave them my support – I was actually deputy chairman for a while – because I agreed with a merciless prosecution of the Cold War. Right-wingers of every type and race aligned across the globe against communism. The war had to be fought tooth and branch. I essentially concurred with Louis Ferdinand C’eline’s mea culpa about Marxist-Leninism – after having toured the Soviet Union on the proceeds of Journey to the End of the Night and Death on Credit. Don’t forget that the third world war, to use a different nomenclature for the Cold War, proved to be an alliance between Western hawks or rightist liberals and neo-fascism across the Third World. Groups like Unita, Renamo, Broad National Front (FAN), the Triple A, the United Social Forces, The Konservative Party and HNP, the Contras and Arena – never mind Ba’athism… all of these tendencies were Ultra in character. Had they all been Caucasian in profile, such groups would have seemed indistinguishable from the OAS or VMO. It was vitally necessary to delouse those “communist peons of dust”… to adopt a line from a stanza by Robinson Jeffers. I have always believed with Mephistopheles in Goethe’s Faust, whether paraphrased by Sir Oswald Mosley or not, that in the beginning there is an action.
Q4: Shortly afterwards you founded the Revolutionary Conservative Caucus with Stuart Millson. What were the reasons behind the establishing of this group and, realistically, how much do you think it managed to achieve?
JB: Ah yes, the Revolutionary Conservative Caucus and all that jazz. Where have one’s salad days gone? Anyway, the RCC was set up by Millson and myself as a cultural struggle tendency. Never really conservative, except metaphysically, it wanted to introduce abstract thought into the nether reaches of the Conservative and Unionist party – an area habitually immune to abstract thought, possibly any thought at all. There have always been such ginger groups – Rising, National Democrat and later Scorpion, Nationalism Today, Perspectives, the European Books Society, the Spinning Top Club, the Bloomsbury Forum and now the New Right. The important thing to remember is that these groups are fundamentally similar – irrespective of distinct semiotics. The system of signs may jar, but, in truth, all of them are advocating radical inequality and meaning through transcendence… that’s the key. As to accomplishments or achievements… well, they were really twofold: first, the mixing together of ultra-conservative and neo-fascist ideas; second, a belief in the importance of meta-politics or cultural struggle. By dint of a third or more casual reading, various publications like Standardbearers , Oswald Spengler’s essay Man & Technics , the ‘Revolutionary Conservative Review’, a brief and intermediate magazine called Resolution and the ultra-conservative journal Right Now… all of these formulations came out of this nexus. It’s a creative vortex, you see? Let’s take one example: my interview with Bill Hopkins in Standardbearers… this links right back to the fifties Angry Young Men and to Stuart Holroyd’s productions in Northern World, the journal of the Northern League. This interconnects – like Colin Wilson writing for Jeffrey Hamm’s Lodestar – with not only Roger Pearson but also the fact that members of the SS were in the Northern League.
Sic cum transierint mei Nullo cum strepitu dies Plebeius moriar senex. Illi mors gravis incubat Qui notus nimis omnibus Ignotus moritur sibi.
It’s this which has to be avoided.
Q5: Your first association with the New Right was as a guest speaker at the very first meeting in January 2005. What made you want to become more involved with the group and what role do you think it can play in the future?
JB: I became involved because of a residual respect for what the New Right and GRECE were trying to achieve. For my own part, this has something to do with the fact that the New Right wishes to bring back past verities in new guises. It ultimately recognises an inner salience; whence the Old Right enjoyed a Janus-faced discourse: whether esoteric or exoteric in character. Do you follow? Because the outer manifestation tended to be conspiratorial, however defined. Whereas the innermost locution rebelled against old forms, postulated a Nietzschean outlook and adopted a pitiless attitude towards weakness in all its forms. Irrespective of this, the New Right recognises that fascism and national-socialism were populist or mass expressions of revolutionary conservative doctrines. Indeed, the Conservative Revolution is tantamount to Marxism on the other side: the truth of the matter is that Evola, Junger, Spengler, Pound, Moeller van den Bruck, Bardeche, Revillo P. Oliver, Rebatet, Brasillach, Jung, Celine, Wyndham Lewis, Yockey, Bill Hopkins and Arthur Raven Thompson, say, are actually to the right of their respective political movements. It’s the same with the extreme left on the other side – whether we’re talking about Adorno, Horkheimer or Althusser. Who’s ever really read Sartre’s The Dialectic of Critical Reason? As to any influence our group might have… well, perhaps it would be best to put it in this manner. I think that the New Right can prove to be a nucleus for illiberal thinking, albeit of a revolutionary and conservative character. Take, for example, Tomislav Sunic’s thesis, Against Democracy; Against Equality – a History of the European New Right. In this purview it becomes obvious that the Conservative Revolution was the seed-bed or think tank for fascism and national-socialism, much in the manner that theoretical Marxism was for communism. In the latter’s case, one only has to think of Adorno and Horkheimer’s The Dialectic of Enlightenment as the forcing house for ‘sixties revolutionism – far more, say, than Marcuse or the Situationists. Percy Bysshe Shelley, in Paul Foot’s terms Red Shelley, once described poets as the unacknowledged legislators of mankind. But, in all honesty, if we were to substitute the word intellectual or philosopher for poet then you might be nearer the mark. (All of which isn’t to take away for a moment the impact of poets like Kipling, Robinson Jeffers or the blind and recently deceased bard John Heath Stubbs, for example). Yet, I say again, one thing that we must deliberate upon is the power of conception. A man who possesses an idea or a spiritual truth is the equivalent of fifty men. Every pundit, tame journalist, academic or mainstream politician is mouthing hand-me-down ideas from a philosopher of yesteryear. At one level artists and intellectuals have no power whatsoever; undertake a parallax view or examine it in a reverse mirror, then you will see that they are matters of the universe. For those who have heard of Mosley, Degrelle, Jose Antonio Primo de Riveria, Mussolini, even at a push Julius Caesar; figures of Bardeche, Thomas Carlyle, Spengler and Lawrence R. Brown will remain forever arcane and mysterious. But fate’s mysterious witching hour knows that you can never have one without the other.
Q6: How did you reconcile your role as Chairman of the New Right, a self-proclaimed elitist and anti-democratic group, with your former position as Cultural Officer of the British National Party (BNP)?
JB: I feel that there was no great contradiction between the New Right and the British National Party. It’s a conundrum that revolves around the exoteric-esoteric fissure mentioned before. The British National Party is a populist or nativist group – it currently has about fifteen percent electoral support across Britain. No campaign and one leaflet garners a tenth of votes. Any sort of campaign nets 15%+; whereas a full-on methodology, Eddy Butler style, can get up to a fifth or a quarter of the vote. Bearing in mind that England is now fifteen per cent non-white then these margins represent an even higher proportion of Caucasia. Given this, the party represents a plebiscitary wing, the organisation’s inner spine are (for the most part) traditional nationalists; whereas their mental fodder needs to be provided by groupings like the New Right. Hierarchically speaking, the new reformats the old, albeit with a new cloak. Let’s put it this way: New Right sensibility sublimates Julius Evola’s The Metaphysics of War into Nietzsche’s The Will to Power. You have to understand that on the doorstep a small proportion of electors can vaguely recollect what country they’re living in… never mind anything else. Philosophy blinds them to a dance of sharp-toothed wolves. My, what large teeth you have, Granny – said little Red Riding Hood. Never mind: the real point is to achieve transcendence or becoming. Let’s begin with Voice of Freedom turning into Identity, inter alia, which leaps upwards to New Imperium – a step to the side of which might really be Bill Hopkins’ essay, Ways Without Precedent, in the volume of essays which served as the Angry Young Men’s manifesto. It was called Declarations. Yet perhaps even a step beyond this actually exists. Doesn’t one of Elisabeth Frink’s sculptures of a Soldier’s massive cranium – or one of her Goggle-heads, perchance – indicate a move ahead into aesthetic puissance? Everything that exists is about to transmute into a superior variant, an intellectual and spiritual speck of light which exists over it. As a BNP activist who’d been electioneering in the streets of East London once told a journalist; “If there’s nothing above you then there’s nothing to aspire to”.
Q7: Is there any real difference between the natural ascendancy of the strong over the weak – a recurring theme in your speeches – and the ruthlessness of capitalist economics?
JB: Again, as before, my answer has to begin and end with a postulation of hierarchy tout court. Do you see? It all has to do with the fact that economics is the lowest level of social reality. It remains purely material. Despising it is no good; what you have to do must be to effectively transcend it. The neo-utilitarian economist, Arthur Marshall, who was active at the turn of the twentieth century once famously described his subject as the dismal science. Just so… literary-minded types have always preferred belletrists of finance, whether J.K. Galbraith or Hilaire Belloc’s Economics for Helen. What you need to do is accept the market as the basis for a national economy that will be mainly privately owned, as Tyndall advocated in the Eleventh Hour, and then impose implacable political ethos on it from above. Politics must master economics; businessmen must be made to be spiritually subordinate to spiritual verities: the supreme expression of which is Art. Money then serves higher interests to which it is beholden – not the other way around. In all vaguely autocratic systems the economy operates in the way I’ve described. Ultimately you have to teach people not that money is the root of all evil – that’s purblind Biblical moralising – but that capital proves to be little more than fuel. To start up your car you need to put the key in the slot. Economic activity then has to serve the national community – not the reverse. As to the alleged ruthlessness of capitalist economics – that’s largely Darwinian romanticism. Does an eagle suffer from pity as it tears its prey to pieces in the stump of a tree? Anyway, do you really suppose that we have an unfettered market after over a century of state intervention or social democratic manipulation of its mechanisms? The only real success the far-left’s ever had was to provide shot-gun marriages for statist institutions in the West. New liberals designed pension, health, credit, insurance and social housing schemes in order to buy off proletarian rebellion from below. It owed as much to the far-right as the accredited Left – hence Skidelsky’s hero-worshipping of Mosley in his biography of that name. (This author moved from being right social democrat to a left conservative at a later date). Likewise, Sir Oswald Mosley’s New Party contained Marxian economists and social commentators like John Strachey – later to be Minister of Food in the post-war Labour government. The real point has to be the metaphysical guiding post behind Mosley’s post-war treatise, The Alternative. Subordinate economics to the meaning of politics not its management. The whole point of a political class is to impose a morality on the market – as Heseltine, of all people, once said, market economics has no ethical system otherwise. Von Hayek’s methodology of the implicit moral goodness of markets (because self-correcting) is flawed. But de Benoist’s attack on an advocacy of jungle law – whether directed at von Mises, Hayek, Friedman, etc… falls sheer. Why so? Because all that’s wrong with primitivism, brutalism and what Ragnar Redbeard called Might is Right has to be an absence of culture. That’s the salient point to remember. No Sistine chapel ceilings would ever have been painted without a systematic metaphysic to master gold. Put it in its proper place, why don’t you? Yet you can only do so after its creation. In this custodianship Sir Digby Jones, the former director general of the CBI, has to find himself subordinated to the manifestation of those eight symphonies by Sir Peter Maxwell Davies.
Q8: How ‘new’ is the New Right?
JB: It is clear to me that the New Right is diverse and diachronic in form. Like the refracted sides of a cerulean gem it casts many different slants afoot. All of these shimmer and break against a dark glass. To be truthful, the biggest disjunctions between old and new have to do with reductionism, conspiracy and revisionism. The old accepts the first two categories and could be said to have reformulated itself by virtue of the third. Perhaps we could go as far as to say that Revisionism is the reworking of the Old Right in modern guise – revisionist literature could then be considered to be the Old Right’s research and development. Just so… maybe Butz, Samning, Steiglitz, Baron, Berg, Harry Elmer Barnes, Rudolf, Mattogno, Graf, Faurisson, Zundel, Rassinger, Joachim Hoffmann, Heddessheimer, et al, are really Maurras, Weininger, Brasillach, Drieu la Rochelle, Celine, Barres, Revilo P. Oliver, Yackey, Ezra Pound, Jack London and Rossenberg… all come round again. I think, in these circumstances, that the New Right is a differentiated codex or semiotic – it enables a great deal of radical conservative material to return, maybe in a new guise. Although another point should be made, in that ultra-Right movements tend to have an occult trajectory. They manifest two sides: the esoteric and the exoteric. This can be considered to be a polarity between internal and external. For the masses Jean Respail’s Camp of the Saints or Christopher Priest’s Fugue for a Darkening Island; for the elite Count Arthur de Gobineau’s Essay on the Inequality of the Human Races . To quote yet another example – for mass taste Kolberg or Der Ewige Jude; for elitist consumption Leni Riefenstahl’s Olympia or the Italian film industry’s version of Ayn Rand’s We the Living. Even Hans Jurgen Syberberg’s seven hour epic, Hitler: a Film from Germany, strives for neutrality in an area where only negative partisanship is allowed. In this context Steukers, Sunic, Gottfried, De Benoist, Walker, Lawson, Krebs and so forth, are the inner elitism or vertical dimension amidst a general carnival. They are less the meat in the sandwich than the inner pagan and non-humanist core to ideas which the residuum cannot grasp unless they are put in a more basic form. It must only be true the less it is understood, in other words… By virtue of our silk-screening, reductive and metaphysical conspiracies are materialisms. They are explanations on a physical level. New Right discourse internalises and sublimates this doxa; it circulates it as spiritual velocity. Aesthetically speaking, what can be transmuted – for a philistine or mass public – as Max Nordau’s Degeneration becomes Ortega Y Gasset’s The De-humanisation of Art at a more advanced illustrative push. Perhaps, even as a reverse dialectic, Wyndham Lewis’ The Demon of Progress in the Arts provides an overlapping negation to Y Gasset’s thesis – all prior to a new or renewed synthesis. Ethnically speaking, one might aver that The Turner Diaries amount to the outside face of the Bell Curve’s Junction. Artistically again, doesn’t Ayn Rand’s The Fountainhead provide a fusion, in mock-libertarian guise, of internal and external messages in a bottle? Whereby the heroic modernist Roark – based loosely on the living example of Mies van der Rohe – overlaps with the neo-classical sculptor ‘Steve’. A character which was loosely based on Gustav Thorak, an artist who’s heroic figurine, Atlas, outside the grand central station in Chicago influenced Ayn Rand’s last right-anarchist novel, Atlas Shrugged. I would go so far as to say that the New Right is a toxic cerebration to the Old Right’s fist: in musical terms it’s Screwdriver becoming Laibach and then morphing into Carl Orff. But isn’t Verese’s noise brought back into focus by Igor Stravinsky’s The Right of Spring? After the performance of which – the master Stravinsky had to be guarded at his concerts, like a prize fighter. Diaghilev strove to remain highly jealous throughout.
Q9: You have a keen interest in Modernism. Why does this form of artistic expression appeal to you most and what, in your opinion, makes Modernism so superior to Modern Art?
JB: Ah yes, the issue of Modernism… I’m an ultra-rightwing modernist, let’s make that clear. Even though some of my work is traditional, restorationist, historical and semi-classic in spirit… nonetheless, I’m a modernist, even on some occasions an Ultra-modernist. Let’s be definite about this: some of my pictures do relate to Bosch, Redon, Klimt, Bacon, Pacher, ancient Greek sculpture and so on, but primarily I wish to create new and ferocious forms. They must come from within; what you really require is an image the like of which no-one has ever seen before, even dreamt of prior to your conception. Bacon always declared that he wanted to paint the perfect cry, after the fashion of the nurse on the steps facing the White Guards in Battleship Potemkin. I never wished to paint the greatest scream a la Poussin’s Massacre of the Innocents. No. For my part, I wanted to paint the most ferocious image of my time – these works are not neurotic, paranoid, schizoid, disturbed or mentally ill, as some might suggest… they are passionate integers of fury. The effort is to project strength and power. One cares nothing for the aesthetic standards of the masses; they are children who only like what they know or feel comfortable with. What really matters has to be the ecstasy of becoming – early or classic modernism happened to be exactly that. It was an attack on sentimentality; it proved to be an art purely for intellectuals. It was anti-humanist, elitist, inegalitarian, vanguardist, misanthropic, sexist, racist and homophobic – all good things. It gave witness to the neo-classic bias within the Modern that related to the theories of T.E. Hulme, a revolutionary conservative, and Ortega Y Gasset, a mild fascist. In the latter’s Dehumanisation of Art he preaches a new style against the Mass – that notion has always intoxicated me; to trample upon the masses and synthesise them into a new evolutionary surge has to be our object. The failure of extremist conservatism, fascism and national-socialism was material; revolutionary right-wing ideas may only really flourish spiritually: art has to be its vehicle; the stars its limit… homo stultus, the putty. Early modernism found itself penetrated by these ideas… only much later did it become a vehicle for liberal humanism. A move which in and itself related to the academic, restorative and conservative aesthetic tendencies in Soviet and Nazi art. One of the ironies is that revolutionary art becomes liberal wall-paper; while revolutionary movements adopted philistinism as their watchword. Their anti-formalism became a rigid fear of upsetting the majority. Art partly exists to disturb expectations, but liberal anti-objectivism has gradually dissolved this influence. An image like Tato’s March on Rome becomes more and more diffuse… until you end up with a David Hockney sketch, a Yorkshire scene bathed in light, and adorning a corporate office anywhere in the world. But let’s not fall into the trap of talking about the revolution betrayed – that’s such a bore. Also, revolutions are always betrayed; that’s their purpose. It’s only then that we recognise the salient truth: namely, they are part of life’s warp and weft. They have to be taken - to use Truman Capote’s axiom – in Cold Blood. A dilemma which brings us to the exposed issue of post-modernism, I dare say.
Q10: A talented and accomplished artist, you have produced over 200 paintings of your own. What first motivated you to take up painting, and how would you describe your own inimitable style?
JB: Unlucky for some, eh? Well, let’s look at it in this way… between around six or thirteen years of age I used to draw comics or graphic novels. They were my first form. Around two thousand images definitely came into the world as a consequence of these endeavours. They were my first love, I suppose – primarily due to their combination of words and images. A factor which also accounts for my interest in the graphic, the horrific or Gothic, the linear and the pre-formed. Contrary to the desiderata of pure modernism, in graphic work you always know where you’re going but not necessarily where you intend to end up. After a brief gap – grammar school and so on – I started to produce images again. Yet now a subtle change had taken place. The pictures underwent a metamorphosis into full-scale paintings and over around thirty years have mounted up to at least 215 works. Some of the early ones are framed; others not. Around 175 or 177 (depending) are available for viewing on my website (www.jonathanbowden.co.uk), sundry sketches and preliminaries will follow… and the coup de gras shall be those graphic novels which await scanning and upload at a later date. Personally speaking, I find them to be captivating in their allure. They are extremely varied in their focus – some are ferocious, savage and expressionist; others are erotic, playful and sensual; still more have a classic, restorationist or historical bias; while the remainder embody autobiographical and ideological themes. Some pertain to child art or the ramifications of Art Brut: that is, a willing or known primitivism in terms of artistic silence. Certain other paintings are literally portraits of people known to me; whilst early on I experimented with the psycho-portrait – here you illuminate a person’s nature and not their looks. Although eschewing abstraction – unlike Norman Lowell – I’ve never been interested in pure representationality after the invention of photography to do it for you. Do you recall those nineteenth century series of photographs by the master Edward Muybridge? He was one of the great pioneers of slow-motion, frame by frame photography when this art or science was in its infancy. A sequential art motif featuring two men engaged in Graeco-Roman wrestling has to be an early classic. These images in particular had profound influence on Francis Bacon’s oeuvre. Anyway, if we examine it closely then this tradition splits several ways. It leads to the strip cartoon, the cartoon or funny, comics and the story board – a development that prepares the ground for early silent cinema. So inter alia, the fantastical and linear presentation of action becomes art’s necessity. All of which involves going inside the mind so as to furnish provender – imagination then facilitates change, transmutation, forays from within and the custody of inner space. An eventuality which portends Modernism – why don’t you think of me as a heterosexual version of Francis Bacon? Maybe you could construe yourself, Troy, as the famous critic David Sylvester with whom Bacon had a well-known artistic dialogue in Plato’s tradition. Thames and Hudson published it years ago.
Q11: In his recent book, Homo Americanus, the Croatian author Tomislav Sunic notes that “postmodernity is hypermodernity insofar as the means of communication render all political signs disfigured and out of proportion.” (p.150)? What is your view on post-modernism and hyper-modernism?
JB: I actually question whether the concept of hyper-modernity actually exists, but we don’t want to end up in a cul-de-sac of meaning and response. By no means… Do you happen to recall that story by H.P. Lovecraft, Pickman’s Model, where the artist’s baying creature at the end of various Old Bostonian tunnels was taken from life? That’s the point… Anyway, in Tomislav Sunic’s Homo Americanus, which I have to admit that I had a hand in editing, he makes a situational point about post-modernism. Note: Situationism was a literary theory of excess, somewhat ‘terrorist’ in spirit, which grew out of a fragment of late surrealism. Its chief text was Guy Debord’s The Society of the Spectacle. Certainly the notion of a twenty-four hour media circus which penetrates everything, cyclonically, has come to be seen as a cliché. Nowadays , a thinker like Jean Baudrillard just tidied up post-modern excess and evinced an ironic distance over any attachment to left radicalism. Post-modernity is really about patterning. It’s an Asiatic or Oriental deportment; one in which displaced tarot cards are endlessly displaced and new meanings then become attached to them. It self-consciously adopts a mosaic’s inflexions, but variously complex or contradictory currents enter into the mixture here. Yet misnomers abound: Stravinsky’s neo-classicism early on in the twentieth century is definitely post-modern in feel… yet historically it can hardly be described as such. Whereas an extremist modernist text written after the Second European Civil War by Samuel Beckett, Comment C’est (How It Is), could be delineated as a post-modern elixir. In it two forms – vaguely reminiscent of the actors Patrick Magee and Max Wall – drag themselves across plateaus of mud towards an uncertain future, mouthing imprecations all the while. Also, there is a complicated interaction between post-modernist diction and historical revisionism over the Shoah. Its extreme relativism, metaphysical subjectivism and heuristic bias lend itself to micrological analysis, rather like Kracuer’s estimation of the German film industry. Nonetheless, the hermeneutical pea-souper which clings to Paul de Mann’s Blindness & Insight definitely has something to do with his own partiality for writing on behalf of Leon Degrelle-like journals during that conflict. Paradoxically though, deep textual analysis or criminological fare, rather like Faurisson’s exegesis, can quite easily dovetail itself with Thion’s post-structuralism, whereby all media certainties become questionable. As to hyper-modernity, what can one say? Perhaps it relates to the mass media’s electronic self-consciousness – the self-consciousness of its own self-consciousness, if you like. Now post-modernism truly behaves like a serpent devouring its tail, or the Worm Ouroborous. It also betokens those cinema audiences in the ‘fifties, metaphorically, who sat in darkened flea-pits watching in X-Ray specs. Possibly hyper dims post-modernity, if only to provide its apotheosis and defeat. A chimpanzee sits before a Sony Playstation playing a Gulf War game with News 24 alive in the background… maybe the latter scenes in Pierre Boulle’s novel, Monkey Planet, have a certain salience. Particularly when these gestures are interestingly spliced with Christopher Priest’s racialist science-fiction novel, Fugue for a Darkening Island… the one with a piece of Ploog-like fantasy art on the cover. A neglected work – it nevertheless intones values similar to those of a British Camp of the Saints. The point to make throughout all of this, however, is that culture cannot just elicit a significatory response. It must entertain an essentialist or organic bias (even in its existential mists) – otherwise it’s meaningless. One can then look forward to conceptual art replacing an art of concepts; wherein Stewart Home’s interpretation of Manzoni’s cube smears over Kipling’s The Stranger.
Jonathan Bowden may be contacted in writing via BCM Refine, London WC1N 3XX, England.
| Home | Articles | Essays | Interviews | Poetry | Miscellany | Reviews | Books | Archives | Links |
00:23 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, conservatisme, conservatisme révolutionnaire, droite, angleterre, théorie politique, esthétique politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 mars 2009
R. Scruton : Waarom cultuur belangrijk is
Boekbespreking
Roger Scruton - Waarom cultuur belangrijk is
Ex: http://onsverbond.wordpress.com/
Het is een open deur intrappen als we stellen dat de conservatieve maatschappijvisie in het publieke debat slechts een minderwaardige positie krijgt toegemeten. Doch - eerlijkheidshalve - is deze op dit moment nog onvoldoende georganiseerd. Buiten enkele zeldzame initiatieven zoals de Iskander-rondzendlijst van Vbr. prof. dr. Matthias Storme en bladen zoals Nucleus en TeKoS blijft het in Vlaanderen nagenoeg windstil.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hongerige lezers hun nectar vaak over de grens halen. Zo beweegt boven de Moerdijk heel wat meer. Het initiatief rond het Bitter Lemon, de uitgeverij Aspekt en auteurs als Andries Kinneging en Ad Verbrugge zijn alvast talrijker en ook beter gewapend om het debat te voeden. Daarom achtten wij de kans klein om een nochtans bekende Engelse conservatief als Roger Scruton ooit in Vlaanderen vertaald te zien. Zijn nieuwste boek ‘Culture Counts’ lag daarom bij ons bezoek aan een New Yorkse boekhandel meteen in het winkelmandje. Groot was onze verbazing toen wij enkele maanden geleden dit werk alsnog in een Nederlandse uitgave zagen verschijnen. Erop vertrouwend dat de vertalers zich nauwgezet aan de tekst hielden, wagen wij het erop hier de Engelse versie te bespreken.
Reeds in de inleiding formuleert de schrijver duidelijk het opzet van dit boek: de verdediging van de Westerse cultuur. Hierbij positioneert Scruton zich uitdrukkelijk tegenover zowel haar innerlijke als externe vijanden, resp. de ‘postmodernisten’ en de ‘humorloze islam’. En omdat jarenlange indoctrinatie en inbreuken op onze Europese cultuur hun tol hebben geëist, voelt hij zich niet te goed om terug te grijpen naar de basis en te vertrekken vanuit het definiëren van het begrip ‘cultuur’. Deze dient men te zien als “de kunst en de literatuur waardoor de beschaving tot bewustzijn van zichzelf komt en haar visie op de wereld definieert”. Of het nu de Griekse, Romeinse of Egyptische beschaving betreft, elk heeft daaraan in de geschiedenis zijn eigen invulling gegeven. Men moet werkelijk ziende blind te zijn om te ontkennen dat Europa sinds 1500 jaar met zijn kathedralen, schilderwerken, beeldhouwkunst en architectuur ook een dergelijke beschaving rijk is.
| Kathedraal van Chartres, gebouwd tussen 1194 en ca. 1220. |
In een tweede fase wenst Roger Scruton antwoord te vinden op volgende twee vragen: hoe kunnen we in deze samenleving ware cultuur (h)erkennen en hoe kan deze worden doorgegeven opdat ze niet verloren gaat. De nieuw-rechtse filosoof Alain de Benoist stelde in dat verband al eerder dat er twee types conservatieven zijn: “zij die de vlam brandend houden en zij die de as koesteren”. Beide pistes krijgen de nodige aandacht bij de Engelse filosoof.
Is cultuur er enkel voor de elite, voor een selecte groep van al dan niet zelfverklaarde intellectuelen? Ja en neen. Neen, omdat ze de overdracht van morele en emotionele kennis betreft en dit zou in principe voor iedereen beschikbaar dienen te zijn en aangeleerd te worden. Ja, omdat het inspanning vergt. De schrijver haalt daarbij uit naar onder meer het medium televisie, dat hij eerder ziet als een verstrooiing. Door het gebruik van snelle beelden en het gebruik van actie en sterke emoties amputeert het de verbeeldingskracht van de Europeaan.
Liefhebbers van poprock zullen het misschien niet graag lezen, maar Scruton vindt deze vorm van muziek ook niet echt cultuur, gezien de focus te veel op ritme en minder op tonaliteit ligt. Hoeft het gezegd dat klassieke muziek wel die harmonie en melodie in zich draagt en daarom de tand des tijds zo makkelijk doorstaat? Samen met bijvoorbeeld een schilderij van Rembrandt of de kathedraal van Chartres slaagt Beethoven erin zijn publiek te imponeren, te laten meeleven. Zonder nochtans te shockeren via obsceniteiten of overdreven sentimentaliteit, waarvan moderne ‘kunst’ vaak doorwrochten is. Neen, ware kunst kenmerkt zich door zijn focus op zijn intrinsieke waarde: l’art pour l’art en geen politieke, economische of zelfs emotionele motieven. Kunst staat op zichzelf en geniet precies daarom aandacht. Het zet aan tot denken, tot reflectie, tot het formuleren van een visie op deze wereld.
Na de lezer vertrouwd te hebben gemaakt met het begrip cultuur en hoe deze op te sporen, rest nog de vraag hoe deze waarde(n)volle cultuur aan onze volgende generaties door te geven, hoe hen te overtuigen van haar rijkdom. Hoeft het gezegd dat de Engelse auteur weinig vertrouwen heeft in de filosofie van scholen zoals Freinet en Steiner? Onderwijs moet kennisgericht zijn, niet kindgericht. Hoe kan het kind immers uit zichzelf weten wat goed, slecht, mooi, lelijk is?
Onze cultuur is boven alles de moeite waard te worden overgedragen en verspreid. Nochtans staan adepten van de Frankfurter Schule klaar om de cultuur van de zogenaamde ‘Dead white men’ neer te sabelen en te brandmerken als seksistisch, racistisch en dies meer. Ook heel wat moslims springen op de kar en zien de kans schoon om met de christelijke concurrent af te rekenen. Edward Saïd is misschien de bekendste telg van deze strekking met zijn boek ‘Orientalism’.
Scruton toont echter aan dat er geen reden is waarom onze Europese cultuur zich zou moeten schamen voor haar verleden. Evenmin zou deze minder aandacht of respect tonen voor vreemde invloeden dan bijvoorbeeld in islamitische landen het geval is. Anderzijds stelt de schrijver terecht dat precies ‘verlichte’ academici, actief in bijvoorbeeld vrouwenstudies, vaak wetenschappelijke kritiek ter zijde schuiven als deze indruist tegen hun politieke overtuiging. Indien de Europese cultuur het vrije woord, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek niet had gekoesterd in haar schoot, zouden we nooit op bijvoorbeeld technologisch vlak zo’n grote sprongen voorwaarts hebben gemaakt. Wetenschap en cultuur of in extenso wetenschap en christelijke religie vormen geen tegenspraak.[1] Zou het kunnen dat onder zogenaamde intellectuelen ‘geestelijke vadermoord’ gemeengoed is geworden?
Met dit boek heeft Scruton als specialist inzake esthetica en filosofie opnieuw een interessant werk afgeleverd. Akkoord, het boek is niet altijd even toegankelijk en verdient daarom af en toe de nodige reflectie en bezinning. Maar wie de boodschap heeft gevat, beseft meer dan ooit dat onze Europese cultuur meer dan de moeite waard is te worden beleefd en overgedragen. Uit respect voor het verleden, met een blik op de toekomst.
Vbr. OS lic. rer. oec. et merc. Pieter Vandermoere
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, conservatisme, angleterre, culture, théorie politique, métapolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 mars 2009
Götz KUbitschek - Provokation

Götz Kubitschek - Provokation
“Unsere Hoffnung ruht in den jungen Leuten, die an Temperaturerhöhung leiden”, sagte Ernst Jünger, und das gilt heute wieder. Kubitscheks Aufruf zur Provokation ist das Manifest des rechten, politischen Existentialismus: Immer dann, wenn einer entschieden etwas tut, vergewissert er sich seiner selbst und gewinnt für sich und seine Überzeugung Strahlkraft und Deutungsmacht. www.edition-antaios.de
00:29 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, conservatisme, existentialisme, allemagne, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 mars 2009
Archives: les "Grünen", quinze ans d'existence et où reste l'écologie?
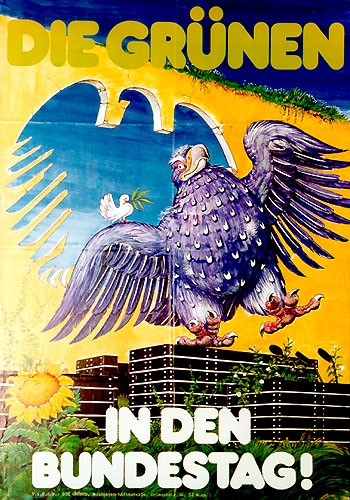
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Les Grünen: quinze ans d'existence et où reste l'écologie?
«Personne ne pourra plus empêcher notre succès, sauf nous-mêmes!». C'est par ces mots que le Dr. Herbert Gruhl a ouvert le congrès de fondation du parti «Die Grünen», le samedi 12 janvier 1980. Le jour de ce congrès était un jour d'effervescence, un moment de réelle euphorie, une date historique: le mouvement écologique, semblait-il, venait de trouver son véritable instrument, un parti qui pouvait sans crainte marcher aux élections, prendre d'assaut la forteresse de la société industrielle.
Quinze ans plus tard, après cette fondation qui avait été fêtée dans la joie par tous les amis de l'environnement, que reste-t-il du souci central, du souci écologique? L'espoir exprimé par le Dr. Gruhl dans son discours inaugural, «que l'esprit de l'histoire souffle dans notre direction, que le grand tournant s'annonce enfin», ne s'est pas accompli. Après que les gauchistes radicaux aient bétonné le parti, imposé leur programme et leurs cadres, lors de la diète du parti à Dortmund en juin 1980, la plupart des conservateurs ont quitté le parti.
Des “conservateurs’ chez les Verts? Est-ce possible? Qui se souvient encore et sait que ce sont des forces conservatrices qui ont joué un rôle dominant dans la phase de construction du parti vert? Herbert Gruhl, qui fut pendant les années 70 le porte-paroles en matières d'environnement pour la fraction parlementaire CDU/CSU, était la personnalité la plus importante de cet aréopage. En 1978, il avait quitté la CDU et fondé la «Grüne Aktion Zukunft», dont le programme avait été élaboré par des esprits conservateurs comme Christa Mewes et le Prof. Bernhard Grzimek. De même, les premières «Listes Vertes», apparues en 1977 en Basse-Saxe, à Hambourg et dans le Schleswig-Holstein, avaient pour pères fondateurs des “conservateurs” plus ou moins radicaux comme Carl Beddermann et Baldur Springmann.
Les origines conservatrices (un conservatisme axiologique et non pas institutionnel, ndt) de l'écologie politique allemande n'étonnent que ceux qui avaient adopté, dans le cadre de la droite régimiste, les positions de Franz-Joseph Strauss qui, trente ans auparavant, avait abandonné les positions originales et initiales de l'idéologie et de l'axiologie conservatrices et avait décidé de «marcher à la tête du progrès (technique)». Le mouvement écologique demeure, par ses origines et par les attitudes qu'il préconise, un mouvement conservateur bien tranché, dont les racines rejoignent celles des associations de protection de la nature et des terroirs, nées sous l'Allemagne de Guillaume II. Les hommes intelligents de la gauche ne l'ont pourtant pas oublié. Ainsi, Peter Glotz, théoricien de la social-démocratie, auteur de thèses pertinentes sur la “neue Rechte” et homme de dialogue, a mille fois raison quand il dit que le camp conservateur s'est fait “chiper” le fleuron des bijoux de son arsenal conceptuel en perdant l'écologie au profit de la gauche.
Le noyau conservateur de l'écologie ne peut effectivement être nié: le primat de “ce qui a eu une croissance organique” sur “ce qui a été fait ou fabriqué”, la propension à accepter l'ascèse et la vie modeste, la pensée en termes de générations, une vision sceptique de l'homme, la protection de la famille en tant que plus petite cellule naturelle parmi les communautés humaines, la critique à l'endroit des superstitions aveugles du progressisme et du technicisme, le souhait de décentralisation, le vœu de voir advenir des structures politico-administratives proches du peuple, la préférence pour les formes vitales alternatives, rurales et traditionnelles à la place de la civilisation urbaine caractérisée par la froideur des sentiments: tout cela, ce sont des points de convergence où se rencontrent les idéologies conservatrices et écologiques. Enfin, ce complexe d'idées comprend également l'attachement à la petite patrie, attachement que les écologues n'interprètent pas dans un sens nationaliste, mais à la lettre, comme protection de l'environnement, du terroir.
En se revendiquant d'une «Europe des Régions», le mouvement vert, lors des élections européennes de 1979, reprenait à son compte l'héritage conservateur du fédéralisme. Aujourd'hui, ces conceptions régionalistes ont disparu du programme des Verts: à leur place, on trouve une profession de foi à l'endroit des structures multinationales. Plus personne, chez les “alternatifs de la gauche verte”, ne semble choqué que de telles allégeances permettent non seulement l'avénement d'un Eldorado pour les tenants d'une économie débridée visant l'expansion infinie, mais consacrent aussi la fin des exigences originelles du mouvement vert qui voulait, jadis, la décentralisation et la transparence du pouvoir. Lorsqu'on demande aux élus ou aux cadres verts d'aujourd'hui, ce qu'ils comptent mettre en œuvre pour sauver nos terroirs et notre environnement, on ne reçoit plus que des réponses condescendantes.
Examinons maintenant les raisons internes qui ont fait que les forces conservatrices du mouvement écologique aient été si rapidement évincées. C'est à cause de leur absence de discipline qu'elles ont été si vite démantelées au moment de la fondation des Verts; pour le dire en une formule plus lapidaire: les cadres expérimentés issus des divers groupes d'action communistes se sont avérés nettement supérieurs, dans le maniement des armes politiques que sont les compositions, rédactions et présentations des ordres du jour dans les diètes et les réunions d'un parti, aux masses de braves petits bourgeois qui partaient au combat sans règle. L'histoire des Verts est aussi l'histoire d'une tentative conservatrice avortée.
Aujourd'hui, les Verts sont un parti-mouvement situé dans le milieu des alternatifs de gauche. Dans les communes rurales, et même dans de nombreux conseils communaux, on trouve encore beaucoup de militants environnementalistes parfaitement compétents et travailleurs, dont l'idéologie ne se situe pas nécessairement à gauche, mais qui se retrouvent, peut-être un peu malgré eux, au service des Verts. Aux niveaux de la direction du parti, toutefois, on ne trouve plus que des activistes issus de groupes protestataires de l'extrême-gauche qui avaient jadis colonisé le milieu des sous-cultures urbaines dans les grandes villes. Ce sont eux qui déterminent les orientations fondamentales du parti.
Ce qui est tragique dans cette évolution, c'est que les Verts commencent à enregistrer des succès au niveau parlementaire, au moment où ils s'éloignent de leur noyau idéologique originel. Exiger par exemple une immigration illimitée est en contradiction flagrante avec l'idée écologique du départ qui critiquait et refusait l'occupation effrénée du pays, la sur-sollicitation du sol agraire et l'augmentation exponentielle de la consommation. Le philosophe Robert Spaemann constate avec pertinence: «L'idéal émancipateur (propre des “Lumières”, ndt) est incompatible avec l'assertion fondamentale de l'écologie. L'idéologie émancipatrice, que traînent les Verts à leurs basques, est tout simplement le modernisme, qui nous a conduit à l'actuelle situation de crise écologique: c'est en effet l'expansion illimitée des désirs humains sans égard pour les lois de la vie, auxquelles l'homme est irrémédiablement soumis, qui nous a conduit où nous sommes. Dans la mesure où les Verts tentent de poursuivre les objectifs de cette idéologie et veulent la radicaliser à l'extrême, l'idée écologique de l'origine s'effondre».
Si l'on tient compte de ce paradoxe philosophique et pratique, on ne s'étonne plus que la plupart des véritables écologues, des vrais amoureux de l'environnement, ne s'intéressent plus aux résultats électoraux des Verts et restent indifférents aux faits qu'ils mordent sur l'électorat libéral ou qu'ils soient en mesure de former de “nouvelles majorités”. De fait, que peuvent bien signifier ces résultats? Tout, sauf un succès des véritables idées écologiques! Robert Spaemann nous tient des propos sans enthousiasme, qui pourraient bien déprimer plus d'un militant écologique. Mais son analyse autorise tout de même l'espoir: si les Verts poursuivent leur chemin dans le cul-de-sac du progressisme, ils créeront automatiquement un vide politique, où pourront s'engouffrer les partisans de l'«écologie pure». Les conservateurs parmi les défenseurs de l'environnement doivent dès aujourd'hui se rendre compte qu'une chance s'offrira très bientôt à eux. Herbert Gruhl disait en 1988: «La droite et la gauche appartiennent au passé. Il s'agit désormais de lutter pour la sauvegarde et la perpétuation de la Vie sur cette Terre ou d'accepter son anéantissement rapide. La combat décisif entre les Préservateurs et les Destructeurs a commencé depuis longtemps. Pourquoi les Préservateurs ne s'appelaeraient-ils pas “conservateurs”?».
Heinz-Siegfried STRELOW.
(Article paru dans Criticón, n°145, janv.-mars 1995).
00:05 Publié dans Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, écologisme, politique, allemagne, histoire, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 mars 2009
A propos du décisionnisme
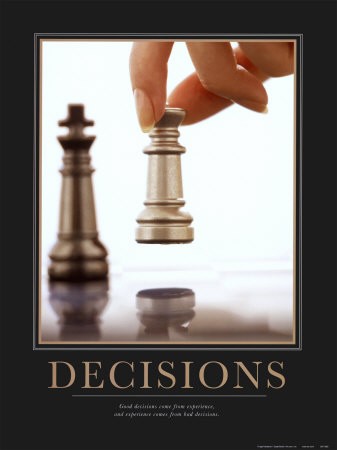
ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
A propos du décisionnisme
Le décisionnisme est, comme son nom l'indique, une pensée en termes de décision. Le décisionniste est l'homme politique qui veut décider, aboutir à une décision, c'est-à-dire à un acte de volonté qui a ses ressorts en lui-même et qui est vierge de toute compromission. Le décisionniste, en conséquence, s'oppose à toutes les formes de compromis que permet le libéralisme. Carl Schmitt, catholique et conservateur, est sans nul doute celui qui, parmi les tenants de la “révolution conservatrice”, a pensé le décisionnisme de la manière la plus conséquante. Chez les penseurs nationaux-révolutionnaires de la même époque, on trouve également des décisionnistes.
Pour Carl Schmitt, ce qui est important, c'est «que dans la simple existence d'une autorité réellement autoritaire, il y ait de la décision, et que toute décision soit valable et valide, car dans les choses les plus essentielles [du politique], il est plus imoportant de savoir que quelqu'un décide, que de savoir comment cette décision est décidée» (1). Il s'agit donc de poser une “décision” en soi, en pleine souveraineté. L'Etat, à l'époque de Carl Schmitt, du moins dans le domaine du politique, est le moyen le plus approprié pour poser de telles décisions; c'est lui qui incarne la souveraineté qui est, en fait, rien d'autre que le “monopole de la décision” (2). Il s'agit de reconnaître le bien-fondé, l'utilité pratique, l'excellence, de la décision absolue, c'est-à-dire de la décision pure, non raisonnée, qui n'est pas le produit d'une discussion, qui n'a nul besoin de se justifier, qui jaillit du néant (3). L'essence de l'Etat apparaît ici clairement, parce qu'il est le vecteur premier de la décision, devient de la sorte le moyen le plus précieux pour contrer, à l'intérieur, la guerre civile que déclenchent les idéologies et les intérêts contradictoires. «L'essence de l'Etat réside en ceci, qu'il y ait [par lui] une décision» (4).
La particularité de Carl Schmitt, dans le cadre de cette “révolution conservatrice” mise en exergue par Armin Mohler, c'est, qu'en tant que penseur catholique, il voit toujours Dieu trôner au-dessus de tout. D'où son constat: «Tous les concepts prégnants des doctrines modernes de l'Etat sont des concepts théologiques sécularisés» (5). Toutefois, le Règne de Dieu n'est pas de ce monde, où c'est l'homme qui gouverne, où c'est l'homme qui est le fondateur des valeurs. Mais comment réalise-t-on concrètement les valeurs, comment établit-on les lois? Schmitt ne cesse de citer l'Anglais Thomas Hobbes, en acceptant ses théorèmes: «Auctoritas, non veritas facit legem» (6). L'autorité est la source des lois, car le pouvoir lui en donne la force, c'est elle qui pose les décisions qui génèrent les lois. C'est au départ de cette conception de Hobbes, que la “révolution conservatrice” allemande a opté pour les systèmes autoritaires, parce qu'ils éliminent les querelles intérieures et les bannissent de la “communauté organique”.
Chez les nationaux-révolutionnaires, que Mohler classe aussi dans la “révolution conservatrice”, il y a donc aussi des décisionnistes. Le concept de décision a fasciné cette gauche non-conformiste, si bien que l'hebdomadaire du mouvement “Widerstand” (= Résistance) d'Ernst Niekisch portait le titre d'Entscheidung (= Décision). Ce n'est pas un hasard. Chez Niekisch, par d'arrière-plan théologique, au contraire de Schmitt. Le décisionnisme de Niekisch découle d'une position fondamentaliste absolue. Niekisch exige la “décision permanente”, car l'“idéologie de Widerstand” équivaut à une “protestation allemande” contre le “romanisme”, à une option pour l'Est contre l'Ouest, pour l'éthique prussienne du service contre le libéralisme (7). Cette protestation tous azimuts, incessante, permanente, exige, selon Niekisch, une “nouvelle attitude humaine”, une promptitude à accepter et à supporter un “destin héroïque”. Pour généraliser cette attitude contestatrice permanente, il faut recruter des hommes qui soient “déjà saisis par l'esprit du futur” (8). Niekisch accuse et brocarde l'éternelle indécision allemande: «Il existe une lenteur, une lourdeur, une faiblesse typiquement allemandes, qui, sans cesse, cherche, en louvoyant, à échapper à la décision nécessaire» (9). Mais le devoir éthique de trancher, donc de décider, de prendre littéralement le taureau par les cornes, personne ne peut l'éviter, le refuser.
Sur le plan littéraire, l'exigence de décision se retrouve, à un degré de radicalité encore plus élevé, chez Ernst Jünger, qui, à cette époque, appartenait encore aux cercles nationaux-révolutionnaires, et était une figure de proue du “nouveau nationalisme”. Il écrivait: «C'est pourquoi cette époque exige une vertu entre toutes: celle du décisionnisme. Il s'agit de pouvoir vouloir et de pouvoir croire, sans se référer au contenu que cette volonté et cette foi se donnent» (10). Cet appel de Jünger est un appel à la “décision en soi”. Chez Jünger, la décision est couplée à un désir ardent de nouveauté, au désir d'une révolution, d'où les éléments de nihilisme ne sont pas totalement absents. Chez lui, la décision est toute imprégnée de l'esprit des “orages d'acier”: elle est quasi synonyme de “mobilisation totale”. «Notre espoir repose sur les hommes jeunes, qui souffre de fièvre, parce qu'ils sont dévorés par le pus verdâtre du dégoût, notre espoir repose dans les âmes saisies par la grandezza, dans les âmes que nous voyons errer dans les sinuosités de l'ordre des auges. Notre espoir repose en une révolution qui s'opposerait à la domination du confort, en une révolution visant à détruire le monde des formes, en une révolution qui a besoin d'explosifs pour nettoyer et vider notre espace vital, afin qu'il y ait la place pour une nouvelle hiérarchie» (11).
Le décisionnisme est en tant que tel une méthode, plus exactement une méthode de critique sociale, une méthode finalement assez proche de la théorie critique utilisée par les gauches nouvelles. Mais il peut bien entendu étoffer l'arsenal d'une nouvelle droite, qui devrait en être l'héritière et la continuatrice, car de larges segments de la “neue Rechte” allemande sont d'ores et déjà influencés par Carl Schmitt. En effet, la critique du déclin du politique à l'ère du libéralisme, formulée par Carl Schmitt en 1922, reste d'une étonnante actualité: «Aujourd'hui rien n'est plus moderne que la lutte contre le politique. Les financiers américains, les techniciens de l'industrie, les socialistes marxistes, les révolutionnaires anarcho-syndicalistes, s'unissent pour exiger que soit éliminée la domination immatérielle du politique sur la matérialité de la vie économique. Il ne devrait plus y avoir que des tâches organisationnelles, techniques, économiques et sociologiques, mais il ne pourrait plus y avoir de problèmes politiques. Le mode aujourd'hui dominant de la pensée économico-technique n'est déjà plus capable de percevoir la pertinence d'une idée politique. L'Etat moderne semble être vraiment devenu ce que Max Weber voyait se dégager de lui: une grande entreprise. En général, [dans ce contexte libéral], on ne comprend une idée politique que lorsque ses tenants sont parvenus à prouver à une certaine catégorie de personnes qu'elles ont un intérêt économique direct et tangible à l'instrumentaliser à leur profit. Si, dans ce cas d'instrumentalisation, le politique disparaît et sombre dans l'économique, ou dans le technique ou l'organisationnel, par ailleurs, il s'épuise dans les intarissables discours ressassant à l'envi les banales généralités que l'on ne cesse d'ânonner sur la “culture” ou sur la “philosophie de l'histoire”, discours définissant au nom de critères esthétiques l'air du temps tantôt comme classique, tantôt comme romantique ou comme baroque, en hypnotisant les “beaux esprits”. Ce basculement dans l'économique ou ce discours [“cultureux”], passe à côté du noyau réalitaire de toute idée politique, de toute décision qui, en tant que décision, est toujours d'une plus haute élévation morale. La signification réelle que revêtent en fait les philosophes de l'Etat contre-révolutionnaires, réside entièrement dans la dimension conséquente de leur démarche, laquelle repose sur la décision, [baigne dans l'incandescance de la décision]. Ces philosophes contre-révolutionnaires mettent si fort l'accent sur l'instant intense de la décision qu'ils annulent finalement l'idée de légitimité, à partir de laquelle, pourtant, ils avaient amorcé leurs réflexions» (12).
Le déclin du politique découle de l'évitement systématique des décisions. La modernité passe de fait à côté de la décision essentielle, de la décision qui fonde le concept du politique, c'est-à-dire de la décision qui aboutit à la désignation de l'ami et de l'ennemi. «C'est ainsi que Carl Schmitt définit la modernité: elle est oublieuse du politique. Dans cette perspective, le communisme et le capitalisme apparaissent pour ce qu'ils sont: les deux pôles complémentaires d'une même positivité impolitique, qui constitue le terminus ad quem d'une objectivisation mécaniciste du social, à l'œuvre depuis le XVIIième siècle» (13).
Jürgen HATZENBICHLER.
(traduction française: Robert STEUCKERS).
Notes:
(1) Carl SCHMITT, Politische Theologie, Berlin, 1990, p. 20.
(2) Ibid., p.71.
(3) Ibid., p.83.
(4) Ibid., p.71.
(5) Ibid., p.49.
(6) Ibid., p.44.
(7) Ce nom dérive de celui du mensuel Widerstand, dirigé par Niekisch.
(8) cf. Uwe SAUERMANN, Ernst Niekisch und der revolutinäre Nationalismus, München, 1985, pp. 173 & ss.
(9) Ernst NIEKISCH, cité par Friedrich KABERMANN, Widerstand und Entscheidung eines deutschen Revolutionärs, Köln, 1973, p. 165.
(10) Ernst NIEKISCH, Widerstand, Krefeld, 1982, p. 164.
(11) Ernst JÜNGER, Das abenteurliche Herz - Erste Fassung, Stuttgart, 1987, p. 110.
(12) E. JÜNGER, ibid., pp. 113 & ss.
(13) C. SCHMITT, ibid., pp. 82 & ss.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, carl schmitt, conservatisme, droite, nouvelle droite, synergies européennes, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 février 2009
Freiheitskonservativismus is overleden
 De publicist Caspar von Schrenck-Notzing is overleden. Meer dan wie ook blijft zijn naam verbonden met hét Europese conservatieve tijdschrift bij uitstek Criticon. Het niveau was jarenlang toonaangevend voor zovele andere Europese tijdschriften.
De publicist Caspar von Schrenck-Notzing is overleden. Meer dan wie ook blijft zijn naam verbonden met hét Europese conservatieve tijdschrift bij uitstek Criticon. Het niveau was jarenlang toonaangevend voor zovele andere Europese tijdschriften. De taak van een rechtse, conservatieve beweging was in die jaren (jaren 50 en 60 van de vorige eeuw) niet gemakkelijk en totaal anders dan 30 jaar geleden. Kon ze in een vroeger tijdsgewricht de staat, het leger, het gerecht en de kerk als traditiegebonden instellingen verdedigen, schragen en uitdragen, dan bleken ze in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw steeds meer aangetast door het liberalisme en het egalitarisme. Zo schreef Caspar von Schrenck-Notzing: “We leven in een tijdperk van een wereldwijd ineenstorten van alle Europese posities”.
De taak van een rechtse, conservatieve beweging was in die jaren (jaren 50 en 60 van de vorige eeuw) niet gemakkelijk en totaal anders dan 30 jaar geleden. Kon ze in een vroeger tijdsgewricht de staat, het leger, het gerecht en de kerk als traditiegebonden instellingen verdedigen, schragen en uitdragen, dan bleken ze in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw steeds meer aangetast door het liberalisme en het egalitarisme. Zo schreef Caspar von Schrenck-Notzing: “We leven in een tijdperk van een wereldwijd ineenstorten van alle Europese posities”.
13:42 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, bavière, conservatisme, revue, droite, politique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
In Memoriam: Caspar von Schrenck-Notzing und "Criticon"
Caspar von Schrenck-Notzing und Criticón
von Karlheinz Weißmann am 4. Februar 2009 - http://www.sezession.de/
[1]Heute wird Caspar von Schrenck-Notzing in München zu Grabe getragen. Damit geht auch ein Abschnitt in der Geschichte des deutschen Nachkriegskonservatismus zu Ende. In allen Würdigungen und Nachrufen wurde darauf hingewiesen, daß Schrenck-Notzing mit der Gründung der Zeitschrift Criticón die Tribüne für die rechte Intelligenz der siebziger und achtziger Jahre geschaffen hatte: von den katholischen Traditionalisten über die Adenauer-Fraktion und die Klassisch-Liberalen bis zu den Nominalisten und Nationalrevolutionären.
Geplant war das ursprünglich nicht. Datiert auf „Ammerland, im Mai 1970″ ging ein hektographierter Rundbrief ins Land, der das Erscheinen der ersten Ausgabe von Criticón ankündigte. Einleitend hieß es: „Bei dem Schwimmen gegen den Strom fällt es immer schwerer, aus der Sturzflut des Gedruckten jene Publikationen herauszufinden, die für die grundlegende und laufende Orientierung über Zeitfragen wesentlich sind.“ Deshalb sei es nötig, eine „Sammelstelle“ zu schaffen, die das Material sichte und den Leser auch auf das hinweise, was eventuell am Rande stehe. Die Nummer 1 war denn auch ein gerade zwölf Seiten umfassendes Heft ohne Umschlag im Format DIN A 4, dessen Schwerpunktthema das Denken Arnold Gehlens bildete (einleitender Text über Moral und Hypermoral von Armin Mohler, Autorenportrait von Gehlens Schüler Hanno Kesting), während man ansonsten nur Rezensionen und kurze Hinweise auf Organisationen, Veranstaltungen oder andere Zeitschriften fand.
Seine spätere Gestalt mit den auffallend farbigen Umschlägen, auf denen eben kein deutscher Adler, sondern ein Hahn in gallischer Manier prangte, nahm Criticón allerdings schon im Laufe des zweiten Erscheinungsjahrs an. Auch die Gliederung der einzelnen Nummer ergab sich frühzeitig. Die Autorenportraits bildeten über die Zeit hinweg eine Art Enzyklopädie der konservativen Meisterdenker, wobei Schrenck-Notzing großzügig jede Fraktion der geistigen Rechten zur Geltung kommen ließ, außerdem gab es theoretische wie aktuelle Aufsätze deutscher und ausländischer Autoren, sowie ein politisch-metapolitisches Editorial, das Schrenck-Notzing unter dem Pseudonym „Critilo“ – der „Kritische“ verfaßte.
[2]Critilo gehörte zu den Figuren des allegorischen Romans El Criticón des spanischen Jesuiten Baltasar Gracián, nach dem Schrenck-Notzing seine Zeitschrift benannt hatte. Gracián war einer jener „Machiavellisten“, die die Freiheit liebten und deshalb die Macht der Gegen-Aufklärung einsetzten, um sich Einsicht in die tatsächlichen Weltzusammenhänge zu verschaffen. Das erklärt etwas von dem hohen analytischen und prognostischen Wert, den viele der in Criticón veröffentlichten Texte hatten. Zusammenfassend schrieb Schrenck-Notzing dazu: „Schwerpunkte von Criticón waren das russische Dissidententum (vor dem Nobelpreis für Solschenizyn), der amerikanische Konservatismus (vor der Wahl Reagans), der britische Konservatismus (vor der Wahl von Mrs. Thatcher), die Emigrationen der Ostblockstaaten (vor deren Zusammenbruch), die deutsche Identität (vor der Wiedervereinigung), Parteien und Medien (vor dem Ausufern des Parteien- und Medienstaates).“
Man muß sich dabei vergegenwärtigen, daß Criticón trotz oder gerade wegen dieser Qualität isoliert in der deutschen Zeitschriftenlandschaft stand. Selbst die Springer-Presse hatte kaum mehr als Häme für die „konservativen Standartenträger“ (Die Welt) übrig. Ein Sachverhalt, der auch durch vermehrte Anstrengungen nicht zu ändern war. Das ließ sich vor allem an den Überlegungen Schrenck-Notzings in den achtziger Jahren ablesen, mit Criticón aktuell einen eigenen, alle drei Wochen erscheinenden Nachrichtendienst herauszubringen. Ein Versuch, der bereits im Ansatz scheiterte. Kurze Zeit später mußte auch die Erscheinungsweise Criticóns von zweimonatlich auf vierteljährlich umgestellt werden.
[3]Der Einsatzbereitschaft von Schrenck-Notzing ist es zu verdanken, daß Criticón trotzdem die damalige Krise des konservativen Zeitschriftensegments überstand, dessen Publikationen nach und nach verschwanden, weil die Verlegerpersönlichkeit, die sie getragen hatte, nicht mehr da war (Herderbücherei Initiative), aufgab (Mut), sich von der CSU umarmen ließ (Zeitbühne, Epoche) oder ihr Milieu verlor (Konservativ heute). Es war deshalb tragisch, daß die Auswahl eines Nachfolgers zu einem immer drängenderen Problem wurde und Schrenck-Notzings Wahl – Gunnar Sohn, ein langjähriger Mitarbeiter von Criticón – sich als Fehlentscheidung erwies. Die gewisse Häme, mit der die Neue Zürcher Zeitung im Frühjahr 2000 einen Artikel über das „neue Criticón“ betitelte mit „Kapitulation vor dem bösen alten Feind“ war ein Signal dafür, daß Sohn nach kurzem Lavieren, das Erbe, das er angetreten hatte, verriet. Das hatte auch mit objektiven Schwierigkeiten zu tun, die Zeitschrift wie bisher fortzuführen, hing aber vor allem mit der Inkompetenz Sohns zusammen.
Und das ist das erstaunliche: Criticón ist eine konservative Zweimonatsschrift, ein Blatt der rechten Intelligenz, sowohl nach seinem Selbstverständnis wie im Urteil der Kritiker. – Claus Leggewie 1987
Schrenck-Notzing wird diese Entwicklung mit Bitterkeit verfolgt haben, wenngleich er sich das niemals anmerken ließ. Durch die Zeitschrift Agenda, die seine Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung (FKBF) mit einigen Nummern erscheinen ließ, versuchte er noch einmal zu den Anfängen von Criticón zurückzukehren und ein konservatives Rezensionsorgan zu schaffen. Geglückt ist das nur im Ansatz. Es war offenbar Zeit für etwas Anderes, und das Erscheinen der Sezession ist von Freund wie Feind als Versuch betrachtet worden, die Linie Schrenck-Notzings unter den gegebenen Umständen fortzusetzen.
Artikel ausgedruckt von Sezession im Netz: http://www.sezession.de
Adresse zum Artikel: http://www.sezession.de/caspar-von-schrenck-notzing-und-criticon.html
Adressen in diesem Beitrag:
[1] Bild: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/02/schrenck.jpg
[2] Bild: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/02/img4881.jpg
[3] Bild: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/02/img4891.jpg
13:41 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, conservatisme, droite, philosophie, revue, politique, bavière |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 février 2009
Mondialisme contre ethnonationalisme
Mondialisme contre ethnonationalisme
Trouvé sur: http://qc.novopress.info/
 Debout devant le Siegessaule, le monument commémorant les victoires de la Prusse sur le Danemark, l’Autriche et la France durant les guerres qui ont vu naître le second Reich, Barack Obama s’est déclaré lui même, « citoyen du monde » et a parlé d’un « monde debout comme un seul homme ».
Debout devant le Siegessaule, le monument commémorant les victoires de la Prusse sur le Danemark, l’Autriche et la France durant les guerres qui ont vu naître le second Reich, Barack Obama s’est déclaré lui même, « citoyen du monde » et a parlé d’un « monde debout comme un seul homme ».
Les mondialistes ont applaudi. Et l’élection de ce fils d’une adolescente blanche venue du Kansas et d’un diplomate kenyan est considérée comme l’évènement qui nous a fait entrer dans un nouvel âge « post-racial ».
Nous trompons-nous ? À travers le monde, la plus puissante force du XXème siècle, l’ethnonationalisme - ce créateur et destructeur de nations et d’empires ; cet effort constant des peuples pour créer un Etat-nation où leur foi et leur culture sont dominantes et où leur race ou leur tribu occupent la première place - semble plus manifeste que jamais.
« Le vote reflète les divisions raciales » titrait le Washington Times à propos d’un fait se situant à Santa Cruz en Bolivie. L’article commençait ainsi :
« Le référendum bolivien pour approuver une nouvelle Constitution soutenue par le président de gauche Evo Morales reflète les division raciales entre les descendants des Indiens d’Amérique et ceux des Européens ».
Les provinces où les métis et les Européens sont majoritaires ont voté contre la Constitution. Mais il apparait que les tribus indiennes des montagnes occidentales du pays ont voté massivement pour elle, car celle-ci traite des droits des groupes ethniques.
En 2005 Morales a accédé au pouvoir en étant résolu à redistribuer à sa propre tribu, les Aymara ainsi qu’à d’autres « peuples indigènes » un pouvoir et une richesse qu’il estime avoir été volés par les Européens à leur arrivée, il y a 500 ans à l’époque de Christophe Colomb.
La victoire de Pizzaro sur l’empire Inca est sur le point d’être renversée.
Selon l’article 190 de la nouvelle Constitution, les 36 zones majoritairement indiennes de la Bolivie sont autorisées à « exercer leurs fonctions juridictionnelles selon leurs propres principes, valeurs, culture, normes et procédures ».
La loi tribale est en passe de devenir la loi provinciale et même la loi nationale.
Le gouverneur Mario Cossio de Tarija, qui a voté « non », assure que cette Constitution va créer un « régime totalitaire », contrôlé par une « bureaucratie ethnique ». Ce à quoi Morales réplique : « les Boliviens de souche qui habitent sur ces terres depuis des milliers d’années sont nombreux mais pauvres. Les Boliviens arrivés récemment sont peu nombreux mais riches ».
La Bolivie est en train de se balkaniser, se divisant et étant partagée selon des critères de tribu, de race et de classe. Salué par Hugo Chavez, la Bolivie de Morales n’est pas la seule région où les revendications ethniques, tribales ou raciales partent en guerre contre l’universalisme et le mondialisme.
Après une élection disputée au Kenya, les Kikyu (1) ont subi un nettoyage ethnique de la part des Luo. Au Zimbabwe, les fermiers blancs sont dépossédés de leurs terres à cause de leur lignage. Au Sri Lanka, la rébellion tamoule contre les dirigeants Sinhalese - afin de créer une nation tamoule, une guerre qui a fait des dizaines de milliers de victimes - paraît perdue, pour l’instant.
A l’époque de Vladimir Poutine, les Russes ont écrasé les Tchétchènes, se sont affrontés aux Estoniens au sujet des monuments militaires russes datant de l’époque soviétique, ont eu des différends avec l’Ukraine concernant la Crimée et ont saigné la Géorgie.
Pékin écrase les Ouïghours qui veulent créer leur propre Turkestan oriental et les Tibétains qui cherchent l’autonomie, en envoyant dans ces deux régions des flots de Chinois Hans. (1)
En Europe, les partis populistes anti-immigration, alarmés par la perte des identités nationales, gagnent en respectabilité et en pouvoir. Le Vlaams Belang, parti indépendantiste flamand est le plus grand parti au Parlement belge. Le Parti populaire (3) et le Parti de la liberté sont maintenant les deuxième et troisième formation politique d’Autriche. Le Parti populaire suisse (4) de Christoph Blocher est le plus fort à Berne. En France, le Front National a récemment humilié le gouvernement en récoltant la moitié des votes dans une banlieue de Marseille (5).
Tous sont des ethnonationalistes convaincus. Le diplomate anglais Sir Christopher Meyer a écrit : « Il est inutile de dire que le nationalisme et le tribalisme ethnique n’ont aucune place dans les relations internationales au XXIème siècle ».
Dans le même temps, des institutions internationales, comme les Nations-Unies, le FMI et l’Union Européenne ont perdu de leur prestige. Les Tchèques - dont le président Vaclav Klaus, considère l’U.E. comme une prison des nations - exercent actuellement la présidence de l’U.E. Quand la crise financière a frappé, les Irlandais, Anglais et Allemands se sont précipités pour renflouer leurs banques, tout comme les Américains qui ont sauvé Ford, Chrysler et General Motors laissant Hyundai, Honda et Toyota dans la tourmente.
Cela s’appelle du nationalisme économique.
L’étoile montante du cabinet d’Ehud Olmert, est Avigdor Lieberman. Ce que défend Lieberman, écrit l’American Prospect, c’est « un nettoyage ethnique : comme ce nom effrayant le suggère, le parti Yisrael Beiteinu (qui signifie : “Israël est notre maison”) pense que le million d’Arabes citoyens israéliens doit être expulsé ».
Barack Obama a gagné le vote Afro-américain avec un ratio de 97 % contre 3 % seulement pour John McCain et un ratio de 90 % contre 10 % pour Hillary Clinton durant les primaires démocrates. McCain n’a fait mieux que son prédécesseur George W. Bush uniquement dans les Appalaches, le berceau des descendants des Écossais et des Irlandais.
Dans son article paru dans Foreign Affairs et intitulé Eux et Nous : le pouvoir durable du nationalisme ethnique, Jerry Z. Muller résume ainsi sa thèse :
« Les Américains sous-estiment généralement le rôle du nationalisme ethnique en politique. Mais (…) cela correspond à de tenaces propensions de l’esprit humain. Ce nationalisme ethnique est galvanisé par la modernisation et de lui dépendront les politiques mondiales des générations à venir. Une fois que le nationalisme ethnique a capturé l’imagination des communutés dans une société multiethnique, la désagrégation ethnique ou la séparation est parfois la moins mauvais réponse possible ».
La désagrégation ou la séparation, dit-il.
Sommes-nous vraiment en présence dans une Amérique post-raciale, ou est-ce que notre Amérique multiculturelle et multiethnique est, elle aussi, destinée à se balkaniser et à exploser ?
Par Patrick J. Buchanan
Traduit de l’américain et annoté par G.W. Blakkheim pour Novopress France
(1) L’auteur veut sans doute parler des Kikuyu.
(2) Ethnie majoritaire en Chine.
(3) L’auteur veut sans doute parler du BZÖ ou « Alliance pour le futur (ou l’avenir) de l’Autriche ».
(4) En fait, l’Union démocratique du centre.
(5) Information non confirmée…
00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mondialisme, globalisation, ethnicité, ethno-nationalisme, nationalisme, etats-unis, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Het vergeten conservatisme
00:11 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, conservatisme anglais, angleterre, philosophie, révolution française, 18ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 février 2009
Gomez Davila ou la passion de la Réaction
Gómez Dávila ou la passion de la Réaction
Ex: http://stalker.hautetfort.com/
« Les deux ailes de l’intelligence sont l’érudition et l’amour ».
Nicolás Gómez Dávila
Nicolás Gómez Dávila est de ces rares auteurs qui tiennent leur lecteur en assez haute estime pour ne lui offrir que le meilleur d’eux-mêmes. Le véritable titre de ces formes brèves, qui ne sont ni des aphorismes, ni des sentences, rassemblées sous le titre Les Horreurs de la Démocratie (choix d’éditeur non dépourvu de roborative provocation) est « Escolios a un texto implicito », Scolies pour un texte implicite. Ces « scolies » ont pour règle de ne laisser apercevoir de la pensée que la fine pointe et pour vertu, la générosité de supposer au lecteur l’intelligence et l’art de déployer, à partir de ces fines pointes, un texte qui est à la fois absent et présent, implicite, c’est-à-dire donné, sans être pour autant révélé.
Toute œuvre digne que l’on s’y attarde ressemble à la part émergée de l’Iceberg : ce qu’elle dit n’est que le signe de ce qu’elle ne dit point. L’implicite est, plus généralement, le propre de la Contrelittérature ; ce qui la distingue de l’information, des sciences humaines et du bavardage où ce qui n’est pas dit vaut encore moins que ce qui est dit. Lorsque l’écrit s’élève au rang de parole, lorsque les pages sont comme la réverbération du Logos-Roi, le moindre scintillement témoigne du gouffre lumineux du Ciel. Ce qui est dit est comme soulevé par la puissance de ce qui n’est pas dit, comme le roulement de la vague accordée au magnétisme des marées. Or, cette puissance-là, l’éminente générosité de Nicolás Gómez Dávila est de l’accorder d’emblée à son lecteur, sans se soucier d’aucune autre qualification extérieure. Ce réputé « anti-démocrate » pose en a priori théorique à son œuvre, à sa « méthode » (au sens où Valéry parle de la « méthode » de Léonard de Vinci) la possibilité pour tout homme soucieux d’une vie intérieure de le comprendre. « Les hommes sont moins égaux qu’ils ne le disent mais plus qu’ils ne le croient ». La logique est ici exactement inverse à celle du « démocrate » fondamentaliste qui affirme théoriquement l’égalité de tous non sans s’accorder le magistère de la définition de l’égalité et, par voie de conséquence, une supériorité absolue qui ne saurait se traduire, en Politique, que par la généralisation des méthodes policières. « L’Etat moderne réalisera son essence lorsque la police comme Dieu, sera témoin de tous les actes de l’homme ».
Les Scolies de Nicolás Gómez Dávila sont une œuvre de combat. Ce qui est en jeu n’est rien moins que la dignité et la liberté humaines, mais à la différence de tant d’autres qui mâchonnent les mots de « dignité » et de « liberté », Gómez Dávila ne pactise point avec les forces qui les galvaudent et les ruinent. Ne nous attardons pas sur les roquets-folliculaires qui furent lancés aux basques de ce livre magnifique : ils n’existent que pour en illustrer la pertinence : « Le démocrate ne considère pas que les gens qui le critiquent se trompent, mais qu’ils blasphèment ». Cette figure du Moderne, que Gómez Dávila nomme le « démocrate » (non, précise-t-il en tant que partisan d’un système politique mais comme défenseur d’une « perversion métaphysique ») peut, en effet, être définie ici comme fondamentaliste dans la mesure où elle ne louange le « débat », la « discussion », le « polémos » que sous l’impérative condition que ceux avec qui il est permis de débattre, discuter et polémiquer fussent déjà, de longtemps et notoirement, du même avis qu’elle ; et qu’ils le soient, par surcroît, avec le même vocabulaire, les mêmes rhétoriques, et si possible, avec les mêmes intonations, le même style ou, plus probablement, la même absence de style. Le démocrate fondamentaliste ne « raisonne » ainsi que dans les limites de sa folie procustéenne ; son amour de l’humanité « en général » ne s’accomplit qu’au mépris du particulier ; la liberté d’expression ne lui vaut que strictement réservée à ceux qui n’ont rien à dire ; la « dignité » humaine ne mérite à ses yeux d’être défendue qu’en faveur de ceux qui s’en moquent et s’avilissent à plaisir.
« Aux yeux d’un démocrate, qui ne s’avilit pas est suspect. » Il n’est point d’écrivain un peu libre qui ne fasse chaque jour l’expérience de cette suspicion. Quand bien même se tiendrait-il à l’écart des idées qui fâchent, une simple tournure, un mot pris dans une acception un peu ancienne, une vague nostalgie, ou le refus de considérer le monde contemporain comme le parangon de toutes les vertus et la source de tous les bienfaits suffisent à le désigner comme suspect. La critique littéraire qui devrait se situer entre la métaphysique et l’hédonisme, entre la sagesse et le plaisir, le vrai et le beau, se réduit tristement à des rodomontades moralisatrices ou de fastidieuses rhétoriques de procureur ou d’avocat, comme si l’on ne pouvait plus lire un roman ou un essai sans en instruire le procès, comme si tout sentiment de gratitude s’était évanoui des cœurs humains pour ne plus laisser place qu’à des maniaqueries de « Fouquier-Tinville » sans envergure ni courage. « Les individus, dans la société moderne, sont chaque jour plus semblables les uns aux autres et chaque jour plus étrangers les uns aux autres. Des monades identiques qui s’affrontent dans un individualisme féroce. »
Le critique moderne est un homme qui, pour exercer son office, ne doit connaître ni remord, ni merci, mais s’enticher éperdument de la scie procédurière à quoi se réduit désormais toute forme d’Eris. Transposée dans la mesquinerie, l’agressivité moderne prend le visage patelin de la bien-pensance, c’est-à-dire de la « pensance » collective, grégaire, aussi revêche, obtuse et obscurantiste dans le « village planétaire » qu’elle le fut dans les « villages » imaginés par des bourgeois libéraux, peuplés, comme de bien entendu, d’une paysannerie torve et cruelle et d’affreux chouans ennemis de la liberté. Le Moderne lorsqu’il décrie son ennemi se décrit lui-même. Cet « archaïque », ce « superstitieux », cet « adversaire de la raison », c’est lui-même. Plus il se nomme « démocrate », et plus il méprise ce « peuple » auquel il n’accorde d’autre pouvoir que celui de l’état de fait, qu’il nomme « volonté générale », par pure tartufferie. « La volonté générale, c’est la fiction qui permet au démocrate de prétendre que pour s’incliner devant une majorité, il y a d’autres raisons que la pure et simple couardise. »
La composition pointilliste des Scolies, qui mêlent les aperçus éthiques, esthétiques et politiques, interdit que l’on traitât de chaque domaine comme d’une région séparée. Le bien, le beau et le vrai sont indissociables. L’esthète est toujours moraliste et politique. « Le monde moderne est un soulèvement contre Platon ». Il appartient donc au « réactionnaire » tel que le définit Nicolás Gómez Dávila (dont la vocation est d’être « l’asile de toutes les idées frappées d’ostracisme par l’ignominie moderne ») d’œuvrer à la recouvrance du platonisme, non en tant que système philosophique (à supposer qu’il existât un « système » platonicien hors des aides-mémoires de quelques pédagogues trop pressés d’enseigner ce qu’ils ne savent pas pour lire des Dialogues) mais en tant qu’expérience métaphysique fondamentale de la lecture (lecture du monde non moins que lecture des livres). « Derrière chaque vocable se lève le même vocable avec une majuscule : derrière l’amour, l’Amour, derrière la rencontre la Rencontre. L’univers s’évade de sa prison lorsque dans l’instance individuelle, nous percevons l’essence. »
Le Politique, pour Nicolás Gómez Dávila, n’est pas la fin de la pensée, ni même son commencement. Elle se tient dans une zone médiane, plus où moins fréquentable selon les époques, entre le métaphysique et le perceptible, entre la théorie et le goût. « Tout est banal si l’homme n’est pas engagé dans une aventure métaphysique. » Cette banalité toutefois n’est point banale, au sens où elle serait négligeable : elle est horrible. Elle nous livre à la servitude et à la laideur, pire à une servitude et une laideur toujours identiques à elles-mêmes, comme dans une catastrophe ou un cauchemar, sous couvert de « changement » et de « nouveauté ». « Le monde moderne est arrivé à institutionnaliser avec une telle astuce le changement, la révolution, l’anticonformisme que toute entreprise de libération est une routine inscrite dans le règlement de la prison ». Ce « changement », c’est-à-dire cette haine de la Tradition, qui est le propre du Moderne, ce culte de l’amnésie, cet oubli de l’oubli est tel qu’il en oublie sa propre identité avec lui-même. L’oubli de l’oubli est ce pur néant immobile qui se rêve comme un changement perpétuel, autrement dit comme un présent sans présence. Ainsi, « les démocrates décrivent un passé qui n’a jamais existé et prédisent un avenir qui ne se réalise jamais. »
La politique se détruisant elle-même dans la lâcheté, le Logos se profanant en propagande et publicité, l’alchimie à rebours transformant l’or du pur amour en plomb de « convivialité » obligatoire, nous tombons sous le joug de cette caste qui prétend n’en point être une et dont l’amour de l’humanité en général est le prétexte pour n’avoir personne à aimer en particulier, dont la « tolérance » abstraite est la ruse pour n’avoir jamais à pardonner une offense, et « l’ouverture aux autres » la condition première à se dispenser de toute magnanimité. L’idéologie « citoyenne » fait office d’indulgences, sans que les Pauvres n’en profitent le moins du monde.
Si pour Gómez Dávila la politique est impossible, c’est une raison supplémentaire pour s’y intéresser, mais seul. « La lutte contre le monde moderne doit être conduite dans la solitude. Lorsqu’on est deux, il y a déjà trahison ». On songe ici à la phrase de Montherlant : « Dès que les hommes se rassemblent, ils travaillent pour quelque erreur. » Il n’en demeure pas moins qu’il y eut des temps où l’ordre politique semblait destiné à nous éviter le pire, autant que possible. Le pire, c’est-à-dire, le nihilisme, le totalitarisme, la terreur. « La démocratie a la terreur pour moyen et le totalitarisme pour fin ». Toutefois, le « totalitarisme » et la « terreur » ne disent point l’entièreté du pire. Le démocrate ne cesse d’en parler, de s’en prétendre le rempart lorsqu’il s’en trouve être la condition, la prémisse. Le pire est ce que l’homme devient, ce que tous les hommes deviennent, lorsque la contemplation disparaît du monde, lorsque le commerce entre les hommes ne s’ordonne plus qu’à l’économie. « L’absence de vie contemplative fait de la vie active d’une société un grouillement de rats pestilentiels ». Ce par quoi le langage témoigne de la contemplation, et de cette joie profonde, ambrée et lumineuse du Logos-Roi, c’est peu dire que le Moderne ne veut plus en entendre parler. Son monde, il le veut sans faille, compact et massif, c’est-à-dire réduit à lui-même, à sa pure immanence, autrement dit à l’opinion que les plus sots et les plus irréfléchis se font de lui. « Le moderne se refuse à entendre le réactionnaire, non que ses objections lui paraissent irrecevables, mais parce qu’elles ne lui sont pas intelligibles ».
A mesure que s’étend cet espace de l’inintelligible, s’étend le malheur. La sagesse et la joie, la ferveur et la subtilité, les nuances et les gradations, reléguées aux marges de plus en plus lointaines, ou dans un secret de plus en plus profond, ne font plus signe qu’aux rares heureux dévoués à une règle d’art ou de religion. « Celui qui se respecte ne peut vivre aujourd’hui que dans les interstices de la société ». Mieux qu’une pensée « réactionnaire » au sens restreint du terme ( dont on doit cependant oser, de temps à autre, se faire un étendard, mais le bon), les Scolies de Nicolás Gómez Dávila rétablissent les droits immémoriaux d’une grande pensée libertaire et aristocratique, alliant, dans l’exigence de son style « la dureté de la pierre et le frémissement de la feuille ». Que dit cette dureté, qui n’est point dureté du cœur ? Elle nous dit que pour être, il nous faut résister à l’informe, aimer l’éclat, la justesse lapidaire, et peut-être encore la pierre qui triomphe de ce Goliath qu’est le monde moderne.
Gómez Dávila, cependant, n’envisage point une victoire temporelle. « Le réactionnaire n’argumente pas contre le monde moderne dans l’espoir de le vaincre, mais pour que les droits de l’âme ne se prescrivent jamais. ». Comme le texte, la victoire est implicite, secrète. Car si les droits de l’âme demeurent imprescriptibles, le Moderne est bel et bien vaincu et ses triomphes ne sont que nuées. A l’imprescriptibilité des droits de l’âme, le Moderne voulut opposer les « droits de l’homme », autre marché de dupe, car le droit de quelque chose de général et d’abstrait fait piètre figure face à la force, ce que savait déjà Démosthène. Or, le droit de l’âme est, en chaque instant, ce qui s’éprouve. A commencer dans le ressouvenir plus vaste que nous-mêmes : « L’âme cultivée, c’est celle où le vacarme des vivants n’étouffe pas la musique des morts. ». Au contraire des « droits de l’homme », les droits de l’âme, de cette âme qui emporte et allège, n’apportent aucune solution. « Les problèmes métaphysiques ne tourmentent pas l’homme afin qu’il les résolve, mais qu’il les vive. »
Sans doute y a t-il dans cette manie moderne à vouloir trouver des « solutions », à laisser les « problèmes » derrière soi, dans des époques révolues, à se croire plus avisé de ne s’intéresser à rien, une immense lassitude à vivre. Ce Moderne qui ne cesse de louanger la « vie » et le « corps » les réduit à bien peu de chose. Que lui est-elle cette « vie » s’il ne la voit comme le miroitement d’une gradation vers l’éternité, qu’est-ce que ce « corps » dont il a une si forte conscience, sinon un corps malade, et malade d’avoir oublié que ce n’est point l’âme qui est dans le corps mais bien le corps qui est dans l’âme ? Sous prétexte que certains crurent médiocrement en Dieu, nommant « Dieu » leur propre médiocrité, le Moderne ne veut plus croire qu’en « l’homme », mais « si le seul but de l’homme est l’homme, de ce principe dérive une vaine réciprocité, comme le double reflètement de deux miroirs vides ». C’est bien en vain que les Modernes et les anti-modernes cherchent en amont, dans l’histoire de la philosophie, de dignes précurseurs au monde moderne. Laissons Spinoza, Hegel, et même Voltaire où ils sont. Le véritable précurseur du monde moderne est, bien sûr, Monsieur de La Palice. Le Moderne n’est point panthéiste, dialecticien ou ironiste, il est « lapaliciste ». Sa philosophie est des plus claires : l’homme n’est que l’homme, la vie n’est que la vie, le corps n’est que le corps. Voilà bien cette pensée moderne dans toute sa splendeur qui exige de nous que nous brûlions, comme obsolètes et néfastes, toutes les philosophies, toutes les religions, tous les arts qui durant quelques millénaires, de par le monde, firent à l’humanité l’affront abominable de lui enseigner la complexité, les nuances, les relations, les rapports et les proportions, toutes choses vaines, en effet, pour qui ne veut que détruire.
Ces Scolies à un texte implicite, se donnent à lire ainsi, non seulement comme une suite d’aperçus lucides en forme d’exercices de désabusement, dans la lignée des meilleurs d’entre nos Moralistes, tels que Vauvenargues ou Rivarol, mais aussi, comme un Art de la guerre, un traité de combat contre les « lapalicistes ». « Est démocrate, celui qui attend du monde extérieur la définition de ses objectifs ». Contre la passivité des tautologies et contre le règne de la quantité qu’elle instaure, c’est à la seule vie intérieure, à la seule âme imprescriptible du lecteur qu’il appartient, dans cette solitude essentielle qui est la véritable communion, de nuancer d’un imprévisible ensoleillement, autrement dit, d’une espérance implicite mais prête à bondir dans le monde, ces Scolies qu’un inattentif regard ordonnerait au seul pessimisme. D’autant plus inquiétantes, roboratives et salubres, ces Scolies, que ce qu’elles ne disent pas chemine en nous à l’insu des censeurs ! « Seuls conspirent efficacement contre le monde actuel ceux qui propagent en secret l’admiration de la beauté. »
Ce qu’il en sera de cette beauté et de cette admiration, nous le savons déjà. « Il n’est jamais trop tard pour rien de vraiment important. » Nicolás Gómez Dávila opère ainsi à une sorte de renversement du pessimisme, celui-ci n’étant plus seulement la fine pointe de la lucidité, mais celle d’une audace reconquise sur le ressassement sans fin de la vanité de toute chose. Certes, nous sommes bien tard dans la nuit du monde, dans la trappe moderne (« tombés dans l’histoire moderne comme dans une trappe »), mais s’il n’est jamais trop tard pour rien de vraiment important, n’est-ce point à dire que toute l’espérance du monde peut se concentrer en un point ? « Un geste, un seul geste suffit parfois à justifier l’existence du monde ». Cette pensée guerroyante et savante, polémique et érudite, est avant tout une pensée amoureuse. Le combat contre l’uniformité, l’étude savante qui distingue et honore la diversité prodigieuse sont autant de sauvegardes de l’amour.
« L’amour est l’organe avec lequel nous percevons l’irremplaçable individualité des êtres ». Or cette « irremplaçable individualité » n’est autre que la beauté. « La beauté de l’objet est sa véritable substance ». Celle-ci n’appartient pas à la durée, de même que la tradition n’appartient pas à la perpétuité, mais à l’instant. « L’éternité de la vérité, comme l’éternité de l’œuvre d’art sont toutes deux filles de l’instant ». L’instant ne s’offre qu’à celui qui le saisit au vol, chasseur subtil, qui discerne dans le monde des rumeurs qui se font musique, en deçà ou par-delà le vacarme obligatoire (le monde moderne étant bruyant comme le sont les prisons). « Les choses ne sont pas muettes, seulement elles sélectionnent leurs auditeurs. » L’utopie du « tout pour tous » renversée en réalité du « rien pour personne » en vient alors à médire des choses elles-mêmes, muettes ou parlantes. La véritable bonté n’est jamais générale de même que « Dieu n’est pas le monde comme un rocher dans un paysage tangible mais comme la nostalgie dans le paysage d’un tableau. ». La véritable bonté advient dans l’imprévisible : « Pour éveiller un sourire sur un visage douloureux, je me sens capable de toutes les bassesses ».
De même que les Scolies sont les cimes du discours, leur « par-delà » salvateur, la véritable magnanimité est l’au-delà de la morale générale, le surgissement de la connaissance de l’Un dans l’instant lui-même, la fulgurance pure où la liberté absolue rejoint la soumission au Règne de Dieu. « Celui qui parle des régions extrêmes de l’âme doit vite avoir recours à un vocabulaire théologique ». Théologique, la pensée de Gómez Dávila n’en garde pas moins ses distances avec ce que Gustave Thibon nommait le « narcissisme religieux », cette inclination fatale à voir l’Eglise d’abord comme une communauté humaine, avec ses administrations, sa sociologie, et son opportunisme. « L’obéissance du catholique s’est muée en une docilité infinie à tous les vents du monde ». Peu importe au demeurant : « Un seul concile n’est rien de plus qu’une seule voix dans le véritable concile oecuménique de l’Eglise, lequel est son histoire totale ». Or, pour Gómez Dávila cette histoire totale inclut les dieux antérieurs. L’Iliade et Pythagore lui sont plus proches que cette Eglise « qui serre dans ses bras la démocratie non parce qu’elle lui pardonne mais pour que la démocratie lui pardonne ».
Le sacré doit « jaillir comme une source dans la forêt et non pas comme une fontaine publique sur une place ». Face au monde moderne « cette effrayante accoutumance au mal et à laideur », le discord entre paganisme et christianisme apparaît secondaire et artificieux. « Le christianisme est une insolence que nous ne devons pas déguiser en amabilité ». Cette insolence, il ne sera pas interdit de la retourner contre les « représentants » du christianisme lui-même : « N’ayant pas obtenu que les hommes pratiquent ce qu’elle enseigne, l’Eglise actuelle a décidé d’enseigner ce qu’ils pratiquent. » Le monde grec apparaît alors comme « l’autre ancien Testament » auquel il n’est pas malvenu de recourir car « entre le monde divin et le monde profane, il y a le monde sacré ». Tout, alors, est bien une question de timbre et d’intonation. La justesse du scintillement d’écume est dans le mouvement antérieur de la vague. « La culture de l’écrivain ne doit pas se répandre dans sa prose mais ennoblir le timbre de sa phrase ». Ainsi faut-il également entendre le monde, comme l’œuvre d’un écrivain « qui nous invite à comprendre son langage, et non à le traduire dans le langage de nos équivalences ». Cette leçon d’humilité et d’orgueil, humilité face au monde et orgueil apparent face à l’arrogance moderne, nous invite à la seule aventure essentielle qui est d’être au monde, comme l’écriture même du monde, nous mêmes Scolies du texte implicite du monde qu’il nous appartient de déchiffrer.
Le monde, disent les Théologiens médiévaux, est « la grammaire de Dieu ». C’est ainsi que nous perdons ou gagnons en même temps Dieu et le monde, de même que nous perdons en même temps (ou gagnons) la compréhension d’Homère et des Evangiles. « Lorsque le bon goût et l’intelligence vont de pair, la prose ne semble pas écrite par l’auteur, mais par elle-même. » Que nous dit le texte implicite sinon notre propre secret qui est le secret du monde ? Tout se joue alors dans la voix, la voix unique, irremplaçable, celle de l’amour divin (« Nous ne sommes irremplaçables que pour Dieu ») ; la plus irrécusable preuve de l’Un étant que toute chose, tant que demeurent les droits imprescriptibles de l’âme, est unique. Point de feuille dont les nervures fussent exactement semblables à sa voisine. Le grand mythe moderne, au sens de mensonge, tient dans cette lâcheté, cette paresse face à l’interprétation qui sans fin hiérarchise les êtres et les choses du plus épais jusqu’au plus subtil. Le Moderne veut croire à tout prix que le monde est inintelligible pour pouvoir le saccager à sa guise. Le bonheur et le malheur est qu’il en est rien. Tout est écrit, et nous ne faisons qu’ajouter la ponctuation. « Mes phrases concises sont les touches d’une composition pointilliste ». L’implicite ne serait alors que le non-encore ponctué. « Si l’univers est d’une lecture malaisée, ce n’est pas qu’il soit un texte hermétique, mais parce que c’est un texte sans ponctuation. Sans l’intonation adéquate, montante ou descendante, sa syntaxe ontologique est inintelligible. »
Il n’est point de question de sens qui ne soit une question de style, d’intonation. Or, les questions de sens sont sans solution, alors que les questions de style se prouvent à chaque instant. « Cohérence et évidence s’excluent ». Toute justesse ne saurait apparaître que sous les atours du paradoxe ou du scandale. Lorsque la pensée est justement ponctuée, elle heurte de front cette inclination unanimiste du démocrate pour qui seuls l’informe et l’indistinct sont aimables. « Maint philosophe croit penser parce qu’il ne sait pas écrire ». La quête de la juste ponctuation, de l’intonation adéquate dépasse non seulement l’opinion commune, et même l’opinion minoritaire, elle dépasse du même élan les idées, les théories, les systèmes. « Le malheur de celui qui n’est pas intelligent, c’est qu’il n’y a pas d’idées intelligentes. Des idées qu’il suffirait d’adopter pour se mettre à la hauteur de l’homme intelligent ».Le dessein de Gómez Dávila n’est pas de faire partager ses idées, de les mettre en circulation, comme une monnaie frappée à son effigie, mais de rendre possible une méditation sur la « cohérence » qui échappe à l’évidence, sur « l’implicite » que ses Scolies désignent et dissimulent. « Si l’on veut que l’idée la plus subtile devienne stupide, il n’est pas nécessaire qu’un imbécile l’expose, il suffit qu’il l’écoute. » Le silence autour du livre de Nicolás Gómez Dávila serait donc d’excellent aloi s’il ne préjugeait toutefois à l’excès de l’écoute des imbéciles et de la surdité des intelligents.
« Je ne suis pas un intellectuel moderne contestataire mais un paysan médiéval indigné ». Si le mot rebelle voulait encore dire quelque chose, l’exégète des Scolies pourrait en faire usage ; tel n’est pas le cas. Demeure à travers ce qui est dit la possibilité offerte de n’être pas soumis au temps, d’imaginer ou de se souvenir d’une cohérence du monde, mystérieuse et sensible à « l’intonation montante ou descendante ». L’implicite des Scolies est une mise en demeure à la recouvrance de l’histoire sacrée, c’est-à-dire d’une histoire qui ne se réduit pas à « l’incertitude de l’anecdote » ni à la « futilité des chiffres ». En ce sens, « les ennemis du mythe ne sont pas les amis de la réalité mais de la banalité », le mythe n’étant pas alors le mensonge, mais bien la réverbération du vrai, la beauté suspendue entre l’immanence ingénue de notre race et la transcendance universelle. Tout écrivain digne de ce nom récite une mythologie d’autant plus réelle, au sens platonicien, c’est-à-dire d’autant plus vraie, qu’elle lui est plus personnelle, se proposant à lui presque par inadvertance, comme une fatalité heureuse. « Les penseurs contemporains sont aussi différents les uns des autres que les hôtels internationaux dont la structure uniforme se pare superficiellement de motifs indigènes. Alors qu’en vérité seul est intéressant le particularisme qui s’exprime dans un langage cosmopolite. »
La meilleure façon de favoriser la haine fanatique des hommes entre eux est de favoriser leur ressemblance, de les confronter en autrui à l’image détestée d’eux-mêmes. L’universalisme, ce péché qui, selon le mot de Gustave Thibon, consiste « à vouloir faire l’Un trop vite » devient alors, faute d’adversaire loyal, le principe d’une catastrophe immense, de même que « la libération totale est le processus qui construit la prison parfaite ». Entre le principe universel du christianisme et l’héritage culturel, où bruissent encore les feuillages orphiques, les armes de l’Iliade et les écumes de l’Odyssée, les pensives sagesses pythagoriciennes ou la souveraineté intérieure de Marc-Aurèle, la liberté de Nicolás Gómez Dávila sera de ne pas choisir. « La structure des relations entre christianisme et culture doit être paradoxale. Tension dynamique des contraires. Non pas fusion où ils se dissolvent mutuellement, ni capitulation d’aucun des deux. » On aura compris que ce « réactionnaire », dont les « saints patrons » sont Montaigne et Burckhardt, cet adversaire déclaré de la démocratie, en tant que « perversion métaphysique » est, par cela même, le contraire d’un fanatique. « Ne flattent le Peuple que ceux qui mijotent de lui vendre ou de lui voler quelque chose. » Face à la démagogie (« Démagogie est le mot qu’emploie les démocrates quand la démocratie leur fait peur »), il n’y a guère que l’aristocratie, celle-ci toutefois, étant définie, non en termes sociologiques, mais rigoureusement métaphysiques comme une possibilité universelle : « Le véritable aristocrate est celui qui a une vie intérieure. Quels que soient son origine, son rang ou sa fortune. L’aristocrate par excellence n’est pas le seigneur féodal dans son château, c’est le moine contemplatif dans se cellule. » Et ceci encore : « Au milieu de l’oppressante et ténébreuse bâtisse du monde, le cloître est le seul espace ouvert à l’air et au soleil ». Les Scolies apparaîtrons ainsi, à qui voudra bien en répondre, comme les signes de la présence de ces cloîtres détruits, de ces temples saccagés, mais dont les cryptes demeurent, textes implicites, de nos vie intérieures imprescriptibles.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, réaction, conservatisme, tradition, traditionalisme, amérique du sud, amérique latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 février 2009
De Reactie nam zijn aanvang bij het eerste betreuren
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, conservatisme, tradition, réaction, amérique latine, amérique du sud, colombie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 28 janvier 2009
Analyse van het Amerikaanse Paleoconservatisme
Analyse van het Amerikaanse Paleoconservatisme
De Amerikaanse rechterzijde komt in onze media praktisch uitsluitend als karikatuur in beeld. Hun echte standpunten verneem je zelden, maar iedereen meent vagelijk te weten dat het gaat om schietgrage cowboys, racisten die negerkerken in brand steken, en bijbelvaste huichelaars die hun maîtresse tot abortus dwingen terwijl ze zelf abortusdokters vermoorden. Zo schamper stelt de linkse pers hen voor, en een bepaalde nieuwrechtse pers doet daar niet voor onder. In werkelijkheid bestaat er rechts in de VS een intellectuele bedrijvigheid van hoog niveau.
De bezinning op fundamentele beginselen en het debat onderling en met de linkerzijde zijn bij de Amerikaanse conservatieven alleszins levendiger en dieper dan gebruikelijk is bij links, dat door zijn langdurige machtspositie moreel zelfgenoegzaam en mentaal vadsig geworden is, althans wat grondvragen betreft. Inzake taktieken om de eigen macht te versterken en de vijand uit te schakelen is links wel zeer vindingrijk; daarin is rechts dan weer verbeeldingloos, inert of gewoon te ontmoedigd. In dit artikel behandelen we de veruit interessantste behoudsgezinde stroming, die tegelijk erg pessimistisch is over de kans om wat dan ook te behouden in de concrete omstandigheden waarin het Amerikaanse volk zich bevindt: het paleoconservatisme.
Verzamelpunt anticommunisme
Na de Tweede Wereldoorlog vormde het anticommunisme het natuurlijke verzamelpunt voor allerlei conservatieve stromingen. Brandpunt was het weekblad National Review van William Buckley. Deze gaf het eerste nummer de ronkende opdrachtsverklaring mee: “To stand athwart history and yell ‘stop!’” Het blad steunde de koude-oorlogshaviken inzake Taiwan, Cuba en Vietnam. Tegelijk gaf het veel ruimte voor reflectie op grondvragen en historische kwesties die als illustratie van de conservatieve inzichten dienden. Het besteedde dus ook aandacht aan het christendom als bron van duurzame overtuigingen inzake de menselijke natuur en de daaruit voortvloeiende wetmatigheden van de samenleving.
In de jaren ’60 werd het conservatisme sterk in het defensief gedrukt, zowel door het beleid van de linkse presidenten John Kennedy (1961-63) en Lyndon Johnson (1963-68), met de zware verkiezingsnederlaag van de libertair-conservatieve Republikein Barry Goldwater in 1964 als teken des tijds; alsook door de opkomende culturele stromingen die men in Europa “mei ’68” pleegt te noemen. Maar ook de nominaal conservatieve presidenten Dwight Eisenhower (1953-60) en Richard Nixon (1969-74) stelden hen diep teleur. Zelfs op het punt van het anticommunisme bleken deze presidenten onbetrouwbaar: zo kon Fidel Castro maar aan de macht komen doordat Eisenhower de Cubaanse president Batista in de steek liet. Onder de door links verguisde president Nixon werd in feite een linkse revolutie doorgevoerd, met een forse uitbreiding van het federale overheidsapparaat en zijn greep op de samenleving.
Blikvangers van de linkse triomf waren de politiek van het “busing” (geforceerde rassenintegratie van scholen door het verplichte vervoer van blanke leerlingen naar zwarte scholen en vice versa) en de opheffing van het abortusverbod in de meeste deelstaten door het Hooggerechtshof in het vonnis Roe vs. Wade. Sindsdien is de opmars van links ook onder Republikeinse presidenten en meerderheden doorgegaan. De linkse pers heeft moord en brand geschreeuwd over de rechtse president Ronald Reagan (1981-88) en de Congresmeerderheid van Newt Gingrich (1994-96), maar behalve op financieel-economisch gebied hebben die periodes geen enkele echte “zwenking naar rechts” te zien gegeven.
Het neoconservatisme
In de loop van de jaren ’70, toen links wereldwijd zijn grootste expansie bereikte, verscheen uit onverwachte hoek een belangrijke tegenstroom. Zoals in Frankrijk een handvol gauchisten zich als nouveaux philosophes tegen het communisme gingen keren, zo bekeerden een aantal trotskistische intellectuelen in de VS zich tot een strijdbaar anticommunisme. Omdat de tenoren van deze beweging joden als Norman Podhoretz en Irving Kristol waren, en zij zich de jongste jaren zo ingezet hebben voor een havikpolitiek ten gunste van Israël (bommen op en embargo tegen Irak), zegt men vandaag soms dat het enkel een intern-joodse koerswijziging betrof: omdat de Sovjet-Unie onder Stalin en zijn opvolgers anti-joods geworden was, keerden de volgelingen van de stichter van het Rode Leger (Trotski) zich af van diens Oktoberrevolutie, met als concreet doel ondermeer het breken van de Sovjet-steun aan de Arabische zaak en het afdwingen van het recht van Sovjet-joden op emigratie naar Israël.
Die voorstelling van zaken is echter veel te eenzijdig. Het is gewoon een feit dat de neoconservatieven het onder de linkse hegemonie toch gedurfde engagement aangingen om allerlei toen als rechts verguisde thema’s tot de hunne te maken: de markteconomie, de steun aan anticommunistische frontlijnstaten, het inhouden van subsidies aan moderne nepcultuur en sociaal ondermijningswerk, de afwijzing van de neo-racistische “positieve discriminatie”, en de verdediging van het gezin. Zij hebben ook bij uitstek goed geïnformeerde kritieken geschreven op de linkerzijde, bv. Podhoretz rekent in zijn boek Ex-Friends (1999) af met het New Yorkse milieu van linkse intellectuelen.
Anders dan de linkse joden respecteren neoconservatieve joden als Mona Charen bovendien het christendom als dominante cultuurfactor, ondermeer als drager van gezinswaarden, gemeenschapszin en plichtsbesef, en ook als historisch het eerste mikpunt van het verfoeide communisme. De sympathie voor het christendom wordt natuurlijk wel vergemakkelijkt door het religieuze pro-zionisme van het Amerikaanse protestantisme; neo-conservatieve joden zijn immers feller pro-zionistisch dan hun linkse volksgenoten, die veelal seculier en niet zelden pro-Palestijns zijn. Bij hun oversteek naar het conservatieve kamp brachten de ex-trotskisten wel hun internationalistisch perspectief mee: Amerikaans patriotisme was voor hen geen waarde op zich, wel een instrument in dienst van republikeinse “waarden”, vergelijkbaar met het Verfassungspatriotismus dat Jürgen Habermas de Duitsers wil aanpraten.
Uiteraard is het neoconservatisme geen exclusief joodse beweging. De meeste klassiek rechtse prominenten in Washington, bv. de bekende commentator George Will, en Republikeinse partijtenoren als William Bennett, Jack Kemp en de Bush-dynastie behoren tot deze stroming. Vandaag bezetten de neoconservatieven in de publieke arena het grootste deel van het niet-linkse veld. Hun standpunten worden in de media vertolkt door de aloude doch meegeëvolueerde National Review, het eigen neoconservatieve blad Weekly Standard, en verder ondermeer de American Spectator, de Wall Street Journal, de Washington Times en de New York Post (uiteraard niet te verwarren met de linksliberale kanonnen New York Times en Washington Post). Overigens mogen in Europa ook de Britse bladen Daily Telegraph en Spectator tot de neoconservatieve stroming gerekend worden, samen met pro-Amerikaanse figuren als Frits Bolkestein of de nouveau philosophe André Glucksmann.
Onder Ronald Reagan deelden de neoconservatieven voor het eerst in de macht. Zij heroriënteerden het buitenlandse beleid naar een pro-actief engagement ten gunste van democratie en vrije markt overal ter wereld. Zij deden Reagan doorbijten in de Koude Oorlog tot de eindzege. Op binnenlands vlak was de periode-Reagan nogmaals een teleurstelling voor de klassieke conservatieven: de overheid bleef maar groeien ten nadele van het initiatief van het individu en de deelstaten, terwijl de discriminatie van de Euro-Amerikanen en de cultuur van de political correctness steeds verder om zich heen grepen.
De paleoconservatieve oppositie
De tegenstelling tussen nieuw en oud conservatisme kwam ook in alle scherpte aan het licht: de neoconservatieven zijn voor het ongebreidelde vrije verkeer van kapitaal en arbeid, daar waar de oude rechterzijde een selectief protectionisme en immigratiebeheersing voorstond. In belangrijke opzichten hadden de neoconservatieven, en met hen de Republikeinse partij, gebroken met alles waar de term “conservatief” tot dan toe voor stond. De reactie tegen deze koerswijziging, de terugkeer naar de conservatieve wortels, noemt men het oer- of paleo-conservatisme.
Onder politici is Patrick Buchanan allicht de bekendste vertegenwoordiger van deze stroming. Hij maakte naam als journalist en als persmedewerker van de presidenten Nixon en Reagan. In 1996 deed hij een opmerkelijke gooi naar de Republikeinse presidentskandidatuur, maar hij werd nipt verslagen door de beginselloze Bob Dole (die bv. meteen verklaarde dat hij zich niet gebonden achtte door het sterk christelijk gekleurde programma dat op de partijconventie goedgekeurd was). Hij verliet de partij uit onvrede met haar uitverkoop van alle conservatieve beginselen, vooral op gebeid van buitenlands beleid. In 2000 was hij kansloos presidentskandidaat voor de marginale Reform Party, overigens met een zwarte vrouw als running mate.
Vlaggenschip van het oerconservatisme in de media is sedert 1977 het maandblad Chronicles: a Magazine of American Culture, uitgegeven te Rockford, Illinois. Hoofdredacteur is dr. Thomas Fleming, classicus. Het blad besteedt veel aandacht aan thema’s als volkssoevereiniteit en de populistische traditie in de VS; vrije wapendracht zoals gegarandeerd door het Tweede Amendement bij de Grondwet; allerlei gevallen van machtsmisbruik door de federale regering; de eindeloze cataloog gevallen van verraad door de Republikeinse partij jegens haar kiezers en haar principes; de dwaze buitenlandse avonturen van de VS in Somalië en vooral Joegoslavië; het gerechtelijk activisme waarbij rechters door formeel de wet te herinterpreteren in feite de wet wijzigen en dus de wetgevende macht usurperen, steevast in progressistische zin; het culturele analfabetisme, ook bij conservatieven die hun eigen klassieken en beginselen amper kennen; de kritische doorlichting van linkse iconen zoals Martin Luther King; de verloedering van het onderwijs en de veelvormige strijd voor de ziel van het kind.
Belangrijk strijdpunt tegen de neoconservatieven is de buitenlandse politiek, waar de paleo’s een terugkeer bepleiten naar het non-interventionisme, de positie van rechts in de beide wereldoorlogen. Chronicles geeft ook veel ruimte aan debatten over kwesties waarover in eigen kring geen eensgezindheid bestaat, bijvoorbeeld tussen vrijhandel en protectionisme. Het eerste is een rechts standpunt uit de Koude Oorlog, toen elke staatsinterventie naar communisme rook, het tweede een rechts standpunt in het immigratie- en globaliseringsdebat.
Immigratie
Het blad zoekt geen aansluiting bij het blanke (of “Euro-Amerikaanse”) activisme. Fleming drijft er af en toe de spot mee en doet “blank” zijn af als een triestig soort vervang-identiteit. Dat zwarten na het verlies van hun talen en tradities door de slavernij alleen hun ras als identiteit behielden, kan men begrijpen, maar Euro-Amerikanen moeten zich volgens hem in de eerste plaats Kelt of Duitser of Italiaan voelen, katholiek of baptist of orthodox. Wel kant de redactie zich tegen de galopperende en grotendeels illegale inwijking uit de Derde Wereld, die de Amerikaanse samenleving onherkenbaar aan het veranderen zou zijn.
Een van de belangrijkste paleoconservatieve denkers over dit onderwerp was de vorig jaar overleden Chronicles-medewerker dr. Samuel Francis, destijds ontslagen bij de neoconservatieve Washington Times wegens zijn kritiek op de immigratie. Hij kaderde de pro-immigratie-politiek van de heersende klasse in zijn analyse van de machtsevolutie in de VS. Sedert het interbellum is de macht verschoven van de oude, voornamelijk Angelsaksische elites, die de grote bedrijven, banken, universiteiten en politieke partijen in handen hadden, naar een nieuwe klasse van technocraten die al deze instellingen zijn gaan beheren. Deze machtsverschuiving noemt men de managerial revolution. In ondermeer zijn boek Beautiful Losers analyseerde Francis de decennialange terugtocht van de conservatieven en van de Amerikaanse samenleving tout court onder druk van de opmars van de linksliberale nieuwe machthebbers. Deze toenemend transnationale overclass voert een strijd tegen de oude upper class en de bredere middle class, dragers van de nationale cultuur en de oude republiek, en steunt daarin ondermeer op de eveneens toenemend transnationale underclass.
Het oude linkse argument dat immigratie een wapen van het grootkapitaal is om de lonen en de macht van de arbeidersklasse te drukken, wordt hier verrijkt met analoge argumenten op cultureel en institutioneel gebeid. Inwijkelingen zijn niet vertrouwd met noch gehecht aan de cultuur en de instellingen van de Founding Fathers, en bemoeilijken dus hun verdediging tegen de mokerslagen van de post-religieuze, post-democratische, post-republikeinse, post-Amerikaanse overclass. Als antwoord moet de Amerikaanse rechterzijde “Middle America” mobiliseren: de “echte” Amerikanen, arbeiders en zelfstandigen evengoed als academici en werkgevers.
Paleoconservatieve auteurs beseffen dat zij zich vooral tot een blank publiek richten, maar betogen dat Amerikaanse blanken en zwarten een gemeenschappelijk belang hebben inzake immigratie. De sterkste groei in carrièrekansen en inkomen van de zwarten werd genoteerd in de jaren 1925-65, toen de immigratie minimaal gehouden werd. Net als de blanke midden- en arbeidersklasse zien de zwarten vandaag hun reëel inkomen dalen als gevolg van de hoge immigratie. In de zuidwestelijke staten zijn het vooral zwarten wier plaatsen op de arbeidsmarkt en in de goedkopere woonwijken door inwijkelingen ingenomen worden. Hier blijkt echter dat politieke massabewegingen zich minder op nuchtere inschatting van concrete belangen baseren dan op basalere tendenzen: het sterke (overigens door de overclass gestimuleerde) antiblanke racisme, dat soms nog “antiracisme” genoemd wordt, verhindert de zwarten om met de blanken gemene zaak te maken voor immigratiebeperkingen.
Francis en zijn medestanders beseffen echter dat de tijd dringt en zijn erg pessimistisch over de kansen van de Amerikanen om te verhinderen dat zij verpletterd zullen worden tussen de oppermachtige overclass en een snel groeiend proletariaat uit de Derde Wereld. Het demografische aspect van dat toekomstscenario is nader uitgewerkt door Pat Buchanan in zijn boek The Death of the West (2001).
Tegenover de doordachte maar ook enigszins voorspelbare analyse van andere immigratiecritici zorgt Thomas Fleming regelmatig voor verrassende standpunten inzake etnische kwesties. Toen zwarten in Los Angeles Koreaanse winkels aanvielen en enkelen door Koreaanse eigenaars neergeschoten werden, was Flemings commentaar: vele rechtsen juichen die flinke Koreaanse ondernemers toe die zich tegen zwart schorremorrie verdedigen, maar “wat ik daar zie zijn immigranten die geboren Amerikanen neerschieten”. Enerzijds plaatst hij artikels tegen de galopperende immigratie, anderzijds wijst hij tevreden op de versterking van het door de blanken verwaarloosde christendom dankzij Latino’s en Oost-Aziatische bekeerlingen.
Lincoln-revisionisme
De duidelijke afstand tot het eigenlijke racisme (dat in de VS een vitale gedachtenstroming is met vranke spreekbuizen als American Renaissance) kan Fleming en vrienden echter niet voor de classificatie als “racist” behoeden. Zijn onvergeeflijke zonde is dat hij regelmatig een forum geeft aan de League of the South en andere pleitbezorgers van de zuidelijke Confederatie (1861-65). Deze afscheuring van zuidelijke staten uit de (grondwettig als vrijwillig en opzegbaar opgevatte) Unie werd in de Amerikaanse Burgeroorlog door president Abraham Lincoln in het bloed gesmoord. Nu de vlag van de Confederatie onder Afrikaans-Amerikaanse druk overal uit openbare gebouwen en officiële emblemen verwijderd wordt, is haar herwaardering erg “fout”. De geschiedenis van de “Oorlog tussen de Staten” is door de overwinnaars geschreven, wordt in die versie langs alle (ook neoconservatieve) kanalen gepropageerd, en is dringend toe aan een vrijmoedige herziening.
Een belangrijk Lincoln-revisionist is Joseph Sobran, germanist en van 1972 tot 1993 redacteur bij de National Review, sindsdien zelfstandig syndicated columnist. Zijn columns in diverse papieren en elektronische media worden gebundeld in een eenmansmaandblad, Sobran’s, en op zijn webstek. Bij de presidentsverkiezingen van 2000 aanvaardde hij om de kandidaat-vice-president te worden voor Howard Phillips’ marginale Constitution Party, maar hij trok zich terug toen dit onverenigbaar bleek met zijn werk als onafhankelijk commentator.
Sobran behandelt vaak historische strijdpunten. Hij geniet bekendheid als pleitbezorger van de theorie dat de werken van William Shakespeare niet door de regisseur uit Stratford geschreven zijn, wel door Edward de Vere, graaf van Oxford (zie zijn boek Alias Shakespeare, 1997, voor een verleidelijke summa van de Oxfordiaanse argumentatie tegen de Stratfordianen). Hij neemt het regelmatig op tegen de wijdverbreide “zwarte legende” van de uitmoording van de indianen door de Spanjaarden (niet van grond ontbloot, wel nog steeds fel overdreven), en voor verguisde pausen als Pius IX, die de pauselijke staten verdedigde tegen het Italiaanse nationalisme. Tijdens de recente ophef rond paus Pius XII pleitte Sobran deze vrij van de nu populaire verdenking van nazi-collaboratie, ondermeer via uitvoerige citaten ten gunste van de oorlogspaus vanwege tal van joodse tijdgenoten.
Abraham Lincoln, de president die de burgeroorlog wilde en kreeg, is één van Sobran’s favoriete mikpunten. Sobran wijst erop dat de afschaffing van de slavernij niet (zoals de Lincoln-mythe het wil) de inzet van de oorlog was, en dat dit doel net als in Engeland en de noordelijke staten met andere middelen bereikt had kunnen worden. Met minutieus bronnenonderzoek sabelt hij de moderne beeldvorming over Lincoln als verlicht antiracist neer: de president was een fel voorstander van rassenscheiding en bepleitte kolonisering van West-Afrika en Midden-Amerika om er de negers naartoe te kunnen sturen. Men kan het zich vandaag nauwelijks voorstellen, maar velen waren toen uit racisme tegen de negerslavernij, die immers een vorm van interraciaal samen-leven was. Dat alles is echter niet de kern van Sobran’s kritiek op Lincoln.
Voor hem was de grote misdaad van Lincoln veeleer dat deze, zonder daartoe gemandateerd te zijn, het karakter van de republiek totaal veranderde. De Unie der Staten was in 1776 gecreëerd als een confederatie van soevereine staten, zoals de tekst van de Grondwet en alle documenten uit die periode bevestigen. Bv, in het verdrag van Parijs (1783) legden de Britten zich neer bij de onafhankelijkheid van de staten Massachusetts, Virginia, Pennsylvania enz, niet van enige Unie. Lincoln was echter een nationalist: hij geloofde dat de onafhankelijkheid de geboorte geweest was van “een nieuwe natie”, die natuurlijk in één staat behoorde te leven, net zoals men in die tijd in de Duitse staten naar een eengemaakt Duitsland streefde.
Het is hierom dat hij de afgescheiden zuidelijke staten tot een oorlog provoceerde, zodat hij tegen hun wil de eenheid van de Unie kon herstellen. Daarbij miskende hij het recht op afscheiding, dat in de stichtende unieverdragen erkend was. Verder stelde hij als feitelijk dictator allerlei ongrondwettige daden, zoals de willekeurige arrestatie van duizenden noordelijke oorlogstegenstanders, de ontbinding van het parlement van Maryland, en de vorming van de staat West-Virginia uit de uniegezinde districten van de afscheidende staat Virginia.
Waarom is dat stuk geschiedenis nu zo belangrijk voor een commentator bij de hedendaagse politiek? Lincoln bracht een beweging van machtsoverdracht richting Washington teweeg, en deze heeft zich sindsdien steeds verder doorgezet. Een vonnis als Roe vs. Wade was in Lincolns tijd ondenkbaar, zowel inhoudelijk (niemand las in de Grondwet ooit enig verbod op een abortusverbod) als formeel (niemand betwistte het recht van de staten om over abortus wetten te maken), maar het was wel een logische uitloper van Lincoln’s politiek van machtsconcentratie in Washington ten nadele van de staten.
Abortus
Twee verschillende lijnen van conservatief engagement vinden elkaar in het verzet tegen, of althans de machteloze verontwaardiging over, Roe vs. Wade. Enerzijds was er de morele afwijzing van abortus zelf, anderzijds de juridische afwijzing van de “usurpatie” van de soevereiniteit der deelstaten door het federale bestuursniveau. De Grondwet beschouwt immers de staten als soevereine eenheden en de federale unie slechts als een afgeleid bestuursniveau. De Unie (Presidentschap, Congres en Hooggerechtshof) heeft slechts enkele welomschreven bevoegdheden die de staten uitdrukkelijk overgedragen hebben; alle restbevoegdheden, inbegrepen het verbieden danwel toelaten van abortus, blijven automatisch bij de staten.
Europese VS-waarnemers maken dat onderscheid tussen religieus en grondwetloyalistisch argument vaak niet, maar de twee zijn radicaal verschillend. Sommige religieuze ijveraars vinden dat de federale overheid in alle deelstaten abortus zou moeten verbieden, want het ongeboren leven is hun wel een schending van de grondwettige bevoegdheidsverdeling tussen staten en federaal niveau waard. Sommige libertariërs zijn daarentegen pro vrije abortus maar willen de macht van Washington minimaal houden en dulden niet dat de soevereiniteit van de staten op dit punt door het federale niveau geüsurpeerd wordt.
De paleoconservatieven combineren de beide motieven als volgt. In ieder geval was Roe vs. Wade een schending van de soevereiniteit van de staten door Washington. Het komt aan de staten toe om abortus te verbieden dan wel toe te laten. En het is dus op het niveau van de staten, de dag dat hun soevereiniteit opnieuw erkend wordt, dat christenen zouden moeten ijveren voor het herstel van het abortusverbod. Dus: trouw aan christelijke principes doen de burgers er goed aan in hun staat abortus te verbieden, maar trouw aan de grondwet moeten zij niet verlangen dat Washington dit in hun plaats doet. Zelfredzaamheid is een aloud principe van de Amerikaanse rechterzijde.
Buitenlands beleid
De historische rol van links en rechts in de Amerikaanse buitenlandse politiek wordt zelden correct weergegeven. Zo heeft bij het publiek het idee post gevat dat het militair-industrieel complex vooral op rechtse politici steunt om de VS op het oorlogspad te krijgen of te houden. Dit is in flagrante tegenspraak met het feitelijke initiatief van linkse presidenten (Lincoln, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, John Kennedy) in de bloedigste militaire avonturen van de VS. Het is juist ter rechterzijde dat het wantrouwen tegen buitenlandse interventies het sterkst is. Het linkse streven om de wereld beter te maken heeft vaak tot bloedige militaire avonturen geleid, bv. toen in de 19de eeuw de Britse linkerzijde militair-koloniale interventies in Afrika eiste en verkreeg om de slavenhandel de kop in te drukken. Terwijl in Somalië en de Balkan geen enkel Amerikaans belang op het spel stond, stuurde de linkse president Clinton er troepen naartoe. De (betrekkelijk) conservatieve president Bush senior daarentegen beperkte zijn campagne tegen Irak tot de bevrijding van Koeweit, hoewel er moreel wel iets te zeggen was voor het omverwerpen van Saddam Hoessein.
Soms waren die “morele” interventies ook wel wenselijk: de negerslaven zullen de Britten zeker dankbaar geweest zijn voor hun bevrijding, zoals de Britten op hun beurt Franklin Roosevelt dankbaar waren voor zijn pogingen om de VS in de oorlog tegen Hitler te krijgen, en zoals de Koerden de gebeurlijke uitschakeling van Saddam zouden toegejuicht hebben. Maar feit blijft dat deze idealistische bemoeizucht het militair-industrieel complex betere zaakjes bezorgde dan de bedaardere realpolitik die, grof veralgemenend, meer typisch is voor conservatieve regeringen.
Na de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon kregen we als Amerikaanse proteststem tegen de oorlogsplannen van president Bush jr. vooral de linkse intellectueel Noam Chomsky te horen. Nochtans is het vooral een bepaalde rechterzijde die sinds decennia het interventionisme en de imperiale allures van de VS-buitenlandpolitiek bekritiseert. De founding father George Washington waarschuwde reeds tegen verstrikking in buitenlandse conflicten. Deze terughoudendheid is gereactualiseerd door Pat Buchanan in het boek A Republic, not an Empire (1999).
In Chronicles wijst dr. Srdja Trifkovic, nochtans een criticus van de islam, op de oorlogszuchtige waanzin die zich na de moslimaanslagen op 11 september meester maakte van de politieke leiders. Bush’ defensie-adviseur Richard Perle bepleitte de “totale oorlog”, defensieminister Donald Rumsfeld was bereid “het ondenkbare te denken”, vice-president Dick Cheney zei dat de oorlog “50 jaar kan duren en 50 landen kan treffen”, en volgens president George Bush jr. is Amerika “door de geschiedenis geroepen” om “het kwaad” te bestrijden in een oorlog zonder voorzienbaar einde. Als echte conservatief bepleit Trifkovic nuchterheid en bescheidenheid. Hij vergelijkt Bush’ titanische hoogmoed en eigengerechtigheid met de toestand in Athene na de Griekse overwinning op het Perzische wereldrijk. Athene evolueerde toen van de leider in een coalitie van soevereine stadsstaten tot de dictator van een onwillig imperium en beschadigde daarmee de vrijheidsliefde die de basis van de Griekse strijdbaarheid gevormd had: “Het resultaat was dat Griekenland voorgoed als machtsfactor vernietigd werd. Amerika zal even zeker vernietigd worden indien zijn leiders verder de wereldhegemonie blijven nastreven.”
De geestdrift voor de oorlog tegen het terrorisme leidde bovendien tot een brede bereidheid om burgerlijke vrijheden in te leveren ten gunste van de “veiligheid”, dus de macht van het veiligheidsapparaat. Samuel Francis schetst het gevaar: “Vrijheid vergaat langzaam. Zij die ze hebben worden eraan gewend ze bij beetjes te verliezen. Zij krijgen meer of minder plausibele redenen gevoederd waarom ze de vrijheid eigenlijk niet nodig hebben totdat ze, net als de mensen in George Orwell’s ‘1984’, totaal vergeten zijn dat ze ze ooit hadden of zelfs vergeten wat vrijheid is.”
De paleoconservatieven sluiten dus aan bij het aloude “isolationisme” van de Amerikaanse rechterzijde. In de conservatieve geest van bescheidenheid en voorzichtigheid verwerpen zij de rol van de VS als wereldpolitieman, en wijzen zij op het roekeloze van de havikpolitiek. Het vooruitzicht van een nederlaag nog daargelaten, herinneren zij aan de ellende die zelfs een overwinning brengen kan. In 1917 waren Frankrijk en Groot-Brittannië rijp om op de Duits-Oostenrijkse vredesvoorstellen in te gaan, maar de Amerikaanse interventie sterkte hun oorlogswil en deed de oorlog verder duren, hetgeen leidde tot verdere verwoestingen, de Oktoberrevolutie en het Verdrag van Versailles, dat later de opkomst van het nazisme zou veroorzaken. De overwinning in de Tweede Wereldoorlog maakte van het communisme een wereldmacht die het VS-kamp tot een nucleaire wapenwedloop en talloze locale gewapende confrontaties dwong. Oorlog is de wieg van revoluties, zoals Lenin goed begreep, en dat is een goede reden voor conservatieven om er niet te lichtzinnig aan te beginnen.
Israël
Anders dan de racistische stroming houdt het paleoconservatisme zich niet bezig met polemiek tegen Israël. In ieder geval zijn joodse intellectuelen hier ruim vertegenwoordigd. In Chronicles heeft de Judaica-geleerde prof. Jacob Neusner regelmatig tegen de secularisering van de maatschappij en met name van de joodse gemeenschap gepleit, tegen de vervanging van God door zionisme en holocaust als fundamenten van het jodendom. Politoloog prof. Paul Gottfried levert belangrijke analyses van de recente en hedendaagse politieke stromingen, doorgaans wars van enige fixatie op specifiek joodse belangen, al mocht hij in Chronicles voor steun aan de harde lijn van Ariël Sjaron pleiten. Commentator Don Feder schreef na het overlijden van Enoch Powell een ware lofrede op deze Britse politicus die waarschuwde dat ongebreidelde immigratie tot een bloedbad zou leiden: “Powell zal de realisatie van zijn voorspelling niet meer beleven. Uw kinderen zullen dat geluk niet hebben.”
De paleoconservatieven bepleiten niet de afstemming van de VS-politiek op die van Israël, en dat is wel een radicaal verschil met de neoconservatieven. Zo heeft Norman Podhoretz in zijn blad Commentary zeer weinig geduld met kritiek op Israël en op de pro-Israëlische politiek van Washington, ook uit het conservatieve kamp. Critici van Israël heten er onmiddellijk antisemieten, een categorie waartoe zelfs George Orwell en Aleksandr Solzjenitsyn gerekend zijn, evenals joden die onvoldoende ijver voor het zionisme aan de dag leggen, zoals Bob Novak en Noam Chomsky.
In 1986 kwam Podhoretz openlijk in botsing met Joe Sobran, toen bij de National Review, wegens diens behandeling van de zaak-Pollard. De opgepakte Israëlische spion Jonathan Pollard vormde voor vele Amerikanen, en zeker voor de veiligheidsdiensten, het bewijs dat Israël toch niet die betrouwbare vriend van de VS was. Sobran had geconcludeerd dat de nationale belangen zelfs van bondgenoten in conflict kunnen komen, en dat de VS geval per geval moesten herbekijken waar en wanneer Israël steun verdiende, eerder dan deze cliëntstaat een blanco cheque te geven. De redactie van National Review bond in, liet Sobran geen columns over het Midden-Oosten meer schrijven, en dwong hem later tot ontslag. Sindsdien is Sobran in deze kringen de felste criticus van Israël en de VS-politiek ten gunste van dat land.
De aanslagen op 11 september bevestigden hem in zijn kritiek op het verregaand Amerikaans engagement voor de Israëlische belangen. Het kan immers moeilijk ontkend worden dat de VS juist omwille van hun steun aan Israël geviseerd worden. Anderzijds is deze steun slechts een uitloper van de sinds Lincoln uitdijende Amerikaanse verstrikking in internationale conflicten.
Sobran gaf dit als zijn eerste reactie op de aanslagen: “Amerikanen zien buitenlanders niet als echt, en beseffen niet hoe diep hun regering een deel van het mensenras tegen hen in het harnas jaagt. Wij zijn best aardige mensen die er meestal geen idee van hebben hoe bullebakkerig wij op vreemden overkomen. Tot nu hadden we geen ervaring opgedaan met wat de VS-regering anderen zo vaak aangedaan heeft. (…) Een juist begrip zou ons kunnen leren hoe we kunnen vermijden, vijanden te maken. Dit vermijden is de beste landsverdediging, beter dan één die met een budget van 300 miljard dollar het WTC niet kon verdedigen. De VS is nu een wereldrijk dat zichzelf als een universele weldoener beschouwt en verbaasd is wanneer buitenlanders dat anders zien. Vroegere rijken hadden niet deze begoocheling, tegelijk te kunnen heersen en geliefd te zijn.”
Religie
Van oudsher wil links via de politiek de wereld veranderen, terwijl rechts de rol van de politiek wil beperken. Bovendien beschouwt rechts de politiek als de bovenbouw van diepere culturele feiten, daar waar links de politiek als veruitwendiging van economische machtsverhoudingen ziet. De paleoconservatieve pers besteedt daarom veel aandacht aan bredere cultuurvraagstukken, ondermeer aan de verdediging van de religie tegen het secularisme en van de geloofsleer tegen allerlei slappe modetrends in de hedendaagse kerken.
De katholieke en orthodoxe tradities blijken de voorkeur te krijgen boven het protestantisme. Chronicles gaat regelmatig in op de fouten van de Evangelische herlevingsbewegingen met hun sentimenteel élan wars van alle ernstige doctrine. Bijvoorbeeld, de Evangelische frontorganisatie Promise Keepers wil de huwelijkstrouw bevorderen en verweeft daarbij nogal wat moderne pop-psychologie met de christelijke moraal. Zo moedigt zij mannen aan om veel met elkaar te praten over hun huwelijksleven, zelfs over hun bedgeheimen. Welnu, merkt Fleming op, het is evident onridderlijk om de oeh’s en aah’s van je geliefde vrouw te grabbel te gooien.
Traditionele religie heeft vooral dit voor op het simplistisch en geëxalteerd “Jesus loves you”-gedoe: zij kent een centrale plaats toe aan een leerstuk dat in de Bijbel niet ontwikkeld en daarom door bijbelvaste protestanten niet erkend wordt, namelijk de natuurwet. Deze notie, vooral ontwikkeld door Thomas van Aquino, verklaart waarom in de VS het katholicisme als conservatiever geldt dan het protestantisme. Zo getuigt Sobran: “Katholiek worden appelleerde aan mijn reactionaire instincten. De katholieke doctrine die mij het meest aantrok was de Natuurwet – een permanente morele wet, kenbaar los van de openbaring doch daarmee in overeenstemming, oud en eeuwig en weerstandig tegen elke moderne gril.” De natuurwet, kern van het blijvende, onberoerd door de “vooruitgang”, is de natuurlijke basis van het conservatisme.
Christelijke politiek, dat betekent voor de conservatieven, zowel neo’s als paleo’s, niet het vaag-linkse conformisme van de softies die zich alleen de Bergrede en het voorbeeld van de “eerste christenen” willen herinneren, met lichtzinnige besluiten van het type: “Christus was de eerste communist”. Wel het rijpere politieke inzicht van een Augustinus of een Thomas van Aquino, en de encyclieken van de pausen uit de moderne periode. Nu de meeste kerken met de dominante ideologische wind meedraaien, wijzen de conservatieven erop dat Christus dat niet deed, en dat hij in het vigerende linksliberale systeem evenzeer een teken van tegenspraak zou zijn als destijds.
De geloofsleer is echter één zaak, het beleid van de reëel bestaande kerken een heel andere. Niemand kan ernaast kijken dat praktisch alle kerken in de VS met de linkse opiniewind meegedraaid zijn. Sommigen engageren zich daarom binnen hun kerk voor de terugkeer naar de oude waarden, de Latijnse mis en dergelijke. Wijlen Sam Francis was in paleoconservatieve kringen een van de weinigen die de keuze voor het christendom zelf in vraag durfde stellen. Als politiek commentator hield hij zich buiten ideologische speculaties over de vraag of het evangelie in essentie links of rechts is. Hij stelde alleen vast dat het christendom eeuwenlang de westerse samenleving geschraagd heeft, maar dat het in de twintigste eeuw een factor van ontbinding en afbraak geworden is. Dat bracht hem dichter bij de racistische stroming, die religie vooral instrumenteel ziet: het christendom van de arbeidsethos, de grote gezinnen en de koloniale expansie was goed, maar het christendom dat bij Europeanen alle zelfrespect en zelfverdediging afkeurt, is gewoon schadelijk.
Het einde?
Toen Pat Buchanan in 1996 tijdens de Republikeinse voorverkiezingen goed scoorde, leek het uur van het paleoconservatisme aangebroken. Het partij-apparaat was echter niet verontrust. Toen hij de partij verliet en in de presidentsverkiezingen van 2000 amper 1% van de stemmen haalde, leek dit het failliet van het paleoconservatisme te bevestigen.
In bredere conservatieve kring bestaat inderdaad een sterk pessimisme over de mogelijkheid om “het land terug te nemen”. Randgroepen spreken al van separatisme als oplossing, redden wat er te redden valt in aparte staatjes. Sam Francis waarschuwde daartegen: het is energieverspilling en zal tot niets leiden behalve dan tot het fragmenteren en verspillen van energie en uiteindelijk tot demoralisering van teleurgestelde activisten. Wat wel nut heeft is een maatschappelijk separatisme, zelforganisatie buiten de structuren van het establishment. Voorbeeld bij uitstek is het snel aan populariteit winnende homeschooling: de opvoeding van je kinderen onttrekken aan de overheid, en het gezin (of een samenwerkende groep gezinnen) herstellen in de rol van opvoedingseenheid.
In november 2001 richtte Thomas Fleming zich in een bijzonder voorwoord aldus tot de Chronicles-lezer: “Er bestaat volstrekt geen kans dat de gewone Amerikanen ooit de macht zullen heroveren voor een voldoende lange tijd om het tij te keren tegen het multiculturalisme, positieve rassendiscriminatie of (…) de roep om verontschuldigingen en herstelbetalingen. De anti-Amerikanen in beide partijen hebben bovendien de Amerikaanse soevereiniteit vernietigd door hun verliefdheid op de economische en politieke globalisering. (…) Het feest is voorbij, het is tijd om het einde vast te stellen. De strijd voor de Amerikaanse toekomst daarentegen is pas begonnen. (…) De Amerikanen hebben nog vele opties, al is geen enkele daarvan een politieke. Sommigen zullen bij hun biertje zitten wenen, anderen zullen hun leven vergooien aan haat zoals de White Power-bewegingen. Maar enkelen zullen dapper genoeg zijn om de toekomst onder ogen te zien en te beseffen dat de Westerse mens dit allemaal al eens eerder meegemaakt heeft en erin geslaagd is om enkele kostbare dingen uit de ruïnes te redden.”
Vier conservatieve programmapunten
(geformuleerd door Joe Sobran in Sobran’s, 5/1999, p.12)
“Hoe zou een echte conservatieve agenda eruit zien? Zijn eerste doel op lange termijn zou zijn, de centrale regering in te perken tot haar grondwettelijke bevoegdheden – dus een heel aantal wetten afschaffen eerder dan er nieuwe op te stapelen. (…)
“Een tweede doel moet zijn, de individuele inkomensbelasting af te schaffen, die de enorme groei van de federale macht bekostigd heeft. Zulke belasting komt immers neer op ‘onvrijwillige dienstbaarheid’, verboden door het Dertiende Amendement – en even fout wanneer we onvrijwillig de staat dienen in plaats van een privé-meester.
“Ten derde moeten conservatieven ernaar streven om de regeringscontrole over het onderwijs af te schaffen. (…) Laïcistisch staatsonderwijs ontzegt kinderen godsdienstonderricht en religieuze moraal, en is het hoofdwapen van de moderne staat tegen de christelijke beschaving.
“Ten vierde moeten conservatieven het militarisme verwerpen. Uitgaven voor ‘landsverdediging’ overtreffen verre elke nood aan verdediging en zijn de hoofdreden waarom Amerikanen vandaag teveel belastingen betalen. Oorlog is ongrondwettig tenzij voor ‘de gemeenschappelijke verdediging van de Verenigde Staten’. Steun aan oorlog moet niet verward worden met patriottisme. Conservatieven moeten er niet voor terugschrikken om ‘isolationisten’ genoemd te worden – de linkse term voor de vaderlandslievende wereldbeschouwing van Washington en Jefferson, die buitenlandse avonturen genre de Joegoslavische oorlog verwierpen. Vriendschap met andere landen, ja. Militaire allianties, nee.
“Als dit alles verwezenlijkt kan worden, dan zullen de Amerikanen opnieuw de vrijheid genieten die voor hun voorouders een vanzelfsprekend geboorterecht was Alleen al het nastreven van zulke agenda zal gewone Amerikanen helpen om te denken zoals hun voorouders en zich te verzetten tegen inbreuken op hun vrijheid.”

00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, politique, conservatisme, paléo-conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 décembre 2008
Breve glossario delnociano
BREVE GLOSSARIO DELNOCIANO
http://patriaeliberta.myblog.it
Breve glossario delnociano: conservazione, reazione e tradizione

Mi permetto di sottoporvi una breve nota terminologica a chiarimento ed esposizione dei concetti di conservazione, reazione e tradizione, tratta da A. Del Noce, I caratteri generali del pensiero politico contemporaneo, vol. I. Lezioni sul marxismo (Giuffrè, Milano 1972). Secondo il filosofo torinese questi concetti vanno assolutamente mantenuti distinti.
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, politique, théorie politique, italie, conservatisme, réaction, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook