dimanche, 12 juillet 2009
Knut Hamsun sauvé par Staline!

Knut Hamsun sauvé par Staline!
Cette année 2009 célèbre le 150ème anniversaire de Knut Hamsun (1859-1952). Le romancier norvégien, né Knut Pedersen, est, avec Hendrik Ibsen, l’écrivain norvégien le plus lu et le plus traduit dans le monde. En 1890, Knut Hamsun fait ses début avec son roman “La faim” qui innove quant à la manière d’écrire. Ce roman fut d’emblée un grand succès et amorça une carrière littéraire longue et productive. En 1920, Knut Hamsun obtient le Prix Nobel de littérature. Son influence sur la littérature européenne et américaine est énorme et d’une importance inestimable. Des écrivains comme Ernest Hemingway, Henry Miller, Louis-Ferdinand Céline, Hermann Hesse, Franz Kafka, Thomas Mann et I. B. Singer ont été inspirés par le talent de Knut Hamsun. Singer l’appelait le “père de la littérature moderne”. En Flandre, deux écrivains, Felix Timmermans et Gerard Walschap, ont reçu l’inspiration du Prix Nobel norvégien.
En Norvège, le 150ème anniversaire de la naissance de Knut Hamsun sera célébré par des expositions, des productions théâtrales et une conférence internationale. L’une des principales places d’Oslo, située juste à côté de l’Opéra national, portera dorénavant son nom. On érigera enfin un monument en son honneur. On dirait que les Norvégiens viennent de découvrir le nom de leur très célèbre compatriote. Ces derniers temps, un grand nombre de villes et de villages ont donné son nom à une place ou à une rue. A l’endroit où il résidait, à Hamaroy, on ouvrira officiellement un “Centre Knut Hamsun”, le 4 août, jour de son anniversaire. Ce jour-là, un timbre poste spécial sera émis. Pourtant, Knut Hamsun a été conspué et vilipendé pendant des décennies par l’établissement norvégien.
Goebbels
Hamsun a mené une vie de nomade pendant la majeure partie de son existence. Il est né fils d’un pauvre tailleur. Son père, démuni, le confia à un oncle riche. Le garçonnet devait travailler pour cet oncle afin de rembourser les dettes que ses parents avaient contractées auprès de ce dernier, âpre au gain. Au bout de quatre ans, le jeune garçon, alors âgé de quatorze ans, en a eu assez de cet oncle et s’en alla de par le vaste monde. Deux fois, la faim le poussa à émigrer aux Etats-Unis où il exerça trente-six mille petits métiers. Avec, toujours, un même objectif en tête: devenir écrivain. Son modèle était son compatriote Björnstjerne Björnson.
Après sa percée littéraire avec “La faim”, Hamsun devint incroyablement productif. Il devait une large part de son succès aux traductions allemandes de son oeuvre. Ses livres y connaissaient des tirages fantastiques. Grâce à son éditeur allemand, Hamsun a enfin pu connaître, après tant d’années de misère noire, la sécurité financière. Mais il y eut plus. L’écrivain norvégien n’a jamais dissimulé sa germanophilie. Qui, de surcroît, prenait davantage de relief au fur et à mesure que grandissait son anglophobie. L’arrogance britannique le révulsait. Il ne put plus la tolérer après la Guerre des Boers et les interventions musclées en Irlande. A ses yeux, les Britanniques ne méritaient plus aucune attention, rien que du mépris. A cette anglophobie s’ajouta bien vite son anti-communisme.
Pendant l’occupation allemande de la Norvège (1940-45), il aida certes l’occupant mais demeura avant tout un patriote norvégien intransigeant. Dans ses articles, Knut Hamsun exhortait ses compatriotes à s’engager comme volontaires pour aider les Allemands à combattre le bolchevisme. Le Président américain Roosevelt était, à ses yeux, un “juif de service”. Il fut reçu par Hitler et Goebbels avec tous les honneurs. La rencontre avec Hitler eut des effets sur le long terme. D’abord, Hamsun, atteint de surdité, foula les règles du protocole aux pieds et exigea du Führer le renvoi du gouverneur allemand Terboven, craint et haï. Personne n’avait jamais eu le toupet de parler sur ce ton à Hitler et ne l’avait à ce point brusqué. L’intervention de Hamsun eut toutefois des effets: après sa visite à Hitler, les exécutions arbitraires d’otages ont cessé.
La potence?
Le 26 mai 1945, Hamsun et son épouse, une national-socialiste convaincue, sont mis aux arrêts à domicile. Pour des raisons peu claires, Hamsun est déclaré “psychiquement dérangé” et enfermé pendant un certain dans une clinique psychiatrique d’Oslo. Le gouvernement de gauche voulait se débarrasser de lui mais, mise à part sa germanophilie, on ne pouvait rien lui reprocher. Il n’avait jamais été membre de quoi que ce soit. Bien au contraire! Grâce à lui, bon nombre de vies avaient été épargnées. Certes, il avait refusé de nier la sympathie qu’il éprouvait pour Hitler. Fin 1945, le ministre soviétique des affaires étrangères, Molotov, fait savoir à son collègue norvégien Trygve Lie qu’il “serait regrettable de voir la Norvège condamner son plus grand écrivain à la potence”. Molotov avait entamé cette démarche avec l’accord de Staline. C’est après cette intervention que le gouvernement norvégien renonça à faire le procès de Hamsun et se borna à lui infliger une solide amende qui le mena quasiment à la faillite. La question reste ouverte: la Norvège aurait-elle condamné le vieillard Hamsun à la peine de mort? Les collaborateurs norvégiens ont tous été condamnés à de lourdes peines. Mais l’Union Soviétique pouvait exercer une influence forte et redoutée en Scandinavie dans l’immédiat après-guerre.
Jusqu’à sa mort en février 1952, le gouvernement norvégien a traité Hamsun comme un délinquent de droit commun. Il a fallu attendre soixante ans pour qu’il soit réhabilité.
(texte issu de l’hebdomadaire anversois “ ’t Pallierterke”, 24 juin 2009; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, prix nobel, littérature norvégienne, lettres norvégiennes, norvège, scandinavie, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondaile, années 30, années 20, années 40, répression |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ein Gea(e)chteter - Ernst von Salomon
Ex: http://www.ostpreussen.de/
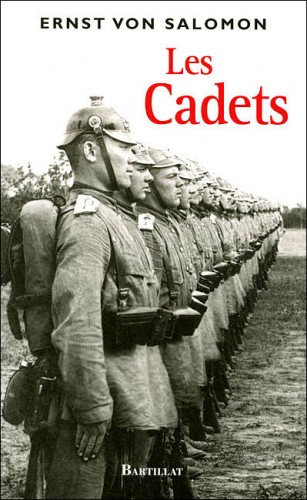 Ein Gea(e)chteter Frage 2 des Fragebogens: Name? Antwort: von Salomon, Ernst. Frage 4: Geburtsdatum? Antwort: 25. September 1902, morgens 2 Uhr 5 Minuten. Frage 5: Geburtsort? Antwort: Kiel. Doch bei so nüchternen Angaben beläßt es der Gefragte, der in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre, nicht. Und das gerade war die ebenso originelle wie zugkräftige Idee, die sein vor 51 Jahren erschienenes Buch "Der Fragebogen" zum ersten Bestseller der Bundesrepublik Deutschland machte, von dem bis heute 450.000 Exemplare verkauft sind. Hinzu kommen Übersetzungen in fast alle wichtigen Sprachen. Die Ausgabe als heute noch lieferbares rororo-Taschenbuch weist im Impressum die Angabe auf, im Dezember 1999 sei das 98. Tausend der Taschenbuchfassung ausgeliefert worden. Und wer sie sich jetzt nicht nur kauft, sondern auch liest, der wird verblüfft feststellen, daß das Buch immer noch so frisch und aktuell ist wie vor einem halben Jahrhundert. Als die Sieger 1945 endlich Deutschland niedergerungen hatten, genügte ihnen nicht die Ausschaltung der deutschen Macht. Sie wollten vielmehr die Deutschen zu anderen Menschen machen. Das sollte mittels einer Methode vollbracht werden, die sie als "Umerziehung" bezeichneten, die später, als die Chinesen sich ihrer bedienten, als "Gehirnwäsche" in die Geschichte einging, treffender und umfassender aber wohl den Namen "Charakterwäsche" verdient. Die Besiegten sollten ihre Geschichte, so wie sie sie bisher gesehen hatten, verleugnen und sie so deuten, wie die Sieger es ihnen vorschrieben, wobei die Schwie- rigkeit darin bestand, daß die vorher so herzlich verbündeten Sieger sich sehr bald uneins wurden und jeweils eine ganz andere Auffassung von deutscher Geschichte demonstrierten. Die Deutschen sollten auch nicht mehr "autoritätsgläubig" sein, nicht mehr gemäß dem fünften Gebot Vater und Mutter ehren, überhaupt all das ablegen, was ein späterer Parteivorsitzender "Sekundärtugenden" nennen sollte. Diesem Ziel diente zunächst einmal der "Fragebogen der Alliierten Militärregierungen", den jeder erwachsene Deutsche ausfüllen sollte. In ihm stellte man den Deutschen 131 Fragen - von der Frage 1: "Für Sie in Frage kommende Stellung" bis zur Frage 131: "Kenntnis fremder Sprachen und Grad der Vollkommenheit". Die Fragen waren von einer Qualität wie etwa jene mit der Nummer 108, die da lautete: "Welche politische Partei haben Sie in der November-Wahl 1932 gewählt?", eine Frage, die Zweifel aufkommen ließ an dem Verständnis der demokratischen Sieger für eine allgemeine, gleiche und geheime Wahl, die nicht gerade dazu dienen konnte, die Hoffnung der Deutschen auf die kommende Demokratie zu festigen. v. Salomon hatte sich, nachdem er anderthalb Jahre lang in einem US-Internierungslager inhaftiert worden war, um dann mit dem Vermerk "irrtümlich verhaftet" sang- und klanglos entlassen zu werden, vorgenommen, den Fragebogen ernst zu nehmen und ihn Punkt für Punkt ausführlich zu beantworten. Dabei beließ er es nicht bei den 131 Fragen, sondern nutzte die den Fragen sich anschließende Rubrik "Remarks/Bemerkungen", um auf 150 Druckseiten "Bemerkungen" über seine Erfahrungen in US-Haft niederzuschreiben. Diese Schilderungen waren seinerzeit wohl ein wesentlicher Grund für den explosionsartigen Erfolg. Im ersten Jahr nach dem Erscheinen wurden 100.000 Bücher verkauft. Weder davor noch - wenn man richtig beobachtet - danach hat jemand dieses wichtige Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte in einer literarisch anspruchsvollen Form geschildert. Doch nicht nur die Form machte den Reiz aus, sondern ebenso die mitgeteilten Tatsachen, die bislang mit einem Tabu belegt waren. Un- menschlichkeiten wurden schon damals ausschließlich der deutschen Seite zugeschrieben, während man nun erkannte, daß sie auch den Siegern nicht fremd waren. Aber weit darüber hinaus ist der "Fragebogen" ein menschliches Dokument über das Leben und das Denken in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, gesehen durch die Brille eines Mannes, der politisch schwer einzuordnen ist. Man könnte ihn konservativ nennen, wenn er nicht auch die vorhandenen Verhältnisse auf dem Wege der Revolution hätte ändern wollen. Mit Sicherheit war er kein Kommunist, weil er nichts von dem Ideal der Gleichheit hielt und auch der Brüderlichkeit gegenüber ein erhebliches Maß an Skepsis beibehielt. Den Liberalismus lehnte er entschieden ab und hielt die Ordnung für lebenswichtiger als die Freiheit. Man hat ihn eingeordnet in die Reihen der konservativen Revolutionäre wie etwa Ernst Jünger, dem er freundschaftlich verbunden war, Oswald Spengler oder Arthur Moeller van den Bruck. Auf die Frage nach der Staatsangehörigkeit antwortete Ernst v. Salomon: "Ich bin Preuße. Die Farben meiner Fahne sind schwarz und weiß. Sie deuten an, daß meine Väter für die Freiheit starben, und fordern von mir, nicht nur bei hellem Sonnenschein, sondern auch in trüben Tagen ein Preuße zu sein. Es ist dies nicht immer einfach." Er sei als Preuße "gewohnt, gehalten und gezwungen, den Tatsachen nüchtern ins Auge zu blicken," schreibt er. Das dürfte eine wichtige Aussage sein: Er läßt sich durch Phrasen nichts vormachen und bleibt der nüchterne Betrachter der Zeitläufe. Natürlich akzeptiert er, daß er nach dem Staatsangehörigkeitsprinzip Deutscher ist. Inhaltlich ist ihm aber das Preußische wichtiger, denn: "Preußen hat den Staat gelebt. Es gibt keinen Augenblick preußischer Geschichte, in welchem sich nicht, wer immer für Preußen verantwortlich war, mit dem Staate, mit der Idee des Staates befassen mußte. Preußen hat jeden Tag vor harten Wirklichkeiten gestanden. Die Gefährdung war ebenso ungeheuer wie die Aufgabe. Vielleicht ist es darum gewesen, daß sich ein Bündel edler Namen aus allen deutschen Geschlechtern zu Preußen hingezogen fühlte, preußisch wurde aus Wahl, durch Bekenntnis, daß die besten Preußen ihrer Herkunft nach nicht preußisch waren, nicht preußisch durch den Zufall der Geburt ... Und dies ist das Erstaunliche: das preußische Staatsgefühl hatte dem einzelnen nichts zu bieten als strenge Forderungen. Es verlangte vom König, der erste Diener des Staates zu sein, wertete niemals Absichten, immer nur Leistungen, es wahrte nicht Interessen und Vorteile, sondern Idee und Formen, es achtete nicht auf die Erfüllung. Im Ganzen ist dies Staatsgefühl ... bedeutend mehr ethisch als metaphysisch oder biologisch be- dingt ..." Angesichts solcher Aussagen kann man nur zu dem Schluß kommen, daß der preußische Geist genau das Gegenteil ist vom bundesrepublikanischen Geist von heute. Neben einigen anderen Büchern aus der Feder Ernst v. Salomons nach dem Kriege, wie etwa "Die schöne Wilhelmine", ein Unterhaltungsroman mit hohen Auflagen und Fernsehweihen, aber ohne politische Bedeutung, ragen seine bis 1945 erschienenen und dann von den Siegern natürlich sofort verbotenen Werke heraus. Sein erstes Buch trug den Titel "Die Geächteten" und erreichte nach Angaben des Verlages eine Auflage von 50.000, was nicht stimmen kann, liegt doch dem Berichterstatter ein Exemplar aus der Kriegszeit vor, das den Vermerk trägt "115.000 bis 119.000 Tausend". In ihm schilderte v. Salomon seinen Weg als preußischer Kadett im Jahre 1919 und in der Zeit der totalen Verwirrung während der ersten Nachkriegsjahre, die er den "Nachkrieg" nennt und in der er als Soldat in einem der von der sozialdemokratisch geführten Reichsregierung ins Leben gerufenen Freikorps mithalf, das Reich vor dem Untergang in kommunistischen Revolutionsversuchen zu bewahren. Dabei stellte er mit seinen Kameraden fest, daß sie eigentlich keineswegs die Absicht gehabt hatten, die alte Ordnung aufrechtzuerhalten. Er schilderte, wie die Idee des Frontsozialismus entstand, der aber angesichts der Gefährdung des Reiches von außen wie von innen nicht ausformuliert werden konnte. Salomon kämpfte mit seinem Freikorps in Berlin gegen spartakistische Umsturzversuche, im Baltikum gegen die auf die deutschen Grenzen vorrückende Rote Armee. Er beschützte die Weimarer Nationalversammlung, arbeitete im Untergrund gegen die französische Besatzungsmacht im Westen Deutschlands und fand sich schließlich mit Tausenden seiner Kameraden zusammen, als es darum ging, Oberschlesien gegen den Ansturm polnischer Insurgenten zu verteidigen. Als die Lage des Reiches vor allem aufgrund der Ausbeutung des Landes durch unermeßliche Tributzahlungen an die Sieger von 1918 immer verzweifelter wurde, gelangte er mit anderen Kameraden zu dem Schluß, daß die sogenannte Erfüllungspolitik der Reichsregierung zum Untergang des Landes führen mußte. Deshalb beschlossen sie, den in ihren Augen für das System repräsentativen Reichsaußenminister Walther Rathenau zu ermorden. Man glaubte, das Attentat könnte das Signal zu einer nationalen Erhebung sein. Sie hatten sich geirrt. Salomon war am Rande an den Vorbereitungen beteiligt. Er wurde gefaßt, vor Gericht gestellt und zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt, die er absaß. Nach der Entlassung entdeckte der Verleger Ernst Rowohlt seine schriftstellerische Begabung und veranlaßte ihn, seine Erlebnisse und Empfindungen niederzuschreiben. Daraus entstand das Buch "Die Geächteten". Ihm folgte in den dreißiger Jahren ein schmalerer Band über seine Kadettenzeit: "Die Kadetten". Salomon bemühte sich, die Geschichte der Freikorps in mehreren Büchern zu dokumentieren, so in dem jetzt wieder als Reprint vorliegenden Werk "Das Buch vom deutschen Freikorpskämpfer" oder in der mehr theoretischen Schrift "Nahe Geschichte". Im Dritten Reich hielt er sich aus der Politik heraus. So hatte er sich das neue Deutschland nicht vorgestellt, war er doch nicht der Mann der Massen, sondern einer, der den Elitegedanken hochhielt. Überhaupt nichts anfangen konnte er mit den Bemühungen der Nationalsozialisten, die Geschichte und die Politik mit Hilfe des Rassegedankens zu interpretieren, ein ideologischer Ansatz, der nicht nur scheiterte, sondern auch zu schrecklichen Verbrechen führ-te. Er war zunächst Lektor im Rowohlt-Verlag, dann Drehbuchautor bei der Ufa und bei der Bavaria. Zahlreiche Drehbücher, die meisten unpolitisch, entstammten seiner Feder. Die einmarschierten US-Truppen nahmen in dem Bemühen, alle Elemente der bisherigen deutschen Elite auszuschalten, auch Ernst v. Salomon im Rahmen des "automatic arrest" fest. Er durchlief mehrere US-Internierungslager und erlebte all die Demütigungen, Schikanen und Brutalitäten, die sich auch die westlichen Sieger gegen die völkerrechtswidrig eingesperrten Internierten im Übermaß zuschulden kommen ließen. Aus den Internierungserlebnissen entstand "Der Fragebogen", den er auf Sylt schrieb. Der Leser erfährt von der Gedankenwelt ebenso wie von den Taten der jungen Nationalrevolutionäre während der Weimarer Republik. Die Freikorpskämpfe werden wieder lebendig, ebenso wie die Anstrengungen der Landvolkbewegung Ende der 20er Jahre. Salomon schilderte die Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945, diese Spanne, die "gewöhnlich als die des Dritten Reiches, billig als die des Tausendjährigen Reiches, kurz als die des Nazi-Regimes, und gut als die der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland bezeichnet wird", wie er es formuliert. Und schließlich holt er aus, um das zu schildern, was er als Internierter in US-Lagern erleben mußte. Was damals den Deutschen am "Fragebogen" so gut gefiel und auch heute noch pures Lesevergnügen bereitet, ist jede fehlende Anpassung, jeder Mangel an vorauseilendem Gehorsam und politischer Korrektheit. Statt dessen schildert v. Salomon selbstbewußt, frech, teils auch wohl sarkastisch und auch nicht ohne Aggression die Zeit. Das Buch wirkte damals Anfang der 50er Jahre wie befreiend für die geistige Atmosphäre und wurde daher auch von den Inhabern der Macht angegiftet. Von den Erträgen des Buches kaufte Salomon für sich und seine Familie ein Bauernhaus in Stöckte an der Luhe. Am 5. August 1972 ist dort Ernst v. Salomon im Alter von 69 Jahren gestorben. Der heimatlose Rechte liegt auf dem Waldfriedhof in Marienthal in der Lüneburger Heide begraben.
CD "Ein preußischer Revolutionär": Bereits mit 28 Jahren schrieb Ernst v. Salomon in seinem autobiographischen Werk "Die Geächteten" seine Erlebnisse als Freikorpskämpfer nieder. Es ist eines der bedeutendsten Dokumente über die Zeit des Bürgerkrieges in Deutschland, der Putschversuche und Aufstände sowie des Kampfes der Freikorps an den deutschen Grenzen. Die gelungene musikalische Untermalung macht die Lesung ausgewählter Kapitel zu einem Hörgenuß. Mit mehrfarbigem Beiheft. Zirka 70 Minuten, 14,95 Euro.
Die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e.V. und der Ostdeutsche Kulturkreis e.V. laden zu einer Gedenkveranstaltung am Donnerstag, 26. September 2002, um 19.30 Uhr im Saal "Kaiser Friedrich", Kiel, Hasselsdieksdammer Weg 2 (Eingang vom Wilhelmplatz aus). Der Historiker und Germanist Dr. Olaf Rose, Bochum, spricht über das Werk und den Menschen Ernst v. Salomon, der Rezitator Günther Pahl, Pinneberg, liest aus v. Salomons Büchern. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt beträgt 5 Euro, für Schüler und Studenten 3 Euro. |
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, années 20, weimar, nationalisme révolutionnaire, militaria, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 11 juillet 2009
Les ancrages économiques et géopolitiques de l'Australie
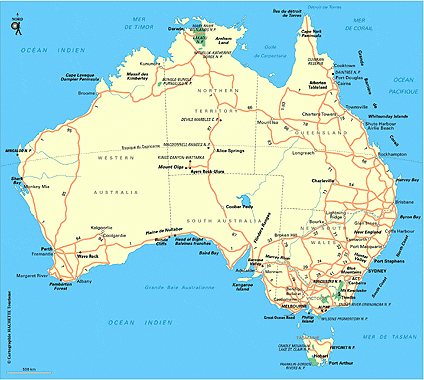
Les ancrages économiques et géopolitiques de l’Australie
Nous sommes prêts à parier de fortes sommes d’argent: demandez à une centaine de citoyens flamands pris au hasard et demandez-leur à quoi ils associent l’Australie. Vous recevrez immanquablement un paquet de clichés comme réponse: des soaps plagistes, des kangourous, ou peut-être encore une série télévisée comme “Flying Doctors” ou un personnage de film comme Crocodile Dundee. En revanche, la plupart des économistes se font un idée plus exacte du pays: ils savent qu’il y a là-bas du charbon et du nickel, mais aussi de l’or et de l’uranium. Voilà ce que vous répondront ceux qui connaissent les réalités économiques de ce continent insulaire. Bon nombre de matières premières importantes se trouvent dans le riche sous-sol australien. Il y a déjà bien des décennies que tel est le cas et c’est bien évidemment cette richesse qui fait la prospérité de cette ancienne colonie pénitentiaire britannique. L’Australie a véritablement été la Sibérie du “British Empire”. Mais, innovation, depuis quelques années, un nouveau facteur a émergé: le facteur chinois. L’Empire du Milieu est devenu, en très peu de temps, le principal client de l’Australie. Cette coopération sino-australienne suscite certes bien des contrats lucratifs mais à ces échanges fructueux, il y a un revers de médaille...
Partenaire commercial
Les années qui viennent de s’écouler ont été fort douces pour ceux de “down under”, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Les nombreuses matières premières du sol australien se vendent cher au prix du marché, ce qui a stimulé l’économie du pays-continent. L’influx de capitaux a fait grimper le prix de l’immobilier, la bourse a connu des “pics” et, au cours des trente dernières années, le taux de chômage n’a jamais été aussi bas. Un tel contexte économique, on s’en doute, a généré de la satisfaction, cependant, dans son sillage, une certaine angoisse est née en Australie. Pour ce qui concerne les investissements étrangers, ce sont toujours les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui demeurent les principaux partenaires de l’Australie mais les Chinois sont en train de les rattraper à une vitesse vertigineuse. Ces mêmes Chinois sont aussi les acheteurs principaux des richesses naturelles du pays. A peu près la moitié du fer et de la laine produits en Australie part en direction des ports chinois. En même temps, quelque 120.000 Chinois étudient en Australie. Les chiffres sont éclairants: l’imbrication économique des deux pays est devenue un fait. Un fait en pleine croissance. Ce qui suscite des questions. Y compris dans les autres pays de la région Insulinde/Océanie.
L’an dernier, le Japon a été détrôné: il n’est plus le principal partenaire commercial de l’Australie, ce qui constitue un symbole important. Un diplomate remarquait naguère: “C’est le cas de toute l’Asie, mais ce sont surtout l’Inde et le Japon qui s’inquiètent du tandem sino-australien”. “Sous l’ancien Premier Ministre John Howard, les liens entre la Chine et l’Australie sont devenus très forts mais sous son successeur Kevin Rudd, ces liens se renforcent encore davantage. En outre, Kevin Rudd est sans doute le seul leader occidental à parler couramment le mandarin. Cette situation éveille des soucis. En Australie et ailleurs”. En soi, ce ne sont pas les importations chinoises à grande échelle qui inquiètent mais certaines tentatives d’acheter des entreprises australiennes. Lorsque trois entreprises d’Etat chinoises ont fait savoir qu’elles entendaient acheter certaines parts de l’industrie minière australienne, une sonnette d’alarme a retenti chez plus d’un observateur.
Au total, les Chinois auraient investi 22 milliards de dollars, ce qui équivaut, à peu près, au total de tous les investissements chinois de ces trois dernières années. “La république communiste de Chine, donc propriété à 100% communiste, achète des parts importantes de ce pays”, a-t-on clamé sur les bancs de l’opposition australienne. Cette remarque peut sans doute faire mousser quelques âmes sensibles dans le débat idéologique et politicien, dans la pratique de telles paroles n’ont que peu de poids. La Chine aligne d’ores et déjà plus de 115.000 entreprises d’Etats, avec pour fleuron, 150 groupes importants qui opèrent au niveau international. En pratique, ces entreprises et ces groupes cherchent à faire du profit, comme n’importe quelle entreprise privée.
Le noyau de l’affaire est une question d’ancrage. Pour l’opposition australienne, le pays se trouve face à une puissance étrangère qui ne cesse d’acheter des parts substantielles de l’économie nationale. Démarches jugées inquiétantes. Le cas australien, à ce niveau, n’est pas isolé. Dans la région, du Vietnam aux Philippines, tous s’inquiètent du poids toujours croissant de la Chine. Un chercheur du “Centre de relations Internationales” de l’Université de Sidney résume la situation en ces termes: “La situation s’est modifiée. Au début, on voyait ces investissements d’un bon oeil, puis le doute s’est installé. Pour l’essentiel, il ne s’agit pas tant des relations spécifiques entre la Chine et l’Australie mais bien du regard assez hostile que jette le monde sur la Chine et son futur rôle de grande puissance”.
Le contexte politique explique l’évolution des relations économiques sino-australiennes. Ce qui est logique car le noyau de toute problématique est in fine toujours politique. Depuis l’entrée en fonction du gouvernement Rudd, celui-ci a résolument tiré la carte chinoise. Il a entrepris plusieurs voyages en Europe, aux Etats-Unis et, bien entendu, en Chine. Mais aucun autre pays asiatique ne figurait au programme, ce qui a offusqué bien des chancelleries en Asie. Un analyste constate: “En Inde, au Japon, en Corée du Sud, on a l’impression que le gouvernement Rudd est entièrement tourné vers la Chine”. La réaction d’un commentateur indien sur le voyage de Rudd le confirme. Son jugement bref est simple et lapidaire: “La Chine, la Chine et encore la Chine”.
Pourtant, il n’est pas neuf le débat quant à savoir si l’Australie est un avant-poste de l’Occident ou un pays asiatique. Mais la convergence des réalités économiques et des choix politiques du gouvernement Rudd indique qu’un nouveau chapitre de l’histoire des relations économiques entre l’Extrême Orient chinois et son environnement océanien vient de s’ouvrir. Est-ce une étape nouvelle vers un “happy end”? Cela reste à voir.
“M.”/” ’t Pallieterke”.
(article paru dans ’t Pallieterke, Anvers, 10 juin 2009; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : australie, chine, océanie, géopolitique, économie, géoéconomie, stratégie, matières premières |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Maurice Bardèche: une fidélité
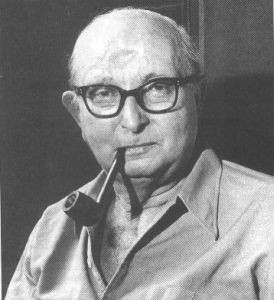
Archives de Synergies Européennes - 1993
Maurice Bardèche: une fidélité
Les souvenirs de Maurice Bardèche sont parus. C'est l'histoire d'une fidélité: à un beau-frère, à une idée, à une espérance, qui fut celle d'une part de la jeunesse européenne. L'espérance, en Europe, de nations réconciliées avec leurs peuples. Espérance très certainement illusoire: avec le fascisme, tout est bien qui finit mal.
L'influence de Bardèche ne s'est peut-être pas exercée sur un nombre important d'esprits, rnais elle a été considérable pour quelques-uns, en intensité et en durée. Sa revue Défense de l'Occident (1) a souvent été la première occasion de collaboration journalistique pour de jeunes non-confortnistes. En fonction des époques et des rédacteurs de la revue, celle-ci, parue de 1952 à 1982, fut d'une qualité naturellement variable. Elle constitua en tout cas un authentique ilot de non conformisme.
Pendant 30 ans, c'est-à-dire les années d'après-guerre, l'essentiel de ce qui s'est dit d'intelligent, "à droite", a été dit par Bardèche: sur la fin des colonies et le retour nécessaire à la fierté des peuples d'Afrique et d'Asie, sur les droits des Arabes en général et des Palestiniens en patticulier, sur le monde moderne comme émasculation de l'homme, sur le culte du dollar et le fonctionnarisme. Et avec une flopée d'autres dont des jugements positifs sur Mendès-France ou le Bérégovoy de 1982 témoignent. Naturellement, Bardèche n'est pas Pareto. Ce n'est pas un théoricien, pas plus qu'un doctrinaire à la Ploncard d'Assac.
Quoiqu'il en soit, avec Montherlant et Pauwels, Bardèche a été à l'origine de mon éveil, qui ne fut pas seulement politique, et ne le fut même pas principalement. Je ne suis sans doute pas seul dans ce cas. On constate à ce sujet une évolution singulière. Pour âpres et parfois violents que furent les combats menés contre le rebelle Bardèche, - celui-ci lançant ses brulôts contre les mythologies du temps -, souvent se manifestait un respect de l'adversaire, ou du moins une reconnaissance de l'ennemi qui n'a plus cours aujourd'hui. Maintenant, l'adversaire des vérités officielles n'est plus respectable, il n'est plus même un simple ennemi du système, il est devenu une "non-personne".
Des années de Défense de l'Occident, - auquel j'ai collaboré jeune -, à 1993, j'ai certes évolué. Assez considérablement même sur certains points (2). Reste une fidélité. Elle unit ceux qui sont passés par les "portes de lumières". Si Brasillach, c'était le don du bonheur, le goût du courage et l'émerveillement devant l'itmocence des jours toujours premiers, Bardèche, ce fut l'ironie dévastatrice de Suzanne et le taudis, et de nombre de pages des Souvenirs, et la distance jusque dans l'engagement le plus radical.
A la fin d'une vie abrégée par les démocrates sincères et les patriotes de progrès, Brasillach plaidait pour un "fascisme libéral". Bardèche, de son côté, n'a cessé de crayonner les traits d'un "fascisme raisonnable". A tel point que beaucoup de ses lecteurs - et j'en suis - sont devenus raisonnablement a-fascistes. Ni haine, ni racisme chez Bardèche, curieux des êtres, amoureux de la diversité du monde. Malgrè un goût prononcé pour le blasphème, on ne trouve pas chez lui une recherche systématique de l'originalité. Bardèche dit d'un de ses livres, Les Temps modernes, qu'il ne contenait que "des vérités largement répandues". Cet écrivain passionné n'aspirait qu'à être un homme tranquille, penché sur les livres, les femmes et les enfants - ce qui constitue somme toute un assez bon programme.
Ce qui unifie l'ensemble des travaux de Bardèche, politiques, historiques et littéraires, c'est effectivement un programme simple et robuste: le refus d'un monde mercantile. "Tout ce que j'ai écrit n'a jamais été qu'une protestation contre l'invasion de l'économique dans notre vie". Tous les livres de Bardèche sont parcourus par une sensation dont il écrit ne l'avoir pleinement composé que dans les dix dernieres jours après la disparition de Défense de l'Occident. Cette sensation, ou cette intuition, c'est la hantise de la dépossession, "non seulement de nos nations, mais de notre personnalité même". Le "monde d'hier" est mort, celui des héroïques petits Bara et Viala, celui où "les nuits étaient de vraies nuits". Il ne reste, aux hommes, sans doute que les femmes pour leur renvoyer l'image de leurs propres rêves. Il n'est pourtant pas certain que cela soit suffisant.
Pierre LE VIGAN
(1) du nom du livre d'Henri Massis.
(2) Pour faire court et me limiter au plan politique, je précise être plus à l'écoute de Lipietz ou de Chevènement que de Le Pen. Sans que la diabolisation de celui-ci ne me paraisse ni souhaitable, ni raisonnable, ni honorable.
Maurice Bardèche, Souvenirs. Buchet-Chastel, 1993.
00:05 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, fascisme, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 10 juillet 2009
Actualité géopolitique du Groenland
Actualité géopolitique du Groenland
Par quel adjectif qualifieriez-vous un pays qui, d’un seul coup de plume, perdrait 98% de son territoire national? Un pays “décapité”? Un pays “pulvérisé”? Peu importe. Si l’on fait abstraction des très nombreux paramètres qui jouent en l’affaire, c’est exactement ce qui risque d’arriver au Danemark si les Groenlandais, qui sont un peu moins de 60.000, décidaient de faire désormais cavaliers seuls. Cela se passera-t-il? Et quand? Nous ne le savons pas, nous ne disposons pas d’une boule de cristal... Mais une chose est sûre: la tendance va dans ce sens. Sans commune mesure avec le nombre fort modeste des habitants de cette immense masse territoriale qu’est le Groenland, l’abandon des liens avec le Danemark provoquerait un glissement de terrain géopolitique que plusieurs pays observent déjà, avides et intéressés.
L’évolution lente vers l’autonomie ou l’indépendance du Groenland, qui se séparerait définitivement du Danemark, est en marche selon un calendrier graduel mis au point depuis des années. Il y a une trentaine d’années, les Groenlandais ont obtenu un statut d’auto-détermination qui, peu le savent, a des conséquences pour l’UE. Ce nouveau statut permettait aux Groenlandais de sortir unilatéralement de l’Union Européenne, ce qui eut effectivement lieu en 1985 après une querelle sur les droits de pêche. Tout comme, disons, les Açores ou la Guadeloupe, le Groenland est devenu en 1973, en même temps que le Danemark, membre de la “Maison européenne”, tout en ayant le statut de “région ultra-périphérique”. Les Groenlandais sont dès lors un exemple d’école: ils sont le seul “peuple” qui ait jamais réussi à tourner le dos à l’UE.
Le pragmatisme danois
Entretemps, une nouvelle étape vers l’indépendance pure et simple vient d’être franchie. En novembre 2008, une bonne majorité de 75% s’est prononcée en faveur d’un démantèlement supplémentaire de l’administration “coloniale” danoise. Les Groenlandais sont désormais maîtres de leur justice et de leur police. La politique étrangère reste à Copenhague. Les Danois continuent cependant à payer cher pour les Groenlandais. Chaque année, ils consacrent quelque 633 millions d’euro à la grande île: des “transferts” en quelque sorte. Le trésor danois alimente un tiers du PNB du Groenland, ce qui explique pourquoi l’indépendance pleine et entière se fera encore un peu attendre... Sauf si, bien entendu, certaines évolutions se manifesteront plus rapidement que prévu.
Sans tenir compte de quelques remarques acides, l’attitude danoise est toute de sérénité face à cet inéluctable processus. Un morceau supplémentaire de ce qui fut jadis l’Empire maritime danois disparaîtrait. Les Danois s’y sont habitués. Il fut un temps, en effet, où le Danemark possédait quelques îles dans les Antilles, l’Islande et quelques lambeaux de territoire aujourd’hui suédois, norvégiens ou allemands. Si cet empire ne s’était pas désintégré, la principale ville danoise resterait certes Copenhague mais elle serait quasiment sur pied d’égalité avec Oslo (Norvège), Kiel (Allemagne) et Malmö (Suède). Le pragmatisme des Danois est certes une chose. Mais l’attention de plus en plus soutenue qu’accordent les puissances tierces à l’évolution de la situation au Groenland en est une autre, qui me semble sortir de l’ordinaire.
Le passage “GIUK”
Un regard sur la carte me paraît fort éclairant. Le Groenland occupe une position stratégique très intéressante entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Les régions du sud de l’île font partie de ce que stratégistes et géopolitologues nomment la zone du “Passage GIUK” (pour “Greenland, Iceland, United Kingdom”). Ce n’est pas un hasard si cette aire maritime constituait l’un des points stratégiques les plus sensibles de la Guerre Froide. Ce fut une zone où l’OTAN et le Pacte de Varsovie s’épiaient et se testaient. C’est pourquoi, d’ailleurs, les Américains, y ont installé une base militaire, Thulé. L’importance stratégique de cette aire est antérieure à la Guerre Froide: déjà lors de la Bataille de l’Atlantique entre puissances anglo-saxonnes et forces de l’Axe, cet espace océanique a révélé toute son importance.
Mais l’enjeu actuel dépasse largement l’aire GIUK. La fonte de parties substantielles de la calotte glaciaire dans la zone arctique rend possible la navigation des mers autour du Groenland. Sur la façade occidentale de l’île, une route semble se former qui rendrait bientôt possible la circulation maritime entre le Pacifique et l’Atlantique, via la zone polaire arctique. Même si le “Northwest Passage” ne deviendra navigable qu’en été, nous verrions se constituer la principale mutation dans les liaisons maritimes depuis le creusement du Canal de Panama.
Ensuite, autre facteur d’intérêt: les richesses naturelles qui se trouvent sous le sol de la région polaire arctique. La règle est claire: ce qui se trouve dans la zone du plateau continental appartient au pays qui le borde. C’est pourquoi plusieurs Etats lancent des enquêtes pour déterminer scientifiquement à qui appartient, effectivement ou non, certaines zones de ce plateau. Le sous-sol groenlandais semble fort bien pourvu de matières premières. Certes, les estimations divergent mais certaines d’entre elles font état d’immenses réserves de pétrole, perspective allèchante même si leur exploitation éventuelle sera difficile. Peut-être que derrière l’apparente sérénité danoise, face à l’éventualité d’une indépendance pleine et entière du Groenland, se cache en réalité une inquiétude politique. Ce ne serait nullement illogique.
Lors des sondages et des forages, il vaut mieux faire preuve de prudence. Ainsi, au début 2009, le gouvernement danois a décidé de rouvrir un dossier ancien, celui d’un accident d’avion datant de 1968. Cette année-là un bombardier B52 des forces aériennes américaines s’est écrasé; il avait à son bord quatre bombes nucléaires. Immédiatement après l’accident, Danois et Américains ont mis tout en oeuvre pour les récupérer. Ils ont réussi à en retrouver trois. Mais la bombe n°78.252 est resté introuvable jusqu’ici. Il faudra bien se fier à l’honnêteté de ceux qui la retrouveront...
“M.”/”’t Pallieterke”.
(article paru dans “ ’t Pallieterke”, Anvers, 1 juillet 2009; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, stratégie, arctique, pôles, danemark, groenland, océan atlantique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Marcel Aymé: Témoignage sur L. F. Céline
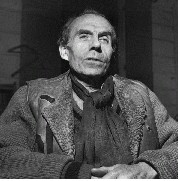
Témoignage
Céline était issu de ce milieu de petits commerçants parisiens, tous plus ou moins antisémites, parce qu'au temps où ils étaient employés de commerce, le juif symbolisait pour eux le patronat et qu'après s'être établis, ils avaient trouvé en lui un redoutable concurrent accusé de ruiner le petit négoce avec le concours de la banque juive. N'oublions pas que jusqu'à l'affaire Dreyfus, la classe ouvrière à Paris (et non en province) était ouvertement antisémite, prétendument en souvenir des banquiers de l'Empire, en realité pour des raisons plus intimes. Lorsque Jaurès eut pris parti dans l'Affaire, l'hostilité des ouvriers cessa d'être avouée, mais n'en subsista pas moins et si, aujourd'hui encore, il existe à Paris un ferment d'antisémitisme, ce n'est pas dans les beaux quartiers, mais dans ce qu'on appelait autrefois les faubourgs et aussi parmi les petits boutiquiers de la capitale. On imagine bien que dans la boutique du passage Choiseul (lequel était déjà sur son déclin) où Céline Destouches (1), la mère de notre futur écrivain, vendait ses dentelles, l'enfant a dû grandir dans la familiarité de cette hargne antijuive flétrissant les suppôts de l'anti-France qui menaçaient le pain du foyer. Et ce n'est pas une prise de conscience littéraire qui a réveille et fait flamber tout à coup un antisémitisme demeuré latent dans son cœur et dans son esprit, mais une injustice outrageante subie dans l'exercice de sa profession de médecin et perpétrée au profit d'un confrère juif. D'autres que lui auraient encaissé l'affront en rongeant leur frein, mais je l'ai dit, on ne l'attaquait pas qu'il ne se défendit à fond, avec toutes ses forces. On jugera excessifs les développements donnés à cette affaire personnelle. Mais une injustice est-elle jamais uniquement affaire personnelle? En tout cas une chose est sûre, c'est que Céline, s'il n'avait pas été provoqué, visé au cœur, ne serait jamais parti en guerre contre les juifs. Ce n'est donc pas, selon le mot de Jean-Pierre Richard, «un délire de causalité» qui l'a jeté hors de ses gonds. Ici, c'est l'injustice qui a engendré l'injustice. Et si la riposte a été hors de proportion avec l'injustice initiale, c'est que Céline, en proie à la colère et à son génie verbal, avait précisément perdu cette faculté d' «objectiver» qu'il possédait pleine lorsqu'il s'agissait de Bardamu et de ses autres créations.
Marcel AYME (1963).
(1) En réalité, Marguerite Destouches-Céline était le prénom de la grand-mère de l'écrivain.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 09 juillet 2009
Entretien avec A. Douguine sur la Russie et l'Union Européenne
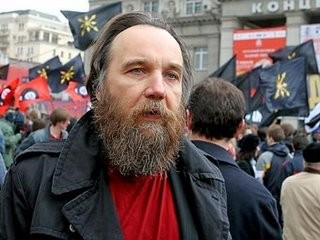
Entretien avec Alexandre Douguine
Sur la Russie et l’Union Européenne
Propos recueillis par Bernhard Tomaschitz pour l’hebdomadaire “zur Zeit” (Vienne)
Q.: Monsieur Douguine, comment jugez-vous le rôle de l’Union Européenne dans le monde?
AD: Je pense que l’Europe est prédestinée à jouer un rôle géopolitique important dans le monde et l’UE pourrait constituer un élément positif dans ce projet car l’unification européenne peut se percevoir comme la volonté des peuples européens de se porter au-delà des limites des Etats nationaux. Et lorsqu’on analyse la situation géopolitique, on constate que, dans un monde en plein changement, le concept de souveraineté reçoit un contenu nouveau. Même de grands Etats comme la France ou l’Allemagne ne sont plus en mesure de maintenir leur souveraineté pleine et entière et risquent, à court ou moyen terme, de devenir des satellites américains. Mais une Europe unie, elle, serait capable de devenir, si elle le voulait, un puissant facteur géopolitique. Mais, justement, cette UE n’a pas la volonté de défendre ses propres intérêts géopolitiques; au lieu de cela, elle ne poursuit que des intérêts économiques immédiats.
Q.: Comment faudrait-il, d’après vous, façonner les relations entre l’UE et la Russie?
AD: Il faut d’abord savoir qu’Européens et Russes sont des alliés naturels parce que la Russie est un Etat continental et que l’Europe, elle aussi, a une identité essentiellement continentale. C’est pourquoi Européens et Russes sont des partenaires idéaux dans un monde multipolaire, parce que la Russie dispose de ressources énormes et que l’Europe, pour sa part, dispose de hautes technologies, d’un bon système économique et est la deuxième économie du monde. Voilà pourquoi je crois que si la Russie et l’UE s’unissent sur base de leurs intérêts communs, elles pourront toutes deux atteindre leurs objectifs. Ce qui affaiblirait les Etats-Unis.
Q.: C’est pourquoi les Etats-Unis tentent de diviser l’Europe, entre une “Vieille Europe” et une “Nouvelle Europe”?
AD: C’est tout à fait exact. Les Etats-Unis tentent de créer en Europe orientale un “cordon sanitaire”. Ils veulent que se constitue une zone de manoeuvre géopolitique qui séparerait la Russie de l’Europe, tout en essayant de contrôler entièrement cet espace géographique-là. La plupart des pays est-européens ne servent plus aujourd’hui des intérêts européens mais, au contraire, ceux des Etats-Unis. Ce que font des pays comme les Pays Baltes, l’Ukraine, la Pologne voire la République Tchèque, c’est empêcher une possible alliance euro-russe. Ces pays sont certes membres de l’UE mais ne sont pas “européens” au sens géopolitique et stratégique du terme: il leur manque une conscience européenne, ils en sont totalement dépourvus, et essaient, de ce fait, de détruire l’Europe qui est en train de se faire. Voilà pourquoi la Russie et l’Europe doivent coopérer en ne songeant qu’à leurs intérêts communs, indépendamment des points de vue différents qu’elles pourraient avoir en d’autres sujets ou matières.
Q.: Comment juge-t-on en Russie les projets d’adhésion de la Turquie à l’UE?
AD: Ce projet est diabolique dans la mesure où il nuit tant à l’Europe qu’à la Turquie. J’entretiens depuis quelque temps de très bonnes relations avec de nombreuses personnalités de haut rang en Turquie et toutes pensent qu’une adhésion de leur pays à l’UE détruirait l’identité turque. Les Américains sont en fait les promoteurs de l’idée d’une adhésion turque à l’UE dans le but d’affaiblir l’Europe et de détruire la Turquie. Nous, Russes, avons actuellement de bons rapports avec la Turquie et nous coopérons étroitement avec elle, quand il s’agit de servir nos intérêts communs, mais nous ne pensons rien de bon d’une éventuelle adhésion de la Turquie à l’UE.
(entretien paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°7/2009; entreten réalisé par Bernhard Tomaschitz; trad. franç.: Robert Steuckers)
00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, europe, affaires européennes, eurasisme, eurasie, géopolitique, stratégie, turquie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Down with the therapeutic left and the managerial right! (Part I)
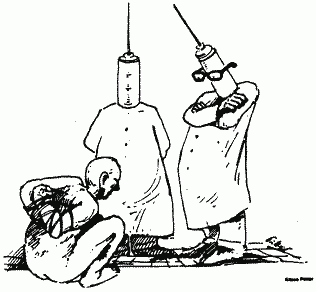
Down with the therapeutic left and the managerial right!
(Part One)
By Mark Wegierski
Ex: http://www.enterstageright.com/
The Next City was in the mid- to late-1990s, a prominent Toronto-based Canadian magazine (which is now no longer being published), although the website archive may still be extant. In his editorial commentary in the Spring 1997 issue, "Down with left and right", Lawrence (Larry) Solomon, the editor-in-chief of the magazine, suggested that those terms had definitively outworn their usefulness. Among the responses published in The Next City (Fall 1997), Michael Taube, then publisher of a small conservative zine From The Right (which in the end lasted only three issues) had argued that those terms continued to mean something significant. Nick Ternette, editor of The Left Fax (another small zine) had claimed that "the left as defined by socialists, Marxists, and greens does not believe in more government intervention, but less -- it believes as some of the new right does that people should do things for themselves instead of relying on government, and it sees an alternative to free markets...and...government interventionism, namely communalization." [emphasis in the original].
Mr. Solomon's response (Fall 1997) can be summarized as a reiteration of the call made in the initial piece, for paying less attention to outward ideology. The implicit hope expressed was that there would be more of the practical working-out of difficult modern-day problems and dilemmas by persons of good will regardless of ideology. Although this is certainly a fine sentiment, one finds that in practice there will often be some kind of partisanship.
Nick Ternette's statement is indeed curious, in that it can be read in a very traditionalist way. Is this in fact “socialism” -- or some kind of “anarcho-communitarianism”? Could this be seen as a call for the abolition of the managerial-therapeutic state, on the understanding that persons should depend on their own resources (or rather perhaps those of their immediate locality)? Is this an advocacy of the devolution of power to smaller municipalities and rural areas, as against the big cities? Should neither provinces nor the federal government in Canada set any general standards for health, education, welfare, human rights laws, etc? Should only local taxes be collected, and should any resources collected stay within the locality? Should one only be bound by the rules, laws, and customs of one's locality?
Nick Ternette was probably thinking mostly of clusters of left-wing activists in large and multicultural urban centers when he made his argument. But it could be argued that most of the communities of the country are in fact not the various components of the urban-based “rainbow coalition” continually trumpeted in the media, but rather smaller municipalities and rural areas typically despised and marginalized by left-liberalism today. One could conjecture that in a situation where local authority became paramount, left-liberal influence in Canada would be confined to a few large cities (or perhaps just a few trendy and/or grungy neighbourhoods in the largest cities) – rather than being projected upon the country as a whole (through mass-media, mass-education, and consumerism) as it is today.
The possible ultra-traditionalist take on Mr. Ternette's writing may strongly suggest the obsolescence of the Left-Right dichotomy. According to many theorists, the prevalent current-day political reality is the "managerial-therapeutic regime". That term is carefully chosen, for it could be argued that there is a "managerial Right" and a "therapeutic Left" which -- although in apparent conflict -- in fact represent little more than a debate as to the most effective application of consumerist desires and/or “market discipline” and/or mandatory sensitivity-training to keep the “subject-citizens” in line. The "managerial Right" represents the consumerist, business, economic side of the system, whereas the "therapeutic Left" represents redistribution of resources along politically-correct lines, and ongoing "sensitization" for recalcitrants.
The Left is also identified today with the pop-culture, which, in a somewhat different way from the therapeutic, seeks to reduce to non-existence traditional social norms of nation, family, and religion. While ferociously struggling for its vision of social justice and equality, much of the Left before the 1960s felt that many such notions were simply a natural, pre-political part of social existence, which it had no desire to challenge. The profit motive of the corporations, and the rebelliousness of the cultural Left and of late modern culture in general, feed off of each other, as Daniel Bell has argued in The Cultural Contradictions of Capitalism. North American pop-culture (which most definitely includes very reckless and irresponsible academic and art trends), and the consumer-culture, are tightly intertwined. What is fundamentally missing is the sense of an integrated self and society, where a more meaningful kind of identity can be held by persons, and in which real public and political discourse can take place.
It could be argued that the real division of late modernity is between supporters and critics of the managerial-therapeutic regime. The latter include genuine traditionalists, as well as various eclectic center and left persons. It may be noted, for example, that Christopher Lasch, one of the most profound critics of late modernity, continued to identify himself as a social democrat to the very end of his life.
This kind of coalition is prefigured in the words of the nineteenth-century aesthetic and cultural critic John Ruskin, who, in an age of a pre-totalitarian and pre-politically-correct Left, could say with some confidence, "I am a Tory of the sternest sort, a socialist, a communist."
To be continued. ![]()
Mark Wegierski is a Canadian writer and historical researcher.
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, gauche, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Aphrodite und das Uridol

SYNERGON/EUROPA - Brüssel - Juni 2000
Gerhoch REISEGGER:
Aphrodite und das Uridol
Mit Aphrodite der Göttin der Liebe wird unsere Behauptung einer urältesten europäischen Herkunft der griechischen Gläubigkeit und Kultur auf die schwerste Probe gestellt. Sogar die griechische Historiographie besteht auf einen orientalischen Ursprung dieser als ³ungriechisch² empfundenen Göttin, deren Namen zudem ³zweifellos ungriechisch² heißt. Herodot, der allerdings auch Herakles aus Ägypten herleiten möchte, nennt als Mutterheiligtum Aphrodites das der Himmelskönigin semitischer Völker und auch des Alten Testaments in Askalon (1, 105). Walter F. Otto, der wie allgemein dieser Genealogie folgt, meint aber doch, daß die asiatische Aphrodite einer alteinheimischen ³begegnet² wäre, die in Athen als ³älteste der Moiren² in den Gärten verehrt wurde.
Er folgert daher:
³Doch wir können die Frage nach dem historischen Ursprüngen ruhig offen lassen, ohne zu befürchten, daß wir etwas Wesentliches für das Verständnis der griechischen Göttin verlieren. Denn was auch der Orient, was Griechenland in vorgeschichtlicher Zeit zu ihrem Bild beige-tragen haben mögen, sein Grundcharakter ist durchaus griechisch.²
Hans Walter meint aber in seinem Werk, das die griechischen Götter im Bildwerk aus dem Gesamtwinkel griechischer Bewußtseinsstufen her betrachtet, geradezu:
³Aphrodite kam nicht von Kypros oder dem Orient, um in Griechenland heimisch zu werden. Sie war eine alteingesessene griechische Göttin schon im zweiten Jahrtausend ... Ihr Ursprung liegt in der unendlichen Fruchtbarkeit des Lebens, nicht in einer fremden Religion. Die Frage nach der Herkunft der Aphrodite ist von geringerer Bedeutung, wenn nach der griechischen Aphrodite gefragt wird.²
Klassischer Archäologe wie Religionshistoriker sind sich demnach merkwürdig einig, daß einmal ³die Himmelskönigin, wie sie in den babylonischen Liedern verherrlicht wird, ... nicht bloß den Homerischen, sondern auch den Orphischen Hymnen durchaus fremd² ist, und ein andermal: ³wie der Mensch an die Göttin gebunden ist, so ist die Göttin an den Menschen - im antropologischen Sinn: an dessen Werdegang im Seinsbereich. Und dieser Werdegang des Menschen bestimmt den Wandel der Gestalt und der Macht der Aphrodite.²
Nichts könnte das Dilemma einer eingeschränkten historischen Sicht, in der die Vorgeschichte nur als Schattenwelt aufdämmert, besser beleuchten. Teils ist man gezwungen Aphrodite als fremde Göttin mit fremden Namen hinzunehmen, teils begegnet dieses völlig Fremde einer ³alt-eingesessenen² griechischen Göttin, die die Frage nach ihrer Herkunft ³von geringerer Bedeutung² macht. Und dennoch entscheidet in diesem Dilemma ein richtiges Gefühl, nämlich die engste Blutsverwandtschaft zwischen Göttin der Liebe und deren Verehrern. In diesem Bereich kann in der Tat das Fremde keine Bedeutung erlangen.
Scheut man sich nicht, die Schranke des zweiten Jahrtausends rückwärts zu passieren, so wird die Herkunft dieser griechischen Göttin der Liebe nicht etwa nebelhafter und daher unbedeu-tender, sondern alle ihre mythischen Züge, ihre Vielgestaltigkeit im griechischen Glauben ziehen sie zur Quelle zusammen, und man ist nicht mehr genötigt wie Hans Walter nur die allgemeine Voraussetzung zu machen: ³Denn eine allmächtige Göttin der weiblichen Frucht-barkeit und Zeugung kann unter den griechischen Göttern der Vorzeit nicht gefehlt haben - es gab das Leben und den Trieb.² Wie dieser feinsinnige Deuter des Gestaltwandels griechischer Götterbilder nachweist, daß vor allem dasjenige der Aphrodite fähig war, bis ans Ende der griechischen Bildschöpfung stets noch neuer Bewußtseinsstufen der Liebe und Leidenschaft - bis hin zum bloßen ³Reiz des Anblicks² - Gefäß zu bleiben, so reicht auch ihre Bildgestalt zu-rück bis in die ältesten Phasen der paläolithischen Bildenthüllung.
Diese Jahrzehntausende lange Dauer eines Götterbildes der Liebe, die von vornherein nur mit der weiblichen Gestalt, mit der enthüllten Weiblichkeit Bild werden konnte, wird nun von den Stufen des Bewußtseins gegliedert; der mythische Grund wandelt sich nicht, so wenig wie die Macht der Liebe sich wandelt. Nicht nur bindet Aphrodite die ganze Natur und alle Götter, außer Artemis und Athena, sondern mit diesen beiden Polen des Seins den Menschen. Sie ist Göttin des Himmels, des Meeres und der Erde zugleich; ihr Wunder offenbart sich überall und zum Enthüllen ihres Wesens und ihrer Macht bedarf es keines Ortes, keiner Lehre und keines Kultes. Ja, sie kann ihr Wesen in seiner allmächtigen Gegenwart bei jeder Frau von Fleisch und Blut reproduzieren wie etwa in Helena, die im nachklassischen Bildwerk auch anonym nicht anders als Aphrodite selbst erscheint.
Es kann daher nicht befremden, daß bei der allgemeinen Tiergotthaftigkeit der Höhlenkunst die Liebesgöttin nur in menschlicher Gestalt erscheinen kann. Man kann sie nicht wie andere griechische Götter in ihrer Wirksamkeit mit einem besonderen Tier vergleichen, denn alle Tiere sind ihrer Macht in gleicher Weise Darstellung unterworfen. Im griechischen Bildwerk sind ihrer Macht in gleicher Weise etwa der Hase in ihrem Schoß, wie die Gans zu ihren Füßen unterworfen; der Schwan wie gar die Muschel sind ihr nur Gefährt und Gefäß. Abweichend von den anderen Göttern wird sie daher in unserer Darstellung nur mit dem eigenen Urbild, genauer Uridol, assoziiert.
Denn das ist das Kennzeichen der Liebe selbst, daß sie nicht denkbar ist ohne das Bild, das in und aus ihr selbst erzeugt wird. In diesem Sinn durchbricht das weibliche Idol die Hierarchie des Jägertums, die sich im Tierbild manifestieren kann und jene Erklärung, daß hinter dem Tierbild letztlich noch das des Menschen steht, bekommt ihre tiefste Begründung. Zuerst zu diesem Idol, über und vor allem andern, vorhanden, und mehr noch: es ist unbedingt nicht mit einem Kult oder Kultort verbunden. Man fand es oft verstreut, weitab von den alten Heilig-tümern.
Kehren wir zu unserm Ausgangsdenkmal von Angles-sur-Anglin zurück, so sehen wir unter den mehrfach vorgestellten nackten Frauen, daß sich eine mit der Tierhierarchie verbindet und somit den Kultort als universalen Lebensraum vervollständigt. Die anderen sind aber nicht bezogen und weisen daher auf die Eigenständigkeit des Frauenbildes im Bereich der Höhle hin, ja übersteigen sowohl nach der Tiefe als nach der Höhe diesen Höhlenraum; weder ihre Füße noch ihre Häupter werden von diesem umschlossen. Da sie in den geheiligten Rahmen kosmisch-tellurischer Zeugungsmacht und -lust hineinversenkt sind, bedarf es keiner hindeutende Attribute oder Charakteristiken. (Abb. 23)
Attribute können hinzutreten wie in den bekannten Frauenreliefs von Laussel, von denen wir die eine mit der Hornschale in der erhobenen Rechten als Beispiel hervorheben um damit zu kennzeichnen, was allen andern hier gemeinsam ist: das so stark an griechische Tempelbilder erinnernde Hinhalten eines deutenden Signums. (Abb. 7) Mann hat nur an die Assoziation der Frau von Angles-sur-Anglin mit Bison und Stier zu denken um hier die gleiche Beziehung zum Attribut des Horns zu erkennen, gleich ob dieses sich zur Trinkschale der Fülle des Glücks sublimiert oder nicht. Die üppige Lebenslust, die sich dort im feisten Bison äußert, ging in Laussel leibhaftig auf die Frauengestalt selbst über. Darum unterscheidet sie sich von den schlankeren, normativen Frauen von Angles-sur-Anglin.
das gleiche Verfahren tritt dann bei den freiplastischen Frauenidolen auf: man ist jetzt genötigt, durch die Charakterisierung und Ausgestaltung allein Assoziatives einzubeziehen. Drum schwanken diese Bildungen auch so erheblich von zierlichen zarten Figuren zu üppigen, wie die allbekannte Venus von Willendorf. Verismus hat wie allgemein in der Höhlenkunst allermindest mit Idolen zu tun. Sie sind bildliche Versinnungen, ja Versonnenheit in einmaliger Ungebundenheit der Imagination, einer Imagination, in der das Wesen der Aphrodite genannten, unbezwingbaren Macht in urtümlicher Gelöstheit schaltet.
Die Figuren und Gebilde, deren die aphrodisische Versinnung fähig ist, schweben in einem imaginären Raum und berühren in diesem ungebundenen Flug unfaßbar Ätherisches zugleich mit unsagbar Sinnlichem, bald vogelhaft zum Aufstieg gestreckt, bald fruchthaft zur Schwere geschwollen; am gleichen Gebilde lösen sich weiblich Wonnevolles und männlich Phallisches von einander ab und fließen willkürlich zusammen, und nie - auch nicht in der surrealistischen Kunst der Gegenwart - war die Ambivalenz ungehemmter.
Die Grundsituation der Erscheinung des Idols bleibt die gleiche wie im Höhlenbild der Frau von Angles-sur-Anglin, nämlich die Epiphanie, das unvermittelte, wie aus dem Nirgends her Auftauchende. Dazu bedarf es der Gehorgane nicht und auch nicht des Antlitzes, denn das Wesen des Liebesgottes äußert sich nicht kausal oder geistig, sondern in der Betörung, der Bezauberung des Körperlichen. In all diesen Zügen ist die griechische Liebesgöttin dem Urbild gleich geblieben. Sogar der Mythos muß sie als ³Fremde² in die Göttersippe wie im Leben empfinden. Sie ist am Lande nicht gebunden.
Wenn sie als Tochter des Zeus in die olympische Ordnung aufgenommen zu sein scheint, so zeigt schon die Titanenschaft ihrer Mutter Dione dieses Außensein ihres Wesens an. Doch ist es vor allem ihre Abstammung von Uranos, die ihr unter den Olympiern nicht nur die verschiedene, sondern sogar die ³ältere² Herkunft bezeugt. Möge sie nun in Bildern aus der Erde oder dem Meer auftauchen und von allen Göttern freudig begrüßt werden, auch diesen ist sie eine plötzlich Erscheinende, in keiner Weise aus ihrem Kreise Erzeugte. Auch bleibt ihr Wesen allen unfaßlich weil völlig unbotmäßig. In ihr bleiben alle jene Züge betörender, ungeistig-ordnungswidriger Körperlichkeit der Uridole geistig erhalten als das vitalste und oft erbaulichste Lebenselement in der griechischen Hierarchie.
Damit erledigt sich von selbst das sogenannte Problem der Fremdheit der Aphrodite im griechischen Glauben: die Liebesgöttin ist eine Un-Heimliche in jedem Glauben; nicht weniger im vorderasiatischen Raum als schon im paläolithischen Höhlenkult. Man braucht nur einmal an die unausgesetzte Verunglimpfung durch den Helden des Gilgamesch-Epos zu denken: Sie ist aber nicht weniger von griechischen Dichtern und Denkern geschmäht und verdammt worden; ganz besonders dann, wenn ihre Macht durch die Vernunft in Frage gestellt wird und sie sich dann als unfaßbar und zerstörend erweisen muß. Daß sie, etwa im Parisurteil oder im Untergang des unschuldigen Hippolytos, jeweils ganz entgegengesetzten olympischen Göttinnen der Sittsamkeit wie Hera, Athene und Artemis zuwiderläuft, hat mit einer Freiheit innerhalb dieser Götterordnung nur insofern zu tun, wie die Liebesmacht sich jeder Lebensordnung zu widersetzen vermag. Auch Apollons Forderungen fielen Unschuldige zum Opfer.
Freilich ist nicht zu verkennen, daß Aphrodite schon durch ihre Herkunft aus der Hierarchie des Uranos, besonders aber dadurch, daß sie von mehreren Anhängern begleitet erscheint - von Eros, Himeros, Pothos und Peitho - den Eindruck macht, als habe sie einst eine eigene, weibliche Gläubigkeit vertreten.. Und hier erhebt sich die besonders seit J. J. Bachofens Werk über das Naturrecht nie verstummende Vorstellung von einer Ära der rein weiblichen Herrschaft der Göttermacht. Auch diese Vorstellung wurzelt wie die sogenannte Fremdheit der Aphrodite nicht in einer kulturgeschichtlichen Ära, sondern, wie die Gegenwart nach zwei Weltkriegen zeigt, im ambivalente Fatum der beiden Geschlechter.
Sie kann hiermit und noch einem Hinweis in unserer Untersuchung übergangen werden: Wenn Bachofen vom ³Hetärismus² als ältester Form des Geschlechterverhältnisses ausgehet, das in der ³demetrischen² Ordnung zu einer ehelichen Gynaikokratie erhoben und endlich durch Einwirkung der ³sonnenhaften², männlichen Potenz zur höchsten, geistigen Hierarchie geführt wurde, so kann hierin nicht ein evolutionärer Fortschritt der menschlichen Kultur statuiert werden, denn alle diese vermeintlichen Stufen der Entwicklung liegen bereits völlig ausgebildet im ältesten Jägertum vor Augen. Auch ist es falsch, etwa im Kultakt des Frauenfestes vom Hetärismus zu sprechen als einer Herrschaftsform der Frauen, weil hier sowohl das Vorbild der Tiersbrunst, als die kosmische Rolle des Mondes einbegriffen ist.
Es soll weiterhin von vornherein festgestellt werden, daß in den Höhlenkulten ein maternales Übergewicht herrscht entgegen der männlichen Himmelsordnung in der arktischen Urkultur. Und der Idolkult schließt sich gewiß der ersteren Lösung näher an, obwohl, wie gesagt, das Auffinden der Idole im Freien auch die Ungebundenheit sogar vielleicht von einem Kulte überhaupt nahelegt. Die Liebe selbst sucht nur zu gerne die Freiheit und Vereinzelung der Natur als ihr heimisches Reich auf. Hier ist auch Aphrodites Domäne. In dieser tritt der Pantheismus Aphrodites zumal als Grundlage der ganzen Urreligion in sein Recht. Sie vereint die drei Bereiche der Urkonzeption der Welt; die die himmlische Sphäre mit der irdischen und der dunklen der Unterwelt.
Beginnt man bei ihrer himmlischen Herrschaftssphäre, so besagt schon ihr Name, ihre Tochterschaft aus dem Samen des Uranos im Meer, diese polare Verwandtschaft zu Zeus in seiner Dreigestalt mit Poseidon und Hades aus: es ist keine Inkonsequenz, daß Aphrodite Urania in der Olympischen Mythik als Tochter des Zeus gilt. Wir legten schon dar, daß, wenngleich nach dem Mythos erst als Enkel dieses Uranos auf Kreta geboren, Zeus dennoch Herr der Himmelslenkung war. Daß anscheinend Aphrodite ihm vorausging, kam nur aus dem Bewußtsein herrühren, daß die Liebe vor allem existiert; daß auch ihr Bild als ältestes Idol entstand, mag kulturhistorisch diese selbstverständliche Anschauung nur bestätigen.
Gerhoch REISEGGER.
(1) Hans Walter: Griechische Götter, München 1971, pg. 169
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, mythologie, mythologie grecque, grèce antique, antiquité grecque, panthéon, panthéon hellénique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 08 juillet 2009
Renaissance ottomane
Renaissance ottomane
Par Günther DESCHNER
Les ambitions d’Ankara d’adhérer à l’UE semblent déçues
La Turquie opte pour une politique étrangère “multidimensionnelle”
Le premier Ministre turc Recep Tayyip Erdogan a décidé de remodeler complètement son cabinet. C’était parfaitement prévisible après les pertes subies lors des élections régionales d’avril 2009. Mais il y a eu une surprise de taille: la nomination d’Ahmet Davutoglu au poste de ministre des affaires étrangères. En procédant à cette nomination, Erdogan a lancé un signal dont alliés, voisins et partenaires régionaux prendront dûment acte. Le professeur Davutoglu, qui n’a jamais auparavant exercé de mandat gouvernemental ni jamais fait partie du Parlement, était un conseiller du Premier Ministre en politique étrangère. Seuls les initiés pourront émettre des spéculations pour savoir s’il est bien l’homme qui a suggéré à Erdogan et à son parti, l’AKP islamo-conservateur, qui gouverne depuis 2002, les lignes directrices de la nouvelle politique étrangère turque.
Dans les décennies qui ont précédé Erdogan, la politique étrangère de la Turquie, membre de l’OTAN, s’était sagement alignée sur celle de Washington au Proche et au Moyen Orient. Dès le départ, l’AKP s’était efforcé d’améliorer les relations de la Turquie avec les pays arabes et musulmans de la région. La politique proche-orientale d’Ankara est ainsi devenue plus active, plus indépendante et surtout plus consciente de la place de la Turquie dans la région et son histoire. Signe patent de cette évolution, où la Turquie risque bel et bien, un jour, de se détacher complètement de l’Occident: le refus du parlement turc en 2003 de mettre son territoire à la disposition des troupes terrestres américaines à la veille de leur entrée en Irak.
Avec Davutoglu, que l’on considère comme l’architecte de cette “politique étrangère multidimensionnelle” d’Erdogan, la Turquie possède désormais un ministre des affaires étrangères qui a réellement conçu, au cours de ces dernières années, une nouvelle ligne et l’a imposée, en tant que conseiller d’Erdogan. Après la neutralité de type “classique”, qui fut l’option turque pendant les premières décennies de la république kémaliste et moderniste, les Turcs ont eu une politique étrangère après 1945, qui fut entièrement tournée vers l’Ouest; aujourd’hui, nous assistons à l’émergence de la “politique étrangère multidimensionnelle” de Davutoglu. Celui-ci, âgé de 50 ans et géopolitologue averti, est l’auteur d’un ouvrage de géopolitique, intitulé “Profondeur stratégique”; d’après ce livre, la Turquie doit regagner la grande influence qu’elle a exercée au cours de son histoire dans sa propre région. En ultime instance, Davutoglu veut renouer avec la politique de l’Empire ottoman et faire de la Turquie actuelle, dans toutes les régions jadis soumises à l’emprise de la “Sublime Porte”, “un facteur ottoman avec d’autres moyens”. Les spécialistes de la Turquie estiment que la montée de Davutoglu au pouvoir est une conséquence directe de la détérioration des relations entre la Turquie et l’UE.
La Turquie va-t-elle se détacher de l’Occident?
Tant que l’actuel président turc Abdullah Gül était ministre des affaires étrangères, la Turquie avait misé entièrement sur un rapprochement avec l’UE. Mais au fur et à mesure que les hommes politiques les plus en vue de l’Europe ont dit, de manière tantôt implicite tantôt explicite, que la Turquie n’était pas la bienvenue dans l’UE, Davutoglu est devenu de plus en plus populaire et sa notion d’une politique étrangère indépendante au Proche Orient, dans le Caucase, dans la région de la Mer Caspienne et face à la Russie a séduit de nombreux esprits. Erdogan avait déjà envoyé Davutoglu comme émissaire lors de missions fort délicates en Syrie, en Iran et en Irak.
On se rappellera que Davutoglu avait servi d’intermédiaire et de modérateur lors de négociations entre Syriens et Israéliens. Cette mission fut couronnée de succès et saluée par l’Occident tout entier, du moins avec quelques réserves, mais celles-ci étaient minimes. Mais depuis le “clash” entre Erdogan et le Président israélien Shimon Peres à Davos, de plus en plus d’observateurs posent la question: la Turquie ne va-t-elle pas très bientôt se détacher de l’Occident?
Le monde s’était habitué à percevoir la Turquie, l’un des cinquante Etats majoritairement musulmans de la planète, comme un cas particulier: elle était le seul pays musulman membre de l’OTAN, elle menait des négociations avec l’UE en vue d’une adhésion, elle était une démocratie et entretenait des relations normales avec Israël. De même, on a toujours considéré que la Turquie constituait un “pont” entre l’Orient et l’Occident. Personne n’a modifié fondamentalement cette perception lorsqu’Erdogan et son AKP islamisant est arrivé au pouvoir en 2002, pour ne plus le quitter jusqu’à ce jour. Erdogan voyait son pays comme une puissance régionale, appelée à jouer un rôle plus prépondérant sur l’échiquier international. Il a forgé des liens plus étroits avec les pays arabes voisins, renforcé les rapports existants avec tous les Etats de la région, intensifié les relations avec l’Iran. Simultanément, Erdogan a réussi à maintenir de bonnes relations avec Israël. Cette politique d’équidistance, tout en recherchant un rôle plus prépondérant dans la région, a connu un succès rapide et remarquable.
Il me paraît intéressant de prendre acte des observations formulées par les experts ès-questions turques de la “Jamestown Foundation” de Washington. Ceux-ci constatent effectivement que des modifications profondes ont eu lieu en Turquie sur le plan des réflexes politiques. Ces modifications conduisent à un intérêt croissant pour les affaires régionales et un désintérêt, également croissant, pour tout ce qui concerne l’Occident. Le journal “Zaman”, proche de l’AKP, se félicite de ce changement général en matière de politique étrangère et le considère comme le principal acquis du gouvernement Erdogan.
La Turquie sent les pulsations de deux mondes
Ce sont surtout des évolutions sociales en Turquie même qui ont provoqué cette mutation en politique étrangère. Elles sont observables depuis longtemps déjà: les tensions en politique intérieure sont le résultat du défi lancé aux élites urbaines pro-occidentales regroupées autour des forces armées par une nouvelle bourgeoisie, une classe moyenne religieuse, qui aspire au pouvoir et a ses racines géographiques en Anatolie. C’est cette nouvelle classe moyenne que représente au Parlement turc l’AKP d’Erdogan. Cette tension conduit la Turquie à vivre une véritable crise d’identité. On a pu voir les effets de cette crise lors de la rude controverse qui a accompagné l’élection de l’islamiste Gül à la fonction de Président de la République ou lors des querelles à propos du voile islamique.
Lors d’un colloque en Allemagne, Davutoglu a déclaré, l’an passé, que la Turquie sentait les pulsations de deux mondes, le monde occidental et le monde islamique. Mais, pour lui, ajoutait-il, la Turquie est bien davantage qu’un pont entre l’Occident et le monde arabe. Il voit son pays dans le rôle d’une puissance régionale. En tant qu’Etat à la fois musulman et séculier, qui unit les valeurs de l’Islam et celles de la démocratie, la Turquie, affirme Davutoglu, est prédestinée à jouer le rôle d’une nation intermédiaire au Proche et au Moyen Orient.
Günther DESCHNER.
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°21/2009; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, diplomatie, turquie, méditerranée, proche-orient, moyen orient, affaires européennes, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Waldgänger et le militant
Le Waldgänger et le militant
par Claude Bourrinet - http://www.europemaxima.com/
« Fabrice eut beaucoup de peine à se délivrer de la cohue ; cette scène rappela son imagination sur la terre. Je n’ai que ce que je mérite, se dit-il, je me suis frotté à la canaille. »
Stendhal, La Chartreuse de Parme.
Qui s’avisera de lire la dernière fable de La Fontaine, son mot dernier avant la mort, connaîtra peut-être l’ultime message d’un sage épicurien en matière d’engagement : l’amateur de jardin ne place pas plus haut l’urgence sacrée de la contemplation, et tout ce qui en peut brouiller l’onde transparente est davantage qu’une faute philosophique : c’est un crime vis-à-vis de l’âme. La vertu de cet ultime apologue est de présenter, dans leur radical altruisme, les deux figures du militant qu’une civilisation ayant pour paradigmes l’apôtre et le citoyen a léguée à l’Europe. On ne fait pas plus concis. L’une, animée du zèle le plus politique, érige la justice en exercice de vertu. L’autre, poussée par une charité admirable, soigne avec abnégation son prochain. Les deux récoltent incompréhension, ingratitude et vindicte. L’hôte des bois, seul, dans son ermitage, sauve quelque chose du grand naufrage humain.
Néanmoins, il n’est pas certain que l’épilogue de ce grand livre du monde que sont les Fables fût si péremptoire dans la condamnation d’un travers dont on sentait, en cette fin de grand siècle, les prémisses. Mainte saynète offre en effet matière, sinon à l’espoir, du moins à un certain plaisir de vivre, voire à un bonheur certain. Si La Fontaine verse quelque peu dans le jansénisme avec les affres de l’âge, il reste pour l’éternité un épicurien sensible aux sollicitations positivement ordonnée d’un Monde qui n’est pas si désagréable que cela, nonobstant sa cruauté.
En ce temps-là, peu avaient oublié Montaigne, le maître de tous, celui qui inspirait ou repoussait, parfois les deux à la fois, sans qui il ne fût ni Charon, ni Pascal, ni La Fontaine, ni beaucoup d’autres. Le châtelain périgourdin avait eu l’occasion de côtoyer La Boétie, qui promettait, ne fût-ce la mort, de donner à la France une plume et un grand cerveau, sinon un grand cœur. Montaigne conçut ses Essais comme un écrin pour l’ouvrage de son ami, lequel est tout un programme, puisqu’il s’intitule De la servitude volontaire. Les Temps étaient pourtant à la rébellion (mais l’une n’empêche pas l’autre), Parpaillots, Ligueurs s’empoignaient, avec l’aide fraternelle des ennemis de la France, pour s’entrégorger pour la plus grande gloire de leur Dieu. Cet âge de fer vit naître, peut-être, le militant moderne. On se mit à concevoir des programmes politiques destinés à changer le régime monarchique, la religion se transmuta en idéologie, et les Églises devinrent des partis. L’État n’était plus le médiateur naturel du Dieu transcendant et du peuple chrétien : il était devenu un instrument autonome, susceptible de transformations, malléable, améliorable, dont on pouvait s’emparer, et qui possédait sa propre Raison. Ainsi, avec le militant, naquit la politique.
On connaît la position de Montaigne là-dessus. Le maire de Bordeaux et le grand commis qui s’entremit entre Henri III et Henri de Navarre, si son loyalisme le plaça dans les régiments royaux, où il fit avec un certain plaisir guerrier le coup de feu, se garda de s’offrir pleinement à la flamme du combat, où il eût à se brûler l’âme, le cœur, ou, quelque fût son nom, ce qui lui assurait de toutes les façons, devant le monde et devant lui-même, la pérennité de son être. Il s’en faut bien de se prêter pour ne pas se perdre. Tel était l’honnête homme, qui, moulé par un livre consubstantiel à sa recherche, invitait à exercer par le monde des hommes et face à la nécessité une indifférence active, qui n’est pas sans prévenir la nonchalance dévote de François de Sales. C’est bien là, chez Montaigne, qui n’évoqua jamais Jésus dans ses écrits, une sorte de synthèse improbable entre le stoïcisme et l’épicurisme. Aussi bien invoqua-t-il volontiers les figures emblématiques de Socrate, d’Alcibiade, de César, d’Alexandre, pour illustrer cette virilité négligente et attentive, cette implication dans les combats de la terre, et cette plasticité de l’âme et du corps, qui saisit le sel de la vie au moment du plus grand danger, comme si ce fût une promenade parmi les prairies élyséennes.
Nous sommes loin du culte chevaleresque et du moine-soldat. L’on n’y perçoit nullement la droite rectitude des héritiers de Zoroastre, des lutteurs manichéens et des croisés juchés sur leurs étriers afin de pourfendre le Mal et vider la cité des hommes des ennemis de la cité de Dieu.
Il faudrait donc repenser le problème et du militantisme et de l’engagement, en ayant conscience des conditionnement culturels et historiques qui en dessinent l’image. Bien évidemment, tout questionnement surgit en son point historial où la réponse est toujours contenue dans la manière d’interroger le destin. Les implicites sont bien plus redoutables que les apparences conceptuelles et rhétoriques les plus sensibles. La pensée, lorsqu’elle se fait servante de l’action, est freinée dans ses élans et ses capacités à creuser jusqu’aux racines. Elle exige un retrait.
L’interrogation première devra porter sur cette inhibition quasi universelle à mettre à la question les plus évidentes légitimités, incertaines dans la mesure de leur évidence. À n’en pas douter, l’engagement pour une cause est une nourriture pour l’existence, même passagère, dont il est bien difficile de se passer comme viatique. Il ne s’agit parfois que de trouver la chapelle sur le marché des causes. Les situationnistes, bien après Nietzsche, rejetaient cette forme de confort qui, même lorsqu’il impliquait la mort et la souffrance, le sacrifice et l’opprobre, semblait octroyer au croyant l’assurance d’un salut, au regard de Dieu, des hommes, ou de soi-même, en tout cas un rôle, dont la véritable et profonde raison réside dans l’irraison de pulsions inavouées ou d’un narcissisme, d’un amour-propre, pour user de la terminologie du Grand Siècle, qui confère à tout discours assertif, et même performatif lorsqu’il s’agit d’agir, cette dose plus ou moins volumineuse de soupçon, de défiance, qui ne demande qu’à envahir l’esprit et le cœur, et justifier toutes les désertions, les abandons et le ressentiment.
Mais il est vrai que le nomadisme militant et la haine des anciens emballements sont des traits caractéristiques de la conscience contemporaine, comme si la maladie sectatrice dénoncée chez les réformés par Bossuet se trouvait soudain envahir le champ politique, une fois les Grands Récits idéologiques chus dans la poussière de l’Histoire.
Il est permis de se demander si un tel type de conscience se manifestait dans l’Antiquité non chrétienne. Il ne semble pas qu’il y eût, avant l’universalisation de la Weltanschauung galiléenne, ce dépassement, cet outre-passement qui caractérise le lutteur convaincu de sa bonne foi et désireux de convertir autrui, avec cette obsession clinique de la trahison, des autres et de soi-même. On pourrait certes excepter de la communauté philosophique grecque, très bigarrée, les disciples d’Antisthène, ces cyniques, qui privilégiaient la physis au Nomos, et convoquaient la parrhèsia, la franchise qui invite à tout dire, pour lancer des invectives à l’égard des pouvoirs en place, ce qui leur valut maints déboires sous l’Empire, sous lequel leur mouvement avait pris une tournure populaire. Julien n’hésitait pas à mêler dans le même mépris cette Cynicorum turba, munie du tribôn et de la besace, et les « Galiléens incultes », auxquels ils ressemblaient beaucoup. Les autres philosophes se contentaient d’une saine abstention, ou, de façon plus risquée, de jouer les conseillers des Princes.
Pour le reste, les Anciens se battaient pour défendre les dieux du foyer, de la cité, de la communauté, ils n’avaient en vue que les intérêts de cette dernière, et si la pensée plus ample d’un ordonnancement impérial leur vint à l’esprit, à la suite des Perses et des Égyptiens, ce fut comme la donnée d’un état de fait, comme le fruit d’un arbre immense à l’ombre duquel devaient s’ébattre, dans leurs particularismes, les peuples variés constituant l’humanité. Nulle part, à nul moment, le Grec et le Romain n’apparaissent comme des sectateurs d’une religion impérieuse. À l’intérieur de la Cité s’affrontaient des factions, les potentes, les humiliores, populo grasso et populo minuto de toujours. Mais il s’agissait de combat politique, d’organisation de l’État, un État organique, lié par mille liens au tissu sociétal, et qui s’incarnait particulièrement dans des hommes, qui étaient des orateurs et des soldats. On recrutait des clientèles, on se faisait des armées privées. Ces solidarités verticales dureraient autant que l’ancien monde, jusqu’à la première moitié du XVIIe siècle, où les puissants, dans une sorte de protection déclinée jusqu’au bas de l’échelle sociale, unissaient les membres de la société, pour parfois les mobiliser contre un État de plus en plus froid et autonome.
Il s’avère néanmoins qu’apparaissaient dans les temps antiques des revendications souvent rapportées par les marxistes dans leur désir d’asseoir leur usurpation sur les traces du passé. Par exemple, dans les pages consacrées à Tibérius et Caius Gracchus, Plutarque reproduit un discours censé avoir été prononcé par Tibérius : « Les bêtes, disait-il, qui paissent en Italie ont une tanière, et il y a pour chacune d’elle un gîte et un asile ; mais ceux qui combattent et meurent pour l’Italie n’ont que leur part d’air et de lumière, pas autre chose. Sans domicile, sans résidence fixe, ils errent partout avec leurs enfants et leurs femmes, etc. » Comment éviter l’émergence de l’espoir quand il faut trouver du pain ? Les fils de Cornélie étaient assez grands pour se vouer au parti populaire et en perdre la vie. Leur stoïcisme les élevait à la conception d’un cosmos garant du Nomos de la Cité, et le caractère subversif de leur combat n’était qu’une tentative de restitutio de l’Urbs, des Temps anciens où le Romain était paysan et libre. On sent dans cette lutte héroïque cet élan de justice qui sert de modèle pour l’éternité aux révoltés de tous temps. Cependant, les Gracques sont d’ici-bas, de la portion sublunaire de l’univers, commune aux choses périssables et imparfaites, et l’édifice qu’ils convoitent, qui participe de la bonne vie en quoi Aristote voit le télos de l’action politique, n’est pas une cathédrale pointée vers le ciel. Leur silhouette ne ressemble pas à celles des saints peints par Gréco, longilignes, tendus presque à rompre vers un point du Ciel ouvrant des vertiges angoissés. Les Gracques ont combattu pour remplir le devoir de leur gens, de leur lignée, celle qui leur enjoignait de défendre le peuple, d’en être le protecteur. Logiquement, César reprendra le flambeau, et assurera les fondements d’un État plus apte à unir les membres de l’Empire.
Depuis la Renaissance, il est d’usage d’invoquer l’exemple de la geste politique antique pour inspirer l’action. Mais la filiation est rompue, la parenté apparente de la politique contemporaine avec celle de l’antiquité est illusoire.
La frontière, on le sent bien, tient à peu de choses, mais séparent deux contrées entièrement différentes. Augustin savait parfaitement que Cité terrestre et cité de Dieu étaient intimement mêlées, et qu’il n’était pas si loisible de les identifier au sein d’une vie qui se nourrit de tout ce qu’elle trouve pour se justifier. Tant que la notion de Res publica subsista, et quand elle revint dans la conscience des hommes, les luttes politiques manifestèrent la propension des clans, des ordres, des classes, des partis, à se projeter dans l’avenir pour établir ce que d’aucuns considéraient comme l’ordre légitime des choses. Chacun au demeurant, même dans les siècles « obscurs » où, selon toutes les apparences, le christianisme appuyait son empreinte, ne remettait en cause l’ordre naturel qui s’appuyait sur l’inégalité, la hiérarchie, l’occupation justifiée de places prédestinées qu’il ne s’agissait seulement que de consolider ou d’élargir. Les potentialités subversives du christianisme, un christianisme au fond vulgaire, comme il y eut un marxisme qu’on appela tel, n’apparaissaient pas, parce qu’on scindait nettement le bas et le haut de la Création, et que les fins de la Justice divines, parfois impénétrables, étaient reportées à plus tard, si possible après la mort, ou à la fin des Temps.
Le militant se trouvait donc chez les orants, les moines. Les évêques, avant le Concile de Trente, ressemblent plus à des Princes qu’à des Bergers soucieux de l’éducation de leur troupeau. L’engagement du croyant, hormis lors de ces brusques flambées que furent les Croisades, qui n’étaient pas si fréquentes, au fond, mis à part l’Espagne de la Reconquista (période où se développe la figure du militant, telle qu’elle se réalisa plus tard dans la vocation de l’hidalgo Ignace de Loyola), était de bien tenir son rôle dans l’économie divine. Cette idée subsiste chez Calderon, dans sa pièce El Gràn teatro del mundo, par exemple, où pauvre, riche, seigneur etc. ont leur rôle dévolu de toute éternité.
Le gouffre ouvert à partir de la révolution nominaliste, qui affirme que les universaux sont des signes, et non des substances, donne au discours, même déraciné, toute sa faculté d’expression et d’universalisation. Si la réalité est singulière, les universaux ne sont pas moins existants, quoique séparés, et relèvent de l’ordre logique, ce que le conceptualisme va étayer, en posant une morale autonome, indépendante de l’ordre naturel. La voie est donc ouverte pour l’élaboration d’une liberté civique spécifiquement humaine, constructiviste, dont les attendus et les conséquences ne dépendent plus d’une transcendance ou d’une immanence cosmique, ou même théologique.
La tension néanmoins prégnante dans l’anthropologie humaniste et baroque, qui sourd parfois de minorités marquées par la structuration mentale lentement instaurée par des siècles de christianisme, tension qui se manifeste spectaculairement dans l’éruption de mouvements millénaristes, comme les mouvements paysans allemands, comme celui des anabaptistes, ou ceux des niveleurs anglais, et même chez les jansénistes qui, bien que fondamentalement dans l’incapacité de proposer un programme politique, comme l’avaient fait les Réformés, ont durablement marqué de leur empreinte militante le paysage politique de la France des XVIIe et XVIIIe siècle, et bien plus tard, n’a pas été contrarié par l’adoption, au sein des grands commis de l’État, des principes machiavéliens de la Raison d’État, selon lesquels la fin justifie les moyens.
L’ironie voudra que ce soit l’être le plus hostile à l’ancien monde, Lénine, le fondateur du parti bolchevik, qui synthétise ces traditions pour unir l’enrégimentement jésuitique et le prophétisme apocalyptique. La puissance d’un programme comme celui contenu dans Que faire ? ne peut s’apprécier que si l’on y distingue la jonction électrique entre le formidable effondrement des valeurs provoqué par l’avènement de l’ère moderne et l’exacerbation d’un vieux fonds mystique, particulièrement présent en Russie orthodoxe, un peu moins dans l’Europe occidentale agnostique.
On découvrit il y a quelques décennies, au moment où mouraient ce que l’on nomma les « Grands Récits » que l’entrée en militantisme possédait de nombreux points communs avec la conversion, l’entrée en religion. Mais on ne put le dire que parce qu’on en était sorti, et que dorénavant on pouvait s’en moquer, comme du pape et des curés de village. Le militantisme de masse devint aussi étrangement suranné que les voix nasillardes de la T.S.F. et les chapeaux mous. Les sociologues et les ethnologues s’en donnèrent à cœur joie. On perdit même l’habitude de coller des affiches sur les murs. Et la production de « Grands Récits » fut remplacée par les stories selling, les compagnons de route par des publicistes girouettes, et les électeurs par des consommateurs d’offres politiques. Dans le même temps, les rivalités générées par la Guerre froide, qui avaient donné l’illusion qu’un choix était possible, devenaient des options de gouvernance.
La vérité se présente-t-elle sous une clarté solaire, nous continuons comme avec nos jeux d’ombres. Le désert a gagné tous les aspects de la vie et de la pensée, et Internet, ironiquement, n’a fait que l’universaliser. Les happy few qui communiaient jadis dans une cercle restreint, parisien, se relisant sans cesse et se prenant de la gueule, ne connaissaient pas autant ce sentiment de vide, cette inutile clameur, que nous, qui sommes dotés de tous les moyens d’expression et de diffusion. Les noms deviennent abstraits, et les paroles, comme les feuilles dans le vent, retombent où elles peuvent. Les idées restent idéelles, peut-être idéales, et ne sont guère suivies d’effets. Le pire, pour un homme qui se respecte, est l’illusion, vertu ô combien plébéienne !
Finalement, la solitude est la vraie condition de l’homme moderne, et il faut une force surhumaine pour réussir à rester homme. Il est plus difficile de trouver un homme véritable maintenant, que du temps de Diogène. Toute communication étant devenue impossible, qu’il n’existe qu’un impératif pour celui qui veut sauver quelque chose du désastre : écrire un texte, le glisser dans une bouteille balancée à la mer immense de l’absurde, et disparaître.
Au demeurant, il faut une perspicacité hors du commun pour saisir du premier coup d’œil, qui vaut un instinct, la vérité d’un système, surtout quand on est plongé dans les conditions horribles qui étaient celles d’Alexandre Zinoviev, lorsqu’il avait dix-sept ans sous Staline. Du moment où la vue prend un peu de hauteur, qui n’est certes pas celle de Sirius, la question de savoir ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire se pose autrement que lorsque elle reçoit l’écume des événements, à la manière des journaux.
Dans le premier chapitre du Voyage au bout de la nuit, Céline nous plonge dans une conversation de café du commerce. Bardamu et Ganate, anticipant les anti-héros beckettiens, parlent de tout, et changent d’avis en un temps record. La critique célinienne va loin. Car ce qui est dénoncé, dans le Voyage…, ce n’est pas seulement la guerre, la colonisation, l’Amérique et la misère. Ce serait déjà beaucoup, mais dès les premières lignes, on saisit l’angle par lequel il faut aborder le monde contemporain, celui qui, faisant appel aux masses, est responsable de dizaines de millions de mort et de l’assassinat d’une civilisation comme on en a rarement vu dans l’Histoire. Ce n’est pas un hasard que Le Temps, le quotidien à succès de la belle époque, vienne à nourrir la conversation. Comme écrit Camus dans La Chute, un autre livre sans concession lui aussi, « Une phrase leur [les historiens futurs] suffira pour l’homme moderne : il forniquait et lisait des journaux. ». Une remarque de Ganate nous met au fait, comme pour nous offrir une clé : « … Grands changements ! qu’ils racontent. Comment ça ? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et c’est tout. Et ça n’est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés !... » En plus de Schopenhauer, il y a de L’Écclésiaste et du Pascal chez Céline. Autant dire que c’est un moraliste de notre Temps de détresse, comme Cioran. Avec seulement de plaisir que le style.
Venons-en justement, au style. Car il faut bien l’avouer, la dose d’optimisme pour faire d’un homme un militant est à peu de chose près la même que pour en faire un imbécile. L’aristocrate, comme le guerrier, sait bien lui, que le cœur de ce phénomène somme toute étrange qu’est l’existence est de savoir mourir élégamment. Tout le reste est du commerce et de la réclame.
Comment prendre néanmoins les situations les plus désagréables ou les plus insupportables ? Les cas extrêmes ne semblent pas offrir beaucoup le choix. Ce même Zinoviev, dont l’autobiographie est un bréviaire pour tout dissident, sauva sa vie plusieurs fois par des gestes dont le génie venait de leur folie même. Ainsi, au sortir de la Loubianka, escorté par deux hommes du N.K.V.D., leur faussa-t-il compagnie de la manière la plus improbable, les sbires ayant oublié quelque chose et l’ayant laissé provisoirement sur place, dans la rue, ne pensant pas qu’il eût l’audace de partir. Ce qu’il fit, sans le sou, sans rien, pour suivre un destin picaresque. Et tragique.
Alexandre Zinoviev, paradoxalement, ne ménageait pas sa peine lorsqu’il s’engageait dans une activité. Il fut bon travailleur, bon soldat, héroïque même. Comme Jünger fut un bon guerrier. Ce qui distingue le rebelle véritable est sa pensée de derrière. Pascal en était un. Le non que l’on porte au fond de soi est peut-être plus efficace que toute agit-prop. Ne fût-on qu’un seul à dire non, la machine est déjà grippée. L’absence d’assentiment, la passivité, la désertion morale sont bien plus dangereux pour le totalitarisme, dur ou mou, que l’attaque frontale, qui ne fait souvent qu’alimenter la propagande en retour et conforter la police. À la longue, ce travail de sape, la multiplication des refus intimes, parfois prudemment partagés avec des happy few, travaille le sol qui soutient l’édifice. Car tout totalitarisme ne vise pas que les corps : il ne peut subsister si ses membres n’adhèrent pleinement à ses rêves, qui ne sauraient être que désirables.
La logique du monde étant régie, depuis des millénaires, par une destruction de plus en plus accélérée de la Tradition, le chaos est le point terminus de son évolution, ce qui peut offrir des perspectives sportives permettant aux âmes guerrières d’exceller.
Le monde contemporain, « post-moderne », est un univers hyper-sophistiqué, emmaillé d’un réseau électronique de surveillance, enfliqué et empuanti de délateurs, géométrisé, arithmétisé, balisé, lobotomisé, enfarci de lipides télévisés engluant les neurones encalminés, robotisé par un dressage pavlovien, qui produit sa bave en guise d’huile de vidange, une société où les flics ont désormais des silhouettes de scaphandres intersidéraux, spectres humanoïdes au regard vide, comme ces caméras qui nous épient cent fois en une heure ; nos gènes sont pesés, enregistrés, archivés, nos désirs sont gérés et marchandisés, nos rêves domestiqués, la trace des colliers irrite de sa sanglante et empestée blessure nos cous, nos poignées, nos sursauts, nos paroles sont empaquetées, lessivées, ensucrées, aseptisées, notre fatigue auscultée, hospitalisée, pharmacataloguée, notre mémoire est enrégimentée, encasernée, emmaillotée dans un drapeau qu’on nous a mis sur le dos, comme ça, quand on avait les yeux braqués sur le présent. Parce que l’homme post-moderne, il ne songe qu’à la baffre, aux délectables digestions d’après-orgies, à coups de bourrages tripaux et crâneux, avec de gros entonnoirs bien vissés qui lui traversent la carcasse jusqu’au croupion pour qu’il déverse son caca bien conforme, soupesé par les pinces régulées de scolopendres aux sourires frigides.
Mais par-delà les barreaux de la cage peinturlurée de couleurs vulgaires, se hument les sous-bois fauves et frais de la forêt splendide, aux sentiers rayés des flèches du soleil, aux buissons sombres des mystères ancestraux, aux butes arides tapissées de feuilles bruissantes, aux odeurs fortes et enivrantes de l’humus, qui est le parfum préféré des loups furtifs et libres. Ils n’ont de rêves que l’étreinte serrée des écorces et des taillis teignant leur pelage âcre des couleurs du combat. La horde suit son chef au fond de la nuit, et la lune, comme l’écho de leurs songes, fait étinceler les crocs acérés. Tapie à l’orée de sa cité sauvage, elle épie de ses yeux étincelants comme des étoiles les spectacles méprisables de la ville grasse et torve, écroulée sous sa masse abrutie.
Cependant ce recours physique aux forêt est bien rare, et ses plaisirs peu à même de se renouveler à mesure que le monde devient plus civilisé, plus féminisé, plus consensuel.
Au demeurant, ceux qui invoquent le peuple devraient réfléchir. Qu’aurait-on à lui proposer, sinon de juguler ses désirs et sa vanité ? Sa place est nécessairement inférieure aux prêtres et aux guerriers. Si révolution il doit y avoir, elle sera autant pour le peuple, dans la mesure où l’humilité est pour lui, avec la protection des puissants, un gage de bonheur, et contre le peuple, parce que le monde moderne est tout autant son produit, celui de l’intérêt, du matérialisme et du dénigrement du sacré.
Le recours aux forêts mentales offre plus de richesse, à mon sens. L’univers n’a pas si sombré dans l’Âge de Kali qu’il ne subsistât, à qui sait les saisir, d’antiques fragments de la Cité perdue. Ils sont à la mesure de chacun, et répondent à qui peut les percevoir. Des expériences dionysiaques et apolloniennes intenses sont à portée, à condition d’en extraire, comme un élixir, la quintessence.
Ainsi partira-t-on de ce postulat, que l’espoir est affaire de Thersite, que l’aristocrate, ou tout simplement celui qui ressent la nostalgie d’un ancien sens du monde, sait que le Temps n’existe pas, qu’il est vain d’ « améliorer les choses », de les « faire bouger », comme l’on dit, ce qui d’ailleurs a toute chance de les faire empirer ; qu’une fois perdu, le monde clos, hiérarchisé, naturellement enté dans l’ordre cosmique, n’a guère de chance de revenir au jour, à moins que la roue ne retourne à l’origine, ce qui ne peut se produire qu’après un cataclysme intégral. Au fond, le meilleur service qu’on puisse faire au monde est d’accélérer sa décomposition, afin de hâter la vitesse de la roue.
La vie est un naufrage. Je veux parler de celle qui échappe à la lumière d’Apollon, et qui est fort commune. Il est bien connu que la vraie est ailleurs, et que je est un autre. Il est évident que la recherche du bonheur est une stupidité, à laisser à la plèbe. Nous avons nos urgences. Et comme il faut bien subsister, la nécessité de côtoyer les imbéciles et les fainéants s’impose à nous. La frénésie que manifestent la plupart des hommes, non seulement à trouver une place plus ou moins rémunératrice, mais aussi à s’élever au sommet du panier de crabe où l’on est bien contraint de s’agiter, subsidiairement de s’appuyer sur la tête ou les parties génitales de ses congénères, rend l’espèce humaine suprêmement comique. Cependant, l’on n’est pas démuni, pour peu qu’on veuille sauver quelque chose de cette ridicule pantalonnade. Trois attitudes sont susceptibles d’êtres adoptées :
— l’attitude baroque : l’on est spectateur du Gràn teatro del mundo, des autres et de soi-même. La distance se présente comme une réaction de salubrité ;
— l’attitude que j’appellerais martiale : l’on possède un dharma, un devoir à remplir, fixé par l’Ordre cosmique, qui nous dépasse, et qu’on ne peut que deviner par les retombées d’un destin qu’on ne peut connaître que fort tard, trop tard peut-être. Nous ne sommes que de braves soldats postés sur la ligne de front, perdus ou sacrifiés, je l’ignore, fidèles à leur devoir.
Ces deux visions ne sont pas incompatibles, comme le suggère Calderon.
— Reste la poésie, qui est une grâce, ou une malédiction. L’Artifex est aussi, et surtout, Vates. Il accède à une existence supérieure par l’imagination, qui est la vision. Il traduit, annonce, clame, enchante. Il s’enchante lui-même car il saisit la finalité d’un combat où hommes, bêtes, dieux sont mêlés. Son rôle rejoint celui du prêtre, qui est de lier. Littéralement, il est porté par enthousiasme, par une force supérieure, l’éros, qui lui donne la paix.
Claude Bourrinet
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, réflexions personnelles, révolution conservatrice, nouvelle droite, théorie politique, politologie, sciences politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Air Power est-il l'horizon indépassable de la stratégie?

ARCHIVES de SYNERGIES EUROPEENNES - 1993
L'AIR POWER EST-IL L'HORIZON INDEPASSABLE DE LA STRATEGIE?
Suite à la première guerre mondiale, une école stratégique, "emmenée" par le général italien Douhet, affirmait que la seule aviation était désormais en mesure d'anéantir l'ennemi et donc de faire la décision. Cette théorie a été infirmée par le faible rendement militaire des bombardements stratégiques de 1940-1945. Pourtant, l'importance du tonnage de bombes déversées sur l'Irak lors de la seconde guerre du Golfe a marqué les opinions publiques; et la défaite qui a suivi semble tardivement confirmer les théoriciens de la guerre aérienne.
Dès avant 1914 le «père de l'aviation», Clément Ader, fait œuvre de stratégie aérienne et souligne la vulnérabilité des villes face aux attaques menées dans la “troisième dimension”. Mais c'est avec l'échec avéré de la guerre offensive, fin 1914, que l'on prend réellement conscience de l'importance de cette nouvelle arme (1).
En septembre 1914, les hostilités sont ouvertes conformément au modèle napoléonien tel que l'a théorisé Clausewitz. Les états-majors visent à désarmer l'ennemi par l'obtention d'une victoire décisive sur le champ de bataille, la victoire étant le moyen d'abattre la volonté adverse et de faire prévaloir ses vues politiques (2). Mais la guerre de mouvement planifiée de part et d'autre (plan XVII et plan Schlieffen) se heurte bien vite à l'association de la puissance de feu, de la bêche et du fil de fer barbelé. Et les armées, paralysées, s'enlisent dans une longue guerre d'usure.
Soucieux de tirer les leçons de cette impasse stratégique, partisans des chars et de l'aviation d'assaut se querellent pendant l'entre-deux-guerres; mais pour le général italien Giulio Douhet, seuls les bombardements stratégiques permettent d'éviter la guerre de position. Plutôt que de s'acharner à anéantir les forces militaires ennemies, fût-ce au moyen des matériels les plus modernes, Douhet pense pouvoir faire l'économie de la bataille en visant les sources de la puissance militaire. C'est-à-dire en bombardant les centres industriels et démographiques de l'ennemi. Frappé dans sa substance, terrorisé, celui-ci ne tarderait pas à céder sur l'enjeu du litige. Dès lors, le plus important, pour un Etat, est d'acquérir la maîtrise de l'air (air power: capacité à empêcher 1'ennemi de voler tout en en gardant la possibilité): «défensive sur terre et sur mer pour faire masse dans les airs» recommande-t-il (3).
Abondamment discutées, ces conceptions sont loins de prévaloir en Italie, en France et en Allemagne. Mais elles ne tardent pas à s'imposer en Angleterre et aux Etats-Unis. Il est vrai que le développement de l'aviation menace de mettre fin à leur insularité géostratégique et que leurs traditions navales prédisposent à ce type de guerre (4). Aussi, Douhet y fait-il école. Aux Etats-Unis, William Mitchell développe des thèses voisines sans négliger pour autant la frappe d'objectifs tactiques; plus prophétique, son disciple Alexandre de Seversky annonce l'entrée du monde dans l'ère aéronautique. En Angleterre le général Hugh Trenchard et le ministre Stanley Baldwin obtiennent la survie de la RAF (constituée en 1918), mise au service de 1'«ordre impérial» (bombardements de l'Afghanistan et de la Somalie en 1919, de l'Irak en 1922).
La deuxième guerre mondiale met à l'épreuve les théories de la guerre aérienne. La France défaite (mai-juin 1940), l'Allemagne lance ses bombardiers sur la Grande-Bretagne (opération OTARIE/16 juillet 1940). Il s'agit de préparer un débarquement en neutralisant la RAF et la flotte, et en anéantissant les centres portuaires et industriels.
Très vite, la Luftwaffe s'avère vulnérable (rayon d'action limité, chargement en bombes insuffisant, nécessité de quatre chasseurs pour protéger un bombardier); et ce alors que les contre-mesures se renforcent (radar, DCA, chasseurs). Aussi les pertes sont impressionnantes, 15% des bombardiers engagés le 15 août 1940 sont abattus et, fin septembre, la Luftwaffe a perdu 1733 appareils (915 pour la RAF). L'opération OTARIE est arrêtée et le "Blitz" sur Londres commence (5). Les usines n'en continuent pas moins de tourner et les pertes humaines soudent la population. Les bombardements stratégiques n'ayant pu abattre la Grande-Bretagne, ils cessent en mai 1941.
L'offensive aérienne sur la Grande-Bretagne n'est guère plus probante. Lancés dès mai 1940, les raids s'intensifient au cours de l'année 1941. Les attaques sont d'abord limitées aux cibles économiques et militaires mais leur imprécision convainc Churchill des bienfaits du bombardement "en tapis", choix que fait sien Sir Arthur Harris nommé à la tête du Bomber Command en février 1942. Il s'agit de casser le moral de l'ennemi. C'est au cours de cette année que les Anglo-Américains se dotent des moyens adéquats et après un temps de "rodage" («raid des 1000 bombardiers» sur Cologne le 30 mai 1942), Churchill et Roosevelt donnent à l'offensive aérienne plus d'ampleur (Conférence de Casablanca en janvier 1943). Les bombardements stratégiques doivent pallier au second front réclamé à cors et à cris par Staline (6). Les raids sont plus meurtriers (Hambourg est détruite à 70% et 30.000 de ses habitants sont tués en juillet 1943) mais la production industrielle allemande s'accroit, la population fait bloc autour d'Hitler et les systèmes de défense sont renforcés: par exemple, 22% des avions américains engagés lors de l'attaque contre Schweinfurt (usines de roulement à bille) en octobre 1943 sont perdus. A la fin de l'année, les vertus du douhetisme restent à démontrer.
C'est en 1944 que l'offensive aérienne arrive à maturité, l'énorme supériorité matérielle des Alliés portant ses fruits. En juin, la maîtrise de l'air est acquise et, début 1945, l'économie allemande est à la limite de l'effondrement. Dresde est incendiée par des bombes au phosphore (7). Mais alors que les Anglo-américains ont perdu depuis les premiers raids 22.000 appareils et 150.000 aviateurs, la guerre n'est pas encore gagnée. Le III° Reich ne capitule qu'à l'issue d'une gigantesque offensive terrestre combinée (8 mai 1945). Les deux axiomes du douhetisme, omnipotence du bombardier et fragilité morale de populations civiles, ont donc été invalidés et la deuxième guerre mondiale a été une guerre d'usure (8).
De 1945 à 1991, les offensives aériennes sur les différents théâtres d'opérations du tiers monde ne s'inscrivent pas dans des stratégies de destruction du potentiel économique. En Corée (1950-1953), les bombardiers n'ont joué qu'un rôle tactique et Truman s'emploie à limiter le conflit. Au Vietnam (1965-1973), les opérations ont été plus importantes, près de 6,4 millions de tonnes de bombes ayant été déversées de 1965 à 1972 (moins de 3 sur l'Europe allemande de 1939 à 1945). Mais Rolling thunder (1965) et Linebacker (1972) privilégient réseaux de communication et objectifs militaires.
Il faut donc attendre 1991 (guerre contre l'Irak) pour assister à une nouvelle offensive aérienne à caractère douhetiste. Dès avant l'ouverture des hostilités, les Etats-Unis faisant preuve de leurs capacités logistiques en dépêchant 500.000 hommes à 12.000 km de leurs bases, le général Dugan révélait au Los Angeles Times ses conceptions quant à la conduite de la guerre (9). Le chef d'état-major de l'Air Force déclarait que la guerre serait totale, l'arme aérienne se voyant attribuer l'essentiel des missions de destruction de l'Etat irakien. Et la conduite effective de la guerre, telle qu'elle a été médiatisée par CNN, semble confirmer ses indiscrétions. Au cours des opérations, 2000 spécialistes (le personnel de l'USAF pour l'essentiel) ont effectué 100.000 sorties et déversé près d'un million de tonnes de bombes (10). Les résultats ont été à la hauteur des efforts déployés; ont été «traités», outre le complexe militaro-industriel, les infrastructures du pays (voies de communication, centrales électriques, stations d'épuration...) et les centres de décision (ministères, administrations, bâtiments du Baath). Et par voie de conséquence, les populations civiles («dommages collatéraux»). Au total, ce pays en voie de développement accéléré a été rejeté plusieurs années en arrière (11).
Mais si la maîtrise de l'espace aérien et les frappes stratégiques ont joué un rôle majeur dans la victoire des Etats-Unis, le néo-douhetisme de Dugan a été réfuté dès le 14 décembre 1990 par le général Powell (chef d'état-major inter-armées), partisan d'une campagne air-terre-mer. Et les opérations ont été menées conformément à ce choix:
- phase I: campagne aérienne stratégique;
- phase II: campagne aérienne tactique (attaque des forces déployées au Koweit);
- phase III: campagne terrestre sous la forme d'une manœuvre d'encerclement.
Le succès de cette stratégie combinée a montré que si l'USAF était à même de briser les armées irakiennes, seule l'action terrestre pouvait matérialiser sur le terrain la supériorité acquise dans les airs.
En définitive, cette victoire totale est donc à attribuer à la combinaison de moyens maritimes (déploiement logistique, maîtrise de la mer et projection de puissance), atmosphériques (anéantissement par attrition), extra-atmosphériques (télédétection, télécommunication, cartographie) et terrestres, «l'ensemble étant intégré dans une vaste architecture s'élevant du sous-marin au satellite» (12). La prétendue capacité des bombardiers à faire la décision à eux seuls demeure un phantasme technologique.
Invalidé par l'épreuve des faits, le douhetisme n'est-il, pour conclure, qu'un archaïsme? C'est la thèse de J.F.C. Fuller qui y voit un retour à la grosse artillerie de la première guerre mondiale. Les bombardements horizontaux, pures opérations de destruction, n'avaient pu alors remédier au statisme du front. Dès 1939, avec la guerre-éclair, leur version verticale perd toute justification théorique. Enfin, la deuxième guerre du Golfe l'a montré, le maître de la mer et de l'air doit débarquer pour vaincre.
Pourtant, Douhet a pressenti les mutations stratégiques dues à l'extension des opérations à la troisième dimension: prime à l'offensive et à la surprise; démantèlement de l'espace et déclassement du territoire (fin de la distinction avant/arrière); dévalorisation de la conquête; convocation des populations civiles à la barre de la guerre; promotion du génocide au rang de nouveau mode stratégique (génocide virtuel depuis la mise au point de l'arme nucléaire). Si la doctrine opérationnelle est erronée, la représentation douhetiste de la guerre et de l'espace stratégique est-elle hypermoderne. Nous sommes bel et bien à l'ère de la stratégie intégrale. Le navalisme futuriste des Etats-Unis, renouvelé par le Space Power (pouvoir spatial et aérien), leur domination satellitaire et furtive, le «hit and run» de leur stratégie planante, leur refus de toute responsabilité impériale (institution d'un nouvel ordre politique par la conquête) en témoignent.
Louis Sorel,
le 10 juillet 1993.
(1) Cf. C. Carlier, "Clément Ader premier stratège aérien" in Stratégique, n°49, 1991. Dans le même volume, lire également D. David, «Douhet ou le dernier imaginaire».
(2) Pour s'initier à la pensée de Clausewitz, lire R. Aron, Sur Clausewitz, éd. Complexe, 1987.
(3) Citation extraite de L. Poirier, Des stratégies nucléaires, éd. Complexe, 1988, P. 31.
(4) Carl Schmitt démontre qu'a l'opposé de la guerre continentale, guerre entre Etats épargnant la population civile et la propriété privée, la guerre navale repose sur une conception totale de l'ennemi. La propriété privée est soumise au droit de prise et le blocus atteint l'ensemble de la population. Cf. «Souveraineté de l'Etat et liberté des mers» in Carl Schmitt, Du politique, éd. Pardès, 1990.
(5) Rappelons que les raids anglais sur Berlin ont précédé le "Blitz". Cf. C. Villers, «Winston Churchill: l'autre visage du bouledogue...» in Terres d'histoire, n°2, 1989.
(6) La question du front occidental, dont l'ouverture avait été promise dès 1941 par les Anglo-Saxons, empoisonne les relations avec Staline qui soupçonne ses alliés d'envisager une paix séparée avec Hitler. Churchill ne parviendra pas à faire prévaloir l'idée d'un débarquement dans les Balkans (afin de couper la route de l'Armée Rouge), Roosevelt étant obnubilé par la victoire totale (notion d'ordre tactique).
(7) Cf. D. Irving, La destruction de Dresde, Art et histoire d'Europe, 1987.
(8) Commencée modestement en avril 1942, l'offensive aérienne américaine a également meurtri le Japon, particulièrement à partir de novembre 1944 (après la prise des Mariannes). Mais les bombardements atomiques d'août 1945 ne doivent pas dissimuler le fait que ce sont les pertes de la marine qui ont mis à genou le pays (opération «Starvation»). Dès juillet, le Japon était prêt à capituler, mais pas inconditionnellement.
(9) Le 24 août 1990. Dugan a été limogé en septembre.
(10) Dont seulement 7% de «bombes intelligentes». Cf. P.M. Gallois, «Le paradoxe de la mère des batailles» in Stratégique, n°51-52, 1991.
(11) C'était là un des buts de guerre des Etats-Unis: ramener l'Irak à la “norme” pour éviter toute polarisation régionale et continuer à jouer sur l'équilibre instable entre cet Etat, l'Arabie Saoudite et l'Iran (Cf. Noël Jeandet, Un golfe pour trois rêves, L'Harmattan, 1993).
(12) P.M. Gallois, op. cit.
Bibliographie complémentaire:
- R. HOLMES, Atlas historique de la guerre, Club France Loisirs, 1990.
- J. KEEGAN, Atlas de la seconde guerre mondiale, Club France Loisirs, 1990.
- E. M. EARLE, Les maîtres de la stratégie, tome II, Champs-Flammarion, 1987.
- A. JOXE, L'Amérique mercenaire, Stock, 1992. Du même auteur, voir également Le cycle de la dissuasion, La Découverte, 1990.
- G. CHALIAND, Anthologie mondiale de la stratégie, Robert Laffont, 1990.
- J.F.C. Fuller, La conduite de la guerre de 1789 à nos jours, Payot, 1990.
00:08 Publié dans Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : puissance aérienne, air power, aviation, aviation militaire, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 07 juillet 2009
Brzezinski derrière les émeutes en Iran?

Brzezinski derrière les émeutes en Iran?
Par Andrea FAIS
Le récent voyage d’Obama au Proche Orient eut, comme on le sait, un point culminant: son discours tenu en Egypte. Il a été bien mis en évidence par tous les médias du monde: la planète entière a été invitée à y voir un geste d’ouverture au monde musulman, sanctionnant du même coup l’idée d’une discontinuité par rapport au gouvernement Bush. Le temps est plutôt venu de créer indirectement des oppositions dans les pays non alignés sur la politique globale atlantiste, en soutenant les oppositions minoritaires ou historiques. Le pays le premier visé est bien entendu l’Iran des ayatollahs. Le processus a commencé: le Liban est déstabilisé, après les secousses provoquées par l’énorme coalition pro-occidentale qui a réussi à défaire les forces du Hizbollah. Les événements du Liban sont le prélude au projet de déstabiliser l’Iran, après la condamnation “morale” et verbale des résultats des élections récentes. Condamnation et premières effervescences qui suivent un bien étrange attentat, survenu il y a quelques jours dans le Nord de l’Iran et pour lequel trois séditieux ont déjà été condamnés à mort; ils appartenaient à une cellule fondamentaliste sunnite.
Une opération médiatique habile et manipulatrice a bien implanté dans l’opinion publique, dans quasi toutes les têtes, partout sur notre planète, qu’Ahmadinedjad, président iranien selon la légitimité des urnes, était en recul, que la participation d’innombrables jeunes au scrutin avait certainement garanti la victoire du réformiste Moussavi. Rapidement, cette interprétation s’est révélée fausse: ni le haut taux de participation des Iraniens aux élections ni aucun sondage préalable ni aucune projection au début du dépouillement n’étaient là pour confirmer les proclamations délirantes des dissidents pro-occidentaux qui avaient annoncé leur victoire deux heures déjà avant la fermeture des bureaux de vote.
En 2007, Zbigniew Brzezinski, historien et stratège au service de la géopolitique américaine, avait tonné du haut de sa chaire lors d’un colloque de la Commission de la Défense du Sénat américain, en affirmant “qu’à l’évidence les promesses de satisfaire les requêtes (du gouvernement américain) n’avaient pas été tenues, ce qui permettrait de faire endosser à l’Iran la responsabilité de cet échec et, moyennant quelques provocations en Irak ou un attentat terroriste commis aux Etats-Unis mêmes, que l’on attribuerait à l’Iran, on pourrait atteindre un ‘point culminant’ autorisant une action militaire ‘défensive’ des Etats-Unis contre l’Iran”. Ces propos ont abasourdi bon nombre de participants à ce colloque.
De fait, ces propos légitimisent l’idée, pour le gouvernement américain, d’orchestrer un attentat, dont les effets seraient à son avantage. Il pourrait alors manipuler à l’envi les effets de cet attentat dans l’opinion publique, créant ainsi ex nihilo la “licéité” pour toute attaque éventuelle. Ce type de démarche n’est pas nouveau. En observant les agissements de Brzezinski au cours de ces dernières décennies, on se rappellera l’usage qu’il fit du faux dossier anglais visant à démontrer l’existence d’armes non conventionnelles dans l’Irak de Saddam Hussein. Les révélations quant à la fausseté de ce document avait déclenché un scandale et fragilisé le duo Blair/Bush. Il avait affirmé que “le Président était préoccupé du fait que s’il n’y avait pas en Irak d’armes de destruction massive, il aurait fallu inventer d’autres raisons pour justifier l’action guerrière”. Ces propos révèlent implicitement une pratique: celle de construire des “théorèmes ad hoc”. Et que ce genre de pratique n’est pas nouveau.
Brzezinski, Soros et Roathyn, agents premiers de la géo-économie et de la finance mondiale, sont aussi les principaux “sponsors” des campagnes qui ont porté Obama à la présidence, à la suite de scores “historiques”. Ces hommes bougent les pièces de l’échiquier international depuis des décennies. Après avoir créé Al Qaeda de toutes pièces pour nuire à l’Union Soviétique, après avoir financé le terrorisme des indépendantistes tchétchènes pour nuire à Poutine, après avoir organisé avec ses associés, dont quatre fils bien installés dans les arcanes de l’OTAN et des services de renseignements américains, les révolutions démocratiques, dites “orange”, en Ukraine et en Géorgie, le Polonais Brzezinski travaille à l’objectif final: la destruction de la République Islamique d’Iran.
Son livre de 1996, “Le grand échiquier”, avait paru, de prime abord, à la plupart des observateurs, comme un essai délirant sur la politique internationale, relevant de la pure fantaisie bien qu’il ait été considéré comme cynique et impitoyable, dans la mesure où il esquissait un globe de plus en plus américano-centré. Dans son livre, Brzezinski indiquait sur la zone du “cordon eurasien” les points essentiels sur les plans stratégique et énergétique qui garantiraient, s’ils étaient maîtrisés, l’avenir du capitalisme et de ses pays-phares. Ce n’était nullement de la fantaisie: petit à petit, en peu d’années, l’esquisse initiale s’est révélée réalité. Le passage de la ficiton à la réalité épouvante les esprits par sa perfection géométrique. Aujourd’hui en Iran, il faut suivre avec toute la prudence nécessaire les manifestations d’une opposition clairement vaincue par les urnes et la situation “putschiste” qui pourrait en découle: Ahmadinedjad vient de lancer des accusations lourdes, mais légitimes, à l’endroit de la désinformation qui émane des services occidentaux, qui prétendent qu’il y a eu fraude électorale, ce qui est faux, parce qu’ils avaient déjà annoncé, deux mois à l’avance, la victoire de l’opposition sur base de sondages que les faits n’ont pas confirmés.
Les délégations de journalistes néerlandais et espagnols ont été expulsées d’Iran. Les manifestations ont été interdites. Malgré les résultats nettement en faveur du président sortant (plus de 60%), et confirmés comme tels, l’opinion publique mondiale émet encore critiques et doutes, alors qu’elle ne s’est jamais prononcée sur des élections dans des pays qui n’ont aucune institution démocratique, comme l’Arabie Saoudite ou l’Egypte. Ces pays-là n’en ont pas besoin, on ne leur tiendra jamais rigueur de ne pas en avoir: ils ont le privilège d’être des alliés des Etats-Unis. Pour mesurer l’hypocrisie médiatique, il suffit de constater qu’en Italie les critiques n’ont cessé de s’accumuler pour dénoncer le gouvernement de Téhéran et le “trucage” des élections qu’il aurait commis, alors qu’à Rome Khadafi se pavanait sur la scène en entendant les louanges de tous; il n’est pas un modèle de démocrate et sa gestion du pouvoir ne correspond certainement pas à la bonne gouvernance que veulent imposer les Etats-Unis au reste du monde, du moins en théorie. Mais, voilà, Khadafi s’est rapproché de l’Occident, au cours de ces dernières années, et adhère désormais aux principes de la “libre économie”.
On le voit: deux poids, deux mesures. Tandis qu’Ahmadinedjad se plaint devant les médias que des “forces extérieures” sont en train de créer un climat irréel de tensions, le “guide suprême” de la révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei promet qu’une enquête approfondie aura lieu pour vérifier ce qu’il en est vraiment de la fraude électorale. Le candidat “libéral” évincé parle de manière de plus en plus incrédible de cette “fraude électorale”, alors qu’il n’a obtenu que 32% des voix. Jamais aucun organe de presse, jamais aucune institution médiatique n’a évoqué une quelconque impartialité pendant le dépouillement, sauf lui-même, qui s’auto-proclamait vainqueur deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, en plein déroulement du scrutin.
Cette arrogance et cette prétention nous apparaissent bien suspectes: qui se cache derrière l’opposition pro-occidentale de Moussavi? Réponse facile: il suffit de tourner le regard vers l’Atlantique.
Andrea FAIS.
(aeticle paru dans le quotidien romain “Rinascita”, 17 juin 2009).
00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, stratégies, révolutions, moyen orient, islam |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Bibliographie sur les événements de "Yougoslavie"
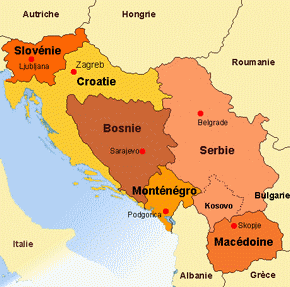
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
Bibliographie sur les événements de «Yougoslavie»
Pour comprendre la question croate
Walter SCHNEEFUSS, Die Kroaten und ihre Geschichte, Wilhelm Goldmann Verlag, Leipzig, 1942.
Cet ouvrage a paru pendant la guerre, au moment où l'Allemagne hitlérienne soutenait l'Etat oustachiste d'Ante Pavélic. Son analyse de la réalité politique, par conséquent, est marquée par ce contexte et n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. En revanche, son esquisse de l'histoire de la Croatie, depuis l'arrivée des premières tribus croates, en passant par les époques byzantines, italiennes, ottomanes et hongroises est l'une des présentations les plus claires de la question qui ait jamais été publiée en Europe de l'Ouest. L'auteur reconnaît les erreurs des administrations autrichienne et hongroise en Croatie, ce qui a suscité des désirs d'unification yougo-slave chez les intellectuels croates. Mais ces aspirations ont été dénaturées par la monarchie des Karageorgevitch. Les Croates ont alors revendiqué leur indépendance. Un livre à rechercher chez les bouquinistes!
Wolfgang LIBAL, Das Ende Jugoslawiens. Chronik einer Selbstzerstörung, Europaverlag, Wien/Zürich, 1991, 176 S., DM 29,-/öS 198,-. ISBN 3-203-51135-5.
Correspondant de plusieurs agences de presse et journaux allemands, suisses et autrichiens, Wolfgang Libal (né en 1912) est l'un des plus éminents spécialistes ès-affaires balkaniques de langue allemande. Son verdict: la «Seconde Yougoslavie» de Tito est morte. Elle vient de connaître le même sort que la «Première Yougoslavie» des Karageorgevitch. Elle a succombé à ses contradictions internes. Aucun des peuples de l'espace sud-slave n'a accepté l'hégémonie serbe puis serbo-communiste. Le poids du passé, des différences de tous ordres forgées au cours des siècles qui nous ont précédés, a pesé plus lourd que la volonté politique d'unir cette région d'Europe. Le livre de Libal retrace les péripéties de la vie politique et parlementaire yougoslave de 1918 à 1934, date de l'assassinat à Marseille du Roi Alexandre par les Macédoniens et les Oustachistes de Pavelic. Dans les querelles entre centralistes et fédéralistes, séparatistes et royalistes, nous retrouvons tous les clivages de l'espace yougoslave.
Jens REUTER, «Der Bürgerkrieg in Jugoslawien. Kriegsmüdigkeit, Kriegspsychose und Wirtschaftsverfall», in Europa Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik, 1991/Nr. 24, 25.12.1991.
Bimensuel édité par la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Verlag für Internationale Politik, Bonn (Adenauerallee 131, D-5300 Bonn). ISSN 0014-2476.
L'auteur examine l'état des «mouvements pour la paix» (la «Marche des Mères», la «Caravane de la Paix», le «Referendum contre la guerre», etc.) en Serbie et en Voïvodine. Le gros de la population est hostile à la guerre. Mais le gouvernement tolère les parades de Tchetniks armés dans les rues et sur les places de marché de Belgrade. Le commerce des armes est libre et les partisans serbes peuvent vendre le produit de leurs pillages sur les marchés. Mais 30% seulement des réservistes serbes ont rejoint leurs unités lors de la mobilisation de l'automne 1991. A Belgrade, moins de 10%! Au Monténégro, 40% des rappelés ont répondu. A Zagreb, règne une psychose paralysante: les irréguliers serbes ne campent pas loin de la capitale croate.
Reuter se penche ensuite sur le problème des désertions, au début de l'automne 91: Bosniaques et Macédoniens ne veulent plus servir dans l'armée fédérale. En Macédoine, les fonctionnaires font disparaître les listes d'appelés; quelques jours plus tard, le Président macédonien Kiro Gligorov et son parlement décident officiellement de ne plus envoyer de soldats dans l'armée fédérale. La situation économique est catastrophique: en Serbie, la planche à billets fonctionne sans interruption, annonçant une inflation sans précédent; la Serbie a néanmoins pu dégager de substantiels surplus agricoles; en Croatie, l'économie est bloquée à cause des combats; la Slovénie a perdu 23% de son marché, qui était auparavant inter-yougoslave.
Wolfgang WAGNER, «Acht Lehren aus dem Fall Jugoslawien», in Europa Archiv. Zeitschrift für internationale Politik, 1992/2, 25.1.1992 (réf. et adresse ci-dessus).
Wagner énonce huit leçons de la crise yougoslave.
1. Quand l'Europe était partagée en deux blocs, elle vivait davantage en paix qu'à l'heure actuelle, où cette confrontation globale a disparu.
2. Les élections libres ne sont plus une garantie de voir les peuples vivre côte à côte en harmonie.
3. Il est faux de croire que la guerre a cessé d'être perçue comme moyen de la politique en Europe, malgré les expériences tragiques des deux guerres mondiales.
4. Les Etats-Unis ne veulent pas intervenir en Europe. Ils estiment que c'est le rôle des Européens de faire respecter les grands principes humanitaires dans les Balkans.
5. L'idée qu'il faut intervenir dans les affaires intérieures d'un Etat qui ne respecte pas les droits de l'homme reste une pure vue de l'esprit. Les réalités politiques continuent à s'imposer, dans toutes leurs dimensions tragiques, en dépit de ce vœu pieux, lancinant depuis la SDN.
6. Les moyens d'empêcher toute effusion de sang dans un conflit politique demeurent faibles.
7. Vu leur impuissance à agir et à résoudre les conflits, les gouvernements cherchent des dérivatifs humanitaires ou diplomatiques, non pas pour résoudre les problèmes par d'autres voies mais pour éviter qu'on ne leur reproche leur inaction.
8. Ni l'Europe ni le monde ne disposent d'une organisation internationale capable d'enrayer et d'arrêter les conflits contre la volonté de leurs protagonistes.
Waldemar HUMMER u. Peter HILPOLD, «Die Jugoslawien-Krise als ethnischer Konflikt», in Europa Archiv. Zeitschrift für internationale Politik, 1992/4, 25.2.1992.
Les auteurs partent du constat qu'en dépit des expulsions massives de minorités (surtout allemandes) après 1945, les conflits inter-ethniques en Europe demeurent aigus. La crise «yougoslave» en est la plus sanglante illustration. Tito avait réussi à maintenir l'équilibre entre les différents peuples de Yougoslavie en introduisant des mécanismes de rotation du personnel politique et administratif. Mais cet équilibre était précaire. Dès la mort du Maréchal, les troubles ont commencé au Kosovo, conduisant, par la suite, Belgrade à réduire l'autonomie accordée en 1963 à cette province ethniquement albanaise à 90%. Hummer et Hilpold analysent les textes de la nouvelle constitution croate et constatent que les règles de protection des minorités, telles qu'elles ont été élaborées par les instances européennes, sont respectées. La constitution croate prévoit également l'autonomie des communes de la Krajina, où les Serbes sont majoritaires. Les Serbes, opposés au nouvel Etat fédéral croate, contestent le principe de territorialité qui préside à l'attribution ou à la non-attribution des droits de minorité, comme l'emploi de la langue serbe (rédigée en caractères cyrilliques). Pour eux, l'emploi de la langue serbe devrait être possible partout sur le territoire de la Croatie indépendante. Ensuite, les droits des minorités doivent reposer sur le principe de réciprocité: si l'Etat A accorde des droits à la minorité B, majoritaire dans l'Etat B voisin, cet Etat B doit accorder les mêmes droits à la minorité A, majoritaire dans l'Etat A. Les Croates sont prêts à accorder ces droits aux Serbes de Croatie, à la condition que les Croates de Serbie jouissent exactement des mêmes droits. Les Slovènes ont exigé de l'Italie qu'elle accorde les mêmes droits aux 100.000 Slovènes d'Italie qu'accorde la Slovénie aux 3000 Italiens qui résident sur son territoire. Rome a refusé!
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, yougoslavie, balkans, bibliographie, histoire, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 06 juillet 2009
Géopolitique du Moyen Orient: avec ou sans l'Iran?
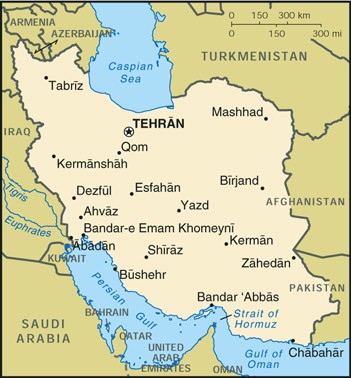
Entretien-éclair avec Robert Steuckers
Quel avenir géopolitique pour le “Grand Moyen Orient”? Avec ou sans l’Iran?
Q.: Lors de vos récentes conférences à Lille, Genève et Metz, sur le fondamentalisme islamique et sur l’eurasisme (*), vous avez évoqué l’éventualité d’un changement d’alliance au sein du Grand Moyen Orient, avec un rapprochement entre l’Iran et les Etats-Unis? Rien ne semble pourtant confirmer cette hypothèse. Pourquoi dès lors en avoir parlé?
RS: Votre question va un peu vite en besogne. J’ai simplement cité deux ouvrages récents qui évoquent cette éventualité d’un rapprochement irano-américain. Il s’agit des livres de Trita Parsi (**) et de Robert Baer (***).
Pour Trita Parsi, les Etats-Unis n’ont cessé de parier sur Israël comme gendarme au Proche et au Moyen Orient. Les Israéliens entendent, dit-il, conserver cette position et ne veulent pas voir l’Iran les relayer ni même les seconder. Mais la position de l’Iran dans la région qui s’étend de l’Egypte au Pakistan et de l’ancienne Transoxiane à l’Arabie Saoudite est stratégiquement parlant bien plus intéressante que celle, marginale et réduite, d’Israël. L’Iran est le centre de la région et, de surcroît, “les Etats-Unis pourraient bénéficier d’un Iran puissant qui servirait d’Etat-tampon contre toute percée chinoise en direction de l’Océan Indien et du bassin de la Caspienne, riche en ressources énergétiques” (p. 261). Parsi ajoute un argument de poids à sa démonstration: “le Moyen Orient est dépourvu d’une base géopolitique pour l’ordre fragile qui y règne” (p. 262) et “Washington a cherché à établir un ordre qui entre en contradiction avec l’équilibre naturel en cherchant à contenir et à isoler l’Iran, l’un des pays les plus puissants de la région” (p. 262). Retour aux arguments de Nixon.
Pour Robert Baer, l’Iran aurait “changé”. Il rejette la notion habituelle d’”Etat voyou” qu’on colle sur le râble du pouvoir iranien. Il souligne la stabilité de l’Iran et sa grande influence (ce qui reste tout de même relatif à mes yeux) sur son environnement géographique immédiat, surtout dans le Golfe, au Liban et aux confins de la Jordanie et de l’Egypte. Il reconnaît, en quelque sorte, les avantages naturels de la position géographique de l’Iran et l’incapacité subséquente des armées américaines à l’envahir et à l’occuper durablement. Les Etats-Unis doivent donc changer de stratégie à son égard et pratiquer à nouveau la politique pro-iranienne du temps d’Eisenhower ou celle préconisée par Nixon. Dans sa conclusion, il écrit: “Les Iraniens ont montré une meilleure aptitude à créer de l’ordre à partir du chaos que qui que ce soit d’autre au Moyen Orient. Ils possèdent les troupes suffisantes pour occuper l’Irak. Alors pourquoi ne pas les laisser assumer avec nous le coût de l’occupation? Céder une partie de l’Irak à l’Iran serait un cauchemar pour les Arabes du Golfe. Mais laisser le chaos et les dissensions religieuses irakiennes traverser les frontières serait bien plus dommageable” (p. 357).
Je pense qu’il faut effectivement replacer ces deux argumentaires, qui prennent apparemment le contre-pied diamétral du discours médiatique dominant, dans le contexte actuel, en pleine effervescence, du Grand Moyen Orient. Il faut d’abord se rappeler en permanence qu’Obama, lors de son voyage en Turquie, a repris la politique turque que Clinton avait in illud tempore suggérée à un Özal enthousiaste mais que les néo-conservateurs républicains avaient plus ou moins abandonnée, en focalisant toute leur politique étrangère sur l’Afghanistan, pour le futur tracé des oléoducs et gazoducs vers l’Océan Indien, et sur l’Irak, pour le pétrole brut. Derrière la nouvelle équipe d’Obama, on assiste aussi au retour discret, dans les coulisses, de Zbigniew Brzezinski, le théoricien des interventions stratégiques en Asie centrale, sur la “Terre du Milieu”, et l’artisan de l’alliance entre les Etats-Unis et les fondamentalistes wahhabites dès l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en décembre 1979. Brzezinski a ainsi été le fossoyeur de la défunte Union Soviétique. Dans ses spéculations stratégiques et réflexions historiques, Brzezinski avait tour à tour réfléchi aux potentialités d’un panislamisme ou d’un pantouranisme (ou la Turquie avait un rôle à jouer). Mais la Turquie a le sens de l’Etat, hérité du kémalisme, de la tradition ottomane et, via les Phanariotes chrétiens qui s’étaient mis au service de la “Sublime Porte”, de Byzance. Si elle intervient en Asie centrale, même comme simple “proxy” des Etats-Unis, la Turquie risque d’y introduire une logique impériale qui, à terme, y serait tout aussi dangereuse pour Washington que l’impérialité russe. Brzezinski a alors spéculé sur la “logique nomade mongole”, celle de Tamerlan (ou Timour Leng), qui détruisit les empires périphériques sans construire des structures impériales durables. Washington a rêvé d’un nouveau “tamerlanisme”, ni russe ni turc ni iranien, en Asie centrale afin qu’une dynamique toujours effervescente et éphémère s’y installe, permettant, grâce au désordre permanent qu’elle génèrerait, toutes les manoeuvres américaines.
Le retour de la carte turque dans le jeu américain, qui n’est toutefois pas assuré, n’implique plus aucun pantouranisme, me semble-t-il, car l’espoir d’utiliser la Turquie comme Cheval de Troie en direction des zones turcophones de l’Asie anciennement soviétique, s’est évanoui face aux faits. L’Asie centrale demeure plus liée à Moscou qu’au reste du monde et participe au groupe de Shanghai, Turkmenistan excepté. Bush II n’avait d’ailleurs pas joué la carte pantouranienne, selon les premiers écrits de Brzezinski. L’équipe néo-conservatrice préférait parler du “Grand Moyen Orient” et ne réservait dans ce jeu aucune procuration particulière et intéressante à la Turquie, qui, du coup, s’est rébiffée, a cultivé un néo-nationalisme anti-américain et glissé vers une forme particulière d’islamisme avec Erdogan. C’est sans nul doute ces “glissements”, peu conformes aux principes de l’alliance turco-américaine, qu’Obama cherche à enrayer en renouant avec l’ancienne politique de Clinton dans la région et en donnant aux Turcs, par la même occasion, un rôle important à jouer dans la stratégie globale des Etats-Unis, surtout en mer Noire et dans le Caucase. Mais, mise à part une promesse d’adhésion à l’UE, permettant de déverser le trop-plein démographique turc dans une Europe minée par le déficit des naissances, on ne voit pas très bien quel rôle plus offensif et plus constructif du point de vue géopolitique turc Obama peut offrir à Ankara: pas question, semble-t-il, de donner un feu vert à la Turquie dans le Kurdistan irakien, qui est aussi la région pétrolifère de Mossoul et Kirkouk. Les pétroliers texans n’admettraient pas de partager le pactole d’hydrocarbures de cette région, déjà arrachée à la Turquie au lendemain de la première guerre mondiale. De plus, une Turquie riche du pétrole de Mossoul, serait plus indépendante de l’Occident et de l’UE et pourrait forger des alliances à sa guise, qui n’iraient pas toujours dans le sens voulu par Washington.
L’espoir de générer un “mongolisme volatile”, violent et guerrier mais éphémère, en Asie centrale, n’a pas eu de traduction dans la réalité. Cette Asie centrale, cette “Terre du Milieu”, est stable dans le cadre du Groupe de Shanghai, élargi aux observateurs indiens, pakistanais et iraniens depuis 2005, sans que les Etats-Unis y aient été conviés. Le groupe de Shanghaï constitue un bloc eurasien qui suit la grande leçon de Carl Schmitt, elle-même dérivée de la fameuse Doctrine de Monroe: pas d’ingérence d’une puissance étrangère à l’espace eurasien dans ce même espace eurasien. Mais les acquis du Groupe de Shanghaï ne doivent pas nous aveugler ni générer en nos esprits un optimisme trop délirant: la “Terre du Milieu” a certes retrouvé une cohérence, représente une masse démographique de 2,8 milliards d’hommes, mais, en lisière, le chaos règne sur les “rimlands”, seuls territoires capables de donner à la “Terre du Milieu” un poumon extérieur et des fenêtres parfaitement exploitables donnant sur les grands océans de la planète. La Chine demeure en voie d’encerclement et tente d’y échapper, notamment en tablant sur le Myanmar (Birmanie) qui lui offre un accès au Golfe du Bengale. L’Inde garde un contentieux avec la Chine et refusera toujours de déchoir au rang de “périphérie” de l’Empire du Milieu, sentiment que Washington tente d’exploiter pour disloquer les anciennes solidarités de l’Inde avec la Russie, désormais alliée à la Chine au sein du Groupe de Shanghaï.
En attendant, le chaos total règne en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. D’après les responsables du Parti Baath irakien, tous les maux qui frappent l’Irak, les dissensus inter-confessionnels, la présence d’Al-Qaïda, sont des importations, des fruits de l’occupation américaine. Aucun de ces phénomènes n’existaient avant l’entrée de la coalition rameutée par Bush II en 2003. A croire que ce chaos est entretenu à dessein! Quant au Pakistan, il a soutenu, formé et fourni en matériels et bases arrières les mudjahiddins puis les talibans, en espérant annexer l’Afghanistan et se donner ainsi une profondeur territoriale face à l’Inde, son ennemie héréditaire. Il sombre désormais dans le chaos et les “zones tribales”, le long de sa frontière avec l’Afghanistan, échappent à sa souveraineté, ce qui réduit cette fois la profondeur territoriale initiale du Pakistan lui-même. Les tâches entre la Mésopotamie et l’Indus s’accumulent pour l’hegemon américain au risque, semble-t-il, d’absorber toutes ses énergies, à moins qu’une analyse moins superficielle et plus subtile ne finisse par admettre que l’organisation du chaos total fait partie d’une stratégie diabolique: mettre pour longtemps à feu et à sang le rimland, y créer des conflictualités durables pour éviter sur le très long terme leur absorption naturelle et sereine par les puissances impériales détentrices de la “Terre du Milieu”. Dans un tel scénario, les Etats-Unis garderaient la mainmise sur l’Océan Indien, “Océan du Milieu”, en arbitrant habilement la rivalité Inde/Chine qui y pointe.
En dépit des démonstrations de Parsi et Baer, l’Iran, lui, demeure, dans l’optique imposée par l’hegemon américain, un “Etat voyou”, avec lequel personne n’a le droit d’entretenir des relations simples ou privilégiées, sous peine de mesures de rétorsion. C’est bien sûr l’option stratégique que contestent, chacun à leur manière, Parsi et Baer, en suggérant une autre politique vis-à-vis de Téhéran. Mais nous n’en sommes pas encore là. Un simple coup d’oeil sur la carte permet de constater que l’Iran est la pièce géographique centrale de cet espace stratégique que les Américains nomment le “Grand Moyen Orient” et qui correspond à l’USCENTCOM. Le “Grand Moyen Orient” constitue donc l’aire centrale du “Vieux Monde”: il a tout à la fois une dimension continentale et une dimension maritime; il relie les ressources de l’Asie centrale tellurique —qui fut d’abord la périphérie septentrionale et régénératrice des empires iraniens de l’antiquité puis le glacis avancé de l’Empire russe et de l’URSS— à la côte de l’Océan Indien. En ce sens, il est bien le “milieu du monde” et non plus simplement la “Terre du Milieu”, telle que l’avait théorisée Halford John Mackinder à partir de 1904. En paraphrasant ce dernier, on pourrait dire que “la puissance qui contrôle, directement ou indirectement, ce ‘milieu du monde’, contrôle le monde entier”.
Pour les Etats-Unis, c’est une question vitale: s’ils ne contrôlent pas ce ‘milieu du monde’ et les hydrocarbures (et accessoirement le “Cotton Belt” ouzbek) qu’il recèle, ils seront relégués dans leur “Nouveau Monde”, avec, en sus, une Amérique latine qui branle dans le manche. Cette “relégation” constituerait un recul définitif et une implosion à terme. Le chaos sur la moitié sud du “Grand Moyen Orient” fait office de verrou et attire l’attention de toutes les puissances eurasiennes qui, du coup, cherchent à l’effacer en priorité sans tenter outre mesure de “prendre la mer” ou d’entretenir des rapports plus privilégiés avec une Europe (endormie), une Afrique, dont la façade atlantique est convoitée par les Etats-Unis, ou une Amérique latine qui cherche la diversification. Le chaos sur le rimland, de la Palestine à l’Indus, sur le territoire même de l’Empire d’Alexandre, freine justement cette volonté générale de diversification des échanges qui est le volet concret d’une volonté de “multipolarité”, exprimée surtout par la Chine. Il est dès lors patent que la puissance qui cherche à être l’hegemon unipolaire tente tout ce qui est en son pouvoir pour retarder au maximum l’avènement d’une telle multipolarité; une fois de plus, nous voilà ramenés à l’oeuvre immortelle de Carl Schmitt: les puissances anglo-saxonnes, disait-il, sont des puissances “retardatrices” de l’histoire et, parfois, dans leur travail incessant de “retardement”, elles en deviennent les “accélératrices contre leur volonté” (“Beschleuniger wider Willen”). Car elles génèrent aux multiples niveaux globaux ou continentaux des réactions collectives, des antagonismes nouveaux qui, pour triompher, surmontent nécessairement des antagonismes anciens, de dimensions locales ou infra-continentales (“petites-nationalistes” disait Jean Thiriart).
“Etat voyou” à éliminer pour asseoir définitivement l’hégémonie américaine sur le “milieu du monde” ou nouvel allié potentiel pour arriver au même but, l’Iran reste important parce qu’il constitue l’aire géographique centrale de la région couverte par l’USCENTCOM. Mais si d’aventure les suggestions de Parsi et de Baer trouvaient quelques oreilles attentives chez les stratégistes du Pentagone, alors quelle latitude les Etats-Unis laisseraient-ils à un Iran qui serait subitement réhabilité? Le contentieux irano-américain depuis les crocs-en-jambe infligés au Shah dès la présidence de Kennedy jusqu’aux querelles de prestige avec Ahmadinedjad repose essentiellement sur deux faisceaux de motifs: 1) le nucléaire; 2) la puissance militaire. Les services américains ont fabriqué la révolution iranienne, à dominante fondamentaliste, parce qu’ils voyaient d’un mauvais oeil le Shah acheter des parts substantielles d’EURODIF, l’agence européenne du nucléaire. Un Iran fort de ses rentes pétrolières et indépendant sur le plan énergétique grâce au nucléaire aurait retrouvé la puissance perse d’antan. Inacceptable car alors le “milieu du monde” n’aurait jamais plus été digérable par l’hegemon américain. Quant à la puissance militaire iranienne potentielle, reposant certes sur de gros bataillons d’infanterie mais aussi sur une aviation performante et sur une marine dotée de capacités d’intervention dans le Golfe, elle aurait géné les Américains et leurs alliés de la rive arabe du Golfe. En effet, par sa masse même, elle aurait fait peser la balance de son côté. La politique réelle des Américains est d’empêcher le constitution et la consolidation d’armées puissantes dans la zone du “milieu du monde”, car elles créeraient, le cas échéant, un hégémonisme régional ou, pire pour les Américains, pourraient s’allier à une puissance impériale eurasienne et lui offrir une façade sur l’Océan Indien. Depuis 1978, l’objectif a donc été de neutraliser l’armée du Shah, d’affaiblir ensuite l’armée de la République Islamique en utilisant pour l’étriller celle de Saddam Hussein pendant huit longues années et, enfin, de détruire lors de la première Guerre du Golfe de 1991, l’armée irakienne victorieuse des Iraniens mais rudement malmenée. Briser les armées de ces pays équivaut à créer le chaos sur la portion du “rimland” qu’ils occupent. Réhabiliter l’Iran, comme le voudraient Parsi et Baer, reviendrait à remettre en selle la doctrine Nixon d’un Iran allié aux Etats-Unis et hissé au rang de gendarme de la région. Mais ce retour à la doctrine Nixon serait simultanément la négation de toutes les autres politiques suivies depuis Kennedy et Carter, dans un but précis: affaiblir le pays pour qu’il ne retrouve plus jamais sa vocation impériale antique, sous quelque signe que ce soit.
La création et l’entretien de ce chaos relèvent forcément d’une stratégie globale, dont l’un des leviers est le fondamentalisme musulman. En effet, ni le Shah ni Saddam Hussein ne toléraient, sur les territoires où s’exerçait leur souveraineté, l’éclosion de réseaux de cette obédience: c’est là un fait historique patent qui nous permet d’affirmer que tous ceux qui, dans les milieux politiques non conformistes, chantent les louanges de l’un ou l’autre de ces fondamentalismes générateurs de chaos, ou leur apportent un soutien quelconque, font le jeu de Washington, car Washington a créé ce fondamentalisme pour installer un chaos permanent qui va uniquement dans le sens des intérêts américains.
Cette volonté d’assurer une hégémonie par le truchement d’un chaos permanent démontre bien clairement que les Etats-Unis agissent là comme une puissance foncièrement étrangère à l’espace eurasien ou grand-moyen-oriental. Ce chaos, et les cortèges d’horreurs qu’il entraîne, n’émeuvent pas l’Amérique outre mesure: la barrière des océans la sépare de ces aires de convulsions qu’elle a contribué à créer. Tous les débordements territoriaux éventuels de ces effroyables dissensus n’affecterait que des puissances tierces et limitrophes du “Vieux Monde”. De ce fait, seules des puissances effectivement étrangères à l’espace artificiellement “chaotisé” peuvent appliquer une telle stratégie. Mais celle-ci trahit une absence totale d’empathie que n’aurait pas un voisin, fût-il l’ennemi héréditaire le plus ancien et le plus tenace. Car tout voisin peut subir à terme les retombées d’un chaos indéfini qui sévit à ses portes. La puissance étrangère à l’espace délibérément “chaotisé”, elle, n’a pas ce souci. Les effets du chaos ne se ressentent pas sur son territoire.
Pour revenir aux événements d’Iran, postérieurs à mes conférences de Lille, Genève et Metz, les agences médiatiques internationales, téléguidées depuis Washington, ont tenté de déstabiliser Ahmadinedjad à la suite des récentes élections iraniennes. Elles évoquent une “fraude électorale” au détriment du candidat de l’opposition, Moussavi. La tentative de générer à Téhéran une “révolution orange”, sur le modèle ukrainien de fin 2004, avait sans doute pour but de créer un Iran “acceptable” et d’appliquer à cet “Etat rénové”, ayant derechef perdu son statut de “voyou”, la politique préconisée par Parsi et Baer. Cette nouvelle politique pro-iranienne de Washington ne peut aller dans le sens des voisins de l’Iran: ni l’Arabie Saoudite, sunnite et wahhabite et ennemie jurée du chiisme duodécimain iranien, ni la Russie qui y verrait une menace sur l’emprise qu’elle conserve sur les ex-républiques musulmanes et turcophones d’Asie centrale, ni la Chine qui y verrait effectivement un verrou pour ses désirs de projection pacifique vers l’Océan Indien. La logique eurasienne du Groupe de Changhai, consubstantiel à l’espace circum-iranien, se heurte ici, avec beaucoup de chances de triompher, à la logique interventionniste américaine, totalement étrangère à l’espace des rimlands et du coeur de l’Eurasie.
Et l’Europe dans tout ça, me demanderez-vous? Eh bien, l’Europe doit se projeter selon l’axe diagonal de Rotterdam à l’Inde et à l’Indonésie, axe de projection que nous avons préconisé dès le milieu des années 80, comme l’attestent plusieurs articles des revues “Vouloir” et “Orientations”, ainsi qu’une carte, dessinée par nos soins, imprimée dans le numéro 7 d’ “Orientations” (1986). Cette fois, non plus dans un rapport incertain avec une Russie communiste ou dans une attitude sceptique à l’égard de la logique binaire des blocs, mais dans un souci d’harmonie eurasienne, en accord avec la Russie, l’Inde, la Chine et le Japon. Cette projection diagonale a pour centre l’Iran. Nous revenons donc à l’essentiel de notre démonstration géopolitique, explicitée dans cet entretien.
00:20 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, iran, etats-unis, stratégie, moyen orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Wann war das Dritte Reich?
Wann war das Dritte Reich?
Betrachtungen zu Beginn und Ende der Imperii auf deutschem Boden
von Richard G. Kerschhofer - http://www.ostpreussen.de/
Von wann bis wann existierte das Dritte Reich. Von 1933 bis 1945, werden viele sagen und vielleicht ergänzen, von der Machtergreifung am 30. Januar 1933 bis zur Kapitulation am 9. Mai 1945. Leider unrichtig, wie zu zeigen ist. Außerdem ist Hitlers Bestellung zum Reichskanzler nicht „die Machtergreifung“, denn die war ein Vorgang, der lange vor 1933 begonnen hatte und sich danach noch fortsetzte. Bis alle gleichgeschaltet oder ausgeschaltet waren.
Begonnen haben kann das Dritte Reich erst nach dem Ende des Zweiten Reiches – doch wann war das? Ebenfalls eine schwierige Frage. Der Anfang hingegen ist eindeutig: Das Zweite Reich, das „Wilhelminische Deutschland“, begann am 18. Januar 1871, als König Wilhelm I. von Preußen zum Deutschen Kaiser ausgerufen wurde.
Ebenso eindeutig sind die Eckdaten beim „Ersten Reich“, auch „Altes Reich“ genannt. Es begann am 2. Februar 962, als der zum deutschen König gewählte Sachsenherzog Otto I. von Papst Johannes XII. in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Dieses Reich ist später als „Sacrum Imperium“ belegt, dann als „Sacrum Romanum Imperium“ – Heiliges Römisches Reich – und am Beginn der Neuzeit wurde „deutscher Nation“ hinzugefügt. Es endete am 6. August 1806, als Kaiser Franz II. die Reichskrone niederlegte. Er hatte bereits 1804 das Erzherzogtum Österreich zum Kaisertum gemacht und war Kaiser Franz I. von Österreich geworden. Aber durfte der Kaiser das Reich beenden? Ob er durfte oder nicht – er mußte, auf Druck Napoleons.
Das Alte Reich war kein Nationalstaat, nicht einmal ein Staat im modernen Sinn – und schon lange vor Napoleon nur mehr eine Fiktion. Goethe läßt in Auerbachs Keller den einen Saufkumpan ein Spottlied auf dieses Reich anstimmen. Ein anderer bringt ihn zum Schweigen: „Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied.“ Aber das wahrhaft Garstige war der dynastische Egoismus deutscher Fürsten, der das Reich in den Untergang trieb und die Anrainer zum Raub von Reichsgebiet einlud.
Das Erste Reich nannte sich nie „Erstes Reich“, denn kein Reich nimmt an, daß danach noch eines kommt. Auch das Zweite Reich nannte sich nicht „Zweites Reich“, denn für die allermeisten war es keine Wiedergeburt des Ersten Reiches. Es war ein weltliches Reich, keines „von Gottes Gnaden“, und es verkörperte nur die „kleindeutsche Lösung“, war also eher ein „großpreußisches Reich“.
Woher stammen dann die Ausdrücke „Erstes Reich“, „Zweites Reich“, „Drittes Reich“ und „Tausendjähriges Reich“? Sie kommen allesamt aus der Religion. Sie hängen zusammen mit dem „Millenarismus“ (lateinisch) oder „Chiliasmus“ (griechisch), mit dem Glauben an die Wiederkunft des Messias. Für „Drittes Reich“ steht auch „Tausendjähriges Reich“ – wobei „tausendjährig“ nach Ablauf des ersten Jahrtausends nicht mehr wörtlich genommen wurde, sondern soviel wie „ewig“ bedeuten sollte.
Erstmals in politischem Sinn verwendete diese Ausdrücke der deutsche Kulturhistoriker und Politiktheoretiker Arthur MOELLER VAN DEN BRUCK in seinem Buch „Das dritte Reich“ (1923). „Parteigenosse“ war er keiner und er starb schon 1925. Ob man ihn als „Wegbereiter“ bezeichnen kann, ist Geschmackssache, aber sicher erleichterte er die Arbeit nationalsozialistischer Ideologen. „Drittes Reich“ und „Tausendjähriges Reich“ paßten trefflich in das mythisch-mystische Gedankengebäude, das der religionsartigen Überhöhung einer durchaus weltlichen Politik diente. „Drittes Reich“ wird heute zwar pauschal für die NS-Zeit verwendet, war aber nicht mehr als ein Schlagwort der Propaganda. Es hatte nie ein Territorium und war nie ein Völkerrechtssubjekt.
Eines ist noch offen: Wann endete das Zweite Reich? Sicher nicht 1918, wie das die Nationalsozialisten sahen. Denn 1918 wie 1933/34 änderte sich jeweils nur die Regierungsform. 1938 entstand ein „Großdeutsches Reich“, das beinahe den großdeutschen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts entsprach. Aber auch wenn im „Anschluß-Gesetz“ (RGBl Nr. 28 vom 18.3.1938) „Großdeutsches Volksreich“ steht – völkerrechtlich blieb es wie 1918 das „Deutsche Reich“.
Der Ausdruck „Drittes Reich“ war jetzt nicht mehr erwünscht und ab 10. Juli 1939 auf Weisung von Goebbels den Medien sogar untersagt. „Großdeutsches Reich“ findet sich im Gesetz zur Einverleibung der Rest-Tschechoslowakei (RGBl Nr. 47 vom 16.3.1939) und in anderen amtlichen Texten. Jener Erlaß der Reichskanzlei, der das Deutsche Reich auch formell in „Großdeutsches Reich“ umbenannte (RK 7669 E vom 26. Juni 1943), wurde aber nicht mehr publiziert. „Großdeutsches Reich“ stand nur auf den Briefmarken.
Anders als das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wurde das Deutsche Reich nie durch irgendeinen Formalakt für beendet erklärt – nicht durch die Kapitulation, nicht durch die Besatzungsmächte, nicht durch Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, ja nicht einmal durch den „Zwei-Plus-Vier-Vertrag“. So wurde die Bundesrepublik zwar Rechtsnachfolgerin des nie für tot erklärten Reiches – mit allen daraus erwachsenen Nachteilen. Friedensvertrag gibt es aber keinen. Und auch Österreich hat nur einen „Staatsvertrag“ mit Einschränkungen der Souveränität, darunter das „Anschlußverbot“.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, histoire, troisième reich, années 20, années 30, années 40, europe centrale, définition, empire, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Opération Barbarossa: forces en présences et conclusions à tirer

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Opération Barbarossa: les forces en présence et les conclusions qu'on peut en tirer
par Joachim F. WEBER
Un matin d'été, 3 h 30. La nuit est sombre du Cap Nord à la Mer Noire. Tout d'un coup, l'air est déchiré par le fracas assourdissant des canons. Des milliers d'obus forment une pluie d'acier et martèlent le versant soviétique de cette frontière. Les positions avancées de l'Armée rouge sont matraquées. Et quand les premières lueurs du jour apparaissent, la Wehrmacht allemande et ses alliés franchissent la frontière et pénètrent en URSS.
C'était le 22 juin 1941. Un jour historique où l'Allemagne a joué son destin. La lutte âpre qui commence en ce jour va se terminer un peu moins de quatre années plus tard, dans les ruines de la capitale allemande, à Berlin. Pendant 45 ans, on nous a répété que cette défaite était le juste salaire, bien mérité, de l'acte que nous avions commis ce 22 juin. L'historiographie des vainqueurs de 1945 et de leur clientèle parmi les vaincus a présenté pendant plusieurs décennies l' comme une guerre d'extermination minutieusement planifiée, perpétrée par des parjures qui n'avaient pas respecté le pacte qui nous liait à notre voisine de l'Est. Les historiens qui osaient émettre des opinions différentes de celles imposées par cette sotériologie officielle n'ont pas rigolé pendant quarante-cinq ans! Mais aujourd'hui, alors que l'ordre établi à Yalta s'effondre, de gros lambeaux de légende s'en vont également en quenouille. En cette année 1991, cinquante ans après les événements, on pourrait pourtant examiner les tenants et aboutissants de cette guerre et de ses prolégomènes sans s'encombrer du moindre dogme. En effet, on est impressionné par le grand nombre d'indices qui tendent à réfuter la thèse officielle d'une attaque délibérée et injustifiée contre une Union Soviétique qui ne s'y attendait pas. Ces indices sont tellement nombreux qu'on peut se demander comment des historiens osent encore défendre cette thèse officielle, sans craindre de ne plus être pris au sérieux. Nous savons désormais assez de choses sur ce qui s'est passé avant juin 1941, pour ne plus avoir honte de dire que l'attaque allemande du 22 juin a bel et bien été une guerre préventive.
Un vieux débat
Pourtant ce débat pour savoir si l' a été une attaque délibérée ou une guerre préventive n'est ni nouveau ni original. Les deux positions se reflétaient déjà dans les déclarations officielles des antagonistes dès le début du conflit. Le débat est donc aussi ancien que l'affrontement lui-même. L'enjeu de ce débat, aujourd'hui, est de savoir si l'on veut continuer à regarder l'histoire dans la perspective des vainqueurs ou non.
L'ébranlement des armées allemandes qui a commencé en ce jour de juin a d'abord été couronné d'un succès militaire sans précédant. Effectivement, le coup brutal asséné par les troupes allemandes surprend la plupart des unités soviétiques. Par centaines, les avions soviétiques sont détruits au sol; les positions d'artillerie et les concentrations de troupes sont annihilées. Au prix de lourdes pertes en matériel, les Soviétiques sont contraints de reculer. Dès le début du mois de juillet, commencent les grandes batailles d'encerclement, où des centaines de milliers de soldats soviétiques sont faits prisonniers. En tout et pour tout, l'URSS perd, au cours des trois premières semaines de la guerre, 400.000 hommes, 7600 chars et 6200 avions: une saignée inimaginable.
C'est après ces succès inouïs que le chef de l'état-major général de l'armée de terre allemande, le Colonel-Général Halder, écrit dans son journal: . Une erreur d'appréciation, comme on n'en a jamais vue. Car au bout de 1396 jours, la campagne la plus coûteuse que l'Allemagne ait jamais déclenchée, se termine par une défaite.
Le désastre soviétique
Pourtant, le désastre soviétique paraissait complet. Au vu de celui-ci, on comprend l'euphorie de Halder, même si on ne prend pas seulement en considération les deux premières semaines de la guerre mais ses six premiers mois. Jusqu'à la fin de l'année 1941, la Wehrmacht fait environ trois millions de prisonniers soviétiques. C'est l'ampleur de ces pertes qui incite les défenseurs de la thèse de l'attaque délibérée à justifier leur point de vue: en effet, ces pertes tenderaient à prouver que l'Union Soviétique n'était pas préparée à la guerre, qu'elle ne se doutait de rien et qu'elle a été complètement surprise par l'attaque allemande.
Il est exact de dire, en effet, que l'Union Soviétique n'avait pas imaginé que l'Allemagne l'attaquerait. Néanmoins, il est tout-à-fait incongru de conclure que l'Union Soviétique ne s'était pas préparée à la guerre. Staline avait bel et bien préparé une guerre, mais pas celle qu'il a été obligé de mener à partir de juin 41. Pour les officiers de l'état-major allemand comme pour tous les observateurs spécialisés dans les questions militaires, c'est devenu un lieu commun, depuis 1941, de dire que l'avance allemande vers l'Est a précédé de peu une avance soviétique vers l'Ouest, qui aurait été menée avec beaucoup plus de moyens. La vérité, c'est que le déploiement soviétique, prélude à l'ébranlement des armées de Staline vers l'Ouest, n'a pas eu le temps de s'achever.
Comparer les forces
et les effectifs en présence
Lorsque l'on compare les forces et les effectifs en présence, on en retire d'intéressantes leçons. On ne peut affirmer que la Wehrmacht allemande —sauf dans quelques unités d'attaque aux effectifs réduits et à l'affectation localisée— était supérieure en nombre. Les quelque 150 divisions allemandes (dont 19 blindées et 15 motorisées), qui sont passées à l'attaque, se trouvaient en face de 170 divisions soviétiques massées dans la zone frontalière. Parmi ces divisions soviétiques, 46 étaient blindées et motorisées. En matériel lourd, la supériorité soviétique était écrasante. Les unités allemandes attaquantes disposaient de 3000 chars et de 2500 avions, inclus dans les escadrilles du front; face à eux, l'Armée Rouge aligne 24.000 chars (dont 12.000 dans les régions militaires proches de la frontière) et 8.000 avions. Pour ce qui concerne les pièces d'artillerie, la Wehrmacht dispose de 7000 tubes et les Soviétiques de 40.000! Si l'on inclut dans ces chiffres les mortiers, le rapport est de 40.000 contre 150.000 en faveur des Soviétiques. Le 22 juin, l'Armée soviétique aligne 4,7 millions de soldats et dispose d'une réserve mobilisable de plus de 10 millions d'hommes.
Les Landser allemands avançant sur le front russe constatent très vite comment les choses s'agençaient, côté soviétique: effectivement, les pertes soviétiques sont colossales, mais, ce qui les étonne plus encore, c'était la quantité de matériels que les Soviétiques étaient en mesure d'acheminer. Les Allemands abattent quinze bombardiers soviétiques et voilà qu'aussitôt vingt autres surgissent. Quand les Allemands arrêtent la contre-attaque d'un bataillon de chars soviétiques, ils sont sûrs que, très rapidement, une nouvelle contre-attaque se déclenchera, appuyée par des effectifs doublés.
Un matériel soviétique
d'une qualité irréprochable
Sur le plan de la qualité du matériel, la Wehrmacht n'a jamais pu rivaliser avec ses adversaires soviétiques. Alors qu'une bonne part des blindés soviétiques appartiennent aux types lourdement cuirassés KV et T-34 (une arme très moderne pour son temps), les Allemands ne peuvent leur opposer, avant 1942, aucun modèle équivalent. La plupart des unités allemandes sont dotées de Panzer I et de Panzer II, totalement dépassés, et de chars tchèques, pris en 1938/39.
Pourquoi l'Allemagne ne peut-elle rien jeter de plus dans la balance? Pour une raison très simple: après la victoire de France, l'industrie allemande de l'armement, du moins dans la plupart des domaines cruciaux, avait été remise sur pied de paix. Ainsi, les usines de munitions (tant pour l'infanterie que pour l'artillerie) avaient réduit leurs cadences, comme le prouvent les chiffres de la production au cours de ces mois-là. Est-ce un indice prouvant que l'Allemagne préparait de longue date une guerre offensive?
Concentration et vulnérabilité
Mais cette réduction des cadences dans l'industrie de l'armement n'est qu'un tout petit élément dans une longue suite d'indices. Surgit alors une question que l'on est en droit de poser: la supériorité soviétique était si impressionnante, comment se fait-il que la Wehrmacht n'ait pas été battue dès 1941 et que l'Armée Rouge ait dû attendre 1944-45 pour vaincre?. La réponse est simple: parce le gros des forces soviétiques était déjà massé dans les zones de rassemblement, prêt à passer à l'attaque. Cette énorme concentration d'hommes et de matériels a scellé le destin de l'Armée Rouge en juin 1941. En effet, les unités militaires sont excessivement vulnérables lorsqu'elles sont concentrées, lorsqu'elles ne se sont pas encore déployées et qu'elles manœuvrent avant d'avoir pu établir leurs positions. A ces moments-là, chars et camions roulent pare-chocs contre pare-chocs; les colonnes de véhicules s'étirent sur de longs kilomètres sans protection aucune; sur les aérodromes, les avions sont rangés les uns à côté des autres.
Aucune armée au monde n'a jamais pris de telles positions pour se défendre. Tout état-major qui planifie une défense, éparpille ses troupes, les dispose dans des secteurs fortifiables, aptes à assurer une défense efficace. Toute option défensive prévoit le creusement de réseaux de tranchées, fortifie les positions existantes, installe des champs de mines. Staline n'a rien fait de tout cela. Au contraire: après la campagne de Pologne et à la veille de la guerre avec l'Allemagne, Staline a fait démanteler presque entièrement la ligne défensive russe qui courait tout au long de la frontière polono-soviétique pour prévenir toute réédition des attaques polonaises; mieux, cette ligne avait été renforcée sur une profondeur de 200 à 300 km. Or, pourtant, l'Armée Rouge, pendant la guerre de l'hiver 1939-40 contre la Finlande, avait payé un très lourd tribut pour franchir le dispositif défensif finlandais. Toutes les mesures défensives, toutes les mesures de renforcement des défenses existantes, ont été suspendues quelques mois avant que ne commence l'. Les barrières terrestres ont été démontées, les charges qui minaient les ponts et les autres ouvrages d'art ont été enlevées et les mines anti-chars déterrées. Quant à la , bien plus perfectionnée, elle a subi le même sort, alors que, depuis 1927, on n'avait cessé de la renforcer à grand renfort de béton armé. Et on ne s'est pas contenté de la démonter en enlevant, par exemple, toutes les pièces anti-chars: on a fait sauter et on a rasé la plupart des bunkers qui la composaient. Ces démontages et ces destructions peuvent-ils être interprétés comme des mesures de défense? Le Maréchal soviétique Koulikov disait en juin 1941: .
Les dix corps aéroportés de Staline
Bon nombre d'autres mesures prises par les Soviétiques ne sauraient être interprétées comme relevant de la défense du territoire. Par exemple, la mise sur pied de dix corps aéroportés. Les troupes aéroportées sont des unités destinées à l'offensive. Entraîner et équiper des unités aéroportées coûtent des sommes astronomiques; pour cette raison budgétaire, les Etats belligérants, en général, évitent d'en constituer, ne fût-ce qu'un seul. L'Allemagne ne l'a pas fait, alors que la guerre contre l'Angleterre le postulait. Staline, pour sa part, en a mis dix sur pied d'un coup! Un million d'hommes, avec tous leurs équipements, comprenant des chars aéroportables et des pièces d'artillerie légères. Au printemps de l'année 1941, l'industrie soviétique, dirigée depuis sa centrale moscovite, ordonna la production en masse des planeurs porteurs destinés au transport de ces troupes. Des milliers de ces machines sont sorties d'usine. Staline, à l'évidence, comptait s'en servir pendant l'été 1941, car rien n'avait été prévu pour les entreposer. Or, ces planeurs n'auraient pas pu résister à un seul hiver russe à la belle étoile.
Ensuite, depuis la fin des années 30, l'industrie de guerre soviétique produisait des milliers d'exemplaires du char BT: des blindés de combat capables d'atteindre des vitesses surprenantes pour l'époque et dont le rayon d'action était impressionnant; ces chars avaient des chenilles amovibles, de façon à ce que leur mobilité sur autoroutes soit encore accentuée. Ces chars n'avaient aucune utilité pour la défense du territoire.
En revanche, pour l'attaque, ils étaient idéaux; en juillet 1940, l'état-major soviétique amorce la mise sur pied de dix armées d'avant-garde, baptisées pour tromper les services de renseignements étrangers. A ce sujet, on peut lire dans l'Encyclopédie militaire soviétique: (vol. 1, p. 256). Il s'agissait d'armées disposant de masses de blindés, en règle générale, de un ou de deux corps dotés chacun de 500 chars, dont les attaques visait une pénétration en profondeur du territoire ennemi.
Les préparatifs offensifs de l'Armée rouge peuvent s'illustrer par de nombreux indices encore: comme par exemple le transport vers la frontière occidentale de l'URSS de grandes quantités de matériels de génie prévoyant la construction de ponts et de voies ferrées. Les intentions soviétiques ne pouvaient être plus claires.
Hitler prend Staline de vitesse
C'est sans doute vers le 13 juin que l'état-major général soviétique a commencé à mettre en branle son 1er échelon stratégique, donc à démarrer le processus de l'offensive. L'organisation de ce transfert du 1er échelon stratégique a constitué une opération gigantesque. Officiellement, il s'agissait de manœuvres d'été. A l'arrière, le 2ième échelon stratégique avait commencé à se former, dont la mission aurait été de prendre d'assaut les lignes de défense allemandes, pour le cas (envisagé comme peu probable) où elles auraient tenus bon face à la première vague.
Mais le calcul de Staline a été faux. Hitler s'est décidé plus tôt que prévu à passer à l'action. Il a précédé son adversaire de deux semaines. Côté soviétique, la dernière phase du déploiement du 1er échelon (trois millions d'hommes) s'était déroulée avec la précision d'une horloge. Mais au cours de ce déploiement, cette gigantesque armée était très vulnérable. Le matin du 22 juin, l'offensive allemande a frappé au cœur de cette superbe mécanique et l'a fracassée.
A ce moment, de puissantes forces soviétiques se sont déjà portées dans les balcons territoriaux en saillie de la frontière occidentale, notamment dans les régions de Bialystok et de Lemberg (Lvov). Les Allemands les ont encerclées, les ont forcées à se rassembler dans des secteurs exigus et les y ont détruites. Et ils ont détruit également d'énormes quantités de carburant et de munitions que les trains soviétiques avaient acheminés vers le front le matin même.
Staline jette ses inépuisables réserves dans la balance
Le désastre soviétique était presque parfait. Presque, pas entièrement. Les pertes étaient certes énormes mais les réserves étaient encore plus énormes. De juillet à décembre 1941, l'Union Soviétique a réussi à remettre sur pied 200 importantes unités, dont les effectifs équivalaient à ceux d'une division. La Wehrmacht n'a pas su en venir à bout. Pendant l'hiver, devant Moscou, l'Allemagne a perdu sa campagne de Russie. A partir de ce moment-là, la Wehrmacht n'a plus livré que des combats désespérés contre l'Armée Rouge, avec un acharnement aussi fou qu'inutile, tant l'adversaire était numériquement supérieur, et compensait ses pertes en matériel par les livraisons américaines.
Voici, en grandes lignes, les faits présents le 22 juin 1941. L'histoire des préliminaires de cette campagne de Russie, la question de savoir à quelle date précise les Allemands et les Soviétiques avaient décidé d'attaquer, restent matières à interprétation, d'autant plus que d'importantes quantités d'archives allemandes sont toujours inaccessibles, aux mains des vainqueurs, et que les archives soviétiques ne peuvent toujours pas être consultées par les chercheurs. La raison de ces secrets n'est pas difficile à deviner...
Joachim F. WEBER.
(texte issu de Criticón, Nr. 125, Mai/Juni 1991; adresse de la revue: Knöbelstrasse 36/0, D-8000 München 22).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, urss, staline, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





