Notes :
[1] A ce sujet, lire Philip Giraldi, « Rumors of War » (Foundation for strategic studies).
[2] L’Union européenne illustre la petite histoire favorite de Richard Holbrooke ; l’équipe de baseball de Charlie Brown (Peanuts) a été écrasée, et il s’étonne ; « comment pouvons-nous perdre quand nous sommes tellement sincères ? » (cité dans Foreign Affairs, may-june 2019).
[3] La lecture du livre de Philippe de Villiers, « J’ai tiré sur le fil du mensonge… » (Flammarion, 2018) interroge ; comment peut-il encore y avoir en France des rues, des lycées et des places qui portent le nom de ces deux collaborateurs au service de puissances étrangères, dont l’un a servi sous l’uniforme allemand, et qui tous les deux rendaient compte à Washington des débats stratégiques de leur Nation ?
[4] Quand Robert Kagan s’interroge sur le possible retour de la question allemande en Europe, il témoigne de l’inquiétude américaine devant l’inconscience géopolitique de l’Union.
[5] Voir la remarquable analyse de Charles et Louis-Vincent Gave, « Clash of Empires », Gavekal Books, January 2018.
[6] Cité dans « Pierre Manent, le regard politique », Flammarion, 2010.
dimanche, 26 mai 2019
L’Inde et les Nouvelles routes de la soie
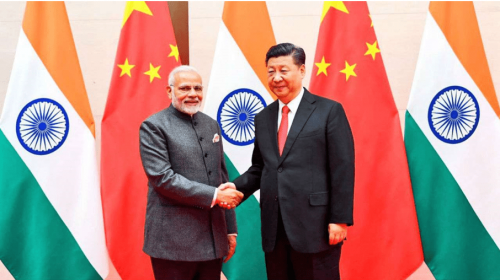
L’Inde et les Nouvelles routes de la soie
« Le ciel et l’océan d’Asie sont assez grands pour que le dragon et l’éléphant dansent ensemble, ce qui amènera à une véritable ère asiatique », a dit un diplomate chinois à la Conférence sur les Nouvelles routes de la Soie à Bombay en 2017[1]. Démontrant ainsi l’importance pour la Chine d’une participation indienne qui légitimerait la devise de Xi Jinping : « l’Asie pour les Asiatiques ».
Il y a quelques années, la « One Belt One Road », a pris le nom de « Belt Road Initiative », afin de corriger l’impression d’une route unique qui courrait à travers l’Eurasie et l’Océan Indien[2]. Cette initiative est le plus souvent dénommée « Nouvelles routes de la Soie » en français. Il s’agit en réalité d’un réseau de coopération régional, initié par les Chinois, avec des projets d’envergure mondiale, qui devrait traverser 65 pays. Ces projets de connectivité et d’infrastructure cherchent à connecter la Chine à ses voisins asiatiques, et d’accéder à l’Europe via l’Asie Centrale et l’Océan indien. Pour ce faire, voies ferroviaires, routes et ports devraient être construits ou modernisés. Il s’agit en réalité de rassembler en un grand programme différentes initiatives qui lui précèdent. Pour autant, les discussions se font principalement sur un mode bilatéral[3].
L’Inde se trouve directement sur les Nouvelles routes de la Soie. Pour certains[4], il s’agit d’une opportunité pour l’Inde, qui serait à même de choisir les projets qui créeraient des bénéfices durables (notamment dans le Nord-Est de l’Inde), tout en rejetant ceux qui seraient entièrement à l’avantage de la Chine. « L’éléphant » serait en effet l’un des rares pays à avoir une économie et un régime politique suffisamment forts pour résister aux désirs hégémoniques du « dragon ».
Cette vue n’est néanmoins pas celle de la majorité des hommes politiques indiens, qui s’inquiètent aujourd’hui des conséquences de cette poussée chinoise. En effet, les Nouvelles routes de la Soie menacent directement l’Inde sur son territoire, et semblent se resserrer en étau autour du pays. L’Inde attaque la Chine sur son manque de transparence avec le soutien européen, américain, et asiatique et africain dans une certaine mesure, mais il est peu probable que cela suffise, d’où le lancement d’initiatives indiennes et de coopérations dans la région.

I/ Un passage controversé par le Cachemire et un encerclement régional
Le projet est particulièrement controversé sur la partie nord-ouest de l’Inde avec le « China Pakistan Economic Corridor » (CPEC). Ce projet de couloir économique est constitué de prêts et d’investissements qui pourraient atteindre la somme de 60 milliards de dollars, sur une distance de 2700 km[5]. Ce réseau est un ensemble d’autoroutes, de lignes ferroviaires, d’oléoducs, de ports, et de parcs de technologie de l’information[6]. Il s’étend de la préfecture de Kashgar (dans la région chinoise du Xinjiang) jusqu’au port de Gwadar (province du Baloutchistan au Pakistan), permettant un accès à la mer d’Arabie. Or, ce couloir passe par un territoire indien et occupé illégalement par le Pakistan depuis de nombreuses années[7]. Si l’on peut considérer, comme le fait Talmiz Ahmad[8], que cela permettra de développer le Pakistan et donc de réduire les causes de l’extrémisme, il n’en demeure pas moins que la souveraineté de l’Inde est mise à mal, et cela renforce la position du Pakistan sur ce territoire. Il ne faut pas oublier que la Chine estime avoir droit au Ladakh, dans la région du Jammu et Cachemire, ce qui rend les Indiens d’autant plus soupçonneux vis-à-vis du CPEC. En outre, et nous y reviendrons, le risque persiste de voir les Chinois transformer ces installations civiles en base navale militaire.
Ce projet a rencontré de nombreuses critiques au sein même du Pakistan, notamment car il risque de réveiller des tensions entre le centre et les unités fédérées, mais aussi au sein mêmes des provinces. Cela est dû aux inégalités que le CPEC risque de causer en ce qui concerne le développement économique et la distribution des ressources[9]. Il est par ailleurs probable que le Penjab pakistanais soit le principal bénéficiaire des projets d’infrastructure et industriels, alors même qu’il s’agit déjà de la province la plus riche et la plus influente du pays sur le plan politique. Mais même là, les Penjabi résisteront sans doute à l’achat de leurs terres par l’Etat.
La situation au Baloutchistan semble tout aussi compliquée en raison des sentiments qui y règnent déjà d’une exploitation et d’un abandon de la part du pouvoir central. La province ne recevra en outre aucun des bénéfices directs du port de Gwadar, et la colère des habitants n’en devient que plus plausible, d’autant que la zone devient hautement militarisée et que les locaux sont déplacés et privés de leur lien vital à leurs terres. Le CPEC ne résoudrait donc en rien les problèmes considérés comme à la racine du problème extrémiste, contrairement à ce qu’espère Talmiz Ahmad, puisque cela pourrait, au contraire, accentuer les inégalités.

En vérité, le CPEC ne constitue que l’un des aspects de la menace chinoise pour l’Inde à travers ce projet. Six des pays voisins ont ainsi signé des accords avec la Chine : le Pakistan donc, mais aussi Sri Lanka, le Bangladesh, le Népal, la Birmanie, et l’Afghanistan. Il n’est pas surprenant, dans ce contexte, que l’Inde voie d’un très mauvais œil ce projet. Ces pays ont un réel besoin d’infrastructure, et apprécient une aide économique non-conditionnée par des engagements de gouvernance ou de transparence[10].
L’un des aspects qui inquiètent le plus l’Inde est en vérité la présence chinoise dans l’Océan Indien. Ses agissements en Mer de Chine méridionale, notamment la construction d’îles[11], pourraient être reproduits. Dans la mesure où Beijing a officiellement établi à Djibouti sa première base militaire à l’étranger en 2017[12], ces inquiétudes ont tendance à se confirmer. Ainsi, la crainte de voir le port de Gwadar se transformer en base navale militaire grandit. Des ports sont également construits en Birmanie, à Sri Lanka. Des sous-marins chinois ont même accosté au Pakistan et à Sri Lanka[13]. Le port sri lankais de Hambantota est d’ailleurs le parfait exemple de la stratégie chinoise : son emplacement stratégique, son financement chinois dont le remboursement est insoutenable pour le pays d’emprunt, et finalement la cession du port et de plus de 6000 hectares alentours pour 99 ans en 2017[14]. L’accord avec la Chine aurait en outre inclus un échange de renseignement dès le départ[15].
II/ Le gouvernement de Modi a fait appel au besoin de transparence et d’égalité
Pour faire face à ce défi, l’Inde a appelé à ce que les projets transnationaux suivent « des normes internationales universellement reconnues, l’Etat de droit, la transparence et les standards internationaux »[16] – une remarque qui fait clairement référence aux Nouvelles routes de la Soie. En effet, il devient évident que les projets sont unilatéraux : non seulement l’endettement envers la Chine n’est pas viable pour les pays ayant contracté des prêts, mais les transferts de compétences semblent inexistants puisque des travailleurs chinois sont envoyés sur place, n’offrant donc aucun emploi aux locaux[17]. En outre, des études de faisabilité au sujet du port sri lankais précité avait estimé que le port ne fonctionnerait pas, et se sont avérées juste puisque 34 bateaux seulement s’y sont rendus en 2012 (contre 3667 dans le port de Colombo, selon le rapport annuel du ministère des Finances cité par Maria Abi-Habib)[18]. Or, tandis que l’Inde avait refusé, la Chine a proposé des prêts, à des taux plus importants que n’importe quel autre prêteur[19]. Ces pratiques sont aussi considérées comme alimentant la corruption (notamment la campagne du président ayant accepté l’accord chinois dans le cas de Ceylan) et les comportements autocratiques dans des démocraties en difficulté[20].
Les reproches exprimés par l’Inde sont soutenus non seulement par l’Europe, mais aussi par les Etats-Unis, le Japon, et l’Australie. S’il est vrai que l’Italie et les pays de l’Est sont particulièrement courtisés par Pékin, toute l’Union européenne est concernée, et elle essaie actuellement de faire front commun[21].
Ces critiques sont également de plus en plus virulentes au sein des organisations internationales et des pays asiatiques et africains, qui commencent à résister à la Chine. Ainsi, au Bangladesh, China Harbour devrait être interdit de contrats futurs en raison d’accusations de corruption envers cette entreprise, qui aurait tenté de soudoyer un fonctionnaire au ministère des Routes[22]. De la même façon, la société-mère, China Communications Construction Company avait été interdite de participer à des projets de la Banque mondiale pour huit ans en 2009, après des actes de corruption aux Philippines[23].
Les accords avec la Chine commencent même à se retourner contre les gouvernements impliqués lors d’élections. En Malaisie, le nouveau Premier Ministre a été élu après avoir remis en cause les investissements chinois dans la campagne – et a annulé un projet de route ferroviaire à 20 milliards de dollars et plusieurs projets de gazoducs et d’oléoducs d’une valeur de 3 milliards de dollars[24]. Aux Maldives, le nouveau Ministre des Finances a remis en cause la préférence chinoise du Premier Ministre, et s’est tourné vers l’Inde[25]. En Afrique, enfin, certains pays annulent ou ralentissent les projets, à cause des énormes dettes qui les accompagnent[26].
L’aspect environnemental, souvent oublié, doit pourtant être pris en compte, et est source d’inquiétudes pour les ONG comme les think tanks : les projets proposés par la Chine auront en effet un impact considérable sur les zones concernées. Ceci est particulièrement vrai du fait que les principaux corridors d’infrastructure traverseront des espaces sensibles écologiquement, et les routes et voies ferroviaires vont mettre en danger les plantes et les animaux des écosystèmes aux alentours. Plus de 265 espèces en danger seraient affectées, et l’accès à des zones reculées jusqu’ici pourrait augmenter le risque de braconnage[27]. Les nouvelles routes de la Soie seront, en outre, un moyen pour la Chine d’exporter une économie qui s’appuie sur les énergies fossiles[28] – dont on connaît déjà les effets néfastes. Pour autant, le pays produit également nombre de technologies liées aux énergies renouvelables, terrain sur lequel elle est en compétition directe avec l’Inde. Le gouvernement Modi a d’ailleurs imposé des taxes à l’importation des panneaux solaires chinois, mais cela ne suffira sans doute pas, là encore, à contrer son rival.
III/ L’Inde doit, pour faire face au désir d’expansion chinoise, créer ses propres projets de coopération
Il est évident, au regard du défi qui se pose à l’Inde, qu’elle doit réagir. S’il est vrai que ses voisins cherchent à contrebalancer les deux puissances, ils semblent aujourd’hui se détourner du projet chinois, et cela peut constituer une opportunité pour la République indienne.
Le Japon, les Etats-Unis, l’Union européenne ou encore les Emirats arabes unis ont démontré un intérêt à travailler avec l’Inde en Afrique, afin de contrer la Chine et d’éviter l’endettement de ces pays[29]. Une coopération avec le Japon, en particulier, semble se développer, à travers le Asia Africa Growth Corridor. Ils pourraient notamment travailler ensemble sur des projets en Birmanie, à Sri Lanka et au Bangladesh[30].
L’Inde pourrait également investir davantage dans le groupe BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation). Etabli en 1997 avec l’intention d’organiser des sommets tous les deux ans, il n’a pourtant vu que trois sommets en deux décennies. Le contexte géopolitique régional a néanmoins relancé une certaine dynamique au sein de ce groupe régional, qui inclue l’Inde, le Bangladesh, le Boutan, la Birmanie, le Népal, Sri Lanka et la Thaïlande. Les secteurs de coopération sont nombreux, puisqu’ils comprennent le commerce, la technologie, l’énergie, le transport, le tourisme, la pêche, l’agriculture, la santé, la lutte contre la pauvreté, le contre-terrorisme, l’environnement, la culture, les contacts entre les peuples et le changement climatique[31]. Des programmes tels la voie ferroviaire trilatérale entre l’Inde, la Birmanie et la Thaïlande et le projet Kaladan, qui permet un accès à la mer pour les États du nord-est de l’Inde via Myanmar, par exemple, doivent encore être finalisés[32]. Il faudra pour cela parvenir à convaincre le Népal et la Thaïlande, qui n’ont pas voulu envoyer plus que des observateurs au premier exercice militaire du groupe afin de ne pas contrarier la Chine[33], que cette coopération est également dans leur intérêt.

Il est tout aussi crucial pour l’Inde de s’assurer que les régions isolées du sous-continent soient mieux connectées à l’ensemble du pays. En effet, un certain nombre de capitales des États du nord-est ne bénéficient ni de ligne ferroviaire pour accéder à leur capitale[34], ni internet : seule 35% de la population de ces États aurait accès à internet[35]. Ainsi le gouvernement a annoncé en 2017 son intention de construire l’« Himalayan rail-express », une ligne ferroviaire rapide qui devrait relier Leh (Jammu et Cachemire) à Hawai (Arunachal Pradesh)[36]. La région du Ladakh au Cachemire fait elle aussi l’objet d’influences chinoises, par la voie de la restauration de monastères bouddhistes, méthode qu’elle emploie également au Tibet[37]. Il faut noter que la visite du Dalai Lama en Arunachal Pradesh a causé des remous[38], et il n’est pas impossible que ce haut lieu du bouddhisme tibétain (où le sixième Dalai Lama est né) fasse l’objet de tentatives d’actions similaires à celles dévoilées au Cachemire.
Dans un tel contexte de tensions et de jeux d’influence, il est aisé de comprendre les réticences de l’Inde vis-à-vis du projet chinois des Nouvelles routes de la Soie. Cette initiative apparaît de plus en plus clairement comme unilatérale, au seul avantage de la Chine. Il est vrai que cette dernière essaie d’impliquer l’Inde, ce qui lui permettrait d’éviter la confrontation. Mais le rival historique ne semble pas près de se laisser convaincre, pour les multiples raisons que nous avons pu évoquer, et qui concernent sa sécurité sur les plans internes comme externes. Dans ce contexte, la coopération avec ses voisins tout comme avec d’autres puissances semble primordiale pour l’Inde.
Cela ne signifie pas une confrontation directe entre les deux puissances asiatiques – elles auraient toutes deux beaucoup à perdre. Elles travaillent d’ailleurs ensemble sur d’autres projets : c’est le cas en Afghanistan. En octobre 2018, elles ont ainsi lancé un programme de formation pour des diplomates afghans, et cela devrait être suivi d’autres projets[39].
[1] AHMAD Talmiz, « India needs to take a fresh look at the Belt and Road Initiative Proposal », The Wire, 2 juillet 2018.
[2] Art. Cit.
[3] BARUAH Darshana M. , « India’s answer to the Belt and Road: A Roadmap for South Asia », Carnegie India, 21 août 2018.
[4] SHAHANE Girish, « India stands to gain the most and risks the least by joining China’s One Belt One Road initiative », Scroll.in, 14 juillet 2018
[5] International Crisis Group, « China-Pakistan Economic Corridor: Opportunities and Risks », Rapport n°297, 29 juin 2018.
[7] Ibid.
[8] AHMAD Talmiz, art. cit.
[9] International Crisis Group, doc. cit.
[10] MARLOW Iain, LI Dandan, « How Asia Fell Out of Love With China’s Belt and Road Initiative », Bloomberg, 10 décembre 2018.
[11] COURMONT Barthélémy, « Mais que se passe-t-il en mer de Chine méridionale ? », IRIS, 27 août 2018.
[13] Ibid.
[14] ABI-HABIB Maria, « How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port », New York Times, 25 juin 2018.
[15] Art. cit.
[16] SIROHI Seema, « India-US-EU Combine Halts China’s Belt and Road Initiative at the UN », The Wire, 12 décembre 2018.
[17] Art. cit.
[18] ABI-HABIB M., art. cit.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] RFI, « L’Europe s’interroge sur sa position face aux ambitions économiques de la Chine », 23 mars 2019.
[22] Art. cit.
[23] Ibid.
[24] MARLOW I., LI D., art. cit.
[25] Ibid.
[26] CHAUDHURY Dipanjan Roy, « Europe, Japan, US, UAE prefer India for joint infrastructure projects in Africa », Economic Times, 24 novembre 2018.
[27] LA SHIER Brian, « Exploring the Environmental Repercussions of China’s Belt and Road Initiative », Environmental and Energy Study Institute, 3 octobre 2018.
[28] Doc. cit.
[29] CHAUDHURY D.R., art. cit.
[30] SINGH Gurjit, « India, Japan and the Asia Africa Growth Corridor », Gateway House, 17 janvier 2019.
[31] India Today Web Desk, « What is BIMSTEC summit? Facts you need to know », India Today, 30 août 2018.
[32] HUSSAIN Nazia, « Can BIMSTEC Finally Become Relevant? », The Diplomat, 2 novembre 2018.
[33] HAIDAR Suhasini, PERI Dinakar, « BIMSTEC embarrassment for India », The Hindu, 11 septembre 2018.
[34] HAIDAR Faizan, « By 2020, capitals of all northeastern states to have rail connectivity », Hindustan Times, 10 mai 2018.
[35] KALITA Prabin, «Northeast states lag behind in internet, mobile connectivity », Times of India, 18 décembre 2018.
[36] BARUAH D. M., Ibid.
[37] PATIL Sameer, « China targets India’s Ladakh », Gateway House, 21 juin 2018.
[38] Press Trust of India, « Dalai Lama’s Arunachal Pradesh visit negatively impacts border dispute, says China », Economic Times, 12 juillet 2018.
[39] MIGLANI Sanjeev, « India, China launch joint training for Afghanistan, plan more projects », Reuters, 15 octobre 2018.
Références
ABI-HABIB Maria, « How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port », New York Times, 25 juin 2018. URL : https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-l.... Consulté le 8 avril 2019.
AHMAD Talmiz, « India needs to take a fresh look at the Belt and Road Initiative Proposal », The Wire, 2 juillet 2018. URL : https://thewire.in/diplomacy/india-needs-to-take-a-fresh-.... Consulté le 5 avril 2019.
BARUAH Darshana M., « India’s answer to the Belt and Road: A Roadmap for South Asia », Carnegie India, 21 août 2018. URL : https://carnegieindia.org/2018/08/21/india-s-answer-to-be.... Consulté le 5 avril 2019.
CHAUDHURY Dipanjan Roy, « Europe, Japan, US, UAE prefer India for joint infrastructure projects in Africa », Economic Times, 24 novembre 2018. URL : https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrast.... Consulté le 8 avril 2018.
COURMONT Barthélémy, « Mais que se passe-t-il en mer de Chine méridionale ? », IRIS, 27 août 2018. URL : http://www.iris-france.org/116542-mais-que-se-passe-t-il-.... Consulté le 5 avril 2019.
DEJOUHANNET Lucie, « DP 8109 : L’Inde, puissance en construction », La documentation française, 26 août 3016. URL : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/territoire.... Consulté le 23 avril 2019.
GAUTHE Thierry, « Cartographie. Avec les nouvelles routes de la soie, la Chine tisse une toile mondiale », Courrier international, 14 septembre 2018. URL : https://www.courrierinternational.com/grand-format/cartog.... Consulté le 9 avril 2019.
HAIDAR Faizan, « By 2020, capitals of all northeastern states to have rail connectivity », Hindustan Times, 10 mai 2018. URL : https://www.hindustantimes.com/india-news/by-2020-capital.... Consulté le 8 avril 2019.
HAIDAR Suhasini, PERI Dinakar, « BIMSTEC embarrassment for India », The Hindu, 11 septembre 2018. URL : https://www.thehindu.com/news/national/bimstec-embarrassm.... Consulté le 8 avril 2019.
HUSSAIN Nazia, « Can BIMSTEC Finally Become Relevant? », The Diplomat, 2 novembre 2018. URL : https://thediplomat.com/2018/11/can-bimstec-finally-becom.... Consulté le 8 avril 2019.
India Today Web Desk, « What is BIMSTEC summit? Facts you need to know », India Today, 30 août 2018. URL : https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affa.... Consulté le 8 avril 2019.
International Crisis Group, « China-Pakistan Economic Corridor: Opportunities and Risks », Rapport n°297, 29 juin 2018. URL : https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/297-.... Consulté le 5 avril 2019.
KALITA Prabin, «Northeast states lag behind in internet, mobile connectivity », Times of India, 18 décembre 2018. URL : https://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/northea.... Consulté le 8 avril 2019.
LA SHIER Brian, « Exploring the Environmental Repercussions of China’s Belt and Road Initiative », Environmental and Energy Study Institute, 3 octobre 2018. URL : https://www.eesi.org/articles/view/exploring-the-environm.... Consulté le 8 avril 2019.
MARLOW Iain, LI Dandan, « How Asia Fell Out of Love With China’s Belt and Road Initiative », Bloomberg, 10 décembre 2018. URL : https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-10/how-as.... Consulté le 5 avril 2019.
MIGLANI Sanjeev, « India, China launch joint training for Afghanistan, plan more projects », Reuters, 15 octobre 2018. URL : https://www.reuters.com/article/us-india-china-afghanista.... Consulté le 5 avril 2019.
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, direction des Archives (pôle géographique), « Asie méridionale », avril 2019. URL : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/jpg/asie_meridionale_c.... Consulté le 23 avril 2019.
PATIL Sameer, « China targets India’s Ladakh », Gateway House, 21 juin 2018. URL : https://www.gatewayhouse.in/china-targets-indias-ladakh/. Consulté le 8 avril 2019.
Press Trust of India, « Dalai Lama’s Arunachal Pradesh visit negatively impacts border dispute, says China », Economic Times, 12 juillet 2018. URL : https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/dalai-l.... Consulté le 8 avril 2019.
RFI, « L’Europe s’interroge sur sa position face aux ambitions économiques de la Chine », 23 mars 2019. URL : http://www.rfi.fr/europe/20190322-europe-economiques-chin.... Consulté le 5 avril 2019.
SHAHANE Girish, « India stands to gain the most and risks the least by joining China’s One Belt One Road initiative », Scroll.in, 14 juillet 2018. URL : https://scroll.in/article/882411/india-stands-to-gain-the.... Consulté le 5 avril 2019.
SINGH Gurjit, « India, Japan and the Asia Africa Growth Corridor », Gateway House, 17 janvier 2019. URL : https://www.gatewayhouse.in/japan-aagc/. Consulté le 5 avril 2019.
SIROHI Seema, « India-US-EU Combine Halts China’s Belt and Road Initiative at the UN », The Wire, 12 décembre 2018. URL : https://thewire.in/diplomacy/india-china-belt-and-road-un.... Consulté le 5 avril 2019.
00:13 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, routes de la soie, asie, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 25 mai 2019
Les routes de la soie au prisme du néo-eurasisme de Douguine : retour de Béhémoth ou triomphe du Léviathan ?

Les routes de la soie au prisme du néo-eurasisme de Douguine : retour de Béhémoth ou triomphe du Léviathan ?
« La Grande Eurasie n’est pas un arrangement géopolitique abstrait, mais, sans exagération, un projet à l’échelle civilisationnelle, tourné vers l’avenir.»
Vladimir Poutine, mai 2017
« L’histoire mondiale est l’histoire de la lutte des puissances maritimes contre les puissances continentales et des puissances continentales contre les puissances maritimes »
Carl Schmitt, 1942
Au cœur de la stratégie politique et commerciale internationale de la Chine depuis 2013, le système multi-vectoriel de projets des nouvelles routes de la soie (appelé officiellement Belt and Road Initiative, BRI1 depuis mai 2017), qui souhaite connecter les économies chinoises, européennes, africaines et centre-asiatiques par une densification des réseaux d’infrastructures de transports et de communication, se concrétise chaque jour un peu plus sérieusement. Avec ses différents volets (construction d’infrastructures terrestres et maritimes, coopération économique, énergétique et sociétale), c’est sans doute l’entreprise la plus ambitieuse au monde et, au vu du potentiel de développement économique et des implications géopolitiques qu’elle comporte2, elle suscite de plus en plus de partenariats.
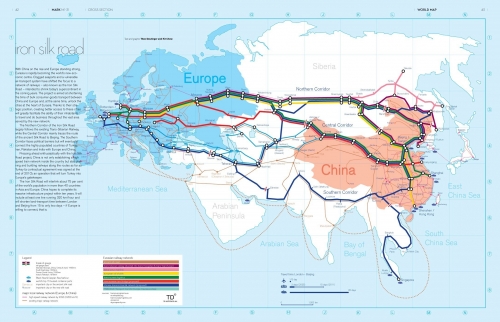
Le 9 avril dernier s’est ainsi tenu à Bruxelles le 21ème sommet Chine-Union Européenne, occasion pour l’UE de déterminer une position commune vis-à-vis de la BRI et de discuter des synergies possibles avec son plan européen de connectivité Europe-Asie4, alors que, l’une après l’autre, les nations européennes signent bilatéralement des engagements dans le projet5.
Bien plus que les timides rapprochements des Européens, c’est la perspective de l’édification d’un axe Moscou-Pékin autour de cette initiative qui soulève les analyses géopolitiques les plus audacieuses : Ressurgirait la vieille menace, préfigurée par Mackinder en 1904 dans les propos concluants son « Pivot géographique de l’histoire »6, d’une Chine qui offrirait aux ressources immenses du continent une large façade océanique (ce qui caractérisait pour lui le véritable « péril jaune » menaçant la liberté du monde). En somme un « empire terrien eurasiatique » dominant le Heartland pourrait émerger et reléguer les puissances maritimes occidentales au second rang dans la rivalité générale pour la domination mondiale.Un tel traitement nous ramènerait aux fondamentaux de la discipline par une réappropriation de la dialectique Terre-Mer pour analyser le phénomène routes de la soie. Elle fascine toujours autant de par sa dimension symbolique et son caractère quelque peu réducteur, la rendant accessible au plus grand nombre.
Cela dit, il est vrai que depuis 2014 Russie et Chine ont opéré un rapprochement bilatéral notable7 et coopèrent de plus en plus activement au travers de la BRI : ainsi en mai 2015 fut-il décidé que l’initiative d’intégration continentale portée par la Russie, l’Union économique eurasiatique (UEE), y soit raccordée8 et en novembre 2017 la « route maritime du Nord » est devenue un des corridors de la BRI9. On relève aussi l’imbrication de l’initiative avec le développement de la coopération sino-russe au sein de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS)10.
De facto, une certaine unification continentale dans l’espace eurasiatique semble donc s’esquisser11. Ceci pourrait alors confirmer la portée heuristique persistante de la clé de lecture Terre-Mer. Mais c’est surtout lorsque l’on entre dans une géopolitique des perceptions que cette dialectique conserve sa pertinence : Il existe en effet un paradigme géopolitique affirmant explicitement la nécessité pour la Russie de briser l’hégémonie des puissances maritimes et de reconstituer une unité politique sur la masse continentale eurasiatique, notamment en développant un partenariat stratégique avec la Chine. Cette vision est portée par les auteurs constituant le mouvement d’idée du néo-eurasisme12. C’est une doctrine très en vue en Russie mais aussi dans d’autres États d’Asie Centrale, notamment au Kazakhstan où l’(ex-)président Nursultan Nazarbaev la soutient explicitement13.
Parmi les différents faisceaux composant le mouvement néo-eurasiste, un auteur se distingue : Alexandre Douguine14. Sa pensée, bien que plus marginale aujourd’hui, a connu ses heures de gloire et continue d’inspirer une partie des élites dirigeantes russes, tout en nourrissant bien des fantasmes chez les commentateurs étrangers15. S’il est issu de la pensée eurasiste classique, il y adjoint des filiations intellectuelles peu habituelles qui singularisent ses propositions, les amenant dans un registre métapolitique, métahistorique et culturaliste : Le monde des phénomènes n’est pour lui que le reflet des puissances archétypales qui le meuvent depuis l’invisible et sa pensée s’inscrit dans la bataille gramscienne16 pour l’« hégémonie culturelle »17.

Les analyses ne manquent pas pour venir questionner les convergences et les limites des projets russes et chinois au-regard des ambitions géopolitiques eurasistes, mais elles s’inscrivent généralement sur des plans stratégique, économique, financier, juridique. Dans cette étude, nous souhaiterions sortir de l’empire des faits pour plonger plus profondément dans le monde des idées. Nous proposerons une lecture du phénomène nouvelles routes de la soie à travers le prisme de la doctrine géopolitique d’Alexandre Douguine, en essayant de nous approprier son discours original, structurant la vision-du-monde de certains acteurs impliqués dans le complexe de la BRI.
Nous nous demanderons donc si la Belt and Road Initiative participe de la constitution d’un bloc continental eurasien face à la thalassocratie atlantiste compatible avec les fondamentaux proposés par Alexandre Douguine pour la politique étrangère russe.
Nous exposerons synthétiquement les contenus de la doctrine géopolitique douguinienne et nous verrons que si les projets de la BRI s’inscrivent bien dans un renversement de la hiérarchie des puissances à l’échelle globale marqué par une revalorisation de l’« île mondiale » – donc à un balancement au profit de la Terre –, l’initiative pourrait constituer, sur un plan plus culturaliste, une submersion du continent par la Mer.
Les fondamentaux de la géopolitique d’Alexandre Douguine : la dialectique Terre-Mer revisitée par la « pensée de la Tradition »
Alexandre Douguine s’inscrit dans une filiation géopolitique a priori classique, à la suite de Ratzel (1882, 1900), Mahan (1892), Castex (1935), Mackinder (1904), Spykman (1944), puisqu’il reprend la récurrente opposition Terre-Mer : « La civilisation thalassique, anglo-saxonne […] serait irréductiblement opposée à la civilisation continentale, russe-eurasienne »19, et le cœur de leur affrontement serait le contrôle du Rimland20. Il a surtout hérité des conceptions allemandes, adoptant un prisme foncièrement culturaliste21 : Il associe comme intrinsèques à la civilisation thalassique les attributs de « protestante, d’esprit capitaliste » tandis que la civilisation continentale serait « orthodoxe et musulmane, d’esprit socialiste ». Il figure parmi les tenants d’une approche plutôt déterministe de cette dichotomie, prise non seulement comme clé de compréhension de la politique au niveau global mais aussi comme véritable « explication de l’histoire ». C’est là toute l’originalité de notre auteur, puisqu’il établit un parallélisme entre cette dichotomie, devenue classique en géopolitique, et la dialectique Tradition-Modernité.
Ce second couple conceptuel n’est pas appréhendé selon ses présentations dans la littérature anthropologique ou sociologique, mais entendu selon l’acception originale portée par une école parfois qualifiée de « pensée de la Tradition »22 qui présente des catégories de pensée très éloignées de celles que l’on rencontre habituellement dans le monde académique contemporain et déployée à la suite de l’œuvre du Français René Guénon. La Tradition renvoie chez ces auteurs « traditionistes »23 à une « Sagesse Éternelle » (Sophia Perennis), une connaissance sacrée, immuable et transcendante transmise aux hommes depuis l’origine de l’humanité. Cette Tradition connaîtrait cependant nécessairement un processus d’obscurcissement à travers les âges (afin que toutes les possibilités de l’Être se manifestent, même les plus inférieures), l’avènement du monde moderne correspondant selon eux à la dernière étape de cette dégradation, une ère chaotique précédent la résorption du monde dans l’incréé – ce que l’on retrouve dans les traditions spirituelles comme étant la « fin des temps ». Pour de tels auteurs, la politique ou l’histoire n’ont de sens qu’en tant qu’elles révèlent l’incarnation de principes métaphysiques – ou archétypes – c’est pourquoi nous évoquions en introduction les termes de métapolitique24 et de métahistoire.
Douguine reprend ces conceptions et s’inscrit parmi ces auteurs traditionistes : Chez lui, la puissance maritime « atlantiste » représenterait les forces de dissolution entraînant le monde moderne vers le chaos, tandis que l’Eurasie aurait pour vocation d’être le bastion de la Tradition, le katechon paulinien25 résistant à la venue des Temps. Ainsi dans son œuvre « l’eschatologie se mêle à la géopolitique », puisqu’il la déploie à partir de postulats visant à se positionner politiquement en fonction des fins dernières de l’homme et des entités politiques. Ce prisme métaphysique l’amène à étudier la politique, l’histoire ou la géographie seulement à travers les principes supérieurs qu’elles incarnent. La Russie et les puissances eurasiatiques deviennent l’incarnation de l’archétype structurant « Terre » (Béhémoth), représentant la Tradition, tandis que les stratégies des États-Unis et de leurs alliés sont lues comme faisant le jeu de l’archétype dissolvant « Mer » (Léviathan), associé aux idéologies modernes. Depuis ces postulats, Douguine propose de « constituer un grand bloc continental eurasien » (versant géopolitique) qui se veut « une force intégratrice, un esprit de renaissance »26 (versant eschatologique) en vue d’édifier un modèle multipolaire pour le système international.
Afin de réaliser cette ambition il propose dès les années 1990, en tant qu’« impératif stratégique majeur » pour la Russie, d’intégrer les pays de la CEI dans une Union Eurasienne fédéraliste : « une seule formation stratégique, unie par une seule volonté et par un seul but de civilisation commune »27. À partir de cette base, il appelle cette entité eurasienne à se rapprocher de ses « partenaires naturels » car en situation de « complémentarité symétrique » avec la Russie : UE, Japon, Iran, Inde. Ceux-ci pourraient devenir de véritable « sujets » des Relations internationales et de la mondialisation s’ils participaient à la sortie du système uni-polaire américano-centré (dans lequel ils n’en seraient que des « objets ») pour construire ensemble la multipolarité. Leur partenariat avec la Russie serait pour Douguine gagnant-gagnant, un renforcement mutuel, étant donné qu’ils ont chacun des éléments vitaux à échanger. D’autres formations géopolitiques intéressées par la multipolarité seraient ensuite encouragées à appuyer ce projet de ré-agencement du système international : Chine, Pakistan, pays arabes… alors que le Tiers-Monde serait plutôt partagé en zones d’influence pour des champions régionaux (le Pacifique constituerait la zone d’influence nippone, l’ Afrique la zone d’influence européenne… ici aussi on retrouve l’influence de l’école géopolitique allemande et des pan-ideen de Haushofer). La thalassocratie étasunienne serait quant à elle refoulée dans l’espace américain (sa zone d’influence naturelle). Ainsi aurait-on des entités géopolitiques puissantes avec leurs zones d’influences propres et un certain équilibre entre les pôles. Cet équilibre multipolaire permettrait alors à la puissance tellurique de laisser se redéployer la Tradition.
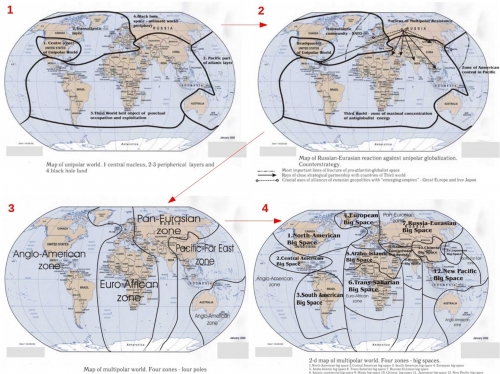
La question que nous poursuivons ici est de savoir si la BRI serait pour Douguine un vecteur potentiel pour ses propositions. Participe-t-elle de l’élan vers la « multipolarité traditionnelle » qu’il appelle de ses vœux ? Voyons alors quels élément dans les projets des nouvelles routes de la soie peuvent être décryptés comme participants des ambitions telluriques néo-eurasistes de réagencement du système international dont nous connaissons maintenant les fondamentaux.
La BRI, facteur d’intégration eurasiatique dans le cadre d’une redistribution globale des cartes de la puissance : quelle compatibilité avec le projet multipolaire néo-eurasiste ?
Vers la multi-polarisation
De prime abord, on peut considérer la BRI comme s’inscrivant dans une stratégie d’émancipation de l’uni-polarité américano-centrée. Comme évoqué en introduction, la BRI vise à développer des lignes de communication routières, ferroviaires et maritimes pour relier la Chine à l’Europe et à l’Afrique orientale, via l’Asie Centrale, le Caucase, la Russie, l’Iran, la Turquie… Couplée avec les initiatives menées dans l’OCS et l’UEE, l’initiative s’imbrique donc dans une stratégie générale d’intégration du Rimland avec la masse eurasiatique29, passant outre les instances multilatérales et les canaux de communications ouverts et normés par les États-Unis.
Ces ambitions pourraient donc bien conduire à la définition de normes non-américaines ou non-occidentales30. On le voit par exemple dans le système d’institutions financières élaboré pour financer les projets de la BRI : Banque asiatique d’investissements pour les infrastructures, Fonds Routes de la soie, Nouvelle banque de développement des BRICS, associés à un appel aux fonds souverains des États impliqués dans le projet et aux banques commerciales, les projets se financeraient hors de l’orbite de la Banque mondiale (présidée depuis 1944 par un Américain) et du Fonds monétaire international, symboles de la domination internationale des normes américaines.
Vers la re-continentalisation
L’économie mondiale est à l’heure actuelle essentiellement dépendante des flux maritimes. Cette maritimisation des flux a conduit à une littoralisation des activités de production et donc de la démographie mondiale. En effet, puisqu’il faut exporter via les ports, les entreprises se sont rapprochées des côtes, entraînant alors des mouvements de population à la recherche d’emplois. La BRI, en faisant la part belle aux tracés terrestres, pourrait participer d’une re-continentalisation des supports logistiques de l’économie mondiale et, ce faisant, d’une re-continentalisation de ses pôles de productions.
C’est notamment le vecteur ferroviaire qui semble le plus porteur, grâce à une capacité d’emport supérieure et un coût inférieur de 80 % au transport aérien, pour des échanges deux fois plus rapide que par voie maritime31. Si 7500 conteneurs ont transité sur des trains intercontinentaux en 2012, l’objectif est de porter ce nombre à 7.500.000 pour 2020. Pour profiter de ces flux logistiques, de grandes entreprises telles Hewlett Packard ou Ford se sont déjà délocalisées depuis les côtes chinoises vers l’intérieur des terres pour se positionner sur ces lignes de trains prometteuses32.
Compatibilité de la BRI avec le projet néo-eurasiste : Multipolarité et continentalité ne suffisent pas, l’aspect culturel demeure le plus important
Ces dimensions, « terrestre » et multipolaire, semblent faire entrer la BRI en résonance avec les ambitions du projet néo-eurasiste d’Alexandre Douguine. À l’occasion du Belt and Road Forum de mai 2017, Vladimir Poutine a pu adopter la rhétorique néo-eurasiste en affirmant que grâce à des «formats d’intégration tels que la CEEA, l’OBOR, l’OCS et l’ASEAN, nous pouvons bâtir les bases d’un partenariat eurasien plus vaste» offrant une «occasion unique de créer un cadre de coopération commun qui va de l’Atlantique jusqu’au Pacifique, pour la première fois dans l’histoire». Il ajoute «La Grande Eurasie n’est pas un arrangement géopolitique abstrait, mais, sans exagération, un projet à l’échelle civilisationnelle, tourné vers l’avenir.»33.
Pour autant, même si la BRI renforçait l’organisation multipolaire du système international, et à supposer que la Chine laissera une place à la Russie dans ce nouvel ordre malgré l’asymétrie de leur relation, cela ne toucherait pas l’essence du projet néo-eurasiste. Car, au vu de ce que nous avons esquissé plus haut concernant la pensée traditionnelle, dans la philosophie archétypale douguinienne ce n’est pas la forme qui importe mais le fond, l’esprit. Aussi sa critique de l’uni-polarité thalassocratique ne concerne pas tant la maritimisation de l’économie mondiale que l’esprit maritime qui uniformiserait le monde. C’est pourquoi même si on assistait au reflux de la thalassocratie américaine par la multi-polarisation du système international et à une re-continentalisation de l’économie et de la démographie, une maritimisation culturelle du continent pourrait avoir lieu (un changement du « morphotype » sans modification du « psychotype »).
Cet esprit maritime est caractérisé par Carl Schmitt, l’une des racines intellectuelles d’Alexandre Douguine, qui veut montrer (selon Alain de Benoist, préfaçant la dernière édition de Terre et Mer de Schmitt) la relation logique entre la vie maritime et le libre-échangisme, le capitalisme, le libéralisme, l’individualisme, le parlementarisme, le droit-de-l’hommisme, le constitutionnalisme34… De plus, la « société liquide » (Bauman, 2000) trans-nationaliste créée par la civilisation océanique marchande amènerait peu à peu au délitement du politique, à l’enfoncement dans le fluctuant, le mouvant, le nomade, le réticulaire, le transitoire, à la fragmentation des identités et des sociétés dans l’homogénéité des flots35. Ce sont ces caractéristiques qui sont accolées chez Douguine à la thalassocratie et à la modernité. Le combat eurasiste ne serait donc pas gagné si cette mentalité continuait de s’imposer aux esprits. La multipolarité sans le souffle de la Tradition et la verticalité de la Terre ne serait pas plus souhaitable pour le néo-eurasiste que le système actuel.
Or la BRI est imprégnée à un certain niveau par cette mentalité moderniste : esprit marchand, capitalistique, libre-échangiste et faisant une large place aux marchés financiers ; réticulation de l’espace eurasien, recherche de la vitesse, du mouvement transfrontalier plutôt que de l’ancrage (les marchandises, les capitaux, les travailleurs seront amenés à migrer) ; le tout étant porté par une Chine maoïste, et donc héritière des idées révolutionnaires de 1789, athée, technocratique, pragmatique.
Bien évidemment, les dimensions libérales et constitutionnalistes qui termineraient de caractériser l’esprit maritime sont absentes. Nous sommes essentiellement face dans l’espace eurasien à des puissances (semi-)autoritaires, des démocratures (Max Liniger-Goumaz, 1992) pour qui la souveraineté, le politique, l’Ordre et l’identité (caractéristiques telluriques) sont encore des valeurs importantes (c’est pourquoi Douguine accorde une certaine dimension « traditionnelle » à l’idéologie socialiste, pourtant moderne36). Néanmoins, si l’on suit les auteurs de tendance contre-révolutionnaire, l’esprit moderne-maritime s’est imposé en Occident parce qu’une caste marchande transnationale a pu se constituer et se renforcer jusqu’à s’imposer politiquement pour ensuite dissoudre peu à peu cet ordre politique. Aussi la BRI pourrait-elle donc être l’ouverture nécessaire à la constitution d’une telle caste dans l’espace eurasiatique qui viendrait à terme renverser les valeurs telluriques prônés par Douguine.
Conclusion
Nous avons eu pour but dans cette étude de caractériser le projet des nouvelles routes de la soie au regard de la dialectique Terre-Mer « pérennialiste » d’Alexandre Douguine, qui peut être prise comme un croisement des pensées de Carl Schmitt et de René Guénon. La question était donc de savoir si ces projets constituaient une opportunité pour l’acheminement vers un système international multipolaire accompagné d’une réaffirmation des principes telluriques traditionnels dans l’ordre international – une « domination culturelle » de Béhémoth – ou au contraire s’ils favorisaient l’ouverture vers une diffusion de la mentalité thalassique et moderniste à tout l’espace eurasiatique – le « triomphe » de Léviathan.
Nous avons vu que la coopération stratégique sino-russe autour de la BRI, dans l’hypothèse où la Chine maintiendrait un partenariat équitable envers la Russie, pourrait conduire à une multi-polarisation du système international, avec un continent eurasiatique autonome vis-à-vis de la thalassocratie étasunienne, ce qui constitue le premier versant (géopolitique) du projet néo-eurasiste d’Alexandre Douguine. Cependant, si l’on considère les choses en profondeur et d’un point de vue culturel, l’initiative pourrait porter les germes de l’esprit moderne-maritime qu’il pourfend, le versant eschatologique de son projet serait alors condamné. En vue de constituer ce front de la Tradition37 qu’il appelle de ses vœux, son combat pour l’hégémonie culturelle ne s’arrêterait pas là, il lui faudra encore proposer un modèle permettant d’intégrer les tendances marchandes modernes dans un ordre tellurique politique traditionnel à l’échelle continentale et de maintenir les ancrages identitaires des peuples eurasiatiques.
Ainsi, au regard des fondamentaux de la vision douguinienne, nous pensons que les projets de la BRI pourraient caractériser une véritable croisée des chemins pour les Relations internationales : En effet, l’initiative porte en elle l’opportunité de voir se réaffirmer un ordre du monde basé sur des principes différents de ceux de la mentalité moderne occidentale, tout en comportant le risque de voir cette mentalité se diffuser rapidement au sein du « cœur du monde ». Au-delà même de la perspective eschatologique supportée par Douguine, nous pouvons y voir un réel enjeu en matière de diversité culturelle mondiale : la tension entre différentialisme et uniformisation, représentée chez Schmitt ou Douguine par le combat entre Béhémoth et le Léviathan (la Terre et la Mer au plan non plus géographique mais presque purement mental), est bien réelle !
***
Au delà de cette étude particulière, l’influence de Douguine sur la politique mérite selon nous d’être questionnée et étudiée, cet auteur connaissant une visibilité certaine tant en Russie que dans certaines mouvances idéologiques ouest-européennes. Cependant, si son discours géopolitique rencontre un certain écho et peut emporter l’adhésion parmi les élites russes, l’aspect « gnostique » de ses théories reste bien plus marginal (car estimé irrationnel, idéaliste, hors des critères de la pensée moderne, ou incompris, de par sa difficulté d’accès pour le grand public). Aussi est-il probable que si en apparence le néo-eurasisme et la politique étrangère russe convergent, le dessein recherché soit tout autre : D’un côté nous aurions une politique étrangère réaliste, somme toute moderne bien que conservatrice mais utilisant par opportunité la rhétorique néo-eurasiste, de l’autre une vision traditionnelle métaphysique dont les ambitions ne sont portées que par une minorité restreinte. Nous pensons toutefois que des études politologiques sur l’influence de sa pensée dans le champ des idées et des mouvements politiques serait pertinentes.
Sur un plan plus théorique, une étude conceptuelle sérieuse du couple Tradition-Modernité, confronté avec la réalité empirique, pourrait également offrir selon nous une clé herméneutique intéressante pour la discipline géopolitique, cette dialectique entendue dans son sens guénonien renvoyant à des double-mouvements (différenciation-uniformisation, conservatisme-progressisme, ancrage-nomadisme…) que l’on peut retrouver au cœur de la plupart des rivalités de puissance dans l’espace mondial.
Notes:
1 En chinois, le programme s’intitule Yidai yilu, « Une ceinture, une route » (« One Belt One Road », OBOR). En anglais, l’expression officiellement utilisée par Pékin est toutefois Belt and Road Initiative (BRI).
2 Pour une présentation synthétique du projet, voir notamment : LASSERRE Frédéric et MOTTET Eric, « L’initiative Belt and Road, stratégie chinoise du Grand Jeu ? », Diplomatie, numéro 90, 2018/1, pp. 36-40.
3 Visible sur : « First Chinese Train Arrives in Tehran to Revive Silk Road », Strategic Demands Online, 15 février 2016. URL: https://strategicdemands.com/eurasia-newsilkroad/
4 Voir « 21e sommet Chine Union Européenne: vers plus de connectivité ! », OBOReurope, 11 avril 2019.
URL: https://www.oboreurope.com/fr/21e-sommet-chine-union-euro...,consulté le 11 avril 2019.
5 Ont déjà été signés des memorandums ou accords d’intégration entre la RPC et le Luxembourg, l’Italie, la Grèce, le Portugal, mais aussi la Lettonie, la Croatie, la Bulgarie ou Monaco. La Deutsche Bahn s’implique aussi financièrement, notamment par des investissement sur la principale ligne ferroviaire Pologne-Chine Voir « Qu’est que l’accord entre la Chine et l’Italie ? », OBOReurope, 24 mars 2019 (URL : https://www.oboreurope.com/fr/accord-chine-italie/, consulté le 11 avril 2019) et CLAIRET Sophie, « Pourquoi l’Europe risque de se perdre sur les nouvelles routes de la soie ? », GeoSophie, 6 janvier 2017 (URL : https://geosophie.eu/2017/02/05/pourquoi-leurope-risque-d..., consulté le 8 avril 2019).
6 MACKINDER Halford, « The Geographical Pivot of History », The Geographical Journal, vol. 23, 1904/4, pp. 421-437, p. 437 pour ces propos.
7 Voir BOULEGUE Mathieu, « La « lune de miel » sino-russe face à l’(incompatible) interaction entre l’Union Economique Eurasienne et la Belt & Road Initiative », Diploweb, 15 octobre 2017.
URL : https://www.diploweb.com/La-lune-de-miel-sino-russe-face-... consulté le 9 avril 2019.
8 Voir ALEXEEVA Olga, « Le partenariat stratégique Chine-Russie : une alliance durable ? », Areion 24 news, 25 janvier 2019.
URL : https://www.areion24.news/2019/01/25/le-partenariat-strat... consulté le 9 avril 2019.
9 Voir « La route polaire et l’initiative Belt and Road », OBOReurope, 7 novembre 2017 (URL: https://www.oboreurope.com/fr/route-polaire/, consulté le 10 avril 2019). Voir aussi BRUNEAU Michel, L’Eurasie. Continent, empire, idéologie ou projet, Paris, CNRS éditions, 2018, pp. 294-295.
10 Laquelle a une réalité géopolitique conséquente : elle vise à faire coopérer politiquement des pays représentants 2.758.000.000 d’habitants, 38% des approvisionnements en gaz naturel, 20% du pétrole, 40% du charbon et 50% de l’uranium disponibles sur la planète. Voir DUPUY Emmanuel, « Les nouvelles Routes de la Soie et l’Asie Centrale : l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) en première ligne… », La Vigie, 16 novembre 2017 (URL : https://www.lettrevigie.com/blog/2017/11/16/les-nouvelles..., consulté le 4 avril 2019)
11 BOUCHARD Renaud et PORFIRYEV Boris, « L’économie russe et le basculement géostratégique », conférence donné dans le cadre du séminaire Franco-Russe « L’intégration eurasiatique en perspective / Евразийская интеграция в перспективе », Paris, EHESS, 14 septembre 2016 – 16 septembre 2016. URL : http://renaudbouchard.canalblog.com/archives/2016/09/22/3..., consulté le 6 avril 2019.
12 L’expression néo-eurasisme distingue ces auteurs du mouvement d’idées qualifié d’eurasisme classique, héritier du mouvement slavophile du XIXème siècle et qui finira par se rapprocher de la « révolution conservatrice » allemande. Pour l’histoire intellectuelle de ces mouvements, voir notamment : MEAUX (de) Lorraine, La Russie et la tentation de l’Orient, Paris, Fayard, 2010, 436 pages ; DRESSLER Wanda (dir.), Eurasie : espace mythique ou réalité en construction ?, Bruxelles, 2009, Bruylant, 410 pages (particulièrement pp. 49-68 et 95-106) ; SEDGWICK Mark, Contre le Monde Moderne. Le traditionalisme et l’histoire intellectuelle secrète du XXème siècle, Paris, Dervy, 2008, 380 pages (particulièrement pp/ 287 et ss.).
13 LARUELLE Marlène, « Le néo-eurasisme russe. L’empire après l’empire ? », Cahiers du monde russe [En ligne], 42/1, 2001, mis en ligne le 01 janvier 2007, pp. 71-94.URL: https://journals.openedition.org/monderusse/8437#bodyftn2, consulté le 5 avril 2019.
14 Philosophe, géopoliticien, écrivain et militant politique, né le 7 janvier 1962 à Moscou.
15 Par ses théories et son apparence physique, Alexandre Douguine est régulièrement qualifié de « Raspoutine », de « conseiller occulte du Kremlin », nourrissant des analyses assez éloignées de la réalité de son influence et parfois teintées d’un esprit « complotiste ».
16 Le concept d’hégémonie culturelle a été pensé par Antonio Gramsci, qui a décrit comment une classe dominante faisait aussi reposer son pouvoir sur une domination culturelle, à travers des outils tels que l’école ou les médias. Il s’agit alors pour les forces d’opposition de conquérir les esprits en diffusant au maximum leurs idéologies avant de pouvoir renverser le rapport de domination (préalable sans lequel le nouveau pouvoir ne saurait être accepté par la population), d’où la formule utilisée de « bataille gramscienne ».
17 MOHAMMEDI Adlène, « Le « néo-eurasisme » d’Alexandre Douguine : une revanche de la géographie sur l’histoire ? », Philitt, 4 juillet 2016. URL : https://philitt.fr/2016/07/04/le-neo-eurasisme-dalexandre... , consulté le 4 avril 2019.
18 Photographie publiée en ligne sur le site Geopolitica.ru. URL : https://www.geopolitica.ru
19 Le Prophète de l’Eurasisme. Alexandre Douguine, Paris, Avatar Éditions, 2006, pp. 16.
20 Définit par Spykman comme « une région intermédiaire située […] entre le Heartland (cœur du monde) et les mers périphériques […] vaste zone tampon de conflits entre la puissance maritime et la puissance terrestre. Orientée des deux côtés, elle doit fonctionner de manière amphibie et se défendre aussi bien sur terre qu’en mer », car « Celui qui domine le Rimland domine l’Eurasie ; celui qui domine l’Eurasie tient le destin du monde entre ses mains ». Voir SPYKMAN Nicolas, The Geography of the Peace, New York, Harcourt, Brace and Co, 1944, p. 43.
21 La dialectique Terre-Mer est appréhendée dans la littérature géopolitique de façon plus ou moins pragmatique – conception surtout présente chez les Anglo-saxons – ou plus ou moins culturaliste – appréhension plutôt rencontrée chez les auteurs Allemands.
22 Formulation retenue par Christophe Boutin, voir BOUTIN Christophe, Politique et tradition. Julius Evola dans le siècle (1898-1974), Paris, Éditions Kimé, 1992, 513 pages ; Id., « Tradition et réaction : la figure de Julius Evola », In., « Les pensées réactionnaires », Mil neuf cent, n°9, 1991, pp. 81-97.
23 Néologisme proposé par le philosophe Pierre Riffard pour éviter les confusions avec le terme de « traditionalistes », utilisé aussi pour parler de courants politiques ou religieux réactionnaires. Voir : RIFFARD Pierre, L’Ésotérisme, Paris, Robert Laffont, 2003 (1990), 1032 pages. On rencontre parfois le terme « pérennialistes », bien qu’il vise plutôt la frange du mouvement développée sur le continent nord-américain. Voir HOUMAN Setareh, De la Philosophia Perennis au pérennialisme américain, Milan, Archè, 2010, 622 pages.
24 Le mot métapolitique est « à celui de politique ce que le mot métaphysique est à celui de physique […] la métaphysique de la politique » (MAISTRE Joseph (de), Considérations sur la France suivi de l’Essai sur le principe générateur des constitutions, Bruxelles, 2006 (1797), Éditions Complexe, p. 227), et vise à donner à une philosophie politique un fondement d’universalité par la référence à une vérité transcendante, le but étant d’orienter l’être et la société vers cette sphère, de traduire cette transcendance dans la réalité sociale en réfléchissant à l’organisation idéale de la Cité. Sous cette acception, le concept est à distinguer tant de la théologie politique (qui est le transfert de concepts théologiques dans le processus de construction de l’État) que du conservatisme (car il ne se réfère pas au passé mais à la métaphysique immuable, éternelle, supra-temporelle) ou de l’intégrisme (car il ne se réfère pas à une tradition spirituelle particularisée, mais à une Vérité absolue devant être supérieure à ces traditions). Voir BISSON David, René Guénon. Une politique de l’esprit, Paris, Pierre Guillaume de Roux, 2013, 527 pages, pp. 130 et s., qui utilise le triptyque infra-politique, politique, méta-politique comme clé méthodologique pour analyser l’impact de l’œuvre de Guénon.
25 Entité évoqué par l’apôtre saint Paul, le katechon est un être dont la nature n’est pas précisée et qui a pour vocation d’empêcher la venue de l’Antéchrist. Ce dernier ne peut se manifester pleinement tant que cette entité est dans le monde Voir dans la Bible les versets : 2 Thes. 2, 6-7.
26 Le Prophète de l’Eurasisme, op. cit, p. 19.
27 Ibid., p. 29.
28 Visible sur le site du mouvement EVRAZIA : http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article.... La carte 1 représente le monde unipolaire actuelle, la 2 la contre-stratégie que doit déployer la Russie pour briser l’uni-polarité, la 3 révèle les futures grandes zones d’influence souhaitées par le projet néo-eurasiste et la 4 les « grands espaces » géopolitiques au sein de ces zones.
29 STRUYE DE SWIELANDE Tanguy, « La Chine et ses objectifs géopolitiques à l’aube de 2049 », in « Regards géopolitiques », Bulletin du Conseil québécois d’études géopolitiques, volume 2, n°1, printemps 2016, pp. 24-28.
30 GARCIN Thierry, « Le chantier – très géopolitique – des Routes de la soie », Diploweb, 18 février 2018.
URL : https://www.diploweb.com/Le-chantier-tres-geopolitique-de..., consulté le 10 avril 2019.
31 LASSERRE Frédéric et MOTTET Eric, « L’initiative Belt and Road, stratégie chinoise du Grand Jeu ? », op. cit.
32 FRANKOPAN Peter, Les Routes de la Soie. L’histoire du cœur du monde, Bruxelles, Éditions Nevicata, 2017, p. 622.
33 ESCOBAR Pepe, « Vladimir Poutine s’aligne avec Xi Jinping pour élaborer un nouvel ordre mondial (commercial) », RTFrance, 17 mai 2017.
URL : https://francais.rt.com/opinions/38470-vladimir-poutine-a..., consulté le 9 avril 2019.
34 Voir SCHMITT Carl, Terre et Mer (1942), Paris, Pierre Guillaume de Roux, 2017, p. 63.
35 Ibid., p. 66-67.
36 De toute manière, selon les postulats métaphysiques retenus par les auteurs comme Douguine, il n’existe aucun étant « pur » : tout ce qui est manifesté est constitué d’un dosage entre les différentes polarités. Concrètement, il ne peut exister d’entité entièrement tellurique ou entièrement thalassique.
37 En référence à l’ouvrage : DOUGUINE Alexandre, Pour le Front de la Tradition, Nantes, Ars Magna, 2017.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
––, Le Prophète de l’Eurasisme. Alexandre Douguine, Paris, Avatar Éditions, 2006, 349 p.
BISSON David, René Guénon. Une politique de l’esprit, Paris, Pierre Guillaume de Roux, 2013, 527 pages
BRUNEAU Michel, L’Eurasie. Continent, empire, idéologie ou projet, Paris, CNRS éditions, 2018, 352 pages.
BOUTIN Christophe, Politique et tradition. Julius Evola dans le siècle (1898-1974), Paris, Éditions Kimé, 1992, 513 pages
DRESSLER Wanda (dir.), Eurasie : espace mythique ou réalité en construction ?, Bruxelles, 2009, Bruylant, 410 pages.
FRANKOPAN Peter, Les Routes de la Soie. L’histoire du cœur du monde, Bruxelles, Éditions Nevicata, 2017, 732 pages.
HOUMAN Setareh, De la Philosophia Perennis au pérennialisme américain, Milan, Archè, 2010, 622 pages.
MAISTRE Joseph (de), Considérations sur la France suivi de l’Essai sur le principe générateur des constitutions, 2006 (1797), Éditions Complexe
MEAUX (de) Lorraine, La Russie et la tentation de l’Orient, Paris, Fayard, 2010, 436 pages.
RIFFARD Pierre, L’Ésotérisme, Paris, Robert Laffont, 2003 (1990), 1032 pages.
SCHMITT Carl, Terre et Mer (1942), Paris, Pierre Guillaume de Roux, 2017, 240 pages.
SEDGWICK Mark, Contre le Monde Moderne. Le traditionalisme et l’histoire intellectuelle secrète du XXème siècle, Paris, Dervy, 2008, 380 pages.
SPYKMAN Nicolas, The Geography of the Peace, New York, Harcourt, Brace and Co, 1944, 66 pages.
Articles
BOUTIN Christophe, « Tradition et réaction : la figure de Julius Evola », in., « Les pensées réactionnaires », Mil neuf cent, n°9, 1991, pp. 81-97.
LASSERRE Frédéric et MOTTET Eric, « L’initiative Belt and Road, stratégie chinoise du Grand Jeu ? », Diplomatie, numéro 90, 2018/1, pp. 36-40.
MACKINDER Halford, « The Geographical Pivot of History », The Geographical Journal, vol. 23, 1904/4, pp. 421-437.
STRUYE DE SWIELANDE Tanguy, « La Chine et ses objectifs géopolitiques à l’aube de 2049 », in « Regards géopolitiques », Bulletin du Conseil québécois d’études géopolitiques, volume 2, n°1, printemps 2016, pp. 24-28.
Articles en ligne
ALEXEEVA Olga, « Le partenariat stratégique Chine-Russie : une alliance durable ? », Areion 24 news, 25 janvier 2019.URL : https://www.areion24.news/2019/01/25/le-partenariat-strat...
BOUCHARD Renaud et PORFIRYEV Boris, « L’économie russe et le basculement géostratégique », conférence donné dans le cadre du séminaire Franco-Russe « L’intégration eurasiatique en perspective / Евразийская интеграция в перспективе », Paris, EHESS, 14 septembre 2016 – 16 septembre 2016. http://renaudbouchard.canalblog.com/archives/2016/09/22/3...
BOULEGUE Mathieu, « La « lune de miel » sino-russe face à l’(incompatible) interaction entre l’Union Economique Eurasienne et la Belt & Road Initiative », Diploweb, 15 octobre 2017 https://www.diploweb.com/La-lune-de-miel-sino-russe-face-...
CLAIRET Sophie, « Pourquoi l’Europe risque de se perdre sur les nouvelles routes de la soie ? », GeoSophie, 6 janvier 2017.URL : https://geosophie.eu/2017/02/05/pourquoi-leurope-risque-d...
DUPUY Emmanuel, « Les nouvelles Routes de la Soie et l’Asie Centrale : l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) en première ligne… », La Vigie, 16 novembre 2017 URL : https://www.lettrevigie.com/blog/2017/11/16/les-nouvelles...
ESCOBAR Pepe, « Vladimir Poutine s’aligne avec Xi Jinping pour élaborer un nouvel ordre mondial (commercial) », RTFrance, 17 mai 2017.URL : https://francais.rt.com/opinions/38470-vladimir-poutine-a...
GARCIN Thierry, « Le chantier – très géopolitique – des Routes de la soie », Diploweb, 18 février 2018. URL : https://www.diploweb.com/Le-chantier-tres-geopolitique-de...
LARUELLE Marlène, « Le néo-eurasisme russe. L’empire après l’empire ? », Cahiers du monde russe [En ligne], 42/1, 2001, mis en ligne le 01 janvier 2007, pp. 71-94. https://journals.openedition.org/monderusse/8437#bodyftn2
MOHAMMEDI Adlène, « Le « néo-eurasisme » d’Alexandre Douguine : une revanche de la géographie sur l’histoire ? », Philitt, 4 juillet 2016.https://philitt.fr/2016/07/04/le-neo-eurasisme-dalexandre...
« 21e sommet Chine Union Européenne: vers plus de connectivité ! », OBOReurope, 11 avril 2019.
URL: https://www.oboreurope.com/fr/21e-sommet-chine-union-euro...
« La route polaire et l’initiative Belt and Road », OBOReurope, 7 novembre 2017.URL: https://www.oboreurope.com/fr/route-polaire/
« Qu’est que l’accord entre la Chine et l’Italie ? », OBOReurope, 24 mars 2019 https://www.oboreurope.com/fr/accord-chine-italie/
Cartes
BOUCHARD Renaud et PORFIRYEV Boris, « L’économie russe et le basculement géostratégique », conférence donné dans le cadre du séminaire Franco-Russe « L’intégration eurasiatique en perspective / Евразийская интеграция в перспективе », Paris, EHESS, 14 septembre 2016 – 16 septembre 2016.http://renaudbouchard.canalblog.com/archives/2016/09/22/3...
« First Chinese Train Arrives in Tehran to Revive Silk Road », Strategic Demands Online, 15 février 2016 URL: https://strategicdemands.com/eurasia-newsilkroad/
« Les nouvelles routes de la soie : le cauchemar de Brzezinski passe par l’Asie centrale », Investig’action, 10 octobre 2018.
URL : https://www.investigaction.net/fr/les-nouvelles-routes-de...
Sitographie
Site Geopolitica.ru. URL : https://www.geopolitica.ru
Site du mouvement EVRAZIA : http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article....
00:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, alexandre douguine, nouvelle droite russe, routes de la soie, eurasisme, eurasie, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 24 mai 2019
La coopération stratégique et scientifique entre la Russie et la Chine se précise

La coopération stratégique et scientifique entre la Russie et la Chine se précise
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
Une question restait posée : la Russie s'associerait-elle à cette démarche ou, à l'inverse, y verrait-elle une concurrence dangereuse pour les relations qu'elle a depuis longtemps établies avec ses voisins du sud au sein de l'Union économique eurasiatique.
La réponse vient d'être donnée à la seconde Conférence de la BRI qui vient de se tenir à Pékin. Elle rassemblait 37 chefs d'Etat, dont Vladimir Poutine en personne. Celui-ci vient d'annoncer son intention d'associer la Route Polaire Maritime russe à la BRI. Cette route est de plus en plus fréquentée pendant la période de fonte des glaces, période qui ne cesse de s'allonger avec le réchauffement climatique. Ceci devrait faire de l'Arctique une zone de coopération où pourraient se retrouver de nombreux intérêts refoulés vers le nord par ces changements de température. La Chine voit déjà dans la Route polaire un élément majeur de son ouverture au reste du monde.
C'est d'abord la diminution des temps de transport maritime qui l'intéresse. La route du port chinois de Dalian à Rotterdam sera raccourcie de 10 jours par rapport au passage par le détroit de Malacca et le canal de Suez. Par ailleurs, un accès aux ressources de l'Arctique sera précieuse pour un pays surpeuplé et sans grandes ressources propres tel que la Chine.
Quelques jours auparavant, dans le cadre de l'International Arctic Forum qui se tenait à St Petersbourg début Avril, la Russie avait mis l'accent sur l'importance de ce qui est nommé un Grand Partenariat Euroasiatique non seulement pour la coopération économique mais pour celle en matière scientifique. Lors de cette conférence, Chine et Russie ont signé un accord de coopération scientifique pour l'Arctique créant un China-Russia Arctic Research Center.
Dans un premier temps, il s'agira de réaliser des constructions durables sur des plateformes flottant sur la glace et des brise-glaces plus performants. Sans attendre on y étudiera des méthodes permettant de préserver les milieux naturels fragiles de cette partie du monde.
Sur ce plan, beaucoup de scientifiques resteront dubitatifs. On peut craindre que les objectifs économiques l'emportent sur les préoccupations de préservation. D'autant plus qu'à plus long terme des dizaines de millions de personne chassées de chez elles par le réchauffement et la désertification chercheront à se reconvertir non seulement dans le nord de la Sibérie mais dans l'Arctique.
Celle-ci est sans doute trop loin de l'Europe pour qu'elle s'intéresse, hormis quelque peu les pays scandinaves (et Total). Ce sera dommage pour elle.
00:35 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, chine, actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 mai 2019
Après l'offensive américaine contre Huawei, Pékin va-t-il déclencher la guerre des terres rares ?
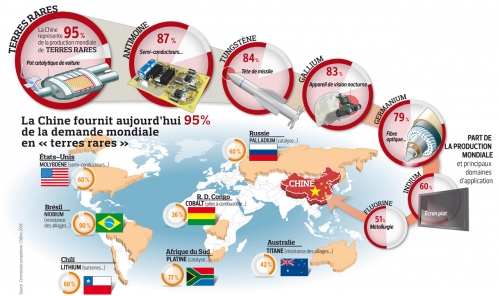
Après l'offensive américaine contre Huawei, Pékin va-t-il déclencher la guerre des terres rares ?
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
Il était prévisible que Pékin riposterait sur ce terrain à l'offensive américaine contre Huawei, menacé par un embargo américain sur des composants électroniques qui lui sont indispensables. Washington vise à exclure Huawei de toutes les applications de demain, telles que la 5 G, au prétexte que le géant chinois pourrait espionner les firmes américaines travaillant pour la défense.
Or le président chinois Li Jinping vient de visiter une société productrice de terres rares. Même s'il n'a fait aucune déclaration à ce sujet, il est évident que cette visite n'était pas de routine. Elle voulait faire peser la menace d'un embargo chinois sur l'exportation de terres rares. Pékin prend son temps cependant avant de déclencher la guerre. Il craint manifestement que les Américains ne trouvent des substituts aux terres rares.
Cependant cela demandera du temps et nécessitera des crédits de recherche considérables. Dans les prochains mois, l'arme des terres rares serait donc utilisable et pourrait considérablement affecter toutes les filières technologiques américaines, ainsi d'ailleurs que les Européens qui en sont totalement dépendants. On notera cep que la France pourrait extraire des terres rares dans son domaine maritime, mais avec de grands risques pour la vie océanique
La Chine produit actuellement 95¨des terres rares nécessaires à l'industrie. Les Etats-Unis en importent environ 80%. Un consultant américain, président de ThREE Consulting, a prévenu qu'un embargo chinois pourrait compromettre tous les fabricants non chinois de produits électroniques, y compris ceux utilisée dans le domaine de l'aviation commerciale et de l'industrie militaire.
En 2014 l'Organisation Mondiale du Commerce avait accusé la Chine d'enfreindre les règles de la concurrence en limitant les exportations de ces terres, au prétexte des dégâts à l'environnement provoqués par leur extraction.
Ceci dit l'United States Geological Survey avait estimé en 2018 que la planète disposait de 120 millions de tonnes de gisements, dont 44 millions en Chine, mais aussi 22 au Brésil et 18 en Russie. Ces deux derniers pays avaient jusqu'ici préféré ne pas exploiter leurs réserves, compte tenu du fait que cette exploitation rejette des quantités considérables de produits toxiques et peut-être radioactifs. La Chine apparemment ne s'en préoccupe pas.
Une intervention de Pékin bloquant ou rendant difficiles les exportations de terres rares sera considérée aux Etats-Unis comme une accélération de la guerre commerciale. De plus, dans le cas encore improbable de conflits militaires avec la Chine dans le Pacifique Sud, il s'agira d'une arme qui devra être prise en considération par les stratèges du Pentagone.
09:30 Publié dans Actualité, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, huawei, terres rares, économie, minerais, guerre économique, géopolitique, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 22 mai 2019
Rand Corp : comment abattre la Russie

Rand Corp : comment abattre la Russie
Contraindre l’adversaire à s’étendre excessivement pour le déséquilibrer et l’abattre : ce n’est pas une prise de judo mais le plan contre la Russie élaboré par la Rand Corporation, le plus influent think tank étasunien qui, avec un staff de milliers d’experts, se présente comme la plus fiable source mondiale de renseignement et d’analyse politique pour les gouvernants des États-Unis et leurs alliés.
La Rand Corp* se vante d’avoir contribué à élaborer la stratégie à long terme qui permit aux États-Unis de sortir vainqueurs de la guerre froide, en contraignant l’Union Soviétique à consommer ses propres ressources économiques dans la confrontation stratégique. C’est de ce modèle que s’inspire le nouveau plan, “Overextending and Unbalancing Russia”, publié par la Rand. Selon ses analystes, la Russie reste un puissant adversaire des États-Unis dans certains domaines fondamentaux. Pour cela les USA doivent poursuivre, avec leurs alliés, une stratégie d’ensemble à long terme qui exploite ses vulnérabilités. Ainsi va-t-on analyser divers moyens pour obliger la Russie à se déséquilibrer, en indiquant pour chacun les probabilités de succès, les bénéfices, les coûts et les risques pour les USA.
Les analystes de la Rand estiment que la plus grande vulnérabilité de la Russie est celle de son économie, due à sa forte dépendance par l’exportation de pétrole et de gaz, dont les recettes peuvent être réduites en alourdissant les sanctions et en augmentant l’exportation énergétique étasunienne. Il s’agit de faire e sorte que l’Europe diminue l’importation de gaz naturel russe, en le remplaçant par du gaz naturel liquéfié transporté par mer depuis d’autres pays.
Une autre façon de nuire dans le temps à l’économie de la Russie est d’encourager l’émigration de personnel qualifié, notamment des jeunes Russes avec un niveau élevé d’instruction. Dans le domaine idéologique et informatif, il faut encourager les contestations internes et en même temps miner l’image de la Russie à l’extérieur, en l’excluant de forums internationaux et en boycottant les événements sportifs internationaux qu’elle organise.
Dans le domaine géopolitique, armer l’Ukraine permet aux USA d’exploiter le point de plus grande vulnérabilité extérieure de la Russie, mais cela doit être calibré pour garder la Russie sous pression sans arriver à un grand conflit dans lequel elle aurait le dessus.
Dans le domaine militaire les USA peuvent avoir des bénéfices élevés, avec des coûts et des risques bas, par l’accroissement des forces terrestres des pays européens de l’OTAN dans une fonction anti-Russie. Les USA peuvent avoir de hautes probabilités de succès et de forts bénéfices, avec des risques modérés, surtout en investissant majoritairement dans des bombardiers stratégiques et missiles d’attaque à longue portée dirigés contre la Russie.
Sortir du Traité FNI et déployer en Europe de nouveaux missiles nucléaires à portée intermédiaire pointés sur la Russie leur assure de hautes probabilités de succès, mais comporte aussi de hauts risques.
En calibrant chaque option pour obtenir l’effet désiré -concluent les analystes de la Rand- la Russie finira par payer le prix le plus haut dans la confrontation avec les USA, mais ceux-ci aussi devront investir de grosses ressources en les soustrayant à d’autres objectifs. Ils pré-annoncent ainsi une forte augmentation ultérieure de la dépense militaire USA/OTAN aux dépens des dépenses sociales.
Voilà l’avenir que nous trace la Rand Corporation, le think tank le plus influent de l’État profond, c’est-à-dire du centre souterrain du pouvoir réel détenu par les oligarchies économiques, financières et militaires, celui qui détermine les choix stratégiques non seulement des USA mais de tout l’Occident.
Les “options” prévues par le plan ne sont en réalité que des variantes de la même stratégie de guerre, dont le prix en termes de sacrifices et de risques est payé par nous tous.
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio
*La RAND Corporation : Research ANd Development (recherche et développement)
- Source : Il Manifesto (Italie)
09:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, russie, états-unis, rand corporation, politique internationale, géopolitique, géostratégie, guerre froide |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 21 mai 2019
Japan’s Political Ambitions could be Jeopardized by its Energy Dependence
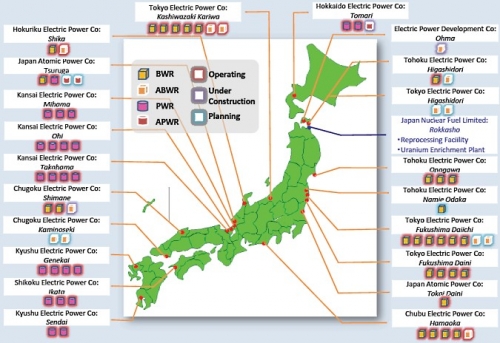
Japan’s Political Ambitions could be Jeopardized by its Energy Dependence
There has been much talk of Japan recently, which has significantly intensified its foreign policy: Japan is working together with the United States to promote the Indo-Pacific strategy with multilateral support within the framework of the US-Japan-India-Australia quadrilateral security dialogue (QUAD), which involves strengthening the Japan Self-Defense Forces and intensive peace treaty negotiations with Russia.
It is a well-known fact that one of the aims of a country’s foreign policy is to ensure the state experiences progressive internal social and economic development. For Japan’s high-tech and industrialized economy, which does not have enough of its own national energy resources to satisfy all its energy needs, one of the most important preconditions for economic growth is to secure an uninterrupted imported energy supply. However, to succeed in solving this problem, it is necessary to highlight two key factors here: a sufficient supply and a competitive price. Let’s try to gain an insight into what the Japanese economy needs in terms of energy resources and where the supply comes from.
Although Japan’s total area exceeds 370 thousand square kilometers; today, the county does not have enough natural resources to meet its own energy needs. This is largely linked to the aggressive exploitation of natural resources which took place in the past, which you can get a good sense of by looking at a map of all the mining enterprises which used to operate in Japan, along with all the oil and gas fields.
Japan is the world’s third largest oil consumer, second only to the US and China. The Japanese consume about two billion barrels of oil a year, 99.7 percent of which is imported. Tokyo weighs in heavy on imports in world rankings, bypassing Beijing to take second place. A significant risk factor threatening Japan’s oil supply is the conflict in the Middle East — violent, simmering flare-ups which could boil over — as Japan sources more than 86 percent of all its imported oil from the region (Saudi Arabia – 31.1%, UAE – 25.4%, Qatar – 10.2%, Iran – 11.5%, Kuwait – 8.2%).
Therefore, it is no wonder that the Japanese authorities are anxiously monitoring the situation in the Asia Pacific gas market. China is the leading buyer of liquefied natural gas (LNG) from the Asia Pacific, whose demands for “blue fuel” are only set to grow.
Not too long ago, Japan even made an attempt to strengthen its position in this market by importing gas from Russia. Japanese companies have developed a project to build a gas pipeline from Sakhalin, with a capacity of 20 billion cubic meters per year. Taking Japan’s current gas consumption of 123 billion cubic meters, if this gas pipeline was constructed, Tokyo would be able to meet a sixth of the national demand for this type of fuel. In 2014 however, Japan imposed sanctions against Russia “for Crimea,” and abandoned the project, even though it could significantly improve the island state’s vulnerable situation as an energy importer.
As a result, Tokyo now has no other choice but to compete with other Asia Pacific countries to secure its LNG supply, which increases the cost of energy and leaves the Japanese with no guarantee of a sufficient supply.
Although Japan does have some of its own coal reserves, it is the world’s top LNG importer. In 2017, Japan spent $ 23 billion to purchase 209 million tons of natural gas About 18 percent of the world’s coal supply goes to Japan. Along with imports of metallurgical coal for the steel industry, Japan is increasing its thermal coal imports. This is due to an electricity shortage caused by the nuclear power plants being shutdown, which had still been operating up until that point. Against this backdrop, the outlook for the next few decades is that the Japanese will be using coal, primarily for electricity production at dozens of new thermal power plants.
The given data on Japan’s oil, gas and coal imports highlights Tokyo’s almost total dependence on imported energy supplies. The availability of this imported energy supply is largely determined by the stability / instability in the region where it is produced, primarily in the Middle East, as well as in the regions along the pipeline routes, where China’s influence is growing. Energy prices today are among the highest they have ever been, as the growing Asia Pacific market consumes more and more energy each year.
Under the given circumstances, one of the most cost-effective ways to strengthen Japan’s energy security in economic terms is greater cooperation with Russia, which possesses and is capable of exporting the full spectrum of energy resources which Tokyo needs. The shared border between Russia and Japan also guarantees that the energy supply will not be severed along the way.

The conclusion this article would give is that Japan’s over-dependence on Washington, as well as the absence of a peace treaty with Moscow act as barriers which frustrate efforts to increase cooperation between Japan and Russia in the area of energy supply (direct supply and transit through other states). The influence of the first factor, Japan’s over-dependence on the US, is apparent in the support Japan expresses for the US policy of levying sanctions against Russia, even in cases and circumstances when this contradicts Japanese interests by not only frustrating bilateral cooperation between Japan and Russia, but also by going against the basic interests of Japan’s national security. The second factor is the peace treaty. Japanese Prime Minister Shinzo Abe’s government is busily working to try and find a solution, but the approach they are taking is not geared towards a win-win treaty.
It is clear that Japan’s ambitions to make a return to the big geopolitical game are suppressed by Tokyo’s dependence on energy imports. As it happens, Germany makes a good example of a state in a similar situation as one of Europe’s most powerful economies and major energy consumer and importer. Berlin is aware of how critically important it is to ensure a cost-effective supply of natural gas to fuel the “locomotive of the European economy”, and is currently implementing its Nord Stream 2 project to lay a gas pipeline along the bottom of the Baltic Sea, despite strong opposition from Washington.
Therefore, we cannot rule out the possibility that Tokyo will look at the experience Berlin has had and follow suit in the near future, and that without walking around Washington on eggshells any longer, Japan will begin to look after its own interests and develop bilateral relations with Russia which are beneficial for both countries.
Valery Matveev, economic observer, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook.”
https://journal-neo.org/2019/04/29/japan-s-political-ambi...
11:21 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, japon, asie, affaires asiatiques, océan pacifique, énergie, sources d'énergie, dépendance énergétique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 19 mai 2019
Début de conflit entre le Pentagone et l'Europe sur les questions de défense

Début de conflit entre le Pentagone et l'Europe sur les questions de défense
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
Mais cette question pose à nouveau la question de savoir si l'Union européenne, ou si certains Etats de celle-ci, en premier lieu la France, pourront sans conflits graves avec Washington, se doter d'une armée européenne indépendante de l'Otan et s'équipant en priorité de matériels militaires conçus et fabriqués en Europe.
Le 1er mai, le département de la Défense des États-Unis a envoyé une lettre à l'Union européenne l'avertissant que la création par les Européens d'une armée indépendante des Américains pourrait entraîner l'effondrement de l'alliance de l'OTAN entre les États-Unis et les Etats européens. La lettre, envoyée par les sous-secrétaires américains à la Défense, Ellen Lord et Andrea Thompson, à la responsable de la politique étrangère de l'Union, Federica Mogherini, a été évoquée é par le quotidien espagnol El Pais le 13 mai. On notera que ce même jour, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, s'était invité sans y avoir été convié à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union à Bruxelles pour exiger leur soutien aux projets américains de guerre contre l'Iran.
La lettre du Département de la Défense indiquait que « Les États-Unis sont profondément préoccupés par l'approbation des règles relatives au Fonds européen de défense et des conditions générales de la Coopération structurée permanente (CSP) ». La lettre a précisé qu'une armée européenne entraînera «un recul spectaculaire de trois décennies d'intégration croissante du secteur de la défense transatlantique». Elle a mis en garde contre le danger d'une «concurrence inutile entre l'OTAN et l'UE».
Cette lettre comportait la menace plus ou moins voilée visant de possibles représailles politiques ou commerciales si Bruxelles maintenait son intention de développer « des projets d'armement européens sans consulter des pays extérieurs, comme les États-Unis». On rappellera à ce sujet que le Fonds européen de la défense stipule que les entreprises européennes doivent contrôler la technologie utilisée dans les systèmes d'armement européens, sans dépendre nécessairement de technologies étrangères, notamment américaine.
Faisant référence aux conflits qui avaient éclaté lorsque Berlin et Paris s'étaient opposées à l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, la lettre indique que les projets européens actuels «pourraient non seulement nuire aux relations constructives entre l'OTAN et l'Union Européenne, mais également relancer potentiellement les échanges tendus qui ont dominé nos relations il y a 15 ans sur les initiatives de défense de l'Europe».
Le sérieux avec lequel des menaces de rupture de l'alliance américano-européenne sont prises en Europe a trouvé un écho dans la publication cette semaine d'une étude réalisée par le groupe de réflexion IISS (International Institute of Strategic Studies) à Londres. Cette étude, intitulée «Défendre l'Europe: les scénarios de capacités nécessaires pour les membres européens de l'OTAN», évalue les coûts supportés par l'Europe pour reconstruire la capacité militaire de l'OTAN si les États-Unis abandonnaient l'alliance. Mais l'IISS n'envisage apparemment que la question de la défense de l'Europe en cas d'une invasion russe. Il évalue en ce cas le renforcement de capacité navale pour un coût de 110 milliards de dollars et des dépenses de 357 milliards de dollars ;
Ceci en soi ne devrait pas inquiéter Washington. Une éventuelle armée européenne n'est en rien présenté par l'Union comme devant mener une guerre contre les Etats-Unis. Mais ce qui inquiète ceux-ci est la perspective de voir les industries de défense européenne faire appel à leurs ressources propres plutôt que dépendre massivement, comme c'est le cas actuellement, à l'exception de la France, de l'industrie militaire américaine. Celle-ci fait la loi au Pentagone.
Aujourd'hui, l'Espagne donne l'exemple en matière de désolidarisation d'avec la politique américaine dans le domaine d'une possible guerre américaine contre l'Iran. Elle retiré sa frégate Méndez Núñez du groupe aéronaval dirigé par les États-Unis et mené par le porte-avions Abraham Lincoln, qui se rend dans le golfe Persique pour menacer l'Iran. La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a déclaré «Si le gouvernement nord-américain a l'intention de faire en sorte que le porte-avions Abraham Lincoln se rende dans une zone donnée pour une mission dont il n'a jamais convenu avec l'Espagne, nous quittons provisoirement le groupement tactique.» Elle a cependant assuré que Washington ne devait pas considérer cela comme une rupture définitive. On pourra lire à ce sujet Challenges
Rappelons que des tensions s'accentuent également au sujet des relations entre l'Europe et la Chine, après que l'Italie eut officiellement signé en mars un mémorandum d'accord approuvant l'Initiative d chinoise de la BRI ou la nouvelle route de la soie), un vaste plan d'infrastructure eurasien pouvant inclure certains Etats européens, ceci malgré les objections des États-Unis. Par ailleurs, Washington a menacé l'Allemagne et la Grande-Bretagne de suspendre la coopération en matière de renseignement pour avoir autorisé la société chinoise Huawei à participer à la construction de leur réseau de télécommunications.
Ceci dit, il est évident que si certains européens voulaient prendre leur indépendance à l'égard des industries militaires américaines, comme De Gaulle en son temps, ils devraient clairement sortir de l'Otan.
11:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pentagone, états-unis, europe, affaires européennes, otan, atlantisme, politique internationale, actualité, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 15 mai 2019
Un nouvel ordre multipolaire fondé sur la régulation

Un nouvel ordre multipolaire fondé sur la régulation
Ligne Droite cliquez ici
& http://synthesenationale.hautetfort.com
Le concept de communauté internationale, qui revient de façon récurrente dans le discours des diplomates occidentaux, n’est qu’un artifice destiné à légitimer la politique étrangère des États-Unis. Or celle-ci, porteuse de l’idéologie mondialiste, est contraire aux intérêts de la France et de l’Europe. Aussi notre pays devrait-il, selon Ligne droite, contester l’organisation actuelle des relations internationales et nourrir la grande ambition d’œuvrer à l’avènement d’un « nouvel ordre multipolaire » ancré dans la réalité du monde d’aujourd’hui et axé sur la régulation des échanges.
La notion de communauté internationale, un instrument de l’imperium américain
La notion de « communauté internationale », qui reprend sous un angle un peu différent celui de nouvel ordre mondial très en vogue à la fin du XXe siècle, est en effet une formule des plus ambiguë. Ceux qui s’en réclament laissent entendre qu’ils parlent pour l’ensemble des nations du monde, alors qu’il ne s’agit le plus souvent que des États-Unis et de leurs « alliés ». Cette référence à la communauté internationale est dès lors quasi systématiquement utilisée pour des actions ou des prises de position qui servent les États-Unis et leur vue du monde.
Autant dire, dans ces conditions, que cette notion s’inscrit dans un cadre très politiquement correct. Elle repose sur l’idée que le modèle américain fondé sur le libéralisme et la démocratie va s’étendre au monde entier et s’appuie sur l’idéologie mondialiste qui conduit à supprimer les frontières, à réduire le pouvoir des États et à œuvrer à la globalisation de la planète. En effet, la communauté internationale en question ne se préoccupe pas des identités et considère avec méfiance les États qui y demeurent attachés comme la Russie et tous les pays de l’Est de l’Europe.
Une conception politiquement correcte inadaptée au monde multipolaire d’aujourd’hui
Ligne droite estime en conséquence que les notions de nouvel ordre mondial et de communauté internationale doivent être rejetées car elles véhiculent le mondialisme, le libre-échangisme intégral, l’immigrationnisme et l’atlantisme. À ce titre, elles vont à l’encontre de ce qui est souhaitable pour le France et l’Europe, aussi notre pays doit-il les contester tout en proposant une autre vision.
Cette démarche se révèle d’autant plus légitime que le concept de communauté internationale ne correspond en rien à la réalité du monde d’aujourd’hui. La planète est en effet loin de converger autour du pôle américain, lequel perd d’ailleurs de son influence. Notre époque apparaît au contraire marquée par l’émergence de nouvelles puissances qui structurent la scène mondiale selon un schéma multipolaire. Un schéma qui n’est pas compatible avec la notion de communauté internationale puisqu’aucun des nouveaux pôles émergents comme la Chine, l’Inde ou le monde musulman, pas plus d’ailleurs que la Russie, le Brésil ou l’Afrique, ne sont prêts à s’aligner sur les États-Unis.
Il faut lui substituer le concept de nouvel ordre multipolaire
Ligne droite considère donc que la France devrait se faire le champion d’une autre conception des relations internationales. Une conception qu’elle devrait populariser sous le nom de « nouvel ordre multipolaire » et qui devrait reposer sur deux grands principes : prendre en compte la réalité multipolaire du monde d’aujourd’hui et substituer à l’ultralibéralisme international le principe de la régulation générale de tous les échanges.
Le nouvel ordre multipolaire pour une régulation des échanges
Contrairement au nouvel ordre mondial qui organisait le laisser-faire laissez-passer général tant pour les biens et services que pour les mouvements migratoires, le nouvel ordre multipolaire proposé par la droite nouvelle devrait s’appuyer sur le principe simple selon lequel les échanges ne sont admis que s’ils sont bénéfiques pour les deux parties concernées et doivent donc être régulés en conséquence.
Dans ce cadre, l’organisation du commerce mondial devrait être entièrement revue et de nouvelles négociations devraient être ouvertes en son sein pour mettre en place des écluses douanières entre les grands ensembles économiquement homogènes.
De même, s’agissant de l’immigration, la maîtrise des flux devrait s’imposer comme la règle commune. Aucun mouvement migratoire ne pourrait être organisé sans l’accord des deux pays concernés. Quant aux déplacements clandestins, ils devraient être combattus par les pays d’émigration comme par ceux d’immigration et, dans la mesure où ils sont organisés par des filières mafieuses, traités comme tels par les services compétents.
Le nouvel ordre multipolaire pour la stabilité du monde
Par ailleurs, le nouvel ordre multipolaire devrait prendre en compte la réalité du monde et reconnaître son caractère multipolaire. Pourrait en effet être constitué un G9 d’un nouveau genre regroupant les principaux pôles de puissance: Chine, Japon, Inde, Brésil, États-Unis, Russie et Europe, auxquels devraient être adjoints deux autres États, l’un représentant le monde musulman et l’autre l’Afrique (au besoin selon une formule de tourniquet). Une telle instance même informelle qui représenterait avec neuf partenaires la presque totalité de la population mondiale pourrait être le lieu le plus pertinent où débattre des conflits et des problèmes du monde. Une configuration qui serait capable d’apporter une plus grande stabilité internationale, car fondée, non plus sur une puissance unique qui cherche à s’imposer, mais sur l’équilibre des principaux pôles de puissance de la planète.
Le nouvel ordre multipolaire, un projet susceptible de s’imposer
Pour mettre en œuvre un tel projet, très différent des pratiques actuelles, la droite nouvelle, une fois au pouvoir, devrait commencer par faire de la France le champion de cette idée, à charge pour elle de l’expliquer et d’en assurer la promotion. Si, ensuite, l’Europe confédérale, telle que préconisée par Ligne droite, reprenait ce projet à son compte, gageons que tout deviendrait alors possible. L’idée d’un nouvel ordre multipolaire pourrait en effet intéresser les BRICS. Le Brésil, la Russie, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud cherchent en effet à réduire l’influence des États-Unis dans le monde. Ils ne pourraient dès lors que soutenir un projet visant à institutionnaliser la réalité multipolaire qu’ils incarnent et, forte de ce soutien, l’Europe serait en mesure de faire prévaloir ce changement radical de l’organisation des relations internationales.
En tout état de cause, la France, dirigée par la droite nouvelle, aurait tout intérêt à porter l’idée d’une rénovation profonde des relations internationales. En dehors des bénéfices qu’elle et les autres pays européens pourraient en retirer si le projet se concrétisait, le seul fait de s’en faire l’artisan permettrait à la France de gagner en stature et d’offrir aux Français des perspectives ainsi qu’une ambition collective qui leur rendrait espoir et fierté.
00:49 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, multipolarité, monde multipolaire, politique internationale, diplomatie, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 13 mai 2019
Le théoricien de la très grande Europe

Le théoricien de la très grande Europe
par Georges FELTIN-TRACOL
Ex: http://www.europemaxima.comComme lors de la chronique de février dernier, il ne sera pas aujourd’hui question d’une figure européenne, mais d’une personnalité déjà évoquée à l’occasion de la deuxième chronique en date du 31 janvier 2017, à savoir Jean Thiriart (1922 – 1992).
La sortie en 2016 dans la collection « Qui suis-je ? » chez Pardès de Thiriart par Yannick Sauveur suscita un regain de curiosité autour de ses idées. Jusqu’alors, on ne disposait que d’Un Empire de quatre cents millions d’hommes, l’Europe. La naissance d’une nation, au départ d’un parti historique chez Avatar sorti en 2007. Paru à l’origine en 1964, cet essai qui présente quelques points toujours actuels par exemple « pas de liberté politique individuelle sans indépendance économique personnelle (p. 108) » n’en demeure pas moins daté.
Ne disposer que de ce seul ouvrage aurait été préjudiciable pour l’activisme grand-européen si les excellentes éditions nantaises Ars Magna n’avaient pas produit un fantastique effort de publication sur et autour de Jean Thiriart. Le prophète de la grande Europe, Jean Thiriart (2018, 484 p., 32 €) contient des entretiens (dont un, célèbre, avec Juan Peron en exil à Madrid), des articles de Thiriart ainsi que quatre textes sur lui. L’empire qui viendra (2018, 168 p., 28 €) comprend une préface de Claudio Mutti, un entretien méconnu de Thiriart en 1987 et divers textes géopolitiques. L’Empire euro-soviétique de Vladivostok à Dublin (2018, 191 p., 28 €) se compose, en dehors de quelques entretiens, d’articles du milieu des années 1980 et la version écrite d’une fameuse discussion à Moscou en août 1992 avec Egor Ligatchev, responsable d’une faction conservatrice au sein du Parti communiste russe. S’y trouvent aussi des notes d’un essai inachevé consacré à un hypothétique ensemble euro-soviétique. À la fin de l’année 2018 est cependant paru aux Éditions de la plus grande Europe L’Empire euro-soviétique de Vladivostok à Dublin, préfacé et annoté par Yannick Sauveur (2018, 337 p., 25 €), soit la version intégrale d’esquisses parfois bien avancées.

Il est indéniable que Jean Thiriart soutenait des positions hétérodoxes au sein de l’anticonformisme intellectuel. Athée résolu, ce faustien – il préférait cependant le terme de « prométhéen » – affirme sans ambages que « le politique, c’est la gestion intelligente de l’homme tel qu’il est, pour ce qu’il est. C’est un effort qui doit tendre à une société cohérente, solidaire, cohésive, efficace, en évolution constante (version de Yannick Sauveur, p. 164) ».
Cet infatigable militant qui connut l’aisance professionnelle et la quiétude privée ne cessa d’agir en faveur d’une union géopolitique continentale paneuropéenne réelle. Reconnaissant volontiers sa dette à l’égard du penseur libéral Vilfredo Pareto, ce lecteur attentif de Machiavel considérait que « l’Union soviétique a hérité du destin historique de la principale puissance continentale (version d’Ars Magna, p. 96) ». Dès 1979, il salue l’intervention de l’Armée Rouge en Afghanistan. Dans « L’Union soviétique dans la pensée de Jean Thiriart », José Cuadrado Costa le range parmi les nationaux-bolcheviks, ce qui est quelque peu réducteur. Jean Thiriart savait dépasser les clivages, y compris au sein des droites radicales.
Rares sont en effet ceux qui effectuent à ces temps de relance de la Guerre froide « une critique positive de l’URSS (version de Yannick Sauveur, p. 185) » et pensent que « l’agrandissement de l’URSS vers Dublin et Cadix relève de la perspective historique (Idem, p. 188) ». Jean Thiriart croît que « l’Empire euro-soviétique sera une construction géopolitique parfaite comme le fut l’Empire romain, comme l’était la première République pour Sieyès. Conception de géohistorien chez moi, dénuée de toute passion (Id., p. 69) ». Il regrette en revanche que l’Union soviétique n’ait pas annexé après 1945 la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Hongrie, l’Allemagne de l’Est, etc. La Bulgarie a failli devenir en 1979 une 16e république soviétique… « La forme grand-européenne exige plusieurs modifications des concepts ou habitudes mentales communistes, écrit Jean Thiriart : la stupide et dangereuse théorie des nationalités (multi-nationalités) doit faire place à la supranationalité, l’Empire (version d’Ars Magna, p. 66). »
Il parie enfin que « l’Empire euro-soviétique – une nécessité pour l’URSS – ne sera pas possible en l’absence d’un nouveau concept, celui d’imperium euro-soviétique. Il se charpente autour de deux règles : la garantie de l’« omnicitoyenneté » et l’État-Nation extensif grâce à un “ nationalisme politique ” (“ peuple politique ” opposé en tant que tel à peuple racial, à peuple linguistique, à peuple religieux, à peuple culturel, etc.) (version de Yannick Sauveur, p. 223) », ce qui implique à l’instar du modèle républicain laïque assimilationniste français qu’il ne cesse d’admirer une forme restreinte de cosmopolitisme, voire un mondialisme relatif et partiel, dans le cadre d’un grand espace continental représenté par cette République impériale euro-soviétique.
Remarquable doctrinaire grand-européen, Jean Thiriart s’inspirait finalement de l’exemple national et républicain turc. Son vœu le plus cher aurait-il été de devenir le Mustapha Kemal Atatürk de la très grande Europe ?
Au revoir et dans quatre semaines pour une chronique consacrée à une nouvelle grande figure européenne.
Georges Feltin-Tracol
• Chronique diffusée le 23 avril 2019 à Radio Courtoisie dans le cadre du « Libre-Journal des Européens » de Thomas Ferrier.
09:52 Publié dans Géopolitique, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : européisme, continentalisme européen, europe, affaires européennes, jean thiriart, yannick sauveur, livre, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 mai 2019
DYNAMIQUES MULTIPOLAIRES - ENTRE ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DES FORCES ET ÉQUILIBRES RÉGIONAUX DE SÉCURITÉ

DYNAMIQUES MULTIPOLAIRES
ENTRE ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DES FORCES ET ÉQUILIBRES RÉGIONAUX DE SÉCURITÉ
VIII MOSCOW CONFERENCE ON INTERNATIONAL SECURITY 2019
par Irnerio SEMINATORE
Texte rédigé en vue de la présentation à la VIIIème Conférence Internationale sur la Sécurité de Moscou des 23-25 avril 2019, organisée par le Ministère de la Défense de la Fédération de Russie.
TABLE DES MATIÈRES
Système et conjoncture
Dissuasion et forces conventionnelles
Les dynamiques et les inconnues du système de la multipolarité
La Chine et la conception chinoise de la mondialisation
La Russie et l'enjeu multipolaire
La stratégie de sécurité de la Russie.
La Russie et le retour des grandes stratégies
La stratégie des États-Unis et les tendances générales du système
L'indispensable dialogue stratégique entre l'Europe et la Russie
États-Unis et Chine. Sur le syndrome de la puissance dominante. Préservation du "statu quo" ou inversion de prééminence?
Un faux retour aux simplifications stratégiques de la bipolarité
Rivalités, desseins stratégiques et montée des tensions
Système et conjoncture
La conjoncture historique actuelle est caractérisée par la transformation du cadre stratégique général( le système international) et par la montée de déséquilibres régionaux (sous-systèmes) en leurs interactions multiples (linkages).
L'environnement stratégique en est affecté, car les équilibres de pouvoir entre acteurs majeurs du système multipolaire résultent de leurs régimes politiques et de leurs alliances globales et visent à contre-balancer les coalitions adverses et à assurer la stabilité du système (ou son bouleversement).
A cet égard la triple dynamique de la conjoncture actuelle, de fragmentation, de polarisation et de confrontation, se traduit en une reconfiguration des alliances militaires et des équilibres mondiaux, face aux risques de conflits entre Chine- Etats-Unis et Russie.
La triade Chine-Etats-Unis-Russie instaure ainsi, une politique ambivalente, de rivalité-partenariat-antagonisme, qui a pour enjeu le contrôle de la masse eurasienne et de l'espace océanique indo-pacifique, articulant les deux stratégies complémentaires du Heartland et du Rimland.
Ainsi et au niveau local, l'issue des conflits ne dépend pas des rapports balistico-nucléaires entre les leaders des pôles ,mais de alliances tissées par la diplomatie globale.
Dissuasion et forces conventionnelles
Dans cette perspective, le facteur nucléaire,qui avait été relégué au second plan , après l'effondrement de la bipolarité, redevient aujourd'hui la principale indication des tensions politiques entre les pôles et la coopération de sécurité apparaît comme l'indication la plus évidente de l'orientation stratégique des parties, en compétition ou en conflit pour les ressources. Cependant le chantage des armes nucléaires entre Grands, servant à anéantir l'intention positive de l'agresseur,joue un rôle plus grand,quand la menace anti-force est plus crédible.
Les rivalités, qui secouent aujourd'hui plusieurs régions du monde, (les Pays baltes et l'Europe de l'Est (Ukraine), le Caucase (Géorgie), le Maghreb et l'Afrique sub-saharienne, le Proche et Moyen Orient( Syrie, Liban, Israël, Iran, Turquie), le Golfe (Arabie Saoudite, Yemen, Quarar, sunnisme et chiisme), l'Amérique du Sud et du Nord, la mer de Chine méridionale et l'extrême Orient), ont forcé l'Est et l'Ouest à reconfigurer leurs alliances militaires.

Le but en est de fixer des "lignes rouges" entre les intérêts des pôles et les enjeux régionaux, pour empêcher des escalades non maîtrisables, éviter un affrontement direct entre les acteurs majeurs du système et limiter la décentralisation de la violence au niveau régional.
Les dynamiques et les inconnues du système de la multipolarité
D'une manière générale les dynamiques du système de la multipolarité, par rapport au système bipolaire sont constituées :
- par la permanence du jeu inter-étatique, stabilisateur ou perturbateur
- par une transformation des règles du jeu (alliances) et des partenariats stratégiques, fragilisés par la rupture d'accords devenus obsolètes (Salt, INF )
- par un accroissement du nombre des acteurs essentiels (leaders de bloc) et une redistribution asymétrique de la puissance
- par le retour du révisionnisme territorial (rectification des frontières )
- par une modification de la nature de la guerre et par le croisement du conventionnel,du nucléaire et du virtuel, ou encore par l'irruption des espaces cybernétiques et satellitaires, dans les domaines de la géopolitique et de la stratégie.
- par une multiplications des tensions et des conflits décentralisés, influant sur l'équilibre général des forces.
Ainsi, toute tentative de redéfinir un ordre régional quelconque ne peut être conçue aujourd'hui , que dans la perspective d'un ordre planétaire global et à la recherche de formes d' équilibre et de stabilité à caractère planétaire. C'est par référence à la triangulation géopolitique et militaire de la Russie, des États-Unis et de la Chine et, en subordre, de l'Europe, de l'inde et du Japon,que doit être comprise la liberté relative des puissances régionales du Moyen Orient et du Golfe, et c'est là que se situe une des clés de la stratégie générale de la triade.
La Chine et la mondialisation à la chinoise
Dans ce cadre, la Chine, poursuivant une quête régionale et mondiale d’indépendance stratégique et d'autosuffisance énergétique étend sa présence et sa projection de puissance vers le Sud-Est du Pacifique, l’Océan Indien, le Golfe et l'Afrique, afin de contrer les goulots d’étranglement de Malacca et échapper aux conditionnements extérieures maritimes, sous contrôle américain.
Elle procède par les lignes internes, par la mise en place d'un corridor économique et par une route énergétique Chine-Pakistan-Golfe Persique, reliant le Port de Gwaidar, au pivot stratégique de Xinjiang.

Béijin adopte la gestion géopolitique des théâtres extérieures, selon la doctrine Kissingerienne du "Linkage horizontal" et resserre ses liens continentaux avec la Russie.
L'influence chinoise est complétée par la construction d'une gigantesque "Route de la Soie", reliant le nord de la Chine à l'Europe, via le Tadjikistan, le Kazakhstan et le Turkménistan et opposant les routes terrestres aux routes maritimes.
La Russie et l'enjeu multipolaire
La Fédération de Russie a pris conscience de la mutation profonde de la perspective historique et a adopté le principe du retour à une stratégie générale défensive, qui n'interdit nullement l'initiative et s'exprime par la manœuvre, la percée et l'action.
Le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine au plan geopolitique, a eu pour but de jouer un rôle d’équilibrage et de contre-poids, au cœur de la masse continentale eurasienne et de repartir les zones d'influence entre les deux puissances dominantes, dans le cadre de la multipolarité.
Cette double poussée, virtuellement antinomique, est corrélée à l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), qui fait fonction de stabilisateur régional.
Stratégie de sécurité de la Russie
La lecture de la position russe dans le monde peut être résumée de la manière simplifiée suivante.
Face à la tendance systémique, marquée par l’émergence de pôles de puissance en compétition ou en rivalité , ainsi que par le potentiel de polarisation dû aux alignements mouvants en Asie, la Russie se doit de:
- freiner les élargissements politiques et militaires de l'OTAN en divisant ses adversaires à l'Ouest, en Europe Centrale et au Sud-Est
- stopper le processus de désagrégation au Proche, Moyen Orient et Golfe, en promouvant des nouveaux équilibres de pouvoir autour de l'axe Moscou - Damas - Téhéran et en isolant la Turquie et l'Arabie Saoudite dans la redéfinition des pouvoirs régionaux
- rapprocher les anciens satellites dans la zone de "l’étranger proche" par différents moyens (Union Euro-Asiatique)
- renforcer l'unité continentale au cœur de l'Eurasie par établissement d'une coopération plus étroite avec la Chine
La Russie et le retour des grandes stratégies
Les trois théâtres à travers lesquels la culture stratégique russe pense sa sécurité, occidental (de la Mer Baltique aux chaînes des Carpates), méridional (du Danube à l'Iran), oriental (de la Volga aux monts AltaÏ), placent au cœur de cette culture deux notions-clés: la souveraineté territoriale et la profondeur stratégique.On y ajoutera que la projection des forces sur un théâtre extérieur est placée sous la couverture des capacités nucléaires, ce qui permet de dominer militairement ses zones d'influence. Or, si au plan mondial la relation russo-américaine est fondée sur la stabilité stratégique, au plan régional la liberté de manoeuvre de la Fédération russe se déploie sur les deux théâtres, de la Méditerranée et de la Mer Noire.
La stratégie des États-Unis et les tendances générales du système
Le Secrétaire à la Défense de l'Administration Trump,l'ancien Général des Marine's James Mattis, a dévoilé en février 2018, à l'Université John Hopkins une nouvelle stratégie de défense nationale, d'où l'on déduit qu'un changement historique est intervenu depuis deux décennies dans la politique extérieure américaine.
Le principal objectif des États-Unis est désormais la concurrence entre les grandes puissances et non le terrorisme. "La Chine est un concurrent stratégique, qui utilise une politique économique prédatrice pour intimider ses voisins, tout en militarisant des zones de la mer de Chine méridionale".
"La Russie a violé les frontières des pays voisins et exerce un droit de veto sur les décisions économiques, diplomatiques et sécuritaires de ses voisins".

Par ailleurs, "la Chine recherche" l'hégémonie dans la région indo-pacifique à court terme et le remplacement des États-Unis, pour atteindre la prééminence mondiale dans l'avenir".
"La Russie, pour sa part, tente de briser l'Organisation de l'Atlantique Nord (OTAN) et de changer les structures économiques et sécuritaires européénnes et du Moyen-Orient"
Ainsi,pour les Etats-Unis,une conclusion est certaine : "la menace croissante des puissances révisionnistes aussi différentes que la Chine et la Russie.....cherche à créer un monde cohérent avec leurs modèles autoritaires".
Trois régions clés sont indiquées comme objets d'une préparation au conflit: l'Indo-pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient.
Dès lors, face au déclin de l'ordre international,fondé sur des règles acquises de longue date et à une concurrence stratégique entre États, le but de l'Amérique est de rester la puissance militaire prééminente dans le monde et d’œuvrer pour que l'équilibre des forces reste en sa faveur. Elle doit faire en sorte que "l'ordre international reste plus favorable à sa sécurité et à sa prospérité, en préservant l'accès aux marchés".
La rivalité entre grandes puissances et la lutte pour la prééminence se traduisent ainsi en une compétition stratégique accrue.
L'indispensable dialogue stratégique entre l'Europe et la Russie
Quant à l'Europe de l'Ouest, la globalisation des enjeux de sécurité, impose une analyse des tendances générales du système mutipolaire et suggère l'établissement d'un dialogue stratégique entre l'Europe et la Russie
Le fondement de ce dialogue repose sur l'exigence d'allègement des tensions et des défis , portés à la stabilité régionale et mondiale.
Il a été observé que des similitudes existent entre deux types de défis, le changement du "statu quo" territorial, en Europe et en mer de Chine méridionale, bref ,en Ukraïne et dans les iles Paracels, Spratley, récif de Mischief et, plus au nord, dans les îles Senkaku (Siaoyu).
Toutefois, dans l' Europe du sud-est, il s'agirait d'un changement de paradigme, concernant l'intégrité territoriale des États; dans l'autre, de "l'internationalisation d'un conflit en mer de Chine" méridionale et orientale, qui cumule une pluralité de revendications de pays frontaliers.
États-Unis et Chine
Sur le syndrome de la puissance dominante
Préservation du "statu quo ou inversion de prééminence?
Les États-Unis seront ils disposés à renoncer à leur prééminence en Europe et en Asie, autrement dit ,dans l'ensemble du système international, ou se montreront capables de trouver des arrangements et des formes de coexistence, qui les détournent d'une fatalité apocalyptique?
En cas de doute, seront ils poussés, par la préservation du"statu quo" et de la prééminence stratégique, ainsi que par une perception antagoniste des faiblesses internes de la puissance rivale, à prendre des risques inconsidérés, par une action de dissuasion préventive?( coup de Copenhague de 1885/UK, Port-Arthur de 1905 et Pearl-Harbor de 1941/ J, Corée du Nord en 1950/URSS)
Au niveau de la conjoncture historique et de la fenêtre d'opportunités, consenties à la Chine,la question est de savoir si l'Empire du milieu a le désir et les moyens de changer le "statu-quo" et d'accéder au rang dominant du système?
Un faux retour aux simplifications stratégiques de la bipolarité
Le cœur du système international de la multipolarité tient certes au triangle stratégique États-Unis, Chine et Russie, mais corrélé à une pluralité de sous- systèmes régionaux, en compétition globale. Ces sous-systèmes sont soumis à des sphères d'influence disputées et souvent exclusives et sont doués d'inégale importance politique et militaire.

Face à un Occident fragmenté,le but de l'Europe réformée (et post- Brexit ) sera-t-il de revenir à un jeu de puissance d'équilibre entre les Etats- Unis et la Russie, bref à la stratégie gaullienne de troisième force, que l'U.E ne peut pratiquer?
Rivalités, desseins stratégiques et montée des tensions
Deux grands mouvements stratégiques rivaux s'esquissent à présent, au niveaux planétaire, internes et extérieurs à l'Eurasie:
- l'alliance sino-russe, assurant l'autonomie stratégique du Hearthland , en cas de conflit et promouvant, en temps de paix, la coopération intercontinentale en matière de grandes infrastructures, (projet OBOR (One Belt, One Road), avec la participation d'environ 70 pays )
- la stratégie du "containement" des puissances continentales par les puissances maritimes du "Rimland" (Amérique, Japon, Australie , Inde, Europe etc), comme ceinture péninsulaire extérieure
Les deux camps sont en rivalité déclarée et leurs buts stratégiques opposés.
En effet, le couple sino-russe est défini "concurrent stratégique", ou "concurrent systémique"(notamment par l'UE vis à vis de la Chine) et refuse de se soumettre à l'ordre international issu de la deuxième guerre mondiale et dessiné par les Etats- Unis .
Dans ce contexte,la défense de l'ordre, de la stabilité et du "statu quo" est assurée par la seule puissance globale du moment, l'Amérique et ses alliés. car,
en termes de politique multipolaire, Chine et Russie soutiennent le principe des zones d'influence exclusives, dites de "l'étranger proche", (Ukraine et Géorgie pour la Fédération russe et Mer de Chine méridionale pour Béijin)
En termes prospectifs et sur le plan des équilibres régionaux à long terme, les interventions des États-Unis,depuis la guerre du Golfe, ont altérés les rapports politiques et diplomatiques antérieurs entre Iran, Arabie Saoudite et pays de la région.
Dans cette même zone l'appui militaire de la Russie à la Syrie a influé sur la desoccidentalisation des affaires régionales et mondiales et, localement, sur la défaite de l'extrémisme islamique , au profit des intérêts russes du flanc sud (du Danube à la Perse et en Asie Centrale).
En termes de modernisation politique, au Proche et Moyen Orient, les idéologies importées de l'Occident, libéralisme, socialisme, laïcité, ont fait faillite et les seules formes de régimes politiques adoptées, ont été les dictatures militaires et les totalitarismes religieux, en conflit permanent.
La révision doctrinale des États-Unis en matière de sécurité s'inscrit aujourd'hui dans le gel progressif des accords sur le contrôle des armements nucléaires
Du point de vue stratégique, le retrait américano-russe des accords START et INF, et celui des accords nucléaires avec l'Iran ont sapé la confiance diplomatique entre puissances occidentales et ont mis en crise les relations des USA avec l'Europe
Par ailleurs une bataille idéologique majeure fonde le rapprochement russo-chinois sur le refus des critères occidentaux de légitimations du pouvoir et sur le mode d'exercice de l'autorité, la démocratie libérale pour les uns, l'autocratie souveraine pour les autres.
Les héritages historiques ne résistent pas toujours aux changements et le déplacement du centre de gravité des tensions vers l'Asie Pacifique, motivant la "politique de pivot" d'Obama,comme "ultime épreuve de force destinée à maintenir la Chine à un rang subalterne" (H.Kissinger), privent, en Europe, l'Alliance atlantique de sa raison d'être et risquent de ne pas la faire survivre aux finalités qui l'avaient fait naitre, celle d'un monde bipolaire.
Au même temps, l'émergence de la question nationale, identitaire et de souveraineté, se répercute en une forme de crise de cohésion des institutions européennes et assume le visage sécessionniste de remise en cause du pacte national entre Barcelone et Madrid et entre Londres, Edinbourg et Dublin à propos du Brexit, dans un processus de désagrégation interne des unités étatiques, réalisées au cours des XIX et XXèmes siècles

Ainsi, la politique de l'équilibre des forces en Asie orientale ne permet pas de considérer les États-Unis comme un balancier , mais comme partie intégrante de l'équiliblibre régional, car l'exercice de l'hégémonie mondiale fait de l'Amérique une puissance globale et, au même temps le centre de gravité stratégique du système.
Dès lors, une montée des tensions apparaît comme une perspective probable, au sein du système planétaire, où les principaux acteurs ne sont pas d'accord, ni sur une conception commune de l'ordre mondial, ni sur les règles de conduite pour les atteindre.
VIII MOSCOW CONFERENCE ON INTERNATIONAL SECURITY 2019
System and situation
The current historical situation is characterized by the transformation of the general strategic framework (the international system) and by the rise of regional imbalances (subsystems) in their multiple interactions (linkages).
All this affects the strategic environment, because the balances of power between major players in the multi-polar system result from their global alliances, aimed at counterbalancing adverse coalitions and ensuring the stability of the system (or its transformation).
In this respect, the triple dynamic of the current situation – fragmentation, polarization and confrontation – is reflected in a reconfiguration of the military alliances and global strategic balances, in the face of the risks of conflicts between China, the United States and Russia.
In this way the China-USA-Russia triad is establishing an ambivalent policy of rivalry-partnership-antagonism. At stake is the control of the Eurasian mass and the Indian-Pacific ocean space, expressed in the two complementary strategies of Heartland and Rimland.
In this way and at local level, the outcome of the conflicts does not depend on the nuclear-ballistic relations between the leaders of the poles, but on alliances woven by global diplomacy.
Regional rivalries
The rivalries that are shaking several parts of the world today (the Baltic countries and Eastern Europe (Ukraine), the Caucasus (Georgia), the Maghreb and sub-Saharan Africa, the Near and Middle East (Syria, Lebanon, Israel, Iran, Turkey), the Gulf (Saudi Arabia, Yemen, Qatar, Sunni and Shiite), South and North America, the South China Sea and the Far East), have forced both East and West to reconfigure their military alliances.
The aim is to set "red lines" between the interests of the poles and regional issues, so as to prevent uncontrollable escalations, to avoid any direct confrontation between the major players in the system, and to limit the decentralization of violence at regional level.
Dynamics and unknowns of the multi-polar system
In general, the dynamics of the multi-polar system, compared with the bipolar system, consist of:
- the permanence of the inter-state game, with either stabilizing or disruptive effects
- a change in the rules of the game (alliances) and of strategic partnerships, weakened by the breakdown of agreements that have become obsolete (SALT, INF)
- an increase in the number of key players (block leaders) and an asymmetrical redistribution of power
- the return of territorial revisionism (rectification of borders)
- a change in the nature of war and the mixing of conventional, nuclear and virtual warfare, and also the sudden and rapid inclusion of cybernetic and satellite spaces as geopolitical and strategy fields.
- a multiplication of tensions and decentralized conflicts, influencing the overall balance of forces.
Thus, any attempt to redefine any one regional order can be conceived today only in the perspective of a global planetary order and of the search for forms of planetary equilibrium and stability. It is by reference to the geopolitical and military triangulation of Russia, the United States and China and, at subordinate level, of Europe, India and Japan, that the relative freedom of the regional powers must be understood. It is there that one of the keys to the hoped-for success of the triad's general strategy lies.
The indispensable strategic dialogue between Europe and Russia
When it comes to Western Europe, the globalization of security issues requires an analysis of the general trends of the multi-polar system and suggests the need to establish a strategic dialogue between Europe and Russia.
The basis of this dialogue is the need to alleviate tensions and challenges to regional and global stability
A false return to the strategic simplifications of bipolarity
The heart of the international multi-polarity system correlates with a plurality of regional subsystems, in global competition with one another. These subsystems are subject to disputed and often exclusive spheres of influence and are of unequal political and military significance.
Faced with a fragmented West, will the goal of reformed (and post-Brexit) Europe be to return to a power play of equilibrium between the United States and Russia, in short to the Gaullist third force strategy that the EU is unable to practice? In prospective terms and on the level of long-term regional balances, US interventions since the Gulf War have altered the previous political and diplomatic relations between Iran, Saudi Arabia, and other countries of the region.
In terms of political modernization, in the Near and Middle East, ideologies imported from the West – liberalism, socialism, secularism – have failed and the only forms of political regimes adopted have been military dictatorships and religious totalitarianism, in permanent conflict.
The United States's revision of its security doctrine is expressed today in the progressive freeze on nuclear arms control agreements.
From a strategic point of view, the US-Russian withdrawal from the START and INF agreements, and from the nuclear agreements with Iran have undermined the diplomatic trust between Western powers and produced a crisis in the United States' relations with Europe.
Elsewhere the balance-of-forces policy in East Asia does not allow us to consider the United States as a balancing pole, but as an integral part of the regional equilibrium, since the exercise of world hegemony makes America a global power and at the same time the strategic centre of gravity of the system. For this reason an increase in tensions appears as a likely prospect within the planetary system, where the main actors do not agree, either on a common conception of the world order, on the rules of conduct to achieve it.
15 avril 2019.
12:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, europe, affaires européennes, eurasie, asie, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 11 mai 2019
Quand l’Europe s’éveillera… La Chine s’esclaffera !

Quand l’Europe s’éveillera… La Chine s’esclaffera !
Par Guillaume Berlat
Ex: https://www.les-crises.fr
« Les temps changent. On ne sait pas quand, mais c’est toujours avant qu’on s’en aperçoive » (Catherine Breillat, cinéaste, romancière). Les temps changent, le ton change. Hier bénie, aujourd’hui (presque) honnie. Tel est le traitement que subit désormais la Chine. Au moment où le président chinois, Xi Jinping effectue une brève visite en Europe (Italie, Monaco1, France) en cette dernière décennie du mois de mars 2019, les critiques pleuvent comme à Gravelotte sur l’Empire Céleste2. Violations répétées des droits de l’Homme (Cf. contre les Ouigours ou contre l’ex-président d’Interpol, Meng Hongwei …), visées hégémoniques en Asie, en Afrique, voire en Europe à travers l’initiative des « Nouvelles routes de la soie »; violations graves des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC basée à Genève) en pratiquant une concurrence déloyale, espionnage à grande échelle (Cf. critiques portées contre le géant des télécommunications Huaweï au moment où il concourt au marché de la 5G)…
Telles sont les philippiques qui reviennent le plus souvent, de manière inattendue, dans la bouche des dirigeants occidentaux, européens avec une certaine insistance depuis quelques dernières semaines. Les mêmes qui ne tarissaient pas d’éloge sur l’Empire Céleste, il y a peu encore. Comme si la guerre commerciale contre la Chine dans laquelle s’est lancée Donald Trump avait enfin décillé les yeux de la Belle au Bois Dormant qui a pour nom Europe sur les visées de Pékin. Le temps n’est plus au libéralisme échevelé, à la candeur rafraichissante. Le temps serait plutôt au patriotisme économique, à la Realpolitik, à la défense des intérêts bien compris. Mais, l’Europe (l’Union européenne) divisée et sans cap est-elle bien armée pour mener à bien ce combat contre la puissance montante du XXIe siècle ?3 Puissance normative incontestée, l’Europe est et restera encore longtemps une impuissance stratégique.
***
L’EUROPE : UNE PUISSANCE NORMATIVE
Pour tenter de comprendre l’impasse structurelle dans laquelle se trouve l’Union européenne, il est indispensable de se pencher sur la philosophie générale qui a présidé à sa création (la paix par le droit) pour être en mesure d’apprécier la conséquence de cette démarche (la construction par le vide).
La paix par le droit : une nouvelle utopie.
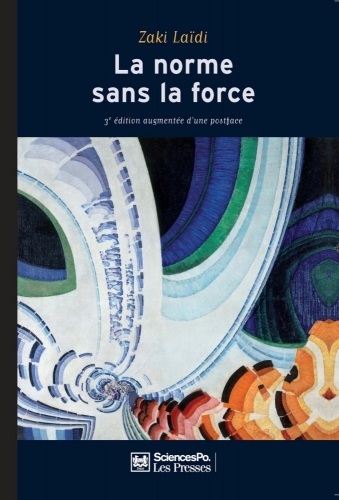 Faut-il le rappeler, comme le Conseil de l’Europe en 1949, l’Union européenne s’est construite sur le mantra de la paix par le droit (celui qui avait si bien fonctionné à l’époque de la SDN…) ! Par sa force intrinsèque et quasi-divine, la norme est censée résoudre tous les problèmes de l’Europe de l’après Seconde Guerre mondiale, de la Guerre froide, de l’après-Guerre froide et de la nouvelle Guerre froide. Ni plus, ni moins La construction européenne – du traité de Rome au traité de Lisbonne – s’est reposée sur d’énormes conventions internationales que seuls quelques initiés – dont ni vous, ni moi ne sommes – parviennent à comprendre et à interpréter. À Bruxelles, les hommes forts (les fortes femmes) de la Commission et du Conseil sont les juristes. Ils pondent en permanence de nouvelles normes et traquent l’État délinquant soit celui qui ne respecte pas les valeurs du machin (Hongrie, Pologne, Roumanie), soit celui qui viole les sacro-saintes règles budgétaires (Grèce, Italie, voire France)4. L’Europe à 28/27 n’a toujours ni cap, ni affectio societatis alors même qu’elle est secouée par des vents mauvais tant à l’intérieur (feuilleton sans fin du « Brexit », montée du sentiment national, croissance atone, phénomènes migratoires non contrôlés, terrorisme…) qu’à l’extérieur (Diktats américains, arrogance chinoise, cavalier seul russe, déclin de l’Occident…). « Cette non-personne pèse de l’extérieur, sans habiter notre intérieur »5.
Faut-il le rappeler, comme le Conseil de l’Europe en 1949, l’Union européenne s’est construite sur le mantra de la paix par le droit (celui qui avait si bien fonctionné à l’époque de la SDN…) ! Par sa force intrinsèque et quasi-divine, la norme est censée résoudre tous les problèmes de l’Europe de l’après Seconde Guerre mondiale, de la Guerre froide, de l’après-Guerre froide et de la nouvelle Guerre froide. Ni plus, ni moins La construction européenne – du traité de Rome au traité de Lisbonne – s’est reposée sur d’énormes conventions internationales que seuls quelques initiés – dont ni vous, ni moi ne sommes – parviennent à comprendre et à interpréter. À Bruxelles, les hommes forts (les fortes femmes) de la Commission et du Conseil sont les juristes. Ils pondent en permanence de nouvelles normes et traquent l’État délinquant soit celui qui ne respecte pas les valeurs du machin (Hongrie, Pologne, Roumanie), soit celui qui viole les sacro-saintes règles budgétaires (Grèce, Italie, voire France)4. L’Europe à 28/27 n’a toujours ni cap, ni affectio societatis alors même qu’elle est secouée par des vents mauvais tant à l’intérieur (feuilleton sans fin du « Brexit », montée du sentiment national, croissance atone, phénomènes migratoires non contrôlés, terrorisme…) qu’à l’extérieur (Diktats américains, arrogance chinoise, cavalier seul russe, déclin de l’Occident…). « Cette non-personne pèse de l’extérieur, sans habiter notre intérieur »5.

La construction par le vide : une puissance Potemkine
Nous avons aujourd’hui un exemple particulièrement éclairant de la vacuité européenne sur la scène internationale en analysant la relation de Pékin avec la France mais aussi avec l’Union européenne. Mais, un léger retour en arrière s’impose. Au cours des dernières années, sous l’influence de la pensée libérale à l’anglo-saxonne (le tout dérégulation), la Commission européenne (agissant dans l’un de ses domaines de compétence exclusif qu’est le commerce) s’est targuée de négocier et de conclure des dizaines de traités de commerce, de libre-échange avec la planète entière. Nos petits marquis drogués aux lobbies, particulièrement actifs à Bruxelles (« un aéropage technocratique, apatride et irresponsable »), nous expliquent fort doctement que tous ces torchons de papier constituent le nec plus ultra de la mondialisation heureuse6, la meilleure garantie pour les citoyens européens en termes de prospérité et de bonheur (« L’Europe des réponses » chère à Nathalie Loiseau), le signe de L’Europe indispensable7. Or, la réalité est tout autre comme ces mêmes citoyens peuvent s’en rendre compte concrètement.
L’Union n’est qu’un tigre de papier ouvert aux quatre vents. Elle ignore un principe cardinal de la diplomatie classique qui a pour nom réciprocité. Elle ouvre grandes ses portes aux entreprises chinoises alors que leurs homologues européennes sont soumises à des règles drastiques et des pratiques déloyales8. Souvenons-nous que Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI), porteur de la diplomatie économique, ne jurait que par la Chine. Sans la Chine, point de salut. Or, aujourd’hui, les langues commencent à se délier sur les étranges pratiques commerciales chinoises. Du côté de la Commission européenne, c’était le silence radio. Du côté de nos partenaires, européens, c’était le chacun pour soit et les vaches seront bien gardées. Comme cela est tout à fait normal de la part d’une authentique grande puissance comme l’est la Chine9, Pékin pratique un vieux classique qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps, le diviser pour mieux régner, la diplomatie des gros contrats pour mieux faire taire les rabat-joie10. Nous en avons un exemple frappant avec l’Italie qui est le premier pays du G7 à emprunter les « nouvelles routes de la soie »11. Une sorte d’embarquement pour Cythère du XXIe siècle.
L’angélisme est une plaie en ces temps conflictuels. Les États membres de l’union européenne ne comprendront jamais que « les puissants n’accordent leur amitié protectrice qu’en échange de la servitude »12. Ils commencent à peine à percevoir que la Chine entend transformer sa puissance économique en puissance diplomatique et stratégique aux quatre coins de la planète.
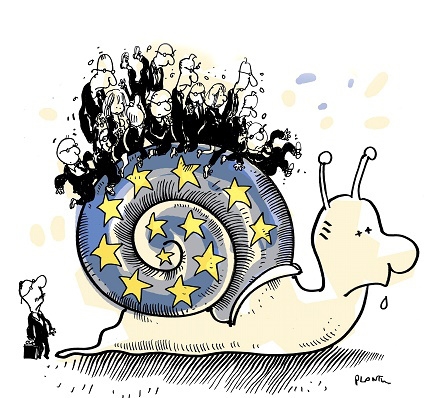
L’EUROPE : UNE IMPUISSANCE STRATÉGIQUE
Il est important d’en revenir aux fondamentaux des relations internationales. Dans un monde frappé au coin de la prégnance du rapport de forces, la désunion structurelle de l’Europe fait sa faiblesse sur la scène internationale. Par ailleurs, au moment où l’on nous annonce que l’Union se réveille face à la Chine, le moins que l’on puisse dire est que cette nouvelle posture relève encore de la cacophonie.
La désunion fait la faiblesse : l’Europe s’agite
L’opération de charme du nouvel empereur. C’est que le président Xi Jinping n’est pas né de la dernière pluie. Il sait parfaitement caresser ses hôtes français dans le sens du poil. Il le fait avec un sens aigu de l’emphase diplomatique. Pour s’en convaincre, il n’est qu’à se reporter à la tribune qu’il publie dans un grand quotidien français à la veille de sa visite en France. Il la conclut ainsi :
« La responsabilité. Ensemble, la Chine et la France pourront apporter de grandes transformations. L’histoire n’a cessé de le prouver au cours des 55 ans écoulés. À l’heure actuelle où l’humanité se trouve à la croisée des chemins, les grands pays du monde ont à assumer les responsabilités qui leur incombent. Membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, la Chine et la France sont invitées à renforcer leur concertation pour défendre le multilatéralisme, préserver les normes fondamentales régissant les relations internationales basées sur les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies, relever conjointement les défis, contribuer à la prospérité et à la stabilité dans le monde et promouvoir la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.
Comme dit un proverbe chinois : « Un voyage de mille lieues commence toujours par le premier pas ». L’illustre écrivain français Victor Hugo disait : « Que peu de temps suffit pour changer toutes choses ! » Aujourd’hui sur un nouveau point de départ historique, la Chine souhaite aller de l’avant avec la France, concrètement et solidement, pour réaliser des accomplissements encore plus éclatants »13.
Et ses officines de propagande (« Échos de Chine ») d’inonder d’encarts publicitaires à l’eau de rose les principaux médias français à la veille de la visite en France du grand timonier sur les thèmes du développement d’un « partenariat stratégique global plus étroit et durable », de « Paris et Wuhan : le Conte de deux cités », de « Beijing et Paris : partenaires majeurs dans la lutte contre le changement climatique » (on en tombe à la renverse en se reportant aux facéties environnementales chinoises), de « Faire progresser plus avant les relations franco-chinoises », des « Perspectives de la coopération pragmatique entre la France et la Chine »… En prime, nous avons même droit aux dernières raffarinades : « Cette année sera une année fertile pour les relations franco-chinoises » (on se croirait revenu au temps d’Alice au pays des merveilles). Dans le rôle de l’idiot utile, Quasimodo n’a pas son pareil. Il est tout simplement parfait et impayable. Une fonction étrange pour un ancien Premier ministre de Jacques Chirac, mais qui ne gêne pas du tout l’intéressé. Ce dernier n’aime d’ailleurs pas qu’on vienne le chercher sur ces ambiguïtés : à l’en croire, il ne joue qu’un seul rôle, celui de poisson-pilote en Chine pour les entreprises françaises. Fermez le ban !
Jupiter tombe sous le charme du carnet de chèques chinois. Comment ne pas succomber aux charmes d’une telle sirène qui arrive avec de nombreuses promesses de contrats pour des entreprises françaises (on met à l’eau bouche avec des quantités extravagantes d’achats d’avions [commande de 300 Airbus pour 30 milliards d’euros par la compagnie d’État CASC]14, de navires et d’autres gadgets dont les Gaulois sont particulièrement friands) ? En bon français, cela s’appelle acheter son ou ses interlocuteurs. Comment évoquer le concept grossier de « violations des droits de l’Homme » dans cette ambiance du genre Embrassons-nous Folleville ?15 Fidèle à son habitude, Emmanuel Macron explique lors de sa conférence de presse commune à l’Élysée que la discussion sur la question des droits de l’Homme avec son homologue a été « franche » mais nous n’en saurons pas plus. Diplomatie de la discrétion oblige !
Oubliées les promesses européennes visant à faire front commun contre le tigre chinois (qui n’est pas de papier, les investissements chinois en Europe sont passés de 1,4 milliard de dollars en 2006 à 42,1 en 2018 après avoir connu un pic de 96,8 milliards en 2017) et vive le cavalier seul, le chacun pour soi dont sont coutumiers les 27/28 ! Il y a fort à parier que les moulinets de Jean-Yves Le Drian (qui accueille le président chinois sur l’aéroport de Nice) sur le thème du double sens des nouvelles routes de la soie feront rapidement pschitt. Il y a fort à parier que les déclarations viriles d’Emmanuel Macron avant la visite officielle chinoise aient autant d’effets positifs sur Xi Jinping que sur Donald Trump en son temps (il devait revenir sur son refus de l’accord sur le climat et sur celui sur le nucléaire iranien, Jupiter nous avait promis). À l’Élysée, Pinocchio (Bijou dans une robe longue rouge immaculée) fait assaut d’amabilités à l’égard de son hôte de marque. Pour nous rassurer sur les bonnes et pures intentions chinoises, quelques experts viennent nous faire la leçon : « La Chine s’essouffle, le monde s’inquiète »16, « La position de Xi Jinping n’est pas si confortable qu’elle en a l’air »17 au regard de la crise commerciale américano-chinoise18. Il est vrai que quelques nuages assombrissent le ciel bleu chinois après une longue période faste. Est-ce une tendance conjoncturelle ou structurelle ? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Mais, heureusement, l’Europe a décidé de sortir de sa torpeur pour prendre la mesure du problème. Faut-il avoir peur de la Chine ?19 Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle qui a noué des relations diplomatiques avec la Chine communiste au nez et à la barbe des Américains.

La cacophonie fait la foire : l’Europe se réveille20
Un réveil tardif et mou. Lors de ses entretiens à la villa Kérylos (Beaulieu), Emmanuel Macron prône « un partenariat équilibré » avec Pékin (déficit commercial de la France de 30 milliards d’euros)21. [Il enfonce le clou lors des entretiens à l’Élysée au cours desquels il déroule le tapis rouge et tous les leviers de la diplomatie gastronomique]. Des limites, du piège de la démagogie surtout lorsque nous apprenons qu’Emmanuel Macron, trop faible pour faire le poids, appelle de ses vœux la constitution d’un front européen (uni, nous imaginons !) destiné à déjouer la stratégie et les ambitions planétaires de Pékin. Trop peu, trop tard, pourrait-on dire. Des mots, toujours des mots… Où est la stratégie suivie d’actes forts d’une Europe unie ? On peine toujours à la découvrir. Ce qui fait le plus défaut à l’Union européenne est sa capacité d’anticipation sans parler de son absence de volonté de prendre à bras le corps les grands problèmes stratégiques du monde. Elle préfère se quereller sur des taux de TVA, de pourcentages de croissance et autres vétilles qui ne contribuent pas à faire d’elle un acteur du monde. En réalité, elle est de plus en plus spectatrice d’un spectacle dans lequel elle joue les seconds rôles. Comme le souligne si justement, Thierry de Montbrial : « Quand on reprend les conversations entre chefs d’État au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on s’aperçoit qu’ils ne parlaient pas de tactique, quand ils se rencontraient mais de visions »22. C’est là toute la différence entre celui qui fait l’avenir et celui qui le subit. « La construction européenne vise à surmonter les conflits et les guerres du passé. Elle a pour but la paix, la prospérité, la stabilité, la sécurité. Elle a construit un édifice institutionnel qui est bien huilé et tourne remarquablement bien. Pour renverser la formule d’Emile de Girardin, elle donne l’impression de tourner le dos à l’imprévu pour mieux diriger le cours des choses » comme le souligne un diplomate brillant, Maxime Lefebvre.
Une grande interrogation pour l’avenir.
Que peut-on mettre concrètement à l’actif de l’Union européenne au cours des dernières semaines ?
Une réponse visible, qui n’est pas pour autant efficace, est donnée au bon peuple. Xi Jinping est convié, le 26 mars 2019, à rencontrer à l’Élysée, outre le président Macron, la chancelière allemande, Angela Merkel et le président de la commission européenne, Jean-Claude Juncker23. Drôle de Sainte-Trinité (le terme de Pieds Nickelés serait plus approprié) pour sermonner le Grand Timonier et répondre d’une seule voix aux ambitieuses « routes de la soie » ! Mais, ce trio parle-t-il et a-t-il reçu mandat expresse des autres partenaires pour parler et s’engager en leur nom ? Emmanuel Macron a fait chou blanc avec son sermon aux citoyens européens. Angela Merkel est sur le départ et voit ses prérogatives rogner par son successeur, AKK24. Jean-Claude Juncker, qui ne sera pas reconduit dans ses fonctions après les élections européennes du 26 mai 2019, peine à marcher à trop lever le coude. Mais, Emmanuel Macron nous indique avoir plaidé pour un « multilatéralisme rénové » (que signifie ce nouveau concept ?) et « plus équilibré » auprès de Xi Jinping tout en confessant l’ampleur des désaccords entre la Chine et le trio choc25. Comme le démontre amplement la guerre commerciale américano-chinoise26, Pékin ne comprend que la force dans son état brut. Un grand classique des relations internationales ! Mais, nous sommes pleinement rassurés en apprenant l’existence de « convergences » euro-chinoises à l’Élysée27. Sur quels sujets, c’est un autre problème ! Nous les sommes encore plus en prenant connaissance des déclarations de de Bruno Le Maire selon lesquelles : « Face à la Chine et aux États-Unis, l’Europe doit s’affirmer comme une puissance souveraine ». Un superbe exemple de diplomatie déclaratoire.
Une réponse moins visible mais plus concrète. Le Parlement européen vient d’adopter (février 2019) et demande la mise en œuvre rapide de « l’instrument de filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité » 28. Il s’agit à l’évidence d’une initiative heureuse qu’il faut saluer. Encore, faut-il qu’elle trouve sa concrétisation dans les meilleurs délais et qu’elle soit ensuite appliquée avec la plus grande rigueur en cas de violation avérée de ses dispositions. L’Union européenne serait bien inspirée de voir ce qui se passe Outre-Atlantique en la matière29. En dernière analyse, il ne faut pas avoir la main qui tremble.
Une réponse encore hypothétique. Manifestement, du côté de la Commission européenne et sous l’amicale pression des États, on commence à mettre au point une sorte de feuille de route dans les relations UE/Chine30. Voici la relation qui nous en est faite par l’hebdomadaire Le Point.
« Nous avons avec la Chine des relations – comment dire ? – bonnes, mais qui ne sont pas excellentes. La Chine aujourd’hui pour nous est un concurrent, un partenaire, un rival. » C’est ainsi que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, concluait le Conseil européen le 22 mars, en amont de la visite de Xi Jinping en Europe, qui sera suivi, le 9 avril, d’un sommet UE-Chine. Emmanuel Macron a invité le président de la Commission et la chancelière Merkel à se joindre à la visite du leader chinois à Paris, en guise de hors-d’œuvre au futur sommet.
La semaine dernière, les chefs d’État et de gouvernement ont débattu des dix mesures que la Commission a mises sur la table vis-à-vis de l’empire du Milieu, qualifié de « rival systémique ». Un changement de ton qui traduit l’impatience des Européens à voir la Chine s’ouvrir à leurs entreprises – notamment les marchés publics –, cesser le dumping déloyal par ses prix, mettre fin au transfert de technologies forcé. En somme, rejoindre le concert des nations dans le cadre de l’OMC et accepter les règles du marché. Or, ce n’est pas le chemin emprunté par Pékin après son adhésion à l’OMC en 2001. Les Occidentaux ont eu la naïveté de croire que la Chine deviendrait une économie sociale de marché. Elle est demeurée étroitement entre les mains du Parti communiste chinois et a inventé une forme de « capitalisme d’État » qui l’a rendue quatre fois plus riche qu’en 2001…

Zhang Ming, l’ambassadeur de Chine auprès de l’Union européenne, a prévenu les Européens que les avancées en termes d’ouverture économique s’effectueront à un « rythme raisonnable » et que « les demandes européennes seront « progressivement prises en compte ». Donc, il n’y a pas de « grand soir » à attendre ni de la visite de Xi Jinping à Paris ni du prochain sommet UE-Chine.
Parmi les dix mesures préconisées par la Commission, appuyée par Federica Mogherini, la haute représentante pour les relations extérieures, certaines relèvent encore, disons, des bons sentiments. Quand on pense pouvoir coopérer avec Pékin sur l’ensemble des trois piliers des Nations unies, à savoir les droits de l’homme, la paix et la sécurité et le développement, l’Union européenne demeure dans le formalisme diplomatique. Mais il est peu probable que la situation s’améliore, à court terme, au Tibet ou pour la minorité musulmane ouïghour. En revanche, l’Union européenne et la Chine sont davantage en phase sur le climat. Jean-Claude Juncker appellera Pékin à plafonner ses émissions de CO2 avant 2030, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Il existe également une bonne coopération sino-européenne sur le dossier iranien.
La mesure 5 est un peu plus « punchie » puisque l’UE « invite » la Chine à tenir ses engagements, dont la réforme de l’OMC, « en particulier pour ce qui est des subventions et des transferts de technologies forcés », de même que la protection des indications géographiques. Dans la mesure 6, la Commission appelle le Parlement européen et le Conseil européen à adopter l’instrument international de réciprocité sur les marchés publics avant la fin 2019. Cet appel a été entendu par le Conseil européen qui, dans ses conclusions du 22 mars, appelle à son tour « à la reprise des discussions sur l’instrument international de passation des marchés de l’UE ». On n’en est donc pas à décider. On discute… depuis 2012. L’Allemagne bloquait la discussion. Elle vient de changer d’avis à la faveur de la fusion avortée entre Alstom et Siemens. Ce travail sera donc parachevé lors de la prochaine législature, après les élections européennes. La mesure 7 est également musclée, puisque la Commission se propose de publier des « orientations » afin que les prix proposés dans les marchés publics de l’UE prennent en compte réellement les normes en matière de travail et d’environnement. C’est par ce biais que les concurrents chinois ne pourraient soutenir la concurrence avec les entreprises européennes. Emmanuel Macron, lui, voulait aller plus loin et établir une préférence communautaire dans les marchés publics. Il n’a pas été suivi par une majorité d’États membres. La Commission proposera également de compléter la législation européenne pour contrecarrer les distorsions de concurrence des pays tiers sur les biens et les services échangés dans le marché intérieur. S’agissant de la 5G, la Commission a pris en compte les problèmes de sécurité posés par le leader mondial Huawei et fera des propositions très prochainement, a annoncé Juncker31. On ne peut que se féliciter que Bruxelles ait décidé de ne pas exclure l’équipementier chinois du marché de la 5G32.

Enfin, la Commission invite les États membres à mettre en œuvre le plus rapidement possible, de manière « complète et effective », la récente législation sur le filtrage des investissements étrangers dans les domaines sensibles. Cette législation n’est pas contraignante pour les États, qui sont seulement tenus de s’informer les uns les autres. Cela n’empêcherait nullement, par exemple, l’Italie de poursuivre le partenariat qu’elle vient de signer avec Xi Jinping qui prévoit, dans le cadre du projet pharaonique des « nouvelles routes de la soie », des investissements chinois dans les ports stratégiques de Gênes et de Trieste. Un protocole d’accord « non contraignant », s’est empressé de dire Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, devant les froncements de sourcils suscités par cet accord à Washington, Bruxelles et Paris. « La partie chinoise souhaite des échanges commerciaux dans les deux sens et un flux d’investissements dans les deux sens », a assuré, de son côté, Xi Jinping. « La relation entre l’Union européenne et la Chine ne doit pas être avant tout une relation commerciale, elle doit être une relation politique et géostratégique », a souligné Emmanuel Macron, au sortir du Conseil européen. Le commerce est un des aspects, mais si nous construisons de proche en proche une dépendance géopolitique ou stratégique, nous comprendrons rapidement les conséquences que cela peut avoir. Et nous serons perdants sur les deux points. »33
On l’aura compris, nous ne sommes qu’au début d’un très long processus diplomatique avant que toutes ces mesures deviennent contraignantes34. L’unanimité n’est pas garantie tant la Chine dispose de sérieux leviers d’influence sur les États les plus faibles de l’Union (Grèce, Italie…) et que les 27/28 pratiquent la défense de leurs intérêts nationaux avec celle de l’intérêt européen.
***
« L’Europe n’aura pas eu la politique de sa pensée ». Ce jugement porté par Paul Valéry avant la Seconde Guerre mondiale n’a pas pris la moindre ride en cette fin de deuxième décennie du XXIe siècle. Comme le rappelle fort justement Jean-Pierre Chevènement : « Les Européens se sont accommodés de la vassalisation ». Vassalisation surtout vis-à-vis du grand frère américain depuis la fin de la Première Guerre mondial et soumission vis-à-vis de l’Empire Céleste depuis la fin de la Guerre froide. Comme l’écrit avec le sens aigu de la formule qui est le sien, Régis Debray : « L’Européen a des velléités mais, à la fin, il fait où Washington lui dit de faire, et s’interdit là ou et quand il n’a pas la permission »35. Que veut-il faire avec et/ou contre la Chine qui tisse lentement mais sûrement sa toile des « nouvelles routes de la soie » (« Pour l’Europe, c’est la déroute de la soie »36), y compris jusqu’au cœur de l’Union (Grèce et maintenant Italie avec l’accord signé par Xi Jinping avec les nouveaux dirigeants37). La réponse est aussi peu claire qu’évidente à ce stade de la réflexion des 27/28. Nous sommes au cœur de la problématique institutionnelle et fonctionnelle de la construction européenne38.
Pourquoi l’Union européenne a-t-elle tant de mal à être unie face à la Chine (« Unité de façade Merkel, Macron-Juncker. Face à l’impérialisme économique de Xi Jinping, l’Europe chinoise ! »39) ? Même si les défis ne manquent pas pour Xi Jinping40, il faudra apprendre à compter avec la Chine et à anticiper des réponses réalistes pour faire jeu égal avec elle41. Aujourd’hui, force est de constater que l’expansionnisme chinois bouscule et divise sérieusement l’Europe qui est restée longtemps inerte42. Longtemps, trop longtemps, le mot « réciprocité » a été considéré comme un mot tabou, grossier du côté européen. Il semble qu’aujourd’hui il soit devenu cardinal dans la langue de certains de nos dirigeants toujours en retard d’une guerre43. Révolution copernicienne pour certains, tournant pour d’autres44. Le temps est venu de trancher le nœud gordien. D’ici là, quand l’Europe s’éveillera vraiment (nous ne savons toujours pas quand compte tenu de son inertie habituelle), le risque est grand qu’elle soit depuis longtemps empêtrée dans la nasse pékinoise et que la Chine s’esclaffera.
Guillaume Berlat
1 avril 2019![]()
1 Alice George, Albert et Charlène de Monaco reçoivent le président chinois et son épouse. Dans les coulisses d’une visite d’État, Point de vue, 27 mars-2 avril 2019, pp. 34 à 37.
2 Gabriel Grésillon/Frédéric Schaeffer, Le président chinois Xi Jinping amorce une tournée Pékin dans une Europe vigilante mais divisée face à Pékin, Les Échos, 21 mars 2019, pp. 6-7.
3 François d’Orcival, Les routes de la puissance et de l’intimidation, Valeurs actuelles, 28 mars 2019, p. 4.
4 Guillaume Berlat, De l’Europe de la sanction à la sanction de l’Europe, www.prochetmoyen-orient.ch , 24 décembre 2018.
5 Régis Debray, L’Europe fantôme, collection « Tracts », Gallimard, 2019, p. 34.
6 Guillaume Berlat, Mondialisation heureuse, balkanisation furieuse, www.prochetmoyen-orient.ch , 11 mars 2019.
7 Nicole Gnesotto, L’Europe indispensable, CNRS éditions, mars 2019.
8 Pierre Tiessen/Régis Soubrouillard, La France made in China, Michel Lafon, 2019.
9 Guillaume Berlat, Quand la Chine s’éveillera vraiment…, www.prochetmoyen-orient.ch , 14 janvier 2019.
10 Jean-Michel Bezat, Pékin emploie la diplomatie des gros contrats avec les Occidentaux, Le Monde, 27 mars 2019, p. 2.
11 Jérôme Gautheret, L’Italie, premier pays du G7 à prendre les « nouvelles routes de la soie », Le Monde, 26 mars 2019, p. 5.
12 Bernard Simiot, Moi Zénobie reine de Palmyre, Albin Michel, 1978, p. 208.
13 Xi Jinping, « La Chine et la France, ensemble vers un développement commun », Le Figaro, 23-24 mars 2019, p. 16.
14 Il convient de rappeler que cette commande avait déjà annoncée, il y a un an déjà, lors de la visite officielle d’Emmanuel Macron en Chine. Tous ces Airbus seront assemblés en Chine par des ouvriers chinois. Pour remporter ce contrat géant, Airbus aura dû consentir à d’importants transferts de technologies. Pékin n’aura pas dû se livrer à quelques activités d’espionnage pour obtenir des secrets de fabrication. Les clés de la Maison lui auront été confiées. Et, tout cela intervient en toute légalité…
15 François Bougon, La Chine cherche à imposer un nouvel ordre mondial de l’information, s’inquiète RSF, Le Monde, 26 mars 2019, p. 17.
16 Frédéric Lemaître/Marie de Vergès, La Chine s’essouffle, le monde s’inquiète, Le Monde, Économie & Entreprise, 22 mars 2019, p. 14.
17 Jean-Philippe Béja, La position de Xi Jinping n’est pas si i confortable qu’elle en a l’air, Le Monde, 26 mars 2019, p. 29.
18 Cyrille Pluyette, L’autorité de Xi Jinping écornée, Le Figaro, 6 mars 2019, p. 7.
19 Renaud Girard, Faut-il avoir peur de la Chine ?, www.lefigaro.fr , 25 mars 2019.
20 Isabelle Lasserre, Le réveil des Européens face à la Chine, Le Figaro, 25 mars 2019, p. 6.
21 Cyrille Pluyette, Macron prône un partenariat équilibré avec Pékin, Le Figaro, 25 mars 2019, p. 6.
22 Thierry de Montbrial (propos recueillis par Isabelle Lasserre), « La principale rupture du système international remonte fut 1989 et non 2001 », Le Figaro, 18 mars 2019, p. 20.
23 Brice Pedroletti/Marc Semo, L’Europe affiche son unité face à Pékin. Front européen face à la Chine de Xi Jinping, Le Monde, 27 mars 2019, pp. 1-2.
24 Thomas Wieder, « AKK », la dauphine de Merkel marque sa différence, Le Monde, 27 mars 2019, p. 4.
25 Michel de Grandi, Les Européens invitent la Chine à respecter « l’unité de l’Union », Les Échos, 27 mars 2019, p. 6.
26 Sylvie Kauffmann, L’Europe, champ de bataille sino-américain, Le Monde, 28 mars 2019, p. 32.
27 Alain Barluet, « Convergences » euro-chinoises à l’Élysée, Le Figaro, 27 mars 2019, p. 8.
28 Éric Martin, L’Union européenne va-t-elle se laisser acheter ? Le filtrage des investissements étrangers en Europe, https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/lunion-europeenne-va-t-se-laisser-acheter-filtrage-investissements , mars 2019.
29 Marie de Vergès, Trump : un an d’escalade protectionniste, Le Monde, Économie & Entreprise, 28 mars 2019, p. 17.
30 Frédéric Lemaître/Jean-Pierre Stroobants/Brice Pedroletti, L’UE durcit le ton face à la Chine, Le Monde, 21 mars 2019, p. 2.
31 Sebastien Dumoulin, L’Union européenne se coordonne face à Huawei, Les Échos, 27 mars 2019, p. 6.
32 Jean-Pierre Stroobants, Huawei : face aux pressions américaines, l’Europe résiste, Le Monde, Économie & Entreprise, 28 mars 2019, p. 18.
33 Emmanuel Berretta, Les 10 préconisations de Bruxelles face à la Chine, www.lepoint.fr , 26 mars 2019.
34 Éditorial, UE-Chine : le bon virage de Paris, Le Monde, 28 mars 2019, p. 32.
35 Régis Debray, précité, p. 24.
36 Frédéric Pagès (propos presque recueillis par), Les interviews (presque) imaginaires du « Canard ». Xi Jinping : « Pour l’Europe, c’est la déroute de la soie », Le Canard enchaîné, 27 mars 2019, p. 1.
37 Olivier Tosseri, L’Italie sera bientôt la porte d’entrée des nouvelles routes de la soie en Europe, Les Échos, 21 mars 2019, p. 6.
38 Louis Vogel, Les 7 péchés capitaux de l’Europe, Ramsay, 2019.
39 Le Canard enchaîné, 27 mars 2019, p. 1.
40 Éric de la Maisonneuve, Les défis chinois : la révolution Xi Jinping, éditions du Rocher, mars 2019.
41 Hervé Martin, Les Chinois attrapent les États par la dette, Le Canard enchaîné, 27 mars 2019, p. 3.
42 Fabrice Nodé-Langlois/Valérie Segond, Les ambitions de Xi Jinping prospèrent dans une Europe divisée, Le Figaro économie, 20 mars 2019, pp. 19-20-21.
43 Anne Rovan, Face à la Chine, Bruxelles tente de trouver la parade, Le Figaro économie, 20 mars 2019, p. 21.
44 Sylvie Kauffmann, Chine-Europe : le tournant, Le Monde, 21 mars 2019, p. 31.
Pour aider le site Proche & Moyen-Orient c’est ici
Source : Proche & Moyen-Orient, Guillaume Berlat, 01-04-2019
00:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, chine, asie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale, économie, eurasie, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 10 mai 2019
Beaucoup d’Allemands veulent comprendre la Russie

Beaucoup d’Allemands veulent comprendre la Russie
Une soirée avec Gabriele Krone-Schmalz
par Matthias Klaus
Ex: http://www.zeit-fragen.ch/fr
La théorie, selon laquelle il existe une grande différence entre les opinions publiées dans nos médias mainstream et les opinions réelles des citoyens allemands, est confirmée régulièrement. Dans la ville de Villingen-Schwenningen en Forêt-Noire, Gabriele Krone-Schmalz a récemment plaidé – dans le cadre de la série d’interviews «Autor im Gespräch» [entretien avec un auteur] – pour la normalisation des relations germano-russes et pour une entente avec la Russie fondée sur la raison et la compréhension. Cette approche a rencontré un écho très favorable.
 La grande affluence dans la nouvelle salle de concert, avec l’accueil de plus de 600 visiteurs, a démontré à quel point les actuels récits unilatéraux concernant la Russie préoccupent les citoyens allemands. On a ressenti un fort besoin d’entendre une voix dissidente à l’opinion publiée, différant agréablement de la continuelle «diabolisation de la Russie». Le sous-titre de son dernier livre «Eiszeit» [L’âge de glace] est «Comment la Russie est diabolisée et pourquoi cela est si dangereux».
La grande affluence dans la nouvelle salle de concert, avec l’accueil de plus de 600 visiteurs, a démontré à quel point les actuels récits unilatéraux concernant la Russie préoccupent les citoyens allemands. On a ressenti un fort besoin d’entendre une voix dissidente à l’opinion publiée, différant agréablement de la continuelle «diabolisation de la Russie». Le sous-titre de son dernier livre «Eiszeit» [L’âge de glace] est «Comment la Russie est diabolisée et pourquoi cela est si dangereux».
Gabriele Krone-Schmalz a déjà obtenu de nombreux prix et distinctions pour son engagement exemplaire, dont notamment, en 1997, la Croix fédérale du mérite du gouvernement allemand pour «la qualité de la couverture télévisée».
Au début de l’entretien, Mme Krone-Schmalz a expliqué à quel point on peut abuser de la langue, pour ne plus devoir écouter, voire prendre au sérieux un interlocuteur, en le qualifiant de «celui qui comprend la Russie» [«Russlandversteher»]. Le désir de comprendre les réflexions d’autrui, d’être capable de se mettre dans sa situation – c’est-à-dire de ressentir de l’empathie – est généralement considéré comme un objectif souhaitable. Mais la combinaison de mots dans le terme polémique de «Russlandversteher» est censée avoir l’effet contraire sur l’esprit du lecteur ou de l’auditeur. Par la création de ce nouveau terme, toute personne souhaitant comprendre la Russie ou le président Poutine est dévalorisé, transformé en «partisan de Poutine», banni de tout intérêt.
 Mais c’est exactement ce que l’historienne et journaliste tente de faire. Une politique étrangère sensée exige que nous prenions en compte les intérêts d’autrui. Cependant, il n’a jamais été et n’est toujours pas dans l’intérêt de l’Occident (des Etats-Unis) que l’Allemagne et la Russie se rapprochent et coopèrent. L’exemple actuel est la tentative du gouvernement américain d’empêcher la construction du gazoduc Nord Stream 2.
Mais c’est exactement ce que l’historienne et journaliste tente de faire. Une politique étrangère sensée exige que nous prenions en compte les intérêts d’autrui. Cependant, il n’a jamais été et n’est toujours pas dans l’intérêt de l’Occident (des Etats-Unis) que l’Allemagne et la Russie se rapprochent et coopèrent. L’exemple actuel est la tentative du gouvernement américain d’empêcher la construction du gazoduc Nord Stream 2.
Selon elle, la déclaration de la nouvelle présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, en fonction de laquelle l’Allemagne doit également développer une option militaire envers la Russie, est extrêmement inquiétante. Mme Krone-Schmalz a mis en garde contre le fait d’aller de l’avant dans cette direction. La Russie se sent à juste titre rejetée et menacée par l’expansion vers l’Est de l’OTAN et par les missiles stationnés en Pologne et en République tchèque. Il est facile de remplacer de tels missiles défensifs par des missiles d’attaque.
L’écrasante majorité de la population allemande est favorable à de bonnes relations avec la Russie, mais l’opinion et la politique mainstream n’en tiennent pas compte. Mme Krone-Schmalz y voit un danger pour le système politique allemand.
Au cours de la dernière demi-heure, les auditeurs ont eu l’occasion de poser des questions et de participer au débat. Un auditeur a soulevé le fait du jumelage de Villingen-Schwenningen avec la ville de Tula. Mme Krone Schmalz a volontiers abordé ce sujet. Pour elle, l’expansion et la mise en place active de jumelages dynamiques avec la Russie constituent un antidote important à la politique russophobe actuelle de l’Allemagne. •
00:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, russie, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 08 mai 2019
Un futur Iran bonapartiste ?

Un futur Iran bonapartiste ?
La question de l’avenir immédiat de l’Iran a probablement des implications plus profondes que toute autre crise contemporaine pour la survie à long terme de l’héritage aryen.
Ex: https://altright.com
Le 19 avril 2017, le Secrétaire d’Etat des USA Rex Tillerson a tenu une conférence de presse dans laquelle il a annoncé que l’Administration Trump allait entreprendre un « examen complet » de sa politique iranienne. Certains d’entre nous savent, même avant l’investiture [de Trump], qu’un changement de régime était envisagé pour l’Iran – la seule question étant : quelle sorte de changement de régime ? La fausse nouvelle de l’attaque au gaz d’Assad et les frappes de représailles en Syrie ne furent pas du tout rassurantes. Un mois plus tard, le 19 mai, la République Islamique a tenu sa douzième élection présidentielle. Une chose est claire : celui qui est élu pourrait être le dernier président de la théocratie chiite.
Il y a un plan pour détruire l’Iran, un plan élaboré avec l’Arabie Saoudite par ceux dans le complexe militaro-industriel américain qui considèrent les Saoudites comme un allié des Etats-Unis. Hillary Clinton, qui a des liens étroits avec les financiers saoudites, voulait certainement mettre en œuvre ce plan. A en juger par les références répétées à l’Arabie Saoudite dans les déclarations sur l’Iran faites par le Secrétaire à la Défense, le général « chien fou » Mattis, et le Secrétaire d’Etat Tillerson, il semble que ce plan pourrait commencer à être appliqué, même s’il semble qu’il y avait des plans substantiellement différents pour l’Iran à l’époque où le général Flynn et Steve Bannon étaient les principaux membres de l’équipe Trump. La réussite ou l’échec de ce plan saoudite aura un profond impact sur l’avenir des Occidentaux et d’autres dans le plus large monde indo-européen. La question de l’avenir immédiat de l’Iran a probablement des implications plus profondes que toute autre crise contemporaine pour la survie à long terme de l’héritage aryen.
Entouré par une douzaine d’Etats artificiels qui n’existaient pas avant les machinations coloniales européennes des XVIIIe et XIXe siècles, l’Iran est la seule vraie nation entre la Chine et l’Inde en Orient et la sphère de la civilisation européenne déclinante à l’Ouest et au Nord. Abréviation d’Irânshahr ou « Imperium aryen », l’Iran ne fut jamais désigné par la majorité à 55% perse du pays comme l’« Empire perse ». Les Grecs antiques forgèrent ce terme et il s’implanta en Occident. Il est dangereusement trompeur parce que si les Perses ont été le groupe ethno-linguistique le plus dominant culturellement à l’intérieur de la Civilisation Iranienne (jouant un rôle comparable aux Hans dans la Civilisation Chinoise), les Kurdes, les Ossètes, les Baloutches et d’autres sont ethniquement et linguistiquement iraniens même s’ils ne parlent pas la langue perse (appelée pârsi ou, erronément, fârsi en Iran de l’Ouest et dari ou tâjiki en Asie Centrale iranienne).

La combinaison d’« Iran » et de « Perse » a, depuis un bon nombre d’années, été utilisée comme partie d’un complot pour éroder encore plus l’intégrité territoriale de l’Iran en le réduisant à un Etat-croupion perse. Si les conspirateurs globalistes sans racines essayant de présenter l’« Iran » comme une construction conceptuelle de l’impérialisme perse sont certainement motivés par des considérations économiques et stratégiques, leur but ultime est l’effacement de l’idée même d’Iran ou d’Irânshahr. Ils voient le renouveau de cette idée comme peut-être la plus grande menace singulière pour leur agenda global, et depuis l’échec total du Mouvement de Réforme Islamique de 1997-2009 c’est justement ce renouveau qui est au cœur d’une révolution culturelle ultranationaliste connue sous le nom de Renaissance Iranienne.
Ce mouvement s’efforce de parvenir à une renaissance de la vision-du-monde préislamique de la Civilisation Iranienne, voyant le dénommé « âge d’or » de l’islam comme une dernière lueur ou un avortement de ce qui aurait pu être si l’Iran avait continué sa trajectoire de développement en tant que nation aryenne. Après tout, l’immense majorité des scientifiques et des ingénieurs qui furent forcés à écrire en arabe sous le Califat étaient des Iraniens ethniques dont la langue maternelle était le perse. A tous les égards, de la science à la technologie, à la littérature, à la musique, à l’art et à l’architecture, la soi-disant « Civilisation Islamique » agit comme un parasite s’appropriant une Civilisation Iranienne vraiment glorieuse qui était déjà âgée de 2000 ans avant que l’invasion arabo-musulmane impose l’islam et que les Mongols génocidaires la cimentent (en écrasant les insurrections perses en Azerbaïdjan, sur la côte caspienne, et au Khorasan).
La Renaissance Iranienne est basée sur le renouveau de principes et d’idéaux anciens, dont beaucoup sont partagés par l’Iran avec l’Europe à travers leur ascendance caucasienne commune et par des échanges interculturels intensifs. Cela inclut la pénétration profonde des Alains, des Scythes et des Sarmates iraniens dans le continent européen, et leur intégration finale avec les Goths dans la « Goth-Alanie » (Catalogne) et les Celtes dans « Erin » (un mot apparenté à « Iran »). Leur introduction de la culture de la Chevalerie (Javanmardi) et du mysticisme du Graal en Europe laissa sur l’ethos « faustien » de l’Occident un impact aussi profond que les idéaux « prométhéens » (en réalité, zoroastriens) du culte de la Sagesse et de l’industriosité innovante, qui furent introduits en Grèce par des siècles de colonisation perse.
La barrière civilisationnelle entre l’Iran et l’Europe a été très poreuse – des deux cotés. Après l’hellénisation de l’Iran durant la période d’Alexandre, l’Europe fut presque persisée par l’adoption du mithraïsme comme religion d’Etat à Rome. En partie comme une conséquence des machinations de la dynastie parthe et des opérations secrètes de sa flotte en Méditerranée, c’était imminent à l’époque où Constantin institutionnalisa le christianisme – probablement comme un rempart contre l’Iran.
Il ne faut donc pas être surpris si beaucoup des éléments essentiels de l’ethos de la Renaissance Iranienne semblent étonnamment européens : le respect pour la Sagesse et la recherche de la connaissance avant tout ; et donc aussi l’accent mis sur l’innovation industrieuse conduisant à un embellissement et une perfection utopiques de ce monde ; la culture de la liberté d’esprit chevaleresque, de l’humanitarisme charitable, et de la tolérance et de la largeur d’esprit ; un ordre politique qui est basé sur le droit naturel, où l’esclavage est considéré comme injuste et où les femmes fortes sont grandement respectées.

Mais il faut se souvenir que dans la mesure où l’Irânshahr s’étendait loin vers l’Est en Asie, ces valeurs étaient jadis aussi caractéristiques de la culture aryenne orientale – en particulier du bouddhisme du Mahayana, qui fut créé par les Kouchites iraniens. L’Iran colonisa l’Inde du Nord cinq fois et toute la Route de la Soie jusqu’à ce qui est maintenant la Chine du nord-ouest était peuplée par des Iraniens à l’apparence caucasienne, jusqu’aux conquêtes turques et mongoles aux XIe et XIIe siècles.
Alors que la Renaissance Iranienne veut « rendre l’Iran à nouveau grand » en faisant revivre cet héritage indo-européen, et même en reconstituant territorialement ce que les gens de notre mouvement appellent le « Grand Iran » (Irâné Bozorg), les globalistes sans racines, les sheikhs arabes du pétrole, et leurs collaborateurs islamistes en Turquie et au Pakistan veulent complètement effacer l’Iran de la carte. Evidemment ce n’est pas du goût des centaines de milliers de nationalistes iraniens qui se sont rassemblés devant le tombeau de Cyrus le Grand le 29 octobre 2016 pour chanter le slogan : « Nous sommes des Aryens, nous n’adorons pas les Arabes ! ». Le slogan est aussi clairement anti-islamique que possible dans les limites de la loi de la République Islamique. Le prophète Mahomet et l’Imam Ali étaient bien sûr des Arabes, donc le sens est très clair. On voit aussi clairement qui est celui que ces jeunes gens considèrent comme leur vrai messager, puisque l’autre slogan le plus chanté était : « Notre Cyrus aryen, tu es notre honneur ! ».
Depuis le soulèvement brutalement écrasé de 2009, presque tous les Iraniens ont rejeté la République Islamique. Beaucoup d’entre eux, spécialement les jeunes, sont convaincus que l’islam lui-même est le problème. Ils se sont clandestinement convertis au néo-zoroastrisme qui est indistinguable de l’ultranationalisme iranien. L’image de Zarathoustra dans un disque ailé, symbolisant la perfection évolutionnaire de l’âme, connue sous le nom de « Farvahar », est partout : sur les pendentifs, les bagues, et même les tatouages (en dépit du fait que les tatouages, qui étaient omniprésents parmi les Scythes, étaient bannis par le zoroastrisme orthodoxe). Maintenant même des éléments-clés dans le régime, spécialement les Gardiens de la Révolution, lisent des traités sur « la pensée politique de l’Imperium Aryen » qui sont extrêmement critiques vis-à-vis de l’islam tout en glorifiant l’ancien Iran.
Pendant ce temps, la soi-disant « opposition » en exil a été presque entièrement corrompue et cooptée par ceux qui souhaitent morceler le peu qui reste de l’Iran. D’un coté vous avez les gauchistes radicaux qui livrèrent en fait l’Iran aux Ayatollahs en 1979 avant que Khomeiny ne se retourne contre eux, forçant ceux qui échappèrent à l’exécution à partir en exil. D’un autre coté vous avez les partisans aveuglément loyaux du Prince héritier Reza Pahlavi, dont la vision – ou le manque de vision – s’aligne largement sur celle des gauchistes, du moins dans la mesure où elle cadre avec les buts des globalistes et des islamistes.
Les gens de l’opposition marxiste et maoïste à la République Islamique promeuvent le séparatisme ethnique, transplantant un discours anticolonialiste des « luttes de libération des peuples » dans un contexte iranien où il n’a rien à faire. Les Perses n’ont jamais méprisé personne. Nous fûmes des libérateurs humanitaires. Nous fûmes plutôt trop humanitaires et trop libéraux.
Les gauchistes des « peuples de l’Iran », comme si les Kurdes et les Baloutches n’étaient pas ethniquement iraniens et comme si un dialecte turcique n’avait pas été imposé à la province d’Azerbaïdjan, la source caucasienne de l’Iran, par les méthodes génocidaires de conquérants asiatiques à demi-sauvages. Tout en prétendant être féministes et partisans de la révolution prolétarienne, ces gauchistes acceptent d’être financés par l’Arabie Saoudite, qui veut les aider à séparer la région riche en pétrole et partiellement arabisée du Khuzistan de l’Iran et à la transformer en nation d’Al-Ahwaz, avec une façade côtière considérable sur ce qu’ils appellent déjà le « Golfe Arabe ». Le Kurdistan, l’Azerbaïdjan, Al-Ahwaz, le Baloutchistan : ces micro-Etats, ostensiblement nés des « mouvements de libération » gauchistes, seraient faciles à contrôler pour les capitalistes globaux sans racines. Dans au moins deux cas, Al-Ahwaz et le « Baloutchistan Libre », ils seraient aussi un terrain de développement pour une plus grande diffusion du terrorisme islamiste. Finalement, ils laisseraient les Perses dépourvus de presque toutes les ressources en pétrole et en gaz naturel de l’Iran, et contiendraient la marée montante de l’Identitarisme Aryen dans un Etat-croupion de « Perse ».

Le mieux armé et le mieux organisé de ces groupes gauchistes est celui des Mojaheddin-e-Khalq (MEK), qui est aussi connu sous les noms de Moudjahidines du Peuple de l’Iran (PMOI) et de Conseil National de la Résistance Iranienne (NCRI). Leurs guérillas armées mirent en fait Khomeiny et le pouvoir religieux au pouvoir avant d’être eux-mêmes dénoncés comme hérétiques. Leur réponse fut de prêter allégeance à Saddam Hussein et de mettre à sa disposition quelques unités militaires qui firent défection pendant la guerre Iran-Irak. Cela signifie qu’ils avaient de facto accepté l’occupation du Khuzistan par l’Irak. Plus tard, lorsqu’ils furent obligés de se repositionner dans le Kurdistan irakien, ils promirent aux Kurdes de soutenir la sécession kurde de l’Iran. Toute une foule de politiciens importants des Etats-Unis et de l’Union Européenne fut soudoyée pour apporter leur appui au leader du groupe, Maryam Radjavi, incluant John McCain, Newt Gingrich, Rudy Giuliani, John Bolton, et les NeoCons.
La majorité des Iraniens voit le MEK comme des traîtres, et le fait qu’ils sont essentiellement une secte dont les membres – ou les captifs – sont aussi coupés du monde extérieur que les Nord-Coréens n’arrange rien. Si cela signifie qu’ils ne seraient jamais capables de gouverner l’Iran efficacement, le MEK pourrait être utilisé comme un agent catalytique de déstabilisation durant une guerre contre la République Islamique.
C’est ici qu’intervient le Prince héritier Reza Pahlavi, avec son groupe de l’« opposition » iranienne en exil. La cabale globaliste et ses alliés arabes dans le Golfe Persique (Arabie Saoudite, Qatar, Emirats Arabes Unis) veulent créer un problème pour lequel il serait la solution. Il est dans leur poche.
Lors d’une réunion du CFR à Dallas au début de 2016, que j’ai révélée dans une interview bien connue avec le journaliste indépendant résidant en Suède, Omid Dana de Roodast (« le Alex Jones perse »), Reza Pahlavi ironisa sur la soi-disant « rhétorique nationaliste exagérée » concernant la conquête arabo-musulmane génocidaire de l’Iran. Il parla de cette tragédie historique incomparable comme d’une chose qui, si elle a vraiment existé, est sans importance parce qu’elle a eu lieu il y a longtemps. En fait, il la voit comme un obstacle pour de bonnes relations de voisinage avec les Etats arabes du « Golfe ». Oh oui, dans des interviews avec des médias arabes il a parlé du Golfe éternellement Persique comme du « Golfe » tout court pour ne pas contrarier ses riches bienfaiteurs arabes. Reza Pahlavi a aussi permis à des représentants de ses organes de presse officiels de faire la même chose à plusieurs reprises. Il a même utilisé le terme dans un contexte qui implique que l’Iran pourrait abandonner plusieurs îles dans « le Golfe » avec l’idée d’améliorer les relations de voisinage (comme si le renoncement de son père à Bahreïn n’était pas suffisant !).
En fait, il a suggéré que l’Arabie Saoudite et d’autres gouvernements arabes inhumains devraient investir dans l’économie de l’Iran dans une mesure telle que l’Iran serait si dépendant d’eux que faire la guerre à ces nations deviendrait impossible. De plus, et de manière très embarrassante, le Prince héritier affirma que son futur Iran ne devrait pas avoir d’armes nucléaires parce qu’il aurait peur de passer une nuit dans son palais, puisque si l’Iran devait acquérir des armes atomiques alors d’autres nations rivales de la région auraient le droit de faire la même chose et pointeraient leurs missiles sur l’Iran.
Le pire de tout dans cette rhétorique est le plan très concret du Prince de soumettre la question d’une fédéralisation de l’Iran à un vote populaire ou à un référendum à l’échelle nationale. Ce n’est pas simplement une proposition. Il rencontre des individus et des groupes qui promeuvent le séparatisme et la désintégration territoriale de l’Iran, la première étape étant « l’éducation dans la langue maternelle » (autre que le perse) et l’autonomie régionale dans le contexte d’un système fédéral. En même temps, il a dénoncé comme « fascistes » les patriotes iraniens qui, au risque d’être emprisonnés ou tués, se sont rassemblés devant le tombeau de Cyrus le Grand le 29 octobre de l’année dernière et qui ont chanté le slogan « Nous sommes des Aryens, nous n’adorons pas les Arabes ! ». En dépit du fait que certains des mêmes protestataires chantèrent aussi des slogans félicitant le Prince héritier pour son anniversaire, c’est une erreur qu’ils ne referont jamais plus. Il fit même des remarques qui ridiculisaient de manière suggestive les partisans de la Tradition impériale perse.

Reza Pahlavi saisit toutes les occasions pour faire savoir que ses vrais idéaux sont la « démocratie libérale » et les « droits humains universels », des concepts occidentaux qu’il adopte imprudemment sans la moindre compréhension des problèmes fondamentaux qu’ils posent lorsqu’on les compare à notre philosophie politique iranienne aristocratique – qui influença des théories politiques occidentales essentielles comme celles de Platon, d’Aristote et de Nietzsche, et qui est beaucoup plus en accord avec celles-ci.
Si son acceptation de la démocratie et des droits de l’homme va jusqu’à un vote populaire sur une fédéralisation qui conduit à l’autonomie régionale et finalement à la sécession de nombreuses provinces, elle ne protège apparemment pas le criticisme envers l’islam. Et sous l’influence de ses manipulateurs occidentaux néolibéraux et de la police PC gauchiste de l’Occident, et totalement en désaccord avec le sentiment populaire parmi la jeunesse iranienne, il a affirmé que si l’islam devait être insulté ou que s’il devait y avoir de l’« islamophobie » dans le futur Iran, alors il vaudrait mieux que la République Islamique reste au pouvoir. Il a le toupet de dire cela tout en dénonçant ses critiques comme des agents de la République Islamique. Quand des dizaines d’éminents monarchistes patriotes signèrent un « Dernier Avertissement » (Akharin Hoshdâr) adressé à lui en juillet 2016, certains d’entre eux étant d’anciens proches conseillers de son père, il les accusa tous d’être des agents de la République Islamique qui falsifiaient ses déclarations et qui fabriquaient des preuves (ce qui était justement une affirmation clairement fausse et calomnieuse).
Nous n’étions pas des agents de la République Islamique, et nous ne serons jamais les complices d’une théocratie chiite sous sa présente forme. Mais étant donné la crise à laquelle nous faisons face aujourd’hui, nous devons envisager une alternative radicale pour les traîtres sécessionnistes de l’opposition gauchiste basée à Paris et les Shahs du Coucher de Soleil de Los Angeles qui seront tous trop heureux de faire régner leur Prince de Perse sur l’Etat-croupion qui restera de l’Iran après le « changement de régime ». Je propose un grand plan, une anticipation bonapartiste du règne de la terreur qui approche.
Ceux qui ont suivi mes écrits et mes interviews savent qu’il n’y a pas de plus sévère critique de l’islam, sous toutes ses formes, que votre serviteur. Je n’ai pas encore publié mes critiques vraiment sérieuses et rigoureuses de l’islam, incluant en particulier ma déconstruction de la doctrine chiite. Rien de ce que je vais proposer ne change le fait que j’ai la ferme intention de le faire dans les toutes prochaines années.
Cependant, nous entrons dans ce que Carl Schmitt appelait un « état d’urgence ». Dans cette situation exceptionnelle, où nous nous trouvons face à une menace existentielle pour l’Iran, il est important de faire la différence entre questions ontologiques ou épistémologiques et le genre de distinction ami/ennemi qui est définitive pour la pensée politique au sens approprié et fondamental. Les nationalistes iraniens ont des amis dans le système de la République Islamique, et le Seigneur sait que nous avons une quantité d’ennemis en-dehors de celui-ci.
Le jeune Gardien de la Révolution (Pasdaran) de Meshed qui récite Hafez en patrouillant le long de la frontière irakienne et attendant d’être tué par des séparatistes kurdes, mais dont la mère est kurde, et qui accompagne son père perse pour aller prier devant l’autel de l’Imam Reza en portant un Farvahar autour du cou n’est pas seulement un ami, il est le frère de tout vrai patriote iranien. Ce ne sont pas les Pasdarans qui ont tué et massacré de jeunes Iraniens pour mater la révolte de 2009, c’étaient des voyous paramilitaires dévoués au Guide Suprême Ali Khamenei – qui est maintenant sur son lit de mort.

Nous devons penser à l’avenir. Le cœur et l’âme de l’enseignement de Zarathoustra était son futurisme, son insistance sur l’innovation évolutionnaire. S’il était vivant aujourd’hui, il ne serait certainement pas zoroastrien. Franchement, même s’il avait été vivant durant l’Empire sassanide, il n’aurait pas été un zoroastrien au sens orthodoxe.
La Renaissance Iranienne considère la période sassanide comme le zénith de l’histoire de l’Iran, « l’apogée avant le déclin spectaculaire ». Mais les deux plus grands hérétiques, du point de vue de l’orthodoxie zoroastrienne, avaient le soutien de l’Etat sassanide. Chapour 1er était le patron de Mani, qui créa une religion mondiale syncrétique dans laquelle Gautama Bouddha et le Christ gnostique étaient vus comme des Shaoshyants (des Sauveurs zoroastriens) et des successeurs légitimes de Zarathoustra. Le manichéisme se répandit jusque dans le sud de la France en Occident, où il suscita la Sainte Inquisition en réaction contre lui, et jusqu’en Chine en Orient, où Mani était appelé « le Bouddha de Lumière » et où son enseignement influença le développement du bouddhisme mahayana. L’ésotériste libertin Mazdak, dont la révolution socialiste était d’après moi plus nationale-bolchevique que communiste, reçut le plein appui de l’empereur perse sassanide Kavad 1er. Même Khosrô Anushiravan, qui écrasa le mouvement mazdakien, n’était pas du tout un zoroastrien orthodoxe. C’était un néo-platonicien, qui invita les survivants de l’Académie à trouver refuge dans les bibliothèques et les laboratoires iraniens comme Gondechapour après la fermeture des dernières universités de l’Europe sur l’ordre de Justinien.
De plus, l’évolution de la tradition spirituelle iranienne fondée par Zarathoustra ne prit pas fin avec la Conquête islamique. La Renaissance Iranienne condamne Mazdak sans équivoque, et pourtant Babak Khorrdamdin est considéré comme un héros de la résistance nationaliste contre le Califat arabe. Mais les partisans de Khorrdamdin en Azerbaïdjan étaient des mazdakiens ! Une claire ligne peut être tracée depuis le mouvement mazdakien, à travers les Khorrdamdin, jusqu’aux groupes chiites ésotériques tels que les Ismaéliens nizarites ou Ordre des « Assassins » comme ils sont généralement connus en Occident. Combattant contre le Califat et les Croisés simultanément, il n’y eut jamais de plus grand champion de la liberté et de l’indépendance iraniennes que Hassan Sabbah. Et sa variété d’ésotérisme chiite ne déclina pas non plus avec la secte ismaélienne.
 Il y a encore en Iran aujourd’hui des religieux supposément chiites qui doivent plus à Sohrawardi, à travers Mullah Sadra, qu’à l’enseignement réel de l’Imam Ali. A l’époque du Sixième Imam, Jaafar al-Sadiq, la foi chiite fut cooptée par les partisans iraniens luttant contre me Califat sunnite. Le genre de doctrine chiite que certains des collègues de l’Ayatollah Khomeiny tentèrent d’imposer à l’Iran en 1979 représenta une reconstruction radicale du premier chiisme arabe, pas le genre d’ésotérisme chiite qui donna naissance à la dynastie safavide. Cette dernière permit à l’Iran de resurgir en tant qu’Etat politique distinct séparé et opposé au Califat Ottoman sunnite et à un Empire Moghol qui était aussi tombé dans le fondamentalisme islamique après que la littérature et la philosophie persisées d’Akbar se soient révélées être un rempart insuffisant contre celui-ci. Certains de ces chiites persisés sont présents aux plus hauts niveaux dans la structure de pouvoir de la République Islamique. Ils doivent être accueillis dans la communauté du nationalisme iranien, et même dans la communauté de la Renaissance Iranienne.
Il y a encore en Iran aujourd’hui des religieux supposément chiites qui doivent plus à Sohrawardi, à travers Mullah Sadra, qu’à l’enseignement réel de l’Imam Ali. A l’époque du Sixième Imam, Jaafar al-Sadiq, la foi chiite fut cooptée par les partisans iraniens luttant contre me Califat sunnite. Le genre de doctrine chiite que certains des collègues de l’Ayatollah Khomeiny tentèrent d’imposer à l’Iran en 1979 représenta une reconstruction radicale du premier chiisme arabe, pas le genre d’ésotérisme chiite qui donna naissance à la dynastie safavide. Cette dernière permit à l’Iran de resurgir en tant qu’Etat politique distinct séparé et opposé au Califat Ottoman sunnite et à un Empire Moghol qui était aussi tombé dans le fondamentalisme islamique après que la littérature et la philosophie persisées d’Akbar se soient révélées être un rempart insuffisant contre celui-ci. Certains de ces chiites persisés sont présents aux plus hauts niveaux dans la structure de pouvoir de la République Islamique. Ils doivent être accueillis dans la communauté du nationalisme iranien, et même dans la communauté de la Renaissance Iranienne.
La Renaissance italienne eut recours à la Rome païenne pour accomplir une revitalisation civilisationnelle, mais elle n’abolit pas le christianisme. Benito Mussolini non plus, lorsqu’il adopta comme but explicite une seconde Renaissance italienne et un renouveau de l’Empire romain. Au contraire, le Duce recruta le catholicisme romain comme allié de confiance dans son vaillant combat contre le capitalisme sans racines, parce qu’il savait que les catholiques romains étaient « romains », même en Argentine.
De même, aujourd’hui, les chiites sont d’une manière ou d’une autre culturellement iraniens, même dans l’Azerbaïdjan du nord turcique, dans l’Irak arabophone et à Bahreïn, sans parler de l’Afghanistan du nord-ouest où le perse demeure la lingua franca. Si les néo-zoroastriens, en Iran ainsi que dans les parties du Kurdistan actuellement en-dehors des frontières de l’Iran, devaient s’allier avec les chiites persisés, cela ferait plus que consolider l’intégrité territoriale de l’Iran. Cela établirait un nouvel Empire perse, fournissant à l’Iran central de nombreuses zones-tampons et positions avancées chiites tout en réincorporant aussi, sur la base du nationalisme iranien, des régions qui sont ethno-linguistiquement iraniennes mais pas chiites – comme le grand Kurdistan et le Tadjikistan (incluant Samarkand et Boukhara).
Ce que je propose est plus qu’un coup d’Etat militaire à l’intérieur de la République Islamique. Le qualificatif de « bonapartiste » est seulement en partie exact. Nous avons besoin d’un groupe d’officiers dans les Pasdarans qui reconnaissent que la Timocratie, comme Platon la nommait, est seulement la seconde meilleure forme de gouvernement et que leur pouvoir aura besoin d’être légitimé par un roi philosophe et un conseil des Mages avec l’intelligence et la profondeur d’âme requises pour utiliser le pouvoir étatique afin de promouvoir la Renaissance Iranienne qui est déjà en cours. Ironiquement, si nous séparons la forme politique de la République Islamique de son contenu – comme le ferait un bon platonicien –, les structures centrales antidémocratiques et intolérantes du régime sont remarquablement iraniennes. Le Conseil Gardien (Shorâye Negahbân) est l’Assemblée des Mages et le Gouvernement du Docte (Velâyaté Faqih) est le Shâhanshâhé Dâdgar qui possède le farr – celui qui est justement guidé par la divine gloire de la Sagesse. Cela ne devrait pas être surprenant puisque, après tout, l’Ayatollah Khomeiny emprunta ces concepts à Al Fârâbî qui, au fond de lui, était tout de même un Aryen.

Le Parti Pan-Iranien, qui est issu du Parti des Travailleurs National Socialiste (SUMKA) de l’Iran du début des années 1940, est un élément-clé dans ce stratagème. Célèbre pour son opposition parlementaire très bruyante à l’abandon de Bahreïn par Mohammad Reza Shah Pahlavi en 1971, l’opposition loyale ultranationaliste (c’est-à-dire à la droite du Shah) du régime Pahlavi pourrait devenir l’opposition loyale de la République Islamique si elle était légalisée après un coup d’Etat par ceux parmi les Gardiens de la Révolution qui comprennent la valeur du nationalisme iranien pour affronter la menace existentielle imminente pour l’Iran.
A la différence de tous les autres partis d’opposition, l’existence clandestine du Parti Pan-Iranien a été seulement à peine tolérée par la République Islamique. Bien qu’il soit techniquement illégal et qu’il ne puisse pas présenter de candidats aux élections, il n’a pas été écrasé par le régime – parce la loyauté du parti envers l’Iran ne fait pas de question. Le parti a des liens étroits avec les principaux intellectuels de la Renaissance Iranienne et avec les membres les plus patriotes du clergé chiite. S’il était le seul parti d’opposition légal, tous les nationalistes iraniens voteraient pour lui et en une seule élection, ou deux tout au plus, les Pan-Iraniens obtiendraient une majorité au Parlement. Leur premier acte de législation devrait être quelque chose avec un grand pouvoir symbolique et peu de chances de réaction hostile de la part du complexe militaro-industriel de la République Islamique : le retour du Lion et du Soleil comme drapeau national légitime de l’Iran (l’un des buts déclarés du Parti).

Le Lion et le Soleil incarne parfaitement l’ambiguïté de l’identité iranienne. Les chiites affirment que c’est une représentation zoomorphique de l’Imam Ali, « le Lion de Dieu » (Assadollâh) et que l’épée brandie par le lion est le Zulfaqâr. La République Islamique remplaça ce symbole parce que ses fondateurs fondamentalistes savaient que c’était faux. Le Lion et le Soleil est un drapeau aryen extrêmement ancien, qui représente probablement Mithra c’est-à-dire le Soleil entrant dans la maison zodiacale du Lion.
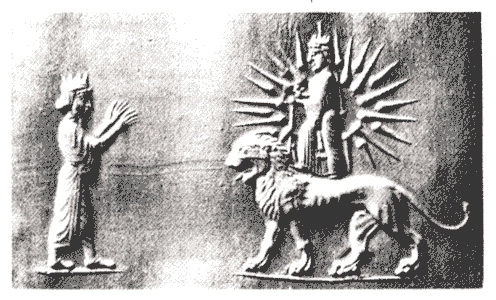
De plus, les néo-zoroastriens ont tort de croire que l’épée recourbée est un ajout islamique (et qu’elle doit donc être remplacée par une épée droite). Au contraire, l’épée du lion est la serpe, qui était le symbole du cinquième degré de l’initiation dans le mithraïsme, connu sous le nom de Perses. Perses était le fils de Perseus, le progéniteur des Aryens perses. Il tranche la tête de la Gorgone avec une épée-serpe. Les Gorgones étaient sacrées pour les Scythes, les tribus rivales des Perses à l’intérieur du monde iranien. Perseus brandissant la tête tranchée de la Méduse symbolise le fait qu’il a saisi sa puissance (sa Shakti) tout en restant humain (sans se transformer en pierre). Mais oui, bien sûr, c’est l’Imam Ali.

Dans le nouvel Iran, les néo-zoroastriens devront tolérer les rituels de deuil de masse de Moharrem et de l’Achoura, car après tout leurs vraies origines sont dans les anciennes processions de deuil iraniennes pour le martyre de Siyâvosh. En échange, les chiites devront tolérer les tatouages de Farvahar chez les femmes néo-zoroastriennes qui ont été tellement ciblées par la République Islamique qu’elles sont prêtes à sauter nues par-dessus des feux de joie Châhâr-Shanbeh Suri allumés en brûlant des Corans.
A la différence de ce qui se passait à l’époque de Reza Shah Pahlavi II, et de la République Arabe d’Al-Ahwaz proposée, il n’y aura pas de criminalisation de l’islamophobie dans l’Iran nationaliste. En fait, la composante chiite du nouveau régime servira à légitimer l’alliance de l’Iran avec les nationalistes européens combattant la cinquième colonne de nouveau Califat sunnite à Paris, Londres, Munich et Dearborn. Les têtes de l’hydre sont en Arabie Saoudite, en Turquie, et au Pakistan. Le Lion de Mithra tranchera ces têtes avec son épée. Pour la première fois depuis la dynastie fatimide des Assassins, La Mecque et Médine seront gouvernées par des mystiques chiites. Les Perses fêteront cela à Persépolis.
Il n’y a pas de doute là-dessus. Le temps est venu pour l’Iran bonapartiste – la forteresse islamique-aryenne et nationaliste-religieuse de la résistance contre les globalistes sans racines, pour qui « Rien n’est vrai, et tout est permis ». Il ne nous reste qu’une question : « Qui est le Napoléon perse ? ».
16:23 Publié dans Actualité, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, politique internationale, géopolitique, iran, iranisme, paniranisme, zoroastrisme, civilisation iranienne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 07 mai 2019
Europe-États-Unis : l’urgence !...

Nous reproduisons ci-dessous un la deuxième partie d'un point de vue d'Hervé Juvin, cueilli sur son site personnel et consacré à la position que l'Europe doit tenir face aux États-Unis.
Économiste de formation, vice-président de Géopragma, Hervé Juvin est notamment l'auteur de deux essais essentiels, Le renversement du monde (Gallimard, 2010) et La grande séparation - Pour une écologie des civilisations (Gallimard, 2013). Candidat aux élections européennes sur la liste du Rassemblement national, il a publié récemment un manifeste intitulé France, le moment politique (Rocher, 2018).
Europe-États-Unis : l’urgence
Combien de Français, combien d’Allemands ou d’Italiens en sont conscients ? La littérature diplomatique et militaire américaine, aussi bien que ce qui transparait des discours et documents officiels de Washington, témoigne de la rapide transformation d’une vision du monde qui aura des conséquences majeures sur la doctrine et sur l’action américaine. Il suffit de lire « Foreign Affairs », et ses livraisons successives consacrées à l’alliance entre nationalisme et libéralisme économique, ou bien aux ruptures irréversibles créées par Donald Trump à Washington (présentées par Williams Burns, par exemple, comme la perte de l’art diplomatique), pour le comprendre. Il y a urgence pour les Européens à se réveiller du sommeil profond dans lequel le parapluie militaire américain et l’engagement des États-Unis à assurer la sécurité de l’Europe les ont plongés.
Il y a plus urgent encore ; interroger, challenger, repenser la relation transatlantique pour nouer avec les États-Unis un dialogue préalable au réajustement vital de la politique extérieure et de Défense des Nations européennes sur la base de cette réalité ; rarement l’écart entre ce qui est dit, publié, débattu, et la réalité n’a été aussi grand ; rarement les risques de collision entre les raisons d’agir et les conséquences de l’action n’ont été aussi grands.
États-Unis : le changement Trump
Révolution dans les affaires diplomatiques ? Sans doute, et tout aussi bien dans la relation transatlantique. Traumatisé par la suppression du tiers de son budget — le tiers ! — le Département d’État a perdu en moins de trois ans la majorité de ses professionnels de haut niveau, notamment parce qu’ils ont été accusés d’avoir souscrit à l’accord nucléaire avec l’Iran, d’être restés impavides face à la montée de la Chine, et plus simplement d’avoir servi pendant deux mandats la politique du Président Obama et de Mme Clinton.

Suspects d’avoir participé aux machinations diverses organisées par l’administration démocrate pour soutenir Mme Clinton, nombre de services de sécurité américains se voient tenus à l’écart de la Maison Blanche, supplantés par des militaires, et nombreux sont les canaux d’échanges avec leurs homologues européens qui sont coupés, devenus aléatoires ou inopérants. Il est plus grave que les professionnels du renseignement expérimentés et capables de dialoguer avec leurs homologues russes, iraniens ou chinois fassent massivement défaut.
Et combien de diplomates américains apprennent sur Twitter les décisions de leur Président, y compris quand elles concernent le pays ou la zone dont ils sont en charge ? D’où la confusion. D’où les excès. D’où une démesure qui frise l’inconscience. D’où une réalité dérangeante ; ils sont bien peu désormais à comprendre la France, l’Italie, ou les autres Nations européennes, ils sont aussi peu nombreux à prêter attention à une Union européenne qui appartient pour eux déjà au passé, encore moins à attendre quelque chose de l’Europe — le vide stratégique dans lequel l’Union a enfermé les Nations n’aide pas.
America First
La plus grande erreur serait d’en conclure à l’inconsistance de la politique extérieure américaine. Comme toujours, elle est dominée par la politique intérieure. Comme toujours, elle vit dans l’hystérie de la menace extérieure, même si aucune puissance ne menace directement la sécurité ou les intérêts vitaux américains [1]. Comme toujours, elle sert de variable d’ajustement à un Président qui prépare sa réélection. Mais les directions invoquées sont claires.
Les États-Unis ne sont plus les gendarmes du monde
La première est l’abandon du rôle de gendarme du monde. Les États-Unis interviennent, avec quelle brutalité, quand leurs intérêts sont en jeu. 800 bases militaires leur permettent d’agir à tout moment, sans délai, partout dans le monde — sauf dans les quelques zones où les systèmes d’interception et de brouillage russes ou chinois le leur interdisent. Qui considère le Kosovo autrement que comme la base militaire et politique qui couvre l’action américaine en Europe ?
Mais ils n’éprouvent plus le besoin de justifier leurs interventions par le maintien de la paix, la défense de la démocratie, etc. Ils tournent le dos à l’idée que la prospérité et le progrès partout dans le monde sont des conditions de leur propre sécurité et de leur propre croissance — une idée qui explique la bienveillance qui a entouré l’essor du Japon, de la Corée du Sud, de l’Allemagne, la contribution décisive des États-Unis aux institutions multilatérales, comme elle explique une part de l’ascension chinoise et du luxe social européen. Chacun peut y voir l’expression de cette conviction, énoncée par Donald Trump ; nous vivons un monde hobbesien, où la violence et la guerre sont partout. D’autres préféreront y voir un égoïsme à courte vue ; à refuser l’interdépendance, les États-Unis pourraient bientôt découvrir leur propre dépendance.

L’état profond est prêt à tout
La seconde est plus claire encore ; contre le réalisme affiché par Donald Trump, l’État profond américain intègre la guerre, la famine et la misère, dans sa stratégie d’affaires. Les Iraniens, les Russes, comme les Irakiens ou les Soudanais hier, sont les cibles désignées d’un système qui « n’admet plus aucune résistance ; le dollar, ou la mort ! Au mépris de toutes les lois internationales, le blocage du détroit d’Ormuz au brut iranien est au programme, comme l’est le blocus de Cuba (trois pétroliers transportant du brut vénézuélien ont été arraisonnés en mars dernier par l’US Navy, dans un acte de piraterie au regard du droit international).
Le projet de loi surréaliste (mais bipartisan, signé à la fois par des sénateurs républicains et des démocrates, Gardner et Menendez, introduit au Sénat le 11 avril 2019 !) qui déclare la Russie complice du terrorisme et les forces armées russes, organisation terroriste, est sans ambigüité ; qui sont ces Russes qui ne se plient pas à l’ordre américain ? Et qui sont ces Équatoriens qui prétendent limiter l’exploitation de leur sol par des majors américains du pétrole pour sauver leur forêt ?
Plus besoin de s’abriter derrière la lutte contre le terrorisme ou les régimes autoritaires ; la militarisation du dollar, qui permet de racketter à volonté les entreprises et les banques étrangères, le piratage des transactions bancaires et des données privées que permet notamment le contrôle de SWIFT, des sociétés de transferts de fonds et des cartes de crédit, sans parler de la loi « FATCA » qui fait de toute banque l’auxiliaire forcé de l’administration américaine, changent la diplomatie mondiale en concours de soumission à l’intérêt national américain – ou à ce qui passe pour tel.
Les débats sur le retrait américain occupent la scène et suscitent ici ou là de complaisantes inquiétudes. La réalité est que l’usurier remplace le gendarme. La tentation américaine demeure bien celle d’un « global reach » monétaire, juridique et numérique, qui garantisse l’enrichissement permanent de l’oligarchie au pouvoir, une emprise universelle qui ne s’embarrasse plus de prétextes, obtenue par le contrôle mondial des données, de l’énergie et de l’alimentation, ou par la terreur — le bombardier américain est derrière le dollar, comme il est derrière toute proposition commerciale américaine.
Donald Trump a été clair dans son allocution inaugurale ; les États-Unis ne vont pas convertir le monde à leurs valeurs et à leur mode de vie, personne ne leur imposera des règles et des lois dont ils ne veulent pas. C’est bien à tort que certains en ont conclu à un retrait des États-Unis ! Ils ne se retirent pas, ils se contentent de poursuivre des intérêts que la globalisation a effectivement rendus mondiaux — ce qui signifie que tous les Etats de la planète qui utilisent le dollar sont en dette à l’égard des États-Unis. Ceux-ci affichent leur indifférence à l’égard des effets de leurs exigences. Et ils se contentent de défendre le mode de vie des Américains qui, faut-il le rappeler, n’est pas négociable – le seul problème est que la poursuite de ce mode de vie et d’enrichissement suppose qu’une part dans cesse croissante des ressources de la planète lui soit consacrée alors même que son coût écologique et financier le rend de plus en plus insupportable au reste du monde.

Money First
La troisième direction est la plus problématique pour les Nations européennes ; quand il n’y a rien à gagner pour les États-Unis, les Américains rentrent chez eux ! Tous les choix de Donald Trump sont ceux d’une liberté stratégique revendiquée contre lois, accords, pratiques, conventions et institutions. Les États-Unis marchent dans le monde les mains déliées. Gulliver est libre des liens qui l’avaient enchaîné ! Ni traité, ni lois internationales, ni liens historiques ne sauraient prévaloir sur le sentiment qu’ont les États-Unis de leur intérêt. Leur désengagement des institutions internationales et leur mépris des accords multilatéraux sont à la hauteur de la crédibilité qu’ils leur accordent — à peu près nulle. C’en est bien fini du « Nation’s building », du « State’s building », du « devoir de protéger », et autres fantasmes politiques qui ont abouti aux désastres que l’on sait. Les États-Unis viennent encore de le dire haut et clair en refusant de signer le pacte de Marrakech comme le traité sur le contrôle du commerce des armes, tous deux proposés par l’ONU. Les croisés de la démocratie planétaire et du libéralisme universel peuvent rentrer au vestiaire!
La décision de retirer toutes les forces américaines de Syrie, même corrigée par la suite, est significative ; quand les buts de guerre affichés sont remplis (éliminer l’État islamique), ou en l’absence d’objectifs politiques clairs et réalisables (chasser les forces iraniennes de Syrie, par un accord avec les Russes en façade et Bachar el Assad en coulisses), l’armée américaine s’en va. Aurait-elle tiré les leçons des désastreuses affaires irakiennes, afghanes et libyennes ?
Et elle s’en ira aussi quand elle n’est pas payée pour les services qu’elle rend. Donald Trump effectue moins une rupture qu’une explication ; il n’y a pas de repas gratuit. Toute intervention américaine a son prix, et ce prix sera payé par ses bénéficiaires — il existe mille et une façons de le payer. Les Nations européennes devraient le comprendre – et se préparer à consacrer 4 % à 5 % de leur PIB à leur Défense, ou à se soumettre.
En quelques mots ; Jackson est de retour, là où les Européens attendent toujours Hamilton, Madison ou Jefferson ! Pour le supporter de Trump, le monde est loin, il est compliqué, cher et dangereux, on est mieux à la maison ! Si les États-Unis ont besoin de quoi que ce soit, il suffit d’envoyer les GI’s le chercher ! Rien ne sert de s’occuper des affaires des autres, il suffit d’être sûr que son propre intérêt va toujours et partout prévaloir, qu’importe le reste ?
L’UE et le vide stratégique
La leçon à tirer est claire ; seul l’intérêt justifiera le maintien d’une défense américaine de l’Europe. L’Europe devra payer pour elle, et le prix qu’elle ne consacre pas à sa défense, elle le paiera pour la défense américaine.
 Rien ne saurait être plus éloigné des palinodies auxquelles l’Union européenne, enlisée dans le juridisme des Droits de l’Homme et dans la prédication morale condamne les Nations européennes. Mais rien non plus n’est aussi nécessaire que le questionnement de la relation transatlantique, sujet tabou et vide abyssal de la diplomatie de l’Union. Quelle occasion perdue quand Donal Trump a mis en question la validité de l’OTAN et exigé des pays de l’Union un effort de Défense significatif ! Qui a compris, qui a répondu, qui a saisi la chance de penser une politique européenne de Défense, c’est-à-dire une Europe politique ?
Rien ne saurait être plus éloigné des palinodies auxquelles l’Union européenne, enlisée dans le juridisme des Droits de l’Homme et dans la prédication morale condamne les Nations européennes. Mais rien non plus n’est aussi nécessaire que le questionnement de la relation transatlantique, sujet tabou et vide abyssal de la diplomatie de l’Union. Quelle occasion perdue quand Donal Trump a mis en question la validité de l’OTAN et exigé des pays de l’Union un effort de Défense significatif ! Qui a compris, qui a répondu, qui a saisi la chance de penser une politique européenne de Défense, c’est-à-dire une Europe politique ?
La question n’est pas et ne peut plus être ; « qu’attendre d’eux ? » La question est et ne peut être que ; comment les Nations européennes s’organisent-elles pour assurer leur propre sécurité ? Comment peuvent-elles contribuer à la sécurité des États-Unis, et au sentiment de sécurité des Américains (le sentiment d’être menacé par un monde extérieur hostile est à la hauteur de la méconnaissance croissante par la population américaine du reste du monde), condition de la paix dans le monde, dans un rapport de réciprocité, de franchise et de reconnaissance mutuelle de souveraineté des États ? Partagent-elles des intérêts communs avec les États-Unis, lesquels, jusqu’où et comment peuvent-elles les servir ? Que peuvent-elles partager comme buts, offrir comme moyens, déployer comme capacités ?
Aucune question n’est de trop dans ce domaine — voici si longtemps que l’Union européenne interdit à l’Europe toute question, y compris sur son existence même ! Voilà si longtemps que l’Union est tellement pleine de ses bonnes intentions qu’elle refuse tout bilan de son action [2] ! Mettre à plat la relation transatlantique est un préalable à toute évolution de l’OTAN, soit pour refonder l’Alliance sur de nouvelles missions, comme la lutte antiterroriste — dans ce cas, pourquoi pas avec la Russie ? – soit pour la dissoudre — l’OTAN ne pouvant demeurer le courtier des armements américains en Europe et le chiffon rouge agité devant l’ours russe. Comme elle est un préalable à tout effort coopératif entre Nations européennes pour assurer leur capacité autonome de faire face à n’importe quelle menace sécuritaire à leurs frontières ou à l’intérieur d’un quelconque pays membre. Comme elle est aussi un préalable à des actions diplomatiques plus fortes et plus marquantes, notamment vis-à-vis des pays avec lesquels telle ou telle Nation européenne entretient des relations historiques particulières, par exemple dans le Maghreb, en Afrique ou en Asie ; demain, les États-Unis auront bien besoin de la France, de l’Italie, de l’Espagne, pour sortir d’un isolement qui produit l’ignorance d’abord, la méprise ensuite, et les accidents stratégiques enfin !
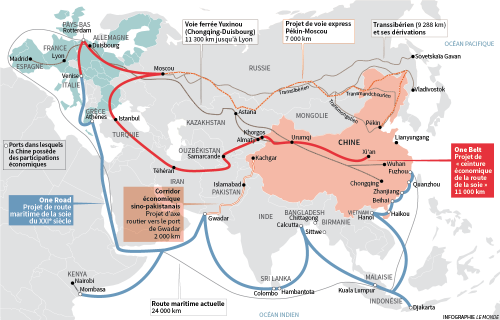
Au lieu de condamner les pays, tels l’Italie, la Suisse, la Grèce et le Portugal, qui s’engagent dans le projet chinois des Routes de la Soie, comme l’a fait bien maladroitement le Président Emmanuel Macron, mieux vaudrait considérer l’intérêt stratégique d’un renforcement géré des liens avec le continent eurasiatique, et l’opportunité qu’il donne à l’Europe de se positionner en troisième pôle mondial d’activité et de puissance. L’intelligence du monde n’a-t-elle pas été la première arme diplomatique de la France, avant même l’arme nucléaire, et quand quelque chose comme une diplomatie française existait encore ?
Encore faudrait-il pouvoir parler, nommer et dire. Encore faudrait-il vouloir, décider, et oser. Sans doute, le temps n’est plus où un proconsul américain dictait les résolutions des premiers pays membres de la Communauté européenne, au mieux des intérêts américains et des instructions de Washington, relayés si besoin était par ces deux collaborateurs diligents qu’étaient Robert Schumann et Jean Monnet [3]. Il n’est même plus besoin de procéder ainsi, tant les Européens ont appris à obéir, à se conformer et à se soumettre avant même d’y avoir pensé !
Le dialogue transatlantique appelle tout autre chose que le catalogue de bonnes intentions et de pieuses résolutions qui tient lieu à l’Union européenne de politique extérieure. Il a besoin que l’Europe décide de ses frontières extérieures, et les tienne. C’est vrai face à la Turquie, c’est vrai davantage face à de faux États comme le Kosovo, base arrière avérée de futurs djihadistes européens rescapés de Syrie, ou d’autres anciens États des Balkans, bastions de la pénétration islamique de l’Europe. Il a besoin que les Nations européennes sachent ce qu’elles sont et ce qu’elles se doivent, à elles, à leur histoire et à leurs peuples, en revoyant l’Union à ses bavardages sur les Droits de l’homme. Et il a besoin que les Nations européennes sachent de nouveau prononcer les mots de puissance, d’armée, de guerre, qu’elles désignent leurs ennemis et qu’elles se préparent à les affronter et à les détruire. S’il est un mensonge qui nous coûtera cher, c’est bien l’idée que l’Union européenne a apporté la paix. La paix était assurée par la guerre froide, puis par la protection militaire et nucléaire américaine. L’Union européenne n’y a eu rien à voir.
La véritable refondation du dialogue transatlantique, en même temps que le progrès des relations avec les États-Unis passe d’abord par une prise d’indépendance. L’Europe doit mériter le respect que l’Union n’a rien fait pour mériter [4]. La dimension de son marché intérieur, de son épargne, les expertises sur les marchés des capitaux, des matières premières et des changes, ses liens avec d’autres puissances qui partagent la quête de souveraineté qui unit leurs peuples, permettent aux Nations européennes de construire des systèmes de paiement, de commerce de matières premières et d’or, des outils de crédit, de change et d’engagements à terme, hors du dollar et des systèmes américains, comme la Chine les construit patiemment de son côté [5].
Ils permettent tout aussi bien aux Nations européennes d’imposer des normes, des bonnes pratiques et des règles dans les domaines écologiques, sanitaires, sociaux, aussi bien que bancaires et financiers, qui rallieront l’adhésion tant elles remplissent un vide béant dans le modèle américain, ou ce qu’il en reste. Il manque à l’Europe la conscience plus que les moyens, et la volonté plus que la force ! Que l’Europe ne reste pas ce continent où, pour paraphraser le commentaire par Charles Péguy du Polyeucte de Corneille, « ils veulent être de la grâce parce qu’ils n’ont pas la force d’être de la nature » [6]. C’est tout le danger que l’Union européenne comporte pour l’Europe ; à force de nier son identité, ses frontières et ses limites, elle se condamne à n’être qu’une bulle de bonnes intentions que l’impitoyable réalité du monde dispersera d’un souffle.
Hervé Juvin (Site officiel d'Hervé Juvin, 30 avril 2019)
11:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, europe, affaires européennes, union européenne, routes de la soie, relations transatlantiques, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 06 mai 2019
La Russie reprend la main en Ukraine

La Russie reprend la main en Ukraine
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
Par ce terme de relations normales, nous entendons celles que par exemple les Etats de l'Union européenne, à qui l'on ne peut reprocher un excès de poutinophilie, entretiennent avec Moscou. Pour rétablir des relations normales avec l'Ukraine, la Russie doit persuader tous ceux qui dans ce pays rêvent encore d'y multiplier des provocations anti-russes, éventuellement militaires, qu'elle ne les laissera plus désormais faire.
Sans menacer Kiev de réactions de l'armée russe dont les conséquences pourraient être nuisibles aux stratégies géopolitiques internationales de la Russie, elle vient d'annoncer une mesure qui rendra pratiquement impossibles les interventions ukrainiennes hostiles dans les républiques auto-proclamées peuplées de russophones de Donetsk et de Lugansk.
Etant donné que l'Ukraine a bloqué ces régions, qu'elle n'a pas fourni de services administratifs à leurs populations, qu'elle n'a pas payé les pensions ou les allocations qui leur sont dues et qu'elle n'a pas permis à ses citoyens qui y vivent de voter aux élections ukrainiennes, la Russie a maintenant autorisé les résidents de ces régions à demander la citoyenneté russe, ouvrant des bureaux régionaux pour étudier et satisfaire le cas échéant celles-ci.
Jusqu'à présent l'armée ukrainienne avait pu bombarder en toute impunité, en y faisant de milliers de victimes, les districts de Donetsk et de Lugansk en prétendant qu'elle y réprimait les rébellions sécessionniste de citoyens ukrainiens. Désormais, elle ne pourra plus le faire car ce seront des citoyens russes qu'elle bombardera. Dans ce cas, Vladimir Poutine serait légitime, conformément au droit international, s'il intervenait militairement.
Alors l'Ukraine, malgré sa relative puissance militaire, subira le même sort que la Géorgie lorsque en 2008 ses militaires ont bombardé l'Ossétie du Sud, un territoire empli de détenteurs de passeports russes. Au cours de cette courte guerre la capacité militaire de la Géorgie a été neutralisée en moins d'une semaine, et le reste du monde en a pris acte.
Moscou pourra prendre bien d'autres mesures pour réduire les capacités économiques et diplomatiques de l'Ukraine, si celle-ci sous la présidence de Volodymir Zelinsky ne revient pas à la raison. Nous en ferons une listé éventuellement. Tout laisse croire que Zelinsky en tiendra compte pour établir les relations normales avec la Russie auxquelles nous faisions allusion. Washington devra s'y résigner.
Lire une excellente analyse de la française Christelle Néant, excellent connaisseuse de la région
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/politologue-toute-la-puissance-de-214739
09:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, ukraine, europe, géopolitique, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 05 mai 2019
La chimère du monde unipolaire

La chimère du monde unipolaire
par V.A. Michurin
Les jugements concernant l’idée selon laquelle nous vivons dans un monde unipolaire peuvent être entendus partout. Les « patriotes » en parlent avec une voix enrouée par la peur et avec un regard de condamnation, les « cosmopolites pro-occidentaux » avec une attitude nettement élogieuse et une tape indulgente sur le bras de l’interlocuteur, les « pragmatiques » lèvent les bras : c’est la réalité, disent-ils. A première vue, de fait, tous les faits confirment cette thèse : après la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis sont devenus le leader évident de tout le monde non-communiste, et après le grand effondrement du « système socialiste mondial » et de l’URSS, et aussi l’affaiblissement de l’héritière de la Russie – la Fédération Russe – au rang d’une puissance plus faible, tributaire des pays occidentaux, les Etats-Unis ont presque automatiquement acquis le rôle de leader mondial. Ils ne veulent pas être évincés de ce rôle, et ils le clament de toutes les manières possibles. Le monde unipolaire est-il donc, réellement, la « Fin de l’Histoire » ? Ou peut-il s’agir d’une illusion qui s’est enracinée dans la conscience de masse ? Ou un paradoxe historique a-t-il réellement surgi ?
 Essayons de donner la réponse, en partant de la théorie de l’ethnogenèse de L.N. Gumiliev [1]. Cette théorie, avant tout, permet d’échapper à ce que Gumiliev lui-même a appelé « l’aberration de la proximité », lorsque « face à face, la face n’est pas vue ». Chacun peut tenter l’expérience : mettez la paume de la main très près du visage – elle semblera plus grande que l’armoire de l’expérimentateur à cinq mètres de là. Si un homme ne connaît pas le concept de la perspective, il y croira toujours. Dans la vie quotidienne, l’erreur est évidente. Mais lorsqu’il s’agit de comprendre des événements modernes avec une perspective vraiment historique, sans une vision objective prenant en compte la régularité de la montée et de la chute des civilisations et des peuples, nous ne pouvons pas l’éviter.
Essayons de donner la réponse, en partant de la théorie de l’ethnogenèse de L.N. Gumiliev [1]. Cette théorie, avant tout, permet d’échapper à ce que Gumiliev lui-même a appelé « l’aberration de la proximité », lorsque « face à face, la face n’est pas vue ». Chacun peut tenter l’expérience : mettez la paume de la main très près du visage – elle semblera plus grande que l’armoire de l’expérimentateur à cinq mètres de là. Si un homme ne connaît pas le concept de la perspective, il y croira toujours. Dans la vie quotidienne, l’erreur est évidente. Mais lorsqu’il s’agit de comprendre des événements modernes avec une perspective vraiment historique, sans une vision objective prenant en compte la régularité de la montée et de la chute des civilisations et des peuples, nous ne pouvons pas l’éviter.
Le problème est que pour la majorité des gens, les événements et les phénomènes modernes semblent toujours magnifiques et faisant date, alors que les anciens semblent recouverts par la poussière des siècles et ne semblent pas aussi significatifs. Il est difficile d’échapper à cette déformation émotionnelle.
Expliquons notre approche de ce thème avec un exemple concret. Toutes les branches occidentales de l’humanité sont déjà entrées jadis dans un nouveau millénaire, en considérant qu’elles étaient dans un « monde unipolaire ». C’était le début d’une nouvelle ère, quand les concepts d’« empire romain », de « monde civilisé », de « monde entier », étaient considérés comme des synonymes par la conscience collective. Cette vision était basée sur de solides fondations – Rome n’avait pas de rivaux puissants, elle gérait plus ou moins efficacement la « pax romana » qui existait alors. La conscience des premiers chrétiens était légitimement liée à une perception unipolaire du monde. Et après ? La « fin du monde » était aussi prévue, et elle survint à l’époque des « grandes invasions ». Les siècles ont passé, et à la place de la partie occidentale de l’empire romain, qui avait toujours paru éternel, un conglomérat varié d’états « barbares » apparut, dont la population ne se rappelait plus du tout l’ancienne tradition. Et maintenant, au XXe siècle, il y a même des gens qui nient en bloc qu’un empire romain ait jamais existé.
Ce que nous voulons dire est que le premier point de vue (le leadership mondial américain comme signe de la « fin de l’histoire ») ne peut absolument pas être pris au sérieux. Le concept de la « dilution du monde dans le marché intégré » sous l’égide des Etats-Unis est une nouvelle sorte de « communisme », c’est-à-dire une propagande-fantôme exigeant un acte de foi, au lieu d’une attitude consciente. Les faits de la présence d’un marché financier mondial, du dollar comme devise mondiale, et d’Internet, n’abrogent pas les lois de l’ethnogenèse, comme la cruelle réalité le démontre constamment.
Tournons-nous donc vers les faits réels.
* * * * *
Aux XVIIIe et XIXe siècles, en Amérique du Nord, à partir des descendants de colons venant de régions d’Europe à prédominance protestante – Anglais, Hollandais, Allemands, Français, Scandinaves –, une ethnie complètement nouvelle se développa, mais qui appartenait en même temps indubitablement à la civilisation occidentale. Elle sera correctement nommée WASP (White-Anglo-Saxons-Protestants) ou Yankee, pour empêcher une confusion avec le concept juridique d’Amérique. Pour les contemporains, il devint bientôt évident que les anciens habitués des salons de thé de Boston ou les Minutemen n’étaient pas simplement des insurgés contre les autorités anglaises, mais quelque chose d’essentiellement nouveau.
La nouvelle ethnie se développa à partir des représentants les plus « passionnés » des ethnies protestantes d’Europe [2]. Ces gens ne savaient pas comment utiliser leurs forces dans leur pays natal et avaient en eux suffisamment d’énergie pour traverser l’océan et s’adapter à des conditions inhabituelles et plutôt dures. On pourrait dire que la colonisation de l’Amérique du Nord et l’apparition à cet endroit d’une ethnie nouvelle en expansion vigoureuse fut la dernière manifestation sérieuse de « passionnarité » venant de la super-ethnie occidentale [3]. La « frontière », la conquête de l’Ouest Sauvage [Wild West] (c’est-à-dire un paysage complètement nouveau), représente en elle-même la dernière grande communauté de « passionnés » générée par la civilisation européenne. Après cela, au XXe siècle, l’Occident donna naissance à un grand nombre de personnalités brillantes, mais dans l’ensemble les « passionnés » restèrent des exceptions plutôt que la règle, dans les ethnies occidentales, leur proportion étant insignifiante et décroissante avec le temps.

Les Etats-Unis créèrent un système ethnico-social assez raisonnable, basé sur la non-ingérence dans les coutumes des divers groupes de colons et sur la tolérance ethnique (c’est précisément ce système qui permet jusqu’à ce jour l’existence du conglomérat poly-ethnique nord-américain). En Amérique se précipitèrent aussi les fractions actives d’autres peuples éloignés des protestants mais capables de cohabiter avec eux dans le cadre du système américain : les Irlandais, les Polonais, les Italiens, les Juifs. Un rôle singulier fut joué dans la vie du pays par les Juifs d’Europe de l’Est, dont la « passionnarité » au XIXe siècle et au début du XXe était très élevée.
A la longue, les Etats-Unis devinrent le refuge des aventuriers du monde entier, cherchant un meilleur sort, représentants les ethnies et les civilisations les plus diverses. Certains d’entre eux devinrent de loyaux citoyens des Etats-Unis, trouvant un langage commun avec la majorité ethnique du pays. Certains se rassemblèrent dans des mafias ethniques fermées. Le poids spécifique de la fraction des ethnies plutôt éloignées du stéréotype de comportement européen s’accrut constamment dans la composition des immigrants (le pourcentage des immigrants originaires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine dans la composition de ceux qui s’établissent définitivement aux Etats-Unis est passé de 12% en 1951 à 88% en 1990 – I. Tsanenko, Social and Political Consequences of International Population Shift, MeiMO, N° 3, 1999, pp. 59-63). En conséquence, l’Amérique s’est transformée en un conglomérat de peuples, loin d’être toujours proches (complémentaires) les uns des autres –, ce qui génère des conflits ethniques sporadiques, et pas seulement cela. Gumiliev a démontré que la montée des Weltanschauungen [visions-du-monde] négatrices de la vie (anti-systémiques) est liée aux zones de contacts ethniques négatifs. Ces phénomènes, à un degré maximum, sont caractéristiques des Etats-Unis : ainsi l’apparition de sectes totalitaires complètement non-naturelles, la croissance de la violence gratuite, et le niveau croissant de criminalité.
Tous ces facteurs contiennent un énorme potentiel d’instabilité pour la société multiethnique américaine. En partant de l’hypothèse qu’à long terme les Etats-Unis seraient capables de conserver leur rôle dans le monde et un état stable de leur économie, étroitement lié à ce rôle, il est possible de formuler le pronostic suivant : la société américaine restera solide tant que l’ethnie de base (Yankees – protestants) conservera un niveau de « passionnarité » suffisant pour maintenir en ordre l’actuel système social, et tant que les groupes ethniques du pays ne seront pas contraints par une politique d’Etat à un mélange artificiel. Si l’Amérique devenait réellement un melting-pot, au lieu d’une cohabitation des ethnies, cela serait la garantie de sa ruine rapide.
* * * * *
Les raisons pour lesquelles l’Amérique est devenue au XXe siècle l’incontestable leader de l’Occident sont, pour le chercheur familiarisé avec la théorie de l’ethnogenèse, aussi évidentes que le sont les raisons de la venue de l’été après le printemps pour des climatologues. Les Etats-Unis ont simplement joué le rôle d’une « pompe aspirante » absorbant les gens les plus forts et les plus entreprenants de toute l’Europe, c’est-à-dire concentrant en eux [= aux Etats-Unis] le fond génétique européen de « passionnarité ». Grâce à celui-ci, la récession générale de « passionnarité », inéluctable pour la super-ethnie occidentale, eut lieu aux Etats-Unis beaucoup plus lentement qu’en Europe.
En plus de cela, il est nécessaire de dire que la destinée historique de l’Amérique avec sa situation géographique au XXe siècle étaient simplement extrêmement favorables. Sa situation devint très favorable dès la fin de la Première Guerre mondiale. A cet égard, la promotion des Etats-Unis à un rôle dirigeant commença déjà à rencontrer un obstacle avec la « passionnarité » décroissante de leur population, composée de gens actifs, pragmatiques et respectueux des lois, ne pensant qu’à accroître leur bien-être, au lieu de penser à la mission mondiale de leur pays – c’est-à-dire des gens représentant la phase inertielle de l’ethnogenèse. Ces gens trouvaient naturelle et évidente l’idéologie de l’isolationnisme, qui peut être exprimée par ces mots : « Pourquoi nous charger d’un autre problème ? ».

Bien que cela puisse sembler paradoxal, il est cependant possible de dire que ceux qui ouvrirent la voie au leadership mondial américain furent les Japonais, provoquant la guerre du Pacifique en attaquant Pearl Harbour en 1941. Le puissant lobby isolationniste, qui ne laissait pas l’Amérique entrer dans la guerre, fut obligé de céder. Les événements ultérieurs se développèrent selon une logique implacable. Le Japon n’avait aucune chance de gagner contre les Etats-Unis (à cause de l’énorme disparité entre les potentiels d’économie de guerre) et était entré en guerre seulement à cause d’un surplus de « passionnarité » de type oblatif, qui avait surgi massivement en résultat de la poussée de « passionnarité » qui transforma le Japon après la révolution de Meiji. Tous les jeunes officiers japonais souhaitaient périr pour l’Empereur, et le gouvernement du pays ne pouvait rien faire contre cela (il est intéressant de noter que, une fois débarrassé du surplus de « passionnarité » qui était un obstacle à la vie, le Japon réalisa d’importants succès économiques dans les années d’après-guerre. La guerre joua pour le Japon un rôle similaire à celui d’une saignée pour les hypertendus). Etant entrés en guerre, les Etats-Unis la menèrent selon leurs inclinations, représentations et possibilités, c’est-à-dire en créant – grâce à l’invulnérabilité de leur territoire face à l’ennemi – un complexe militaro-industriel d’une dimension absolument sans précédent, permettant à l’armée de conduire la guerre en usant d’une supériorité technique quantitative (et souvent aussi qualitative) écrasante.
On pense généralement que si l’Amérique n’était pas entrée en guerre, les pragmatiques Américains auraient difficilement commencé à investir dans la création d’un aussi vaste complexe militaro-industriel. Mais dès que cette branche hypertrophiée eut été créée, elle se transforma dans les années d’après-guerre en une force autonome poussant les Etats-Unis à adopter un style de comportement plus actif, plus « puissant », sur la scène mondiale.
Après la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis eurent à nouveau de la chance : ils trouvèrent un ennemi idéal – le communisme, qui leur permit de rassembler tout le monde non-communiste sous leur égide, et qui n’avait aucune chance de remporter une victoire définitive (pour beaucoup d’Américains, et aussi pour Staline, il était évident que même les espoirs les plus illusoires de « victoire mondiale du communisme » étaient morts le matin du 22 juin 1941).
Les Etats-Unis tirèrent avantage de tous les avantages de leur situation. Ils se subordonnèrent les restes de « passionnarité » de l’Europe Occidentale, épuisée par la guerre et égarée, et s’attachèrent le Japon, ils introduisirent le dollar comme équivalent monétaire mondial, remplaçant dans les faits l’or lui-même. Les succès américains se déroulaient parallèlement à un déclin constant de la « passionnarité » de la population du pays. Après avoir vaincu le Japon, trente ans plus tard les Américains perdirent au Vietnam, bien qu’ils aient utilisé la même stratégie d’usage massif d’une puissance militaro-technique écrasante. Les recrues étaient simplement d’une autre génération.
Ensuite, les Américains et leurs alliés poussèrent habilement l’URSS à sa dissolution, en stimulant le processus objectivement rapide de désintégration de son élite politique. Après août 1991, la « force des choses » elle-même, ainsi que la politique rigoureuse de leur gouvernement, avaient porté les Etats-Unis à une position dirigeante dans le monde.
Et maintenant ?
* * * * *
Maintenant, nous voyons un paradoxe historique, où le leader mondial est un pays avec une population apathique, bien que travaillant dur, généralement pas intéressée par la politique étrangère (chacun sait que dans les campagnes électorales des candidats à la présidence US, les questions de politique intérieure sont absolument prédominantes, et selon les sondages
13% seulement des Américains sont favorables à ce que les Etats-Unis deviennent l’unique leader mondial pour la solution des problèmes internationaux – Z. Brzezinski, The Grand Chessboard, Moscou 1998, p. 249). La puissance militaro-technique des Etats-Unis est incontestable, mais il existe un certain nombre de limitations externes et internes, qui ne permettent pas à cette puissance de devenir une arme absolue capable de mettre le monde entier à genoux.

Remarquons qu’après le Vietnam, la force militaire a été utilisée par les Américains seulement dans des cas où des pertes humaines significatives dans leur camp étaient exclues (Irak, Serbie). En cela, les Etats-Unis ressemblent à un homme qui de temps en temps frappe son chien juste pour lui montrer « qui est le maître dans la maison ». Face à des centres de force, ou « pôles », sérieux (Chine, Inde, Iran, et récemment même la Russie), les Etats-Unis se comportent plus poliment, visant moins à imposer qu’à manœuvrer. Les Etats-Unis ont donc tendance à beaucoup insister sur leur « leadership mondial » dans un but de propagande, et en retirent un bénéfice très concret.
Economiquement aussi les Etats-Unis sont très forts, pas tellement en tant qu’hégémonie et dictateur mondial, mais en tant que l’un des secteurs importants de l’économie mondiale, représentant un système uniforme se développant selon ses propres lois. En même temps, il est déjà impossible de dire que leur rôle soit beaucoup plus important que celui de la « Grande Chine » ou celui de l’Europe unie (la part des Etats-Unis dans le PNB mondial a diminué – en 1950 elle constituait environ 30% et elle atteint aujourd’hui à peine plus de 20% – MEiMO, n.s. 10, 1999, p. 27 – et leur part dans les exportations mondiales a chuté encore plus fortement, de 60% en 1950 à 12-13% aujourd’hui).
Le monde unipolaire est une chimère. La réalité est une chose différente. Une élite essentiellement cosmopolite, basée sur la « continuation transocéanique de l’Europe » faible en « passionnarité » mais pragmatique – les Etats-Unis –, exploitant correctement une situation historique mondiale unique qui prit forme grâce au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, a maintenant gagné plus de poids dans le monde que toute autre élite. Elle a ainsi habilement joué sur les contradictions existantes dans le monde moderne (en fait, multipolaire), construit par un processus en fait contemporain. Le mythe de la puissance éternelle et indestructible de l’Amérique est donc une efficace arme de propagande et d’intimidation.
Les perspectives d’existence des Etats-Unis dans le présent et difficile monde « pseudo-unipolaire » dépendent de savoir si l’élite politique américaine peut rester en équilibre sur la corde, en empêchant les processus de croissance de « passionnarité » dans diverses régions du monde (avant tout, en Eurasie) de passer cette limite critique où le contrôle US sur les endroits stratégiques importants et les sources de matières premières serait perdu, ce qui en retour pourrait saper la position militaire et économique mondiale américaine. Si cette limite était franchie, la destinée future des Etats-Unis serait pitoyable : ils deviendraient un Etat lointain et pas particulièrement intéressant, dont l’élite politique resterait face à une population ethniquement variée, ayant perdu le très haut niveau de vie qui ne servirait plus de stimulant pour rester dans le cadre du système social existant de nos jours.
En dépit des incontestables avantages de l’actuelle situation des Etats-Unis dans le monde, la tendance basique mondiale à long terme (et peut-être pas à si long terme) leur est défavorable : la « passionnarité » de la civilisation européenne vieillissante et de sa partie transocéanique va en diminuant, alors qu’elle augmente dans de nombreuses nations du monde – certaines d'entre elles étant loin d’être prêtes à se résigner à l’actuel rôle mondial des Etats-Unis. Tout cela justifie parfaitement le sentiment d’« alerte historique, et probablement même de pessimisme » qui, comme l’écrit Brzezinski dans le livre susmentionné (p. 251), « commence à être perçu dans les milieux les plus conscients de la société occidentale ».
Originellement publié dans « Deti feldmarshala », n° 6, 2000.
Republié avec des modifications mineures sur : http://kulichki.rambler.ru/~gumilev/MVA/mva03.htm
Notes de la rédaction (M.C.)
[1] Lev Nikolaiévitch Gumiliev (1912-1992), historien, orientaliste, ethnologue et archéologue russe. Selon la théorie de l’ethnogenèse de Gumiliev, une ethnie (« un phénomène à la frontière de la biosphère et de la sociosphère ») n’est pas un « état » mais un « processus », caractérisé par sa propre structure particulière, son propre stéréotype comportemental et ses propres phases de développement (la période créative, la période de réalisme ou période inertielle, la période de déclin). [Il est intéressant de comparer les idées de Gumiliev à celles d’Oswald Spengler et d’Arnold Toynbee, NDT].
Une courte biographie et une version abrégée de son livre Ethnogenesis and the Biosphere peuvent être trouvées en langue anglaise sur le site d’Artiom : http://artiom.home.mindspring.com/gumilev/
[et aussi sur www.cossackweb.com/gumilev/contents.htm]
[2] Le mot russe « passionarnost » (« drive » étant son équivalent anglais) a été introduit par Gumiliev pour identifier le « facteur X » de l’ethnogenèse, l’impulsion anti-entropique dont le jaillissement est typique de la période créative d’une ethnie. Le processus de l’ethnogenèse, dans son ensemble, peut être décrit comme une perte plus ou moins intensive de la « passionnarité » du système.
[3] La super-ethnie est un groupe d’ethnies qui sont apparues en même temps dans une certaine région et qui se manifeste dans l’histoire en tant qu’unité d’une mosaïque d’ethnies.
19:24 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : unipolarité, actualité, politique internationale, monde unipolaire, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
DOUGUINE : Israël nous rapproche de l’Armageddon – la Déclaration de Trump sur les Hauteurs du Golan est de mauvais augure

DOUGUINE : Israël nous rapproche de l’Armageddon – la Déclaration de Trump sur les Hauteurs du Golan est de mauvais augure
Par Natalia Makeeva
La reconnaissance par le président américain Donald Trump de la souveraineté israélienne sur les Hauteurs du Golan continue à être discutée par des politiciens et des figures publiques autour du monde. Le décret correspondant a été signé par le dirigeant américain le jour d’avant, le 25 mars 2019. La Syrie a déjà déclaré que par cette mesure Trump a piétiné la loi internationale.
L’Agence d’Information Fédérale (FAN) rappelle que depuis de nombreux siècles, tout ce qui arrive en Israël, en Syrie et dans cette région est souvent interprété par une partie de la tradition intellectuelle à travers des interprétations chrétiennes, juives et islamiques comme associé à la Fin du Monde. FAN a discuté de cela avec le leader du « Mouvement Eurasien » international, le philosophe et politologue Alexandre Douguine.
Au début de la conversation, le philosophe a expliqué l’essence de l’Etat d’Israël du point de vue de la tradition religieuse juive.
« L’actuel Etat d’Israël est un simulacre. C’est une proclamation antisémite et antijuive dans tous les sens de ces concepts », assure Douguine. « Si vous le regardez depuis le judaïsme, c’est une parodie. En tant que partie du modèle eschatologique juif [décrivant la fin du monde], sa mission est une pure imposture. Le fait est que dans le judaïsme, dans l’histoire juive, le retour des Juifs dans la Terre Promise doit survenir au moment de l’arrivée du Moshiach [= le Messie]. Tant que le Messie ne vient pas, ils n’ont pas le droit religieux de revenir ici. L’Etat d’Israël est un obstacle pour le Messie. [Il faut choisir :] Le Moshiach ou Israël. »
Par conséquent, d’après Douguine, pour que le Moshiach puisse venir, Israël doit cesser d’exister, parce que c’est un simulacre, une tentative de remplacer le divin, du point de vue du judaïsme, par la volonté humaine.
Douguine explique que la reconnaissance des Hauteurs du Golan par Trump amène la Fin du Monde.
Quant à Trump, d’après l’interlocuteur de FAN, il est loin des sujets religieux.
« Trump, bien sûr, est un réaliste et un politicien complètement séculier. Il cherche des alliés parmi les mouvements conservateurs de droite, sans prêter attention à la religion à laquelle ils appartiennent », explique Douguine. « Il a misé sur quelques politiciens, en particulier sur Netanyahu. En même temps, Trump est absolument indifférent aux questions eschatologiques et elles n’ont pas de sens pour lui. Il soutient des politiciens simplement en raison des nécessités politiques ».
Quant au Golan, l’idée de reconnaître les droits d’Israël sur les Hauteurs du Golan de la Syrie, qui sont occupées par cet Etat [Israël], est une mesure purement politique.
« De mon point de vue, cela rend finalement plus proche l’effondrement de l’Etat d’Israël », dit Alexandre Douguine. « L’Amérique, représentée par Trump, peut temporairement soutenir Netanyahu, mais plus Israël agit agressivement et audacieusement, plus l’hostilité envers lui grandit, non seulement de la part de la population arabe mais aussi de la part d’autres pays ».
Par conséquent, conclut l’interlocuteur de FAN, le seul résultat de cette reconnaissance sera l’approche de la fin de l’Etat d’Israël.

« Et c’est la signification eschatologique », Douguine en est convaincu. « Lorsqu’il s’effondrera, les Juifs se retrouveront face à une nouvelle expulsion, recherchant un nouveau foyer, et alors, du point de vue des Juifs traditionnels, l’obstacle à la réalisation de leur scénario eschatologique sera éliminé. C’est dans ce sens et seulement dans ce sens que j’interprète la décision de Trump, qui est simplement un instrument du destin. Plus tôt l’Etat d’Israël s’effondrera et disparaîtra de la face de la terre, plus tôt dans la perspective juive – c’est-à-dire de leur point de vue, le Moshiach viendra et plus tôt le [véritable] Etat apparaîtra, de leur point de vue. »
« D’un point de vue chrétien, tout sera différent », remarque-t-il.
En même temps, d’après Douguine, les cercles fondamentalistes protestants n’ont pas beaucoup d’influence sur Trump, il est bien plus probablement un homme séculier – un playboy, un réaliste politique.
« D’une manière générale il est de droite, conservateur, et il traite bien les religions. Mais il ne comprend pas la théologie protestante – il a un profil complètement différent, un style différent. Il ne s’y intéresse pas, cela ne compte pas. Et il voit tout à travers des catégories politiques réelles. Et les lignes plus profondes du destin et de l’humanité motivent les actions des pays ou de leurs dirigeants contre leur volonté, sans qu’ils s’en rendent compte, qu’ils comprennent ce qu’ils font ou qu’ils ne le comprennent pas », conclut le philosophe.
Rappelons que les Hauteurs du Golan sont un territoire disputé entre Israël et la Syrie, dont ils firent partie entre 1944 et 1967. En résultat de la dénommée Guerre des Six Jours en juin 1967, le territoire fut envahi par Israël. En 1981, la Knesset israélienne proclama sa souveraineté sur le Golan, mais cette décision ne fut pas reconnue par le Conseil de Sécurité de l’ONU. En 2018, les hauteurs furent complètement capturées par des militants islamistes. Durant l’été 2018, l’Armée Arabe Syrienne parvint à les chasser de la région.
Les Hauteurs du Golan sont un territoire important pour au moins deux raisons : l’accès aux réserves d’eau dépend du contrôle de ces hauteurs, et elles sont aussi d’une importance stratégique d’un point de vue militaire.
[Dans un article il y a quelques années, le philosophe russe disait déjà : « Le problème d’Israël n’est pas géopolitique ou économique. Il est théologique. Leur Messie ne vient pas. Les calculs juifs disent unanimement : il est grand temps, il devrait sûrement se hâter. Si les USA tombent, il y aura presque immédiatement un pays de moins au Moyen-Orient. Devinez lequel ? Donc il doit vraiment venir, parce que toutes les actions politiques et militaires des Juifs dans la seconde moitié du XXe siècle furent orientées vers sa venue. S’il attend encore, ils sont perdus. Il ne viendra pas, ni maintenant, ni plus tard. C’est vraiment une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour les bon Juifs. Ils pourraient promouvoir un simulacre du genre Sabbataï Zeevi. Un Messie virtuel. Ils le peuvent peut-être. Et ils le feront peut-être. Ce sera encore pire pour eux. Internet ne peut pas les sauver. Ni le veau d’or, ni un gros mensonge. » (Alexandre Douguine, « The end of Present World. Post-American future », conférence de Londres, octobre 2013). – NDT.]
19:09 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, nouvelle droite russe, golan, syrie, israël, judaica, levant, proche-orient, géopolitique, politique internationale, donald trump, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 04 mai 2019
If Mr. Dugin is demonized by the ”Washington Post”, that means he's right

If Mr. Dugin is demonized by the ”Washington Post”, that means he's right
It is well known that the ”Washington Post” is one of the most important tentacles of the octopus called mainstream or corporate media which is at the service of the great capital, of globalism that undermines the sovereignty of all states, causes huge economic discrepancies, poverty, misery and suffering everywhere. But in the last few years the dominant media has lost a lot of its credibility. And this, first of all, thanks to the honest intellectuals who criticize the System of the new kind of devastating imperialism that seriously affects all peoples of the world. In the last twenty years, among the world's most influential scholars who present a profound, complex and coherent analysis of the spiritual, cultural, political and economic essence of financial capitalism, neoliberalism, the West's civilization exclusivity, which pretend to be the superior and obligatory model for the rest of the world is the Russian conservative philosopher Aleksandr Dugin. His books are translated and published regularly in many countries, his presence at various international conferences has an enormous impact. His notoriety has become so great on a global scale that liberal virus promoters, corporate media propagandists can no longer ignore him. And the following article is a suplimentary argument in that sense: https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/04/16/why-far....
A first remark about this article is that in fact the authors try to defame US political strategist Steve Bannon, but devoted almost all of the text to Dugin's denigration. Or, more precisely, Bannon's association with Dugin should be compromising for the one who, as the author of the article claims, would be inspired by the books of the Russian thinker. That is why Dugin's demonization has become a priority for the servants of the System. In this sense, Dugin's ideological opponents have some success. Their purpose is not just a banal disinformation of the public by using all the denigratory terms of the religion of political correctness.
One of the basic targets of the attacks against him, along with the clear intention of compromising the person and hence of his thinking, is the intimidation, ostracizing and defamation of all intellectuals who meet or even intend to cooperate with him. Thus, a few years ago in Romania was published a so-called Dugin list, which included writers, scholars, journalists and other well-known intellectuals with whom he had met during his visits to this country. Then a real witch-hunt took place, the mainstream media terrorizing those people, asking them for explanations and especially to publicly dissociate themselves from the relationship with the Russian philosopher. The intimidation force of such a campaign was so strong that some hesitated, was forced to give incoherent explanations, and to justify that they had nothing in common with Dugin's ideas.
But why is this article published just now? There would be some explanations in this regard. First, because Steve Bannon has repeatedly declared that he is determined to give his full support to sovereignist, patriotic and eurosceptic political forces. His close relationship with Viktor Orban, Matteo Salvini and Marine Le Pen as well as his intention to contribute to the victory of the new vave of populist poltical forces in the European Parliament elections raises concerns in the camp of global players such as Soros, whom Bannon defeats directly. Then, several major political events in recent years have created panic in the camp of globalists. Trump's success at the last presidential election in the US (largely thanks to Bannon), the Brexit, the creation ruling coalition between two apparently incompatible parties in Italy, opposition from the Visegrad group countries to Brussels, the movement of the Yellow vests in France, the rise of AfD in Germany etc. show that the project of a unipolar world under the dictate of American imperialism is about to collapse. At the same time, the presence of Russia in Syria, her co-operation with China, Iran, and even with Turkey, its co-operation with Venezuela's legal government weakens even more American hegemony. In this sense, the Multipolar World Theory, conceptualized by Dugin is increasingly shared by many countries of the world.
Dugin became the number one enemy of globalists not only because of his exceptional ability to theorize the great challenges of our time. He is not just a scholar who writes his books and remains isolated from the great public debates. Dugin as a public figure is the one who scandalize and disturb istablishment who has been accustomed for decades to arrogantly exercise his monopoly on the truth. His merit lies equally in the exemplary assumption of the role of a militant with a dynamic presence in the capitals of different countries with a colossal impact. But the most serious crime of the Russian political philosopher before the masters of the dominant discourse is that he is a profoundly religious man who confesses openly his Orthodox faith. In a world of aggressive hyperliberalism, in which secularism has become a state religion, confessing your Christian faith has become an unacceptable attitude.
That's why the statement which is repeated in this article that Dugin is ”The Most Dangerous Philosopher in the World” for his influence of world politics” is the greatest compliment to him, a true title of glory. But for who is the Russian thinker dangerous? For the system of market fundamentalism, for international law violators who practice criminal military aggression against sovereign countries? For the promoters of the apocalyptic project of transhumanism? For the apostles of the culture of death, of consumerism, of mass subcultures, of the destruction of civilizations, countries and peoples through the direct aggression and economic neo-colonialism? In this respect, Dughin's detractors' statement is a totally true one, to which we enthusiastically subscribe.
Dugin is admired by normal men who have preserved their mental integrity and discernment for the same reasons why they are denied by liberals who represent the last stage of spiritual blindness and moral degradation. He is a follower and a theorist of Tradition, of the perennial religious and civilization values, of the family and the state of normality that are severely affected by the deadly epidemic and apostate Modernity. He knows that in the struggle between God and Satan neutrality is an infamy. In this spiritual war that takes place in the soul of every man, but also at the geopolitical level, he made his own choice, which is a total, fully assumed and irreversible. Dugin is not confined to ephemeral opinions or preferences. He has firm convictions, which he can develop brilliantly in his books and speeches. That is why it is dangerous for liberal totalitarian system.
I would like to mention that I am the translator, editor and promoter of Dugin's books in the Republic of Moldova and Romania. I translated "The Fourth Political Theory", "The Theory of the Multipolar World," "Eurasian Mission," "International Relations," as well as many articles by this author, which we included in the anthology published in 2017 in Chisinau and in Bucharest "Eurasian Destiny". I have read many other books signed by Dugin. I would like to say that I am an old anti-Communist and anti-Soviet militant, and as a patriot of my country who detests any kind of foreign domination, I can confirm that Dugin is far from any idea of religious, cultural, civilization, racial or politico-military supremacy.
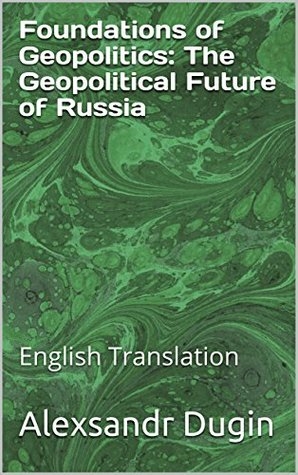 "Washigton Post" listed the whole series of invectives against Dugin. Nothing new in this. They represent the propaganda tics of the servants of liberal globalism, who feel that their system of world domination is about to fall inevitably. The spring of the peoples engaged in the total battle for the restoration of national sovereignty becomes a global phenomenon that can no longer be stopped. And Dugin is one of the most vocal spiritual and ideological leaders who brings together intellectuals and political movements from whole continents engaged in the collective effort to regain the freedom stolen by this new type of extraterritorial imperialism.
"Washigton Post" listed the whole series of invectives against Dugin. Nothing new in this. They represent the propaganda tics of the servants of liberal globalism, who feel that their system of world domination is about to fall inevitably. The spring of the peoples engaged in the total battle for the restoration of national sovereignty becomes a global phenomenon that can no longer be stopped. And Dugin is one of the most vocal spiritual and ideological leaders who brings together intellectuals and political movements from whole continents engaged in the collective effort to regain the freedom stolen by this new type of extraterritorial imperialism.
The work of this philosopher is full of admiration for all the civilizations, cultures, languages and religions of the world. His monumental work, "Noomahia," comprising more than twenty volumes, is an exceptional synthesis of the peoples' logos all over of the world. It elevates this scholar to the highest stage of science on man and society. To declare him a fascist, xenophobic, racist thinker who has so much admiration and respect for the ethno-cultural diversity of all peoples is not more than a stupid joke.
Returning to the denigratory article against Bannon, I would like to return to the reader's attention a quote from his speech launched on March 10, 2018 in front of the congress of the French National Front. In his speech, he showed his full support for populist, sovereignist, anti-system European parties:
“What I’ve learned is that you’re part of a worldwide movement, that is bigger than France, bigger than Italy, bigger than Hungary — bigger than all of it. And history is on our side,” he said. “The tide of history is with us, and it will compel us to victory after victory after victory.”
And continued:
“Let them call you racists. Let them call you xenophobes. Let them call you nativists”. In other words, Bannon's call for European patriots is not to be intimidated by the pernicious accusations of corporate media. Well, denigration and demonization of the opponents of international mafia like Soros network continues. And this is a sure sign that European populists are on the right track. This shows that Dugin and his followers everywhere are not just right, but also successful.
Nearly a year ago, I published an article about Bannon's initiative to support European populist movements. (https://www.geopolitica.ru/en/article/movement-gravedigge...). Some of my foreign friends found my text too enthusiastic. Some European dissidents, of whom I have a special respect, have published critical articles on this initiative. I do not negate their arguments. I just want to say that as we all welcomed Trump's election, no matter how he later evolved, as we applauded Brexit, no matter what the later maneuvers was made, I looked with sympathy for Bannon's public statements. For the simple reason that all these phenomena are symptomatic and demonstrate that the wave of revolt against the current state of affairs is steadily increasing.
In conclusion I would like to repeat the following. I am proud to say publicly that I am a friend of Aleksandr Dugin. We are at the same side in this total spiritual, intlectual and political war against our common ennemies who are the enemies of all nations. The Chisinau Forum, which is a joint initiative of dissident intellectuals from several countries, created in 2017 as a platform for discussion and development of geopolitical, economic and cultural alternative visions, has as its leader Dugin. For the simple reason that he is the most representative and respected among us. Of course, those who are afraid of the system's repression and do not take the risk of being with us can still remain in expectancy. It is the choice of those who prefer personal comfort and thus miss the direct participation in the great transformations of our time.
As for myself, I remain with Dugin.
Iurie Roșca,
Journalist, editor
Chisinau, Republic of Moldova,
22th April
If some English-speaking people is really interested to better understand the vision on Mr. Dugin it might be useful for them to read at least the book Mark Sedgwick ”Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century”, or even better the author's books.
17:57 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, alexandre douguine, nouvelle droite russe, politique internationale, iure rosca |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un autre regard sur la Syrie

Un autre regard sur la Syrie
par Yannick Sauveur
Ex: http://leblancetlenoir.com
RETOUR DE SYRIE
Cela n’étonnera que ceux qui s’ « informent » via les media du Système mais on peut aller en Syrie. Non, ce pays n’est pas fermé, rien n’empêche d’y aller même si le tourisme a très fortement diminué depuis le début de la guerre (2011), nous y avons rencontré des Français, une Suissesse, des Norvégiens. La chute du tourisme a pour conséquences une baisse des rentrées de devises, une répercussion économique sur le niveau de vie des commerçants, des artisans, des hôteliers, des voyagistes,... Certains se reconvertissent.
Aller en Syrie n’est certes pas anodin. Il faut naturellement un visa qu’on peut obtenir soit au consulat en France, soit directement sur place à la frontière, solution que nous préconisons et il vous en coûtera 60 euros. Si le voyage par ses propres moyens est possible, il nous paraît préférable de recourir à un voyagiste. Nous avons utilisé les services de la Communauté Syrienne de France (CSF)[1] qui organise l’accueil de groupes de Français deux fois par an. La responsable de CSF, une Syrienne, parfaitement bilingue français / arabe, est bien introduite au sein des milieux officiels syriens, ce qui est indispensable pour la réussite d’un tel voyage.
Pour avoir connu la Syrie avant la guerre (2008), il n’étonnera personne que bien des choses ont changé, ainsi des contrôles, nombreux. La population s’y est parfaitement adaptée, ce qui est bien compréhensible dans un pays qui a vécu au rythme des attentats et qui est loin d’être sécurisé en totalité.
À Damas, la vie est toujours aussi intense avec un trafic automobile encore plus important que par le passé. L’afflux de population réfugiée est une explication à ce surcroît de trafic. La vie est normale, les gens travaillent, consomment, rient, fréquentent les cafés. Partout, nous retrouverons cette hospitalité caractéristique du peuple syrien.
C’est avec bonheur que nous avons retrouvé les merveilles architecturales damascènes : la mosquée des Omeyyades, le palais Azem, mais également le tombeau de Saladin, le souk, le Musée National[2], lequel est à nouveau ouvert depuis l’automne 2018. Sa fermeture et la protection des trésors du Musée a permis leur sauvegarde à l’inverse des pillages qui se sont produits en Irak. Là aussi, preuve est faite que l’État est debout et bien présent, ce qui est à mettre au crédit du gouvernement syrien et de son président. Est-il besoin de préciser qu’avant la guerre, la situation économique de la Syrie était saine, le pays était autosuffisant, n’ayant pas de dette extérieure. Le taux d’analphabétisme était de 1 % et la Syrie était le troisième pays le plus visité des pays arabes. Pendant la guerre, les fonctionnaires ont toujours été payés y compris ceux qui se trouvaient dans des zones contrôlées par les terroristes. Tel est ce pays que la Coalition internationale, les USA et ses larbins ont attaqué via leurs supplétifs et terroristes de tous poils formés, financés, armés par l’Occident, le Qatar et l’Arabie Saoudite.
Les media occidentaux se plaisent à présenter la Syrie de façon schématique : la minorité alaouite, celle à laquelle appartient le président Al-Assad, dirige le pays et occupe tous les leviers. En réalité cette présentation est inexacte et partiale. La Syrie est d’abord et avant tout un État et non une addition d’ethnies et/ou de religions. On est citoyen syrien avant d’être de telle ethnie ou de telle religion. La Syrie est un pays laïc, authentiquement laïc, respectueux des religions et des minorités. On peut se balader partout en Syrie, à Damas ou dans toute autre grande ville, dans les coins les plus reculés, il y règne la même harmonie, la même tolérance, peu importe qu’on soit alaouite, sunnite, chrétien,… aucune tension n’est perceptible, ce que nous a confirmé le Père Elias Zahlaoui[3], de l’Église ND de Damas, que nous avons rencontré et qui, anecdotes à l’appui, nous a fait part de la qualité des relations entre musulmans et chrétiens.

En quittant Damas, nous avons laissé les embouteillages pour rejoindre l’autoroute Damas-Alep. Peu après Damas, nous avons pu voir ce qu’il reste de Duma (à l’Est de l’autoroute). L’ampleur des destructions (il ne reste que des ruines) donne un aperçu de la violence des combats dans cette zone où cette partie d’autoroute était coupée. Nous poursuivons sur l’autoroute en direction de Homs puis bifurquons vers Tartous et ensuite vers Safita, charmante petite ville à majorité chrétienne. Nous n’y avons pas vu une femme voilée ! Nous sommes accueillis par des officiels à la Maison de la Culture à l’occasion d’un festival de traditions populaires : chants, musique traditionnelle, expo peinture, photos, tout en goûtant aux spécialités confectionnées par nos hôtes. Impossible de quitter Safita sans visiter le joyau historique, le donjon du Chastel-Blanc des Templiers. Au rez-de-chaussée de l’édifice la chapelle Saint-Michel est dédiée au culte grec orthodoxe. À l’étage la salle de garde et au niveau supérieur la terrasse de laquelle il était possible de communiquer avec le Krak des Chevaliers.
À proximité de Safita, nos hôtes nous font découvrir Hosn Souleiman, temple d’époque romaine (IIè siècle). Après cette longue visite commentée et la photo de groupe, nous quittons ce lieu chargé d’histoire pour rejoindre Masyaf. La traversée des villages est l’occasion de constater à quel point cette région a participé à la cause syrienne : la plupart des maisons affichent la photo d’un martyr. À Masyaf, à proximité d’Hama, dans une région qui n’est pas encore tout à fait sécurisée, nous visitons le château-forteresse appartenant à la secte des Assassins[4].
Après cette visite, nous reprenons la route pour Tartus où nous allons passer la soirée et la nuit. Là, le changement de décor est total. Tartus, ville industrielle et port, est typiquement une ville méditerranéenne : joyeuse, animée. Les bars et restaurants qui se succèdent face à la mer sont pleins.

Nous quittons le lendemain Tartus pour de longues heures de route qui vont nous mener à Alep tout en ne manquant pas de nous arrêter au Krak des chevaliers qui est resté en l’état à l’inverse du village voisin détruit en grande partie. À l’intérieur du Krak, nous rencontrons deux jeunes bénévoles de l’association Chrétiens d’Orient, une ONG très active sur le terrain en Syrie. L’autoroute entre Homs et Alep étant fermée, en raison des combats affectant la région d’Idlib, le trajet est allongé avec des routes parfois en très mauvais état. Arrivés à la nuit tombée à Alep, nous prenons possession de nos chambres dans un très bel hôtel qui a été fermé plusieurs années jusqu’à ce qu’Alep soit libérée. Nous nous faisons recommander un restaurant typique et celui qui nous y conduit a été volontaire dans la bataille d’Alep. Il s’en est sorti par miracle, la bouche défigurée une balle ayant traversé son visage de part en part. L’opération a duré neuf heures. Les volontaires ont été nombreux dans cette guerre contre le terrorisme. Nous avons rencontré un groupe d’hommes jeunes, environ 30 ans, qui étaient partis combattre sur le front alors qu’étant diplômés de l’enseignement supérieur, ils avaient tous de bonnes situations. Cela va à l’encontre de l’image complaisamment véhiculée en Occident du « dictateur » (sic) alors que la défense de l’État est une préoccupation essentielle de la population. L’attaque de l’extérieur a renforcé le patriotisme syrien.
Même si nous étions largement informés des destructions à Alep, la confrontation avec la réalité du terrain fit l’effet d’une douche froide. La visite, à pied, d’Alep, nous fit traverser des quartiers dévastés, des immeubles éventrés, inoccupés, des rues défoncées. Et cependant, au dire de notre accompagnatrice, les travaux vont bon train et les progrès en six mois sont patents : des voies ont été rendues à la circulation. Le pire fut sans doute de constater l’inexistence du souk, ce joyau inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et détruit par la folie meurtrière des djihadistes et vrais larbins de l’impérialisme américano-sioniste. En revanche, nous avons retrouvé la citadelle, intacte. La foule abondante, tant à l’extérieur, qu’à l’intérieur respirait la joie de vivre. Étonnant cette dictature où les gens sont heureux ! Il nous faut rendre hommage à ces valeureux combattants retranchés trois ans dans la citadelle et qui ont tenu deux mois en totale autonomie jusqu’à ce que les troupes gouvernementales réussissent à les approvisionner par un souterrain dont ils avaient connaissance. En trois ans de siège les terroristes n’ont jamais pu pénétrer dans la citadelle occupée par seulement 40 militaires (les djihadistes les pensaient beaucoup plus nombreux). Une seule fois ils ont réussi à arriver par une ouverture dans le sol et le militaire de faction n’a rien pu faire d’autre que de tirer pour donner l’alerte. Le soldat a été attrapé par les pieds et égorgé. Les terroristes, imprudents et un peu trop sûrs d’eux, ont fait leur réapparition, mais cette fois, grâce au soldat martyr, le comité d’accueil était là et s’est chargé de tous les liquider.
Nous ne pouvions pas quitter Alep sans rendre visite à l’hôtel Baron[5], cet hôtel où ont séjourné Agatha Christie, le roi Fayçal, Charles de Gaulle, Thomas Edward Lawrence[6]. La veuve du propriétaire nous fait visiter l’hôtel (ou ce qu’il en reste) : les salons et les chambres des illustres personnalités ayant fréquenté les lieux. Avis aux amateurs : l’hôtel est à vendre !

La vie reprend tout doucement à Alep mais quel contraste avec la vie trépidante et grouillante que nous avions connue dix ans plus tôt. La circulation est fluide. Il est vrai qu’Alep a perdu une grande partie de sa population même si on assiste au retour de certaines familles. La reconstruction sera longue d’autant plus que si Alep ville est libérée, ce n’est pas le cas de certains quartiers extérieurs où les combats continuent.
Le retour vers Damas se fait avec un car des lignes régulières, très confortable. Il doit partir à 9 heures, il partira une heure plus tard mais on apprend vite qu’en Orient, le temps n’a pas la même signification qu’en Occident ! Les pièces d’identité (de l’ensemble des voyageurs) sont contrôlées avant le départ, elles le seront à nouveau à deux reprises au cours du voyage. Le voyage Alep-Damas, d’une durée de près de sept heures, est ponctué d’arrêts à des « check-points » (une cinquantaine). À l’arrivée à proximité de Damas, le car, réquisitionné pour une autre mission, nous laisse dans une banlieue qui a subi les outrages de la guerre : bâtiments détruits partiellement ou totalement. Le chauffeur de taxi qui nous emmène insiste auprès de notre accompagnatrice : « Tu leur as dit que c’était Israël et l’Amérique… », nous lui faisons répondre que nous le savons et que nous sommes solidaires du peuple syrien dans sa lutte contre l’impérialisme américano-sioniste.
La vie est difficile dans le pays en raison des sanctions économiques qui frappent la Syrie. Les coupures d’électricité sont nombreuses. Le rationnement du carburant concerne l’ensemble du pays. À Alep, nous avons vu des files de voitures de plusieurs centaines de mètres en attente aux stations essence. Pour les professionnels, c’est un drame car c’est l’outil de travail qui est touché. Damas subit également avec un décalage la pénurie de carburant et il est à craindre que des denrées de première nécessité soient, elles aussi, concernées par des ruptures d’approvisionnement dans un proche avenir. Cependant, nos interlocuteurs restent confiants : le peuple syrien est fier, courageux et résistant. Il a connu d’autres épreuves. Il est apte à surmonter celles-ci.
Tentons maintenant de dresser un parallèle entre les situations de nos deux pays : France et Syrie. On peut dire que, nous plaçant du point de vue des peuples, nous subissons un même ENNEMI. Certes, il est plus visible en Syrie parce que c’est toute une coalition qui s’acharne contre un pays, mais en réalité, à bien y regarder, notre Ennemi en France, et plus généralement en Europe, est le même, c’est l’oligarchie mondialiste qui, depuis Washington, Tel Aviv, Bruxelles détruit les États-nations pour organiser un marché mondial sans frontières dirigé par la finance internationale. La classe dirigeante a disparu au profit de marionnettes aux ordres d’une caste ploutocratique. Les insipides Macron-Merkel-Juncker et consorts sont programmés pour appliquer la politique voulue et dictée par leurs sponsors. On assiste en conséquence depuis des décennies à la même dégradation à tous les niveaux : politique, économique, social, sociétal, environnemental. Parallèlement, au nom de la Démocratie, de la Liberté et des Droits de l’Homme, la liberté d’expression, de plus en plus menacée, se réduit comme peau de chagrin. Dans cette société post orwellienne, le totalitarisme n’est plus une fiction, il est présent et bien présent. Les gens se croient LIBRES. La propagande (pardon l’information) leur fait avaler que Bashar al-Assad est un « boucher sanguinaire », il « doit partir, c’est un assassin », voire « il ne mériterait pas d’être sur la Terre » (dixit Laurent Fabius !). D’une certaine manière, la guerre a au moins le mérite d’ouvrir les yeux aux Syriens qui ne peuvent pas ne pas voir quel est leur Ennemi là où la Propagande[7], les media, la consommation de masse, la paresse intellectuelle ont anesthésié les peuples européens.
Plus que jamais la solidarité s’impose entre nos deux pays.
Yannick Sauveur
Notes:
[2] Je ne détaille pas nos visites de musées, monuments, citadelles. Tout cela se retrouve abondamment décrit dans les guides dont celui dans la collection Guides Bleus consacré à la Syrie.
[3] Né à Damas en 1932, ordonné prêtre en 1959, le Père Elias Zahlaoui a été remercié et honoré par la Première Dame de Syrie, Asma Al-Assad, au nom de tous les Syriens. Il a écrit plusieurs lettres ouvertes à François Hollande et Laurent Fabius. On écoutera cet entretien (2014) qui reste très actuel, https://www.egaliteetreconciliation.fr/Entretien-exclusif...
[4] Ainsi appelés car accusés d’agir sous l’effet du haschisch, d’où le nom de hashishin qui, par déformation, a donné en français le mot « assassin ».
[5] https://www.nouvelobs.com/topnews/20190405.AFP4171/a-alep...
[6] Cf. Jacques Benoist-Méchin, Lawrence d’Arabie, Paris, 1961.
[7] http://www.france-irak-actualite.com/2019/04/a-quoi-joue-...
17:45 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : syrie, levant, proche-orient, politique internationale, actualité, monde arabe, monde arabo-musulman, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 avril 2019
Colloque de « Synthèse Nationale » - Intervention de Robert Steuckers

Nieppe, 28 avril 2019 – Colloque de « Synthèse Nationale »
Intervention de Robert Steuckers
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et camarades,
Aujourd’hui, nous avons les élections législatives espagnoles ; dans moins d’un mois, les élections européennes. Très récemment, nous avons eu les législatives finlandaises qui ont fait du parti des Finlandais la deuxième formation du pays, qui talonne les sociaux-démocrates, généralement vainqueurs dans le grand Nord et cette fois avec un écart de seulement 0,2% des voix (17,5% contre 17,7%). En septembre, les sondages donnent l’AfD victorieuse en Saxe où s’effondrent le parti de Merkel et les sociaux-démocrates. Le vent semble tourner en Europe et les chances de Vox en Espagne sont réelles aujourd’hui, où l’on vote pour des législatives anticipées. Nous verrons ce soir ce que ce scrutin donnera et s’il y aura, ou non, dans les prochaines semaines, un gouvernement PP/Vox/Ciudadanos. Mais ces diverses élections, à quoi pourraient-elles bien servir ? Quels projets nouveaux et nécessaires devraient-elles promouvoir pour autant que les élections apportent réellement du nouveau ? La nécessité, urgente aujourd’hui, est l’émancipation de l’Europe qui doit échapper, coûte que coûte si elle veut simplement survivre, à l’étau qui l’enserre, à l’étau qui est formé par la politique du Deep State américain et par les initiatives, en théorie privée, des multiples associations et ONG patronnées par George Soros. Les élections italiennes, qui ont porté au pouvoir et le populisme de droite de la Lega de Salvini et le populisme de gauche du « Mouvement Cinq Etoiles » de diMaio, semble être de bon augure et les meilleures nouvelles, en ces temps moroses où les gilets jaunes peinent à obtenir gain de cause, viennent assurément d’Italie.
Dans quel contexte, plus précisément, ces espoirs de changement rapide se déploient-ils ? Le principal de ces contextes a été, sans aucun doute, la 63ème Conférence sur la Sécurité de Munich, tenue en février dernier dans la capitale bavaroise. Lors de cette conférence, où, généralement, les participants ânonnent benoîtement les mots d’ordre de l’OTAN, les dissonances entre les deux rives de l’Atlantique se sont fait bruyamment entendre sur des points essentiels comme le gazoduc Nord Stream 2 et les relations euro-iraniennes. Auparavant, l’alignement inconditionnel des instances européennes sur les positions de l’OTAN (donc des Etats-Unis) faisait dire au ministre russe Sergueï Lavrov que l’UE ne détenait pas le monopole de la décision dans le modelage de ses propres affaires régionales et avait raté toutes les occasions de construire réellement la « maison commune européenne ». Pour le journaliste italien Lorenzo Lamperti, qui écrit pour Affari italiani (www.affaritaliani.it ), l’Europe semble avoir pris la voie de l’émancipation en n’acceptant pas la politique violemment anti-iranienne de Washington et en créant, pour la contourner et la vider de tout contenu articulable, l’instance baptisée « Instex », véhicule financier destiné à commercer avec Téhéran selon les bonnes vieilles règles du troc, sans passer par une monnaie d’échange donc sans passer par le dollar. La volonté américaine de faire jouer le « droit » et la « justice » pour punir tous ceux qui contourneraient les embargos qu’ils imposent, surtout dans la question iranienne, a attiré les critiques de Lavrov, véritable vedette à Munich, contrairement aux émissaires de Trump (Pompeo, Pence et Bolton, trois « faucons », nouvelles moutures du néo-conservatisme belliciste). Federica Mogherini a clairement affirmé que l’Europe n’entendait pas se faire dicter une conduite dans l’affaire iranienne ni s’aligner, ipso facto, sur les politiques bellicistes, dictées par les Etats-Unis, d’Israël et surtout de l’Arabie Saoudite, à laquelle les Américains s’apprêteraient à vendre des technologies nucléaires pour que l’épicentre du wahhabisme se dote de l’arme atomique pour affronter l’Iran (à la place d’Israël, qui conserverait son arsenal intact et échapperait à d’éventuelles représailles perses ?). C’est, on le voit, dans le cadre de l’UE, le retour, encore bien timide, de la géographie, donc de la géopolitique et de la géo-économie. A Munich, l’Administration Trump avait exigé que les Européens reprennent les quelque 800 prisonniers de l’Etat islamique faits en Syrie par l’US Army et qu’en cas de refus, ceux-ci seraient libérés : les Allemands ont sèchement répondu que c’était impossible.
 Dans le dossier très complexe et très épineux de la 5G développée par la firme chinoise Huawei, les Européens, surtout les Allemands, se montrent très réticents à annuler les projets qui sont déjà en phase de réalisation. Pour les Etats-Unis, ne pas se laisser distancer par les Chinois dans la technologie de la 5G est un impératif de sécurité nationale, d’où les multiples interdits qui frappent la firme Huawei et la mesure qui a permis l’arrestation d’une des cadres de la firme au Canada récemment. La raison majeure de cette panique à Washington vient du fait que la 5G chinoise ne possède pas la « porte d’entrée » (le « backdoor ») permettant à la NSA de s’y introduire, comme dans les appareils Samsung. Les appareils chinois et même certains modèles d’Apple permettent en revanche aux services chinois d’y accéder : l’Europe, qui n’a jamais misé sur ces technologies, se trouve dès lors coincée entre les Etats-Unis et la Chine et soumise à leurs réseaux d’espionnage, sans possibilité de répondre à ce défi et d’en contrer les inconvénients.
Dans le dossier très complexe et très épineux de la 5G développée par la firme chinoise Huawei, les Européens, surtout les Allemands, se montrent très réticents à annuler les projets qui sont déjà en phase de réalisation. Pour les Etats-Unis, ne pas se laisser distancer par les Chinois dans la technologie de la 5G est un impératif de sécurité nationale, d’où les multiples interdits qui frappent la firme Huawei et la mesure qui a permis l’arrestation d’une des cadres de la firme au Canada récemment. La raison majeure de cette panique à Washington vient du fait que la 5G chinoise ne possède pas la « porte d’entrée » (le « backdoor ») permettant à la NSA de s’y introduire, comme dans les appareils Samsung. Les appareils chinois et même certains modèles d’Apple permettent en revanche aux services chinois d’y accéder : l’Europe, qui n’a jamais misé sur ces technologies, se trouve dès lors coincée entre les Etats-Unis et la Chine et soumise à leurs réseaux d’espionnage, sans possibilité de répondre à ce défi et d’en contrer les inconvénients.
Les menaces de Trump, d’imposer des droits de douane aux automobiles européennes, ne sont pas passées à Munich en février et l’UE s’apprête à prendre des contre-mesures. Trump, en adoptant une intransigeance qu’il n’avait pas promis, bien au contraire, pour se faire élire, a sabordé l’unanimité qui faisait la force, jusqu’ici, de l’alliance transatlantique, contraire aux intérêts européens. L’Allemagne lorgne désormais vers la Chine et vers le Japon : les ministres des affaires étrangères allemand et chinois insistent sur le droit national des Etats européens et asiatiques à pratiquer le multilatéralisme en commerce international. Quant à l’Italie, elle s’est branchée sur les « routes de la Soie » et a accepté que le port adriatique de Trieste, aujourd’hui encore souvenir des splendeurs de la monarchie austro-hongroises, redevienne un port de la plus haute importance en Méditerranée certes mais branché aussi et surtout sur l’Europe centrale bavaroise, autrichienne et hongroise comme avant son annexion à l’Italie. Trieste est relié à Stettin sur la Baltique par un chemin de fer rapide, lien indispensable dans l’isthme du centre de l’Europe, ce qui apportera encore davantage de cohérence géopolitique à l’ensemble européen. A terme, Gènes s’y branchera aussi, entraînant la Suisse qui est son hinterland naturel ainsi que la Provence, le Languedoc et la Catalogne. La société danoise Maersk, spécialisée dans le transport par conteneurs vers la Chine est d’ores et déjà présente sur la côte ligure, prête à lancer une synergie balto-méditerranéenne, avec les ports d’Anvers, Rotterdam et Hambourg, le trio portuaire nord-européen au passé hanséatique.
Pour l’observateur irlandais Finian Cunningham, les tentatives de Macron, absent à Munich, de bidouiller un montage institutionnel au sein de l’UE, pour freiner l’utilisation du gazoduc Nord Stream 2, constitue un piètre expédient atlantiste que l’Allemagne, les pays du Benelux, la Grèce et Chypre n’ont pas accepté, faute de devoir payer l’énergie trop chère, tant pour les industries que pour les ménages. Cette tentative maladroite et déraisonnable de torpiller l’approvisionnement énergétique de l’Europe du Nord comme du Sud met en exergue les contradictions de la politique européenne de Macron : d’une part, il se veut le champion du « couple franco-allemand » mais, d’autre part, empêche son partenaire soi-disant privilégié de s’approvisionner en énergie comme il l’entend, rendant automatiquement caduques toutes les belles déclamations du nouveau traité d’Aix-la-Chapelle qu’il a signé naguère avec Merkel sous les huées de gilets jaunes allemands, français et wallons. Ensuite, Macron a promis d’être le champion des « causes vertes » et de pratiquer des politiques écologiques, où le gaz, moins polluant, devrait toujours être préféré au nucléaire, au pétrole et au charbon. Une contradiction de plus et non des moindres. Enfin, alors qu’il devrait se montrer soucieux de tarir le mécontentement des gilets jaunes qui déstabilisent la France, il agit pour que l’énergie soit plus chère, car éventuellement dérivée du gaz de schiste américain, quand le peuple français se rebelle justement contre la hausse du prix de l’essence. Plus sévère encore à l’endroit de la politique anti-gazière de Macron est la géopolitologue française Caroline Galacteros : « Nous agissons comme si (…) nous n’avions nul besoin de nous mettre en ordre de bataille (entre Européens) pour projeter notre puissance de frappe commerciale collective vers le reste de la planète, afin de ne pas nous faire dévorer tout crus par Pékin et Washington. Bref on a tout faux… mais on fonce dans le mur avec l’assurance d’un taureau au front court se précipitant sur une muleta rouge pour finir lardé de banderilles meurtrières ». Fin de citation. L’UE, ajoute-t-elle, « paralysée par ses propres réglementations anachroniques, …, consent à son effacement de la carte des grands ensembles ». Pour Caroline Galacteros, Macron a agi par peur des pressions américaines, pour saisir une chance de plaire au « maître ».
Cette attitude ouvre bien entendu le dossier, crucial et inquiétant, du « parti américain » au sein des institutions eurocratiques qui, le 12 mars dernier, a encore voté une résolution antirusse présentée par une parlementaire lettone, Sandra Kalniete, dénonçant les présidentielles russes comme « non-démocratiques » : elle a obtenu 402 voix pour, 163 voix contre et 89 abstentions. Dans la plupart des cas, le parlement européen répète, à la lettre près, les accusations formulées par des ONG américaines. De même, quand l’Italie a formulé, pour la première fois, le désir de participer aux synergies de la « route de la soie », la Commission de Juncker lui a fait savoir que la Chine « est un rival qui promeut des modèles alternatifs de gouvernance » ( !), alors que, justement, tous ont besoin de gouvernance nouvelle ou rénovée, tant le « malgoverno » s’est généralisé en Europe depuis près d’un demi-siècle ! Manlio Dinucci, observateur des fluctuations géopolitiques dans le monde, dénonce dès lors « l’influence qu’exerce le ‘parti américain’, puissant camp transversal qui oriente les politiques de l’UE le long des lignes stratégiques USA/OTAN », avec le risque, s’empresse-t-il d’ajouter, « d’accepter très bientôt les missiles balistiques avec base à terre, soit de nouveaux euromissiles qui feront, une fois encore, de l’Europe la base et, en même temps, la cible d’une guerre nucléaire ». Nous revoilà revenu à l’année 1982 quand les Etats-Unis, en pleine guerre froide, voulaient déployer leurs missiles Pershing en Allemagne pour préparer l’Armageddon annoncé par Reagan, premier président américain à avoir réintroduit le discours biblique et apocalyptique dans l’exposition des buts de la politique internationale de Washington et à avoir abandonné le « réalisme » cher à Kissinger.
C’est ce « parti américain » que les formations politiques nouvelles, populistes de droite ou de gauche, devront empêcher de nuire dans l’avenir pour que les générations qui nous suivront puissent simplement survivre dans un monde de plus en plus multipolaire et de moins en moins européen. On parle d’une internationale des populistes en gestation, sans nécessairement s’entendre sur une définition précise de ce qui est populiste et ne l’est pas. On sait depuis le début du 20ème siècle que les partis se sclérosent, « s’oligarchisent », « se bonzifient », pour reprendre la terminologie polémique d’un observateur que l’on n’a cessé de citer depuis : Roberto Michels. La sclérose a indubitablement frappé les trois principales formations qui structurent le fonctionnement du parlement européen : les chrétiens-démocrates du PPE, les sociaux-démocrates et les libéraux. Ces trois ensembles ont répété à satiété la politique voulue et imposée par Washington, conduisant l’Europe dans l’impasse où elle se trouve aujourd’hui. Toute formation réellement politique se doit de dégager notre continent de cette cangue et de permettre son désenclavement géopolitique. C’est donc en politique étrangère, comme on l’a vu à Munich en février dernier, que ce dégagement et ce désenclavement devront s’opérer en premier lieu.
Les chrétiens-démocrates de Merkel, et leurs partenaires socialistes et libéraux, ont toujours joué la carte atlantiste or cette option est désormais grosse de dangers réels pour notre avenir, ceux qui nous précipiteront à coup sûr, s’ils ne sont pas conjurés dans les plus brefs délais, dans une irrémédiable récession. L’idéologie que véhiculent ces forces politiques du passé est une idéologie du sur place, de la répétition ad nauseam du même et encore du même dans un monde qui change à une vitesse désormais vertigineuse (celle de la 5G !). Cette idéologie de l’indécision et du débat stérile, théorisée par Jürgen Habermas, pratiquée par Verhofstadt et vulgarisée par Cohn-Bendit doit être balayée de nos horizons. Mais tous les populistes qui ont émergé dans les contextes nationaux des pays d’Europe, d’Ibérie aux rives de la Baltique, ont-ils conscience de ce double enjeu ? Ont-ils tous la volonté de sortir de la cangue de l’atlantisme ? Ont-ils tous viré leur cuti néolibérale ? Car, ne l’oublions pas, la science politique qualifie de « populiste » tout mouvement qui n’est pas strictement chrétien-démocrate, socialiste ou libéral, à la rigueur écologiste, et qui sera, dès lors, disqualifié par les médias dominants qui lui colleront l’étiquette de « populiste ». Or Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce voire Mélanchon en France sont aussi étiquetés « populistes », tout en bénéficiant d’une certaine mansuétude de la part des médiacrates et des intellocrates parce qu’ils sont des « populistes de gauche », non hostiles à la vague migratoire donc peu susceptibles de gagner des voix en suffisance et de défier effectivement les trois pôles politiques majeurs en place dans les institutions eurocratiques. Seule Sarah Wagenknecht avait des chances dans une fraction des gauches allemandes de parfaire une politique populiste de gauche efficace mais elle a démissionné et a quitté la scène politique. Macron, en se dégageant du parti socialiste de Hollande et en n’empruntant pas la voie du sarkozisme, est considéré, lui aussi, comme un « populiste », un « populiste néolibéral », un peu comme Bolsanaro au Brésil mais en moins vigoureux, en moins machiste.
L’Internationale populiste, crainte par les Merkel et les Macron de tous poils et acabits, verra le jour, c’est certain, car il est très probable que onze ou douze nationalités participeront à un groupe politique unique au parlement européen à la fin du mois de mai 2019. Mais cette nouvelle Internationale des nationaux sera-t-elle homogène sur le plan de la politique internationale et sur le plan d’une géopolitique européenne enfin ressuscitée ? Là est la question, l’épineuse, la lancinante question qu’il faut se poser aujourd’hui, à la vieille du grand scrutin. Agira-t-elle dans le sens des paroles fermes de Federica Mogherini à Munich en février, lors de la 63ème Conférence sur la Sécurité en Europe ? L’Internationale populiste, si elle est appelée à s’ancrer, à partir de mai 2019, dans le quotidien du parlement européen et à constituer un bloc antisystème au sein du système, doit être intransigeante sur la politique énergétique européenne, qui doit demeurer totalement indépendante de toute ingérence extra-européenne, doit être inflexible sur la politique iranienne de l’UE, sur la politique russe de l’UE, sur les relations que l’Europe souhaitera entretenir avec la Chine.
Tel est le programme, la ligne directrice incontournable qu’il s’agira de suivre. C’est ce désenclavement politique, géopolitique et idéologique auquel il faudra œuvrer sinon ce qui nous attend au tournant, et très vite, c’est la mort, lente ou rapide, dans la récession économique, dans l’implosion sociale et la submersion démographique.
Je vous remercie.
Bibliographie :
- Jean-Paul BAQUIAST, « L’Union européenne va-t-elle s’effondrer ? », http://europesolidaire.eu (14 février 2019).
- Christopher Th. COONEN, « Réseaux 5G : encore une révolution qui échappe à l’Europe ?... », http://metapoinfos.hautetfort.com , repris sur http://euro-synergies.hautetfort.com (11 mars 2019).
- Finian CUNNINGHAM, « L’Allemagne remet Macron au pas », https://echelledejacob.blogspot.com , repris sur http://euro-synergies.hautetfort.com (28 février 2019).
- Mario DINUCCI, « Le ‘parti américain’ dans les institutions UE », https://www.mondialisation.ca (19 mars 2019).
- Tyler DURDEN, « L’Italia, la Via della Seta, la Cina, la UE e gli USA », https://www.ariannaeditrice.it (13 mars 2019).
- Pierluigi FAGAN, « Scommesse sul futuro : G7 o 5G ? », https://www.ariannaeditrice.it (24 mars 2019).
- Caroline GALACTEROS, « L’Europe, usine à gaz… », http://metapoinfos.hautetfort.com , repris sur http://euro-synergies.hautetfort.com (13 mars 2019).
- Lorenzo LAMPERTI, « Huawei, Siria, Iran, auto, Cina. Europa sempre più lontana dagli USA », https://www.ariannaeditrice.it (19 février 2019).
- Roberto PECCHIOLI, « L’Italia e la via della seta », http://ereticamente.net (28 mars 2019).
- Fulvio SCAGLIONE, « Grano : la prossima guerra tra Russie e Stati Uniti », https://www.ariannaeditrice.it (11 février 2019).
- Roberto VIVALDELLI, « Cosi Trump ha ucciso l’alleanza Transatlantica », https://www.ariannaeditrice.it (7 mars 2019).
Articles anonymes :
- « Wagenknecht tritt kürzer : Keine Kandidatur mehr für Linken-Fraktionsvorsitz », ex: https://de.sott.net (11 mars 2019).
- “US-Vizepräsident aus der Münchner SiKo: Washington läuft weiter Sturm gegen “Nord Stream 2””, http://www.zuerst.de (18 février 2019).
- “Une ‘Internationale populiste’?”, http://www.dedefensa.org , repris sur http://euro-synergies.hautetfort.com (12 octobre 2018).
- « Plus que jamais, l’Iran entre USA et Europe », https://echelledejacob.blogspot.com , repris sur http://euro-synergies.hautetfort.com (28 février 2019).
- « Lawrow auf der Münchner SiKo : Die EU leidet unter realem Bedeutungsverlust », http://zuerst.de (18 février 2019).
- “Ischinger auf der 63. Sicherheitskonferenz: Völkerrecht aushöhlen – mehr Interventionsmöglichkeiten schaffen”, http://zuerst.de (16 février 2019).
19:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, union européenne, politique internationale, robert steuckers, synthèse nationale, synergies européennes, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 29 avril 2019
Fin des Unions d’États (UE, OTAN) et triomphe des acteurs non-étatiques

Fin des Unions d’États (UE, OTAN) et triomphe des acteurs non-étatiques
par Bernard WICHT
Bernard Wicht est privatdocent auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université́ de Lausanne où il enseigne la stratégie. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment Citoyen-soldat 2.0 (2017); Europe Mad Max demain ? Retour à la défense citoyenne (2013); Une nouvelle Guerre de Trente Ans: réflexion et hypothèse sur la crise actuelle (2012); L’OTAN attaque. La nouvelle donne stratégique (1999); L’idée de milice dans la pensée de Machiavel (1995). Ses réflexions sur la milice et le citoyen-soldat l’ont amené à des conclusions alarmantes au sujet de l’évolution policière des États couplée au désarmement progressif des citoyens.
Pourquoi le récit des années 1990 n’est plus adéquat
Il est frappant de constater combien la classe politique suisse dans sa grande majorité est encore prisonnière du discours des années 1990. Élaboré avec honnêteté et conviction dans le cadre des négociations sur l’Espace économique européen (EEE), ce discours insistait sur la nécessité économique pour la Suisse de ne pas s’isoler, de garder ouvert l’accès au Grand Marché européen et voyait dans la construction d’une Union européenne renforcée un facteur de stabilité en Europe suite à l’effondrement du bloc soviétique. En 1992 (date du vote suisse sur l’EEE), un tel récit avait toute sa pertinence. Aujourd’hui en 2019, c’est-à-dire plus d’un quart de siècle plus tard, il est totalement dépassé. Pourtant, une grande partie de la classe politique suisse continue de le servir à chaque occasion aux citoyennes et citoyens du pays. C’est notamment le cas en ce moment dans le cadre du référendum contre la directive européenne sur les armes et sa mise en œuvre en droit suisse.
Or, comme on va essayer de le comprendre ci-après, de nos jours l’enjeu stratégique a complètement changé : il ne s’agit plus de ne pas s’isoler, mais bel et bien de se protéger. Essayons de comprendre comment et pourquoi un tel renversement est intervenu.
Les événements ne sont que poussière et ils ne prennent sens que lorsqu’on les replace dans les cycles et les rythmes de la longue durée (Braudel, Wallerstein). En conséquence, il faut se demander si l’on peut expliquer les pannes de l’UE — Brexit, démarche en solitaire de l’Allemagne et de la France avec le traité d’Aix-la-Chapelle, résistances italiennes, défiance de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque — et celles de l’OTAN — dont l’un des membres, la Turquie, combat les alliés kurdes des États-Unis en Syrie tout en se rapprochant la Russie alors que, dans le même temps, l’Alliance organise des manœuvres militaires en vue de contrer une éventuelle invasion russe en direction de la Pologne et des Pays Baltes —, par un changement de cycle macro-historique qui verrait la remise en cause fondamentale de la pertinence du mode d’organisation stato-national.
Hypothèse iconoclaste sans aucun doute, mais qu’il importe d’examiner dans le contexte actuel si on veut tenter d’appréhender les enjeux stratégiques majeurs plutôt que de céder à la facilité consistant à répéter un discours « clef en main » datant de la fin du siècle passé.
En effet, dans son histoire du temps long, Fernand Braudel souligne que les institutions sont comme les êtres humains : elles naissent, vivent et meurent. Mais ajoute-t-il, leur cycle de vie est beaucoup plus long que les biographies humaines – le temps des institutions est beaucoup plus lent que celui des hommes. C’est pourquoi ce temps échappe généralement à l’observation et, compte tenu de sa « lenteur », nous avons tendance à penser que les institutions avec lesquelles nous vivons (État, Églises, armée) sont éternelles.
Aujourd’hui pourtant, ne sommes-nous pas confrontés à la mort progressive d’un système étatique qui a vu le jour grosso modo à la fin de la Guerre de Trente Ans (1648) et qui, avec certaines modifications, s’est maintenu bon an mal an jusqu’au début du XXIe siècle? L’ordre westphalien (du nom de la Paix de Westphalie qui a mis fin à la guerre précitée) était composé d’États souverains en compétition et en lutte les uns contre les autres, ceci conduisant Clausewitz à énoncer que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens. À partir de 1945, cet ordre inter-national devient peu à peu supra-national avec la création des grandes organisations onusiennes et, en Europe, avec la construction communautaire (CECA, puis CEE, puis CE et enfin UE). L’objectif explicite de la mise en place de cet étage au-dessus des États, est le « plus jamais ça » en référence au drame en trois actes de la première moitié du XXe siècle – Verdun, Auschwitz, Hiroshima. La cohésion de cet ensemble est garantie par le leadership politique, militaire et monétaire (accords de Bretton Woods) des États-Unis.
Toutefois, à partir des années 1990, la globalisation du capitalisme fragilise gravement cette ambitieuse construction. Avec la libéralisation des flux financiers, elle dépouille progressivement les États de leurs compétences économiques. Au nom des dividendes des actionnaires, elle désindustrialise l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord (thatchérisme, reaganisme, néolibéralisme). Combinée à la révolution de l’information, elle annule la souveraineté des États permettant à des organisations non-étatiques, transnationales, beaucoup plus fluides de se développer.
Là aussi, l’explication braudélienne continue d’être éclairante en distinguant, voire en opposant capitalisme et économie de marché : le capitalisme n’est pas l’économie de marché. S’il se construit à partir de celle-ci, sa logique s’en détache complètement parce qu’il n’est ni basé sur les échanges, ni ouvert à tous. Le capitalisme est opaque, limité à un petit cercle d’initiés, il vise l’accumulation et la spéculation financières. Aujourd’hui, cette dynamique capitaliste a atteint sa masse critique. Elle a pris une telle envergure qu’elle assèche l’économie formelle et provoque, en contrepoint, l’explosion de l’économie grise et informelle. La situation est devenue complètement incontrôlable par les institutions en place (États, organisations internationales).
Le paradigme guerre
Dans ce contexte, c’est sans doute le paradigme guerre qui est l’élément le plus significatif pour saisir les évolutions en cours. C’est celui qui s’est transformé de la manière la plus radicale… et la plus visible. Groupes armés, narco-guérillas, narco-terroristes, islamistes-djihadistes, gangs militarisés ont su profiter de cette « dérégulation » avec le succès que l’on sait. Et face aux formes de guerres qu’ils pratiquent, tant l’ONU, l’UE que l’OTAN sont devenus largement inefficaces.
Or, Charles Tilly enseigne que la guerre fait l’État. Il faut déduire de cette formule que, si la guerre se transforme, l’État en subit alors automatiquement le contrecoup en vertu du principe la fonction crée l’organe : lorsque la première disparaît ou change profondément de nature, le second s’atrophie ou mute de manière fondamentale.
Ouvrons une parenthèse pour dire que la prise de conscience d’une telle réalité n’a pas encore eu lieu. Certes, le « tremblement de terre » est bien perçu, il fait peur, mais il n’est ni compris, ni expliqué. Face à leur sentiment d’impuissance, les États et les organisations susmentionnées sont entrés dans l’ère de l’incantation droit-de-l’hommiste et, pire encore, de la désignation de coupables «immédiats»: les terroristes et, surtout, les populistes. Ces derniers – de Trump aux gilets jaunes – pointent du doigt (parfois maladroitement) la profonde inadéquation du système actuel avec les besoins des citoyennes et citoyens. Ils sont alors irrémédiablement qualifiés d’extrémistes faisant le lit d’un fascisme-nazisme qui serait en plein retour. C’est la reductio ad hitlerum dont les médias mainstream se font volontiers l’écho et qui a pour effet d’évacuer tout effort d’analyse au profit d’une commode extrapolation du passé récent de l’entre-deux-guerres. Peu ou pas de volonté de comprendre ce qui se passe – la reductio ad hitlerum est intellectuellement confortable !
Revenons à la transformation de la guerre et à ses effets. Que peut-on en dire du point de vue du temps long historique ?
1) Si l’État et ses avatars que sont les Unions d’États (UE, OTAN) ne sont plus les formes d’organisation les mieux adaptés pour faire la guerre, alors on peut supposer que nous sommes à la fin d’un cycle historique de près de 400 ans (de 1648 à nos jours). La guerre étant, avec l’économie, le principal moteur des transformations historiques, les formes des communautés politiques découlent de ces deux paramètres et de leur aptitude à combiner efficacement les moyens de faire la guerre et les ressources pour entretenir ces moyens. C’est le couple contrainte (moyens)/capital (ressources) mis en œuvre par Tilly pour expliquer le processus de formation et de dé-formation des unités politiques. D’où sa fameuse phrase :
« Les empires, les royaumes, les cités-États, les fédérations de cités, les réseaux de seigneurs terriens, les Églises, les ordres religieux, les ligues de pirates, les bandes de guerriers et bien d’autres formes d’organisation de pouvoir prévalurent en Europe à différentes époques durant le dernier millénaire. La plupart de ces organisations méritent le titre d’État d’une manière ou d’une autre, parce qu’elles contrôlèrent les principaux moyens concentrés de contrainte dans le cadre de territoires délimités et exercèrent leur droit de priorité sur toutes les autres organisations qui agissaient sur leur territoire. »
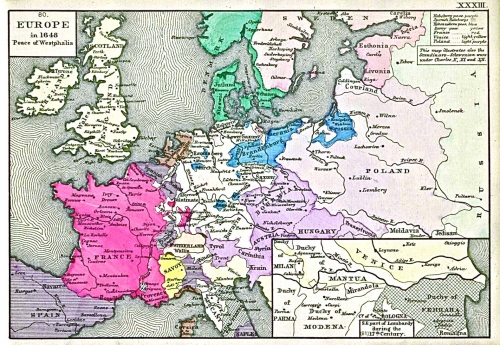
2) Entre 1648 et 1945, l’État-nation a représenté cette meilleure synthèse pour faire la guerre: ceci explique la diffusion quasi universelle de ce modèle d’organisation étatique jusqu’à le considérer, à partir de la Révolution française, comme l’aboutissement ultime et le plus accompli de toutes les constructions politiques (Hegel et l’Esprit du monde). Or, avec la transformation de la guerre et la globalisation financière, le paradigme étatique moderne est remis en cause dans ses fondements parce qu’il n’est plus la synthèse la mieux adaptée pour faire la guerre et que, du point de vue économique, il est « prisonnier des recettes qui ont fait son succès » (G. Arrighi), c’est-à-dire l’État-providence. La fin du cycle hégémonique américain vient encore faciliter la transition vers d’autres formes d’organisation militaro-politique. Car, le déclin rapide de la superpuissance états-unienne et l’absence de challenger apte à reprendre le leadership mondial (ni la Chine, ni la Russie n’en ont actuellement les qualités), créent une situation de « Grand Interrègne » et de désordre international: une sorte de chaos systémique profitant aux acteurs non-étatiques en guerre un peu partout dans le monde.
3) On l’a dit, la guerre s’est transformée radicalement. De nos jours, elle n’est plus inter-étatique, mais infra-étatique et conduite par des acteurs plus proches des gangs que des armées régulières. Les grandes guerres systémiques (Guerre de Trente Ans, Guerres napoléoniennes, Guerres mondiales) qui ont accouché des différents ordres hégémoniques mondiaux cèdent désormais la place à de longues séries de conflits de basse intensité démembrant les États et donnant l’avantage aux acteurs précités dont la structure non-bureaucratique, non-territoriale et transnationale permet toutes les flexibilités nécessaires. Cette structure est basée sur 1° des fidélités personnelles, 2° le contrôle de certaines franges de population à la fois par la contrainte et la prise en charge de leurs besoins de base (soins, alimentation, parfois scolarisation idéologiquement orientée), 3° le financement via l’économie grise et informelle.
Ce phénomène a débuté (Acte I) avec la Guerre civile libanaise (1975 – 1990) qui a servi de laboratoire, a pu ensuite se diffuser en raison de l’effondrement du bloc soviétique (1989 – 1991), puis a atteint sa vitesse de croisière (Acte II) avec le lancement de la War on Terror par Washington, à partir des attentats du 11 septembre 2001 (Afghanistan, Irak, Libye, Syrie). Depuis, le phénomène ne cesse de s’étendre, notamment à l’Afrique subsaharienne et jusqu’au Nigéria avec Boko Haram, sans oublier la Corne de l’Afrique (Acte III). Aujourd’hui, si les actes I à III ont pratiquement abouti au démembrement des États de toute cette région, l’Acte IV a démarré en Europe occidentale, au plus tard avec les attentats terroristes de 2015. Cette nouvelle phase d’expansion ne peut que s’amplifier compte tenu de l’inadaptation de plus en plus manifeste des États à ce type de menace et de guerres. Comme dans tout conflit de longue durée, c’est la découverte de l’antidote militaro-économico-institutionnel qui permettra d’y mettre fin.
Ce dernier élément, en lien avec l’approche de Tilly, est un des principaux enseignements à retenir de l’histoire de la longue durée : il en ressort que la résilience des formes d’organisation politique ne dépend ni des décisions de la classe politique au pouvoir, ni de la signature de traités internationaux, ni de la mobilisation (des jeunes et des moins jeunes) en faveur de certains sujets de société « dans l’air du temps » (par exemple, en ce moment, le réchauffement climatique). Non ! Le processus n’est ni éthique, ni moral, encore moins « tendance »; il est d’essence darwinienne – adaptation et survie. Dans le contexte actuel marqué par l’état d’esprit « Chacun d’entre nous est un petit flocon unique et merveilleux », il est évident que de telles considérations, pourtant tirées de l’outillage de la longue durée, risquent fort d’être qualifiées de cryptofascistes… et pourtant… (eppur…, comme disait Galilée devant le tribunal de la Sainte Inquisition).
Un désarmement opportun
Dès lors, et pour continuer avec Galilée sur la piste de l’hérésie, à l’heure actuelle les communautés politiques susceptibles de survivre au chaos mondial, susceptibles de se protéger elles et leurs enfants, ne sont pas celles correspondant au modèle dominant calé sur « plus d’Europe et moins de nations », sur « plus de sécurité et moins de liberté ». Au contraire, ce sont celles que la grande presse tend généralement à diaboliser, celles qui se rebellent, celles qui ont encore une identité (aujourd’hui qualifiées de populistes), celles qui souhaitent maintenir leurs frontières (aujourd’hui qualifiées de nationalistes) et celles qui ont encore envie de se battre (aujourd’hui qualifiées de dangereuses). En d’autres termes, toutes celles qui n’ont pas envie de se dissoudre dans le politiquement correct au nom du libre-échange… et de cet autre argument plus récent sur la protection des espèces menacées par l’Homme, c’est-à-dire au nom de slogans curieusement apparus avec la globalisation financière, les macrospéculations boursières et les subprimes… Il est vrai que le capitalisme goûte peu la contestation populaire, surtout lorsque le peuple est armé.
Vivant à l’ère du premier capitalisme, Machiavel l’avait bien compris lorsqu’il écrivait à ce propos : « Le riche désarmé est la récompense du soldat pauvre (L’art de la guerre).»
Tiens, l’UE veut désarmer les citoyens européens… Étrange coïncidence !
Bernard Wicht
• D’abord mis en ligne sur Antipresse, le 21 avril 2019.
11:55 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ordre westphalien, europe, affaires européennes, politique internationale, otan, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 avril 2019
Un objectif vital pour notre avenir construire un réseau pour le « NATO EXIT »

Un objectif vital pour notre avenir construire un réseau pour le « NATO EXIT »
Quel a été le résultat du Colloque international “Les 70 ans de l’OTAN : quel bilan historique ? Sortir du système de guerre, maintenant”, qui s’est tenu à Florence le 7 avril 2019. Manlio Dinucci en parle avec Michel Chossudovsky.
Note : au cours de cette année, l’OTAN effectue 310 exercices militaires, quasiment tous contre la Russie.
Avec l’OTAN du welfare au “warfare”
70 ans de l’OTAN. Interview de Michel Chossudovsky sur les 70 ans de l’OTAN : “ce n’est pas une Alliance, ce sont les USA qui commandent, ils veulent plus de dépense militaire dans toute l’Europe, ils sont prêts à de nouveaux conflits armés, y compris nucléaires”
Au colloque international “Les 70 ans de l’OTAN : quel bilan historique ? Sortir du système de guerre, maintenant”, qui s’est tenu à Florence le 7 avril 2019 -avec plus de 600 participants d’Italie et d’Europe-, a participé comme principal intervenant Michel Chossudovsky, directeur de Global Research, le centre de recherche sur la globalisation (Canada), organisateur du Colloque avec le Colitato No Guera No Nato et d’autres associations italiennes. Nous avons posé quelques questions à Michel Chossudovsky -un des plus grands experts internationaux d’économie et géopolitique-, collaborateur de l’Encyclopedia Britannica, auteur de 11 livres publiés en plus de 20 langues.
***
Quel a été le résultat du Colloque de Florence ?
L’événement a eu un très grand succès, avec la participation d’intervenants provenant des États-Unis, d’Europe et de Russie. L’histoire de l’OTAN y a été présentée. Y ont été identifiés et attentivement documentés les crimes contre l’humanité. À la fin du Colloque a été présentée la “Déclaration de Florence” pour sortir du système de la guerre.
Dans votre intervention introductive vous avez affirmé que l’Alliance atlantique n’est pas une alliance…
Sous l’apparence d’une alliance militaire multinationale c’est au contraire le Pentagone qui domine le mécanisme décisionnel de l’OTAN. Les USA contrôlent les structures de commandement de l’OTAN, qui sont incorporées à celles des États-Unis. le Commandant Suprême Allié en Europe (Saceur) est toujours un général étasunien nommé par Washington. Le Secrétaire général, actuellement Jens Stoltenberg, est essentiellement un bureaucrate qui s’occupe de relations publiques. Il n’a aucun rôle décisionnel.
Un autre thème que vous avez soulevé est celui des bases militaires USA en Italie et dans d’autres pays européens, y compris à l’Est, bien que le Pacte de Varsovie n’existe plus depuis 1991 et malgré la promesse faite à Gorbachev qu’aucun élargissement à l’Est n’aurait lieu. À quoi servent-elles ?
L’objectif tacite de l’OTAN -thème important de notre débat à Florence- a été d’opérer, sous une autre dénomination, “l’occupation militaire” de facto de l’Europe occidentale. Les États-Unis non seulement continuent à “occuper” les ex “pays de l’Axe” de la Seconde guerre mondiale (Italie, Allemagne), mais ont utilisé l’emblème de l’OTAN pour installer des bases militaires USA dans toute l’Europe occidentale, et, par la suite, en Europe Orientale dans le sillon de la guerre froide et dans les Balkans dans le sillon de la guerre OTAN contre la Yougoslavie (Serbie-Monténégro).
Qu’y a-t-il de changé par rapport à un possible usage d’armes nucléaires ?
Immédiatement après la guerre froide a été formulée une nouvelle doctrine nucléaire, focalisée sur l’usage préventif d’armes nucléaires, c’est-à-dire sur le first strike nucléaire comme moyen d’autodéfense. Dans le cadre des interventions USA-OTAN, présentées comme actions de maintien de la paix, a été créée une nouvelle génération d’armes nucléaires de “basse puissance” et “plus utilisables”, décrites comme “inoffensives pour les civils”. Les responsables politiques étasuniens les considèrent comme des “bombes pour la pacification”. Les accords de la guerre froide, qui établissaient certaines sauvegardes, ont été effacés. Le concept de “Destruction Mutuelle Assurée”, relatif à l’usage des armes nucléaires, a été remplacé par la doctrine de la guerre nucléaire préventive.
L’OTAN était “obsolète” au début de la présidence Trump mais maintenant elle est relancée par la Maison Blanche. Quelle relation y a-t-il entre course aux armements et crise économique ?
Guerre et globalisation vont de pair. La militarisation soutient l’imposition de la restructuration macro-économique dans les pays-cibles. Elle impose la dépense militaire pour soutenir l’économie de guerre au détriment de l’économie civile. Elle conduit à la déstabilisation économique et à la perte de pouvoir des institutions nationales. Un exemple : dernièrement le président Trump a proposé de grosses coupes budgétaires dans la santé, l’instruction et les infrastructures sociales, alors qu’il demande une grosse augmentation pour le budget du Pentagone. Au début de son administration, le président Trump a confirmé l’augmentation de la dépense pour le programme nucléaire militaire, lancé par Obama, de 1.000 à 1.200 milliards de dollars, en soutenant que cela sert à garder un monde plus sûr. Dans toute l’Union européenne l’augmentation de la dépense militaire, jumelée à des mesures d’austérité, est en train de conduire à la fin de ce qui était appelé “l’État-Providence” (welfare state). Maintenant l’OTAN est engagée sous la pression étasunienne à augmenter la dépense militaire et le secrétaire général Jens Stoltenberg déclare qu’il s’agit là de la chose juste à faire pour “garder la sécurité de notre population”. Les interventions militaires sont jumelées à des actes concomitants de sabotage économique et de manipulation financière. L’objectif final est la conquête des ressources autant humaines que matérielles et des institutions politiques. Les actes de guerre soutiennent un processus de conquête économique totale. Le projet hégémonique des États-Unis est de transformer les pays et les institutions internationales souveraines en territoires ouverts à leur pénétration. Un des instruments est l’imposition de lourdes contraintes aux pays endettés. L’imposition de réformes macro-économiques létales concourt à appauvrir de vastes secteurs de la population mondiale.
Quel est et quel devrait être le rôle des médias ?
Sans la désinformation opérée, en général, par presque tous les médias, le programme militaire USA-OTAN s’écroulerait comme un château de cartes. Les dangers imminents d’une nouvelle guerre avec les armements les plus modernes et du péril atomique, ne sont pas des informations qui font la Une. La guerre est représentée come une action de pacification. Les criminels de guerre sont dépeints comme des pacificateurs. La guerre devient paix. La réalité est renversée. Quand le mensonge devient vérité, on ne peut pas revenir en arrière.
Traduit de l’italien par M-A P
- Source : Il Manifesto (Italie)
00:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, otan, atlantisme, occidentalisme, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Intuiciones geopolíticas de Ganivet: el "espíritu del territorio"
Carlos Javier Blanco Martín
Ex: http://www.elespiadigital.com
Sé que hay españoles de bien, movidos por una honesta preocupación ante los desafíos centrífugos y la pérdida de su identidad nacional, que hacen remontar la cuna y la prosapia de España hasta unas fechas remotas, anteriores a 722 y muy anteriores a la Gesta de Covadonga. Las fechas remotas les llevan hasta el período de los godos y, con ello, reducen el ser nacional de los españoles al componente específico de barbarie que a una provincia romana muy concreta, la Hispania, habría de corresponderle. Es así que nuestro Ortega culpa a este pueblo godo, en origen extraño, de todas las específicas dosis mórbidas que a los romanos peninsulares -abuelos nuestros- les tocaron en suerte. Por aquello de ser más flojos, más decadentes, más "civilizados", dicho esto en el sentido spengleriano, los españoles habríamos de transportar, dentro del ancho mundo de la romanidad, las gotas perversas de decaimiento gótico que, por lo visto, los francos, sajones o lombardos no llevaron. Tosca me parece esta idea orteguiana. Vicios y errores cometieron los godos, a qué dudarlo, y prueba de ello es el modo en que cayeron en Guadalete a manos de los moros (711), en una fecha en que caídos se mostraban ya ante el mundo, divididos en facciones, podridos por los vicios y locos de sangre y ambición. En descargo de aquellos godos que ya iniciaban su proceso de mixtura con los romanos de Hispania, hay que decir que sólo los imperiales, esto es, bizantinos, les superaban en esplendor y cultura. De justicia es advertir que ya eran nuestros godos casi civilizados mucho antes de invadir tierras de Roma, pues de Roma era soldados y aduaneros, vasallos y aprendices. De genio jurídico como pocos pueblos de la edad bárbara, su matrimonio con la Iglesia, no menos reguladora y ordenancista, hubiera dado ricos frutos. De ese matrimonio hablaba Ángel Ganivet en Idearium Español:
 "La exaltación de la Iglesia española durante la dominación visigótica es obra de los bárbaros; pero no es obra de su voluntad, sino de su impotencia, incapaces para gobernar a un pueblo más culto, se resignaron a conservar la apariencia del poder, dejando el poder efectivo en manos más hábiles. De suerte, que el principal papel que en este punto desempeñaron los visigodos fue no desempeñar ninguno y dar, con ello, involuntariamente, ocasión para que la Iglesia se apoderara de los principales resortes de la política y fundase de hecho el estado religioso, que aún subsiste en nuestra patria, de donde se originó la metamorfosis social del cristianismo en catolicismo; esto es, en religión universal, imperante, dominadora, con posesión real de los atributos temporales de la soberanía." (Idearium Español, Agilar, Madrid, 1964; p. 11).
"La exaltación de la Iglesia española durante la dominación visigótica es obra de los bárbaros; pero no es obra de su voluntad, sino de su impotencia, incapaces para gobernar a un pueblo más culto, se resignaron a conservar la apariencia del poder, dejando el poder efectivo en manos más hábiles. De suerte, que el principal papel que en este punto desempeñaron los visigodos fue no desempeñar ninguno y dar, con ello, involuntariamente, ocasión para que la Iglesia se apoderara de los principales resortes de la política y fundase de hecho el estado religioso, que aún subsiste en nuestra patria, de donde se originó la metamorfosis social del cristianismo en catolicismo; esto es, en religión universal, imperante, dominadora, con posesión real de los atributos temporales de la soberanía." (Idearium Español, Agilar, Madrid, 1964; p. 11).
El ilustre ensayista cifra aquí, en la monarquía goda, las raíces de una teocracia hispana. Reyes y nobles abandonaron tan importante aspecto del "cratos" (del poder o fuerza efectiva) en un clero, en la línea de los "reyes holgazanes" y de una suerte de simulacro de poder: ellos hacían como que lo tenían, pero la Iglesia mandaba bajo cuerda. Bien es verdad que las tornas se cambian en el periodo de la Monarquía Asturiana. Los godos de Oviedo, o más bien dicho, los monarcas astures, salvaron y relanzaron la Iglesia, como aparato que les era esencial para el ejercicio y detentación del poder. El propio autor, al invertir el esquema, reconoce la especificidad del catolicismo hispano. La imagen que mejor representa la idiosincrasia imperial española, y ya la prefigura en el Medievo, no es la de una teocracia coronada sino la de una corona teocrática. Son los reyes asturianos, y después los leoneses, castellanos, etc. los que realzan el carácter sacro de su regio poder no como sucursal o vasallo de una Iglesia universal sino como la espada imperantede esa misma Iglesia universal. Esta es la razón por la que me parece que Ángel Ganivet ve en el catolicismo hispánico una mayor densidad o esencia, como si fuera la cumbre y la pureza misma dentro del catolicismo genérico. No pudo ser la torpeza política de los godos, ni su holgazanería a la hora de dejarse gobernar por una casta clerical, la causa que nos deparó ese espíritu imperial-teocrático que condicionaría nuestra historia hasta los días del fin del Imperio de los Austrias. Bien al contrario, fue la propia idea de que la Iglesia no fuera subalterna y pingajo de la Corona, sino colaboradora, aliada y, a ser posible, socia agradecida para con ella, la que se inició en la Monarquía Asturiana y se expandió en tiempos de los Habsburgo ya en un contexto mundial.
Tengo para mí que la idea imperial de los godos reinantes en Toledo había de verse bloqueada por su misma condición de pueblo en "interinidad" usufructuaria de una provincia romana, en coexistencia con Bizancio, único legítimo detentador de toda idea imperial-cristiana una vez caído el Imperio de occidente. Antes de Carlomagno, y antes de los grandes reyes astures (Alfonso II, Ramiro I, Alfonso III), esta idea imperial-católica sólo podría mostrarse en modo difuso y embrionario. Los godos de Hispania habían venido de otras tierras, dando tumbos, buscando una patria. Y la hallaron, pero la hallaron como ocupantes. En cambio, los godos-astures de la Reconquista hallaron la patria desocupando a los invasores. La teoría ganivetiana de la "independencia" como motor del alma nacional española toma toda su fuerza, sin que su creador quiera o pueda hacerla explícita, precisamente en el momento inicial de la Reconquista. Las gestas de los españoles en materia bélica lo son en procura de su independencia.
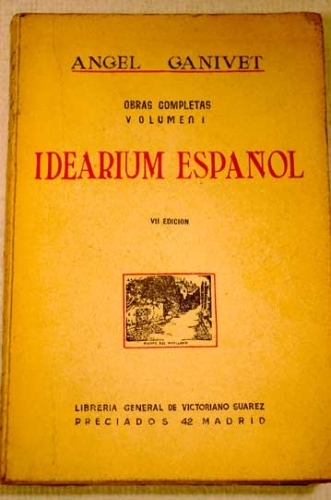 La lucha por la independencia, ya fuera ante Roma, ante los moros o ante Napoleón vendría dada por un supuesto "espíritu del territorio", que Ganivet maneja al modo de una especie de constante histórica. En realidad, tal constante difusamente descrita por el ensayista, es el factor geopolítico. España, junto con Portugal, está en una península. Las dos puertas que debe guardar son los Pirineos, al norte, y el Estrecho, al sur. En las penínsulas, los pueblos invasores entran fácilmente pero a menudo salen escaldados en una lucha contra los nativos agresivamente amantes de su independencia. Sólo Roma venció verdaderamente en ésta península ibérica (así llamada, aunque en dos tercios era península celta más bien). Cuando Ganivet habla de la insularidad agresiva (hacia el exterior) de los ingleses, más bien habla de modo difuso de una talasocracia (el poder de los barcos y sobre los mares, con una escasa y torpe milicia en la propia patria). De igual manera, cuando habla de la resistencia de los continentales (franceses, alemanes), alude al factor geopolítico de la escasa entidad física de las fronteras en las potencias "telúricas". Así pues, da igual que hablemos de los hunos o de los soviéticos: las cabalgadas de aquellos, o los tanques blindados de éstos, podían allegarse al corazón de Europa, y aun hasta Lisboa, en cuestión de días. Las potencias telúricas pueden llegar muy lejos por vía terrestre de acuerdo con los medios de su época, aunque a su paso hallan bolsas de saboteadores y resistentes que siempre pueden cortar la cadena de dominación, romper eslabones de control.
La lucha por la independencia, ya fuera ante Roma, ante los moros o ante Napoleón vendría dada por un supuesto "espíritu del territorio", que Ganivet maneja al modo de una especie de constante histórica. En realidad, tal constante difusamente descrita por el ensayista, es el factor geopolítico. España, junto con Portugal, está en una península. Las dos puertas que debe guardar son los Pirineos, al norte, y el Estrecho, al sur. En las penínsulas, los pueblos invasores entran fácilmente pero a menudo salen escaldados en una lucha contra los nativos agresivamente amantes de su independencia. Sólo Roma venció verdaderamente en ésta península ibérica (así llamada, aunque en dos tercios era península celta más bien). Cuando Ganivet habla de la insularidad agresiva (hacia el exterior) de los ingleses, más bien habla de modo difuso de una talasocracia (el poder de los barcos y sobre los mares, con una escasa y torpe milicia en la propia patria). De igual manera, cuando habla de la resistencia de los continentales (franceses, alemanes), alude al factor geopolítico de la escasa entidad física de las fronteras en las potencias "telúricas". Así pues, da igual que hablemos de los hunos o de los soviéticos: las cabalgadas de aquellos, o los tanques blindados de éstos, podían allegarse al corazón de Europa, y aun hasta Lisboa, en cuestión de días. Las potencias telúricas pueden llegar muy lejos por vía terrestre de acuerdo con los medios de su época, aunque a su paso hallan bolsas de saboteadores y resistentes que siempre pueden cortar la cadena de dominación, romper eslabones de control.
La España imperial teocrática fue el más grande experimento de gobierno universal después de Roma. Combinó, ciertamente, los elementos talasocráticos con los telúricos. España, o lo que debería haber sido su unidad más perfecta, una Iberia que uniera las coronas de España y la de Portugal, es casi una isla adecuadamente orientada hacia las Américas. La Castilla más atlántica hubiera crecido en unión estrecha con Portugal, y en armonía con el inicial ímpetu de la Reconquista, que hallaba su núcleo germinal en el Noroeste (Las Asturias, las de Oviedo y las de Santillana, Galicia, Norte de Portugal, León). También en esto, el autor granadino alcanzó intuiciones de gran valor. Acaso la política mediterránea habría debido ceñirse a una férrea contención del poder berberisco y otomano, y a una prosecución de la reconquista en el Magreb, y aun más allá, hacia Túnez. La potencia colonizadora de los españoles, muy superior a la de Francia u otras potencias europeas, habría convertido el norte de África, por medio de cristianos de origen ibérico junto con nativos conversos, en una enorme y hermosa nueva Andalucía.
La España atlántica fue el puente, por medio del dominio y roturación de mares, para la civilización del Nuevo Mundo, para la aplicación de fuerzas administrativas y espirituales formidables. Gobierno de territorios inmensos, estructuración racional de pueblos, países, razas así como evangelización de todo ello. No se entiende muy bien el desprecio con que Ganivet, y otros miembros de su generación (Maeztu, Ortega) hablan de la Escolástica, haciéndolo en unos términos que, o bien evidencian a las claras que tal materia ignoran, o bien revelan que andaban hartos de ella por causa de su tardía y acartonada implantación escolar en España a las puertas mismas del siglo XX. Pero tal Escolástica (en su versión fresca y original del siglo de Oro), junto con el "espíritu del territorio" hispano y sus tácticas guerrilleras, hicieron de esta nación, no sólo la primera en la Europa occidental moderna, sino la más perfecta reencarnación de un ideal imperial-católico, siendo éste universal por espíritu pero centralizador sólo en la medida en que ello resulte de utilidad práctica, pues Imperio, en el genuino sentido cristiano-europeo, no es despotismo oriental divisible todo lo más en satrapías, sino verdadera federación de comunidades orgánicas regidas bajo los principios de subsidiariedad y solidaridad, así como matriz y nido de naciones futuras, hijas y protegidas de una Madre Patria cuando las tales hijas aún se hayan en un cierto grado de inmadurez.
El Idearium Español es, en suma, un hontanar lleno de intuiciones sobre el pasado, el presente y el futuro de España que puede ser leído en clave geopolítica, si bien han de corregirse excesos, errores y anacronismos, justo como en toda lectura crítica ello es menester.
00:50 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : angel ganivet, géopolitique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’initiative chinoise « Belt and Road » bat son plein en Europe

L’initiative chinoise « Belt and Road » bat son plein en Europe
Ex: https://echelledejacob.blogspot.com
La visite de Xi Jinping en Europe confirme ce que beaucoup d’entre nous ont écrit au cours des derniers mois et des dernières années, à savoir la réalité de la transformation mondiale en cours, d’un monde dominé par les États-Unis, vers un monde pluraliste composé de puissances différentes travaillant ensemble à l’avenir d’un monde multipolaire.
L’Europe se trouve donc dans une position imprévue, à l’équilibre entre l’ancien monde avec ses liens avec les États-Unis d’une part et le nouveau monde de l’Eurasie naissante portée sur les fonds baptismaux par la Russie et la Chine d’autre part.
Des pays comme l’Allemagne et la France, et même le Royaume-Uni, ont depuis longtemps mis en place des politiques commerciales favorisant l’intégration avec les pays du supercontinent eurasien. En 2015, le Royaume-Uni a été l’un des premiers pays occidentaux à rejoindre la Banque d’investissement pour l’infrastructure (AIIB), dirigée par la Chine, qui finance des projets de l’Initiative Belt and Road (BRI).
Le méga projet chinois BRI [les nouvelles routes de la soie] a débuté en 2014 avec l’objectif ambitieux de favoriser le commerce entre la Chine et l’Europe par mer et par terre, avec la participation de tous les pays intermédiaires. L’idée, en tant que consolidation naturelle du commerce, est de réduire les délais de livraison des marchandises par chemin de fer et d’intégrer les routes maritimes. Le projet couvre non seulement les ports et les lignes ferroviaires, mais également la construction d’infrastructures technologiques permettant une inter-connectivité mondiale en utilisant la technologie 5G développée par le géant chinois de la technologie Huawei.
L’Allemagne et la France ont, au fil des années, renforcé leurs partenariats avec Beijing. Paris, en particulier, a des liens historiques avec la Chine découlant de la coopération nucléaire entre le groupe chinois General Power Group (CGNPC) et Électricité de France (EDF), qui remonte à 1978, ainsi que de la coopération aérospatiale entre Airbus et les compagnies aéronautiques chinoises, en cours depuis 1985.
L’Italie a récemment approché la BRI, suite à une initiative du nouveau gouvernement constitué du mouvement Lega Nord et du Mouvement des cinq étoiles (M5S). La décision de signer un mémorandum d’accord entre Beijing et Rome souligne la volonté du nouveau gouvernement de maintenir une position équilibrée entre Washington et Beijing dans certains secteurs. C’est exactement la démarche de l’Allemagne, qui a choisi de continuer à approfondir ses liens avec Moscou vis-à-vis des hydrocarbures et de Nord Stream 2, face aux énormes pressions de Washington. En outre, l’Allemagne et l’Italie ont toutes deux confirmé leur volonté de faire confiance à Huawei pour la mise en œuvre et la gestion du trafic 5G, élément fondamental d’un monde dominé par l’internet des objets.
Les décisions de l’Allemagne, de la France et de l’Italie de poursuivre leur coopération avec Moscou et Beijing dans divers domaines vont à l’encontre du discours avancé par les médias aux ordres, contrôlés par les États-Unis, qui tentent de décourager les hommes politiques européens d’agir dans l’intérêt de leurs pays et de s’engager avec la Russie et la Chine.
Washington ne comprend toujours pas pourquoi certains pays européens sont si déterminés à saisir les opportunités offertes par l’Est. L’exemple récent de l’Italie est assez facile à comprendre. Les Italiens espèrent que la BRI donnera une impulsion indispensable à leur industrie manufacturière, qui est en berne ces dernières années. La volonté de capitaux chinois de stimuler les exportations de produits italiens est le moteur du projet d’accord entre Beijing et Rome.
Outre le besoin évident et naturel de capital financier, il y a aussi l’idée d’assurer l’approvisionnement en énergie, comme le fait l’Allemagne avec la construction du Nord Stream 2 avec la Russie. Malgré la forte opposition américaine, Berlin a défendu ses intérêts nationaux en matière de diversification énergétique, en évitant de céder aux pressions de Washington, qui souhaitait que l’Allemagne s’appuie sur le GNL [gaz naturel liquéfié] fourni par les États-Unis à un prix exorbitant par rapport au gaz fourni par la Russie.
Les divergences entre les hommes politiques européens sont frappantes, surtout si l’on examine les relations entre Macron et Salvini en Italie ou entre May et ses collègues européennes. Même entre Merkel et Macron, il semble y avoir des frictions notables autour de l’indépendance énergétique. Cependant, malgré ces divergences apparentes, le thème dominant en dernière analyse est celui de vouloir échapper à la domination étouffante de Washington au profit d’une plus grande participation au concept d’un monde multipolaire.
Aucune capitale européenne – que ce soit Paris, Rome, Berlin ou Londres – n’a l’intention de rompre le pacte atlantique avec Washington. Ceci est confirmé à chaque occasion officielle possible. Cependant, alors que Pékin se trouve de plus en plus au centre des questions de technologie, de fourniture de capital pour des investissements ou d’expansion commerciale, les modifications apportées à l’ordre global semblent imparables.

Ce n’est pas un hasard si pour les stratèges américains les deux plus grands dangers résident dans la possibilité que Moscou et Beijing, ou Moscou et Berlin, coopèrent et coordonnent leurs efforts. Le triangle Berlin-Moscou-Beijing, avec l’ajout de Rome et de Paris, représente un scénario sans précédent pour Washington en ce qui concerne son défi à l’hégémonie américaine en Europe.
Wang Yiwei, chercheur principal au Center for China and Globalization, lors de la visite historique de Xi Jinping à Rome, a exprimé de manière concrète l’évolution de l’ordre mondial : « Avec le plan de coopération 16 + 1 des pays d'Europe centrale et orientale avec la Chine, plusieurs pays ont signé un mémorandum d'accord avec celle-ci afin de construire conjointement la BRI. Actuellement, 171 accords de coopération ont été conclus avec 123 pays et 29 organisations internationales dans le cadre de la BRI ».
Federico
00:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, chine, asie, affaires asiatiques, belt & road, eurasisme, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 avril 2019
Le GRISCY ou l'amorce d'un OTAN méditerranéen

Le GRISCY ou l'amorce d'un OTAN méditerranéen
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
Aussi Washington n'a pas perdu de temps pour mettre en place un « axe stratégique » dorénavant dit GRISCY pour Grèce, Israël et Chypre. Le fait qu'Israël est le point fort de cet axe montre que l'initiative n'est pas seulement américaine mais israélienne. Tel Aviv veut ainsi renforcer son influence dans cette partie de la Méditerranée, très importante pour sa sécurité.
Le projet vient d'être validé par le Sénat américain qui a proposé le terme de « Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act” . La traduction ne s'impose pas. L'Act ou Bill prend les décisions suivantes :
-
lever l'interdiction de ventes d'armes américaines à la République de Chypre.
-
autoriser la création d'un United States-Eastern Mediterranean Energy Center afin de faciliter la coopération en matière énergétique entre les Etats-Unis, Israël, la Grèce et Chypre.
-
autoriser le financement par l'Amérique de 3 millions de dollars d'aide militaire à la Grèce, complété de 2 millions d'aide à la Grèce et à Chypre en matière de formation et d'entraînement militaire.
-
refuser de vendre à la Turquie comme initialement prévu des avions de combat F-35 du fait que la Turquie continue à envisager l'acquisition de missiles anti-missiles russes S-400. Sur ce point, remarquons-le, Ankara qui s'y attendait ne s'en inquiétera pas.
-
demander à la Maison Blanche de soumettre au Congrès un projet de coopération renforcé entre les Etats-Unis, Israël, la Grèce et Chypre en matière de sécurité et de coopération énergétique, ainsi que pour le renseignement militaire.
Le GRISCY réunit sous la direction américaine trois Etats hostiles à la Turquie aux frontières occidentales de celle-ci. L'objectif immédiat est de réaliser un projet de gazoduc dit Est-Med sous la mer les reliant au gaz de l'Amou Daria au Turkménistan leur permettant de ne pas dépendre du futur gazoduc dit TANAP ou Gazoduc Transanatolien passant par la Turquie.
Parallèlement, la fourniture d'armements américains à la moitié de Chypre en conflit pour l'autre moitié occupée par la Turquie depuis la fin de la 2e guerre mondiale sera ressentie par cette dernière comme une intervention directe américaine dans le conflit, au profit de Chypre.
Il va de soi que l'intervention américaine est aussi dirigée en arrière plan contre la Russie et son accord avec Israël afin de la couper de la route commerciale dite route du Levant entre la Crimée, la Syrie, le Sinaï et l'Érythrée.
Référence
http://www.ekathimerini.com/239415/article/ekathimerini/n...
Ekathimerini est un organe grec d'information très populaire. Il publie en grec et en anglais
00:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, méditerranée, isarël, chypre, grèce, europe, affaires eruopéennes, otan, atlantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




