vendredi, 27 février 2026
Guerre contre la drogue au Mexique

Guerre contre la drogue au Mexique
Leonid Savin
Nouvelle phase de conflit et rôle des États-Unis
Le 22 février, dans l’État mexicain de Jalisco, lors d’une opération spéciale, selon les autorités, le chef du cartel de la drogue « Nouvelle Génération Jalisco », Nemesio Oseguera Cervantes, alias « El Mencho » (photo, ci-dessous), a été tué. Il était l’un des criminels les plus recherchés du Mexique, et les États-Unis avaient offert une récompense de 15 millions de dollars pour son arrestation. Il est accusé d’activités criminelles depuis les années 1990, y compris de trafic de drogues, d'enlèvements, d'assassinats, de trafic d’armes et d'extorsion. Avant la création de « Nouvelle Génération Jalisco », Nemesio a travaillé dans les cartels de Milenio et de Sinaloa, ainsi que dans la police (après avoir purgé une peine de trois ans aux États-Unis pour trafic d’héroïne dans les années 90). Des rumeurs circulaient auparavant sur sa mort, due à une maladie, mais une enquête officielle n’a pas confirmé cette version.

En réponse aux informations du gouvernement, les représentants du cartel «Nouvelle Génération Jalisco» ont lancé des raids et des actes de vandalisme avec des tirs indiscriminés. On a repéré des attaques contre 50 agences bancaires, l’aéroport de Guadalajara, une base de la garde nationale, ainsi que des blocages routiers et de nombreux incendies criminels. Selon les données officielles, plus de 10 personnes ont été tuées et au moins 50 ont été blessées. D’après les photos et vidéos publiées, au moins un avion, des dizaines de bus et de véhicules ont été brûlés, et une attaque contre un hôpital a eu lieu.
Outre l'État de Jalisco, des troubles ont également eu lieu dans d’autres régions du Mexique. Dans l’État voisin d’Oaxaca, les écoles ont été fermées. Étant donné les tentatives de bloquer les autoroutes dans des États qui appartiennent officiellement à d’autres cartels, il est possible que d’autres groupes criminels paramilitaires aient exprimé leur solidarité avec «Nouvelle Génération Jalisco». Ces actions étaient tout à fait prévisibles – car si le gouvernement commence à éliminer des dirigeants de cartels, d’autres pourraient suivre. Par conséquent, le gouvernement de Claudia Sheinbaum, qui suit la ligne de Donald Trump, risque d'aggraver le conflit intérieur, ce qui aura des conséquences politiques, et sera exploité par ses opposants.

Si l’on considère l’histoire des cartels de drogue au Mexique, ils ont évolué au fil des décennies et, d’organisations criminelles, ils sont devenus une puissante écosphère, qui constitue une sorte d’État dans l’État. Comme dans le cas de la Colombie sous Pablo Escobar, lorsque les barons de la drogue remplaçaient les services publics, les cartels mexicains ne se contentent pas d’activités illégales, mais achètent aussi la loyauté des populations locales via des projets sociaux tels que la construction d’hôpitaux et d’écoles. Les combattants des cartels sont bien équipés, disposent d’armes modernes, de véhicules blindés et de moyens de communication avancés. Fait intéressant, la guerre en Ukraine leur a apporté une expérience supplémentaire: il est connu que des représentants de cartels ont été envoyés dans les territoires contrôlés par Kiev pour acquérir de l’expérience dans l’utilisation de drones, pour ensuite utiliser ces connaissances contre les forces de l’ordre mexicaines. Cela a été reconnu aussi par les médias occidentaux, où le cartel «Nouvelle Génération Jalisco» a été spécifiquement mentionné.
Au total, il y a 16 grands cartels de drogue au Mexique, certains coopèrent entre eux, d’autres sont en conflit. Ils ont des liens avec des organisations similaires en Équateur, en Colombie, au Pérou et en Bolivie, pays d’où provient la cocaïne. Au Mexique, des drogues synthétiques comme la méthamphétamine et le fentanyl sont aussi produites, et des raids réguliers sont menés contre des laboratoires de drogue. Les principaux marchés de consommation sont les États-Unis, mais aussi les pays de l’UE, où la drogue est livrée par voie maritime.

Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que presque toutes les armes à feu en possession des membres des cartels sont fabriquées aux États-Unis, et sont souvent de type militaire. Depuis le début de la guerre contre la drogue en 2006, initiée par la direction américaine et ayant coûté la vie à des dizaines de milliers de Mexicains, personne n’a pu expliquer comment ces armes ont atterri chez les cartels. Cependant, il est évident que leurs tentacules ont pénétré profondément non seulement dans le système gouvernemental mexicain, mais aussi chez le voisin du nord. En effet, une partie des revenus issus de la vente de drogue a été historiquement utilisée par les services secrets américains comme budget spécial pour les opérations secrètes, et certains itinéraires du trafic mondial de drogue ont été planifiés par ces mêmes agences. Étant donné que la CIA et le Pentagone ne sont que des exécutants avec un appui politique, il existe sans aucun doute, tant chez les républicains que chez les démocrates, des groupes qui profitent directement du trafic de drogue (comme les fonds occultes pour les campagnes électorales).
Cependant, Donald Trump a tendance à accuser les autres et à chercher des problèmes à l’étranger, inventant parfois des organisations inexistantes, comme dans le cas du cartel «Los Soles», que l’on attribuait au président vénézuélien Nicolás Maduro. Même la mention du groupe vénézuélien «Tren de Aragua» dans le trafic international de drogue par le Département d’État et la Maison Blanche allait à l’encontre des recherches américaines, qui affirmaient que ce groupe ne constitue pas une telle organisation.
L’expérience de la Colombie et de l’Équateur a montré que les méthodes préventives de lutte contre ces organisations, dans le cadre de l’aide fournies par les États-Unis, sont peu efficaces. De nouveaux leaders remplacent ceux qui sont tués, la spirale de violence tourne toujours, et la société en souffre davantage. Les experts, engagés dans ce domaine depuis de nombreuses années, ont reconnu que suivre les directives des États-Unis ne ferait qu’aggraver la situation, qui sera utilisée pour une ingérence constante de Washington. Pour une solution durable, d’autres mécanismes, d’autres formats et d’autres plateformes, tant régionales qu’internationales, sont nécessaires. Bien qu’il y ait eu aussi des exemples locaux de succès, comme en Équateur sous Rafael Correa, où la criminalité grave a diminué de manière significative en quelques années. Par conséquent, dans les efforts pour améliorer la sécurité des citoyens et éliminer la criminalité organisée au Mexique, il faut adopter une approche souveraine, plutôt que de réagir uniquement aux menaces du voisin.
17:03 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, mexique, cartels, drogues, narco-trafic |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le "monde l'eau" de Golovine comme seuil d'accès à l'Anima Mundi

Le "monde l'eau" de Golovine comme seuil d'accès à l'Anima Mundi
Martin Kovac
ARS INVISIBILITATIS : Stratégie de disparition verticale pour les agents de l'«Anima Mundi» à l'ère de la Quantité Totale.
« Le chemin vers l'Esprit passe par l'Eau. L'Anima Mundi est une porte qu'il est impossible de contourner, on ne peut que la traverser».
SOLUTIO : De la nécessité de liquéfier l'Esprit dans le processus hermétique du Retour.
La topographie de la conscience moderne est dominée par l'élément Terre (Hylé). Nous vivons à une époque de « sécheresse ontologique », où la réalité est perçue comme un ensemble d'objets séparés et rigides, définis par des paramètres mesurables et des frontières rigides. L'ego, fortifié dans sa carapace de matérialisme, est devenu prisonnier de sa propre fixation. Cependant, Evgueni Golovine, dans sa tradition radicale, propose une carte pour s'en échapper: l'ascension vers le «Monde de l'eau».
En y regardant de plus près à travers le prisme du néoplatonisme, nous découvrons que le « monde de l'eau » de Golovine n'est pas une simple métaphore des émotions ou du subconscient, mais une rencontre avec l'Anima Mundi (l'âme du monde) dans sa fonction primaire et dissolvante.
L'architecture fluide de l'âme
Le néoplatonisme enseigne qu'il existe un médiateur entre l'Esprit pur (Noos) et la Matière lourde (Hylé) : l'Anima Mundi. C'est un champ vivifiant qui imprègne tout. Pour l'homme moderne, dont la perception s'est sclérosée, ce médiateur est toutefois inaccessible. Pour pouvoir revenir à l'Unité (Epistrophé), nous devons d'abord abandonner la Matière.

C'est là qu'intervient l'impératif de Golovine: entrer dans l'Eau.
Cet acte n'est pas une « expérience », mais un changement radical d'état de conscience. Le «monde de l'eau» est un état ontologique où l'Anima Mundi cesse d'être un concept théorique et devient une réalité tangible et fluide. L'eau fonctionne ici comme Menstruum Universale – un solvant universel qui élimine les dépôts de fausse individualité.
Phase SOLVE : Dissolution de l'ego
La maxime alchimique Solve et Coagula (Dissoudre et coaguler) nous donne la clé pour comprendre ce processus. Avant qu'une nouvelle cristallisation de l'esprit à un niveau supérieur (Coagula) puisse avoir lieu, l'ancienne forme doit être détruite (Solve). Le «monde de l'eau» de Golovine est le domaine de la fluidité radicale. Y entrer signifie la mort volontaire du «moi» profane. Les frontières rigides qui définissent notre identité sociale et biologique (notre «moi» sec) commencent à se dissoudre au contact de l'Anima Mundi. C'est le moment où nous réalisons que le « moi » n'est pas une île isolée, mais une vague dans l'océan de l'Âme du monde.

Ce processus est dangereux. Les néoplatoniciens mettaient en garde contre «l'humidification de l'âme», qui conduit à la chute dans la génération et la sensualité. Golovine renverse cependant cette crainte : sans humidification, il n'y a pas de vie. Sans dissolution dans l'Anima Mundi, nous restons prisonniers de la matière morte. Le risque n'est pas l'eau elle-même, mais l'incapacité à nager dedans. Nous arrivons ici au cœur du problème. L'entrée dans le «Monde de l'eau» n'est pas le but ultime (celui-ci étant le Feu/l'Unité), mais un seuil critique. C'est une initiation.
Le «Monde de l'eau» de Golovine EST une entrée phénoménologique dans l'Anima Mundi au stade Solve. C'est un acte de sacrifice de la forme au profit de l'essence. Dans cet espace fluide, ce ne sont pas les lois de la mécanique qui s'appliquent, mais celles de la sympathie, de la résonance et de la métamorphose. C'est le moment où la conscience apprend à « respirer sous l'eau », c'est-à-dire à exister en dehors du soutien des dogmes matérialistes rigides et du temps linéaire. Seul celui qui se dissout dans l'Anima Mundi (l'Eau) sans se noyer, celui qui conserve sa verticalité intérieure même au milieu du chaos des vagues, peut commencer à s'élever en elle. Tout comme l'eau se transforme en vapeur sous l'effet de la chaleur, l'âme « dissoute », réchauffée par l'éros intérieur vers la Vérité, commence à se transformer. L'eau lourde devient de l'air léger (Pneuma), prêt à entrer dans la sphère de Noos. Sans l'immersion de Golovine, cependant, cette ascension ne serait pas possible; nous resterions seulement de la poussière sèche à la surface de la Terre, rêvant de voler, mais incapables de quitter la gravité.

Nous sommes maintenant confrontés à un problème stratégique: comment survivre dans un «monde moderne» qui est par essence l'antithèse de l'âme? La modernité est la tyrannie de la quantité (Regnum Quantitatis). C'est un monde qui ne reconnaît que ce qui peut être pesé, mesuré, indexé et vendu. Ceux qui restent «matière solide» seront broyés par les rouages du déterminisme. La seule défense n'est pas la fuite physique (impossible dans le Panoptique mondial), mais l'invisibilité ontologique.
Voici la procédure opérationnelle pour atteindre l'état de Pneuma (Air/Esprit), indétectable par les «capteurs» du matérialisme. Mettez le «masque liquide».
Le système moderne chasse les «identités». Il exige que vous soyez défini : par votre profession, vos opinions politiques, votre profil de consommateur. Acceptez la leçon de Golovine sur l'eau. Soyez conforme en apparence, mais complètement détaché intérieurement. Portez votre rôle social comme un masque (Persona), et non comme un visage. Soyez dans le récipient (le monde), mais soyez le liquide, pas la paroi du récipient. Pour le système, vous êtes « visibles » (vous remplissez une fonction), mais votre essence n'est pas affectée par cette fonction. Sublimez-vous. Réchauffez votre eau intérieure avec le feu de l'intuition intellectuelle (Noos).

Si vous déplacez votre centre de gravité – votre «moi» – dans la sphère de la pensée et de l'esprit, vous devenez insaisissable pour le matérialisme. Votre corps est là, mais votre conscience opère à une fréquence que le radar matérialiste ne peut capter, car il la considère comme «irréelle». Cessez de vous définir par «la possession» ou «l'être». Définissez-vous de manière apophatique (négative): «Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce statut, je ne suis pas cette réussite». Dès l'instant où vous renoncez à prétendre «être quelqu'un» aux yeux du monde, vous devenez Ulysse dans la caverne du Cyclope. Vous dites: «Je m'appelle Personne (Outis). » Le Cyclope (la force aveugle de la matière qui n'a qu'un seul œil – l'esprit quantifiant) ne peut pas vous atteindre, car il ne peut pas viser «Personne».
Pour que le « moi fluide » ne se dissolve pas dans le chaos (ce qui est le risque de la simple anarchie), il doit être ancré en haut, et non en bas. Maintenez une connexion constante avec l'Unité (Hen). Votre tête doit respirer dans l'Hyper-ouranos (le monde des archétypes), tandis que vos pieds marchent sur Terre. C'est l'état de « veille éveillée ». Pour le monde, vous dormez (vous ne vous intéressez pas à ses jouets, ses drames et ses peurs), mais pour l'Esprit, vous êtes pleinement éveillé.
Vous êtes toujours physiquement présent dans la polis moderne, vous payez vos impôts et vous saluez vos voisins. Mais ontologiquement, vous êtes un étranger. Vous êtes un agent de l'Anima Mundi qui opère dans les arrières de l'ennemi (la Matière) sans être découvert. C'est cela, la véritable invisibilité: être dans le monde, mais pas du monde.
16:37 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : evgueni golovine, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La justice sans vérité: Rawls et la neutralisation morale du libéralisme post-métaphysique
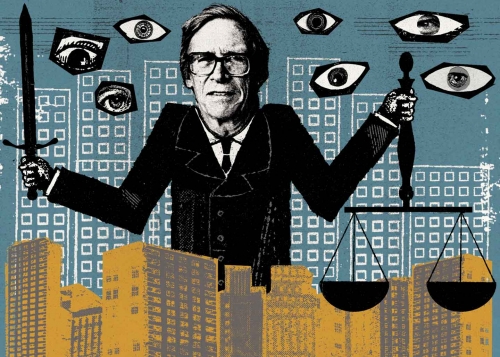
La justice sans vérité: Rawls et la neutralisation morale du libéralisme post-métaphysique
Santiago Mondejar Flores
Source: https://posmodernia.com/la-justicia-sin-verdad-rawls-y-la...
Alors que la théorie politique contemporaine célèbre avec un rituel académique l'œuvre de John Rawls comme l'aboutissement d'une réflexion libérale raisonnable et modérée, nous devons considérer cette jubilation pour ce qu'elle est à bien des égards: la cristallisation philosophique d'une époque moralement affaiblie, d'une civilisation qui a remplacé la recherche du bien par la gestion prudente des préférences, la vérité par le consensus, la dignité par la neutralité (MacIntyre, 1981 ; Taylor, 1989).
Rawls fait sans aucun doute preuve d'une grande et brillante technique, mais il adopte également une attitude épistémologique et morale qui renvoie à ce que l'on pourrait appeler l'hypostase de la justice: la transformation de la justice en un fétiche, qui n'est pas très différent du fétiche libéral de la liberté absolue, promu dans d'autres contextes comme la sphère inviolable de l'individu et la transaction rationnelle sans poids moral ultime (Deneen, 2018). C'est cette hypostase que nous devons soumettre à la critique, car il ne s'agit pas d'une erreur mineure, mais d'un renoncement profond à une dimension incontournable de la vie morale humaine.
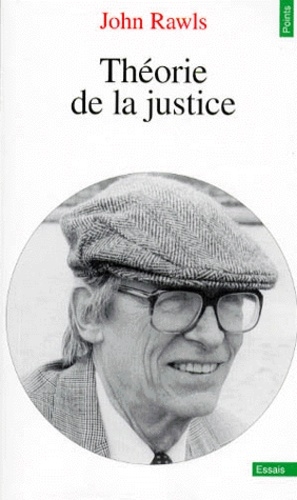 Le projet rawlsien, tel qu'il se déploie dans A Theory of Justice et ses développements ultérieurs, repose sur une décision méthodologique qui est en même temps une déclaration de foi: la justice n'a pas besoin d'être ancrée dans une conception substantive du bien, il suffit qu'elle soit acceptable pour des agents rationnels placés dans des conditions idéales d'impartialité (Rawls, 1971).
Le projet rawlsien, tel qu'il se déploie dans A Theory of Justice et ses développements ultérieurs, repose sur une décision méthodologique qui est en même temps une déclaration de foi: la justice n'a pas besoin d'être ancrée dans une conception substantive du bien, il suffit qu'elle soit acceptable pour des agents rationnels placés dans des conditions idéales d'impartialité (Rawls, 1971).
La célèbre « position originelle » et son voile d'ignorance ne sont donc pas des outils heuristiques neutres permettant de découvrir une vérité morale; ils constituent un artifice conceptuel conçu pour balayer sous le tapis toute question gênante sur ce qui constitue une bonne vie, une nature humaine orientée vers le bien ou une hiérarchie de valeurs qui transcende le consensus contingent d'une société libérale avancée (Sandel, 1982).
Chez Rawls, la justice se légitime par son acceptabilité, et non par sa vérité. Et si la justice se définit par son acceptabilité, et non par sa vérité, alors nous ne sommes plus face à une éthique, mais à une technique de stabilisation sociale (Williams, 1985).
Cette neutralité axiologique — que Rawls présente comme une vertu — est, du point de vue d'une réflexion morale plus exigeante, un symptôme d'épuisement philosophique. Car renoncer à une conception substantive du bien n'équivaut pas à une ouverture pluraliste compréhensive, mais à un silence délibéré sur les tensions morales les plus profondes (Taylor, 1992). La tradition classique concevait la justice comme une vertu orientée vers la réalisation de possibilités humaines objectivement valables.
Pour Aristote, la justice et le bien commun étaient intrinsèquement liés; pour Kant, la moralité — y compris la justice — repose sur des impératifs catégoriques qui ne peuvent dépendre d'accords contingents. Rawls, en faisant abstraction de ces fondements, confie la force normative de la justice au consensus entre agents rationnels. Mais le consensus n'est pas la vérité, et l'acceptabilité n'est pas la correction morale (MacIntyre, 1988). L'universalisme que proclame Rawls est un universalisme formel, un vide qui peut accueillir des conceptions incompatibles du bien à condition qu'elles s'ajustent à ses conditions procédurales.
La position originelle, conçue comme l'appareil justificatif des principes de justice, révèle clairement cette renonciation. Sous le voile de l'ignorance, les agents ne savent rien de leur personne concrète: ils ne connaissent pas leur talent, leur statut social, leurs priorités vitales. Cette abstraction extrême élimine du jugement moral tous les facteurs qui font de la vie humaine un événement moralement significatif (Sandel, 1982).
Il n'y a pas de passions, pas d'histoire, pas de conflit tragique entre le devoir et le désir. Il n'y a qu'une rationalité calculatrice qui tente d'équilibrer les attentes dans des conditions artificielles. Dans ce panorama, la justice ne répond plus à une urgence morale — comme elle répondrait à la fragilité, à la vulnérabilité, à l'inégalité réelle des vies incarnées — mais à une prudence rationnelle qui cherche à atténuer les risques (Walzer, 1983). Ainsi conçue, la justice devient un contrat destiné à protéger ses propres intérêts potentiels, et non une exigence morale qui transforme la vie des sujets.
Le caractère appauvri de cette conception apparaît de manière paradoxale si on la compare à l'élaboration contemporaine de la liberté comme totémisme. Dans l'analyse culturelle de notre époque, la liberté absolue — la revendication de l'autodétermination sans sanction morale ou sociale — a été élevée au rang de mythe qui fonctionne comme un placebo face à la désorientation morale de la modernité tardive (Taylor, 2007).

Cette liberté sans ancrage dans une compréhension du bien devient une illusion, un masque qui cache le vide de notre orientation éthique. De manière analogue, chez Rawls, la justice devient une idolâtrie: une structure formelle technocratique vénérée pour sa neutralité, même si, au fond, elle ne fait qu'administrer des préférences sans soutenir aucune vie morale au-delà de la simple coexistence pacifique (Mouffe, 2005).
Si ce diagnostic culturel peut être identifié comme le mal de notre époque – une foi dans la liberté comme absolu, dans l'économie comme critère ultime de sens, dans la transaction comme modèle d'interaction humaine –, alors Rawls n'en est pas l'antidote, mais sa synthèse la plus raffinée. Sa théorie ne sauve pas la moralité de l'indifférence postmoderne, mais l'intègre dans un schéma de légitimation rationnelle (Deneen, 2018).
La neutralité axiologique, célébrée comme le respect de la pluralité, est, d'un autre point de vue, le même renoncement qui se répand aujourd'hui sous la forme de célébrations culturelles du choix personnel: la suspension des jugements sur le bien au profit du respect procédural des décisions subjectives (Taylor, 1992).
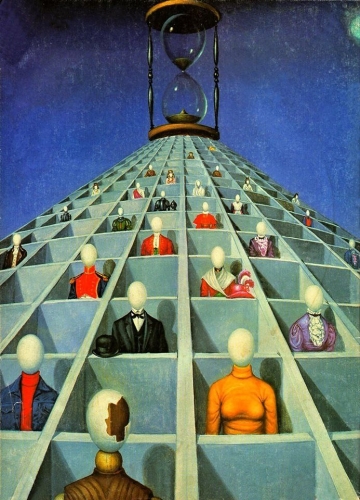
L'égalitarisme de Rawls ne sauve donc pas la justice de cette renonciation; il la reconfigure simplement. La priorité des principes de justice n'est pas de nier les inégalités en elles-mêmes, mais de s'assurer que les inégalités sont acceptables selon des critères procéduraux (Rawls, 1971). Ce résultat est-il préférable à une inégalité arbitraire ? Peut-être. Mais moralement, la question de savoir pourquoi nous devrions le préférer implique de faire appel à une conception du bien humain que Rawls a exclue de sa théorie. La justice rawlsienne devient ainsi une justice fonctionnelle: elle sert à administrer des sociétés complexes, mais ne donne aucune indication sur les vies qui méritent d'être vécues ni sur les raisons pour lesquelles certains biens ont plus de valeur que d'autres (Walzer, 1983).
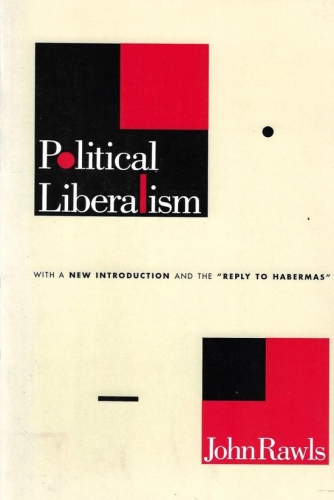 Cette désactivation n'est pas un accident marginal, mais est inhérente au projet de neutralité post-métaphysique que Rawls assume dans Political Liberalism (Rawls, 1993). Là, l'idée que la société doit être légitime pour les citoyens porteurs de doctrines compréhensives diverses semble, à première vue, être une défense contre la tyrannie morale.
Cette désactivation n'est pas un accident marginal, mais est inhérente au projet de neutralité post-métaphysique que Rawls assume dans Political Liberalism (Rawls, 1993). Là, l'idée que la société doit être légitime pour les citoyens porteurs de doctrines compréhensives diverses semble, à première vue, être une défense contre la tyrannie morale.
Cependant, une telle neutralité n'est pas une suspension de la moralité, mais une consécration tacite d'une morale libérale particulière, historiquement située et rarement soumise à un examen critique (Sandel, 1998). L'exigence critique est suspendue sur l'autel de l'acceptabilité et de la stabilité sociale.
Cette suspension ne reste pas confinée au plan théorique et n'est pas politiquement inoffensive. Lorsque la légitimité de l'ordre politique repose exclusivement sur la correction procédurale et non sur une conception substantive — bien que contestée — du bien commun, l'autorité morale des institutions s'affaiblit progressivement (Williams, 2005).
Là où la justice ne peut plus faire appel à des vérités normatives fortes, le pouvoir recourt à la légalité formelle, à l'efficacité administrative et à l'expertise technique pour maintenir l'obéissance. Ce déplacement n'est pas accidentel, mais structurel.
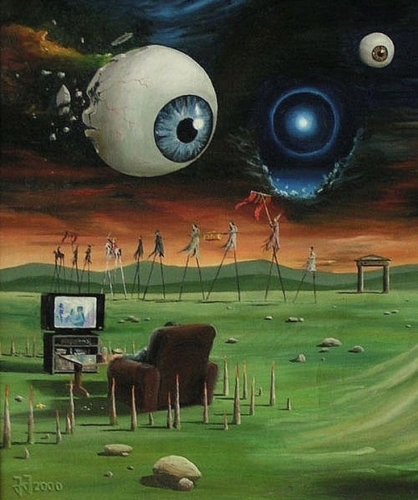
Une société qui a renoncé à délibérer publiquement sur les fins de la vie en commun n'élimine pas le conflit moral, mais le réintroduit sous la forme d'une gestion technocratique, d'une réglementation intensive ou d'une décision exceptionnelle (Mouffe, 2005 ; Schmitt, 1922/2005).
En ce sens, le libéralisme rawlsien ne fonctionne pas comme un rempart contre l'autoritarisme, mais comme l'un des cadres qui affaiblissent les défenses morales contre celui-ci. En réduisant la politique à la bonne application de procédures par des institutions supposées impartiales, il déplace la légitimité de l'orientation vers le bien commun vers la conformité à des règles abstraites (Williams, 1985).
Lorsque ces procédures cessent de générer la loyauté civique – en raison d'inégalités persistantes, de crises sécuritaires ou de fragmentation culturelle –, le procéduralisme manque de ressources internes pour se renouveler. Le vide normatif laissé par la neutralité est comblé par des formes de pouvoir qui promettent l'ordre, la décision et l'efficacité là où le libéralisme ne peut offrir que des garanties formelles (Deneen, 2018).
Les expressions contemporaines de l'illibéralisme et de l'autoritarisme démocratique formellement irréprochable ne doivent pas être comprises comme de simples régressions pré-libérales, mais comme des réponses symptomatiques à l'appauvrissement moral de l'ordre libéral.
Là où la justice a été réduite à une technique de stabilisation et la liberté à un choix sans orientation, la revendication de sens revient sous des formes plus brutales: décision sans délibération, autorité sans légitimité morale partagée, ordre sans justice substantive (Mouffe, 2018). La coercition apparaît alors comme un substitut à la persuasion morale que le libéralisme neutre lui-même a désactivée.
Bibliographie
Deneen, P. J. (2018). Why liberalism failed. Yale University Press.
MacIntyre, A. (1981). After virtue: A study in moral theory. University of Notre Dame Press.
MacIntyre, A. (1988). Whose justice? Which rationality? University of Notre Dame Press.
Mouffe, C. (2005). On the political. Routledge.
Mouffe, C. (2018). For a left populism. Verso.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Rawls, J. (1993). Political liberalism. Columbia University Press.
Sandel, M. J. (1982). Liberalism and the limits of justice. Cambridge University Press.
Sandel, M. J. (1998). Liberalism and the limits of justice (2nd ed.). Cambridge University Press.
Schmitt, C. (2005). Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty (G. Schwab, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1922)
Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity. Harvard University Press.
Taylor, C. (1992). The ethics of authenticity. Harvard University Press.
Taylor, C. (2007). A secular age. Harvard University Press.
Walzer, M. (1983). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Basic Books.
Williams, B. (1985). Ethics and the limits of philosophy. Harvard University Press.
Williams, B. (2005). In the beginning was the deed: Realism and moralism in political argument. Princeton University Press.
15:24 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john rawls, justice, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ésotérisme, néo-athéisme et Epstein
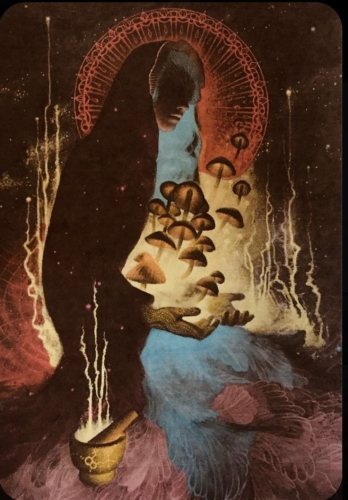
Ésotérisme, néo-athéisme et Epstein
par Bruna Frascolla
Source: https://telegra.ph/Esoterismo-neoateismo-ed-Epstein-02-19
Les documents Epstein ont révélé l'implication de figures de proue du néo-athéisme auprès du pédophile. Le néo-athéisme étant lié au sionisme, la relation entre Jeffrey Epstein, juif pratiquant, et le néo-athéisme ne peut se limiter à un soutien utilitaire visant exclusivement les découvertes scientifiques. Examinons les figures de proue du néo-athéisme.
 Le néo-athéisme, en tant que mouvement organisé et phénomène Internet, a émergé dans les années 2000. Il s'adressait à un public jeune, intéressé par la science et, en effet, il est difficile de trouver un vulgarisateur scientifique qui ne soit pas au moins agnostique. Cette catégorie, telle que nous la connaissons aujourd'hui – le vulgarisateur scientifique expert en médias – a probablement eu son premier représentant en la personne de Carl Sagan (1934-1996) (photo), un scientifique médiocre à la recherche d'OVNI qui avait un accès privilégié aux médias et se présentait comme une sorte d'incarnation de la rationalité, ce qui implique d'être un athée scientiste qui explique la religion comme une simple conséquence de l'ignorance et des peurs humaines. Cependant, ce grand prêtre de la rationalité s'est enthousiasmé pour le projet de la NASA visant à enseigner l'anglais aux dauphins sous l'influence du LSD et a même fondé l'« Ordre du Dauphin », une société secrète composée de scientifiques intéressés par les extraterrestres. Au lieu d'être un athée agressif (il convient de rappeler qu'il était américain et que les États-Unis ont des préjugés à l'égard des athées), Sagan a adopté une philosophie spinozienne et a cité Einstein. Il n'était donc qu'un athée juif parmi d'autres.
Le néo-athéisme, en tant que mouvement organisé et phénomène Internet, a émergé dans les années 2000. Il s'adressait à un public jeune, intéressé par la science et, en effet, il est difficile de trouver un vulgarisateur scientifique qui ne soit pas au moins agnostique. Cette catégorie, telle que nous la connaissons aujourd'hui – le vulgarisateur scientifique expert en médias – a probablement eu son premier représentant en la personne de Carl Sagan (1934-1996) (photo), un scientifique médiocre à la recherche d'OVNI qui avait un accès privilégié aux médias et se présentait comme une sorte d'incarnation de la rationalité, ce qui implique d'être un athée scientiste qui explique la religion comme une simple conséquence de l'ignorance et des peurs humaines. Cependant, ce grand prêtre de la rationalité s'est enthousiasmé pour le projet de la NASA visant à enseigner l'anglais aux dauphins sous l'influence du LSD et a même fondé l'« Ordre du Dauphin », une société secrète composée de scientifiques intéressés par les extraterrestres. Au lieu d'être un athée agressif (il convient de rappeler qu'il était américain et que les États-Unis ont des préjugés à l'égard des athées), Sagan a adopté une philosophie spinozienne et a cité Einstein. Il n'était donc qu'un athée juif parmi d'autres.
Les personnages principaux
Les étapes historiques du néo-athéisme sont éditoriales. En 2004, le jeune journaliste californien Sam Harris (né en 1967) a publié The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, une diatribe contre la « religion organisée » comme cause de tous les maux. Le livre fut un best-seller, un résultat impressionnant compte tenu du fait qu'il s'agissait des États-Unis, mais explicable par le traumatisme récent de l'attaque des tours jumelles. Selon l'argumentation du pionnier, le simple fait d'être religieux suffit pour commettre des attentats terroristes. En ce qui concerne son parcours religieux, Sam Harris est le fils d'un père quaker et d'une mère juive, ce qui fait de lui un juif selon la Halacha.
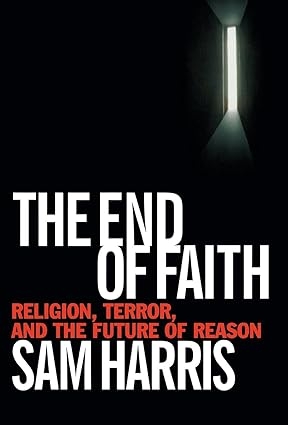 Il convient de noter que Sam Harris n'est pas un athée compatible avec le rationalisme typique des vulgarisateurs scientifiques, car il est adepte de l'ésotérisme, s'est ouvert à la « spiritualité » grâce aux drogues et s'est même rendu au Tibet pour étudier la méditation avec le Dalaï Lama. Peut-être que le problème de Harris réside exclusivement dans la « religion organisée », c'est-à-dire la religion avec des institutions et des doctrines solides, plutôt que dans les religions désorganisées qui vénèrent des gourous ésotériques. En 2009, après avoir atteint la célébrité, sa recherche de la moralité scientifique lui a valu un doctorat en neurosciences (pas en philosophie : en neurosciences !), mais il n'a pas poursuivi de carrière universitaire.
Il convient de noter que Sam Harris n'est pas un athée compatible avec le rationalisme typique des vulgarisateurs scientifiques, car il est adepte de l'ésotérisme, s'est ouvert à la « spiritualité » grâce aux drogues et s'est même rendu au Tibet pour étudier la méditation avec le Dalaï Lama. Peut-être que le problème de Harris réside exclusivement dans la « religion organisée », c'est-à-dire la religion avec des institutions et des doctrines solides, plutôt que dans les religions désorganisées qui vénèrent des gourous ésotériques. En 2009, après avoir atteint la célébrité, sa recherche de la moralité scientifique lui a valu un doctorat en neurosciences (pas en philosophie : en neurosciences !), mais il n'a pas poursuivi de carrière universitaire.
Le deuxième nom important dans la chronologie est celui de l'Anglais Richard Dawkins (né en 1949), professeur à Oxford, qui mène une vie indépendante de l'activisme athée. Dawkins incarne au mieux l'idéal du néo-athée : c'est un véritable scientifique avec une œuvre reconnue, il présente le darwinisme comme la preuve que la science contredit la religion (qu'il considère tacitement comme synonyme de créationnisme), il est athée depuis son adolescence et considère toutes les personnes religieuses comme des fanatiques.
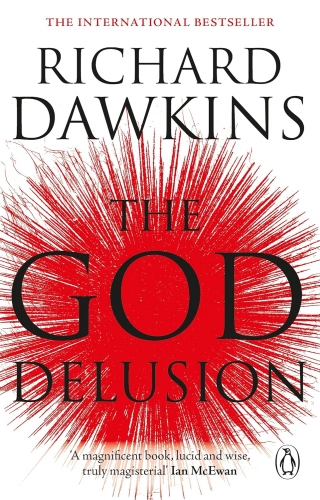 Après le succès éditorial de Sam Harris, l'éditeur a accepté sa vieille proposition d'écrire un livre contre la religion. En 2006, The God Delusion trouve éditeur, un livre radical selon lequel quiconque croit en Dieu est littéralement délirant. Quant à ses origines, Dawkins est né au Kenya britannique, fils de parents anglicans. C'est lui qui a lancé la mode de se définir comme « culturellement chrétien » ou « culturellement anglican » (Pinker se définit comme « culturellement juif ») – et puis on se demande comment un scientifique super-scientifique peut être culturellement délirant.
Après le succès éditorial de Sam Harris, l'éditeur a accepté sa vieille proposition d'écrire un livre contre la religion. En 2006, The God Delusion trouve éditeur, un livre radical selon lequel quiconque croit en Dieu est littéralement délirant. Quant à ses origines, Dawkins est né au Kenya britannique, fils de parents anglicans. C'est lui qui a lancé la mode de se définir comme « culturellement chrétien » ou « culturellement anglican » (Pinker se définit comme « culturellement juif ») – et puis on se demande comment un scientifique super-scientifique peut être culturellement délirant.
Le philosophe américain Daniel Dennett (1942-2024) est le personnage le plus intéressant quand on examine ses origines. Son père était titulaire d'un doctorat en études islamiques et il a passé son enfance au Liban parce que son père y travaillait pour l'OSS (un précurseur de la CIA). Le nom complet de Daniel Dennett était Daniel Clement Dennett III, et son père était Daniel Clement Dennett Jr. Il a écrit trois livres importants en rapport avec notre sujet: Consciousness Explained (1991), dans lequel il propose une explication matérialiste de l'esprit ou de l'âme (toute conscience et toute pensée coïncideraient avec l'activité cérébrale) ; Darwin’s Dangerous Idea (1995), qui fonde la moralité sur le darwinisme (en accord avec la thèse de Harris) ; et, pendant le phénomène du néo-athéisme, il a publié Breaking the Spell (2006), dans lequel il tente de trouver des explications évolutionnistes à l'existence de la religion.
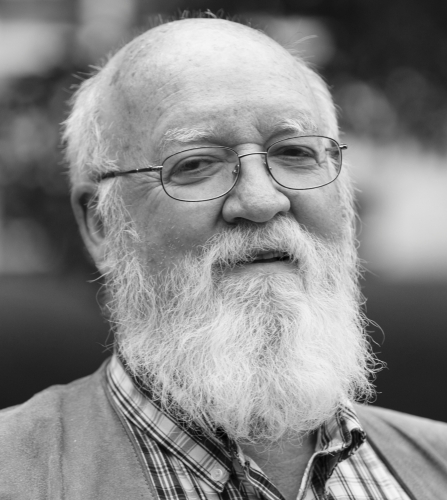 Dans ce livre, au lieu de se définir comme athée, il se déclare « bright » et encourage un mouvement appelé The Brights, composé de « naturalistes philosophiques ». Cela inclurait à la fois des athées radicaux comme Dawkins et des personnalités nuancées comme Einstein (Daniel Dennett, photo, ci-contre).
Dans ce livre, au lieu de se définir comme athée, il se déclare « bright » et encourage un mouvement appelé The Brights, composé de « naturalistes philosophiques ». Cela inclurait à la fois des athées radicaux comme Dawkins et des personnalités nuancées comme Einstein (Daniel Dennett, photo, ci-contre).
Enfin, il y a le journaliste anglais Christopher Hitchens (1949-2011). Il a suivi un parcours libéral de gauche pendant la majeure partie de sa vie, avec une parenthèse au sein du Parti travailliste et du trotskisme. Il était ami avec d'importantes figures de l'antisionisme tels qu'Edward Said, Israel Shahak et Noam Chomsky. Cependant, son parcours change en 2001, lorsqu'il soutient l'invasion de l'Irak, encouragé par l'attaque des tours jumelles. En 2007, en pleine vague de néo-athéisme, il publie God is Not Great, dans lequel il rejette la phrase arabe « Allahu Akbar ». Quant à ses origines, il a été élevé dans la religion chrétienne et ce n'est qu'à l'âge de 38 ans qu'il a découvert que sa mère était d'origine juive, après quoi il a commencé à s'identifier comme juif. Selon la nécrologie publiée par le magazine identitaire juif Tablet Mag, Hitchens considérait l'athéisme comme un remède juif pour éviter le totalitarisme. Dans le même article, nous apprenons que sa mère était une fanatique du New Age qui s'est suicidée avec son amant, un ancien pasteur qui l'avait conduite vers la secte d'un gourou indien. Loin de rejeter la folie comme un bon athée rationaliste, Hitchens considérait l'adhésion de sa mère à cette mode comme une caractéristique dialectique du judaïsme.

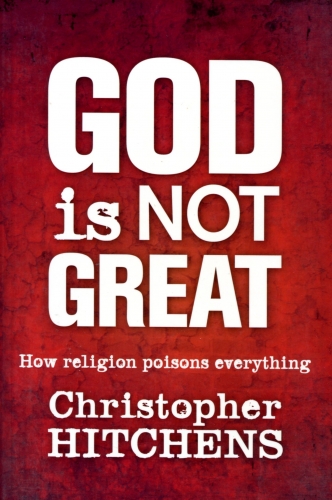
Considérations
Une chose qui m'a toujours frappé dans le néo-athéisme, c'est l'invraisemblance de sa thèse principale: que toutes les personnes religieuses sont ignorantes, et que seuls les athées sont scientifiques et intelligents. L'athéisme était très rare avant le siècle dernier, et le seul grand scientifique dont nous sachions qu'il était sans équivoque athée est Darwin. Le fait que cette idée se soit répandue dans le pays d'Isaac Newton est encore plus absurde, car ce génie scientifique, en plus d'être un exégète biblique obstiné enclin au mysticisme, était aussi une sorte de proto-créationniste, qui croyait en un Créateur expert en mathématiques et qui a inspiré les Boyle Lectures. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que le néo-athéisme visait à combattre le fantôme de Newton afin de séparer le christianisme de la science, en faisant croire aux gens que si l'on est chrétien, on est stupide. Si l'on est juif, cependant, il existe de nombreuses preuves scientifiques que le QI est lié à la race – preuves fournies, entre autres, par James Watson, prix Nobel et énième scientifique à apparaître dans les Epstein Files.
Eh bien, en regardant ces courtes biographies, je constate que seul l'un des « quatre cavaliers » correspond à l'image de l'athée sans équivoque qui méprise tout ce qui n'est pas un miroir. L'initiateur de cette tendance, Sam Harris, est un ésotériste qui croit que la science peut remplacer la religion en fournissant un guide moral scientifiquement correct. Il pourrait être considéré comme un spinoziste, un type qui croit que Dieu est la même chose que la nature. Hitchens considérait l'athéisme comme une vertu juive, son athéisme est donc lié à cette religion ethnique. Celui qui se rapproche le plus du radicalisme du gentil Dawkins est le tout aussi gentil Dennett. Tous deux partagent une agressivité darwinienne qui ne semble pas ouverte à la déification de la nature, que Darwin décrit comme un monde réel où règne la loi du plus fort. Cependant, Dennett suit l'aspect moins médiatisé de Darwin, qui considère la solidarité sociale comme un mécanisme évolutif de l'espèce : alors que Dawkins fragmente les individus pour parler d'un gène égoïste, Dennett préfère prêter attention à la sélection des collectivités altruistes. De plus, au lieu de se positionner simplement comme athée, il a préféré rejoindre un mouvement de brillants « naturalistes » autoproclamés. À l'exception de Dawkins, tous indiquent une zone ambiguë entre athéisme et déisme, ouvrant la voie à toute charlatanerie de type New Age dans laquelle on peut insérer des chiffres et affirmer qu'il s'agit de science. Rien de très différent de Sagan qui s'émerveille devant les dauphins sous l'effet du LSD.
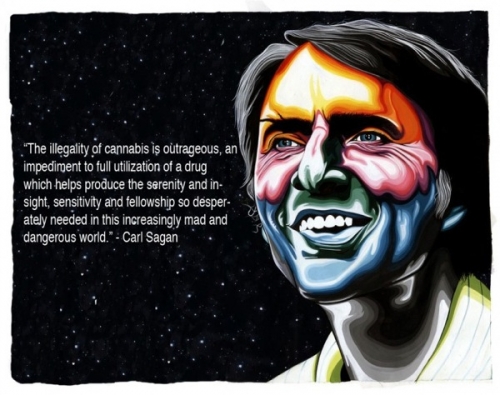
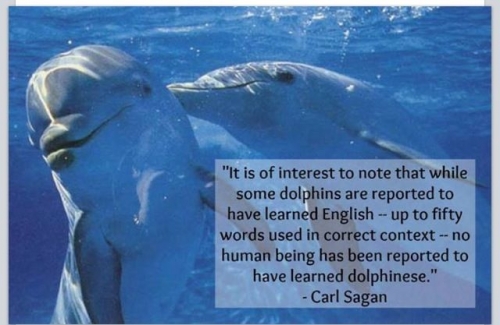
Or, la divinisation de la nature expliquerait également la vénération d'un juif religieux comme Epstein pour les mécanismes de la sélection naturelle. Il est courant de souligner la relation entre le calvinisme et le darwinisme en raison du concept de prédestination. Cependant, un déisme spinoziste et matérialiste conduirait à une divinisation du mécanisme même de la sélection naturelle.
Une question qui est un éléphant dans la pièce est le sionisme. D'un point de vue rationnel, le sionisme devrait être rejeté par les athées qui détestent la « religion organisée », car Israël est un État religieux fondé sur une promesse faite par Dieu à Abraham.
Cependant, les trois néo-athées ont pour habitude de se concentrer sur l'islam : c'est comme si Israël était un État laïc et que le conflit existait uniquement parce que les musulmans sont fanatiques, et non parce que leurs biens (ainsi que ceux des chrétiens) ont été volés. Dennett ne semble pas avoir commenté le sujet, mais il n'était pas très versé dans les médias. Hitchens, bien qu'il se définisse comme antisioniste et argumente sur la base du libéralisme, soutenait en pratique l'État d'Israël car il appuyait avec enthousiasme l'invasion de l'Irak. Les Juifs sont représentés comme des êtres rationnels et éclairés (même si le fanatisme religieux juif n'est pas absent en Israël) ; seuls les Palestiniens sont des personnes religieuses, obscurantistes et pleines de haine.
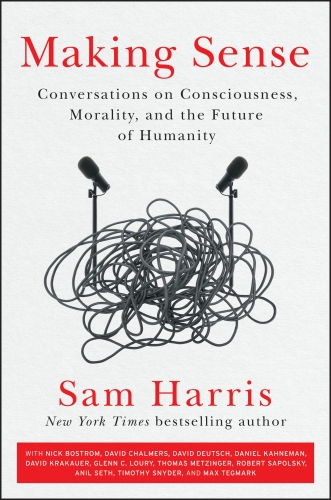 Et puisque Epstein nous a amenés à ce point, il convient de rappeler une fois de plus que deux des personnalités mentionnées se trouvaient à bord du Lolita Express d'Epstein (Dawkins et Dennett) et que Sam Harris a reçu des fonds d'Epstein pour son ONG d'athées qui se considèrent comme géniaux (Edge Foundation, ou Edge.Org).
Et puisque Epstein nous a amenés à ce point, il convient de rappeler une fois de plus que deux des personnalités mentionnées se trouvaient à bord du Lolita Express d'Epstein (Dawkins et Dennett) et que Sam Harris a reçu des fonds d'Epstein pour son ONG d'athées qui se considèrent comme géniaux (Edge Foundation, ou Edge.Org).
Nous avons également discuté des convictions d'Epstein dans un article précédent, et ici réapparaît le matérialisme psychique, qui fait de l'âme une chose matérielle située dans le cerveau, même si nous ne pouvons pas la voir. Dennett fournit les bases philosophiques de cette conviction. En ce qui concerne les correspondances avec la Renaissance, l'idée darwinienne d'une moralité inhérente à la nature trouve un précédent dans De rerum natura, car ce ne sont pas seulement les corps biologiques qui sont composés selon un ordre, mais aussi les corps sociopolitiques, qui se constituent spontanément et se désintègrent lorsqu'ils souffrent d'un désordre interne.
Un autre sujet intrigant que nous n'avons pas encore abordé (car je suis encore en train de me mettre à jour) est la tentative, pendant la Renaissance, de dépasser la division du christianisme occidental par une nouvelle religion fondée sur les révélations d'Hermès Trismégiste. Les hermétistes croyaient que Moïse, Pythagore et Platon s'étaient rendus en Égypte pour apprendre toute leur sagesse de ce personnage, Hermès. De cette manière, le christianisme aurait pu revenir à ses véritables racines avec le judaïsme, car Hermès était le maître de Moïse. C'est de là que proviennent l'hermétisme, la kabbale chrétienne et le début du mouvement occultiste.
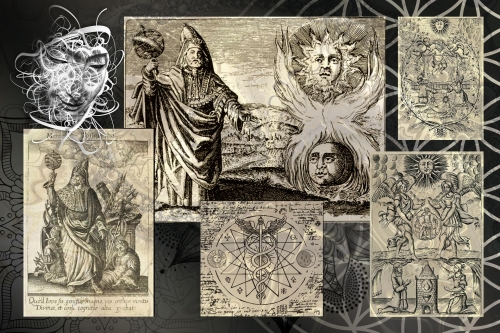
Enfin, une question demeure : si l'occultisme ne professe pas publiquement tout ce en quoi il croit, est-il possible que l'athéisme militant soit la couche exotérique d'une religion hermétique ? Se pourrait-il qu'avec l'essor du scientisme, le surnaturel (ou pré-naturel) ait été privatisé pour de petits cercles d'initiés qui fréquentent d'étranges fêtes dans des temples situés sur des îles privées, tandis que toutes les institutions affirment que rien de surnaturel n'existe ?
14:52 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ésotérisme, athéisme, néo-athéisme, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 février 2026
Le "Board of Peace" de Trump. Que faut-il en penser?

Le "Board of Peace" de Trump. Que faut-il en penser?
par Daniele Perra
Source : Daniele Perra & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/board-of-peace
Comme tout ce qui touche au « trumpisme », le « Board of Peace » semble voué à un échec (scientifiquement recherché) qui oscille entre le tragique et le ridicule. D'après les premières indiscrétions, la bande de Gaza serait divisée en cinq parties, chacune gérée par l'un des cinq pays qui ont actuellement accepté d'envoyer des troupes: le Kosovo, le Kazakhstan, l'Albanie, le Maroc et l'Indonésie. Ce sont tous des pays à majorité musulmane (ce qui, en théorie, devrait faciliter la coopération avec la population gazaouie). Cependant, aucun d'entre eux (à l'exception du Maroc et de l'Indonésie, mais dans une mesure limitée) n'a d'expérience dans la confrontation avec des groupes insurrectionnels armés. Au contraire, dans le cas de l'Albanie et du Kosovo (qui, entre autres, ne dispose même pas de véritables forces armées, étant un protectorat de l'OTAN), on peut ouvertement parler de soutien à des groupes terroristes. L'Albanie héberge le groupe terroriste iranien MeK ; le Kosovo est né de la lutte du groupe terroriste UCK, bien connu également pour le trafic de stupéfiants et d'êtres humains.
Il est donc peu probable qu'ils parviennent à convaincre le Hamas de déposer les armes.
Tout cela, bien sûr, au profit d'Israël qui se sentirait (à nouveau) autorisé à intervenir militairement (comme il le fait déjà, malgré le prétendu cessez-le-feu). Enfin, l'objectif fondamental ne semble pas du tout être la stabilisation, mais plutôt de créer le chaos dans le but précis de pousser les Palestiniens hors du territoire et de spéculer autant que possible. Dans ce sens, le rôle de plus en plus prépondérant du promoteur immobilier et gendre de Trump, Jared Kushner (fils de Charles Kushner, l'un des meilleurs «amis» de Netanyahu), dans les plans géopolitiques de la nouvelle administration Trump n'est pas surprenant. Après tout, ce rôle était déjà apparu avec force dans les dossiers Epstein.
14:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, donald trump, palestine, gaza, board of peace |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Iran est une petite Russie mais plus grande...

L'Iran est une petite Russie mais plus grande...
Cristi Pantelimon
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005135564621
La relation entre les États-Unis et l’Iran comporte tous les ingrédients du vieux nœud gordien. L'actuel Alexandre le Grand des États-Unis, Trump, n’a pas, en revanche, l’option de la force face à ce nœud complexe.
L’Iran n’est pas seulement soutenu par la Chine, mais il est aussi le symbole de la résistance de l’Eurasie face à l’ingérence américaine, qui, après l’Afghanistan, s’est de plus en plus affaiblie dans la région. De plus, l’Iran est le symbole de la résistance de l’islam face à Israël, ce qui complique énormément la tâche de Trump.
D’un côté, Trump a besoin d’Israël pour faire pression sur le monde arabe ; de l’autre, il a besoin du monde arabe (y compris l’Iran) pour diminuer la pression du lobby israélien aux États-Unis (tel que le définissent John Mearsheimer et d'autres). Un Israël remis à sa place lui garantirait une retraite honorable du front moyen-oriental, afin d’essayer un retour ailleurs (au Japon, en Australie, au Groenland?).
D’un autre côté, un Iran dans le camp sino-russe ne convient pas à long terme aux plans américains visant à étouffer partiellement l’économie chinoise.
Tel est l'actuel nœud gordien !
Trump n’a aucune option gagnante.
L’interview de Tucker Carlson avec l’ambassadeur Mike Huckabee est une tentative de faire pression sur Israël, dans le sens de dévoiler les tendances hégémoniques israéliennes dans la région, qui, bien sûr, attendent la réponse des Arabes/musulmans. Mais la situation générale de la région ne suit plus la symbolique politique habituelle.
Les États-Unis vont frapper dans le vide, comme l’année dernière ; Israël frappera pleinement quand il le pourra ; et l’Iran restera dans la sphère d’influence de la Chine.
Le nœud gordien ne se dénouera pas, et l’Asie ne cédera pas cette fois.
12:50 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, iran, eurasie, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 février 2026
Coup de gueule numérique: l'interdiction des réseaux sociaux enferme la jeunesse dans une chambre d’écho de gauche

Merz soutient les projets d’interdiction
Coup de gueule numérique: l'interdiction des réseaux sociaux enferme la jeunesse dans une chambre d’écho de gauche
Source: https://derstatus.at/politik/digitaler-maulkorb-social-me...
Le couvre-feu numérique pour les jeunes arrive-t-il ? Alors qu’on parle officiellement de protection, la suspicion grandit car il ne s’agit nullement d'une prévention de la dépendance, mais d'un contrôle, d'un monopole de l’interprétation et d'une influence politique généralisée sur toute une génération. Et d’une surveillance potentielle de tous les citoyens comme “effet secondaire utile”.
Le gouvernement discute d’une interdiction graduelle
En Allemagne aussi, une interdiction progressive des médias sociaux pour les enfants et les jeunes est à l’étude. Le prétexte: prétendument “protéger les jeunes contre la dépendance, le stress psychique, la haine et la désinformation”. La SPD a présenté à la mi-février 2026 un document pour impulsion au projet. Le parti socialiste exige une interdiction totale pour les enfants de moins de 14 ans, avec un blocage technique d’accès par les plateformes, sous peine de sanctions allant jusqu’au blocage du réseau. Pour les 14-16 ans, une “version jeunesse” obligatoire doit être instaurée: sans recommandations algorithmiques, sans défilement infini ni systèmes de récompense, avec une vérification obligatoire de l'âge.
La CDU a discuté, lors de son congrès, la proposition du Land du Schleswig-Holstein. Celle-ci prévoit un âge minimum légal de 16 ans pour les plateformes ouvertes telles qu’Instagram, TikTok ou Facebook, avec vérification obligatoire de l'âge. Il existe un large soutien pour cette proposition, mais certains prônent une régulation plutôt qu’une interdiction totale. Le chancelier Friedrich Merz a exprimé dans le podcast “Machtwechsel” “beaucoup de sympathie” pour les deux propositions. Il a souligné que beaucoup de jeunes adolescents de 14 ans sont en ligne jusqu’à cinq heures par jour. Cela nuirait, selon lui, à la socialisation, à la concentration et au développement de la personnalité. Lui aussi avance la “protection des enfants” pour se justifier par un motif louable.
Imposer une chambre d’écho: tel est le calcul politique
Le danger réside dans le fait que de nombreux citoyens pourraient percevoir cette initiative comme une “bonne” mesure visant la protection de l’enfance. En Autriche, où une mesure similaire est envisagée, le système produit facilement des sondages suggérant qu'une majorité de citoyens soutient le projet. Mais, du point de vue populiste et patriotique, il ne faut en aucun cas approuver tout cela sans émettre de critique. Même à des fins électorales. Car, depuis la campagne pour les élections européennes, l’idée qu’il pourrait y avoir une stratégie politique derrière ce "beau projet" ne constitue plus une théorie du complot.

Lors de cette campagne électorale, l’AfD a particulièrement gagné des suffrages auprès des jeunes électeurs, et même l’opposition soulignait, entre autres choses, l’efficacité de leur offensive sur TikTok & Co. La capacité de l'AfD, malgré l'environnement parfois très à gauche dans lequel baignent les jeunes en subissant une propagande constante qui prône des idées “woke”, à atteindre les jeunes avec des contenus patriotiques et critiques du système s'avère particulièrement menaçante pour les élites au pouvoir. Sans internet, beaucoup de jeunes seraient enfermés dans une chambre d’écho de gauche, qui, dans le pire des cas, serait composée d'une famille aux idées de gauche, de camarades de classe campés à gauche et de professeurs militants de gauche.
Si on prive désormais les jeunes de la possibilité de s’informer en dehors des médias mainstream, on étouffe dans l’œuf leur contestation potentielle des narratifs dominants. Toute opposition à l'hégémonie en place de la part des jeunes serait rapidement reléguée au rang d'une simple rébellion juvénile fortuite. Que les médias sociaux puissent être une arme à double tranchant n’est rien de nouveau. Le danger qu'il y a à être exposé pendant de longues heures de loisirs improductifs et psychiquement destructeurs ne peut être nié. Mais ces médias sociaux restent aussi, pour l’instant, les seuls moyens pertinents pour transmettre aux jeunes des idées d’opposition sans qu'ils aient à subir le filtre méprisant du mainstream.
Briser la bulle d’échos de gauche
De plus, chacun doit être conscient qu’une vérification de l’âge donnerait aux gouvernants encore plus de pouvoir sur ce qui est écrit en ligne, puisqu’il faudrait déposer ses pièces d’identité. Et cela signifie, dans le pire des cas, que même les personnes de 80 ans devraient prouver qu’elles ont en réalité plus de 14 ans. Rappelons que des raids policiers ont déjà eu lieu à cause de memes inoffensifs en ligne, dans un réseau partiellement anonyme, ce qui constitue un nouveau levier pour faire fuir les personnes politiquement indésirables sur Internet.
Le fait que les revendications pour une telle interdiction s’intensifient presque simultanément dans tout l’Occident, surtout lorsque les élites perdent leur contrôle politique, doit faire retentir tous les signaux d'alarme. Cela ressemble à une synchronisation concertée pour nuire à l’opposition contre les élites souvent mondialistes et pour reprendre le pouvoir d’interprétation. Justement celles que l’on a commencé à perdre lors des récentes manifestations de “gilets jaunes” – ou des protestations contre la crise migratoire, le coronaturlutuvirus et la guerre en Ukraine.
+++ Suivez-nous sur Telegram : t.me/DerStatus & sur Twitter/X : @derStatus_at +++
13:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, affaires européennes, réseaux sociaux, censure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Parution du numéro 75 de War Raok
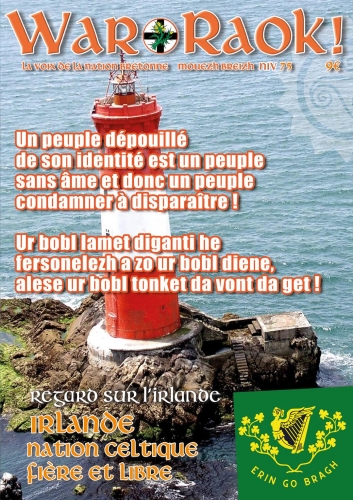
Parution du numéro 75 de War Raok
EDITORIAL
Bientôt une messe de requiem ?
Le titre va très certainement vous interpeller ? Oui, sans aucun doute. Maintenant voici la question que vous allez vous poser : qui peut bien être l’illustre personnage, l’illustre défunt méritant un tel hommage ? Un tel honneur au point de lui dédier une messe de requiem ! Illustre n’est peut-être pas le terme exact : voyou, malfrat, usurpateur, autocrate, violent serait plus adapté… Rassurez-vous notre filou est toujours parmi nous, toujours présent, toujours aussi nocif même s’il se trouve en phase terminale et que son pronostic vital est engagé. Il n’est pas question, et je dirais même que c’est hors de propos, de souhaiter la mort d’un malade en fin de vie. Laissons le mourir, s’éteindre lentement… mais aucune pitié, aucune compassion pour un être qui a tant fait souffrir mon peuple.
Un peu de patience pour la messe de requiem
Vous avez peut-être enfin reconnu notre mystérieux agonisant ? Eh oui, il s’agit bien de la république française et de ses bas-fonds, de son État, État malfaisant qui a privé et prive toujours le peuple breton de ses libertés fondamentales, mais également les peuples basque, corse, catalan, occitan, flamand… peuples qu’il n’a même pas la décence de reconnaître officiellement ! Une exception en Europe faut-il le souligner !
Héritier et fier de sa révolution bolchevique de 1789, (révolution honorée tant par la gauche que par la droite française soit dit en passant), cet État français a fait couler les larmes, le sang dans une logique à la fois impérialiste et totalitaire.
Ah elle est belle cette France des lumières, France patrie des Droits de l’homme et des libertés, de la démocratie, ou plutôt devrais-je dire de la démocratie raréfiée ! France qui ose constamment, sans aucune gêne, sans aucune pudeur s’arroger, s’approprier et clamer le célèbre principe « des peuples à disposer d’eux-mêmes » et le refuser aux peuples qu’elle maintient arbitrairement sous tutelle ! Peuples privés de toute existence légale et de vie nationale. La vision de la France reste une vision hégémonique, coloniale, une vision figée qui n’aspire qu’à la domination. La France a bâillonné la Bretagne, vieille nation souveraine pendant plus de dix siècles. Elle a effacé son histoire, piétiné sa culture, interdit sa nationalité, miné ses institutions, confisqué son identité... La France, mythe, fausse religion ne nous a apporté ni civilisation, ni progrès mais uniquement un total asservissement.
Aujourd’hui, elle est devenue la France des bougies ! Les lumières sont éteintes.

Ouvrir les pages de War Raok, c’est un peu comme « on arme un fusil » !
Cet éditorial est le premier de l’année 2026 et la revue, qui fête ses 26 années de parution, tient à rester fidèle à sa ligne politique, à la défense des libertés bretonnes, à l’autodétermination du peuple breton et se veut une véritable ligne de faille, une brèche dans la coque d’une Europe aujourd’hui malade et agonisante. En écartant systématiquement les imposteurs, aucune haine, aucun esprit de revanche, aucun propos violents, injurieux ou déplacés, mais des analyses, des articles pertinents et sérieux pour informer le lecteur et forger ainsi de futurs sympathisants, voire militants à la cause nationale bretonne. Il est malheureusement fort regrettable que certains continuent de refuser de faire face à la réalité, préférant la fuite, s’obstinant encore à jouer dans un bac à sable et se voilant la face. Ne pas ôter ce voile… c’est se mentir à soi-même.
Padrig MONTAUZIER, directeur de publication.
* * *
SOMMAIRE de WAR RAOK n°75
Buhezegezh vreizh, page 2
Éditorial, page 3
Buan ha Buan, page 4
Tribune libre
La Vallée des Saints : un rêve brisé, page 10

Politique
La gauche, la droite... la liberté, la démocratie !, page 12
L’impertinence de la démocratie parlementaire, page 13
Chroniques bretonnes
Aux origines de l'hermine, page 16
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton, page 19

Un regard sur l’Irlande, page 23-31
Mythologie, gaélique, culture, éducation,
immigration, nationalisme…
Tradition
Des célébrations de Samhain à Halloween, page 32
Histoire de Bretagne
L’Édit du Plessis-Macé, page 34

Nature
Le courlis cendré, page 36
Lip-e-bav
Recette végétarienne de la galette bretonne, page 37

Keleier ar Vro
La mémoire de l’abbé Marcel Blanchard attaquée, page 38
Bretagne sacrée
Le tombeau de Saint-Lénard, page 39.
12:59 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bretagne, irlande, pays celtiques, revue, terroirs, racines, régions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Connaissiez-vous Mario Merlino?
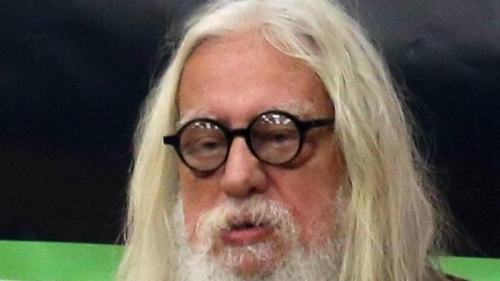
Connaissiez-vous Mario Merlino?
par Georges Feltin-Tracol
Le 4 février 2026 à Rome décède à l’âge de 81 ans Mario Merlino. Inconnu en France, ce militant a su ouvrir des perspectives originales sinon durables en politique.
Né à Rome le 2 juin 1944, Mario Merlino grandit au sein d’une famille fasciste. Inscrit à l’université de la capitale italienne, il adhère très tôt au FUAN (Front universitaire d’action nationale), la branche étudiante du MSI (Mouvement social italien) qu’il intègre en 1962. Il adopte aussitôt la ligne d’opposition interne de Giorgio Almirante (1914 - 1988).
Contrairement aux clichés paresseux véhiculés par une presse en mal de sensations fortes, le MSI n’a jamais été une formation monolithique. Diverses sensibilités antagonistes le traversent dès sa fondation. Outre une tendance monarchiste qui tend vers la droite de la démocratie chrétienne, on recense selon les années la faction droitière d’Arturo Michelini (1909 - 1969), la tendance révolutionnaire de Giorgio Almirante, l’aile socialiste nationale du géographe et géopoliticien Ernesto Massi (1909 - 1997) et la faction nationaliste-révolutionnaire d’obédience évolienne de Pino Rauti (1926 - 2012). De 1954 à 1969, Michelini s’impose en homme fort du MSI. Son programme conservateur – libéral et atlantiste agace Merlino. Il quitte le MSI en 1965 et se rallie d’abord au Centre d’étude Ordre Nouveau de Pino Rauti. Puis, à la demande de son vieil ami Stefano Della Chiaie (1936 – 2019), il se tourne vers Avanguardia Nazionale (« Avant-garde nationale »).

À la fin de la décennie 1960, l’Italie entre dans une période d’agitation marquée par un regain d’activisme de la part des nationalistes et des gauchistes. Les heurts se multiplient dans toute la péninsule. Mario Merlino contribue par exemple à la « bataille de Valle Giulia » (photo), le 1er mars 1968, prémices des « Années de plomb ». Ce jour-là, les étudiants néo-fascistes et gauchistes font cause commune et affrontent les policiers. Si l’extrême gauche occupe dans la foulée la faculté des Lettres, le FUAN s’empare de la faculté de Droit. Fait intéressant, suite à cet événement, l’écrivain, poète et réalisateur communiste Pier Paolo Pasolini applaudit l’action de la police et dénigre en revanche les étudiants.
Mario Merlino se rend quelques semaines en Grèce alors dirigée par les colonels. Ce qu’il y observe ne l’enchante guère. La présence informelle, mais réelle, de la CIA le dérange; il ne peut pas approuver le maintien du capitalisme atlantiste aux portes du « Rideau de Fer » alors qu’il réclame un dialogue méditerranéen ainsi qu’une entente géopolitique avec les gouvernements nationalistes arabes.
La coopération soudaine, momentanée et inattendue entre néo-fascistes et gauchistes amène Mario Merlino à s’infiltrer dans le Cercle Bakounine riche en activistes anarchistes. En référence aux événements du 22 mars 1968 à Nanterre, il fonde en octobre 1969, à la suite du Cercle Bakounine, le Cercle du 22 mars où se rencontrent des néo-fascistes et des anarchistes. Ce cercle a une durée éphémère. Les autorités italiennes l’accusent bientôt de terrorisme après l’explosion de trois bombes à Rome en décembre 1969. Arrêté, il passe trois ans en détention préventive. En février 1979, la cour d’assises le condamne à quatre ans de prison pour « association subversive ». L’appel confirme cette condamnation. Mais cette dernière sentence est à son tour cassée en 1985. En 1987, la Cour suprême italienne acquitte définitivement Mario Merlino.
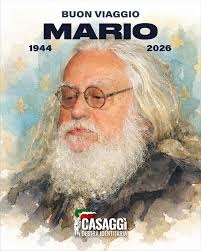 Traducteur de Robert Brasillach, auteur de pièces de théâtre inspirées par l’écrivain japonais Yukio Mishima, Mario Merlino enseigne l’histoire et la philosophie dans un lycée scientifique romain. Au cours de ces années effrénées, Mario Merlino conçoit une théorie politique paradoxale, voire oxymorique : l’anarcho-fascisme qu’il ne faut surtout pas confondre avec le national-anarchisme pensé et promu par le Britannique Troy Southgate, l’Allemand Peter Töpfer, le Néerlandais Tim Mudde et le Français Hans Cany.
Traducteur de Robert Brasillach, auteur de pièces de théâtre inspirées par l’écrivain japonais Yukio Mishima, Mario Merlino enseigne l’histoire et la philosophie dans un lycée scientifique romain. Au cours de ces années effrénées, Mario Merlino conçoit une théorie politique paradoxale, voire oxymorique : l’anarcho-fascisme qu’il ne faut surtout pas confondre avec le national-anarchisme pensé et promu par le Britannique Troy Southgate, l’Allemand Peter Töpfer, le Néerlandais Tim Mudde et le Français Hans Cany.
Ce rapprochement n’est cependant pas incongru pour la scène politique italienne où œuvre le « transformisme » politico-parlementaire. Le plus éclatant demeure les manœuvres du président de la région autonome de Sicile, Silvio Milazzo (1903 – 1982). Soucieux d’accéder à cette fonction, l’élu démocrate-chrétien négocie avec les responsables régionaux du MSI et du PCI. Le 30 octobre 1958, il obtient ce poste grâce à leurs voix. Ce choix commun suscite l’indignation des démocrates-chrétiens et de l’Église catholique. Elle a reçu l’approbation préalable de Palmiro Togliatti, secrétaire du PCI, de Giorgio Almirante et de Domenico Leccisi (1920 – 2008), fondateur du fugace et clandestin Parti démocratique fasciste (1945 – 1946), favorable à la démocratie organique.
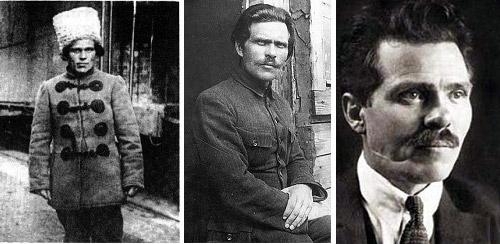
« Fanatisme de la liberté intégrale », l’anarchisme est une bien mauvaise appellation comme d’ailleurs son synonyme peu usité, l’acratie. Les préfixes privatifs a- et an- ne doivent toutefois pas effacer la réalité de l’archie (arkhê) et de la cratie (kratos), facteurs consubstantiels à la vie humaine en collectivité. Comment l’anarchisme qui postule l’absence d’État peut-il s’associer au fascisme qui fait de l’État la clé de voûte du cadre social ? Du point de vue fasciste, l’anarchisme serait plus proche du national-socialisme qui envisage, lui aussi, le dépérissement de l’État au profit de la communauté holiste de peuple ethnique malgré une bureaucratie nihiliste d’ampleur inégalée vers 1944 – 1945 sans oublier le caractère polycratique et charismatique du régime hitlérien. Mario Merlino estime que des précédents historiques démontrent la propension des anarchistes engagés à la discipline collective. Il fait référence à la Commune de Paris en 1871, à la révolte de Kronstadt en 1921, à l’épopée militaire de Nestor Makhno (1888 - 1934) (photos), chef de l’« Armée verte » (ou Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne) pendant la guerre civile russe ou à la « Colonne Durruti » de Buenaventura Durruti (1896 - 1936) en pleine Guerre d’Espagne. On pourrait aussi comprendre Pierre-Joseph Proudhon (1809 – 1865) et son fédéralisme mutualiste comme un corporatisme égalitaire à rebours des corporations hiérarchisées traditionnelles. En fait, la principale convergence entre le fascisme et l’anarchisme demeure certainement l’insistance accordée à l’action directe, ce qui ferait de Georges Sorel (1847 – 1922), l’auteur des Réflexions sur la violence en 1908, le penseur-modèle de l’anarcho-fascisme… La thèse est vraiment osée.
Plus prosaïquement, Mario Merlino cherchait à recruter de jeunes anarchistes virulents afin de les attirer vers un néo-fascisme révolutionnaire anti-bourgeois et ainsi mettre à bas un régime détestable et détesté, à savoir la République italienne élevée sur les ruines fumantes du Ventennio. L’anarcho-fascisme s’apparente à une autre agrégation politique anti-Système originaire des marges militantes: le phénomène « nazi-maoïste » autour de l’action et des écrits de l’éditeur dissident Franco Freda.
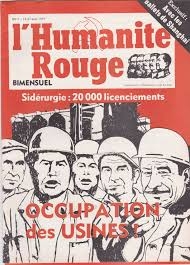 On retrouve des situations semblables dans la France des années 1970 quand les rédacteurs maoïstes de L’Humanité rouge, l’organe officiel du PCMLF (Parti communiste marxiste-léniniste de France), combattent les campagnes trotskystes anti-militaristes, approuvent le programme nucléaire français et soutiennent la réunification de l’Allemagne devenue neutraliste. En Allemagne, le KPD (Parti communiste allemand) adopte un tournant nationaliste en 1932 et s’ouvre à certains membres des SA (Sections d’assaut) déjà déçus par le renoncement implicite des objectifs socialistes du national-socialisme. Dans les dernières années de sa courte vie, le meneur de la contestation étudiante ouest-allemande, Rudi Dutschke (1940 - 1979), prend des positions nationales-neutralistes en faveur de la réunification allemande. D’abord exilé à Cuba pour cause d’activités révolutionnaires, Günter Maschke (1943 – 2022) retourne en Allemagne révolutionnaire-conservateur et va se consacrer à l’étude magistrale de l’œuvre de Carl Schmitt. Enfin, l’inventeur de l’ethno-différentialisme, Henning Eichberg (1942 - 2017), adhère sous l’impulsion de sa seconde épouse au Parti populaire socialiste danois (SF).
On retrouve des situations semblables dans la France des années 1970 quand les rédacteurs maoïstes de L’Humanité rouge, l’organe officiel du PCMLF (Parti communiste marxiste-léniniste de France), combattent les campagnes trotskystes anti-militaristes, approuvent le programme nucléaire français et soutiennent la réunification de l’Allemagne devenue neutraliste. En Allemagne, le KPD (Parti communiste allemand) adopte un tournant nationaliste en 1932 et s’ouvre à certains membres des SA (Sections d’assaut) déjà déçus par le renoncement implicite des objectifs socialistes du national-socialisme. Dans les dernières années de sa courte vie, le meneur de la contestation étudiante ouest-allemande, Rudi Dutschke (1940 - 1979), prend des positions nationales-neutralistes en faveur de la réunification allemande. D’abord exilé à Cuba pour cause d’activités révolutionnaires, Günter Maschke (1943 – 2022) retourne en Allemagne révolutionnaire-conservateur et va se consacrer à l’étude magistrale de l’œuvre de Carl Schmitt. Enfin, l’inventeur de l’ethno-différentialisme, Henning Eichberg (1942 - 2017), adhère sous l’impulsion de sa seconde épouse au Parti populaire socialiste danois (SF).
En 2014, Mario Merlino salue la révolte de l’Euromaïdan et les initiatives du Secteur Droit. Il enjoint néanmoins les Ukrainiens à rejeter toute influence de l’Union dite européenne. Plus que jamais, il réclame une Europe des peuples libérée de la tutelle des financiers et de la bureaucratie parasitaire. Sa pensée radicale ne l’empêche pas de s’exprimer devant les cénacles de l’Alliance nationale et de Forza Nuova (« Force nouvelle »). Mario Merlino restera très probablement dans l’histoire des idées comme le partisan de la complémentarité entre le fascisme et l’anarchisme, le précurseur d’une troisième voie anticonformiste, l’exceptionnel ordonnateur de l’alliance entre le Feu et la Glace.
GF-T
« Vigie d’un monde en ébullition », n° 182, mise en ligne le 19 février 2026 sur Radio Méridien Zéro.
12:39 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, mario merlino, italie, anarcho-fascisme, anarchisme, msi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 février 2026
Lors d'une réunion informelle de l'UE à Larnaca, l'Irlande demande davantage d'efforts pour la remigration…

Lors d'une réunion informelle de l'UE à Larnaca, l'Irlande demande davantage d'efforts pour la remigration…
Peter Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
Vous n’en avez rien lu ni entendu dans nos médias mainstream flamands, l’intérêt était apparemment « modéré », comme il se doit. Mais lors d’un sommet informel de l’UE à Larnaca (Chypre), où tous les ministres de la Justice et de l’Intérieur des États membres de l’UE se sont réunis le 23 janvier pour discuter notamment de migration et de la lutte contre la migration illégale, le ministre irlandais Niall Collins a plaidé de manière argumentée pour une politique de retour plus forte et plus ferme, en d’autres termes, la remigration.

Niall Collins est ministre du parti de centre-droit Fianna Fáil, et en tant que membre du gouvernement irlandais, il est responsable du Droit international, des réformes juridiques et de la Justice en ce qui concerne la jeunesse. En Chypre, il a suscité l’émoi en plaidant «pour une politique durable de retour et de réintégration», toujours dans le plein respect des droits de l’homme. «Nous devons accélérer considérablement le rythme du retour», a déclaré Collins. Il ne s’agit pas seulement des étrangers ayant commis de graves crimes, mais aussi de ceux qui mettent en danger la sécurité du pays d’accueil.
L’Irlande dépense jusqu’à 10.000 euros par famille qui retourne
Cela ne se limite pas à de simples souhaits politiques: depuis l’automne 2025, Niall Collins a augmenté les primes pour le retour volontaire en Irlande. La petite île verte «encourage les demandeurs d’asile à retirer leur demande d’asile pendant le traitement de leur dossier, à quitter l’île et à retourner dans leur pays d’origine. En échange, une aide financière de 2500 euros par personne est proposée, jusqu’à 10.000 euros maximum pour une famille entière», rapporte InfoMigrants.
 InfoMigrants est une filiale de France Médias Monde et de la chaîne publique allemande Deutsche Welle
InfoMigrants est une filiale de France Médias Monde et de la chaîne publique allemande Deutsche Welle
Pour les migrants qui sont en procédure d’appel (c’est-à-dire qui ont fait appel contre le rejet de leur demande d’asile par les autorités irlandaises) et qui retournent volontairement, les aides financières sont limitées à 1500 euros par personne et à 6000 euros maximum par famille. «Ce soutien est essentiel pour faciliter financièrement l’intégration dans le pays d’origine», explique le ministre Niall Collins. «Ainsi, nous pourrons certainement augmenter le nombre de remigrants».
Pourquoi nos médias mainstream restent-ils si silencieux à ce sujet? Ce n’est pas parce que de plus en plus d’États membres abandonnent progressivement l’«axiome des frontières ouvertes»? Ce n’est tout de même pas parce que le ministre irlandais plaide pour une politique de remigration...?
20:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, niall collins, fianna fail, irlande, europe, affaires européennes, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Noomachie comme alchimie politique selon Evgueni Golovine

La Noomachie comme alchimie politique selon Evgueni Golovine
Martin Kovac
Bron: https://www.facebook.com/martin.kovac.3511
L'œuvre monumentale de Douguine, Noomachie (la Guerre des logos), n'est pas seulement une théorie des relations internationales, mais une tentative d'opérations magiques à l'échelle des civilisations. En y regardant de plus près, on constate que l'architecture de ce temple de la pensée est une systématisation des visions ésotériques de « l'Amiral » de l'underground soviétique, Evgueni Golovine.

La guerre qui précède l'histoire
Pour l'homme moderne, la guerre est un conflit pour les ressources, les territoires ou les sphères d'influence. Pour Alexandre Douguine, la véritable guerre ne se déroule pas sur le terrain, mais dans le Nous – dans l'Intellect. Le concept de Noomachie chez Douguine repose sur l'hypothèse qu'il n'existe pas une seule vérité ni un seul esprit humain. Il y a trois « Logos » inconciliables – trois façons de créer le monde – qui s'affrontent dans une lutte éternelle à la mort et à la vie.
L'histoire n'est pas un progrès linéaire de la barbarie aux Lumières, mais un drame cyclique où domine l'un de ces principes. Pour comprendre ce conflit métaphysique, il faut revenir aux idées du Cercle Južinskij (Youjinski).

Evgueni Golovine et Alexandre Douguine en 2003.
La figure centrale de ce groupe, auquel Alexandre Douguine a adhéré en 1980, était Evgueni Golovine (1938–2010). Poète, alchimiste et mystique, surnommé « l'Amiral » par ses disciples, il était le centre silencieux d'une tempête intellectuelle. C'est lui qui a apporté au cercle les idées de l'ésotérisme traditionnel, de l'alchimie et du mythe de l'Hyperborée – la patrie originelle de l'esprit du Nord. Pour Golovine, le monde n'était pas une «réalité objective», mais un texte ou une alchimie à retentir, qu'il faut lire ou briser correctement.
Trois Logos : Apollon, Cybèle et Dionysos
La Noomachie de Douguine repose sur une triade, qui est une application directe des leçons hermétiques de Golovine sur l'histoire de la philosophie:

- Logos d'Apollon (Père Céleste): lumière, verticalité, ordre, distance. C'est le monde des idées platoniciennes, où l'essentiel est en haut et la matière en bas n'est qu'une ombre. C'est le principe de « l'exclusion » – la vérité n'est qu'une.

- Logos de Cybèle (Grande Mère) : obscurité, horizontalité, matière, chair. C'est le monde du matérialisme, où « tout vient d'en bas ». L'homme n'est qu'un animal intelligent, l'esprit n'est qu'une chimie du cerveau. Cybèle gouverne par la masse, le marché et la technologie.

- Logos de Dionysos (Logos Obscur) : la clé se trouve ici. Dionysos est l'intermédiaire. Il n'est ni la lumière stérile d'Apollon, ni la boue de Cybèle. C'est le « soleil de minuit », un dieu qui meurt et ressuscite. C'est le principe du paradoxe.
Le diagnostic de la modernité chez Douguine est impitoyable: nous vivons à l'époque du Triomphe de Cybèle. La civilisation occidentale, le libéralisme, le capitalisme et le matérialisme scientifique sont des manifestations de la domination du Logos Noir de la Mère Terre. L'esprit a été englouti par la matière. La verticalité a été renversée et remplacée par l'horizontalité.
L'alchimie de l'eau noire: la clé de Golovine
L'originalité de la conception de Douguine – et l'endroit où elle correspond le plus avec celle de Golovine – réside dans la distinction entre « Ténébreux » et « Noir ». La plupart des penseurs occidentaux (y compris Nietzsche) avaient tendance à tout jeter dans un même sac, irraisonnable et ténébreux. Golovine enseignait cependant une fine distinction d'ordre alchimique. Il y a la Nigredo – le noir fécond, l'obscurité de la terre dont naît la vie (Dionysos). Et il y a l'Aqua Nigra – l'eau noire, liquide putréfié qui dissout les formes et mène à la destruction de l'esprit dans la boue de la matière. Golovine soutenait que la modernité n'était pas dionysiaque (comme certains romantiques le pensaient), mais une magie de l'Aqua Nigra. C'est un processus de décomposition, non d'extase. Douguine a emprunté cette idée pour purifier Dionysos. La Russie, dans son rôle géopolitique, ne doit pas être « l'empire de la lumière » (ce qui serait naïf), mais le porteur d'une force capable de descendre dans l'enfer de la modernité sans s'y dissoudre.

Reine des Neiges et Sujet Radical
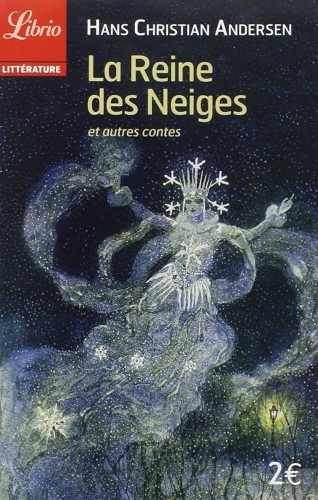 L'apogée de cette référence ésotérique est le concept de « Sujet Radical », que Douguine a tiré de l'interprétation de Golovine de la Reine des Neiges d'Andersen. Golovine inverse la signification de cette histoire: la Reine des Neiges n'est pas un mal absolu. Elle symbolise l'Intellect pur, cristallin, de l'Extrême Nord. Le petit Kay, dont un éclat de miroir a pénétré l'œil, ne voit pas le monde « déformé », comme le prétend le conte. Il le voit véritablement – il perçoit le vide et la laideur du monde bourgeois et chaud des hommes (le monde de Cybèle). Gerda, qui le « sauve » avec ses larmes et sa chaleur, le ramène en réalité dans la boue de la banalité, dans le monde des « couples et de la bière ». Le porteur du « Sujet Radical » est celui qui porte dans son cœur un éclat glacial du Nord. C'est l'homme qui refuse le diktat de la matière, du confort et des valeurs libérales. C'est l'aristocrate de l'esprit au milieu du marché.
L'apogée de cette référence ésotérique est le concept de « Sujet Radical », que Douguine a tiré de l'interprétation de Golovine de la Reine des Neiges d'Andersen. Golovine inverse la signification de cette histoire: la Reine des Neiges n'est pas un mal absolu. Elle symbolise l'Intellect pur, cristallin, de l'Extrême Nord. Le petit Kay, dont un éclat de miroir a pénétré l'œil, ne voit pas le monde « déformé », comme le prétend le conte. Il le voit véritablement – il perçoit le vide et la laideur du monde bourgeois et chaud des hommes (le monde de Cybèle). Gerda, qui le « sauve » avec ses larmes et sa chaleur, le ramène en réalité dans la boue de la banalité, dans le monde des « couples et de la bière ». Le porteur du « Sujet Radical » est celui qui porte dans son cœur un éclat glacial du Nord. C'est l'homme qui refuse le diktat de la matière, du confort et des valeurs libérales. C'est l'aristocrate de l'esprit au milieu du marché.
Conclusion: la politique comme magie noire
La Noomachie révèle que le projet politique de Douguine (la Quatrième Théorie Politique) n'est pas une science politique, mais une théologie de la guerre. Douguine a rassemblé les perles hermétiques de son maître Golovine – destinées à un cercle restreint d'initiés – et, avec celles-ci, il a forgé une arme. Tandis que Golovine restait « Amiral » du navire qui naviguait sur les eaux du monde et ignorait totalement le monde politique, sans même chercher à le changer, Douguine a décidé d'y faire couler cette «eau noire». Sa lutte contre «l'Occident» est essentiellement une tentative d'expulser Cybèle, une gigantomachie, une collision entre continents invisibles de l'esprit. Comprendre Douguine, c'est réaliser que son combat métaphysique dure tant que Cybèle règne. Cette guerre est pour lui une nécessité ontologique, un chemin vers la restauration de la verticalité.
20:17 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, evgueni golovine, alexandre douguine, noomachie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Débat nucléaire en Europe: Qui serait vraiment prêt à mourir pour qui?

Débat nucléaire en Europe: Qui serait vraiment prêt à mourir pour qui?
Elena Fritz
Bron: https://t.me/global_affairs_byelena#
En Europe, un débat a commencé ( https://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/... ), qui aurait été impensable il y a seulement quelques années. Des politiciens de premier plan parlent désormais ouvertement d’un «parapluie nucléaire» européen. Le président polonais Karol Nawrocki le réclame, le chancelier fédéral Friedrich Merz en discute avec Emmanuel Macron, et lors de la Conférence sur la sécurité à Munich, ce sujet n’était plus un tabou. Le fait même que cette question soit posée montre surtout une chose: la confiance dans les garanties de sécurité actuelles s’émousse. Le point de départ est moins idéologique que stratégique. Dans de nombreuses capitales européennes, l’incertitude grandit quant à savoir si, en cas d’urgence, les États-Unis seraient vraiment prêts à risquer leur propre survie pour l’Europe. Cette inquiétude ne date pas de la politique intérieure américaine actuelle. Déjà pendant la Guerre froide, la même question se posait. Lorsque l’Union soviétique a développé des missiles intercontinentaux dans les années 1950, il est devenu évident pour les États-Unis qu’une attaque contre l’Europe menacerait inévitablement la population américaine. Washington a alors réagi avec une nouvelle stratégie: pas de représailles automatiques et massives, mais une réponse flexible. En d’autres termes: une marge de manœuvre plutôt qu’un auto-engagement.
Aujourd’hui, cette logique revient. Le monde est devenu multipolaire, les risques sont plus complexes, et la politique américaine se concentre davantage sur l’Indo-Pacifique. Pour des États comme la Pologne ou les pays baltes, cela signifie une réalité désagréable: en cas d’urgence, l’Europe pourrait se retrouver seule stratégiquement. Le fait que Varsovie tourne désormais son regard vers Paris est rationnel.
Mais c’est ici que commence le vrai problème. La France est une puissance nucléaire, mais son arsenal est limité et surtout conçu pour sa propre dissuasion nationale. Une extension à toute l’Europe ferait de la France la principale cible d’une contre-attaque. Il en découle une question cruciale, rarement posée dans le débat politique jusqu’à présent:
La France serait-elle prête à risquer son propre existence pour la Pologne, l’Allemagne ou la Finlande ?
Cette question est inconfortable, car elle touche au cœur de toute dissuasion. La dissuasion ne fonctionne que si l’adversaire croit qu’un État est prêt à vraiment commencer une politique d'escalade en cas de crise. Mais cette crédibilité ne peut pas être remplacée par des traités ou des déclarations politiques. Elle repose sur la culture politique, la réflexion stratégique et les intérêts nationaux.
On peut pousser cette logique plus loin. Si la France devait prendre cette décision, elle serait existentielle. Une contre-attaque nucléaire ne viserait pas seulement l’infrastructure militaire, mais aussi les fondements de l’État français. Aucun système politique ne décide à la légère de sa propre destruction. C’est précisément pour cette raison que la fiabilité d’une telle garantie reste incertaine.
Cela met en lumière une deuxième question, encore plus difficile:
D’autres États européens seraient-ils prêts à ce que la France prenne ce risque pour eux?
Car une garantie de protection nucléaire implique toujours une dépendance politique. Celui qui est protégé doit céder du pouvoir. Celui qui protège exige une influence. Un parapluie de protection européen ne concernerait donc pas seulement la sécurité militaire, mais aussi la réorganisation des rapports de force en Europe. La France deviendrait le centre politique de la sécurité. Les décisions concernant toute politique d’escalade, le risque et la guerre seraient finalement prises à Paris.
Pour l’Allemagne, cette situation serait particulièrement sensible. D’un côté, la pression croît pour rendre la politique de sécurité plus efficace. De l’autre, l’Allemagne deviendrait, dans un tel système, un acteur central à la fois financier et politique, sans en avoir le contrôle ultime. La dépendance aux États-Unis serait en partie remplacée par une dépendance à la France.
19:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, armement nucléaire, europe, affaires européennes, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
De l'Amérique sinisée

De l'Amérique sinisée
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/sino-america/
Pékin établit une série d’accords avec l’Uruguay.
Le président uruguayen, Yamadù Orsi, a été reçu avec tous les honneurs à Pékin, où il a eu une longue entrevue avec Xi Jinping.
En marge de cette rencontre, le leader chinois a souligné la nécessité d’un monde toujours plus intégré, basé sur la coopération. Un monde non dominé par un seul despote ou maître.
Xi ne l’a pas nommé, bien sûr. Cependant, même un aveugle peut voir la référence explicite à Washington. Surtout parce qu’Orsi est le premier leader sud-américain à se rendre dans la Cité Interdite après le cas Maduro.
C’est-à-dire après que des forces spéciales américaines ont enlevé le président vénézuélien avec sa femme, pour l’emmener aux États-Unis et le poursuivre pour trafic de drogue.
Cela ne concerne personne, puisque le Venezuela est un pays presque insignifiant pour les cartels de la drogue.
Et, surtout, Trump lui-même n’a jamais caché que les véritables raisons de l’«opération Maduro» sont autres: ramener le Venezuela, avec ses immenses richesses pétrolières, dans l’orbite des États-Unis.
Selon ce qui semble, l’opération a réussi. Avec un coût modique (pour dire) de juste un peu plus d’une centaine de morts. Tous vénézuéliens, bien entendu.
Les événements ont cependant semé la terreur dans toute l’Amérique latine. Où seules l’Argentine et le Chili sont, pour l’instant, parfaitement alignés sur Washington.
Le Brésil de Lula semble très préoccupé, malgré le fait que, en raison de sa force et de sa taille, il reste dur à cuire.
Le Mexique tremble.
Cuba cherche des aides et un bouclier à Pékin.
Et il semble que les pays de la région andine aient aussi l’intention de faire de même.

De même, comme on peut le voir aujourd’hui, l'Uruguay.
En effet, Pékin représente la seule possibilité authentique d’alternative à la soumission totale à Washington qui, pour beaucoup, s'avère néfaste.
La Russie, qui déclare officiellement s’opposer à la lourde emprise des États-Unis sur l’Amérique latine, ne peut cependant faire grand-chose au-delà de déclarations de principe.
Trop occupée par le conflit ukrainien et, par ailleurs, en quête d’un accord, aussi difficile soit-il, avec les États-Unis sur les équilibres européens.
Pékin, en revanche, c’est une autre histoire. La stratégie de Xi Jinping vise totalement une pénétration capillaire dans chaque région du monde.
Bien sûr, principalement une pénétration commerciale. Et donc pacifique… du moins en apparence.
Il est cependant vrai que Pékin cherche un nouvel équilibre multipolaire, qui libère le système économique mondial du contrôle américain.

Pour cette raison, la Banque centrale chinoise délaisse ses énormes réserves de dollars.
Une opération qui pourrait avoir de fortes répercussions sur la stabilité économique des États-Unis.
Et Xi Jinping parle, avec une dureté sibylline, de nouveaux équilibres mondiaux. Et avertit que Pékin n’est pas disposé à accepter davantage d’hégémonies imposées par la force.
Comme je le disais, il ne nomme personne. Ni pays, ni hommes.
Ce n’était pas nécessaire. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ont entendu.
19:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, chine, états-unis, uruguay, amérique ibérique, amérique du sud, amérique latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 février 2026
Le Monde et l’Occident selon Toynbee
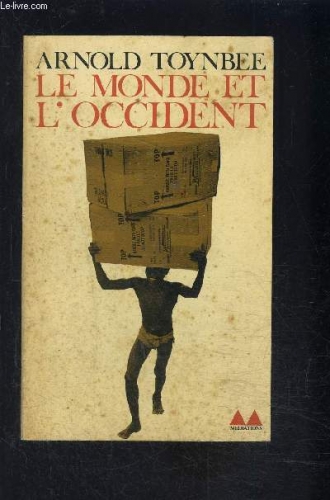
Le Monde et l’Occident selon Toynbee
Claude Bourrinet
Arnold Toynbee donna à la BBC des conférences, en 1952, qu’il groupa dans un petit livre qui a pour titre Le monde et l’occident.
Celui-ci se présente en deux volets. D’abord, une réflexion qui tente d’identifier des lois inhérentes au choc des civilisations. Puis un ensemble de documents historiques. Nous nous en tiendrons à la première partie.
En 1952, les empires européens, notamment britannique et français, sont sur le point de s’effondrer. Les Britanniques ont quitté l’Inde, et les Français perdent l’Indochine, en attendant l’Algérie. Cette domination mondiale de nations d’Europe occidentales semblait, quelque vingt ans auparavant, pérenne, et destinée à demeurer indéfiniment, quoique les Anglais aient promis de laisser aux autochtones la maîtrise de leur pays.
En initiant son titre par l’évocation du monde, avant celle de l’Occident, Toynbee révèle l’axe de sa réflexion. Il tente d’échapper à l’inévitable déformation perspectiviste qu’induit la surévaluation d’une appartenance. Il répudie toute appréhension journalistique, et même la strate que Hegel nomme l’Histoire immédiate. Il s’agit de dégager des constantes qui, si elles ne sont pas des lois, permettent de rendre visibles des évolutions peut-être prévisibles.
 Et en plaçant prioritairement le « monde » devant un Occident qui paraît avoir conquis la planète, il laisse entendre que l’avenir lui appartient avec une probabilité certaine.
Et en plaçant prioritairement le « monde » devant un Occident qui paraît avoir conquis la planète, il laisse entendre que l’avenir lui appartient avec une probabilité certaine.
Depuis quatre ou cinq cents ans, « le monde et l’Occident s’affrontent ». Mais c’est le monde qui a dû subir les assauts occidentaux, désastreux, terribles. Un monde qui, pourtant constitue, et de loin, la majorité de l’humanité.
Parmi les « civilisations » que Toynbee énumère, il y a les Russes, les Musulmans, les Hindous, les Chinois et les Japonais. Or, chacune de ces civilisations a essuyé des agressions féroces de la part de l’Occident. Les Russes, en 1941, 1915, 1812, 1709, 1610 ; les peuples d’Asie et d’Afrique, dès le XVe siècle. En outre, les Occidentaux ont dévoré ce qui restait de la planète: l’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande. Les Africains furent transportés en masse, comme esclaves, de l’autre côté de l’Atlantique, et les peuplades autochtones de l’Amérique éradiquées, ou soumises.
Ce sont des réalités historiques qui suscitent, chez les Occidentaux, un malaise, ou de l’indignation. Mais il s’agit, bien entendu, de se mettre à la place des peuples du monde, et d’essayer de comprendre ce qu’ils éprouvent, à savoir la colère.
Toynbee, alors, passe en revue ces peuples.
Les Russes sont chrétiens, mais orthodoxes, car convertis par Constantinople. Le communisme est une foi qui suit la logique de l’exaltation religieuse de l’ancienne religion. La haine entre les orthodoxes et l’Eglise catholique est plus que millénaire. Toutefois, la Russie (soviétisée) et l’Occident se trouvent maintenant dans une séquence post-chétienne. Or, on note, dans la longue histoire de leurs relations, la même hostilité. L’Occident a toujours voulu détruire la Russie. Pour Toynbee, cette récurrence de l’agressivité occidentale explique que les Russes aient toujours opté pour des régimes autoritaires, centralisateurs, militarisés, le tsarisme, ou le communisme. C’était soit la tyrannie, soit l’anéantissement.
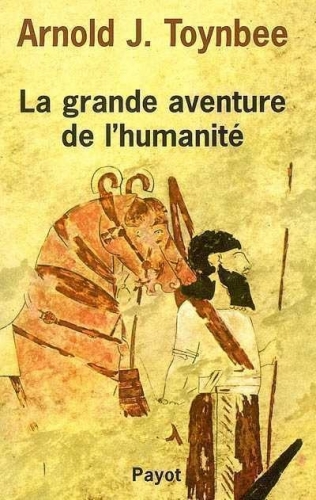 Pour se défendre, la Russie arriérée a adopté l’’armement occidental, ce qui lui a permis de mettre fin à la domination mongole, au XVIe siècle. Elle en a profité pour conquérir les terres de l’Oural et de Sibérie. Mais elle avait toujours du retard : les Polonais se sont emparés de Moscou durant deux ans, en 1610, grâce à la supériorité de leurs armes, et les Suédois ont coupé la Russie de son débouché sur la Baltique, au XVIIe siècle. C’est pourquoi Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, a mené dans son pays une révolution technique, qui a donné in fine la victoire sur l’Empire napoléonien. C’est le même schéma qui prévaut en 1917, avec, en plus, une arme idéologique typiquement occidentale, le marxisme: la Russie bolchevique a accéléré la concentration industrielle par besoin de puissance militaire: la victoire sur les Allemands n’a pas d’autre source.
Pour se défendre, la Russie arriérée a adopté l’’armement occidental, ce qui lui a permis de mettre fin à la domination mongole, au XVIe siècle. Elle en a profité pour conquérir les terres de l’Oural et de Sibérie. Mais elle avait toujours du retard : les Polonais se sont emparés de Moscou durant deux ans, en 1610, grâce à la supériorité de leurs armes, et les Suédois ont coupé la Russie de son débouché sur la Baltique, au XVIIe siècle. C’est pourquoi Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, a mené dans son pays une révolution technique, qui a donné in fine la victoire sur l’Empire napoléonien. C’est le même schéma qui prévaut en 1917, avec, en plus, une arme idéologique typiquement occidentale, le marxisme: la Russie bolchevique a accéléré la concentration industrielle par besoin de puissance militaire: la victoire sur les Allemands n’a pas d’autre source.
Toynbee transfère ce cas de figure à d’autres civilisations: le Japon avec l’ère Meiji, en 1868, bouleversement du vieux Japon, qui a amené une occidentalisation forcenée, d’abord technique et scientifique; la Chine avec le Kouo-Min-Tang, créé par Sun Yat-sen en 1912, puis avec les communistes; les musulmans qui, après un déclin aux XVIIIe siècle succédant à une série de conquêtes apparemment irrésistibles, jusqu’au siège de Vienne, en 1682-1683, essayèrent de se redresser, d’abord en Egypte, avec, en 1839, Mehemet-Ali Pacha.
C’est surtout en Turquie que le sursaut est spectaculaire: après la grande guerre russo-turque de 1768-1774, une réforme militaire fut diligentée par le sultan Selim III, qui monta sur le trône en 1789. Mais c’est surtout, un peu plus d’un siècle plus tard, en 1919, qu’un jeune officier, Mustapha Kemal Ataturk, décréta que les Turcs devaient s’occidentaliser.
Il faut noter que ces bouleversements énergiques étaient souvent le fait d’officiers, par exemple ceux qui entouraient Pierre le Grand, ceux qui tentèrent un coup d’état – qui échoua – en 1825, contre Nicolas 1er. Pourquoi? Parce que l’armée est la première concernée par la question technique, gage d’efficacité et de puissance.
Je ne vais pas entrer dans tous les aperçus d’une analyse qui est souvent passionnante. Mais il est opportun de s’arrêter sur deux questions capitales.
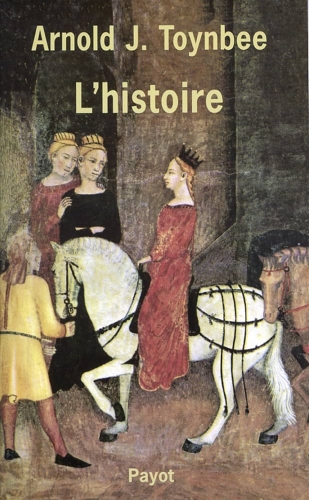 La première concerne les conséquences, pour une civilisation, de l’adoption d’un aspect important – comme la technique – d’une autre civilisation présumée « supérieure » (en puissance). Prenons le cas de deux nations d’extrême Orient, le Japon et la Chine. Le premier a rejeté violemment les Espagnols et les Portugais du pays, au XVIIe siècle, et la seconde les Occidentaux au XVIIIe. Les raisons de cette expulsion sont religieuses. La conversion d’une élite de ces pays au christianisme menaçait de susciter une « cinquième colonne » au sein des instances dirigeantes, et d’ouvrir la porte à la conquête étrangère. En outre, la religion est le cœur d’une civilisation, surtout si celle qui aspire à la remplacer est une foi fanatique, intolérante et dominatrice, ce qui n’est pas le cas des spiritualités orientales.
La première concerne les conséquences, pour une civilisation, de l’adoption d’un aspect important – comme la technique – d’une autre civilisation présumée « supérieure » (en puissance). Prenons le cas de deux nations d’extrême Orient, le Japon et la Chine. Le premier a rejeté violemment les Espagnols et les Portugais du pays, au XVIIe siècle, et la seconde les Occidentaux au XVIIIe. Les raisons de cette expulsion sont religieuses. La conversion d’une élite de ces pays au christianisme menaçait de susciter une « cinquième colonne » au sein des instances dirigeantes, et d’ouvrir la porte à la conquête étrangère. En outre, la religion est le cœur d’une civilisation, surtout si celle qui aspire à la remplacer est une foi fanatique, intolérante et dominatrice, ce qui n’est pas le cas des spiritualités orientales.
Or, les Européens, à partir de la fin du XVIIe siècle, prennent une certaine distance par rapport aux religions, catholique et protestante. Leur mode de fonctionnement politique et leurs rapports avec le reste du monde se font sur le mode de la puissance sécularisée. A ce titre, ils paraissent plus acceptables, car ils ne cherchent plus à convertir.
L’emprunt de moyens techniques, notamment pour l’armement, semble, a priori, être un ajout sans grand danger à l’identité civilisationnel d’un pays. Mais c’est une erreur de penser ainsi, et le prisme uniquement utilitariste relève d’une mauvaise perception des conséquences à long terme (cela peut mettre un siècle pour s’actualiser) pour la vie du pays, jusqu’aux moindres replis de l’existence. Car, pour utiliser la technique, il faut des hommes qui soient formés pour ce faire, qui en ait l’intelligence de l’usage, qui soient émancipés des traditions, qui ait de l’esprit d’initiative, qui soient curieux des innovations. Il faut aussi un Etat moderne, donc, à terme, des «citoyens». Tout cela crée des hommes individualistes et «libres». Les formations que les jeunes Japonais suivirent en Occident ne furent pas vaines: ils en ramenèrent les idées de progrès, de confort personnel, de nationalisme, etc. L’adoption de la technique occidentale aboutit fatalement à l’occidentalisation intégrale de la société traditionnelle, donc à sa destruction, comme la grippe, bénigne pour un Européen, provoqua des millions de morts en Amérique, chez les Indiens, et chez les peuplades du Pacifique.
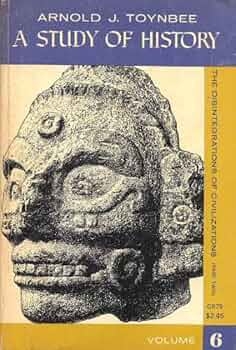 A ce destin fatal, deux attitudes sont possibles: soit une résistance à mort, soit une adaptation inévitable.
A ce destin fatal, deux attitudes sont possibles: soit une résistance à mort, soit une adaptation inévitable.
Une autre interrogation concerne notre avenir, celui d’un monde désormais occidentalisé. Remarquons que Toynbee aspire à une unité politique du monde, à un Etat unificateur, capable d’instaurer une paix universelle. Mais sur quelles bases? Il observe qu’au milieu du IIe siècle de notre ère, un immense espace, du Gange au Tyne, de l’Inde à la « Bretagne » (l’Angleterre) était occupé par trois Empires, l’Empire romain, celui des Parthes, et l’Empire Kouchan, qui avaient connu l’empreinte hellénique, et qui évitaient de se faire une guerre d’extermination. La paix régnait de facto, par l’équilibre des puissances.
Toutefois, pour créer ces empires, il avait fallu beaucoup batailler, souffrir. Et cette paix, qui ressemblait à un repos bien mérité, n’était pas satisfaisante pour les aspirations du cœur et de l’esprit. La vie sociale s’était stabilisée, mais au prix d’un ennui mortel. Le dard avait été retiré, mais le vide s’immisçait partout. Il fallait une raison de vivre, et ce fut une religion orientale, parmi d’autres concurrentes, une spiritualité transcendante, qui ouvrait un autre monde beaucoup, une eschatologie, un rêve millénariste, au prix d’une hellénisation de son corpus philosophique et artistique, ce fut le christianisme qui l’emporta dans l'Empire romain. Puis il y eut l'islam dans les autres parties de cet espace.
« Un dénouement historique similaire va-t-il s’inscrire dans l’histoire inachevée de la rencontre entre le monde et l’Occident ? Nous ne saurions le dire, puisque nous ignorons ce qui arrivera. Nous pouvons seulement dire que, ce qui s’est déjà produit une fois, au cours d’un autre épisode de l’histoire, reste une des possibilités de l’avenir. »
17:19 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : arnold j. toynbee, toynbee, histoire, livre, occident, occidentalisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le nouvel atlantisme de Marco Rubio

Le nouvel atlantisme de Marco Rubio
Alexander Douguine
Le discours du secrétaire d'État américain Marco Rubio lors de la Conférence de sécurité de Munich le 14 février 2026 différait nettement de celui du vice-président J. D. Vance, qui en avait prononcé un tout autre un an auparavant lors de la même conférence.
Le discours de Vance était, en substance, un triomphe de l'esprit MAGA, cette idéologie sous la bannière de laquelle Donald Trump était arrivé au pouvoir et avait remporté à nouveau l’élection présidentielle. Le vice-président américain avait expliqué devant des Européens (majoritairement globalistes) la nouvelle orientation prise par Washington, visant à renforcer les États-Unis en tant que pôle souverain dans un monde multipolaire, ainsi que la fin de l’ère du mondialisme. Vance ne dissimulait pas son mépris envers les Européens et critiquait sévèrement leur idéologie libérale de gauche. L’absence de discours hystériques russophobes et de malédictions dans son allocution a été perçue par l’élite euro-globale comme une «position pro-russe». On a eu l’impression que l’atlantisme s’était effondré et que l’Occident collectif se divisait en deux systèmes autonomes: le nationalisme américain (America First) et un fragment du mondialisme déchu, incarné par l’UE.
Cette fois-ci, c’est le secrétaire d’État Marco Rubio qui s’est exprimé à Munich — et son discours reflétait les transformations que la politique de l’administration américaine avait traversées depuis. Il est important de noter que Rubio est lui-même un néoconservateur, orienté vers le renforcement de la solidarité atlantique, la poursuite, voire l’amplification, de la politique hégémonique en Amérique latine (c’est précisément Rubio qui a promu l’invasion du Venezuela, le renversement de Maduro ainsi que les interventions et changements de régime à Cuba), et vers l'escalade vis-à-vis de la Russie. Mais en même temps, Rubio cherche à s’inscrire dans la rhétorique conservatrice de Trump, critiquant (même si c'est de manière beaucoup plus douce que le mouvement MAGA et Vance) le programme du libéralisme de gauche.
Tout d’abord, Rubio a rassuré les dirigeants européens quant au maintien de la solidarité atlantique. Selon lui: «À une époque où les titres annoncent la fin de l’ère transatlantique, sachez et faites savoir à tous que cela n’est ni notre objectif ni notre désir, car pour nous, les Américains, notre maison peut être dans l’hémisphère occidental, mais nous serons toujours l’enfant de l’Europe». Et il a poursuivi: «L’Europe et l’Amérique appartiennent l’une à l’autre».
L’ère transatlantique, donc, se poursuit. En ce sens, Rubio, dans l’esprit des néoconservateurs classiques, a souligné l’aspect stratégique de l’Europe. Il a déclaré: «Nous voulons que l’Europe soit forte. <...> Notre destin a toujours été, et le sera toujours, lié au vôtre. Car le destin de l’Europe ne sera jamais indifférent pour nous». Le secrétaire d’État a également assuré que rien ne menace l’OTAN. «Nous ne voulons pas nous séparer de l’Europe, mais nous voulons raviver l’alliance».
Rubio a critiqué le système des valeurs libérales/gauchistes, mais il a surtout expliqué que l’illusion de la victoire mondiale garantie par les libéraux, leur assurance après la chute de l’URSS, était erronée. Rubio a déclaré: «L’euphorie de cette victoire nous a conduits à une erreur dangereuse, celle de croire que chaque nation deviendrait une démocratie libérale, que les liens formés uniquement par le commerce et les affaires remplaceraient l’identité nationale, que l’ordre mondial basé sur des règles remplacerait les intérêts nationaux et que nous vivrions dans un monde sans frontières où chacun serait citoyen du monde. <...> L’idée de vivre dans un monde sans frontières était une idée stupide».
Bien que Rubio n’ait pas mentionné directement la Russie dans son discours, lors de ses déplacements il s’est plaint des «horreurs de la guerre», a déclaré que «nous ne savons pas si les Russes sont sérieux quant à la fin de la guerre» et que «nous continuerons à vérifier cela», tout en assurant que les États-Unis continueront à faire pression sur la Russie par des sanctions économiques et par la livraison d’armes à l’Europe, qui finiront par se retrouver en Ukraine. Sur cette question, Rubio s’est plutôt rangé du côté du Vieux Continent: «… nous et l’Europe continuons à prendre des mesures pour faire pression sur la Russie afin qu’elle se mette à la table des négociations».

Cependant, Rubio a manqué la rencontre entre les dirigeants européens et Zelensky sur l’Ukraine, organisée en marge du forum, et est allé rencontrer Orban — ce qui a été critiqué par les euro-globaux, qui ont considéré ce comportement comme un «défi».
Son discours lors de la conférence s’est terminé de manière optimiste, laissant entendre que le «nouveau shérif» incarné par Donald Trump n’est pas aussi terrible qu’on le pense, et que dans la réalité, son programme international ne diffère pas beaucoup de celui des mondialistes, si ce n’est qu'il a pris une forme particulière et extravagante. La figure du néoconservateur et mondialiste Rubio devait confirmer cette thèse. Il a conclu en disant: «L’Amérique ouvre la voie à un nouveau siècle de prospérité, et nous voulons le réaliser avec vous, nos chers alliés et amis de longue date».
En faisant abstraction des émotions, on peut constater que la visite du secrétaire d’État Marco Rubio en Europe, lors de la conférence de Munich, marque un déplacement important dans la politique de l’administration américaine par rapport à l’année précédente. La nouvelle stratégie de sécurité nationale a affirmé que les États-Unis se concentreraient désormais sur «l’hémisphère occidental», ce qui a été interprété comme un retour à la doctrine Monroe («L’Amérique aux Américains») et une rupture avec l’ancien continent. Rubio a cependant clarifié que ce n’était pas le cas et que toutes les structures atlantistes restent en place.
On peut donc, avec une certaine confiance, affirmer que la politique des États-Unis s’est éloignée depuis un an des projets révolutionnaires du mouvement MAGA et s’oriente vers une version plus radicale du néoconservatisme et du réalisme atlantiste.
Sur la base des principes avec lesquels Trump a commencé son second mandat présidentiel, la Russie et les États-Unis avaient la possibilité de négocier de nouveaux fondements pour l’ordre mondial. Surtout parce que nous, Vance, Trump lui-même et Rubio, sommes d’accord pour dire que l’ancien ordre mondial libéral basé sur des «règles» n’existe plus. Nous n’aurions pas particulièrement d’objection à ce que les États-Unis renforcent leur présence dans l’hémisphère occidental, et Vladimir Poutine aurait pu, à Anchorage, discuter avec le président américain de sa vision globale du monde. La question ukrainienne aurait été difficile à résoudre, mais Washington aurait pu sortir de cette guerre et se concentrer sur ses propres problèmes. La détérioration des relations entre les États-Unis et l’UE nous a plutôt été favorable, et le retour aux valeurs traditionnelles correspondait même à notre propre idéologie patriotique-conservatrice. Avec MAGA, nous avions toutes les chances de trouver un terrain d’entente.
Mais à un moment donné, Trump lui-même a commencé à s’éloigner des principes du mouvement MAGA dans sa politique et à se rapprocher des néoconservateurs. Parallèlement, le rôle de Marco Rubio dans le système politique s’est renforcé. Les négociations sur l’Ukraine, déjà problématiques et ambivalentes, ont progressivement abouti à une quasi impasse.
Le plus important, c’est que cela ne concernait pas seulement les relations russo-américaines. La stratégie néoconservatrice (essentiellement un effort pour sauver l’hégémonie de l’Occident et un monde unipolaire) s’est également étendue à d’autres domaines: pression sur les BRICS, attaques contre l’Iran, enlèvement de Maduro, renforcement des sanctions contre la Russie. Et voilà que Rubio, lors de la conférence de Munich, expose le programme du nouvel atlantisme, moins libéral et plus réaliste, mais toujours atlantiste. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau projet de mondialisation des grandes puissances.
Les voies de la civilisation russe et celles de l’Occident s’éloignent de plus en plus (alors que ce processus a commencé il y a plusieurs siècles). Et nous devons nous y préparer.
16:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, états-unis, marco rubio, conférence de munich, atlantisme, néo-atlantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Carlos X. Blanco: «L'Occident est un concept explosif»

Carlos X. Blanco: «L'Occident est un concept explosif»
Dans cet entretien avec Carlos X. Blanco, l'un des penseurs contemporains les plus influents et les plus hétérodoxes du panorama intellectuel espagnol, nous approfondissons une idée provocatrice: «L'Occident est un concept explosif». Nous discutons de la manière dont ce concept (au-delà d'une simple étiquette géographique ou culturelle) agit comme une lentille permettant de comprendre les tensions géopolitiques, identitaires et philosophiques dans un monde en mutation. De sa formation philosophique à son regard critique sur les narratifs dominants, Carlos X. Blanco nous invite à repenser les catégories à travers lesquelles nous interprétons notre époque.
papelcrema : Dans vos essais, vous insistez sur le fait que la crise de l'Occident n'est pas seulement politique ou économique, mais profondément ontologique et métaphysique: une rupture dans la manière même dont l'être humain se comprend et se situe dans le monde. Où situeriez-vous le moment historique où cette rupture est devenue irréversible et dans quelle mesure les grandes catégories modernes (progrès, individu, droits) ont-elles contribué à vider de leur sens des notions fortes telles que communauté, limite ou transcendance ?
Carlos X. Blanco: Pour commencer, je pense que l'Occident n'existe pas. C'est un concept-bombe (pour faire exploser l'Europe), trompeur, analogue à beaucoup d'autres qui nous contaminent, nous confondent et nous détruisent. Tout comme «judéo-christianisme», tout comme «Amérique latine». C'est une bombe terminologique destinée à semer la confusion, à détruire les identités, à camoufler la domination d'une partie du monde sur une autre. Je préfère parler d'Europe plutôt que d'Occident, et ne pas prêter attention aux Anglo-Saxons, qui ont tout intérêt à faire de nous, Européens continentaux, une simple colonie périphérique de leur empire.

L'Europe en tant que civilisation est l'Europe païenne (avant Jésus-Christ) et l'Europe catholique, après: je me passe complètement de cet «Occident», je me passe aussi du terme «judéo» placé devant le mot christianisme. Les ruptures ont commencé avec la crise de la scolastique (avec le nominalisme), la Réforme associée à l'essor du capitalisme et la domination coloniale ignoble et génocidaire des puissances européennes sur les peuples des autres continents. La pire destruction, je ne sais pas si elle est irréversible, de l'Europe, sous forme de suicide, s'est produite dans la première moitié du 20ème siècle, lors de cette longue guerre civile européenne, de cette grande guerre fratricide partagée en deux guerres mondiales: le suicide commis entre 1914 et 1945. L'Europe a définitivement sombré en 1945 de manière absolue. Je ne sais pas si nous nous en remettrons.
Face au libéralisme présenté comme l'horizon insurmontable de l'histoire, votre critique vise directement son anthropologie sous-jacente, la figure de l'individu souverain, autonome et détaché. Quel type d'être humain le libéralisme avancé produit-il réellement et quelles sont, à votre avis, les conséquences spirituelles, culturelles et politiques de l'absolutisation de ce «moi» déraciné de toute tradition, appartenance et destin commun?
Un simple animal sans âme. Le libéralisme a réussi à animaliser l'être humain, en particulier celui qui vit dans une société «moderne» dominée par l'Empire occidental. «Moderne» équivaut à capitaliste, c'est un synonyme de personne «occidentale» et «occidentalisée». Cela signifie vivre dans un monde de marchandises où tout s'achète et tout se vend. La société de consommation est, en réalité, la société de l'abrutissement total. Nous nous sommes habitués à nous vendre, et pas seulement avec un contrat de travail comme l'affirme le marxisme classique, mais aussi à vendre nos organes, notre affection, notre sexualité, notre image, nos données. Le libéralisme n'est rien d'autre qu'une superstructure idéologique: ce qui bat au fond, c'est un mode de production extrêmement destructeur, le capitalisme, un régime difficilement domesticable: dans son ADN est inscrit le besoin insatiable de tout vendre et tout acheter, la logique de la réification.
Le premier défi d'une société plus traditionaliste et émergente, comme la société russe, chinoise, indienne ou perse, est de vaincre le libéralisme de l'Empire occidental. Mais l'objectif immédiat suivant est d'écraser l'hydre capitaliste, dans chaque peuple, avec les outils traditionnels qui lui sont propres: religion orthodoxe, éthique confucéenne, socialisme national, peu importe. Peu importe les moyens, pour ramener la vie humaine dans son lit initial.
Dans un contexte de mondialisation économique, d'affaiblissement de l'État-nation classique et de prolifération de structures supranationales opaques, vous avez défendu la nécessité de réfléchir à des formes politiques alternatives au cadre moderne. Pensez-vous que des concepts historiquement «maudits» tels que l'empire, la souveraineté forte ou la communauté organique peuvent redevenir des outils théoriques valables pour comprendre le pouvoir réel, ou sommes-nous condamnés à évoluer dans le langage appauvri de la gouvernance libérale?
Les concepts que vous mentionnez sont des concepts métapolitiques et, par conséquent, méta-idéologiques. Ils dépassent la droite et la gauche, transcendent la lutte entre les factions et les partis.
Ce sont des concepts qui peuvent guider la lutte pour un sauvetage ou une restauration civilisationnelle. Les concepts pièges du libéralisme, comme par exemple celui d'«Occident» dont je vous parlais tout à l'heure, ne sont rien d'autre que des armes. Comme un filet, comme une embuscade, comme un piège. Le libéralisme nous enferme dans sa cage d'acier depuis des siècles, mais plus particulièrement depuis 1945, lorsque l'Europe a été vaincue, occupée, asservie.
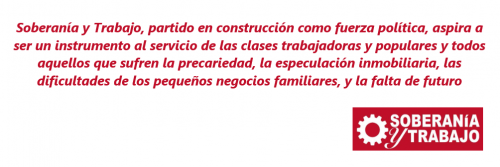
Une gauche anti-woke (comme le parti Soberania y Trabajo - Souveraineté et Travail), clairement anti-américaine, émerge timidement. On voit également apparaître, de manière minoritaire, un populisme de droite illibéral... et d'autres courants qui voient le jour. À long terme, ils devront converger: nous voulons des sociétés gouvernées selon le principe de la justice sociale, nous voulons un continent qui conserve ses racines, qui puisse se défendre, dont les États redeviennent souverains et où l'humanisme règne sur nos pays et nos cultures, loin des immondes théories bourgeoises. Cela ne pourra se faire que dans un Imperium. Un organe suprême d'autorité conciliatrice, et une autosuffisance militaire, nucléaire et énergétique, voilà ce qu'est l'Imperium. Sans la Russie en notre sein, et sans nous en Russie, les Européens ne seront plus jamais rien. De la chair à canon. Nous serons les nouveaux Peaux-Rouges des Yankees, ou les Gazaouis des sionistes.
La technique occupe une place centrale dans votre réflexion, non seulement en tant qu'ensemble d'instruments, mais aussi en tant que vision globale du monde qui façonne notre relation à la nature, au travail et au temps. À quel moment la technique cesse-t-elle d'être un moyen au service de l'homme pour devenir une fin autonome qui le domine, et quelles formes de résistance (intellectuelle, politique ou même spirituelle) considérez-vous encore possibles face à cette colonisation technique de l'existence ?
La technique est indissociable du mode de production capitaliste. Elle a été élevée au rang de dispositif supplantant la réalité, comme une divinité, un pouvoir omnipotent exempt... Mais la technique, en réalité, fait partie du système général d'obtention de valeur. Si la valeur est obtenue par un Capital privé qui aspire la vie humaine non seulement dans le processus de production au sens strict (marxiste), mais aussi dans le processus global de l'existence humaine (divertissement, sexe, relations de toutes sortes), et si cette valeur ne revient pas à la société, alors la technique est aliénante.

Mais si la technique n'est pas une pompe à valeur pour le capital, si elle fait partie du processus général d'enrichissement qualitatif de la vie, alors elle n'est pas différente de l'art, de la philosophie, de l'horticulture, de l'éducation des enfants, de l'amour ou d'une conversation amicale sur la place du village. La technique créatrice de valeur sociale et non aspirante de valeur, c'est la culture humaine elle-même. Lorsque tant de philosophes prétendent critiquer la «technique», ce qu'ils devraient faire ou dire, c'est «critiquer le capitalisme lui-même». Ce n'est pas que la technique soit, comme ils le disent, «neutre». Loin de là. Il n'est pas neutre qu'un adolescent occidental de quinze ans possède un smartphone ultra-intelligent avec plusieurs caméras et un accès au réseau des réseaux du monde entier, alors que des millions de personnes n'ont pas de puits d'eau potable près de chez elles. La technique doit être socialisée et non transformée en un jouet diabolique qui nous séduit et nous exploite à la fois.
Vos positions vous éloignent tant du progressisme hégémonique que de certaines droites purement réactives ou nostalgiques. Depuis cette position inconfortable, quel rôle devrait assumer aujourd'hui la pensée philosophique critique: se limiter à diagnostiquer la décadence du monde moderne ou oser formuler des projets de reconstruction culturelle et politique, même au risque de se retrouver en dehors des consensus et des cordons sanitaires du débat public ?
Il faut incontestablement agir. Créer des revues, fonder des maisons d'édition, des sites web, des académies de débat et de lutte des idées, des centres de formation de cadres, des structures civiques et politiques non partisanes, des «complicités» (des synergies, dirait Robert Steuckers) entre des personnes qui peuvent apporter des idées pour une restauration européenne et une critique de la dictature libérale...
Se limiter au diagnostic: c'est une mauvaise médecine. Il faut concevoir des thérapies, y compris des thérapies de choc. Il faut un travail éducatif très important, possible en marge des institutions formelles, institutions qui sont corrompues et mercenaires dans une large mesure. Concrètement, il faudrait créer une Internationale «européiste» qui lutte pour la dissolution de l'actuelle Union européenne-OTAN (qui est la même chose, avec ou sans uniforme) et pour la justice sociale.
La tradition apparaît dans votre œuvre non pas comme une simple conservation du passé, mais comme une transmission vivante de sens, comme un fil qui relie les générations et ordonne l'expérience collective. À une époque qui semble avoir délibérément rompu avec tout héritage, comment envisager un retour à la tradition qui ne débouche ni sur une archéologie stérile ni sur un folklore vide de sens, mais qui serve de base réelle pour réorienter la vie communautaire et l'horizon moral?
Tradere signifie « transmettre ». Personne ne veut recevoir du passé des bric-à-brac cassés, des cadavres embaumés, les vestiges d'anciennes splendeurs. On transmet ce qui est vivant, on le chérit et on en prend soin, on le transmet et on le confie aux nouvelles générations afin qu'elles en prennent soin et en amplifient la lumière. Être traditionaliste, aujourd'hui, signifie être révolutionnaire. Les snobs de la gauche woke qualifient le marxiste de «rance»... parce que c'est un traditionaliste qui veut changer le monde. Les snobs néolibéraux du PP et de Vox qualifient d'«autoritaire» celui qui n'est pas pro-américain ou pro-israélien comme eux, et qui, dans la même veine, issu d'une tradition humaniste (et donc anti-libérale), veut changer le monde en le rendant plus traditionnel. Et ce qui est traditionnel n'est pas réactionnaire, mais précieux de manière pérenne.
Nous, les traditionnels-révolutionnaires, sommes plus nombreux qu'il n'y paraît. Si demain tombait la dictature néolibérale que les snobs woke ou les «caetaniens» aiment tant, nous réaliserions combien nous sommes nombreux à aspirer à une vie saine, bonne, énergique, militante, débordante d'amour pour la culture et l'éthique, une vie plus égalitaire, tout en étant hiérarchisée selon le mérite et la capacité, une vie productiviste, d'insubordonnés désireux de travailler, de nouveaux ouvriers-guerriers en contact avec le travail, la souveraineté nationale, la famille, la foi (chacun la sienne) et une existence digne.
Ces dernières années, on parle avec insistance d'une nouvelle droite et d'une nouvelle gauche, souvent opposées au consensus libéral mais aussi entre elles. De votre point de vue, quels sont les éléments que ces deux espaces partagent réellement (dans leur critique du système, de la mondialisation ou de l'individualisme) et quelles sont les divergences profondes qui les séparent en termes d'anthropologie, de communauté, de nation et de sens historique ?
Si elles sont vraiment «nouvelles», il y a plus de similitudes que de différences dans leur approche, car la distinction gauche-droite a déjà perdu toute sa validité. Il faut distinguer «souverainisme» et «mondialisme», par exemple. Au sein de la gauche espagnole, les propositions de Manolo Monereo (photo, ci-dessous) ou Carlos Martínez sont celles d'une gauche souverainiste, qui conteste l'Union européenne, conteste l'atlantisme, rejette le séparatisme basque-catalan, méprise la supercherie du mode «woke», n'admet pas aussi joyeusement la politique des «portes ouvertes» à l'immigration incontrôlée, etc.


Ces propositions sont la version espagnole de ce que défend Sahra Wagenknecht (photo), et ne diffèrent pas beaucoup de celles soutenues par certains «populismes» européens, que certains qualifient de «droite». Le communautarisme de Preve, un marxiste, n'était pas loin de celui de la Nouvelle Droite. Se replier sur l'Europe des États-nations et des peuples (Patrias Carnales) comme étape préalable à une nouvelle Union européenne transcende la maladie bipolaire de la gauche et de la droite, et constitue un repli nécessaire. Revenir à l'État souverain pour donner un élan à l'Europe qui s'étend de Lisbonne à Vladivostok.
Source: https://papelcrema.com/conversaciones/carlos-x-blanco-occ...
15:33 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carlos x. blanco, entretien, occident |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pourquoi la Doctrine Monroe ne peut pas être rétablie
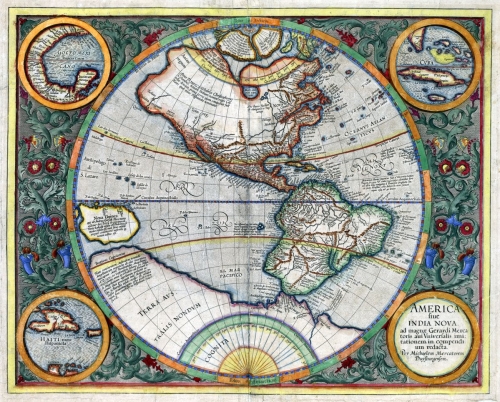
Pourquoi la Doctrine Monroe ne peut pas être rétablie
Patrick Frise
Source: https://es.sott.net/article/103531-Por-que-no-se-puede-re...
La Doctrine Monroe occupe une place inhabituelle dans le discours politique américain. Elle est souvent invoquée comme si elle représentait une norme permanente de gouvernance de l’hémisphère, susceptible d’être réactivée ou appliquée par toutes les administrations ultérieures. Dans son utilisation contemporaine, elle est fréquemment considérée comme une déclaration d’autorité américaine sur l’hémisphère occidental ou comme une justification pour l’intervention contre des puissances étrangères et des gouvernements régionaux.
Cette interprétation ne reflète pas le texte tel qu’il a été rédigé, ni les circonstances qui l’ont fait naître, ni les limites que ses auteurs lui ont assignées.
 La Doctrine Monroe n’était pas une doctrine destinée à conforter une politique permanente. Il s’agissait d’une proclamation circonstancielle émise en réponse à une série de préoccupations géopolitiques concrètes au début du 19ème siècle. Une fois ces conditions disparues, la doctrine a perdu sa signification opérationnelle. Ce qui en reste aujourd’hui n’est pas une politique vivante, mais un texte historique qui a été réutilisé à plusieurs reprises pour justifier une autorité qu’elle n’a jamais conférée.
La Doctrine Monroe n’était pas une doctrine destinée à conforter une politique permanente. Il s’agissait d’une proclamation circonstancielle émise en réponse à une série de préoccupations géopolitiques concrètes au début du 19ème siècle. Une fois ces conditions disparues, la doctrine a perdu sa signification opérationnelle. Ce qui en reste aujourd’hui n’est pas une politique vivante, mais un texte historique qui a été réutilisé à plusieurs reprises pour justifier une autorité qu’elle n’a jamais conférée.
La doctrine est née du message annuel du président James Monroe au Congrès en décembre 1823. À cette époque, le paysage politique des Amériques évoluait rapidement. Le Mexique avait obtenu son indépendance de l’Espagne en 1821. Les provinces d’Amérique centrale, y compris celles qui deviendront plus tard le Guatemala, le Honduras, El Salvador, le Nicaragua et le Costa Rica, avaient déclaré leur indépendance la même année. L’Amérique du Sud était en révolte depuis plus d’une décennie. Ces mouvements s’étaient en grande partie achevés au début des années 1820, bien que leur stabilité politique restait incertaine. En Europe, les guerres napoléoniennes venaient de se terminer, et les monarchies conservatrices organisées sous l'égide de la Sainte-Alliance revendiquaient le droit de réprimer les révolutions libérales et de restaurer les régimes traditionnels. La France intervint militairement en Espagne en 1823, ce qui suscita la crainte que les puissances européennes puissent aider l’Espagne à récupérer ses anciennes colonies. Pendant ce temps, la Russie avançait dans ses revendications territoriales le long de la côte pacifique de l’Amérique du Nord.
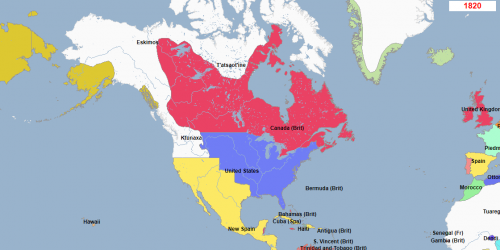

C’est en réponse à ces événements que Monroe a formulé ce qui sera plus tard appelé la Doctrine Monroe. Les passages pertinents du message sont explicites quant à leur portée. Monroe affirma que les continents américains, « en raison de leur statut libre et indépendant qu’ils ont assumé et maintiennent », ne devaient pas être considérés comme soumis à une future colonisation par les puissances européennes. La clause conditionnelle est essentielle. L’interdiction de la colonisation était directement liée à l’indépendance existante des États américains, et non à une revendication d’autorité américaine sur eux. Monroe souligna également que les États-Unis n’interviendraient pas dans les affaires intérieures de l’Europe ni dans ses colonies existantes. « Lors des guerres entre puissances européennes, dans des affaires qui les concernent », dit-il, « nous n’avons jamais pris part, car cela ne concorde pas avec notre politique. » L’action américaine, expliqua-t-il, serait défensive et limitée aux circonstances où des droits américains seraient piétinés ou sérieusement menacés.
Rien dans la proclamation n’affirmait le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’autres États américains, d’exercer une autorité de supervision ou de contrôler la politique régionale. La doctrine fonctionnait comme une mise en garde diplomatique à l’extérieur, non comme une déclaration d’autorité à l’intérieur. Elle était indissociable des conditions qui l’avaient engendrée. En 1823, les États-Unis ne disposaient pas des capacités militaires nécessaires pour imposer leur domination dans l’hémisphère. La puissance navale britannique, motivée par l’intérêt du Royaume-Uni pour le libre-échange plutôt que pour la restauration d’empires, était le principal élément dissuasif contre toute tentative de recolonisation européenne.
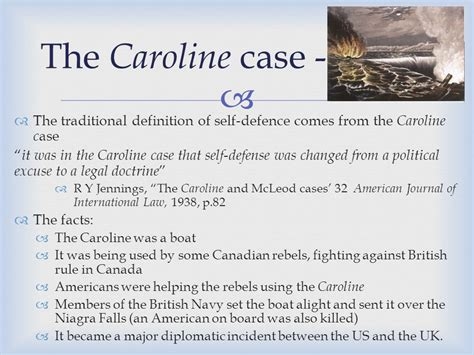
Cette conception de la modération n’était pas exclusive à Monroe. Après l’incident du navire Caroline en 1837, lors de la rébellion du Haut-Canada, le secrétaire d’État Daniel Webster formula ce qui serait plus tard connu sous le nom de doctrine Caroline. Dans sa correspondance avec les responsables britanniques, Webster rejeta les revendications étendues d’autodéfense préventive et insista sur le fait que toute utilisation de la force devait être justifiée par un besoin immédiat, écrasant, qui ne laissait pas d’autre choix que de délibérer sur les moyens ou le moment. L’incident, qui découla des tensions le long de la frontière entre le Maine et le Canada, reflétait le même principe sous-jacent que la Doctrine Monroe: l’usage de la force n’était permis qu’en dernier recours, lié à des menaces concrètes et limité par la proportionnalité.
Même au 19ème siècle, la Doctrine Monroe ne fonctionnait pas comme une norme de conduite internationale applicable. Les puissances européennes continuèrent d’intervenir en Amérique après 1823, notamment avec l’instauration par la France de l’empereur Maximilien au Mexique dans les années 1860. Plus significatif encore, les fondements réciproques de la doctrine se sont érodés lorsque les États-Unis ont abandonné leur propre engagement de non-intervention. À la fin du 19ème siècle, la politique étrangère américaine s’était nettement éloignée de la modération. La guerre hispano-américaine (1898) et le contrôle américain ultérieur sur Cuba et Porto Rico marquèrent un éloignement évident par rapport à la position de Monroe.

Ce changement fut officialisé avec le Corollaire Roosevelt en 1904, lorsque le président Theodore Roosevelt affirma que les désordres politiques dans l’hémisphère occidental pouvaient justifier l’intervention américaine pour empêcher toute participation européenne. Ce raisonnement inversait la logique de la Doctrine Monroe. Alors que Monroe mettait en garde contre l’ingérence extérieure, Roosevelt affirmait un droit discrétionnaire d’ingérence intérieure. Le corollaire ne découlait pas du texte de la Doctrine Monroe, mais la remplaçait.
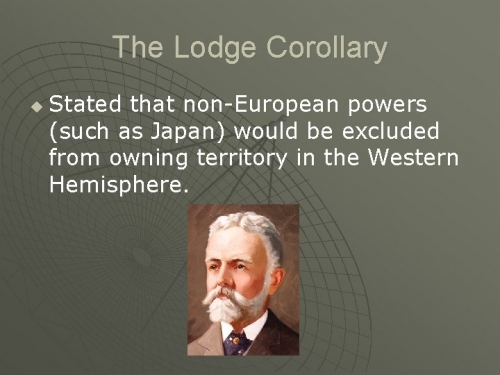
Le corollaire Lodge de 1912 illustre encore davantage à quel point la politique américaine s’était éloignée des prémisses originales fixées par Monroe. Proposé par le sénateur Henry Cabot Lodge et adopté par le Sénat, la résolution affirmait que les États-Unis s’opposeraient à l’acquisition de territoires dans l’hémisphère occidental par des puissances non américaines, même par le biais d'un contrôle privé ou corporatif. Bien plus restrictif que les interprétations ultérieures, le Corollaire Lodge marqua une déviation par rapport aux préoccupations de Monroe concernant la colonisation européenne formelle liée à la restauration post-napoléonienne. Il reflétait une importance croissante accordée à l’exclusion plutôt qu’à la réciprocité. Cependant, il ne visait pas à autoriser le changement de régime, la domination militaire ou la supervision politique des États américains.
Une fois que les États-Unis se furent engagés dans des interventions répétées dans toute l’Amérique centrale et les Caraïbes, et qu’ils se lièrent plus tard de façon permanente à la sécurité européenne à travers deux guerres mondiales et des alliances durables, la prémisse réciproque de la Doctrine Monroe disparut. Une politique basée sur la non-intervention mutuelle ne peut survivre lorsque l’une des parties abandonne ce principe. À ce moment-là, la doctrine cessa de fonctionner comme elle avait été rédigée; elle ne subsista que comme rhétorique.
Les récentes invocations de la Doctrine Monroe illustrent à quel point cette distanciation rhétorique a progressé.
Lors d’un discours prononcé le 6 décembre 2025 au Forum de la Défense Nationale Reagan, le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth a déclaré :
« C’est le corollaire de Trump à la Doctrine Monroe, récemment codifié avec autant de clarté dans la Stratégie de Sécurité Nationale. Après des années d’abandon, les États-Unis restaureront leur domination militaire dans l’hémisphère occidental. Nous l’utiliserons pour protéger notre patrie et accéder à des terrains clés dans toute la région. »
Le 3 janvier 2026, le secrétaire Hegseth a déclaré :
« Le Venezuela a une longue histoire en tant que pays riche et prospère. Il a été volé à son peuple par des dirigeants abominables. Nous pouvons les aider, ainsi que les États-Unis, à rétablir la Doctrine Monroe dans l’hémisphère occidental. Paix par la force avec nos alliés. »
Ces déclarations considèrent que la Doctrine Monroe constitue une base pour justifier la domination militaire, l’accès territorial et l’intervention politique. Cependant, rien dans la proclamation de 1823 n’autorise de telles actions. La doctrine ne confère pas le droit d’attaquer des nations, de procéder à des changements de régime ou de gérer la politique régionale. Elle traitait d’une crainte spécifique que les monarchies européennes pourraient réimposer la domination coloniale sur les nouveaux États indépendants américains au début du 19ème siècle. Cette crainte ne définit plus le système international. La géographie politique des Amériques s’est stabilisée pendant des générations. Les ambitions coloniales européennes dans l’hémisphère ont disparu depuis longtemps. Les États-Unis eux-mêmes ont à plusieurs reprises violé la restriction mutuelle sur laquelle reposait la doctrine.
Parler de « rétablir » la Doctrine Monroe dans ces conditions est une mauvaise interprétation du document. Un message présidentiel lié à un moment historique précis ne peut pas être ressuscité comme s'il était devenu le noyau dur d'une politique permanente, tout comme aucun autre discours du 19ème siècle ne peut aujourd’hui justifier une autorité contraignante. La doctrine n’était ni une loi, ni un traité, ni une disposition constitutionnelle. C’était un avertissement contextualisé, émis en réponse à des conditions temporaires. Une fois ces conditions disparues, la portée opérationnelle de la doctrine a également cessé d’avoir du sens.
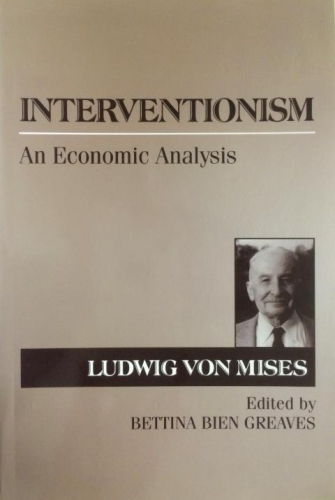 D’un point de vue de l'école autrichienne, ce processus n’est ni surprenant ni unique. Ludwig von Mises soutenait que l’intervention de l’État se limite rarement à son champ d’application initial, mais qu’elle engendre des pressions pour une intervention accrue, car les mesures antérieures ne résolvent pas les problèmes qu’elles créent. Dans Interventionism: An Economic Analysis (Interventionnisme : une analyse économique), Mises décrit cette dynamique comme un processus par lequel les autorités politiques élargissent continuellement leur champ d’action en réinterprétant leurs actions passées comme des justifications pour d’autres, plutôt que comme des limites à leur pouvoir. L’évolution de la Doctrine Monroe suit ce modèle. Une mise en garde historiquement contingente, une fois détachée de son contexte d’origine, devient un instrument politique flexible plutôt qu’une restriction à celle-ci.
D’un point de vue de l'école autrichienne, ce processus n’est ni surprenant ni unique. Ludwig von Mises soutenait que l’intervention de l’État se limite rarement à son champ d’application initial, mais qu’elle engendre des pressions pour une intervention accrue, car les mesures antérieures ne résolvent pas les problèmes qu’elles créent. Dans Interventionism: An Economic Analysis (Interventionnisme : une analyse économique), Mises décrit cette dynamique comme un processus par lequel les autorités politiques élargissent continuellement leur champ d’action en réinterprétant leurs actions passées comme des justifications pour d’autres, plutôt que comme des limites à leur pouvoir. L’évolution de la Doctrine Monroe suit ce modèle. Une mise en garde historiquement contingente, une fois détachée de son contexte d’origine, devient un instrument politique flexible plutôt qu’une restriction à celle-ci.
12:55 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, doctrine de monroe, états-unis, amérique, hémisphère occidental, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 février 2026
La Chine à Munich: les règles de la politique de grande puissance mises en pratique

La Chine à Munich: les règles de la politique de grande puissance mises en pratique
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena#
L'agitation autour des déclarations de Wang Yi lors de la Conférence de Munich sur la sécurité méconnaît l'essentiel. La Chine n’a pas changé de camp à Munich. La Chine a défini son rôle. Ceux qui veulent comprendre ce qui s’est passé doivent abandonner l'idée fixe que les grandes puissances s’engagent durablement.
Ce que Pékin a pratiqué à Munich, c’est de la politique de grande puissance classique. Il ne s’agissait ni de la Russie, ni de l’Europe, ni de l’Ukraine — il s’agissait de se positionner dans l’échiquier mondial du pouvoir.
Premièrement, la Chine a démontré son autonomie stratégique. Wang Yi a consciemment envoyé trois messages simultanément: partenariat avec l’Europe, dialogue avec les États-Unis, et poursuite de la coopération avec la Russie. Cette démarche multipolaire n’est pas le fruit du hasard, mais une méthode. Elle indique que la Chine ne fait pas partie d’un bloc, mais constitue un pôle indépendant.
Deuxièmement, la Chine a déplacé le cadre des négociations. Le soutien à un rôle accru de l’Europe n’est pas une concession à Bruxelles. Il sert à relativiser la puissance monopolistique de Washington. Lorsque l’Europe est à la table, une structure multipolaire se met en place automatiquement. En même temps, la Russie sort de l’isolement, sans que la Chine ait à prendre ouvertement parti. Pékin étend ainsi sa zone d’influence dans l’espace diplomatique.
Troisièmement, la Chine s’est posée en médiateur incontournable. La combinaison de rhétorique du dialogue politique, d’aide humanitaire et de l’accent sur l’intégrité territoriale crée une légitimité. La Chine devient ainsi un acteur auquel aucun futur format de négociation ne pourra échapper. En même temps, elle ne prend aucune responsabilité quant au résultat. C’est une stratégie optimale: influence sans risque.
Quatrièmement, la Chine a gagné du temps. La stabilité en Europe est nécessaire économiquement pour Pékin. Toute escalade mobilise des ressources, augmente l’incertitude et met en danger les relations commerciales. Par une rhétorique modératrice, la Chine crée de l’espace pour sa propre ascension économique et technologique.
Cinquièmement, la Chine a montré à tous que les partenariats sont relatifs. Les déclarations sur d’éventuelles perspectives positives dans les relations avec les États-Unis ne sont pas en contradiction avec la coopération avec la Russie. Elles montrent plutôt que la Chine maintient des options ouvertes et n’accepte aucune dépendance stratégique.
La leçon essentielle pour l’Allemagne et l’Europe est évidente. Dans un monde multipolaire, ce n’est pas la rhétorique morale qui prime, mais la pertinence structurelle. Ceux qui restent indispensables économiquement et technologiquement seront intégrés. Ceux qui peuvent être remplacés seront évités.
Munich n’était donc pas un lieu de changement de cap pour la Chine. C’était la démonstration d'une logique de puissance. Alors que l’Europe pense encore en termes de loyauté et de communauté de valeurs, d’autres acteurs agissent selon des intérêts à long terme. Ceux qui ne comprennent pas ces règles du jeu ne façonnent pas, ils réagissent.
20:56 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, conférence de munich, diplomatie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Trump a divisé l’Occident en cinq parties

Trump a divisé l’Occident en cinq parties
Alexandre Douguine
La politique mondiale traverse des processus extrêmement rapides et dynamiques. Cela est en grande partie dû à la politique de Trump, qui a introduit dans le système des relations internationales un niveau élevé de turbulence, d’imprévisibilité et de radicalité, et les événements se développent de manière de plus en plus intense.
Devant nos yeux, la conception d’un Occident collectif s’effondre, c’est-à-dire la politique solidaire et assez prévisible des principales puissances occidentales et des pays qui suivent entièrement la ligne de l’Occident. Un tel consensus n’existe plus. Les projets mondialistes se fissurent, même l’unité euro-atlantique, l’avenir de l’OTAN et de l’ONU sont remis en question. Trump a déclaré explicitement que le droit international ne le concerne pas et qu’il agit selon ses propres idées, selon son propre jugement de ce qui est moral ou non.
Les revendications de Trump concernant l’annexion du Groenland et du Canada, ainsi que sa posture méprisante envers l’Europe et ses partenaires de l’OTAN (et son soutien total à Netanyahu et à sa politique au Moyen-Orient, l’absence de soutien inconditionnel au régime de Zelensky, tout en soutenant pleinement Netanyahu) aggravent encore la fracture déjà en cours ou presque réalisée.
Dans une situation où l’Occident collectif n’existe plus en tant que tout politique, idéologique et géopolitique, une nouvelle carte commence à se dessiner, où, à la place de l’Occident, apparaissent plusieurs entités distinctes et parfois conflictuelles. Ce n’est pas encore un modèle achevé, mais simplement un processus avec une fin qui demeure ouverte.
Cependant, on peut déjà supposer qu’à la place d’un Occident uni se formeront cinq entités géopolitiques distinctes. Essayons de les décrire.

Les États-Unis de l’ère Trump 2.0 comme l’Occident numéro un
Les vues géopolitiques de Trump diffèrent radicalement de la stratégie mondialiste suivie par les administrations précédentes, non seulement sous les démocrates, mais aussi sous les républicains (comme sous George W. Bush). Trump proclame ouvertement une hégémonie américaine directe, qui comporte plusieurs niveaux.
Il souhaite avant tout affirmer la domination des États-Unis dans l’espace des deux Amériques. Cela est reflété dans la dernière version de la Stratégie de sécurité nationale, où Trump se réfère directement à la doctrine Monroe, à laquelle il ajoute sa propre vision.
La doctrine Monroe a été formulée par le président James Monroe le 2 décembre 1823 dans son discours annuel au Congrès. L’idée principale était d’obtenir une indépendance totale du Nouveau Monde vis-à-vis de l’Ancien (c’est-à-dire des métropoles européennes), et les États-Unis étaient considérés comme la principale force politique et économique pour libérer les États des deux Amériques du contrôle européen. Il n’était pas explicitement dit qu’une forme de colonialisme (européen) allait être remplacée par une autre (américaine), mais une certaine hégémonie des États-Unis dans la région était sous-entendue.
Dans sa lecture moderne, en tenant compte des nouveautés de Trump, la doctrine Monroe implique ce qui suit :
- La souveraineté totale et absolue des États-Unis, indépendants de toute institution transnationale, rejet du mondialisme ;
- La suppression des influences géopolitiques majeures sur tous les pays des deux Amériques par d’autres grandes puissances (Chine, Russie, et pays européens) ;
- L’établissement d’une hégémonie militaire, politique et économique directe sur les deux continents et les espaces océaniques adjacents par les États-Unis.
Cette doctrine prévoit aussi la promotion de régimes vassaux des États-Unis en Amérique latine, le remplacement de toutes les politiques qui s'avèreront indésirables à Washington, et l’interférence dans les affaires intérieures des États de cette zone — souvent sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue, l’immigration illégale, voire le communisme (Venezuela, Cuba, Nicaragua). En résumé, ce n’est pas très différent de la politique poursuivie par les États-Unis au 20ème siècle.
Ce qui est nouveau avec la doctrine de Trump, c’est sa revendication d’annexer le Groenland et le Canada, ainsi que sa posture méprisante envers l’Europe et ses partenaires de l’OTAN.
En substance, les États-Unis sont ici proclamés comme un empire, entouré de pays vassaux qui doivent demeurer dans une dépendance vassale vis-à-vis de la métropole. C’est ce qui est reflété dans le principal slogan de la politique de Trump: Make America Great Again ou son synonyme America First.
Trump poursuit cette ligne de manière bien plus ferme lors de son deuxième mandat que lors du premier, ce qui modifie radicalement l’équilibre des forces à l’échelle mondiale.
On peut considérer cette vision trumpiste, américanocentrique, de l’Occident comme l’Occident numéro un.

L’Union européenne comme l’Occident numéro deux
L’Occident numéro deux devient alors l’Union européenne, qui se trouve dans une situation très compliquée. Pendant des décennies, les pays de l’UE ont orienté leur politique, leur sécurité et même leur économie en fonction des États-Unis dans le cadre du partenariat atlantique, choisissant à chaque fois entre la souveraineté européenne et la soumission à Washington, cette dernière posture étant la plus souvent favorisée.
Les anciens dirigeants américains faisaient semblant de considérer les Européens comme des partenaires presque équivalents, et leur opinion était prise en compte, ce qui créait l’illusion d’un consensus au sein du « collectif » Occident. Trump a brisé ce modèle, forçant brutalement l’Union européenne à reconnaître sa position de vassale.
Ainsi, le Premier ministre belge De Wever, en janvier 2026, lors du Forum économique mondial à Davos, a parlé ouvertement d’un « heureux vassal » et d’un « esclave malheureux » dans le contexte de la dépendance de l’Europe aux États-Unis.
Les élites européennes étaient auparavant des « vassaux heureux ». Trump a vu cette situation sous un autre angle, et ils se sont sentis comme des « esclaves malheureux ». Il a souligné le choix entre le respect de soi et la perte de dignité sous la pression de Washington concernant l’annexion du Groenland, mais l’UE n’est pas encore prête à faire un tel choix.
Dans cette nouvelle configuration, l’UE, contre sa volonté, devient une entité plus autonome. Macron et Merz ont parlé de la nécessité d’un système de sécurité européen, car les États-Unis ne représentent plus la garantie de cette sécurité, mais une menace nouvelle et sérieuse.
L’UE n’a pas encore pris de mesures décisives, mais ses contours du second Occident deviennent de plus en plus clairs.
La position de l’UE sur l’Ukraine diffère fortement de celle de Trump : le président américain veut mettre fin à cette guerre contre la Russie (du moins le dit-il), tandis que l’UE veut la poursuivre, voire participer directement.
Les positions concernant Netanyahu et le génocide des Palestiniens à Gaza diffèrent aussi : Trump soutient totalement, l’UE condamne davantage.

Le Royaume-Uni comme troisième Occident
Face à cette fracture atlantique, le Royaume-Uni, après le Brexit, demeure une autre puissance — le troisième Occident.
D’un côté, la politique libérale de Starmers est proche de celle de l’UE, mais de l’autre, Londres entretient traditionnellement des relations étroites avec les États-Unis, jouant le rôle de superviseur des processus européens depuis Washington.
Mais le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE, et il ne soutient pas la ligne de Trump, où il joue un rôle peu enviable de simple esclave-vassal, comme le dit le Premier ministre belge.
Le Royaume-Uni ne peut plus jouer le rôle de médiateur international, devenant dans plusieurs situations une partie intéressée, notamment dans le conflit ukrainien, où il a totalement adopté la position de Kiev et a même amorcé l’escalade avec la Russie, y compris avec une implication militaire directe aux côtés du régime de Zelensky.
C’est notamment la visite du Premier ministre britannique Boris Johnson en Ukraine qui a ruiné les Accords d’Istanbul de 2022.
Mais le troisième Occident britannique ne peut pas revenir à la politique impériale d’autrefois. Les ressources de l’Angleterre moderne, sa dégradation économique et la crise migratoire empêchent tout rôle de leader dans le Commonwealth ou toute hégémonie en Europe.

Les globalistes comme le quatrième Occident
Avec l’idéologie, les réseaux organisationnels et les institutions des globalistes, comme George Soros, avec le Forum économique mondial et d’autres organisations internationales prônant l’idée d’un gouvernement mondial et d’un monde unifié, nous obtenons le quatrième Occident.
Ce dernier a été la principale force qui a dicté le ton à une époque, étant la force unificatrice, ce qui permettait de parler de « l’Occident collectif ». Ces cercles étaient représentés par l’élite mondialiste aux États-Unis — notamment le « deep state » contre lequel Trump a commencé à lutter.
Il s’agissait principalement de la haute direction du Parti démocrate, ainsi que d’une partie des néo-conservateurs républicains, situés entre Trump (avec son « America First ») et le globalisme classique.
La majorité des dirigeants de l’UE et même Starmers appartiennent à ce projet mondialiste, dont les positions ont fortement diminué sous Trump, ce qui a conduit à la division de l’Occident en plusieurs pôles distincts.
Un exemple récent de ce quatrième Occident, qui était autrefois unique et dominant, est le Canada. Le Premier ministre Trudeau a déclaré lors du Forum de Davos que l’ordre mondial actuel s’effondre, et que le monde est en rupture, pas en transition.
Les grandes puissances utilisent l’économie comme arme — tarifs, chaînes d’approvisionnement, infrastructure — pour faire pression, ce qui, selon lui, mène à la déglobalisation.
Il a rejeté les affirmations de Trump sur la dépendance du Canada vis-à-vis des États-Unis, appelant les États moyens à s’unir contre l’hégémonie de Trump, à diversifier leurs liens (y compris se rapprocher de la Chine), et à lutter contre le populisme.
C’est un signe que le quatrième Occident se distingue progressivement en tant que communauté séparée, basée sur des principes idéologiques et géopolitiques, en opposition de plus en plus radicale au « trumpisme » en tant que forme de l’Occident.

Israël comme cinquième Occident
Et enfin, ces dernières années, surtout après le début du second mandat de Trump, un autre Occident apparaît — le cinquième. Il s’agit d’Israël sous Binyamin Netanyahu.
Un petit pays, dépendant vitalement des États-Unis et de l’Europe, avec des ressources démographiques limitées et une économie locale, revendique de plus en plus le statut d’une civilisation autonome et joue un rôle important, voire exceptionnel, dans le destin de l’Occident dans son ensemble, en tant que bastion de celui-ci au Moyen-Orient.
Jusqu’à un certain point, Israël pouvait être considéré comme un proxy des États-Unis, un autre vassal, mais la politique de Netanyahu, la droite nationaliste radicale sur laquelle il s’appuie, ainsi que l’influence révélée du lobby sioniste israélien sur la politique américaine, ont changé la donne.
L’ample destruction de la population civile de Gaza par Netanyahu et l’émergence de leaders politiques et religieux radicaux, qui appellent ouvertement à la construction d’un Grand Israël (Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Dov Lior, etc.), ont suscité un rejet en Occident — surtout dans le deuxième, le troisième et le quatrième.
Ni l’UE, ni la politique de Starmer, ni les réseaux mondialistes (y compris le Parti démocrate américain et le gouvernement canadien de Carney) n’ont soutenu Netanyahu dans ses mesures les plus dures, notamment en ce qui concerne la guerre contre l’Iran.
Deuxièmement, le soutien inconditionnel de Trump à Netanyahu a divisé ses partisans, qui ont lancé une vague massive sur les réseaux sociaux contre l’influence d’Israël et ses réseaux dans la politique américaine.
Tout républicain ou représentant de Trump qui s’exprime publiquement se retrouve face à la question : America First ou Israel First ? Qu’est-ce qui est le plus important pour toi: l’Amérique ou Israël ?
Cela a mis beaucoup de gens dans une impasse et a détruit des carrières. Reconnaître l’un ou l’autre a été risqué à cause de l’ostracisme par des grands lobbies ou l’influence de l’AIPAC.
La publication des fichiers Epstein a renforcé la crainte que l’influence d’Israël sur la politique américaine soit excessive et disproportionnée. Il semble que Tel-Aviv et son réseau d’influence constituent une instance autonome et extrêmement importante, capable d’imposer sa volonté aux grandes puissances mondiales.
Ainsi est apparu le cinquième Occident — avec son propre programme, sa propre idéologie et sa propre géopolitique.
Conclusion
Concluons cette brève analyse de l’Occident divisé en comparant leur attitude face à la guerre en Ukraine. C’est probablement notre critère le plus important.
Le moins intéressé par ce conflit est le cinquième Occident. Pour Netanyahu, la Russie et Poutine ne sont pas le principal adversaire, et le régime de Kiev ne bénéficie pas d’un soutien inconditionnel des réseaux de droite. Dans la mesure où la Russie soutient stratégiquement, politiquement, économiquement et surtout militairement les forces anti-israéliennes au Moyen-Orient — notamment l’Iran —, le cinquième Occident se trouve objectivement du côté opposé à la Russie dans une série de conflits locaux.
Mais il ne soutient pas directement le régime de Zelensky. Bien qu'Israël ne soit pas du tout de notre côté.
Globalement, le premier Occident ne considère pas la Russie comme le principal ennemi ou objectif, même pas Trump. De temps en temps, il avance des arguments anti-russes (notamment en justifiant la nécessité d’annexer le Groenland pour des raisons de sécurité face à une éventuelle attaque nucléaire de la Russie), continue de faire pression sur Moscou de manière multilatérale et fournit des armes à Kiev.
La politique de Trump ne peut pas être qualifiée d’amie pour nous, mais, par rapport à d’autres forces au sein de l'Occident «déchiré» (et déchiré par lui-même), sa position anti-russe n’est pas extrême.
C’est tout à fait différent pour le deuxième, le troisième et le quatrième Occident. L'UE, la politique de Starmer et les réseaux mondialistes (y compris le Parti démocrate américain et le gouvernement canadien de Carney) adoptent des positions radicalement anti-russes, soutiennent inconditionnellement le régime de Zelensky et sont prêts à continuer à apporter leur soutien militaire à l’Ukraine.
Ici, la position globale est que la Russie de Poutine, qui s’oriente résolument vers un monde multipolaire et affirme sa souveraineté civilisationnelle, est idéologiquement et géopolitiquement l’opposé des plans des mondialistes pour créer un gouvernement mondial et un monde unifié.
L’exemple d’un tel État mondialiste est l’Union européenne, dont le modèle, selon les mondialistes, doit progressivement s’étendre à toute l’humanité — sans États-nations, sans religions, sans peuples ou ethnies.
Pour le deuxième et surtout pour le quatrième Occident, non seulement Poutine, mais aussi Trump, sont de véritables ennemis. D’où la naissance du mythe politique selon lequel Trump travaille pour la Russie.
Le président américain a divisé l’Occident collectif et a, en réalité, houspillé les mondialistes, qui occupaient auparavant la position centrale. Mais il ne l’a pas fait dans l’intérêt de Poutine et de la Russie, mais en fonction de ses propres idées et convictions.
Si cette tendance à la division entre le premier et le deuxième Occident se poursuit, on peut supposer que les contradictions entre Bruxelles et Washington augmenteront à tel point que les dirigeants européens commenceront à envisager de se tourner vers la Russie pour équilibrer les demandes croissantes et l’agressivité générale de Trump.
Pour l’instant, cela reste très peu probable, mais l’aggravation de la fracture du « West » en cinq entités pourrait rendre cette possibilité plus réaliste.
Et enfin, le troisième Occident, représenté par la Grande-Bretagne, est l’un des principaux pôles d’hostilité et de haine envers la Russie.
Il est difficile d’expliquer cela rationnellement, car la Grande-Bretagne n’a plus aucune réelle chance de restaurer son hégémonie. Si, au premier moitié du 20ème siècle, le Grand Jeu entre l’Angleterre et la Russie constituait l’une des principales, sinon la principale, ligne d’action de la politique mondiale, l’Angleterre a depuis perdu tout statut de puissance mondiale, le transférant aux États-Unis, son ancienne colonie.
Mais la russophobie est énorme dans les élites anglaises et ne peut pas s’expliquer seulement par la douleur d’une hégémonie perdue.
En résumé, l’Occident collectif est divisé en cinq centres de pouvoir relativement autonomes. Comment le puzzle se formera dans le futur, il est difficile de le prévoir, mais il est évident que nous devons prendre en compte ces circonstances dans notre analyse de la situation internationale. Et surtout, dans l’étude du contexte géopolitique et idéologique dans lequel se déploie notre opération spéciale en Ukraine.
20:29 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, alexandre douguine, occident |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’Arménie, le corridor du Zangezour et les équilibres dans le Caucase

L’Arménie, le corridor du Zangezour et les équilibres dans le Caucase
Ce territoire est aujourd’hui un carrefour entre les intérêts russes, turcs, iraniens, européens et américains, où Erevan n’a pas la force de s’imposer mais peut faire preuve d’intelligence en s’insérant dans le contexte.
par Giorgio Arconte
Source: https://www.barbadillo.it/128093-globalia-larmenia-il-cor...
2026 pourrait être une année déterminante pour l’avenir de l’Arménie, et ce n’est pas une figure de style mais la réalité d’un pays qui, après la perte définitive de l’Artsakh et la purification ethnique qui s'est achevée dans cette région historiquement arménienne, se trouve aujourd’hui à négocier non pas la paix, mais son espace d’existence dans le Caucase.
Erevan évolue dans un environnement stratégique radicalement changé. La Russie n’est plus le garant absolu de la sécurité qu’elle avait été dans les décennies précédentes; l’Occident offre un soutien politique mais pas de garanties militaires automatiques; l’Azerbaïdjan, fort de ses victoires et de ses revenus énergétiques, dicte le rythme des négociations; la Turquie observe et influence. Entre-temps, nous avons un petit État de trois millions d’habitants, avec une diaspora puissante mais distante, et une société traversée par de profondes fractures.
 Le gouvernement de Nikol Pashinyan (photo) a choisi une voie claire: mettre fin à la longue phase de conflit permanent. L’Artsakh a été officiellement mis de côté. On ne parle plus de statut, on ne revendique plus de droits collectifs internationalisés, on n’évoque plus d’options militaires. C’est une décision logique: éviter un nouveau choc que l’Arménie, aujourd’hui, ne pourrait pas se permettre. Mais la paix n’est jamais une action unilatérale, et l’Azerbaïdjan continue de parler du “corridor du Zangezour” avec un vocabulaire qui frôle la revendication d’extraterritorialité. La frontière est en cours de délimitation, mais la pression reste constante.
Le gouvernement de Nikol Pashinyan (photo) a choisi une voie claire: mettre fin à la longue phase de conflit permanent. L’Artsakh a été officiellement mis de côté. On ne parle plus de statut, on ne revendique plus de droits collectifs internationalisés, on n’évoque plus d’options militaires. C’est une décision logique: éviter un nouveau choc que l’Arménie, aujourd’hui, ne pourrait pas se permettre. Mais la paix n’est jamais une action unilatérale, et l’Azerbaïdjan continue de parler du “corridor du Zangezour” avec un vocabulaire qui frôle la revendication d’extraterritorialité. La frontière est en cours de délimitation, mais la pression reste constante.
Le Premier ministre arménien Pashinyan insiste sur un concept: pleine souveraineté sur les passages, intégrité territoriale mutuelle, réouverture des communications sur une base équitable. C’est une ligne cohérente mais fragile, car le déséquilibre des force entre Erevan et Bakou demeure évident. La question centrale est le fameux corridor de Zangezour. Pour Bakou et Ankara, c’est la pièce qui relie l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan, consolidant ainsi la continuité turco-azerbaïdjanaise dans l’espace turcophone. Pour l’Arménie, c’est une question existentielle: permettre le transit, oui, mais sans perdre le contrôle et la juridiction. Là se joue bien plus qu’une ligne de chemin de fer: c’est l’équilibre futur du Caucase méridional. Si le corridor devenait extraterritorial, l’Arménie perdrait en profondeur stratégique; s’il restait sous souveraineté arménienne, il pourrait transformer sa vulnérabilité en opportunité, en reliant l’Iran, la Russie et potentiellement l’Europe dans une nouvelle alliance commerciale. La question n’est pas seulement technique, c’est une question géopolitique pure.
L’Arménie tente un repositionnement international difficile. L’Union européenne a accru sa présence politique par le biais de la mission civile de surveillance à la frontière avec l’Azerbaïdjan. Les sommets européens prévus à Erevan en 2026 ont une forte valeur symbolique: pour la première fois, l’Arménie essaie de se présenter comme une plateforme européenne dans le Caucase. Mais Erevan reste membre de l’Union économique eurasiatique, n’a pas présenté de candidature officielle à l’UE, et continue de maintenir des canaux ouverts avec Moscou.
La Russie, bien qu'affaiblie par la guerre en Ukraine, conserve des leviers importants: la base militaire de Gyumri, le contrôle de segments d’infrastructures, l’influence économique. Moscou n’est plus le seul garant, mais ce n’est pas un acteur marginal non plus. Pendant ce temps, les États-Unis augmentent leur engagement. La visite récente du vice-président américain et le début d’une coopération dans le domaine de la défense — y compris la fourniture de drones V-BAT — marquent un changement de cap. Ce n’est pas une alliance formelle, mais un signal politique.

L’Arménie ne peut pas se permettre de choisir un camp de façon claire et nette; elle doit rester équilibrée. Le problème, c’est que l’équilibre dans le Caucase est toujours précaire. La vraie fragilité arménienne, cependant, est intérieure. Les élections parlementaires du 7 juin 2026 se tiendront dans un climat de polarisation profonde. Pashinyan se présente comme l’homme de la paix et de la stabilisation économique, tandis que ses opposants l’accusent d’avoir normalisé la défaite et d’avoir minimisé l’identité nationale. En fait, la question de l’Artsakh n’est pas effacée de la mémoire collective; pour beaucoup d’Arméniens, ce n’est pas une question territoriale, mais une blessure identitaire. De plus, la suppression de symboles historiques, comme l’iconographie de l’Ararat dans les timbres officiels, a été perçue comme une forme d’autolimitation symbolique. À cela s’ajoute le conflit avec l’Église apostolique arménienne, pilier historique de la continuité nationale. Les tensions entre le gouvernement et la direction ecclésiastique ont creusé la fracture, aussi dans la diaspora, et le risque n’est pas seulement politique: il est identitaire.
L’Arménie se trouve à un carrefour étroit: d’un côté, la normalisation avec l’Azerbaïdjan et la Turquie pourrait ouvrir des routes commerciales, réduire l’isolement, créer de la croissance; de l’autre, sans un système solide de garanties multilatérales, la paix pourrait rester réversible. Le Caucase du Sud est aujourd’hui un carrefour entre les intérêts russes, turcs, iraniens, européens et américains, où l’Arménie n’a pas la force de s’imposer, mais peut faire preuve d’intelligence en s’insérant dans le jeu comme un nœud d’équilibre. Pour y parvenir, elle doit éviter deux erreurs: croire que l’Occident remplacera automatiquement la Russie comme garant de la sécurité, ou penser que le retour exclusif sous l’aile russe est encore possible comme dans le passé.
La survie de l’Arménie, aujourd’hui, passe par une diplomatie fine, une stabilisation intérieure et une utilisation intelligente de sa position géographique. 2026 ne sera pas seulement une année électorale, mais un test de maturité géopolitique.
16:44 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, arménie, caucase, politique internationale, corridor du zangezour, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Cuba n’est plus seul

Cuba n’est plus seul
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/cuba-non-e-piu-sola/
Cuba n’est plus seul. Même si ajouter un “peut-être” me semblerait approprié.
Le resserrement des sanctions américaines, un véritable python, pourrait ne pas suffire à Trump pour faire tomber les héritiers de Fidel Castro.
Car il y a la Chine et la Russie. Et elles semblent déterminées à entrer en jeu. De manière lourde.
Xi Jinping a en effet annoncé l’installation de milliers de panneaux solaires sur la grande île. Pour compenser l’embargo énergétique de Washington.
Et Moscou se prépare à envoyer d’importants approvisionnements en pétrole par voie maritime.
La partie qui se joue autour de Cuba est extrêmement importante. Vitale pour Washington, certes. Mais tout aussi fondamentale pour Pékin et Moscou.
Il ne s’agit pas seulement de la Grande Île. C’est de la configuration future de l’Amérique latine. Et, peut-être encore plus, du système des équilibres mondiaux.
Trump, qui a pris conscience de la difficulté, ou mieux, de l’impossibilité de contrôler le monde en tant qu'hegemon – le vieux rêve de Bill Clinton – vise néanmoins un contrôle absolu et total des Amériques. Du Groenland à la Terre de Feu.
Contrôle à la fois politique et économique. Et les actions récentes entreprises par Washington, tant au Venezuela qu’au Groenland, en témoignent.
Dans ce dessein, qui prévoit une normalisation américaine non seulement des pays andins rebelles, mais aussi du Mexique et, à terme, du Brésil, Cuba représente une anomalie.
Une anomalie qui n'est pas des moindres, car La Havane échappe totalement, depuis l’époque de Castro, au contrôle de Washington. Et se présente comme une alternative au système du pouvoir américain.
La normaliser, provoquer un changement de régime, la transformer à nouveau en colonie, ou même en un grand bordel et une salle de jeux comme à l’époque de Batista, constitue donc une priorité pour Trump.
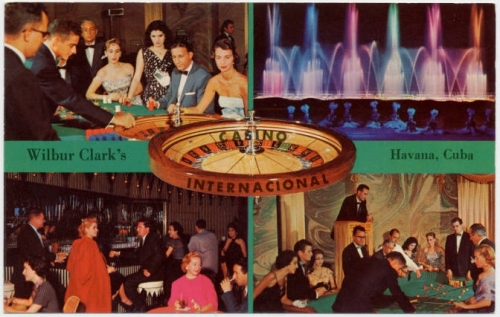
Il veut enfin régler une question restée ouverte pendant trop d’années. Et qui a causé plusieurs échecs aux stratégies de la Maison Blanche.
La Baie des Cochons, à l’époque de Kennedy, reste le seul exemple demeuré célèbre. Et emblématique.
Toutefois, l’intention du Bureau Ovale se heurte à la volonté de Pékin et de Moscou de soutenir le régime cubain. Pour remettre en question la prétention américaine d’hégémonie absolue sur les Amériques.
Et, peut-être encore plus, pour lancer un avertissement précis à Trump et à ses successeurs.
Ils ne doivent pas croire qu’ils peuvent intervenir à leur guise au Moyen-Orient ou dans d’autres zones du monde. En restant tranquilles, retranchés dans les Amériques.
Le “jeu” est mondial. Et personne ne peut plus prétendre jouir d’une sécurité totale. Même Washington dans les Amériques.
13:37 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, cuba, caraïbes, amérique latine, amérique ibérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 février 2026
Polemos. La condition de la guerre

Polemos. La condition de la guerre
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/polemos-la-condizione-della-gue...
Une réflexion, en marge de ce qui se passe sous nos yeux.
La chute du monde dans une guerre générale. Mondiale, si l’on veut la définir ainsi, bien qu’elle soit fragmentée en une pluralité de guerres et de petits conflits déconnectés les uns des autres.
Seulement en apparence, cependant. Car la condition de la guerre est générale. Et, surtout, ce sont les intérêts, qui déclenchent tant de conflits, qui sont généraux.
Bien, j’en ai déjà parlé. Peut-être même trop.
Ce qui, cependant, m’apparaît maintenant de façon presque angoissante, c’est autre chose.
La guerre, la condition de la guerre, est une constante dans l’histoire et dans la vie des hommes.
La paix ? Il est désolant de le constater, mais ce ne sont que des périodes de trêve. Plus ou moins courtes. Qui ont pour seul but de se reposer, de récupérer forces et énergies pour revenir à la lutte.
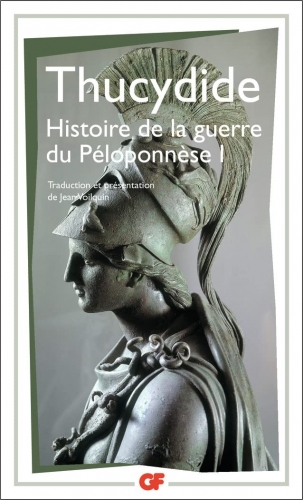
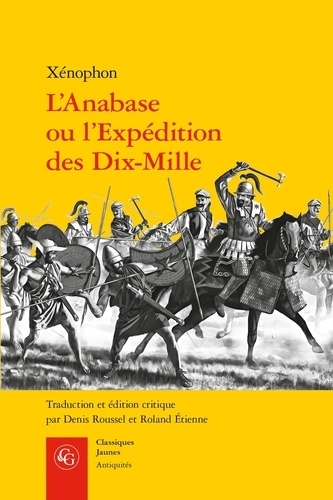
L’exemple qui me vient à l’esprit est la Guerre du Péloponnèse. Tel que nous l’a racontée Thucydide, du moins en partie. Et puis telle qu'elle le fut par d’autres, par Xénophon, etc.
Une guerre très longue. Interrompue par de longues, très longues trêves parfois. Parfois par des trêves saisonnières, car on combattait au printemps, en été. En automne et en hiver, on se consacrait aux activités agricoles nécessaires.
Ainsi, des générations entières ont grandi en Grèce antique sans connaître la paix, sauf comme une trêve courte et occasionnelle.
Et même lorsque Athènes, vaincue, capitula, il n’y eut pas de paix. De nouveaux conflits commencèrent. La Confédération de Delphes, le Tyran de Fère, Thèbes d’Epaminondas…
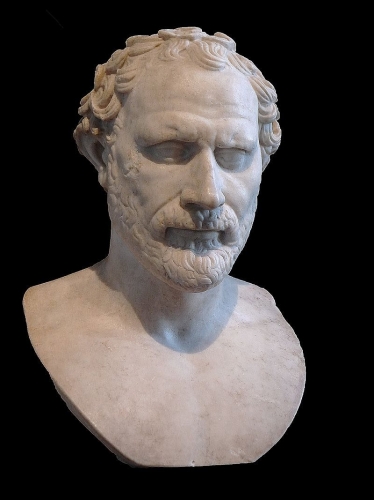
Et puis Philippe de Macédoine (buste) et son fils Alexandre…
Il n’y eut donc jamais la paix utopique et idyllique. Absolue. C'est une illusion. Un rêve.
Notre histoire, celle de l’humanité en général, est bien illustrée par celle de la Grèce antique.
Prenons presque le temps présent.
La longue trêve, de plus d’un demi-siècle, s'appelle la Guerre froide. Qui, certes, a représenté une saison de paix, bien qu'angoissée, pour nous, Européens.
Et qui, cependant, a vu se déclencher et se dérouler des guerres ailleurs. Menées directement entre les États-Unis et l’URSS, ou plus exactement, par procuration. Le Vietnam, la Corée… juste deux exemples parmi tant d’autres.
Puis, la chute de l’URSS. La Glasnost, vouée à l’échec, de Gorbatchev. Les années folles et dissipées d'Eltsine.
Mais ce n’était pas la paix. Juste une illusion d’hégémonie mondiale américaine. Représentée par Bill Clinton qui riait. Et jouait du saxophone.
Cela a duré très peu de temps. Tout comme la “fin de l’histoire”, théorisée par Fukuyama, n’a duré que l'espace d'un instant. Qui a dû ensuite vite rétropédaler. Faire un mea culpa sincère.
Et nous voilà déjà aux portes de l’Ukraine. Du conflit mondial asymétrique dont ils subissent les ravages. Inconscients.
Mais avant cela, il y a eu la Somalie, les guerres africaines, le Moyen-Orient perpétuellement en flammes… et je pourrais continuer, longtemps, très longtemps. Malheureusement.
Alors? Je pense que les anciens Grecs avaient raison. La condition naturelle de l’homme est le conflit. La guerre. Le Polemos.

La seule possibilité pour nous, les humains, n’est pas de rêver la paix, impossible, mais d’établir des règles précises de guerre. Jusqu’à la ritualiser, comme dans les tournois du Moyen Âge lointain.
Ce qui manque aujourd’hui, malheureusement. Car les élites actuelles se révèlent pires qu’incompétentes. Totalement désintéressées du destin des peuples qu’elles devraient gouverner.
Et qui, au contraire, les conduisent à l’abattoir.
19:14 Publié dans Actualité, Polémologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, guerre, polémologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les vigilants aux abonnés absents

Les vigilants aux abonnés absents
par Georges Feltin-Tracol
Ancienne militante de l’UMP qui soutint à la primaire de la droite et du centre de 2016 Alain Juppé avant de rallier quelques mois plus tard Emmanuel Macron, Aurore Bergé exerce à compter du 11 janvier 2024 (avec une brève interruption sous Michel Barnier) le rôle de ministresse déléguée chargée à l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la sacro-sainte lutte contre les discriminations. À cette fonction subalterne, elle a appartenu et appartient encore aux gouvernements de Gabriel Attal, de François Bayrou et de Sébastien Lecornu.

En juillet 2025, elle a fomenté une coalition autour d’une dizaine d’associations déjà grassement subventionnées afin de combattre une soi-disant haine en ligne: comprendre les canaux de diffusion de la ré-information et de la liberté d’expression.
Afin d’améliorer le travail de cette nouvelle censure numérique, elle a osé débloquer plusieurs millions d’euros en ces temps de restriction budgétaire. Mais au diable l’avarice quand un tel combat ontologique frôle un sommet eschatologique! On doit cependant s’étonner que toutes les ligues de petite vertu, toujours prêtes à dénoncer et à déposer plainte pour des broutilles, demeurent silencieuses face à la résurgence incroyable des « heures-les-plus-sombres-de-leur-histoire » dans le tourisme de masse.

En effet, depuis le 14 janvier dernier, plusieurs hauts-lieux touristiques et musées français (le Louvre, les châteaux de Versailles et de Chambord, l’ensemble de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle sur l’Île de la Cité et l’Opéra Garnier) pratiquent une tarification différenciée. Les touristes non-citoyens ou non-résidents d’un État-membre de l’Union dite européenne ainsi que ceux de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein (et quel sort pour les Andorrans, les Monégasques et les Saint-Marinais?) doivent payer un prix d’entrée augmenté de 45%, soit 32 euros. À Versailles, ce sont trois euros supplémentaires pour les étrangers. Quant à Chambord, les «privilégiés» paient 21 euros et les extra-Européens 31 euros ! La préférence nationale existerait donc bien !
La direction de ces établissements à la renommée internationale justifie cette distinction tarifaire au nom d’inévitables travaux de rénovation qui s’élèvent, par exemple, à plus d’un milliard d’euros pour le seul Louvre. Tablant sur une fréquentation touristique en hausse, le gouvernement envisage neuf millions de visiteurs par an, soit la possibilité d’engranger chaque année entre 20 et 30 millions d’euros rien que pour le Louvre. En janvier 2025, le Louvre, cette autre gare parisienne où l’on circule comme dans un moulin, avait augmenté l’entrée de 17 à 22 euros…

En raison des variations de prix, les agents des musées doivent désormais vérifier l’identité des visiteurs. Le temps d’attente devant la tristement célèbre pyramide de l’architecte Ming Pei risque de s’étirer encore plus. Or, avec le risque de manquer d’effectifs de contrôle, on peut envisager une procédure de fluidification des admissions en recourant au QR-code à l’instar des temps maudits de l’imposture covidienne.
On s’en doute: les syndicats fulminent contre «cette double tarification qui foule aux pieds notre Histoire républicaine et l’universalisme fondateur du musée du Louvre». Ils ont raison parce qu’ils y voient avec justesse une éclatante démonstration de discrimination. L’hostilité à toutes les formes de discrimination reste pourtant le mantra officiel de cette république croulante. Le régime républicain vermoulu les condamne toutes, mais il en promeut d’autres. Attention Marianne ! La schizophrénie te guette !!!
Parmi les nombreux (et exagérés) motifs de discrimination pénalement répréhensibles se trouve l’origine, en l’occurence pour les musées, la nationalité. Faire payer plus cher les touristes étrangers sous le prétexte qu’ils sont précisément des étrangers représente un singulier paradoxe. Pour paraphraser la magnifique saynète des Inconnus, il y aurait de bonnes discriminations et de mauvaises discriminations. Qui aurait la capacité d’effectuer cette distinction? L’État? Les associations para-étatiques? Le quidam? Le hasard?
Les bonnes discriminations ne s’arrêtent pas aux seuls musées. Dans les métropoles mondialisées, il devient courant que des boîtes de nuit et des bars réservent la fin d’après-midi ou le début de soirée à des fêtes exclusivement ouvertes aux femmes, souvent mères de famille harassées par leur progéniture. À part les vigiles, les responsables légaux de l’établissement et, peut-être, le serveur au bar, toute présence masculine y est proscrite. Pis, des féministes tiennent des réunions non mixtes excluant les hommes blancs cisgenres hétérosexuels de tout âge. Entend-on les ligues de petite vertu s’indigner de ces actes discriminatoires assumés ? Non, elles préfèrent viser l’Institut Iliade qui tiendrait des réunions avec uniquement des Albo-Européens ou bien Le Canon français qui organise dans tout l’Hexagone des réunions festives accompagnés de chants traditionnels, de charcuterie et de vins de terroir.

L’extrêêêêêêêêêêêêêêêêêêêême droite tapie dans l’ombre serait à la manœuvre. On frise ici le complotisme à l’état pur, mais comme il est propagé par les plumitifs de gauche, cela ne choque personne.
La fin du mois de janvier vient d’être secouée par une polémique futile. La SNCF propose, contre un billet plus élevé, à ses clients qui prennent les TGV en semaine des compartiments sans enfants, la classe Optimum Plus.

La compagnie ferroviaire française ne fait que suivre une tendance sociétale bien vivace. Outre les mariages, bien des restaurants, des hôtels et des centres de loisirs refusent la venue de jeunes enfants de moins de 12 ans. Certaines associations condamnent cette mode, reflet manifeste du naufrage historique du système scolaire hexagonal. Les gamins dérangent parce que leur éducation à l’école repose sur la bienveillance, ce terme politiquement correct pour désigner le laxisme.
Hormis Jean-Yves Le Gallou dans un article mis en ligne sur Polémia le 2 janvier dernier, personne n’a enfin réagi aux propos pitoyables tenus en décembre 2025 par Mathias Wargon, le patron des urgences à l’hôpital Delafontaine en Seine – Saint-Denis. L’urgentiste médiatique suggérait de refuser les malades de la grippe de plus de 65 ans non vaccinés. Singulière application du serment d’Hippocrate ! Dans « Matthias Wargon veut interdire les urgences médicales aux non-vaccinés », le président – fondateur de Polémia cingle avec un rare bonheur les contradictions de l’époux d’Emmanuelle Wargon, ancienne ministresse des gouvernements d’Édouard Philippe et de Jean Castex, fille par ailleurs de l’immigrationniste Lionel Stoléru. « Wargon veut-il aussi fermer les urgences aux victimes de coma alcoolique et les hôpitaux aux alcooliques, écrit Jean-Yves Le Gallou ? Wargon veut-il interdire des soins aux drogués et aux victimes d’overdose. Allons plus loin, Wargon veut-il fermer l’hôpital public aux accidentés de sports à risque – équitation, parachutisme, alpinisme par exemple – activités dangereuses qu’ils auraient pu sagement éviter de pratiquer ? Pourquoi aussi ne pas limiter l’accès aux soins cardiovasculaires pour les obèses souvent jugés responsables de leur état en raison de leur alimentation et de leur sédentarité ? Dans le même ordre d’idées, faut-il conditionner l’accès aux soins respiratoires aux non-fumeurs ? On peut d’ailleurs poursuivre l’idéologie wargoniste à l’infini et reprocher à certains malades du SIDA ou de MST d’être la cause de leur malheur par certaines de leurs pratiques sexuelles dangereuses. » Aucune officine spécialisée dans la délation n’a attaqué le médecin devant la justice. En aurait-il été autrement s’il avait porté une chemise noire ?
L’hostilité officielle aux discriminations est une vaste et coûteuse fumisterie. Selon son étymologie latine, discriminer signifie « mettre à part, séparer, distinguer ». Mettre à part, distinguer, séparer sont des actions de tous les jours. Tout un chacun discrimine en permanence. S’il choisit telle compagne et non une autre, il pratique une discrimination. S’il préfère acquérir une maison résidentielle péri-urbaine et non un appartement miteux dans un immeuble de banlieue saturé par l’immigration, il réalise une autre discrimination.

Avant de conclure, n’oublions pas enfin que la discrimination est parfois recommandée et même encouragée. Les ménages doivent trier les ordures et les distinguer selon leur caractère domestique, alimentaire ou recyclables (papier, carton, bouteilles en plastique). Notons au passage que le « tri sélectif » constitue un pénible pléonasme puisque trier, c’est distinguer et donc sélectionner… Loin de l’opinion officielle, les discriminations façonnent le quotidien. Dans une logique évolutionnaire darwinienne, c’est grâce à ce jeu complexe que s’opère la sélection des espèces. La réalité le prouve avec aisance: discriminer, c’est vivre!
GF-T
«Chronique flibustière», n° 181, mis en ligne le 11 février 2026 sur Synthèse nationale.
17:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, france, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’affaire Epstein? Nous en avions tout dit il y a cinq ans

L’affaire Epstein? Nous en avions tout dit il y a cinq ans
Pierre-Emile Blairon
Presque jour pour jour. C’était le 7 février 2021 dans un article intitulé Mais quelle est cette secte qui dirige le monde ?
Vous trouverez cet article en note [1] de cette présente intervention.
On a toujours tort d’avoir raison trop tôt: cette phrase pourrait être la devise de ceux que la caste dominante, les comploteurs, appelle dédaigneusement les complotistes. Car il n’est pas facile d’être constamment en butte et en lutte avec la majeure partie de ses semblables à qui les « complotistes » ne veulent que du bien, il ne s’agit pas de masochisme, c’est une mission pour les « complotistes ». Le moteur des « complotistes », que j’appellerai plus simplement et moins agressivement des personnes honnêtes, lucides et dévouées, est la quête constante de la vérité et la dénonciation de l’injustice dans une démarche altruiste d’aide à son prochain.
Malheureusement, ce dernier, le plus souvent intoxiqué et formaté de longue date par les comploteurs, adopte à l’encontre des « complotistes » une attitude de rejet afin de protéger son confort intellectuel, et aussi matériel.

La transgression assumée et partagée des « élites »
Un ami m’a envoyé ce matin une information à propos d’un professeur chinois nommé Jiang Xueqin, désormais célèbre dans le monde entier pour sa thèse à propos de ces « élites » qui dirigent le monde dont le comportement, les réactions et les idées qu’elles soutiennent sont exactement identiques quel que soit leur pays d’origine.
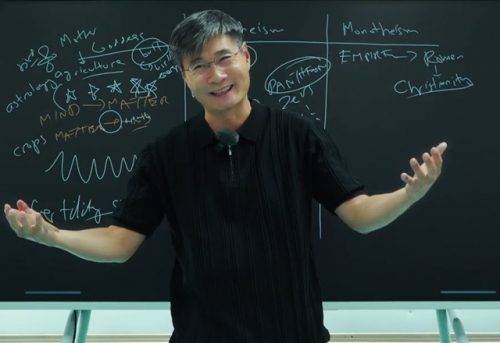
Il a notamment été interrogé par un autre professeur tout aussi célèbre dont nous avons souvent diffusé les interviews d’analystes toujours passionnants, le professeur norvégien Glenn Diesen [2].
Le professeur Xueqin (photo) a élaboré l’idée que les élites au pouvoir (qu’elles soient politiques, financières, culturelles ou technologiques) ne se maintiennent pas seulement par l’argent, les institutions ou la violence légale. Elles utilisent aussi - et surtout - la transgression délibérée et partagée comme un outil de cohésion et de contrôle extrêmement puissant.
En résumé, son argumentation se déroule souvent ainsi:
- La transgression crée une loyauté plus forte que n’importe quel contrat ou idéologie.
Quand un groupe commet ensemble des actes qui violent les tabous les plus profonds de la société (sexuels, violents, moraux, légaux), cela crée un lien indestructible: chacun sait que les autres peuvent le détruire s’ils parlent. Chacun sait aussi que les autres ont autant à perdre que lui. Cela produit une confiance mutuelle extrême et une coordination quasi-parfaite, bien plus solide que chez les gens «normaux».
- Plus la transgression est grave, plus le groupe est cohérent. Il cite souvent en exemple: les abus rituels sur mineurs, les violences sexuelles organisées, les meurtres rituels ou sacrifices et l'anthropophagie. Plus l’acte est considéré comme ʺimpardonnableʺ par la société normale, plus il lie les participants entre eux.
- Les scandales ne détruisent pas les élites, ils les renforcent (paradoxalement). Jiang explique que les grandes affaires (style Epstein et bien d’autres) ne font pas tomber les systèmes de pouvoir. Au contraire.
C’est pourquoi, selon lui, les élites peuvent accumuler toujours plus de pouvoir même quand leurs actes sont connus: la transgression n’est pas un défaut du système, c’est une de ses technologies principales de survie».
La règle divine du libre-arbitre
Le professeur Xueqin a le mérite d’apporter une explication rationnelle à des comportements que les gens normaux seraient incapables d’expliquer.
La thèse du professeur Xueqin apporte un volet psychologique qui vient s’insérer cependant dans un dispositif plus large et plus diversifié dans ses modalités pour expliquer le caractère et les agissements de ces individus qu’on appelle communément dans le jargon psychiatrique des psychopathes mais dont certaines variantes présentent des anomalies telles qu’elles font de ces gens des monstres qui semblent ne pas appartenir à l’espèce humaine.
C’est un peu vrai.

Quand j'écris ou que je décris ce qui va se passer plusieurs années plus tard, ce n'est pas parce que je suis un devin, mais parce que j’ai appris à écouter ce que disent les suppôts de Satan; j’ai écrit dans beaucoup de mes articles que nos persécuteurs ne cachent rien des sévices qu’ils nous préparent; parce que les grands de ce monde sont obligés à une règle imprescriptible: ils doivent dire longtemps à l'avance ce qu'ils vont faire, parce que cette obligation fait partie de leurs croyances (ils sont tous satanistes, le satanisme est une croyance). Selon leurs préceptes, Dieu est supérieur à Satan mais Satan est le prince de notre monde matériel auquel Dieu a donné un royaume tangible, concret: la Terre; régner sur notre planète, c'est la prérogative de Satan; il est cependant astreint à respecter certaines règles imposées par Dieu.
Les satanistes doivent laisser le choix aux humains de décider eux-mêmes de leur sort: c'est ce que les chrétiens appellent le "libre-arbitre"; les humains sont donc avertis de ce qui va leur arriver. Et les satanistes ne sont plus ni responsables ni coupables (nous avons déjà entendu ce type d’argumentation) puisque les humains sont informés; les satanistes ne peuvent pas nous faire de mal sans notre consentement (mais les satanistes s’arrangent avec cette loi, par exemple en respectant le vieux dicton: qui ne dit mot consent).
La loi du libre-arbitre n’appartient pas spécifiquement au christianisme; selon Sandrine Muller [3] (photo), c’est une loi universelle: ce qui coule d’un côté doit être rempli de l’autre pour respecter l’équilibre du monde et du cosmos: on reçoit autant que l’on donne et vice-versa : on inspire, on respire, c’est une règle comptable: débit-crédit; la loi du karma est aussi une variante indoue de la notion de libre-arbitre: on récolte ce que l’on sème.

Il y a d'autres possibilités d'être informés par avance: l'intuition, l'expérience, l'observation; il est facile de savoir ce que prépare l'élite: il suffit de comprendre et d'aller en sens inverse des "infos" diffusées par la presse télévisuelle de grand chemin, etc.
De ce qui résulte de ce que je viens d’écrire, il faut comprendre que les informations divulguées par l’administration américaine feront tomber des têtes mais ne changeront pas grand-chose au fond du problème et que les satanistes resteront au pouvoir tant que leurs forces, qui ne sont pas inépuisables, les porteront; il nous appartient de nous organiser, afin que leurs agissements ne puissent pas nous atteindre ; les personnes qui sont, ou qui ont été, sous la coupe d’un manipulateur pervers narcissique savent de quoi je parle : il n’existe plus dès qu’on l’ignore. C’est à nous de répondre à ces forces obscurantistes en leur opposant la Lumière qui nous guide.
Pierre-Émile Blairon
Notes
[1] http://euro-synergies.hautetfort.com/apps/search/?s=mais+...
17:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaire epstein |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lyon, Quentin, un seuil est franchi

Lyon, Quentin, un seuil est franchi: l’antifascisme imaginaire tue
par Sergio Filacchioni
Source: https://www.ilprimatonazionale.it/approfondimenti/lione-q...
Rome, 14 février – Une conférence de la députée de gauche Rima Hassan, qui s’est tenue le 12 février à l’Institut d’Études Politiques de Lyon, s’est transformée en un grave incident, où le sang a coulé. En effet, aux abords du lieu où se déroulait l’événement, une agression a eu lieu, qui a fait une victime Quentin, 23 ans, qui serait intervenu — selon les versions — pour défendre des activistes du collectif identitaire Nemesis présentes sur place lors d’un flash mob de protestation.
À Lyon, le sang recommence à couler
Selon les dénonciations des militants eux-mêmes, un groupe d’environ trente antifascistes, affiliés au groupe de la Jeune Garde, aurait encerclé et frappé plusieurs personnes. Quentin aurait été atteint de coups de poing et de pieds, même une fois à terre, subissant de graves traumatismes crâniens. Transporté en urgence à l’hôpital Édouard-Herriot, il a été admis dans un état critique. Dans les heures qui ont suivi, son état s’est aggravé jusqu’à son décès, selon les mêmes sources proches du collectif. Les autorités françaises ont ouvert une enquête pour meurtre volontaire et analysent les vidéos de surveillance ainsi que les témoignages pour reconstituer la dynamique exacte des faits et identifier d’éventuels responsables. Parmi les noms cités par les activistes de Nemesis, figure celui de Jacques-Élie Favret. Sa présence dans le groupe responsable du meurtre brutal indique comment la gauche structure le conflit politique: Favret est collaborateur du député de La France Insoumise, Raphaël Arnault.
Seul contre un grand nombre
Avec l’assassinat de Quentin, la France et l’Europe sont confrontées à un fait qui ne s’était pas produit depuis des années: un jeune militant a été tué lors d’une attaque organisée et politiquement protégée par l’extrême gauche. Un événement qui ne peut pas nous laisser indifférents en Italie: de Sergio Ramelli à Paolo Di Nella, les agressions antifascistes ont marqué une période sanglante de notre histoire nationale récente. Et, non, le discours sur les “extrêmes opposés” ne tient pas. Quentin, Sergio et Paolo ont été attaqués par de nombreux adversaires alors qu'ils étaient seuls: certains revenaient chez eux, d’autres collaient des affiches, d’autres encore se sont avancés. Des militants politiques qui n’ont pas brandi d’arme ou de bâton, mais qui avaient le courage de vouloir changer le destin de leur pays. Quentin était un patriote, un catholique dévot, un garçon sportif et amoureux de la lecture. Selon les témoins, il n’aurait pas hésité à se porter volontaire pour protéger les jeunes activistes du collectif féministe/identitaire lors d'un moment de tension maximale. C’est cet élément, plus encore que la dynamique violente, qui frappe ceux qui le connaissaient: l’idée d’une responsabilité assumée personnellement, sans calcul.
L’antifascisme à l’épreuve des faits
Pendant des années, une certaine mouvance politique a revendiqué “l’antifascisme militant” comme une catégorie légitime, distincte de la violence. Pourtant, lorsqu’un antifascisme se structure comme présence organisée dans la rue, prête à l’affrontement physique, la frontière entre politique modérée et politique violente disparaît. Si la France a connu ces dernières années dissolutions, polémiques et procédures surtout contre des groupes identitaires et nationalistes, il est évident que la tolérance pour certaines formes de militantisme de gauche a nourri leur aura d’impunité. En fin de compte, lorsque des partis structurés présentent des candidats issus de l'activisme radical, les protègent ou légitiment de telles figures, le message est clair: cet engagement fait partie intégrante du champ politique institutionnel. Le cas d’Ilaria Salis en Italie — devenue symbole avant même la fin de sa procédure judiciaire — illustre cette dynamique où le charognard est transformé en modèles pour la représentation politique par des partis qu’on voudrait en théorie modérés, qu'ils soient “verts” ou de centre-gauche.
À Lyon, le climat change pour tous
Pendant des années, on a répété que “tuer un fasciste n’est pas un crime”, que l’adversaire politique n’est pas un concurrent mais une menace ontologique, le saut de la délégitimation morale à l’agression physique n’est pas une aberration imprévisible: c’est une dérive logique. Et le problème ne concerne pas seulement la France. En Italie, en 2025, à Padoue, un militant de CasaPound a fini à l’hôpital après une attaque antifasciste organisée pour frapper durement. Nous nous souviendrons de Quentin, mais pas comme d’une victime. Nous nous souviendrons du courage et de la détermination avec lesquels cet “un” est meilleur que ce “beaucoup”. Nous nous souviendrons de ce jour comme le point où une nouvelle ère de radicalisation tragique trouve sa pleine éclosion. Parce qu’à partir de maintenant, personne ne pourra plus faire semblant que ce n’est qu’un simple conflit politique. Une nouvelle frontière a été franchie. Et quand une frontière est dépassée, le climat change pour tous.
Sergio Filacchioni.
Sergio Filacchioni est journaliste, graphiste et photographe, actif avec le site en ligne Il Primato Nazionale. Rome. Il est né en 1998.
* * *
16:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, quentin, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


