Bulletin célinien n°406 (avril 2018)
Sommaire :
Élizabeth, une vie célinienne
Rencontre avec Jean Monnier
Le bras de fer entre Gallimard et le Crif continue
La nouvelle épuration littéraire
Lettres d’Alphonse Juilland à Éric Mazet (I).
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Bulletin célinien n°406 (avril 2018)
Sommaire :
Élizabeth, une vie célinienne
Rencontre avec Jean Monnier
Le bras de fer entre Gallimard et le Crif continue
La nouvelle épuration littéraire
Lettres d’Alphonse Juilland à Éric Mazet (I).
 C’est une sorte de miracle: à la fin de l’année passée, Rémi Ferland, l’éditeur des Écrits polémiques, découvre au marché aux puces de Québec quelques exemplaires d’une brochure à la couverture bleu ciel: L.-F. Céline / Lettres familières. Au sommaire: trente-deux lettres, soit onze à sa fille Colette et vingt et une à Édith Follet, sa deuxième épouse. Toutes écrites après la guerre : les premières du Danemark, les suivantes de Meudon. La composition, réalisée à l’aide d’une machine à écrire électrique, est rudimentaire. Guère d’indication si ce n’est une mention anonyme d’éditeur : « Petits papiers / près Halifax / chez la Belle Hortense (sur le port) ». Qui a donc pu publier outre-Atlantique ce modeste recueil recelant de vrais trésors ? Le mystère est entier… Toujours est-il que Ferland a eu la bonne idée de rééditer cette correspondance sous la forme d’une élégante plaquette avec, cette fois, comme titre Lettres à Édith et à Colette (voir en dernière page). Dans sa biographie, François Gibault nous en avait déjà révélé quelques unes et il n’avait certes pas eu tort d’écrire que beaucoup de celles adressées à Édith « sont de véritables lettres d’amour ». En témoigne notamment cette lettre qui commence ainsi : « Que tu le veuilles ou non tu seras mon Édith chérie jusqu’à la mort et au-delà ! » et où percent, comme dans bien d’autres, le remords et les regrets: « Mon Édith chérie encore bien pardon je suis bien marri et j’ai bien souffert je t’assure et je suis bien malheureux de penser à ma sottise. » C’est assurément un Céline bien différent de celui que l’on nous dépeint aujourd’hui qui apparaît dans cette correspondance. Un être tout en sensibilité, d’une grande finesse et maniant un humour subtil, comme dans cette lettre où il se plaît à pasticher Mme de Sévigné : « Ma très chère, ma mie, mon cœur, je vais vous narrer une nouvelle, dont tout Versailles est bouleversé, le roi en a tenu Conseil de n’en savoir autant, voici en mille mots, non en dix ! ce qu’il faut que vous gardiez secret… » Et d’enchaîner avec cette observation prosaïque : « Votre plante bretonne, fougère d’eau, a été dépotée, et mise en terre, parfaitement, et paraît s’en trouver très bien… ne le dites à âme qui soit ! La pluie aidant vous la retrouverez géante. » Les lettres à sa fille, écrites en exil, ne sont pas moins émouvantes. L’une d’entre elles se conclut ainsi : « Oh pas de cadeaux ! pas d’envois ! Je les laisse à la douane ! Des baisers ! Des baisers ! C’est tout ! Des paroles d’espoir aussi bien que j’en tienne vraiment une immense provision en stock ! à l’écœurement ! (…) Toute mon affection à tes enfants, à toi. Ton papa. Louis. » Certains n’ont pas compris que Céline, fuyant de nouvelles affections car trop émotif, n’ait pas souhaité rencontrer ses petits-enfants à Meudon. Quant à Colette, on sait que sur le conseil de son avocat, elle renonça à l’héritage de son père. Celui qu’il eût fallu conserver précieusement c’est la correspondance qu’elle reçut de lui lorsqu’elle était enfant. Et Édith, les très nombreuses lettres qu’elle eut de Louis Destouches avant leur mariage. …Hélas !
C’est une sorte de miracle: à la fin de l’année passée, Rémi Ferland, l’éditeur des Écrits polémiques, découvre au marché aux puces de Québec quelques exemplaires d’une brochure à la couverture bleu ciel: L.-F. Céline / Lettres familières. Au sommaire: trente-deux lettres, soit onze à sa fille Colette et vingt et une à Édith Follet, sa deuxième épouse. Toutes écrites après la guerre : les premières du Danemark, les suivantes de Meudon. La composition, réalisée à l’aide d’une machine à écrire électrique, est rudimentaire. Guère d’indication si ce n’est une mention anonyme d’éditeur : « Petits papiers / près Halifax / chez la Belle Hortense (sur le port) ». Qui a donc pu publier outre-Atlantique ce modeste recueil recelant de vrais trésors ? Le mystère est entier… Toujours est-il que Ferland a eu la bonne idée de rééditer cette correspondance sous la forme d’une élégante plaquette avec, cette fois, comme titre Lettres à Édith et à Colette (voir en dernière page). Dans sa biographie, François Gibault nous en avait déjà révélé quelques unes et il n’avait certes pas eu tort d’écrire que beaucoup de celles adressées à Édith « sont de véritables lettres d’amour ». En témoigne notamment cette lettre qui commence ainsi : « Que tu le veuilles ou non tu seras mon Édith chérie jusqu’à la mort et au-delà ! » et où percent, comme dans bien d’autres, le remords et les regrets: « Mon Édith chérie encore bien pardon je suis bien marri et j’ai bien souffert je t’assure et je suis bien malheureux de penser à ma sottise. » C’est assurément un Céline bien différent de celui que l’on nous dépeint aujourd’hui qui apparaît dans cette correspondance. Un être tout en sensibilité, d’une grande finesse et maniant un humour subtil, comme dans cette lettre où il se plaît à pasticher Mme de Sévigné : « Ma très chère, ma mie, mon cœur, je vais vous narrer une nouvelle, dont tout Versailles est bouleversé, le roi en a tenu Conseil de n’en savoir autant, voici en mille mots, non en dix ! ce qu’il faut que vous gardiez secret… » Et d’enchaîner avec cette observation prosaïque : « Votre plante bretonne, fougère d’eau, a été dépotée, et mise en terre, parfaitement, et paraît s’en trouver très bien… ne le dites à âme qui soit ! La pluie aidant vous la retrouverez géante. » Les lettres à sa fille, écrites en exil, ne sont pas moins émouvantes. L’une d’entre elles se conclut ainsi : « Oh pas de cadeaux ! pas d’envois ! Je les laisse à la douane ! Des baisers ! Des baisers ! C’est tout ! Des paroles d’espoir aussi bien que j’en tienne vraiment une immense provision en stock ! à l’écœurement ! (…) Toute mon affection à tes enfants, à toi. Ton papa. Louis. » Certains n’ont pas compris que Céline, fuyant de nouvelles affections car trop émotif, n’ait pas souhaité rencontrer ses petits-enfants à Meudon. Quant à Colette, on sait que sur le conseil de son avocat, elle renonça à l’héritage de son père. Celui qu’il eût fallu conserver précieusement c’est la correspondance qu’elle reçut de lui lorsqu’elle était enfant. Et Édith, les très nombreuses lettres qu’elle eut de Louis Destouches avant leur mariage. …Hélas !
09:20 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
17:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature américaine, beat generation, lettres, lettres américaines, états-unis, années 50, années 60 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

00:15 Publié dans Cinéma, Film, Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne brassié, cheyenne-marie caron, film, cinéma, cinéma français, marc laudelout, céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, aviation, martine gay, russie, seconde guerre mondiale, urss, armée rouge |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: https://www.brusselsjournal.com
The conservative historical view tends to correlate the ascendancy of the ideological dictatorships with the degrading tumult of World War II, making of the Nazi-Communist rivalry in the 1930s the tense build-up to that war while interpreting the conflict itself as a paroxysmatic re-ordering of world politics. The regulation of the re-ordered world would be technocratic and autocratic – it would ideological – whether the victorious global hegemon was the United States of America or the Union of Soviet Socialist Republics. A type of elective étatisme was in the air. The British majority, for example, voted socialist immediately the conflict ended, contemptuously booting the architect of the victory, Winston Churchill, from office. France and Italy contended with large, well-organized Communist Parties and likewise embarked on the nationalization of their economies and the provision of generous welfare guarantees to the citizenry. The liberal colonization of institutions begins in this period, to become implacable and irreversible about the time that the Soviet Union dissolves in 1990. Quite apart from historical discussion, many non-scholars who think of themselves as conservatives nourish the notion that the “soft” totalitarianism of the contemporary politically correct regime in the West has only a short pedigree and that but a few decades ago, as in the 1950s, perhaps, tradition still reigned and things were in their proper proportion and arrangement. Of course such a view ignores the “enlightened” managerialism of Woodrow Wilson and the socialist quasi-dictatorial style of Franklin D. Roosevelt, just as it ignores the mobilized character of such phenomena as Suffragism and Prohibitionism, early phases of the liberal project that confusingly coincided with the anti-immigration and anti-Communist movements.

E. E. Cummings
The most famous literary dystopia, George Orwell’s 1984, sees publication in 1948, but the most plausible literary dystopia, Aldous Huxley’s Brave New World, sees publication in 1932. The 1920s and 30s see a flood in spate of critical anti-modern discourse, not least in the single most definitive, formally modernist, text of all, T. S. Eliot’s Waste Land (1922); but also in philosophical works by Oswald Spengler, Nicolas Berdyaev, Herman Keyserling, René Guénon, Paul Valéry, Christopher Dawson, and Jacques Maritain, and in novels and short stories by, among others, F. Scott Fitzgerald, Pär Lagerkvist, Thomas Mann, Huxley himself, and two American contemporaries of Fitzgerald, E. E. Cummings (1894 – 1962) and John Dos Passos (1896 – 1970). Cummings and Dos Passos attended Harvard as undergraduates at the same time, studied with George Santayana, and absorbed his skepticism about modernity. They decided, before Wilson took America to war, to see the front first-hand by joining the ambulance service. Cummings and Dos Passos served in the Norton-Harjes Ambulance Corps as volunteers. Both fathomed the war keenly and both wrote about their experiences within a few years of the Armistice. In The Enormous Room (1922), an experimental non-fiction novel, and in Three Soldiers (1923), a novelistic panorama of America at war, Cummings and Dos Passos respectively and decisively break ranks with what they have come convergently to regard as the claptrap of war talk and the enlistment of whole societies in a project of total conflict.
I. The correctly – that is to say, passively – educated know Edward Estlin Cummings best as “e. e. cummings,” author of brilliant lyric poems, owing something to French Symbolist poetry, and written in an idiosyncratic English that omits capitalization and scrambles grammar and syntax. (Carefully scrambles, but never flouts.) Most of Cummings’ verse belongs to the genre of erotic poetry, but more than a few items of his bardic creativity are scathingly, bitterly satiric, suggesting when taken in isolation a strain of unmitigated sarcasm.
“next to of course god america i
love you land of the pilgrims’ and so forth oh
say can you see by the dawn’s early my
country ‘tis of centuries come and go
and are no more what of it we should worry
in every language even deafanddumb
thy sons acclaim your glorious name by gorry
by jingo by gee by gosh by gum
why talk of beauty what could be more beaut-
iful than these heroic happy dead
who rushed like lions to the roaring slaughter
they did not stop to think they died instead
then shall the voice of liberty be mute?”He spoke. And drank rapidly a glass of water
 The “hip” high-school English teachers of one’s youth in the 1960s and the eager, clueless assistant professors of one’s contemporary acquaintance naturally suppose, on the basis of this quasi-sonnet (in the pattern of fourteen lines established by Petrarch), that Cummings must have conducted himself as a self-congratulating liberal, meticulously thinking only approved thoughts, quite as each of them does. Devotees of Goodthink thus interpret the poem for their students catechistically, as their instructors have previously interpreted it for them, seeing in it an attack on patriotism as such, on America as such, on seriousness and high sentiment as such, and, naturally, as the indiscriminate rejection of anything established or traditional. They mistake the syntactic displacements for the “deconstruction” of something, perceiving illusorily a model of the sacrcastico-piety that passes today as humor. When one of the professoriate kens that later in life after a visit to the Soviet Union in 1932, Cummings became an ardent anti-Communist who would defend the activities of Senator Joseph McCarthy – then, as in the case of recent Cummings biographer Christopher Sawyer-Lauçanno, the discourse devolves into condescension. Cummings acquires the epithet of a “hard-line quarrelsome conservative.” Sawyer-Lauçanno also dislikes Cummings for his disdain of homosexuals. Another critic accuses Cummings of “racism” although the use of the forbidden-for-some n-word in Cummings’ published work is obviously denunciatory.
The “hip” high-school English teachers of one’s youth in the 1960s and the eager, clueless assistant professors of one’s contemporary acquaintance naturally suppose, on the basis of this quasi-sonnet (in the pattern of fourteen lines established by Petrarch), that Cummings must have conducted himself as a self-congratulating liberal, meticulously thinking only approved thoughts, quite as each of them does. Devotees of Goodthink thus interpret the poem for their students catechistically, as their instructors have previously interpreted it for them, seeing in it an attack on patriotism as such, on America as such, on seriousness and high sentiment as such, and, naturally, as the indiscriminate rejection of anything established or traditional. They mistake the syntactic displacements for the “deconstruction” of something, perceiving illusorily a model of the sacrcastico-piety that passes today as humor. When one of the professoriate kens that later in life after a visit to the Soviet Union in 1932, Cummings became an ardent anti-Communist who would defend the activities of Senator Joseph McCarthy – then, as in the case of recent Cummings biographer Christopher Sawyer-Lauçanno, the discourse devolves into condescension. Cummings acquires the epithet of a “hard-line quarrelsome conservative.” Sawyer-Lauçanno also dislikes Cummings for his disdain of homosexuals. Another critic accuses Cummings of “racism” although the use of the forbidden-for-some n-word in Cummings’ published work is obviously denunciatory.
The book that glosses “next to of course god america i,” The Enormous Room, also testifies to its author’s youthful courage and passion for truth, recounting as it does quasi una documentaria his brutal collision with the French Republic, whose violated sovereignty, as he saw it on volunteering, he had crossed an ocean to save from “Prussian Tyranny.” (In the phrase Cummings quotes President Wilson ironically.) In uncanny anticipation of the imbroglio that first inducted Alexander Solzhenitsyn into Archipelago Gulag, an epistolary association brought the suspicious eye of the French wartime government on Cummings, whose buddy in the Norton-Harjes “Section Sanitaire Vingt-et-Un,” William Slater Brown, had written letters in which, casually, he criticized the policies of La belle nation. Betrayal would steal on Cummings, however, from more than one direction. His supervisor in the ambulance outfit, in Kafkaesque nomenclature “Mr. A,” despised Cummings and Brown because he also despised “dirty Frenchmen,” whom the two volunteers admired and with whom they persisted in fraternizing. One day, shortly after the arrival of “a gentleman in a suspiciously quiet French uniform” along with two soldiers, Cummings found himself under arrest and being transported, none too politely, to what turned out to be the Porte de Triage, essentially a political prison, at La Ferté-Macé in Lower Normandy. “Mr. A” did nothing to help either Cummings or Brown; nor did Norton-Harjes, nor did the American government.
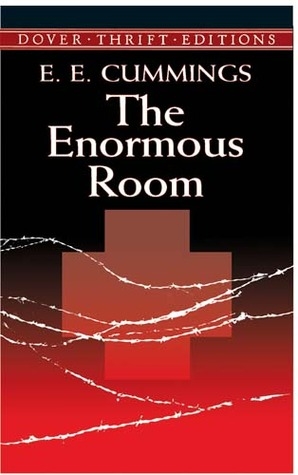 The Enormous Room provides one of the earliest accounts, outside of the French Revolution and the final half-century of Czarist Russia, of political arrest and incarceration. Like the recorders of étatist persecution in those other milieux, Cummings knows with instantaneous conviction that spying on private opinion signifies the advent of a totalitarian order the ideological rigidity and intolerance of which motivate a program of investigation and punishment. This regime directs its supervision at even the most trivial and private utterances of doubt concerning the legitimacy of the state. Such a regime must, according to the insidious logic of its principles, declare war against conscience. In so doing that regime will swiftly make hellish the nation-state it controls. From this premise about ideological-totalitarian politics comes the appropriateness of Cummings’ outstanding narrative gestures, which draw on the descent-imagery of Dante’s Inferno and the tribulation-plot of John Bunyan’s Pilgrim’s Progress. Dante’s native Florence banished him in 1301 when the Ghibelline faction gained power in the city. Bunyan wrote A Pilgrim’s Progress during his twelve years in jail (1660 – 1672) for the offending the Church of England by the lese-majesté of unlicensed preaching.
The Enormous Room provides one of the earliest accounts, outside of the French Revolution and the final half-century of Czarist Russia, of political arrest and incarceration. Like the recorders of étatist persecution in those other milieux, Cummings knows with instantaneous conviction that spying on private opinion signifies the advent of a totalitarian order the ideological rigidity and intolerance of which motivate a program of investigation and punishment. This regime directs its supervision at even the most trivial and private utterances of doubt concerning the legitimacy of the state. Such a regime must, according to the insidious logic of its principles, declare war against conscience. In so doing that regime will swiftly make hellish the nation-state it controls. From this premise about ideological-totalitarian politics comes the appropriateness of Cummings’ outstanding narrative gestures, which draw on the descent-imagery of Dante’s Inferno and the tribulation-plot of John Bunyan’s Pilgrim’s Progress. Dante’s native Florence banished him in 1301 when the Ghibelline faction gained power in the city. Bunyan wrote A Pilgrim’s Progress during his twelve years in jail (1660 – 1672) for the offending the Church of England by the lese-majesté of unlicensed preaching.
The scene in which Cummings, after a long sleepless journey by railroad and automobile, at last reaches the Porte de Triage takes inspiration from various Alighierian motifs and from the depictions of Satan by the painters of the Flemish school, especially Jerome Bosch. In the famous triptych, Bosch represents Satan as devouring and excreting the capital sinners. The policeman-clerk who processes Cummings at La Ferté-Macé cannot get his Gallic jaw around the American’s surname: “Vous êtes uh-ah KEW-MANGZ… Vous vous appelez KEW MANGZ, n’est-ce pas?” To the inquisition, “why are you here,” Cummings furnishes a non-cooperative “sais pas,” after which his inquisitor says, “Il a écrit, votre ami, des bêtises, n’est-ce pas?” The moral kernel of such black humor is the metaphysics of the proper name, which Cummings takes seriously. Mangling the name is the objective correlative, as T. S. Eliot might say, of the state’s assault on the person, the inner-person, the conscience. The same petty official says, “Your friend got you into a lot of trouble,” a clumsy attempt to misidentify the agents of injustice. “N’importe,” Cummings replies, “we are camarades.”
The system has nevertheless ingested Cummings, who finds himself in the belly of the beast, with its “monstrous atmospheric slime” and “sweet unpleasant odor.” The gendarme has ushered him into the titular Room, where some sixty inmates bide their time for having committed this or that infraction against the absolute privilege of the state. When Cummings awakes on his first morning, Slater-Brown proves himself already present, maintaining paradoxically that, “this is the finest place on earth!” Slater-Brown means what he says morally, of course. Physically, the Enormous Room is overcrowded; its denizens, through no fault of their own, bathe but rarely, and the place stinks from body-odor, piss-pots, and the cabinet d’aisance. And yet distinctions have become adamant and unavoidable. Monsieur le Directeur, for example, specializes in the bullying and abuse of those under detention. “As soon as he saw me,” Slater-Brown tells Cummings, “he bellowed: ‘Imbecile et inchrétien!’; and then he called me a great lot of other things, including Shame of my Country, Traitor to the sacred cause of Liberty, Contemptible coward and Vile Sneaking Spy.”
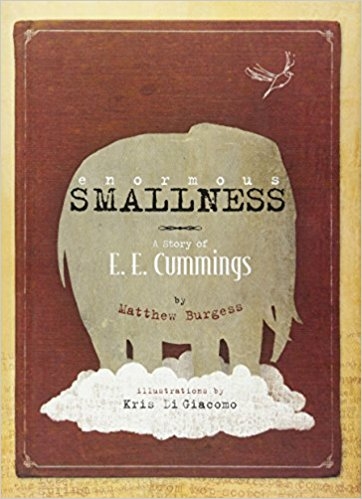 The bureaucratic vulgarity that typifies the corporate patois of La Ferté-Macé, especially the use of political clichés of the lowest order during humiliating dressings-down and interrogations, would find concentrated expression in the quasi-sonnet ‘next to of course god america i.” The punitive regimen of La Ferté-Macé extends, however, beyond ritualized verbal abuse; it extends to les cabinots – the wet tubercular chastisement cells to which, at any time, Monsieur le Directeur might consign an inmate. Cummings calls the Director “Apollyon,” the name of the devil in A Pilgrim’s Progress. In his tiny domain, reflecting the perversions in the larger domain without, the Director is “a very complete Apollyon, a Satan whose word is dreadful not because it is painstakingly unjust, but because it is incomprehensibly omnipotent.”
The bureaucratic vulgarity that typifies the corporate patois of La Ferté-Macé, especially the use of political clichés of the lowest order during humiliating dressings-down and interrogations, would find concentrated expression in the quasi-sonnet ‘next to of course god america i.” The punitive regimen of La Ferté-Macé extends, however, beyond ritualized verbal abuse; it extends to les cabinots – the wet tubercular chastisement cells to which, at any time, Monsieur le Directeur might consign an inmate. Cummings calls the Director “Apollyon,” the name of the devil in A Pilgrim’s Progress. In his tiny domain, reflecting the perversions in the larger domain without, the Director is “a very complete Apollyon, a Satan whose word is dreadful not because it is painstakingly unjust, but because it is incomprehensibly omnipotent.”
II. The Director figures forth, in Cummings’ words, the “perfect representative of the Almighty French Government.” The adjective, borrowed from theology, indicates compactly an analysis of pure secularity that affiliates The Enormous Room to the work of Edmund Burke, Joseph de Maistre, and such Twentieth Century writers as Nicolas Berdyaev and Eliot. When the state decides to promote itself to godhead the result is not divinity but devilishness, the negation of decency, and a degrading mockery of all things good. The prison building itself, a medieval structure, strikes Cummings as having once served a religious purpose, as a monastery maybe or a cloister. The Director permits Catholic Mass on Sunday, but the Mass takes on the perverse, unholy character of its surroundings. The priest, who changes every week, works with an assistant, a jailer, who never changes, and who polices the Mass, “to gaze about from time to time upon the worshippers for purposes of intimidation.” One priest solemnly tells the celebrants what they already know to be true based on their incarcerated lives, that, “L’Eternité est une existence sans durée.” Elsewhere and often Cummings refers to La Ferté as La misère.
The totalitarian regime cannot permit un-vetted thought or its expression; worse than that, the regime insists, not that the dissenter keep his peace, but that the dissenter volubly assent to the correct – to government-approved – locutions. Le gouvernement français had jailed Cummings and Slater-Brown because the latter committed to writing, in letters destined to his family back home, his private reservations about Allied war aims. Cummings shared Slater-Brown’s skepticism. Even before arriving at La Ferté, when he had only just been arrested, Cummings faced questions about his attitude to Les boches. “Monsieur asked,” Cummings records, “if I would have any hesitation in dropping bombs on Germans.” Cummings assented that he would be ready to bomb German soldiers – on the battlefield. That answer pleased the official too little. “Est-ce-que vous detestez les boches?” Cummings comes back with: “Non. J’aime beaucoup les français.” To which the official insists, “It is impossible to love Frenchmen and not to hate Germans.” Cummings thus finds himself under coercive pressure to join in ritualized collective hatred that is based on logical non-sequiturs and that grossly violates Christian precepts.
Cummings resolves never to relent in resisting the program of conscience-betrayal. He always responds to and records knowledge that bolsters his standing judgment. A fellow inmate called One-Eyed David (“Da-veed”) “had been in prison at Noyon during the German occupation, which he described fully and without hyperbole.” David, Cummings writes, “had seen with his own eyes a French girl extend an apple to one of the common soldiers as the German army entered the outskirts of the city.” The soldier, as David narrated, refused. The soldier said, “Pardon, Madame… but you must know that a German soldier is forbidden to take anything without paying for it.” The plausible anecdote about Teutonic decorousness makes hay of Allied propaganda about Les boches. David tells another story, this one at second or third hand, but having equally the ring of truth. David’s barber’s brother, an airman, “was flying over the lines, and he was amazed, one day, to see that French guns were not firing on the boches but on the French themselves.” When the aviator reports what he has seen to a staff officer at headquarters, the reply comes that, “They have begun; they must finish.”
Another prisoner, whom Cummings calls Guard Champêtre, relates two even more outrageous stories about French military doctrine than One-Eyed David does. Guard Champêtre had served as a motorcycle dispatch rider on the Yser salient. The first of the tales recounts how he had, as Cummings writes, “seen a bridge hastily constructed by les alliés over the Yser River, the cadavers of the faithful and the enemy being thrown in helter-skelter to make a much-needed foundation for the timbers… The Yser, he said, flowed perfectly red for a long time.” The second of Guard Champêtre’s two tales also concerns the fighting on the Yser. Demoralized by the brutality of combat, the French, Belgian, and English soldiers, according to Guard Champêtre: “Did not see any good reason for continuing the battle. But we continued. O indeed we continued.” On the question, why, Guard Champêtre explains: “Because in front of us we had the German shells, behind, the French machine guns, always the French machine guns, mon vieux.” Whenever the soldiery showed signs of flagging, “Pupupupupupupupup” and “we went forward.” Guard Champêtre closes with, “Vive le patriotisme.” That the Red Army under Stalinist leadership conducted itself in a similar way at Stalingrad is well known and unsurprising; that the same was French policy in 1917 comes as a shock. Cummings is taken aback and he would convey his deep disillusionment to his readers.
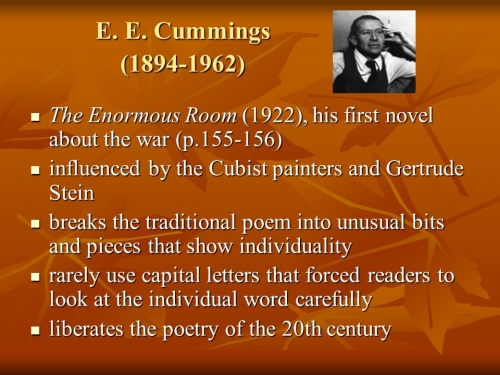
The French government holds the inmates at La Ferté largely incommunicado, in the political and legal equivalent of Dante’s Limbo. Every three months comes to the Porte a traveling Commission, to hear individual cases recommended to it by Monsieur le Directeur. The hearing entails for Cummings yet another denunciation of Slater-Brown. The investigators, exhausting their questions, tell him nothing. Late in January 1918, a planton or warden suddenly calls Cummings from the barracks to the Director’s office. The Director informs Cummings that he will be discharged from La Ferté but that he will have to remain in France under technical arrest until the end of the war. Meanwhile Cummings’ father has been conducting a panicked search, repeatedly querying the State Department to inquire of the French Government as to his son’s whereabouts and status.
Edward Cummings’ letters to various high officials, including one desperate and irate letter to President Wilson, constitute the prefatory section of Cummings’ narrative in The Enormous Room. At one point, the French War Office declared Cummings dead, listing him falsely as having taken passage on a ship torpedoed mid-Atlantic on the voyage from Le Havre to New York. The elder Cummings wrote to Wilson, “More than two months ago [Cummings and Slater-Brown] were arrested, subjected to many indignities, dragged across France like criminals, and confined in a Concentration Camp at La Ferté Macé; where, according to latest advices they… remain.” Cummings père suggests to Wilson that the American President should “do something to make American citizenship as sacred in the eyes of Frenchmen as Roman citizenship was in the eyes of the ancient world.” Whether Wilson heeded the letter or ignored it, Edward Cummings could not guess.
In The Enormous Room, Cummings describes his own attitude to his experience under incarceration in terms Stoic, sometimes ironic, even declaring his sense of guilt on his liberation: “To leave La Misère with the knowledge, and worse than that the feeling, that some of the finest people in the world are doomed to remain prisoners thereof for no one knows how long – are doomed to continue, possibly for years and tens of years and all the years which are terribly between them and their deaths, the grey and indivisible Non-existence which without apology you are quitting for Reality – cannot by any stretch of the imagination be conceived as a constituting a Happy Ending to a great and personal adventure.” It was thanks to his experience of what the father calls a Concentration Camp that Cummings would recognize the Soviet Union for one vast prison on a continental scale when he visited there in 1932. Cummings could see what the useful idiots – Walter Duranty was one – could not see and he could see it with Dantesque visionary clarity, thanks to his ordeal.
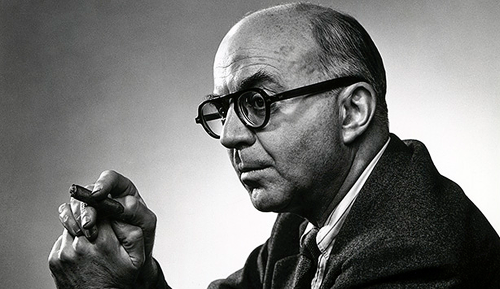
III. Dos Passos likewise volunteered to drive an ambulance but ended up in Italy after only a brief stay in France. Dos Passos never stumbled into anything as nasty as Cummings’ embroilment with Le government français, but what he saw of war and the effects of war influenced him to reassess many of his youthful political convictions and provoked him to judge American participation in the Allied cause with dissident skepticism. His short novel One Man’s Initiation (1920) gave voice to his change of heart and non-conformist attitude, but Dos Passos made no lasting literary impression until the appearance of Three Soldiers, a much more ambitious novel than One Man’s Initiation, in 1923. Where Cummings rarely explained himself directly, Dos Passos offered personal retrospection and autobiographical analysis in abundance all his authorial life. Investigation may therefore trace Dos Passos’ transition from the political left to the political right phase by phase in the author’s own explication. In The Theme is Freedom (1956), for example, Dos Passos republished key items from his journalistic portfolio with added backwards-glancing commentary on his own changing attitude through the decades. Returned from the war service, Dos Passos took interest in labor politics, leftwing political movements like the New England anarchist movement, and the Sacco and Vanzetti case.
 In 1928 he went to Russia full of optimism only to leave the Workers’ Paradise in dour mood. In 1936 Dos Passos went to Spain ostensibly to assist in making a documentary film favorable to the Republic; when Dos Passos’ Spanish friend Juan Robles suffered arrest and execution by the Soviet “allies” of the Republic, Dos Passos abruptly lost enthusiasm for the side.
In 1928 he went to Russia full of optimism only to leave the Workers’ Paradise in dour mood. In 1936 Dos Passos went to Spain ostensibly to assist in making a documentary film favorable to the Republic; when Dos Passos’ Spanish friend Juan Robles suffered arrest and execution by the Soviet “allies” of the Republic, Dos Passos abruptly lost enthusiasm for the side.
Already in the early and middle 1920s, based on his experience of ideological crudity and gross indoctrination-regimes during the war, Dos Passos had begun to doubt supposed causes that draped themselves in emotive formulas and images of a radiant future. Of Communist infiltration of and influence over the labor movement, Dos Passos grew resentful. Having worked tirelessly on behalf of striking coal miners in Kentucky, it shocked Dos Passos when, “back in New York the chairman of the Central Committee [of the CPUSA] sent for me and asked me to go back [to Kentucky] and stand trial.” That would have been in Harlan County, where the district attorney indicted Dos Passos under an arcane anti-syndicalism law. Dos Passos suddenly saw his putative comrades as “human engineers,” hence also as effective dehumanizers, of the people whose cause they claimed to represent. A man was expendable, on the battlefield or in politics. Dos Passos recognized a “professional’s sneer,” a “scornful attitude toward perfectly sincere I.W.W. and A.F. of L. men,” in the radicals’ gambit of “denying help to men who wouldn’t play their game.” The revolutionaries, as it occurred to Dos Passos, “were out, not to even up the scales, but to smash them.”
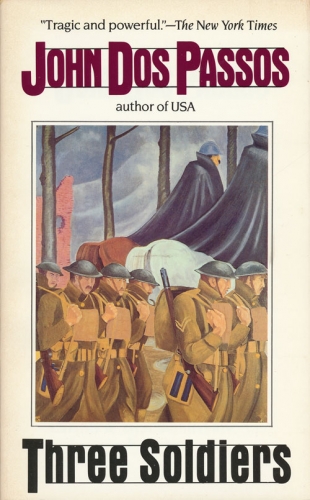 Social engineering, obliterating the individual’s personality so as to refashion it to sub-serve a dehumanizing scheme, mobilization, militarization, and smashing things, whether tangible or intangible: The novel takes these predilections as its themes. The titles of the larger sections into which Dos Passos subdivides Three Soldiers tell already of the author’s point of view: “Making the Mould,” “The Metal Cools,” “Machines,” “Rust,” “The World Outside,” and “Under the Wheels.” The eponymous soldierly trio furnishes a set of American specimens representing classes and occupations. Dan Fuselli hails from San Francisco where he has worked as stock clerk in an optical goods store. Fuselli has little formal education and a restricted intellectual horizon, his idea of success being to rise from private soldier to corporal by fitting in. “Chris” Chrisfield, a kid from Indiana, also lacks formal education. More high-strung than Fuselli, Chrisfield grows swiftly to loathe officers and orders; his disintegration under military discipline reaches its climax in a battlefield homicide. Dos Passos locates the story’s controlling perspective in John Andrews, an Easterner with an education who dreams of becoming a serious composer. No saint and prone to self-pity, Andrews nevertheless grasps what is happening, not only personally to him but also culturally and historically. His plight stands for the plight of all civilized people in a world where civilization has undertaken to see to its own disintegration in ways gross and subtle.
Social engineering, obliterating the individual’s personality so as to refashion it to sub-serve a dehumanizing scheme, mobilization, militarization, and smashing things, whether tangible or intangible: The novel takes these predilections as its themes. The titles of the larger sections into which Dos Passos subdivides Three Soldiers tell already of the author’s point of view: “Making the Mould,” “The Metal Cools,” “Machines,” “Rust,” “The World Outside,” and “Under the Wheels.” The eponymous soldierly trio furnishes a set of American specimens representing classes and occupations. Dan Fuselli hails from San Francisco where he has worked as stock clerk in an optical goods store. Fuselli has little formal education and a restricted intellectual horizon, his idea of success being to rise from private soldier to corporal by fitting in. “Chris” Chrisfield, a kid from Indiana, also lacks formal education. More high-strung than Fuselli, Chrisfield grows swiftly to loathe officers and orders; his disintegration under military discipline reaches its climax in a battlefield homicide. Dos Passos locates the story’s controlling perspective in John Andrews, an Easterner with an education who dreams of becoming a serious composer. No saint and prone to self-pity, Andrews nevertheless grasps what is happening, not only personally to him but also culturally and historically. His plight stands for the plight of all civilized people in a world where civilization has undertaken to see to its own disintegration in ways gross and subtle.
“Making the Mould” takes place in the stateside training and transportation camps where the three characters become acquainted with one another. Whether Dos Passos was responding to Eliot’s poem The Waste Land or not, he was at least participating in the minority spirit that Eliot articulated – and Three Soldiers is replete with “Waste Land” imagery. The numerous “cinder piles” that mark the drill-field are like so many newly dug graves; the “long shadows” of the late afternoon combine with the ticking of many pocket watches to reinforce the unstated theme of death-in-life. Fuselli recalls the “man behind the desk at the draft board,” who, with his “white bony hand,” gave him his induction papers.” Andrews, assigned to wash windows in a filthy barracks, finds the phrase “Arbeit und Rhythmus” seizing his mind until he recalls that it is German and the recognition jolts him back into conscious awareness of his situation. A crude, relentless propaganda regime intrudes everywhere into basic training. Cummings’ jail keepers wanted to know,“Est-ce-que vous detestez les boches?” In Three Soldiers, no one heeds subtlety enough to put the compulsion in the form of a question. In the recreation hall before the Friday night movie, the “Y man” (a representative of the Young Men’s Christian Association) leads the soldiers in song: “Hail, hail, the gang’s all here – We’re going to kill the Kaiser, we’re going to kill the Kaiser!” Criticizing the dearth of enthusiasm, the “Y man” presses for “lots of guts in the get and lots of kill in the Kaiser.”
The film depicts “soldiers in spiked helmets… bayoneting civilians in wide Dutch pants.” Chrisfield tells Andrews, “Gee, it makes ye hate the Huns.” Andrews overhears another man: “I never raped a woman in my life, but by God I’m going to” and “I’d give a lot to rape some of those goddam German women.” The coarsening effect on undeveloped minds has consequences unforeseen by the propagandists. Having warmed to the idea of killing, Chrisfield confides to Andrews that if he got the chance on the ocean passage, he would throw a certain sergeant into the sea. Despite nourishing murderous hatred for officers, however, Chrisfield never rebels against his conscript status. Andrews thinks to himself that his companions “did not seem appalled by their loss of liberty.” Fuselli has nightmares of embarrassing himself in front of an officer. When a soldier with the archly appropriate name of Eisenstein comments that “you’ve got to turn men into beasts before ye can get ‘em to act that way,” Fuselli warns: “Be careful how you go talkin’ around the way you do.”
Dos Passos’ novel depicts an Army transforming itself into a police state. Beginning in “The Metal Cools” the MPs become ubiquitous and menacing, a gesture that Ernest Hemingway would appropriate for A Farewell to Arms (1929). Eisenstein interprets the war mentality and the rush to obedience as indicating a slavish proneness to “do what we’re ordered to do.”
Not all MPs are military police; some are morality police. Marching to the trenches, Andrews and Chrisfield take advantage during a break to bathe in a pond. “Say, if you don’t mind my suggestion,” a “Y-man” says, “why don’t you fellers get under water… You see there’s two French girls looking at you from the road.” When Andrews finishes his bath and pulls his uniform back on he says out loud that it feels like “taking up filth and slavery again.” The “Y man” says, “You’ll get in trouble, my boy, if you talk that way.” He adds: “Oh, boys, never forget that you are in a great Christian undertaking.”
IV. In denouncing propaganda (“make the world safe for democracy”) was Dos Passos not simply engaging in his own vulgar “anti-war” propaganda? Could doughboys really face the firing squad, as someone tells Fuselli, for sounding off the way Eisenstein does? But MPs arrested Cummings merely because his friend – in private letters – mildly criticized French belligerent policy. In Three Soldiers, Dos Passos represents the “democratization” of military service as the vanguard phase of the militarization of the democracies and the broad destruction of freedom. He furthermore makes little case for democracy, as such, the language of which strikes him as false (“a great Christian undertaking”). He prefers to give his vote for the traditional civilization that the war, in his view, has ambushed. The “Y-man,” for example, prudishly disdains “French girls,” but it is the war for which the “Y-man” cheers that has driven those girls into prostitution, coarsening the relation of the sexes. Virtually all the females with whom Dos Passos’ soldiers have contact freely sell themselves for a price. Andrews knows what to value; Andrews’ misfortune – or rather civilization’s misfortune in Andrews – is that he knows and experiences his civilized commitment weakly, self-pityingly. The “Rust” segment of the story sees Andrews wounded by shell splinters and sent to hospital for recovery. He acquires a copy of Flaubert’s Tentation de Saint-Antoine, which he studies while recuperating, with the thought of setting it as an opera.
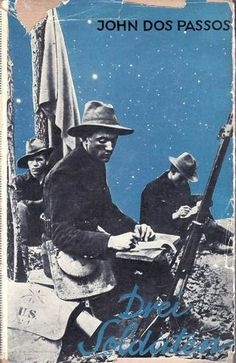 Like The Enormous Room, Three Soldiers develops a complicated web of literary and artistic allusions. Even so, Flaubert’s recherché theater-of-the-mind of 1874 about the Late-Antique founder of Christian monasticism (251 – 356) seems a peculiar reference. What might justify or explain it? Anthony’s “Thebaïd,” his withdrawal into the Egyptian desert, represented in the first place a spiritual response to the political and moral corruption of existing imperial institutions – and from the clash of religious ideologies that characterized Alexandrian life in the saint’s era. Famously, after many years of isolation and contemplation, Anthony experienced the visionary tentation that chiefly concerns Flaubert in the seven acts of his drama. Andrews fixates on Anthony’s vision of the Queen of Sheba, whose person combines the allure of whoredom with the allure of power. All the tempters in La tentation, however, embody the perverse spirit of libido dominandi. The most apposite of Flaubert’s images for Three Soldiers would therefore be the anchorite’s nightmare-vision of mutual sectarian slaughter in the agora of Alexandria. “We saints,” the butchers say, “to hurry the end of the world, we go poisoning, burning, massacring.” Anthony sees the cutting of throats, incinerations, and he hears a “Terrible Invocation,” until the colonnades and palaces collapse in rubble. The followers of doctrine hate and kill one another.
Like The Enormous Room, Three Soldiers develops a complicated web of literary and artistic allusions. Even so, Flaubert’s recherché theater-of-the-mind of 1874 about the Late-Antique founder of Christian monasticism (251 – 356) seems a peculiar reference. What might justify or explain it? Anthony’s “Thebaïd,” his withdrawal into the Egyptian desert, represented in the first place a spiritual response to the political and moral corruption of existing imperial institutions – and from the clash of religious ideologies that characterized Alexandrian life in the saint’s era. Famously, after many years of isolation and contemplation, Anthony experienced the visionary tentation that chiefly concerns Flaubert in the seven acts of his drama. Andrews fixates on Anthony’s vision of the Queen of Sheba, whose person combines the allure of whoredom with the allure of power. All the tempters in La tentation, however, embody the perverse spirit of libido dominandi. The most apposite of Flaubert’s images for Three Soldiers would therefore be the anchorite’s nightmare-vision of mutual sectarian slaughter in the agora of Alexandria. “We saints,” the butchers say, “to hurry the end of the world, we go poisoning, burning, massacring.” Anthony sees the cutting of throats, incinerations, and he hears a “Terrible Invocation,” until the colonnades and palaces collapse in rubble. The followers of doctrine hate and kill one another.
“Why do you hate the Huns,” Andrews asks another “Y-man.” The answer comes: “Because they are barbarians, enemies of civilization.” Andrews thinks to himself: “How these people enjoyed hating”; and he asks himself: “Was civilization nothing but a vast edifice of sham, and the war… its fullest and most ultimate expression?” He thinks also of those “who had taught unworldliness… Democritus, Socrates, Epicurus, Christ.” It dawns on him that as soon as he recovers, he should “desert.” Andrews spends much of the second half of the novel (“The Outside World” and “Under the Wheels”), which takes place after the Armistice, more or less AWOL, until the increasingly ubiquitous peacetime MPs catch up with him brutally near Chartres. Cathedral spires – glimpsed often in the distance – and Gothic architecture answer implicitly the important question, whether civilization is a “sham.” They signify the spiritually intact order, the civilization proper, that the war has betrayed, only to replace it with the ideological state. It is the ideological state that is the sham. In a YMCA lecture on the meaning of the Occupation, one “Reverend Skinner” admonishes: “I am sorry to say, boys, that the Germans have not undergone the change of heart for which we had hoped. They have, indeed, changed the name[s] of their institutions, but their spirit they have not changed.” In the Reverend’s view, “Germany should have been utterly crushed.”
Bell towers of defunct Christendom and carved ceilings with chivalric panoply now resemble the City of God – they represent a domain of lawfulness not to be realized on this flat earth.
Awash in slogans and second-hand emotions, even those who have spent the war in civilian life find it hard to form independent judgments. When Andrews asks the girl who will later snub him, Geneviève Rod, whether she has read La tentation, she calls it “not [Flaubert’s] best work,” but “a very interesting failure,” a phrase that she subsequently admits having gleaned from writer-critic Emil Faguet. Thought itself has become artificial, restricted, and automatic. In comparison with people of the Gothic Age or the Renaissance, “men seemed [to Andrews] to have shrunk in stature before the vastness of the mechanical contrivances they had invented.” Bureaucracies and police forces merely betoken the rampant “slave psychology.” Andrews, watching the Parisian crowds, thinks: “Today, everything was congestion… men had become antlike.” Crowding invites stringent regulation and then “slavery”; it promotes conformism – precisely José Ortega’s thesis in The Revolt of the Masses (1930). No matter what tendency prevailed – whether “tyranny from above” or “spontaneous organization from below” – it would fall out that “there could be no individuals.” In the final image of Dos Passos’ novel the MPs take Andrews in custody, at gunpoint: “All right, walk downstairs slowly in front of me,” whereupon the sheets of the unfinished Saint-Anthony opera blow through the window on the breeze.
In The Theme is Freedom, commenting on what he latterly saw as his misguided vote for Roosevelt’s third term, Dos Passos wrote: “The federal government [under FDR] became a storehouse of power that dwarfed the fabled House of Morgan that had been the bogy of our youth. When you add to the coercive power of the government the power of the purse and a standing army you have a situation that would have alarmed even the most authoritarian statesmen of our early history.” As Lord Acton said, power corrupts; and as Dos Passos sees it, fear of losing power corrupts absolutely. “Consciously or unconsciously, Roosevelt could find no other way of consolidating the vast power… than by leading the country to war.” Dos Passos omits to mention that in undertaking the war-program Roosevelt followed in the footsteps of Wilson, who sent a million doughboys “over there.” Dos Passos viewed World War II as the phase of consolidation of the already-aggrandized and increasingly dictatorial-technocratic federal government.
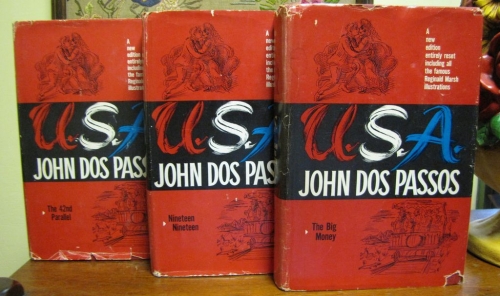
Contemplating this emergent global corporatism, Dos Passos would write that, “The antithesis between capitalism and socialism is beside the point.” What is striking in the convergent mentality of the elites and in the political regimes, which that mentality takes advantage to create, is “the centralization of power and the isolation of the individual in his routine at an office desk, or in his job on the assembly line, or even at the more varied work of turret or lathe.” Everyone is thus held incommunicado in the Enormous Room, or rather shackled to his desk in the corporate office-tower, under threat of his livelihood should he actively dissent. “Y-men” and MPs go disguised as co-workers. Everywhere meanwhile the average, institutionally isolated person must try to make sense of the “selfserving propaganda which is daily pumped in his ears by the political climbers who use corporations, labor unions, stratified organizations of any kind, as ladders to positions from which they may ride to glory on the backs of their fellows.” The choice facing Americans, as Dos Passos wrote (the words come to us from 1955), lay between “a stratified autocratic society more or less on the Russian model and the selfgoverning republic, which is our heritage.”
00:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : première guerre mondiale, e. e. cummings, john dos passos, états-unis, lettres, lettres américaines, littérature, littérature américaine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par E. Francovich
Ex: http://rebellion-sre.fr
12 septembre 1919. Onze heures quarante-cinq. Une colonne de deux mille hommes entre triomphalement dans la ville de Fiume, port dalmate occupé par une force interalliée. Les négociations entourant les traités de paix vont certainement refuser l’ancien port hongrois à l’Italie et le donner à la nouvelle Yougoslavie, décision que tous ces hommes — grenadiers, aviateurs, arditi et autres survivants italiens des tranchées, arborant tous chemises noires et poignards — ne se résignent pas à accepter. Audessus d’eux, sur un drapeau rouge, lové sur lui-même, le Serpent Ourobouros transforme l’expression latine de Saint-Paul1 et siffle : « Si spiritus pro nobis, quis contra nos ? » (Si l’esprit est avec nous, qui est contre nous ?) Les hommes, électrisés, répondent en choeur par un chant de combat : « Giovinezza, Giovinezza, Primavera di bellezza / per la vita, nell’asprezza il tuo canto squilla e va ! » (Jeunesse, jeunesse, Printemps de beauté / dans la vie âpre ton chant résonne et s’en va). Débute alors une aventure-épopée unique en son genre, cinq cents jours d’une contre-société expérimentale 2 dont le principe fondamental proclamé est la musique, cinq cents jours d’une cité de vie où se conjuguent fête et discipline, cinq cents jours d’une pratique collective et archéofuturiste de la révolte. A la tête de cette colonne et de la future Régence italienne du Carnaro qui va gouverner la ville, un homme d’un mètre soixante-quatre, chauve, peau couverte de décorations, monoclé et mains gantées, il approche de la soixantaine, il est poète célèbre, soldat de la Grande Guerre, « barde du peuple » et bientôt… Roi. Il s’appelle Gabriele D’Annunzio. A travers le récit des épisodes de son existence, baroque et agitée, c’est le mystère de cet homme étrange, « tout poivre et nerfs », aux allures de Napoléon un peu sauvage, que le livre de Maurizio Serra se propose de pénétrer. D’un côté, la tâche pourrait sembler aisée tant le personnage n’a jamais rien caché et orgueilleux omnivore, a voulu monter sur toutes les scènes et conquérir tous les théâtres sans jamais dissimuler ses intentions. Mais cette profusion de pièces à conviction ne garantie pas une preuve absolue : l’homme se dérobe toujours quelque peu car, selon le mot de Suarès qui a donné le titre au livre de Maurizio Serra : « D’Annunzio est le plus magnifique de ses personnages. » Alors que s’est-il passé sous ce crâne dégarni qu’il surnommait sa « clarté frontale » pour qu’âgé de cinquante six ans son corps se lance dans une folle équipée qui le fera Roi ? L’auteur le confesse : aucune biographie de parviendra à épuiser le « sujet D’Annunzio ». Alors il faut néanmoins rassembler, détailler, examiner toutes les actions, les discours et les gestes, les collisions sensuelles et les étincelles spirituelles, se baigner dans les œuvres, dresser les décors et les personnages qui entourent le poète — la haute société, les femmes virevoltantes, les soldats fascinés, les dramaturgies de volupté et de mort. Et trois grands flambeaux se dressent alors comme des aiguillons brûlants dans cette existence qui ne veut jamais se reposer : la poésie, les femmes, la guerre.

Aujourd’hui, pour un jeune européen de l’ouest, épargné par la guerre, bercé de discours bêtifiants et béatement humanistes sur la violence et à qui sont proposés, comme héros et hérauts du moment, des saltimbanques millionnaires, des aventuriers de plateaux télé ou des startupers transhumanistes, un caractère rebelle et aventureux comme celui de D’Annunzio suscite des interrogations et semble appartenir à un type d’homme révolu ou, en tous cas, anachronique par rapport aux modèles promus et normalisés par notre époque. Comme si le goût du danger et l’instinct belliqueux chez l’homme pouvaient être éradiqués à coup de longues périodes de paix, d’environnement « climatisé » et de slogans publicitaires. On ne peut supprimer cette part d’ombre. Dans une optique d’harmonisation individuelle et collective, on peut, tout au plus, négocier avec elle et lui laisser la place qui lui revient car le désordre qu’elle porte est aussi source de vie. L’ombre refoulée par une rationalité aseptique fait généralement retour d’une manière extrême, cruelle et avec une intensité décuplée. Ceux qui éconduisent le discours dit progressiste, taxant tout comportement non conforme à son évangile désincarné de modèle dépassé, ont bien saisi le message de Zarathoustra : « Je vous le dis : il faut porter encore en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » C’est le chaos de ce type d’homme différencié que D’Annunzio le Magnifique veut nous faire percevoir. Le poète confie qu’il « adore la guerre » et il ajoute : « Ce fut pour moi un second étincellement de jeunesse. Ne fût le sang d’autrui qui coule, je serai tenté de considérer avec effroi la fin de la guerre ». Ce qui ressort dans les parties du livre consacrées aux expériences guerrières de notre personnage est parfaitement résumé dans leurs titres respectifs : Le Conquérant et Le Commandant. Désir de conquête donc. Conquête du verbe, des femmes, du monde. Désir de conduire également, d’assumer sa nature de « condotierre de la Renaissance », d’être héraut, d’être Roi. Conserver l’énergie pure et première de la jeunesse qui ne veut pas se résigner au statu quo. Être fidèle à sa nature d’ « homme-animal », prendre la guerre comme expérience intérieure, pour reprendre le titre d’un essai d’un autre écrivain-soldat, allemand cette fois, ayant combattu en 14-18. Ainsi, en dépit de leurs réticences, D’Annunzio, alors âgé de 52 ans en 1915, parviendra, à force d’insistance, à convaincre les autorités militaires italiennes de l’enrôler.

Certes, il n’a pas connu les tranchées, mais aucun doute n’est permis quant au caractère risqué des opérations qu’il a menées, aussi bien dans l’infanterie, la marine ou en tant qu’aviateur, ni sur une certaine bravoure dont il a fait preuve. Selon Maurizio Serra, il serait malhonnête d’en faire un dilettante qui aurait joué à la guerre et se serait préservé de tout danger dans un conflit qui fut d’une violence extrême. Il perd d’ailleurs son œil droit dans un accident dont les circonstances ne sont pas vraiment élucidées3. Cette blessure obligera ce désormais « borgne voyant » à, une fois encore, devoir insister auprès des autorités pour reprendre du service. De cette période de guerre naîtra son dernier chef-d’œuvre, Nocturne, confession dans laquelle il se dévoile plus intimement. L’ouvrage, qui ne sortira qu’en 1921, est décrit par Serra comme « un des documents les plus humains, fraternels, mystiques inspirés par le conflit », « un journal de l’âme par la guerre, plutôt qu’un journal de guerre ».
C’est durant cette même guerre que les italiens créèrent des unités de choc sur le modèle des Stosstruppen allemandes : les arditi. Nombre de ces « hardis » qu’il recruta lui-même l’accompagneront, plus tard, lors de l’épopée de Fiume. Baroudeurs, soldats aguerris, garçons dévoyés et aussi bien aristocrates et intellectuels composeront ces troupes. Cette biographie mentionne également un autre personnage tout aussi fascinant que notre poète-guerrier italien, un japonais membre des arditi et intime de D’Annunzio : le poète japonais Harukichi Shimoi, surnommé plus tard le « samouraï de Fiume » et avec lequel D’Annunzio projettera un raid aérien Rome-Tokyo. A propos de Fiume, nous apprenons que ce coup de force ne fut pas impulsif et improvisé mais préparé de manière pragmatique. Nous pouvons également déceler dans les démarches effectuées auprès de Mussolini en vue d’obtenir son appui, la méfiance de D’Annunzio vis-à-vis du Duce (la suite des événements montrera qu’elle était justifiée). Quant à l’aventure elle-même, l’occupation de la ville qui dura 16 mois, elle est principalement envisagée d’un point de vue politique4 et elle fait pièce aux exégèses visant à réduire cette expérimentation, riche et complexe, à un proto-fascisme de carnaval. A l’appui de cette thèse, plus nuancée et moins idéologisée, viennent quelques faits : Lénine et Gramsci s’intéresseront de près à cette expérience politique avant-gardiste ; la Régence du Carnaro fut le premier État à reconnaître l’URSS ; D’Annunzio reconnaîtra le parti indépendantiste irlandais du Sinn Féin ; plus globalement Fiume portera un message international de droit à l’auto-détermination des peuples ; enfin, à la différence de certaines options fascistes ultérieures, la sédition fiumaine ne s’attira pas la sympathie des Alliés ni des autorités italiennes. Avec le même souci de restituer les événements dans toute leur diversité et leur complexité, l’auteur passe également en revue les différents acteurs de cette entreprise unique. Dans cette galerie de personnages et de tendances dont l’union reposait, pour grande part, sur la personnalité même du Comandante D’Annunzio, on trouvait ainsi des nationalistes ou patriotes, des expansionnistes ou impérialistes, des internationalistes dont le syndicaliste révolutionnaire Alceste De Ambris, bras droit de D’Annunzio qui s’opposera plus tard au fascisme au sein des Arditi del Popolo5. Mais se rencontraient aussi des futuristes et des personnages singuliers tels l’as de l’aviation Guido Keller ou le poète et musicien Léon Kochnitzky. Cet exemple d’imagination au pouvoir s’achèvera en décembre 1920, après une longue période de siège et avec l’intervention de l’armée régulière, dans un épisode portant un nom qui parle de lui-même : « Le Noël de sang ».
 C’est encore le langage de la guerre et du combat qui prévaut lorsque D’Annunzio parle de la femme. Pour lui, elle est « l’ennemie nécessaire ». Nous verrons plus loin ce que recouvre plus exactement cette expression ambiguë. Toutefois, décrire D’Annunzio comme un Casanova de bazar ne correspondrait pas à la réalité du personnage. Ce qui ressort du livre de Serra, c’est indéniablement une sensualité exacerbée mais le personnage n’est pas, à proprement dit, un obsédé sexuel. Serra parle plutôt d’ « obsédé sensuel » car c’est bien, avant tout, de l’âme des femmes convoitées dont il veut s’emparer. Le magnétisme qu’il exerce auprès d’elles relève certainement de ce « priapisme physique et cérébral » qui émane de sa personne. Fanatiser la femme comme fanatiser la foule — la foule étant femme — semble être la finalité de l’énergie déployée pour ses conquêtes. Sa période romaine fût le théâtre de relations multiples dans lesquelles cet « homme-animal » considérait les femmes comme des proies à posséder intégralement. Cette période marqua également le début de sa carrière d’ « endetté permanent » qui ne finira qu’à sa mort, ses conquêtes et liaisons ne faisant pas l’économie d’une profusion de cadeaux et de dépenses diverses. Quelques éléments témoignent de ce rapport aux femmes qui apparaît aujourd’hui d’autant plus singulier qu’il contrevient aux nouveaux crédos que notre époque tente d’imposer. Il épouse, par exemple, à vingt ans, en 1883, une « petite duchesse inoffensive » dont il ne divorcera jamais pour ne pas être obligé d’épouser les autres compagnes qui jalonneront immanquablement et régulièrement toute son existence. Dans ce rapport aux femmes, nous retrouvons un élément typique de sa personnalité, un mélange de calcul, de contrôle de soi et d’exaltation. Belliciste et esthète à la sensibilité élevée, il est par ailleurs extrêmement attentif aux détails physiques, caractéristique qui nourrira bien entendu sa littérature. Sur le terrain des femmes, c’est donc encore sa prédilection pour la conquête et la possession qui s’exprime. La plus rétive à cette disposition toute totalitaire et à ce machisme vampirique fut Eleonora Duse, une tragédienne surnommé la Divina qui s’emploiera à ne pas abandonner ses velléités d’indépendance ainsi que son goût pour les femmes. La résistance de cette primadonna de laquelle « émane un halo sexuellement trouble » et qu’il rencontra en 1895, alors qu’elle avait entamé la trentaine, laissera d’ailleurs notre héros quelque peu dépité. Elle fut toutefois une vraie muse et nourrira la production de D’Annunzio jusqu’en 1905 quand, mû par sa logique vampirique de possession et de rejet (« ce qui a été n’est plus »), il se tournera alors vers une nouvelle proie, Alessandra di Rudini Carlotti del Garda, qu’il surnommera Niké en hommage à la divinité de la victoire. Sur l’importance de la Divina, nous pouvons lire la chose suivante : « On a calculé qu’en six ou sept ans à peine, entre 1898 et 1905, D’Annunzio a écrit vingt mille vers sous forme de poèmes et douze mille vers pour ses drames (…). Cette productivité phénoménale, même pour lui, n’a pas été toujours inspirée par la Duse, mais aurait atteint difficilement ce record sans elle. » Cette aventure passionnée irriguera également son grand roman intitulé Le Feu dont le personnage principal sera Eleonora.
C’est encore le langage de la guerre et du combat qui prévaut lorsque D’Annunzio parle de la femme. Pour lui, elle est « l’ennemie nécessaire ». Nous verrons plus loin ce que recouvre plus exactement cette expression ambiguë. Toutefois, décrire D’Annunzio comme un Casanova de bazar ne correspondrait pas à la réalité du personnage. Ce qui ressort du livre de Serra, c’est indéniablement une sensualité exacerbée mais le personnage n’est pas, à proprement dit, un obsédé sexuel. Serra parle plutôt d’ « obsédé sensuel » car c’est bien, avant tout, de l’âme des femmes convoitées dont il veut s’emparer. Le magnétisme qu’il exerce auprès d’elles relève certainement de ce « priapisme physique et cérébral » qui émane de sa personne. Fanatiser la femme comme fanatiser la foule — la foule étant femme — semble être la finalité de l’énergie déployée pour ses conquêtes. Sa période romaine fût le théâtre de relations multiples dans lesquelles cet « homme-animal » considérait les femmes comme des proies à posséder intégralement. Cette période marqua également le début de sa carrière d’ « endetté permanent » qui ne finira qu’à sa mort, ses conquêtes et liaisons ne faisant pas l’économie d’une profusion de cadeaux et de dépenses diverses. Quelques éléments témoignent de ce rapport aux femmes qui apparaît aujourd’hui d’autant plus singulier qu’il contrevient aux nouveaux crédos que notre époque tente d’imposer. Il épouse, par exemple, à vingt ans, en 1883, une « petite duchesse inoffensive » dont il ne divorcera jamais pour ne pas être obligé d’épouser les autres compagnes qui jalonneront immanquablement et régulièrement toute son existence. Dans ce rapport aux femmes, nous retrouvons un élément typique de sa personnalité, un mélange de calcul, de contrôle de soi et d’exaltation. Belliciste et esthète à la sensibilité élevée, il est par ailleurs extrêmement attentif aux détails physiques, caractéristique qui nourrira bien entendu sa littérature. Sur le terrain des femmes, c’est donc encore sa prédilection pour la conquête et la possession qui s’exprime. La plus rétive à cette disposition toute totalitaire et à ce machisme vampirique fut Eleonora Duse, une tragédienne surnommé la Divina qui s’emploiera à ne pas abandonner ses velléités d’indépendance ainsi que son goût pour les femmes. La résistance de cette primadonna de laquelle « émane un halo sexuellement trouble » et qu’il rencontra en 1895, alors qu’elle avait entamé la trentaine, laissera d’ailleurs notre héros quelque peu dépité. Elle fut toutefois une vraie muse et nourrira la production de D’Annunzio jusqu’en 1905 quand, mû par sa logique vampirique de possession et de rejet (« ce qui a été n’est plus »), il se tournera alors vers une nouvelle proie, Alessandra di Rudini Carlotti del Garda, qu’il surnommera Niké en hommage à la divinité de la victoire. Sur l’importance de la Divina, nous pouvons lire la chose suivante : « On a calculé qu’en six ou sept ans à peine, entre 1898 et 1905, D’Annunzio a écrit vingt mille vers sous forme de poèmes et douze mille vers pour ses drames (…). Cette productivité phénoménale, même pour lui, n’a pas été toujours inspirée par la Duse, mais aurait atteint difficilement ce record sans elle. » Cette aventure passionnée irriguera également son grand roman intitulé Le Feu dont le personnage principal sera Eleonora.
Deux autres figures féminines émanent de cette myriade de rencontres et de liaisons, du moins pour ce qu’elles révèlent de la psychologie de D’Annunzio, c’est-à-dire de cette oscillation entre mépris utilitariste et exaltation démesurée : une première, antérieure à la Duse, Barbarella Leoni en 1887 et une autre, postérieure, Nathalie-Donatella en 1908. La rencontre avec la première fut un véritable choc pour Gabriele. Cette « lionne barbare », cette « espèce de sauvageonne », cette « pulpeuse fille du peuple » trouvera avec lui cette volupté de laquelle un traumatisme subi dans le lit nuptial — un mariage malheureux avec comme cadeau de noces une maladie vénérienne — l’avait séparée. La secousse sismique subie par Gabriele eut des répercussions pendant cinq ans et s’estompa après avoir provoqué une avalanche de milliers de lettres, de télégrammes et de billets doux. Serra ajoute : « Il est amoureux de l’amour, pas de cette créature de rêve, qu’il veut dévorer jusqu’au bout, pour assouvir la faim qu’elle lui inspire. » Concernant Nathalie-Donatella, Maurizio Serra donne également les raisons de l’intérêt qu’elle suscite chez D’Annunzio et en quoi cette liaison révèle un ressort psychologique du Magnifique : « Elle l’intrigue par son charme slave, son allure de panthère, son insatiable lubricité, bref tout le paquet. Sans compter le mystère de ses origines : est-elle fille d’un petit marchand juif, ou d’un officier de la garde impériale ? Cette nouvelle incarnation de la Femme fatale aux multiples attraits (…) n’ajoutera pas grand-chose au sérail d’annunzien. Elle est pour lui le prototype de ces « pauvres folles » (Roland), ou cinglées de luxe (…). A une ou deux exceptions près, ces vestales n’ont rien signifié pour lui, rien ajouté à son œuvre, rien perçu de l’exigence qui l’habitait. Elles n’auront finalement représenté qu’un divertissement ou un décor qui servait (…) à meubler ses baisses d’inspiration et sa virilité déclinante. » Nous saisissons donc mieux au travers de ces exemples ce que recouvre l’expression « l’ennemie nécessaire » par laquelle nous avions introduit cette partie consacrée aux femmes.
 D’Annunzio, ce sont donc des grandes lignes de force qui s’activent. Se détachent d’abord ce goût pour l’aventure et un sens aigu de la dramaturgie, dispositions qui verseront indéniablement dans l’emphase mais qui se contenteront de flirter incidemment avec le cliché sans jamais toutefois y succomber. Prend forme également au fil de la lecture de D’Annunzio le Magnifique, une silhouette nietzschéenne qui refuse la vie tiède et bourgeoise et prend le parti de la vie, mobilisant pour cela une énergie toute dionysiaque. Ce qui frappe c’est cette volonté de ne pas s’endormir, ne pas céder à la satisfaction, au confort. Lorsque le guette le dannunzisme, lorsqu’il atteint une sorte de maîtrise à la fois de son art et de son personnage, il cherche dans la vie même le danger, le feu régénérateur qui lui évitera d’être simplement lui-même, achevé dans un contentement de soi de ruminant. C’est ce caractère faustien qui le poussera à 56 ans à se lancer dans l’aventure de Fiume. Pour lui, s’endormir c’est se rendre vulnérable. Il est animé d’un vitalisme nourri par ce proverbe local qu’il n’oubliera jamais : « Qui se fait brebis, trouve le loup qui le dévore. » Pour ce faire, il doit créer avec frénésie, créer sa propre vie et la créer la plus extraordinaire qui soit dans un royaume à son image. Si l’on devait résumer ce qu’il est, on pourrait dire : D’Annunzio c’est Fiume, Fiume c’est D’Annunzio. Et Fiume, c’est un radical et nietzschéen oui à la vie. Et d’ailleurs, pour se définir lui-même, on l’entendrait bien dire, amusé : D’Annunzio c’est moi !
D’Annunzio, ce sont donc des grandes lignes de force qui s’activent. Se détachent d’abord ce goût pour l’aventure et un sens aigu de la dramaturgie, dispositions qui verseront indéniablement dans l’emphase mais qui se contenteront de flirter incidemment avec le cliché sans jamais toutefois y succomber. Prend forme également au fil de la lecture de D’Annunzio le Magnifique, une silhouette nietzschéenne qui refuse la vie tiède et bourgeoise et prend le parti de la vie, mobilisant pour cela une énergie toute dionysiaque. Ce qui frappe c’est cette volonté de ne pas s’endormir, ne pas céder à la satisfaction, au confort. Lorsque le guette le dannunzisme, lorsqu’il atteint une sorte de maîtrise à la fois de son art et de son personnage, il cherche dans la vie même le danger, le feu régénérateur qui lui évitera d’être simplement lui-même, achevé dans un contentement de soi de ruminant. C’est ce caractère faustien qui le poussera à 56 ans à se lancer dans l’aventure de Fiume. Pour lui, s’endormir c’est se rendre vulnérable. Il est animé d’un vitalisme nourri par ce proverbe local qu’il n’oubliera jamais : « Qui se fait brebis, trouve le loup qui le dévore. » Pour ce faire, il doit créer avec frénésie, créer sa propre vie et la créer la plus extraordinaire qui soit dans un royaume à son image. Si l’on devait résumer ce qu’il est, on pourrait dire : D’Annunzio c’est Fiume, Fiume c’est D’Annunzio. Et Fiume, c’est un radical et nietzschéen oui à la vie. Et d’ailleurs, pour se définir lui-même, on l’entendrait bien dire, amusé : D’Annunzio c’est moi !
D’Annunzio, ce sont aussi les opposés qui s’accordent : préciosité et violence, la volupté et le raffinement avec la sauvagerie la plus primitive6 ; l’ascétisme et le calcul avec la démesure la plus fantasque (il avait pour projet fou de faire construire un amphithéâtre gigantesque en plein air) ; enfin l’Antiquité comme bain spirituel avec la modernité la plus excessive (il était un amateur de vitesse, de technique, cela l’amènera d’ailleurs à s’intéresser au cinéma naissant). En résumé, il est « impulsif à la surface » et « calculateur dans le fond », la chair contre l’esprit. Laisser agir ses instincts et ses pulsions tout en contrôlant son destin, tel semble avoir été l’enjeu. L’amour sous la volonté. Du livre de Maurizio Serra, se dégage enfin la figure d’un individu absolu désireux de se mettre au service d’un ordre supérieur. Il veut avoir un rôle à jouer et incarner, dans cette modernité asphyxiante qui tue dans l’œuf les légendes et les mythes, un type d’homme intemporel.
L’enjeu était de taille et c’est avec un D’Annunzio mis à l’écart (par Mussolini) et quelque peu épuisé que se conclue cette biographie. Cloîtré dans son Vittoriale degli italiani, supplanté dans le monde par de nouvelles forces et de nouvelles figures, on l’imagine mal cependant en train de savourer une sorte de devoir accompli et de se dire que, voilà, il a joué son rôle et il a fait de son mieux. Ceux pour lesquels il est encore aujourd’hui une figure agissante se représentent plutôt le héraut au seuil de la mort dans une posture toute olympienne, en train de lancer par delà les générations un radical et tonitruant : « En avant, par delà les tombeaux ! »7.
E. Frankovich
Sauf mention contraire, les expressions entre guillemets sont tirées du livre de Maurizio Serra.
A lire : Maurizio Serra, D’Annunzio le Magnifique, Grasset, 14 février 2018.
Note
1. Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-39) : « Si Deus pro nobis, quis contra nos » (Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?)
2. « contre-société expérimentale », l’expression est de Claudia Salaris dans son ouvrage A la fête de la révolution, Editions du Rocher, 2006.
3. Maurizio Serra fait cette remarque à propos de la perception de la réalité : « D’ailleurs ce qui est vrai pour d’Annunzio est ce qu’il sent, croit imagine comme tel. »
4. Dans la présentation des différents groupes présents sur place, Maurizio Serra distingue entre « fiumains, centrés sur l’agenda politique » et « fiumistes, plus sensibles aux aspects de caractère social, existentiel et intellectuel ». Ce versant plus intellectuel et artistique a été magnifiquement traité dans l’ouvrage A la fête de la révolution, Artistes et libertaires avec D’Annunzio à Fiume de Claudia Salaris.
5. C’est une organisation née de la scission des Arditi et qui optera pour la lutte contre les fascistes.
6. Cette fougue lui vient de la terre abruzzaise de ses origines, fonds dont il ne se séparera jamais. Ce loup des Abruzzes conservera cette dimension primitive et sauvage, forme de saine vulgarité provinciale qui ne fera pas de lui un dandy éthéré et caricatural assimilé à une bourgeoisie gangrenée par l’argent.
7. Cité dans Un Prince de l’Esprit, Raymonde Lefèvre, Nouvelles éditions latines, 1951.
00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, littérature, littérature italienne, lettres, lettres italiennes, gabriele d'annunzio, première guerre mondiale, fiume |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

« Je n’ai jamais été démocrate », « Je ne suis pas anti-démocrate » ; voici deux phrases qui semblent illustrer le paradoxe de Bernanos. Royaliste qui fait l’apologie du « mouvement de 1789 », reconnaissant que le roman national est un bloc que l’on ne peut qu’assumer totalement ou renier totalement, camelot du roi qui abjura son passé militant à l’Action Française après s’être brouillé avec Charles Maurras, Georges Bernanos n’est pas de ceux que l’on puisse coller une confortable étiquette, encore moins à l’aune d’un clivage contemporain. En réalité, au moment où Bernanos rentra du Brésil et écrivit sa France contre les Robots, la notion de partis et de clivages politiques ne revêtaient plus la moindre espèce d’importance à ses yeux. Seul l’obnubile le génocide culturel que la civilisation des machines s’apprêta à commettre, et commença même déjà à commettre comme il le constata dès son retour à Paris, où il déplora la désertion de l’idéal révolutionnaire au profit d’un conformiste mortifère chez ses contemporains. Or, ce qui est la cause principale de ce désistement, et l’incapacité totale de la politique à résoudre la question de la Technique, tient à ce qu’il nomme « l’usurpation bourgeoise » dans Le Chemin de la Croix des Âmes, soit l’idée qu’une caste domine le système, peu importe la forme que revêt son régime politique.
 Dans Les grands cimetières sous la Lune, Georges Bernanos tenait en effet la démocratie pour une invention d’intellectuels, mais « au même titre que la monarchie de Joseph de Maistre ». Cette comparaison récurrente entre la démocratie comme régime faible en proie aux prédations financières et une monarchie aux mains d’une aristocratie qui l’est tout autant fait justement de Bernanos ce penseur singulier qu’il serait ridicule de vouloir classer sur l’échiquier politique. Bernanos ne critiquait pas la démocratie en tant qu’idéal, mais sa réalité telle qu’il l’observait, où il discernait nettement « l’usurpation bourgeoise ». La démocratie et son jeu électoral notamment, ne sont « qu’une fiction politique au service d’intérêts économiques inavouables », chose que l’on serait bien culotté de vouloir lui contester à l’heur de la mondialisation. Si Bernanos rejettait le qualificatif de démocrate, c’est parce que « Le démocrate, et plus particulièrement l’intellectuel bourgeois démocrate, me paraît l’espèce de bourgeois la plus haïssable », ce qui n’est pas sans rappeler les attaques de Pasolini contre cette même bourgeoise de l’Argent qui vampirise le peuple pour le rendre aussi monstrueux qu’elle. Mais Bernanos, contrairement à Pasolini, analysait directement la répercussion de cette usurpation bourgeoise sur l’État, dont il assimilait la crise au profit des puissances financières et occultes ; « la dépossession progressive des États au profit des forces anonymes de l’Industrie et de la Banque ». Bernanos, ni ne gauche, ni de droite, rejettait le libéralisme qu’avait embrassé la bourgeoisie et qu’elle imposait par son hégémonie depuis la Révolution Française. Or, cela constitue dans la pensée de Bernanos une spoliation de tout, même de l’État, au profit d’un individualisme qui se traduit économiquement, là où la puissance publique était censée agir comme un rempart contre la prédation du capitalisme dérégulé. Voilà pourquoi Bernanos se moquait bien des clivages et du jeu politique ; comme il le dit dans La France contre les Robots : « ce sont les démocrates qui font les démocraties, c’est le citoyen qui fait la République ». C’est justement ce point-là qui le démarque de l’étiquette vulgaire que certains tenteraient lui accoler par excès de bien-pensance ; Bernanos, bien qu’attaché à la royauté, appréhendait totalement l’idéal républicain. Si, pour lui, il faut « se méfier des systèmes démocratiques modernes, si imparfaits, si sommaires, si mal défendus contre les trahisons de l’argent », c’est du fait des hommes politiques dont l’obédience ne va pas à la patrie, mais à l’Argent. Or, Bernanos clamait ouvertement dans Le lendemain, c’est vous qu’il n’a « jamais été républicain, mais [qu’il a] compri[t] maintenant ce que ce mot exprimait à tort ou à raison, pour des milliers d’hommes qui ont mis en lui leur foi et leur fierté ». Il ajoutera plus tard que « L’idéalisme de ce qu’on pouvait appelait jadis les masses républicaines, leur enthousiasme naïf pour la liberté, la justice, le progrès […], nous l’avons laissé tourner en dérision, faute immense ».
Dans Les grands cimetières sous la Lune, Georges Bernanos tenait en effet la démocratie pour une invention d’intellectuels, mais « au même titre que la monarchie de Joseph de Maistre ». Cette comparaison récurrente entre la démocratie comme régime faible en proie aux prédations financières et une monarchie aux mains d’une aristocratie qui l’est tout autant fait justement de Bernanos ce penseur singulier qu’il serait ridicule de vouloir classer sur l’échiquier politique. Bernanos ne critiquait pas la démocratie en tant qu’idéal, mais sa réalité telle qu’il l’observait, où il discernait nettement « l’usurpation bourgeoise ». La démocratie et son jeu électoral notamment, ne sont « qu’une fiction politique au service d’intérêts économiques inavouables », chose que l’on serait bien culotté de vouloir lui contester à l’heur de la mondialisation. Si Bernanos rejettait le qualificatif de démocrate, c’est parce que « Le démocrate, et plus particulièrement l’intellectuel bourgeois démocrate, me paraît l’espèce de bourgeois la plus haïssable », ce qui n’est pas sans rappeler les attaques de Pasolini contre cette même bourgeoise de l’Argent qui vampirise le peuple pour le rendre aussi monstrueux qu’elle. Mais Bernanos, contrairement à Pasolini, analysait directement la répercussion de cette usurpation bourgeoise sur l’État, dont il assimilait la crise au profit des puissances financières et occultes ; « la dépossession progressive des États au profit des forces anonymes de l’Industrie et de la Banque ». Bernanos, ni ne gauche, ni de droite, rejettait le libéralisme qu’avait embrassé la bourgeoisie et qu’elle imposait par son hégémonie depuis la Révolution Française. Or, cela constitue dans la pensée de Bernanos une spoliation de tout, même de l’État, au profit d’un individualisme qui se traduit économiquement, là où la puissance publique était censée agir comme un rempart contre la prédation du capitalisme dérégulé. Voilà pourquoi Bernanos se moquait bien des clivages et du jeu politique ; comme il le dit dans La France contre les Robots : « ce sont les démocrates qui font les démocraties, c’est le citoyen qui fait la République ». C’est justement ce point-là qui le démarque de l’étiquette vulgaire que certains tenteraient lui accoler par excès de bien-pensance ; Bernanos, bien qu’attaché à la royauté, appréhendait totalement l’idéal républicain. Si, pour lui, il faut « se méfier des systèmes démocratiques modernes, si imparfaits, si sommaires, si mal défendus contre les trahisons de l’argent », c’est du fait des hommes politiques dont l’obédience ne va pas à la patrie, mais à l’Argent. Or, Bernanos clamait ouvertement dans Le lendemain, c’est vous qu’il n’a « jamais été républicain, mais [qu’il a] compri[t] maintenant ce que ce mot exprimait à tort ou à raison, pour des milliers d’hommes qui ont mis en lui leur foi et leur fierté ». Il ajoutera plus tard que « L’idéalisme de ce qu’on pouvait appelait jadis les masses républicaines, leur enthousiasme naïf pour la liberté, la justice, le progrès […], nous l’avons laissé tourner en dérision, faute immense ».
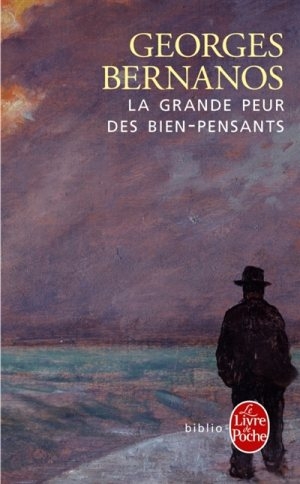 Si pour Bernanos, la démocratie est « probablement le mot le plus prostitué de toutes les langues », c’est à cause de sa mise en pratique par des hommes de pouvoir et opportunistes. Il relève ainsi dans une de ses lettres que les démocraties « font semblant de croire à ce qu’elles défendent, mais elles n’y croient pas. Au réalisme cynique des dictatures, elles n’opposent qu’un opportunisme hypocrite », allant jusqu’à consacrer « Saint Tartufe, patron des démocraties », dans Le Chemin de la Croix des Âmes. C’est pour cette raison qu’à son retour à Paris lors de la Libération, Bernanos remarqua que la France est retournée à un état proche de celui de 1789. La démocratie ne serait qu’une illusion, qui « après avoir signifié une conviction profonde, un état d’âme, une fois, le mot de démocrate ait pris peu à peu le sens de citoyen d’une démocratie, rien d’avantage, de sorte que nous sommes menacés de voir un jour des démocraties sans démocrates, des régimes libres sans hommes libres ». Mais n’en sommes-nous justement pas à ce point ? Ce que Bernanos s’échinait à démontrer n’était pas tant de savoir si la démocratie était mauvaise et faible dans son essence, au contraire puisqu’il l’estimait dans La France contre les Robots comme « un héritage sacré » où « justice et fraternité sont incluses », ajoutant même que « La démocratie est encore à faire », mais qu’elle a une propension plus forte que les autres régimes à succomber aux pouvoirs de l’Argent et de la Technique, car lorsqu’elle n’est que « la forme politique du capitalisme », elle « n’est pas plus la déclaration des droits de l’Homme que la dictature cléricale du général Franco n’est l’Évangile ». Cette usurpation bourgeoise n’est pas une expression vaine chez le penseur, car il fustigeait avec la même force l’idée d’une monarchie phagocytée par la bourgeoisie. Or, elle constitue le principal problème de régression sociale et culturelle selon Bernanos, de par l’acculturation du peuple qu’elle entraîne, mais aussi par l’absence totale de loyauté et de fidélité qui la caractérise. Bernanos notait d’ailleurs avec une certaine ironie que tout le monde se dit démocrate, « y compris le Führer et Mussolini », ou encore que « la bombe atomique est entrée dans l’histoire sous le signe des démocraties ». Autant de saillies qui devraient nous faire réfléchir sur l’absurde dimension messianique que nous donnons par occidentalisme au sens du mot « démocratie », alors qu’aujourd’hui, nous sommes plus que jamais dans ce que craignait Bernanos dans Le Chemin de la Croix des Âmes : « un système de slogans, comme un oiseau pris sous le faisceau d’un projecteur ».
Si pour Bernanos, la démocratie est « probablement le mot le plus prostitué de toutes les langues », c’est à cause de sa mise en pratique par des hommes de pouvoir et opportunistes. Il relève ainsi dans une de ses lettres que les démocraties « font semblant de croire à ce qu’elles défendent, mais elles n’y croient pas. Au réalisme cynique des dictatures, elles n’opposent qu’un opportunisme hypocrite », allant jusqu’à consacrer « Saint Tartufe, patron des démocraties », dans Le Chemin de la Croix des Âmes. C’est pour cette raison qu’à son retour à Paris lors de la Libération, Bernanos remarqua que la France est retournée à un état proche de celui de 1789. La démocratie ne serait qu’une illusion, qui « après avoir signifié une conviction profonde, un état d’âme, une fois, le mot de démocrate ait pris peu à peu le sens de citoyen d’une démocratie, rien d’avantage, de sorte que nous sommes menacés de voir un jour des démocraties sans démocrates, des régimes libres sans hommes libres ». Mais n’en sommes-nous justement pas à ce point ? Ce que Bernanos s’échinait à démontrer n’était pas tant de savoir si la démocratie était mauvaise et faible dans son essence, au contraire puisqu’il l’estimait dans La France contre les Robots comme « un héritage sacré » où « justice et fraternité sont incluses », ajoutant même que « La démocratie est encore à faire », mais qu’elle a une propension plus forte que les autres régimes à succomber aux pouvoirs de l’Argent et de la Technique, car lorsqu’elle n’est que « la forme politique du capitalisme », elle « n’est pas plus la déclaration des droits de l’Homme que la dictature cléricale du général Franco n’est l’Évangile ». Cette usurpation bourgeoise n’est pas une expression vaine chez le penseur, car il fustigeait avec la même force l’idée d’une monarchie phagocytée par la bourgeoisie. Or, elle constitue le principal problème de régression sociale et culturelle selon Bernanos, de par l’acculturation du peuple qu’elle entraîne, mais aussi par l’absence totale de loyauté et de fidélité qui la caractérise. Bernanos notait d’ailleurs avec une certaine ironie que tout le monde se dit démocrate, « y compris le Führer et Mussolini », ou encore que « la bombe atomique est entrée dans l’histoire sous le signe des démocraties ». Autant de saillies qui devraient nous faire réfléchir sur l’absurde dimension messianique que nous donnons par occidentalisme au sens du mot « démocratie », alors qu’aujourd’hui, nous sommes plus que jamais dans ce que craignait Bernanos dans Le Chemin de la Croix des Âmes : « un système de slogans, comme un oiseau pris sous le faisceau d’un projecteur ».
« C’est le citoyen qui fait la République ; une démocratie sans démocrates, une république sans républicains, c’est la dictature de l’intrigue et de la corruption »
–Georges Bernanos, in « La France contre les Robots »–
En réalité, le régime idéal de Bernanos n’est guère éloigné de celui de Machiavel. Royaliste, certes, mais Bernanos rêvait d’un césarisme qui se souciât du peuple et fît avec lui bloc contre les puissances de l’Argent. Le sort des humbles est toujours ce qui distingua Bernanos du reste de l’Action Française ; avoir un roi pour avoir un roi ne l’intéressait pas si c’était pour revenir à l’Ancien Régime. La figure monarchique selon Bernanos devait être l’alliée des prolétaires, pas des sociétés anonymes ou des banques, fustigeant ceux qui lui prêtaient l’intention de professer « pour la personne des princes une espèce de fétichisme analogue à celui que certains dévots manifestent, en toute occasion, à l’égard du Saint-Père », à l’opposé d’un Charles Maurras par exemple.. Il écrivit ainsi que « « l’idée ne nous serait pas venue de nous rallier, au nom de l’ordre, avec ce vieux radical réactionnaire [Clémenceau, ndlr] contre les ouvriers français ». C’est toutefois désillusionné par la société moderne que Bernanos abjurât ses anciennes positions antirévolutionnaires, comprenant que le danger qu’apportèrent ces nouveaux obscurantismes que sont l’idéologie du progrès ou la modernité nécessitât un nouvel « élan national », dans la veine de 1789. Le prince n’est donc pour Bernanos « que le premier serviteur du peuple contre les puissantes oligarchies, hier les féodaux, à présent les trusts ». Ce qui le distingue de Pasolini réside en fait dans sa réflexion sur le rôle de l’État dans la lutte contre la civilisation des machines, estimant qu’il est le seul instrument capable de contenir la prédation de puissances occultes de cette « ère mécaniste et totalitaire » dans laquelle nous sombrons. Néanmoins, comme Pasolini, c’est au peuple que Bernanos tient, à ce peuple français qui savait résister contre l’usurpation bourgeoise, où qu’elle fût, et qui dorénavant est incapable de s’interroger sur les causes de sa propre misère. S’il eût vécu une décennie de plus, l’émergence des médias de masse ou de la télévision l’eut probablement terrifié, et alors qu’il pensait que seul « le peuple de la Résistance » aurait pu revivifier la Nation, peut-être aurait-il aussi rédigé un article sur la disparition des lucioles.
00:46 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : georges bernanos, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Nicolas Bonnal
Ex: http://www.dedefensa.org
Un lecteur sympathique me demande bien gentiment comment résister à la matrice. Ma réponse est simple : couper sa télé, retirer l’argent de la banque, cultiver son jardin comme sa famille, faire des enfants, leur éviter l’école, bref se réconcilier avec la réalité de terrain, car elle existera toujours, sauf pour les Baudrillard qui regardent trop la télé. Le système ne doit pas être combattu ; il est assez grand pour ça, rappelle Philippe Grasset, il bouillonne dans son autodissolution imbécile. Il faut aussi maîtriser son accès au web et ne pas se laisser démoraliser par certains sites antisystèmes qui deviennent pires que le système. Pour le système la manipulation du catastrophisme (achetez de l’or, creusez un trou, et surtout préparez-vous à la guerre…) est excellente et décourage les braves gens ! Dans mes livres sur Tolkien j’ai souvent insisté sur le père de Sam le jardinier qui ignore le grand combat que lui explique mal son fils et cherche à protéger ses patates et ses salades. Car l’important est là.
Le monde change sans changer, et Voltaire nous avait tout dit dans son immortel et scolaire Candide, à l’issue d’un voyage mondialiste bien terrifiant (ceux qui se plaignent feraient bien de relire le conte et le récit de la vieille par exemple).
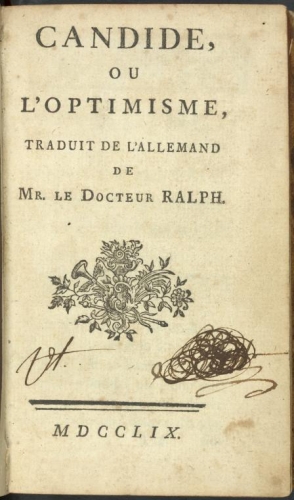 On écoute ce maître qui, disait Borges, écrit la plus belle prose du monde :
On écoute ce maître qui, disait Borges, écrit la plus belle prose du monde :
« Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople deux vizirs du banc et le muphti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d'orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le muphti qu'on venait d'étrangler. »
Réponse de génie dans la simplicité :
« Je n'en sais rien, répondit le bonhomme, et je n'ai jamais su le nom d'aucun muphti ni d'aucun vizir. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez ; je présume qu'en général ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu'ils le méritent ; mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople ; je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. »
L’étendue de la terre importe peu. Ce qui importe c’est le travail familial :
« Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre ? Je n'ai que vingt arpents, répondit le Turc ; je les cultive avec mes enfants ; le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice, et le besoin. »
Il faut cultiver son jardin, ajoute Candide dans une phrase finalement peu comprise.
L’information industrielle abêtissante a toujours existé, voyez mon texte sur la rumeur (Fama) chez Ovide et Virgile. La Bruyère traduisant Théophraste, vieux disciple d’Aristote, écrit dans ses caractères :
« De là il se jette sur ce qui se débite au marché, sur la cherté du blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville ; il dit qu’au printemps, où commencent les Bacchanales, la mer devient navigable ; qu’un peu de pluie serait utile aux biens de la terre, et ferait espérer une bonne récolte ; qu’il cultivera son champ l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur ; que le siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à vivre. »
Le bon chrétien rajoutera à son jardin ces classiques et notre bon Cassien qui nous explique déjà comment résoudre nos problèmes psychologiques en temps de guerre ou de paix.
Voltaire – Candide
Cassien – Institutions
Bonnal – Les secrets de Cassien (Amazon.fr)
La Bruyère – Caractères
19:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, voltaire, 18ème siècle, candide |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
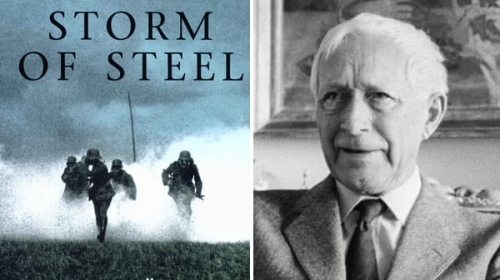
Ex: http://literaturkritik.de
Vor den Beiträgen in der Februar-Ausgabe 2018 zum 20. Todestag Ernst Jüngers (geb. am 29.3.1895, gest. 17.2.1998) sind in literaturkritik.de zahlreiche Rezensionen und Essays erschienen, die sich mit dem umstrittenen Autor, seinem Werk und seiner Rezeption auseinandergesetzt haben. Hier eine Zusammenstellung aus unserem Archiv in chronologischer Anordnung:
Ernst Jüngers Gestaltdenken aus narratologischer Sicht.
Eine neue Studie untersucht „Heliopolis“ und „Eumeswil“
Von Christophe Fricker
Ausgabe 08-2017
Der Chronist des Getöses.
Zur kritischen Edition von Ernst Jüngers „Krieg als inneres Erlebnis. Schriften zum Ersten Weltkrieg“
Von Walter Delabar
Ausgabe 09-2016
Im Gespräch mit einem Titanen.
Christophe Fricker gibt die Gespräche zwischen Ernst Jünger und André Müller heraus
Von Stefan Tuczek
Ausgabe 08-2015
Aporien des Krieges, des Erzählens und der Theorie.
Die lesenswerte Studie „Writing War“ von Daniela Kirschstein widmet sich der Kriegsliteratur von Ernst Jünger, Louis-Ferdinand Céline und Curzio Malaparte
Von Wolfgang M. Schmitt
Ausgabe 07-2015
Günter Grass und Ernst Jünger.
Trotz aller Unterscheide zeigen sich erstaunliche Parallelen im Werk der beiden Schriftsteller
Von Gabriela Ociepa
Ausgabe 05-2015
 Biographisches Rohmaterial.
Biographisches Rohmaterial.
Über Ernst Jüngers „Feldpostbriefe an die Familie 1915–1918“
Von Niels Penke
Ausgabe 12-2014
Die Hoffnung führt weiter als die Furcht.
Tom Schilling liest Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“
Von Martin Ingenfeld
Ausgabe 07-2014
Warum eigentlich Ernst Jünger?.
Ein neues Handbuch bereichert die Forschung zu einem umstrittenen Autor
Von Daniel Borgeldt
Ausgabe 07-2014
In allen Lagern Gegner.
Tonaufnahmen von Lesungen und Vorträgen Ernst Jüngers
Von Andreas R. Klose
Ausgabe 03-2014
Stahlgewitter.
Ernst Jünger und der Erste Weltkrieg
Von Helmuth Kiesel
Ausgabe 02-2014
Werkpolitik im Spiegel nordischer Motive.
Niels Penke stellt Ernst Jüngers Schriften in den Kontext der skandinavischen Literatur
Von Maik M. Müller
Ausgabe 01-2014
Tore der Wahrnehmung.
Über eine erstmals veröffentlichte Auswahl des Briefwechsels zwischen Albert Hofmann und Ernst Jünger
Von Volker Strebel
Ausgabe 11-2013
Noch einmal: Der neue revolutionäre Mensch.
Mario Bosincu über „Die Wende Ernst Jüngers“
Von Jerker Spits
Ausgabe 08-2013
Planetarisches aus der Provinz.
Ein Konstanzer Tagungsband nimmt den mittleren und späten Ernst Jünger in den Blick
Von Niels Penke
Ausgabe 04-2013
En vogue in einem kleinen Kreis.
Ernst Jünger aus der Sicht seines französischen Übersetzers Julien Hervier
Von Jerker Spits
Ausgabe 10-2012
Ein zuweilen starrsinniges Beharren auf Unabhängigkeit.
In bislang ausführlichster Weise berichtet der 2011 verstorbene Literaturwissenschaftler Heinz Ludwig Arnold über seine Zeit mit Ernst Jünger
Von Volker Strebel
Ausgabe 06-2012
Zwischen Bewegung und Verharren.
Jan Robert Weber untersucht den ästhetischen Wert von Ernst Jüngers Reisetagebüchern
Von Heide Kunzelmann
Ausgabe 01-2012

Zum Oberlehrer ungeeignet.
Thomas Amos legt in der bewährten Reihe der Rowohlt-Monografien eine Biografie Ernst Jüngers mit Ecken und Kanten vor
Von Volker Strebel
Ausgabe 01-2012
Instrumentalisierter Tötungstrieb.
Michael Gratzke untersucht die Grundfiguren des Heldentums bei Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich von Kleist, Theodor Fontane, Ernst Jünger und Heiner Müller
Von Erhard Jöst
Ausgabe 06-2011
Der kanonische Rang eines Klassikers.
Ernst Jünger – mehr als eine Bilanz in einem neuen Sammelband
Von Gabriele Guerra
Ausgabe 05-2011
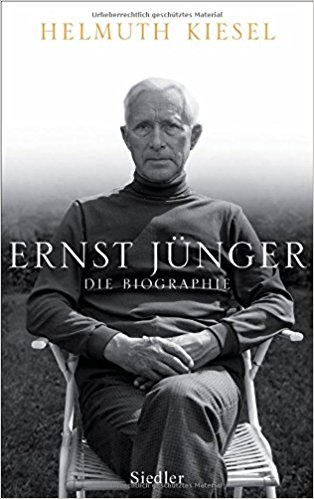 Ernst Jüngers Rhodos-Reisen von 1938, 1964 und 1981
Ernst Jüngers Rhodos-Reisen von 1938, 1964 und 1981
Ausgabe 01-2011
Totale Tinte.
Ohne Anlass wird Ernst Jünger vom Deutschen Literaturarchiv Marbach als einer der „wichtigsten Schriftsteller der Moderne“ vorgestellt – und Helmuth Kiesel beglückt uns mit seiner Erst-Edition der „Tagebücher 1914-1918“
Von Jan Süselbeck
Ausgabe 01-2011
Der verborgene Prophet.
Ernst Jüngers politische Theologie zwischen Autorität und Repräsentation
Von Gabriele Guerra
Ausgabe 01-2010
Eine gute Zeit für Drogen.
Wiederbegegnung mit Ernst Jüngers „Annäherungen“
Von Christophe Fricker
Ausgabe 01-2009
Kriegsträumer.
Lars Koch zu Walter Flex und Ernst Jünger als Repräsentanten der Gegenmoderne
Von Walter Delabar
Ausgabe 12-2008
Fotoalbum für Wehrsport-Fans.
Nils Fabiansson hat Schauplätze von Ernst Jüngers Kriegstagebuch „In Stahlgewittern“ aufgesucht
Von Jan Süselbeck
Ausgabe 03-2008
Nach dem Fazit.
Hans Blumenberg über Ernst Jünger
Von Kai Köhler
Ausgabe 03-2008
Hochmut und Leutseligkeit auf dem Dorf.
Ernst Jünger in neueren Biografien und Monografien
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 03-2008
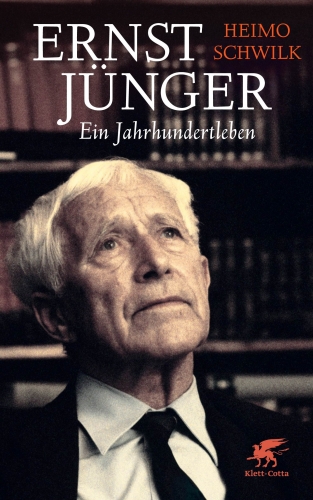 Springtime for Ernst Jünger.
Springtime for Ernst Jünger.
Über Heimo Schwilks Jünger-Biografie
Von Philipp Steglich
Ausgabe 03-2008
Freunde unter sich.
Günther Nicolin editiert den Briefwechsel von Ernst Jünger und Stefan Andres
Von Torsten Mergen
Ausgabe 06-2007
Unterhaltung über Mescalin.
Die späte Begegnung der beiden Einzelgänger Gottfried Benn und Ernst Jünger: Jetzt wurde der schmale Briefwechsel vorgelegt
Von Volker Strebel
Ausgabe 07-2006
Deutschsein als Amt.
Zum Briefwechsel Ernst Jüngers und Friedrich Hielschers
Von Volker Strebel
Ausgabe 12-2005
Ernst Jünger: Politik – Mythos – Kunst
Ausgabe 12-2004
„Wie kein anderer erfährt er den Weltkrieg sogleich metaphysisch.“.
Martin Heideggers Bemerkungen zu Ernst Jünger
Von Stephan Günzel
Ausgabe 08-2004
Teilnehmen, Anteil nehmen.
Michael E. Sallinger begeistert sich für Ernst Jünger und seinesgleichen
Von Viktor Schlawenz
Ausgabe 08-2004
Zwischen Traum und Trauma.
Michael Gnädingers Studie zum Frühwerk Ernst Jüngers
Von Helmut Kaffenberger
Ausgabe 04-2004
„Wann hat dieser Scheißkrieg ein Ende“?.
Der britische Germanist John King gewährt Einblicke in die originalen Kriegstagebücher Ernst Jüngers
Von Jerker Spits
Ausgabe 12-2003
Vor und nach dem Rochenstich.
Mit Band 22 ist die Ausgabe der „Gesammelten Werke“ Ernst Jüngers abgeschlossen
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 12-2003
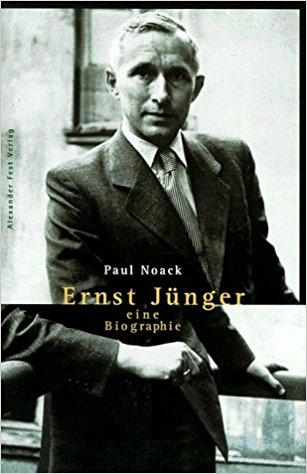 Stratege im Hintergrund.
Stratege im Hintergrund.
Ernst Jüngers Briefwechsel mit Gerhard Nebel
Von Gunther Nickel
Ausgabe 11-2003
Ernst Jünger – verzettelt und verzeichnet.
Nicolai Riedels Ernst Jünger-Bibliographie und Tobias Wimbauers „Personenregister“
Von Gunther Nickel
Ausgabe 07-2003
Die Psychoanalyse des körperlichen und gestischen Agierens.
Über ein neues Paradigma für Psychotherapie und Kulturwissenschaften mit einem Ausblick auf Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“
Von Harald Weilnböck
Ausgabe 03-2003
Literarische Adaption des Griechentums.
Annette Rinks Studie über Ernst Jüngers Antike-Rezeption
Von Reinhard Wilczek
Ausgabe 11-2002
Schönheit des Untergangs.
Roswitha Schieb untersucht Körper- und Kollektivbilder bei Ernst Jünger, Hans Henny Jahnn und Peter Weiss
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 11-2002
Eine Welt sinnloser Bezüge.
Ulrich Prill entdeckt Ernst Jünger als homo ludens
Von Helge Schmid
Ausgabe 11-2002
Ich befand mich einfach in einer anderen Dimension.
Ernst Jünger im Gespräch mit Antonio Gnoli und Franco Volpi
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 11-2002
Ich fühle, dass meine Wurzeln hier sind.
Ein Bildband über Ernst Jünger in Oberschwaben
Von Helge Schmid
Ausgabe 11-2002
 Der Einzelne nach der Kehre.
Der Einzelne nach der Kehre.
Jörg Sader untersucht Ernst Jüngers „Strahlungen“
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 11-2002
Starke Frauen, intrigante Männer.
Ernst Jüngers Dramenfragment „Prinzessin Tarakanowa“
Von Christina Ujma
Ausgabe 11-2002
Ernst Jünger in Berlin 1927-1933
Ausgabe 01-2002
Ernst Jünger in Wilflingen
Ausgabe 01-2002
Zwischen Subjektivität und Authentizität.
Volker Mergenthaler zum poetologischen Problem narrativer Kriegsbegegnung im Frühwerk Ernst Jüngers
Von Reinhard Wilczek
Ausgabe 01-2002
Ambiguität des Figürlichen.
Julia Draganovic untersucht das metaphysische Grundkonzept in Ernst Jüngers Prosa
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 01-2002
Exotische Lesefrüchte eines Jahrhundert-Autors.
Thomas Pekars Studie über Ernst Jüngers Orient-Rezeption
Von Reinhard Wilczek
Ausgabe 01-2002
Führung durch Stahlgewitter und Waldgänge.
Steffen Martus gibt einen exzellenten Überblick über das Werk Ernst Jüngers
Von Stephan Landshuter
Ausgabe 01-2002
Autor und Sekretär, Verehrer und Gegner.
Ernst Jünger in einer Festschrift und in einer Streitschrift
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 01-2002
Garantiert politisch unkorrekt.
Ernst Jüngers politische Publizistik aus den Jahren 1919 bis 1933
Von Gunther Nickel
Ausgabe 01-2002
Großer Übergang und päpstlicher Segen.
Ernst Jüngers Werkausgabe in den Supplementbänden 19 und 20
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 01-2002
Ernst Jünger als Nietzsche-Rezipient.
Die Nihilismusthese ist die Leitlinie seines Schaffens
Von Ursula Homann
Ausgabe 02-2001
Momente der Selbstbegegnung.
Ernst Jüngers Tagebuch und Briefwechsel
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 10-2000
 Unsere Total-Kalamität.
Unsere Total-Kalamität.
Ernst Jüngers Briefwechsel mit Carl Schmitt
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 10-2000
Saulus und Paulus.
Elliot Y. Neamans Studie über Ernst Jünger und die post-faschistische Literaturpolitik
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 10-2000
Elementar nützlich.
Tobias Wimbauers Personenregister der Tagebücher Ernst Jüngers
Von Helge Schmid
Ausgabe 10-2000
Trauma, Drogenrausch, Gewaltrausch.
Klaus Gauger über drei liminale Zustände in Ernst Jüngers Werk
Von Helge Schmid
Ausgabe 10-2000
Das Ende der Heldenzeit.
Dirk Blotzheim untersucht Ernst Jüngers Frühwerk
Von Lutz Hagestedt
Ausgabe 10-2000
Ich werde plötzlich dumpf, erbreche draußen.
Armin Mohler berichtet über seine Jahre mit Ernst Jünger
Von Kai Köhler
Ausgabe 10-2000
Die durchgedrückte Brust des Melancholikers.
Die Ernst Jünger-Biografie von Paul Noack
Von Oliver Jahn
Ausgabe 10-2000
Bildhauer, bleib bei deinen Skulpturen.
Serge D. Mangin und seine „Annäherungen an Ernst Jünger 1990 – 1998“
Von Oliver Jahn
Ausgabe 10-2000
18:57 Publié dans Hommages, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: https://www.der-dritte-weg.info
Auch heute noch, zwanzig Jahre nach seinem Tod, ist es kein leichtes Unterfangen über Leben, Werk und Wirken des Jahrhundertschriftstellers zu schreiben. Zu widersprüchlich scheinen seine Worte und seine Taten zu sein, zu wechselhaft seine Gedanken und Sätze. Ernst Jünger, das ist der hochdekorierte Stoßtruppführer des ersten Weltkriegs, der radikale Nationalist der Zwischenkriegszeit, der innere Emigrant während des dritten Reiches und schließlich der kategoriensprengende Denker der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Es kann bereits am Anfang dieses Artikels gesagt werden, dass man keinesfalls eine befriedigende oder abschließende Betrachtung Jüngers – auch aus nationalrevolutionärer Perspektive – in diesem begrenzten Platz liefern kann, sondern allenfalls eine Annäherung. Wie soll man auch einen Soldaten, Schriftsteller und Denker, dessen Leben 103 Jahre währte, dessen Gesamtausgabe (wo nicht einmal alle Werke und Aufsätze drin enthalten sind!) nicht weniger als 23 dicke Bände füllt und der nicht nur zwei Weltkriege, sondern, die BRÖ mit eingerechnet, sechs deutsche Staaten gesehen hat, in einem einzigen Artikel gerecht werden? Als ältestes von fünf Kindern 1895 geboren, erlebte Jünger noch die letzten Jahre des deutschen Kaiserreiches, welches ihn durchaus noch für den Rest seines Lebens prägen sollte. Der Weg des schlechten Schülers, aber begeisterten Lesers, sollte ihn zunächst in den Wandervogel und später durch die halbe Welt führen.
Dass Jünger vor allem ein „abenteuerliches Herz“, wie eines seiner Werke heißt, war, zeigte sich bereits 1913, als der grade 18 Jährige nach Frankreich entfloh und sich zur Fremdenlegion meldete. Einzig dem diplomatischen Geschick seines Vaters ist es geschuldet, dass sich Jünger als Kriegsfreiwilliger nach Ablegung seines Notabiturs 1914 in den ersten Weltkrieg auf deutscher Seite melden konnte und er nicht als Fremdenlegionär gegen das eigene Vaterland zu Felde ziehen musste. Mehr als 20 Jahre später beschrieb Jünger in seinen „Afrikanischen Spiele“ seine Zeit bei der Fremdenlegion. Bereits am ersten Kriegstag begann er mit dem Schreiben seines später weltberühmt werdenden Tagebuchs. Schonungslos und objektiv, und doch mit einer lebendigen Sprache und einer, wie er schrieb, „trunkenen Stimmung aus Rosen und Blut“ beschrieb er in seinem als „In Stahlgewittern“ veröffentlichtem Tagebuch seine Kriegserlebnisse. Der „ruhige Leutnant“ machte sich in vierjährigem Einsatz an der Westfront einen Namen, durchquerte alle bekannten westlichen Schlachtfelder des ersten Weltkriegs und ging mit fast stoischer Haltung durch „Feuer und Blut“, wie eines seiner weiteren Werke über den ersten Weltkrieg heißt.
„Es entstand ein neuer Mensch, ein neuer Lebenswille. Ihn kennzeichnete die nervige Härte des Kämpfers, der Ausdruck der einsameren Verantwortung, der seelischen Verlassenheit. In diesem Ringen … bewährte sich sein Rang. Der Weg, den er ging, war schmal und gefährlich, aber es war ein Weg, der in die Zukunft führte … Der Anblick des Gegners bringt neben letztem Grauen auch Erlösung von schwerem, unerträglichem Druck. Das ist die Wollust des Blutes, die über dem Kriege hängt wie ein rotes Sturmsegel über schwarzer Galeere, an grenzenlosem Schwunge, nur dem Eros verwandt“, schrieb Jünger in seinem ersten literarischen Gehversuch. Den Krieg hatte, laut ihm, der deutsche Frontsoldat wie einen Wein genossen und war auch nach seinem Ende immer noch davon berauscht, ein Ausdruck, der sicherlich auf viele der entlassenen Soldaten und kommenden Freikorpskämpfer zutrifft. Für ihn gewann der Kampf neben der Zerstörung und des Todes auch eine metaphysische Bedeutung, wie er in „Der Kampf als inneres Erlebnis“ darzustellen versuchte. Für ihn war derjenige, der beim Krieg nur die Verneinung, nur das eigene Leiden und nicht die Bejahung empfunden habe, ein Sklave, der lediglich ein äußeres, aber kein inneres Erlebnis hatte.
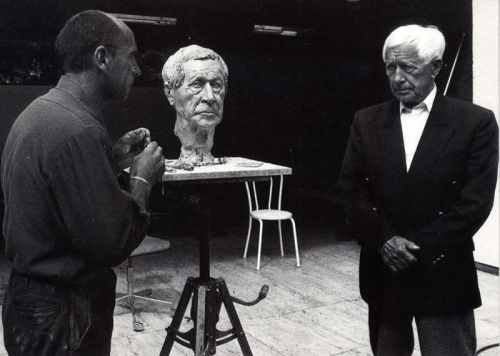
Doch in den Stahlgewittern der Materialschlachten gewann er nicht nur seine Ansichten über Krieg und Frieden, sondern auch den Beginn seiner technikkritischen Anschauungen, die ihn sein Leben lang als einer der wenigen Kontinuitäten begleiten sollte. Die Materialschlachten, Artilleriegeschosse und Panzer reduzierten den Krieg zum Handwerk und den Krieger zu einem namen- und gesichtslosen Objekt. Die Ansichten, ob der Soldat doch über die Materie siegen kann oder ob diese ihn dominiert, schwankt immer wieder in seinen Werken und in denen seiner Zeitgenossen. Die vier Hauptwerke Jüngers über sein „Bruderschaftstrinken mit dem Tod“, „In Stahlgewittern“, „Feuer und Blut“, „Der Kampf als inneres Erlebnis“ und „Wäldchen 125“ zeugen nicht nur von diesen Gedanken, sondern gehören wohl auch zu den literarisch besten Beschreibungen der Erlebnisse des feldgrauen Soldaten des ersten Weltkriegs. Es ist eine Mischung aus Heldenmut, Eros, Sprachkraft, Tod und Leben, die ihm bei vielen Pazifisten bis heute in den Ruf eines Kriegstreibers bringt.
„Oft hielt ein Fähnlein eherner Gesellen sich endlose Tage im Gewölk der Schlacht, verbissen in ein unbekanntes Stückchen Graben oder eine Reihe von Trichtern, wie sich Schiffbrüchige im Orkan an zertrümmerte Masten klammern. In ihrer Mitte hatte der Tod seine Feldherrnstandarte in den Boden gestoßen. Leichenfelder vor ihnen, von ihren Geschossen gemäht, neben und zwischen ihnen die Leichen der Kameraden, Tod selbst in ihren Augen, die seltsam starr in eingefallenen Gesichtern lagen, diesen Gesichtern, die an die grausige Realistik alter Kreuzigungsbilder erinnerten. Fast verschmachtet hockten sie in der Verwesung, die unerträglich wurde, wenn wieder einer der Eisenstürme den erstarrten Totentanz aufrührte und die mürben Körper hoch in die Lüfte schleuderte … Man zog ja über das Grausige hinweg mit genagelten Stiefeln, ehern und blutgewohnt. Und doch fühlte man, wie etwas um die verwaisten Kamine strich und einem den Hals zuschnürte, so eisig, daß man schlucken mußte. Man war ja ein Träger des Krieges, rücksichtslos und verwegen, hatte manchen umgelegt, über den man weitergeschritten war mit starken Gefühlen in der Brust. Doch dies war wie ein Kinderwimmern aus wilden Mooren, eine gespenstische Klage wie das Glockengeläut des versunkenen Vineta über Meer und Mittag. Gleich dem Untergang jener übermütigen Stadt spürte man das hoffnungslose Versinken einer Kultur, erschauernd vor der Erkenntnis, im Strudel mit hinabgerissen zu werden“, heißt es etwa im „Kampf als inneres Erlebnis“.
Selbst am Ende seines Lebens sollte er sich nie von diesen Darstellungen distanzieren, noch als Greis antwortete er französischen Journalisten, dass sein schrecklichstes Erlebnis im ersten Weltkrieg gewesen sei, dass Deutschland ihn verloren habe. Eine Aussage, die umso höher zu bewerten ist, wenn man bedenkt, dass der junge Stoßtruppführer vierzehn Verwundungen erlitt. Mit Ende des Krieges begann auch der wohl bis heute umstrittenste Abschnitt seines Lebens. Während sich zahlreiche andere Soldaten zu den Freikorps meldete , diente der Kriegsheld zunächst in der Reichswehr. Zwar soll er, laut eigener Aussage, einmal eine kurze Zeit bei dem berühmten Freikorpsführer Roßbach gewesen sein, allerdings habe ihn die Landknechtartigkeit vieler Freikorpskämpfer abgeschreckt. In die folgenden Jahren folgen nicht nur seine zahlreichen Artikel in radikalnationalistischen Zeitschriften – zusammengefasst gibt es sie heutzutage als „Politische Publizistik“ zu erwerben – sondern auch seine Zeit als Bohemien. Neben literarische Studien, nationalistischen Büchern und Artikeln gab es auch Jüngers erste Drogenerfahrungen, die er in seiner Erzählung „Polnischer Karpfen“ behandelt. (Später sollten weitere Experimente, speziell zusammen mit dem Erfinder von LSD, folgen.) Jünger, so viel sei an dieser Stelle gesagt, ergab sich aber nicht dem in der Weimarer Schandrepublik propagierten Drogenkonsum zur Erhöhung der Lust und des Rausches wegen, sondern eher aus transzendenten Abenteuerlust.
Während der Kampfzeit der Nationalisten gegen die Novemberverbrecher wurde Jünger einer der Wortführer des „Neuen Nationalismus“. Sätze wie „Der Tag, an dem der parlamentarische Staat unter unserem Zugriff zusammenstürzt, und an dem wir die nationale Diktatur ausrufen, wird unser höchster Festtag sein.“ begeisterten zahllose nationale Aktivisten. Doch grade auch seine nationalistische Zeit wirft neue Fragen in Mysterium Jüngers auf. War er auf der einen Seite radikaler Nationalist – die NSDAP lehnte er später u. A. deswegen ab, weil diese einen legalen Weg beschritt, er wollte die bewaffnete Revolution – und erklärter Todfeind der bürgerlichen Gesellschaft, so führte er, während Hunderte Nationalisten im Straßenkampf ihr Leben ließen, selbst ein bürgerliches Leben. Noch 1926 sandte er Adolf Hitler sein Buch „Feuer und Blut“ mit der Widmung „Dem nationalen Führer Adolf Hitler“ und sprach sich in verschiedenen Beiträgen positiv über die NSDAP und den Nationalsozialismus aus. Erst die Entwicklung zur Massenpartei sowie eine wirtschaftspolitische Orientierung von Jünger an den Bolschewismus entfremdeten ihn der NSDAP, der er schließlich sogar vorwarf, verbürgerlicht zu sein.

Als vermeintlich sein höchster Feiertag gekommen war und der parlamentarische Staat am 30. Januar 1933 zerbrach, stellte sich Jünger nicht der neuen nationalen Regierung zur Verfügung, sondern begab sich in die „innere Emigration“. Vom Nationalsozialismus trennte ihn zwar der Rassegedanke (den Jünger als materialistisch ablehnte) , auch war die NSDAP eine Massenpartei, während sich Jünger in einem, wie man es wohl heute aus unserer Sicht beurteilen kann, „Elitenwahn“ befand, dennoch waren die Übereinstimmungen zwischen dem dritten Reich und Jüngers nationaler Visionen weit größer als die Differenzen. Es wird wohl für immer ein Rätsel bleiben, wieso Jünger nicht wie andere seiner Zeit und einiger seiner engen Freunde – etwa Heidegger, Benn oder Schmitt – zumindest versuchte, die neue Zeit mitzugestalten, sondern sich von Beginn an abseits hielt. Unzweifelhaft war ihm der Totalitarismus des dritten Reiches nicht genehm, dennoch muss man wohl als Nationalist das Urteil ziehen, dass für Jünger mehr der Weg als das Erreichen des Ziels entscheidend gewesen war. Dazu kommt seine Ende der 20er-Jahre einsetzende Entwicklung weg von der politischen Publizistik hin zur reinen literarischen Betätigung. Allerdings sollte er eine gewisse nationale Einstellung sein Leben lang beibehalten, zwar nicht mehr in ihrer ursprünglichen Radikalität, aber dennoch vorhanden.
So wie es über seine Tätigkeiten in der Novemberrepublik zahlreiche Vorwürfe von den späteren Kriegssiegern und liberalen Nachkriegsgenerationen gab, so gibt es über seine Zeit im dritten Reich und insbesondere im zweiten Weltkrieg solche von nationalistischer Seite. Jünger hielt auch während der Zeit der nationalsozialistischen Regierung Kontakt zu Staatsfeinden wie Ernst Niekisch, was ihn ins Visier der Polizei geraten ließ. Doch handelt es sich dabei nicht um einen im eigentlichen Sinne widerständigen Kontakt, Jünger hielt vielmehr den intellektuellen Austausch mit dem ihm befreundeten Niekisch. Später sollte er einen solchen auch mit dem französischen Faschisten und Kollaborateur Pierre Drieu la Rochelle, zu dem ihm ebenfalls eine Freundschaft verband, pflegen. Überhaupt muss Jünger mehr als Denker und Schriftsteller und weniger als politischer Mensch angesehen werden. Als solcher hatte er auch Kontakt zu dem Widerstandskreis des 20. Juli 1944, allerdings ohne sich an den Planungen zum Attentat auf Adolf Hitler zu beteiligen oder genaueres zu wissen. Zwar war Jünger ohne Zweifel ein Gegner des Krieges, in dem sein einziger Sohn fiel, politische Attentate lehnte er allerdings schon aus Prinzip ab.
Er hatte sich in den Jahren seiner „inneren Emigration“ zunehmend zum Selbstbildnis seiner literarischen Gestalt des Anarchen bzw. des Waldgängers entwickelt, einer Person, die sich aus dem Laufe der Geschichte heraushält und versucht, seinen eigenen Weg abseits der großen Ereignisse zu gehen. Seine oft als Anti-NS Schrift beschriebenen Marmorklippen sind ebenfalls Teil dieser Entwicklung, die Marmorklippen sind aber eher als generell antitotalitäres Buch zu verstehen, als explizit gegen das dritte Reich gerichtet. Adolf Hitler selbst hielt die zwölf Jahre durchgehend persönlich seine schützende Hand über Jünger, mit dem er in der Kampfzeit noch signierte Bücher austauschte. Nach dem 8. Mai 1945 erhielt Jünger über einige Jahre ein Publikationsverbot, bevor er sein literarisches Schaffen weiterführen konnte. Damit gelangen ihm nicht nur Bestseller, sondern sogar die Verleihung des Goethe-Preises, wobei zahlreiche linke und linksradikale Akteure der bundesrepublikanischen Kulturlandschaft gegen Jünger zu Felde zogen.
Über Jahrzehnte zog sich die Diskussion um ihn und seine Werke, auch heute noch ist sie nicht abgeschlossen. Unabhängig von den Inhalten seiner Werke mussten aber die meisten Kulturkritiker die hohe literarische Qualität des wohl umstrittensten deutschen Autoren überhaupt würdigen. Ein abschließendes Fazit zu Jünger wird sich wohl nie finden lassen: Abenteurer und doch verharrend in einem bürgerlichen Leben, radikaler Nationalist und doch Gegner des dritten Reiches, Kriegsheld und Denker, Schriftsteller und Philosoph, zu groß sind die Widersprüche und die Richtungswechsel, die Jünger eingeschlagen hat. Am ehesten lässt er sich wohl noch als romantischer Abenteurer beurteilen, er selbst gefiel sich in der Rolle des Seismografen, der die Ereignisse seiner Zeit beobachtet und schilderte, statt sie zu gestalten. Ob man ihn ablehnt – und wenn ja aus welchen Gründen – oder ob man sich von seinen Werken begeistern lässt, vor 20 Jahren starb unzweifelhaft einer der Großen der deutschen Kulturlandschaft.
18:19 Publié dans Hommages, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Nicolas Bonnal
Ex: http://www.dedefensa.org
Je ne les ouvre jamais mais depuis deux semaines les journaux en Espagne parlent très intelligemment de trois choses : la tyrannie de Poutine, qui n’en finira jamais (pauvre occident, que va-t-il faire, heureusement la bombe, heureusement l’OTAN, etc.) ; le changement climatique (il y a du vent et de la pluie, on est en mars…) et la grève féministe, qui permet de combattre enfin le nazisme masculin – on demande des budgets au gouvernement néocon local en ce sens.
Dans toutes ces histoires il ne s’agit que de racket.
On a évoqué le féminisme avec Nietzsche. On le relit :
« Il y a aujourd’hui, presque partout en Europe, une sensibilité et une irritabilité maladives pour la douleur et aussi une intempérance fâcheuse à se plaindre, une efféminisation qui voudrait se parer de religion et de fatras philosophique, pour se donner plus d’éclat — il y a un véritable culte de la douleur. »
Cette irritabilité se reflète-t-elle dans notre obsession pour les conditions météo ?
Sur le changement climatique je me demandais depuis combien de temps on s’abrutit ainsi ; car aucun classique ne nous emmerdait avec. Tout apparaît semble-t-il au milieu du dix-neuvième siècle : la guerre de Crimée crée la science météorologique, et Baudelaire se plaint de son ciel bas et lourd qui baisse comme un couvercle…
On connaît mon goût pour la cuisinière (une femme géniale, qui ne connaît ni Louis-Philippe, ni république, ni Badinguet) et la correspondance de Flaubert. Je recommande le début des années 1850, qui est prodigieux (voyez ses lettres à Victor Hugo). Sur une petite tempête météo voici ce qu’il écrit notre analyse littéraire de la femme moderne :
12 juillet 1853 – Tu auras appris par les journaux, sans doute, la soignée grêle qui est tombée sur Rouen et alentours samedi dernier.
Désastre général, récoltes manquées, tous les carreaux des bourgeois cassés ; il y en a ici pour une centaine de francs au moins, et les vitriers de Rouen ont de suite profité de l’occasion (on se les arrache, les vitriers) pour hausser leur marchandise de 30 p 100. Ô humanité ! C’était très drôle comme ça tombait, et ce qu’il y a eu de lamentations et de gueulades était fort aussi. Ç’a été une symphonie de jérémiades, pendant deux jours, à rendre sec comme un caillou le cœur le plus sensible ! On a cru à Rouen à la fin du monde (textuel). Il y a eu des scènes d’un grotesque démesuré, et l’autorité mêlée là-dedans !
M le préfet, etc. »
Oui, l’administration française avec ses préfets et notre inféodation a certainement joué dans cette formation du caractère geignard et assisté – plus de lois et de taxes, et d’amendes et de menaces, pour le féminisme et la lutte contre le racisme et pour le socialisme, et tout le reste…
Flaubert poursuit, coquin, comme James Kunstler ou Dimitri Orlov aujourd’hui :
« Ce n’est pas sans un certain plaisir que j’ai contemplé mes espaliers détruits, toutes mes fleurs hachées en morceaux, le potager sens dessus dessous.
En contemplant tous ces petits arrangements factices de l’homme que cinq minutes de la nature ont suffi pour bousculer, j’admirais le vrai ordre se rétablissant dans le faux ordre. Ces choses tourmentées par nous, arbres taillés, fleurs qui poussent où elles ne veulent (pas), légumes d’autres pays, ont eu dans cette rebuffade atmosphérique une sorte de revanche… »
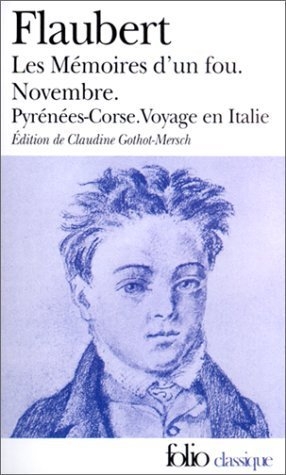 Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :
Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :
« Ah ! ah ! cette nature sur le dos de laquelle on monte et qu’on exploite si impitoyablement, qu’on enlaidit avec tant d’aplomb, que l’on méprise par de si beaux discours, à quelles fantaisies peu utilitaires elle s’abandonne quand la tentation lui en prend ! Cela est bon. On croit un peu trop généralement que le soleil n’a d’autre but ici−bas que de faire pousser les choux.
Il faut replacer de temps à autres le bon Dieu sur son piédestal. Aussi se charge−t−il de nous le rappeler en nous envoyant par−ci par−là quelque peste, choléra, bouleversement inattendu et autres manifestations de la Règle, à savoir le Mal − contingent qui n’est peut−être pas le Bien − nécessaire, mais qui est l’être enfin : chose que les – hommes voués au néant comprennent peu. »
Et Flaubert un peu plus loin souligne ce qui accompagne cette jérémiade climatique, savoir le règne des machines et la montée de notre stupidité :
14 août 1853 – « La cloche du paquebot du Havre sonne avec tant d’acharnement que je m’interromps. Quel boucan l’industrie cause dans le monde ! Comme la machine est une chose tapageuse ! à propos de l’industrie, as-tu réfléchi quelquefois à la quantité de professions bêtes qu’elle engendre et à la masse de stupidité qui, à la longue, doit en provenir ? Ce serait une effrayante statistique à faire ! »
Flaubert est un génie et prévoit donc les effets du taylorisme soixante-dix avant Charlot (un autre génie) :
« Qu’attendre d’une population comme celle de Manchester, qui passe sa vie à faire des épingles ? Et la confection d’une épingle exige cinq à six spécialités différentes ! Le travail se subdivisant, il se fait donc, à côté des machines, quantité d’hommes−machines. Quelle fonction que celle de placeur à un chemin de fer ! de metteur en bande dans une imprimerie ! etc., etc. Oui, l’humanité tourne au bête. Leconte a raison ; il nous a formulé cela d’une façon que je n’oublierai jamais. Les rêveurs du moyen âge étaient d’autres hommes que les actifs des temps modernes. »
Ici ce serait du Guénon, du Chesterton, du Bernanos : « Les rêveurs du moyen âge étaient d’autres hommes que les actifs des temps modernes. »
On comprend que pour fuir cette connerie il se soit voué au culte de l’art, quand il était encore possible (car comment faire connaître un Flaubert aujourd’hui s’il en existait un ???) :
« L’humanité nous hait, nous ne la servons pas et nous la haïssons, car elle nous blesse. Aimons-nous donc en l’art, comme les mystiques s’aiment en Dieu, et que tout pâlisse devant cet amour ! »
Enfin Flaubert avait compris que notre fin de l’histoire, comme je le dis toujours, durerait des siècles :
Je comprends depuis un an cette vieille croyance en la fin du monde que l’on avait au moyen âge, lors des époques sombres. Où se tourner pour trouver quelque chose de propre ? De quelque côté qu’on pose les pieds on marche sur la merde. Nous allons encore descendre longtemps dans cette latrine. »
Car qui pensait qu’après Hollande détesté, la multitude élirait son ministre de l’économie ?
Tout cela donne raison à sa cuisinière décidément :
« J’ai eu aujourd’hui un grand enseignement donné par ma cuisinière. Cette fille, qui a vingt-cinq ans et est Française, ne savait pas que Louis-Philippe n’était plus roi de France, qu’il y avait eu une république, etc. Tout cela ne l’intéresse pas (textuel). Et je me regarde comme un homme intelligent ! Mais je ne suis qu’un triple imbécile. C’est comme cette femme qu’il faut être. »
Sauf qu’aujourd’hui la brave fille serait abrutie par son smartphone et sa télé…
Nicolas Bonnal – Chroniques sur la fin de l’histoire
Flaubert – Correspondance, 1850-1854 (ebookslib.com)
Nietzsche – Par-delà le bien et le mal
17:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave flaubert, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Bulletin célinien n°405
 Sommaire :
Sommaire :
- Lucette, entre toutes les femmes
– Céline et le Comité de Prévoyance et d’Action sociale
– Misère de la condition humaine chez Céline
– Galtier-Boissière
– Céline à Leningrad
Faut-il que la gloire posthume de Céline insupporte certains ! Dans un roman aussi pesant que touffu, Maxime Benoît-Jeannin raconte les liens professionnels et privés qui unirent, sous l’Occupation, deux personnalités aussi affirmées que Dominique Rolin et Jeanne Loviton à Robert Denoël. Céline, son auteur fétiche, apparaît à plusieurs reprises. Paranoïaque, veule et bien entendu partisan de l’extermination de la race élue ¹, c’est ainsi que ce romancier le dépeint sans nuance. En revanche, il a pour Sartre les yeux de Chimène, se gardant bien de rappeler que celui-ci se compromit avec un autre totalitarisme ². Et de dénoncer dans l’épilogue « un Sartre bashing frénétique qui touche tous les milieux » ainsi que « cette haine pathologique pour le philosophe français le plus important depuis Descartes [sic] ». Pour en arriver à déplorer que « du coup, la commémoration du centenaire de sa naissance se fit a minima. » La phrase qui suit est édifiante à souhait : « Parallèlement, la gloire de Céline monte encore en puissance, son lectorat ne cesse de grandir. » …Voilà qui est assurément insupportable.
 Quant à ce roman, gageons qu’il découragera plus d’un lecteur s’intéressant à cette période. Tant de personnages défilent qu’on ne parvient à s’attacher à aucun d’entre eux. On a en outre l’impression que l’auteur a voulu y fourguer toute sa documentation. Elle est d’autant plus vaste qu’il l’a largement puisée sur un site internet en libre accès: celui qu’Henri Thyssens consacre depuis 2005 à Robert Denoël. Mais on est loin de l’élégance d’un Pierre Assouline qui, à la fin de son roman Sigmaringen, tint à citer ses sources. Le travail de Thyssens est ici sommairement mentionné au détour d’une page alors que, sans les recherches qu’il a accumulées pendant vingt ans, ce roman n’existerait tout simplement pas. Quant au chercheur il est qualifié d’« admirateur de Louis-Ferdinand Céline », ce qui, dans l’esprit de l’auteur, doit être un tantinet suspect.
Quant à ce roman, gageons qu’il découragera plus d’un lecteur s’intéressant à cette période. Tant de personnages défilent qu’on ne parvient à s’attacher à aucun d’entre eux. On a en outre l’impression que l’auteur a voulu y fourguer toute sa documentation. Elle est d’autant plus vaste qu’il l’a largement puisée sur un site internet en libre accès: celui qu’Henri Thyssens consacre depuis 2005 à Robert Denoël. Mais on est loin de l’élégance d’un Pierre Assouline qui, à la fin de son roman Sigmaringen, tint à citer ses sources. Le travail de Thyssens est ici sommairement mentionné au détour d’une page alors que, sans les recherches qu’il a accumulées pendant vingt ans, ce roman n’existerait tout simplement pas. Quant au chercheur il est qualifié d’« admirateur de Louis-Ferdinand Céline », ce qui, dans l’esprit de l’auteur, doit être un tantinet suspect.
Dans la presse Benoît-Jeannin se défend d’être manichéen mais le lecteur constate qu’il n’a que profond mépris pour tous les écrivains qui se sont engagés dans la voie de la Collaboration. C’est dire si l’on s’écarte du jugement d’un Malraux qui considérait Drieu comme « l’un des êtres les plus nobles qu’[il ait] rencontrés ». Ici, tous ceux qui étaient dans le mauvais camp sont jugés à l’aune de la même toise. C’est tellement plus simple ainsi.
Reste l’énigme du meurtre de Robert Denoël. L’auteur y voit la conséquence d’une altercation qui aurait mal tourné entre un résistant revenu des camps et Denoël qui lui aurait demandé son appui pour le procès dont il était menacé. Hypothèse qui paraît un peu alambiquée. Une seule chose est sûre : on n’a pas fini de gloser sur cette affaire vieille de plus d’un demi-siècle.
• Maxime BENOÎT-JEANNIN, Brouillards de guerre (roman), Éditions Samsa, 2017, 500 p. (26 €)
17:23 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, céline, robert denoël, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Franck Buleux
Ex: https://metamag.fr
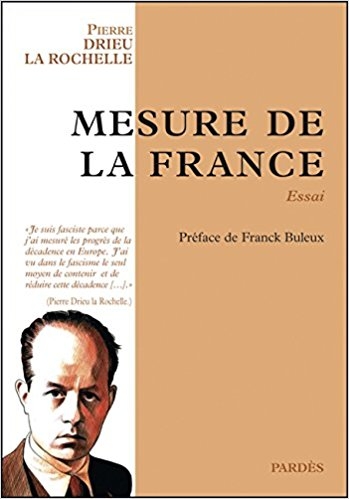 L’intérêt essentiel de cet essai est de souligner le fait, pour Drieu la Rochelle, de ne pas se satisfaire, comme les nationalistes français, de la victoire sur l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, qui s’est soldée par le Diktat de Versailles, en 1919. Au-delà de l’Europe exsangue, meurtrie par cette guerre civile européenne, Drieu la Rochelle nous propose une Europe digne de son passé, qui retrouve son Imperium.
L’intérêt essentiel de cet essai est de souligner le fait, pour Drieu la Rochelle, de ne pas se satisfaire, comme les nationalistes français, de la victoire sur l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, qui s’est soldée par le Diktat de Versailles, en 1919. Au-delà de l’Europe exsangue, meurtrie par cette guerre civile européenne, Drieu la Rochelle nous propose une Europe digne de son passé, qui retrouve son Imperium.
L’expression « mesure » était faite pour choquer. Qui oserait « mesurer » la France éternelle, présente sur les cinq continents ? Le Normand Drieu la Rochelle rêve d’Empire mais a conscience de la faiblesse démographique française. Visionnaire lorsque l’auteur exprime cette nécessité d’union continentale, cet essai mérite d’être lu parce qu’il annonce (prématurément ? à tort ?) la fin des nations, alors que brille encore dans les yeux des Français, la victoire en trompe l’œil, selon l’auteur, de 1918. Une victoire certes, mais à quel prix ? Au prix d’une population dévastée sur un territoire, devenu un champ de bataille et de ruine, une Europe exsangue soumise à des traités qui, loin d’en satisfaire les parties, la renvoient vers d’autres interminables et sanglants conflits. Mais qui s’en soucie, en 1922 ?
C’est dans l’euphorie générale de la victoire, dans la germanophobie ambiante, que Drieu la Rochelle en appelle au dépassement de la notion de patrie. Sans nier cette réalité, « l’ère des patries n’est pas close » tient-il à préciser d’emblée, il ouvre l’avenir européen à celui des alliances entre États. Il constate notre faible démographie déjà, parle de « suicide » et ouvre les yeux, lucide, face à des mondes qui nous entourent, ces « énormes morceaux » d’Amérique et d’Asie, lire les États-Unis et l’Union soviétique. Supputant la fin des colonies, Drieu la Rochelle ne peut se représenter la France que dans le cadre d’une alliance continentale. Il évoque, en les appelant de ses vœux, ces futures unions entre patries comme ayant une « physionomie propre », qui « mêleront les traits des États »… Vaste débat qui sera largement repris lors de la construction européenne dans les années 1950, et bien au-delà.
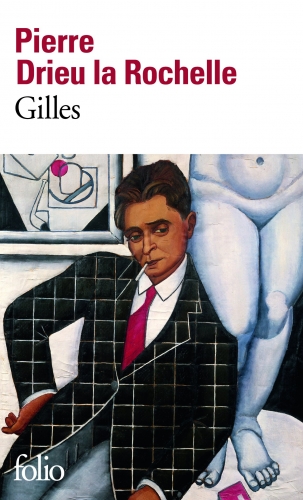 Face à l’euphorie de l’éphémère victoire, cette alliance européenne (car il s’agit bien de cela) est une « question de vie ou de mort », selon l’auteur lui-même : ne pas aller vers cette union nous entraînerait inéluctablement et irrésistiblement vers d’autres conflits. Intégrer l’Allemagne, contre laquelle la France vient de combattre, avant que celle-ci ne se tourne vers d’autres alliances, plus à l’Est. N’oublions pas que l’Union soviétique est en train de se construire, à l’intérieur, comme une véritable fortification socialiste (et un modèle pour beaucoup !) et qu’en serait-il de nous, Français, si l’Europe centrale (Mitteleuropa) se tournait vers elle ? L’insularité britannique et la défaite allemande ne sont-ils pas des risques de division du Vieux Continent ? La perfide Albion tournée vers l’Amérique et l’Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, lorgnant vers l’Empire communiste… Dans cette saisissante hypothèse, que resterait-il de la France éternelle ?
Face à l’euphorie de l’éphémère victoire, cette alliance européenne (car il s’agit bien de cela) est une « question de vie ou de mort », selon l’auteur lui-même : ne pas aller vers cette union nous entraînerait inéluctablement et irrésistiblement vers d’autres conflits. Intégrer l’Allemagne, contre laquelle la France vient de combattre, avant que celle-ci ne se tourne vers d’autres alliances, plus à l’Est. N’oublions pas que l’Union soviétique est en train de se construire, à l’intérieur, comme une véritable fortification socialiste (et un modèle pour beaucoup !) et qu’en serait-il de nous, Français, si l’Europe centrale (Mitteleuropa) se tournait vers elle ? L’insularité britannique et la défaite allemande ne sont-ils pas des risques de division du Vieux Continent ? La perfide Albion tournée vers l’Amérique et l’Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, lorgnant vers l’Empire communiste… Dans cette saisissante hypothèse, que resterait-il de la France éternelle ?
Anticipant les travaux de Carl Schmitt sur la distinction entre puissance maritime et puissance terrestre, Drieu la Rochelle rappelle le positionnement géographique central de l’Allemagne, qu’il situe « en pleine terre, en plein Europe ». En développant cet aspect d’union continentale, Drieu la Rochelle rêve de cet empire romain germanique disparu qui mobiliserait la jeunesse européenne.
Mais Drieu la Rochelle demeure d’un tempérament pessimiste. Il condamne les Français, en les dépeignant comme « résignés », s’attachant à une armée nationale alors que des transformations commencent à poindre à l’horizon du monde. C’est résolument vers l’Allemagne qu’il faut nous tourner, pense l’auteur, pour fonder l’Europe unique qu’il appelle de ses vœux et dont il aimerait voir la France fer de lance.
À défaut, Drieu la Rochelle, en visionnaire éclairé, s’interroge sur la Russie naissante qui se dresse « dans sa steppe » et « dont le mystère semblait plein de promesses ». La jeunesse du prolétariat russe préfigurerait-t-elle l’avenir ? S’interroge l’auteur, observant cette montée en puissance de l’Est face à l’Amérique, grand vainqueur économique du premier conflit mondial.
Pourtant, Drieu la Rochelle rejette ce qu’il appelle le parti de la Production, c’est-à-dire le parti de l’argent, celui qui domine l’Amérique mais il retrouve, dans le bolchevisme, cette même idée fondée sur le matérialisme, comme unique ressort de l’humanité.
Née sous les cendres de la Première Guerre mondiale, la Société des nations (SDN) semble préfigure, pour Drieu la Rochelle, une avancée vers cette union européenne face aux dangers qui s’annoncent. Il développera cette idée, lui “Le jeune Européen” (texte paru en 1927), dans” Genève ou Moscou”, paru en 1928. Ce choix, que l’on pressent déjà dans” Mesure de la Franc”e, ce choix « central » de l’Europe permettrait de résister aux deux impérialismes qui s’annoncent. Il entrevoit Genève (rappelons-le, c’est dans cette ville que siège, à l’époque, la SDN) comme capitale, pour résister d’abord à l’impérialisme américain (Les États-Unis ont refusé d’intégrer la SDN). Le second rempart possible contre l’hégémonie américaine serait le communisme, représenté par Moscou. Or, le rempart communiste ne représente qu’un simulacre, « l’ombre du capitalisme », symbolisant pour Drieu le triomphe de la Production et, au terme, celui de la mort. « Il faut faire l’Europe parce qu’il faut respirer quand on ne veut pas mourir. Il faut faire l’Europe à moins qu’on ne soit bolchevik d’extrême droite ou d’extrême gauche, à moins qu’on ne veuille laisser un grand bûcher s’amonceler sur lequel flambera, avant vingt ans, toute la civilisation, tout l’espoir, tout l’honneur humain. ». Dans les années vingt, si Drieu La Rochelle était encore hésitant sur sa voie politique, fréquentant les surréalistes et l’Action française, l’approche des années trente le fait sortir de sa réserve en choisissant l’Europe et martèle-t-il inexorablement face au monde, encore incrédule : « Si la capitale politique et économique des États-Unis d’Europe ne se fait pas, si Genève ne se fait pas, Moscou se fera.»
Ainsi, “Mesure de la France” préfigure d’autres écrits, considérés comme majeurs, de Drieu la Rochelle. Cet essai de 1922 annonce aussi son choix de l’Allemagne, non par idéologie, mais par qu’elle lui semble, à une époque incertaine, le meilleur rempart contre les impérialismes et le meilleur allié pour espérer, au-delà de la France seule, donner à l’Europe une place dans l’Histoire, celle qui lui revient.
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre drieu la rochelle, livre, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, années 20, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
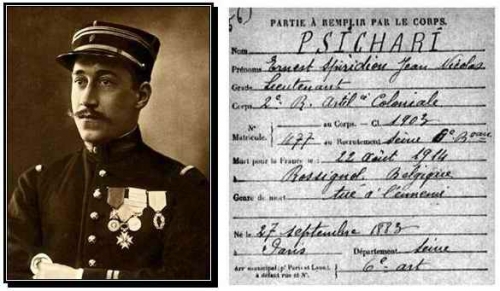
1913 : la France cède aux « douces romances » du pacifisme. Sous l’influence de l’intelligentsia parisienne, la jeunesse française se désintéresse de la guerre et des soldats. Contre le parti des intellectuels, Ernest Psichari, un jeune officier d’artillerie coloniale, publie son deuxième roman, un roman à thèse, dont le mot d’ordre est le « militarisme intégral ». Achevé sous la tente saharienne, L’appel des armes (1913) célèbre la figure du soldat, la beauté de l’action et de la force. Par le service des armes, il redevient possible de mener dans le monde une vie de grand style.
« Lorsque l’auteur de ce récit fit ses premières armes au service de la France, il lui sembla qu’il commençait une vie nouvelle. Il eut vraiment le sentiment de quitter la laideur du monde et d’accomplir comme la première étape d’une route qui devait le conduire vers de plus pures grandeurs. » Engagé à 20 ans, Ernest Psichari quitte avec enthousiasme la maison paternelle. Ce jeune intellectuel, petit-fils d’Ernest Renan, trouve dans la vie militaire une délivrance de la vie ordinaire qu’il mène à Paris. Admis dans l’artillerie coloniale, Psichari découvre la joie de l’action, et consacre près de cinq années de sa vie à l’Afrique. Au cours d’un « magnifique exil » en Mauritanie, il rédige L’appel des armes, un roman d’apprentissage dont la trame n’est pas sans rappeler le parcours du jeune écrivain.
Le héros de ce roman, Maurice Vincent, est un adolescent, fils d’un instituteur antimilitariste. Au contact de Timothée Nangès, capitaine dans l’artillerie coloniale, il trouve dans son cœur une vocation de soldat. Prenant « contre son père le parti de ses pères », il choisit le parti des hommes d’action et s’engage comme simple canonnier. Contre son père biologique, il se réfère désormais à une autre paternité, spirituelle, incarnée par ce soldat de l’armée coloniale. Les rapports entre les deux hommes sont désormais ceux de maître à disciple, d’initiateur à initié. L’adolescent embrasse une vie entièrement nouvelle, qui s’apparente à une seconde naissance.
Selon Psichari, les soldats sont les derniers représentants d’une idée, l’incarnation de l’action et de la force. À l’abri de toute compromission, de toute faiblesse, l’armée est le dernier rempart de la nation. Quelque direction que prenne le monde, il ne se passera pas des armes. Psichari rejoint en cela son ami Charles Péguy : « Que la Sorbonne le veuille ou non, c’est le soldat français qui lui mesure la terre. […] C’est le soldat français qui fait qu’on parle français à Paris » (L’Argent). Pour la nouvelle génération, l’armée est la meilleure école. Elle est l’héritière de la « grande œuvre romaine et française », le seul moyen d’échapper à son siècle et la société moderne. Elle est également l’objet d’un véritable mystique : sa mission est de « racheter la France par le sang ». Contre l’humanitarisme, contre le pacifisme, l’armée incarne la France éternelle, « fille aînée de la Gloire », « toujours guerrière et aventureuse », « toujours prête à se lancer dans une généreuse aventure […] s’il est de la gloire à glaner ».

Le jeune Maurice Vincent cultive des « pensées de gloire ». Il rêve de pays lointains, de champs de bataille ensoleillés. « Son foyer, désormais, serait une tente errante parmi les déserts roses des Tropiques. » Son modèle, le capitaine Nangès, est une force vive, un homme tendu vers l’action, une authentique figure de guerrier. Celui-ci se charge de son éducation, lui enseigne un idéal. En parallèle de son instruction militaire, l’adolescent recueille l’instruction spirituelle du capitaine. L’enfant soldat s’éveille au « militarisme intégral ».
L’annonce de son départ pour la Mauritanie est « la plus belle heure de sa vie », le point culminant de son destin. L’Afrique est une « terre d’action », la seule qui permette à son pays d’inscrire quelques pages de gloire dans l’histoire médiocre de son temps. Le principal danger, c’est « d’oublier l’histoire », de perdre le sens de celle-ci. « Nous nous préparons des années d’histoire vide. Pensez-vous à ce que pourront dire plus tard de nous les historiens ? Nos enfants verront dans leur manuel : ‘‘De 1880 à 19.., le commerce et l’industrie prospérèrent’’. À quoi servons-nous, sinon à faire l’histoire, et si nous ne la faisons pas, qui la fera ? »
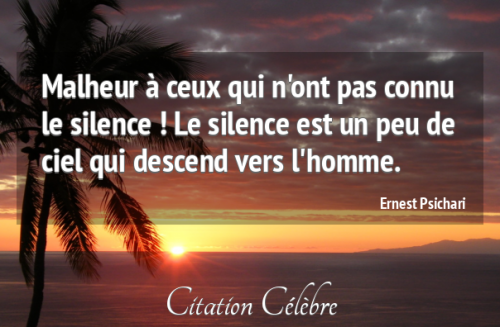
L’appel de la tradition
Héritière d’un passé glorieux, véritable incarnation de l’ordre, l’armée est la seule, avec l’Église, qui ait maintenu une tradition : « L’armée représente une grande force du passé, la seule, avec l’Église, qui reste vierge, non souillée, non décolorée par l’impureté nouvelle. » Le rôle du soldat, c’est donc de maintenir un certain « fonds moral », qui s’oppose au pacifisme, à l’humanitarisme, aux rêveries infécondes de son siècle. Le parti des intellectuels est représenté par le père biologique de Maurice, un « sophiste », une « âme tiède » maudissant les soldats et leur drapeau. Paradoxalement, Maurice est un représentant du passé, d’un passé héroïque – son père, un représentant de l’avenir, du parti des intellectuels, grands selon l’esprit, mais non selon le cœur. Maurice est désormais « un bel enfant barbare, dans un monde jeune ».
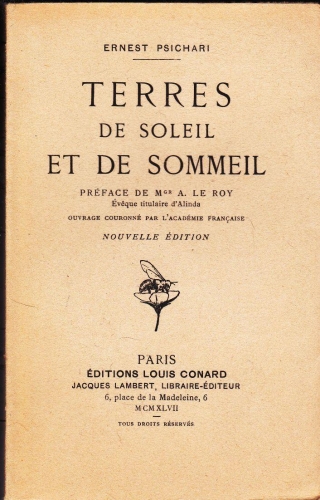 En rêve, le capitaine Nangès rencontre Timoléon d’Arc, un personnage de Servitude et grandeur militaires (1835) de Vigny. Le héros de Vigny envie le héros de Psichari. Il aurait aimé fouler en conquérant cette terre d’Afrique, pleine de charme et de volupté. Là, l’homme se purifie, s’épure, loin des « pourritures modernes ». Là, du moins, « quelque idéal reste encore ». En réponse, le capitaine Nangès évoque le mépris de la nation, le rejet du colonialisme. La métropole tient les glorieuses chevauchées des soldats en piètre estime. « Le bourgeois a la crainte de ce qu’il ne comprend pas. Il tremble aux mots d’infini, d’absolu. Le Sahara lui fait peur, comme la musique de Wagner. » Comme Ernst Jünger le décrira quelques années plus tard : « L’élémentaire réside en dehors de son monde idéal ; pour lui, l’élémentaire est l’irrationnel voire l’immoral. »
En rêve, le capitaine Nangès rencontre Timoléon d’Arc, un personnage de Servitude et grandeur militaires (1835) de Vigny. Le héros de Vigny envie le héros de Psichari. Il aurait aimé fouler en conquérant cette terre d’Afrique, pleine de charme et de volupté. Là, l’homme se purifie, s’épure, loin des « pourritures modernes ». Là, du moins, « quelque idéal reste encore ». En réponse, le capitaine Nangès évoque le mépris de la nation, le rejet du colonialisme. La métropole tient les glorieuses chevauchées des soldats en piètre estime. « Le bourgeois a la crainte de ce qu’il ne comprend pas. Il tremble aux mots d’infini, d’absolu. Le Sahara lui fait peur, comme la musique de Wagner. » Comme Ernst Jünger le décrira quelques années plus tard : « L’élémentaire réside en dehors de son monde idéal ; pour lui, l’élémentaire est l’irrationnel voire l’immoral. »
Au contraire, « la guerre est divine ». Dans Terres de soleil et de sommeil (1908), Ernest Psichari décrivait la guerre comme un « indicible poème de sang et de beauté ». Elle est « la plus voisine des puissances cachées qui nous mènent » et le capitaine Nangès ne regrette pas que le jeune Maurice ait éprouvé cela : « Heureux les jeunes hommes qui, de nos jours, ont mené la vie frugale, simple et chaste des guerriers ! […] Toutes les terres sont belles pour un jeune soldat. Toutes les aubes sont fraîches, naïves ; puisqu’on s’y lève joyeux, confiant dans sa force, audacieux. » Dans cette terre d’Afrique, terre de soldats, imprégnée de grandeur et de noblesse, le capitaine Nangès entend son métier « en artiste ». Et Psichari de citer Alfred de Vigny : « Il exerce, non en ambitieux, mais en artiste, l’art de la guerre. » Ernst von Salomon, reprendra cette image dans Les Cadets (1933) : « Les soldats sont des artistes et les grands maîtres de la guerre sont le cœur mystique du monde. »
Témoignage d’une génération, L’appel des armes rencontre en 1913 un succès notable. La conversion de Psichari au catholicisme la même année achève d’en faire un modèle à la jeunesse de France. Il connaîtra néanmoins une destinée tragique. Comme Charles Péguy, dont il fut le « disciple préféré », Ernest Psichari est rappelé à Dieu au cours des premières semaines de la Grande Guerre. Mort à 30 ans le 22 août 1914 à la tête de ses hommes, le lieutenant Psichari devient l’un des héros de la « génération sacrifiée ».
14:09 Publié dans Littérature, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernest psichari, première guerre mondiale, guerre, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
01:16 Publié dans Jean Parvulesco, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean parvulesco, laurent james, poésie, japon, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Nicolas Bonnal
Ex: http://www.dedefensa.org
Je découvre enchanté le livre de sagesse de Luis Buñuel, mi ultimo suspirio. Il résume sa vie aventureuse et formidable, à la pointe de la modernité comme on dit ; mais aussi il décoche çà et là, comme un autre grand de la rébellion d’alors, Orson Welles, des traits remarquables contre notre monde (nos « sociétés ») moderne.
Il commence par me rassurer, Don Luis : le moyen âge a duré plus qu’on ne le croit dans le milieu traditionnel !
 « On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. »
« On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. »
Cet arrogant monde moderne dont parle aussi Ortega Y Gasset se manifestera par la guerre d’Espagne et son million de morts. Fascisme et cléricalisme certes, mais aussi communisme et anarchisme pour empiler des corps. Le libéralisme privatisera les survivants.
Buñuel parle très bien de Calanda, son pueblo aragonais, et de son vendredi saint, rythmé par des tambours cosmiques (à découvrir sur Youtube.com). Mais il ajoute :
« Aujourd'hui, à Calanda, il n'y a plus de pauvres qui sentent les vendredis à côté du mur de l'église pour demander un morceau de pain. La ville est relativement prospère, les gens vivent bien. Le costume typique, la ceinture, le cachirulo à la tête et le pantalon étroit ont disparu depuis longtemps.
Les rues sont pavées et éclairées. Il y a de l'eau courante, des égouts, des cinémas et des bars. Comme dans le reste du monde, la télévision contribue efficacement à la dépersonnalisation du spectateur. Il y a des voitures, des motos, des réfrigérateurs, un bien-être matériel bien préparé, équilibré par cette société à nous, où le progrès scientifique et technologique a relégué dans un lointain territoire la morale et la sensibilité de l'homme. L'entropie - le chaos - a pris la forme de plus en plus effrayante de l'explosion démographique. »
Tel quel. Je ne commente même pas.
Don Luis rappelle comme Michelet (On se permet de mépriser Michelet maintenant ?) que le Moyen Age a eu la vie dure (1789 en France, 1914 en Espagne et ailleurs parfois !) :
« J'ai eu la chance de passer mon enfance au Moyen Âge, cette période «douloureuse et exquise», comme le dit Huysmans. Douloureux dans le matériel. Exquis dans le spirituel. Le contraire d'aujourd'hui. »
Tout est dit. Comme Guy Debord Buñuel aime boire. Mais comme pour Guy Debord il y a eu un mais (moi je suis arrivé trop tard, le monde était déjà mort dans les années 70). Les centres commerciaux remplacent les collèges jésuites à Saragosse et on vide les lieux :
« Malheureusement, et pour aucune raison valable, le bar a fermé. Nous nous voyons encore Silberman, Jean-Claude et moi en 1980, l'hôtel errant comme des âmes perdues à la recherche d'un niveau acceptable, il est un mauvais souvenir, notre temps dévastateur détruit tout ne respecte pas même les bars. »
Une ligne admirable sur la fin des apéritifs :
« Malheureusement, ces combinaisons admirables sont en train de disparaître. Nous assistons à une effroyable décadence de l'apéritif, triste signe des temps. Un de plus. »
 Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :
Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :
« Puis, après 1934, je me suis installé à Madrid. Je n'ai jamais voyagé pour le plaisir. Cet amour pour le tourisme, si répandu pour moi autour, c'est inconnu pour moi. Je ne ressens aucune curiosité pour les pays que je ne connais pas et que je ne rencontrerai jamais. Au contraire, j'aime retourner aux endroits où j'ai vécu et à ceux qui lient mes souvenirs. »
Théophile Gautier écrivait vers 1843 dans son critique Voyage en Espagne pas trop médiévale :
« Quand tout sera pareil, les voyages deviendront complètement inutiles, et c’est précisément alors, heureuse coïncidence, que les chemins de fer seront en pleine activité. À quoi bon aller voir loin, à raison de dix lieues à l’heure, des rues de la Paix éclairées au gaz et garnies de bourgeois confortables ?
Nous croyons que tels n’ont pas été les desseins de Dieu, qui a modelé chaque pays d’une façon différente, lui a donné des végétaux particuliers, et l’a peuplé de races spéciales dissemblables de conformation, de teint et de langage. C’est mal comprendre le sens de la création que de vouloir imposer la même livrée aux hommes de tous les climats, et c’est une des mille erreurs de la civilisation européenne ; avec un habit à queue de morue, l’on est beaucoup plus laid, mais tout aussi barbare. »
Luis Buñuel découvre aussi que le monde moderne ou la société actuelle feront disparaitre l’amour (on est en 1980 !) :
« A l'époque de notre jeunesse, l'amour nous semblait un sentiment puissant, capable de transformer une vie. Le désir sexuel, inséparable pour lui, s'accompagnait d'un esprit d'approximation, de conquête et de participation qui devait nous élever au-dessus du simple matériel et nous rendre capables de grandes choses.
L'une des enquêtes surréalistes les plus célèbres ont commencé par cette question: «Si je l'aime, tout l'espoir, sinon l'amour, non » « ? Quel espoir, vous met dans l'amour » je l'ai dit, aimer nous a semblé indispensable à la vie, pour toute action, pour toute pensée, pour toute recherche.
Aujourd'hui, si je dois accepter ce qu'on me dit, il en va de l’amour comme de la foi en Dieu. Il a tendance à disparaître, du moins dans certains médias. Il est généralement considéré comme un phénomène historique, comme une illusion culturelle. Il est étudié, analysé ... et, si possible, il est guéri. »
Buñuel écrit de belles pages favorables à Marcuse et à mai 68. Il note simplement que tout cela se termina mal, comme la révolution surréaliste. Je lui laisse le soin de le dire lui-même :
“Al igual que nosotros, los estudiantes de Mayo del 68 hablaron mucho y actuaron poco. Pero no les reprocho nada, Como podría decir André Breton, la acción se ha hecho imposible, lo mismo que el escándalo.”
Redécouvrons le rêve…
Bunuel – Mi ultimo suspirio
Bonnal – Les voyageurs éveillés ; l’apocalypse touristique
12:37 Publié dans Cinéma, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : modernité, vide moderne, luis bunuel, espagne, cinéma, cinéma espagnol, littérature, lettres, lettres espagnoles, littérature espagnole, 7ème art |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

La libertad en el Estado Mundial
José Javier Esparza
Ex: http://www.posmodernia.com
Jünger relexionó incesantemente sobre la libertad, en particular sobre la libertad personal. Lo hizo al mismo tiempo que expresaba su convicción de que la humanidad caminaba hacia formas de organización colectiva cada vez más férreas y hasta asfixiantes. Esas formas de organización, vistas desde la perspectiva jüngeriana, revestían en los años 30 los colores del mundo del Trabajador y en los años 50 se manifestaron cada vez más como Estado Mundial, que en realidad son dos fases distintas del mismo proceso. La pregunta es cómo concebir la libertad personal en semejante contexto. Y a modo de guía en el camino, Jünger aporta una interpretación que descansa en dos conceptos clave: organismo y organización.
El Estado Mundial de Jünger es, ante todo, la constatación y la explicación de una tendencia que se está acelerando a medida que el poder técnico se desarrolla; en cierto modo, podemos decir que es una pionera exploración metafísica de lo que hoy se ha llamado “globalización”. El Estado Mundial es la forma de organización del estado en la era de la técnica. Pero frente a esa organización, surgen las correspondientes resistencias. Y aquí se basa la perspectiva jüngeriana del eterno conflicto entre organismo y organización:
“Desde siempre ha sido dominante la desconfianza frente al Estado. Los esfuerzos hechos por él, sus intervenciones, despertaron desde el primer momento unos temores en los que se expresa algo más que la simple prudencia política y que la reivindicación de un modo propio de ser. Aquí no son sólo la persona singular y sus comunidades naturales, como la familia, la parentela, la tribu, el pueblo, las que se ven expuestas a una exigencia que penetra hondamente en la substancia y cuyas ventajas y desventajas es difícil ponderar. Aquí es la vida misma la que está en una de sus grandes encrucijadas. En ella el organismo y la organización se encuentran” (pp. 193-194).
Lobos y abejas
Jünger obtiene estos términos, “organismo y organización”, de una máxima del escritor francés Rivarol: “El poder es la fuerza organizada” (La puissance est la force organisée), síntesis de sus aforismos políticos . Pero Jünger intenta ir más allá de la perspectiva de este autor y se sitúa en una posición en la que la organización es aprehendida al mismo tiempo que su contrario, el organismo . Tampoco es difícil hallar aquí ecos de la tradición organicista alemana, en la que la materia y el organismo se contraponen como, en Tönnies, se contraponen sociedad (mecánica) y comunidad (orgánica).
El organismo es la forma de ser de las realidades vivas, naturales; la organización es la “plantilla”, el “molde” que se impone sobre el organismo ya para facilitar su supervivencia, ya para incrementar su poder. Al orden del organismo pertenecen la familia, el clan, la comunidad; al orden de la organización pertenecen el Estado y la división del trabajo. En el orden del organismo, la libertad es muy amplia, pero también el riesgo, pues la capacidad de supervivencia disminuye; en el orden de la organización, la seguridad es intensa, así como la riqueza, pero a costa de enormes sacrificios de la libertad. Esta díada de potencias no es exclusiva del orden humano, sino que echa sus raíces en la propia estructura del mundo natural:
“La elección es honda y penetra profundamente, llega hasta la célula. Tiene su balance de pérdidas y ganancias. Un ejemplo: cuando las células de la visión se diferencian, la ganancia de fuerza perceptiva tiene como contrapartida una pérdida de fuerza sensorial, erótica. Cuando se forman colonias, como ocurre en el caso de las esponjas, la seguridad de los individuos afectados aumenta, pero su libertad disminuye. Cuando, como ocurre en el caso de los insectos estatizadores, la ordenación del trabajo y su división han hecho progresar la economía hasta un grado tal que posibilita el acumular reservas, esa riqueza es comprada con sacrificios asombrosos. La abeja obrera es una hembra mutilada, producto de una reducción; el asesinato de los zánganos es un modelo de implacable razón de Estado. En las termitas y en las hormigas encontramos formas que anticipan idealmente no sólo la agricultura, sino también la esclavitud” (p. 194).
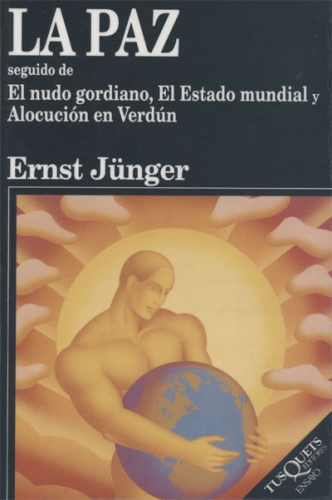 Jünger constata que la tendencia a la estatización (a la “organización”) se hace más rara a medida que ascendemos en la escala de los animales superiores. En ellos –por ejemplo, en los lobos, en numerosos grupos de aves, etc.- es frecuente hallar ejemplos de socialización, pero muy rara vez asistiremos a los sacrificios que la estatización impone a los insectos. En ese sentido, el hombre ocupa un lugar especial: la estatización no es algo que le sea natural, aunque el proceso de desarrollo de la civilización técnica muestre claras tendencias estatizadoras. En el mundo natural, la tendencia hacia la organización es un rasgo específico de los animales sociales; en el caso de la especie humana, es el síntoma más evidente del avance del proceso de civilización. Y sin embargo, la tendencia a la organización no es inapelable, inevitable; ni siquiera natural. Ese es el sentido de la pregunta que Jünger se formula: ¿Acaso el mundo está lleno de organismos que esperan ser organizados y reivindican tal organización? No, e incluso lo contrario es lo cierto, pues por todas partes puede percibirse como actúa “la tentativa de sustraerse al poder”. De manera que la organización no es un hecho natural, o al menos no lo es más que la resistencia a la organización.
Jünger constata que la tendencia a la estatización (a la “organización”) se hace más rara a medida que ascendemos en la escala de los animales superiores. En ellos –por ejemplo, en los lobos, en numerosos grupos de aves, etc.- es frecuente hallar ejemplos de socialización, pero muy rara vez asistiremos a los sacrificios que la estatización impone a los insectos. En ese sentido, el hombre ocupa un lugar especial: la estatización no es algo que le sea natural, aunque el proceso de desarrollo de la civilización técnica muestre claras tendencias estatizadoras. En el mundo natural, la tendencia hacia la organización es un rasgo específico de los animales sociales; en el caso de la especie humana, es el síntoma más evidente del avance del proceso de civilización. Y sin embargo, la tendencia a la organización no es inapelable, inevitable; ni siquiera natural. Ese es el sentido de la pregunta que Jünger se formula: ¿Acaso el mundo está lleno de organismos que esperan ser organizados y reivindican tal organización? No, e incluso lo contrario es lo cierto, pues por todas partes puede percibirse como actúa “la tentativa de sustraerse al poder”. De manera que la organización no es un hecho natural, o al menos no lo es más que la resistencia a la organización.
Más allá del Estado y el Mercado
A nuestro juicio, lo que hace especialmente interesante la perspectiva jüngeriana es su capacidad para sentar un marco de interpretación que trasciende las habituales polémicas entre diversas formas de organización, cada una de las cuales pretende a su vez encarnar mayores cotas de libertad. Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha invocado la libertad en nombre del Estado? ¿Y cuántas otras veces se ha invocado esa misma libertad en nombre del Mercado y contra el Estado? La división jüngeriana entre organismo y organización nos brinda un esquema bastante más profundo que el que aporta Hayek con su dialéctica entre “orden tribal” y “orden amplio”: la verdadera espontaneidad reside en el organismo, donde los impulsos naturales actúan con mayor libertad; la organización, por el contrario, significa la imposición de una estructura racional sobre los impulsos primarios, y esa estructura no es sólo de tipo estatal, sino que también puede adoptar otras formas. El mercado, sin duda, es una de ellas. Cambian las reglas del ejercicio de la organización, pero no el hecho de la organización en sí. Desde la perspectiva de la organización que se contrapone al organismo, Estado y Mercado no representan fuerzas esencialmente contradictorias, sino que ambas responden a una misma lógica: las dos, por su potencia reglamentadora, normativizadora, constituyen otras tantas formas de organización, esto es, otras tantas formas de someter al organismo, vale decir, a la libertad.
Como suele ocurrir en Jünger, erraríamos el tiro si tratáramos de incorporar juicios de valor demasiado simples a los términos de este esquema. No tiene mucho sentido ver en la organización una suerte de desdicha; más bien se trata de un hecho inevitable, porque cuanto más arriesgada es la vida, más necesaria es la cooperación, esto es, la sociedad. Y toda vida en sociedad, en la medida en que exige la imposición de normas, presenta necesariamente ciertos rasgos de alienación –eso es algo que está en la naturaleza humana. En consecuencia, cuanto más compleja es la sociedad, esto es, la organización, mayor es su carácter alienante. Ahora bien, la tendencia hacia el organismo, hacia la libertad, tampoco deja nunca de estar presente, porque forma parte igualmente de las pulsiones naturales. Y en el caso de la especie humana, además, esta tendencia se hace consciente, pues sólo el hombre es racionalmente consciente de su libertad. En cierto modo, la búsqueda del equilibrio entre organismo y organización es una de las claves fundamentales de la historia natural, no sólo en la especie humana. Toda la cuestión, pues, reside en que el ser humano sea capaz de mantener siempre alta la guardia de su libre albedrío:
“Cuando el Estado y con él el pensamiento organizativo cobran dimensiones enormes, tal como lo están experimentando en el presente los hombres y los pueblos, ocurre que los peligros son en parte sobreestimados y en parte subestimados. Consisten no tanto en la amenaza física que representan para los pueblos y los hombres que los componen –esa amenaza es desde luego evidente- cuanto en el riesgo que corre la especie como tal, sobre todo porque es afectada en su nota específica: el libre albedrío. Ello haría que la luminosidad de una civilidad superior desapareciese en el brillo de la perfección. El peligro real del plan no está tanto en que fracase cuanto en que obtenga un éxito demasiado fácil (…)
La especificidad del ser humano está en su libre albedrío, o sea, en su imperfección; está en su capacidad de convertirse en culpable, de cometer errores. La perfección hace superflua, por el contrario, la libertad; el orden racional cobra entonces la precisión del instinto” (pp. 204-205).
Jünger no cree que la marcha de la civilización, que apunta hacia una creciente complejidad de la organización, hacia una creciente perfección de la técnica , sea reversible. No estamos en condiciones de decidir si queremos entrar en esa nueva casa, porque ésta se nos impone de manera irresistible. Pero sí estamos en condiciones de preguntarnos qué queremos llevarnos con nosotros al entrar en la nueva casa, y aquí es donde Jünger reivindica el libre albedrío como seña principal de la especie humana. La conclusión del texto apunta inequívocamente en esa dirección. Y sostiene, precisamente, que tal cosa será más fácil en el Estado mundial que en los Estados que el mundo han conocido hasta ahora:
“La forma del Estado humano viene determinada por el hecho de la existencia de otros Estados. Viene determinada por el pluralismo. No siempre ha sido así y, esperémoslo, no siempre será así. Cuando el Estado era una excepción en la Tierra, cuando era insular o, en el sentido de su origen, único en su género, los ejércitos de guerra resultaban innecesarios, más aún, estaban fuera de lo imaginable. Eso mismo habrá de ocurrir cuando el Estado en su sentido final se vuelva único en su género. Entonces el organismo humano podría destacar con más pureza como lo auténticamente humano, liberado de la coacción de la organización” (p. 217).
Una libertad difícil
Toda la posición de Jünger frente al Estado/Organización en sus obras posteriores mantiene esta misma línea. La organización, aupada sobre el poder técnico, representa una fuerza que no es posible invertir, aunque sí es posible actuar dentro de ella. En el lado contrario, el organismo, la libertad, no podrá consistir en una declaración de derechos o en una lista de libertades formales, sino en una actitud de espíritu que pasa por mantener el libre albedrío como fundamento de la persona singular.
Todos los protagonistas de novelas jüngerianas como Heliópolis, Eumeswil e incluso El problema de Aladino se caracterizan por ese talante . La misma atmósfera se respira en ensayos como La emboscadura. Y es muy importante subrayar que todo este planteamiento guarda perfecta coherencia con las posiciones del Jünger anterior a 1933. El descreimiento de las libertades formales se halla ya en los textos de la “Revolución conservadora”, al mismo título que la desconfianza en los movimientos basados en “principios universales”. La percepción del Estado como máquina subsidiaria, dependiente de devoradores procesos técnicos, nace en las trincheras de la Gran Guerra y se prolonga a través de La movilización total y El Trabajador hasta llegar a las opresivas ciudades-Estado de Eumeswil y Heliópolis. La idea aristocratizante de la libertad –la libertad interior como signo de una aristocracia del espíritu- enlaza con el anarquista prusiano de El corazón aventurero, el libro que marcó su separación de la órbita nacionalista alemana en 1929, y se prolonga en Sobre los acantilados de mármol y en La emboscadura.
Ahora la pregunta post-jüngeriana podría ser esta: ¿Qué ocurre cuando la nueva casa, el Estado Mundial, exige como señal de entrada la renuncia al libre albedrío, a la libertad interior? Entonces volveríamos a la necesaria insurgencia, al mismo tiempo espiritual y política, que alimentó los grandes incendios de Sobre los acantilados de mármol.
Jünger, Ernst “La Paz seguido de El nudo gordiano, El Estado Mundial y Alocución en Verdún”, traducción de Andrés Sánchez Pascual), Tusquets Editores, Barcelona, 1996.
13:36 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, livre, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: http://www.contrelitterature.com
ALAIN SANTACREU : Je suis né à Toulouse, au mitan du dernier siècle. Mes parents étaient des ouvriers catalans, arrivés en France en 1939, en tant que réfugiés politiques. J’ai vécu toute mon enfance et mon adolescence dans cette ville. J’y ai fait mes études, depuis l’école des Sept-Deniers jusqu’à l’ancienne Faculté des Lettres de la rue des Lois, en passant par le lycée Pierre de Fermat et le lycée Nord. C’est au Conservatoire de Toulouse, dans la classe de Simone Turck, que j’ai commencé ma formation théâtrale.
Je me suis marié très jeune et j’ai dû quitter Toulouse. Durant quelques années, j’ai joué dans diverses compagnies théâtrales de l’Est de la France. J’ai aussi été directeur d’un centre culturel, près de Belfort. Finalement, je suis devenu enseignant et j’ai exercé dans des établissements de la région parisienne. C’est au cours de cette période que j’ai écrit mes premiers textes et fondé la revue Contrelittérature. Par la suite mes activités éditoriales se sont diversifiées et, tout en publiant un premier roman et un recueil d’essais, j’ai dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur l’art et la spiritualité, dans le cadre de la collection « Contrelittérature » aux éditions L’Harmattan. Quant à mon parcours intellectuel proprement dit, je l’aborderai en répondant à vos autres questions.
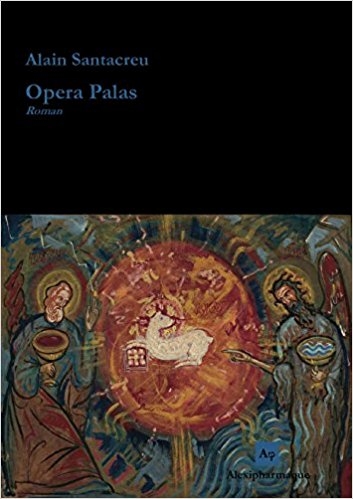 R/ Dans votre dernier roman Opera Palas vous placez le lecteur dans une posture opérative originale. Pensez-vous que le regard du lecteur « fait » vraiment un roman ?
R/ Dans votre dernier roman Opera Palas vous placez le lecteur dans une posture opérative originale. Pensez-vous que le regard du lecteur « fait » vraiment un roman ?
AS/ Toute la stratégie romanesque d’Opera Palas tourne autour de la phrase célèbre de Marcel Duchamp : « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux ». C’est un commentaire qu’il a prononcé à propos de ses ready-made [1]. On sait que le ready made inventé par Duchamp est un vulgaire objet préfabriqué, prêt à l’emploi, comme son célèbre urinoir, « Fontaine », devenu un chef-d’oeuvre de l’art du XXe siècle.
Toute oeuvre d’art a deux pôles : le pôle de celui qui fait l’oeuvre et le pôle de celui qui la regarde. Dans le ready made, l’artiste s’efface du pôle créatif puisqu’il ne réalise pas l’objet « tout fait » qu’il donne à voir. Dès lors, la production de l’oeuvre ne dépend plus que du second pôle, du regardeur, celui de la réception. Ainsi, le ready made de Duchamp démontre que le goût esthétique n’est que la projection de l’ego du regardeur sur l’oeuvre.
Le spectacle – ce que j’appelle « littérature », comme j’aurai l’occasion de l’expliciter – est le pouvoir qui veut que je tienne mon rôle dans le jeu social dont il est l’unique metteur en scène. S’opposer à la volonté du spectacle, c’est donc mourir à soi-même, renoncer à ce faisceau de rôles qui me constitue, devenir réfractaire à cette image que la société me renvoie. Un texte signé Alaric Levant, paru récemment sur votre site internet, affirme que ce travail sur soi est un acte révolutionnaire : « Aujourd’hui, nous sommes face à une barricade bien plus difficile à franchir que celle des CRS : c’est l’Ego, c’est-à-dire la représentation que l’on a de soi-même »[2].
La démarche de Duchamp vise à nous extraire de la perspective spectaculaire, en cela elle annonce le situationnisme, la dernière avant-garde artistique et politique qui se soit manifestée dans notre société contemporaine. Le pouvoir du regardeur de décider si une pissotière est une oeuvre d’art est factice ; en réalité, c’est dans les coulisses que le meneur du spectacle décide de la seule norme esthétique qui puisse me faire exister au regard des autres.
Ainsi, les œuvres de l’art fonctionnent comme un immense kaléidoscope de miroirs que le regardeur manipule afin de customiser l’image qu’il a de lui-même. Plus encore : pour la pensée aliénée toute chose n’est que ready-made, marchandise « prête à l’emploi ». Votre goût esthétique est tout simplement le signe que vous êtes un moderne comme tout le monde. Si vous voulez être intégré dans le spectacle, vous devez vous conformer à l’exercice obligatoire de la différenciation mimétique – pour le dire à la manière de René Girard – de façon à vous assurer que vous appartenez bien à la classe de loisir – pour le dire à la manière de Thorstein Veblen.
Opera Palas est l’équivalent contre-littéraire du ready-made duchampien. Marcel Duchamp est un protagoniste du roman et son oeuvre maîtresse, La mariée mise à nu par ses célibataires, même – aussi appelée Le Grand verre – est l’élément déclencheur du récit. La vanité de vouloir jouer un rôle dans la société du spectacle, la quête du succès et son obtention, Duchamp les a analysées dans son oeuvre majeure.
En lisant, le lecteur est renvoyé à son propre acte interprétatif, le roman est le miroir de sa pensée. Cela est rendu possible parce que le moi du narrateur anonyme du roman s’efface au fur et à mesure qu’avance le récit. En effet, une véritable opération alchimique se joue entre le narrateur et son double : Palas.
Le personnage de Palas est le nom générique de tous les lecteurs zélés d’Opera Palas. Il y a deux types possibles de lecteur. Le premier est celui qui se conforte dans la certitude de son moi, le lecteur aliéné qui réagit à partir du prêt-à-penser que la « littérature » lui a inculqué – pour celui-là, ce roman n’est pas un roman et il renoncera très vite à le lire ou même, sous l’emprise de son propre conditionnement idéologique, il l’interprètera comme antisémite, fasciste, homophobe ou conspirationniste. Le second type de lecteur est celui dont le zèle lui permet d’entrer en relation avec l’œuvre, d’établir un dialogue avec elle et de faire de sa lecture une opération de désaliénation de sa pensée. Le lecteur zélé accepte la mise en danger d’une lecture cathartique qui l’amène à oser se regarder lire.
Lorsque le lecteur referme Opera Palas, il prend conscience qu’il n’a fait qu’un tour sur lui-même, étant donné que la dernière page du roman est la description de l’icône qui illustre la couverture du livre. C’est alors qu’il peut traverser le miroir.
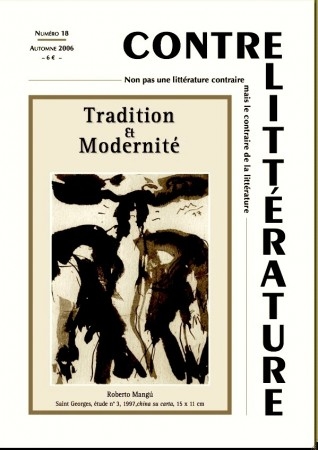 R/ Comment définir votre démarche de "Contre-Littérature" ?
R/ Comment définir votre démarche de "Contre-Littérature" ?
AS/ Le texte germinatif de la contrelittérature est Le manifeste contrelittéraire. Ce texte est d’abord paru, en février 1999, dans le n°48 de la revue Alexandre dirigée par André Murcie ; puis, quelques mois plus tard, en postface de mon premier roman, Les sept fils du derviche, (Éditions Jean Curutchet, 1999). Par la suite, il sera repris et étayé dans l’ouvrage éponyme, paru en 2005 aux éditions du Rocher : La contrelittérature : un manifeste pour l’esprit. Dès le début, j’ai préféré lexicaliser le terme pour le différencier du mot composé « contre-littérature » déjà employé par la critique littéraire officielle.
La contrelittérature est donc née à la fin du XXe siècle, pendant cette période d’unipolarisation du monde dans laquelle Fukuyama disait voir la « fin de l’histoire ». L’idéologie postmoderne du consensus global a été façonnée, dès le XVIIIe, par une Weltanschauung qu’Alexis Tocqueville, dans L’Ancien Régime et la Révolution, nomme « l’esprit littéraire » de la modernité. En deux siècles, la littérature avait si intensément « homogénéisé » la pensée, qu’à l’orée du XXIe siècle, une pensée hétérogène, contradictoire, était presque devenue impensable ; d’où la nécessité d’inventer un néologisme pour désigner cet impensable, ce fut : « contrelittérature ».
Cela se fit à partir de la découverte de la logique du contradictoire de Stéphane Lupasco. Pour la contrelittérature, Stéphane Lupasco est un maillon d’une catena aurea qui se manifeste avec Héraclite et les présocratiques, en passant aussi, comme nous le verrons, par Pierre-Joseph Proudhon, un auteur très important dans ma démarche.
Il faut partir de la définition la plus large possible : la littérature, c’est non seulement le corpus de tous les récits à travers lesquels une civilisation se raconte, mais encore tous les textes poétiques où elle prend conscience de son propre être et cherche à le transformer. La littérature doit être perçue comme un organisme vivant, un système dynamique d’antagonismes, pour reprendre la terminologie lupascienne, dont la production dépend de deux sources d’inspiration contraires : une force « homogénéisante » en relation avec les notions d’uniformité, de conservation, de permanence, de répétition, de nivellement, de monotonie, d’égalité, de rationalité, etc. ; et, à l’opposé, une force « hétérogénéisante » en relation avec les notions de diversité, de différenciation, de changement, de dissemblance, d’inégalité, de variation, d’irrationnalité, etc. Ce principe d’antagonisme a été annihilé par la littérature moderne qui a imposé l’actualisation absolue de son principe d’homogénéisation et ainsi tenté d’effacer le pôle de son contraire, l’hétérogène « contrelittéraire ».
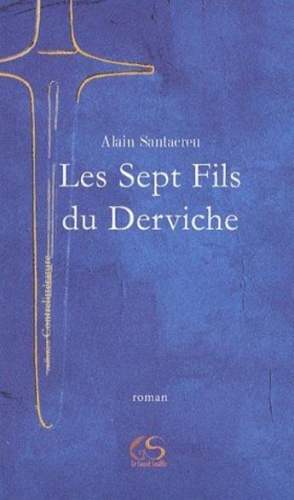 Tous les romans étaient devenus semblables, de plates « egobiographies » sans âme, il fallait verticaliser l’horizontalité carcérale à laquelle on voulait nous condamner, retrouver la sacralité de la vie contre sa profanation imposée. C’est pourquoi, dans une première phase, nous nous sommes attachés à valoriser l’impensé de la littérature, le récit mystique qui se fonde sur la désappropriation de l’ego. D’où la redécouverte du roman arthurien et de la quête du graal, la revisitation des grands mystiques de toutes sensibilités religieuses – par exemple le soufisme dans mon premier roman, Les sept fils du derviche. Cela a pu conforter l’image fausse d’une contrelittérature confite en spiritualité et se complaisant dans une forme d’ésotérisme. Très peu ont réellement perçu la dimension révolutionnaire de la contrelittérature.
Tous les romans étaient devenus semblables, de plates « egobiographies » sans âme, il fallait verticaliser l’horizontalité carcérale à laquelle on voulait nous condamner, retrouver la sacralité de la vie contre sa profanation imposée. C’est pourquoi, dans une première phase, nous nous sommes attachés à valoriser l’impensé de la littérature, le récit mystique qui se fonde sur la désappropriation de l’ego. D’où la redécouverte du roman arthurien et de la quête du graal, la revisitation des grands mystiques de toutes sensibilités religieuses – par exemple le soufisme dans mon premier roman, Les sept fils du derviche. Cela a pu conforter l’image fausse d’une contrelittérature confite en spiritualité et se complaisant dans une forme d’ésotérisme. Très peu ont réellement perçu la dimension révolutionnaire de la contrelittérature.
La contrelittérature est une tentative pour redynamiser le système antagoniste de la littérature. Il est évident que ce point d’équilibre des deux sources d’inspiration exerce une attraction sur tous les « grands écrivains ». Leurs oeuvres contiennent les deux antagonismes dans des proportions différentes mais tournent toutes autour de ce « foyer » de mise en tension. Il serait stupide de se demander si un écrivain est « contrelittéraire ». Toute création contient nécessairement à la fois des éléments littéraires et contrelittéraires. C’est le quantum antagoniste qui varie, c’est-à-dire le point de la plus haute tension entre les antagonismes constitutifs de l’oeuvre.
On ne peut percevoir la liberté qu’en surplomblant les contraires, en les envisageant ensemble, d’un seul regard, sans en exclure un au bénéfice de l’autre. Telle est la perpective romanesque d’Opera Palas. Mon roman se construit en effet sur une série d’antagonismes. J’en citerai quelques-uns : la cabale de la puissance et la cabale de l’amour, le bolchévisme stalinien et le slavophilisme de Khomiakov, le sionisme de Buber et le sionisme de Jabotinsky, l’individu (le moi) et la commune (le non-moi, le je collectif) ; le nationalisme politique et le nationalisme de l’intériorité, l’éros et l’agapé ; sans oublier, pour finir, le couplage scandaleux entre Buenaventura Durruti et José Antonio Primo de Rivera, les ennemis politiques absolus.
Ainsi, la contrelittérature reprend le projet fondamental du Manifeste du Surréalisme d’André Breton, à partir du point où les surréalistes l’ont abandonné en choisissant le stalinisme : « Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l’esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. Or c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. »
Le plus haut drame de l’homme, ce n’est pas tant To be or not to be mais bien plutôt To be and not to be. La vraie quête initiatique est celle de ce point d’équilibre entre l’être et le non-être, c’est cela le grand retour du tragique, un lieu où la tension entre les contraires est si intense que nous passons sur un autre plan : un saut de réalité où les contraires entrent en dialogue.
R/ Votre démarche se rapproche pour moi de l'ABC de la lecture d'Ezra Pound. Ce prodigieux poète est-il une influence pour vous ?
AS/ L’ABC de la lecture est un génial manuel de propédeutique à l’usage des étudiants en littérature. On y trouve des réflexions d’une clarté fulgurante, telle cette phrase qui vous plonge dans un puits de lumière : « Toute idée générale ressemble à un chèque bancaire. Sa valeur dépend de celui qui le reçoit. Si M. Rockefeller signe un chèque d’un million de dollars, il est bon. Si je fais un chèque d’un million, c’est une blague, une mystification, il n’a aucune valeur. » [3]
On voit que, pour Ezra Pound aussi, c’est le récepteur qui accorde son crédit à l’émetteur. Si un milliardaire émet un gros chèque, le récepteur l’estime tout de suite valable ; mais, par contre, si le même chèque est émis par un vulgaire péquenot, ce n’est pas crédible. On retrouve ici l’interrogation de la pissotière de Duchamp, qu’est-ce qui en fait une oeuvre d’art pour le regardeur ?
Bien sûr, ce n’est pas exactement ce que veut signifier Pound dans cette phrase de son ABC de la lecture mais je l’ai citée à cause de son allusion « économique », thème prégnant dans d’autres de ses ouvrages. Je pense à un livre comme Travail et usure ou encore au Canto XLV.
 Ezra Pound est un des grands prédécesseurs de la contrelittérature. C’est à partir de lui que j’ai compris la similarité du processus d’homogénéisation de la littérature avec celui de l’usure. Pound a perçu de façon très subtile le phénomène de l’ « argent fictif ». Il insiste dans ses écrits sur la constitution et le développement de la Banque d’Angleterre, modèle du système bancaire moderne né en pays protestant où l’usure avait été autorisée par Élisabeth Tudor en 1571.
Ezra Pound est un des grands prédécesseurs de la contrelittérature. C’est à partir de lui que j’ai compris la similarité du processus d’homogénéisation de la littérature avec celui de l’usure. Pound a perçu de façon très subtile le phénomène de l’ « argent fictif ». Il insiste dans ses écrits sur la constitution et le développement de la Banque d’Angleterre, modèle du système bancaire moderne né en pays protestant où l’usure avait été autorisée par Élisabeth Tudor en 1571.
Pour comprendre la nature métaphysique du sacrilège qu’Ezra Pound dénonce sous le concept d’usure, il faudrait se reporter au onzième chant de L’Enfer de Dante – La Divine Comédie est une référence constante dans Les Cantos – qui condamne en même temps les usuriers et les sodomites pour avoir péché contre la bonté de la nature (« spregiando natura e sua bontade »). J’ai moi-même repris ce parallèle dans mon roman Opera Palas en relevant la synchronicité, durant la seconde partie du XVIIIe siècle, de l’émergence des clubs d’homosexuels – équivalents des molly houses – avec l’officialisation de l’usure bancaire – décret du 12 octobre 1789 autorisant le prêt à intérêt.
C’est en 1787, dans ses Éléments de littérature, que François de Marmontel utilisa pour la première fois le terme « littérature » au sens moderne. Il ne me semble pas que ce phénomène de la concomitance entre la littérature et l’usure ait jamais été pris en compte ni étudié avant la contrelittérature [4].
Le concept poundien d’Usura ne se laisse pas circonscrire aux seuls effets de l’économie capitaliste. Dans la société contemporaine globalisée, tous les signes sont devenus des métonymies du signe monétaire, à commencer par les mots de la langue, arbitraires et sans valeur.
L’usure littéraire consiste à vider les mots de leur sens pour leur prêter un sens abstrait. Usura entraîne le progrès de l’abstraction, c’est-à-dire de la séparation – en latin abstrahere signifie retirer, séparer. Usura ouvre le monde de la réalité virtuelle et referme celui de la présence réelle. Par l’usure, l’homme se retrouve séparé du monde.
Durant l’été 1912, Ezra Pound parcourut à pied les paysages du sud de la France, sur les pas des troubadours, afin de s’incorporer les lieux topographiques du jaillissement de la langue d’oc. La poésie poundienne est un combat contre l’usure. Chaque point de l’espace devient un omphalos, un lieu d’émanation du verbe, chaque pas une station hiératique. Ainsi est dépassée l’entropie littéraire du mot, l’érosion du sens par l’usure répétitive.
Ce que Pound, lecteur de Dante, nomme « Provence », correspond géographiquement à l’Occitanie et à la Catalogne. Ce pays évoquait pour lui une civilisation médiévale de l’amour qui s’oppose au capitalisme moderne. L’amour est le contraire de l’usure.
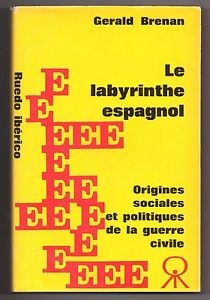 Cependant, Pound n’a pas su reconnaître la surrection du catharisme des troubadours dans l’anarchisme espagnol, ce que Gerald Brenan a très bien vu dans son Labyrinthe espagnol [5]. J’ai soutenu dans Opera Palas cette vision millénariste de la révolution sociale espagnole.
Cependant, Pound n’a pas su reconnaître la surrection du catharisme des troubadours dans l’anarchisme espagnol, ce que Gerald Brenan a très bien vu dans son Labyrinthe espagnol [5]. J’ai soutenu dans Opera Palas cette vision millénariste de la révolution sociale espagnole.
À mes yeux, la véritable trahison politique d’Ezra Pound ne se trouve pas tant dans les causeries qu’il donna sur Radio Rome, entre 1936 et 1944, la plupart consacrées à la littérature et à l’économie, mais dans son aveuglement face à ce moment métahistorique que fut la guerre d’Espagne. Comment n’a-t-il pas vu qu’Usura n’était plus dans les collectivités aragonaises et les usines autogérées de Catalogne ? Comment n’a-t-il pas entendu d’où soufflait le vent du romancero épique, la poésie de Federico García Lorca, d’Antonio Machado, de Rafael Alberti, de Miguel Hernández?
R/ La notion de tradition apparaît dans vos écrits depuis l’origine. Quelle définition en donneriez-vous ? Quel est votre rapport à l’oeuvre de Guénon ?
AS/ Selon moi, le paradigme essentiel de la tradition réside dans la notion d’anthropologie ternaire, tout le reste n’est que littérature ésotérique.
Jusqu’à la fin de la période romane, soit l’articulation des XIIe et XIIIe siècles, la « tripartition anthropologique » a été la référence de notre civilisation chrétienne occidentale [6]. La structure trinitaire de l’homme – Corps-Âme-Esprit – fut simultanément transmise à la « science romane » par les sources grecque et hébraïque. Sans doute, le ternaire grec, « soma-psyché-pneuma », ne correspond-il pas exactement au ternaire hébreu, « gouf-nephesh-rouach », mais les deux se fondent sur une tradition fondamentale qui inclut le spirituel dans l’homme.
Dieu est immanent à l’esprit, mais il est transcendant à l’homme psycho-corporel, telle est l’aporie devant laquelle nous place cette « tradition primordiale » dont parle René Guénon. L’esprit n’est pas humain mais divino-humain ; ou, plus précisément, il est le lieu de la rencontre entre la nature divine et la nature humaine. Il n’y a pas de vie spirituelle sans Dieu et l’homme. C’est comme faire l’amour : il faut être deux ! C’est pourquoi une « spiritualité » laïque ne sera jamais qu’un onanisme de l’esprit.
 Cette tradition dialogique entre l’incréé et le créé m’évoque le mot principe « Je-Tu » de Martin Buber. L’existence humaine se joue, selon Buber, entre deux mots principes qui sont deux relations antagonistes : « Je-Tu » et « Je-Cela ». Le mot-principe Je-Tu ne peut être prononcé que par l’être entier mais, au contraire, le mot-principe Je-Cela ne peut jamais l’être : « Dire Tu, c’est n’avoir aucune chose pour objet. Car où il y a une chose, il y a autre chose ; chaque Cela confine à d’autres Cela. Cela n’existe que parce qu’il est limité par d’autres Cela. Mais là où l’on dit Tu, il n’y a aucune chose. Tu ne confine à rien. Celui qui dit Tu n’a aucune chose, il n’a rien. Mais il est dans la relation. » [7]
Cette tradition dialogique entre l’incréé et le créé m’évoque le mot principe « Je-Tu » de Martin Buber. L’existence humaine se joue, selon Buber, entre deux mots principes qui sont deux relations antagonistes : « Je-Tu » et « Je-Cela ». Le mot-principe Je-Tu ne peut être prononcé que par l’être entier mais, au contraire, le mot-principe Je-Cela ne peut jamais l’être : « Dire Tu, c’est n’avoir aucune chose pour objet. Car où il y a une chose, il y a autre chose ; chaque Cela confine à d’autres Cela. Cela n’existe que parce qu’il est limité par d’autres Cela. Mais là où l’on dit Tu, il n’y a aucune chose. Tu ne confine à rien. Celui qui dit Tu n’a aucune chose, il n’a rien. Mais il est dans la relation. » [7]
Cependant, si Buber oppose ainsi le monde du Cela au monde du Tu, il ne méprise pas pour autant un monde au détriment de l’autre. Il met en évidence leur nécessaire antagonisme. L’homme ne peut vivre sans le Cela mais, s’il ne vit qu’avec le Cela, il ne peut réaliser sa vocation d’homme, il demeure le « Vieil homme » et sa misérable vie, dénuée de la Présence réelle, l’ensevelit dans une réalité irreliée.
À l’intérieur de la relation du mot principe « Je-Tu », nous rentrons dans l’ordre du symbole. Le symbole est un langage qui nous permet de saisir l’immanence de la transcendance. Il n’est pas une représentation, il réalise une présence. La Présence divine ne peut être représentée, elle est toujours là.
L’effacement de la conception tripartite de l’homme correspond à la période liminaire de la mécanisation moderne de la technique. Le XIIIe siècle marque ce point d’inflexion du passage à la modernité. C’est durant la crise du XIIIe siècle, comme l’a appelée Claude Tresmontant [8], que la pensée du signe va remplacer la pensée du symbole. Le mot pour l’esprit bourgeois n’est pas l’expression du Verbe, il est un signe arbitraire qui lui permet de désigner l’avoir, la marchandise.
La logique du symbole est une logique du contradictoire. René Guénon, dans un de ses articles [9], affirme qu’un même symbole peut être pris en deux sens qui sont opposés l’un à l’autre. Les deux aspects antagoniques du symbole sont liés entre eux par un rapport d’opposition, si bien que l’un d’eux se présente comme l’inverse, le « négatif » de l’autre. Ainsi, nous retrouvons dans la structure du symbole ce point de passage, situé hors de l’espace-temps, en lequel s’opère la transformation des contraires en complémentaires.
 La découverte de l’oeuvre de René Guénon a été décisive dans mon cheminement. Mes parents étaient des anarchistes espagnols et j’ai lu Proudhon, Bakounine et Kropotkine bien avant de lire Guénon. C’est la lecture de René Guénon qui m’a permis de me libérer de la pesanteur de l’idéologie anarchiste.
La découverte de l’oeuvre de René Guénon a été décisive dans mon cheminement. Mes parents étaient des anarchistes espagnols et j’ai lu Proudhon, Bakounine et Kropotkine bien avant de lire Guénon. C’est la lecture de René Guénon qui m’a permis de me libérer de la pesanteur de l’idéologie anarchiste.
Toute erreur moderne n’est que la négation d’une vérité traditionnelle incomprise ou défigurée. Au cours de l’involution du cycle, le rejet d’une grille de lecture métaphysique du monde a provoqué la subversion de l’idée acrate, si chère à Jünger, et sa transformation en idéologie anarchiste. La négation des archétypes inversés de la bourgeoisie, à laquelle s’est justement livrée la révolte anarchiste ne pouvait qu’aboutir à un nihilisme indéfini, puisque son apriorisme idéologique lui interdisait la découverte des « archés » véritables. Cette incapacité fut l’aveu de son impuissance spirituelle à dépasser le système bourgeois. La négation du centre, perçu comme principe de l’autorité, au bénéfice d’une périphérie présupposée non-autoritaire, est l’expression d’une pensée dualiste dont la bourgeoisie elle-même est issue. La logique du symbole transmise par René Guénon ouvre une autre perspective où la tradition se conjugue à la révolution.
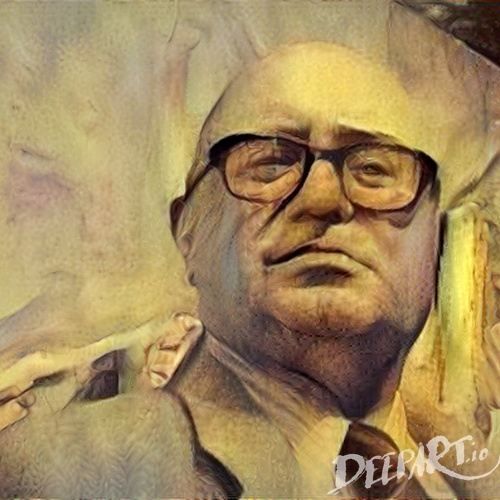
R/ Vous avez croisé la route de Jean Parvulesco. Pouvez-vous revenir sur cette personnalité flamboyante qui fut un ami fidéle de Rébellion ?
AS/ Jean Parvulesco et moi ne cheminions pas dans le même sens et nous nous sommes croisés, ce fut un miracle dans ma vie. Il est la plus belle rencontre que j’ai faite sur la talvera. Savez-vous ce qu’est la talvera ?
Les paysans du Midi appellent « talvera » cette partie du champ cultivé qui reste éternellement vierge car c’est l’espace où tourne la charrue, à l’extrémité de chaque raie labourée. Le grand écrivain occitan Jean Boudou a écrit un poème intitulé La talvera où l’on trouve ce vers admirable : « C’est sur la talvera qu’est la liberté » (Es sus la talvèra qu’es la libertat).
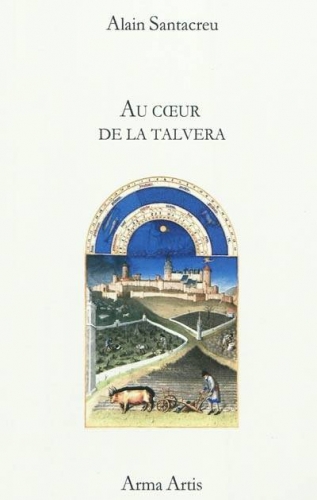 Mon intérêt pour la notion de talvera a été suscité par la lecture du sociologue libertaire Yvon Bourdet [10]. La talvera est l’espace du renversement perpétuel du sens, de sa reprise infinie, de son éternel retournement. Elle est la marge nécessaire à la recouvrance du sens perdu, à l’orientation donnée par le centre. Loin de nier le centre, la talvera le rend vivant. La conscience de la vie devenue de plus en plus périphérique, notre aliénation serait irréversible s’il n’y avait un lieu pour concevoir la rencontre, un corps matriciel où l’être, exilé aux confins de son état d’existence, puisse de nouveau se trouver relié à son principe. Sur la talvera se trouve l’éternel féminin de notre liberté, cette dimension mariale que Jean Parvulesco vénérait tant. C’est là que nous nous sommes rencontrés.
Mon intérêt pour la notion de talvera a été suscité par la lecture du sociologue libertaire Yvon Bourdet [10]. La talvera est l’espace du renversement perpétuel du sens, de sa reprise infinie, de son éternel retournement. Elle est la marge nécessaire à la recouvrance du sens perdu, à l’orientation donnée par le centre. Loin de nier le centre, la talvera le rend vivant. La conscience de la vie devenue de plus en plus périphérique, notre aliénation serait irréversible s’il n’y avait un lieu pour concevoir la rencontre, un corps matriciel où l’être, exilé aux confins de son état d’existence, puisse de nouveau se trouver relié à son principe. Sur la talvera se trouve l’éternel féminin de notre liberté, cette dimension mariale que Jean Parvulesco vénérait tant. C’est là que nous nous sommes rencontrés.
Jean Parvulesco était un « homme différencié », au sens où l’entendait Julius Evola. Il appartenait à cette race spirituelle engagée dans un combat apocalyptique contre la horde des « hommes plats ». Ce fut le dernier « maître de la romance ». Il est l’actualisation absolue de la contrelittérature. C’est-à-dire que Parvulesco inverse totalement le rapport littérature-contrelittérature. Son oeuvre à contre-courant potentialise l’horizontalité littéraire et actualise la verticalité contrelittéraire, pour employer la terminologie de Lupasco. D’un certain point de vue, Jean Parvulesco incarne le contraire de la littérature.
Je comprends aujourd’hui combien ma rencontre avec Parvulesco a été cruciale. Si notre éloignement m’est apparu comme une nécessité, j’ai su intérioriser sa présence, la rendre indispensable à ma propre démarche.
J’ai relu l’autre jour le texte qui a été la cause de notre séparation. C’était durant l’hiver 2002, son article s’intitulait « L’autre Heidegger » et aurait dû paraître dans le n° 8 de la revue Contrelittérature mais j’ai osé le lui refuser [11]. Parvulesco s’y interroge sur la véritable signification de l’œuvre d’Heidegger. Il soutient que la philosophie n’était qu’un moyen pour dissimuler un travail initiatique qu’Heidegger menait sur lui-même et qui se poursuivit jusqu’à son appel à la poésie d’Hölderlin, ultime phase de son oeuvre que Parvulesco nomme son « irrationalisme dogmatique ».
Or, ma démarche se résume à cette quête du point d’équilibre entre le rationalisme dogmatique des Lumières et l’irrationalisme dogmatique des anti-Lumières, ce point de la plus haute tension entre la littérature et la contrelittérature, alors que Jean Parvulesco incarnait le pôle contrelittéraire absolu.
 On ne lit pas Jean Parvulesco sans crainte ni tremblement : la voie chrétienne qui s’y découvre est celle de la main gauche, un tantrisme marial aux limites de la transgression dogmatique. Son style crée dans notre langue française une langue étrangère au phrasé boréal. Mon ami, le romancier Jean-Marc Tisserant, qui l’admirait, me disait que Parvulesco était l’ombre portée de la contrelittérature en son midi : « Vous ne parlez pas de la même chose ni du même lieu », me confia-t-il lors de la dernière conversation que j'eus avec lui. Il est vrai que Parvulesco, à partir de notre séparation, a choisi d’orthographier « contre-littérature », en mot composé – sauf dans le petit ouvrage, Cinq chemins secrets dans la nuit, paru en 2007 aux éditions DVX, qu'il m'a dédié ainsi : « Pour Alain Santacreu et sa contrelittérature ».
On ne lit pas Jean Parvulesco sans crainte ni tremblement : la voie chrétienne qui s’y découvre est celle de la main gauche, un tantrisme marial aux limites de la transgression dogmatique. Son style crée dans notre langue française une langue étrangère au phrasé boréal. Mon ami, le romancier Jean-Marc Tisserant, qui l’admirait, me disait que Parvulesco était l’ombre portée de la contrelittérature en son midi : « Vous ne parlez pas de la même chose ni du même lieu », me confia-t-il lors de la dernière conversation que j'eus avec lui. Il est vrai que Parvulesco, à partir de notre séparation, a choisi d’orthographier « contre-littérature », en mot composé – sauf dans le petit ouvrage, Cinq chemins secrets dans la nuit, paru en 2007 aux éditions DVX, qu'il m'a dédié ainsi : « Pour Alain Santacreu et sa contrelittérature ».
J’ai repris dans le texte de mon roman, pour les trois seules occurrences où le mot apparaît, cette graphie « contre-littérature ». Ce mot désignait à ses yeux le combat pour l’être. Oui, finalement, la seule réalité qui vaille, c’est la réalité de ce combat. Il ne faut pas refuser de se battre, si l’on veut vaincre les forces antagonistes !
Ma rencontre avec Jean Parvulesco n’a pas été une « mérencontre », pour reprendre l’expression de Martin Buber, c’est-à-dire une rencontre qui aurait dû être et ne se serait pas faite. Notre rencontre a bien eu lieu, je l’ai compris en écrivant mon roman : Opera Palas, c’est l’accomplissement de ma rencontre avec Jean Parvulesco.
R/ Pour vous, comme pour Orwell, l’histoire s’arrête en 1936. Pourquoi ? Vous évoquez dans votre roman l’expérience de l’anarcho-syndicalisme de la CNT-AIT espagnole. Cette vision fédéraliste et libertaire est-elle la voie pour sortir de l’Âge de fer capitaliste ?
AS/ Comment faire pour s’extraire de l’« Âge de fer » capitaliste ? Alexandre Douguine [12] pense qu’il faut partir de la postmodernité – cette période qui, selon Francis Fukuyama, correspond à la « fin de l’histoire » – mais il commet une erreur de perspective : il faut partir du moment où l’histoire s’est arrêtée.
Selon Douguine, la chute de Berlin, en 1989, marque l’entrée de l’humanité dans l’ère postmoderne. La dernière décennie du XXe siècle aurait vu la victoire de la Première théorie politique de la modernité, le libéralisme, contre la Deuxième, celle du communisme – la Troisième théorie politique, le fascisme, ayant disparu avec la défaite du nazisme.
 Je ne partage pas ce point de vue. Il n’y a pas eu de victoire de la Première théorie sur la Deuxième mais une fusion des deux dans un capitalisme d’État mondialisé. La postmodernité est anhistorique parce que l’histoire s’est arrêtée en 1936. C’est cela que j’ai voulu montrer avec Opera Palas. Le prétexte de mon roman est une phrase de George Orwell « Je me rappelle avoir dit un jour à Arthur Koestler : L’histoire s’est arrêtée en 1936. » Orwell écrit ces mots en 1942, dans un article intitulé « Looking Back on the Spanish War » (Réflexions sur la guerre d’Espagne). Et il poursuit : « En Espagne, pour la première fois, j’ai vu des articles de journaux qui n’avaient aucun rapport avec les faits, ni même l’allure d’un mensonge ordinaire. » Ainsi, parce que la guerre d’Espagne marque la substitution du mensonge médiatique à la vérité objective, l’histoire s’arrête et la période postmoderne s’ouvre alors.
Je ne partage pas ce point de vue. Il n’y a pas eu de victoire de la Première théorie sur la Deuxième mais une fusion des deux dans un capitalisme d’État mondialisé. La postmodernité est anhistorique parce que l’histoire s’est arrêtée en 1936. C’est cela que j’ai voulu montrer avec Opera Palas. Le prétexte de mon roman est une phrase de George Orwell « Je me rappelle avoir dit un jour à Arthur Koestler : L’histoire s’est arrêtée en 1936. » Orwell écrit ces mots en 1942, dans un article intitulé « Looking Back on the Spanish War » (Réflexions sur la guerre d’Espagne). Et il poursuit : « En Espagne, pour la première fois, j’ai vu des articles de journaux qui n’avaient aucun rapport avec les faits, ni même l’allure d’un mensonge ordinaire. » Ainsi, parce que la guerre d’Espagne marque la substitution du mensonge médiatique à la vérité objective, l’histoire s’arrête et la période postmoderne s’ouvre alors.
En 1936, contrairement à l’information unanimement répercutée par toute la presse internationale, les ouvriers et paysans espagnols ne se soulevèrent pas contre le fascisme au nom de la « démocratie » ni pour sauver la République bourgeoise ; leur résistance héroïque visait à instaurer une révolution sociale radicale. Les paysans saisirent la terre, les ouvriers s’emparèrent des usines et des moyens de transports. Obéissant à un mouvement spontané, très vite soutenu par les anarcho-syndicalistes de la CNT-FAI, les ouvriers des villes et des campagnes opérèrent une transformation radicale des conditions sociales et économiques. En quelques mois, une révolution communiste libertaire réalisa les théories du fédéralisme anarchiste préconisées par Proudhon et Bakounine. C’est cette réalité révolutionnaire que la presse antifasciste internationale reçut pour mission de camoufler. Du côté franquiste, la presse catholique et fasciste se livra aussi à une intense propagande de désinformation. À Paris, à Londres, comme à Washington ou à Moscou, la communication de guerre passa par le storytelling, la « mise en récit » d’une histoire qui présentait les événements à la manière que l’on voulait imposer à l’opinion. L’alliance des trois théories politiques a voulu détruire en Espagne la capacité communalisante du peuple. Ce que le bolchévisme avait fait subir au peuple russe, il est venu le réitérer en toute impunité en Espagne. C’est pourquoi je fais dans mon roman un parallèle entre les deux événements métahistoriques du XXe siècle où l’âme « communiste » des peuples a été annihilée : Cronstadt, en 1921 et Barcelone, lors des journées sanglantes de mai 1937.

Cronstadt voulait faire revivre le mir (commune rurale) et l’artel (coopérative ouvrière). Supprimer le mir archaïque signifiait supprimer des millions de paysans, c’est ce que firent les bolchéviques, par le crime et la famine.
Comme en Russie, les bolchéviques furent les fossoyeurs de la révolution sociale espagnole. Il suffit pour s’en convaincre de lire Spain Betrayed de Ronald Radosh, Mary R. Habeck et Grigory Sevostianov, un ouvrage qui procède au dépouillement systématique des dernières archives consacrées à la guerre d’Espagne, ouvertes à Moscou (Komintern, Politburo, NKVD – police politique et GRU – service d’espionnage de l’armée) [13]. Ainsi, bien au contraire de ce que dit Alexandre Douguine, si l’on prend la Guerre d’Espagne comme point focal, on comprend qu’il n’y a pas eu combat mais connivence entre les trois théories politiques de la modernité.
La vision fédéraliste et libertaire reste la seule méthode de guérison pour ranimer la capacité communalisante du peuple et lui permettre de retrouver son instinct de solidarité et de liberté.
L’anarcho-syndicalisme de la CNT espagnole n’a pas réussi à s’extraire de l’idéologie anarchiste pour s’ouvrir à l’esprit traditionnel de l’idée libertaire. C’est justement cette opération utopique – ou plutôt uchronique – que tente de mettre en place un des protagonistes du roman : Julius Wood.

Opera Palas établit un couplage insensé entre Buenaventura Durruti et José Antonio Primo de Rivera, une mise en relation scandaleuse et paradoxale qui prend à revers la notion même du politique telle que la résume Carl Schmitt dans cette phrase : « La distinction spécifique du politique, à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c’est la distinction de l’ami et de l’ennemi. » [14]
Le fédéralisme proudhonien repose sur cette mise en dialectique des contraires. Dans la pensée de Proudhon, le passage de l’anarchisme au fédéralisme est lié à cette recherche d’un équilibre entre l’autorité et la liberté dont un État garant du contrat mutualiste doit préserver l’harmonie.
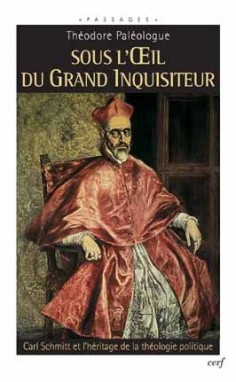 On se rappellera la légende du « Grand Inquisiteur » que Dostoïevski a enchâssée dans Les Frères Karamazov : le Christ réapparaît dans une rue de Séville, à la fin du XVe siècle et, le reconnaissant, le Grand Inquisiteur le fait arrêter. La nuit, dans sa geôle, il vient reprocher au Christ la « folie » du christianisme : la liberté pour l’homme de se déifier en se tournant vers Dieu.
On se rappellera la légende du « Grand Inquisiteur » que Dostoïevski a enchâssée dans Les Frères Karamazov : le Christ réapparaît dans une rue de Séville, à la fin du XVe siècle et, le reconnaissant, le Grand Inquisiteur le fait arrêter. La nuit, dans sa geôle, il vient reprocher au Christ la « folie » du christianisme : la liberté pour l’homme de se déifier en se tournant vers Dieu.
Dans ce récit se trouve la quintessence du mystère du socialisme. Choisir les idées du Grand inquisiteur, comme le fera Carl Schmitt [15], qui en cela se révèle non seulement catholique mais « marxiste », c’est le socialisme d’État ; Bakounine, lui, à l’image de Tolstoï, choisit le Christ contre l’État, et c’est le socialisme anarchiste. Dépasser la contradiction entre Schmitt et Bakounine par la dialectique proudhonienne, telle est la théorie politique de l’avenir.
______________________
NOTES
[1] Marcel Duchamp, Ingénieur du temps perdu, Belfond, 1977, p. 122.
[2] Alaric Levant, « Une révolution de l’intérieur… pour faire avancer notre idéal ? » : http://rebellion-sre.fr/revolution-de-linterieur-faire-av....
[3] Ezra Pound, ABC de la lecture, coll. « Omnia », Éditions Bartillat, 2011, p. 27.
[4] Cf. « Talvera et Usura » paru dans Contrelittérature n° 17, Hiver 2006. Texte repris et développé dans le recueil d’essais Au coeur de la talvera, Arma Artis, 2010.
[5] Gerald Brenan, Le labyrinthe espagnol. Origines sociales et politiques de la guerre civile, Éditions Ruedo Ibérico, 1962.
[6] Jean Borella, « La tripartition anthropologique », in La Charité profanée, Éditions du Cèdre/DMM, 1979, pp.117-133.
[7] Martin Buber, « Je et Tu » in La Vie en dialogue, Aubier 1968, p. 8.
[8] Claude Tresmontant, La métaphysique du christianisme et la crise du treizième siècle, Éditions du Seuil, 1964.
[9] René Guénon, « Le renversement des symboles » in Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, chap. XXX.
[10] Yvon Bourdet, L’espace de l’autogestion, Galilée, 1979.
[11] Cet article a été intégré dans l’ouvrage de Jean Parvulesco, La confirmation boréale, Alexipharmaque éditions, 2012, pp. 223-229.
[12] Alexandre Douguine, La Quatrième théorie politique, Ars Magna Éditions, 2012.
[13] Édité en 2001, aux éditions Yale University, l’ouvrage est paru en Espagnol, en 2002, sous le titre España traicionada, mais n’a toujours pas été traduit en français.
[14] Carl Schmitt, La notion du politique, Calmann-Lévy, 1972, note 1, p.
66.
[15] Cf. Théodore Paléologue, Sous l’œil du grand inquisiteur : Carl Schmitt et l'héritage de la théologie politique, Cerf, 2004.
01:33 Publié dans Entretiens, Jean Parvulesco, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alain santacreu, jean parvulesco, entretien, rébellion, littérature, lettres, contrelittérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
18:25 Publié dans Cinéma, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, cinéma, 7ème art |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Benjamin Fayet
Ex: https://www.philitt.fr
À l’automne 1942, après deux années passées à l’état-major parisien du général Hans Speidel, Ernst Jünger part en mission dans le Caucase. L’offensive allemande contre l’URSS atteint, cette année-là, son apogée. Les divisions du Reich s’apprêtent bientôt à refluer après avoir atteint Stalingrad et les rives de la Volga. De ce voyage dans les ténèbres, l’auteur d’Orage d’acier en tirera un texte court et dense sobrement intitulé Notes du Caucase, inséré dans son Journal parisien.
 Passer des écrits d’Ernst Jünger sur la Première Guerre mondiale à la lecture de son journal parisien, tenu entre 1940 et 1944, peut surprendre. Que reste-t-il alors de l’officier héroïque de 1918 ? Que reste-t-il de celui qui célébrait avec une dimension mystique sa plongée dans la fureur de la guerre des tranchées ? Que reste-t-il encore de cette expérience combattante qui fit de lui un des officiers les plus décorés de l’armée allemande ? Au cours de ces 20 années, l’homme a incontestablement changé. De son Journal parisien, ce n’est plus l’ivresse du combat qui saisit mais, tout au contraire, l’atonie confortable de la douceur de vie parisienne. S’y exprime la sensibilité d’un homme qui ne semble avoir conservé du soldat que l’uniforme. La guerre y semble lointaine, étonnamment étrangère, alors que le monde s’embrase. L’homme enivré par le combat, le brave des troupes de choc a désormais disparu. L’écrivain semble traverser ce terrible conflit éloigné de toute ambition belliqueuse, porté par cet esprit contemplatif qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie. Celui du poète mais aussi de l’entomologiste, l’homme des « chasses subtiles » comme il appelle lui-même ses recherches d’insectes rares. Et c’est encore, non pas en soldat, mais en naturaliste qu’il semble percevoir, dans le ciel de la capitale occupée, les immersions subites et meurtrières de la guerre. Ainsi, quand il observe, une flûte de champagne à la main, les escadrilles de bombardiers britanniques, la description qu’il en fait prend davantage la forme de celle d’un vol de coléoptères que de l’intrusion soudaine d’engins de morts, prêts à lâcher leurs bombes sur la ville.
Passer des écrits d’Ernst Jünger sur la Première Guerre mondiale à la lecture de son journal parisien, tenu entre 1940 et 1944, peut surprendre. Que reste-t-il alors de l’officier héroïque de 1918 ? Que reste-t-il de celui qui célébrait avec une dimension mystique sa plongée dans la fureur de la guerre des tranchées ? Que reste-t-il encore de cette expérience combattante qui fit de lui un des officiers les plus décorés de l’armée allemande ? Au cours de ces 20 années, l’homme a incontestablement changé. De son Journal parisien, ce n’est plus l’ivresse du combat qui saisit mais, tout au contraire, l’atonie confortable de la douceur de vie parisienne. S’y exprime la sensibilité d’un homme qui ne semble avoir conservé du soldat que l’uniforme. La guerre y semble lointaine, étonnamment étrangère, alors que le monde s’embrase. L’homme enivré par le combat, le brave des troupes de choc a désormais disparu. L’écrivain semble traverser ce terrible conflit éloigné de toute ambition belliqueuse, porté par cet esprit contemplatif qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie. Celui du poète mais aussi de l’entomologiste, l’homme des « chasses subtiles » comme il appelle lui-même ses recherches d’insectes rares. Et c’est encore, non pas en soldat, mais en naturaliste qu’il semble percevoir, dans le ciel de la capitale occupée, les immersions subites et meurtrières de la guerre. Ainsi, quand il observe, une flûte de champagne à la main, les escadrilles de bombardiers britanniques, la description qu’il en fait prend davantage la forme de celle d’un vol de coléoptères que de l’intrusion soudaine d’engins de morts, prêts à lâcher leurs bombes sur la ville.
Ces occupations dilettantes, Jünger les complète par l’exercice fréquent de mondanités. L’officier multiplie les rencontres avec l’élite culturelle de la capitale. Aussi bien Drieu la Rochelle, Picasso, Jouhandeau, Gide que Céline deviennent les acteurs d’un théâtre parisien qu’il dépeint avec l’intérêt de l’esthète francophile. En revanche, ce que son journal n’évoque que de manière lapidaire et voilée est la place prise par la Wehrmacht en France dans le mouvement d’opposition à Hitler et à la SS. La capitale occupée devient au cours de la guerre un foyer d’opposition dans lequel de nombreux officiers sont liés au comte de Stauffenberg, futur auteur à l’été 1944 de la tentative d’assassinat contre le Führer. Opposé à toute forme d’attentat, Jünger souhaite cependant fermement le renversement du dictateur nazi. Son texte La Paix, dont la lecture marque profondément le général Rommel, devient l’écrit politique sur lequel s’appuient les conjurés. C’est donc officiellement pour un voyage d’étude militaire et, officieusement, pour sonder l’état d’esprit des officiers du front de l’Est qu’il quitte Paris en novembre 1942. Il doit rejoindre les troupes engagées sur les rives de la Volga, bientôt témoins de la destruction de la VIe armée allemande du général Von Paulus.

Vers les ténèbres
Après un épuisant voyage, il arrive à Kiev le 21 novembre 1942, capitale ukrainienne du départ de son expédition vers le front. Mais là encore, c’est en observateur passif qu’il aborde ce voyage au plus près pourtant de l’affrontement des deux titans totalitaires qui s’affrontent de Petrograd à la Mer Noire. Et c’est toujours avec ce regard naturaliste qu’il observe cette guerre. Contraint de traverser la rivière Pchich, il se voit confronté à une apocalypse wagnérienne, une vision effroyable que le génie de Jünger retranscrit avec une saisissante beauté dans un panorama digne des infernales représentations du peintre Jérôme Bosch : « Comme des fourmis, des centaines et des milliers de porteurs, en longues files, charrient vers le front des madriers et des barbelés. En même temps, clamés par une voix surhumaine, des chants de Noël emplissent l’énorme cirque des montagnes : la propagande d’une compagnie de propagande allemande joue “Stille nacht, Heilige nacht”. Et parallèlement, sans arrêts, les lourds coups de mortiers que la montagne répercute. Tout ceci ressemble à un grand cirque enfermé en un cercle démoniaque, et qui n’admettrait dans son enceinte, hormis les couleurs mornes, que la couleur rouge. Ici il n’y a que violence et douleur qui, toutes deux, viennent s’y confondre. » Jünger s’enfonce encore un peu plus dans les ténèbres sur ces terres embrasées où se joue l’avenir du monde. Mais le contact avec le front et le froid de la Russie n’ôte toujours pas la dimension poétique à son regard. Il conserve sa capacité à saisir l’enchantement au-delà de la mort et des destructions. Face à la nature qui l’environne ou à la guerre qu’il subit, Jünger ne quitte jamais la position du contemplateur. Il n’est plus l’homme des coups de main militaires mais des coups d’œil poétiques ; l’esprit perméable à la beauté sous toutes ses formes. Comme l’écrit le critique littéraire Bruno de Césolle, il « fait sienne l’idée du philosophe allemand Johan Georg Hamann dit le “Mage du Nord”, à savoir que la contemplation, et non l’action, est à l’origine de toutes choses ». Une forme de résistance intérieure au monde moderne comme au nazisme et à la destruction, prémisse de ce « recours aux forêts » qu’il théorisera durant l’après-guerre dans son Traité du rebelle. Une nuit, alors que le fracas d’un duel d’artillerie se fait entendre, c’est la magnificence du ciel étoilé qui le bouleverse alors : « Que sommes-nous devant cette splendeur ? Qu’est donc notre éphémère tourment ? »
Les signes de l’apocalypse
Plus il s’enfonce à l’Est, plus sa vision idéalisée de la guerre s’effrite face à ce qu’il semblait déjà percevoir dès la Première Guerre mondiale. Plus encore qu’en 1914, la nouvelle forme de guerre industrielle aboutit à transformer le soldat en rouage d’une machine dans laquelle les anciennes vertus chevaleresques n’ont plus leur place. « Autrefois, écrit-il, alors que nous rampions dans les cratères de bombes, nous croyions encore que l’homme était plus fort que le matériel. Cela devait s’avérer une erreur. » Dans son livre Le Travailleur, écrit en 1932, il prophétisait déjà l’emprise de la technique sur les hommes et le travail. Celle-ci s’étend maintenant à la guerre, soldats et travailleurs sont maintenant devenus les enfants de la technique. L’étincelant des médailles, la beauté des uniformes, les couleurs des drapeaux et les rêves de gloire s’effacent brutalement dans ce conflit mécanique dans lequel s’enfonce la civilisation. Eléments contrastés que développera également son frère Frederich Georg dans son livre majeur : La perfection de la technique. Le soldat comme l’officier ne sont plus qu’un minuscule rouage de la superstructure.

Sur le front de l’Est, plus qu’ailleurs, les soldats sont maintenant des pièces interchangeables à la conscience broyée qui renonceront à s’engager dans la conjuration. Il est ainsi confronté à un effondrement moral du soldat allemand dont les crimes de masse, commis sur ce front, sont le terrible symptôme. Lui qui saluait militairement les porteurs d’étoile jaune à Paris est confronté à de multiples témoignages qui font état d’exactions envers les Juifs et les populations occupées. « Ce sont là des rumeurs, que je note en tant que telles ; mais il est sûr que se commettent des meurtres sur une grande échelle » S’il avait encore un doute sur la destruction définitive de l’idéal chevaleresque, il est désormais levé. Le heaume a été remplacé par le casque d’acier. Avec l’âge industriel, le nihilisme l’a emporté : « L’homme a donc atteint ce stade que Dostoievski décrit à travers Raskolnikov. Il considère alors ses semblables comme de la vermine. » Son ami Carl Schmitt écrit dans Le Nomos de la terre une idée similaire alors que les villes allemandes s’embrasent une à une sous les vagues de bombardiers alliés : « Le bombardement aérien n’a pour sens et fin que l’anéantissement. » Alors que Stalingrad s’apprête à tomber et que son humeur s’assombrit face au futur cataclysme militaire qu’il pressent, il reçoit l’annonce de la mort de son père le 8 janvier 1943. Il quitte alors précipitamment la Russie et retourne chez lui à Heidelberg.
Malgré la brièveté de ce voyage de trois mois, il s’envole vers sa ville natale avec maintenant quelques certitudes : les officiers allemands sur le front de l’Est ne soutiendront pas la conjuration. Il a acquis aussi l’intime conviction que l’Allemagne se dirige vers une inexorable défaite, la marche funèbre du Crépuscule des Dieux résonnera à Berlin.
17:35 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : litérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, ernst jünger, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Bulletin célinien n°404 (février 2018)
Sommaire :
Une réédition censurée
Ce qu’en pense la traductrice israélienne de Céline
Ce qu’en pense Marc-Édouard Nabe
Polémique pour une autre fois
Rééditer les pamphlets ? C’est déjà fait !
Céline sur les planches.
 De l’utilité du conditionnel. Dans le Bulletin de janvier, j’aurais dû écrire : « les pamphlets pourraient être réédités par les éditions Gallimard ». Ce numéro fut envoyé aux abonnés le 10 janvier. Le lendemain même, on apprenait qu’Antoine Gallimard jetait l’éponge. C’était à prévoir: les pressions en tous genres furent trop fortes. Dans ce numéro, je rappelle la chronologie des évènements. Ce qui est navrant, c’est qu’en faisant preuve de discrétion, ce naufrage aurait sans doute pu être évité. Il est à relever que l’échéance de mai 2018 circula dans la presse comme date de sortie du volume. Sans doute parce qu’il s’agissait initialement de reprendre tel quel l’appareil critique de l’édition “canadienne” et d’y adjoindre seulement une préface de Pierre Assouline. Certes Sollers commit une indiscrétion en annonçant durant l’été cette réédition. Mais cette confidence n’eut aucun écho car diffusée sur un site internet confidentiel. Lorsque l’information fut reprise sur celui d’un mensuel, il en alla tout autrement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les groupes de pression se mirent en branle avec le succès que l’on sait.
De l’utilité du conditionnel. Dans le Bulletin de janvier, j’aurais dû écrire : « les pamphlets pourraient être réédités par les éditions Gallimard ». Ce numéro fut envoyé aux abonnés le 10 janvier. Le lendemain même, on apprenait qu’Antoine Gallimard jetait l’éponge. C’était à prévoir: les pressions en tous genres furent trop fortes. Dans ce numéro, je rappelle la chronologie des évènements. Ce qui est navrant, c’est qu’en faisant preuve de discrétion, ce naufrage aurait sans doute pu être évité. Il est à relever que l’échéance de mai 2018 circula dans la presse comme date de sortie du volume. Sans doute parce qu’il s’agissait initialement de reprendre tel quel l’appareil critique de l’édition “canadienne” et d’y adjoindre seulement une préface de Pierre Assouline. Certes Sollers commit une indiscrétion en annonçant durant l’été cette réédition. Mais cette confidence n’eut aucun écho car diffusée sur un site internet confidentiel. Lorsque l’information fut reprise sur celui d’un mensuel, il en alla tout autrement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les groupes de pression se mirent en branle avec le succès que l’on sait.
Tout se serait donc passé autrement si le projet n’avait pas été ébruité. Il aurait fallu simplement veiller à ce qu’il n’y ait aucune fuite. Un fort volume serait sorti dans les “Cahiers de la Nrf” ou dans une autre collection et les opposants eussent été mis devant le fait accompli. Au lieu de cela les groupes de pression ont largement eu le temps de s’organiser, de se concerter et finalement d’empêcher que ce projet éditorial aboutisse. Cette affaire a permis, par ailleurs, d’observer de multiples divisions. Ainsi, au sein du CRIF, plusieurs militants étaient partisans d’une réédition encadrée par un collectif d’historiens alors que le président de cette organisation, après avoir hésité, s’est finalement rallié à la position de Klarsfeld.
Les historiens eux-mêmes n’étaient pas d’accord entre eux : Taguieff fit circuler un appel favorable à une réédition contrôlée par eux (appel signé notamment par Laurent Joly, Grégoire Kaufmann, Annette Becker et Odile Roynette) alors qu’un autre collectif d’historiens (Alya Aglan, Tal Bruttman, Éric Fournier, André Loez) se déclarait, lui, partisan de l’interdiction. Du côté politique, même chose: si le Premier Ministre était pour, plusieurs députés (Alexis Corbière mais aussi plusieurs élus de la majorité) étaient hostiles. Même division dans le milieu littéraire : les uns (Moix, Sansal, Jourde, Millet et Maulin) estimaient cette édition utile, alors que les autres (Modiano, Angot, Ernaux et même Vitoux) y étaient opposés. Une fois encore, Céline a suscité post-mortem un joli barouf, ce qui est somme toute très célinien.
Un esprit libre comme Philippe Bilger a su poser le problème en termes pertinents : « Derrière ces joutes aussi bien intellectuelles que politiques, prônant l’emprise d’un passé tragique sur le présent ou un présent libre mais non oublieux, il y a toujours la même hantise, la même crainte, presque le même mépris. À quel titre prétend-on se mêler de ce qui regarde le citoyen, le lecteur, de son choix et de son intelligence ? (…) N’aurait-il pas été concevable, convenable de rééditer ces textes et de laisser tous ceux qui admirent Céline pour partie ou pour le tout, qui le détestent pour le tout ou pour partie ou qui sont tout simplement curieux de l’ensemble se forger leur opinion, élaborer leur conviction et prendre un parti ? Faut-il donc toujours les prévenir, les alerter, les dissuader, leur enjoindre, les priver AVANT au lieu de les laisser lire, vivre ? » ¹. On peut raisonnablement penser que les lecteurs du Bulletin partagent cette opinion.

00:29 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, pamphlets céliniens, revue, littérature, littérature française, années 30, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Nicolas Bonnal
Ex: http://www.dedefensa.org
Fatigué des nouvelles du jour, je me remets à glaner dans tout Montaigne. Sur nos guerres protestantes, américaines, notre choc des civilisations, j’y trouve ceci :
«… je trouve mauvais ce que je vois en usage aujourd’hui, c’est-à-dire de chercher à affermir et imposer notre religion par la prospérité de nos entreprises.
Notre foi a suffisamment d’autres fondements pour qu’il ne soit pas nécessaire de fonder son autorité sur les événements. Car il y a danger quand le peuple, habitué à ces arguments plausibles et bien de son goût, voit sa foi ébranlée par des événements qui lui sont contraires et défavorables. Ainsi en est-il des guerres de religion dans lesquelles nous sommes plongés. »
Sur la société d’abondance et de consommation qui produit satiété et dépression, j’y trouve cela :
« Pensons-nous que les enfants de chœur prennent vraiment du plaisir à la musique ? La satiété la leur rend plutôt ennuyeuse. Les festins, les danses, les mascarades, les tournois réjouissent ceux qui ne les voient pas souvent, et qui désirent depuis longtemps les voir ; mais pour celui dont ils forment l’ordinaire, le goût en devient fade et même déplaisant : les femmes n’excitent plus celui qui en jouit autant qu’il veut… Celui qui n’a pas l’occasion d’avoir soif ne saurait avoir grand plaisir à boire. »
Montaigne ajoute, comme s’il pensait à nos comiques :
“Les farces des bateleurs nous amusent, mais pour eux, c’est une vraie corvée. »
La société d’abondance ? Il la définit ainsi Montaigne :
« Il n’est rien de si ennuyeux, d’aussi écœurant que l’abondance. Quel désir ne s’émousserait d’avoir trois cent femmes à sa disposition, comme le Grand Turc dans son sérail ?
Quel désir et quelle sorte de chasse pouvait bien avoir celui de ses ancêtres qui n’y allait jamais qu’avec au moins sept mille fauconniers ? »
Sur l’espionnage par l’Etat profond, Montaigne nous rappelle tout simplement que les Grands sont plus espionnés que les petits, mais qu’ils y ont pris goût (pensez à son pessimiste ami La Boétie):
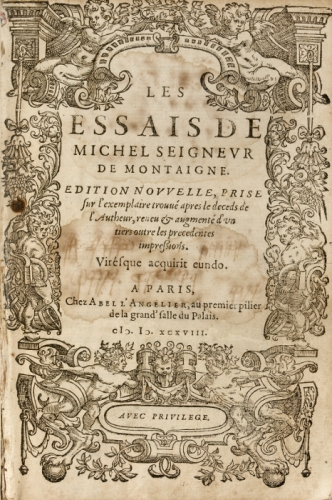 « Tout le monde redoute d’être contrôlé et épié ; les grands le sont jusque dans leurs comportements et leurs pensées, le peuple estimant avoir le droit d’en juger et intérêt à le faire. »
« Tout le monde redoute d’être contrôlé et épié ; les grands le sont jusque dans leurs comportements et leurs pensées, le peuple estimant avoir le droit d’en juger et intérêt à le faire. »
Pensons au harcèlement de nos pauvres peoples. A son époque c’est pire :
« Et il ne m’est jamais venu à l’idée que cela puisse constituer un quelconque avantage, dans la vie d’un homme cultivé, que d’avoir une vingtaine d’observateurs quand il est sur sa chaise percée… »
Deux siècles avant Montesquieu, Montaigne dénonce les caprices de la mode :
« La façon dont nos lois tentent de régler les folles et vaines dépenses de table et de vêtements semble avoir un effet contraire à son objet. Le vrai moyen, ce serait de susciter chez les hommes le mépris de l’or et de la soie, considérés comme des choses vaines et inutiles. Au lieu de cela, nous en augmentons la considération et la valeur qu’on leur attache, ce qui est bien une façon stupide de procéder si l’on veut en dégoûter les gens. »
La mode va vite comme la télé (cf. Virgile-Ovide) :
« Il est étonnant de voir comment la coutume, dans ces choses de peu d’importance, impose si facilement et si vite son autorité. À peine avions-nous porté du drap pendant un an à la cour, pour le deuil du roi Henri II, que déjà dans l’opinion de tous, la soie était devenue si vulgaire, que si l’on en voyait quelqu’un vêtu, on le prenait aussitôt pour un bourgeois. »
La Fontaine dira que le courtisan est un ressort. Montaigne :
« Le reste de la France prend pour règle celle de la cour.
Que les rois renoncent à cette vilaine pièce de vêtement qui montre si ostensiblement nos membres intimes, à ce balourd grossissement des pourpoints qui nous fait si différents de ce que nous sommes et si incommode pour s’armer, à ces longues tresses efféminées de cheveux… »
Montaigne vit au présent perpétuel, les ridicules qu’ils dénoncent sont donc ceux de la cité grecque d’Alan Bloom et Platon :
« Dans ses Lois, Platon estime que rien n’est plus dommageable à sa cité que de permettre à la jeunesse de changer ses accoutrements, ses gestes, ses danses, ses exercices et ses chansons, en passant d’une mode à l’autre, adoptant tantôt tel jugement, tantôt tel autre, et de courir après les nouveautés, adulant leurs inventeurs. C’est ainsi en effet que les mœurs se corrompent, et que les anciennes institutions se voient dédaignées, voire méprisées. »
Oui, il n’est pas trop réformateur, Montaigne.
Parfois il divague gentiment et il nous fait rêver avec ce qu’il a lu dans sa bibliothèque digne de Borges (voyez Guénon, Règne de la Quantité, les limites de l’histoire et de la géographie) :
« On lit dans Hérodote qu’il y a des peuples chez qui les hommes dorment et veillent par demi années. Et ceux qui ont écrit la vie du sage Épiménide disent qu’il dormit cinquante-sept ans de suite. »
Bon catholique, homme raisonnable surtout, Montaigne tape sur la Réforme, rappelant que deux siècles avant la révolution on a voulu changer les noms :
« La postérité ne dira pas que notre Réforme d’aujourd’hui a été subtile et judicieuse ; car elle n’a pas seulement combattu les erreurs et les vices, et rempli le monde de dévotion, d’humilité, d’obéissance, de paix et de toutes les vertus. Elle est aussi allée jusqu’à combattre ces anciens noms de baptême tels que Charles, Louis, François, pour peupler le monde de Mathusalem, Ézéchiel, Malachie, supposés plus imprégnés par la foi ! »
Sur ce sujet lisez son disciple Rothbard et son texte sur l’idéal communisme-millénariste des protestants, en particulier des anabaptistes.
Lire Montaigne (il dénonce le rustre son temps et sa mode efféminées !), qui nourrit Pascal, Cervantès et Shakespeare, c’est retomber dans l’enfance de la sagesse de la grande civilisation européenne aujourd’hui engloutie. Une sagesse biblique un rien sceptique, héritée de Salomon, plus sympathique que celle du sinistre Francis Bacon, qui triompha avec son Atlantide scientiste et son collège d’experts en folles manipulations psychologiques, génétiques et même agronomiques (lisez-le pour ne pas rire). Montaigne a moins voulu nous prévenir contre la tradition que contre cette folle quantité de coutumes, de modes et de snobismes qui s’imposeraient dans notre monde moderne déraciné.
On le laisse nous remettre chrétiennement à notre place (apologie de Raymond Sebond) :
« Le moyen que j’utilise pour combattre cette frénésie, celui qui me semble le plus propre à cela, c’est de froisser et fouler aux pieds l’orgueil et la fierté humaine. Il faut faire sentir à ces gens-là l’inanité, la vanité, et le néant de l’homme, leur arracher des mains les faibles armes de la raison, leur faire courber la tête et mordre la poussière sous le poids de l’autorité et du respect de la majesté divine. Car c’est à elle, et à elle seule qu’appartiennent la connaissance et la sagesse… »
Voilà pour le paganisme aseptisé de nos couillons de nos manuels scolaires !
Ou bien (Essais, I, L) :
« Je ne pense pas qu’il y ait en nous autant de malheur que de frivolité, autant de méchanceté que de bêtise ; nous sommes moins remplis de mal que d’inanité, nous sommes moins malheureux que vils. »
A transmettre à Davos. Et comme on parlait du roi Salomon, on citera ses proverbes :
« La gloire de Dieu est de cacher une chose, et la gloire des rois est de sonder une chose. »
Enfin pour faire lire et relire Montaigne je prends plaisir à recommander l’édition-traduction de Guy de Pernon, que j’ai trouvée juteuse et agréable, presque autant que le légendaire texte original (ebooksgratuits.com).
11:06 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, montaigne, 16ème siècle, histoire, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ultérieurement connu comme dramaturge sous le pseudonyme de Michel de Ghelderode, Adémar Martens naît le 3 avril 1898 à Ixelles, dans la banlieue Sud de Bruxelles.
C’est le dimanche des Rameaux, que les chrétiens nomment les Pâques fleuries. Par une étonnante coïncidence, dans cette rue de l’Arbre Bénit, est mort deux décennies plus tôt Charles De Coster (1827 – 1879), considéré comme le père fondateur des lettres belges de langue française (La Légende d’Ulenspiegel, 1867).
Dans un texte nostalgique de 1948, Ghelderode écrit :
« Ô cloches de neuf heures, ô larmes de ma mère,
Et ma sœur frappant d’un balai mon berceau
Parce que j’étais roux, que je n’étais pas beau !
Et naître près du lieu où mourut De Coster ! »
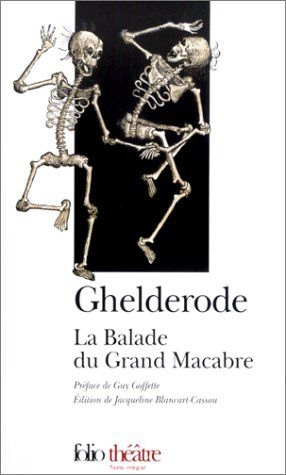 À son père archiviste, il doit sa « passion pour l’ancien ». Son nom de plume date de 1918 et s’inspire de celui d’un petit village des environs de Louvain, région natale de sa mère, qui berce son enfance par la narration de vieilles légendes flamandes.
À son père archiviste, il doit sa « passion pour l’ancien ». Son nom de plume date de 1918 et s’inspire de celui d’un petit village des environs de Louvain, région natale de sa mère, qui berce son enfance par la narration de vieilles légendes flamandes.
Ghelderode exerce divers métiers, dont celui d’employé de librairie, qui lui permet de rencontrer Jeanne Françoise-Gérard (1894 – 1980). Il l’épouse en 1924. Il est alors fonctionnaire à l’administration communale de Schaerbeek, faubourg de Bruxelles où il décède le 1er avril 1962.
Ses chroniques sur les ondes de Radio-Bruxelles durant l’occupation allemande valent à Ghelderode une période de disgrâce toutefois relative et très courte, puisque Gallimard entame dès 1950 la publication de son Théâtre complet, dont le sixième et dernier volume paraîtra en 1982.
Luc Pire sa collection « Espace Nord » rééditent en 2016 Sortilèges, un recueil de contes fantastiques initialement paru en 1947, à Liège, aux éditions Maréchal. En ce début d’après-guerre, alors que Ghelderode est toujours totalement méconnu en tant que prosateur, le préfacier Franz Hellens, autre explorateur belge du paranormal, compare les récits ghelderodiens à ceux d’Hoffmann, de Poe et de Villiers-de-l’Isle-Adam.
En 1953 paraît aux éditions Durendal, à Bruxelles, La Flandre est un Songe, où sont rassemblées des chroniques parues dans les années 1930, dans des revues à tirage limité, voire confidentiel. C’est dans ces textes que Ghelderode étale une verve de narrateur qui reste encore à découvrir de manière d’autant plus impérative que l’opulente histoire de la Flandre en est la principale source d’inspiration.
Furnes et sa procession des pénitents du dernier dimanche de juillet, Gand où naquit Charles Quint, Malines qui fut la cité préférée des ducs de Bourgogne, Bruges qui se souvient du temps où ses quais étaient secoués par « la grande pulsation de la mer»: autant de villes où Ghelderode emmène ses lecteurs sur les traces de promeneurs imaginaires, « gens heureux puisqu’ils sont riches de temps à perdre ». Bruxelles complète la liste et si un autre poète a qualifié la capitale belge de « joyau flamand », c’est parce qu’elle était autrefois traversée par la Senne, affluent de la Dyle, qui arrose Malines et Louvain, et sous-affluent de l’Escaut. Bruxelles fait partie intégrante de la partie orientale du bassin scaldéen.
Voûtée depuis 1866 sur son parcours bruxellois, « l’aimable Senne coule souterrainement qu’on enjambe sans se douter de sa présence de rivière honteuse, dont le nom prêtait à sourire ». Pareille à son homologue et quasi homonyme parisienne, la Senne se divisait jadis en deux bras encerclant l’île Saint-Géry, du nom d’un évêque de Cambrai qui vint la visiter au VIIe siècle et dont la légende veut qu’il y affronta victorieusement des dragons.
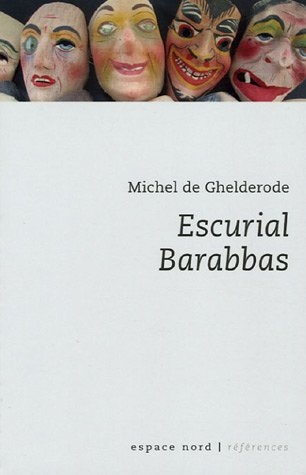 La chronique de 1937 consacrée à Bruxelles renferme un superbe éloge du Flâneur, qui « est après tout le dernier avatar de l’homme libre dans une société où personne ne l’est plus guère ». « Ces flâneurs, dont je suis, ne les appelez pas des badauds. Ils méritent mieux, ces attendris, ces lunatiques. La flânerie est une badauderie dirigée, consciente. Et nombre de nos flâneurs ont droit au respect dû aux historiens et archéologues, car ils en savent long sur le passé de leur domaine et vous en révéleront à l’occasion les aspects sensationnels – voire les mystères. »
La chronique de 1937 consacrée à Bruxelles renferme un superbe éloge du Flâneur, qui « est après tout le dernier avatar de l’homme libre dans une société où personne ne l’est plus guère ». « Ces flâneurs, dont je suis, ne les appelez pas des badauds. Ils méritent mieux, ces attendris, ces lunatiques. La flânerie est une badauderie dirigée, consciente. Et nombre de nos flâneurs ont droit au respect dû aux historiens et archéologues, car ils en savent long sur le passé de leur domaine et vous en révéleront à l’occasion les aspects sensationnels – voire les mystères. »
Ghelderode invite les habitants d’Anvers, de Lierre et d’autres hauts-lieux de sa Flandre bien-aimée à redécouvrir leur patrimoine citadin en se laissant guider par une sorte d’instinct venu du fond des âges. « Il suffira, un beau soir, de bonnement laisser aller vos jambes où elles veulent. Les jambes cessent d’être conduites par votre vouloir, suivent ataviquement et à votre insu les antiques routes marchandes de la cité. Ainsi font-elles, éclairées, éclairées par leur mémoire ancestrale, vous pouvez m’en croire. »
Comme De Coster, Ghelderode est fasciné par la Flandre du XVIe siècle courbant l’échine sous la rude domination des Habsbourgs d’Espagne. Avec Escurial et Le Soleil se couche, brefs morceaux de bravoure théâtrale, il nous laisse des petits chefs-d’œuvre dépeignant Philippe II à l’agonie dans son palais castillan et Charles Quint oublieux de sa fière devise dans le monastère d’Estrémadure, où il s’est retiré après son abdication et où Ghelderode ne lui tolère pour seule compagnie que des marionnettes et un perroquet proférant des jurons en dialecte marollien.
Autre drame très court et attestant la maîtrise de l’auteur : Les Aveugles. Trois pèlerins atteints de cécité croient cheminer vers Rome alors qu’ils tournent en rond dans la campagne brabançonne. Juché au sommet d’un arbre, un borgne leur assène la terrible vérité : tous les chemins mènent à la mort !
Il est cependant difficile de cataloguer Ghelderode parmi les auteurs anti-chrétiens quand on garde en mémoire la sublime Chronique de Noël de 1933. La Sainte-Famille suit le Massacre des Innocents dans le décor hivernal d’une ville flamande imaginaire qui rappelle l’Yperdamme d’Eugène Demolder (1862 – 1919) : contraction d’Ypres, à la flamboyante architecture gothique, et de Damme l’ensablée, où naît l’Ulenspiegel de De Coster. Tandis que les Rois-Mages patinent sur des canaux gelés, « la neige dégringole soudain, abolissant la ville et nous martelant d’innocence ». Joseph, Marie et Jésus s’en vont par les chemins enneigés d’une Flandre élevée au rang de terre sainte, comme dans les poèmes et les contes de José Gers (1898 – 1961), quasi strictement contemporain de Ghelderode, auteur oublié venu au monde sur les rives de l’Escaut. La Nativité de Ghelderode fait penser à Brueghel et à son Dénombrement de Bethléem, à l’arrière-plan duquel on reconnaît l’ancien village de Molenbeek.
 Revenons donc à Bruxelles et savourons l’évocation ghelderodienne de la « ville basse », qui « naquit péniblement dans les prés inondés enserrant l’île Saint-Géry » et de la « ville haute [qui] se développe sur le flanc de la vallée couronnée de forêts». Ghelderode est natif de la « ville haute » qui englobe « le pays d’Ixelles, si boisé, riche d’étangs et de terre conventuelles ». L’auteur pense évidemment à l’abbaye de la Cambre, qui abrita la retraite de Sabine d’Egmont, veuve de l’un des deux comtes (Egmont et Harnes) qui conduisirent une révolte anti-espagnole et furent décapités en 1568. Face à « l’homme contemporain de couleur neutre et de cervelle négative battant maussadement l’asphalte de l’Actuel », Ghelderode dresse le modèle du promeneur nostalgique inlassablement motivé par la redécouverte du Passé.
Revenons donc à Bruxelles et savourons l’évocation ghelderodienne de la « ville basse », qui « naquit péniblement dans les prés inondés enserrant l’île Saint-Géry » et de la « ville haute [qui] se développe sur le flanc de la vallée couronnée de forêts». Ghelderode est natif de la « ville haute » qui englobe « le pays d’Ixelles, si boisé, riche d’étangs et de terre conventuelles ». L’auteur pense évidemment à l’abbaye de la Cambre, qui abrita la retraite de Sabine d’Egmont, veuve de l’un des deux comtes (Egmont et Harnes) qui conduisirent une révolte anti-espagnole et furent décapités en 1568. Face à « l’homme contemporain de couleur neutre et de cervelle négative battant maussadement l’asphalte de l’Actuel », Ghelderode dresse le modèle du promeneur nostalgique inlassablement motivé par la redécouverte du Passé.
La Flandre est un Songe dévoile un Ghelderode prosateur très différent du dramaturge que d’aucun veulent enfermer dans la rubrique du « théâtre de la cruauté », sans que l’illustre anthologie de Lagarde et Michard lui concède pour autant une seule des lignes complaisamment accordées à Artaud, Arrabal et Genet.
Ce recueil de chroniques révèle aussi un Ghelderode fasciné par le mystère chrétien de la Nativité, en opposition avec le créateur de Barrabas, où le brigand occupe le devant de la scène au détriment d’un Jésus insignifiant. Saluons donc en Michel de Ghelderode un écrivain aux facettes multiples et contradictoires, un chantre d’une certaine idée de la Flandre, un narrateur-poète en recherche identitaire dont nous pouvons faire nôtres les lignes que voici : « Chacun sait où il va sur la planète, mais il arrive qu’on parte en quête d’une patrie morale. Le pèlerin se dit touriste que l’inquiétude pousse aux épaules vers quelque terre rêvée sainte, en appétit de ruines et de tombeaux, et secrètement préoccupé de retrouver le foyer primitif de sa tribu. Ainsi sommes-nous. »
Daniel Cologne
00:31 Publié dans Belgicana, Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : michel de ghelderode, daniel cologne, belgique, belgicana, littérature, lettres, lettres belges, littérature belge |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
19:22 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
19:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dostoïevski, littérature, lettres, lettres russes, littérature russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Bruno Lafourcade
Ex: https://ladecadencedecordicopolis.com
Trouvé sur Délit d’images à propos de Louis Pauwels qui sut défrayer les chroniques en son temps en étant l’auteur de cinglantes et impitoyables volées de bois contre le monde moderne et ses enfants atteints de « sida mental »…
Il s’agit d’un article de Bruno Lafourcade de Boulevard Voltaire.
Merci pour ce rafraîchissement !
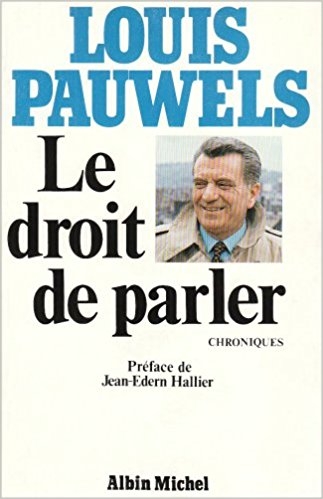 « Il y a vingt ans que Louis Pauwels est mort. Ce nom ne dit peut-être rien aux jeunes gens d’aujourd’hui ; il disait beaucoup à ceux des années quatre-vingt – ils manifestaient contre « la loi Devaquet », les anciens de 68 les brossaient dans le sens du duvet et Pauwels, lui, « n’ayant pas de minus à courtiser », leur dit virilement qui ils étaient : « les enfants du rock débile, les écoliers de la vulgarité pédagogique, les béats de Coluche et Renaud nourris de soupe infra-idéologique cuite au show-biz, ahuris par les saturnales de “touche pas à mon pote”, et, somme toute, les produits de la culture Lang ». La suite de ce « Monôme des zombies », publié le 6 décembre 1986 dans Le Figaro Magazine, n’était pas moins fouetteur : « Ils ont reçu une imprégnation morale qui leur fait prendre le bas pour le haut. Rien ne leur paraît meilleur que n’être rien, mais tous ensemble, pour n’aller nulle part. […] C’est une jeunesse atteinte d’un sida mental. »
« Il y a vingt ans que Louis Pauwels est mort. Ce nom ne dit peut-être rien aux jeunes gens d’aujourd’hui ; il disait beaucoup à ceux des années quatre-vingt – ils manifestaient contre « la loi Devaquet », les anciens de 68 les brossaient dans le sens du duvet et Pauwels, lui, « n’ayant pas de minus à courtiser », leur dit virilement qui ils étaient : « les enfants du rock débile, les écoliers de la vulgarité pédagogique, les béats de Coluche et Renaud nourris de soupe infra-idéologique cuite au show-biz, ahuris par les saturnales de “touche pas à mon pote”, et, somme toute, les produits de la culture Lang ». La suite de ce « Monôme des zombies », publié le 6 décembre 1986 dans Le Figaro Magazine, n’était pas moins fouetteur : « Ils ont reçu une imprégnation morale qui leur fait prendre le bas pour le haut. Rien ne leur paraît meilleur que n’être rien, mais tous ensemble, pour n’aller nulle part. […] C’est une jeunesse atteinte d’un sida mental. »
Cette expression en scandalisa beaucoup, en effraya certains, en secoua d’autres, arrachés à leur sommeil dogmatique, qui comprirent d’un seul coup que son auteur, à la vigueur imagée et frontale, avait raison : le style n’a jamais tort. Pauwels, dans cet article prémonitoire, arrachait de leur chemise la petite main jaune de la bonne conscience que les mitterrandiens y avaient épinglée.
Bien entendu, laisser un article, quand on en a écrit des milliers, c’est peu ; une expression, c’est moins encore, quand on est romancier ; c’est pourtant ce qui est arrivé à Pauwels, que ce « sida mental » résume, sans le déformer – qui exprime exactement sa phrase et sa morale également robustes.
À la tête de Combat à vingt-neuf ans, Pauwels fondera, plus tard, Le Figaro Magazine, où il fit entrer l’équipe de la Nouvelle Droite, avant de s’en séparer. Il s’est aussi intéressé à l’ésotérisme, écrivit avec Jacques Bergier Le Matin des magiciens, dont le succès sera suivi par la revue Planète. Il a été, enfin, un romancier très imprégné par le « réalisme fantastique », sauf pour son dernier roman, Les Orphelins, qui offre curieusement un écho à son plus célèbre article, publié dix ans plus tôt.
Nous sommes peu après Mai 68 ; Michel Cartry, un jeune gauchiste, voue à son père, Antoine, un riche industriel, une haine qui le conduit à accepter de feindre d’avoir été enlevé par les Brigades rouges : il s’agit d’obtenir une rançon. Pauwels en profite pour traduire Mai 68 en justice (« Comment tant de gens intelligents ont-ils consenti à voir un Messie dans cette jeunesse devenue folle qui brûlait sa maison afin de l’éclairer ? »), avec la génération qui, vingt ans plus tard, s’amuserait à en faire descendre d’autres dans la rue (« Michel, dit son père, aurait pu devenir un jeune homme. L’époque l’a réduit à l’état vaseux et acide des “jeunes”. Les “jeunes” : des grégaires qui se prétendent singuliers ; qui se croient naturels parce qu’ils sont informes » ; d’ailleurs, « pour ceux qui ne valent pas grand-chose, comme Michel, c’est un réconfort de crier que rien ne vaut »).
Vif et vigoureux, jamais alourdi par l’empathie, Pauwels aurait eu assez de dons, d’intuition et de jugement (« C’est deux fois vieillir que vieillir dans la laideur ») pour être le grand romancier des mœurs de son temps ; il a préféré en être le reporter. Il n’est pas exagéré de dire qu’il ne fut pas indigne de sa mission. ».
Tout est tellement vrai et bien vu ! Avec un franc-parler au style impeccable… un vrai plaisir.
Nous pouvons constater qu’aujourd’hui, les enfants du rock débile se sont perpétués en donnant naissance à une flopée d’enfants d’une techno débile, des immondes parades et du téléphone portable abêtissant.
Pauvre France…
11:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis pauwels, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook