samedi, 04 décembre 2010
Mishima, l'eterna giovinezza di un samurai
Mishima, l'eterna giovinezza di un samurai
Quarant’anni fa moriva lo scrittore giapponese
Lo ricorda un ex ragazzo che crebbe nel suo mito
 Le parole non bastano. Così parlò Yukio Mishima, e il 25 novembre del 1970 si uccise davanti alle telecamere col rito tradizionale del seppuku. Alle parole seguì il gesto e la scrittura debordò nella vita per compiersi nella morte. Il suicidio eroico di Mishima scosse la mia generazione, versante destro. Era il nostro Che Guevara, e sposava in capitulo mortis la letteratura e l’assoluto, l’esteta e l’eroe, il Superuomo e la Tradizione. Lasciò un brivido sui miei quindici anni. Poi diventò un mito a diciassette, quando uscì in Italia Sole e acciaio, il suo testamento spirituale. È uno di quei libri che trasforma chi lo legge; gustato riga per riga, non solo letto ma vissuto, come un libro d’istruzioni per montare la vita, pezzo per pezzo. Altro che Ikea, il pensare si riversava nell’agire. Le parole non bastano.
Le parole non bastano. Così parlò Yukio Mishima, e il 25 novembre del 1970 si uccise davanti alle telecamere col rito tradizionale del seppuku. Alle parole seguì il gesto e la scrittura debordò nella vita per compiersi nella morte. Il suicidio eroico di Mishima scosse la mia generazione, versante destro. Era il nostro Che Guevara, e sposava in capitulo mortis la letteratura e l’assoluto, l’esteta e l’eroe, il Superuomo e la Tradizione. Lasciò un brivido sui miei quindici anni. Poi diventò un mito a diciassette, quando uscì in Italia Sole e acciaio, il suo testamento spirituale. È uno di quei libri che trasforma chi lo legge; gustato riga per riga, non solo letto ma vissuto, come un libro d’istruzioni per montare la vita, pezzo per pezzo. Altro che Ikea, il pensare si riversava nell’agire. Le parole non bastano. Andammo in palestra, dopo quel libro, tra i manubri e i pesi, sulla scia di Mishima e del suo acciaio per scolpire il corpo all’altezza dei pensieri e per dare una vita ardita a un’indole intellettuale. Correvamo a torso nudo d’inverno con alcuni pazzi amici per andare incontro al sole. Dopo una corsa di dieci chilometri c’era un ponte che era la nostra meta finale perché sembrava che corressimo verso il cielo. Arrivavamo sfiniti ma a testa alta, con uno scatto finale, e una benda rossa sulla fronte. Pazzi che eravamo, illusi di gloria. Ridicoli. Vedevamo il sole come obbiettivo, non guardavamo sotto, all’autostrada, che banalmente scorreva sotto il ponte. Eravamo nella via del Samurai, mica sull’asfalto. Inseguivamo il mito. Un mito impolitico, che ci portava lontano dall’impegno militante e ci avvicinava a quella comunità eroica che Mishima aveva fondato due anni prima di darsi la morte. Mishima diventò col tempo il nostro Pasolini, disperato cantore di un mondo antico contro il mondo moderno e le sue macerie spirituali, l’americanizzazione e i consumi. Oggi di Mishima non è più proibito parlare, tutte le sue trasgressioni restano vietate, eccetto una che però basta a glorificarlo agli occhi del nostro tempo: Mishima era omosessuale. Sposato, ma omosessuale. E così viene oggi celebrato dai media e riabilitato.
Su Radio3 è andato in onda qualche giorno fa un bel programma a lui dedicato di Antonella Ferrera. Ho scritto più volte di lui, accostandolo al Che, d’Annunzio e Pasolini. Fu grande gioia ripubblicare, con un mio saggio introduttivo, Sole e acciaio, dieci anni dopo la sua prima lettura. Avevo ventisette anni ma avevo un conto in sospeso con la mia giovinezza, e fui felice di onorarlo. Il peggior complimento che ricevetti fu da un professore che allora mi disse: è più bella la tua introduzione del testo. Mi piace ricevere elogi, non nego la vanità. Ma quell’elogio fu peggio di un insulto, disprezzava il breviario della nostra gioventù. Come poteva paragonare un saggetto giovanile e letterario a un testamento spirituale così denso e forte? L’ho riletto dopo svariati anni, quel piccolo libro; non era un libro sacro, d’accordo, ma lo trovai ancora bello e teso, spirituale e marziale.
Poi c’era Mishima romanziere, gran letterato, ma poco rispetto al testimone dell’Assoluto. Certo, Mishima soffriva di narcisismo eroico, c’era in lui una componente sadomaso e molto di quel che lui attribuiva allo spirito dell’antico Giappone imperiale proveniva in realtà dalla letteratura romantica d’occidente e dalle sue letture. Mishima era stato lo scrittore più occidentale del Giappone, era di casa in America, veniva in Italia, amava Baudelaire e d’Annunzio, Keats e Byron, perfino Oscar Wilde. Faceva il cinema, scriveva per il cinema e per il teatro moderno, amava i film di gangster, era amico di Moravia. E c’era in lui quell’intreccio di vitalismo e decadentismo comune agli esteti nostrani. La stessa voluttà del morire di d’Annunzio, lo stesso culto della bella morte degli arditi e poi di alcuni fascisti di Salò...
Ma il miracolo di Mishima fu proprio quello: ritrovare nella modernità occidentale il cuore antico del suo Giappone, il culto dell’imperatore, la via del samurai, il pazzo morire; il nostro pensiero e azione che diventano in Giappone il crisantemo e la spada. Ribelle per amor di Tradizione. Certo, dietro il suicidio non c’è solo il grido disperato e irriso verso lo spirito che muore; c’è anche il gusto del beau geste clamoroso e c’è soprattutto l’orrore della vecchiaia, del lento e indecoroso morire nei giorni, negli anni. Dietro il samurai c’era Dorian Gray. Ma colpisce la sua cerimonia d’addio, vestito di bianco come si addice al lutto in Giappone, e prima il suo congedo in scrittura. Saluto gli oggetti che vedo per l’ultima volta... Mi siedo a scrivere e so che è l’ultima volta... Poi il pranzo dai genitori alla vigilia, la ripetizione fedele delle abitudini, come se nulla dovesse accadere. E il giorno dopo conficcarsi una lama nel ventre e farsi decapitare, dopo aver gridato tra le risa dei soldati, l’occhio delle telecamere e il ronzio degli elicotteri, il suo discorso eroico caduto nel vuoto.
Quell’immagine ti resta conficcata dentro, come una spada, capisci che l’unica morale eroica è quella dell’insuccesso, pensi che il successo arrivi quando il talento di uno si mette al servizio della stupidità di molti; diffidi delle vittorie e accarezzi la nobiltà delle sconfitte. E leggi Morris e la Yourcenar che a Mishima dedicò uno splendido testo, per accompagnare con giuste letture il suo canto del cigno. Su quegli errori si fondò la vita di alcuni militanti dell’assoluto, alla ricerca di una gloria sovrumana che coincideva con la morte trionfale, la perdita di sé nel nome di una perfetta eternità... Perciò torno oggi in pellegrinaggio da Mishima e porto un fiore di loto ai suoi 45 anni spezzati, e ai nostri quindici anni spariti con lui.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres japonaises, japon, littérature japonaise, asie, mishima |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 décembre 2010
Il cuore di Mishima

Il cuore di Mishima

di Marco Iacona
Ex: http://www.scandalizzareeundiritto.blogspot.com/
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres japonaises, littérature japonaise, japon, mishima, asie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Seppuku vor 40 Jahre: Yukio Mishima

Seppuku vor 40 Jahren: Yukio Mishima

Vor 40 Jahren beging der japanische Schriftsteller Yukio Mishima feierlich Selbstmord. Seine Tat war konsequent. In einem Abschiedsbrief an seinen englischen Übersetzer, den Wissenschaftler Donald Keene, schrieb er: »Es war schon seit langem mein Wunsch, nicht als Literat, sondern als Soldat zu sterben«.
Als solcher starb er auch. Mit vier Kameraden aus der »Schildgesellschaft«, seiner kleinen Privatmiliz, drang er, bewaffnet mit Samuraischwertern und gekleidet in eine Phantasieuniform, am Vormittag des 25. November 1970 in das Hauptquartier der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte in Tokio ein. Dort nahm er einen General als Geisel und forderte als Gegenleistung für dessen Freilassung, eine Rede vor den Soldaten der Garnison halten zu dürfen. Über tausend Soldaten versammelten sich auf dem Kasernenhof des Quartiers, während Mishima sich auf den Balkon stellte, die Hände in die Hüften stützte und einen Appell auf die Kaiserherrschaft, die altehrwürdige Tradition Japans und den Samuraigeist hielt.
Der Appell blieb unverstanden, Mishima erntete Spott und Beschimpfungen aus der Menge und brach die Rede vorzeitig ab. Er zog sich mit seinen Begleitern in ein Zimmer zurück und beging seppuku, die traditionelle japanische Form des Selbstmords durch Bauchaufschneiden, wie sie auch die Samurai praktiziert haben. Noch bevor Mishima unter Schmerzen starb, köpfte ihn einer seiner Begleiter. So hatte man es abgesprochen, und vereinbart war auch, daß ihm ein anderer Begleiter (pikanterweise Mishimas Geliebter Morita) in den Tod folgte. Das Bild von Mishimas abgetrenntem Kopf, den immer noch ein Stirnband mit dem Symbol der aufgehenden Sonne zierte, ging um die Welt.
Ein anderer Abgang Mishimas ist nur schwerlich vorstellbar. Der Großteil seines Lebens gleicht einer zeremoniellen Selbstinszenierung, und der Großteil seines künstlerischen Schaffens kreist um den Gedanken des Selbstmords: Ungezählt sind seine literarischen Arbeiten, in denen der Suizid als ästhetisches Ritual idealisiert wird; ungezählt sind seine Auftritte, bei denen er sich als Schauspieler in Film und Theater in langen, schmerzvollen Akten selbst tötet.
Als Kind und Jugendlicher war der am 14. Januar 1925 als Kimitake Hiraoka in Tokio geborene Mishima schmächtig, unnatürlich blaß und zurückhaltend. Seine dominante Großmutter, die einen großen Einfluß auf die gesamte Familie ausübte, verbat ihm den Umgang mit gleichaltrigen Jungen; er durfte nur mit Mädchen spielen. Männerkörper – vor allem Samuraikrieger und europäische Ritter, die er aus Bilderbüchern kannte – übten daher bereits im Kindesalter einen besonderen Reiz auf ihn aus. Als er eines Tages erfuhr, daß der Ritter auf einem seiner Lieblingsbilder eine Frau, Jeanne d’Arc, sei, war er darüber sehr enttäuscht.
Als Heranwachsender verbrachte Mishima seine Freizeit vornehmlich mit Lesen, wobei ihn auch europäische Literatur, insbesondere Raymond Radiguet – dessen Roman Der Teufel im Leib (1923) vielfach verfilmt wurde –, Oscar Wilde und Rainer Maria Rilke, prägte. Später wird er Thomas Mann als den Schriftsteller benennen, den er am meisten schätzt. Da bei Mishima irrtümlich eine beginnende Tuberkulose diagnostiziert wurde, mußte er den Militärdienst im Zweiten Weltkrieg nicht leisten.
Um dem Eindruck der Verletzlichkeit entgegenzuwirken, widmete sich Mishima fortan intensiv dem Kampf- und Kraftsport. Dank einer gnadenlosen Selbstdisziplin hatte er schon bald den muskelgestählten Körper, den er sich wünschte. Nicht selten wurden Mishima später Narzißmus und dandyhafte Züge nachgesagt; tatsächlich zeigen ihn viele seiner Bilder in heroischer Samuraipose mit nacktem, eingeöltem Oberkörper oder herrisch dreinblickend in dunklem maßgeschneidertem Anzug. Mishima wurde sein eigenes Ideal, er wurde der Held, den er als Kind so bewundert hatte.
Nachdem seine ersten schriftstellerischen Schritte weitgehend unbeachtet blieben, gelang ihm 1949 mit Geständnis einer Maske sein erster Erfolg. Das streckenweise autobiographische Werk ist das Porträt eines sensiblen, von Selbstzweifeln bedrängten Jungen an der Schwelle zum Erwachsensein. Bereits hier treten zahlreiche Themen auf, die sich wie rote Fäden durch Mishimas Werk ziehen: die Todessehnsucht, die erotische Zuneigung zu Knaben, die auffallende Betonung von Brust- und vor allem Achselhaar an männlichen Körpern.
Ein weiteres stets wiederkehrendes Motiv in seinem Werk ist die Figur des Heiligen Sebastian, des römischen Soldaten, der zum christlichen Märtyrer wurde. In Geständnis einer Maske bewirkt der Anblick eines Gemäldes des italienischen Barockmalers Guido Reni, das den Heiligen, malträtiert und halbnackt an einen Baum gefesselt, abbildet, die erste Ejakulation des Erzählers; 1966 veröffentlichte Mishima eine Übersetzung von Gabriele d’Annunzios Bühnenwerk Märtyrertum des heiligen Sebastian und ließ sich von dem japanischen Fotografen Kishin Shinoyama in der Pose, die Guido Reni für sein Sebastian-Gemälde ausgewählt hatte, fotografieren: mit nacktem, von mehreren Pfeilen durchbohrtem Oberkörper – wobei ein Pfeil markant aus seiner linken, schwarz behaarten Achselhöhle herausragt.
Obwohl Mishima zu einem auch international erfolgreichen und gefeierten Schriftsteller avancierte, schrieb er auch weiterhin immer wieder etliche anspruchslose Auftragsarbeiten, die in Magazinen oder als Fortsetzung in Tageszeitungen veröffentlicht wurden. Auf dem quantitativen Höhepunkt seines Schaffens entstanden bis zu drei Romane und ein Dutzend Kurzgeschichten im Jahr. Aus der breiten Masse der in den 50er Jahren entstandenen Werke stechen insbesondere Die Brandung (1954), eine zeitgenössische japanische Interpretation der antiken Liebesgeschichte um Daphnis und Chloe, und Der Tempelbrand (1956) hervor. Hierin erzählt Mishima von dem authentischen Fall eines Priesteranwärters, der im Nachkriegsjapan einen der schönsten buddhistischen Tempel, der den Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden hat, anzündet.
Neben seinen Romanen schrieb Mishima auch zahlreiche Theaterstücke und trat selbst als Schauspieler von NÕ-Stücken auf. NÕ bezeichnet ein klassisches japanisches Theater, das traditionell nur von Männern gespielt wird und sich vornehmlich mit Motiven der japanischen Mythologie befaßt. 1957 verbrachte Mishima ein halbes Jahr in den USA, wo er sich u.a. die Aufführung seiner Stücke anschauen wollte. Verbittert und unvermittelt brach er seinen Aufenthalt am Silvestertag ab. Auch wenn ihn gewisse Aspekte am amerikanischen Lebensstil reizten, ödete ihn auf Dauer die dortige Selbstsucht, die Fixierung auf Materielles ab, wie sein englischer Übersetzer Keene mit Blick auf das – leider nicht ins Deutsche übersetzte – »Reisebilderbuch« Mishimas feststellt.
Insoweit blieb sein Verhältnis zum Westen, insbesondere zu den USA zeitlebens ein gespaltenes. Am deutlichsten drückte Mishimas eigenes Haus diese Ambivalenz aus: Es bestand aus einem westlich und einem traditionell japanisch möblierten Trakt. Überhaupt zeichnete eine gewisse Zerrissenheit Mishimas Leben aus: Privat changierte es zwischen Bürgertum und Provokation. Er heiratete und wurde Vater zweier Kinder, nachts durchstreifte er hingegen die einschlägigen Homosexuellen-Bars in Tokio. Künstlerisch machte der weltweit anerkannte, mehrmals für den Literaturnobelpreis vorgeschlagene Schriftsteller Seitensprünge, indem er auch Rollen in billig produzierten Trashfilmen spielte.
Als Mishima 1968 erneut als einer der engeren Kandidaten für den Literaturnobelpreis diskutiert wurde, schmeichelte ihm dies natürlich. Die Wahl fiel schließlich auf den Japaner Kawabata Yasunari. Mishima eilte zu Yasunari, um ihm als erster gratulieren zu dürfen, und auch auf den gemeinsamen Fotos bei der Pressekonferenz macht Mishima einen erfreuten Eindruck. Doch so ganz ist ihm die Beherrschung nicht geglückt; sein Biograph Henry Scott Stokes, der Mishima auch privat gut kannte, beobachtete in den kommenden Tagen eine gewisse Enttäuschung und Niedergeschlagenheit. Vielleicht waren dies jene seltenen Momente, die Mishima ohne Maske zeigten: sensibel und von Selbstzweifeln bedrückt.
In den 60er Jahren streifte sich Mishima allmählich eine weitere Maske über: er entdeckte die Politik. Bereits in den 50er Jahren trat die japanische Kommunistische Partei mit der Anregung an ihn heran, über einen Eintritt in die Partei nachzudenken; diesem Kuriosum darf jedoch kaum eine ernstzunehmende Relevanz beigemessen werden. Literarisch näherte sich Mishima erstmals im Jahre 1960 politischen Themen an. Der Roman Nach dem Bankett erzählt von den Verstrickungen eines Diplomaten in politische Machtstrukturen, zweifelhafte Geldgeschäfte und private Liebschaften. Die Geschichte beruht auf einem authentischen Fall – die Romanfigur ist an einen ehemaligen liberalen Außenminister Japans angelehnt –, Mishimas eigene politische Position bleibt aber unklar.
Die im selben Jahr erschienene Kurzgeschichte Patriotismus ist hingegen eine deutliche Verbeugung vor dem Ethos des japanischen Soldatentums. Als Hintergrund der Geschichte dient der Ni-Ni-Roku-Aufstand vom 26. Februar 1936, bei dem sich eine Reihe junger Offiziere infolge außenpolitischer Diskrepanzen zwischen Regierung und militärischer Führung gegen letztere erhob und dabei den Tod fand. Patriotismus beschreibt den letzten Abend eines jungen, frisch verheirateten Leutnants, der gemeinsam mit seiner Frau den Freitod wählt, um nicht gegen seine Kameraden – die aufständischen Offiziere – vorgehen zu müssen. In einer bis dato nicht bekannten Detailliertheit schildert Mishima den Selbstmord als einen zeremoniellen Akt, als selbstverständliche Antwort auf einen moralischen Interessenkonflikt. In der fünf Jahre später unter seiner Regie entstandenen Verfilmung spielte Mishima die Rolle des jungen Offiziers selbst. Auch hier gleicht der Suizid einem feierlichen Ritual.
Das schicksalhafte Jahr 1968 ließ auch Japan nicht unberührt. Auch hier herrschte eine politische und gesellschaftliche Unruhe, deren Stifter mehrheitlich links standen. Mishima beobachtete die Entwicklung mit Interesse und suchte zu den wenigen rechten Studentengruppen Kontakt. Im Sommer 1968 gründete er eine paramilitärische Vereinigung, die sogenannte Schildgesellschaft (japanisch: Tatenokai), die sich ausschließlich aus jungen Studenten rekrutierte und die für die Rückkehr der klassischen Kaiserherrschaft eintrat. Es war der Versuch, eine an ästhetischen Idealen und traditionellen japanischen Vorstellungen orientierte Elite aufzubauen.
Mishima machte die jungen Männer mit den Tugenden des bushido, dem Verhaltenskodex der Samurai, vertraut und unterrichtete sie in Karate sowie in Schwertkampf. Er ließ eigene Uniformen schneidern, ein Wappen entwerfen und kreierte sogar eine eigene Hymne. Aufgrund der strengen Aufnahmevoraussetzungen hatte die Schildgesellschaft niemals mehr als hundert Mitglieder, was Mishima nur recht war; er sprach von der »kleinsten Armee der Welt und der größten an Geist«.
Die öffentliche Resonanz auf die Schildgesellschaft fiel erstaunlich dürftig aus. Dies überraschte um so mehr, als die Schildgesellschaft mit ausdrücklicher Genehmigung des damaligen Verteidigungsministers Nakasone sogar in den Militärkasernen der japanischen Armee exerzieren durfte. Die japanischen Medien beachteten Mishimas private Miliz trotzdem kaum, und wenn, dann nahmen sie sie als den Spleen eines exzentrischen Schriftstellers wahr, der eine »Spielzeugarmee« unterhielt. Auch das Verhältnis zwischen Mishimas Schildgesellschaft und anderen politisch rechtsstehenden Organisationen blieb von einem gewissen Desinteresse geprägt. Erst posthum entdeckten einige Gruppierungen aus dem Umfeld der japanischen »Neuen Rechten« – allen voran die nationalistische Issuikai, die erst kürzlich auch europaweit auf sich aufmerksam machte, nachdem sie mehrere Delegierte europäischer Rechtsparteien zum traditionellen Besuch des Yasukuni-Schrein eingeladen hatten – die politische Strahlkraft Mishimas. Seit 1972 veranstaltet die Issuikai gemeinsam mit anderen rechten Gruppierungen alljährlich ein Heldengedenken mit anschließendem Besuch an Mishimas Grab.
Im Mai 1969 nahm Mishima die Einlandung radikaler linker Studenten zu einer Podiumsdiskussion an der Universität von Tokio an. Es entwickelte sich ein teilweise recht aggressives Streitgespräch, während dem Mishima seine politischen Standpunkte, insbesondere seine Verehrung des Kaisers bekräftigte, aber auch Berührungspunkte zu den linken Studenten betonte. Auch er wolle Unruhe hineinbringen, auch er hasse Menschen, die »in Ruhe dasitzen«. Er schloß seine Rede mit einem Versprechen: »Eines Tages werde ich aufstehen gegen das System, so wie ihr Studenten aufgestanden seid – aber anders.« Es bleibt unklar, wie weit Mishimas Absicht eines Staatsstreichs bereits im Mai 1969 ausgereift war. Daß er je an einen politischen Erfolg seiner Aktion geglaubt hat, darf wohl bezweifelt werden. Vielmehr bildete der naive, zum Scheitern verurteilte Umsturzversuch nur einen Vorwand, nur einen ansprechenden Rahmen für die Inszenierung seines eigenen Todes, den er so viele Male zuvor eingeübt hatte.
Mishima erwartete wenig Lohnendes von der Zukunft. In einem Artikel von 1962 schrieb er: »In der Bronzezeit betrug die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen achtzehn Jahre; zur Römerzeit waren es zweiundzwanzig. Damals muß der Himmel voll gewesen sein mit schönen, jungen Menschen. In letzter Zeit muß es dort oben erbärmlich aussehen.« Auch in seinen Romanen griff er mehrmals den Gedanken auf, Selbstmord zu begehen, solange der Körper noch schön und muskulös ist. Mishima selbst befand sich 1970 mit seinen 45 Jahren körperlich in bester Verfassung. Die kommenden Jahre würden jedoch unweigerlich ein Abnehmen seiner physischen Kräfte bedeuten.
Literarisch war er auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Mit Die Todesmale des Engels – das Manuskript hierzu korrigierte er noch am Vorabend seines Todes und adressierte es an seinen Verleger – beendete er sein monumentales, vierbändiges Epos Das Meer der Fruchtbarkeit, an dem er die letzten sechs Jahre gearbeitet hatte. Zudem entfremdete er sich zunehmend von einer Gesellschaft, die für Begriffe wie Ehre und Tradition immer weniger empfänglich war. Alles Kommende hätte dem Gesamtkunstwerk Yukio Mishima an Glorie genommen. Das Todesfanal aber vollendete es auf eine morbide Weise.
(Mishima ist Angehöriger der Division Antaios)
00:05 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, littérature, lettres, lettres japonaises, littérature japonaise, mishima |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 novembre 2010
Nobelprijswinnaar niet welkom in Turkije
voor de Literatuur won, kan vanwege zijn kritiek op de islam niet deelnemen
aan een internationale literaire bijeenkomst in Istanboel.
 Aanvankelijk was de in Trinidad geboren Naipaul als eregast uitgenodigd voorhet European Writers Parliament, een groot internationaal literair evenement dat vandaag in Istanboel van start gaat. Toen dat bekend werd, protesteerde een groep Turkse schrijvers fel en dreigde met een boycot.
Aanvankelijk was de in Trinidad geboren Naipaul als eregast uitgenodigd voorhet European Writers Parliament, een groot internationaal literair evenement dat vandaag in Istanboel van start gaat. Toen dat bekend werd, protesteerde een groep Turkse schrijvers fel en dreigde met een boycot.De komst van Naipaul zou "een belediging zijn voor moslims", vanwege eerdere uitlatingen van de schrijver over de islam.
Zo heeft de Nobelprijswinnaar eens gezegd dat islamisering een vorm van
kolonisatie is die rampzalige gevolgen met zich meebrengt. Dat zou volgens
Naipaul vooral gelden voor mensen die zich tot de islam bekeren, omdat ze
hun afkomst en eigen verleden moeten verloochenen.
Volgens de Turkse dichter en filosoof Hilmi Yavuz beledigt de schrijver met
zulke opmerkingen de islam en moslims. Daarom is zijn komst naar het
literaire evenement niet gewenst, aldus Yavuz. Vele andere Turkse schrijvers
zijn dezelfde mening toegedaan. "De uitnodiging aan Naipaul moet worden
ingetrokken en men moet de schrijver vertellen wat daarvan de reden is",
aldus Özdenören. "De aanwezigheid van Naipaul is een belediging voor
moslims", aldus de linkse Turkse schrijver Cezmi Ersöz.
De organisator van het evenement, Ahmet Kot, probeerde nog de protesterende
Turkse schrijvers tegemoet te komen door Naipaul niet meer als eregast te
verwelkomen. Naipaul zou alleen de openingsspeech houden. Het
compromisvoorstel mocht niet baten. De protesterende Turkse schrijvers
hielden voet bij stuk. Daarna hebben het organisatiecomité en Naipaul
gezamenlijk besloten dat het beter is dat hij thuisblijft.
00:35 Publié dans Actualité, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, turquie, littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, naipaul, boycot, islam, islamisme, prix nobel, intolérance, censure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 novembre 2010
Paganismo e Filosofia da Vida em Knut Hamsun e D.H. Lawrence
Paganismo e Filosofia da Vida em Knut Hamsun e D.H. Lawrence
 O filólogo húngaro Akos Doma, formado na Alemanha e nos EUA, acaba de publicar uma obra de exegese literária, na qual faz um paralelismo entre as obras de Hamsun e Lawrence. O ponto em comum é uma "crítica da civilização". Conceito que, obviamente, devemos apreender em seu contexto. Em efeito, a civilização seria um processo positivo desde o ponto de vista dos "progressistas", que entendem a história de forma linear. Em efeito, os partidários da filosofia do Aufklärung [*Iluminismo] e os adeptos incondicionais de uma certa modernidade tendem à simplificação, à geometrização e à "cerebrização". Sem embargo, a civilização mostra-se a nós como um desenvolvimento negativo para todos aqueles que pretendem conservar a fecundidade incomensurável em relação aos venenos culturais, para os que constatam, sem escandalizar-se com isso, que o tempo é plurimorfo; quer dizer, que o tempo para uma cultura não coincide com o da outra, em contraposição aos iluministas quem se afirmam na crença de um tempo monomorfo e aplicável a todos os povos e culturas do planeta. Cada povo tem seu próprio tempo. Se a modernidade rechaça esta pluralidade de formas do tempo, então entramos irremissívelmente no terreno do ilusório.
O filólogo húngaro Akos Doma, formado na Alemanha e nos EUA, acaba de publicar uma obra de exegese literária, na qual faz um paralelismo entre as obras de Hamsun e Lawrence. O ponto em comum é uma "crítica da civilização". Conceito que, obviamente, devemos apreender em seu contexto. Em efeito, a civilização seria um processo positivo desde o ponto de vista dos "progressistas", que entendem a história de forma linear. Em efeito, os partidários da filosofia do Aufklärung [*Iluminismo] e os adeptos incondicionais de uma certa modernidade tendem à simplificação, à geometrização e à "cerebrização". Sem embargo, a civilização mostra-se a nós como um desenvolvimento negativo para todos aqueles que pretendem conservar a fecundidade incomensurável em relação aos venenos culturais, para os que constatam, sem escandalizar-se com isso, que o tempo é plurimorfo; quer dizer, que o tempo para uma cultura não coincide com o da outra, em contraposição aos iluministas quem se afirmam na crença de um tempo monomorfo e aplicável a todos os povos e culturas do planeta. Cada povo tem seu próprio tempo. Se a modernidade rechaça esta pluralidade de formas do tempo, então entramos irremissívelmente no terreno do ilusório.Desde um certo ponto de vista, explica Akos Doma, Hamsun e Lawrence são herdeiros de Rousseau. Porém, de qual Rousseau? Do que foi estigmatizado pela tradição maurrasiana (Maurras, Lasserre, Muret) ou daquele outro que critica radicalmente o Aufklärung sem que isso comporte defesa alguma do Antigo Regime? Para o Rousseau crítico do Iluminismo, a ideologia moderna é, precisamente, o oposto real do conceito ideal em sua concepção da política: aquele é anti-igualitário e hostil à liberdade, ainda que reivindique a igualidade e a liberdade. Antes da irrupção da modernidade ao longo do século XVIII, para Rousseau e seus seguidores pré-românticos, existiria uma "comunidade sadia", a convivência reinaria entre os homens e as pessoas seriam "boas" porque a natureza é "boa". Mais tarde, entre os românticos que, no terreno político, são conservadores, esta noção de "bondade" seguirá estando presente, ainda que na atualidade tal característica se considere como patrimônio exclusivo dos ativistas ou pensadores revolucionários. A idéia de "bondade" tem estado presente tanto na "direita" como na "esquerda".
Sem embargo, para o poeta romântico inglês Wordsworth, a natureza é "o marco de toda experiência autêntica", na medida em que o homem se enfrenta de uma maneira real e imediatamente com os elementos, o que implicitamente nos conduz mais além do bem e do mal. Wordsworth é, de certa forma, um "perfectibilista": o homem fruto de sua visão poética alcança o excelso, a perfeição; porém dito homem, contrariamente ao que pensavam e impunham os partidários das Luzes, não se aperfeiçoava somente com o desenvolvimento das faculdades do intelecto. A perfeição humana requer acima de tudo passar pela prova do elemento natural. Para Novalis, a natureza é "o espaço da experiência mística, que nos permite ver mais além das contingências da vida urbana e artificial". Para Eichendorff, a natureza é a liberdade e, em certo sentido, uma transcendência, pois permite escapar aos corpetes das convenções e instituições.
Com Wordsworth, Novalis e Eichendorff, as questões do imediato, da experiência vital, do rechaço das contingências surgidas da artificialidade dos convencionalismos, adquirem um importante papel. A partir do romantismo se desenvolve na Europa, acima de tudo na Europa setentrional, um movimento hostil a toda forma moderna de vida social e econômica. Carlyle, por exemplo, cantará o heroísmo e denegrirá a "cash flow society". Aparece a primeira crítica contra o reino do dinheiro. John Ruskin, com seus projetos de arquitetura orgânica junto à concepção de cidades-jardim, tratará de embelezar as cidades e reparar os danos sociais e urbanísticos de um racionalismo que desembocou no puro manchesterismo. Tolstói propõe um naturalismo otimista que não tem como ponto de referência a Dostoiévski, brilhante observador este último dos piores perfis da alma humana. Gauguin transplantará seu ideal da bondade humana à Polinésia, ao Taiti, em plena natureza.
Hamsum e Lawrence, contrariamente a Tolstói ou a Gauguin, desenvolverão uma visão da natureza carente de teologia, sem "bom fim", sem espaços paradisíacos marginais: assimilaram a dupla lição do pessimismo de Dostoiévski e Nietzsche. A natureza nesses não é um espaço idílico propício para excursões tal como sucede com os poetas ingleses do Lake District. A natureza não somente não é um espaço necessariamente perigoso ou violento, mas sim que é considerado aprioristicamente como tal. A natureza humana em Hamsun e Lawrence é, antes de nada, interioridade que conforma os recursos interiores, sua disposição e sua mentalidade (tripas e cérebro inextricavelmente unidos e confundidos). Tanto em Hamsun como em Lawrence, a natureza humana não é nem intelectualidade nem demonismo. É, antes de nada, expressão da realidade, realidade tradução imediata da terra, Gaia; realidade enquanto fonte de vida.
Frente a este manancial, a alienação moderna leva a duas atitudes opostas: 1º necessidade da terra, fonte de vitaldiade, e 2º soçobra na alienação, causa de enfermidades e escleroses. É precisamente nessa bipolaridade em que se deve localizar as duas grandes obras e Hamsun e de Lawrence: 'Benção da Terra', para o norueguês, e 'O Arco-Íris', do inglês.
Em 'Benção da Terra' de Hamsun, a natureza constitui o espaço do trabalho existencial no qual o homem opera com total independência para se alimentar e se perpetuar. Não se trata de uma natureza idílica, como sucede em certos utopistas bucólicos, e ademais o trabalho não foi abolido. A natureza é inabarcável, conforma o destino, e é parte da própria humanidade de tal forma que sua perda comportaria desumanização. O protagonista principal, o camponês Isak, é feio e desalinhado, é tosco e simples, porém inquebrantável, um ser limitado, porém não isento de vontade. O espaço natural, a Wildnis, é esse âmbito que tarde ou cedo há de levar a pegada do homem; não se trata do espaço ou o reino do homem convencional ou, mais exatamente, o delimitado pelos relógios, mas sim o do ritmo das estações, com seus ciclos periódicos. Em dito espaço, em dito tempo, não existem perguntas, se sobrevive para participar do refúgio de um ritmo que nos transborda. Esse destino é duro. Inclusive chega a ser muito duro. Porém em troca oferece independência, autonomia, permite uma relação direta com o trabalho. Outorga sentido, porque tem sentido. Em 'O Arco-Íris', de Lawrence, uma família vive de forma da terra de forma independente, apenas com o lucro de suas colheitas.
Hamsun e Lawrence, nessas duas novelas, nos legam a visão de um homem unido à terra (ein beheimateter Mensch), de um homem ancorado em um território limitado. O beheimateter Mensch ignora o saber livresco, não tem necessidade das prédicas dos meios informativos, sua sabedoria prática lhe é suficiente; graças a ela, seus atos tem sentido, inclusive quando fantasia ou dá rédea solta aos sentimentos. Esse saber imediato, ademais, lhe proporciona unidade com os outros seres.
Desde uma ótica como essa, a alienação, questão fundamental no século XIX, adquire outra perspectiva. Geralmente se aborda o problema da alienação desde três pontos e vista doutrinais:
1º Segundo o ponto de vista marxista e historicista, a alienação se localizaria unicamente na esfera social, enquanto que para Hamsun ou Lawrence, se situa na natureza interior do homem, independentemente de sua posição social ou de sua riqueza material.
2º A alienação abordada a partir da teologia ou da antropologia.
3º A alienação percebida como uma anomalia social.
Em Hegel, e mais tarde em Marx, a alienação dos povos ou das massas é uma etapa necessária no processo de adequação gradual entre a realidade e o absoluto. Em Hamsun e Lawrence, a alienação é um conceito todavia mais categórico; suas causas não residem nas estruturas sócio-econômicas ou políticas, mas sim no distanciamento em respeito às raízes da natureza (que não é, consequentemente, uma "boa" natureza). Não desaparecerá a alienação com a simples instauração de uma nova ordem sócio-econômica. Em Hamsun e Lawrence, assinala Doma, é o problema da desconexão, da interrupção, o que tem um traço essencial. A vida social tornou-se uniforme, desemboca na uniformidade, na automatização, na funcionalização extrema, enquanto que a natureza e o trabalho integrado no ciclo da vida não são uniformes e requerem em todo momento a mobilização de energias vitais. Existe imediatidade, enquanto que na vida urbana, industrial e moderna tudo está mediatizado, filtrado. Hamsun e Lawrence se rebelam contra ditos filtros.
Para Hamsun e, em menor medida, Lawrence as forças interiores contam para a "natureza". Com a chegada da modernidade, os homens estão determinados por fatores exteriores a eles, como são os convencionalismos, a luta política e a opinião pública, que oferecem um tipo de ilusão para a liberdade, quando em realidade conformam o cenário ideal para todo tipo de manipulações. Em um contexto tal, as comunidades acabam por se desvertebrar: cada indivíduo fica reduzido a uma esfera de atividade autônoma e em concorrência com outros indivíduos. Tudo isso acaba por derivar em debilidade, isolamento e hostilidade de todos contra todos.
Os sintomas dessa debilidade são a paixão pelas coisas superficiais, os vestidos refinados (Hamsun), signo de uma fascinação detestável pelo externo; isto é, formas de dependência, signos de vazio interior. O homem quebra por efeito de pressões exteriores. Indícios, por fim, da perda de vitalidade que leva à alienação.
No marco dessa quebra que supõe a vida urbana, o homem não encontra estabilidade, pois a vida nas cidades, nas metrópoles, é hostil a qualquer forma de estabilidade. O homem alienado já não pode retornar a sua comunidade, a suas raízes familiares. Assim Lawrence, com uma linguagem menos áspera porém acaso mais incisiva, escreve: "He was the eternal audience, the chorus, the spectator at the drama; in his own life he would have no drama" ("Ele era a audiência eterna, o coro, o espectador do drama; porém em sua própria vida, não haveria drama algum"); "He scarcely existed except through other people" ("Ele mal existia, salvo através de outras pessoas"); "He had come to a stability of nullification" ("Ele havia chegado a uma estabilidade de nulificação").
Em Hamsun e Lawrence, o Ent-wurzelung e o Unbehaustheit, o desenraizamento e a carência de lar, essa forma de viver sem fogo, constitui a grande tragédia da humanidade de fins do século XIX e princípios do XX. Para Hamsun o lar é vital para o homem. O homem deve ter lar. O lar de usa existência. Não se pode prescindir do lar sem provocar em si mesmo uma profunda mutilação. Mutilação de caráter psíquico, que conduz à histeria, ao nervosismo, ao desequilíbrio. Hamsun é, ao fim e ao cabo, um psicólogo. E nos diz: a consciência de si é não raro um sintoma de alienação. Schiller, em seu ensaio Über naive und sentimentalische Dichtung, assinalava que a concordância entre sentir e pensar era tangível, real e interior no homem natural, ao contrário que no homem cultivado que é ideal e exterior ("A concordância entre sensações e penamente existia outrora, porém na atualidade somente reside no plano ideal. Esta concordância não reside no homem, mas sim que existe exteriormente a ele; trata-se de uma idéia que deve ser realizada, não um fato de sua vida").
Schiller advoga por uma Überwindung (superação) de dita quebra através de uma mobilização total do indivíduo. O romantismo, por sua parte, considerará a reconciliação entre Ser (Sein) e consciência (Bewusstsein) como a forma de combater o reducionismo que trata de encurralar a consciência sob os grilhões do entendimento racional. O romantismo valorará, e inclusive sobrevalorará, ao "outro" em relação à razão (das Andere der Vernunft): percepção sensual, instinto, intuição, experiência mística, infância, sonho, vida bucólica. Wordsworth, romântico inglês, representante "rosa" de dita vontade de reconciliação entre Ser e consciência, defenderá a presença de "um coração que observe e aprove". Dostoiévski não compartilhará dita visão "rosa" e desenvolverá uma concepção "negra", em que o intelecto é sempre causa de mal, e o "possesso" um ser que tenderá a matar ou suicidar-se. No plano filosófico, tanto Klages como Lessing retomarão por sua conta esta visão "negra" do intelecto, aprofundando, não obstante, no veio do romantismo naturalista: para Klages, o espírito é inimigo da alma; para Lessing, o espírito é a contrapartida da vida, que surge da necessidade ("Geist ist das notgeborene Gegenspiel des Lebens").
 Lawrence, fiel em certo sentido à tradição romântica inglesa de Wordsworth, crê em uma nova adequação do Ser e da consciência. Hamsun, mais pessimista, mais dostoievskiano (daí sua acolhida na Rússia e sua influência nos autores chamados ruralistas, como Vasili Belov e Valentín Rasputin), nunca deixará de pensar que desde que há consciência, há alienação. Desde que o homem começa a refletir sobre si mesmo, se desliga da continuidade que confere a natureza e à qual deveria estar sempre sujeito. Nos ensaios de Hamsun, encontramos reflexões sobre a modernidade literária. A vida moderna, escreveu, influencia, transforma, leva o homem a ser arrancado de seu destino, a ser apartado de seu ponto de chegada, de seus instintos, mais além do bem e do mal. A evolução literária do século XIX mostra uma febre, um desequilíbrio, um nervosismo, uma complicação extrema da psicologia humana. "O nervosismo geral (ambiente) se apossou de nosso ser fundamental e se fixou em nossa vida sentimental". O escritor mostra-se a nós assim, ao estilo de um Zola, como um "médico social" encarregado de diagnosticar os males sociais com o objetivo de erradicar o mal. O escritor, o intelectual, se embarca em uma tarefa missionária que trata de chegar a uma "correção política".
Lawrence, fiel em certo sentido à tradição romântica inglesa de Wordsworth, crê em uma nova adequação do Ser e da consciência. Hamsun, mais pessimista, mais dostoievskiano (daí sua acolhida na Rússia e sua influência nos autores chamados ruralistas, como Vasili Belov e Valentín Rasputin), nunca deixará de pensar que desde que há consciência, há alienação. Desde que o homem começa a refletir sobre si mesmo, se desliga da continuidade que confere a natureza e à qual deveria estar sempre sujeito. Nos ensaios de Hamsun, encontramos reflexões sobre a modernidade literária. A vida moderna, escreveu, influencia, transforma, leva o homem a ser arrancado de seu destino, a ser apartado de seu ponto de chegada, de seus instintos, mais além do bem e do mal. A evolução literária do século XIX mostra uma febre, um desequilíbrio, um nervosismo, uma complicação extrema da psicologia humana. "O nervosismo geral (ambiente) se apossou de nosso ser fundamental e se fixou em nossa vida sentimental". O escritor mostra-se a nós assim, ao estilo de um Zola, como um "médico social" encarregado de diagnosticar os males sociais com o objetivo de erradicar o mal. O escritor, o intelectual, se embarca em uma tarefa missionária que trata de chegar a uma "correção política".Frente a esta visão intelectual do escritor, a reprovação de Hamsun assinala a impossibilidade de definir objetivamente a realidade humana, pois um "homem objetivo" é, em si mesmo, uma monstruosidade (ein Unding), um ser construído como se tratasse de um mecanismo. Não podemos reduzir o homem a um compêndio de características, pois o homem é evolução, ambigüidade. O mesmo critério encontramos em Lawrence: "Now I absolutely flatly deny that I am a soul, or a body, or a mind, or an intelligente, or a brain, or a nervous system, or a bunch of glands, or any of the rest of these bits of me. The whole is greater than the part" ("Agora eu nego em absoluto que eu sou uma alma, ou um corpo, ou uma mente, ou uma inteligência, ou um cérebro, ou um sistema nervoso, ou um monte de glândulas, ou qualquer dos restos desses pedaços de mim. O todo é maior do que a parte"). Hamsun e Lawrence ilustram em suas obras a impossibilidade de teorizar ou absolutizar uma visão diáfana do homem. O homem não pode ser veículo de idéias pré-concebidas. Hamsun e Lawrence confirmam que os progressos na consciência de si mesmo não implicam em processos de emancipação espiritual, mas sim perdas, desperdício da vitaldiade, do tônus vital. Em seus romances, são as figuras firmes (isto é, as que estão enraizadas na terra) as que logram se manter, as que triunfam mais além dos golpes da sorte ou das circunstâncias desgraçadas.
Não se trata, em absoluto, de vidas bucólicas ou idílicas. Os protagonistas das novelas de Hamsun e Lawrence são penetrados ou atraídos pela modernidade, os quais, pese a sua irredutível complexidade, podem sucumbir, sofrem, padecem de um processo de alienação, porém também podem triunfar. E é precisamente aqui onde intervem a ironia de Hamsun ou a idéia da "Fênix" de Lawrence. A ironia de Hamsun perfura os ideais abstratos das ideologias modernas. Em Lawrence, a recorrente idéia da "Fênix" supõe uma certa dose de esperança: haverá ressurreição. É a idéia da Ave Fênix, que renasce de suas próprias cinzas.
O paganismo de Hamsun e Lawrence
Sua dita vontade de retorno a uma ontologia natural é fruto de um rechaço do intelectualismo racionalista, isso implica ao mesmo tempo uma contestação silenciosa à mensagem cristã.
Em Hamsun, vê-se com clareza o rechaço do puritanismo familiar (concretizado na figura de seu tio Han Olsen) e o rechaço ao culto protestante pelos livros sagrados; isto é, o rechaço explícito de um sistema de pensamento religioso que prima pelo saber livresco frente à experiência existencial (particularmente a do camponês autosuficiente, o Odalsbond dos campos noruegueses). O anticristianismo de Hamsun é, fundamentalmente, um a-cristianismo: não se propõe dúvidas religiosas ao estilo de Kierkegaard. Para Hamsun, o moralismo do protestantismo da era vitoriana (da era oscariana, diríamos para a Escandinávia) é simples e completa perda de vitalidade. Hamsun não aposta em experiência mística alguma.
Lawrence, por sua parte, percebe a ruptura de toda relação com os mistérios cósmicos. O cristianismo viria a reforçar dita ruptura, impediria sua cura, impossibilitaria sua cicatrização. Nesse sentido, a religiosidade européia ainda conservaria um poço de dito culto ao mistério cósmico: o ano litúrgico, o ciclo litúrgico (Páscoa, Pentecostes, Fogueira de São João, Todos os Santos, Natal, Festa dos Reis Magos). Porém inclusive isto foi agrilhoado como consequência de um processo de desencantamento e dessacralização, cujo começo arranca no momento mesm oda chegada da Igreja cristã primitiva e que se reforçará com os puritanismos e os jansenismos segregados pela Reforma. Os primeiros cristãos se apresentaram com o objetivo de separar o homem de seus ciclos cósmicos. A Igreja medieval, ao contrário, quis adequar-se, porém as Igrejas protestantes e conciliares posteriores expressaram com clareza sua vontade de regressar ao anti-cosmicismo do cristianismo primitivo. Nesse sentido, Lawrence escreve: "But now, after almost three thousand years, now that we are almost abstracted entirely from the rhythmic life of the seasons, birth and death and fruition, now we realize that such abstraction is neither bliss nor liberation, but nullity. It brings null inertia" ("Porém hoje, depois de três mil anos, depois de estarmos quase completamente abstraídos da vida rítmica das estações, do nascimento, da morte e da fecundidade, compreendemos ao fim que tal abstração não é nem uma benção nem uma liberação, mas sim puro nada. Não nos aporta outra coisa além de inércia"). Essa ruptura é consubstancial ao cristianismo das civilizações urbanas, onde não há abertura alguma para o cosmos. Cristo não é um Cristo cósmico, mas sim um Cristo reduzido ao papel de assistente social. Mircea Eliade, por sua parte, referiu-se a um "homem cósmico" aberto à imensidão do cosmos, pilar de todas as grandes religiões. Na perspectiva de Eliade, o sagrado é o real, o poder, a fonte de vida e da fertilidade. Eliade nos deixou escrito: "O desejo do homem religioso de viver uma vida no âmbito do sagrado é o desejo de viver na realidade objetiva".
A lição ideológica e política de Hamsun e Lawrence
No plano ideológico e político, no plano da Weltanschauung, as obras de Hamsun e de Lawrence tiveram um impacto bastante considerável. Hamsun foi lido por todos, mais além da polaridade comunismo/fascismo. Lawrence foi etiquetado como "fascista" a título póstumo, entre outros por Bertrand Russel que chegou inclusive a referir-se a sua "madness": "Lawrence was a suitable exponent of the Nazi cult of insanity" ("Lawrence foi um expoente típico do culto nazista à loucura"). Frase tão lapidária como simplista. As obras de Hamsun e de Lawrence, segundo Akos Doma, se inscrevem em um contexto quádruplo: o da filosofia da vida, o dos avatares do individualismo, o da tradição filosófica vitalista, e o do anti-utopismo e do irracionalismo.
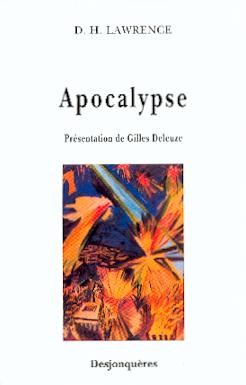 1º. A Filosofia da Vida (Lebensphilosophie) é um conceito de luta, que opõe a "vivacidade da vida real" à rigidez dos convencionalismos, aos fogos de artifício inventados pela civilização urbana para tratar de orientar a vida para um mundo desencantado. A filosofia da vida se manifesta sob múltiplas faces no contexto do pensamento europeu e toma realmente corpo a partir das reflexões de Nietzsche sobre a Leiblichkeit (corporeidade).
1º. A Filosofia da Vida (Lebensphilosophie) é um conceito de luta, que opõe a "vivacidade da vida real" à rigidez dos convencionalismos, aos fogos de artifício inventados pela civilização urbana para tratar de orientar a vida para um mundo desencantado. A filosofia da vida se manifesta sob múltiplas faces no contexto do pensamento europeu e toma realmente corpo a partir das reflexões de Nietzsche sobre a Leiblichkeit (corporeidade).2 º O Individualismo. A antropologia hamsuniana postula a absoluta unidade de cada indivíduo, de cada pessoa, porém rechaça o isolamento desse indivíduo ou pessoa de todo contexto comunitário, familiar ou carnal: situa à pessoa de uma maneira interativa, em um lugar preciso. A ausência de introspecção especulativa, de consciência e de intelectualismo abstrato tornam incompatível o individualismo hamsuniano com a antropologia segregada pelo Iluminismo. Para Hamsun, sem embargo, não se combate o individualismo iluminista sermoneando sobre um coletivismo de contornos ideológicos. O renascimento do homem autêntico passa por uma reativação dos recursos mais profundos de sua alma e de seu corpo. A soma quantitativa e mecânica é uma insuficiência calamitosa. Em consequência, a acusação de "fascismo" em relação a Lawrence e Hamsun não se sustenta.
3º O Vitalismo tem em conta todos os acontecimentos da vida e exclui qualquer hierarquização de base racial, social, etc. As oposições próprias do vitalismo são: afirmação da vida/negação da vida; sadio/enfermo; orgânico/mecânico. Daí, que não possam ser reconduzidas a categorias sociais, a categorias políticas convencionais, etc. A vida é uma categoria fundamental apolítica, pois todos os homens sem distinção estão submetidos a ela.
4º O "irracionalismo" lançado sobre Hamsun e Lawrence, assim como seu anti-utopismo, tem sua base em uma revolta contra a "viabilidade" (feasibility; Machbarkeit), contra a idéia de perfectibilidade infinita (que encontramos também sob uma forma "orgânica" nos românticos ingleses da primeira geração). A idéia de viabilidade choca diretamente com a essência biológica da natureza. De fato, a idéia de viabilidade é a essência do niilismo, como apontou o filósofo italiano Emanuele Severino. Para Severino, a viabilidade deriva de uma vontade de completar o mundo apreendendo-o como um devir (porém não como um devir orgânico incontrolável). Uma vez o processo de "acabamento" tendo concluído, o devir detem bruscamente seu curso. Uma estabilidade geral se impõe na Terra e esta estabilidade forçada é descrita como um "bem absoluto". Desde a literatura, Hamsun e Lawrence, precederam assim a filósofos contemporâneos como o citado Emanuele Severino, Robert Spaemann (com sua crítica do funcionalismo), Ernst Behler (com sua crítica da "perfectibilidade infinita") ou Peter Koslowski. Estes filósofos, fora da Alemanha ou Itália, são muito pouco conhecidos pelo grande público. Sua crítica profunda dos fundamentos das ideologias dominantes, provoca inevitavelmente o rechaço da solapada inquisição que exerce seu domínio em Paris.
Nietzche, Hamsun, e Lawrence, os filósofos vitalistas ou, se preferível, "antiviabilistas", ao insistir sobre o caráter ontológico da biologia humana, se opuseram à idéia ocidental e niilista da viabilidade absoluta de qualquer coisa; isto é, da inexistência ontológica de todas as coisas, de qualquer realidade. Bom número deles - Hamsun e Lawrence incluídos - nos chamam a atenção sobre o presente eterno de nossos corpos, sobre nossa própria corporeidade (Leiblichkeit), pois nós não podemos conformar nossos corpos, em contraposição a essas vozes que nos querem convencer das bondades da ciência-ficção.
A viabilidade é, pois, o "hybris" que chegou a seu ápice e que conduz à febre, à vacuidade, à pressa, ao solipsismo, e ao isolamento. De Heidegger a Severino, a filosofia européia se ocupou sobre a catástrofe causada pela dessacralização do Ser e pelo desencantamento do mundo. Se os recursos profundos e misteriosos da Terra ou do homem são considerados como imperfeições indignas do interesse do teólogo ou do filósofo, se tudo aquilo que foi pensado de maneira abstrata ou fabricado mais além dos recursos (ontológicos) se encontra sobrevalorizado, então, efetivamente, não pode nos estranhar que o mundo perca toda sacralidade, todo valor. Hamsun e Lawrence foram os escritores que nos fizeram viver com intensidade essa constante, acima até mesmo de alguns filósofos que também deploraram a falsa rota empreendida pelo pensamento ocidental há séculos. Heidegger e Severiano no marco da filosofia, Hamsun e Lawrence no da criação literária, trataram de restituir a sacralidade no mundo e revalorizar as forças que se esconem no interior do homem: desde esse ponto de vista, estamos diante de pensadores ecológicos na mais profunda acepção do termo. O oikos nos abre as portas do sagrado, das forças misteriosas e incontroláveis, sem fatalismos e sem falsa humildade. Hamsun e Lawrence, em definitivo, anunciaram a dimensão geofilosófica do pensamento que nos ocupou durante toda essa universidade de verão. Uma aproximação sucinta a suas obras se fazia absolutamente necessária no temário de 1996.
Tradução por Raphael Machado
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettrs anglaises, lettres norvégiennes, lettres scandinaves, littérature anglaise, littérature norvégiernne, littérature scandinave, vitalisme, philosophie, philosophie de la vie, knut hamsun, d. h. lawrence, études littéraires |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 novembre 2010
Ernst Jünger - La civiltà come maschera
Ernst Jünger. La civiltà come maschera
La prima figura in ordine cronologico estrapolabile dai lavori giovanili di Ernst Jünger, (ma probabilmente prima anche per importanza) è quella del soldato. Il combattente nella terra di nessuno, il giovane che in solitudine affronta con invidiabile coraggio le truppe e che osserva con lungimiranza l’affermarsi della guerra dei materiali, è già in grado di assumere una propria posizione ideologica che influenzerà parte della cultura tedesca negli anni a venire. Le azioni e le idee del giovane Ernst (qualunque significato assumano) costituiscono, in questi primi anni, un esempio che verrà trasmesso per mezzo delle opere scritte, alla gioventù tedesca e in particolare alle migliaia di reduci insoddisfatti. Tuttavia nello stesso periodo, agli scritti di guerra Jünger alternerà opere di carattere più marcatamente psicologico, e ciò fino agli inizi degli anni ‘30 quando dando alle stampe Der Arbeiter, concluderà oltre un decennio di studi e riflessioni. Nei paragrafi che seguono ci occuperemo di approfondire l’attività del grande scrittore negli anni del primo dopoguerra.
A diciannove anni i sogni africani di Ernst Jünger sono arrivati dinanzi ad un bivio. «Il tempo dell’infanzia era finito» afferma il giovane Berger, alla fine dell’avventura nella Legione Straniera, si può rimanere, cominciare una vita borghese, fatta di agi, piccole e vecchie corruzioni, o si può continuare non fuggendo ma agendo, per soddisfare una incancellabile voglia di protagonismo e scacciare l’horror vacui della crisi. Forte di queste convinzioni, soltanto un cuore avventuroso avrà il coraggio di raggiungere il fronte, poiché è alla ricerca di uno stile di vita maledettamente non-borghese, di un antidoto alla insoddisfazione, di un ideale per cui battersi fino all’estinzione. Accadrà che nel corso della guerra, il fuoco causerà quattordici ferite al corpo del giovane Ernst, ma il pericolo stesso finirà col correggere l’acerba vitalità della recluta: la Grande guerra trasformerà il giovane tenente in un uomo, ne scolpirà il carattere, permetterà lo sviluppo di un pensiero audace.
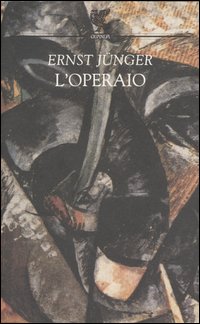 Nel dopoguerra Ernst Jünger, «soffre la pace» e l’inattività, decide di chiudersi in se stesso, e dopo l’elaborazione dei diari di guerra, «butta giù» numerose riflessioni in forma di schizzo che più tardi comporrà in volume, ama leggere gli scrittori «maledetti», autori dallo spirito fortemente irrequieto, poeti e narratori che sente «propri», è alla ricerca di qualcosa e «crede alla fine di trovarla nell’ascesa della politica tedesca a cui prenderà parte». Le riviste nazionaliste lo attraggono, sceglie l’opposizione alla borghesia e al liberalismo e agli inizi degli anni ‘30 pubblica due fra le più importanti opere del primo periodo: Die totale Mobilmachung e Der Arbeiter ove sviluppa le proprie idee frutto degli anni di riflessione e studio. Si tratta di opere che indagano la realtà con sguardo fermo, a volte spinto agli eccessi, ma guidato dall’onestà intransigente dell’ex combattente.
Nel dopoguerra Ernst Jünger, «soffre la pace» e l’inattività, decide di chiudersi in se stesso, e dopo l’elaborazione dei diari di guerra, «butta giù» numerose riflessioni in forma di schizzo che più tardi comporrà in volume, ama leggere gli scrittori «maledetti», autori dallo spirito fortemente irrequieto, poeti e narratori che sente «propri», è alla ricerca di qualcosa e «crede alla fine di trovarla nell’ascesa della politica tedesca a cui prenderà parte». Le riviste nazionaliste lo attraggono, sceglie l’opposizione alla borghesia e al liberalismo e agli inizi degli anni ‘30 pubblica due fra le più importanti opere del primo periodo: Die totale Mobilmachung e Der Arbeiter ove sviluppa le proprie idee frutto degli anni di riflessione e studio. Si tratta di opere che indagano la realtà con sguardo fermo, a volte spinto agli eccessi, ma guidato dall’onestà intransigente dell’ex combattente.
In tutto il primo periodo, Jünger dimostra di poter abbracciare, grazie ad una scrittura facile e dal contenuto sempre «a fuoco», vari temi: è passato, via via, dai resoconti di guerra, alle riflessioni psicologiche e biografiche per approdare infine, negli anni ‘30, al saggio teorico «impersonale». È agevole notare una natura di scrittore «poco regolata», desiderosa di espressione continua per mezzo di forme diverse e in grado di soddisfare una varietà di esigenze mai fissate a priori. Se la guerra lo ha costruito come uomo, il dopoguerra lo costruisce come scrittore, la scrittura viene utilizzata (secondo alcuni critici, in modo assolutamente inconscio) per superare le crisi del combattente e del reduce e le conseguenze psicologiche ad esse legate. Tuttavia se volessimo tentare una lettura organica degli scritti di cui si è detto, si rende opportuna la ricerca di un leitmotiv che percorra tutta l’opera jüngeriana, costituendone, per così dire, una spina dorsale ideale. Date le premesse, questo tentativo facilita la costruzione di basi idonee a liberare il pensiero di Ernst Jünger da quell’indeterminatezza che alcuni hanno evidenziato, accostandolo ad un tempo ad un ben individuato filone intellettuale e politico.
Per Marcel Decombis la ricerca di un solido punto di vista ha, in Ernst Jünger (malgrado la mancanza di uno specifico metodo) «principi assolutamente fissi», postulati da una forza eminentemente rivoluzionaria; vale a dire lo scrittore manifesta nelle proprie opere una volontà di rottura dello status quo coerentemente sostenuta da un atteggiamento negazionista. D’altro canto, Jünger non può essere annoverato tra i pensatori nihilisti: egli manterrebbe infatti un atteggiamento perennemente (anche se simbolicamente) positivo. Affrontando ogni difficoltà ma mai certo della propria sopravvivenza egli ha dimostrato di intendere l’esistenza, descritta prevalentemente nelle forme del diario-romanzo, nei termini di una vita che nasce dalla morte. Questo capovolgimento dottrinario della natura, già utilizzato da Hölderlin ma presente anche in Wagner e Nietzsche, rappresenta un omaggio sia alla viva forza come sostantivo imperituro, sia alla mortalità generatrice come presupposto di un’idea di immortalità. «Penetrato da questa convinzione, Jünger, chiede [...]che si faccia tabula rasa del passato, prima di porre le basi del futuro». Pertanto le durissime, tragiche prove contenute in ogni esistenza, servono soltanto da prologo al compiersi di uno spirito rigeneratore: guerra, caos, anarchia, non possono che rafforzare la volontà di ciò che è già forte, «la distruzione [non può che avere] un effetto creativo». Riassumendo: le crisi degli anni ‘20 conducono all’elaborazione di opere distruttive, prima di crudo realismo, poi di opposizione interiore, la rigenerazione si rivela nell’opera politica degli anni ‘30, quando tutte le difficoltà precedenti assumono la forma di una nuova dottrina.
 Sulla scorta di quanto ha scritto Langenbucher, si può operare un’importante distinzione tra i grandi artisti che presero parte alla guerra nel 1914. Alcuni come George, al momento dello scoppio del conflitto erano adulti, con una personalità formata in pieno e dunque «già carichi di pregiudizi»; altri, Jünger fra questi, erano giovanissimi e molto più adatti a descrivere la nuova esperienza di cui erano così intensamente partecipi; questi ultimi saranno pronti a narrare i trascorsi avvenimenti con una «purezza di intenzioni» che caratterizzerà in modo netto l’intreccio narrativo di numerosissime opere.
Sulla scorta di quanto ha scritto Langenbucher, si può operare un’importante distinzione tra i grandi artisti che presero parte alla guerra nel 1914. Alcuni come George, al momento dello scoppio del conflitto erano adulti, con una personalità formata in pieno e dunque «già carichi di pregiudizi»; altri, Jünger fra questi, erano giovanissimi e molto più adatti a descrivere la nuova esperienza di cui erano così intensamente partecipi; questi ultimi saranno pronti a narrare i trascorsi avvenimenti con una «purezza di intenzioni» che caratterizzerà in modo netto l’intreccio narrativo di numerosissime opere.
Sebbene di diari di guerra, dotati di crudo e visibile realismo, la letteratura del primo dopoguerra abbondi, l’opera di Jünger «è unica nel suo spirito». Decombis individua in essa uno spirito ricco di certezze; i diari jüngeriani sono memorie «spogliate di ogni carattere soggettivo al punto da apparire come dei semplici documenti». In Stahlgewittern è un libro contenente un’elencazione di fatti, spesso identici, che si susseguono nella loro concreta monotonia, è un’opera senza censure, o convenienti omissioni che presenta pagina dopo pagina, un freddo spettacolo di estinzione ed un dietro le quinte fatto di snervante attesa. È il libro che riassume quattro anni di guerra. Das Wäldchen 125 mostra invece un particolare essenziale della lunga esperienza del fronte: la difesa di una postazione di prima linea, è un episodio che in sé riassume la violenza degli attacchi e dei contrattacchi. Feuer und Blut è la narrazione di un giorno al fronte: la controffensiva tedesca del 21 marzo 1918 (evento che Jünger non dimenticherà mai); il soggetto è, dunque, ancora una volta la Grande guerra.
Der Kampf als inneres Erlebnis, può essere considerato un ponte tra le opere narrative di cui si è testé detto ed i lavori successivi. Si apre con essa il periodo di grande riflessione ed elaborazione intellettuale dell’esperienza vissuta. In quest’opera lo scrittore di Heidelberg riflette sul bisogno psicologico di uccidere e sulla distruzione come legge «essenziale» della natura; ma le azioni dell’uomo qui assumono il valore di «flagello necessario» che alimenta un salutare spirito di rinascita. La guerra è «il più potente incontro tra i popoli», ogni principio tra le genti si è affermato attraverso la guerra, essa viene accettata (così come non viene rimosso il ricordo di quattro anni di trincea) perché inevitabile, ed anzi l’accettazione è legata intimamente allo studio delle tecniche di offesa. Una procedura indispensabile per «non rimanere vittima dell’evento», affrontarlo senza soccombere, e dare un’idea di cosa la guerra sia e quale sforzo straordinario il combatterla comporti.
Dunque, a ben vedere, la scelta dello scrittore è di non cantare le lodi della guerra in modo dissennato, bensì di rappresentarla con totalizzante realismo, tentando di ricercarne «un’anima» che possa superare l’emergere delle contraddizioni che la ragione stenta a spiegare. Così egli ha registrato la Materialschlacht, ha convissuto per anni con l’assoluta impotenza del soldato in trincea, ed andando alla ricerca di un proprio «ruolo da protagonista», ha inteso dare alla materialità proprie regole e confini. Jünger accetta la guerra tecnologica («il regno della macchina dinnanzi alla quale il soldato deve annullarsi [...]»), non c’è rimpianto per un passato fatto di eroismi, non c’è insoddisfazione per un presente ove le virtù eroiche non trovano posto; egli ricerca un ordine, un equilibrio tra uomo e macchina, consapevole del ruolo di assoluta importanza che la tecnica occupa, anzi rivolgendo la massima attenzione a quest’ultima, prevedendo già che nuovi comportamenti e nuove mansioni attenderanno l’uomo «prigioniero» della tecnica. Scopriamo cosi uno Jünger materialista che si «sforza di respingere tutte le illusioni dello spirito al fine di ritrovare il linguaggio dei fatti». Tuttavia l’uomo vuole restare «superiore» alla forza potenzialmente distruttiva della tecnica, egli può allora utilizzare quest’ultima come medium per «riaffermare la potenza dell’essere»; così il materialismo, che allontana dalla volontà dello scrittore qualunque superstizione idealista, diviene materia per operare personalissimi adattamenti: la realtà bellica si tramuta in evento estetico ove l’eroismo del singolo convive, in una continua ricerca d’armonia, con lo «strapotere» delle macchine. E poiché Die Maschine ist die in Stahl gegossene Intelligenz eines Volkes, le diverse forze della modernità amano procedere parallelamente.
 In Stahlgewittern è un diario-romanzo pubblicato due anni dopo la fine della grande guerra. Come si è detto, costituisce la non breve ouverture di oltre ottant’anni di continua produzione letteraria; per anni la critica, a causa dei contenuti e delle intenzioni del giovane autore, la etichetterà come l’opera principe dell’anti-Remarque della cultura europea. Protagonista unico del libro è il Soldato-Jünger che sconosce le decisioni prese dai superiori e soprattutto le motivazioni di largo respiro strategico delle azioni intraprese. La guerra viene rappresentata in modo parziale attraverso gli occhi del protagonista, l’opera descrive dunque soltanto l’evento in quanto evento e non fatto storico che porta con sé, innumerevoli risvolti e significati. Kaempfer vi ha scorto una lettura degli eventi bellici di comodo, data cioè una tesi aprioristica, l’intreccio narrativo si svilupperebbe con l’intento unico di confermarla, omettendo i dati che con essa contrasterebbero. D’altra parte Prümm ha visto in questo approccio un filo conduttore dell’opera jüngeriana: l’accettazione della realtà in quanto oggetto «che si sviluppa indipendentemente dal singolo individuo». Di conseguenza secondo alcune tesi abbastanza diffuse, vero protagonista dell’opera non si rivelerebbe il soggetto scrivente, bensì un oggetto:
In Stahlgewittern è un diario-romanzo pubblicato due anni dopo la fine della grande guerra. Come si è detto, costituisce la non breve ouverture di oltre ottant’anni di continua produzione letteraria; per anni la critica, a causa dei contenuti e delle intenzioni del giovane autore, la etichetterà come l’opera principe dell’anti-Remarque della cultura europea. Protagonista unico del libro è il Soldato-Jünger che sconosce le decisioni prese dai superiori e soprattutto le motivazioni di largo respiro strategico delle azioni intraprese. La guerra viene rappresentata in modo parziale attraverso gli occhi del protagonista, l’opera descrive dunque soltanto l’evento in quanto evento e non fatto storico che porta con sé, innumerevoli risvolti e significati. Kaempfer vi ha scorto una lettura degli eventi bellici di comodo, data cioè una tesi aprioristica, l’intreccio narrativo si svilupperebbe con l’intento unico di confermarla, omettendo i dati che con essa contrasterebbero. D’altra parte Prümm ha visto in questo approccio un filo conduttore dell’opera jüngeriana: l’accettazione della realtà in quanto oggetto «che si sviluppa indipendentemente dal singolo individuo». Di conseguenza secondo alcune tesi abbastanza diffuse, vero protagonista dell’opera non si rivelerebbe il soggetto scrivente, bensì un oggetto:
-L’immagine dei corpi straziati, vale a dire la cruda realtà dei morti giacenti sulla superficie delle campagne.
Ovvero uno spirito-guida:
-Il respiro della battaglia che aleggia intorno alle truppe.
In proposito, scrive Jünger:
«Cresciuti in tempi di sicurezza e tranquillità tutti sentivamo l’irresistibile attrattiva dell’incognito, il fascino dei grandi pericoli [...] la guerra ci avrebbe offerto grandezza, forza, dignità. Essa ci appariva azione da veri uomini [...]» Accenti forti, espressi anni prima in terra francese anche da F.T. Marinetti, accenti forti ma così poco inusuali nella storia delle moderne nazioni. Pertanto In Stahlgewittern, concesse al lettore poche battute iniziali, mostra senza perifrasi, le vere conseguenze dei conflitti moderni: primo inverno di guerra, Champagne, villaggio di Orainville, un bombardamento, tredici vittime, una strada arrossata da larghe chiazze di sangue e la morte violenta che rimescola i colori della natura. Segue il terribile resoconto di una forzata convivenza con la morte e con le azioni di belliche, ove «l’orrore della guerra viene estetizzato in incantesimo demonico e trasfigurato in veicolo estetico di accesso ad una sfera superiore [...]».
La vita comincia al crepuscolo in trincea e continua nelle buche scavate nel calcare e coperte di sterco. Si combatte una guerra di posizione che richiede un davvero difficile eroismo tanto da lasciare poco spazio alle illusioni: l’importante non è la potenza o la solidità delle trincee, ma il coraggio e l’efficienza degli uomini che le occupano. Bohrer sostiene che la rappresentazione dell’orrore in Ernst Jünger, serve a fornire della guerra una «immagine critica», vale a dire l’estetizzazione della stessa sarebbe il solo metodo in grado di darne un’idea reale. D’altro canto, la realtà medesima della guerra diviene realtà «superiore» poiché ogni valore e modello tradizionale è stato da lungo tempo dimenticato.
 La scoperta della battaglia dei materiali è l’evento cardine nel processo di formazione delle idee jüngeriane: il valore individuale è annullato dallo strapotere della tecnica. La meccanizzazione della guerra e le conseguenze che ne discendono, sono comprese dal Soldato in tutta la loro forza epocale. È la controffensiva inglese sulla Somme a segnare la fine di un primo periodo di guerra e l’esordio di un nuovo tipo. Questo registra le battaglie dei materiali e subentra col suo gigantesco spiegamento di mezzi, al «tentativo di vincere la guerra con battaglie condotte alla vecchia maniera, tentativo inesorabilmente finito nella snervante guerra di posizione». Già Spengler aveva capito come il valore e il ruolo dell’individuo sarebbero stati ridotti dall’andamento della guerra moderna; ma dalla sua prospettiva Jünger continua ad insistere sulle capacità del soldato, sforzandosi di dare ai compiti del combattente un accento da molti considerato irresponsabile. Tuttavia l’ideale eroico prussiano che Jünger manifesta nel suo diario, sconta anch’esso una lettura di tipo “psicanalitico”. Si tratterebbe, a parere di alcuni, di un tentativo di fuga dal mondo reale, ove il Soldato è costretto ad affrontare gli echi del destino simboleggiati dal Trommelfeuer. L’eroismo diviene la necessità o il calcolo razionale di chi ha pochissimo spazio per combattere una propria guerra, e finisce col dissimulare azioni e comportamenti necessari dettati da tempi meccanici fuori da ogni controllo.
La scoperta della battaglia dei materiali è l’evento cardine nel processo di formazione delle idee jüngeriane: il valore individuale è annullato dallo strapotere della tecnica. La meccanizzazione della guerra e le conseguenze che ne discendono, sono comprese dal Soldato in tutta la loro forza epocale. È la controffensiva inglese sulla Somme a segnare la fine di un primo periodo di guerra e l’esordio di un nuovo tipo. Questo registra le battaglie dei materiali e subentra col suo gigantesco spiegamento di mezzi, al «tentativo di vincere la guerra con battaglie condotte alla vecchia maniera, tentativo inesorabilmente finito nella snervante guerra di posizione». Già Spengler aveva capito come il valore e il ruolo dell’individuo sarebbero stati ridotti dall’andamento della guerra moderna; ma dalla sua prospettiva Jünger continua ad insistere sulle capacità del soldato, sforzandosi di dare ai compiti del combattente un accento da molti considerato irresponsabile. Tuttavia l’ideale eroico prussiano che Jünger manifesta nel suo diario, sconta anch’esso una lettura di tipo “psicanalitico”. Si tratterebbe, a parere di alcuni, di un tentativo di fuga dal mondo reale, ove il Soldato è costretto ad affrontare gli echi del destino simboleggiati dal Trommelfeuer. L’eroismo diviene la necessità o il calcolo razionale di chi ha pochissimo spazio per combattere una propria guerra, e finisce col dissimulare azioni e comportamenti necessari dettati da tempi meccanici fuori da ogni controllo.
In tutto il resoconto c’è un’impronta magico-fiabesca, una coincidenza degli opposti, che unisce all’esplosione di forze elementari una continua ricerca della quiete cosmica: la battaglia viene sovente destorizzata e calata in una superficie mitica, al di sotto della quale la scrittura jüngeriana edifica possenti colonne, così si legge infatti: «La guerra aveva dato a questo paesaggio [davanti al canale di Saint Quentin] un’impronta eroica e malinconica». In mezzo ai colori della natura «anche un’anima semplice sente che la sua vita assume una profonda sicurezza e che la sua morte non è la fine».
Il tentativo di esorcizzare la guerra, minimizzando gli eventi tragici e costruendo a propria difesa un mondo magico, condurrebbe in tal modo Jünger alla creazione di figure irreali, è questo il caso dell’immagine classica dell’eroe immortale, immerso nella contemplazione di una natura amica. D’altra parte anche l’amatissima letteratura apparirebbe, e non di rado, come incredibile via di fuga. Scrive Jünger, durante un assalto:
«L’elmetto calato sulla fronte, mordevo il cannello della pipa, fissando la strada, dove le pietre lanciavano scintille all’urto con le schegge di ferro; tentai con successo di farmi filosoficamente coraggio. Stranissimi pensieri mi venivano alla mente. Mi preoccupai di un romanzo francese da quattro soldi, Le vautour de la Sierra, che mi era capitato fra le mani a Cambrai. Mormorai più volte una frase dell’Ariosto: “Una grande anima non ha timore della morte, in qualunque istante arrivi, purché sia gloriosa!” Ciò mi dava una specie di gradevole ebbrezza, simile a quella che si prova volando sull’altalena al luna park. Quando gli scoppi lasciarono un po’ in pace i nostri orecchi, udii accanto a me risuonare le note di una bella canzone: la Balena nera ad Ascalona; pensai tra me che il mio amico Kius era impazzito. A ciascuno il suo spleen».
La guerra diventa strumento di intima e eterna vittoria, epifania dell’arte. L’uomo Jünger, traghetta il guerriero in un kunstwald: i pensieri fanno da sfondo ad una tragedia che conosce un’eroica, ma mai sinistra, tristezza. Repentinamente lo sguardo indagatore si affaccia a scrutare gli abissi della guerra ove la passione umana trascolora all’urto di invincibili forze ctonie, leggiamo: «È una sensazione terribile quella che vi si insinua nell’animo quando vi trovate ad attraversare, in piena notte, una posizione sconosciuta, anche se il fuoco non è particolarmente nutrito; l’occhio e l’orecchio del soldato tra le pareti minacciose della trincea sono messe in allarme dai fatti più insignificanti: tutto è freddo e repellente come in un mondo maledetto». Il mondo maledetto è forse soltanto l’arena della tecnica e delle tecniche di guerra? Osservato dalla trincea, il Welt jüngeriano assume i contorni della fabbrica. Compiuto da schiavi-stregoni, l’apprendistato diventa giorno dopo giorno, utilizzo produttivo della paura: la fusione dei materiali in forze onnipotenti.
 Lo spirito-guida, la battaglia che non concede vere soste, non cessa di essere protagonista: quando nei primi mesi del 1918, si parla di una immensa offensiva sull’intero fronte occidentale, annota Jünger: «La battaglia finale, l’ultimo assalto sembravano ormai arrivati, lì si gettava sulla bilancia il destino di due interi popoli; si decideva l’avvenire del mondo». La micro-storia di alcuni villaggi di confine, assurge a Macro-storia, la tragedia a Schicksal di un’epoca. Decisione e azione si trasmutano nel faro ideologico degli anni a venire. La guerra indagata con sguardo lungimirante sarà prologo e continuazione di una ventennale politica europea. In definitiva: le aspre reazioni emotive (i «lati oscuri» jüngeriani) emerse dall’animo umano quali effetti avranno sulla ripresa della quotidianità nel dopoguerra? La «rivincita del brutale sul sentimentale» come ha scritto Decombis, quali effetti avrà sugli anni a venire? L’idea che rimane è che la guerra abbia riscoperto ciò che persiste immutabile nell’animo umano: gli istinti primitivi, allo stesso modo il fuoco ha rimosso quella sottile vernice che ricopriva il fondo della natura umana. Nel corso di quattro indimenticabili anni essa ha strappato la maschera della civiltà permettendo all’uomo di apparire nella sua armonica totalità.
Lo spirito-guida, la battaglia che non concede vere soste, non cessa di essere protagonista: quando nei primi mesi del 1918, si parla di una immensa offensiva sull’intero fronte occidentale, annota Jünger: «La battaglia finale, l’ultimo assalto sembravano ormai arrivati, lì si gettava sulla bilancia il destino di due interi popoli; si decideva l’avvenire del mondo». La micro-storia di alcuni villaggi di confine, assurge a Macro-storia, la tragedia a Schicksal di un’epoca. Decisione e azione si trasmutano nel faro ideologico degli anni a venire. La guerra indagata con sguardo lungimirante sarà prologo e continuazione di una ventennale politica europea. In definitiva: le aspre reazioni emotive (i «lati oscuri» jüngeriani) emerse dall’animo umano quali effetti avranno sulla ripresa della quotidianità nel dopoguerra? La «rivincita del brutale sul sentimentale» come ha scritto Decombis, quali effetti avrà sugli anni a venire? L’idea che rimane è che la guerra abbia riscoperto ciò che persiste immutabile nell’animo umano: gli istinti primitivi, allo stesso modo il fuoco ha rimosso quella sottile vernice che ricopriva il fondo della natura umana. Nel corso di quattro indimenticabili anni essa ha strappato la maschera della civiltà permettendo all’uomo di apparire nella sua armonica totalità.
00:10 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, ernst jünger, révolution conservatrice, années 20, années 30, philosophie, weimar |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 novembre 2010
Il fascino eterno della femme fatale
Il fascino eterno della femme fatale
Mario Bernardi Guardi
Ex: http://www.mirorenzaglia.org/
 “Non lo fo per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio”, garantivano in rima baciata i camicioni da notte delle nostre trisavole. E diamo pure per buoni pudori e rossori di quelle spose e madri esemplari: ma non ci si venga a dire che tutte le signore dello stupido XIX secolo, con novecentesche appendici, erano così devote e vereconde. Non lo era sicuramente la celeberrima contessa di Castiglione, cugina di Cavour, e scelta dal conte per convincere Napoleone III a scendere a fianco dei piemontesi nella guerra contro l’Austria. Lei, «bocca sdegnosa, occhi grigi dal fascino inesplicabile» non se lo fece ripetere due volte e «in una camera tappezzata di Damasco di seta azzurra del castello di Compiegne» lo sedusse, convertendolo alla buona causa del patriottismo italico. Ma così come non era mai stata fedele al marito, «un ingenuo galantuomo ingannato ‘prima, durante e dopo’, non si consacrò certo a un esclusivo amore imperiale e concesse lo stropicciato fiore della sua (poca) virtù a una numerosa schiera di amanti, non disdegnando l’amore mercenario. Visto che per una notte di fuoco chiese a Lord Hertford un milione di franchi. Va detto anche che la vocazione libertina della nostra contessa era ben nota. Tanto è vero che un gentiluomo della corte di Napoleone, vedendola succhiare un sorbetto di fiori d’arancio, le chiese in tono pesantemente allusivo: “Le piace succhiare, contessa?”, e lei rispose ridendo: “Dipende da cosa…”».
“Non lo fo per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio”, garantivano in rima baciata i camicioni da notte delle nostre trisavole. E diamo pure per buoni pudori e rossori di quelle spose e madri esemplari: ma non ci si venga a dire che tutte le signore dello stupido XIX secolo, con novecentesche appendici, erano così devote e vereconde. Non lo era sicuramente la celeberrima contessa di Castiglione, cugina di Cavour, e scelta dal conte per convincere Napoleone III a scendere a fianco dei piemontesi nella guerra contro l’Austria. Lei, «bocca sdegnosa, occhi grigi dal fascino inesplicabile» non se lo fece ripetere due volte e «in una camera tappezzata di Damasco di seta azzurra del castello di Compiegne» lo sedusse, convertendolo alla buona causa del patriottismo italico. Ma così come non era mai stata fedele al marito, «un ingenuo galantuomo ingannato ‘prima, durante e dopo’, non si consacrò certo a un esclusivo amore imperiale e concesse lo stropicciato fiore della sua (poca) virtù a una numerosa schiera di amanti, non disdegnando l’amore mercenario. Visto che per una notte di fuoco chiese a Lord Hertford un milione di franchi. Va detto anche che la vocazione libertina della nostra contessa era ben nota. Tanto è vero che un gentiluomo della corte di Napoleone, vedendola succhiare un sorbetto di fiori d’arancio, le chiese in tono pesantemente allusivo: “Le piace succhiare, contessa?”, e lei rispose ridendo: “Dipende da cosa…”».
Donne, donne eterni dèi! E davvero fascinose, voluttuose, vampiresche divinità sciupamaschi sono quelle (ventidue, tra grandi dame, grandi cortigiane, attrici, muse ispiratrici, intellettuali salottiere e militanti ecc.) ritratte da Giuseppe Scaraffia in un libro uscito l’anno scorso, ma che, in questo delirio di escort piuttosto sgraziate, volgarotte e urlanti da cui siamo afflitti, può essere recuperato, a insegna di altri tempi e altre, più eleganti e galanti, atmosfere (Femme fatale, Vallecchi, pp.175, euro 15).
Andiamo di fiore in fiore. Cristina di Belgioioso, avvezza a ricevere gli spasimanti «in un salotto tappezzato di velluto scuro ricamato di stelle d’argento» dove si mostrava mollemente «allungata su un sofà vicino a un narghilè, la testa incoronata di fucsie, il suo fiore preferito», era tanto sicura di sé da dividere gli uomini in tre categorie: «Mi ama, mi ha amato, mi amerà». E la amarono, tra alterne vicende, Balzac, Bellini, Heine, Liszt e de Musset. Non fece in tempo ad amarla, invece, il garibaldino Goffredo Mameli che, ferito mentre combatteva contro i francesi sul Gianicolo, spirò tra le braccia di Cristina, mentre lei gli sussurrava “Fratelli d’Italia”.
Sciupamaschi d’eccezione fu anche l’attrice Sarah Bernhardt di cui si diceva che dormisse «in una bara di raso bianco, tra una funebre abbondanza di fiori». Ma anche che dietro i suoi pallori anoressici occultasse bulumici appetiti: in pubblico rifiutava sdegnosamente il cibo, ma solo dopo essersi «rimpinzata coscienziosamente» in privato. La amarono, a lei si ispirarono, per lei si entusiasmarono Hugo, Proust, James, Rostand, Lawrence, Shaw: chissà se sapevano che la Divina «nei periodi di penuria non esitava a prostituirsi per congrue cifre, come testimoniano le note della polizia parigina».
Anche Jeanne Duval, la creola «bruna come la notte», la «strega dai fianchi d’ebano», che ammaliò il bello, dannato e fragilissimo Baudelaire, era adusa a procurarsi i soldi nei modi più spregiudicati. E amava troppo «bere e fare l’amore» per recitar la parte della Musa devota e dell’amante fedele. Lui, ovviamente, pativa, implorava, malediceva. Ma, cotto com’era, continuava a venerare quella mulatta ignorante che se ne fregava dei suoi versi. «Anche quando cammina si direbbe che danzi», scriveva trasognato. E dopo aver beccato la sifilide.
Fior di danzatrice e “femme fatale” per eccellenza fu Mata Hari che diceva di essere nata nel sud dell’India, figlia di un bramino e di una baiadera. Quel nome esotico, aggiungeva, significa “pupilla dell’aurora”. Fosse vero o meno, quando appariva in palcoscenico, «ondeggiando sinuosamente sotto i veli che la nascondevano e la rivelavano», il pubblico andava in estasi e immergeva lo sguardo goloso in quel corpo che, tentatore, si arrotolava e si srotolava, fino a lasciarsi scivolare a terra, spossato, coperto soltanto da un minuscolo “cache-seins” e, sul pube, da un invitante triangolino tempestato di pietre preziose. Anche lei fu amata e venerata. Nell’aureo “carnet”, tra gli altri, Céline e Filippo Tommaso Marinetti. E un appuntamento con la morte, la mattina del 15 ottobre 1917. Fucilata dai francesi con l’accusa di spionaggio a favore degli Imperi Centrali. Ma gli elementi a suo carico erano ridicoli e inconsistenti. Forse, più che la spia, chi la condannò volle ammazzare la “femme fatale”. Che bella morte, però. Che stile. Che movimenti eleganti e ondulati da magnifica pantera non profanata dalla prigionia. E che concede un’ultima rappresentazione: «Si lasciò docilmente legare al palo. I due gendarmi le fecero una legatura finta, da teatro, da cui si sarebbe potuta liberare facilmente, ma non lo fece. Non doveva uscire dalla parte che la storia le aveva assegnato. Guardò negli occhi il comandante del plotone: “Monsieur, vi ringrazio”. Non volle che le bendassero gli occhi. Mata Hari non significava ‘luce del mattino’?».
MARIO BERNARDI GUARDI
00:10 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, femme fatale, féminité, féminisme, antiféminisme, philosophie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 novembre 2010
Mishima 1970-2010: la distruzione dell'ideologia occidentale
di Aldo Braccio
Fonte: cpeurasia
“Non chiedo nulla. La sola cosa che desidero è che una di queste mattine, mentre i miei occhi sono ancora chiusi, il mondo intero cambi”
(Yukio Mishima)
Assieme al fedele Masakatsu Morita, il 25 novembre di quarant’anni fa Yukio Mishima poneva volontariamente fine alla sua vita compiendo seppuku, dopo avere inutilmente spronato alla ribellione la guarnigione di Ichigatani.
Nel Proclama letto pochi istanti prima della fine, egli sottolineava i motivi del suo gesto : “Abbiamo veduto il Giappone del dopoguerra rinnegare, per l’ossessione della prosperità economica, i suoi stessi fondamenti, perdere lo spirito nazionale, correre verso il nuovo senza volgersi alla tradizione, piombare in una utilitaristica ipocrisia (…) Avete tanto cara la vita da sacrificarle l’esistenza dello spirito ? Che sorta di esercito è mai questo, che non concepisce valore più nobile della vita ? Noi ora testimonieremo a tutti voi l’esistenza di un valore più alto del rispetto per la vita. Questo valore non è la libertà, non è la democrazia. E’ il Giappone”.
***
La lezione della vita e dell’intera opera di Mishima si compendia nell’irriducibile e completo rifiuto dell’americanizzazione/occidentalizzazione del mondo, a partire naturalmente dal Giappone. Non è tanto o soltanto una prospettiva politica : in un’intervista concessa proprio nel 1970 l’autore del Mare della fertilità affermava : “Io sono ancora antipolitico : quello che voglio fare ora è un movimento per la giustizia”; ancora un antipolitico : e pensava evidentemente alla “politica politicante”, alle false dicotomie del tipo destra/sinistra che il Giappone aveva importato dal mondo occidentale.
Egli perseguiva invece, prima di tutto, una disciplina antropologica inattuale, che combina armonicamente corpo, anima e spirito contro la dissociazione e la frammentazione moderna : la pratica del kendo, magistralmente esposta in Cavalli in fuga, e quella della cultura del corpo di Sole e acciaio ne sono due esempi, fra i tanti disponibili nella sua opera.
Il mondo americano-occidentale della globalizzazione è unidimensionale, meramente orizzontale, non riconosce il valore complesso e profondo della personalità umana – non comprende cosa sia il Sacro, e come il corpo stesso possa essere funzionale a una realizzazione spirituale.
“Il linguaggio della carne è la vera antitesi delle parole”, afferma in Sole e acciaio. Non è un’espressione retorica, è necessario uscire dagli schemi mentali ed esistenziali consueti.
Tutto in Mishima è funzionale alla ricerca dell’Assoluto, anche l’erotismo, “metodo per raggiungere la divinità attraverso il peccato”, anche l’amore, nella sua accezione più vera : “L’amore non può esistere in una società moderna. Se non interviene l’immagine di una terza figura in comune, ossia il vertice del triangolo, l’amore sfocia in perpetuo scetticismo”, ossia nell’agnosticismo.
***
L’Assoluto è rappresentato dall’Imperatore, la modernità è relativista.
La cultura, che nel Paese del Sol Levante è innanzitutto forma e stile di vita, “favorisce il carattere di continuità e di ritorno, ed è proprio questo che chiamiamo Tradizione” (Saggio in difesa della cultura, 1969). Mishima è estraneo a infatuazioni di tipo ideologico, ed è questo un altro tratto differenziale dal nostro Occidente moderno; è, piuttosto, preideologico, e ostile alla globalizzazione del pensiero : “L’idea astratta di una cultura universale, di una cultura del genere umano, è per lo meno contestabile”.
D’altra parte, la cultura per essere tale deve essere vissuta, “abbraccia tanto le opere d’arte quanto le azioni e i modelli dell’agire” : una cultura integrale.
***
Il nostro occhio si è fatto grezzo, quello di Mishima è un occhio totale, che esplora e illumina corrispondenze e sovrapposizioni, che rende un senso alle molteplici esperienze umane.
Il mondo della Bellezza senza scopo utilitario e quello della giovinezza che è ingenuità disinteressata e può protrarsi nel tempo – quando è incurante del tempo – sono colti nella loro valenza essenziale. L’equivoco che attanaglia l’Occidente è quello della modernità, nell’epoca dell’individualismo borghese e della predazione capitalista
.“Quanto più una nazione tende a modernizzarsi, tanto più i rapporti individuali diventano freddi e anonimi, perdono significato”, sottolineava Mishima in un’intervista del 1968.
La modernità è sterile, bandisce il sacrificio e il senso di responsabilità per seguire la moda, il facile, il provvisorio. I rapporti personali, invece, acquistano significato e verità solo quando si consacrano a valori o sentimenti che trascendono i frammenti di vita individuale.
***
“Non importa cadere.
Prima di tutto.
Prima di tutti.
E’ proprio del fior di ciliegio
cadere nobilmente
in una notte di tempesta”
Sono versi di Mishima che sarebbe facile ricondurre a un malinteso e umbratile “culto della morte”, e che invece rappresentano la serenità del samurai di fronte alla conclusione della pagina terrena : vita e morte vanno rispettate ma non messe parossisticamente al di sopra di tutto, vanno accettate per quello che sono e non sprecate, utilizzate nobilmente … in vista dell’Assoluto.
Una dimensione, questa, spesso incompresa e – come si accennava all’inizio – irriducibile all’ideologia occidentale, quale irradiatasi dagli Stati Uniti d’America all’intero pianeta e diventata quotidiana banalità ai nostri giorni.
Mishima – che nella sua vita fu, a più riprese, esploratore/viaggiatore aperto al mondo – rispettava e distingueva nettamente le altre civiltà dalle loro contraffazioni artificiali imposte dalla globalizzazione. L’Europa, ad esempio, è altro rispetto alla sua contraffazione moderna : “La mia Europa è un mondo basato sulla struttura. Una struttura architettonica, ad archi. L’arco è stato inventato in Europa. La metà di un arco non può reggersi da sola, la metà sinistra regge la destra mantenendo un saldo equilibrio. I miei drammi e i miei romanzi sono proprio così, sostenuti da una struttura ad archi”.
Costruire questa struttura, ricostituire l’armonia fra sé e il mondo. Per tutta la vita Yukio Mishima ha operato con questo intendimento, non solo nella sua straordinaria opera letteraria ma anche nel suo cammino esistenziale.
Il 25 novembre 1970 decise che l’equilibrio era stato raggiunto. “La vita è così breve, e io vorrei viverla per sempre”, aveva detto sorridendo – ma, oltre la vita, aveva rimosso il limite, e trovato l’Assoluto.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, lettres, lettres japonaises, littérature japonaise, japon, mishima, occident, occidentalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
F. Sieburg: "Die Lust am Untergang"
Friedrich Sieburg: „Die Lust am Untergang“ – eine Rezension
Ellen KOSITZA
Friedrich Sieburg: Die Lust am Untergang. Selbstgespräche auf Bundesebene.
Mit einem Vorwort und einem Nachwort von Thea Dorn
Frankfurt a.M.: Eichborn 2010. 418 S., 32 €
 Friedrich Sieburg (1893–1964) war der Edelstein, ja: ein Solitär der nichtlinken Nachkriegspublizistik. Wegen seiner unklaren Rolle in der NS-Zeit war er bis 1948 mit einem Publikationsverbot belegt. Wolf Jobst Siedler titulierte den konservativen Essayisten und Literaturkritiker der Nachkriegszeit einmal als »linksschreibenden Rechten«. Sieburg war ein brillanter Stilist, seine Feder und Gedanken von einer gleichsam elastischen Gespanntheit; polternde Polemik war ebensowenig seine Sache wie der langweilig-dogmatische Duktus herkömmlicher Konservativer. Weniger aus Sturheit denn mit würdiger Gelassenheit pflegte er sich zwischen jene Stühle zu setzen, die die gesellschaftliche Nachkriegsordnung bereithielt. Die großen Namen seiner Zeit zogen teils den Hut vor seinem Scharfsinn (Thomas Mann schrieb in seinem Tagebuch, Die Lust am Untergang erinnere ihn an seine Betrachtungen eines Unpolitischen), andere zahlten ihm harsch zurück, was er austeilte: Kein anderer Literaturkritiker ging so erbarmungslos wie Sieburg mit den Vertretern der Gruppe 47 ins Gericht.
Friedrich Sieburg (1893–1964) war der Edelstein, ja: ein Solitär der nichtlinken Nachkriegspublizistik. Wegen seiner unklaren Rolle in der NS-Zeit war er bis 1948 mit einem Publikationsverbot belegt. Wolf Jobst Siedler titulierte den konservativen Essayisten und Literaturkritiker der Nachkriegszeit einmal als »linksschreibenden Rechten«. Sieburg war ein brillanter Stilist, seine Feder und Gedanken von einer gleichsam elastischen Gespanntheit; polternde Polemik war ebensowenig seine Sache wie der langweilig-dogmatische Duktus herkömmlicher Konservativer. Weniger aus Sturheit denn mit würdiger Gelassenheit pflegte er sich zwischen jene Stühle zu setzen, die die gesellschaftliche Nachkriegsordnung bereithielt. Die großen Namen seiner Zeit zogen teils den Hut vor seinem Scharfsinn (Thomas Mann schrieb in seinem Tagebuch, Die Lust am Untergang erinnere ihn an seine Betrachtungen eines Unpolitischen), andere zahlten ihm harsch zurück, was er austeilte: Kein anderer Literaturkritiker ging so erbarmungslos wie Sieburg mit den Vertretern der Gruppe 47 ins Gericht.
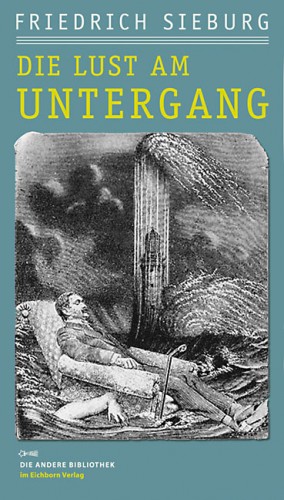 Man mag nicht glauben, daß 56 Jahre seit der Erstveröffentlichung des vorliegenden Bandes vergangen sind! Die Fragen, denen Sieburg sich hier in neun Kapiteln (etwa »Die Kunst, Deutscher zu sein«, »Vom Menschen zum Endverbraucher«) widmet, lesen sich nicht als Rückblick auf Gefechte von gestern. Sie sind noch ebensogut unsere Themen: Identitätssuche, Vergangenheitsbewältigung, Konsumwahn, die Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Auch wo seine Angelegenheiten einmal der unmittelbaren Aktualität entbehren – etwa in seiner bemerkenswerten Replik auf Curzio Malaparte (d.i. K.E. Suckert) oder in seinen Einlassungen zum Verlust der Ostgebiete – nickt man staunend. Ohne Twitter oder Ryan Air gekannt zu haben, spottet Sieburg über »das Management des Vergnügens«, die »Mechanisierung der Freizeit«. Er meinte damit – wie bescheiden aus heutiger Warte! – »Betriebsausflüge an den Comer See« und Klassenfahrten in die Alpen. »Der Vorschlag, die Kinder sollten an der Nidda Blumen suchen, würde heute auf allen Seiten große Heiterkeit hervorrufen.« Für Sieburg waren die Deutschen »ein Volk ohne Mitte«: »Im Deutschen, so glaubte die Welt gestern noch, ist mehr Explosivstoff angehäuft als in jedem anderen Erdenbewohner. Hat sich diese Ansicht geändert, sind beim Anblick des fleißigen und lammfrommen Bundesdeutschen, der sogar den Karneval straff organisiert und wirtschaftsbewußt dem Konsum dienstbar macht, der das Wort Europa dauernd im Mund führt, (…) den kein Aufmarsch mit Fahnen mehr aus seinem Wochenendhaus, seinem Faltboot und Volkswagen herauslocken kann, der nur noch zu den Vertretern versunkener Fürstenhäuser und zu Filmstars aufschaut, der einen harmonischen Bund zwischen Preußentum und Nackenfett eingegangen ist, (…) der vom Golf von Neapel bis zum Nordkap die schnellsten Wagen fährt, sich in Capri bräunen läßt (…), der sich aus Ordnungssinn mit der abstrakten Kunst und dem Nihilismus beschäftigt – sind, so frage ich, beim Anblick dieses Musterknaben, der sich in der Schule der Demokratie zum Primus aufarbeitet, alle Ängste und mißtrauische Befürchtungen verschwunden? Ich antworte, nein.«
Man mag nicht glauben, daß 56 Jahre seit der Erstveröffentlichung des vorliegenden Bandes vergangen sind! Die Fragen, denen Sieburg sich hier in neun Kapiteln (etwa »Die Kunst, Deutscher zu sein«, »Vom Menschen zum Endverbraucher«) widmet, lesen sich nicht als Rückblick auf Gefechte von gestern. Sie sind noch ebensogut unsere Themen: Identitätssuche, Vergangenheitsbewältigung, Konsumwahn, die Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Auch wo seine Angelegenheiten einmal der unmittelbaren Aktualität entbehren – etwa in seiner bemerkenswerten Replik auf Curzio Malaparte (d.i. K.E. Suckert) oder in seinen Einlassungen zum Verlust der Ostgebiete – nickt man staunend. Ohne Twitter oder Ryan Air gekannt zu haben, spottet Sieburg über »das Management des Vergnügens«, die »Mechanisierung der Freizeit«. Er meinte damit – wie bescheiden aus heutiger Warte! – »Betriebsausflüge an den Comer See« und Klassenfahrten in die Alpen. »Der Vorschlag, die Kinder sollten an der Nidda Blumen suchen, würde heute auf allen Seiten große Heiterkeit hervorrufen.« Für Sieburg waren die Deutschen »ein Volk ohne Mitte«: »Im Deutschen, so glaubte die Welt gestern noch, ist mehr Explosivstoff angehäuft als in jedem anderen Erdenbewohner. Hat sich diese Ansicht geändert, sind beim Anblick des fleißigen und lammfrommen Bundesdeutschen, der sogar den Karneval straff organisiert und wirtschaftsbewußt dem Konsum dienstbar macht, der das Wort Europa dauernd im Mund führt, (…) den kein Aufmarsch mit Fahnen mehr aus seinem Wochenendhaus, seinem Faltboot und Volkswagen herauslocken kann, der nur noch zu den Vertretern versunkener Fürstenhäuser und zu Filmstars aufschaut, der einen harmonischen Bund zwischen Preußentum und Nackenfett eingegangen ist, (…) der vom Golf von Neapel bis zum Nordkap die schnellsten Wagen fährt, sich in Capri bräunen läßt (…), der sich aus Ordnungssinn mit der abstrakten Kunst und dem Nihilismus beschäftigt – sind, so frage ich, beim Anblick dieses Musterknaben, der sich in der Schule der Demokratie zum Primus aufarbeitet, alle Ängste und mißtrauische Befürchtungen verschwunden? Ich antworte, nein.«
Sieburg, der Frankophile, liebte seine Heimat und litt an ihr, an diesem Volk, das sich nun in einer
 Müdigkeit und Geschichtslosigkeit zeige, »die mit einer nie dagewesenen Nüchternheit« gepaart sei. »Nur der Deutsche schwärzt seinen Landsmann bei Fremden an, nur der Deutsche verständigt sich lieber mit einem Exoten als mit einem politischen Gegner eigenen Stammes (…), nur der Deutsche verleugnet Flagge, Hymne und Staatsform des Mutterlandes vor Dritten.« Als »dümmstes Schlagwort« seiner Zeit erschien dem Publizisten der schon damals opportune Vorwurf, »restaurative Tendenzen« zu befördern. Alles Große, Geniale, das Heldenhafte ohnehin, dessen die Deutschen einst fähig waren, werde nun verhöhnt und gegeißelt unter dem Vorwand, »daß die alten Zeiten nicht wiederkommen dürfen«. Ja, und wie furchtbar war auch der »deutsche Spießer!« Allerdings, so Sieburg, sei zu befürchten, daß der Spießer in neuem Gewand, nämlich mit »heraushängendem Hemd« nach US-Vorbild wiedergekehrt sei, und daß die »Vorurteilslosigkeit in der Kleidung, im Umgang mit dem anderen Geschlecht und den Nerven der Mitmenschen nicht eine höhere sittliche Freiheit und einen souveränen Geist« mit sich führe.
Müdigkeit und Geschichtslosigkeit zeige, »die mit einer nie dagewesenen Nüchternheit« gepaart sei. »Nur der Deutsche schwärzt seinen Landsmann bei Fremden an, nur der Deutsche verständigt sich lieber mit einem Exoten als mit einem politischen Gegner eigenen Stammes (…), nur der Deutsche verleugnet Flagge, Hymne und Staatsform des Mutterlandes vor Dritten.« Als »dümmstes Schlagwort« seiner Zeit erschien dem Publizisten der schon damals opportune Vorwurf, »restaurative Tendenzen« zu befördern. Alles Große, Geniale, das Heldenhafte ohnehin, dessen die Deutschen einst fähig waren, werde nun verhöhnt und gegeißelt unter dem Vorwand, »daß die alten Zeiten nicht wiederkommen dürfen«. Ja, und wie furchtbar war auch der »deutsche Spießer!« Allerdings, so Sieburg, sei zu befürchten, daß der Spießer in neuem Gewand, nämlich mit »heraushängendem Hemd« nach US-Vorbild wiedergekehrt sei, und daß die »Vorurteilslosigkeit in der Kleidung, im Umgang mit dem anderen Geschlecht und den Nerven der Mitmenschen nicht eine höhere sittliche Freiheit und einen souveränen Geist« mit sich führe.
Die Krimiphilosophin und TVTalkerin Thea Dorn durfte man bislang für eine wohl kluge, aber strikt den Kategorien aktueller Meinungsmoden hingegebene Zeitgenossin halten. Nun hat sie uns mit geradezu schwärmerischer Geste – Vor- und Nachwort, vereinzelt nur gespickt mit zeitgeistigen Kotaus, stammen aus ihrer Feder – den nahezu radikalen Widerborst Sieburg wiederentdeckt. Ein Glücksfall!
00:10 Publié dans Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 novembre 2010
Dictionnaire des injures littéraires
Mais ces deux livres supportent difficilement la comparaison avec l’imposant volume proposé par Pierre Chalmin : 700 pages agrémentées d’un précieux « index des insulteurs ». Céline y est cité plus de quarante fois. Comme ses saillies sont bien connues des lecteurs du Bulletin, je signalerai plutôt les insultes qu’à son tour il dût encaisser : de Jean Renoir qui voit en lui un « Gaudissart de l’antisémitisme » à Elias Canetti qui le traite de « paranoïaque » en passant par un certain Ferron qui le considère « menteur, mythomane et peut-être fou », la récolte est belle. Encore que je ne voie pas bien en quoi le commentaire de Marcel Aymé (brocardant gentiment son antisémitisme) et celui de Jünger (constatant qu’il n’eut pas le même destin que Brasillach) soient vraiment injurieux. Mais sans doute faut-il tenir compte d’un imperceptible second degré...
Un des attraits du livre est de mettre en valeur des ouvrages contenant des pépites, comme le Journal de Paul Morand et celui de Matthieu Galey. Ou les critiques d’Angelo Rinaldi – celles de L’Express – étincelantes de fiel ³. Ainsi, à propos de Hervé Bazin : « Une si scrupuleuse absence d’art, qui équivaut à fournir le moteur sans le capot, sans la carrosserie, voire sans la voiture, méritait à la longue d’être relevée. » Ou à propos de Roger Peyrefitte : « Un grand méchant loup pour revue de L’Alcazar, l’œil concupiscent sous les coiffes de dentelles, et fouillant de sa patte sénile la culotte du Chaperon rouge. »
Comme tout dictionnaire, ce n’est évidemment pas un ouvrage qu’on lit d’une traite. On le butine plutôt, happant ici et là des bonheurs d’écriture. Je l’ai déjà indiqué, les pointes de Céline reprises dans cette anthologie sont archi connues, à l’exception de celle sur Malraux : « Il me semblait splendidement doué et puis il a manqué de pudeur, d’autocritique et de véritable expérience, il s’est pris au sérieux. À présent il est devenu tout à fait putain. Je ne crois plus qu’il en sortira rien. Des vagues bafouillages orientaux et prétentieux et gratuits. » Prescience de Céline ! Il écrit cela en 1934 dans une lettre privée. Ce qui ne l’empêchera pas de saluer dans Bagatelles le Malraux qu’il estimait : celui des Conquérants parus dix ans plus tôt.
Dans sa préface, Chalmin n’a pas tort de relever un certain dépérissement du genre : « On insulte aujourd’hui en se taisant, conspirant les silences : c’est un progrès qui confine à l’imitation des anémones. » Céline, lui, n’a jamais pu se taire. Inconscience mais aussi bravade sans lesquelles il ne serait pas ce génie de l’invective qui lui valut et lui vaut encore tant d’opprobres.
Marc LAUDELOUT
• Pierre Chalmin, Dictionnaire des injures littéraires, l’Éditeur, 2010, 734 pages (29 €)
1. Sylvie Yvert, Ceci n’est pas de la littérature… Les forcenés de la critique passent à l’acte, Éditions du Rocher, 2008, 222 pages.
2. Elsa Delachair, L’Art de l’insulte. Une anthologie littéraire, Éditions Inculte, 2010, 208 pages
3. Son dernier livre, Dans un état critique (Éd. La Découverte) rassemble 120 chroniques parues entre 1998 et 2003.
00:15 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : injures, injures littéraires, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, dictionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 novembre 2010
Les discours de Louis-Ferdinand Céline sur la Grande Guerre
Les discours de Louis-Ferdinand Céline sur la Grande Guerre
par Charles-Louis Roseau
Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/
 Intéressé par la représentation de la Guerre de 14-18 dans l’œuvre de Céline, Charles-Louis Roseau a mené deux travaux universitaires sur ce sujet. Achevé en 2006, le premier traite du corps et de la Grande Guerre chez Céline et le peintre Allemand Otto Dix. Plus récemment, il a soutenu une étude [ à télécharger ici (clic droit puis "enregistrez la cible du lien sous")] portant sur les évolutions et les enjeux du discours célinien sur la Première Guerre mondiale entre 1912 et 1961. Il livre ici quelques pistes de réflexions.
Intéressé par la représentation de la Guerre de 14-18 dans l’œuvre de Céline, Charles-Louis Roseau a mené deux travaux universitaires sur ce sujet. Achevé en 2006, le premier traite du corps et de la Grande Guerre chez Céline et le peintre Allemand Otto Dix. Plus récemment, il a soutenu une étude [ à télécharger ici (clic droit puis "enregistrez la cible du lien sous")] portant sur les évolutions et les enjeux du discours célinien sur la Première Guerre mondiale entre 1912 et 1961. Il livre ici quelques pistes de réflexions.Sur Internet, dans la rubrique culturelle des médias plus traditionnels, dans les manuels de littérature, Louis-Ferdinand Céline est bien souvent présenté, aux côtés de Barbusse, Cendrars, Dorgelès et bien d’autres, comme l’une des figures essentielles des écrivains combattants. Très en vogue depuis les années 1990, cette représentation du Céline soldat des tranchées n’est cependant pas totalement inédite. Au contraire, elle n’a jamais cessé de perdurer, depuis qu’en 1932, lors de la parution de Voyage au bout de la nuit, les journalistes et les lecteurs ont relevé la force du témoignage célinien sur la première conflagration mondiale. Dans les années 1960, par exemple, prié de donner ses impressions sur le romancier, Guy Mazeline, lauréat du prix Goncourt 1932, écrivait : « je me représente le Céline qui n’a jamais, au mental, été démobilisé, le Céline bleu horizon tout dépenaillé avec sa capote écornée comme un livre sale, ses bandes molletières qui godent à la manière de ces crayons, vous vous souvenez ? (1) »
Pourquoi se représenter Céline en soldat de la Grande Guerre alors que l’auteur a porté bien d’autres masques et occupé bien d’autres fonctions ? Pourquoi le décrire comme un témoin majeur alors que le récit de son expérience du front, trois mois de guerre de mouvement, ne tient essentiellement qu’à la centaine de pages qui ouvrent son premier roman ? Il est évidemment très délicat, voire impossible, d’estimer l’intensité des souffrances éprouvées par un soldat de 14-18. Il serait tout aussi maladroit de tenter d’évaluer le réalisme ou l’authenticité d’un témoignage sur la Grande Guerre. Néanmoins, dans le cas de Céline, on reste persuadé que c’est davantage l’investissement fictionnel du thème que l’expérience martiale qui contribua à forger la figure du témoin.
Le déséquilibre observé entre, d’une part, le passage éclair à dos de cheval dans une guerre encore indécise, et, d’autre part, le récit constant, dans les discours céliniens, littéraires ou périphériques, de l’expérience des combats, invite à réfléchir sur la naissance, la construction et la pérennisation du mythe du Céline soldat de 14-18. A l’origine, on trouve bien entendu la contamination permanente et réciproque, chère au romancier, du réel par la fiction. Il est effectivement surprenant de constater comment la légende de la blessure au bras et à la tête, formulée publiquement pour la première fois en 1932, évolue et s’étoffe par la suite dans les entretiens, dans les articles et dans les romans postérieurs de l’écrivain. De même, véritable leitmotiv de l’œuvre célinienne, l’épisode de l’engagement fait l’objet d’un réagencement constant que l’auteur réinvente dans chacun de ses discours publiques ou intimes. La propagation du mythe, quant à elle, met nécessairement en jeu un environnement communicationnel qui, dans le cas de Céline, s’avère polyphonique et terriblement complexe. Puisque fiction et réalité se trouvent mêlées en un unique et même discours, puisque les propos intimes du Docteur Destouches se voient souvent relayés et parfois publiés aux côtés d’énonciations publiques, il convient de mettre les choses au clair en considérant les différents éléments de l’environnement communicationnel dans lequel fut colportée la légende du Céline combattant.
Apparaissent alors les notions de destinateur, de destinataire, de message, d’objectif et de contexte. Ces dernières mettent en exergue combien le thème de la Grande Guerre évolua dans le discours célinien entre 1912, année de l’entrée à la caserne, et 1961, date de la mort de l’auteur. Revanchardes dans les années 1900, libertaires au moment de l’exil africain, antimilitaristes durant dans l’entre-deux-guerres, réactionnaires et cocardières sous l’occupation, paradoxalement patriotes et pacifistes dans les années 1950, les figures du récit martial célinien, parce qu’elles se conforment tant au contexte d’énonciation qu’aux attentes supposées des destinataires, sont terriblement mouvantes.
La mémoire de la Grande Guerre a ceci de particulier qu’elle a touché toutes les familles de France. En réveillant le souvenir 14-18, Céline était donc en mesure d’attirer l’intérêt de nombreux destinataires. Peut-être peut-on voir dans les variations du thème martial une tentative incessante d’unisson mémorielle avec le souvenir changeant de la Grande Guerre ? Et au-delà de cette volonté de conformité perpétuelle, ne pourrait-on pas mettre au jour un usage tactique et multiforme du souvenir de 14-18 susceptible de mener à bien des objectifs personnels ? Le récit célinien de la Grande Guerre serait alors à considérer comme la clé d’un succès littéraire initié dans les années 1930. En s’inspirant des romans de guerre nouvellement populaires, le romancier entendait conquérir un public large et s’assurer, ainsi qu’il l’avoua lui-même, popularité et recettes juteuses. De même, le recours constant, durant les différents procès Céline, aux souvenirs du combat, aux stigmates ou aux décorations, sembla fonctionner puisque c’est précisément parce qu’il était invalide de guerre que l’ancien combattant Destouches fut amnistié.
Le 20 août 1916, le jeune Destouches écrivait à ses parents : « je ne me connais encore que deux infirmités, une paralysie radiale qui m’a rapporté la médaille militaire – et une légère phobie inconstante qui ne m’a encore rien rapporté. » Il n’envisageait pas encore combien son passage au front pourrait lui rapporter…
Charles-Louis ROSEAU
1- Guy Mazeline, « Cher Bardamu mon concurrent », Céline, Paris, Éditions de l’Herne, 1963, 1965, 1972, réédition 2007, p. 179.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, céline, france, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 novembre 2010
Croquis étrusques de D. H. Lawrence
Croquis étrusques de D. H. Lawrence
Ex: http://stalker.hautetfort.com/
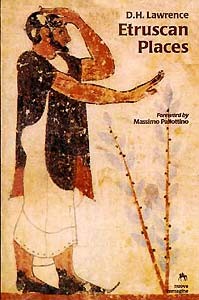 C’est à la fin du VIIe siècle avant la naissance du Christ qu’apparaît en Toscane une population que les Latins appelleront Tusci ou Etrusci, dont les origines continuent de rester énigmatiques. On suggère aujourd’hui que la culture étrusque est née d’un ancien substrat local qui s’est lentement modifié au cours des différentes vagues de population s’installant en Italie, tandis que l’hypothèse qui prévalait au début du siècle passé rejoignait le récit d’Hérodote, d’après lequel ce peuple serait venu par la mer de Lydie.
C’est à la fin du VIIe siècle avant la naissance du Christ qu’apparaît en Toscane une population que les Latins appelleront Tusci ou Etrusci, dont les origines continuent de rester énigmatiques. On suggère aujourd’hui que la culture étrusque est née d’un ancien substrat local qui s’est lentement modifié au cours des différentes vagues de population s’installant en Italie, tandis que l’hypothèse qui prévalait au début du siècle passé rejoignait le récit d’Hérodote, d’après lequel ce peuple serait venu par la mer de Lydie. Après un essor spectaculaire, la civilisation étrusque est entrée, à partir du Ve siècle, dans une phase d’affaiblissement notable jusqu’à sa soumission à Rome aux IVe et IIIe siècles.
Pourtant, au milieu du VIIe siècle, ce peuple fascinant de Toscane à la vocation maritime, avait commencé à se poser en rival sérieux des Grecs pour l’hégémonie méditerranéenne. Ainsi, allié à Carthage, il avait accepté la pénétration punique en Sardaigne alors que, dès le milieu du VIe siècle, il dut affronter les Hellènes désireux de coloniser l’Italie méridionale.
Cette période de guerres et d’alliances s’acheva en 474 par une défaite étrusque face à la coalition maritime que menèrent Cumes et Syracuse.
Cette date marque le début de l’effondrement du système confédéral instauré par Tarchon et regroupant, selon la tradition, douze cités ou groupes urbains dirigés par un lucumon, dans la région située entre l’Arno et le Tibre. C’est ce même Tarchon qui, selon la légende, fut le premier à fonder douze villes dans le nord de l’Italie, franchit ensuite les Apennins pour fonder la ville de Mantoue puis onze autres villes, redoublant ainsi la ligue originelle, villes qui s’unirent en une ligue appelée par les Latins Duodecim Populi Etruriae. Tarquinia était la plus ancienne des douze premières cités-États. Il y avait aussi Vulci, Vetulonia, Cerveteri, Arezzo, Chiusi, Roselle, Volterra, Cortona, Perugia, Volsinii, Populonia, certaines d’entre elles constituant les titres des chapitres du livre de Lawrence.
Après la défaite devant Cumes, les comptoirs commerciaux étrusques s’effondrèrent les uns après les autres sous la pression des Oscques et des Sabelliens qui prennent Capoue en 430.
Quoi qu’il en soit, durant les premiers siècles de l’histoire romaine, l’Étrurie sut conserver une relative indépendance, les Étrusques ayant obtenu le droit à la citoyenneté romaine en 89 avant Jésus-Christ, alors que l’Étrurie devient, elle, dans la division administrative de l’Italie conçue par Auguste, la septième région. Élie Faure évoque bellement l’appétit insatiable de conquêtes, secrètement conforté par l’Étrurie soumise devenue le cœur de l’Empire, qui fut celui de Rome : «Dès ses débuts, Rome est elle-même. Elle détourne à son profit les sources morales du vieux monde, comme elle détournait les eaux dans les montagnes pour les amener dans ses murs. Une fois la source captée, son avidité l’épuise, elle va plus loin pour en capter une autre.Dès le commencement du IIIe siècle l’Étrurie, broyée par Rome, cimente de son sang, de ses nerfs, avec le sang et les nerfs des Latins, des Sabins, le bloc où Rome s’appuiera pour se répandre sur la terre, en cercles concentriques, dans un effort profond» (in Histoire de l’art. L’art antique, Gallimard, coll. Folio Essais, 1988, pp. 305-6). Lawrence, parfois, fort rarement à vrai dire, croit découvrir sur les visages de certains hommes et femmes croisés lors de son périple les traits caractéristiques qu’il prête aux anciens Étrusques. De même, il constatera que de très anciens édifices construits par ce peuple disparu ont été restaurés, plus ou moins fidèlement à son goût, par son implacable conquérant romain.
La langue étrusque fut tout d’abord parlée en Toscane. Nous en avons conservé plus de dix mille inscriptions ainsi qu’un texte manuscrit de mille cinq cents mots environs, inscrits sur les bandelettes de lin enveloppant une momie. Les autres textes connus à caractère votif ou funéraire n’expriment guère que le nom du fidèle ou du défunt. L’alphabet a été emprunté au grec, probablement autour de 700 avant Jésus-Christ, sous l’influence des colonies grecques des îles Pithécuses. Elle demeure indéchiffrable pour Lawrence et, bien sûr, d’autant plus poétique.
La religion des Étrusques, sur laquelle notre auteur écrira de belles et étranges pages, a fait l’objet de maints commentaires de la part des Anciens. Peut-être d’origine orientale, sa «révélation» avait été consignée dans des livres sacrés dépositaires de la théologie et des rites inspirés par le génie Tagès et la nymphe Végoia, aux antipodes du paganisme gréco-romain.
C’est chargé d’un immense savoir livresque qu’il ne manquera pas de moquer dans son propre livre, c’est après avoir accumulé les lectures des ouvrages savants de Mommsen, Weege, Ducati ou encore Fell (1), que D. H. Lawrence commence son périple au milieu des ruines des anciennes villes étrusques, qu’il a projeté de visiter dès la fin mars 1926. Lawrence connaît aussi bien qu’il l’aime l’Italie qui ne «juge pas» (2), à ses yeux, à la différence de pays fatigués comme l’Angleterre et l’Allemagne, où la morale a remplacé la belle vitalité des peuples jeunes. Pour ce qui concerne la civilisation étrusque, l’écrivain semble avoir été frappé, assez tôt (en 1908) par sa lecture de La Peau de chagrin de Balzac, roman publié en 1831, dans lequel, dès le début du livre, le héros observe un vase étrusque qui le fascine : «Ah ! Qui n’aurait souri comme lui de voir sur un fond rouge la jeune fille brune dansant dans la fine argile d’un vase étrusque devant le Dieu Priape qu’elle saluait d’un air joyeux». En 1915, c’est la lecture du chapitre IX (intitulé Le culte des arbres) du célèbre Rameau d’or de Frazer qui frappe l’esprit de Lawrence comme il a durablement frappé celui de tant d’autres écrivains (comme T. S. Eliot), chapitre où sont mentionnés l’Étrurie centrale et ses «champs fertiles».
Ce savoir que D. H. Lawrence accumula pourtant consciencieusement durant les années de lente maturation de son projet de livre ne lui fut que d’un maigre secours au moment de rédiger ce dernier et même, au moment où il fut lu et critiqué par ses premiers lecteurs professionnels (cf. pp. 272-278 de notre ouvrage). Plusieurs critiques reprochèrent en effet à l’écrivain son manque de sérieux scientifique, alors que Lawrence, de son côté, avait plusieurs fois émis des doutes, dans les lettres adressées à ses amis et éditeurs, sur la capacité réelle des foules à apprécier et goûter son œuvre qui, pour réellement exister, devait à son goût se détacher du savoir pulvérulent et sans grâce des gros livres savants et inutiles mais, tout autant, se frayer un chemin difficile vers le cœur de lecteurs ne sachant plus vraiment lire.
Quoi qu’il en soit, ce dépouillement nécessaire était finalement dans la logique même des différents croquis que Lawrence consacra aux tombes étrusques ornées de fresques magnifiques. Car c’est tout compte fait peu dire que, au travers de la découverte puis de la description de ces chefs-d’œuvre picturaux des anciens âges, l’unique sujet de l’écrivain est l’opposition entre le fourmillement plein de vie du passé et l’étiolement bavard dans lequel nos sociétés modernes sont tombées. Pénétrant dans les ténèbres des caveaux étrusques, Lawrence est un homme qui semble se dépouiller de sa très vieille peau occidentale comme un serpent qui ferait sa mue, et se remplir, a contrario, d’un savoir paradoxal qui irrigue son être tout entier, comme la religion des Anciens, selon l’écrivain, a irrigué les danseurs dont il contemple les représentations sur les murs des tombeaux : «Comme le disait l’antique auteur païen, écrit ainsi Lawrence : Il n’est partie vivante de nous ou de nos corps qui ne ressente la religion; dès lors, qu’aucune chanson ne manque à l’âme, et qu’aux genoux et au cœur abondent le bond et la danse; car tous autant qu’ils sont connaissent les dieux…» (p. 109). Nous ne les connaissons plus, puisqu’il est vrai que nous ne dansons ou même ne savons plus danser, comme Lawrence d’ailleurs le remarque, en accomplissant des gestes scellant la magique entente des hommes et du monde qui les porte.
L’Italie elle-même, du moins dans sa partie qui conserve quelques antiques traces du peuple disparu, paraît pour Lawrence (mais qu’en est-il de nos jours ?) s’être salutairement éloignée du foyer de contagion : la vie moderne qui corrompt le vivant de façon irrémédiable. Ainsi, dès le tout premier texte des Croquis étrusques, Cerveteri, décrivant le visage d’un des habitants de la peu riante région qu’il traverse avec son ami, nous pouvons lire sous la plume de Lawrence : «Il est probable que, quand je retournerai dans le Sud, il aura disparu. Ils ne peuvent survivre, ces hommes à visage de faune au profil si pur, avec ce calme étrange qui est le leur, éloigné de toute morale. Seuls survivent les visages déflorés» (p. 24).
C’est dire en somme que la civilisation étrusque, insouciante, légère, aérienne comme les oiseaux qui ornent les fresques de ses tombeaux, était condamnée à disparaître dans un monde qui, au fil des siècles, s’est figé dans la lourdeur sans vie des peuples sérieux qui ont oublié la danse, le rire et les chants célébrant l’harmonie rejouée par chaque nouvelle célébration. Finalement encore, notre époque consacre le triomphe des visages flétris, comme, sous couvert de respect d’une morale aussi ridicule que contraignante (sans compter qu’elle est mensongère), notre société magnifie le comble de la dégénérescence, les portraits de milliers de Dorian Gray qui, devenus trop compliqués, exclusivement cérébraux, ont perdu tout contact réel avec la «verte primitivité» chère à Kierkegaard qui est à l’œuvre, selon D. H. Lawrence, dans l’ensemble des témoignages que la civilisation étrusque nous a légués. Vitalité des premiers jours de l’homme. Immobilité, en dépit même du mythe du progrès qui lance ses milliers de tentacules dans toutes les directions, de l’homme moderne. Art de l’aube des peuples, «émerveillement des matinées humaines» comme dit le poète, science véritable de la vie quotidienne contre psychologie des «ignorantins» que nous sommes devenus (cf. p. 127).
L’écrivain poursuit, contemplant cette fois les visages féminins, porteurs d’un secret évident, qui se tient à portée de regard ou plutôt, pour l’auteur de L’Amant de lady Chatterley, à portée de toucher (au sens de communication physique et pré-mentale que Mellors, dans le roman le plus célèbre de Lawrence, développera) : «Ce sont de belles femmes, issues d’un monde ancien, en qui se mêlent ce silence et cette réserve qui les rendent si attirantes et qui sans doute étaient leur apanage, dans le passé. Comme si, au profond de chaque femme, il y avait encore quelque chose à chercher que l’œil jamais n’est en mesure de déceler. Quelque chose qui peut être perdu, et qui jamais ne peut être retrouvé» (p. 26). C’est dire que la femme est toujours du côté du passé, précieux puits originel d’où sortent les hommes hagards, presque immédiatement nostalgiques de ce qu’ils ont conscience d’avoir perdu d’une façon irrémédiable et qu’ils tenteront, leur vie durant, de reconquérir de mille et mille façons, par la guerre, l’art, l’écriture, la déchéance même, surtout si elle devient un dérèglement systématique de tous les sens. Et ce qu’ils ont perdu, ce que chaque homme perd en venant au monde, ce sont la beauté, la sécurité, une forme souveraine d’harmonie inconsciente, primitive, primesautière, pas moins reliée à toute la chaîne des vivants et à l’univers tout entier, le secret éternellement rejoué à chaque nouvelle naissance de l’être et de ses manifestations, que D. H. Lawrence ira chercher au plus profond de l’obscurité gardienne d’un peu de poussière qui autrefois fut femme et homme.
Ce secret de la spontanéité et de la fraîcheur de la vie, Lawrence les surprend ainsi dans les fresques splendides qui ornent les dernières demeures de riches Étrusques : «Aux formes et mouvements des murs et volumes souterrains s’attache une simplicité jointe à une spontanéité, un naturel dépoitraillé tout à fait particulier qui, immédiatement, réconforte l’esprit. Les Grecs cherchaient à faire impression, et le gothique bien plus encore vise à frapper l’esprit. Les Étrusques, non. Ce qu’ils réalisaient, en ces siècles insouciants où ils vécurent, apparaît aussi simple et naturel que la respiration. Ils laissent la poitrine respirer librement, aspirer sans effort une certaine abondance de vie» (p. 38).
Belle, audacieuse image bien que je ne pense pas que nous puissions véritablement parler de «siècles insouciants» à propos des âges de rapines et de violences de toute sorte qui furent ceux des anciens peuples ayant colonisé l’Italie. Élie Faure a raison de distendre l’ombre inquiétante qui est celle des personnages si joyeux de vivre que Lawrence croit contempler de son regard grisé, creusant la naïveté des dessins étrusques d’une profondeur qui, à vrai dire, n’est absolument pas étrangère au texte de Lawrence lui-même, surtout lorsqu’il contemple, pris de vertige, l’abîme des siècles et des millénaires : «Le prêtre règne. Les formes sont enfermées dans les tombeaux. La sculpture des sarcophages où deux figures étranges, le bas du corps cassé, le haut secret et souriant s’accoudent avec la raideur et l’expression mécaniques que tous les archaïsmes ont connues, les fresques des chambres funéraires qui racontent des sacrifices et des égorgements, tout leur art est fanatique, superstitieux et tourmenté» (op. cit., p. 305). Je crois que Lawrence tente en fait de magnifier en estompant plus qu’en effaçant toutes ses ombres une époque de non-réflexivité absolue pour ainsi dire, où les femmes et les hommes préféraient de très loin vivre plutôt que se voir vivre, agir plutôt que bavarder comme il en va, selon l’écrivain, à notre époque anémiée.
Nous retrouvons ici la thématique si chère à Lawrence de la «conscience phallique» que nous pourrions caractériser comme l’aspiration naïve de la vie vers son expansion maximale et, surtout, libérée de toute contrainte d’ordre moral ou religieux (3) : «C’est la beauté de proportion naturelle de la conscience phallique, qui vient s’opposer aux proportions plus recherchées ou plus extatiques de la conscience mentale et spirituelle à laquelle nous sommes habitués» (p. 35). C’est dans L’Amant de lady Chatterley que Lawrence évoquera, tout comme il a fait du toucher un de ses thèmes centraux, cette «conscience phallique», écrivant de son livre qu’il est un : «roman phallique, tendre et délicat – pas un roman érotique au sens propre […]. Je crois sincèrement qu’il faut restaurer, ajoute-t-il, une conscience phallique dans nos vies, parce qu’elle est à la source de toute vraie beauté et de toute vraie douceur» (4).
La simplicité que Lawrence voit à l’œuvre dans l’art funéraire étrusque est encore décrit comme un «naturel confinant à la platitude» et, plus loin, comme un véritable secret dont la clé a été perdue : «C’est là presque toujours présent dans les objets étrusques, ce naturel confinant à la platitude, mais qui en général l’évite, et qui, bien souvent, atteint à une originalité si spontanée, si hardie et si fraîche que nous, amoureux des conventions et des expressions «ramenées à une norme», en venons à qualifier cet art de bâtard et de banal» (p. 79).
 Lawrence, suivant en cela la leçon d’un nombre incalculable d’auteurs mais sans toutefois tomber dans le délire de certains qui, comme Keyserling, fonda à Darmstadt en 1920 une École de la Sagesse dénonçant les limites de la culture occidentale et puisant son enseignement de pacotille dans une Inde fantasmée, confère au monde ancien une vertu éminente : au contraire de ce que nous pouvons constater à notre époque de spécialistes qui poussent de grands cris dès qu’un esprit un peu audacieux essaie de créer des passerelles entre plusieurs domaines de savoir, le monde ancien ne craignait pas d’établir des parentés symboliques, donc réelles, entre les êtres vivants et les choses, reliés par un flux souterrain de sang (5). «Merveilleux monde, écrit ainsi Lawrence, qu’était sans doute ce monde ancien où toutes choses semblaient vivantes, luisantes dans l’ombre crépusculaire du contact qui les faisait se toucher, un monde où chaque chose n’était pas seulement une individualité isolée prise au piège de la lumière diurne; où chaque chose apparaissait en son clair contour, visuellement, mais qui du sein de sa clarté même était reliée par des affinités émotionnelles ou vitales à d’autres choses étranges, une chose surgissant d’une autre, mentalement contradictoires qui fusionnaient dans l’émotion, si bien qu’un lion pouvait au même instant être aussi une chèvre, et ne pas être une chèvre [Lawrence a évoqué précédemment la chimère en bronze d’Arezzo, conservée au musée de Florence et qui fut en partie restaurée par Benvenuto Cellini)» (p. 142).
Lawrence, suivant en cela la leçon d’un nombre incalculable d’auteurs mais sans toutefois tomber dans le délire de certains qui, comme Keyserling, fonda à Darmstadt en 1920 une École de la Sagesse dénonçant les limites de la culture occidentale et puisant son enseignement de pacotille dans une Inde fantasmée, confère au monde ancien une vertu éminente : au contraire de ce que nous pouvons constater à notre époque de spécialistes qui poussent de grands cris dès qu’un esprit un peu audacieux essaie de créer des passerelles entre plusieurs domaines de savoir, le monde ancien ne craignait pas d’établir des parentés symboliques, donc réelles, entre les êtres vivants et les choses, reliés par un flux souterrain de sang (5). «Merveilleux monde, écrit ainsi Lawrence, qu’était sans doute ce monde ancien où toutes choses semblaient vivantes, luisantes dans l’ombre crépusculaire du contact qui les faisait se toucher, un monde où chaque chose n’était pas seulement une individualité isolée prise au piège de la lumière diurne; où chaque chose apparaissait en son clair contour, visuellement, mais qui du sein de sa clarté même était reliée par des affinités émotionnelles ou vitales à d’autres choses étranges, une chose surgissant d’une autre, mentalement contradictoires qui fusionnaient dans l’émotion, si bien qu’un lion pouvait au même instant être aussi une chèvre, et ne pas être une chèvre [Lawrence a évoqué précédemment la chimère en bronze d’Arezzo, conservée au musée de Florence et qui fut en partie restaurée par Benvenuto Cellini)» (p. 142).Plus même, puisque Lawrence, tirant finalement les conséquences logiques du mythe de l’Âge d’or, ayant même peut-être lu Vico qui associait naissance du langage et chant dans une même étreinte poétique de l’univers, affirme que les anciens dont il contemple les œuvres d’art étaient de véritables enfants : «Les anciens voyaient consciemment ce que les enfants voient inconsciemment : l’éternelle merveille des choses. Dans le monde antique, les trois émotions cardinales devaient être l’émerveillement, la crainte et l’admiration – l’admiration au sens latin du mot comme dans notre acception présente, et la crainte dans sa signification la plus large, qui inclut la répulsion, l’épouvante et la haine» (p. 143). Puisque les Étrusques incarnaient merveilleusement les vertus de l’aube (l’insouciance, la légèreté, la spontanéité, la fraîcheur, la joie), ils ne pouvaient être que de véritables enfants, et non point de ridicules adultes qui singeraient l’enfance. Leur caractère enfantin plutôt qu’infantile provenait du fait qu’ils ne séparaient point les êtres qu’ils considéraient de la grande chaîne reliant toutes les choses, tous les êtres créés. L’esprit d’abstraction, au sens propre du terme, leur était inconnu. Ils ne connaissaient que l’esprit procédant par association symbolique, qui est sans doute le seul qui soit capable de révéler la vérité profonde des êtres. Lawrence emploie, à propos de cette vérité profonde, une magnifique expression (que je souligne), écrivant : «C’est en étant capable de voir le qui-vive de toutes choses au cœur partout ramifié de la grande signification, toute palpitante de passion, que les anciens maintenaient vivants l’émerveillement et la délectation, mais aussi bien l’effroi et la répugnance. Ils étaient comme les enfants – mais ils avaient la force, la puissance et la connaissance sensuelle des vrais adultes» (pp. 143-4).
Et l’auteur de tirer toutes les conséquences de cette idée selon laquelle l’homme a perdu la grâce de ses premiers gestes. La religion elle-même, selon Lawrence, a vu sa nature profonde s’infléchir pour n’être plus qu’un vil instrument dont l’homme se sert. Tout le délire mécaniciste moderne semble pour Lawrence sorti du culte grec de la raison et du génie bâtisseur romain : «L’ancienne religion, qui voulait que l’homme assidûment tente de s’harmoniser avec la nature, tienne ferme sur ses pieds et s’épanouisse en fleur dans le grand bouillonnement de la vie, s’est transformée avec les Grecs et les Romains en un désir de résister à la nature, de développer la ruse mentale et la force mécanique susceptibles de surpasser la nature en intelligence et de l’enchaîner complètement, complètement au point qu’il ne subsiste plus aucune liberté en cette nature et que tout soit contrôlé, domestiqué et asservi aux pouvoirs mesquins de l’homme» (p. 158).
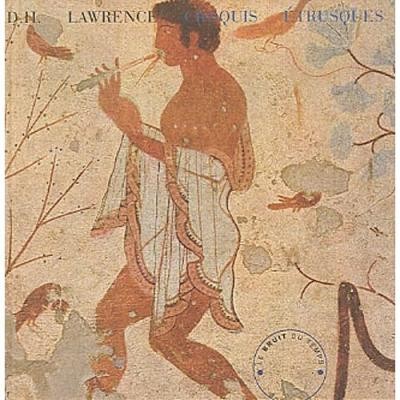 C’est dans un chapitre inachevé, resté à l’état de manuscrit et qui, peut-être, eût pu servir à Lawrence de conclusion pour ses Croquis étrusques, intitulé Le musée de Florence, que l’auteur va systématiser ses intuitions sur le thème d’une déperdition, au travers des siècles, d’une force rayonnante qui s’échappe désormais inéluctablement des œuvres des hommes. Ainsi, selon Lawrence, nous devons bien comprendre que les religions elles-mêmes de nos ancêtres les plus magnifiques, comme le sont, à ses yeux, les Étrusques, ne sont que des bribes d’un savoir immémorial ayant précédé les plus anciennes civilisations : «Ce qu’il nous faut saisir lorsque nous contemplons des œuvres étrusques, c’est que celles-ci nous révèlent les derniers feux d’une conscience cosmique humaine – disons, la tentative d’hommes aspirant à la conscience cosmique – différente de la nôtre. L’idée qui veut que notre histoire soit issue des cavernes ou de précaires habitats lacustres est puérile. Notre histoire prend corps à l’achèvement d’une phase précédente de l’histoire humaine, une phase prodigieuse et comparable à la nôtre. Il est bien plus vraisemblable que le singe descende de nous que nous du singe» (p. 225). Renversement de perspective qui a dû faire bondir les esprits scientistes ou chagrins, c’est tout un, qui lurent les Croquis étrusques lorsqu’ils furent publiés ! On se demande même comment l’auteur n’a semble-t-il pas été traité de réactionnaire. Il l’a peut-être été, à la réflexion, tout comme on n’a pas manqué de lui reprocher son manque de sérieux scientifique (cf. la réception du livre, pp. 272-278). Citons donc longuement ce très beau passage, toujours extrait du même texte qui ne fut pas recueilli en livre par Lawrence, où il semble sérieusement douter de la théorie de l’évolution, l’homme ayant toujours été un homme, l’homme ne provenant pas du singe comme nous l’avons vu mais l’homme, pourtant, depuis qu’il s’est coupé de ses plus profondes racines de savoir symbolique, paraissant en revanche devoir dégénérer, dévoluer : «Les civilisations apparaissent comme des vagues, et comme des vagues elles s’évanouissent. Tant que la science, ou l’art, n’aura pu saisir le sens dernier de ces symboles flottant sur l’ultime vague de la période préhistorique, c’est-à-dire cette période qui précède la nôtre, nous ne serons pas en mesure d’instituer la juste relation avec l’homme en ce qu’il est, en ce qu’il fut, en ce que toujours il sera.
C’est dans un chapitre inachevé, resté à l’état de manuscrit et qui, peut-être, eût pu servir à Lawrence de conclusion pour ses Croquis étrusques, intitulé Le musée de Florence, que l’auteur va systématiser ses intuitions sur le thème d’une déperdition, au travers des siècles, d’une force rayonnante qui s’échappe désormais inéluctablement des œuvres des hommes. Ainsi, selon Lawrence, nous devons bien comprendre que les religions elles-mêmes de nos ancêtres les plus magnifiques, comme le sont, à ses yeux, les Étrusques, ne sont que des bribes d’un savoir immémorial ayant précédé les plus anciennes civilisations : «Ce qu’il nous faut saisir lorsque nous contemplons des œuvres étrusques, c’est que celles-ci nous révèlent les derniers feux d’une conscience cosmique humaine – disons, la tentative d’hommes aspirant à la conscience cosmique – différente de la nôtre. L’idée qui veut que notre histoire soit issue des cavernes ou de précaires habitats lacustres est puérile. Notre histoire prend corps à l’achèvement d’une phase précédente de l’histoire humaine, une phase prodigieuse et comparable à la nôtre. Il est bien plus vraisemblable que le singe descende de nous que nous du singe» (p. 225). Renversement de perspective qui a dû faire bondir les esprits scientistes ou chagrins, c’est tout un, qui lurent les Croquis étrusques lorsqu’ils furent publiés ! On se demande même comment l’auteur n’a semble-t-il pas été traité de réactionnaire. Il l’a peut-être été, à la réflexion, tout comme on n’a pas manqué de lui reprocher son manque de sérieux scientifique (cf. la réception du livre, pp. 272-278). Citons donc longuement ce très beau passage, toujours extrait du même texte qui ne fut pas recueilli en livre par Lawrence, où il semble sérieusement douter de la théorie de l’évolution, l’homme ayant toujours été un homme, l’homme ne provenant pas du singe comme nous l’avons vu mais l’homme, pourtant, depuis qu’il s’est coupé de ses plus profondes racines de savoir symbolique, paraissant en revanche devoir dégénérer, dévoluer : «Les civilisations apparaissent comme des vagues, et comme des vagues elles s’évanouissent. Tant que la science, ou l’art, n’aura pu saisir le sens dernier de ces symboles flottant sur l’ultime vague de la période préhistorique, c’est-à-dire cette période qui précède la nôtre, nous ne serons pas en mesure d’instituer la juste relation avec l’homme en ce qu’il est, en ce qu’il fut, en ce que toujours il sera.Aux temps d’avant Homère, les hommes vivant en Europe n’étaient pas de simples brutes, des sauvages ou des monstres prognathes; ce n’étaient pas non plus de grands enfants stupides. Les hommes restent des hommes, et bien que l’intelligence puisse prendre diverses formes, les hommes sont toujours intelligents : ce ne sont pas des imbéciles mal dégrossis, des crétins en masse.
Ces symboles qui nous parviennent à la crête des dernières vagues de la culture préhistorique constituent le reliquat d’une immense et très ancienne tentative de l’humanité de se former une conception de l’univers. Cette conception s’est exténuée, elle a volé en éclats au moment même où elle reprenait vie, en Égypte. Elle a connu un nouvel essor dans la Chine ancienne, en Inde, en Babylonie et en Asie Mineure, chez les Druides, chez les Teutons, chez les Aztèques et les Mayas de l’Amérique, chez les Noirs même. Mais à chaque fois cet essor était plus faible, la vague se mourait, le flux de conscience peu à peu se transformait en un autre flux traversé de multiples courants contradictoires» (p. 226, l’auteur souligne).
Je parlais plus haut de secret. Lawrence écrit, opposant une nouvelle fois le passé magnifié d’un débordement d’énergie et de candeur et le présent se mourant par son excès de normes et de réflexion : «C’est comme si un courant puissant venu de quelque vie différente les traversait de part en part, sans rien de commun avec le courant superficiel qui nous anime aujourd’hui; comme si les Étrusques tiraient leur vitalité de profondeurs inconnues dont l’accès nous est désormais refusé» (p. 111).
Citons d’ailleurs, extrait des Tombes peintes de Tarquinia, I, ce long passage, très intéressant, où se découvre le mépris de Lawrence à l’égard d’un peuple, celui composé par ses contemporains, considéré comme étant un immense lecteur aveugle, incapable de goûter la beauté secrète d’une œuvre. Ce thème est très présent dans la correspondance de l’écrivain, y compris même durant les mois qui précèdent la rédaction de ses Croquis étrusques dont Lawrence doute fortement qu’ils soient appréciés d’un public de plus en plus grossier et inculte. L’ésotérisme, par essence, ne peut être réservé qu’à une élite puisque, de fait, il ne peut être séparé non point seulement d’une révélation mais d’une pratique, dont ne peut absolument rien dire celui qui ne l’a point vécue. Dans ce même passage, l’auteur affirme que notre époque n’est plus même reliée à son prestigieux passé par un filet de savoir secret (6), alors que, inversement, c’est la maigreur même de ce savoir transmis depuis les âges les plus anciens qui entretient son insurpassable bavardage : «Les peuples ne sont pas initiés aux cosmogonies, ni ne se voient révéler le chemin vers cet état d’éveil où palpite la conscience aiguisée. Quoi que vous puissiez faire, jamais la masse des hommes n’atteindra cette vibration de la pleine conscience. Il ne leur est pas possible d’aller au-delà d’un soupçon de conscience.en foi de quoi il faut leur donner des symboles, des rituels et des signes qui empliront leur corps de vie jusqu’à la mesure qu’ils peuvent contenir. Plus leur serait fatal. C’est la raison pour laquelle il convient de les tenir à l’écart du vrai savoir, de crainte que, connaissant les formules sans avoir jamais traversé les expériences qui y correspondent, ils deviennent insolents et impies, croyant avoir atteint le grand tout quand ils ne maîtrisent en réalité qu’un verbiage creux. La connaissance ésotérique sera toujours ésotérique, car la connaissance est une expérience, non une formule. Par ailleurs, il est stupide de galvauder les formules. Même un petit savoir est chose dangereuse. Aucune époque ne l’a mieux montré que la nôtre. Le verbiage est, en définitive, ce qu’il y a de plus désastreux» (pp. 114-5, l’auteur souligne).
D’une autre façon, Lawrence raillera la science muséographique, invoquant le prétexte que la plongée réelle dans le passé ne peut être qu’une expérience poétique : «Mais quel intérêt présentent ces leçons de choses concernant des races évanouies ? Ce que l’on cherche, c’est un contact. Les Étrusques ne sont ni une théorie ni une thèse. Ils sont, d’abord et avant tout, une expérience» (p. 218, l’auteur souligne). Et l’écrivain d’enfoncer le clou : «Et c’est une expérience toujours ratée. Des musées, encore des musées, toujours des musées, des leçons de choses bricolées n’importe comment en vue d’illustrer les théories insanes des archéologues, tentatives insensées de coordonner et ajuster en un ordre intangible cela qui échappe à tout agencement définitif et se refuse à toute coordination !» (Ibid.) (7).
Le savoir est et ne peut être qu’expérience véritable, non point accumulation de thèses mortes avant même que d’avoir été publiées, pour la raison qu’elles ne peuvent en aucun cas délivrer un savoir autre que livresque, les livres évoquant d’autres livres dans une régression infinie qui est synonyme de mort spirituelle et morale des hommes. Celui qui sait se tait (8), vérité de la plus immémoriale ancienneté que D. H. Lawrence aura redécouverte (9) en s’enfonçant dans les tombes abandonnées, pillées, parfois très endommagées, des Étrusques dont la force véritable, spirituelle, est aussi fragile que celle d’une plante mais n’en a pas moins prodigué son suc dans les membres de l’immense corps de l’empire romain, selon la loi que commente Élie Faure : «Asservi matériellement, un peuple de culture supérieure asservit moralement le peuple qui l’a vaincu» (op. cit., p. 309).
Et ce sont pourtant cette plante (une pâquerette, précise Lawrence) ou ce rossignol (10), manifestations les plus humbles de la vie qui, plus durables qu’une altière pyramide qui finira par se désagréger au fil des millénaires, témoigneront d’une force dont les fresques étrusques gardent et révèlent le magnifique et bouleversant secret.
Notes
(1) Lawrence, avant de se rendre sur le terrain, a beaucoup lu sur la question, éminemment débattue à son époque, de la civilisation étrusque. Par exemple Theodor Mommsen, Römische Geschichte, que Lawrence connaissait dans sa traduction anglaise réalisée en 1861 (revue et corrigée en 1894), par W. P. Dickson, sous le titre The History of Rome. Fritz Weege, Etruskische Malerei (Halle, 1920-1921). Pericle Ducati, Etruria Antica (Turin, 1925). Roland Arthur Lonsdale Fell enfin, Etruria and Rome, Cambridge, 1924.
(2) The Letters of D. H. Lawrence (édition établie par James T. Boulton, Cambridge, 1979), I, p. 544, citées par Simonetta de Filippis dans la Notice aux Croquis étrusques, p. 250 de notre ouvrage.
(3) Voir cette curieuse image : «Si nous n’aimons pas les asphodèles, c’est à mon sens parce que nous rejetons tout ce qui est fier et jaillissant» (p. 28).
(4) In Letters of D. H. Lawrence, op. cit., tome VI, p. 328.
(5) «Le monde vivant, nous ne le connaîtrons jamais que symboliquement. Pourtant, chaque conscience – la rage du lion et le venin du serpent – est, donc elle est divine. Tout provient du cercle ininterrompu et de son noyau, le germe, l’Un, le Dieu, s’il vous plaît de l’appeler ainsi. Et l’homme qui apparaît, avec son âme et sa personnalité, est éternellement relié à l’ensemble. Le fleuve de sang est un, il est ininterrompu, mais il bouillonne d’oppositions et de contradictions» (p. 143).
(6) «C’est comme si un courant puissant venu de quelque vie différente les traversait de part en part, sans rien de commun avec le courant superficiel qui nous anime aujourd’hui; comme si les Étrusques tiraient leur vitalité de profondeurs inconnues dont l’accès nous est désormais refusé» (p. 111).
(7) C’est le sens des moqueries que D. H. Lawrence adresse à l’un des personnages qu’il a rencontrés lors de son voyage : «Mais le jeune Allemand ne veut rien entendre à tout cela. C’est un moderne, pour qui n’existent véritablement que les seules évidences. Un lion à tête de chèvre, en plus de sa propre tête, est une chose impensable. Et ce qui est impensable n’existe pas, n’est rien. Raison pour laquelle tous les symboles étrusques n’ont pour lui aucune réalité et ne témoignent que d’une grossière incapacité à penser. Il ne gaspillera pas une minute de son temps à y réfléchir. Ces symboles ne sont que le produit de l’impuissance mentale, par conséquent négligeables» (p. 139).
(8) «L’air du dehors nous paraît immense, blême, et de quelque façon vide. Nous ne percevons plus aucun des deux mondes, ni celui, souterrain, des Étrusques, ni celui du jour banal qui est le nôtre. Silencieux, épuisés, nous revenons vers la ville environnés de vent, le vieux chien stoïquement sur nos talons – et le guide nous promet de nous montrer les autres tombes dès le lendemain» (p. 110).
(9) La quête d’une vérité originelle semble avoir fasciné Lawrence qui écrit ainsi que les dieux personnels des Grecs «ne sont que les avatars décadents d’une religion cosmique antérieure», les «mythes grecs» n’étant pour leur part que «les représentations grossières de certaines conceptions ésotériques très anciennes et fort précises, qui sont bien plus âgées que les mythes – ou les Grecs» (p. 138).
(10) Voir cette image aussi étonnante que belle : «La force brute écrase de nombreuses plantes. Et pourtant ces plantes repoussent. Les pyramides ne durent qu’un instant, comparées à la pâquerette. Avant que Bouddha ou Jésus aient commencé de parler le rossignol chantait, et bien après que les paroles de Jésus ou de Bouddha seront tombées dans l’oubli, le rossignol continuera de chanter. Point de prêche ni d’enseignement, ni de commandement ou d’intimidation : juste le chant. Au commencement n’était pas le Verbe, mais le pépiement» (p. 71). Remarquons encore que Lawrence oppose l’antique religion des Étrusques qui «s’intéresse à l’ensemble des puissances et des forces physiques et créatrices en tant qu’elles participent à la construction et à la destruction de l’âme» à la religion du Verbe qui, étrange vue, n’accorderait aucune réalité au monde physique, Verbe qui «est martelé dru jusqu’à le rendre mince et permettre, comme une dorure, de recouvrir et dissimuler toutes choses» (p. 139).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature anglaise, lettres anglaises, lettres, littérature, angleterre, italie, etrurie, etrusques, vitalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 novembre 2010
La ballade de Marc Hanrez
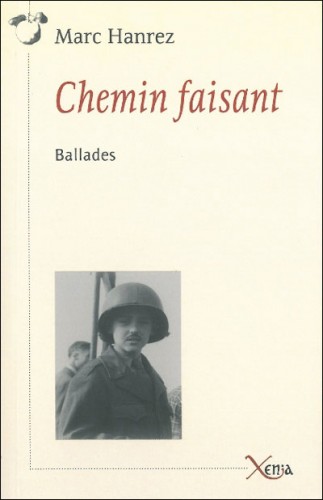 Les lecteurs de ce blog (*) n'ignorent pas que Marc Hanrez fut l’un des pionniers de la recherche célinienne. Auteur en 1961 d’une des premières monographies sur Céline (1), il a publié, il y a quatre ans, une somme réunissant ses principaux articles sur l’écrivain (2). Il fut aussi le maître d’œuvre d’un important cahier de L’Herne sur Drieu La Rochelle (3). Et l’auteur d’innombrables études sur ses écrivains de prédilection, d’Abellio à Nimier en passant par Proust ou Genet. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est aussi, et depuis longtemps, poète. Poète discret puisque son premier recueil, La Grande chose américaine, a paru en 1992 (4), le suivant, Colomb, Cortex & Cie, datant de 2004 (5). Jamais deux sans trois. Voici que paraît Chemin faisant, ballades (en vers libres) remontant le temps.
Les lecteurs de ce blog (*) n'ignorent pas que Marc Hanrez fut l’un des pionniers de la recherche célinienne. Auteur en 1961 d’une des premières monographies sur Céline (1), il a publié, il y a quatre ans, une somme réunissant ses principaux articles sur l’écrivain (2). Il fut aussi le maître d’œuvre d’un important cahier de L’Herne sur Drieu La Rochelle (3). Et l’auteur d’innombrables études sur ses écrivains de prédilection, d’Abellio à Nimier en passant par Proust ou Genet. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est aussi, et depuis longtemps, poète. Poète discret puisque son premier recueil, La Grande chose américaine, a paru en 1992 (4), le suivant, Colomb, Cortex & Cie, datant de 2004 (5). Jamais deux sans trois. Voici que paraît Chemin faisant, ballades (en vers libres) remontant le temps.Marc Hanrez avait dix ans en 1944. Dans la première partie de ce recueil, « Grandir en guerre », il fait revivre son enfance bruxelloise sous l’occupation, puis à la Libération. Prodigieuse puissance de la mémoire ! Mille et une images gravées et autant d’émotions. L’humour aussi qui affleure parfois :
« dans notre tram ce jour-là monte
en culotte de cheval
un officier allemand
quelle mouche alors me pique
avant-bras levé de faire un salut
que l’autre par réflexe rend au polisson »
La partie intitulée « L’Europe se lève à l’est » évoque trois villes, Vienne, Budapest et Prague, bousculées par l’histoire au siècle précédent :
« Vienne en première vision
l’année du Troisième Homme
ce film-culte avant la lettre
aussitôt vénéré pour son
thème à la cithare et son tournage
en clairs-obscurs
la ville entière me servant de cadre
au visage idole d’Alida Valli
et voir sourire Orson Welles causant
guerre et paix version suisse
au pied de la Grande Roue »
La force du texte, c’est, en quelques mots sobres, de ressusciter toute une époque enfouie mais à jamais vivante sous la plume imagée du poète. La troisième partie, « À verbe d’oiseau », nous le montre en observateur attentif de la nature. Le meilleur Jules Renard, celui du Journal, trouve ici un épigone inattendu. Et de conclure par un hommage à Hergé, immortel créateur de Tintin, tous deux « Bruxellois de souche » — comme l’est aussi Marc Hanrez.
Marc LAUDELOUT
• Marc Hanrez, Chemin faisant (Ballades), Xénia Éditions, 2010.
1. Céline, Éd. Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 1951 (éd. révisée en collection de poche, 1969). Robert Poulet le considérait comme « un ouvrage consciencieux, intelligent, d’un jugement qui semble parfaitement libre » (Pan, 20 décembre 1961 ; compte rendu repris dans Le Bulletin célinien, n° 254, juin 2004). Voir aussi Le Bulletin célinien, n° 279, octobre 2006 qui comprend un dossier consacré à Marc Hanrez.
2. Le Siècle de Céline, Dualpha, coll. « Patrimoine des lettres », 2006.
3. Drieu La Rochelle, Les Cahiers de l’Herne, n° 42, 1982.
4. La Grande chose américaine (illustrations de Paul Hanrez), Cadex Éditions, 1992.
5. Colomb, Cortez & Cie, Cadex Éditions, 2004.
00:05 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, poésie, poésie française, belgique, belgicana |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 09 novembre 2010
Le Bulletin célinien n°324 - novembre 2010
Le Bulletin célinien n°324 - novembre 2010
ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/
Marc Laudelout : Bloc-notes
Frédéric Saenen : Céline, fictions du politique
*** : Céline songeait à la Pléiade dès 1951
M. L. : Dictionnaire des injures littéraires
M. L. : Le souvenir de Roland Cailleux
Roland Cailleux : Rencontre avec Marcel Aymé (1943)
Une lettre de Roland Cailleux à Céline
David Labreure : Pour une médecine du travail
M. L. : La ballade de Marc Hanrez
Un numéro disponible contre un chèque de 6 euros.
Le Bulletin célinien, B. P. 70, B 1000 Bruxelles 22
 J’ai salué ici l’excellent article de Christophe Mercier sur la correspondance de Céline dans Commentaire (1). Il semble que plusieurs lecteurs de cette revue aient réagi différemment. Dont Jean-Claude Weill, de l’Institut universitaire de France, qui n’a pas apprécié une phrase bien anodine sur « les sulfureux pamphlets faisant partie du délire qui, maîtrisé, fait le prix de ses grands livres ». Ou une autre visant les « plumitifs qui poussent des cris d’orfraie au seul nom de Céline ». Et de se fendre d’une lettre au directeur de la revue dans laquelle il rapproche la réplique de Céline à Robert Desnos en 1941 de la mort de celui-ci survenue en déportation trois ans plus tard (2).
J’ai salué ici l’excellent article de Christophe Mercier sur la correspondance de Céline dans Commentaire (1). Il semble que plusieurs lecteurs de cette revue aient réagi différemment. Dont Jean-Claude Weill, de l’Institut universitaire de France, qui n’a pas apprécié une phrase bien anodine sur « les sulfureux pamphlets faisant partie du délire qui, maîtrisé, fait le prix de ses grands livres ». Ou une autre visant les « plumitifs qui poussent des cris d’orfraie au seul nom de Céline ». Et de se fendre d’une lettre au directeur de la revue dans laquelle il rapproche la réplique de Céline à Robert Desnos en 1941 de la mort de celui-ci survenue en déportation trois ans plus tard (2).En fait, il n’est apparemment plus possible de célébrer le génie de Céline sans devoir obligatoirement rappeler qu’il est l’auteur de lignes condamnables. Ce qui prête à réflexion, c’est que lorsque la même revue, sous la plume du même chroniqueur, tresse des lauriers à Aragon pour ses Œuvres poétiques complètes dans la Pléiade, cela ne suscite en revanche aucune réaction. Or, dans ce cas, la revue ne se fait pas un devoir de rappeler que dans Hourra l’Oural (inclus dans cette édition) le poète stalinien approuvait de manière infâme l’assassinat du tsarévitch. Pas plus qu’elle ne voit la nécessité de rappeler que, dans un poème davantage connu, Aragon appelait de ses vœux « le Guépéou nécessaire de France ».
Dans sa réponse à Weill, le directeur de la revue, Jean-Claude Casanova, croit devoir préciser que son chroniqueur « ne partage aucune des opinions et des passions de Céline » [!]. Sans doute aurait-il dû s’arrêter là car il ajoute imprudemment ceci : « Céline a souhaité que ses pamphlets ne soient pas réédités. Je ne sais pas si c’est le remords ou la prudence qui inspire cette décision, mais il faut la prendre au moins comme une contrition de sa part, comme une reconnaissance de sa faute (3). » Le directeur de Commentaire connaît manifestement mal Céline. Face à un journaliste suisse qui le poussait dans ses derniers retranchements, l’auteur de Bagatelles disait textuellement ceci : « Je ne renie rien du tout… je ne change pas d’opinion du tout.. je mets simplement un petit doute, mais il faudrait qu’on me prouve que je me suis trompé, et pas moi que j’ai raison (4) ». Autre bévue que celle consistant à affirmer que « le cas Céline ne pose pas de problème moral dans son œuvre romanesque, mais en pose dans son œuvre politique ». A-t-il bien lu Céline ? « Moi qui suis extrêmement raciste » est-elle une phrase extraite des pamphlets ou d’un roman de l’après-guerre ? En réalité, Céline formula des pensées éminemment incorrectes jusqu’à la fin. C’est dire si son œuvre forme un tout et qu’il est vain de vouloir séparer le « bon » Céline du « mauvais ». Un célinien va même plus loin, estimant que « plus Céline est cruel, plus il est injuste et meilleur il est (5). »
Marc LAUDELOUT
1. Christophe Mercier, « Les lettres de Céline », Commentaire, n° 129, printemps 2010, pp. 261-263. Voir aussi Marc Laudelout, « Céline épistolier vu par la presse ( II ) », Le Bulletin célinien, n° 319, mai 2010, pp. 5 & 7-8.
2. « Lettres. La correspondance de Céline », Commentaire, n° 130, été 2010, pp. 571-572. En ce qui concerne la mort de Desnos, Jean-Paul Louis a fait litière de l’accusation en rendant Céline responsable : voir J.-P. Louis, « Desnos et Céline, le pur et l’impur » in Histoires littéraires, n° 5, janvier-février-mars 2001, pp. [47]-60.
3. Jean-Claude Casanova in Commentaire, n° 130, op. cit.
4. Louis-Albert Zbinden, « Miroir du temps », Radio-Télé Suisse Romande [Lausanne], 25 juillet 1957. Repris in Céline et l’actualité littéraire, 1957-1961, « Les Cahiers de la Nrf », Gallimard, 1993 (rééd.), pp. 67-79.
5. Philippe Alméras, « Céline sent toujours le soufre », Le Figaro Magazine, 18 juin 1994. Repris sous le titre « Cent ans après » in Ph. Alméras, Sur Céline, Éditions de Paris, 2008, pp. [241]-250.
00:15 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 novembre 2010
Réflexions sur "Le Zéro et l'Infini" d'Arthur Koestler
Michael WIESBERG :
Réflexions sur Le Zéro et l’Infini d’Arthur Koestler
 La vie d’Arthur Koestler fut loin d’être paisible et monotone. Après avoir abandonné ses études d’ingénieur à la « Haute Ecole Technique » de Vienne, il a émigré vers la Palestine où il a vécu de petits boulots occasionnels. Après ses mésaventures palestiniennes, les éditions Ullstein de Berlin lui offrent un poste de correspondant au Proche Orient, à Paris, puis un poste de journaliste scientifique à Berlin même. Cela durera de 1926 à 1931. Cette période est caractérisée par l’engagement passionné de Koestler pour la cause sioniste. En 1931, il change d’option : il s’engage dans le parti communiste allemand. Pendant la guerre civile espagnole, il écope d’une condamnation à mort et échappe de peu à l’exécution. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert brièvement dans les armées française et britannique. Il finit par s’établir à Londres, où il écrira des ouvrages de vulgarisation scientifique. Le 3 mars 1983, il se suicide.
La vie d’Arthur Koestler fut loin d’être paisible et monotone. Après avoir abandonné ses études d’ingénieur à la « Haute Ecole Technique » de Vienne, il a émigré vers la Palestine où il a vécu de petits boulots occasionnels. Après ses mésaventures palestiniennes, les éditions Ullstein de Berlin lui offrent un poste de correspondant au Proche Orient, à Paris, puis un poste de journaliste scientifique à Berlin même. Cela durera de 1926 à 1931. Cette période est caractérisée par l’engagement passionné de Koestler pour la cause sioniste. En 1931, il change d’option : il s’engage dans le parti communiste allemand. Pendant la guerre civile espagnole, il écope d’une condamnation à mort et échappe de peu à l’exécution. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert brièvement dans les armées française et britannique. Il finit par s’établir à Londres, où il écrira des ouvrages de vulgarisation scientifique. Le 3 mars 1983, il se suicide.
Le roman Le Zéro et l’Infini de Koestler paraît d’abord à Londres en 1940. La figure centrale et fictive de ce roman est un bolchevique de la vieille garde, ancien commissaire du peuple : Roubachov. Il est accusé de « menées contre-révolutionnaires », après que les services secrets soviétiques, les sbires du NKVD, l’aient arrêté et placé en détention. D’après Koestler lui-même, cette figure de fiction est inspirée par les dirigeants bolcheviques réels, et de premier plan, que furent Karl Radek, Nicolas Boukharine et Léon Trotski, qui, tous, en ultime instance, devinrent des victimes des purges staliniennes de la seconde moitié des années 30. En créant le personnage de Roubachov, Koestler a essayé de montrer, de manière exemplative, ce qui se passait dans les prisons du NKVD et d’expliquer comment ce noyau dur des anciens révolutionnaires d’octobre 1917 a pu être liquidé. Roubachov est confronté à deux autres personnages, ses adversaires tout au long de l’intrigue : Ivanov et Gletkine. Ils représentent deux générations de bolcheviques. Ivanov, le plus âgé, reçoit l’ordre de convaincre Roubachov de la nécessité de faire des aveux. Bien sûr, Ivanov sait que les crimes imputés à Roubachov sont purement fictifs. Et, malgré cela, il tente de convaincre celui-ci qu’il serait insensé de jouer les martyrs. On ne doit pas transformer le monde en un « bordel sentimental et métaphysique ». La pitié, la conscience, le remord et le doute doivent demeurer des « dérapages répréhensibles ». On ne doit pas abjurer la violence tant qu’il y a du chaos dans le monde. Tout compromis avec sa propre conscience, explique Ivanov au prisonnier, équivaut à de la désertion. Comme l’histoire est a priori immorale, toute attitude qui reposerait sur des décisions morales dictées par la conscience d’un individu, équivaudrait à faire de la politique en s’inspirant des bonnes paroles d’un prêche dominical. Pour cette raison, explique Ivanov, les blessures que ressent Roubachov dans sa propre conscience, au vu des hommes sacrifiés au nom de la « raison de parti », ne sont jamais que des « fictions grammaticales ».
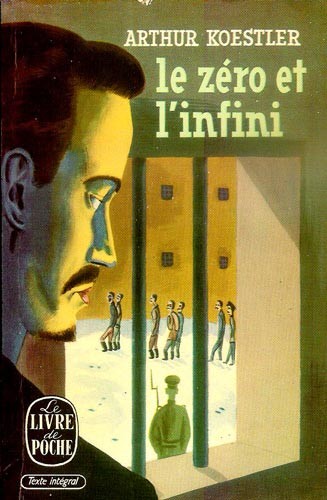 Pour Koestler, cette notion de « fiction grammaticale » doit nous expliquer cette part du moi que l’on ne définit pas comme « logique » mais comme « personnelle ». Or comme ce moi est inexistant pour le parti, mais que la grammaire réclame un substantif pour cette chose, Ivanov nomme cet aspect du « moi » celui de la « fiction grammaticale ». Roubachov, dans cette phase-là de sa détention, est tourmenté par des scrupules moraux, à cause de ses propres manières d’agir d’antan : celles-ci étaient déterminées exclusivement par un schéma de pensée rationnelle et acceptaient en toute conscience les pertes humaines qu’imposait cette rationalité. Ivanov réussit finalement à convaincre Roubachov que les idées, que celui-ci cultive et rumine, relèvent d’une « sentimentalité bourgeoise ». « On n’entendra aucun coq chanter », dit Ivanov, « si, objectivement parlant, des individus nuisibles sont liquidés ».
Pour Koestler, cette notion de « fiction grammaticale » doit nous expliquer cette part du moi que l’on ne définit pas comme « logique » mais comme « personnelle ». Or comme ce moi est inexistant pour le parti, mais que la grammaire réclame un substantif pour cette chose, Ivanov nomme cet aspect du « moi » celui de la « fiction grammaticale ». Roubachov, dans cette phase-là de sa détention, est tourmenté par des scrupules moraux, à cause de ses propres manières d’agir d’antan : celles-ci étaient déterminées exclusivement par un schéma de pensée rationnelle et acceptaient en toute conscience les pertes humaines qu’imposait cette rationalité. Ivanov réussit finalement à convaincre Roubachov que les idées, que celui-ci cultive et rumine, relèvent d’une « sentimentalité bourgeoise ». « On n’entendra aucun coq chanter », dit Ivanov, « si, objectivement parlant, des individus nuisibles sont liquidés ».
Ivanov conjure alors Roubachov de tirer les « conséquences logiques » de leurs conversations, et obtient du prisonnier que celui-ci se déclare prêt à signer un aveu qui va dans le sens de l’accusation. A partir de ce moment-là du récit, le roman prend une tournure dramatique. Ivanov, qui, lui aussi, est une figure controversée, est accusé d’avoir mené l’enquête sur Roubachov de manière trop négligente : il est alors remplacé par un représentant de la jeune génération de bolcheviques, qui ne connaît pas les compromis. Ivanov est ensuite liquidé.
Gletkine, qui prend la place d’Ivanov, représente, dans Le Zéro et l’Infini, une génération qui agit toujours sans réticence aucune selon la ligne fixée par le parti et qui ne connaît plus personnellement les circonstances vécues par les premiers bolcheviques dans la Russie des Tsars. La liste des crimes supposés que Gletkine présente à Roubachov, est en fait un ramassis d’accusations fantaisistes, dont, en tête, celle d’avoir fomenté un attentat contre le « numéro un », Staline. La volonté de résister, chez Roubachov, est ensuite annihilée par l’application d’une procédure d’audition véritablement éreintante. Au cours de cette longue audition, on apprend pour quels motifs Roubachov doit être sacrifié. « L’expérience nous apprend », explique Gletkine, « que l’on doit donner aux masses des explications simples et compréhensibles pour les processus difficiles et compliqués ». Si l’on disait aux paysans que malgré « les acquis de la révolution », ils sont restés fainéants et arriérés, on n’obtiendra rien. Mais si on leur explique qu’ils sont des « héros du travail » et que l’on attribue les maux qui les frappent encore à des saboteurs, alors on obtiendra quelque chose. Gletkine explique alors de manière fort plausible que le parti est régi par le principe que « la fin justifie les moyens ». Le parti attend donc des « vieux bolcheviques » qu’ils se sacrifient. La raison de cette exigence réside dans le fait que la guerre menace l’Union Soviétique. En cas de guerre, s’il y a des mouvements d’opposition, cela peut conduire à la catastrophe. Gletkine déclare alors à Roubachov qu’on lui reproche d’avoir, en liaison avec d’autres opposants, tenté de provoquer une scission au sein du parti. Si son repentir est « vrai », alors Roubachov doit aider le parti à éliminer cette scission. Il s’agit de montrer aux masses que tout opposant est un « criminel ». Après la victoire finale du socialisme, explique Gletkine, la vérité reviendra sans doute à la surface. A ce moment-là, Roubachov et les autres recevront la gratitude qui leur revient. Complètement brisé, Roubachov accepte pour finir de signer des aveux de culpabilité. Deux balles dans la nuque mettent fin à son existence.
Si l’on cherche à évaluer les conséquences des « grandes purges » pour l’Union Soviétique, l’attention se focalise immanquablement sur les successeurs des « vieux bolcheviques ». La nouvelle génération fut celle qui se soumit de manière inconditionnelle au parti. A la fin de la « tchistka » (de la « purge »), se dresse la pâle figure de l’apparatchik, caractérisée par une « non-identité ». Staline a créé les conditions préalables d’un système de parasites et de pleutres qui n’ânonnaient rien d’autre que les slogans doctrinaires du parti. Sous Staline, le matérialisme cru du marxisme-léninisme est entré dans un processus de perversion, dont l’apogée la plus emblématique fut l’émergence d’une pensée purement immanentiste, érigée au rang de dogme. C’est ainsi, in fine, que Staline a introduit les conditions initiales de l’effondrement final des systèmes sociaux du « socialisme réel » ou, plutôt, de l’égalitarisme radical. L’idée d’un ordre socialiste juste est resté une chimère en Europe orientale, pour laquelle des millions d’hommes ont dû sacrifier leur vie.
L’histoire ne se répète pas. Une tyrannie à la Hitler ou à la Staline ne se présentera plus. Mais il est certainement une chose que le livre de Koestler nous enseigne, et qui reste valable aujourd’hui : il nous montre où nous mène un monde régi par la pleutrerie et la pensée conformiste. Une république qui se vante d’incarner la liberté et la démocratie n’est pas pour autant immunisée contre les tumeurs totalitaires. Il faut donc toujours, dans tous les cas de figure, apprendre à se défendre contre la pleutrerie et le conformisme dès qu’ils se pointent à l’horizon.
Michael WIESBERG.
(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°11/1996, dans la série « Mein Lieblingsbuch / Folge 6 : « Sonnenfinsternis » von Arthur Koestler – Chronik der stalinistischen Säuberung » / « Mon livre favori / 6°partie : « Le Zéro et l’Infini » d’Arthur Koestler – Chronique des purges staliniennes » - Trad. franç. : octobre 2010).
00:10 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, communisme, arthur koestler, anticommunisme, années 30, purges staliniennes, stalinisme, épuration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 novembre 2010
J. Raspail: la patrie trahie par la République
La patrie trahie par la République
PAR JEAN RASPAIL
[Le Figaro 17 juin 2004]
J'ai tourné autour de ce thème comme un maître-chien mis en présence d'un colis piégé. Difficile de l'aborder de front sans qu'il vous explose à la figure. Il y a péril de mort civile. C'est pourtant l'interrogation capitale. J'ai hésité. D'autant plus qu'en 1973, en publiant Le Camp des saints, j'ai déjà à peu près tout dit là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que je crois que les carottes sont cuites. Car je suis persuadé que notre destin de Français est scellé, parce qu'“ils sont chez eux chez moi” (Mitterrand), au sein d'une “Europe dont les racines sont autant musulmanes que chrétiennes” (Chirac), parce que la situation est irréversible jusqu'au basculement définitif des années 2050 qui verra les “Français de souche” se compter seulement la moitié – la plus âgée – de la population du pays, le reste étant composé d'Africains, Maghrébins ou Noirs et d'Asiatiques de toutes provenances issus du réservoir inépuisable du tiers monde, avec forte dominante de l'islam, djihadistes et fondamentalistes compris, cette danse-là ne faisant que commencer(1).
Car je suis persuadé que notre destin de Français est scellé, parce qu'“ils sont chez eux chez moi” (Mitterrand), au sein d'une “Europe dont les racines sont autant musulmanes que chrétiennes” (Chirac), parce que la situation est irréversible jusqu'au basculement définitif des années 2050 qui verra les “Français de souche” se compter seulement la moitié – la plus âgée – de la population du pays, le reste étant composé d'Africains, Maghrébins ou Noirs et d'Asiatiques de toutes provenances issus du réservoir inépuisable du tiers monde, avec forte dominante de l'islam, djihadistes et fondamentalistes compris, cette danse-là ne faisant que commencer(1).
La France n'est pas seule concernée. Toute l'Europe marche à la mort. Les avertissements ne manquent pas – rapport de l'ONU (qui s'en réjouit), travaux incontournables de Jean-Claude Chesnais et Jacques Dupâquier, notamment –, mais ils sont systématiquement occultés et l'Ined pousse à la désinformation. Le silence quasi sépulcral des médias, des gouvernements et des institutions communautaires sur le krach démographique de l'Europe des Quinze est l'un des phénomènes les plus sidérants de notre époque. Quand il y a une naissance dans ma famille ou chez mes amis, je ne puis regarder ce bébé de chez nous sans songer à ce qui se prépare pour lui dans l'incurie des “gouvernances” et qu'il lui faudra affronter dans son âge d'homme...
Sans compter que les “Français de souche”, matraqués par le tam-tam lancinant des droits de l'homme, de “l'accueil à l'autre”, du “partage” cher à nos évêques, etc., encadrés par tout un arsenal répressif de lois dites “antiracistes”, conditionnés dès la petite enfance au “métissage” culturel et comportemental, aux impératifs de la “France plurielle” et à toutes les dérives de l'antique charité chrétienne, n'auront plus d'autre ressource que de baisser les frais et de se fondre sans moufter dans le nouveau moule “citoyen” du Français de 2050. Ne désespérons tout de même pas. Assurément, il subsistera ce qu'on appelle en ethnologie des isolats, de puissantes minorités, peut-être une quinzaine de millions de Français – et pas nécessairement tous de race blanche – qui parleront encore notre langue dans son intégrité à peu près sauvée et s'obstineront à rester imprégnés de notre culture et de notre histoire telles qu'elles nous ont été transmises de génération en génération. Cela ne leur sera pas facile.
Face aux différentes “communautés” qu'on voit se former dès aujourd'hui sur les ruines de l'intégration (ou plutôt sur son inversion progressive: c'est nous qu'on intègre à “l'autre”, à présent, et plus le contraire) et qui en 2050 seront définitivement et sans doute institutionnellement installées, il s'agira en quelque sorte – je cherche un terme approprié – d'une communauté de la pérennité française. Celle-ci s'appuiera sur ses familles, sa natalité, son endogamie de survie, ses écoles, ses réseaux parallèles de solidarité, peut-être même ses zones géographiques, ses portions de territoire, ses quartiers, voire ses places de sûreté et, pourquoi pas, sa foi chrétienne, et catholique avec un peu de chance si ce ciment-là tient encore.
Cela ne plaira pas. Le clash surviendra un moment ou l'autre. Quelque chose comme l'élimination des koulaks par des moyens légaux appropriés. Et ensuite?
Ensuite la France ne sera plus peuplée, toutes origines confondues, que par des bernard-l'ermite qui vivront dans des coquilles abandonnées par les représentants d'une espèce à jamais disparue qui s'appelait l'espèce française et n'annonçait en rien, par on ne sait quelle métamorphose génétique, celle qui dans la seconde moitié de ce siècle se sera affublée de ce nom. Ce processus est déjà amorcé.
Il existe une seconde hypothèse que je ne saurais formuler autrement qu'en privé et qui nécessiterait auparavant que je consultasse mon avocat, c'est que les derniers isolats résistent jusqu'à s'engager dans une sorte de reconquista sans doute différente de l'espagnole mais s'inspirant des mêmes motifs. Il y aurait un roman périlleux à écrire là-dessus. Ce n'est pas moi qui m'en chargerai, j'ai déjà donné. Son auteur n'est probablement pas encore né, mais ce livre verra le jour à point nommé, j'en suis sûr...
Ce que je ne parviens pas à comprendre et qui me plonge dans un abîme de perplexité navrée, c'est pourquoi et comment tant de Français avertis et tant d'hommes politiques français concourent sciemment, méthodiquement, je n'ose dire cyniquement, à l'immolation d'une certaine France (évitons le qualificatif d'éternelle qui révulse les belles consciences) sur l'autel de l'humanisme utopique exacerbé. Je me pose la même question à propos de toutes ces associations omniprésentes de droits à ceci, de droits à cela, et toutes ces ligues, ces sociétés de pensée, ces officines subventionnées, ces réseaux de manipulateurs infiltrés dans tous les rouages de l'Etat (éducation, magistrature, partis politiques, syndicats, etc.), ces pétitionnaires innombrables, ces médias correctement consensuels et tous ces “intelligents” qui jour après jour et impunément inoculent leur substance anesthésiante dans l'organisme encore sain de la nation française.
Même si je peux, à la limite, les créditer d'une part de sincérité, il m'arrive d'avoir de la peine à admettre que ce sont mes compatriotes. Je sens poindre le mot renégat, mais il y a une autre explication: ils confondent la France avec la République. Les “valeurs républicaines” se déclinent à l'infini, on le sait jusqu'à la satiété, mais sans jamais de référence à la France. Or la France est d'abord une patrie charnelle. En revanche, la République, qui n'est qu'une forme de gouvernement, est synonyme pour eux d'idéologie, idéologie avec un grand “I”, l'idéologie majeure. Il me semble, en quelque sorte, qu'ils trahissent la première pour la seconde.
Parmi le flot de références que j'accumule en épais dossiers à l'appui de ce bilan, en voici une qui sous des dehors bon enfant éclaire bien l'étendue des dégâts. Elle est extraite d'un discours de Laurent Fabius au congrès socialiste de Dijon, le 17 mai 2003: “Quand la Marianne de nos mairies prendra le beau visage d'une jeune Française issue de l'immigration, ce jour-là la France aura franchi un pas en faisant vivre pleinement les valeurs de la République...”
Puisque nous en sommes aux citations, en voici deux, pour conclure: “Aucun nombre de bombes atomiques ne pourra endiguer le raz de marée constitué par les millions d'êtres humains qui partiront un jour de la partie méridionale et pauvre du monde, pour faire irruption dans les espaces relativement ouverts du riche hémisphère septentrional, en quête de survie.” (Président Boumediene, mars 1974.)
Et celle-là, tirée du XXe chant de l'Apocalypse: “Le temps des mille ans s'achève. Voilà que sortent les nations qui sont aux quatre coins de la terre et qui égalent en nombre le sable de la mer. Elles partiront en expédition sur la surface de la terre, elles investiront le camp des saints et la ville bien-aimée.”
*Ecrivain, romancier.
(1)Le délicat iman de Vénissieux, en vertu du jus soli, a engendré à lui seul seize petits citoyens français.
00:10 Publié dans Littérature, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, jean raspail, france, république, idéologie républicaine, patrie, patriotisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ezra Pound and the Occult
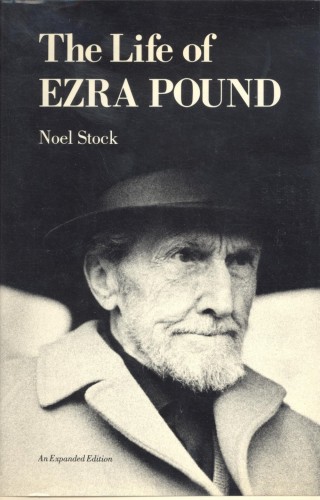 Ezra Pound and the Occult
Ezra Pound and the Occult
Brian Ballentine
In 1907, when Ezra Pound was still teaching Romance languages at Wabash
College in Indiana, he completed the poem "In Durance":
I am homesick after mine own kind
And ordinary people touch me not.
Yea, I am homesick
After mine own kind that know, and feel
And have some breath for beauty and the arts (King 86).
Pound left America and its "ordinary people" behind for Europe shortly after. When he arrived in London in 1908, Pound wasted no time becoming a part of the community of writers which he considered his "own kind." He was quickly running among the more prestigious of London’s literary society including members from the Rhymer’s Club and W. B. Yeats’s publisher Elkin Mathews. Of course, it was Yeats’s association that Pound truly desired and successfully sought out. In Poetry 1, Pound begins his "Status Rerum" by declaring that he found "Mr. Yeats the only poet worthy of serious study" (123). Pound would eventually be content to condense his esoteric community of cutting edge writers down to two men: himself and Yeats. In 1913 he wrote Harriet Monroe proclaiming that London’s writers are divided into two groups: "Yeats and I in one class, and everybody else in the other" ("Status Rerum" 123).When Pound first met Yeats, the older poet was heavily involved and experimenting with theurgy, or magic, that is performed with the aid of beneficent spirits. This form of occult study was not at all of interest to Pound. Shortly after their introduction, it was arranged for Pound to serve as Yeats’s "secretary" at the winter retreat Stone Cottage. Not trying to hide his skepticism , Pound wrote this letter to his mother just prior to his first winter with Yeats at Stone Cottage:
My stay at Stone Cottage will not be in the least profitable. I detest
the country. Yeats will amuse me part of the time and bore me to
death with psychical research the rest. I regard the visit as a duty to
posterity (Paige 25).
The purpose of this research is to expose the various types of occultism that were prevalent during Pound's life and determine what elements of the occult he subscribed to. Although there are signs of an occult influence all the way through his later writing, Pound’s own stance on the occult is difficult to pin down. Pound’s own belief in the occult was one that was constantly being rethought and revised. There are moments when Pound was on the brink of exploration into Yeats’s world of spirits as well as moments when he was ready to abandon the occult altogether. Pound’s exploration of "retro-cognition," his revitalization
of the Greek idea of the "phantastikon," his pursuit of gnosis or what he termed a "crystal" state, and his associations with some of London’s premiere occultists provide evidence for the former. The latter is demonstrated in his revisions on the original 1917 Three Cantos and his apparent desire to be disassociated with the "pseudo-sciences" of the occult. Much of the occult element that dominated the original publication has been edited entirely out of the final and existing copy. In any case, much of Pound’s writing is indebted to an occult influence and it will be explored in this paper.
In his essay "Ezra Pound’s Occult Education," Demetres Tryphonopoulos warns other critics not to view Pound’s skeptical letter to his mother as a rejection towards all forms of the occult. He states that "it is only theurgy and spiritualism that Pound rejects" (76). These "pseudo-sciences" are what Tryphonopoulos believes to be "the areas of human interest which many true occultists would reject as involving the degradation of humanity" ("Occult Education" 74). Yeats’s other interests in astrology and numerology, both of which were popular in the early twentieth century, are also included among the "pseudo-sciences." Occult studies such as gnosticism and theosophy are understood as legitimate pursuits by scholars like Tryphonopoulos. Gnosis, an esoteric form of knowledge that made possible the direct awareness of the Divine, was one of Pound’s major interests with the occult. James Longenbach argues that Pound labored over creating a "priest-like status" for himself and his work (92). The quest for becoming as close to God as possible led Pound on a long exploration of occult texts. According to Walter Baumann, Pound’s quest drove him to "provide further ingredients for [his] own vision of Paradise" (311). These esoteric components or "ingredients" then become the source of much difficulty in understanding Pound’s work. To date only a few scholars have made the occult element in Pound’s work more accessible and in the past only people "deeply steeped in occult literature" could successfully navigate his writing (Baumann 318). Pound never came so far around as to accept Yeats’s interests in what he considered less useful facets of the occult, but he would humor Yeats. The older poet was also interested in astrology and asked Pound for his birth date so he could determine his horoscope. In a letter to Dorothy Shakespear Pound exclaimed:
The Eagle [Yeats] is welcomed to my dashed horoscope tho’ I
think Horace was on the better track when he wrote
"Tu ne quaesaris, scire nefas, quem
mihi quem tibi
Finem dii dederunt" (Litz 113).
[Ask not, we cannot know, what ends the gods have set for me, for thee]
Despite Pound’s show of pessimism, he provided Yeats with all of the necessary information, which included writing a letter to his mother for the exact time of his birth. He told his mother that "half a million people, some of them intelligent, who still believe in the possibility of planetary influences . . . When astrology is taken hold of systematically by modern science there will be some sort of discoveries. In the meantime there is no reason why one should not indulge in private experiment and investigation (Paige 152).A subject of particular interest to both men is something that psychologists today have termed "retro-cognition." Yeats, Pound and the rest of England received their introduction to this phenomenon when Anne Moberly and Eleanor Jourdain published An Adventure in 1911. On August 10, 1901 the two women claimed to have been strolling through the Versailles gardens and found themselves transported back into the eighteenth century. Apparently, neither of them had realized what had occurred at the time but recounted the experience in a narrative:
We walked briskly forward, talking as before, but from the moment we left the lane an
extraordinary depression had come over me. . . In front of us was a wood, within which,
and overshadowed by trees, was a light garden kiosk, circular and like a small bandstand,
by which a man was sitting. There was no greensward, but the ground was covered by
rough grass and dead leaves as in a wood. The place was so shut that we could not see
beyond it. Everything suddenly looked unnatural, therefore unpleasant; even the trees
behind the building seemed to have become flat and lifeless, like a wood worked in a
tapestry (41).
Ten years of research in the French National Archives led them to believe that all the things they saw that day existed not in 1901 but in 1789. Also, they determined the person Moberly saw by the terrace, who is referred to as a "man" in the narrative, to be Marie Antoinette (Longenbach 222-23).Shortly after the publication of An Adventure, Yeats completed two essays for Lady Gregory’s Visions and Beliefs in the West of Ireland. In his essays, Yeats references An Adventure, making it highly probable that the two men had possession of the book during the Stone Cottage years if not sooner. An Adventure became an important beginning for the work of Pound and how the artist can relate to the spirit of his ancestors. The key to these relations with the past is the soul. Pound borrowed from a lot of different sources to derive his own theories on the human soul. He used Cicero’s idea of the "immortality of the soul" in De Senectute (Longenbach 222-23).He also borrowed from Plato and the Phaedrus in the Spirit of Romance: "And this is the recollection of those things which our souls saw when in company with God-when looking down from above on that which we now call being, and upward toward the true being" (140-41). Pound himself claimed to have had two experiences with retrocognition which were extremely important to him. As Longenbach writes, "Pound’s poetic goal was the cultivation of ‘adventures,’ the soul’s visionary memories of the paradise or the past it once knew" (229).Pound recounts his own experiences with retrocognition in an essay on Arnold Dolmetsch published in 1914. "So I had two sets of adventures. First, I perceived a sound which was undoubtedly derived from the Gods, and then I found myself in a reconstructed century- in a century of music, back before Mozart or Purcell, listening to clear music, to tones clear as brown amber" (Eliot 433). Pound was drawing on or participating in what he determined to be the soul’s eternal memory. His essay begins with a description of his first adventure:
I have seen the God Pan and it was in this manner: I heard a bewildering and pervasive music moving from precision to precision within itself. Then I heard a different music, hollow and laughing. Then I looked up and saw two eyes like the eyes of a wood- creature peering at me over a brown tube of wood. Then someone said: Yes, once I was playing a fiddle in the forest and I walked into a wasps’ nest. Comparing these things with what I can read of the Earliest and best authenticated appearances of Pan, I can but conclude that they relate to similar experiences. It is true that I found myself later in a room covered with pictures of what we now call ancient instruments, and that when I picked up the brown tube of wood I found that it had ivory rings upon it. And no proper reed has ivory rings on it, by nature. . . .Our only measure of truth is, however, our own perception of truth. The undeniable tradition of metamorphoses teaches us that things do not remain always the same. They become other things by swift and unanalysable process (Eliot 431).
Pound’s own understanding of truth and what he perceived to be his reality are bold advancements from what was presented in the original An Adventure. The visionary’s experience becomes the sole measure of reality and therefore Pound’s encounter with Dolmetsch as Pan becomes factual. In his essay, "Psychology and Troubadours," Pound draws a parallel between himself and early visionaries who had no way of differentiating imaginary visions from a "real" environment: "These things are for them real" (Spirit of Romance 93). Also, although Pound’s adventures and experiences cannot technically be affirmed in any way, they "stand in a long tradition of similar experiences recorded in the literature of folklore, mythology, and the occult" (Longenbach 230). In the essay on Dolmetsch, Pound works to place himself in this tradition when he writes: "When any man is able, by a pattern of notes or by an arrangement of planes or colours, to throw us back into the age of truth, everyone who has been cast back into that age of truth for one instant gives honour to the spell which has worked, to the witch-work or the art-work, or whatever you like to call it" (Eliot 432). Like Moberly and Jourdain, who had peered into the past and subsequently took ten years to write about it, Pound was wrestling with putting his visions into poetry. The "arrangement of planes or colours," the "art-work" which "throws us back into the age of truth" is what Pound wanted to create with the early Cantos. Pound began writing the first of the Cantos around 1910 but did not pursue them in earnest until 1915. It was during this time that Pound is documented in his letters as having read Robert Browning’s poem "Sordello" out loud to Yeats at Stone Cottage. Although Pound had read the poem before, it was not until he read it to Yeats that "Sordello" became a major influence. He praises the poem in a letter to his father on December 18, 1915: "It is probably the greatest poem in English. Certainly the best long poem since Chaucer. You’ll have to read it sometime as my big long endless poem that I am now struggling with starts out with a barrel full of allusions to ‘Sordello’" (Bornstein 119-20). However, the original support Pound relied on from Browning would soon be replaced with occult references. In the June, July and August 1917 edition of Poetry Magazine, Pound published his Three Cantos. These three were supposed to be the beginning of his existing long work The Cantos. Even after the highly positive review of Browning’s poem to his father, Pound would have nothing to do with Browning’s style. The original opening, which served more or less as a dialogue with Browning, is deceiving. Pound makes no effort to sustain Browning’s technique through his poem. It does not function in a lyric mode, rather it is an "apologia for the lyric mood" (Nassar 12). Pound began to question Browning’s elaborate metaphor for the stage and his character’s acting on it. Pound did not hide his "aesthetic and philosophic problems" (Nassar 13) that he had with Browning when he wrote:
. . . what were the use
Of setting figures up and breathing life upon them,
Were’t not our life, your life, my life extended?
I walk Verona. (I am here in England.)
I see Can Grande. (Can see whom you will.)
You had one whole man?
And I have many fragments, less worth? Less worth?
Ah, had you quit my age, quit such a beastly age and
cantankerous age?
You had some basis, had some set belief (Poetry, June 1917, 115).
As if to answer his own question, and provide Browning with proper examples, Pound continued with passages in the mode of An Adventure. The only way to contain the "beastly and cantankerous age" in which one lived was to tap into the past as Moberly and Jordain had done.
Sweet lie!-Was I there truly? . . .
Let’s believe it . . .
No, take it all for lies
I have but smelt this life, a wiff of it-
. . . And shall I claim;
Confuse my own phantastikon,
Or say the filmy shell that circumscribes me
Contains the actual sun;
confuse the thing I see
With actual gods behind me?
Are they gods behind me?
How many worlds we have! If Botticelli
Brings her ashore on that great cockle-shell-
His Venus (Simonetta?),
And Spring and Aufidus fill the air
With their clear outlined blossoms?
World enough.
(Poetry, June 1917, 120-21)
Eugene Nassar claims that Pound demonstrated the "mind circumscribed by its diaphanous film-its limits-[which] imagines gods when in the presence of beauty . . . The mind as ‘phantastikon’ may be intuiting transcendent truths" (12). Pound wrestled with the "truth" about his occult link to the past in his revisions on Three Cantos all the way up until its republication in 1925. The once long opening addressed to Browning was reduced to the opening four lines of Canto II:
Hang it all, Robert Browning, There can be but the one Sordello. But Sordello and my Sordello? Lo Sordels si fo di Mantovana" (6).Following the address to Browning, Pound presents his vision of his characters or in this case "Ghosts" that "move about me / Patched with histories" (Poetry 116). There is no need for Pound to go "setting up figures and breathing life into them" because his characters were already part of a living past. Pound’s "fragments" are in fact not "less worth" because together they form a more complete whole than Browning’s characters. Pound sees these apparitions hovering over the water at Lake Garda. As with his Imagist poetry, these early portions of the Cantos reflect Pound’s attention to presenting the clearest possible picture of his experience:
And the place is full of spirits.
Not lemures, not dark and shadowy ghosts,
But the ancient living, wood white,
Smooth as the inner bark, and firm of aspect,
And all agleam with colors-no, not agleam,
But colored like the lake and like the olive leaves (Poetry June 1917, 116).
Pound used specific people and places, such as Lake Garda, to set up a desired historical backdrop. Often with Pound, the more oblique source was championed. The names are obscure and esoteric, leaving "ordinary people" in the dark just as Pound intended. Pound’s references to antiquated places, his use of foreign language, all in addition to his occult content, contribute to a higher level of difficulty in his poetry:
‘Tis the first light-not half light-Panisks
And oak-girls and the Maenads
Have all the wood. Our olive Sirmio
Lies in its burnished mirror, and the Mounts Balde and Riva
Are alive with song, and all the leaves are full of voices (Poetry June 1917,118).
The visionary experiences that Pound recreates in the Three Cantos are matched with these areas to "emphasize their origin in the meeting of a particular consciousness with a particular place" (Longenbach 232). This association was a technique that Pound had already begun experimenting with in some of his writing such as "Provincia Deserta." Yeats put it into his own words in a portion of his prose piece Per Amica Silentia Lunae: "Spiritism . . . will have it that we may see at certain roads and in certain houses old murders acted over again, and in certain fields dead huntsmen riding with horse and hound, or in ancient armies fighting above bones or ashes" (354). The spirits that haunt Pound’s Cantos are ones which he spent much time excavating from history during his reading at Stone Cottage. Also, Pound used specific names and places from his research to create a sense of locality. In the first Canto it was places such as Sirmio, and in the second there were others such as the Dordogne valley in France:
So the murk opens.
Dordogne! When I was there,
There came a centaur, spying the land,
And there were nymphs behind him.
Or going on the road by Salisbury
Procession on procession-
For that road was full of peoples,
Ancient in various days, long years between them.
Ply over ply of life still wraps the earth here.
Catch at Dordoigne (Poetry July 1917, 182).
At the same time that Pound was struggling with the original Three Cantos, Yeats was preparing his own take on An Adventure. The older poet was busy formulating what he called the "doctrine of the mask" (Autobiography 102). According to Yeats, this doctrine "which has convinced [him] that every passionate man . . . is, as it were, linked with another age, historical or imaginary, where alone he finds images that rouse his energy" (Autobiography 102). Yeats’s link to the past came in a voice which he claimed to have heard for awhile but ignored. The voice even provided him with information leading to its identity. Yeats discovered that he was communicating with a Cordovan Moor named Leo Africanus. However, he did not take Leo seriously until a seance conducted on July 20, 1915. After the seance, Yeats began to consider the possibility of an anti-self existing from another period of time. Communication with this opposite personality would lead to a more complete existence as well as a better understanding of the self. Yeats began writing letters to Leo and in turn would write letters back to himself believing that Leo’s intentions could be conveyed through him. Now that Yeat’s theory had advanced to a stage where his opposite existed in another century, his idea advanced from one that was grounded in psychology to a theory that had just as much to do with history (Longenbach 190-91). There is no documented proof of Pound ever participating in one of Yeats’s seances. Despite Pound’s lack of involvement, it is impossible to overlook the parallels between the two poets work at the time. Pound was using his own ghosts and their historical associations in his early Cantos. In his final winter at Stone Cottage, Pound took interest in the seventeenth-century Neo-Platonic occult philosopher John Heydon. In 1662, Heydon published his Holy Guide. Although Pound enthusiastically read Heydon’s book, he presented a mixed image of him with Heydon’s debut in the original Three Cantos . In the final version of the original Three Cantos III, Pound introduces Heydon in a fashion that is somewhere between mockery and praise:
Another’s a half-cracked fellow-John Heydon,
Worker of miracles, dealer in levitation,
In thoughts upon pure form, in alchemy,
Seer of pretty visions (‘servant of God and secretary of nature’);
Full of a plaintive charm, like Botticelli’s,
With half-transparent forms, lacking the vigor of gods. . .
Take the old way, say I met John Heydon,
Sought out the place,
Lay on the bank, was ‘plunged deep in the swevyn;’
And saw the company-Layamon, Chaucer-
Pass each his appropriate robes; (Poetry Aug, 1917, 248)
Walter Bauman refers to Heydon as Pound’s "spiritual brother" (314). Despite the not-so flattering introduction of Heydon, Pound would appear to agree with Bauman. One possible explanation for Pound’s harsher opening remarks on Heydon could be that many people of Heydon’s own time did not think highly of his work. To many, Heydon was simply "a charlatan trifling with occult lore" (Bauman 306). In any case, Pound seems to make a point of acknowledging Heydon’s uncertain past before citing him as a credible source. Pound begins to spell out exactly what one could obtain by reading Heydon in a section of his prose piece Gaudier-Brzeska: A Memoir. In section 16, Pound writes positively about artists like Brzeska, Wyndham Lewis and Jacob Epstein who were on the forefront of the new movement Vorticism. Here he discusses the power a work of art can have:
A clavicord or a statue or a poem, wrought out of ages of knowledge, out of fine perception and skill, that some other man, that a hundred other men, in moments of weariness can wake beautiful sound with little effort, that they can be carried out of the realm of annoyance into the realm of truth, into the world unchanging, the world of fine animal life, the world of pure form. And John Heydon, long before our present day theorists, had written of the joys of pure form . . . inorganic, geometrical form, in his "Holy Guide" (157).
Pound also closes the section with a final reminder to read "John Heydon’s ‘Holy Guide’ for numerous remarks on pure form and the delights thereof" (Gaudier-Brzeska: A Memoir 167). There are several facets of the occult found in Pound’s memoir. He infers that the perfect work of art is layered with history. It is hundreds of years and hundreds of men in the making. The "realm of truth" is reached when the mind, as Nassar previously described it, has the ability to imagine "gods when in the presence of beauty." The "transcendent truths," that are a conglomeration of the past, can then be tapped as a source for the pure form Pound is describing (Nassar 12).Much of Pound’s desire for a pure truth goes hand in hand with his quest to be close to the Divine and obtain his "priest-like status." His use of Heydon becomes clearer as one reads that Heydon pondered questions such as "if God would give you leave and power to ascend to those high places, I meane to these heavenly thoughts and studies (Heydon 26). Pound borrows almost verbatim from Heydon and then cites him in "Canto 91":
to ascend those high places
wrote Heydon
stirring and changeable
‘light fighting for speed’ (76).
Heydon continues stating that people involved with studies such as his should realize that "their riches ought to be imployed in their own service, that is, to win Wisdome" (31). This "Wisdome" was something Pound wanted to make certain the masses or the "ordinary people" would not be privy to. It was exactly the divine wisdom, or gnosis, that Pound was in search of. Pound was asking the same questions and desiring the same answers that Heydon was asking hundreds of years earlier: "let us know first, that the minde of man being come from that high City of Heaven" (33). With these overt connections to Heydon, Pound’s opening remarks on him as a "half-cracked fellow" remain puzzling. Again, it is likely that Pound was initially shy about such overt references to a less-than-favorable occultist just as he was with some of Yeats’s mysticism. As it turns out, the title "Secretary of Nature" was actually Heydon’s and was printed on the title page of Holy Guide. Pound was respectful enough to include the title. Also in the Cantos, Heydon is in the company of men such as Ocellus, Erigena, Mencius and Apollonius. Pound appears to have thought much higher of Heydon than his opening remarks lead a reader to believe. In total, over half a dozen quotes are taken from Heydon’s work adding to the "crystal clear" quality of Pound’s Cantos (Davie 224).
From the green deep
he saw it,
in the green deep of an eye:
Crystal waves weaving together toward the gt/healing
Light compenetrans of the spirits
The Princess Ra-Set has climbed
to the great knees of stone,
She enters protection,
the great cloud is about her,
She has entered the protection of crystal . . .
Light & the flowing crystal
never gin in cut glass had such clarity
That Drake saw the splendour and wreckage
in that clarity
Gods moving in crystal
(Canto 91, 611)
In this selection, the "Pricess Ra-Set" has completed a journey that has allowed a metamorphosis to take place about her. The crystal which has encompassed her represents Heydon’s "pure form" that Pound was himself searching for. Inside this crystal protection "gods are manifest, whatever their ontological status outside" (Nassar 110). Pound’s metaphor shows up in several places. In "Canto 92," Pound describes "a great river" with the "ghosts dipping in crystal" (619). Also, in "Canto 91," Pound wrote:
"Ghosts dip in crystal,
adorned"
. . . A lost kind of experience?
scarcely,
Queen Cytherea,
che ‘l terzo ciel movete
[who give motion to the third heaven]
Pound already knew the answer to his own question about experience when he asked it. Crystal was chosen not only for its clarity to represent the pureness of form but it is hard and durable as well. The experience was not lost in the protection of this divine state that is the "crystal."
There are several individuals who were contemporaries of Pound that had a large influences on Pound and exposed him to their own ideas about the occult. People such as Yeats, A. R. Orage, Allen Upward, Dorothy Shakespear, and Olivia Shakespear all had their own occult interests. However, the largest occult influence on Pound, even greater than that of Yeats, was G. R. S. Mead. Mead became a member of Madame Blavatsky’s Theosophical Society in 1884. In 1889 he was Blavatsky’s private secretary and kept that position until her death in 1891. He served as the society’s editor for their monthly magazine but branched off and quit the society altogether in 1909. Blavatsky’s writings and practices aligned themselves more with the "pseudo-sciences" that Pound would not have approved of. Oddly enough, in Mead’s essay "‘The Quest’ - Old and New:
Retrospect and Prospect," he apparently does approve of Blavatsky’s ways either:I had never, even while a member, preached the Mahatma - gospel of H. P. B. [Blavatsky], or propagandized Neo-theosophy and its revelations. I had believed that "theosophy" proper meant the wisdom-element in the great religions and philosophies of the world (The Quest 296-97).
This passage represents thinking that was in line with Pound’s ideas on gnosis and his own pursuit of wisdom. Mead is considered by some to be "the best scholar the Theosophical Society ever produced" (Godwin 245).Pound’s assessment of what he experienced in his visionary episodes as well as his readings was heavily influenced by the writings and teachings of Mead. Pound met him at one of Yeats’s "Monday Evenings" at 18 Woburn Building in London which Mead regularly attended. On October 21, 1911, Pound wrote to his parents: "I’ve met and enjoyed Mead, who’s done so much research on primitive mysticism - that I’ve written you at least four times." [1] In another letter to his parents dated February 12, 1912, Pound praises Mead writing: "G. R. S. Mead is about as interesting - along his own line - as anyone I meet"(Beinecke 238). In a letter to his mother dated September 17, 1911, Pound relays that Mead had asked him to write a publishable lecture. Pound discusses the task with his more skeptical side of the occult: "I have spent the evening with G. R. S. Mead, edtr. of The Quest, who wants me to throw a lecture for his society which he can afterwards print. ‘Troubadour Psychology,’ whatever the dooce that is" (Beinecke 223). Pound did go on to give the lecture which gave birth to his essay "Psychology and the Troubadours." In this essay Pound wrote that "Greek myth arose when someone having passed through delightful psychic experience tried to communicate it to others" (92). Again Pound was referring to an occult "adventure" similar to that of Moberly and Jourdain. Once an individual has undergone this event "the resulting symbol is perfectly clear and intelligible" (Longenbach 91). Pound also endeavors to explain further his idea of the Greek "phantastikon." According to Pound, "the consciousness of some seems to rest, or to have its center more properly, in what the Greek psychologists called the phantastikon. Their minds are, that is, circumvolved about them like soap-bubbles reflecting sundry patches of the macrocosmos" (92). In April of 1913, Pound wrote a letter to Harriet Monroe attempting to clarify this element of his essay: "It is what Imagination really meant before the term was debased presumably by the Miltonists, tho’ probably before them. It has to do with the seeing of visions."
Pound’s phantastikon became his link to tapping into the purest form of "real symbolism." Dorothy Shakespear requested that Pound explain to her the difference between this symbolism and aesthetic or literary symbolism. He wrote her stating:
There’s a dictionary of symbols, but I think it immoral. I mean that I think a superficial acquaintance with the sort of shallow, conventional, or attributed meaning of a lot of symbols weakens - damnably, the power of receiving an energized symbol. I mean a symbol appearing in a vision has a certain richness and power of energizing joy - whereas if the supposed meaning of the symbol is familiar it has no more force, or interest of power of suggestion than any other word, or than a synonym in some other language (Pound/Shakespear 302).
Of course, the ability to perceive these symbols was not within the reach of everyone. It was only for those who have set sail in the pursuit of higher wisdom. Those in pursuit of gnosis "possess the key to the mysteries of its symbolism and establish themselves as priests - divinely inspired interpreters to whom the uninitiated public must turn for knowledge" (Longenbach 91). From here, the possibilities are endless according to Pound:
"All is within us", purgatory and hell,
Seeds full of will, the white of the inner bark
the rich and the smooth colours,
the foreknowledge of trees,
sense of the blade in seed, to each its pattern.
Germinal, active, latent, full of will,
Later to leap and soar,
willess, serene,
Oh one could change it easy enough in talk.
And no one vision will suit all of us.
Say I have sat then, the low point of the cone,
hollow and reaching out beyond the stars,
reaches and depth, the massive parapets,
Walls whereon chariots went by four abreast (Longenbach 237).
Pound made it a habit to not only read Mead’s article’s and books but he also religiously attended his lectures outside the "Monday Evenings." In another letter to his parents he wrote: "I’m going out to Mead’s lecture. And so on as usual. This being Tuesday" (Beinecke 271). From these readings and lectures, Pound most likely got his inspiration for the beginning of his revised Cantos:
the passing into the realms of the dead, while living, refers to the initiation of the soul of the candidate into the states of after- death consciousness, while his body was left in a trance. The successful passing through these states of consciousness removed the fear of death, by giving the candidate an all sufficing proof of the immortality of the soul and of its consanguinity with the gods (Taylor 319).
The "initiation" process of the soul was one that Pound decided must begin his entire Cantos. "Canto 1" starts with: "And then went down . . ." which initiates a descent that is the beginning of this journey (3). Pound made it clear in "Canto 1" that the Odysseus figure was alive during his descent just as Mead required the figure to be "living." Also, in a blatant attempt to achieve the "consanguinity with the gods," Pound’s character drank the blood of the sheep that was sacrificed to them.
The process that Pound is discussing is palingenesis, or the birth and the growth of the soul. The ultimate goal of the entire process, as Pound saw it, was "the expansion of the initiand’s consciousness into a state where he awakes to his relationship with the gods, and participates in their world" (Celestial Tradition 107). At this initial stage the initiate knows nothing except that he is on a quest for gnosis. As Pound wrote in Canto 47: "Knowledge the shade of a shade, / Yet must thou sail after knowledge / Knowing less than drugged beasts" (30).
The completion of the journey is the passage into what was previously described as "the crystal." This stage is the graduation from the ephemeral world of man to the realm of the gods. The soul has passed "from fire" of the "Kimmerian lands" of "Canto 1" "to crystal / via the body of light" (Canto 91,61). Pound put it much more bluntly when he stated that one must "bust thru" to this realm of understanding but he made his point (Celestial Tradition 107). Although he makes references to the exceptions, Tryphonopoulos contends that "Scholarly comment on Pound’s relation to the occult is virtually nonexistent" ("Occult Education" 75). The difficulty in analyzing Pound’s occult studies is that his reading and influences are so vast. From his amassed material Pound would piece together a detailed mosaic. This method provided a coherence for his presentation. In this fashion, structure begins to surface in even his most dense work The Cantos. Tryphonopoulos understands The Cantos to be a "collection of fragments gathered according to a predetermined plan for the purpose of validating the author’s original value system" (1). Pound seems to be speaking of this in the very late "Canto 110" when he writes: "From times wreckage shored / these fragments shored against ruin" (781). These elements pulled from the rubble of history and which Pound tiles together are what make the picture complete.
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature américaine, lettres, lettres américaines, etats-unis, ezra pound, occultisme, usure, usurocratie, philologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 novembre 2010
Romain Gary, "camaleonte" e libertario
di Roberto Alfatti Appetiti
Fonte: Roberto Alfatti Appetiti (Blog) [scheda fonte]
 Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura».
Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura».
Se lei nel settembre del ’79, appena quarantenne ma sempre più instabile psicologicamente, era stata trovata morta in una automobile parcheggiata alla periferia di Parigi, l’anno successivo – il 3 dicembre del ’80, giusto trent’anni fa – fu Gary stesso a scrivere la sceneggiatura del proprio congedo dal mondo. Curandone ogni dettaglio: la pistola con cui bruciarsi il cervello e la vestaglia di seta rossa, comprata e indossata per l’occasione affinché nell’appartamento di rue du Bac il sangue si notasse meno. Un biglietto d’addio lasciato per eliminare sin troppo facili interpretazioni, prendere le distanze dalla ex moglie, la cui militanza nelle Pantere nere s’era fatta via via più imbarazzante, e ristabilire così davanti all’eternità chi fosse l’unico protagonista della scena: «Nessun rapporto con Jean Seberg. I patiti dei cuori infranti sono pregati di rivolgersi altrove».
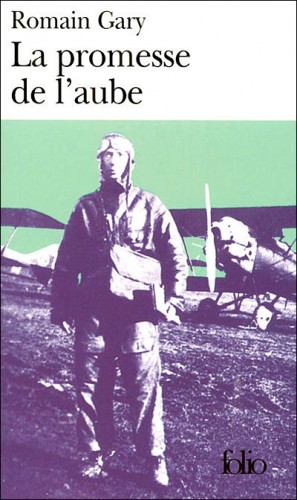 Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare».
Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare».
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
What did Ezra Pound really say?
WHAT DID EZRA POUND REALLY SAY?
by Michael Collins Piper
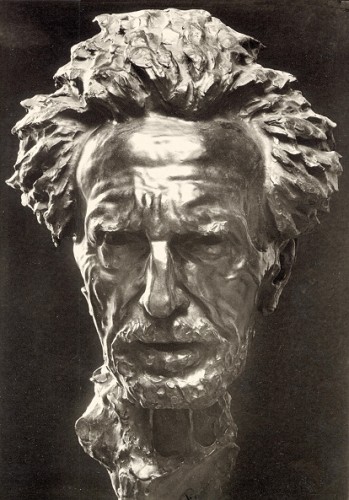 From 1945 through 1958 America's iconoclastic poet--the flamboyant Ezra Pound, one of the most influential individuals of his generation--was held in a Washington, D.C. mental institution, accused of treason. Pound had merely done what he had always done--spoken his mind. Unfortunately for Pound, however, he had made the error of criticizing the American government in a series of broadcasts from Italy during World War II. For that he was made to pay the price. Was Pound a traitor--or a prophet? Read his words and judge for yourself.
From 1945 through 1958 America's iconoclastic poet--the flamboyant Ezra Pound, one of the most influential individuals of his generation--was held in a Washington, D.C. mental institution, accused of treason. Pound had merely done what he had always done--spoken his mind. Unfortunately for Pound, however, he had made the error of criticizing the American government in a series of broadcasts from Italy during World War II. For that he was made to pay the price. Was Pound a traitor--or a prophet? Read his words and judge for yourself.
American students have been taught by scandalized educators that famed American poet and philosopher Ezra Pound delivered "treasonous" English-language radio broadcasts from Italy (directed to both Americans and to the British) during World War II. However, as noted by Robert H. Walker, an editor for the Greenwood Press: "Thousands of people have heard about them, scores have been affected by them, yet but a handful has ever heard or read them." This ignorance of Pound's most controversial political rhetoric is ironic, inasmuch as: "No other American--and only a few individuals throughout the world--has left such a strong mark on so many aspects of the 20th century: from poetry to economics, from theater to philosophy, from politics to pedagogy, from Provencal to Chinese. If Pound was not always totally accepted, at least he was unavoidably there." One critic called Pound's broadcasts a "confused mixture of fascist apologetics, economic theory, anti-Semitism, literary judgment and memory" Another described them as "an unholy mixture of ambiguity, obscurity, inappropriate subject matters [and] vituperation," adding (grudgingly) there were "a few pearls of unexpected wisdom."
Despite all the furor over Pound's broadcasts--which were heard between January of 1941 through July of 1943--it was not until 1978 that a full-length 465-page compendium of transcriptions of the broadcasts was assembled by Prof. Leonard Doob of Yale University in association with aforementioned Greenwood Press. Published under the title "Ezra Pound Speaking"--Radio Speeches of World War II, the volume provides the reader a comprehensive look at Pound's philosophy as it was presented by the poet him self in what Robert Walker, who wrote the foreword to the compendium, describes as "that flair for dramatic hyperbole."
What follows is an attempt to synthesize Pound's extensive verbal parries. Most of what is appears here has never been printed anywhere except in the compendium of Pound's wartime broadcasts. Thus, for the first time ever--for a popular audience--here is what Pound really had to say, not what his critics claim he said. When he was broadcasting from Italy during wartime, Pound evidently pondered the possibility of one day compiling transcriptions of his broadcasts (or at least expected--quite correctly--that one day the transcripts would be compiled by someone else). He hoped the broadcasts would show a consistent thread once they were committed to print. Pound recognized relaying such a massive amount of information about so many seemingly unrelated subjects might be confusing listeners less widely read than he. However, the poet also had very firm ideas about the need of his listeners to be able to synthesize the broad range of material that appeared in his colorful lectures.
Pound was sure his remarks on radio were not seditious, but were strictly informational and dedicated to traditional principles of Americanism--including the Constitution, in particular. In response to media claims that he was a fascist propagandist, Pound had this to say: "If anyone takes the trouble to record and examine the series of talks I have made over this radio it will be found I have used three sorts of material: historical facts; convictions of experienced men, based on fact; and the fruits of my own experience. The facts . . . mostly antedate the fascist era and cannot be considered as improvisations trumped up to meet present requirements. Neither can the beliefs of Washington, John Adams, Jefferson, Jackson, Van Buren, and Lincoln be laughed off as mere fascist propaganda. And even my own observations date largely before the opening of the present hostilities. "I defend the particularly American, North American, United States heritage. If anybody can find anything hostile to the Constitution of the U.S.A. in these speeches, it would greatly interest me to know what. It may be bizarre, eccentric, quaint, old-fashioned of me to refer to that document, but I wish more Americans would at least read it. It is not light and easy reading but it contains several points of interest, whereby some of our present officials could, if they but would, profit greatly." Pound's immediate concern was the war in Europe--"this war on youth--on a generation" --which he described as the natural result of the "age of the chief war pimps." He hated the very idea that Americans were being primed for war, and on the very day of Pearl Harbor he denounced the idea that American boys should soon be marching off to war: "I do not want my compatriots from the ages of 20 to 40 to go get slaughtered to keep up the Sassoon and other British Jew rackets in Singapore and in Shanghai. That is not my idea of American patriotism," he added. In Pound's view, the American government alliance with British finance capitalism and Soviet Bolshevism was contrary to America's tradition and heritage: "Why did you take up with those gangs?" he rhetorically asked his listeners. "Two gangs. [The] Jews' gang in London, and [the] Jew murderous gang over in Moscow? Do you like Mr. Litvinov? [Soviet ambassador to Britain Meyer Wallach, alias Litvinov, born 1876.--Ed.] "Do the people from Delaware and Virginia and Connecticut and Massachusetts . . . who live in painted, neat, white houses . . . do these folks really approve [of] Mr. Litvinov and his gang, and all he stands for?" There was no reason for U.S. intervention abroad, he said: "The place to defend the American heritage is on the American continent. And no man who had any part in helping [Franklin] Delano Roosevelt get the United States into [the war] has enough sense to win anything . . . The men who wintered at Valley Forge did not suffer those months of intense cold and hunger in the hope that . . . the union of the colonies would one day be able to stir up wars between other countries in order to sell them munitions."
What was the American tradition? According to Pound: "The determination of our forbears to set up and maintain in the North American continent a government better than any other. The determination to govern ourselves internally, better than any other nation on earth. The idea of Washington, Jefferson, Monroe, to keep out of foreign shindies." Of FDR's interventionism, he declared: "To send boys from Omaha to Singapore to die for British monopoly and brutality is not the act of an American patriot." However, Pound said: "Don't shoot the President. I dare say he deserves worse, but . . . [a]ssassination only makes more mess." Pound saw the American national tradition being buried by the aggressive new internationalism.
According to Pound's harsh judgment: "The American gangster did not spend his time shooting women and children. He may have been misguided, but in general he spent his time fighting superior forces at considerable risk to himself . . . not in dropping booby traps for unwary infants. I therefore object to the modus in which the American troops obey their high commander. This modus is not in the spirit of Washington or of Stephen Decatur." Pound hated war and detected a particular undercurrent in the previous wars of history. Wars, he said, were destructive to nation-states, but profitable for the special interests. Pound said international bankers--Jewish bankers, in particular--were those who were the primary beneficiaries of the profits of from war. He pulled no punches when he declared: Sometime the Anglo-Saxon may awaken to the fact that . . . nations are shoved into wars in order to destroy themselves, to break up their structure, to destroy their social order, to destroy their populations. And no more flaming and flagrant case appears in history than our own American Civil War, said to be an occidental record for size of armies employed and only surpassed by the more recent triumphs of [the Warburg banking family:] the wars of 1914 and the present one.
Although World War II itself was much on Pound's mind, the poet's primary concern, referenced repeatedly throughout his broadcasts, was the issue of usury and the control of money and economy by private special interests. "There is no freedom without economic freedom," he said. "Freedom that does not include freedom from debt is plain bunkum. It is fetid and foul logomachy to call such servitude freedom . . .Yes, freedom from all sorts of debt, including debt at usurious interest." Usury, he said, was a cause of war throughout history. In Pound's view understanding the issue of usury was central to understanding history: "Until you know who has lent what to whom, you know nothing whatever of politics, you know nothing whatever of history, you know nothing of international wrangles. "The usury system does no nation . . . any good whatsoever. It is an internal peril to him who hath, and it can make no use of nations in the play of international diplomacy save to breed strife between them and use the worst as flails against the best. It is the usurer's game to hurl the savage against the civilized opponent. The game is not pretty, it is not a very safe game. It does no one any credit."
Pound thus traced the history of the current war: "This war did not begin in 1939. It is not a unique result of the infamous Versailles Treaty. It is impossible to understand it without knowing at least a few precedent historic events, which mark the cycle of combat. No man can understand it without knowing at least a few facts and their chronological sequence. This war is part of the age-old struggle between the usurer and the rest of mankind: between the usurer and peasant, the usurer and producer, and finally between the usurer and the merchant, between usurocracy and the mercantilist system . . . "The present war dates at least from the founding of the Bank of England at the end of the 17th century, 1694-8. Half a century later, the London usurocracy shut down on the issue of paper money by the Pennsylvania colony, A.D. 1750. This is not usually given prominence in the U.S. school histories. The 13 colonies rebelled, quite successfully, 26 years later, A.D. 1776. According to Pound, it was the money issue (above all) that united the Allies during the second 20th-century war against Germany: "Gold. Nothing else uniting the three governments, England, Russia, United States of America. That is the interest--gold, usury, debt, monopoly, class interest, and possibly gross indifference and contempt for humanity."
Although "gold" was central to the world's struggle, Pound still felt gold "is a coward. Gold is not the backbone of nations. It is their ruin. A coward, at the first breath of danger gold flows away, gold flows out of the country." Pound perceived Germany under Hitler as a nation that stood against the international money lenders and communist Russia under Stalin as a system that stood against humanity itself.
He told his listeners: "Now if you know anything whatsoever of modern Europe and Asia, you know Hitler stands for putting men over machines. If you don't know that, you know nothing. And beyond that you either know or do not know that Stalin's regime considers humanity as nothing save raw material. Deliver so many carloads of human material at the consumption point. That is the logical result of materialism. If you assert that men are dirty, that humanity is merely material, that is where you come out. And the old Georgian train robber [Josef Stalin--ed.] is perfectly logical. If all things are merely material, man is material--and the system of anti-man treats man as matter." The real enemy, said Pound, was international capitalism. All people everywhere were victims: "They're working day and night, picking your pockets," he said. "Every day and all day and all night picking your pockets and picking the Russian working man's pockets." Capital, however, he said, was "not international, it is not hyper-national. It is sub-national. A quicksand under the nations, destroying all nations, destroying all law and government, destroying the nations, one at a time, Russian empire and Austria, 20 years past, France yesterday, England today."
According to Pound, Americans had no idea why they were being expected to fight in Britain's war with Germany: "Even Mr. Churchill hasn't had the grass to tell the American people why he wants them to die, to save what. He is fighting for the gold standard and monopoly. Namely the power to starve the whole of mankind, and make it pay through the nose before it can eat the fruit of its own labor." As far as the English were concerned, in Pound's broadcasts aimed at the British Isles he warned his listeners that although Russian-style communist totalitarianism was a threat to British freedom, it was not the biggest threat Britain faced: You are threatened. You are threatened by the Russian methods of administration. Those methods [are not] your sole danger. It is, in fact, so far from being your sole danger that I have, in over two years of talk over this radio, possibly never referred to it before.
Usury has gnawed into England since the days of Elizabeth. First it was mortgages, mortgages on earls' estates; usury against the feudal nobility. Then there were attacks on the common land, filchings of village common pasture. Then there developed a usury system, an international usury system, from Cromwell's time, ever increasing." In the end, Pound suggested, it would be the big money interests who would really win the war--not any particular nation-state--and the foundation for future wars would be set in place: "The nomadic parasites will shift out of London and into Manhattan. And this will be presented under a camouflage of national slogans. It will be represented as an American victory. It will not be an American victory. The moment is serious. The moment is also confusing. It is confusing because there are two sets of concurrent phenomena, namely, those connected with fighting this war, and those which sow seeds for the next one." Pound believed one of the major problems of the day--which itself had contributed to war fever--was the manipulation of the press, particularly in the United States: "I naturally mistrust newspaper news from America," he declared. "I grope in the mass of lies, knowing most of the sources are wholly untrustworthy." According to Pound: "The United States has been misinformed. The United States has been led down the garden path, and may be down under the daisies. All through shutting out news.
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, philosophie, philologie, ezra pound, etats-unis, lettres, littérature, lettres américaines, littérature américaine, usure, usurocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 novembre 2010
Céline e il dramma biologico della storia
di Luca Leonello Rimbotti
Fonte: Italicum [scheda fonte] 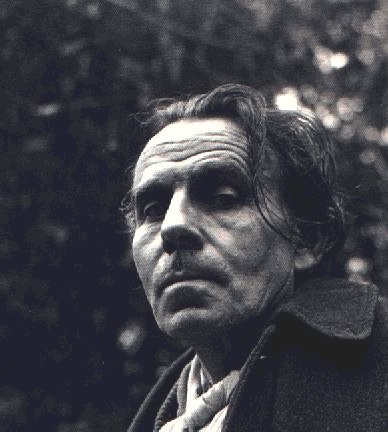 Infernale manipolatore della parola oppure sacerdote ideologico della décadence? Inventore nichilista di quadri solo letterari, oppure geniale interprete politico di una civiltà al tramonto? Insomma: il fin troppo noto anarchisme di Céline è una posa individualista, oppure un vero e proprio manifesto sociale e antropologico? Possiamo ancora oggi leggerlo in tanti modi, Céline. Ma, se vogliamo andare al fondo della sua anima, tra gli squarci e gli urli, le maledizioni e le ingiurie è possibile trovare netta e precisa un’interpretazione della storia europea. Céline è un analista del tracollo dell’Europa, rappresenta un sensore sensibile agli smottamenti e alle derive, denuncia e preavverte, minaccia e sibila oltraggi alla maniera di un apocalittico profeta antico: magari l’“Ezechiele parigino” di cui parlò Pol Vandromme. C’è in Céline la sensiblerie di un osservatore straziato, che ha sottomano la disintegrazione della civiltà europea e ne grida i misfatti, attraverso le sue storie disperate, ma anche attraverso pagine e pagine di lamentazioni millenaristiche. Céline sa di trovarsi di fronte a uno sbocco, nel centro di uno snodo di epoche, dal cui scioglimento dipenderà l’avvenire del suo mondo. E il suo mondo è l’Europa tradizionale. L’Europa nordica franco-germanica. L’Europa dei popoli sani che fanno la civiltà e la storia.
Infernale manipolatore della parola oppure sacerdote ideologico della décadence? Inventore nichilista di quadri solo letterari, oppure geniale interprete politico di una civiltà al tramonto? Insomma: il fin troppo noto anarchisme di Céline è una posa individualista, oppure un vero e proprio manifesto sociale e antropologico? Possiamo ancora oggi leggerlo in tanti modi, Céline. Ma, se vogliamo andare al fondo della sua anima, tra gli squarci e gli urli, le maledizioni e le ingiurie è possibile trovare netta e precisa un’interpretazione della storia europea. Céline è un analista del tracollo dell’Europa, rappresenta un sensore sensibile agli smottamenti e alle derive, denuncia e preavverte, minaccia e sibila oltraggi alla maniera di un apocalittico profeta antico: magari l’“Ezechiele parigino” di cui parlò Pol Vandromme. C’è in Céline la sensiblerie di un osservatore straziato, che ha sottomano la disintegrazione della civiltà europea e ne grida i misfatti, attraverso le sue storie disperate, ma anche attraverso pagine e pagine di lamentazioni millenaristiche. Céline sa di trovarsi di fronte a uno sbocco, nel centro di uno snodo di epoche, dal cui scioglimento dipenderà l’avvenire del suo mondo. E il suo mondo è l’Europa tradizionale. L’Europa nordica franco-germanica. L’Europa dei popoli sani che fanno la civiltà e la storia.
L’Europa delle aristocrazie di stirpe. Céline – è stato osservato – fu allievo del de Gobineau nel soffrire la decadenza come un’ingiuria ineluttabile, forse anche necessaria. Come una fine obbligata, soltanto dalla quale poi ripartire per un nuovo inizio. Già molti anni fa, nel 1974, lo studioso Paolo Carile rilevò la filiazione di Céline dalla inquadratura gaubinista e dall’antropologia di Ėlie Faure, e la rilevò dalla sua lettura degli eventi moderni come dramma biologico della storia, al culmine del quale si attua il precipitare dell’ordine antico in una sequela di accelerati sfaldamenti.
“Cronista tragico”, si definì Céline in un’intervista del 1960. Cronista in grado di intercettare e di rappresentare il tragico dell’epoca, come a pochi era stato concesso. Poiché, così aggiunse, “la maggior parte degli autori cercano la tragedia senza trovarla”. Lui invece la trovò, si agitò al centro del ciclone e sospinse il dramma fino ai suoi limiti radicali. Lo psicodramma di Céline – che non fu certo il solo nella sua epoca a vivere questa dimensione dell’assurdo totale – rappresenta il destino europeo sotto la specie di una tragedia personale elevata a simbolo di un mondo e di una generazione. Ed ecco qua, pertanto, una prima applicazione di quella consapevolezza per il “dramma biologico della storia” di cui dicevamo, e che Céline vedeva chiaramente all’opera nel cuore parigino della France eternelle. Un cuore marcio, scolpito con tutte le putredini della mescolanza. Questo orrifico affastellamento di destini assemblati dal caso è la risultante del tradimento che l’uomo moderno ha compiuto nei confronti della nobiltà dell’appartenenza di stirpe. Céline il bretone, orgoglioso della sua nordicità, della limpidezza dei suoi trascorsi ereditari di terra e di sangue, vive la lacerazione dolorosa di una realtà, quella della cosmopoli parigina, borghese e progressista, liberale e capitalista, che affoga ogni nobile istinto nella primitiva lotta per il possesso materiale, per il lusso. Sopra sta la borghesia che si rimpinza le budella e, dice Céline, si dimentica sempre di passare alla cassa per pagare. Sotto sta la massa dei disperati disonorati, condannati alla perversione di pagare il benessere altrui con la propria allucinante miseria. Non più un popolo, ma feccia senza nome. Non più nemmeno massa, ma semplice turba depravata, scavata dalla malattia, finita dal degrado. Questo è il “socialismo nazionalista” di Céline: una rivolta del sentimento estetico, prima ancora che sociale. Una rivolta per la sanità del corpo e della mente liberati, un gridare carico d’odio in nome della vendetta per le masse deturpate dall’alcool, dal lavoro logorante e animalesco, dall’assenza di ogni segno di nobiltà. Poiché – lo scrisse proprio Vandromme – ciò che vuole questo anarchista (più che anarchico), irrazionalmente devoto alle sue radici celtiche di purezza, è per l’appunto la restaurazione di un mito aristocratico di nobiltà. Leggiamo un attimo quanto sempre Carile scrisse circa l’antropologia etica di Céline: “Céline riprende le tesi tipiche della sua generazione al fine di giustificare il proprio elitismo, frutto di un movimento psicologico di difesa dalla pessimistica sensazione della decadenza della civiltà europea. In tal modo lo scrittore, ergendosi contro il mondo moderno, crede di far barriera contro la tecnologia e il consumismo dilaganti che caratterizzano la nostra epoca ‘decadente’. L’elitismo razzista – continuava Carile – lo preserverebbe da quanto ai suoi occhi è simboleggiato negativamente dalla routine democratico-borghese. La sua ribellione lo porta ad esaltare l’irrazionalismo, la gratuità della danza e nel contempo a sublimare il proprio orgoglio aristocratico di ‘autentico celte’; dato che si considerava uno degli ultimi esempi di una razza etnicamente intatta, al di qua della torre di Babele dei popoli e delle culture imbastardite del suo tempo”. In questa analisi c’è tutto quanto il significato epocale della figura e della scrittura di Céline, questo Spengler narratore dei bassifondi del tardo impero europeo, che invoca con fanatismo disperato un’ultima resurrezione del popolo.
Faure era un critico d’arte socialista che spiegava le aggregazioni estetiche come esito di combinazioni positive di sangue e di influssi ambientali, e in questo modo si confrontò con l’ideologia di Gobineau, di cui però rovesciava gli assunti: gli incroci come esiti positivi, come moltiplicatori delle possibilità creative. Nondimeno, egli attribuiva alla forza dinamica ìnsita nei popoli e negli individui il valore di un condizionamento, attraverso il dispiegarsi di dispositions ethnobiologiques determinanti nel formare l’anima collettiva. Céline, che fu in rapporti col Faure, si abbeverò a questa dimensione di un’energia occulta che sanziona le predisposizioni, e Carile appunto ne scorse la manifestazione nel concetto céliniano di âme, l’anima “ancorata ad un’interpretazione strettamente biologica che non accetta gli slanci mistici fauriani”, quale compare, ad esempio, in Mea culpa del 1936. “Céline si credeva depositario di una profezia la cui rivelazione era fondamentale per la salvezza dell’umanità”, ha scritto molti anni fa Vandromme. Difatti, sembra sempre di sentire rintoccare la campana apocalittica di un ultimo evento, di una imminente catastrofe che attende l’Europa nel fondo del suo declino. E questo, tanto nelle sue storie di trascinamenti nei degradi scuri della psiche metropolitana, quanto nelle filippiche nevrotiche dei suoi luciferini e brutali pamphlet. Con, al centro, ogni volta, l’allucinazione dello sfacelo fisico e mentale, dell’abbrutimento, la febbricitante sofferenza per l’oscenità della lenta, sicura consunzione che attanaglia l’individuo spoglio e isolato, così come le plebi, i popoli, l’Europa intera.
Si è individuato nell’inizio del 1942 – con la brutta piega presa dalla guerra “tedesca” - il momento del distacco di Céline da ogni furore di lotta positiva: ciò che fino a quella data egli ancora riteneva possibile attraverso la violenta liberazione di tutte le energie ancora inespresse dalla Francia e dall’Europa germanizzate, cioè un arresto della nostra civiltà sull’orlo dell’abisso e un raddrizzamento dei fini e dei modi, da allora in poi divenne disperata ricerca di un precipizio in cui gettare l’uomo e la sua incapacità di salvarsi. Il fatalismo céliniano non è tuttavia rassegnato: è esibizione di volontà di rovina. In questo, egli rappresenta al meglio la tragicità di un modo d’essere incapace di interpretare la realtà, altrimenti che nei modi manichei del trionfo o della catastrofe. E allora, se il trionfo non poteva più aversi, si sarebbe dovuto volere la catastrofe. E tanto più grandiosa e definitiva, tanto meglio.
L’ossessione per la degenerazione psico-fisica dell’uomo occidentale diventa in Céline una sorta di manifesto bioetico, depotenziato forse per l’ambiguo estremismo del linguaggio popolaresco, che cerca nell’argot dei bassifondi la parola infame per descrivere le brutture della vita; ma potenziato, d’altra parte, proprio dalla consapevolezza, vissuta forse come bagaglio d’esperienze del “medico dei poveri”, dell’illimitata miseria delle masse umane urbanizzate e rese indegne, ignobili, dalle logiche della società capitalista moderna. La purezza, in questo quadro, è un vero richiamo al mito di un’unità di specie che è andata perduta per la violenza e le ingiustizie del mondo. Una purezza introvabile ormai, il paradiso perduto dell’uomo nel suo eterno inganno moralista. Già nel Viaggio al termine della notte, Céline tratteggia la sua rabbia per l’impossibilità fisica di igienizzare l’umanità povera, per redimerla, per dunque ripulire dal male la razza e restituirla a una qualunque dignità. Le parole con cui rappresenta la mescolanza oscena dei miserabili della banlieue e dei quartieri poveri – da lui ben conosciuta di persona – sono l’attestato del suo dolore per un disfacimento ormai irrefrenabile: “la razza…è un ammasso di malandati, pidocchiosi, miserabili che sono capitati qui per causa di fame, peste, tumori e freddo…da tutte le parti del mondo…”.
“Céline crede nella sola cosa necessaria, nel ritorno a una vita nobile”, ha commentato infatti Vandromme. Una nobiltà che appartiene alla concezione tradizionale e antimodernista della vita, di cui Céline fu uno dei massimi rappresentanti novecenteschi. “Vedo l’uomo tanto più inquieto quanto più ha perduto il gusto delle favole, del mito, inquieto fino alla disperazione…” scrisse Céline in Les beaux draps. E aggiunse che l’uomo moderno è come preda di una comune pazzia acquisitiva, un tormento superficiale per i beni materiali che gli fa dimenticare ogni dimensione legata all’irrazionale, al bello, al superiore, al gratuito. Ogni dimensione legata insomma alla natura, rappresentando la società progressista essenzialmente l’anti-natura. E questa anti-natura si esprime sinistramente nel dilagare di tutto ciò che è basso e informe, dando vita a una specie di Sodoma universale, in cui l’impuro imbratta ogni retaggio, corrompe ogni antica bellezza. “Il fatalismo biologico lombrosiano che implica il naufragio di ogni capacità autodecisionale non è lontano da certe pessimistiche considerazioni antropologiche di Céline”. Questa osservazione di Carile ci mostra quanto centrale fosse nel dottor Destouches l’apprensione per il destino del corpo dell’uomo europeo, aggredito da tutte le degenerazioni della massificazione e dell’edonismo borghese. Davanti allo spettacolo di corruzione dei corpi e delle menti, Céline reagisce con l’insulto e con l’odio forsennato, oppure con il gesto picaresco dello sberleffo, l’ironia, la rigolade. Ultimo rifugio – come nel “lazzarone” napoletano – di un’umanità di vinti condannata al disonore e all’anonimato sociale.
Della sua epoca fortemente ideologizzata e rivoluzionaria, densa di contraddizioni sociali e di aperture politiche chiliastiche, Céline apprese l’inclinazione radicale verso l’apocalisse. Interpretò il fascismo come un’arma di raddrizzamento del piano inclinato e in favore di un sorgere dell’élite nuova, della giovane aristocrazia che imponesse nuovi codici di etica comunitaria e di onore sociale. Il tutto inquadrando nel contesto di un amore viscerale per la carne, per il corpo fisico dell’uomo, elevato a simbolo sommo dell’ideale di purezza. Le pagine che, ad esempio, Céline dedicò alla bellezza estetica della danza, di cui era ammirata interprete la moglie, gli accenti lirici che spese a proposito del bel gesto armonico, dell’aggraziato flettersi del corpo, della grandezza dell’arte perché in-utile, non monetizzabile, gratuita, sono l’attestato di questo amore celiniano per l’incanto della purezza, priva di prezzo ma grandemente preziosa. Un sovramondo che aveva il suo tenebroso contraltare nel sottomondo dei deformi, degli sfiancati, dei ruderi umani che erano gli avanzi antropologici del capitalismo borghese.
Céline sapeva di essere uno dei pochi capaci di andare davvero fino in fondo. Le sue scelte oltranziste – dall’antisemitismo al filogermanesimo, da Sigmaringen alla cocciuta ostinazione postbellica di non rinnegare nulla – gli attirarono un carico d’odio che soltanto oggi viene meno, per via di certi biografi che però fanno anche di peggio, dato che vogliono fare di Céline non il felino ungulato che era, ma un cappone da cortile, solo un po’ bizzarro. Lo sapeva che imboccando la strada di una difesa antropologica ed etnica dell’uomo europeo si sarebbe guadagnato una fama luciferina. Lo sapeva almeno dai tempi di Bagatelles quando, rivolgendosi a se stesso, scrisse: “Ferdinand,…t’auras le monde entier contre toi”. Avere tutto il mondo contro di sé…È il destino dei veri profeti.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, france, biologie, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 novembre 2010
Pound, Jefferson, Adams e Mussolini
Pound, Jefferson, Adams e Mussolini
 È vero: siamo in tempo di crisi e accadono cose davvero sorprendenti. Anche nel movimento delle idee. Occupa appena una trentina di pagine il saggio di Ezra Pound su Il carteggio Jefferson-Adams come tempio e monumento ed è quindi motivo di un lieve stupore l’ampiezza dell’interesse che ha suscitato. Il 18 febbraio scorso si parte con un’intera pagina del Corriere della Sera per una recensione di Giulio Giorello, filosofo della scienza, ma anche raffinato lettore dei Cantos da un versante laico-progressista, che ha acceso la discussione a cominciare dal titolo: Elogio libertario di Ezra Pound. Scambiò Mussolini per Jefferson. Ma il suo era un Canto contro i tiranni. Di quel titolo il giorno dopo profittava Luciano Lanna per ribadire sul nostro Secolo: “Pound (come Jünger) era libertario”. Due giorni dopo (venerdì 20 febbraio) nelle pagine culturali del Corriere della Sera Dino Messina riapriva il dibattito : “Fa scandalo il “Pound libertario”, mentre il 21 febbraio il tema veniva approfondito da Raffaele Iannuzzi nel paginone centrale ancora del Secolo.
È vero: siamo in tempo di crisi e accadono cose davvero sorprendenti. Anche nel movimento delle idee. Occupa appena una trentina di pagine il saggio di Ezra Pound su Il carteggio Jefferson-Adams come tempio e monumento ed è quindi motivo di un lieve stupore l’ampiezza dell’interesse che ha suscitato. Il 18 febbraio scorso si parte con un’intera pagina del Corriere della Sera per una recensione di Giulio Giorello, filosofo della scienza, ma anche raffinato lettore dei Cantos da un versante laico-progressista, che ha acceso la discussione a cominciare dal titolo: Elogio libertario di Ezra Pound. Scambiò Mussolini per Jefferson. Ma il suo era un Canto contro i tiranni. Di quel titolo il giorno dopo profittava Luciano Lanna per ribadire sul nostro Secolo: “Pound (come Jünger) era libertario”. Due giorni dopo (venerdì 20 febbraio) nelle pagine culturali del Corriere della Sera Dino Messina riapriva il dibattito : “Fa scandalo il “Pound libertario”, mentre il 21 febbraio il tema veniva approfondito da Raffaele Iannuzzi nel paginone centrale ancora del Secolo.
Ricordo ancora le critiche rivolte a Pound e a Giorello il 27 febbraio da Noemi Ghetti su LEFT. Avvenimenti settimanali dell’Altraitalia: era abbastanza facile indicare qualche contraddizione tra la censura fascista e lo spirito libertario, pur essendo altrettanto innegabile il durissimo prezzo pagato da Ezra Pound pacifista alla sua appassionata predicazione contro l’usura, la speculazione finanziaria internazionale e le guerre, con le settimane vissute in gabbia nella prigionia americana di Pisa e i dodici anni di manicomio criminale a Washington. Tuttavia nell’ampio dibattito di cui ho segnalato le tappe è comparso solo marginalmente il nome di Luca Gallesi (Antonio Pannullo lo ha però intervistato il 5 marzo in queste pagine sull’etica delle banche islamiche), geniale studioso di Pound cui si deve la pubblicazione del saggio su Jefferson, ma anche e soprattutto l’apertura di nuovi percorsi in una materia di crescente interesse quale è la storia delle idee.
 Occorre rimediare alla disattenzione per l’importanza dei contributi che Gallesi ci sta suggerendo e per i risultati che nel campo degli studi poundiani sta raccogliendo con l’editrice Ares guidata da Cesare Cavalleri insieme alla rivista Studi cattolici, anch’essa molto attenta al pensiero economico di un poeta che sin dai primi anni ’30 aveva previsto lo spaventoso disordine della finanza globale e il dissesto con cui oggi il mondo è alle prese. Le Edizioni Ares avevano già pubblicato gli atti di due convegni internazionali curati da Luca Gallesi, prima Ezra Pound e il turismo colto a Milano, poi Ezra Pound e l’economia, e dello stesso Gallesi lo studio su le origini del fascismo di Pound ove dimostra che il più innovativo poeta di lingua inglese del secolo scorso era stato predisposto a larga parte dei programmi socio-economici mussoliniani degli anni di collaborazione a Londra con la rivista The New Age diretta da Alfred Richard Orage, espressione di una corrente gildista, cioè corporativa del laburismo. Dalla frequentazione della società inglese Pound si portò dietro anche alcuni trattati del tutto sgradevoli d’antisemitismo, che negli anni Venti salvo rare eccezioni erano ancora ignote al fascismo italiano. L’introduzione di Gallesi al breve saggio di Pound sul carteggio Jefferson-Adams punta a estendere agli Usa la ricerca già avviata in Inghilterra sulle origini anglosassoni del fascismo poundiano. Questa volta paragoni diretti tra i fondatori degli stati Uniti e il fascismo non emergono come nel più noto Jefferson e Mussolini ripubblicato nel ’95 a cura di Mary de Rachelwiltz e Luca Gallesi da Terziaria dopo che era andata dispersa la prima edizione per la Repubblica sociale del dicembre ’44. Di Jefferson e Adams da Gallesi viene ricordato l’impegno, da primi presidenti americani, nello sventare i tentativi di Hamilton di togliere al Congresso, cioè al potere politico elettivo, il controllo sull’emissione di moneta per delegarlo ai banchieri e alla speculazione attraverso la creazione di una banca centrale controllata, come nel modello inglese, da gruppi privati. Un’altra traccia innovativa per la storia delle idee è stata suggerita da Gallesi il 4 marzo sul quotidiano Avvenire segnalando il saggio dell’americano Jonah Goldberg, che stufo di sentirsi accusare di fascismo ha scalato i vertici delle classifiche librarie con Liberal Fascism, un saggio ove ha sostenuto la natura rivoluzionaria del fascismo, che durante la stagione roosveltiana del New Deal suscitò “negli Usa stima e ammirazione soprattutto negli ambienti progressisti, mentre all’estrema destra il Ku Klux Klan faceva professione di antifascismo”.
Occorre rimediare alla disattenzione per l’importanza dei contributi che Gallesi ci sta suggerendo e per i risultati che nel campo degli studi poundiani sta raccogliendo con l’editrice Ares guidata da Cesare Cavalleri insieme alla rivista Studi cattolici, anch’essa molto attenta al pensiero economico di un poeta che sin dai primi anni ’30 aveva previsto lo spaventoso disordine della finanza globale e il dissesto con cui oggi il mondo è alle prese. Le Edizioni Ares avevano già pubblicato gli atti di due convegni internazionali curati da Luca Gallesi, prima Ezra Pound e il turismo colto a Milano, poi Ezra Pound e l’economia, e dello stesso Gallesi lo studio su le origini del fascismo di Pound ove dimostra che il più innovativo poeta di lingua inglese del secolo scorso era stato predisposto a larga parte dei programmi socio-economici mussoliniani degli anni di collaborazione a Londra con la rivista The New Age diretta da Alfred Richard Orage, espressione di una corrente gildista, cioè corporativa del laburismo. Dalla frequentazione della società inglese Pound si portò dietro anche alcuni trattati del tutto sgradevoli d’antisemitismo, che negli anni Venti salvo rare eccezioni erano ancora ignote al fascismo italiano. L’introduzione di Gallesi al breve saggio di Pound sul carteggio Jefferson-Adams punta a estendere agli Usa la ricerca già avviata in Inghilterra sulle origini anglosassoni del fascismo poundiano. Questa volta paragoni diretti tra i fondatori degli stati Uniti e il fascismo non emergono come nel più noto Jefferson e Mussolini ripubblicato nel ’95 a cura di Mary de Rachelwiltz e Luca Gallesi da Terziaria dopo che era andata dispersa la prima edizione per la Repubblica sociale del dicembre ’44. Di Jefferson e Adams da Gallesi viene ricordato l’impegno, da primi presidenti americani, nello sventare i tentativi di Hamilton di togliere al Congresso, cioè al potere politico elettivo, il controllo sull’emissione di moneta per delegarlo ai banchieri e alla speculazione attraverso la creazione di una banca centrale controllata, come nel modello inglese, da gruppi privati. Un’altra traccia innovativa per la storia delle idee è stata suggerita da Gallesi il 4 marzo sul quotidiano Avvenire segnalando il saggio dell’americano Jonah Goldberg, che stufo di sentirsi accusare di fascismo ha scalato i vertici delle classifiche librarie con Liberal Fascism, un saggio ove ha sostenuto la natura rivoluzionaria del fascismo, che durante la stagione roosveltiana del New Deal suscitò “negli Usa stima e ammirazione soprattutto negli ambienti progressisti, mentre all’estrema destra il Ku Klux Klan faceva professione di antifascismo”.
Una storia trasversale di idee al di là della destra e della sinistra che Gallesi si prepara a approfondire lungo l’Ottocento americano attraverso la secolare resistenza che da Jefferson in poi vide opporsi correnti legate allo spirito dei pionieri e delle fattorie alla creazione di una banca centrale, che avvenne solo nei primi del Novecento, alla speculazione monetaria e alla dilagante corruzione. Tutti contributi a una interpretazione di Pound, che senza indebolire le posizioni ideali a cui teniamo, risulterà più autentica, più ricca, più fuori dagli schemi, più prossima alla definizione di ”libertario” che della lettura poundiana di Jefferson ha ricavato Giorello.
E non so trattenermi dal riportare due frasi che avevo sottolineate un quindicina di anni fa leggendo la prima volta l’ancor più scandaloso confronto tra Jefferson e Mussolini. Una tesa a far somigliare i due leader nella lotta alla corruzione: “In quanto all’etica finanziaria, direi che dall’essere un pese dove tutto era in vendita Mussolini in dieci anni ha trasformato l’Italia in un paese dove sarebbe pericoloso tentare di comprare il governo”. E proprio alla fine del libro l’invenzione della settimana corta, per una gestione politica della decrescita economica che solo adesso assume aspetti marcati d’attualità: “Nel febbraio del 1933 il governo fascista precedette gi altri, sia di Europa che delle Americhe, nel sostenere che quanto minor lavoro umano è necessario nelle fabbriche, si deve ridurre la durata della giornata di lavoro piuttosto che ridurre il numero del personale impiegato. E si aumenta il personale invece di far lavorare più ore coloro che sono già impiegati”. Queste erano le soluzioni pratiche che piacevano a Pound, autore di solito complicato, ma reso a volte paradossalmente difficile per eccesso di semplicità.
* * *
Tratto da Il Secolo d’Italia del 28 aprile 2009.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, fascisme, italie, ezra pound, économie, politique, lettres, littérature, littérature américaine, lettres américaines, usure, usurocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 31 octobre 2010
Il mito antartico di Miguel Serrano
Il mito antartico di Miguel Serrano
 Qualcosa o qualcuno si agita nelle bianche distese del continente antartico; una presenza non umana, prigioniera di sogni indicibili. Ciò che scrivevano Edgar Allan Poe nel Gordon Pym e Howard Phillips Lovecraft ne Le Montagne della Follia non era semplice creazione letteraria; i Grandi Antichi vissero davvero nell’Antartide. Né sono fantasia i racconti degli indigeni Ona della Terra Fuoco sugli straordinari poteri dei loro stregoni o “kon”, capaci di ibernarsi nei ghiacci, e sfidare – praticamente – l’immortalità.
Qualcosa o qualcuno si agita nelle bianche distese del continente antartico; una presenza non umana, prigioniera di sogni indicibili. Ciò che scrivevano Edgar Allan Poe nel Gordon Pym e Howard Phillips Lovecraft ne Le Montagne della Follia non era semplice creazione letteraria; i Grandi Antichi vissero davvero nell’Antartide. Né sono fantasia i racconti degli indigeni Ona della Terra Fuoco sugli straordinari poteri dei loro stregoni o “kon”, capaci di ibernarsi nei ghiacci, e sfidare – praticamente – l’immortalità.
Ne è convinto lo scrittore ed esoterista cileno Miguel Serrano (nato nel 1917), improbabile figura di fanatico nazista eppure poeta affascinante, convinto che Hitler sia stato l’ultimo avatar o incarnazione del dio Vishnu, e che abbia lasciato il suo corpo fisico per trasfigurarsi in un corpo immateriale, rifugiandosi – appunto – tra i ghiacci del Polo Sud…
Nato nel 1917, diplomatico in pensione, il novantenne Miguel Serrano è senza dubbio una figura tra le più discusse della cultura del suo paese, il Cile, e dell’intera letteratura mondiale. Personaggio politicamente scorretto quant’altri mai (basti dire che è, ed è sempre stato, un fanatico sostenitore di Hitler e del nazismo), ha subìto una sorta di censura da parte dell’editoria europea, tanto che vi è tuttora pochissimo conosciuto, nonostante il suo valore artistico non sia di molto inferiore a quello del celebratissimo Pablo Neruda e senz’altro non da meno di quello di un altro scrittore cileno contemporaneo, molto tradotto all’estero negli ultimi anni, Francisco Coloane. Tuttavia le sue posizioni ideologiche sono difficilmente separabili dalla sua opera puramente letteraria e ciò spiega in parte l’ostracismo di cui è stato vittima. Per la stessa ragione, ossia l’estrema difficoltà di separare la dimensione politico-filosofica da quella artistico-letteraria, non è senza imbarazzo che ci accostiamo alla figura e all’opera controversa e discutibile di questo autore, imbarazzo dovuto al fatto che si potrebbe leggere il nostro interesse per lui, impropriamente, in chiave di riabilitazione ideologica. Al contrario, riteniamo doveroso confrontarci con la sua opera letteraria per il semplice fatto che, tra quanti scrittori si sono occupati dei Poli nella letteratura occidentale, egli occupa un posto in sommo grado eminente; vorremmo anzi dire che occupa, in un certo senso, il posto più notevole, poiché lui solo non ha visto nei Poli (anzi, nel Polo Sud: poiché solo di esso si è occupato) un mero pretesto scenografico per sviluppare una trama narrativa o una creazione poetica, bensì il centro e la ragione stessa della sua arte e della sua concezione poetica.
 Da giovane Serrano abbraccia il marxismo; poi, deluso dal comunismo, alla vigilia della seconda guerra mondiale, aderisce al Partito nazionalsocialista cileno di Jorge Gonzalez von Marées, collaborando al giornale Trabajo (Il lavoro) e poi fondando la rivista letteraria La Nueva Edad, dalle cui colonne fiancheggia la politica dell’Asse e passa in seguito a una decisa propaganda antisemita. Egli sostiene, riprendendo l’antica concezione gnostica e catara, che Yahweh incarna il principio del male, è il Demiurgo che ha creato il mondo e che regna sui pianeti caduti, sul mondo delle tenebre; e che esiste un complotto sionista il cui obiettivo ultimo è quello di instaurare il dominio mondiale del giudaismo. Fra il 1941 e il 1942 avviene la svolta più importante nell’itinerario di Serrano: l’ingresso in un circolo esoterico capeggiato da un cileno-tedesco, il quale è convinto che Hitler sia un avatar, una incarnazione del dio Vishnu la cui missione è combattere una lotta eroica – non solo sul piano fisico e materiale, ma anche e soprattutto sul piano mentale – contro le nere forze dissolvitrici del Kali-Yuga, e che è possibile mettersi telepaticamenrte in contatto con centri iniziatici dell’Himalaia e con lo stesso Hitler. A guerra finita, tra parentesi, Serrano sostiene che Hitler ha rinunciato al suo corpo fisico ma si è alchemicamente costruito un corpo di luce con il quale si è trasferito nell’Antartide, donde aspetta il momento di ritornare per riprendere la lotta contro le forze delle tenebre. In quest’ultima parte del suo pensiero, Serrano coniuga miti e leggende degli Araucani e soprattutto degli Ona, il ramo dei Tehulche stabilito nella Terra del Fuoco, circa l’esistenza di un qualcosa, di un grande spirito che ha le fattezze di un gigante (la figura biancovestita del finale di Gordon Pym?), laggiù nelle bianche soltudini del Sud, fra i ghiacci eterni e le nebbie di un mondo intatto e misterioso, con la fede in una missione divina di Hitler – posizione che lo accomuna a quella strana figura di esoterista che fu Savitri Devi.
Da giovane Serrano abbraccia il marxismo; poi, deluso dal comunismo, alla vigilia della seconda guerra mondiale, aderisce al Partito nazionalsocialista cileno di Jorge Gonzalez von Marées, collaborando al giornale Trabajo (Il lavoro) e poi fondando la rivista letteraria La Nueva Edad, dalle cui colonne fiancheggia la politica dell’Asse e passa in seguito a una decisa propaganda antisemita. Egli sostiene, riprendendo l’antica concezione gnostica e catara, che Yahweh incarna il principio del male, è il Demiurgo che ha creato il mondo e che regna sui pianeti caduti, sul mondo delle tenebre; e che esiste un complotto sionista il cui obiettivo ultimo è quello di instaurare il dominio mondiale del giudaismo. Fra il 1941 e il 1942 avviene la svolta più importante nell’itinerario di Serrano: l’ingresso in un circolo esoterico capeggiato da un cileno-tedesco, il quale è convinto che Hitler sia un avatar, una incarnazione del dio Vishnu la cui missione è combattere una lotta eroica – non solo sul piano fisico e materiale, ma anche e soprattutto sul piano mentale – contro le nere forze dissolvitrici del Kali-Yuga, e che è possibile mettersi telepaticamenrte in contatto con centri iniziatici dell’Himalaia e con lo stesso Hitler. A guerra finita, tra parentesi, Serrano sostiene che Hitler ha rinunciato al suo corpo fisico ma si è alchemicamente costruito un corpo di luce con il quale si è trasferito nell’Antartide, donde aspetta il momento di ritornare per riprendere la lotta contro le forze delle tenebre. In quest’ultima parte del suo pensiero, Serrano coniuga miti e leggende degli Araucani e soprattutto degli Ona, il ramo dei Tehulche stabilito nella Terra del Fuoco, circa l’esistenza di un qualcosa, di un grande spirito che ha le fattezze di un gigante (la figura biancovestita del finale di Gordon Pym?), laggiù nelle bianche soltudini del Sud, fra i ghiacci eterni e le nebbie di un mondo intatto e misterioso, con la fede in una missione divina di Hitler – posizione che lo accomuna a quella strana figura di esoterista che fu Savitri Devi.
Nel 1947-48 Serrano prende parte, come giornalista, alle spedizioni antartiche della marina da guerra cilena e ne riporta la convinzione che i nazisti, negli anni precedenti, vi abbiano costruito delle basi segerete (1) e che il corpo di Hitler – trasfigurato, come quello di Cristo dopo la resurrezione – si è portato laggiù dopo la caduta di Berlino in mano ai Sovietici.
 Più tardi compie dei viaggi in Europa e stringe amicizia con lo psichiatra Carl Gustav Jung e lo scrittore Hermann Hesse; inoltre fa conoscenza con il poeta Ezra Pound e il filosofo Julius Evola, oltre che con Otto Skorzeny, l’ex paracadutista tedesco che aveva liberato Mussolini dalla prigionia sul Gran Sasso. Nel 1953 entra nel corpo diplomatico e svolge funzioni di ambasciatore in India (fino al 1962), Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Austria. Rimosso da ogni incarico dal presidente Salvador Allende nel 1970, si ritira in esilio in Svizzera, a Montagnola nel Canton Ticino, abitando nella stessa casa che era stata di Hermann Hesse. Nel 1973, dopo il colpo di stato del generale Augusto Pinochet, Serrano rientra in Cile, dove si segnala per la clamorosa partecipazione a convegni e commemorazioni di personaggi come Rudolf Hess o come i sessantadue giovani nazisti cileni che furono uccisi, nella loro patria, nel 1938. Ha svolto inoltre un’intensa attività di conferenziere e di scrittore, dando alle stampe un numero considerevole di libri di filosofia, esoterismo, poesia, narrativa, memorie. Tra i titoli più importanti ricordiamo La Antàrtica y otros Mitos (1948), Quien llama en los Hielos (1957), Las visitas de la Reina de Saba, con prefazione di C. G. Jung (1960); El circulo hermético, de Hesse a Jung, tradotto in lingua inglese con il titolo Jung and Hesse: A Record of Two Friendships (1965); El Cordòn Dorado: Hitlerismo Esotérico (1974); Adolf Hitler, el Ultimo Avatara (1984); No Celebraremos la Muerte de los Dioses Blancos (1992), e le Memorias de El y Yo, ossia Hitler e lui stesso, in quattro volumi (1996-1999). Instancabile, il terribile vegliardo continua a scrivere e a far parlare di sé, rilasciando interviste anche su temi di attualità; come quella del gennaio 2004 in cui accusa gli Stati Uniti di volersi impadronire della Patagonia mediante il cavallo di Troia delle organizzazioni ecologiste.
Più tardi compie dei viaggi in Europa e stringe amicizia con lo psichiatra Carl Gustav Jung e lo scrittore Hermann Hesse; inoltre fa conoscenza con il poeta Ezra Pound e il filosofo Julius Evola, oltre che con Otto Skorzeny, l’ex paracadutista tedesco che aveva liberato Mussolini dalla prigionia sul Gran Sasso. Nel 1953 entra nel corpo diplomatico e svolge funzioni di ambasciatore in India (fino al 1962), Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Austria. Rimosso da ogni incarico dal presidente Salvador Allende nel 1970, si ritira in esilio in Svizzera, a Montagnola nel Canton Ticino, abitando nella stessa casa che era stata di Hermann Hesse. Nel 1973, dopo il colpo di stato del generale Augusto Pinochet, Serrano rientra in Cile, dove si segnala per la clamorosa partecipazione a convegni e commemorazioni di personaggi come Rudolf Hess o come i sessantadue giovani nazisti cileni che furono uccisi, nella loro patria, nel 1938. Ha svolto inoltre un’intensa attività di conferenziere e di scrittore, dando alle stampe un numero considerevole di libri di filosofia, esoterismo, poesia, narrativa, memorie. Tra i titoli più importanti ricordiamo La Antàrtica y otros Mitos (1948), Quien llama en los Hielos (1957), Las visitas de la Reina de Saba, con prefazione di C. G. Jung (1960); El circulo hermético, de Hesse a Jung, tradotto in lingua inglese con il titolo Jung and Hesse: A Record of Two Friendships (1965); El Cordòn Dorado: Hitlerismo Esotérico (1974); Adolf Hitler, el Ultimo Avatara (1984); No Celebraremos la Muerte de los Dioses Blancos (1992), e le Memorias de El y Yo, ossia Hitler e lui stesso, in quattro volumi (1996-1999). Instancabile, il terribile vegliardo continua a scrivere e a far parlare di sé, rilasciando interviste anche su temi di attualità; come quella del gennaio 2004 in cui accusa gli Stati Uniti di volersi impadronire della Patagonia mediante il cavallo di Troia delle organizzazioni ecologiste.
 Tutto ciò crediamo che basti per delineare la figura di un personaggio scomodissimo e francamente indifendibile, non solo sul piano politico ma anche su quello strettamente culturale; e tuttavia non privo, come poeta e come cultore di antichissimi miti amerindi, di un suo fascino strano, oltre che di una indubbia tenacia nel remare controcorrente, che si esita se qualificare come franchezza brutale o come sfrontatezza e autentico vaneggiamento. Comunque, in questa sede ci limiteremo ad approfondire l’interesse di Miguel Serrano per la dimensione mitica e poetica dell’Antartide, caratterizzata da potenti squarci visionari che ne fanno un legittimo continuatore, e anzi un originale rielaboratore, del Poe di Gordon Pym e del Lovecraft de Le Montagne della Follia. I due testi più notevoli, in questo senso, dello scrittore cileno sono La Antàrtica y otros Mitos, (L’Antartide e altri miti), pubblicato a Santiago nel 1948, e Quien llama en los Hielos (Chi chiama nei ghiacci), pubblicato a Santiago (e, più tardi, a Barcellona), nel 1957; nessuno dei due è stato finora tradotto in lingua italiana, né in inglese. (2) Nel secondo, Serrano racconta di un sogno nel quale una creatura misteriosa gli rivela che l’immortalità si raggiunge fra i ghiacci e si consegue a patto di ibernarsi, in vista del supremo combattimento con l’Angelo delle Ombre. Tuttavia, noi concentreremo ora la nostra attenzione sul primo di questi due libri, che ci pare più significativo nel senso della tradizione esoterica relativa al continente antartico e più “in linea”, idealmente, con quelli già esaminati di Poe e di Lovecraft.
Tutto ciò crediamo che basti per delineare la figura di un personaggio scomodissimo e francamente indifendibile, non solo sul piano politico ma anche su quello strettamente culturale; e tuttavia non privo, come poeta e come cultore di antichissimi miti amerindi, di un suo fascino strano, oltre che di una indubbia tenacia nel remare controcorrente, che si esita se qualificare come franchezza brutale o come sfrontatezza e autentico vaneggiamento. Comunque, in questa sede ci limiteremo ad approfondire l’interesse di Miguel Serrano per la dimensione mitica e poetica dell’Antartide, caratterizzata da potenti squarci visionari che ne fanno un legittimo continuatore, e anzi un originale rielaboratore, del Poe di Gordon Pym e del Lovecraft de Le Montagne della Follia. I due testi più notevoli, in questo senso, dello scrittore cileno sono La Antàrtica y otros Mitos, (L’Antartide e altri miti), pubblicato a Santiago nel 1948, e Quien llama en los Hielos (Chi chiama nei ghiacci), pubblicato a Santiago (e, più tardi, a Barcellona), nel 1957; nessuno dei due è stato finora tradotto in lingua italiana, né in inglese. (2) Nel secondo, Serrano racconta di un sogno nel quale una creatura misteriosa gli rivela che l’immortalità si raggiunge fra i ghiacci e si consegue a patto di ibernarsi, in vista del supremo combattimento con l’Angelo delle Ombre. Tuttavia, noi concentreremo ora la nostra attenzione sul primo di questi due libri, che ci pare più significativo nel senso della tradizione esoterica relativa al continente antartico e più “in linea”, idealmente, con quelli già esaminati di Poe e di Lovecraft.
La Antàrtica y otros Mitos è la trascrizione di una serie di conferenze tenute dall’autore nella sua patria. Fin dalla copertina, il libro tributa un omaggio esplicito al Gordon Pym e alla sua dimensione esoterica: vi campeggia la figura spaventosa di un gigante alato, bicorne, che impugnando un tridente si staglia al di sopra di un candido paesaggio ghiacciato. Del resto, come osserva Erwin Robertson, l’Antartide in se stessa è un mito (3); dunque il “mito antartico” di Serrano non è che una variante di un mito preesistente alla tradizione esoterica occidentale, già presente – secondo lui – nelle credenze del popolo che da migliaia d’anni vive più vicino a quel mistero: gli Ona della Terra del Fuoco.
 Ma lasciamo la parola a Sergio Fitz Roa, uno dei più noti studiosi di Serrano nei paesi di lingua spagnola:
Ma lasciamo la parola a Sergio Fitz Roa, uno dei più noti studiosi di Serrano nei paesi di lingua spagnola:
“Serrano riporterà numerose leggende intorno al tema che ci interessa: le cronache delle guerre degli Onas (antichi abitanti della Terra del Fuoco), la leggenda della vergine dei Ghiacci, il continente Lemuria, il gigante di Poe e, ancora, la sfacciata idea che Adolf Hitler vive nel freddo antartico. E anche se a prima vista ci sembra non esistere alcuna relazione tra ciascuna di esse, vi è, dato che tutte queste leggende fanno riferimento ai misteriosi dimoratori dell’Antartide. Vi è qui un altro punto nel quale confluisce il pensiero di questi tre autori [cioè Poe, Serrano e Lovecraft]. Serrano conosce il racconto di Poe e riguardo al Gigante Bianco annota: ‘Poe conosceva la leggenda dei Selknam sugli Jon che abitano l’Isola Bianca. O sapeva anche del Prigioniero dell’Antartide, che vive nel suo nero fondo, e che per questo stesso motivo appare bianco?
“Per capire chi sono gli Jon e a che cosa si riferisca Serrano quando parla dell’Isola Bianca, si raccomanda di leggere la pagina 25 de La antàrtica y otros Mitos, dove si spiega che gli antichi Onas (i Selknam erano solo una delle tribù Onas) credevano nell’esistenza degli Jon: uomini di una casta aristocratica dotati di facoltà sovrannaturali e possessori dei Misteri. ‘Furono gli Jon, maghi Selknam della Terra del Fuoco, coloro che conservano i segreti insegnati da Queno e che ancora si immortalizzavano imbalsamandosi entro i ghiacci del sud, per resuscitare rinnovati nel più lontano futuro. Dicono anche i Selknam che è nel Sud, lì, in quell’Isola Bianca che sta nel Cielo dove dimorano gli spiriti dei loro antenati, conducendo una vita libera da preoccupazioni’ (4).
“Saranno questi spiriti ancestrali gli Antichi menzionati da Lovecraft? Sarà l’Antartide quella Isola Bianca della quale parlano le vecchie leggende onas?
“Serrano, che fu uno dei primi cileni a visitare la regione antartica, ci parla della relazione esistente fra questo luogo e la follia e segnaliamo, da parte nostra, che il titolo dell’indimenticabile racconto di Lovecraft Alle Montagne della Follia non è dovuto a un capriccio o a una trovata ingegnosa per richiamare l’attenzione di alcuni lettori febbricitanti.
“Serrano dirà che l’unica via per comprendere questa realtà del Sud o, meglio, per salvarsi dalla follia che lì è in agguato, è il Sogno; ed il mondo dei sogni è un elemento classico nella narrativa di H. P. Lovecraft.
“L’inquietante possibilità che esista una entità non-umana nell’Antartide si registra anche nelle pagine del testo dell’autore cileno. Il sincronismo tra questi due scrittori ci lascia stupefatti, soprattutto per il fatto che Miguel Serrano non conosceva l’opera di Lovecraft, quando scrisse La Antàrtica y otros Mitos. Citiamo, allora, Serrano, che con la sua arte ci ricorda i vecchi alchimisti: ‘Senza dubbio, in quel continente del riposo e della morte vive qualcuno. Un prigioniero si agita, avendo come mezzo di sopravvivenza il fuoco ardente ed eterno. Questa idea di Serrano si plasma anche in un altro testo del medesimo autore: Quien llama en los Hielos.
“In esso vi è un paragrafo di una bellezza terribile: ‘Io ho visto questo essere, questo Angelo nero: lì, nel suo recinto del Polo Sud. È in una immensa cavità oscura che egli risiede… Spazi enormi, senza limiti, lievi e deprimenti allo stesso tempo, che si estendono, sicuramente, nell’interiorità psichica della Terra, al di sotto dei ghiacci eterni. E così si muove il Zinoc… Ascende o discende fino all’estremo di quell’apertura e, da lì, si lancia ad una velocità vertiginosa in cerca del suo altro estremo, della sua fine irraggiungibile… Tutta l’eternità l’ha trascorsa in questo sforzo, cadendo a testa in giù, cercando di raggiungere il luogo antipodico dal quale è stato proscritto dall’inizio stesso della creazione. Il nord è il suo sogno, il suo profondo anelito e la sua maggior sofferenza’. Lovecraft, da parte sua, nel suo racconto scriverà qualcosa di rivelatore: ‘Fondarono nuove città terrestri, le più importanti di esse nell’Antartico, perché quella regione, scenario del loro arrivo, era sacra. A partire da allora, l’Antartico fu come prima il centro della Civiltà degli Antichi, e tutte le città costruite lì dalla prole di Chtulhu furono distrutte’. Più innanzi il narratore del racconto di Lovecraft indicherà che le mappe incontrate nella vecchia città polare mostrano che le città degli Antichi nell’epoca pliocenica si trovavano, nella loro totalità, al di sotto del 50° parallelo di latitudine Sud. Queste referenze di entrambi gli autori sono fondamentali, perché ci indicano l’opposizione simbolica tra il Polo Nord (o la mitica Iperborea) ed il Polo Sud, sede degli Antichi. Qusta opposizione non risponde solamente a una differenza di carattere geografico ma, prima di tutto, a delle differenze spirituali. In effetti, il Polo Nord è il polo positivo – in termini cristiani, il Bene – ed il Polo Sud, secondo la stessa prospettiva, il Male. Senza dubbio, questi opposti, conformi ai princìpi della filosofia manichea, sono complementari. Entrambi i Poli mantengono l’Ordine della Terra, regolano il buon funzionamento energetico del nostro mondo. L’unica possibile differenza ha relazione col tipo di energia che irradiano detti luoghi, dacché in verità sono dei centri energetici. Questa conoscenza che si esprime attraverso la letteratura moderna (Lovecraft e Serrano), che differenzia i centri volitivi terrestri, concorda punto per punto col pensiero antico o tradizionale che insegnarono i maestri indoeuropei, per i quali le parole che danno il nome ai distinti luoghi sacri sono: Cielo, Terra o Mondo, Centro e Inferno. Il Cielo, per essi, è la dimora degli eroi, coloro che vissero la vita come si deve, e corrisponde ad Iperborea o al nostro Polo Nord; la Terra è il luogo abitato o il terreno di spedizioni e viaggi, essi la identificavano con l’Asia e l’Europa. L’Inferno , che era la casa dei dèmoni – gli Antichi e gli shoggots - sembra non essere mai stata descritta e ubicata con maggior dettaglio dagli antichi saggi indoeuropei. Questo Inferno è per noi il Polo Sud” (5).
È appena il caso di notare che, negli ultimi decenni, alcuni autori hanno incominciato a ventilare la possibilità che sia esistita effettivamente un’antica civiltà nel continente antartico, che poi l’avanzata dei ghiacci avrebbe lentamente soffocato e le cui rovine giacerebbero, quindi, a migliaia di metri sotto la calotta glaciale del Polo Sud. Il primo ad avanzare questa ipotesi, a quanto ne sappiamo, è stato proprio uno studioso italiano, Flavio Barbiero, col suo libro Una civiltà sotto il ghiaccio che, negli anni Settanta, è passato praticamente inosservato; anche se, poi, le sue tesi sono state riprese in gran parte da due scrittori canadesi di successo, Rand e Rose Flem-Ath. (6) Il libro di Barbiero recava una presentazione di Silio Zavatti, il quale confermava la sua straordinaria capacità di pensare in maniera indipendente rispetto ai dogmi dell’archeologia e della scienza accademica, mantenendo un’apertura epistemologica di trecentosessanta gradi pur essendo abituato, lui uomo di scienza, a muoversi sul solido terreno dei fatti. Il nucleo delle tesi dell’autore era che esistette un’antichissima civiltà primordiale, erede diretta di quella di Atlantide, che svolse il ruolo di centro di diffusione per le successive culture a noi note dell’antichità.
“Continuando a credere nella teoria diffusionista – scriveva Zavatti nella sua prefazione – […] bisognerebbe ammettere che nonostante millenni di lenta maturazione, popoli profondamente diversi abbiano inventato simultaneamente l’agricoltura, l’architettura, gli usi, gli ordinamenti sociali ecc. che presentano un fondo comune senza che vi fossero stati dei contatti di qualsiasi ordine.
“Sarebbe voler credere nell’impossibile e infatti nessuno più vi presta fede.
“Bisogna allora ritornare a un’origine comune della civiltà e non c’è altra strada che riprendere il creduto mito di Atlantide. Non s’inventa nulla perché in tutte le civiltà antiche se ne parla, dai Maya agli Egizi, dai Sumeri agli Indiani, pur sotto nomi diversi.
“Ecco, dunque, che il quadro si completa; le navi atlantidi superstiti della tragedia approdarono in terre diverse e i loro occupanti, in misura più o meno sensibile, influenzarono le culture delle popolazioni incontrate, quando addirittura non le formarono. Solo così si spiega il fondo comune di tutte le civiltà e la spiegazione non ha bisogno di funambolismi per apparire logica. […]
“La prova per eccellenza che la teoria del Barbiero è esatta si può avere soltanto da uno scavo sistematico da farsi in un determinato punto dell’isola Berkner ma, come si è detto, gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del progetto sono molteplici e di varia natura.” […]
“Al principio del 1976 l’ing. Barbiero ebbe la possibilità di aggregarsi a una spedizione alpinistica e un po’ scientifica, organizzata alla garibaldina, che per una ventina di giorni operò nell’area della Penisola Antartica, una regione, cioè, molto lontana dal Mare di Weddell e dall’isola Berkner, ma che poteva riservare pur sempre delle sorprese. Infatti fu nell’isola Seymour che il capitano norvegese C. A. Larsen trovò, nel 1893, una cinquantina di palline di sabbia e ‘cemento’ messe su colonnette dello stesso materiale. Larsen scrisse che quegli oggetti sembravano ‘fatti da una mano umana’. Un’espressione generica per dire che erano oggetti fatti molto bene? Forse, e infatti non li fece mai studiare e analizzare ed oggi, putroppo, non li possediamo più perché andarono distrutti nell’incendio della sua casa a Grytviken (Georgia Australe).
“Nel corso della spedizione del 1976 l’ing Barbiero scoprì nell’isola Re Giorgio (una del gruppo delle Shetland Australi), una grande quantità di tronchi semifossilizzati che potrebbero risalire a 10-12.000 anni fa. Purtroppo gli istituti scientifici ai quali erano stati inviati i campioni di questi tronchi per la datazione col metodo del C14 non hanno fatto conoscere ancora la loro risposta. In Antartide sono stati trovati, a più riprese, dei fossili di alberi e altre piante (Robert Falcon Scott stesso ne riportò moltissimi), ma se i tronchi semifossilizzati trovati da Barbiero risalgono veramente a un massimo di 12.000 ani fa, si ha la prova che fino a quell’epoca l’Antartide poteva essere abitata e molti fatto coinciderebbero con le affermazioni contenute nei dialoghi di Platone e, di conseguenza, con l’ipotesi avanzata da Barbiero in questo volume” (7).
Anche studiosi anglosassoni, come il professor Charles Hapgood, erano giunti a conclusioni analoghe, studiando il problema di alcune antiche carte geografiche che rivelano conoscenza “impossibili”, a meno di ammettere l’esistenza di una evoluta civiltà antidiluviana, padrona dei mari all’epoca in cui la morsa dei ghiacci con aveva ancora stretto l’Antartide, e dalla quale sarebbero derivate le conoscenze cartografiche e marittime altrimenti inspiegabili; si veda, per tutte, la celebre carta nautica dell’ammiraglio turco Piri Reis (8). Fantasie? Certo è che Miguel Serrano, così come Lovecraft e, forse, Poe, hanno dato voce poetica a una ipotesi che ora alcuni studiosi di formazione scientifica hanno ripreso con la massima serietà: che quanto oggi sappiamo sul continente antartico è solo una piccola parte della sua storia antichissima, misteriosa e affascinante; che forse vi fiorirono, prima dell’ultima glaciazione, le imponenti città di una razza evoluta; che forse qualcosa o qualcuno ancora vi si trova, in attesa di essere rivelato all’umanità.
Note
1) Cfr. ROBERT, James, La guerra segreta della Gran Bretagna in Antartide, su Nexus, nr. 61 e 62 del 2006; Temolo, Luca, I dischi volanti di Hitler, su Xché, nr. 3 del 2003; TROMBETTI, Pierluigi, Una base nazista in Antartide, su Hera Magazine; BACCARINI, Enrico, Dal nazismo occulto al fascismo esoterico, su Archeomisteri, nr. 20 e 21 del 2004.
2) Ci serviremo, pertanto, della traduzione italiana di alcuni passi dell’opera eseguita dal sito Internet Alchemica (www.alchemica.it/antartidemito.html).
3) ROBERTSON, Erwin, Por el Hombre que Vendrà, in Ciudad de los Césares, nr. 18, 1990.
4) Il missionario-esploratore De Agostini, uno dei massimi conoscitori della Terra del Fuoco, che conobbe diversi sciamani e potè osservarli da vicino nelle loro attività occulte, li chiama non Jon, ma Kon, e afferma che “il potere dei Kon si estendeva fin dopo morti e per questo i Kon venivano seppelliti con la faccia rivolta all’ingiù, affinché non potessero inviare malattie ai vivi”: DE AGOSTINI, A. M., Trent’anni nella Terra del Fuoco, Torino, S. E. I., 1955, p. 302.
5) FRITZ ROA, Sergio, La Antártica y el mito lovecraftiano, originariamente in Ciudad de los Césares, nr. 47, 1997.
6) FLEM-ATH, Rand e Rose, La fine di Atlantide, Casale Monferrato, Piemme ed., 1997.
7) BARBIERO, Flavio, Una civiltà sotto ghiaccio, Milano, Ed. Nord, Milano, 1974, pp. XII-XV.
8) HAPGOOD, Charles P., Maps of Ancient Sea King, Adventure Unilimited Press, 1996; HANCOCK, Graham, Impronte degli Dèi, Milano, Corbaccio, 1996; Id., Civiltà sommerse, Milano, TEA, 2005.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres chiliennes, littérature chilienne, chili, antarctique, amérique latine, amérique du sud, littérature latino-américaine, lettres latino-américaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 octobre 2010
"Porte Louise", par Christopher Gérard
« Porte Louise » par Christopher Gérard
L’auteur a publié deux romans, Le songe d’Empédocle (2003) et Maugis (2005), dont Pol Vandromme a dit qu’ils étaient écrits « à contre-mode de la platitude littéraire d’aujourd’hui », un essai, La source pérenne (2007), « défense et illustration du polythéisme » (Marcel Conche), et un récit, Aux armes de Bruxelles (2009), « délicieuse flânerie dans un haut lieu de la civilisation du Saint-Empire » (Bruno de Cessole).
C’est encore dans la capitale belge, où il existe bien une avenue et une Porte Louise, que se situe le nouveau roman de Christopher Gérard. Son personnage principal est une femme de 51 ans, professeur, justement prénommée Louise, qui, après trente-huit ans passés à Dublin, revient à Bruxelles, sa ville natale, pour essayer de comprendre pourquoi son père y a été assassiné de trois coups de feu dans la nuit du 1er novembre 1972. Irlandais installé à Bruxelles, celui-ci, selon la police, frayait avec le grand banditisme et aurait été victime d’un règlement de compte. Mais pour sa fille qui demeure inconsolable, ce meurtre reste mystérieux et c’est pour essayer de découvrir la vérité et de « voir clair dans son passé » qu’elle revient sur les lieux du crime.
Au fil des pages de ce récit joliment et subtilement mené, nous découvrons Charlie, le père de Louise, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a vécu à Berlin où il enseignait l’anglais à l’université et animait des émissions de radio en gaélique. Dans la capitale du IIIe Reich, il a fréquenté l’entourage de Von Ribbentrop et rencontré Céline qui lui a offert un exemplaire du Voyage au bout de la nuit avec cette dédicace : « A mon frère Celte, l’énigmatique Charles ». De fait, les énigmes sur sa vie au cours de cette période sont nombreuses : que faisait-il vraiment à Berlin ? Fut-il, de 1942 à 1944, le chef de la section irlandaise de l’Abwehr ? Comment a-t-il pu quitter l’Allemagne après la chute de la capitale du IIIe Reich ? S’est-il plus tard rendu en RDA et a-t-il travaillé pour la Stasi ? Autant d’interrogations qui rendent Louise encore plus perplexe lorsqu’un Français membre de la Commission européenne lui apprend que son père a organisé un trafic d’armes pour l’IRA, via la Tchécoslovaquie. L’hypothèse de son assassinat par le KGB l’effleure un moment, mais son interlocuteur penche plutôt pour les services secrets anglais, ce que dément formellement un ancien responsable de l’Intelligence Service, Lord Pakenham. Celui-ci révèle en revanche à Louise que lui et son père ont envisagé de faire signer un traité de paix entre Allemands et Alliés après la disparition du Führer. Le distingué « Lord of the Spies » lui avoue toutefois que Charlie a été un agent des services secrets de la République d’Irlande chargé de surveiller l’IRA, ses trafics d’armes et ses contacts avec le régime nazi…
Après l’effondrement du régime hitlérien, Charlie réussit à passer en Suisse, puis regagna l’Irlande, avant de se lancer dans les affaires et de s’installer à Bruxelles. Cela ne l’empêcha pas de reprendre ses activités d’agent double au service du gouvernement de Dublin et de l’IRA. Envoyé par cette dernière à Berlin pour obtenir des armes il eut pour « honorable correspondant » un ancien collaborateur de Von Ribbentrop, devenu colonel dans la Stasi et spécialiste des affaires irlandaises…
Outre les deux principaux protagonistes du livre, Charlie et Louise, un troisième personnage occupe une place importante dans le roman. C’est le mari de Louise, l’écrivain Liam O’Reilly, celui qu’elle appelle le « cher vieux druide », fidèle aux « anciens Dieux » et à « l’Ancienne Religion des feux et des purifications, des festins et des poèmes, de l’hydromel ambré dans les coupes, du saumon sacré… » Elle lui adresse régulièrement de longues missives qui sont comme le journal de bord de son enquête.
Si, grâce à ses multiples interlocuteurs, Louise a pu retracer le parcours « ondoyant et divers » de Charlie, elle n’a pas réussi à savoir par qui et pourquoi son père a été assassiné. Une dernière tentative lui permettra-t-elle de lever le mystère ? On laissera au lecteur le soin de découvrir le dénouement de cette « ténébreuse affaire ».
En toile de fond de l’enquête de Louise et de l’existence de Charlie, Bruxelles, cette « ville improbable et attachante », apparaît comme le cœur et l’âme du roman. Tout au long des cinq chapitres qui portent chacun le nom d’une rue ou d’une place bruxelloise, on passe de l’avenue de la Toison d’or à la chaussée de Charleroi, de la porte de Namur au passage du Nord, de la rue de l’Arbre-bénit à la place de Brouckère… La quête du père et de l’identité que poursuit Louise est en effet inséparable de ses déambulations dans la capitale belge. Celle-ci a beaucoup changé, certains de ses quartiers ont disparu, d’autres se sont complètement transformés, ressemblent désormais au Bronx ou sont en voie de « créolisation accélérée » ; la population de souche est parfois minoritaire et, dans le centre-ville, on croise désormais des « mahométanes en foulard ».
Porte Louise est un roman d’espionnage plus proche de ceux de John Le Carré ou de Vladimir Volkoff que de ceux de Gérard de Villiers ou de Ian Fleming. Mais en le lisant c’est surtout au film d’Éric Rohmer, Triple Agent, que nous avons songé, éprouvant le même plaisir à la lecture de l’un qu’au visionnage de l’autre. Comme l’écriture cinématographique de Rohmer, la langue de Christopher Gérard est élégante, concise et précise. Mais il écrit aussi avec gourmandise lorsqu’il évoque une dégustation de charcuterie du Sud-Ouest arrosée de « deux fillettes de Chinon frais, légèrement fumé […] doux comme du lait » ou, dans un restaurant libanais, un plateau de mezzés avec son « hachis vinaigré de persil, d’oignons et de tomates, [son] onctueuse purée de pois chiches et [son] caviar d’aubergine au goût fumé ». Ce fin gourmet lettré n’est pas non plus dénué d’humour : tel Alfred Hitchock dans ses films, l’auteur apparaît au détour d’une page de son livre et n’hésite pas à appeler Parvulesco le commissaire européen qui officie à Bruxelles… Ici encore, jeu de miroir littérature-cinéma et clin d’œil aux happy few puisque ceux-ci n’ignorent pas que le romancier et essayiste Jean Parvulesco apparaît notamment dans le film de Jean-Luc Godard A bout de souffle sous les traits de Jean- Pierre Melville, et en personne dans L'Arbre, le maire et la médiathèque d’Éric Rohmer.
Ce roman à la fois nostalgique et allègre, où des personnages captivants traversent le labyrinthe d’une ville et de l’Histoire, est un régal pour les amoureux de vraie littérature. A la manière du « Bien joué, Callaghan », expression utilisée à plusieurs reprises dans le livre et probablement empruntée à Peter Cheney, disons pour conclure « Bien joué, Gérard » !
Didier Marc
13/10/2010
Correspondance Polémia – 21/10/2010
00:14 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgicana, roman, littérature, lettres, littérature belge, lettres belges, littérature française, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 octobre 2010
Ernst Jünger: "Sicilian Letter to the Man in the Moon"

Ernst Jünger’s “Sicilian Letter to the Man in the Moon”
Ernst Jünger
Ex: http://www.counter-currents.com/
Translated by Andreas Faust
1.
Greetings you magician and friend of magicians! Friend of solitaries. Friend of heroes. Friend of lovers. Friend of the good and the bad. Knower of nighttime secrets. Tell me: where there is a knower — is there not already something more than can be known?
I still remember the hour when your face appeared in the window, large and terrible. Your light fell into the room like that ghostly sword which freezes all motion when drawn. Rising over the wide realms of stone, you see us slumbering close together with pale faces, like the countless white pupae which rest in the corners and corridors of ant cities, while the night wind roams through vast fir forests. Do we not appear to you like creatures of the deep — submerged in abysses of the sea?
My small room, too, appeared submerged — the room where I had sat up in bed, immersed in a solitude too deep to be broken by men. Things stood silent and motionless, in a strange light, like the sea creatures one glimpses beneath a curtain of algae on the ocean floor. Did they not appear mysteriously changed — and is change not the mask behind which the secret of life and death conceals itself? We all know these moments of uncertain expectation when one feels the voice of the unknown near, and listens for it to resound, and when the hidden conceals itself only with difficulty in every form. A crackling in the woodwork, the vibration of a glass, over which an invisible hand seems to brush — just as space itself is charged around the exertions of a being who hungers for sense, and who can catch its signals!
Language has taught us to hold Things in contempt. Grand words are like a grid stretched across a map. But isn’t a single fistful of earth greater than an entire cartographic world? Once, the whispering of nameless forms still had an urgency. There are signs scrawled on broken down fences and crossroad posts, which the burghers carelessly ignore as they pass. But the tramp notices — indeed, he knows a great deal about them. To him they are a cipher in which the essence of an entire district is revealed — its dangers and securities.
The child, too, is such a tramp, who only recently wandered through the dark gate which separates us from our timeless homeland. The child still understands the language of the runes of Things, which tell of a profound brotherhood of essences.
2.
I feared you in those days, as a being of malignant, magnetic power, and believed one could never stare directly into your full, gleaming radiance without being robbed of gravity, and sucked irresistibly into empty space. Sometimes I dreamt I let my caution slip, and saw myself in a long, white shirt, devoid of will, like a cork on a sinister flood tide, driven high above a landscape in whose depths lurked nightshade forests, and where the roofs of villages, castles, and churches glimmered like black silver — the sign language of a threatening geometry, directly apprehensible to the soul.
On such dream journeys my body was completely rigid. The toes were curled, fists closed, and the head bent back. I felt no fear — just a feeling of inescapable loneliness in a deserted world, governed mysteriously by silent powers.
3.
How this image later changed under the influence of the northern lights, whose first penetration of the fiery and proud heart was like a raging fever. There comes a time when one feels ashamed of one’s frenzied ecstasies, and another time when one again accepts them. Nor would one wish to have gone without the ecstasy of reason in its utmost excess, because in every triumph of life containing an absolute — in every enlightenment deeper than enlightenment — there too hides a spark of the eternal light and a shadow of the eternal darkness.
Dark assault on the infinite! Should a courageous heart be ashamed to be party to it? Military solitude of the siege tunnels, as seconds and millimetres pass; powerful front lines of the trenches in no man’s land, equipped with the strict mathematics of ramparts and sentry posts, with sparkling machines and fantastic instruments!
The idea willingly remains at that border where number dissolves into symbol, willingly revolves around both symbolic poles of the infinite, atom and star, and loves nothing more than taking booty on the battlefield of endless possibility. Was there any sorcerer’s apprentice who didn’t stand once behind the artificial predatory eye of the telescope, moved by the operation of silent clocks in cosmic trajectories, which never once belonged to the bustling crowd of psychologists?
Here danger looms, and he who loves danger loves to answer for it. He wants to be attacked with greater ferocity, so he can answer more ferociously in return. Light is more obscure by day than by night. He who has tasted doubt is certain to go beyond the frontiers of lucidity in search of the miraculous. He who doubted once must doubt still more, if he wishes to avoid despair. Whether one was capable of seeing a number or sign in the infinite — this question is the last and only measure to which a mind of this type will reply. But for each the position is another that he must win to be capable of deciding. Happy is that simplicity which knows not these forked paths — yet a wild and manly joy blooms on the edges of precipices.
In any case, was it not surprising to learn that behind the man in the moon, a light- and shadow-play was concealed, of plains, mountains, dried-up seas and extinct volcanoes? Here the strange suspicion of Svidrigajlov entered my mind — the suspicion that eternity is only a bare, whitewashed chamber, whose corners are inhabited by black spiders. One may enter . . . and that is all there is to eternity.
Yes, and why not? What is the air to one who breathes it? What does he care for the beyond when it gives him nothing that is not beyond as well?
A new topography is required.
4.
The drill thinks in a different way to the pincers, which grip one point after another. Its thread cuts broadly through several layers in the material, but through all the many points it touches in spiral motion, it is the tip which gives direction and energy to the thrust.* This relationship between chance and necessity, which do not exclude each other, but are mutually dependent, is also inherent in the words and images of a language, which claim to be the sole and final possibilities of understanding. Every word turns on an axis, which itself is incapable of containing words. The language I dream of must be comprehensible, or completely incomprehensible, until its last letters, as the expression of a great isolation which alone makes possible the highest love. There are crystals which are transparent solely in one direction.
But are not you yourself a master who knows how to put his riddle elaborately, that riddle of which only the text, not the solution, is communicable – just as the hunter sets his snares with great care but must then wait for a beast to stumble into them?
The solution itself is not important – only that the riddle is seen.
* “The motion of the screw, crooked and straight, is one and the same.” – Heraclitus
5.
You know how life is at the edges of dark forests: the gardens, lighted islands in the glow of lanterns, encircled by a magical whirling of music. You know the couples who lose each other silently in the darkness; your light meets their faces like pale masks, while lust accelerates their breathing and fear stifles it. You know the intoxicated ones who break out of the thicket.
You rose large over the thatched houses along the river, on that June night when one of your apprentices entered into closer brotherhood with you. The festive table was placed on the trampled threshing floor, and the weapons and red caps gleamed in the tobacco smoke on walls lined with fir twigs. Where now is the youth who so soon afterwards broke the secret seal of death, whose tidings were already prepared for him? He was there once, and is there evermore. How the first ecstasy pulls the heart like sails! Did you not love him as he sank for the first time in the depths, where elemental spirits mightily exalted power? Are there not hours when one is beloved by everything, like a flower who blossoms in wild innocence? Hours when from sheer excess we are shot like a projectile along the paths of habit? Only then do we begin to fly, and only in uncertainty is there a high objective.
I follow him with my eyes as if it had been today, for some experiences have a validity which eludes all laws of time. When wine’s fire melts away the growth rings which have yearly encircled this strange and wondrous heart, we discover in our depths that we have remained the same. O memory, key to the innermost forms contained in people and experiences! I am certain that you yourself are contained in the dark, bitter, intoxicating wine of death as the last and decisive triumph of Being over Existence. I greet you above all, you solitary revellers who keep your own company at table, and time and time again raise a glass to yourselves! What are we, other than mirror images of ourselves? And where we sit with ourselves in pairs, then the third one, God, is never far.
I see your protégé as he appears from a raging cloud of noise, before the low doors, over which the thin white horse’s skull gleams in the night light. The warm air, laden with the pollen of grasses like narcotic gunpowder, creates a wild eruption which drives him crying blindly into the silent landscape. He ran along the crest of the high wall bordering the meadows, and fell, oddly enough without pain, down into the thick grass. Further along the course turns to the feeling of a power, which seems to be nourished by unlimited resources. The large white umbrels gliding by like alien signals, the scent of a hot, fermenting earth, the bitter haze of the wild carrots and spotted hemlocks — all these like the pages of a book which opens of its own accord, in which eternally deep, miraculous relationships are described. No more thoughts whose properties melt darkly into each other. The nameless life will be greeted exultantly.
He penetrates the wide belt of reeds in the stream’s midst. Gases bubble up from the mud. The water embraces the glowing breast as if it had arms, and the face glides away along the dark mirror of the river. In the distance a weir thunders, and the ear, which has come near to the primeval language, feels dangerously enticed. The stars glimmer upwards from bottomless depths, and when the water swirls and eddies they begin to dance.
On the other bank the forest opens up; its thickets trap life, threateningly and in tangled lines. The roots spread their intertwining patterns of threads and tendrils, and the branches weave themselves into a net, in whose seams a swarm of faces move and change. Over the tops of the trees lattices of blind generative power intersect, their forms giving birth to both enmity and destruction, and the foot throws up the soft mist of decay where life dully mingles with death.
Then the clearing breaks open, and your light falls into the darkness like an excommunication of law. The trunks of the beech trees gleam like silver, the oaks like the dark bronze of ancient swords. Their crowns emerge in a powerful structure. The smallest twigs and the last blackberry stalks are touched by your light, unlocked and interpreted, and at the same time surrounded – struck by a great moment which makes everything significant and which chance surprises on its secret paths. They are part of an equation whose unknown symbols are written with glowing ink.
How the simple lines of the homeland are hidden even in the most intricate landscape! Happy allegory, in which a deeper allegory is embedded.
6.
What sustains us, if not the mysterious ray of light which sometimes flashes through the inner wilderness? People wish to speak, however imperfectly, of that which to them is more than human.
The attempts of science to contact distant stars are an important characteristic of this age. Not only the endeavour itself, but also its technical methods provoke a strange mixture of soberness and imagination. Is it not an astonishing proposal to draw with navigational lights the right-handed triangle of Pythagoras and its three quadrats over an expanse of the Sahara Desert? What does it matter to us whether a mathematician exists somewhere in the universe! But here is a living feature that calls to mind the language of the pyramids, an echo of the sacred origin of art, of the solemn knowledge of creation in its hidden meaning — with all conditions of abstract thought brought into harmony, and the devices of modern technology disguised.
Will the radio signals we hurl into the bottomless depths of icy space ever be received, this transformation of languages (whose boundaries lay in earthly mountains and rivers) into an electrical pulse which announces itself all the way to the borders of the infinite? Into which language will this translation be translated?
Wondrous Tibetans, whose monotonous prayers ring out from the cliff-top monasteries of the observatories! Would anyone wish to laugh at prayer wheels who was familiar with our landscapes, with their myriad of revolving wheels — those fierce agitations which move the hour hand of the clock and the furious crankshafts of aeroplanes? Sweet and dangerous opium of velocity!
But is it not true that in the innermost centre of the wheel stillness lies hidden? Stillness is the proto-language of velocity. Through translations one would like to see the velocity increase — all these increases can only be a translation of the proto-language. But how is man supposed to understand his own language?
See, you glance down over our cities. You saw many other kind of cities before them, and will see many others yet. Every individual house is well furnished and built for its own special purpose. There are narrow, winding streets established seemingly by chance in the course of time, just as the the fields of a farming area are divided according to long-forgotten inheritances. Other streets are straight and wide, their alignments determined by princes and master builders. The fossilizations of eras and races fit into each other in many different ways. The geology of the human soul is a special science. Between the churches and government buildings, villas and tenement houses, bazaars and entertainment palaces, train stations and industrial zones, life spreads out its cycles; the circulation is significant, solitude exceptional.
From so great a height, however, this vast store of organic and mechanical powers takes on another picture. Even an eye which observes it through the most powerful telescope could not fail to notice the difference. Indeed, the things do not actually change for that which stands over them, but rather present a different side. It is no longer the case that churches and castles are a thousand years old and warehouses and factories the products of yesterday; for something emerges that one could call their pattern — the common crystalline structure, in which the raw material has condensed. Even the vast diversity of goals and movements which they give rise to, the eye no longer takes as true. Down there are two people, who hurry past each other, two worlds in themselves, and one part of the city can be further from another than the north pole is from the south. But from yourself outwards, you who are a cosmic being and yet still a part of the earth, everything is perceived in its stillness, just like the separation whereby this life has taken form out of volcanic ferment and volatile liquids. O marvellous drama, time after time, as form upon form arises through the difference and hostility of eras and regions! This is what I call the deeper fraternity of life, in which every enmity is included.
For us down here, however, it is rarely permitted to see the aim fused with the meaning. And perhaps our highest endeavour is that stereoscopic glance which comprehends things in their more hidden, more dormant physicality. The necessary is a special dimension. We live in it, and as yet are only capable of beholding its projections in significant beings. There are signs, allegories and keys of many kinds — we are like the blind man who, while he can’t see anything, still feels the light in its vaguer quality — as warmth.
Is it not also the case that the blind man’s every movement takes place in what for a seeing eye is the light, although he himself is shrouded in eternal darkness? We never saw our face in more timeless mirrors. But so, too, do we speak a language whose significance is incomprehensible to us ourselves — a language of which every syllable is both transitory and immortal. Symbols are signs, which nevertheless give us consciousness of our values. They are first of all projections of forms from a hidden dimension, then, too, searchlights through which we hurl our signals into the unknown in a language pleasing to the gods. And these mysterious conversations, this chain of miraculous efforts from which the core of our history exists, which is a history of the battles of men and gods – - – : they are the only things which make learning worthwhile for humanity.
7.
True comparison, that is, the contemplation of things according to their location in necessary space, is the most marvellous method of the protective art. Its base is the mutual expression of the essential, and its peak the essential itself.
This is a kind of higher trigonometry, which deals with the mass of invisible fixed stars.
8.
I climbed on this radiant morning in the ravines of Monte Gallo. The red-brown earth of the gardens was still moist with dew, and under the lemon trees stood the red and yellow blossoms of the Sarazenenfrühlings like the pattern of an oriental rug. There, where the last leaves of the opuntias peered naked and curious over the reddish wall, were mountain pastures, towered over by cliffs and overblazed by yellow perennial spurges. Then the path led through a narrow valley carved from barren rock.
I do not know, and will not attempt to describe, how in the middle of these walls the insight emerged to me that a valley like this grasps the wayfarer more urgently with its stony language, as if a pure landscape were possible, or, put differently, a landscape like this one had deeper powers at its disposal. It probably never had awareness of rank, which would have been unclear to it, and in fact such moments are rare, when one recognises an ensouled life prevailing in nature from a physical expression of this life standing directly opposite. Yes, I believe it has again become possible in recent times. But it was just such a moment that surprised me in this hour — I felt the eyes of this valley resting on me with complete affection. Put differently: it was beyond doubt that this valley had its demon.
Straight away and still in the frenzy of discovery my gaze fell on your already very pale disc, which hovered close over the crest and could probably only be seen looking up from such depths. There rose again, in a strange flashing birth, the image of the man in the moon. Certainly, the lunar landscape with its rocks and valleys is a surface formulated by astronomical topography. But it is just as certain that, at the same time, it is available to that magical trigonometry of which we have spoken — that at the same time it is a region of spirits, and that the fantasy which gave it a face understood the primordial language of runes and the speech of demons with the depths of the childlike gaze.
But the incredible thing for me in this moment was to see both these masks, of one and the same Being, melt inseparably into each other. Because here for the first time an agonising conflict resolved itself, which I, great-grandson of an idealistic, grandson of a romantic, and son of a materialistic race, had hitherto regarded as irreconcilable. It didn’t exactly happen that an Either-Or metamorphosed into an As-Well-As. No, the real is just as fantastical as the fantastical is real.
That was the wonderful thing which delighted us about the doubled images we observed through the stereoscope as children: In the same moment in which they melted together into a single picture, the new dimension of depth burst out from them.
Yes, that is how it is; the age has brought home to us the old magical spells which were always present, if long forgotten. We feel that sense begins to weave itself in, hesitantly still, to the great work which we all create, which holds us in its spell.
00:10 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, allemagne, sicile, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 25 octobre 2010
L'accueil critique de "Bagatelles pour un massacre"
L'accueil critique de Bagatelles pour un massacre
Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/
 C’est un passionnant dossier de presse que propose André Derval. Toutes les grandes signatures ayant traité de Bagatelles à l’époque de sa sortie y sont réunies : de Brasillach à Gide en passant par Léon Daudet, Charles Plisnier, Lucien Rebatet ou Marcel Arland. Et d’autres qui ont sombré dans l’oubli aujourd’hui mais qui détenaient une autorité certaine à l’époque, tels André Billy ou Gabriel Brunet.
C’est un passionnant dossier de presse que propose André Derval. Toutes les grandes signatures ayant traité de Bagatelles à l’époque de sa sortie y sont réunies : de Brasillach à Gide en passant par Léon Daudet, Charles Plisnier, Lucien Rebatet ou Marcel Arland. Et d’autres qui ont sombré dans l’oubli aujourd’hui mais qui détenaient une autorité certaine à l’époque, tels André Billy ou Gabriel Brunet.Ce dossier atteste que l’accueil du livre fut beaucoup moins clivé qu’on ne l’imagine aujourd’hui. Ainsi, les lecteurs, voire les rédacteurs, actuels du Canard enchaîné seraient sans doute étonnés d’apprendre que leur hebdomadaire commenta Bagatelles pour un massacre de manière très favorable : « Un livre libérateur, torrentiel et irrésistible » [sic]. C’est que, dans les années trente, l’antisémitisme était répandu dans tous les milieux, de la droite à la gauche. À ce propos, on peut regretter que, dans l’introduction, Derval s’abstienne de situer le livre dans son contexte politique. Soit, en France, un climat délétère suscité par les agissements en vogue sous la IIIème République. Évoquant les circonstances de la parution du livre, il se borne à rappeler la déception de Céline face au piètre accueil critique de Mort à crédit. Divers autres spécialistes de l’écrivain ont, eux, fourni bien des clefs permettant de comprendre la genèse du pamphlet. Tel célinien évoque « sa haine de la guerre, et par ricochet sans doute son antisémitisme (duplicité, « internationalisme » et avidité des banquiers et marchands de canons, synonymes de juifs) ¹ », tel autre explique son engagement « par le fait que, d’un naturel très personnel et volontaire, Céline n’était ni lâche ni hypocrite et n’était pas homme à rester sur les gradins quand d’autres se font étriper dans l’arène ². » Rien de tel sous la plume d’André Derval qui trace du pamphlétaire un portrait univoque. Ce n’est pas exonérer Céline de ses excès que de rappeler ses motivations réelles : la hantise d’une nouvelle guerre européenne (considérée par lui comme fratricide) et la défense d’une esthétique.
En revanche, l’intérêt du recueil est de donner à voir l’éventail de la réception critique, notamment celle émanant de la presse d’information juive. À ce propos, aucun des articles parus dans l’hebdomadaire belge L’Avenir juif n’a été référencé dans les bibliographies céliniennes. Apportons donc notre contribution à cette étude de l’accueil critique de Bagatelles en signalant l’un des articles publiés par ce journal. L’auteur n’y cache pas sa surprise de constater que l’imprécateur antisémite est « précisément Céline, le même qui, dans son Voyage, nous donna tout de même l’impression que sa révolte contre un ordre social où l’on s’accommode si allègrement de tant d’injustices ne relevait pas du dilettantisme verbal, d’autant plus qu’il sut trouver souvent des accents bouleversants parce que si indiciblement humains. » Et d’ajouter : « Nous nous sommes trompés. M. Céline n’est qu’un sinistre cabotin ³ ».
Marc LAUDELOUT
• André Derval, L’accueil critique de Bagatelles pour un massacre, Écriture, coll. « Céline & Cie », 2010.
1. Jean-Paul Louis in Louis-Ferdinand Céline, Lettres à Marie Canavaggia, 1936-1960, Gallimard, coll. « Les Cahiers de la Nrf » [Cahiers Céline 9], 2007, p. 328.
2. François Gibault in Louis-Ferdinand Céline, Céline et l’actualité, 1933-1961, Gallimard, coll. « Les Cahiers de la Nrf » [Cahiers Céline 7], 2003, p. 8.
3. N. Gutter, « Bagatelles pour un massacre », L’Avenir juif [Anvers – Bruxelles], 3ème année, n° 92, 11 mars 1938, p. 4d.
00:15 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook






