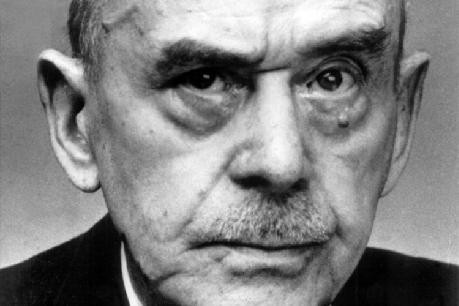Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°336. Au sommaire :
Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°336. Au sommaire :
- Marc Laudelout : Bloc-notes
- Claude Duneton : Un engagement lyrico-stylistique
- François Pignon : Retour en juillet 1961…
- *** : La vente du cinquantenaire
- Francis Bergeron : Paris Céline
- P. S. : Montaigne dans « Voyage au bout de la nuit »
- Jean-Claude Demeilliez : Céline à Dinard
- Robert Le Blanc : Céline en Bretagne, le grand retour
Un numéro de 24 pages, 6 € frais de port inclus.
Abonnement pour l’année 2012 (11 numéros) : 50 €
Le Bulletin célinien
B.P. 70
Gare centrale
BE 1000 Bruxelles
lundi, 05 décembre 2011
Bulletin célinien n°336 décembre 2011
Le Bulletin célinien n°336 décembre 2011
Le Bulletin célinien n°336 - Bloc-notes
En cette année du cinquantenaire, un ultime colloque Céline s’est déroulé le 9 novembre à Paris sous l’égide de la Fondation Singer-Polignac. André Derval y prononça une communication sur « L’accueil critique de Céline, du vivant de l’auteur ». C’était l’occasion de lui demander si, dans le dossier de presse de la période concernée, il avait pu constater des accusations du même genre formulées par des exégètes céliniens. De sa réponse, j’ai essentiellement retenu que, selon lui, il n’y a nullement dérive et qu’accuser Céline d’avoir appelé à l’extermination, comme le fait Viviane Forrester dans la préface citée, ne fait pas nécessairement référence au génocide mais peut aussi s’appliquer, par exemple, à un pogrom. Certes (2). Mais je ne suis pas certain qu’un lecteur contemporain lisant « extermination des juifs » ne songe pas ipso facto aux événements de la deuxième guerre mondiale. Je ne suis pas davantage certain que certains spécialistes de Céline ne récusent pas ce commentaire de François Gibault selon lequel, après la guerre, « Bagatelles et L’École (…) apparaissaient à la lueur des événements que l’on sait comme des appels au massacre » [ce qu’ils ne sont donc pas, ndlr], et qu’« à la lumière de ce que l’on venait de découvrir en Allemagne, ces pamphlets prenaient un tour tragique (…), tandis que Céline lui-même prenait figure d’assassin. » Et d’ajouter : « Céline, mieux que tout autre, savait qu’il n’avait pas voulu l’holocauste et qu’il n’en avait pas même été l’involontaire instrument (3) ». Au risque de me répéter, je dirai qu’il ne s’agit nullement d’exonérer Céline de ses excès, ni même de nier qu’il a manqué de compassion à une époque où elle eût été requise. Autre chose est de lui dénier tout regard compassionnel, ne voyant que « manœuvre ressemblant fort à de l’opportunisme, dont l’auteur ne sort pas grandi (4) » là où d’autres — tel un Yves Pagès, peu suspect de complaisance à l’égard de Céline – perçoivent une réelle humanité. Dira-t-on bientôt que la figure du sergent Alcide dans Voyage au bout de la nuit est une construction habile totalement dénuée de sincérité ?
On n’a assurément pas fini de disserter du cas Céline. Un mot, pour conclure : s’il était ce monstre cynique, inaccessible à la pitié et indifférent au sort de ses contemporains, aurait-il écrit cette œuvre dont l’émotion et la sensibilité sont les caractéristiques premières ? Que ce pamphlétaire, avec tout le génie qui fut le sien, se soit fourvoyé, il était le premier à l’admettre. Sans pour autant formuler le moindre reniement, on le sait. Mais Céline serait-il Céline sans ses outrances et cette démesure qui lui vaut encore tant d’inimitiés ? Au moins ne faudrait-il pas lui prêter des idées qui ne furent pas les siennes.
Marc LAUDELOUT
1. Viviane Forrester, « La peau dernière », préface à Pierre Duverger, Derniers clichés, Imec-Écriture, 2011.
2. François Gibault, préface aux Lettres de prison à Lucette Destouches et à Maître Mikkelsen, Gallimard, 1998.
3. Dans Bagatelles pour un massacre, Céline écrit : « Les Juifs à Jérusalem, un peu plus bas sur le Niger, ils ne me gênent pas ! ils me gênent pas du tout !... Je leur rends moi tout leur Congo, toute leur Afrique ! »
4. André Derval, « Singulier ou pluriel ? Céline, du nombre... », Revue des Deux mondes, n° 6, juin 2011, p. 141.
00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 décembre 2011
"EL TRABAJADOR" DE ERNST JÜNGER
"EL TRABAJADOR" DE ERNST JÜNGER
Ex: http://sangreyespiritu.blogspot.com/
 Principal ensayo del siempre polémico, incomprendido o mal entendido genio de Heidelberg. Publicado originalmente en 1932 la obra no se ha sustraido a una serie de revisiones por su autor adaptando ciertas reflexiones a secuencias vitales cuya magnitud es imposible de menospreciar. El vigor intelectual, el futurismo de sus planteamientos, así como la altura insospechada de una perspectiva que resulta desconcertadora para aquellos que no están preparados para la visión de horizontes nunca explorados, configuran la actual vigencia de esta obra. Incluso sigue aportando claves para lo que será el desarrollo de la modernidad en el siglo XXI.
Principal ensayo del siempre polémico, incomprendido o mal entendido genio de Heidelberg. Publicado originalmente en 1932 la obra no se ha sustraido a una serie de revisiones por su autor adaptando ciertas reflexiones a secuencias vitales cuya magnitud es imposible de menospreciar. El vigor intelectual, el futurismo de sus planteamientos, así como la altura insospechada de una perspectiva que resulta desconcertadora para aquellos que no están preparados para la visión de horizontes nunca explorados, configuran la actual vigencia de esta obra. Incluso sigue aportando claves para lo que será el desarrollo de la modernidad en el siglo XXI.
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 02 décembre 2011
Céline et la question de l’anarchie
Céline et la question de l’anarchie
par Charles-Louis Roseau
Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/
 « De droite » ou « de gauche », on a souvent qualifié Louis-Ferdinand Céline d’anarchiste. Le romancier, quant à lui, se réclamait parfois de ce mouvement. Pourtant, on sait bien qu’il est peu prudent de prendre les dires de l’auteur pour argent comptant, ce d’autant que les assertions céliniennes de la veille sont souvent démenties par les déclarations du lendemain. J’admire infiniment les auteurs qui ont la patience et la culture suffisantes pour décortiquer la pensée politique de Céline et la présenter comme un tout cohérent, systémique, comme une sorte de mécanique dans laquelle chaque rouage s’ordonne et s’ajuste aux engrenages qui précèdent et qui suivent. J’avoue, en ce qui me concerne, ne pas parvenir à m’élever suffisamment haut pour jeter sur le discours politique célinien un regard synthétique. Ce qui me rassure, en revanche, c’est que les études confirment, en les étoffant de maints exemples et arguments, une intuition qui m’assaille dès qu’il s’agit d’analyser le raisonnement célinien. Je parle évidemment de la tendance contradictoire permanente sur laquelle le romancier a bâti son discours. Céline n’est jamais tout à fait « de droite », ni « de gauche ». Jamais tout à fait « fasciste », ni complètement « anarchiste ». Souvent un peu « patriote », mais parfois absolument « antimilitariste ». Les concepts politiques forgés depuis le XVIIIe siècle à grand renfort de nuances, d’alinéas et d’exceptions qui confirment la règle, seraient-ils inaptes à qualifier une réalité terriblement complexe ? Ou, peut-être, est-ce le discours célinien, dont les échos innombrables ponctuèrent les péripéties politiques du siècle dernier, qui, trop alambiqué, refuse de rentrer dans les cases de la boîte à classification ?
« De droite » ou « de gauche », on a souvent qualifié Louis-Ferdinand Céline d’anarchiste. Le romancier, quant à lui, se réclamait parfois de ce mouvement. Pourtant, on sait bien qu’il est peu prudent de prendre les dires de l’auteur pour argent comptant, ce d’autant que les assertions céliniennes de la veille sont souvent démenties par les déclarations du lendemain. J’admire infiniment les auteurs qui ont la patience et la culture suffisantes pour décortiquer la pensée politique de Céline et la présenter comme un tout cohérent, systémique, comme une sorte de mécanique dans laquelle chaque rouage s’ordonne et s’ajuste aux engrenages qui précèdent et qui suivent. J’avoue, en ce qui me concerne, ne pas parvenir à m’élever suffisamment haut pour jeter sur le discours politique célinien un regard synthétique. Ce qui me rassure, en revanche, c’est que les études confirment, en les étoffant de maints exemples et arguments, une intuition qui m’assaille dès qu’il s’agit d’analyser le raisonnement célinien. Je parle évidemment de la tendance contradictoire permanente sur laquelle le romancier a bâti son discours. Céline n’est jamais tout à fait « de droite », ni « de gauche ». Jamais tout à fait « fasciste », ni complètement « anarchiste ». Souvent un peu « patriote », mais parfois absolument « antimilitariste ». Les concepts politiques forgés depuis le XVIIIe siècle à grand renfort de nuances, d’alinéas et d’exceptions qui confirment la règle, seraient-ils inaptes à qualifier une réalité terriblement complexe ? Ou, peut-être, est-ce le discours célinien, dont les échos innombrables ponctuèrent les péripéties politiques du siècle dernier, qui, trop alambiqué, refuse de rentrer dans les cases de la boîte à classification ?
Qu’en est-il de l’anarchie chez Céline ? Céline est-il anarchiste ? Je l’avoue tout de suite : ce n’est pas à cette dernière question que j’entends répondre. Je me souviens d’une étude que j’ai faite en 2007 à propos des anarchistes francophones sur Internet (1). J’avais envoyé un questionnaire aux webmasters de tous les sites dignes d’intérêt répertoriés sur la toile. L’un d’entre eux m’avait répondu : « Juste un conseil, ne vous lancez pas dans les tendances de l'anarchisme, vous risqueriez d'y perdre votre tête, conservez juste les affiliations, cela suffira à votre propos, les unes ne reflétant pas les autres. Des gens de la même tendance pouvant être soit à la fois, soit séparément dans diverses organisations ou groupe ou revue ou, ou, ou… La mouvance libertaire est, comme les sables, mouvante. » J’ai gardé ce conseil dans un coin de ma tête. Encore aujourd’hui, je ne manque pas de l’appliquer ; cela m’évite de dire des bêtises. Pour se prononcer sur l’anarchisme de Céline, il faudrait donc concevoir clairement et l’homme et le concept… J’en suis malheureusement bien loin. Alors que faire ? M’arrêter ? Le lecteur qui, entamant cet article, se réjouissait d’avance à l’idée de pouvoir « ranger » Céline dans une mouvance, sera sans doute déçu. Il peut en rester là. Celui qui, au contraire, se demande pourquoi on cherche encore à savoir si Céline est anarchiste, celui-ci, qu’il n’hésite pas à me suivre.
L’anarchisme est l’un de ces courants politiques sur lesquels plus on lit, moins on en sait. Quelle que soit l’approche, chaque livre allonge la liste des complexités, des nuances et des diversités internes. Cela ne facilite vraiment pas la tâche, surtout quand il convient d’être synthétique. Historiquement, la définition moderne et politique de l’anarchie naît avec l’État-nation. C’est après la Révolution française, et, plus particulièrement, au cours du XIXe siècle, que le mouvement, ses penseurs et ses principes se sont peu à peu mis en place. Mais quels principes au juste ? Si l’on en croit les auteurs de L’Encyclopédie anarchiste : « Ce qui existe et ce qui constitue ce qu’on peut appeler la doctrine anarchiste, c’est un ensemble de principes généraux, de conceptions fondamentales et d’applications pratiques sur lesquels l’accord s’est établi entre individus qui pensent en ennemis de l’autorité et luttent isolément ou collectivement, contre toutes les disciplines et contraintes politiques, économiques, intellectuelles et morales qui découlent de celle-ci. Il peut donc y avoir et, en fait, il y a plusieurs variétés d’anarchistes, mais tous ont un trait commun qui les sépare de toutes les autres variétés humaines. Ce point commun, c’est la négation du principe d’autorité dans l’organisation sociale et la haine de toutes les contraintes qui procèdent des institutions fondées sur ce principe. (2) » Cette définition pour le moins générique qui, tout en suggérant des sous-ensembles, se garde bien de les détailler, semble englober le cas célinien. En effet, on connaît les critiques que l’auteur adresse à la morale, à la religion, au capitalisme, à la démocratie et au militarisme. L’empreinte anarchiste est d’autant plus vivace, chez Céline, qu’il en est de la littérature comme de la vie : la première impression est souvent la plus vivace. Dans cette perspective, Voyage au bout de la nuit, le roman liminaire, celui par lequel tout lecteur commence son périple célinien, n’en finit jamais d’orienter les opinions. Il est sans doute le roman le plus réaliste de Céline. L’auteur y fustige la guerre, y dénonce la marchandisation des hommes, la misère des classes populaires, les méfaits du colonialisme et du capitalisme… De ce fait, il a été et est toujours perçu comme un roman politique, à tendance populiste, dont l’auteur refusait de prendre parti. Il suffit pour s’en convaincre de consulter les échos parus dans la presse à partir de 1932 (3) : on y parle de roman révolutionnaire, de cri, de souffle nouveau, de peinture réaliste et misérabiliste… À l’époque où chaque intellectuel se devait de choisir un camp et où le communisme figurait la seule expression envisageable de la révolte, tout individu qui, bien qu’ayant des sympathies pour les idées révolutionnaires, refusait de s’encarter, se voyait dédaigneusement taxé d’anarchisme (4) . N’est pas le cas de Bardamu qui, dans les premières pages de Voyage au bout de la nuit, se voit traiter d’ « anarchiste » parce qu’il refuse de défendre la « race française » chère à Arthur Ganate ? C’est donc par défaut que Céline est devenu anarchiste, un peu comme ces étrangers que l’on traitait de « rastaquouères » à la fin du XIXe siècle. Parce qu’il convenait de lui donner une étiquette, mais qu’aucune ne lui correspondait véritablement.
 Pourtant, à y regarder de plus près, de l’anarchiste, Louis-Ferdinand Céline n’a que la posture. Très vite, il se présente comme le reclus, le révolté incompris dont la parole rebelle perturbe la bienséance et l’équilibre politique établi. Tout au long de sa carrière, il alimentera cette image d’insoumis, d’abord par ses discours, puis, à la fin de sa vie, à l’aide de photos le représentant en guenilles, lui, l’homme du peuple, dans son « en-dehors » de Meudon. Il y a en effet une forme d’anarchisme ostentatoire chez Céline, mais qu’on ne s’y trompe pas, elle n’entretient aucun rapport avec le politique. Car « la vérité de ce monde, c’est la mort », et il n’y a rien à espérer, rien à construire, rien à autogérer, tant l’homme est viscéralement pourri. La seule once d’anarchisme présente chez Céline, on la doit donc, je pense, à son incroyable égoïsme. À cette indestructible conviction qui fait de l’ego la seule réalité possible, le point de départ et le critère de tout jugement. Il faut relire les lettres d’Afrique (5) pour saisir l’émergence de cette individualisme égocentrique et contestataire qui inscrit Destouches dans la droite lignée du philosophe allemand Max Stirner (6) et de certains de ses homologues français, à commencer par Georges Palante… On parlera alors d’anarchisme « littéraire », « philosophique », « apolitique », « du mépris », « de droite »… N’en reste pas moins qu’il s’agit avant tout d’une posture : d’un « être au monde » ostensible qui n’engage que soi.
Pourtant, à y regarder de plus près, de l’anarchiste, Louis-Ferdinand Céline n’a que la posture. Très vite, il se présente comme le reclus, le révolté incompris dont la parole rebelle perturbe la bienséance et l’équilibre politique établi. Tout au long de sa carrière, il alimentera cette image d’insoumis, d’abord par ses discours, puis, à la fin de sa vie, à l’aide de photos le représentant en guenilles, lui, l’homme du peuple, dans son « en-dehors » de Meudon. Il y a en effet une forme d’anarchisme ostentatoire chez Céline, mais qu’on ne s’y trompe pas, elle n’entretient aucun rapport avec le politique. Car « la vérité de ce monde, c’est la mort », et il n’y a rien à espérer, rien à construire, rien à autogérer, tant l’homme est viscéralement pourri. La seule once d’anarchisme présente chez Céline, on la doit donc, je pense, à son incroyable égoïsme. À cette indestructible conviction qui fait de l’ego la seule réalité possible, le point de départ et le critère de tout jugement. Il faut relire les lettres d’Afrique (5) pour saisir l’émergence de cette individualisme égocentrique et contestataire qui inscrit Destouches dans la droite lignée du philosophe allemand Max Stirner (6) et de certains de ses homologues français, à commencer par Georges Palante… On parlera alors d’anarchisme « littéraire », « philosophique », « apolitique », « du mépris », « de droite »… N’en reste pas moins qu’il s’agit avant tout d’une posture : d’un « être au monde » ostensible qui n’engage que soi. [Photo :Louis Lecoin] L’anarchie célinienne, me semble-t-il, fonctionne comme un trompe l’œil : réaliste de loin et improbable de près. Si l’auteur aime à paraître anarchiste, il ne voit aucun intérêt, je pense, à l’être concrètement. Les anarchistes, quant à eux, n’ont pas l’air de considérer le romancier comme un porte-parole. Et, quand, touché par tel ou tel discours, l’un des leurs se tourne vers l’écrivain, la main ne reste jamais longtemps tendue. L’usage de la référence anarchiste se situe donc ailleurs que dans le champ du politique et de l’engagement solidaire. Il relève au contraire d’une stratégie personnelle, voire tout à fait intime, liée à des vertus symboliques et esthétiques. Dans son essai sur Céline (12), Michel Bounan présente l’écrivain comme un conservateur antisémite et réactionnaire qui se serait sciemment « déguisé » en anarchiste pour mieux véhiculer ses idées. Sans tomber dans les excès d’une telle démonstration, il ne me semble pas déplacé de retenir la thèse du travestissement utilitaire. Comme il le fit pour son statut d’ancien combattant, Céline se serait donc fabriqué, ou simplement contenté d’entretenir, une image d’écrivain anarchiste. Il faut bien reconnaître que la verve révolutionnaire de ses premiers romans, tout comme le récit fantasmé de son enfance populaire et son statut de clochard céleste, ont contribué à alimenter la veine populiste qui participe de la symbolique anarchiste. De même, sa position d’écrivain frondeur, ses frasques judiciaires, son exil et son passage en prison le rangent, du moins en apparence, aux côtés des réfractaires. Pour le non-initié, ou pour l’intellectuel libertaire davantage soucieux de la posture que de l’engagement pratique, Céline pouvait donc aisément passer pour un anarchiste. Mais comment expliquer ce camouflage... Dont je ne saurais même pas m’aventurer à dire s’il était conscient ou non ? À y regarder de plus près, l’idéologie libertaire, vidée de ses applications pratiques, figure l’aboutissement de la marche initiée au siècle des Lumières. Les notions de critique, d’individu et de libre-pensée, qui s’inscrivent au cœur même de la mouvance libertaire, sont également des gages de qualité qui surent s’imposer dans l’histoire politique et littéraire. Dans cette perspective, l’étiquette anarchiste possède des vertus fédératrices qui ne purent que servir les intérêts du romancier. De plus, si l’anarchie reste un concept d’autant plus nébuleux qu’on le regarde de loin, il n’en reste pas moins une pensée politique légitime, humaniste, voire romantique, que seuls les réactionnaires d’un autre temps remettent radicalement en cause. De ce point de vue, Céline avait quelques avantages médiatiques à passer pour un anarchiste : d’abord parce qu’il est inconcevable d’être simultanément libertaire et fasciste. Mais aussi, parce qu’ainsi, sa cause devenait encore plus noble et tolérable.
[Photo :Louis Lecoin] L’anarchie célinienne, me semble-t-il, fonctionne comme un trompe l’œil : réaliste de loin et improbable de près. Si l’auteur aime à paraître anarchiste, il ne voit aucun intérêt, je pense, à l’être concrètement. Les anarchistes, quant à eux, n’ont pas l’air de considérer le romancier comme un porte-parole. Et, quand, touché par tel ou tel discours, l’un des leurs se tourne vers l’écrivain, la main ne reste jamais longtemps tendue. L’usage de la référence anarchiste se situe donc ailleurs que dans le champ du politique et de l’engagement solidaire. Il relève au contraire d’une stratégie personnelle, voire tout à fait intime, liée à des vertus symboliques et esthétiques. Dans son essai sur Céline (12), Michel Bounan présente l’écrivain comme un conservateur antisémite et réactionnaire qui se serait sciemment « déguisé » en anarchiste pour mieux véhiculer ses idées. Sans tomber dans les excès d’une telle démonstration, il ne me semble pas déplacé de retenir la thèse du travestissement utilitaire. Comme il le fit pour son statut d’ancien combattant, Céline se serait donc fabriqué, ou simplement contenté d’entretenir, une image d’écrivain anarchiste. Il faut bien reconnaître que la verve révolutionnaire de ses premiers romans, tout comme le récit fantasmé de son enfance populaire et son statut de clochard céleste, ont contribué à alimenter la veine populiste qui participe de la symbolique anarchiste. De même, sa position d’écrivain frondeur, ses frasques judiciaires, son exil et son passage en prison le rangent, du moins en apparence, aux côtés des réfractaires. Pour le non-initié, ou pour l’intellectuel libertaire davantage soucieux de la posture que de l’engagement pratique, Céline pouvait donc aisément passer pour un anarchiste. Mais comment expliquer ce camouflage... Dont je ne saurais même pas m’aventurer à dire s’il était conscient ou non ? À y regarder de plus près, l’idéologie libertaire, vidée de ses applications pratiques, figure l’aboutissement de la marche initiée au siècle des Lumières. Les notions de critique, d’individu et de libre-pensée, qui s’inscrivent au cœur même de la mouvance libertaire, sont également des gages de qualité qui surent s’imposer dans l’histoire politique et littéraire. Dans cette perspective, l’étiquette anarchiste possède des vertus fédératrices qui ne purent que servir les intérêts du romancier. De plus, si l’anarchie reste un concept d’autant plus nébuleux qu’on le regarde de loin, il n’en reste pas moins une pensée politique légitime, humaniste, voire romantique, que seuls les réactionnaires d’un autre temps remettent radicalement en cause. De ce point de vue, Céline avait quelques avantages médiatiques à passer pour un anarchiste : d’abord parce qu’il est inconcevable d’être simultanément libertaire et fasciste. Mais aussi, parce qu’ainsi, sa cause devenait encore plus noble et tolérable.Il est toujours malvenu de conclure une réflexion sur une série d’hypothèses. Les certitudes, comme le meilleur, sont pour la fin. Je souhaiterais donc clore cet article sur un lien qui, sans aucun doute, rapproche Céline de l’anarchie. Cette attache d’ordre esthétique a été étudiée en détails par Yves Pagès dans son livre sur la pensée politique de l’auteur (13). Il s’agit de l’influence des anarchistes de la Belle Epoque sur l’œuvre célinienne. Plutôt que de résumer cette brillante étude, j’invite le lecteur à la parcourir. Il y découvrira combien le jeune Destouches dut être impressionné par la série d’attentats anarchistes qui ponctuèrent son enfance et sévirent souvent dans son quartier. Il y croisera les figures de Caserio, d’Emile Henry, d’Auguste Vaillant, de Liabeuf, ou encore de tous ceux qui formèrent la bande à Bonnot. Les polémistes insoumis aussi : Libertad, Zo d’Axa… Étrangement, certains de ces personnages semblent refaire surface dans l’œuvre célinienne. On pense évidemment à Bardamu, mais aussi au Borokrom de Guignol’s Band. Dès lors, on ne peut que tomber d’accord avec Yves Pagès. Le projet littéraire célinien est semblable aux combats de ces libertaires accrochés au tournant des siècles. C’est une révolte individuelle perdue d’avance.
Un cri populaire d’autant plus déchirant qu’il est conscient de sa propre fin. L’acte d’un forcené assiégé qui refuse de se rendre.
Charles-Louis ROSEAU
Le Petit Célinien, 19 novembre 2011.
1 - Charles-Louis Roseau, Les Anarchistes francophones et Internet, Mémoire de Master sous la direction de Véronique Richard, Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées (Celsa), Paris IV – La Sorbonne, 2007.
2 - Sébastien Faure (sous la direction de), Encyclopédie anarchiste, Paris, Œuvre internationale des Éditions anarchistes, 4 Vol, 1934-1935.
3 - André Derval – textes réunis et présentés par – Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, Critiques 1932 – 1935, Paris, Ed. de l’IMEC, 1993.
4 - Le 9 décembre 1932, Paul Nizan écrit dans l’Humanité : « Céline n'est pas parmi nous : impossible d'accepter sa profonde anarchie, son mépris, sa répulsion générale qui n'acceptent point le prolétariat. Cette révolte pure peu le mener n'importe où : parmi nous, contre nous ou nulle part. Il lui manque la révolution.» Cité dans Ibid., p. 61.
5 - Louis-Ferdinand Céline, Cahiers Céline n°4 – Lettres et premiers écrits d’Afrique 1916 – 1917, textes réunis et présentés par Jean-Pierre Dauphin, Paris, Gallimard, 1978.
6 - Max Stirner, L’Unique et sa propriété, Lausanne, l’Âge d’homme, 1972. Paru en Allemagne en 1845, ce livre a été traduit pour la première fois en français en 1899.
7 - Cité dans Lettres, édition établie par Henri Godard et Jean-Paul Louis, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2009, p. 416.
8 - Cité par Bruno Jouy dans Voyage au bout de la nuit, Etude d’une réception, Thèse de Doctorat sous la direction de Pierre Lainé, Université de Bretagne occidentale, 1992.
9 - Lettres, Op. cit., p. 1243.
10 - Jean Vita, « Céline et l’enfance », dans Défense de l’Homme, N°17, février 1950, p.25-27. Dans cet article initialement paru en 1944, l’auteur présente Céline comme un « anarchiste ».
11 - Une synthèse complète de cette étude publiée sur trois numéros est disponible sur : http://florealanar.wordpress.com/2011/01/26/un-peu-dhistoire/
12 - Michel Bounan, L’Art de Céline et son Temps, Editions Allia, Paris, 2004.
13 - Yves Pagès, Les Fictions du politique chez L.-F Céline, « L’Univers historique », Paris, Le Seuil, 1994.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, anarchie, anarchisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 novembre 2011
Bestandsaufnahme der deutschen Seele nach dem Jahrhundertkrieg: Joachim Fernaus „Disteln für Hagen“
| Bestandsaufnahme der deutschen Seele nach dem Jahrhundertkrieg: Joachim Fernaus „Disteln für Hagen“ |
|
Geschrieben von: Martin Böcker |
|
Ex: http://www.blauenarzisse.de/ |
|
Als Joachim Fernau eben das getan hat, sich den Nibelungen genähert, war er kein junger Mensch mehr. Disteln für Hagen erschien 1966. Damals war der „erfolgreiche Geschichtsfeuilletonist“ (SPIEGEL) 56 Jahre alt. Im zweiten Weltkrieg wurde der in Posen Geborene und in Schlesien Aufgewachsene als Kriegsberichterstatter eingesetzt. Er arbeitete in München als Schriftsteller und freier Journalist, sein erstes Buch Deutschland, Deutschland über alles…, 1952 erschienen, war bereits ein Bestseller. Der flapsige Blick auf die Nationalhelden So nahm sich Fernau das Recht heraus, ziemlich flapsig über Siegfried, Hagen, Gunther, Gernot, Brunhild und die schöne Kriemhild zu berichten und darüber, was nach dem Jahrhundertkrieg noch von ihnen übrig war. Eine Bestandsaufnahme der deutschen Seele wollte er versuchen, so lautet auch der Untertitel des Buches. Er erzählt die Nibelungen-Geschichte nach, und immer wieder kommentiert er sie in „Rondos“, kurzen Zwischenstücken, in denen er die Sage aus seiner Sicht erläutert, also den „Bestand“ aufnimmt. Das ist an einigen Stellen sehr unterhaltsam. Wer die Sage noch nicht kennt, findet hier einen lesenswerten Einstieg. Fernau schafft andererseits Distanz zwischen sich und dem ersten „deutschen“ Nibelungendichter. Der Journalist und Schriftsteller vergleicht die „deutsche“ Version der Sage mit ihren nordischen, skandinavischen und isländischen Vorgängern. So deckt er allerlei beschönigende Brüche auf, will damit der „deutschen Seele“ auf die Spur kommen. Wenn der deutsche Nibelungendichter bei der Ankunft Siegfrieds in Worms schreibt, dass die Wormser „den Herren“ entgegen liefen, weil das so „Fug und Recht“ war, dann schreibt Fernau: „Sie gafften und staunten und umkreisten die blendenden Gestalten; sie hingen mit den Blicken an den gewaltigen Pferdestärken, sie riefen sich ihre Mutmaßungen zu und waren entzückt, wenn die Fremden nur lächelten.“ Immer wieder kommt er mit diesem hämischen Spott. Fernau der Kindskopf bläst den Staub vom ehrwürdigen Epos
Fernaus wichtigstes Indiz in seiner Argumentation über die deutsche Seele ist die „Saalschlacht“ (besser wohl: das „Saalschlachten“) am Ende der Nibelungensage. Wie die Deutschen in den vier Jahren des ersten Weltkrieges blieb Hagen dort bis zum Ende treu. Doch was hat Hagen getan? Wer ist Hagen? Fernau gibt die Antworten: Er ermordete Siegfried, verriet Kriemhild und versenkte ihren Schatz, vernichtete die Donau-Fähre und machte so jeden Rückzug unmöglich, ermordete den wehrlosen Sohn Etzels, seines ahnungslosen Gastgeber, und traf damit eine Entscheidung über den Kopf seines Königs hinweg. Hagens falsche Treue und ein Blick auf die Untiefen der deutschen Seele Wer war treu, sagen Sie es mir!“ fragt der Autor – irgendwie verzweifelt und empört – in die Runde. Hagen, so impliziert der ehemalige Kriegsberichterstatter, war es nicht. Doch was fasziniert „uns Deutsche“ so an diesen gerissenen, kampfstarken, weltgewandten Helden? Was hat diese „schauerlich-imposante Geradlinigkeit“? Es ist die Idee, sagt Fernau. Der Schriftsteller schließt mit beißendem Spott: „Keiner kann der Idee so treu sein wie der Deutsche. Wo die Idee fehlt, schafft er sie. Wo das nicht möglich ist, ist er nicht treu.“ Damit glaubt Fernau, die Essenz der deutschen Seele ermittelt zu haben. Dieser Gedanke ist anziehend, so kann man ihm angesichts Luther, Marx, Wilhelm II., Hitler und den Grünen doch einiges abgewinnen. „Schreckliche Zutaten, sagen Sie? Ja, das ist wahr. Aber seien Sie ohne Sorge; wenn Sie wüssten, womit die Kuchen anderer Völker gebacken sind!“ schreibt der Journalist und Buchautor. Er wirbt für einen klaren, offenen Blick der Deutschen auf sich selbst. Nicht die Welt soll an uns genesen, sondern wir selbst. Denn die Geschichte ist sicher noch nicht zu Ende. Joachim Fernau: Disteln für Hagen. 11. Auflage. Herbig Verlag. 224Seiten, gebunden. 6,95 Euro. Joachim Fernau - Leben und Werk in Text und Bildern. Herausgegeben von Götz Kubitschek und Erik Lehnert. Edition Antaios. 144 Seiten, gebunden. 14 Euro. |
00:05 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, livre, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, joachim fernau |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 27 novembre 2011
Goethe and the Indo-European religiosity

Goethe and the Indo-European religiosity
Hans Friedrich Karl Günther
The greatest ideas of mankind have been conceived in the lands between India and Germania, between Iceland and Benares (where Buddha began to teach) amongst the peoples of Indo-European language; and these ideas have been accompanied by the Indo-European religious attitude which represents the highest attainments of the mature spirit. When in January 1804, in conversation with his colleague, the philologist Riemer, Goethe expressed the view that he found it “remarkable that the whole of Christianity had not brought forth a Sophocles”, his knowledge of comparative religion was restricted by the knowledge of his age, yet he had unerringly chosen as the precursor of an Indo-European religion the poet Sophocles, “typical of the devout Athenian… in his highest, most inspired form”,41 a poet who represented the religiosity of the people, before the people (demos) of Athens had degenerated into a mass (ochlos). But where apart from the Indo-European, has the world produced a more devout man with such a great soul as the Athenian, Sophocles?
Where outside the Indo-European domain have religions arisen, which have combined such greatness of soul with such high flights of reason (logos, ratio) and such wide vision (theoria)? Where have religious men achieved the same spiritual heights as Spitama Zarathustra, as the teachers of the Upanishads, as Homer, as Buddha and even as Lucretius Carus, Wilhelm von Humboldt and Shelley?
Goethe wished that Homer’s songs might become our Bible. Even before the discovery of the spiritual heights and power of the pre-Christian Teuton, but especially after Lessing, Winckelmann and Heinrich Voss, the translator of Homer, the Indo-European outlook renewed itself in Germany, recalling a world of the spirit which was perfected by great German poets and thinkers during the late eighteenth and early nineteenth centuries.
Since Goethe’s death (1832), and since the death of Wilhelm von Humboldt (1835), the translator of the devout Indo-European Bhagavad Gita, this Indo-European spirit, which also revealed itself in the pre-Christian Teuton, has vanished.
Goethe had a premonition of this decline of the West: even in October 1801 he remarked in conversation with the Countess von Egloffstein, that spiritual emptiness and lack of character were spreading — as if he had foreseen what today characterises the most celebrated literature of the Free West. It may be that Goethe had even foreseen, in the distant future, the coming of an age in which writers would make great profits by the portrayal of sex and crime for the masses. As Goethe said to Eckermann, on 14th March 1830, “the representation of noble bearing and action is beginning to be regarded as boring, and efforts are being made to portray all kinds of infamies”. Previously in a letter to Schiller of 9th August 1797, he had pointed out at least one of the causes of the decline: in the larger cities men lived in a constant frenzy of acquisition and consumption and had therefore become incapable of the very mood from which spiritual life arises. Even then he was tortured and made anxious, although he could observe only the beginnings of the trend, the sight of the machine system gaining the upper hand; he foresaw that it would come and strike (Wilhelm Meisters Wanderjahre, Third Book, Chapter 15, Cotta’s Jubilee edition, Vol. XX, p. 190). In a letter to his old friend Zelter, on 6th June 1825, he pronounced it as his view that the educated world remained rooted in mediocrity, and that a century had begun “for competent heads, for practical men with an easy grasp of things, who [...] felt their superiority above the crowd, even if they themselves are not talented enough for the highest achievements”; pure simplicity was no longer to be found, although there was a sufficiency of simple stuff; young men would be excited too early and then torn away by the vortex of the time. Therefore Goethe exhorted youth in his poem Legacy of the year 1829:
In increasing degree since approximately the middle of the nineteenth century poets and writers as well as journalists — the descendants of the “competent heads” by whom Goethe was alarmed even in the year 1801 — have made a virtue out of necessity by representing characterlessness as a fact. With Thomas Mann this heartless characterlessness first gained world renown. Mann used his talent to conceal his spiritual desolation by artifices which have been proclaimed by contemporary admirers as insurpassable. But the talent of the writers emulating Thomas Mann no longer sufficed even to conceal their spiritual emptiness, although many of their readers, themselves spiritually impoverished, have not noticed this.
The freedom of the Press, which was introduced through the constitution of May 1816 into the Duchy of Weimar and which had already been demanded by Wieland with his superficial judgment would, Goethe declared, do nothing more than give free rein to authors with a deep contempt of public opinion (Zahme Xenien, Goethes Sämtliche Werke, Cotta’s Jubilee edition, Vol. IV, p. 47; Annalen (Annals) 1816, same edition, Vol. XXX, p. 298). In the Annalen of 1816, he remarked that every right-thinking man of learning in the world foresaw the direct and incalculable consequences of this act with fright and regret. Thus even in his time, Goethe must have reflected how little the men of the Press, were capable of combining freedom with human dignity.
When the descendants of the competent heads of the beginning of the nineteenth century rose, through their talents, to the upper classes, where due to a lower birthrate their families finally died out, the eliminating process of social climbing in Europe seized hold of less capable heads and bore them away into the vortex of the time. Their culture has been described most mercilessly by Friedrich Nietzsche in his lectures of the year 1871-72: Concerning the Future of Our Educational Institutions (Pocket edition, Vol. I, 1906, pp. 314, 332-333, 396). Nietzsche above all concentrated on famous contemporary writers, “the hasty and vain production, the despicable manufacturing of books, the perfected lack of style, the shapelessness and characterlessness or the lamentable dilution of their expressions, the loss of every aesthetic canon, the lust for anarchy and chaos” — which he described as if he had actually seen the most celebrated literature of the Free West, whose known authors no longer mastered their own languages even to the extent still demanded by popular school teachers around 1900. These vociferous heralds of the need for culture in an era of general education were rejected by Nietzsche who in this displayed true Indo – European views – as fanatical opponents of the true culture, which holds firm to the aristocratic nature of the spirit. If Nietzsche described the task of the West as to find the culture appropriate to Beethoven, then the serious observer today will recognise only too well the situation which Nietzsche foresaw and described as a laughing stock and a thing of shame.
In the year 1797, Friedrich Schiller composed a poem: Deutsche Grösse. Full of confidence in the German spirit he expressed the view that defeat in war by stronger foes could not touch German dignity which was a great moral force. The precious possession of the German language would also be preserved. Schiller (Das Siegesfest) certainly knew what peoples had to expect of war:
| For Patrocles lies buried and Thersites mes back; |
but he must have imagined that the losses of the best in the fight could be replaced. The dying out of families of dignity and moral stature (megalopsychia and magnanimitas), had then not yet begun in Europe.
In the year 1929, just a decade after the First World War had ended, that Peloponnesian war of the Teutonic peoples, which caused both in England and in Germany excessively heavy losses of gifted young men, of officers and aristocrats, Oskar Walzel (Die Geistesströmungen des 19. Jahrhunderts, 1929, p. 43), Professor of German literature at the university of Bonn, gave it as his opinion that after this war the trend to de-spiritualise Germany had gained ground far more rapidly than hitherto: “Is there in German history in general such an identical want of depth in men to be observed as at present?” But for the Germans it is poor consolation that this “de-spiritualising” is just as marked in other Western countries. Another sign of this trend is that today many famous writers are no longer capable of preserving the precious possession of the German language. Other Western languages are also neglecting their form and literature, but this again is poor consolation for the Germans. Such neglect is considered by many writers today as characteristic of, and part of the process of gaining their freedom and liberation from all traditional outlooks. Goethe criticised this as a false idea of freedom (Maxims and Reflections, Goethes Sämtliche Werke, Cottas Jubiläumsausgabe, Vol. IV, p. 229) in the following words:
“Everything which liberates our spirit, without increasing our mastery of ourselves, is pernicious.”
Thus, by freedom Goethe also understood the dignity of the freeborn, not the nature and mode of life of the freed slave.
From The Religious Attitudes of The Indo-Europeans, London 1967. Translated by Vivian Bird.
00:09 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : indo-européens, philosophie, littérature, goethe, allemagne, littérature allemande, lettres allemandes, lettres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 novembre 2011
Emil Cioran e o Culto à Morte
O ensaísta franco-romeno, Emile Cioran, sugere que uma conscientização da futilidade existencial representa a única arma contra delírios teológicos e ideológicos que têm balançando a Europa por séculos. Nascido na Romênia em 1911, Cioran desde muito cedo se identificou com o velho provérbio Europeu de que geografia significa destino. Da sua região nativa, de onde uma vez vagou pelas hordas de Scythian e Sarmatian, e na qual mais recentemente, vampiros e Draculas políticos estão tomando o pedaço, ele herdou um típico talento “balkanesque” de sobrevivência. Dezenas de povos gregos antigos evitavam esta área, e quando as circunstâncias políticas os forçaram a fugir, escolheram uma nova pátria na Sicília ou na Itália – ou hoje, como Cioran, na França. “Nossa época” escreve Cioran, “vai ser marcada pelo romantismo de pessoas apátridas. Já a imagem do universo está no passo de que ninguém terá direitos civis.”[1] Similarmente a esses compatriotas exilados, Eugene Ionesco, Stephen Lupasco, Mircea Eliade, e muitos outros, Cioran vem para compreender muito cedo que o senso de futilidade existencial pode melhor ser curado pela crença em um conceito histórico cíclico, que exclui qualquer noção de chegada de um Messias ou a continuação do progresso tecno-econômico.
A atitude política, estética e existencial, de Cioran em relação a ser e tempo é um esforço para restaurar o pensamento pré-Socrático, o qual o Cristianismo, logo a herança do racionalismo e do positivismo, empurrou para a periferia da especulação filosófica. Nesse ensaio e aforisma, Cioran tenta lançar uma fundação de uma filosofia de vida que, paradoxalmente, consiste na refutação total de todo o viver. Em uma era de história acelerada lhe parece sem sentido especular sobre o aperfeiçoamento humano ou sobre o “fim da história”. “O futuro”, escreve Cioran, “vão e vejam por si mesmos se realmente desejam. Eu prefiro me agarrar ao inacreditável presente e ao inacreditável passado. Eu os deixo a oportunidade de encarar o inacreditável.”[2] Antes dos empreendimentos humanos em devaneios sobre a sociedade futurista, ele devia primeiro imergir a si mesmo na insignificância da sua vida, e finalmente restaurar a vida para o que ela é de fato: uma hipótese trabalhosa. Em uma de suas litografias, o pintor francês J. Valverde, do século XVI, esboçou um homem que tinha tirado sua própria pele. Esse incrível homem, segurando uma faca em uma das mãos e sua pele recém tirada na outra, assemelha-se a Cioran, que agora ensina aos seus leitores como melhor tirar a máscara das ilusões políticas. Homens sentem medo somente na sua pele, não no esqueleto. Como seria para uma mudança, pergunta Cioran, se o homem poderia ter pensado em algo não relacionado ao ser? Nem tudo que transparece teimoso tem causado dores de cabeça? “E eu tenho pensado em todos que eu conheço”, escreve Cioran, “em todos que não estão mais vivos, há muito chafurdando em seus caixões, para sempre isentos da sua carne – e medo.”[3]
A interessante característica de Cioran é a tentativa de lutar contra o niilismo existencial por significados niilistas. Diferente de seus contemporâneos, Cioran é averso ao pessimismo chic dos intelectuais modernos que lamentam paraísos perdidos, e que continuam pontificando sobre o fim do progresso econômico. Inquestionavelmente, o discurso literário da modernidade tem contribuído para essa disposição do falso pessimismo, embora esse pessimismo pareça ser mais induzido por apetites econômicos frustrados, e menos, pelo que Cioran fala, “alienação metafísica”. Contrário ao existencialismo de J.P. Sartre, que foca na ruptura entre ser e não-ser, Cioran lamenta a divisão entre a linguagem e a realidade e, portanto, a dificuldade de transmitir inteiramente a visão da insignificância existencial. Em um tipo de alienação popularizada por escritores modernos, Cioran detecta o ramo da moda do “parnasianismo” que elegantemente mascara uma versão aquecida de uma crença frustrada em andamento. Como uma atitude crítica em relação aos seus contemporâneos, talvez seja a razão do por quê Cioran nunca teve elogios caindo aos montes sobre ele, e por quê seus inimigos gostam de apelida-lo de “reacionário”. Para rotular Cioran de filósofo do niilismo pode ser melhor apropriado em vista do fato de quê ele é um blasfemador teimoso que nunca se cansa de chamar Cristo, São Paulo, e todo o clérigo cristão, tão bem quanto seus seculares marxistas freudianos, de sucessores totais da mentira e mestres da ilusão. Ao atenuar Cioran para uma categoria ideológica e intelectual preconcebida não se pode fazer justiça ao seu temperamento complexo, nem refletir objetivamente sua filosofia política complicada. Cada sociedade, democrática ou despótica, tenta silenciar aqueles que encarnam a negativa da sacrossanta teologia política. Para Cioran, todo os sistemas devem ser rejeitados pela simples razão de que eles glorificam o homem como criatura final. Somente no louvor do não-ser, e na total negação da vida, argumenta Cioran, a existência do homem se torna suportável. A grande vantagem de Cioran é, como ele diz, “eu vivo somente porque é meu poder morrer quando eu quiser; sem a idéia de suicídio, eu tenho me matado já há muito tempo atrás.”[4] Essas palavras testemunham a alienação de Cioran da filosofia de Sisyphus, bem como sua desaprovação do pathos moral do trabalho infestado de esterco. Dificilmente um caráter bíblico ou moderno democrata poderia querer contemplar de maneira similar a possibilidade de quebrar o ciclo do tempo. Como Cioran diz, o supremo senso de beatitude é alcançável somente quando o homem compreende que ele pode, em qualquer momento, terminar com sua vida; somente nesse momento isso significará uma nova “tentação de existir”. Em outras palavras, poderia ser dito que Cioran desenha sua força vital do constante fluxo de imagens de morte saudada, assim interpretando irrelevante todas as tentativas de qualquer compromisso ético ou político. O homem deveria, por uma mudança, argumenta Cioran, tentar funcionar como uma bactéria saprófita; ou melhor, como uma ameba da era Paleozóica. Como forma primordial de existência pode suportar o terror do ser e do tempo mais facilmente. Em um protoplasma, ou em espécies mais arcaicas, há mais beleza que em todos os filósofos da vida. E para reiterar este ponto, Cioran acrescenta: “Oh, como eu gostaria de ser uma planta, mesmo que eu teria que ser um excremento de alguém!”[5]
Talvez Cioran poderia ser retratado como arruaceiro, ou como os franceses diriam, “trouble fete”, do qual os aforismas suicidas ofendem a sociedade burguesa, mas de quem as palavras também chocam os socialistas modernos sonhadores. Em vista da sua aceitação da idéia da morte, assim como sua rejeição de todas as doutrinas políticas, não é de admirar que Cioran não mais se sente imposto ao egoísta amor da vida. Por isso, não há razão para ele no refletir sobre a estratégia de vida; alguém deveria, primeiro, começar a pensar sobre a metodologia da morte ou, melhor ainda, como nunca ter nascido. “A humanidade tem regredido muito”, escreve Cioran, e “nada prova isso melhor que a impossibilidade de encontrar uma única nação ou tribo na qual o nascimento de uma criança causa luto e lamentação”[6] Onde estão aqueles tempos sacros, pergunta Cioran, quando os bogumils balcânicos e os cátaros franceses viram no nascimento de uma criança um castigo divino? As gerações atuais, ao invés de alegrarem-se quando seus queridos morrem, estão aturdidos com terror e descrença na visão da morte. Ao invés de lamentar e lutar quando sua prole nasce, organizam festividades em massa:
“Se embargá-los é um mal, a causa desse mal deve ser vista no escândalo do nascimento – porque para nascer significa ser embargado. O propósito da separação deveria ser a supressão de todos os vestígios desse escândalo – o sinistro e o menos tolerável dos escândalos.”[7]
A filosofia de Cioran carrega uma forte marca de Friedrich Nietzsche e das Upanishads indianas. Embora seu incorrigível pessimismo muitas vezes chama a “Weltschmerz” de Nietzsche, sua linguagem clássica e sua rígida sintaxe raramente tolera narrativas românticas ou líricas, nem as explosões sentimentais que pode-se encontrar na prosa de Nietzsche. Ao invés de recorrer à melancolia trovejante, o humor paradoxal de Cioran expressa algo o qual, em primeiro lugar, nunca deveria ter sido construído verbalmente. A fraqueza da prosa de Cioran reside, provavelmente, na sua falta de organização temática. Quando seus aforismos são lidos como notas destruídas de uma boa construção musical, e também sua linguagem é bastante hermética, em que o leitor tem de tatear o significado.
Quando alguém lê a prosa de Cioran é confrontado por um autor que impõe um clima de gélido apocalipse, que contradiz completamente a herança do progresso. A verdadeira alegria está em não-ser, diz Cioran, que é, na convicção de que cada ato de criação intencional perpetua o caos cósmico. Não há propósito nas deliberações intermináveis sobre um melhor sentido da vida. A história inteira, seja a história lembrada ou a história mítica, é repleta de cacofonia de tautologias teológicas e ideológicas. Tudo é “éternel retour”, um carrossel histórico, com aqueles que estão hoje no topo, terminando amanhã no fundo do poço.
“Eu não posso desculpar a mim mesmo por ter nascido. É como se, ao insinuar a mim mesmo nesse mundo, eu profanasse algum mistério, traísse algum importante noivado, executasse um erro de gravidade indescritível.”[8]
Não significa que Cioran seja completamente isolado dos tormentos físicos e mentais. Ciente da possibilidade de um desastre cósmico, e persuadido neurologicamente de que algum outro predador pode em qualquer momento privar-se do seu privilégio para assim morrer, ele implacavelmente evoca um conjunto de imagens de morte em camas. Não é um verdadeiro método aristocrático de aliviar a impossibilidade d ser?
“A fim de vencer a ansiedade ou temor tenaz, não há nada melhor do que imaginar seu próprio funeral: método eficiente e acessível a todos. A fim de evitar recorrer a isso durante o dia, o melhor é entrar nessas virtudes logo após se levantar. Ou talvez fazer uso disso em ocasiões especiais, semelhante ao Papa Inocêncio IX que mandou pintarem ele morto em sua cama. Ele lançaria um olhar para aquela pintura toda vez que tivesse uma decisão importante a fazer...”[9]
Primeiramente, já se deve ter sido tentado a dizer que Cioran é afeiçoado em mergulhar nas suas neuroses e idéias mórbidas, como se pudessem ser usadas para inspirar sua criatividade literária. Tão emocionante que ele encontra seu desgosto pela vida que ele próprio sugere que “aquele que consegue adquiri-lo tem um futuro o qual fará tudo prosperar; sucesso assim como derrota.”[10] Tal franca descrição de seus espasmos emocionais o faz confessar que sucesso, para ele, é tão difícil adquirir quanto a falha. Tanto um como o outro lhe causam dor-de-cabeça.
O sentimento da futilidade sublime com relação a tudo que engloba a vida vai de mão à mão com a atitude pessimista de Cioran com respeito ao surgimento e à decadência dos impérios e dos Estados. Sua visão da circulação do tempo histórico lembra Vico's corsi e ricorsi, e seu cinismo sobre a natureza humana desenha na “biologia” histórica de Spengler. Tudo é um carrossel, e todo sistema está condenado a perecer no momento em que toma entrada na cena histórica. Pode-se detectar nas profecias sombrias de Cioran os pressentimentos do estóico imperador romano Marcus Aurelius, quem ouviu na distância do Noricum o galope dos cavalos bárbaros, e quem discerniu através da neblina de Panonia as pendentes ruínas do império romano. Embora hoje os atores sejam diferentes, a configuração permanece similar; milhões de novos bárbaros começaram a bater nos portões da Europa, e em breve tomarão posse daquilo que está dentro dela:
“Independentemente do quê o mundo se tornará no futuro, os ocidentais assumirão o papel do Graeculi do império romano. Necessitados de e desprezados por novos conquistadores, não terão nada para oferecer a não ser a imposturice da sua inteligência ou o brilho de seu passado.”[11]
Este é o momento da rica Europa arrumar-se e ir embora, e ceder a cena histórica para outros povos mais viris. A civilização se torna decadente quando toma a liberdade como certa; seu desastre é iminente quando se torna tolerante a todo tosco de lá de fora. No entanto, apesar de que os furacões políticos estão à espreita no horizonte, Cioran, como Marcus Aurelius, está determinado a morrer com estilo. Seu senso do trágico ensinou-o a estratégia do ars moriendi, o tornando preparado para qualquer surpresa, independente da sua magnitude. Vitoriosos e vítimas, heróis e capangas, eles todos não se revezam nesse carnaval da história, lamentando e lamentando seu destino enquanto no fundo do poço, e tomando vingança enquanto no topo? Dois mil anos de história greco-cristã é uma mera ninharia em comparação à eternidade. Uma civilização caricatural está agora tomando forma, escreve Cioran, na qual os que estão criando estão ajudando aqueles que a querem destruir. A história não tem sentido e, portanto, na tentativa de torna-la significativa, ou esperar disso uma explosão final de teofania, é uma quimera auto-destrutiva. Para Cioran, há mais verdade nas ciências ocultas do que em todas as filosofias que tentam dar sentido de vida. O homem se tornará finalmente livre quando ele tirar sua camisa de força do finalismo e do determinismo, e quando ele compreender que a vida é um erro acidental que saltou de uma circunstância astral desconcertante. Provas? Uma pequena torção da cabeça claramente mostra que a história, de fato, se resume a uma classificação do policiamento: “afinal de contas, a barganha histórica não é a imagem da qual as pessoas têm do policiamento das épocas?”[12] Suceder na mobilização das massas em nome de algumas idéias obscuras, para as permitir farejar sangue, é um caminho certeiro para o sucesso político. As mesmas massas, as quais carregaram nos ombros a revolução francesa em nome da igualdade e da fraternidade, não têm muitos anos atrás também carregado nos ombros um imperador de roupas novas – um imperador em cujo nome corriam descalços de Paris a Moscou, de Jena para Dubrovnik? Para Cioran, quando uma sociedade cai fora das utopias políticas, não há mais esperanças, e consequentemente não se pode mais haver vida. Sem utopia, escreve Cioran, as pessoas são forçadas a cometer suicídio; graças à utopia, elas cometem homicídio.
Hoje em dia não há mais utopia. A democracia de massa tomou seu lugar. Sem a democracia a vida possui algum sentido; agora, a democracia não possui vida em si mesmo. Afinal, Cioran argumenta, se não fosse por um lunático da Galiléia, o mundo seria um lugar muito chato. Ai, ai, quantos lunáticos hoje estão incubando hoje suas auto-denominadas derivativas teológicas e ideológicas. “A sociedade está mal organizada”, escreve Cioran, “ela não faz nada contra os lunáticos que morrem tão cedo.”[13] “Provavelmente todos os profetas e adivinhos políticos deveriam imediatamente ser condenados à morte, porque quando a ralé aceita um mito – prepare-se para massacres ou, melhor, para uma nova religião.”[14]
Inequivocamente, como os ressentimentos de Cioran contra a utopia poderiam aparecer, ele está longe de ridicularizar sua importância criativa. Nada poderia ser mais repugnante para ele do que o vago clichê da modernidade que associa a busca pela felicidade com uma sociedade da busca pelo prazer da paz. Desmistificada, desencantada, castrada, e incapaz de prever a tempestade que virá, a sociedade moderna está condenada à exaustão espiritual e à morte lenta. Ela é incapaz de acreditar em qualquer coisa, exceto na pseudo-humanidade dos seus chupa-cabras futuros. Se uma sociedade realmente desejasse preservar seu bem biológico, argumenta Cioran, sua tarefa primordial é aproveitar e alimentar sua “calamidade substancial”; isso deve manter um cálculo da sua capacidade de auto-destruição. Afinal, seus nativos Balkans, nos quais seus vampiros seculares hoje novamente dançam ao tom da carnificina, não têm também gerado uma piscina de espécimes vigorosas prontas para o cataclisma de amanhã? Nessa área da Europa, na qual interminavelmente se estraga pelos tremores políticos e terremotos reais, uma nova história está hoje sendo feita – uma história da qual provavelmente recompensará sua população pelo sofrimento passado.
“Qualquer que fosse seu passado, e independente de sua civilização, esses países possuem um estoque biológico do qual não se pode encontrar no Ocidente. Maltradados, deserdados, precipitados no martírio anônimo, tornados a parte entre miséria e insubordinação, eles irão, talvez, no futuro, ter uma recompensa por tantas provações, tanto por humilhação como por covardia.”[15]
Não é o melhor retrato da anônima Europa “Oriental” da qual, segundo Cioran, está pronta hoje para acelerar a história do mundo? A morte do comunismo na Europa Oriental pode provavelmente inaugurar o retorno da história para toda a Europa. Por causa da “melhor metade” da Europa, a única que nada em ar condicionado e salões assépticos, que a Europa está esgotada de idéias robustas. Ela é incapaz de odiar e sofrer, logo de liderar. Para Cioran, a sociedade se torna consolidada no perigo e atrofia: “Nesses lugares onde há paz, higiene e saque do lazer, psicoses também se multiplicam...eu venho de um país no qual nunca se ensinou a conhecer o sentido da felicidade, mas também nunca se tem produzido um único psicoanalista.”[16] A maneira cru dos canibais do novo Leste, sem “paz e amor”, determinará a direção da história de amanhã. Aqueles que passaram pelo inferno sobrevivem mais facilmente do que aqueles que somente conheceram o clima acolhedor de um paraíso secular.
Essas palavras de Cioran são objetivas na decadente França ‘la Doulce’ na qual as conversas da tarde sobre a obesidade ou a impotência sexual de alguém se tornaram maiores bafafás nas preocupações diárias. Incapazes de montar resistência contra os conquistadores de amanhã, essa Europa Ocidental, de acordo com Cioran, merece ser punida da mesma maneira da nobreza do regime antigo, o qual na véspera da Revolução Francesa, ria de si mesmo, enquanto louva a imagem do ‘bon sauvage’. Quantos dentre aqueles bons aristocratas franceses estavam cientes de que os mesmos bon sauvage estavam prestes ter suas cabeças roladas nas ruas de Paris? “No futuro”, escreve Cioran, “se a humanidade é para nascer novamente, serão os parias, com mongóis por todas os lados, com a escora dos continentes.”[17] A Europa está se escondendo na sua própria imbecilidade em frente a um fim catastrófico. Europa? “A podridão que cheira agradável, um corpo perfumado.”[18]
Apesar das tempestades que virão, Cioran está seguro com a noção de que pelo menos ele é o último herdeiro do “fim da história”. Amanhã, quando o real apocalipse começar, e como o perigo das proporções titânicas tomam forma final no horizonte, então, até o mundo “arrependido” desaparecerá de seu vocabulário. “Minha visão do futuro”, continua Cioran, “ é tão clara que se eu tivesse crianças eu iria estrangula-las imdediatamente”.[19]
Depois de uma boa lida do opus de Cioran pode-se concluir que ele é essencialmente um satírico que ridiculariza o estúpido arrepio existencial das massas modernas. Pode-se ser tentado a argumentar que Cioran oferece um elegante manual de suicídio designado para aqueles que, assim como ele, tem deslegitimado o valor da vida. Mas assim como Cioran diz, o suicídio é cometido por aqueles que não são mais capazes de agir no otimismo, e.g., para aqueles em que o fio da alegria e da felicidade rasga em pedaços. Aqueles assim como ele, os pessimistas cautelosos, “dado que eles não têm nenhuma razão para viver, porque eles teriam para morrer?”[20] A impressionante ambivalência do trabalho literário de Cioran consiste nos pressentimentos apocalípticos em uma mão, umas evocações entusiastas de horror na outra. Ele acredita que a violência e a destruição são os principais ingredientes da história, porque o mundo sem violência é condenado ao colapso. Ainda se admira do por quê Cioran é assim oposto ao mundo da paz, se, pela sua lógica, esse mundo de paz poderia ajudar a acelerar sua própria morte cravada, e assim facilitar sua imersão na insignificância? Claro que sim, Cioran nunca moraliza sobre a necessidade da violência; antes, de acordo com os cânones dos seus queridos antecessores reacionários Joseph de Maistre e Nichollo Machiavelli, ele afirma que “a autoridade, não a verdade, faz a lei”, e que, consequentemente, a credibilidade de uma mentira política também determinará a magnitude da justiça política. Admitido que isso seja correto, como ele explica o fato de que a autoridade, pelo menos do modo como ele a vê, somente perpetua o ser odioso do qual ele tão fortemente deseja para absolver a si mesmo? Esse mistério nunca será conhecido a não ser por ele mesmo. Cioran admite, entretanto, que apesar da aversão à violência, todo o homen, incluindo a ele, tem, pelo menos uma vez na sua vida, contemplado como se assa uma pessoa viva, ou como se corta a cabeça de uma pessoa:
“Convencido de que os problemas da sociedade vêm das pessoas mais velhas, eu tenho concebido o plano de liquidar todos os cidadãos que passarem dos quarenta – o início da esclerose e da mumificação. Eu cheguei a acreditar que isso foi um ponto de virada quando cada humano se tornou um insulto à sua nação e um fardo à sua comunidade...Aqueles que ouviram isto não apreciaram esse discurso e me consideraram um canibal...Esta minha intenção deve ser condenada? Ela somente expressa algo que cada homem, que está ligado ao seu país, deseja do fundo do seu coração: a liquidação de metade de seus compatriotas.”[21]
O elitismo literário de Cioran é sem comparação na literatura moderna, e por causa disso ele muitas vezes aparece como um incômodo para orelhas sentimentais e modernas domadas com canções de ninar da eternidade terrestre ou êxtase espiritual. O ódio de Cioran em relação ao presente e ao futuro, seu desrespeito à vida, continuará certamente contrariando os apóstolos da modernidade que nunca descansam de cantarolar vagas promessas sobre o “melhor-aqui-e-agora”. Seu humor paradoxal é tão devastador que não se pode toma-lo pelo valor literal, especialmente quando Cioran descreve a si mesmo.
Seu formalismo na linguagem, sua impecável escolha das palavras, apesar de algumas similaridades com autores modernos do mesmo calibre elitista, o torna difícil de seguir. Pode-se admirar o arsenal de palavras de Cioran como “abulia”, “esquizofrenia”, “apatia”, etc, que realmente mostram um ‘nevrosé’ que ele diz ser.
Se alguém pudesse atenuar a descrição de Cioran em um curto parágrafo, então deveria descreve-lo como um autor que parece na veneração moderna do intelecto, um diagrama de moralismos espirituais e da transformação feia do mundo. De fato, para Cioran, a tarefa do homem é lavar-se a si mesmo na escola da futilidade existencial, por futilidade não é desespero; a futilidade não é uma recompensa para aqueles que desejam livrar-se a si mesmos da vida epidêmica e do vírus da esperança. Provavelmente, esta pintura melhor convém o homem que descreve a si mesmo como um fanático, sem nenhuma convicção – um acidente encalhado no cosmos que projeta olhares nostálgicos em direção de seu rápido desaparecimento.
Ser livre é livrar-se a si mesmo para sempre da noção de recompensa; esperar nada das pessoas e deuses; renunciar não só esse e outros mundos, mas salvar-se a si mesmo; destruir até mesmo essa idéia de correntes entre correntes. (Le mauvais demiurge, p. 88.)
2. De l'inconvénient d'etre né (Paris: Gallimard, 1973), p. 161-162. (my translation) (The Trouble with Being Born, translated by Richard Howard: Seaver Bks., 1981)
3. Cioran, Le mauvais démiurge ( Paris: Gallimard, 1969), p. 63. (my translation)
4. Syllogismes de l'amertume, p. 87. (my trans.)
5. Ibid., p. 176.
6. De l'inconvénient d'etre né, p. 11. (my trans.)
7. Ibid., p. 29.
8. Ibid., p. 23.
9. Ibid., p. 141.
10. Syllogismes de l'amertume, p. 61. (my trans.)
11. La tentation d'exister, (Paris: Gallimard, 1956), p. 37-38. (my trans.) (The temptation to exist, translated by Richard Howard; Seaver Bks., 1986)
12. Syllogismes de l'amertume, p. 151. (my trans.)
13. Ibid., p. 156.
14. Ibid., p. 158.
15. Histoire et utopie (Paris: Gallimard, 1960), p. 59. (my trans.) ( History and Utopia, trans. by Richard Howard, Seaver Bks., 1987).
16. Syllogismes de l'amertume, p. 154. (my trans.)
17. Ibid., p. 86.
18. De l'inconvénient d'etre né, p. 154. (my trans.)
19. Ibid. p. 155.
20. Syllogismes de l'amertume, p. 109.
21. Histoire et utopie (Paris: Gallimard, 1960), p. 14. (my trans.)
00:10 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, pessimisme, cioran, france, roumanie, lettres, lettres françaises, lettres roumaines, littérature roumaine, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 20 novembre 2011
Der Dandy der Leere – E.M.Cioran
Der Dandy der Leere – E.M.Cioran
Cioran, der »Dandy der Leere, neben dem selbst Stoiker wie unheilbare Lebemänner wirken« (Bernard-Henri Lévy), war einer der einflussreichsten kulturkritischen Denker des 20. Jahrhunderts. Sein widersprüchliches Leben ist noch nie so detailreich rekonstruiert worden wie in der vorliegenden Biografie von Bernd Mattheus. In bisweilen schmerzlicher Nähe zu den Äußerungen des Selbstmord- Theoretikers beleuchtet er auch die bislang wenig bekannte Zeit vor seiner Emigration nach Frankreich.
Emil M. Cioran, geboren 1911 im rumänischen Sibiu (Hermannstadt), studierte an der Universität Bukarest, wo er mit Mircea Eliade und Eugène Ionesco eine lebenslange Freundschaft schloß. Nach einem längeren Aufenthalt in Berlin emigrierte er 1937 nach Paris; seit dieser Zeit schreibt er auf französisch. Der Verfasser von stilistisch brillanten Aphorismen und Essays pessimistischster Prägung erregt schließlich mit der 1949 erschienenen Schrift »Lehre vom Zerfall« großes Aufsehen. Das Buch, das ihn international bekannt machte, wurde von Paul Celan ins Deutsche übersetzt und begründete seinen Ruf als unerbittlicher Skeptiker. Es folgen viele weitere kompromisslose Werke wie »Syllogismen der Bitterkeit« oder »Die verfehlte Schöpfung«. Bis in die späten 1980er Jahre bleibt Ciorans finanzielle Lage prekär, 1995 stirbt der Aristokrat des Zweifels und der Luzidität als gefeierter Denker in Paris.
Die vorliegende Biografie Ciorans ist die bislang gründlichste Gesamtdarstellung von Leben und Werk dieses Ausnahmedenkers. Bernd Mattheus gelingt nicht nur eine präzise Rekonstruktion Ciorans Lebens, sondern auch eine verblüffende Verlebendigung des »nach Kierkegaard einzigen Denkers von Rang, der die Einsicht unwiderruflich gemacht hat, daß keiner nach sicheren Methoden verzweifeln kann.« Peter Sloterdijk

Bernd Mattheus
Cioran
Portrait eines radikalen Skeptikers
367 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
3 Abbildungen
ISBN 978-3-88221-891-6
€ 28,90 / CHF 40,50
Stimmen
»Komplementär zur Werkausgabe sollte man das im Matthes & Seitz Verlag erschienene vorzügliche biographische Porträt des Cioran-Übersetzers Bernd Mattheus heranziehen. Bei aller Bewunderung ist es nicht blind für die Abgründe und Widersprüche dieses Lebens und Werkes. Es bietet auch genealogisch Erhellendes, das heißt bei Cioran stets: Verdüsterndes, so zu der tiefambivalenten Beziehung zu seiner Mutter.«
Ludger Lütkehaus, Badische Zeitung, 16. April 2011
»Die spannende und nicht nur in politischen Fragen differenzierte Cioran-Biografie von Bernd Mattheus gibt Einblick in die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge und das turbulente Leben Ciorans, der gerne auch mal die Einladung eines französischen Staatspräsidenten ausschlug.«
Tobias Schwartz, Märkische Allgemeine, 26./27. Juni 2010
»So ausführlich und aus neuesten französischen wie auch rumänischen Quellen gespeist, ist Ciorans Leben bislang auf Deutsch noch nicht dargestellt worden.«
Cornelius Hell, Die Furche, 24. Juli 2008
»In einem anregenden wie irritierenden Buch fasst er Cioran mitunter ganz aus der Nähe, mit wenig schmeichelhaften Zügen.«
Karl- Markus Gauß, Kommune, Juni/Juli 2008
»Bernd Mattheus porträtiert diesen trostlosen Misanthropen nicht. Er lässt ihn einfach zu Wort kommen. Es ist ein seltsamens und in gewisser Weise schon wieder ein faszinierendes Buch.«
Walter van Rossum, WDR, 17. Juli 2008
»Sein Leben ist noch nie so detailreich rekonstruiert worden wie in der vorliegenden Biographie von Bernd Mattheus. Mattheus gelingt nicht nur eine präzise Rekonstruktion Ciorans Leben, sondern auch eine verblüffende Verlebendigung des nach Kierkegaard ›einzigen Denkers von Rang‹.Mattheus liefert damit eine vorzügliche Monographie zum Werk Ciorans in Form einer Biographie, die viel Neues in sich birgt.«
Daniel Bigalke, Buchtips.net
»Ciorans Biograf Bernd Mattheus hat nun ein Porträt des radikalen Auflösers vorgelegt, das ein differnziertes, facettenreiches Bild zeichnet.«
Wolfgang Müller, taz, 24. Mai 2008
»Als Mattheus ein junger Mann war, in den siebziger Jahren, war er mit Cioran in Paris bekannt. Die Biographie spart nicht mit Kritik, lässt aber immer die Symphatie des Autors für den exzentrischen Rumänen durchscheinen, was das Buch lesenswert macht. Eine einfühlsame, kluge Biographie.«
Franziska Augstein, Süddeutsche Zeitung, 7. April 2008
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littératurefrançaise, lettres roumaines, littérature roumaines, philosophie, france, roumanie, e. m. cioran |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 novembre 2011
Zeitenthobenheit und Raumschwund
Zeitenthobenheit und Raumschwund
Ernst Jünger hat ein umfängliches Reisewerk hinterlassen. Im Laufe seines Lebens unternahm er mehr als 80 Reisen, etliche auch an exotische Orte in Übersee. Ausgehend von größtenteils unbekannten Dokumenten des Nachlasses – authentischen Reisenotizen und unveröffentlichten Briefen –, fügt Weber der Biografie dieses Jahrhundertmenschen das bislang ungeschriebene Kapitel eines intensiven Reiselebens hinzu.
Jünger reflektierte die Moderne als Beschleunigungsgeschichte und dokumentierte die um (Selbst-)Bewahrung bemühten Versuche, die katastrophalen Umbrüche, den permanenten Wandel des 20. Jahrhunderts literarisch zu bewältigen. Ernst Jüngers ›Ästhetik der Entschleunigung‹ liefert damit nicht nur eine Ästhetik des Tourismus und der literarischen Moderne, sondern hält auch Verhaltensregeln für eine Epoche bereit, in der das Zeit-für-sich-haben immer weniger möglich erscheint.
Jan Robert WEBER
Ästhetik der Entschleunigung
Ernst Jüngers Reisetagebücher
(1934 - 1960)
525 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-88221-558-8
€ 39,90 / CHF 53,90
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettrees allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, weimar, ernst jünger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 novembre 2011
Lovecraft Contra a Modernidade
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lovecraft, modernité, littérature, littérature américaine, lettres, lettres américaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 novembre 2011
Le ballet des asticots
Le ballet des asticots
par Pierre Chalmin
Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/
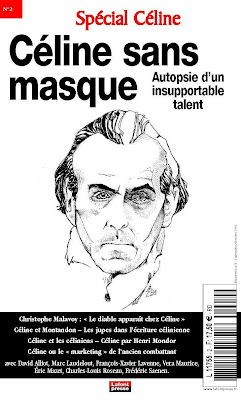 À propos de Joseph Vebret, Céline, l’infréquentable ? (Jean Picollec éditeur) et n°2 de la revue Spécial Céline, Céline sans masque. Autopsie d'un insupportable talent (Le Magazine des Livres, Lafont Presse, septembre/octobre 2011). «Celui qui parle de l’avenir est un coquin. C’est l’actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots.» Céline, Voyage au bout de la nuit.
À propos de Joseph Vebret, Céline, l’infréquentable ? (Jean Picollec éditeur) et n°2 de la revue Spécial Céline, Céline sans masque. Autopsie d'un insupportable talent (Le Magazine des Livres, Lafont Presse, septembre/octobre 2011). «Celui qui parle de l’avenir est un coquin. C’est l’actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots.» Céline, Voyage au bout de la nuit.On remet Céline en route, c’est tous les jours en cette glorieuse année du cinquantenaire de sa mort. Je commence à en avoir assez, je le dis tout net, et l’effet s’avère désastreux sur mes nerfs de ces fastidieuses compilations d’opinions ressassées, de tant de livres inutiles, de numéros «hors-série» fumeux fabriqués avec des bouts de chandelles, de tous ces avis doctes et cons et mille fois entendus de tout le monde et de n’importe qui : tant de broutilles indigentes, de temps perdu et de papier gâché… Je sais bien qu’il s’agit d’une industrie, que les illettrés aussi doivent gagner leur vie, etc. Permettez qu’étant femme du monde et non pas putain, je décline l’invitation à partouzer. On me proposa jadis d’écrire un petit ouvrage évoquant notre sujet : Les Céliniens, j’avais déjà mon idée, mon angle d’attaque. On me sait las méchant. On a renoncé. Je n’eusse rien pu écrire de toute façon, on ne diffame pas la canaille, à quoi serviraient sinon les lois ?
Bref, je reçois deux nouvelles publications d’anniversaire – cent et cent-unième, deux cent et deux cent-unième publiées en cette année faste ? – relatives à Céline, et Asensio me somme, avec ses grâces habituelles – pistolet sur la tempe – d’en rendre compte.
Je contemple la couverture du premier objet : Spécial Céline, c’est déjà le n° 2, – un troisième est annoncé en novembre ! –, qui s’intitule Céline sans masque. Une réminiscence de Sipriot et son Montherlant. Sous-titré : Autopsie d’un insupportable talent. Je bondis. Qui peut commettre une telle ânerie ? Je renvoie aux dictionnaires, n’importe lequel : ça ne veut rien dire. Je soupèse l’objet : 135 grammes. Pour 128 pages imprimées sur du papier torchon. Dites un prix ?… 17,50 euros ! C’est publié par Lafont Presse, un trust énorme. Ça doit leur coûter dans les 30 centimes à imprimer, et encore j’exagère peut-être, il y a longtemps que je n’ai pas joué à l’éditeur… J’ouvre et je lis le nom des deux compères éditorialistes à qui l’on doit je présume les jolis titres : MM. Joseph Vebret et David Alliot. David Alliot, je le connais, il publie un livre par trimestre sur Céline depuis quelques années. Joseph Vebret, un de ses amis me l’avait jadis décrit comme le plus désintéressé des amateurs de littérature, le plus fauché, le plus gratuit… (C’est peu de temps après que je l’ai vu deviser – oh ! quelques instants ! on n’a plus guère de patience à mon âge – avec Houellebecq, le passage juste où Houellebecq explique sa supériorité sur Baudelaire. Je me suis arrêté trente secondes plus tard, je pensais que Vebret se lèverait et partirait, que la messe était dite. Et puis pas du tout, ils continuaient de disserter sur le «génie» de Houellebecq : parce que c’est ainsi, Houellebecq a du génie, Céline du «talent» seulement…). Curieux de le retrouver là.
Second objet qui cette fois ressemble à un livre : Céline l’Infréquentable ? Publié par Jean Picollec, un ami de longue date. 208 pages, 16 euros. Je souffle un peu. Miséricorde ! l’auteur, c’est précisément et encore Joseph Vebret. Je saute à la page de faux-titre… «À Jules, parce que» : parce que quoi ? qu’est-ce que cette puérilité ! Tout de suite envie de le jeter aux orties «parce que merde»… Même page, trois épigraphes. Le nom du destinataire de la première est mal orthographié : lire «Marcel Lafaÿe»; deuxième citation, de Philippe Muray… sortie de son contexte et qui exprime exactement le contraire de ce que Muray a longuement écrit, expliqué, disséqué dans son Céline (je renvoie à ma contribution – bénévole ! – au copieux Muray à paraître à la mi-octobre aux éditions du Cerf, où précisément je traite le sujet); enfin, pied de page, dernière citation, de Gide cette fois, un article de la NRF d’avril 1938 (du 1er avril exactement, mais notre citateur n’y est pas allé chercher et c’est dommage parce que cet article, consacré entre autres à Bagatelles pour un massacre, recèle mille fois plus intéressant que la pauvre phrase qu’il en extrait) : «Les juifs, Céline et Maritan»… «Maritan» pour Maritain ! l’association est pourtant explicite quand on sait un peu d’histoire littéraire…
Soyons franc, ça commençait par trop mal. Ma patience avait été fort éprouvée déjà par un récent entretien avec le professeur Philippe Alméras à qui j’avais tenu à donner la parole puisque aussi bien tout le monde la lui refusait, mais dont la thèse ne m’a jamais convaincu. Je m’apprêtais à sabrer sans nuance ces nouvelles publications, et bien-succinctement. Heureusement, je dispose depuis plus de quinze ans d’un nègre critique, comme par hasard qui se trouve être le plus compétent des céliniens. Je l’ai donc sommé – pistolet sur la tempe, méthode Asensio – de me donner un avis nuancé sur ces deux ouvrages. Lisez plutôt.
Céline l’Infréquentable ?
– Je trouve ce petit livre très bien, c’était une très bonne idée, car il donne la parole à plusieurs céliniens qui ne se connaissent pas forcément et qui ont chacun une approche différente ou des réponses différentes… ou semblables. Une histoire avec Céline différente. Comment chacun y est venu, à quel âge, pourquoi, ce qu’il a apporté… Des âges différents; des formations différentes aussi. On pourrait reprocher à l’ouvrage de n’avoir pas donné la parole à Alméras, ou à André Derval qui aurait été plus critique à l’égard de Céline que certains. Même si on peut dire qu’aucun n’est complaisant à l’égard d’un certain Céline et que tous se posent des questions. Soulignons que ce sont des interviews, donc des «instants», des «réponses partielles», «limitées», qui demanderaient sans doute explications, nuances, compléments, non des thèses ou des études qui se voudraient complètes, définitives, mûrement réfléchies. Les interviews les plus intéressantes sont celles des jeunes céliniens : Laudelout, Mazet, Brami, Alliot. Les vieux céliniens ont tendance à plus parler d’eux-mêmes que de Céline… (N.B. : Les «vieux» céliniens sont donc, en procédant par élimination, Bruno de Cessole, François Gibault, Philippe Sollers et Frédéric Vitoux, l’ouvrage étant constitué de huit entretiens…).
Céline sans masque
– «Les céliniens : combien de divisions ?» par Marc Laudelout : une synthèse remarquable, Laudelout étant aux premières loges depuis plus de trente ans avec son Bulletin célinien pour juger des querelles intestines incessantes qui agitent le petit monde des céliniens.
Malavoy dans l’entretien qu’il accorde à David Alliot sous le titre : Le diable apparaît chez Céline est fort sympathique, il montre de l’enthousiasme, est honnête avec lui-même, mais un peu naïf tout de même, fait trop confiance à ce que dit Céline ou ce qu’en dit Lucette…
Céline et Montandon par Éric Mazet : analysant Montandon, fanatique communiste puis fanatique nazi, Mazet ne se contente pas de la caricature d’un être déjà caricatural; c’est fouillé, extrêmement précis, très éclairant.
Céline par Henri Mondor par David Alliot : il y a de l’exagération dans le titre ! Alliot n’apporte rien sur Mondor ni son texte. Même remarque pour son Céline à Kränzlin, le témoignage d’Asta Schertz. Plus intéressante est son exhumation des archives de la Préfecture de Police de Paris sur Céline. Une riche idée de rééditer ces textes peu connus ou difficilement trouvables.
L’étude de Lavenne : Image de l’écrivain, Céline face aux médias. De l’aura de l’absent à la présence du spectre, est intéressante en dépit d’un titre trop long… qui a cependant le mérite de résumer trente-six pages en moins de vingt mots.
Charles Louis Roseau, Céline ou le «marketing» de l’ancien combattant est assez complet sans rien révolutionner.
Véra Maurice, Quand les jupes se retroussent dans l’écriture célinienne, a réfléchi à son sujet…
Et voilà ce qui s’appelle de la critique enlevée ! Quant à moi, je relève la présence des mêmes noms dans les deux ouvrages, et je me demande, naïvement, pourquoi on ne demande jamais leur avis à des céliniens aussi éminents et décisifs et «qui bossent» comme disait Céline – «Tout ce que je vois, c’est que je bosse et que les autres ne foutent rien…» –, que Jean-Paul Louis qui est à l’origine de la publication des Lettres de Céline en Pléiade, mais encore de L’Année Céline depuis 1990, ni de l’extraordinaire Gaël Richard, auteur d’un Dictionnaire des personnages dans l’œuvre romanesque de Louis-Ferdinand Céline, qui prépare un Dictionnaire de la correspondance de Céline et une Bretagne de Céline, ouvrages édités parmi cent merveilles et autant de raretés par le même Jean-Paul Louis aux éditions Du Lérot (Les Usines réunies, 16140 Tusson – site : www.editionsdulerot.fr) ? La réponse est dans la question : ils bossent, ils n’ont pas de temps à perdre. Ni moi non plus pour finir.
En conclusion, et suivant ses centres d’intérêt, que le lecteur choisisse ce qu’il a envie de lire : lequel des deux ouvrages sommairement présentés supra, l’un, l’autre, aucun…
S’il recherche une introduction à l’œuvre de Céline, la plus abordable, entre biographie et essai, est le Céline d’Henri Godard qui vient de paraître (Gallimard, 594 pages, 25,50 euros). La biographie «historique» de François Gibault, en trois volumes : Céline – 1894-1932 – Le Temps des espérances; Céline – 1932-1944 – Délires et persécutions; Céline – 1944-1961 – Cavalier de l’Apocalypse, vient de reparaître au Mercure de France (compter un peu plus de 80 euros pour un peu moins de 1 200 pages).
Voyage au bout de la nuit, 505 pages, est disponible dans la collection Folio pour le prix de 8,90 euros; Mort à crédit, 622 pages, 9,40 euros, que nous conseillons aux néophytes pour aborder l’œuvre de Céline, se trouve dans la même collection.
Pierre CHALMIN
Stalker, 11/10/2011
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 novembre 2011
Le bulletin célinien n°335 (novembre 2011)
Le bulletin célinien n°335 (novembre 2011)
 Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°335. Au sommaire :
Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°335. Au sommaire :
Marc Laudelout : Bloc-notes
P.-L. Moudenc : « Céline’s band »
Robert Le Blanc : Jeanne Alexandre et « Voyage au bout de la nuit »
Jeanne Alexandre : « Voyage au bout de la nuit » [1933]
Rémi Astruc : Céline et la question du patrimoine
M. L. : Céline et Jean Renoir
Pierre de Bonneville : Céline et Villon (4 et fin).
Un numéro de 24 pages, 6 € franco.
Le Bulletin célinien, B. P. 70, Gare centrale, BE 1000 Belgique.
Le Bulletin célinien n°335 - Bloc-notes
 André Derval (1) m’écrit que, contrairement à ce que j’ai laissé entendre, le colloque de février dernier n’a pas été organisé sous les auspices de la Société des Études céliniennes. « J’en suis personnellement responsable, en collaboration avec Emmanuèle Payen, de la BPI (Bibliothèque Publique d’Information, ndlr) », précise-t-il. Je suis heureux de cette rectification car j’avais déploré, on s’en souvient, qu’au cours dudit colloque, Céline ait été présenté comme un partisan du génocide. La présence active de François Gibault, président de la SEC, et d’André Derval, qui dirige la revue de la société, m’avaient induit en erreur. Mea culpa.
André Derval (1) m’écrit que, contrairement à ce que j’ai laissé entendre, le colloque de février dernier n’a pas été organisé sous les auspices de la Société des Études céliniennes. « J’en suis personnellement responsable, en collaboration avec Emmanuèle Payen, de la BPI (Bibliothèque Publique d’Information, ndlr) », précise-t-il. Je suis heureux de cette rectification car j’avais déploré, on s’en souvient, qu’au cours dudit colloque, Céline ait été présenté comme un partisan du génocide. La présence active de François Gibault, président de la SEC, et d’André Derval, qui dirige la revue de la société, m’avaient induit en erreur. Mea culpa.Il ne s’agit pas, soyons clairs, d’exonérer Céline de ses outrances. Ainsi, on regrettera, pour la mémoire de l’écrivain, que celui-ci se soit laissé aller à adresser, sous l’occupation, des lettres aux folliculaires de bas étage qui constituaient la rédaction de l’hebdomadaire Au Pilori, pour ne citer que cet exemple. Encore faut-il ajouter que des céliniens, peu suspects de complaisance, tel Henri Godard, admettent que Céline était dans l’ignorance du sort tragique réservé aux juifs déportés.
La Société des Études céliniennes n’est donc pas responsable de ces dérives et c’est tant mieux. Elle ne l’est pas davantage de l’édition du livre iconographique de Pierre Duverger, Céline, derniers clichés, coédité par l’IMEC et les éditions Écriture, dans une collection que dirige André Derval (2). Dans ce cas aussi, il faut s’en féliciter. La préfacière de cet ouvrage n’y affirme-t-elle pas que « Céline appela à l’extermination » [sic] ? C’est, une fois encore, interpréter abusivement le langage paroxystique du pamphlétaire.
Après la guerre, Céline se gaussait de ses accusateurs qui voyaient en lui « l’ennemi du genre humain » ou, pire, « un génocide platonique, verbal ». « On ne sait plus quoi trouver », ajoutait-il, désabusé (3).
Sur cette période trouble de l’occupation, il faut lire la somme de Patrick Buisson, 1940-1945, années érotiques, qui vient d’être rééditée en collection de poche (4). S’il est vrai que le rapport à l’argent, au pouvoir et au sexe détermine un individu, l’auteur montre avec perspicacité à quel point la libido joua un rôle majeur dans ces années tumultueuses. Céline y est défini comme un « thuriféraire de la France virile ». C’est sans doute l’une des raisons pour laquelle il est si mal considéré en notre époque qui voit le triomphe des valeurs féminines « au détriment de l’impératif communautaire avec lequel les valeurs mâles ont, depuis toujours, partie liée ». Et d’observer que « cette féminisation de la société s’accompagne d’un effacement symétrique des marqueurs identitaires du masculin tels que l’autorité et la force physique dont le capital social et symbolique semble promis à une lente mais inexorable évaporation ». C’est dire si Céline, qui fustigeait le pays femelle qu’était alors la France à ses yeux, aurait honni ce qu’il en est advenu.
Marc LAUDELOUT
1. Né en 1960, André Derval est l’auteur d’une thèse de doctorat, Le récit fantastique dans l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline (Université de Paris VII, 1990). Il est actuellement responsable du fonds d’archives Céline à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) et directeur de la revue Études céliniennes éditée par la Société d’études céliniennes. Au cours du colloque de Beaubourg, André Derval a déploré, à juste titre, qu’en France aucun travail collectif relatif à Céline ne soit entrepris par une équipe d’enseignants chercheurs, comme cela se produit pour tant d’autres écrivains.
2. Pierre Duverger, Céline, derniers clichés (préface de Viviane Forrester), Imec-Écriture, 2011.
3. Entretien avec Louis-Albert Zbinden, Radio suisse romande [Lausanne], 25 juillet 1957.
4. Patrick Buisson, 1940-1945, années érotiques (I. Vichy ou les infortunes de la vertu ; II. De la Grande Prostituée à la revanche des mâles), Le Livre de Poche, 2011. Ce livre est paru initialement en 2008 (Éd. Albin Michel).
00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 novembre 2011
Les tribulations d'un poète au pays des Soviets
Emmanuel Carrère, Prix Renaudot pour son "Limonov"
par Minnie Veyrat
Ex: http://www.metamag.fr
Quel est le metteur en scène qui s’emparera, le premier, de l’incroyable scénario écrit par Emmanuel Carrère dans son dernier livre, « Limonov » tout juste consacré par un jury Renaudot qui a jeté sa gourme ? Car, tout y est. La naissance du héros : gros plan sur le bébé couché dans une vielle caisse d’obus et suçant une queue de hareng séché. A parents médiocres, enfance morose et c’est à l’adolescence que les choses commencent à bouger.
Savenko réalise vite qu’il trouvera argent et succès chez les voyous. Il tentera donc d’en faire partie pour essayer de sortir de la grisaille de sa petite ville de Kharkov. Notre apprenti voyou, malheureusement, est aussi poète, mais n’est pas Villon qui veut !
Là, entre en jeu Anna. Grosse femme excentrique dont la librairie sera l’antichambre (puis la chambre) des premier succès d’Edouard. Le voilà amant en titre et sa petite renommée locale commence. Il sera désormais Ed. Limonov.
Il reste qu’il faut bien vivre à Moscou où ils s’installent en 1968. Et ce n’est pas forcément déchoir pour un poète que de vendre des pantalons fabriqués à demeure. Exit Anna. Voici la splendide Elena qui partagera son rêve américain : devenir mannequin pour elle et connaître enfin le succès pour lui. Mais le rêve tourne rapidement au cauchemar.
Heureusement, une autre femme, Jenny, lui ouvre les portes d’un milliardaire dont il deviendra le « majordome poète » et que celui-ci se plaît à exhiber dans son salon. Le poète russe plaît dans le nouveau monde.
Elena le quitte et le plonge dans un de ces chagrins éthyliques à la Russe : un zapoï. Rien de tel que Paris pour se consoler. Limonov devient, ici, la coqueluche, pour un temps, des intellos de l’époque (Robbe–Grillet et Edern Hallier entre autres...), dont il fréquente le QG de la place des Vosges. Ses premiers livres autobiographiques paraissent, écrits que Madame Carrère d’Encausse juge, pour sa part, « pornographiques et ennuyeux ». C’est aussi à Paris qu’il rencontre Natacha, dont il tombe amoureux, malgré sa nymphomanie et son goût immodéré pour les boissons fortes. Là, on a envie de dire « stop ». Trop, c’est trop. Mais non, le film continue.
Une vie de merde ?
Limonov rêve de voir son pays retrouver sa grandeur. Mais, après un court passage à Moscou, où il apprend qu’Anna s’est pendue et que ses anciens amis sont soit morts soit en prison, plus rien ne le tente que la guerre. Quel meilleur endroit que les Balkans ? Croates, Serbes, Bosniaques… On s’y perd un peu, mais voici Limonov chez les Serbes en tenue camouflée, la kalachnikov à l’épaule.
Ses livres se vendant bien, il retourne à Moscou où commence le règne de Poutine. Le voilà rédacteur en chef contestataire d’une feuille de chou, organe d’un obscur parti national-bolchévique. Il manquait la case prison, c’est fait. Le voilà condamné pour terrorisme et trafic d’armes. C’est, bizarrement, en prison qu’il accédera à une certaine sérénité. L’auteur pourra enfin peaufiner son œuvre de poète maudit, oublié de tous.
C’est là qu’il écrit, d’après Emmanuel Carrère, son chef d’œuvre, « Le livre des eaux ». Hélas, les politiciens russes ont besoin de nouvelles idoles et ils découvrent qu’un nouveau « Dostoïevski » croupit dans un camp de travail, à Engels. On l’en fait sortir en grande pompe, sous les caméras de la télévision. La suite sera sans grand intérêt.
Vous croyez écrire le mot « fin ». Vous n’y êtes pas encore. Car, dans les tribulations de ce Russe à travers le siècle, tout est vrai ou presque. Qui plus est, le vrai Limonov existe. Emmanuelle Carrère l’a rencontré. Et il pourrait être indispensable de le consulter pour éclaircir quelques points de détail, avant de dire « moteur ».
Que dire du livre d’Emmanuel Carrère ? Bien que Limonov ne soit guère sympathique, on peut comprendre la sorte de fascination qu’un tel personnage ait pu inspirer à l’auteur qui se qualifie, lui-même, de « bourgeois-bobo » et qui, bien qu’à l’opposé du voyou ukrainien, aimerait sans doute, à ses heures, voir son propre visage se dégager du reflet de Limonov dans un miroir.
Limonov, quant à lui, termine sa vie dans un beau domaine, avec sa dernière épouse et son jeune enfant. Lorsque l’on évoque, devant lui, l’Asie centrale et ses immensités, ses yeux brillent encore. Toutefois, si l’on en vient, plus largement, à parler de sa vie et de son œuvre, il répond, désabusé : « une vie de merde... »
Ce livre se lit comme un roman d’aventures ; le style est alerte, mais, parfois, Carrère fait preuve de facilité en adoptant, avec une certaine gourmandise, le vocabulaire ordurier de son modèle.
Limonov d’Emmanuel Carrère aux éditions POL, 488 pages à 20 €
00:10 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edouard limonov, prix renaudot, livre, lettres, lettres françaises, littérature française, littérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 26 octobre 2011
Der Renegat der konservativen Revolution: Das Buch „Thomas Mann – Der Amerikaner“
|
|
|
Geschrieben von: Simon Meyer |
|
Ex: http://www.blauenarzisse.de/
|
|
Als im Sommer 1914 auf die Schüsse von Sarajevo die allgemeine Mobilmachung folgte, machte einer der schon damals berühmtesten Schriftsteller Deutschlands keinen Hehl aus seiner Solidarität mit dem Reich und dessen Kriegsführung: Thomas Mann. Er wurde – nicht zuletzt wegen seines berühmten Namens – vom Kriegsdienst freigestellt. Doch sein literarisches Schaffen stellte er in den Dienst der Sache. Zwanzig Jahre später jedoch, befand er sich geographisch und politisch auf der anderen Seite. Thomas Manns literarischer Kriegsdienst begann noch 1914 mit der Schrift Gedanken im Kriege, auf die im gleichen Jahr der Großessay Friedrich und die große Koalition folgte. Und er legte nach. 1915 verfaßte er eine leidenschaftliche Verteidigung Deutschlands in einem Beitrag für die Schwedische Tageszeitung Svenska Dagbladet. Drei Jahre später, zum Ende des Krieges, sammelte er seine Gedanken unter dem Titel Betrachtungen eines Unpolitischen – einem der Grundlagenwerke der Konservativen Revolution. Flucht vor der Heimat und der eigenen politischen Vergangenheit Um so verwunderlicher: Derselbe Schriftsteller propagierte gut zwei Jahrzehnte später aus seinem amerikanischen Exil heraus unablässig die bedingungslose Vernichtung Deutschlands als notwendig und verdient. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Thomas Mann die amerikanische Staatsbürgerschaft erworben. Seit 1938 hatte er in den Vereinigten Staaten seinen ständigen Aufenthalt. Der Amerikaner Thomas Mann war den Deutschen ein Fremder geworden. In den Nachkriegsjahren war er nicht willkommen, zu frisch war bei vielen die Erinnerung an das, was Mann ihnen in den Rundfunksendungen der Alliierten entgegengeschleudert hatte. Doch auch als die Verhältnisse sich 1968 grundlegend geändert hatten, blieb er ein Fremdkörper. Zu liberal-großbürgerlich erschien Thomas Mann nun und wurde angesichts seiner frühen Schriften schon fast als unsicherer Kantonist behandelt, jedenfalls als Fossil aus einer überholten Epoche. Warum ging Thomas Mann, der für die Buddenbrooks mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde und darin eine hanseatische Handelsfamilie beschrieb, diesen Weg? Warum wurde er nicht nur aus der Notwendigkeit des Exils sondern aus innerer Überzeugung zum Amerikaner? Wäre nicht der Weg, den etwa Gottfried Benn, Martin Heidegger oder Ernst Jünger während der Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft gingen, für ihn der wahrscheinlichere gewesen? In diese Fragestellungen, so hofft man, würde ein Buch des Deutschamerikaners Hans Rudolf Vaget, Professor an einem College in Massachusetts und ausgewiesener Kenner des Lebens und Schaffens Manns, etwas Klarheit bringen können. Dieses Buch befaßt sich mit den amerikanischen Jahren Manns, ist unlängst im S. Fischer Verlag erschienen und trägt den bezeichnenden Titel Thomas Mann, der Amerikaner. Ein detailreicher Blick in eine wenig bekannte Epoche Manns Der Autor beeindruckt im Buch mit einem Detailreichtum, der eine langjährige, akribische Arbeit erahnen läßt. In allen Einzelheiten schildert Vaget die Zeit und die Zeitgenossen Manns in den Vereinigten Staaten, so daß der Leser den Weg des Autors in seinem Exil bis ins einzelne nach verfolgen kann. Viele deutsche Leser Thomas Manns haben sich zunächst mit den Buddenbrooks und dem Zauberberg befaßt und haben auch Tonio Kröger und den Tod in Venedig gelesen. Alles Werke, die für den Deutschen Thomas Mann stehen. Die amerikanischen Jahre und die amerikanischen Verhältnisse jener Zeit sind oft weniger bis überhaupt nicht bekannt. Insoweit eröffnen sich durch das vorliegende Werk in großer Breite neue Aspekte auf einen Zeitraum, mit dem man sich bisher vielleicht kaum oder gar nicht eingelassen hatte. Leider erschöpft sich das Buch auch häufig in der Aneinanderreihung von Fakten und Ereignissen. Vaget ist stärker in der Schilderung der amerikanischen Protagonisten, etwa Franklin D. Roosevelts oder der Gönnerin Manns, Agnes Meyer. Thomas Mann selbst bleibt in den Schilderungen etwas blaß. Vor allem gelingt es Vaget nicht, den eigentlichen Grund für die Entwicklung Manns aus der Fülle der Details zu entwickeln. Die Verweise auf die Beschäftigung Manns mit den Dichtern Walt Whitman oder Joseph Conrad während der zwanziger Jahren, die eine erste tiefere Verknüpfung Manns zur anglo-amerikanischen Literatur entstehen ließ, mag biographisch interessant sein. Erhellend für die Amerikanisierung Manns sind sie nicht. Thomas Manns politischer Lagerwechsel wird nicht begründet Die Verwandlung Manns vom Verteidiger des deutschen Sonderwegs hin zu einem glühenden Anhänger des Sozialdemokraten Roosevelt bleibt dunkel. Denn gerade Roosevelt ist dem, was Mann noch 1918 für richtig hielt diametral entgegengesetzt. Roosevelt war ein Mann von ausgesprochener Deutschfeindlichkeit, der schon vor dem Krieg bedauerte, man habe es 1918/19 versäumt, den Deutschen den ihnen gebührenden Denkzettel zu verpassen. Im Gegensatz hierzu herrschte in der amerikanischen Öffentlichkeit überwiegend die Überzeugung vor, mit Versailles weit über das Ziel hinausgeschossen zu sein, und man blickte verschämt auf das Auseinanderklaffen des eigenen Anspruchs, mit dem man 1917 angetreten war, und dem Ergebnis der Friedensbedingungen. Roosevelt ging es – ähnlich wie Churchill – nicht nur um die Beseitigung Hitlers sondern um die Vernichtung Deutschlands als Subjekt der Geschichte. Thomas Mann erkannte dies und unterstützte Roosevelt trotzdem vorbehaltlos. Die Frage nach dem „warum“ scheint Vaget aber auch nicht besonders wichtig zu sein. Vaget ist selbst so durchdrungen von der Überzeugung der gerechten Sendung der Amerikaner. Und zwar der Amerikaner in ihrer Variante der demokratischen Partei und ihres Anspruchs auf eine Formung und Umgestaltung der Welt in ihrem Sinne. Eine Alternative, einen dritten Weg gleichsam, kann sich Vaget nicht ernsthaft vorstellen. Wiederholt schimmert so die eigene Vorliebe des Autors für die amerikanischen Demokraten von F. D. Roosevelt bis hin zu Obama durch. Zuweilen ist es schwer zu unterscheiden, wo die Wiedergabe der Gedanken Manns endet und eigene Ansichten des Autors in den Vordergrund rücken. Man hält den Autor zunächst für einen typischen Amerikaner, der trotz seiner ausgewiesenen Kenntnisse über Goethe, Mann und Nietzsche schlußendlich doch Amerikaner bleibt. Herbert Rosendorfer bemerkte in einem seiner Bücher, sowohl Sprache als auch Geschichte Deutschlands bliebe selbst dem intelligentesten Ausländer dem Grunde nach unbegreiflich. Aber Vaget ist Deutscher, im böhmischen Marienbad geboren. Gleichwohl scheint er sich derart amerikanisiert zu haben, wie dies auch beim späten Thomas Mann der Fall war. Da ihm selbst der Zugang zu dem fehlt, was Mann vor diesem Wandel ausmachte, kann er diesen Wandel auch nicht erklären. Jünger, Benn und Bergengruen: Das politische Exil war 1933 nicht der alleinige Weg So selbstverständlich, wie der Autor meint, war selbst 1933 der Weg nicht, den Thomas Mann genommen hatte. Zwar galt Mann seit etwa 1922, damals für viele überraschend, als Anhänger des parlamentarischen Parteienstaats, aber noch 1933 hätte ihn das Regime zumindest aus propagandistischen Zwecken mit offenen Armen begrüßt. Warum Mann nicht in der Schweiz blieb, sondern schlußendlich ein amerikanischer Linksliberaler mit noch dazu einem zuweilen pathologischen Haß auf Deutschland und die Deutschen wurde, bleibt nach der Lektüre dieses sehr umfangreichen Werkes komplett im Dunkeln. Man kann Thomas Mann nicht vorwerfen, die Möglichkeit eines deutschen Sonderwegs in der Moderne nicht erfaßt zu haben. Er sah dies und ging trotzdem den langen Weg nach Kaisersaschern. Thomas Mann bleibt in der Vielgestaltigkeit seiner Facetten und seiner Entwicklung ein Rätsel. Anders als viele konservativ-bürgerliche Deutsche, die der Ansicht waren, zunächst sollte der Krieg gewonnen werden, wie man danach Hitler loswerde, werde man dann schon sehen, wollte Thomas Mann zuletzt zwischen Hitler und Deutschland nicht mehr trennen. Warum wurde Thomas Mann zum Amerikaner? Eine letzte Antwort hierauf gibt auch das vorliegende Buch nicht und eine letzte Antwort kann hierauf vielleicht auch nicht gefunden werden. Hans R. Vaget: Thomas Mann, der Amerikaner. S. Fischer Verlag Frankfurt. Gebunden, 545 Seiten. 24,95 Euro |
00:10 Publié dans Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, thomas mann, livre, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 25 octobre 2011
Pierre Vial présente "Le loup-garou" d'Hermann Löns
Pierre Vial présente "Le loup-garou" d'Hermann Löns
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nouvelle droite, pierre vial, nouvelledroite, littérature, lettres, lettres allemandes, hermann löns, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 octobre 2011
Pierre Vial présente "Nouveaux Cathares pour Montségur" de Saint-Loup
00:13 Publié dans Littérature, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nouvelle droite, saint-loup, marc augier, pierre vial, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 16 octobre 2011
Identità umana e pregiudizio etnico ne «I viaggi di Gulliver» di Jonathan Swift

di Francesco Lamendola
Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]
Da quando è apparso nelle librerie di Londra, nel 1726, il capolavoro di quella mente satirica e paradossale che fu Jonathan Swift (in una sua opera minore, la «Modesta proposta», del 1729, aveva suggerito, con la impassibile seriosità dell’economista, che i bambini poveri venissero utilizzati come cibo per i ricchi), ossia «Gulliver’s travels», esso non ha finito di dar luogo ad equivoci e fraintendimenti.
Basti dire che, per anni ed anni, di esso, o piuttosto di una sua edizione ridotta e “normalizzata”, si è voluto fare un classico per la gioventù; cosa ancora più amaramente paradossale di quel che avrebbe potuto immaginare il suo stesso autore, dato che tutto si può pensare de «I viaggi di Gulliver», tranne che sia un romanzo adatto ai bambini.
Se bastasse il fatto che il protagonista, a un certo punto, capita nel paese di Lilliput, dove tutto, a cominciare dagli abitanti, è quindici volte più piccolo che nel nostro mondo; oppure che, nella sua successiva avventura, egli finisce nel paese di Brobdingnag, ove il rapporto delle grandezze è rovesciato a sfavore dell’uomo, e lo stesso protagonista finisce rinchiuso in gabbia come un canarino, per il trastullo della gigantesca figlia del re; se bastassero tali aspetti puramente esteriori, allora vorrebbe dire che noi attribuiamo ben poca importanza a ciò che diamo da leggere ai bambini, oppure che non abbiamo capito nulla della terribile serietà di questo libro.
Che cos’è che non passa attraverso la macina della satira impietosa di Swift, misantropo inguaribile e scatenato pessimista? Non si salva nessuno: i suoi strali colpiscono con infallibile cattiveria i filosofi, gli storici, gli inventori (e questo in piena ideologia del progresso, in pieno secolo dei Lumi!); l’avidità e la brutalità degli Europei, protesi alla conquista degli altri continenti (e ciò nel Paese europeo che più di tutti si stava impegnando in questa sedicente “missione di civiltà”, la Gran Bretagna, dopo aver ridotto alla disperazione i vicini Irlandesi); la sete degli uomini di vivere eternamente; il primordiale istinto di sopraffazione proprio della natura umana, che viene significativamente contrapposto alla olimpica saggezza e all’esplicito disprezzo ad essa riservato dai nobili cavalli parlanti.
Dal punto di vista filosofico, «I viaggi di Gulliver» sono una vera e propria miniera di spunti per la riflessione, almeno quanto lo sono altri classici ammirati sotto il profilo letterario, ma, di solito, poco considerati in questa prospettiva, quali la «Divina Commedia» di Dante, il «Don Chisciotte della Mancia» di Cervantes e i «Promessi Sposi» di Manzoni.
Una miniera addirittura inesauribile: al punto che, se volessimo non già trattare, ma anche solo sfiorare, le principali tematiche filosofiche sottese al romanzo di Swift, avremmo la necessità di riempire parecchi volumi; qui, pertanto, vogliamo limitarci a toccare uno solo di tali aspetti, vale a dire quello riguardante il problema dell’identità e del pregiudizio etnico.
Formidabile accusatore dell’etnocentrismo, Swift insiste continuamente, lungo tutta la sua opera, sulla estrema difficoltà, anzi, sulla radicale impossibilità di superare i pregiudizi culturali della propria civiltà, nel momento in cui ci si trova alle prese con una civiltà diversa, i cui presupposti materiali e spirituali siano totalmente differenti dai nostri e anche da quelli che potremmo teoricamente concepire.
È ovvio che, così impostata la questione, la soluzione non può consistere nel generico e velleitario cosmopolitismo illuminista, benché tanto decantato da Voltaire e dagli altri “philosophes” francesi, a cominciare da Montesquieu: come si fa ad essere cittadini del mondo, infatti, se risulta per noi insormontabile la barriera culturale entro la quale siamo nati e cresciuti e dall’interno della quale tendiamo a giudicare, con arbitraria sicumera, altri modi di essere, di sentire e di pensare, del tutto diversi ai nostri?
Più sensato, semmai, appare un atteggiamento di scettica tolleranza, simile a quello già mostrato da Montaigne e del quale abbiamo già avuto, a suo tempo, occasione di occuparci (cfr. il nostro articolo «Michel de Montaigne e il cannibale felice», apparso sul sito di Arianna Editrice in data 13/12/2007).
Ha scritto Gianni Celati nel suo saggio introduttivo a «I viaggi di Gulliver» di Jonathan Swift (Feltrinelli, Milano, 2004, pp. XV-XVI):
«Che si tratti di meschini lillipuziani o di magnanimi giganti o di cavalli virtuosi, le abitudini dei vari paesi dipendono sempre da una fissazione su certi assiomi, definizioni nominali, dogmi o giudizi a priori; e sono una cecità che impedisce di vere oltre i limiti di una cultura, anche dove si tratta di cose osservabili a occhio nudo. Non solo nei comportamenti, ma anche nelle percezioni e nei pensieri intimi, la natura umana sembra ineluttabilmente dipendente da condizionamenti ambientali. Per cui il passaggio da un regime di abitudini all’altro corrisponde sempre a un lavaggio del cervello; e Gulliver non fa che subire lavaggi del cervello passando da un paese all’atro e adeguandosi a sempre nuove situazioni.
Se tutti i comportamenti e i pensieri dipendono così strettamente da condizionamenti esterni, viene da chiedersi dove ci porti questa lezione di relativismo radicale. Come si chiede Patrick Reilly: “che ne è della vantata libertà della mente, l’inviolabile santuario dell’io”? Spesso è stato detto che Swift porge un orecchio all’uomo perché si riconosca. Ma guardiamo Gulliver, che sembra un automa in balia della relatività , alieno in tutti i paesi dove capita e anche nella sua amata Inghilterra: se lui è l’uomo in cui specchiarsi, l’uomo è l’alieno del mondo, che appena fuori casa diventa come Gulliver una specie di “freak” da baraccone, alla maniera dei selvaggi che erano esibiti per lo svago delle folle o dei potenti. Dal libro risulta che l’identità umana viene riconosciuta attraverso “leggi di Natura”; le quali però sono giudizi a priori, abitudini di pensiero per discriminare l’indigeno dall’estraneo. Ad esempio, nella prima parte Gulliver si trova subito a essere classificato dai dotti lillipuziani come un uomo caduto dalla luna, in base a supposte “leggi di Natura”; e per gli stessi motivi i dotti di Brobdingnag lo classificano come un embrione abortivo, poi uno scherzo di natura; e i matematici lapuziani lo disprezzano perché non ha le loro stesse attitudini demenziali; infine i cavali lo espellono dalla Houyhnhnmland perché lo considerano una bestia irrazionale. Sempre le “leggi di natura” servono a definire la differenza tra l’indigeno e l’estraneo, e hanno il risultato di esporre Gulliver a sanzioni, a condanne al rischio della vita, all’espulsione.
Inoltre va notato che la consistenza di questi giudizi a priori si fonda soprattutto sulla boria dei sapienti, sui luoghi comuni della cultura, e in nessun altro libro la scienza dei dotti viene così collegata alle forme universali dell’etnocentrismo. È questo che impedisce di riconoscere nell’alieno Gulliver un’identità umana;, facendone appunto un “freak”, uno scherzo di natura: perché, nella scienza dei dotti, i valori differenziali diventano modi del pregiudizio etnico che decide l’identità dell’individuo; sicché i luoghi comuni d’ogni cultura rappresentano i criteri ultimi per distinguere gli individui umani al resto delle creature sensitive.
Questa una lezione che Swift ha imparato da Montaigne, uno dei suoi grandi ispiratori; e il «Gulliver»» sviluppa la visione di Montaigne sulla relatività delle opinioni e abitudini e di tutti i popoli. Una battuta nella quarta parte riassume il pensiero che attraversa il nostro libro: “dov’è mai un essere vivente non trascinato da preconcetti e parzialità per la sua terra natia?”: Bisognerebbe citare i tratti del pregiudizio etnico negli omiciattoli di Lilliput come nei cavali della Houyhnhnmland : pensare alle idee dei capi lillipuziani di macellare o accecare il povero Gulliver, ricordare le proposte nell’assemblea dei cavalli di castrare gli Yahoo. Che si tratti dell’untuosa crudeltà dei lillipuziani, della crudeltà orientale del re di Luggnagg, di quella olimpica dei cavalli, o di quella degli europei impegnati in guerre e massacri coloniali, la cultura delle nazionalità sembra che debba sempre confermare le proprie abitudini ricorrendo a sistemi di crudeltà.
Ogni cultura risulta un modo violento di marchiare gli altri, di segnare i limiti tra noi e l’estraneo. Perché chi è fuori dai limiti d’una cultura, l’alieno, sembra appartenere alla natura brada come le bestie, dunque dovrà essere domato, marchiato o castrato come le bestie. Questo mi sembra il succo delle disavventure di Gulliver, e fa venire un mente un celebre passo di Montaigne: “Noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea degli usi e opinioni del nostro paese. […] Perciò gli altri diversi da noi sembrano selvaggi, allo stesso modo in cui chiamiamo selvatici i frutti che la natura ha prodotto nel suo naturale sviluppo” (“Essais”, libro I, cap. XXXI).»
Abbiamo detto che la constatazione della irrimediabile limitatezza e dell’insuperabile condizionamento degli individui da parte della società fa sì che Swift propenda per una visione relativistica e scettica della condizione umana.
La sua satira, che assume talora i toni di un feroce sarcasmo, non sa o non vuole individuare una”pars costruens” sulla quale far leva, in tanto pessimismo antropologico; egli è un formidabile distruttore, ma non si pone nemmeno il problema di come l’uomo possa tentare di uscire dal condizionamento cui sempre viene sottoposto, senza neppure rendersene conto.
Non si può dire che ne abbia l’obbligo: Swift non è un filosofo, ma uno scrittore; il fatto che abbia saputo vedere e criticare, dietro la vuota retorica del cosmopolitismo illuminista e del progresso illimitato, il vuoto presuntuoso di una cultura incapace anche solo di comprendere i limiti della sua stessa ideologia, sta a significare che il grande demistificatore era di parecchie lunghezze più avanti dei suoi contemporanei, senza però spingersi innanzi fino a raggiungere, o almeno a intravedere, un terreno solido su cui poggiare i piedi.
Proviamo, dunque, a riprendere il discorso là dove l’autore de «I viaggi di Gulliver» lo lascia in sospeso, e vediamo a quali conclusioni si possa arrivare.
Oggi che la globalizzazione sta rimescolando le culture, le riflessioni di Swift appaiono di particolare urgenza, perché è ovvio che una mescolanza culturale, realizzata in tempi brevissimi e con l’unico denominatore comune del profitto economico di pochi, non può che portare a incomprensioni, tensioni, conflitti.
Non ci sembra, però, che l’appartenenza a una determinata cultura debba connotarsi prevalentemente in senso negativo, come Swift sembra pensare: al contrario, l’identità culturale è un elemento essenziale al buon vivere, perché consente all’individuo di interagire positivamente con l’ambiente, di comprendere gli altri ed esserne compreso, di condividere con essi valori, strumenti di pensiero e sensibilità. Un individuo senza identità è come una pianta secca e senza radici; una cultura senza identità è, a sua volta, come un deserto pietrificato, dove ogni cosa diviene anonima e intercambiabile.
È chiaro che l’identità culturale, se si chiude su se stessa e degenera in esclusivismo intollerante, finisce per rendere un pessimo servizio all’individuo, espropriandolo della sua unicità e precludendogli la via di ogni possibile arricchimento spirituale; ma, fino a che questo non avviene e la società si limita ad offrire all’individuo dei saldi punti di riferimento e una rete di relazioni armoniose con l’altro, non solo non ne limita la creatività, ma gli offre un insostituibile punto d’appoggio, sul quale far leva e con il quale orientarsi.
Il problema è che, oggi, da un lato le culture tendono ad abdicare alla propria autonomia e a lasciarsi omologare in un generale appiattimento, ciò che produce un gravissimo impoverimento anche per il singolo individuo; dall’altro, tendono a svuotarsi dall’interno e a dimenticare le proprie radici, trasformandosi in quelle “società liquide” di cui parla Zygmunt Bauman, dominate dalla smania del cambiamento e caratterizzate dalla riduzione del cittadino a consumatore compulsivo di beni sempre più inutili, senza i quali, però, egli si sentirebbe povero ed escluso.
Il grande pericolo, perciò, al giorno d’oggi, non è tanto l’etnocentrismo, quanto l’anonimità e la degradazione delle culture, in nome di un “progresso” incontrollabile e di un tecnicismo esasperato che relegano sempre più l’individuo nel ruolo di semplice accessorio di un sistema efficiente, ma impersonale, dominato dalla sola dimensione economica.
E non ci sembra si possa dire che i pregiudizi dell’economia siano più accettabili di quelli di origine culturale: al fanatismo identitario si sostituisce il non meno temibile ricatto dello status economico-sociale.
Nel romanzo di Gulliver, “freak” è lo straniero in quanto diverso, ridotto a fenomeno da baraccone; nella società globalizzata contemporanea, ove imperano la tecnoscienza e le leggi del profitto, “freak” è colui che non può o non vuole consumare secondo le modalità totalitarie del consumismo imperante: chi, per esempio, si accontenta di essere fruitore di beni e servizi e non più di marchi, di firme, di simboli legati all’industria.
“Freak”, abnorme, è, oggi, colui che voglia essere se stesso e rifiutare le maschere dell’avere e dell’apparire: egli viene guardato con sospetto e disprezzo, proprio come i lillipuziani guardano Gulliver, così ingombrante nella sua diversità.
Ma tale diversità è un bene, non un male, sia per il singolo individuo, sia per la società intera.
Potrebbe una società permettersi di fare a meno di quel cinque per cento creativo, di quella piccola minoranza di persone che non si adeguano passivamente a tutte le mode e a tutti i pregiudizi, ma che coltivano in se stesse la preziosa, inestimabile pianticella dell’originalità, della consapevolezza, dell’apertura esistenziale?
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gulliver, jonathan swift, 18ème siècle, angleterre, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 octobre 2011
Céline, un génie des lettres, un enfant et un fou
 Par Amaury Watremez. A propos de la sortie en Folio d’une partie de la correspondance de Céline, les Lettres à la NRF, passionnantes.
Par Amaury Watremez. A propos de la sortie en Folio d’une partie de la correspondance de Céline, les Lettres à la NRF, passionnantes.Les Lettres à la NRF de Céline sont au fond comme un journal littéraire de ce dernier, et dans les considérations de ces deux misanthropes on perçoit des remarques qui se rejoignent très souvent sur eux, sur leur entourage, leur œuvre, le reste de l’humanité.
Ce que dit Céline dans sa correspondance sur la littérature, il le mettra en forme plus clairement encore dans les Entretiens avec le professeur Y en particulier. Céline écrit tout du long de sa vie littéraire qui se confond avec sa vie tout court car la littérature, n’en déplaise aux petits marquis réalistes, est un enjeu existentiel. Il écrit des lettres pleines de verve, parfois grossières, à la limite du trivial. Il y explique, en développant sur plusieurs courriers sa conception de l’écriture, basée sur le style. Il se moque de l’importance de l’histoire par l’écrivain (« des histoires, y’en a plein les journaux »), se moque des modes littéraires, n’est pas tendre avec ses amis, dont Marcel Aymé, dont il suggère l’édition sur papier toilettes ainsi que l’œuvre de Jean Genet, comme un gosse jaloux du succès de ses pairs, qui entend conserver toute l’attention sur lui.
Car il cultive les paradoxes, il est misanthrope mais a soif de gloire et de la reconnaissance la plus large possible des lecteurs.
Ses correspondants ne sont pas sans talent, ainsi Gaston Gallimard, son éditeur : on s’étonne encore du flair remarquable de celui-ci en matière d’édition, on chercherait vainement son équivalent de nos jours où domine à des rares exceptions le clientélisme, l’obséquiosité, le copinage entre « beaux messieurs coquins et belles dames catins » pour reprendre le terme de Maupassant dans sa correspondance. Ce qui montre d’ailleurs que ce copinage ne date pas d’hier, ce qui n’est pas une excuse vu les sommets himalayens qu’il atteint en ce moment dans les milieux littéraires en particulier, culturels, ou plutôt « cultureux » en général.
Céline comme Léautaud est un misanthrope littéraire exemplaire, ce que sont finalement la plupart des littérateurs de toute manière, qui se libèrent des blessures subies par eux à cause de l’humanité en écrivant, en ouvrant un passage vers des univers mentaux et imaginaires inexplorées. Mais l’écriture n’est pas qu’une catharsis, contrairement à ce que les auteurs d’auto-fiction voudraient nous laisser croire, eux qui font une analyse en noircissant des pages qui ont pour thème central l’importance de leur nombril.
La misanthropie en littérature est un thème couru, maintes fois traité et repris, souvent lié à la pose de l’auteur se présentant en dandy, en inadapté, en poète maudit incompris de tous.
C’est un sujet d’écriture au demeurant très galvaudé.
Parfois, l’auteur qui prend cette posture a les moyens de ses prétentions, de ses ambitions, et d’ailleurs la postérité a retenu son nom à juste titre, pour d’autres, c’est souvent assez ridicule voire grotesque. Les artistes incompris de pacotille, les rebelles de ce type sont des fauves de salon comparés aux écrivains qui refusent les mondanités, les dorures, et l’ordure. Ces fauves de salon ne sont pas méchants, ils sont émouvants à force d’évoquer Rimbaud ou Baudelaire pour tout et n’importe quoi, de manière aussi désordonné que l’adolescent post-pubère clame sa détestation de la famille pour mieux y coconner, et continuer à se vautrer ensuite dans un mode de vie bourgeois. Et après tout, Claudel qui se réclamait de Rimbaud, et qui était un grand bourgeois conservateur, était aussi un grand écrivain, les fauves de salon peuvent donc avoir encore quelque espoir que leur démarche ne soit pas totalement vaine.
C’est encore mieux quand le prétendu inadapté rebelle, artiste et créateur, est jeune, et vendu comme génie précoce pour faire vendre (ne surtout pas oublier la coiffure de « rebelle » avec mèche ou frange « ad hoc »).
Cette rentrée littéraire, on nous refait le coup avec Marien Defalvard dont le livre s’avère certes plutôt bien écrit, et certainement réécrit, mais sans personnalité, sans saveur, sans couleur, sans odeur.
Les personnages misanthropes les plus connus sont le capitaine Némo et Alceste, les plus intéressants, les plus remarquables aussi. Louis-Ferdinand Destouches alias Céline, semble être eux aussi de véritable misanthrope, détester ses semblables.
Au final, on songe plutôt à son encontre au mot de Jean Paulhan répondant à une lettre d’injures de Céline, ces misanthropes, ce sont à la fois des enfants, des fous, mais aussi des hommes de talent, des génies avides de gloire. Ils ont des blessures diverses, surtout à cause du monde, dont ils ressentent la sottise et la cruauté plus fortement que les autres. Ce sont finalement des blessures d’amour, en particulier pour Léautaud, mais aussi pour Céline, qui feint de haïr ses semblables mais qui veut à tout prix ou presque leur reconnaissance.
Céline fût fidèle à Lucette, toujours discrète, toujours présente, consolatrice, fluette et solide, qui avait son atelier de danse au-dessus du cabinet de l’écrivain à Drancy, l’exception peut-être de quelques « professionnelles » de Bastoche, ce qu’évoque Claude Dubois dans son ouvrage sur La Bastoche : Une histoire du Paris populaire et criminel dont l’auteur de ses lignes a déjà parlé sur Agoravox.fr. Derrière les pétarades de l’auteur du Voyage on distingue aussi un grand pudique goûtant la présence discrète de sa femme attentionnée.
Ces deux auteurs comme beaucoup de natures très sensibles sont dans l’incapacité au compromis sentimental, amical, à l’amour mesuré, raisonnable, sage, et finalement un rien étriqué. Il est difficile de leur demander de rentrer dans un cadre ce dont ils sont incapables.
Sur ce point là, Céline est aussi un enfant comme Léautaud, on sent dans ses amitiés, à travers ses lettres à Roger Nimier, Denoèl ou Gaston Gallimard, cette recherche de la perfection et d’une amitié sans réelle réciprocité où c’est l’ami qui couve, qui prend les coups, les responsabilités à la place, et à qui l’on peut reprocher la brutalité et la sottise du monde extérieur, du monde des adultes où ils ne sont jamais au fond rentrés en demeurant des spectateurs dégoûtés par ce qu’ils y voient.
Sa misanthropie est aussi sa faiblesse, mais comme du charbon naissent parfois quelques diamants, de celle-ci naît le génie particulier de son œuvre littéraire. Cette hyper-émotivité du style que l’on trouve surtout chez Céline, ce chuchotement fébrile et passionné.
Amaury WATREMEZ
Agorafox.fr, 26/09/2011.
> Mes terres saintes, le blog d'Amaury Watremez.
00:10 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, livre, lettres, littérature, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 14 octobre 2011
Le Bulletin célinien n°334 - octobre 2011
 Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°334.
Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°334.
Au sommaire :
Marc Laudelout : Bloc-notes
M. L. : In memoriam Paul Yonnet (1948-2011)
Nos amis écrivent…
M. L. : Henri Guillemin, admirateur de Céline
Henri Guillemin : « Drôle de Céline ! » [1938]
Robert Le Blanc : Céline et Mahé
Pierre de Bonneville : Villon et Céline [3]
Frédéric Saenen : Céline sans contredit
François Marchetti : In memoriam Johannes C. Johansen
Un numéro de 24 pages, 6 € franco.
Le Bulletin célinien, B. P. 70, Gare centrale, BE 1000 Bruxelles.
Si Céline n’était pas croyant, il était surtout très hostile à l’Église catholique. La manifestation la plus éclatante figure dans Les Beaux draps : « La religion catholique fut à travers toute notre histoire, la grande proxénète, la grande métisseuse des races nobles, la grande procureuse aux pourris (avec tous les saints sacrements), l’enragée contaminatrice ». Et de déplorer que « l’aryen n’a jamais su aimer, aduler que le dieu des autres, jamais eu de religion propre, de religion blanche ». C’est aussi l’époque où il reproche vivement à la presse doriotiste d’avoir censuré une lettre qu’il adressa au chef du PPF, le passage caviardé visant précisément « l’Église, notre grande métisseuse, la maquerelle criminelle en chef, l’anti-raciste par excellence ».
Ces attaques virulentes datent de la période noire. Peu de temps avant, Charles Lacotte lui avait adressé son roman, Nicias le Pythagoricien (sous-titré « Comment les Juifs font sauter les empires »), avec cette dédicace bien sentie : « À l’effrayant Louis-Ferdinand Céline, homme d’effroyable vérité » (1). Un bilan exhaustif des nombreuses lectures du pamphlétaire dans ce domaine est impossible. On en connaît en tout cas un certain nombre, dont celles qu’il cite lui-même au début de L’École des cadavres (2).
Jusqu’à la fin, Céline n’abjura en rien ses convictions. Ainsi, dans un entretien accordé un an avant sa mort à Robert Stromberg, il constate que « l’homme blanc est une chose du passé » et qu’il « a laissé l’Église le corrompre » (3). Dans son œuvre romanesque d’après-guerre, on trouve ainsi de nombreuses allusions au déclin biologique de l’homme blanc et au manque de volonté qui fut le sien de demeurer maître de son destin. C’est la raison pour laquelle il est vain, une fois encore, de faire une distinction entre le romancier et le pamphlétaire, les écrits de fiction et les écrits de combat. On ne le répètera jamais assez : l’œuvre de Céline forme un tout. Et s’il est politiquement incorrect dans les textes interdits de réédition, il l’est tout autant sur papier bible (4).
Marc LAUDELOUT
1. Exemplaire proposé dans le catalogue de la Librairie ancienne Bruno Sepulchre. Ce « roman judéo-christien du Ier siècle » parut en 1939. Professeur révoqué pour raisons politiques, Charles Lacotte se lança dans le combat et le journalisme politique à la fin du XIXème siècle. Il publia diverses brochures, dont Nos seigneurs républicains (1909), et un pamphlet Les Guêpes, qui parut très irrégulièrement de 1906 à 1939. Député socialiste de l’Aube de 1919 à 1924, il devint délégué à la propagande du PPF pour ce département sous l’Occupation. Assassiné d’une balle dans la nuque le 31 août 1943.
2. Citons à ce propos Où va l’Église ? (1938) de Henry-Robert Petit. Céline estima cet opuscule « très remarquable » et en distribua plusieurs exemplaires autour de lui. Son auteur est d’ailleurs cité dans L’École des cadavres parmi d’autres dont Henry Coston. Celui-ci confia à Emmanuel Ratier avoir procuré une documentation à Céline pour la rédaction de ce pamphlet (cf. l’émission radiophonique « Le Libre Journal de Serge de Beketch » [2001] en hommage à Coston à la suite de son décès. Voir aussi « Lettres à Henri-Robert Petit (1938-1942) » in L’Année Céline 1994, Du Lérot-Imec Éditions, pp. 67-90.
3. Robert Stromberg, « A Talk with L.-F. Céline », Evergreen Review [New York], vol. V, n° 19, July-August 1961. Traduction française dans Céline et l’actualité littéraire, 1957-1961, Les Cahiers de la nrf (Cahiers Céline 2), 1993, pp. 172-177.
4. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, une phrase comme « Moi qui suis extrêmement raciste... » ne figure pas dans les pamphlets mais bien dans D’un château l’autre (Pléiade, p. 161).
00:11 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, céline, littérature, lettrees, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Il Dio di Ezra Pound
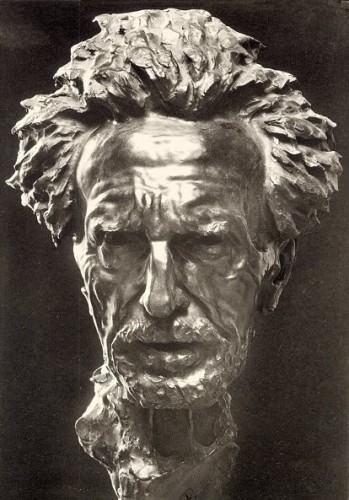
di Luca Leonello Rimbotti
Fonte: mirorenzaglia [scheda fonte]
 Il contraltare di Evola, dal punto di vista di una lettura “pagana” del Fascismo, fu certamente Ezra Pound. Se il primo del regime mussoliniano intese fare un risultato moderno delle virtù guerriere ario-romane, un’epifania della potenza, il secondo ne scorse i connotati di religione agreste, la cui continuità sarebbe stata garantita – più che non ostacolata – da forme di cristianesimo non dogmatiche, legate alle credenze arcaiche relative alla sacralità della terra. Se Evola vide nel movimento dei fasci una rinascenza del fato di gloria, qualcosa dunque di “uranico”, Pound rimase colpito invece dalla natura tellurica, diremmo quasi Blut-und-Boden, del comunitarismo fascista del suolo e del seme. Il significato è comunque, nei due casi, quello di una continuità ininterrotta, ben rappresentata dal particolare tipo di imperialismo veicolato dal Fascismo, tutto incentrato sull’idea di redenzione del suolo, di lavoro dei campi, di civilizzazione attraverso la coltivazione e la valorizzazione della terra.
Il contraltare di Evola, dal punto di vista di una lettura “pagana” del Fascismo, fu certamente Ezra Pound. Se il primo del regime mussoliniano intese fare un risultato moderno delle virtù guerriere ario-romane, un’epifania della potenza, il secondo ne scorse i connotati di religione agreste, la cui continuità sarebbe stata garantita – più che non ostacolata – da forme di cristianesimo non dogmatiche, legate alle credenze arcaiche relative alla sacralità della terra. Se Evola vide nel movimento dei fasci una rinascenza del fato di gloria, qualcosa dunque di “uranico”, Pound rimase colpito invece dalla natura tellurica, diremmo quasi Blut-und-Boden, del comunitarismo fascista del suolo e del seme. Il significato è comunque, nei due casi, quello di una continuità ininterrotta, ben rappresentata dal particolare tipo di imperialismo veicolato dal Fascismo, tutto incentrato sull’idea di redenzione del suolo, di lavoro dei campi, di civilizzazione attraverso la coltivazione e la valorizzazione della terra.
Ezra Pound è stato probabilmente il maggiore e più profondo cesellatore del ruralismo fascista, che giudicò elemento direttamente proveniente dagli arcaici riti latini legati alla fertilità e ai cicli di natura. La “battaglia del grano”, l’impresa delle bonifiche, la celebrazione del pane quale simbolo di vita santificato dalla fatica quotidiana, non sarebbero stati, per il poeta americano, che altrettanti momenti in cui gli antichi misteri pagani tornavano a parlare al popolo, e sotto la sollecitazione ideologica di un regime che fu allo stesso tempo quanto mai attento alla modernità. E che registrò il passaggio dell’Italia a nazione più industriale che agricola, con un numero di operai che per la prima volta nel 1937 superò quello dei contadini.
Questo doppio registro, tipico del Fascismo, di portare avanti insieme i due comparti, senza deprimerne uno a vantaggio dell’altro, questa simmetrica capacità di operare lo sviluppo industriale e quello agricolo, iniettando la modernizzazione nelle tecniche di coltura ma rinforzando l’attaccamento atavico al suolo, fu la formula adottata da Mussolini per promuovere il progresso senza intaccare – ma anzi rinsaldandolo – il patrimonio immaginale legato alla terra, e per di più abbinandolo ad un reale incremento della capacità produttiva, affidata alla scelta autarchica. Della terra, con costante perseveranza, si celebrò la sacralità, facendo del suolo patrio, quello da cui il popolo ricava la fonte di vita, una vera e propria religione di massa. Questa religione popolare fascista, riscoperta intatta dall’antichità e dotata di moderne applicazioni anti-utilitariste ed anti-speculative, ebbe in Pound un cantore geniale.
La recente uscita del libro di Andrea Colombo Il Dio di Ezra Pound. Cattolicesimo e religioni del mistero (Edizioni Ares) ce ne fornisce un nuovo attestato. In questo agile ma importante lavoro noi riscopriamo tutta la profondità di una concezione del mondo incentrata su ciò che Pound definitiva “economia sacra”. Come già fatto da Caterina Ricciardi nel 1991, nella sua antologia di scritti giornalistici di Pound, anche Colombo sottolinea questa impostazione del poeta che, forte della sua recisa ostilità al mondo liberista del profitto finanziario e nemico giurato dell’usura, vide nella sana e naturale economia fascista un preciso riverbero di ancestrali tendenze sacrali. In una serie di articoli pubblicati sul settimanale “Il Meridiano di Roma” fra il 1939 e il 1943, Pound andò indagando le origini italiche, perlustrandone la vena religiosa relativa ai misteri e ai riti di fertilità. In tal modo, «Roma è Venere, l’antica dea dell’amore che ritorna a restituire il sogno pagano agli uomini», realizzando il contatto vivente fra l’antichità e il presente moderno: «E Mussolini, il Duce della bonifica e della battaglia del grano, diventa per il poeta il riesumatore dell’antica cultura agraria, la religione fondata sul mistero sacro del grano, mistero di fertilità».
Entro questi grandi spazi ideologici di rinascita moderna delle logiche arcaiche, Pound ingaggiò la sua personale lotta contro quel mondo di speculatori, affaristi privi di scrupoli e autentici criminali da lui individuato nei governanti angloamericani, che in nome dell’usura finanziaria e dell’idolatria dell’oro non avevano esitato a scatenare contro i popoli a economia organica la più distruttiva delle guerre. Proveniente per nascita egli stesso dal pericoloso milieu presbiteriano, come Colombo ricorda, Pound ben presto se ne distaccò, avvicinandosi ad una interpretazione del cristianesimo come continuità pagana sotto specie devozionale ai santi locali, alle varie Madonne, alle processioni popolari d’impronta rurale. Convinto – e a ragione – di una netta presenza neoplatonica nella stessa teologia cattolica, Pound finì col considerare la religione di Cristo come una forma neopagana di accettazione del mistero della vita. Egli contestava alla radice la filiazione del cristianesimo dall’ebraismo, affermando che invece ciò che si doveva stabilirne era la continuità con l’ellenismo e con il politeismo in auge nell’Impero romano, al cui interno il cristianesimo poté inserirsi senza traumi particolari, in virtù della sua sostanza di religione dapprima solare, erede del mitraismo, poi anche tellurica, erede delle venerande liturgie agresti.
Pound conobbe gli scritti di Frazer e di Zielinski, allora famosi, ma noi possiamo aggiungere che questa lettura poundiana, tutt’altro che peregrina, ha trovato conferma in molti studiosi di religione anche molto importanti, da Cumont a Wind, da Seznec fino a Wartburg: il cristianesimo, ed ivi compreso talora anche il papato, veicolavano sostanziose dosi di neoplatonismo pagano. L’interesse di Pound per figure come Gemisto Pletone o Sigismondo Malatesta – esemplari del neopaganesimo rinascimentale – furono il lato filosofico di un mondo ammirato profondamente da Pound, quello dell’etica economica medievale e proto-moderna, coi suoi fustigatori dell’interesse e della speculazione: un San Bernardino, ad esempio, che combatté tutta la vita l’usura, in forme anche violente e non meno anticipatrici di certi argomenti moderni.
Pound nel paganesimo, e di nuovo nel cristianesimo francescano (notoriamente di ispirazione neoplatonica), vide l’antefatto di quella guerra aperta alla schiavitù dell’interesse che solo con il Fascismo, e con la sua ideologia corporativa del “giusto prezzo”, divenne movimento mondiale di lotta al disumano profitto liberista. Il prezzo della merce, quando stabilito dalla mano pubblica, dà garanzie di giustizia, è regolato dal potere politico, ha veste legale, è insomma pretium justum; quando invece è affidato al gioco incontrollato degli interessi privati, come accade nelle economie liberiste, fornisce l’evidenza di una guerra belluina fra speculatori, a tutto danno del popolo e del suo lavoro.
Questi concetti Pound li martellò in scritti e discorsi alla radio italiana durante la guerra, e sono massicciamente presenti anche nei Cantos. E questo gli costò, come noto, l’infamia della gabbia e del manicomio, cui lo destinarono i “democratici” vincitori. Questa di Pound fu una battaglia a difesa del lavoro onesto contro la bolgia degli speculatori. A difesa della sacralità dell’economia – che è lavoro del popolo – e contro quanti al denaro attribuiscono un demoniaco potere assoluto.
Pound era in prima fila, non faceva l’intellettuale ben ripagato e ben protetto, magari pronto a cambiare bandiera al primo vento contrario. Propagandava idee, lanciava fulmini e saette contro l’ingiustizia sociale e la speculazione, come un moderno Bernardino da Feltre ci metteva la faccia del predicatore intransigente e la parola infiammata del profeta che vede prossimo l’abisso. La sua condanna dell’usura e dell’usuraio ebbe aspetti di radicalismo medievale in piena guerra mondiale.
Quest’uomo vero fu pronto a pagare di persona, senza mai rinnegare una sola parola. Si esponeva senza remore. E parlava chiaro e forte. Come ad esempio in quella lettera – riportata da Colombo – indirizzata a don Calcagno (il sacerdote eresiarca fondatore di “Crociata Italica” durante la RSI e vicino a Farinacci) nell’ottobre 1944, in cui si scagliò contro la doppiezza vaticana di Pio XII: «Credete che un figlio d’usuraio, venduto e stipendiato, o indebitato agli ebrei sia la persona più adatta a “portare le anime a Cristo”? La Chiesa una volta condannava l’usura».
Ezra Pound non era un sognatore fuori dal mondo, e nemmeno un visionario ingenuo, come hanno cercato di farlo passare certi suoi non richiesti ammiratori antifascisti. Era un perfetto lettore della realtà e un geniale interprete dell’epoca in cui visse. Ebbe chiarissima davanti a sé l’entità della prova che si stava svolgendo con la Seconda guerra mondiale. Comprese come pochi che quella era la lotta decisiva fra l’usuraio e il contadino, e che difficilmente per il vinto ci sarebbe stata una rivincita. Quando la guerra piegò verso il trionfo degli usurai – allorché, come scrisse, «i fasci del littore sono spezzati» – partecipò fino in fondo all’esperienza tragica della Repubblica Sociale, consapevole di vivere, come dice Colombo, «l’età apocalittica della fine».
L’uomo europeo deve molto a Pound. Gli deve una grande passione ideale e una formidabile attrezzatura ideologica, che è grande poesia e a volte anche grande prosa. Proprio mentre l’usura universale sta facendo a pezzi un popolo dietro l’altro, proprio mentre infuria la volontà di scannare i popoli per arricchire piccole oligarchie di speculatori apolidi, quella di Pound appare come una gigantesca opera di profezia e di riscatto.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, théologie, tradition, philosophie, littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 12 octobre 2011
This Difficult Individual Eustace Mullins—& the Remarkable Ezra Pound
This Difficult Individual Eustace Mullins—& the Remarkable Ezra Pound
By Beatrice Mott
Ex: http://www.toqonline.com/

Eustace Mullins
Earlier this year my friend Eustace Mullins passed away. He had been ailing for some time — at least since I first met him in 2006. Hopefully he is in a better place now.
Mr. Mullins made a huge mark on the nationalist community here in the United States, but also has a following in Europe and Japan. For those who have not read his books, Mr. Mullins attempted to expose the criminal syndicates that manipulate governments and the international financial system.
But Mr. Mullins’ most sparkling claim to fame was his partnership with Ezra Pound in order to write Secrets of the Federal Reserve — probably the most well-known exposé of how our government really works.
But nobody’s life is all sunshine and light. While Mr. Mullins’ work is among the most famous in the nationalist community, it is also some of the worst researched. He often fails to reference where he uncovered the material in his books. While Mr. Mullins was very perceptive of historical trends, his insights were sometimes overshadowed by unbalanced statements.
Authors wishing to quote Eustace’s books in their own writing make themselves an easy target for reasonable critics or hate organizations like the ADL. In this way, Mr. Mullins has done more harm to the movement than good.
I learned this the long way. Having read Secrets, I drove down to Staunton, VA in the summer of 2006 and spent an afternoon talking with Mr. Mullins. My goal was to find the origin of several stories and statements which I could not reference from the text. Mr. Mullins was an elderly gentleman and he couldn’t remember where he had found any of the material I was interested in. He simply replied: “It’s all in the Library of Congress. Back then they would let me wander the stacks.”
So I moved to D.C., a few blocks from the library and spent the better part of two years trying to retrace Mr. Mullins’ footsteps. Prior to this I had had several years’ experience as a researcher and was used to trying to find the proverbial “needle in a haystack.” They wouldn’t let me wander around the book storage facility (the stacks), but I scoured the catalog for anything that might contain the source for Mr. Mullins’ statements. I couldn’t verify any of the information in question.
Sadly, I realized that it would never be good practice to quote Mr. Mullins. But I hadn’t wasted the time. I know more about the Federal Reserve now than most people who work there and I learned about the fantastic Mr. Pound.
Ezra Pound is among the most remarkable men of the last 120 years. He made his name as a poet and guided W. B. Yeats, T.S. Elliot and E. Hemingway on their way to the Noble Prize (back when it meant something). He is the most brilliant founder of Modernism — a movement which sought to create art in a more precise and succinct form. Modernism can be seen as a natural reaction to the florid, heavy Victorian sensibility — it is not the meaningless abstractions we are assaulted with today.
Born in Idaho, Pound left the United States for Europe in 1908. In London he found an audience of educated people who appreciated his poetry. He married Dorothy Shakespear, a descendant of the playwright. Pound also befriended some of the most brilliant artists of the time and watched them butchered in the First World War.
Henri Gaudier-Brzeska [1], a sculptor and one of Ezra’s best friends, was one of these sacrifices. The Great War changed Pound’s outlook on life — no longer content with his artistic endeavors alone, he wanted to find out why that war happened.
 The answer he got bought him 12 years as a political prisoner in St. Elizabeth’s Hospital in Anacostia, just across the river from the Capitol in Washington D.C. Pound was never put on trial but was branded a traitor by the post-war American media.
The answer he got bought him 12 years as a political prisoner in St. Elizabeth’s Hospital in Anacostia, just across the river from the Capitol in Washington D.C. Pound was never put on trial but was branded a traitor by the post-war American media.
What answer did Pound find? Our wars begin and end at the instigation of the international financial houses. The bankers make money on fighting and rebuilding by controlling credit. They colonize nations and have no loyalty to their host countries’ youth or culture. No sacrifice is too great for their profit.
Much of Pound’s work chronicles the effect of this parasitic financial class on societies: from ancient China to modern-day Europe. Pound was a polyglot and scoured numerous (well-documented) sources for historical background. The education that Mullins’ work promises is delivered by the truckload in Pound’s writing. Pound often lists his sources at the end of his work — and they always check out.
Eustace Mullins got to know Pound during the poet’s time as a political prisoner. He was introduced to Pound by an art professor from Washington’s Institute of Contemporary Arts which, in Mullins’ words, “housed the sad remnants of the ‘avant-garde‘ in America.”
According to Mr. Mullins, Pound took to him and commissioned Eustace to carry on his work investigating the international financial system. Pound gave Eustace an American dollar bill and asked him to find out what “Federal Reserve” printed across its top meant. Secrets, many derivative books, and thousands of conspiracy websites have sprung from that federal reserve note.
And here is where the story goes sour. Pound was a feared political prisoner incarcerated because of what he said in Italy about America’s involvement with the international bankers and warmongering. Pound was watched twenty four hours a day and was under the supervision of Dr. Winfred Overholser, the superintendent of the hospital.
Overholser was employed by the Office of Strategic Services (the CIA’s forerunner) to test drugs for the personality-profiling program, what would be called MK-ULTRA. (See John Marks’ The Search for “the Manchurian Candidate”: The CIA and Mind-Control [2].) Personality profiling was St. Elizabeth’s bread and butter: The asylum was a natural ally to the agency.
Overholser was also a distinguished professor in the Psychiatry and Behavioral Sciences Department of George Washington University. This department provided students as test patients for the Frankfurt Schools’ personality profiling work, which the CIA was very interested in. Prophets of Deceit, first written by Leo Löwenthal [3] and Norbert Guterman in 1948, reads like a clumsy smear against Pound.
It does seem odd that a nationalist student would be allowed to continue the work of the dangerously brilliant Pound right under Winny’s nose. The story gets even stranger, as Mr. Mullins describes his stay in Washington during this time. He was housed at the Library of Congress — apparently he lived in one of the disused rooms in the Jefferson building and became good friends with Elizabeth Bishop [4].
Bishop was the Library of Congress’ “Consultant in Poetry” — quite a plum position. She was also identified by Frances Stonor Saunders as working with Nicolas Nabokov in Rio de Janeiro. Nabokov was paid by the CIA to handle South American-focused anti-Stalinist writers. (See The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters [5].) If what Saunders says is true, then it puts Eustace in strange company at that time of his life.
According to the CIA’s in-house historians, the Library was also a central focus for intelligence gathering [6] after the war, so it is doubly unlikely that just anybody would be allowed to poke around there after hours.
Whatever the motivation for letting Mullins in to see Pound was, the result has been that confusion, misinformation and unverifiable literature have clouded Pound’s message about the financial industry’s role in war. Fortunately Pound did plenty of his own writing.
According to Eustace, his relations with Pound’s relatives were strained after Pound’s release from prison. Pound moved back to Italy where he died in 1972. He was never the same after his stay with Overholser in St. E’s. The St. Elizabeth’s building is slated to become the new headquarters of the Department for Homeland Security [7].
Eustace went on to write many, many books about the abuses of government, big business and organized religion. They are very entertaining and are often insightful, but are arsenic from a researcher’s point of view. A book that contains interesting information without saying where the information came from is worse than no book at all.
While lackadaisical about references in his own writing, Mr. Mullins could be extremely perceptive and critical of the writing of others. I once told him how much respect I had for George Orwell’s daring to write 1984 — to which he sharply replied: “It’s a great piece of pro-government propaganda — they win in the end.” Mr. Mullins is of course right: Orwell’s Big Brother is always one step ahead, almost omniscient — and therefore invincible.
Eustace Mullins was much more than a writer. He became a political activist and befriended many prominent people in the American nationalist movement. But Mr. Mullins didn’t have much faith in American nationalism: It is a movement, he told me, that the government would never let go anywhere.
The Occidental Observer [8], March 20, 2010
00:05 Publié dans Economie, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, ezra pound, littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine, usure, usurocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 10 octobre 2011
Ignatius Royston Dunnachie Campbell: A Commemoration
Ignatius Royston Dunnachie Campbell:
A Commemoration
By Kensall Green
Ex: http://www.counter-currents.com/
So much fine writing already exists here concerning Roy Campbell (October 2, 1901–April 22, 1957) that it would be hardly fair to Counter-Currents’ previous Campbell biographers to repeat—my own rephrasing notwithstanding—this poet’s life story once again. Let it simply stand that October 2, 2011 is Roy Campbell’s 110th birthday, and we remember him as poet, as a man of action, and as a heroic defender of the faith.
It is a mighty testament to his talent that his work and life are commemorated still, considering how much suppression his poetry — and therefore his very existence as a poet and hero — were subject to by the intellectual cabal of his day, and all the days since. He died, neck broken in an auto accident in Portugal, April 1957.
The following poems of Campbell both appeared in Sir Oswald Mosley’s BUF Quarterly magazine, published sometime between 1936 and 1940.
The Alcazar*
By Roy Campbell
The Rock of Faith, the thunder-blasted—
Eternity will hear it rise
With those who (Hell itself outlasted)
Will lift it with them to the skies!
‘Till whispered through the depths of Hell
The censored Miracle be known,
And flabbergasted fiends re-tell
How fiercer tortures than their own
By living faith were overthrown;
How mortals, thinned to ghastly pallor,
Gangrened and rotting to the bone,
With winged souls of Christian valour
Beyond Olympus or Valhalla
Can heave ten million tons of stone!
*In the summer of 1936, during the early part of the Spanish Civil War [2], Colonel José Moscardó Ituarte [3], and Spanish Nationalist Forces in support of General Franco, held a massive stone fortress, The Alcazar, against overwhelming Spanish Republican [4] forces. Despite being under continual bombardment, day and night, Col Moscardo and the Nationalists (reportedly nearly 1000 people—more than half of which were women) held out for two months.
The Fight
By Roy Campbell
One silver-white and one of scarlet hue,
Storm-hornets humming in the wind of death,
Two aeroplanes were fighting in the blue
Above our town; and if I held my breath,
It was because my youth was in the Red
While in the White an unknown pilot flew—
And that the White had risen overhead.
From time to time the crackle of a gun
Far into flawless ether faintly railed,
And now, mosquito-thin, into the Sun,
And now like mating dragonflies they sailed:
And, when like eagles near the earth they drove,
The Red, still losing what the White had won,
The harder for each lost advantage strove.
So lovely lay the land—the towers and trees
Taking the seaward counsel of the stream:
The city seemed, above the far-off seas,
The crest and turret of a Jacob’s dream,
And those two gun-birds in their frantic spire
At death-grips for its ultimate regime—
Less to be whirled by anger than desire.
‘Till (Glory!) from his chrysalis of steel
The Red flung wide the fatal fans of fire:
I saw the long flames, ribboning, unreel,
And slow bitumen trawling from his pyre,
I knew the ecstasy, the fearful throes,
And the white phoenix from his scarlet sire,
As silver the Solitude he rose.
The towers and trees were lifted hymns of praise,
The city was a prayer, the land a nun:
The noonday azure strumming all his rays
Sang that a famous battle had been won,
As signing his white Cross, the very Sun,
The Solar Christ and captain of my days
Zoomed to the zenith; and his will was done.
Roy Campbell. Poet, hero, comrade. You are commended and celebrated. Your talent shall not fade, nor shall your works grow old, age shall not bury you, nor every future time condemn.[1] Happy birthday.
Note
1. Paraphrase of Laurence Binyon’s “For The Fallen,” as quoted by Paul Fussell, The Great War and Modern Memory (New York: Oxford University Press, 1977), p. 56.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
00:10 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, littérature, littérature anglaise, lettres, lettres anglaises, espagne, guerre civile espagnole, guerre d'espagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 05 octobre 2011
Emil Cioran - Un siècle d'écrivains (1999)
Emil Cioran - Un siècle d'écrivains (1999)
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, france, roumanie, emil cioran, littérature, littérature française, littérature roumaine, lettres, lettres françaises, littérature française, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 04 octobre 2011
Evgueni Zamiatine
Evgueni Zamiatine
Ex: http://www.centrostudilaruna.it/
On ne doit pas oublier Zamiatine, si étrange et parfois déplaisant soit le personnage, car il est peu d’écrivains «soviétiques» aussi étonnants, totalement inclassable au temps du tsar, de la révolution et de l’exil, solitaire entre les solitaires.
Evgueni Ivanovitch Zamiatine est né le 20 janvier 1884 à Lebedian, dans la province de Tambov. Son père est un pope de l’Eglise de l’Intercession de la Vierge et sa mère une pianiste, elle-même fille de prêtre. Après ses études au lycée de Voronej, il prépare l’Institut polytechnique de Saint-Petersbourg. Mais ses idées avancées lors de la révolution de 1905 lui valent séjours en prison, assignations à résidence et même deux ans de déportation dans une bourgade du golfe de Finlande.
Malgré tous ces aléas révolutionnaires, il devient, à 24 ans, ingénieur des constructions navales, songe à une carrière littéraire et épouse une étudiante en médecine. Il a déjà écrit une évocation de sa vie carcérale: Seul, ainsi qu’un récit prometteur, Province, d’un ton elliptique très personnel.
Bénéficiant d’une amnistie il regagne Saint-Petersbourg, où il publie dans un journal, en mars 1914, une longue nouvelle, Au diable vauvert, qui vient d’être traduite en français. Le sujet fait scandale tant il dénonce les turpitudes d’une poignée d’officiers russes en garnison dans un poste perdu d’Extrême-Orient, sur les bords de l’océan Pacifique. Jugé antimilitariste et même pornographique, le livre est interdit par la censure et son auteur, âgé maintenant d’une trentaine d’années, est à nouveau déporté, cette fois à Kemi, en Carélie, dans le Grand Nord.
Au diable vauvert. Le titre indique que l’action se déroule loin, très loin, dans quelque garnison perdue. Un jeune officier, Andreï Ivanytch, originaire de Tambov, comme Zamiatine, a l’impression d’arriver au bout du monde. Il fait peu à peu connaissance de ses camarades, après une visite à son général, cuisinier à ses heures. Tous sont d’assez tristes personnages: paillards, ivrognes, tricheurs, brutaux, voleurs même, puisque telle la seule loi de cet univers corrompu, rongé jusqu’à l’os par tous les vices.
La femme du capitaine Netchessa accouche de son neuvième enfant et la grande question qui se pose est de savoir
qui en est le père, puisqu’il s’agit à chaque fois d’un officier différent. Cette interrogation lancinante n’empêchera pas un baptême fort arrosé. Bagarres, duels, suicides semblent les seules distractions de ces soldats perdus, pour qui la visite d’une escadre de marins français deviendra le seul dérivatif: nous sommes à la belle époque de l’alliance franco-russe. Quelques figures de femmes, comme la belle Maroussia, l’épouse de l’ignoble capitaine Schmidt, n’apportent même pas une note de joie dans cet univers désespéré.
On comprend la hargne de la censure tsariste, d’autant que n’importe qui serait désarçonné par le style d’un Zamiatine qui, sous prétexte de réalisme, bouscule allégrement la langue russe et la simple logique. Comme doit l’avouer le traducteur Jean-Baptiste Godon dans sa préface à l’édition française: «On rencontre de nombreux archaïsmes, des régionalismes, des proverbes, des néologismes… et les formules intempestives du langage parlé succèdent aux longues phrases ciselées: l’ordre des mots est bouleversé, les phrases sont tronquées, les pensées et dialogues, inachevés, interrompus par des points de suspension, des tirets. Zamiatine n’écrit pas, il narre…» On plaint le traducteur. Et encore bien davantage le lecteur.
Zamiatine n’est pas seulement un écrivain, c’est un ingénieur qui a beaucoup voyagé, de Constantinople à Salonique et de Beyrouth à Port-Saïd. Pendant la guerre, il sera envoyé en Angleterre pour y construire des navires brise-glaces. Il revient en Russie en 1917, juste pour la Révolution, dont il est un partisan résolu avant d’en être assez vite saturé et déçu.
Il se réfugie dans des récits brefs et des pièces de théâtre comme La Puce, qui sera par la suite interdite. Son roman Nous autres, impubliable en Russie communiste, est publié (sans son autorisation, dira-t-il) en Angleterre et en Allemagne en 1923. Situé dans des siècles futurs, c’est l’histoire d’une «Révolution qui a mal tourné», alors qu’elle devait apporter «le bonheur mathématique et exact, en forçant les gens à être heureux».
Dirigés par un grand Bienfaiteur qui a sur eux droit de vie et de mort et les a définitivement privés de toute inquiétude héritée des religions absurdes d’autrefois, hommes et femmes ne sont plus que des «Numéros», étroitement surveillés par le Bureau des Gardiens. Tout est organisé pour leur bonheur par l’Etat unique, qui a planifié leur travail, leur repos et même leurs amours, grâce à des carnets à souches de couleur rose destinés à organiser leurs «Heures personnelles». Un mur de verre sépare cette cité soit-disant idéale du monde extérieur et il y a bien longtemps qu’a été oublié tout ce qui constituait l’âme des époques d’autrefois, avant la guerre de Deux Cents Ans, entre la ville et la campagne, entre les sédentaires et les nomades où ces derniers furent vaincus.
L’ingénieur D.5O3, dont la confession est écrite à la première personne, est chargé de construire un vaisseau intersidéral qui porte le nom d’Intégral. Il fait la connaissance d’une femme, I.330 qui va le subjuguer en lui faisant entrevoir une autre vérité que celle du monde dans lequel vivent les sujets soumis à la loi des «Tables», ces codes rythmant leur vie: «Tous les matins, avec une exactitude de machines, à la même heure et à la même minute, nous, des millions, nous nous levons comme un seul numéro. Nous commençons notre travail et le finissons avec le même ensemble».
Le seul idéal: «Rien n’arrivera plus». Le seul péché, c’est d’être original, car c’est détruire le fondement de la société nouvelle: l’égalité, condition de l’éternité du néant.
Il arrive un drame: on découvre que D.5O3 est malade: « Ca va mal, lui dit le médecin. Il s’est formé une âme en vous». La conscience personnelle est une maladie et une maladie si grave qu’elle ne peut être éradiquée que par une opération chirurgicale. En attendant cette intervention, l’ingénieur rencontre I.33O à la Maison Antique, sorte de fragment du vieux monde oublié, «le monde déraisonnable et informe des arbres, des oiseaux, des animaux…». Lors de la fête du Jour de l’Unanimité, il n’en courbera pas moins la tête sous le joug du «Numéro des Numéros», ce Bienfaiteur qui lui ordonnera l’opération décisive, celle qui le débarrassera des quelques gouttes de «sang solaire et sylvestre» qui lui venaient des temps anciens. Il va redevenir comme tous les autres.
Une telle contre-utopie ne pouvait qu’attirer la fureur des autorités soviétiques. En 1931, Zamiatine écrit à Staline pour lui demander l’autorisation d’émigrer, sans perdre sa nationalité pour autant. Il part pour Prague puis pour Paris, où il meurt dans la misère et l’oubli le 10 mars 1937, ayant conscience de faire partie de la grande confrérie des hérétiques: «Seuls les hérétiques découvrent des horizons nouveaux dans la science, dans l’art, dans la vie sociale; seuls les hérétiques, rejetant le présent au nom de l’avenir, sont l’éternel ferment de la vie et assurent l’infini mouvement en avant de la vie».
* * *
(National-Hebdo n. 1126 – 16-22 fevrier 2006).
00:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : dystopie, anti-utopisme, contre-utopie, littérature, littérature russe, lettres, lettres russes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Alexandre Soljénitsyne sur "Apostrophes" - 11 avril 1975
Alexandre Soljénitsyne sur "Apostrophes" - 11 avril 1975
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, soljénitsyne, littérature, lettres, lettres russes, littérature russe, dissidence, union soviétique, soviétisme, communisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Houellebecq and the narrow, very liberal culture of nationalism in America
Houellebecq and the narrow, very liberal culture of nationalism in America
by Graham Lister
Ex: http://majorityrights.com/
 It is my opinion that Michel Houellebecq should be on the reading list of any committed non-liberal - assuming, of course, this paragon of nationalist virtue is interested in culture. And I think people who are seriously interested in understanding the grotesque spectacle of post-modern, ultra-liberal, hyper-modernity should be so interested. Cultural values are at the core of self-conception and define the contours of the political imagination.
It is my opinion that Michel Houellebecq should be on the reading list of any committed non-liberal - assuming, of course, this paragon of nationalist virtue is interested in culture. And I think people who are seriously interested in understanding the grotesque spectacle of post-modern, ultra-liberal, hyper-modernity should be so interested. Cultural values are at the core of self-conception and define the contours of the political imagination.
The malaise facing the West goes far deeper than PeeCee and multiculturalism, even if they can be regarded as the most egregious symptoms of our total embrace of liberalism (that is, liberalism as the foundational paradigm for politics, culture, economics et al, rather than a secondary “corrective” ideology which is how classical liberalism arose).
Unfortunately no-one has a positive agenda to rebalance the West upon a sustainable course. There are of course some excellent critiques of the problems but, as yet, no really credible, putative solution has coalesced into a substantive form.
A comments elsewhere on the blog mentioned the spurning of Houellebecq, and I want to return to that. It strikes me that American nationalists in particular have a very narrow range of “cultural resources” that they bring to their politics. This also is true of many ‘nationalists’ across the board. How many times have the virtues of institutional religion (typically in the ‘Jesusland’ style) been offered as the “solution”, or indeed some bizarre “new” version of fascism offered up? Pardon the paradox but both are deeply trivial non-answers (for rather obvious reasons). The exhaustion of the already exiguous political and cultural imagination of nationalists is palpable (neo-Nazi techno anyone??? - Jesus wept). There is, sadly, a lack of genuine radicalism or innovative thought – in the true sense of thinking about these issues both deeply and widely, and in being ruthless in the analysis of old assumptions and outdated or discredited shibboleths.
Returning to Houellebecq, he is deeply anti-American in outlook, and this animosity is not without very good reason. It seems that, in general, Americans - nationalists often included - completely fail to understand that their own nation is the most profoundly liberal nation in history. America was conceived as an inorganic “social experiment” in terms of Enlightenment-derived individual liberty. Individualistic liberalism is the true American ideology/religion. To be sure, it is not the only theme in American life but the others have been peripheral to the cardinal (liberal) impetus animating American culture and society. I have encountered very few American non-liberals (a Hayekian liberal who thinks he is a conservative is still a sub-species of the liberal genus). The axiomatic and defining role of liberal philosophy in American society is something that the overwhelming mass of American people, even self-described conservatives and nationalists, have a very hard time understanding. Collectively, America has drunk from that particular (liberal) well more deeply, and for longer, than any European society.
Of course, all of the West has caught the liberal disease which is deeply corrosive to the collective well-being of ordinary Europeans – truly, we are Voltaire’s bastards. To be sustainable, any society must balance the collective interests - those unifying forces that build cohesion and social capital - and the legitimate individual impulses that invariably tend to differentiation and fragmentation. Equally, a balance must exist between the interests and desires of the present generation and those to whom we will bequeath our collective life and national community. That is why post-liberal politics is actually the “radical centre”. It is a fulcrum conceptualised, for me, in more Aristotelian terms. It is not simply the centre as conceived in the conventional political spectrum, which presently represents only relative variations of liberal political philosophy.
A final thought on American nationalist thinking. I note that the ideal of white Zion has been floated on the blog. Nothing ... nothing illustrates the difference being the inorganic, propositional societies of the New World and the organic ones of “old” Europeans. The idea that whites should move to one place is the ultimate in white-flight fantasies, and is a council of despair. No European patriot could possibly think that abandoning our ancestral homelands represents anything other than the nadir of complete and humiliating defeat.
Why should the British tribes (the Anglos and the Celts) give up our homelands? When I am in the beautiful Highlands of Scotland I reflect on all those generations that lived in this land before me and bequeathed it to us, and I feel deeply connected to the past. What right do we have to surrender our inheritance? Do we really want to run off like cowards scared into self-destruction when faced by some uppity Africans and Pakistanis? Our American friends must try to solve their own problems in a way they judge is appropriate to their situation. However as a European patriot, I for one, will never surrender – anything else is little short of traitorous.
P.S. So we have Houellebecq as a dissector of liberal cultural values, and I would also suggest Ballard and Coetzee in this regard also. But who else might be on the “contemporary literature” reading list for the by no means narrow-minded non-liberal?
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, france, actualité, michel houellebecq |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




 Wenn Siegfried bei seiner Ankunft in Worms Gunther grundlos zum Duell fordert, dann bezeichnet Fernau das als „peinlich“ – so benimmt sich kein Ritter, das machen höchstens Abenteurer oder Rumtreiber. Hagens „Nibelungentreue“ wird zur „schauerlich-imposanten Geradlinigkeit“. Bei Fernau ist nichts bis wenig von diesem ehrfürchtigen Schauer zu spüren, der – so glaubt man doch als Jugendlicher – bei einem Text dieser Größe und dieses Alters angemessen wäre.
Wenn Siegfried bei seiner Ankunft in Worms Gunther grundlos zum Duell fordert, dann bezeichnet Fernau das als „peinlich“ – so benimmt sich kein Ritter, das machen höchstens Abenteurer oder Rumtreiber. Hagens „Nibelungentreue“ wird zur „schauerlich-imposanten Geradlinigkeit“. Bei Fernau ist nichts bis wenig von diesem ehrfürchtigen Schauer zu spüren, der – so glaubt man doch als Jugendlicher – bei einem Text dieser Größe und dieses Alters angemessen wäre.