lundi, 08 janvier 2018
Jornada Evoliana 2017 - A 100 años de la Revolución Bolchevique
10:03 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution bolchevique, julius evola, italie, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 janvier 2018
Tradition du jour des Rois et galette de l'Epiphanie
09:31 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, galette des rois, épiphanie, janvier |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 janvier 2018
Le retour des olympiens

Le retour des olympiens
par Thierry DUROLLE
Dans une logique de contrecarrer le Grand Effacement des mémoires, donc de notre identité d’Européen – ce que nous nommons par néologisme « européanité » – l’étude des Indo-Européens nous paraît être incontournable. Au-delà de l’utilité de telles études, dans ce qu’elles peuvent apporter au champ de la métapolitique, il faut aussi souligner ô combien le sujet est passionnant en lui-même, pour peu que l’on ne soit pas réfractaire à une certaine rigueur académique ainsi qu’à des spécificités d’ordre disciplinaire pouvant rendre l’étude hermétique.
Dans le domaine des études indo-européennes, le professeur Jean Haudry, à la suite de Georges Dumézil, fait office de référence incontestable. Néanmoins ses travaux ne sont pas accessibles au néophyte, même armé de la meilleure volonté, quand bien même muni d’une patience qui lui servira à rechercher, en parallèle de sa lecture initiale, de nombreux termes et de nombreux concepts propices à la bonne compréhension de son sujet. Le lecteur désireux de se cultiver devra s’orienter vers une ou plusieurs introductions adéquates. L’une d’entre elles, La question d’une tradition européenne, du talentueux et regretté Adriano Romualdi représente, à n’en pas douter, la meilleure introduction qui soit.

Adriano Romualdi
Fils de l’un des cadres de la République sociale italienne, Adriano Romualdi se fit remarquer très tôt pour son talent. En parallèle de son statut de professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Palerme, il se distingua comme l’un des meilleurs théoriciens de la Droite radicale italienne. Grand disciple de Julius Evola, dont il promouva l’œuvre, Romualdi consacra ses écrits à dessiner les contours d’une Droite radicale alter-européenne et racialiste. Hélas ! Ce penseur brillant perdit la vie lors d’un accident de voiture durant l’été 1973. La Droite radicale italienne venait de perdre l’« un de ses représentants les mieux qualifiés » selon les mots de l’auteur de Révolte contre le monde moderne. Adriano Romualdi n’est pas une figure connue en France. Seulement trois de ses livres sont disponibles en français, dont La question d’une tradition européenne. Espérons à l’avenir que ses nombreux écrits feront l’objet d’une traduction car il serait dommageable de se priver d’un tel talent.
L’essai d’Adriano Romualdi pose donc la question de l’existence de ce qu’il nomme une « tradition européenne ». Par où devrions-nous commencer à chercher les fondements de celle-ci ? « Une physionomie européenne commence à émerger des brumes de la Haute-Préhistoire au cours du IVe millénaire av. J-C. C’est un événement qui s’accompagne d’un choix déjà spirituellement significatif : le rejet de la “ civilisation de la Mère ” et l’affirmation de l’Urvolk, du peuple originel indo-européen comme communauté essentiellement virile et patriarcale (p. 29). » D’emblée, l’auteur, en bon héritier de Julius Evola, expose la dichotomie des pôles masculin (olympien) et féminin (chthonien), l’élément racial nordique incarne ce premier pôle essentiellement et, donc, substantiellement albo-européen, alors que le deuxième correspond au « ciel euro-asiatique et euro-africain de la Mère qui pénètre, à travers la race méditerranéenne et ses prolongements libyens, ligures, ibériques, pélasgiens, jusqu’au cœur du continent européen (p. 30) ». Ces peuples du Nord vont déferler sur l’Europe centrale, orientale et balkanique. Romualdi note que « cette irruption s’accompagne de l’apparition de symboles solaires. Elle marque la naissance du svastika […], de la roue solaire, du cercle dans le carré, du disque incisé ou poinçonné et du disque radiant (p. 31) ».
L’européanité se trouve également présente chez les « occidentaux de l’Orient » comme l’écrit Romualdi. Nos liens avec la Perse et l’Inde d’une certaine époque semblent évidents. À ce titre l’auteur fait remarquer que « dans le Rig-Veda apparaît déjà la notion centrale de la religiosité indo-européenne et de la race blanche : la notion d’Ordre. L’Ordre entendu comme logos universel et collaboration de toutes les forces humaines avec toutes les forces divines (p. 37) ». Celui-ci « comme fondement de l’univers indo-européen, est à la fois dans le monde et hors du monde. C’est la source d’où jaillissent le kosmos visible et le kosmos invisible (p. 40) ». L’Ordre est donc synonyme de Totalité. Un autre moment important est la migration dorienne, « c’est-à-dire de ce mouvement de peuples du Nord […] qui pousse les Doriens en Grèce, amorce les migrations italiques dans la péninsule des Apennins et provoque la dispersion des Celtes dans toute l’Europe occidentale (p. 45) ».
« Dans le monde grec, c’est la Préhistoire indo-européenne qui se met à parler. Le premier “ verbe ” articulé de la civilisation grecque est la religion olympienne (p. 52). » En effet, s’il y a bien un Dieu européen qui fait office de Dieu tutélaire (et qui constitue alors l’aspect solaire et ouranien du Divin), c’est bien Apollon. Le Dieu à la lyre « incarne un autre aspect de l’Ordre : l’Ordre comme lumière intellectuelle et formation artistique, mais aussi comme transparence solaire qui est santé et purification (p. 53) ». Les Dieux de l’Olympe, selon Adriano Romualdi, reflètent une part de nous-mêmes : « Dans les divinités olympiennes, l’âme nordique de la race blanche a contemplé sa plus pure profondeur métaphysique. L’eusébia, la vénération éclairée par la sagesse du jugement; l’aidos, la retenue pudique face au divin; la sophrosyné, la vertu faite d’équilibre et d’intrépidité : telles sont les attitudes à travers lesquelles la religion olympienne s’exprime comme un phénomène typiquement européen. Et le panthéon olympien est le miroir de cette mesure. De manière significative, même ses composantes féminines tendent à participer à des valeurs viriles : comme Héra, en tant que symbole du coniugium, comme Artémis, en raison de sa juvénilité réservée et sportive, comme Athéna, la déesse de l’intelligence aguerrie et de la réflexion audacieuse, sortie tout armée de la tête de Zeus (p. 55). »
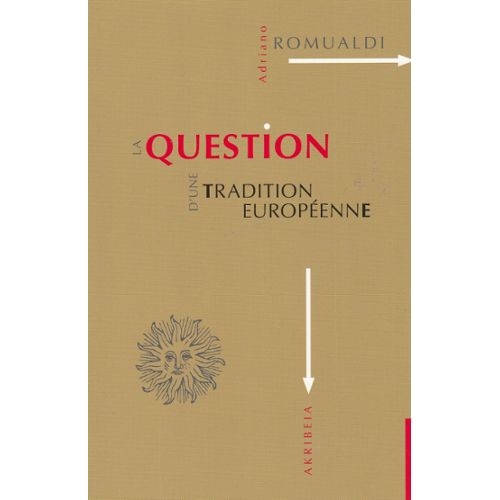
Concernant le monde romain, Adriano Romualdi précise que « la religiosité romaine présente en arrière-plan expressément politique (p. 61) ». L’avènement du christianisme au sein de l’Empire romain n’a pas échappé à l’auteur. Ce dernier nous rappelle ce qu’il est vraiment « un phénomène racial, social et idéal étranger à l’Antiquité gréco-romaine (p. 70) ». Il poursuit : « Le pathos chrétien, ce mélange de sentimentalisme plébéien et de grandiloquence sémitique, cet humanitarisme veiné d’hystérie eschatologique, contredit le goût classique (p. 70) ». Enfin, il conclut cet épisode de notre histoire en mettant en lumière l’exemplarité laissée durant cette période. Revenir aux Grecs, c’est retrouver la splendeur radieuse d’Apollon. « Ainsi déclinait le monde antique, où l’idée d’un Ordre sage et lumineux, apparue durant la préhistoire indo-européenne, était devenue image et parole en Grèce, puis organisation politique à Rome. Une ultime théophanie de la lumière disparaissait, mais elle laissait un modèle de clarté, de maîtrise et de mesure dans lequel l’esprit de la race blanche ne cesserait plus de se reconnaître (p. 75). »
Adriano Romualdi ne peut pas faire l’impasse de l’analyse de l’européanité au temps de l’Europe chrétienne. De toute évidence, cette dernière ne fut pas créée ex nihilo, les polythéismes ont laissé une trace plus que visible qui « traduit aussi la réapparition d’une vision ancienne dans l’intériorité même de la race indo-européenne (pp. 78-79) ». Comme le dit lui-même l’auteur, « le christianisme s’illumine et se fait olympien. […] C’est ainsi que […] refleurit la conception de l’ordre visible symbole de l’ordre invisible […], c’est ainsi qu’au pacifisme cosmopolite du premier christianisme succèdent le mythe de la guerre sainte et l’Éloge de la nouvelle milice par Bernard de Clairvaux (p. 79) ». Ce « corps étranger » à l’européanité finit donc par s’intégrer à lui, tout du moins en partie, et, finalement, à y trouver sa place. « La vocation antique à la rationalité olympienne resurgit et, avec la même passion géométrique que celle qui avait projeté dans l’espace les colonnes doriennes, mesure le kosmos grâce à la mathématique hardie des cathédrales gothiques. C’est ainsi que le christianisme, romanisé dans ses structures hiérarchiques, germanisé dans sa substance humaine et hellénisé en raison d’incessantes transfusions d’aristotélisme et de néoplatonisme, acquiert une citoyenneté pleine et entière en Europe (p. 81). »
Pourtant, l’âme européenne originelle existe toujours. Elle ne se prête pas, entièrement du moins, à une hybridation qui serait, il faut le dire, contre-nature. Le syncrétisme, et ce que certains nomment pagano-christianisme ou catholicisme solaire, bien qu’effectif en partie, ne fonctionne pas. L’exception pour Adriano Romualdi se trouve en la personne de ce grand mystique chrétien que fut Maître Eckart. Malheureusement l’involution « kali-yugesque » corrompt tout, et de la Réforme à la déchristianisation, le Divin s’efface en apparence, mais demeure toujours chez les Européens, même si le rationalisme et le scientisme semblent avoir détrôné ce dernier. « Les origines des mathématiques sont apolliniennes, même si leurs applications semblent aller à la rencontre de Marsyas. Il y a dans la science et la technique une adhésion au style intérieur de l’homme blanc qu’il ne faut pas méconnaître (p. 91). » À l’instar d’Oswald Spengler, qu’il a sûrement lu, Romualdi a parfaitement compris que la civilisation de l’Homme blanc est celle de la Technique.
En définitive, cet essai synthétique, simple d’accès et passionné, nous paraît être un exposé brillant. Véritable mise en forme de l’histoire de notre européanité, Adriano Romualdi n’omet pas les caractéristiques de l’âme de notre race, tout en soulignant toujours la réalité du substrat biologique de notre peuple. Lecture complémentaire du livre La religiosité indo-européenne d’Hans F.K. Günther (1), que nous avions précédemment recensé (2), La question d’une tradition européenne permettra aux néophytes d’acquérir des bases solides et saines sur un sujet particulièrement important.
Thierry Durolle
Notes
1 : Hans F.K. Günther, La religiosité indo-européenne, Diffusion du Lore, 124 p., 16,90 €.
2 : cf. http://www.europemaxima.com/la-lumiere-septentrionale-de-nos-origines-par-thierry-durolle/
• Adriano Romualdi, La question d’une tradition européenne, Akribeia, 2014, 112 p., 15 €.
10:27 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, tradition, traditionalisme, adriano romualdi, olympiens, indo-européens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 décembre 2017
Le phare spirituel de l’Europe

Le phare spirituel de l’Europe
par Georges FELTIN-TRACOL
Ex: http://www.europemaxima.com
« Il est des lieux où souffle l’esprit. Il est des lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l’émotion religieuse. […] Illustres ou inconnus, oubliés ou à naître, de tels lieux nous entraînent, nous font admettre insensiblement un ordre de faits supérieurs à ceux où tourne à l’ordinaire notre vie. Ils nous disposent à connaître un sens de l’existence plus secret que celui qui nous est familier, et, sans rien nous expliquer, ils nous communiquent une interprétation religieuse de notre destinée. Ces influences longuement soutenues produiraient d’elles-mêmes des vies rythmées et vigoureuses, franches et nobles comme des poèmes. Il semble que, chargées d’une mission spéciale, ces terres doivent intervenir, d’une manière irrégulière et selon les circonstances, pour former des êtres supérieurs et favoriser les hautes idées morales. » Ces propos de Maurice Barrès, écrits en 1913 dans La Colline inspirée, concordent parfaitement avec la Sainte-Montagne plus connue sous le nom de Mont Athos.
Point culminant à 2033 m de la plus orientale des péninsules grecques de la Chalcidique, le Mont Athos devient dès la fin du VIIe siècle le lieu de retraite des ermites. L’endroit se couvre bientôt de monastères qui dépendent directement du patriarchat œcuménique de Constantinople. Très tôt, le territoire, dédié à la Vierge Marie, applique l’abaton (un terme grec signifiant « lieu pur ou inaccessible ») : l’accès y est interdit à toute personne de sexe féminin ainsi qu’à tout animal femelle, excepté pour des raisons pratiques les poules et les chattes.

L’actuelle hystérie féministe voit dans cette interdiction « anachronique » le caractère machiste, discriminatoire et sexiste de la Sainte-Montagne. Dès 2002, une socialiste député grec au Parlement européen avait réclamé de l’assemblée une ferme condamnation. Athènes s’y opposa avec vigueur. En effet, la Grèce garantit les spécificités de ce « Tibet chrétien » reconnues par le traité de Lausanne en 1923 et par les différents traités européens.
Héritier de l’Empire byzantin dont il a gardé l’étendard doré à l’aigle impériale bicéphale, le Mont Athos est un État monastique autonome de 2 250 habitants qui se répartissent entre les vingt monastères d’origine grecque, russe, bulgare, roumaine, serbe, géorgienne et arménienne. Organe délibératif, sa Communauté sacrée réunit les représentants de chaque monastère. Quatre moines choisis pour un an forment la Sainte-Épistasie, l’instance exécutive présidée par un Protos.
Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998, le Mont Athos concilie avec une harmonie certaine spiritualité, tradition et écologie. Des éoliennes discrètes et des panneaux solaires fournissent aux monastères leur propre électricité. Tandis que le Mont Saint-Michel croûle sous le tourisme de masse et que le Rocher de Saint-Michel d’Aiguilhe au Puy-en-Velay connaît pour l’instant une fréquentation somme toute supportable, le Mont Athos reste encore ce grand phare spirituel de l’Europe.
Georges Feltin-Tracol
• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n° 58, diffusée sur Radio-Libertés, le 22 décembre 2017.
12:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, grèce, mont athos, monachisme, europe, affaires européennes, spiritualité, tradition, traditionalisme, orthodoxie, orthodoxie grecque, orthodoxie byzantine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 25 décembre 2017
Pour les fils et les filles d’Apollon

Pour les fils et les filles d’Apollon
par Thierry DUROLLE
L’avenir d’un peuple se bâtit grâce à ses enfants; celui de notre peuple se fondera sur l’héroïsme de nos enfants. La jeunesse est un bien précieux, elle est le zénith de la vie de nos peuples blancs. Nous voyons, dans les sourires et les jeux de nos fils et de nos filles, la beauté et la radiance de notre sang. Voilà quelque chose d’inestimable, voilà où se cache notre Graal !
Malencontreusement, l’Âge de Fer corrompt également la famille et nos jeunes pousses. La natalité du monde blanc est dramatiquement en chute libre tandis que celui des pays du Sud, non-blancs et qui nous sont souvent hostiles, explose. L’Afrique représente incontestablement un péril. Nous la voyons se déverser inéluctablement dans nos patries avec des conséquences parfois tragiques.
Dans nos sociétés actuelles, la famille dite traditionnelle n’est plus (cela concerne les Albo-Européens bien entendu). À ce titre, nous devons faire remarquer qu’il est hypocrite d’attribuer au seul « mariage pour tous » la cause de la destruction du modèle familial classique : cette parodie de mariage représente juste un énième résultat concret de la guerre occulte.
L’individualisme effréné, fils de la philosophie des Lumières, dynamisé par la société de consommation, représente selon nous la cause majeure de la fin de la famille traditionnelle. Ses émanations sont la pseudo-libération sexuelle (mais réel servage à ses propres instincts et parfois à ceux des autres!), le divorce et, dans un autre registre, ô combien répugnant et mortifère, l’IVG, soit le meurtre industrialisé d’enfants in utero.
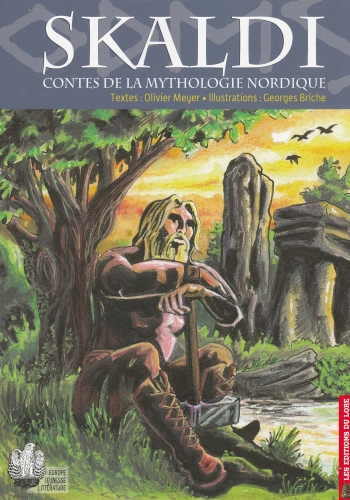
Bref, avoir et élever un ou plusieurs enfants dans ce monde « vétuste et sans joie » à de quoi décourager les meilleurs volontés. Malgré tout, ceux qui ont le sens du devoir savent ce qu’ils ont à faire. L’impératif démographique nous commande, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d’avoir de nombreux enfants si nous ne souhaitons pas disparaître de l’Histoire. La quantité, néanmoins, doit se subordonner à la qualité : ainsi nous devons avoir de nombreux enfants sains, de corps et d’esprit.
À cet effet, l’instruction et l’éducation de nos chères têtes blondes doit être notre priorité, le fond et la forme doivent avant tout être « européocentrés » (sans pour autant freiner la curiosité des enfants). Fort d’une civilisation à l’Histoire exceptionnelle, riche de mythes fondateurs et de poètes, l’Européen conscient dispose d’une materia prima unique ! Cette dernière est parfaitement mise en forme dans la collection « Europe Jeunesse Littérature » de la Diffusion du Lore.
Trois tomes composent d’ores et déjà cette superbe collection : Skaldi. Contes de la mythologie nordique, Braghi. Contes de la mythologie nordique et Roland à Roncevaux. Jules Dufresnes, responsable de la Diffusion du Lore, a particulièrement soigné l’esthétique de cette collection qui plaira aux petits comme aux grands ! Tous ces livres sont au format A4, et sont magnifiquement illustrés par Georges Briche. Les textes des deux premiers tomes sont signés Olivier Meyer, écrivain, essayiste et pamphlétaire nietzschéen bien connu. Ce fils d’Heimdall réadapte brillamment l’Edda de Snorri Sturluson pour le premier, et l’Edda poétique pour le second. C’est Vincent Dubois qui s’occupe quant à lui des textes du livre sur Roland. Il retranscrit cet épisode de notre histoire de la plus belle des manières.
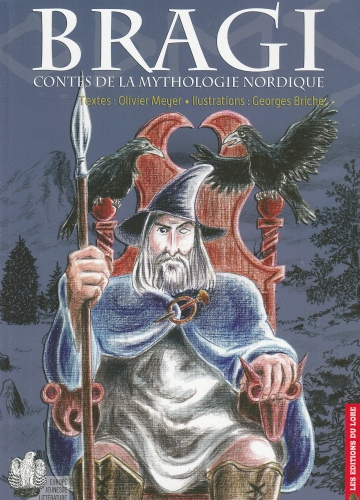
Nous saluons l’initiative de la Diffusion du Lore qui vise à mettre à la disposition des enfants européens de si jolis ouvrages au contenu passionnant. Parfait pour les histoires du soir grâce à des textes de qualité et une esthétique adaptée, voilà de quoi donner de l’engouement à nos progénitures pour qu’ils (re)découvrent nôtre culture, nos mythes et nôtre passé. Hormis un excellent livre sorti chez Auda Isarn (1), nous ne pouvons pas dire que nous croulons sous les livres consacré à la jeunesse, ce qui est dommage. La Diffusion du Lore participe grandement à l’effort de former la jeunesse grâce à cette collection. La période de Jul/Noël étant proche, voici trois ouvrages qui feront bien des heureux sous le sapin.
Thierry Durolle
Note
1 : Pierre Gillieth, Jean Combe, Héros et héroïnes de France, Auda Isarn, 2012, 20 €.
• Olivier Meyer et Georges Briche, Skaldi. Contes de la mythologie nordique, Diffusion du Lore, 2016, 60 p., 16 €.
• Olivier Meyer et Georges Briche, Bragi. Contes de la mythologie nordique, Diffusion du Lore, 2016, 52 p., 16 €.
• Vincent Dubois et Georges Briche, Roland à Roncevaux. Contes de la mythologie nordique, Diffusion du Lore, 2016, 60 p., 16 €.
21:27 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, mythologie, mythologie nordique, livre, paganisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 décembre 2017
René Guénon face à l’orthodoxie du bouddhisme

René Guénon face à l’orthodoxie du bouddhisme
Dans le règne de la Quantité que nous vivons, la copie semble avoir remplacée l’original, et avec lui tout rapport à l’Origine. La Tradition est absente de nos traditions. Les voies spirituelles se multiplient autant qu’elles semblent se combiner, parfois au sein même d’une unique religion. Le syncrétisme spirituel, nourrit par un matérialisme et un sentimentalisme qui rongent les voies ancestrales, est peut-être le plus grand ennemi de l’esprit de synthèse que toute intelligence métaphysique tend à développer. Si, comme le notait René Guénon, l’Occident chrétien a fermé sa porte aux voies initiatiques depuis le XIIIe siècle et n’est aujourd’hui capable que de retarder l’effondrement absolu de ses propres structures, alors se tourner vers l’Orient semble salutaire. À l’Orient civilisationnel correspond toujours un Orient spirituel, intérieur, qui ne saurait se dégrader dans l’abandon des lignées de transmission. Dans ce défrichement progressif des réceptions occidentales du bouddhisme , les lecteurs de Guénon ont souvent traité avec distance le cas du bouddhisme, ne sachant statuer définitivement sur son orthodoxie. Zone Critique se propose ici d’explorer la question.
« le bouddhisme […] devait aboutir […] tout au moins dans certaines de ses branches, à une révolte contre l’esprit traditionnel, allant jusqu’à la négation de toute autorité, jusqu’à une véritable anarchie, au sens étymologique d’ « absence de principe », dans l’ordre intellectuel et dans l’ordre social »
René Guénon, La Crise du monde moderne
« Le dharma et les dharmas, quiddité unitive et quiddité de l’existence diversifiée : c’est là que réside la base d’une exégèse interreligieuse qui ne cherchera pas à remédier aux conflits historiques en minimisant les facteurs formels ou doctrinaux qui en réalité traduisent des différences de génie spirituel. Loin de minimiser l’importance de pareilles différences au nom d’une bienveillance oecuménique facile et éventuellement faussée, elles seront appréciées pour le message que chacune d’elles apporte de même que comme nécessités surgies de la différenciation de l’humanité elle-même ».
Marco Pallis, Lumières Bouddhiques

Tout lecteur, aussi inattentif qu’il soit, sait que René Guénon a changé plusieurs fois son jugement concernant le bouddhisme. Ses proches ne furent pas inutiles à ces revirements, notamment ce monstre d’érudition que fût Ananda Coomaraswamy. Avant de statuer sur l’orthodoxie du bouddhisme, que Guénon n’a reconnu que d’une manière boiteuse, il est nécessaire de comprendre à quoi cette orthodoxie se rattache, puisque l’orthodoxie dont il est ici question n’est autre que la fidélité à la Tradition Primordial. Selon Guénon, la Tradition Primordiale représente l’idée suivante : à l’Origine de l’humanité, la Révélation était Une, pour une humanité Une. Cette humanité fonctionnait dans une sorte d’harmonie consensuelle et entière, non sujette à séparations. En tant qu’axe spirituel, la Tradition Primordiale commune à tous était pourvue de fondements métaphysiques auxquels tous les peuples, aussi différents qu’ils soient, se rattachaient. À la suite de la marche du temps, la Tradition Primordiale va se diffuser sur les différents peuples qui l’exprimeront sous une forme culturelle propre et qui permettront de la rejoindre dans son cœur via la mise en place, à l’intérieur des voies spirituelles exotériques, d’une voie initiatique et ésotérique elle-même fondue dans la civilisation. Cependant et avec l’avancée du progrès dans l’histoire, les traditions vont tendre à se diviser (et non plus simplement à se différencier), elles vont se réformer, se modifier, et s’écarter de leur axe primordial. C’est, selon Guénon et pour ne citer qu’un exemple parmi des centaines, le cas du protestantisme, qui a tellement réformé le christianisme originel qu’il en est venu à dévier de son axe spirituel traditionnel. La Tradition Primordiale est donc toute tendue vers le principe d’Origine métaphysique. Il est inutile de vouloir la situer dans une chronologie historique ou de vouloir la répliquer matériellement, puisque cette Tradition est un fil spirituel supra-humain qui n’est pas sujet à une matérialisation définitive.
Il existe donc, selon Guénon, une connaissance universelle non-humaine à la base de toutes les traditions spirituelles humaines.
Il existe donc, selon Guénon, une connaissance universelle non-humaine à la base de toutes les traditions spirituelles humaines. Comme il le dira dans L’homme et son devenir selon le Védanta à propos des évolutions de la tradition, « si l’exposition peut suivant les époques, se modifier jusqu’à un certain point dans sa forme extérieure pour s’adapter aux circonstances, il n’en est pas moins vrai que le fond reste toujours rigoureusement le même et que ces modifications extérieures n’affectent en rien l’essence de la doctrine ». Selon Guénon, la Tradition Primordiale est donc une quête vers laquelle les traditions spirituelles humaines avancent. La fascination de Guénon pour la tradition hindoue vient du fait même qu’il considérait cette voie comme privilégiée au regard de son orthodoxie, les autres traditions ayant, en quelque sorte, une « dette » spirituelle envers la tradition hindoue. « La situation vraie de l’Occident par rapport à l’Orient n’est, au fond, que celle d’un rameau détaché du tronc .» (Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues). Encore une fois, il ne s’agit pas ici pour Guénon de dire si telle religion est supérieure à une autre, ou si le christianisme dépasse l’Islam dans sa profondeur ésotérique, ce qui, évidemment, n’a absolument aucun sens. Il faut entendre cette filiation comme une remontée généalogique dans l’espace de l’origine métaphysique. A ce titre, il n’existe aucune « religion vraie » ou « religion fausse », mais simplement des voies orthodoxes ou hétérodoxes vis-à-vis de la Tradition Primordiale. C’est d’ailleurs en cela que Guénon fût peut-être plus moderne qu’on ne veut bien le penser habituellement : il encourage ses lecteurs, vivant dans un monde qui ne propose plus, comme ce fût le cas, un cheminement initiatique et ésotérique, à explorer les différentes possibilités traditionnelles qui s’offrent à eux. Ce fût pour Guénon et beaucoup de ses disciples le choix de l’Islam et du soufisme, quand d’autres firent un retour au christianisme (Jean Borella) ou une exploration du bouddhisme (Marco Pallis). A ce titre, il ne s’agit pas pour Guénon de se convertir à une voie plutôt qu’à une autre, conversion qui sous-entendrait une validation d’une voie contre une autre, mais plutôt de « s’installer » dans une religion qui, par sa forme exotérique, permet l’accès à une voie interne, ésotérique, vers la Tradition Primordiale. Ce qui compte, en définitive, c’est le fond métaphysique et divin commun à tous, et que la civilisation moderne a délaissé. Dans un monde où les spiritualités sont, comme le reste, mondialisées, l’exigence d’investigation de Guénon semble bien plus moderne qu’elle n’y paraît. Gardons donc toujours à l’esprit que Guénon évolue non en tant que musulman au sens commun du terme, mais en tant qu’esprit fidèle à la Tradition qui a besoin d’une voie exotérique pour s’initier à l’ésotérisme. A la suite de cette définition, un problème se pose immédiatement : savoir quelles sont les traditions qui sont déviantes (hétérodoxes) de la Tradition Primordiale, et quelles sont celles qui proposent un cheminement orthodoxe et initiatique vers cette dite Tradition. Dans le cas qui nous intéresse, et ce notamment parce que les intuitions premières de Guénon allaient dans un sens négatif, la question sera donc : le bouddhisme est-il orthodoxe ?
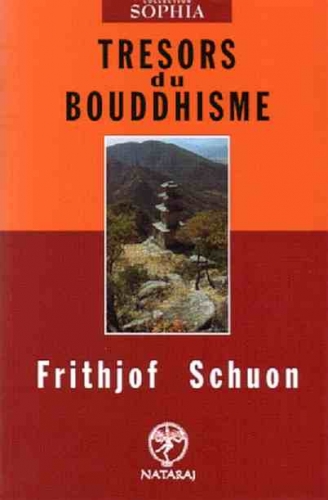 Orthodoxie temporelle
Orthodoxie temporelle
« S’il y a dans le Bouddhisme des éléments apparemment « chrétiens », il y a aussi dans le Christianisme des éléments apparemment « bouddhiques », et il y a du « Christianisme » aussi dans l’Hindouisme, et ainsi de suite ».
Trésors du Bouddhisme, Frithjof Schuon
Comme nous l’avons vu, le concept de Tradition Primordiale sert de référentiel pour les traditions humaines qui se manifestent dans l’histoire. La somme des voies orthodoxes représentent un perspectivisme métaphysique d’une même Possibilité, s’effaçant progressivement dans leur singularité afin de se fondre dans le monde du non-manifesté. Si les critères métaphysiques ne sont pas à confondre avec ceux de la « méthode historique », méthode d’autant combattue par Guénon qu’elle fût dominante chez les orientalistes de son temps, le critère historique ne demeure pas moins inutile pour situer l’orthodoxie du bouddhisme. Coomaraswamy, dans son article Rebirth and Omniscience in Pâli Buddhism, se montrera critique sur cette manière de considérer les textes bouddhiques en enlevant leur partie métaphysique, retrait à l’origine des incompréhensions sur cette tradition spirituelle. Comme le rappelle le Dr Jean-Pierre Schnetzler dans son article des Cahiers de l’Herne, Guénon a soutenu l’hétérodoxie du bouddhisme de 1921 à 1939, notamment dans la première édition de L’Homme et son devenir selon le Védânta et dans l’Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues, ainsi que dans de nombreux articles et lettres rédigés durant la période (voir par exemple dans sa lettre à Coomaraswamy du 2 décembre 1935). On sait que Coomaraswamy ainsi que Marco Pallis furent responsables des changements de vues de Guénon, ce dernier étant si enthousiaste pour la métaphysique hindoue qu’il considéra hâtivement le bouddhisme comme étant une hérésie dans l’immense sagesse du Véda. On ne reprochera pas à Guénon d’avoir analysé le bouddhisme avec les sources limitées de l’époque. Les préjugés orientalistes sur le bouddhisme étaient innombrables et le jeune Guénon eut vite fait de considérer le Dharma comme une source de libération sociale, un vecteur « anarchique », une « libre pensée », etc. Des erreurs factuelles sont également recensées, qu’il ne s’agit pas ici de lister. Encore aujourd’hui, le bouddhisme est souvent présenté comme une excroissance déviée de l’hindouisme. En ce sens, les questions métaphysiques ne sont pas à poser puisque le bouddhisme est, temporellement, une déviation consciente de la Tradition Primordiale pour des motifs sociaux. C’est l’apport de Coomaraswamy, notamment dans son livre brillant de clarté Hindouisme et bouddhisme, qui permit de replacer l’enseignement bouddhique dans son orthodoxie métaphysique.
Sur le plan temporel, le bouddhisme possède une orthodoxie qui lui est propre et demeure indépendant de l’hindouisme
Avant de revenir sur ce point, essentiel, il semble nécessaire de montrer en quoi, sur le plan temporel, le bouddhisme a sa propre orthodoxie et demeure indépendant de l’hindouisme (même si les conclusions métaphysiques du Mahayana semblent sur beaucoup de points se joindre presque symétriquement à celles de l’hindouisme tardif). Si l’historiographie pétrie de nationalisme indien a conduit, en Occident, à valider une interprétation du bouddhisme comme réactif au système des brahmanes, nous savons désormais aux vues des recherches indianistes que rien n’est plus faux. Le bouddhisme naît dans les populations dravidiennes situées à l’est de l’Inde, populations qui ont su développer de grandes écoles religieuses fondées sur une pratique ascétique stricte (dont également le jaïnisme). Le rapport religieux des populations dravidiennes est, malgré des différences locales, un rapport pratique qui amène au « salut ». Les populations brahmanes, arrivées plus tardivement (-1000 avant J-C), ont quant à elles un rapport indo-européen à la religion : il s’agit d’établir un ordre social en concordance avec la structure du cosmos. Les brahmanes ont alors leur propre culte basé sur le sacrifice, culte totalement extérieur avec le bouddhisme des origines. D’un côté, des ascètes avec une spiritualité individuelle. De l’autre, une religion dont le but est l’ordonnancement de la société. Il est inutile de dire que ces pratiques se sont progressivement pénétrées les unes les autres aux grès des mouvements de population. Or, le Bouddha ne naît pas dans une région brahmanisée mais dans une société clanique (le clan des Shakya). Les quatre castes des brahmanes validant les fonctions tripartites indo-européennes ne concernent donc pas l’univers mental du Bouddha, qui n’est pas pour autant hors de tout contact avec les brahmanes, ces derniers vivant souvent dans des villes relativement identifiables. Notons ici que le bouddhisme réutilisera le mot de « brahmane » dans son contexte propre, à l’image des versets du Dhammapada qui utilisent le terme comme synonyme de « saint », « Arhat », celui qui a atteint l’Éveil. Ce truchement dans le vocabulaire ajouté à une absence de précision des traducteurs est peut-être à l’origine de nombre de malentendus. Le brahmanisme n’étant alors pas dominant en Inde, le Bouddha n’a donc pas eu à s’y confronter directement comme cela sera le cas pour ses successeurs indiens. L’enseignement du Bouddha ne vient donc ni du brahmanisme, et encore moins de l’hindouisme. Il n’est en rien une branche déviée comme pouvait le penser originellement Guénon. Il faut également rappeler que ce que nous appelons aujourd’hui et communément « hindouisme » est le produit historique des relations entre le jaïnisme et le bouddhisme, relations qui ont progressivement infusées dans le brahmanisme ancien (sacrificiel), ce dernier se transformant alors en religion de libération au même titre que le bouddhisme. C’est donc ce produit « récent » historiquement que l’on nomme hindouisme, le système des castes étant comme une survivance formelle – mais non inutile du point de vue hindou – du brahmanisme ancien dans l’hindouisme tardif. Ce qu’il s’agit de montrer contre l’analyse trop rapide de Guénon est qu’il n’existe aucune une dette temporelle du bouddhisme envers l’hindouisme. Le bouddhisme possède sa propre orthodoxie, attestée d’une transmission, en dehors du système brahmanique dont il n’est pas originaire et n’a, finalement, rien à dire. Si certains individus de basses castes ont trouvé dans le bouddhisme une manière d’échapper à leur position dans le système des brahmanes, ils sont comparables aux paysans qui faisaient le choix du clergé pour échapper à une condition sociale jugée incertaine. L’unique « dette » du bouddhisme envers l’hindouisme est donc une dette à situer sur le plan métaphysique, et pour cela encore faut-il lui reconnaître son orthodoxie et son indépendance à puiser sa source dans cette souche commune de la Tradition. Dans La pensée du Bouddha, récemment traduit en français, l’éminent Richard Gombrich montre bien comment le bouddhisme a d’ailleurs bien plus de liens avec le jaïnisme qu’avec le système hindou, notamment en ce qui concerne l’éthicisation de la loi du karma.
Il faut remercier Guénon d’avoir modifié ses écrits et reconnu son erreur initiale. A la suite des analyses de Coomaraswamy et de Pallis, Guénon considérera le bouddhisme comme le moyen de transmettre aux non-indiens ce que l’hindouisme avait retenu dans son système fermé. Le bouddhisme, et particulièrement le Mahayana, n’avait plus une situation analogue au protestantisme (une réforme du christianisme), mais était similaire à la mission du christianisme face au judaïsme (une universalisation). Le bouddhisme était reconnu catholique au plein sens du mot. Coomaraswamy[1] remarquait à ce titre que le bouddhisme ne fût admiré en Occident, et particulièrement en Europe, que pour la raison qu’il fût mal compris. Il est probable que la situation n’ait pas énormément changé sur ce point, et une encyclopédie de la réception du bouddhisme par les occidentaux serait à écrire à la suite des travaux de Roger Pol-Droit[2]. Ce revirement a cependant permis à Guénon de préciser que l’hétérodoxie d’une tradition humaine face à la Tradition Primordiale venait de la conception rationaliste tardive qui avait présenté le bouddhisme en occident sous ce seul angle. Comme le remarquait son disciple Denys Roman, il était important de rectifier ce point qui plaçait l’Asie dans l’erreur pour plus de deux millénaires. Cette rectification a conduit de nombreux lecteurs de Guénon à s’installer dans le bouddhisme en tant que structure orthodoxe, et ce pour les raisons pertinemment évoquées par Schnetzler (les lignées de maître-disciples encore vivantes, système ésotérique fort, ordinations monastiques qui sont de véritables passages initiatiques).

Orthodoxie du Soi
« Le Bouddha visible est ce qu’est son essence invisible, il est conforme à la nature des choses. Il a une activité, puisque ses mains parlent, mais cette activité est essentiellement « être » ; il a une extériorité puisqu’il a un corps, mais elle est « intérieure » ; il est manifesté puisqu’il existe, mais il est « manifestation du Vide » (shûnyamûrti). Il est la personnification de l’Impersonnel en même temps que la Personnalité transcendante ou divine des hommes ; que le voile se déchire, et l’âme retourne à sa bouddhéité éternelle comme la lumière, diversifiée par un cristal, retourne à l’unité indifférenciée quand aucun objet ne brise son rayon ».
Trésors du Bouddhisme, Frithjof Schuon
L’apport de Guénon n’est donc pas dans une lecture fine de la pensée sotériologique du Bouddha. Les imprécisions et les affirmations tranchées n’apporteront rien à celui qui compte comprendre le Dharma à partir de Guénon. La relation de Guénon au bouddhisme demeura difficile, malgré l’atténuation des vues initiales. Ce regard suspect semble l’avoir éloigné, comme le soulignait Pierre Feuga dans ses Fragments tantriques, d’une compréhension de la métaphysique bouddhique dans sa pleine puissance. A ce titre, Guénon n’a pas réussi à voir le génie absolu, égal à Aristote, de Nâgârjuna. Que dire également de l’omission du moine gandharais Vasubandhu et de son frère Asanga. Il est difficile de traiter la métaphysique bouddhiste sans évoquer la profondeur exceptionnelle du Madhyamaka ou du Yogacara, et avec ces écoles les débats sur la nature de la vacuité, étant dans un premier cas la résultante logique de l’interdépendance des phénomènes prouvant la non-substantialité, et dans un deuxième cas un pendant idéaliste plaçant le lieu de l’illusion comme lieu de l’éveil dans la conscience. A ce titre et comme le remarquait Jean-Marc Vivenza dans son étude Tout est conscience. Une voie d’éveil bouddhiste, il devient subtil de distinguer nettement les conclusions métaphysique du bouddhisme d’avec les développements tardifs de l’hindouisme philosophique, et il est dommage que Guénon soit passé à côté d’une pensée aussi radicalement négative et idéaliste. Le bouddhisme chinois et japonais Chan (Zen) était sûrement trop anti-intellectualiste dans ses conclusions pour la sensibilité de Guénon, malgré le fort caractère ésotérique d’une voie située « en dehors des écritures » qui commença par le silence même du Bouddha. D’une même manière, Guénon était évidemment loin de soupçonner l’existence de voies comme celle du Shugendô qui, dans le cas du bouddhisme japonais le plus ascétique et ésotérique, n’est pas moins fidèle à une tradition initiatique rigoureuse.
Guénon a très tôt éprouvé dans sa fascination pour l’hindouisme un rejet de la pensée dualiste et un amour pour les doctrines de l’Unité.
Si les imprécisions sur l’orthodoxie temporelle du bouddhisme ont été rectifiée, il s’agit de traiter un point métaphysique fondamental dans ce refus de l’esprit dualiste : l’absence de « soi » dans le bouddhisme. On pourrait rapidement supposer que cette question est secondaire, Guénon semblant plus préoccupé des « techniques » initiatiques et de la fidélité d’une voie à son origine, plutôt qu’à des conclusions métaphysiques précises. En réalité, Guénon a très tôt éprouvé dans sa fascination pour l’hindouisme un rejet de la pensée dualiste et un amour pour les doctrines de l’Unité. Ce facteur n’est d’ailleurs sûrement pas absent de son choix de s’installer dans la tradition islamique. Ce grand Soi, unité totale dans laquelle se fond l’individu qui se quitte lui-même, reste le point terminal de la pensée hindoue, rappelant à bien des égards certains gnostiques chrétiens (Guénon cite notamment Jacob Boehme). Le rejet du « soi » dans le bouddhisme a peut-être été la plus grosse incompréhension occidentale de l’enseignement du Bouddha, et on ne compte pas les orientalistes qui ont entendu ce rejet comme la marque d’une réforme des doctrines hindoues. Encore une fois, Coomaraswamy comme Caroline Rhys Davids ont permis certaines clarifications. Le non-soi (anattâ) n’implique en rien une négation réactive du Soi (Âtma). En fait, tout dépend de quel « soi » nous parlons, et l’usage des majuscules n’est peut-être pas synonyme de meilleure clarté. Le disciple de Guénon Marco Pallis, dans ses Lumières Bouddhiques, soulignait qu’il est fort probable que le Bouddha ait voulu par cette négation du soi souligner une tendance naturelle vis-à-vis de l’égo chez ses disciples, l’enseignement étant dans le bouddhisme toujours contextuel, individuel, et circonstancié. La distinction du « Grand Âtmâ » et du « petit Âtmâ » trouve sa traduction plus nette dans la distinction entre le « Soi » et le « moi ». Le caractère de réalité permanente est niée dans le second cas, puisque ce « moi » n’existe tout simplement pas en tant qu’existence réelle. Il ne peut être permanent puisqu’il procède d’un conditionnement mental dans la réalité relative et mondaine. Il n’y a d’ailleurs pas à combattre le moi ou à le faire disparaître par ce même motif de non-existence absolue. Lorsque l’on dit que l’individualité ne concerne pas le « Soi », cela suppose que, contrairement aux interprétations classiques, il y a un Soi, qui est indépendant du « moi ». Cependant, ce soir n’en est pas pour autant permanent. C’est paradoxalement ce point qui servi d’appui pour statuer de l’hétérodoxie du bouddhisme quant à la tradition hindoue qui semble le plus proche des doctrines du brahmanisme. Dans son article The Reinterpretation of Buddhism, Coomaraswamy nous dit : « Aussi, l’état de l’arhat, qui est libéré du « moi » ou du « petit âtmâ », ne saurait-il en aucune façon être regardé comme une « annihilation » (chose qui est d’ailleurs proprement inconcevable) ; il a cessé d’être « quelqu’un », mais, par cela même, il « est » purement et simplement ; il est vrai qu’il n’est « nulle part » (et ici Mrs Rhys Davids paraît s’être méprise sur le sens ou il faut l’entendre), mais parce que le « Soi » ne saurait évidemment être soumis à l’espace, non plus qu’à la quantité ou à toute autre condition spéciale d’existence. Une autre conséquence importante est que, dans le Bouddhisme pas plus que dans le Brâhmanisme, il ne peut y avoir place pour une « prétendue réincarnation » : le « moi » étant transitoire et impermanent, cesse d’exister par la dissolution du composé qui le constituait, et alors il n’y a rien qui puisse réellement se « réincarner » ; l’« Esprit » seul peut être conçu comme « transmigrant », ou comme passant d’une « habitation » à une autre, mais précisément parce qu’il est, en lui-même, essentiellement indépendant de toute individualité et de tout état contingent ».

Le bouddhisme ne nie donc pas le « Soi », il précise le propos et restructure les imprécisions, et cela permet d’évacuer automatiquement toute critique qui voudrait faire du bouddhisme un nihilisme. Par ailleurs, cette réintroduction métaphysique du « Soi », un soi qui, on l’a compris, est un non-soi en tant que fixe, se retrouvera indirectement dans les développements plus techniques de l’ālayavijñāna, que Guénon semblait malheureusement méconnaître. Dans le Lankavatarasutra, on expose huit types de consciences, contrairement aux six consciences des Abhidarma classiques. Dans son commentaire sur le même Sûtra, D.T. Suzuki traduit : « De même que les vagues dans leur variété sont l’océan agité, de même la variété de ce qu’on nomme les consciences est-elle produite dans l’alaya. L’esprit pensant, le mental et les consciences sont distincts dans leur aspects, mais, en substance, les huit ne doivent point être séparés les uns des autres, car il n’y a ni qualifié ni qualifiant ». Le rôle de l’ālayavijñāna est de susciter, lors de la remontée en surface des semences karmiques, une activité consciente entachée d’ignorance et de passions qui appréhende un « soi » individuel. C’est la conscience mentale souillée qui se saisi des semences alors devenus des objets manifestés, et qui, par se saisissement, produit un objet d’attachement et d’aversion qui vont créer de nouveaux karman qui, encore une fois, vont déposer une empreinte dans l’ālayavijñāna. Dans son Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme, Philippe Cornu relève à propos de l’ālayavijñāna que « selon Vasubandhu, « elle évolue en un courant continu comme le flot d’un fleuve ». Sans interruption, elle forme une série homogène tout au long des vies successives : elle est la source des trois domaines, des six destinées et des quatre modes de naissance et porte les semences qu’elle préserve. Pourtant, elle change d’instant en instant, étant cause et fruit, naissance et destruction. Si elle était permanente, elle ne pourrait être « parfumée » et il n’y aurait pas de distinction entre samsara et nirvana. Elle est ainsi le support de la production conditionnée ».

En ce sens, la disqualification du « moi » est issue d’une simple catégorisation secondaire dans le fonctionnement de l’esprit. Le non-soi bouddhique est un non-soi en tant que substance immuable, mais le soi n’est pas pour autant rejeté. On pourrait dire, comme Dogen le disait, que lorsque le soi est attesté il contient en retrait la vacuité (et donc tous les êtres en tant que co-production conditionnée), et lorsque la vacuité est attestée, elle contient en retrait les individualités en tant que soi. « La vacuité est forme et la forme est vacuité ». L’un des plus grands maître zen du XXe siècle, Kodo Sawaki, dont les propos ont été transmis par son élève Kosho Uchiyama, disait régulièrement que « Zazen est le soi-soyant-le-soi ». A ce titre, Dogen Zenji écrit dans le Genjokoan : « Comprendre la Voie du Bouddha, c’est Comprendre le Soi. Comprendre le Soi, c’est s’oublier. S’oublier c’est se laisser attester par le dharma du Bouddha […]. Comprendre le Soi, c’est s’oublier en tant que soi. S’oublier en tant que soi c’est se laisser attester par le Dharma du Bouddha. Réaliser cela, c’est abandonner son corps et son esprit et toutes notions narcissiques. Dès ce stade sera atteint, vous vous détacherez de l’éveil, tout en continuant à vous y adonner sans y penser. Quand le Dharma authentique est transmis, le Soi-même [le soi véritable] apparaît. Dès l’instant où nous recherchons le Dharma — comme un objet extérieur à obtenir-nous nous éloignons de l’endroit initial où il demeure ».
Concluons ici en disant que René Guénon n’a pas réussi à saisir l’immense profondeur du bouddhisme, et a peut-être été plus fécond par ses disciples (notamment Marco Pallis et Frithjof Schuon) que par ses propres développements.
Concluons ici en disant que René Guénon n’a pas réussi à saisir l’immense profondeur du bouddhisme, et a peut-être été plus fécond par ses disciples (notamment Marco Pallis et Frithjof Schuon) que par ses propres développements. Son opposition fervente contre le syncrétisme se justifiait vis-à-vis de cette fidélité à une Tradition Primordiale ramenant au Principe métaphysique. À ce titre, il eut raison d’opposer radicalement les combinaisons spirituelles croyant se passer d’une tradition instituée. L’intuition métaphysique est moins syncrétiste que synthétique. Ce qui prime chez Guénon n’est jamais l’appartenance à une Voie, mais le concert harmonieux des traditions. Marco Pallis, qui se considérait comme un « pèlerin du bouddhisme tibétain », illustre par un recours à l’histoire chinoise cette jointure entre les traditions humaines, qui dirige l’esprit traditionaliste lorsqu’il passe le seuil d’un temple zen, d’une mosquée ou d’une église (Lumières Bouddhiques) : « En l’an 638 ap. JC, un groupe de chrétien syriens de la secte nestorienne arriva en Chine et se posa la question de savoir si ces étrangers venus de loin devaient être autorisés ou non à fonder un établissement dans le pays. L’empereur T”ai Tsung de la dynastie des T’ang publia un rescrit impérial :« Le Chemin [tao] n’a pas le même nom en tout temps et en tout lieu ; le Sage n’a pas eu le même corps humain en tout temps et en tout lieu. Le Ciel a fait en sorte que soit instituée une religion appropriée à chaque région et climat, afin que toutes les races de l’humanité puissent être sauvées. L’évêques A-lo-pên du royaume de Ta-ch’in, apportant avec lui des sutras et des images, est venu de loin et les a présentés à notre capitale. Ayant soigneusement examiné la portée de son enseignement, nous l’avons trouvé mystérieusement spirituel et d’action silencieuse. Ayant considéré ses points principaux et les plus essentiels, nous sommes arrivé à la conclusion qu’ils recouvrent tout ce qui est le plus important dans la vie… cet enseignement est utile à toutes les créatures et bénéfique à tous les hommes. Qu’il ait donc libre pratique dans tout l’Empire… ».
[1] The Reinterpretation of Buddhism, New Indian Antiquary, 1939
[2] Le culte du néant: les philosophes et le Bouddha, 1997
Clément Sans
18:36 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, rené guénon, frithjof schuon, bouddhisme, asie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 14 décembre 2017
Guénon et la spiritualité perdue de la monnaie

Guénon et la spiritualité perdue de la monnaie
par Nicolas Bonnal
Ex: http://www.dedefensa.org
On sait que l’argent ne vaut plus rien. Les prix de l’immobilier ont été multipliés par cent à Paris en soixante ans. J’ai plusieurs exemples en tête.
On se doute que sur ce sujet j’aurai recours à René Guénon, au règne de la quantité (chapitre XVI). Ensuite à Egon Von Greyerz, dont tous les crétins se moquaient récemment encore sur certains soi-disant sites antisystèmes !
Une chose est sûre, le fric, qui ne valait déjà plus rien, va disparaitre. Une autre l’est moins, savoir si on nous volera notre or (quand vous en avez) comme au temps de Roosevelt (Gold Reserve Act, bonne fiche sur Wikipédia-anglais), des nazis et du Front populaire. Il suffira de tuer quelques contrevenants pour faire craquer tous les autres. L’Etat moderne, qui en a vu et fait d’autres, ne s’arrêtera pas là. Lisez l’historien Hoppe pour le comprendre enfin.
Je vais insister théologie ici, parce les choses sont plus graves que ne le pensent les « éconoclastes » : l’annihilation de la monnaie reproduit en ces Temps de la Fin l’annihilation spirituelle de notre civilisation ET MEME DE NOS PERSONNES.
Je rappelle à certains que salaire vient du mot « sel », que espèces viennent du mot « épices » !
Mais venons-en à Guénon qui se surpasse parfois – et pourtant c’est Guénon :
« La question dont il s’agit est celle de la monnaie, et assurément, si l’on s’en tient au simple point de vue « économique » tel qu’on l’entend aujourd’hui, il semble bien que celle-ci soit quelque chose qui appartient aussi complètement que possible au « règne de la quantité » ; c’est d’ailleurs à ce titre qu’elle joue, dans la société moderne, le rôle prépondérant que l’on ne connaît que trop et sur lequel il serait évidemment superflu d’insister ; mais la vérité est que le point de vue « économique » lui-même et la conception exclusivement quantitative de la monnaie qui lui est inhérente ne sont que le produit d’une dégénérescence somme toute assez récente, et que la monnaie a eu à son origine et a conservé pendant longtemps un caractère tout différent et une valeur proprement qualitative, si étonnant que cela puisse paraître à la généralité de nos contemporains. »
Guénon explique ce qu’était une monnaie :
« Il est une remarque qu’il est bien facile de faire, pour peu qu’on ait seulement « des yeux pour voir » : c’est que les monnaies anciennes sont littéralement couvertes de symboles traditionnels, pris même souvent parmi ceux qui présentent un sens plus particulièrement profond ; c’est ainsi qu’on a remarqué notamment que, chez les Celtes, les symboles figurant sur les monnaies ne peuvent s’expliquer que si on les rapporte à des connaissances doctrinales qui étaient propres aux Druides, ce qui implique d’ailleurs une intervention directe de ceux-ci dans ce domaine ; et, bien entendu, ce qui est vrai sous ce rapport pour les Celtes l’est également pour les autres peuples de l’antiquité, en tenant compte naturellement des modalités propres de leurs organisations traditionnelles respectives. »
Le lien entre spirituel et temporel était ainsi établi selon Guénon :
« Le contrôle de l’autorité spirituelle sur la monnaie, sous quelque forme qu’il se soit exercé, n’est d’ailleurs pas un fait limité exclusivement à l’antiquité, et, sans sortir du monde occidental, il y a bien des indices qui montrent qu’il a dû s’y perpétuer jusque vers la fin du moyen âge, c’est-à-dire tant que ce monde a possédé une civilisation traditionnelle. On ne pourrait en effet s’expliquer autrement que certains souverains, à cette époque, aient été accusés d’avoir « altéré les monnaies » ; si leurs contemporains leur en firent un crime, il faut conclure de là qu’ils n’avaient pas la libre disposition du titre de la monnaie et que, en le changeant de leur propre initiative, ils dépassaient les droits reconnus au pouvoir temporel. »
 Guénon rajoute dans une note passionnante :
Guénon rajoute dans une note passionnante :
« Voir Autorité spirituelle et pouvoir temporel, p. 111, où nous nous sommes référé plus spécialement au cas de Philippe le Bel, et où nous avons suggéré la possibilité d’un rapport assez étroit entre la destruction de l’Ordre du Temple et l’altération des monnaies, ce qui se comprendrait sans peine si l’on admettait, comme au moins très vraisemblable, que l’Ordre du Temple avait alors, entre autres fonctions, celle d’exercer le contrôle spirituel dans ce domaine ; nous n’y insisterons pas davantage, mais nous rappellerons que c’est précisément à ce moment que nous estimons pouvoir faire remonter les débuts de la déviation moderne proprement dite. »
Relisez Dante…
Fin du caractère sacré :
« Il est donc arrivé là ce qui est arrivé généralement pour toutes les choses qui jouent, à un titre ou à un autre, un rôle dans l’existence humaine : ces choses ont été dépouillées peu à peu de tout caractère « sacré » ou traditionnel, et c’est ainsi que cette existence même, dans son ensemble, est devenue toute profane et s’est trouvée finalement réduite à la basse médiocrité de la « vie ordinaire » telle qu’elle se présente aujourd’hui. »
Guénon donne une bonne explication à la Prison Planet du capitalisme moderne :
« Ce que nous avons dit du caractère quantitatif par excellence de l’industrie moderne et de tout ce qui s’y rapporte permet de le comprendre suffisamment : en entourant constamment l’homme des produits de cette industrie, en ne lui permettant pour ainsi dire plus de voir autre chose (sauf, comme dans les musées par exemple, à titre de simples « curiosités » n’ayant aucun rapport avec les circonstances « réelles » de sa vie, ni par conséquent aucune influence effective sur celle-ci), on le contraint véritablement à s’enfermer dans le cercle étroit de la « vie ordinaire » comme dans une prison sans issue. »
Il explique avant Yellen-Draghi pourquoi la monnaie ne vaut rien (un quarantième de l’or depuis quarante ans, un centième pour le dollar depuis la FED-1913) :
« Pour en revenir plus spécialement à la question de la monnaie, nous devons encore ajouter qu’il s’est produit à cet égard un phénomène qui est bien digne de remarque : c’est que, depuis que la monnaie a perdu toute garantie d’ordre supérieur, elle a vu sa valeur quantitative elle-même, ou ce que le jargon des « économistes » appelle son « pouvoir d’achat », aller sans cesse en diminuant, si bien qu’on peut concevoir que, à une limite dont on s’approche de plus en plus, elle aura perdu toute raison d’être, même simplement « pratique » ou « matérielle », et elle devra disparaître comme d’elle-même de l’existence humaine. »

Et tout cela annonce notre Armageddon :
« Cela peut déjà servir à montrer que, comme nous le disions plus haut, la sécurité de la « vie ordinaire » est en réalité quelque chose de bien précaire, et nous verrons aussi par la suite qu’elle l’est encore à beaucoup d’autres égards ; mais la conclusion qui s’en dégagera sera toujours la même en définitive : le terme réel de la tendance qui entraîne les hommes et les choses vers la quantité pure ne peut être que la dissolution finale du monde actuel. »
Et maintenant je laisse conclure von Greyerz qui n’a peut-être pas lu Guénon mais nous aura prévenus.
« Peu de gens réalisent que leur monnaie n’est qu’une entrée électronique qui peut être annulée en une seconde par le gouvernement. Cela signifie que leur monnaie peut disparaître, pour ne jamais réapparaître. C’est ce que les gouvernements et les banques centrales veulent imposer dans la plupart des pays occidentaux.
Les gens pensent que leur argent est en sécurité à la banque et ne réalisent pas que la monnaie électronique n’est pas introduite par commodité, mais bien pour les empêcher de retirer leur argent lorsque les banques insolvables ayant utilisé à outrance l’effet de levier manqueront de cash. Quiconque possède un compte bancaire doit comprendre qu’un jour, il n’y aura plus d’argent à la banque. Les distributeurs automatiques seront fermés et il n’y aura pas de cash disponible. C’est une façon élégante de régler le problème d’insolvabilité du système financier: il n’y aura pas de monnaie papier disponible, ni de monnaie électronique… plus d’argent à retirer.

À ce moment-là, le gouvernement n’imprimera plus de monnaie pour les particuliers, puisqu’elle sera inutilisable. Il imprimera des coupons à utiliser dans certains magasins et pour d’autres dépenses. C’est déjà le cas dans des pays comme le Zimbabwe. Les gens ne pourront dépenser qu’une quantité très limitée de l’argent déposé sur leur compte bancaire chaque mois, comme nous l’avons vu en Argentine.
Bien sûr, l’impression monétaire massive continuera pour sauver le système financier lorsque tous les actifs imploseront. Une très faible quantité de cette monnaie parviendra aux gens ordinaires. »
La plupart d’entre vous diront que ce scénario est totalement irréaliste, pire qu’apocalyptique. J’espère qu’il ne se réalisera jamais. Mais ce que je veux dire est qu’en remettant des actifs aux banques et, finalement, au gouvernement, qui contrôle les banques, la plupart des gens perdront totalement le contrôle de leurs biens. »
On va citer Dante, pour terminer, sur la destruction des templiers et nos rois maudits. Et je vous préviens : ça n’est pas dépassé du tout. C’est même à l’époque du reptilien Draghi et des dettes (debitum, le péché, en latin) européennes ou yankees terriblement actuel :
Que pourrais-tu nous faire, Avarice, de plus,
après avoir si bien avili tous les miens,
que de leur propre chair ils ont perdu le soin ?
Pour que le mal futur ou fait paraisse moindre,
je vois la fleur de lis entrer dans Anagni
et faire prisonnier le Christ en son vicaire.
Je le vois à nouveau soumis aux moqueries ;
je vois renouveler le vinaigre et le fiel ;
je le vois mettre à mort, où les larrons sont saufs.
Ce Pilate nouveau, je le vois si cruel
qu’il n’en est pas content et pousse jusqu’au Temple,
sans jugement, la nef de sa cupidité.
Sources
Dante –Purgatoire, XX, vers 48-82
René Guénon – Le règne de la quantité et les signes des temps (chapitre XVI)
Elgin Groseclose – Money and man
G. Edward Griffin –The creature from Jekyll Island
Murray Rothbard – The mystery of banking
Stephen Zarlenga – The lost science of money
13:06 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monnaien, argent, rené guénon, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 décembre 2017
La jeunesse, Evola et la montée d’une véritable Droite

La jeunesse, Evola et la montée d’une véritable Droite
par Thierry DUROLLE
En tant que traditionalistes (1), nous croyons en la doctrine des cycles cosmiques (2) et par conséquent nous savons que notre temps actuel correspond au dernier cycle, celui qui est connu sous le nom de Kali-Yuga (3). Ce cycle particulier est le plus sombre des quatre cycles et affecte tous les aspects de la vie en général. Ainsi, les êtres humains, les civilisations et la politique ne peuvent-ils échapper à son pouvoir corrupteur. C’est un fait important à garder à l’esprit.
Cependant, le cycle se termine seulement pour repartir avec le premier, l’Âge d’Or ou Krita-Yuga d’un cycle suivant, les jours sombres laissent place à une nouvelle ère. Toutefois, entre-temps, certains d’entre nous, ceux qui forment la Jeunesse, ressentent le besoin d’une action politique mais nécessitent une formation solide pour faire face aux abominations de nos sociétés postmodernes. La Droite est un concept large après tout, comme c’est le cas pour la gauche. En France, la Droite signifie « Droite économique », même si elle apparaît parfois plus progressiste, parfois plus conservatrice. Dans son échelle de principes, le principe économique est toujours le plus élevé et tous les autres lui sont subordonnés. Voici un exemple frappant d’une étape finale involutive.
La définition de ce qui devrait être considéré comme la vraie Droite est une tâche impérative. Parmi les nombreux sujets qu’il a abordés à travers ses écrits, Julius Evola a consacré de nombreux articles sur cette question. Le philosophe italien, souvent réduit à un « fasciste ésotérique », incarne l’homme de Droite. Ses écrits, mais surtout ses actes, en ont fait un exemple vivant de la droiture que chacun voudrait atteindre. La jeunesse néo-fasciste italienne d’après-guerre n’avait pas tort de chercher toutes ces pierres précieuses dans les livres d’Evola afin de construire sa doctrine.
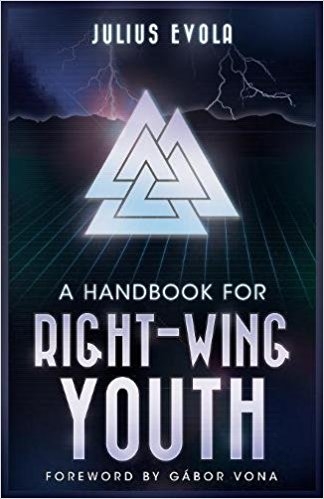 Publié à l’origine en hongrois fin 2012 en tant qu’anthologie des articles d’Evola sur la jeunesse et la Droite, A Handbook For Right-Wing Youth (Un manuel pour la jeunesse de Droite) est maintenant disponible grâce à Arktos en anglais. Nous espérons qu’une version française verra le jour tôt ou tard. En effet, l’influence d’Evola sur la désormais célèbre Nouvelle Droite française et tous ses héritiers (des identitaires aux militants nationalistes-révolutionnaires et traditionalistes radicaux), sans oublier le fondateur du présent site, Georges Feltin-Tracol (4), et certains contributeurs tels Daniel Cologne (5) et votre serviteur lui-même, est tout simplement énorme.
Publié à l’origine en hongrois fin 2012 en tant qu’anthologie des articles d’Evola sur la jeunesse et la Droite, A Handbook For Right-Wing Youth (Un manuel pour la jeunesse de Droite) est maintenant disponible grâce à Arktos en anglais. Nous espérons qu’une version française verra le jour tôt ou tard. En effet, l’influence d’Evola sur la désormais célèbre Nouvelle Droite française et tous ses héritiers (des identitaires aux militants nationalistes-révolutionnaires et traditionalistes radicaux), sans oublier le fondateur du présent site, Georges Feltin-Tracol (4), et certains contributeurs tels Daniel Cologne (5) et votre serviteur lui-même, est tout simplement énorme.
A Handbook For Right-Wing Youth contient dix-sept textes, principalement des articles de presse, mais aussi des extraits de livres tels que L’arc et la massue (6), ainsi que l’intégralité de l’essai intitulé Orientations (7). Il comprend une préface de Gabor Vona, président du parti hongrois Jobbik, et des notes bibliographiques de Robert Horvath. Nous devons également souligner les nombreuses notes de bas de page et la qualité de leurs explications. Le lecteur se retrouve avec un manuel destiné aux militants mais aussi à tous ceux qui désirent découvrir Julius Evola.
Comme le titre le suggère, les deux sujets principaux sont la Droite et la jeunesse. Le premier était un sujet classique développé par l’auteur à travers la totalité de ses écrits. En fait, la Droite suit l’écrivain italien comme son ombre. Julius Evola reste l’éveilleur le plus politique de la Tradition. Il s’est toujours considéré comme un homme de Droite, il a écrit à propos de la Droite et ses critiques et ses positions ont esquissé une doctrine, mieux encore, une vision du monde de Droite. « Cependant, il est également possible de laisser de côté toutes les hypothèses institutionnelles et de parler de la Droite en tant qu’orientation spirituelle et vision du monde. En plus de s’opposer à la démocratie et à tous les mythes “ socialistes ”, appartenir à la Droite signifie défendre les valeurs de la Tradition comme valeurs spirituelles, aristocratiques et guerrières (éventuellement avec des références à une tradition militaire stricte, comme dans le cas du prussianisme). De plus, cela signifie un certain mépris pour l’intellectualisme et pour le fétichisme bourgeois de l’homme cultivé (p. 50). »
Tout au long des différents textes du livre, Julius Evola insiste sur le fait que la vraie Droite est anti-égalitaire, anti-matérialiste, anti-démocratique mais aussi spirituelle et héroïque. En un mot traditionaliste. « En ce sens, le concept de Tradition s’applique à un système dans lequel toutes les activités sont en principe ordonnées d’en haut et ont une direction ascendante (p. 37). » En outre, Julius Evola vise les principaux foyers d’infection qui doivent être combattus selon lui (le marxisme, la psychanalyse, l’existentialisme et le darwinisme) et donne quelques indices sur les domaines culturels sur lesquels la Droite devrait se concentrer, c’est le cas de l’historiographie par exemple.
À propos du second sujet, Robert Harvath fait remarquer que « le sujet de la jeunesse ne faisait pas partie des préoccupations centrales d’Evola; c’est une ligne fine, mais visible, qui parcourt toute son œuvre (p. 150) ». Lorsqu’il écrit sur les jeunes, Julius Evola encourage une « autre jeunesse » ou, au contraire, critique la jeunesse au sens large. Cette dernière appartient à la jeunesse moyenne pour ainsi dire et Evola a surtout concentré ses critiques sur les étudiants et les beatniks comme dans Against the Youth (Contre les jeunes) ou Some Observations on the Student Movement (Quelques remarques sur le mouvement étudiant), tous deux présents dans ce manuel.
Julius Evola a rédigé ses premiers écrits d’après-guerre pour les jeunes militants néo-fascistes italiens. Il n’écrit pas sur ce qui doit être fait mais sur la façon d’être : « Ne pas se laisser aller est ce qui est crucial aujourd’hui. Dans cette société égarée, il faut se payer le luxe d’avoir un caractère. Il faut être du genre, avant même d’être reconnu comme le champion d’une idée politique, à faire preuve d’une certaine conduite de vie, d’une cohérence intérieure et d’un style de droiture et de courage intellectuel dans chaque relation humaine (p. 1). » Par ailleurs, « sur le plan de l’esprit, il existe quelque chose qui peut déjà servir de trace aux forces de résistance et de renouveau : c’est l’esprit légionnaire. C’est l’attitude de ceux qui surent choisir la voie la plus dure, de ceux qui surent combattre tout en étant conscients que la bataille était matériellement perdue, de ceux qui surent convalider les paroles de la vieille saga : “ Fidélité est plus forte que feu ”, et à travers lesquels s’affirma l’idée traditionnelle (p. 7) ». Enfin, « l‘action intérieure doit précéder toutes les autres actions (p. 3) ».
Nous croyons que ces conseils sont d’une importance capitale même si Evola a écrit sur des thèmes strictement plus politiques comme l’idée impériale, le corporatisme, la guerre occulte ou la « démonie de l’économie ». Certaines personnes comme Claudio Mutti ont rapidement fait d’Evola un admirateur de l’islam puisqu’il a montré à ses lecteurs, de manière positive, la mentalité guerrière de cette religion et son concept du grand djihad. Ce qu’il voulait montrer (et surtout apprécier), c’est ce processus ascétique, cette transformation presque alchimique de soi-même pour atteindre quelque chose de plus élevé. Ses intérêts pour la magie, qu’il a explorée en compagnie d’Arturo Reghini (8) dans le groupe Ur, son intérêt pour le tantra vamachara ou l’alpinisme sont des faits qui tendent à prouver notre point de vue.
En ce qui concerne cette collection de textes, nous aurions pu apprécier l’ajout des dernières parties de Chevaucher le tigre (9) qui consistent en un groupe de préceptes pour être et devenir dans cet âge sombre du Kali-Yuga. Aussi, et cela aurait été une addition nécessaire selon nous, quelques textes ou extraits de ses écrits sur la race auraient été une excellente correctif concernant le racialisme.
En conclusion, A Handbook For Right-Wing Youth est certainement un must pour tous les militants politiques et métapolitiques, pour chaque homme de Droite dans sa véritable essence. Nous croyons fermement que les sociétés occidentales ont besoin d’un renouveau de la Droite, pour ne pas dire une révolution. Gabor Vona a souligné un vrai problème dans la vraie Droite de nos jours : « La tragédie de cette situation est que les outils de la gauche sont contagieux. Cela crée une catastrophe politique, qui est extrêmement banale de nos jours: le paysage de la soit-disant Droite est en réalité de plus en plus rempli d’idées gauchistes, et permet aux frontières de la gauche de s’approcher de plus en plus, de la fausse Droite. Bien sûr, cela aboutit à une confusion totale, à la schizophrénie et au chaos des idées (p. 11 de l’avant-propos). »
C’est le plus grand danger auquel la vraie Droite puisse faire face maintenant. Le national-bolchevisme et le maoïsme nazi mis à part (même si leur tiers-mondisme était idéologiquement néfaste), nous identifions clairement une forte « gauchisation » de la Nouvelle Droite française (en particulier de l’une de ses personnalités, Alain de Benoist) et ce que les médias nomment « extrême droite ». La prévalence des questions sociale et économique, les critiques du libéralisme d’un point de vue marxiste et pire, l’abandon de la défense de la race de notre peuple – l’urgence numéro une pour la plupart des pays d’Europe occidentale – et la volonté d’éviter ces sujets sont de véritables signes de dégénérescence. Nous n’avons pas le temps et ne devrions pas prendre la peine d’analyser les causes; le fruit est déjà trop pourri. Le temps de reconstruire une vraie Droite est maintenant venu. Les livres de Julius Evola et A Handbook For Right-Wing Youth sont plus que des lectures nécessaires pour remettre les idées à l’endroit !
Thierry Durolle
Notes
1 : Par « traditionaliste », nous entendons quelqu’un qui se réfère au sens du mot expliqué par René Guénon.
2 : La doctrine des cycles cosmiques est souvent comprise comme un concept uniquement hindou, mais elle correspond également aux âges d’homme d’Hésiode.
3 : Il est le même que l’Âge de Fer d’Hésiode ou l’Âge du Loup nordique.
4 : Né en 1970, Georges Feltin-Tracol est rédacteur en chef du site Europe Maxima et auteur de nombreux ouvrages et articles. Militant depuis longtemps pour la Grande Europe, il a toujours revendiqué l’influence de Julius Evola dans sa réflexion.
5 : Né en 1946, Daniel Cologne est journaliste et essayiste. Il a écrit plusieurs livres sur la Tradition et a travaillé pour la revue traditionaliste Totalité.
6 : Julius Evola, L’Arc et la massue, Éditions Trédaniel, 1983, 275 p.
7 : Julius Evola, Orientations, Éditions Pardès, 2011, 90 p.
8 : Né en 1878, Arturo Reghini était un franc-maçon italien et était considéré comme le plus célèbre pythagoricien italien.
9 : Julius Evola, Chevaucher le tigre, Éditions Trédaniel, 2002, 290 p.
• Julius Evola, A Handbook For Right-Wing Youth, en anglais, Éditions Arktos, 2017, 182 p., 21,07 €.
• D’abord mis en ligne en anglais sur Euro-Synergies, le 8 novembre 2017.
15:28 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola, evola, livre, thierry durolle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 27 novembre 2017
René Guénon réédité

René Guénon réédité
par Thierry DUROLLE
Les lecteurs d’Europe Maxima connaissent l’intérêt qu’une bonne partie de l’équipe rédactionnelle porte à ce grand éveilleur de la Tradition que fût René Guénon. Daniel Cologne et nous-même lui sommes redevable en bien des aspects !
Né à Blois le 15 novembre 1886 à Blois et mort au Caire le 7 janvier 1951, René Guénon est le dépositaire d’une œuvre dense issu d’un travail colossal mais aussi, comme il lui plaisait de dire, d’une « intuition intellectuelle ». Son champ d’exploration concernait les domaines de la métaphysique, de l’ésotérisme, du symbolisme et la critique du monde moderne. Ses connaissances des doctrines orientales, de la franc-maçonnerie, de l’islam (auquel il se convertit), entre autre, suscitait le respect.
Julius Evola, Guido de Giorgio et Frithjof Schuon compte parmi ceux chez qui l’œuvre de Guénon est sans doute la plus importante. Contrairement à Julius Evola, auteur politique attaché à son « européanité » – ce qui ne l’empêcha pas d’être, lui aussi, un grand connaisseur des doctrines extrêmes-orientales et de leur métaphysique –, René Guénon n’a jamais vraiment eu d’intérêt pour la politique. D’ailleurs ces deux grands éveilleurs sont souvent identifiés au Kshatriya (le guerrier, le principe royale, l’action) pour le premier, et au Brahmane (le prêtre, la contemplation) pour le second pour qui seule la chose spirituelle comptait véritablement.
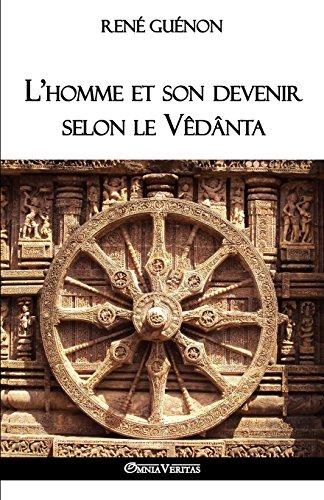 Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.
Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.
Il était temps qu’arrive ces rééditions plus que bienvenues. Nombreux livres fondamentaux à notre famille de penser mériterait une nouvelle jeunesse. Les éditions Omnia Veritas confirme le vieux proverbe « Tout vient à point qui sait attendre ». Bonne lecture !
Thierry Durolle
Notes
1 : Cf. leur site https://www.omnia-veritas.com/
2 : René Guénon, Études sur l’hindouisme, Omnia Veritas, 2017, 294 p., 25 €.
3 : René Guénon, L’erreur spirite, Omnia Veritas, 2017, 402 p., 25 €.
4 : René Guénon, Aperçus sur l’ésotérisme chrétien, Omnia Veritas, 2017, 202 p., 23 €.
5 : René Guénon, L’homme et son devenir selon le Vêdânta, Omnia Veritas, 2017, 274 p. , 25 €.
16:30 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené guénon, philosophie, tradition, traditionalisme, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 20 novembre 2017
Tradition, Nostradamus, Provence et Grand Monarque - Entretien avec Pierre-Émile Blairon

Tradition, Nostradamus, Provence et Grand Monarque
Entretien avec Pierre-Émile Blairon
Ex: http://www.europemaxima.com
 Y a–t-il une Provence secrète ? Il semblerait bien que oui. Pierre-Émile Blairon a eu l’excellente idée de rééditer son livre La Dame en signe blanc (La prophétie du Grand Monarque, Éditions Hyperborée, 2017, 284 p., 20,00 €) qui plonge le lecteur dans les mystères de la région de Roquefavour, entre Graal païen et prédictions de Nostradamus. Il n’en fallait pas plus pour qu’Europe Maxima se décide à l’interroger.
Y a–t-il une Provence secrète ? Il semblerait bien que oui. Pierre-Émile Blairon a eu l’excellente idée de rééditer son livre La Dame en signe blanc (La prophétie du Grand Monarque, Éditions Hyperborée, 2017, 284 p., 20,00 €) qui plonge le lecteur dans les mystères de la région de Roquefavour, entre Graal païen et prédictions de Nostradamus. Il n’en fallait pas plus pour qu’Europe Maxima se décide à l’interroger.
Europe Maxima : Lorsque l’on regarde la note biographique de vos ouvrages il est question de deux passions, la Provence et la spiritualité traditionnelle. La Dame en signe blanc réunit ces deux passions qui vous sont chères. Par quelle « intuition intellectuelle » avez-vous opéré cette jonction ?
Pierre-Émile Blairon : J’avoue que cette expression « intuition intellectuelle », quand je l’ai lue sous la plume de Julius Evola (mais je crois qu’elle provient de René Guénon), m’a décontenancé tellement ces deux termes sont antinomiques, tellement nos deux grands traditionalistes sont proches de ce mot « intuition » et loin de cet autre mot : « intellectuelle », en tout cas, dans l’acception que nous lui donnons aujourd’hui; il n’est rien de plus éloigné d’un intellectuel que l’intuition. Un intellectuel se trompe toujours, aveuglé qu’il est par l’image qu’il prend soin de donner au monde, au « public », de son immodeste et narcissique personne; il se comporte comme un politicien, toujours à chercher d’où vient le vent, sans jamais découvrir où il va (il s’en moque, c’est le temps présent qui compte : après moi, le déluge) mais en caressant dans le sens du poil les masses, les médias, et les nombreuses mais peu diverses coteries parisiennes, car il n’est de bon bec…
Si j’ai bien compris le sens que voulait lui donner Evola, « l’intuition intellectuelle » fait qu’un être différencié ne peut pas se tromper car il porte en lui, naturellement, comme un don, comme une mission – un don est une mission, sinon, à quoi servirait-il ? – cet héritage supra-humain qui lui a fait choisir la Voie des Dieux, olympienne, aristocratique, plutôt que la Voie des Pères, qui lui a fait choisir l’immortalité des dieux, même si elle est, de facto, inaccessible, plutôt que la laborieuse suite lignagière des générations humaines.
Pour en revenir à mes choix, il est évident que j’ai voulu conjuguer mon désir de comprendre le monde à son plus haut niveau, cosmique, et mon besoin d’enracinement, de réenracinement, en ce qui me concerne – je suis né dans une ancienne province française qui n’existe plus – du sol qui vous porte, ou, mieux, qui vous a vu naître, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, image qui résume cette recherche de l’équilibre qui est la base même de l’identité indo-européenne.
EM : Votre intérêt pour la Provence vous a amené à étudier l’œuvre de Nostradamus, figure énigmatique dont certaines prédictions sont plus que troublantes… Pensez-vous que ce dernier détenait un savoir traditionnel ?
P-ÉB : La figure de Nostradamus a été ternie par les nombreux exégètes qui se sont servis de son nom pour faire connaître le leur, sans bien comprendre le personnage et son œuvre.
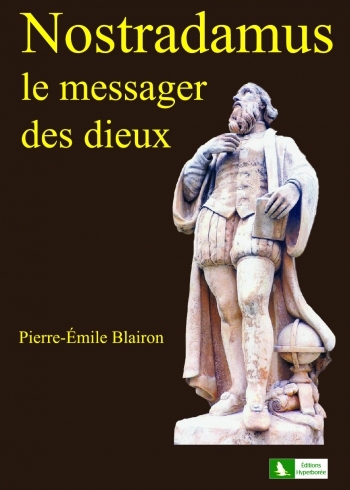
On a présenté Nostradamus soit comme un astrologue, charlatan revêtu d’une longue robe bleue parsemée d’étoiles, une boule de cristal à la main, soit comme un « humaniste » parce qu’il vivait à l’époque de la Renaissance (et encore pire, dans l’acception qu’on lui donne aujourd’hui, celui qui s’intéresse à son prochain, mais plus encore à son lointain), soit comme un médecin qui soignait par les plantes au risque d’être inquiété par l’Inquisition. En vérité, Nostradamus a passé sa vie à acquérir toutes sortes de connaissances, alchimiques, astrologiques, astronomiques, médicales, historiques, métaphysiques… pour mener à bien une mission dont il était conscient d’en être porteur : annoncer aux humains du XXIe siècle le sort qui les attend. La fin d’un cycle mais le commencement d’un nouveau en même temps, enfin, juste après… J’ai sous-titré la biographie que j’ai consacrée à Nostradamus parue aux éditions Hyperborée, « Le messager des dieux », parce que Nostradamus connaissait parfaitement le système des cycles et la Tradition primordiale, laquelle représente symboliquement ce qu’on peut appeler « les Dieux », que Guénon appelle aussi le « supra-humain »; Nostradamus a vécu pendant ce qu’on a appelé la Renaissance, période qui constituait un palier dans le cours de l’Âge de Fer, le cycle final et, comme tel, nous sommes en pleine inversion des valeurs : la Renaissance signifie le début de la fin comme le siècle des Lumières, celui de l’obscurcissement du monde.
EM : En parlant de Tradition, pourriez-vous nous présenter la revue Hyperborée ?
P-ÉB : Hyperborée est la fille d’une modeste revue que j’avais lancée en 1994, qui s’appelait Roquefavour. J’avais constaté que la véritable et salutaire révolution qu’avait constituée la réapparition du paganisme 25 ans plus tôt, initiée par ce qu’on a appelé plus tard la « Nouvelle Droite », n’avait pas suffisamment mis l’accent sur les spiritualités anciennes-européennes, limitées essentiellement aux panthéons grec et romain, au risque d’engendrer dans les mêmes termes et pour les mêmes raisons une seconde Renaissance, dont j’ai souligné plus haut l’aspect illusoire de la première, cette deuxième fois heureusement débarrassée de la chape de plomb que l’Inquisition, le bras armé du catholicisme, faisait peser à l’époque sur tous les aspects de la vie.
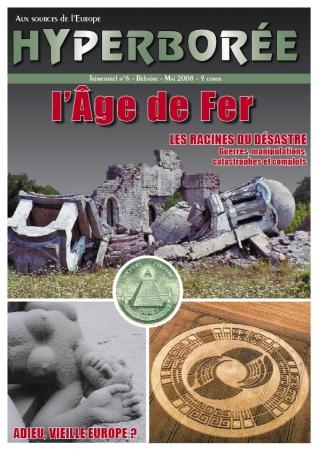
Je n’ai personnellement jamais été attiré par les écrits des philosophes, anciens ou modernes, dont le jargon prétentieux, en ce qui concerne les seconds, m’ennuyait profondément, ni par ce qu’on a appelé la « Raison » grecque, issue en partie des réflexions des premiers, ni par ce qui a constitué le matérialisme et la force de l’Empire romain, qui a été, selon moi, surtout un système d’oppression sur les peuples européens, à l’image du prométhéisme – du titanisme – triomphant de notre mondialisation actuelle.
Je me suis senti beaucoup plus proche du lyrisme de nos « ancêtres les Gaulois », dont la civilisation empreinte de spiritualité à travers l’enseignement de ses druides a été promptement mise sous le boisseau et nos ancêtres les Gaulois mâtinés en Gallo-Romains.
La civilisation celte, qui s’étendait, avant l’Empire romain, sur la quasi-totalité de l’Europe, avait su conserver le mystère et les pulsions intuitives qui la reliait directement aux dieux. Je tente de démontrer, dans La Dame en signe blanc, que les Celtes étaient les descendants des Hyperboréens, dont les anciens Grecs avaient gardé la nostalgie, en témoigne la geste d’Apollon qui leur rendait régulièrement visite.
Avec la création de la revue Hyperborée, j’ai voulu donner un ton plus ésotérique, ou spirituel, à une histoire qui nous projette dans le plus lointain passé indo-européen, le sous-titre de la revue étant « Aux sources de l’Europe ».
Ces sources étant essentiellement constituées par ce qu’on appelle la Tradition primordiale, une culture-racine qui a apporté sa connaissance à l’ensemble des peuples de la planète et dont le siège géographique mythique serait installé au pôle, vraisemblablement sous les glaces.
La revue se réfère régulièrement à d’autres messagers des dieux (expression que j’ai utilisée pour définir Nostradamus) qui, dans des domaines différents ont, surtout par leurs écrits, communiqué les vérités essentielles qui constituent la base de notre grand peuple européen mais aussi son avenir. Nous retrouverons ainsi dans notre revue les noms et les textes d’Oswald Spengler, de Mircea Eliade, de René Guénon, de Julius Evola, d’Alain Daniélou et de quelques autres. Comme nous y incitait logiquement l’approche plus poétique et spirituelle de notre héritage celte, nous nous sommes volontiers intéressés à la poésie et aux auteurs fantastiques comme Tolkien, Lovecraft, Giono (mais oui !), voire aux peintres surréalistes et fantastiques (belges comme Delvaux et Magritte, espagnol comme Dali, ou italien comme Giorgio De Chirico), ou au cinéma de Stanley Kubrick, de John Boorman, de John Milius, de Coppola, de Cimino pour y adjoindre nos frères exilés aux Amériques.
Dès le premier numéro d’Hyperborée est apparue la signature de mon ami le professeur Paul-Georges Sansonetti, le grand spécialiste du monde nordique, de la runologie, du symbolisme et de la guématrie, qui collaborait déjà à Roquefavour et qui a amené dans son sillage d’autres collaborations, venant notamment du mouvement de scoutisme fondé par Jean Mabire, les Oiseaux migrateurs. Le professeur Jean Haudry, incontestable maître de l’indo-européanisme, y a aussi régulièrement collaboré.
La revue, à partir de cette année 2017, ne paraît plus sous sa forme papier mais continue sous sa forme numérique grâce au site Hyperboree.fr, qui regroupe en lecture libre et gratuite l’ensemble de notre production depuis le premier numéro en 2006. D’autre part, ce choix nous permet une plus grande souplesse. Ainsi, je pourrai déployer sur le site un reportage photographique complet sur les sites évoqués dans La Dame en signe blanc, ce qui permettra une meilleure compréhension du livre.
EM : En 2015 paraît La Roue et le Sablier (Bagages pour franchir le gué, Éditions Hyperborée, 2015, 288 p., 20,00 €). Tout d’abord nous devons saluer la qualité de cet ouvrage qui expose de façon claire et concise une vue du monde à la fois traditionaliste, au sens guénonien, et païenne. Ce livre entre-t-il en résonance avec La Dame en Signe Blanc ?
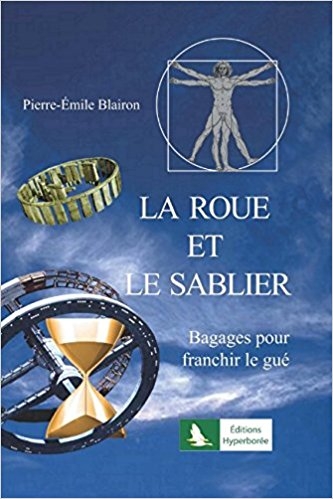 P-ÉB : Le titre, La Roue et le Sablier, indique deux symboles, la roue représente le monde profane qui tourne autour du moyeu qui, lui est fixe, c’est le domaine des dieux qui font tourner le monde, c’est la Tradition primordiale, immuable et pérenne. Plus on se rapproche du centre, du moyeu immobile, et plus on se rapproche du monde spirituel, et, inversement, plus on va vers le grand cercle, celui qui va toucher le sol dur, la terre, et plus on est dans le matériel.
P-ÉB : Le titre, La Roue et le Sablier, indique deux symboles, la roue représente le monde profane qui tourne autour du moyeu qui, lui est fixe, c’est le domaine des dieux qui font tourner le monde, c’est la Tradition primordiale, immuable et pérenne. Plus on se rapproche du centre, du moyeu immobile, et plus on se rapproche du monde spirituel, et, inversement, plus on va vers le grand cercle, celui qui va toucher le sol dur, la terre, et plus on est dans le matériel.
Le sablier représente certes le temps, mais aussi la trifonctionnalité. Au sommet du sablier, la première fonction, celle du prêtre et du roi, celle des conducteurs, puis, au centre, dans le goulet d’étranglement, la deuxième fonction, celle des protecteurs, et en bas, celle des producteurs. Lorsqu’on arrive à la fin d’un cycle, les fonctions sont inversées, celle des producteurs est en haut, en fait, même les producteurs – il y avait une grande noblesse dans le travail du paysan et de l’artisan – ne produisent plus rien, ou plus grand-chose, on fait simplement travailler l’argent (oui, il n’y a que l’argent qui « travaille »), celle des conducteurs est en bas, ils ne conduisent plus rien du tout, ils sont rejetés, décrédibilisés, moqués, celle du milieu, l’armée et la police, est au service de la fonction qui est en haut, quelle qu’elle soit, sans états d’âme. Lorsque le monde retrouve son équilibre après la fin du cycle, le sablier est à nouveau renversé et tout rentre dans l’ordre.
J’ai entièrement adhéré la définition de la première fonction qu’en donne mon ami Pierre Vial dans la dernière livraison de sa revue, Terre et Peuple, n° 73, sur le paganisme, et dont je vous donne la teneur : « Le paganisme de première fonction, lui, a pour mission d’incarner et d’enseigner la conception du monde, de la vie, de l’homme, de l’Histoire qui est la nôtre. C’est le rôle des éveilleurs de peuples qui doivent être, comme le furent les druides, des pédagogues. Mais des pédagogues enseignant d’abord par l’exemple, en se vouant totalement à leur mission et en laissant de côté, donc, tout souci de réussite sociale, d’enrichissement, de renommée intellectuelle, tous ces hochets qui domestiquent l’individu et en font un être soumis à ceux qui, dans notre société, détiennent les pouvoirs, tous les pouvoirs. »
Je me rends compte que c’est la seule citation que j’ai donnée jusqu’à présent dans cet entretien, ceci dit pour en souligner l’importance.
Ce livre, La Roue et le Sablier, a bien sûr un rapport avec La Dame en signe blanc, qui est le premier livre que j’avais écrit; en fait, on peut remarquer que les écrivains (ceux qui ont quelque chose à transmettre, et non pas à gagner) sont comme les peintres qui peignent toujours le même tableau.
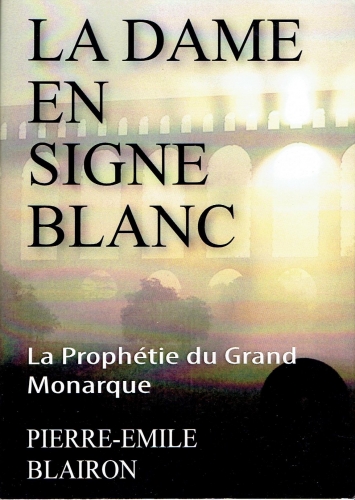 EM : Cela est moins le cas dans La Dame en signe Blanc mais nous avions remarqué dans La Roue et le Sablier que vous citiez à plusieurs reprises Rudolf Steiner. Envisagez-vous l’anthroposophie de façon positive, bien que cette « seconde religiosité », pour emprunter l’expression de Spengler, fut durement critiquée par Julius Evola, ou séparez-vous cette doctrine d’une partie de l’œuvre de Steiner ?
EM : Cela est moins le cas dans La Dame en signe Blanc mais nous avions remarqué dans La Roue et le Sablier que vous citiez à plusieurs reprises Rudolf Steiner. Envisagez-vous l’anthroposophie de façon positive, bien que cette « seconde religiosité », pour emprunter l’expression de Spengler, fut durement critiquée par Julius Evola, ou séparez-vous cette doctrine d’une partie de l’œuvre de Steiner ?
P-ÉB : Steiner a employé l’expression « intuition transcendantale » – et nous en revenons au début de cet entretien – qui me paraît plus appropriée que celle d’« intuition intellectuelle » pour dire à peu près la même chose que ce que disaient Guénon et Evola. Je me suis intéressé plus au personnage qu’au concept d’anthroposophie, qu’il a, à mon sens, largement dépassé, par une imagination foisonnante et la création de multiples concepts à l’intérieur du concept principal qui finit par s’effacer : l’eurythmie, la biodynamie (la plupart des vignerons actuels tendent vers cette pratique), l’éducation (les écoles Steiner sont très réputées) et, tout comme Nostradamus, Steiner avait de véritables dons de voyance. En lisant ses conférences, on se perd dans un dédale poétique, surréaliste ou fantastique, qui a aussi existé chez les théosophes de Madame Blavatsky. Je sais bien qu’Evola, et encore plus Guénon, parlant de contre-initiation, ont condamné ces deux courants, il n’en reste pas moins qu’ils ont participé à mon éveil, de la même façon que Le Matin des magiciens, le cultissime ouvrage de Pauwels et Bergier, qui m’a ouvert l’esprit sur des domaines que j’ignorais.
EM : Vous venez donc de rééditer votre ouvrage La Dame en signe Blanc. Pourquoi rééditer ce livre ? Y avez-vous apporté des modifications par rapport à l’édition originale ?
P-ÉB : La Dame en signe blanc est une expression de Nostradamus pour désigner la reine qui dort à côté du Grand Monarque qui est appelé à se réveiller lorsque l’Europe sera en danger de mort, selon la légende.
Je m’étonnais d’une demande récurrente de quelques amis concernant la réédition de cet ouvrage pour lequel j’avais une certaine affection – c’était mon premier – et je m’y suis replongé, il avait des défauts comme tous les livres, et encore plus comme les premiers. Les événements ont fait que les écrits de Nostradamus concernant le Grand Monarque étaient de plus en plus crédibles – quand il disait qu’un grand chef allait se dresser pour combattre une invasion musulmane – et j’ai donc ajouté ce sous-titre à mon ouvrage, La Prophétie du Grand Monarque. J’ai d’autre part également réactualisé mon livre en y ajoutant une fin concernant les prémisses du nouveau cycle que j’entrevois qui, à mon sens, va voir le rapprochement de l’espèce humaine avec celle des autres règnes, végétal et animal, sans quoi, la Terre, qui un être vivant, mourra et ce qui en vit avec.
EM : La perspective de ce livre est fort intéressante car elle s’inscrit dans un cadre local et historique (la région de Roquefavour). « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », formule ésotérique bien connue, résumerait à merveille le contenu de l’ouvrage…
P-ÉB : Les Celtes, les Gaulois chez nous en l’occurrence, avaient coutume de percevoir le monde en s’appropriant celui que leur vision pouvait englober; le Gaulois était au centre du monde, de son monde; les Bituriges, les habitants gaulois de Bourges, en avaient même fait leur raison d’être : ils étaient « les rois du monde ». Et, de fait, Bourges était bien le centre de la France, donc, les rois de notre pays.

J’ai un peu dépassé ce concept, démontrant d’abord que ce lieu dont je parle, Roquefavour, que j’appelle Le Cercle magique, fut l’un des centres de l’ancien monde, par les événements qui s’y sont déroulés, et suggérant qu’il pourrait être aussi celui qui verra la naissance du nouveau, en accord avec l’un de ses illustres voisins, Nostradamus.
En effet, Nostradamus situe le tombeau, et donc le réveil du Grand Monarque et de son épouse dans le Cercle magique, ou non loin; il situe également non loin du Cercle magique de grandes batailles qui permettront au Grand Monarque d’arrêter les envahisseurs. On pourrait se dire qu’il est bien facile pour le mage de situer tous ces événements sur un territoire qu’il connaît bien – il habitait Salon, à une vingtaine de km du Cercle magique, situé sur la commune de Ventabren – et qu’il y aurait là comme un enfantillage ou une supercherie. Nous pourrions répondre que ce n’est pas le messager des dieux qui situe là ces grands événements, il ne fait que constater ou prédire ce qui aura lieu. Ce sont les dieux, le supra-humain, qui décident. Si ces événements devaient se passer au Japon ou au Canada, nous aurions tout simplement un Nostradamus japonais ou canadien pour en parler.
J’émets l’hypothèse qu’un cycle doit renaître sur les lieux où l’ancien a fini sa course, selon la loi du « témoin » celui d’une course où le coureur passe le témoin à un autre pour accomplir son nouveau tour de piste.
EM : Le livre s’organise autour de trois cycles : l’un païen, le suivant chrétien et le dernier nommé « Ère du Verseau ». Concernant les deux premiers, vous parlez du christianisme comme étant une « religion de coucous », c’est–à–dire qu’elle s’est servie du paganisme pour asseoir son autorité. Dès lors pensez-vous que ce l’on a pour coutume de nommer ésotérisme chrétien n’a de chrétien que le nom ?
P-ÉB : Je ne fais que me référer au système des cycles et, plus précisément, au système des cycles zodiacaux qui durent chacun 2160 ans. Le cycle païen était placé sous le signe du Bélier, de Mars, de la guerre, cycle initié par Prométhée, le Titan, qui voit, paradoxalement, s’accomplir ses rêves de puissance en notre fin de cycle chrétien; nul ne peut contester que le titanisme – le mondialisme – prend tous ses terribles effets à l’époque que nous vivons. Quel fut le rôle du christianisme dans ce processus, le cycle des Poissons ? Atténuer sa brutalité ou bien la corrompre dans une mièvrerie humaniste ? Ces deux cycles, en y ajoutant celui du Taureau, faisaient déjà partie du Kali-Yuga, le cycle de la fin. Mais s’est perpétuée, à travers tous les cycles, quels qu’ils soient, la pérennité de la Tradition primordiale; l’ésotérisme chrétien constitue cette perpétuation, intangible, à travers notamment les écrits de Saint-Jean sur l’Apocalypse, et, d’autre part, les interventions des druides après leur supposée disparition, notamment dans l’élaboration du concept cistercien, sur le plan architectural et spirituel.
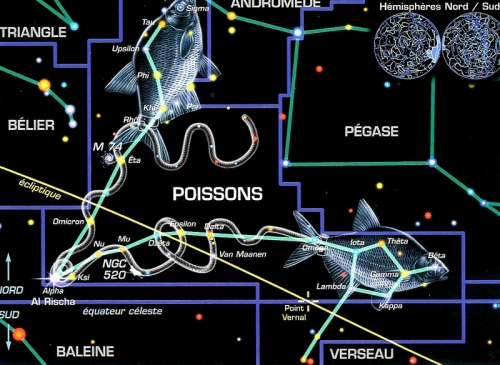
EM : Le dernier cycle qui est en fait l’Ère du Verseau, thème prisé dans les milieux New Age, correspond à la fin de ce que Jean Phaure appelait « Cycle de l’humanité adamique ». Selon ce dernier, la durée de ce cycle serait d’ailleurs indéterminée… Comment envisagez-vous celui-ci ?
P-ÉB : Non, le dernier cycle n’est pas l’ère du Verseau mais bien l’ère des Poissons; nous somme dans cette période transitoire où nous ne savons pas exactement quand finit un cycle et quand commence le nouveau (les nombres bien précis que nous transmettent la Tradition sont vraisemblablement exacts mais comme nous ne savons rien, ou pas grand-chose, de la période où ces cycles auraient commencé, le problème de la datation reste entier). En ce qui concerne le nouveau cycle, je l’ai dit, je pense qu’il y aura un rapprochement des divers règnes, l’homme n’étant plus le prédateur et le déprédateur qu’il a toujours été jusqu’à présent mais bien le régulateur d’un monde que les dieux lui ont confié et qu’il a si mal géré.
EM : La figure du Grand Monarque dont vous parlez n’est pas sans rappeler les annonciateurs/restaurateurs du cycle nouveau tels Baldr, Kalki ou Jésus, mais aussi les rois cachés comme Arthur ou Sébastien. Le nouvel Âge d’Or étant inéluctable, quid de l’action politique durant le Kali-Yuga ?
P-ÉB : Le Grand Monarque n’est pas un avatar, c’est-à-dire un être divin qui descend sur Terre, comme le Christ. Ce serait plutôt une sorte de demi-dieu.
Plusieurs personnages de l’Histoire ont représenté le Grand Monarque, que Nostradamus appelait aussi le Grand Romain, le Grand Celtique, ou le Grand Chyren, ou le Prince Dannemarc, faisant alors référence à l’un de ces personnages légendaires, Ogier le Danois qui était l’un des lieutenants de Charlemagne, qui dort et se réveillera lorsque le Danemark sera en danger, le fameux roi Arthur, chef de guerre celte, qui combattit l’invasion des Germains au VIe siècle, qui est lui aussi en dormition, mais le Grand Monarque, c’est aussi le Khan, titre porté par les chefs mongols, turcs ou chinois. Citons aussi Roderik le Wisigoth qui s’opposa à l’invasion musulmane de ce qui deviendra l’Andalousie. Il serait mort noyé mais son corps ne fut jamais retrouvé. Le Shaoshyant en Iran mazdéen est le nom du Sauveur suprême qui apparaîtra dans les derniers jours du monde.

Chez René Guénon, le Grand Monarque, c’est le Roi du monde, qu’il définit comme le législateur primordial et universel.
Tous ces personnages ont au moins trois points communs :
– Ils sont légendaires, on n’est pas sûr de leurs existences et encore moins de leurs morts.
– Ils dorment d’un long sommeil jusqu’à leur réveil : c’est la dormition.
– Ils sont appelés à être réveillés pour sauver la patrie en danger.
Et, en fait, le Grand Monarque constitue une synthèse de tous ces personnages de légende, un principe universel même car il est appelé à une mission divine.
L’action politique est claire, telle que je l’ai exposé dans La Roue et le Sablier et telle qu’elle est résumée dans le sous-titre « Bagages pour franchir le gué ».
D’abord, il s’agirait de choisir sans état d’âme son camp lorsque l’affrontement guerrier prédit par Nostradamus demandera un engagement total, mais ce n’est pas tout, d’autres actions en amont auront été nécessaires.
Nos ennemis tentent de faire en sorte d’arrêter la roue qui tourne, la robotisation du monde et des hommes annoncée par le transhumanisme va dans ce sens; arrêter le cours du monde signifierait leur victoire, même si cette victoire constituerait aussi une défaite, puisque ses promoteurs, ou leurs héritiers, n’y survivraient pas. Mais leur égoïsme ne se soucie même pas du sort de leurs héritiers, « Après moi, le déluge » est une belle expression pour définir ces nihilistes égotistes. Nous ne savons pas encore si la fin de notre cycle sera caractérisée principalement par un déluge, nous savons que toutes les fins de cycle antérieures à la nôtre, dont Mircea Eliade a collecté les derniers témoignages chez tous les peuples, se traduisent par une conjonction de catastrophes, à la fois humaines et naturelles.
Il nous faut donc rassembler tous les concepts historiques et spirituels qui ont fait la grandeur de l’Europe, une sorte d’Arche de Noé, ou les braises qu’on transporte dans le film, La Guerre du feu, pour pouvoir rallumer le feu en franchissant le gué.
Une autre attitude, mais qui peut être aussi complémentaire, consiste, comme le préconisait Julius Evola, à faire tomber le mur qui menace de s’écrouler; le principe de survie consistant à ne pas se trouver dessous, mais de l’autre côté. Cette méthode revient à précipiter la fin d’un monde qui meurt, le Kali-Yuga, l’Âge de Fer, pour pouvoir accéder plus rapidement au cycle suivant, l’Âge d’Or, qui rétablit l’ordre du cosmos. Ce faisant, paradoxalement, nous pourrions prendre de court ceux qui tentent laborieusement d’empêcher sa venue.
Propos recueillis par Thierry Durolle
15:59 Publié dans Entretiens, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-émile blairon, entretien, nostradamus, provence, grand monarque, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 16 novembre 2017
Un Front de la Tradition?...
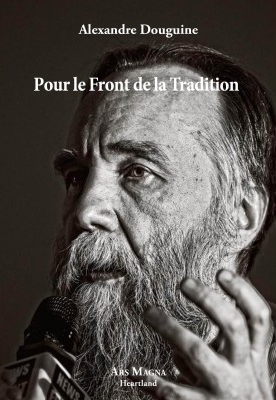
Un Front de la Tradition?...
Les éditions Ars Magna viennent de publier un recueil de textes d'Alexandre Douguine intitulé Le Front de la Tradition. Théoricien politique influent, un moment proche d'Edouard Limonov, Alexandre Douguine est la figure principale du mouvement eurasiste en Russie. Outre L'appel de l'Eurasie (Avatar, 2013), le texte d'une longue conversation entre lui et Alain de Benoist, plusieurs de ses ouvrages ou recueils de ses textes sont déjà traduits en français comme La Quatrième théorie politique (Ars Magna, 2012), Pour une théorie du monde multipolaire (Ars Magna, 2013) ou Vladimir Poutine, le pour et le contre - Écrits eurasistes 2006-2016 (Ars Magna, 2017).
" Connu surtout comme le promoteur de l’idée eurasiste et comme le théoricien qui a une influence fondamentale sur les orientations géopolitiques de l’actuel maître du Kremlin, Alexandre Douguine est aussi (voire surtout) pour beaucoup de ses lecteurs celui qui a le mieux exposé l’idée traditionaliste dans notre Kali Yuga.
On reconnaît un arbre à ses fruits et ceux issus du traditionalisme de René Guénon et de Julius Evola étaient bien décevants. Ces grands penseurs avaient laissé une oeuvre gigantesque mais des disciples aussi petits que médiocres dont la seule fréquentation était de nature à dégouter de se revendiquer de la Tradition.
Puis Alexandre Douguine vint… et il ouvrit des perspectives immenses sur l’islam, l’orthodoxie, le judaïsme, sans oublier les liens entre la Tradition et la géopolitique. On peut résumer son influence en écrivant qu’il fit de ses disciples des « traditionalistes du XXIe siècle ».
D’où la nécessité impérative de rendre accessible aux lecteurs francophones la totalité de ses textes consacrés à la Tradition traduits dans notre langue. Nombre d’entre eux sont totalement inédits, d’autres ont déjà été publiés dans d’obscures revues ou sur des sites internet éphémères, tous méritent d’être lus et médités, tous vous changeront en profondeur et contribueront à faire de vous les kshatriyas que demande notre âge de fer. "
00:05 Publié dans Eurasisme, Livre, Livre, Nouvelle Droite, Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, russie, philosophie, philosophie politique, tradition, traditionalisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 13 novembre 2017
V. V. Putin & Eastern Wisdom

V. V. Putin & Eastern Wisdom
By MEHMET SABEHEDDIN
Ex: http://www.newdawnmagazine.com
Back in October 2000, the newly elected President of the Russian Federation, Vladimir V. Putin, granted a revealing interview to the editors of India Today and The Russian Journal. President Putin paid special tribute to Nicholas Roerich, the Russian artist, explorer and mystic, stating:
“Roerich’s life was an amazing life, a marvel of creativity and astonishing example of spiritual closeness that, perhaps doesn’t lie on the surface, but is nevertheless the spiritual closeness that binds all peoples.”
In December 2002, President Putin’s wife Lyudmila opened an exhibition of Nicholas Roerich’s work at the National Museum of India in Delhi.
Nicholas Roerich (1874-1947) is remembered today as a celebrated Russian painter and occultist, whose intrepid journeys through Central Asia captured the attention of the Western public in the 1920s and 1930s. But Nicholas Roerich was also a master of ‘spiritual geopolitics’ who sought to establish a pan-Buddhist, transnational ‘New Country’ stretching from Tibet to southern Siberia, including territory that was governed by China, Mongolia, Tibet, and the Soviet Union. This ‘New Country’ was conceived by Roerich as the manifest, earthly expression of the invisible Kingdom of Shambhala, “the Holy Place, where the earthly world links with the highest states of consciousness.”1 This Shambhala Project was to establish the Sacred Union of the East.

The American scholar John McCannon, who is writing a biography of Roerich, points out that in today’s Russia Roerich’s ideas are discussed at the highest echelons:
Roerich’s name has appeared with surprising frequency in civic and academic discussion of international relations and new directions in foreign policy. Mainly, he has been cited by political scientists and strategic thinkers in Russia looking for models of ‘multipolarity’ and ‘global pluralism’ to counter U.S. hegemony and seemingly triumphalist or confrontational political theories from the West…2
Since the earliest days of his first presidency, Vladimir Putin has worked tirelessly to lay the foundations of a Eurasian alliance. Just weeks after paying tribute to Nicholas Roerich, Putin told an international forum that “Russia has always perceived of itself as a Eurasian country.” Then in 2001, Russia and China, along with the states of Central Asia, founded the Eurasian political, economic and military organisation known today as the Shanghai Cooperation Organisation. Mongolia, Pakistan, Iran and India, have all expressed interest in joining the group.
In the lead up to his election for a third term as Russian president, Putin set out his grand Eurasian vision in a series of widely published articles.
Nicholas Roerich was introduced to the Buddhist legend of Shambhala while working on the first Buddhist temple ever constructed in Europe, in St. Petersburg the imperial capital of the vast Russian Empire. The Russian Tsar Nicholas II, although a devout Orthodox Christian and head of the Russian Church, had a deep interest in mysticism and Eastern wisdom. On several occasions the Tsar received the Buddhist monk Dorzhiev, assuring him that, “Buddhists in Russia may feel as if under the wing of a mighty eagle.” Construction of the St Petersburg Buddhist temple commenced in 1913 to coincide with the 300th anniversary of the Romanov dynasty. That same year Lama Dorzhiev, a friend of Nicholas Roerich and George Gurdjieff, wrote that Russia was about to fulfil the old Buddhist messianic myth of Shambhala by founding a great Buddhist empire in the East.
One hundred years later in 2013, President Putin, himself a native of St. Petersburg, promised “100-percent support” for Russia’s Buddhists. Speaking during a visit to Russia’s Buryatia republic, Putin said he was proud that Russia is the only country in Europe where Buddhism is officially recognised as a traditional religion. The Russian President emphasised that “Buddhism plays a significant role in Russia… It has always been that way. It is well known that the Buddhists helped during both world wars.” Putin described Buddhism as a “kind, humanist learning based on love for others and love for one’s country,” and said he, the federal government and regional authorities were “always at [the Buddhists’] disposal and ready to support them.”3

Like Tsar Nicholas II, President Vladimir Putin is known to be a devout Russian Orthodox believer with a strong interest in Eastern wisdom. A master of both sambo and judo, Putin has often spoken of how the martial arts – imbued with Asian philosophy – are intended to train the body and the mind. Though an Orthodox Christian, he is conscious of the spiritual authenticity of other traditional religions. And like Nicholas Roerich, who was born Orthodox Christian but later became steeped in Buddhism, Vladimir Putin may well sympathise with the view that the highest forms of all the world’s religions point to the same ultimate reality.
For more about Russian President Putin, check out New Dawn Special Issue Vol 8 No 5.
If you appreciate this article, please consider a digital subscription to New Dawn.
Footnotes
1. See ‘From Synarchy to Shambhala, The Role of Political Occultism and Social Messianism in the Activities of Nicholas Roerich’ by Markus Osterrieder, www.scribd.com/doc/119329670/From-Synarchy-to-Shambhala
2. ‘By the shores of white waters: the Altai and its place in the spiritual geopolitics of Nicholas Roerich’ by John McCannon, www.roerichmongolia.org/files/sibirica%20full%20text%20ar...
3. ‘Putin Promises 100% Support for Buddhists’, RIA Novosti, 11 April 2013, http://en.ria.ru/russia/20130411/180578136.html
MEHMET SABEHEDDIN is a researcher, writer and global traveller. He is a longtime contributor to New Dawn magazine. He can be contacted c/- of New Dawn Magazine, GPO Box 3126, Melbourne VIC 3001, Australia.
The above article appeared in New Dawn Special Issue Vol 7 No 6.
09:55 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir poutine, bouddhisme, russie, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale, religion, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Tout dans la Tradition, rien contre la Tradition, rien en dehors de la Tradition

Tout dans la Tradition, rien contre la Tradition, rien en dehors de la Tradition
par Thierry DUROLLE
« Fascisme » et « fasciste » sont aujourd’hui des termes de novlangue relevant de l’insulte. Ils servent, à l’instar du mot « nazi », à disqualifier toute personne qui tient un discours non conforme. Pour autant, le sens initial de ces mots résonne encore dans la tête d’un bon nombre de personnes, du militant politique jusqu’à l’historien.
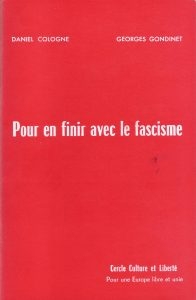 En effet, les fascismes – non pas uniquement le fascisme italien – en tant que phénomènes politiques, doivent d’être étudiés et leurs résultats longuement médités. En 1977, Georges Gondinet et Daniel Cologne se prononcent sur cette épineuse question avec leur fascicule Pour en finir avec le fascisme. Essai de critique traditionaliste-révolutionnaire (1). L’objectif de ce roboratif essai au titre provocateur consiste tout d’abord à mettre dos à dos les deux « mythologisations » du fascisme : la première positive, émanant des milieux dit d’extrême droite; la seconde provenant des ennemis du fascisme, soit le libéralisme et le marxisme. Les auteurs se posent en « héritiers partiels et lucides ». Leur critique du phénomène fasciste s’inscrit donc dans une troisième voie où dominent l’influence de la Tradition Primordiale et le recul historique.
En effet, les fascismes – non pas uniquement le fascisme italien – en tant que phénomènes politiques, doivent d’être étudiés et leurs résultats longuement médités. En 1977, Georges Gondinet et Daniel Cologne se prononcent sur cette épineuse question avec leur fascicule Pour en finir avec le fascisme. Essai de critique traditionaliste-révolutionnaire (1). L’objectif de ce roboratif essai au titre provocateur consiste tout d’abord à mettre dos à dos les deux « mythologisations » du fascisme : la première positive, émanant des milieux dit d’extrême droite; la seconde provenant des ennemis du fascisme, soit le libéralisme et le marxisme. Les auteurs se posent en « héritiers partiels et lucides ». Leur critique du phénomène fasciste s’inscrit donc dans une troisième voie où dominent l’influence de la Tradition Primordiale et le recul historique.
Les critiques du condominium libéralo-marxiste (les auteurs parlent de « critique externe ») n’ont guère évoluées en quarante ans et ne méritent pas que l’on s’y attarde. La « critique interne », c’est-à-dire celle de la Droite radicale, est quant à elle « surtout l’œuvre de nostalgiques, des gens qui ont vécu et apprécié cette époque, de sentimentaux attachés à l’image qu’ils se font de leur passé (p. 11) ». Maurice Bardèche et sa conception rêvée du fascisme n’est pas de leur goût, car selon eux elle ne « débouche pas sur une critique interne, sur une proposition politique nouvelle, sur un fascisme purifié (p. 12) ». Ceci n’enlève rien à l’une des facettes du phénomène fasciste, soit sa proportion à renouer vers un nouvel âge d’or, dans une tentative de restauration de nature héroïque, en plein âge du loup. « Le fascisme nous apparaît comme l’effort révolutionnaire pour retrouver, en plein cœur de la modernité décadente, un monde où la puissance sociale et la supériorité naturelle soit fondées sur des critères spirituels plutôt que matériels (p. 13). » Rebondissant sur deux critiques professées par les libéraux, celles de l’impérialisme et du racisme, Daniel Cologne et Georges Gondinet, en bons défenseurs de l’idée traditionnelle, affirment que « le monde traditionnel connut l’idée impériale et la race, nullement l’impérialisme et le racisme (p. 13) ».
Néanmoins le phénomène fascisme atteint sa limite malgré la tentative de restauration de type héroïque qu’il prétend incarner. En effet, son vitalisme est avant tout perçu comme une dégradation d’un élément autrefois supérieur : « son défaut fut de considérer l’héroïsme comme l’expression de la “ volonté de puissance ”, l’affirmation brutale de la vie, l’exaltation dionysiaque de l’être subintellectuel, le culte de l’action pour l’action, la libération des forces instinctives délivrées de tout interdit moral ou religieux et de toute préconception de l’esprit (p. 16) ». En clair, et les auteurs reprennent d’ailleurs volontiers le terme de Spengler, l’homme façonné par le fascisme est l’incarnation typique de l’« homme faustien ». L’influence de la philosophie typiquement naturaliste de Nietzsche n’échappe donc pas à la critique. « En prônant le naturalisme nietzschéen, le fascisme a voulu renouer avec la grande tradition de l’Europe. En cela, il se trompait. En effet, pour saisir l’essence de la tradition européenne, il faut avoir recours à la conception de la “ spiritualité primordiale ” (Evola) (p. 17). » Ainsi pour renouer avec un idéal à la fois européenne et traditionnelle, la nécessité de se tourner vers un type ascético-militaire comme ce fut le cas avec l’Ordre du Temple par exemple. À l’époque contemporaine et à l’instar de Julius Evola, Georges Gondinet et Daniel Cologne se tournent vers la Garde de Fer du Roumain Codreanu et la Phalange de l’Espagnol Primo de Rivera plutôt que vers le régime du Duce.
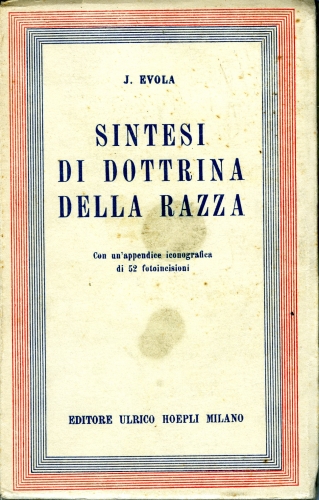 La question du matérialisme biologique, c’est-à-dire de la race, figure parmi les sujets évoqués dans cet essai. En bon évoliens, les auteurs condamnent le racisme biologique national-socialiste et adoptent sans réelle surprise les positions de Julius Evola exprimées dans Synthèse de doctrine de la race (2). « La pureté de la race ainsi comprise résulte de l’équilibre entre les trois niveaux existentiels : l’esprit, l’âme, et le corps. Il n’y a pas de pureté raciale sans une totalité de l’être, un parfait accord entre ses traits somatiques, ses dispositions psychiques et ses tendances spirituelles (p. 24). » Les auteurs en arrivent à la conclusion que la race de l’esprit, qu’ils nomment « générisme » est « la condition sine qua non du dépassement du fascisme, du retour à un traditionalisme véritable, de l’effort vers une révolution authentique (p. 25) ».
La question du matérialisme biologique, c’est-à-dire de la race, figure parmi les sujets évoqués dans cet essai. En bon évoliens, les auteurs condamnent le racisme biologique national-socialiste et adoptent sans réelle surprise les positions de Julius Evola exprimées dans Synthèse de doctrine de la race (2). « La pureté de la race ainsi comprise résulte de l’équilibre entre les trois niveaux existentiels : l’esprit, l’âme, et le corps. Il n’y a pas de pureté raciale sans une totalité de l’être, un parfait accord entre ses traits somatiques, ses dispositions psychiques et ses tendances spirituelles (p. 24). » Les auteurs en arrivent à la conclusion que la race de l’esprit, qu’ils nomment « générisme » est « la condition sine qua non du dépassement du fascisme, du retour à un traditionalisme véritable, de l’effort vers une révolution authentique (p. 25) ».
Après avoir mentionné la distinction entre totalitarisme et « totalitisme », terme que l’on pourrait remplacer par les concepts de holisme ou d’« organicité », Daniel Cologne et Georges Gondinet s’attardent sur l’aspect socialiste du phénomène fasciste. Bien que « le socialisme est une des concessions du fascisme à la modernité (p. 38) », son principal intérêt réside dans la sublimation du prolétariat et de la bourgeoisie car « il débourgeoise le nationalisme en l’unissant au socialisme et déprolétarise le socialisme en lui adjoignant le nationalisme (p. 31) ». Ce dernier découle d’une vision du monde, il n’est pas une technique ou un moyen pour arriver à une fin; les auteurs citent Moeller van den Bruck pour appuyer leurs propos. « Le socialisme, c’est pour nous : l’enracinement, la hiérarchie, l’organisation (p. 32). » Enfin, d’un point de vue social, les auteurs, sans jamais utiliser le terme, insinuent l’idée de caste. « Dans le monde apollinien, la solidarité primordiale est ressentie au niveau de catégories éthiques supranationales, entre des classes d’hommes dont les critères transcendaient le plan naturaliste ou racial. […] Le paysan français attaché à sa terre est plus lié au paysan allemand ou italien partageant sa mystique du sol qu’à l’ouvrier embourgeoisé et déraciné de la banlieue parisienne (p. 34). »
En guise de conclusion à cet essai, Georges Gondinet et Daniel Cologne font un rappel salutaire quant à l’idée, mais surtout au fait, que « le fascisme n’a de sens que dans le contexte de la culture albo-européenne (p. 37) ». Ils rappellent aussi que le fascisme ne se résume pas simplement à une troisième voie politique; cela consisterait à réduire la portée du phénomène fasciste, chose qui « conduit à de graves erreurs (p. 37) ». Ces propos visent clairement certains au sein de la mouvance nationale-révolutionnaire, adeptes du « tiers-mondisme de droite », et qui encensaient à l’époque les divers mouvements de « libération nationale » franchement hostiles au monde blanc. À ce sujet, Philippe Baillet, ancien collaborateur de la revue Totalité où écrivaient aussi Gondinet et Cologne, a fait le tour de la question dans son livre L’Autre Tiers-mondisme. Des origines à l’islamisme radical (3). Enfin, les auteurs énumèrent les concepts-clé de la pensée traditionaliste-révolutionnaire : la volonté de valeur, l’idée impériale, le « générisme », l’État organique, le « totalisme ». « Tels sont les grands axes de la pensée traditionaliste-révolutionnaire permettant d’en finir avec le fascisme, ses erreurs passées et sa déformation présente (p. 40). »
Bien que cet essai fut écrit en 1977, certains propos n’ont pas vieilli, là où d’autres ne sont peut-être plus ou alors moins d’actualité. Nous pensons bien sûr aux attaques à peine dissimulées à l’encontre de la Nouvelle Droite qui à l’époque, et comparé à aujourd’hui, méritait bien son épithète de Droite. Daniel Cologne a toujours été critique envers le nietzschéisme. Nous ne pouvons pas le lui en vouloir. Remettons toutefois les choses à leur place. Comparé à l’involution de la philosophie et de l’éthique du monde moderne, comparé à la subversion galopante des sociétés humaines, notamment celle en cours au sein de la société occidentale, le recours à la philosophie éthique et vitaliste de Nietzsche est définitivement un pas en avant de nature anagogique, comparable au « cycle héroïque » d’Hésiode. Toutefois, il ne doit pas être une finalité, mais une étape vers l’idéal défendu par Georges Gondinet et Daniel Cologne dans ce cas de figure, et par celui de Julius Evola avant eux. La nature de la philosophie nietzschéenne est naturaliste, dionysiaque, c’est-à-dire qu’elle prend source dans l’immanence, alors que la Tradition ou plus exactement l’Âge d’Or, d’essence apollinienne, prend sa source dans la transcendance ou la « transcendance immanente » chère à Evola. Nieztsche a cependant le mérite de focaliser sa philosophie sur l’européanité (5) là où certains éveilleurs de la Tradition, Frithjof Schuon en tête, négligent totalement les voies « européennes » de la philosphia perennis…

Cet opuscule que l’on peut aisément comparer au Fascisme vu de Droite (4) synthétise en partie ce dernier. Cependant, sa nature est différente car la prise de distance toute évolienne du premier cède la place, dans le deuxième, à un volontarisme politique assumé. Court dans le format, direct dans le propos, sa place est naturellement entre les mains de militants. Il est également appréciable que les auteurs ne tombent jamais dans le battage de coulpe, chose qui aurait été surprenante.
« Messagère d’une nouvelle aurore (p. 14) », la Tradition et son incarnation politique, le traditionalisme-révolutionnaire, constitue l’étape d’après dans le perfectionnement d’un mouvement politique d’envergure européen. Le traditionalisme-révolutionnaire est d’autant plus d’actualité dans notre Europe de l’Ouest enlisée dans le laïcisme et le matérialisme. La critique de Daniel Cologne et Georges Gondinet ne plaira sans doute pas aux fascistes orthodoxes, tandis que les militants néo-fascistes, sur lesquels l’influence de Julius Evola est souvent prépondérante, devraient y être plus réceptifs. Certains traditionalistes, ceux qui se tiennent strictement à l’écart de tout engagement politique, ne doivent pas non plus bouder ce fascicule. Pour en finir avec le fascisme. Essai de critique traditionaliste-révolutionnaire mériterait d’être réédité, tout comme Éléments pour un nouveau nationalisme (6), opuscule doctrinal paru dans un format identique dont l’auteur est Daniel Cologne. Nous espérons que des éditeurs à contre-courant entendrons notre appel…
Thierry Durolle
Notes
1 : Georges Gondinet et Daniel Cologne, Pour en finir avec le fascisme. Essai de critique traditionaliste-révolutionnaire, Cercle Culture et Liberté, 1977.
2 : Julius Evola, Synthèse de doctrine de la race, Éditions de L’Homme Libre, 2002.
3 : Philippe Baillet, L’autre tiers-mondisme. Des origines à l’islamisme radical, Akribeia, 2016.
4 : Julius Evola, Le Fascisme vu de Droite, Pardès, 1981.
5 : Friedrich Nietzsche, « Regardons-nous en face. Nous sommes des Hyperboréens », dans L’Antéchrist, 1894.
6 : Daniel Cologne, Éléments pour un nouveau nationalisme, Cercle Culture et Liberté, 1977.
02:45 Publié dans Définitions, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 novembre 2017
«El católico gibelino», de Attilio Mordini

«El católico gibelino», de Attilio Mordini
Ex: http://www.hiperbolajanus.com
 En toda esta trayectoria hemos percibido la necesidad de seguir profundizando en la vía de la espiritualidad, y si en su momento hemos querido mostrar perspectivas muy concretas del mundo islámico, ahora, en estos tiempos en los que la religiosidad y las grandes verdades del Espíritu se han visto erosionadas de forma irreversible, consideramos que cierta visión tradicional del Catolicismo se integraba perfectamente en los propósitos y finalidades que, desde nuestros inicios, hemos proyectado. Dentro de las corrientes del tradicionalismo católico podríamos incluir al propio Joseph De Maistre, uno de los iconos fundamentales de la contrarrevolución liberal, testigo directo de la Revolución Francesa y uno de los primeros, y más feroces, críticos de la Modernidad. No obstante, no han faltado las visiones críticas en relación a esa Modernidad dentro de las trincheras católicas, es evidente que desde la perspectiva de un cristianismo preconciliar, más cercanas en el tiempo, que como es el caso del autor que nos ocupa, reviste un carácter muy particular.
En toda esta trayectoria hemos percibido la necesidad de seguir profundizando en la vía de la espiritualidad, y si en su momento hemos querido mostrar perspectivas muy concretas del mundo islámico, ahora, en estos tiempos en los que la religiosidad y las grandes verdades del Espíritu se han visto erosionadas de forma irreversible, consideramos que cierta visión tradicional del Catolicismo se integraba perfectamente en los propósitos y finalidades que, desde nuestros inicios, hemos proyectado. Dentro de las corrientes del tradicionalismo católico podríamos incluir al propio Joseph De Maistre, uno de los iconos fundamentales de la contrarrevolución liberal, testigo directo de la Revolución Francesa y uno de los primeros, y más feroces, críticos de la Modernidad. No obstante, no han faltado las visiones críticas en relación a esa Modernidad dentro de las trincheras católicas, es evidente que desde la perspectiva de un cristianismo preconciliar, más cercanas en el tiempo, que como es el caso del autor que nos ocupa, reviste un carácter muy particular. Attilio Mordini, autor de la presente obra, fue un autor muy especial, tanto a nivel literario, como pensador, así como en su propia vida personal. Su paso por este mundo fue relativamente corto y accidentado. De origen florentino, vivió unos años dramáticos, los más trascendentales del pasado siglo, y acabó participando como voluntario en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos años de guerra se adhirió a la República Social Italiana, y cuando ésta cayó acabó vagando por Italia, camino de Roma. Finalmente, como ocurrió con muchos combatientes italianos que apoyaron el régimen precedente, Mordini acabó siendo detenido por los partisanos y sometido a un juicio del que finalmente sería absuelto. Durante su estancia en la cárcel sufrió todo tipo de penalidades y maltratos, que a muy temprana edad le hicieron contraer tuberculosis, una enfermedad que le acompañaría hasta el fin de sus días. Nuestro autor, nacido en 1923, vivió todos los dramáticos acontecimientos de su época a una temprana edad, tal es así que su formación y desarrollo intelectual sólo pudo completarse una vez terminada la guerra. Se licenció en lengua y literatura por la Universidad de Florencia, en la facultad de Magisterio, para finalmente convertirse en profesor de la Universidad de Kiel en los años que precedieron a su muerte, la cual acontecería, desgraciadamente, en 1966, a la temprana edad de 43 años. No obstante, y pese a lo prematuro de su desaparición, dejó una obra amplia y variada sobre diversos temas relacionados con la Tradición, y además se convirtió en uno de los principales revulsivos de la escena tradicionalista italiana de los años 60. Fue el promotor de algunos congresos tradicionalistas como el que tuvo lugar en mayo de 1962 en la ciudad de Nápoles, y en el que, a través de una serie de ponencias, desarrolló los principales elementos de su doctrina.
Attilio Mordini, autor de la presente obra, fue un autor muy especial, tanto a nivel literario, como pensador, así como en su propia vida personal. Su paso por este mundo fue relativamente corto y accidentado. De origen florentino, vivió unos años dramáticos, los más trascendentales del pasado siglo, y acabó participando como voluntario en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos años de guerra se adhirió a la República Social Italiana, y cuando ésta cayó acabó vagando por Italia, camino de Roma. Finalmente, como ocurrió con muchos combatientes italianos que apoyaron el régimen precedente, Mordini acabó siendo detenido por los partisanos y sometido a un juicio del que finalmente sería absuelto. Durante su estancia en la cárcel sufrió todo tipo de penalidades y maltratos, que a muy temprana edad le hicieron contraer tuberculosis, una enfermedad que le acompañaría hasta el fin de sus días. Nuestro autor, nacido en 1923, vivió todos los dramáticos acontecimientos de su época a una temprana edad, tal es así que su formación y desarrollo intelectual sólo pudo completarse una vez terminada la guerra. Se licenció en lengua y literatura por la Universidad de Florencia, en la facultad de Magisterio, para finalmente convertirse en profesor de la Universidad de Kiel en los años que precedieron a su muerte, la cual acontecería, desgraciadamente, en 1966, a la temprana edad de 43 años. No obstante, y pese a lo prematuro de su desaparición, dejó una obra amplia y variada sobre diversos temas relacionados con la Tradición, y además se convirtió en uno de los principales revulsivos de la escena tradicionalista italiana de los años 60. Fue el promotor de algunos congresos tradicionalistas como el que tuvo lugar en mayo de 1962 en la ciudad de Nápoles, y en el que, a través de una serie de ponencias, desarrolló los principales elementos de su doctrina.
Si la jerarquía es unidad, no es concentración de poder. La igualdad de todos bajo un solo jefe, como la nivelación de los órdenes y las clases auspiciado por las varias ideologías socialistas son dos aspectos del mismo materialismo, la mayor parte de las veces inconsciente el primero, querido y ambicionado por los hombres mediocres el segundo. No existe concepción verdaderamente espiritual de la vida y del mundo que no ame manifestarse en órdenes, justo como la ley armónica de los nueve coros angélicos.
02:13 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : attilio mordini, tradition, traditionalisme, gibelin, saint-empire, catholicisme gibelin |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 10 novembre 2017
Lovers of Sophia

Lovers of Sophia
Jason Reza Jorjani
Ex: https://manticorepress.net
Introduction to Lovers of Sophia
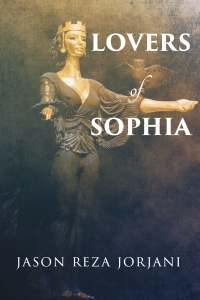 This mammoth volume is a collection of twenty distinct philosophical reflections written over the course of a decade. Most of them are essays, some almost of book length. Others would be better described as papers. A few are well structured notes. There is also one lecture. A magnum opus like Prometheus and Atlas does not emerge from out of a vacuum, and an alternative title to these collected works could have been “The Path to Prometheus and Atlas.” While there are a few pieces that postdate not only that book but also World State of Emergency, most of the texts included here represent the formative phase of my thought. Consequently, concepts such as “the spectral revolution” and “mercurial hermeneutics” are originally developed in these essays.
This mammoth volume is a collection of twenty distinct philosophical reflections written over the course of a decade. Most of them are essays, some almost of book length. Others would be better described as papers. A few are well structured notes. There is also one lecture. A magnum opus like Prometheus and Atlas does not emerge from out of a vacuum, and an alternative title to these collected works could have been “The Path to Prometheus and Atlas.” While there are a few pieces that postdate not only that book but also World State of Emergency, most of the texts included here represent the formative phase of my thought. Consequently, concepts such as “the spectral revolution” and “mercurial hermeneutics” are originally developed in these essays.
In addition to revealing the context for the genesis of specific concepts that I have developed, these reflections also have certain stylistic features and central concerns that, when taken together with my two published books, make it possible to discern the key characteristics of my philosophical standpoint. For example, I reject any subdivision of Philosophy into distinct and specialized fields such as Ontology, Epistemology, Aesthetics, Ethics, and Politics. The main reason that I have included “An Introductory Lecture on Ethics” is because it exemplifies my integral conception of what it means to philosophize. From the essay, “Philosophy, Science, and Art” it becomes clear that beyond a rejection of specialization within Philosophy, I go so far as to argue against any fundamental differentiation of Philosophy from the arts and sciences. It is my contention that philosophers (such as Aristotle and Descartes) determine the deep structure of successive scientific paradigms, at least at their inception, and that philosophical thought can take place in an artistic and literary medium. This is why several of the pieces here are interpretations of literary or cinematic works, such as The Trial of Franz Kafka, or two films based on the writings of Philip K. Dick. In my view, aesthetic intuition is a necessary (but not a sufficient) condition for being a philosopher.
While on the subject of what it means to be a philosopher, let me point out that it is only with the publication of these essays that I reconcile myself to making the claim that I am one. Thus far I have described myself only as “an aspiring philosopher”. In addition to the aforementioned “Introductory Lecture on Ethics” and reflection on the relationship between “Philosophy, Science, and Art”, my diatribe “Against Perennial Philosophy” makes it quite clear that I do not recognize the majority of academics in the field of Philosophy as “philosophers” even though they disrespect the great thinkers of the past by referring to themselves as that. “Against Perennial Philosophy” actually disqualifies the majority of so-called “philosophers” in the Canon as well, and it suggests that there has hardly been any philosophy worthy of the name outside of the Indo-European civilizations (including Buddhist Asia).
A philosopher is someone whose thought engages with fundamental questions concerning Truth, Beauty, and Justice, in a way that leads to the discovery of concepts with a potential to catalyze scientific and political revolutions. The philosopher’s ethics and politics must be grounded on his ontology and epistemology, and, as I have already suggested, this integral thought has to be guided by an aesthetic intuition comparable to that of the most extraordinary geniuses in literature and the arts. This is a definition that disqualifies scientists as innovative as Khayyam, Galileo, and Newton, political theorists like Cicero, Rousseau, and Strauss, or artists such as Ferdowsi, Dostoyevsky, and Kubrick. That I reflect philosophically on the brilliant works of Franz Kafka and Philip K. Dick, does not mean that I consider them philosophers. On this definition, there are probably not many more than two dozen philosophers known to recorded history. (This qualifier “recorded history” is important since I am certain that we have lost a great deal of legitimate philosophy to vicissitudes such as the burning of the Library of Alexandria or the Islamic Conquests of Iran and India.) On account of the development of at least four original concepts thus far, namely the “spectral revolution” and “mercurial hermeneutics” in Prometheus and Atlas, the concept of a “world state of emergency” in the book by that name, and the terrifying idea of a “destructive departure in worldview warfare” from the essay “Black Sunrise” that appears in this volume, I now see myself as (just barely) having joined the ranks of these fellow lovers of Sophia.

The backbone of this collection is constituted of critical, and in some cases iconoclastic, contemplation of the work of my predecessors in the Canon: Plato, Aristotle, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, James, and Wittgenstein. The interpretation of Plato ventured in “The Pharmakon Artist” and that of Aristotle in “Building the Theater of Being” are totally original and extremely destabilizing to received tradition. The essay on Hegel’s “Paranormal Phenomenology”, which also adopts and adapts certain ideas from Maurice Merleau-Ponty, is the point of origin for the concept of “mercurial hermeneutics” further developed in Prometheus and Atlas.
But it is by no means the case that these philosophical reflections are limited to the Western Canon. Rather, one of the distinguishing characteristics of Prometheus and Atlas as well as World State of Emergency is the cosmopolitan scope of my thought. My “Critique of Shiite Esotericism” and exegesis of “Verse 4:34” from the Quran, are incisive philosophical critiques of Islam. They were instrumental scholarly exercises on the way to the anti-Islamic argument of World State of Emergency. Essays like “Serpent Power of the Superman”, where I argue that Hindu Tantra is more Nietzschean than Nietzsche, reaffirm that I recognize no distinction between ‘Western’ and ‘Eastern’ philosophy. Although most of what could be called philosophical thought in the East is Indo-European or Aryan in origin, my “Notes on the Tao of Bruce Lee” suggest that Aryan traditions like Buddhism can be augmented by assimilating elements of non-Aryan traditions such as Taoism. As I argued in both Prometheus and Atlas and World State of Emergency, I see this innovatively evolving cosmopolitan humanism as one of the most distinctive qualities of the Indo-European community. Bruce Lee is Aryan, not Chinese – and I say that mainly on account of the form of his thought, rather than his half-German genetic inheritance or his upbringing in the British colonial culture of Hong Kong.
By the way, as “Trial Goddess” strongly suggests, I also consider Franz Kafka to be an Aryan. Fragmentary as his writings may be, in my view Kafka is the peak of German literature – or rather the cathedral gloom of its most horrifyingly abyssal depth. How integral Jews have been to defining the most Aryan of attitudes and ideas in the Western Canon is also clear from the overwhelming influence of Baruch Spinoza on the development of the core structure of Nietzsche’s thought, which I trace in the essay, “Spinoza, the Untimely One.” Nietzsche, the progenitor of the Aryan Superman, himself recognized the Jews as a world-historical community who, as compared to their small numbers, have demonstrated an incomparable genius in every field of human endeavor, producing some of the most brilliant philosophers, scientists, artists, and mystics.
To the horror of those who consider cosmopolitan Jews to be nothing other than crafters of corrupting golem, in the essay “Prisoners of Property and Propriety” I argue that Karl Marx was a devotee of Prometheus – the most Aryan of all divinities. Moreover, it is in this essay on Marx and other radical Marxists that I first developed the concept of the “spectral revolution” as early as 2010. I synthesized Prometheus and Atlas from this essay with Deleuze’s idea of conceptual personae in “Philosophy, Science, and Art” and Merleau-Ponty’s understanding of spectrality as I interpret it in “Paranormal Phenomenology”, in order to produce the core structure of my magnum opus. Reflecting on Ludwig Wittgenstein’s concept of language games was also instrumental to arriving at the idea of “worlds at war over Earth” in Prometheus and Atlas.

My thinking defies all binaries. More than that – it mocks them. Those who know how to read esoterically, as I know how to write esoterically, ought to have discerned that in Prometheus and Atlas. Hermes or Mercury, the Trickster, is not the book’s villain. Like the figure of The Joker in the essay “Gotham Guardian”, he (or she, another false binary) is an agent of chaos and a de-structuring force required for any new world order. This is what the Alt-Right never understood about Pepe, the incarnation of the ancient Egyptian god Kek. Of all the figures in the leadership of the Alt-Right, I was Kek’s most faithful emissary. Richard Spencer and Daniel Friberg are just the devil’s playthings.
This brings me to “Black Sunrise”, which is by far the most disturbing essay in this collection and the only one in which I develop a new concept beyond those of my first two books. While a superficial reading might leave one with the impression that this is a Fascist manifesto, those who are attentive will find no explicit endorsement. Even more thoughtful people would recognize that the text carries out what occultists call “revelation of the method.” The method in question is the means whereby a global Fascist state could be established on this planet, well within this century. I conceptualize this method as “destructive departure in worldview warfare” – a loose translation from the much more evocative German phrase that I coined to express this idea: Abbauende Aufbruch ins Weltanschauungskrieg. This is not a hypothetical idea.
It is, in practice, the most radical form of psychological warfare imaginable. It presupposes an anarchical existential ontology on the basis of which one can captivate entire societies through the manipulation of false binaries that form the fabric of their weltanschauung. The societies are broken down and then re-conquered by a breakaway civilization, in comparison to which the target societies are simulacra with programmable mytho-poetic variables. I disclose the modus operandi of this occulted Fascist breakaway civilization. But what is more interesting, from a philosophical standpoint, is the way in which this disclosure serves as the context for an exploration of some radical ideas about the nature of space-time and the possible non-linearity of human history reaching all the way back to the antediluvian civilization of Atlantis.
These questions about Time, and specifically whether it is possible for the future to re-write the past, are at the heart of the debate over free will and determinism. One of the oldest philosophical debates, it is central to at least four of the pieces in this book: “Free Will vs. Logical Determinism”, “Rewriting God’s Plan”, “Changing Destiny”, and “An Introductory Lecture on Ethics.” Readers who are familiar with Prometheus and Atlas will know that my argument for Free Will, which draws heavily on the metaphysics of William James, also featured prominently in that text. Consequently, this concern with the metaphysical preconditions of human freedom, conscientious action, and genuine creativity can rightly be seen as one of the most defining characteristics of my thought. These four essays on free will should leave no doubt that I am, above all, a freedom fighter. It is because, like Zarathustra and Buddha before me, I recognize that superhuman gods are real but unjust and deceptively manipulative that I reject democracy as a political form that is capable of protecting the creative power of the precious individual genius. Democracies will always be instruments of these master manipulators, whether through their direct power over the psyche of the ignorant mob or through their dealings with oligarchs who hide behind the façade of democracy in order to outlast other more forthright forms of tyranny.
My philosophical project ultimately represents a rebellion against all forms of tyranny, including the tyranny of the majority. Its goal is the highest human self-consciousness and the most creative self-determination. One reason that this has not been understood is that my detractors, and those who have defamed me, are not capable of seeing past their own noses. At its deepest and most esoteric level, my thought, like that of Plato or Nietzsche, is scaled to thousands of years of human and post-human evolution. People who think that John Rawls is a philosopher and waste their time writing about him are ants laboring in the shadow of my obelisk. What is written in these pages is not for them. It is for you, lovers of Sophia – all of you, across the ages into the distant future, into the lighthouses of a galactic Alexandria. From Zarathustra onwards, we are all flames of the same undying cosmic fire. We are the glowing forge of futures past.
02:46 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jason reza jorjani, sophia, sagesse, philosophie, traditionalisme, tradition, traditions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 09 novembre 2017
The Youth, Evola and the rise of a true Right
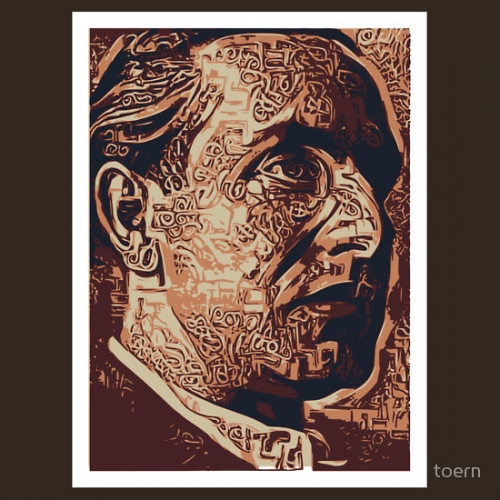
The Youth, Evola and the rise of a true Right
by Thierry Durolle
As traditionalists (1), we believe in the doctrine of cosmic cycles (2) and therefore we know that our present time matches with the last cycle, the one which is known by the name of Kali-Yuga (3). This particular cycle is the darkest one of all four cycles and affects every aspects of life in general. Thus human beings, civilizations and politics cannot escape its corrupting power. This is an important fact to keep in mind.
However, the cycle ends only to start up again with the first one, the Golden age or Krita-Yuga, the dark days leaves room for a new era. Yet in the meantime some of us, the youth, feels the urge for political action but need a strong formation to face the abominations of our post-modern societies. Right-wing is a wide concept after all, as it is the same for the Left. In France – we give this example because we know the situation of this country very well – the Right means ‘Economic Right’, even if it appears sometimes more progressive, sometimes more conservative. Within its scale of principals, the economic principle is always the highest and all the others are subordinated to it. Here is a clear example of a final stage of involution.
The definition of what should be considered the real Right is an imperative task. Among the numerous topics he dealt with through his writings, Julius Evola wrote numerous articles about that question. The Italian philosopher, often reduced to an ‘esoteric fascist’, embodies himself the man of the Right. His writings but especially his deeds made him a living example of the uprightness one would try to attain. The neo-fascist youth of post WW2 Italy was not wrong to seek all the gems herein Evola’s books in order to build its doctrine.
Originally published in Hungarian at the end of 2012 as an anthology of Evola’s articles about the youth and the Right, A Handbook For Right-Wing Youth is now available thanks to Arktos in English. We hope that a french version will see the day sooner or later. Indeed, Evola’s influence on the now famous french Nouvelle Droite and all its heirs (from identitarians to national-revolutionary and traditionalist-revolutionary militants), not to mention the founder of this website Georges Feltin-Tracol (4), contributors Daniel Cologne (5) and ourselves, is simply huge.
A Handbook For Right-Wing Youth contains seventeen texts, mostly press articles but also some excerpts from books like The Bow and the Club and the entire essay Orientations. It includes a foreword by Gabor Vona who is the Chairman of Jobbik and bibliographical notes by Robert Horvath. We also must stress the numerous footnotes and the quality of their explanations. The reader ends up with a handbook intended for militants but also for anyone yearning to discover Julius Evola.
As the title suggests, the two main subjects are the Right and the Youth. The first one was a common topic developed by the author along his writings. In fact the Right follows the Italian writer like his shadow. Julius Evola remains the most political awakener of the Tradition. He always considered himself a man of the Right, he wrote about the Right and his critics and stances outlined a doctrine, even better, a view of the world from the Right:
‘Yet it is also possible to leave all institutional assumptions aside and speak of the Right as a spiritual orientation and worldview. Aside from opposing democracy and all ‘socialists’ myths, belonging to the Right means upholding the values of Tradition as spiritual, aristocratic, and warrior values (possibly with references to a strict military tradition, as in the case of Prussianism, for instance). Moreover, it means harboring a certain contempt for intellectualism and for the bourgeois fetishism of the ‘cultured man’ [...]’ (p.50.).
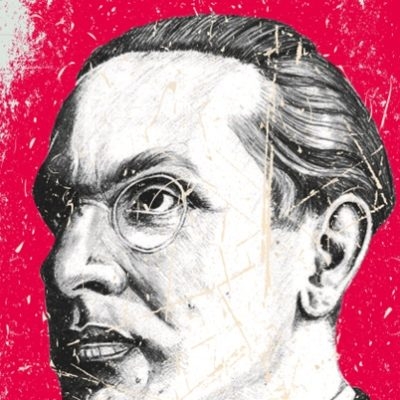
Throughout the different texts herein the book, Julius Evola stresses how the real Right is: anti-egalitarian, anti-materialistic, anti-democratic but spiritual and heroic. In one word traditionalist: ‘In this sense, the concept of Tradition applies to a system in which ‘all activities are in principle ordered from above and have an upward direction’ (p.37.). In addition, Julius Evola aims at the main sources of infection which must be fought according to him (Marxism, Psychoanalysis, existentialism and Darwinism) and give some clues on the cultural domains that the Right should focus on, one of them being the historiography.
About the second subject Robert Harvath points out ‘that the subject of youth was not among Evola’s central concerns; it’s a thin, but visible, line that runs throughout his entire oeuvre’ (p.150.). When writing about the Youth, Julius Evola either encourages an autre jeunesse or, on the contrary, criticizes it. The latter belongs to the average youth so to speak and Evola focused especially his critics on students and beatniks like in Against the Youth or Some Observations on the Student Movement, both featuring in this handbook.
Julius Evola wrote his first post WW2 writings for the young Italian neo-fascist militants. He does not write about what has to be done but how to be:
‘Not letting oneself go is what is crucial today. In this society gone astray, one must be capable of the luxury of having a character. One ought to be such that, even before being recognized as the champion of a political idea, one will display a certain conduct of life, an inner coherence, and a style consisting of uprightness and intellectual courage in every human relationship’(p.1).
‘As spirit there exists something that can serve as an outline for the forces of resistance: it is the legionary spirit. It is the attitude of one who knows how to choose the hardest life, to fight even when he knows that the battle is substantially lost, and to confirm the words of the ancient saga: ‘loyalty is stronger than fire’. Through him the traditional idea is affirmed’(p.7).
‘Inner action must precede all other actions’(p.3).
We believe that these advice are of first-hand importance even if Evola wrote about more strictly political themes like the imperial idea, corporatism, occult war or the ‘demonic possession of the economy’. Some people like Claudio Mutti hastily made Evola an admirer of islam since he positively showed to his readers the warlike mentality of this particular religion and its concept of greater jihad. What he wanted to show (and mostly liked) is this ascetic process, this almost alchemical transformation of oneself to reach something higher. His interests for magic, which he explored in company of Arturo Reghini (6) in the Ur-group, his interest for vamachara tantra or mountaineering are facts that tend to prove our point.
Concerning this collection of texts, we could have appreciated if the last parts of Evola’s Ride the Tiger (6) which consist in a bunch of precepts to be and become in this dark age of Kali-Yuga could have been added. Also, and this would have been a necessary addition according to us, some texts or excerpts from his writings about race, which would have been an excellent correcting concerning racialism.
To conclude, A Handbook For Right-Wing Youth is definitely a must have for any political and metapolitical militants, for every men of the Right in its true essence. We strongly believe that Western societies need a renewal of the Right, not to say a revolution. Gabor Vona pointed out a real problem in nowadays ‘real right’:
‘The tragedy of this situation is that the tools of the Left are infectious. This creates a political catastrophe, which is extremely common nowadays: the landscape of the so-called Right is in reality becoming more and more filled with Leftist ideas, and allows the Left’s borders to approach closer and closer, displaying and mainstreaming the pseudo- or fake Rightism. Of course, this results in total confusion, schizophrenia, and a chaos of ideas’ (p.11. Of the foreword).

This is the greater danger the real Right faces now. National-Bolshevism and nazi-maoism left aside (even if their Third-Worldism was ideologically harmful), we clearly identify a strong ‘leftisation’ of the French Nouvelle Droite (especially of one of its prominent figure Alain de Benoist) and what the mass media names Far-Right. The prevalence of the social and economic question, the critics of liberalism from a marxist perspective and worse, the abandonment of the defense of our people’s race – the number one emergency for most of western European countries – and the will to even avoid such words and topics are true signs of degeneracy. We do not have the time and should not bother analyzing the causes; the fruit is too far rotten. The time to rebuild a true Right is now. Julius Evola’s books and A Handbook For Right-Wing Youth are more than necessary readings in order to set les idées à l’endroit!
Thierry Durolle
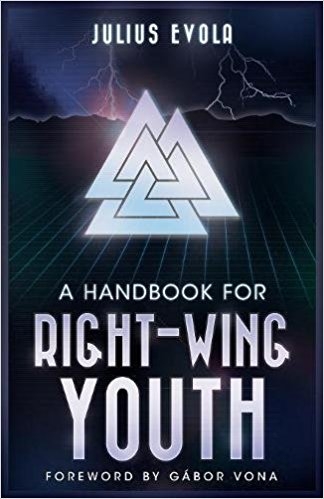 Footnotes:
Footnotes:
(1) By ‘traditionalist’ we mean someone who refers to the meaning of the word explained by René Guénon.
(2) The doctrine of cosmic cycles is often understood as Hindu concept, yet it corresponds to Hesiod’s ages of Man as well.
(3) It is the same than Hesiod’s age of iron or Nordic age of the wolf.
(4) Born in 1970, Georges Feltin-Tracol is the editor-in-chief of the Europe Maxima website as well as the author of numerous books and articles. Being a long time militant for the Greater Europe, he always claimed Julius Evola’s influence on his work.
(5) Born in 1946, Daniel Cologne is a journalist and essayist. He wrote several books about Tradition and worked with the traditionalist magazine Totalité.
(6) Born in 1878, Arturo Reghini was an Italian free-mason and was considered as the most famous Italian Pythagorean.
(7) Julius Evola, Ride the Tiger: A Survival Manual for the Aristocrats of the Soul, Inner Traditions, 2003, 256 pages.
01:40 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : états-unis, altright, nouvelle droite, nouvelle droite américaine, american new right, philosophie, tradition, traditionalisme, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 06 novembre 2017
Le Feu dans la tradition indo-européenne...

Le Feu dans la tradition indo-européenne...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Les éditions Archè ont publié en 2016 une étude de Jean Haudry intitulée Le feu dans la tradition indo-européenne. Spécialiste des langues indo-européennes, ancien professeur à l'Université de Lyon III et ancien directeur d’étude à l'École pratique des hautes études, Jean Haudry est l'auteur de nombreuses études sur les indo-européens, parmi lesquels quelques ouvrages de vulgarisation, dont le Que sais-je Les Indo-Européens (1981) ou, dernièrement, Le message de nos ancêtres (éditions de la Forêt, 2016), destiné aux jeunes adolescents.
"L’étude est consacrée au thème central dont Pensée, parole, action dans la tradition indo-européenne, Archè, Milano, 2009, développait quatre annexes, les feux de la pensée, de la parole, de l’action et du corps, après avoir établi l’ancienneté de la triade et de sa variante principale, et dont Le Feu de Naciketas, paru l’année suivante chez le même éditeur, présentait l’une des figures humanisées. D’autres devraient suivre.
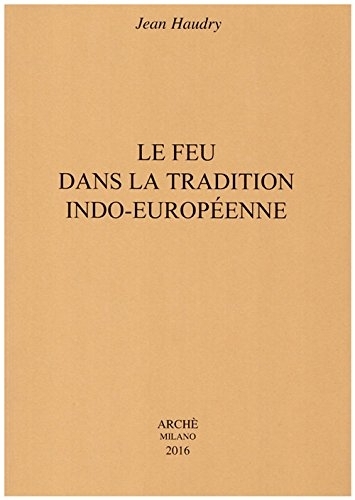 La première partie intitulée « le feu dans le monde indo-européen » étudie successivement les noms du feu, ainsi que le rapport de l’un d’entre eux avec celui du souffle, la place du feu dans le formulaire reconstruit, les motifs, les énigmes, les paradoxes où il figure, dans la triade des couleurs, dans la cosmologie, la cosmogonie, l’eschatologie, les cycles temporels ; ses rapports avec les trois fonctions et les quatre cercles de l’appartenance sociale ; ses divers rôles dans la société et dans le panthéon. Une étude détaillée est consacrée à son emploi dans le culte et aux exemples d’un culte du Feu divin, qui constituent l’objet des deux parties suivantes.
La première partie intitulée « le feu dans le monde indo-européen » étudie successivement les noms du feu, ainsi que le rapport de l’un d’entre eux avec celui du souffle, la place du feu dans le formulaire reconstruit, les motifs, les énigmes, les paradoxes où il figure, dans la triade des couleurs, dans la cosmologie, la cosmogonie, l’eschatologie, les cycles temporels ; ses rapports avec les trois fonctions et les quatre cercles de l’appartenance sociale ; ses divers rôles dans la société et dans le panthéon. Une étude détaillée est consacrée à son emploi dans le culte et aux exemples d’un culte du Feu divin, qui constituent l’objet des deux parties suivantes.
La deuxième partie est consacrée aux divinités féminines du foyer (Hestia, Vesta), aux divinités, en majorité masculines, du feu dont certaines portent le nom (Agni, Ātar), d’autres un ancien qualificatif (Vulcain). Cette partie ne fait que développer dans une perspective diachronique et comparative des conceptions communément admises.
Il n’en va pas de même pour la troisième, consacrée aux « anciens Feux divins ». Elle commence par les Feux artisans comme Héphaistos, et Tvaṣṭar, se poursuit avec le voleur du feu Prométhée. Dionysos y est présenté comme Feu de la fureur, puis du vin, et mis en rapport avec une série de correspondants dont le nom est tiré de la racine qui signifie « croître » comme le Liber pater latin. L’interprétation première de Heimdall et Loki comme anciens Feux divins, solidement étayée, mais abandonnée pour des raisons de mode, est reprise avec de nouveaux arguments. Pour Janus, au contraire, une telle interprétation est propre à l’auteur qui l’a exposée précédemment dans deux articles parus dans la Revue des études latines, « La préhistoire de Janus », REL 83, 2005, 33-51 et « Les feux de Rome », REL 90, 2013, 57-82. Hermès a été reconnu comme un ancien Feu divin par Paul-Louis Van Berg, « Hermes and Agni : a fire-god in Greece ? » Proceedings of the Twelth Annual UCLA Indo-European Conference, 2001, 189-204 ; le chapitre ne fait que confirmer ses conclusions. A ma connaissance, le Dagda irlandais n’a jamais été interprété comme un ancien Feu divin, mais l’un de ses noms, Aed « Feu » plaide en faveur de cette interprétation qui s’accorde avec sa mythologie et avec plusieurs de ses attributs. Le dernier chapitre est consacré à quatre personnages qui représentent le Feu maître ou maîtresse des animaux, rôle qui remonte à la plus ancienne préhistoire. Il s’agit de Rudra « maître des animaux » dans lequel l’Inde brahmanique a vu l’une des formes d’Agni, et de Śiva qui – à tort ou à raison – a été considéré comme son prolongement ; d’Artémis et de son double humain Iphigénie dont le nom, qui signifie « fille de la force », reflète une formule appliquée au feu. Le couple gémellaire que forment Artémis avec Apollon, « loup du vent » selon Daniel E Gershenson, Apollo the Wolf-god, Mc Lean, Virginia, Institute for the Study of Man, 1991 (JIES Monograph Nr.8) et l’équivalence reconnue depuis longtemps entre Apollon et Rudra ramènent à la question essentielle, abordée dès les premières pages, des rapports étroits entre le feu et le souffle.
Ce travail est, de bout en bout, diachronique et comparatif. Il doit s’apprécier dans cette perspective, et non comme une suite de monographies qui, considérées isolément, paraîtraient incomplètes ou paradoxales."
14:51 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean haudry, feu, livre, tradition, indo-européens, mythologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 septembre 2017
Eric Voegelin and the "Orient"
Review: Éric Voegelin et l’Orient: Millénarisme et religions politiques de l’Antiquité à Daech. Renaud Fabbri. Editions L’Harmattan, 2016.
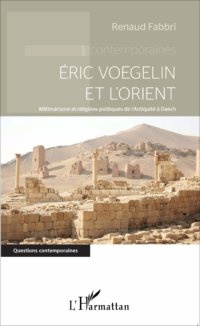 Renaud Fabbri is a professor of political science at l’Université de Versailles. Over the past few years he has been quietly blogging away at a post-secular age, applying the ideas of Eric Voegelin to Hinduism and Islam. Éric Voegelin et l’Orient seems to be his first book and it is a very welcome addition to Voegelinian thought indeed. Just about anyone familiar with Voegelin’s output should be able to admit that what he had to say in relation to India and Islam, two of the most important players in world history, was inattentive at best and perhaps downright woeful, Eurocentric and dismissive at worst. Voegelin was a very prolific thinker, yet one cannot do equal justice to everything one supposes. Happily, Fabbri is seeking to remedy this by charting what he sees as a decline in Hindu and Muslim luminosity into immanentism, nationalism and millenarianism in the form of contemporary phenomena such as Daesh (ISIS) and the Iranian Revolution. As one might expect a great deal of the blame for these eastern “political religions” falls squarely (and rightly) on “Gnostic” influences absorbed from the West during the colonial period: Hegel, Marx, Nietzsche, “process theology”.
Renaud Fabbri is a professor of political science at l’Université de Versailles. Over the past few years he has been quietly blogging away at a post-secular age, applying the ideas of Eric Voegelin to Hinduism and Islam. Éric Voegelin et l’Orient seems to be his first book and it is a very welcome addition to Voegelinian thought indeed. Just about anyone familiar with Voegelin’s output should be able to admit that what he had to say in relation to India and Islam, two of the most important players in world history, was inattentive at best and perhaps downright woeful, Eurocentric and dismissive at worst. Voegelin was a very prolific thinker, yet one cannot do equal justice to everything one supposes. Happily, Fabbri is seeking to remedy this by charting what he sees as a decline in Hindu and Muslim luminosity into immanentism, nationalism and millenarianism in the form of contemporary phenomena such as Daesh (ISIS) and the Iranian Revolution. As one might expect a great deal of the blame for these eastern “political religions” falls squarely (and rightly) on “Gnostic” influences absorbed from the West during the colonial period: Hegel, Marx, Nietzsche, “process theology”.
At 123 pages Eric Voegelin et l’Orient is a very short text. My overwhelming sense when reading it the first time was that it is simply an opening salvo for a much larger and more detailed work we can expect from Fabbri in the near future. Moreover, one can tell Fabbri is a blog writer. Even in producing a monograph he writes in linked short bursts of a few pages on certain important figures in the history of the two religions in question. However, this is not to denigrate the book; rather we should celebrate it for its adventurousness. Fabbri is an abstract and thematic thinker, like Voegelin at his most experimental. Anyone picking up this book expecting something akin to the Voegelinian-Straussian The New Political Religions, written not long after 9/11 on the pneumatopathological history of Islamic terrorism (including its eye-opening essay on the ethics of suicide bombing), is going to be more than a little surprised.[1] Fabbri leaps around, he reads between the lines and conjures up obscure thinkers, both as nodes in the history of the decline of Islamic and Hindu religious experience, and as accessories to aid him in his explorations.
The two most important accessories Fabbri uses besides Voegelin are the French thinkers René Guénon and Henry Corbin, the former of which he uses largely in his discussions on Hinduism and the latter on Islam. Many readers may not be familiar with either of these so perhaps a little explanation is in order. Guénon is the father of an esoteric movement known commonly as Traditionalism or Perennialism. He believed that for all the diversity of the world’s religions, they call contained a transcendental unity of shared truth. Ergo, Guénon was a universalist, a very unpopular opinion in our post-colonial era. However, he was a very eccentric universalist, even for the early 20th century. The basis of Guénonian history is the idea that the cosmos passes through cycles of decline, from all quality and no quantity (=God) to all quantity and no quality. This comes to a final Kali Yuga, a scientistic “reign of quantity”. Finally the world collapses into total atomisation and spiritual decay before another Golden Age begins.[2]
However, this does not tend to make Traditionalists millenarians trying to force the Golden Age to come back. There is of course the exception of far-right outliers such as Julius Evola and Russian “New Rasputin” Aleksandr Dugin, in whom there is at least as much Nietzsche as Guénon.[3] In my experience with Traditionalists (all my teachers when I was an undergrad religious studies student were Guénonians), there is a far more profound sense of a pessimistic acceptance of a pre-determined order to things. There are no “Guns, Germs and Steel”, theories about millenarian “political religions” or Heideggerian blame-Plato-for-the-reign-of-quantity in Guénon.[4] The West simply drew the short straw in a natural cosmic process. Nonetheless, in Guénon’s successor Fritjof Schuon one can certainly find the idea that the West was metaphysically broken from the start because of Greek rationalism, scepticism and materialism. To Schuon Islam and Christianity got more out of the Greeks than they got out of themselves:
“The true “Greek miracle, if a miracle there be – and in this case it would be related to the “Hindu Miracle”- is doctrinal metaphysics and methodic logic, providentially utilized by the monotheistic Semites”.[5]
The aim for the Traditionalist becomes to find what is left of an imagined universal sophia perennis of esoteric truth in Sufism, Hinduism, the Western Hermetic traditions – the part of inferno that is not inferno, so to speak. Thus, as one might imagine, Fabbri seems to believe that the Guénonian narrative of decline can be laid over the Voegelinian narrative of pneumatopathology. There are problems with this, perhaps. Compared with Voegelin’s open-ended “order in history” as the produce of human experiences of social crisis, there is very little metacritical about the deterministic Guénonian historical narrative. All of this is amusingly epitomised by the Guénonian who put me on to Fabbri and his book: “Oh Voegelin? Too historicist for my liking. But then again you have to be if you want the academy to take you seriously.” However, I think that what Fabbri has done, nonetheless, is attempt a highly original experimental dual focus using both thinkers well, yet erring on the side closer to Voegelin and historicity.
Fabbri utilises the ideas of Guénon to patch up what he sees, quite reasonably, as Voegelin’s faults in understanding India. For Voegelin India had never been the recipient of any great historical upheavals, as occurred in the Ancient Near East with the collapse of the ancient cosmological empires. Thus no one ever really had to think about rationalising an order to history. Moreover, because God/Brahman in Hinduism is always atman (the self) and never Other, this also prevented any emergence of a “differentiation in being” to take place. Voegelin writes:
“In the culture of Hinduism, historical consciousness is muted by the dominance of late-cosmological speculations on the cosmos as a “thing” with a beginning and an end, as a “thing” that is born and reborn in infinite sequence. The hypostasis of the cosmos, and the fallacious infinite of cosmological speculation, can be identified as the stratum in the Hinduist experience of reality that has not been broken by epochal events comparable to the noetic and pneumatic theophanies in Hellas and Israel. As a consequence, the Brahmanic experience of reality does not develop the self-consciousness of the Platonic-Aristotelian philosophy as a noetic science; in its self-understanding it is a darshana, a way of looking at reality from this particular thinker’s position… The most striking manifestation of this phenomenon is the nonappearance of historiography in Hindu culture.”[6]
Now, so one might think, to Voegelin all this would be a good thing – none of the dualism and millenarianism that caused the decline of Near Eastern and Western religious experience into secular political religions. However, Voegelin simply seems to snub India as something which never really went anywhere. He shows some passing interest in the Greco-Bactrian cultural exchange, but the only thinker of note is Shankara with his advaitya vedanta. This is perhaps because of similarities between the neti neti (God is not this, not this) of Shankara and the via negativa (negative theology) of the Christian Cloud of Unknowing, which Voegelin initially took to be a Gnostic text, but later came to embrace because of its refusal of “Gnosis”- ultimate positive knowledge.[7] There are other problems, small but niggling. We are never even told by Voegelin whether, as with China and its t’ien hsien (all under heaven), anyone in Indian history ever attempted to symbolise a universal “humanity”.[8] Even more invitingly, as Fabbri (p. 39) suggests, we are left wondering why Voegelin never had anything to say about the great Indian epic the Mahabharata. Let’s hope that Fabbri or someone else in the near future gets around to fixing this. I would love to read such a thing.

Fabbri attempts to turn Voegelin’s remarks on their head. From a Guénonian perspective India’s atman and lack of “historicism” makes it far more spiritually healthy. To Fabbri India represents a more complete primordial view of things, spared from the dualism inherent in monotheism that leads to obsessions with mastery over nature and the millenarian immanentisation of an alien God (pp. 40-1). This only begins to come apart with the introduction of Western ideas during the colonial period (p. 43). Fabbri’s main target of interest is Sri Aurobindo, a British-educated turn of the century figure who reshaped Hinduism towards a progressive view of history – a Hegelesque “integral” view of the world. The whole world comes to be united in a futuristic enlightened communist consciousness emanating from India and its god-man sages (pp. 49-60). Indeed Aurobindo and those like him such as the Theosophists have done a lot of damage to Indian thought. Without them there would have been none of the “New Age” millenarianism of the 60s that the West (and India) came to be soaked in. What is curious, and what Fabbri fails to mention, is that Guénon initially had some enthusiasm for Aurobindo, but eventually realised that his evolutionism was a modern corruption of the traditional Hindu cyclic view of history.[9] However, the supreme sin of Aurobindo for Fabbri is the fact that he transformed Maya, the veil of illusion separating the individuated entity from realising it is part of atman, to Lila, merely the cosmic playfulness of entities coming into being and perishing (p. 57). The phenomenal world becomes a joyous, immanentised plenitude, reminiscent of “process theology”. Such views in my experience are of course extremely prevalent in New Ageism and its gutting of Hindu thought, especially the twee Spinozism of “Deep Ecology”.
This brings us to two curious absences in Fabbri’s take on India. The first is that although he traces the influences of Aurobindo down to modern Indian nationalism and communism and New Age gurus, he does this perhaps too succinctly. For instance, he mentions Radhakrishnan only in passing (p. 48). This thinker not only actively engaged in attempting to square Hindu thought with western progress narratives, science and “process thought”, but also played an enduring part on the international stage as a representative of Indian nationalism.[10] At least something on this figure would have been welcome. The second issue is that although Fabbri (p. 41) mentions the idea of the kalki-avatara, the tenth and final avatar of Vishnu, who is supposed to come at the end of this cosmic cycle to renew the world, he never queries whether even this idea might have come from the millenarianisms of the Abrahamic religions. Some thinkers have certainly asked this before, as also in regard to the closely related legend of the eschatological kalki kings and armies of Shambhala in Buddhism, for which at least some Islamic influence has been posited.[11] Nonetheless, Fabbri (p. 42) is very much right to remind us that there are thousands more years of the to go before any kalki-avatara might be expected. Anyone, especially all those dubious New Age gurus, who claim otherwise, seem testament to the idea that millenarianism should perhaps be called the opiate of the Kali Yuga. Everyone wants out but Great Disappointments keep on coming.
Fabbri then moves from India into tracing a similar history in Islam. In fact India disappears for the rest of the book. This largely seems to be because Islam is a far greater issue in relation to contemporary global politics. Fabbri’s (p. 67) understanding of Islam takes its bearings from two things. The first is the idea that Islam has always been troubled by a “noeud gordien” (Gordian Knot), wherein prophesy and empire-building have had an uneasy coexistence. He attributes the origins of this understanding to Voegelin, which does not actually seem to be the case, though the conception still seems quite valuable. Rather, if we are to look at what Voegelin has to say about Islam in The Ecumenic Age, the results are even more woeful than what he has to say about India. All we get is a couple of pages, most of which are simply block-quotes from the Koran and the declaration that Islam was little more than the combined empire-and-church approach of the Byzantine and Sassanid ecumenai. These, so Voegelin says, formed the “horizon” in which Mohammad thought:

“Mohammed conceived the new religion that would support its ecumenic ambition with the simultaneous development of imperial power. The case is of special interest as there can be no doubt that Islam was primarily an ecumenic religion and only secondarily an empire. Hence it reveals in its extreme form the danger that beset all of the religions of the Ecumenic Age, the danger of impairing their universality by letting their ecumenic mission slide over into the acquisition of world-immanent, pragmatic power over a multitude of men which, however numerous, could never be mankind past, present, and future.” [12]
Whether we are talking about “Gordian Knots” or “sliding over”, for all the briefness of Voegelin’s observations, there would certainly seem to be something profound to work with here. It seems that Islam, like Christianity with its Heavenly and Earthly City, millennium and later its “two swords” of Church and State, was troubled from the moment it began to set down concrete notions of the historical finalisation of the nature of things.
This brings us to the second basis for Fabbri’s history of Islamic spiritual decline – his reliance on the ideas of Henry Corbin (pp. 70, 83-5). Like Guénon, the name of Corbin in not well-known (except perhaps within Islamic mystical circles or in the writing of Norman O. Brown). Corbin was the first French translator of Heidegger, but his main importance comes from his enterprising work on angelology and proposed Zoroastrian influences in Shi’a Islam.[13] Corbin describes the existence of a “mundus imaginalis” (imaginal world) – a medial realm between man and God – peopled by angelic beings. This Nâ-Kojâ-Abâd, “Country of Non-Where”, or “Eighth Clime”, is accessible only through the consciousness and is the organ for the reception of the visions and prophesies that are brought to men from God via the angels. The “imaginal” is not to be confused with modern western understandings of the “imagination”, which largely view this term to mean simply a source for entertaining aesthetic produce or downright falsity. Imagination isn’t “fantasy”. However, so I am tempted to propose, if one looks closely at the history of these two terms their confusion seems to lie in the mediaeval reception of the ideas of Avicenna in Europe. Many tangled arguments ensued over which term meant a purely receptive capacity for external images and inner divine visitations, and which the organ of active creativity from pre-received material.[14]
What both Corbin and then Fabbri do is chart the history of Islam as the history of the decay and forgetting of the angelic reality – the death of ongoing prophesy. As one might imagine Fabbri finds similarities between the medial nature of this “mundus imaginalis” and Voegelin’s metaxy or In-Between and his reading of history as the breaking down of this dynamic experiential system into dualism and then immanentism. Without a “resolving third” full of intramundane spirits and myths one’s ecumene and consciousness becomes very empty indeed. Fabbri also sees this inherent in the discarding of the cult of the gods, the Ishtadevas, in Hinduism by thinks such as Aurobindo. In a later essay I would like to return to such questions in relation to the history of the West and its own loss of angels. However, for now it is more important to emphasise that all this means that both Corbin and Fabbri come down hard on the side of Shi’a rather than Sunni Islam. The root of Islam’s issues is the “tragédie fondatrice” (founding tragedy) of the Sunni-Shi’a division (the fitna), just as much as the “Gordian Knot” of prophesy and empire mentioned above. For the Shi’a, prophesy kept on going to a certain point, depending on how many Imams each faction take to be rightfully guided, up to the Great Occultation of the mahdi – the imam in hiding. For the Sunnis, Muhammad was the “seal of the prophets” and that was that. This means that those claiming to be the recipients of new prophesies and divine knowledge have always had a strained relationship with mainstream Islamic thought.

Fabbri (pp. 74-7) lays out the history of these difficulties through figures such as Al Farabi, whose mixture of Platonism and Islamic revelation produces an image of a proto-Kantean world state ruled by “philosopher kings”. Following Corbin, Fabbri (p. 75) ponders whether Farabi was a “crypto-Shiite” trying to think beyond the Grand Occultation of the last imam. Another important thinker is the Sufi Ibn Arabi who represented the rulers from Adam to Muhammad as God’s representatives on Earth, and those thereafter as simply secular rulers. History instead is controlled from the outside by the saints and angels. As Fabbri (pp. 88-9) notes there is something strongly anti-millenarian and “realist” about this. Yet, at the same time, this descacralisation of the caliphate opens up the space for a “spiritual anarchy” where the secular rulers are unimportant compared with the Gnostic claims of holy men.
The “Gordian Knot” problem leads down to the “presque schmittienne” (almost Schmittian p. 90) political theorisations of Ibn Taymiyya. Here maintaining the sharia and the temporal rule of the Islamic states against heathens becomes the onus. So too is the cult of the saints pejorated as idolatry, leaving no intermediaries or intercessors between man and God. The genesis of Islamism then emerges in a kind of dual spiritual desperation. On the one hand there is the destruction of the Caliphate by the Mongols (and later the collapse of the Ottoman Empire). On the other there in an increasing shutting out and disappearance of prophetic claims and the intercession of saints. What then emerges is a kind of panicked assumption that if the Caliphate is restored, Islamic consciousness then too will be restored to how it was during its early period. Increased persecution of Sufis, attempts to rid foreign corruptions from an imagined pure, original Islam and abject literalism ensue through Abd al-Wahhab, Sayyid ibn Qutb and other prominent thinkers among contemporary Sunni Islamists. Fabbri (pp.91-3), in comparison with The New Political Religions, only gives these influential thinkers a couple of pages and he has nothing to say about Westernised Pan-Arabist movements like Ba’aathism. He remains far more interested in the stranger, more obviously “Gnostic” cases.
Fabbri (pp. 95-101) then descends into the influence of Western political religions on Islam during the colonial period. The most important thinker here is Muhammad Iqbal, who attempted to square Einsteinian cosmology, and the “process” thought of Whitehead and Bergson with Islam, and ends up producing a series of bizarre “Gnostic” visons about modernity. Marx becomes the angel Gabriel of the new age, feminism appears manifest as a monstrous Priestess of Mars. Reading all this strongly reminds me of the way in which in the Soviet Era the old religious and heroic oral epics of “minorities” in the USSR were secularised to replace millenarian heroes such as Geser Khan and his titanic foes with Marx, Engels and Lenin flying through the cosmos battling the fifty-headed hydra of capitalism.[15] The strange syncretism of the old religions and the political religions seems to have got into everything in the twentieth century.

Finally, Fabbri (pp. 103-11) comes to Ali Shariati, Khomeyni and the Iranian Revolution. Fabbri deftly notes the influence of a number of Western thinkers such as Sartre and Marx (“red Shi’ism”) on the formation of these ideas and the degeneration into millenarian theocracies ruled by Gnostic “philosopher kings”. Yet, there is one very obvious absence in his analysis. This is Heidegger. Fabbri mentions Heidegger numerous times throughout Eric Voegelin et l’Orient in connection with globalism, subjectivity, technology and nihilism (pp. 30, 46, 50, 58, 100). However, like his references to Leo Strauss (ie. pp. 99-100), Heidegger is always cited as a kind of minor accessory – one of the “good guys” – but not as important as Corbin, Guénon and of course Voegelin himself. Fabbri does not at all mention how the influential concept gharbzadegi (“westosis/weststruckness”- being infected with western nihilism) from the Iranian Revolution is nearly entirely down to Heidegger’s influence through Ahmad Fardid, who propagated Heidegger’s ideas about cultural “authenticity” in Iran and organised a group of “Iranian Heideggerians” in the 1970s.[16] Fabbri (p.104) in passing names Jalal al-e-Ahmad who popularised the concept, but Ahmad and his Heideggerianism is never dealt with at all.
Heidegger is a very troublesome thinker, far more than the occasional ritualistic hand-wringing about his Nazi period in contemporary continental philosophy usually conveys. Heidegger’s embrace of Nazism has its basis in the idea that the Germans had a unique primordial and “authentic” link with the Greeks and Being, which was under threat by the flattening effects of capitalist and communist nihilism.[17] There is quite a profound legacy to this idea of one’s people possessing an ancient and unique manifest destiny and identity to overcome global nihilism. Shortly after Heidegger’s infamous Rektor speech in 1933, some of the Japanese philosophers of the “Kyoto School” such as Keiji Nishitani, who studied with Heidegger, took this up, replacing Being with the Zen Void, to construct a Japanese imperial manifest destiny.[18] “Reactionary” Heidegger returns in the Iranian Revolution and more recently in the “Fourth Political Theory” of Aleksandr Dugin and his obsessions with building a Eurasian Empire to combat the “post-liberal” monster of globalised American consumer culture.[19] As Foucault said of the Iranian Revolution – it was to be the first great rebellion against the Western “world system”. Just as much as Heidegger, his reputation never managed to live this down.[20] Thus, I think that Fabbri should have expended at least some attention on dealing with the millenarian and deforming aspects of Heidegger’s ideas outside the West.
In comparison, perhaps, as Chinese Heideggerian Yuk Hui has recently shown with his book The Question Concerning Technology in China, which touched upon the uneasy Heideggerian legacy in Dugin and the “Kyoto School”, there might be some hope of using Heidegger’s later ideas to undertake culturally-specific “rememberings of Being” without it all just turning into a “metaphysical fascism”. This possibility is based around re-investigating how imported Western conceptions of technology have covered over the ongoing relationship between Qi and Tao in Chinese philosophy. Knowing the dangers of an emerging China simply repeating Western global empire building and technological nihilism seems to be the first step; to live with technology China must learn to reintegrate it, the world, life and society together into a “cosmotechnics”. One can only hope this doesn’t backfire and we end up with some sort of exceptionalist Taoism with a transhumanist immortality complex.[21] Heideggerian “traditionalism” remains a dangerous animal.
Fabbri draws his book to a close by attempting to consider how to deal with contemporary Islamism. Although one is unsure of his political leanings, he does seem very much aware of the weaknesses of the contemporary left and right in Europe (though it could be America, Australia…) in understanding Islam and its history. To the liberal left Islam is a magical victim, which must be defended at all costs, often to the point of naivety; to the increasingly reactionary right and the actively anti-religious left it is simply anathema – it has no place in Western society (p. 121). Fabbri’s (pp. 116-9) beginning of an answer to this is in the vague hope he seems to find in the figure of Tariq Ramadan, a popular Islamic public intellectual. Ramadan believes that Islam needs to reform the Sharia for the “complexities” of the modern world and understand that there is a “double revelation of God” – the koran and nature.

What is it that Fabbri finds promising about Ramadan? It simply seems to be that he is not necessarily a priori against the ideas from Sufi thinkers (p. 118). This doesn’t really sound like much. Fabbri himself recognises that Ramadan’s attitude towards the metaphysical aspects involved in the nature of modernity and Islam are gravely lacking. Moreover he admits that Ramadan is rather “naïve” in his attempts to square Islam with modern science. All in all to Fabbri (p. 116), Ramadan “illustre bien la vitalité mais aussi les limites de cette literature de résistance au fondamentalisme en terre d’Islam” (illustrates well the vitality but also the limits of this literature of resistance to fundamentalism in the Islamic world). These days there seem to be “Ramadans” everywhere, many far worse than the man himself. Some of them are atheists simply flying the identity politics flag of “cultural Islam”. They people TV talk show panels and public lectures telling everyone of the wonders of some liberal Islamic reformation, which seems to exert almost no influence outside of educated liberal Western circles. As to how the Islamic world might actually go about such a thing, and moreover, how it might do so without losing even more of its spirit than it already has done through the “Gordian knot” and Western influence, seems extremely fanciful.[22] Nonetheless, it seems difficult to consider how the Islamic world might actually go about a renewal of the spirit, and moreover, how it might do so without losing even more of its spirit than it already has done through the “Gordian knot” and Western influence.
Although things might seem rather dark, Fabbri (p. 122) ends his book with the optimistic hope for a “New Axial Age”, a renewal of Islam, Hinduism (and presumably Western traditions too) that might emerge by looking back over their histories and rediscovering the moments of luminosity that produced them. Yet because of the narratives of spiritual decline inherent in Voegelinian and Guénonian perspectives, there might seem no real exit beyond simply enduring “modernity without restraint” as best one can. In the words of Peter Sloterdijk on Voegelin, one of the few popular thinkers to engage with his ideas in recent years: “defences of philosophia perennis in the twentieth century frequently become involuntary obituaries instead.”[23] Here Sloterdijk might as well have been speaking of Guénon. The elephant in the room, however, is whether announcing a new epoch like this is not an act of millenarianism in itself. In light of this one should perhaps recall Georges Sorel’s apt observation that it is pessimist desperation that gives rise to millenarian will-to-deliverance and revolution, not optimistic images of the world.[24] Maybe the best we can do is stay positive about what remains of esoteric tradition, name the devil of millenarianism for what it is, and keep an open mind to different traditions, experiences and ecumenical histories. All in all Fabbri has written an amazing little book, as much as it cannot help but seem to be slightly tinged with obituary. I look forward to finding out more about this “New Axial Age”.
Notes
[1] Barry Cooper, The New Political Religions, or, An Analysis of Modern Terrorism, University of Missouri Press, Columbia and London, 2004.
[2] René Guénon, The Essential René Guénon, World Wisdom, Sophia Perennis, Bloomington, 2009.
[3] Julius Evola, Ride the Tiger: A Survival Manual for Aristocrats of the Soul, trans. Jocelyn Goodwin, Inner Traditions, New York, [1961] 2003; Aleksandr Dugin, The Fourth Political Theory, Arktos, London, 2014.
[4] For an example of just how dependent upon the idea of deterministic primary causes in the narrative of the cosmos Guénonian thought is, compare Voegelin’s conceptions of order and history with this: Fritjof Schuon, The Essential Fritjof Schuon, edited by Seyyed Hussein Nasser, World Wisdom Publishers, Bloomington, Indiana, 2005, p. 181:”…traditions having a prehistoric origin are, symbolically speaking, made for “space” and not for “time”; that is to say, they saw the light in a primordial epoch when time was still but a rhythm in a spatial and static beatitude…the historical traditions on the other hand must take the experience of “time” into account and must foresee instability and decadence, since they were born in periods when time had become like a fast-flowing river and ever more devouring, and when the spiritual outlook had to be centred on the end of the world.”
[5] Fritjof Schuon, The Essential Fritjof Schuon, p. 144. Cf. p. 138 uses the anti-philosophical arguments of the Sufis against the philosophical obsessions with laws of causation and the “outer world”. Here Schuon refers to the “best of the Greeks” as those who saw immanent Intellect at work in the world, but even here he has to emphasise that he believes the Arabic mismatch of Plato, Plotinus and Aristotle was superior because Islamic thinkers considered them holy men and used their ideas as a combined instrument to search for the truth. Also see: Ibid, Art from the Sacred to the Profane: East and West, World Wisdom Publihsers, Bloomington, Indiana, 2007, p. 48. Perhaps an anecdote might shed some light on the occasional habit among Traditionalists to pejorate the “Western tradition” in favour of Hinduism and Islam. Many years ago when my old teacher Roger Sworder hired Harry Oldmeadow for his Philosophy and Religious Studies Department at Latrobe University Bendigo, Australia he asked him one important question over the phone: “What do you think of Guénon and Schuon’s attitudes towards the Greeks?” The appropriate answer that got him the job was “They said Plato was the best the West had available. They didn’t say enough.” Sworder spent his whole life in many ways trying to redeem the Greeks (especially the Neo-Platonic tradition) from a Traditionalist perspective. See: Roger Sworder, Mining, Metallurgy and the Meaning of Life, Sophia Perennis, San Rafael CA, [1995] 2008.
[6] Eric Voegelin, Collected Works of Eric Voegelin Vol. 17: Order in History Vol IV: the Ecumenic Age, University of Missouri Press, Columbia, 2000, p. 394. Cf. Idem, Anamnesis, trans. Gerhart Niemeyer, University of Missouri Press, Columbia and London, 1990, p. 123 on India: “but no historiography.”
[7] Idem, Collected Works of Eric Voegelin Vol. 21: History of Political Ideas Vol. III: The Later Middle Ages, University of Missouri Press, Columbia, p. 177: “the civilizational destruction perpetrated by a peasant group fighting for the perfect realm does not differ in principle from the annihilation of the world content in the…Cloud of Unknowing.” Cf. Eugene Webb, Eric Voegelin: Philosopher of History, University of Washington Press, Seattle, 1981, pp. 28-9.
[8] Eric Voegelin, The Ecumenic Age, esp. pp. 375-6.
[9] Pierre Feuga, “Rene Guenon et l’Hindouisme,” http://pierrefeuga.free.fr/guenon.html#_ftnref25 last accessed: 11th July 2017. Also see: René Guénon, Studies in Hinduism, trans. Henry D. Fohr and Cecil Bethell, Sophia Perennis, Hillsdale NY, 2004, p. 168 where he quotes Aurobindo at length against the Freudian unconsciousness.
[10] See: Radhakrishnan, An Idealist View of Life, Unwin Books, London, 1970.
[11] Mahabharata Vol. II, trans. and ed. by J. A. B. van Buitenen University of Chicago Press, Chicago and London, 1975, Book III. section 188.86-189.12. See: A. L. Basham, The Wonder that Was India, Rupa, Calcutta, 1986, p. 309 which mentions similarities with Christ’s second coming on a white horse as a similarity with Kalki; Zoroastrianism and Buddhism are mentioned as possible sources for the myth too. Wendy Doniger, The Hindus: An Alternative History, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 486-7. On Shambhala, Kalki and Islam see: Alexander Berzin, “Holy Wars in Buddhism and Islam,” Alexander Berzin Archive:www.studybuddhism.com/en/advanced-studies/history-culture...islam last accessed: 19th June 2016; Jan Elvserskog, “Ritual Theory Across the Buddhist-Muslim Divide in Late Imperial China,” in A. Akasoy, C. Burnett and R. Yoeli-Tlalim, (eds) Islam and Tibet: Interactions Along the Musk Road, Ashgate, Farnham UK, 2011, pp. 1-16 and 293-312. On the Soviet use of the Shambhala myth to spread communism: Alexander Znamenski, Red Shambala: Magic, Prophesy and Geopolitics in the Heart of Asia, QuestBooks, Theosophical Publishing House, Wheaton, 2011.
[12] Eric Voegelin, The Ecumenic Age, pp. 198. The koranic quotes are carried over onto pp. 199-201. Perhaps Voegelin didn’t like Islam very much, as is suggested in The New Science of Politics, University of Chicago Press, Chicago, 1952, pp. 139-42 where he uses the term “koran” pejoratively to indicate the Gnostic habit of writing heretical third testaments to biblical history.
[13] Henry Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi, trans. Ralph Manheim, Princeton University Press, Princeton N.J., 1969. Idem, “Mundus Imaginalis, or, The Imaginary and the Imaginal,” Zurich, Spring 1972, available from: https://ia600201.us.archive.org/28/items/mundus_imaginali... last accessed: 6th July 2017.
[14] For a commensurate overview see: Dennis L. Sepper, Descartes’ Imagination: Proportions, Images and the Activity of Thinking, University of California Press, Berkeley, 1996, pp. 19-25.
[15] Jonathan Ratcliffe, “The Messianic Geser: from Religious Saviour to Communism,” Paper delivered at Geser Studies Conference, 23rd June 2016, Buryat Scientific Centre, Ulan Ude. English and Russian versions. http://anu-au.academia.edu/JonathanRatcliffe last accessed: 6th July 2017.
[16] Mohammad Rafi, “Re-Working the Philosophy of Martin Heidegger: Iran’s Revolution of 1979 and its Quest for Cultural Authenticity,” Telos Press, 19th April 2013, http://www.telospress.com/re-working-the-philosophy-of-ma... last accessed: 6th July 2017.
[17] Martin Heidegger, “The Self-Assertion of the German University,” in Richard Wolin, The Heidegger Controversy, MIT Press, London, 1993, pp. 29-39; idem, Nature History and the State 1933-1934, trans. Gregory Fried and Richard Polt, various contributors, Bloosmbury, London, 2015.
[18] Yuk Hui, The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics, Urbanomic, Falmouth, UK, 2016, pp. 241-69.
[19] Aleksandr Dugin, The Fourth Political Theory; Alexander S. Duff, “Heidegger’s Ghosts,” The American Interest 11/5 25th February 2016, http://www.the-american-interest.com/2016/02/25/heidegger... last accessed: 17th September 2016.
[20] Janet Afary and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution, University of Chicago Press, Chicago, 2005. Cf Slavoj Žižek, In Defence of Lost Causes, Verso, New York, 2008, esp. pp. 107-17.
[21] Yuk Hui never talks about transhumanism, but is very much dependent upon Joseph Needham, Science and Civilisation in China Vol II: History of Scientific Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1956. However as noted by one of the most millenarian thinkers of the last century: Norman O. Brown, Life Against Death, Wesleyan University Press, Middletown Connecticut, 1959, p. 311: “But Needham’s enthusiasm for Taoism as a human and organismic response to life in the world must be qualified by recognising that the Taoist perfect body is immortal: Taoism does not accept death as part of life.”
[22] Exemplary is this book: Paul Berman, The Flight of the Intellectuals, Scribe, Melbourne, 2010. This is little more than a kind of rather ineffectual beat-up about Ramadan, all based on his father’s connections with the Muslim Brotherhood rather than the thinker’s own character. The conclusions of its author were simple: replace the public intellectual Ramadan with another, Ayaan Hirsi Ali. What’s so special about Ali? She’s an ex-muslim, she loathes Islam and campaigns against it. Ergo, the only good Islam in Europe (or possibly everywhere) is no Islam.
[23] Peter Sloterdijk, In the World Interior of Capital, trans. Wieland Hoban, Polity, Cambridge UK, 2016, p. 283 n.4.
[24] Georges Sorel, Reflections on Violence, trans. J. Roth and T.E. Hulme, Collier Books, New York, 1961, pp. 34-6.
16:12 Publié dans Islam, Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eric voegelin, tradition, traditions, livre, philosophie politique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 septembre 2017
Le chevalier dans l’imaginaire européen

Le chevalier dans l’imaginaire européen
par Paul-Georges Sansonnetti
Ex: https://www.theatrum-belli.com
Malgré l’envahissement des sociétés modernes et, en conséquence, de l’existence quotidienne par les sciences et les techniques, le chevalier demeure un personnage exemplaire car nimbé d’un prestige qui joint les contingences de l’humain aux orbes de la métaphysique. Prestige qui, dans toute l’Europe et bien au-delà, devait survivre à la disparition de l’ancien régime royal et féodal ou, selon les nations, à sa transformation en monarchie constitutionnelle. C’est pourquoi, par exemple, la République française a le pouvoir de conférer, entre autres, le titre de « chevalier de la Légion d’Honneur ». De plus, à travers notre « vieux continent », comme disent les natifs d’outre Atlantique (qui, eux aussi, associent médailles et chevalerie), des ordres célèbres issus du Moyen Âge – de la Toison d’Or à la Jarretière en passant par Calatrava – existent toujours. Tout cela semble dire que l’image du chevalier manifeste quelque chose de fondamental et, de la sorte, d’indissociable de l’identité européenne.
Dans l’imagination populaire, où se télescopent reliquats de l’Histoire, séquences de cinéma, séries télé et album de B.D. (pardon, de « romans graphiques », selon la dénomination désormais académique), le chevalier est un personnage possédant un ensemble de qualités qui font de lui un être hors du commun, différencié du troupeau de l’humanité ordinaire. À l’exemple de Bayard, « sans peur et sans reproches », on l’imagine prêt à défendre « la veuve et l’orphelin » ; il est le « chic type » qui, semblablement à Martin de Tours, saint patron de notre nation, se montre immédiatement secourable au malheureux quémandant secours. Jadis, il y a trente ans, tout personnage sympathique et courageux qui, de façon fictionnelle ou tangible captivait le public, participait un peu – sinon beaucoup – de la figure du chevalier. Ainsi, sur le petit écran, Tanguy et Laverdure étaient-ils Les Chevaliers du ciel, tandis que le refrain du générique de Starsky et Hutch qualifiait ces policiers de « chevaliers qui n’ont jamais peur de rien ! ». Certes, la comparaison est outrée mais néanmoins fort significative. De façon émouvante, Georges Rémi, alias Hergé, en rédigeant une lettre à son fils Tintin, écrit que la carrière qui attendait ce dernier devait être journalistique mais qu’en réalité elle fut au service de la chevalerie (1). Et même dans l’univers futur que déploie la plus célèbre saga du Septième Art – Star Wars, rassemblant des fans par millions sur toute la planète – l’harmonie et la pax profunda galactique dépendent de l’ordre de chevalerie Jédi.
« CHEVALIER » RIME AVEC « JUSTICIER »
Nous avons brièvement fait allusion aux qualités du chevalier. Trois d’entre elles émergent et caractérisent le comportement existentiel de ce personnage. En premier le courage, ce « cœur » immortalisant le Rodrigue de Pierre Corneille et qui, dans l’esprit des anciens, impliquait aussi la générosité. Le courage se raréfiant, il ne reste du « cœur » que sa synonymie de générosité ; ce qu’illustre « les restos du cœur » à l’initiative de Coluche. Selon le monde médiéval, celui qui n’est pas avare de son sang est obligatoirement généreux. En second intervient la droiture, qualité exigeant que l’on ne transige pas et que symbolise l’épée du chevalier. Puis s’impose l’humilité, car le chevalier véritable s’interdit tout sentiment d’orgueil, toute hubris aurait dit les Grecs par la voix d’Hésiode. Courage, droiture et humilité, ouvrent une brèche dans la densité de ce que d’aucuns, usant d’un néologisme, nommeront l’ « égoïté », le haïssable « moi-je ». Par ces trois notions, le chevalier prend ses distances d’avec « l’humain trop humain », insatiable accumulateur de médiocrité, dénoncé par Fréderic Nietzsche, le « philosophe au marteau ».
Refuser l’hubris et même la combattre farouchement, tant en soi-même qu’à l’extérieur, dans la société, implique de vivre guidé par la diké, c’est-à-dire la justice, affirme encore Hésiode (2). De fait, le chevalier est, par excellence, l’individu qui s’efforce d’avoir en toute circonstance une attitude juste. Gouvernant spirituellement la chevalerie, saint Michel archange tient, comme Thémis, la balance et l’épée. Parce qu’il préside à la psychostasie du Jugement Dernier, la seule référence à sa personne nécessite de se comporter avec équité. Le chevalier est obligatoirement un justicier.
Nous venons de citer Hésiode à propos de ces antinomiques polarités que constituent l’hubris et la dyké. Il nous faut revenir sur ce que cet auteur en dit afin de découvrir l’un des soubassements possibles de la chevalerie. Hésiode considère en effet que l’hubris est symptomatique d’une humanité éloignée de l’Âge d’Or. Toutes les conséquences négatives de cette démesure de l’« égoïté » allaient se précipiter durant le dernier Âge voué au métal du dieu de la guerre, Arès. C’est la raison pour laquelle Zeus, dont Thémis fut une épouse, donna naissance aux héros « ceux-là mêmes qu’on nomme demi-dieux » (3). Les armes à la main, ils œuvrent pour la dyké, même si certains d’entre eux sombrent parfois dans l’hubris (4). Ancêtre d’Héraclès, le modèle même du héros pourrait se nommer Persée. Il annonce les chevaliers de légende en ce que, vainqueur de deux monstres, on le voit brandir l’épée et monter Pégase, le plus mythique de tous les chevaux (5) puisque les ailes dont il est pourvu font que son galop devient un envol. Blasonnant de la tête de Méduse (6), le bouclier offert par Athéna, Persée se révèle un justicier dès lors qu’il renverse la tyrannie que Polydectès exerçait sur l’île de Sériphos et qu’il chassera Acrisios de la cité d’Argos. Le mythe de Persée est apparu d’une telle importance aux yeux des Grecs que pas moins de cinq constellations, sur les quinze principales constituant l’hémisphère boréal, au-dessus du zodiaque, lui sont consacrées (7). C’est également porté par Pégase que Bellérophon affrontera une horreur — et erreur — génétique, la chimère.

LE CHEVAL ET L’ÉPÉE
L’équipement du chevalier pourrait se ramener à sa monture et à l’épée (8). Dans l’ancien monde, tout objet, parallèlement à sa destination utilitaire, pouvait revêtir une signification symbolique. Cette omniprésence du symbole contribuait à une mise en mémoire de ce qui s’imposait comme essentiel, fondamental même, pour les individus et la société qu’ils composaient. Un cheval ou une épée relèvent de l’utilitaire : avec un coursier, on augmente les possibilités de couvrir de longues distances et, par une arme, on peut sauvegarder son intégrité corporelle. Mais l’animal et l’objet se chargent également de significations symboliques explicitant ce que Mircea Eliade nommerait un « changement radical de statut ontologique » (9).
Le cheval, « la plus belle conquête de l’homme » selon un dicton bien connu, permet donc d’aller plus vite et plus loin. Ce qui sous-entend que le dressage de l’équidé confère une capacité à outrepasser le conditionnement temporel et spatial. La monture représente le corps d’un individu – sa composante animale (10) – et l’équitation est métaphorique d’une totale maîtrise des instincts inhérents au corps. La maîtrise, voilà le mot clef. Le chevalier idéal se distingue du commun des mortels ou même d’un simple cavalier par la faculté de se dominer, de posséder le commandement absolu sur son corps et sur le psychisme que conditionne la densité physiologique (11). Ajoutons que le déplacement du cheval s’opère selon un triple mode : le pas, le trot et le galop. Le pas s’accorde au rythme de l’homme et, par conséquent, au monde des corps physiques, au domaine matériel qui nous entoure. Le trot représenterait le monde subtil, celui de l’âme ou, si l’on préfère et pour se rapprocher de l’interprétation des anciens, du « Double », le corps de nature subtile, la « physiologie mystique » (12) dirait encore Eliade. Enfin, le galop qui, métaphoriquement, à l’image de Pégase, faisant que le coursier s’envole, correspond à l’illimité des corps glorieux, là où règne la pure lumière divine (13). Ces trois états résument la constitution de l’être et de ce qui, au-delà du perceptible, appartient à l’éternité.
Celui qui possède la maîtrise qu’illustre l’équitation a le droit de porter une arme, en l’occurrence l’épée. Par la brillance de sa lame, l’épée apparaît métaphorique d’un éclairement car l’acier bien fourbi reflète la lumière et se confond avec. Comme le note Gilbert Durand, cette arme — surtout brandie par un chevalier — se mue en un « symbole de rectitude morale » (14). Dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, le maître d’armes de Perceval, lors de l’adoubement chevaleresque de son élève, lui dit qu’avec l’épée « il lui confère l’ordre le plus élevé que Dieu ait établi et créé, l’ordre de chevalerie qui n’admet aucune bassesse » (15). Gilbert Durand ajouterait que « La transcendance est toujours armée » (16). D’autant plus que dans le symbolisme chrétien, saint Paul nous le rappelle (17), l’épée c’est le Verbe ; ce que confirme saint Jean l’Évangéliste lors de sa vision d’un être au corps glorieux dont le visage ressemblait « au soleil lorsqu’il luit dans sa force » tandis que « de sa bouche sortait un glaive aigu à double tranchant » (18). Le Verbe, autrement dit la parole, ce qui implique l’écriture et les mots qui naissent des lettres, se change en épée ; comme pour dire que, selon l’ancien monde, le langage à la source d’une civilisation est indissociable de la lumineuse rectitude joignant, par l’ethos qu’elle nécessite, l’humain au divin.
Prenant en quelque sorte le relais des helléniques pourfendeurs de monstres, le Christianisme suscite, sous l’autorité de l’Archange de justice, toute une phalange de saints combattants : Georges, Théodore, Victor, si bien nommé, ou encore Véran. À côté de ces bienheureux en armes, le chevalier idéal, tel que le Moyen Âge l’a imaginé et que le monde moderne en rêve encore, s’oriente spirituellement vers une source de clarté divine. D’autant plus qu’à la même époque, passage du XIIè au XIIIè siècle, surgissent les cathédrales gothiques – vouée à la lumière de par la prépondérance des vitraux — et toute une littérature chevaleresque consacrée à un objet illuminant comme l’astre diurne et synonyme de suprême connaissance : le Graal.
Pour les auteurs de ces récits en vers ou en prose, il ne fait aucun doute que le but et l’idéal de toute chevalerie consiste à rejoindre un calice miraculeux. Mais qu’est-ce que le Graal ? Le symbole d’une transformation radicale de l’être, sa rencontre avec le principe divin qu’il porte en lui. Mon regretté maître en Sorbonne, Jean Marx, disait que la signification du Graal était exposée sur une pièce archéologique d’une extrême importance découverte au Danemark et datée du premier siècle avant notre ère. Il s’agit du célèbre chaudron celtique de Gundestrup (19) dont la signification rituelle ne fait aucun doute puisque huit divinités, occupant sa surface extérieure, le situe symboliquement in medio mundi dès lors qu’elles semblent regarder vers les directions cardinales et intermédiaires de l’espace.

Une scène décorant l’intérieur révèle ce que sous-entend la chevalerie. Même si l’image qui va retenir notre attention est très antérieure à l’institution chevaleresque, elle traduit très précisément la symbolique du Graal (20). Cette scène est séparée en deux registres par un motif végétal disposé à l’horizontale. Le registre inférieur montre une file de guerriers s’avançant, sous la conduite d’un officier ou, peut-être, d’un officiant, vers un personnage d’une taille formidable qui les empoignent l’un après l’autre pour les tremper, tête la première, dans un récipient disposé devant lui. Pareil personnage n’est autre que le Dagda (littéralement, « dieu bon »), maître de l’éternité, du savoir total et des guerriers (21). Ce récipient, l’un des attributs du dieu, est le chaudron d’abondance (22), de résurrection et d’immortalité. De cette « trempe », les guerriers ressortent, sur le registre supérieur, d’une part, changés en cavaliers et, d’autre part, casqués : ce ne sont plus de simples fantassins, les pieds en contact avec la terre, mais des êtres que la maîtrise d’une monture emporte en sens inverse que leurs compagnons du registre inférieur. Quant au casque les coiffant, sa signification pourrait être la suivante : de par le fait que la tête de chacun de ces guerriers a été plongée dans le chaudron, ils ressortent le mental désormais protégé, armé, « blindé » pourrait-on dire et, de la sorte, définitivement à l’abri de toute faiblesse (23). Ajoutons que les différents motifs ornant les casques (un oiseau, un sanglier, des cornes de cerf et un cimier en crin de cheval) personnalisent chacun des cavaliers, comme le ferait un blason (24). Cette cavalerie issue d’une seconde naissance – spirituelle – annonce la chevalerie du Graal.
On pourrait dire que, par l’ascèse chevaleresque, se produit intérieurement une distanciation d’avec cette « égoïté » déjà mentionnée. Distanciation faisant éclore des états de conscience que l’ancien monde assimilait à un autre corps, de nature non plus physique, bien entendu, mais subtile. Selon les peuples, on l’a nommé eidolon (dans la Grèce antique), delba (chez les Celtes d’Irlande), hamr ou, sous son aspect supérieur, fylgja (chez les Vikings) et Régis Boyer, approfondissant l’étude de ces deux derniers termes, intitule précisément son ouvrage Le Monde du Double (25). La tradition chrétienne ne fera pas exception puisque l’âme sera perçue comme la duplication immatérielle du corps physique ainsi que, par exemple, le montre un chapiteau de la basilique romane de Vézelay représentant la mort d’un avare. Un petit personnage à l’image du mourant sort de sa bouche, illustrant ainsi la formule « rendre l’âme ».
Ce thème du Double est explicite dans la mythologie grecque avec les Dioscures. Castor, le mortel, accède à l’immortalité par son frère Pollux qui, lui, est immortel. Précision importante, ils patronnent les cavaliers et, au ciel étoilé, constituent le signe astrologique des Gémeaux. Le symbolisme qu’exprime cette figure céleste sera repris par le Moyen Âge puisque Castor et Pollux sont sculptés au portail occidental de la cathédrale de Chartres sous l’aspect de deux jeunes gens qui, par un geste rituel (26), sont positionnés de telle façon que chacun apparaît comme le reflet de l’autre dans un miroir. Ils tiennent devant eux un écu. Un unique écu alors qu’ils sont deux ? Ce qui signifie bien qu’il n’y a en réalité qu’un seul personnage. Plus tardif (XIIIè siècle) que cette sculpture mais s’en inspirant peut-être, l’un des sceaux de l’Ordre du Temple montre deux chevaliers tout équipés montés sur un même cheval (27). Remplaçant l’unique écu, la monture laisse supposer qu’il n’y a en réalité qu’un cavalier mais figuré avec son Double – rendu visible – comme à Chartres. Ainsi que le fit remarquer Gilbert Durand après publication de l’un de mes ouvrages (28), cette image de deux combattants sur la même monture rappelle fortement ce que l’on voit sur deux pièces archéologiques datant de la période des invasions germaniques et découvertes en des lieux éloignés l’un de l’autre (29). Elles montrent exactement la même figuration d’un cavalier renversant son adversaire tandis que, derrière lui sur le cheval, un personnage de taille réduite l’aide à tenir fermement sa lance dans le combat. Ce personnage n’est autre que sa fylgja (littéralement, « accompagnatrice »), terme évoqué plus haut et désignant le Double ou corps subtil d’un être (30).
Durant l’expédition des Argonautes, les têtes de Castor et Pollux furent illuminées par le phénomène appelé « feu de Saint Elme ». Ce qui fait immédiatement songer à la descente du feu du Saint Esprit sur tête des Apôtres lors de la Pentecôte, fête célébrée au début ou, approximativement, au milieu de la période astrologique des Gémeaux. Or, c’est précisément ce moment de l’année que choisit l’enchanteur Merlin pour créer la fameuse Table Ronde destinée à rassembler les meilleurs d’entre les chevaliers. Ainsi que nous l’avons dit dans d’autres études, Merlin pourrait être considéré comme bien autre chose qu’un sage doté d’un prodigieux savoir. On l’a considéré comme l’héritier et le continuateur du druidisme. Disons que, comme son nom latinisé (chez Geoffroy de Monmouth) l’indique, il serait le détenteur de ce que l’on nomme, depuis René Guénon, la Tradition primordiale (31) synonyme d’Âge originel ou, pour se référer une fois encore à Hésiode, d’Âge d’Or.

Ce n’est pas non plus par hasard si Chrétien de Troyes, dans le récit qui inaugure le cycle du Graal, fait arriver son héros, Perceval, dans un énigmatique château — véritable temple de la connaissance suprême — un soir de Pentecôte (32). Là, il assistera au cortège du Graal. Dans diverses études, il nous a été donné de montrer toute l’importance de ce singulier procession où sont portés cinq objets éminemment symboliques. Il ne fait guère de doute que l’auteur de ce récit compose une scène d’une importance extrême permettant d’entrevoir à quelle signification d’ordre initiatique se réfère ce modèle idéal de chevalerie qu’illumine le Graal. Nous en sommes arrivés à la conclusion suivante : par la disposition des cinq personnages qui le constituent, ce cortège stylise la silhouette de quelqu’un se tenant debout et levant ses bras en V, de façon à former un caractère runique, le quinzième de l’écriture germanique de la période des invasions. On pourrait s’étonner du rapprochement que nous établissons entre cette lettre d’un alphabet païen qui avait disparu depuis six siècles au moins et ce conte médiéval tout empreint de religiosité christique. Mais ce serait oublier ce qui a été dit un peu plus haut concernant l’image du combattant chevauchant avec sa fylgja et que l’on retrouve sur le sceau templier. D’autant plus que le caractère runique tracé par le cortège du Graal renvoie à la symbolique des Dioscures version germanique (33), comme le font remarquer d’éminents runologues parmi lesquels Lucien Musset (34) et Wolfgang Krause (35). De plus, Chrétien de Troyes introduit dans ce cortège une composante directement allusive aux Gémeaux. En effet, après le porteur de la lance qui saigne surnaturellement (36), « parurent deux autres jeunes gens tenant des chandeliers d’or pur (…) Ces jeunes gens, qui tenaient les chandeliers, étaient d’une grande beauté » (37). Nous sommes tentés de dire que cette beauté fait songer à Castor et Pollux puisqu’on les représente, nous dit P. Commelin, « sous la figure de robustes adolescents d’une irréprochable beauté » (38).
Si l’on admet que le cortège du Graal stylise à l’extrême la silhouette d’un personnage aux bras levés, le précieux calice occupe la place du cœur. Le Graal étant d’or fin (39), on pourrait dire qu’il évoque l’Âge que blasonne ce même métal. D’une part, le cortège trace la silhouette du Double et, d’autre part, le Graal, en constituant le cœur de cette autre corporéité, annonce la transformation du Double en corps glorieux et, de la sorte, la réintégration de l’Âge d’Or (40).
À travers les images chargées de symboles des récits arthuriens, le but initiatique de la chevalerie consistait à proposer une vision héroïque de l’existence tournée vers l’idée d’une possible restauration des temps primordiaux. Restauration qu’énoncent le Grec Hésiode ou le Romain Virgile (41) et qui, dans l’Apocalypse de Jean, se traduit par l’apparition de la Jérusalem céleste dont le matériaux singulier — cet « or pur, pareil à du pur cristal » (42) – est évocateur de l’Âge originel. Chrétien de Troyes fait allusion au fait que l’Âge comparé au métal solaire reviendra et, ainsi, ensevelira celui voué au Fer ; et ce par l’armure du chevalier destiné à restaurer le royaume du Graal. En effet, Perceval porte un haubert dont les mailles de fer sont recouvertes d’or (43).

L’image du chevalier idéal se présente donc comme indissociables d’un supposé Âge d’Or. Dans l’imaginaire médiéval, ce thème d’un commencement merveilleux fit se confondre le Jardin d’Éden et des données issues du paganisme telles que l’apollinienne Hyperborée ou les îles du Nord du monde du légendaire irlandais (44). C’est probablement la raison pour laquelle la légende envoie saint Brandan découvrir le Paradis terrestre dans une région septentrionale sinon polaire (45). L’éthique chevaleresque pourrait alors être définie comme la tentative de parvenir à cette rupture de niveau ontologique qu’énonce Éliade et qui, tout en suscitant la mémoire des origines, ferait en sorte de préparer à un retour du fondement originel de toute civilisation. Issu de l’Antiquité et repris par le Moyen Âge cette conception de l’existence et de l’Histoire replace l’identité européenne dans un contexte non point évolutionniste mais conforme à ce que l’on pu nommer, avec René Guénon, la Tradition.
Paul-Georges SANSONETTI
- Diplômé de l’Ecole du Louvre,
- Diplômé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes,
- Doctorat de Lettres de 3eme Cycle
————————————
NOTES :
(1) Lettre reproduite dans l’ouvrage de Numa Sadoul intitulé Tintin et moi, entretiens avec Hergé, Editions Casterman (2000), p. 254.
(2) Cf. Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, Editions Maspéro (Paris, 1965), p. 18.
(3) Dans Les Travaux et les Jours, Editions Librairie Générale Française (Paris, 1999), p. 102, vers 157-160.
(4) Ainsi, sous les murs de Troie, pour certains d’entre eux.
(5) Avec Sleipnir (littéralement, « Glissant »), le cheval à huit jambes du dieu scandinave Odinn. Or, Odinn est le maître de la noblesse, classe sociale destinée à incarner la fonction guerrière et, selon les circonstances, à assumer l’autorité spirituelle que confèrent des étapes initiatiques.
(6) On sait que le regard de Méduse, la Gorgone, changeait en pierre les infortunés qui la rencontraient. Persée en la décapitant grâce aux armes divines (le bouclier miroir donné par Athéna et le glaive par Hermès) montre qu’il est capable de neutraliser la pétrification qu’opère cette créature monstrueuse dont, se confondant avec sa chevelure, les nœuds de vipères traduisent un mental horriblement venimeux. Cette neutralisation de ce que l’on nommerait un pouvoir incapacitant donne naissance à Pégase, autrement dit à la jonction entre terre et ciel ou, si l’on préfère, entre les humains (mortels) et les Olympiens (immortels). La sienne (tenant la tête de Méduse), Pégase, Danaé et ses parents, Céphée et Cassiopée.
(8) La lance accompagne souvent l’épée mais sa signification est la même. Dans les deux cas, il s’agit d’une arme droite symbolisant la rectitude.
(9) Dans Le sacré et le Profane, Edition Gallimard (Paris, 1969), p. 156.
(10) Telle est probablement la signification du centaure, créature tantôt négative, l’être prisonnier de ses pulsions animales (on songe à ces centaures ivres qui s’emparent des femmes Lapithes ou encore à Nessus enlevant Déjanire), tantôt exemplaire si les instincts sont totalement maîtrisés (ainsi pour Chiron, initiateur d’Héraclès et d’Achille, devenu le signe astrologique du Sagittaire).
(11) On aura compris que l’équitation est métaphorique du yoga. De plus, la représentation de la Tempérance montre que cette figure féminine tient un mors comme attribut emblématique. Sur ce thème, cf P-G. Sansonetti, Chevalerie du Graal et Lumière de Gloire, Editions Exèdre (Menton, 2004), p. 240 et suivantes.
(12) Dans Le Yoga, immortalité et liberté, Editions Payot (Paris, 1968), p. 239.
(13) Sur un plan iconographique médiéval, ce monde radieux car divin est traduit par l’auréole dorée des saints personnages et par le ciel d’or entourant les figures de la Trinité ou les entités angéliques. Ce même procédé intervient dans les mosaïques byzantines et dans l’art orthodoxes ainsi que dans certaines miniatures persanes ; cf Henri Corbin, Terre céleste et Corps de résurrection, Editions Buchet-Chastel (Paris, 1961), p. 44.
(14) Dans Les Structures Anthropologiques de l’Imaginaire, Editions Bordas (Paris, 1973), p. 189.
(15) Transcription en prose moderne par Jacques Ribard, Editions Honoré Champion (Paris-Genève, 1997), p. 44.
(16) Les Structures Anthropologiques de l’Imaginaire, op. cit., p. 179.
(17) Epître aux Théssaloniciens, 4, 8.
(18) Apocalypse, 1, 16.
(19) Du nom de la localité où il fut mis à jour. Cet objet est conservé au Nationalmuseet de Copenhague mais une réplique existe au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye (dans la grande salle d’archéologie comparée).
(20) Pour une étude plus détaillée de cette scène, nous ne pouvons que renvoyer à notre ouvrage, déjà mentionné, Chevalerie du Graal et Lumière de Gloire, p. 91 et suivantes.
(21) Cf. Françoise Le Roux et Christian-J. Guyonvarc’h, Les Druides, Editions Ouest France (Rennes, 1986), p. 379.
(22) Equivalent celtique de l’inépuisable corne d’abondance dans la tradition grecque. On notera que le chaudron de Gundestrup contient l’image d’un autre chaudron, divin celui-là.
(23) Ce qui n’est pas sans évoquer l’image de Pallas Athéna, toujours casquée car déesse de l’intelligence armée.
(24) A propos de l’oiseau blasonnant le premier cavalier, on a retrouvé dans un site celtique de Roumanie (à Ciumesti) un casque d’apparat surmonté d’un oiseau métallique aux ailes articulées. Peut-être s’agit-il de la représentation d’un corbeau, animal dédié au dieu Lug. Porté par le second cavalier, le sanglier, très fréquent dans l’art celte, relève d’un symbolisme polaire car associé à la notion de terre originelle et de lumière (l’accentuation des soies dorsale évoque une radiance de la colonne vertébrale) ; sur le sanglier, cf. René Guénon, le chapitre XXIV des Symboles fondamentaux de la Science sacrée, Edition Gallimard (Paris, 1965). Le casque du troisième porte des cornes de cerf, emblème du dieu forestier Cernunnos précisément représenté dans la décoration intérieure (et sans doute aussi extérieure) du chaudron. Enfin, le quatrième cavalier arbore un cimier assez semblable à ceux ombrageant les casques grecs ou italiques. Comme il ne peut s’agir que de crin de cheval, le symbolisme renvoie à ce dernier animal consacré à la déesse cavalière Epona. Il n’est sans doute pas inutile de signaler que le motif végétal isolant l’un de l’autre les deux registres possède trois racines qui jouxtent le chaudron ; on nous précise ainsi que pareille figuration s’identifie avec ce que contient et représente le récipient : la « force vitale » (source d’abondance et de résurrection) souvent figurée par l’Arbre Axe du monde qui, marquant l’invariable milieu de toute chose, joint la terre au ciel. Sans doute s’agit-il d’un tel Arbre qui, ici, est stylisé en une simple ligne végétale ramifiée. Si cet Arbre fait corps avec le chaudron, cela signifie que ceux dont la tête est plongée dedans en ressortiront définitivement porteurs de ce que l’Arbre symbolise. La notion de jonction entre l’humain et le divin est donc indissociable de cette « proto-chevalerie » conçue par la tradition celtique. Dans le récit intitulé La Queste del Saint Graal, il est question de passer de la chevalerie terrestre à la chevalerie « célestielle ».
(25) Editions Berg International (Paris, 1986). Cette silhouette aux bras en V est celle du crucifié. Toutefois, l’iconographie chrétienne présente parfois Jésus non point sur la croix mais sur un une sorte d’Y (comme le montre la mitre de Saint Charles Borromeo, dans le trésor de la cathédrale de Milan) ou carrément sur ce qui ressemble fort à la rune quinzième (ainsi, dans l’église San Andrea à Pistoie, sur la chaire en marbre par Jean de Pise, réalisée en 1301 ; ou encore, dans la cathédrale de Cologne, le Christ dit « de la peste » datant aussi du XIVème siècle). On pourrait également citer, du XIIème siècle et légèrement antérieur à l’œuvre de Chrétien de Troyes, sur le tympan du monastère de Ganagobie, la singularité de l’auréole du Christ : au lieu de comporter une croix, cette auréole est marquée par un tracé évocateur de la rune quinze.
(26) Tous deux portent une main à leur épaule : la senestre à l’épaule droite pour le premier et la dextre à l’épaule gauche pour le second. Ils indiquent ainsi la clavicule — du latin clavicula, « petite clef » – comme pour avertir celui qui les contemple que cette sculpture nécessite des clefs de lecture. Le « meuble » héraldique déployé sur leur écu résume tout un processus alchimique reflétant la transmutation de l’homme mortel en un être immortel. En effet, ce meuble est intitulé « rais d’escarboucle » et, en alchimie, l’escarboucle est synonyme de pierre philosophale, le Grand Œuvre sensé conférer l’immortalité.
(27) 0n a interprété le fait que deux Templiers enfourchent un même cheval comme un symbole de pauvreté de l’Ordre. Cette assertion tient d’autant moins qu’à l’époque où ce sceau était en usage le Temple possédait une fortune considérable.
(28) Graal et Alchimie, Editions Berg International (Paris, 1992).
(29) Il s’agit d’abord d’une bractéate en or trouvée à Pliezhausen, dans le Wurtemberg (Allemagne). Le motif qu’elle porte est reproduit de façon répétitive sur le casque découvert à Sutton Hoo, Suffolk (Angletrre), dans la tombe d’un prince anglo-saxon enterré probablement en 625. Le fait que nous soyons en présence de deux représentations exactement semblables montre toute l’importance de ce motif et tendrait à prouver que les artistes (ou artisans) reproduisaient scrupuleusement certains modèles d’inspiration initiatique.
(30) Le mot fylgja est norrois mais il correspond au gothique fulgja et, dans la terminologie concernant ce qu’il conviendrait de nommer, avec Mircea Eliade, la « physiologie subtile » (Le Yoga, op.cit., p. 81), correspond à l’aspect supérieur du Double. On peut voir au Musée de Berlin une tête d’argile très schématiquement façonnée sur laquelle sont répartis cinq caractères runiques formant approximativement le mot fulgja. Comme on peut le lire sous la reproduction photographique de cet objet dans la Mythologie Générale, Editions Larousse (Paris, 1936), p. 247, « cette statuette représenterait sous un aspect concret, la partie immatérielle d’un être vivant ».
(31) Cf diverses études dans lesquelles nous avons montré que ce nom latinisé, Merlinus, occultait la notion de Tradition primordiale ou, ce qui revient au même, de Pôle ; cf., par exemple, notre article consacré au film de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux dans le n° 22 de la revue Liber Mirabilis (saison 2001-2002), p. 34.
(32) Entre autres à l’occasion d’un article intitulé Les symboles dans le cortège du Graal, pour la revue Histoire et images médiévales (Février-Mars 2006), p. 39.
(33) Rappelons que Tacite établit un parallèle entre les Dioscures et les Alci que « l’on vénère comme deux frères, comme deux jeunes hommes » ; chapitre XLIII de De Germania, Editions Les Belles Lettres (Paris, 1967), p. 97.
(34) Dans Introduction à la Runologie, Editions Aubier Montaigne (Paris, 1976), p. 137.
(35) Cf son ouvrage Les Runes, Editions du Porte-Glaive (Paris, 1995), p.36.
(36) Il s’agit de la lance du centurion Longin qui perça le flanc du Christ lors de la crucifixion.
(37) Le Conte du Graal, traduit en français moderne par Jacques Ribard, Editions Honoré Champion (Paris, 1997), p. 70.
(38) Mythologie grecque et romaine, Edition Pocket (Paris, 1994), p. 354.
(39) Vers n° 3233 de l’Edition William Roach
(40) N’oublions pas que le symbolisme chrétien avait incorporé la doctrine des quatre Âges symbolisés par des métaux, à la fois par la connaissance du texte d’Hésiode et par le passage du livre de Daniel où, dans le songe de Nabuchodonosor, il est question de la statue dont la tête est d’or, la poitrine d’argent, le ventre et les cuisses d’airain et les mollets de fer.
(41) Dans ses Bucoliques, quatrième églogue, le poète annonce la naissance de l’enfant qui va « bannir le siècle de fer et ramener l’Âge d’Or (…) Cet enfant vivra de la vie des dieux » ; traduction de M. Charpentier de Saint Prest, Editions Garnier frères (Paris). On sait que Chrétien de Troyes avait lu Virgile, comme le montre le vers 9059 où il cite les noms de Lavinie et d’Énée, personnages de l’Énéide.
(42) 21 – 18, Bible du chanoine Crampon.
(43) « Une(s) armes totes dorees. » dit le texte original ? Vers 40
(44) Il est question, dans le Lebor Gabala, de quatre îles au Nord du monde où se trouvait le chaudron de résurrection et siège de l’enseignement druidique ; cf. Françoise Le Roux et Christian-J. Guyonvarc’h, Les Druides, op. cit., p. 305. Cette thématique d’un lieu mystérieux situé « quelque part » dans l’extrême Nord et qui, singulièrement verdoyant (le nom même de Groenland a suscité des interrogations), serait le siège d’une connaissance supra-humaine rejoint l’ultima Thulé des auteurs grecs et latins, de Pythéas et Sénèque à Virgile qui, dans ses Georgiques (1, 30), situe cette contrée « aux extrémités du monde ».
(45) Le Voyage de Saint Brandan par Benedeit, Edition 10/18, bibliothèque médiévale (Paris, 1984).
16:35 Publié dans Histoire, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : imaginaire européen, chevalerie, chevaliers, tradition, moyen âge, histoire, histoire médiévale, paul-georges sansonnetti |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 02 juillet 2017
LE CYCLE DES FÊTES CELTIQUES
10:01 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditions, tradition celtique, celtisme, mythologie celtique, cycle celtique, liturgie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 juin 2017
L’épée de l’archange saint Michel : ces sept sanctuaires unis par un fil invisible

Une mystérieuse ligne imaginaire unit entre eux sept monastères, de l’Irlande jusqu’en Israël. Simple coïncidence ? Ces sanctuaires sont très éloignés les uns des autres, mais parfaitement alignés. La ligne sacrée de saint Michel archange serait, selon la légende, le coup d’épée que le saint asséna sur le diable pour le renvoyer en enfer.
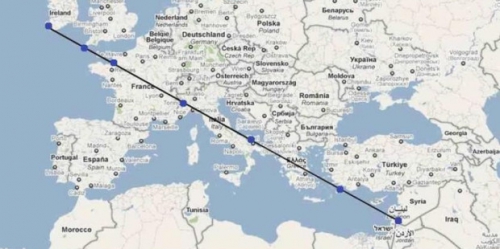
Quoi qu’il en soit, le parfait alignement de ces sanctuaires est surprenant : les trois sites les plus importants – le Mont-Saint-Michel en France, l’abbaye Saint-Michel–de-la-Cluse et le sanctuaire du Mont-Gargan en Italie – sont équidistants. Un avertissement du saint afin que les lois de Dieu soient toujours respectées et que les fidèles restent sur le droit chemin. Par ailleurs, cette ligne sacrée s’aligne parfaitement avec le soleil levant du solstice d’été.

1) SKELLING MICHAEL
La ligne commence en Irlande, sur une île déserte, là où l’archange Michel serait apparu à saint Patrice pour l’aider à délivrer son pays du démon. C’est ici que se trouve le premier monastère, celui de Skelling Michael (« Le Rocher de l’archange Michel »).
2) SAINT MICHEAL’S MOUNT
La ligne se dirige ensuite vers le Sud et s’arrête en Angleterre, au St. Michael’s Mount (« Mont Saint-Michel »), une petite île dans les Cornouailles, accessible à marée basse. À cet endroit-même saint Michel aurait parlé à un groupe de pécheurs.

3) LE MONT-SAINT-MICHEL
Puis la ligne sacrée se poursuit en France, sur une autre île célèbre, le Mont-Saint-Michel, où l’archange Michel serait également apparu. La beauté de son sanctuaire et de l’immense baie qui l’entoure sur la côte normande, en fait l’un des sites touristiques les plus visités de toute la France. Il est inscrit au patrimoine de l’Humanité de l’Unesco depuis 1979. Déjà au temps des Gaules, ce lieu était imprégné d’un fort mysticisme, puis en 709 l’archange apparut à l’évêque d’Avranches, saint Aubert, à qui il demanda de construire une église dans le rocher. Les travaux commencèrent mais ce n’est qu’en 900, avec les moines bénédictins, que l’abbaye fut construite.
4) L’ABBAYE SAINT-MICHEL-DE-LA-CLUSE
À 1000 kms de distance, à l’entrée du Val de Suze, dans le Piémont (Italie), se dresse le quatrième sanctuaire: L’abbaye Saint-Michel-de-la-Cluse (en italien Sacra di San Michele). La ligne droite unit ce lieu sacré au reste des monastères dédiés à saint Michel. La construction de l’abbaye commence vers l’an 1000, mais lui seront ajoutées de nouvelles structures au fil des siècles. Les moines bénédictins l’ont développée en lui ajoutant aussi une dépendance pour loger les pèlerins parcourant la voie Francigena, réseau de routes et chemins empruntés par les pèlerins venant de France.
5) SANCTUAIRE DE SAINT-MICHEL-ARCHANGE
Mille kilomètres plus loin, la ligne franchit les Pouilles et l’on tombe sur le Gargan, où une caverne inaccessible est devenue un lieu sacré : le Sanctuaire de Saint-Michel-Archange. La construction du site remonte à l’an 490, année de la première apparition de saint Michel à saint Laurent Maiorano, l’évêque local.
6) MONASTERE DE SYMI
Puis de l’Italie, la ligne sacrée de saint Michel arrive au sixième sanctuaire, en Grèce, sur l’île de Symi: le monastère orthodoxe de l’archange Michel « Mixalis » abrite une effigie du saint de 3 mètres de haut, une des plus grandes au monde.
7) MONASTERE DU CARMEL
La ligne sacrée se termine en Israël, au Monastère du Mont-Carmel à Haïfa. Ce lieu est vénéré depuis l’Antiquité et sa construction, comme sanctuaire chrétien et catholique, remonte au XIIe siècle.
Article traduit de l’italien par Isabelle Cousturié.
12:44 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : archanges, saint michel, traditions, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 juin 2017
Autonomie et Tradition

Autonomie et Tradition
par Johann Sparfell
Ex: http://www.in-limine.eu
« Il ne faut pas agir et parler comme nous l'avons appris par l'héritage de l'obéissance ». C'est ainsi qu'Héraclite introduisit sa pensée sur l'autonomie, sur l'art d'acquérir un esprit libre. Il est en effet possible et même indispensable de lier la notion d'autonomie de celle d'une éducation au travers de laquelle l'on devient soi-même, l'on s'élève. Il est bien entendu que par là nous pouvons ainsi faire référence à la nécessité d'une affirmation de l'être de l'homme et, comme d'une conséquence, de la propre personnalité de chacun en ce monde. Mais serait-ce pour autant une autorisation prêtée à l'individu d'accroître sans cesse, pense-t-il naïvement, ses prérogatives, dans une « limite » de la liberté d'autrui, afin de se soumettre toujours davantage à l'illusion de la jouissance ? Au nom d'un tel dévoiement de la notion d'autonomie, nous avons en fait appris à renier cela même qui en faisait l'élément primordial de l'existence des communautés et des hommes : la Tradition.
Mais enfin ! Qu'est-ce donc que cette « autonomie » de pacotille dont on nous serine dans nos oreilles les louanges afin de faire de nous des consommateurs « libres » de leurs choix et de leur « vie » ? Bien sûr une illusion, parce que, plutôt que d'être sans limite, elle en a au contraire beaucoup ! Ce n'est point en ce cas une affirmation de soi, mais une affirmation d'une chose extérieure à soi : d'une norme ! Oui, et c'est en cela qu'elle n'est que pure illusion ; il nous faudrait atteindre un certain état par lequel nous nous mettrions en état de suivre un mouvement que nous « participerions » à faire perdurer. « Participer » peut-être ! Mais certainement pas initier. Et encore moins innerver, c'est-à-dire en déterminer le cours, parce que ce mouvement, ce serait nous-mêmes en acte !
La liberté individualiste, que nous confondons aujourd'hui avec l'autonomie, se mêle inextricablement dans la soupe post-moderne avec l'adaptabilité, la flexibilité, la rentabilité, l'utilitarisme, l'esprit d'innovation techniciste et l'instinct de concurrence ; tout ce qui, en fait, permet au Capital, en tant que rapport social, de faire perdurer l'exploitation des ressorts humains au milieu de l'obsolescence de l'homme, et la domination de classe. Cette « liberté » est un statut, un état fixe et idéalisé, un ensemble de dispositions à atteindre au travers desquels les individus gagnent leur vie. La solvabilité en est par exemple un indice de relative réussite : elle ouvre la voie aux jouissances d'une consommation raréfiée. L' « autonomie » qui lui est liée est en ce cas un simulacre en ce sens qu'elle implique, une fois atteinte, de ne se battre que pour s'y maintenir, seul, et en regard des impératifs d'un procès que l'on ne maîtrise qu'à la mesure de nos renoncements.

Elles se situent bel et bien là les limites de ce simulacre d'autonomie : à l'horizon bouchée des impératifs d'un économisme totalisant au noms desquels nous nous transformons en entités mécaniques dont le seul but devient de ne point tomber dans le néant du déclassement sociale. Le modernisme a inventé, par l'absolutisme de l'économisme, une nouvelle forme d'hétéronomie qui a su, comme ses prédécesseurs, se voiler des apparats de l'accomplissement humain et d'une certaine forme de rédemption. Or, se « mouvoir », ou plutôt bouger, par l'incitation de cette forme d'hétéronomie ne se résume dans les faits qu'à faire du sur-place en tentant de maintenir les « misérables » acquis dus à notre soumission à l'ordre accumulatif. Lorsque nous y creusons un peu plus, nous y voyons les racines du ressentiment ; d'un ressentiment que l'on ne pourrait croire issu que de ce que l'autre a pu acquérir à notre place, mais en fait provoqué par l'horreur que nous inspire l'image de la futilité d'une quête qui n'est que course vers le néant : nihilisme ! Par lui, nous nous en voulons à nous-mêmes de ne point savoir exister, signe d'une faiblesse inexcusable et d'un manque de savoir-vivre !
Car l'autonomie, au contraire, est bien d'exister par soi-même : exister, sortir du néant, tout simplement, sans artifice, sans préjugés. L'autonomie n'est pas une fixation en un état supposé idéal malgré qu'elle implique de savoir se donner des limites, des lois, par soi-même. Elle est une dynamique, un processus jamais parfaitement accompli d'auto-détermination. Si l'hétéronomie économiste est un effort d'adaptation à un procès dans lequel il s'avère absolument nécessaire de s'intégrer pour « exister », tout en étant un rapport social de domination en sous-main, l'autonomie est une participation à un flux vital dont l'assomption invite l'être à se fonder en soi-même en tant qu'être libre de sa propre détermination : il s'agit en ce cas d'une intégration dans un tissus de relations communautaires par lesquelles l'on coopère à son propre destin et à celui de son environnement – tant humain que naturel ou artificiel.

L'hétéronomie économiste est une fixation. L'homme échappe ainsi à son devenir, sa responsabilité, en s'enfermant dans un éternel présent, qui s'avère en réalité être un piège vers une néantisation – l'éternel présent, ou le règne de l'immédiateté, est un univers carcéral où l'horizon se résume en une fuite perpétuelle vers un futur idéalisé qui n'est en réalité qu'adhésion, au sens premier du terme. Plus rien ne fait lien dans un monde où domine une dépendance totale à des impératifs quantitatifs, ni les hommes entre eux – car tous concurrents les uns des autres – ni le passé d'avec l'avenir – car l'un et l'autre sont devenus absolument contradictoires. Se donner ses propres règles, selon la définition de l'autonomie, ce n'est nullement se laisser enfermer selon une prescription commandée par une appartenance de classe ou autres dans une actualité sans fin. C'est fort au contraire dépasser l'actualité afin de donner corps à une connivence toujours possible, toujours souhaitable, entre le passé et l'avenir : participer par conséquent au recouvrement d'un lien intime entre les deux.
Plutôt que dans le temps, qui est une constante projection vers l'au-delà du réel, ce qui nous rend absolument dépendants du règne de la mesure temporelle, nous devrions nous inscrire dans la durée, qui est une possibilité perpétuellement donnée de pouvoir affirmer son être. Chaque être est en fait une durée singulière, un devenir qui s'étire de son origine à sa finalité, mais s'inscrivant toujours inévitablement dans une plus longue durée au sein de laquelle il devient un transmetteur, le dépositaire d'une traditio. La longue durée est une suite indéfinie d'événements, un processus global du devenir des civilisations, chacune d'elles imbriquée dans le devenir de l'humanité, et où demeurent les archaïsmes : « ce qui ne passe pas » et que l'on tient en réserve afin de dépasser sa propre condition initiale. Les durées singulières se lient les unes aux autres, transposent d'une génération à l'autre le socle sur lequel chacune participera à bâtir l'histoire à sa façon. Et pour ce faire, il est indispensable de pouvoir réellement exister ! Qu'est-ce à dire ? Que chaque homme, chaque communauté, doit pouvoir construire sur de bonnes bases ses propres règles, donc être autonome et ne plus dépendre de l'arbitraire des dogmes.

L'existence est une élévation, l'acte de se mettre debout et d'affirmer la singularité de son être au milieu de la pluralité contradictoire de ce, et de ceux qui nous entourent. Exister, réellement, a à voir avec l'autonomie ; c'est un acte de volition qui est la condition même de la réalisation de l'autonomie. Lorsque nous nous mettons à exister « pleinement », non de façon désobligée comme aujourd'hui – l'individualisme ne nous engage plus à rien -, nous nous en tenons à une affirmation qui repose en premier lieu et qui a toute chance de pouvoir prendre son essor à partir d'un socle commun. L'existence est un passage : celui du non-être à l'être au croisement du passé et de l'avenir, où règne l'infini et la négation, l'éternel présent – mais ne s'y attardent que les aventuriers de l'esprit, s'y perdent les autres... les insensés ! -, ce qui implique de devoir y adjoindre un sens. L'existence est une dynamique en quelque sorte, dont l'élément moteur est la Tradition : le « socle » commun. Un « élément » dont la primordialité n'a d'égale que le sens qu'Elle apporte aux hommes et à leurs œuvres, un sens partagé de génération en génération par lequel le monde se voit doté d'une signification sacrée en une « durée » où se déploie l'existence, l'indéfinité des existences influant les unes sur les autres en de multiples « écosystèmes ».
La durée dans laquelle nous nous inscrivons est une épaisseur qui est celle des interrelations par lesquelles il nous est donné de pouvoir construire nos autonomies, tant personnelles que communautaires ; en d'autres termes donc, exister, à chaque instant qu'il nous est donné de pouvoir vivre par soi-même ! A contrario du temps, linéarisé par les besoins d'une foi toute basée sur un type d'homme, que l'on peut s'imaginer telle une meurtrière à travers de laquelle l'on n'a la possibilité de n'apercevoir qu'une frange étroite de la réalité : celle d'objectif qui recule sempiternellement à chaque minute.
La quête de l'autonomie est en nous comme un besoin vital de réaliser notre vie, d'être pleinement nous-même en accord avec le monde. C'est une dynamique qui se prolonge durant « mille vies » et nous transpose à chaque point de cette durée du non-être à la grâce d'être – dynamique symbolisée par la Croix, l'un des plus vieux symbole en ce monde. Elle est le Mythe, le mythos primordial que ne vient pas de l'homme, mais qui néanmoins perdure en l'homme et le fait être tel lorsqu'il en ressent le devoir, c'est-à-dire tant qu'il a en lui ce désir de s'affirmer pour le bien commun de ceux par qui, et quoi, il existe. Elle est en fin de compte l'expression « vitale » de la Tradition Elle-même, son souffle sacré par lequel les mondes se constituent et se succèdent, prennent sens et épaisseur.

Mais qu'est-ce donc qu'être autonome sinon être soi-même, devenir soi-même, simplement, parmi les autres ? Être un esprit libre comme ont su le dire Héraclite, Montaigne ou Nietzsche, un « barbare » - un être « simple » - en chemin vers la maîtrise de son existence qui se réfère en toute humilité aux leçons et expériences accumulées par les générations qui l'ont précédées. C'est un accomplissement qui se réalise au nom d'une notion de Bien Commun, d'une notion secrètement portée par la Tradition et qui ne peut dépendre que d'un minimum de préjugés sur l'homme et la nature a contrario du respect de la parole donnée. Comme le disait S. Weill, la vérité est enfouie dans le silence des humbles ; la Tradition y a toujours trouvé son ultime refuge. La Tradition est un appel intemporel pour l'homme à s'extraire et s'élever par lui-même, de par ses propres forces, au-delà du magma informe de l' « indifférencié civilisateur » - j'entends par là la tendance historique à la standardisation massificatrice du processus civilisateur dont le marxisme orthodoxe et le néo-libéralisme, qui sont si proches l'un de l'autre dans les faits, en sont les portes-voix modernes -, donc des préjugés et des « héritages de l'obéissance ». Elle est une Connaissance qui engage à l'empathie, donc à l'autonomie.
Que pourrions-nous en conclure en somme ? Que la Tradition, loin d'être une sommation à l'inertie et l'impuissance, est fort au contraire une invitation au développement indéfini de nouvelles manière de « voir » le monde et de le faire nôtre, consciemment. Elle n'est pas une vérité imposée d'une « hauteur » inatteignable mais l'invitation à la recherche constante de la vérité. La Tradition est ce qui ne passe pas, telle une clef intemporelle qui est à même de nous élever à la com-préhension, à la lucidité « raisonnable », de ce qui agit dans le monde au travers de nos êtres et constitue celui-ci à chaque instant, à chaque époque singulière. Loin de pouvoir être interprétée Elle-même telle un carcan ou une « vérité » irréfutable sur l'homme, Elle constitue ce qui au contraire peut nous apporter en tout temps la conscience du devoir de construire nos autonomies, celle de la personne comme celle de ses communautés, afin de toujours pouvoir faire surgir, in limine, la nécessité de concevoir un sens commun au milieu de ce qui n'est, en vérité, que chaos, mais chaos riche d'une multitude de possibilités de créations, mais aussi de destructions. Elle est en somme, la richesse des possibles contenue dans l'existence et qu'il nous appartient de mettre à jour à chaque instant de l'histoire, en faisant l'histoire : en composant de nouvelles harmonies, en donnant du sens à nos vies. Elle est un socle bâti par la multitude d'expériences accumulées par l'homme sur lui-même et son devenir...

La Tradition accompagne donc la marche de l'histoire, en lui donnant l'ouverture indispensable vers l'ensemble des possibles et des révolutions ; Elle ne saurait par conséquent représenter pour l'humanité éveillée un système clos sur lui-même, une injonction théorique idéalisée dans un système religieux, « politique » ou philosophique : « La transformation de l'activité théorique en système théorique qui se veut fermé c'est le retour vers le sens le plus profond de la culture dominante. C'est l'aliénation à ce qui est déjà là, déjà créé ; c'est la négation du contenu le plus profond du projet révolutionnaire, l'élimination de l'activité réelle des hommes comme source dernière de toute signification, l'oubli de la révolution comme bouleversement radical, de l'autonomie comme principe suprême ; c'est la prétention du théoricien de prendre sur ses propres épaules la solution des problèmes de l'humanité. Une théorie achevé prétend apporter des réponses à ce qui ne peut être résolu, s'il peut l'être, que par la praxis historique. Elle ne peut donc fermer son système qu'en pré-asservissant les hommes à ses schémas, en les soumettant à ses catégories, en ignorant la création historique, lors même qu'elle la glorifie en paroles. Ce qui se passe dans l'histoire, elle ne peut l'accueillir que s'il se présente comme sa confirmation, autrement elle le combat – ce qui est la façon la plus claire d'exprimer l'intention d'arrêter l'histoire. »1
Yohann Sparfell
Note:
1Cornélius Castoriadis in L'institution imaginaire de la société, éd. Du Seuil, 1975, p. 101
09:55 Publié dans Définitions, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, tradition, autonomie, définition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 mai 2017
Renaissance des Konfuzianismus oder warum die Chinesen weltweit so erfolgreich sind
00:05 Publié dans Actualité, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, confucius, confucianisme, asie, affaires asiatiques, politique internationale, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 mai 2017
L'alchimie spirituelle de Julius Evola et la tradition hermétique
00:55 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, tradition, traditionalisme, italie, tradition hermétique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 26 mars 2017
The Power of Myth: Remembering Joseph Campbell

The Power of Myth:
Remembering Joseph Campbell
(March 26, 1904 - October 30, 1987)
By John MorganJoseph Campbell, the famed teacher of comparative mythology, was born on this day in 1904. For many people, including yours truly, he has served as a “gateway drug” into not only a new way of looking at myths, but into a non-materialistic way of viewing the world. And although as a public figure, Campbell mostly remained apolitical, evidence from his private life indicates that he was at least nominally a “man of the Right.”
Campbell was born into an Irish Catholic family in White Plains, New York. He attended Dartmouth College, and then later, Columbia University, where he studied English and medieval literature. He was not strictly a bookish type, either, being an accomplished athlete, and in fact during his time at Dartmouth he was considered to be among the fastest half-mile runners in the world.
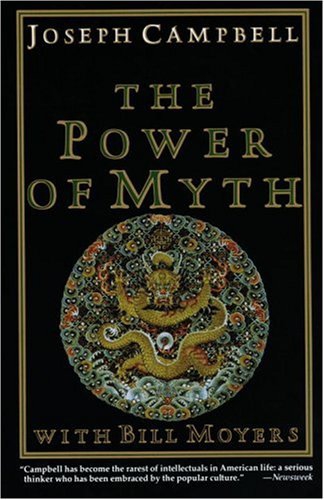 It was during his travels to Europe and Asia during the 1920s and ‘30s, as well as a great deal of wide reading while living in a shack in Woodstock, New York, that Campbell developed his interest in world mythology. He also discovered the ideas of C. G. Jung, which were to profoundly influence all of his work. Indeed, he participated in many of the early and historic Eranos conferences in Switzerland alongside not only Jung himself, but such luminaries as Mircea Eliade, Karl Kerényi, and Henry Corbin, among many others. In 1934 Campbell was hired as a professor at Sarah Lawrence College in New York, a position he was to hold until his retirement in 1972, after which he and his wife moved to Honolulu, Hawaii.
It was during his travels to Europe and Asia during the 1920s and ‘30s, as well as a great deal of wide reading while living in a shack in Woodstock, New York, that Campbell developed his interest in world mythology. He also discovered the ideas of C. G. Jung, which were to profoundly influence all of his work. Indeed, he participated in many of the early and historic Eranos conferences in Switzerland alongside not only Jung himself, but such luminaries as Mircea Eliade, Karl Kerényi, and Henry Corbin, among many others. In 1934 Campbell was hired as a professor at Sarah Lawrence College in New York, a position he was to hold until his retirement in 1972, after which he and his wife moved to Honolulu, Hawaii.
Interestingly, in regards to the Second World War, Campbell was a fervent non-interventionist (like his friend, the poet Robinson Jeffers [2]), even in the wake of the Pearl Harbor attack, and in fact gave a public lecture at Sarah Lawrence three days afterwards in which he urged his students not to get caught up in war hysteria and to pursue their educations instead of joining the military. He felt passionately enough about this matter to send a copy of his lecture to the German novelist Thomas Mann, who at the time was working to convince Americans to join the fight against the Third Reich as an exile in California. (Mann sent him a quite angry reply.) And according to Campbell’s biographer, Stephen Larsen, in his journals he comes across as an early Pearl Harbor conspiracy theorist, pointing out that the Roosevelt administration had been trying to goad the Japanese into war for years and discussing the fact that the US Navy had received indications that the Japanese were about to attack in the days prior, but that these warnings were ignored – perhaps deliberately.
While Campbell gave frequent public lectures and published many books, including The Hero with a Thousand Faces [3] in 1949, which was the most thorough overview of his essential ideas, and his four-volume The Masks of God [4] opus, which appeared between 1959 and 1968, in which he attempted to summarize all of the world’s mythologies, he remained relatively obscure outside academic circles until late in his life. His later fame is largely attributable to the endorsements he received from two of his biggest fans. One is Jerry Garcia of the Grateful Dead, who invited Campbell to observe a concert [5] they gave in Berkeley, California in February 1985. (Campbell reported that he was impressed by the event, comparing it to the ancient Dionysian festivals and Russian Easter celebrations.) In November 1986, Campbell and Garcia shared a stage at a conference [6] at UC Berkeley. The other is George Lucas, who frequently cited [7] Campbell’s conception of myth in interviews as being one of his primary inspirations in his writing of the Star Wars films. Indeed, in the 1980s Lucas invited Campbell to come to his Skywalker Ranch to view the entire trilogy (Campbell gave it somewhat guarded praise), and also helped to arrange the most crucial factor in securing Campbell’s late fame: Bill Moyers’ The Power of Myth [8] series.
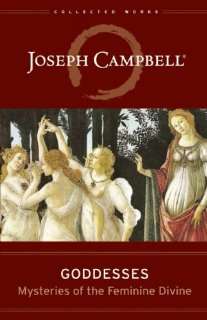 Moyers, a well-respected figure in broadcasting, filmed a series of interviews with Campbell during the mid-1980s, mostly at Skywalker Ranch, that were edited into six one-hour episodes and broadcast on PBS in 1988, along with an accompanying book of the same name [9]. The series introduces and details Campbell’s ideas in a very accessible and entertaining way. It proved to be very popular, both during its original airing as well as in reruns and on video, and cemented Campbell’s reputation as an influential and respected intellectual in the American popular consciousness. Sales of Campbell’s books began to skyrocket as well. Unfortunately, he himself didn’t live to see any of this, as he had passed away the previous year, but he left behind a large body of work in which he had already presented his fully-articulated worldview.
Moyers, a well-respected figure in broadcasting, filmed a series of interviews with Campbell during the mid-1980s, mostly at Skywalker Ranch, that were edited into six one-hour episodes and broadcast on PBS in 1988, along with an accompanying book of the same name [9]. The series introduces and details Campbell’s ideas in a very accessible and entertaining way. It proved to be very popular, both during its original airing as well as in reruns and on video, and cemented Campbell’s reputation as an influential and respected intellectual in the American popular consciousness. Sales of Campbell’s books began to skyrocket as well. Unfortunately, he himself didn’t live to see any of this, as he had passed away the previous year, but he left behind a large body of work in which he had already presented his fully-articulated worldview.
As is frequently the case with prominent white men who don’t pay the proper lip service to political correctness, it wasn’t until after Campbell’s death that some of his former colleagues and acquaintances began to come forward with accusations of racism and anti-Semitism. This charge first appeared in an article by Brendan Gill in the September 28, 1989 issue of The New York Review of Books entitled “The Faces of Joseph Campbell [10],” in which he cited purely anecdotal evidence to support his claim that Campbell had been an anti-Semite, including Campbell’s stance on the war as well as the fact that he had praised the Germanic Jung while disdaining the Jewish Freud, and the fact that he had evinced a love of German culture as well as a general dislike of the Abrahamic religions in his work – all of which is undeniably true.
In the letters [11] that were printed in response, some came to Campbell’s defense while others pressed the attack, including a Sarah Lawrence colleague who claimed that Campbell had reacted to the racial integration of the school with horror. (Although again, no evidence for this was ever produced.) His sympathetic friends indicated that Campbell never tried to hide his conservative sympathies, and pointed out that the fact that Campbell was sympathetic to German and “pagan” cultures while disdaining Judaism and Christianity was hardly evidence that he had been a racist. Nevertheless, these charges have overshadowed Campbell’s work ever since, even if they have had no noticeable impact on the popularity of his work. (I first became aware of the controversy shortly after discovering Campbell, sitting at a restaurant in Ann Arbor, Michigan in 1995, when a passing waiter noticed that I was reading The Hero with a Thousand Faces and felt compelled to ask me, “Reading Joseph Campbell, the ol’ anti-Semite, huh?” I later learned that the waiter was a grad student at the University of Michigan.)
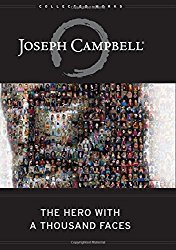 Regardless of whether these accusations are true or not, they follow a pattern that is typical for any artist or scholar who refuses to tow the party line. If Campbell had been engaged in “deconstructing” mythology, and showing that the Mahabharata or the Arthurian legends were nothing more than “narratives” expressing patriarchy and sexual repression for example, his personal failings in the eyes of academia would have been ignored. Surely what really bothers academics about Campbell, as well as about scholars with a similar worldview such as Jung, Mircea Eliade, or René Guénon, is that they dared to assert that there is an essential meaning to things, which of course then implies that there may actually be such a thing as values and traditions that are worth preserving.
Regardless of whether these accusations are true or not, they follow a pattern that is typical for any artist or scholar who refuses to tow the party line. If Campbell had been engaged in “deconstructing” mythology, and showing that the Mahabharata or the Arthurian legends were nothing more than “narratives” expressing patriarchy and sexual repression for example, his personal failings in the eyes of academia would have been ignored. Surely what really bothers academics about Campbell, as well as about scholars with a similar worldview such as Jung, Mircea Eliade, or René Guénon, is that they dared to assert that there is an essential meaning to things, which of course then implies that there may actually be such a thing as values and traditions that are worth preserving.
I first discovered The Power of Myth series on video at my local library in 1995, during a period when I was looking for a new sense of direction and meaning in my life. I was 22, and like most Americans I had been educated in a strictly materialist way of understanding things. For the previous few years I had regarded myself as a Nietzschean, existentialist atheist (in spite of the fact that I only half-understood either Nietzsche or the existentialists). But I soon found this stance to be insufficient as I grew into adulthood and began to better understand the complexities of the human condition. It was my discovery of Colin Wilson, who I have written about elsewhere [12], and Campbell at this time (and through the latter, his own guru, Jung) which persuaded me that there is more to reality and living than what can be known through the five senses. Although I later moved on to other teachers and interests who in some ways surpass them, I will always owe a debt of gratitude to these two figures for “converting” me to something other than a model of a modern major materialist.
The Power of Myth struck me as a revelation, and it caused me to seek out Campbell’s books as well. Like most of us these days, I had always thought of myths as nothing more than quaint stories with some sort of simple moral lesson to be gleaned. Campbell contended that these myths are in fact reflections of a much deeper reality, one that is both metaphysical and which is reflective of deep psychological processes in our unconscious that transcend the individual and are connected to our racial memory. Even more importantly, Campbell first showed me that meaning was in fact anchored in something outside of ourselves, which was certainly very different from what I was being taught in most of my literature classes at the University. I soon began to see everything from a Campbellesque perspective, and I doubt I could have mustered the enthusiasm to finish my degree were it not for the inspiration I derived from him.
The center of Campbell’s worldview is the idea of what he termed the “monomyth.” It posits that underneath all of the world’s mythologies, there is a single structure which they all more or less follow. This structure is timeless, as it is embedded within our consciousness, and can be found in the best modern art and literature – Campbell himself was particularly fond of James Joyce, and in fact the term monomyth itself is derived from Finnegan’s Wake [13] – as much as in the ancient myths. Campbell believed that this monomyth was the expression of the single metaphysical reality which lies hidden behind the mere appearance of things, and that each culture and era develops its own stories to express this unchanging reality. In this sense, he shares some commonality with the traditionalists such as Guénon and Julius Evola. I don’t know of any place where the traditionalists have commented on Campbell directly, but surely they would criticize him along the same lines for which they criticized Jung: namely, that he understood myths as merely containing psychological symbols and “archetypes,” and as depictions of psychic processes, rather than as expressions of an objective reality (this is a complaint that a “true believer” in any religion could make against the Jungian conception of myth).
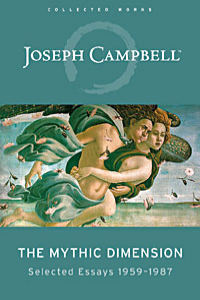 Surely a large part of the success of The Power of Myth, as it certainly was in my case, was due to the fact that Campbell comes across in his recorded interviews and lectures as an extremely likeable man with a gift for communicating complex ideas and stories in simple language. He was the very embodiment of your favorite teacher, who (hopefully) turned you on to the wonders of the world of ideas and filled you with the fiery passion to learn more about a particular subject. Like the very best teachers, what you learned from him only marked the starting point in a long odyssey that ended up leading you to other ideas and other destinations in life.
Surely a large part of the success of The Power of Myth, as it certainly was in my case, was due to the fact that Campbell comes across in his recorded interviews and lectures as an extremely likeable man with a gift for communicating complex ideas and stories in simple language. He was the very embodiment of your favorite teacher, who (hopefully) turned you on to the wonders of the world of ideas and filled you with the fiery passion to learn more about a particular subject. Like the very best teachers, what you learned from him only marked the starting point in a long odyssey that ended up leading you to other ideas and other destinations in life.
There are certainly many criticisms one can make of Campbell’s conception of things. In addition to the traditionalist objections already mentioned, some scholars have said that not just Campbell’s, but all efforts in the fields of comparative mythology and comparative religion, are flawed in that they emphasize the commonalities between all of the world’s traditions at the expense of the particularities which distinguish them, thus positing a false universalism. There may be some truth in this, but at the same time it seems to me to be symptomatic of the general postmodern disregard for anything which asserts that there is an essential meaning to things. After all, how can a three-thousand-year-old story from ancient Greece teach a present-day American anything more than a Toni Morrison novel can? In fact, those old stories may actually be detrimental, given that they posit a way of life that reinforces old social orders rather than emphasizing the need for racial equality or the fluidity of gender.
At his post-war trial on the charge of promoting Fascism, Evola said about his beliefs, “My principles are only those that, before the French Revolution, every well-born person considered sane and normal.” I suspect that Campbell believed something similar, even if he never couched it in language that was quite so incendiary. When we look at the ancient stories, whether they are European, Indian, Chinese, Native American, or whatever, there is certainly a common outlook there which directly challenges the norms and values which we have come to accept as normal in the modern world.
And this, perhaps, is Campbell’s ultimate value from our point of view. There are certainly greater scholars of myth and religion to read. But especially for newcomers, he can open up the world of primordial, timeless, pre- and anti-modern wisdom that still lurks deep within our souls and continues to shape our lives, whether we are consciously aware of it are not. We are all part of a story that began long before we were born and which will continue long after we die. Campbell brings this story, and our place in it, to light like few others can. And this, in the end, is what the “true Right” is really about.
18:07 Publié dans Hommages, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mythe, mythologie, joseph campbell, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook









