dimanche, 31 août 2008
La "Mensur"
La Mensur
autore: Ella Loescher
categoria: --vario
inserito il: 2006-09-17
Grazie al gentile permesso dell'autrice, la Sig.na Ella Loescher, redattrice del sito Scherma Online, pubblichiamo il seguente excursus su una tradizione squisitamente germanica quale la "mensur", o per dirla all'italiana: "mensura".
Introduzione
La Mensur non è nè una disciplina sportiva nè un duello, tuttavia ha qualcosa in comune con entrambi: è un duello rituale in cui i due avversari devono rispettare una distanza fissa, cioè una misura, o Mensur, rimanendo fermi evitando il retrocedere vile; l'arma, la spada da Mensur, viene tenuta al di sopra della testa e puntata verso il viso dell'avversario.
I tagli vanno suturati senza uso di anestetico. Le parti del corpo minacciate, in particolare occhi, naso, orecchie, collo, insomma tutte le parti superiori del corpo sono protette da monocoli in ferro con un'appendice che protegge il naso, da gorgiere, bendaggi, corsetti, cinture di cuoio o di tela imbottita.
La Mensur pretende norme rigorose
 Come in tutti gli sport da combattimento, non deve esistere nessuna antipatia o rivalità personale, anzi una certa fiducia nella relazione fra i contendenti è necessaria.
Come in tutti gli sport da combattimento, non deve esistere nessuna antipatia o rivalità personale, anzi una certa fiducia nella relazione fra i contendenti è necessaria.
La Mensur non conosce vincitori o perdenti; più importante di una "vittoria" è la partecipazione diretta. La prestazione di ogni schermitore partecipante viene valutata indipendentemente dalla prestazione del suo avversario: è una dimostrazione di coraggio, di autocontrollo, di responsabilità, non di tecnica schermistica.
La Mensur è una lotta fra due di uomini, e si tratta solo di questo, in cui i partecipanti devono superare il timore di possibili ferite, che è l'obiettivo reale della Mensur.
Contrariamente al duello non si cerca di provocare una morte per avere "soddisfazione" in seguito a violazioni "dell'onore": tutto questo è giuridicamente vietato e molto lontano dal senso delle Mensuren che oggi possono essere combattute soltanto a condizione di escludere ferite serie o mortali.
Alcune critiche vedono una similarità della Mensur con un comportamento autolesionistico, ma mi viene ribattuto da uno studente universitario di una confraternita che la pratica, che nella Mensur non ci si ferisce da soli bensì è l'avversario che colpisce. Non capisco chi ci rimprovera. Diversamente da quella parte di uomini timorosa delle cure chirurgiche e con stati e relazioni emozionali inquietanti, noi impariamo a controllare la paura e a mantenere il pieno autocontrollo dei conflitti interiori, ad acquisire fiducia in noi stessi e nei compagni. Ci alleniamo praticamente tutti i giorni, per stimolare l'attitudine a batterci.
Lo scopo della Mensur è dunque sempre stato quello di essere un aiuto importante e doveroso per la formazione della personalità, poichè il partecipante deve prepararsi con cura e autodisciplina a battersi con le proprie forze; l'affrontare con calma una situazione pericolosa superando timori rafforza allo stesso tempo la coesione delle comunità.
A sostegno di questo, alcuni tenaci sostenitori della Mensur vorrebbero che i contendenti, per misurare maggiormente il proprio sangue freddo, non si conoscessero e non appartenessero alla stessa corporazione. Per altri la Mensur, ritornando al suo scopo, non dovrebbe avere una partecipazione volontaria, ma obbligatoria e più allargata.
Infine, qualcuno critica la tradizionale esclusione delle donne.
Sta di fatto che in Germania, pur non essendo un fattore determinante, l'aver praticato la Mensur giocava e pare possa ancora giocare a favore di un candidato alla dirigenza d'azienda.
L'inizio
Prima del 1514 il porto d'armi era un privilegio concesso soltanto ai soldati e all'aristocrazia; gli studenti, costretti a spostarsi spesso in viaggi d'istruzione da uno stato all'altro, da un'universitè all'altra, non avevano nessuno strumento per difendere la loro incolumità. In quell'anno, Massimiliano I d'Asburgo (imperatore del Sacro Romano Impero) concesse anche ad essi il porto d'armi, che rappresentava per l'epoca la carta d'identità di una elevata posizione sociale.
Le armi piè utilizzate inizialmente furono pugnali e "rapire" o daghe; successivamente si preferirono le armi spagnole e italiane, più maneggevoli. Il privilegio d'arma era legato strettamente ad un codice d'onore sociale: i signori pretendevano rispetto non soltanto dalle bande di ladri che incontravano lungo la via, ma esigevano che nessuno dubitasse del loro rango.
Presso gli studenti universitari dell'epoca andò formandosi via via la consapevolezza del loro stato sociale basata sull'uso di una propria lingua (il latino), su norme proprie di comportamento e sull'uso di abiti speciali di propri colori che portò a voler difendere la loro libertà di studio, la gioia di vivere e la difesa del loro mondo e dei cittadini.
Per gli studenti il porto d'armi e i duelli studenteschi di scherma diventarono presto un elemento indispensabile della vita universitaria.
Particolarmente brutali furono i duelli universitari che aumentavano selvaggiamente in tempi di guerra, specie nelle guerre di Riforma e nella guerra dei Trent'anni.
Numerosi furono i divieti delle università al "duello selvaggio" - ovviamente con scarso successo -: in ordine cronologico lo Statuto di Erfurt, la decisione del rettore di Heidelberger, l'Editto di Wittenberg sul duello, il Mandato sul duello di Jena.
Allora le autorità universitarie, inascoltate, provarono ad orientare il combattimento studentesco verso l'uso di regole con la speranza di ridurre, attraverso una migliore formazione, il numero dei feriti. Fu così che l'arte del combattere diventò nel corso del tempo una disciplina universitaria peculiare.
Accanto ai maestri di equitazione e di danza, molte università richiesero maestri di scherma: ad esempio, è documentata l'assunzione di maestri di scherma presso l'Università di Jena nel 1550, a Rostock nel 1560.
Danzare, cavalcare e duellare erano dunque esercitazioni universitarie precorritrici dello sport universitario attuale.
Nel frattempo alcuni maestri di scherma fondarono proprie associazioni sviluppando presto tecniche di combattimento comuni.
La necessità di regole
Nel suo autobiografico "Dichtung und Wahrheit", Johann Wolfgang Goethe descrive le sue lezioni di scherma prima a Francoforte e, dal settembre 1765, a Lipsia, dove si era spostato per dedicarsi allo studio del Diritto.
In un primo tempo lui e i suoi amici si esercitarono con armi di legno (bastoni); successivamente passarono alle armi d'acciaio munite di un guardamano "a canestro", e le lezioni si fecero più animate e divertenti. In seguito Goethe continuò a tirare di scherma ma non diventò mai un abile spadaccino.
Nuovo impulso verso una regolarizzazione del duello fu nel secolo XIX la codificazione di regole da parte delle università - un primo tentativo vero e proprio lo troviamo nel "Mandato sul duello" di Jena del 1684 - che stabilivano fra l'altro la necessità di una giusta causa, la presenza di secondi e arbitri e la condanna per crimine se le regole non venivano osservate.
Le dispute furono organizzate da delegati in luoghi convenuti e sempre piè disciplinate ottenendo, si sperava, una fermezza di carattere attraverso l'osservanza delle regole, considerata ben più importante del reale risultato schermistico.
Benchè il "duello selvaggio" fosse stato vietato severamente e disapprovato per i feriti e i morti che procurava, godette comunque di una certa accettazione sociale da parte di chi riteneva che uno studente potesse difendere con l'arma non soltanto la vita, ma anche il suo "onore".
Per quanto riguarda le armi da combattimento, gli studenti continuarono a utilizzare prevalentemente le "dagen" fino al XVIII secolo (anche se sono citati combattimenti con bastoni e fruste), che adottarono come elemento fisso dell'uniforme o dell'abito una volta divenuti persone autorevoli.
Circa i vari nomi attribuiti alle armi, in documenti fra cui uno statuto universitario, si trovano riferimenti riguardanti rispettivamente "Galanteriedegen" e "gladius consuetus".
Il termine "Raufdegen" venne utilizzato spontaneamente per indicare l'arma appuntita degli studenti facili alla "Rauferei", allo scontro, qui chiamato anche "duello selvaggio".
La facilità e la continuità con cui avvenivano questi scontri portarono man mano alla creazione di armi apposite con guardia ampia e lame più corte, aguzze, triangolari e prive di affilatura il cui obiettivo era infilzare l'avversario. Modifiche successive, che variavano in base alle aree geografiche, portarono all'uso generalizzato di un'arma corta con la guardia "a canestro" di dimensioni assai ridotte quindi poco protettiva, la punta smussata per evitare facili perforazioni e la lama affilatissima.
Furono questi i cambiamenti che portarono allo sviluppo delle "Mensurwaffen", armi da Mensur.
Nel frattempo, per impedire il dilagare del "duello selvaggio" fra studenti, nelle città degli stati tedeschi e dell'Impero Austro-ungarico venne vietato il porto d'armi, la cui concessione rimase invariata solo nel caso di viaggi extraurbani.
Tali innovazioni portarono a stabilire norme di comportamento (Komment) riservate agli studenti universitari delle varie confraternite locali.
Queste nuove leggi scritte per gli studenti delle rispettive università furono una prima forma di regolamento amministrativo studentesco.
L'evoluzione
All'inizio del XIX secolo, le università tedesche adottarono un codice di comportamento con priorità diverse di regione in regione.
Nella stesura venne considerato tra l'altro che...
malgrado fra gli studenti di teologia questi scontri godessero di grande popolarità, era sentita l'esigenza di rendere le cicatrici meno visibili per non rischiare la fine della carriera universitaria.
Ci si sofferma a riflettere sull'elevato pericolo di vita causato dalla Mensur; gli ultimi decessi avvennero a Jena e a Monaco negli anni 1840, l'ultimo scontro mortale fu nel 1860.
A Tèbingen, nel 1831, la Mensur era considerata una rappresentazione romantica tipica dell'epoca Biedermeier, tutta sentimentalismi e arcadiche situazioni rusticane.
I regolamenti erano differenti, tuttavia simili nei punti importanti come al giorno d'oggi, da università ad università.
Ecco alcuni esempi:
uno scontro durava anche dodici riprese;
uno scontro poteva concludersi in un quarto d'ora;
con un colpo inferto, lo scontro poteva essere interrotto;
un colpo andava a segno anche se la lama segnava soltanto gli abiti;
il piede posteriore doveva restare fermo;
lo scontro finiva per scadenza del termine, perchè si indietreggiava per paura, per ferimento con perdita di sangue;
la ferita doveva avere una certa dimensione;
ci si poteva servire di protezioni: un cappello simile al tipico copricapo universitario che, per gli studenti di teologia, era munito di un'ampia visiera più in là sostituito da occhiali senza lenti;
una sciarpa per salvare il collo e la carotide;
un guanto di cuoio (l'altra mano era fissata dietro i pantaloni), una fascia di seta per proteggere il braccio.
L'appartenenza a confraternite studentesche non era determinante per combattere.
Alcuni studenti lasciarono l'università senza mostrare un solo segno provocato da armi aguzze, perfettamente in linea col modo generale di pensare dell'epoca che poneva la rispettabilità al centro.
Tuttavia, relazioni contemporanee a quel periodo dicono che gli schermitori che raggiunsero l'obiettivo della Mensur ottennero un buon ritorno d'immagine non soltanto negli ambienti di studenti, ma anche in altre parti della popolazione.
Il Pastore Franz O. Goettinger parlò di atteggiamento nobile degli studenti che salvaguardavano la loro parola d'onore; del resto, era proprio la difesa dell'onore come segno esteriore del valore individuale che ci si aspettava da essi, secondo lo spirito del tempo.
Ancora oggi una valutazione della Mensur non riguarda solo gli aspetti tecnici come la qualità e la complessità dei colpi, ma giudica la consistenza di valori come l'onore e l'amicizia e caratteristiche individuali quali la personalità e il carattere. Un'eliminazione dovuta, per esempio, al solo ritrarsi istintivo del capo, è temuta ancora oggi più di una ferita fisica. Per riacquistare nuovamente credito lo schermitore "pusillanime" deve affrontare nuove Mensur. Nei casi più gravi di "vigliaccheria" viene ancora oggi radiato dalla Corporazione.
Tuttora sono due le forme di Mensur che prevalgono: quella tra due privati in cui le regole vengono stabilite attraverso un contratto personale; quella tra più confraternite, in cui le regole vengono stabilite dai delegati e dove i migliori combattono per tutti.
![]() Ad esempio, l'immagine qui a fianco rappresenta una Mensur nei dintorni di Tubinga intorno al 1831, in cui i contendenti usano armi con il guardamano "a canestro".
Ad esempio, l'immagine qui a fianco rappresenta una Mensur nei dintorni di Tubinga intorno al 1831, in cui i contendenti usano armi con il guardamano "a canestro".
Dal nazismo ad oggi
Si potrebbe pensare che chiunque praticasse la Mensur fosse attratto dall'ideologia di Hitler: no.
I nazisti, d'altra parte, non tolleravano le associazioni ben strutturate, quindi anche le confraternite studentesche erano combattute come possibili forze nemiche. Alcune di esse si adattarono ben presto alle regole imposte dal regime, una parte invece volle mantenere una posizione autonoma e intransigente, che portò ben presto ad accese rivalità fra gli studenti.
L'irremovibilitè dei "puristi" della Mensur che volevano mantenere la propria indipendenza dal nazismo li portò però all'isolamento.
Nel frattempo Hitler decretò che i tedeschi dovevano saper combattere per salvaguardare il proprio onore; a tutti gli studenti nazionalsocialisti tedeschi fu vietato praticare la Mensur e fu reso obbligatorio l'apprendimento della scherma; ben presto fiorirono circoli che la insegnavano, le Mensurwaffen furono escluse.
In quel clima, chi continuò a praticare la Mensur lo fece segretamente e con un gesto di sfida, accrescendone talora il fascino.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale il combattimento della Mensur si è mantenuto segreto senza regole giuridiche.
Nel 1951, alcune requisizioni di armi da Mensur a due corporazioni studentesche di Goettingen da parte della polizia locale, hanno portato all'istituzione di un processo.
Il 19 dicembre dello stesso anno il Tribunale di Goettingen ha dichiarato che la Mensur non è un duello con armi mortali e che inferire una lesione corporale col consenso delle due parti come nella Mensur non è punibile e non è immorale.
La Corte Federale di Giustizia ha confermato il giudizio il 29 gennaio 1953 (Goettinger Mensurenprozess).
Per evitare l'incriminazione è dunque chiaro che:
- non bisogna combattere una Mensur per difendere l'onore
- si devono osservare regole e protezioni che escludano ferite mortali.
La situazione giuridica della Mensur è resa sorprendentemente simile ad altri sport da combattimento!
Nel 1954 il Tribunale Amministrativo di Hannover ha riportato l'attenzione sulla Mensur in seguito alla denuncia di due corporazioni studentesche (Corps Hannoverania Hannovre, Corps Teutonia Berlino): ad uno studente che si era dichiarato favorevole alla Mensur era stata rifiutata l'iscrizione alla Libera Università di Berlino. Questa decisione è stata revocata il 24 ottobre 1958 dal Tribunale Amministrativo Federale (BVerwGE 7/287).
La motivazione di salvaguardare il proprio onore sfidandosi alla Mensur non è più considerata valida dal 8 aprile 1953, quando i rappresentanti di alcune corporazioni studentesche (Kèsener Senioren-Convents-Verband, Weinheimer Senioren-Convent, Deutsche Burschenschaft e Coburger Convent) hanno promesso formalmente davanti all'allora Presidente della Repubblica Theodor Heuss che la natura del duello studentesco apparteneva definitivamente al passato.
L'ultima crisi della Mensur ha avuto il suo apice nel 1968, anche se i prodromi si erano avvertiti fin dai primi anni sessanta. In quegli anni di rinnovamenti sociali e culturali, le tradizioni avevano poco peso e così anche nella Mensur si è avvertita la necessità di qualche cambiamento. Nelle confraternite il combattimento è diventato facoltativo, le protezioni si sono parzialmente rinnovate ed estese talora anche alla mandibola inferiore.
Negli anni settanta alcune confraternite che volevano eliminare completamente il combattimento studentesco si sono sciolte, ma dagli anni ottanta si assiste ad un incremento d'interesse verso di esso, tanto che nel 2005 le confraternite che rendono la Mensur obbligatoria sono numericamente stabili.
Ella Loescher
http://blog.schermaonline.com/kasher/
schermaonline@libero.it
articolo originariamente pubblicato su www.schermaonline.com
Bibliografia:
Martin Biastoch, Duell und Mensur im Kaiserreich, SH-Verlag, Vierow 1995
Egon Eis, Duell, Geschichte und Geschichten des Zweikampfs, K. Desch Verlag, Mènchen 1971
Michael Gierens S.J., Ehre, Duell und Mensur, Darstellung und Begrèndung der christlich-ethischen Anschauungen èber Ehre und Ehrenschutz, Duell und Mensur auf Grund einer Synthese historischer, biblischer, juristischer, kanonistischer und philosophischer Erkenntnisse, Akademischen Bonifatius-Einigung, Congregazione curatrice della vita religiosa dello studente cattolico, Paderborn 1928
Jonathan Green, Armed and Courtegous, Financial Times magazine, 3. Januar 2004
Links
http://www.swordhistory.com
http://www.prager-arminia.de
http://www.die-corps.de
http://www.slesvigia-niedersachsen.de
http://www.jonathan-green.com
00:09 Publié dans Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, etudiants, monde étudiants, traditions universitaires, sport de combat, art martiaux |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 août 2008
Conflictmaatschappij en nationaal gevoel
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, sociologie, philosophie, conflit, polémologie, nationalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Du symbolisme de la hache

Du symbolisme de la hache
Le terme "hache" ("ascia" en italien) existe dans nos langues de manière quasi inchangée au cours des millénaires. Il correspond effectivement au terme latin "ascia", qui dérive de la forme indo-européenne *aksi/*agwesi, que les linguistes ont reconstituée sur base de comparaisons entre le terme latin et le terme gothique "aqizi", le terme de vieil haut allemand "ackus" (en allemand moderne "Axt", en anglais "ax", "adze") et le grec "axi(on)". Il me semble nécessaire de préciser cependant que cette forme est une forme indo-européenne occidentale; les linguistes ont également reconstitué la forme orientale, soit "*peleku", cette fois sur base d'une comparaison entre certaines formes linguistiques grecques et sanskrites. C'est ainsi que le pélican, à travers un processus assez intéressant, se voit assimilé à la hache, à cause de son grand bec caractéristique.
La hache revêt une importance énorme, comme en témoigne le passé archaïque des Indo-Européens. Adams et Mallory expliquent que, durant le néolithique, les haches, en Eurasie, étaient faites de silex ébréchés ou d'autres pierres capables d'être façonnées. En outre, il s'agissait généralement de haches plates; cependant, dans certaines cultures néolithiques plus tardives, on trouve rapidement des haches munies d'une perforation permettant d'y placer un manche. Ces haches sont qualifiées de "haches de bataille"; quand on les trouve dans des sépultures, comme par exemple celles de la céramique cordée (notamment dans les régions d'Europe septentrionale, où l'on parle de la "culture des haches de combat"), elles sont de toute évidence des instruments ou des armes considérées comme "viriles". Elles sont donc les emblèmes d'une société patriarcale et guerrière, car, comme l'a écrit Adriano Romualdi, "la culture nordique ne présente aucune trace de matriarcat: les idoles féminines sont absentes… la structure familiale est solide, les traditions de chasse et de guerre attestent d'une culture éminemment virile". Quant à E. Sprockhoff, il formule des observations extrêmement intéressantes sur la hache de guerre dans l'antique culture mégalithique; il assimile la hache primordiale au dieu du Tonnerre, qui, aux temps les plus reculés, était aussi le dieu du Ciel et du Soleil. D'après ce chercheur allemand, "on consacre à cette puissante divinité des haches d'ambre et d'argile, comme d'ailleurs des haches en miniature. Ainsi, la femme germanique a porté ultérieurement le marteau de Thor comme bijou, suspendu à une chaîne; de même, les populations nordiques de l'âge de la pierre le plus éloigné ont porté au cou cet ornement, en tant que perles d'ambre en forme de hache bipenne, symbole du dieu du Tonnerre et des jours, un dieu qui n'a plus de nom aujourd'hui pour nous. La hache de combat est tout simplement devenue le symbole de la plus haute divinité" (ex: "Die nordische Megalithkultur").
L'irruption de la hache de combat dans les régions du Sud et de l'Est, attestée par des découvertes archéologiques, montre comment se sont déroulées les différentes phases de pénétration indo-européenne; on les identifie évidemment aux pointes les plus avancées des conquêtes cimmériennes et tokhariennes: «Le témoignage concret de cette migration, écrit Romualdi, est l'arrivée subite en Chine d'une quantité d'armes occidentales, que l'on date en Europe entre 1100 et 1800 avant J. C., et qui n'avaient en Asie aucun antécédent». La hache est, en somme, le symbole du dieu céleste suprême et de l'esprit créateur de nos plus lointains ancêtres.
Alberto LOMBARDO.
(Etude parue dans La Padania, 14 octobre 2001 - http://www.lapadania.com ; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, indo-européens, symboles, mythologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 août 2008
Technopol und maschinen-Ideologie

Technopol und Maschinen-Ideologien
Analyse: Neil POSTMAN, Das Technopol. Die Macht der Technologien und die Entmündigung der Gesellschaft, S. Fischer Verlag, 1991, 221 S., ISBN 3-10-062413-0.
Neil Postman, zeitgenößischer amerikanischer Denker und Soziolog, ist hauptsächlich für seine Bücher über die Fernsehen-Gefahren bei Kindern bekannt. In seinem Buch Das Technopol klagt er den Technizismus an, wobei er nicht die Technik als solche ablehnt, sondern die Mißbräuche davon. In seiner Einleitung, spricht Postman eine deutliche Sprache: Die Technik ist zwar dem Menschen freundlich, sie erleichtert ihm das Leben, aber hat auch dunkle Seiten. Postman: «Ihre Geschenke sind mit hohen Kosten verbunden. Um es dramatisch zu formulieren: man kann gegen die Technik den Vorwurf erheben, daß ihr unkontrolliertes Wachstum die Lebensquellen der Menschheit zerstört. Sie schafft eine Kultur ohne moralische Grundlage. Sie untergräbt bestimmte geistige Prozesse und gesellschaftliche Beziehungen, die das menschliche Leben lebenswert machen» (S. 10).
Weiter legt Postman aus, was die Maschinen-Ideologien eigentlich sind und welche Gefahren sie auch in sich tragen. Postman macht uns darauf aufmerksam, das gewisse Technologien unsichtbar sein können: so Postman: «Management, ähnlich der Statistik, des IQ-Messung, der Notengebung oder der Meinungsforschung, funktionniert genau wie eine Technologie. Gewiß, es besteht nicht aus mechanischen Teilen.
Es besteht aus Prozeduren und Regeln, die Verhalten standardisieren sollen. Aber wir können ein solches Prozeduren- und Regelsystem als eine Verfahrensweise oder eine Technik bezeichnen; und von einer solchen Technik haben wir nichts zu befürchten, es sei denn, sie macht sich, wie so viele unserer Maschinen, selbstständig. Und das ist der springende Punkt. Unter dem Technopol neigen wir zu der Annahme, daß wir unsere Ziele nur erreichen können, wenn wir den Verfahrensweisen (und den Apparaten) Autonomie geben. Diese Vorstellung ist um so gefährlicher, als sie niemand mit vernünftigen Gründen gegen den rationalen Einsatz von Verfahren und Techniken stellen kann, mit denen sich bestimmte Vorhaben verwirklichen lassen. (...) Die Kontroverse betrifft den Triumph des Verfahrens, seine Erhöhung zu etwas Heiligem, wodurch verhindert wird, daß auch andere Verfahrensweisen eine Chance bekommen» (S. 153-154).
Weiter warnt uns Postman von einer unheimlichen Gefahr, d. h. die Gefahr der Entleerung der Symbole. Wenn traditionnelle oder religiöse Symbole beliebig manipuliert oder verhöhnt werden, als ob sie mechanische Teilchen wären, entleeren sie sich. Hauptschuldige daran ist die Werbung, die einen ständig größeren Einfluß über unseres tägliche Denken ausübt und die die Jugend schlimm verblödet, so daß sie alles im Schnelltempo eines Werbungsspot verstehen will. Um Waren zu verkaufen, manipulieren die Werbeleute gut bekannte politische, staatliche oder religiöse Symbole. Diese werden dann gefährlich banalisiert oder lächerlich gemacht, dienen nur noch das interressierte Verkaufen, verlieren jedes Mysterium, werden nicht mehr mit Andacht respektiert. So verlieren ein Volk oder eine Kultur ihren Rückengrat, erleben einen problematischen Sinnverlust, der die ganze Gemeinschaft im verheerenden Untergang stoßen. Postmans Bücher sind wichtig, weil sie uns ganz sachlich auf zeitgenößischen Problemen aufmerksam machen, ohne eine peinlich apokalyptische Sprache zu verwenden. Zum Beispiel ist Postman klar bewußt, daß die Technik lebenswichtig für den Menschen ist, denunziert aber ohne unnötige Pathos die gefährliche Autonomisierung von technischen Verfahren. Postman plädiert nicht für eine irrationale Technophobie. Schmittianer werden in seiner Analyse der unsichtbaren Technologien, wie das Management, eine tagtägliche Quelle der Deligitimierung und Legalisierung der politischen Gemeinschaften. Politisch gesehen, könnten die soziologischen Argumente und Analysen von Postman eine nützliche Illustration der Legalität/Legitimität-Problematik sein (Robert STEUCKERS).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, technopole, technopolis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 août 2008
Brève note sur Heimito von Doderer

Brève note sur Heimito von Doderer
Né le 5 septembre 1896, sous le nom de Franz Carl Heimito, Chevalier von Doderer, à Hadersdorf-Weidlingau et mort à Vienne le 23 décembre 1966, Heimito von Doderer fut un écrivain autrichien, fils d'un architecte et entrepreneur de travaux de construction. Il a servi comme aspirant dans un régiment de dragons pendant la première guerre mondiale. Il a été prisonnier pendant quatre ans en Russie [ndt: plus exactement, en Sibérie]. En 1920, il revient en Autriche, où il étudie l'histoire à Vienne, notamment sous la férule du Chevalier Heinrich von Srbik [ndt: et obtient son diplôme en 1925]. Sous la forte influence d'Albert Paris Gütersloh, il tente de s'initier au difficile métier d'écrivain. Il a commencé, ainsi, mais sans grand succès, par publier des poèmes, de brèves nouvelles et des romans. En 1933, il adhère à la NSDAP, qui est interdite en Autriche à l'époque, mais la quitte en 1938. Cette année-là, il accède enfin à une plus vaste notoriété grâce au roman Ein Mord den jeder begeht. En 1940, après sa conversion, il est accepté au sein de l'Eglise catholique. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert en tant qu'officier de la force aérienne. Finalement, il acquiert la gloire par la publication de deux grands romans à thématique sociale, Die Strudlhofstiege (1951) et Die Dämonen (1956).
La prose de Doderer se caractérise par une langue imagée, totalement inédite. Une série de motifs revient sans cesse dans son écriture, dont une critique systématique du progrès technique et de la civilisation moderne des grandes métropoles; Doderer rejette aussi tous les linéaments de l'ère des masses, qui empêchent, dit-il, le déploiement optimal de l'individualité personnelle. Il écrit, à ce propos: «Celui qui appartient aux "masses", a d'ores et déjà perdu la liberté et peut s'installer où il veut».
Une adhésion à la plénitude complète du réel
[ndt: Le style littéraire de Doderer est largement influencé par Marcel Proust et Robert Musil, dans la mesure où, tout entier, il part, lui aussi, à la "recherche du temps perdu"; chez lui, cette recherche vise à retrouver les innombrables fractions de bonheur de l'Autriche-Hongrie d'avant 1914, en replongeant dans l'histoire sociale des hommes et des familles. Pour Doderer, le chaos de la société moderne exprime la crise de l'universalité, raison pour laquelle la tâche de l'écrivain doit être d'esquisser une nouvelle universalité, qui n'est évidemment pas un universalisme idéologique à côté d'autres universalismes idéologiques, mais une adhésion à la plénitude complète du réel, comme on l'éprouvait généralement sans détours dans l'ancien empire danubien austro-hongrois. L'homme universel n'est pas un modèle abstrait, taillé sur mesure une fois pour toutes, mais un être qui se manifeste sous des "variations multiples". En revanche, plongé dans le carcan étroit d'une "réalité seconde", faite de restrictions mutilantes de nature idéologique, il perd et son universalité et ses variations pour n'être plus qu'un instrument au service des pires barbaries politisées de l'histoire. Heimito von Doderer dénonce l'idiotie immanente de toutes les positions doctrinaires, quelles qu'elles soient. En cela, Doderer est disciple de Hoffmansthal, qui disait: «L'idiotie, comme l'indique l'étymologie de ce mot étranger, n'est rien d'autre que l'auto-limitation de l'homme par lui-même». Une telle posture implique de revaloriser les communautés humaines, avec leurs échelles variables de formes sociales et de classes, contre l'uniformité grise des sociétés totalitaires, plaide simultanément pour une restauration des qualités humaines contre les affres de la quantité (Musil, Guénon). Universalité, variété et qualité impliquent de ce fait de respecter et de conserver le jeu des interpénétrations créatrices entre les éléments contradictoires du réel prolixe pour unir l'esprit conservateur et l'esprit émancipateur dans une quête permanente de la "totalité" (Ganzheit) ou, comme on le dit plus justement aujourd'hui en philosophie, l'"holicité" - RS].
Dans les ouvrages de Doderer, nous trouvons donc trois concepts centraux, présentés sous des facettes diverses: celui d'"aperception" (Apperzeption), celui de "seconde réalité" (zweite Wirklichkeit) et celui du "devenir-homme" (Menschwerdung). Celui qui refuse de percevoir la réalité (telle qu'elle est), c'est-à-dire la réalité première, dit Doderer, fait éclore en lui, justement par ce refus de l'aperception, une seconde réalité, sous la forme d'une représentation fixiste (fixe Vorstellung) ou d'une idée-corset ou idée-cangue (Zwangsidee), ce qui correspond à une image du donné viciée par l'idéologie. Doderer considère que l'Etat totalitaire constitue une "seconde réalité" de ce type, de même que ces volontés révolutionnaires et fébriles de vouloir tout changer, que le primat accordé névrotiquement à la politique, que les complexes d'ordre sexuel, que les névroses et que l'attachement forcené à certains systèmes et ordres.
La vie telle qu'elle est
Une bonne partie des personnages de l'univers romanesque de Doderer sont en lutte contre les formes de "seconde réalité". Les dépasser n'est possible que par un processus de "devenir-homme", soit par le fait que l'homme revient ainsi à sa véritable destination, en s'ouvrant, de manière inconditionnelle, à la première réalité, la seule vraie, qui, pour Doderer, est la vie civile naturelle, sans fard et sans excitations artificielles. Dans ce contexte, Doderer se réclame "de la vie telle qu'elle est" et nous enjoint de l'accepter. Il faut dès lors se détourner des fixismes idéologiques —qu'il désigne comme les "hémorroïdes de l'esprit"— des convictions et des idéaux qui sont soi-disant sublimes, pour s'adonner à l'aperception pleine et entière du réel. Cette aperception est essentiellement conservante —ici, Doderer articule clairement sa position— car celui qui adopte cette position ne souhaite pas voir modifier ce qu'il aime réceptionner par "aperception" et se trouve autour de lui. Raison pour laquelle Doderer dit: «L'attitude fondamentale de l'homme apercevant est conservatrice».
Dr. Ulrich E. ZELLENBERG.
(extrait de "Lexikon des Konservatismus" - Caspar v. Schrenck-Notzing /Hrsg. - Leopold Stocker Verlag, Graz, 1996 - ISBN 3-7020-0760-1; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, allemagne, autriche, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 août 2008
Citaat Max Horkheimer
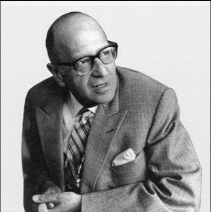
"De deugdelijkheid van de eigen identiteit in een kwaad daglicht stellen en als racisme bestempelen, is een opvallend voorbeeld van verstandsverbijstering van de rede."
Max Horkheimer
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ecole de francfort, mai 68, identité, mouvement identitaire, politique, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
De la guerre dans le cyberspace

De la guerre dans le “Cyberspace”
Entretien avec le journaliste Stefano Silvestri, expert militaire, sur la cryptographie, la sphère privée et la sécurité sur le net
Q. : Professeur Silvestri, au cours de cette dernière année 1998, on a beaucoup parlé, sur le net et ailleurs, du projet “Echelon”, élaboré par l'agence américaine NASA, dans le but de contrôler toutes les communications téléphoniques, y compris les fax et les courriers électroniques, même en dehors d'Amérique et, surtout, en Europe. D'après certains observateurs, il s'agirait en fait d'une légende colportée sur le net; pour d'autres, en revanche, cette intrusion est une donnée fondamentale, comme l'explique l'intérêt qu'y portent les organismes officiels de la Communauté Européenne; cet intérêt semble prouver qu'il ne s'agit donc pas d'une “légende”. Qu'en dites-vous?
StS : Je dis que le contrôle des communications a toujours grandement focalisé l'attention des agences d'information américaines. En ce qui concerne les simples communications téléphoniques, leur contrôle est déjà un fait acquis depuis longtemps. L'attention actuelle, portée à internet, n'a fait que croître ces derniers temps, d'abord dans l'intention de contrôler les aspects de cette technologie qui ont bénéficié à la criminalité —je pense notamment à la pornographie— ensuite dans l'intention de protéger les informations confidentielles contre les interventions des “hackers”, les pirates de l'informatique. Dans ce double contexte, est née l'idée qu'il faudra contrôler toujours plus étroitement les communications. Le problème qui se pose est, tout naturellement, de savoir si un tel contrôle est légitime ou non, et dans quelle mesure, car les communications sont en théorie ouvertes, car elles ont été créées pour être et demeurer ouvertes, pour être lues de tous, comme c'est le cas sur la grande toile. Mais si elles sont lues par tous, elles peuvent l'être par les agences de sécurité. Cette évidence est moins légitime, voire totalement illégitime, si l'on parle d'informations confidentielles, de quelque forme que ce soit, de quelque manière qu'elles soient cryptées, même si elles ne sont que de simples communications téléphoniques. S'il existe une tutelle, ou des garde-fous, pour ce qui concerne les communications à l'intérieur d'un Etat, il n'existe aucune protection juridique pour les communications internationales.
Q. : Je vais émettre une hypothèse, faire un saut en avant dans le temps, disons de dix ans, ce qui nous amène en l'an 2009. On peut prévoir, sur base de ce qui se passe aujourd'hui, que les autoroutes de l'information acquerront une importance encore plus importante d'ici ces dix années. A quoi ressembleront ces autoroutes de l'information, seront-elles plus libres ou plus contrôlées? Quelle forme prendra, selon vous, la lutte pour le contrôle et la surveillance des informations et surtout pour la protection de la sphère privée?
StS : Ce n'est pas facile de faire des prévisions, parce que le net, tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'il s'est développé jusqu'ici, se base sur l'idée d'une liberté complète d'informer et de faire circuler des informations. Mais la multiplication des phénomènes de nature criminelle a forcé les autorités à élaborer des systèmes plus complexes de contrôle. Je crois donc que cette lutte continuera. Vous savez qu'il existe des organisations à l'intérieur même de la grande toile qui s'opposent d'ores et déjà, par principe, à toute forme de contrôle, même limitée, parce qu'elles estiment que tout type de contrôle finit par bloquer la communication. Je retiens personnellement qu'il faut certaines formes de contrôle, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut réussir pour le net ce qui se passe déjà pour les communications téléphoniques internationales : parvenir à généraliser un contrôle sur les thèmes et les mots clefs. De ce fait, je ne pense pas que nous aurons nécessairement plus ou moins de liberté, mais que nous aurons une situation différente, où deux phénomènes prendront parallèlement de l'ampleur : l'élargissement de la grande toile, c'est-à-dire un accroissement de liberté, mais aussi, simultanément, une “intrusivité” accrue de la part de certaines agences étatiques.
Q. : Quels instruments pourra-t-on utiliser pour maintenir la sphère privée dans une situation de ce genre?
StS : Partiellement, la sphère privée est reliée à ce qui se met sur la toile. Il est dès lors évident que ce qui est présent sur la toile peut être lu, tandis que les choses qui n'y sont pas de manière évidente, ne peuvent pas être lues. Par conséquent, on sera tenté de ne pas dire certaines choses sur la toile elle-même. Par ailleurs, on pourra recourir à des systèmes de plus en plus sophistiqués de cryptage. Mais c'est une démarche beaucoup plus complexe, parce que tout système de cryptage peut être décrypté, sauf si l'on utilise un système supérieur d'élaboration de données. En conséquence, le problème, à ce niveau, est celui de posséder une capacité systémique à élaborer des données de manière plus rapide et plus puissante que les autres. Ce type de capacité, seuls les Etats les possèdent.
Q. : Quels sont les Etats qui ont les systèmes les plus puissants ?
StS : Essentiellement, les Etats-Unis. Nous en sommes arrivés au stade que les Etats-Unis, sur injonction de leur ministère de la défense, n'exportent jamais ces systèmes de sécurité complets, qu'ils élaborent chez eux pour le bénéfice du gouvernement américain, pour éviter d'affronter des systèmes de cryptage étrangers, difficiles à briser.
Q. : Si je vous comprends bien, nous avons affaire, d'une part, à un processus de globalisation et, d'autre part, à un retour au nationalisme, face au nouveau système mondial de communication…
StS : C'est un double processus qui survient toujours sur les marchés globalisés : au départ, on commence avec un maximum de liberté, puis, à un certain moment, on en arrive à développer des rapports de force. Dans le cas qui nous préoccupe, nous sommes face à un problème de rapports de force.
Q. : Nous avons donc affaire à une guerre dans le “cyberspace”, pour le contrôle des flux d'informations, mais est-ce une perspective bien réelle? Si oui, comme va-t-on la combattre et par quels moyens?
StS : Disons que cette idée d'une guerre dans le “cyberspace” reçoit beaucoup d'attention actuellement parce qu'elle se concilie parfaitement avec l'hypothèse que posent les Américains aujourd'hui, affirmant que nous assistons à une nouvelle révolution dans les affaires militaires. Ce que l'on considère désormais comme le système des systèmes consiste, pour l'essentiel, en une méthode électronique de contrôle des diverses armes, qui tend simultanément à utiliser aussi des systèmes de guerre non traditionnels: par exemple, le contrôle de l'information. Celui-ci revêt évidemment une importance cruciale en temps de guerre. Les médias donnent de fausses informations, ou n'en donnent pas, et réussissent ainsi à empêcher la circulation de certaines informations déterminées, ou à se substituer aux systèmes d'information nationaux des pays que l'on veut attaquer. Tout cela est théoriquement possible. Le contrôle peut également s'exercer sur les informations d'ordre technique, dans la mesure où nos nouveaux systèmes d'armement dépendent d'un certain flux d'information. Par exemple, les informations, en provenance de satellites, relatives aux positions géo-stationnaires, au climat, etc., peuvent se faire influencer d'une certaine manière, ce qui est aussi une façon de faire la guerre. Notamment l'intrusion, en provenance de l'extérieur, dans les systèmes d'information ou de sécurité, ou dans les systèmes de contrôle du trafic aérien, sont considérés comme des actes de guerre. De telles intrusions n'ont pas encore eu lieu; elles ne sont que de pures hypothèses, relevant de la science fiction ou du roman et non pas encore du réel. Mais il est évident que si un hacker peut perturber un ordinateur du Pentagone, celui-ci peut utiliser la même technique contre un tiers.
Q. : Par conséquent, dans l'hypothèse d'une guerre “informatique”, n'aurons-nous pas affaire à un problème se focalisant davantage sur les sources d'information?
StS : Effectivement, plusieurs problèmes se juxtaposent: un problème qui relève de la sécurité des sources, un problème quant à la “pureté” des informations et un problème de sécurité des informations. Sur le Vieux Continent, nous avons peu d'expériences, parce qu'en Europe, nos systèmes militaires sont archaïques, au pire, trop vieux en tout cas pour faire face à la nouvelle donne. Les Américains ont plus d'expériences parce qu'en fait leurs systèmes militaires utilisent certes d'anciennes techniques, comme les Européens, mais utilisent aussi la grande toile; ils ont donc une indéniable expérience dans la façon d'utiliser celle-ci, tant sur le plan défensif que, potentiellement, sur le plan offensif.
Q. : Pourriez-vous nous donner quelques exemples récents de conflits ou, plus généralement, d'événements de la politique internationale, où la lutte pour le contrôle de l'information dans le “cyberspace” a déjà eu un rôle d'une importance particulière?
StS : Je dirais que, pour l'essentiel, c'est encore une question de rapports de force entre les Etats-Unis, l'Europe et les autres pays. Exemple : nous avons affaire à un nouveau niveau dans l'utilisation des informations et des données recueils à la suite d'interceptions téléphoniques à la suite immédiate des attentats en Afrique contre les ambassades américaines; ce nouveau degré d'utilisation de la technologie s'utilise désormais pour repérer les groupes terroristes responsables de ces attentats. Ce niveau technologique en est encore au stade de la simple information. Par ailleurs, il y a toute une série d'exemples de guerre informatique mais ces cas sont surtout liés au monde industriel plus qu'au monde militaire ou à la sécurité pure. Ou bien l'on utilise les canaux informatiques libres ou couverts pour troubler la sécurité des industries.
Q. : Le “cyberspace”, par définition, est en quelque sorte “a-territorial”, ou, au moins, très éloigné du type de territorialité auquel nous sommes habitués dans le monde réel (et non virtuel). Existe-t-il dès lors une géopolitique du “cyberspace”. Et sous quelle forme?
StS : Le “cyberspace” constitue une négation de la géopolitique. Par suite, nous pouvons dire que nous sommes essentiellement confrontés à une question de frontières. Les frontières peuvent tout simplement se connecter, non pas aux médias, mais aux utilisateurs eux-mêmes. Nous pouvons dire qu'il existe une géopolitique du “cyberspace” dans la mesure où nous trouvons plus d'utilisateurs concentrés dans une région du monde que dans une autre. Ce qui nous donne une forte concentration aux Etats-Unis, une concentration en croissance constante en Europe et une concentration très réduite et éparpillée en Afrique. Autre hypothèse : on pourrait développer des catégories géopolitiques reposant sur la capacité technologique à intervenir dans le “cyberspace”, capacité qui coïncide dans une large mesure avec la zone où l'on utilise de la manière la plus intense ces technologies et où celles-ci sont par conséquent les plus avancées. Je crois que j'ai énuméré là les principales catégories, parce que, pour le reste, introduire des barrières à l'intérieur même du “cyberspace” équivaudrait à détruire le “cyberspace” lui-même. Et, en conséquence, cela signifierait ipso facto de détruire ce principe de liberté de circulation ou ce principe de grande facilité de circulation des informations, qui pose problème, mais qui est simultanément la richesse de cet instrument.
Q. : Existe-t-il des protocoles de réglementation entre les Etats en ce qui concerne le “cyberspace”?
StS : Non. Pas encore en tant que tels. Je dirais que ce qui va se faire tournera essentiellement autour du problème des contrôles. En d'autres termes: comment pourra-t-on générer des coopérations pour éviter l'augmentation de la criminalité dans ce nouveau moyen de communication qui, comme tous les médias, peut évidemment se faire pénétrer par les réseaux criminels. Tous ces problèmes sont liés au fait que le “cyberspace” est par définition extra-territorial. En tant que tel, toutes les interventions à l'intérieur de ce cyberspace, mises à part les interventions sur un opérateur singulier, sont des interventions forcément transnationales. A l'échelon national, une intervention est possible, mais elle fait automatiquement violence à des tiers. Des romans commencent à paraître qui prennent pour thème de tels sujets. Tom Clancy est de ceux qui s'occupent ainsi de la grande toile; il a inventé une police américaine fictive qui s'appelle “Net Force” mais qui n'a pas une fonction seulement protectrice et judiciaire, mais se livre à des actions offensives et défensives à l'intérieur même du “cyberspace”. En Europe, nous n'en sommes pas encore là. Loin de là.
Q. : Pouvez-vous nous donner une définition de ce que l'on appelle un système de “cryptographie”?
StS : La cryptographie est un système visant à camoufler, à masquer, le langage. Vous prenez un mot et vous lui donnez une tout autre signification. Vous avez affaire là à un système de cryptographie banale. Les systèmes de cryptographie ont crû en importance, au fur et à mesure que les communications, elles aussi, ont acquis de l'importance. Ainsi, au fur et à mesure que les opérations militaires proprement dites se sont mises à dépendre toujours davantage du bon fonctionnement des communications, la cryptographie est, à son tour, devenue très importante. C'est clair : tant que les communications se faisaient entre le commandant des forces sur le terrain et, par exemple, le peloton de cavalerie qu'il avait envoyé en reconnaissance, la communication se voyait confiée à un messager et la cryptographie n'avait pas beaucoup de sens. Pour l'essentiel, il suffisait que le messager comprenne bien ce que le commandant lui disait et le répète correctement. Petit à petit, quand les opérations sont devenues plus globales, on a commencé à utiliser des systèmes plus complexes, mais qui risquaient d'être interceptés ou décryptés comme la radiophonie. La cryptographie était devenue nécessaire. Pendant la seconde guerre mondiale, la cryptographie a joué un rôle fondamental. Les alliés ont réussi à décrypter le système allemand de cryptographie. Cela leur a procuré un gros avantage stratégique, pendant toute la durée des hostilités. Pendant la guerre froide également, la capacité de pénétrer les systèmes de communication de l'adversaire a eu une importance capitale. Dans cette guerre, la capacité des Américains à parfaire ce genre d'opération était supérieure à celle des Soviétiques, ce qui a donné, in fine, l'avantage aux Etats-Unis. Aujourd'hui, la guerre des cryptographies continue tant dans la sphère économique que dans celle du militaire. La guerre actuelle dépend largement des nouveaux systèmes de cryptographie, lesquels sont désormais intégralement basés sur l'informatique. Plus l'ordinateur est rapide et puissant, plus le logarithme est complexe, sur base duquel on crée la cryptographie des phrases, et, finalement, l'ensemble du système est le plus fort. Les super-ordinateurs américains sont nés, partiellement, pour être capables de gérer les opérations de la Nasa dans l'espace, mais aussi, pour gérer de nouveaux systèmes de cryptographie.
Q. : Par conséquent, les systèmes de cryptographie, comme le soutient le département de la défense aux Etats-Unis, peuvent se considérer véritablement comme des armes?
StS : Ils font assurément partie du système de sécurité et de défense d'un pays. Ils constituent une arme offensive dans la mesure où ils peuvent potentiellement pénétrer le système de communication de l'ennemi, et constituent aussi une arme défensive, car ils empêchent l'ennemi de pénétrer leurs propres systèmes. A ce système de cryptographie s'ajoutent les autres systèmes spécialisés mis en œuvre. La combinaison des divers types de systèmes donne un maximum de sécurité.(entretien paru dans Orion, n°179/août 1999; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, cyberspace, militaria, défense, libertés |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 août 2008
Pour un populisme offensif!

Pour un populisme offensif!
Le terme “populisme” désigne tous les mouvements politico-sociaux qui dérangent et qui ne sont pas assimilables à la gauche classique, au nationalisme traditionnel ou à une forme ou une autre de néo-fascisme ou de néo-nazisme. Le “populisme” est un mouvement politique qui s'adresse directement au peuple, qui est animé par des hommes et des femmes qui sont eux aussi directement issus du peuple, qui, avant de passer à l'action politique, n'appartenaient à aucun réseau "traditionnel”, à aucun parti en place. Le populisme, c'est la spontanéité populaire, c'est la réaction directe du peuple, de la population, surtout dans les grandes villes où, justement, les attaches avec les réseaux partisans conventionnels se sont relâchées et où cette population, venue généralement des quatre coins du pays, ne se reconnaît plus dans les agences politiques de l'établissement.
Le peuple, c'est avant toute chose, les hommes et les femmes qui doivent travailler chaque jour pour gagner leur vie, c'est l'ensemble de ceux qui ne sont pas sûrs du lendemain, que guette le spectre du chômage, ce sont aussi ceux qui n'ont pas la garantie de l'emploi et qui sombrent parfois dans ce chômage désormais omniprésent et dans ses humiliations: faire interminablement la file à la CAPAC pour ne demander rien que son droit le plus strict à des apparatchiks grossiers, subir la scandaleuse tracasserie du pointage, quémander un emploi auprès de fonctionnaires qui se fichent de votre destin et de votre misère comme un poisson d'une pomme. En latin, travailler se dit laborare, ce qui veut également dire souffrir. Le populisme est donc l'idéologie de ceux qui travaillent donc qui souffrent.
Car, chacun le sait, travailler sans souci du lendemain n'est plus une évidence aujourd'hui. Depuis plus de vingt ans, l'incompétence et l'insouciance des partis en place, des coalitions rouges-romaines ou bleues-romaines, a plongé le pays dans une basse conjoncture aux effets négatifs devenus permanents. L'ensemble de la population est appauvri sur fond d'une dette publique colossale, qui fait que chacun d'entre nous, du nourrisson au centenaire et immigrés compris, est endetté pour un million de francs! Cette situation malsaine, la plus malsaine d'Europe en ce qui concerne l'endettement public, fait que le chômage frappe les jeunes, qui ne fondent plus de famille, qui n'ont plus d'enfants, qui vivent dans la précarité et l'instabilité financière, qui sont exclus des circuits du travail, qui alimentent les effectifs de la “nouvelle pauvreté”. Notre pays perd sa population tout simplement parce que les générations ne se renouvellent plus, le mal-vivre ne permettant pas de voir la vie en rose, de cultiver la sérénité qu'il faut avoir pour élever des enfants. Dans une vingtaine ou une trentaine d'années, notre pays sera un gigantesque hospice, financé par une poignée de personnes qui travailleront encore.
L'établissement nous dit: «Mais ce sont les immigrés qui payeront nos pensions...». Ce discours est malhonnête. D'abord pour les immigrés eux-mêmes qui songent tout naturellement aux leurs d'abord, à éduquer leurs propres enfants, et non pas à financer les pensions d'une population qui leur est étrangère et à qui ils reprocheront d'avoir élu de mauvais bergers. Enfin, les immigrés, même ceux qui sont les mieux payés, touchent des bas salaires et ne paient pas suffisamment d'impôts pour financer une aussi gigantesque machine. Ensuite, précarisés eux-mêmes dans un pays qui leur a promis monts et merveilles et ne leur a donné que le chômage, les immigrés font aussi de moins en moins d'enfants. Donc ceux sur qui nos lamentables escrocs comptent pour payer nos pensions, n'existeront tout simplement pas, parce qu'on n'aura pas eu le cœur de les engendrer! Il y a ensuite tout lieu de croire que les flux migratoires vont s'inverser: ne trouvant plus d'emplois stables chez nous, les allocations se faisant de plus en plus congrues, étant de plus en plus bouffées par l'inflation, les jeunes immigrés vigoureux et courageux iront chercher un destin ailleurs, dans des pays où la conjoncture est haute.
Le bilan de tout cela, c'est que personne n'a été intégré: ni les autochtones ni les immigrés. La source de notre malaise, c'est effectivement que les recettes de l'établissement ne permettent plus aucune forme d'intégration sociale. On le constate aisément: les statistiques et les travaux d'observation des grands instituts européens, comme l'OCDE, parlent sans arrêt d'une désagrégation de la société, démontrent que les immigrés sont les premières victimes du chômage donc qu'ils ne sont nullement intégrés et risquent de rester inintégrables, vu le manque de moyens. Tel est donc le langage que nous tient l'OCDE, qui constate la faillite de toutes les formes d'intégration sociale pour les autochtones comme pour les immigrés; mais au lieu de prendre cette misère à bras le corps, de chercher des solutions réalisables, de fixer des projets clairs, satisfaisants pour tous, l'établissement esquive les vrais problèmes et camoufle ses carences derrière un formidable battage publicitaire et médiatique où l'on ne parle plus que d'intégration et où l'on promet le purgatoire et l'enfer à tous ceux qui oseraient douter de l'opportunité de ce miroir aux alouettes.
Personne ne peut être hostile à la notion d'intégration et nous ne le sommes pas a priori, car nous aimerions que chaque concitoyen, que chaque étranger qui est notre hôte, ait son boulot, son atelier, puisse travailler selon son cœur et ses aptitudes. Animés comme tous les populistes par une volonté sincère de donner à chacun son dû, nous sommes tout simplement hostiles aux prometteurs de beaux jours, aux charlatans et aux menteurs: cette intégration tous azimuts n'est malheureusement plus possible et le sera encore moins demain. Nos enfants ne sont déjà plus pleinement intégrés à la société dans laquelle ils vivent et les enfants des immigrés risquent bien de connaître un sort pire, même s'ils ont réussi de brillantes études, comme certains sont en train de le faire.
Pour reprendre un vieux slogan socialiste, les “damnés de la terre” sont revenus à l'avant-plan. Et ces “damnés de la terre”, c'est nous! Cette position peu enviable postule d'organiser la résistance et de s'opposer rationnellement et efficacement à tous ceux qui jouissent de privilèges indûs dans notre société, qui bénéficient de pensions exagérément élevées, qui ne subissent pas le principe du cumul des époux et/ou des cohabitants dans la fiscalisation des pensions, qui bénéficient de clauses de stabilité d'emploi dont les salariés ne bénéficient plus et dont les indépendants ne peuvent que rêver, qui ont obtenu des emplois dans la fonction publique en dépit de l'inutilité de ces postes. La priorité doit être redonnée en matières d'emploi et de lois sociales à tous ceux qui travaillent dans la précarité, qui doivent lutter âprement, chaque jour que Dieu fait, pour vivre, qu'ils soient indépendants ou salariés.
Car se déclarer “populiste”, c'est marquer une volonté d'aller au réel et de ne pas vouloir transformer le monde d'après une idéologie toute faite, d'après des planifications qui ne masquent que très mal les intentions idéologiques de leurs auteurs. En effet, le peuple est un tout complexe, composé de personnalités et d'individus très différents les uns des autres. Développer un discours ou une action populistes ne signifie pas une volonté de mettre au pas ces innombrables différences entre les personnes, mais constater que celles-ci ne peuvent plus déployer leurs originalités, exercer leurs compétences, si le pays est mal gouverné, si l'endettement jugule toutes les initiatives intelligentes. Aussi différentes que soient les personnes qui composent notre peuple, elles partagent une sorte de destin, de fatalité: elles vivent non seulement sur un même espace géographique mais aussi sous un seul régime politique qui finit par les exclure du marché du travail, par leur confisquer leur liberté de créer, par les ligoter dans leur élan par une fiscalité qui sert avant tout à nourrir les suppôts fonctionnarisés du régime ou à payer les intérêts pharamineux de la dette. La démocratie, qu'il ne s'agit pas de nier ici, a prévu l'alternance: si un gouvernement ou une coalition ne donne pas satisfaction, il faut mettre les meilleurs challengeurs au pouvoir, s'ils sont choisis par le peuple. En rendant nulle et non avenue la séparation des trois pouvoirs, en nommant les magistrats en dépit de l'indépendance que devrait avoir le pouvoir judiciaire, en rendant la séparation entre le législatif et l'exécutif illusoire à cause du poids des partis et des chefs de parti, le régime a perdu sa légitimité démocratique: le recours au peuple, à ces innombrables différences qu'il recèle, devient donc une nécessité. Il faut inventer de nouveaux mécanismes de pouvoir ou en réexhumer dans nos traditions politiques.
Le régime se défend, bien évidemment. Il veut conserver la non-démocratie qui le maintient au pouvoir et empêcher tout recours au peuple réel.
- D'où des trains de lois qui décrèteront “raciste” toute question relative au bien-fondé, à l'utilité ou à l'efficacité de l'immigration (répétons-le: nous sommes hostiles au mécanisme économique qui consiste à recourir à l'immigration, nous déplorons la non-intégration de masses immigrées et juvéniles désœuvrées, nous déplorons la petite criminalité qui en découle en en rendant prioritairement responsable le pouvoir et non pas les délinquants, nous refusons toute démarche qui serait a priori hostile à des personnes en vertu de leurs appartenance à une race ou à une religion autres que celles de la majorité de la population).
- D'où les tentatives de juguler l'action des syndicats qui débordent leur encadrement dévoué d'une façon ou d'une autre au pouvoir, notamment aux partis socialistes.
- D'où la suppression subtile de la liberté de la presse par un contrôle systématique des rubriques “courrier des lecteurs”.
- D'où l'augmentation scandaleuse des tarifs postaux pour les éditeurs de revues indépendantes, qui pourraient préparer des équipes à reprendre les affaires en mains (c'est là une manière de ruiner les audacieux qui osent faire usage de leur droit à la parole).
- D'où la déconstruction systématique de l'enseignement, de façon à raréfier l'esprit critique dans les nouvelles générations: l'enseignement gratuit de qualité avait été un des plus beaux acquis démocratiques de ce siècle; le pouvoir est en train de le démonter pour faire de nos enfants un vulgaire troupeau de moutons de Panurge, taillable et manipulable à souhait. C'est la raison pour laquelle les populistes doivent défendre les enseignants et l'enseignement.
Le populisme peut recevoir une interprétation de gauche ou une interprétation de droite. Il est de gauche quand il prend appui sur des injustices sociales flagrantes, quand il vient d'une base ouvrière lésée, quand il prend racine dans des comités de quartiers. Il est de droite quand il veut dépasser les divisions naturelles de la société en mythifiant l'unité de destin des personnes et en évoquant ainsi l'unité mythique de la Nation, quand il se range derrière la bannière d'un chef politique charismatique ou d'une élite de notabilités traditionnelles. Mais les frontières entre populisme de gauche et populisme de droite sont floues et poreuses. Le peuple dans sa plénitude et dans ses différences transcende le clivage d'une gauche ou d'une droite: le peuple est un, il n'y a pas deux demi-peuples.
Le populisme, répétons-le, n'est pas une idéologie pré-fabriquée que l'on plaquerait sur une réalité mouvante et rétive. Le populisme, c'est le recours à la réalité quotidienne.
Dans notre contexte, celui des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, la réalité quotidienne ne fonctionne plus correctement parce qu'une immigration incontrôlée, avec beaucoup de clandestins, ne parvient pas à s'intégrer, parce qu'un urbanisme délirant chasse les hommes de chair et de sang pour faire place aux bureaux et aux administrations eurocratiques, parce que la convivialité disparaît. L'immigration n'aurait pas posé beaucoup de problèmes si nos dirigeants avaient respecté scrupuleusement les clauses des accords belgo-marocains, prévoyant des contrats de travail pour cinq ans seulement, sans regroupement familial, dans cinq secteurs précis de l'industrie. Pacta sunt servanda, les traités (pactes et accords) doivent être respectés, dit l'adage latin. Quand les Belges se plaignent de l'immigration, c'est ce que leur répondent les autorités marocaines: si vous aviez respecté nos accords à la lettre, l'immigration n'aurait pas posé de problèmes, vous n'avez donc qu'à vous en prendre à vous-mêmes. Les débordements d'une jeunesse immigrée déboussolée, la non-intégration, le taux de chômage des immigrés sont des effets pervers de la négligence de nos gouvernants et non pas des immigrés ou des autochtones qui seraient brusquement devenus des “racistes”. L'afflux d'immigrés et d'eurocrates, couplé à un urbanisme spéculateur et axé sur la seule construction de bureaux, fait augmenter considérablement le coût du logement à Bruxelles, l'espace se raréfie pour les familles et les enfants, la population de souche doit migrer vers les campagnes ou les communes périphériques du Brabant flamand ou wallon, ce qui fait disparaître la convivialité et monter la tension entre les plus démunis qui restent dans leur ville natale et les nouveaux arrivants qui ne comprennent pas pourquoi ils sont mal reçus.
Chômage, dette, urbanisme spéculateur, disparition de la convivialité ambiante, nécessité de respecter les traités signés pour réguler harmonieusement les flux migratoires: ce sont là autant de problèmes auxquels il s'agit désormais de donner une forme politique, non idéologique, réalitaire et populiste. En forgeant cette forme politique, nous donnerons de la substance à la protestation populaire contre les déraillements de l'établissement et des partis au pouvoir depuis des décennies et des décennies.
Les objectifs d'un nouveau populisme à Bruxelles:
- répondre aux problèmes de la vie quotidienne;
- opposer aux partis établis une logique du bon sens;
- libérer les énergies du peuple réel qui ont été brimées pendant trop longtemps.
Robert STEUCKERS.
(texte de 1999).
00:05 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, europe, idéologie, révolte, populisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 25 août 2008
Consolidons deux axes contre l'atlantisme!

Ugo GAUDENZI:
Consolidons deux axes contre l’atlantisme !
Depuis des années déjà, mon quotidien romain, “Rinascita”, milite, prêche et exhorte ses lecteurs pour aboutir à ce qui semble la seule et unique solution possible pour assurer la survie de notre Europe: l’union stratégique de l’Ouest et de l’Est du continent.
Cette unité de la “plus grande Europe” est une question de vie ou de mort: elle ne se réalisera que par la réactivation et la consolidation d’un nouvel “axe carolingien”, l’Axe Paris-Berlin-Moscou (ndt: remarquablement mis en exergue par Henri de Grossouvre en France), et par l’invention révolutionnaire d’une “alliance continentale-méditerranéenne”, d’un Axe Madrid-Rome-Belgrade-Moscou, capable de fermer les côtes méridionales de l’Europe à toute influence hostile émanant de l’atlantisme.
Telle est notre “utopie réalisable” (et, en partie, elle est déjà en voie de réalisation): construire un double axe géopolitique assurant la défense et la sécurité en Europe.
L’objectif, de fait, est de rendre la souveraineté aux Etats nationaux européens, qui ont été transformés, par les Anglo-Américains, en un chapelet de petites colonies satellisées. L’objectif, pour tous les peuples d’Europe, c’est de faire converger leurs forces, de les additionner et de les joindre à celles de la Russie, l’unique Etat national européen encore capable de donner à notre “plus grande patrie” un avenir dans l’unité sur tous les plans: culturel, social, économique et politique.
En dépit de toutes les vicissitudes, et même des vicissitudes négatives, jour après jour, année après année, notre vision commune s’est renforcée et n’a cessé de se renforcer en Europe. Notre voix, celle de “Rinascita”, n’est plus une voix qui crie dans le désert, mais une voix qui a suscité, en dehors de son vivier d’origine, un écho tangible et des analyses similaires, désormais partagées par de nombreux cercles et personnalités.
De l’effondrement du Mur de Berlin à nos jours, l’histoire européenne a enregistré et subi des offensives répétées contre son territoire. Par le miroir aux alouettes du bien-être occidental ou par les armes de l’OTAN, les fédérations des Etats d’Europe orientale, soit l’URSS et l’ex-Yougoslavie, ont été brisées, émiettées et fragmentées par l’offensive anglo-américaine et néo-libérale, agissant souvent par le biais de “révolutions oranges”, financées par des fonds issus de l’usure et de la finance.
Actuellement, les “fondations” et les groupes de pression occidentaux (Rockefeller, Agnelli, Trilatérale, Davos et autres) ont juré de détruire tous les Etats nationaux et tous les systèmes de protection sociale qu’ils ont mis sur pied, en faisant miroiter les délices d’un “fédéralisme” composé d’autonomies régionales, alors que leur objectif réel est tout entier contenu dans le vieil adage latin “Divide et impera” (“Diviser pour régner”), à appliquer, cette fois, à tout le globe, par ceux qui détiennent le maximum de pouvoir sur les plans politique et économique.
Mais voilà que l’attaque en direction du coeur de la Russie, attaque qui était censée constituer la manoeuvre principale dans la conquête définitive de l’Europe, vient d’échouer.
Le Kremlin a repris les rênes du pouvoir en ses terres propres. Il a utilisé les mêmes armes que les puissances atlantiques, le pétrole et l’énergie, mais sans avoir eu besoin, pour ce faire, d’envahir d’autres pays et de les occuper. Ainsi, le Kremlin est revenu à un “status quo ante” qui hisse à nouveau la Russie au rang de puissance planétaire et non plus régionale.
Pour le bien commun de toutes nos terres européennes, pour le bien de l’humanité toute entière, il faut qu’échoue la stratégie mondialiste qui, sous les oripeaux de la “globalisation économique” et sous la bannière du “libre marché”, cherche en réalité à imposer à toutes les nations la domination unipolaire des Anglo-Américains, orchestrée par la haute finance.
L’enjeu est énorme, extrême. Tellement extrême que, depuis 2001, Washington, prévoyant, pour sa puissance, l’émergence imminente de vents prochains très défavorables, a fait battre ses tambours de guerre, partout dans le monde.
Ces tambours, il faut les faire taire. Notre tâche, à nous Italiens, est de travailler à l’alliance méditerranéenne/continentale, à l’Axe qui nous unira à Moscou.
Ugo GAUDENZI.
(éditorial de “Rinascita”, Rome, 13 août 2008; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, géostratégie, atlantisme, russie, anti-atlantisme, etats-unis, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Emigration blanche, fascismes russes, stalinisme
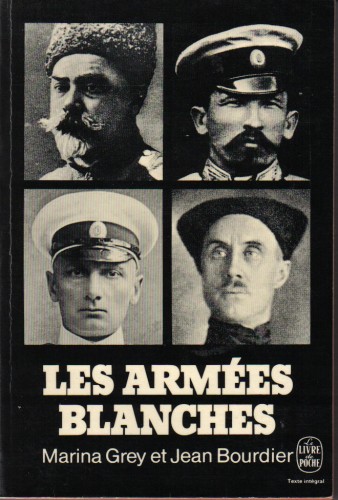
Emigration blanche, fascisme, stalinisme: approches nouvelles après la chute du communisme
Le généalogie des droites russes chez Walter Laqueur
par Robert STEUCKERS
L'impact des fascismes ouest-européens et du national-socialisme allemand a été important dans les cercles d'émigrés blancs pendant l'entre-deux-guerres. Le fascisme séduisait parce qu'il promettait des solutions rapides aux problèmes de l'époque, alors que les parlements, qui soumettaient tout à d'interminables discussions, étaient accusés de laisser «pourrir les situations». Ce culte de la «décision rapide», très présent dans les débats allemands de l'époque et dans les discours tonitruants de Mussolini, débordait les cercles restreints des fascistes russes purs et durs et séduisait des conservateurs, dont Struve, et des modérés, dont Timachev.
Pour propager ce double culte de l'autorité et de la vitesse de décision, plusieurs groupes ont vu le jour dans les années 20. Ils étaient surtout constitués de jeunes gens enthousiastes. Le plus petit de ces groupes était le «Mouvement des Jeunes Russes» (Mladorossitsy), dirigé par Alexandre Kassem Bek, issu d'une famille aristocratique d'origine persane, russifiée au cours du XIXième siècle. Emigré à Paris, Kassem Bek prend dès l'âge de 21 ans la tête d'un groupe d'étudiants blancs, réclamant l'avènement d'une monarchie totalitaire de type nouveau. Reprenant à leur compte tous les éléments du decorum fasciste, ainsi que la discipline qui caractérisait cette mouvance, les adeptes de Kassem Bek estimaient, nous explique Laqueur, que l'ancien régime ne pouvait plus être restauré, car il avait été rongé de l'intérieur par la décadence, le «bourgeoisisme» et le «philistinisme». L'effondrement de ce régime sous les coups des Bolcheviks était donc une punition largement méritée. L'apocalypse de 1917 et l'horreur de la guerre civile auraient donc eu des vertus purgatives, selon les partisans de Kassem Bek. Propos qui n'ont guère choqué les conservateurs comme Struve (qui ouvre aux «Jeunes Russes» les colonnes de sa revue) ni Cyrille, le prétendant au trône des Romanovs. Deux grands-princes adhèrent au mouvement.
Au culte de Mussolini et de Hitler, s'ajoute, curieusement, le culte de Staline. Ce dernier, affirmaient Kassem Bek et ses «Jeunes Russes», avait mis un terme à l'anarchie révolutionnaire, avait rétabli l'autorité de l'exécutif (concentrée entre ses mains) et donné congé à l'internationalisme. Kassem Bek plaidait dès lors pour une symbiose entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau, pour une monarchie incarnée par le Grand-Prince Cyrille mais reposant sur les nouvelles institutions soviétiques: bref, pour une monarchie bolchévique!
Après une tentative de collaboration avec les nationaux-socialistes allemands, qui téléguidaient le ROND (un parti nazi russe établi à Berlin), le rapprochement tourna court: les Allemands reprochant aux Russes d'être des «nationaux-bolchévistes» et non d'authentiques «nationaux-socialistes». Xénophobes (mais pas officiellement antisémites; en pratique, pourtant, ils l'étaient), les «Jeunes Russes» reprenaient aux Eurasiens l'idée que la mission réelle de la Russie est en Asie, et que Moscou doit constituer un glacis pour la race blanche contre le «péril jaune». Mais Kassem Bek se méfiait des projets concoctés par les Allemands en Europe orientale: en 1939, il demande aux «Jeunes Russes» de soutenir la cause des alliés occidentaux et quitte l'Europe pour les Etats-Unis. En 1956, il revient à Moscou, y devient le secrétaire du Patriarche et meurt en 1977. Il aurait été un agent soviétique tout au long de sa carrière. Laqueur souligne (pp. 111-112) que les Soviétiques ont recruté bon nombre d'agents dans tous les milieux politiques de l'exil russe, y compris chez les Mencheviks, mais que seuls les Blancs fascisants ont été autorisés à rentrer au pays.
Parmi les idéologues autoritaires, monarchistes-bolcheviks, une figure sort du lot: celle d'Ivan Loukianovitch Solonévitch (1891-1953). Il a commencé sa carrière dans la presse radicale de droite avant la Révolution. Il quitte l'URSS en 1934, en franchissant clandestinement la frontière finlandaise, puis publie le récit de cette évasion, qui devient un best-seller international. Solonévitch devient alors journaliste dans la presse émigrée libérale et modérée. Puis, brusquement, il opère un virage à droite, qui le rapproche des cénacles conspiratifs animés par d'anciens lieutenants et capitaines de l'armée du Tsar. Il termine sa vie en Argentine. Son ouvrage politique majeur, Narodnaïa Monarkhiia («La Monarchie Populaire»), a été réédité à Moscou en 1991, et inspire quelques néo-monarchistes.
Les partis fascistes russes ont connu une brève existence en Allemagne, en Mandchourie et aux Etats-Unis dans les années 30. Le groupe le plus significatif était celui de Mandchourie. Il naît dans la faculté de droit de l'université locale, parmi les jeunes Blancs réfugiés là-bas. Le général tsariste Kosmine les soutient. Ils se regroupent d'abord dans l'«Organisation Fasciste Russe» (OFR), puis dans le «Parti Fasciste Russe» (PFR), et éditent deux revues: Nache Poute («Notre Voie») et Natsia («Nation»). De 1931 à 1945, année où l'armée rouge pénètre dans Kharbine, capitale de la Mandchourie, ce fut la figure de Konstantin Rodzayevski qui mèna le parti. Enthousiaste, fougueux mais naïf, il adopte fébrilement les colifichets à croix gammées des nationaux-socialistes allemands, donnant à sa formation des allures quelque peu carnavalesques. De plus, il dépend financièrement du bon vouloir des Japonais. Il espère une victoire de l'Axe Berlin-Tokyo, dont les armées, espère-t-il en dépit de son nationalisme russe, occuperont l'Union Soviétique et placeront à la tête de la nouvelle Russie dé-bolchévisée un «gouvernement national», dirigé évidemment par lui!
Concurrent de Rodzayevski en Mandchourie: l'Ataman Semionov, militaire conservateur, nullement attiré par les imitations du folklore nazi, parie sur la solidarité des Cosaques réfugiés en Extrême-Orient. En 1945, Rodzayevski et Semionov sont tous deux condamnés à mort dans un procès commun, assez expéditif. Et l'activiste du PFR introduit alors une demande pour rentrer au service de Staline, considéré comme «leader fasciste russe», et propose de réactiver ses réseaux pour en faire une «cinquième colonne» au bénéfice de la politique de Moscou. Sa demande n'a pas été retenue.
Aux Etats-Unis, un certain Anastase Vozniyatski fonde une «Organisation Fasciste Panrusse» (OFPR) en 1933, à Windham County dans le Connecticut, avec l'argent de son épouse, une millionaire américaine du nom de Marion Stephens, née Buckingham Ream dans une famille de négociants en bétail et en céréales. Malgré son argent, Vozniyatski n'a pas réussi en politique. La chronique de son mouvement ne révèle rien d'original ni d'extraordinaire.
Pendant les vingt premières années d'exil des Blancs et des anti-bolchéviques de toutes opinions, le mouvement qui, incontestablement, a connu le plus de succès, fut le NTS (in extenso: «Fédération Nationale du Travail de la Nouvelle Génération»). Ce mouvement d'inspiration solidariste et chrétienne-orthodoxe a tenu son premier congrès en 1930 et élu son président, W. M. Baïdalakov, un Cosaque du Don. Objectif: poursuivre le combat pour l'«idée blanche» sous une autre forme, adaptée aux plus jeunes générations. Le NTS travaillait très sérieusement, contrairement aux «Jeunes Russes» et aux groupuscules fascistes de Mandchourie. A peu près tous les deux ans, l'organisation tenait un congrès où l'on décidait des nouvelles orientations et où l'on fixait un nouveau programme. Son idéologie sociale était le solidarisme, un solidarisme qui se distinguait toutefois du solidarisme préconisé par les écoles politiques catholiques d'Europe occidentale. Ce solidarisme reposait sur une triade: idéalisme, nationalisme, activisme. L'idéalisme soulignait l'importance des idées pures et des valeurs, formes permanentes et indépassables dans le monde effervescent de la politique. Le nationalisme indiquait que ces valeurs s'inscrivaient toujours dans un contexte et que ce contexte était la nation, en l'occurrence la nation russe. L'activisme correspondait à la volonté de réaliser l'adéquation de la théorie et de la pratique, un peu comme dans le marxisme.
Ce solidarisme était bel et bien une idéologie conservatrice, dans le sens où l'harmonie entre les classes qu'il prônait le conduisait à rejeter l'«individualisme libéral excessif» et à imposer des limites à la liberté individuelle; le solidarisme du NTS refusait également la démocratie pluripartite. Les industries-clefs devaient demeurer sous la houlette de l'Etat. Le NTS reprenait à son compte une idée centrale dans l'héritage slavophile, l'idée de Sobornost, telle que l'avait théorisée Khomiakov.
Le NTS ne s'est jamais aligné idéologiquement sur les fascismes européens ou sur le nazisme, car sa dimension religieuse le rapprochait davantage du corporatisme catholique autrichien ou du salazarisme portugais, idéologies éloignées du modernisme industrialiste fasciste-italien ou national-socialiste allemand. Quelques éléments toutefois ont collaboré en Allemagne avec les autorités nationales-socialistes, même si le NTS était interdit et ses adhérants emprisonnés. Cette coopération a eu lieu dans les territoires occupés par l'armée allemande et dans le mouvement du général Vlassov. L'organe de presse de ces militants pro-allemands du NTS était le Novoïé Slovo.
Après la guerre, le NTS adopte une idéologie de «troisième force», cherchant à dépasser le marxisme et le capitalisme. Les puissances occidentales ont passé l'éponge sur la collaboration des quelques éléments du NTS (Redlich, Poremski, Tenserov, Vergoune, et Kazantsev) et les Américains, logique de la guerre froide oblige, ont soutenu le mouvement et financé sa propagande à l'intérieur du territoire soviétique. Cette double collaboration avec les ennemis de la Russie, l'Allemagne d'abord, les Etats-Unis ensuite, n'ont pas donné bonne presse au NTS, en dépit de la pureté de ses idéaux, bien ancrés dans la tradition et le mental du peuple russe. Le citoyen soviétique moyen s'en désintéressait.
Selon Laqueur, le principal idéologue du NTS fut le Professeur Ivan Ilyine (1881-1954), qui enseignait la philosophie à l'Université de Moscou avant la Révolution. Cet excellent connaisseur de la pensée de Hegel est expulsé d'URSS en 1922, en même temps que Berdiaev. Il publiait ses écrits dans la revue Russkii Kolokol, proche du NTS sans en épouser toutes les thèses: en effet, Ilyine était monarchiste tandis que les militants du NTS ne se prononçaient pas sur cette question et envisageaient l'éventualité d'une République russe non soviétique. Ilyine se faisait l'avocat d'une «démocratie organique», qui n'aurait plus été ni formelle ni mécanique à la façon occidentale. Dans son livre Pout'k otchevidnosti (= La Voie vers l'évidence), Ilyine définit la «vraie politique» comme un «service», comme le contraire diamétral de la politique envisagée comme «carrière». La notion de service implique de servir les intérêts du peuple tout entier et non d'une catégorie sociale ou d'un réseau d'intérêts. Cette volonté de servir une entité collective de vastes dimensions fait de la politique un «art de la volonté», d'une volonté qui sait d'instinct choisir et promouvoir, dans le flot ininterrompu des faits et des événements, ce qui est bon pour le peuple dans son ensemble, pour l'avenir de l'entité nationale. Or cette volonté doit pouvoir se lover dans le moule d'un idéal et ne pas oublier les vertus du cœur, qui donnent impulsion et sagesse aux potentialités créatives de l'homme politique (pour une approche des idées d'Ilyine, cf. Helmut Dahm, Grundzüge russischen Denkens. Persönlichkeiten und Zeugnisse des 19. und 20. Jahrhunderts, Johannes Berchmans Verlag, München, 1979).
Laqueur, ensuite, passe à une analyse des sources du néo-nationalisme russe contemporain. Ce «parti russe» est né des œuvres des néo-slavophiles et des «écrivains du terroir». Pionniers à l'ère stalinienne de ce style ruraliste, Vladimir Ovetchkine et Yefim Doroche ont préparé le terrain d'une nouvelle école littéraire populiste et nationaliste. Dans les années 60 et 70, les écrivains de Russie septentrionale et de Sibérie, comme Fiodor Abramov, Vassili Choukchine (Kalina Krasnaïa, Le beau bosquet de boules de neige) et Valentin Raspoutine (Adieu à Matiora). Cette littérature est loin d'être idyllique, souligne Laqueur. Les conditions de vie dans les villages du Nord et de la Sibérie sont terribles et les villageois décrits par Abramov se haïssent mutuellement, ne forment plus une communauté soudée et solidaire. Belov, pour sa part, est moins pessimiste: ses personnages vivent dans un monde beau et pur, à l'ombre des clochers en bulle, bercé par la musique douce et gaie des cloches des églises, où se côtoient des mystiques et des idiots qui atteignent la sainteté. Soloükhine se déclare disciple du Norvégien Knut Hamsun, qui, lui aussi, a décrit des personnages ruraux non pervertis par la civilisation moderne. Astafiev et Raspoutine évoquent les descendants des pionniers, dispersés dans les immensités sibériennes. Dans les petites villes, les habitants n'ont plus de référants moraux: ils pillent un dépôt en flammes, n'ont plus de racines et plus aucun sens du devoir. Ils ne songent qu'à s'enrichir et saccagent l'environnement naturel. Cette dépravation est le fruit du pouvoir communiste, écrivait Soloükhine, sans pour autant encourir les foudres du régime; au contraire: il a été lauréat du Prix Lénine! La tonalité générale de cette littérature ruraliste est un scepticisme à l'égard du progrès mécanique, matériel et économique, à l'égard des productions intellectuelles des grandes villes, à l'égard de la culture de masse contemporaine, importée de l'Ouest.
Dans le grand public, ce sont des revues littéraires conservatrices, mais fidèles en paroles au régime, qui se sont fait le relais de ce ruralisme, de ce culte de l'enracinement et de ce refus du déracinement: Nache Sovremenik et Molodaïa Gvardiya. Novii Mir, pour sa part, défendait les thèses progressistes classiques de l'idéologie marxiste. Cet engouement pour le passé intact de la Russie a conduit à une redécouverte de l'héritage slavophile du 19ième siècle, dès la fin des années 70, où Chalmaïev, Lobanov et Kochinov en arrivent à la conclusion que la Russie est devenue un pays décérébré et américanisé, qui perd sa «dimension intérieure», ses racines, en dépit de sa puissance militaire. La Russie est une «coquille vide».
Ce mélange de ruralisme, de slavophilie rénovée, de culte de l'enracinement et d'anti-américanisme, conduit à une critique plus fondamentale de l'idéologie marxiste dominante. Les nationalistes, en effet, évoquent la thèse du «flux unique» de l'histoire russe, thèse qui est en contradiction totale avec le léninisme. En effet, d'après Lénine et ses disciples, l'histoire russe se subdivise en deux courants, un courant progressiste (Pierre le Grand partiellement, Herzen, Tchernitchevski et Gorki) et un courant obscurantiste composé de réactionnaires, de fanatiques religieux et d'exploiteurs du peuple. A ce dualisme officiel, les ruralistes opposent, sans nier la validité du courant progressiste, une réhabilitation des forces politiques et spirituelles qui ont consolidé la Russie au cours des siècles passés, sans être marquées par la philosophie progressiste, moderniste et occidentaliste. L'histoire russe, dans cette optique slavophile et nationale, draine dans un fleuve unique une masse d'éléments positifs, tantôt frappés du sceau du progressisme, tantôt frappés de celui de l'enracinement ou de la tradition, soit de l'immuable.
Le Parti ne pouvait pas accepter cette vision sans risque. Car cela aurait impliqué une revalorisation du rôle de la monarchie et de l'église dans l'histoire russe. Et cela aurait également signifié que, lors de la guerre civile, les Rouges comme les Blancs avaient eu des raisons, avaient eu les uns et les autres partiellement ou entièrement raison. Si Nicolas II et Lénine avaient eu tous deux raison, la révolution aurait pu être considérée comme inutile et l'idéal aurait sans doute été un régime à mi-chemin entre le bolchevisme et la monarchie, sans doute une monarchie populaire comme l'envisageait Ivan Solonévitch. Mais lentement la thèse du «flux unique» a fait son chemin, s'est imposée et structure métaphysiquement la convergence que l'on observe actuellement entre nationalistes et anciens communistes. Hors du «flux unique» ne se trouvent désormais plus que les libéraux qui restent fidèles aux thèses «progressistes», tout en avalisant l'inflation terrible qui secoue la vie russe depuis la libéralisation des prix de janvier 1992, voulue par Gaïdar et son équipe. Aval qui leur fait perdre toute légitimité populaire.
Déjà pendant les dernières années du règne de Brejnev, la maison d'édition Roman Gazetta, qui publiait des livres de poche bon marché, n'éditait plus que des auteurs populistes, slavophiles ou nationalistes, précise Laqueur (p. 135). Signe de leur victoire: quand Alexander Yakovlev, chef du département idéologique du comité central, prononça en 1972 un discours contre l'«anti-historicisme» des russophiles et critiqua leur culte de la religion orthodoxe, tout en défendant les «démocrates» révolutionnaires du XIXième siècle, il fut promu ambassadeur d'URSS au Canada et y resta de nombreuses années. Eviction déguisée, bien évidemment. Cet incident marqua la victoire des revues Nache Sovremenik et Molodaïa Gvardiya. Novii Mir, dont les collaborateurs «libéraux» et «progressistes» avaient été écartés dès les années 70, tenta de reprendre son combat en faveur du «courant progressiste». Sans succès. Elle fut réduite au silence pendant 20 ans et ne reparut que dans le sillage de la perestroïka.
Au départ de sa carrière d'écrivain persécuté, Alexandre Soljénitsyne se situait plutôt dans le camp libéral. Il en sortira petit à petit pour esquisser les grandes lignes d'un «conservatisme» populiste et slavophile particulier, en marge du conservatisme plus musclé des nationalistes et des paléo-communistes actuels. Au départ, ce sont les libéraux, notamment les rédacteurs de Novii Mir, qui se sont engagés à défendre l'écrivain Soljénitsyne, alors que conservateurs et nationalistes critiquaient ses positions. Mais Soljénitsyne jugeait les libéraux trop mous dans leur défense des dissidents. Son glissement vers un conservatisme populiste et slavophile s'est amorcé dès sa lettre ouverte aux dirigeants soviétiques, où, depuis son exil zurichois, il critiquait cette intelligentsia libérale qui croyait que sa tâche première était de «dépasser la folie nationale et messianique des Russes». Entreprise impossible, selon Soljénitsyne, car elle aurait réduit la russéité à rien. Dans cette lettre, il exhortait les dirigeants soviétiques à abandonner le marxisme-léninisme, une idéologie qui ne cessait de provoquer des conflits avec l'étranger, affaiblissait la Russie de l'intérieur et instaurait un système du «mensonge permanent». Ensuite, il demandait l'abrogation du service militaire obligatoire, ce qui hérissait les nationalistes. Sa pensée, au fond, était une synthèse entre le libéralisme national et populaire et le nationalisme dur: le régime qui conviendrait à la Russie serait à la fois éclairé et autoritaire, et s'appuyerait sur les Soviets, car introduire une démocratie à l'occidentale sans transition en Russie conduirait à la catastrophe.
Cette synthèse, malgré ses relents d'anti-militarisme, ou, au moins, son hostilité à la conscription générale, finit tout de même par plaire davantage aux nationalistes qu'aux libéraux. Sakharov trouvait le nationalisme de Soljénitsyne «exagéré», voire quelque peu «xénophobe» et déplorait que l'auteur de l'Archipel Goulag n'entonnât pas un plaidoyer a-critique en faveur de la démocratie à l'occidentale. Le nouveau clivage séparait désormais ceux qui prétendaient que les idées occidentales (dont le marxisme) pervertissaient l'âme russe et ceux qui affirmaient que c'était les défauts de la mentalité russe qui précipitaient la Russie dans le malheur.
La «Nouvelle Droite» russe, ou plutôt les «nouvelles droites» russes, puisent leurs idées dans des synthèses plus modernes ou chez des auteurs plus actuels et seul Soljénitsyne conserve une influence réelle dans le débat. Son influence est évidement plus nette auprès des nationaux-libéraux et des conservateurs tranquilles qu'auprès des nationaux-bolchéviques plus militants et plus activistes. Les Russes d'aujourd'hui tentent également de découvrir des auteurs occidentaux auxquels ils n'avaient pas accès au temps de la censure. La révolution conservatrice allemande et la ND franco-italienne, de même que les synthèses nationales-révolutionnaires de tous acabits, influencent les conservateurs musclés et les nationaux-bolchéviques, tandis que les travaux de Max Weber, José Ortega y Gasset, etc. intéressent les nationaux-libéraux. L'engouement pour Nietzsche est général et cela va des réceptions caricaturales aux analyses les plus fines. Dans ce bouillonnement, un penseur original: Lev Goumilev, décédé en juin 1992, considéré comme une sorte de «Spengler russe»; il a élaboré une théorie de l'«ethnogénèse» des peuples, en expliquant que ceux-ci font irruption sur la scène de l'histoire, animés par une passionarnost, une «passion», un instinct, une pulsion. Cette passionarnost s'épuise petit à petit, forçant les peuples vidés de leurs pulsions créatives, à quitter l'avant-scène de l'histoire, puis à sombrer dans l'insignifiance. Goumilev était «eurasiste» et essuyait les critiques de ceux qui revendiquaient une russéité européenne.
Les nouvelles synthèses russes se forgeront dans la lutte, dans cette opposition à l'occidentalisation brutale dont ils sont les victimes. Imaginatifs et prenant les idées beaucoup plus au sérieux que les Occidentaux, les concepts mobilisateurs de demain seront à coup sûr originaux. Et provoqueront l'étonnement de ceux qui veulent tout mesurer à l'aune des statistiques et des chiffres, des bilans et des profits. Et aussi l'étonnement de ceux qui croient, sur les rives de la Seine, les neurones assaillis par les gaz d'autos, avoir trouvé la formule politique définitive et indépassable dans cette panade ultra-mixée, suggérée par certains journaux (un peu comme si vous mélangiez des fraises écrasées dans l'huile de vos sardines, avec une cuiller de chocolat chaud et du müesli, le tout arrosé de Curaçao bleu, avec un zeste de pamplemousse, le tout saupoudré d'ail).
Robert STEUCKERS.
Walter LAQUEUR, Der Schoß ist fruchtbar noch. Der militante Nationalismus der russischen Rechten, Kindler, München, 1993, 416 S., DM 42, ISBN 3-463-40212-2.
00:05 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, russie blanche, antibolchevisme, fascisme, années 20, années 30, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 août 2008
Société "Thulé": mythe, légende et réalité

La société Thule: légende, mythe et réalité
Il n'y a pas une organisation qui a autant fait spéculer et autant alimenter les imaginations fertiles que la “Thule-Gesellschaft”. Selon leur provenance politique ou idéologique, les auteurs, qui en traitent, disent tantôt qu'elle est un ordre occulte, une secte, tantôt qu'elle a été l'avant-garde intellectuelle, voire le moteur secret qui téléguidait en coulisses la marche en avant de la NSDAP hitlérienne. La littérature consacrée à cette organisation est désormais assez importante, mais, malgré cette ampleur relative, on peut dire que le mystère et/ou le flou qui entourent cette organisation défunte n'ont pas été dissipés. Les affects des auteurs (favorables ou défavorables) oblitèrent encore et toujours la recherche sur cette question et empêchent tout jugement serein.
Detlev Rose, auteur du livre Legende, Mythos und Wirklichkeit der Thule-Gesellschaft, peut revendiquer, pour lui-même, d'avoir enfin comblé, de manière convaincante, une lacune dans l'historiographie contemporaine relative à ces questions. Son écriture est analytique et précise, ses jugements sur les faits sont prudents, on ne peut pas lui reprocher de prendre parti ou de fantasmer.
Pour ce que l'on allait appeler plus tard la “Société Thule”, un homme revêt une importance capitale: Theodor Fritsch, que l'on décrit généralement comme “le principal antisémite allemand avant Hitler”. Il fait irruption sur la scène politico-intellectuelle de son pays à une époque que Detlev Rose décrit comme “le début d'un tournant stratégique définitif” pour le mouvement nationaliste et folciste (völkisch) en Allemagne. Concrètement, Rose désigne l'année 1912, où les sociaux-démocrates deviennent la faction la plus forte du Reichstag et où les premiers symptômes d'une grave crise internationale pointent à l'horizon. Cette époque est celle où l'Allemagne se sent menacée et encerclée par les puissances voisines.
“Un puissant mouvement extra-parlementaire”
Cette constellation crée un climat propice à l'éclosion de toutes sortes de théories du complot, qui ont dès lors connu une haute conjoncture. Du point de vue folciste (völkisch), ce sont surtout les francs-maçons et les juifs qui auraient soi-disant comploté contre l'Allemagne. Fritsch, dans ce contexte, était un élément moteur de l'antisémitisme. Son objectif était d'établir l'antisémitisme comme “un puissant mouvement extra-parlementaire”. Il voulait réformer la société allemande en se basant sur les données raciales. Concrètement, cela signifiait que les Juifs ne pouvaient plus avoir de place dans la vie publique allemande. La pensée de Fritsch était influencée par les théories biologiques sur les races, notamment celles que propageait le philosophe Houston Stewart Chamberlain.
Logique avec lui-même, Fritsch a tenté de rassembler en un seul mouvement tous les activistes antisémites. Ce projet, le maître ès-étalonnage Hermann Pohl de Magdebourg le réalisera. L'objectif principal du programme du Germanen-Orde (L'Ordre des Germains), qu'il avait fondé, était de surveiller et de combattre les Juifs en Allemagne. Seules des “natures germaniques” pouvaient être acceptées comme membres au sein de cet Ordre, c'est-à-dire des hommes et des femmes que la nature avait pourvu d'yeux bleus et de cheveux blonds. La situation de l'Ordre est vite devenue problématique pendant la première guerre mondiale, lorsque la moitié des membres sont mobilisés et envoyés à la guerre. L'Ordre a connu dès 1914 de sérieuses difficultés financières. Le Grand-Maître Pohl, vu cette situation financière déplorable, subit des critiques de plus en plus sévères et finit par être démis de ses fonctions.
Glauer, alias “Sebottendorf”
Pohl réagit à cette exclusion en provoquant une scission dans l'Ordre. A cette époque, survient un homme qui se fera un nom en tant que président et fondateur de la Société Thule: Rudolf von Sebottendorf, né Adam Glauer (1875-1945). La place nous manque, dans le cadre de ce bref article, pour évoquer toutes les vicissitudes de la vie mouvementée de cet homme. En résumé: Sebottendorf se met à déployer un zèle étonnant dans ses activités au bénéfice de l'aile demeurée fidèle à Pohl dans le Germanen-Orde. Cette aile acquiert dès lors une importance sans cesse croissante.
A la fin de la première guerre mondiale, la situation devient critique: la révolution spartakiste provoque une hémorragie de membres. Dans cette situation, Sebottendorf décide, pour des raisons de camouflage, de prendre le nom de “Société Thule”. L'emblème de cette “nouvelle” société est une croix gammée aux branches arrondies avec épée.
Pour l'extérieur, on essayait de donner l'impression que la société existait uniquement pour favoriser des recherches scientifiques sur l'histoire allemande et pour promouvoir de toutes manières jugées opportunes le peuple allemand (la race germanique) en tant que tel. En réalité, cette Société Thule se concevait comme le fer de lance d'une contre-révolution, qui, aux yeux de ses membres, s'avérait nécessaire, car la situation sociale et politique, dans l'Allemagne vaincue de 1918 et 1919, s'éloignait de jour en jour des objectifs jadis fixés par le Germanen-Orde.
Quand le publiciste israélite Kurt Eisner devient Premier Ministre de Bavière pour le compte de l'USPD (les sociaux-démocrates radicaux qui s'étaient désolidarisés de la SPD), et cherche à fusionner système parlementaire classique et républicanisme des conseils de facture bolchevique, en coulisses, la faction des “ennemis du peuple”, appartenant à la Société Thule, semblaient prendre le contrôle de la situation. En effet, les efforts de la société pour abattre la république des conseils de Munich avaient été considérables; sa stratégie n'était toutefois pas la “terreur à objectif précis”, comme le constate Rose. Malgré toutes les suppositions qui ont été énoncées, rien de clair ne peut être dit sur la participation éventuelle de la Société Thulé dans l'attentat qui a coûté la vie à Kurt Eisner.
Une fois la république des conseils de Munich abattue, la Société Thule semble effectivement avoir atteint son objectif, accomplie la mission qu'elle s'était donnée, et ne s'occupe plus que d'activités fort modestes. Ce qui permet d'affirmer que le développement ultérieur du national-socialisme ne lui doit vraiment pas grand chose et que ce mouvement politique a suivi sa logique et ses dynamiques propres, sans la tutelle d'une société à vocation ésotérique.
Une signification marginale
Dès lors, pour en arriver au cœur de la problématique et du “mythe” qui s'y accroche, posons la question: quel rôle cette Société a-t-elle joué en tant qu'élément précurseur du national-socialisme? Rose nous brosse un tableau bien moins coloré et fantasmagorique que celui que nous font miroiter les interprétations habituelles (ndlr: néo-nazies exaltées ou anti-fascistes tourmentées par de nouvelles théories du complot) . Il constate: «Nous ne pouvons parler ni d'une idéologie unitaire ni d'une Weltanschauung originale dans le cas de la Société Thule». Pour Rose, la Société Thule ne revêt qu'une signification marginale dans le processus général d'émergence du national-socialisme.
A propos de la Société Thule, on ne peut nullement parler d'une “influence téléguidée, dûment planifiée, aux objectifs précis, visant à piloter la NSDAP”. Bon nombre d'auteurs se sont laissé piéger par Sebottendorf, qui a donné trop d'importance à la Société Thule dans son livre Bevor Hitler kam (= Avant que Hitler n'arrive). Sebottendorf, notamment, exagère et extrapole en écrivant que certains membres en vue de la NSDAP, comme Rudolf Hess ou Hans Frank, étaient membres de la Société Thule.
Les élucubrations de Rauschning
Rose a également abordé la question cruciale des racines soi-disant occultes du national-socialisme; évoquons rapidement ses arguments: avec des phrases claires, Detlev Rose écrit que les cent conversations que Hermann Rauschning aurait, paraît-il, eues avec Hitler, ne sont que des élucubrations, notamment quand Rauschning parle des “tendances occultistes” de Hitler («Hitler aurait été l'instrument de “forces mystérieuses”»). Pourtant, ces conversations, vraisemblablement fausses, ont été décrites par l'historien Theodor Schieder, décédé en 1984, comme des “documents attestant de sources indubitables et de grande valeur”. A la lumière des recherches de Rose, on peut dire désormais que Schieder a malheureusement répandu et consolidé, par son autorité, une “grossière falsification de l'histoire”.
Tentons une synthèse: l'écriture claire et précise de Rose, qui évite toute jactance et toute grandiloquence, rend son livre indispensable pour tous ceux qui veulent jeter un regard critique ou s'informer sur les racines soi-disant occultes ou ésotériques du national-socialisme.
Michael WIESBERG.
(article paru dans Junge Freiheit, n°3/1995; trad. franç.: Robert Steuckers).
Detlev ROSE, Die Thule-Gesellschaft. Legende, Mythos, Wirklichkeit, Grabert Verlag, Tübingen, 1994, 224 pages, DM 32.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, national-socialisme, sectes, sociétés secrètes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 août 2008
G. Schröder sur la Guerre du Caucase et les relations euro-russes

L’ex-Chancelier Gerhard Schröder sur la Guerre du Caucase et les relations euro-russes
Résumé de l’entretien qu’il a accordé au “Spiegel”, n°34/2008
Q.: Monsieur Schröder, qui est responsable de la guerre dans le Caucase?
GSch: Le conflit possède sans nul doute ses racines historiques, car ila déjà connu plusieurs expressions au cours de l’histoire. Mais l’élément déchencheur dans les hostilités actuelles est l’entrée des troupes géorgiennes en Ossétie du Sud. Voilà ce qu’il ne faut pas chercher à dissimuler.
Voilà la première réponse de l’ancien Chancelier fédéral Schröder aux journalistes du “Spiegel”, cette semaine. Le ton est donné. Il est vif, succinct, dépourvu d’ambigüités. Schröder rappelle également dans cet entretien, plusieurs vérités bonnes à entendre et qui recèlent bien des similitudes avec notre discours, que nous tenons depuis bientôt trois décennies:
- qu’il n’a jamais jugé intelligente la politique de Washington de faire encadrer l’armée géorgienne par des conseillers militaires américains;
- qu’il est bizarre que ces conseillers n’ait pas eu vent des projets russes; “ils sont soit dénués de qualités professionnelles ou alors ils ont été trompés sur toute la ligne”, ajoute-t-il;
- qu’il ne faut pas oublier que le déploiement de fusées américaines en Pologne et en Tchéquie a hérissé les Russes; ndlr: imagine-t-on l’effet qu’aurait fait l’installation de fusées en Géorgie?
- que l’Occident a commis des erreurs très graves dans sa politique à l’endroit de la Russie.
- qu’il ne partage pas l’idée répandue en Occident d’un “danger russe” et que la perception de la Russie à l’Ouest n’a pas grand chose à voir avec la réalité;
- qu’il existe une dépendance mutuelle entre l’Ouest (du moins l’Europe de l’Ouest, ndlr) et la Russie; qu’il n’y a pas un seul problème global qui puisse être réglé sans le concours de la Russie; qu’il n’y a pas moyen, en Europe de l’Ouest, de se passer du pétrole et du gaz russes et, en Russie, de se passer des commandes européennes;
- qu’il n’y a aucune raison d’abandonner le principe du “partenariat stratégique” germano-russe pour satisfaire la politique de Saakachvili;
- qu’il n’y aura pas de retour au “status quo ante” en Abkhazie et en Ossétie du Sud, non pas parce la Russie y a pratiqué, contre Saakachvili, une politique du “gros bâton”, mais parce que la population ne le veut pas;
- qu’il ne souhaite pas l’envoi de soldats allemands en Géorgie pour une mission de pacification;
- que Merkel et Steinmeier ont eu raison de ne pas s’enthousiasmer, de manifester leur scepticisme, lors du sommet de l’OTAN en avril dernier à Bucarest, face à la candidature géorgienne, contrairement à l’avis des Américains et de certains pays est-européens;
- que si la Géorgie avait fait partie de l’OTAN, l’Allemagne et l’Europe entière se seraient retrouvées aux côtés d’un aventurier politique (“ein Hasardeur”);
- que l’Ukraine et la Géorgie doivent d’abord régler leurs problèmes intérieurs avant de songer à rejoindre des regroupements d’Etats comme l’OTAN ou l’UE;
- que le coup de force de Saakachvili aura eu au moins l’effet bénéfique de postposer pendant plusieurs années au moins l’adhésion effective de la Géorgie à l’OTAN;
- qu’il ne partage pas les propos tenus, lors des événements de Géorgie, par le secrétaire général de l’OTAN;
- qu’il n’est pas un “Géorgien” dans le sens où le veut la déclaration du candidat républicain à la présidence des Etats-Unis, McCain, qui avait proclamé: “Nous sommes tous des Géorgiens!”;
- qu’après avoir lu les dernières tirades du belliciste néocon Robert Kagan à propos de l’entrée des troupes russes en Ossétie du Sud, évoquant un “tournant dans l’histoire” et “le retour des conflits entre grandes puissances pour raisons territoriales”, il reste profondément perplexe; que Kagan appartenait déjà au club de “ces messieurs” (sic) qui ont poussé à la guerre en Irak, guerre dont les conséquences ne sont intéressantes ni pour l’Amérique ni pour l’Europe; et que, par conséquent, personne ne doit plus écouter les “bons conseils” de ce Kagan;
- que la fin de la domination unipolaire de l’Amérique approche (allusion à son récent essai publié par l’hedomadaire “Die Zeit” de Hambourg); que les démocrates autour d’Obama s’en rendent compte, comme d’ailleurs tous les républicains raisonnables; que l’Amérique est contrainte d’accepter la multipolarité dans le monde, qu’il n’y a plus moyen désormais d’agir sur le monde autrement qu’en termes de multipolarité; que les républicains devront se soumettre à cette évidence et agir en cherchant des alliés et en tenant compte de l’avis des instances internationales (ndlr: contrairement à l’équipe de Bush jr.); sinon, l’Amérique gagnera sans doute encore des guerres mais perdra toujours la paix; en clair, Schröder annonce la faillite de l’option néocon;
- que l’unification des esprits en Europe, sur le plan de la politique extérieure, a connu un réel ressac depuis 2005 (ndlr: c’est-à-dire depuis la disparition factuelle de l’Axe Paris-Berlin-Moscou), notamment à cause de l’intégration de nouveaux Etats (ndlr : agités par une certaine russophobie);
- que l’Europe ne jouera un rôle sur l’échiquier international, entre l’Amérique et l’Asie, que si elle développe des relations étroites avec la Russie et les maintient sur le long terme; qu’en ce sens, lui Schröder, perçoit la Russie comme partie intégrante de l’Europe plutôt que comme partie intégrante de toute autre constellation;
- que l’équipe dirigeante de la Russie actuelle pense de la même façon mais que sa marge de manoeuvre est plus grande: la Russie peut jouer une carte asiatique mais non l’Europe;
- qu’il s’insurge contre toute diabolisation de la Russie dans les médias; que ni le “Spiegel” ni les autres organes de presse en Allemagne et en Europe ne doivent participer à la diffusion d’informations erronées voire carrément fausses (ndlr: c’est-à-dire, pour nous, à ne pas reproduire les clichés des agences du soft power américain);
- qu’il est le président du comité des actionnaires de “Nord Stream” (le complexe des oléoducs et gazoducs amenant vers la Baltique les hydrocarbures de Russie); que ce complexe est géré par un ensemble d’entreprises allemandes, néerlandaises et russes dont l’objectif est de construire un réseau de gazoducs et d’oléoducs sous la Baltique pour approvisionner l’Europe et l’Allemagne parce que cet approvisionnement garantit le bon fonctionnement de nos économies, donc de nos sociétés.
Des propos qui ont le mérite de la clarté. Et auxquels nous n’avons rien à ajouter! Puisque c’est ce que nous avons toujours dit, depuis la création des revues “Orientations” (1980) et “Vouloir” (1983), “Nouvelles de Synergies Européennes” (1994) et “Au fil de l’épée” (1999), dont le relais est repris, entre autres, par ce blog (2007).
(résumé de Robert Steuckers).
21:08 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, russie, europe, spd, socialisme, allemagne, etats-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Géorgie: les racines du conflit

Günther DESCHNER:
Géorgie: les racines du conflit
C’est dans une constellation “triangulaire” de tensions, entre Tiflis (Tbilisi), Washington et Moscou qu’il faut aller rechercher les déclencheurs de la “Guerre d’août” dans le Caucase, guerre qu’a ordonnée le président Mikhail Saakachvili pour ramener de force dans l’ordre étatique de la Géorgie la “République d’Ossétie du Sud” qui avait fait sécession et n’avait pas été reconnue en tant que telle par l’ordre politique international. Cette action a donné à la Russie le prétexte d’une intervention militaire de grande ampleur. Finalement, les raisons profondes de cette “Guerre d’août” résident dans la lutte géostratégique que mènent les Etats-Unis et d’autres puissances pour contrôler les ressources pétrolières et gazières des régions caucasienne et caspienne.
Mais ce conflit a d’autres racines et il faut remonter loin dans le passé pour les découvrir et les comprendre. Au 18ième siècle, l’Empire des Tsars, en pleine expansion, absorbe, dans le Caucase du Sud les territoires habités par les Abkhazes, les Géorgiens et les Ossètes, qui deviennent une province russe. En Ossétie, plus exactement sur le territoire actuel de l’Ossétie du Nord/Alanie, qui appartient à la Fédération de Russie, la “Commission du Caucase” fit construire une forteresse en 1784, qui deviendra la capitale de la région, en portant le nom significatif de “Vladikavkaz” (= “Qui domine le Caucase”).
Après la chute des tsars et la révolution d’Octobre qui s’ensuivit, on vit d’abord se constituer dans la région une “République Fédérative et Démocratique de Transcaucasie”, qui s’est rapidement disloquée. Finalement, à côté d’une nouvelle Arménie et d’un nouvel Azerbaïdjan, une “République Démocratique de Géorgie” proclame son indépendance en 1918. Le Reich allemand contribua directement à l’émergence de cette république géorgienne, notamment par l’action du général bavarois Kress von Kressenstein, qui appartenait à l’encadrement allemand de l’armée ottomane, alors alliée de Berlin. Les Géorgiens espéraient à l’époque que les Allemands l’emporteraient sur les Russes, victoire qui leur garantirait l’indépendance. Ce fut partiellement le cas. Les objectifs allemands en Géorgie étaient de lier le pays à l’Allemagne par le truchement de traités économiques et de conventions militaires.
Ces plans allemands ne pouvaient se réaliser que si la Géorgie accédait à la pleine indépendance; dès lors, on assista à une convergence des intérêts allemands et géorgiens dans la région. En avril 1918, Berlin s’immisca directement dans les événements. L’Allemagne et la Géorgie signent un accord, où les parties reconnaissent les frontirèes de la Géorgie; pour sa part, l’Allemagne promet de jouer un rôle d’intermédiaire entre la Géorgie, la nouvelle Russie et l’Empire ottoman. Pour appuyer l’indépendance de la Géorgie, l’Allemagne envoie trois mille soldats. L’Allemagne a ainsi parrainé l’indépendance géorgienne qui n’a duré que jusqu’en 1921. Les bonnes relations germano-géorgiennes, qui persistent encore, sont dues partiellement à ce souvenir historique.
Suite aux vicissitudes de la guerre civile russe, entre Blancs et Rouges, la Géorgie glisse, elle aussi, sous l’autorité des Bolcheviks; elle est conquise, toutefois après que les Abkhazes et les Ossètes aient proclamé leurs propres républiques soviétiques. Au départ, ces deux républiques ont constitué des “oblast” autonomes de la grande “République Soviétique de Transcaucasie”, à laquelle appartenait aussi la Géorgie. En 1936, Joseph Staline dissout cette république transcaucasienne.
C’est justement lui, un Géorgien, qui a tracé arbitrairement les frontières des républiques soviétiques. La nouvelle “République Socialiste Soviétique de Géorgie”, selon la volonté de Staline, reprenait à son compte les territoires inclus dans cette Géorgie qui s’était proclamée indépendante en 1918; l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud devinrent dès lors parties intégrantes de la RSS de Géorgie, mais jouissaient d’une très large autonomie.
Par ce processus, les Ossètes furent partagés en deux entités, l’une au Nord du Caucase, l’autre au Sud. Les uns appartenaient désormais à la République Socialiste Soviétique Fédérative de Russie, tandis que les autres se retrouvaient au sein de la nouvelle RSS de Géorgie, ce qui, à l’époque, n’avait guère d’importance pour la vie quotidienne du peuple ossète. Les choses ont changé lorsque la Géorgie, dans les années 90 du 20ième siècle, a retrouvé une nouvelle fois son indépendance, au moment de l’effondrement de l’URSS. Dès ce moment, les Ossètes ont été véritablement séparés les uns des autres, car la frontière, internationalement reconnue, passait alors au beau milieu de leur territoire.
Dans l’ivresse de leur indépendance retrouvée, les Géorgiens ne se sont pas rendus compte que d’autres peuples vivaient sur le territoire de leur république et aspiraient à une autonomie politique dans les limites de leur propre espace vital. L’un des premiers chefs d’Etat de la nouvelle Géorgie, l’ancien ministre soviétique des affaires étrangères, Edouard Chevarnadzé, comprenait les aspirations abkhazes et ossètes, s’était montré conciliant face aux frictions et aux tensions inter-ethniques, tandis que son successeur Saakachvili, lui, se pose comme un “dur”, un “hardliner”.
L’Occident, sur lequel Saakachvili a tant parié, n’a cessé de cultiver les ambigüités et n’a rien fait pour améliorer la situation, bien au contraire, il a tout fait pour envenimer les choses. L’Occident proclame qu’il est pour l’ “intégrité territoriale” de la Géorgie, mais ne souffle mot quant à la façon dont le gouvernement géorgien s’y prend pour maintenir cette “intégrité territoriale”. La Géorgie, ex-république de l’Union Soviétique, s’est proclamée indépendante lors de l’effondrement de l’URSS, ce qui entre parfaitement dans le cadre du droit des gens.
Les républiques autonomes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, du coup, n’ont plus eu la possibilité de se déclarer indépendantes de la Géorgie selon le droit international. Nous sommes là face à une contradiction non résolue. Qui a débouché, en 1992, sur une guerre de sécession sanglante, qui a duré un an. Crimes de guerre, massacres et expulsions furent à l’ordre du jour; des milliers de Géorgiens, d’Abkhazes et d’Ossètes ont été chassés de leurs lieux de résidence. En 1992, un armistice est signé avec l’Ossétie du Sud et, deux ans plus tard, avec l’Abkhazie, armistice qui prévoit que des troupes des Etats de la CEI y maintiendront la paix et y feront taire les armes. En Abkhazie, la Russie a envoyé 3000 militaires, qui ont quasiment constitué le seul contingent de “soldats de la paix” jusqu’à ce qu’éclate la “Guerre d’août”.
De facto, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud sont des républiques agissant en toute autonomie même si elles ne sont pas reconnues sur le plan international et continuent d’appartenir à la Géorgie selon le droit des gens. Le conflit persistant entre la Russie et la Géorgie a poussé petit à petit les deux républiques dans les bras de la Russie. Quand la Géorgie a décrété, par sottise, un embargo économique général contre les deux républiques, la Russie a eu beau jeu de placer les deux régions sous sa propre tutelle économique. Les deux républiques se posent certes comme “indépendantes” mais elles ne le sont pas car leur survie sur les plans économique, politique et militaire dépend directement de leur grand voisin russe, avec lequel elles aimeraient d’ailleurs fusionner. Mais sans l’accord de la Géorgie, cet “Anschluss” est tout aussi impossible sur le plan du droit des gens que leur déclaration unilatérale d’indépendance. La plupart des habitants des deux régions sécessionnistes ont d’ailleurs déjà reçu des passeports russes. Quant au président sud-ossète Edouard Kokoity, il souhaite que se constitue une Ossétie unie.
Les parallèles et les différences entre ce conflit et celui du Kossovo sont étonnants. Dans les deux cas, nous avons affaire à des régions autonomes, où l’Etat titulaire réclame le droit d’exercer sa souveraineté, en se basant sur une interprétation stricte du droit des gens, tandis que ce sont des soldats de la paix venus d’autres pays qui y assurent la sécurité. Quand l’Occident a reconnu le Kosovo, à l’évidence, la Russie allait, dans l’avenir proche, soutenir l’indépendantisme abkhaze et sud-ossète, surtout si cela nuisait à la Géorgie et présentait un intérêt dans l’opposition géostratégique générale entre Washington et Moscou.
Dans cette logique, en avril 2008, deux mois après la reconnaissance du Kosovo, Vladimir Poutine, qui était encore le président russe à l’époque, ordonne de “soutenir substantiellement” l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, tandis que la Douma préconisait de reconnaître les deux républiques. Depuis lors, les autorités russes ont reconnu tous les documents émis par ces deux républiques et permis l’établissement de relations consulaires. La Russie a donc reconnu de facto les deux républiques sécessionnistes, ce que la Géorgie interprète comme une annexion déguisée. C’est cela qui a donné le prétexte à Saakachvili de se lancer dans cette aventure militaire, dont l’issue conduira à l’émergence de réalités nouvelles dans la région.
Günther DESCHNER.
(artcle tiré de “Junge Freiheit”, Berlin, n°34/2008, trad. franç.: Robert Steuckers).
20:49 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, europe, russie, caucase, ossétie, abkhazie, géorgie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dionysische wijsheid
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dionysos, nietzsche, mythologie, dieux, antiquité grecque, grèce antique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les avatars chrétiens de Wodan après la conversion des Germains

Les avatars chrétiens de Wodan après la conversion des Germains
d'après Otto Rudolf Braun
Wodan était l'une des principales figures divines au temps de la christianisation des Germains. Il était le dieu qui donnait la sagesse aux hommes. Il était aussi le dieu des guerriers et des héros tombés au combat. Son importance était grande parmi les Germains comme le prouve la formule d'abjuration que les convertis devaient prononcer avant de recevoir le baptême. En effet, les Germains, comme tous les païens, avaient d'innombrables dieux et la formule n'en reprend que trois: Donar (Thor), Ziu (dieu primordial indo-européen; Zeus et Ziu ont la même racine) et Wodan lui-même.
Précisons que, pour les premiers Chrétiens de Germanie, les dieux ancestraux n'étaient pas perçu comme des superstitions mais comme des forces ennemies, maléfiques, qu'il s'agissait de combattre. Le spécialiste de la question Erich Jung nous l'explique: «Pendant longtemps, l'Eglise germanique primitive n'a pas nié l'existence et l'action des dieux ancestraux, mais a combattu ces derniers comme des esprits maléfiques, des monstres, des démons. Donc, pour eux, Wodan gardait toute son influence sur les âmes non baptisées. Son Armée (Heer), sa horde, était principalement composée d'âmes d'enfants morts».
C'est la raison pour laquelle l'Eglise demandait aux anciens Germains d'abjurer leurs dieux ancestraux. Mais cette injonction ne fut pas immédiatement suivie d'obéissance: le peuple continuait d'honorer ces anciens dieux. L'Eglise fut donc obligée de changer de politique et de les christianiser, d'en faire des saints. Wodan est par conséquent le dieu qui a connu le plus d'avatars chrétiens.
Il a été transformé en archange Michel, que l'on représente tantôt avec l'attribut de Ziu (l'épée), tantôt avec l'attribut de Wodan (le manteau). A son propos, Cäsarius von Heisterbach (1180-124?), chroniqueur médiéval, cite une légende allemande, où Wodan, très manifestement, entre en scène. C'est la légende du Chevalier Gerhard von Holenbach. Un jour, le diable lui apparaît, déguisé en pélerin. Il frappe à la porte du Chevalier et lui demande l'aumône. Comme il faisait froid, le Chevalier le fit entrer et, pour la nuit, lui offrit son manteau en guise de couverture. Au petit matin, le pélerin avait disparu avec le manteau. Peu après, le Chevalier décide d'entreprendre un pélérinage au tombeau de St. Thomas en Inde. Avant de partir, il brise son anneau en deux morceaux et en donne un à sa femme, afin qu'elle conserve un signe de reconnaissance. S'il ne revient pas avant cinq ans, elle sera libre. Mais le Chevalier n'atteint le tombeau de St. Thomas qu'au jour où il aurait dû rentrer chez lui. C'est alors qu'apparaît le diable vêtu de son manteau qui, en un tour, le ramène d'un coup chez lui. Gerhard retrouve sa femme en train de célébrer son repas de fiançailles avant un autre Chevalier et lance son anneau dans une coupe. Sa femme le reconnaît et le Chevalier reprend sa place.
Le Diable joue ici très nettement le rôle de Wodan. Cäsarius von Heisterbach a sans doute transformé une vieille légende wotanique. Plus tard, au 15° siècle, la chronique suisse des Seigneurs von Stretlingen, de la région du Thurnersee, remplace, dans la même légende, le Diable par l'Archange Michel.
La Sainte Lance est, elle aussi, un ancien attribut de Wodan et même l'un des principaux. Avec sa lance, Wodan désignait les guerriers les plus braves, avant que les vierges-pages ne viennent les chercher pour les conduire au Walhall. Cette sainte lance fit partie, plus tard, des insignes de la cérémonie du couronnement des Empereurs du Saint-Empire, sous le nom de Lance de St. Maurice. A la bataille du Lechfeld contre les Hongrois, on apporta à l'Empereur Othon I la lance dite de St. Michel. La Sainte Lance joua encore un rôle décisif lors d'une bataille de la première croisade quand, en 1098, devant Antioche, les guerriers francs et normands, découragés, minés par la fatigue, ne se relancèrent à l'assaut qu'après l'apparition de la Sainte Lance.
Wodan était le protecteur de Siegfried, lorsque ce dernier terrassa le dragon. Dans la Saga de Wolfdietrich, c'est St. Georges qui reprend ce rôle. Plus tard, St. Georges lui-même tue le dragon, de la même façon que St. Michel. St. George (dont l'existence historique n'est pas prouvée) est devenu ultérieurement le protecteur des armuriers et des guerriers. Son amulette protégeait contre les coups de lance malencontreux.
Les anciennes églises dédiées à St. Michel se situent toutes au sommet de montagnes ou de collines, lieux de résidence privilégiés par Wodan. C'est particulièrement patent dans le cas du Michelsberg près de Kleebronn en Allemagne. Avant que l'on ne parle de Wodan, c'est-à-dire avant la germanisation, il y avait déjà là un lieu de culte celtique. Wodan a tout simplement remplacé la divinité celtique et, après la christianisation, St. Michel a pris le relais. Wodan et St. Michel sont tous deux des détenteurs de lances miraculeuses. Tous deux tuent des dragons et servent de guide aux âmes. Les paysans de la région nomment toujours le Michelsberg de son ancien nom: Gudinsberg ou Wudinsberg, selon les variations dialectales.
L'ethnologue Gößler précise: «Cette persistance des cultes païens s'observe partout où il y a des monts ou collines portant le nom de Michel, surtout s'il s'agit de hauteurs occupées depuis la nuit des temps, comme, par exemple, sur le fameux Michelsberg près de Bruchsal, où l'on a découvert des poteries typiques de la préhistoire, poteries qui ont permis de déterminer la civilisation préhistorique indo-européenne du Michelsberg. Idem pour le Michelsberg près de Gundelsheim, le Heiligenberg de Heidelberg et le Michelsberg-en-Zabergäu».
L'histoire du Heiligenberg près de Heidelberg signale effectivement un passage direct de Wodan à St. Michel. Un acte de Konrad I, d'août 912, en parle comme d'une colline sainte, dédiée à un archange "tout-puissant". Or, pour l'église chrétienne, les archanges ne sont jamais "tout-puissants". Cet adjectif trahit la transposition...
St. Martin est aussi un avatar de Wodan. Souvent on le représente flanqué d'une oie, l'oiseau dont le sacrifice plaisait à Wodan. M. Ninck écrit: «La transposition des traits wotaniques a dû être facilitée par l'étymologie même du nom de Martin, signifiant en fait «guerrier de Mars». St. Martin est en effet Chevalier servant et, plus tard, un exorciste qui parcourt les campagnes. Sous sa forme chevaleresque, il porte un manteau, comme tous les chevaliers, mais le caractère particulièrement sacré de son manteau prouve nettement les origines wotaniques de son culte».
Les légendes prouvent, elles aussi, le rapport étroit qui existe entre Wodan et St. Martin. Dans la région de Coblence, l'homme qui blesse une cigogne (dans la symbolique païenne, animal qui équivaut au cygne, oiseau dédié à Wodan), est menacé de la Lance de St. Martin. En Bavière, lors des moissons des dernières semaines de l'été, les paysans laissent une gerbe pour le cheval de St. Martin, comme jadis ils en laissaient une pour le cheval de Wodan. Au Tyrol, la «Chasse Sauvage» s'appelle la Martinsgestämpe et l'on dit aussi que, derrière la Horde Sauvage, trotte une oie difforme, animal lié à St. Martin.
St. Martin est aussi magicien et sa fête, le 11 novembre, est célébrée à une époque de l'année où, jadis, on fêtait Wodan. Cette fête a repris à son compte bon nombre de traits du culte wotanique. Elle se célèbrait de nuit, avec des feux. On tuait des oies et l'on buvait la Minne de Wodan, comme on boit aujourd'hui la Minne de St. Martin.
Lors de la bénédiction des chiens à Vienne, célébration qui remonte au 10° siècle et est également une transposition d'un vieux rite wotanique, on évoque St. Martin comme patron protecteur des chiens (car Wodan, jadis, était accompagné de loups ou de chiens). A Bierdorf dans le Westerwald, se trouvent des tumuli germaniques, autour d'une colline nommée Martinsberg, jadis vouée à Wodan.
St. Oswald est sans doute aussi un avatar de Wodan, dont l'un des surnoms était précisément Oswald. Le passage du dieu païen au saint chrétien (?) est facilement repérable: une colonne de la nef principale de l'église abbatiale d'Alpirsbach dans le Württemberg nous montre encore Wodan accompagné de ses deux corbeaux Hugin et Munin. Une gravure sur bois datant de 1500 environ, nous présente, elle, St. Oswald avec deux corbeaux...
St. Cuthbert de Durham est représenté avec la tête tranchée d'Oswald: autour de lui, des cygnes, animaux wotaniques. Rappelons-nous que Wodan, dans l'Edda, enmenait toujours avec lui la tête tranchée de Mimir. Les cygnes sont, eux, inséparables des Walkyries, les vierges-pages de Wodan.
Mais l'avatar le plus aimé de Wodan est sans conteste St. Nicolas, qui offre des cadeaux aux enfants. Sa fête, le 6 décembre, n'a pratiquement rien à voir avec le saint historique, un évêque d'Asie Mineure. St. Nicolas est un saint qui a même réussi à résister au protestantisme dans le Nord des pays germaniques. Dans certains régions, il est assimilé à la vieille figure de Knecht Rupprecht (le «Gaillard Robert»), dans lequel on reconnaît sans difficulté Wodan. St. Nicolas porte souvent, comme lui, un bonnet de fourrure, une longue barbe soyeuse et il voyage dans un traîneau tiré par des rennes. Dans les régions catholiques, il est encore habillé comme un évêque, avec une mitre et une crosse et il accompagne Krampus, avatar du Diable.
L'Eglise chrétienne a donc pratiqué deux politiques à l'égard de Wodan: d'une part, elle a conservé son souvenir sous les oripeaux d'une quantité de saints; d'autre part, elle en a fait un diable et un méchant démon. Son surnom glorieux des temps païens, der Rabenase (L'Ase aux corbeaux), est devenu une injure, Rabenaas (carogne). Wodan est devenu le meneur de la terrible chasse sauvage, le seigneurs des démons. Dans quelques régions d'Allemagne, on brûle des effigies de Wode, Gode ou Gute lors du solstice d'été, devenu, sous l'impulsion de l'Eglise, les feux de la St. Jean. Mais Wodan, dans l'âme du peuple, a résisté à toutes les tentatives de christianisation.
Otto Rudolf BRAUN.
(Source: Germanische Götter - Christliche Heilige. Über den Kampf der Christen gegen das germanische Heidentum, Verlag Hohe Warte, Pähl/Obb., 1979; adaptation française: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, scandinavie, mythologie, christianisme, germanisme, nord, nordisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 août 2008
Brèves réflexions sur l'oeuvre de H. G. Wells

Werner OLLES:
Brèves réflexions sur l’oeuvre de H. G. Wells
Incontestablement, Herbert George Wells est l’un des plus intéressants écrivains du 20ème siècle, à facettes multiples. Son oeuvre complète comprend près de cent volumes et va de la théorie (en biologie, en histoire contemporaine, en philosophie et en politique) à ces romans et récits devenus si célèbres dans le monde entier. Toutes ces créations littéraires sont des exemples de perfection en matière de littérature fantastique et utopique: de véritables classiques de la narration contemporaine. Wells est entré dans l’histoire intellectuelle de notre monde comme le père fondateur de la littérature de science-fiction et comme l’un des plus géniaux écrivains de ce genre.
H. G. Wells est né le 21 septembre 1866 dans la petite ville de Bromley dans le Comté de Kent en Angleterre. Son père était jardinier; plus tard, ses économies lui permirent d’ouvrir un petit commerce d’étoffes mais sa carrière de commerçant ne fut guère brillante. Le foyer parental était petit bourgeois, bigot, ce qui limitait les perspectives du jeune Wells. De cette époque de jeunesse date également son antipathie profonde à l’encontre du catholicisme qu’il abhorrait véritablement, l’accusant d’être une pensée pré-bourgeoise. La haine intense qu’il cultivait pour le culte “romain”, accusé d’être contre-révolutionnaire et médiéval, hostile à la modernité, l’amena même à plaider, pendant la seconde guerre mondiale, pour une destruction complète de Rome par les bombardiers alliés. Cette violente position anti-catholique le mettait pourtant en porte-à-faux par rapport à de nombreux intellectuels et écrivains anglais de son époque mais ne le dérangeait pas outre mesure: beaucoup d’écrivains anglicans en effet, comme Graham Greene, Evelyn Waugh, G. K. Chersterton ou Julien Green se convertirent au catholicisme.
Déjà dans ses premiers ouvrages, comme “La machine à remonter le temps”, un récit fantastique où un inventeur s’envole vers le futur, il se percevait lui-même en héros. De manière parfaitement prosaïque, il décrit un petit paradis où débarque son “voyageur à travers le temps”; y vivent les “Eloïs”, des créatures affables qui vivent en dehors de tous soucis. Mais bien vite, l’inventeur et voyageur remarque que cette société, en apparence si paisible, est pourtant soumise à la terreur le plus brutale. Les “Eloïs”, en effet, sont rançonnés et exploités par les Morloks, des monstres souterrains qui les massacrent sans pitié.

Dans “L’Ile du Dr. Moreau”, le héros est un scientifique expulsé d’Angleterre qui mène des expériences dans une île du Pacifique Sud, afin de transformer des animaux en demi-êtres à la suite d’opérations chirurgicales précises. Moreau, vivisectionniste démoniaque, est simultanément un Prométhée et un dieu punisseur. Les parallèles avec le récit de la Genèse sont flagrants: l’homme est toujours menacé de glisser à nouveau vers l’état de la bête et, à l’instar des créatures fabriquées par Moreau, les hommes, eux aussi, sont condamnés à la souffrance.
Wells s’était engagé dans la “Fabian Society”, une association de socialistes britanniques mais ce ne fut que pour une courte durée. Ses rêves sociaux-révolutionnaires se sont assez rapidement évanouis et il se tourne alors vers la métaphysique. Dans “La guerre des mondes”, il décrit comment des extra-terrestres réduisent l’Angleterre en cendres. Dans les années 30, Orson Welles fit de ce récit un reportage radiophonique qui semblait si vrai que des dizaines de milliers d’Américains prirent la fuite, en panique devant cette invasion imminente de Martiens. Dans “Les géants arrivent”, il pose la question: les hommes, comme jadis les dinosaures, sont-ils condamnés à disparaître?
A la fin de sa vie, l’évolution de la politique et le développement des technologies firent de lui un pessimiste (voir son essai: “L’esprit est-il au bout de ses possibilités?”). H. G. Wells meurt le 13 août 1946 à l’âge de 79 ans à Londres.
Werner OLLES.
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°33/2006; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lettres, angleterre, lettres anglaises, science-fiction, utopie, dystopie, scientisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Die Memoiren von Jaruzelski

Die Memoiren von Jaruzelski: bemerkenswerte Notizen über die Rolle des Staatsmannes
Analyse: Wojciech Jaruzelski, Hinter den Türen der Macht. Der Anfang vom Ende einer Herrschaft, Militzke Verlag, Leipzig, 1996, 479 S., ISBN 3-86189-089-5.
Im Frühsommer 1992 publizierte der polnische General Jaruzelski ein Buch, wo er seine politische Erinnerungen darstellte. Er schilderte die Ereignisse in Polen ab dem 13. Dezember 1981, wenn das Kriegsrecht ausgerufen wurde. Moskau fürchtete, daß das destabilisierte Polen das sowjetische Herrschaftssystem wankeln ließ. Deshalb sollte die kommunistische Moskau-treue Ordnung wiederherstellt werden. Jaruzelski hatte als Aufgabe bekommen, sein Land sowjettreu zu erhalten, eben durch Mittel der Gewalt, wenn nötig. Die Kapitel seines Buches enthüllen wenig bekannte Sachlagen der polnischen Zeitgeschichte in den Jahren 1980-1985. Obwohl “Sozialist” und Anhänger des damals “realexistierenden” Sozialimus sowjetischer Prägung, erscheint uns nach diesen tumultvollen Ereignissen der Militär Jaruzelski als eine Art konservativer “Katechon”, d. h., um die Definition von Carl Schmitt zu wiederholen, als ein Staatsmann, der als Aufgabe hat, die Ordnung zu herstellen und sein Staatswesen vom Chaos und Zerfall zu retten.
Selbstverständlich bleibt in unseren Augen der Kommunismus ein Fremdkörper am Leibe der polnischen Nation und die Solidaritätsbewegung Walesas ein spontaner Ausdruck des Volkzornes. Nichtdestoweniger muß heute der neutrale Beobachter doch wohl annehmen, daß fremde Geheimdienste “Solidarnosc” manipuliert haben, genau um das schon morsche Sowjetsystem zu sprengen, am Ort wo es am weichsten war, d. h. zwischen dem sowjetischen Großraum und der DDR (Thüringisches Bollwerk und Speerspitze der Warschauer-Pakt-Verbände). Konservative und militärische Kräfte innerhalb des Sowjetsystems konnte eine solche zwar demokratische aber doch “abenteuerische” Entwicklung in den damaligen Kräftenverhältnissen nicht dulden. Jaruzelski wurde als Retter der Lage eingesetzt: als Militär hat er den Befehlen seiner politischen Vorgesetzten gefolgt. Die Geisteshaltung von Jaruzelski wird im Buch deutlich dargelegt. Sie kann eigentlich als konservativ-erhaltender bzw. katechonischer (im Schmittschen Sinn) Art betrachtet werden. Folgende Aussagen zeugen davon: “Geschichte und Geographie sucht man sich nicht aus. In meiner Generation findet man kaum Menschen, die aus einem Stück Holz geschnitzt sind. Das Leben hat uns aus den Splittern des Schicksals und den Abschnitten des Weges geformt. Wir waren Kinder unserer Zeit, unseres Milieus, unseres Systems. Jeder ist auf seine Weise aus diesem Rahmen ausgebrochen. Nicht jeder, dem das schnell gelang, verdient Achtung. Und nicht jeder, dem das erst später gelang verdient Verachtung. Das Wichtigste ist, wovon der einzelne Mensch sich leiten ließ, wie er das tat, was er tat, und was für ein Mensch er heute ist” (S. 8).
“Als Soldat weiß ich, daß ein militärischer Führer und überhaupt jeder Vorgesetzte für alles und alle verantwortlich ist. Das Wort ‘Entschuldigung’ mag nichtssagend klingen, aber ein anderes Wort kann ich nicht finden. Ich möchte deshalb um eines bitten: Wenn es Menschen gibt, bei denen die Zeit die Wunden nicht geheilt, den Zorn nicht zum Erlöschen gebracht hat, dann mögen sie diesen Zorn vor allem gegen mich richten, nicht aber gegen diejenigen, die unter den gegebenen Bedingungen, erhlich und in gutem Glauben, viele Jahre lang ihre ganze Arbeitskraft dem Aufbau unseres Vaterlandes geopfert haben” (S. 9).
In seinem Schluß, äußert sich Jaruzelski in einem klaren “katechonischen” Stil: “Außergewöhnliche Situationen und Maßnahmen führen oft zu Blutvergießen. Wir wissen, daß in vielen Ländern der Ausnahmezustand Tausende und Abertausende von Menschenleben gekostet hat. Wir dagegen trafen diese dramatische Entscheidung eben deshalb, damit es nicht zu einer solchen Tragödie komme. Dies ist uns in hohem Maße gelungen. Hunderprozentig leider nicht. Im Bergwerk “Wujek” kam es zum Schußwaffengebrauch, neun Bergleute kamen ums Leben. Dieses schmerzliche Ereignis wirft bis heute seinen Schatten auf die Gesamtbewertung der damaligen Vorgänge” (S. 465).
Seine nüchtere Beobachtung der menschlichen Kräfte in der Politik erweisen sich erstaunlich dem konservativ-katechonischen Gedankengut von Denkern wie Donoso Cortés, Joseph de Maistre oder Constantin Franz nah: “Im Machtapparat gab es viele nachdenkliche, gebildete und erfahrene Menschen. Leider führt eine Summe von klugen Köpfen nicht automatisch zu einem Zuwachs an Klugheit. Oftmals wird man von den Dümmeren hinabgezogen, die durch Fanatismus, Demagogie und Schneid dafür sorgen, daß selbst die besten Absichten mit falschem Zungenschlag vorgetragen werden. Sowohl aus objektiven als auch aus subjektiven Gründen ließ sich die Regierungsbasis nicht wesentlich erweitern. Sehr viele wertvolle Menschen, die sich auf keiner der beiden Seiten klar engagieren wollten, gerieten ins Abseits” (S. 466).
Der Unterscheid zwischen Mythologie und Pragmatismus in der Politik sieht der polnische General auch klar: “Die Mythologie ist ein untrennbarer Bestandteil des Gesellschaftsleben. Diese Färbung hat auch der Begriff “Ethos der ‘Solidarnosc’”, obwohl er heute schon merklich an Lebenskraft verliert. Wahrscheinlich war es Pilsudski, der gesagt hat, daß die Polen “nicht in Tatsachen, sondern in Symbolen denken”. Der Pragmatismus hat in der Politik ungeheure Vorteile und sollte eigentlich Wegweiser für alle Führungsmannschaften sein. Aber Pragmatismus allein reicht nicht. Er ist dürr und grau, wenn seine Vertreter nicht gleichzeitig an die emotionalen Grundlagen des kollektiven und des individuellen Bewußtseins appellieren” (S. 469). Skeptisch bleibt Jaruzelski, wenn er die totale Wirtschafts-Liberalisierung der ehemaligen Ostblokstaaten observiert: “Ich fürchte, daß verschiedene Racheparolen, die zur “Dekommunisierung” aufrufen, unsere Aufmerksamkeit von den wesentlichen Zielen ablenken und zu einer Zersplitterung der Anstrengungen unserer Gesellschaft führen könnten. Das wäre für Polen im wahrsten Sinne des Wortes mörderisch. Es kann den Interessen unseres Landes nur schaden, wenn man sich in dieser von Rivalität, Wettlauf und Konkurrenz geprägten Welt Ersatzziele sucht und die Energie der Gesellschaft darauf verschwendet” (S. 470).
Jaruzelski hat einen sowjetgeprägten Staat verteidigt und gerettet, ohne anscheinend ein Anhänger der kommunistischen Ideologie zu sein. Warum hat er dann so gehandelt? Kapitel 28 des Buches gibt uns eine sehr detaillierte und interessante Antwort. Hauptsache für den General ist es, die Souveränität Polens zu bewahren: “Gab es für Polen nach dem Zweiten Weltkrieg die Chance, als vollkommen unabhängiger Staat zu existieren, ohne sowjetischen Einfluß? (...) Teheran, Jalta und Potsdam gehören zu jenen Knotenpunkten in der neuzeitlichen Geschichte, über die die Historiker endlos diskutieren werden. (...) Die Mehrheit der damaligen Politiker mußte das Abkommen von Jalta wohl oder übel als gegebene Realität (...) hinnehmen (...). Die existierende Ordnung zwang auch Polen ihre Spielregeln auf und bestimmete seinen Handlungsspielraum. Als Militär konnte ich nicht so tun, als ob ich das nicht wüßte” (S. 302-303).
Jaruzelski erinnert seine Leser an einen Brief, den er an seine Mutter und seine Schwester 1945 geschrieben hatte: “Ich bin verpflichtet für Polen zu dienen und zu arbeiten, ganz gleich, wie Polen auch aussehen mag und welche Opfer von uns auch gefordert werden mögen” (S. 304). Der junge damalige Offizier wollte sein Land als ein real-existierende polnischer Staat, für Polen “wie es auch aussehen mag”, und dieses Pflicht allem anderen überordnen. Die nationalen Deutsche werden sehr wahrscheinlich eine solche Bekenntnis als dubiös und unhaltbar betrachtet, sie ist trotzdem wihl oder übel eine typische Haltung des polnischen Offizierentum, wo Dienst und Pflicht wichtiger erscheinen als etwa ethnische oder historische Fakten oder ideologische Konstruktionen. Jaruzelski skizziert in diesem 28. Kapitel die Auseinandersetzungen zwischen den Londoner-Polen um General Anders und den Moskauer-Polen.
Die westliche Mächte haben die neue Westgrenzen Polens nie garantiert, im Gegenteil zu Moskau. In den Augen Jaruzelskis, erscheint also die Sowjetunion als ein treuer Garant und ein fester Bundgenosse. Nur Moskau garantierte dem polnischen Staat eine feste und klare Gestalt. Die Londoner-Polen wollten die Grenzen von 1939, was die Sowjets nie akzeptiert hätten, weil Polen Riesengebiete Weißrußlandes und der Ukraine 1921 annektiert hatte, so lief Polen die Gefahr, an der Gestalt des früheren Kongreß-Polen reduziert zu werden, d. h. ein Land, das zergliederte Grenzen gehabt hätte, die nicht zu verteidigen waren. So wurde das Schicksal der Ostdeutschen besiegelt: das mit der Sowjetunion verbündete Polen mußte seine eigene Ostgebiete abgeben und nach Westen als Kompensation erweitert werden.
Die Feinde Jaruzelskis betonen, Polen war im Warschauer Pakt versklavt. Dazu antwortet der General, daß es zwei Formen der Souveränitätsbeschränkung gibt: 1) Die freiwillige Beschränkung im Interesse des Staates oder einer verbündeten Staatengruppe; 2) Die Beschränkung, die Protektoratscharakter hat. Jaruzelski gibt zu, Polen war ein Protektorat bis 1956, danach war seine Souveränität nur “beschränkt” im Rahmen des Warschauer-Paktes. Funktionsfähigkeit des Staates und Vermeidung des sozialen und wirtschaftlichen Chaos sind die beiden Hauptaufgaben, die Jaruzelski sich gesetzt hatte.
Jaruzelski zitiert noch die Appelle von den Kanzlern Kreisky und Schmidt, die Ordnung zu retten, damit Polen seine vertragliche Verpflichtungen gegenüber anderen Staaten erfülle, und Vernunft und Mäßigung zu pflegen. Weiter finden man den kompletten Wortlaut eines Berichts des polnischen Außenministers Jozef Czyrek über seinen Besuch beim Papsten (S. 353-354), und auch einen Bericht des General Kiszczaks über die sowjetischen, ostdeutschen und tschechischen Manöver an den polnischen Grenzen in Herbst 1981 oder durch Mittel von Geheimdienst-Agenten innerhalb der polnischen Grenzen selbst. Hätte Jaruzelski das Kriegsrecht nicht am 13. Dezember 1981 ausgerufen, wären die Warschauer-Pakt-Verbündeten am 16. einmarschiert, um Polen “vom Wurg der Konterrevolution” zu retten. Genauso wie in Prag 1968.
Die Aktion Jaruzelskis war also, wie der amerikanische antikommunistische “Falke” Zbigniew Brzezinski es geschrieben hat, die Übergang vom “kommunistischen Autoritarismus” zum “postkommunistischen Autoritarismus”. Solidarnosc ist nicht verboten worden, wie auch der Papst es Czyrek gebeten hatte, sondern einfach gezügelt, damit man Polen von einer sowjetischen Invasion, von Chaos und Bankrott bewahren konnte. Man kann skeptisch bleiben, aber die Lektüre dieses Buches ist hoch interessant, nicht weil es uns die Gedankenwelt eines sowjetfreundlichen polnischen Generals, sondern weil es sehr genau das Pflichtbewußtsein eines Militärs in der Politik enthüllt. Militärs, Katholizismus, Russophilie und Kommunismus mischen sich erstaunlicherweise in den Memoiren Jaruzelskis. All diese Ingredienten sind letzter Hand eine unstabile Mischung und entsprechen ganz genau die real-existierende polnische Identität (Robert STEUCKERS).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pologne, europe, stratégie, militaria, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 21 août 2008
Guerre du Caucase: entretien avec A. Rahr

Guerre du Caucase: entretien avec Alexander Rahr
Propos recueillis par Moritz Schwarz
Alexander Rahr est le directeur du programme “Russie/Eurasie” auprès de la “Société allemande de politique étrangère” (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik) à Berlin. Il est un spécialiste de réputation internationale pour toutes les questions eurasiennes.
Q.: Monsieur Rahr, à quoi pensait, dans le fond, le Président Saakachvili en poussant ses troupes à entrer en Ossétie du Sud
AR: Votre question est pertinente. Car lundi, après seulement deux jours de guerre, il a capitulé. Toute l’opération s’est révélée un parfait désastre, comme c’était à prévoir. Saakachvili a tout raté, sur toute la ligne.
Q.: Manifestement, Saakachvili n’a pas cru à une intervention russe. Etait-ce une position réaliste?
AR: Non. Ou bien cet homme est totalement stupide ou bien il a été inspiré par des dilettantes. Voici les faits: la Géorgie veut devenir membre de l’OTAN le plus vite possible. Bush a déjà promis l’adhésion à Saakachvili, mais, si Obama devient président, cet objectif sera bien plus difficile à atteindre. La condition posée pour une adhésion rapide, c’est qu’il n’y ait plus de conflits inter-ethniques, car l’Aliance atlantique cherche à les éviter. Saakachvili a voulu régler le problème par une politique à la hussarde. Manifestement, il est parti du principe que l’intervention russe serait moins totale, plus ponctuelle; il pensait gagner du temps pour entraîner les Etats-Unis dans le conflit.
Q.: Là, il a pratiquement réussi son coup...
AR: A peine. Les réactions agressives de Bush démontrent plutôt son désarroi. Toutes les ONG, téléguidées par les Etats-Unis, qui ont tenté, au cours de ces dernières années, de mettre sur pied, avec la Géorgie, une “Alliance de la Mer Noire” alignée sur l’atlantisme et dont les objectifs auraient été d’éloigner au maximum les Russes de la région maritime pontique, sont désormais devant des ruines, leurs efforts n’ayant conduit à rien.
Q.: Dans les sphères de l’UE, beaucoup rêvaient aussi de faire de la Mer Noire une nouvelle mer intérieure européenne...
AR: Tous ces rêves se sont évanouis, ce qui rend un tas de gens furieux. En ce qui concerne la Géorgie, les Etats-Unis sont allés beaucoup trop loin au cours de ces dernières années. Maintenant, ils ne peuvent plus laisser leurs alliés dans le pétrin. Mais, par ailleurs, ils sont suffisamment intelligents pour ne pas se laisser entraîner. Les Etats-Unis ont besoin de la Russie en plusieurs domaines: dans le dossier de la non prolifération des armes non conventionnelles, dans la lutte contre le terrorisme, dans la stratégie de l’endiguement de l’Iran et de la Chine, etc. Toutes ces questions sont bien plus importantes que les humeurs de Saakachvili. Malgré toute la colère et toute la déception qui affectent les cercles stratégistes de Washington, personne aux Etats-Unis n’est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale pour lui. En outre, bon nombre de responsables à Washington doivent être furieux contre Saakachvili car il a mis les Etats-Unis dans une posture fort embarrassante.
Q.: Comment, à votre avis, s’achèvera le conflit?
AR: Les Géorgiens ne parviendront sans doute plus jamais à recomposer leur pays. Le conflit va geler vraisemblablement. Pour Moscou, ce serait là la meilleure solution. Ainsi, le rôle de la Russie en tant que puissance génératrice d’ordre demeurera tel, à l’arrière-plan.
Q.: Saakachvili survivra-t-il à cette défaite, en politique intérieure géorgienne?
AR: Il s’est probablement posé la question lui-même. Car, à l’avance, il ne pouvait pas sortir gagnant de cette opération, qui a coûté inutilement la vie à une grande quantité de soldats géorgiens.
Q.: Les Russes se frottent-ils les mains parce qu’ils ont eu l’occasion de faire une démonstration de force ou se sentent-ils blessés dans leur propre sphère d’intérêt?
AR: Les cris de triomphe se font entendre partout en Russie, c’est évident, car on attendait cette heure depuis de longues années: dans les années 90, les Russes devaient constater, sans pouvoir agir, comment l’Occident réorganisait à sa guise les Balkans; maintenant, ils peuvent montrer dans le Caucase que l’Occident est désormais à son tour dans le rôle du spectateur impuissant, tandis que la Russie agit. Il y a trois ans, la Russie avait obtenu que les bases militaires américaines quittent l’Asie centrale; maintenant, les Russes ont remis les Américains à leur place dans le Caucase. Il est possible que l’Allemagne récupère bientôt son rôle d’intermédiaire. Berlin a de bonnes relations avec la Russie et peut influencer plus profondément le nouveau président russe Medvedev que n’importe quel autre Etat de l’UE.
(entretien paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°34/2008; trad. franç.: Robert Steuckers).
13:09 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasie, eurasisme, russie, géorgie, caucase, mer noire, etats-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Géorgie: les intérêts américains et russes se télescopent dans le Caucase

Günther DESCHNER:
Géorgie: les intérêts américains et russes se télescopent dans le Caucase
A peine les premiers obus de la “Guerre d’août” dans le Caucase avaient-ils explosé que Mamouka Kourachvili expliquait ce qui se passait, en termes passablement nébuleux: l’armée géorgienne aurait ainsi lancé une grande offensive “pour rétablir l’ordre constitutionnel dans la province séparatiste d’Ossétie du Sud”. Le président géorgien Mikhail Saakachvili n’a ni rappelé son général à l’ordre ni démenti ses dires.
Le conflit pour l’avenir de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud n’avait cessé de s’amplifier au cours de ces dernières années, entre la Géorgie, tournée vers l’atlantisme, et la Russie. Les deux camps utilisant des cartes truquées. Depuis des mois, on sentait venir la guerre. La portée de ce conflit nous amène bien loin du Caucase. En effet, les deux républiques, qui entendent faire sécession et se séparer de la Géorgie, sont de sérieuses pommes de discorde entre les Etats-Unis et la Russie, constituent quasiment des points de rupture.
Depuis la fin de l’Union Soviétique et depuis que les statégistes américains avaient défini le Caucase du Sud comme appartenant à la sphère d’influence américaine, Washington avait élu la Géorgie comme son partenaire privilégié dans la région. La raison réelle de ce choix réside toute entière dans le conflit géostratégique dont les enjeux sont 1) l’accès au gaz et au pétrole de la région de la Mer Caspienne et 2) le contrôle des grands oléoducs et gazoducs. L’enjeu principal est surtout constitué par la ligne d’oléoducs BTC, longue de 1800 km, qui part de Bakou en Azerbaïdjan, pour passer par Tiflis (Tbilisi) en Géorgie et aboutir à Ceyhan en Turquie, sur la côte méditerranéenne. Washington privilégie cette voie pour faire venir le pétrole de la Caspienne à l’Ouest, car elle ne passe ni par la Russie ni par l’Iran, ce qui empêche ipso facto ces deux puissances d’intervenir sur le tracé des oléoducs et gazoducs. C’est là qu’il faut trouver la raison majeure de l’appui apporté par les Etats-Unis, depuis tant d’années, à Mikhail Saakachvili, lequel vise à aligner totalement son pays sur la politique américaine. Il veut à tout prix que la Géorgie fasse partie de l’OTAN; pour y parvenir, il a fait du contingent géorgien le troisième contingent en importance numérique en Irak dans la fameuse “coalition des bonnes volontés” de Bush.
L’objectif de Moscou est de déstabiliser la Géorgie et d’y installer un gouvernement qui tienne davantage compte des intérêts de son grand voisin russe. C’est clair comme de l’eau de roche. C’est la tradition de grande puissance que la Russie a réactivée depuis Poutine, ce qui a pour conséquence que Moscou s’efforce de déconstruire toutes les positions atlantistes qui se sont incrustées sur les flancs de l’ancien empire russe et/ou soviétique. Dans le cas de la Géorgie, la Russie dispose d’un bon instrument en soutenant les mouvements sécessionnistes en Abkhazie et en Ossétie du Sud.
L’offensive déclenchée par Saakchvili contre les Ossètes du Sud relève donc de la naïveté et de la stupidité politique. Il offrait ainsi au Kremlin un prétexte en or pour une intervention militaire musclée. Le bellâtre de la “révolutions des roses” y perdra sans nul doute ses fonctions et les deux provinces sécessionnistes risquent bel et bien d’être définitivement perdues pour la Géorgie. Près de vingt ans après l’effondrement de l’Union Soviétique, cette dernière guerre du Caucase a démontré clairement que la Russie, grande puissance renée de ses cendres, estime que ce glacis régional caucasien appartient à sa sphère d’intérêt. Aux yeux des Russes, l’action musclée était parfaitement appropriée, dotée de sens. Une réaction sciemment disproportionnée et mise en scène de la sorte, a donné une leçon au voisin, qu’il n’oubliera pas de sitôt, et démontré aux puissances occidentales que la Russie, elle aussi, a des intérêts de grande puissance, et qu’elle est bien décidée et capable de les faire valoir. Personne ne doit feindre la surprise. Tous auraient dû y penser: la reconnaissance unilatérale du Kosovo par l’Occident allait tout naturellement conduire la Russie, à la première occasion, à rendre la pareille, selon l’adage “J’agis comme tu agis”.
Mais la stratégie choisie par Moscou n’est pas exempte de dangers. On sait, sous les murs du Kremlin, que plusieurs foyers de conflit demeurent potentiellement virulents sur le flanc nord du massif caucasien. Moscou ne peut se permettre de voir ressurgir une escalade de violence en Ingouchie, en Tchétchénie et au Daghestan. La position géostratégique de la Géorgie, corridor en direction de la Caspienne, rend son territoire très intéressant à contrôler pour les puissances occidentales. Sans la Géorgie, les oléoducs et gazoducs devraient passer par le territoire de la Russie pour arriver en Europe occidentale ou par l’Iran (ndt : pour arriver en Asie orientale), ce qui est inacceptable pour les Etats-Unis.
Les intérêts stratégiques des Etats-Unis sont clairs: la Géorgie est non seulement un maillon important dans la chaîne d’Etats et de bases qui doivent parfaire l’encerclement de la Russie, mais aussi une base très bien située pour mener tout guerre future contre l’Iran fort proche. Depuis que la Turquie n’est plus qu’un acteur peu fiable pour l’atlantisme dans la question iranienne, les Américains ont parié sur la Géorgie et se sont faits les avocats de son adhésion à l’OTAN. La Géorgie offre aussi des ports en eaux profondes, dans une région hautement stratégique, où l’OTAN et les Américains pourraient installer des bases militaires et des points d’appui pour leurs forces aériennes.
Les Etats-Unis et l’UE auraient pu rappeler les Géorgiens à l’ordre et les empêcher ainsi de se jeter dans la gueule du loup. Ils ne l’ont pas fait. Ainsi, Moscou a profité de l’occasion que lui offrait Saakachvili, en prenant l’OTAN de court et en démontant qu’elle n’était qu’un tigre de papier. L’alliance dont les Etats-Unis sont l’hegemon perd de son pouvoir d’attraction auprès d’autres candidats potentiels. Toute politique des “doux yeux” à l’adresse de l’OTAN peut désormais s’avérer dangereuse. A Kiev, à Bakou et dans d’autres capitales, l’intervention russe en Ossétie du Sud aura eu l’effet d’un avertissement, dont il faudra impérativement tenir compte.
Washinton applique la “Doctrine de Monroe” et considère que l’Amérique latine est son arrière-cour, où les Etats-Unis peuvent intervenir à leur guise; face à cette “Doctrine de Monroe”, nous voyons désormais émerger une sorte de “Doctrine de Poutine” qui veut que les Etats, se trouvant sur la périphérie de la Russie, sur ses anciens glacis, sont importants pour la politique étrangère et pour la sécurité de la Russie. Manifestement, le retour de la Russie à de tels principes géostratégiques conduit à un nouvel affrontement froid entre Washington et Moscou. Du moins dans l’optique des Russes, l’intervention en Ossétie du Sud constitue un acte de vengeance contre la politique de Washington qui, depuis des années, ne s’occupent que d’encercler la Russie au lieu de l’intégrer.
Dès le début, les choses étaient claires: la “Guerre d’août” au Caucase n’allait nullement être le prélude d’une guerre russe de reconquête. Elle a pour conséquence que les facteurs politiques de la région doivent être réexaminés et réévalués. Règle normale de toute Realpolitik.
Günther DESCHNER.
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, Nr. 34/2008; trad. franç.: Robert Steuckers).
13:03 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, etats-unis, caucase, géorgie, ossétie, mer noire, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le grand bouleau est tombé... Hommage à A. Soljénitsyne

“De Brave Hendrik” / ’t Pallieterke:
Le grand bouleau est tombé...
Hommage à Alexandre Soljénitsyne (1918-2008)
Le bouleau est un type d’arbre à l’écorce blanche argentée, dont le bois est fort clair et très dur. En Sibérie et dans de nombreuses régions de l’immense plaine russe, avec ses marécages gelés et enneigés, cet arbre est familier, appartient au paysage. La barbe et les cheveux gris de Soljénitsyne, écrivain, chrétien orthodoxe que Staline n’était pas parvenu à éliminer, rappelaient, depuis quelques années déjà, les couleurs de cet arbre si emblématique, qui jaillit partout de la terre russe.
Sa vie connut un premier bouleversement en 1945, lorsque, dans une lettre à un camarade, il décrit “l’homme à la moustache” (= Staline) comme incompétent sur le plan militaire. Soljénitsyne était alors en Prusse orientale et participait aux combats pour prendre la ville de Königsberg (que l’on appelle aujourd’hui Kaliningrad, dans l’enclave russe sur les rives de la Baltique). Il est arrêté: une routine sous la terreur soviétique de l’époque. Il ne sera libéré que huit ans plus tard, en 1953, à l’époque où la paranoïa du dictateur atteignait des proportions à peine imaginables, tandis que sa santé diminuait à vue d’oeil. Staline ne voyait alors dans son entourage que complots juifs ou américains; de 1953 à 1956, Soljénitsyne, professeur de mathématiques de son état, réside, libre mais banni, au Kazakhstan. En 1956, on le réhabilite et en 1962, il amorce véritablement sa carrière d’écrivain en publiant dans la revue “Novi Mir” une nouvelle, “Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch”. Mais c’est en 1968 que ce dissident acquiert la notoriété internationale, à cinquante ans, quand sortent de presse “Le pavillon des cancéreux” et “Le premier cercle”; il a réussi à faire passer clandestinement ses manuscrits à l’étranger; rapidement, ils sont connus dans le monde entier, par des traductions qui révèlent l’atrocité de son vécu de bagnard dans l’Archipel du goulag. En 1970, il est le deuxième Russe (le premier fut Ivan Bounine) à recevoir le Prix Nobel de littérature.
Celui qui veut comprendre et apprendre un maximum de choses sur la littérature russe dans l’espace linguistique néerlandophone, doit lire les écrits du grand slaviste Karel van het Reve (1921-1999), car celui-ci, mieux que quiconque, a pu, dans ses nombreux livres et essais, décrypter les mystères russes. Mais sa “Geschiedenis van de Russissche literatuur” (1) s’arrête malheureusement à Anton Tchekhov. Pour mieux comprendre la dissidence et l’intelligentsia russes, il me paraît toutefois utile de relire les travaux de ce slaviste, dont les titres sont éloquents: “Met twee potten pindakaas naar Moskou” (1970; “Avec deux pots de crème de cacahouète à Moscou”), “Lenin heeft echt bestaan” (1972; “Lénine a vraiment existé”) et “Freud, Stalin en Dostojevski” (1982; “Freud, Staline et Dostoïevski”). Dans un ouvrage posthume, paru en 2003, et intitulé “Ik heb nooit iets gelezen” (= “Je n’ai jamais rien lu”), ce grand connaisseur de la Russie, au regard froid et objectif mais néanmoins très original, émet force assertions qui témoignent de sa connaissance profonde des lettres russes. De son essai “De ondergang van het morgenland” (1990; “Le déclin de l’Orient”), je ne glanerai qu’une seule et unique phrase: “Selon le régime, en 1917, c’est la classe ouvrière, que l’on appelle également le prolétariat, qui est arrivée au pouvoir, alliée, comme on le prétend officiellement, aux paysans. C’est là une déclaration dont nous n’avons pas à nous préoccuper, si nous entendons demeurer sérieux. Surtout, ces paysans, que l’ont a tirés et hissés dans la mythologie révolutionnaire, font piètre figure, prêtent à rire (jaune): le régime a justement exterminé une bonne part du paysannat. Pour ce qui concerne les ouvriers, il est bien clair que ce groupe au sein de la population n’a quasiment rien à dire dans un régime communiste, et sûrement beaucoup moins que sous Nicolas II ou sous Lubbers et Kok aux Pays-Bas”.
Un changement qui doit surgir de l’intérieur même du pays...
Soljénitsyne n’était pas homme à se laisser jeter de la poudre aux yeux; prophète slavophile, il a progressivement appris à détester les faiblesses spirituelles et le matérialisme de l’Occident, pour comprendre, au bout de ses réflexions, que l’effondrement de l’Union Soviétique ne pouvait pas venir d’une force importée mais devait surgir de l’intérieur même du pays. La révolution, comme on le sait trop bien, dévore ses propres enfants. Le régime soviétique, lui, avec la “glasnost”, a commencé à accepter et à exhiber ses propres faiblesses, si bien que les credos marxistes ont fini par chanceler et le régime par chavirer. Déjà en 1975, la revue “Kontinent”, épaisse comme un livre, qui était un forum indépendant d’écrivains russes et est-européens, avait amorcé un débat sur l’idéologie en URSS en se référant à la “Lettre aux dirigeants de l’Union Soviétique” de Soljénitsyne, en la commentant à fond, avec des arguments de haut niveau. Un poète fidèle au régime avait même déclaré, à propos de ce débat: “Nous avons fusillé la Russie, cette paysanne au gros postérieur, pour que le ‘Messie communisme’ puisse marcher sur son cadavre et ainsi, y pénétrer”.
Pour donner un exemple du ton de Soljénitsyne, impavide et inébranlable, courageux et solide, j’aime citer une réponse claire qu’il adressa un jour à son compatriote Sakharov, une réponse qui garde toute sa validité aujourd’hui: “Nous devrions plutôt trouver une issue à tout ce capharnaüm omniprésent de termes tels impérialisme, chauvinisme intolérant, nationalisme arrogant et patriotisme timide (c’est-à-dire vouloir rendre avec amour service à son propre peuple, posture intellectuelle combinée avec des regrets sincères pour les péchés qu’il a commis; cette définition s’adresse également à Sakharov)”. Et il y a cette citation plus humaine encore: “Cette hypocrisie ne suffit-elle pas? Comme un électrode rouge, elle a laminé nos âmes pendant cinquante-cinq ans...”.
Les meilleurs livres de Soljénitsyne sont sans doute ceux qui sont le moins connus: je pense surtout à “Lénine à Zurich” (1975) et “Les erreurs de l’Occident” (1980). Quoi qu’il en soit, cet homme a surtout eu le grand mérite d’avoir, à temps et sans cesse, ouvert nos yeux, à nous ressortissants du riche Occident, alors qu’ils étaient aveuglés ou trompés; de nous avoir apporté son témoignage sur son époque et sa patrie (l’Orient ou la “Petite Mère Russie”) dans ses livres tout ruisselants d’authenticité; de nous avoir ainsi libérés des griffes du communisme, idéologie catastrophique et inhumaine.
Il a pu être enterré solennellement dans le sol de sa patrie russe et non pas en Suisse ou en cette lointaine Amérique, ses terres d’exil. Personne ne l’aurait cru, n’aurait osé le prévoir, il y a vingt ou trente ans.
“De brave Hendrik”,
(article paru dans “ ’t Pallieterke”, Anvers, 13 août 2008, trad. franç. : Robert Steuckers).
Note:
(1) paru à Amsterdam chez van Oorschot, cinquième édition revue et corrigée, 1990.
00:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres russes, littérature russe, urss, communisme, russie, soljénitsyne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Eerbetoon aan Castro...
00:05 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, caraïbes, cuba, national-communisme, communisme, castro, marxisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Europa degli eroi - Europa dei mercanti

Claudio Bonvecchio,
Europa degli eroi Europa dei mercanti
Settimo Sigillo, Roma 2004, pag. 94, euro 10.
Già il titolo di questo lavoro di Claudio Bonvecchio, professore di Filosofia Politica presso l’Università dell’Insubria e prolifico autore di saggi sul mito e sul simbolico, pone il lettore di fronte ad un’opzione. Europa degli eroi o Europa dei mercanti? L’interrogativo, che riprende la distinzione resa famosa da Werner Sombart, richiede una risposta perentoria e definitiva. L’autore non esita a darla, ponendosi dalla parte di chi crede in un risveglio europeo dal torpore del cosmopolitismo e del globalismo, che sembra aver precipitato il continente in una desolazione fino ad oggi sconosciuta. Ma cos’è l’Europa? Da buon studioso di simbolica politica, Bonvecchio utilizza strumenti a lui familiari per delinearne i contorni: è il mito, di cui viene ribadita l’efficacia conoscitiva e quella caratteristica di immediatezza che manca all’approccio logico-discorsivo, a venire riproposto quale chiave di lettura. Ed il mito racconta dell’unione fra la lunare Europa ed il solare Zeus, da cui nasceranno tre figli, Sarpedonte, Minosse e Radamanto, fondatore di città il primo, sovrani e legislatori i secondi. Un’unione che rappresenta, simbolicamente, una perfetta totalità, ove le diversità si armonizzano tra loro e il cui frutto richiama l’armonia e l’equilibrio. Funzione dell’Europa, racconta il mito, è l’essere punto di riferimento e appianatrice di conflitti e controversie. Ma l’Europa, e lo dimostrano i doni nuziali ricevuti da Zeus (un cane, un gigante, una lancia), è sempre bisognosa di difesa e ha nella vulnerabilità il suo tallone d’Achille. L’esegesi mitica termina quindi con un interrogativo irrisolto: da chi deve difendersi l’Europa? Da qualcun altro o da se stessa?
Per rispondere, Bonvecchio passa dalla fase mitica, alla base del sorgere dell’Europa, a quella del tramonto e della decadenza europea; si entra così nella storia che l’Europa sta vivendo: un presente, sotto gli occhi di tutti, in cui essa si abbrutisce in mancanza di punti di riferimento trascendenti, sostituiti dal culto del profitto e del consumo. Un presente che la vede, nello scacchiere globale, assolutamente incapace di recitare un ruolo che non sia di comparsa. Non meno impietosa la diagnosi rispetto alle forme politiche che alimentano questa deriva: dalla statualità, frutto della modernità che ha finito per divorare se stessa, alla democrazia formale che si nutre di un egualitarismo acritico, produttivo di forme di raccolta del consenso sempre meno partecipative e sempre più funzionali ai poteri economici. L’Europa deve, quindi, la sua vulnerabilità all’incapacità di ritrovarsi: all’aver permesso che alla comunità, fondata sull’appartenenza e l’adesione a valori che trascendevano l’individuo, seguisse la società, in cui si sta insieme per interesse e l’individuo rimane solo con la propria sete di guadagno. Anche qui si recuperano le categorie rese famose da Tönnies per riproporle in una dimensione contemporanea e assolutamente attuale. A Bonvecchio, infatti, l’Europa dell’euro sembra il modello perfetto di una società di tipo geo-economico: c’è una banca, una moneta, persino un parlamento ma nessuna traccia di identità, nessuna radice nella quale rispecchiarsi. Eppure, afferma Bonvecchio, i possibili riferimenti identitari ci sarebbero e vanno cercati nella propria storia: ma a frenarne il riemergere ci pensa un senso di colpa e di timore che l’eredità della seconda guerra mondiale continua ad alimentare. Tutto ciò ha impedito all’Europa di resistere al modello etico, oltre che economico-politico, americano, che dimostra tutta la sua aggressività e l’incapacità di considerare il diverso da sé. A questo modello massificante ed omologante viene contrapposta la vocazione universalista di cui il Vecchio Continente è storicamente portatore.
Qui va fatta una precisazione. L’universalismo cui si riferisce Bonvecchio non può dissociarsi dall’idea di imperialità. E l’impero è concepito come l’unica forma politica e simbolica capace di unire le differenze, al tempo stesso preservandole. È inutile ricordare ai lettori di Diorama lo stesso riferimento presente nel de Benoist de L’impero interiore, che pure non perde occasione per criticare il concetto moderno di universalismo, considerato una corruzione dell’oggettività e un grimaldello ideologico al servizio del pensiero dominante per annullare le identità e qualunque espressione di appartenenza in nome dell’astrazione più assoluta (si veda, da ultimo, il suo saggio Oltre i diritti dell’uomo). Ne sono figli la teorizzazione dei diritti umani, nonché l’idea dell’esportibilità di modelli politici quali la democrazia liberale. L’universalismo di Bonvecchio non può concepirsi se non in relazione al pluralismo culturale (si veda, a tal proposito, il volume di Chiodi, Europa. Universalità e pluralismo delle culture): esso è connesso all’idea di un’Europa quale casa comune, legata dalla spiritualità e dal sacro prima e dalla cultura poi, munita di una lingua, il latino, che oltre ad essere uno strumento di comunicazione era soprattutto l’espressione di un modo di vivere, pensare e ragionare essenzialmente europei. Questo riferimento al latino permette il raffronto con un'altra lingua, quella inglese, che pure oggi viene propugnata quale lingua universale, ma che qui viene liquidata come la lingua del commercio e della pratica del mercato, incapace di imprimere nell’anima di chi la adopera qualunque idea di appartenenza comune. L’inglese è infatti la lingua del particolarismo individualistico, di quel cosmopolitismo che per Bonvecchio è la vera malattia dell’Europa. È il cosmopolitismo a determinare il declino del Vecchio Continente: il suo momento centrale è individuato nella Rivoluzione Francese, che sostituirà alla centralità del sistema simbolico europeo, espressione di valori condivisi, il particolarismo ideologico ed il funzionalismo dello stato nazionale ad esso asservito. La chiave di volta non sarà più l’uomo, ma il denaro: l’Europa sceglierà i mercanti. Il frutto di questo processo sarà l’affermazione di un’identità cosmopolita che si pensa politicamente nella nazione ma economicamente nel mercato internazionale e mondiale: una contraddizione solo apparente, alimentata dal prevalere dell’economico sul politico, che sfocerà nei due conflitti mondiali che hanno messo in ginocchio l’Europa. La globalizzazione rappresenta, a tal proposito, la moderna forma di asservimento alla signoria del mercato, capace di avvalersi della formidabile gamma di apparati tecnici, sociali e amministrativi che deresponsabilizzano l’uomo e concorrono ad un’omologazione mortificante e massificante. Qualunque differenza e specificità viene stritolata in nome di una totalità virtuale, basata su valori troppo astratti per essere coesivi.
Come se ne esce? Bonvecchio non ha dubbi: l’Europa ha nella sua storia le armi dello spirito e della cultura che le permetterebbero, se solo volesse, di resistere. Si tratta di “passare al bosco”; l’espressione di Jünger, che la ha adottata ne Il trattato del ribelle, ben si presta alla scelta che spetta all’uomo europeo: ritrovare l’originaria partecipazione alla comunità che passa per un recupero della dignità perduta. Si devono scegliere gli eroi: viene tracciato così un’itinerario di ribellione, che da individuale si fa collettivo, e che passa per la riscoperta delle proprie radici spirituali, che affondano nel Sacro e nelle molteplici forme in cui esso si esprime, e che continua nella scelta politica di una grande Europa, imperiale, capace di riscoprire la ricchezza che proviene dall’essere differenti nell’unità. L’ultimo passo è il recupero di un’economia sociale piegata alle leggi del politico: il modello non può essere quello liberista, causa dello squilibrio che costringe l’uomo all’interno della schiavitù del mercato e della tirannia del consumo.
Volutamente provocatorio, al limite dell’utopico come lo stesso autore non ha remore ad ammettere, il testo di Bonvecchio non fa sconti al ‘politicamente corretto’. Questo ne rappresenta indubbiamente un punto di forza, a cui si accompagna una vis argomentativa altrettanto efficace, che permette più di uno spunto di riflessione. Segnaleremmo, tra questi, la riaffermazione della centralità e dell’efficacia del mito in un tempo che, di fronte ad interrogativi sempre più inquietanti, sconta una paurosa carenza di risposte e in cui il pensiero è quasi costretto a presentarsi quale ‘debole’. Ma, soprattutto, il riferimento all’impero come forma politica ancora praticabile: già Carl Schmitt aveva rimarcato ne Le categorie del politico il carattere storico dello stato moderno, il cui declino era inevitabile; l’Europa degli stati e dei governi, quella di Bruxelles, finisce per essere l’espressione di una burocrazia e di una tecnocrazia economica e finanziaria che sfuggono ad ogni controllo e si avvalgono di un’assoluta deresponsabilizzazione. Si può convenire quindi, con Claudio Bonvecchio come con Alain de Benoist, che il modello imperiale rimane l’unica alternativa praticabile per una Europa delle culture e dei popoli.
Fabio Pagano
00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
N. Danilveski: esquisse biographique

Karl NÖTZEL
Nikolaï Jakovlevitch Danilevski est né le 28 novembre 1822 dans le village d'Oberets dans le gouvernement d'Orlov. Son père, Jakob Ivanovitch, commandait à l'époque un régiment de hussards et deviendra par la suite général de brigade. Au départ, ce militaire était étudiant en médecine, mais, quand les Français envahissent la Russie en 1812, il s'engage comme volontaire dans l'armée. Pendant la guerre de Crimée, il démissionne parce qu'on refuse l'une de ses propositions qu'il estimait urgente et importante; il meurt peu après en 1855, victime d'une épidémie de choléra. Il aurait aimé l'art et la littérature et aurait laissé le texte d'une comédie.
Nikolaï Jakovlevitch passera sa petite enfance en des lieux très différents, au gré des affectations du régiment de son père. A dix ans, il vit en pension chez un pasteur allemand de Livonie. A treize ans, il fréquente une école privée à Moscou. De quatorze à vingt ans, il étudie au lycée de Tsarskoïe Zelo. C'était un élève très doué, animé par une véritable fringale spirituelle. Ses aspirations le conduisait à aimer les sciences naturelles; ainsi , pendant quatre ans, de 1843 à 1847, il étudiera à la faculté de sciences naturelles de Saint-Petersbourg, comme élève libre, et, simultanément sert dans la chancelerie du Ministère de la Guerre. Il choisit pour spécialité la botanique. En 1849, il obtient le grade de magister pour ses travaux sur la flore dans le gouvernement d'Orlov. A la demande de la “Société d'Economie libre”, il s'occupe de recherche dans la zone des terres noires, plus particulièrement sur la flore; dans le cadre de ces activités, il est brusquement arrêté un jour et incarcéré dans la Forteresse Pierre-et-Paul. On l'avait accusé de participation à la fameuse affaire Petrachevski, qui était également à l'origine du bannissement de Dostoïevski. Danilevski passa cent jours en prison. Au début, toute lecture lui était interdite, mais, plus tard, il eut l'immense plaisir de pouvoir lire le Don Quichotte. Il put prouver devant le Tribunal que, entièrement absorbé par ses études et ses recherches, il n'avait plus vu Petrachevski depuis des années et qu'il ne savait pas ce qui se passait là. Dans un volumineux memorandum sur le système de Fourier, il démontra clairement, avec grande précision, qu'il s'agissait là d'une doctrine purement économique, qui ne contenait rien de révolutionnaire ou d'anti-religieux. Danilevski fut acquitté, mais il dut quitter la chancelerie du gouvernement et on le déplaça, d'abord à Vologda, ensuite à Samara. C'est là qu'il épousa en 1852 la veuve d'un général-major, Véra Nikolaïevna Beklemichev, qui décéda un an plus tard. L'année suivante, il participe, à titre de statisticien, à une expédition scientifique de deux ans, destinée à “explorer l'état des pècheries sur le cours de la Volga et dans la Mer Caspienne”. Cette expédition décida de son destin futur. Le chef de l'expédition, le grand naturaliste Karl Ernst Bär, reconnut les capacités et l'ampleur du savoir de son statisticien et lui ouvrit la voie. A peine cette première expédition de trois ans était-elle terminée que Danilevski obtint sa nomination de chef d'une autre expédition, cette fois pour recenser les bans de poissons de la Mer Blanche et de l'Océan Arctique. Cette expédition dura elle aussi trois ans (jusqu'en 1861). Cette année-là, il épouse la fille d'un ami qui venait de mourir, Olga Alexandrovna Mechakova. Ensuite, il participa encore à sept autres expéditions, au cours desquelles il enquête sur tous les bancs de poissons de la Russie d'Europe et en tira des conclusions toujours valables aujourd'hui. C'est au cours d'un de ces voyages que Danilevski meurt d'une maladie cardiaque à Tiflis le 7 novembre 1885.
En 1880, il avait constaté la présence du phylloxera en Crimée et organisé un lutte systématique contre ce fléau par l'imposition de lois et règlements. Ce travail avait rempli les dernières années de sa vie.
Mais le caractère saisonnier de ces expéditions scientifiques lui laissait beaucoup de temps libre: son esprit toujours en éveil se consacra à toutes sortes de travaux intellectuels dans tous les domaines possibles et imaginables. Son livre le plus célèbre, Rußland und Europa a été écrit pendant les hivers de 1865 à 1867. Un ouvrage en deux volumes sur le darwinisme est malheureusement resté inachevé.
Danilevski était un homme de haute taille, puissamment bâti, qui jouissait d'une santé exceptionnelle. Son caractère ouvert et honnête l'éloignait de toute forme d'orgueil personnel. C'est pourquoi il est resté assez méconnu; il n'avait pas d'ennemi, ce qui lui permit d'officier dans le conseil secret du ministère de l'agriculture. Malgré la vivacité de son esprit insatiable, il accomplit les tâches de sa profession avec beaucoup de conscience. Il fut bon père et bon époux. Il vécut heureux dans la simplicité. Le seul désagrément fut d'être séparé de sa famille à cause de sa profession qui le contraignait à de longues et fréquentes absences.
L'amour qu'il portait à son pays fit de lui le fondateur scientifique du panslavisme; cet amour était passionné, mais au fond sans haine d'autrui: c'est justement dans cette attitude qu'il s'est révélé un vrai Russe. Ce naturaliste professionnel a certes pu se tromper dans les faits et dans l'interprétation de ceux-ci quand il a joué le rôle de l'historien des cultures. Mais ses sentiments demeurent au-dessus de tout soupçon. Il y a quelque chose de l'esprit des prophètes de l'ancien testament dans l'amour qu'il portait à sa patrie. En aimant son peuple, il a aimé l'humanité tout entière.
Karl NÖTZEL.
(préface à Rußland und Europa. Eine Untersuchung über die kulturellen und politischen Beziehungen der slawischen zur germanisch-romanischen Welt, 1920, réédition, Otto Zeller Verlag, Osnabrück, 1965; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, révolution conservatrice, panslavisme, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 août 2008
Sur les Ossètes

Sur les Ossètes
INTRODUCTION: Le 5 septembre 2004, immédiatement après la tragédie qui a frappé l'école de Beslan en Ossétie du Nord, nous avions envoyé un long communiqué de presse, où nous faision allusion à l'histoire et la culture ossète. Voici l'extrait de notre communiqué:
"La tragique affaire de l’école de Beslan nous amène tout naturellement à expliquer qui sont les Ossètes, ce peuple indo-européen du Caucase, parlant une langue proche de l’iranien ancien et du patchoune actuellement parlé en Afghanistan. Les Ossètes sont les 300.000 descendants des peuples cavaliers indo-européens de la haute antiquité, les Scythes, les Sarmates, les Sakes et les Alains, dont les sources du Bas-Empire romain font souvent mention. On sait que ces peuples cavaliers indo-européens ont été balayés par les envahisseurs hunno-turco-mongols, venu d’une région sibérienne située au nord de la Mandchourie, leur patrie initiale. Les Alains ont été repoussés vers les montagnes du Caucase, l’actuelle Ossétie du Nord ou “Alanie”. Les autres Alains ont rejoint, dans leur fuite en 370, les tribus germaniques et les ont accompagnées jusqu’en Espagne et en Afrique du Nord (cf. http://www.neohumanism.org/a/alans.html ). Leur roi Respendial est ainsi arrivé dans la péninsule ibérique. Des éléments de son peuple se sont éparpillés dans toute l’Europe occidentale, en Rhénanie et dans les Iles Britanniques, générant là-bas les légendes arthuriennes (nous y reviendrons, sur base de publications officielles et toutes récentes, émanant des armées polonaise et britannique). Après un affrontement avec les Wisigoths, la couronne des Alains passe aux Vandales, que les cavaliers alains accompagneront en Afrique du Nord. Ils introduisent également une “arme” nouvelle, les chiens de combat, que leurs descendants espagnols utiliseront contre les Maures et dans leurs guerres en Amérique. Les Ossètes, réfugiés dans le Caucase, donneront aussi à Byzance un “Magister militium”, Aspar. En 1767, ils seront libérés par les Russes. Leur langue sera codifiée par le poète Kosta Xetagurov (1859-1906). L’Académicien français Georges Dumézil sera le plus grand spécialiste des traditions et de la littérature épique des Ossètes (cf. G. Dumézil, “Romans de Scythie et d’alentour”, Payot, 1978). Toute l’œuvre de Dumézil sur les peuples indo-européens dérive de sa découverte des traditions ossètes, tant celles-ci avaient gardé intact le fonds de notre identité la plus profonde : on mesure pleinement l’importance de ce peuple en suivant la démarche et en étudiant les travaux de Dumézil. Le folklore ossète est proprement époustouflant de beauté et de charme (cf. http://www.ifrance.com/folkloriades/gr2003/ossetiedunord.htm ). C’est donc ce peuple admirable que la vermine tchétchène essaie, avec la complicité des Turcs, des Américains, des islamistes et des journalistes comme ceux du “Soir”, de génocider, car c’est une démarche proprement génocidaire de tuer de la sorte des enfants, une démarche génocidaire qui se place dans la suite logique du génocide turc contre les Arméniens. Nous lançons un appel solennel à lutter, dans toute l’Europe, de Dublin à Vladivostock, contre ce génocide pluriséculaire perpétré contre les Indo-Européens du Caucase.
A la tenacité turco-tchétchène dans ses entreprises de mort, il convient d’opposer des principes stratégiques clairs : dire par exemple que le Caucase dans son ensemble est soit aborigène (Ibériens, Géorgiens) soit indo-européen (Ossètes, Alains, Arméniens), soit de religion native soit de religion orthodoxe. Les autres peuplements et confessions y sont illégitimes. Cela ne signifie pas que nous refusions le droit de vivre à ces peuplements et confessions; nous affirmons haut et clair qu’ils n’ont tout simplement aucun droit à y déterminer la politique ou à y imposer d’autres lignes de projection géostratégiques et géopolitiques que celles, éternelles, des Scythes, de Rome, de Byzance, des Arméniens, des Croisés et des Tsars russes. Les poussées géopolitiques doivent s’élancer là-bas du Nord vers le Sud et non du Sud vers le Nord ou de l’Est vers l’Ouest. Pour les peuples européens, c’est une question de vie ou de mort : ceux qui, parmi nous, disent le contraire sont des traîtres ou des fous. Parce que le triomphe d’une géopolitique turque impliquerait l’étouffement définitif des Européens dans leur presqu’île ou des Russes dans la zone peu écouménique des forêts et des toundras. En tant qu’Européen, on ne peut être à la fois sain d’esprit et vouloir cet étouffement, cette mort lente".
00:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossétie, caucase, russie, beslan, indo-européens, peuples cavaliers, georges dumézil |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Vandaag Zuid-Ossetië, morgen Vlaanderen?
00:25 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossétie, russie, politique, actualité, europe, caucase, mer noire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook







