mercredi, 20 août 2008
Refuser le mensonge: hommage à A. Soljénitsyne

J.K.: ’t Pallieterke :
Refuser le mensonge: hommage à Soljénitsyne
“C’est justement ici que se trouve la clef, celle que nous négligeons le plus, la clef la plus simple, la plus accessible pour accéder à notre libération: ne pas participer nous-mêmes au mensonge! Le mensonge peut avoir tout recouvert, peut régner sur tout, ce sera au plus petit niveau que nous résisterons: qu’ils règnent et dominent, mais sans ma collaboration!”.
Ces phrases sont tirées d’un essai de Soljénitsyne, intitulé “Ne vis pas avec le mensonge!”. Elles caractérisent parfaitement l’écrivain russe, décédé début août 2008. Il avait été le plus célèbre des dissidents et Prix Nobel de littérature. Il n’a pas participé au mensonge, effectivement, ce qui lui permit de donner une impulsion à la résistance contre le régime soviétique, impulsion qui, à terme, a conduit à l’effondrement de l’Etat totalitaire alors que, jadis, il avait semblé si invincible.
“Ce fut Alexandre Soljénitsyne qui ouvrit les yeux du monde sur la réalité du système soviétique. C’est pourquoi, son vécu a une dimension universelle”, a déclaré le président français Sarközy après avoir appris la mort de l’écrivain. Les réactions officielles post mortem n’ont généralement rien de bien substantiel. Quoi qu’il en soit, en France, le pays de Sarközy, l’oeuvre littéraire de Soljénitsyne avait provoqué un gigantesque retournement des esprits. Gramsci, marxiste italien, savait que toute société est dirigée par ceux qui influencent la pensée. En France, dans le sillage de mai 68, fourmillaient les “compagnons de route”, souvent des intellectuels bien intentionnés, qui voyaient dans l’Etat soviétique la réalisation du paradis sur la Terre. La publication de “L’Archipel Goulag”, oeuvre littéraire monumentale où Soljénitsyne règle ses comptes avec le régime de terreur communiste, ouvre les yeux à de nombreux intellectuels français. C’est le début de la fin pour le communisme, en France et en dehors des frontières de l’Hexagone. Plus que n’importe quel autre écrivain, Soljénitsyne dévoila la vérité quant à l’oppression subie par son peuple sous la dictature communiste. Parce qu’il ne voulait pas participer au mensonge.
Qui connait encore Soljénitsyne?
La biographie de Soljénitsyne a été révélée dans ses grandes lignes dans notre presse flamande. Soldat de l’Armée Rouge, il est fait prisonnier par sa propre hiérarchie et déporté en Sibérie parce qu’il avait émis des critiques contre Staline dans une lettre à un ami; il fut condamné à huit années de camp de travail et ensuite à cinq années de bannissement intérieur. Auteur d’ouvrages critiques à l’endroit du régime, il oeuvre dans un premier temps avec l’accord de Khrouchtchev, leader du parti, qui espère tirer un profit personnel en autorisant certaines critiques contre Staline. Plus tard, contre l’avis des autorités soviétiques, Soljénitsyne obtint le Prix Nobel de littérature; il n’ira pas lui-même le chercher de crainte de ne pouvoir rentrer en Russie; il sera malgré tout banni du pays après la publication en Occident de “L’Archipel Goulag”. Pendant des années, il vivra reclus aux Etats-Unis, dans une propriété enneigée et plantée de pins dont les allures lui rappellaient la Russie. Réhabilité après la chute du communisme, il revient en Russie en 1994, où il se posera, une fois de plus, comme un critique non conformiste, hostile aux pouvoirs établis.
La presse flamande n’a pas raconté beaucoup d’autres choses à la suite de son décès. “La Libre Belgique” en a fait son grand titre, exactement comme “Le Monde” à Paris et d’autres quotidiens de qualité ailleurs en Europe. Chez nous, seulement de brefs articulets, quelques analyses toutes de platitude dans les pages intérieures des journaux. Rik van Cauwelaert fit exception dans les colonnes de l’hebdomadaire “Knack”, où un éditorial bien ficelé fut entièrement consacré à Soljénitsyne.
D’où question: nos journalistes ne connaissent-ils plus Soljénitsyne? L’ont-ils jamais lu? Ou bien, l’appellation de “fossoyeur du régime soviétique”, dont on l’a si souvent gratifié, les effraie-t-elle? La Flandre a démontré, la semaine dernière, sa petitesse.
Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi dans nos régions. “Le premier cercle” contenait, en page 202 de son édition néerlandaise, un phrase caractéristique: “Il y a toujours eu l'une de ces idées pour fermer la bouche à ceux qui voulaient crier la vérité ou monter sur la brèche pour la justice”. “Le pavillon des cancéreux”, “Lénine à Zurich”, “La Russie sous l’avalanche”, “La fille d’amour et l’innocent”, “Flamme au vent”, “Pour le bien de la cause”, “Août 1914”, “Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch”, “L’Archipel Goulag”, “Le chêne et le veau”, “Lettre ouverte aux dirigeants de l’Union Soviétique”, “Discours américains”, etc., tous furent rapidement traduits en néerlandais et connurent de réels succès éditoriaux. Les éditions successives se bousculaient à un rythme constant.
Aujourd’hui, on ne peut plus acheter neuf qu’”Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch” en librairie. Même “L’Archipel Goulag” est épuisé.
Le mensonge en lui-même
Partout dans le monde, l’intérêt pour l’auteur et ses idées s’est rapidement estompé après son bannissement à l’Ouest. Pour les clans de la gauche, Soljénitsyne resta suspect, alors que, pourtant, l’Amérique libérale, à son tour, était devenue la cible de ses critiques. La prise du pouvoir par les communistes, il l’a toujours considérée comme une “importation occidentale” (Marx était allemand) qui, par voie de conséquence, s’opposait diamétralement aux ressorts de l’âme russe. Le capitalisme était pour lui une horreur. Mais après la chute du communisme, il ne ménagea pas ses critiques à l’encontre de Gorbatchev et surtout d’Eltsine, qui, selon lui, vendaient le pays aux plus offrants et le transformaient en un marécage sordide où dominait une culture glauque, décadente, sans contenu réel.
En 1999, Soljénitsyne écrit “L’effondrement de la Russie”, une synthèse de toutes les idées qui ont émaillé son oeuvre. Il règle ses comptes avec l’idéologie de la privatisation et déplore le déclin du patriotisme. La nouvelle norme est hélas devenue la suivante, elle se résume en une question: “Qu’est-ce que cela rapporte?”. Pour Soljénitsyne, le patriotisme est un sentiment organique, “la conviction que l’Etat vous protège dans les moments difficiles”. La patrie jouait un grand rôle pour Soljénitsyne. Mais Dieu aussi. Et Dieu disparaît également, ou alors on n’écrit plus son nom qu’avec un “d” minuscule.
La ligne de démarcation
Il est clair que Soljénitsyne ne visait pas le succès auprès des détenteurs du pouvoir. Mais les intellectuels contemporains, ceux qui se targuent d’être dans le vent, n’aiment pas davantage ce conservateur fondamental, avec sa tête et son visage comme taillés dans du bois de chêne. “Il est dépassé”: tel est sans doute le commentaire le plus courant et le plus aimable qu’on a entendu à son propos. La plupart le rejetait en ne tenant compte que de la caricature que l’on avait faite de lui.
Il a survécu à l’Union Soviétique mais est revenu dans une Russie où toutes les non valeurs, comme la corruption, le matérialisme, la superficialité et la décadence étaient omniprésents.
Dans une recension remarquable, aux arguments solides comme l’acier, Hubert Smeets, dans les colonnes du “NRC-Handelsblad” (15 janvier 1999), évoque Wayne Allensworth qui était, dans les années Clinton, analyste auprès du “Foreign Broadcast Information Service”, une officine gouvernementale américaine qui suit la presse non anglophone du monde entier. Wayne Allensworth y défendait Soljénitsyne contre tous les critiques américains et étrangers. Selon Allensworth, en effet, Soljénitsyne était logique avec lui-même, suivait toujours sa même piste: la lutte contre LE mensonge, “contre la croyance en la possibilité qu’aurait l’homme de transformer sa propre nature, de manipuler l’univers et de créer un paradis sur la Terre”. C’est dans ce grand mensonge-là que se retrouvent, tous ensemble, les communistes, les capitalistes, les révolutionnaires et les libéraux.
“Ce que les Occidentaux, convaincus de la supériorité du capitalisme, devraient comprendre, c’est que Soljénitsyne ne perçoit pas les racines de la misère économique et écologique de la Russie dans le socialisme en soi, mais dans le manque d’humilité de l’humanité moderne”.
Pour Allensworth, on ne peut dès lors pas considérer Soljénitsyne comme un slavophile, simple héritier et imitateur des slavophiles russes du 19ème siècle, ni comme un idéologue “Blut-und-Boden” (à la mode allemande) mais comme un personnaliste contemporain, se situant dans la tradition d’Edmund Burke, James Burnham ou Christopher Lash.
Concluons en citant Soljénitsyne lui-même: “La ligne de démarcation entre le bien et le mal ne passe pas entre les Etats, les classes ou les partis, mais à l’intérieur même de chaque coeur d’homme”. Le coeur de Soljénitsyne, lui, s’est arrêté de battre à 89 ans.
J. K.
(article paru dans “’t Pallieterke”, Anvers, 13 août 2008; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres russes, littérature russe, russie, soljénitsyne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le concept d'aristocratie chez Nicolas Berdiaev
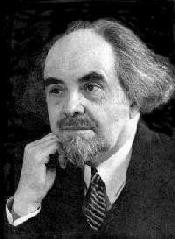
Le concept d'aristocratie chez Nicolas Berdiaev
Pierre MAUGUÉ
Par son livre La philosophie de l'inégalité (1), Berdiaev (2) s'inscrit dans la grande tradition des écrivains contre-révolutionnaires. Bien qu'il ait été écrit dans le chaos de la révolution russe, et tout imprégné qu'il soit du mysticisme propre à l'orthodoxie, ce livre recèle en effet un message de portée universelle. Par delà le temps et le fossé culturel qui sépare l'Europe latine du monde slave orthodoxe, les analyses de Berdiaev rejoignent celles de Maistre et de Bonald; elles mettent non seulement en lumière les racines communes à la révolution jacobine et à la révolution bolchevique, mais concluent à la primauté des principes sur lesquels reposent les sociétés traditionnelles.
Comme Joseph de Maistre (3), Berdiaev voit dans la révolution une conséquence de l'incroyance et de la perte du centre organique de la vie. «Une révolution, quelle qu'elle soit, est anti-religieuse de par sa nature même, et tenter de la justifier religieusement est une bassesse... La révolution naît d'un dépérissement de la vie spirituelle, de son déclin, et non de sa coissance ni de son développement intérieur». Mais la révolution ne s'attaque pas seulement à la religion en tant qu'elle relie l'homme au sacré et à la transcendance, mais aussi dans la mesure où elle établit un lien entre les générations passées, présentes et futures. Comme le note Berdiaev, «il existe non seulement une tradition sacrée de l'Eglise, mais encore une tradition sacrée de la culture. Sans la tradition, sans la succession héréditaire, la culture est impossible. Elle est issue du culte. Dans celle-ci, il y a toujours un lien sacré entre les vivants et les morts, entre le présent et le passé... La culture, à sa manière, cherche à affirmer l'éternité».
Berdiaev ne peut donc que s'insurger contre la prétention des révolutionnaires d'être des défenseurs de la culture. S'adressant à eux, il écrit: «Vous avec besoin de beaucoup d'outils culturels pour vos fins utilitaires. Mais l'âme de la culture vous est odieuse». Ce que Berdiaev leur reproche, c'est aussi leur mépris des œuvres du passé: «La grandeur des ancêtres vous est insupportable. Vous auriez aimé vous organiser et vous promener en liberté, sans passé, sans antécédents, sans relations», et il se voit obliger de rappeler que «la culture suppose l'action des deux principes, de la sauvegarde comme de la procréation».
Le principe conservateur dont Berdiaev se fait le héraut n'est donc pas opposé au développement, il exige seulement que celui-ci soit organique», que l'avenir ne détruise pas le passé mais continue à le faire croître». L'antimarxisme de Berdiaev n'en fait pas pour autant un défenseur inconditionnel du libéralisme. Bien qu'il reconnaisse, avec Tocqueville, qu'«il y a dans la liberté quelque chose d'aristocratique» et qu'il considère que «les racines de l'idée libérale ont une relation plus étroite avec le noyau ontologique de la vie que les idées démocratiques et socialistes», il n'en estime pas moins que, dans le monde actuel, le libéralisme «vit des miettes d'une certaine vérité obscurcie».
Berdiaev relève ainsi que l'individualisme libéral sape la réalité de la personne, à laquelle il entendait donner la première place, du fait qu'il détache l'individu de toutes les formations historiques organiques. «Pareil individualisme», dit-il, «dévaste en fait l'individu, il lui ôte le contenu super-individuel qu'il a reçu de l'histoire, de sa race et de sa patrie, de son Etat et de l'Eglise, de l'humanité et du cosmos». Quant au libéralisme économique, il lui paraît avoir plus d'affinités avec une certaine forme d'anarchisme qu'avec la liberté aristocratique. «L'individualisme économique effréné, qui soumet toute la vie économique à la concurrence et à la lutte d'intérêts égoïstes, qui ne reconnait aucun principe régulateur, semble n'avoir aucun rapport nécessaire avec le principe spirituel du libéralisme».
En définitive, Berdiaev considère que la philosophie de l'état et des droits naturels, prônée par les libéraux, est superficielle, car «il n'y a pas et il ne peut y avoir d'harmonie naturelle». Pour lui, «la foi libérale» n'est donc pas moins fausse que «la foi socialiste».
* * *
La «philosophie de l'inégalité» se présente comme une suite de lettres traitant chacune d'un thème bien précis. Hormis la première lettre, qui traite de la révolution russe, toutes les autres lettres abordent des sujets qui ne sont pas spécifiquement liés à la situation de la Russie. Partant d'une analyse «des fondements ontologiques et religieux de la société», Berdiaev va nous parler de l'Etat, de la nation, du conservatisme, de l'aristocratie, du libéralisme, de la démocratie, du socialisme, de l'anarchie, de la guerre, de l'économie, de la culture, et, pour conclure, d'un sujet qui n'intéresse généralement pas les politologues: du royaume de Dieu.
La lettre sur l'aristocratie est peut-être celle qui retient le plus l'attention, car elle ose faire l'apologie d'un principe que, depuis deux siècles, l'on s'est plus non seulement à dévaloriser, mais à désigner à la vindicte populaire. Aujourd'hui, note Berdiaev, il est généralement considéré qu'«avoir des sympathies aristocratiques, c'est manifester soit un instinct de classe, soit un esthétisme sans aucune importance pour la vie».
La vision réductrice de l'aristocratie que l'on a tout fait pour imposer depuis la Révolution française est battue en brèche par Berdiaev en partant d'un point de vue spirituel. Pour lui, l'aristocratie a un sens et des fondements plus profonds et plus essentiels. Alors que «le principe aristocratique est ontologique, organique, qualitatif», les «principes démocratiques, socialistes, anarchiques, sont formels, mécaniques, quantitatifs; ils sont indifférents aux réalités et aux qualités de l'être, au contenu de l'homme». La démocratie, dépourvue de bases ontologiques, n'a au fond qu'une nature “purement phénoménologique”; elle ne serait finalement rien d'autre que le régime politique correspondant au “règne de la quantité”, à l'“âge sombre”, dont parlent les représentants de la pensée traditionnelle, notamment René Guénon.
Mais Berdiaev ne met pas seulement en valeur la supériorité du principe aristocratique du point de vue spirituel. Comme Maurras, il voit en lui un élément fondamental de l'organisation rationnelle de la vie sociale; il rappelle que tout ordre vital est hiérarchique et a son aristocratie. «Seul un amas de décombres n'est pas hiérarchisé» et «tant que l'esprit de l'homme est encore vivant et que son image qualitative n'est pas définitivement écrasée par la quantité, l'homme aspirera au règne des meilleurs, à l'aristocratie authentique».
Berdiaev refuse de croire que la démocratie représentative ait, comme elle le prétend, la capacité d'assurer cette sélection des meilleurs et le règne de l'aristocratie véritable. «La démocratie», estime-t-il, «devient facilement un instrument formel pour l'organisation des intérêts. La recherche des meilleurs est remplacée par celle des gens qui correspondent le mieux aux intérêts donnés et qui les servent plus efficacement».
La démocratie, le pouvoir du peuple, ne sont pour Berdiaev qu'un trompe-l'oeil. «Ne vous laissez pas tromper par les apparences, ne cédez pas à des illusions trop indigentes. Depuis la création du monde, c'est toujours la minorité qui a gouverné, qui gouverne et qui gouvernera. Cela est vrai pour toutes les formes et tous les genres de gouvernement, pour la monarchie et pour la démocratie, pour les époques réactionnaires et pour les révolutionnaires». Cette vue de Berdiaev n'est pas sans rappeler Pareto et sa théorie de la circulation des élites. Mais à la question de savoir si c'est la minorité la meilleure ou la pire qui gouverne, berdiaev ne donne pas la même réponse que Pareto (4). Il considère en effet que «les gouvernements révolutionnaires qui se prétendent populaires et démocratiques sont toujours la tyrannie d'une minorité, et bien rares ont été les cas où celle-ci était une sélection des meilleurs. La bureaucratie révolutionnaire est généralement d'une qualité encore plus basse que celle que la révolution a renversée».
Pour Berdiaev, la réalité est qu'«il n'y a que deux types de pouvoir: l'aristocratie et l'ochlocratie, le gouvernement des meilleurs et celui des pires». Vue peut-être un peu trop manichéenne dans la mesure où la médiocratie, ou gouvernement des médiocres, paraît être aujourd'hui la forme de pouvoir la plus répandue, et qu'elle est d'autant plus forte qu'elle se trouve en accord quasi parfait avec l'esprit même du monde moderne.
L'aristocratie est quant à elle en porte-à-faux avec les idées modernes parce qu'elle suppose la sélection et la prise en compte du temps. Pour Berdiaev, l'aristocratie s'inscrit dans l'histoire, elle présuppose une filiation et le lien ancestral. «La formation sélective des traits nobles du caractère s'effectue avec lenteur, elle implique une transmission héréditaire et des coutumes familiales. C'est un processus organique».
Il faut, dit Berdiaev, qu'il y ait dans la société humaine des gens qui n'ont pas besoin de s'élever et que ne chargent pas les traits sans noblesse de l'arrivisme. Les droits de l'aristocratie sont inhérents, non procurés. Il faut qu'il y ait dans le monde des gens aux droits innés, un type psychique qui ne soit pas plongé dans l'atmosphère de la lutte pour l'obtention des droits».
Mais à ce privilège correspondent des devoirs qui ne peuvent précisément être remplis qu'en raison même de ce privilège originel. «L'aristocratie véritable peut servir les autres, l'homme et le monde, car elle ne se préoccupe pas de s'élever elle-même, elle est située suffisamment haut par nature, dès le départ, elle est sacrificielle». Vue extrêmement exigeante pour laquelle «l'aristocratie doit avoir le sentiment que tout ce qui l'élève est reçu de Dieu et tout ce qui l'abaisse est l'effet de sa propre faute», alors que le propre de la psychologie plébéienne est de considérer «tout ce qui élève comme un bien acquis et tout ce qui abaisse comme une insulte et comme la faute d'autrui».
Du fait que «l'aristocrate est celui auquel il est donné davantage» et qu'il peut ainsi «partager son surcroît», il est appelé à jouer un rôle de médiateur entre le peuple et les valeurs supérieures. Berdiaev tient ainsi à rappeler que, dans toute l'histoire, «les masses populaires sortent de l'ombre et qu'elles communient avec la culture par l'intermédiaire de l'aristocratie qui s'en est distinguée et qui remplit sa tâche». C'est la raison pour laquelle les valeurs aristocratiques doivent demeurer prédominantes, car «c'est l'aristocratisation de la société et non pas sa démocratisation qui est spirituellement justifiée». Berdiaev tient d'ailleurs à rappeler que l'attitude méprisante envers le menu peuple n'est pas le fait de l'aristocratie, mais qu'«elle est le propre du goujat et du parvenu».
* * *
Tout en affirmant les principes qui forment la trame des valeurs aristocratiques, Berdiaev n'ignore pas que, «dans l'histoire, l'aristocratie peut déchoir et dégénérer», qu'«elle peut facilement se cristalliser, se scléroser, se clore sur elle-même et se fermer aux mouvements créateurs de la vie». Elle trahit alors sa vocation et, «au lieu de servir, elle exige des privilèges». Pour Berdiaev, les conséquences qu'entraîne cette décadence sont les mêmes que celles qu'envisage Joseph de Maistre. «Lorsque les classes supérieures ont gravement failli à leur vocation et que leurs dégénérescence spirituelle est avancée, la révolution mûrit comme un juste châtiment pour les péchés de l'élite».
Mais quelle que soit la décadence qui peut frapper l'aristocratie, le principe qui est à son origine n'en garde pas moins une valeur éternelle. La noblesse peut mourir en tant que classe, «elle demeure en tant que race, que type psychique, que forme plastique». Ainsi, la chevalerie, dont Berdiaev regrette l'absence dans l'histoire de la Russie, fut plus qu'une catégorie sociale et historique, elle est un principe spirituel, et «la mort définitive de l'esprit chevaleresque entrainerait une dégradation du type de l'homme, dont la dignité supérieure a été modelée par la chevalerie et par la noblesse, d'où elle s'est diffusée dans des cercles plus larges».
Si l'influence de la noblesse fut plus tardive en Russie, il serait injuste, estime Berdiaev, de méconnaître le rôle important qu'elle a joué dans le développement intellectuel de ce pays. «Elle a», dit-il, «été notre couche culturelle la plus avancée. C'est elle qui a créé notre grande littérature. Les gentilhommières ont constitué notre premier milieu culturel... Tout ce qui comptait dans la culture russe venait de l'aristocratie. Non seulement les héros de Léon Tolstoï, mais encore ceux de Dostoïevski, sont inconcevables en dehors de celle-ci... Tous nos grands auteurs ont été nourris par le milieu culturel de la noblesse».
Berdiaev, qui appartient à la noblesse, héréditaire, n'en reconnaît pas moins qu'«il n'y a pas seulement l'aristocratie historique où le niveau moyen se crée grâce à la sélection raciale et à la transmission héréditaire», mais qu'«il y a aussi l'aristocratie spirituelle, principe éternel, indépendant de la succession des groupes sociaux et des époques». Cette aristocratie spirituelle, qui se forme selon l'ordre de la grâce personnelle, n'a pas un rapport nécessaire avec un groupe social donné, elle n'est pas fonction d'une sélection naturelle. «On n'hérite pas plus du génie que de la sainteté». Mais cette «aristocratie spirituelle a la même nature que l'aristocratie sociale, historique; c'est toujours une race privilégiée qui a reçu en don ses avantages».
Opposer la démocratie à l'aristocratie n'est pas concevable pour Berdiaev. «Ce sont là des notions incommensurables, de qualités complètement différentes». Il voit d'ailleurs dans le triomphe de la métaphysique, de la morale et de l'esthétique démocratiques «le plus grave péril pour le progrès humain, pour l'élévation qualitative de la nature humaine». «Vous niez», dit-il, «les fondements biologiques de l'aristocratisme, ses bases raciales, ainsi que celles de la grâce et de l'esprit. Vous condamnez l'homme à une existence grise, sans qualités». Quant à la volonté affirmée de porter une masse énorme de l'humanité à un niveau supérieur, elle résulte, selon Berdiaev, non pas d'un amour de ce haut niveau, mais avant tout d'un désir d'égalitarisme, d'un refus de toute distinction et de toute élévation.
Se plaçant délibérément à contre-courant des idées qui ont cours à son époque et qui ont aujourd'hui acquis une valeur de dogme, Berdiaev s'adresse en ces termes aux grands-prêtres de l'idée démocratique: «Ce qui vous intéresse par-dessus tout, ce n'est pas d'élever, c'est d'abaisser. Le mystère de l'histoire vous est inaccessible, votre conscience y reste à jamais aveugle. Le mystère de l'histoire est un mystère aristocratique. Il s'accomplit par la minorité».
Pierre MAUGUÉ.
(décembre 1993).
Notes:
(1) La philosophie de l'inégalité, écrite en 1918, a été publiée à Berlin en 1923. Sous le titre De l'inégalité, une traduction en français a été éditée en 1976, à Lausanne, par les Editions L'Age d'Homme.
(2) NIcolas Berdiaev est né à Kiev en 1874 et mort à Clamart en 1948. Sa mère était une princesse Koudachev, apparentée à la famille Choiseul. Professeur de philosophie à l'Université de Moscou, Berdiaev, que l'on a parfois qualifié d'existentialiste chrétien, s'oppose à toutes les formes modernes de matérialisme. Expulsé d'Union Soviétique en 1922, il s'établira en France, où il demeurera jusqu'à sa mort.
(3) Cf. Considérations sur la France. Cette œuvre a récemment été rééditée par “Les Editions des Grands Classiques” (ELP) (37, rue d'Amsterdam, F-75.008 Paris).
(4) Cf. Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : révolution conservatrice, russie, spiritualité, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 19 août 2008
V. Eggermont: De Delta Optie
00:30 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, pays-bas, flandre, belgique, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lo politicamente correcto y la metapolitica

Alberto BUELA (*):
Lo políticamente correcto y la metapolítica
En estos días nos ha llegado desde varios lados un reportaje al militar franco-ruso, ahora devenido ensayista, Vladimir Volkoff sobre lo políticamente correcto. Las respuestas que da Volkoff son acertadas pero insuficientes, pues él limita lo políticamente correcto a un problema del decir: “circula a través de nuestro vocabulario. El vocabulario políticamente correcto es el principal vehículo de contagio”.
Es cierto que lo políticamente correcto, en inglés denominado political correctness, tiene que ver con una forma de decir; por ejemplo a un negro llamarlo "hombre de color", hablar de interrupción del embarazo en lugar de aborto, invidente en lugar de ciego. Pero hay que dar un paso más en busca de su fundamento, sino simplemente nos quedamos en la descripción del fenómeno.
Así lo políticamente correcto es todo eso que dice Volkoff: el "todo vale", el cristianismo degradado, el socialismo reinvindicativo, el freudismo antimoral, el economicismo marxista, el igualitarismo como punto de llegada y no de partida, la decadencia del espíritu crítico, lo practican los intelectuales desarraigados, confunde el bien y el mal. Pero todo ello no alcanza para asir su naturaleza, esencia y fundamento. Incluso Volkoff afirma que: es de imposible definición.
Además, está el hecho bruto e incontrovertible de que existen temas y problemas políticos de mucho peso en la historia del mundo que no son tratados por ser políticamente incorrecto hacerlo, por ejemplo: el poder judío en las finanzas internacionales y en los medios masivos de comunicación o el poder de las sectas e iglesias cristianas al servicio del imperialismo. Vemos con estos solos ejemplos como lo políticamente correcto no se limita al decir o al dejar de decir, como sostiene Volkoff.
Además hay temas y muchos, que no son tratados ni mediática ni privadamente por ser políticamente incorrectos: la jerarquía, el disenso, la disciplina, el arraigo, la pertenencia, las virtudes, el deber, el heroísmo, la santidad, la lealtad, la autoridad, etc.
Nosotros sin embargo creemos que lo políticamente correcto se apoya y tiene su fundamento en el denominado pensamiento único. Pensamiento que encuentra su justificación en los poderes que manejan y gobiernan este mundo terrenal y finito que vivimos hoy.
Podemos definir lo políticamente correcto como la forma de hacer y decir la política que se adecua al orden constituido y al statu quo reinante. Es por ello que el simulacro y el disimulo, la amplia calle de la acción y el discurso político contemporáneo, tiene en lo políticamente correcto su mejor instrumento. Hoy la política es entendida y practicada como “un como sí” kantiano. Se piensa y se actúa “como si ” se pensara y se actuara de verdad. Es por ello que los gobiernos no resuelven los conflictos sino que, en el mejor de los casos, los administran. Nos tratan de mantener siempre en una pax apparens como agudamente ve Massimo Cacciari, el filósofo y actual intendente de Venecia.
¿Y por qué hablamos de pensamiento único? Porque hay una convergencia de intereses de los distintos poderes que manejan este mundo que necesita ser justificada y su justificación se halla en el pensamiento único, que está constituido por el pensamiento social, política y académicamente aceptado. Esto prueba como lo han demostrado intelectuales "políticamente incorrectos" como Michel Maffesoli, Massimo Cacciari, Danilo Zolo, Alain de Benoist, Günter Maschke, y tantos otros, que existe una "policía del pensamiento" (los Habermas, Eco, Henry-Levy, Gass, Saramago -en nuestro país los Aguinis, Sebrelli, Verbisky, Feinmann, Grondona, etc.-) que determina en forma "totalitariamente democrática" quienes son los buenos y quienes los malos. A quien se debe promocionar y a quien denostar o silenciar. Es le totalitarisme doux propre des démocraties occidentales del que nos habla Mafffesoli.
Esta policía del pensamiento es una, como es uno el pensamiento único y como lo es también uno el sistema de intereses de los poderes mundiales, más allá de sus aparentes diferencias ideológicas. Perón a esto lo llamaba sinarquía, que el pensamiento políticamente correcto se encargó de negar y burlarse.
No se puede hablar en profundidad de lo political correctness sin estudiar aquello que constituye la pensée unique tan bien descripta por Alain de Benoist, Ignacio Ramonet o Vitorio Messori. Y no se puede hablar del pensamiento único sin hacer referencia a la unitaria madeja de intereses que sostiene el funcionamiento de los poderes indirectos, en muchos casos más poderosos incluso que los mismos Estado-nación. Todo ello a su vez tiene una fuerza coercitiva que es "la policía del pensamiento" que funciona en forma aceitada hasta en el último pueblito de la tierra.
Esta tenaza poderosa de dinero, poder político y prestigio intelectual es la que presiona sobre la vida de los pueblos para el logro de la homogenización del mundo y las culturas en una sola. Esta tenaza es la expresión acabada de un mecanismo perverso de alienación existencial de las naciones que pueblan la tierra. Y es en vista a la denuncia de este mecanismo perverso, donde se juntan lo políticamente correcto, el pensamiento único, los poderes indirectos y la policía del pensamiento, que buscamos hacer una observación crítica a lo sostenido por Volkoff.
La tarea de desmontaje de lo políticamente correcto es una tarea correspondiente stricto sensu a la metapolítica pues esta disciplina con el estudio de las grandes categorías que condicionan la acción política de los gobiernos de turno es la que nos brinda las mejores condiciones epistemológicas para el conocimiento de aquello que nos hace padecer lo políticamente correcto como vocero del pensamiento único impuesto a su vez por la policía del pensamiento. Lo políticamente correcto al transformar sus propuestas y temas en “el lugar común”, puede ser desarmado con el uso de la metapolítica que para Giacomo Marramao “ convierte a la divergencia en un concepto de comprensión política ”.
Con lo cual llegamos finalmente a constatar que para comprender acabadamente la política y lo político estamos obligados a desmantelar el andamiaje de este círculo vicioso conformado por lo políticamente correcto, el pensamiento único, los poderes indirectos y la policía del pensamiento que se retroalimentan entre sí en una totalidad de sentido, que en nuestra opinión produce ese gran sin sentido que caracteriza a la política mundial de nuestro tiempo.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, métapolitique, politically correct, philosophie, argentine, amérique latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les stratégies des belligérants pendant la seconde guerre mondiale

Dr. Heinz MAGENHEIMER:
Les stratégies des belligérants pendant la seconde guerre mondiale
Introduction: Le Dr. Heinz Magenheimer est historien militaire et enseigne à l’Académie de Défense Nationale à Vienne et à l’Université de Salzbourg. L’article qui suit est une présentation de son livre le plus récent, “Kriegsziele und Strategien der grossen Mächte – 1939-1945”, paru à Bonn en 2006 chez l’éditeur Osning (27 euro).
Contrairement aux thèses qu’affirment certains historiens, le but de guerre de l’Allemagne, immédiatement après le 1 septembre 1939, se limitait à soumettre la Pologne et à organiser la défense de l’Ouest du pays (et de la Ligne Siegfried) contre les alliés occidentaux. Il me semble passablement exagéré d’attribuer à Hitler un “plan par étapes” car la stratégie allemande dépendait entièrement des vicissitudes de la situation, que l’on ne pouvait évidemment pas prévoir. La stratégie allemande ressemble bien plutôt à de l’improvisation, car la production de guerre, à l’époque, ne suffisait pas pour faire face à une belligérance de longue durée.
Les puissances occidentales, elles, avaient d’abord développé une stratégie défensive sur le long terme, visant l’isolement et l’exténuation de l’Allemagne. L’exigence des alliés à l’endroit de Berlin, soit la restitution de la souveraineté de la Pologne dans ses frontières, n’avait plus de sens, après l’occupation soviétique de la moitié orientale du pays, à partir du 17 septembre 1939. Les grandes puissances extérieures, soit les Etats-Unis et l’Union Soviétique, attendaient leur heure et espéraient tirer le maximum d’avantages de la guerre en Europe occidentale. Moscou ne pouvait qu’y gagner, si les deux camps s’épuisaient mutuellement. Les Etats-Unis pourraient, eux, satelliser complètement la Grande-Bretagne et la France, si la guerre durait longtemps. Les deux grandes puissances extérieures suivaient une “stratégie de la main libre”.
La victoire rapide de la Wehrmacht en Europe occidentale à partir du 10 mai 1940 a certes renforcé la position du Reich mais n’a pas atteint le but de guerre espéré: forcer une paix de compromis avec l’Angleterre. Une prolongation de la guerre n’allait pas dans le sens de l’Allemagne. Les dirigeants britanniques ont rejeté toutes les propositions allemandes de paix et ont opté pour la lutte à outrance. Churchill suivait en cela une stratégie irrationnelle, car il mettait en jeu l’existence de l’Empire britannique. Son but de guerre était dès lors de briser une fois pour toutes la prépondérance allemande en Europe centrale, en ne craignant aucun sacrifice, ce qui, de manière inattendue, rendit la belligérance encore plus âpre. Le président américain Franklin D. Roosevelt soutenait la Grande-Bretagne, dans la mesure de ses moyens, mais son objectif final était d’absorber la puissance britannique aux profit des Etats-Unis et de la soumettre.
C’est alors que la deuxième grande puissance extérieure, l’URSS, qui n’avait pas escompté une victoire aussi rapide de la Wehrmacht, se mit à préparer la guerre contre l’Allemagne. Dans ce but, elle étendit son glacis dans le Nord-Est et dans le Sud-Est de l’Europe en juin et en juillet 1940. Staline abandonna sa politique de prudence, qu’il avait suivie jusqu’à ce moment-là, se mit à préparer la guerre à grande échelle et donna son aval à un déploiement offensif de l’armée rouge, car une guerre avec l’Allemagne lui semblait inévitable.
Comme la stratégie directe de l’Allemagne contre la Grande-Bretagne avait échoué, à la suite de la bataille aérienne pour la maîtrise du ciel anglais et que la liberté de mouvement dont le Reich bénéficiait sur ses arrières grâce au pacte germano-soviétique semblait de plus en plus menacée, Hitler décida, pendant l’hiver 40/41, de changer de stratégie: il ne fallait plus donner priorité au combat final à l’Ouest mais d’abord abattre l’Union Soviétique. Il y avait certes d’autres options stratégiques possibles mais elles n’auraient pas été moins risquées. C’est ainsi que l’Allemagne se sentit contrainte d’ouvrir une guerre sur deux fronts, pour échapper à un plus grand danger encore, celui d’une attaque directe de l’Armée Rouge à moyen terme. A l’Ouest, les Allemands devaient s’attendre tôt ou tard à l’intervention des Etats-Unis car Roosevelt, malgré le conflit qui l’opposait au Japon, considérait que l’Allemagne était l’ennemi principal.
L’attaque de la Wehrmacht contre l’URSS, le 22 juin 1941, ruinait tous les principes de la stratégie allemande antérieure mais offrait à Churchill une alliance avec Staline. Les dirigeants de l’Allemagne ont sous-estimé leur adversaire, qu’ils voulaient seuls et sans l’aide du Japon abattre en un bref laps de temps. C’était là une faute stratégique des Etats du Pacte Tripartite, que Hitler a fort regretté rétrospectivement car, disait-il, les Etats-Unis ne seraient jamais entrés en guerre si l’URSS s’était effondrée.
Au Japon, on considérait que les Etats-Unis étaient l’ennemi principal. Après que Washington ait décrété l’embargo économique contre le Japon le 1 août 1941, l’Empire du Soleil Levant se retrouvait face à un dilemme: faire la guerre ou accepter le diktat américain. La stratégie japonaise a misé sur la destruction totale de la flotte ennemie et sur la conquête d’une solide base de matières premières dans le Sud-Est asiatique, conditions pour arriver à une paix de compromis avec les Etats-Unis. Le but de guerre de Roosevelt était d’abattre l’Allemagne et d’ôter toute puissance réelle à la Grande-Bretagne. Il prit le risque d’affronter également le Japon pour se retrouver, par une voie indirecte, en état de guerre avec l’Allemagne.
Avec l’enlisement de la Wehrmacht devant Moscou en décembre 1941 et avec l’attaque japonaise contre Pearl Harbour, la guerre prit des dimensions mondiales. La deuxième puissance extérieure était désormais pleinement impliquée dans la guerre mais concentrait, dans cette première phase du conflit, l’essentiel de ses efforts contre le Japon. La déclaration de guerre de l’Allemagne aux Etats-Unis résultait de l’analyse suivante: tôt ou tard le Reich se trouverait tout de même en guerre avec les Américains; pour l’instant toutefois, c’était le Japon qui subissait la pression américaine maximale.
Les Etats du Pacte Tripartite commirent une deuxième erreur stratégique en 1942: ils n’ont pas coordonné leurs efforts, mais ont mené des guerres parallèles, où l’Allemagne passait à l’offensive en Russie et le Japon dans l’espace du Pacifique. Ce que l’on a appelé le “Grand Projet” de guerre maritime en février 1942, de concert avec le Japon, avait pour objectif d’attaquer les positions britanniques en Egypte et au Moyen-Orient. Mais il ne fut pas réalisé car les chefs allemands ont renoncé à déménager vers ces régions le gros de leurs forces massées sur le front principal en Russie.
La Wehrmacht a dû changer d’objectif à l’Est pendant l’été 1942 et passer d’une stratégie d’abattement de l’ennemi à une stratégie d’épuisement de ses forces, tandis que la stratégie japonaise n’avait quasiment plus aucune chance de concrétiser ses buts après sa défaite navale à Midway le 4 juin. Les deux pays, à partir de ce moment-là, n’ont plus fait autre chose que de lutter pour conserver leurs acquis, ce qui est l’indice d’une faiblesse stratégique. Les chefs de guerre allemands n’ont pas voulu reconnaître l’aggravation de leur situation à l’automne 1942, alors que la fortune de la guerre allait manifestement changer de camp à Stalingrad, dans le Caucase et devant El Alamein. Ils ont malgré cela envisagé des objectifs offensifs, alors que le sort leur était devenu défavorable.
Le but de guerre de l’Union Soviétique était simple au départ: la direction soviétique voulait tout simplement assurer la continuité du régime et de l’Etat. Ce n’est qu’après l’échec allemand devant Moscou que leurs buts de guerre se sont lentement modifiés; d’abord, on a voulu à Moscou récupérer les territoires qui avaient été soviétiques avant le 22 juin 1941. Mais on se réservait aussi l’option d’une paix séparée avec l’Allemagne, parce que les dirigeants soviétiques estimaient que leur pays subissait à titre principal tout le poids de la guerre. Mais lorsque la situation a réellement changé au profit des Soviétiques et que les alliés occidentaux tardaient à ouvrir le fameux “second front” en Europe occidentale, Staline a clairement envisagé d’étendre ses objectifs de conquête territoriale aussi loin à l’Ouest que possible, sans tenir compte de l’avis des “nations libérées”.
Au début de l’année 1943, les alliés occidentaux modifient fondamentalement leurs buts de guerre, dans la mesure où ils ne visent plus à simplement affaiblir l’Allemagne et à ramener l’Europe à la situation qui prévalait avant le 1 septembre 1939 mais à soumettre et à détruire leur adversaire allemand, à le punir de manière rigoureuse. Les chefs de guerre anglo-saxons donnèrent alors à la belligérance un caractère nettement moralisant. L’exigence d’une capitulation inconditionnelle et les directives données pour mener une guerre des bombes à outrance excluaient toute possibilité d’une paix négociée. Si les puissances de l’Axe voulaient poursuivre la guerre, elles auraient alors à encaisser de terribles coups. La guerre des bombes connut effectivement une escalade à partir du printemps de l’année 1943 et tourna véritablement, en de nombreux endroits, à une guerre d’extermination contre la population civile. Le haut commandement des forces aériennes britanniques envisageait même d’infliger à l’Allemagne des destructions si terribles que les alliés pourraient gagner la guerre sans même devoir débarquer en France.

Après la victoire des alliés dans l’Atlantique au printemps 1943 et le début de leur offensive contre la “Forteresse Europe”, on s’aperçoit clairement que les puissances de l’Axe ne sont passées que bien trop tard à la défensive. La bataille autour de la ville russe de Koursk en juillet 1943, perdue par les Allemands, ruina définitivement leurs espoirs en une victoire limitée. Malgré quelques succès défensifs, la Wehrmacht, à la suite de cette bataille de Koursk, n’a plus subi que des revers sur le Front de l’Est, si bien que toute idée de “partie nulle” devenait impossible. Les dirigeants allemands n’ont pas exploité la possibilité de conclure une paix séparée avec Staline.
Du côté des alliés occidentaux, on avait, au départ, des points de vue divergents quant à la stratégie à adopter. Les Américains voulaient une attaque directe contre l’Europe occidentale, en organisant un débarquement, tandis que l’état-major général britannique refusait cette option par prudence; les Britanniques plaidaient pour une invasion de l’Italie d’abord, pour un débarquement dans le Sud ensuite. Finalement, on déboucha sur un compromis en postposant le débarquement en France et en le prévoyant pour le début de l’année 1944. Compromis qui rendit plus difficiles les relations avec Staline. Le débarquement de Normandie, en juin 1944, mené avec une écrasante supériorité en forces et en matériels, et les défaites catastrophiques subies par l’armée de terre allemande à l’Est pendant l’été 1944 firent en sorte que la guerre était définitivement perdue pour l’Allemagne. Dans le Pacifique, les Américains l’emportèrent définitivement contre le Japon après la bataille des Philippines au cours de l’automne 1944.
La dernière offensive allemande dans les Ardennes mit une nouvelle fois toutes les cartes dans une seule donne, en négligeant les autres fronts. L’attaque, qui fut un échec, eut pour conséquence que l’offensive générale de l’armée rouge de janvier 1945 se heurta à un front dégarni et affaibli, qui s’effondra très rapidement, ce qui, simultanément, favorisait les plans de guerre de Staline.
En résumé, on peut dire, et c’est frappant, que les buts de guerre des Etats belligérants, à l’exception du Japon, se sont modifiés pour l’essentiel au fil des vicissitudes. L’attitude qui a joué le plus fut incontestablement l’esprit de résistance inconditionnelle, adopté par la Grande-Bretagne à partir de l’été 1940, attitude intransigeante qui a étendu automatiquement le théâtre des opérations. Cette extansion n’allait pas dans le sens des intérêts allemands; pour la puissance extérieure à l’espace européen que sont les Etats-Unis, cette intransigeance britannique constituait une aubaine. Beaucoup d’historiens actuels prêtent aux dirigeants de Berlin de l’époque des prétentions à l’hégémonie mondiale, alors que la stratégie allemande n’envisageait ni la destruction de l’Empire britannique ni une attaque contre les Etats-Unis.
Alors que la stratégie britannique avait pour objectif final de défaire complètement l’Allemagne,la stratégie allemande fit une volte-face et se tourna contre l’Union Soviétique car elle percevait une menace plus grande encore dans son dos. L’Allemagne a cherché ainsi à échapper à une double pression en déclenchant une guerre sur deux fronts, sans créer pour autant les conditions organisationnelles et matérielles nécessaires pour la mener à bien. L’arrêt de l’avancée de la Wehrmacht devant Moscou marque la fin d’une stratégie qui visait l’élimination de l’Union Soviétique. Les Allemands optèrent ensuite pour une stratégie d’épuisement de leur adversaire soviétique en conquérant d’énormes territoires en Ukraine et au-delà, en direction de la Volga et du Caucase. L’Allemagne s’est alors épuisée dans la défense de ces territoires conquis en 1942. De plus, les Allemands se sont payé le luxe de mener une “guerre parallèle” à celle de leurs alliés japonais.

Face à cette situation, les buts de guerre des alliés occidentaux, auxquels se joignait l’URSS avec quelques restrictions, ont subi une modification essentielle: il ne s’agissait plus de forcer les Allemands à rendre les territoires qu’ils occupaient ou à payer des réparations; la guerre, dès le début de 1943, prit toutes les allures d’une croisade dont le but était la soumission totale de l’adversaire. Tous les belligérants ont commis de sérieuses erreurs stratégiques, mais celles des alliés ont été beaucoup moins prépondérantes.
Les Allemands ont réussi, pendant assez longtemps, à compenser leurs désavantages ou leurs revers par leur valeur militaire et par une gestion de la guerre souple au niveau opérationnel dans l’espoir de transformer ces atouts en une victoire stratégique. Mais finalement, les décisions erronées du commandement eurent des conséquences fatidiques et la supériorité en nombre et en matériels des adversaires eut le dessus. Les décisions qui mènent à la victoire ou à la défaite se font d’abord au niveau intellectuel, bien avant qu’elles ne deviennent tangibles sur le théâtre des opérations.
Dr. Heinz MAGENHEIMER.
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°23/2006; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, militaria, défense, stratégie, géopolitique, guerre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Union Soviétique et l'économie allemande dans l'entre-deux-guerres

ORIENTATIONS (Bruxelles) - Juillet 1988
L'Union soviétique et l'économie allemande dans l'entre-deux-guerres
Recension: Rolf-Dieter MÜLLER, Das Tor zur Weltmacht.. Die Bedeutung der Sowjetunion für die deutsche Wirtschafts- und Rüstungspolitik zwischen den Weltkriegen, Harald Boldt Verlag, Boppard am Rhein, 1984, 420 S., DM 54.
L'époque qui s'étend de la révolution russe d'octobre 1917 à la signature du pacte germano-soviétique entre Hitler et Staline est l'une des plus passionnantes et des plus riches de l'histoire contemporaine. Les relations germano-soviétiques tissées pendant ces vingt années ont été le plus souvent étudiées sous l'angle de la diplomatie ou alors les historiens ont cherché à cerner l'importance que revêtait l'accord d'août 1939 dans les stratégies personnelles de Hitler ou de Staline. Ont été dès lors négligés les aspects économiques et la politique d'armement. Le travail de Müller vise à combler cette lacune, en explorant méthodiquement les archives de l'époque et en tentant de cerner les constantes de la politique allemande envers la Russie, constantes où se mêlent étroitement les ambitions impériales et les intérêts économiques. Ces constantes se sont appliquées jusqu'au 22 juin 1941, date à laquelle les armées allemandes entrent en Russie. L'objectif de ce travail d'investigation minutieux, c'est aussi d'éclairer le présent sur les éventualités d'une future politique allemande à l'Est. Müller démontre ainsi que le tandem germano-russe a pris le pas sur les projets pan-européens élaborés à l'Ouest entre 1925 et 1932 et que l'Allemagne a gardé une stricte neutralité dans le conflit anglo-russe de 1927, attitude qui favorisait la Russie. Müller étudie ensuite les variations de la politique russe du régime national-socialiste, d'abord allié à la Pologne de Pilsudski et spéculant sur un démembrement de la Russie avec l'appui de l'Angleterre et du Japon, puis lié économiquement à la Russie, laquelle ne devient plus une zone d'exploitation potentielle mais un espace détenu par un allié tacite où l'on achète des matières premières. En 1941, c'est la première option qui reprend le dessus, mais sans l'alliance anglaise. Une somme capitale pour comprendre les mécanismes d'une politique qui a déterminé l'histoire européenne.(Robert STEUCKERS).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, économie, urss, russie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 août 2008
Hommage à E. Delvo

Hommage à Edgard Delvo pour son 90ième anniversaire
Edgard Delvo: une quête sans repos de la justice sociale
Peter LEMMENS
Dans le paysage intellectuel flamand, on rencontre peu de personnages de ce format, peu de personnalités qui, mues par une pulsion intérieure, partent en quête de la vérité sans jamais plus s'arrêter. Ce sont généralement des personnalités qui se mettent en travers de toutes les valeurs et de toutes les idoles conventionnelles, de tous les systèmes jugés éternels et de tous les concepts abstraits; elles suivent l'ordre de leur conscience en dépit de tout et de tous, elles s'avancent sur leur propre chemin. Au beau milieu d'une réalité qui ne cesse de changer, elles sont souvent obligées de redéterminer leurs positions, avec le risque de ne plus être comprises par leur entourage, doté de capacités intellectuelles moindres.
Parmi ces rares personnalités en Flandre: Edgard Delvo. L'idée directrice, pour laquelle il a voué sa vie entière, est l'idée de justice sociale. A partir de cette idée, Delvo a toujours cherché à donner des fondements idéologiques solides à sa pensée et à son action. Il était essentiel pour lui de faire concorder doctrine et action. Toujours, Delvo est parti du réel, hic et nunc, et su que ce réel formait toujours l'ultime pierre angulaire sur laquelle reposait l'expérience personnelle, aussi riche soit-elle.
Au beau milieu de ce XXième siècle effervescent, cette option pour un réel toujours mouvant l'a contraint à arpenter des chemins très différents les uns des autres et à mener une existence des plus hasardeuses...
Edgard Delvo est né le 20 juin 1905 à Gand dans une famille d'ouvriers pauvres et socialistes. Son milieu familial le prédisposait donc à devenir, très jeune, un ouvrier, comme son père et son grand-père. Mais la nature l'a doté d'une intelligence assez vive. Avec l'aide d'une bourse pour élève doué, il peut aller au-delà de l'école primaire et, comme on le disait à l'époque, «faire ses moyennes». Plongé dès le foyer familial dans une ambiance socialiste, son enthousiasme pour cette idéologie ouvrière fut ravivé par l'homme de poigne, le génie du verbe, du socialisme gantois, Edouard Anseele. Plus tard, Delvo témoignera et dira que c'est surtout les dimensions humaines d'Anseele qui l'ont séduit et attiré. L'étape suivante dans l'évolution du jeune Delvo se déroule rapidement: au départ de ses prédispositions naturelles pour le travail intellectuel, Delvo, à partir de l'âge de 16 ans, approfondit ses connaissances du marxisme et devient un socialiste bien écolé et formé.
Après avoir obtenu son diplôme d'instituteur, il s'en va travailler dans l'“imprimerie populaire” (Volksdrukkerij), une entreprise appartenant au parti socialiste, qui fonctionnait pourtant pratiquement comme une pure entreprise capitaliste. Delvo s'est alors rapidement aperçu que bien que le socialisme se réclame de la doctrine marxiste (détruire le capitalisme par la lutte des classes et libérer le travailleur par le biais de la dictature du prolétariat), le socialisme belge, en pratique, visait la création, par la voie du réformisme, d'un capitalisme ouvrier, où les travailleurs seraient ipso facto transformés en de “petits bourgeois” de seconde zone. Il y avait donc une profonde césure entre la théorie socialiste et la pratique. Delvo en déduit immédiatement que les théories marxistes ne correspondent pas à la réalité sociale, comme il peut s'en apercevoir de visu dans sa propre entreprise socialiste.
Mais il est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions de ce constat. Le jeune homme Delvo doit encore accumuler de l'expérience. Mais la direction de la Volksdrukkerij lui donne rapidement l'occasion d'élargir ses horizons: il reçoit l'autorisation de suivre les cours de l'Université d'Etat de Gand à titre d'étudiant libre. Reconnaissant, Delvo, en autodidacte, acquiert un vaste savoir dans une quantité de sciences sociales et humaines, telles la psychologie, la pédagogie, la sociologie et aussi l'économie.
En même temps, Delvo s'engage à fond dans le mouvement de jeunesse socialiste. En toute connaissance de cause, il n'opte pas pour la Jonge Wacht (la “Jeune Garde”), très inféodée au parti, mais pour la SAJ (Socialistische Arbeidersjeugd; Jeunesse Ouvrière Socialiste), qui s'inspirait davantage des Wandervögel allemands et prônait, dans ses programmes, une sphère indépendante de la jeunesse dans la société, l'épanouissement culturel de ses membres, un vécu communautaire socialiste et une sorte de retour à la nature.
Delvo accumule du savoir à l'Université, son intelligence vive est rapidement remarquée par les dirigeants du parti: dès 1928, il occupe le poste de secrétaire flamand de la Centrale d'Education Ouvrière. C'est la première fois qu'un homme aussi jeune —23 ans— est appelé à diriger l'écolage des cadres socialistes en Flandre. Une tâche dont Delvo s'acquittera parfaitement, au point d'être hissé au poste de Secrétaire général quatre ans plus tard.
Par son expérience quotidienne de la réalité sociale et en approfondissant sans cesse ses idées, Delvo finit par avoir des problèmes de conscience; la doctrine marxiste lui apparaît de moins en moins idoine à servir de fondement idéologique à ses sentiments et ses aspirations socialistes. Heureusement, il trouve un livre qui lui permet de sortir de cette impasse: Psychologie van het socialisme (traduit en français sous le titre d'Au-delà du marxisme), ouvrage publié en 1926 par Henri De Man. Ce livre lui ouvre des perspectives entièrement nouvelles; remotive son engagement socialiste et étaye ses idées.
D'après De Man, le socialisme n'était rien d'autre que l'expression d'une idée éternelle de justice sociale, ancrée en l'homme, qui lui permettait d'agir selon sa propre conscience, en tant qu'être responsable, guidé par la raison, et de rechercher justement cette justice sociale. De cette façon, le socialisme apparaissait comme lié indissolublement à une vision humaniste globale. C'est la raison pour laquelle De Man a saisi la nécessité de dégager le socialisme de la doctrine marxiste et d'opposer au marxisme un socialisme à fondement éthique. Au lieu de considérer la question ouvrière et le socialisme comme des phénomènes déterminés par l'histoire et la matière, De Man et ses adeptes en viennent à la percevoir comme une problématique essentiellement d'ordre psychologique. Il ne s'agissait plus de réaliser l'émancipation ouvrière par le biais de la lutte des classes et de la dictature du prolétariat; ni de reprendre à son compte les valeurs et la culture du monde bourgeois et capitaliste, comme le socialisme politique l'avait fait en pratique. Non: l'émancipation ouvrière devait être réalisée en donnant au travailleur une valeur propre, en créant pour lui un système de valeurs qui lui soit spécifique. Il s'agissait donc de faire advenir un nouveau type humain, qui n'aurait plus rien à voir avec les vertus bourgeoises, mais développerait ses propres valeurs et ses propres normes, une culture nouvelle, comme bases d'une société socialiste. Le socialisme ne visait donc pas la pure et simple matérialité (rôle du “socialisme-beafsteak”), mais se posait essentiellement comme un souci éthique, culturel et spirituel. Il ne s'agissait plus d'acquérir toujours davantage de biens matériels, mais de mettre au centre de l'éthique des travailleurs la joie au travail.
A la suite de leur vision humaniste intégrale et de leur désir de généraliser la justice sociale, leur souci socialiste ne pouvait plus se limiter à une seule classe sociale, mais devait nécessairement s'élargir à toute la réalité ambiante, où vivaient les hommes de chair et de sang: c'est-à-dire embrasser l'ensemble de la “communauté populaire”. Dès qu'ils eurent opéré leur “renversement copernicien”, De Man et Delvo, sur base de leur postulat d'élargissement, commencèrent à s'intéresser au nationalisme. Cela amena De Man à publier en 1931 une brochure, Nationalisme en Socialisme, où il accorde une valeur positive au “nationalisme de libération”, concept que nous considérerions comme synonyme de notre “nationalisme populaire” (volksnationalisme). Mais contrairement à son maître-à-penser, Henri De Man, qui, ultérieurement, s'égarera dans les eaux du “nationalisme d'Etat” (staatsnationalisme), Delvo va approfondir ce concept au cours des années 30, ce qui le conduira à dire que tout sentiment socialiste véritable doit être indissolublement lié à une conscience nationale-populaire (et vice-versa). Sentiment socialiste et conscience nationale convergent tous deux vers un seul et unique but: la construction de la communauté populaire (volksgemeenschap).
Delvo est également devenu un protagoniste enthousiaste et convaincu du planisme de De Man. La vision planiste impliquait que toute la vie économique devait contribuer à un équilibre entre les besoins de la consommation et les capacités de production, où il fallait tabler et utiliser toute la créativité qui résidait en l'homme. Pour les planistes, cet équilibre et ce pari pour la créativité humaine n'étaient possibles que si l'on avançait une vision beaucoup plus nuancée de la propriété que les marxistes. Au lieu de nationaliser purement et simplement les moyens de production et la propriété, il fallait, disaient-ils, partir des diverses formes de propriété et voir si elles apportaient des avantages ou des inconvénients au peuple en tant que communauté. Sur base de ce tri, les planistes finirent par juger que les monopoles et les puissances d'argent devaient être freinées dans leurs initiatives et leur expansion, tandis que les initiatives privées qui donnaient des avantages au peuple devaient être stimulées. L'idéal consistait donc à construire une économie mixte avec secteurs nationalisé et privé. Mais il était essentiel, dans la vision planiste, que l'autorité et non la propriété soit transférée à l'Etat. Le contrôle de la gestion de la propriété a donc été considéré comme prioritaire par rapport à la possession de l'entreprise.
Pour réaliser un tel “Plan”, il fallait, pensaient les planistes, réformer de fond en comble la démocratie, afin de dégager l'Etat de l'emprise des puissances d'argent et des groupes de pression. Pour accéder au stade de cette planification rationnelle, le système démocratique manquait d'une réelle direction, d'auto-discipline et surtout de responsabilité personnelle. Les planistes formulent une série de propositions, afin d'incorporer ces “vertus” dans le système démocratique et de rendre ainsi la démocratie plus forte. Le résultat aurait du être, pour De Man, Delvo et les planistes belges, le “socialisme démocratique”. Bien entendu, les adversaires de ce planisme socialiste et démocratique n'ont pas hésité à accuser De Man et Delvo de plaider pour une “démocratie autoritaire”. Ce reproche était injuste: les deux hommes sont restés des démocrates convaincus; ils se reconnaissaient pleinement dans le principe des élections libres et du contrôle parlementaire, mais ils voulaient biffer les dysfonctionnement et les débordements du système, afin de le sauver et non pas de le torpiller définitivement.
En 1934, De Man et ses collaborateurs réussissent à mettre le parti socialiste officiellement sur la ligne du planisme et du “socialisme démocratique”. Cela ne signifie pas, évidemment, que les instances du parti ont été convaincues de la justesse des thèses planistes au point de s'y convertir; plus exactement, elles ont dû avouer leurs impuissance à résoudre la crises économiques des années 30 à l'aide des recettes marxistes, devenues au fil du temps, étrangères au monde et inefficaces. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti, l'opposition au projet planiste s'est rapidement organisée pour barrer la route à toute amorce de réalisation des idées de De Man et de Delvo. Les adversaires du planisme ont, en fin de compte, réussi à empêcher toute réforme graduelle et rationnelle de la démocratie belge.
Vers la fin des années 30, certains nationalistes flamands commencent à manifester un vif intérêt pour les aspirations socialistes de De Man et de Delvo. Et ceux-ci commencent, pour leur part, à s'intéresser de plus près au nationalisme flamand. Une fraction des intellectuels nationalistes et une fraction des intellectuels socialistes se rapprochaient. A la tête des socialistes rénovateurs et d'esprit ouvert, Edgard Delvo. En 1939, il entre en contact avec le nationaliste flamand Viktor Leemans et avec le “national-solidariste” Joris Van Severen. Ces rencontres permettent à ces hommes venus d'horizons fort différents de constater qu'au fond ils sont très proches les uns des autres. Ils envisagent de fonder une revue, à laquelle ils collaboreraient tous et où ils confronteraient leurs points de vue dans un but constructif, mais la guerre éclate et ce projet ne peut pas se concrétiser.
Quand les Allemands entrent en Belgique le 10 mai 1940, le régime démocratique et la machine de propagande française suscite au sein de la population belge une psychose de terreur, en décrivant l'armée allemande comme une horde de barbares massacrant tout sur son passage, poussant des centaines de milliers de réfugiés sur les routes et les exposant aux risques de la guerre. Delvo prend cette propagande au mot et décide de combattre l'Allemagne et se présente comme volontaire, d'abord dans un bureau de recrutement de l'armée belge, puis de l'armée française. Mais Delvo ne rencontre que le chaos. Après l'effondrement des armées alliées, il s'aperçoit de la fausseté des propagandes belge et française, constate que les atrocités radiodiffusées ont été inventées de toutes pièces. Cette révélation le dégoûte des régimes démocratiques et il perd toute foi en eux.
Delvo décide de réaliser ses aspirations socialistes-démocratiques dans le cadre de l'“Ordre Nouveau”, plus précisément dans le giron du parti nationaliste flamand, le VNV. Deux éléments l'ont pousser à cette option. D'abord, ce fut Viktor Leemans qui le contacta en premier lieu à son retour de France. Plus fondamentalement, c'est un projet du VNV qui le séduit: celui de se transformer en un vaste mouvement d'unité flamande. Cette tentative de dépassement des étroits contingentements politiques de l'avant-guerre et de construction d'un vaste mouvement populaire surplombant les clivages politiciens en Flandre était, pour Delvo, l'occasion rêvée de concrétiser ses visions socialistes et nationales-populaires. Delvo est immédiatement introduit dans le “Conseil de Direction” du VNV, où il devient responsable de la formation des militants et membres, de l'école des cadres et de la propagande. Le fait que de telles responsabilités aient été déléguées à un dirigeant important du parti socialiste d'avant-guerre prouve que le VNV prenait effectivement cette opération au sérieux. Mais le projet de mouvement unitaire ne débouche pas sur les résultats escomptés. D'abord, la base, contrairement à la direction, ne souhaite pas dépasser aussi rapidement les clivages idéologiques d'avant-guerre et ne propose pas de nouvelle synthèse. Ensuite, les circonstances de la guerre n'autorisaient pas la réalisation d'un tel projet; les Allemands accordaient la priorité aux opérations de guerre, avant toutes autres considérations. En cas de nécessité, ils sacrifiaient d'abord les objectifs de nature idéologique.
Cette réticence allemande a conduit Delvo à plaider en faveur d'une collaboration inconditionnelle avec l'Allemagne. Car, à ses yeux, à ce moment-là de la guerre, seule une victoire définitive du Reich national-socialiste permettrait aux Flamands de réaliser chez eux les aspirations socialistes et nationales-populaires, théorisées par Delvo. C'est en voulant joindre les actes à la parole que Delvo s'est présenté un jour comme volontaire pour combattre sur le Front russe, après l'entrée des troupes de Hitler en URSS. Mais Staf De Clercq, chef du VNV, a estimé que la présence de Delvo était plus utile en Flandre que dans les plaines de Russie; il a donc refusé l'engagement de Delvo et l'a obligé à rester au pays.
En avril 1942, Delvo devient le chef de l'UTMI/UHGA (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), une organisation syndicale calquée sur le modèle du “Front du Travail” allemand et destinée à devenir un mouvement syndical unitaire en Belgique selon les modèles préconisés par l'“Ordre Nouveau”. Delvo reçoit donc entre les mains un instrument potentiellement puissant, lui permettant de réaliser à terme ses objectifs socialistes et nationaux-populaires. La guerre l'oblige à se limiter et à n'ébaucher qu'idéellement la société qu'il appelait de ses vœux.
Quand les dernières troupes allemandes évacuent la Belgique, Delvo se replie en Allemagne, bien décidé à s'engager jusqu'au bout pour ses idéaux. Il trouve tout de suite une place dans le gouvernement flamand en exil, le Vlaamse Landsleiding, où l'on tente, selon Delvo, de faire l'unité de toutes les tendances de la collaboration flamande encore prêtes à combattre aux côtés de l'Allemagne, dans l'espoir de réaliser leurs idées nationalistes, nationales-socialistes ou autres. Delvo devient le “plénipotentiaire” des Affaires Sociales et élabore un programme social, bien dans la ligne de ce qu'il avait suggéré dès le départ au VNV.
Après l'effondrement définitif du IIIième Reich, Delvo connaîtra des années fort sombres. En 1945, un tribunal militaire belge le condamne à mort par contumace. Sans cesse repéré et poursuivi, il n'avait plus qu'une solution: errer à travers l'Allemagne sous plusieurs fausses identités, séparé de sa femme et de ses enfants. Il exerça toutes sortes de petits boulots pour gagner maigrement sa vie. En 1965, il est frappé d'un infarctus, est dans l'incapacité de travailler et obligé de se livrer aux autorités allemandes. Mais comme il est persécuté pour des raisons politiques, les autorités allemandes le relâchent immédiatement et refusent de le livrer à la Belgique. En 1972, sa condamnation est ramenée à 20 ans de prison, si bien qu'il pourra rentrer au pays après 30 ans d'exil. En 1974, il est de retour en Flandre, mais sous le statut d'apatride.
Delvo a survécu à toutes ses années de misère, de difficultés matérielles, physiques et émotionnelles, parce qu'il a approfondi ses idées et ses réflexions, a lu, a continué à se former politiquement et philosophiquement. Le feu sacré qui brûlait dans le cœur du jeune militant socialiste de 1920 ne s'est finalement jamais éteint. Dès son retour, avec l'appui de la grande presse flamande (notamment le quotidien De Standaard), de la très sérieuse maison d'édition De Nederlandse Boekhandel, des milieux nationalistes de droite et de gauche (Voorpost, VUJO, etc.) et de l'hebdomadaire anversois 't Pallieterke, il tente une dernière fois d'éveiller l'intérêt des intellectuels flamands pour son socialisme populaire et national. Il publie coup sur coup trois ouvrages théoriques et autobiographiques. Delvo était convaincu, à son retour d'exil, que ses conceptions avaient gardé un certain degré d'actualité, tout en comprenant parfaitement que les circonstances avaient changé de fond en comble. Il est dès lors curieux de constater qu'un homme comme Delvo, qui a toujours mis l'accent sur la nécessité de bien coupler pensée et action et de se référer à la réalité actuelle, a limité ses ouvrages d'après-guerre à un regard rétrospectif sur l'histoire et ne nous a pas livré une analyse de la réalité nouvelle.
Mais Delvo, dans la seconde moitié des années 70 a été un conférencier fort demandé, surtout dans les milieux nationalistes flamands. Mais lorsque l'on relit aujourd'hui les textes de ces interviews et de ces conférences, on a le sentiment, un peu amer, que ce retour de Delvo dans le milieu nationaliste ou, du moins, chez les nationalistes qui avaient la volonté de suggérer un projet de société nouvelle, a finalement été peu fécond et que les formations nationalistes flamandes qui l'ont invité et écouté, n'ont pas mis à profit ses enseignements.
Cette année, Edgard Delvo a fêté son 90ième anniversaire. Il est devenu aveugle, mais son esprit est resté intact, toujours animé par ce formidable feu sacré. Il reste à l'écoute des grands débats par la radio, la télévision, des cassettes audio, des conversations, mais sa cécité l'empêche quand même de juger notre réalité trop changeante, trop effervescente, dans toutes ses nuances. La troisième révolution industrielle a modifié en profondeur la société dans laquelle nous vivons. Par la diminution du temps de travail, par l'attention croissante que portent nos contemporains à leurs loisirs, par le changement des mentalités, le concept de “travail” a perdu bon nombre de ses significations d'antan. La mécanisation et la robotisation croissantes ont produit une nouvelle armée de chômeurs et une nouvelle société duale. Tout cela, et beaucoup d'autres choses encore, font que toute la problématique sociale doit être totalement repensée. Indubitablement, bon nombre d'idées, de méthodes et de structures que Delvo a analysées ont succombé aujourd'hui. Mais l'essentiel de la pensée de Delvo, c'est-à-dire sa volonté de lutter pour une véritable justice sociale et pour un ancrage du sentiment socialiste dans l'humus national, doit demeurer pour nous un leitmotiv. Dans notre travail de re-penser la société, la question sociale et le statut de l'ouvrier, ce fil conducteur est indispensable pour aboutir à une NOUVELLE SYNTHESE.
Peter LEMMENS.
(adaptation française: Robert Steuckers)
Bibliographie:
- Edgard DELVO, In dienst der arbeidersopvoeding. Handboek voor medewerkers van de Opvoedingscentrale, Deurne, 1937, 244 p.
- E.D., De Belgische arbeidersbeweging. Geschiedkundige studie, Deurne, 1938, 47 p.
- E.D., Hedendaagsch humanistisch streven: democratisch socialisme en zijn beteekenis voor de BWP, Antwerpen, 1939, X-91 p.
- E.D., Arbeiders, mijn Kameraden! Ons geleidt de nieuwe tijd, Brussel, [1940], 31 p.
- E.D., Arbeid en arbeider in de volksche orde, Brugge, 1941, 42 p.
- E.D., Sociale collaboratie. Pleidooi voor een volksnationale sociale politiek, Antwerpen, 1975, 266 p.
- E.D., De mens wikt. Terugblik op een wisselvallig leven, Antwerpen, 1978, 189 p.
- E.D., Democratie in stormtij. Democratisch socialisme in de crisisjaren dertig, Antwerpen, 1983, 205 p.
00:07 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, socialisme, flandre, belgique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une histoire des Juifs de Pologne

Entre étoile de David et drapeau rouge : une histoire des Juifs de Pologne
Par Johannes BIEBERSTEIN
Le livre de Holger Michael, intitulé « Zwischen Davidstern und Roter Fahne » (Entre étoile de David et Drapeau rouge), décrit l’histoire des Juifs de Pologne au cours du vingtième siècle. Avant 1939, la minorité juive de Pologne, avec ses trois millions de ressortissants, constituait environ 10% de la population totale du pays et parlait pour l’essentiel le Yiddish. Elle s’organisait comme une vaste association religieuse, disposant de « droits dits corporatifs », permettant notamment de lever une sorte d’impôt pour le culte. A cette vaste communauté organisée appartenaient aussi les « membres non croyants de la nation juive ».
L’auteur du livre est un slaviste dûment diplômé de l’Université de Leipzig, ancien collaborateur de l’Académie de Berlin-Est, qui, depuis la chute du régime SED communiste, vit au Kazakhstan, où il enseigne l’allemand. Pour lui, sur le plan politique, la « force populaire », la « Volksmacht », constitue le seul ordre politique légitime, qui a été renversé par la « restauration bourgeoise », autrement dit par les « droites » en 1989/1990. Mais bien que Holger Michael s’aligne sur une position marxiste « orthodoxe », selon laquelle le nationalisme constitue les prémisses de l’antisémitisme et donc est derechef le mal principal de tout ce qui arrive, nous lirons son ouvrage avec grand profit.
On peut dire, en effet, qu’il aborde un sujet brûlant et important, parce que sous la dictature rouge, ni la haine à l’encontre des Juifs ni la critique légitime que l’on pourrait adresser aux Juifs communistes (ni bien d’autres critiques) ne pouvaient être articulées. Cette minorité juive, numériquement faible mais capable de marquer l’histoire, a joué un rôle spectaculaire tant en 1920 dans le cadre du « Comité révolutionnaire polonais » de Bialystok, installé par les Soviétiques, que dans le gouvernement en exil de la « Fédération des Patriotes Polonais » (le ZPP), créé en 1943, également sous le patronage des Soviétiques. Dans l’appareil stalinien polonais, dans les départements de la sécurité et dans les bureaux qui déterminaient l’idéologie à suivre, les communistes juifs étaient souvent représentés de manière disproportionnée. Holger Michael estime, pour sa part, que cette disproportion est acceptable, vu les souffrances indicibles subies par le peuple juif, mais, en l’acceptant, il en minimise les effets tragiques pour les autres et ignore les persécutions perpétrées par ce qu’il appelle la « Volksmacht ». Mais en opérant ce tour de passe-passe, Holger Michael omet de reconnaître clairement la dynamique de l’antisémitisme polonais, qu’il combat par ailleurs. Antisémitisme qui ne fit que se renforcer, même après 1945, parce que les Juifs communistes étaient perçus, en Pologne, comme les valets de l’occupant russe-soviétique cordialement détesté.
La valeur de ce livre réside dans la présentation objective et claire de l’histoire sociale des Juifs en Pologne, surtout pendant l’entre-deux-guerres. En s’appuyant sur des données statistiques, l’auteur explique que les 10% de la population totale, que constituait la minorité juive en Pologne, représentait également 50% de la grande bourgeoisie du pays. Les Juifs polonais étaient également surreprésentés dans les professions libérales, comme celles d’avocat ou de médecin. Dans l’armée, on trouvait aussi des rabbins militaires.
Le livre nous apporte également beaucoup d’informations intéressantes sur les organisations juives et non juives. Parmi les organisations juives, la plus importante était le parti « Agudat » des juifs orthodoxes. Il avait mis sur pied des écoles juives et des séminaires pour former des rabbins et parvenait à glaner jusqu’à 40% des voix lors d’élections municipales. Le « Parti Populaire Juif », plus petit, s’affirmait en revanche comme anti-clérical et représentait la bourgeoisie juive assimilée. A côté de ces deux principales formations politiques, on trouvait aussi en Pologne une pléthore de petits partis juifs socialistes, qui couvraient tout l’éventail des tendances possibles et imaginables, tout en se partageant en deux camps discernables : celui de ceux qui étaient sionistes et celui de ceux qui ne l’étaient pas.
Au Comité central du parti communiste polonais athée, on trouvait également un « Bureau Juif Central ». Ce parti communiste, section du Komintern, essuyait souvent les insultes des autres communistes, notamment lorsqu’on l’appelait « Judokommune », « judéo-communiste », un terme chargé de haine, équivalent à l’allemand « jüdischer Bolschewismus » (« bolchevisme juif »). Les chapitres que consacre Holger Michael aux rapports entre la société et les partis polonais, d’une part, et les Juifs, d’autre part, sont des plus intéressants, même s’ils contiennent parfois des critiques très dures à l’encontre des catholiques et des nationalistes polonais, qui, eux aussi, dans leurs cénacles les plus extrémistes, avaient réclamé l’instauration de « Lois de Nuremberg ». En revanche, Holger Michael se montre très positif à l’égard du Maréchal Jozef Pilsudski, pourtant partisan d’un gouvernement autoritaire. Pilsudski, à ses yeux, étaient un ancien social-démocrate proscrit ; il n’avait aucun profil religieux distinct, ne se souciait guère des différences entre confessions, et n’a jamais manifesté ouvertement des tendances antisémites.
Dans le chapitre qu’il consacre à la catastrophe d’entre 1939 et 1945, Holger Michael revient sur l’attitude controversée des Polonais à l’endroit des Juifs poursuivis et traqués par les nationaux-socialistes et glorifie la résistance juive. Les chapitres consacrés aux survivants et à ceux qui entamèrent l’épopée de l’Exodus, apportent des informations nouvelles et intéressantes. En Pologne, quelque 100.000 juifs ont survécu, auxquels il faut ajouter 200.000 personnes qui avaient pu se sauver en se réfugiant en Union Soviétique. Après l’expulsion des Allemands de Silésie, de Poméranie et de Posnanie, ces survivants se sont principalement installés en Silésie.
Pendant la guerre, en Union Soviétique, s’était constitué un « Comité de Libération National Polonais » (PKWN) qui fit que, pour la première fois dans l’histoire, un gouvernement polonais fut constitué, comptant en son sein des citoyens de confession israélite. Or, en dépit de cette innovation, l’époque dite stalinienne fut marquée par une importante vague d’émigration juive. La dictature communiste apparaissait aux Polonais comme la dictature d’une minorité et les partisans non communistes, toujours armés, provoquèrent une guerre civile en Pologne, qui fit rage pendant quelques années, et connut ses excès antisémites. On se souvient surtout du pogrom de 1947 à Kielce, qui fait l’objet d’âpres controverses aujourd’hui en Pologne.
Alors que, dès 1945, la vie culturelle et associative juive pouvait se redéployer sans frein, l’exode massif fit qu’en 1950 déjà les deux tiers des Juifs de Pologne avaient émigré en Palestine ou en Occident, ce qui eut pour effet d’éteindre complètement la vie culturelle juive.
Les autorités communistes ont accepté la situation et l’ont même promue, parce qu’elles ne s’intéressaient en fait qu’aux seuls communistes. On ne se souvient guère d’une évidence politique pourtant patente : Staline a soutenu au départ la création de l’Etat d’Israël contre les Britanniques impérialistes et contre les Arabes « réactionnaires ». En Silésie, les autorités communistes avaient toléré l’installation d’un camp d’entraînement de la Haganah en 1947/48, où 2500 juifs polonais subissaient une formation militaire avant de s’engager dans la lutte en Palestine. On se rappellera aussi qu’un pont aérien amenait sans cesse des armes de Prague à Tel Aviv.
Ce qui fut tragique et malsain dans la vie politique polonaise, c’est que tant le mouvement indépendantiste polonais que les nationaux-communistes polonais étaient animés de nettes tendances antisémites. Ce qui eut pour effet d’amener de très nombreux juifs de Pologne à émigrer, décimant du même coup les communautés des survivants d’après 1945. Ensuite, beaucoup de juifs communistes, qui avaient cru que le socialisme allait avoir la fonction d’un « médecin » qui guérirait les Polonais de leur antisémitisme, ont basculé dans le camp de la dissidence anti-soviétique. Quelques-uns d’entre eux ont contribué à la chute de la dictature marxiste en s’engageant dans les rangs de Solidarnosc.
Johannes BIEBERSTEIN.
(article tiré de « Zur Zeit », Vienne, n°12/2007; trad. franç.: Dimitri Severens)
Références : Holger MICHAEL, Zwischen Davidstern und Roter Fahne, Kai Homilius Verlag, Berlin, 2007.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : judaica, antisémitisme, sémitisme, judaïsme, sionisme, hébreux, hébraïsme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 août 2008
Poetin wil rol in Cuba terug
Poetin wil rol in Cuba terug
MOSKOU - De Russische premier Vladimir Poetin wil dat zijn land zijn invloedrijke rol in de voormalige communistische bondgenoot Cuba weer oppakt. Dat hebben Russische media gisteren gemeld.
Er wordt druk gespeculeerd of er sprake is van een tactiek van Rusland om ook militaire aanwezigheid te krijgen op het eiland, op slechts 150 kilometer van de Verenigde Staten.
Rusland zou daarmee reageren op Amerikaanse inspanningen om een raketschild te installeren in Oost-Europa, dat volgens de officiële berichtgeving bedoeld is om aanvallen uit Iran af te weren.
'Het is geen geheim dat het Westen een bufferzone om Rusland heen creëert', zei Leonid Ivasjov, hoofd van de Russische Academie voor Geopolitieke Problemen. 'In reactie daarop breiden we onze militaire activiteiten in het buitenland mogelijk ook uit, waaronder in Cuba.'
Poetin maakte de opmerking na op de hoogte te zijn gebracht van de uitkomst van een bezoek van een Russische delegatie aan Cuba. Vicepremier Igor Sechin sprak in Cuba over samenwerking op het gebied van energie, mijnbouw, landbouw, gezondheidszorg en communicatie, meldde persbureau RIA-Novosti. Het is niet bekend of er ook over militaire samenwerking gesproken is.
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF05082008_011&ref=nieuwsoverzicht
17:45 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, poutine, cuba, politique, stratégie, amérique, caraïbes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
I Giovani ed il consumismo
I Giovani ed il Consumismo
di Claudio Risé
Questa lettera con relativa risposta del Prof.Claudio Risè, è apparsa sabato 30 novembre 2002 su "IoDonna" inserto settimanale del Corriere della Sera.Troverete altre risposte di Claudio RIsé al sito www.claudio-rise.it
"Ho 27 anni. Tre rapporti importanti negli ultimi anni, in cui funzionava tutto piuttosto bene, ma lei non riusciva ad accettare la mia indifferenza nei confronti del denaro, delle convenzioni sociali. Non sono un fannullone, o un maleducato, ma penso che il valore sacrale del denaro e dei riti di consumo produca sofferenza in uomini e donne.
Dovremmo distanziarcene e vivere, invece, in modo più fisico: stare di più nella natura, in modo molto semplice. Meno cinema e sushi, e più boschi e minestroni in baita. Vivendo in modo più autentico é anche più facile avere delle vere esperienze spirituali (non necessariamente religiose), impossibili se sei catturato dai consumi. Anche i miei amici più vicini fanno fatica a trovare delle compagne che li seguano su questa strada.
Magari protestano contro le "cose", o il materialismo, non mangiando, e svalutando il cibo, ma in questo modo si (e ci) fanno solo del male. Come avere una vita più semplice e istintiva, senza rinunciare a una vita sentimentale?"
lettera firmata
Caro amico,
io, però, ricevo molte lettere come la sua, oltre che da ragazzi, anche da ragazze. Lamentano la superficialità dei ragazzi, incapaci di accettare la loro avversione per il consumo coatto. Chiedono affetti che condividano con loro questo "stile autentico" che sta crescendo in modo sempre più evidente, sotto la vernice modaiola e "di immagine" che i media cercano di stendere su tutto.
Dunque: come mai non vi incontrate? Come mai loro trovano solo i tipi da discoteca, e voi pure?
La prima risposta, abbastanza ovvia, é che probabilmente continuate a cercarvi nei vecchi templi del consumismo di ieri: le discoteche, le happy hours. Rappresentate un nuovo stile giovanile, ma non avete ancora creato i vostri luoghi di aggregazione. Che rimangono divisi tra quelli classici del consumismo più sdato, e quelli (anche loro lì da circa trent'anni) di un anticonsumismo molto ideologico, non molto fisico, e poco naturale. E qui siamo al punto più specifico della sua lettera. Nella galassia dell'anticonsumismo giovanile, infatti, si é sviluppata negli ultimi anni una "via" al "dopo società dei consumi", praticata da individui e piccoli gruppi ( a cui lei accenna nelle altre parti della sua lettera), che sembra più specificatamente maschile, e forse difficile per molte ragazze.
Si tratta di quel "passaggio al bosco", inteso in senso fisico e simbolico, assai più radicale dell'anticonsumismo vissuto da un'ottica ancora metropolitana. Il giovane maschio che vive profondamente quest'esperienza infatti, anno dopo anno, dando sempre più spazio e importanza al suo stare nella natura, ascoltandola, dopo un po' vive come consumo e costrizione anche il cinema o l'"evento" culturale, magari di denuncia del consumismo. Quando si fa una vera esperienza di vita naturale e autentica, insomma, l'uomo sente anche il discuterne come qualcosa che le toglie energia.
Si riaffaccia qui quel modo di essere "poco verbale" del maschio, che crea non poche difficoltà alla comunicazione tra uomo e donna nella vita sentimentale. L'uomo dimostra ciò che prova facendolo, ma la donna vuole anche parole che lo dichiarino. Nello sviluppo dello stile di vita post consumista dovrete dunque tenerne conto, cari amici amanti dei boschi e dei silenzi attorno al fuoco. Naturalmente ci sono, anche, delle vere donne selvatiche, che sono esattamente come voi.
Ma quelle , per trovarle, dovete fare come il contadino delle leggende: andare in quello spazio magico tra il bosco e le malghe alte, e aspettare di incontrarle. L'altra, la selvatica che magari lavora tre scrivanie più in là della vostra, per aprirsi, e lasciarsi portare a casa, vi chiederà qualche parola, e qualche rito di condivisione culturale. Che magari ha il suo lato consumista e modaiolo, e soprattutto ideologico. Ma, se volete una vita sentimentale più ricca, probabilmente é uno scotto che potrete pagare senza timore. Tanto, poi, il bosco vince.
Claudio Risé
00:10 Publié dans Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : consumérisme, sociologie, psychologie, modernité, temps modernes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Etranges conservatismes américains

Etranges conservatismes américains
Par Herbert AMMON
En dépit des impulsions culturelles venues des Etats-Unis via Hollywood et la Pop culture, le paysage idéologique et politique de la seule puissance globale (dixit Zbigniew Brzezinski) demeure « terra incognita » pour la plupart des Européens. Les césures spécifiquement américaines, qui séparent les « liberals » des « conservatives » ne se perçoivent jamais clairement, tant et si bien qu’on les classe en Europe de manière binaire : entre une gauche et une droite. Les problèmes s’accumulent lorsque l’on cherche à établir une bonne taxinomie des écoles politiques et idéologiques américaines : les slogans et mots d’ordre sont si nombreux, reçoivent tant de définitions particulières qu’on ne s’y retrouve plus, surtout si l’on évoque une ancienne droite et une nouvelle droite, soit des paléo-conservateurs et des néo-conservateurs.
Pour définir les camps politico-idéologiques américains, les définitions habituelles ne sont guère de mise (sauf quand il s’agit, par exemple, du conservatisme tel que l’a défini jadis un Russell Kirk). Européens et Américains ont une expérience différente de l’histoire, nomment donc les choses politiques différemment, ce qui conduit aux confusions et quiproquos actuels. « Cum grano salis », on peut distinguer quelques différences majeures entre conservatismes européens et américains : d’abord, les conservatismes européens sont devenus sceptiques quant à l’histoire à venir ; les conservatismes américains sont nettement orientés vers le futur, sont, dans le fond, anti-historiques, dans la mesure où ils entendent maintenir l’idée fondamentalement américaine d’une société contractuelle (ils n’envisagent pas d’autres modèles). Ensuite, les conservatismes américains sont fiers de leur tradition historique continue, non brisée, que les Européens jugent « courte » ; les conservatismes européens, eux, sont contraints de tenir compte d’une longue histoire, marquée par des ruptures successives. Enfin, les conservateurs américains perçoivent de façon positive le rôle de puissance mondiale que joue leur pays, alors que les Européens se souviennent constamment du « suicide de l’Europe » (dixit Paul Ricoeur) en 1914. Et, last but not least, les conservateurs américains acceptent sans hésitation l’idée libérale d’un libre marché sans entraves, alors que les conservatismes européens critiquent tous le libéralisme.
Adhésion sans entraves au libre marché
La genèse des notions de « liberal » et de « conservative » nous ramène à l’ère Roosevelt (1933-1945). Les partisans de la politique social-réformiste et interventionniste / étatique du New Deal rooseveltien se dénommaient « liberals ». Les adversaires de Franklin D. Roosevelt venaient d’horizons divers : parmi eux, on trouvait des libéraux au sens économique le plus strict, qui se posaient comme les seuls véritables libéraux ; il y avait ensuite des critiques de la bureaucratie (du « big government »), en train de devenir pléthorique à leurs yeux. Enfin, du moins jusqu’à l’attaque japonaise contre Pearl Harbor, il y avait les défenseurs de l’isolationnisme. Murray Rothbard, un « libertarien », soit un extrémiste du marché, désigne cette coalition hostile à Roosevelt sous le nom de « Vieille Droite » (« Old Right »). D’après Rothbard, le terme « conservateur » n’était guère usité aux Etats-Unis avant la parution en 1953 de « Conservative Mind », le grand livre de Russell Kirk.
Les « conservateurs », qui suivaient la forte personnalité de Robert A. Taft, sénateur de l’Ohio (de 1939 à 1953) et rival républicain de Dwight D. Eisenhower en 1952, renonçaient à toute élévation du débat intellectuel en politique. Attitude qui n’a guère changé en dépit de l’émergence de courants de pensée conservateurs mieux profilés. Libéral et théoricien peu original, Peter Viereck, dans « Conservatism Revisited » (1949) s’est posé comme critique des idéologies totalitaires, le « communazisme ». Russell Kirk (1918-1994) fut donc le premier à se positionner comme explicitement conservateur et à être reconnu comme tel par l’établissement « libéral ». En se référant à Edmund Burke, le critique de la révolution française de 1789, perçue comme rupture de la Tradition, Kirk mettait l’accent sur l’origine « conservatrice » de la révolution américaine. Dans ses écrits, Kirk citait, en les comparant à Thomas Jefferson, les pères fondateurs « conservateurs », tels John Adams et les auteurs des « Federalist Papers », se référait également aux critiques européens de la révolution comme Burke ou Tocqueville. Kirk se posait également comme un conservateur écologiste, pratiquant la critique de la culture dominante, ce qui fit de lui une exception parmi les conservateurs américains, optimistes et orientés vers le futur.
« On pourrait, pour simplifier, résumer comme suit l’histoire du conservatisme américain : Russell Kirk l’a rendu respectable ; William Buckley l’a rendu populaire et Ronald Reagan l’a rendu éligible » (citation de J. v. Houten). En effet, les conservateurs doivent à William F. Buckley, né en 1925, d’avoir pu accroître leurs influences au sein du parti républicain et d’avoir percé pendant l’ère Reagan. Ils doivent ces succès au réseau de revues et de « think tanks » que Buckley a tissé dès les années cinquante, dont l’ « American Heritage Foundation », créé en 1973.
Buckley, comme le rappelle son livre « God and Man at Yale » (1951), était un catholique fervent. Il débarque un beau jour à Yale dans le bastion du « liberalism » à l’américaine, dominé par les agnostiques, les athées et les unitariens post-chrétiens, variante du protestantisme aligné sur l’idéologie des Lumières. En 1955, ce fils d’un millionnaire du pétrole fonde la « National Review », autour de laquelle se rassembleront des personnalités très diverses, toutes étiquetées, à tort ou à raison, comme « conservatrices » : des libertariens à Kirk lui-même. Dans ces années-là, où la « New Left » connaissait son apogée, le groupe « Young Americans for Freedom », lancé par Buckley, constituaient déjà un contrepoids politique. Et puisque Buckley, récemment, a critiqué les stratégies de Bush, quoique de manière très modérée, on peut le considérer aujourd’hui comme un représentant des « paléo-conservateurs ».
Le conservatisme américain, nous l’avons constaté, est un champ fort vaste dont les idéologèmes et les stratégies ne se sont cristallisés que depuis quelques décennies, contrairement à ce que l’on observe chez les conservateurs européens. Aujourd’hui, c’est évidemment George W. Bush qui domine l’univers conservateur américain. Bush se déclare « conservateur », plus exactement le continuateur de l’œuvre politique de Reagan que tous vénèrent en oubliant qu’il était au départ un « liberal ». Les Républicains doivent leurs succès électoraux depuis Reagan à un courant profond, agitant toute la base aux Etats-Unis, courant qui englobe le patriotisme (la fierté de s’inscrire dans une tradition de liberté) et les « valeurs » conservatrices (la famille, la religion, la morale, l’assiduité au travail, etc.).
Les hommes politiques qui veulent réussir en tant que « conservateurs » sont dès lors contraints de chercher le soutien de la « droite chrétienne ». Par ce vocable, il faut entendre cette immense masse d’électeurs liés aux mouvements religieux du renouveau protestant, animé par les « évangélisateurs ». Ce conservatisme théologien, partiellement fondamentaliste, rassemble des groupements où l’on retrouve les « Southern Baptists », le plus grand groupe protestant organisé, les pentecôtistes (notamment les « Assemblies of God ») et, bien sûr, les « méga-églises » des télé-évangélistes. Tous ensemble, ces mouvements évangéliques alignent quelque 80 millions de croyants, ce qui les place tout juste derrière les catholiques, qui restent le groupe religieux chrétien le plus nombreux aux Etats-Unis.
Certains évangélistes toutefois, et pas seulement les Afro-Américains, estiment que leur foi peut s’exprimer chez les démocrates. Religion et race se mêlent souvent : ainsi, Pat Robertson, étiqueté de « droite », et Jesse Jackson, étiqueté de « gauche », appartiennent tous deux au mouvement qui soutient les Baptistes et le sanglant « seigneur de le guerre » Charles Taylor au Libéria.
Malgré la très forte pression que la « droite religieuse » exerce aux niveaux locaux, voire dans certains Etats, elle n’a presque aucune influence au niveau fédéral. Ainsi, le candidat à la Présidence, Mitt Romney, appartient à la secte des Mormons, considérée comme éminemment conservatrice, ce qui ne l’a pas empêché d’être élu gouverneur du Massachusetts, Etat à majorité « libérale ». Le pentecôtiste John D. Ashcroft, représentant notoire de la « droite religieuse », fut ministre de la justice dans le premier cabinet de George W. Bush. Il serait faux, toutefois, de dire qu’après le choc du 11 septembre 2001, le bellicisme de l’actuel président américain, qui prétend être un « chrétien re-né » tout comme son adversaire Jimmy Carter, découle en droite ligne de sentiments religieux qui lui seraient propres.
La politique extérieure américaine est marquée depuis longtemps par les néo-conservateurs, comme on le constate sous le républicain Reagan avec Jean C. Kirkpatrick ou sous le démocrate Bill Clinton avec Madeleine Albright. Sous Bush Junior, les « neocons » tirent toutes les ficelles seulement depuis le retrait de Colin Powell. L’exécutif qui a programmé la politique moyen-orientale et déclenché la seconde guerre d’Irak alignait des hommes comme Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz et Richard Perle.
Tous ceux qui ont forgé le vocable « neocons » viennent à l’origine, comme d’ailleurs aussi bon nombre de paléo-conservateurs, du camp de la gauche (des « liberals ») ; on trouve dans leurs rangs des intellectuels de la gauche progressiste, issu des milieux juifs, qui se sont détachés du Parti démocrate au cours des années 70. Les meilleurs plumes de ce groupe furent Irving Kristol, avec sa revue « The Public Interest », Norman Podhoretz, avec « Commentary », et le sociologue Daniel Bell (« La fin des idéologies », 1970).
La définition usuelle du néo-conservatisme nous vient de Kristol : « Un conservateur est un homme de gauche, qui a été frappé de plein fouet par le réel ». Ce bon mot ne nous révèle que la moitié de la « réalité » : il pose le néo-conservateur, ex-homme de gauche, simplement comme celui qui n’accepte plus et critique les programmes sociaux pléthoriques lancés par les Démocrates. En fait, le néo-conservateur veut surtout une politique étrangère musclée : ainsi, le fils d’Irving Kristol, William Kristol (revue : « The Weekly Standard ») veut que cette politique étrangère américaine instaurent partout une « démocratisation », selon des critères déterminés depuis longtemps déjà par la vieille gauche interventionniste.
Pat Buchanan : vox clamans in deserto
Les « anciens conservateurs », ou paléo-conservateurs, qui avaient jadis forcé la mutation sous Reagan, entre 1981 et 1989, ont perdu depuis bien longtemps toute influence. Ainsi, Pat Buchanan n’est plus qu’une voix isolée dans le désert depuis des années, alors qu’il fut l’un des rédacteurs des discours de Nixon, puis conseiller de Reagan. Il tenta, rappelons-le, de lancer un parti réformiste et échoua dans sa candidature à la présidence en 2000. Il est redevenu républicain par la suite. En politique intérieure, Buchanan, catholique traditionnel, dont on se moque en le traitant de « conservateur paléolithique », lutte contre les « libertés » nouvelles que veulent imposer les « liberals » et les libertariens (avortement, mariage homosexuel, euthanasie).
Buchanan est protectionniste, s’oppose à la société multiculturelle et à l’immigration qui modifie de fond en comble le visage de l’Amérique. Sur le plan de la politique extérieure, il défend un isolationnisme modéré et s’inquiète des pièges que recèle l’interventionnisme global voulu par les « neocons ».
Il me reste à mentionner –et à saluer- un combattant isolé, qui pourfend le « culte de la faute » choyé par de nombreux « liberals » (et par leurs homologues allemands), culte qui sert à promouvoir l’idéologie de la « correction politique » (les « Gender studies », les codes anti-discriminatoires de tous acabits, le multiculturel, etc.) : ce combattant n’est autre que l’historien des idées Paul Gottfried. Mais, malgré Buchanan et Gottfried, les paléo-conservateurs n’ont plus aucun influence notable, ni dans les universités ni dans les médias, a fortiori dans l’établissement politique.
Quelles conclusions peut-on tirer de la topographie que je viens d’esquisser ici ? Après la disparition graduelle des paléo-conservateurs, les nationaux-conservateurs allemands auront bien des difficultés à trouver des alliés Outre-Atlantique. Sans doute, seuls les chrétiens à la foi très stricte trouveront des frères en esprit pour toutes les questions morales chez les évangélisateurs ou les conservateurs catholiques.
Personnellement, je ne trouve, dans ce camp conservateur américain (toutes tendances confondues), aucune position qui me sied. Si je suis éclectique, je trouverai peut-être quelques points d’accord avec Russell Kirk, mais seulement quand il appelait en 1976 à voter pour le « démocrate de gauche » Eugene McCarthy. Quand je pense à l’idéologie qui domine la RFA aujourd’hui, je suis souvent d’accord avec Paul Gottfried, qui avait dû quitter, enfant, le IIIième Reich national-socialiste. Enfin, je lis toujours avec beaucoup d’intérêt les textes des intellectuels américains qui s’opposent à l’interventionnisme.
Vu que nous assistons à une orientalisation, soit une islamisation croissante de l’Europe occidentale les analyses clairvoyantes de nos temps présents par Samuel P. Huntington méritent que nous y consacrions toute notre attention ; Huntington nous annonce le déclin de l’Occident en général et la perte d’identité européenne des Etats-Unis. Aujourd’hui âgé de 80 ans, ce professeur de Harvard n’est toutefois pas étiqueté « conservative » mais considéré comme un représentant du « liberal establishment ».
S’intéresser aux relations intellectuelles transatlantiques est une bonne chose et permet de se comprendre réciproquement. Jusqu’ici, le monde universitaire s’est limité à importer en Allemagne et en Europe le prêchi-prêcha du « politiquement correct » des « liberals », y compris les expressions du mépris que vouent les gauches à Bush qui, quand elles sont satiriques, satisfont leur orgueil blessé. Une poignée de conservateurs allemands critiquent aujourd’hui l’idéologie importée des « liberals » (qui s’expriment en Allemagne sous des oripeaux «écologistes ») mais cette démarche est insuffisante. Face à l’immigration de masse qui menace directement l’existence du peuple allemand, en tant que peuple porteur d’histoire et en tant que nation historique et politique, et l’avenir même de l’Europe toute entière, nous devons, en première instance, procéder à une analyse factuelle et objective de la situation et ne pas ergoter et pinailler sur nos préférences intellectuelles ou rêver à d’hypothétiques coalitions qui ne viendront jamais.
La politique extérieure américaine se caractérise depuis l’immixtion des Etats-Unis dans la politique mondiale (au moins depuis 1917) par la double nature de la puissance et de la morale qu’elle révèle. La conscience qu’ont les Américains de mener à bien une « mission » inspire cette politique globale ou planétaire, et vice-versa, dans la mesure où les démarches concrètes de cette politique étayent la vision messianique que distille la religiosité américaine.
Henry Kissinger était une exception : il se posait comme « réaliste » et les notions de « mission » ne l’intéressaient pas vraiment. Depuis la montée en puissance des « neocons », qu’ils soient adhérents des démocrates ou des républicains, l’aspect idéologique et para-religieux de la politique extérieure des Etats-Unis est passé à l’avant-plan. Force est de constater que les assises fondamentales de la politique extérieure des Etats-Unis réconcilient, in fine, les « liberals » et les « conservatives » : il nous suffit d’énumérer les grands événements de ces quinze ou vingt dernières années, avec l’élargissement de l’OTAN aux pays d’Europe centrale et orientale, avec la politique balkanique (de Madeleine Albright), avec l’appui qu’apporte Washington à la candidature turque à l’UE, aux conflits qui ensanglantent le Proche- et le Moyen-Orient, etc.
Par ailleurs, la politique extérieure américaine se montre souvent fort dépendante des fluctuations de l’opinion publique intérieure. Hillary Clinton et d’autres candidats à la Présidence commencent à caresser cette opinion dans le sens du poil, en songeant à l’investiture de 2008, car, en effet, si les troupes américaines doivent se retirer d’Irak aussi peu glorieusement qu’elles se sont retirées du Vietnam, la politique extérieure américaine se trouvera confrontée à ses propres misères, aux monceaux de ruines qu’elle aura provoquées.
Quel rôle jouera la Turquie dans ce scénario ? Rien n’est certain. Quoi qu’il en soit, la paix entre Israël et la Palestine sera, une fois de plus, remise aux calendes grecques.
Herbert AMMON.
(article extrait de « Junge Freiheit », n°29/2007; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, etats-unis, néocons, néo-conservatisme, conservatisme, trotskisme, atlantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Entretien avec E. Delvo

Entretien avec Edgar DELVO, ancien secrétaire de la Centrale d'Education Ouvrière du POB (Parti Ouvrier Belge)
Propos recueillis par Robert Steuckers
Monsieur Delvo, vous êtes consubstantiellement socialiste; vous êtes né dans une famille socialiste, vous avez été totalement imbriqué dans la vie du mouvement socialiste jusqu'en 1945. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre famille et votre jeunesse?
Je suis né à Gand le 20 juin1905, dans une famille et un quartier ouvriers. Pour les gens de très modeste condition, c'était des temps difficiles: nos contemporains, et a fortiori les jeunes gens, ne s'imaginent plus combien pénibles étaient les circonstances de la vie quotidienne, même pour les bourgeois. La notion de “temps libre” n'existait pas: tout était orienté vers le labeur, vers les corvées de tous les jours. Impossible, dans un tel contexte, d'imaginer une forme ou une autre d'épanouissement ludique ou culturel. Mon père était un ouvrier métallurgiste, un ouvrier qualifié qui aimait son métier et y mettait tout son cœur. Il était certes mieux payé que les simples manœuvres, mais, comme tout le monde, il avait grand'peine à joindre les deux bouts. Mon grand-père, que j'ai bien connu, était une célébrité dans les cafés de Gand et des environs, non pas parce qu'il aimait trop la bière, mais parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent pour nourrir décemment sa ribambelle d'enfants. Il travaillait dix heures par jour et, le soir, il vendait encore de la sciure de bois et du sable pour répandre sur le sol des auberges et des bistrots. Mon père était l'aîné d'une famille de six enfants: sa qualité d'aîné lui donnait quelques privilèges; c'est sur lui que se fondaient les espoirs de la famille. Le principal de ces privilèges était de recevoir une tartine complémentaire après le coucher. Ensuite, il a reçu l'autorisation d'apprendre à lire, alors que l'obligation scolaire n'existait pas encore dans le Royaume de Belgique, et que mon grand-père était analphabète.
Savoir lire donnait des avantages énormes: on pouvait apprendre rapidement, on pouvait lire les journaux, à cette époque où il n'y avait ni radio ni télévision. La seule distraction que s'accordait les gens était de jouer au lotto à la lumière d'une chandelle: mais de telles récréations étaient exceptionnelles, un luxe rare. Mon père a été un homme heureux, il était fier de ses talents. Il avait une conscience socialiste, tout comme mon grand-père. Ils avaient abandonné l'église. Mon grand-père avait été profondément choqué par l'anti-socialisme et l'anti-syndicalisme de son curé, qui refusait de prendre en compte la misère ouvrière. Cette arrogance avait fait naître un sentiment d'aigreur profonde dans les familles ouvrières: «nous ne valons rien aux yeux des curés». Pourtant, mon père était fier de son travail: il façonnait des moules en argile pour couler des pièces. Il m'amenait le dimanche pour voir son œuvre et il me communiquait sa fierté. Pour nous le travail bien fait était une valeur inestimable et nous ne comprenions pas pourquoi les gens d'église le méprisaient. Mon père pourtant ne cultivait pas de ressentiment et n'était certainement pas un fanatique de la lutte des classes: quand il y avait une grève, il se retirait à la maison et élaborait des plans pour de nouveaux moules.
A douze ans, j'ai pu fréquenter l'“école moyenne”, alors qu'il n'y avait toujours pas d'obligation scolaire. J'emmagasinait facilement les matières, je travaillais bien, mais je n'oubliais pas non plus que j'étais un enfant de la rue, un enfant qui avait grandi au sein d'une communauté de voisins, solidaires et chaleureux. Malgré la misère ambiante, j'ai vécu une enfance insouciante. Mes parents, qui étaient doux et bienveillants, m'avaient accordé ce qu'ils n'avaient pas eu, eux: du “temps libre”. Mais leur tolérance avait des limites fixées à l'avance: il fallait toujours que nous gardions une attitude digne. Paradoxalement, ces socialistes avaient quitté l'église mais vivaient toujours selon les canons de la charité chrétienne. Ils refusaient simplement, mais absolument, la hiérarchie catholique. Pour eux, l'église était l'ennemie du peuple; elle choisissait toujours le camps des nantis et des puissants. Mes parents n'étaient pas actifs dans le mouvement socialiste, mais lisaient le journal socialiste de Gand, Vooruit (= «En avant», équivalent flamand du journal social-démocrate allemand Vorwärts). C'est ainsi qu'ils se tenaient au courant des événements du monde. L'idéologie de Vooruit était marxiste mais modérée, déjà réformiste. Mais les querelles idéologiques importaient peu: Vooruit avait le mérite de donner toute sa place au socialisme spontané du peuple.
Quand les voisins me demandaient ce que je voulais devenir plus tard, quand j'aurai quitté l'école, je répondais que je voulais devenir instituteur, maître d'école. Je le disais parce que c'était la profession que les gens de mon quartier m'attribuaient d'office: «tu es malin, tu deviendras instituteur». Je fus un des rares fils d'ouvrier à pouvoir accéder en quatrième; le directeur, un francolâtre fanatique qui haïssait tout ce qui était populaire et flamand, m'y avait accepté à contre-cœur. Cet extrémiste inventait mille chicanes pour les élèves flamands de condition modeste. J'ai donc conservé un mauvais souvenir de cette école, que je fréquentais grâce à une bourse. Mais j'ai tenu bon et j'ai fait ma cinquième et ma sixième; c'était au début de la première guerre mondiale; les temps étaient très difficiles. Nous étions à l'arrière du front allemand, en zone militaire et nous ne pouvions pas nous rendre à Bruxelles. Mes parents ne pouvaient plus me payer des chaussures: il a bien fallu que j'aille à l'école en sabots de bois, de beaux petits sabots qu'on m'avait décorés avec amour. J'étais géné. Mon francolâtre de directeur a fait une vie: il ne voulait pas que les élèves viennent en sabots à l'école. Ce fut un prétexte pour démontrer bruyamment son arrogance de classe. Cet incident m'a appris une chose: pour l'ouvrier, ce n'est pas l'argent qu'il gagne qui est important, c'est que l'on respecte sa dignitié.
J'ai donc eu de bons parents, qui m'ont éduqué dans la douceur, avec souci de l'avenir, malgré les difficultés. Il m'ont laissé beaucoup de liberté, à condition que je ne suscite pas de plaintes, que j'aie un comportement exemplaire. Ils m'ont aussi transmis le sens de la communauté. A l'école moyenne, j'étais le condisciple d'un fils de fabricant de liqueur assez aisé, qui recevait des jouets merveilleux, notamment un coffret pour faire de la chimie amusante. Ce garçon ne pouvait pas nous fréquenter, son père le lui interdisait: il restait seul dans un coin avec ses éprouvettes, alors qu'il aurait bien donné tous ses jouets pour partir en randonnée avec nous. L'esprit de communauté est donc supérieur à l'individualisme bourgeois et à l'arrogance de classe: un grande leçon de mon enfance.
Comment s'est passé pour vous la première guerre mondiale?
A Gand, nous étions à l'arrière immédiat du front, dans ce que les Allemands appelaient l'Etappengebiet. Pour survivre, il ne nous restait plus que la débrouille, le marché noir, ramasser des escarbilles de charbons, retourner au troc. La Croix-Rouge américaine et le Plan Hoover permettaient aux enfants pauvres de recevoir le matin du cacao et un petit pain, et le midi, une soupe avec du lard, que l'on nous servait dans les bâtiments du théâtre.
Nous avons vu passé les uhlans dans notre quartier. Plus tard, des prisonniers russes étaient contraints à des travaux de terrassement pour le Canal Gand-Terneuzen. Nous échangions des denrées avec ces prisonniers et nous les réconfortions. Le plus mauvais souvenir de la guerre, a été les réquisitions. Les Allemands ne réquisitionnaient pas les hommes qui avaient du travail. Mais les gens ne le savaient pas. La police gantoise venait demander si on travaillait, les gens ne disaient rien, croyant qu'on allait imposer leurs maigres revenus. Bon nombre de réquisitions se sont effectuées sur de tels quiproquos. Nous avons été frappés par la terrible discipline qui régnait dans l'armée allemande: les officiers giflaient ou bastonnaient leurs soldats en public quand ils avaient commis des pécadilles.
Quand êtes-vous devenu un militant socialiste?
C'est venu tout seul. Quand j'étais à l'“école normale” pour devenir instituteur, un professeur de néerlandais lisait Multatuli (1), la littérature pacifiste. C'était un socialiste. Il est venu chez moi pour me proposer de devenir correcteur dans l'imprimerie socialiste qui s'était réorganisée et entendait devenir une entreprise commerciale comme les autres, en ne se limitant plus à imprimer des tracts ou des pamphlets socialistes. J'ai d'abord refusé car je voulais achever mes études. Plus tard, j'y suis allé et je suis devenu automatiquement membre du parti: cela allait de soi; on travaillait dans une entreprise socialiste, on était donc militant socialiste. La politique de commercialisation m'a d'abord séduit parce que l'atmosphère n'était pas politisée à outrance. Ce fut pour moi, à seize ans, l'occasion de lire des livres plus sérieux et de me pencher sur l'idéologie socialiste. J'ai lu Marx, non pas pour adhérer à un catéchisme, mais pour prendre le pouls du socialisme à un moment de son histoire. Je n'en suis pas resté à Marx. J'ai voulu connaître le socialisme dans toutes ses moutures, même avant qu'il ne porte le nom de “socialisme”: chez les premiers chrétiens, chez les socialistes utopiques, chez les Indiens d'Amérique. J'ai voulu tout connaître de l'esprit de charité, de justice.
Les typographes étaient des ouvriers, mais ils étaient lettrés. Ils savaient communiquer le fruit de leurs lectures. Dans l'imprimerie socialiste, j'ai appris aussi à vivre dans un mouvement politique qui prévoyait toute une série de structures d'accueil pour ses membres et sympathisants. Les jeunes avaient le choix: ou bien militer à la Jonge Wacht (JW; = Jeune Garde) ou bien adhérer à la Socialistische Arbeiderjeugd (SAJ; = Jeunesse ouvrière socialiste). Ces deux structures étaient bien différentes l'une de l'autre. Dans la JW se regroupaient les activistes, toujours présents dans les meetings et dans les bistrots, où ils fumaient et buvaient comme les adultes. Les garçons de la SAJ voulaient quitter cette ambiance et retourner à la nature, camper, organiser des randonnées à pied ou à bicyclette. Les JW fréquentaient les dancings. Les SAJ remettaient les vieilles danses populaires à l'honneur. La jeunesse socialiste était donc séparée par deux esprits bien différents. Les SAJ, dont j'étais, avaient un esprit Wandervogel, c'étaient des amis de la nature; ils voulaient réintégrer l'homme dans la nature. Nous avions l'impression d'aller plus loin, plus en profondeur. Bon nombre de garçons de la JW voulaient d'emblée faire une carrière politique. Les SAJ n'avaient pas cette préoccupation.
Petit à petit, l'imprimerie populaire (Volksdrukkerij) est devenue une entreprise purement capitaliste. La solidarité entre les membres du personnel s'est d'abord estompée puis a disparu. Les linotypistes se sentaient supérieurs aux typographes, qui estimaient valoir plus que les relieurs, qui, eux, n'adressaient pas la parole aux femmes de ménage.
Je suis ensuite devenu le chef de la SAJ de Gand. C'est à ce titre que j'ai rencontré pour la première fois Edouard Anseele (père), dit “Eedje Anseele”, un tribun socialiste fort populaire, qui avait le sens de la communauté et qui cherchait de jeunes idéalistes, notamment dans les rangs des SAJ, pour remplir de nouvelles fonctions dans le parti. Il m'a demandé si je connaissais la “coopérative”. J'avais lu beaucoup de livres et d'articles sur les coopératives, notamment un ouvrage important pour toute mon évolution future, La République coopérative du Français Ernest Poisson. Edouard Anseele voulait que je dirige une revue d'esprit “coopérativiste”. Son objectif était de relancer le mouvement coopératif afin de concurrencer le secteur capitaliste en offrant des marchandises à meilleur prix, en sautant au-dessus du maximum d'intermédiaires, notamment en affrétant une flotte marchande “rouge”. Mais comme le parti, à cette époque, était encore belge-unitaire, le projet coopératif n'a pas trop bien marché, car, rapidement, un clivage a surgi entre Wallons et Flamands. Les Wallons ont refusé l'orientation “coopérativiste”, au profit d'un syndicalisme plus anarchisant, de l'action directe, de la syndicalisation extrême et des grèves dures. Les Flamands, notamment les Gantois, rêvaient de la “République coopérative” d'Ernest Poisson.
J'ai toujours admiré Edouard Anseele (le père) car c'était un homme qui avait le sens de la décision, c'était un chef populaire, charismatique, incontesté. Ce leader populaire bénéficiait de la ferveur de son peuple. Son enterrement atteste cette dévotion des petites gens de sa ville. A la suite des conseils d'Anseele, j'ai voulu créer une culture nouvelle, solidaire et socialiste, bien organisée et bien insinuée dans le tissu social. Gand était le modèle de ce socialisme où toutes les branches du mouvement socialiste coopéraient en synergie. A Anvers, la fédération ne travaillait pas de la même façon: au contraire, on contingentait, le plus hermétiquement possible, les différentes instances du mouvement socialiste. Beaucoup de Gantois ont animé le mouvement socialiste avec succès, même en dehors de leur ville et dans les hautes sphères du parti. Anvers n'a pas donné de leader charismatique au mouvement socialiste belge et flamand. Huysmans et De Man, tous deux Anversois, n'ont pas réussi a capté la ferveur des masses socialistes. De Man était animé de très bonnes intentions, comprenait quels étaient les ratés du parti, mais il est toujours demeuré un solitaire qui communiquait difficilement avec les petites gens. J'ai assisté à la réconciliation entre De Man et Anseele, mes deux héros, l'un sur le terrain, l'autre dans le monde sublime des théories.
Comment avez-vous vécu l'immédiat après-guerre?
En dépit de mon évolution future vers le nationalisme, le croquemitaine, pour moi, c'était le malheureux Borms, incarcéré pour collaboration en 1919. Bien entendu, nous ne le connaissions pas. Nous croyions ce que disait de lui la propagande de l'Etat belge. Notre mouvement socialiste suivait à la lettre la “Trêve du Havre”, où le gouvernement belge réfugié en Normandie avait accepté pour la première fois en son sein des ministres socialistes, qui n'avaient peut-être pas reçu de portefeuille mais à qui on avait promis d'accorder le suffrage universel. Ce qui fut fait.
Quand avez-vous rencontré De Man pour la première fois?
De Man n'était pas né dans un milieu ouvrier comme moi. C'était un bourgeois d'Anvers. Dans notre mouvement, cette origine lui a causé des problèmes, pour une raison fort simple, qu'on comprend assez difficilement aujourd'hui: les ouvriers vivaient dans la nécessité, dans une nécessité extrême, et étaient prêts à suivre tous ceux qui leur promettaient ce qu'ils attendaient. Les bourgeois, eux, pouvaient se permettre d'avoir des principes, dégagés des affres de la nécessité. Les livres de De Man ont participé au renouveau du socialisme, mais, au départ, nous les lisions presque en cachette dans nos groupes de la SAJ. Sa réputation était mauvaise: il ne cessait de dire que le parti ne faisait rien d'essentiel pour le peuple, ce qui ne faisait évidemment pas plaisir aux gars qui trimaient sur le terrain. Pour De Man, la misère des ouvriers n'était pas seulement matérielle mais aussi culturelle; en affirmant cette vérité, il se distanciait automatiquement du marxisme, alors qu'il se désignait encore comme marxiste. Un jour, pourtant, la fédération gantoise avaient restauré des orgues pour offrir des soirées musicales aux ouvriers: De Man a critiqué cette initiative, au grand mécontentement des militants, qui avaient côtisé et collecté. Coupé du peuple, De Man n'évoquait qu'une culture purement intellectuelle, où les orgues ne trouvaient pas leur place. En dépit de ces travers bien humains, De Man m'a énormément appris. Ses ouvrages étaient fascinants, tant ils modernisaient notre vision socialiste de la politique et de l'économie.
Quand je l'ai vu pour la première fois, en 1930, j'étais déjà secrétaire de la Centrale d'Education Ouvrière. Je l'ai invité à Bruxelles pour prononcer une conférence, à la tribune où étaient également venus Norman Angel, Harold Laski, Pietro Nenni, le Suisse Lucien Dubreuil et les Français Gaston Bergery, Lucien Laurat et Francis Delaisi. De Man est venu nous parler du “socialisme et du nationalisme”. Son analyse était très pertinente: il distinguait le socialisme du marxisme et le nationalisme agressif du nationalisme défensif. Une idée a commencé à germer en moi: l'idéal à atteindre c'était l'unité du peuple tout entier, organisateur d'un appareil étatique.
Plus tard, De Man est venu à Gand. Je l'ai accompagné dans le train. Mais, sur place, nos militants l'ont boudé. Néanmoins, j'ai pu avoir une première longue conversation avec l'inventeur du planisme. De Man refusait la pensée en termes de systèmes. Il évoquait l'homme réel, avec ses défauts et ses qualités. Il parlait de l'“être” et du “devenir” et optait bien entendu pour le deuxième de ces termes: nous, militants socialistes, activistes politiques, étions des hommes “en chemin”, vers un but. Cette idée de devenir lui permettait de dire que Marx avait été le théoricien du “socialisme qui avait été”: la loi du devenir postulait que l'on évolue, que l'on adapte l'idée aux impératifs du temps. L'humanisme véritable ne consistait pas à répéter une doctrine figée mais à se mouler dans les méandres du devenir et des mutations sociales. A la suite de ces conversations et de mes lectures, j'ai expliqué le teneur de son Plan à nos militants. Même si cette matière est ardue, d'une haute densité philosophique, nos militants ont compris intuitivement que le Plan, théorisé par De Man, recelait des potentialités immenses pour la classe ouvrière et qu'il n'était pas de la démagogie.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, belgique, flandre, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 août 2008
La Légion Etrangère du Komintern

Erich KÖRNER-LAKATOS:
La “Légion étrangère” du Komintern
Le 10 octobre 1936, trois mois après l’ “Alzamiento nacional”, le soulèvement national espagnol, le navire “Ciudad de Barcelona” jette l’ancre dans le port d’Alicante. Débarquent alors 650 volontaires qui apporteront non seulement leur aide aux forces de gauche espagnoles dans la guerre civile mais chercheront à traduire dans les faits une motion décidée par le “7ème Congrès mondial du Komintern” lors de l’été 1935: la constitution d’un Etat de type soviétique sur la péninsule ibérique. Ce 10 octobre est désormais considéré comme le jour de la naissance de cette “légion étrangère” rouge, mieux connues sous le nom de “Brigades Internationales”. Parmi les organisateurs, nous trouvons Josip Broz, dit “Tito”, futur leader de la Yougoslavie non alignée. Le poète Erich Weinert rédige en allemand le chant de combat des “Brigadas Internacionales”, où nous trouvons les paroles “unsere Brüder sind Bauer und Prolet”, “nos frères sont le paysan et le prolétaire” et “dem Faschistengesindel keine Gnade”, “pas de pitié pour la racaille fasciste”.
Le lieu de rassemblement de ces troupes, leur camp d’entraînement et leur quartier général se situent dans la ville d’Albacete sur le haut plateau de la Nouvelle Castille. Une compagnie de grandes célébrités y tiendra son camp. Parmi elles, un certain Herbert Karl Frahm, que le monde connaîtra plus tard sous le nom de Willy Brandt; ensuite l’écrivain Ilya Ehrenburg qui, lors de la seconde guerre mondiale, en appelera aux viols de masse (“Brisez l’orgeuil des femmes germaniques, prenez-les comme juste butin!”). En tout, quelque 40.000 volontaires s’y rassembleront jusqu’à l’automne 1938. Mis à part les volontaires communistes, on y retrouvait des idéalistes de gauche, ou les “Schutzbündler” d’Autriche (1). Hélas aussi, dans cette grande fraternité, dans cet élan de solidarité avec les républicains espagnols, se mêlèrent des figures moins reluisantes: des criminels violents cherchant à échapper à la justice de leur pays, des endettés cherchant à fuir leur créanciers, des proxénètes qui cherchent une nouvelle virginité.
“Los Internacionales” sont répartis en cinq grandes unités, sur base de leur nationalité. La 11ème Brigade, dirigée par l’Autrichien Manfred Stern, qui a pris pour nom de guerre “général Kléber”, rassemble des ressortissants allemands et autrichiens. Les bataillons s’appelaient “Ernst Thälmann”, du nom du chef du parti communiste allemand, “Edgar André” (ancien président des milices du “Front Rouge” allemand, exécuté pour assassinat le 4 novembre 1936), “Hans Beimler” (commandant de l’unité) et, enfin, “12 février”, création spécifique du parti communiste autrichien, à l’époque illégal.
Au nom de ce parti entré en clandestinité, Franz Honner, futur ministre de l’intérieur autrichien après 1945, se rend en Espagne. Dans la nuit du 1 au 2 juillet 1937, il fonde ce bataillon autrichien, qui sera composé de quatre compagnies; elles porteront le nom de militants du Schutzbund communiste: “Georg Weissel”, “Koloman Wallisch”, “Franz Münichreiter” et “Josef Gerl”. 1700 ressortissants autrichiens combattront dans les rangs de ces compagnies; deux cents trouveront la mort au combat. Chez les Allemands, l’impôt du sang, payé à la république espagnole, sera plus lourd encore: la moitié des 3300 brigadistes allemands sera tuée.
Les Italiens se rassembleront dans la 12ème Brigade. La plus haute figure du Risorgimento italien du 19ème siècle lui donnera son nom: Giuseppe Garibaldi. Ces volontaires italiens se heurteront, sur le champ de bataille, à leurs compatriotes du corps expéditionnaire envoyé par Mussolini pour soutenir Franco. Nous en reparlerons.
La 13ème Brigade est composé de volontaires issus des pays slaves. Les Polonais serviront dans le bataillon “Dombrowski”; les Tchèques donneront à leur contingent le nom du principal saint hussite, Thomas Masaryk; les Bulgares nomment leur compagnie, forte d’une centaine d’hommes, “Compagnie Georgi Dimitrov”. Les Hongrois, non slaves, sont inclus dans cette 13ème Brigade. Leur unité est commandée par Mihàly Szalavi, agitateur et ouvrier maçon cultivé; mais le nom de l’unité est celui d’un aristocrate, “Ferenc Ràkoczi”, chef d’une insurrection contre les Habsbourg: il avait proclamé l’indépendance de la Hongrie en 1703.
Les francophones sont affectés à la 14ème Brigade, dite “Commune de Paris”, sous le commandement du Colonel Rol Tanguy. Au sein de cette Brigade, un aviateur de chasse, André Malraux, à l’époque jeune militant communiste; avec la maturité, il deviendra gaulliste et ministre de la culture. La 15ème Brigade rassemble les volontaires de langue anglaise; la majorité d’entre eux est américaine et sert dans le bataillon “Abraham Lincoln”; la plupart des autres sont Canadiens et appartiennent à l’unité “Mackenzie-Papineau”.
Au sein de chacune des brigades, un véritable réseau de commissaires politiques, tous communistes triés sur le volet, assure un contrôle serré, auquel personne n’échappe. Le “politruk” suprême est un Autrichien qui a pour nom Heinrich Dürmayer. En 1945 à Vienne, il montera la police d’Etat, la “Staatspolizei” ou, en abrégé la “Stapo”, du nouvel Etat autrichien. Bien entendu, tous les cadres de cette Stapo seront, à l’époque, des cadres “moscovites” patentés.
Sur le plan militaire, les Brigadistes n’ont pu intervenir que deux fois sur le cours des événements, notamment à Madrid en novembre 1936 et à Guadalajara, au nord de la capitale espagnole, en mars 1937. La bataille pour la capitale commença le 7 novembre 1936. Les Nationaux alignaient 20.000 soldats, principalement des Marocains, des “Moros” et la fameuse “Légion étrangère” espagnole. Ces unités étaient bien entraînées et bien équipées. Elles reçurent l’ordre d’avancer en quatre colonnes contre une masse de combattants bien plus importante mais sans grande formation militaire. Les “héros” du PC espagnol consacrèrent plutôt leurs efforts contre une “cinquième colonne” imaginaire, qui aurait fourbi ses armes dans la clandestinité, à l’intérieur même de la capitale. Pour l’attirer dans les rets des milices communistes, on ne recula devant aucun truc, aussi veule fût-il: une vaste maison madrilène abritait, apparemment, une représentation diplomatique du Royaume du Siam (qui n’avait aucun ministre en Espagne à l’époque). Des centaines de Madrilènes y demandèrent l’asile politique. Ils finirent tous fusillés. Les prêtres et les religieuses furent les victimes favorites des milices du PCE. A la radio, l’agitatrice Dolores Ibarruri Gomez, connue sous le sobriquet de “La Pasionaria”, excitait les esprits. Elle s’adressait aux femmes de Madrid: “Il vaut mieux être la veuve d’un héros que l’épouse d’un lâche”. Elle martèlait sans cesse un maître-slogan dans la tête des Madrilènes: “No pasaran!”; “Ils ne passeront pas!”.
Le 7 novembre 1936, le 11ème Brigade (germanique) traverse à marche forcée la capitale espagnole; son objectif? Le quartier universitaire à l’ouest de la ville. Les brigadistes rouges y connaîtront le baptême du feu. Un tiers des effectifs tombe au combat rien que dans les quatre premiers jours. Le 12 novembre, une nouvelle brigade entre dans la danse, sous les ordres du Général Lukacs (de son vrai nom Màté Zalka). La bataille durera jusqu’au 23 novembre. Les jeux sont clairs: les Nationaux ont échoué dans leur offensive. Franco ne prendra la capitale espagnole qu’en mars 1939.
La deuxième épreuve du feu des “Internacionales” fut un affrontement entre Italiens. On le sait, Benito Mussolini est venu en aide au camp nationaliste espagnol, en lui envoyant quatre divisions; pour une moitié composées de soldats réguliers, pour un autre moitié de miliciens fascistes. Après la prise de Malaga en février 1937, qui se déroula sans peine, Rome croyait avoir montré ses muscles. Mais un mois plus tard, nous ne sommes plus en Andalousie mais au nord de Madrid, à Guadalajara. Le 3 mars 1937, les troupes du Duce passent à l’attaque. Face à elles, se tiennent les Italiens rouges. En lançant des tracts et des slogans par mégaphone, ils invitent à la désertion. Avec succès! Les nationalistes espagnols connaissent désormais la valeur de leurs alliés, si peu fiables. Malgré ce que colportent les légendes héroïques de la gauche, après Guadalajara, le rôle des Brigades Internationales fut quasiment terminé. Car la cohésion des brigades n’existe plus: c’est la méfiance qui règne en leur sein au lieu de la camaraderie. Pourquoi? A Moscou, les fameuses purges, les procès spectaculaires ont commencé. Dans les rangs des Brigades, le NKVD soviétique cherche aussi des suspects. Tous ceux qui n’adoptent pas la ligne du parti, c’est-à-dire les trotskistes, les anarchistes et les autres “déviationnistes” finissent dans les chambres de torture. Les fusillades sont à l’ordre du jour. Finalement, les idéalistes perdent leur ferveur: ils ne luttent pas pour un avenir radieux de l’humanité mais pour les intérêts de Staline.
En novembre 1938, le gouvernement de l’Espagne rouge décide de dissoudre les Brigades, afin de satisfaire une clause interdisant à toutes puissances étrangères d’intervenir dans la guerre civile. En vain. Six mois plus tard, Franco peut annoncer la victoire du “soulèvement national”.
Erich KÖRNER-LAKATOS.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°36/2006; trad. franç.: Robert Steuckers).
Note:
(1) Julius Deutsch fut un communiste guerrier. En 1923/24, il organisa le Schutzbund républicain, une milice d’auto-défense ouvrière armée. Il en fut le commandant jusqu’en 1934. Le 12 février de cette année-là, il avait organisé, conjointement avec Otto Bauer, la lutte ouvrière contre le gouvernement autrichien. De 1936 à 1939, Deutsch fut général dans l’armée républicaine espagnole.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, guerre civile espagnole, europe, communisme, gauche, brigades internationales |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
E. Delvo: Henri De Man, mon mâitre à penser

Henri De Man, mon “maître-à-penser”
Edgard DELVO/E.d.V.
En mai 1940, l'homme politique socialiste flamand Edgard Delvo, 35 ans, se présente comme volontaire dans un bureau de recrutement de l'armée française, pour s'engager dans la lutte contre les “barbares allemands”. Mais un mois plus tard, il devient membre du Conseil de Direction (Raad van Leiding) du VNV (Vlaams Nationaal Verbond), le parti nationaliste flamand dirigé à l'époque par Staf De Clercq. Delvo est prêt en 1941 à s'engager pour le front russe, mais, en 1942, il est appelé à la tête de l'UTMI/UHGA (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels; Unie van Hand- en Geestesarbeiders), le syndicat unifié, pendant belge du Front du Travail allemand. En septembre 1944, il fuit la Belgique, se réfugie en Allemagne et participe au Landsleiding (le gouvernement flamand en exil). Condamné à mort par contumace par un Tribunal militaire belge, Delvo vit trente ans en exil en Allemagne, dont vingt sous une fausse identité. A l'âge de 71 ans, revenu en Flandre, il publie un livre de mémoires Sociale Collaboratie (Collaboration sociale), où il retrace les grandes lignes de son socialisme national-populaire (volksnationaal socialisme) et confie aussi ses souvenirs à E.d.V., chroniqueur historique de l'hebdomadaire satirique flamand ‘t Pallieterke (Anvers). Nous en publions un court extrait, où Delvo évoque la figure de Henri De Man, théoricien rénovateur du socialisme européen, très contesté au sein de son propre parti.
La plupart des jeunes militants socialistes de la génération de Delvo ne connaissaient même pas le nom de Henri De Man. «Dans les conférences et les cours du mouvement ouvrier belge, on ne le mentionnait pas. Ce n'est que dans un petit cénacle de notre groupe des Jeunesses Ouvrières (AJ; Arbeidersjeugd) que son nom avait bonne réputation et, pour moi personnellement, ses écrits constituaient un message de salut». Voilà ce que nous déclare Delvo qui ajoute que ses amis et lui comprenaient parfaitement qu'il valait mieux ne rien laisser transparaître de leur admiration pour De Man. Il était préférable, disaient-ils, de ne même pas prononcer son nom en dehors des cercles culturels de la jeunesse socialiste. La meilleure et la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était d'étudier ses idées de la manière la plus approfondie et d'en parler le moins possible avec les vieux camarades du parti, et certainement pas «avec les dirigeants».
Première rencontre
Henri De Man vivait encore en Allemagne quand Delvo et ses amis le lisait en cachette. Quelques années avant la prise du pouvoir par Hitler en 1933, Delvo reçoit l'ordre d'accompagner son maître vénéré à Gand et de présenter De Man aux socialistes de la ville. De Bruxelles à Gand, De Man et Delvo occupent à eux seuls un compartiment dans le train. Mais ils n'ont pas fait plus ample connaissance. Henri De Man avait vingt de plus que son admirateur; il n'a pas posé à son jeune camarade les questions conventionnelles que l'on pose pour montrer de un intérêt réel ou feint à son interlocuteur. De Man n'interroge donc pas Delvo sur sa jeunesse, son travail, sa façon de penser, ses dififcultés, ses espoirs... Nulle question de ce type. «Ce n'était apparemment pas son habitude de feindre de l'intérêt quand cet intérêt n'existait pas». Delvo était là comme un passant. «Mais n'allez pas croire que De Man était méprisant ou garder ostentativement ses distances. Au contraire. Il n'y avait rien d'affecté ou de blessant dans son attitude. Si je n'avais pas su que je me trouvais en présence de mon idole intellectuelle, je n'aurais rien remarqué de particulier à sa présence tranquille, à cet homme qui fumait confortablement sa pipe et laissait libre cours au vagabondage de ses idées».
Nationalisme et socialisme
En cours de route, les deux hommes ont échangé quelques mots sans signification, mais au moment où le train s'est approché de la gare de Gand-Saint-Pierre, De Man s'est brusquement animé: son intérêt s'éveillait pour la ville où il avait passé ses années d'étudiant et vécu ses premières expériences dans le mouvement socialiste. Il s'est appuyé sur la fenêtre du compartiment et quand nous sommes entrés dans la gare, il a dit: «Il y a bien longtemps! On va voir si on ne m'a pas déjà oublié». Delvo relate cette soirée gantoise: «Non, on ne l'avait pas oublié et, apparemment, on ne lui avait rien pardonné non plus. Pour ce qui concerne le nombre de militants présents, nous n'avions pas à nous plaindre; on s'attendait à une conférence compliquée qui n'attirait évidemment pas la masse. Un théoricien n'est pas une star du football ou un coureur cycliste victorieux. Nous pouvions aussi être satisfait du niveau intellectuel des assistants; le cercle d'étude socialiste qui avait organisé la conférence avait visé les intellectuels. Les dirigeants du parti, eux, ne s'étaient pas montrés. La vieille querelle durait-elle encore? Ou bien l'absence des dirigeants socialistes était-elle plutôt due à leur indifférence à l'égard de la thématique annoncée, “nationalisme et socialisme”, soit un problème auquel le POB n'a jamais voulu consacrer l'attention voulue?
«Je ne sais pas si Henri De Man a été déçu ou non de l'absence des dirigeants ouvriers de Gand lors de sa conférence; quoi qu'il en soit il ne l'a pas fait remarqué pendant le voyage de retour. A l'arrivée à Bruxelles-Nord, notre séparation a été brève et sans façons, comme notre tout première rencontre: une forte poignée de main».
Amis?
Selon Delvo, De Man était «tout naturel, sans contrainte dans son comportement, nullement vaniteux». Il le décrit comme «une personnalité tranquille, maîtresse d'elle-même, avec laquelle on se sentait à l'aise, bien qu'on aurait donné beaucoup pour savoir ce qui se passait derrière ce front haut et dans les sentiments de ce homme remarquable, qui ne laissait rien entrevoir de ses attirances et de ses répulsions».
Delvo, qui avait vingt-cinq ans quand il a rencontré De Man pour la première fois, n'a pas modifié fondamentalement ses premières impressions du théoricien. On a reproché à De Man «une indifférence blessante à l'endroit de ses semblables»; pour Delvo, ce n'était qu'«une inattention pour son environnement, une évasion totale ou un plongeon profond dans le monde de ses idées».
De Man, écrit Delvo, ne se donnait jamais la peine de susciter des effets dans son entourage. Il se comportait comme le dictait sa propre intériorité: «il restait toujours naturel et simple dans ses relations et dans son style de vie; il ne se pavanait pas, n'en mettait jamais plein la vue à ses proches, il ne faisait pas semblant, ne commettait jamais de fanfaronnades». De Man était un exemple pour l'attitude existentielle qu'il prônait lui-même: plus être que paraître, accorder moins d'importance à l'avoir qu'à l'être.
C'est précisément cet Henri De Man-là qui n'avait pas d'amis au sens profond de ce mot, écrit Delvo. Mais il semblait n'avoir nul besoin d'amis, «bien que beaucoup de personnes appartenant à son cercle de pensée souhaitaient que les sentiments de proximité qu'il suscitait en eux, reçoivent une réponse de sa part».
Assainir la démocratie
En 1933, De Man se fixe à Bruxelles. A partir de cette année-là, Delvo aura avec lui «des contacts extrêmement précieux et féconds». Delvo ajoute que De Man n'avait pas quitté l'Allemagne «sous pression», au moment où Hitler a accédé au pouvoir, «comme on l'a dit trop souvent par erreur». D'après Delvo, De Man aurait pu conserver sa chaire sans problème à Francfort, s'il l'avait voulu. «Combien de professeurs allemands compromis politiquement aux yeux des nouveaux détenteurs du pouvoir, pour leurs activités du temps de la République de Weimar, sont restés en Allemagne en dépit du changement de régime, en adaptant tout simplement leurs matières et leurs cours aux circonstances nouvelles, tout comme, ultérieurement, ils se sont réadaptés une seconde fois après 1944, en empruntant une direction nouvelle, dans le cadre du programme démocratique de “rééducation” du peuple allemand».
De Man, en revanche, a quitté le Troisième Reich volontairement et librement, parce qu'il «n'était pas prêt à s'adapter à un régime dont il rejetait les fondements». Il a préféré mettre son expérience au service «du mouvement socialiste et de la lutte contre la crise dans son propre pays». Mais Delvo nous rappelle n'est pas simplement rentré en Belgique pour défendre une démocratie menacée et exposée aux coups de la dégénérescence. Non: De Man envisageait une réforme en profondeur de la démocratie belge, son assainissement». De Man croyait à la possibilité de telles réformes. Il voulait protéger la Belgique de «toute expérimentation totalitaire et dictatoriale».
Hendrik De Man, dit Delvo, «n'a jamais cessé de nous dire que toute démocratie sans responsabilité et sans autorité personnelles, sans auto-discipline et sans direction consciente, ne résisterait pas aux manipulations démagogiques et à l'auto-destruction». Il a opté pour une «démocratie puissante, vitale et “autoritaire”» contre toutes les formes de dictature. Mais, en même temps, De Man concentrait toute son attention aux efforts entrepris par Hitler «pour susciter une solidarité nationale plus cohérente par plus de justice sociale». De Man considérait que «les réalisations sociales du Troisième Reich comme une contribution importante à l'unification spirituelle et psychique, condition préalable à ce sursaut soudain et étonnant du peuple allemand».
Peu après son retour en Belgique, Henri De Man devient vice-président du POB/BWP. Cette nomination avait été préparée lors de conversations avec le “patron’, Emile Vandervelde. Dans ces années de crise, tous les espoirs, dans le sérail du POB, reposaient sur Henri De Man. Les socialistes belges du POB ne désiraient plus s'adresser exclusivement et principalement aux ouvriers. En réalisant son fameux “Plan du Travail”, le POB entendait libérer toutes les catégories de la population «de l'emprise des forces économiques et financières monopolistiques».
Delvo, fidèle collaborateur à la revue de De Man, Leiding, adepte convaincu de son socialisme éthique, défenseur passionné des point de vue de son maître-à-penser, contribua à diffuser largement, par la plume et la parole, les thèses de l'auteur d'Au-delà du marxisme. Pendant des années, Delvo est resté en rapports étroits avec De Man. Malgré cela, il n'ose toujours pas dire aujourd'hui, «qu'il a bien connu De Man».
«Réformateur du monde»
Pour comprendre la nature de leur relation et pour comprendre la personnalité de De Man, citons ces mots que Delvo consigne dans ses mémoires: «Henri De Man a voulu faire beaucoup de choses pour les gens, mais il n'a pas pu le faire avec les gens». De Man «était profondément convaincu que les gens avaient besoin de lui». Il s'est toujours senti dans la peau d'un «réformateur du monde». Il voulait littéralement compénétrer les gens de ses idées, qu'il avait bien entendu formulées pour leur bien. Il voulait aller de l'avant et diriger, mais, personnellement, il ne ressentait nullement le besoin d'appartenir à l'humanité! «Il n'a jamais été un homme de communauté», au contraire de son élève Delvo, qui ajoute: «il acceptait le soutien et la collaboration de ceux qui étaient prêts à l'aider, et voyait en eux des hommes partageant les mêmes idées et les mêmes sentiments, des compagnons de combat, et non des amis».
Et Spaak?
«Pas même Paul-Henri Spaak», nous dit Delvo, «qui a tout de même, avec De Man, été considéré comme le représentant le plus influent du “socialisme national” dans notre pays, et qui a été pour lui, un soutien indispensable quand il s'est heurté, inévitablement, au vieux président du parti, Emile Vandervelde, qui possédait encore à cette époque une grande autorité; je le répète, même Paul-Henri Spaak, n'a jamais été son ami. Non, personne n'avait accès à l'intériorité de De Man, n'avait droit à une part de sa vie sentimentale. C'était un homme que l'on appréciait et que l'on respectait, pas un homme à qui on se liait d'amitié».
Spaak et De Man, selon Delvo, «étaient liés dans un combat commun, basé sur une vision commune». Mais De Man avait derrière lui un «long processus de maturation». Spaak, au contraire, était devenu un “socialiste national” en répudiant brusquement son passé à “Action Socialiste”, où violence et extrémisme s'était souvent conjugués. C'est vrai: le retournement soudain dans la pensée politique de Spaak s'est opéré quand il est devenu ministre «de manière inespérée et inattendue»; toutefois, Delvo pense qu'il s'agit bien d'une conversion soudaine, mais sincère, et non d'un “simple calcul”. Delvo croit pouvoir comprendre cette conversion; il sait qu'il n'est pas le seul jeune “demaniste” qui «à ce moment, savait que Spaak, depuis quelques temps, sous l'influence des conceptions de De Man, avait soumis son internationalisme prolétarien à une sévère critique» et était devenu un adepte du “socialisme national”.
De Man et Spaak ont-ils été “amis”? «Ils ont été liés politiquement», sans aucun doute. «Mais amis?»: «Non» répond Delvo. Mais ce n'est certainement pas Spaak qui a été le responsable de cette “incommunicabilité”. Tout simplement, De Man n'accordait aucune valeur à l'amitié. Dans ses rapports humains, il ne visait qu'une chose: faire partager à ses interlocuteurs et à ses camarades les mêmes visions de la société et de la politique. Tous les efforts intellectuels de De Man tendaient à améliorer le sort de l'humanité, mais il perdait presque toujours de vue les «hommes vivants», y compris ceux qui évoluaient dans son environnement immédiat. Delvo a très bien perçu cet aspect de la personnalité de De Man: «Celui qui espérait des avantages personnels, entendait assurer son avenir, faisait bien de se ranger derrière la bannière de Spaak, qui ne décevait jamais ses amis et répondait toujours à leurs attentes». Mais ceux qui suivaient De Man pour ses idées ne récoltait qu'un “bénéfice intellectuel”. Aujourd'hui encore, Delvo pense que c'était là le “meilleur choix”. Et si Delvo a opté pour une autre voie que celle de De Man pendant la seconde guerre mondiale, il reste reconnaissant au théoricien du planisme.
Magnanimité?
Pendant l'été 1940, après la publication de son manifeste —qui fit tant de vagues, parce qu'il réclamait la dissolution du parti socialiste et appelait à coopérer avec l'occupant allemand— De Man reçut la visite de nombreux dirigeants socialistes et surtout syndicalistes, à qui il a promis son soutien, bien qu'il était parfaitement convaincu «qu'ils le renieraient plus de trois fois avant que le coq ne chante une seule fois, si la fortune des armes venait à changer de camp».
En recevant ces socialistes et ces syndicalistes, De Man a-t-il agit par magnanimité? Ou parce qu'il se souvenait de leur lutte commune au sein du mouvement socialiste belge? Pas du tout, nous répond Delvo. Si De Man a reçu pendant l'été 1940 ses anciens camarades du parti qui venaient lui demander conseil, «sans dire un seul mot à propos de l'attitude hostile qu'ils lui avaient manifestée quelques temps auparavant, sans prononcer le moindre blâme pour le fait qu'ils avaient déserté et abandonné leurs camarades», cela n'a rien à voir avec la sentimentalité ou la vertu du pardon: De Man a reçu ses anciens camarades parce qu'ils avaient besoin de lui, de ses conseils, et qu'il était de son devoir de les aider, au-delà de tout sentiment de sympathie ou d'antipathie, de vénération ou de mépris. Parce que De Man avait décidé de remplir la mission qu'il s'était assignée à ce moment-là de notre histoire: rassembler la population belge derrière son Roi.
Leo Magits
Delvo n'aime pas qu'on lui pose trop de questions sur l'«homme» Henri De Man, pour la simple et bonne raison, dit-il, qu'il ne peut le faire, qu'il n'en a pas le droit. Mais il souhaite expressément nous dire ceci: lorsque De Man «avait pris une décision, lorsque quelque chose était bon et nécessaire selon son propre jugement, aucune considération ne pouvait plus l'empêcher d'agir selon son idée. Devant ce qu'il considérait être son devoir, tout devait fléchir et il oubliait tout, y compris ses propres enfants».
Lorsque Delvo devint en 1932 secrétaire général de la Centrale d'Education Ouvrière, en prenant la succession de Max Buset, il a fallu nommer un nouveau secrétaire flamand. Parmi les candidats: Leo Magits, émigré en 1918 aux Pays-Bas, où il fut actif dans le Syndicat International. Delvo ne connaissait pas Magits personnellement, mais avait lu sa brochure Vlaams socialisme [= Socialisme flamand]. Lorsque les deux hommes font connaissance à Bruxelles, deux choses sautent aux yeux de Delvo: «l'attachement absolu de Magits à la démocratie» et «sa vision du nationalisme qui se profilait avantageusement, par rapport à la vision de De Man sur cette question», dans le sens où Magits opérait une distinction beaucoup plus nette entre les concepts de “nation” et d'“Etat”, ne réduisait pas le nationalisme à une simple question de langue; de plus, son analyse des valeurs qu'apporte le fait national dans le mouvement ouvrier, permet des déductions bien plus positives et fécondes que l'œuvre de De Man. Magits avait le mérite de ne pas sous-estimer la valeur de la prise de conscience nationale chez les ouvriers, dans la mission culturelle que doit s'assigner tout véritable mouvement socialiste.
Sous la double impulsion de De Man et de Magits, Delvo va évoluer intellectuellement, et finir par théoriser ce qu'il a appelé le “volksnationaal socialisme”, le socialisme national-populaire.
E. de V.
(extrait de la très longue étude de l'auteur, parue dans 't Pallieterke en 1976; cet épisode a été publié le 21 octobre 1976; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, belgique, flandre, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 août 2008
La "Légion Tchèque" en Russie

Erich KÖRNER-LAKATOS:
La “Légion tchécoslovaque” en Russie
A la mi-août 1914, le Tsar va à l’encontre d’une demande des Tchèques vivant en Russie, qui veulent constituer des unités autonomes dans l’armée impériale russe. Sur la Place Sainte-Sophie de Kiev, les premiers éléments de cette légion tchèque prêtent bientôt serment de fidélité à l’autocrate de toutes les Russies. Il s’agit de quatre compagnies de fantassins, dont les soldats se nomment eux-mêmes “Ceska Druzina”, la “suite tchèque”; ils veulent à tout prix libérer leur patrie de la domination autrichienne. Les journaux russes considèrent cet engagement comme une curiosité, voire une bizarrerie: ils appellent cette petite troupe la “Légion Hussite”.
Dans le cadre de la 3ème Armée russe, les “Hussites”, commandés par le Lieutenant-Colonel Lokocky, réussisent leur mission: faire de l’agitation panslaviste dans le dos de l’ennemi. En octobre déjà, près de Jaroslaw en Galicie, des éléments du 36ème Régiment d’Infanterie austro-hongrois et du 30ème Régiment de la Landwehr se rendent sans avoir résisté. Mais le coup de maître des “Hussites” a eu lieu le 3 avril 1915. Au Col de Dukla dans les Carpathes, le 28ème Régiment d’Infanterie, composée essentiellement de ressortissants tchèques, et plus de 1400 hommes du Régiment de la Place de Prague passent avec armes et bagages dans le camp russe. Mais ce ne fut pas tout: lors des combats le long de la San, les 26 et 27 mai, de nombreux soldats du 18ème Régiment d’Infanterie de Königgrätz, du 21ème Régiment de Tschaslau et l’entièreté du 98ème Régiment d’Infanterie de Hohenmauth désertent. Ces régiments étaient tous composés de soldats récrutés ou mobilisés dans des régions tchèques.
La plupart de ces soldats, qui venaient de rompre leur serment, n’a pas envie de poursuivre la guerre; seuls peu de transfuges s’engagent dans la Légion, dont les 1673 hommes (fin 1915) demeurent majoritairement des Tchèques de Russie. En décembre 1916, la Légion compte 2500 soldats; ce nombre est vraiment réduit, si on tient compte que 50.000 à 60.000 soldats tchèques de l’armée impériale autrichienne sont prisonniers des Russes; leurs sentiments sont toutefois peu loyaux à l’endroit de Vienne, comme l’atteste le témoignage de nombreux codétenus allemands ou hongrois, auxquels, ostensiblement, ils ne manifestent aucun esprit de camaraderie. Certains essaient d’amadouer les gardiens russes en leur disant qu’ils sont “leurs frères slaves”, ce qui ne leur rapporte que des coups.
Sur pression de leurs alliés occidentaux, courtisés par Masaryk et Benes, le Ministère des Affaires Etrangères du Tsar accepte en février 1917 la constitution d’une armée tchèque autonome en Russie. Les “Hussites” de la première heure inondent alors les camps de prisonniers de tracts appelant à l’engagement dans cette nouvelle armée mais les résultats sont maigres. Le nouveau gouvernement Kerenski à Saint-Pétersbourg regarde cette agitation avec méfiance mais ne souhaite pas contrarier Paris et Londres.
Dans la foulée de l’offensive Broussilov, les trois régiments de la Légion Tchèque (désormais forte de 3530 hommes) se retrouvent le 2 juillet 1917 près de Zborov, une localité de Galicie, située entre Lvov et Tarnopol, face au 35ème régiment d’Infanterie de Pilzen (61% des hommes sont tchèques), au 75ème Régiment d’Infanterie de Neuhaus, autre ville de Bohème (le Régiment compte plus de quatre cinquièmes de Tchèques) et à une unité croate. A la suite du travail de sape et d’agitation des “Hussites”, ce corps de troupes impériales et royales austro-hongroises, se rend après un bref combat; en tout, 62 officiers et 3150 hommes. Seules quelques unités, essentiellement allemandes et croates, résistent avec acharnement malgré le risque de prendre une balle dans le dos, meilleur moyen pour les déserteurs de se frayer un passage vers l’ennemi.
Plus tard, la République tchécoslovaque célèbrera le combat de Zborov comme le jour de la naissance de l’armée nationale; les “Hussites” ont effectivement gonflé cette victoire sans combat pour en faire un mythe héroïque. Même les alliés occidentaux tombent dans le panneau et soutiennent la Légion. A la fin de l’année 1917, la Légion Tchécoslovaque, qui se donne désormais ce nom alors qu’il n’y a que 3% de Slovaques parmi ses effectifs, compte désormais 35.000 hommes car bon nombre de prisonniers accordent foi aux promesses qui leur sont faites ou fléchissent devant les pressions. Mais les belles promesses ne se concrétisent pas: à l’automne de 1917, plus aucun approvisionnement ne parvient de Russie, les Tchèques sont obligés de réquisitionner des stocks; d’autres marchandises sont saisies sans autre forme de procès, comme l’admit Masaryk lui-même. La Paix de Brest-Litovsk met la Légion tchèque dans une sale position: elle risque d’être livrée à l’Autriche-Hongrie. Les Bolcheviks accordent le 15 mars 1918 un laisser-passer à la Légion, à la condition toutefois qu’elle n’intervient pas dans les conflits internes de la Russie. Masaryk décide d’évacuer ses hommes vers le Pacifique en empruntant le Transsibérien; ensuite, ces soldats embarqueront à Vladivostok pour parcourir la moitié du globe et aller garnir le front français. Le 25 avril, effectivement, les premiers légionnaires tchèques atteignent le port sibérien d’Extrême-Orient; en mai, 14.000 autres soldats les rejoignent, en une douzaine de tenues différentes, sans armes, car les partis de la guerre civile russe les leur ont prises, en guise de péage pour les laisser passer.

Au printemps de 1918, l’état-major britannique conçoit un plan: faire passer une partie de la Légion par Arkhangelsk et l’amener sur le front occidental. Ce plan déclenche une grosse agitation dans les rangs des “Hussites”; un grand nombre d’entre eux cultivaient sans nul doute des arrière-pensées; il valait mieux, pensaient-ils, effectuer un très long voyage par le Transsibérien, attendre un navire sur les côtes du Pacifique, traverser le plus grand océan du monde et faire ainsi le tour du globe. A ce moment-là, spéculaient-ils sans doute, la guerre serait finie et ils échapperaient tous au front de France, auquel aspiraient prétendument les forts en gueule et les Svejks de la nouvelle Légion.
La ville de Tchéliabinsk dans l’Oural fut alors le théâtre de querelles et de bagarres, où l’abus de vodka ne fut certes pas étranger, entre Tchèques et Bolcheviks. Pour cette raison, Trotski ordonne le 25 mai, dans une circulaire télégraphiée, de désarmer immédiatement les légionnaires tchèques. Cet ordre fut vain car le long du Transsibérien les soldats de l’Armée Rouge sont trop peu nombreux et rassemblés dans des bandes désordonnées; ils ne feront pas le poid devant les légionnaires tchèques armés jusqu’aux dents. Très rapidement, les principales gares de la voie de chemin de fer entre la Volga et Vladivostok tombent aux mains des légionnaires tchèques.
Le 18 juin 1918, ils prennent la ville de Troïk et y commettent une hécatombe; parmi les victimes, beaucoup de prisonniers austro-hongrois de langues allemande ou hongroise. Le 10 août, Kazan tombe à son tour aux mains de la Légion Tchèque. Dans la ville prise, ils s’emparent des réserves de devises de la Banque Impériale Russe de Saint-Pétersbourg, qui y avaient été entreposées. En tout, 651 millions de roubles-or.
Ennivrés par leurs succès, dû à la faiblesse des effectifs de l’Armée Rouge et à l’inexpérience de ses combattants, et excités par les Alliés occidentaux, qui répandant la légende de la coopération étroite entre les puissances centrales et Lénine, la Légion se pose alors en dominatrice de la Sibérie. Le comportement des légionnaires à l’endroit de la population est épouvantable.
Mais le sort des armes, d’abord favorable aux légionnaires tchèques, n’a pas duré. En septembre, les Rouges attaquent et leurs succès sont fulgurants. Mais les Tchèques ont suffisamment de temps pour faire partir 250 trains de marchandises pillées, de munitions et d’armes. La Légion démoralisée quitte alors les rives de la Volga et se replie vers l’Est, en même temps que l’Amiral Koltchak, ancien commandant en chef de la flotte de la Mer Noire et désormais chef des armées blanches. Koltchak et les Tchèques ont désormais partie liée.
En dépit des défaites, le nombre de légionnaires ne cesse de croître car, à Prague, le 28 octobre 1918, naît officiellement la République tchécoslovaque indépendante; beaucoup de prisonniers avaient attendu ce moment pour se joindre à la Légion et pour rentrer le plus vite possible en leurs foyers, en toute légalité. A la fin mai 1919, l’ensemble de la Légion se trouve en Sibérie occidentale, entre l’Oural et le Lac Baïkal. En Europe, la guerre est finie. Les Tchèques ne veulent plus qu’une chose: partir.

Lorsque les Rouges prennent Irkhoutsk et barrent aux légionnaires la route de l’Est, les Tchèques sacrifient l’Amiral Koltchak et livrent le 15 janvier 1919 leur ami et allié aux Bolcheviks, afin de pouvoir fuir librement vers l’Est, vers Vladivostok. Quelques jours plus tard, le malheureux amiral blanc fit face au peloton d’exécution. Plus tard, les Tchèques, la mort dans l’âme, doivent abandonner le trésor russe pris à Kazan. Mais pas entièrement. Sur le dernier tronçon du Transsibérien, le long du fleuve Amour, les troupes japonaises font face aux Rouges et permettent aux Tchèques de passer. Beaucoup de Tchèques utilisent l’or et l’argent de Kazan pour faire des transactions importantes. Ils achètent, à des prix très nettement inférieurs à ceux du marché, du cuivre (quelque 740.000 tonnes), du coton (5600 tonnes), du caoutchouc (5000 tonnes) et du salpètre (2500 tonnes). Plus de vastes quantités de cuir, de peaux et de machines. A Vladivostok, la Légion réquisitionne vingt-huit wagons transportant des pneus de camion, pour une valeur de 38 millions de roubles. En plus, les légionnaires, pillent la résidence du consul du Danemark, dont les objets d’art précieux se sont retrouvés en 1922 dans le Musée National de Prague.
Gerburg Thunig-Nittner écrit dans son ouvrage de référence sur la Légion Tchèque, paru en 1970: “On n’expliquera jamais complètement comment les légionnaires, à titre individuel, ont acquis cette immense fortune, qu’ils ont rapporté dans leur pays. On ne pourra jamais prouver, non plus, quelles sont les parties de cette fortune qu’ils ont acquises en toute régularité et quelles sont celles qu’ils se sont appropriées de manière illégale. Mais qu’en ce domaine, ce soit seule la loi du plus fort qui ait primé, voilà qui est hors de doute”.
Le retour au pays, via le Grand Océan, commença le 9 décembre 1919. Les “Svejks” peinaient sous le poid de leur butin. Immanquablement, cette situation nous amène à méditer le “Ring des Polykrates” de Schiller, où l’on trouve les vers suivants: “De trésors étrangers richement chargée/ revient dans les eaux de la patrie/ la forêt des bateaux aux nombreux mâts” (“Mit fremden Schätzen reich beladen/ Kehrt zu den heimischen Gestaden/ Der Schiffe mastenreicher Wald”).
Erich KÖRNER-LAKATOS.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°35/2006; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : russie, république tchèque, tchécoslovaquie, europe centrale, mitteleuropa, sibérie, transsibérien |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ideologische Grundlagen für das egalitäre Weltbild und die differentialistische Alternative
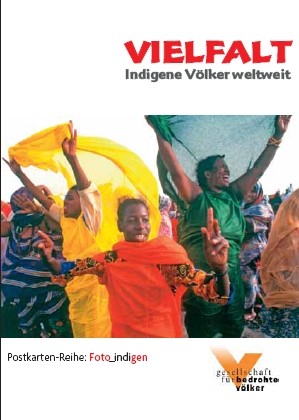
Robert Steuckers
(Text im Jahre 1991 verfasst)
Die ideologischen Grundlagen für das egalitäre Weltbild der westlichen Gesellschaften und die differentialistische Alternative.
Eine Analyse historischer und zeitgenössischer Philosophien
Jede vorindustrielle Gesellschaft ist ursprünglich ein Gewebe von mehr oder weniger autonomen und bäuerlichen Gemeinschaften, die zur Nahrungsfreiheit tendieren. Der Geograph und Ethnolog Friedrich Ratzel (1844-1904) und der Soziolog Gustav Ratzenhofer (1842-1904), die alle beiden die Grundlagen der Soziologie und der Völkerkunde festgelegt haben, stellen fest, daß die menschlichen Gemeinschaften sich langsam stabilisieren, wenn sie das Stadium des Nomadismus verlassen, sich ein Boden aneignen und diesen mit ihrem spezifischen Genie prägen. Für Ratzel (s. Völkerkunde, 3 Bände, 1885/1888), die moralisch hochwertige und patriarchalisch-kriegerische Kultur des Nomadismus weicht allmählich vor der moralisch schwächeren, vorstädtischen und matriarchalisch-bäuerlichen Kultur der Seßhaftigkeit. Für Ratzenhofer, kommt die Kulturstufe erst nach die Eroberung von unordentlichen, nomadisierenden, auf einem bestimmten Raum zerstreuten oder durch allerlei Katastrophen sozial zerstörten Haufen durch eine «starke Rasse», die die Besiegten dominiert.
Dieser Prozeß der Dominanz erlaubt nach Ratzenhofer und Gumplowicz die Entfaltung der Kultur. Aber sowohl für Ratzel als für Ratzenhofer, d.h. sowohl in der Prozeß des unkriegerischen Seßhaft-Werdens als in der Kulturwerdung durch Eroberung, wirkt der Faktor Zeit als Identitätsschaffend. Landwirtschaft und Dominanz führen zur Schaffung von Identitäten, die nicht notwendigerweise ewig und immer Wandlungsprozeßen ausgesetzt sind.
Diese Identitäten wirken vielfältig und kulturproduzierend. Jede dieser Identitäten entspricht einem Boden, passt sich einen spezifischen Ort an. Diese Vision von Ratzel impliziert kein geschlossenes Weltbild: es gibt Identitätskerne und -randzonen; diese letzten untergehen fruchtbare spezifische Mischungen, die sich später als eigenständige Kulturen erweisen. Die Geschichte ist also ein unendliches Spiel von positiven und kulturschaffenden Differenzierungen innerhalb Identitätskerne. Wenn man das Beispiel Deutschlands nimmt, gibt es selbsverständlich eine Vielfalt von ortsverbundenen Schattierungen innerhalb des deutschen Volkes selbst: Nordseedeutsche (mit Holländern und Skandinaven verbunden), Alpendeutsche (mit Lombarden, Veneten, Slowenen, Welschschweizern verbunden), ostdeutsche Landwirte (die Kontakte zu Westslawen und Balten unterhalten), Rheindeutsche (die über die Elsaß Kontakte mit Lothringern und anderen Gallo-Romanen bzw. Franzosen unterhalten), uzw. Der gleiche Prozeß läßt sich in den romanischen und slawischen Ländern beobachten. Die Differenzierungen sind geographisch bedingt, so daß es unmöglich ist, ihre konkrete Resultate (d.h. die ethnischen Identitäten) philosophisch zu verleugnen, entweder durch die kritiklose Affirmation einer hypothetischen Rassenreinheit oder durch die ebenso kritiklose Affirmation einer durch wahllose Mischung vereinheitlichen Welt. Beide Affirmationen negieren den unentrinnbaren Faktor "Erde", Quelle stetiger preziser Wandlungen. Die Affirmation der Rassenreinheit negiert die manchmal kulturreichen Mischungen der Identitätsrandzonen weil die Affirmation der Weltmischungseuphorie alle möglichen differenzierten und kulturschaffenden Wandlungen prinzipiell ablehnt.
Diese dynamischen und autonomen Gemeinschaften sind Hindernisse für alle willkürlich-zentralisierenden Gewalten. Um Kontrolle üben zu können, sollten die zentralisierenden Gewalten die Nahrungsfreiheit der freien menschlichen Gemeinschaften auslöschen. Historische Beispiele eines solchen Prozeßes fehlen nicht: Karl der Große erobert Sachsenland und gibt seinen Gefolgsleuten die Allmenden der Sachsen als persönliche Lehen. Die Allmende der Gemeinschaft wird so der persönlichen Feod des karolingischen Herrn. Die nächsten Generationen können also die Lebensquelle Boden nicht mehr richtig umverteilen, so daß ein Prozeß der Re-Nomadisierung entsteht. Junge Norddeutsche müssen durch Not und Mangel an Boden gezwungen ihre Heimat verlassen, kinderlose Mönchen werden, Söldner für fränkische Könige oder für den römischen Papst werden, sich als Sklaven für die Bagdader Kalifen verkaufen, usw. Alle sozialen Unruhen des Mittelalters sind Folgen dieser Feodalisierung. Die neuen historischen Forschungen legen eben den Akzent auf diese Enteignung der Bevölkerung. So z. B. der russische Historiker Porschnew, die Franzosen Bercé, Walter, Bois und Luxardo, der Deutscher Schibel (1).
Die bäuerlichen Gemeinschaften füssten auf die Unveräußerlichkeit des Bodens. Der Boden war Eigentum der Gemeinschaft, d.h. sowohl der zeitgenössischen Generationen als der Verstorbenen und der Künftigen. Die Feodalisierung durch die karolingische Enteignungspraxis, die Einführung des spätrömischen Rechtes (von Flavius Justitianus kodifiziert) und des Kirchenrechtes (Codex juris canonici) hatte als Resultat, daß der Boden veräußerlich geworden ist, was die Lebenssicherheit der Bevölkerung in Gefahr bringt. So sind auch die Grundlagen der Identität erschüttert. Diese kann sich in der Präkarität nicht optimal entfalten.
Hauptaufgabe der Identitätsbewußten Kräfte der europäischen Geschichte wurde also, diese Präkarität zu beseitigen, damit die geistigen Kräfte sich entfalten können. Die blutigen Etappen dieses Kampfes lässen sich makaber aufzählen: Westfälische Bauerrevolte in 1193, die Revolte der Stedinger in 1234, die Bauernrevolten des XV. Jahrhunderts (Deutschland, Böhmen, England), der große deutsche Bauerkrieg (1525/26), die Aufhebung der niederländischen Städte gegen den spanisch-absolutistischen Joch, die gleichzeitige Revolte der Spanier und Katalanen gegen die königlichen Beamten, die französischen und normandischen Aufhebungen der sog. Croquants und Nouveaux Croquants im XVI. Jahrhundert. Alle diese blutig niedergemetzelten Aufhebungen wollten das alte ureuropäische Recht mit dem Prinzip der Unveräußerlichkeit des Bodens wieder einführen.
Wenn während und besonders am Ende des Mittelalters die Figur des Bürgers sich auf der Vorszene hebt, bedeutet das keineswegs das Verschwinden des impliziten Individualismus des hier obenerwähnten spätrömischen Rechtes. Die Städte waren am Anfang Zufluchtsort für besitzlose Bauern. Dort konnten sie innerhalb neuer städtischer Gemeinschaften bzw. Zünfte arbeiten und ihre eventuell angeborene Genie gelten lassen. Zur gleichen Zeit schwärmten aber in diesen mittelalterlichen Städten Spekulanten aller Art, die bald mit den Fürsten Front gegen die Zünfte und die ländliche Bevölkerung machen. Statt dem Willkür des Feodalismus einen Riegel zu setzen, verstärkt diese Spekulantenkaste noch straffer den impliziten Individualismus in Europa. Max Hildebert Boehme schreibt, daß das germanische Rechtsempfinden die Gesellschaft pluralistisch fasst, so daß die verschiedene Körperschaften, aus denen jede bestimmte Gesellschaft besteht, von einer konkreten Autonomie genießen (2). Aber «bereits gegen Ende des Mittelalters setzt sich das etatistische Gegenbewung spätrömischer Prägung durch. Die Fürstengeschlechter richten mit Hilfe der geldspendenden Spekulanten eine absolute Herrschaft im Staate auf, die im allgemeinen in der Richtung einer Straffung der Staatsgewalt und einer Schrumpfung gesellschaftlicher Autonomie wirkt. Nicht im "finstern Mittelalter", sondern in der "aufgeklärten" Neuzeit verfallen weite Teile des Volkes in drückende Leibeigenschaft, und auch der religiöse Befreiungskampf der reformatoren hat zunächst nur einen verstärkten Gewissensdruck des Staates zur Folge. Namentlich im Umkreis des spanischen und französischen Einflusses entwickelt sich zwischen Staat und Volk eine polare Gegensätzlichkeit und scharfe Spannung, die sich dann vor allem in der französischen Revolution entlädt. Durch sie erhält zwar der Gedanke der absoluten Fürstenherrschaft, keineswegs aber die Staatsgewalt selber den entscheidenden Stoß. Das eigentliche Opfer dieser Entwicklung ist die korporative Volksfreiheit, die Volksautonomie, die durch den grundsätzlichen Individualismus und Unitarismus (bzw. Zentralismus) des romanischen Denkens zutiefst in Frage gestellt wird. Das Volk macht sich —ganz im Sinne der Theorie von Rousseau— nicht autonom, sondern souverän. Es sichert einen staatsfreien Raum den Menschenrechten im Sinne des neuzeitlichen Individualismus und nicht den Gesellschafts- und Körperschaftsrechten» (M.H. Boehm, op. cit., S. 32-33).
In einem solchen historischen Kontext, heißt Freiheit angepaßte ortsverbundene bzw. konkrete Sozialitäten schaffen, genauso wie die erste städtische Gemeinschaften Europas, neue konkrete Sozialitäten gegenüber der karolingisch-feudalen Entwurzelung waren. Der Brüsseler Historiker Alphonse Wauters in seinem wichtigen Buch Les libertés communales (Brüssel, 1878) (3) erklärt wie die mittelalterlichen Kommunen Orte der volksverbundenen Kreativität waren. Seine historische Entdeckungen und seine Analyse der Quellen ergänzen glänzend die Theorien des Volkhaften und Volklichen bei Max Hildebert Böhm (4). Die Entstehung der mittelalterlichen Kommunen entspricht die Entstehung einer institutionsschaffenden Freiheit, die der kürzlich verstorbene deutsche Professor Bernard Willms, in Anlehnung an Hobbes, als die Grundfreiheit des Menschen als politisches Wesen theorisiert hatte (5). Wenn die menschliche Grund- und Urfreiheit darin besteht, Institutionen bzw. institutionnelle Begrenzungen zu schaffen, dann ist sie eben konkrete Freiheit. Abstrakt und steril bleibt aber eine absolute konzipierte Freiheit, weil diese dann unproduzierend/unfruchtbar inmitten eines dschungelhaften «Naturzustandes» bleibt. In einem solchen von Hobbes meisterhaft theorisierten dschungelhaften Naturzustand kann die Freiheit sich eben nicht entfalten, weil alle ihre Freiheit absolut gelten lassen wollen. Jede raum- bzw. ortsverbundene Gemeinschaft produziert also seine bedingte aber nur so mögliche Freiheit, damit die positiv-nützlich-notwendigen Eigenschaften der Gemeinschaft sich optimal entfalten können.
Das Denken von Hobbes entsteht in einem Europa, das alle religiösen Stützen verloren hat und mit den harten nackten Fakten der Freiheit und des durch Bürgerkriegen wiedergekommenen Naturzustandes konfrontiert wurde. Die Illusion der mittelalterlichen theologischen Zeitalter war verschwunden. Aber der Mensch liebt die Illusionen, so billig diese sein könnten. Die großen illusionslosen Denker des 17. Jahrhunderts (Hobbes, Balthasar Gracian, Pascal, Galilei, Giordano Bruno) haben künftig nicht viele Schüler gehabt. Eine neue Illusion —die Aufklärung— ist gekommen, um den Europäern eine grenzenlose d. h. abstrakte Freiheit zu versprechen. Die aufklärerische Denkweise ist insofern pervers, daß sie alle Institutionen als irrational gegründet ablehnt bzw. kritisiert. Wenn diese Denkweise mittlerweile metapolitisch Fortschritte macht, können die Institutionen nicht mehr optimal funktionnieren. Einige Anhänger der aufklärerischen Denkweise meinen manchmal richtig, daß die Institutionen, die unter der Kritik der Auklärer untergehen, schon im voraus morsch sind. Aber die Aufklärung ist allzuoft nur Kritik und schafft deshalb nicht die Bedingungen einer Rekonstruktion neuer Institutionen nach dem Verschwinden der alten und morschen Institutionen. So kentert die ganze europäische Ideologie in den Schablonen der Abstraktheit und der Unfruchtbarkeit. Pedagogisch gesehen ist also die aufklärerische Denkweise nicht für den Menschen als civis, als zoon politikon geeignet. Da die ganze Philosophiegeschichte seit Aristoteles den Menschen primär als zoon politikon, als politisches Wesen, betrachtet, kann man sich wohl fragen, ob die aufklärerische Besessenheit noch eigentlich über ihre üblichen Phrasen menschlich ist.
Die Anhänger der Aufklärungsideologie behaupten, ihre philosophische Grundlagen haben dazu beigetragen, die freiheitlichen Institutionen der französischen Revolution zu schaffen. Alle wertfreien Historiker sind aber der Meinung, daß nach zwanzig Jahre aufklärerischer Regime Frankreich definitv geschwächt wurde. Die Aufhebung des Zünftwesens durch die Gesetze von Le Chapelier in 1791 ohne entsprechende Einführung eines preußisch-ähnlichen allgemeinen Erziehungswesens hat zu einer kompletten Desorganisation der konkreten Sozialität Frankreichs geführt und damit in den folgenden Jahrzehnten zu einem gewerblichen Rückzug, die noch heute deutliche Spuren hinterläßt. Die Bauernschaft wurden wie bekannt nicht gespart. Besonders im Westen des Landes wollten die Bauern ihr uraltes Gemeinwesen bewahren, d.h. frei über ihr eigenes Schicksal entscheiden. Dieser ortsverbundener Wille paßten die grenzenlosen bzw. universellen Prinzipien der Aufklärung nicht. So entschieden sich an die Macht gekommene Pariser Intellektuellen aufklärerischer Prägung für eine «Entvölkerungsstrategie» in den aufständischen Gebieten der Bretagne, der Vendée und des Anjous. Etwa 300.000 unschuldige Dorfbewohner (Erwachsene und Kinder beider Geschlechter) dieser westfranzösischen Region wurden so einfach massakriert. Konkrete ortsverbundene Menschen hatten sich gegen Abstrakte Ideen rebelliert.
In den von den Revolutionsarmeen eroberten germanischen Gebieten —die südlichen Niederlanden und Rheinland— gibt es am Anfang eine wahre Begeisterung für die Revolutionsideen. Tatsächlich verkünden der französische General Dumouriez und seine Freunde, die in Jemappes (Hennegau) die kaiserlichen Armeen besiegen und kurz danach ihren Eintritt in Brüssel machen, daß künftig die Gemeindeversammlungen ihre Bürgermeister und deren Berater direkt für einen Jahr wählen wurden. Dieser Wahlmodus wird generell in Flandern, Brabant und Rheinland akzeptiert. Aber die Pariser Behörden führen dieses rein demokratisches Prinzip nicht ein. Die Convention entscheidet sich, für die Benennung der Bürgermeister ohne Wahl. Entscheidungsort dieser Benennung: Paris, Hauptstadt der triumphierenden politischen Aufklärung! Dumouriez, ein ehrlicher Mann, nimmt Abschied und flüchtet nach Preussen. Verlooy, ein Schüler Herders, der inzwischen Bürgermeister von Brüssel geworden war, verlässt auch seine Heimat. Viele deutschen Intellektuellen aus dem Rheinlande, unter denen Görres, folgen dem gleichen Pfad. Diese Revolutionsbefürwörter sind sehr schnell Revolutionsfeinde geworden, eben weil die Revolution alle Ortsverbundenheit ablehnte. Die Einführung des hier oben erwähnten Wahlmodus hätte die diversen und differenzierten Wirklichkeiten Europas die Möglichkeit gegeben, sich gelten zu lassen. Ein solcher Wahlmodus rechnet mit den unentbehrlichen Faktoren Raum und Zeit. Jeder Ort hat seine eigene Dynamik. Was hier gilt, gilt nicht notwendigerweise dort. Hier ist der Boden sandig und karg, hier gibt es kaum Verkehr und dort ist der Boden fruchtbar und fett und die Nähe eines Flußes verschnellt den Verkehr. Die Bedürfnisse der verschiedenen Orte sind deshalb grundverschieden und brauchen konsequenterweise eine angepaßte Modulierung. Der am Anfang des Revolutionsprozeßes vorgeschlagene Wahlmodus war eben eine solche Modulierung. Die deutsche Bewegung mit Arndt und Freiherrn von Stein, die südniederländisch-belgischen Traditionalisten-Demokraten (Die zwei Generationen von Rechtsanwälten der Familien Raepsaet aus Gent und Dumortier aus Tournai/Doornik) wurden während der Restauration —die eben nichts restauriert— die energischen Vorkämpfer eines solchen angepaßten Wahlmodus.
Die Aufklärung wurde auch schon von Kant —dem kühnsten Denker der Aufklärung aber auch zur gleichen Zeit demjenigen, der die Unzulänglichkeiten der Aufklärung am scharfsten gesehen hat— als zu mechanistisch beurteilt. In seiner Kritik der Urteilskraft (1790), unterscheidet Kant die Naturprodukte und die Kunstprodukte. Die Naturprodukte sind keine Produkte eines willkürlichen Willens. Nur Kunstprodukte sind Produkte eines Willens, der sich außerhalb des Produktes selbst befindet. Naturprodukte sind simultan Ursache und Wirkung ihrer selben. Die aufklärerisch-mechanizistischen Denkweise betrachtete die Staaten und Nationen als Uhrwerke, die von dem Wille oder der Laune eines außerlichen Souveräns bzw. Fürsten abhingen. Die Aufklärung ist also nicht demokratisch. Ihre politische Modalität ist die der aufgeklärten Despotie. Die französische Revolution und besonders die Convention übernehmen bloß diese Modalität ohne Achtung für was Kant die innerliche bildende Kraft eines Naturprodukte genannt hat. Die Nationen und Völker sind eben Naturprodukte, die von einer innerlichen bildenden Kraft beseelt sind. Der von Dumouriez, Verlooy und Görres suggerierte Wahlmodus implizierte eben eine Achtung für diese innerliche bildende Kraft, die von Ort zu Ort und Zeit zu Zeit variiert. Die aufklärerische Convention ist diesen unersetzlichen Kräften gegenüber taub und blind geblieben. Der romantische Protest in Deutschland ist politisch betrachtet ein Wille, diese Kraft freie Bahn wiederzugeben und zu gestalten bzw. organisieren. Aus dieser Perspektive gesehen, gestaltet die Aufklärung nicht: sie ist unfruchtbar und autoritär im schlechtsten Sinne des Wortes. Das anti-autoritäre Pathos der zeitgenössischen Aufklärung ist deshalb bloße Tarnung, ist auch der Spur eines schlechten Gewissens. Wenn sie bis zur letzten Konsequenz durchgeführt wird, bringt sie die Menschheit in einer neuen Naturzustand, wo eine moderne Fassung des Nomadismus herrscht. Die aktuelle Beispiele der Melting-Pot-Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, der Unsicherheit der Pariser Vorstädten und des Hooliganismus in Großbritanien zeugen dafür.
Wenn man von diesen Fakten bewußt ist, was sollte man tun? Eine geortete Gemeinschaft zu organisieren heißt heute eine Sozialpolitik neuer Art vorzuschlagen, da die herrschenden Systeme eben zu einem erneuten Naturzustand tendieren. Produkt der Aufklärung ist nämlich die Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Diese Déclaration ist eine Mischung von aufklärerischem Gedankengut und allgemeingültigen Prinzipien. Da kürzlich bekannte französische Historiker wie Jean-Joël Brégeon und Reynald Sécher die Perversität der politischen (conventionnel) Aufklärung erörtet haben, dadurch daß sie die Logik der Entvölkerung hervorgehebt haben, brauchen wir hier nicht die aufklärerische Elemente zu analysieren sondern nur die Allgemeingültigen. Diese schaffen die feudalen Reste aus dem Weg. Und das bedeutet konkret, daß jeder Bürger wieder das Recht hat, das Seine zu genießen als Mitglied einer Gemeinschaft. Als Mitlglied einer Gemeinschaft hätte er ein Allod bekommen und die Gesamtgemeinschaft hätte wieder seine Allmende als Lebenssicherheit haben müssen. Die Convention hat alle kirchliche und aristokratische Güter den reichen Parvenüs verkauft, ohne eine soziale Umverteilung einzuleiten! Damit konfiziert die undemokratische Revolution dem Volke seine Nahrungsfreiheit. Die feudalen Herren werden durch miserablen Parvenüs ersetzt. Darum hat Proudhon vom Eigentum als Diebstal geredet. Der Sozialismus des 19. Jahrhundert, bevor er oligarchisiert wurde (s. Roberto Michels), hat nur eine Teilumverteilung verursacht. Der Kommunismus verstaatlicht alles, was am Ende bedeutet, daß nur die Parteifunktionäre Eigentümer werden.
Die heutige Diskussion über das garantierte Grundeinkommen (Opielka in D.; Gorz in F.) in linken non-konformistischen Kreisen wäre eine Lösung, besonders wenn man dazu ein Wahlsystem schweizerisches Modell hinzufügt. Aber solange die Gruppierungen der Linken noch von aufklärerisch-autoritären Ideen verseucht bleiben, ist diese Lösung nicht möglich. Ein garantierte Grundeinkommen an jedem Bürger als Ersatz der Allmende wäre nur möglich in Europa, solange die Bürgerschaft begrenzt gewährt wird. Die Linke kann also nicht konkret das garantierte Grundeinkommen vorschlagen und zur gleichen Zeit die Asylantenflut bejahen. Diese letzte wurde bloß dieses Grundeinkommen lächerlich und jammerlich reduzieren, sodaß die jahrhundertelange Entfremdung doch erhalten bleibt. Um jeder Bürger das Seine zu geben, muß man notwendigerweise und arithmetischerweise den Zugang zur ortsgebundenen Bürgerschaft beschränken. Wie Reinhold Oberlercher es sagte, die Freizügigkeit ist wohl eine der Todsünde der Aufklärung, da sie die Lösung der sozialen Frage unmöglich macht. Hier auch sind Schranken notwendig um eine konkrete Aktion durchführen zu können und auch um überhaupt Politik treiben zu können.
Das garantierte Grundeinkommen muß minimal bleiben, damit man nicht davon leben kann, aber damit man trotzdem etwas zum Überleben hat im Ernstfall, wie in vorfeudaler Zeit unsere Bauern ihren Allod hatten. Die Einführung eines garantierten Grundeinkommen ist durchaus möglich, da unsere Staaten dann keine Arbeitslosigkeitszulagen zahlen werden und auch keine Verwaltung dieser Arbeitslosigkeit finanzieren müssen. Durch eine angepaßte Steuerpolitik kann dann der Staat ohne Mühe die Gelder bei denen, die es nicht nötig haben, wieder einkassieren. Diese Regulierung verlangt auch keinen Abbau der sozialen Sicherheit, wie die neo-liberale Welle es vorgeschlagen hatte.
André Gorz, französischer Befürworter des garantierten Grundeinkommens, fügt hinzu, daß dieses Einkommen es für viele Leute ermöglichen würde, andere nicht gewinnbringende Aktivitäten zu leisten, z. B. ökologische sinnvolle Aktivitäten oder die Bildung von Netzen für Kinderversorgung, die dann einfach und problemlos privatisiert werden könnten. Die Bürger werden dann spontan mehr Zeit haben, für lebenswichtige Sachen: die ökologische Nische sauberer halten und ihre Kinder versorgen. Die sozialen Kosten der Verschmutzung und der psychologischen Amoklaufen bei Kindern sind erheblich höher als was ein allgemein garantierten Grundeinkommens dem Staate kosten wurde.
Mit dem garantierten Grundeinkommen als Recht des Bürgers in einer begrenzt gehaltenen Gemeinschaft, sind die Gefahren der Aufklärung, dieser Religiosität der Schrankenlosigkeit, nicht gebannt und ausgeschloßen. Der durch Kredit gefördete Konsum würde die Gelder des garantierten Grundeinkommens rasch aufsaugen. Deshalb muß der Staat als Organisationsinstrument der Sozialität Gesetze einführen, damit Kredite nicht wahllos gewährt werden, besonders an Leuten die diese nur für Konsum benutzen. Solch Gesetze wollte zwei oder drei Jahre her der wallonische Minister Busquin einführen. Sein Projekt ist von den Banken und konservativ-bornierten Politikern torpediert worden.
Die Grundlagen des egalitären Denkens liegen also in der «Entgemeinschaftungspraxis» des Feudalismus und in dem mechanizistischen Denkmuster der Aufklärung, und nicht notwendigerweise im Gedankengut der sozialistischen Tradition, eben wenn die linken Gruppierungen einen egalitären Diskurs entwickelt haben, die Ungleicheiten schafft. Egalitarismus im Sinne des Verfassers bedeutet selbstverständlich nicht Gleicheit der Chancen. Das ist eben, was er verallgemeinen will. Egalitarismus ist eher diese gefährliche Ablehnung aller differenzierenden Ortsverbundenheiten, die Zeit und Raum ständig produzieren. Wenn alle Räume der Erde gleichgeschaltet und gezwungen unter den gleichen Mustern ent-organisiert werden, dann ist Chancengleicheit eben unmöglich, da diese nur in einem raum- und zeitlich bedingten Rahmen erreicht werden kann. Der Mensch, als begrenztes Wesen, kann nur Verantwortung für etwas Begrenztes übernehmen. Da der Mensch kein Gott bzw. kein allmächtiges Wesen ist, kann er nur teilmächtig handeln. Der Mensch kann also nur in einem begrenzten Raum und, da er sterblich ist, in einer begrenzten Zeit handeln und nicht universell. Universell denken und handeln wollen heißt deshalb unverantwortlich weilk ortlos denken und handeln. Die große Ideen der Brüderschaft, der Caritas, der Menschenrechte können nur von Menschen in begrenzten Räumen verwirklicht werden. Diese großen Ideen sind nur konkret möglich, wenn man sie im nahen Ort wo man bei Geburt geworfen worden ist und nur da —um die Sprache des alemanischen Philosophen Martin Heidegger nachzuahmen— zu verwirklichen versucht. Dieser Ort bleibt für Jeden Sprungbrett in der nahen oder fernen Welt. Die sockellosen Ideologien, sei es die ortfremde Religion im Frühmittelalter oder die gewollt ortlose Aufklärung, verpassen die Möglichkeit, etwas von der ideellen Caritas oder der ideellen Chancengleicheit zu verwirklichen.
Fazit: die differentialistische Alternative verlangt Verantwortung für den Mitmenschen im Ort wo man bei Geburt geworfen worden ist und Aufmerksamkeit für die Geräusche der Welt. Gewiß keine Sackgasse, da die Möglichkeiten dieser Welt unendlich sind, nur wenn man die schöne bunte Welt nicht mit herzlosen Schablonen gleichschalten will.
Die multikulturelle Gesellschaft kann dadurch nicht fließend funktionnieren, da sie nämlich eine Gesellschaft und keine Gemeinschaft ist. Harmonie kommt immer nur relativ und mit der Zeit und nicht wenn ständig neue Menschenwellen unordentlich strömen. Der langfristige Prozeß der «Vergemeinschaftung» ist in solchen Umständen unmöglich. Sobald einige Schichten in einer bestimmten Gemeinschaft assimiliert bzw. «vergemeinschaftet» sind, warten noch unruhige und ungeduldige Schichten auf diese versprochene Assimilation, die nur mit langer Zeit zu erreichen ist. Manche Ideologe und Politiker meinen, daß mit einer formellen und verschnellten Einbürgerung eine Lösung zu finden ist. Das ist eine aufklärerische Illusion, die keine Rechnung mit dem äußerst wichtigen Faktor Zeit rechnet. Notwendig wäre, die Substanz der Gesetzgebungen in Europa, die nur die Staatsbürgerschaft nach Fristen von 20 bis 30 Jahren gewährten, mit Aufmerksamkeit zu studieren. Diese Gesetzgebungen waren orts- und zeitbewußt. Die Wiedergeburt Europas braucht keine großen und pompösen Phrasen. Nur ein sachliches, ruhiges Orts- und Zeitsbewußtssein.
Fußnoten:
(1) Boris Porchnev (franz. Schreibweise für «Porschnew»), Les soulèvements populaires en France au XVIIième siècle, Paris, Flammarion, 1972; Gérard Walter, Histoire des Paysans de France, Paris, Flammarion, 1963; Paul Bois, Paysans de l'Ouest, Paris, Flammarion, 1971; Yves-Marie Bercé, Révoltes et révolutions dans l'Europe moderne, XVIième-XVIIIième siècle, Paris, PUF, 1980; Hervé Luxardo, Les Paysans. Les républiques villageoises, 10ième-19ième siècles, Paris, Aubier, 1981; Karl-Ludwig Schibel, Das alte Recht auf die neue Gesellschaft. Zur Sozialgeschichte der Kommune seit dem Mittelalter, Sendler, Frankfurt a.M., 1985.
(2) Max Hildebert Boehm, Das eigenständige Volk, 1923.
(3) Alphonse Wauters, Les libertés communales. Essai sur leur origine et leurs premiers développements en Belgique, dans le Nord de la France et sur les bords du Rhin, Brüssel, 1878 (reprint: Brüssel, 1968).
(4) Für Max Hildebert Boehm ist das Völkische die biologische Grundlage des Volkes; das Volkhafte ist die soziale Grundlage des Volkes und das Volkliche ist die synthetische Gesamtgrundlage aller konstitutiven Elemente des Volkes.
(5) Bernard Willms, s. Idealismus und Nation, 1986; ders., Thomas Hobbes. Das Reich des Leviathan, 1987.
Kurze Biographie:
Robert STEUCKERS
Geboren am 8. Januar 1956 in Ukkel-bei-Brüssel. Verheiratet. Hat einen Sohn: Cedrik (1988). Hat Germanistik und Anglistik studiert. Diplomübersetzer ILMH (Brüssel). Diplomarbeit über den Begriff «Ideologie» bei Ernst Topitsch. 1981: Redaktionssekretär von Nouvelle Ecole (Paris). Gründet die Zeitschriften Orientations (1982) und Vouloir (1983). Leitet sein eigenes Übersetzungsbüro in Brüssel seit 1985. Wissenschaftlicher Mitarbeiter des «Presses Universitaires de France» seit 1990. Ständiger Mitarbeiter der Zeitschriften Nouvelle Ecole (Paris), Dissident (Gent), Trasgressioni (Florenz), Diorama Letterario (Florenz), Elementi (Finale Emilia), Nationalisme et République (La Roche d'Anthéron), Elemente (Kassel), The Scorpion (London/Köln). Mitglied der Abteilung «Studien und Forschungen» des «Groupement de Recherches et d'Etudes sur la Culture Européenne» (Paris).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ethnopolitique, démocratie, philosophie, sociologie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 14 août 2008
Essai de typologie des extrémismes

Essai de typologie des extrémismes
Uwe BACKES, Politischer Extremismus in demokratischen Verfassungsstaaten. Elemente einer normativen Rahmentheorie, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1989, 385 S., DM 52, ISBN 3-531-11946-X.
Né en 1960, docteur en sciences politiques, enseignant à l'Université de Bayreuth, Uwe Backes s'est imposé comme l'un des principaux analystes de l'extrémisme politique en Europe. Son ouvrage de base, qui permet de rénover entièrement l'approche scientifique des phénomènes d'extrémisme, commence par une critique des méthodes conventionnelles de recherche en ce domaine. Celles-ci partaient généralement d'a priori idéologiques, 68 oblige, opéraient une confusion permanente des concepts, retraçaient des généalogies lacunaires, transposaient dans le présent des concepts qui ne valaient que pour des phénomènes du passé, manipulaient des schémas interprétatifs monocausaux et refusaient trop souvent de recourir à des fertilisations croisées entre les recherches posées dans divers pays (le «provincialisme scientifique»). L'auteur passe ensuite à une phénoménologie générale des extrémismes politiques.
A «gauche», il distingue un filon communiste et un filon anarchiste. Dans le filon communiste, il met les subdivisions suivantes en exergue: marxisme, léninisme, stalinisme, trotskisme, maoïsme, communisme de gauche (luxembourgisme et conseillisme), nouvelle gauche et eurocommunisme. Dans le filon anarchiste, il distingue la zone de flou entre l'anarcho-communisme et l'anarcho-libéralisme, l'anarcho-syndicalisme et l'anarchisme pragmatique.
A «droite», espace du «conservatisme antidémocratique», il distingue quatre filons: 1) le monarchisme; 2) le nationalisme; 3) le conservatisme révolutionnaire et le fascisme; 4) la xénophobie et le racisme. Dans le filon nationaliste, le plus diversifié des quatre, Uwe Backes repère les tendances suivantes: l'insistance sur la notion de communauté (communauté culturelle, idéologique et raciale), le binôme ethnocentrisme/ethnopluralisme, le séparatisme (il entend les mouvements régionalistes, y compris ceux qui recourent à la violence) et le populisme (avec une analyse du caractère populiste mâtiné d'ethnocentrisme repérable dans le discours de Le Pen).
Dans un quatrième chapitre, Uwe Backes dresse une typologie des modes d'organisation extrémistes; il y a les cercles de théoriciens, les associations traditionalistes, les activistes isolés, les sectes politiques, les groupes terroristes, les mouvements rassembleurs et les partis de cadres. Enfin, dans un cinquième chapitre, Backes procède à une analyse critique des caractéristiques majeures des doctrines extrémistes; elles prétendent toutes détenir les clefs de l'absolu, tant dans leurs phases offensives que dans leurs phases défensives. Elles reposent sur un dogmatisme; elles visent une utopie ou rejettent catégoriquement le principe utopique. Backes examine ensuite les stéréotypes de l'ami et de l'ennemi qu'elles génèrent. Il nous parle des théories de la conspiration —souvent motrices dans l'aire des extrémismes— du fanatisme et de l'activisme.
Au départ de tous ces éléments, il est possible de formuler une théorie complexe et complète de l'extrémisme et d'appliquer à chacun des phénomènes particuliers une grille d'analyse objective (Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, extrémisme, allemagne, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 août 2008
Intervista a Julius Evola (La Nation européenne, 1967)
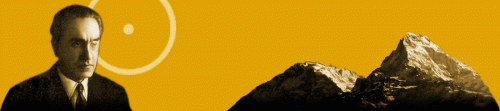 |
| Un pessimismo giustificato? Intervista a Julius Evola di Franco Rosati Lei crede che esista un rapporto tra la filosofia e la politica? Una filosofia può influire su un'impresa di ricostruzione politica nazionale o europea? Io non credo che una filosofia intesa in senso strettamente teorico possa influire sulla politica. Perché eserciti un'influenza, bisogna che essa si incarni in un'ideologia o in una concezione del mondo. E' quanto è avvenuto, per esempio, con l'illuminismo, col materialismo dialettico marxista e con certe concezioni filosofiche che erano incorporate nella concezione del mondo del nazionalsocialismo tedesco. In generale, l'epoca dei grandi sistemi filosofici è terminata; non esistono più che filosofie bastarde e mediocri. A una delle mie opere passate, del mio periodo filosofico, io avevo posto in esergo queste parole di Jules Lachelier: "La filosofia (moderna) è una riflessione che ha finito per riconoscere la propria impotenza e la necessità di un'azione che parta dall'interno" (nota 1). Il dominio proprio di un'azione di questo tipo ha un carattere metafilosofico. Di qui, la transizione che si osserva nei miei libri, i quali non parlano di "filosofia", ma di "metafisica", di visione del mondo e di dottrine tradizionali. Lei pensa che morale ed etica siano sinonimi e che debbano avere un fondamento filosofico? E' possibile stabilire una distinzione, se per "morale" si intende propriamente il costume e per "etica" una disciplina filosofica (quella che viene chiamata la "filosofia morale"). A mio parere, qualunque etica o qualunque morale voglia avere un fondamento filosofico di carattere assoluto, è illusoria. Senza riferimento a qualcosa di trascendente, la morale non può avere che una portata relativa, contingente, "sociale" e non può resistere ad una critica dell'individualismo, dell'esistenzialismo o del nichilismo. Lo ho dimostrato nel mio libro Cavalcare la tigre, nel capitolo intitolato Nel mondo dove Dio è morto. In questo capitolo ho anche affrontato la problematica posta da Nietzsche e dall'esistenzialismo. Lei crede che l'influenza del Cristianesimo sia stata positiva per la civiltà europea? Non pensa che l'aver adottato una religione d'origine semitica abbia snaturato certi valori europei tradizionali? Parlando di Cristianesimo, ho spesso usato l'espressione "la religione che è venuta a prevalere in Occidente". Infatti il più grande miracolo del Cristianesimo è di essere riuscito ad affermarsi tra i popoli europei, anche tenendo conto della decadenza in cui erano piombate numerose tradizioni di questi popoli. Tuttavia non bisogna dimenticare i casi in cui la cristianizzazione dell'Occidente è stata soltanto esteriore. Inoltre, se il Cristianesimo ha, senza alcun dubbio, alterato certi valori europei, vi sono anche dei casi in cui questi valori sono risorti dal Cristianesimo rettificandolo e modificandolo. Altrimenti il cattolicesimo sarebbe inconcepibile nei suoi diversi aspetti "romani"; allo stesso modo sarebbe inconcepibile una parte della civiltà medioevale con fenomeni quali l'apparizione dei grandi ordini cavallereschi, del tomismo, una certa mistica di alto rango (per esempio Meister Eckhart), lo spirito della Crociata ecc. Lei pensa che il conflitto tra guelfi e ghibellini nel corso della storia europea sia qualcosa di più che non un semplice episodio politico e costituisca un conflitto tra due diversi tipi di spiritualità? Ritiene possibile una recrudescenza del "ghibellinismo"? L'idea che alle origini della lotta tra l'Impero e la Chiesa non vi sia stata soltanto una rivalità politica, ma che questa lotta traducesse l'antinomia di due diversi tipi di spiritualità, questa idea costituisce il tema centrale del mio libro Il mistero del Graal e la tradizione ghibellina dell'Impero. Questo libro è stato edito in tedesco e uscirà presto anche in francese. In fondo, il "ghibellinismo" attribuiva all'autorità imperiale un fondamento di carattere soprannaturale e trascendente quanto quello che la Chiesa pretendeva di essere la sola a possedere (Dante stesso difende in parte la medesima tesi). Così certi teologi ghibellini poterono parlare di "religione regale" e, in particolare, attribuire un carattere sacro ai discendenti degli Hohenstaufen. Beninteso, l'Impero cristallizzava un tipo di spiritualità che non poteva essere identificato con la spiritualità cristiana. Ma se questi sono i dati del conflitto guelfi-ghibellini, è chiaro, allora, che una resurrezione del "ghibellinismo" alla nostra epoca e molto problematica. Dove trovare, infatti, i "riferimenti superiori" per opporsi alla Chiesa, se ciò non avviene in nome di uno Stato laico, secolarizzato, "democratico" o "sociale", sprovvisto di ogni concezione dell'autorità proveniente dall'alto? Già il "Los von Rom" e il "Kulturkampf" del tempo di Bismarck avevano soltanto un carattere politico, per non parlare delle aberrazioni e del dilettantismo di un certo neopaganesimo. Nel suo libro Il Cammino del Cinabro, dove è esposta la genesi delle sue opere, lei ammette che il principale difensore contemporaneo della concezione tradizionale, René Guénon, ha esercitato una certa influenza su di lei, al punto che la hanno definita "il Guénon italiano". Esiste una corrispondenza perfetta tra il suo pensiero e quello di Guénon? E non crede, a proposito di Guénon, che certi ambienti sopravvalutino la filosofia orientale? Il mio orientamento non differisce da quello di Guénon per quanto concerne il valore da attribuire al Mondo della Tradizione. Per Mondo della Tradizione bisogna intendere una civiltà organica e gerarchica in cui tutte le attività sono orientate dall'alto e verso l'alto e sono improntate a valori che non sono semplicemente valori umani. Come Guénon, io ho scritto diverse opere sulla sapienza tradizionale, studiandone direttamente le fonti. La prima parte della mia opera principale Rivolta contro il mondo moderno è appunto una "Morfologia del Mondo della Tradizione". Vi è anche corrispondenza tra Guénon e me per quanto concerne la critica radicale del mondo moderno. Su questo punto vi sono tuttavia delle divergenze minori tra lui e me. Data la sua "equazione personale", nella spiritualità tradizionale Guénon ha assegnato alla "conoscenza" e alla "contemplazione" il primato sull'azione; egli ha subordinato la regalità al sacerdozio. Io, invece, mi sono sforzato di presentare e di valorizzare l'eredità tradizionale dal punto di vista di una spiritualità da "casta guerriera" e di mostrare le possibilità parimenti offerte dalla "via dell'azione". Una conseguenza di questi punti di vista differenti è che, se Guénon assume come base per una eventuale ricostruzione tradizionale dell'Europa una élite intellectuelle, io, per quanto mi concerne, sono piuttosto incline a parlare di un ordine. Divergono anche i giudizi che Guénon ed io diamo del Cattolicesimo e della Massoneria. Credo tuttavia che la formula di Guénon non si situi nella linea dell'uomo occidentale, il quale è malgrado tutto, per sua natura, orientato specialmente verso l'azione. Non si può qui parlare di "filosofia orientale"; si tratta piuttosto di modalità di pensiero orientali facenti parte di un sapere tradizionale che, anche in Oriente, si è conservato più integro e più puro ed ha preso il posto della religione, ma era parimenti diffuso nell'Occidente premoderno. Se queste modalità di pensiero valorizzano ciò che ha un contenuto universale metafisico, non si può dire che vengano sopravvalutate. Quando si tratta di concezione del mondo, bisogna guardarsi dalle semplificazioni superficiali. L'Oriente non comprende solo l'India del Vêdanta, della dottrina della Mâyâ e della contemplazione distaccata dal mondo; esso comprende anche l'India che, con la Bhagavad Gîtâ, ha dato una giustificazione sacrale alla guerra e al dovere del guerriero; comprende anche la concezione dualista e combattiva della Persia antica, la concezione imperiale cosmocratica dell'antica Cina, la civiltà giapponese, la quale è così lontana dall'essere unicamente contemplativa e introversa, che in Giappone una frazione esoterica del buddhismo ha potuto dar nascita alla "filosofia dei Samurai" ecc. Sfortunatamente, ciò che caratterizza il mondo europeo moderno non è l'azione, ma la sua contraffazione, vale a dire un attivismo privo di fondamento, che si limita al dominio delle realizzazioni puramente materiali. "Si sono distaccati dal cielo col pretesto di conquistare la terra", fino a non sapere più che cosa sia veramente l'azione. Il suo giudizio sulla scienza e sulla tecnica sembra, nella sua opera, negativo. Quali sono le ragioni della sua posizione? Non crede che le conquiste materiali e l'eliminazione della fame e della miseria permetteranno di affrontare con più energia i problemi spirituali? Per quanto riguarda il secondo punto da lei sollevato, dirò che, come esiste uno stato di abbrutimento dovuto alla miseria, così esiste uno stato di abbrutimento dovuto al benessere e alla prosperità. Le "società del benessere", nelle quali non si può più parlare di fame e di miseria, sono lungi dall'ingenerare un aumento della vera spiritualità; anzi, vi si constata una forma violenta e distruttiva di rivolta delle nuove generazioni contro il sistema nel suo insieme e contro un'esistenza sprovvista di ogni significato (USA-Inghilterra-Scandinavia). Il problema consiste piuttosto nel fissare un giusto limite, frenando la frenesia di un'economia capitalista creatrice di bisogni artificiali e liberando l'individuo dalla sua crescente dipendenza dall'ingranaggio sociale e produttivo. Bisognerebbe stabilire un equilibrio. Fino a poco tempo fa, il Giappone aveva dato l'esempio di un equilibrio di questo tipo; si era modernizzato e non si era lasciato distanziare dall'Occidente nei domini scientifico e tecnico, pur salvaguardando le sue tradizioni specifiche. Ma oggi la situazione è ben diversa. C'è un altro punto fondamentale da sottolineare: è difficile adottare la scienza e la tecnica circoscrivendole entro i limiti di mezzi materiali e di strumenti di una civiltà, vale a dire mantenendo, nei lori riguardi, una certa distanza; al contrario, è praticamente inevitabile che ci si impregni della concezione del mondo su cui si basa la moderna scienza profana, concezione che viene praticamente inculcata nei nostri spiriti dai metodi di istruzione abituali e che ha, sul piano spirituale, un effetto distruttivo. Il concetto stesso della vera conoscenza viene così ad essere totalmente falsato. Si è anche parlato del suo "razzismo spirituale". Qual è il significato esatto di questa espressione? Nella mia fase precedente, ho pensato bene di formulare una dottrina della razza che avrebbe impedito al razzismo tedesco e italiano di andare a finire in una sorta di "materialismo biologico". Il mio punto di partenza è stato la concezione dell'uomo come essere costituito di corpo, di anima e di spirito, con il primato della parte spirituale sulla parte corporea. Il problema della razza doveva dunque porsi per ciascuno di questi tre elementi. Di qui la possibilità di parlare di una razza dello spirito e dell'anima, oltre alla razza biologica. L'opportunità di questa formulazione risiede nel fatto che una razza può degenerare, anche restando biologicamente pura, se la parte interiore e spirituale è morta, diminuita o obnubilata, se ha perso la propria forza (come presso certi tipi nordici attuali). Inoltre gl'incroci, di cui oggi pochissime stirpi sono esenti, possono avere come conseguenza che ad un corpo di una data razza siano legati, in un individuo, il carattere e l'orientamento spirituale propri di un'altra razza, donde una più complessa concezione del meticciato. La "razza interiore" si manifesta attraverso il modo d'essere, attraverso un comportamento specifico, attraverso il carattere, per non parlare della maniera di concepire la realtà spirituale (i diversi tipi di religioni, di etiche, di visioni del mondo ecc. possono esprimere "razze interiori" ben distinte). Questo punto di vista consente di superare molte concezioni unilaterali e di allargare il campo delle ricerche. Per esempio, il giudaismo si definisce soprattutto nei termini di una "razza dell'anima" (di una condotta) unica, osservabile in individui che, dal punto di vista della razza del corpo, sono assai diversi. D'altra parte, per dirsi "ariani" nel senso completo della parola non è necessario non avere la minima goccia di sangue ebraico o di una razza di colore; bisognerebbe innanzitutto esaminare qual è la vera "razza interiore", ossia l'insieme di qualità che in origine corrispondevano all'ideale dell'uomo ario. Ho avuto occasione di dichiarare che, ai giorni nostri, non si dovrebbe insistere troppo sul problema ebraico; infatti, le qualità che dominavano e dominano oggi in diversi tipi di ebrei sono evidentissime in tipi "ariani", senza che per questi ultimi si possa invocare come attenuante la minima circostanza ereditaria. Nella storia d'Europa, vi sono stati diversi tentativi di formare un "Impero europeo": Carlo Magno, Federico I e Federico II, Carlo V, Napoleone, Hitler, ma nessuno è riuscito a rifare, in maniera stabile, l'Impero di Roma. Quali sono state, secondo lei, le cause di questi fallimenti? Pensa che oggi la costruzione di un Impero europeo sia possibile? Se no, quali sono le ragioni del suo pessimismo? Per rispondere, sia pure in maniera sommaria, a questa domanda, bisognerebbe poter disporre di uno spazio ben più grande che non quello di un'intervista. Mi limiterò a dire che gli ostacoli principali, nel caso del Sacro Romano Impero, sono stati l'opposizione della Chiesa, gl'inizi della rivolta del Terzo Stato (come nel caso dei Comuni), la nascita di Stati nazionali centralizzati che non ammettevano alcuna autorità superiore e, infine, la politica non imperiale ma imperialista della dinastia francese. Io non attribuirei, al tentativo di Napoleone, un vero carattere imperiale. Malgrado tutto, Napoleone è stato l'esportatore delle idee della Rivoluzione Francese, idee che sono state utilizzate contro l'Europa dinastica e tradizionale. Per quanto riguarda Hitler, bisognerebbe fare delle riserve nella misura in cui la sua concezione dell'Impero era fondata sul mito del Popolo (Volk = Popolo-razza), concezione che rivestiva un aspetto di collettivizzazione e di esclusivismo nazionalista (etnocentrismo). Fu solo nell'ultimo periodo del Terzo Reich che le vedute si allargarono, da una parte grazie all'idea di un Ordine, difesa da certi ambienti della SS, dall'altra grazie all'unità internazionale delle divisioni europee di volontari che si battevano sul fronte dell'Est. Per contro, non bisognerebbe dimenticare il principio di un Ordine europeo che è esistito con la Santa Alleanza (il cui declino fu imputabile in gran parte all'Inghilterra) e anche con il progetto chiamato Drei Kaiserbund, al tempo di Bismarck: la linea difensiva dei tre imperatori che avrebbe dovuto inglobare anche l'Italia (con la Triplice Alleanza) e il Vaticano e opporsi alle manovre antieuropee dell'Inghilterra e della stessa America. Un "Reich Europa", non una "Nazione Europa", sarebbe l'unica formula accettabile dal punto di vista tradizionale per la realizzazione di una unificazione autentica ed organica dell'Europa. Quanto alla possibilità di realizzare l'unità europea in questo modo, non posso non essere pessimista per le stesse ragioni che mi hanno indotto a dire che oggi c'è poco spazio per una rinascita del "ghibellinismo": non c'è un punto di riferimento superiore, non c'è un fondamento per dare saldezza e legittimità a un principio d'autorità sopranazionale. Non si può infatti trascurare questo punto fondamentale e accontentarsi di fare appello alla "solidarietà attiva" degli Europei contro le potenze antieuropee, passando sopra ad ogni divergenza ideologica. Anche quando si giungesse, con questo metodo pragmatico, a fare dell'Europa una unità, ci sarebbe sempre il pericolo di veder nascere, in questa Europa, nuove contraddizioni disgregatrici, in particolare per quanto concerne le divergenze ideologiche e per effetto della mancanza di un principio, posto come primordiale, di un'autorità superiore. "Comunità di destino" ha valore solo come parola d'ordine di carattere pratico. Oggi è difficile parlare di "comune cultura europea": la cultura moderna non conosce frontiere; l'Europa importa ed esporta "beni culturali"; non solo nel dominio della cultura, ma anche nel dominio del gusto, nel modo di vivere, si manifesta sempre più un livellamento generale che, coniugato con il livellamento prodotto dalla scienza e dalla tecnica, fornisce argomenti non a coloro che vogliono un'Europa unitaria, ma piuttosto a coloro che vorrebbero edificare uno Stato mondiale. Di nuovo, ci scontriamo con l'ostacolo costituito dall'inesistenza di una vera idea superiore differenziatrice, che dovrebbe essere il nucleo dell'Impero europeo. Al di là di tutto, il clima generale è sfavorevole: lo stato spirituale di devozione, di eroismo, di fedeltà, di onore nell'unità, che dovrebbe servire da cemento al sistema organico di un Ordine europeo imperiale è oggi, per così dire, inesistente. Il primo compito da eseguire dovrebbe essere una purificazione sistematica degli spiriti, antidemocratica e antimarxista, nelle nazioni europee. In seguito, bisognerebbe potere scuotere le grandi masse dei nostri popoli con mezzi diversi, sia facendo appello agli interessi materiali, sia con un'azione a carattere demagogico e fanatico che, necessariamente, solleciterebbe lo strato subpersonale e irrazionale dell'uomo. Questi mezzi implicherebbero fatalmente certi rischi. Ma tutti questi problemi non possono essere tratti in poche parole; d'altronde, ho avuto modo di parlarne in uno dei miei libri, Gli uomini e le rovine. Note 1. Per una svista, Evola attribuisce a Jules Lachelier la frase di Lagneau che egli aveva preposta a mo' di epigrafe al primo dei suoi Saggi sull'Idealismo Magico (Atanòr, Todi-Roma 1925): "La philosophie, c'est la réflexion aboutissant à reconnaître sa propre insuffisance et la nécessité d'une action absolue partant du dedans" (J. Lagneau, Rev. de Mét. et de Mor., mars 1898, p. 127). L'intervista che traduciamo qui di seguito apparve originariamente in francese, sui nn. 13 (15 dicembre 1966 - 15 gennaio 1967) e 14 (15 febbraio - 15 marzo 1967) del mensile "La Nation Européenne" (Parigi). Il periodico, diretto da Gérard Bordes, aveva come "conseiller politique" Jean Thiriart, che l'aveva fondato tra il 1965 e il 1966, e contava su una rete paneuropea di collaboratori. L'intervista, realizzata da Franco Rosati, era accompagnata da una foto e da una bibliografia francese della produzione evoliana ed era preceduta da una breve presentazione in cui, nonostante Evola venisse definito "uno dei più grandi pensatori europei (...) un caposcuola, un maestro", si prendevano le distanze nei confronti della sua "sfiducia verso l'avvenire unitario dell'Europa". Al testo dell'intervista seguiva, sul n. 14, una nota redazionale che esprimeva in termini chiarissimi la divergenza esistente fra il tradizionalismo di Evola e il pragmatismo di Thiriart. Infatti vi si leggeva tra l'altro: "La 'Tradizione', certo, è rispettabile. Vogliamo anzi ammettere che noi attingiamo da essa un certo modo di vedere il mondo e un certo metodo di azione. Ma non possiamo accettare di fare di questa 'Tradizione' un nuovo 'senso della storia' e ancor meno una Bibbia in cui è racchiuso tutto. Per noi, la verità si costruisce ogni giorno attraverso metodi e vie diverse. (...) La verità non è posta fin da principio come un faro che rischiara la via. Noi pensiamo piuttosto che, alla fine, la lenta e difficile scoperta della verità nasca, il più delle volte, dall'azione e grazie all'azione". Claudio Mutti |
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, italie, europe, julius evola, traditions, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les trois régions historiques de l'Europe
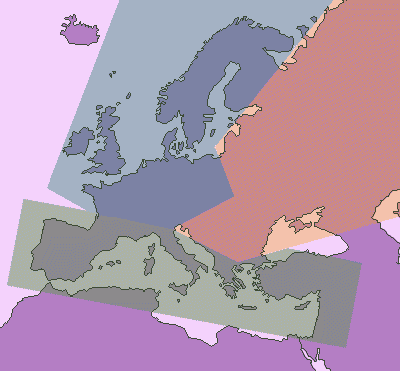
Les trois régions historiques de l'Europe
Jenö SZÜCS, Die drei historischen Regionen Europas, Verlag Neue Kritik, Frankfurt a.M., 1990, 107 S., DM 20, ISBN 3-8015-0240-6 (avec une préface de Fernand Braudel).
Dans sa préface, Fernand Braudel reconnaît la pertinence du découpage, par Jenö Szücs, de l'Europe en trois régions historiques: l'Europe occidentale, l'Europe orientale et la Mitteleuropa. Cette dernière oscillant en permanence entre les deux autres pôles. Cet espace du milieu focalise toute l'attention de l'historien hongrois. Il étudie les forces souterraines qui agitent en permanence cette portion centrale de notre continent, sans céder à la nostalgie facile du temps des Habsbourgs. Disciple de l'historien hongrois Istvan Bibo et de l'école française des Annales (Le Goff, Braudel, Duby), Szücs se réfère également à la théorie de l'absolutisme formulée par Perry Anderson et à la théorie de l'impérialisme d'Immanuel Wallerstein. Sur base de ce corpus théorique, Szücs détermine comme suit les coordonnées de l'Europe:
1) un «Occident», forgé par les Germains qui reprennent à leur compte l'héritage de Rome (500-800) et étendent leur sphère d'influence vers l'Est et le Nord (Scandinavie et Mitteleuropa orientale) entre 1000 et 1300;
2) une sphère d'influence byzantine, composée d'un bloc continental russe et d'une péninsule balkanique, soustraite à l'histoire européenne, déterminée par l'Ouest romano-germanique, d'abord par la présence byzantine puis par l'occupation ottomane.
A partir des temps modernes, l'Ouest s'étend aux Amériques et l'Est se prolonge, grâce aux conquêtes des Cosaques du Tsar, jusqu'au Pacifique. Coincée entre ces deux sphères, devenues démesurées: la Mitteleuropa, qui doit se défendre contre les grignotements occidentaux (conquête allemande, occupation française des côtes dalmates sous Napoléon), orientaux (les partages successifs de la Pologne) et ottomans (la défense de Vienne contre les Turcs). C'est cette dynamique qui, aujourd'hui encore, détermine les rythmes différents qui animent le sous-continent européen (Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, europe, affaires européennes, ecole des annales, fernand braudel, géographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 août 2008
Aymon de Savoie, Roi de Croatie

Erich KÖRNER-LAKATOS:
Aymon de Savoie, Roi de Croatie au temps du Poglavnik Pavelic
Le matin du 30 janvier 1948, le drapeau de l’Hôtel Plaza de Buenos Aires est en berne. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répand parmi les clients rassemblées dans la grande salle boisée des petits déjeuners: Aymon, Prince de Savoie, est mort. Ce client permanent et célèbre de l’hôtel a définitivement ermé les yeux dans la plus belle force de l’âge, à 48 ans. Sa vie fut courte, certes, mais animée.
Aimone (Aymon) Roberto di Savoia était né le 9 mars 1900 à Turin, l’ancienne capitale du Royaume de Piémont-Sardaigne, dans une lignée apparentée à la famille royale d’Italie. Son père, Emmanuel-Phillibert était un cousin du roi et portait le titre de Duc d’Aoste. Sa mère est Hélène d’Orléans, princesse française née en 1971 à Twickenham en Angleterre et descendante du roi bourgeois. Le chef de la famille est Amadeo, un frère de deux ans plus âgé.
Selon la tradition de la famille, Aymon entame rapidement une carrière militaire et opte pour la marine de guerre. En 1918, il participe aux combats en tant que pilote de l’aéronavale. Outre son service d’officier, l’aristocrate se consacre à des travaux scientifiques. Il dirige ainsi l’expédition dans le désert de Karakoroum, patronnée par l’Institut Géographique italien. Les fouilles archéologiques menées en plein centre de l’ancien empire mongol, où résida jadis Gengis Khan, passionne la nation italienne. Aymon, que la nature a doté d’un physique imposant, se fait aduler par les Italiens comme le Marco Polo du 20ème siècle. Le roi lui octroie le titre de Duc de Spolète.
En 1931, son père, qui est surtout son modèle, meurt. Emmanuel Phillibert avait sympathisé dès 1922 avec le mouvement fasciste et mis sa personne à la disposition du pays, pour assurer les fonctions de régent, au cas où Victor-Emmanuel III s’opposerait à la Marche sur Rome. Mussolini n’avait pas oublié cette offre et, reconnaissant, n’a jamais cessé de promouvoir les deux princes désormais orphelins de père.
Lors de la guerre contre l’Abyssinie (Ethiopie), Aymon se porte volontaire pour l’Erythrée, en tant qu’officier de marine. Le 1 juillet 1939, il se fiance à Irène de Grèce, une fille de Constantin, Roi des Hellènes, mort en exil à Palerme. En novembre de la même année, il devient amiral et commandant-en-chef de la flotte à Pola. A partir de mars 1941, il commande la base navale de La Spezia, sur la côte de Ligurie. Le Duc de Spolète est au sommet de sa carrière militaire. Mais Mussolini, qui a installé son frère Amadeo comme vice-roi en Abyssinie en novembre 1937, réserve une meilleure promotion encore à Aymon.
Le jour décisif est le samedi 18 mai 1941. Lieu de l’action: le Quirinal, résidence royale. A la fin de la matinée se déroule une cérémonie prestigieuse, où la dynastie déploie tout son faste. Le roi est assis sous un baldaquin, avec, à sa droite, le prince héritier Umberto et, à sa gauche, Aymon prend place. C’est alors qu’une délégation, conduite par Ante Pavelic, portant un uniforme de colonel, fait son entrée. Pavelic est le chef, le “Poglavnik”, de l’Etat indépendant de Croatie, proclamé le 10 avril 1941. Avec toute la rigidité de l’étiquette, le roi demande quelle est le requête du visiteur. Celui-ci exprime le souhait du peuple croate d’avoir un souverain issu de la glorieuse dynastie des Savoie. A la suite de quoi, le roi, en sa qualité de chef de la Maison de Savoie, prononce un nom: Aymon. Les assistants se lèvent et les “Evviva” italiens et les “Zivio” croates retentissent dans la salle. Et ainsi se termina l’acte de fondation du royaume de Croatie.
La Croatie, qui venait, trois jours plus tôt, de hisser la Couronne médiévale de Zvonimir au rang de symbole du nouvel Etat, devint ainsi une monarchie, mais le pouvoir réel demeure aux mains du premier ministre Ante Pavelic. Benito Mussolini n’avait toutefois nulle intention de tolérer ce nouveau royaume comme un Etat pleinement souverain et lui prépare dès lors un statut que les croates connaissent trop bien depuis des siècles et qu’ils croient pourtant avoir dépassé définitivement, soit le statut d’un pays qui existe mais comme subalterne, comme annexe, d’une grande puissance ou d’une puissance plus grande; jusqu’en 1918, Zagreb avait tourné ses regards vers Vienne ou Budapest, ensuite, vers Belgrade.
Le 18 mai 1941, une bonne heure après sa nomination, Aymon a le sentiment d’avoir été rétrogradé et d’être devenu le Capitaine d’un Etat satellisé. Dans la salle “Mappamondo” du Palazzo Venezia, siège du Duce, Mussolini et Pavelic signent trois traités. Le premier de ces traités concerne les frontières du nouvel Etat croate; il prévoit la rétrocession des villes dalmates de Sebenico, Traù et Spalato (Split), ensuite de la région autour de la ville de Zara (la ville elle-même est italienne depuis le traité de Saint-Germain) et de la Baie de Cattaro/Kotor. Ces territoires appartiennent tous à la Dalmatie dite “classique”, qui faisait jadis partie de la République de Venise. L’ensemble de ces territoires rétrocédés a une superficie de 5400 km2 et compte 380.000 habitants, parmi lesquels seulement 5000 Italiens. La plus belle ville de la région, Ragusa/Dubrovnik, reste croate.
Dans le deuxième traité, l’italie garantit l’indépendance de la Croatie. Le troisième réduit l’ampleur de la souveraineté croate: Rome se réserve le droit de faire circuler ses troupes le long de l’antique voie longeant les côtes dalmates, y compris dans les portions relevant de l’Etat croate. De plus, l’Etat oustachiste ne peut se doter d’une flotte de guerre.
Après la signature des traités, Benito Mussolini s’est levé pour porter un toast; il évoque alors Aymon de Savoie: “Je me réjouis de penser à ce prince lumineux que l’on vient de choisir pour occuper le trône de Croatie et je me réjouis également de formuler les souhaits les plus cordiaux pour vous, Pavelic, afin que la nation croate aille au devant d’un avenir glorieux!”.
Un banquet chez le roi termine cette étrange journée, qui fut aussi, pourtant, une journée de défaite pour la Maison de Savoie: à Amba Alagi en Ethiopie, le frère aîné d’Aymon, Amadeo, Duc d’Aoste, est contrait de capituler devant les Anglais. Le 19 mai, le quotidien helvétique “Neue Zürcher Zeitung” évoque les accords de Rome de la veille: “Ils maintiennent plus ou moins l’équilibre entre les deux parties contractantes”. Mais le journaliste suisse estime tout de même qu’en fin de compte, c’est l’Italie qui en tire les meilleurs avantages. En Croatie, la rétrocession des régions dalmates suscite un sentiment général de haine à l’encontre des Italiens. Pavelic et le mouvement oustachiste perdent beaucoup de crédit au sein de la population. Le Poglavnik tentera alors de se dégager de la tutelle italienne.
C’est pourquoi Aymon, sous le nom de Tomislav II, ne sera pas couronné à Zagreb, dans la cathédrale Saint-Etienne par l’Archevêque Alois Stepinac. Le roi désigné —qui est également devenu Prince de Bosnie-Herzégovine et Voïvode de Dalmatie et de Tuszla— ne mettra jamais les pieds sur le sol croate; il se consacrera entièrement à la marine et assumera les fonctions d’inspecteur général des célèbres et glorieuses unités MAS de vedettes rapides.
Le 27 septembre 1943, un héritier voit le jour: Amadeo Umberto Constantino. Le nourrisson ne sera prince héritier de Croatie que pendant fort peu de temps car son père abandonne la Couronne le 12 octobre. En juin 1946, à la suite du plébiscite qui fait de l’Italie une république, la dynastie des Savoie quitte le pays pour l’exil. Aymon-Tomislav prend, lui aussi, la route de l’exode: il n’a plus qu’un an et demi à vivre.
Erich KÖRNER-LAKATOS.
(article tiré de “zur Zeit”, Vienne, n°3/2006; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:19 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : croatie, italie, deuxième guerre mondiale, marine, militaria, dynasties, monarchies |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
De la contestation mondiale bobo-docile et du souverainisme de libération
De la contestation mondiale bobo-docile et du souverainisme de libération
http://rebellion.hautetfort.com/
"Si le mouvement national contemporain ne veut pas se contenter de rééditer les anciennes tragédies amères de notre histoire passée, il doit se montrer capable de s’élever au niveau des exigences de l’heure présente". James Connolly (1868-1916), fondateur de l’Irish Republican Socialist Party
"Donnez-moi un point d’appui et un levier et je soulèverai la Terre." Archimède
"Pensez-vous tous ce que vous êtes supposés penser ?"
"Ce que nous devons conquérir, la souveraineté du pays, nous devons l’enlever à quelqu’un qui s’appelle le monopole. Le pouvoir révolutionnaire, ou la souveraineté politique, est l’instrument de la conquête économique pour que la souveraineté nationale soit pleinement réalisée". Ernesto Guevara.
Qu’est-ce que la mondialisation ? L’intégration croissante des économies dans le monde, au moyen des courants d’échanges et des flux financiers. Elle se définit par les transferts internationaux de main-d’oeuvre et de connaissances, et les phénomènes culturels et politiques que ceux-ci engendrent. Les principales caractéristiques en sont : la concentration de la production et du capital sous forme de monopoles ; la fusion du capital bancaire et industriel ; l’exportation massive des capitaux ; la formation d’unions transnationales monopolistes se partageant le monde ; la fin du partage territorial du monde entre les puissances capitalistes.
La mondialisation actuellement en oeuvre est une forme avancée de l’impérialisme capitaliste apparu au début du XXe siècle. Étant donné ses conséquences constatables et prévisibles (mort des cultures, disparition des particularismes, avènement du positivisme néo-kantien bêtifiant, anéantissement de la pensée critique, massification, dressage cognitif, crises économiques et guerres récurrentes, désintégration des religions occidentales et moralisme morbide subséquent, etc.), la mondialisation apparaît, à sa limite, comme un "holocauste mondial", ainsi que l’a définie Jean Baudrillard.
Du côté de la résistance organisée et spectaculaire - les mouvements altermondialistes et antiglobalisation qui défilent dans les médias - règne la confusion la plus grande. L’ambiguïté de la critique qu’ils adressent à la mondialisation et la limite des solutions qu’ils proposent se révèlent patentes si on les passe au tamis d’une critique impartiale. Pétris de bonnes intentions (remarquons à leur actif un notable appel à voter non au référendum sur le Traité européen), les altermondialistes sont aussi, au fond, les meilleurs alliés de la mondialisation capitaliste.
La diversion altermondialiste
D’abord, les altermondialistes sont des gestionnaires, et non des critiques radicaux. José Bové s’en vante : "A Seattle, dit-il, personne ne brandit le drapeau rouge de la révolution chinoise, ni le portrait du Che, ni la victoire révolutionnaire dans un pays devant bouleverser les autres ; c’est bien fini et c’est porteur d’espoir".
Les altermondialistes vitupèrent en effet le capitalisme, mais n’ont en fait nulle intention de le renverser. Ils désirent seulement l’amender. La taxe Tobin, le prélèvement qu’ils veulent instaurer sur les transactions spéculatives, ne s’attaque en réalité qu’à une infime partie de la spéculation et cache le fait que la crise du capitalisme ne porte pas uniquement sur la spéculation mais sur l’ensemble du capitalisme. La crise générale du capitalisme a pour trait distinctif l’accentuation extrême de toutes les contradictions de la société capitaliste. Et ces contradictions sont aujourd’hui portées à un point d’incandescence jamais atteint.
La campagne pour la suppression des paradis fiscaux, autre thème de campagne des altermondialistes, vise quant à elle à moraliser le capitalisme. Mais, à nouveau, la spéculation et les trafics financiers ne sont nullement la cause de la crise. Ils sont seulement la conséquence directe de l’impasse où est acculé le mode de production actuel. Aucune mesure de ce type n’empêchera jamais la crise de se poursuivre ni d’étendre ses ravages.
Au lieu de proposer une alternative efficace, les altermondialistes militent pour un système de redistribution à l’intérieur du capitalisme : les pays riches doivent partager leur richesse avec les pays pauvres, les patrons avec ceux qu’ils exploitent, etc. Ils espèrent ainsi qu’un capitalisme revu et corrigé sera porteur de justice, perpétuant l’utopie d’un capitalisme viable, à orienter dans un sens favorable. Pourtant, il n’y a pas de société "juste" dans le cadre du capitalisme dont l’essence conflictuelle nourrit des antagonismes en cascade. La seule réponse historique valable est de le dépasser, d’abolir le salariat en développant les luttes contre l’exploitation de la force de travail et les rapports capitalistes de production.
Les altermondialistes croient au soft-capitalisme, au capitalisme à visage humain, comme s’ils avaient lu l’oeuvre de Karl Marx avec les lunettes de plage d’Alain Minc. À l’instar de José Bové, avatar actuel de Proudhon, la plupart d’entre eux voudraient retourner au capitalisme de papa, celui des petits producteurs. Leur rêve est de freiner la concentration monopolistique par des institutions internationales qui superviseraient l’économie mondiale. Mais ils oublient que c’est la libre concurrence, constitutive du capitalisme, qui a depuis plus d’un siècle donné naissance aux monopoles mondiaux. C’est la libre concurrence qui a produit le monopole. C’est la libre concurrence du XIXe siècle qui a accouché de la dictature de deux cents multinationales du XXe siècle. Combattre la dictature des multinationales sans combattre en même temps la libre concurrence et le libre marché capitaliste qui les engendrent est un non-sens.
Comme le monopole, la mondialisation est contenue en germe dans le capitalisme : le capitalisme la porte en lui, c’est son produit inéluctable, sa déduction. Les multinationales, les délocalisations, comme les inégalités sociales et la flexibilité, sont les effets naturels de sa logique, le déroulement d’un processus autodynamique irréversible tant que l’on ne se décide pas à le subsumer.
Poussés par le besoin incessant de trouver des débouchés toujours nouveaux, les marchands ont envahi le monde entier. L’exploitation du marché mondial a du coup donné un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Déplorer le coeur sur la main "l’horreur économique" comme Viviane Forrester, scander "no logo" comme Noami Klein , hurler "le monde n’est pas une marchandise" ou manifester sous les murailles des forteresses de Big Brother pour que le monde capitaliste reparte du bon pied, ce n’est pas prendre le problème à la racine : c’est le décentrer. Couper les mauvaises herbes sans désherber, c’est leur permettre de repousser.
Le capitalisme est, par nature, une économie poussant à la mondialisation et à la marchandisation. Or tout est marchandisation en puissance, et puisque Dieu est provisoirement mort, il n’y a plus aucune limite humaine connue à l’expansion universelle de la marchandisation si on la laisse suivre son cours. Les marchands ont tout le temps devant eux, et ce ne sont pas les comités d’éthique officiels qui les empêcheront d’agir. Comme ces institutions spectaculaires nourrissent une pensée théologique coupée du terreau social, les marchands ont raison de prendre patience, car la théologie s’écroule toujours un moment donné de l’histoire, lorsque l’infrastructure la rend caduque.
Pour s’opposer concrètement à la marchandisation du monde, il ne suffit donc pas de minauder sur quelques-unes des conséquences annexes du Système, il faut dénoncer celui-ci dans son ensemble et en son fondement. Il importe en premier lieu de commencer par lui donner un nom, car "ce qui est censé être atteint, combattu, contesté et réfuté", comme disait Carl Schmitt, doit être nommé afin de viser la cible en son coeur : ici, il s’agit du mode de production capitaliste. Et il faut également proposer une alternative radicale, car nuancer, c’est considérer que la mécanique mérite de fonctionner, qu’il suffit de l’adapter et d’y incorporer de menus arrangements régulateurs : c’est au fond rester keynésien et marcher main dans la main avec MM. Attali et Fukuyama. "La compréhension de ce monde ne peut se fonder que sur la contestation, et cette contestation n’a de vérité qu’en tant que contestation de la totalité", écrivait Guy Debord.
Au temps où on évoquait (déjà) les États-Unis d’Europe, un révolutionnaire célèbre avait (déjà) remarqué que les gauchistes - ancêtres des altermondialistes - étaient les meilleurs alliés des opportunistes. Les gauchistes partagent en effet la vision de ceux qui veulent perpétuer le Système à la solde duquel ils vivent. Si l’ex-animateur du Mouvement du 22-Mars, Daniel Cohn-Bendit est devenu le meilleur allié de l’ancien cofondateur du mouvement atlantiste Occident, Alain Madelin, formant ainsi le noyau du libéral-libertarisme, ce n’est pas à cause d’une conjonction astrale fortuite : c’est parce que leurs destins convergents étaient inscrits dès l’origine dans leurs gènes idéologiques. Nous revivons cycliquement cette situation, aujourd’hui avec les altermondialistes, qui ne sont en somme que des antimondialistes de papier.
Les altermondialistes au service de l’oppression
Face la mondialisation du capital, on assiste à une mondialisation des résistances et des luttes. Seulement il ne s’agit pas de courants authentiquement antimondialistes - telle était leur dénomination première, et le changement de terminologie, opéré à leur instigation, est lumineux -, car ils militent de facto pour une "autre mondialisation", comme l’assure et l’assume François Houtart, directeur la revue Alternatives Sud. Susan George, présidente de l’Observatoire de la mondialisation se détermine, elle, en faveur d’une "mondialisation coopérative". Les chefs de file de l’altermondialisme médiatique se veulent ainsi des mondialistes. L’un des livres de Bové s’intitule Paysan du monde. Les altermondialistes revendiquent simplement l’avènement d’un mondialisme plus humain.
Du coup, et ce n’est pas un hasard, les voici réclamant l’avènement de la mondialisation des Droits de l’homme. Lorsque José Bové se rend Cuba, la première pensée qui lui traverse l’esprit, c’est qu’il y a "beaucoup de policiers dans les rues" et "des queues devant les magasins". Ce distrait vient d’oublier les quarante années d’embargo américain. Il aurait pu dire : "La mortalité due à la maternité est dix-sept fois plus basse à Cuba que la moyenne mondiale". Mais il est passé à côté, car il raisonne en métaphysicien, articulant des catégories fixes d’usage obligatoire dans un Système que de telles notions ont pour unique mission de soutenir. Il n’a pas compris que les Droits de l’homme sont devenus l’idéologie par laquelle les pays riches s’ingèrent dans les affaires des pays pauvres (hochet kouchnerien à vocation exterministe, depuis le Vietnam jusqu’à l’Irak, en attendant mieux). Et qu’au final, les Droits de l’homme sont devenus le cheval de Troie des oppresseurs d’aujourd’hui.
Comme l’a démontré Noam Chomsky, c’est en se fondant sur ces principes universels datant de la révolution bourgeoise que les États-Unis ont déclaré toutes leurs guerres depuis cinquante ans. Preuve éclatante de leur manque de logique, MM. Bové et ses amis ne se sont pas demandé qui ferait régner ces Droits précieux sur le monde, ni quelle puissance idéalement autonome parviendrait à lutter contre les diverses influences économiques et politiques pour les appliquer avec impartialité. Ni par qui serait élue cette autorité mondiale suprême. Ni comment elle gouvernerait. Ni quel parti ou quelle tendance de parti la dirigerait. Ni avec quelles forces armées elle se ferait respecter.
La tendance despotique de ce Léviathan serait, de plus, consubstantielle à son existence, puisque l’expérience a prouvé que plus un organisme est éloigné des individus qu’il encadre, plus son déficit démocratique est levé. On peut donc s’étonner que des anarchistes et des gauchistes soutiennent l’édification d’un tel monument d’oppression.
L’utopie des altermondialistes est donc totale. Ils croient en la vertu opératoire de la parole magique : "Monde, ouvre-toi !" , et le trésor des 40 voleurs nous sera acquis. Or le monde est un rapport de forces entre puissances économiques, et il ne suffit pas de vouloir avec détermination, ni de crier à tue-tête que les États-Unis, fer de lance de l’impérialisme, réduisent leur puissance pour que celle-ci décline dans les faits. Croire le contraire relève de la naïveté. Être naïf, c’est se payer le luxe d’être inopérant. Et tout mouvement inopérant encourage nolens volens la persistance du système qu’il prétend combattre.
La nation, comme foyer de guérilla
De glissement en compromis, d’accommodement en complicité objective, les altermondialistes reprennent ainsi dans leurs discours les arguments qui soutiennent le plus puissamment les intérêts des capitalistes. C’est-à-dire qu’ils s’inoculent à haute dose - et inoculent à ceux qui les écoutent - le virus qui justifie l’oppression, en retour.
Le mépris qu’ils affichent pour le fait national, auquel ils substituent un antiracisme formel, sentimental et terroriste, est à ce titre révélateur. Si les peuples désorientés par l’évolution actuelle et le dynamitage des frontières se jettent parfois dans les bras de partis qui semblent ici et là leur proposer un barrage provisoire au mondialisme, ce n’est pas, comme le prétendent les belles âmes de l’altermondialisme, parce qu’ils sombrent dans le fascisme, notion datée et dépassée. C’est d’abord parce que ces populations vivent au quotidien des situations dramatiques et déchirantes, et que nul ne leur propose un avenir digne d’être vécu, les altermondialistes moins que les autres, avec leur programme gauchiste de tabula rasa. C’est sur cette base qu’il faut édifier une réflexion.
A contrario, il est bien sûr parfaitement ridicule de prôner le raidissement identitaire comme solution-miracle. "Le repli sur la tradition, frelaté d’humilité et de présomption, n’est capable de rien par lui-même, sinon de fuite et d’aveuglement devant l’instant historial" écrivait Martin Heidegger. Le désir de rejouer le passé est vain, car "l’histoire ne repasse pas les plats", ainsi que le disait plaisamment Céline. Tout autre est l’affirmation d’une communauté nationale populaire vivante, une communauté de culture et de destin qui entend conserver son indépendance, sa volonté de puissance, sa capacité d’agir sur son avenir en puisant dans un héritage partagé, et qui offrirait la possibilité d’un contrôle populaire réel et conscient sur le pouvoir et l’expression libre des aspirations et des besoins.
La nation, catégorie historique du capitalisme ascendant, demeure en effet, contre de nombreuses prévisions, une réalité à l’époque du capitalisme déclinant. Elle devient même, selon la conception de Fidel Castro, un "bastion", un pôle de résistance révolutionnaire. La défense d’une communauté attaquée dans sa substance s’avère d’autant plus révolutionnaire que l’agression provient d’un système coupeur de têtes et aliénant. Le world-capitalisme a en effet intérêt à trouver devant lui des peuples désagrégés, des traditions mortes, des hommes fébriles et sans attache, disposés à engloutir son évangile standardisé. Ce qui freine la consommation de ses produits mondiaux, ce qui est susceptible de ralentir l’expansion de ses chansons mondiales formatées, de ses films mondiaux compactés, de sa littérature mondiale normalisée, doit disparaître, ou finir digéré dans ses circuits, ce qui revient au même. Le capitalisme est uniformisateur et l’arasement préalable des esprits encourage son entreprise uniformisatrice. Il ravage l’original, les particularismes, sauf ceux qui vont momentanément dans le sens qui lui profite.
Or la communauté, aspiration profonde des hommes, voit dans la forme nationale son actualité la plus aboutie. Passant pour les altermondialistes comme un résidu passéiste, une province pourrissante, un paradoxe historique au temps du cosmopolitisme triomphant, la nation conserve sa justification historique, a minima par le "plébiscite de tous les jours" qu’évoque Ernest Renan. Le patriotisme est un des sentiments les plus profonds, consacré par des siècles et des millénaires. Aujourd’hui, la nation conserve donc un contenu réel, qui, même s’il est épars et dilapidé, est à retrouver et à se réapproprier : "Délivré du fétichisme et des rites formels, le sentiment national n’est-il pas l’amour d’un sol imprégné de présence humaine, l’amour d’une unité spirituelle lentement élaborée par les travaux et les loisirs, les coutumes et la vie quotidienne d’un peuple entier ? ", disait Henri Lefebvre. L’étude du contenu national doit être au cour du programme d’un projet de renaissance.
Évidemment, la démocratie formelle n’a réalisé jusqu’ici qu’une pseudo-communauté abstraite qui frustre la plus grande partie du peuple, à commencer par les couches populaires (classe ouvrière et classes moyennes) sur qui pèse le fardeau le plus lourd. Car le Parlement, fût-il le plus démocratique, là où la propriété des capitalistes et leur pouvoir sont maintenus, reste une machine à réprimer la majorité par une minorité ; la liberté y est d’abord celle de soudoyer l’opinion publique, de faire pression sur elle avec toute la force de la money. La nation telle qu’elle doit être envisagée dans le cadre d’une pensée radicale ne peut qu’aller de pair avec le progrès social et l’alliance internationale avec les forces qui partagent cette ambition subversive totale. L’identité nationale doit être conçue comme une réorganisation sociale sur la base d’une forme élaborée de propriété commune, sous peine de nous ramener à un passé désuet, qui nous conduirait immanquablement au point où nous en sommes.
La nation doit être le cadre de l’émancipation, de l’épanouissement, et non une entité oppressive. C’est seulement comme instrument du progrès qu’elle conserve sa mission historique. Conception qui faisait dire à Lénine : "Nous sommes partisans de la défense de la patrie depuis le 25 octobre 1917 (prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie). C’est précisément pour renforcer la liaison avec le socialisme international, qu’il est de notre devoir de défendre la patrie socialiste."
La souveraineté nationale - non pas le souverainisme libéral ou le national-libéralisme, des oxymores dont il faut apprendre à se dépolluer - constitue ainsi, dans le meilleur des cas (exemple frappant du Venezuela bolivarien de Hugo Chávez), un pôle vivant de résistance à l’homogénéisation, une structure servant d’appui à la contestation globale, un foyer possible de guérilla au sens guévarien du terme. Si elle s’intègre dans une lutte émancipatrice au plan national (engagement dans un processus anticapitaliste) et international (retournement des alliances, nouvelle forme d’internationalisme rationnel, et non abstrait ou mystique, c’est-à-dire avec des allés objectifs et partisans), elle ne peut plus être considérée comme un vulgaire sédatif aux luttes sociales, comme elle le fut un temps (le nationalisme bourgeois désunissant les ouvriers pour les placer sous la houlette de la bourgeoisie). Elle devient au contraire l’avant-garde de la radicalité. Sans l’autonomie et l’unité rendues à chaque nation, l’union internationale des résistants au Système (une fraternité, une collaboration et des alliances nouvelles qui ne sont pas à confondre avec la mélasse mondialiste) ne saurait d’ailleurs s’accomplir. C’est lorsqu’un peuple est bien national qu’il peut être le mieux international.
La nation ainsi comprise est tout l’inverse des duperies formalistes à fuir à tout prix : niaiserie sentimentale, chauvinisme étriqué version Coupe du monde, cocardisme sarkozyste à choix multiple, roublardise mystificatrice d’un Déroulède germanopratin digéreant mal l’oeuvre de Charles Péguy, crispation irraisonnée sur les mythes fondateurs, etc. Elle devient l’une des pièces agissantes du renversement du Système. Dans des conditions historiques différentes, Sultan Galiev pour les musulmans, Li Da-zhao pour les Chinois ont en leur temps théorisé une notion approchante, considérant que le peuple musulman, d’un côté, chinois de l’autre, pouvaient, par déplacement dialectique provisoire, être dans leur ensemble considérés comme une classe opprimée en prise avec le Système à renverser. Chaque nation entrant en résistance frontale, pour autant qu’elle s’identifie avec l’émancipation générale, devient ainsi de nouveau historiquement justifiée. On a peut-être une chance de voir alors se produire l’encerclement des villes de l’Empire par les campagnes, les bases arrières et les focos.
Pour un nouveau différentialisme et un souverainisme de libération
Les particularités culturelles, les richesses nationales, individuelles et naturelles sont des armes que le mot d’ordre de world-culture, claironné par les altermondialistes-mondialistes, lors de leurs rassemblements champêtres, désamorce. Plus que quiconque, les artistes - parlons-en - devraient se préoccuper de marquer leurs différences, d’imposer des styles nouveaux et des concepts baroques, d’instiller des idées réactives, de dynamiter les formes étroites dans lesquelles on veut les faire entrer. Eux les premiers devraient se méfier d’instinct de la gadoue musicale qu’on leur propose comme horizon indépassable. Eux les premiers devraient imposer de nouvelles formes poétiques et un style adapté à la lutte contre l’homogénéisation totalitaire qui tend à les émasculer. Leur ouvre est écrasée sous les impératifs de production. La créativité a disparu devant la productivité. Qu’ils se donnent enfin les moyens d’être eux-mêmes : "Que chacun découvre pour la prendre en charge, en usant de ses moyens (la langue, les ouvres, le style) sa différence, écrivait encore Henri Lefebvre, au temps de son Manifeste différentialiste, ajoutant : "Qu’il la situe et l’accentue". Car exister, c’est agir. Et créer.
Dans d’autres domaines, il s’agirait également de repenser la modélisation de la dialectique, le renversement des tabous historiques et idéologiques, la défétichisation des concepts usés jusqu’à la corne par des philosophes ordonnés au Système (ou, pour certains l’ordonnant), de remettre en chantier une théorie de la subjectivité qui ne soit pas subjectiviste, etc. Un laboratoire d’élaboration conceptuelle serait le bienvenu (appelons-le Projet Archimède, du nom du grand scientifique grec de Sicile qui cherchait un point d’appui et un levier pour soulever le monde), sorte de fight-club de la théorie qui se donnerait comme objectif la critique impitoyable de l’existant dans sa totalité. Il faut retrouver l’idée de mouvement, en lui incluant bien sûr une logique de la stabilité qui sied à toute défense identitaire.
Face aux hyperpuissances d’homogénéisation, il est grand temps que l’antimondialisation réelle et efficace présente un front uni et international des différences, un bloc historique constitué par une armada pirate se lançant à l’abordage des vaisseaux de l’Empire.
Avant de réclamer une autre forme de mondialisation, une mondialisation toujours plus ouverte, c’est-à-dire de poursuivre, sur un mode de contestation bobo-docile, la mondialisation capitaliste par d’autres moyens en bradant dès aujourd’hui le monde aux multinationales comme si elles étaient au service de l’Internationale prolétarienne, les mouvements d’altermondialisation-mondialistes-contre-le-capitalisme-sauf-s’il-est-humain doivent prendre conscience que chaque peuple, chaque langue, chaque ethnie, chaque individu, chaque particularité est un reflet de l’universel, un éclat d’humanité. Pour l’avoir oublié, nous sommes entrés dans la norme de la société du "on", où se déploie le Règne de la Quantité annoncé par René Guénon, un monde de grisaille suant la "nullité politique" décrite par Hegel, qui n’est plus régulé que par la seule loi de la valeur capitaliste, l’habitude, l’hébétude et la résignation. Il est temps d’y remettre de la couleur et du mouvement, et, ce faisant, trouver les formes possibles du dépassement de la contradiction actuelle et aider à la prise de conscience de la dialectique de l’histoire présente.
Cette invitation aux particularités ne doit pas se faire de manière parodique ni mimétique, comme nous y invite le Système, mais en Vérité, comme parle l’Évangile, la vérité "révolutionnaire" de Gramsci et celle qui "rend libre" de saint Jean. C’est-à-dire comme un moment essentiel d’un projet de révolution maximale, ayant pour objectif d’inventer un nouveau style de vie. "Tout simplement, je veux une nouvelle civilisation", disait Ezra Pound. C’est bien le moins auquel nous puissions prétendre.
Ce n’est qu’en procédant par étapes que l’on pourra intensifier infiniment la différenciation de l’humanité dans le sens de l’enrichissement et de la diversification de la vie spirituelle, des courants, des aspirations et des nuances idéologiques. Dès à présent, l’internationalisme véritable, au lieu d’être l’idiot utile du capitalisme, doit s’opposer à toutes les tentatives d’homogénéisation mondiale et tendre à défendre sur le mode symphonique les particularismes nationaux, en tant qu’ils peuvent se constituer en fractions d’un souverainisme de libération, mais aussi les particularismes régionaux et individuels. Tel doit être le véritable projet des adversaires du mondialisme. Le reste n’est que bavardage, compromission et désertion en rase campagne.
Que cent fleurs s’épanouissent !
Paul-Eric Blanrue
00:05 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, socialisme, liberté populaire, libération nationale, révolte, rébellion, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 août 2008
Homo Americanus - noodlot of bestemming?
Homo Americanus – noodlot of bestemming?
Worden wij allemaal straks ‘homo americanus’, mensen die leven in een compleet geglobaliseerde wereld, die als enige god naast Mammon de Rechten van de mens aanbidt? Worden wij straks allemaal ‘homo americanus’, onder een globaal economisch kapitalistisch systeem, een multicultureel paradijs op aarde (althans als men sommige heilsbrengers en hogepriesters van het nieuwe geloof mag geloven)?
 Tomislav Sunic, voormalig professor aan enkele Amerikaanse universiteiten en voormalig Kroatisch diplomaat, vreest van wel en probeert in dit zeer belangrijk werk Homo Americanus: child of the postmodern age (*) duidelijk te maken wat de bronnen zijn van deze ‘homo americanus’ en vooral wat de uitdagingen zijn waarmee de Europeaan – en bij uitbreiding de andere culturen – in de nabije toekomst zal worden geconfronteerd. Hij gaat hierbij interdisciplinair te werk, om zo elk academisch reductionisme tegen te gaan (een zeer on-Amerikaanse manier, want is het academisch reductionisme wijder verspreid dan juist in de VSA?). Tenslotte heeft Sunic aan den lijve het communistisch totalitarisme moeten ondergaan, zodat hij meer dan goed geplaatst is om ook het softtotalitair karakter van de Amerikaanse academische en politieke wereld aan te klagen, dat door een fijnmazig netwerk van media, politiek, universiteiten en andere opiniemakers de politieke en publieke discussie binnen zeer benepen en enge grenzen probeert te houden. Er zijn trouwens voldoende voorbeelden hoe ditzelfde fenomeen zich ondertussen ook in Europa voordoet: het woord “immigrant” of “immigratie” bijvoorbeeld bezigen zonder de verplichte adoratie is reeds voldoende om bepaalde door de staat betaalde inquisitieorganen te alarmeren en in hoogste staat van paraatheid te brengen.
Tomislav Sunic, voormalig professor aan enkele Amerikaanse universiteiten en voormalig Kroatisch diplomaat, vreest van wel en probeert in dit zeer belangrijk werk Homo Americanus: child of the postmodern age (*) duidelijk te maken wat de bronnen zijn van deze ‘homo americanus’ en vooral wat de uitdagingen zijn waarmee de Europeaan – en bij uitbreiding de andere culturen – in de nabije toekomst zal worden geconfronteerd. Hij gaat hierbij interdisciplinair te werk, om zo elk academisch reductionisme tegen te gaan (een zeer on-Amerikaanse manier, want is het academisch reductionisme wijder verspreid dan juist in de VSA?). Tenslotte heeft Sunic aan den lijve het communistisch totalitarisme moeten ondergaan, zodat hij meer dan goed geplaatst is om ook het softtotalitair karakter van de Amerikaanse academische en politieke wereld aan te klagen, dat door een fijnmazig netwerk van media, politiek, universiteiten en andere opiniemakers de politieke en publieke discussie binnen zeer benepen en enge grenzen probeert te houden. Er zijn trouwens voldoende voorbeelden hoe ditzelfde fenomeen zich ondertussen ook in Europa voordoet: het woord “immigrant” of “immigratie” bijvoorbeeld bezigen zonder de verplichte adoratie is reeds voldoende om bepaalde door de staat betaalde inquisitieorganen te alarmeren en in hoogste staat van paraatheid te brengen.
 In zijn voorwoord stelt professor Kevin MacDonald van de California State University dat Tomislav Sunic het begin van deze morele en intellectuele legitimiteit situeert met de overwinning van links na de Tweede Wereldoorlog en dat de bestraffing van de misdaden die in naam van het totalitarisme werden begaan, gediend hebben om de linkse dogma’s, vooral die over mens, natie en ras, te versterken. Het belangrijkste instrument in deze institutionalisering was zeker de Frankfurter Schule, die erin slaagde om elke positieve ingesteldheid tegenover etnische cohesie, familie, natie, religie of ras gelijk te stellen met het purgatorium, het vagevuur. Eén stap verwijderd van de hel dus.
In zijn voorwoord stelt professor Kevin MacDonald van de California State University dat Tomislav Sunic het begin van deze morele en intellectuele legitimiteit situeert met de overwinning van links na de Tweede Wereldoorlog en dat de bestraffing van de misdaden die in naam van het totalitarisme werden begaan, gediend hebben om de linkse dogma’s, vooral die over mens, natie en ras, te versterken. Het belangrijkste instrument in deze institutionalisering was zeker de Frankfurter Schule, die erin slaagde om elke positieve ingesteldheid tegenover etnische cohesie, familie, natie, religie of ras gelijk te stellen met het purgatorium, het vagevuur. Eén stap verwijderd van de hel dus.
De Europese volkeren moesten (en moeten) dus geloven dat hun eigen inzichten over demografie en culturele ondergang irrationeel waren (en zijn) en een indicatie van een psychopathologie. In het licht hiervan krijgt natuurlijk ook het begrip ‘democratie’ een totaal andere betekenis. In de plaats van uitdrukking te zijn van de wil van het volk wordt het eerder de woonplaats van de norm van de intellectueel superieure elites die geen enkel verband meer hebben met de eigenlijke bescherming van de belangen van het volk.
 In de laatste hoofdstukken belicht professor Sunic de verhouding ‘Homo Americanus’ en de postmoderniteit. Want hoewel de postmoderniteit de wereld ging verlossen van alle ideologische dwang, is er integendeel sprake van een totale ideologisering van alle uitingen van het maatschappelijk leven, wat zich vooral manifesteert in het gebruik van begrippen als ‘mensenrechten’, ‘fascisme’ en ‘etnie’ of ‘identiteit’. Daardoor blijft er van het zogezegde recht op vrije meningsuiting steeds minder over, de – veelal nieuwe – taboes blijken integendeel nog sterker dan vroeger. Media en andere opiniemakers in Amerika – maar ook steeds vaker in de rest van de wereld – vinden het steeds moeilijker om topics aan te raken die beschouwd worden als tegengesteld aan de postmoderne geest.
In de laatste hoofdstukken belicht professor Sunic de verhouding ‘Homo Americanus’ en de postmoderniteit. Want hoewel de postmoderniteit de wereld ging verlossen van alle ideologische dwang, is er integendeel sprake van een totale ideologisering van alle uitingen van het maatschappelijk leven, wat zich vooral manifesteert in het gebruik van begrippen als ‘mensenrechten’, ‘fascisme’ en ‘etnie’ of ‘identiteit’. Daardoor blijft er van het zogezegde recht op vrije meningsuiting steeds minder over, de – veelal nieuwe – taboes blijken integendeel nog sterker dan vroeger. Media en andere opiniemakers in Amerika – maar ook steeds vaker in de rest van de wereld – vinden het steeds moeilijker om topics aan te raken die beschouwd worden als tegengesteld aan de postmoderne geest.
Terwijl veel Amerikanen in het besef leven dat de vrije pers een tegengewicht vormen tegen de almachtige politieke wereld, strijden de beide groepen integendeel in een zelfde geest en in een zelfde strijd. Ook Régis Debray stelde hetzelfde vast: “Het zijn de media die eigenlijk de meester van de staat zijn. De staat moet haar overleven onderhandelen met de opiniemakers”.
 Officieel zijn er in het postmoderne Amerika geen rassen of etnieën. Nochtans wordt geen land ter wereld zo gedomineerd door het rassenvraagstuk als juist de VSA, in die mate zelfs dat Sunic het beeld van een raciaal opgedeeld of zelfs raciaal uiteenvallend Amerika als redelijk reëel voorkomt. Maar de Amerikaanse overheid reageert op dit fenomeen met een gekende ‘overkill’. Om de dreigende balkanisering van Amerika af te wenden, weigert men de raciale influx te stoppen, integendeel, men meent dat men dit best kan doen door nog méér verscheidenheid in het land binnen te brengen. Gevolg zou het einde van de Angelsaksische desem van de Amerikaanse droom kunnen zijn, zeker is in elk geval dat nog meer etnische en/of raciale verscheidenheid in Amerika zal leiden tot een politieke en demografische marginalisering ervan.
Officieel zijn er in het postmoderne Amerika geen rassen of etnieën. Nochtans wordt geen land ter wereld zo gedomineerd door het rassenvraagstuk als juist de VSA, in die mate zelfs dat Sunic het beeld van een raciaal opgedeeld of zelfs raciaal uiteenvallend Amerika als redelijk reëel voorkomt. Maar de Amerikaanse overheid reageert op dit fenomeen met een gekende ‘overkill’. Om de dreigende balkanisering van Amerika af te wenden, weigert men de raciale influx te stoppen, integendeel, men meent dat men dit best kan doen door nog méér verscheidenheid in het land binnen te brengen. Gevolg zou het einde van de Angelsaksische desem van de Amerikaanse droom kunnen zijn, zeker is in elk geval dat nog meer etnische en/of raciale verscheidenheid in Amerika zal leiden tot een politieke en demografische marginalisering ervan.
Het enige voordeel van de postmoderniteit is het feit dat ze zelfvernietigend is, aldus de auteur Tomislav Sunic. Maar tegen welke prijs? Het is de vraag hoe Amerika uit deze odyssee zal kom. Het is vooral de vraag op welke manier de Europeanen zullen omgaan met de ervaringen van de Amerikanen.
Dit boek dat onmiddellijk en zonder omwegen naar de kern van de zaak gaat, hoort eigenlijk in de bibliotheek van eenieder thuis! Sunic heeft zijn veruit belangrijkste werk gepubliceerd.
(P.L.)
Titel: Homo Americanus: child of the postmodern Age (214 pag)
Auteur: Sunic Tomislav
Uitgever: in eigen beheer
ISBN: 978 – 1419659843 (2007)
00:13 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, américanisme, politique, théorie politique, amérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'idée touranienne dans la stratégie américaine

L'idée touranienne dans la stratégie américaine
Le régime turc est autorisé à se maintenir en lisière de l'Europe et dans l'OTAN, malgré ses dimensions "non démocratiques", parce ce pays reçoit en priorité l'appui des Etats-Unis, qui savent que le militarisme turc pourra leur être très utile si le "Grand Jeu" reprend au beau milieu de l'espace eurasiatique. Cette coïncidence d'intérêts entre militaires turcs et stratégie générale des Etats-Unis incite les uns et les autres à redonner vigueur au "panturquisme", qui porte quelques fois un autre nom : celui de "pantouranisme" ou de "touranisme". C'est le rêve et le projet d'un "empire grand-turc", même s'il doit rester informel, qui s'étendrait de l'Adriatique (en Bosnie) à la Chine (en englobant le Xinjian ou "Turkestan oriental" ou "Turkestan chinois") (1). Cet empire grand-turc rêvé prendrait le relais de l'Empire ottoman défunt. Le projet touranien a été formulé jadis par le dernier ministre de la guerre de cet empire ottoman, Enver Pacha, tombé au combat face aux troupes soviétiques en commandant des indépendantistes turcophones d'Asie centrale. La "Touranie" centre asiatique n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman, sauf quelques bribes territoriales dans les marches; néanmoins, il y a toujours eu des liens entre les khanats des peuples turcs d'Asie centrale et l'Empire ottoman, qui y recrutait des hommes pour ses armées. Si la lignée d'Osman s'était éteinte, celle des khans de Crimée, de la maison de Giraj, dont l'ancêtre était le Grand Khan des Mongols, Gengis Khan (2), serait alors devenue, comme prévu, la dynastie dirigeante de l'Empire Ottoman (3).
Face au projet touranien, Atatürk adoptait plutôt une position de rejet, mais c'était très vraisemblablement par tactique (4), car il devait justifier sa politique face à l'Occident et condamner, pour cette raison, le génocide perpétré par les gouvernements jeunes-turques contre les Arméniens. Ensuite, dès que le régime soviétique s'est consolidé, il n'aurait pas été réaliste de persister sur des positions pantouraniennes. Pourtant, en 1942, quand les troupes allemandes pénètrent profondément à l'intérieur du territoire soviétique, le panturquisme, longtemps refoulé, revient très vite à la surface. Mais, vu la constellation internationale, le gouvernement turc a dû officiellement juger certains activistes pantouraniens, comme le fameux Alparslan Türkesch, pour "activités racistes"; en effet, les Britanniques (et non pas l'Allemagne nationale-socialiste) avaient, selon leurs bonnes habitudes et sans circonlocutions inutiles, menacé d'occuper la Turquie et Staline, lui, était passé à l'acte en déportant en Sibérie les Tatars de Crimée, alliés potentiels d'une coalition germano-turque.
Perspective touranienne et "grande turcophonie"
Après l'effondrement de l'URSS, la perspective touranienne (5) est bien trop séduisante pour les Etats-Unis, héritiers du système de domination britannique, pour qu'ils la négligent. Mises à part les républiques caucasiennes, la majorité écrasante de la population des Etats indépendants dans la partie méridionale de l'ex-Union Soviétique sont de souche turque, sauf les Tadjiks qui sont de souche persane. Qui plus est, de nombreux peuples au sein même de la Fé dération de Russie appartiennent à cette "grande turcophonie": leur taux de natalité est très élevé, comme par exemple chez les Tatars, qui ont obtenu le statut d'une république quasi indépendante, ou chez les Tchétchènes, qui combattent pour obtenir un statut équivalent. Les "pantouraniens" de Turquie ne sont pas encore très conscients du fait que les Yakoutes de Sibérie nord-orientale, face à l'Etat américain d'Alaska, relèvent, eux aussi, au sens large, de la turcophonie.
Si l'on parvient à unir ces peuples qui, tous ensemble, comptent quelque 120 millions de ressortissants, ou, si on parvient à les orienter vers la Turquie et son puissant allié, les Etats-Unis, à long terme, les dimensions de la Russie pourraient bien redevenir celles, fort réduites, qu'elle avait au temps d'Ivan le Terrible (6). En jouant la carte azérie (l'Azerbaïdjan), ethnie qui fournit la majorité du cadre militaire de l'Iran, on pourrait soit opérer une partition de l'Iran soit imposer à ce pays un régime de type kémaliste, indirectement contrôlé par les Turcs. Certains pantouraniens turcs, à l'imagination débordante, pourraient même rêver d'un nouvel Empire Moghol, entité démantelée en son temps par les Britanniques et qui sanctionnait la domination turque sur l'Inde et dont l'héritier actuel est le Pakistan.
Le "Parti du Mouvement National" (MHP), issu des "Loups Gris" de Türkesch, se réclame très nettement du touranisme; lors des dernières élections pour le parlement turc, ce parti a obtenu 18,1%, sous la houlette de son président, Devlet Bahceli et est devenu ainsi le deuxième parti du pays. Il participe au gouvernement actuel du pays, dans une coalition avec le social-démocrate Ecevit, permettant ainsi à certaines idées panturques ou à des sentiments de même acabit, d'exercer une influence évidente dans la société turque. C'est comme si l'Allemagne était gouvernée par une coalition SPD/NPD, avec Schroeder pour chancelier et Horst Mahler comme vice-chancelier et ministre des affaires extérieures! […].
Une Asie centrale "kémalisée"?
Dans un tel contexte, le kémalisme comme régime a toutes ses chances dans les républiques touraniennes de l'ex-Union Soviétique. Les post-communistes, qui gouvernent ces Etats, gardent leur distance vis-à-vis de l'Islam militant et veulent le tenir en échec sur les plans politique et institutionnel. Mais l'arsenal du pouvoir mis en œuvre là-bas peut rapidement basculer, le cas échéant, dans une démocratie truquée. Jusqu'à présent, ces Etats et leurs régimes se sont orientés sur les concepts du soviétisme libéralisé et, mis à part l'Azerbaïdjan, choisissent encore de s'appuyer plutôt sur la Russie que sur la Turquie (8), malgré l'engagement à grande échelle de Washington et d'Ankara dans les sociétés pétrolières et dans la politique linguistique (introduction d'un alphabet latin modifié (7), adaptation des langues turques au turc de Turquie. Comme l'Occident exige la liberté d'opinion et le pluralisme, ces éléments de "bonne gouvernance" sont introduits graduellement par les gouvernements de ces pays, ce qui constitue une démocratisation sous contrôle des services secrets selon la notion de perestroïka héritée de l'Union Soviétique (9).
Cela revient à construire les "villages à la Potemkine " de la démocratie (10), dont le mode de fonctionnement concret est difficile à comprendre de l'extérieur. Tant que les différents partis et organes de presse demeurent sous le contrôle des services secrets, on n'aura pas besoin d'interdire des formations politiques en Asie centrale (contrairement à ce qui se passe en Allemagne fédérale!). Mieux: on ira jusqu'à soutenir le "pluralisme" par des subsides en provenance des services secrets, car cela facilitera l'exercice du pouvoir par les régimes post-communistes établis, selon le bon vieux principe de "Divide et impera", mais l'Occident aura l'impression que la démocratie est en marche dans la région.
Avec Peter Scholl-Latour, on peut se poser la question: «Pendant combien de temps l'Occident —principalement le Congrès américain et le Conseil de l'Europe— va-t-il cultiver le caprice d'imposer un parlementarisme, qui soit le calque parfait de Westminster, dans cette région perdue du monde, où le despotisme est et reste la règle cardinale de tout pouvoir? ». Ce jeu factice de pseudo-partis et de pseudo-majorités ne peut conduire qu'à discréditer un système, qui ne s'est avéré viable qu'en Occident et qui y est incontournable. Le pluralisme politique et la liberté d'opinion ne sont pas des "valeurs" qui se développeront de manière optimale en Asie centrale. Même le Président Askar Akaïev du Kirghizistan, considéré en Europe comme étant "relativement libéral", a fait prolonger et bétonner arbitrairement son mandat par le biais d'un référendum impératif. Nous avons donc affaire à de purs rituels pro-occidentaux, à un libéralisme d'illusionniste, pure poudre aux yeux, et les missionnaires de cette belle sotériologie éclairée, venus d'Occident, finiront un jour ou l'autre par apparaître pour ce qu'ils sont: des maquignons et des hypocrites (11).
Va-t-on vers une islamisation de l'extrémisme libéral?
Comme la pseudo-démocratie à vernis occidental court tout droit vers le discrédit et qu'elle correspond aux intérêts américains, tout en ménageant ceux de la Russie (du moins dans l'immédiat…), c'est un tiers qui se renforcera, celui dont on veut couper l'herbe sous les pieds : l'islamisme. Comme le kémalisme connaît aussi l'échec au niveau des partis politiques, parce que la laïcisation forcée qu'il a prônée n'a pas fonctionné, la perspective touranienne conduit ipso facto à réclamer une ré-islamisation de la Turquie , mais une ré-islamisation compatible avec la doctrine kémaliste de l'occidentalisation (12); de cette façon, le kémalisme pourra, à moyen terme, prendre en charge les régimes post-communistes de la "Touranie".
La synthèse turco-islamique ("Türk-islam sentezi") est un nouvel élément doctrinal, sur lequel travaillent depuis longtemps déjà les idéologues du panturquisme (13), avec de bonnes chances de connaître le succès : si l'on comptabilise les voix du DSP et du CHP, on obtient à peu de choses près le nombre des adeptes de l'alévisme; ceux-ci se veulent les représentants d'un Islam turc, posé comme distinct du sunnisme, considéré comme "arabe", et du chiisme, considéré comme "persan" (14). Dans cette constellation politique et religieuse, il faut ajouter aux adeptes de l'alévisme, l'extrême-droite turque et une partie des islamistes (15). Ces deux composantes du paysage politique turc étaient prêtes à adopter une telle synthèse, celle d'un Islam turc, voir à avaliser sans problème une islamisation du kémalisme, qui aurait pu, en cas de démocratisation, conduire à une indigénisation de facto de l'extrémisme libéral.
Universalisme islamique et Etats nationaux
En s'efforçant de créer une religion turque basée sur la maxime "2500 ans de turcicité, 1000 ans d'islam et (seulement) 150 ans d'occidentalisation", un dilemme se révèle : celui d'une démocratisation dans le cadre d'un islam qui reste en dernière instance théocratique. L'établissement de la démocratie dans tout contexte islamique s'avère fort difficile, parce que la conception islamique de l'Etat implique une négation complète de l'Etat national (16). Or cette instance, qu'on le veuille ou non, a été la grande prémisse et une des conditions premières dans l'éclosion de la démocratie occidentale (en dépit de ce que peuvent penser les idéologues allemands au service de la police politique, qui marinent dans les contradictions de leur esprit para-théocratique, glosant à l'infini sur les "valeurs" de la démocratie occidentale). Dans l'optique de l'islam stricto sensu, en principe, tous les Etats existants en terre d'islam sont illégitimes et peuvent à la rigueur être considérés comme des instances purement provisoires. Ils n'acquièrent légitimité au regard des puristes que s'ils se désignent eux-mêmes comme bases de départ du futur Etat islamique qui, en théorie, ne peut être qu'unique.
Dans le christianisme, le conflit entre la revendication universaliste de la religion et les exigences particularistes de la politique "mondaine" (immanente) se résout par la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Dans le christianisme oriental (orthodoxie), la séparation de l'Eglise et de l'Etat n'a pas été poussée aussi loin, ce qui est une caractéristique découlant tout droit de la forme de domination propre au système ottoman, que l'on appelle le "système des millets", où les chefs d'Eglise, notamment le Patriarche de Constantinople, sont considérés comme des "chefs de peuple". De ce fait, le principe de l'"église nationale" constitue la solution dans cette aire byzantine et orthodoxe. Dans l'aire islamique, nous retrouvons cette logique, qui, en Occident, a conduit à la démocratie, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette démocratie a pu s'organiser dans un espace particulier et circonscrit, via l'instance "Etat national". Donc dans l'aire islamique, réaliser la démocratie passe nécessairement par le postulat de créer une religion nationale. On retrouve une logique similaire dans le judaïsme, lui aussi apparenté à l'Islam, où le sionisme a été le moteur d'une démocratisation nationaliste, qui a finalement conduit à la création de l'Etat d'Israël. Cependant, dans l'aire islamique, une religion nationale de ce type, qui pourrait concerner tous les Etats musulmans, ne pourrait pas se contenter d'être une simple religion civile, comme en Occident et notamment en RFA, où la religion civile repose sur un reniement moralisateur du passé, organisé par l'Etat lui-même; elle devrait avoir tous les éléments d'une véritable religion (17), pouvant se déclarer "islamique", même si d'autres refusent de la considérer comme telle.
L'alévisme turc, religiosité de type gnostique
Dans les doctrines de l'alévisme turc (18), nous avons affaire à une religion de type gnostique, car son noyau évoque la théorie des émanations, selon laquelle tous les étants sont issus de Dieu, vers lequels ils vont ensuite s'efforcer de retourner. Dieu a créé les hommes comme êtres corporels (physiques) (19), afin de se reconnaître lui-même dans sa création. Après le "retour" dans l'immense cycle ontologique, toutes les formes, produites par l'émanation, retournent à Dieu et se dissolvent en lui (20), ce qui lui permet de gagner en quelque sorte une plus-value d'auto-connaissance. La capacité qu'a l'homme de reconnaître Dieu atteste de la nature divine de l'homme. Par extrapolation, on aboutit quelques fois à une divinisation de l'homme, devenant de la sorte un être parfait (où l'homme devient un dieu sur la Terre ), et, dans la logique de l'alévisme turc, le Turc devient ainsi le plus parfait des êtres parfaits. L'homme a parfaitement la liberté d'être athée, car l'athéisme constitue une possibilité de connaître Dieu (21), car la connaissance de Dieu, dans cette optique, équivaut à une connaissance de soi-même.
Par conséquent, les lois islamiques, y compris les règles de la prière, ne sont pas reconnues et, à leur place, on installe les anciennes règles sociales pré-islamiques des peuples turcs, ce qui revient à mettre sur pied une religion ethnique turque, compénétrée d'éléments chamaniques venus d'Asie centrale. Dans une telle optique, Mohammed et Ali, qui, au titre d'émanation est pied sur pied d'égalité avec lui, sont perçus comme des êtres angéliques préexistants, devenus hommes. Le Coran n'a plus qu'une importance de moindre rang, car, disent les gnostiques turcs, par sa chute dans une forme somatique d'existence, le Prophète a subi une perte de savoir, le ramenant au niveau de la simple connaissance humaine. Tous les éléments d'arabité en viennent à être rejetés, pour être remplacés par des éléments turcs.
Ordre des Janissaires, alévisme et indigénisme turc
Si l'on ôte de l'idéologie d'Atatürk tout le vernis libéral (extrême libéral), on perçoit alors clairement que le fondateur de la Turquie moderne —même s'il n'en était pas entièrement conscient lui-même— était effectivement un Alévite, donc en quelque sorte un indigéniste turc (on le voit dans ses réformes : égalité de l'homme et de la femme, interdiction du voile, autorisation de consommer de l'alcool, suppression de l'alphabet et de la langue arabes, etc.). Ce programme ne peut évidemment pas se transposer sans heurts dans d'autres Etats islamiques. En Turquie, ces réformes ont pu s'appliquer plus aisément dans la majorité sunnite du pays sous le prétexte qu'elles étaient une occidentalisation et non pas une transposition politique des critères propres de l'alévisme. La suppression du califat sunnite par Atatürk en 1924 peut s'interpréter comme une vengeance pour la liquidation de l'ordre des janissaires par l'Etat ottoman en 1826. Les janissaires constituaient la principale troupe d'élite de l'Empire ottoman; sur le plan religieux, elle était inspirée par l'Ordre alévite des Bektachis , lui aussi interdit en 1827 (22). Les intellectuels de l'Armée et les nationalistes d'inspiration alévite reprochent à cette interdiction d'avoir empêché la turquisation des Albanais, très influencés par le bektachisme, à l'ère du réveil des nationalités. Les nationalistes alévites constituent l'épine dorsale du mouvement des Jeunes Turcs qui arrivent au pouvoir en 1908. Ces événements et cette importante cardinale du bektachisme alévite explique pourquoi la Tur quie actuelle et les Etats-Unis (23) accordent tant d'importance à l'Albanie dans les Balkans, au point de les soutenir contre les Européens.
L'idéal de "Touran" vise à poursuivre la marche de l'histoire
La religion quasi étatique dérivée directement des doctrines alévites pourrait sous-tendre un processus de démocratisation dans l'aire culturelle musulmane (24), mais elle ne serait acceptée ni par les Sunnites ni par les Chiites. Ceux-ci n'hésiteraient pas une seconde à déclarer la "guerre sainte" aux Alévites. On peut penser que les prémisses de cet Islam turco-alévite pourrait, par un effet de miroir, se retrouver dans le contexte iranien, où les Perses se réfèreraient à leur culture pré-islamique (ou forgeraient à leur tour un islam qui tiendrait compte de cette culture). Une telle démarche, en Iran, prendrait pour base l'épopée nationale du Shahnameh (le "Livre des Rois"). Aujourd'hui, on observe un certain retour à cette iranisme, par nature non islamique, ce qui s'explique sans doute par une certaine déception face aux résultats de la révolution islamique. Mais le nouvel iranisme diffus d'aujourd'hui se plait à souligner toutes les différences opposant les Perses aux Turcs, alliés des Etats-Unis. Enfin, dans l'iranisme actuel, on perçoit en filigrane une trace du principe fondamental du zoroastrisme, c'est-à-dire la partition du monde en un règne du Bien et un règne du Mal, un règne de la "Lumière" et un règne de l'"Obscurité", compénétrant entièrement l'épopée nationale des Perses. Cela se répercute dans l'opposition qui y est décrite entre l'Empire d'"Iran" et l'Empire du "Touran". « L'Iran étant la patrie hautement civilisée des Aryens, tandis que le Touran obscur est le lieu où se rassemblent tous les peuples barbares de la steppe, venus des profondeurs de l'Asie centrale, pour assiéger la race des seigneurs de souche indo-européenne » (25).
La fin de l'histoire occidentale
Peu importe ce que les faits établiront concrètement dans le futur : dés aujourd'hui, on peut dire que la perspective touranienne permet d'aller dans le sens des intérêts américains au cas où le "Grand Jeu" se réactiverait et aurait à nouveau pour enjeu la domination du continent eurasiatique, prochain "champ de bataille du futur" (26). Parce qu'ils bénéficient du soutien des Etats-Unis, les Etats riverains et touraniens de la Mer Caspienne équipent leurs flottes de guerre pour affirmer leurs droits de souveraineté sur cette mer intérieure face à la Russie et à l'Iran. Le tracé de ces frontières maritimes est important pour déterminer dans l'avenir proche à qui appartiendront les immenses réserves de pétrole et de gaz naturel. Le risque de guerre qui en découle montre l'immoralité de la politique d'occidentalisation, dont parle Huntington (27). Celui-ci nous évoque les moyens qui devront irrémédiablement se mettre en œuvre pour concrétiser une telle politique : ces moyens montrent que la conséquence nécessaire de l'universalisme est l'impérialisme, mais que, dans le contexte actuel qui nous préoccupe, l'Occident n'a plus la volonté nécessaire de l'imposer par lui-même (mis à part le fait que cet impérialisme contredirait les "principes" occidentaux…). L'universalisme occidental, qui cherche à s'imposer par la contrainte, ne peut déboucher que sur le désordre, car les moyens mis en œuvre libèreraient des forces religieuses, philosophiques et démographiques qu'il est incapable de contrôler et de comprendre. Cette libération de forces pourra conduire à tout, sauf à la "fin de l'histoire". Mais cette fin de l'histoire sera effectivement une fin pour la civilisation qui pense que cette fin est déjà arrivée. «Les sociétés qui partent du principe que leur histoire est arrivée à sa fin sont habituellement des sociétés dont l'histoire sera interprétée comme étant déjà sur la voie du déclin » (28).
On peut émettre de sérieux doute quant à la réalisation effective de la "perspective touranienne" ou d'une issue concrète aux conflits qu'elle serait susceptible de déclencher dans l'espace centra-asiatique quadrillé jadis par l'internationalisme stalinien qui a imposé des frontières artificielles, reprises telles quelles par le nouvel ordre libéral, qui ne parle pas d'"internationalisme", comme les Staliniens, mais de "multiculturalisme". Ce multiculturalisme ne veut pas de frontières, alors que ce système de frontières est une nécessité pour arbitrer les conflits potentiels de cette région à hauts risques. Renoncer aux frontières utiles revient à attendre une orgie de sang et d'horreur, qui sera d'autant plus corsée qu'elle aura une dimension métaphysique (29). C'est une sombre perspective pour nous Européens, mais, pour les Turcs, elle implique la survie, quoi qu'il arrive, à l'horizon de la fin de l'histoire, que ce soit en préservant leur alliance privilégiée avec les Etats-Unis ou en entrant en conflit avec eux, remplaçant l'URSS comme détenteurs de la "Terre du Milieu", nécessairement opposés aux maîtres de la Mer.
Josef SCHÜSSLBURNER.
(extrait d'un article paru dans Staatsbriefe, n°9-10/2001; trad. franç.: Robert Steuckers).
Notes :
(1) Cf. «Waffen und Fundamentalismus. Die muslimischen Separatisten im Nordwesten Chinas erhalten zulauf», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.3.1999.
(2) Plus tard, un nombre plus élevé de tribus mongoles se sont progressivement "turquisées"; le terme "Moghol" le rappelle, par exemple, car il signifie "mongol" en persan; c'est un souvenir des origines mongoles des familles dominantes, alors qu'en fin de compte, il s'agit d'une domination turque sur l'Inde.
(3) F. Gabrieli, Mohammed in Europa - 1300 Jahre Geschichte, Kunst, Kultur, 1997, p. 143.
(4) La position d'Atatürk était purement tactique, en effet, si l'on se rappelle que les principaux responsables du génocide sont devenus les meilleurs piliers du régime kémaliste; cf. W. Gust, Der Völkermord an den Armeniern, 1993, pp. 288 et ss.
(5) Cf. «Stetig präsent. Das Engagement der Türkei in einem unsicher werdenden Mittelasien», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.10.1999.
(6) La Russie reconnaît effectivement cette problématique; cf. «Moskau will eine Allianz gegen Russland nicht hinnehmen. Ankara der Verbreitung pantürkischer Vorstellung bezichtigt - Abschluß des Gipfels (der Staatschefs von Aserbaidschan, Kasachstan, Kyrgystan, Usbekistan und Turkmnistan) in Istanbul» (!), Frankfurter Allgmeine Zeitung, 20.10.1994.
(7) Vu le caractère "irréversible" de la candidature de la Turquie à l'UE, la CDU et le Frankfurter Allgemeine Zeitung espèrent que l'ancien bourgmestre d'Istanbul fondera un parti islamique sur le modèle de la CDU (cf. «Im Zeichen der Glühbirne - Die neugegründete islamische Partei in der Türkei könnte erfolgreich sein - Diesen Erfolg will jedoch das kemalistische Regime nicht zulassen», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1991, p. 12; cf. également: «Neues Verfahren gegen Erdogan», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.8.2001, p. 8.
(8) A ce sujet, cf. «Ein U für ein Y. Schriftwechsel in Aserbaidschan von kyrillischen zu lateinischen Buchstaben; "…die durch den Wechsel der Schrift zu erwartende engere Anbindung an die Türkei sei von Vorteil für das Land, weil dadurch auch ein wirtschaftlicher Aufschwung zu erwarten sei», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.8.2001, p. 10.
(9) Pourtant la distance s'amplifie, cf. «Staatschefs der GUS reden über regionale Sicherheit; "… herrschen indes Zweifel am Sinn und Zweck der GUS, deren Staaten sich in den vergangenen Jahren auseinanderentwickelt haben», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.8.2001, p. 6.
(10) Malheureusement, il n'existe aucune présentation systématique de ce concept de "pseudo-démocratisation" téléguidée par les services secrets; on trouve cependant quelques allusions chez A. Zinoviev, Katastroïka, L'Age d'Homme, Lausanne. Par ailleurs, des allusions similaires se retrouvent dans A. Golitsyn, New Lies for Old, 1984, livre dont nous recommandons la lecture car l'auteur, sur base de sa bonne connaissance du système soviétique de domination, a parfaitement pu prévoir la montée de la perestroïka.
(11) Voir le titre de chapitre, p. 109, dans le livre de Peter Scholl-Latour, Das Schlachtfeld der Zukunft. Zwischen Kaukasus und Pamir, 1998.
(12) Ibidem, pp. 151 et ss.
(13) Cf. «Türkisierung des Islam? Eine alte Idee wird in Ankara neu aufgelegt», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.9.1998.
(14) Références dans U. Steinbach, Geschichte der Türken, 2000, p. 111.
(15) Dans ce contexte, il convient de citer le nom du prédicateur itinérant Fethullah Gülen, toutefois soupçonné par les kémalistes, cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.4.1998.
(16) C'est ce que souligne à juste titre Huntington, pp. 281 et suivantes de l'édition de poche allemande de son livre Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, 1996.
(17) Il existe une étape intermédiaire entre une religion civile empreinte de dogmatisme, comme cette "révision moralisante et permanente du passé" qui s'exerce en RFA, et une véritable religion d'Etat: c'est le concept du "panchasilla", qui est à la fois politique et religieux, propre au régime indonésien, qui permet à l'Etat d'énoncer des dogmes religieux, comme celui d'un monothéisme abstrait, ce qui oblige la minorité bouddhiste d'interpréter l'idée de nirvana dans un sens théiste, ce qui prépare en fait son islamisation (voir notre note 20).
(18) On en trouve une bonne présentation chez Anton J. Dierl, Geschichte und Lehre des anatolischen Alevismus-Bektasismus, 1998, voir en particulier pp. 29 et ss.
(19) L'accent mis sur le corps et sur les besoins du corps, y compris l'autorisation de boire de l'alcool, a rendu les Alévites suspects, comme jadis les Pauliciens et les Bogomils, dont la spiritualité est sous-jacente à l'islam européen dans les Balkans. On peut hésiter à qualifier cette religiosité de "gnostique". Toutefois la construction théologique générale possède les caractéristiques du gnosticisme, car son lien avec l'islam apparaît plutôt fortuit (en effet, les doctrines gnostiques peuvent recevoir aisément une formulation chrétienne ou bouddhiste, comme l'atteste le manichéisme).
(20) Cette conception peut provenir du temps où la majeure partie des peuples turcs était encore bouddhiste : à l'évidence, il s'agit ici d'une interprétation théiste du nirvana; on peut supposer qu'elle ait continué à exister au niveau de la mémoire, même après la conversion à l'islam de ces Turcs bouddhistes d'Asie centrale et d'Inde, même si cette théorie n'est pas satisfaisante pour expliquer le principe du karma tout en niant l'existence de l'âme.
(21) On peut y reconnaître des influences venues de l'hindouisme ; la vision de Dieu comme créateur, conservateur et destructeur du monde rappelle la doctrine trifonctionnelle (Trimurti) de l'hindouisme; quant à savoir si les cercles ésotériques de l'alévisme turc croient à la transmigration des âmes —comme les Druses, mais qui se réfèrent à d'autres traditions, on peut simplement le supposer. Les Alaouites de Syrie le pensent, mais les Alévites turcs ne veulent rien avoir à faire avec les Alaouites qui dominent le système politique en Syrie, comme, en fin de compte, aucun Turc s'estimant authentiquement turc ne veut rien avoir à faire avec les Arabes!
(22) L'orthodoxie sunnite n'a pas pu reprendre en charge cette fonction, car elle s'opposait à la conversion forcée des Chrétiens (jusqu'en 1700, les janissaires se recrutaient parmi les garçons chrétiens enlevés à leurs familles); cette orthodoxie ne pouvait accepter qu'un musulman soit l'esclave d'un chrétien (ce que les janissaires étaient formellement en dépit de leur conversion forcée); ce devrait être un avertissement à ceux qui pensent que les Alévites sont des "libéraux" que l'on pourrait soutenir contre l'orthodoxie islamique.
(23) Cf. «Das Doppelspiel der Amerikaner : Unter den Europäern wächst die Irritation über das zwielichtige Agieren Washingtons auf dem Balkan : Als Paten der UÇK sind die USA mitverantwortlich für die Zuspitzung des Konflikts zwischen Albanern und Slawo-Mazedoniern», Der Spiegel, n°31/2001, p. 100.
(24) Il faut tenir compte du fait que l'Islam, actuellement, se trouve à une période de son histoire qui correspond à celle de la Ré forme en Europe : à cette époque-là en Europe, la démocratisation ne pouvait se comprendre que comme une théocratisation - l'Iran actuel correspond ainsi au pouvoir instauré par Calvin à Genève (et aux théocraties équivalentes installées en Nouvelle-Angleterre). Il faudrait en outre accorder une plus grande importance à la phénoménologie culturelle que nous a léguée un Oswald Spengler; celui-ci , avec une précision toute allemande, a approfondi la théorie de l'anakyklosis (doctrine des cycles ascendants) de Polybe. Pour les collaborateurs des services de sûreté allemands, Spengler et Polybe seraient automatiquement classés comme des "ennemis de la constitution", car ni l'un ni l'autre n'auraient cru, aujourd'hui, à l'éternité du système de la RFA actuelle, que tous les historiens contemporains sont sommés de ne jamais relativiser!
(25) Cf. le résumé final dans le livre de Peter Scholl-Latour, op. cit., p. 294.
(26) Comme le dit bien le titre du livre de Peter Scholl-Latour, op. cit.
(27) Ibidem, p. 511.
(28) Comme le dit à juste titre Samuel Huntington, op. cit. , p. 495.
(29) Exactement comme le dit le titre de chapitre en page 151 du livre de Peter Scholl-Latour, op. cit.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, turquie, panturquisme, pantouranisme, europe, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 août 2008
Il simbolismo degli scacchi
Il simbolismo degli scacchi
di Titus Burckhardt
Il simbolismo degli scacchi
Il gioco degli scacchi, come è noto, è originario dell’India. L’Occidente medievale lo ha conosciuto grazie alla mediazione dei Persiani e degli Arabi, come testimonia fra l’altro l’espressione “scacco matto” (in tedesco: Schachmatt) derivante dal persiano shah (re) e dall’arabo mat (è morto). Nel Rinascimento furono cambiate alcune regole del gioco: la regina e i due alfieri (erano in origine elefanti che trasportavano una torre fortificata) acquistarono maggiore mobilità; il gioco divenne più astratto e matematico, e si allontanò dal suo modello concreto (la strategia) senza comunque perdere i tratti essenziali del suo simbolismo.
Nella posizione iniziale dei pezzi, l’antico modello strategico resta evidente; vi si riconoscono le due armate disposte nell’ordine di battaglia in uso presso gli eserciti dell’antico Oriente: le truppe leggere, rappresentate dai pedoni, formano la prima linea, mentre il grosso dell’armata è costituito dalle truppe pesanti, i carri da guerra (le torri), i cavalieri (i cavalli) e gli elefanti da combattimento (gli alfieri); il re e la sua dama - o il suo “consigliere” - si tengono al centro delle truppe. La forma della scacchiera corrisponde al tipo “classico” del Vastu-mandala, il diagramma che costituisce anche il tracciato fondamentale di un tempio o di una città. Tale diagramma è simbolo dell’esistenza, concepita come un “campo d’azione” delle potenze divine. Il combattimento rappresentato dal gioco degli scacchi è dunque figura, nel suo significato più universale, del combattimento dei devas con gli asuras, degli “dei” con i “titani”, o degli “angeli” (i devas della mitologia indù sono infatti analoghi agli angeli delle tradizioni monoteiste) coi “demoni”: tutti gli altri significati del gioco derivano da questo.
La più antica descrizione del gioco degli scacchi che sia giunta fino a noi si trova nelle “Praterie d’Oro” dello storico arabo al-Mas’udi, vissuto a Baghdad nel IX secolo. Al-Mas’udi attribuisce l’invenzione, o la codificazione, del gioco ad un re indù chiamato “Balhit”, discendente di “Barahman”. Vi è qui una confusione evidente fra una casta, quella dei Brahmani, ed una dinastia; ma l’origine brahmanica del gioco degli scacchi è dimostrata dal carattere eminentemente sacerdotale del diagramma a 8 x 8 quadrati (ashtapada). D’altronde, il simbolismo guerriero del gioco si rivolge agli Kshatriyas, la casta dei principi e dei nobili, come del resto è indicato da al-Mas’udi quando egli scrive che gli Indù consideravano il gioco degli scacchi (shatranj) come una “scuola di governo e di difesa”. Il re Balhit avrebbe scritto un libro su questo gioco, di cui “fece una sorta di allegoria dei corpi celesti, come i pianeti e i dodici segni zodiacali, dedicando ogni pedina ad un astro.”. Notiamo che gli Indù contano otto pianeti: il sole, la luna, i cinque pianeti visibili ad occhio nudo e Rahu, l’”astro oscuro” delle eclissi; ognuno di questi “pianeti” domina una delle otto direzioni dello spazio. Continua al-Mas’udi: “Gli Indiani attribuiscono un misterioso significato alla progressione geometrica effettuata sulle caselle della scacchiera; essi stabiliscono un rapporto fra la causa prima, che domina tutte le sfere ed a cui tutto fa capo, e la somma del quadrato delle caselle della scacchiera.”. Qui, l’autore confonde probabilmente il simbolismo ciclico implicito nell’ashtapada con la famosa leggenda secondo la quale l’inventore del gioco chiese al monarca di riempire le caselle della sua scacchiera con dei chicchi di grano, ponendo un solo chicco sulla prima casella, due sulla casella successiva, quattro sulla terza e così via, fino alla 64° casella, ottenendo così un totale di 18446744073709551616 chicchi. Il simbolismo ciclico della scacchiera consiste nel fatto che essa esprime lo sviluppo dello spazio secondo il quaternario e l’ottonario delle direzioni principali (4×4x4=8×8), e che sintetizza, sotto forma “cristallina”, i due grandi cicli complementari del sole e della luna: il duodenario dello Zodiaco e le 28 case lunari; d’altra parte, il numero 64, somma delle caselle della scacchiera, è un sottomultiplo del numero ciclico fondamentale 25920, che misura la processione degli equinozi. Abbiamo visto che ciascuna fase di un ciclo, “fissata” nello schema di 8×8 quadrati, è dominata da un astro e simboleggia al contempo un aspetto divino personificato da un deva (certi testi buddhisti descrivono l’universo come una tavola di 8×8 riquadri, fissati per mezzo di corde d’oro; questi riquadri corrispondono ai 64 kalpas del Buddhismo. Nel Ramayana, la città inespugnabile degli dei, Ayodhya, è descritta come un quadrante avente otto comparti su ciascun lato. Nelle Tradizione cinese, i 64 segni derivanti dagli 8 trigrammi commentati nell’I-King. Questi 64 segni sono generalmente disposti in maniera tale che corrispondono alle otto regioni dello spazio). In tal modo questo mandala rappresenta contemporaneamente il cosmo visibile, il mondo dello Spirito e la Divinità nei suoi molteplici aspetti.
Al-Mas’udi afferma dunque con ragione che gli Indiani spiegano “con dei calcoli” basati sulla scacchiera “il cammino del tempo ed i cicli, le influenze superiori che agiscono su questo mondo ed i legami che le collegano con l’anima umana.”. Il simbolismo ciclico della scacchiera era noto ad Alfonso il Saggio, il celebre trovatore di Castiglia che compose nel 1283 i suoi Libros de Acedrex, opera che s’ispira in gran parte alle fonti orientali. Alfonso il Saggio descrive anche un’antichissima variante del gioco degli scacchi (il “gioco delle quattro stagioni”) che richiede quattro giocatori, così che le pedine, disposte ai quattro angoli della scacchiera, avanzino in un senso rotatorio analogo al movimento del sole. Le 4×8 pedine devono essere di colore verde, rosso, nero e bianco; esse corrispondono ai quattro elementi: aria, fuoco, terra ed acqua, ed ai quattro “umori” organici. Il movimento dei quattro gruppi simboleggia la trasformazione ciclica.
Questo gioco, che richiama stranamente certi riti e certe danze “solari” degli Indiani dell’America settentrionale, mette in evidenza il principio fondamentale della scacchiera. La scacchiera può essere considerata come uno sviluppo di uno schema composto da quattro quadrati alternativamente neri e bianchi, e costituisce di per sé un mandala di Shiva, Dio nel suo aspetto di “trasformatore”: il ritmo quaternario, di cui questo mandala è come la “cristallizzazione” spaziale, esprime il principio del tempo. I quattro quadrati, disposti intorno ad un centro non manifestato, simboleggiano le fasi cardinali di ogni ciclo. L’alternanza delle caselle bianche e nere, in questo schema elementare della scacchiera, ne evidenzia il significato ciclico e ne fa l’equivalente rettangolare del simbolo estremo orientale del yin-yang; essa è un’immagine del mondo visto sotto l’aspetto del suo dualismo intrinseco. Se il mondo sensibile, nel suo dispiegamento integrale, risulta in qualche modo dalla moltiplicazione delle qualità inerenti allo spazio e di quelle del tempo , il Vastu-mandala, dal canto suo, deriva dalla divisione del tempo secondo lo spazio: ricordiamo a questo proposito la genesi del Vastu-mandala a partire dal ciclo celeste indefinito, ciclo diviso dagli assi cardinali e poi “cristallizzato” in una forma rettangolare. Il mandala è dunque il riflesso inverso della sintesi principale dello spazio e del tempo, ed è in ciò che risiede la sua portata ontologica.
D’altra parte, il mondo è “intessuto” delle tre qualità fondamentali o gunas, e il mandala rappresenta questa “tessitura” in modo schematico, conformemente alle direzioni cardinali dello spazio. L’analogia tra il Vastu-mandala e la tessitura è evidenziata dall’alternanza dei colori, che ricorda un tessuto il cui ordito e la cui trama sono alternativamente apparenti o nascosti. L’alternanza del bianco e del nero corrisponde d’altro canto ai due aspetti, in linea di principio complementari ma in pratica opposti, del mandala: questo è da una parte un Purusha-mandala, cioè un simbolo dello Spirito universale (Purusha) in quanto sintesi immutabile e trascendente del cosmo; d’altra parte, esso è un simbolo dell’esistenza (Vastu) considerata come il supporto passivo delle manifestazioni divine. La qualità geometrica del simbolo esprime lo Spirito; la sua estensione puramente quantitativa esprime l’esistenza. Del pari, la sua immutabilità ideale è “spirito”, la sua fissazione limitativa è “esistenza” o materia; nella polarità considerata, quest’ultima non è la materia prima, vergine e generosa, ma la materia secunda tenebrosa e caotica, radice del dualismo esistenziale. Ricordiamo a questo proposito il mito secondo cui il Vastu-mandala rappresenterebbe un asura, personificazione dell’esistenza bruta: i devas hanno sconfitto questo demone, stabilendo le loro “dimore” sul corpo disteso della loro vittima; essi gli imprimono così la loro “forma”, ma è lui che li manifesta (il mandala di 8×8 quadrati è anche detto Manduka, la “rana”, per allusione alla Grande Rana che sostiene tutto l’universo ed è il simbolo della materia indifferenziata e oscura).
Questo doppio senso che caratterizza il Vastu-Purusha-mandala, e che si ritrova, d’altronde, in modo più o meno esplicito, in ogni simbolo, verrà per così dire “attualizzato” dal combattimento che il gioco degli scacchi rappresenta. Questo combattimento, dicevamo, è essenzialmente il conflitto fra devas e asuras, che si disputano la scacchiera del mondo. E’ qui che il simbolismo del bianco e del nero, già contenuto nell’alternanza delle caselle della scacchiera, acquista tutto il suo valore: l’armata bianca è quella della Luce, l’armata nera è quella delle tenebre. Da un punto di vista relativo, la battaglia raffigurata sulla scacchiera rappresenta sia quella di due veri e propri eserciti terreni, ciascuno dei quali combatte in nome di un principio, sia quella dello spirito e delle tenebre nell’uomo (in una guerra santa, è possibile che ciascuno dei due avversari possa legittimamente considerarsi il protagonista della lotta della Luce contro le tenebre. E’ questa un’altra conseguenza del duplice senso di ogni simbolo: quello che per l’uno è espressione dello Spirito, può essere l’immagine della materia tenebrosa agli occhi dell’altro). Sono, queste, le due “guerre sante”: la “piccola guerra santa” e la “grande guerra santa”, secondo un’espressione del Profeta. E’ da notare l’affinità fra il simbolismo del gioco degli scacchi ed il tema della Bhagavad-Gita, il libro parimenti rivolto agli Kshatriyas. Se si traspone il significato dei diversi pezzi del gioco nell’ordine spirituale, il re sarà il cuore o lo spirito e le altre figure saranno le diverse facoltà dell’anima. Le loro mosse corrispondono d’altronde a differenti modalità di realizzazione delle possibilità cosmiche rappresentate dalla scacchiera: vi è il movimento assiale delle “torri” o carri da guerra, il movimento diagonale degli “alfieri” o elefanti, che si spostano su caselle di uno stesso colore, ed il complesso movimento dei cavalieri. Il movimento assiale, che “taglia” attraverso i diversi “colori”, è logico e virile, mentre il movimento diagonale corrisponde ad una continuità “esistenziale”, perciò femminile. Il salto dei cavalieri corrisponde all’intuizione.
Ciò che più affascina l’uomo di casta nobile e guerriera, è la relazione fra volontà e destino. Ora, il gioco degli scacchi illustra proprio questa relazione, in quanto i suoi concatenamenti restano sempre intelligibili senza essere limitati nella loro varietà. Alfonso il Saggio, nel suo libro sul gioco degli scacchi, racconta che un re dell’India volle sapere se il mondo obbedisce all’intelligenza o al caso. Due saggi, suoi consiglieri, fornirono risposte contrastanti e, per provare le rispettive tesi, uno di loro prese come esempio il gioco degli scacchi, in cui l’intelligenza prevale sul caso, mentre l’altro portò dei dadi, immagine della fatalità. Del pari, al Mas’udi scrive che il re “Balhit”, il quale avrebbe codificato il gioco degli scacchi, preferì quest’ultimo al nerd, un gioco d’azzardo, poiché nel primo “l’intelligenza trionfa sempre sull’ignoranza”. Ad ogni fase del gioco, il giocatore è libero di scegliere fra varie possibilità; ma ogni mossa comporterà una serie di conseguenze ineluttabili: la necessità delimiterà vieppiù la libera scelta, facendo sì che il termine del gioco non rappresenti il frutto del caso, bensì il risultato di leggi rigorose. E’ qui che si rivela non soltanto la relazione fra volontà e destino, ma anche fra libertà e conoscenza: prescindendo da eventuali inaccortezze dell’avversario, il giocatore manterrà la propria libertà d’azione nella misura in cui le sue dimensioni coincideranno con la natura stessa del gioco, ovvero con le possibilità che questo implica. In altri termini, la libertà d’azione va in questo caso di pari passo con la preveggenza e con la conoscenza delle possibilità; l’impulso cieco, di contro, per quanto possa apparire libero e spontaneo in un primo momento, si rivela a conti fatti come una non-libertà. L’ “arte regia” sta nel governare il mondo (esteriore o interiore) in conformità con le leggi che gli sono proprie. Questa arte presuppone la sapienza, che è conoscenza delle possibilità; ora, tutte le possibilità sono contenute in sintesi nello Spirito universale e divino. La vera sapienza è l’identificazione più o meno perfetta con lo Spirito (Purusha), simboleggiato dalla qualità geometrica della scacchiera (lo Spirito o il Verbo è la “forma delle forme”, vale a dire il principio formale dell’universo), “sigillo” dell’unità essenziale delle possibilità cosmiche. Lo Spirito è la Verità: nella Verità l’uomo è libero, fuori di essa è schiavo del destino. Questo è l’insegnamento del gioco degli scacchi. Lo Kshatriya che ad esso si dedica non vi trova solo un passatempo, un modo di sublimare la sua passione guerriera e la sua sete d’avventura, ma anche (in proporzione alla sua capacità intellettuale) un supporto speculativo, una via che dall’azione porta verso la contemplazione.
Titus Burckhardt
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, symbolisme, échecs |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
R. Vaneigem: "Nous qui désirons sans fin"
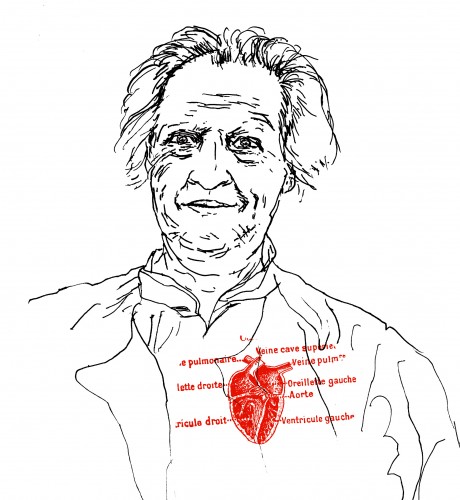
Vaneigem: «nous qui désirons sans fin»
Les écrits des auteurs situationnistes bénéficient chez nos amis toujours d'un accueil intéressé surtout depuis que la crise sociale du capitalisme libre-échangiste confirme certaines de leurs prévisions. Le délitement de la société débouchant sur “une nouvelle forme de lutte spontanée: la criminalité”, selon Guy Debord et ce, dès 1968 (voir NdSE n°20), ou sur une crise de l'école sans précédent jusqu'à devenir “une bureaucratie parasitaire destinée à s'effondrer sous le poids de sa propre inutilité”, selon Raoul Vaneigem dans son opuscule Avertissement aux écoliers et lycéens paru l'an dernier (voir NdSE n°16). Voici une lucidité sociale indéniable qu'aujourd'hui monsieur-tout-le-monde peut vérifier dans sa vie quotidienne. Fait significatif: son Avertissement... a joui d'un succès incroyable: plus de 100.000 exemplaires vendus et Guy Debord, lui aussi, n'avait jamais connu une diffusion aussi considérable. Vaneigem, qui avait peu écrit après son ouvrage maître Traité de savoir vivre à l'usage des jeunes générations (1967), semble inspiré par les temps présents puisqu'il enchaîne maintenant succès sur succès.
Ainsi il aura fallu attendre trente ans pour que les prophéties des auteurs situationnistes se révèlent exactes. Debord décédé, il reste à Vaneigem le soin de décrire l'aboutissement de celles-ci. Après son essai sur le système éducatif, il publie Nous qui désirons sans fin, analyse critique de la société marchande en déclin, livre conçu sous forme de brèves analyses et de thèses. L'idée centrale en est que le capitalisme mondial n'est plus qu'un système parasitaire déterminant l'existence d'une bureaucratie où le politique est aux ordres d'une pratique usuraire. Toute l'organisation sociale est ainsi menacée jusque dans sa contestation qui, ne cherchant d'autre solution en dehors de l'économie d'exploitation, se dégrade avec elle.
Cependant ce livre se veut optimiste puisqu'il en appelle à une société vivante vouée à dépasser la nôtre: la réponse est en chacun d'entre nous, dès l'instant où il lui importe avant tout de renaître à ce qu'il y a en lui de plus vivant. Dans ses paragraphes généralement courts, Vaneigem n'arrive pas toujours à éviter des répétitions, ce qui en rend la lecture parfois un peu lassante. Malgré ce défaut de forme, sa démonstration apparaît comme brillante surtout lorsqu'il s'agit de démonter les mécanismes d'un capitalisme spéculatif, qui reste le point fort de l'ouvrage. Alors les aphorismes éclairants jaillissent, criants de vérité, délicieux joyau pour l'esprit, comme:
* «Il a fallu que le libre-échange conquière la terre entière et la désole au nom de sa liberté pour se convaincre dans les faits que l'être humain ne se pouvait confondre totalement avec la marchandise».
* «La désagrégation sociale et le désarroi des mentalités s'accentuent à mesure que le capital se retire lentement et sûrement du secteur de la production».
Presque à chaque instant nous pouvons vérifier le bien fondé de ces affirmations.
Dans une société où la croissance n'avait jamais été aussi importante, générant une production gigantesque de richesse, le travail avait fini par être accepté, la consommation en étant sa consolation. On en vient maintenant à réduire le chômage en produisant des emplois sans nécessité comme s'il importait “aux yeux des gouvernants de fournir un salaire plutôt que d'accorder une aumône”. Créer des emplois parasitaires, tel est le projet de société de ce capitalisme.
Vaneigem décrit alors cet univers étrange, dans lequel nous sommes, avec beaucoup de réalisme: «Une apathie générale consume les individus et les foules dans la corrosion du désenchantement, la morosité du jour qui se lève, une indigne résignation, la rage absurde de révolte sans révolution. Le parasitisme érigé en pratique par une rentabilité prioritaire colporte des comportements d'assistés, déclenche des réflexes d'obédience, remplace le poing sur la gueule par la main qui mendie».
Malheureusement pour lui, ce discours jusqu'ici inégalé vient d'être repris pour le très grand public par la romancière Viviane Forrester dans L'horreur économique, essai, il faut bien le dire verbeux, qui jouit actuellement d'une grande notoriété médiatique. Ses thèses, somme toutes assez banales, dont la finalité est de sauver, par une dernière version sociale-démocrate, la démo-ploutocratie, se trouve confortée par un sondage C.S.A. pour L'événement du jeudi qui révèle des résultats proprement effrayants pour les partisans du système: 31 % des personnes interrogées estiment que le système économique leur inspire de l'horreur, 40 % l'ennuie, 82 % pensent qu'il accroît les inégalités, 70 % pensent que les chefs d'entreprise sont prêts à sacrifier leurs employés au nom de la sacro-sainte rentabilité économique. Face à l'ampleur de la crise sociale que la France est en train de connaître une prise de conscience timide des populations est en train de s'opérer.
Bien entendu, nous partageons également l'analyse de Vaneigem sur la destruction de l'environnement qui le rattacherait plutôt au courant de la deep ecology. Il pense également que la crise pourra engendrer des mouvements de reconversion comme nous pouvons l'observer actuellement dans des mouvements alternatifs tel le S.E.L. Et son appel à un dépassement du religieux, en dehors de toutes les sectes, son attaque à mots couverts contre la célèbre phrase de Malraux («le XXIième siècle sera religieux ou ne sera pas») sont d'un intérêt certain.
Par contre ses développements sur la société vivante, appelée à dépasser la nôtre, sont décevants. Ceci parait malgré tout logique, si l'on prend en considération que la situation actuelle, radicalement nouvelle ne permet absolument pas de deviner ce que sera le monde de demain: une situation à l'albanaise est-elle envisageable chez nous? Alors pourquoi affirmer que “le renouveau de la femme et de l'enfant est l'avenir du monde”?, affirmation qui apparaît ici presque gratuite est surtout bien naïve.
Et puis même si nous souscrivons pleinement à une affirmation comme “Qui prête moins d'attention à ses désirs qu'à son travail ne devrait pas s'étonner qu'il travaille contre lui”. Nous ne sommes quand même pas assez bêtes pour croire à un épanouissement de l'individu par le travail. Seuls les cons n'ont pas encore compris une telle banalité!
Nous ne croyons d'ailleurs pas non plus à un changement de la nature humaine par l'éducation à laquelle Vaneigem semble croire, alors que, pour ma part, je pense que la scolarisation actuelle est déjà surannée. Des études aussi poussées n'ont été acceptées par les enfants des classes modestes justement en contrepartie d'une promotion sociale quasiment impossible à réaliser aujourd'hui, et alors permise par les quelques décennies de grande croissance économique. D'une certaine manière, le désordre actuel est un retour à la situation qui régnait dans les campagnes au XIXième siècle ou les instituteurs avaient le plus grand mal à apprendre à lire à des petits paysans qui préféraient déjà à l'époque garder leurs vaches dans les champs ou jouer à la guerre des boutons: une version traditionnelle du repli sur sa communauté d'origine et du phénomène des bandes ethniques, en quelque sorte. Enfin comme dans son précédent ouvrage, Vaneigem fait une impasse totale sur le rôle fondamental que jouent les médias dans le système qu'il dénonce.
Alors je me suis dit, en voyant les piles de bouquins empilés de Vaneigem sur le rayon “sociologie” d'une FNAC, que les écrits des vrais rebelles, ceux qui veulent une véritable alternative au système, ne sont disponibles ni dans les kiosques, ni dans les librairies, temples de ce monde de la culture marchande et dont par conséquent les marchandises doivent le plus souvent chanter les louanges, sauf exceptions rarissimes. Nous, à “Synergies”, sommes de véritables auteurs de samizdats et c'est là notre fierté et notre force.
En définitive, il s'agit donc là d'un livre à aborder en ayant à l'esprit le fait que cette pensée démystifie en partie le sens du progrès propre au judéo-christianisme et à ses avatars libéraux et marxistes. Dans cette optique, Vaneigem marche dans les pas laissés par Nietzsche, Guénon ou Cioran: c'est ce qui nous intéresse dans sa pensée.
Pascal GARNIER.
Raoul VANEIGEM, Nous qui désirons sans fin, Paris, Le Cherche-Midi éditeur, 1996, Collection “amor fati”, 189 p., 98 FF.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, situationisme, désir |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook







