jeudi, 19 février 2026
Le Monde et l’Occident selon Toynbee
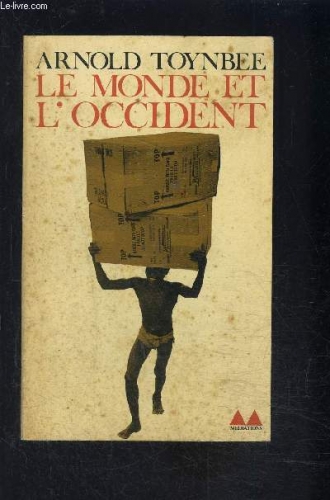
Le Monde et l’Occident selon Toynbee
Claude Bourrinet
Arnold Toynbee donna à la BBC des conférences, en 1952, qu’il groupa dans un petit livre qui a pour titre Le monde et l’occident.
Celui-ci se présente en deux volets. D’abord, une réflexion qui tente d’identifier des lois inhérentes au choc des civilisations. Puis un ensemble de documents historiques. Nous nous en tiendrons à la première partie.
En 1952, les empires européens, notamment britannique et français, sont sur le point de s’effondrer. Les Britanniques ont quitté l’Inde, et les Français perdent l’Indochine, en attendant l’Algérie. Cette domination mondiale de nations d’Europe occidentales semblait, quelque vingt ans auparavant, pérenne, et destinée à demeurer indéfiniment, quoique les Anglais aient promis de laisser aux autochtones la maîtrise de leur pays.
En initiant son titre par l’évocation du monde, avant celle de l’Occident, Toynbee révèle l’axe de sa réflexion. Il tente d’échapper à l’inévitable déformation perspectiviste qu’induit la surévaluation d’une appartenance. Il répudie toute appréhension journalistique, et même la strate que Hegel nomme l’Histoire immédiate. Il s’agit de dégager des constantes qui, si elles ne sont pas des lois, permettent de rendre visibles des évolutions peut-être prévisibles.
 Et en plaçant prioritairement le « monde » devant un Occident qui paraît avoir conquis la planète, il laisse entendre que l’avenir lui appartient avec une probabilité certaine.
Et en plaçant prioritairement le « monde » devant un Occident qui paraît avoir conquis la planète, il laisse entendre que l’avenir lui appartient avec une probabilité certaine.
Depuis quatre ou cinq cents ans, « le monde et l’Occident s’affrontent ». Mais c’est le monde qui a dû subir les assauts occidentaux, désastreux, terribles. Un monde qui, pourtant constitue, et de loin, la majorité de l’humanité.
Parmi les « civilisations » que Toynbee énumère, il y a les Russes, les Musulmans, les Hindous, les Chinois et les Japonais. Or, chacune de ces civilisations a essuyé des agressions féroces de la part de l’Occident. Les Russes, en 1941, 1915, 1812, 1709, 1610 ; les peuples d’Asie et d’Afrique, dès le XVe siècle. En outre, les Occidentaux ont dévoré ce qui restait de la planète: l’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande. Les Africains furent transportés en masse, comme esclaves, de l’autre côté de l’Atlantique, et les peuplades autochtones de l’Amérique éradiquées, ou soumises.
Ce sont des réalités historiques qui suscitent, chez les Occidentaux, un malaise, ou de l’indignation. Mais il s’agit, bien entendu, de se mettre à la place des peuples du monde, et d’essayer de comprendre ce qu’ils éprouvent, à savoir la colère.
Toynbee, alors, passe en revue ces peuples.
Les Russes sont chrétiens, mais orthodoxes, car convertis par Constantinople. Le communisme est une foi qui suit la logique de l’exaltation religieuse de l’ancienne religion. La haine entre les orthodoxes et l’Eglise catholique est plus que millénaire. Toutefois, la Russie (soviétisée) et l’Occident se trouvent maintenant dans une séquence post-chétienne. Or, on note, dans la longue histoire de leurs relations, la même hostilité. L’Occident a toujours voulu détruire la Russie. Pour Toynbee, cette récurrence de l’agressivité occidentale explique que les Russes aient toujours opté pour des régimes autoritaires, centralisateurs, militarisés, le tsarisme, ou le communisme. C’était soit la tyrannie, soit l’anéantissement.
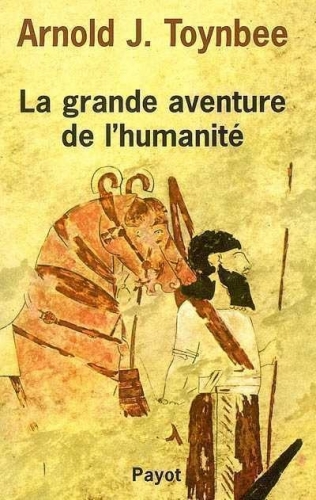 Pour se défendre, la Russie arriérée a adopté l’’armement occidental, ce qui lui a permis de mettre fin à la domination mongole, au XVIe siècle. Elle en a profité pour conquérir les terres de l’Oural et de Sibérie. Mais elle avait toujours du retard : les Polonais se sont emparés de Moscou durant deux ans, en 1610, grâce à la supériorité de leurs armes, et les Suédois ont coupé la Russie de son débouché sur la Baltique, au XVIIe siècle. C’est pourquoi Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, a mené dans son pays une révolution technique, qui a donné in fine la victoire sur l’Empire napoléonien. C’est le même schéma qui prévaut en 1917, avec, en plus, une arme idéologique typiquement occidentale, le marxisme: la Russie bolchevique a accéléré la concentration industrielle par besoin de puissance militaire: la victoire sur les Allemands n’a pas d’autre source.
Pour se défendre, la Russie arriérée a adopté l’’armement occidental, ce qui lui a permis de mettre fin à la domination mongole, au XVIe siècle. Elle en a profité pour conquérir les terres de l’Oural et de Sibérie. Mais elle avait toujours du retard : les Polonais se sont emparés de Moscou durant deux ans, en 1610, grâce à la supériorité de leurs armes, et les Suédois ont coupé la Russie de son débouché sur la Baltique, au XVIIe siècle. C’est pourquoi Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, a mené dans son pays une révolution technique, qui a donné in fine la victoire sur l’Empire napoléonien. C’est le même schéma qui prévaut en 1917, avec, en plus, une arme idéologique typiquement occidentale, le marxisme: la Russie bolchevique a accéléré la concentration industrielle par besoin de puissance militaire: la victoire sur les Allemands n’a pas d’autre source.
Toynbee transfère ce cas de figure à d’autres civilisations: le Japon avec l’ère Meiji, en 1868, bouleversement du vieux Japon, qui a amené une occidentalisation forcenée, d’abord technique et scientifique; la Chine avec le Kouo-Min-Tang, créé par Sun Yat-sen en 1912, puis avec les communistes; les musulmans qui, après un déclin aux XVIIIe siècle succédant à une série de conquêtes apparemment irrésistibles, jusqu’au siège de Vienne, en 1682-1683, essayèrent de se redresser, d’abord en Egypte, avec, en 1839, Mehemet-Ali Pacha.
C’est surtout en Turquie que le sursaut est spectaculaire: après la grande guerre russo-turque de 1768-1774, une réforme militaire fut diligentée par le sultan Selim III, qui monta sur le trône en 1789. Mais c’est surtout, un peu plus d’un siècle plus tard, en 1919, qu’un jeune officier, Mustapha Kemal Ataturk, décréta que les Turcs devaient s’occidentaliser.
Il faut noter que ces bouleversements énergiques étaient souvent le fait d’officiers, par exemple ceux qui entouraient Pierre le Grand, ceux qui tentèrent un coup d’état – qui échoua – en 1825, contre Nicolas 1er. Pourquoi? Parce que l’armée est la première concernée par la question technique, gage d’efficacité et de puissance.
Je ne vais pas entrer dans tous les aperçus d’une analyse qui est souvent passionnante. Mais il est opportun de s’arrêter sur deux questions capitales.
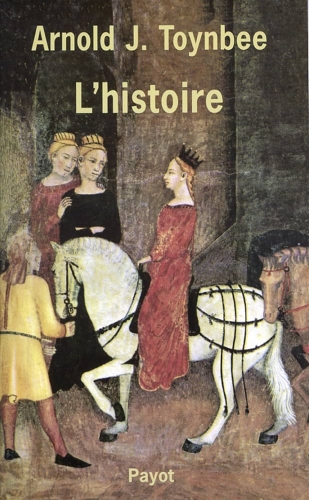 La première concerne les conséquences, pour une civilisation, de l’adoption d’un aspect important – comme la technique – d’une autre civilisation présumée « supérieure » (en puissance). Prenons le cas de deux nations d’extrême Orient, le Japon et la Chine. Le premier a rejeté violemment les Espagnols et les Portugais du pays, au XVIIe siècle, et la seconde les Occidentaux au XVIIIe. Les raisons de cette expulsion sont religieuses. La conversion d’une élite de ces pays au christianisme menaçait de susciter une « cinquième colonne » au sein des instances dirigeantes, et d’ouvrir la porte à la conquête étrangère. En outre, la religion est le cœur d’une civilisation, surtout si celle qui aspire à la remplacer est une foi fanatique, intolérante et dominatrice, ce qui n’est pas le cas des spiritualités orientales.
La première concerne les conséquences, pour une civilisation, de l’adoption d’un aspect important – comme la technique – d’une autre civilisation présumée « supérieure » (en puissance). Prenons le cas de deux nations d’extrême Orient, le Japon et la Chine. Le premier a rejeté violemment les Espagnols et les Portugais du pays, au XVIIe siècle, et la seconde les Occidentaux au XVIIIe. Les raisons de cette expulsion sont religieuses. La conversion d’une élite de ces pays au christianisme menaçait de susciter une « cinquième colonne » au sein des instances dirigeantes, et d’ouvrir la porte à la conquête étrangère. En outre, la religion est le cœur d’une civilisation, surtout si celle qui aspire à la remplacer est une foi fanatique, intolérante et dominatrice, ce qui n’est pas le cas des spiritualités orientales.
Or, les Européens, à partir de la fin du XVIIe siècle, prennent une certaine distance par rapport aux religions, catholique et protestante. Leur mode de fonctionnement politique et leurs rapports avec le reste du monde se font sur le mode de la puissance sécularisée. A ce titre, ils paraissent plus acceptables, car ils ne cherchent plus à convertir.
L’emprunt de moyens techniques, notamment pour l’armement, semble, a priori, être un ajout sans grand danger à l’identité civilisationnel d’un pays. Mais c’est une erreur de penser ainsi, et le prisme uniquement utilitariste relève d’une mauvaise perception des conséquences à long terme (cela peut mettre un siècle pour s’actualiser) pour la vie du pays, jusqu’aux moindres replis de l’existence. Car, pour utiliser la technique, il faut des hommes qui soient formés pour ce faire, qui en ait l’intelligence de l’usage, qui soient émancipés des traditions, qui ait de l’esprit d’initiative, qui soient curieux des innovations. Il faut aussi un Etat moderne, donc, à terme, des «citoyens». Tout cela crée des hommes individualistes et «libres». Les formations que les jeunes Japonais suivirent en Occident ne furent pas vaines: ils en ramenèrent les idées de progrès, de confort personnel, de nationalisme, etc. L’adoption de la technique occidentale aboutit fatalement à l’occidentalisation intégrale de la société traditionnelle, donc à sa destruction, comme la grippe, bénigne pour un Européen, provoqua des millions de morts en Amérique, chez les Indiens, et chez les peuplades du Pacifique.
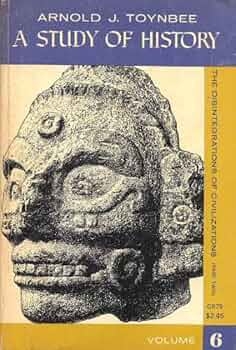 A ce destin fatal, deux attitudes sont possibles: soit une résistance à mort, soit une adaptation inévitable.
A ce destin fatal, deux attitudes sont possibles: soit une résistance à mort, soit une adaptation inévitable.
Une autre interrogation concerne notre avenir, celui d’un monde désormais occidentalisé. Remarquons que Toynbee aspire à une unité politique du monde, à un Etat unificateur, capable d’instaurer une paix universelle. Mais sur quelles bases? Il observe qu’au milieu du IIe siècle de notre ère, un immense espace, du Gange au Tyne, de l’Inde à la « Bretagne » (l’Angleterre) était occupé par trois Empires, l’Empire romain, celui des Parthes, et l’Empire Kouchan, qui avaient connu l’empreinte hellénique, et qui évitaient de se faire une guerre d’extermination. La paix régnait de facto, par l’équilibre des puissances.
Toutefois, pour créer ces empires, il avait fallu beaucoup batailler, souffrir. Et cette paix, qui ressemblait à un repos bien mérité, n’était pas satisfaisante pour les aspirations du cœur et de l’esprit. La vie sociale s’était stabilisée, mais au prix d’un ennui mortel. Le dard avait été retiré, mais le vide s’immisçait partout. Il fallait une raison de vivre, et ce fut une religion orientale, parmi d’autres concurrentes, une spiritualité transcendante, qui ouvrait un autre monde beaucoup, une eschatologie, un rêve millénariste, au prix d’une hellénisation de son corpus philosophique et artistique, ce fut le christianisme qui l’emporta dans l'Empire romain. Puis il y eut l'islam dans les autres parties de cet espace.
« Un dénouement historique similaire va-t-il s’inscrire dans l’histoire inachevée de la rencontre entre le monde et l’Occident ? Nous ne saurions le dire, puisque nous ignorons ce qui arrivera. Nous pouvons seulement dire que, ce qui s’est déjà produit une fois, au cours d’un autre épisode de l’histoire, reste une des possibilités de l’avenir. »
17:19 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : arnold j. toynbee, toynbee, histoire, livre, occident, occidentalisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pourquoi la Doctrine Monroe ne peut pas être rétablie

Pourquoi la Doctrine Monroe ne peut pas être rétablie
Patrick Frise
Source: https://es.sott.net/article/103531-Por-que-no-se-puede-re...
La Doctrine Monroe occupe une place inhabituelle dans le discours politique américain. Elle est souvent invoquée comme si elle représentait une norme permanente de gouvernance de l’hémisphère, susceptible d’être réactivée ou appliquée par toutes les administrations ultérieures. Dans son utilisation contemporaine, elle est fréquemment considérée comme une déclaration d’autorité américaine sur l’hémisphère occidental ou comme une justification pour l’intervention contre des puissances étrangères et des gouvernements régionaux.
Cette interprétation ne reflète pas le texte tel qu’il a été rédigé, ni les circonstances qui l’ont fait naître, ni les limites que ses auteurs lui ont assignées.
 La Doctrine Monroe n’était pas une doctrine destinée à conforter une politique permanente. Il s’agissait d’une proclamation circonstancielle émise en réponse à une série de préoccupations géopolitiques concrètes au début du 19ème siècle. Une fois ces conditions disparues, la doctrine a perdu sa signification opérationnelle. Ce qui en reste aujourd’hui n’est pas une politique vivante, mais un texte historique qui a été réutilisé à plusieurs reprises pour justifier une autorité qu’elle n’a jamais conférée.
La Doctrine Monroe n’était pas une doctrine destinée à conforter une politique permanente. Il s’agissait d’une proclamation circonstancielle émise en réponse à une série de préoccupations géopolitiques concrètes au début du 19ème siècle. Une fois ces conditions disparues, la doctrine a perdu sa signification opérationnelle. Ce qui en reste aujourd’hui n’est pas une politique vivante, mais un texte historique qui a été réutilisé à plusieurs reprises pour justifier une autorité qu’elle n’a jamais conférée.
La doctrine est née du message annuel du président James Monroe au Congrès en décembre 1823. À cette époque, le paysage politique des Amériques évoluait rapidement. Le Mexique avait obtenu son indépendance de l’Espagne en 1821. Les provinces d’Amérique centrale, y compris celles qui deviendront plus tard le Guatemala, le Honduras, El Salvador, le Nicaragua et le Costa Rica, avaient déclaré leur indépendance la même année. L’Amérique du Sud était en révolte depuis plus d’une décennie. Ces mouvements s’étaient en grande partie achevés au début des années 1820, bien que leur stabilité politique restait incertaine. En Europe, les guerres napoléoniennes venaient de se terminer, et les monarchies conservatrices organisées sous l'égide de la Sainte-Alliance revendiquaient le droit de réprimer les révolutions libérales et de restaurer les régimes traditionnels. La France intervint militairement en Espagne en 1823, ce qui suscita la crainte que les puissances européennes puissent aider l’Espagne à récupérer ses anciennes colonies. Pendant ce temps, la Russie avançait dans ses revendications territoriales le long de la côte pacifique de l’Amérique du Nord.


C’est en réponse à ces événements que Monroe a formulé ce qui sera plus tard appelé la Doctrine Monroe. Les passages pertinents du message sont explicites quant à leur portée. Monroe affirma que les continents américains, « en raison de leur statut libre et indépendant qu’ils ont assumé et maintiennent », ne devaient pas être considérés comme soumis à une future colonisation par les puissances européennes. La clause conditionnelle est essentielle. L’interdiction de la colonisation était directement liée à l’indépendance existante des États américains, et non à une revendication d’autorité américaine sur eux. Monroe souligna également que les États-Unis n’interviendraient pas dans les affaires intérieures de l’Europe ni dans ses colonies existantes. « Lors des guerres entre puissances européennes, dans des affaires qui les concernent », dit-il, « nous n’avons jamais pris part, car cela ne concorde pas avec notre politique. » L’action américaine, expliqua-t-il, serait défensive et limitée aux circonstances où des droits américains seraient piétinés ou sérieusement menacés.
Rien dans la proclamation n’affirmait le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’autres États américains, d’exercer une autorité de supervision ou de contrôler la politique régionale. La doctrine fonctionnait comme une mise en garde diplomatique à l’extérieur, non comme une déclaration d’autorité à l’intérieur. Elle était indissociable des conditions qui l’avaient engendrée. En 1823, les États-Unis ne disposaient pas des capacités militaires nécessaires pour imposer leur domination dans l’hémisphère. La puissance navale britannique, motivée par l’intérêt du Royaume-Uni pour le libre-échange plutôt que pour la restauration d’empires, était le principal élément dissuasif contre toute tentative de recolonisation européenne.
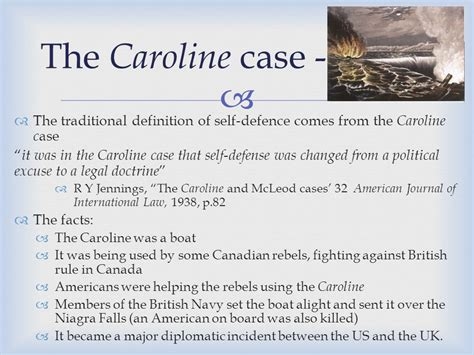
Cette conception de la modération n’était pas exclusive à Monroe. Après l’incident du navire Caroline en 1837, lors de la rébellion du Haut-Canada, le secrétaire d’État Daniel Webster formula ce qui serait plus tard connu sous le nom de doctrine Caroline. Dans sa correspondance avec les responsables britanniques, Webster rejeta les revendications étendues d’autodéfense préventive et insista sur le fait que toute utilisation de la force devait être justifiée par un besoin immédiat, écrasant, qui ne laissait pas d’autre choix que de délibérer sur les moyens ou le moment. L’incident, qui découla des tensions le long de la frontière entre le Maine et le Canada, reflétait le même principe sous-jacent que la Doctrine Monroe: l’usage de la force n’était permis qu’en dernier recours, lié à des menaces concrètes et limité par la proportionnalité.
Même au 19ème siècle, la Doctrine Monroe ne fonctionnait pas comme une norme de conduite internationale applicable. Les puissances européennes continuèrent d’intervenir en Amérique après 1823, notamment avec l’instauration par la France de l’empereur Maximilien au Mexique dans les années 1860. Plus significatif encore, les fondements réciproques de la doctrine se sont érodés lorsque les États-Unis ont abandonné leur propre engagement de non-intervention. À la fin du 19ème siècle, la politique étrangère américaine s’était nettement éloignée de la modération. La guerre hispano-américaine (1898) et le contrôle américain ultérieur sur Cuba et Porto Rico marquèrent un éloignement évident par rapport à la position de Monroe.

Ce changement fut officialisé avec le Corollaire Roosevelt en 1904, lorsque le président Theodore Roosevelt affirma que les désordres politiques dans l’hémisphère occidental pouvaient justifier l’intervention américaine pour empêcher toute participation européenne. Ce raisonnement inversait la logique de la Doctrine Monroe. Alors que Monroe mettait en garde contre l’ingérence extérieure, Roosevelt affirmait un droit discrétionnaire d’ingérence intérieure. Le corollaire ne découlait pas du texte de la Doctrine Monroe, mais la remplaçait.
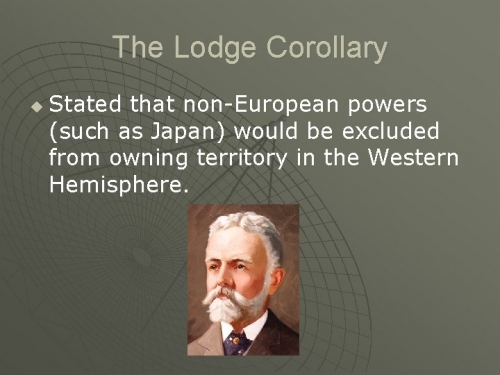
Le corollaire Lodge de 1912 illustre encore davantage à quel point la politique américaine s’était éloignée des prémisses originales fixées par Monroe. Proposé par le sénateur Henry Cabot Lodge et adopté par le Sénat, la résolution affirmait que les États-Unis s’opposeraient à l’acquisition de territoires dans l’hémisphère occidental par des puissances non américaines, même par le biais d'un contrôle privé ou corporatif. Bien plus restrictif que les interprétations ultérieures, le Corollaire Lodge marqua une déviation par rapport aux préoccupations de Monroe concernant la colonisation européenne formelle liée à la restauration post-napoléonienne. Il reflétait une importance croissante accordée à l’exclusion plutôt qu’à la réciprocité. Cependant, il ne visait pas à autoriser le changement de régime, la domination militaire ou la supervision politique des États américains.
Une fois que les États-Unis se furent engagés dans des interventions répétées dans toute l’Amérique centrale et les Caraïbes, et qu’ils se lièrent plus tard de façon permanente à la sécurité européenne à travers deux guerres mondiales et des alliances durables, la prémisse réciproque de la Doctrine Monroe disparut. Une politique basée sur la non-intervention mutuelle ne peut survivre lorsque l’une des parties abandonne ce principe. À ce moment-là, la doctrine cessa de fonctionner comme elle avait été rédigée; elle ne subsista que comme rhétorique.
Les récentes invocations de la Doctrine Monroe illustrent à quel point cette distanciation rhétorique a progressé.
Lors d’un discours prononcé le 6 décembre 2025 au Forum de la Défense Nationale Reagan, le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth a déclaré :
« C’est le corollaire de Trump à la Doctrine Monroe, récemment codifié avec autant de clarté dans la Stratégie de Sécurité Nationale. Après des années d’abandon, les États-Unis restaureront leur domination militaire dans l’hémisphère occidental. Nous l’utiliserons pour protéger notre patrie et accéder à des terrains clés dans toute la région. »
Le 3 janvier 2026, le secrétaire Hegseth a déclaré :
« Le Venezuela a une longue histoire en tant que pays riche et prospère. Il a été volé à son peuple par des dirigeants abominables. Nous pouvons les aider, ainsi que les États-Unis, à rétablir la Doctrine Monroe dans l’hémisphère occidental. Paix par la force avec nos alliés. »
Ces déclarations considèrent que la Doctrine Monroe constitue une base pour justifier la domination militaire, l’accès territorial et l’intervention politique. Cependant, rien dans la proclamation de 1823 n’autorise de telles actions. La doctrine ne confère pas le droit d’attaquer des nations, de procéder à des changements de régime ou de gérer la politique régionale. Elle traitait d’une crainte spécifique que les monarchies européennes pourraient réimposer la domination coloniale sur les nouveaux États indépendants américains au début du 19ème siècle. Cette crainte ne définit plus le système international. La géographie politique des Amériques s’est stabilisée pendant des générations. Les ambitions coloniales européennes dans l’hémisphère ont disparu depuis longtemps. Les États-Unis eux-mêmes ont à plusieurs reprises violé la restriction mutuelle sur laquelle reposait la doctrine.
Parler de « rétablir » la Doctrine Monroe dans ces conditions est une mauvaise interprétation du document. Un message présidentiel lié à un moment historique précis ne peut pas être ressuscité comme s'il était devenu le noyau dur d'une politique permanente, tout comme aucun autre discours du 19ème siècle ne peut aujourd’hui justifier une autorité contraignante. La doctrine n’était ni une loi, ni un traité, ni une disposition constitutionnelle. C’était un avertissement contextualisé, émis en réponse à des conditions temporaires. Une fois ces conditions disparues, la portée opérationnelle de la doctrine a également cessé d’avoir du sens.
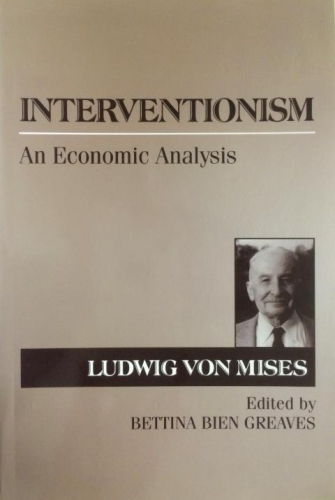 D’un point de vue de l'école autrichienne, ce processus n’est ni surprenant ni unique. Ludwig von Mises soutenait que l’intervention de l’État se limite rarement à son champ d’application initial, mais qu’elle engendre des pressions pour une intervention accrue, car les mesures antérieures ne résolvent pas les problèmes qu’elles créent. Dans Interventionism: An Economic Analysis (Interventionnisme : une analyse économique), Mises décrit cette dynamique comme un processus par lequel les autorités politiques élargissent continuellement leur champ d’action en réinterprétant leurs actions passées comme des justifications pour d’autres, plutôt que comme des limites à leur pouvoir. L’évolution de la Doctrine Monroe suit ce modèle. Une mise en garde historiquement contingente, une fois détachée de son contexte d’origine, devient un instrument politique flexible plutôt qu’une restriction à celle-ci.
D’un point de vue de l'école autrichienne, ce processus n’est ni surprenant ni unique. Ludwig von Mises soutenait que l’intervention de l’État se limite rarement à son champ d’application initial, mais qu’elle engendre des pressions pour une intervention accrue, car les mesures antérieures ne résolvent pas les problèmes qu’elles créent. Dans Interventionism: An Economic Analysis (Interventionnisme : une analyse économique), Mises décrit cette dynamique comme un processus par lequel les autorités politiques élargissent continuellement leur champ d’action en réinterprétant leurs actions passées comme des justifications pour d’autres, plutôt que comme des limites à leur pouvoir. L’évolution de la Doctrine Monroe suit ce modèle. Une mise en garde historiquement contingente, une fois détachée de son contexte d’origine, devient un instrument politique flexible plutôt qu’une restriction à celle-ci.
12:55 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, doctrine de monroe, états-unis, amérique, hémisphère occidental, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 février 2026
Edward Joris: anarchiste, terroriste et activiste flamand

Edward Joris: anarchiste, terroriste et activiste flamand
Jan Huijbrechts
Source: https://www.facebook.com/jan.huijbrechts.9
Le 11 février marquera le 150ème anniversaire de la naissance d’Edward Joris. Edward qui? me demandez-vous déjà… Aujourd’hui, cet Anversois est une note de bas de page oubliée dans les livres d’histoire, mais il a été un jour connu et surtout redouté dans le monde entier en tant que « terroriste ».
Il vit le jour en tant qu’unique enfant dans une famille modeste du quartier populaire de Sint-Andries. Ce quartier était connu comme la « Paroisse de Misèrerie », ce qui s’appliquait certainement à la famille Joris, qui ne roulait pas sur l’or, surtout après le décès de son père peu après la naissance d’Edward. Peut-être était-ce la raison pour laquelle le curieux Edward a dû quitter l’école à 13 ans pour travailler dans diverses entreprises maritimes. Très tôt, il s’intéressa à la politique, et à 19 ans, Edward Joris, qui avait déjà déménagé à Borgerhout, devint secrétaire de la section locale du Parti Ouvrier Socialiste belge.
De plus, il était aussi un syndicaliste énergique de la confédération de travailleurs « l’Unitas ». Jeune et radical, il était attiré par l’anarchisme et fréquentait régulièrement la Chapelle (de Kapel), un ancien lieu de culte, dit Lantschot, dans le Schipperskwartier ("le quartier des bateliers"). Cette Chapelle abritait un groupe éclectique d’avant-gardistes comprenant notamment les écrivains Emanuel De Bom, Lode Baekelmans, l’historien de l’art Ary Delen et les amateurs d’art libéraux, les frères Franck. Edward se sentait comme un poisson dans l’eau dans cette compagnie artistique et engagée, et il devint ami avec le futur beau-frère de Baekelmans, le libraire-éditeur flamand-libéral Victor Resseler, qui publiait la revue anarchiste Ontwaking, sympathisante du mouvement flamand.
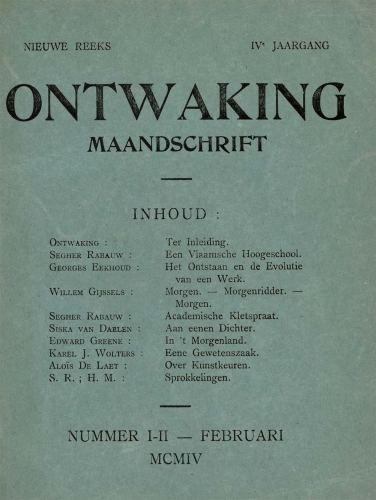
Entre 1901 et 1904, Edward Joris publiait régulièrement dans « Ontwaking » sous les pseudonymes Edward Greene et Garabed, traitant des tensions politiques dans l’Empire ottoman turc. Et ce n’était pas un hasard: en 1901, cherchant de nouveaux horizons, l'aventure et peut-être aussi une meilleure rémunération, il avait quitté le sable de Sint Anneke et les rives de l’Escaut pour aller se fixer sur le Bosphore, à Constantinople. Il obtint un poste de correspondant anglophone et francophone pour la Deutsche Levante Linie, mais le 14 août 1902 — moins d’un mois après son mariage avec sa fiancée d’Anvers, Anna Nellens — il fut mis à la porte. Heureusement pour le jeune couple, il trouva rapidement du travail et s’intégra à la filiale ottomane de la Singer Company, célèbre fabricant de machines à coudre. C’est dans cette entreprise qu’il rencontra Vramchabouh Vram Kendirian, nationaliste arménien, et fut impliqué dans ce que l’on appelait alors « la Question arménienne ».
L’Empire ottoman, immense, était un État multi-religieux et multi-ethnique où, avant la Première Guerre mondiale, les Arméniens occupaient une position protégée mais clairement subordonnée. Au fur et à mesure que s'affaiblissait le pouvoir central à Constantinople et que montait en puissance économique la communauté arménienne, les tensions entre chrétiens arméniens et Ottomans musulmans s’intensifièrent. Au milieu des années 1890, ces tensions entraînèrent le massacre de Hamidié. Ces massacres, nommés d’après le sultan Abdul Hamid II, qui avait réintroduit le pan-islamisme comme idéologie d’État, furent en partie ciblés contre les Arméniens, mais dégénérèrent parfois en pogroms antichrétiens arbitraires. Le nombre de victimes estimé de ces massacres varie entre 100.000 et 300.000.
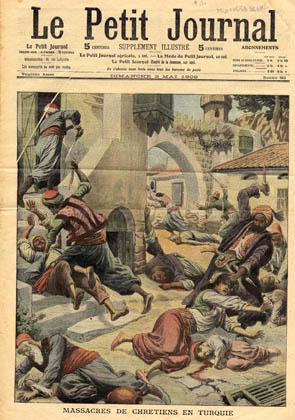
Les récits de Vram Kendirian, qui était devenu le meilleur ami d’Edward, laissèrent une profonde impression sur lui. Vram était un membre éminent de la « Dashnaktzutium », la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA). Lors d’un congrès à Sofia, en Bulgarie, en 1904, cette organisation décida d’assassiner le sultan. La personne chargée de cette mission était Christapor Mikaelian (photo, ci-dessous), l’un des fondateurs de la FRA, présenté à Edward par Vram.

Ils eurent peu de mal à convaincre Joris que seule la violence pouvait résoudre la Question arménienne. Vram et Mikaelian trouvèrent la mort en mars 1905 en expérimentant des explosifs en Bulgarie. Sur le corps déchiqueté de Vram, la police retrouva le passeport d’Edward Joris, utilisé par les terroristes présumés pour faire passer des explosifs, mais heureusement pour Joris, cette piste ne fut pas suivie. La mort de Vram radicalisa sans aucun doute Joris. Il apporta son aide à l’opération visant à éliminer le sultan. Dans sa maison, on ne se réunissait pas seulement pour discuter, mais il y hébergea aussi les conspirateurs, et comme si cela ne suffisait pas, 140 kg de poudre explosive, emballés comme si c'était du savon français, furent dissimulés dans sa résidence. Ces explosifs furent utilisés le 21 juillet 1905 lors de l’attentat contre le sultan, alors qu’il se rendait à la mosquée Yildiz pour la prière. L’explosion fit 26 morts et en blessa 58. Le sultan en sortit indemne. Les deux auteurs échappèrent à la police, et la femme de Joris réussit à se réfugier en Suisse. Cependant, Joris resta à Constantinople, ce qui le plaça dans une situation précaire, car une semaine plus tard, il fut arrêté. Le 25 novembre 1905, le procès débuta sous une large attention médiatique, et le 18 décembre, Joris et trois Arméniens furent condamnés à mort. Sa femme fut également condamnée à mort par contumace. Contrairement à ses co-condamnés arméniens, Joris ne fut pas torturé et fut plutôt bien traité. Cependant, l’isolement pesait psychologiquement, et à la mi-1907, il commença à élaborer des plans sérieux pour réussir une évasion…

Edward Joris et son épouse Anna Nellens.
Grâce à une campagne de solidarité internationale organisée par Emanuel De Bom et Victor Resseler, et à la pression diplomatique notamment des gouvernements belge et allemand, Joris fut libéré le 22 décembre 1907, contre toute attente. Après son retour à Anvers, il reprit « ’t Kersouwke », la librairie et maison d’édition de Resseler sur la place Saint-Jacques. Pendant la Première Guerre mondiale, il joua un rôle de premier plan dans la mouvance socialiste de l’activisme, aux côtés de Jef Van Extergem et Antoon Jacob. Les activistes voulaient, avec l’aide de l’occupant allemand, réaliser les revendications de la mouvance flamande d’avant-guerre, mais des figures plus radicales comme Van Extergem et Joris aspiraient se séparer de la Belgique et à créer une république flamande. Son activisme lui valut, après la guerre, cinq années de détention, mais il put y échapper en fuyant vers les Pays-Bas. Après la loi de suspension, il retourna à Anvers en 1929 et travailla à la Radio ouvrière socialiste. Il n’est pas clair si son travail comme directeur de la publicité pour le journal collaborateur « De Dag » à Anvers lui causa à nouveau des problèmes après la Seconde Guerre mondiale.
Edward Joris mourut le 20 décembre 1957 à Anvers.
19:04 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, edward joris, flandre, anvers, anarchisme, arménie, mouvement flamand |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’Argentine est le pays le plus européen d’Amérique

L’Argentine est le pays le plus européen d’Amérique
Enric Ravello
Bron: https://euro-sinergias.blogspot.com/2026/01/la-argentina-...
Il existe l’idée pertinente selon laquelle l’Argentine est le pays qui nous ressemble le plus, ou – ce qui revient au même – le pays le plus européen d’Amérique. Ce n’est pas une impression, c’est une réalité – incluant également l’Uruguay. Je voyage fréquemment dans ce pays du sud, avec lequel je suis lié par des liens profonds de toutes sortes. Lors de ces voyages, je visitais souvent la zone située entre Buenos Aires et la fameuse « Pampa gringa ». A une occasion, j’ai visité Tucumán, et lors de mon dernier séjour, j’étais à Córdoba ville et dans la partie centrale de cette province.
Ces voyages, ainsi que de nombreuses lectures sur l’histoire, la culture et l’identité argentine, m’ont conduit à écrire cet article – avec l’idée de l’étoffer à l’avenir – sur la réalité ethno-démographique de l’Argentine.
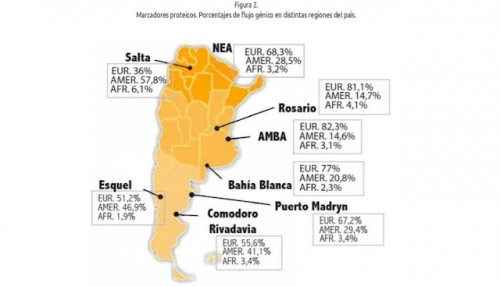
Reprenons l’idée initiale : « L’Argentine est le pays le plus européen d’Amérique. »
C'est un fait, sans aucun doute – insistons – mais cela n’a pas toujours été le cas, et cela aurait pu ne pas l’être. Comme nous le verrons dans ces lignes, sans l’immigration massive d’Européens entre 1890 et 1930, la physionomie de l’Argentine aurait été très similaire à celle du Pérou actuel.



À l’époque hispanique, la grande ville argentine était Córdoba, fondée en 1573 par l’Espagnol Jerónimo Luis de Cabrera. Cabrera désobéit aux ordres du vice-roi du Pérou et fonda une ville qu’il nomma Córdoba de la Nueva Andalucía, bien plus au sud de ce qui lui avait été ordonné, en plein territoire des Indiens Comechingón. Le vaillant conquistador espagnol pénétra dans un territoire encore non colonisé par la Couronne et fonda une ville selon les modèles castillans de l’époque, avec une grande place où étaient présents le pouvoir politique (le cabildo) et le pouvoir religieux (la cathédrale). La ville mérite d’être visitée rien que pour apprécier la richesse de cet héritage hispanique. Un lieu particulièrement remarquable est la maison du marquis de Sobre Monte. Le bâtiment, en plein centre de la ville, conserve la cour intérieure typique avec des pièces tout autour, très répandue en Andalousie, et qui est l’héritage direct de la domus romaine ; c’est aussi cela, l’Espagne a transmis l'héritage de Rome en Amérique.
Aujourd’hui, Córdoba conserve – comme aucune autre ville argentine – une empreinte hispanique impressionnante, visible dans son architecture monumentale et très riche. La ville porte le nom de « la docta » car c’est là que fut fondée la première université du pays. Elle possède également une démographie claire, et la majorité de population est indigène et métissée, avec une fine strate albo-européenne. Comme nous le disait un professeur d’histoire, Córdoba a maintenu la structure de la société de castes qui fut la réalité ethno-démographique de l’Amérique hispanique. Jusqu’à ce jour, la vague migratoire européenne des 19ème et 20ème siècles n’a pas atteint Córdoba.
Nous pouvons affirmer avec certitude que cette réalité ethno-démographique de la capitale régionale qu'est Córdoba aurait été celle de tout le pays si ce flux européen n’avait pas eu lieu.
On retrouve cette même réalité dans des villes plus au nord-ouest comme Salta, où la composante indigène est beaucoup plus importante qu’à Córdoba ou Tucumán, la ville où l’indépendance de l’Argentine a été proclamée.
L’empreinte hispanique dans ces régions est le résultat de l’action conquérante et civilisatrice des Espagnols depuis le 16ème siècle.
Nous appelons cet élément par son nom correct: les criollos, c’est-à-dire les Espagnols nés en Amérique.


Buenos Aires – Santa María del Buen Ayre – fut provisoirement fondée en 1536 par Pedro de Mendoza, puis définitivement en 1580 par Juan de Garay. C’était un petit port. Fondée selon la logique hispanique de défense du littoral fluvial du Paraná et du Río de la Plata, depuis le centre géo-historique d’Asunción, au Paraguay, en créant une ligne défensive contre les Portugais et les Britanniques: Asunción – Buenos Aires – Montevideo. La ville portuaire grandit, et après l’indépendance du pays, et suite aux affrontements entre unionistes et fédéralistes, elle devint le centre politique de la nouvelle réalité politique indépendante: la République argentine.
En tant qu’État indépendant, dirigé par une élite criolla, l’Argentine lança une grande expansion territoriale, dont l’événement principal fut la fameuse «Conquête du Désert» menée par le général Roca. La conquête permit à la jeune Argentine de disposer d’un vaste territoire sous sa souveraineté, mais il restait un problème fondamental à résoudre: celui de la population – un problème qui perdure encore aujourd’hui, car l’Argentine pourrait accueillir environ 200 millions d’habitants supplémentaires.
 Deux présidents argentins d’origine criolla, Juan Bautista Alberdi (photo) et Nicolás Avellaneda, ainsi que Domingo Sarmiento, virent la nécessité de combler ce vide démographique – ce sont là leurs marques historiques. Pour que l’Argentine devienne le grand pays qu’ils envisageaient, cette immigration devait être européenne. C’est ainsi que commença l’arrivée massive d’Européens, qui changea à jamais la physionomie et la réalité de l’Argentine.
Deux présidents argentins d’origine criolla, Juan Bautista Alberdi (photo) et Nicolás Avellaneda, ainsi que Domingo Sarmiento, virent la nécessité de combler ce vide démographique – ce sont là leurs marques historiques. Pour que l’Argentine devienne le grand pays qu’ils envisageaient, cette immigration devait être européenne. C’est ainsi que commença l’arrivée massive d’Européens, qui changea à jamais la physionomie et la réalité de l’Argentine.
Entre 1880 et 1930, plus de 7 millions d’Européens arrivèrent dans un pays qui comptait en 1895 seulement 4 millions d’habitants. Ce flux migratoire européen se poursuivit pratiquement jusqu’en 1960, avec des chiffres quelque peu moindres. Ces données démographiques expliquent parfaitement la profonde transformation de la société, de la culture, de la physionomie, de l’architecture et de l’identité argentine. L’Argentine que nous connaissons aujourd’hui est en grande partie le fruit de cette émigration européenne, dans un cadre étatique créé par une population criolla d’origine hispano-européenne.
Par nationalités, le groupe principal des arrivants fut celui des Italiens avec 59%, suivis par les Espagnols avec 40% – appelés les «gallegos», à la différence des «criollos» – eux aussi d’origine espagnole mais arrivés bien antérieurement – auxquels il faut ajouter d’autres groupes d’origines européennes diverses: Français, Allemands, Irlandais, Anglais, Écossais, Ukrainiens, Gallois, Polonais, Suisses, Scandinaves, et même des Boers venus d’Afrique du Sud après leur guerre contre l'Empire britannique.
Pour désigner ce contingent européen, nous utiliserons le terme couramment employé en Argentine, même si sa signification est floue: «gringo». Bien que «criollo» soit un terme clairement défini, «gringo» est une expression populaire dont la signification a évolué au fil du temps. Au début, il désignait principalement des immigrés italiens, notamment du Nord de l’Italie (pour les Italiens du Sud, on disait «Tano»). Par la suite, il a été élargi pour englober non seulement tous les Italiens, mais aussi tous les Européens d’origine non espagnole, y compris les Espagnols qui faisaient partie de cette vague migratoire (les «gallegos»). Il y a donc deux groupes de population blanche en Argentine: les «criollos», espagnols arrivés à partir du 16ème siècle, et le groupe beaucoup plus large des « gringos », Européens arrivés aux 19ème et 20ème siècles.

Ce flot démographique européen est entré par le port de Buenos Aires – les Argentins étaient aussi à bord des navires – et a rapidement transformé la capitale en une ville à l’aspect européen, connue au début du siècle dernier comme « le Paris du Sud ». En réalité, c’est une synthèse de Paris, Madrid, Rome, Gênes et des bâtiments rappelant l’Italie de la Renaissance. Le poète euro-argentin Juan Pablo Vitali l’a brillamment décrite comme «la capitale des Blancs du Sud».
Cette immense immigration européenne s’est également étendue à la province de Santa Fe, où la physionomie de ses deux villes principales, Rosario et Santa Fe, ainsi que Rafaela, en témoigne. Et elle s’est répandue dans toute la Pampa gringa. Si l’on devait fixer une limite géographique précise à cette expansion, on pourrait citer Villa María, dans la province de Córdoba. Il suffit de visiter des villages comme Marcos Juárez (Pampa gringa – sud de Córdoba) et de s’asseoir dans un café pour voir les mêmes visages que dans la ville de Turin.
Ainsi, le principal noyau de population européenne se trouve entre Buenos Aires et Villa María, où environ deux tiers de la population totale du pays est concentrée.
Quatre points géographiques méritent une attention particulière:
Misiones, une province au nord-ouest du pays, limitrophe du Paraguay et du Brésil, où une grande population d’origine italienne, scandinave, suisse-allemande et polonaise réside. Récemment, Maribel Ivaciuta est devenue célèbre, élue reine de la fête locale de la Mojarrita, avec une apparence tout-à-fait nord-européenne, tout comme Azul Antolinez, «reine» de San Rafael.

La Patagonie, intégrée pleinement à l’Argentine après la Campagne du Désert menée par le grand général Roca, est peuplée encore de quelques communautés indigènes et de rares Européens s’y étant installés. Les Gallois de Puerto Madryn, qui ont su préserver leur identité et leur culture, font aujourd’hui de l’Argentine le troisième pays au monde avec le plus grand nombre de locuteurs de la langue galloise, après le Royaume-Uni et l’Australie.
Mendoza possède quelques caractéristiques propres. Intégrée à la Vice-Royauté du Río de la Plata en 1776, elle faisait partie du Chili depuis sa fondation en 1561, ce qui explique l’origine des criollos mendociens. En raison de sa situation géographique, elle est éloignée des routes d’immigration européennes, mais le développement du chemin de fer à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle a attiré beaucoup d’Italiens et d’Espagnols dans la région.

La Sierra de Córdoba (photo)
Si l’on parle du sud de cette province comme partie de la Pampa gringa, et de la ville comme exemple d’une ville fondée par des criollos avec une majorité d’indigènes, la « Sierra cordobesa » représente une réalité démographique très différente. On y trouve des villages avec une forte empreinte britannique comme La Cumbre, ainsi que d’autres – plus nombreux et connus – fondés par des Allemands, tels que La Cumbrecita et Villa General Belgrano. En novembre dernier, j’ai eu l’occasion de visiter ces deux lieux, lors de la célébration de l’Oktoberfest à General Belgrano, où l’ambiance, les gens et la fête étaient typiques d’un village allemand.
Cette réalité historique, démographique, culturelle et identitaire fait de l’Argentine – le grand acteur géopolitique de l’Amérique du Sud – un pays clé avec une opportunité unique d’établir des relations privilégiées avec l’Europe par deux voies: son héritage historique et culturel criollo qui la lie à l’Espagne, et son héritage identitaire et démographique «gringo» qui la relie à plusieurs pays européens, notamment l’Italie, mais aussi l’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine, les Pays-Bas, l’Irlande, et même le Royaume-Uni, que la chancellerie argentine devrait traiter avec un soin particulier, étant donné la composition de sa population. Aujourd’hui, dans un monde où l’Europe et l’Amérique du Sud semblent être exclues en tant qu’acteurs géopolitiques, cette potentialité argentine serait doublement précieuse.
14:13 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, argentine, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 février 2026
L’âme orientale de l’Irlande - L’île verte entre la steppe et l’océan

L’âme orientale de l’Irlande
L’île verte entre la steppe et l’océan
Callum McMichael
Source: https://www.multipolarpress.com/p/irelands-eastern-soul
Callum McMichael remet en question le mythe de l’Irlande comme étant uniquement occidentale.
L’Irlande, isolée à l’extrême ouest du continent européen, est généralement imaginée comme une île atlantique dont l’identité culturelle aurait été façonnée dans l’isolement, principalement influencée par les traditions celtiques, les incursions vikings, les conquêtes normandes, et des siècles de domination anglo-normande et britannique. Pourtant, ce récit familier dissimule une réalité plus complexe et surprenante: tout au long de son histoire, l’Irlande a maintenu des liens profonds et pluriels avec la moitié orientale du continent. Ces connexions — qui couvrent les mouvements préhistoriques de populations, les réseaux ecclésiastiques médiévaux, les diasporas militaires de l’époque moderne, la solidarité humanitaire du XIXe siècle, et des parallèles au cours du XXe siècle dans la renaissance nationale et les douleurs d'une partition — suggèrent que l’Irlande n’est pas simplement une extrémité périphérique de l’ouest européen, mais, et c'est à bien des égards essentiels, une société dont l’expérience historique s’aligne davantage sur les modèles de l’Europe de l’Est, bien davantage que ce que l’on croit généralement.
La couche la plus profonde de cette connexion orientale réside dans la préhistoire. Les recherches génétiques menées au cours de ces vingt dernières années ont considérablement modifié notre compréhension de l’histoire démographique de l’Irlande. Vers 2500–2000 av. J.-C., lors de la transition du Néolithique à l’Âge du bronze, une migration importante a eu lieu depuis la steppe pontique-caspienne, cette vaste région de plaines au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne qui couvre aujourd’hui le sud de la Russie, l’est de l’Ukraine et une partie du Kazakhstan. Les populations associées à ce mouvement, connues des archéologues sous le nom de culture Yamnaya (et des généticiens comme les principales porteuses de l’ascendance de la steppe en Europe), ont apporté avec elles des économies pastorales, des véhicules à roues, la métallurgie et, très probablement, des langues indo-européennes précoces, qui évolueront plus tard en une branche celtique telle que parlée en Irlande.

Des études sur l’ADN ancien, y compris des analyses marquantes menées sur des restes trouvés sur l’île de Rathlin ou à Ballynahatty (photo), montrent que cette ascendance d’origine steppique représente entre 30 et 50% du génome irlandais moderne, selon la région et le modèle utilisé. Le reste provient principalement de fermiers néolithiques arrivés d’Anatolie et du Levant via l’Europe du sud et centrale, mais la rotation démographique décisive de l’âge du bronze ancre fermement la population fondatrice de l’Irlande dans les mêmes migrations de la steppe qui ont donné naissance à de nombreux peuples d’Europe de l’Est, des États baltes aux Balkans.
Ce lien génétique ne se limite pas à une origine lointaine; il a aussi eu des conséquences culturelles et linguistiques. Les migrations de la steppe sont largement comprises comme ayant introduit la famille des langues indo-européennes dans une grande partie de l’Europe, parmi lesquelles les langues celtiques qui finiront par dominer l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles et la Bretagne, qui font partie de cette même famille linguistique. Ainsi, l’identité linguistique qui distingue la « frange celtique » trouve ses origines ultimes dans ces mouvements venus de l'est qui ont également façonné les populations slaves, baltes et autres, parlant une variante ou une autre de l'indo-européen, géographiquement située plus à l’est.

Au début de l’époque médiévale, de nouvelles voies de contact se sont ouvertes. Le monachisme irlandais, notamment entre le VIe et le IXe siècle, a produit l’une des diasporas les plus remarquables de l’histoire européenne. Les peregrini irlandais — moines et érudits qui se sont exilés volontairement par amour de Dieu — ont voyagé vers l’est en grand nombre, établissant des monastères et des écoles à travers ce qui est aujourd’hui l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, le nord de l’Italie, et jusqu’en Hongrie, Slovénie et Ukraine modernes. Des figures telles que Saint Colmán de Stockerau (martyre près de Vienne), Saint Kilian (actif en Franconie), et le cercle autour de Saint Virgile de Salzbourg illustrent la profondeur de l’influence irlandaise dans ces régions centrales et orientales. Ces missionnaires ont non seulement apporté l’apprentissage du latin et des scriptoria, mais aussi introduit des styles artistiques insulaires qui ont influencé l’art carolingien et ottonien.
Ce faisant, ils ont contribué à préserver le savoir classique durant une période où une grande partie de l’Europe occidentale se relevait de l’effondrement, tout en inscrivant les traditions intellectuelles irlandaises dans le paysage culturel émergent de ce qui deviendra la Mitteleuropa et le monde slave occidental.
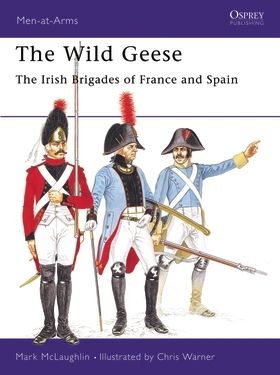 L’époque moderne voit une orientation encore plus marquée vers l’est à travers le service militaire. Après les défaites de la noblesse catholique irlandaise au XVIIe siècle — notamment après la guerre de Guillaume et le traité de Limerick en 1691 — des dizaines de milliers de soldats irlandais, collectivement appelés « Oies sauvages », ont quitté l’île pour servir dans des armées étrangères. Si la France a accueilli le plus grand contingent, l’Empire russe s’est montré particulièrement attractif au XVIIIe siècle. L'armée russe, en pleine modernisation sous Pierre le Grand et ses successeurs, offrait une progression rapide, un salaire important et une relative tolérance religieuse aux officiers catholiques qualifiés. La figure irlandaise la plus célèbre dans ce contexte est le maréchal de camp Pierre (Pyotr Petrovitch) Lacy, né en 1678 près de Kilmallock, dans le comté de Limerick.
L’époque moderne voit une orientation encore plus marquée vers l’est à travers le service militaire. Après les défaites de la noblesse catholique irlandaise au XVIIe siècle — notamment après la guerre de Guillaume et le traité de Limerick en 1691 — des dizaines de milliers de soldats irlandais, collectivement appelés « Oies sauvages », ont quitté l’île pour servir dans des armées étrangères. Si la France a accueilli le plus grand contingent, l’Empire russe s’est montré particulièrement attractif au XVIIIe siècle. L'armée russe, en pleine modernisation sous Pierre le Grand et ses successeurs, offrait une progression rapide, un salaire important et une relative tolérance religieuse aux officiers catholiques qualifiés. La figure irlandaise la plus célèbre dans ce contexte est le maréchal de camp Pierre (Pyotr Petrovitch) Lacy, né en 1678 près de Kilmallock, dans le comté de Limerick.
Après un service initial en France et en Autriche, Lacy entra au service de la Russie en 1700, et devint l’un des généraux les plus brillants du XVIIIe siècle. Il commandait les forces russes lors de la Grande Guerre du Nord contre la Suède, gérait l’occupation de la Finlande, dirigeait les opérations durant la guerre de Succession de Pologne, et joua un rôle décisif dans la guerre russo-turque de 1735–1739, notamment lors du siège d’Azov et de la campagne dévastatrice dans le Khanat de Crimée.
 Son contemporain, et autre officier d’origine irlandaise, Joseph Cornelius O’Rourke (comte Iosif Kornilovich O’Rourke) (portrait), a également atteint un haut rang, en tant que commandant la cavalerie lors des guerres napoléoniennes. Ces carrières illustrent non seulement la réussite individuelle, mais attestent aussi d'un modèle plus large: l’Irlande a fourni un nombre disproportionné de hauts gradés à l’armée russe au XVIIIe et au début du XIXe siècle, intégrant des familles militaires irlandaises dans la société impériale russe.
Son contemporain, et autre officier d’origine irlandaise, Joseph Cornelius O’Rourke (comte Iosif Kornilovich O’Rourke) (portrait), a également atteint un haut rang, en tant que commandant la cavalerie lors des guerres napoléoniennes. Ces carrières illustrent non seulement la réussite individuelle, mais attestent aussi d'un modèle plus large: l’Irlande a fourni un nombre disproportionné de hauts gradés à l’armée russe au XVIIIe et au début du XIXe siècle, intégrant des familles militaires irlandaises dans la société impériale russe.
Ce modèle de solidarité a trouvé une expression poignante lors de la grande famine de 1845–1852. Au milieu de la catastrophe qui a réduit la population irlandaise d’environ un quart par la mort et l’émigration, une aide internationale est arrivée de diverses sources.
Parmi les contributions symboliquement les plus significatives figure la donation personnelle de 2000 livres sterling faite par le tsar Nicolas Ier (et non Alexandre II, comme on le croit parfois) à la reine Victoria pour soulager la détresse irlandaise. La somme, bien que modeste par rapport à l’ampleur de la catastrophe, était notable parce qu'elle trouvait son origine dans le trésor impérial russe ainsi que parce qu’elle a été donnée directement par le tsar lui-même. La donation a suivi l’exemple du sultan ottoman Abdülmecid Ier, qui a également contribué personnellement. Ces gestes, de la part de dirigeants d’empires souvent considérés comme « arriérés » ou « semi-orientaux » par les observateurs occidentaux, soulignaient un sentiment commun de marginalité et de vulnérabilité dans l’ordre européen. La Russie et l’Irlande, bien que très différentes en échelle et en puissance, étaient toutes deux positionnées comme des sociétés périphériques soumises aux pressions économiques et politiques des États occidentaux plus centralisés.
Le XXe siècle a apporté d’autres convergences. L’effondrement des empires multinationaux après 1918 a engendré une vague de nouveaux États-nations en Europe de l’Est, beaucoup d’entre eux ayant connu la partition, les problèmes de minorités, les revendications irrédentistes et des ajustements frontaliers violents.

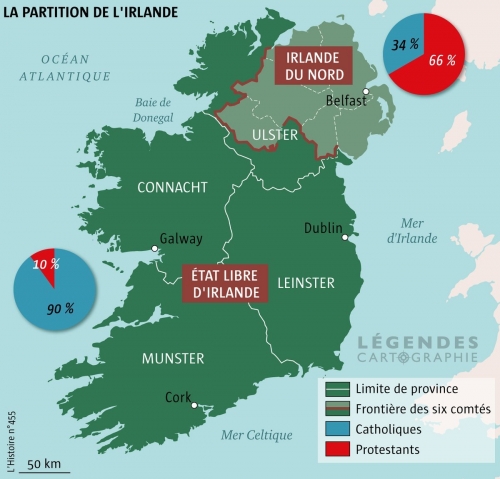
L’expérience propre de l’Irlande — partagée entre l’État libre d’Irlande et l’Irlande du Nord en 1921 — a reflété ces dynamiques de façon frappante. La Commission frontalière irlandaise de 1925, la violence ethno-religieuse du début des années 1920, et la division ethno-religieuse persistante le long de la frontière rappellent la Pologne, la Tchécoslovaquie et le différend sur Vilnius/Wilno. Les nationalistes irlandais, surtout dans les décennies suivant l’indépendance, ont souvent invoqué des analogies avec l’Europe de l’Est lorsqu’ils abordaient l'autodétermination, les droits des minorités et la légitimité ou l'illégitimité d'une partition.
 Arthur Griffith (photo) et d’autres penseurs du Sinn Féin, dès les premières années, s’étaient inspirés de la monarchie austro-hongroise et des campagnes d’autonomie de la Hongrie. Plus tard, durant les Troubles, des comparaisons régulières étaient faites entre l’Irlande du Nord et le Kosovo, Chypre ou les États baltes sous domination soviétique.
Arthur Griffith (photo) et d’autres penseurs du Sinn Féin, dès les premières années, s’étaient inspirés de la monarchie austro-hongroise et des campagnes d’autonomie de la Hongrie. Plus tard, durant les Troubles, des comparaisons régulières étaient faites entre l’Irlande du Nord et le Kosovo, Chypre ou les États baltes sous domination soviétique.
Pris ensemble, ces différentes filières — migrations préhistoriques de la steppe, pèlerinages médiévaux, service militaire dans l’Empire russe au XVIIIe siècle, générosité tsariste lors de la famine, et parallèles du XXe siècle avec la partition et la renaissance nationale — forment un continuum cohérent. L’Irlande s’est maintes fois retrouvée alignée, que ce soit par la génétique, la migration, l’échange culturel ou le destin politique partagé, avec l’expérience historique de l’Europe de l’Est. L’identité de l’île ne peut se réduire à une simple binarité celtique-occidentale; dans ses moments les plus déterminants, c’est une histoire orientale qui s'est transplantée à l’extrémité atlantique de l'Europe. Reconnaître cette affinité plus profonde ne diminue pas le caractère distinctif de l’Irlande; au contraire, cela enrichit notre compréhension de la véritable interconnectivité du passé européen, et de la manière dont même les sociétés les plus apparemment périphériques ont longtemps participé aux courants continentaux qui coulent de l’est vers l’ouest.
Au bout du compte, l’âme orientale de l’Irlande n’est pas une note de bas de page, une note cachée, mais un fil central dans la tapisserie du continent, nous rappelant que les frontières que nous traçons entre l’est et l’ouest ont toujours été plus poreuses, plus perméables, et plus illusoires que ne le laissent penser les cartes.
21:38 Publié dans Définitions, Histoire, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terres d'europe, irlande, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 21 janvier 2026
Seward, Trump et la tentation groenlandaise

Seward, Trump et la tentation groenlandaise
par Alessandro Mazzetti
Source: https://www.destra.it/home/seward-trump-e-la-tentazione-g...
Après les nombreux événements rocambolesques du Venezuela, qui, tous, demandent encore à être éclaircis, les déclarations de Trump concernant la nécessité pour les États-Unis d’acquérir le Groenland font écho. Ces affirmations de Washington ont suscité à la fois de l’indignation et de l’inquiétude, non seulement à Copenhague, mais dans toutes les capitales européennes.
Une surprise en partie injustifiée, car ce n’est certainement pas la première fois que Washington tente d’acheter l’île verte, découverte par Erik le Rouge. Nous allons essayer d’éclaircir un peu la situation en proposant une lecture différente de celles qui ont jusqu’à présent été publiées. Comme mentionné, le désir américain pour le Groenland est très ancien. Le premier à envisager son achat fut le secrétaire d’État de Lincoln, William Henry Seward (photo, ci-dessous), qui est devenu célèbre pour l’achat de l’Alaska par les États-Unis. Selon Seward, l’acquisition de la possession russe ne visait pas seulement à intégrer le Canada et à amorcer un processus d’américanisation de la domination anglaise, mais aussi à relancer la possibilité d’un autre achat potentiel: le Groenland.

En résumé, la doctrine Monroe, ou plutôt l’intention derrière, était de créer un bloc politique-culturel anglo-saxon et germanique, qui pourrait également bénéficier de l’achat du Groenland et de l’Islande. L’offre fut rejetée par la monarchie danoise, et le projet de Seward fut interrompu. Le second cas remonte à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir défendu l’île, installé des bases militaires et des centres d’observation météorologique, les Américains ont fait une proposition au gouvernement danois, qui la refusa poliment.
Ce n’est pas la première fois que Trump tente d’acheter l’île; cela remonte à août 2019. Pourquoi cet intérêt renouvelé ? Il est plausible d’en identifier deux raisons principales. La première est la nécessité de renforcer la doctrine Monroe, avec un projet qui, comme le démontrent les pressions exercées par la Chine et la Russie en Amérique du Sud, ainsi que le dynamisme du Mexique, date de plus de 150 ans. La seconde raison réside dans l’application des règles de Montego Bay 1982 (UNCLOS), permettant la création des Zones Économiques Exclusives, qui étendent jusqu’à 200 milles marins la souveraineté sur les eaux nationales.
Ce sujet met en évidence la nécessité pour les États-Unis de renforcer leur système de défense militaire, mais surtout d’accroître leur contrôle sur la route arctique, en raison de la guerre économique féroce en cours. Washington sait pertinemment que, depuis 2017, des navires chinois empruntent régulièrement ces routes, grâce à l’ouverture de l’Arctique. De plus, Pékin est actif dans ces zones depuis plus de vingt ans: les entreprises de l’ancien empire d'Extrême-Orient sont présentes depuis longtemps en Groenland, notamment à Kvanefjeld pour l’uranium, à Cittronen Fjord pour le zinc, à Illoqortormiut pour l’or, et à Isua pour le fer. La stratégie chinoise consiste à construire des infrastructures, ce qui leur confère un avantage stratégique considérable face à leurs concurrents. La Chine prévoit depuis des années de réaliser, à coûts très faibles et avec une main-d’œuvre locale, le réseau d’infrastructures indispensables pour relancer économiquement et commercialement l’île. En 2016, la proposition de Pékin pour réactiver l’ancienne base navale Blue West dans le fjord d’Arsuk a été rejetée délicatement par le gouvernement danois.
Les demandes chinoises pour la construction de pistes d’atterrissage et de nouveaux ports se sont intensifiées ces dernières années, tandis que le gouvernement de Copenhague a souvent repoussé ces offres pour ne pas heurter la sensibilité américaine. La tentative de Washington d’acheter économiquement le Groenland répond principalement à des besoins économiques et commerciaux, car dans un monde dominé par une économie maritime, celui qui contrôle les routes et les ports contrôle le cœur de l’économie. Bien que géographiquement et anthropologiquement le Groenland fasse partie du continent américain, l’île reste une possession européenne. Une acquisition pour des raisons non économiques serait impossible, car cela signifierait une rupture irrémédiable du monde occidental et la fin de l’Alliance atlantique.
22:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, william henry seward, états-unis, alaska, groenland |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 janvier 2026
Nietzsche et son temps: pour une contextualisation de son oeuvre
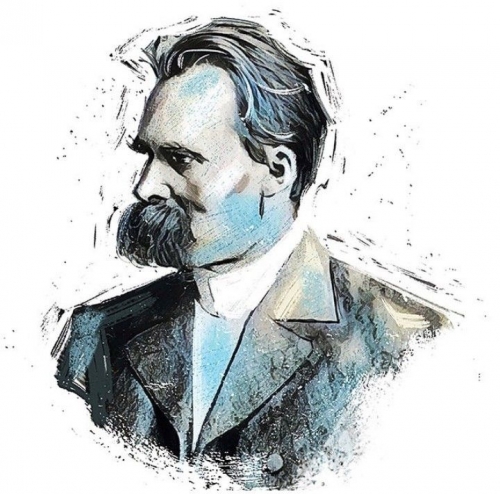
Nietzsche et son temps: pour une contextualisation de son oeuvre
Robert Steuckers
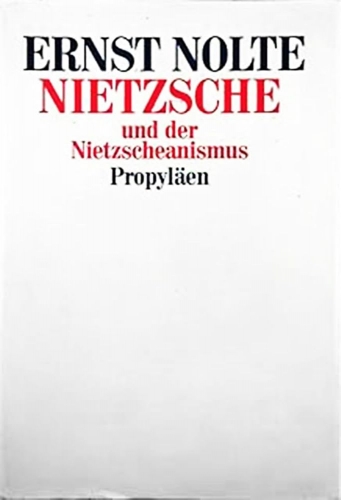 L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.
L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.
 Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).
Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).
 Kant, autre figure emblématique des Lumières en Europe, malgré la précision extrême de son œuvre, véhicule, lui aussi, des contradictions, indices d’une certaine naïveté; Rousseau est le chantre d’un primitivisme qui, sous bon nombre d’aspects, est l’antithèse des Lumières; Adolf von Knigge (ci-contre), lui aussi adepte des Lumières, compile dans ses écrits de nombreuses contradictions qui induisent Nolte à lui poser, à titre posthume, les questions suivantes: l’adepte des Lumières ne doit-il pas craindre par-dessus tout l’ultime conséquence de la philosophie des Lumières: la complète neutralisation de la raison générale par les pulsions de l’individu, lesquelles se posent comme expressions de la «raison» (individualiste) et engendrent ainsi l’anarchie ?
Kant, autre figure emblématique des Lumières en Europe, malgré la précision extrême de son œuvre, véhicule, lui aussi, des contradictions, indices d’une certaine naïveté; Rousseau est le chantre d’un primitivisme qui, sous bon nombre d’aspects, est l’antithèse des Lumières; Adolf von Knigge (ci-contre), lui aussi adepte des Lumières, compile dans ses écrits de nombreuses contradictions qui induisent Nolte à lui poser, à titre posthume, les questions suivantes: l’adepte des Lumières ne doit-il pas craindre par-dessus tout l’ultime conséquence de la philosophie des Lumières: la complète neutralisation de la raison générale par les pulsions de l’individu, lesquelles se posent comme expressions de la «raison» (individualiste) et engendrent ainsi l’anarchie ?
Conclusion de Nolte: les Lumières sont un corpus bourré des contradictions qui a été mis entre parenthèse pendant quelques décennies en Europe mais qui est revenu au grand galop à partir des années 1970 (après les engouements existentialistes des années 1950-1960 et l’effervescence soixante-huitarde.
Ces contradictions, Nietzsche les mettra en exergue de manières différentes, en se passionnant pour la musique de Wagner pour s’en désolidariser ensuite, en explorant l’œuvre des dramaturges grecs de l’antiquité, etc. Nietzsche ne rejette pas toutes les Lumières: il restaure, dans une phase de son œuvre, entre son wagnérisme et sa philosophie finale, une pratique des Lumières, soustraite aux pesanteurs métaphysiques (Nietzsche se veut «physiologue» et «Freigeist», «esprit libre»). Ce pragmatisme activiste entend se débarrasser du «ballast catagogique de la civilisation» (comme nous devrions nous débarrasser aujourd’hui des ballasts de ce qui s’affiche comme adepte ou héritier ou bétonneur des Lumières du 18ème siècle, tout en prétendant détenir les seuls atouts porteurs d’un pouvoir politiques et métapolitique/médiatique parfait et jugé indépassable et inamovible).
Le Nietzsche proche des Lumières semble préconiser une sphère politique rationalisée, équilibrante mais, en dépit de cette apparence, ses positions recèlent un rejet assez radical du message des Lumières (et surtout de ce qu’elles vont devenir au fil du temps pour aboutir au pandémonium qu’elles sont aujourd’hui en Europe occidentale). Nietzsche, en effet, constate, dans cette phase «rationnelle» (en apparence) de son œuvre, que le monde, en son holicité (en sa totalité), n’est nullement rationnel et que la raison elle-même n’est jamais qu’un phénomène surgissant par hasard dans un monde soumis à un hasard général.
Nietzsche emprunte la voie qui le mène à formuler sa philosophie finale. Il démasque ceux qui veulent faire des hommes les porteurs exclusifs de leur rationalité imaginaire (et de pacotille); les vertus, chantées par les «illuministes» (pour parler comme les philosophes italiens) ne sont que des oripeaux camouflant un égoïsme fondamental que les moralistes français avaient déjà, avant les Lumières, bien mis en exergue. Dès lors, Nietzsche voudra léguer aux lucides du futur un «double cerveau »: l’une moitié vouée à la science pratique et philologique; l’autre capable de faire face au «socle fondamental de toutes choses, lequel est dépourvu de toute logique».
 Dans Aurore, Nietzsche brocarde cruellement l’adepte des Lumières qui veut faire de «belles choses» (der schöntuerische Aufklärer). C’est là le moment de basculement dans l’œuvre de Nietzsche, aux répercussions politiques, métapolitiques et philosophiques de grande ampleur, dont les ondes de choc nous ébranlent aujourd’hui encore. Il évoque, dès ces aphorismes d’Aurore, une équivalence entre le christianisme et les Lumières, une équivalence qui apparaît dès le moment où le philosophe perçoit qu’il y a, chez les deux piliers philosophiques de son 19ème siècle, la marotte infertile de la «Schöntuerei» (de vouloir fabriquer du bien et du beau au départ de bonnes intentions, reposant sur une forme de négation du réel tel qu’il est, sur des raisonnements qui ne prennent pas acte de ce que le réel est mais se référant à un réel imaginaire qui est, en fait, un «voudrait-être»: on ne peut pas être plus actuel! ).
Dans Aurore, Nietzsche brocarde cruellement l’adepte des Lumières qui veut faire de «belles choses» (der schöntuerische Aufklärer). C’est là le moment de basculement dans l’œuvre de Nietzsche, aux répercussions politiques, métapolitiques et philosophiques de grande ampleur, dont les ondes de choc nous ébranlent aujourd’hui encore. Il évoque, dès ces aphorismes d’Aurore, une équivalence entre le christianisme et les Lumières, une équivalence qui apparaît dès le moment où le philosophe perçoit qu’il y a, chez les deux piliers philosophiques de son 19ème siècle, la marotte infertile de la «Schöntuerei» (de vouloir fabriquer du bien et du beau au départ de bonnes intentions, reposant sur une forme de négation du réel tel qu’il est, sur des raisonnements qui ne prennent pas acte de ce que le réel est mais se référant à un réel imaginaire qui est, en fait, un «voudrait-être»: on ne peut pas être plus actuel! ).
D’autres termes témoignent également de ce basculement: les Lumières à la Rousseau, notamment, sont «à moitié folles», «théâtrales», «d’une cruauté bestiale», «sentimentales» et «auto-enivrantes», toutes tares qui donnent sa substance à l’idéologie de la «Révolution française» et, nous empresserons-nous d’ajouter, au fatras comique et hargneux de l’actuelle idéologie républicaine, telle qu’elle se manifeste dans les discours insipides de Macron et dans les vitupérations hystériques de Mélanchon, sans parler des piaillements de la piétaille qui claudique derrière ces deux bonshommes, une piétaille qui serait toute prête à porter à son paroxysme la «cruauté bestiale» (tierisch-grausam) exposée par Nietzsche.
Les Lumières affichées par ce ramassis d’abjects politicards ne sont donc pas les «Lumières libératrices», annoncées avec fracas par la propagande régimiste/néolibérale et par celle d’une fausse opposition, dûment contrôlée, juste bonne à dégoiser des slogans qui ne débouchent sur rien de concret. Nous avons affaire à un «révolutionnisme» dangereux, sous tous ses aspects, qui est solidement en place mais qu’il aurait fallu, dixit Nietzsche à son époque, étouffer dans l’œuf (in der Geburt zu ersticken).
Deux positionnements peuvent se déduire de ce Nietzsche du «moment de basculement»: 1) être un adepte pragmatique des Lumières qui expurge l’espace politique de tout «révolutionnisme bestial»; 2) dénoncer le «jésuitisme» des «Lumières démocratiques» (ou relevant de la «bestialité révolutionnaire») qui s’oppose, par ressentiment ou pas pure et simple bassesse, au «splendide effort» que constitue le fait européen. Les «esprits libres» de ces Lumières-là ne sont plus des Freigeister, dont Nietzsche espérait l’avènement mais des «niveleurs» stupides, véhicules d’un phénomène de dégénérescence, de déclin, de décadence.
Cette morale de l’amélioration constante (Besserungs-Moral) est une sinistre farce. La luminosité diurne la plus aveuglante, la petite rationalité à tout prix, la vie éclairée, froide, prudente, consciente, sans instinct, résistant en permanence contre les instincts, n’est qu’une pathologie, une autre pathologie (que le christianisme) et, de ce fait, n’est nullement un retour à la «vertu» (de romaine mémoire), à la «santé», au «bonheur». «Vouloir combattre les instincts, telle est la manie qui conduit à la décadence».

Nietzsche et la révolution française
Des clivages politiques émergent au fur et à mesure que les événements de Paris bouleversent la France de l’intérieur ou interpellent les observateurs sympathisants ou hostiles à l’extérieur, ailleurs en Europe. En Allemagne, les enthousiastes de la révolution, assez nombreux au départ, surtout suite à la chute de la place de Mayence, feront place à des tenants du scepticisme puis à d’ex-révolutionnaires devenus totalement hostiles à l’entreprise napoléonienne. Les excès des jacobins refroidissent les ardeurs des révolutionnaires allemands; l’exécution de Louis XVI et de la Reine Marie-Antoinette entraîne d’autres désaffections et la prise du pouvoir par Bonaparte, perçu comme un «despote militaire», réduit quasi à néant les rangs déjà éclaircis des adeptes allemands des idées révolutionnaires.
 L’auto-couronnement de Napoléon en 1804 est vu comme un scandale inacceptable: même Beethoven, auteur de la symphonie Eroica, retire son soutien. Schiller et Klopstock avait tourné le dos aux idéaux de la Révolution dès la Terreur. Goethe avait exprimé son scepticisme dès le départ. Seuls Kant et Hegel gardent des sentiments positifs. Fichte restera fidèle aux idéaux de la Révolution jusqu’en 1813. Les libéraux allemands d’avant 1789, qui envisageaient un glissement progressif vers un Etat idéal selon les critères des Lumières –Brandes, Rehberg, Gentz- sont très rapidement devenus des adversaires résolus du «Synode despotique de Paris» et du régime napoléonien.
L’auto-couronnement de Napoléon en 1804 est vu comme un scandale inacceptable: même Beethoven, auteur de la symphonie Eroica, retire son soutien. Schiller et Klopstock avait tourné le dos aux idéaux de la Révolution dès la Terreur. Goethe avait exprimé son scepticisme dès le départ. Seuls Kant et Hegel gardent des sentiments positifs. Fichte restera fidèle aux idéaux de la Révolution jusqu’en 1813. Les libéraux allemands d’avant 1789, qui envisageaient un glissement progressif vers un Etat idéal selon les critères des Lumières –Brandes, Rehberg, Gentz- sont très rapidement devenus des adversaires résolus du «Synode despotique de Paris» et du régime napoléonien.
Au 19ème siècle, période où ont mûri tous les filons idéologiques de l’histoire européenne contemporaine, un «parti de la réaction» s’est opposé à un «parti du mouvement» (antinomie entre «Beharrung» et «Bewegung»). C’est là une terminologie qui est récurrente et dont les échos sont encore parfaitement audibles de nos jours. Nietzsche, politiquement parlant, nous explique Ernst Nolte (p. 147), n’est pas une figure qui s’inscrit pourtant dans le sillage conservateur traditionnel d’Edmund Burke ou de Joseph de Maistre. Dès La naissance de la tragédie, Nietzsche rejette les idéaux modernes/illuministes comme étant des «platitudes», diamétralement opposées à l’esprit hellénique/germanique.
 Dans Le gai savoir (aphorisme 350), il écrit: «Déjà le protestantisme est une révolte du vulgaire au profit de ce qui est médiocrement bourgeois (bieder), ingénu et superficiel… mais il faudra attendre la révolution française pour donner le sceptre, sans retenue et festivement, aux «hommes bons» (au mouton, à l’âne, à l’oie et à tout ce qui est incurablement plat et braillard et mûr pour la maison des fous, celle où règnent les idéaux modernes».
Dans Le gai savoir (aphorisme 350), il écrit: «Déjà le protestantisme est une révolte du vulgaire au profit de ce qui est médiocrement bourgeois (bieder), ingénu et superficiel… mais il faudra attendre la révolution française pour donner le sceptre, sans retenue et festivement, aux «hommes bons» (au mouton, à l’âne, à l’oie et à tout ce qui est incurablement plat et braillard et mûr pour la maison des fous, celle où règnent les idéaux modernes».
Nietzsche, le 19ème et le socialisme
Dans le sillage des idées révolutionnaires émerge le mouvement socialiste, lequel, avant d’être largement «marxisé», était franchement utopique : on rêvait de phalanstères égalitaires, telles celles qu’imaginaient Robert Owen en Angleterre ou Charles Fourier en France.
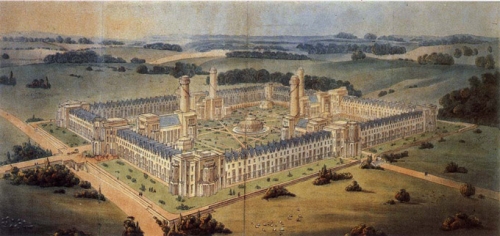
Des villages communautaires voient le jour et se nomment Orbiston, New Lanark (illustration) et Queenswood. Hélas pour les utopistes, ces expériences, séduisantes sur le papier, seront de très courte durée: l’impossibilité pratique de les faire fonctionner provenant du fait que la valeur d’une heure de travail de tel artisan n’équivalait pas à l’heure de travail de tel autre métier; ensuite, les assemblées communes, appelées régulièrement à débattre de tous les problèmes du village égalitaire et à prendre des décisions, durent trop longtemps pour pouvoir régler, en des délais raisonnables, toutes les questions qui réclament une solution plus ou moins rapide.
Le démocratisme outrancier de ces expériences utopiques butait contre les différences qualitatives existant de facto dans les œuvres et prestations diverses des hommes, lesquels sont peut-être égaux en droit mais très différents les uns des autres vu les capacités diverses qu’ils peuvent faire valoir. Ce démocratisme caricatural bute enfin sur la nécessité pour toute communauté ou organisation de limiter les débats stériles, trop longs, et de prendre rapidement des décisions d’importance vitale. Ces pierres d’achoppement du démocratisme utopique et caricatural demeurent bien présentes dans nos sociétés actuelles (d’où la nécessité de décider avant de débattre, nécessité perçue au 19ème par Donoso Cortés en Espagne, au 20ème par Carl Schmitt dans l’Allemagne de Weimar).
Le socialisme, ensuite, a besoin de planification: cette planification en elle-même ou le degré de son extension dans la gestion d’une commune ou d’un Etat demeure une question politique ouverte mais le problème politique majeur reste en ce domaine permanent: il faut de la planification (un Bureau du Plan), indubitablement, car l’absence de planification est le propre de l’idéologie libérale, elle aussi issue des Lumières (et avec un droit d’aînesse!) et conduit à l’impasse.
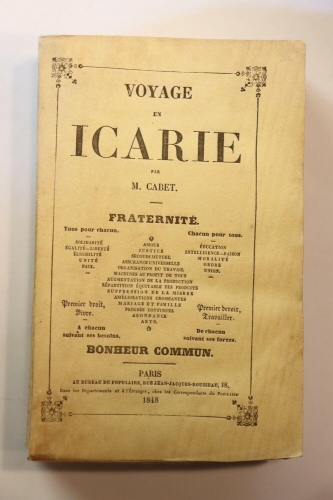 Cependant, l’utopisme et les faillites des phalanstères anglo-saxonnes d’Owen conduisent à une radicalisation théorique chez Etienne Cabet, auteur de Voyage en Icarie. Cabet théorise une utopie très coercitive: le travail y est un devoir auquel personne ne peut se soustraire. Tout y est standardisé, tout est partout pareil. Et on y décèle déjà du wokisme avant la lettre: les langues anciennes ne sont plus enseignées dans les écoles car elles sont inutiles (point de vue partagé aujourd’hui par les néolibéraux, les soixante-huitards, les gauchistes de tous poils et les tenants de la cancel culture). Les mauvais livres, en Icarie, sont brûlés en place publique. On ne parle pas de transhumanisme ou de transgendérisme mais la «race humaine» doit être améliorée par l’étude de la phénologie et en observant les lois de l’eugénisme.
Cependant, l’utopisme et les faillites des phalanstères anglo-saxonnes d’Owen conduisent à une radicalisation théorique chez Etienne Cabet, auteur de Voyage en Icarie. Cabet théorise une utopie très coercitive: le travail y est un devoir auquel personne ne peut se soustraire. Tout y est standardisé, tout est partout pareil. Et on y décèle déjà du wokisme avant la lettre: les langues anciennes ne sont plus enseignées dans les écoles car elles sont inutiles (point de vue partagé aujourd’hui par les néolibéraux, les soixante-huitards, les gauchistes de tous poils et les tenants de la cancel culture). Les mauvais livres, en Icarie, sont brûlés en place publique. On ne parle pas de transhumanisme ou de transgendérisme mais la «race humaine» doit être améliorée par l’étude de la phénologie et en observant les lois de l’eugénisme.
 Mieux et très contemporain: on a, en Icarie, le souci du passé; on y a institué un «tribunal pour les morts», où des «historiens» jugent le passé du point de vue du bonheur (atteint) en ce moment (icarien) de fin de l’histoire. Dans la vision de Cabet (illustration), l’Icarie n’est pas isolée sur elle-même: elle sort de sa coquille pour lancer des croisades au profit des opprimés dans le monde entier… Cet utopisme du début du 19ème est, rappelle Nolte, l’écho laïcisé de visions chrétiennes, exprimées dans certains formes de monachisme (à la différence près que le monachisme, contrairement à l’Icarie de Cabet, se veut retranché du monde et s’organise exclusivement intra muros). On retrouve des visions comparables chez Maître Eckhart, chez les bégards qu’il fréquentait ou chez Joachim de Flore (et son «Troisième Empire») ou encore chez les Taborites, les Anabaptistes et dans les écrits qui ont accompagné les révoltes paysannes anglaises (Wycliff).
Mieux et très contemporain: on a, en Icarie, le souci du passé; on y a institué un «tribunal pour les morts», où des «historiens» jugent le passé du point de vue du bonheur (atteint) en ce moment (icarien) de fin de l’histoire. Dans la vision de Cabet (illustration), l’Icarie n’est pas isolée sur elle-même: elle sort de sa coquille pour lancer des croisades au profit des opprimés dans le monde entier… Cet utopisme du début du 19ème est, rappelle Nolte, l’écho laïcisé de visions chrétiennes, exprimées dans certains formes de monachisme (à la différence près que le monachisme, contrairement à l’Icarie de Cabet, se veut retranché du monde et s’organise exclusivement intra muros). On retrouve des visions comparables chez Maître Eckhart, chez les bégards qu’il fréquentait ou chez Joachim de Flore (et son «Troisième Empire») ou encore chez les Taborites, les Anabaptistes et dans les écrits qui ont accompagné les révoltes paysannes anglaises (Wycliff).
 Nolte ne pense pas que Nietzsche ait lu Marx, bien qu'il aurait lu son adversaire socialiste Dühring (photo) et s’est, à certains moments, intéressé à la littérature socialiste de son temps. Nolte constate cependant qu’il y a des rapprochements possibles à faire entre l’œuvre de Nietzsche et celle de Marx. Ces rapprochements seraient les suivants: commune hostilité à l’idée figée, mièvre et déconnectée de «civilisation» (au sens que donnent les Lumières à ce terme); même intérêt pour la «résurrection de la nature» (le retour au dionysiaque chez Nietzsche), oblitérée par les ratiocinations éthérées des juristes et par les raisonnements mécaniques, seuls posés comme «rationnels»; commune hostilité au principe de la division du travail et à la politique économique du «laisser faire»; même valorisation de l’homme comme membre de sa propre espèce (Gattungsmensch) contre l’individu détaché et sans plus aucun lien; dans ce sens, Nietzsche écrit: «La fabrique règne; l’homme devient rouage»; comme Engels, Nietzsche déplore amèrement la massification par l’urbanisation, laquelle entraîne l’apathie généralisée et pousse les foules dans une hâte qui ne s’interrompt jamais.
Nolte ne pense pas que Nietzsche ait lu Marx, bien qu'il aurait lu son adversaire socialiste Dühring (photo) et s’est, à certains moments, intéressé à la littérature socialiste de son temps. Nolte constate cependant qu’il y a des rapprochements possibles à faire entre l’œuvre de Nietzsche et celle de Marx. Ces rapprochements seraient les suivants: commune hostilité à l’idée figée, mièvre et déconnectée de «civilisation» (au sens que donnent les Lumières à ce terme); même intérêt pour la «résurrection de la nature» (le retour au dionysiaque chez Nietzsche), oblitérée par les ratiocinations éthérées des juristes et par les raisonnements mécaniques, seuls posés comme «rationnels»; commune hostilité au principe de la division du travail et à la politique économique du «laisser faire»; même valorisation de l’homme comme membre de sa propre espèce (Gattungsmensch) contre l’individu détaché et sans plus aucun lien; dans ce sens, Nietzsche écrit: «La fabrique règne; l’homme devient rouage»; comme Engels, Nietzsche déplore amèrement la massification par l’urbanisation, laquelle entraîne l’apathie généralisée et pousse les foules dans une hâte qui ne s’interrompt jamais.
Ces convergences partielles entre Nietzsche et Marx n’autorisent toutefois pas de ne retenir que celles-ci pour fabriquer une idéologie superficielle qui serait «rouge-brune», «social-dionysiaque» ou quelque chose du même genre. Nietzsche reste critique face aux travers possibles de tout socialisme politique et semble percevoir le danger que représente une volonté d’abolir les legs du passé ou de les reléguer au niveau de simples pièces de musée.
Nietzsche ne partage pas la vision hegelo-marxiste d’une « réalisation » finale de l’essence de l’humanité. Les convergences demeurent donc partielles, bien qu’importantes, et partagent la critique du «travail déshumanisant», de «la dépersonalisation du travailleur», de la «monstrueuse machinerie» qui s’impose aux sociétés modernes. La Kulturkritik et le rejet de toute « aliénation » (Entfremdung) ne sont donc pas des apanages des seules écoles marxistes ou post-marxistes.
 Face aux manifestations patentes d’un déclin général de l’Europe et de l’humanité toute entière, Nietzsche exprime une certaine confiance, critique toutefois, dans le Reich bismarckien car il est devenu, après 1871, la principale puissance militaire européenne, qui a mis en place des lois antisocialistes (avant de créer un socialisme solide au sein de l’Obrigkeitsstaat prusso-allemand ce qui ne fut réalisé qu’après que Nietzsche ait sombré dans l’inconscience) et qui pratique une politique hostile aux ingérences vaticanes au sein d’un Reich, pour une bonne part luthérien; Rome souhaitait le faire imploser pour que se constitue une moitié catholique et une autre moitié protestante (le mouvement «Los von Rom»).
Face aux manifestations patentes d’un déclin général de l’Europe et de l’humanité toute entière, Nietzsche exprime une certaine confiance, critique toutefois, dans le Reich bismarckien car il est devenu, après 1871, la principale puissance militaire européenne, qui a mis en place des lois antisocialistes (avant de créer un socialisme solide au sein de l’Obrigkeitsstaat prusso-allemand ce qui ne fut réalisé qu’après que Nietzsche ait sombré dans l’inconscience) et qui pratique une politique hostile aux ingérences vaticanes au sein d’un Reich, pour une bonne part luthérien; Rome souhaitait le faire imploser pour que se constitue une moitié catholique et une autre moitié protestante (le mouvement «Los von Rom»).
Nietzsche n’est toutefois que partiellement satisfait: dans l’avenir, ce Reich bismarckien devrait se donner tous les moyens adéquats de mettre un terme à tous les phénomènes de déclin, bien que ceux-ci relèvent de la «dégénérescence générale de l’humanité». Si Nietzsche se félicite que le Reich bismarckien soit devenu la principale puissance militaire européenne, il déplore toutefois le militarisme caricatural, que Frédéric III, le père de Guillaume II, avait voulu corriger («l’inoubliable Frédéric III» écrit-il). Cet empereur n’eut qu’un règne des plus éphémères.
 L’anti-militarisme allemand, anarchisant, satirique, socialiste et conservateur tout à la fois, de l’ère bismarckienne puis wilhelminienne, s’est exprimé dans la riche tradition des cabarets et des revues satiriques. Il n’est pas anti-patriotique ni même pacifiste: il veut une armée plus professionnelle, des officiers mieux formés même au niveau académique (ce à quoi s’emploiera le Général Hans von Seeckt après 1918); ces auteurs de satires et animateurs de cabarets politisés s’opposent plutôt à une armée et à un corps d’officiers (insuffisamment formés) qui est caricaturale. Ils doivent plus à Nietzsche qu’à d’autres auteurs, hostiles par pacifisme ou par impolitisme à la chose militaire.
L’anti-militarisme allemand, anarchisant, satirique, socialiste et conservateur tout à la fois, de l’ère bismarckienne puis wilhelminienne, s’est exprimé dans la riche tradition des cabarets et des revues satiriques. Il n’est pas anti-patriotique ni même pacifiste: il veut une armée plus professionnelle, des officiers mieux formés même au niveau académique (ce à quoi s’emploiera le Général Hans von Seeckt après 1918); ces auteurs de satires et animateurs de cabarets politisés s’opposent plutôt à une armée et à un corps d’officiers (insuffisamment formés) qui est caricaturale. Ils doivent plus à Nietzsche qu’à d’autres auteurs, hostiles par pacifisme ou par impolitisme à la chose militaire.
Les convergences ténues entre l’œuvre de Nietzsche et certains aspects de la pensée de Marx (qui réfute l’utopisme gauchiste comme le fera aussi plus tard Lénine) et la critique du militarisme caricatural de l’ère wilhelminienne font que Nietzsche sera reçu et lu, dès la fin du 19ème siècle, par un public de gauche plutôt que par un public de droite. L’orthodoxie, qui se voulait marxiste (sans l’être en fait) au sein de la social-démocratie allemande, posait, avec un certain Franz Mehring et sous l’impulsion de Bebel, Nietzsche comme un «ennemi du prolétariat». La «correction politique» avant la lettre, veillait comme elle veille toujours en Allemagne, à l’heure où Sahra Wagenknecht et son époux Oskar Lafontaine cherchent à échapper à l’impolitisme de la SPD et de Die Linke.
Cette inquisition, sans dire son nom, impliquait entre 1890 et 1914, que toute pensée un tant soit peu virulente ou inclassable devait être condamnée: il fallait que les ouailles l’ignorent, il fallait l’effacer des horizons. Cependant, cet alignement des sociaux-démocrates allemands, qui se proclamaient marxistes et veillaient à ce qu’un conformisme figé serve de «pensée» aux intellectuels du parti, ne satisfait pas tous les contestataires du statu quo politique, qui votaient peut-être pour les socialistes mais n’avalaient pas toutes les couleuvres que les bonzes (dixit Roberto Michels) voulaient leur faire gober. Certaines tendances socialisantes, syndicalistes ou anarchisantes dans la vaste mouvance socialiste rejetaient les rigidités des bonzes qui craignaient, certainement à juste titre, d’être brocardés et moqués par tous ceux qui, à gauche, et partout en Europe, entendaient se donner des horizons plus vastes, où les orthodoxies étriquées n’avaient pas leur place, où un syndicalisme pugnace plus ancré dans le réel (notamment en Italie) déterminait un activisme plus en prise sur des réalités populaires, régionales ou sectorielles rétives à tout enfermement dogmatique et à toute orthodoxie théorisée par des philosophes abscons ou des avocaillons ergoteurs.
 La pensée plastique, mouvante, démasquante de Nietzsche pouvait, pour tous ces contestataires de la bonzification de la social-démocratie en Allemagne, en Italie ou en Belgique (les pays où Michels -photo- a vécu, participant aux initiatives socialistes), être bien plus utile et surtout plus galvanisante que le pilpoul des idéologues sans envergure ou des avocats marrons qui tentaient de compenser leur extrême médiocrité en se posant comme les défenseurs raisonnables (et donc stérilisateurs) d’un peuple qu’ils méprisaient profondément, qu’ils infantilisaient dans leur pâle imaginaire et auquel ils vendaient leurs salades insipides. A cette médiocrité, que constituait la bonzification des cadres socialistes d’avant 1914 (la Verbonzung de Michels), s’ajoutait l’élément utopique qu’était et est resté l’internationalisme (ou l’universalisme ou la panmixie de nos jours): cette lubie idéologique, indéracinable chez les bonzes, idéologues et avocats, conduisait à sacrifier les intérêts directs du peuple concret pour préserver des chimères sans ancrage temporel ou spatial. On ne peut créer un socialisme, qui soit réellement au service du peuple, que si l’on entend le réaliser dans un cadre précis, un cadre national ou régional ou autre, selon les circonstances réelles, en excluant la démesure des projets internationalistes qui ne pourront jamais mobiliser les moyens nécessaires pour établir cette utopie globale.
La pensée plastique, mouvante, démasquante de Nietzsche pouvait, pour tous ces contestataires de la bonzification de la social-démocratie en Allemagne, en Italie ou en Belgique (les pays où Michels -photo- a vécu, participant aux initiatives socialistes), être bien plus utile et surtout plus galvanisante que le pilpoul des idéologues sans envergure ou des avocats marrons qui tentaient de compenser leur extrême médiocrité en se posant comme les défenseurs raisonnables (et donc stérilisateurs) d’un peuple qu’ils méprisaient profondément, qu’ils infantilisaient dans leur pâle imaginaire et auquel ils vendaient leurs salades insipides. A cette médiocrité, que constituait la bonzification des cadres socialistes d’avant 1914 (la Verbonzung de Michels), s’ajoutait l’élément utopique qu’était et est resté l’internationalisme (ou l’universalisme ou la panmixie de nos jours): cette lubie idéologique, indéracinable chez les bonzes, idéologues et avocats, conduisait à sacrifier les intérêts directs du peuple concret pour préserver des chimères sans ancrage temporel ou spatial. On ne peut créer un socialisme, qui soit réellement au service du peuple, que si l’on entend le réaliser dans un cadre précis, un cadre national ou régional ou autre, selon les circonstances réelles, en excluant la démesure des projets internationalistes qui ne pourront jamais mobiliser les moyens nécessaires pour établir cette utopie globale.
Bruno Wille
 Le clivage au sein de la social-démocratie allemande peut s’expliquer, à nos contemporains des années 2020, en opposant deux figures aux positions diamétralement différentes : Franz Mehring et Bruno Wille (photo). Mehring a lutté dans les années 1890 pour que Nietzsche n’ait plus aucune influence sur les raisonnements des intellectuels socialistes. Bruno Wille dirigeait les jeunes du parti sous l’appellation de «Die Jungen». Ces derniers accusaient le parti d’être «accommodationniste» et de s’embourgeoiser (de s’aligner sur les avocats), de se contenter de faire du parlementarisme, de s’ossifier (la Verknochung de Michels), de tout miser sur le fonctionnement d’une bureaucratie qui s’éloignerait très rapidement des préoccupations des masses, qui, elles, sont toujours au bord de la pire des précarités. Wille et ses amis, dans leurs critiques, se sont toujours explicitement référés à Nietzsche, philosophe permettant, disaient-ils, de déployer en permanence une créativité qu’étouffait la bureaucratie.
Le clivage au sein de la social-démocratie allemande peut s’expliquer, à nos contemporains des années 2020, en opposant deux figures aux positions diamétralement différentes : Franz Mehring et Bruno Wille (photo). Mehring a lutté dans les années 1890 pour que Nietzsche n’ait plus aucune influence sur les raisonnements des intellectuels socialistes. Bruno Wille dirigeait les jeunes du parti sous l’appellation de «Die Jungen». Ces derniers accusaient le parti d’être «accommodationniste» et de s’embourgeoiser (de s’aligner sur les avocats), de se contenter de faire du parlementarisme, de s’ossifier (la Verknochung de Michels), de tout miser sur le fonctionnement d’une bureaucratie qui s’éloignerait très rapidement des préoccupations des masses, qui, elles, sont toujours au bord de la pire des précarités. Wille et ses amis, dans leurs critiques, se sont toujours explicitement référés à Nietzsche, philosophe permettant, disaient-ils, de déployer en permanence une créativité qu’étouffait la bureaucratie.
L’ouvrier, le prolétaire, avait potentiellement une personnalité, capable de déployer de la créativité. La bureaucratie socialiste condamnait, en imposant ses routines stéréotypées, le prolétaire à s’effacer au sein d’une masse amorphe, sevrée de tout élan révolutionnaire. Mehring et Bebel gagneront néanmoins l’épreuve de force: les militants de «Die Jungen» quitteront alors un à un le parti pour devenir des «socialistes indépendants», qui s’éparpilleront dans d’autres mouvances politiques, anarchistes, syndicalistes ou national-révolutionnaires.
Lily Braun
 Parmi les socialistes contestataires et nietzschéens au sein même du parti social-démocrate allemand avant 1914, il convient de citer Lily Braun (photo), qui fut aussi la théoricienne d’un féminisme de bon aloi. Elle avait, en dépit de sa position élevée dans la hiérarchie du parti, réfuté, dans de nombreux écrits, les fondements du socialisme des bonzes encartés (et non le socialisme du peuple), en déclarant, de manière récurrente, que le socialisme n’était pas viable à long terme s’il restait campé sur des bases kantiennes, hégéliennes ou chrétiennes. Il fallait tenir compte des foucades de Nietzsche contre ces débris idéologico-philosophiques vétustes, inféconds, hérités des Lumières. Ensuite, il fallait discipliner ces foucades pour évacuer les dogmes, contourner le contrôle bureaucratique.
Parmi les socialistes contestataires et nietzschéens au sein même du parti social-démocrate allemand avant 1914, il convient de citer Lily Braun (photo), qui fut aussi la théoricienne d’un féminisme de bon aloi. Elle avait, en dépit de sa position élevée dans la hiérarchie du parti, réfuté, dans de nombreux écrits, les fondements du socialisme des bonzes encartés (et non le socialisme du peuple), en déclarant, de manière récurrente, que le socialisme n’était pas viable à long terme s’il restait campé sur des bases kantiennes, hégéliennes ou chrétiennes. Il fallait tenir compte des foucades de Nietzsche contre ces débris idéologico-philosophiques vétustes, inféconds, hérités des Lumières. Ensuite, il fallait discipliner ces foucades pour évacuer les dogmes, contourner le contrôle bureaucratique.
Le socialiste vrai, ajoutait Lily Braun, est un révolutionnaire et, à ce titre, il vise l’héroïsme car la praxis du révolutionnaire est de se transcender personnellement dans le combat pour le peuple. Le combat, communautaire par nature, ne doit pas conduire, in fine, à se subordonner aux bureaucrates replets mais doit assurer le libre développement de la personnalité, laquelle est également vectrice d’une dimension esthétique (comportementale) que l’idéologie médiocre des bureaucrates étouffe et évacue hors du champ de tout socialisme bien compris.
 Lily Braun, curieusement, théorisera ce qu’elle appelait «l’esprit de négation» (Geist der Verneinung). Aujourd’hui, cette notion est attribuée aux théoriciens de l’Ecole de Francfort, précurseurs des dérives soixante-huitardes et du négativisme absolu et virulent de la «cancel culture» et du wokisme. Pour Lily Braun, toutefois, l’esprit de négation doit conduire à nier ce qui sclérose, ce qui est figé, ce qui ne recèle plus aucune potentialité et qui ne permet plus aucune «re-juvénilisation» du socialisme. Il s’agit donc, pour elle, de nier les dogmes inspirés du kantisme, qui structuraient l’idéologie de la social-démocratie allemande d’avant 1914 et qui structurent toujours, mutatis mutandis, le fatras hétéroclite des idéologies dominantes (et seules tolérées) d’aujourd’hui.
Lily Braun, curieusement, théorisera ce qu’elle appelait «l’esprit de négation» (Geist der Verneinung). Aujourd’hui, cette notion est attribuée aux théoriciens de l’Ecole de Francfort, précurseurs des dérives soixante-huitardes et du négativisme absolu et virulent de la «cancel culture» et du wokisme. Pour Lily Braun, toutefois, l’esprit de négation doit conduire à nier ce qui sclérose, ce qui est figé, ce qui ne recèle plus aucune potentialité et qui ne permet plus aucune «re-juvénilisation» du socialisme. Il s’agit donc, pour elle, de nier les dogmes inspirés du kantisme, qui structuraient l’idéologie de la social-démocratie allemande d’avant 1914 et qui structurent toujours, mutatis mutandis, le fatras hétéroclite des idéologies dominantes (et seules tolérées) d’aujourd’hui.
Nietzsche, avec ses démarches démasquantes, avec ses critiques incisives des poncifs de toutes natures, avec son idée cardinale de procéder à une «transvaluation de toutes les valeurs», est le philosophe qui doit nous apprendre à parfaire cette négation de ce qui nous nie (de ce qui nous niait hier et continue de nous nier aujourd’hui).
Lily Braun est même très explicite quand elle dit qu’il faut «dire oui à la Vie», tout en se débarrassant de cet «idéal du plus grand bonheur pour le plus grand nombre», idéal désuet qui nous amène «à ne créer qu’une société de petits bourgeois flegmatiques». L’esprit de négation, à condition qu’il n’ait que des références directement tirées de Nietzsche, sert à dire mieux «oui à la Vie» et à créer les conditions pour que les hommes ne sombrent pas dans un univers de «petits bourgeois flegmatiques».
 Le fils de Lily Braun, Otto Braun (1897-1918) (photo), frotté avant-guerre aux démarches polémiques de sa mère contre les bonzificateurs du socialisme allemand, rangés derrière Mehring et Bebel, s’engage très tôt dans l’armée impériale pour partir combattre en Russie et en France, où il trouvera la mort au front. Dans les lettres adressées à ses parents et à son amie Julia Vogelstein pendant la guerre, recueil de lettres qui constitue son unique livre d’une extraordinaire densité, eu égard à son jeune âge, Otto Braun résume les positions qu’il avait déjà exprimées entre sa dixième et sa douzième année dans des missives adressées à son père et à sa mère: il chante l’Eros et la liberté; il veut déjà voir la vie telle qu’elle est et non telle qu’elle doit être, passant ainsi, en toute conscience à la fin de son enfance et au tout début de son adolescence, de l’idéalisme (abstrait) au réalisme, laissant très tôt entrevoir un refus du moralisme social-démocrate (et autre), qui ne veut qu’amender et corriger le monde sans l’aimer pour ce qu’il est, sans l’accepter tel qu’il est. «Nous, jeunes d’aujourd’hui, avons besoin de gens qui s’immergent dans la vie pour accomplir quelque chose de nouveau, déjà que quelque chose de nouveau se rapproche de nous, je le sens!».
Le fils de Lily Braun, Otto Braun (1897-1918) (photo), frotté avant-guerre aux démarches polémiques de sa mère contre les bonzificateurs du socialisme allemand, rangés derrière Mehring et Bebel, s’engage très tôt dans l’armée impériale pour partir combattre en Russie et en France, où il trouvera la mort au front. Dans les lettres adressées à ses parents et à son amie Julia Vogelstein pendant la guerre, recueil de lettres qui constitue son unique livre d’une extraordinaire densité, eu égard à son jeune âge, Otto Braun résume les positions qu’il avait déjà exprimées entre sa dixième et sa douzième année dans des missives adressées à son père et à sa mère: il chante l’Eros et la liberté; il veut déjà voir la vie telle qu’elle est et non telle qu’elle doit être, passant ainsi, en toute conscience à la fin de son enfance et au tout début de son adolescence, de l’idéalisme (abstrait) au réalisme, laissant très tôt entrevoir un refus du moralisme social-démocrate (et autre), qui ne veut qu’amender et corriger le monde sans l’aimer pour ce qu’il est, sans l’accepter tel qu’il est. «Nous, jeunes d’aujourd’hui, avons besoin de gens qui s’immergent dans la vie pour accomplir quelque chose de nouveau, déjà que quelque chose de nouveau se rapproche de nous, je le sens!».
La mort précoce d’Otto Braun a privé l’Europe (et pas seulement l’Allemagne) d’un philosophe en devenir qui aurait peut-être égalé Ernst Jünger. Les positions de Lily Braun révèlent donc un socialisme aujourd’hui bien révolu, le «mehringisme bébélien» de la Belle Epoque ayant triomphé sur toute la ligne, oblitérant notre présent de ses avatars les plus dégénérés et les plus biscornus.
Impact sur les marxistes russes
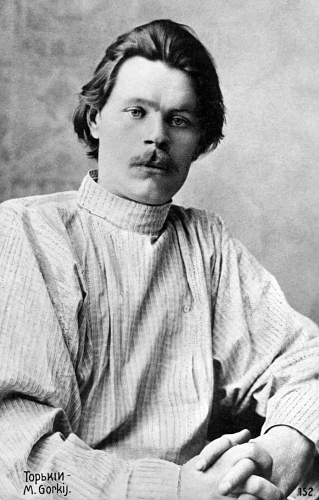 A la même époque, Nietzsche exerce une influence non négligeable sur les marxistes et les socialistes russes. Ainsi, Maxime Gorki (photo) a été un homme qui fut immergé, par déréliction familiale ou parfois volontairement, dans les misères du petit peuple russe sans partager les illusions des «populistes» sur l’hypothétique bonté intrinsèque du peuple buveur, batailleur, roublard. Son adhésion à la mouvance marxiste prérévolutionnaire puis au bolchévisme l’obligera à mettre en sourdine sa dette envers Nietzsche, qu’il ne reniera pas pour autant, ce qu’attestent clairement certains écrits datant de l’ère stalinienne. Lounatcharski et Bogdanov seront eux aussi les débiteurs de Nietzsche et l’impact du philosophe de Sils-Maria sur leur vision du monde et de la politique, sur leur manière d’interpréter le marxisme mériterait une étude en soi.
A la même époque, Nietzsche exerce une influence non négligeable sur les marxistes et les socialistes russes. Ainsi, Maxime Gorki (photo) a été un homme qui fut immergé, par déréliction familiale ou parfois volontairement, dans les misères du petit peuple russe sans partager les illusions des «populistes» sur l’hypothétique bonté intrinsèque du peuple buveur, batailleur, roublard. Son adhésion à la mouvance marxiste prérévolutionnaire puis au bolchévisme l’obligera à mettre en sourdine sa dette envers Nietzsche, qu’il ne reniera pas pour autant, ce qu’attestent clairement certains écrits datant de l’ère stalinienne. Lounatcharski et Bogdanov seront eux aussi les débiteurs de Nietzsche et l’impact du philosophe de Sils-Maria sur leur vision du monde et de la politique, sur leur manière d’interpréter le marxisme mériterait une étude en soi.
L’impact de Nietzsche sur les droites et, ensuite, sur le national-socialisme est plus mitigé, ce qui pourrait être vu comme un paradoxe, si l’on tient benoîtement compte des schématismes idéologico-médiatiques dominants de nos jours. Les droites n’ont pas toujours, loin s’en faut, accepté les critiques acerbes de Nietzsche sur le christianisme ou elles lui ont justement reproché d’avoir trop influencé certains socialistes, les plus turbulents voire les plus mécréants, et d’avoir eu un ascendant trop considérable «sur les artistes déjantés et les femmes hystériques».
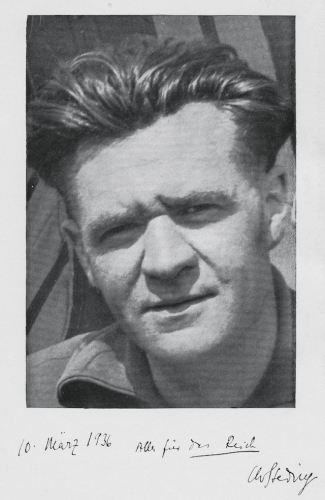 Sous le IIIème Reich, Christoph Steding (photo) lui reproche son a-politisme (bien réel, il faut en convenir) et l’influence qu’il a exercée sur les formes culturelles neutres et anti-impériales de Suisse, des Pays-Bas et des royaumes scandinaves, tandis qu’Alfred Bäumler, de très loin le plus pertinent de ses exégètes à l’époque national-socialiste, tire des conclusions qui méritent encore le détour aujourd’hui, qui sont analysées en profondeur et sans a priori en Italie actuellement. Rien de cela ne transparaît dans l’espace linguistique français.
Sous le IIIème Reich, Christoph Steding (photo) lui reproche son a-politisme (bien réel, il faut en convenir) et l’influence qu’il a exercée sur les formes culturelles neutres et anti-impériales de Suisse, des Pays-Bas et des royaumes scandinaves, tandis qu’Alfred Bäumler, de très loin le plus pertinent de ses exégètes à l’époque national-socialiste, tire des conclusions qui méritent encore le détour aujourd’hui, qui sont analysées en profondeur et sans a priori en Italie actuellement. Rien de cela ne transparaît dans l’espace linguistique français.
Le chantier est vaste quand on aborde Nietzsche et le nietzschéisme. Se pencher sur ce philosophe, sur les diverses facettes de son œuvre, sur la fascination que penseurs et écrivains de toute l’Europe ont ressenti en le lisant, est un travail herculéen. Mais il faudra s’y atteler.
Forest-Flotzenberg, juillet 2025.
15:00 Publié dans Histoire, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich nietzsche, histoire, philosophie, socialisme allemand, révolution conservatrice, robert steuckers, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 03 janvier 2026
Technocratie américaine – De la vision des années 1930 à la technocratie moderne

Technocratie américaine – De la vision des années 1930 à la technocratie moderne
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/12/22/amerikan-teknaatti-193...
Au début des années 1930, aux États-Unis, en pleine crise de la Grande Dépression, naquit le mouvement technocratique, qui remettait en question l’ordre social dominant. Sa vision radicale était de remplacer la politique et l’économie de marché par une planification scientifique et une distribution efficace des ressources — une société dirigée par des ingénieurs et des scientifiques.

Bien que l’ingénieur californien William H. Smyth ait popularisé le terme dès 1919, c’est Howard Scott (photo) qui devint la véritable figure idéologique centrale, qui introduisit cette vision dans les années 1930 et la développa davantage.

La proposition centrale du mouvement technocratique était de créer un “technat” américain: une région géographiquement cohérente, autosuffisante, s’étendant du pôle Nord au canal de Panama, comprenant les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Amérique centrale, ainsi que des parties des Caraïbes et de l’Amérique du Sud. Cette région fut choisie en raison de ses vastes ressources naturelles, ses voies d’eau et ses réserves d’énergie, permettant une quasi-autonomie avec un commerce extérieur minimal.
De nos jours, l’administration Trump a exprimé un vif intérêt à étendre l’influence des États-Unis dans le Nord en annexant le Groenland, qui appartient au Danemark. Trump a justifié cette démarche à plusieurs reprises par des raisons de sécurité nationale, de stratégie arctique et de gestion des terres rares, ce qui correspond à la vision technocratique d’un bloc autosuffisant en ressources.
De même, Trump a proposé d’intégrer le Canada en tant que 51ème État des États-Unis, en insistant sur la sécurité et l’intégration économique de l’ensemble de l’hémisphère occidental — c'est là une répétition de l’idée forgée dans les années 1930, celle d’un continent uni sans frontières politiques.
Le mouvement technocratique des années 1930 souhaitait réaliser cette vision à travers une région aussi vaste et unifiée que possible. Ses ressources, sa production et sa gouvernance devaient être entièrement pilotées par des méthodes techniques et énergétiques, sans recourir aux processus décisionnels politiques traditionnels.
Au cœur de l’idéologie se trouvait la théorie de l’énergie, selon laquelle la valeur et l’activité de la société seraient mesurées en fonction de la consommation d’énergie (en joules ou en ergs). L’ordre économique traditionnel était considéré comme obsolète et à l’origine d’une pénurie artificielle, tandis que la technologie permettrait de créer une abondance.
Chaque citoyen se verrait accorder un droit à vie à une quantité fixe de certificats énergétiques, qui seraient la seule monnaie d’échange dans la société. Ces certificats représenteraient directement la part de l’individu dans la consommation totale d’énergie de la société. Ils expireraient après un an, ne seraient ni échangeables, ni épargnés, ni transférables, afin de maintenir un équilibre entre production et consommation sans l'artificialité de la pénurie.
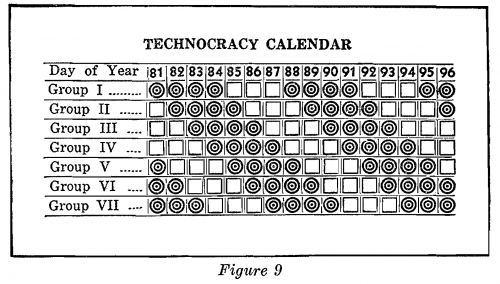
La semaine de travail serait réduite à quatre heures par jour, quatre jours par semaine, suivis de trois jours de congé. La production fonctionnerait en rotation continue de sept équipes, permettant aux machines et équipements de fonctionner presque sans interruption.
L’administration serait organisée en unités fonctionnelles et en régions basées sur la latitude et la longitude, permettant une distribution efficace et systématique des ressources et de l’énergie. Le dirigeant suprême serait nommé par des experts, tandis que les gouvernements régionaux seraient subdivisés en segments fonctionnels selon les besoins. Politiciens et hommes d’affaires seraient exclus du système, étant perçus comme sources d’inefficacité et de corruption.

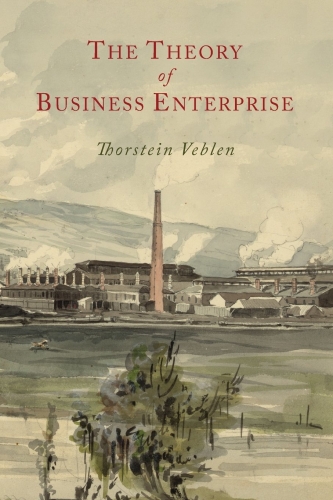
Le mouvement technocratique s’appuyait fortement sur les idées de l’économiste norvégien-américain Thorstein Veblen (photo), sur les conseils des ingénieurs, ainsi que sur l’optimisme de l’époque selon lequel des machines à calcul mécanique pouvaient équilibrer la production et la consommation en temps réel. Les technocrates voyaient en IBM et ses systèmes une base pour l’automatisation, qui remplacerait les professions traditionnelles et permettrait une surveillance systématique sans erreur humaine.
Le mouvement technocratique connut une courte période de succès entre 1932 et 1933, attirant des chômeurs, des ingénieurs et d’autres victimes de la crise. Les membres portaient des uniformes gris et utilisaient le symbole de la monade, ce qui attira aussi l’attention des médias. Cependant, des conflits internes conduisirent à des divisions du mouvement technocratique en différentes organisations, comme Technoracy Inc. dirigée par Howard Scott.
Le New Deal de Roosevelt offrit une alternative plus pragmatique à la dépression, et la chute annoncée du système économique ne se produisit pas. Le mouvement fut rapidement marginalisé lors de la Seconde Guerre mondiale, en partie à cause de son pacifisme et de son isolationnisme, et se réduisit finalement à une petite organisation qui a presque disparu de l’histoire.
Les critiques furent sévères à l'époque. On reprocha à ce mouvement son élitisme, son autoritarisme et ses tendances totalitaires. Il fut comparée au fascisme et au stalinisme, car il voulait remplacer la démocratie par une gouvernance d’experts sans participation citoyenne. Les marxistes considéraient la théorie de l’énergie comme arbitraire par rapport à la théorie de la valeur travail, et les libéraux y voyaient des traits de “stalinisme progressif”, où la liberté était sacrifiée à l’efficacité.
Bien que le mouvement technocratique d’origine ait disparu, ses idées clés — la domination d’experts, la prise de décisions basée sur les données, la priorité à l’efficacité et le remplacement des processus politiques par une gestion technique — ont été ravivées dans le contexte technologique et géopolitique des années 2020.

La coopération entre Elon Musk et Donald Trump, ainsi que la forte présence des sociétés technologiques comme Palantir lors du second mandat de Trump, reflètent des traits technocratiques. Le projet DOGE (Department of Government Efficiency), visant à rendre l’administration plus efficace et à réduire la bureaucratie par l’intelligence artificielle, rappelle la vision initiale d’une gestion efficace, politiquement neutre. Il est remarquable que le grand-père d’Elon Musk, Joshua Norman Haldeman, ait été un animateur en vue de la branche canadienne du mouvement technocratique dans les années 1930.
Les plateformes d’intelligence artificielle de Palantir, fondées par l’investisseur en capital-risque et transhumaniste Peter Thiel, permettent la gestion massive de données et la création de bases de données intégrées pour la défense, la surveillance de l’immigration et la prise de décision. Cette évolution associe la puissance technologique du secteur privé à l’action de l’État, soulevant des inquiétudes concernant la vie privée, la surveillance et la réduction de la démocratie.
Dans un monde multipolaire où les États-Unis, la Chine et la Russie rivalisent pour la domination de l’intelligence artificielle, la technologie devient un enjeu stratégique majeur. L’idée d’un bloc autosuffisant, comme le serait une technocratie américaine parachevée, reflète la division géopolitique actuelle, où les grandes puissances cherchent à préserver leur souveraineté technologique et à créer leurs propres écosystèmes numériques.
Ce développement soulève le risque de techno-polarisation — la concentration du contrôle de la technologie et des données, créant de nouveaux centres de pouvoir. Ceux-ci modifient l’autorité traditionnelle de l’État et instaurent une gouvernance basée sur des algorithmes et des identités numériques des citoyens. Les critiques mettent en garde contre des tendances techno-fascistes où l’efficacité et la surveillance restreignent les libertés individuelles.
Bien que le mouvement technocratique des années 1930 soit resté une curiosité historique, sa vision d’un pouvoir d’experts et de suprématie technologique a connu un nouvel essor mondial. La numérisation, le dataïsme et la nécessité de contrôler l’intelligence artificielle ont ramené la pensée technocratique à la vie — dans les États, chez les grandes entreprises technologiques et en politique, où la prise de décision se déplace de plus en plus vers des algorithmes et leurs gestionnaires.
19:12 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, technocratie, histoire, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La guerre des États-Unis contre le Venezuela a commencé en 2001

La guerre des États-Unis contre le Venezuela a commencé en 2001
Source: https://comedonchisciotte.org/gli-stati-uniti-attaccano-i...
Les attaques actuelles des États-Unis contre le Venezuela s’inscrivent dans un processus de vingt ans dirigé par les États-Unis et la droite vénézuélienne pour miner le projet bolivarien et sa courageuse décision d’utiliser la richesse pétrolière du pays pour améliorer la vie de sa population.
Par Vijay Prashad, pour peoplesdispatch.org
Les États-Unis n’avaient aucun problème avec le Venezuela en soi, ni avec le pays ni avec son ancienne oligarchie. Le problème que le gouvernement américain et sa classe d’entrepreneurs ont, c’est avec le processus lancé par le premier gouvernement du président vénézuélien Hugo Chávez.
En 2001, le processus bolivarien de Chávez a adopté une loi appelée Loi Organique sur les Hydrocarbures, qui affirmait la propriété de l’État sur toutes les réserves de pétrole et de gaz, réservait les activités en amont d’exploration et d’extraction aux entreprises contrôlées par l’État, mais permettait aux entreprises privées, y compris étrangères, de participer aux activités en aval (raffinage et commercialisation).
Le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, avait déjà nationalisé son pétrole par des lois en 1943 puis à nouveau en 1975. Cependant, dans les années 90, dans le cadre des réformes néolibérales promues par le Fonds Monétaire International (FMI) et les grandes compagnies pétrolières américaines, l’industrie pétrolière avait été largement privatisée.

Lorsque Chávez a promulgué la nouvelle loi, il a ramené l’État au contrôle de l’industrie pétrolière (dont les ventes à l’étranger représentaient 80 % des revenus extérieurs du pays). Cela a mis en colère les compagnies pétrolières américaines, en particulier ExxonMobil et Chevron, qui ont fait pression sur le gouvernement du président George W. Bush pour agir contre Chávez.
Les États-Unis ont tenté d’organiser un coup d’État pour destituer Chávez en 2002, qui a duré plusieurs jours, puis ont poussé la direction corrompue de la compagnie pétrolière vénézuélienne à déclencher une grève pour nuire à l’économie vénézuélienne (finalement, ce sont les travailleurs qui ont défendu l’entreprise et la ont reprise en main).
Chávez a résisté à la fois à la tentative de coup d’État et à la grève parce qu’il bénéficiait d’un large soutien populaire.
Maria Corina Machado, qui en 2025 a reçu le Prix Nobel de la Paix, a fondé un groupe appelé Sumaté (« Unis »), qui a soumis à référendum la révocation du président. En 2004, environ 70% des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes, et une large majorité (59%) a voté pour maintenir Chávez à la présidence.
Mais ni Machado ni ses soutiens américains (y compris les compagnies pétrolières) ne se sont calmés. Depuis 2001, ils ont cherché à renverser le processus bolivarien, pour remettre effectivement au pouvoir les compagnies pétrolières détenues par les États-Unis.
La question du Venezuela ne concerne donc pas tant la « démocratie » (un mot usé, qui perd peu à peu de sa signification), mais la lutte de classe internationale entre le droit du peuple vénézuélien à contrôler librement son pétrole et son gaz, et celui des compagnies pétrolières américaines à dominer les ressources naturelles vénézuéliennes.

Le processus bolivarien
Lorsque Hugo Chávez est apparu sur la scène politique dans les années 90, il a capturé l’imagination de la majorité du peuple vénézuélien, en particulier de la classe ouvrière et des paysans.
La décennie a été marquée par les trahisons dramatiques des présidents qui avaient promis de protéger le pays riche en pétrole contre l’austérité imposée par le FMI, puis ont adopté ces mêmes propositions du FMI. Peu importait qu’ils soient social-démocrates (comme Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática, président de 1989 à 1993) ou conservateurs (comme Rafael Caldera des Démocrates Chrétiens, président de 1994 à 1999).
L’hypocrisie et la trahison caractérisaient le monde politique, tandis qu’un niveau élevé d’inégalité (avec un indice de Gini de 48,0, un chiffre incroyablement élevé) accablait la société. Le mandat de Chávez (qui a remporté l’élection avec 56% contre 39% pour le candidat des anciens partis) était contre cette hypocrisie et cette trahison.
Le fait que les prix du pétrole soient restés élevés de 1999 (lorsque Chávez a pris ses fonctions) jusqu’en 2013 (lorsqu’il est mort à seulement 58 ans) a aidé Chávez et le processus bolivarien. Après s’être approprié les revenus du pétrole, Chávez les a utilisés pour obtenir d’extraordinaires résultats sociaux. Tout d’abord, il a développé une série de programmes sociaux de masse (« misiones ») qui ont redirigé ces revenus pour satisfaire les besoins humains fondamentaux, comme les soins de santé de base (Misión Barrio Adentro), l’alphabétisation et l’éducation secondaire pour la classe ouvrière et les paysans (Misión Robinson, Misión Ribas et Misión Sucre), la souveraineté alimentaire (Misión Mercal puis PDVAL) et la construction de logements (Gran Misión Vivienda).
L’État a été réformé comme un véhicule de justice sociale, et non comme un outil pour exclure la classe ouvrière et les paysans des bénéfices du marché. Avec l’avancement de ces réformes, le gouvernement a cherché à construire le pouvoir populaire à travers des outils participatifs comme les communes (comunas). Ces communes sont nées initialement des conseils communaux (consejos comunales) et ont ensuite évolué en organes populaires pour contrôler les fonds publics, planifier le développement local, créer des banques communautaires et former des entreprises coopératives locales (empresas de producción social).
Les communes représentent l’un des contributions les plus ambitieuses du processus bolivarien: un effort – irrégulier mais historiquement significatif – pour bâtir le pouvoir populaire comme une alternative durable à la domination oligarchique.

La guerre hybride imposée par les États-Unis au Venezuela
En 2013-2014, deux événements ont profondément menacé le processus bolivarien : d’une part, la disparition prématurée de Hugo Chávez, sans doute la force motrice de l’énergie révolutionnaire dans le pays, et d’autre part, le déclin lent puis constant des revenus pétroliers. Chávez a été remplacé à la présidence par l’ancien ministre des Affaires étrangères et syndicaliste Nicolás Maduro, qui a tenté de stabiliser la situation, mais a dû faire face à un défi sérieux lorsque les prix du pétrole, atteignant un pic en juin 2014 à environ 108 dollars le baril, ont chuté drastiquement en 2015 (en dessous de 50 dollars) puis en janvier 2016 (en dessous de 30 dollars). Pour le Venezuela, dépendant des ventes de pétrole brut à l’étranger, cette baisse a été catastrophique. Le processus bolivarien n’a pas réussi à revoir la redistribution dépendante du pétrole (pas seulement à l’intérieur du pays, mais aussi dans la région, notamment via PetroCaribe) ; il est resté piégé par sa dépendance aux exportations pétrolières et par ses contradictions en tant qu’État rentier. De même, le processus bolivarien n’avait pas exproprié la richesse des classes dominantes, qui continuaient à peser fortement sur l’économie et la société, empêchant ainsi une transition complète vers un projet socialiste.
Avant 2013, les États-Unis, leurs alliés européens et les forces oligarchiques d’Amérique latine avaient déjà forgé leurs armes pour une guerre hybride contre le Venezuela. Après que Chávez ait remporté ses premières élections en décembre 1998, et avant qu’il n’entre en fonction l’année suivante, le Venezuela a connu une fuite accélérée de capitaux, l’oligarchie vénézuélienne transférant ses richesses à Miami. Lors du coup d’État et du blocus pétrolier, d’autres preuves de fuite de capitaux ont encore affaibli la stabilité monétaire du Venezuela. Le gouvernement américain a commencé à poser les bases diplomatiques pour isoler le Venezuela, en qualifiant le gouvernement de problème et en constituant une coalition internationale contre lui. Cela a conduit, en 2006, à des restrictions d’accès aux marchés financiers internationaux. Les agences de notation de crédit, les banques d’investissement et les institutions multilatérales ont constamment augmenté les coûts de financement, rendant plus difficile le refinancement bien avant que les États-Unis n’imposent des sanctions formelles au Venezuela.
Après la mort de Chávez, avec la chute des prix du pétrole, les États-Unis ont lancé une guerre hybride ciblée contre le Venezuela. Par guerre hybride, on entend l’utilisation coordonnée de coercition économique, d’asphyxie financière, de guerre de l’information, de manipulation légale, d’isolement diplomatique et de violence ciblée, employées pour déstabiliser et inverser les projets politiques souverains sans invasion à grande échelle. Son objectif n’est pas la conquête territoriale, mais la soumission politique : discipliner les États qui tentent la redistribution, la nationalisation ou une politique étrangère indépendante.
La guerre hybride opère par la militarisation de la vie quotidienne. Attaques monétaires, sanctions, pénuries, narrations médiatiques, pressions des ONG, vexations juridiques (lawfare) et crises de légitimité orchestrées sont conçues pour éroder la capacité de l’État, épuiser le soutien populaire et fragmenter la cohésion sociale.
La souffrance qui en résulte est ensuite présentée comme une preuve d’un échec intérieur, masquant l’architecture extérieure de la coercition. C’est précisément ce que le Venezuela a affronté depuis que les États-Unis ont imposé illégalement des sanctions financières au pays en août 2017, puis aggravé par des sanctions secondaires en 2018. En raison de ces sanctions, le Venezuela a subi l’interruption de tous ses systèmes de paiement et canaux commerciaux, étant contraint à une conformité excessive aux réglementations américaines.
Pendant ce temps, les narrations des médias occidentaux ont systématiquement minimisé les sanctions, amplifiant inflation, pénuries et migration comme des phénomènes purement internes, renforçant le discours sur le changement de régime.
La chute du niveau de vie au Venezuela entre 2014 et 2017 ne peut être séparée de cette stratégie à plusieurs niveaux d’étouffement économique.
Attaques de mercenaires, sabotage du réseau électrique, création d’un conflit avantageant ExxonMobil entre la Guyana et le Venezuela, invention d’un président alternatif (Juan Guaidó), attribution du Prix Nobel de la Paix à quelqu’un qui prône la guerre contre son propre pays (Machado), tentative d’assassinat du président, bombardements de pêcheurs au large des côtes vénézuéliennes, saisie de pétroliers en partance du Venezuela, accumulation d’une flotte au large des côtes du pays : chacun de ces éléments est conçu pour créer une tension neurologique à l’intérieur du Venezuela, menant à la reddition du processus bolivarien en faveur d’un retour à 1998, et donc à l’annulation de toute loi sur les hydrocarbures promettant la souveraineté du pays.

Si le pays devait revenir à 1998, comme le promet Maria Corina Machado (photo), tous les progrès démocratiques obtenus par les misiones et les comunas, ainsi que par la Constitution de 1999, seraient invalidés. En effet, Machado a déclaré qu’un bombardement étasunien de ses compatriotes vénézuéliens serait « un acte d’amour ». Le slogan de ceux qui veulent renverser le gouvernement est : « En avant vers le passé ».
En octobre 2025, entre-temps, Maduro a dit en anglais à un public à Caracas: «Écoutez-moi, non à la guerre, oui à la paix, peuple des États-Unis.»
Ce soir-là, dans un discours radiophonique, il a averti: «Non au changement de régime, qui nous rappelle tant les guerres infinies et ratées en Afghanistan, en Irak, en Libye, etc. Non aux coups d’État orchestrés par la CIA.»
La phrase «non à la guerre, oui à la paix» a été reprise sur les réseaux sociaux et remixée en chansons. Maduro est apparu à plusieurs reprises lors de rassemblements et rencontres avec de la musique à plein volume, chantant « non à la guerre, oui à la paix » et, à au moins une occasion, portant un chapeau avec ce message.
13:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine, caraïbes, révolution bolivarienne, bolivarisme, hugo chavez, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 02 janvier 2026
Tierra y Libertad – Eternel désir au Mexique

Tierra y Libertad – Eternel désir au Mexique
Peter Backfisch
Source: https://opposition24.com/politik/tierra-y-libertad-ewige-sehnsucht-in-mexico/
 Les lecteurs du portail opposition24.com connaîtront probablement peu de choses sur les périodiques de l’organisation d’aide patronnée par l’extrême gauche, porte-voix d'Antifa en Allemagne, « Die Rote Hilfe ». On pourrait aussi supposer qu’on préfère généralement jeter ce genre de publications à la poubelle plutôt que de les feuilleter.
Les lecteurs du portail opposition24.com connaîtront probablement peu de choses sur les périodiques de l’organisation d’aide patronnée par l’extrême gauche, porte-voix d'Antifa en Allemagne, « Die Rote Hilfe ». On pourrait aussi supposer qu’on préfère généralement jeter ce genre de publications à la poubelle plutôt que de les feuilleter.
L’auteur de ces lignes les as feuilletées et est tombé sur des choses plutôt intéressantes ! D’une part, il y a le point central du magazine, 4.2025, « Resistencia – Luttes et répressions au Mexique », qui débute par une introduction assez instructive sur l’histoire du pays. La Révolution mexicaine (1910-1917) y est traitée en détail, notamment la lutte du légendaire chef paysan Emilio Zapata. Sous la devise « Tierra y Libertad » (Terre et Liberté), il mena une lutte armée contre les grands propriétaires fonciers pour la restauration de droits ancestraux sur la terre. « La terre doit appartenir à ceux qui la cultivent. » Il jouit encore aujourd’hui d’un grand respect auprès de la population rurale.
Cela est particulièrement vrai pour les États de Chiapas et Oaxaca, où j'ai séjourné en 1992/1993, exactement un an avant l’insurrection de l’« Armée zapatiste ». Dans le numéro du magazine que j'ai examiné, les événements sont rapportés de manière bien informée et majoritairement correcte. J’ai pu ressentir l’atmosphère pré-révolutionnaire lors de mes échanges avec les Indigènes, entre Noël 1992 et le Nouvel An 1993. Quelque chose flottait dans l’air, et il était conseillé, lorsqu’on demandait si l’on était un « Gringo », de nier et d’affirmer que l’on était « Alemán », ce qui passa sans problème.

Au cœur du Chiapas, à San Cristóbal de las Casas, l’ancienne ville de « Ciudad Real », fondée en 1528 et dite « Ville Royale », les Indigènes se rassemblèrent la veille de Noël 1992 sur la place Zócalo devant la magnifique cathédrale construite dans le style colonial espagnol, et débattaient passionnément des événements qui se dessinaient à l’horizon. La participation du Mexique au traité de libre-échange NAFTA (North American Free Trade Agreement) était prévue pour le 1er janvier 1994, ce qui devait aggraver encore la situation des Indigènes de Chiapas et Oaxaca.


L’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) rappelle les anciennes revendications du chef révolutionnaire Emilio Zapata, les reprend et ajoute à « Terre et Liberté » les revendications de « Pain, Éducation et Meilleure Santé », appelant en janvier 1994 à la révolte contre le traité NAFTA et le statu quo. L’armée mexicaine n’a pas été en mesure de rétablir la paix et l’ordre, et de longues négociations avec des représentants du gouvernement s’engagèrent.

Samuel Ruiz, évêque de Chiapas (photo), joua le rôle de médiateur. Il s’était déjà engagé dans la défense des droits des Indigènes lors de ses sermons, notamment lors de la messe de Noël 1992 dans la cathédrale de San Cristóbal de las Casas, à laquelle j'ai eu la chance d’assister. L’évêque Ruiz, qui s’était attiré la colère des grands propriétaires terriens par son engagement, mit fin aux combats par un accord. Les revendications de la population furent partiellement satisfaites, les insurgés reçurent la garantie de liberté de mouvement et d’impunité, assurée par l’Église catholique de Chiapas.


En lisant les articles relatant ces événements dans le magazine, on remarque que beaucoup de paragraphes sont écrits à travers le prisme d’une vision historique de gauche, tandis que d’autres aspects importants de la situation des Indigènes dans le sud du Mexique ne sont pas mentionnés. Par exemple, la situation des Indigènes lacandones (photo), « les derniers gardiens de la forêt ». Ils restent aujourd’hui les seuls habitants humains de la vaste forêt tropicale du sud du Mexique, jusqu’à la frontière guatémaltèque. Ils parlent toujours une langue maya et maîtrisent peu ou pas du tout l’espagnol. Ils chassent encore à l’arc et à la flèche des sangliers, des cerfs, des tapirs et d’autres animaux de la forêt tropicale.
Les turbulences de l’insurrection dans le Chiapas ont probablement peu affecté les Iacandones/Lacandones (les deux graphies existent), ce qui explique aussi pourquoi ils ne sont pas mentionnés dans un magazine de gauche.
Pour les renégats et les activistes de gauche des années 1970, l’histoire de « Rote Hilfe » pourrait aussi être intéressante. Peut-être fête-t-elle aujourd’hui ses 50 ans ? Mais on ne le sait pas avec certitude. Au début des années 70, il existait en tout cas deux organisations « Rote Hilfe », créées par la KPD/ML: la Rote Hilfe Deutschland (RHD) et celle de la KPD/AO, la Rote Hilfe e.V. Elles se sont affrontées violemment jusqu’à ce que le Comité central du Parti communiste chinois intervienne et exige l’unification immédiate des deux organisations. Après un voyage de délégation à Pékin, cela fut effectivement mis en œuvre. Un document d’unification était prêt en 1975, mais fut à plusieurs reprises saboté par différentes sections locales. La description des événements est divertissante et montre encore une fois que la gauche n’est pas capable de donner vie à ses propres objectifs.
Mis à part les textes qui m'intéressent, le périodique « Rote Hilfe » est imbuvable. Les contributions que je ne mentionne pas, qui sont autant d'hommages propagandistes de mouture antifa, et, par suite, illisibles, méritent vraiment d’être jetées à la poubelle.
Qui est Peter Backfisch?
Peter Backfisch, né en 1954, est diplômé en pédagogie et a travaillé pendant 40 ans pour une organisation (ONG) du secteur social. Il a été notamment conseiller du président du conseil d’administration en politique internationale. Il a aussi travaillé jusqu’en 2004 en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans les États de la CEI en tant que collaborateur indépendant pour divers prestataires internationaux. Depuis 2019, il écrit en tant qu’auteur indépendant, notamment pour Junge Freiheit, Abendland, Wochenblick, Attersee Report et Tumult (en ligne).
18:08 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, zapatisme, mexique, amérique centrale, amérique latine, amérique ibérique, chiapas |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 décembre 2025
La Commission Trilatérale a créé l’Occident contemporain

La Commission Trilatérale a créé l’Occident contemporain
Giacomo Gabellini
Source: https://telegra.ph/La-Commissione-Trilaterale-ha-creato-l...
Comment le modèle économique moderne a été créé
Lorsque, en 1973, ils ont créé la Commission Trilatérale, les fondateurs David Rockefeller, Zbigniew Brzeziński et George Franklin aspiraient à établir un organisme transnational destiné à consolider l’ordre international dirigé par les États-Unis et à atténuer les tensions émergentes entre les membres de la « triade capitaliste » – composée des États-Unis, de l’Europe occidentale et du Japon – dues à la croissance économique européenne et japonaise, ainsi qu’à l’intensification de la concurrence inter-capitaliste déclenchée par la crise pétrolière. Vers le milieu des années 70, le groupe de réflexion publia, parmi d’autres, une étude affirmant qu'«une initiative conjointe Trilatérale-OPEC, mettant à disposition plus de capitaux pour le développement, serait conforme aux intérêts des pays trilatéraux. Dans une période marquée par une croissance stagnante et une augmentation du chômage, il est évidemment avantageux de transférer des fonds des États membres de l’OPÉC vers les pays en développement pour qu’ils absorbent les exportations des nations représentées au sein de la Commission Trilatérale».
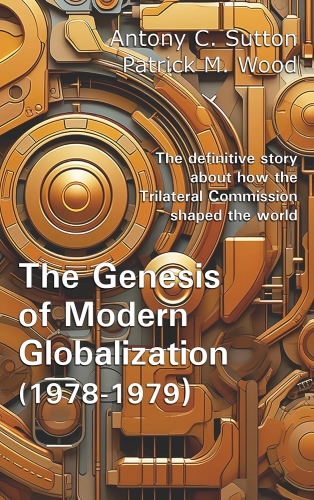 Dans un autre document datant de la même période, il est écrit que: «l’objectif fondamental est de consolider le modèle basé sur l’interdépendance [entre États], afin de protéger les avantages qu’il garantit à chaque pays du monde contre les menaces extérieures et intérieures, qui proviendront constamment de ceux qui ne sont pas disposés à supporter la perte d’autonomie nationale que comporte le maintien de l’ordre en vigueur. Cela pourra parfois nécessiter de ralentir le rythme du processus de renforcement de l’interdépendance [entre États] et d’en modifier les aspects procéduraux. La plupart du temps, cependant, il faudra s’efforcer de limiter les ingérences des gouvernements nationaux dans le système de libre-échange international des biens, qu’ils soient économiques ou non économiques. »
Dans un autre document datant de la même période, il est écrit que: «l’objectif fondamental est de consolider le modèle basé sur l’interdépendance [entre États], afin de protéger les avantages qu’il garantit à chaque pays du monde contre les menaces extérieures et intérieures, qui proviendront constamment de ceux qui ne sont pas disposés à supporter la perte d’autonomie nationale que comporte le maintien de l’ordre en vigueur. Cela pourra parfois nécessiter de ralentir le rythme du processus de renforcement de l’interdépendance [entre États] et d’en modifier les aspects procéduraux. La plupart du temps, cependant, il faudra s’efforcer de limiter les ingérences des gouvernements nationaux dans le système de libre-échange international des biens, qu’ils soient économiques ou non économiques. »
L’objectif des trilatéralistes était donc de transformer la planète en un espace économique unifié, impliquant l’établissement de liens étroits d’interdépendance entre États, et comme le précise une étude fondamentale sur le sujet, «la restructuration de la relation entre le travail et la gestion en fonction des intérêts des actionnaires et des créanciers, la réduction du rôle de l’État dans le développement économique et le bien-être social, la croissance des institutions financières, la reconfiguration de la relation entre secteurs financiers et non financiers en faveur des premiers, l’établissement d’un cadre réglementaire favorable aux fusions et acquisitions d’entreprises, le renforcement des banques centrales à condition qu’elles se consacrent d’abord à garantir la stabilité des prix, et l’introduction d’une nouvelle orientation générale visant à drainer les ressources de la périphérie vers le centre». Sans oublier la baisse des impôts sur les revenus les plus élevés, sur le patrimoine et sur le capital, afin de libérer des ressources pour les investissements productifs et mettre fin au déclin préoccupant de la part de richesse totale — mesurée en propriété combinée d’immobilier, d’actions, d’obligations, de liquidités et d’autres biens — détenue par le 1 % le plus riche de la population, atteignant ses niveaux les plus bas depuis 1922.
Une donnée significative, en partie imputable au renversement historique de l’architecture fiscale mise en place avant la crise de 1929 par l’administration Coolidge — et en particulier par son secrétaire au Trésor Andrew Mellon —, et opéré par Franklin D. Roosevelt. La contraction des revenus perçus par les classes les plus aisées était étroitement liée à la baisse tendancielle des profits des entreprises, qui, comme Karl Marx l’avait compris, se produit chaque fois qu’il y a un durcissement de la concurrence inter-capitaliste. En l’occurrence, l’augmentation astronomique des investissements et de la productivité réalisée par l’Europe occidentale et le Japon n’était pas seulement supérieure à celle capitalisée par les États-Unis, mais avait aussi été réalisée dans un contexte caractérisé par une faible inflation, un taux élevé d’emploi et une hausse rapide du niveau de vie. Pendant un certain temps, la baisse du taux de rémunération résultant de la compétition accrue entre les États-Unis, l’Europe occidentale et le Japon était compensée par l’augmentation vertigineuse de la masse des profits industriels générés par le boom économique, mais à partir du milieu des années 60, cette marge avait commencé à diminuer progressivement en raison de l'exacerbation supplémentaire de la compétition inter-capitaliste, combinée à la hausse généralisée des salaires et au renforcement des syndicats. D’autre part, le krach de Wall Street, survenu entre 1969 et 1970, avait porté un coup sévère aux tendances spéculatives, déclenchant une spirale négative qui allait perdurer au moins jusqu’à la fin 1978, avec la liquéfaction d’environ 70% des actifs détenus par les 28 principaux hedge funds américains.

Ce phénomène attira l’attention de Lewis Powell (photo), juge de la Cour suprême avec une carrière d’avocat pour les multinationales du tabac, qui, en août 1971, envoya une célèbre lettre au fonctionnaire de la Chambre de commerce américaine Eugene B. Sydnor. Intitulé Attack of the American free enterprise system (L’attaque du système de libre entreprise américain), Powell y déplorait l’attaque idéologique et axiologique menée contre le système des entreprises par «l’extrême gauche, qui est beaucoup plus nombreuse, mieux financée et mieux tolérée que jamais dans l’histoire. Ce qui surprend, c’est que les voix les plus critiques viennent d’éléments très respectables, issus des universités, des médias, du monde intellectuel, artistique et même politique […]. Près de la moitié des étudiants soutiennent également la socialisation des industries américaines fondamentales, à cause de la propagation à grande échelle d’une propagande fallacieuse qui mine la confiance du public et le confond». Le juge déclara alors qu’il était désormais «temps pour le secteur privé américain de se mobiliser contre ceux qui veulent le détruire […]. [Les entreprises] doivent s’organiser, planifier à long terme, s’auto-discipliner pour une période indéfinie et coordonner leurs efforts financiers dans un objectif commun […]. La classe entrepreneuriale doit tirer des leçons des enseignements du monde du travail, à savoir que le pouvoir politique représente un facteur indispensable, à cultiver avec engagement et assiduité, et à exploiter de manière agressive […]. Ceux qui défendent nos intérêts économiques doivent aiguiser leurs armes […], exercer des pressions fortes sur tout l’establishment politique pour en assurer le soutien, et frapper sans délai les opposants en s’appuyant sur le secteur judiciaire, de la même manière que l’ont fait dans le passé les extrêmes, les syndicats et les groupes de défense des droits civiques […], capables d’obtenir d’importants succès à nos dépens».
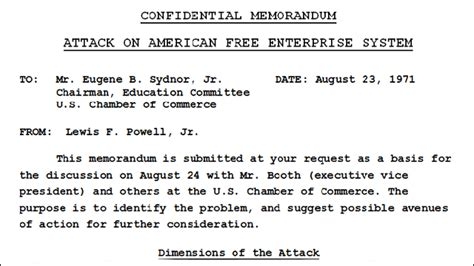
Le passage le plus significatif de la lettre est cependant celui où Powell insiste sur la nécessité de prendre le contrôle de l’école et des grands médias, considérés comme des outils indispensables pour «modeler» l’esprit des individus et créer ainsi les conditions politico-culturelles pour la reproduction perpétuelle du système capitaliste. Manifestement, Powell n’avait pas échappé aux réflexions formulées par Marx et Gramsci sur le concept d’«hégémonie», qui s’exerce beaucoup plus efficacement par une manipulation habile des appareils éducatifs et médiatiques que par la coercition. Selon lui, il fallait en effet convaincre les grandes entreprises de consacrer des sommes suffisantes pour relancer l’image du système par un travail raffiné et minutieux de «construction du consensus», auquel des professionnels bien rémunérés devraient s’appliquer. «Nos présences dans les médias, lors de conférences, dans le monde de l’édition et de la publicité, dans les tribunaux et les commissions législatives devront être inégalées dans leur précision et leur niveau exceptionnel».
Un autre aspect crucial concerne la mise en place d’une collaboration avec les universités, préalable à l’intégration dans ces institutions de « professeurs qui croient fermement au modèle entrepreneurial […] [et qui, selon leurs convictions, évaluent les manuels scolaires, notamment en économie, sociologie et sciences politiques]». En ce qui concerne l’information, «les télévisions et radios devront être constamment contrôlées avec la même rigueur utilisée pour l’évaluation des manuels universitaires. Cela s’applique particulièrement aux programmes d’analyse approfondie, dont certains critiques très insidieux au système économique […]. La presse devra continuellement publier des articles qui soutiennent notre modèle, et même les kiosques devront être impliqués dans le projet».
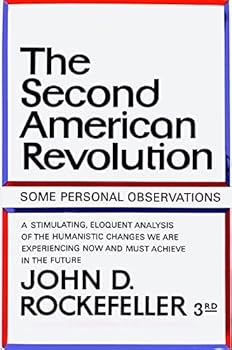 L’autre document de référence, complémentaire au mémorandum de Powell, dont s’inspirèrent les trilatéralistes, fut The Second American Revolution de John D. Rockefeller III, un véritable manifeste idéologique publié par le Council on Foreign Relations en 1973, dans lequel il était proposé de limiter drastiquement le pouvoir des gouvernements à travers un programme de libéralisation et de privatisation, visant à déposséder les autorités publiques de certaines de leurs fonctions régulatives fondamentales, et à revenir aux politiques keynésiennes en vigueur depuis le New Deal, dans une optique de retour au modèle darwinien et fortement déréglementé, jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Franklin D. Roosevelt.
L’autre document de référence, complémentaire au mémorandum de Powell, dont s’inspirèrent les trilatéralistes, fut The Second American Revolution de John D. Rockefeller III, un véritable manifeste idéologique publié par le Council on Foreign Relations en 1973, dans lequel il était proposé de limiter drastiquement le pouvoir des gouvernements à travers un programme de libéralisation et de privatisation, visant à déposséder les autorités publiques de certaines de leurs fonctions régulatives fondamentales, et à revenir aux politiques keynésiennes en vigueur depuis le New Deal, dans une optique de retour au modèle darwinien et fortement déréglementé, jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Franklin D. Roosevelt.
La mise en œuvre des plans trilatéraux, favorisée par la prolifération des fondations (l’activisme des fondations du Midwest, dirigées par les familles Olin, Koch, Richardson, Mellon Scaife et Bradley, aurait été particulièrement incisif) et par l’application pratique d’un ensemble de mesures indiquées dans un rapport impressionnant sur la « crise de la démocratie » rédigé par les politologues Samuel Huntington, Michel Crozier et Joji Watanuki pour le compte de la Commission, fut menée sous la présidence de Jimmy Carter. C’est-à-dire le candidat démocrate vainqueur des élections de 1976, grâce à une campagne médiatique massive centrée sur la responsabilité de l’administration publique face à une série de problématiques qui secouaient les États-Unis, notamment l’inefficacité causée par une bureaucratie excessive et les « ingérences » dans la vie économique, nuisibles à la pleine valorisation des potentialités économiques du pays. Significativement, dans l’administration Carter, 26 membres de la Commission Trilatérale furent recrutés, dont Walter Mondale (vice-président), Cyrus Vance (secrétaire d’État), Harold Brown (secrétaire à la Défense), Michael Blumenthal (secrétaire au Trésor) et Zbigniew Brzezinski (conseiller à la Sécurité nationale).
18:44 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, commission trilatérale, mondialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 décembre 2025
La vieille passion géopolitique et l’intérêt du Royaume-Uni pour la Russie

La vieille passion géopolitique et l’intérêt du Royaume-Uni pour la Russie
"En 1613, les ambassadeurs anglais John Merrick et William Russell débarquent dans la cité portuaire d'Arkhangelsk, dans le nord de la Russie".
par Lorenzo Ferrara
Source: https://www.barbadillo.it/126802-lantica-passione-attenzione-geopolitica-delluk-per-la-russia/ & London – History Today, Volume 73, Numéro 11, novembre 2023, Shahid Hussein: “The English Plan to Colonise Russia”
When England’s search for a Northwest Passage via sea failed, an audacious plan to forge a land route was hatched by the Muscovy Company (= Lorsque la recherche par l'Angleterre d'un passage nord-ouest échoua, un plan audacieux de créer une voie terrestre a été conçu par la Muscovy Company). Ou encore : Le plan anglais pour coloniser une partie de la Russie. Voyons-en plus.
“Lorsque la recherche par l’Angleterre d’un passage nord-ouest par voie maritime échoua, la Muscovy Company mit au point un plan audacieux pour créer une route terrestre. En 1613, les ambassadeurs anglais John Merrick et William Russell débarquèrent dans la ville portuaire d’Arkhangelsk, dans le nord de la Russie. Le premier objectif de leur mission était relativement innocent. À ces deux hommes furent remis une série d’instructions écrites pour protéger la situation financière de la Muscovy Company, qui à l’époque était la principale entité commerciale régulant le commerce avec la Russie. Mais ils avaient aussi un objectif secret: explorer la possibilité d’annexer une partie du nord de la Russie et de fonder une colonie anglaise en Moscovie. On espérait que cette colonie pourrait s’étendre le long du fleuve Volga et atteindre la frontière russe avec la Perse.
Cette tentative assez audacieuse de landgrabbing (de conquête territoriale) dans le nord de la Russie était en soi déjà remarquable. Ce qui la rendait encore plus significative, c’est le fait que la proposition a reçu le soutien de plusieurs groupes à Londres. Cela comprenait des membres de la Royal Navy anglaise, des mercenaires, de vieux courtisans, le roi et, bien sûr, la Muscovy Company.

Les plans de l’Angleterre pour coloniser la Russie ont été conçus dans une période de troubles politiques. En 1605, le premier Faux Dimitri, un imposteur prétendant être le plus jeune fils d’Ivan le Terrible, mena une révolte contre le tsar de Moscovie, Boris Godounov (illustration).
Cela est souvent considéré comme le début du Temps des Troubles (1605-1613) en Russie, une période de conflits politiques où plusieurs prétendants rivaux se disputèrent le trône. L’absence d’autorité centrale permit à la Pologne et à la Suède de lancer des invasions en Moscovie entre 1610 et 1612. C’est dans ce contexte que le soldat mercenaire anglais Thomas Chamberlain, avec d’autres militaires, formula et développa l’idée d’une invasion anglaise de la Russie. En 1613, l’idée d’une colonie anglaise en Russie reçut également le soutien de hauts courtisans, comme le comte de Pembroke, le Lord Chancelier et même le roi Jacques Ier. Il ne fait aucun doute que Thomas Smythe (illustration), gouverneur de la Muscovy Company, soutint le projet d’établir une colonie en Moscovie.

Au cours de la première décennie du XVIIe siècle, sous la direction de Smythe, la Muscovy Company et la East India Company sponsorisèrent des expéditions à la recherche d’un passage nord-ouest. On croyait qu’un tel passage permettrait aux voyageurs de se diriger vers le nord, puis vers la Chine, l'Inde et l'Asie centrale. Cela aurait pu économiser des mois sur la route commerciale traditionnelle vers l’Extrême-Orient et l’Inde qui passait par le Cap de Bonne-Espérance en Afrique. La malheureuse destinée de ces expéditions pour découvrir un passage septentrional via la mer, en lesquelles Smythe était partiellement ou totalement impliqué, le conduisit à soutenir la proposition la plus extrême: celle d’annexer une partie de la Russie, en hiver 1612-1613. Mais le plan de colonisation de l’Angleterre eut peu de résultats; le passage tant attendu, par mer ou par terre, resta un rêve éveillé. Quand Merrick et Russell arrivèrent à Moscou en 1613, ils apprirent la nouvelle de l’élection d’un nouveau tsar, Michaël Ier. Une annexion militaire était désormais impossible. L'astucieux stratège Merrick présenta simplement ses lettres de créance au nouveau tsar et demanda le renouvellement des privilèges commerciaux antérieurs de la Muscovy Company. Le projet d’invasion britannique de la Russie avait échoué”.
Il y a peu à ajouter à ce texte, qui décrit des intentions et des projets d'une annexion partielle, déguisés en entreprise commerciale, si ce n’est que derrière chaque déclaration retentissante où les Anglo-Saxons évoquent la liberté et la défense des droits, se cachent, surtout dans le chef des Anglais, des intérêts économiques et stratégiques profonds, qui surgissent comme des bulles toxiques à chaque page de leur histoire. La liste serait longue, une rapacity vendue comme une attention ou du regard (de la considération), qui n’est en réalité qu’ingérence. Est-ce la découverte de "d'une eau toujours chaude"? Il vaut toujours mieux s’appuyer sur des faits prouvés pour décrire l’histoire et pour comprendre les attitudes, déclarations et tendances du passé et du présent.
Shadid Hussain étudie les réseaux et le patronage parmi les ambassadeurs britanniques en Moscovie au XVIIe siècle à l’Université College London.
16:16 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, angleterre, muscovy company, moscovie, arkhangelsk |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 décembre 2025
Le moment messianique de 1666: Sabbatai Tsevi, le millénarisme de la „Cinquième Monarchie“ et les origines de la Rénovation radicale

Le moment messianique de 1666: Sabbatai Tsevi, le millénarisme de la „Cinquième Monarchie“ et les origines de la Rénovation radicale
Introduction : Crise des attentes eschatologiques
1666 entre dans l’histoire intellectuelle de l’Europe non seulement comme la date marquée par la Grande Peste et le Grand Incendie de Londres, mais aussi comme le point culminant des attentes messianiques centrées sur la figure de Sabbatai Tsevi. L'historiographie traditionnelle a longtemps ignoré le sabbatianisme, le considérant uniquement comme une crise interne du judaïsme. Cependant, les travaux de Richard Popkin et les études monumentales de Jonathan Israel ont démontré de façon convaincante que ce phénomène était profondément intégré dans le contexte européen. À travers un réseau de dissidents (de non-conformistes) en Angleterre et aux Pays-Bas, la figure du faux messie juif est devenue un catalyseur de débats allant bien au-delà de la théologie, préparant paradoxalement le terrain pour un cosmopolitisme séculier.
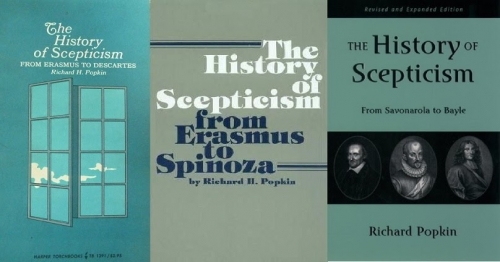
Cadre théorique et „Troisième force“
Richard Popkin a avancé la thèse de l’existence, au XVIIe siècle, d’une „troisième force“ — un groupe intellectuel qui n’appartenait ni à la scolastique orthodoxe ni au rationalisme cartésien strict. Ce furent des penseurs combinant scepticisme scientifique et intérêt profond pour les prophéties bibliques. Jonathan Israel souligne qu’Amsterdam était un «creuset» unique où les frontières entre confessions s’effaçaient. C’est ici que les nouvelles concernant Sabbatai Tsevi n’étaient pas perçues comme une hérésie, mais comme une possible réalisation des prophéties communes aux religions abrahamiques.
Le lien central dans ce processus était Pierre Serrarius — un théologien hollandais et un millénariste. En tant que nœud d’information entre la communauté juive d’Amsterdam et les intellectuels londoniens, Serrarius a contribué à créer une atmosphère où les protestants voyaient en Sabbatai Tsevi un instrument de la Providence divine. Pour beaucoup de chrétiens de l’époque, le retour des Juifs en Palestine était une étape nécessaire avant la Deuxième Venue du Christ, ce qui rendait les succès de Tsevi théologiquement légitimes aux yeux des protestants radicaux.
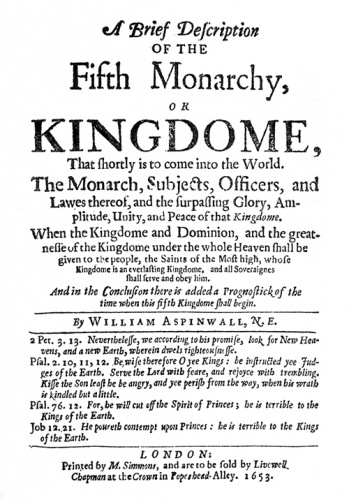
Radicalisme politique : Sabbatianisme et la „Cinquième Monarchie“
Le phénomène Sabbatai Tsevi reçut une attention particulière en Angleterre grâce au contexte idéologique préparé par le mouvement des „Hommes de la Cinquième Monarchie“. Cette secte puritaine radicale, active durant la Révolution anglaise et le protectorat de Cromwell, croyait en une doctrine basée sur le livre du prophète Daniel. Ils pensaient qu’après la chute des quatre monarchies terrestres (babylonienne, perse, grecque et romaine), la Cinquième viendrait — avec le royaume du Christ sur la terre.
Après la restauration des Stuart en 1660, les espoirs politiques des „monarchistes“ s’effondrèrent, et le mouvement entra dans la clandestinité, en état de profonde frustration. L’apparition de Sabbatai Tsevi en 1665–1666 fut perçue comme le signal extérieur tant attendu — comme un „Deus ex machina“, qui détruirait l’ancien ordre mondial, y compris la monarchie des Stuarts et le trône pontifical. Selon leur interprétation, le messie juif devait anéantir l’Empire ottoman, déclenchant une série d’événements menant à la domination mondiale des saints. Ainsi, l’intérêt des radicaux anglais pour Tsevi était moins philo-sémite que révolutionnaire-politique: le mysticisme juif devenait le carburant du républicanisme anglais.
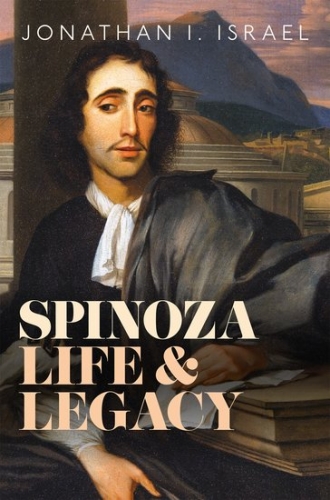
Baruch Spinoza : l’alternative rationnelle à l’extase mystique
Au cœur de l’hystérie messianique, la figure de Baruch Spinoza, expulsé de la communauté juive d’Amsterdam une décennie avant l'avènement de Tsevi, acquiert une signification particulière. Jonathan Israel insiste sur le fait que le spinozisme et le sabbatianisme se sont développés dans le même contexte socio-culturel, représentant deux réponses diamétralement opposées à la crise du judaïsme traditionnel et à la conscience européenne en général.
Alors que le sabbatianisme proposait une sortie irrationnelle et mystique par le miracle et par l'action et la présence d'un leader charismatique, Spinoza prônait la raison et le monisme philosophique. La chute du mouvement Tsevi (son apostasie et sa conversion à l’islam) porta un coup dur à l’autorité de la tradition rabbinique et à la croyance dans les prophéties en tant que telles. Ce vide, selon Israel, créa les conditions idéales pour l’acceptation des idées de Spinoza. « Le traité théologico-politique » (1670), publié peu après la chute du sabbatianisme, fut lu par de nombreux intellectuels désillusionnés comme le manifeste d’une ère nouvelle où la place des prophètes est prise par celle des philosophes, et les miracles par les lois de la nature. Ainsi, l’échec du sabbatianisme a paradoxalement ouvert la voie à la Rénovation radicale.

Henri Oldenburg et les réseaux proto-masoniques
Un aspect clé de la réception du sabbatianisme est le rôle de la communication scientifique. Henri Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, entretenait une correspondance étendue avec Spinoza, Boyle et Serrarius, demandant régulièrement des nouvelles du „Messie juif“. Le fait que le secrétaire de la principale institution scientifique d’Europe s’intéressait au messie kabbalistique contredit le mythe populaire d’une séparation stricte entre science et mysticisme au XVIIe siècle.
Bien qu’Oldenburg soit décédé en 1677 et n’ait pas pu participer à la fondation de la première Grande Loge en 1717, son activité incessante a posé les bases de cet événement. Oldenburg fut l’architecte de ce que Robert Boyle appelait « l’Université Invisible » — un réseau de penseurs cherchant la vérité en dehors des dogmes confessionnels. Les chercheurs en ésotérisme (notamment dans les œuvres analysées par Popkin) notent que la structure de la Royal Society et les réseaux de correspondance d’Oldenburg ont intégré des éléments de l’idéal rosicrucien de « réforme universelle ». Ces cénacles intellectuels, où la discussion de la physique comme de l’eschatologie était permise, devinrent le prototype des loges spéculatives maçonniques. La transition de la « maçonnerie opérative » à la « maçonnerie spéculative », achevée en 1717, reposait précisément sur cette culture de tolérance, de curiosité scientifique et de dissidence secrète, cultivée par le cercle d’Oldenburg, influencé aussi par les attentes philo-sémites de l’époque de Sabbatai Tsevi.
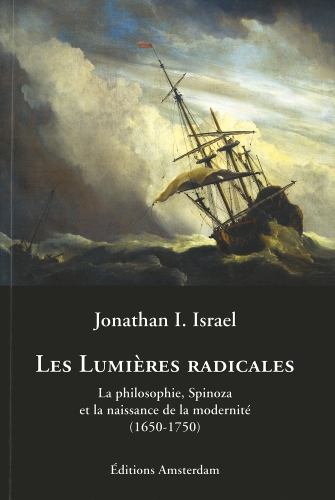
Conclusion
Le lien entre les protestants anglais et néerlandais et le mouvement de Sabbatai Tsevi constitue un point critique dans l’histoire intellectuelle du début de la Renaissance moderne. L’interaction entre le protestantisme radical (« Fifth Monarchy »), le messianisme juif et la naissance de la nouvelle science (avec le cercle d’Oldenburg) a créé un terreau unique. L’échec des espoirs sabbatianistes a discrédité la connaissance eschatologique du monde, obligeant les penseurs européens à chercher de nouvelles bases. Dans ce contexte, le rationalisme de Spinoza et les structures organisationnelles qui ont précédé la franc-maçonnerie ont offert une alternative: construire la „Nouvelle Jérusalem“ non par le miracle, mais par la raison et la construction/ingénierie sociale.
12:04 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sabbatai tsevi, histoire, messianisme, spinoza |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 décembre 2025
L'Allemagne d'après-guerre et la formation des Revolutionäre Obleute

L'Allemagne d'après-guerre et la formation des Revolutionäre Obleute
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/postwar-germany-and-...
L'histoire de la gauche allemande à la fin de la Première Guerre mondiale, ainsi que pendant la période qui a immédiatement suivi le conflit, est un sujet fascinant que j'ai longuement abordé dans mes biographies d'Otto Strasser (2010) et d'Ernst Röhm (2016). Cependant, dans la nouvelle édition traduite de l'ouvrage d'Albert Schmelzer sur Rudolf Steiner et le mouvement tripartite, le rôle des communistes dans la création des conseils ouvriers allemands est considérablement minimisé. Si Schmelzer a la chance, en tant qu'Allemand de souche, d'avoir accès à certaines sources historiques précieuses sur la période en question, certaines de ses conclusions sont toutefois quelque peu douteuses.

S'il note à juste titre que le Parti social-démocrate (SPD), par exemple, a adopté une attitude résolument nationaliste et a commencé à soutenir l'effort de guerre du pays, il minimise considérablement l'influence que la Russie soviétique a eue sur les conseils eux-mêmes. Ce n'est pas pour rien que les Freikorps – qui, au départ, étaient utilisés par le gouvernement réactionnaire comme unités mercenaires afin de renforcer sa propre position – avaient réussi à rallier tant de personnes à leur cause anticommuniste, mais Schmelzer soutient que les conseils eux-mêmes étaient composés en grande majorité de membres du SPD et que les communistes pro-soviétiques n'y jouaient qu'un rôle mineur, voire insignifiant.
Cela mis à part, il propose un résumé intéressant des cinq visions du monde qui étaient en vogue à l'époque:
(1) la monarchie restauratrice,
(2) la démocratie pluraliste dans une économie capitaliste,
(3) le gouvernement parlementaire avec des conseils démocratiques et la socialisation économique,
(4) la dictature communiste pure et dure, et
(5) ce qu'il décrit comme un système de conseils politiques et économiques « purs ».
Il ne fait guère de doute que la droite militariste, du moins avant l'avènement de l'hitlérisme, privilégiait la première option, tandis que la deuxième était préférée par ceux qui, comme le Parti populaire allemand (DVP), étaient libéraux-conservateurs. La troisième catégorie désigne le SPD de centre-gauche, qui comptait plus d'un million de membres en 1918, tandis que la quatrième fait clairement allusion au Parti communiste (KPD) de Rosa Luxemburg.

Peu après que les sociaux-démocrates indépendants (USPD) se soient séparés de la SPD en raison de son nouveau bellicisme, l'USPD s'est lui-même scindé en deux lorsqu'il a donné naissance à la KPD susmentionnée. La cinquième catégorie de Schmelzer, si je ne vous ai pas trop submergé avec cette litanie kaléidoscopique de labels idéologiques, était apparemment occupée par les segments de gauche de l'USPD et ce sont eux qui, selon lui, luttaient pour une forme plus autonome de décentralisation politique, sociale et économique.

Les membres de l'USPD qui adhéraient à cette vision plus radicale se faisaient appeler les « délégués révolutionnaires » (Revolutionäre Obleute) et menèrent des grèves très efficaces afin d'essayer d'empêcher le pays de sombrer dans une guerre totale destructrice. Ironiquement, bien que ces éléments particuliers n'aient pas suivi Luxemburg au sein de la KPD, ils étaient considérablement plus radicaux dans le sens où ils s'opposaient fondamentalement au contrôle de l'économie par l'État et à la participation à l'assemblée nationale bourgeoise. Leur principale erreur, cependant, comme le souligne Schmelzer dans son livre, est que, alors que la faction Revolutionäre Obleute luttait pour l'autodétermination, elle a commis l'erreur de chercher à appliquer ces principes dans un climat marqué par un chaos total et un autoritarisme croissant.
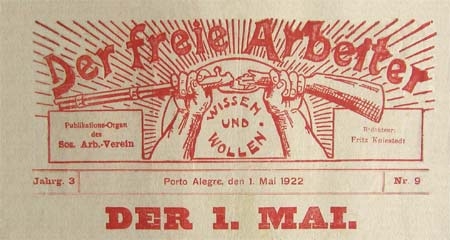

La meilleure stratégie, du moins pour les nationaux-anarchistes qui soutiennent bon nombre d'objectifs similaires, aurait été d'appliquer ces principes autarciques à la périphérie et non au cœur d'une société de plus en plus technologique. En fin de compte, ce sont Karl Kautsky, Hugo Haase et Rudolf Hilferding – tous issus de l'aile droite de l'USPD – qui ont finalement décidé que le parti devait prêter allégeance au système démocratique et abandonner complètement l'idée de conseils « purs ». Bien que de nombreux partisans des Revolutionäre Obleute aient ensuite rejoint l'Union libre des travailleurs (FAUD), une occasion unique avait été gâchée.
19:02 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, gauches allemandes, années 20, république de weimar |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 26 novembre 2025
Directoire et Macronisme: un parallèle historique saisissant!

L’Europe du déclin
Directoire et Macronisme: un parallèle historique saisissant!
Frédéric Andreu
Une crise interminable — et, disons-le, minable — éteint peu à peu les lumières de l’Europe réelle. On assiste aujourd’hui à une fragmentation esthétique et morale qui n’est pas sans rappeler la période du Directoire (1795-1799), entre chapeaux à plumes et déclarations de guerre opportunes. Nous allons voir comment une oligarchie irréformable génère toujours des dérivatifs.
Alors que la corruption et la délinquance gangrènent la France d’alors, l’expédition d’Égypte sert le régime. L’UE de Macron et de von der Leyen, quant à elle, désigne aujourd’hui la Russie comme l’ennemi du genre humain. Une faute qui risque de coûter cher au peuple, éternel dindon de la farce.
- Des élections qui ne plaisent pas au pouvoir. Lorsqu’on regarde le tour de passe-passe électoral de 2005 et le discrédit persistant de la classe politique, on remarque une troublante similarité avec la période du Directoire. Nous sommes en 1797. La misère ronge les faubourgs de Paris; on mange des chats tandis que l’oligarchie d’affaires festoie dans des palais cossus. Dérive conjoncturelle ou aboutissement de la Révolution de 1789: tromper le peuple, lui retirer ses libertés concrètes et coutumières pour les remplacer par des lois abstraites? À chacun d’en juger.
Sans le savoir, la Révolution politique allait servir de préparatif à la révolution industrielle: il s’agissait de remplacer les anciennes élites par des marchands et des banquiers, et de faire entrer la machine dans la société. C’est ce que l’Histoire officielle — tatillonne sur les faits mais aveugle sur les structures — ne dit jamais: le coup d’État politique anticipait un coup d’État technique.

Dans ce contexte délétère, on ne s’étonnera pas que les élections de 1797 (dites du « 18 Fructidor an V ») donnent une large victoire aux royalistes. Que fait alors le pouvoir? Il invalide purement et simplement les résultats ! Depuis cette époque, l’ADN du républicain semble inchangé: en 2005, Sarkozy confisque lui aussi le résultat du « non » à Bruxelles, en faisant revoter le même traité par les parlementaires. Sarkozy serait-il un héritier du Directoire? Dans un certain sens, oui: sa politique reflète sa culture personnelle, celle d’un Barras amateur de Rolex et de Fouquet’s. Moins flamboyants, Hollande et Macron resteront sans doute dans l’Histoire comme des ploutocrates sans envergure, les Directeurs dont personne ne retient le nom.
- La désignation de l’« ennemi dérivatif ». La dérive corruptrice d’un pouvoir s’accompagne toujours de la désignation d’ennemis factices. Il faut détourner le regard du pourrissement des élites en inventant des menaces opportunes. L’Italie puis l’Égypte vont remplir ce rôle: la presse fabrique un « Mars de la guerre », Bonaparte, alors même que le pillage des églises par ses soldats est encouragé. Suivez mon regard: que fait aujourd’hui l’UE — le Directoire de notre temps — sinon créer elle aussi de faux ennemis? Les « nationalistes/populistes » sont désignés comme l’ennemi intérieur; la Russie comme l’ennemi extérieur, destiné à canaliser les angoisses collectives. Rien de nouveau sous le soleil !

Bonaparte part en Égypte. À cette époque, il n’est qu’un général ambitieux parmi d’autres. Joubert lui est d’ailleurs préféré, mais celui-ci meurt au combat. Les années qui viennent diront si un soldat surgira pour « sauver l’Europe » face à une invasion russe imminente...
- Bonaparte contre Pichegru: Cette période du Directoire, courte mais si riche en éclats, a connu l’irruption de Bonaparte au détriment d’autres hommes, tombés dans les oubliettes de l’Histoire. Le cas de Jean-Charles Pichegru (portrait) est emblématique de cette époque ! Fils de cordonnier, entré dans l’armée, il devient un Général plus populaire que Bonaparte. Il faut dire qu’il libère l’Alsace de la menace autrichienne et réalise nombre d’exploits militaires. Cet homme le plus populaire de son temps est totalement oublié aujourd’hui. Pourquoi ? Ni jacobin sectaire, ni bonapartiste arriviste, il se rallie peu à peu, lui le fils de cordonnier, aux camps des Royalistes. Il est envoyé au bagne de Cayenne après avoir remporté les élections de 1797!

Aujourd’hui, on n’envoie plus les opposants au bagne, mais certains dissidents sont mis au ban médiatique. C’est une autre manière d’exclure. Comme au temps du Directoire, les courants favorables à la démocratie directe ou à la royauté sont craints par le système. Bien que minoritaires, ces courants représentent un rempart contre un système jugé intrinsèquement profanateur. Ils appartiennent plus à la tradition qu’à la politique proprement dite.
- Le moteur en trois temps : On remarque que ce pouvoir délétère qui règne sur l’Europe, avec von der Leyen en tête de gondole, suit toujours le même scénario :
- (1) Le déclin de l’élite conduit inexorablement le pays à la ruine.
- (2) Elle secrète alors un « leader » chargé de remettre de « l’ordre ».
- (3) Une fois le travail accompli, elle se débarrasse du « sauveur » avant de recommencer un cycle identique.
Ce moteur à articulation ternaire peut expliquer comment un idéaliste comme Robespierre fut mis au pouvoir, puis exécuté une fois sa tâche accomplie; comment un Bonaparte, à la fois redouté par les élites mais jugé assez corruptible, fut mis en selle par Sieyès, puis envoyé en exil. D’un certain point de vue, même De Gaulle — rappelé en 1958 lors de la crise algérienne, puis battu au référendum de 1969 — a joué un rôle similaire.
À ces époques, on ne parlait pas encore de « deep state », mais c’était déjà une oligarchie — celle de l’industrie et de la colonisation — qui exerçait les pouvoirs profonds. En partie autonomes, les forces de l’argent et de la technique génèrent un pouvoir cybernétique tournant autour d’une classe possédante et non élue. Ce pouvoir « cherche » des acteurs (conscients ou non) pour jouer leur rôle dans le grand théâtre démocratique, puis les jette ou les recycle en icônes. De Gaulle est particulièrement emblématique de ces figures historiques, à une époque où le gaullisme est érigé en idéal par des gens qui ne cessent de le trahir. Dernier chef d’État à avoir eu une haute conscience du principe monarchique au-dessus des partis, il entretenait des échanges réguliers avec le prétendant au trône. Rien d’étonnant : il savait qu’il servait un principe supérieur à sa personne.
On remarquera au passage que le seul chef d’État du XIXᵉ siècle à n’avoir connu ni exil ni prison n’est ni un président ni un empereur, mais un roi: Louis XVIII, un souverain dont l’aura et la finesse mériteraient d’être étudiées de près. La République, experte en théâtralisation, en trahison et en usurpation, n’a cessé de renier ses propres principes, tandis que le pouvoir légitime n’a pas besoin de postuler les siens: il les incarne.
Les technocrates d’aujourd’hui sont à l’image des Directeurs d’hier. Von der Leyen, Macron ou Zelensky forment un « Euro-Directoire » prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Comme leurs ancêtres Barras et autres chapeaux à plumes, ils inventent des dérivatifs pendant que le peuple, lui, est livré à un effacement progressif. Nous savons que l’expédition d’Égypte, par exemple, avait servi de diversion au pouvoir de l’époque; aujourd’hui, c’est la fabrication de la menace russe qui joue ce rôle.
Les événements à venir permettront-ils aux arapèdes de se cramponner au rocher du pouvoir ? Ou, a contrario, les contraindront-ils à quitter la scène ? Des réponses sont attendues dans les mois à venir.

18:36 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, emmanuel macron, directoire, histoire, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 16 novembre 2025
Huey Pierce Long: un gars à découvrir

Huey Pierce Long: un gars à découvrir
par Georges Feltin-Tracol
À 35 ans, Zohran Mamdani, né en Ouganda d’une famille originaire d’Inde et naturalisé citoyen des États-Unis en 2018, deviendra au 1er janvier 2026 le plus jeune maire de New York et le premier musulman chiite à administrer la « Grosse Pomme ». Ce militant démocrate adhère au courant des socialistes démocrates auquel appartient aussi l’actuelle représentante fédérale de New York, Alexandria Ocasio-Cortez. Mamdani a mené une campagne progressiste et populiste, ce qui, dans le contexte étatsunien, n’est pas contradictoire.
On oublie en effet qu’avant l’irruption de Donald Trump sur la scène politique, les États-Unis constituaient un foyer régulier et fécond de populisme. Lors de l’élection présidentielle de 1912, l’ancien président républicain, Theodore Roosevelt, se présente sous la bannière du parti progressiste, propose une politique populiste et concurrence le président républicain sortant William Taft. Cette division favorise le lamentable candidat démocrate Woodrow Wilson.
Auparavant, à la fin du XIXe siècle, dans les États de l’Ouest, les candidats du People’s Party secouent le monopole des républicains. Ils défendent le bimétallisme or – argent, inscrivent dans les constitutions locales le caractère secret du vote, l’élection directe des sénateurs fédéraux et la révocation des élus locaux. Certains suggèrent même un impôt progressif sur le revenu et la limitation du temps de travail dans l’industrie. Longtemps perçu comme le porte-parole de la défunte Confédération sudiste, le parti démocrate peut parfois adopter dans le contexte spécifique à chaque État fédéré une réelle tonalité populiste. C’est le cas de la Louisiane pendant l’Entre-deux-guerres.
En 1928 accède à la fonction de gouverneur de cet État Huey Pierce Long. Né le 30 août 1893 à Winnfield dans le Nord de l’État, il montre très tôt de grandes dispositions pour la politique. En octobre 1918, il entame sa carrière publique en remportant le mandat de commissaire aux chemins de fer de Louisiane. Candidat dès 1924 au poste de gouverneur, il n’arrive que troisième à la primaire démocrate avec cependant près de 31% des voix. Ce n’est que quatre ans plus tard qu’il réalise son rêve. Dès la primaire, il recueille plus de 44% des suffrages…
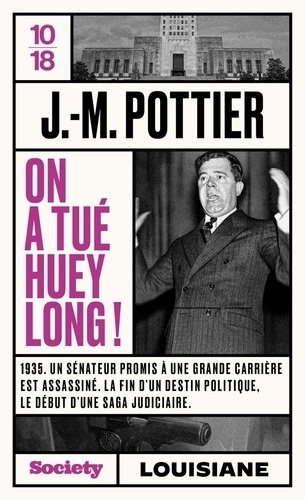 Très vite, le nouveau gouverneur, fort ambitieux, reçoit le surnom de « Kingfish » (« Gros poisson ») plutôt que celui de « Parrain ». La Nouvelle-Orléans est en effet le berceau de la mafia italo-américaine. Il est inévitable que le « Kingfish » discute avec les patrons de la pègre. Ses adversaires, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, dénoncent son clientélisme et sa corruption. Ils s’offusquent par ailleurs de la construction d’un nouveau Capitole, le plus haut des États-Unis ! Dans un ouvrage qui vient de paraître, On a tué Huey Long ! (Éditions 10/18, 2025, 256 p., 8,30 €), Jean-Marie Pottier évoque ces turpitudes. Il mentionne par exemple la « boîte à déduction », un système ingénieux de collecte occulte de fonds qui repose sur « un coffre où il [Huey Long] entreposait les dons en liquide versés par ses partisans ou par des entreprises voulant s’implanter en Louisiane, ainsi que des déductions mensuelles de cinq à dix pour cent prélevées sur les salaires des employés recrutés par son administration ».
Très vite, le nouveau gouverneur, fort ambitieux, reçoit le surnom de « Kingfish » (« Gros poisson ») plutôt que celui de « Parrain ». La Nouvelle-Orléans est en effet le berceau de la mafia italo-américaine. Il est inévitable que le « Kingfish » discute avec les patrons de la pègre. Ses adversaires, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, dénoncent son clientélisme et sa corruption. Ils s’offusquent par ailleurs de la construction d’un nouveau Capitole, le plus haut des États-Unis ! Dans un ouvrage qui vient de paraître, On a tué Huey Long ! (Éditions 10/18, 2025, 256 p., 8,30 €), Jean-Marie Pottier évoque ces turpitudes. Il mentionne par exemple la « boîte à déduction », un système ingénieux de collecte occulte de fonds qui repose sur « un coffre où il [Huey Long] entreposait les dons en liquide versés par ses partisans ou par des entreprises voulant s’implanter en Louisiane, ainsi que des déductions mensuelles de cinq à dix pour cent prélevées sur les salaires des employés recrutés par son administration ».
Élu sénateur fédéral de la Louisiane à Washington, Huey Long tergiverse et reste gouverneur avant d’accepter en 1932 son nouveau mandat. Son successeur est un fidèle qu’il a choisi, car il continue à gouverner l’État indirectement. Il ne cache plus non plus son intention de briguer la présidence des États-Unis. Or, le 9 septembre 1935, dans l’enceinte du Capitole de Bâton-Rouge, capitale de la Louisiane, le docteur Carl Austin Weiss tire sur Huey Long qui décède deux jours plus tard. Ses gardes du corps ripostent et abattent de plusieurs dizaines de balles le meurtrier.
Quel est le motif de Weiss ? Il refuse que son beau-père, Benjamin Pavy, juge local anti-Long, ne soit pas réélu au prochain renouvellement en raison d’un redécoupage partial de sa circonscription. Toutefois, les anti-Long propagent aussitôt que l’homme fort de la Louisiane aurait surtout été tué par les tirs de ses propres protecteurs.
Journaliste à Sciences humaines et à Society, Jean-Marie Pottier enquête sur les circonstances de cet assassinat qui stupéfia l’opinion publique outre-Atlantique. Il souligne qu’en 1991 – 1992, la police relance l’enquête. Elle exhume le corps de Carl Weiss et étudie la trajectoire des balles. Sa conclusion confirme la seule et pleine responsabilité de Weiss. En revanche, ses motivations réelles restent obscures.
Pour Jean-Marie Pottier, Huey Long « est l’homme qui a sorti la Louisiane de la boue à coup de milliers de kilomètres de routes et qui lui a offert ponts, hôpitaux, asiles psychiatriques et livres scolaires gratuits ». L’auteur ajoute que le futur sénateur assassiné « est l’homme qui a fait plier les “ Bourbons ”, la vieille aristocratie qui maintenait la Louisiane sous son joug depuis plus d’un demi-siècle, mais a plié aussi la démocratie et ses garde-fous à sa brutalité ».
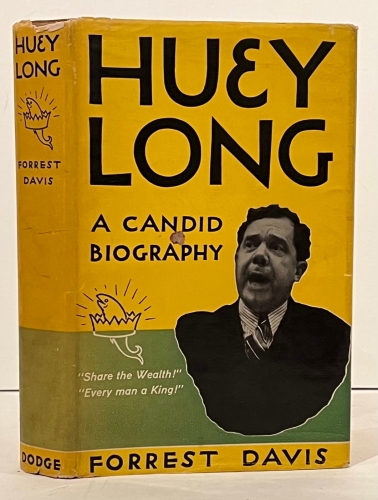
Fort de ses succès en Louisiane, Huey Long développe ses ambitions nationales. Il vise la fonction suprême pour 1936 ou, plus sérieusement, 1940. Il écrit l’année de son assassinat un essai intitulé Mes premiers jours à la Maison Blanche. Réputé pour sa fibre sociale et sa franche hostilité aux banques, il lance le 23 février 1934 Share Our Wealth (« Partageons notre richesse »). Il se rapproche dès lors du père Charles Coughlin. Ce prêtre catholique conspue les méfaits du capitalisme et du communisme à la radio à l’occasion d’une émission hebdomadaire très écoutée en ces temps de « Grande Dépression » issue du Krach de 1929. Huey Long critique de plus en plus ouvertement le New Deal de Franklin Delano Roosevelt qu’il juge bien trop bureaucratique. Il rejette enfin les expériences communistes et fascistes en cours en Europe.

L’héritage de Huey Long marque durablement la Louisiane. Son épouse, Rose McConnell, le remplace au Sénat de 1936 à 1937. Leur fils, Russell, est sénateur fédéral entre 1948 et 1987. Le frère aîné de Long, George, en est le représentant fédéral de 1953 à 1958. Leur frère cadet, Earl (photo), est gouverneur de la Louisiane à trois reprises (1939 – 1940, 1948 – 1952, 1956 - 1960). Quatre cousins éloignés, y compris l’épouse de l’un d’eux, sont des élus locaux ou nationaux jusqu’au début des années 2020. Les Long forment ainsi une autre dynastie bien moins connue que celle des Kennedy ou des Bush.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 174, mise en ligne le 13 novembre 2025 sur Radio Méridien Zéro.
14:00 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : huey pierce long, états-unis, louisiane, histoire, populisme américain |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 03 novembre 2025
Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee
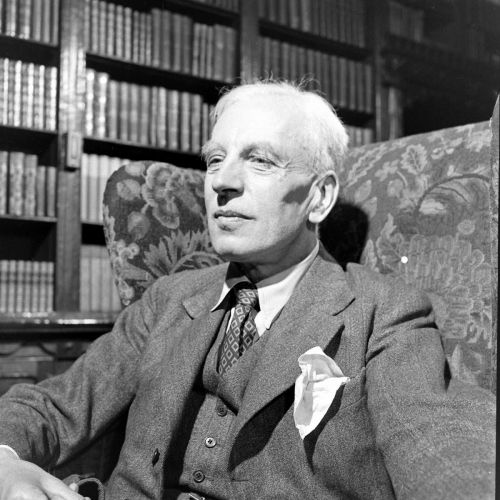
Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee
Rodolfo S. Souza
Source: https://www.facebook.com/rodolfo.souza.7
Arnold J. Toynbee, qui est aujourd'hui malheureusement tombé dans l'oubli, fut l'un des plus grands historiens du 20ème siècle. Son ouvrage « A Study of History » (publié en 12 volumes entre 1934 et 1961) est l'un des plus grands traités théoriques d'histoire comparée, au même titre que des ouvrages tels que « Le Déclin de l'Occident » d'Oswald Spengler. « A Study of History » attire l'attention tant par son immense érudition que par l'ambition épistémologique et spirituelle de sa vision: formuler une métathéorie de l'histoire humaine qui ne se réduit à aucune science particulière, ni à une simple succession de faits — une histoire qui est à la fois philosophie, théologie et diagnostic civilisationnel.
Pour Toynbee, l'histoire ne doit pas être racontée à partir des États, des empires ou des individus, mais à partir des civilisations: de grandes totalités culturelles, spirituelles et sociales. Il a identifié environ 21 civilisations, des Sumériens et des Hellènes à l'Occident moderne, et a cherché à comprendre comment elles apparaissent, s'épanouissent et déclinent. Son originalité réside dans le fait qu'il ne considérait pas les civilisations comme des entités déterminées par la race ou la géographie, mais comme des organismes spirituels, façonnés par des réponses créatives aux défis de l'existence. Chaque civilisation naît d'un défi environnemental, social ou spirituel (famine, invasions, désordre moral, perte de sens) et ne survit que si une élite créative (une minorité inspirée) répond de manière adéquate à ce défi, en générant de nouvelles institutions, de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de vie.

Lorsque cette élite perd son dynamisme, elle devient une minorité dominante (au lieu d'être créative), et la civilisation entre alors en déclin, remplacée par la passivité et la révolte des masses. Contrairement au biologisme d'Oswald Spengler, Toynbee rejette le déterminisme. Aucune civilisation n'est condamnée à mourir: sa mort survient lorsqu'elle perd le contact avec son élan spirituel originel, c'est-à-dire lorsque ses institutions cessent de servir la vocation créative et religieuse qui les a fondées. Le déclin est donc moral et spirituel, et pas seulement matériel ou politique.
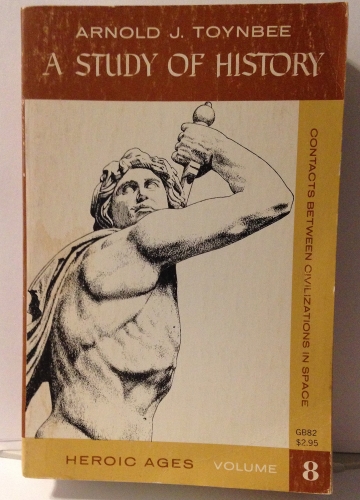
Toynbee réintroduit également l'élément religieux dans la philosophie de l'histoire, à une époque dominée par le matérialisme historique et la sociologie sécularisée. Il croyait que le sens de l'histoire réside dans un rapprochement progressif avec le divin, et que les religions universelles (en particulier le christianisme, le bouddhisme et l'hindouisme dans leurs dimensions mystiques) représentent des tentatives de transcender le cycle d'ascension et de chute des civilisations.
Dans ses derniers volumes, Toynbee en vient à parler d'une histoire dont le point culminant n'est pas politique, mais spirituel: la quête humaine de l'union avec l'Absolu. Ce tournant mystique situe sa pensée en dehors du positivisme, du libéralisme et du marxisme.
14:55 Publié dans Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arnold j. toynbee, histoire, philosophie de l'histoire, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 31 octobre 2025
L’Autre Gramsci

L’Autre Gramsci
par João Martins
Source: https://www.arktosjournal.com/p/the-other-gramsci
João Martins se souvient du frère oublié du célèbre théoricien marxiste italien Antonio Gramsci, Mario Gramsci, un soldat dévoué dont la vie aventureuse incarnait la loyauté, le courage et le destin tragique des guerres civiles en Europe.
Au-delà de toutes tendances idéologiques, nous admirons les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie à un idéal. Sans de telles vies, expériences et actes décisifs de volonté ou de courage, toute conception du monde devient totalement dépourvue d’humanité — ces visages, ces sentiments et ces émotions sont si souvent portés à des niveaux d’intensité étonnants qu’ils débouchent sur des drames humains tragiques. Les guerres civiles représentent le point culminant de tels drames, car aucune famille n’échappe au spectacle de ses membres présents de part et d’autre des barricades.
Récemment, lors de mes pérégrinations à travers l’histoire européenne moderne, je suis tombé sur un épisode des plus curieux qui m’a profondément ému — un épisode qui s’est déroulé en Italie durant la première moitié du 20ème siècle, ou, pour être plus précis, durant ce que l’historien allemand Ernst Nolte appelait la "Deuxième Guerre civile européenne".
Je souhaite partager avec vous le destin d’un homme portant un nom bien connu, mais dont la mémoire, en raison de circonstances politiques, a été reléguée dans l’oubli obscur de l’histoire. J’en profite donc pour sauver de l’oubli une vie, une damnatio memoriae, et pour brosser, aussi brièvement et injustement que ce soit, sa biographie extraordinaire.
Antonio Gramsci, le célèbre penseur marxiste et théoricien de l’"Hégémonie culturelle", était en prison sous le régime fasciste, qui lui permit néanmoins de poursuivre son travail idéologique en captivité. Il est décédé il y a 70 ans. Nous pouvons éprouver une certaine sympathie pour cet homme, ou même étudier sa pensée complexe ; pourtant, aucun biographe ne pourrait lui attribuer ce qui rend une vie humaine plus riche et plus belle — l’esprit d’aventure, de renoncement, cette impulsion rebelle de marcher à contre-courant ou simplement d’être la « brebis noire » de la famille. La dernière expression convient ici le mieux, évoquant la chemise noire des escadrons fascistes — la même que portait fièrement le frère d’Antonio, Mario Gramsci, et dans laquelle il savait vivre et mourir.

Né en 1893 dans une famille modeste, le plus jeune de sept enfants, Mario Gramsci ne vécut pas longtemps, mais ses jours furent remplis de sentiments profonds et d'un patriotisme ardent — une vie si intense qu’elle aurait pu sortir tout droit du Manifeste futuriste italien, cette célèbre diatribe de Marinetti contre la timidité et la conformité, qui exaltait «l’amour du danger, l’habitude de l’énergie et de l’audace (…) le courage, l'audace, la rébellion».
Dans l’année fatidique de 1914, la Première Guerre mondiale éclata — un conflit qui clôturerait dans le sang les illusions impérialistes du 19ème siècle. À 22 ans, Mario Gramsci soutint avec enthousiasme l’entrée de l’Italie dans la guerre en 1915 et s’engagea volontairement au front, où il combattit comme lieutenant. Lorsque le conflit prit fin, l’Italie se trouva plongée dans une crise politique et sociale profonde (1). La « victoire mutilée » et la montée de l’agitation communiste le poussèrent à rejoindre les Fasci di Combattimento, la nouvelle organisation fondée par le vétéran socialiste et ex-soldat Benito Mussolini. Il grimpa rapidement au poste de secrétaire fédéral du Fasci de Varese, et même les supplications persistantes d’Antonio Gramsci et de toute la famille (Mario était le seul fasciste parmi eux) ne purent le dissuader — pas même les solides raclées qu’il reçut des camarades communistes de son célèbre frère, qui l’envoyèrent à l’hôpital.
Antonio rompit tout contact avec lui en 1921. Néanmoins, en août 1927, à la demande de leur mère, Mario tenta de se réconcilier avec Antonio — qui était alors emprisonné à San Vittore — pour l’aider dans ses difficultés juridiques.
En 1935, l’Italie déclara la guerre et envahit le Royaume d’Abyssinie. Encore une fois, Mario Gramsci se porta volontaire pour rejoindre le corps expéditionnaire italien qui allait conquérir l’Éthiopie de l’empereur Haïle Selassié — une campagne féroce de neuf mois qui permit à Mussolini de proclamer depuis le Palazzo Venezia la naissance de l’Empire italien.
En 1941, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, mû par son esprit guerrier et désormais âgé de 47 ans, Mario — qui considérait la vie comme une bataille permanente — retourna en Afrique, cette fois pour faire face aux forces britanniques menaçant les possessions italiennes en Libye et en Afrique orientale italienne.
À mesure que la guerre avançait, les puissances de l’Axe perdaient l’initiative, et le tournant du conflit s’opéra de manière décisive en faveur des Alliés. En 1943, suite à une série de défaites, une partie de la péninsule italienne fut envahie par les troupes anglo-américaines. Le mécontentement se répandit dans le Grand Conseil fasciste, et Mussolini fut démis de ses fonctions par le roi Victor Emmanuel III, puis arrêté. Peu après, le 8 septembre, vint la trahison de Badoglio: l’Italie se rendit aux Alliés et déclara la guerre au Troisième Reich.
Au milieu du chaos, Mario resta inébranlable, sa foi dans la doctrine fasciste demeura intacte. Mussolini, libéré de la captivité par un commando SS, proclama le 23 septembre l'avènement de la République sociale italienne (RSI) — la courte mais mal famée République de Salò. Au lieu d’accueillir les envahisseurs avec des drapeaux blancs, ou parfois rouges ou même américains, Mario Gramsci répondit à l’appel fasciste à continuer le combat, en s’engageant dans les forces armées de la RSI.
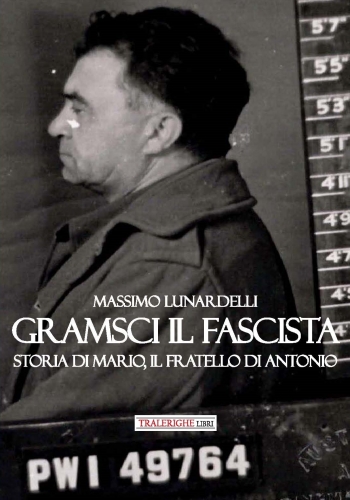
Capturé par les partisans, le Gramsci fasciste fut remis aux Britanniques et déporté dans un camp de concentration en Australie, très loin de chez lui. Les conditions difficiles qu’il endura — une forme de traitement inhumain réservée surtout aux soldats fascistes sans repentir — détruisirent peu à peu sa santé.
Libéré fin 1945, il revint en Italie, pour mourir peu après, ses blessures en camp s’étant révélées incurables. Il fut admis dans une clinique mal équipée, où il mourut à l’âge de 52 ans, en présence de sa femme Anna et de leurs enfants, Gianfranco et Cesarina.
Ironiquement, il est intéressant de noter qu’Antonio Gramsci, lorsqu’il tomba malade en prison à cause d’une maladie chronique contractée dans sa jeunesse, fut libéré et, en tant qu’homme libre, put recevoir un traitement — aux frais du régime fasciste — dans une clinique privée.
Le nom de Mario ne fut jamais donné à une rue, contrairement à celui de son frère Antonio, et il est presque oublié dans les pages injustes de l’histoire. Pourtant, Mario — le Gramsci en chemise noire — reste sans doute l’image même de l’aventurier: un exemple de courage et de loyauté, la glorification du soldat politique. Peut-être que les mots de John M. Cammett résument la richesse émotionnelle de la vie de Mario Gramsci: « Il était volontaire pendant la Première Guerre mondiale, volontaire lors de la guerre en Éthiopie, et à nouveau lors de la Seconde Guerre mondiale (à 47 ans !). Et entre ces catastrophes, il était un volontaire enthousiaste pour l’idéologie qui l’a finalement détruit ! Quelle vie ! » (2).
Notes:
(1) Bien que nation victorieuse, l’Italie n’a pas vu la pleine mise en œuvre des traités qui lui auraient accordé des territoires supplémentaires et des avantages économiques.
(2) John M. Cammett, “L’autre frère de Antonio : une note sur Mario Gramsci,” International Gramsci Society Newsletter 7 (mai 1997) [ http://www.internationalgramscisociety.org/igsn/articles/... ].
12:10 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mario gramsci, fascisme, histoire, italie, biographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 22 octobre 2025
De Kim Il Sung à Hölderlin et Kafka - L'itinéraire d'un révolutionnaire allemand des années 1960

De Kim Il Sung à Hölderlin et Kafka
L'itinéraire d'un révolutionnaire allemand des années 1960
par Werner Olles
Dans les beaux jours du mouvement de protestation estudiantin de 1967/68, je fis la connaissance de KD Wolff en tant que président fédéral de l’Union des étudiants socialistes allemands (SDS), dont je suis devenu membre le Jeudi Saint 1968, le jour de l’attentat contre le responsable du SDS à Berlin, Rudi Dutschke. Le Vendredi Saint, le SDS est passé devant notre appartement à Bockenheim près de l’université à bord d’une vieille Volkswagen, et depuis notre balcon, j’ai entendu le haut-parleur qui diffusait la chanson de Joan Baez “It’s all over now, Baby blue!”. Ensuite, une invitation a été lancée pour se retrouver l’après-midi sur le campus et se rendre ensemble à l’imprimerie Societät pour empêcher la livraison du Bild Zeitung, car la presse de Springer, et en particulier le “Bild,” était jugée responsable de l’attentat contre Dutschke à cause des titres à teneur diffamatoire que ce journal grand tirage n'avait cessé d'imprimer. Les affrontements violents qui ont suivi avec la police, en partie montée, nos protestations et manifestations contre la guerre de l’impérialisme américain au Vietnam, la Conférence internationale du Vietnam en février 1968 à Berlin-Ouest, la lutte ratée contre la loi d’exception, et la recherche d’une reconstruction de la théorie révolutionnaire dans l’espace sis entre la théorie critique et la pratique activiste, visant à développer un socialisme anti-autoritaire et non stalinien, ont été durant plusieurs années les points communs qui m’unissaient à KD. Il n’y a pas de raisons pour se livrer, aujourd'hui, à des distanciations hypocrites.


Le comité fédéral du SDS, comptant dans la fraction anti-autoritaire des “Loups Rouges” (Wolff = Loup), KD et son frère cadet Frank, prônait un modèle d’émancipation anti-autoritaire, sans réaliser que le système politique en Allemagne de l’Ouest évoluait depuis longtemps vers une société libérale et tolérante.
Contrairement à ce que prétend KD Wolff dans son autobiographie — où il évoque “un passé nazi dissimulé par le silence et une éviction de la question de la culpabilité” —, la tendance à “affronter le passé” était très faible, du moins au sein du SDS de Francfort et de Berlin. En réalité, KD a suivi une longue psychanalyse pour traiter les traumatismes liés à ses parents, qui avaient parfois sympathisé avec le national-socialisme. Il faut donc voir la rébellion de 68 aussi comme une lutte des fils contre leurs pères, où les grands-pères (Marcuse, Adorno, Horkheimer, etc.) leur venaient en aide.
Heureusement, chez les intellectuels et penseurs comme Hans-Jürgen Krahl, Rudi Dutschke et Bernd Rabehl, la tendance à s’occuper du passé était très faible, ils avaient probablement compris que “chaque peuple a connu son Hitler,” comme l’avait dit le sage président égyptien Anouar el Sadat. Leur préoccupation portait surtout sur le rôle de l’intelligentsia dans le contexte du pouvoir politique, tout en sachant clairement que l’intelligence ne se trouve pas uniquement dans la tête. KD, en revanche, était l’organisateur qui maintenait ensemble, au sein du SDS, les différentes factions, celles des antiautoritaires, des sympathisants de la DKP et de la faction maoïste en vestes de cuir.
Les premiers conflits entre KD d’une part, et Krahl et Dutschke de l’autre, ont éclaté lors de la 22ème Conférence des délégués du SDS en septembre 1967 à Francfort. La déclaration de principe des deux exprimait clairement que le modèle archaïque d’un mouvement de protestation avec des manifestations et des rassemblements, ainsi qu’une attitude purement théorique, n’était plus capable de faire bouger quoi que ce soit, mais que théorie et pratique devaient fusionner dans la revendication “Education par l’action” (Aufklärung durch Aktion)
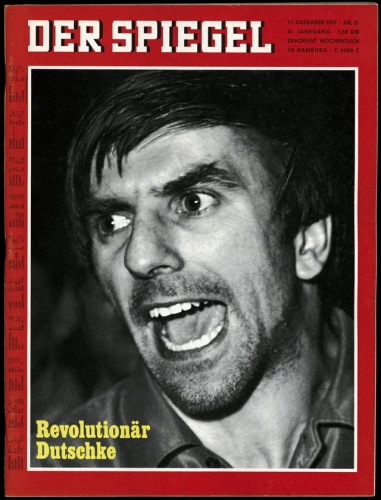
Dutschke parlait ouvertement d’organiser une “guérilla urbaine,” qui devait s’inspirer des mouvements révolutionnaires latino-américains. La question sensible était celle de la violence, celle qui permettrait de dépasser les limites du système. KD était littéralement atterré, il ne voulait pas aller jusque-là. Mais avec la mort d’Adorno en août 1969 et le décès tragique et accidentel de Krahl en février 1970, l’atmosphère dans le SDS a finalement basculé dans la consternation et la résignation. S’y ajoutait la conversion de nombreux activistes du SDS au néo-léninisme, leur entrée dans la DKP financée par la RDA, et la dogmatisation de la théorie marxiste en une vision du monde socialiste, qui s’est exprimée dans des sectes comme le KBW, la KPD/AO, diverses KPD/ML et groupes trotskystes.
La dissolution de l’Union fédérale du SDS, dont les actifs sont malheureusement tombés entre les mains d’un groupe mafieux qui a donné naissance plus tard au KBW, dont les membres ont même dû apporter leur patrimoine en adhérant, avec ses tendances radicales, a certes marqué la fin du mouvement étudiant, mais à Francfort, on était prêt à explorer de nouvelles voies.
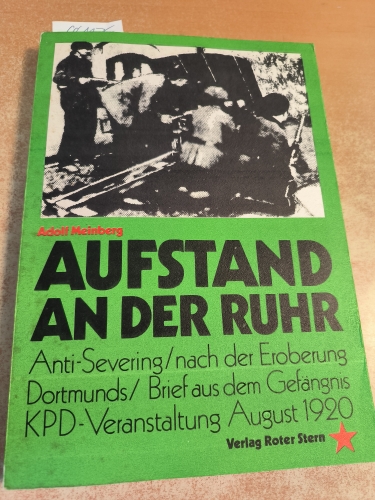
KD a fondé avec les futurs terroristes Winfried “Boni” Böse et Johannes Weinrich la maison d’édition “Roter Stern” ("Etoile Rouge") avec ses librairies éponymes à Bochum, Marburg et Mayence, et a noué, après un voyage en Corée du Nord (voir Kursbuch n° 30, “Le socialisme comme pouvoir d’État”), des liens commerciaux avec ce régime. Parallèlement, des groupes comme “Roter Gallus,” “Rote Panther,” et le “Comité de solidarité des Black Panthers” sont apparus, dont KD Wolff était au moins le “leader informel”.
Le fait que des membres de la RAF aient encore séjourné en avril 1971 dans les locaux de l’éditeur à Westend/Francfort, et aient été fournis en armes par Weinrich et Böse, n'aurait pas été remarqué par KD, selon ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Personnellement, je pouvais parfois affranchir le courrier chez l’éditeur, et j'ai cependant pu constater que Weinrich et Böse approvisionnaient notamment des groupes terroristes grecs et italiens en armes, en les dissimulant dans les garnitures intérieures des portières de voitures, puis en les faisant passer clandestinement vers la Grèce et l’Italie.
Aujourd’hui, on sait qu’avec des pistolets livrés au groupe terroriste italien Lotta Continua, deux jeunes du MSI, la jeunesse néofasciste, qui montaient la garde devant leur siège à Rome, ont été assassinés de manière sournoise depuis des tirs venus d'une voiture. Encore aujourd’hui, à Rome, chaque année, le jour de leur assassinat, des milliers de jeunes hommes leur rendent hommage; leurs noms sont appelés, et une voix unanime s’élève alors dans la rue: “Présente !”.
Mais aussi les “Rote Panther”, les "Panthères rouges", dont j’étais membre, n’ont pas été inactifs. Après les plénières, deux ou trois camarades se retrouvaient généralement et lançaient des attaques nocturnes contre des cibles telles que la "Cité de l’Emploi" américaine, la société Hochtief, le United Trade Center ou le consulat général d’Espagne. Heureusement, aucune personne n’a été blessée lors de ces actions, et nous n’avions aucun problème à commettre des violences contre des biens. Cependant, tout cela devenait dangereux puisqu’une nuit, une terroriste de la RAF — selon mes souvenirs, il s’agissait d’Astrid Proll — a reçu une arme. Nous fûmes alors poursuivis par la police d’État, qui nous avait observés, à travers tout Francfort. Et qu’en était-il encore une fois de l’appartement secret dans la cour dans la Leipzigerstraße, dans le quartier Bockenheim de Francfort, qui aurait été loué pour cacher un agent du consulat américain à l’occasion d’une opération de kidnapping? Le fait que KD ne mentionne pas tout cela, n'en dit pas un seul mot, est totalement incompréhensible, car d’une part tout est depuis longtemps prescris, et d’autre part, il savait non seulement tout de nos actions nocturnes, mais il était aussi présent lors de la majorité d’entre elles.
Winfried Böse, (tué en 1976 à l'aéroport d'Entebbe par une unité spéciale israélienne après que les passagers juifs d'un avion détourné aient été sélectionnés — après quoi ils furent séparés du reste —), et Hannes Weinrich, (qui purge une peine de prison à vie à Berlin en tant que bras droit du tueur en série Carlos), ont ensuite fondé les Cellules révolutionnaires, qui auraient apparemment accidentellement tiré sur le ministre des Finances de Hesse, Heinz-Herbert Karry (FDP), j’ai quitté le scène parce que j'ai lutté pendant des décennies contre une maladie extrêmement grave que j’avais contractée en 1969 lors d’un camp d’entraînement de terroristes palestiniens du Fatah au Liban. En ce lieu, des membres du SDS s’entraînaient avec des terroristes de l’Armée rouge japonaise, de l’ETA basque, de l’Action directe française et de l’IRA pour acquérir les techniques de la guérilla.


Les succès ultérieurs de KD en tant qu’éditeur de Hölderlin, Kafka, Manes Sperber et des “Fantaisies masculines” de Klaus Theweleit, ainsi que son existence de père de famille comblé de bonheur, on les lui auraient bien souhaités. En ce sens, il est effectivement un “Hans-la-chance.” On aurait toutefois pu attendre un peu de compassion pour ceux du “mouvement” qui ont ensuite eu une vie difficile et dont la trajectoire n’était pas celle qu’ils avaient imaginée. Peut-être aussi quelques mots sur les scandales antisémites que nous avions provoqués à l’époque avec notre “solidarité avec la Palestine”, laquelle était en réalité clairement antisémite, et qui dominent aujourd’hui les “universités” allemandes ruinés par les années 68, ou la cancel culture est tout sauf “libérale” et “tolérante,” menée qu'elle est par les successeurs ratés du soulèvement de l’époque, et qui se traduisent par des menaces et de la violence contre des maisons d’édition conservatrices et de droite. Malheureusement, il n’y a pas un seul mot à ce sujet, dans l'autobiographie de KD. Une chose est cependant hautement méritoire: selon ses propres dires, il n’a jamais voté pour les Verts.
Werner Olles
KD Wolff : Bin ich nicht ein Hans im Glück? Studentenrevolte - Hölderlin - Kafka (= Ne suis-je pas un Hans-la-chance ? Révolution étudiante — Hölderlin — Kafka). Klostermann Verlag. Francfort 2025. 260 pages. 28 euros
16:43 Publié dans Biographie, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sds, allemagne, histoire, kd wolff, années 60, révolution, révolte étudiante |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 19 octobre 2025
Le symbole national de la Palestine est l’orange

Le symbole national de la Palestine est l’orange
Robina Qureshi
Source: https://mpr21.info/el-simbolo-nacional-de-palestina-es-la...
Autrefois, le symbole national de la Palestine était l’orange. Le premier agrume à apparaître dans la région, vers le IIe siècle av. J.-C., fut le cédrat, cultivé exclusivement à des fins rituelles. Les oranges amères arrivèrent huit siècles plus tard avec les conquérants arabes. Cependant, ce sont les commerçants portugais des XVe et XVIe siècles qui introduisirent les variétés douces, transformant le paysage. À la fin du XVIIIe siècle, les oranges et les citrons étaient cultivés dans toute la Palestine, et ceux de la vieille ville de Jaffa étaient particulièrement appréciés.

Une société d’exportation appartenant aux Templiers, une société chrétienne allemande établie en Palestine au XIXe siècle, utilisa pour la première fois le nom de Jaffa en 1870. En quelques décennies, l’orange de Jaffa acquit une renommée mondiale et arriva même sur la table de la reine Victoria. Elle était appréciée pour sa douceur, son écorce épaisse et sa remarquable conservation, la rendant idéale à l’exportation. D’abord expédiée dans des sacs de jute, puis dans des caisses en bois, chaque fruit était soigneusement enveloppé dans du papier de soie pour éviter les dommages.
La culture commerciale des agrumes à grande échelle débuta dans les années 1830 et 1840 sous domination ottomane. Les grandes familles terriennes palestiniennes de Jaffa et des villages voisins, telles que les familles Abu Laban et Al Dajani, investirent massivement dans la culture des agrumes, l’irrigation et l’infrastructure d’exportation.

À la fin du XIXe siècle, les commerçants palestiniens avaient établi des routes commerciales reliant directement le port de Jaffa aux marchés européens, notamment la Grande-Bretagne et la France. Ils organisèrent le transport, l’emballage et la promotion de la marque, faisant de l’orange de Jaffa un produit reconnu mondialement bien avant l’arrivée des colonies sionistes dans la région.
La famille Abu Laban, en particulier, fut l’une des plus influentes: ses orangeraies et ses opérations d’exportation devinrent la pierre angulaire de ce commerce. Leur marque jouissait d’une grande réputation sur les marchés européens. Après 1948, leurs terres, comme celles de milliers d’autres agriculteurs palestiniens, furent confisquées sous les lois dites de la «propriété absente».
Le port de Jaffa était l’artère de cette économie. À chaque saison de récolte, les agriculteurs livraient les fruits de leurs vergers. Dockers, fabricants de caisses, emballeurs et commerçants se pressaient sur les quais. Des barges transportaient les caisses vers des navires à destination de Londres, Marseille ou Trieste.
En 1939, les exportations d’agrumes de Palestine s’élevaient à environ 15 millions de caisses par an, Jaffa en produisant la majorité. La Grande-Bretagne était le principal importateur. Les agriculteurs palestiniens utilisaient des techniques innovantes de greffage et d’irrigation pour cultiver des variétés sans pépins et faciles à peler, qui dominaient les marchés hivernaux européens.

Les oranges de Jaffa étaient à la fois un moteur économique et un ancrage culturel. Après 1948, les Palestiniens déportés emportèrent en exil des graines ou des écorces séchées d’orange, fragments d’une patrie volée.
Pendant la Nakba, les milices sionistes, telles que la Haganah, l’Irgoun et le Lehi, attaquèrent des villages palestiniens, expulsèrent les civils et confisquèrent leurs vergers. Le nouvel État d’Israël légalisa ce vol par des lois sur la « propriété absente », transférant terres, entrepôts et réseaux de transport à des coopératives et organisations de colons soutenues par l’État. Le Curateur des Propriétés Absentes attribua les vergers à des institutions sionistes telles que le Fonds National Juif.
Ce fut une destruction délibérée du pilier économique palestinien par la guerre, l’expulsion forcée et le vol légalisé. Le contrôle de Jaffa et de sa ceinture d’agrumes était stratégique. Contrôler cette région, c’était contrôler le flux de devises.
Le nom « Jaffa » a survécu comme marque mondiale, mais il s’agit d’un produit volé, dépouillé de ses racines palestiniennes et commercialisé sous pavillon israélien. Les clients britanniques et européens ont continué à acheter les mêmes oranges auprès des nouveaux exportateurs. Avant 1948, l’industrie était majoritairement palestinienne. Après 1948, les Palestiniens ont été exclus du commerce qu’ils avaient créé. Comme l’écrit Susan Abulhawa, ce fut une « falsification épique ».
Une petite activité de production d’oranges a survécu à Gaza et à Tulkarem, mais des décennies d’appropriation des terres, de restrictions sur l’eau et de blocus ont réduit son activité à l’ombre de son ancienne gloire. Les vergers restants sont des actes de résistance. Les agriculteurs palestiniens continuent de planter, défiant le dépouillement.


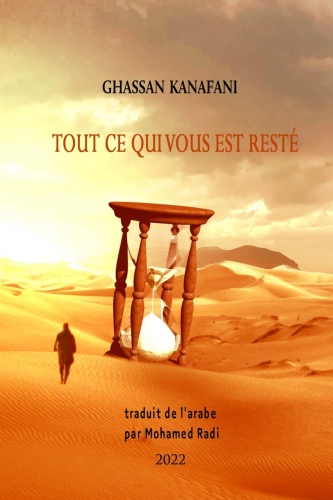
Plusieurs écrivains, historiens et militants palestiniens ont documenté le vol des oranges de Jaffa et leur signification. En 1962, dans la nouvelle de Ghassan Kanafani, « La terre des oranges tristes », le fruit incarne l’exil et la perte. Une famille fuit avec un sac d’oranges dont la vue devient insoutenable.
Un autre écrivain palestinien, Rashid Khalidi, décrit l’industrie des agrumes comme le joyau de l’économie palestinienne avant 1948 et sa confiscation comme un vol à la fois économique et politique.
Ilan Pappé a documenté comment la ceinture d’agrumes de Jaffa fut délibérément ciblée comme un produit stratégique, et non simplement comme moyen de subsistance.
Edward Said évoquait Jaffa comme un lieu d’activité culturelle et économique effacé par la colonisation, avec des oranges « rebaptisées et revendues ».
Mahmoud Darwish utilise la métaphore de l’oranger comme symbole de la patrie. Dans « Carte d’identité », il relie l’identité aux vergers, soulignant le rôle des symboles quotidiens dans la transmission de la mémoire.
Ces voix présentent l’orange non seulement comme l’une des plus grandes pertes économiques, mais aussi, et surtout, comme symbole d’identité nationale, de mémoire et de résistance.
Le monde consomme toujours des oranges de Jaffa. Peu de gens savent qu’elles sont nées sur le sol palestinien, cultivées par des Palestiniens et volées par violence. Un ancien agriculteur, déporté en 1948, se souvient: «Nous avons planté ces arbres. Nous avons récolté ces oranges. Quand les soldats sont venus, ils ont pris la terre, les arbres et même le nom. Mais le parfum du fruit nous appartient à jamais».
Ce n’est pas seulement la perte de terres agricoles, mais aussi l’anéantissement d’une société entière: familles dispersées, travailleurs expulsés, agriculteurs privés du fruit d’une vie de labeur. L’industrie reposait sur le travail humain et l’intelligence collective; ces populations furent les premières à être dépossédées.
Cette histoire met en lumière notre complicité en tant que consommateurs. Le peuple palestinien avait fondé toute une économie sur sa terre. Les autorités sionistes la leur ont arrachée par la guerre, la déportation et le vol légalisé, pour ensuite la présenter au monde comme une réussite israélienne. Les Palestiniens ont enduré massacres, famine, blocus, occupation et exil sans fin. Aucun film hollywoodien n’a cherché à les humaniser ni à mettre fin à leur déshumanisation. Nous avons consommé les fruits du travail palestinien sans percevoir la violence sous-jacente. Chaque orange portant le label « Jaffa » symbolise notre complicité.
Robina Qureshi
https://thisisrobinaqureshi.substack.com/p/jaffa-oranges-...
17:55 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agrumes, oranges, palestine, nakba, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 octobre 2025
Emergence et développement des BRICS: un point de vue européen

Emergence et développement des BRICS: un point de vue européen
Robert Steuckers
(Texte rédigé en septembre 2024)
Par le poids déterminant mais non oblitérant de la Russie et de la Chine dans le phénomène des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), ce dernier apparaît bien évidemment comme un fait géopolitique et géoéconomique propre à la masse continentale eurasienne, située à l’Est du Niémen, du Dniepr, du Bosphore et du Caucase. Notre espace, situé à l’Ouest de cette ligne floue n’aurait rien à voir avec ce monde de steppes infinies, au-delà duquel la race jaune domine. C’est oublier un peu vite que l’Europe a été matériellement une pauvre civilisation repliée sur elle-même (ce qui ne minimise aucunement la richesse spirituelle du moyen âge), une civilisation « enclavée », et qui cherchait désespérément à se désenclaver (1), position fragile que l’esprit de croisade tentera en vain d’annuler. Seules les villes marchandes italiennes, Venise et Gênes, resteront vaille que vaille branchées sur les routes de la Soie. La pression ottomane, surtout après la chute de Byzance (1453), semblait inamovible. Les initiatives maritimes portugaises suite aux travaux scientifiques et géographiques du Prince Henri le Navigateur, la découverte de l’Amérique par Colomb et la conquête russe du bassin de la Volga et des premières terres sibériennes effaceront cet enclavement européen. On connaît la suite. Toutefois, à la fin du 18ème siècle, avant la totale mainmise britannique sur le sous-continent indien, la Chine et l’Inde demeuraient les principales puissances industrielles, les civilisations les plus riches. La parenthèse miséreuse de l’Inde et de la Chine n’aura finalement duré que moins de deux siècles. Nous assistons aujourd’hui, voire depuis trois décennies, au retour à la situation d’avant 1820 (2).

Le désir de désenclavement était bien présent dans l’esprit de nos ancêtres aux 15ème et 16ème siècles. Pour ce qui concerne la Moscovie (on ne parlait pas encore de « Russie »), le personnage le plus emblématique fut Sigismund von Herberstein (3) (illustration). Diplomate au service des empereurs germaniques Maximilien I, Charles-Quint et Ferdinand I, il exécuta deux missions en Russie en 1517-1518 et 1526-1527, à l’époque où régnait Vassili III, père d’Ivan IV le Terrible. Sigismund von Herberstein ramène de ces deux voyages une description détaillée et inédite du territoire de la Russie-Moscovie, plus particulièrement de son hydrographie, les fleuves étant les principales voies de communication depuis les Varègues (et probablement de peuples divers avant eux) (4). La mission de von Herberstein était de plaider la paix entre la Pologne-Lituanie et la Moscovie afin d’organiser une vaste alliance entre ces puissances slaves ou balto-slaves et le Saint-Empire contre les Ottomans, puissance montante à l’époque. Dès les premières décennies du 16ème siècle, la raison civilisationnelle postulait une alliance entre l’Europe centrale (et bourguignonne car Philippe le Bon et Charles le Hardi entendaient tous deux reprendre pied sur le littoral de la mer Noire) et les Etats polono-lituanien et moscovite, tout en annulant, par l’art de la diplomatie, les belligérances entre ces derniers. Une sagesse qui n’a pas été réitérée dans l’actuel conflit russo-ukrainien.

Plus tard, après que le Saint-Empire a été ravagé par les armées de Louis XIV (allié aux Ottomans pour prendre l’Autriche à revers), les universités, dont Heidelberg, avaient été réduites en cendres, laissant une quantité d’étudiants et de professeurs sans emploi. Le Tsar Pierre le Grand entreprend, au même moment, une modernisation-germanisation de la Russie et fait appel à ces cadres déshérités, tout en recevant les conseils de Gottfried Wilhelm Leibniz (portrait), le célèbre philosophe et mathématicien allemand. Pour Leibniz, intéressé par la pensée chinoise, la Moscovie du Tsar Pierre, en commençant à gommer le chaos de toutes les terres sises entre l’Europe et la Chine, fera de cet espace un « pont » entre l’écoumène européen, centré sur le Saint-Empire (à reconstituer), et la Chine. L’harmonie devra alors, à terme, régner sur cet ensemble à trois piliers. L’eurasisme, avant la lettre, est donc né dans la tête de ce philosophe et mathématicien hors pair (pour son époque), qui oeuvrait sans relâche dans la bonne ville de Hanovre, à la charnière des 17ème et 18ème siècles.

Plus tard, sous la République de Weimar, les cercles nationaux-révolutionnaires, qu’Armin Mohler comptait parmi les avatars de la « révolution conservatrice », évoquaient une « Triade » germano-soviéto-chinoise, reposant sur le Kuo Min Tang de Tchang Kai Tchek, le PCUS sous la houlette de Staline et un pôle révolutionnaire allemand anti-occidental qui devait encore prendre le pouvoir : cet aspect de la diplomatie et de la géopolitique nationales-révolutionnaires de l’ère de Weimar n’a guère été exploré jusqu’ici. En effet, mis à part une thèse de doctorat de Louis Dupeux (5), ni la littérature scientifique ni la très nécessaire littérature militante et vulgarisatrice n’ont abordé en profondeur cette notion de « Triade » qu’analyse pourtant un témoin direct des activités de ces cercles nationaux-révolutionnaires sous la république de Weimar, Otto-Ernst Schüddekopf (6). Ce dernier fréquenta les cercles autour d’Ernst Niekisch, Ernst Jünger et Friedrich Hielscher à partir de 1931. Il se spécialisa dans l’histoire de la marine et des forces aériennes britanniques et dans la politique des points d’appui du Reich de Guillaume II au cours de ses études de 1934 à 1938. Plus tard, il fut affecté à l’Abwehr (pour des opérations antibritanniques, notamment en Irlande) puis à l’Ahnenerbe (dont le directeur Wolfram Sievers était un ami de Hielscher) et, finalement, au RSHA. En dépit de cette inféodation aux sphères prétoriennes du Troisième Reich, Schüddekopf et Sievers aideront des dissidents proches des cercles NR et seront au courant de la tentative d’attentat contre Hitler, qui fut ultérieurement perpétrée par Stauffenberg, sans pour autant subir les foudres de la police politique. En 1945, Schüddekopf sera incarcéré pendant trois ans dans une prison de haute sécurité à Londres puis entamera une carrière universitaire en République Fédérale (7).

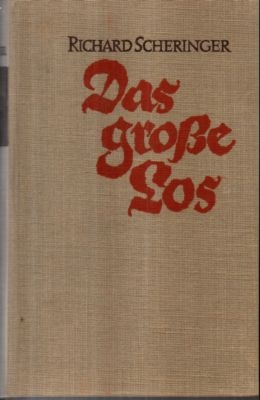
Un autre personnage précurseur de l’eurasisme, style BRICS, sera l’officier Richard Scheringer (1904-1986) (photo), natif d’Aix-la-Chapelle. Sa qualité d’officier ne l’empêcha pas d’avoir eu plutôt une carrière rouge de rouge. L’analyse des textes parus dans sa revue Aufbruch (8) révèle un tropisme chinois, inséré dans l’espoir de voir triompher une « Triade » anti-occidentale, tropisme chinois qui agitait certains esprits dans les coulisses de la diplomatie belge (et dont la trace la plus visible reste la présence de Tchang, l’ami d’Hergé, à Bruxelles dans les années 30 et la parution de l’album de Tintin, Le Lotus bleu, clairement sinophile). En dépit de son militantisme communiste, Scheringer servira dans la Wehrmacht en territoire soviétique sans être inquiété par les services allemands et reprendra son militantisme rouge, avec ses fils et sa petite-fille (qui seront tous députés PDS, ancêtre de Die Linke). Au soir de sa vie, il appellera à manifester contre la « double décision de l’OTAN » et contre l’implantation de missiles américains sur le territoire de la RFA. Il tentera de mobiliser son vieux camarade Ernst Jünger pour qu’il en fasse autant. Jünger envoya une couronne de fleurs à son enterrement à Hambourg avec la mention « Au vieil ami ». Il resterait à analyser les rapports entre les universités allemandes de l’entre-deux-guerres et des dizaines d’étudiants indiens, désireux de secouer le joug britannique. Ces étudiants appartenaient à toutes les tendances révolutionnaires et indépendantistes possibles et imaginables et cherchaient des appuis allemands tant sous la république de Weimar que sous le régime national-socialiste. La question des rapports germano-indiens est extrêmement complexe et excède le cadre de ce modeste article (9). Aujourd’hui, les étudiants indiens sont, dans Allemagne en déclin du Post-Merkelisme et de Scholz, les plus nombreux parmi les étudiants étrangers inscrits dans les universités.

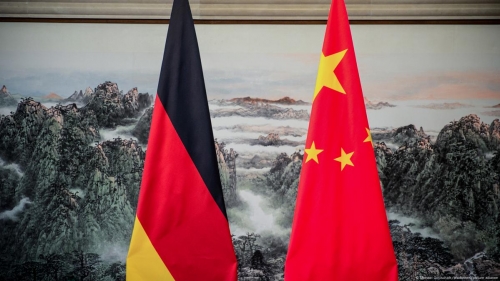
La « Triade » semble être aujourd’hui une chimère imaginée par des personnages en marge des politiques dominantes et triomphantes de l’entre-deux-guerres allemand. Mais son émergence, même marginale et diffuse, est la hantise des services anglo-saxons. Or, force est de constater qu’en dépit des élucubrations impolitiques répandues par les médias, en coulisses, la « Triade » était devenue, tacitement, un fait accompli. La Russie fournissait le gaz de l’Arctique à un prix défiant toute concurrence, lequel gaz passait dans les eaux de la Baltique, bordée jusqu’il y a quelques mois par des Etats neutres non inféodés à l’OTAN (Finlande, Suède). La Chine était le premier partenaire commercial de l’Allemagne. L’Ostpolitik des socialistes (Brandt, Schmidt, Schröder), préconisant des relations normalisées avec l’Union Soviétique d’abord avec la Russie ensuite, et la Fernostpolitik des démocrates-chrétiens (Strauss), favorisant tous les liens possibles avec la Chine, avaient, avec un réel succès, pris le relais des spéculations sans lendemain des intellectuels non conformistes du temps de la république de Weimar.
La Terre du Milieu russe (ou le « Pont » de Leibniz) avait apaisé le Rimland centre-européen, apaisé l’Iran des mollahs et forgé une alliance pragmatique avec une Chine qui se débarrassait des colifichets idéologiques du maoïsme de la « révolution culturelle », tout en gardant les bons rapports avec l’Inde forgés depuis l’indépendance du sous-continent en 1947. Deux cauchemars de la géopolitique anglo-saxonne de MacKinder et de Spykman s’étaient installés dans le réel : 1) la Terre du Milieu avait avancé pacifiquement ses glacis, rendant plus difficile toute stratégie d’endiguement ; 2) Un morceau considérable du rimland sud-asiatique, l’Iran, était désormais relié aux réseaux ferroviaires financés par la Chine et branchés sur le Transsibérien russe, qui, en fait, est le véritable « pont », bien concret, rêvé par Leibniz du temps de Pierre le Grand. Les deux gazoducs de la Baltique soudaient, dans une concrétude énergétique tout aussi tangible, l’alliance germano-russe préconisée par quantité d’hommes d’Etats depuis Gneisenau, Clausewitz, Bismarck, Rathenau, etc.

Pour briser cette dynamique, il fallait agir en actualisant de vieilles stratégies d’endiguement, de propagande et de zizanie belliciste. Rendre purulent l’abcès ukrainien, en réactivant de vieilles querelles entre Slaves (le contraire de la politique préconisée par Sigmund von Herberstein), en hissant partout au pouvoir en Europe des politiciens de bas étage, des idéologues fumeux et incultes, des juristes ou des banquiers dépourvus de culture historique, des écologistes véhiculant les délires woke, etc. Ce personnel, en rupture de ban avec toutes les écoles diplomatiques, fera une politique dictée par Washington : reniement des politiques socialistes en Allemagne (avec ostracisme à l’encontre de Schröder, qui présidait la gestion des gazoducs de la Baltique), réalignement de la France sur les délires atlantistes depuis Sarközy, abandon des politiques de neutralité en Suède, Finlande et même Suisse (seule l’Autriche résiste mieux grâce à la solide présence de la FPÖ dans les assemblées fédérale et régionales et à la proximité de la Hongrie), création du chaos wokiste et multiculturel dans toutes les sociétés ouest-européennes et même en Pologne depuis le retour de Tusk au pouvoir.
L’émergence, le développement et la consolidation du Groupe BRICS vient donc d’une volonté d’organiser l’ensemble du territoire eurasien des rives orientales du Don et de la Volga jusqu’aux littoraux du Pacifique, d’échapper à un Occident devenu fou, plus rébarbatif encore que l’Occident fustigé par les intellectuels non conformistes des années 1920 et 1930, d’une volonté d’appliquer les recettes d’un économiste pragmatique du 19ème siècle, Friedrich List. Pour cet économiste libéral, ou considéré tel, le rôle premier de l’Etat est d’organiser les communications à l’intérieur de ses frontières, de rendre ces communications rapides et aisées, de créer des flux permanents de marchandises et de personnes, notamment afin de fixer les populations sur leur propre sol et d’empêcher toute hémorragie démographique, telle celle que les Etats allemands (avant l’unification) avaient connu au bénéfice des Etats-Unis.

List (illustration) a exercé une influence prépondérante dans l’Allemagne de son temps mais a également œuvré aux Etats-Unis, préconisant de grands travaux (chemins de fer, canaux, etc.) qui, après leur réalisation, ont donné aux Etats-Unis les assises de leur puissance et permis l’éclosion de leur atout majeur : la bi-océanité. L’idée d’organiser les communications terrestres sera reprise par les dirigeants russes qui créeront le Transsibérien et par des penseurs pragmatiques du Kuo Min Tang chinois, oubliés suite aux vicissitudes tragiques de l’histoire chinoise des 19ème et 20ème siècles. C’est cette volonté véritablement politique de créer des infrastructures, présente en Chine, qui incitera Xi Jinping à lancer son fameux projet des « routes de la Soie » ou BRI (« Belt and Road Initiative »).
La Chine est passée ainsi du maoïsme et de son interprétation naïve et schématique de Marx à un listisme concret et créatif et, ensuite et surtout, à un intérêt pour Carl Schmitt, théoricien qui refusait explicitement toute immixtion étrangère dans les affaires intérieures d’un autre « grand espace ». Dès la fin des années 1980, la Chine avait émis « les cinq principes de la coexistence pacifique », l’adoption planétaire desquels garantissant à tous d’emprunter les « bons taos » (les « bonnes voies », les « bon chemins ») (10). Parmi ces cinq principes figure, bien évidemment, celui qui vise à préserver chaque entité étatique de toute immixtion indue et corruptrice en provenance de puissances lointaines, développant un programme hégémonique ou cherchant à monter des alliances interventionnistes à prétention planétaire, comme l’est, par exemple, l’OTAN. Les BRICS, le noyau initial comme les nouveaux pays adhérents, entendent justement emprunter de « bon taos », qui postulent le contraire diamétral de ce que préconise le « nouvel ordre mondial » de Bush et de ses successeurs à la Maison Blanche ou des dispositifs que veut mettre en place la nouvelle direction de l’OTAN (Stoltenberg, Rutte).
Les deux postulats principaux qui animent les pays du groupe BRICS sont : 1) le développement sans entraves de voies de communications terrestres et maritimes sur la masse continentale ou autour d’elle (le long des littoraux des pays du rimland selon MacKinder et Spykman) et le refus de toute immixtion visant l’hégémonie unipolaire (américaine) ou le blocage des communications entre les rimlands et l’intérieur des continents ou l’endiguement de toute exploitation des nouvelles routes maritimes (Arctique, Mer de Chine du Sud, côtes africaines de l’océan Indien). Voyons comment cela s’articule pour chaque pays participant à la dynamique des BRICS :
La Russie a toujours cherché un débouché sur les mers chaudes ; elle est actuellement attaquée sur deux fronts : celui de l’Arctique-Baltique et celui de la mer Noire. Elle n’a les mains libres qu’en Extrême-Orient, justement là où l’appui britannique au Japon en 1904 avait manœuvré pour lui interdire un accès facile au Pacifique, quatre ans après les 55 jours de Pékin ; les sanctions, forme d’immixtion et de guerre hybride, permettent paradoxalement de développer un commerce des matières premières avec l’Inde et la Chine, totalisant près de trois milliards d’habitants. Le chaos créé en mer Noire bloque (partiellement) l’exportation des céréales russes et ukrainiennes vers la Méditerranée et l’Afrique : le développement de l’agriculture russe sous Poutine est un atout de puissance, que la Russie des Tsars était sur le point de se doter avant que certains services n’utilisent des révolutionnaires utopistes pour éliminer Stolypine et ne favorisent l’émergence d’un bolchevisme anti-agraire. Cette défaillance sur le plan agricole a rendu le communisme soviétique faible et caduc au bout de sept décennies. Il est dans l’intérêt de tous de voir les agricultures russe et ukrainienne se développer et trouver des débouchés, notamment en Afrique. La création d’un foyer durable de turbulences aux embouchures du Don, du Dniepr et du Dniestr contrecarre les intérêts de bon nombre de pays, d’où l’intérêt pour le groupe BRICS de l’Ethiopie, de l’Egypte et de l’Algérie, voire d’autres pays d’Afrique subsaharienne.
La Chine a développé, dans la phase post-maoïste de son histoire récente, une modernité technologique étonnante pour tous ceux qui la croyaient condamnée à une stagnation archaïsante. Dès la moitié du 19ème siècle, les visées américaines sur l’Océan Pacifique, entendaient conquérir le marché chinois pour une industrie américaine à développer qui ne comptait pas encore sur les marchés européens. Ce marché chinois, espéré mais jamais conquis, relevait d’une puissance sans forces navales, non thalassocratique, qui pouvait s’étendre vers l’Ouest, le « Turkestan chinois » (ou Sinkiang) et le Tibet. Washington acceptait une Chine continentale et refusait implicitement une Chine dotée d’un atout naval. L’industrialisation de pointe de la Chine au cours de ces trois dernières décennies a obligé Pékin à protéger les lignes de communications maritimes en mer de Chine du Sud, autour du « point d’étranglement » (choke point) qu’est Singapour pour accéder aux sources d’hydrocarbures que sont les rivaux iranien et saoudien. Par ailleurs, Chinois et Russes tentent de rentabiliser la route arctique qui mène plus rapidement à l’Europe, aux ports de Hambourg, Rotterdam et Anvers-Zeebrugge (ces deux derniers alimentant la Lorraine, l’Alsace, la Bourgogne, la Champagne et partiellement la Franche-Comté, via l’axe du Rhin) (11).

La fonction de « pont » passant ainsi à l’Arctique et doublant le Transsibérien et les nouvelles voies ferroviaires prévues par les Chinois. La construction du Transsibérien et son parachèvement en 1904 avait suscité les réflexions de MacKinder sur la nécessité d’endiguer le « Heartland » russe. Le projet à tracés multiples de Xi Jinping suscite le bellicisme actuel des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l’OTAN. A cela s’ajoute que la Chine dispose de réserves considérables de terres rares, indispensables à la fabrication de matériels informatiques, fait qui ne devraient pas laisser nos dirigeants indifférents et les inciter à poursuivre une politique européenne rationnelle, visant à ne pas être dépendants et à ne pas être entraînés dans les stratégies vengeresses et destructrices des Etats-Unis.
L’Inde britannique était une masse territoriale capable d’offrir une vaste base territoriale pour contrôler le rimland de la Méditerranée à l’Indochine, sans oublier la façade africaine de l’Océan Indien jusqu’au Grands Lacs et jusqu’au-delà du Nil ; au Soudan et en Egypte. Le combat pour l’indépendance fut long pour tous les Indiens, qu’ils soient musulmans, sikhs ou hindous. L’émancipation de l’Inde impliquait une nouvelle orientation géopolitique : le sous-continent ne devait plus être la base principale, la plus vaste et la plus peuplée, destinée à parfaire la stratégie de l’endiguement de la Russie/de l’Union Soviétique mais devenir à terme une éventuelle fenêtre du Heartland sur l’Océan du Milieu. Les rapports indo-soviétiques furent toujours optimaux, puisque l’URSS restait seule en piste après l’élimination de l’Allemagne en 1945, mais l’Inde a toutefois servi de barrage contre la Chine, abondant ainsi directement dans le sens de la géopolitique thalassocratique anglo-américaine : dans l’Himalaya (Ladakh) et dans toutes ses entreprises visant à soutenir le Tibet. Le conflit indo-pakistanais a induit une géopolitique particulière : les Etats-Unis incluaient le Pakistan dans l’alliance endiguante que fut le Pacte de Bagdad (Turquie, Irak avant 1958, Iran, Pakistan), ce qui obligeait l’Inde à maintenir ses bons rapports avec l’URSS, tout en demeurant l’un des pays-phares du non-alignement de Bandoeng. Le Pakistan demeurait l’ennemi et cet ennemi était ancré dans des structures militaires « défensives » pilotées par les Etats-Unis. Et pour être plus précis, quand la Chine et les Etats-Unis deviennent de facto alliés à partir de 1972, suite à l’œuvre diplomatique de Kissinger, le Pakistan offre à la Chine un débouché sur l’Océan Indien.

L’art de la diplomatie des Indiens est subtil : il navigue entre l’amitié traditionnelle avec la Russie, le non-alignement et ses avatars actuels et une ouverture méfiante mais réelle à l’anglosphère, héritage de son imbrication dans l’ancien Commonwealth britannique et résultat du statut de langue véhiculaire qu’y revêt l’anglais. On s’aperçoit ainsi que l’Inde bascule vers la multipolarité, surtout à cause de ses relations économiques avec la Russie et de sa volonté de « dé-dollariser », mais participe aux manœuvres militaires de l’AUKUS dans la zone indo-pacifique, lesquelles manœuvres visent la Chine. L’Inde entend réactiver les initiatives des « non-alignés » qui avaient joint leurs efforts dès le grand congrès de Bandoeng (Indonésie) en 1955. Le non-alignement avait perdu de son aura : avec la multipolarité qui se dessine à l’horizon, il semble revenir à l’avant-plan avec Narendra Modi.
L’Iran, dont on ne saurait juger la politique extérieure en ne tenant compte que des aspects du régime des mollahs à l’intérieur, a été une grande puissance jusqu’à l’aube du 19ème siècle. Comme l’Inde et la Chine, l’irruption de l’impérialisme anglais dans l’espace des océans Indien et Pacifique a induit un ressac dramatique de la puissance persane, laquelle avait déjà subi les coups de butoir russes dans l’espace sud-caucasien. L’Iran s’est alors retrouvé coincé entre deux empires : celui des Russes puis des Soviétiques, menace terrestre, au nord et surtout dans les zones de peuplement azerbaïdjanais ; celui des Britanniques à l’Est d’abord, dans les régions du Beloutchistan, à l’Ouest ensuite, dès sa présence en Irak suite à l’effondrement de l’Empire ottoman en 1918 et dès sa mainmise sur les pétroles de Mésopotamie (Koweit, Kirkouk, Mossoul).

Comme Atatürk en Turquie post-ottomane, le premier Shah de la dynastie de Pahlavi opte pour une modernisation qu’il ne peut réellement mener à bien malgré des aides européennes (allemandes, italiennes, suisses, suédoises). La neutralité iranienne est violée par les Britanniques et les Soviétiques en 1941, immédiatement après le déclenchement de l’Opération Barbarossa : l’Iran est partagé en zones d’influences et, en 1945, après l’élimination de l’Axe, Staline entend rester dans les régions azerbaïdjanaises, quitte à y faire proclamer une république provisoire qui demanderait bien vite son inclusion dans l’URSS. Le nouveau Shah, dont le père venait de mourir en exil dans les Seychelles britanniques, perçoit le danger soviétique comme la menace principale et s’aligne sur les Américains qui n’ont pas de frontière commune avec l’Iran. Son ministre Mossadegh, qui voulait nationaliser les pétroles de l’Anglo-Iranian Oil Company, est évincé en 1953, suite à des opérations que le peuple iranien n’oublia pas. L’Iran adhère au Pacte de Bagdad ou au CENTO, prolongement de l’OTAN et de l’OTASE, organisant au profit des Etats-Unis et selon les doctrines géopolitiques de Nicholas Spykman l’ensemble du rimland euro-asiatique pour endiguer et l’URSS et la Chine. Le CENTO ne durera que jusqu’en 1958, année où la révolution baathiste irakienne arrive au pouvoir à Bagdad.
La révolution chiite fondamentaliste de 1978-79, dont les avatars actuels sont anti-américains, a d’abord été favorisée par les Etats-Unis, Israël, le Royaume-Uni et la France de Giscard d’Estaing. Le Shah évoquait un « espace de la civilisation iranienne », qu’il entendait faire rayonner sans tenir compte des projets stratégiques américains, avait signé avec la France et l’Allemagne les accords de l’EURATOM (déjà la question du nucléaire !), avait développé une marine en toute autonomie, avait eu des velléités « gaulliennes », avait conclu des accords gaziers avec Brejnev et réussi quelques coups diplomatiques de belle envergure (liens renforcés avec l’Egypte, paix avec les Saoudiens et accords pétroliers avec Riyad, accords d’Alger avec l’Irak pour régler la navigation dans les eaux du Shat-el-Arab). Ces éléments ne sont plus mis en exergue par les médias aujourd’hui et le rôle joué par les Occidentaux dans l’élimination du Shah est délibérément occultée, notamment par une gauche qui fut, à la fin des années 1970, le principal agent de propagande pour justifier, dans l’opinion publique, ces manœuvres américaines contre leur principal allié théorique dans la région.
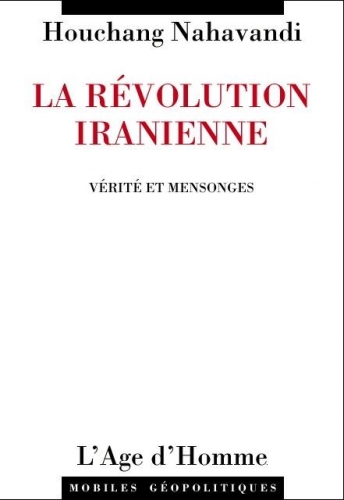
Plusieurs historiens et l’ancien ministre du Shah, Houchang Nahavandi, ont cependant analysé les événements d’Iran en ce sens, ce que j’ai bien mis en évidence dans un texte antérieur (12). Il semble que les services américains aient voulu agir sur deux plans : premièrement, éliminer le Shah qui avait créé une synergie nucléaire et industrielle avec l’Europe et gazière avec l’URSS (l’objectif premier a été de nuire à l’Europe et de ruiner toute coopération énergétique avec l’URSS) ; deuxièmement, installer un régime très différent des régimes occidentaux, ce qui permettait d’orchestrer sans cesse une propagande dénigrante contre lui, de créer une sorte de « légende noire » anti-iranienne, comme il en existe contre l’Espagne, l’Allemagne, la Russie, la Chine ou le Japon qui peuvent être réactivées à tout moment. L’Iran est donc un exemple d’école pour démontrer a) la théorie de l’occupation d’une part du rimland asiatique à des fins d’endiguement ; b) la relativité de la notion d’« allié », dans la pratique américaine, dans la mesure où un « allié », sur le rimland, ne peut chercher à se réinscrire dans sa propre histoire, à développer une diplomatie originale neutralisant des inimitiés que l’hegemon entend laisser subsister pour créer des conflits régionaux affaiblissants, à renforcer son potentiel militaire, à sceller des accords énergétiques avec des pays tiers même alliés (en l’occurrence l’Europe, l’URSS et l’Arabie Saoudite) ; c) la pratique de créer des mouvements extrémistes déstabilisateurs, de les appuyer dans un premier temps puis de les dénigrer une fois leur pouvoir établi et d’organiser boycotts et sanctions contre eux sur le long terme afin de prévenir la réactivation de toutes les synergies autonomes qu’avaient amorcé à feu doux le régime initial.
Ce sont précisément ces exemples d’école, perceptibles dans le cas iranien, qui ont donné aux puissances émergentes (ou réémergentes comme la Russie de l’après-Eltsine) l’impulsion première qui les amènent, aujourd’hui, à joindre leurs efforts économiques. Il convenait d’échapper à ce quadruple danger qu’avait révélé l’histoire iranienne de ces cinquante dernières années. Les stratégies économiques des BRICS, suivies de l’organisation de la nécessaire protection militaire des nouvelles voies ou systèmes de communication, visait à annuler la stratégie d’endiguement en organisant des routes nouvelles reliant le Heartland russo-sibérien aux périphéries (rimlands), les régions orientales de la Chine à l’intérieur des terres (Sinkiang) et au reste de l’Asie centrale (Kazakhstan), les réseaux intérieurs chinois aux ports du Pakistan (et, de là, aux sources arabiques d’hydrocarbures). Ces axes de communications se portent vers l’Europe, réalisant le vieux vœu de Leibniz. Les diabolisations russophobes, sinophobes (etc.) ne permettent pas de créer une diplomatie globale efficace et fructueuse. L’entretien médiatique de « légendes noires » n’est donc pas de mise, comme le soulignaient déjà les « amendements » chinois au programme du « nouvel ordre mondial » dans les années 1990.

La notion d’« allié », battue en brèche par la doctrine Clinton depuis ces mêmes années 1990, n’existe plus en réalité car elle a été bel et bien remplacée par la notion d’« alien countries », ce qui explique l’adhésion aux BRICS d’anciens alliés des Etats-Unis comme l’Arabie Saoudite ou l’Egypte et les velléités turques. Enfin, la pratique de soutenir des mouvements extrémistes déstabilisateurs ou de monter des « révolutions de couleur » ou des « printemps arabes » oblige les puissances du monde entier à une vigilance commune contre l’hyperpuissance unipolaire, allant bien au-delà d’inimitiés ancestrales ou de la fadeur de l’internationalisme simpliste des communismes de diverses moutures. La leçon iranienne a été retenue partout, sauf en Europe.
Il est évident que les BRICS ont leur noyau solide en Asie, plus exactement en Eurasie, l’Afrique du Sud, bien que potentiellement riche, est une projection afro-australe de cette nouvelle grande synergie eurasiatique qui ne pourra être pleinement intégrée à la dynamique si les Etats de la Corne de l’Afrique, dont l’Ethiopie, nouvelle adhérente aux BRICS, retrouvent stabilité et organisent leurs réseaux de communication intérieurs. Le Brésil, où les Etats-Unis ont encore de solides alliés, est certes un géant mais il est fragilisé par la défection de l’Argentine de Miléi. Seules les communications transcontinentales en Amérique du Sud, reliant les littoraux du Pacifique à ceux de l’Atlantique, donneront corps à un véritable pôle ibéro-américain dans la multipolarité de demain. De même, la coopération sino-brésilienne sur le plan de l’agro-alimentaire, sur base d’échanges dé-dollarisés, laisse envisager un avenir prometteur.
La multipolarité en marche dispose d’atouts de séduction réels :
Le gaz russe et les autres hydrocarbures sont incontournables pour l’Europe, l’Inde, la Chine et le Japon. L’effondrement économique de l’Allemagne (but visé par Washington) et de son industrie automobile est dû aux sanctions et au sabotage des gazoducs de la Baltique, renforcé par la politique énergétique inepte dictée par les Verts, téléguidés en ultime instance par le soft power américain et les services de Washington : le refus du nucléaire (et la politique de s’attaquer au nucléaire français) s’inscrit bel et bien dans le cadre d’une vieille politique américaine d’affaiblir l’Europe, le pari sur les énergies solaire et éolienne correspond aux objectifs du fameux « Plan Morgenthau », visant, en 1945, avant la généralisation du Plan Marshall, à transformer le centre du sous-continent européen en une aimable société pastorale, comme l’a souligné avec brio la Princesse Gloria von Thurn und Tassis (13). Ces énergies, dites « renouvelables » ne suffisent pas pour alimenter une société hautement industrialisée.

Autre atout : le blé (14). La fin du communisme et aussi du néolibéralisme en Russie, en 1991 et en 1999, a permis, sous Poutine, de relancer l’agriculture et d’en faire un atout majeur de la politique russe. De même, avant les événements, l’Ukraine, elle aussi, était devenue une puissance agricole qui comptait. Ce blé est indispensable à de nombreux pays d’Afrique, qui, sans lui, risqueraient en permanence la famine et l’exode vers l’Europe d’une bonne fraction de leur jeunesse. La confrontation russo-ukrainienne, outre qu’elle ramène la guerre en Europe, ruine les bénéfices qu’avait apportés la résurrection de l’agriculture dans les anciennes républiques slaves de l’URSS. La coordination des productions agricoles est en voie de réalisation rationnelle dans les pays BRICS, y compris en Inde qui, de vaste pays souvent victime de famines jusque dans les années 1960, est devenu un exportateur de céréales et de riz (15).
La consolidation lente de pays BRICS, malgré les embûches systématiques perpétrés par les services américains, progresse, accompagnée du phénomène de la « dé-dollarisation », qui inquiète les décideurs étatsuniens. Ainsi, le sénateur américain Marco Rubio, de Floride, vient de présenter au Congrès un projet de loi visant à punir les pays qui se désolidariseraient du dollar. Le projet de loi vise à exclure du système mondial du dollar les institutions financières qui encouragent précisément la dédollarisation et utilisent les systèmes de paiement russe (SPFS) ou chinois (CIPS) (16).

Cette pression constante et ces interminables sanctions, procédés éminemment vexatoires, n’empêchent nullement l’ANASE (ASEAN), le marché commun de l’Asie du Sud-Est, de se rapprocher de la Chine et donc du groupe BRICS, détachant ainsi partiellement un marché de 600 millions de clients potentiels des réseaux dominés par les Etats-Unis (17). Des basculements de telle ampleur risquent à terme de réduire considérablement, voire d’annuler, la suprématie occidentale et de la ramener à ce qu’elle était à la fin du 18ème siècle. L’Europe, par son inféodation inconditionnelle et irrationnelle à Washington, risque tout bonnement une implosion de longue durée si elle persiste dans cette alliance atlantique contre-nature. Il est donc temps d’unir les esprits véritablement politiques de notre sous-continent et de combattre les tenants délirants de toutes les nuisances idéologiques, insinués dans les mentalités européennes par le soft power américain. Car l’Europe est perdante sur tous les tableaux.
A l’Est de l’Europe, une guerre lente persiste, handicapant les communications entre des parties du monde qui ont toujours été des débouchés pour nous, depuis la plus haute antiquité : origines steppiques des cultures kourganes, présence grecque en Crimée et à l’embouchure du Don, domination des fleuves russes par les Varègues et présence scandinave dans la place de Bolgar en marge de l’Oural, nécessité des croisades pour reprendre pied dans toutes les régions-portails du Pont, du Levant et du delta du Nil, présence des Génois et des Vénitiens aux terminaux pontiques de la route de la Soie, etc. Une Ukraine qui serait demeurée neutre, selon les critères mis au point lors des pourparlers soviéto-finlandais à partir de 1945, aurait été bénéfique à tous, y compris aux Ukrainiens qui seraient demeurés maîtres de leurs richesses minérales et agricoles (au lieu de les vendre à Monsanto, Cargill et Dupont).
La pire défaite de l’Europe (et de la Russie !) dans le contexte hyper-conflictuel que nous connaissons aujourd’hui se situe dans la Baltique. La Baltique était un espace neutre, où régnait une réelle sérénité : l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN fait de cette mer intérieure du Nord de l’Europe un espace de guerre chaude potentielle. Le territoire finlandais, désormais otanisé, permet de faire pression sur la mer Blanche et sur l’espace arctique, à l’heure où la « route de la Soie maritime » du Grand Nord permettrait de raccourcir considérablement la distance entre l’Europe et l’Extrême-Orient chinois, japonais et coréen, sans compter l’ensemble des pays de l’ANASE.

L’Europe est donc face à un triple verrou : a) le verrou baltique-arctique (avec suppression des gazoducs Nord Stream, et blocage potentiel de la route arctique) ; b) le verrou pontique en mer Noire qui entrave la ligne Danube-Pont-Don-Volga-Caspienne-Iran et que les Russes cherchent à contourner en organisant avec les Iraniens et les Indiens le « Corridor économique Nord-Sud », partant de Mumbai, traversant l’Iran et la Caspienne ou longeant celle-ci à travers l’Azerbaïdjan (18) ; c) le verrou est-méditerranéen ou israélien, qu’il serait judicieux de nommer le « mur hérodien », érigé par les Britanniques et ensuite entretenu par les Américains, afin de créer un chaos permanent au Levant et en Mésopotamie. Les lecteurs de Toynbee et de Luttwak sauront que les rois Hérode de l’antiquité étaient en place grâce à l’appui romain pour contrer toute avancée perse en direction de la Méditerranée : le sionisme israélien est un avatar moderne de ce mur romain, incarné par les rois Hérode. L’énergie russe ne passe plus par les gazoducs de la Baltique ; dans quelques semaines, le gouvernement Zelenski fermera les gazoducs ukrainiens qui amènent le gaz aux Slovaques, aux Hongrois et aux Autrichiens, trois pays récalcitrants dans l’OTAN et l’UE. Il restera le gazoduc turc mais quid si Erdogan pique une crise d’anti-européisme ou si l’Occident américanisé impose des sanctions à Ankara, si la Turquie s’aligne sur les BRICS ou continue à avoir des relations normales avec Moscou ?
Le monde bouge, les cartes sont redistribuées chaque jour qui passe. Cette mobilité et cette redistribution postule une adaptation souple, allant dans nos intérêts. L’Europe n’était pas une aire enclavée mais était ouverte sur le monde. Elle risque désormais l’enclavement. Elle se ferme au risque de l’implosion définitive, parce qu’elle s’est alignée sur les Etats-Unis et a adopté, contre ses intérêts, des idéologies nées aux Etats-Unis : hippisme, néolibéralisme, irréalisme diplomatique (alors que Kissinger préconisait un réalisme hérité de Metternich), wokisme. Il est temps que cela change. La montée des BRICS est un défi, à relever avec des dispositions mentales très différentes, que nous enseignent les grandes traditions pluriséculaires, surtout celles nées aux périodes axiales de l’histoire.
Notes :
- (1) Lire le livre de Jean-Michel Sallmann, Le grand désenclavement du monde 1200-1600, Payot, 2011.
- (2)Ian Morris, Why the West Rules – For Now, Profile Books, London, 2011.
- (3) Gerd-Klaus Kaltenbrunner, « Sigmund von Herberstein – Ein österreichischer Diplomat als ‘Kolumbus Russlands’ », in : Vom Geist Europas – Landschaften – Gestalten – Ideen, Mut-Verlag, Asendorf, 1987.
- (4) Lecture indispensable : Cat Jarman, River Kings. The Vikings from Scandinavia to the Silk Roads, Collins, London, 2021.
- (5) Louis Dupeux, Stratégie communiste et dynamique conservatrice. Essai sur les différents sens de l'expression « National-bolchevisme » en Allemagne, sous la République de Weimar (1919-1933), (Lille, Service de reproduction des thèses de l'Université) Paris, Librairie H. Champion, 1976.
- (6) Otto-Ernst Schüddekopf, National-Bolschewismus in Deutschland 1918-1933, Ullstein, Frankfurt/M-Berlin-Wien, 1972. J’inclus bon nombre de faits, mentionnés par Schüddekopf dans le chapitre intitulé « Conférence de Robert Steuckers à la tribune du ‘Cercle non-conforme’ » (Lille, 27 juin 2014), in : R. S., La révolution conservatrice allemande, tome deuxième, Editions du Lore, s. l., 2018.
- (7) Fiche Wikipedia d’Otto-Ernst Schüddekopf : https://de.wikipedia.org/wiki/Otto-Ernst_Sch%C3%BCddekopf
- (8) Reprint partiel de cette revue « nationale-communiste » : « Aufbruch » - Dokumentation einer Zeitschrift zwischen den Fronten, Verlag Dietmar Fölbach, Koblenz, 2001.
- (9) On lira toutefois la passionnante étude de Kris Manjapra, Age of Entanglement. German and Indian Intellectuals Across Empire, Harvard University Press, Cambridge/London, 2014.
- (10) Robert Steuckers, « Les amendements chinois au ‘Nouvel Ordre Mondial’ », in ; Europa – vol. 2 – De l’Eurasie aux périphéries ; une géopolitique continentale, Bios, Lille, 2017.
- (11) Voir : https://market-insights.upply.com/fr/la-carte-verite-des-...
- (12) Robert Steuckers, « L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du Grand Moyen-Orient » & « Réflexions sur deux points chauds : l’Iran et la Syrie », in Europa, vol. III – L’Europe, un balcon sur le monde, Bios, Lille, 2017. Voir aussi, R. S., « Le fondamentalisme islamiste en Iran, négation de l’identité iranienne et création anglo-américaine », in Europa, vol. II – De l’Eurasie aux périphéries, une géopolitique continentale, Ed. Bios, Lille, 2017.
- (13) Daniell Pföhringer, « Plan Morgenthau et Nord Stream: Gloria von Thurn und Taxis en remet une couche », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/10/08/m...
- (14) Stefan Schmitt, « Les céréales et la guerre », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/07/31/l...; Enrico Toselli, « Le blé ukrainien contre les agriculteurs polonais. Et le blé russe nourrit l'Afrique », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2023/04/14/l...; un point de vue russe sur le problème : Groupe de réflexion Katehon, « La crise du blé et la sécurité alimentaire », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/07/19/l... ; pour réinsérer la question dans une vaste perspective historique : Andrea Marcigliano, « Sur le blé: de l'antiquité à la guerre russo-ukrainienne », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/06/22/s...
- (15) Pour bien comprendre la problématique, ainsi que celle du stockage stratégique du grain (dont la Chine est l’incontestable championne), lire le chapitre IV de : Federico Rampini, Il lungo inverno – False apocalissi, vere crisi, ma nonci salverà lo Stato, Mondadori, Milan, 2022.
- (16) Le dossier présenté par Thomas Röper, sur base d’une analyse d’Asia Times : «La dédollarisation, voie vers la liberté financière mondiale », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2024/09/09/l...; voir aussi : Bernhard Tomaschitz, « Les États-Unis veulent désormais sanctionner les pays qui abandonnent le dollar - Un sénateur veut stopper la dédollarisation progressive par des sanctions », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2024/08/18/l...
- (17) Enrico Toselli, « Pour la première fois, les pays de l'ANASE préfèrent la Chine aux États-Unis en matière d'investissement dans la défense militaire », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2024/04/05/p...
- (18) Arthur Kowarski, « L'Inde intensifie sa coopération avec l'Iran dans le domaine des infrastructures de transport », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2024/05/15/l... ; Pepe Escobar, « L'interconnexion de la BRI et de l'INSTC complètera le puzzle eurasien », http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/08/22/l...
18:21 Publié dans Actualité, Géopolitique, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert steuckers, brics, géopolitique, politique internationale, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 septembre 2025
La question de Staline en Russie aujourd'hui - Empire, mythe et héritage du pouvoir soviétique

La question de Staline en Russie aujourd'hui
Empire, mythe et héritage du pouvoir soviétique
Alexander Douguine
Alexander Douguine retrace comment une figure, celle de Staline, est devenue, dans l’imaginaire russe, à la fois empereur, bourreau et légende.
L’immense popularité de Staline dans la Russie contemporaine est un phénomène complexe.
L’évaluation positive de Staline par la majorité du peuple est liée à plusieurs facteurs :
- Les succès évidents de l’URSS sous sa direction: essor économique, égalité matérielle, victoire dans la guerre, acquisitions territoriales et attitude ferme et impitoyable envers les élites dirigeantes (que le peuple a toujours détestées).
- La comparaison avec d’autres dirigeants de l’URSS — le chaos et la violence de la Révolution et de la guerre civile, où le romantisme héroïque s’était grandement estompé, rendant Lénine bien moins univoque; la propension à susciter des querelles et la bêtise chez Khrouchtchev; la stagnation et la sénile dégradation progressive de Brejnev. Sur ce fond, Staline apparaît éclatant. Un véritable Empereur.
- Le fait que Staline a été attaqué avec le plus de virulence par les libéraux de la perestroïka et des années 1990, libéraux qui étaient absolument répugnants aux yeux du peuple — ils étaient mesquins, russophobes et corrompus. Comparé à ces petits homoncules nuisibles qui n’ont fait que détruire, trahir, vendre et ridiculiser, Staline apparaissait comme divin. La bassesse de ces critiques libérales a contribué à élever la figure de Staline dans l'imaginaire du peuple.

Dans ce contexte, d’autres aspects de Staline ont été presque totalement oubliés: l’inhumaine cruauté de ses méthodes de prise et de conservation du pouvoir, un machiavélisme hypertrophié, la destruction effective de la paysannerie lors de l’industrialisation et de l’urbanisation, l’imposition d’une idéologie antichrétienne grossière et artificielle, les répressions contre les coupables comme contre les innocents, y compris les enfants, et bien d’autres choses encore.
La position des patriotes russes et de l’Église à l’égard de Staline a été divisée. Sous l’influence des points 1 à 3, et surtout à cause de la haine générale envers les libéraux, non seulement la gauche, mais aussi la droite et même les orthodoxes en sont venus à voir Staline d'un oeil favorable. Ce Staline impérial et mythique a complètement évincé la réalité.
Une minorité de patriotes et de membres de l’Église, cependant, a vu en Staline le bourreau du peuple russe et le persécuteur de l’orthodoxie. Mais précisément à cause de l’anti-stalinisme des libéraux, qui suscitent une répulsion insurmontable chez le peuple, cette position est devenue non seulement impopulaire, mais aussi dangereuse. Quiconque l’exprimait pouvait être accusé de libéralisme, ce qui est la pire des disqualifications pour un Russe — et à juste titre.
Aujourd’hui, le temps d’une évaluation plus équilibrée de Staline n’est toujours pas venu; des mythes idéologiques opposés restent à l’œuvre. Mais ce temps viendra nécessairement. De façon générale, l’histoire russe et notre peuple doivent évaluer sobrement et de façon responsable, dialectique et spirituelle, la période soviétique — ses significations, ses paradoxes, sa place dans la structure russe globale, ainsi que ses chefs et ses personnalités les plus marquantes.
L’obstacle évident à cela est la simple existence des libéraux. Tant qu’ils existent, toute perspective est biaisée et déformée, et aucune analyse sérieuse n’est possible. Ce n’est que lorsqu’ils auront entièrement disparu de notre société que les Russes, libérés de cette infection, pourront se demander: qu’était-ce donc tout cela? Un obscurcissement de la conscience, un effondrement ou une ascension?

Peut-être est-il temps de commencer à discuter de ce sujet non pas en public (en évitant la rhétorique et la polémique à tout prix), mais dans des cercles russes fermés ? Aujourd’hui, tout finit immédiatement sur les réseaux, dans un flux continu, dans le monde extérieur. Pourtant, les questions subtiles et non évidentes exigent une toute autre atmosphère.
Nous avons besoin de cercles russes fermés, de communautés organiques de gens de notre terre et de notre histoire. C’est en leur sein que les significations profondes peuvent être clarifiées. Les Russes doivent apprendre à écouter les Russes et à parler sur un tout autre ton. Trop longtemps, d’autres ont parlé en notre nom, déformant, consciemment ou non, les structures de notre pensée. Cela est devenu une habitude.
La cristallisation de la pensée requiert des conditions particulières. Viktor Kolesov montre que le mot russe dumat’ (« penser ») est formé de la racine um (« esprit ») et d’un préfixe généralisant très ancien d, qui s’est depuis longtemps fondu avec la racine. Ainsi, « penser » (dumat’) veut toujours dire penser ensemble, en cercle. On peut réfléchir (myslit’) seul, mais on ne peut penser (dumat’) qu’avec tous. D’où le nom même de Douma des boyards. Les boyards [l'aristocratie terrienne] se réunissent et pensent ensemble. C’est un cercle russe institutionnalisé.
15:36 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, staline, russie, actualité, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 12 septembre 2025
Winston Churchill et l'élite de l'ombre

Winston Churchill et l'élite de l'ombre
Le Premier ministre britannique était manipulé en coulisses
Sjors Remmerswaal
Source: https://remmerswaal.substack.com/p/winston-churchill-en-d...
Un institut de notre pays (= les Pays-Bas, ndt) a publié un communiqué faisant état d'une élite malveillante qui aurait des plans néfastes à l'encontre de la population. On parle d'un « discours sur l'élite malveillante » car certains de nos concitoyens observent le monde et les événements majeurs en concluant qu'ils ne seraient pas le fruit du hasard, mais feraient partie d'un plan plus vaste visant à nuire délibérément aux Néerlandais. Cette élite serait même déterminée à dominer le monde entier, à opprimer les peuples et à les réduire en esclavage.
Existe-t-il une « élite » qui impose ses choix à la société de haut en bas ? L'idée d'une élite qui, par exemple, dirigerait les politiciens et leur donnerait des ordres semble folle, mais il existe suffisamment d'informations pour affirmer que cela s'est parfois bel et bien produit. C'est le cas, par exemple, de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill. J'ai lu un jour dans un livre – dont j'ai oublié le titre – écrit par un agent des services secrets américains qui avait observé le Premier ministre britannique lors d'une réunion et qui avait eu l'impression qu'il s'agissait d'un haut fonctionnaire qui recevait des ordres d'autres personnes.
 Dans un témoignage de l'avocat Tom Denning (photo, ci-contre), qui occupait pendant la Seconde Guerre mondiale le poste de conseiller juridique de la région nord-est du pays, on donne également la parole à Winston Churchill.
Dans un témoignage de l'avocat Tom Denning (photo, ci-contre), qui occupait pendant la Seconde Guerre mondiale le poste de conseiller juridique de la région nord-est du pays, on donne également la parole à Winston Churchill.
Qui, lors d'une réunion privée, tout en sirotant un verre, rêvait à la guerre qui allait bientôt toucher le Royaume-Uni.
Winston Churchill :
Le temps, l'océan, une étoile guide et une haute cabale ont fait de nous ce que nous sommes (Time and the Ocean and some guiding star and high cabal have made us what we are).
Oui, Churchill parlait d'une élite de l'ombre, qui semble jouer un rôle énorme, orienter la société et avoir fait du pays ce qu'il est aujourd'hui.
C'est l'historien britannique David Irving qui, grâce à des recherches dans les archives, a découvert qui étaient ces personnes, cette élite de l'ombre. Il s'agissait du « Focus », un groupe de riches industriels.
C'est l'historien britannique David Irving qui, grâce à des recherches dans les archives, a découvert qui étaient ces personnes, cette élite de l'ombre. Il s'agissait du « Focus », un groupe de riches industriels, banquiers et anciens politiciens. Selon Irving, ce groupe voulait changer la politique du Royaume-Uni dans le but d'affronter le Troisième Reich dirigé par Adolf Hitler.

À partir de 1936, ils ont payé Winston Churchill afin qu'il puisse se concentrer entièrement sur sa carrière politique. Il s'agissait de sommes d'argent considérables qui lui ont permis de conserver et de payer ses maisons et son personnel. Dès les premiers versements, Churchill a cherché la confrontation avec le Troisième Reich, ce qui était clairement le souhait du groupe qui le finançait.
Sources :
# The Family Story - Lord Denning
# They bought him - David Irving
19:38 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, winston churchill, grande-bretagne, royaume-uni |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 septembre 2025
Socialisme ou domination mondiale

Socialisme ou domination mondiale
Peter Backfisch
En 1906, l’historien de l’économie et réformateur social Werner Sombart publia son ouvrage « Pourquoi n’y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis ? » Initialement influencé par Karl Marx, Friedrich Engels voyait en lui « le seul professeur qui ait vraiment compris Le Capital ». Il s’intéressa par la suite aux théories de Max Weber et écrivit sur les développements du capitalisme au XIXe siècle et au tournant du siècle, en plaçant les mouvements sociaux au centre de ses recherches. Après sa visite à l’Exposition universelle de Saint-Louis en 1904, accompagné de Max Weber, il devint clair pour lui que le prolétariat ne renverserait pas le capitalisme. Il relata ses expériences dans le livre mentionné ci-dessus. Cette question sera le point de départ de cet essai.

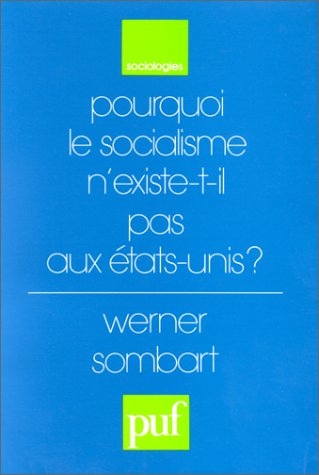
Les États-Unis sont restés, même après leur guerre d’indépendance contre les colonisateurs britanniques, l’enfant de leurs géniteurs européens ; on pourrait même dire, leur enfant raté. Précisément parce que le développement du mode de production capitaliste a commencé immédiatement après la paix avec les Britanniques et la fondation de l’État, les États-Unis sont à considérer dès le début comme la première civilisation de gauche du monde ou, comme l’a formulé Alexandre Douguine, une « expérience de la modernité ». Dans leurs fondements idéologiques marqués par le libéralisme, ils ont prôné une société fondée sur la liberté individuelle et la garantie du droit. Cependant, pour les populations autochtones et les esclaves africains, les droits de liberté inscrits dans la loi ne s’appliquaient pas dès le départ. Même les ouvriers blancs pauvres et les paysans ont été confrontés, durant les 140 premières années, à l’absence de droits et à l’exclusion.
Dès le début, les chefs de la révolution se méfiaient de la populace pauvre, qu’ils voyaient dans les immigrants blancs affluant dans le pays et les soldats démobilisés. Les esclaves et les Indiens n’étaient pas un sujet dans les premières années, car les idées révolutionnaires n’exerçaient aucune attraction sur eux. La première étape concernait la répartition des terres confisquées aux loyalistes en fuite. Les grandes terres, surtout celles de valeur, passaient immédiatement, pour l’essentiel, entre les mains des chefs de la révolution et de leurs partisans. Une certaine quantité de terre, de petites parcelles, était néanmoins réservée aux paysans afin de constituer une base de soutien relativement solide pour le nouveau gouvernement. L’énorme richesse en ressources de la Nouvelle-Angleterre rendit possible que des ouvriers manuels, des travailleurs, des marins et de petits paysans soient gagnés aux nouvelles idées grâce à la rhétorique révolutionnaire, à la camaraderie du service militaire et à l’attribution de petites parcelles de terre, permettant ainsi la naissance d’un « esprit pour l’Amérique ». Mais le plus grand groupe de sans-terre ne pouvait survivre qu’en tant que métayers sur les vastes domaines des grands propriétaires fonciers et ne pouvait pas nourrir leur famille avec les récoltes. Dès 1776, il y eut les premières « révoltes de métayers » contre les immenses domaines féodaux.

Dans le Sud du pays, les grandes plantations se développaient, tandis qu’à l’Est, les premières usines et organisations commerciales apparaissaient, qui accélérèrent l’industrialisation jusqu’en 1850. 75 ans après l’indépendance, en Nouvelle-Angleterre, quinze familles (« Associates ») contrôlaient 20 % des filatures de coton, 39 % du capital d’assurance dans le Massachusetts et 40 % des réserves bancaires à Boston. Les industriels étaient devenus puissants et s’organisaient. Pour les artisans et les ouvriers, ce fut un processus bien plus difficile et long. Les voix refusant de plus en plus l’ordre social et politique se faisaient plus nombreuses, car la pauvreté s’étendait et s’aggravait même. Les formes de résistance, sous la forme de grandes grèves, restaient encore limitées localement et n’étaient pas organisées collectivement ; il manquait encore des associations ouvrières et des syndicats.
Avec l’éclatement de la guerre de Sécession, les questions nationales prirent le pas sur les questions de classes. Les partis politiques réclamaient du patriotisme pour la cause nationale et la mise de côté des intérêts égoïstes, occultant ainsi les causes économiques de la guerre civile, et surtout le fait que c’était le système politique lui-même et ses bénéficiaires, les classes riches, qui étaient responsables des problèmes sociaux croissants.
Les antagonismes de classes persistèrent et s’accrurent rapidement, ce qui, immédiatement après la guerre civile, mena à des affrontements sociaux encore plus vifs, atteignant un premier sommet avec la grande grève des cheminots de 1877 à Saint-Louis. À la fin, on dénombrait une centaine de morts, un millier d’ouvriers furent arrêtés et emprisonnés. Parmi les 100.000 grévistes, la plupart furent licenciés et se retrouvèrent au chômage. Cette grande grève attira beaucoup d’attention en Europe ; Marx écrivit à Engels : « Que penses-tu des ouvriers des États-Unis ? Cette première explosion contre l’oligarchie associée du capital depuis la guerre civile sera bien sûr à nouveau réprimée, mais pourrait très bien être le point de départ d’un parti ouvrier. » (Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis, p. 244).
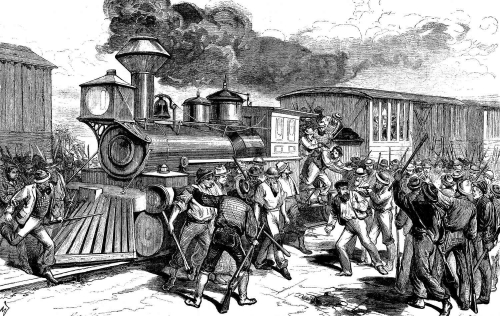
La grève de 1877 fut la première grande grève aux États-Unis menée par un parti ouvrier. Il était encore minuscule et seulement local, mais il eut une grande influence sur la fondation de nombreux syndicats dans les années 1880. Ceux-ci organisèrent de plus en plus la résistance des travailleurs. Les premières revendications pour l’instauration d’un ordre socialiste se firent plus fortes. Le mouvement s’est doté de leaders devenus célèbres bien au-delà des États-Unis, tels qu’Alexander Berkman, Emma Goldman et Eugene Debs (photo, ci-dessous), président du parti socialiste des États-Unis et cinq fois candidat à la présidence. Berkman et Goldman jouèrent ensuite un rôle de premier plan dans la révolution russe de 1917 et 1918. Après avoir soutenu la révolte des marins de Cronstadt contre le pouvoir soviétique en 1918, ils furent expulsés par les bolcheviks vers les États-Unis, bien qu’il fût connu qu’ils y seraient arrêtés.
 Dans les années 1880 et 1890, les forces productives étaient si développées et la situation de la classe ouvrière si misérable qu’une situation régnait qui aurait pu mener à une révolution socialiste. « Des centaines de milliers d’Américains commencèrent à penser au socialisme. » (Howard Zinn, ibid., p. 330.) En Europe, la situation avait déjà été désamorcée par l’introduction des droits des travailleurs et des normes sociales. Nous revenons ici à la question posée par Sombart : « pourquoi n’y a-t-il jamais eu de socialisme en Amérique ? » Aujourd’hui, nous savons qu’il n’aurait jamais pu exister. Quelles en étaient les raisons ?
Dans les années 1880 et 1890, les forces productives étaient si développées et la situation de la classe ouvrière si misérable qu’une situation régnait qui aurait pu mener à une révolution socialiste. « Des centaines de milliers d’Américains commencèrent à penser au socialisme. » (Howard Zinn, ibid., p. 330.) En Europe, la situation avait déjà été désamorcée par l’introduction des droits des travailleurs et des normes sociales. Nous revenons ici à la question posée par Sombart : « pourquoi n’y a-t-il jamais eu de socialisme en Amérique ? » Aujourd’hui, nous savons qu’il n’aurait jamais pu exister. Quelles en étaient les raisons ?
Les guerres offrent toujours aux gouvernants la possibilité de réunir le peuple autour d’un certain patriotisme. Ainsi, les conflits militaires et économiques entre les États-Unis et le Royaume d’Espagne menèrent en 1898 à une guerre qui aboutit à la prise de possession de Cuba, Porto Rico et Guam. À l’époque, il n’était pas clair si ces territoires seraient jamais rendus. En 1899, cette guerre se prolongea avec les Philippines. On estime que 200.000 à 1.000.000 de civils y trouvèrent la mort. La guerre dura jusqu’en 1902 et s’acheva également par l’annexion de l’île.
Au tournant du siècle, se forma le premier syndicat ouvrier à l’échelle des États-Unis, l’American Federation of Labor (AFL). Dès le début, d’importants défauts apparurent, nuisant à une morale de combat unifiée et efficace : presque tous les membres étaient des hommes, presque tous blancs, presque tous ouvriers qualifiés. Les attitudes racistes envers les Noirs étaient répandues. Les dirigeants percevaient de hauts salaires et côtoyaient les employeurs, menant un mode de vie axé sur la consommation. Il est attesté qu’un dirigeant de l’AFL a offert, lors d’un match de baseball, un billet de 100 dollars à celui qui avait retrouvé sa bague en or d’une valeur de 1 000 dollars, billet qu’il tira d’une liasse dans sa poche.

La principale raison de la pacification de la classe ouvrière réside cependant dans le processus de réforme qui s’amorça vers 1904. Le président Theodore Roosevelt y vit le seul moyen de contrer la montée du socialisme. Malgré la résistance des employeurs, des changements législatifs furent introduits, se traduisant par des droits de protection des travailleurs. Les principaux économistes y voyaient la seule possibilité de stabiliser les intérêts de la grande industrie.
Avec l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917, le spectre du socialisme avait définitivement disparu aux États-Unis. Les États-Unis étaient devenus la première puissance mondiale, et la politique fut alors guidée par d’autres intérêts.
Le libéralisme, en tant qu’idéologie de la modernité avec sa promesse quasi-religieuse de salut pour l’humanité, remonte à la toute première colonisation britannique et reçut une consécration idéologique avec la déclaration d’indépendance américaine. Il avait remporté sa première victoire. Jusqu’en 1945, la nouvelle puissance mondiale, alliée à la Grande-Bretagne et à la France, a façonné le monde européen, y compris dans ses colonies. Une transformation majeure survint à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont l’Union soviétique sortit également victorieuse. Dès lors, le monde fut confronté à une configuration bipolaire avec deux superpuissances. Avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, les États-Unis sont devenus « la seule superpuissance mondiale » (Zbigniew Brzezinski).
Allons-nous vers un ordre mondial multipolaire ?
Après les nombreux échecs militaires de l’Occident ces dernières décennies, il est de plus en plus soutenu que l’ordre mondial dominé par les États-Unis est en déclin et sera remplacé par un ordre multipolaire. On attribue aux pays dits BRICS la capacité d’opérer ce changement, car les principaux acteurs – Chine, Inde, Russie, Brésil, Iran et les États arabes – disposent de ressources matérielles adéquates et développent de plus en plus la volonté politique de se soustraire à la domination américaine. En 2009, dix pays se sont réunis pour la première fois à Iekaterinbourg, en Russie, afin de devenir de plus en plus puissants et influents d’ici 2025 (Rio de Janeiro). Aujourd’hui, 40 pays ont manifesté leur intérêt. Fin août 2025, une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a eu lieu à Tianjin, en Chine. Cette alliance de plusieurs pays des BRICS a adopté une déclaration ayant le caractère d’une affirmation géopolitique de soi et formulant des objectifs pour l’avenir. Les points clés du document sont:
- Création d’une banque de développement de l’OCS.
- Pas de prise de position sur les conflits armés actuels comme en Ukraine.
- Réforme des Nations unies.
- Condamnation de la violence dans la bande de Gaza.
- Rejet de la logique des blocs.
- Stabilisation de l’Afghanistan.

Les objectifs formulés dans la déclaration constituent un projet ambitieux. Ils ont le potentiel d’ébranler et d’affaiblir efficacement la domination de l’Occident en général, et celle des États-Unis en particulier. Surtout, l’organisation planifiée de la société sur la base d’un système de crédit social, grâce à une banque de développement propre, agissant indépendamment des influences géopolitiques, renforcera la souveraineté des nations. Il faut toutefois garder à l’esprit que les BRICS et l’OCS sont des alliances pragmatiques, qui fonctionnent de façon fragile sur de nombreux points. Ils ne possèdent pas l’unité civilisationnelle et l’identification dont fait montre l’alliance du G7. Cela ressort particulièrement du point 2 de la déclaration, qui laisse la Russie seule face à son consensus dans la guerre et contre les ingérences occidentales en Ukraine. Une justification invoquant l’unité de l’alliance paraît peu convaincante. La réforme des Nations unies, point 3, avec son Conseil de sécurité, est absolument nécessaire, mais cela ne doit pas conduire à une implication accrue d’États européens comme l’Allemagne, car cela renforcerait encore la surreprésentation occidentale.
Les développements actuels montrent qu’un contrepoids dans le système mondial est en train d’émerger. L’ordre mondial sera refondé et sera multipolaire. Les États-Unis pourront y jouer un rôle. Pour les Européens, il n’y aura probablement pas de place à l’échelle mondiale, tout au plus comme appendice des États-Unis. À moins qu’ils ne se souviennent de leur propre histoire et ne choisissent la voie de la redécouverte de soi.
18:23 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, états-unis, sco, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 août 2025
Douguine sur l'Alaska et la doctrine Monroe eurasienne

Douguine sur l'Alaska et la doctrine Monroe eurasienne
Des erreurs du passé à une nouvelle vision de la puissance russe
Alexandre Douguine évoque la vente de l'Alaska et l'effondrement de l'Union soviétique comme des leçons à tirer de la perte de puissance, appelant à une doctrine Monroe eurasienne pour contrer la domination américaine.
Le célèbre philosophe Alexandre Douguine s'est exprimé sur ce qu'il considère comme la plus grande erreur de la Russie, un acte qui, selon lui, fait passer la vente de l'Alaska pour une capitulation relativement mineure des intérêts nationaux.
Les débats en ligne ont enflammé les esprits à propos de la rencontre prévue cette fin de semaine en Alaska entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump.
Le choix inattendu du lieu a relancé le débat sur la pertinence de la vente de l'Alaska aux États-Unis par la Russie. Les partisans de cette décision soulignent qu'à l'époque, le budget du pays avait été gravement affecté par la guerre de Crimée et que cette vente avait permis de lever des fonds dont le pays avait un besoin urgent. Ces fonds ont été investis dans l'extension du réseau ferroviaire et le développement des régions de l'Amour et du Primorié. L'accord a également renforcé les relations de la Russie avec les États-Unis et affaibli l'influence britannique en Amérique du Nord. En outre, la Russie a acquis les plans et la technologie de production du fusil Berdan, qui a permis le réarmement de l'armée et contribué à venger sa défaite dans la guerre de Crimée pendant la guerre russo-turque.

Les détracteurs rétorquent que l'Alaska a été vendue pour une fraction de sa valeur réelle. La richesse de ses ressources — or et pétrole — vaut plusieurs fois plus, voire plusieurs centaines de fois plus que le prix encaissé suitye à la vente. De plus, cette vente a permis d'affirmer définitivement la doctrine Monroe, une politique américaine déclarant que toute l'Amérique du Nord et du Sud ainsi que les îles des Caraïbes relevaient de la sphère d'influence américaine. Si les bases militaires russes étaient restées en Alaska, elles auraient constitué un puissant moyen de dissuasion pour les États-Unis, qui aujourd'hui attisent les conflits dans le monde entier tout en bénéficiant de la sécurité offerte par la distance géographique et l'absence de menaces directes.
Douguine reconnaît que la vente de l'Alaska était une erreur, que Moscou s'efforce aujourd'hui de compenser en élaborant sa propre doctrine Monroe, qui s'étend à toute l'Eurasie.
Il considère toutefois que les politiques de Mikhaïl Gorbatchev et de Boris Eltsine ont été des erreurs bien plus graves. Le premier a démantelé l'Union soviétique, le second a cédé la Crimée et le Donbass à l'Ukraine, tout en démantelant partiellement et en vendant aux oligarques le grand héritage de l'Union soviétique.
« Une vaste Union eurasienne, voilà notre doctrine Monroe pour l'Eurasie. Ils ont leur propre doctrine Monroe, nous avons la nôtre. Bien sûr, l'Alaska n'aurait pas dû être vendu. Mais même ainsi, ce n'était pas le même genre de folie [de comportement absurde et illogique – NDLR] qui a accompagné Gorbatchev et Eltsine. Car cela dépassait les bornes », a déclaré Douguine.
Il a ajouté qu'aujourd'hui, la Russie attire l'Inde, la Turquie et l'Iran dans son orbite tout en restaurant progressivement son influence sur les territoires de l'ancien Empire russe, rendant ainsi de plus en plus viable une version eurasienne de la doctrine Monroe.
Il a été annoncé précédemment que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine tiendraient une réunion bilatérale en Alaska à la fin de la semaine pour discuter de l'Ukraine. Certains experts estiment que le choix du lieu n'est pas fortuit. Premièrement, l'Alaska rappelle une époque où la Russie et les États-Unis étaient alliés contre la Grande-Bretagne. Deuxièmement, cela indique que ces négociations sont désormais une affaire exclusivement américaine et russe, l'Europe étant exclue de la table des négociations après avoir alimenté le conflit par tous les moyens pendant quatre ans.
20:47 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, états-unis, alaska, histoire, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


