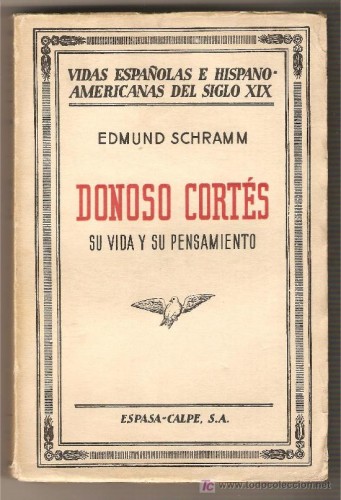Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Robert STEUCKERS:
Présentation des options philosophiques et politiques de “Synergies Européennes”
Lande de Lüneburg, 5 avril 1997
Pourquoi le terme “synergie”?
Pourquoi avons-nous choisi, pour désigner notre mouvement, d'adopter le terme de “synergie”, et non pas un autre terme, plus politique, plus ancré dans un champ idéologique clairement profilé? Pourquoi employons-nous un vocable qui ne laisse deviner aucun ancrage politique précis? En effet, la notion de “synergie” ne se laisse ancrer ni à droite ni à gauche. Au départ, “synergie” est un concept issu de la théologie, tout comme, d'ailleurs, tous les autres concepts politiques, même après la phase de neutralisation des effervescences religieuses qu'a connue la modernité à ses débuts, au XVIIième siècle. Pour Carl Schmitt, tous les concepts prégnants de la politique sont des concepts théologiques sécularisés. Dans le langage des théologiens, une “synergie” s'observe quand des forces différentes, des forces d'origines différentes, de nature différente, entrent en concurrence ou joignent leurs efforts pour atteindre en toute indépendance un objectif commun. Nos objectifs principaux, dûment inscrits dans notre charte, visent, d'une part, la liberté et la pluralité dans la vie quotidienne, d'autre part, la capacité de décider en cas de situation exceptionnelle. L'erreur des idéologies dominantes de ce siècle, c'est justement d'avoir pensé séparément la liberté de la décision.
- Ou bien l'on croyait, avec Kelsen notamment, que l'effervescence et les turbulences du monde cesseraient définitivement et qu'une ère de liberté éternelle s'ouvrirait sans que les hommes politiques n'aient plus jamais à prendre de décisions. Fukuyama a réactualisé ce vœu de “fin de l'histoire”, il y a six ou sept ans.
- Ou bien on ne croyait qu'à la seule décision virile, comme les fascismes quiritaires, et on voulait maximiser à outrance la quantité de décisions suivies d'effets “constructifs”; de cette façon, on a contraint certains peuples à vivre dans une tension permanente, obligé les strates paisibles de la société à vivre comme les élites conquérantes ou les soldats sur la brèche, on a négligé l'organisation du quotidien, qui ne postulait nullement cette perpétuelle effervescence de la mobilisation permanente et totale. Les fascismes quiritaires, le national-socialisme n'ont généré ni un droit propre (si ce n'est une opposition systématique aux “paragraphes abstraits”) ni une constitution ni restauré un droit jurisprudentiel à la façon anglaise (au grand dam d'un juriste comme Koellreutter, qui a oscillé entre le droit anglais et le national-socialisme!). Aucun corpus doctrinal de ce siècle, d'après 1919, n'a su ou voulu penser conjointement et harmonieusement ces deux impératifs, ces deux nécessités:
1) se tenir prêt pour faire face aux imprévus qui s'abattent sans cesse sur le monde et sur l'histoire des hommes (ce que voulaient les décisionnistes);
2) organiser le quotidien dans la cohérence, sur le long terme (ce que voulaient les constitutionnalistes).
Une bonne part du débat politique de fond a tourné autour de l'opposition binaire entre “décisionnistes” (assimilés aux fascistes ou aux conservateurs) et “quotidiennistes” (qui survalorisaient l'Alltäglichkeit, le “règne du on”, les jugeant plus “moraux“ parce que leur marque principale était la quiétude). La nécessité d'organiser le quotidien dans la cohérence et sur le long terme n'exclut pas la nécessité impérieuse de la décision, de faire face à l'imprévu ou à la soudaineté.
Un projet politique d'avenir doit donc nécessairement reposer sur une capacité d'appréhension à la fois de la décision et du quotidien. Comment décision et quotidien ont-ils été appréhendés dans les idéologies dominantes de la gauche et de la droite? Pourquoi les modes d'appréhension de ces droites et de ces gauches dominantes ont-ils été insuffisants?
A droite: un fusionisme sans souci des valeurs
Dans le camp des droites, du conservatisme ou du national-conservatisme, il n'y a pas d'homogénéité dans l'appréhension de la liberté (entendue au sens d'absence de mobilisation politique permanente) ou de la décision. Quelques exemples: au temps de la guerre froide, terminée avec l'effondrement du Mur de Berlin en 1989, la liberté, disait-on, surtout aux Etats-Unis, s'opposait au communisme, quintessence de la non-liberté et idéologie fortement mobilisatrice. Hannah Arendt écrivait que le stalinisme, au début des années 50, était l'incarnation de l'“autoritarisme”, qui avait pris, jadis, tour à tour, un visage clérical, militariste, fasciste, etc. A la fin des années 50, pour faire pièce aux gauches étatistes, communistes, socialistes ou keynésiennes, le monde politique américain lance l'expérience du “fusionisme”, soit l'alliance des conservateurs anti-communistes et des libertaires anti-autoritaires, c'est-à-dire des partisans d'une société civile sans élites mobilisatrices et quiritaires, axée sur l'économie, le commerce et la technique, et les partisans d'une sorte de “leisure society”, propre des rentiers et des artistes situés en dehors de tout circuit économique fonctionnant. Dans ce fusionisme, la question des valeurs reste sans solution. Parce que les valeurs habituellement attribuées au conservatisme, comme le sens du devoir, se marient mal avec les options des libertaires, on fait, par calcul politicien, l'impasse sur la valeur “devoir”, cardinale pour toute philosophie cohérente et stable de la Cité. On se rend forcément compte que la notion de devoir limite la liberté (du moins si on entend par liberté la licence ou la permissivité), ce que n'acceptent pas les alliés libertaires et anarchisants. Du fusionisme découle le conservatisme technocratique, qui se passe de toute référence à des valeurs mobilisantes et cimentantes et esquive de ce fait la question de la justice qui repose inévitablement sur une table de valeurs, située au-delà des intérêts matériels et économiques. Ainsi, les communautés ou les résidus de communauté perdent leur cohésion, en dépit des politiques conservatrices.
Fusionisme et conservatisme technocratique prennent le pas sur les conservateurs axiologiques (Wertkonservativen) ou les conservateurs décisionnistes, ruinant ainsi l'homogénéité de la droite et annonçant à plus ou moins long terme d'autres recompositions (même si elles se font encore attendre). Autres exemples: au niveau de la politique économique, axiologistes et décisionnistes chercheront généralement à inscrire des valeurs dans leur praxis économique. Ils s'opposeront dès lors forcément au néo-libéralisme ou à toute forme de globalisation inscrite sous le signe de cette idéologie strictement économique. Fusionistes et technocrates accorderont la priorité à l'efficacité et tolèreront les pratiques néo-libérales du profit à très court terme, considérant que la globalisation est inévitable et que la société qu'ils sont appelés à gérer n'aura pour seule originalité que d'être une niche particulière parmi d'autres niches particulières dans le processus général de globalisation, une niche qu'on nettoiera de ses particularités et où règneront, finalement, les mêmes principes que ceux de la globalisation.
Des idéologies qui donnent la priorité aux valeurs
En Europe, face à la problématique de l'unification européenne, si l'on donne la priorité aux valeurs, on sera:
- soit un nationaliste hostile à l'eurocratisme, dont le patriotisme nationalitaire sera fondé sur l'appartenance charnelle à une culture précise, héritée des générations précédentes et de l'histoire, cimentée par un jeu de valeurs de longue durée;
- soit un européiste qui considère l'ensemble des peuples européens comme un écoumène civilisationnel de facture chrétienne ou non chrétienne,
- soit un ordo-socialiste ou un socialiste acceptant les règles de l'ordo-libéralisme allemand (le modèle du “capitalisme rhénan” selon Michel Albert).
Le souci des valeurs postule donc implicitement l'alliance prochaine
1) des nationalistes qui auront la force de transcender les limites des Etats-Nations modernes conventionnels,
2) des européistes qui voient d'abord dans l'Europe à la fois un espace stratégique indissociable et un espace de civilisation et de valeurs spécifiques et, enfin,
3) des socialistes enracinés dans la culture industrielle de type “rhénan”, qui donne la priorité à l'investissement industriel par rapport au capital spéculatif, où les impératifs industriels locaux et les structures patrimoniales sont pris en compte concrètement, où les investissements dans l'appareil éducatif ne sont jamais rognés, et où l'on ne bascule pas dans les mirages délocalisés d'une culture économique axée principalement sur la spéculation boursière. La fusion de ces corpus politiques est l'impératif des premières décennies du XXIième siècle. A la fusion technocratisme conservateur/libertarianisme, née dans les années cinquante aux Etats-Unis puis importée en Europe, il faut opposer la fusion de ces trois forces politiques, au-delà de tous les faux clivages, désormais obsolètes.
Nationalistes patriotes, ordo-socialistes et européistes “axiologues” refusent pourtant l'eurocratisme actuel, car celui-ci ne tient nullement compte des valeurs et repose sur ce “relativisme des valeurs” et cet oubli des leçons de l'histoire qui provoquent la déliquescence des sociétés. Si l'européisme peut être un retour à des valeurs fondatrices, renforçant les ressorts de la Cité, l'eurocratisme ne peut que perpétuer le relativisme absolu et la déliquescence sociale.
Si l'on accorde la priorité à l'efficacité économique, on peut être en faveur de l'unification européenne, selon les critères critiquables d'aujourd'hui, mais on ne devra pas oublier que le chômage alarmant est un frein à l'efficacité économique et qu'il découle directement de l'application des principes néo-libéraux, issus du relativisme des valeurs et du refus des héritages historiques. En revanche, une volonté d'efficacité économique pourra s'avérer hostile à l'unification européenne dans les conditions actuelles, car le gigantisme eurocratique réduit l'efficacité là où elle est réellement présente et où elle constitue un barrage contre le chômage pandémique: dans certains tissus agricoles locaux (ce que n'a pas manqué de souligner la FPÖ autrichienne) ou dans certaines entreprises industrielles locales, bien ancrées dans le marché européen mais qui seraient incapables de faire face à une concurrence extra-européenne qui se nicherait dans notre continent, au nom d'un libre-échangisme planétaire ouvrant toutes les portes aux marchandises japonaises ou coréennes, dont le coût est plus bas car il n'inclut ni la sécurité sociale du personnel ni les taxes écologiques visant la protection du patrimoine “environnement” ni un certain réinvestissement dans les réseaux éducatifs.
Sur le plan géopolitique, opter pour le primat des valeurs implique de raisonner en termes de civilisation, de percevoir le monde comme un réseau d'espaces civilisationnels juxtaposés, différents mais pas nécessairement antagonistes. Ces espaces sont animés par une logique intérieure, c'est-à-dire par un système de valeur cohérent et accepté, impliquant pour les hommes harmonie et consensus. Le primat des valeurs implique aussi ipso facto que l'on respecte les valeurs qui animent les espaces voisins du nôtre. Cependant, opter comme les droites néo-libérales (voire les droites “hayekiennes”) pour un primat de l'efficacité, sans tenir compte des valeurs structurantes, ou ne considérer celles-ci que comme des reliquats en voie de disparition graduelle, c'est opter automatiquement pour le système des pseudo-valeurs occidentales modernes et relativistes. Une telle option implique le refus de toutes les valeurs structurantes des civilisations, quelles qu'elles soient, et impose le “relativisme des valeurs”, c'est-à-dire leur négation pure et simple (Benjamin Barber: McWorld contre Djihad!), et, partant, le refus de la valeur “justice” (Rawls).
La gauche tiraillée entre justice et relativisme
Dans le camp de la “gauche” (du moins pour les adeptes des systèmes de classification binaires qui se déclarent tels), il n'y a pas davantage d'homogénéité que dans le camp des droites (pour les binaires d'un autre genre...). Dans cette nébuleuse de gauche, aux contours flous, on est en faveur de l'unification européenne quand on imagine qu'elle est une étape vers l'“Internationale”, désormais mise en équation avec la parousie globaliste. Ou bien on est hostile à cette Europe de Bruxelles et de Strasbourg, parce qu'elle est une Europe capitaliste. Sur le plan géopolitique, face à l'émergence de “blocs civilisationnels”, une gauche sympathique mais en voie de disparition, approuve la consolidation des valeurs dans les aires civilisationnelles voisines des nôtres (islam, animisme africain, bouddhisme, indigénisme hispano-amérindien, etc.), tandis qu'une nouvelle gauche agressive et messianique fait sienne une vulgate militante basée sur les “droits de l'homme”, subtilement raciste car seule cette idéologie, née en Europe du Nord-Ouest, est jugée valable, le reste étant “tribalisme”, injure équivalant désormais de “para-nazisme”.
En conclusion, face à une droite tiraillée entre le sens des valeurs et le néo-libéralisme et face à une gauche tiraillée entre le sens de la justice et l'agressivité occidentaliste et relativiste, force est de constater que les vocables politisés de “gauche” et de “droite” ne recouvrent plus rien de précis, qu'ils ne parviennent plus à séparer réellement des options politiques antagonistes. La droite ou la gauche idéales, pour les uns comme pour les autres, n'existent pas: elles sont des “sites introuvables”, comme l'affirmait Marco Tarchi (in: «Destra e sinistra: due essenze introvabile», Democrazia e diritto, 1/1994, Ed. Scientifiche Italiane).
Sur le plan historique, effectivement, nous découvrons une flopée de figures et de théoriciens importants qui oscillent entre cette droite et cette gauche ou que l'on a fourré dans la boîte de gauche quand ils étaient vivants, pour les fourrer ensuite dans la boîte de droite, quand la mode a changé ou le vent a tourné. Ainsi, Georges Sorel, théoricien socialiste français du début du siècle, appartenait de son vivant à l'ultra-gauche syndicaliste et révolutionnaire. Mais ce syndicaliste-révolutionnaire inspire Mussolini, également classé dans la gauche socialiste et belliciste italienne. Mais, voilà, Mussolini, étatiste et volontariste, est contesté par la gauche parlementariste et déterministe: on le sort de sa boîte de gauche pour l'enfouir dans une boîte de droite, avec son Sorel, son fascisme et ses flonflons. Après 1919, les “révolutionnaires-conservateurs” allemands, Ernst Jünger et Carl Schmitt admirent chez Sorel son sens de la décision et sa théorie de la grève générale insurrectionnelle. Sorel reste donc, malgré son ouvriérisme foncier, dans la boîte de droite: il devient même une figure de la droite radicale en Italie, en France et en Allemagne, après 1945. En France, l'un de ses disciples, Hubert Lagardelle, devient même ministre de Vichy pendant la seconde guerre mondiale.
Il n'existe donc pas d'idées de droite qui n'aient pas été jadis à gauche. Le nationalisme est dans ce cas. Mais il n'existe pas davantage d'idées de gauche qui n'aient pas été ancrées un jour à droite. Cet état de choses doit nous conduire à formuler le jugement suivant: la gauche et la droite sont des concepts dépassés, dans la mesure où elles ne sont pertinentes que dans le cadre d'un régime précis mais uniquement tant que ce régime est accepté par les grandes masses et fonctionne efficacement, tant qu'il peut affronter les vicissitudes du monde en perpétuelle effervescence.
Représentations figées et guerre des looks
Mais tout régime s'use. L'usure de l'histoire est le lot de toutes les constructions politiques. Quand cette usure a fait son œuvre, les gauches et les droites institutionnelles voire leurs dérives plus radicales se figent, deviennent des phénomènes raidis dans un monde qui ne cesse de se mouvoir. A partir du moment où les gauches et les droites institutionnelles ne peuvent plus résoudre les problèmes de société comme le chômage et l'emploi, l'augmentation démesurée des dettes publiques, l'incompétence de la magistrature, la crise de l'enseignement, l'effondrement du consensus, elles ne sont plus que des “représentations” (pour reprendre le vocabulaire de Gilles Deleuze). Des sortes d'images platoniciennes figées que l'on agite comme s'il s'agissait de vérités révélées et immuables ou, plus prosaïquement, que l'on agite avec véhémence comme des pancartes revendicatrices lors de manifestations. Toute l'histoire des “grands récits” (Lyotard) de l'idéologie occidentale du XVIIIième au XXième siècles consiste en une succession de “représentations”: aux représentations conservatrices-cléricales puis bourgeoises, on a opposé la représentation ouvrière-socialiste ou la représentation fasciste ou nationale-socialiste ou verte-écolo. Quand une représentation ne convenait plus à une catégorie de la population, on en fabriquait une nouvelle et on l'opposait aux plus anciennes. Toute la vie politique a consisté ainsi en une guerre des représentations, une guerre des looks. Jusqu'au paroxysme des représentations totalitaires... et surtout jusqu'à la satiété des citoyens.
Cette guerre des looks ne résout rien: on s'en est aperçu et ce fut la fin des “grands récits” (théorisée par Lyotard). Ce type de conflit est insuffisant. Avec Deleuze et ses continuateurs, on s'aperçoit désormais que l'on ne peut pas sans cesse produire et reproduire des représentations, en n'y apportant que de légères retouches. Le monde n'est pas fractionné en camps fermés sur eux-mêmes et détenteurs théoriques de vérités définitives. Le monde, l'histoire, les arènes politiques, les héritages juridiques, les jurisprudences, etc. sont bien plutôt autant de réseaux denses et inextricables, de croissances vitales, d'effervescences organiques ordonnées ou désordonnées mais néanmoins bien présentes et bien réelles, concrètes. Dans ces réseaux, l'homme actif (politiquement, socialement ou existentiellement) doit se tailler, se frayer un chemin à la machette, sich eine Schneise durchhaken, disait Armin Mohler quand il tentait d'expliciter son existentialisme ou son réalisme héroïque (en l'appelant maladroitement “nominalisme”, vocable qu'a rapidement repris Alain de Benoist, son admirateur naïf, collectionneur -ânonneur de vocables non usuels, toujours vainement en quête d'une notoriété qu'il n'a jamais obtenue). La démarche vitale ne consiste donc plus à imposer au dense grouillement du réel des “représentations” figées et naïves, mais de repérer des forces et des opportunités, des passages et des trouées, pour cheminer le plus sûrement, le plus sereinement possible, en dépit des défis fusant de toutes parts.
Complexité, pluralité et démarche archéologique
Cette vision deleuzienne du réel, implique, sur le plan politique concret, de ne plus chercher à répandre des programmes rigides, à se balader dans la société avec sa pancarte ou son affiche sur le ventre, mais à retourner résolument à l'épais sous-bois de l'histoire, où les traits trop simples d'un look idéologico-politique ne valent que ce qu'ils valent: une mauvaise caricature, une gesticulation maladroite. Prendre position politiquement, aujourd'hui, c'est donc plonger plus profondément dans les tréfonds de notre histoire, aller fouiller sous l'humus qui ne recouvre le sol que sur une faible profondeur. Prendre position politiquement aujourd'hui, c'est procéder à une démarche archéologique, c'est faire l'archéologie de notre site de vie. Je vis dans une Cité politique précise qui s'est construite progressivement au fil du temps, qui a généré un appareil juridique/constitutionnel complexe, tenant compte des strates multiples qui composent cette société et récapitulant subtilement dans les méandres mêmes de ses textes et dans les arcanes de ses pratiques les oppositions, fusions et contradictions dont cette société est finalement le résultat mouvant et vivant. Cet entrelac compliqué est précisément le sous-bois auquel il faut retourner et sur lequel il ne faut pas plaquer d'idéologie toute faite. Toute véritable prise en compte de l'histoire du droit dans une Cité interdit les jugements binaires des gauches et des droites ainsi que les simplismes des faux savants qui manient l'idéologie (schématisante) comme d'autres la trique.
La pensée politique doit donc retourner à des œuvres fondamentales, injustement méconnues, comme celles d'Althusius, de Justus Möser, de Wilhelm Heinrich von Riehl et d'Otto von Gierke. Leurs travaux prennent en compte l'ensemble des sociétés, avec toutes leurs différences intérieures, toutes les symbioses qui s'y juxtaposent. Leur pensée juridique, sociale et politique ne peut nullement se résumer à un schématisme binaire, mais exprime toujours de denses complexités, tout en nous apprenant à les explorer sans les mutiler. Le drame de la civilisation occidentale, c'est justement de ne pas s'être mis à l'écoute de ses œuvres depuis deux ou trois cents ans. Pour ces auteurs, ce qui compte, c'est le fonctionnement harmonieux/symbiotique ou le développement graduel de la Cité, selon des rythmes éprouvés par le temps, et non pas sa correction forcée et son alignement contraignant sur les critères d'un programme abstrait. Le programme-représentation ne saurait en aucun cas, avec cette pensée politique organique, oblitérer le fonctionnement rythmé et traditionnel d'une société. Tout retour à ces corpus organiques postule de raviver des modèles liés à un site géographique, de faire revivre, vivre et survivre des héritages et non pas d'imposer des “choses faites”, des choses relevant de la manie moderne de la “faisabilité” (que Joseph de Maistre nommait plus élégamment l'“esprit de fabrication”). Le sous-bois épais et touffu de Deleuze, véritable texture de son “plan d'immanence”, est un héritage, non pas une fabrication. Le sous-bois est un tout mais un tout composé de variétés et de nuances à l'infini: l'attitude qui est pertinente ici n'est pas celle qui est pertinente là. L'homme qui chemine dans ce sous-bois (qui ne mène nulle part, si ce n'est sur la terre même, où il se trouve toujours déjà) doit être capable d'adopter rapidement et tour à tour plusieurs attitudes, de s'adapter plastiquement aux circonstances diverses qu'il rencontre au gré des imprévus: cette vision du monde comme un immense entrelac immanent d'abord, cette nécessité bien perçue de l'adaptation permanente ensuite, sont les deux principales garanties de la pluralité. Quand on pense simultanément entrelac et adaptation, on pense pluriel et on est vacciné contre les interprétations et les représentations unilatérales.
Symbiotique et subsidiarité
Autre avantage pratique: la vision deleuzienne et le recours au filon qui part d'Althusius pour aboutir à Gierke permettent, une fois qu'ils sont combinés, de donner un contenu concret à ce que l'on nomme la subsidiarité. Dans l'article 3b du Traité de Maastricht, les législateurs européens ont prévu le passage à la subsidiarité sur l'ensemble du territoire de l'Union. Mais la définition qu'ils donnent de cette subsidiarité reste imprécise. Et elle est interprétée de diverses façons. En effet, que signifie la subsidiarité pour différents acteurs politiques européens?
- Pour Madame Thatcher et ses successeurs, la subsidiarité n'était qu'un prétexte pour défendre exclusivement les intérêts britanniques dans le concert de l'UE. Certains gaullistes lui ont emboîté le pas, de même que le groupe De Villiers/Goldsmith.
- D'autres espèrent, par antipolitisme, que la subsidiarité va conduire à une balkanisation de l'Europe, à un retour à la Kleinstaaterei incapacitante, car, à leurs yeux, toute capacité politique est un mal en soi.
- Pour d'autres encore, elle n'est qu'un artifice de gouvernement dans un futur Etat européen hyper-centralisé. La subsidiarité conduira à l'intérieur d'une telle Europe à une régionalisation à la française, où les parlements régionaux sont purement formels et n'ont pas de pouvoir de décision réel.
- Pour nous, un projet continental de subsidiarité est un projet de rapprochement des gouvernants et des gouvernés dans tout l'espace européen, visant à instaurer des rapports de citoyenneté féconds, à redonner à la société civile un espace public, où ses dynamismes peuvent réellement s'exprimer et se répercuter dans la vie quotidienne de la Cité, sans rencontrer d'obstacles ou d'obsolescences incapacitantes. Ce projet continental de subsidiarité est indissociable de la question économique. Si l'ancrage politique au niveau des pays est une nécessité pour rétablir les consensus écornés par la déliquescence des valeurs, il doit être concomitant à une “recontextualisation” de l'économie. Si la volonté de “recontextualiser” l'économie, de réancrer les forces économiques sur le lieu même de leur déploiement, si cette recontextualisation redevient la caractéristique principale d'une économie saine, on ne pourra plus parler d'une césure gauche/droite mais d'un clivage opposant les orthodoxies économiques, voire les orthoglossies économiques (consistant à répéter inlassablement les mêmes discours idéologisés sur l'économie), aux hétérodoxies. Pour les historiens français de l'histoire des théories économiques, les orthodoxies sont: 1) l'économie classique (le libéralisme dévié d'Adam Smith, le manchesterisme), 2) le marxisme et 3) la synthèse keynésienne, du moins telle qu'elle est instrumentalisée par les sociaux-démocrates. Toutes ces pensées orthodoxes sont mécanicistes. Face à elles, les hétérodoxies sont très variées: elles ne prétendent pas à l'universalité; elles se pensent comme produits de contextes précis. Elles ont pour sources les réflexions posées par l'école historique (allemande) au XIXième siècle, pour laquelle l'économie se déployait toujours dans des espaces travaillés par l'histoire. Dans une telle perspective, aucune économie ne peut se développer dans un contexte dépourvu d'histoire. Outre l'école historique allemande, les hétérodoxies dérivent des socialistes de la chaire et des institutionalistes américains (dont Thorstein Veblen; les institutions déterminent l'économie, or les institutions, elles aussi, comme le droit, sont produites par l'histoire). Pour François Perroux qui, en France, a fait la synthèse de ces corpus variés, l'économie se déploie au sein de dynamiques de structures, dans des turbulences où s'entrechoquent des forces variées: nous retrouvons là, dans un langage scientifique, avec un appareil mathématique adéquat, ce que le philosophe-poète Deleuze avait appelé le “rhizome”, ce sous-bois, cette jungle du plan d'immanence, dans laquelle l'homme lucide doit repérer et capter des forces.
Parmi ces lucides qui repèrent et captent, il y a bien entendu des hétérodoxes que l'on classe à gauche et d'autres que l'on classe à droite. Mais ce qui importe, dans leurs théories et discours, ce n'est pas le label, mais, plus justement, ce qui fait leur hétérodoxie, soit la volonté de se démarquer du mécanicisme des orthodoxies, de se dégager des impasses politiques dans lesquelles elles ont fourvoyé nos sociétés.
Révolution conservatrice et “événement-choc”
Mais si les questions brûlantes de la politique sont celles de la subsidiarité, de la réorientation de la pensée économique vers les théories hétérodoxes, que reste-t-il de notre engouement pour la “révolution conservatrice”? N'est-il pas le dernier indice d'un ancrage que l'on pourrait labéliser de “droite”? N'est-il pas ce petit “plus” qui permettrait de nous ranger définitivement dans la “boîte de droite”? Premier élément de réponse: ce qui consitue l'essence de la “révolution conservatrice”, ce n'est pas tant la dimension proprement conservatrice, c'est-à-dire le maintien de formes anciennes ou la volonté de garder “fixes” et immuables certaines institutions, mais l'attention constante pour l'Ernstfall (le cas d'exception), l'éveil à tout ce qui est soudain (Das Plötzliche), inattendu (Das Unerwartete), l'événement choc vécu en direct et qui appelle une réponse rapide, une décision (Eine Entscheidung). Cette attention et cet éveil ont été considérés comme les marques les plus caractéristiques de la “révolution conservatrice”, rangée à droite dans l'univers des panoplies politiques. Mais l'éveil à ce qui est soudain n'est pas seulement ancré à “droite”. Tant les surréalistes, contestataires et hostiles à toute forme de conservation institutionnelle, que Walter Benjamin y ont été attentifs et lui ont accordé la priorité, le statut d'essentialité, par rapport à la simple et répétitive quotidienneté. On retrouve la même valorisation de l'instant crucial, marqué d'une forte charge d'intensité, chez Carl Schmitt, chez Ernst Jünger, chez Martin Heidegger. Chez Benjamin, le fait de vivre un choc et de gérer ainsi l'irruption de l'imprévu, de vivre sous l'emprise d'une logique du pire, évite le traumatisme incapacitant, permet de vivre et de naviguer dans un monde qui transite de catastrophe en catastrophe.
Focaliser l'attention du personnel politique d'élite sur la soudaineté et l'irréductibilité du particulier face aux prétentions de l'universel, permet justement de ne pas “perdre les pédales”, de ne pas “craquer” devant le constat que l'on est bien forcé de poser aujourd'hui: la fin de l'histoire (Fukuyama), l'advenance d'un temps hypothétique où les décisions seraient devenues superflues, n'arriveront pas. Jamais. Cette non-advenance bien constatable prouve l'inanité des thèses de Kelsen ainsi que des institutions et des pratiques politiques qui en découlent. Elle contraint à penser métaphoriquement le plan du politique comme un sous-bois touffu, comme une masse unique et toujours particulière de sédimentations multiples, inextricablement enchevêtrées, dont témoignent l'histoire du droit, l'histoire constitutionnelle et la jurisprudence. Dans l'enchevêtrement de pratiques juridiques non répressives mais codifiant, décodifiant et recodifiant la convivialité publique (pratiques qui sont de ce fait non punissantes et non surveillantes, pour rappeler ici le travail de Foucault), dans cet enchevêtrement donc, s'expriment des valeurs, sous des oripeaux qui se modifient et s'adaptent au fil du temps, tout en conservant l'essentiel de leur message.
Conclusion
Par conséquent, le projet de “Synergies Européennes” étaye sa revendication de subsidiarité par un recours aux corpus symbiotiques d'Althusius, Möser, Riehl, Gierke, etc. pour organiser et renforcer une quotidienneté organique, dégagée des simplismes politiciens et mécanicistes qu'ont véhiculés la plupart des idéologies du pouvoir en Europe. Cette quotidienneté doit pouvoir s'exprimer dans des assemblées élues par la population de régions historiques, expressions de substrats historiques, juridiques et économiques de longue durée. Ces substrats représentent des “contextes” économiques particuliers, dont la particularité ne saurait être ni altérée ni oblitérée ni éradiquée. Toute volonté d'altérer, d'oblitérer ou d'éradiquer ces substrats participent d'une volonté mécanique de “surveiller” et de “punir”, qui se camoufle souvent derrière des discours iréniques et moralisants. Ces particularités substratiques doivent donc être prises en compte telles qu'elles sont, dans leur complexité que le philosophe-poète compare volontiers à un sous-bois touffu ou à une forêt vierge. Cette complexité est organique et forcément rétive à toute logique mécanique, binaire ou simpliste. Sur le plan économique, elle ne peut être appréhendée que par une pensée de type historique, c'est-à-dire, selon la classification qu'ont opérée les historiens français contemporains de la pensée économique, une pensée “hétérodoxe”.
Mais ce réel pensé comme sous-bois peut le cas échéant subir l'assaut d'aléas mettant ses équilibres particuliers en danger. L'événement-choc, soudain, fortuit, terrible, peut bousculer des équilibres organiques pluriséculaires: ceux-ci doivent toujours être capables de faire face, de cultiver une logique du pire, pour que les chocs qu'ils affrontent ne les détruisent ni ne les traumatisent. Telle est la disposition d'esprit qu'il faut retenir des décisionnistes historiques (Sorel et ses disciples de la “révolution conservatrice”) et de l'œuvre de Walter Benjamin.
Deux pistes pour sortir des enfermements de gauche et de droite et pour accepter la diversité du monde et le divers en nos propres sociétés.
Robert STEUCKERS.
 Présentation de l'éditeur
Présentation de l'éditeur



 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
 sich zu bezeichnen angewohnt hat. Insbesondere sein sowohl wissenschaftlichen Ansprüchen wie allgemeinverständlicher Darstellung gerecht werdendes Buch „Preußen. Geschichte eines Staates“ (1) ist als geschichtliche Einführung bis heute unübertroffen. Eine von Schoeps veranstaltete Preußen-Anthologie „Das war Preußen. Zeugnisse der Jahrhunderte“ wurde im übrigen von Julius Evola ins Italienische übersetzt. (2)
sich zu bezeichnen angewohnt hat. Insbesondere sein sowohl wissenschaftlichen Ansprüchen wie allgemeinverständlicher Darstellung gerecht werdendes Buch „Preußen. Geschichte eines Staates“ (1) ist als geschichtliche Einführung bis heute unübertroffen. Eine von Schoeps veranstaltete Preußen-Anthologie „Das war Preußen. Zeugnisse der Jahrhunderte“ wurde im übrigen von Julius Evola ins Italienische übersetzt. (2)



 In seinem Buch „Gottheit und Menschheit. Die großen Religionsstifter und ihre Lehren“ (Stuttgart: Steingrüben 1950) nimmt Schoeps auch zum Islam Stellung, es hat aber den Anschein, dies geschähe mehr der Vollständigkeit halber als von Interesse oder Kompetenz her. Schoeps reiht einige der Platitüden der Orientalistik über den unoriginellen, allzumenschlichen usw. Propheten des Islam aneinander und charakterisiert den Islam als in seinem Prädestitationsdenken und seiner Schicksalsgläubigkeit „calvinistisch“, was genauso sinnvoll ist, wie das Christentum – unter Ausblendung all seiner anderen Strömungen – als calvinistisch zu bezeichnen. Tatsächlich schreibt Schoeps auch von der entgegengesetzten „pantheistischen“ Strömung, die Einseitigkeit durch eine zweite ergänzend. Denn in Wirklichkeit ist Ibn Arabi als wichtigster Vertreter des esoterischen Islam genausowenig pantheistisch wie Shankara, Meister Eckart oder Lao-Tse, deren grundsätzliche Identität mit seiner „Mystik“ oder vielmehr Gnosis aufgezeigt werden kann. Auch das beklagte „allzumenschliche“ also anscheinend unethische Verhalten des Propheten muß hinterfragt werden, denn es beruht auf einigen späten Hadithen. Träte uns Muhammad als fehlerlose Idealgestalt entgegen, wären die Orientalisten sofort bei der Stelle, um den geschichtlichen Wahrheitsgehalt dieser Stellen in Zweifel zu ziehen. Tatsächlich sind diese Berichte über Fehler und unmoralisches Verhalten aber Hadithen – vorwiegend aus der „Hadithfabrik“ von
In seinem Buch „Gottheit und Menschheit. Die großen Religionsstifter und ihre Lehren“ (Stuttgart: Steingrüben 1950) nimmt Schoeps auch zum Islam Stellung, es hat aber den Anschein, dies geschähe mehr der Vollständigkeit halber als von Interesse oder Kompetenz her. Schoeps reiht einige der Platitüden der Orientalistik über den unoriginellen, allzumenschlichen usw. Propheten des Islam aneinander und charakterisiert den Islam als in seinem Prädestitationsdenken und seiner Schicksalsgläubigkeit „calvinistisch“, was genauso sinnvoll ist, wie das Christentum – unter Ausblendung all seiner anderen Strömungen – als calvinistisch zu bezeichnen. Tatsächlich schreibt Schoeps auch von der entgegengesetzten „pantheistischen“ Strömung, die Einseitigkeit durch eine zweite ergänzend. Denn in Wirklichkeit ist Ibn Arabi als wichtigster Vertreter des esoterischen Islam genausowenig pantheistisch wie Shankara, Meister Eckart oder Lao-Tse, deren grundsätzliche Identität mit seiner „Mystik“ oder vielmehr Gnosis aufgezeigt werden kann. Auch das beklagte „allzumenschliche“ also anscheinend unethische Verhalten des Propheten muß hinterfragt werden, denn es beruht auf einigen späten Hadithen. Träte uns Muhammad als fehlerlose Idealgestalt entgegen, wären die Orientalisten sofort bei der Stelle, um den geschichtlichen Wahrheitsgehalt dieser Stellen in Zweifel zu ziehen. Tatsächlich sind diese Berichte über Fehler und unmoralisches Verhalten aber Hadithen – vorwiegend aus der „Hadithfabrik“ von
 En su condición de superpotencia el gobierno norteamericano dispone de una fuerza militar y de un potencial económico que excepto la Unión Soviética, ninguno de sus adversarios ni todos juntos han podido retar. Ese poder es la base de una enorme influencia política; sin embargo, salvo excepciones, a la mayoría de las administraciones estadounidenses les ha faltado talento para convertir su musculatura en liderazgo autentico y para conducir constructivamente la política exterior con el Tercer Mundo, particularmente con América Latina.
En su condición de superpotencia el gobierno norteamericano dispone de una fuerza militar y de un potencial económico que excepto la Unión Soviética, ninguno de sus adversarios ni todos juntos han podido retar. Ese poder es la base de una enorme influencia política; sin embargo, salvo excepciones, a la mayoría de las administraciones estadounidenses les ha faltado talento para convertir su musculatura en liderazgo autentico y para conducir constructivamente la política exterior con el Tercer Mundo, particularmente con América Latina.











 El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Manoucher Mottaki, denunció hoy “la pasividad” de las grandes potencias en la lucha contra el narcotráfico y subrayó que es un problema que debe ser afrontado con igual intensidad que la piratería en aguas de Somalia.
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Manoucher Mottaki, denunció hoy “la pasividad” de las grandes potencias en la lucha contra el narcotráfico y subrayó que es un problema que debe ser afrontado con igual intensidad que la piratería en aguas de Somalia.



 El manejo comunicacional oculta dos de esas verdades y hace blanco en la tercera, en los que resisten.
El manejo comunicacional oculta dos de esas verdades y hace blanco en la tercera, en los que resisten.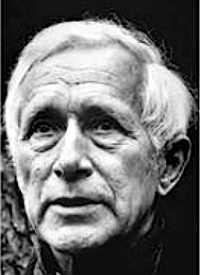
 En el piso de una taberna en los Balcanes, el dueño trazó una raya amarilla: a un lado queda Eslovenia; al otro, Croacia, de modo que quienes piden un bistec de cerdo y una jarra de cerveza en un país de la Unión Europea, salen de las fronteras comunitarias un rato después, en busca de los baños. Y el asunto es motivo de risa para los parroquianos.
En el piso de una taberna en los Balcanes, el dueño trazó una raya amarilla: a un lado queda Eslovenia; al otro, Croacia, de modo que quienes piden un bistec de cerdo y una jarra de cerveza en un país de la Unión Europea, salen de las fronteras comunitarias un rato después, en busca de los baños. Y el asunto es motivo de risa para los parroquianos.