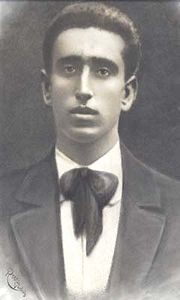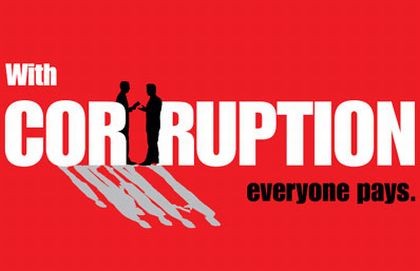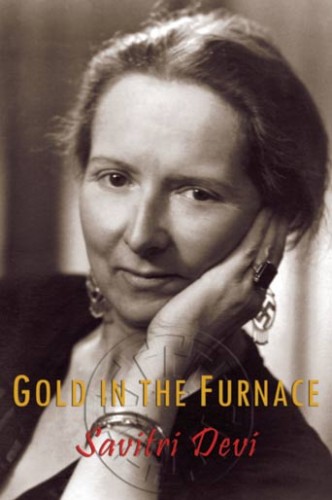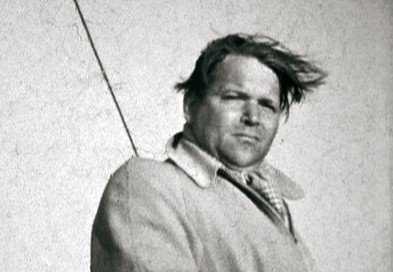vendredi, 22 mai 2009
L. F. Céline : Siegmaringen: quel pittoresque séjour!
Louis-Ferdinand Céline - Siegmaringen : quel pittoresque séjour !
 Peut-être pas encore se vanter, Siegmaringen?... pourtant quel pittoresque séjour!... vous vous diriez en opérette... le décor parfait... vous attendez les sopranos, les ténors légers... pour les échos, toute la forêt!... dix, vingt montagnes d'arbres !... Forêt Noire, déboulées de sapins, cataractes... votre plateau, la scène, la ville, si jolie fignolée, rose, verte, un peu bonbon, demi-pistache, cabarets, hôtels, boutiques, biscornus pour « metteur en scène »... tout style « baroque boche » et « Cheval blanc »... vous entendez déjà l'orchestre !... le plus bluffant : le Château!... la pièce comme montée de la ville... stuc et carton-pâte !... pourtant... pourtant vous amèneriez le tout : Château, bourg, Danube, place Pigalle ! quel monde vous auriez !... autre chose d'engouement que le Ciel, le Néant et l'à Gil!... (1) les « tourist-cars » qu'il vous faudrait !... les brigades de la P. P. ! ce serait fou, le monde, et payant !
Peut-être pas encore se vanter, Siegmaringen?... pourtant quel pittoresque séjour!... vous vous diriez en opérette... le décor parfait... vous attendez les sopranos, les ténors légers... pour les échos, toute la forêt!... dix, vingt montagnes d'arbres !... Forêt Noire, déboulées de sapins, cataractes... votre plateau, la scène, la ville, si jolie fignolée, rose, verte, un peu bonbon, demi-pistache, cabarets, hôtels, boutiques, biscornus pour « metteur en scène »... tout style « baroque boche » et « Cheval blanc »... vous entendez déjà l'orchestre !... le plus bluffant : le Château!... la pièce comme montée de la ville... stuc et carton-pâte !... pourtant... pourtant vous amèneriez le tout : Château, bourg, Danube, place Pigalle ! quel monde vous auriez !... autre chose d'engouement que le Ciel, le Néant et l'à Gil!... (1) les « tourist-cars » qu'il vous faudrait !... les brigades de la P. P. ! ce serait fou, le monde, et payant !Nous là je dois dire l'endroit fut triste... touristes certainement ! mais spéciaux... trop de gales, trop peu de pain et trop de R. A. F. au-dessus!... et l'armée Leclerc tout près... avançante... ses Sénégalais à coupe-coupe... pour nos têtes !... pas les têtes à Dache!... je lis là actuellement tous nos « quotidiens » pleurer sur le sort des pauvres Hongrois... si on nous avait reçus comme eux ! tant larmoyé sur nos détresses, on l'aurait eu belle, je vous dis ! dansé des drôles de claquettes ! s'ils avaient eu au prose l'article 75 ces pathétiques fuyards hongrois Coty les garderait pas souper!... merde!... s'ils étaient simples Français de France il les ferait vite couper en deux!... en dix s'ils étaient mutilos! surtout médaillés militaires ! la sensibilité française s'émeut que pour tout ce qu'est bien anti-elle! ennemis avérés; tout son cœur! masochisse à mort !
Nous là dans les mansardes, caves, les sous d'escaliers, bien crevant la faim, je vous assure pas d'Opérette!... un plateau de condamnés à mort !... 1142 !... je savais exactement le nombre...
Je vous reparlerai de ce pittoresque séjour! pas seulement ville d'eau et tourisme... formidablement historique !... Haut-Lieu!... mordez Château!... stuc, bricolage, déginganderie tous les styles, tourelles, cheminées, gargouilles... pas à croire !... super-Hollywood !... toutes les époques, depuis la fonte des neiges, l'étranglement du Danube, la mort du dragon, la vidoire de SaintFidelis (2), jusqu'à Guillaume Il et Goering.
De nous autres, tous là, Bichelonne avait la plus grosse tête, pas seulement qu'il était champion de Polytechnique et des Mines... Histoire ! Géotechnie !... pardon !... un vrai cybernétique tout seul ! s'il a fallu qu'il nous explique le quoi du pour ! les biscornuteries du Château! toutes ! qu'il penchait plutôt sud que nord?... si il savait? pourquoi les cheminées, créneaux, pont-levis, vermoulus, inclinaient eux plutôt ouest?... foutu berceau Hohenzollern! pardi! juché qu'il était sur son roc ! ... traviole ! biscornu de partout !... dehors !... dedans ! ... toutes ses chambres, dédales, labyrinthes, tout! tout prêt à basculer à l'eau depuis quatorze siècles !... quand vous irez vous saurez !... repaire berceau du plus fort élevage de fieffés rapaces loups d'Europe ! la rigolade de ce Haut-Lieu! et qu'il vacillait je vous le dis sous les escadres qu'arrêtaient pas, des mille et mille « forteresses », pour Dresde, Munich, Augsburg... de jour, de nuit... que tous les petits vitraux pétaient, sautaient au fleuve !... vous verrez !...
Louis-Ferdinand Céline, D'un château l'autre, 1957.
Sur le sujet :
A voir :
>>> Lucette à Sigmaringen, émission Le Fond et la forme de 1971.
A lire :
>>> Céline, Degrelle et quelques autres à Sigmaringen
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, allemagne, france, deuxième guerre mondiale, années 40, seconde guerre mondiale, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un seul peuple de frères - l'Etat dans la littérature
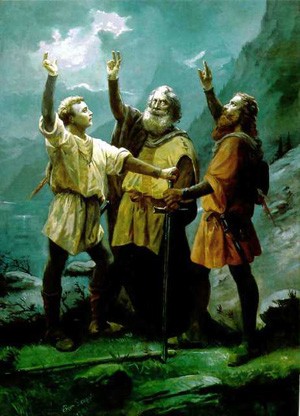
SYNERGIES EUROPÉENNES - Juillet 1988
Un seul peuple de frères - L'Etat dans la littérature
Peter SCHNEIDER, ”... ein einzig Volk von Brüdern”. Der Staat in der Literatur, Athenäum, Frankfurt a.M., 390 S., DM 48.
Le titre de cet ouvrage, c'est la formule du célèbre serment de Rütli, fondateur de la Confédération Helvétique. Etre un seul peuple de frères, tel est le vœu profond de toute nation qui veut for-mer un Etat de citoyens, un Etat fondé sur la volonté commune de tous les citoyens. Dans cette formule, la multiplicité sociale se voit sublimée, les oppositions et les clivages de toutes sortes s'évanouissent dans un néant idéal. Cette aspiration pluriséculaire, qui traverse toute l'histoire européenne, c'est davantage la littérature que la théorie politique qui s'en est fait le véhicule. Schiller, dans son Wilhelm Tell (= Guillaume Tell) opère de manière optimale la fusion entre unité et pluralité au sein des corps politiques: l'individu-personne possède des droits mais de-meure responsable vis-à-vis du tout; ainsi, sans concept rigide, sans corset juridico-philosophique, dans une langue limpide, s'exprime, par le génie du poète, l'instinct politique européen, idéaliste et faisant ta-ble rase de toutes les corruptions. L'œuvre antonymique, c'est l'épopée médiévale de Reineke Fuchs (le Roman de Renard), marquée d'esprit satirique. Aucune volonté communautaire, holiste, ne s'y manifeste et il n'y règne que la ruse et la violence. Si Wilhelm Tell représente l'idéal pur de la psyché politique européenne, Reineke Fuchs exprime sa désillusion, sublimée en satire. Entre ces deux pôles a émergé une quantité de variantes, démontre Schneider: chez Kafka, il perçoit une désillusion noire qui a la nostalgie de l'amitié, manifestation de pro-xi-mité humaine, et aspire à une nouvelle union de la ratio et de la voluntas. Les réflexions de Schneider se poursuivent sur Jerry Cotton, James Bond, Ernst Jünger, Anna Seghers, Friedrich Dürrenmatt et Albert Camus (Robert STEUCKERS).
00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, suisse, littérature, lettres, littérature allemande, lettres allemandes, histoire, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 21 mai 2009
Comité P erg kritisch over geweld politie
Comité P erg kritisch over geweld politie bij VB-betoging
Ex: http://klauwaert.blogspot.com/
Het Comité P heeft zware kritiek op het politieoptreden tijdens de verboden anti-islambetoging op het Brusselse Schumanplein op 11 september 2007. De Vlaams Belangparlementsleden Frank Vanhecke en Filip Dewinter werden toen hardhandig aangepakt. Volgens het verslag van het comité, dat vandaag in de parlementaire begeleidingscommissie besproken werd, was de aanpak chaotisch en werd in sommige gevallen te veel geweld gebruikt.
Geslachtsdelen
Op 11 september 2007 hield het Vlaams Belang een korte manifestatie op het Schumanplein nadat een grote internationale betoging tegen de islamisering van Europa door de Brusselse burgemeester verboden was. Maar die werd na "drie minuten en 18 seconden" hardhandig beëindigd, waarbij Europarlementslid Frank Vanhecke "langs achteren bij de geslachtsdelen vastgenomen" werd en werd Filip Dewinter een pepperspray tegen het gezicht geduwd terwijl hij op de grond lag. Een journalist werd door een politiehond gebeten.
Het Comité analyseerde de opgenomen beelden - 11 dvd's en 8 video's - en hoorde 24 betrokkenen bij de voorbereiding en uitvoering van de ordehandhaving. Uit het rapport van het Comité P blijkt dat de voorbereiding van de manifestatie zeer gebrekkig was, onder meer omdat de burgemeester contact met de organisatoren verbood. Er werden 826 politiemensen ingezet, waarvan 510 uit de politiezones van Brussel en pelotons uit Gent, Antwerpen, Luik en Namen.
Frans
Op de briefing werd slechts een beperkte operatieorder verspreid "vanwege mogelijke lekken naar het Vlaams Belang". De Brusselse pelotons kregen later meer uitleg. Er werd hen gezegd dat ze zich enkel dienden klaar te houden om offensief op te treden. De pelotons uit Antwerpen en Gent bleven passief, en enkel Franstalige agenten kwamen tussen en gaven de manifestanten Franstalige bevelen.
Het Comité P besluit dat het optreden van de politie chaotisch en ongecoördineerd overkwam en dat er duidelijk veel te veel politiemachten op het terrein waren. Bij de aanhoudingsoperatie op het Schumanplein werd in sommige gevallen meer dan de nodige dwang en geweld gebruikt. Dat sommige vrouwelijke aangehoudenen hun bh dienden uit te doen was blijkbaar een persoonlijke fout van één van de bewakende vrouwelijke politiebeambten, stelt het comité nog vast.
De Parlementaire begeleidingscommissie onderschreef de aanbevelingen van het Comité P, onder meer over het op voorhand duidelijk vastleggen van de tolerantiegrenzen. Deze dienen tactisch uitgewerkt te worden en opgenomen in het schriftelijk operatieorder. In dat order moeten ook de verwachte attitude, de bejegening en de procedure bij de aanhoudingen en de geweldsinstructies beschreven worden. Er mag niet van uitgegaan worden dat deze door iedereen gekend zijn, zeker niet als er pelotons deelnemen van buiten de eigen politiezone.
Alternatieven
Daarnaast wordt aangedrongen op het zoeken naar alternatieve scenario's vermits grootschalige aanhoudingen altijd controversieel blijven en operationeel moeilijk te beheren zijn. Er wordt ook aandacht gevraagd voor communicatie, vrijwillige medewerking en de rechten van de aangehouden persoon. De verantwoordelijke officieren en andere politieambtenaren die blijk geven van een onaangepast optreden tijdens de manifestatie moeten geconfronteerd worden met hun optreden en de zich opdringende tucht- of andere maatregelen dienen te worden genomen.
VB tevreden
Het Vlaams Belang reageerde tevreden op het rapport. Filip De Man, lid van de begeleidingscommissie, hoopt dat de partij voortaan wel haar democratische rechten zal mogen uitoefenen in Brussel. (belga/kh)
00:35 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, flandre, violences policières, arbitraire, totalitarisme, censure, bavures, dérapages policiers, ratonnades |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La crisi del dono - Intervista Claudio Risé
di Susanna Dolci - 07/05/2009
Fonte: mirorenzaglia [scheda fonte]
È, Claudio Risé [nella foto sotto], uno degli psicanalisti italiani di ampia fama nazionale ed internazionale. Docente di Scienze Sociali alle Università di Trieste-Gorizia, Insubria (Varese) e Bicocca (Milano), da oltre trent’anni studia l’uomo e la donna ovvero il maschile ed il femminile, nelle loro molteplici sfaccettature. La vita, la famiglia e la genitorialità con particolare attenzione alla figura paterna intesa come assenza o come “mestiere” difficile. I suoi numerosi libri sono stati tradotti in molti paesi europei ed in Brasile. Un spazio internet a disposizione del suo pubblico: www.claudio-rise.it. Esce in questi giorni per le Edizioni San Paolo La crisi del dono. La nascita e il no alla vita. È questo suo nuovo andare in riflessione, una discesa verso le «radici del pensiero che rifiuta la nascita». Un’attenzione di saggia misura sull’aborto inteso come quotidianità di azione da cronaca e da statistica, di battaglia politica, di leggi, di polemica, di giudizi positivi e negativi, di “crimine” addirittura, di orrori legalizzati od illegali e di tanto altro da aggiungere. O da sottrarre… Dipende, sempre, dai punti di vista. Ma il libro non è solo questo… ed è già molto. “La crisi del dono” è una sorta di Summa che non tralascia nulla perché niente vuole lasciare nel silenzio. Tutti gli attori legati alla venuta al mondo vengono chiamati in causa. Siano essi uomini, donne, bambini stessi e dunque padri, madri e figli, miti e mitologie, cambiamento e rinnovamenti, sacro e profano. Spetta, alfine ed in piena libertà, ad ogni singolo lettore decidere a quale cammino interpretativo accingersi. Che oscilla, in presenza, dagli albori temporali come il classico pendolo foucaultiano o la inimitabile quanto terribile spada di Damocle. Tutto sempre e come eterna scelta tra la vita e la morte. Un sentito ringraziamento a Claudio Risé per la sua piena e gentile disponibilità alla realizzazione dell’intervista che segue, nonostante i suoi molteplici impegni.
È stato appena editato dalle Edizioni San Paolo. È il suo “La crisi del dono. La nascita ed il no alla vita”. Lei ci parla di: Mito, Nascita, Figlicidio, Figli, Uomo, Donna, Aborto… E tanto ancora… Se dovesse definire il centro di questo libro, cosa direbbe?
È un libro sulla nascita, come evento fisico, psichico e simbolico, sul suo significato e sulle resistenze che suscita. Molto spesso non la vogliamo (non solo quella fisica), perché ci chiede sempre di cambiare, trasformarci, ri/nascere.
Cos’è veramente l’aborto?
La scelta di evitare una nuova nascita sopprimendo il nascituro. Al di là delle considerazioni morali (non spetta a me giudicare), è una scelta fortemente conservatrice, contro il cambiamento. Dal punto di vista psicologico esprime un’avversione al futuro, alla trasformazione che regge il mondo, cui oppone il potere dell’Io individuale, quello che decide, appunto, l’aborto.
Tra abortire e dare in adozione c’è da sempre in mezzo una montagna invalicabile? Perché?
È invece valicabile; molti la attraversano. Occorre rinunciare al possesso del figlio. Che del resto nessuno ha, perché il figlio appartiene a sé stesso. E, per la persona religiosa, a Dio.
Com’è il mondo in cui viviamo? Cito alcuni termini ricorrenti nei suoi studi e libri: neopaganesimo, narcisismo, droghe, guerra, terrorismo, scontro di etnie ma anche felicità come dono di sé, l’altro. Incubi quotidiani, difetti e pregi di questa nostra esile esistenza. Come affrontare al meglio o meno peggio tutto ciò?
Io racconto solo la psiche delle persone che vedo, la quale a sua volta parla del mondo in cui vivono. Un buon metodo per star bene, conosciuto da sempre, potrebbe essere quello di cercare di essere se stessi, senza continuamente conformarsi, o dipendere dall’approvazione degli altri. Ha dei prezzi, ma ci si guadagna il vivere la propria vita, e non quella altrui, o del sistema di comunicazione dominante.
Uomo? Uomo selvatico? O Maschio? Identità maschile tra essere io e/od altro da proprio sé medesimo? Tra Don Giovanni e Padre?
Consiglio di evitare ogni etichetta, comprese quelle sopra elencate (anche se prese dai miei libri) ed ascoltare chi si è. Che è sempre dentro, non fuori di noi.
La Donna? Mi verrebbe di aggiungere “è mobile….” ma forse è meglio “selvatica”? E d’ingegno? A metà tra forza e mistero dell’eterno archetipo dell’essere femminile? La Grande Madre, terribile eppur generosa?
Idem. Ognuna scopra sé stessa, e la interpreti. Il resto riguarda le altre, non te.
Lei parla della figura del Padre come dono, assenza e mestiere? Chi è un padre?
Un uomo che genera con una donna un figlio, lo protegge e aiuta a crescere quando è piccolo, e poi a diventare se stesso quando è più grande. Una figura elementare, che la natura conosce da sempre.
La natura intesa come mondo selvatico? Ancora respira nel suo esistere?
Sì. Tra le prime leggi firmate dal nuovo Presidente degli Stati Uniti ce n’è una che estende enormemente le aree vincolate a Wilderness, cioè destinate a rimanere incontaminate, già molto estese in quel Paese. E’ una questione di grande attualità, e futuro. Ma naturalmente la Wilderness è ovunque, a cominciare da dentro di noi. Anche qui, si tratta di ascoltarla, e onorarla. E goderla.
Dove vanno i giovani?
Bisognerebbe chiederlo a loro. Io sono vecchissimo.
La comunità vivente ha ancora un suo specifico perché ben definito? È ancora dono e sacrificio?
Senza l’uno, e l’altro, non esiste comunità. Al massimo società, associazioni, club etc.
Famiglia VS divorzio. Anche qui quali i pregi, le colpe e loro effetti collaterali
La famiglia può fallire, così come un bimbo può essere soppresso. Basta si sappia che è un disastro, e non si spacci divorzio ed aborto per cose da niente.
A conclusione. Siamo ancora in grado di trasformarci e rinnovarci? O restiamo in una immobile opposizione che nega l’anelito alla vita?
Non siamo noi a scegliere. È la natura a determinare che tutto, nell’essere umano, cambia continuamente nel corso della vita, le sue cellule, i suoi neuroni, i suoi sentimenti, il mondo intorno a lui. Certo possiamo optare per la sclerosi, mummificarci a vent’anni; molti lo fanno. Sono di solito pazzi, e piuttosto infelici, ma si può fare anche così. Però è meglio seguire, con spirito di avventura e divertimento, il misterioso e sorprendente itinerario che la vita ci propone.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:25 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : crise, don, entretiens, livre, actualité, sociologie, problèmes de sociétés, société, avortement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La littérature abolit le progrès
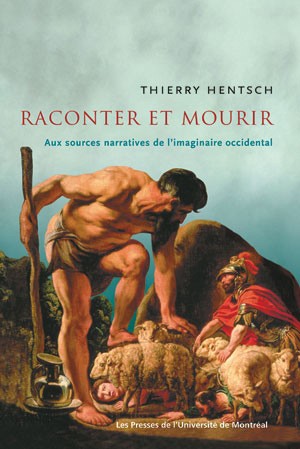
La littérature abolit le progrès
Pierre Le Vigan / http://europemaxima.com/
Thierry Hentsch écrivait : « La mort est la grande affaire de l’homme. Elle est, qu’il le veuille ou non, le révélateur de sa vie, le suprême moment de vérité, l’échéance qui éclaire la vie de son inéluctable avènement. Vie, mort et vérité sont étroitement chevillées les unes aux autres, et la conscience n’échappe à la pensée de cette jonction qu’au prix de sa propre diminution. » Le récit n’est pas la vérité, mais, même quand il est mythique, il n’est pas le contraire non plus de la vérité. Il est un moyen de mieux se comprendre. Ceci a toujours été admis sauf avec le Nouveau Testament, le seul récit qui s’est voulu aussi La Vérité. « Le christianisme accomplit un incroyable exploit. Il réussit à imposer cette antinomie : un récit de vérité », note Thierry Hentsch. C’est le seul Grand Récit ancien qui ne s’est voulu susceptible de ne relever que d’une seule interprétation. Le Nouveau Testament représente ainsi la fin de la gratuité du récit, offert aux libres interprétations, et le début des mono-interprétations, donc des appauvrissements de l’imaginaire.
Il n’en était pas de même, à son origine, du grand récit scientifique. Kant avait écrit que la science ne nous donnait aucune certitude sur les choses en soi. La science a sauté au dessus de ce problème du vrai. Ce qui importe est ce qui est efficace, ce qui fonctionne. C’est ce qui fonctionne qui est vrai, et non ce qui est vrai qu’il importe de faire fonctionner. De cette conception découle une dévalorisation de la littérature, bien vue, par exemple, par Alain Finkielkraut. Car la logique de la littérature n’est pas l’efficacité, c’est le labourage, c’est le sarclage, c’est justement la culture. La littérature s’oppose à deux choses : à la science, et aussi à l’herméneutique. Le postulat de la littérature est que aucune érudition, aussi nécessaire soit-elle, ne confère une autorité en matière d’interprétation. C’est pourquoi, selon le mot de Thierry Hentsch, la littérature « nous délivre de l’idée de progrès » - et c’est d’ailleurs aussi pour cela, pour éviter cette délivrance funeste à notre « productivité » que la littérature tend à ne plus être enseignée. Heidegger n’est pas un « progrès » par rapport à Pascal ou à Montaigne. Ce point concerne aussi l’art, qui ne peut relever du progrès. Il serait insensé de dire que Van Dongen est un progrès par rapport à Lorenzo Veneziano. Si la littérature n’abolit pas le temps, elle abolit le progrès et c’est en cela qu’elle aide enfin chacun à se comprendre dans le temps.
Pierre Le Vigan
Note
1 : Thierry Hentsch, Raconter et mourir. Aux sources narratives de l’imaginaire occidental, Presses de l’Université de Montréal-Bréal, 2002, prix Louis-Pauwels 2003.
00:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Julius Evola: Carlo Michelstaedter
Carlo Michelstaedter
par Julius Evola (dans: Explorations. Hommes et problèmes; Puiseaux 1989)
Carlo Michelstaedter est l'un des auteurs qui ont affirmé, à l'époque moderne, la nécessité pour l'individu de s'élever à l'être, à une valeur absolute en mettant fin à tous les compromis sous lesquels se masque une abios bios, une vie qui n'est pas vie, ne acceptant ce dont l'homme a plus peur que de toute autre chose: se mettre en face de soi, prendre sa propre mesure en fonction, précisément, de l'"être". L'état correspondant à l'être est appelé par Michelstaedter l'état de la "persuasion"; il est défini essentiellement comme une négation des corrélations. Chaque fois que le Moi ne pose pas en soi-même mais dans l'"autre" le principe de sa propre consistance, chaque fois que sa vie est conditionnée par des choses et relations, chaque fois qu'il succombe àdes dépendances et au besoin - il n'y a pas "persuasion", mais privation de valeur. Il n'y a valeur que dans l'existence en soi-même, dans le fait de ne pas demander à l'"autre" le principe ultime et le sens de sa propre vie: dans l'"autarcie", au sens grec du terme. Aussi bien l'ensemble d'une existence faite de besoins, d'affections, de "socialité", d'oripeaux intellectualistes et autres, mais aussi l'organisme corporel et le système de la nature (lequel, en tant qu'expérience, est compris comme engendré, dans son développement spatio-temporel indéfini, par la gravitation incessante en quête de l'être, qu'on ne possédera cependant jamais tant qu'on le cherchera hors de soi) (1), rentrent-ils dans la sphère de la non-valeur.
Le Moiqui pense être en tant qu'il se continue, en tant qu'il ignore la pléntitude d'une possession actuelle et renvoie sa "persuasion" à un moment successif dont il devient par là dépendant; le Moi qui dans chaque instant présent s'échappe à lui-même, le Moi qui ne se possède pas, mais qui se cherche et se désire, qui ne sera jamais dans un quelconque futur, celui-ci étant le symbole même de sa privation, l'ombre qui court en même temps que celui qui fuit, sur une distance entre le corps et sa réalité qui reste inchangée à chaque instant - tel est, pour Michelstaedter, la sens de la vie quotidienne, mais aussi la "non-valeur", ce qui "ne-doit-pas-être". Face à cette situation, le postulat de la "persuasion" est le suivant: l'autoconsistance, le fait de résister de toutes ses forces et à tout moment `a la déficience existentielle, ne pas céder à la vie qui déchoit en cherchant hors de soi ou dans l'avenir - ne pas demander,mais tenir dans son poing l'"être": ne pas "aller", mais demeurer (2).
Alors que la déficience existentielle accélère le temps toujours anxieux du futur et remplace un présent vide par un présent successif, la stabilité de l'individu "pré-occupe" un tempf infini dans l'actualité et arrête le temps. Sa fermeté est une traînée vertigineuse pour les autres, qui sont dans le courant. Chacun de ses instants est un siècle de la vie des autres - "jusqu'à ce qu'il se fasse lui-même flamme et parvienne à se tenir dans le présent ultime" (3). Pour éclairer ce point, il est important de comprendre la nature de la corrélation qui est contenue dans les prémisses: étant donné que le monde est compris comme engendré par la direction propre à la déficience, dont il est comme l'incarnation tangible, c'est une illusion de penser que la "persuasion" puisse être réalisée au moyen d'une consistance abstraite et subjective dans une valeur qui, comme dans la stoïcisme, aurait contre elle un être (la nature expérimentée) dont on peut dire que, pourtant sans valeur, il est. Celui qui tend à la persuasion absolue devraint en fait s'élever à une responsabilité cosmique. Ce qui signifie: je ne dois pas fuir ma déficience - que le monde reflète -, mais la prendre sur moi, m'adapter à son poids et la racheter. C'est pourquoi Michelstaedter dit: "Tu ne peux pas te dire persuadé tant qu'il reste une chose qui n'a pas été persuadée". Il renvoie à la persuasion comme "à l'extrême conscience de celui qui est un avec les choses, qui a en soi toutes les choses: e ounekes".
Pour rendre plus intelligible le problème central de Michelstaedter, on peut rattacher le concept d'insuffisance au concept aristotélicien de l'acte imparfait. L'acte imparfait ou "impur", c'est l'acte des puissances qui ne passent pas d'elles-mêmes (kath auto) à l'acte, mais qui pour cela ont besoin du concours de l'autre. Tel est par exemple le cas de la perception sensorielle: en elle, la puissance de perception n'étant pas autosuffisante, ne produit pas d'elle-même la perception, mais a pour ce faire besoin de la corrélation à l'objet. Or, le point fondamental dont dépend la position de Michelstaedter est le suivant: sur le plan transcendental, l'acte imparfait ne résout qu'en apparance la privation du Moi. En réalité, il la confirme de nouveau. À titre d'exemple, prenons une comparasion. Le Moi a soif; tant qu'il boira, il confirmera l'état de celui qui ne suffit pas a sa propre vie, mais qui pour vivre a besoin de l'"autre"; l'easu et le reste ne sont que les symboles de sa déficience (il importe de fixer l'attention sur ce point: on ne désire pas parce qu'il y a privation de l'être, mais il y a privation de l'être parce qu'on désire - en second lieu: il n'y a pas désir, par exemple celui de boire, parce qu'il y a certaines choses, par exemple l'eau, mais parce que les choses désirées, à l'instar de la privation de l'être qui pousse vers elles, sont créés au même moment par le désir qui s'y rapporte, lequel est donc le prius qui pose la corrélation et les deux termes de celle-ci, la privation et l'objet correspondant, dans notre exemple la soif et l'eau). En tant qu'il se nourrit de cette déficience et lui demande la vie, le Moi se repâit seulement de sa propre privation et demeure en elle, s'éloignant de l'"acte pur" ou parfait, de cette eau éternelle au sujet de laquelle on pourrait citer les paroles même du Christ, eau pour laquelle toute soif, et toute autre privation, seraient vaincues à jamais. Cette appétence, cette contrainte obscure qui entraîne le Moi vers l'extérieur - vers l'"autre" -, voilá ce qui engendre dans l'expérience le système des réalités finies et contingentes. La persuasion, qui va brûler dans l'état de l'absolue consistance, du pur être-en-soi - cet effort a donc aussi le sens d'une "consommation" du monde qui se révèle à moi.
Le sens de cette consommation, il faut, pour l'éclairer, aller jusqu'à des conséquences que Michelstaedter n'a pas complètement développées.
Tout d'abord, dire que je dois pas fuir ma déficience signifie notamment que je dois me reconnaître comme la fonction créatrice du monde expérimenté. De là pourrait suivre une justification de l'Idéalisme transcendental (à savoir du système philosophique selon lequel le monde est posé par le Moi) sur la base d'un impératif moral. Mais on a vu que, selon la prémisse, le monde est considéré comme une négation de la valeur. Du postulat général exigeant que le monde soit racheté, que sa déficience soit assumée, procède donc, toujours comme postulat moral, mais aussi sur le plan pratique, un second point: la négation même de la valeur doit être reconnue, d'une certaine façon, comme une valeur. Cela est important. En effet, si je considère l'impulsion qui a engendré le monde comme une donnée pure, irrationnelle, il est évident que la persuasion, en tant qu'elle est conçue comme la négation de cette impulsion, va en dépendre, donc qu'elle n'est pas absolument autosuffisante mais dépend d'un "autre", dont la négation lui permet de s'affirmer. Dans ce cas, donc dans le cas où le désir même n'est pas réinséré dans l'ordre de l'affirmation de la valeur, mais reste intégralement une donnée, la persuasion ne serait donc pas du tout persuasion - le mystère initial en réduirait inévitablement la perfection à une illusion.
Il faut donc admettre comme postulat moral que l'antithèse même participe, d'une certain façon, de la valeur. Mais de quelle façon? Ce problème amène à inclure dans le concept de persuasion un dynamisme. En effet, il est écident que si la persuasion ne réduit pas à une suffisance pure et autonome - donc à un état - , mais est suffisance en tant que négation d'une insuffisance - donc est un acte, une relation -, l'antithése a certainement und valeur et peut être expliquée ainsi: le Moi doit poser dans un premier moment la privation, la non-valeur, y compris sous la condition òu la privation n'est posée que pour être niée, car cet acte de négation, et lui seul, engendre la valeur de la persuasion. Mais que signifie nier l'antithèse - qui en l'occurence revient à dire la nature? On se rappelle que pour Michelstaedter la nature est non-valeur en tant que symbole et incarnation du renoncement du Moi à la possession actuelle de soi-même, en tant que corrélat d'un acte imparfait ou "impur" au sens défini plus haut. Il ne s'agit donc pas de nier telle ou telle détermination de l'existant, parce qu'on n'atteindrait par là que l'effet, la conséquence, non la racine transcendentale de la non-valeur; il ne s'agit pas non plus d'éliminer en général toute action, car l'antithèse n'est pas l'action en général, mais l'action en tant que fuite de soi, "écoulement" - et il n'est pas dit que toute action ait nécessairement ce sens. Ce qu'il faut résoudre, c'est plutôt le mode - passif, hétéronome, extraverti - d'action. Or, la négation d'un tel mode est constitutée par le mode de l'action autosuffisante, laquelle est aussi puissance - tel est donc le sens du rachat tout à la fois cosmique et existentiel. De même que la concrétisation de la persuasion est le développement d'un monde d'autarcie et de domination; et le moment de la négation pure n'est que le moment neutre entre les deux phases.
Aussi bien le développement des vues de Michelstaedter dans ce qu'on pourrait appeler un "Idéalisme magique" apparaît-il obéir à une continuité logique. En fait, Michelstaedter s'est d'une certaine façon arrête à une négation indeterminée, et ce, en grande partie, pour n'avoir pas considéré suffisamment que le fini et l'infini ne doivent pas être rapportés à un objet particulier ou à une action particulière, mais sont deux modes de vivre n'importe quel objet ou n'importe quelle action. En général, le vrai Maître n'a pas besoin de nier (au sens d'annuler) et, sous le prétexte de la rendre absolue, de réduire la vie à une unité indifférenciée, comme, si l'on veut, dans une espèce de fulguration: l'acte de puissance - qui n'est pas acte de désoir ou de violence - , loin de détruire la possession parfaite, l'atteste et la confirme. Le fait est que Michelstaedter, à cause de l'intensité même avec laquelle il vécut l'exigence de la valeur absolue, ne sut pas donner à cette exigence un corps conret, donc la développer dans la doctrine de la puissance, ce qui pourrait avoir quelque relation avec la fin tragique de son existence mortelle.
Toutefois, c'est Michelstaedter qui a écrit: "Nous ne voulons pas savoir par rapport à quelles choses l'homme s'est déterminé, mais bien comment il s'est déterminé". Au-delá de l'acte, il s'agit donc de la forme ou valeur sous laquelle cet acte est vecú par l'individu. De fait, toute relation logique est, d'une certaine façon, indéterminée, et la valeur est une dimension supérieure où elle se spécifie. L'un des mérites de Michelstaedter, c'est d'avoir réaffirmé la considération selon la valeur dans l'ordre métaphysique: en effet, la "rhétorique" et la "voie vers la persuasion" peuvent être distinguées non d'un point de vue purement logique, mais du point de vue de la valeur. Dans ce contexte, il est très important que Michelstaedter reconnaisse qu'il y a, d'une certaine manière, deux voies. Cette coexistence est elle-même une valeur: car l'affirmation de la persuasion ne peut valoir comme affirmation d'une liberté que si l'on a conscience de la possibilité de l'affirmation comme valeur de la non-valeur elle-même, selon d'indifférence: seul étant libre et infini le "Seigneur du Oui et du Non" (sur cette problématique, cf. notre Teoria dell'Individuo Assoluto, I, 1-5). L'autre justification de l'antithèse dont il a été question plus haut, a évidemment pour présupposé l'option positive pour la "persuasion".
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola, evola, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Encerclement de l'Iran (6/6) + Bibliographie

L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du “Grand Moyen-Orient” (6/6)
par Robert STEUCKERS
L’Iran d’hier et d’aujourd’hui: un obstacle à l’émergence d’un “Grand Moyen Orient” sous domination américaine
Ces réflexions, issues des mémoires de Houchang Nahavandi, nous permettent, enfin, d’énoncer notre deuxième batterie de conclusions.
◊ L’encerclement de l’Iran a pour objectif d’éliminer le dernier obstacle sur la voie de la constitution du marché commun du “Grand Moyen-Orient”. L’Iran en est en même temps la pièce centrale, le centre territorial d’une périphérie qui, au cours de l’histoire, a été plus ou moins influencée par la “civilisation iranienne”. On parle aussi de “Nouvel Orient énergétique” dans la littérature géopolitique et géo-économique actuelle. Avec, en plus, la Corne de l’Afrique (Somalie, Ethiopie, Kenya), cette région correspond à l’USCENTCOM, soit le Commandement américain du “Centre” de la masse continentale eurasiatique, entre le territoire où s’exerce l’USEUCOM, Commandement américain en Europe et en Afrique, et celui de l’USPACOM, le Commandement américain du Pacifique, qui s’étend de l’Inde à la Nouvelle Zélande et de l’Australie au Japon. Dans le Vieux Monde, le “Grand Moyen-Orient” ou “Nouvel Orient énergétique” constitue bien le centre géographique et géostratégique du grand continent “eurafricasien”, dont l’Iran est l’une des pièces maîtresses, constituant de la sorte un espace charnière. La création d’un marché commun dans cette zone, qui servira essentiellement de débouché pour l’industrie américaine en perte de vitesse, qui en fera un nouvel espace de chasse jalousement gardé et en excluera impitoyablement tous autres partenaires, y compris les “alliés” européens, japonais ou indiens. Cette exclusion de tous se devine déjà clairement quand on voit le sort qui a été fait aux deux projets successifs de diversification, émis par les deux Shahs de la dynastie Pahlavi, et elle se constate quand on voit avec quelle célérité les firmes européennes ont été évincées de tous les marchés de reconstruction de l’Irak.
Les bases américaines de l’USCENTCOM encerclent donc l’Iran aujourd’hui et préparent sinon son invasion, du moins son étouffement lent. Notons, à la lumière de l’histoire pluri-millénaire de l’Iran, que l’USCENTCOM occupe précisément tous les territoires dont les empires perses successifs ou les empires non perses maîtres de l’Iran, avant ou après l’Islam ont eu besoin afin de s’assurer un équilibre stratégique ou des frontières “membrées” (pour reprendre la terminologie de Vauban et Richelieu): 1) la Transoxiane, qui correspond à l’Ouzbékistan actuel (avec toutefois un ressac récent, encaissé par les Américains: l’expulsion de la base de l’USCENTCOM en Ouzbékistan à la suite d’une campagne de dénigrement contre le président et le pouvoir ouzbeks, orchestrée par les grandes agences d’Outre-Atlantique); 2) l’Afghanistan, prolongement pré-himalayen et iranophone des empires du plateau iranien, auquel l’Iran récent n’a jamais renoncé (le dernier Shah le souligne, de manière évidente et en caractères gras, dans sa “réponse à l’histoire”, réf. infra); 3) les Américains campent également en Irak, soit dans cette Mésopotamie dont le contrôle a fait la puissance de tous les empires perses et qui était l’enjeu du conflit entre Rome et les Parthes. Dans un tel contexte, l’Iran est condamné à un lent étouffement, à une stagnation irréversible qui génèrera des troubles intérieurs, qui seront immédiatement exploités, amplifiés et répercutés.
L’Iran: éliminé en deux temps – un projet programmé depuis longtemps
◊ L’Iran est l’objectif d’une stratégie de longue haleine, qui s’est déployée en deux temps: d’abord par l’élimination du Shah, de sa politique d’émancipation, d’industrialisation, de diversification commerciale et énergétique (déjà le nucléaire!), d’indépendance nationale et diplomatique, de rayonnement dans l’Océan Indien (jusqu’en Australie) et de sa marine de guerre (aussi modeste ait-elle été face à la colossale puissance maritime américaine). Pour éliminer cet autocrate avisé, on a monté une révolution de toute pièc, en appuyant tous les illuminés marxistes et autres et en sortant du placard un vieux leader religieux démonétisé et inculte. Pour mener à bien cette opération, on a mobilisé tout l’appareil médiatique occidental: du New York Times où Richard Falk décrivait, avec ce lyrisme coutumier des machines propagandistes américaines, l’humanisme de Khomeiny (Piccolomini et Erasme, Mélanchton et von Hutten doivent se retourner dans leurs tombes!), à un Professeur James Cockraft de la Rutgers University qui prévoyait, sous la houlette de Khomeiny, une ère de “liberté totale” et de “multipartisme”, au Sénateur démocrate Edward Kennedy (le frère de l’autre) qui décrivait le Shah comme le pire monstre ayant traîné ses godasses sur notre pauvre vieille terre; d’autres figures entrent dans la danse: le Sénateur Church mène campagne contre l’Iran. George Ball se rend à Téhéran pour exhorter tous les ennemis du Shah à le combattre. En même temps, les Etats-Unis, Israël et la Grande-Bretagne refusent de vendre des matériels anti-émeute à l’Iran, condamnant les forces de police impériales à l’impuissance. Les ondes sont mobilisées: la Voix de l’Amérique, la Voix d’Israël et surtout la BBC se mettent au service de l’opposition au Shah: ce sont ces radios-là qui assurent la logistique des émeutiers en transmettant les ordres des opposants et des mollahs, en donnant heures et lieux des manifestations contre le régime et pour Khomeiny. Le Général Huyser, commandant en chef adjoint des forces de l’OTAN, est envoyé en Iran pour une mission d’urgence: demander au Shah de déguerpir et neutraliser l’armée iranienne. Une fois le monarque parti sous la pression de Huyser, les officiels américains Richard Holbrooke, Leslie Gelb et Anthony Lake rédigent un rapport, dans lequel il est écrit: “Nous avons acquis la certitude que le système de gouvernement théocratique adopté par Khomeiny était de bonne augure pour les intérêts américains” (cité par H. Nahavandi, pp. 199-200).
L’objectif des Américains, en installant une théocratie qu’ils ne prenaient pas au sérieux, était de freiner et d’arrêter le programme militaire autonome de l’Iran, afin que celui-ci ne devienne pas une puissance régionale sur le “rimland” de l’Océan Indien, dans une région qui avait été impériale dans l’antiquité et était de toute évidence prédéstinée à jouer ce rôle, et dont l’influence s’était étendue sur la frange méridionale de la “Terre du Milieu”, décrite par MacKinder dans ses traités de géopolitique. Mieux: l’Iran avait toujours reçu des impulsions constructives de cette périphérie centre-asiatique conquise dès la proto-histoire par les peuples cavaliers indo-européens, dont les cosaques des tsars pouvaient se poser comme les héritiers légitimes. Si l’Iran du Shah Mohammad Reza Pahlavi se dotait d’une armée, qui deviendrait ipso facto la sixième du monde, l’impérialité persane antique pouvait ressusciter et s’allier au plus offrant. Le risque était énorme. Il fallait l’éliminer. Houchang Nahavandi rappelle que l’armée a tenté d’ailleurs de s’opposer à la prise du pouvoir par les théocrates islamistes, y compris une partie du clergé chiite, dont l’Hodjatoleslam Béhbahani, qui arrangua les 300.000 manifestants du 25 janvier 1979, accourus pour témoigner leur solidarité avec l’empereur. Béhbahani sera assassiné quelques jours plus tard. En effet, tout le clergé chiite, exposant d’une religiosité islamo-persane de grande profondeur mystique et historique, n’a pas suivi la révolution islamiste: l’Ayatollah Sayed Kazem Shariat-Madari appelle le Shah et l’armée à la fermeté. Sa position dans la hiérarchie chiite est si élevée qu’il ne sera pas assassiné tout de suite. Il sera arrêté en 1982, torturé, exhibé à la télévision. Il mourra en 1986 sans jamais avoir pu se faire soigner par un médecin de son choix.
Les figures étranges du premier “Conseil de la Révolution islamique”
Houchang Nahavandi note que dans le premier “Conseil de la Révolution Islamique” figurait Mustafa Tchamran, qui possédait la double nationalité, américaine et iranienne, qui fondera les services secrets de la république islamique, puis exercera les fonctions de ministre de la défense. Autant de positions clefs! Il sera assassiné ultérieurement par, dit-on, des “agents contre-révolutionnaires” ou des inconnus posés comme “agents irakiens”. Les auteurs de l’assassinat n’ont jamais été retrouvés. Un hasard? Mieux: Ibrahim Yazdi est aussi un Américano-Iranien. Il devient vice-premier ministre, puis ministre des affaires étrangères du cabinet Bazargan. C’est lui qui présidera les tribunaux révolutionnaires, sera responsable de l’élimination des militaires (généraux Rahimi, à qui il fit couper une main avant son exécution, Pakravan, Moghadam, Khosrodad, Nassiri et Nadji) et de son prédécesseur Abbas Khalatbari, ministre des affaires étrangères des cabinets Hoveyda et Amouzegar. Ce personnage est toujours en vie. Il a éliminé des témoins gênants. Mieux encore: Houchang Nahavandi rappelle que les membres effectifs des conseils secrets ne sont pas connus: parmi eux, combien d’Américano-Iraniens? Autre fait troublant: le nombre ahurissant de ces membres du premier conseil qui ont été assassinés, sans que l’on ne découvre jamais les auteurs de ces éliminations, tous supposés “contre-révolutionnaires”. Houchang Nahavandi rappelle aussi que “plus de 1200 officiers et sous-officiers ont été mis à mort par les révolutionnaires, souvent sans même une parodie de justice (…). 400 autres, presque tous de l’armée de l’air, ont été massacrés deux ans plus tard après la découverte d’un projet de coup d’Etat; dont 128 pilotes brevetés au cours des quarante-huit heures qui ont suivi cette découverte. L’une des plus puissantes et plus performantes aviations militaires du monde fut ainsi réduite à presque rien. Huit mille autres officiers et sous-officiers ont été rayés des cadres sans aucune indemnité”.
Un procédé avéré depuis la révolution française
◊ La deuxième étape de l’élimination de l’Iran se déroule selon un procédé avéré depuis la révolution française. L’historien Olivier Blanc nous a rappelé, dans Les hommes de Londres. Histoire secrète de la Terreur (Albin Michel, 1989), que les services secrets britanniques de Pitt, avaient fomenté des dissensions à l’infini en France, soutenant tout à la fois des royalistes et des républicains extrémistes, afin que règne le chaos dans un pays qui devait être complètement désorganisé, afin de devenir totalement impuissant et surtout de ne plus avoir assez de fonds pour bâtir une flotte et dominer les mers. D’autres diront que les révolutions russes de 1905 et de 1917 ont des origines similaires. Si le pays, visé par une telle stratégie, se rétablit, on participera à toutes les coalitions contre lui. La révolution iranienne entre parfaitement dans ce schéma, correspond à ce “modus operandi”. Le rétablissement d’un nouvel ordre politique, à références “révolutionnaires” permet alors de démoniser le pays: ce fut le cas de la France révolutionnaire et napoléonienne; ce fut le cas de la révolution mexicaine de Pancho Villa (d’abord décrit comme un “sauveur” puis comme un “monstre”); ce fut le cas de la révolution bolchevique. L’Iran n’échappe pas à la règle. Mais l’illégitimité du nouveau pouvoir, républicain en France, bolchevique en Russie, islamiste en Iran, ne lui procure pas la stabilité voulue: il existe des leviers, par le biais de contre-révolutionnaires et de mécontents, pour disloquer sa cohésion, pour entretenir le dissensus, pour le miner de l’intérieur; on peut lui appliquer les techniques du boycott, du blocus ou de l’embargo. On met des bâtons dans les roues de sa diplomatie, on le dénigre dans les chancelleries. Les machines médiatico-propagandistes peuvent dès lors fonctionner à fond et entretenir systématiquement une attitude de réprobation à l’endroit du pays visé. Personne ne se dresse pour le défendre, sans éveiller des méfiances rédhibitoires. Parce que beaucoup de situations de fait inacceptables, beaucoup de faits accomplis relevant de l’arbitraire, beaucoup de déclarations et de proclamations insoutenables, empêchent de le défendre intelligemment.
Tel est le sort de l’Iran, aujourd’hui, au beau milieu du territoire dévolu à l’USCENTCOM. Après la conquête américaine de l’Afghanistan et de l’Irak, l’Iran sait qu’il doit se doter de l’arme nucléaire pour éviter le même sort, bien que l’immensité de son territoire et les effectifs limités de l’US Army le met à l’abri d’une occupation similaire. Les Etats-Unis ne disposent pas vraiment d’alliés dans la région, prêts à s’embarquer dans l’aventure et qui demanderaient des compensations que Washington ne peut offrir, car les Etats-Unis veulent conserver tous les avantages du pays envoyé au tapis pour eux, comme en Irak. Le risque que court l’Iran est d’être étouffé par des blocus et des embargos, tout en subissant des bombardements au départ des bases de l’USCENTCOM. Ces bombardements et ces blocus viseraient à meurtrir profondément la population civile dans sa vie quotidienne, à susciter chez elle une lassitude face au pouvoir islamiste, à provoquer à moyen ou long terme une révolution intérieure, où des éléments disparates —anciens communistes, partisans nostalgiques des Pahlavi, démocrates occidentalistes, minorités ethniques sunnites— entreraient en rébellion ouverte contre le pouvoir islamiste-chiite de Téhéran et d’Ahmadinedjad.
L’Europe ne peut accepter une élimination de l’Iran en tant que nation indépendante
Malgré la réprobation que peut susciter la révolution islamiste, surtout du fait qu’elle a été une fabrication américaine, l’Europe ne peut toutefois accepter une élimination de l’Iran en tant que nation indépendante, autorisée à déterminer sa politique étrangère et son commerce extérieur. Quel qu’en soit le régime. L’Iran est un débouché pour l’Europe et un fournisseur éventuel de pétrole. Il aurait donc mieux valu conserver les relations économiques qui existaient du temps du Shah. Et conserver le maximum de relations commerciales avec le pouvoir islamiste, de façon à occuper le terrain avant tous nos concurrents. L’Europe ne doit pas agir sous la dictée des médias, en apprence indépendants, mais qui obéissent aux injonctions d’une politique étrangère toujours programmée de longue date. Au contraire, Armin Mohler nous enseignait de prendre toujours le contre-pied des programmes d’action induits par la propagande médiatique américaine. Si les Etats-Unis décrètent tel ou tel pays “infréquentable”, ce doit être une raison supplémentaire pour le fréquenter et entretenir avec lui de bonnes relations. Si une telle politique, qualifiable de gaullienne et, mieux, de “mohlerienne”, avait été suivie en 1978-79, le Shah serait resté en place: la sidérurgie européenne en aurait tiré profit et n’aurait pas connu la banqueroute; nous y aurions vendu des armes et des équipements civils, des avions et des navires. Nous aurions pu en investir les bénéfices dans de nouvelles technologies. Nous venons de perdre l’Irak, où les firmes françaises, allemandes et russes ont été exclues du marché, de même que l’agro-alimentaire danois, malgré l’alignement de Copenhague sur la politique de Washington; la cabale des caricatures de Mahomet, bien orchestrée via tous les médias du globe, a exclu l’agro-alimentaire danois, très performant, de tout le futur “Grand Moyen-Orient”. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de perdre l’Iran de la même façon. Ce serait nous couper pour longtemps d’une région importante du monde et ce serait un ressac terrible pour notre économie.
Il reste à espérer que Moscou et Beijing s’opposeront à toute intervention américaine en Iran. Il n’y a rien à attendre de l’Europe d’aujourd’hui. L’axe Paris-Berlin-Moscou n’a été qu’un espoir. Nos dirigeants n’ont pas été à la hauteur de ce projet, mais il fallait s’y attendre. Cependant, pour ceux qui ont encore la volonté et l’honneur de s’insérer dans la continuité de l’histoire européenne, l’Iran demeure l’espace du premier empire de facture indo-européenne, un espace qui a amené les langues et la culture européennes jusqu’à l’Indus et au Gange, et, si l’on tient compte des peuples de cavaliers proto-iraniens, jusqu’au Tarim et sans doute jusqu’au Pacifique voire jusqu’au Japon. De l’Ecosse au Bengale. Des Pyrénées au Pacifique. Une mémoire qui oblige. Devrait obliger. Que nous voulons honorer. L’unité stratégique de cet espace nous donnerait à tous la puissance, nous redonnerait les rênes du monde.
Robert STEUCKERS,
Forest-Flotzenberg / Nancy, novembre 2005.
Bibliographie:
- Franz ALTHEIM, Niedergang der Alten Welt. Eine Untersuchung der Ursachen, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2 Bände, 1952.
- Franz ALTHEIM, Reich gegen Mitternacht. Asiens Weg nach Europa, Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, Bd. 5, Hamburg, 1955.
- Franz ALTHEIM, Entwicklungshilfe im Altertum. Die große Reiche und ihre Nachbarn, Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, Bd. 162, 1962.
- Louis BREHIER, Vie et mort de Byzance, Ed. Albin Michel, Paris, 1969.
- Claire BRIERE / Pierre BLANCHET, Iran: la révolution au nom de Dieu, Seuil, Paris, 1979.
- Z. N. BROOKE, A History of Europe. From 911 to 1198, Methuen & Co., London, 1938-1969.
- Gérard CHALIAND, Guerres et civilisations, Odile Jacob, Paris, 2005.
- Gérard CHALIAND, Atlas du nouvel ordre mondial, Robert Laffont, Paris, 2003.
- Henry CORBIN, Le paradoxe du monothéisme, L’Herne, Paris, 1981-2003.
- Henry CORBIN, Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, 1964.
- Henry CORBIN, L’Homme de Lumière dans le soufisme iranien, Ed. Présence, Sisteron, 1971.
- Vesta Sarkosh CURTIS, Persian Myths, British Museum Press, 1993-1998.
- Alfonso DI NOLA, Der Teufel. Wesen, Wirkung, Geschichte, Diederichs, München, 1990.
- Mohammed-Reza DJALILI, Géopolitique de l’Iran, Ed. Complexe, Bruxelles, 2005.
- Nazir FANSA, Téhéran, destin de l’Occident, Pierre Saurat éd., Paris 1987.
- Karen FARRINGTON, Atlas historique des Empires, Succès du Livre/Maxi-Livres, Paris, 2002.
- R. GHIRSHMAN, Iran from the Earliest Times to the Islamic Conquest, Penguin Books, Harmondsworth, 1954.
- Peter GÖDEKE, Elmar STUCKMANN, Martin VOGT, Kriege im Frieden, Westermann-Aktuell, Braunschweig, 1983.
- René GROUSSET, L’épopée des croisades, Plon, Paris, 1939.
- John R. HINNELLS, Zoroastre et les dieux de la Perse, R. Laffont, Paris, 1988.
- Peter HOPKIRK, The Great Game. On Secret Service in High Asia, OUP, Oxford, 1990.
- Bernard HOURCADE, Iran. Nouvelles identités d’une république, Ed. Belin/Documentation française, Paris, 2002.
- Clément HUART, Louis DELAPORTE, Paul MASSON-OURSEL, L’Iran antique. Elam et Perse. La civilisation iranienne, Ed. Albin Michel, Paris, 1952.
- Shireen T. HUNTER, Iran and the World. Continuity in a Revolutionary Decade, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis, 1990.
- Dimitri KITSIKIS, L’empire ottoman, PUF, Paris, 1985.
- Gerhard KONZELMANN, Die Schiiten und die islamische Republik, Herbig, München, 1979.
- Vladimir KOUZNETSOV & Iaroslav LEBEDYNSKY, Les Alains, cavaliers des steppes, seigneurs du Caucase. Ier-XVième siècles apr. J. C., Ed. Errance, 2005.
- Bernard LEWIS, From Babel to Dragomans. Interpreting the Middle East, Phoenix, London, 2004-2005.
- John MAN, Atlas de l’an Mil. Sociétés et cultures dans le monde: les premiers liens, Autrement, Paris, 2000.
- Colin McEVEDY, The New Penguin Atlas of Ancient History, Penguin Books, Harmondsworth, 2nd ed., 2002.
- Colin McEVEDY, The New Penguin Atlas of Medieval History, Penguin Books, Harmondsworth, 2nd ed., 1992.
- Patrick MERIENNE, Petit atlas mondial du moyen âge, Ed. Ouest-France, 1997.
- Afshin MOLAVI, The Soul of Iran. A Nation’s Journey to Freedom, W. W. Norton & Co., New York/London, 2002-2005.
- M. MOLE, L’Iran ancien, Bloud & Gay, Paris, 1965.
- Jean-Jacques MOURREAU & Catherine MARTINERIE, La Perse des grands rois et de Zoroastre, Ed. Famot, Genève, 1977.
- Claude MUTAFIAN & Eric VAN LAUWE, Atlas historique de l’Arménie. Proche-Orient et Sud-Caucase du VIII° siècle av. J.C. au XXI° siècle, Autrement, Paris, 2001-2003.
- Houchang NAHAVANDI, La révolution iranienne. Vérité et mensonges, L’Age d’Homme, Lausanne, 1999.
- David NICOLLE, Atlas historique de l’islam, Succès du livre/Maxi-Livres, Paris, 2004.
- Walther PAHL, Wetterzonen der Weltpolitik, Goldmann, Leipzig, 1937.
- Mohammad Reza PAHLAVI, Réponse à l’Histoire, Albin Michel, 1979.
- Christiane et Jean PALOU, La Perse antique, PUF, 1967 (Coll. “Que-sais-je?”, n°979).
- E. D. PHILLIPS, Les nomades de la steppe, Sequoia, Paris/Bruxelles, 1966.
- Michel POCHOY, Le Pakistan, l’Océan Indien et la France, Fondation pour les études de défense nationale, Paris, 1991.
- Paul SCHMITZ, All-Islam! Weltmacht von morgen?, Goldmann, Leipzig, 1937.
- Peter SCHOLL-LATOUR, Allah ist mit den Standhaften. Begegnungen mit der islamischen Revolution, DVA, Stuttgart, 1983.
- Gerhard SCHWEIZER, Iran. Drehscheibe zwischen Ost und West, Klett-Cotta, Stuttgart, 1991.
- SOHRAVARDI, L’Archange empourpré. Quinze traités et récits mystiques, traduits du persan et de l’arabe par Henry Corbin, Fayard, Paris, 1976.
- François SUARD, Alexandre le Grand, Larousse, Paris, 2001.
- François THUAL, Géopolitique du chiisme, Arléa, Paris, 2002.
- Jean-Christophe VICTOR / Virginie RAISSON / Frank TETARD, Le dessous des cartes. Atlas géopolitique, Ed. ARTE/Tallandier, 2005.
- The Collins Atlas of Military History, Collins, London, 2004.
- The Collins Atlas of World History, Collins, London, 2004.
Ouvrage paru après la première composition de cet article:
- Jean-Paul ROUX, Histoire de l’Iran et des Iraniens. Des origines à nos jours, Fayard, Paris, 2006.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, moyen orient, grand moyen orient, iran, perse, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 mai 2009
Partijen in overheidsdiensten
Partijen in overheidsdienst
De politieke partijen hebben tijdens de voorbije decennia ongegeneerd in de staatskas gegraaid, met als gevolg dat hun inkomsten vandaag voor 83procent afkomstig zijn van de overheid. Elk jaar vloeit 53 miljoen euro van de belastingbetaler naar de partijen. Politieke partijen zijn daardoor parastatale organisaties geworden, die uit de hand eten van de overheid. Helemaal problematisch wordt het wanneer de gevestigde partijen die overheidsfinanciering ook gaan misbruiken als een politiek wapen om hun concurrenten onderuit te halen.
In 2003 verloren zowel Agalev als de N-VA hun dotatie. Dit betekende voor beide partijen een enorme financiële aderlating en bracht hen op de rand van de afgrond. Maar goed, dat was nu eenmaal de wet: dura lex, sed lex. Alleen hadden de gevestigde partijen het zo niet begrepen. Open VLD wilde vermijden dat de N-VA om financiële redenen een kartel zou sluiten met de CD&V. De N-VA kreeg van Open VLD de belofte dat de criteria om een dotatie te krijgen zouden worden versoepeld, op voorwaarde dat de partij geen kartel zou sluiten met de CD&V. Uiteindelijk is die deal niet doorgegaan en werd er pas bij de Vlaamse regeringsvorming een akkoord bereikt over de wijziging van de wet in het voordeel van de N-VA. Agalev daarentegen bleef financieel in de kou staan. Dat paste het best in het kraam van de SP.A, die op dat moment aanstuurde op een rood-groen kartel. De wetgeving werd dus gewijzigd à la tête du client. Anders gezegd: de gevestigde partijen maken misbruik van de partijfinanciering om het politieke landschap naar hun hand te zetten.
Nog een straffer voorbeeld daarvan is de manier waarop een aantal gevestigde partijen nu proberen om Vlaams Belang financieel droog te leggen. Politici hebben de geldkraan van de bedrijfsgiften helemaal dichtgedraaid en ook de privégiften sterk aan banden gelegd. Het gevolg is dat men door de overheidsfinanciering stop te zetten meteen ook de financiële levenslijn van een partij doorknipt. Wanneer men dit systematisch zou doen, dan komt dit in de praktijk op hetzelfde neer als een partijverbod. Op die manier krijgt de politieke elite een machtig wapen in handen om ongewenste partijen hetzij van de kaart te vegen, hetzij in de pas te doen lopen. Vandaag wordt dit wapen gebruikt tegen een uiterst-rechtse partij, maar morgen kunnen ook andere (communistische, islamitische, Eurosceptische) partijen worden geviseerd die door de elite als bedreigend worden ervaren.
Het zijn heus niet enkel separatisten en extremisten die problemen hebben met de financiële drooglegging van Vlaams Belang. De Raad van State heeft zelf twijfels bij de grondwettelijkheid daarvan en vraagt zich af of die drooglegging wel te rijmen valt met de vrijheid van vereniging. In januari heeft de Raad deze kwestie dan ook voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. Benieuwd wat het Hof zal doen met deze wel zeer hete aardappel.
Maar de kiesstrijd wordt ook nog op een andere manier financieel gemanipuleerd door de overheid. Op 17 mei organiseert de vzw Belgavox een gratis concert aan het Atomium. Het concert heeft een uitgesproken politiek oogmerk, namelijk 'het versterken van de solidariteit, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België, en het versterken van de Belgische identiteit.' (aldus de Belgavox-website). Ook al omdat dit concert plaatsvindt in de directe aanloop naar de verkiezingen gaat het hier overduidelijk om een politieke manifestatie. Er kan moeilijk worden ontkend dat het initiatief is gericht tegen de separatistische partijen in Vlaanderen: Vlaams Belang en de N-VA, die samen ruwweg 20procent tot 30procent van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigen. Tot hier is er evenwel geen vuiltje aan de lucht. Verkiezingen of niet, het staat de betrokken artiesten en intellectuelen volledig vrij om zich te outen als goede Belgische patriotten en om een antiseparatistische manifestatie te organiseren.
Maar wat te denken van het feit dat deze electorale manifestatie mee wordt gefinancierd door de overheid? Hoofdsponsors van het concert zijn immers de Nationale Loterij en Belgacom (voor 54procent in handen van de Belgische staat). Het initiatief wordt ook gesteund door de Vlaamse en Franstalige openbare omroep en door de Stad Brussel. En bovendien voorziet de NMBS in een voordelig tarief voor wie met de trein naar deze politieke meeting komt.
Met de ene hand probeert de overheid de grootste separatistische partij financieel te nekken. Met de andere hand financiert diezelfde overheid een antiseparatistische politieke manifestatie vlak voor de verkiezingen. Partijen en kandidaten worden tijdens de campagne stevig gekortwiekt door de overheid. Ze moeten zich houden aan draconische uitgavenbeperkingen. Dat gaat zelfs zo ver dat gewone kandidaten nauwelijks nog een campagne kunnen voeren die naam waardig. Maar diezelfde overheid mag zelf blijkbaar onbeperkt electorale manifestaties financieren. Dit is toch echt wel de wereld op zijn kop.
Een land waar zulke dubieuze praktijken mogelijk zijn en worden geduld kan men bezwaarlijk een normale democratie noemen. Maar wie maakt zich daar nu nog illusies over?
Bart Maddens is politicoloog aan de K.U. Leuven.
00:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, flandre, corruption, manipulations, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pirateria e Impero
Piratería e Imperio
 La actual “guerra contra la piratería,” que se extiende a los tribunales kenianos y estadounidenses después pasar meses hirviendo a fuego lento ante las costas de Somalia, es sólo la última en una larga serie de acciones de EE.UU. al servicio del imperio contra protagonistas no-estatales. La “Guerra Global contra el Terror,” que el gobierno de Obama reemplazó recientemente por el término más vago de “operaciones de contingencia en ultramar,” justificó un aumento en gran escala de los gastos militares, dos grandes intervenciones, y llamados explícitos a que EE.UU. mantenga su poderío sin igual. Al poner en peligro los puntos neurálgicos marítimos del mundo, los piratas emergen como la última amenaza no-estatal: los terroristas de los mares.
La actual “guerra contra la piratería,” que se extiende a los tribunales kenianos y estadounidenses después pasar meses hirviendo a fuego lento ante las costas de Somalia, es sólo la última en una larga serie de acciones de EE.UU. al servicio del imperio contra protagonistas no-estatales. La “Guerra Global contra el Terror,” que el gobierno de Obama reemplazó recientemente por el término más vago de “operaciones de contingencia en ultramar,” justificó un aumento en gran escala de los gastos militares, dos grandes intervenciones, y llamados explícitos a que EE.UU. mantenga su poderío sin igual. Al poner en peligro los puntos neurálgicos marítimos del mundo, los piratas emergen como la última amenaza no-estatal: los terroristas de los mares.
Sin embargo, no es una historia nueva. Hace doscientos años, los piratas de Barbería llevaron a los primeros gastos militares de importancia en la historia pos-revolucionaria de EE.UU. y aumentaron el perfil del Cuerpo de Marines de EE.UU. Después de los ataques del 11-S, los conservadores utilizaron comparaciones forzadas entre esos piratas y al-Qaeda como justificación para invadir Afganistán y lanzar una guerra global contra el terrorismo.
Hubo piratas presentes en la creación del imperio de EE.UU. ¿Han vuelto para el acto final del imperio?
Los neoliberales y los neoconservadores tienen diferentes respuestas a esta pregunta.
El mito del guerrero renuente
Según un agradable mito liberal excepcionalista, EE.UU. siempre ha defendido la democracia en el extranjero y ha renunciado a primeros ataques militares. George Washington, quien estableció un ejemplo al renunciar a su cargo militar para convertirse en el primer presidente civil del país, recomendó la neutralidad en la política exterior del nuevo país. Como tema utilizado por Jefferson en su advertencia contra “alianzas enmarañadas,” la neutralidad de los Padres Fundadores inspiró un siglo de subsiguientes aislacionistas. En el Siglo XX, EE.UU. entró a dos guerras mundiales sólo cuando fue provocado (el Lusitania, Pearl Harbor), y libró las guerras de Vietnam y Corea no para conseguir ventajas territoriales o por ambición imperial sino para defender a todo el Mundo Libre de una creciente mancha roja.
Las recientes guerras en Afganistán e Iraq pueden ser reempaquetadas para que se ajusten a esa narrativa inofensiva. Lanzamos la guerra contra los talibanes sólo después de que nos atacaron el 11 de septiembre. Luego apuntamos (inicialmente) a Sadam Husein por sus vínculos con el terrorismo, la amenaza (después) de sus armas de destrucción masiva, y (finalmente) por su verdaderamente atroz historial de violaciones de derechos humanos. En los tres casos, fuimos guerreros renuentes y combatimos por cuenta de otros, por razones altruistas de seguridad general o de democracia iraquí. En la más amplia Guerra Global contra el Terror, según la doctrina Bush, EE.UU. combate a terroristas en el extranjero para que no tengamos que combatirlos en nuestro suelo. La guerra “preventiva”, aunque pueda parecer imprudente y agresiva, es en los hechos prudente y defensiva. Como guerreros renuentes, loa estadounidenses son en última instancia hijos de George Washington.
Es un hermoso cuento de hadas para contarlo a niños a la hora de acostarse o a la ONU en tiempos de guerra. Pero, patrocinadores de la Guerra Global contra el Terror, incómodos con la visión de EE.UU. como pacífico excepto cuando es provocado, construyeron una contra-narrativa para servir sus propios propósitos. Para justificar una agenda bastante poco liberal – la adopción de masivos aumentos de los gastos militares, la suspensión de leyes internacionales como las Convenciones de Ginebra y la Convención de la ONU contra la Tortura, la perpetración de violaciones generalizadas de las libertades cívicas dentro del país – los neoconservadores prefirieron una narrativa con más testosterona. Ni siquiera se avergonzaron al utilizar la palabra “imperio.” Su contra-narrativa ha rastreado la historia intervencionista de EE.UU. desde el comienzo del imperio estadounidense hasta fines del Siglo XIX pasando por la construcción del “Siglo Estadounidense” durante la Guerra Fría. Esa desenfadada adopción del imperio suministra el elemento crítico – el thymós o el deseo y el esfuerzo y por lograr reconocimiento – cuya defunción fue lamentada por Francis Fukuyama en el fin de la historia. Los nostálgicos por la era del imperio reconocen que el mundo tiende hacia una inmensa democracia uniforme de mercado. Pero siguen existiendo por ahí diversas fuerzas antidemocráticas y anticapitalistas – vestigios comunistas como Cuba, potencias autoritarias como China, líderes dictatoriales como Robert Mugabe de Zimbabue, y la junta de Myanmar – y los facilitadores de la “Vieja Europa” carecen de las agallas para resistir a toda esa tiranía. Sólo el coraje y el poder de fuego pueden restaurar el thymós a su lugar de honor en el desarrollo de la historia del mundo.
La historia convencional de la expansión de EE.UU. en el extranjero se ha concentrado en que habría repelido a otros imperios y naciones-estado: españoles, soviéticos, vietnamitas, norcoreanos. Perceptiblemente ausentes en esa lista, excepto por un breve período durante el gobierno de Reagan, han quedado los protagonistas no-estatales y el mundo musulmán. Como tal, la campaña inspirada por los ataques del 11-S pareció ser un desvío en la historia de EE.UU.: una reacción sin precedentes a un evento sin precedentes. La Guerra Global contra el Terror se exponía a parecer no-estadounidense en su singularidad. Después de todo, ¿no fueron las Cruzadas algo europeo? ¿No fue el terrorismo un problema local para Londres, Madrid, Moscú, y Beijing? ¿No eran los Estados totalitarios los que libraban guerras globales?
De modo que, después de que decreció el choque inicial de los ataques del 11-S, los arquitectos de la nueva campaña de contraterrorismo se apresuraron a establecer una continuidad histórica. Para sustentar lo que se convertiría en la campaña militar más cara de la historia de EE.UU., era importante fabricar una genealogía – tal como la familia de un nuevo rico construye un escudo de armas falso para establecer un orgulloso y aristocrático linaje. La Guerra Global contra el Terror tenía que convertirse en una expresión esencial del destino de EE.UU. en lugar de ser un desvío del camino hacia una economía liberal de mercado global.
De esta manera, los propugnadores de la guerra global contra el terror descubrieron a los piratas de Barbería. A fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, EE.UU. mantuvo un conflicto de dos décadas de duración contra varios Estados a lo largo de la costa norafricana. La campaña inspiró la expansión de los Marines y la creación de la moderna Armada de EE.UJU. En días de debilidad general de EE.UU. – luchando con poco éxito contra los franceses y los británicos – las guerras de Barbería constituyeron un raro éxito para la joven república. Fue, en breve, una historia predispuesta para ser abusada: una guerra contra terroristas musulmanes antes de los hechos que resultó en una victoria militar de EE.UU. y un temprano triunfo del libre comercio.
La interpretación errónea de este episodio en la historia de EE.UU. es muy reveladora sobre los objetivos de la guerra global contra el terror. Y sirve como punto de salida útil para una consideración del futuro de la disputa entre los neoliberales y los neoconservadores sobre la trayectoria del poder global en lo que Thomas Friedman ha llamado una “era de piratería.”
Un paralelo pirata forzado
Los propugnadores de una Guerra Global contra el Terror no tuvieron que buscar mucho en los libros de historia después del 11-S para encontrar lo que necesitaban. Thomas Jewett, en la edición de invierno/verano de Early America Review, escribió que el 11-S “no es el primer conflicto en el que EE.UU. ha enfrentado semejantes ofensas contra la vida y la propiedad. Hubo otra época en la que se determinó que la diplomacia no sería sólo fútil, sino humillante y a la larga desastrosa. Una época en la que un rescate o tributo no compraría la paz. Una época en la que la guerra era considerada más efectiva y honorable. Y una época en la que la guerra se libraría, no contra grandes concentraciones de poderío militar, sino por pequeñas bandas formadas por individuos de espíritu indomable. Hace casi 180 años nuestro joven país atacó Trípoli bajo circunstancias que son extrañamente similares a los tiempos contemporáneos.”
Los panfletistas identificaron rápidamente los paralelos religiosos. Rick Forcier, director ejecutivo de la Coalición Cristiana del Estado de Washington, escribió en noviembre de 2001 sobre el terrorismo: “Es bastante antiguo, y así es su empleo por fundamentalistas islámicos, quienes durante siglos, han atacado con bombas, secuestrado, raptado, asesinado y extorsionado para difundir su religión y la gloria de su dios Alá. Conocidos en el pasado como ‘piratas de Barbería,’ los terroristas hicieron que el mundo de otrora temblara ante el pensamiento de ser capturado en alta mar y ser muerto o vendido a los traficantes de esclavos de Timbuktú.”
El periodista conservador Joshua London también tocó el tema de la Guerra Santa. Escribiendo en The National Review, opinó: “Aunque hay mucho en la historia de las guerras de EE.UU. contra los piratas de Barbería que es de relevancia directa con la actual guerra global contra el terrorismo, un aspecto parece ser particularmente instructivo para informar nuestro entendimiento de los asuntos contemporáneos. Dicho de modo muy simple, los piratas de Barbería eran musulmanes comprometidos, militantes, que insistían en hacer exactamente lo que decían.”
Sólo un mes después del 11-S, la derivación de paralelos era suficientemente significativa como para justificar un artículo del Washington Post que destacó los puntos de vista de numerosos historiadores sobre el tema. Entre los citados estaba el profesor de derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, quien utilizó explícitamente la analogía histórica en su recomendación al Congreso. “Invocó el precedente de los piratas de Barbería, diciendo que EE.UU. tenía pleno derecho a atacar y destruir a la dirigencia terrorista sin declarar la guerra,” informó el artículo.
Tres años después, cuando el entusiasmo por la Guerra de Iraq seguía siendo fuerte en las filas conservadoras, Christopher Hitchens escribió una apología de alto perfil de Thomas Jefferson y su tratamiento de los piratas de Barbería en la revista Time. El punto de partida para Hitchens fue el carácter definitivo de Jefferson. “Considerado en conjunto con algunas otras acciones ambiciosas y casi-constitucionales de Jefferson – la Compra de Luisiana y el envío de la expedición de Lewis y Clark al Oeste – la guerra de Barbería lo expuso a algunas críticas federalistas y en los periódicos por su secretismo, su prepotencia y su estilo exageradamente ‘presidencial.’ Pero no fue posible argüir contra el éxito,” escribió en una obvia reverencia hacia el gobierno de Bush.
En su minería de la historia estadounidense, periodistas, historiadores, y activistas conservadores encontraron las pepitas que buscaban: las humillaciones de la diplomacia, la importancia de demostraciones individuales de valor (¡el thymós!), las contribuciones de un poderoso presidente, y la perfidia militante de los musulmanes. Este establecimiento de paralelos entre los talibanes y al-Qaeda por una parte y los piratas de Barbería por la otra logró varios objetivos. Primero, estableció que los propios Padres Fundadores de EE.UU. habían ido a la guerra contra terroristas islámicos, dando a la guerra global contra el terror un pedigrí indiscutible. Segundo, reveló que desde el comienzo, el apaciguamiento en la forma de diplomacia estéril y del pago a chantajistas era poco efectivo, y que sólo una enérgica reacción militar podía asegurar la victoria. Tercero, esas batallas necesitaban nuevos enfoques (guerra preventiva) y nuevas capacidades (una armada expandida, una guerra centrada en la red). Finalmente, no se trataba de un simple conflicto local sino de una guerra global entre fundamentalistas retrasados y los que defendían el vigor de la ley.
Los mismos temas reaparecieron en una más reciente vinculación de la reacción del gobierno de Obama frente los piratas somalíes con el enfoque de Jefferson ante los piratas de Barbería. Los piratas somalíes son musulmanes y vinculados a fundamentalistas, el apaciguamiento no funciona, y la guerra es la respuesta. Y los expertos utilizan a los piratas como argumento a favor de una transformación de las capacidades del Pentágono. La asociación de piratas y terroristas es tan poco probable hoy en Somalia como lo fue en la histórica malinterpretación de las guerras de Barbería.
El “descubrimiento” de los piratas de Barbería es casi demasiado bueno como para ser verdad – como si un activista contra el aborto descubriera un dictamen desapercibido de la Corte Suprema del Siglo XVII sobre la concepción como inicio de la vida. Al proyectar sus prejuicios hacia el pasado, los neoconservadores deformaron la historia para que sirviera sus intenciones. Por cierto hay paralelos entre las Guerras de Barbería y los conflictos actuales. Pero no son los paralelos aprovechados por Jewett, London, y otros.
La verdadera historia del contraterrorismo
A pesar de las interpretaciones de los neoconservadores, las guerras de Barbería no tuvieron que ver con la religión. Los Estados del Norte de África, distantes tributarios del Imperio Otomano, no eran califatos islámicos sino gobiernos seculares dirigidos por un dey y sus jenízaros turcos. Clérigos musulmanes controlaban la esfera eclesiástica pero tenían poco poder político real. Además, los ataques contra los barcos comerciales no tenían nada que ver con el yihad. Más bien, excluidos de los mercados europeos, Argel, Trípoli y Marruecos se volvieron a la piratería para sobrevivir económicamente. EE.UU., en el intertanto, no inició una guerra santa contra esos Estados. En su lugar, estaba librando la Guerra Revolucionaria a posteriori a fin de conseguir mercados abiertos para productos estadounidenses. Fue, como argumentó Thomas Paine en “Common Sense,” una clave para la supervivencia de un país recientemente independizado. Pero Gran Bretaña no dio la bienvenida al recién independizado EE.UU. en sus mercados. Peor todavía, los británicos lanzaron a los piratas de Barbería contra la navegación comercial de EE.UU. en el Mediterráneo. Lo que algunos intérpretes contemporáneos ven como una temprana confrontación entre Occidente y el Resto – un prototipo para el choque de civilizaciones – fue en realidad la continuación de una batalla entre EE.UU. y sus rivales europeos.
Sin embargo, existen algunos paralelos útiles entre entonces y ahora. Por ejemplo, los Padres Fundadores identificaron rápidamente a sus oponentes de Barbería como piratas y negreros. Pero los británicos interpretaron las incursiones realizadas por John Paul Jones durante la Guerra Revolucionaria como poco más que piratería. La piratería, como el terrorismo, depende del punto de vista del observador. En cuando a la esclavitud, EE.UU. era en esos días el centro de la trata de esclavos. La hipocresía del trato por los Estados de Barbería de un par de cientos de marineros estadounidenses – cuando los negreros estadounidenses había llevando cientos de miles de esclavos africanos – no fue percibida por la mayoría de los comentaristas de la época (con la notable excepción de Benjamin Franklin).
Se puede encontrar un paralelo más pertinente en la esfera militar. A fines del Siglo XVIII, EE.UU. carecía de fuerzas armadas que se pudieran enfrentar frente a frente con las potencias europeas, mucho menos con la flota de Barbería. Muchos Padres Fundadores consideraban que una armada permanente era una amenaza para la libertad. Era costosa y, con el fin de la Guerra Revolucionaria, no existían razones compulsivas para gastar dinero en la construcción de barcos de guerra. James Madison recomendó que EE.UU., en una temprana versión de la Seguridad Interior, se concentrara en la defensa de las líneas costeras. En 1794, sin embargo, el Congreso rechazó los argumentos de Madison y Jefferson y aprobó legislación, firmada por el presidente Washington, para la construcción de seis fragatas. Los propugnadores de la ley utilizaron a los piratas de Barbería como justificación explícita para ese fuerte aumento en los gastos militares, pero sin duda también pensaban en las flotas de Gran Bretaña y Francia.
Había, sin embargo, una cláusula interesante en la ley: “Si llegara a haber paz entre EE.UU. y la Regencia de Argel, no habrá actuaciones ulteriores bajo esta ley.” Después, EE.UU. firmó un tal tratado con Argel. Washington invocó esa cláusula en 1796 para reducir los desembolsos navales. Pero incluso entonces, cuando el complejo militar-industrial estaba en su nadir histórico, hubo preocupaciones sobre el desempleo en el sector de la defensa. De modo que, en un compromiso, la temprana república siguió adelante con la construcción de tres barcos.
La guerra que terminó por acontecer entre EE.UU. y primero Trípoli, y luego Argel, estableció muchos de los mitos fundadores de las hazañas militares de EE.UU. (las hazañas de Stephen Decatur), nuevos tipos de guerra (misiones militares secretas), y la vinculación de la intervención en el extranjero con el comercio. En otras palabras, los neoconservadores del Siglo XXI recibieron una cierta mitología prefabricada en la cual basarse. Todo lo que necesitaban era vincular a los piratas de Barbería con al-Qaeda. Eso precisaba que se convirtiera a los agentes de gobiernos seculares con limitados objetivos económicos en musulmanes terroristas con los más amplios objetivos ideológicos. De esta manera, una guerra de EE.UU. contra el terrorismo islámico adquiriría la distinción de un antiguo interés nacional.
Piratería y globalización
Cuando EE.UU. declaró la Doctrina Monroe en 1823, sólo ocho años después del fin de la Guerra Argelina, tenía el deseo, pero no la capacidad, de mantener a sus rivales europeos fuera del Caribe y de Latinoamérica. Fueron las guerras contra los Estados de Barbería – y ciertamente no la desastrosa guerra de 1812 – lo que había dado a EE.UU. la confianza necesaria para desafiar a los imperios europeos. Esos tempranos conflictos suministraron a EE.UU. la retórica y la visión de un imperio comercial cuando EE.UU. no era más que un simple páramo.
La noción de que EE.UU. pudiera mantenerse fuera de guerras y de las sucias complicaciones de la política imperial europea se acabó durante los conflictos de Barbería. El crecimiento económico de EE.UU. dependía del libre comercio, y los barcos de guerra de EE.UU. eran necesarios para mantener abiertas las líneas de navegación. Cuando Thomas Friedman escribió sobre la importancia de McDonnell Douglas para la seguridad de los restaurantes McDonald’s – el puño de hierro de los militares tras la mano invisible del mercado – heredó esa tradición de lógica imperial. Es también el espíritu que animó la visión geoeconómica de Bill Clinton de mantener el poder económico de EE.UU. mediante la conservación del poder militar de EE.UU., que he llamado en otro contexto “globalización de cañonera.”
Con la presidencia de Barack Obama, sobreviene una cierta versión resucitada del enfoque de Clinton. Se deja de lado toda el habla de imperio, en la que los adversarios son derrotados definitivamente, y viene el arte de la hegemonía, en el que aliados y adversarios de EE.UU. son persuadidos para que vean la confluencia de sus intereses y de los intereses de EE.UU. Obama sigue comprometido con unas inmensas fuerzas armadas – está redistribuyendo tropas de Iraq a Afganistán, aumentando la cantidad de soldados en 92.000 hombres, y manteniéndose “a la ofensiva” de Djibouti a Kandahar” – incluso mientras promete utilizar su pericia persuasiva con los dirigentes de Irán, Corea del Norte, y Venezuela. Obama ha prometido echar marcha atrás en algunos de los aspectos más ofensivos de la Guerra Global contra el Terror (Centro de detención de Guantánamo, la tortura) pero el marco general será mantenido bajo la designación AfPak. Mientras tanto, el nuevo presidente se concentrará en la expansión del poder económico global de EE.UU. como parte de un intento de reanimar la moribunda economía del país.
En este entorno neoliberal reanimado, al-Qaeda seguirá siendo el mismo importante “otro” que constituyeron los Estados de Barbería en el Siglo XVIII: una excusa útil para nuevos gastos militares y la proyección de la fuerza. Pero ahora se le suman otros herederos más directos del manto de Barbería: los piratas de Somalia. Esos piratas atacan la sangre vital misma de la globalización – los barcos que transportan energía y bienes por el Canal de Suez – tal como los piratas de Barbería bloqueaban la intención del temprano EE.UU. de convertirse en un protagonista económico global. Como parte de su propia transformación después de la Guerra Fría, la Armada está alejando su estrategia de la custodia de alta mar al control de las líneas costeras. Ya ha tenido una importante confrontación con China (relacionada con el USNS Impeccable). Pero ante las inversiones de China en la economía de EE.UU., los piratas representan una justificación más segura para este cambio de dirección.
Los terroristas en tierra y en el mar son útiles de otra manera. Precisamente porque no son Estados sino entidades dispersas, los piratas y los terroristas pueden servir mejor para justificar tanto una guerra global como una nueva doctrina militar. El Pentágono ha insistido en costosos, pero bastante anticuados, sistemas de armas para encarar la creciente amenaza de China: portaaviones de tecnología avanzada, inmensos destructores navales, y nuevos submarinos nucleares. Una amenaza dispersa, mientras tanto, requiere una defensa dispersa: Bases militares de EE.UU. (reconfiguradas como “hojas de nenúfar” [ciudades flotantes], tanto mejores para salirse de ellas), unidades de reacción rápida, nuevas capacidades de C4 (comando, control, comunicación y computadores). También justifica una nueva doctrina militar que subraya la rapidez por sobre la posición. Obama ha apoyado esos cambios. Permitirán al Pentágono que reaccione rápido ante amenazas a los intereses económicos de EE.UU., sean ataques paramilitares contra oleoductos en el Golfo de Guinea y Colombia, disputas territoriales que afecten rutas de navegación en el Sudeste Asiático, o piratas en los Estrechos de Malaca.
El fin de la Guerra Fría creó una crisis de misión para la OTAN. ¿Para qué era necesaria si la Unión Soviética ya no existía? Pero esa crisis de misión podía ser aplicada más generalmente al Pentágono. El celebrado segundo frente de la zona desmilitarizada de Corea perdió su propósito cuando Corea del Sur dejó de considerar a Corea del Norte como su enemiga. La amenaza china disminuyó considerablemente cuando Beijing se convirtió en el principal socio comercial de todos los países de la región. Cuba ya no representaba ningún potencial de amenaza aparte de enviar botes cargados de refugiados a la costa de Florida. Sadam Husein está muerto. Colin Powell hizo la genial declaración después de la primera Guerra del Golfo: “Se me acaban los malvados. Sólo me quedan Kim Il Sung y Castro.” Osama bin Laden llegó justo a tiempo para el gobierno de Bush. Los piratas somalíes son el último lazo salvavidas para el Pentágono.
La conservación de altos gastos militares, sea para impulsar los “duros” objetivos imperiales de los conservadores o los “suaves” objetivos económicos hegemónicos de los neoliberales, requiere a malvados de una estatura comparablemente grande. El hermano de Castro y el hijo de Kim Il Sung no bastan. Si al-Qaeda no existiera Washington tendría que crearlos. Por cierto, en su construcción de terroristas islámicos de piratas bastante corrientes, ha hecho precisamente eso.
John Feffer
Traducido por Germán Leyens, extraído de Rebelión.
00:22 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, impérialisme, piraterie, politique, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Savitri Devi Mukherji : Defiance
00:15 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, inde |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Encerclement de l'Iran (5/6)
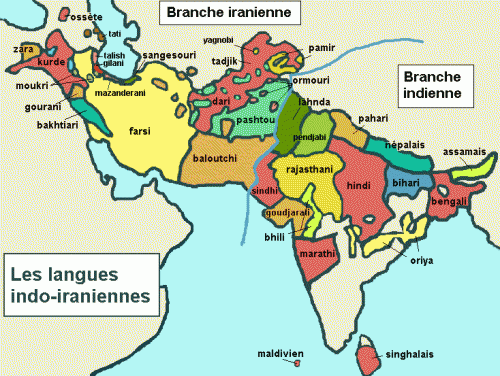
L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du “Grand Moyen-Orient” (5/6)
par Robert STEUCKERS
Matrices territoriales afro-asiatique, élamo-dravidienne et indo-européenne: la conclusion de Colin McEvedy
La matrice indo-européenne procède d’une “Urheimat” de départ beaucoup plus vaste que celles, réduites, que l’on avait imaginées jusqu’ici. Toujours selon Colin McEvedy, il ne faut pas réduire la matrice territoriale indo-européenne (ni l’afro-asiatique ni l’élamo-dravidienne) à une zone trop restreinte, réduite à un petit espace géographique confiné, mais l’étendre à un espace assez vaste, car la mobilité proto-historique a été une réalité trop peu prise en compte jusqu’ici: les Afro-Asiatiques s’étendaient de l’Atlantique marocain actuel à l’ensemble de la péninsule arabique; les Indo-Européens —et McEvedy rejoint en cela l’archéologue allemand Lothar Kilian— de la Mer du Nord (Norvège, Danemark, Pays-Bas) au delta de la Volga dans la Caspienne; la matrice élamo-dravidienne, quant à elle, s’étendait des côtes actuellement iraniennes du Golfe jusqu’au sous-contient indien. Pour McEvedy, seules les matrices ouest-méditerranéennes et caucasiennes de la proto-histoire disposaient d’un territoire plus réduit: péninsule ibérique, bassin de la Garonne, côtes et arrière-pays de Provence, Etrurie-Toscane pour la première; Caucase et Nord-Est de la Turquie actuelle, pour la seconde. Colin McEvedy: “Quelques [archéologues] ont suggéré que le “homeland” original des Indo-Européens correspondait à une zone [allant de la Mer du Nord au Turkestan]. Cette idée est étayée par le fait qu’il n’y a aucun nom de rivière autre qu’indo-européen au sein de ce territoire. Pour le lien récemment démontré entre Elamites et Dravidiens, nous concluons désormais que la Heimat originelle de ce groupe nouvellement baptisé élamo-dravidien a au moins 3000 km de longueur. Nous savons déjà que le groupe afro-asiatique s’étendait sur un espace de 5000 km de longueur d’Est en Ouest. Il semble donc extrêmement improbable qu’un groupe aussi efficace que l’ont été par la suite les Indo-Européens, ait disposé d’un territoire plus réduit que les Afro-Asiatiques et les Elamo-Dravidiens”.
Le territoire d’origine des peuples européens correspond donc plus ou moins à l’espace européen actuel, Russie comprise. L’Iran traditionnel, de Zarathoustra au dernier Shah, se perçoit comme une émanation de cette matrice européenne, comme le produit d’une irruption constructive, bâtisseuse d’empires, dans les espaces élamo-dravidien et sémitique, amorcée vers -1800. Si au départ, cette vision avait une connotation raciale évidente, le brassage continu des peuples dans cette zone a, par la force des choses, fait disparaître le caractère purement racialiste de cet idéal d’irano-européité, pour faire place à la notion intégrante et impériale de “civilisation iranienne”, défendue par Reza Khan Pahlavi, et, dans une moindre mesure, par son fils (qui, pour éviter affrontements et dissensions intérieures, devait composer avec l’islam, qui ne lui a pourtant manifesté aucune gratitude).
La “civilisation iranienne”, pour le dernier des Pahlavi, était le patrimoine iranien, qu’il convenait de réhabiliter contre l’ignorance dans laquelle était plongé le peuple d’Iran, faute d’écoles et d’instituteurs et, à ses yeux, à cause de l’islam. Pour Mohammad Reza Pahlavi, il fallait réactiver les forces du passé iranien en multipliant bibliothèques, instituts, universités, initiatives culturelles. Dans son mémoire en défense, face à l’histoire future et face à l’échéance fort brève que lui laissait la maladie qui le rongeait, il a écrit ces paroles pertinentes: “Cette conception selon laquelle tout ce qui appartient au passé est réactionnaire, antiprogressiste ou dépassé, fort répandue dans une certaine bourgeoisie citadine, avait porté à dénigrer la culture proprement iranienne, à négliger les oeuvres d’art léguées par le passé”. Les nouveaux programmes scolaires, déjà imaginés par son père, devaient remédier à cette déliquescence, fruit funeste de l’urbanisation; par ailleurs, des programmes de télévision et de radio-diffusion étaient appelés à faire revivre, avec succès, l’ancienne musique persane, qui, sinon, serait tombée aux oubliettes. Ce recours aux valeurs sûres du passé, aux archétypes, consolidateurs de toute durée historique et de toute continuité impériale, voulu par Reza Khan et son fils, était pourtant contemporain, dans les années 60 et 70, d’un futurisme culturel, porté par des avant-gardes audacieuses, souvent patronnées par la troisième épouse de Mohammad Reza Shah, la Shabanou Farah Diba.
Révolution Blanche, Démocratie impériale et Grande Civilisation
La référence à la “civilisation iranienne”, chez le dernier Shah, qui cite en ce sens l’iranologue français du 19ième siècle, Gobineau, devait être le prélude à un vaste projet géopolitique, baptisé “Grande Civilisation” et soutenu, en Iran, par la “révolution blanche” et le système dit de la “démocratie impériale”. D’inspiration clairement zoroastrienne et sur le modèle de l’empire de Cyrus, cette marche en direction de la “Grande Civilisation” devait mener l’Iran vers une révolution “anamorphique”, où il aurait été tiré vers le haut par la volonté impériale. L’Iran aurait alors été le modèle à suivre pour ses voisins. Cette révolution intérieure impliquait de poursuivre, en politique extérieure, le projet constructif de susciter et de consolider une vaste solidarité de tous les riverains du Golfe Persique et de l’Océan Indien. Le Shah prévoyait de bonnes relations avec l’URSS et les pays européens du COMECON (dont la Roumanie). Sa diplomatie a indubitablement connu de beaux succès et, notamment, a conduit à la paix avec l’Irak en 1975, grâce au règlement du trafic fluvial et maritime dans le Chatt-el-Arab’ mis au point par le Traité d’Alger; a apporté, avant l’entrée des troupes soviétiques dans le pays, une aide à l’Afghanistan isolé et enclavé (un type d’ingérence iranienne dont ne veulent pas les puissances anglo-saxonnes, comme en 1837 et en 1857); a forgé une alliance tacite avec le Pakistan (mais sans braquer l’Inde); a formulé le projet d’une politique commune avec Singapour et l’Australie pour amener la paix dans tout l’espace de l’Océan Indien (suscitant du même coup des lézardes dans le camp anglo-saxon, dont l’Australie est une pièce maîtresse, mais qui ruait dans les brancards à l’époque, allant jusqu’à doter son aviation de Mirages français).
En déployant cette diplomatie originale et de grande envergure, le Shah profitait de la nouvelle doctrine nixonienne, prévoyant de laisser les alliés des Etats-Unis organiser en toute autonomie leur environnement. Mais les Démocrates challengeurs, puis vainqueurs des élections après la disgrâce de Nixon, suite au scandale du Watergate, avaient d’autres projets, prévoyant notamment la fin de ces autonomies, jugées incontrôlables à long terme, et le ré-alignement inconditionnel des alliés moyen-orientaux sur les politiques américaines, en dépit des principes pragmatiques de la Realpolitik et en dépit des alliances et des fidélités proclamées depuis quelques décennies: la chute de Nixon allait de ce fait entraîner la fin de l’autonomie iranienne dans le contexte délicat et effervescent du “Grand Moyen-Orient”, puis, par fatalité, l’érosion du pouvoir du Shah et, finalement, sa chute. L’entourage de Jimmy Carter, comme avant lui celui de John Kennedy, est hostile au Shah. Il prend un net recul par rapport à la Realpolitik du duo Nixon/Kissinger et introduit le ferment “moraliste” et “droit-de-l”hommesque” dans l’orbe de la politique internationale. Ce fut le début d’une ère de calamités, d’un véritable ressac éthique dans toute l’américanosphère occidentale sous le masque d’une sur-éthique hyper-moralisante, gonflée artificiellement et démesurément par la propagande médiatique, dont on mesure bien les conséquences aujourd’hui, surtout après qu’une nouvelle génération de Républicains, juste avant Reagan puis dans son sillage, a, elle aussi, abandonné la Realpolitik classique pour pimenter et corser le “moralisme” cartérien de discours apocalyptiques, dérivés d’un biblisme religieux protestant et puritain (avec de nouveaux vocables propagandistes tels: “l’empire du Mal”, “l’axe du Mal”, etc.). En règle générale, avant 1978, les Républicains étaient favorables au Shah au nom d’une Realpolitik traditionnelle, qui commençait toutefois à s’éroder; les Démocrates, héritiers de l’idéologie mondialiste et militante de Roosevelt, lui étaient hostiles, à l’exception de Lyndon Johnson.
Cette mutation funeste dans la politique de Washington à l’endroit du régime du Shah, nous induit à développer quelques préliminaires, pour bien saisir notre deuxième batterie de conclusions, celles qui portent, non pas sur l’histoire pluri-millénaire de l’Iran, dont la connaissance reste toutefois un impératif de la raison politique, non pas davantage sur le rôle des facteurs déjà évoqués, qui sont de nature idéologique, religieuse ou ethnique, mais sur la situation géopolitique et géostratégique actuelle, où l’Iran est bel et bien encerclé, pris en tenaille dans un réseau dense de bases américaines, installées en Transoxiane (Ouzbékistan), en Afghanistan et en Irak. C’est-à-dire dans tous les espaces stratégiques, dans tous les glacis ou zones de réserve, qui ont permis à l’Iran, à un moment ou à un autre de son histoire, de rayonner sur son environnement, de consolider les assises de la “civilisation iranienne”, de s’étendre et de survivre.
Washington contre Téhéran
Houchang Nahavandi, dans le chapitre (XI) à nos yeux le plus important de son livre sur la “révolution iranienne”, et qui s’intitule précisément “Washington contre Téhéran”, récapitule toutes les étapes des relations américano-iraniennes depuis 1941, année de l’invasion anglo-soviétique et de l’abdication forcée de Reza Shah. Pour l’Iran, la Grande-Bretagne et la Russie étaient les deux puissances ennemies par excellence, celles qui menaçaient l’intégrité territoriale iranienne. L’ennemi principal était britannique, car il colonisait toute l’exploitation des pétroles d’Iran, par le biais de l’”Anglo-Persian Oil Company”, puis de l’”Anglo-Iranian Oil Company”, et visait une satellisation du pays, permettant d’installer une continuité territoriale sans aucune interruption entre les possessions ou protectorats britanniques situés, d’une part, entre l’Afrique du Sud et l’Egypte, et, d’autre part, entre la frontière égypto-libyenne et la Birmanie.
Après 1918, Londres n’avait plus réellement les moyens de réaliser une politique aussi grandiose, rêve de Cecil Rhodes: l’hypertrophie impériale dans la zone de l’Océan Indien était devenue une réalité fort préoccupante, jetait les derniers feux d’une démesure sans solution donc générait une frustration qu’on ne voulait pas avouer. Reza Khan, devenu Reza Shah en 1926, était, par sa personne et par sa forte volonté de colonel cosaque, un obstacle de taille au projet jadis rêvé par Rhodes. Reza Shah composait avec les Soviétiques, car il était plus russophile qu’anglophile comme nous venons de le voir, mais ne contestait pas encore fondamentalement le monopole anglais sur les pétroles iraniens. Il entendait toutefois diversifier ses relations avec les pays occidentaux industrialisés et avec le Japon: des milliers d’ingénieurs allemands et italiens travaillaient en Iran et les relations commerciales germano-iraniennes étaient fort avantageuses pour Téhéran. Des consortiums scandinaves avaient réalisé la prouesse technique d’achever en onze ans de travaux titanesques le tracé de la voie ferroviaire transiranienne entre le Golfe et la Mer Caspienne, avec des ouvrages d’art stupéfiants, dans des territoires montagneux quasiment vierges. L’Allemagne livre les locomotives. L’Italie et le Japon avaient livré à la marine iranienne naissante des bâtiments de guerre destinés à contrôler les eaux du Golfe. Les officiers de la marine avaient été formés en Italie. Quand les troupes allemandes et leurs alliés envahissent l’URSS en juin 1941 et bousculent les armées soviétiques massées le long de la ligne de démarcation de septembre 1939, l’URSS devient ipso facto l’alliée de la Grande-Bretagne. Les deux puissances décident d’occuper l’Iran neutre, de façon à pouvoir approvisionner l’URSS par la Caspienne et l’axe fluvial de la Volga. L’armée de Reza Shah résiste, les villes iraniennes sont bombardées, la marine iranienne est anéantie dans le Golfe et y perd quasiment tous ses officiers. La garnison de Kermanshah bloque provisoirement l’avance britannique, mais le rapport des forces est évidemment au détriment de l’Iran: le 27 août, le Shah est contraint de demander la cessation des hostilités. En septembre 1941, il abdique en faveur de son fils Mohammad Reza. Il est emmené en captivité en Afrique du Sud où il meurt en 1944 d’un cancer que l’on n’a sans doute pas voulu soigner convenablement.
Les Etats-Unis en Iran pendant la deuxième guerre mondiale
Les Etats-Unis, qui n’entrent en guerre qu’en décembre 1941, ne sont, aux yeux des Iraniens, qu’un troisième comparse, débarqué plus tard, ne sont pas les envahisseurs directs, mais une puissance qui arrive dans la guerre, après la violation délibérée de la neutralité du pays et après les opérations militaires qui ont frappé durement les civils des villes, l’armée iranienne et sa marine. L’Amérique n’est donc pas perçue en Iran, pendant la seconde guerre mondiale, comme une puissance occupante. Elle n’est pas présente visiblement par des déploiements de troupes et des patrouilles; seuls des ingénieurs civils organisent voies ferroviaires et installations portuaires. Pour Nahavandi, les relations cordiales entre l’Iran et les Etats-Unis commencent surtout au lendemain de la deuxième guerre mondiale, quand les Soviétiques refusent d’évacuer le nord du pays et les régions azerbaïdjanaises, qu’ils avaient occupées et où ils avaient organisé un mouvement séparatiste, appelé, à un stade ultérieur, à proclamer l’union de la nouvelle république séparée avec l’URSS. Truman menace Staline, qui cède, et l’intégrité du territoire iranien est ainsi sauvegardée. Ce coup d’éclat scelle l’amitié irano-américaine que le Shah n’oubliera jamais, vouant à Washington une fidélité honnête et dépourvue d’arrière-pensées, qui se révèlera, in fine, pure naïveté. Et le conduira à sa perte.
En 1953, les Etats-Unis, foulant aux pieds cette amitié que leur voue sincèrement le jeune Shah, soutiennent d’abord le nationaliste Mossadegh, en voyant d’un bon oeil la fin du monopole britannique sur les pétroles d’Iran, que Téhéran entend nationaliser. Mais quand Mossadegh doit s’allier au “Toudeh” communiste pour consolider sa majorité en faveur des nationalisations, la CIA change d’avis, par crainte d’une absorption soviétique de l’Iran tout entier ou d’un alignement sur Moscou, et participe aux opérations visant le renversement du ministre nationaliste. Le Shah doit donc une nouvelle fois sa survie et son trône à l’action énergique des Américains. Les relations entre l’Iran et les Etats-Unis restent bonnes entre août 1953 (date de la chute de Mossadegh) et 1961, avec l’arrivée au pouvoir de l’Administration Kennedy. Celle-ci veut se débarrasser du Shah et fomente un coup d’Etat des services secrets iraniens, la fameuse SAVAK. La tentative se solde par un échec. L’assassinat de Kennedy met fin à cette nouvelle politique de volte-face. Lyndon Johnson reconduit l’alliance entre Washington et le Shah.
“Révolution blanche” et diversification
A partir de 1965, les Etats-Unis chercheront toutefois à forcer un changement en Iran. L’année 1965 est marquée par le conflit entre l’Inde et le Pakistan. Lié au Pakistan par le pacte militaire pro-occidental du CENTO, l’Iran soutient son allié, par l’effet du lien contractuel inhérent au traité mais aussi par solidarité musulmane et parce que l’Inde, qui décroche finalement la victoire, recevait le soutien de l’URSS. Malgré cette fidélité aux alliances pro-américaines, trois facteurs contribuaient à brouiller, simultanément et en coulisses, les rapports irano-américains.
- D’abord, les effets de la “révolution blanche”, commencée en 1961, avec partage des terres de la Couronne et des latifundia entre les paysans, l’alphabétisation et l’émancipation des femmes. Ces démarches, nécessaires à l’avancée du pays, provoquent une forte résistance de la part des grands propriétaires terriens, des chefs de tribus et du clergé chiite. En octobre 1963, à la suite de désordres semés par Khomeiny, celui-ci est banni d’Iran. Washington craignait que la “révolution blanche” ne génère une déstabilisation du pays et ne provoque un effet de contagion dans d’autres Etats alliés, y compris en Amérique latine. La leçon à tirer de ces événements, c’est que les Etats-Unis ne tolèrent aucune réforme sociale en profondeur, qu’elle soit portée par une idéologie marxiste-léniniste ou par des mesures pratiques et non idéologiques, parfois autocratiques, comme dans l’Argentine de Péron ou l’Iran du Shah ou la France de De Gaulle hier, ou dans le Vénézuela de Chavez aujourd’hui. Pour les Etats-Unis, c’est clair, les Etats alliés doivent vivoter sous des démocraties qui ne génèrent que le désordre, l’enlisement et la corruption, afin de freiner et de bloquer les initiatives originales, sans modèle préconçu tiré d’une idéologie trop souvent irréaliste, mais taillées chaque fois à la mesure du peuple auquel elles s’adressent, leur donnant véritablement à terme la liberté et l’autonomie sur le plan intérieur et sur la scène internationale.
- Ensuite, la défaite, face à l’Inde en 1965, du Pakistan, qui dépendait entièrement des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne pour son armement, fait craindre au Shah un sort similaire pour l’Iran en cas de coup dur. L’Iran doit donc s’autonomiser et chercher à diversifier ses sources d’approvisionnement en technologies avancées, tant les militaires que les civiles. Houchang Nahavandi cite, à ce propos, un rapport de 1966 de l’ambassadeur américain à Téhéran à l’époque, Armine Mayer: “La crise de septembre 1965 entre l’Inde et le Pakistan a persuadé le Shah qu’une dépendance excessive de la défense iranienne à l’égard des Etats-Unis pourrait réserver à l’Iran le même sort que le Pakistan. Il recherche sa liberté de mouvement”. Le Shah cite de plus en plus souvent De Gaulle en exemple. Et passe à la pratique: il commande en Europe. Et signe des contrats avec l’URSS. Il vise le développement d’une industrie iranienne autonome des armements. Le Shah devient un “ennemi” potentiel: on le traite de “dangereux mégalomane” et même de “cinglé”, injures que Péron et De Gaulle avaient également essuyées. L’enseignement à tirer de cette volonté de diversification du Shah, c’est, bien sûr, que les Etats-Unis ne tolèrent aucune forme de diversification et d’autonomie. La diversification voulue par Mohammad Reza Shah avait connu une précédence: celle réalisée par son père dans les années 20 et 30, avec le concours des Scandinaves, des Allemands et des Italiens. Pire: avec l’argent du pétrole, au début des années 70, le Shah acquiert 10% du capital d’Eurodif, ce qui aurait pu permettre à l’Iran, à terme, de se doter de technologies nucléaires, tant militaires que civiles. L’hostilité à un Iran doté de technologies nucléaires ne date donc pas de ces dernières années et ne relève pas d’une inimitié viscérale à l’endroit de la seule révolution islamiste, qui serait l’expression radicale et musulmane du fameux “choc des civilisations”, théorisé dès 1993, dans les colonnes de Foreign Affairs, par Samuel Huntington.
L’OPEP, la hausse des prix du pétrole et l’émergence de l’agitation islamiste
- Enfin, la hausse des prix du pétrole, décidée par l’OPEP, avait reçu l’approbation du Shah et du roi Fayçal d’Arabie Saoudite (assassiné en 1975). Kissinger, qui, comme les autres, commence à émettre des doutes, à s’aligner sur le camp anti-iranien, finit par vouloir, lui aussi, le départ du Shah, mais ne cherche pas à brusquer les choses, car il entend agir dans le cadre d’une diplomatie traditionnelle de type bismarckien; Kissinger refuse également de mettre les ventes d’armes américaines à l’Iran en danger; il entend conserver au moins cet atout, qui permet un contrôle indirect de l’armée iranienne, à laquelle, le cas échéant, on ne livrerait pas de pièces de rechange. En même temps, Kissinger veut bloquer tout développement et toute prospérité aux firmes européennes exportatrices d’armements. Les trois principaux reproches que Kissinger adresse au Shah sont les suivants: grâce aux plus-values du pétrole, le Shah va consolider son influence régionale, exercer ipso facto des pressions sur les Etats-Unis, transformer son pays en grande puissance. C’est à ce moment-là que Washington décide de parier sur le “fanatisme islamiste” et qu’émergent dans les débats stratégiques certaines des thèses de Brzezinski: insistance sur l’importance stratégique millénaire de la “Route de la Soie” qu’aucune puissance d’Eurasie ne peut dominer entièrement, utilisation de certains réflexes religieux musulmans intégristes pour déstabiliser les Etats qui deviendraient trop puissants dans cette zone, théorisation de la stratégie “mongole” visant à créer des dynamiques destructrices qui jettent à bas les régimes qui dérangent sans les remplacer par des structures politiques cohérentes et alternatives. A ce propos Houchang Nahavandi cite le politologue libanais Nicolas Nasr: “La promotion du fanatisme islamique, inspirée par Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, visant à promouvoir la naissance d’Etats confessionnels dans la région, pourrait servir hautement les intérêts américains, … la promotion des principes coraniques, en bloquant le développement et toute modernisation dans les pays musulmans, profiterait idéalement au capitalisme américain et occidental, en conférant à ces pays sous-développés le statut de simple marché de consommation des produits industriels” (p. 187). “Les Etats-Unis veulent que les contrées riches en matières premières demeurent des zones économiquement et politiquement faibles, “molles”, susceptibles de receler de nombreux consommateurs potentiels, sans pour autant être en mesure de devenir des Etats forts du point de vue politico-militaire et technologique. Ils doivent rester “dépendants” et donc demeurer des “ventres mous” (p. 188). Ces axiomes de la politique américaine ne valent pas seulement pour l’Iran.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, perse, iran, moyen orient, grand moyen orient, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Préface à "Religiosité indo-européenne" de H. F. K. Günther

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - Septembre 1987
Préface du traducteur à "Religiosité indo-européenne" de H. F. K. Günther
Un préjugé défavorable accompagnera ce livre de Günther. En effet, en France, Günther jouit d'une réputation détestable, celle d'être "l'anthropologue officiel" du Troisième Reich de Hitler. Cet étiquetage n'a que la valeur d'un slogan et il n'est pas étonnant que ce soit le présentateur de télévision Polac qui l'ait instrumentalisé, lors d'un débat à l'écran, tenu le 17 avril 1982 sur la "Nouvelle Droite" d'Alain de Benoist. Avec la complicité directe d'un avocat parisien, Maître Souchon, et la complicité indirecte d'un essayiste britannique, ayant comme qualification scientifique d'être un "militant anti-fasciste", Michael Billig (1), Polac pouvait fabriquer, devant plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, le bricolage médiatique d'un "Günther hyper-nazi", maniaque de la race et dangereux antisémite. Comme aucun représentant de la "Nouvelle Droite", aucun anthropologue sérieux, aucun connaisseur des idées allemandes des années 20 et 30, n'étaient présents sur le plateau, Polac, Souchon et leurs petits copains n'ont pas dû affronter la contradiction de spécialistes et le pauvre Günther, décédé de-puis quatorze ans, a fait les frais d'un show médiatique sans la moindre valeur scientifique, comme le démontre avec brio David Barney dans Eléments (n°42, juin-juillet 1982).
Qui fut Günther? Hans Friedrich Karl Günther est né le 16 février 1891 à Fribourg en Brisgau, ville où il vécut sa jeunesse. Il y fréquenta l'université et, après un séjour d'études à Paris, acquit les diplômes qui sanctionnaient ses connaissances en linguistique comparée et en philologie germanique. La formation de Günther est donc celle d'un philologue, non celle d'un anthropologue. Quand éclate la guerre de 1914, Günther se porte volontaire mais, atteint d'un rhumatisme des articulations pendant son instruction, il est renvoyé chez lui et jugé inapte au service actif. Il servira ultérieurement le Reich dans la Croix-Rouge. La guerre finie, il enseigne à Dresde et à Fribourg. Son premier ouvrage paraît en 1920 et s'intitule Ritter, Tod und Teufel. Der heldische Gedanke (= Le chevalier, la mort et le diable. L'idée héroïque), conjointement à une pièce de théâtre, d'inspiration nationaliste, faustienne, païenne et romantique, Hans Baldenwegs Aufbruch. Ein deutsches Spiel in vier Auftritten (=Le départ de Hans Baldenweg. Pièce allemande en quatre actes). Le destin de Günther venait d'être scellé. Non par le contenu intellectuel de ces deux travaux, mais par la personnalité de son éditeur munichois, Julius Friedrich Lehmann, enthousiasmé par Ritter, Tod und Teufel. Cet éditeur connu avait repéré des qualités innées d'anthropologue chez son jeune protégé. Günther, avait remarqué Lehmann, repérait tout de suite, avec justesse, les caractéristiques raciales des individus qu'il rencontrait au hasard, dans les rues ou sur les chemins de campagne. Il était dès lors l'homme que cherchait Lehmann, pour écrire un précis de "raciologie" vulgarisé, accessible au grand public, commercialisable à grande échelle. Malgré l'avis défavorable d'un professeur d'anthropologie de l'université, Lehmann déci-de de payer Günther pendant deux ans, afin d'achever, à l'abri du besoin, sa "raciologie". En juillet 1922, Rassenkunde des deutschen Volkes sort de presse. Plusieurs éditions se succéderont jusqu'en 1942 et 124.000 exemplaires du livre trouveront acquéreurs. En 1929, paraît une édition abrégée, Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes, rapidement surnommée Volksgünther, qui sera, elle, tirée à 295.000 exemplaires.
Auteur d'un ouvrage scientifique de référence sur "l'idée nordique" en Allemagne (2), Hans-Jürgen Lutzhöft explique les raisons qui ont fait le succès de ces deux manuels:
1) En reprenant les classifications des races, dressées par les anthropologues anglo-saxons Beddoe et Ripley, Günther analysait la population allemande et repérait les mixages dont elle était le résultat. C'était la première fois qu'un livre aussi didactique sur la question paraissait en Allemagne. Günther faisait dès lors figure de pionnier.
2) Didactique, Günther initiait ses lecteurs, avec une remarquable clarté, aux arcanes et aux concepts fondamentaux de l'anthropologie biologique. Le lecteur moyen acquérait, avec ce livre, un texte "initiatique" pratique, concret et instructif.
3) Les deux ouvrages étaient richement illustrés, ce qui ôtait toute abstraction ennuyeuse aux descriptions des phénotypes raciaux (physionomies, corpulences, formes des crânes, couleur des cheveux et des yeux etc.).
4) Le style du livre était précis, clair, compréhensible, convaincant.
5) La simplicité des démonstrations encourageait la lecture.
6) Günther ne sombrait dans aucune polémique gratuite. Certes, sa race "favorite" était la race nordique mais jamais il ne médisait des au-tres races européennes. Cette absence de propos médisants, inhabituelle dans les vulgarisations anthropologiques de l'époque, accordait à Günther un public nettement plus large que celui des petites sectes nordicomanes.
7) Vulgarisation qui n'avait pas la prétention d'être autre chose, la Rassenkunde possèdait un niveau scientifique réel et incontestable, malgré les lacunes que pouvaient repérer les spécialistes autorisés des universités. Pour l'anthropologue Eugen Fischer, le plus renommé dans sa profession pendant l'entre-deux-guerres allemand, la lecture de la Rassenkunde était impérative pour le débutant et même pour le professionnel qui voulait acquérir une souplesse didactique dans sa branche.
Le succès incroyable et inattendu de la Rassenkunde permet à Günther d'envisager la vie d'un écrivain libre. Il suit les cours de l'anthropologue Theodor Mollison (1874-1952) à Breslau et rencontre à Dres-de celle qui deviendra bien vite son épouse, la jeune musicologue norvégienne Maggen Blom. En 1923, il suit la jeune fille à Skien, sa ville natale, dans le Telemark norvégien, et l'épouse en juillet. Deux filles naîtront de cette union, Ingrid et Sigrun. Les Günther resteront deux ans à Skien, puis se fixeront à Uppsala en Suède, où se trouve "l'Institut d'Etat suédois de biologie raciale". Il travaillera là avec les anthropologues Lundborg et Nordenstreng. En 1927, la famille va habiter dans l'île de Lidingö près de Stockholm. Les années scandinaves de Günther sont indubitablement les plus heureuses de sa vie. Son âme de solitaire trouve un profond apaisement en parcourant les forêts et les montagnes peu peuplées de Norvège et de Suède. Il décline plusieurs invitations à revenir en Allemagne. En 1929, pourtant, quand le Reich est frappé durement par la crise économique, les ventes de la Rassenkunde baissent sensiblement, ce qui oblige Günther à abandonner sa vie de chercheur libre. Son ami Hartnacke use de son influence pour lui donner, à Dresde, un emploi de professeur de Gymnasium à temps partiel.
C'est à ce moment que des militants nationaux-socialistes ou nationalistes commencent à s'intéresser à lui. Darré estime que la Rassenkunde a donné une impulsion déterminante au "mouvement nordique". Ludendorff en chante les louanges. Rosenberg, lui, avait déjà, dans le Völkischer Beobachter du 7 mai 1925, réclamé la présence d'un homme du format de Günther à la Deutsche Akademie. Ce sera finalement Wilhelm Frick, ministre national-socialiste de l'intérieur et de l'éducation populaire du Land de Thuringe, qui, avec l'appui de Max Robert Gerstenhauer, Président thuringien de la Wirtschaftspartei (= Parti de l'Economie), bientôt alliée au NSDAP, déploiera une redoutable énergie pour donner à Günther, apolitique et simplement ami du responsable national-socialiste Paul Schultze-Naumburg, une chaire de professeur à l'université d'Iéna. Le corps académique résiste, arguant que Günther, diplômé en philologie, n'a pas la formation nécessaire pour accéder à un poste de professeur d'anthropologie, de raciologie ou d'hygiène raciale (Rassenhygiene). Frick et Gerstenhauer circonviennent ces réticences en créant une chaire "d'anthropologie sociale", attribuée immédiatement à Günther. Ce "putsch" national-socialiste, que Günther, bien que principal intéressé, n'a suivi que de loin, finit par réussir parce qu'une chaire d'anthropologie sociale constituait une nouveauté indispensable et parce que Günther, en fin de compte, avait amplement prouvé qu'il maîtrisait cette discipline moderne. La seule réticence restante était d'ordre juridique: les adversaires des nazis jugeaient que Frick posait là un précédent, risquant de sanctionner, ultérieurement, toutes inter-ventions intempestives du politique dans le fonctionnement de l'université. Le 15 novembre 1930, Günther prononce son discours inaugural seul, sans la présence du recteur et du doyen de sa faculté. Mais bien en présence de Hitler, qui vint personnellement féliciter le nouveau professeur, qui ne s'attendait pas du tout à cela... Hitler prenait sans doute la nomination de Günther comme prétexte pour être présent à l'université lors d'une séance publique et pour encourager ses compagnons de route à intervenir dans les nominations, comme l'avaient fait Frick et Gerstenhauer.
En 1933, quand Hitler et ses partisans accèdent au pouvoir, deux adversaires de Günther sont destitués voire emprisonnés, sans doute pour avoir mi-lité dans des formations hostiles à la NSDAP victorieuse. Rosenberg fait accorder à Günther le "Prix de science de la NSDAP" en 1935. En 1936, Günther reçoit une distinction honorifique moins compromettante: la "Plaquette Rudolf Virchow de la Société berlinoise d'Ethnologie, d'Anthropologie et de Proto-histoire", dirigée par Eugen Fischer. En 1937, il entre dans le comité directeur de la Société Allemande de Philosophie. Pour son cinquantième anniversaire, le 16 février 1941, il reçoit la "Médaille Goethe d'Art et de Science" et, ce qui est cette fois nettement compromettant, l'insigne d'or du parti.
En 1932, Günther publie un ouvrage très intéressant sur la présence d'éléments raciaux nordiques chez les Indo-Européens d'Asie (Indo-Iraniens, Beloutches, Afghans, Perses, Tadjiks, Galtchas, Sakkas, Tokhariens et Arméniens). Günther décèle de cette façon la voie des migrations indo-européennes, amorcées vers -1600 avant notre ère et repère les noyaux de peuplement encore fortement marqués par ce mouvement de population (3).
En 1935, paraît un autre livre important de Günther, Herkunft und Rassengeschichte der Germanen. Par la suite, jusqu'en 1956, Günther se préoccupera essentiellement d'hérédité, de sociologie rurale, etc., tous thèmes difficilement politisables. Malgré cet engouement du régime pour sa personne, Günther demeure en retrait et ne fait pas valoir sa position pour acquérir davantage d'honneurs ou d'influence. Hans-Jürgen Lutzhöft estime que cette discrétion, finalement admirable, est le résultat des dispositions psychiques, du tempérament de Günther lui-même. Il n'aimait guère les contacts, était timide et soli-taire. Par dessus tout, il appréciait la solitude dans la campagne et avait en horreur la fébrilité militante des organisations de masse. Comme le montre bien Frömmigkeit nordischer Artung (1934, 6ème éd.: 1963), Günther détestait le "byzantinisme" et le fanatisme. En 1941, en pleine guerre, Günther fait l'apologie d'un sentiment: celui de la "propension à la conciliation", fruit, dans le chef de l'individu, d'une fidélité inébranlable à ses principes et d'une tolérance largement ouverte à l'égard des convictions d'autrui; pour Günther, véritable-ment "nordique", donc exemplaire selon les critères de sa mythologie, était l'adage: "You happen to think that way; allright! I happen to think this way" (Vous pensez de cette façon? Fort bien! Moi, je pense de cette autre façon). Nostalgique de la Scandinavie, Günther, dit Lutzhöft, a souvent songé à émigrer; mais, une telle aventure l'aurait privé, lui et sa famille, de bien des avantages matériels...
Le cours des événements a fait réfléchir Günther et a renforcé son attitude réservée à l'endroit du régime. Entre l'idéologie officiellement proclamée et la pratique politique réelle de l'Etat national-socialiste, l'observateur détaché que voulait être Günther constate des différences flagrantes. Ce scepticisme croissant apparaît clairement dans le manuscrit qu'il prévoyait de faire paraître en 1944. Ce livre, intitulé Die Unehelichen in erbkundlicher Betrachtung (= Les enfants illégitimes vus sous l'angle des notions d'hérédité) fut en dernière instance interdit par les autorités nationales-socialistes, surtout à l'instigation de Goebbels et de Bormann. Pourquoi? Günther, personnellement, ne reçut jamais aucune explication quant à cette interdiction, surprenante lorsqu'on sait que l'anthropologue détenait l'insigne d'or du parti. Lutzhöft donne quelques explications intéressantes, qui, approfondies, vérifiées sur base de documents et de témoignages, permettraient d'élucider davantage encore la nature du régime national-socialiste, encore très peu connu dans son essence, malgré les masses de livres qui lui ont été consacrées. La raison majeure de l'interdiction réside dans le contenu du manuscrit, qui défend la monogamie et la famille traditionnelle, institutions qu'apparemment la dernière garde de Hitler, dont Bormann, souhaitait supprimer. Pour Günther, la famille traditionnelle monogame doit être maintenue telle quelle sinon le peuple allemand "risque de dégénérer". L'urbanisation croissante du peuple allemand a entraîné, pense Günther, un déclin du patrimoine génétique germanique, de telle sorte qu'un bon tiers de la nation pouvait être qualifié de "génétiquement inférieur". Sur le plan de la propagande, un tel bilan s'avère négatif car il autorise tous les pessimismes et contredit l'image d'une "race des seigneurs".
Pour Günther, une politique raciale ne doit pas être quantitative; elle ne doit pas viser à l'accroissement quantitatif de la population mais à son amélioration qualitative. Günther s'insurge dès lors contre la politique sociale du IIIème Reich, qui distribue des allocations familiales de façon égalitaire, sans opérer la moindre sélection entre familles génétiquement valables et familles génétiquement inintéressantes. Ensuite, il critique sévèrement l'attribution d'allocations aux filles-mères parce qu'une telle politique risquerait de faire augmenter indûment les naissances illégitimes et de détruire, à plus ou moins courte échéance, l'institution du mariage. Günther avait eu vent des projets d'établissement de la polygamie (conçus par Himmler et les époux Bormann) afin de combler le déficit des naissances et l'affaiblissement biologique dus à la guerre. Le trop-plein de femmes que l'Allemagne allait inévitablement connaître après les hostilités constituait un problème grave devant être résolu au profit exclusif des combattants rescapés de l'épopée hitlérienne. Bormann envisageait une institution polygamique prévoyant une femme principale et des femmes secondaires ou "amantes légales", toutes destinées à concevoir des enfants, de façon à ce que les Germains demeurent majoritaires en Europe. Pour Günther, ce système ne pourrait fonctionner harmonieusement.
Les "amantes légales", souvent sexuellement attrayantes, fantaisistes, gaies, auraient monopolisé l'attention de leurs mâles au détriment des femmes principales, plus soucieuses, en théorie, de leurs devoirs de mères. En conséquence, pense Günther, les femmes sexuellement fougueuses, qui ne sont pas nécessairement valables génétiquement (Günther, en tout cas, ne le croit pas), verraient leurs chances augmenter au détriment de la race, tandis que les femmes plus posées, génétiquement précieuses, risquent d'être délaissées, ce qui jouerait également au détriment de la race. Pire, ce système ne provoquerait même pas, dit Günther, l'accroissement quantitatif de la population, pour lequel il a été conçu. La polygamie, l'histoire l'enseigne, produit moins d'enfants que la monogamie. L'opposition de Günther au régime est évidente dans cette querelle relative à la politique sociale du IIIème Reich; il adopte une position résolument conservatrice devant la dérive polygamiste, provoquée par la guerre et la crainte d'être une nation dirigeante numériquement plus faible que les peuples dirigés, notamment les Slaves.
Revenu à Fribourg pendant la guerre, il quitte une nouvelle fois sa ville natale quand son institut est détruit et se fixe à Weimar. Lorsque les Américains pénètrent dans la ville, le savant et son épouse sont réquisitionnés un jour par semaine pour travailler au déblaie-ment du camp de Buchenwald. Quand les troupes US abandonnent la région pour la céder aux Russes, Günther et sa famille retournent à Fribourg, où l'attendent et l'arrêtent des militaires français. L'anthropologue, oublié, restera trois ans dans un camp d'internement. Les officiers de la Sûreté le traitent avec amabilité, écrira-t-il, et la "chambre de dénazification" ne retient aucune charge contre lui, estimant qu'il s'est contenté de fréquenter les milieux scientifiques internationaux et n'a jamais fait profession d'antisémitisme. Polac, Billig et Souchon, eux, sont plus zélés que la chambre de dénazification... S'ils avaient été citoyens ouest-allemands, ils auraient dû répon-dre devant les tribunaux de leurs diffamations, sans objet puisque seule compte la décision de la chambre de dénazification —contrôlée par la France de surcroît puisque Fribourg est en zone d'occupation française— qui a statué en bon-ne et due forme sur la chose à juger et décidé qu'il y avait non-lieu.
Günther se remit aussitôt au travail et dès 1951, recommence à faire paraître articles et essais. En 1952, paraît chez Payot une traduction française de son ouvrage sur le mariage (Le Mariage, ses formes, son origine, Payot, 1952). En 1953, il devient membre correspondant de l' American Society of Human Genetics. En 1956 et 1957, paraissent deux ouvrages particulièrement intéressants: Lebensgeschichte des Hellenischen Volkes et Lebensgeschichte des Römischen Volkes, ("Histoire biologique du peuple grec" et "Histoire biologique du peuple romain"), tous deux repris de travaux antérieurs, commencés en 1929. En 1963, paraît la sixième édition, revue et corrigée, de Frömmigkeit nordischer Artung. Cette sixième édition, avec l'édition anglaise plus complète de 1967 (Religious attitudes of the Indo-Europeans, Clair Press, London, 1967), a servi de base à cette version française de Frömmigkeit nordischer Artung, dont le titre est dérivé de celui d'une édition italienne: Religiosita indoeuropea. Le texte de Frömmigkeit... est une exploration du mental indo-européen à la lumière des textes classiques de l'antiquité gréco-romaine ainsi que de certains passages de l'Edda et de poésies de l'ère romantique allemande. Avec les travaux d'un Benveniste ou d'un Dumézil, ce livre apparaîtra dépassé voire sommaire. Sa lecture demeure néanmoins indispensable, surtout pour les sources qu'il mentionne et parce qu'il est en quelque sorte un des modestes mais incontournables chaînons dans la longue quête intellectuelle, philologique, de l'indo-européanité, entreprise depuis les premières intuitions des humanistes de la Renaissance et les pionniers de la linguistique comparée.
Après la mort de sa femme en 1966, Günther vit encore plus retiré qu'auparavant. Pendant l'hiver 1967-1968, il met péniblement en ordre —ses forces physiques l'abandonnent— ses notes personnelles de l'époque nationale-socialiste. Il en sort un livre: Mein Eindruck von Adolf Hitler (L'impression que me fit Adolf Hitler). On perçoit dans ce recueil les raisons de la réticence de Günther à l'égard du régime nazi et on découvre aussi son tempérament peu sociable, hostile à tout militantisme et à tout collectivisme comportemental. S'il fut, malgré lui, un anthropologue apprécié du régime, choyé par quelques personnalités comme Darré ou Rosenberg, Günther fut toujours incapable de s'enthousiasmer pour la politique et, secrètement, au fond de son cœur, rejetait toute forme de collectivisme. Pour ce romantique de la race nordique, les collectivismes communiste ou national-socialiste sont des "asiatismes". L'option personnelle de Günther le rapproche davantage d'un Wittfogel, théoricien du "despotisme oriental" et inspirateur de Rudi Dutschke. L'idéal social de Günther, c'est celui d'un paysannat libre, sans Etat, a-politique, centré sur le clan cimenté par les liens de consanguinité. En Scandinavie, dans certains villages de Westphalie et du Schleswig-Holstein, dans le Nord-Ouest des Etats-Unis où se sont fixés de nombreux paysans norvégiens et suédois, un tel paysannat existait et subsiste encore très timidement. Cet idéal n'a jamais pu être concrétisé sous le IIIème Reich. Mein Eindruck von Adolf Hitler (4) est, en dernière instance, un réquisitoire terrible contre le régime, dressé par quelqu'un qui l'a vécu de très près. Ce document témoigne d'abord, rétrospectivement, de la malhonnêteté profonde des pseudo-historiens français qui font de Günther l'anthropologue officiel de la NSDAP et, ensuite, de la méchanceté gratuite et irresponsable des quelques larrons qui se produisent régulièrement sur les plateaux de télévision pour "criminaliser" les idéologies, les pensées, les travaux scientifiques qui ont l'heur de déplaire aux prêtres de l'ordre moral occidental...
Epuisé par l'âge et la maladie, Günther meurt le 25 septembre 1968 à Fribourg. La veille de sa mort, il écrivait à Tennyson qu'il souhaitait se retirer dans une maison de repos car il ne ressentait plus aucune joie et n'aspirait plus qu'au calme.
Robert Steuckers.
(Bruxelles, septembre 1987).
Notes
(1) Michael Billig, L'internationale raciste. De la psychologie à la science des races, François Maspero, Paris, 1981.
(2) Hans-Jürgen Lutzhöft, Der Nordische Gedanke in Deutschland, 1920-1940, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1971. La présente introduction tire la plupart de ses éléments de cet ouvrage universitaire sérieux.
(3) Cf. Hans F. K. Günther, Die Nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens, Verlag Hohe Warte, Pähl, 1982 (réédition).
(4) Hans F. K. Günther, Mein Eindruck von Adolf Hitler, Franz v. Bebenburg, Pähl, 1969.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : racialisme, races, racisme, anti-racisme, révolution conservatrice, allemagne, indo-européens, religion, religiosité, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 19 mai 2009
Dirigente de Kirguistan denuncia permanencia de base aérea de EE.UU
Dirigente de Kirguistán denuncia permanencia de base aérea de EE.UU
 El vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Legislativa de Kirguistán, Kabai Karabékov, afirmó que todos los acuerdos referentes a la base que Estados Unidos emplazó en ese país asiático han vencido, y la permanencia de sus tropas es injustificada.
El vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Legislativa de Kirguistán, Kabai Karabékov, afirmó que todos los acuerdos referentes a la base que Estados Unidos emplazó en ese país asiático han vencido, y la permanencia de sus tropas es injustificada.
Insistió el líder parlamentario en que no existen razones para que efectivos del Pentágono permanezcan en Kirguistán.
El parlamento kirguís rescindió el respectivo acuerdo con Estados Unidos y otras once naciones de la llamada coalición antiterrorista. No se justifica que siga funcionando la base de Manas y permanezcan en ella militares extranjeros, reiteró el diputado.
Reiteró Karabékov que no se justifica que siga funcionando la base de Manas y permanezcan en ella militares extranjeros.
Karabékov fue tajante al advertir que todos los acuerdos sellados anteriormente perdieron ya su vigencia.
Con esas palabras el vicepresidente del comité parlamentario explicó la inutilidad de una propuesta del senado estadounidense de destinar 30 millones de dólares al desarrollo de la aeronavegación de Kirguiztán si este país acepta tropas de Washington en Manas.
Recientemente la secretaria de Estado de la potencia del Norte, Hillary Clinton, dijo a la prensa que se sentía confiada en que sea alcanzado un acuerdo.
En nombre de la lucha global contra el terrorismo, Manas fue inaugurada en 2001 de acuerdo con la ONU para apoyar la invasión de fuerzas de la OTAN encabezadas por Estados Unidos contra Afganistán.
Unos mil 200 efectivos estadounidenses y de otros países permanecen en ese enclave militar.
A tenor de una resolución aprobada por el parlamento kirguiz el 19 de febrero, las tropas foráneas tendrán que marcharse de ese cuartel 180 días después de invalidado el acuerdo, o sea en la primera mitad de agosto.
Extraído de Radio Habana Cuba.
00:50 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, relations internationales, otan, etats-unis, eurasie, asie, asie centrale, affaires asiatiques, terre du milieu |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Politieke schandalen

Politieke schandalen
Door yvespernet op 13 mei 2009
Het is een goed seizoen voor mensen die zich graag bezighouden met politieke schandalen. Lijst Dedecker waar de broodjesmadam verdwijnt en terugkeert. En niet alleen met broodjes, maar ineens met een heel dubieus contract ondertekend door kopstukken van de OpenVLD. In Knack staat dan weer een voorpublicatie uit het boek van Leo Goovaerts waarin wordt aangetoond dat ook Verhofstadt niet vies is van dubieuze praktijken. Zo zou Verhofstadt Goovaerts een goede 50.000 euro afhandig hebben gemaakt waarna hij Goovaerts uit de partij liet smijten, nadat hem eerst nog een senaatszetel was beloofd. Meer info over die zaak hierzo. Hieronder een kleine anekdote;
De zaak-Dirk Vijnck is één keer gebeurd ‘en zal nooit meer gebeuren’, zei Open VLD-voorzitter Bart Somers vorige week na de onverkwikkelijke overlopersaffaire met een backbencher van LDD. Toch lijkt het ‘kopen’ van loyauteit een essentieel onderdeel van de liberale partijcultuur. Zelfs het omgekeerde is er mogelijk: geld afhandig maken en dan elimineren. [...] Het verhaal begint in 1988 wanneer Annemie Neyts Guy Verhofstadt opvolgt als voorzitter van de toenmalige PVV. De partij zit in de schulden, maar ook Verhofstadt zelf zit in slechte papieren. ‘Maar er was meer aan de hand.[...]

Tussen 1989 en 1998 schrijft Leo Goovaerts – die ondertussen penningmeester van de VLD is en samen met Verhofstadt, De Gucht en Dewael tot de absolute partijtop behoort – herhaaldelijk brieven aan Guy Verhofstadt met de vraag om de persoonlijke lening terug te betalen. In 1998 was de schuld al opgelopen tot 3,6 miljoen frank (90.000 euro). Dan doet Verhofstadt hem een voorstel: een verkiesbare plaats op de Senaatslijst voor de verkiezingen van 1999.[...]
Die vijfde januari was er een geheime bijeenkomst in de Gentse privéwoning van Guy Verhofstadt. Onder meer Patrick Dewael was erbij. En Karel De Gucht natuurlijk, want als er iemand af te maken is, is de Karel altijd bij de pinken. Ook de persman van de partij was die dag aanwezig. En er was intens contact met Annemie Neyts. Het enige agendapunt van de besloten vergadering: de eliminatie van Leo Goovaerts,’ schrijft Goovaerts.
Een goede opinie over de politieke oligarchie vindt men trouwens hier terug door Rik van Cauwelaert. Maar ook in Groot-Britannië zjin er problemen genoeg. Daar bleken immers de parlementsleden hun onkostenvergoedingen nogal breed te gebruiken. Gaande van hun huizen te laten kuisen voor een goeie 4.000 euro tot een yoghurtje van 42 cent of het betalen van een pornofilm, alles werd de belastingsbetaler aangerekend. Meer info daarover vindt u hier.
Het politieke systeem is rot en sommige mensen vertikken het dan ook, begrijpelijk, om zelf nog maar te gaan stemmen. Ikzelf ga echter bij de volgende verkiezingen zeker stemmen. Niet omdat ik overtuigd ben dat er ook maar iets gaat veranderen door te stemmen of doordat ik geloof dat een bepaalde partij beter is dan een andere. Nee, ik ga stemmen omdat in het verleden duizenden mensen hebben betoogd, zijn vervolgd, fysiek uitgeschakeld, etc… zodat ik het recht zou hebben om mijn keuze te maken tussen de hopen lijsten zakkenvullers. Uit respect voor die mensen ga ik stemmen, niet uit respect voor de politieke demoligarchie. Daarbij, mijn inziens, als je niet gaat stemmen, heb je daarna ook geen recht van spreken of klagen.
00:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, flandre, scandales politiques, politique, corruption, démoligarchie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Veit Harlan revisited
Veit Harlan revisited
Martin LICHTMESZ - http://www.sezession.de/
Um meine kleine, ungeplante Harlan-Serie abzuschließen, möchte ich noch auf den sehr guten Dokumentarfilm „Harlan – Im Schatten von Jud Süß“ von Felix Moeller hinweisen, der zur Zeit im Kino zu sehen ist. Moeller hat den vielköpfigen Harlan-Söderbaum-Körber-Klan (Hilde Körber war Harlans zweite Ehefrau, Söderbaum die dritte) bis zu den Enkeln hinab zu dem berüchtigten Patriarchen befragt.
Dabei sind etwa dreiviertel der Interviewten ebenfalls im Film-und Showbusiness tätig, am bekanntesten wohl Stanley Kubricks Witwe Christiane, eine Nichte Harlans, und ihr Bruder Jan, Kubricks „Executive Producer“. Es ist interessant zu sehen, wie auf sie alle der „Schatten von Jud Süss“ gefallen ist, und wie sich die ganze Familie immer noch mehr oder weniger daran abarbeitet.
Am extremsten ist dabei sicher der 1929 geborene älteste Sohn Thomas Harlan, seines Zeichens selbst Filmemacher, für den die Bewältigung der tatsächlichen, vermuteten oder unterstellten Schuld des Vaters zur lebenslangen Obsession geworden ist. Dafür wird er von seinen eher moderaten Geschwistern, die eine überwiegend positive emotionale Bindung zu ihren Eltern haben, auch recht kritisch betrachtet. Es ist erschütternd mitanzusehen, wie dieser nunmehr 80jährige Mann immer noch vom Gespenst des Vaters heimgesucht wird. Sein Film „Wundkanal“ aus dem Jahr 1984 gehört zu den wohl krassesten Exponaten einer auf die Spitze getriebenen, nahezu pathologischen Vergangenheitsbewältigung (die Edition Filmmuseum wird ihn im Juni auf DVD herausbringen). Harlan engagierte sich seit den Fünfziger Jahren auf der radikalen Linken, wovon nicht zuletzt „Wundkanal“ mit seiner offenen Sympathie für die RAF zeugt. Harlans anklägerische Besessenheit erinnerte mich an Horst Mahler und seine 180 Grad-Wendungen: beide sind für mich Zeugen, daß der deutsche Rechtsextremismus und Linksextremismus ein- und demselben Knacks entspringen, und der eine nur die Kehrseite des anderen ist.
„Harlan“ kann man als einen weiteren Eintrag in einem Subgenre des „Bewältigungsfilms“ sehen, das ich als die „Familiengeschichte“ bezeichnen möchte. Andere Beispiele der letzten Jahre waren Malte Ludins „Zwei oder Drei Dinge, die ich von ihm weiß“ (2004), Jens Schanzes „Winterkinder“ (2005) und Rosa von Praunheims „Meine Mütter“ (2008) . Dabei ist zu verzeichnen, daß die jüngeren filmischen Aufarbeitungen (Ludin ist natürlich das Gegenbeispiel) sich immer mehr von der Anklage weg zum Versuch des distanzierten Verstehens hin bewegen. So läßt auch Felix Moellers Film den unterschiedlichen Perspektiven und Urteilen der Familienmitglieder einen beträchtlichen Spielraum, ohne selbst Partei zu ergreifen.
Als exponierter, herausragender Künstler ist Veit Harlan bis heute einer der bevorzugten Sündenböcke des Dritten Reichs. Es mutet seltsam an, seine Kinder und Enkel, die allesamt unverkennbar seinen und Kristina Söderbaums physiognomischen Stempel tragen, im Banne der „Schuld“ ihres Ahnherren zu sehen. Diese Identifikation oder zumindest schandhafte Affizierung durch das „Blut“ ist ein ebenso irrationaler wie seelisch schlüssiger Vorgang. Eine der Enkelinnen Harlans merkt in dem Film an, daß es ihr natürlich lieber wäre, wenn ihr Großvater ein „Widerstandskämpfer“ gewesen wäre, aber rational betrachtet würde das genausowenig einen besseren oder einen schlechteren Menschen aus ihr machen wie ein „Nazi“-Großvater.
Dennoch bleibt diese eigentümliche Affizierung, gleich einer Art von Erbsünde zurück, wobei der Grad der Emotionalität bei den Familienmitgliedern sehr verschieden ist. Man kann Moellers Film auch als eine Art von „Familienaufstellen“ sehen, frei nach der therapeutischen Schule des („umstrittenen“) Psychologen Bert Hellinger. (Über dessen ebenso seltsames wie genialisches Konzept kollektiver seelischer Kausalitäten und Verstrickungen kann man „kritisch“ hier und hier nachlesen.)
Hellinger postuliert die Existenz einer Art „Familienkarma“, das über Generationen hinweg schicksalshaft fortwirkt. Man muß den Begriff nicht unbedingt „mystisch“ nehmen – mir gefällt er als Metapher, mit der man auch die seelische Verfassung der Deutschen als Volk beschreiben könnte, die sich immerhin aus der Gesamtheit von vielen Millionen Familiengeschichten- und -schicksalen speist. Wer das bis heute weitervererbte Schuldgefühl und Unbehagen der Deutschen an sich selbst allein auf „Umerziehung“ und politische Idoktrinierung zurückführt, greift meines Erachtens zu kurz. Die „Seelengeschichte“ der Deutschen, das ist etwas, das immer noch nicht in seiner Tiefe ergründet worden ist.
Erwähnen möchte ich noch, daß der Film auch die faszinierende Seite von Harlan nicht unterschlägt. Seine schwerblütigen, zum Teil kitschigen und morbiden Melodram-Exzesse in berauschendem Agfacolor wie „Die goldene Stadt“ (1942), „Immensee“ (1943) oder „Opfergang“ (1944) haben auch heute noch ihren eigentümlichen, unverwechselbaren Reiz bewahrt. Sie mit neuen Augen sehen lernen kann man mithilfe der exzellenten und materialreichen Harlan-Biographie „Des Teufels Regisseur“ von Frank Noack. Noack scheut sich nicht vor kühnen Urteilen, und wartet mit vielen, zum Teil überraschenden historischen Details auf, die einen hochdifferenzierten Blick auf den Regisseur und seine Arbeit erlauben.
Zum Schluß noch eine Abbitte. Neulich schrieb ich „Nach dem Krieg ließ Stalin heroische Filme drehen, die dem Stil von „Kolberg“ aufs Haar glichen und den Sieg über den „Faschismus“ feierten, etwa 1948 in Farbe „Die Schlacht um Berlin“. Nachdem ich nun „Die Schlacht um Berlin“ (1949) zur Gänze gesehen habe, muß ich zu Harlans Gunsten sagen, daß „Kolberg“ auch nicht nur annähernd so plump und naiv ist wie diese stalinistische Sowjetproduktion.
00:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, cinéma, années 20, années 30, années 40, national-socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Encerclement de l'Iran (4/6)

L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du “Grand Moyen-Orient” (4/6)
Reza Khan et le pan-iranisme
Pendant la première guerre mondiale, l’Iran se déclare neutre. Sa toute petite armée, réduite à l’impuissance, était organisée par des officiers suédois, la Suède conservatrice tentant toujours de faire diversion dans le sud, de s’y donner des alliés de revers, afin de récupérer la Finlande au nord. Dès le début des hostilités, les Russes violent le territoire au Nord et les Britanniques au Sud, sous prétexte de protéger les champs pétrolifères contre toute attaque germano-turque venue de Mésopotamie. Deux expéditions allemandes, dirigées par von Niedermeyer et Wassmuss, faiblement équipées, parviennent à soulever des tribus iraniennes et afghanes contre les Britanniques ou les Russes. Ces opérations de petite envergure obligent toutefois les Britanniques à mobiliser des milliers d’hommes pour tenter de les neutraliser. Les opérations de Wassmuss lui ont valu le surnom de “Lawrence allemand”. Après la guerre et après le Traité de Versailles, qui cherche à placer l’Iran tout entier sous la domination britannique, Reza Khan, par un coup d’Etat le 21 février 1921, prend le pouvoir, dépose le dernier Shah qadjar, le faible Ahmad Mirza, et fonde la dynastie des Pahlavi. Il compose avec les Soviétiques en 1924 pour obtenir la paix sur sa frontière septentrionale et pour se ménager les Soviétiques contre les Anglais, bien plus menaçants au sud et à l’est; l’objectif britannique étant d’inclure la Perse toute entière dans leur orbite pour “créer une continuité territoriale du Caire à Calcutta”. Pour contrer l’impérialisme anglais, le nouveau pouvoir bolchevique remet toutes les dettes que l’Iran devait à la Russie tsariste. De cette façon, l’Iran, redevable de sa sécurité financière à Moscou, cesse automatiquement de devenir un tremplin éventuel pour envahir l’Asie centrale soviétique.
Le 25 avril 1926, Reza Khan se fait couronner empereur. Il veut insérer son pays dans le 20ième siècle. Admirateur d’Atatürk, il souhaite doter le pays d’un système scolaire moderne, diminuer la dépendance face à l’Angleterre, réduire le pouvoir des religieux chiites, promulguer un code civil et enlever l’exercice de la justice au clergé, ce que ce dernier n’acceptera pas et ne pardonnera jamais. Le plus intéressant dans l’ensemble de ces innovations imposées d’autorité par le nouveau Shah est sa volonté de réhabiliter le passé iranien pré-islamique. Cette réhabilitation passe par la fondation d’une académie qui épure la langue persane de ses emprunts arabes. Mais, comment, par ailleurs, va s’articuler ce “persisme”? Quels en sont les ingrédients idéologiques, les lignes de force?
Le culte de Cyrus le Grand
◊ D’abord le culte de Cyrus le Grand, fondateur de l’impérialité perse. En dépit de 27 ans de pouvoir islamiste, les pèlerinages au site de son tombeau ne cessent pas. Cyrus est l’archétype de l’identité persane mais aussi un symbole de liberté et de tolérance dans l’exercice de la puissance impériale. Cyrus a toujours été un vainqueur magnanime, une “grande âme” (“magna anima”), qui réhabilitait les vaincus, contrairement aux Assyriens qui les décapitaient ou les empalaient. Les deux shahs de la dynastie pahlavi ont tenté d’introniser ce culte de la grandeur perse antique pour évincer un islamisme qu’ils jugeaient décadent, qu’ils considéraient comme un frein au développement de l’Iran. La période d’effervescence, qui a précédé la chute du dernier shah et le retour de Khomeiny, a été marquée par cette lutte idéologique: d’une part, les forces de gauche, comme le parti Tudeh, d’obédience communiste, posaient Cyrus comme un tyran, sapant de la sorte —et de manière préventive— les assises de toute monarchie et de tout retour à celle-ci, quand bien même la monarchie aurait été stabilisatrice et progressiste (au sens technique du terme), indépendantiste (anti-britannique et anti-américaine). L’idéologie du Tudeh voulait promouvoir un “avenir radieux” (pour paraphraser Zinoviev) et ne voulait rien avoir à faire avec le passé, avec des archétypes. Les partisans islamistes de Khomeiny entendaient, eux, ignorer le passé pré-islamique de la Perse et ne valorisaient que l’enseignement des “nobles récits” des héros de la tradition musulmane chiite. Pour le clergé chiite, il est inacceptable de valoriser des événements historiques antérieurs à l’islam, puisque, par définition, toute époque pré-islamique est considérée comme “jahilliya”, soit un “âge d’ignorance”. Ce sera surtout l’ayatollah Khalkhali, —surnommé le “juge pendeur”, car il a été l’exécuteur intraitable de l’élite militaire iranienne favorable au Shah déchu,— qui tentera, mais en vain, d’éradiquer le culte de Cyrus, en réclamant, avec une véhémence tenace, la destruction de son tombeau, des ruines de Persépolis et de toutes les traces de l’impérialité persane pré-islamique (les talibans détruiront, dans un même esprit, les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan). Les islamistes et les partisans de cette figure originale de la révolution iranienne, Ali Shariati, voulaient valoriser la figure de l’Imam Hossein, martyr au 7ième siècle de la foi chiite parce qu’il s’était opposé à la tyrannie illégitime des Ommeyades, apparentés au Calife Othman.
Impérialité perse, zoroastrisme et culte de la Lumière aurorale
Les partisans du Shah, en revanche, se réclamaient du passé “aryen” de la Perse, se démarquant du même coup de leurs voisins arabes (sémitiques) et turcs (ouralo-altaïques). Mohammad Reza Pehlavi, le dernier Shah, qui sera abandonné par ses “alliés” (?) américains, avait clairement renoué avec ce passé en faisant célébrer à grands frais, et de manière maladroite parce que trop dispendieuse, le 2500ième anniversaire de la fondation par Cyrus de l’impérialité perse. Dans ce contexte, il modifie d’autorité le calendrier musulman: l’année de la naissance de Cyrus remplaçant l’Hégire, la fuite de Mahomet de la Mecque à Médine. L’année 1976 devenant ainsi 2535, au lieu de 1355. Un idéologue paniraniste (le paniranisme veut la réunification légitime de la Perse et de l’Afghanistan), Shahrokh Meskoob, écrivait, peu après la révolution khomeyniste: “C’est surtout en deux choses que, nous, Iraniens, différons des autres musulmans: par l’histoire et par la langue. Ce sont ces deux facteurs qui nous ont induits à construire notre propre identité en tant que peuple et que nation. L’histoire a été notre valeur, elle a constitué les réserves pour nous permettre de suivre à chaque fois notre propre voie, et elle est aussi notre refuge. La langue a constitué le socle, le sol et le refuge de notre âme, un point d’appui sur lequel nous nous sommes toujours arc-boutés” (cité par Molavi, cf infra).
◊ Ensuite, la position par rapport au zoroastrisme. Si l’Iran est chiite, admettent la plupart des iranologues, c’est parce que son passé pré-islamique a été zoroastrien. Le chiisme traditionnel, du moins avant Khomeiny, gardait du zoroastrisme le culte du feu et de la lumière, notamment dans les écoles dites “illuminationistes” ou Eshraqi / Ishrâqî. Cette école date du renouveau iranien du 11ième siècle, est en cela typiquement perse, non arabe et non turque. L’idée centrale de cette “illuminationisme” perse est, in fine, un culte de la lumière, hérité du zoroastrisme, dont la manifestation tangible est une architecture religieuse et sacrée, laissant filtrer dans les mosquées ou les mausolées la lumière d’une manière particulièrement ravissante, provoquant des jeux de couleurs turquoise ou émeraude du plus bel effet. Des dieux du jour (et donc de la lumière et du soleil) indo-européens au culte de la Lumière du zoroastrisme, un filon millénaire conduit directement à ces poètes persans des 11ième et 12ième siècles, les Ishrâqîyûn ou adorateurs de l’ “illumination aurorale” ou des “princes célestes”, qui sont en fait les Intelligences illuminantes, dont les astres sont les symboles et les théurgies (oeuvres divines). A l’oeuvre, dans cet univers, un “Eros cosmogonique” porté par les “fidèles d’amour”. Dans les récits mystiques de Sohrawardi (12ième siècle), le Dieu des Dieux proclame: “Rien n’est plus vénérable pour moi que Bahman-Lumière (…) Célébrez en longues liturgies la race de Bahman-Lumière et les rois de la famille de Bahman-Lumière peuplant l’inviolable enceinte du Jabarût (soit le “monde des pures intelligences lumineuses et illuminantes, aurorales”)”. Implicitement, après le “Shahnameh” de Ferdowsi (cf. infra), Sohrawardi réclame, en utilisant le nom zorosastrien de “Bahman” (ou “Vohu Manah”), l’avènement d’un Ordre Royal de tradition persane où ceux qui sont issus de la race de Bahman-Lumière doivent s’organiser en une sodalité ésotérique, élitaire, en “templiers célestes”, sur le modèle de la chevalerie ouranienne pour répondre à l’appel de cette race et pour installer, selon son esprit, un Ordre aussi parfait que possible sur terre, brisant du même coup la solitude de l’homme égaré par ses affects et ses intérêts matériels et le sauvant de la déréliction humaine, tare constante, terrible et récurrente.
Renaissance iranienne au 11ième siècle: le “Shahnameh” de Firdowsi
◊ Dans cette renaissance iranienne du 11ième siècle, émerge également le “Livre des Rois”, le “Shahnameh”, dû à la plume du poète Ferdowsi. Ce dernier a véritablement sauvé la tradition perse de l’arabisation par l’islam. Ferdowsi n’est pas opposé à l’islam. Aucun texte de lui ne constitue une réfutation ou un rejet de l’islam. En revanche, il critique l’invasion seldjouk, danger pour l’identité perse. Ferdowsi était issu d’une famille iranienne du Nord-Est, de la région de Machhad où la mémoire des épopées persanes avait été conservée en dépit de l’islamisation. Né vers 941, il bénéficie du soutien du maître des lieux, Abou Mansour Tousi, qui gouverne le Khorassan pour le compte des Samanides de Boukhara. Afin de réhabiliter l’histoire perse, et donc la geste des rois de la “race de Bahman-Lumière”, les Samanides demandent à Ferdowsi de rédiger ce “Livre des Rois” en 957. Il reprend l’oeuvre laissée par Daqîqî, un poète perse qui avait été assassiné par un esclave turc, et inclut les 988 vers de son “Livre des Rois” dans son “Shahnameh”, auquel il travaille pendant plus de trente ans, jusqu’en 1010, avec le soutien continu des Samanides. La version définitive de cette épopée persane comptera entre 48.000 et 55.000 vers. Quand les Samanides quittent l’avant-scène politique de l’Islam et de l’Iran, Ferdowsi s’adresse à Mahmoud de Ghazni (cf supra), qu’il perçoit comme l’homme fort capable de redonner à l’Iran sa gloire et son lustre d’antan, de résister à l’arabisation et de constituer un rempart contre la menace turque-seldjouk qui pointe à la frontière. Mahmoud de Ghazni l’ignore et le méprise et Ferdowsi mourra abandonné et misérable. Les mollahs musulmans sunnites refusent qu’il soit enterré dans un cimetière religieux, sous prétexte qu’il est tout à la fois chiite et zoroastrien. Le premier Shah Pahlavi lui fera construire un mausolée en 1934, à l’occasion du millénaire de sa naissance. L’oeuvre de Ferdowsi, d’une beauté incomparable, sert de référence au paniranisme voulu par Reza Shah. Il atteste d’abord d’une continuité perse très ancienne, ensuite, d’une résistance iranienne à toutes les influences arabes et turques qui ont tenté de subjuguer le pays et d’en éradiquer la mémoire.
La poésie d’Omar Khayyam
Né vers 1045 dans le Nord-Est de l’Iran, comme Ferdowsi, Omar Khayyam est nommé astronome à la cours du grand vizir seldjouk Nizam al-Molk en 1073. Il calcule le temps avec plus de précision encore que ses homologues européens qui élaborent le nouveau calendrier grégorien. Savant versé dans toutes les disciplines de son époque, il connaît la pensée grecque et indienne, est plus que probablement influencé par une forme de soufisme qui récapitule plus ou moins secrètement, sous un masque islamique, le savoir des siècles et des millénaires antérieurs à la conversion forcée. Omar Khayyam est aussi poète: dans son “Robayyat”, il exprime, pour lui et quelques rares lecteurs initiés, une pensée peu bigote, où le scepticisme domine, assorti d’un rejet des dogmes figés, d’une ironie décapante, d’une misanthropie humoristique et d’un épicurisme affiché. Cette poésie sera redécouverte à Oxford au 19ième siècle par Edward Fitzgerald, qui avait consulté un exemplaire du “Robayyat” de 1461, conservé dans la bibliothèque de l’université britannique. La traduction de Fitzgerald fera connaître et aimer cette poésie persane à l’Europe toute entière. Au 14ième siècle, un autre poète persan, Hafez, réanime les mêmes thématiques poétiques: moqueries à l’égard des zélotes religieux, de la police de la foi. Il inspirera Goethe.
Conclusions:
◊ Notre première batterie de conclusions portera sur la nature réelle des antagonismes qui ont tissé l’histoire du “Grand Moyen-Orient”, que nous avons tenté, sommairement, d’esquisser ici. Généralement, on considère que trois sortes de facteurs sont en jeu: les facteurs religieux, les facteurs idéologiques et les facteurs ethniques. A la lumière de l’histoire iranienne, il ne semble pas que les facteurs religieux soient prépondérents. Le zoroastrisme, bien que réellement religieux et universel, c’est-à-dire transposable à d’autres peuples que les peuples aryens-iraniens, demeure constitutif de l’identité aryenne-iranienne, donc, par voie de conséquence, constitue davantage un facteur ethnique qu’un facteur proprement religieux. La volonté iranienne, surtout depuis les Séfévides, d’adopter le chiisme comme religion d’Empire, est certes un facteur religieux indéniable, mais, vu que ce chiisme est une volonté de se démarquer d’autres peuples, non indo-européens de souche, et vu qu’il véhicule sous un manteau chiite des linéaments religieux zoroastriens inspirés d’une mythologie persane indo-européenne et surtout pré-islamique, il procède forcément, lui aussi, du facteur ethnique iranien.
Les facteurs idéologiques habituels, basés sur les grands récits hégéliens et marxistes, nés en Europe et en Occident au début du 19ième siècle, n’ont guère eu d’impact dans la vaste région du “Grand Moyen-Orient” depuis l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan et la révolution islamiste iranienne de 1978. En effet, les idéologies, et plus particulièrement les fameux “grands récits”, définis par Jean-François Lyotard, se sont effondrés partout dans le monde, comme des châteaux de cartes, à commencer par le marxisme. Des bribes et des morceaux de ces récits ont survécu, ici ou ailleurs, mais travestis, réadaptés, relus, pimentés de mythes religieux ou nationaux (comme chez le théoricien chiite-marxisant Ali Shariati ou chez des révolutionnaires du “tiers monde”). Ces “grands récits” idéologiques ne peuvent donc pas être considérés comme des facteurs essentiels dans le “grand jeu” à l’oeuvre sur l’échiquier du “Grand Moyen-Orient”. Les acteurs locaux se mobilisent plutôt au nom de valeurs plus anciennes, plus fondamentales: celles que portent en germe les facteurs ethniques ou raciaux (n’ayons pas peur du mot). Les acteurs extérieurs, essentiellement les services américains, manipulent des conflits religieux, certes, mais qui recouvrent des antagonismes ethniques pluriséculaires. Il suffit de lire attentivement les documents anglo-saxons pour s’apercevoir que le raisonnement qui les produit n’est ni religieux ni idéologique, mais ethnique et politique. Ce qui offre une base d’action réellement concrète et laisse la manipulation vaine et illusoire de tous ces brics et brocs résiduaires des vieilles idéologies froides, artificielles et purement intellectuelles aux adversaires ou aux “alien audiences”, que sont les opinions publiques des pays alliés, qui ont pour seule tâche d’entériner, sans intervenir vraiment dans le jeu.
Facteurs raciaux: matrices turco-mongole, arabo-sémitique et indo-européenne
Lorsque l’on évoque les “facteurs ethniques ou raciaux” dans l’espace du “Grand Moyen-Orient”, il ne s’agit pas, évidemment, de définir, de retrouver ou de récréer une “race pure”, qu’elle soit iranienne, turque ou arabe. L’exercice serait vain, tant les brassages d’une histoire tumultueuse ont été fréquents et importants. De nombreux sultans d’origine turque ont adopté la vision iranienne/aryenne de l’histoire, ou plus tard, la vision russe. Lorsque nous évoquons ces “facteurs ethniques”, nous entendons de ce fait l’identification volontaire des acteurs de l’histoire ou des peuples à l’une des matrices ethniques fondamentales: la turco-mongole, l’arabo-sémitique et l’indo-européenne.
La matrice turco-mongle a son épicentre originel au nord de la Mandchourie. Les décideurs politiques qui inscrivent leurs actions dans cette tradition turco-mongole se perçoivent comme les avant-gardes d’un vaste mouvement originaire de cet épicentre, en quête de nouvelles terres à conquérir ou à annexer. Ainsi, le pantouranisme turc rêve d’un espace uni de l’Adriatique à la Muraille de Chine.
La matrice arabo-sémitique a son épicentre dans la péninsule arabique. D’après l’historien et cartographe britannique Colin McEvedy, elle procède d’un vaste conglomérat de tribus locutrices de langues “afro-asiatiques” qui s’est scindé, vers –4000, en quatre groupes, chacun disposant d’une “écosphère” propre: les Berbères du littoral nord-africain, les Egyptiens de la vallée du Nil, les Kouchites de la Corne de l’Afrique et les Arabo-Sémites de la péninsule arabique. Le nord de leur “Heimat” originelle s’est urbanisé en marge de l’Empire assyrien et a utilisé la langue araméenne. Le sud est resté isolé dans le désert arabique, devenant au fil des temps de plus en plus sec et aride. La civilisation du Yémen contient des éléments indubitablement indo-européens: architecture et alphabet. L’Islam a sorti les cultures arabo-sémitiques de leur isolement. Elles ont conquis leur environnement araméo-byzantin et perse, mais aussi égyptien et berbère. Ces peuples conquis ont résisté ou résistent toujours. On a vu comment l’esprit persan est revenu à l’avant-plan en Perse malgré l’arabisation, la turcisation et les conquêtes mongoles.
Dans les zones berbères, cette résistance existe également aujourd’hui en Algérie et au Maroc. Charles de Foucauld, récemment canonisé, était l’ami des Berbères Touaregs. Il a été assassiné par des bandes sénoussistes, oeuvrant pour le compte du Sultan d’Istanbul et de ses alliés allemands (les Sénoussistes ont effectué des raids en Egypte, au Darfour, au Tchad, en Libye et dans le désert du Sud algérien, tandis que certaines tribus montagnardes berbères de l’Atlas marocain se rebellaient, clouant au Maroc de nombreuses unités françaises). Détail piquant: les tribus sénoussistes, dont l’obédience est wahhabitique et intégriste, avaient été formées militairement par Atatürk, pour harceler les arrières italiens dans la guerre italo-turque de 1911-1912. Cette stratégie d’ “insurgency” sera reprise par Lawrence d’Arabie contre les Ottomans en Palestine et en Jordanie. Atatürk a donc armé, à son corps défendant et sur l’ordre de son état-major de l’époque, des intégristes islamistes, alors que sa vision personnelle était “indo-européenne”: il voulait identifier sa Turquie nouvelle à l’Empire hittite, indo-européen. Le monde afro-asiatique, et la matrice arabo-sémitique, ne peuvent donc être jugés comme les expressions d’un bloc uni, homogène, sauf quand il s’agit de faire face aux Perses ou à des puissances européennes plus récentes.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, iran, perse, grand moyent orient, moyen orient, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Espace et temps chez Ezra Pound
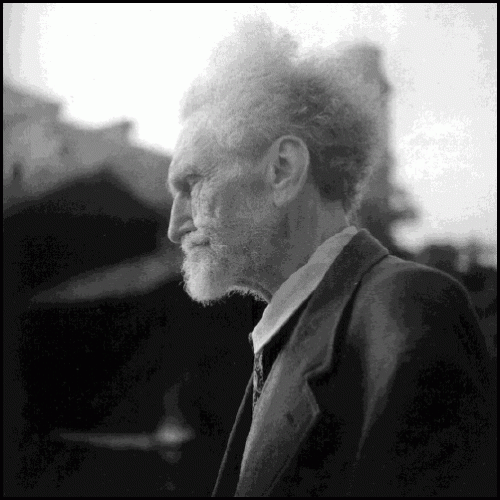
Archives de "Synergies Européennes" - 1986
Vintilia Horia:
Espace et temps chez Ezra Pound
Pour avoir défendu une position similaire, pour s'être attaqué à l'usure comme procédé hétérodoxe dans le cadre de l'Eglise de son temps, Dante perdit sa patrie, fut condamné à mort et dut passer le reste de ses jours loin des siens. Au XXème siècle, Ezra Pound subit le même sort…
Ce qu'on pourrait appeler "le plan vital" dans la poésie d'Ezra POUND ne peut trouver qu'une seule comparaison, ancienne mais toujours valable: l'œuvre de DANTE. La poésie que ce grand Italien a produite ne se limite pas à La Divine Comédie mais comprend aussi De la Monarchie, œuvre en prose contenant le projet d'une société basée sur l'idée impériale. Cette idée recèle une transcendance que l'homme doit conquérir en subissant les épreuves de l'enfer, épreuves de la connaissance en profondeur; en tant qu'être inférieur, il doit surpasser les purifications du purgatoire afin de trouver, avec l'aide de l'amour, considéré comme possibilité maximale de sagesse, les dernières perfections du Paradis. Dans cette optique, la Vie serait un voyage, comme l'imaginaient les Romantiques ainsi que RILKE et JOYCE. Dans l'œuvre de POUND, ce qui nous rapproche de La Divine Comédie, ce sont les Cantos Pisans. Dans toute la poésie et la prose de POUND, comme dans tous les gestes de son existence, on repérera un souci quasi mondain de la perfection, confinant au métaphysique. L'homme, dans cette perspective, doit se perfectionner, non seulement sur le plan de la transcendance et de l'esprit, mais aussi dans le feu des affrontements momentanés qui composent sa vie de pauvre mortel. La perfection spirituelle dépend de l'héroïcité déployée dans le quotidien. "La lumière plane sur les ténèbres comme le soleil sur l'échine d'une bourrique".
Une révolte contre le monde moderne
Le pire, chez DANTE, l'ennemi qu'il combattit tout au long de sa vie d'exilé, fut la confusion consciente entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. La tâche du Pape, c'était de s'occuper de la santé et du salut des âmes. L'Empereur, lui, devait s'occuper du monde visible, sans jamais perdre de vue le but ultime. Le Souverain Pontife ne devait s'abstenir de lutter contre les maux du quotidien. L'homme est une combinaison d'antagonismes complémentaires. Sa complexe constitution psychosomatique révèle un désir d'harmonie finale, désir qui s'exprime sans cesse conformément à la "coincidentia opposi- torum". L'affrontement politique, qui caractérisa et marqua l'existence de DANTE, constitue finalement le sceau typique d'un être capable de vivre et d'assumer la même essence, tant dans sa trajectoire vitale que dans son œuvre; la marque de l'affrontement politique confèrera une aura tragique à POUND également. Cette similitude dévoile non seulement une certaine unité de destin commune aux deux poètes mais aussi l'immuabilité de la tragédie humaine, (de l'homme en tant que zoon politikon, NdT), à travers les siècles. Le poète nord-américain ne put échapper au XXème siècle à ce sort qui frappa le Florentin six cents ans plus tôt. On constate une relation perverse avec la politique qui affecte l'homme et lui est dictée par le droit, ou plutôt le devoir, de se scruter sous l'angle du péché originel. La politique est le terrain où l'homme trouvera, avec le maximum de probabilités, une tribune pour se faire comprendre aisément et rendra ses pensers accessibles aux commentateurs.
La révolte de Pound contre le monde moderne est une attitude quasi générique, consubstantielle à sa génération. En effet, c'est cette lost generation nord-américaine qui abandonna sa patrie lorsque le puritanisme céda le pas au pragmatisme, dans un mouvement comparable à la révolte de KAFKA contre la technique considérée comme inhumaine. Mais ce n'est pas la technique qui définit le désastre. HEIDEGGER a consacré un essai entier à ce problème crucial et nous savons désormais combien les machines et leur développement peuvent être nocives et ceci seulement par le fait qu'il y a malignité chez ceux qui les manipulent. Le problème nous apparaît dès lors beaucoup plus profond. Il s'agit de l'homme lui-même et non des œuvres qu'il produit. Il s'agit de la cause, non de l'effet. Déjà les romanciers catholiques français de la fin du XIXème, tout comme le Russe DOSTOIEVSKI, avaient souligné ce fait. C'est le manque de foi, la perte du sens religieux qui octroye à l'homme des pouvoirs terrestres illimités.
Le problème n'est donc pas physique mais métaphysique. POUND n'est certes pas un poète catholique. C'est un homme soulevé par une religiosité profonde qui se situe dans une forme d'ésotérisme compris comme technique de la connaissance. Ce qui lui permet d'utiliser les mêmes sources et de chercher les mêmes fins que BERNANOS ou CLAUDEL. Il n'est donc pas difficile de rencontrer des points communs -et d'impétueux déchaînements au départ d'une même exégèse- entre POUND et l'auteur du Journal d'un curé de campagne, qui lança de terribles attaques contre notre monde actuel après la seconde guerre mondiale.
Le Mal, c'est l'usure
En conséquence, nous pouvons affirmer que, de son premier à son dernier bilan, POUND sait où se trouve le mal. Il le définit par le terme usure, tout en se proclamant combattant contre tout système voué à l'utiliser sous les formes de l'exploitation, de l'oppression ou de la dénaturation de l'être humain et contre toute Weltanschauung ne se basant pas sur le spirituel. C'est là que les attaques de POUND contre l'usure, présentes dans les Cantos, trouvent leurs origines, ainsi que ses critiques d'un capitalisme exclusivement basé sur ce type d'exploitation et son désir de s'allier à une régime politique ressemblant à l'Empire défendu et illustré par DANTE.
Ses émissions de Radio-Rome dirigées contre ROOSEVELT durant les dernières années de la guerre sont, dans ce sens, à mettre en parallèle avec les meilleurs passages des Cantos. Pour avoir défendu une position similaire, pour s'être attaqué à l'usure comme procédé hétérodoxe dans le cadre de l'Eglise de son temps, DANTE perdit sa patrie, fut condamné à mort et dut passer le reste de ses jours loin des siens. Ezra POUND subit le même sort. Lorsque les troupes nord-américaines submergèrent l'Italie, POUND fut arrêté, moisit plusieurs mois en prison et, pour avoir manifesté son désaccord avec un régime d'usure, un tribunal le fit interner dans un asile d'aliénés mentaux. Son anti-conformisme fut taxé d'aliénation mentale. Cette leçon de cynisme brutal, d'autres défenseurs d'un régime d'usure, je veux dire de l'autre face de l'usure, celle de l'exploitation de l'homme en masse, l'apprendront. Cette usure-là engendre les mêmes résultats, en plus spectaculaire peut-être puisque le goulag concentre davantage d'anti-conformistes déclarés tels et condamnés en conséquence.
"L'usure tue l'enfant dans les entrailles de sa mère" déclare un des vers de la célèbre finale du Cantos XV. Cet enfant pourrait bien être le XXIème siècle, celui que POUND prépara avec tant de passion, avec un soin quasi paternel. Ce siècle à venir est déjà menacé de tous les vices prévus par le poète, contrairement à sa volonté et à ses jugements empreints de sagesse.
Vintilia HORIA.
(traduit de l'espagnol par Rogelio PETE, décembre 1985).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature américaine, lettres, lettres américaines, etats-unis, italie, fascisme, économie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 mai 2009
Iran destaca nexos con Brasil y Latinoamérica
Irán destaca nexos con Brasil y Latinoamérica
 La cancillería de Irán encomió hoy creciente nivel de las relaciones con Latinoamérica y desmintió rumores de que la cancelación de un viaje presidencial a Brasil respondiera a presiones o problemas bilaterales. En rueda de prensa ofrecida aquí, el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Hassan Qashghavi, aseguró que “el viaje (que tenía programado el mandatario Mahmoud Ahmadinejad) no fue suspendido por la parte brasileña, como se ha informado”.
La cancillería de Irán encomió hoy creciente nivel de las relaciones con Latinoamérica y desmintió rumores de que la cancelación de un viaje presidencial a Brasil respondiera a presiones o problemas bilaterales. En rueda de prensa ofrecida aquí, el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Hassan Qashghavi, aseguró que “el viaje (que tenía programado el mandatario Mahmoud Ahmadinejad) no fue suspendido por la parte brasileña, como se ha informado”.
Fue Irán el que anuló la visita por razones de agenda del presidente, agregó Qashghavi, al puntualizar que los vínculos con el llamado Nuevo Mundo y, particularmente con Brasilia, “son crecientes” y están en permanente expansión.
Ahmadinejad tenía previsto iniciar el 4 de mayo una gira latinoamericana que le llevaría a Brasil, Venezuela y Ecuador, países con los que la República Islámica tiene interés en impulsar la cooperación bilateral.
En declaraciones a comienzos de mes, el canciller iraní, Manouchehr Mottaki, confirmó que el jefe de estado se proponía discutir con sus homólogos las vías para desarrollar las relaciones y temas de interés.
Respecto a Venezuela, precisó Mottaki, se alentaría la “continuada cooperación y se dará seguimiento a los acuerdos, así como al establecimiento de un fondo conjunto para la cooperación y las inversiones en un tercer país con su base en Caracas”.
La visita a Brasil, puntualizaron entonces diplomáticos persas, sería la primera de gobernante iraní en 30 años, y ayudaría a fomentar nexos dinámicos y provechosos para ambas partes.
Según las mismas fuentes, la comitiva presidencial pensaba llegar a Brasilia con 110 representantes de 65 compañías nacionales de los sectores del petróleo, gas, petroquímicos, agricultura, industria alimentaria, automovilística y de construcción.
Extraído de Prensa Latina.
00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : iran, amérique latine, brésil, amérique du sud, moyen orient, relations internationales, géopolitique, géoéconomie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Nouvelle revue d'histoire n°42

DISPONIBLE EN KIOSQUE !
00:30 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, 20ème siècle, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Money Talks

http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Sunic-Money.html#TS
Money Talks
Tom Sunic
Never has money been so important in human relations. Never has it so much affected the destiny of so many Americans and Europeans. Today money has become a civil religion that makes it the centerpiece of discourse in all cultures and subcultures. At European and American cafes, on the Champs Élysées, or on Sunset Boulevard, at concert halls, and even in parliaments, one hears and smells its verbal derivatives such as “moulah,” “dough,” “fric,” “Kohle,” “pognon.” It is a language understood by all. In all segments of their lives Western citizens invariably talk about money and what money can buy. The great respite may come with the current financial crisis, which is finally undoing the liberal system with all its conventional wisdoms and lies. The ongoing economic depression may be the sign that the reign of money and the dictatorship of well-being are coming to an end.
Sounds familiar? No, it does not. In ancient European traditions money and commerce were looked down upon and at times these two activities were in principle forbidden to Europeans. Merchants were often foreigners and considered second class citizens.
The famous English poet and novelist D. H. Lawrence — a "revolutionary nationalist" — talks about “money madness” in his collection of poems Pansies. His poem “Kill money” summarizes best this facet of 20th-century mores: Kill money/put money out of existence/It is a perverted instinct/A hidden thought /which rots the brain, the blood, the bones, the stones, the soul.
Similar views were held by the long forgotten American Southern agrarians in the 30’s, who viciously attacked American money madness and the belief in progress. They had dark premonitions about the future of America. As noted by John Crowe Ransom, “Along with the gospel of progress goes the gospel of service. Americans are still dreaming the materialistic dreams of their youth.” And further he writes: “The concept of Progress is the concept of man’s increasing command, and eventually a perfect command over the forces of nature: a concept which enhances too readily our conceit and brutalizes our life.”
Thousands of book titles and thousands of poems from antiquity all the way to early modernity bear witness to a tradition of deep revulsion Europeans had for money and merchants. Charles Dickens’ description of the character Fagin the Jew in his novel Oliver Twist may be soon cut out from the mandatory school curriculum. Fagin’s physical repulsiveness, his strange name, and most of all his Jewish identity do not square with modern ukases on ethnic and diversity training in American schools. The crook Fagin illustrates boundless human greed when he sings to himself and his young captive boys: “In this life, one thing counts / In the bank, large amounts / I'm afraid these don't grow on trees, / You've got to pick-a-pocket or two / You've got to pick-a-pocket or two, boys, / You've got to pick-a-pocket or two.”
Already Ezra Pound, a connoisseur of the English language and a visionary on the methods of usury, and his contemporary, Norwegian Nobel prize winner Knut Hamsun, have disappeared from library shelves. Their fault? They critically examined the crisis of financial capitalism, or what we call more euphemistically today “global recession” and the main movers and shakers behind it.
In medieval times, money and the merchant class were social outcasts solely needed to run the economy of a country. Yet today they have morphed into role models of the West represented by a slick and successful banker dressed in an Armani suit and sporting a broad smile on his face. What a change from traditional Europe in which an intelligent man was destined for priesthood, sainthood, or a military career!
It is with the rising tide of modernity that the value system began to change. Even nowadays the word ‘merchant’ in the French and the German languages (marchand, Händler) has a slightly pejorative meaning, associated with a foreigner, prototypically a Jew. The early Catholic Church had an ambiguous attitude toward money — and toward Jews. Well known are St. Luke’s parables (16:19–31) that it “is easier for a camel to go thru the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven.”
But the Church chose a less pious way to power. In 1179, the Third Lateran Council forbade Jews from living in Christian communities and exiled them to ghettos — with full rights to practice usury and tax collecting. To a large extent the Church, while providing the best shelter for Jews against frequent bouts of popular anti-Jewish anger, also greatly amassed wealth — courtesy of Jewish tax collectors.
The father of the Enlightenment, the 18th-century French philosopher Voltaire, is often quoted as a first spokesman of tolerance and human rights in Western civilization. But it is often forgotten that Voltaire was also an unabashed anti-Semite. Voltaire’s critical remarks about Jews and their love for money were recently expunged from his books, or simply not translated. But some still thrive such as “always superstitious and greedy for the good of others, always barbarous, crawling when in misfortune and insolent in prosperity, that is what the Jews were in the eyes of the Greeks and Romans..” (Essais sur les mœurs)
The ancient European ruling class certainly had its share of corruption and greed. But in principle, until the Enlightenment, the social roles of money and merchants were subjugated to the role of the prince and power politics. Until then, the entire value system had been based on spiritual transcendence and not on economic growth — at least in its appearance. In ancient Greece, King Midas who was a kind man, could not resist the temptation of turning everything into gold with his magic fingers, until he ruined his family, turned water into undrinkable metal, and his face assumed the shape of a donkey. King Croesus went berserk after amassing so much wealth that he could not devote his time and his thoughts to the impending war with the Persians.
In the ancient European tradition, revulsion against money pervades the sagas and the old popular legends, teaching everybody that piety prospers over prosperity. Material wealth brings disaster.
Today, by contrast, official advocacy of frugality and modesty is perceived as a sign of the early stage of lunacy. If a well-educated and well-cultivated man comes along and starts preaching modesty or rejects honoraria for his work, he is considered a failure, a person who does not respect his own worth. How on earth can some well-read and well-bread person offer his services for free? How on earth can a well-educated man refuse using his mental resources to generate the almighty dollar? The answer is not difficult to discover. In capitalism everything has its price, but nothing has value.
The modern liberal capitalist system is a deeply inhuman system, based on fraudulent teaching that everybody is equal in economic competition. In reality though, it rewards only those whose skills and talents happen to be marketable. Those rare Whites who decide to retain some vestiges of old European traditions are squarely pronounced incompetent. Liberal capitalism both in America and in Europe has turned all humans into perishable commodities.
Nobody summarized this better than the Italian philosopher Julius Evola, another revolutionary nationalist who wrote: “Facing the classical dilemma 'your money or your life,' the bourgeois will answer: 'Take my life but leave me my money.'”
Greed, passionate greed eclipses all elements of human decency. Until relatively recently avarice was laughed at and its chief protagonists were considered immoral people, so well represented in Molière’s comedy L’Avare. Today the greedier the better: The money maker is the ultimate role model.
Both East and West participate in this ethic of greed. The richest people in post-communist Eastern Europe are former communist hacks who converted themselves in a twinkle of an eye from disciples of Marx into acolytes of Milton Friedman and Friedrich Hayek. Finance capitalism provides the perception of limitless possibility of how to get rich out of the blue. This is a typical Bernie Madoff syndrome, namely that affluence can be created by sheer speculation. The entire banking system in Eastern Europe has been sold to foreigners over the last 10 years.
Modern capitalism and a penchant for finance owe much to Judaism. Werner Sombart, a German disciple of Max Weber, who can in no way be called an anti-Semite wrote in The Jews and Modern Capitalism that “money was their sole companion when they were thrust naked into the street, and their sole protector when the hand of the oppressor was heavy upon them. So they learned to love it, seeing that by its aid alone they could subdue the mighty ones of the earth. Money became the means whereby they — and through them all mankind — might wield power without themselves being strong.”
Money changes social mores too. Young White couples put off having children until they achieve their economic dreams, while Mexicans and Blacks begin having children as impoverished teenagers, and Muslims place a high value on fertility. This is one of the main causes of our malaise, as White societies with declining fertility are inundated by highly fertile non-White populations with value systems that prize fertility over the accumulation of the accouterments of economic success.
And in this economic recession these Whites are not interested in a pay raise but rather in how to keep their job — security at all cost, even if it means working for lower wages. Neither are young job market entrants interested in saving money. Instead they live on credit in their petty little niche with their petty little pleasures and without incurring any risks.
What a difference from early American pioneers described by Jack London, who braved the vagaries of weather and who totally ignored the meaning of “hedge funds”! The attractions of money and the necessity of making money mean that everybody in our postmodern world becomes prey to the system.
It is a fundamental mistake among many so called right wingers and racialists to assume that capitalism is the only answer to communism. Both systems are in fact similar because they preach the same religion of progress and the unfolding of earthly paradise — albeit in different gears. But this time liberal capitalism has nobody to hide behind in order to conceal its vulgar depravity. The likely hypothesis is that the crumbling capitalist system will fall apart as a result of its own victory. One dies always from those who give him birth.
Tom Sunic (http://www.tomsunic.info/; http://doctorsunic.netfirms.com/) is an author, former political science professor in the USA, translator and former Croat diplomat. He is the author of Homo americanus: Child of the Postmodern Age ( 2007
00:22 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, usure, argent, monnaie, économie, sociologie, histoire, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Encerclement de l'Iran (3/6)

L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du “Grand Moyen-Orient” (3/6)
par Robert STEUCKERS
L’oeuvre stratégique de Trajan
 De la mort de César en –44 à +138, les Perses se maintiennent à l’ouest dans la région d’Edesse, empêchant les Romains d’exercer un contrôle réel et définitif sur le Proche-Orient et leur barrant l’accès à la Mésopotamie et au Golfe Persique. Avec l’empereur Trajan [photo], la grande stratégie envisagée par César, à la veille de son assassinat, se concrétise: avec dix légions, Trajan s’empare du pays des Daces, dont il fait la seule province romaine au nord du Danube en +105. Comme la maîtrise du cours inférieur du Danube implique la maîtrise totale de l’Anatolie et de la Mer Noire et, qu’à son tour, cette maîtrise permet de contrôler les bassins du Tigre et de l’Euphrate, Trajan, bien conscient de ces réalités géopolitiques, poursuit son grand dessein: il transforme le pays des Nabatéens en une province d’Arabie, se dotant de la sorte d’une base arrière, pour réduire le saillant perse d’Edesse, s’emparer des hautes terres arméniennes et, dans la foulée, de débouler avec ses légions en Mésopotamie. Finalement, les Romains arrivent à Charax, sur les rives du Golfe Persique. Plus jamais une Europe impériale et unie n’y reviendra! Son successeur Hadrien estime, sans nul doute à juste titre car la puissance parthe n’est pas négligeable et le front est désormais trop long, qu’il est trop risqué de poursuivre l’aventure et de mettre ses pas dans ceux d’Alexandre. Il retire les légions de Mésopotamie, rend à l’Arménie son statut de royaume client, non inclus dans l’orbe romaine. Il affronte une révolte juive, celle de Simon-Bar-Kochba (+132 à +135), qui sème le trouble sur ses arrières et rompt les liaisons entre la Méditerranée et la Mésopotamie. Cette révolte coûte à Rome les effectifs d’une légion entière. Neuf légions sur un total de vingt-huit sont stationnées de la Mer Noire à l’Egypte face aux Parthes. Dix sont stationnées entre l’Autriche et l’embouchure du Danube, région où elles font face aux peuples cavaliers (indo-européens) des Roxolans et des Iazyges (qui formeront bientôt le noyau de la cavalerie romaine, modifiant ipso facto le caractère majoritairement fantassin de l’armée). Hadrien n’avait pas eu tort: sa politique purement défensive apporte à l’empire romain une paix de près de deux siècles, qu’on peut considérer comme son âge d’or.
De la mort de César en –44 à +138, les Perses se maintiennent à l’ouest dans la région d’Edesse, empêchant les Romains d’exercer un contrôle réel et définitif sur le Proche-Orient et leur barrant l’accès à la Mésopotamie et au Golfe Persique. Avec l’empereur Trajan [photo], la grande stratégie envisagée par César, à la veille de son assassinat, se concrétise: avec dix légions, Trajan s’empare du pays des Daces, dont il fait la seule province romaine au nord du Danube en +105. Comme la maîtrise du cours inférieur du Danube implique la maîtrise totale de l’Anatolie et de la Mer Noire et, qu’à son tour, cette maîtrise permet de contrôler les bassins du Tigre et de l’Euphrate, Trajan, bien conscient de ces réalités géopolitiques, poursuit son grand dessein: il transforme le pays des Nabatéens en une province d’Arabie, se dotant de la sorte d’une base arrière, pour réduire le saillant perse d’Edesse, s’emparer des hautes terres arméniennes et, dans la foulée, de débouler avec ses légions en Mésopotamie. Finalement, les Romains arrivent à Charax, sur les rives du Golfe Persique. Plus jamais une Europe impériale et unie n’y reviendra! Son successeur Hadrien estime, sans nul doute à juste titre car la puissance parthe n’est pas négligeable et le front est désormais trop long, qu’il est trop risqué de poursuivre l’aventure et de mettre ses pas dans ceux d’Alexandre. Il retire les légions de Mésopotamie, rend à l’Arménie son statut de royaume client, non inclus dans l’orbe romaine. Il affronte une révolte juive, celle de Simon-Bar-Kochba (+132 à +135), qui sème le trouble sur ses arrières et rompt les liaisons entre la Méditerranée et la Mésopotamie. Cette révolte coûte à Rome les effectifs d’une légion entière. Neuf légions sur un total de vingt-huit sont stationnées de la Mer Noire à l’Egypte face aux Parthes. Dix sont stationnées entre l’Autriche et l’embouchure du Danube, région où elles font face aux peuples cavaliers (indo-européens) des Roxolans et des Iazyges (qui formeront bientôt le noyau de la cavalerie romaine, modifiant ipso facto le caractère majoritairement fantassin de l’armée). Hadrien n’avait pas eu tort: sa politique purement défensive apporte à l’empire romain une paix de près de deux siècles, qu’on peut considérer comme son âge d’or.
Les Parthes ne profitent pas du départ des Romains pour reprendre l’Arménie et le saillant d’Edesse: à l’Est se forme un autre empire indo-européen et cavalier, celui des Kouchans, qui s’étend sur le Pakistan actuel, mais aussi sur l’arrière-pays de réserve des empires perses précédents: la Bactrie et la Transoxiane. Privé de cet espace de réserve, l’empire parthe entre en déclin, ce qui amène à nouveau les Perses du Roi Ardashir au pouvoir. L’empire cesse donc d’être parthe, pour redevenir perse, comme du temps des Achéménides. Dans ce contexte de transition du pouvoir, la donne géopolitique est la suivante: Ardashir contrôle certes le noyau antique de l’Empire perse, soit l’Iran actuel, mais les Rois d’Arménie sont de sang parthe et s’allient aux Romains contre le nouveau pouvoir. Cette décision barre la route à Ardashir, qui ne peut reprendre pied sur les hautes terres d’Arménie. Il tourne alors ses forces vers l’est, contre l’Empire kouchan. C’est un succès: les Perses contrôlent tous les territoires du Golfe à l’Indus, y compris la Bactrie et la Transoxiane, espaces de réserve indispensables à assurer la puissance perse sur ses arrières. Mieux: Ardashir traverse le Golfe et place Bahrein sous suzeraineté perse. Deux options géostratégiques de l’ “iranité éternelle” venaient de se traduire dans le réel: le contrôle de l’arrière-pays steppique et la rive opposée du Golfe.
La poussée germanique vers le Danube
Au nord du Danube, les Goths, partis de Suède, ont conquis le bassin de la Vistule, traversé les marais du Pripet et se massent dans la vallée du Dniestr, en Moldavie et en Ukraine actuelles. Ils sont désormais sur la Mer Noire, à hauteur d’Odessa. Ils repoussent les Roxolans vers le Dniepr et le Don. D’autres Germains, les Vandales, partis de Silésie, poussent à travers la Bohème, arrivent dans le nord de la Hongrie actuelle et coincent les Iazyges cavaliers dans la vallée de la Tisza (Theiss). Les Germains de l’Est sont plus menaçants pour Rome que ne l’avaient jamais été les Roxolans et les Iazyges, avec lesquels ils avaient composé. Cette première poussée germanique, bien organisée, oblige les Romains à abandonner deux positions stratégiques importantes: les Champs Décumates entre le Rhin et le Danube, laissés aux Alamans, et la Dacie, si chèrement acquise sous Trajan, aux Gépides, Vandales Asding et Wisigoths. Mais sur le front perse, Rome se maintient, grâce aux légions de Galérien. L’Arménie est toujours cliente de Rome, le saillant d’Edesse sous le contrôle des légions, de même que la moitié nord de la Mésopotamie. Quant aux Perses, ils sont maîtres de tout l’Iran actuel, plus de l’Azerbaïdjan, des régions steppiques au Nord de l’Iran, zone de rassemblement depuis la proto-histoire des peuples cavaliers indo-européens —qui, toujours, fonderont ou redonneront vigueur à l’impérialité perse-parthe,— et de la moitié occidentale du Pakistan actuel, dont la quasi totalité du Béloutchistan.
Les deux empires semblent immuables, résister à leurs périphéries, moyennant des affrontements mineurs. Cependant, à la fin du règne de Julien, qui part contre les Perses avec ses légions gauloises et germaniques, les Huns, partis des flancs de l’Altaï en Sibérie centrale, ont avancé leurs hordes et leurs troupeaux vers la Mer d’Aral: à l’ouest, ils avancent vers la Volga qu’ils atteignent vers +350; à l’Est, ils conquièrent la Bactrie et la Transoxiane, mettant définitivement fin à l’indo-européanité centre-asiatique; depuis lors en effet, cette Asie centrale, indo-européenne depuis la culture proto-historique de Jamnaïa, est devenue turco-mongole, hunnique; elle ne sera jamais plus un espace de réserve pour les empires sédentaires du “rimland”, tous issus de peuples guides indo-européens. Toutes les potentialités démographiques indo-européennes d’Asie centrale altaïque sont, à un moment ou à un autre de la proto-histoire ou de l’histoire antique, rentrés dans l’espace iranien pour y consolider un ordre impérial; désormais, ces potentialités n’existent plus.
La fin lamentable de l’Empire romain d’Occident
Sur l’embouchure de la Volga dans la Caspienne, les Huns font face à un peuple cavalier indo-européen, les Alains, et, à hauteur de la boucle du Don, à proximité de la Volga, ils sont les voisins des Ostrogoths germaniques, dirigés par leur roi Ermanarich, qui s’est rendu maître de la Crimée (les descendants des Ostrogoths s’y maintiendront jusqu’au 17ième siècle!). Les Ostrogoths sont les premiers, avant les Romains et les Perses, à percevoir le danger hunnique: en +372, ils avancent leur cavalerie en direction de la Volga pour affronter la présence étrangère hunnique, mais ils sont écrasés par la tactique avérée des Huns: volées de flèches, décrochages rapides, retour des archers montés, nouvelle volée de flèches, nouveau décrochage, jusqu’à l’épuisement de l’adversaire. Boucliers de l’Europe lors de ce premier assaut hunnique, les Goths, bousculés et vaincus, en seront aussi les premiers martyrs. Leur défaite scelle le sort de l’Europe: les Huns, que plus aucune force militaire digne de ce nom ne peut arrêter, poussent jusqu’à la puszta hongroise, idéale pour l’élevage de leurs chevaux. Ils colonisent cette plaine en soumettant les Gépides. Les peuples germaniques sont repoussés, chassés des rives de la Mer Noire et des terres noires d’Ukraine: ils entrent dans l’Empire romain et finissent par en prendre le contrôle, d’autant plus que le meilleur général romain de l’époque, Stilicon, est un Vandale qui sait composer avec ses compatriotes. En 408, l’empereur Honorius, méfiant, le fait assassiner: mauvais calcul, absence de clairvoyance, mesquinerie de dégénéré, car plus aucun militaire de valeur n’est à même de défendre l’Italie. Alaric, chef des Wisigoths, va venger Stilicon et piller Rome. Honorius se replie à Ravenne et assiste, indifférent, au spectacle. Athaulf, successeur d’Alaric, souhaite une paix définitive avec Rome, mais l’empereur, décadent, irresponsable, incapable de défendre les citoyens de Rome, refuse tout compromis. S’il avait accepté les propositions honnêtes d’Athaulf, l’Empire d’Occident aurait été aussitôt restauré, sous l’impulsion des Wisigoths, pour faire face au second assaut des Huns.
Attila, les Turcs et les Avars
Après le choc entre Goths et Romains, les Huns de Hongrie se donnent pour roi Attila, qui conserve ses puissants alliés germaniques, les Ostrogoths et les Gépides. Attila avance ses troupes jusqu’à Orléans, le point le plus à l’Ouest qu’aient jamais atteint des conquérants venus de l’Altaï. Aetius, dernier général romain de l’Ouest, perdu au milieu des nouveaux royaumes germaniques constitués sur l’ancien Empire romain, parvient à s’allier aux Wisigoths, qui formeront le gros des troupes, aux Burgondes et aux Francs pour faire face à la menace: Attila est battu aux Champs catalauniques en +451 et reflue en Hongrie. Il y meurt l’année suivante. Son empire est partagé entre ses fils, très nombreux. Face à l’anarchie qui s’ensuit, les Germains se révoltent et écrasent les Huns en +454 en Hongrie (Bataille de Nedao, site inconnu). L’Empire romain sort exsangue et démembré de l’aventure, tandis que l’Empire perse, maître des zones les plus importantes de la Transoxiane et de la Bactrie, était parvenu à résister. Mais, le danger ne disparaît pas pour autant: il se transpose à l’est, où les Huns Blancs, qui n’osent affronter les Perses, annihilent l’empire kouchan vers +440, portant l’ennemi potentiel sur l’ensemble de la frontière orientale de l’orbe perse. En +484, l’empereur perse est tué à la tête de son armée, mais les Huns Blancs préfèrent jeter leur dévolu sur l’Inde. La situation changera au siècle suivant: les premiers Turcs à arriver aux portes des empires du “rimland” battent préalablement les Mongols jouan-jouan en +552, qui se réfugient chez les Huns Blancs en Transoxiane. Les Turcs battent les Huns Blancs en +557. Les Perses profitent de l’occasion pour réoccuper la Transoxiane, et se redonner ainsi le territoire qui a toujours été leur habituelle “bouffée d’oxygène”. Après cela, les Turcs restent cois. Mais les débris des Huns Blancs et des Jouan-Jouans se portent vers l’Ukraine et, de là, vers la Hongrie, où nos ancêtres les connaîtront sous le nom d’Avars. Ils affronteront les Francs en Thuringe (+562), qui leur barreront la route de l’ouest. Mais les Avars reproduisent la stratégie des raids tous azimuts d’Attila, frappant au hasard, où on les attend le moins. Les Byzantins les utiliseront, comme mercenaires ou comme alliés de revers, pour mater les Slaves, mais devront leur payer un tribut énorme, empêchant la Rome d’Orient, par la suite, de mobiliser les moyens financiers nécessaires pour battre définitivement les Perses d’abord, pour faire face ensuite aux Arabes, successeurs de Mahomet.
Des Samanides à Mahmoud de Ghazni
La Perse, après les Sassanides, servira de lieu de passage, d’espace de transit pour les tribus turques et hunniques en marche vers le Sud et l’Ouest. Elle n’a plus une réserve indo-européenne semi-nomade et semi-sédentaire, cavalière et guerrière, au-delà de la Transoxiane et de la Bactrie. Les vagues migrantes qui arrivent n’apportent pas un renouveau de souche européenne, mais de la nouveauté non persane, non assimilable à la persité antique. Toutefois, cette spécificité perse ne disparaît pas pour autant: malgré les coups durs encaissés, c’est une dynastie iranienne du Khorassan, les Samanides, qui règne de 819 à 1005. Une autre domine à l’Ouest de l’Iran actuel, les Bouyyides, de 934 à 1055. Les Samanides s’affirment dans la région au sud de la Mer d’Aral, dans le triangle formé par trois villes prestigieuses: Samarkand, Boukhara et Merv. Descendants d’un ancêtre appelé Saman Khudat, les représentants de cette famille islamisée ne sont que vice-rois des califes dans la région: ils se débarrassent, de manière subtile, de leurs maîtres arabes pour établir une culture propre, certes musulmane mais persane et non arabe. Au cours des premiers siècles de la domination arabe, le rejet de l’arabité par les Iraniens sera constant: d’abord, les conversions ont été lentes (il a fallu plus de quatre siècles!), ensuite, la base zoroastrienne de leur religion les induit à choisir généralement des voies chiites, contestatrices des pouvoirs dominants sunnites chez les Arabes, tout simplement parce que le zoroastrisme, puis les doctrines de Mani et de Mazdak, s’opposent aux pouvoirs sclérosés et aux répétitions rituelles stériles.
Les trois villes, qui forment les piliers du pouvoir samanide, sont des centres caravaniers, des foyers de commerce et de culture. Boukhara comptait près de 300.000 habitants. Dans la bibliothèque royale s’accumulaient 45.000 volumes. Un syncrétisme religieux et philosophique y émergeait, favorisé par les contacts entre Arabes et Persans, entre Européens du Nord et marchands chinois, entre Musulmans, Nestoriens et Bouddhistes. Les Samanides, sous la pression des Bouyyides, finissent par perdre le contrôle des mines d’argent de la région, source matérielle de leur pouvoir. Les tribus turques d’Asie centrale lorgnent sur les richesses des villes samanides, qui tombent en déliquescence et ne possèdent plus leur puissance d’antan. Après d’innombrables péripéties, changements d’alliances, trahisons et querelles intestines, les Turcs entrent dans Boukhara le 23 octobre 999.
Une date clef : la chute de Boukhara
Pour l’historien britannique John Man, “la chute de Boukhara en 999 doit être considérée comme le premier épisode d’une crise générale”, qui amènera les Turcs en Anatolie, déclenchera les croisades européennes un siècle plus tard, débouchera sur la prise de Constantinople en 1453 et générera, après les innombrables avatars de l’histoire, le problème des Balkans, toujours irrésolu. Pour éviter un raz-de-marée turc sur le reste de l’Iran, Mahmoud de Ghazni, un Perse, se soumet formellement au calife de Bagdad. Les Turcs n’occupent encore que l’espace clef d’Asie centrale, le triangle urbain de Boukhara, Samarkand et Merv. Mahmoud de Ghazni, fort de l’alliance qui le lie au calife, veut recréer, manu militari, l’empire d’Alexandre et celui des gupta, sous sa rude férule. Il envahit l’Inde, réussit un exploit militaire extraordinaire pour l’époque: la traversée du désert de Thar pour prendre la ville de Somath sur les rives de l’Océan Indien. L’objectif géopolitique de Mahmoud de Ghazni était de créer un barrage d’empires islamisés, de la Méditerranée à l’Inde, pour barrer la route aux Turcs d’Asie centrale, non encore convertis. Mais le pillage systématique des villes indiennes et des lieux de culte hindous, qu’il a pratiqué pour obtenir des fonds, le rendra odieux aux Indiens, qui le considèrent comme le premier envahisseur musulman décidé à détruire les bases de l’hindouisme. Sa rudesse est bel et bien à l’origine du conflit indo-musulman actuel. A sa mort en 1030, son empire, dirigé par ses héritiers, s’étend provisoirement jusqu’à Bénarès (prise en 1033), puis s’écroule. Les Turcs écrasent l’armée de son fils et amorcent, vers 1037, leur longue marche vers l’ouest, qui conduira à la bataille de Manzikert en 1071, contre les Byzantins, puis aux Croisades. A l’Est, ils prendront l’Inde en 1206, sous la conduite d’Aîbek.
Les Séfévides, alliés de revers du Saint-Empire et de l’Espagne
L’Iran ne retrouvera une identité politique propre qu’avec l’avènement des Séfévides en 1501. De 1037 à 1500, effectivement, l’Iran est sous la coupe de chefs turcs ou mongols. Au 15ième siècle toutefois, le déclin mongol permet le réveil de trois puissances: la Lithuanie, la Moscovie et l’ordre religieux soufi des Séfévides. Les Lithuaniens repoussent les Mongols et arrivent sur la Mer Noire. La Moscovie se structure au nord et passera à l’attaque au siècle suivant. Sur les marches turcomanes de l’Iran, un ordre soufi se crée sous la houlette du Cheikh Safi’uddin Ardébili en 1301. Celui-ci adhèrera pleinement à ce complexe religieux soufi-chiite au cours du 14ième siècle. En 1447, six ans avant la chute de Constantinople, le Cheikh Junayd et son fils Heydar imposent une réforme à l’ordre: celui-ci prend un aspect militaire et vise le pouvoir politique. Les tribus turcomanes de la région sont organisées selon de telles règles mystiques et militaires. On les appelle les “Qizilbash” ou “chapeaux rouges”: ils seront entièrement dévoués aux Séfévides.
En 1487, Shah Ismaël succède à son père Heydar, qui avait épousé Marie, la petite-fille d’Alexius IV, empereur de Byzance. L’origine de son épouse lui dicte une hostilité aux Ottomans. Du coup, les puissances européennes traditionnelles cherchent à faire de lui l’allié de revers contre les Ottomans, comme François I était l’allié de revers des Ottomans contre le Saint-Empire et l’Espagne. Shah Ismaël s’assure dans un premier temps la bienveillance, voire l’alliance, des tribus turcomanes de la périphérie septentrionale de l’Iran (sauf les Ouzbeks), conquiert ensuite Diyarbakir en 1508, puis envahit la Mésopotamie. La défaite des Ouzbeks au nord ne lui permet cependant pas de conserver l’espace de la Transoxiane dans la sphère d’influence iranienne, ce qui constitue, comme toujours, un sérieux handicap sur le long terme. Les Ouzbeks sont de fait les alliés de revers des Ottomans. La situation stratégique du début du 16ième siècle est donc la suivante: Espagne, Saint-Empire, Iran contre France, Ottomans et Ouzbeks. L’alliance franco-ottomane ne se fera que dans les années 20 du 16ième siècle, mais, de fait, la volonté de Louis XII, puis de François I, de sortir du cadre légitime de la Francie occidentale (selon le Traité de Verdun de 843) qui s’était déjà emparé antérieurement de la Burgondie rhodanienne, de se rendre maître de la plaine padane pour débouler dans l’Adriatique, sont autant de démarches trahissant une foncière inimitié à l’endroit de l’Espagne et de l’Empire, qui sont, à l’époque, sous la souveraineté commune du jeune Charles-Quint.
Heurs et malheurs des Séfévides
Les Ottomans ripostent et envahissent l’Iran en 1514. L’armée de Shah Ismaël est écrasée. L’expansion ottomane au Proche et au Moyen-Orient commence: Soliman le Magnifique s’empare de Bagdad en 1534. L’Iran séfévide perd définitivement l’Irak. Il faudra attendre l’avènement du Shah Abbas I (1588-1629) pour stabiliser à nouveau l’Iran séfévide, en faire un bloc inexpugnable, regroupant le Caucase, l’Iran et une bonne partie de l’Afghanistan actuel. Abbas I a réussi à consolider ses frontières occidentales, mais sans récupérer la Mésopotamie et le Kurdistan actuel. En 1639, les hostilités entre Ottomans sunnites et Perses chiites cessent durablement: la frontière occidentale de l’Iran restera, grosso modo, la même que celle que nous connaissons aujourd’hui. Au 18ième siècle, Nader Shah Afshar (1729-1747) tenta une nouvelle fois, sans succès, de reconquérir la Mésopotamie, soulageant par ses efforts les Européens, qui purent ainsi consolider les conquêtes d’Eugène de Savoie dans les Balkans et celles de Catherine II sur le pourtour de la Mer Noire. Nader Shah Afshar s’opposa toutefois victorieusement à la Russie dans le Caucase. Il réussit à envahir l’Afghanistan et l’Inde, à prendre Dehli, capitale des Moghols. Ses efforts en Transoxiane furent vains, ce qui n’est pas sans conséquences: l’histoire nous enseigne qu’un Iran qui ne domine pas la Transoxiane demeure faible et menacé. L’épopée guerrière de Nader Shah Afshar se fit au détriment de l’organisation intérieure de l’Empire, comme du temps de Mahmoud de Ghazni: ses conquêtes furent perdues après sa mort. Plus tard, Karim Khan Zand prend Bassorah aux Ottomans, ce qui permet à la Perse de développer son commerce avec l’Inde. Cette victoire montre l’importance stratégique primordiale de ce port au sud de la Mésopotamie.
Au 19ième siècle, la dynastie des Qadjars, turcomane d’origine, affronte la Russie qui, forte de ses victoires contre les Ottomans, a progressé dans le Caucase et commence à grignoter les territoires iraniens. La Russie est désormais maîtresse de la Caspienne. L’Iran, sous la conduite de Fath’Ali Shah, tente de reprendre pied en Afghanistan en conquérant Hérat en 1837: les Anglais font alors pression sur le Shah pour qu’il retire ses troupes. Au même moment, comme par hasard, une révolte religieuse, celle des Bâbis, plonge l’Iran dans une guerre civile. Les Babistes luttaient contre le clergé chiite, jugé trop rétrograde, et militaient pour un assouplissement général des règles islamiques de la vie quotidienne. Réprimé durement, le mouvement continue toutefois à agir dans la clandestinité et travaillera à la chute des Qadjars, en soutenant le mouvement constitutionaliste de la première décennie du 20ième siècle, qui a reçu un certain soutien britannique, retiré prestement, dès que les nécessités stratégiques de l’Entente avec la France et la Russie obligeaient Londres à ménager Pétersbourg pour concentrer tous les efforts contre l’adversaire allemand. La Russie s’opposait au constitutionalisme, craignant la contagion, et préférait soutenir le Shah et le clergé hostile à toute réforme socio-religieuse. En 1857, immédiatement après la Guerre de Crimée, le Shah Nasser ed-Din tente une nouvelle fois de reprendre Hérat; les Anglais, qui n’acceptent pas et n’accepteront jamais cette expansion iranienne vers l’est, débarquent dans le Sud. Russes et Anglais finissent par se partager des zones d’influence dans le pays, le réduisant, non pas au statut d’une colonie, mais d’une zone sans indépendance réelle. Le pouvoir des Qadjars au 19ième siècle est l’histoire d’un lent déclin de la Perse.
00:14 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, iran, perse, grand moyen orient, moyent orient, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Claduio Risé: la postmodernité est une révolution conservatrice!

Archives de "Synergies Européennes" - 1997
Claudio Risé:
La postmodernité est une révolution conservatrice!
Quel corpus idéologique succédera à la droite? Affinons notre question: comme jamais la droite ne gagne les élections, sauf en Angleterre, comme elle connaît la défaite depuis plus d'un demi-siècle en Italie, sera-t-elle éliminée à tout jamais des prochains chapitres des livres d'histoire? Cette question, nombreuses sont les revues les plus autorisées de l'établissement culturel et politique du monde occidental: depuis Foreign Affairs aux Etats-Unis, très écouté au “département d'Etat”, en passant par Theory, Culture and Society en Grande-Bretagne, l'une des revues les plus attentives aux phénomènes dits “postmodernes”, jusqu'au Monde Diplomatique de Paris, qui se pose comme l'observateur classique de la gauche en matières de politique internationale.
Le Monde Diplomatique se préoccupe surtout de “la droite à la conquête des âmes”, dont la gauche semble avoir oublié de s'occuper, parce qu'elle se concentre obsessionnellement sur sa propre survie après l'écroulement du marxisme. Cette droite qui inquiète le Monde Diplomatique est une droite dont la vitalité ne se mesure pas tant (ou pas seulement) en termes de suffrages, mais surtout en termes d'adhésions individuelles ou d'élites intellectuelles ou, plus particulièrement, de jeunes. De ce point de vue, la victoire récente des listes de droite lors des dernières élections universitaires italiennes —même si l'on décrète dans les rangs mêmes des droites qu'il ne s'agit que d'un phénomène “qualunquiste”, “quelconque”, purement réactif, dépourvu de signification— je crois, personnellement, qu'il s'agit d'un signal de plus, annonciateur d'une situation en mutation rapide.
Mais ce qui inquiète un bon nombre de politologues de gauche, ce sont les curieuses affinités qui relient la réflexion sur la postmodernité dans son ensemble au mouvement qui s'était développé dans l'Allemagne de la République de Weimar et que l'on appelle la “révolution conservatrice”, dont les principaux exposants furent Ernst Jünger, Martin Heidegger et le juriste Carl Schmitt.
Quels sont les indices qui nous permettent de dire que la “révolution conservatrice” est de retour? Goran Dahl, professeur de sociologie à l'Université de Lund en Suède, vient de consacrer un long essai sur cette question dans la revue Theory, Culture and Society. L'un des principaux indices permettant de poser l'analogie “révolution conservatrice”/“postmodernité” est la valorisation accordée à la technologie, perçue comme l'instrument parfait pour se libérer du “vieil ordre”, ainsi que des classes dirigeantes incapables et corrompues qui l'expriment. Du temps de la “révolution conservatrice”, Ernst Jünger avait fait du “Travailleur” le héros des nouvelles technologies destinées à changer le monde. Cette option “technique” avait grandement irrité les proto-nazis (on a trouvé la phrase suivante dans l'une de leurs publications mineures: «Jünger se rapproche de la zone des balles dans la nuque»), tout comme les sociaux-démocrates, désorientés par cette figure d'un “Travailleur” si peu marxiste, plus passionné par la guerre que par l'économie.
Aujourd'hui, à l'âge postmoderne, c'est quelque chose de très semblable qui se passe: la technologie et l'informatique constituent la grande ligne de partage entre ceux qui parient sur les “temps nouveaux” et sont prêts à courir des risques et à se lancer dans l'aventure, d'une part, et ceux qui, à droite mais surtout à gauche, dressent haut la bannière de la “vieille” modernité contre la postmodernité hypertechnologique. Ces partisans conservateurs et frileux de la “vieille modernité” accusent par exemple Internet de tous les maux imaginables: la guerre, l'effondrement de la religion ou la prolifération des religiosités alternatives et irrationnelles, la pédophilie, etc. Mais Internet est surtout utilisé ouvertement comme instrument pour rassembler des informations sur les mouvements affirmant les identités traditionnelles (culturelles, religieuses, nationales) et, de ce fait, proches des principes qu'avait affirmés jadis la “révolution conservatrice”.
Autre similitude entre postmodernité et “révolution conservatrice”, qui a surpris beaucoup de monde: les deux mouvements d'idées estiment que sont positives et fécondes les “différences” entre les peuples et les cultures, nées sur des territoires précis. Cette position conduit à une rupture voire à un choc frontal tant avec la gauche —qui prône l'universalisme et, en paroles du moins, l'égalité absolue— qu'avec la droite (du temps de la “révolution conservatrice”, c'était Hitler) qui est toujours plus ou moins ouvertement raciste et pour laquelle le différent est toujours inférieur. Sur le terrain des “différences”, le réveil de la révolution conservatrice acquiert une vitalité explosive face à l'égalitarisme hypocrite de la gauche car justement cet égalitarisme a été contesté en premier lieu par les peuples dominés par les empires coloniaux construits sur des fondements issus de l'idéologie progressiste! Sur cette thématique, la version postmoderne de la révolution conservatrice est bien vivante, non seulement parce qu'elle s'articule sur les notions dégagées par les principaux philosophes du siècle —de Derrida à Foucault et à Deleuze— mais surtout parce que ses thèses sont celles de tout le discours culturel et politique de l'ère post-coloniale, discours qui est sans doute la part la plus substantielle de la postmodernité.
Par l'effet de la globalisation, marque majeure de notre contemporéanité, cet héritage idéologique postcolonial trouve évidemment des alliés importants. Comme, par exemple, Kishore Mahbubani, secrétaire du ministère des affaires étrangères de Singapour, qui se plaignait, dans les colonnes de la revue Foreign Affairs, que les Occidentaux avaient du mal à comprendre que l'Asie pouvait accepter la technologie avancée sans pour autant renoncer à ses propres traditions et à sa propre culture.
L'Occident, selon cet homme politique de Singapour, n'a pas vraiment accepté que “d'autres cultures ou d'autres formes d'organisation sociale pouvaient avoir une égale validité”, justement parce que “la croyance en la valeur universelle de ses propres idées peut amener à l'incapacité de reconnaître le principe de la diversité”. La domination à l'ère coloniale de l'idéologie des Lumières et de ses dérivés idéologiques constitue d'ailleurs une thématique à la fois politique et morale que l'on ne peut plus esquiver. Thématique à laquelle un philosophe attentif et sensible comme Salvatore Veca, pour ne donner qu'un exemple, a consacré des réflexions très précises et pertinentes dans son dernier essai, Dell'incertezza (paru chez Feltrinelli). Pour Veca, la (re)-valorisation des différences induit que le lieu, le site, le topos d'une culture, puis la culture proprement dite ainsi que les traditions enracinées prennent le pas, dans l'ère postmoderne comme dans le corpus doctrinal de la “révolution conservatrice”, la place qu'occupait le temps (plus ascétique) dans la modernité, et cela sous l'oripeau de l'idée de progrès, présente depuis le XVIIIième des Lumières jusqu'à nos jours.
Avec la (re)-valorisation du topos, on affirme également ipso facto la centralité de la géopolitique (comme l'a noté l'Allemand Joachim Weber), qui affirme les caractéristiques “organiques” (c'est-à-dire culturelles au sens anthropologique) des nations qui ne sont finalement que fort mal représentées par les ordres juridiques que sont les Etats classiques, issus des révolutions bourgeoises et aujourd'hui nettement en crise. Cette radicalité “révolutionnaire-conservatrice” se lie non seulement avec les exposants philosophiques de la postmodernité mais aussi avec les autres protagonistes de la pensée scientifique contemporaine tels Paul Feyerabend, dont l'idée centrale est que le savoir n'est jamais universel, mais toujours une “valeur locale, destinée à satisfaire des besoins locaux”, propres de nations, de peuples et de cultures particulières (ou de “tribus”, dirait Michel Maffesoli, autre brillant exposant de cette option particulariste suscitant tant de turbulences).
«Le conservatisme, pour être plus révolutionnaire que n'importe quelle forme d'“illuminisme” positiviste, n'a besoin de rien de plus que d'esprit, et de rien de moins qu'une révolution conservatrice», écrivait Thomas Mann en 1921. Voilà pourquoi, à l'ère postmoderne, qui est tout à la fois conservatrice et futuriste, on assiste au retour de la “révolution conservatrice”, nous assure Goran Dahl. Du reste, on peut observer que cette “révolution conservatrice” n'a jamais totalement disparu. Tant Jünger que Heidegger ou Schmitt ont survécu gaillardement à l'effondrement allemand de 1945 et n'ont jamais abandonné leurs idées. Immédiatement après la fin des hostilités, ils ont trouvé des disciples attentifs et des continuateurs féconds. Certes, la “modernité” est restée en selle, du moins officiellement, et continue à nier les différences, à manier sa notion de “progrès”, à imposer son mépris pour tout ce qui est “local”, pour les potentialités de la “terre”. La survivance du corpus des Jünger, Schmitt et Heidegger peut sembler marginale. Mais aujourd'hui, postmodernité et postcolonialisme ont revalorisé les traditions, les différences et les territoires et il me semble beaucoup plus difficile de faire machine arrière, alors que les plus brillants esprits du siècle ont bel et bien participé au mouvement. Mais il est vrai aussi que les tenants actuels du différencialisme sont fort différents de cette “nichée de dragons” qu'avait aimée Stephen Spender dans le Berlin qui basculait dans le nazisme et qu'il a décrite avec un esthétisme complaisant dans Un monde dans le monde. Les tenants contemporains ressemblent au contraire davantage à ces étudiants qui viennent, en Italie, de voter pour les listes de droite lors des élections universitaires. Car, comme nous l'a dit Sergio Ricossa, dans les colonnes d'Il Giornale, le 27 avril 1997, “ils veulent connaître le monde tel qu'il est”. Ils sont moins romantiques, moins grandiloquents, que leurs prédécesseurs. C'est mieux, car notre siècle en a trop vus, des dragons...
Claudio RISÉ.
(article paru dans Il Giornale, 6 mai 1997).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, postmodernité, modernité, sociologie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 mai 2009
Ambitieuse Turquie, myopie de la Vieille Europe
Ambitieuse Turquie, myopie de la vieille Europe
Osons cependant entreprendre ici de corriger quelques illusions d'optique.
Rien de plus faux, d'abord rien de plus contraire à l'Histoire, rien de plus trompeur pour l'avenir que l'idée romantique de "la vieille Turquie immobile." Propagée par Pierre Loti, elle ne correspond qu'aux fantasmes surannés du personnage. Mais elle continue ses ravages.
Ce peuple de la steppe est venu d'Asie centrale au XIe siècle. S'il avait correspondu en quoi que ce soit aux rêveries des orientalistes, le pays qui porte son nom n'existerait même pas.
Aujourd'hui animé d'une grande énergie, bouillonnant de ses contradictions et de son dynamisme vital, il se pousse à nouveau sur la scène mondiale.
Occupant dès maintenant une place géostratégique décisive, poussant son économie vers l'avenir, il cherche aussi l'agrandissement de son espace vital.
L'Union européenne, quant à elle, formatée en 1991 par le traité de Maastricht, déformée par le traité signé à Nice en 2001, n'en finit pas de ne pas se doter d'une véritable politique extérieure. Cela vaut peut-être mieux, penseront d'ailleurs certains, tant que le président de la commission de Bruxelles, actuellement M. Barroso, et tant que la majorité du parlement de Strasbourg persisteront à raisonner et à agir, au rebours des intérêts, et surtout de l'âme de notre Vieux Continent.
Telle une certaine fusée expérimentale détournée par une puissance mauvaise, et que le professeur Tournesol préféra détruire plutôt que de la perdre, je sais que certains croient sauver l'Europe en lui retirant ses institutions. J'espère qu'on pardonnera quand même à ceux qui souhaitent encore donner une dernière chance à la raison.
Personne ou presque n'ose s'insurger contre la manière péremptoire dont les évolutions nous sont présentées. On voudrait bien pourtant pouvoir renvoyer dos-à-dos les docteurs Tant-Pis du souverainisme comme leurs confrères Tant-Mieux de l'eurocratie. Les choix binaires et caricaturaux proposés aux citoyens, moins sots que l'imaginent les communicants, ne sauraient être tenus pour étrangers à l'indifférence que suscite à ce jour la campagne actuelle.
Néanmoins, sans illusion pour l'immédiat, m'adressant à une partie plus éclairée, plus rare aussi, de l'opinion, je voudrais souligner l'évolution de la politique régionale d'Ankara depuis le début de l'année 2009.
Cet hiver, en février, un nouveau secrétaire d'État chargé des relations avec l'Europe est apparu. Ce négociateur s'appelle M. Egemen Bagis. On ne peut pas considérer comme positive l'évolution qui en est résultée si j'en juge par l'évaluation d'un grand quotidien du soir, habituellement moins sévère pour ce pays : "méthode" d'Ankara pour adhérer à l'Union européenne crée le malaise à Bruxelles
Au-delà de la polémique sur la nomination de M. Rasmussen, "c'est la méthode suivie par Ankara qui pose problème", souligne un diplomate bruxellois. S'incarnant en porte-parole des pays musulmans, ce qui a aussi fortement déplu, M. Erdogan a relancé les interrogations quant à la volonté réelle de son pays de respecter la liberté d'expression, l'une des exigences les plus fortes des négociateurs européens.
"Très choqué" par la pratique de la Turquie et son évolution vers ce qu'il a appelé "une religion plus renforcée, une laïcité moins affirmée", Bernard Kouchner a, quant à lui, saisi l'occasion pour affirmer, mardi 7 avril, qu'il n'était plus favorable, désormais, à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
La
Deux mots sur ce nouvel interlocuteur. Pour la première fois dans ce pays, il ne s'agit pas d'un parlementaire du parti au pouvoir, mais d'un professeur de Relations internationales. Or la ligne qu'il représente risque fort d'étonner tous ceux qui imaginent à la fois une Turquie aspirant avant tout à une intégration européenne et, en même temps, une sorte de barrière contre les divers courants de l'islamisme proche-oriental.
Puissance régionale, aspirant à jouer un rôle mondial, la république fondée par Mustapha Kemal a cessé de se penser elle-même comme une sorte de pré carré inviolable, protégée contre elle-même par son armée laïque, gardant jalousement des frontières définitives. Il va falloir désapprendre les images fortes, convaincantes, mais hélas fausses, propagées par Benoist-Méchin.
En 2004 par exemple, pour complaire à la commission de Bruxelles, une révision constitutionnelle majeure liquidait la conception théoriquement nationaliste de la supériorité du droit interne. En même temps, symboliquement, la peine de mort était abolie. Donc désormais, quand ce qu'on appelle "l'État profond" voudra se débarrasser d'un gêneur, d'un journaliste arménien ou d'un contestataire quelconque il devra renoncer aux méthodes judiciaires. Il lui restera le recours de l'assassinat. Le scandale momentané sera suivi d'une enquête stérile, d'un procès truqué, et enfin d'un jugement débonnaire quand les exécuteurs auront bien voulu se livrer à la police. Jusqu'ici ça ne marche pas trop mal, dans cet excellent pays, où l'on attache plus d'importance à la cuisine qu'à la philosophie, je veux dire à la pratique plutôt qu'aux grandes idées abstraites.
Ankara peut donc avancer sereinement, et impunément sur la voie de son projet multidirectionnel.
Nommé officiellement le 1er mai Ahmet Davutoglu, 50 ans, se verrait, nous assure-t-on, accusé par ses adversaires de "néo-ottomanisme".
Cette expression, citée par "Libération" (2) ne veut strictement rien dire.
Ou plutôt elle peut recouvrir des concepts tout à fait contradictoires.
"L'ottomanisme" historique domina l'évolution de l'Empire au cours du XIXe siècle. Cela fonctionna à partir des années 1830- 1839 ("Tanzimat" réformateur), puis 1856 (égalité complète des citoyens vis-à-vis du service militaire). Et cela dura jusqu'à la catastrophique révolution jeune-turque de 1908-1909. Cette évolution eût conduit à un résultat sans doute préférable à ce que fabriquèrent le sinistre Enver pacha, jusqu'en 1918, puis Mustapha Kemal.
Parler de "néo-ottomanisme" permet de ne pas comprendre.
En fait la "doctrine Erdogan" consiste à dire par la bouche de M. Davutoglu de façon très réaliste :
"la Turquie ne peut pas privilégier ses liens avec l’Orient ou avec l’Occident car les deux sont indissolublement liés".
Que le caractère "multidirectionnel" de son projet dépasse, certes, comme celui de l'hitlérisme défini dès les années 1920, ses capacités propres, ne l'empêchera pas de nuire. Dans les années 1980 la junte militaire avait inventé Turgut Özal. Premier ministre (1983-1989) puis président de la république civil (1989-1993), il déposa auprès de l'Union européenne la candidature d'Ankara. Or il donnait déjà du monde turc une définition très large "de l'Adriatique à la muraille de Chine".
Nous ne nous trouvons donc pas dans une situation de véritable innovation doctrinale, due à on ne sait quelle bouffée d'islamisme mystique. Les confréries auxquelles se rattachent, aussi bien aujourd'hui MM. Erdogan et Gül que M. Özal hier, n'ont jamais pensé autre chose. Je développerai bientôt ce point particulier. Ahmet Davotuglu n'en donnera sans doute que la version savante et diplomatique.
Et pour bien comprendre les choix que la Turquie devrait et pourrait opérer, on peut citer plusieurs potentialités.
1° la plus déstabilisante pour le proche orient vise les pétroles du nord de l'Irak. Elle prétend s'appuyer sur les droits de la minorité turkmène dans la ville de "Kirkouk à moitié kurde" (3). Sans le vote de mars 2003 du parlement d'Ankara, qui ne permit pas alors, faute d'une majorité suffisante, l'envoi d'un premier contingent de 62 000 hommes aux côtés des Anglo-Américains, nous pourrions en observer le scénario.
2° la plus classique pour les stratèges conservateurs consiste à intervenir pour "maintenir l'ordre dans le Kurdistan irakien" en frappant une fois de plus dans la zone montagneuse où se réfugient les rebelles marxistes-léninistes du PKK, mais aussi en satellisant les "Kurdes modérés" installés au pouvoir.
3° la plus extravagante mais aussi la plus inquiétante pour le gouvernement chinois, qui la prend très au sérieux, consiste à encadrer la contestation des Ouïgours du Sin-kiang, supposés de race turque et de religion mahométane.
4° la plus illusoire vise les anciennes républiques dites "musulmanes" détachées de l'Union soviétique en 1991. Elle permettrait de réunir l'Anatolie au "Turkestan" chinois via l'ancien "Turkestan" russe. Ce programme "panturquiste", après avoir beaucoup intéressé les Allemands à partir de 1941 (4) a séduit, semble-t-il, un certain nombre d'hommes d'affaires occidentaux. Au début des années 1990, les Ouzbeks, Kazakhs, Kirghiz, Turkmènes et Azéris (5) ont vu avec plaisir arriver des cousins très lointains. Ces gens aimables leur parlaient un idiome forgé par Kemal sous le nom de langue "soleil", voisin des leurs. De plus ils semblaient susceptibles de compter en dollars. Mais tout le monde est revenu sur terre, et le projet a depuis tourné court. Le plus important pays de la région, l'Ouzbékistan fait accessoirement figure de principal opposant à cette "grande idée".
5° la plus immédiate, celle qui préoccupe Israël, consiste à se présenter comme le porte-parole des pays musulmans du proche orient et à prendre en main le projet d'un État palestinien, en mettant en place un accord avec la Syrie, etc. Freinée par le gouvernement Bush, cette démarche semble prendre de la crédibilité avec la présidence d'Obama.
6° la plus dangereuse pour l'Europe, la seule qui la concerne directement, vise une expansion rêvée dans les Balkans, en direction de l'Adriatique, vers l'ensemble des territoires que l'on appelait autrefois "Roumélie". Le secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique, le Turc Ekmeleddin Ihsanoglu est parvenu, lors la XIe réunion des 57 pays musulmans qui s'est tenu à Dakar en 2008, à faire insérer une résolution se solidarisant et appelant explicitement à une intervention en vue de protéger les coreligionnaires opprimés dans les Balkans et en citant la Thrace occidentale et la Bulgarie. Dans les années 1990 on a appelé cela la flèche verte. Elle vise en fait l'ensemble des pays du sud-est européen.
Pour toutes ces raisons et pour quelques autres je juge, quant à moi, fort périlleux pour ne pas dire inconvenant d'imaginer l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.
Apostilles
- cf. Le Monde édition du 11 avril 2009
- cf. Libération du 5 mai.
- cf. Le livre de Amanj al-Barzanji "Kirkouk à moitié kurde" Cairn 2007
- Date où ils mirent un terme à leur alliance avec Staline. Un rapport secret de 1943 rédigé par l'ambassadeur du Reich Von Papen, et publié après la guerre, démontrait l'absurdité de ce projet. En 1944 un jeune officier pro-nazi Alpaslan Turkes fut emprisonné pour y avoir imprudemment adhéré. Plus tard il fondera, et dirigera jusqu'à sa mort, le parti des Loups gris "MHP" qui représente environ 15 % du corps électoral, qui a plusieurs fois participé au gouvernement et siège actuellement au parlement sur la base de cette doctrine inchangée.
- Le Tadjikistan appartient, lui, du point de vue linguistique, à la sphère iranienne.
JG Malliarakis
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, turquie, affaires européennes, balkans, mer noire, caucase, méditerranée, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Susbielle: le déclin de l'empire européen
Jean-François Susbielle, Le déclin de l'empire européen, Ed. First, 2009.
00:28 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, actualité, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Encerclement de l'Iran (2/6)
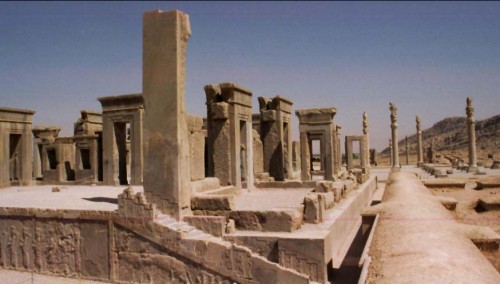
L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du “Grand Moyen-Orient” (2/6)
par Robert STEUCKERS
Fin de l’unité seldjoukide et avancées européennes
L’unité seldjoukide s’effondre: trois sultanats se partagent, après les coups portés par les Croisés, l’héritage d’Alp Arslan. Mais le flot démographique turc continue à se déverser via l’Iran vers l’Anatolie et le Moyen-Orient arabe. Le Sultan seldjouk Sanjar de Merv ne parvient pas à canaliser ce flot ininterrompu qui consolide parfois les sultanats turcs établis mais y introduit tout aussi souvent le désordre: une tare du nomadisme. La Perse, dans ce contexte, est devenue le sultanat seldjouk d’Hamadan. Elle est un espace de transit pour les nomades et leurs troupeaux qui suivent leurs guerriers victorieux. Les croisades, qui ne sont pas vraiment un succès militaire sur le long terme, permettent toutefois, par la pression constante qu’elles exercent, aux royaumes ibériques de libérer une très vaste partie de la péninsule hispanique, à la Géorgie de se dégager de la tutelle seldjouk, aux Russes de Novgorod et de Souzdal de tenir tête aux Coumans, aux Byzantins de reprendre pied dans les Balkans.
L’affrontement a été lourd face aux Seldjouks. L’histoire des croisades nous montre que les Croisés “latins” et les Arméniens “grecs” feront cause commune, en dépit du contentieux entre Rome et Byzance, sanctionné par le schisme de 1054. Quand les Croisés doivent plier devant le général kurde Saladin, le conflit demeure chevaleresque, tout simplement parce que Saladin est un indo-européen, ni turc ni arabe. De là, la littérature épique et courtoise de notre moyen-âge, où Feirefiz, le chevalier perse ou kurde est l’ami de Parzifal, son homologue allemand, dans l’épopée de Wolfram von Eschenbach. Aucune fraternité de ce type n’est attestée dans la littérature épique espagnole, où Européens affrontent Berbères et Arabes, ni dans une oeuvre antérieure à l’affrontement avec les soldats de Saladin ou ceux de ces successeurs.
L’académicien René Grousset, spécialiste de l’Asie centrale, dans son livre L’épopée des Croisades, restitue clairement la situation: l’Empereur germanique Frédéric II Hohenstaufen admire, non pas tant l’islam en tant que religion, mais la science arabo-perse, capable de structurer durablement un empire. Frédéric n’a donc pas les aprioris habituels des chrétiens occidentaux contre l’islam ou les civilisations antérieures qu’il recouvre de son vernis. Les successeurs de Saladin le Kurde, eux, raisonnent en termes géopolitiques. Son empire, qui comprend alors l’Egypte, la Syrie-Palestine et la Mésopotamie, est administré par ses trois neveux, chacun sultan de l’une de ces provinces. El-Mouazzam, sultan de Syrie-Palestine à Damas, entre en conflit avec son frère aîné, El-Kâmil, sultan d’Egypte. Pour vider la querelle, El-Mouazzam fait appel à des nomades turcs commandés par Djélal ed-Dîn Mangouberdi, chassé du Khwarezm (Nord-Est de l’Iran actuel) par les Mongols de Gengis Khan. El-Kâmil voit le territoire de son Kurdistan original ravagé, l’élément perse subjugué et l’héritage de Saladin menacé jusqu’en Egypte. Il envoie un ambassadeur, l’émir Fakhr ed-Din, à Frédéric, pourtant excommunié, pour lui implorer son secours contre El-Mouazzam et Djélal ed-Dîn Mangouberdi; en échange, il lui offre Jérusalem, reprise jadis par son oncle Saladin.
Les Croisades échouent parce qu’elles n’ont pas le soutien pontifical
Les croisés du Saint-Empire romain germanique débarquent à Saint-Jean-d’Acre sous le commandement de Henri de Limbourg, qui bien vite, repousse les troupes d’El-Mouazzam et vient en aide à Hermann von Salza, grand maître de l’Ordre Teutonique en Palestine. El-Mouazzam meurt avant l’arrivée —tardive, il est vrai— de Frédéric. El-Kâmil marche sur Damas avec les troupes de son frère El-Achraf, sultan de Mésopotamie. Après moultes tergiversations, El-Kâmil et Frédéric s’entendent pour donner à Jérusalem un statut de condominium, acceptable pour les deux parties. Les Germains l’occupent et l’administrent officiellement, flanqués d’un cadi musulman, en charge de guider les pélerins vers l’enceinte du Haram ech-Chérif. C’était en 1229. Frédéric est rappelé en Italie, où les intrigues pontificales suscitent révoltes et troubles. Sa victoire diplomatique n’est pas reconnue comme telle. Triste exemple de mauvaise foi.
En 1239, les Croisés obtiennent encore une victoire, en conquérant la Galilée et Ascalon. Mais, faute de soutien pontifical, cette victoire sera de courte durée: les Turcs Khwarezmiens prennent Jérusalem en 1244, puis Tibériade et Ascalon en 1247, prouvant par là même que la volonté frédéricienne de faire barrage commun avec les Kurdes de la famille de Saladin était un projet stratégique cohérent. Les Mongols, qui suivent les Khwarezmiens, comme l’avait prévu le Sultan El-Kâmil, prennent Bagdad en 1258. Il faudra un sursaut des mamelouks d’Egypte pour mettre un terme à la présence mongole en Palestine. Pire, la lutte de la Papauté contre l’Imperium de Frédéric affaiblit l’Europe, au point qu’elle a risqué une conquête mongole en 1240-41: les hordes de Batou, prennent Kiev en 1240, envahissent la Pologne, se heurtent victorieusement à l’armée impériale à Liegnitz en 1241, mais ne poursuivent heureusement pas leur course plus loin à l’Ouest. Une autre horde longe le Danube et ravage la Hongrie. Une fois de plus, les deux attaques turco-mongoles ont été simultanées, comme au temps des Seldjouks et des Coumans, à une époque où l’Europe était affaiblie par des querelles intestines, fomentées à Rome ou à Paris. Paradoxe: le Sultan El-Kâmil était plus lucide que le Pape romain!
L’émergence de la puissance ottomane
Après les croisades, les sultanats seldjouks disparaissent. L’Anatolie est fractionnée entre des émirats antagonistes, dont les principaux sont ceux de Karaman, de Sivas et, enfin, celui des Ottomans, qui connaitra un grand destin. Les Ottomans, proches de la Mer de Marmara et de Constantinople, parviennent à prendre pied à Gallipoli en 1354. Sur la rive européenne, l’empire serbe de Stéphane (ou Etienne) Douchan, qui s’étend de Belgrade à l’Egée, se décompose en plusieurs petites entités rivales à la mort du grand roi en 1355. Les Bulgares sont également divisés en fractions rivales. Ce désordre et ces querelles fratricides permettent aux Ottomans de passer à l’attaque et d’annihiler Serbes et Bulgares. Dans les années 1360, ils se bornent à grignoter le territoire des anciens royaumes cohérents des Serbes et des Bulgares, ce qui les amènent à contrôler la Thrace. Dans les années 1370, ils établissent une frontière militaire contre les Slaves des Balkans. Dans les années 1380, ils font des Serbes et des Bulgares leurs vassaux. En 1389, le Sultan Bayazid bat les Serbes au Champs des Merles (Kosovo) et force les émirats turcomans à l’Ouest de l’Euphrate à se soumettre à son autorité. Un croisade de secours, franco-germanique, dont fait partie notre Duc Jean Sans Peur, est écrasée en Bulgarie en 1396. Bayazid Yildirim (le “Tonnerre” ou la “Foudre”) se rend maître de l’ensemble des territoires jadis byzantins sauf Contantinople et Trébizonde, devenues des enclaves urbaines isolées de leur environnement. La masse territoriale de l’Empire d’Orient devient ottomane. Les anti-unionistes orthodoxes imaginent une théologie qui puisse fusionner le christianisme grec et l’islam turc (Georgios Scholarios, dit “Gennadios”, Georgios Amoiroutzès de Trébizonde), d’autant plus qu’avant la conquête du Proche-Orient par les Ottomans, l’empire est majoritairement “grec”. Les nouveaux maîtres vont reprendre à leur compte les stratégies d’expansion des Byzantins en direction des Balkans, puis vont reconquérir le Proche-Orient, la Mésopotamie et l’Egypte (début du XVIième siècle) et se heurter aux Perses.
Mais l’oeuvre géopolitique de Bayazid Yildirim sera ruinée par un chef tatar converti à l’islam, qui n’aura détruit que des empires musulmans au cours de sa fulgurante carrière: Timour Leng ou Tamerlan, qui le bat à Ankara en 1402, donnant paradoxalement un répit à l’Europe. Prisonnier de Tamerlan, Bayazid meurt en captivité. Mais le chef tatar abandonne l’Anatolie; il a un autre projet: envahir la Chine et la détruire comme il a détruit l’Inde de Dehli. Il meurt en chemin. L’empire ottoman peut renaître et se retourner contre l’Europe: Mehmet II Fatih prend Constantinople en 1453, chasse les Génois de Crimée, vassalise les Tatars de cette presqu’île russe, devient le maître incontesté de l’espace pontique. Il ne commet pas l’erreur des Seldjouks: laisser le flot démographique turcoman d’Asie centrale se déverser sur ses possessions; il oblige les “Turcs de la Horde du Mouton Blanc” à demeurer à l’Est de l’Euphrate, ce qui lui permet de réorganiser en paix les territoires conquis sans devoir subir le désordre d’une immigration incontrôlée. Son premier objectif est de se rendre maître de toute l’Egée, d’arracher aux Vénitiens et aux Génois tous leurs comptoirs dans le bassin oriental de la Méditerranée. Lesbos tombe en 1462 et Eubée en 1470. Remarque: c’est Tamerlan qui sert de modèle à Zbigniew Brzezinski aujourd’hui car il détruit sans les reconstruire les empires du rimland eurasien. Ce principe dit “mongol” séduit Brzezinski car, s’il est appliqué à intervalles réguliers, aucune concentration de pouvoir ne peut demeurer en Eurasie sur la longue durée, en étant capable de challenger l’unique superpuissance encore en place sur cette planète.
Chevaux, chars de combat et roues à rayons
Revenons au destin de la Perse, dans la période qui va des premières croisades à l’expansion ottomane du 15ième siècle. Cette histoire est instructive pour les temps présents, où la région est à nouveau théâtre de guerres. Depuis des temps immémoriaux, des tribus indo-européennes (aryennes) erraient dans la steppe, de l’Ukraine à la Mer d’Aral. Elles avaient domestiqué le cheval. Elles étaient partiellement sédentaires (culture de Fatyanovo dans le bassin de la Volga). Elles semblent avoir commencé leurs mouvements vers l’Oural avec la culture d’Usatovo (entre –4000 et –3000). Celle-ci est suivie de la culture dite de Serednij Stog, puis par celle de Jamnaïa, qui sera la culture-source des grandes expansions indo-européennes de la proto-histoire vers l’Iran, l’Inde et probablement la Chine. Dans son grand atlas historique, le Prof. Jacques Bertin souligne l’importance de la culture d’Afanasievo (-2400 à –1700): “L’expansion indo-européenne, depuis l’Ukraine, atteint toute l’Asie centrale. La culture d’Afanasievo (…) profite de la richesse en minerais et en pâturages des montagnes de l’Altaï et des Saïan pour développer l’élevage (chevaux, bovins), l’agriculture et fabriquer des bijoux en métal (…). Une agriculture irriguée est pratiquée au sud de la steppe près de la Mer d’Aral (culture de Kelteminar) et au pied des montagnes de Turkménie”. Ensuite, ajoute-t-il, la culture de Glaskovo (-1700 à –1200) fait de “la région le lieu d’échange entre l’Ouest et la Chine”. Le déssèchement général amène des transformations, mais Bertin constate que la civilisation de Glaskovo, vers –1300 continue à “rayonner sur le Bassin de l’Amour”.
Vers –1800, ces cavaliers apparaissent en Iran et dominent les Elamites de souche dravidienne. Ils forment l’aristocratie cavalière chez des peuples dravidiens (comme les Kassites) ou caucasiens (les Hurriens organisés par les Mitanni indo-européens). Les Mitanni nous ont laissé un manuel d’entraînement de cavalerie et d’utilisation du char de combat; on a découvert ce document à Hattusas, la capitale des Hittites. Plus loin, ces mêmes tribus, qui maîtrisent la technique militaire du char et de la roue à rayons, déboulent en Chine et jettent les bases de l’organisation militaire des futurs empires chinois (période de –1600 à –1400). Vers –1275, trois branches indo-européennes orientales distinctes occupent l’espace qui va de la Mer d’Azov aux confins de la Chine et de la Mer d’Aral à la Perse à l’Ouest et à l’Inde à l’Est: les Scytho-Cimmériens, les Iraniens et les Indiens.
Zarathoustra
En -714, des troupes scythes et cimmériennes bousculent le royaume caucasien d’Ourartou, s’établissent en Anatolie, puis défont les Assyriens en –705. Le facteur indo-européen et cavalier devient décisif et incontournable au Moyen-Orient: jusqu’à l’avènement de l’Islam, plus aucun empire de facture sémitique ne s’imposera à la région. Toutes les directions politiques seront scythes, cimmériennes, mèdes, perses, grecques, macédoniennes, parthes ou romaines. Vers -560, apparaissent les Mèdes, qui soumettent Arméniens, Cimmériens d’Anatolie et Perses (une petite tribu reléguée dans le Sud peu fertile de l’Iran actuel). Pourtant ce seront les Perses, en –533, qui prendront la direction de l’ensemble, fort vaste, de l’Empire mède. C’est là que commence la véritable histoire de l’Iran.
Elle est précédé par l’apparition d’une figure prophétique, celle de Zarathustra ou Zoroastre, entre –610 et –590. Ce réformateur religieux est né en Bactrie, région centre-asiatique au nord de l’Iran actuel, où attendent, comme dans une anti-chambre, les peuples cavaliers de la steppe sibérienne pour jouer un rôle politique prépondérant dans le rimland moyen-oriental et mésopotamien, comme l’atteste l’histoire, depuis les Elamites et les Hurriens. Considéré comme un trouble-fête dans sa région natale, Zarathustra émigre par la suite dans le royaume de Chorasmie —situé au sud de la Mer d’Aral selon les uns, sur le cours moyen du fleuve Amou Daria pour les autres— où le roi Vishtapa l’accueille et accepte son code religieux, social et éthique. Les prêtres traditionnels, représentant d’une hiérarchie figée et adeptes d’une religiosité purement formelle et rituelle, organisent une révolte générale contre la nouvelle foi. Zarathoustra meurt martyr en –553. Il avait jeté les bases d’une religion de la justice, de la participation active du croyant à la chose politique, participation positive qui sera, disait-il, jugée par Dieu lors d’un Jugement Dernier. Le modèle “messianique”, plus exactement celui du “saoshyant”, du “Sauveur qui aide”, “qui vient pour aider”, est né dans cet espace scytho-iranien, entre la Mer d’Aral et la vallée de l’Amou Daria. Les Juifs, avec le prophète Daniel, le ramènent de la captivité babylonienne, après la victoire des Perses de Cyrus contre les héritiers de Nabukhodonosor. Le modèle, mutatis mutandis, sera repris par le Christ puis par deux prophètes iraniens, Mani et Mazdak, qui connaîtront également le martyr, et, enfin, mais cette fois-ci en Arabie, par Mahomet.
La fin des Séleucides et l’arrivée des Parthes
Les Achéménides (-550 à –330) acceptent le zoroastrisme dans ses grandes lignes, comme un moyen commode d’unir Perses et peuples soumis. Le zoroastrisme, devenu ainsi religion d’Empire, survit sans problème à la parenthèse des conquêtes d’Alexandre. Et se diffuse dans tout l’espace dominé par les Perses, créant une véritable diaspora, véhiculant l’esprit d’une “certaine civilisation iranienne”. Sous les Séleucides, qui prennent le relais après le partage de l’empire d’Alexandre, la Perse hellénisée connaît une longue période de déclin et perd les régions clefs de la Bactriane et de la Sogdiane au nord de l’Oxus (= Amou Daria). De nouveaux nomades indo-européens venus de Sibérie vont s’y concentrer: parmi eux, les Parthes, sous l’impulsion des Arsacides. Les Séleucides s’opposent à la progression parthe, qu’ils jugent à juste titre fort dangereuse. Ils n’y parviennent pas à cause d’un soulèvement levantin à Antioche. Les Parthes avancent jusqu’en Hyrcanie (la région qui se trouve au sud de la Caspienne). Antiochos III rétablit la situation, bat les Egyptiens, reprend la Syrie et la Palestine, s’allie avec les nomades indo-européens de Bactriane, renoue avec l’empire indien des Maurya, mais répond —décision funeste— à l’appel de Philippe V de Macédoine, qui fait face à la colère de Rome, parce qu’il avait soutenu Carthage. Antiochos III lui envoie des renforts, qui sont écrasés par les légions aux Thermopyles. Les Romains entament la poursuite, franchissent le Bosphore, écrasent l’armée séleucide en –189. Les Séleucides perdent l’Asie Mineure. La Macédoine perd son indépendance. L’Arménie se déclare indépendante.
L’empire séleucide, fort diminué, est donc coincé entre les Parthes et Rome. Il doit abandonner toute prétention sur l’Egypte, faire face à la révolte juive des Maccabées (-167 à –164), ce qui lui ôte toute possibilité d’expansion vers le Sud. Pendant qu’Antiochos IV perd ses pions en Palestine, les Parthes s’emparent de toutes les régions de l’Iran actuel et entrent en Mésopotamie. Ils y fondent une nouvelle capitale: Ctésiphon. Les Arsacides prennent le relais d’une dynastie hellénisée mais épuisée. Malgré une période romanophile au début de l’ère parthe, sous l’imperium d’Auguste, le conflit entre les deux puissances surviendra bien vite et durera, après la fin des Arsacides et l’avènement des Sassanides en +220, jusqu’à la chute de Rome au 5ième siècle, se poursuivra avec Byzance jusqu’à l’avènement de l’islam. Le principal but géopolitique de cette très longue guerre est le contrôle de l’Arménie, dont le territoire abrite la plupart des sources des grands fleuves du Croissant Fertile et dont les hautes terres permettent de surplomber militairement toute la région.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, perse, grand moyen orient, moyen orient, asie, affaires asiatiques, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook