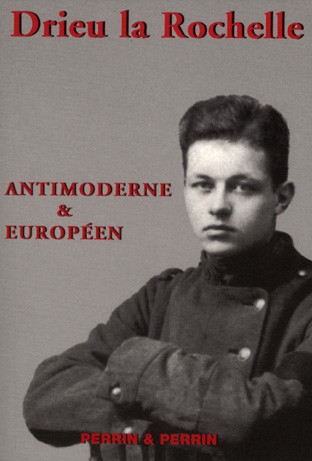
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
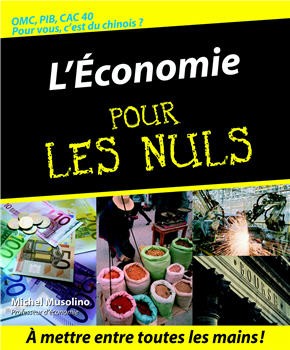
Recettes pour assainir l'économie au quotidien |
| Ex: http://unitepopulaire.org/
|
| « Il est naturel d’adopter un mode de vie économe quand les temps sont durs et que l’on craint pour son emploi. Mais, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et dans d’autres pays, comme l’Espagne et l’Irlande, où l’activité est tirée par la consommation, cette tendance semble annoncer un changement bien plus profond : la fin d’un mode de vie fondé sur une consommation effrénée, alimentée par le crédit facile et l’effet de richesse induit par une valorisation constante des actifs [immobilier et portefeuilles d’actions]. D’ores et déjà, les Américains, naguère si dépensiers, ont relevé leur taux d’épargne personnelle de quasiment zéro – niveau aux alentours duquel il tournait depuis des années – à presque 3 % en novembre. Il devrait prochainement atteindre au moins 8 %, du jamais-vu depuis vingt ans, prévoit David Rosenberg, le chef économiste de la banque Merrill Lynch. A l’image des banques, surendettées et sous-capitalisées, poursuit Rosenberg, les ménages assainissent leur situation en dépensant moins, en épargnant plus et en remboursant leurs dettes. Et, comme dans le secteur financier, cela ressemble de moins en moins à des ajustements temporaires et de plus en plus à un changement d’habitudes durable. […]
Newsweek, mars 2009 |
00:23 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, sociologie, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
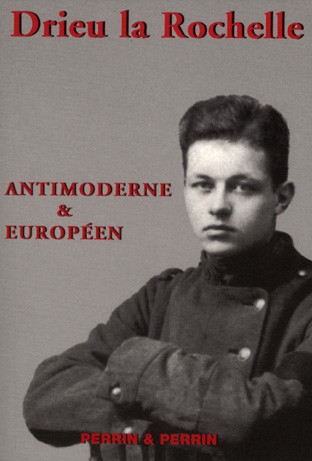
by Michael O’Meara
TRANSLATOR’S NOTE: The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany. This dictatorship — whose defining characteristic, East and West, is its techno-economic worship of the Jewish Moloch — was subsequently imposed on the rest of Europe and, in the form of globalization, now holds the whole world in its grip. For white nationalists, the defeat of National Socialist Germany is both the pivotal event of the 20th century and the origin of their own movement. Opposing the powers which are one generation away from exterminating their race, white nationalists resume, in effect, the struggle of the defeated Germans. But they do so not uncritically.
As an idea and a movement, National Socialism (like Fascism) was a product of the late 19th-century political convergence that brought together elements from the revolutionary anti-liberal wing of the labor movement and elements from the revolutionary anti-liberal wing of the nationalist right. Hitler’s NSDAP was the most imposing historical offshoot of this anti-liberal convergence, but one not always faithful to its origins — which bears on the fact
that Hitler shares at least part of the responsibility for the most devastating defeat ever experienced by the white race.
It is not enough, then, for the present generation of white nationalists to honor his heroic resistance to the anti-Aryan forces. Of greater need, it seems to me, is to identify and come to terms with his failings, for these, more than his triumphs, now weigh on our survival as a people.
The following is an excerpt from a piece that Pierre Drieu La Rochelle wrote in the dark days after August 1944, after the so-called “Liberation” of Paris and before the suicide that “saved” him from De Gaulle’s hangman. It was written in haste, on the run, and never completed, but is nevertheless an illuminating examination of Hitler’s shortcomings (even where incorrect).
The central point of Drieu’s piece (and it should be remembered that he, like many of France’s most talented thinkers and artists, collaborated with the Germans in the hope of creating a new European order) is that Germany alone was no match for the combined powers of the British Empire, the United States, and the Soviet Union. Only a Europe recast on the basis of National Socialist principles, he believed, could triumph against the Jew inspired coalition. Hitler’s petty bourgeois nationalism, critiqued here by Drieu, prevented him from mobilizing the various national families of Europe in a common front, proving that his distillation of the anti-liberal project was inadequate to the great tasks facing the white man in this period.
*
From Drieu’s “NOTES SUR L’ALLEMAGNE:”
I was shocked by the extreme political incompetence of the Germans in 1939, ‘40, and ‘41, after the victories [which made them Europe's master]. It was in this period that their political failings sealed the fate of their future military defeat.
These failings seem even greater than those committed under Napoleon [in the period 1799-1815, when the French had mastered Europe]. The Germans obviously drew none of the lessons from the Napoleonic adventure.
Was German incompetence the incompetence of fascism in general? This is the question.
The imbecilic maxim guiding Hitler was: “First, wage and win the war; then, reorganize Europe.” This maxim contradicted all the lessons of history, all the teachings of Europe’s greatest statesmen, particularly those of the Germans, like Frederick and Bismarck. It was Clausewitz who said war is only the extension of politics.
But even if one accepts Hitler’s maxim, the German dictator committed a number of military mistakes:
1. Why did he wait six months between the Polish campaign and the French campaign?
2. Why did he squander another ten months after the French campaign?
3. Why in late 1940 did he wage a futile aerial assault on England, instead of striking the British Empire at its most accessible point, Gibraltar?
After July 1940 [when no European power opposed him on the continent], he could have crossed Spain, destroyed the [English] naval base at Gibraltar, and closed off the Mediterranean.
The armistice with Pétain [which led to the establishment of the Vichy regime] was [another] German disaster. If the French had followed [Paul] Reynaud [the last Premier of the Third Republic who advocated continued resistance from France's North African colonies], the Germans would have been forced to do what was [militarily] necessary to win the war. For once master of Gibraltar, Hitler would have rendered [the English base at] Malta useless, avoided the Italian folly in the Balkans [which doomed Operation Barbarosa in Russia], and assured the possibility of an immediate and relatively uncostly campaign against [English occupied] Egypt. Rather than bombing London, he should, instead, have seized Alexandria, Cairo, and Suez. This would have settled the peace in the Balkans, avoiding the exhausting occupations of Greece and Yugoslavia, [it would have cut England off from her overseas empire, and guaranteed Europe's Middle Eastern energy sources].
These military failings followed from Hitler’s total lack of imagination outside of Germany. He was [essentially] a German politician; good for Germany, but only there. Lacking political culture, education, and a larger tradition, having never traveled, being a xenophobe like many popular demagogues, he did not possess an understanding of what was necessary to make his strategy and diplomacy work outside Germany. All his dreams, all his talents, were devoted to winning the war of 1914, as if conditions [in 1940] were still those of 1914. . . He thus underestimated Russian developments and totally ignored American power, which had already made itself felt in 1914.
He did understand the importance of the tank and the airplane [whose military possibility came into their own after 1918], but not in relationship to the enormous industrial potential of Russia and America. He neglected [the role of] artillery, which was a step back from 1916-1918. He is least reproachable in his estimation of submarine warfare, whose significance was already evident in the Great War. But even here, the Anglo-Saxons [i.e., the Anglo-Americans] deployed their maritime genius in a way difficult for a European continental to anticipate.
Hitler’s political errors [, however,] were far worse and more thorough-going than his military errors. He hardly comprehended the problem, seeing it in terms of 1914 — in terms of diplomacy, national states, cabinet politics, and [rival] chancelleries. His understanding of Europe did not even measure up to that of old aristocrats like Bismarck and Wilhelm II, who never forgot the traditions of solidarity that united Europe’s dynasties, courts, and nobilities. . .
It is curious that this man who knew how to inspire the masses in his own country, who always maintained the closest contact with his people, never, not for a second, thought of extending his [successful] German policies to the rest of Europe. He [simply] did not understand the necessity of forging a policy to address Europe domestically and not just internationally. Diplomats and ambassadors had lost command of the stage — it was now in the hands of political leaders capable of winning the masses with the kind of social policies that had succeeded in Germany and could succeed elsewhere.
Hitler didn’t understand this. After his armies invaded Poland, France, and elsewhere, he never thought of implementing the social and political practices that had worked in Germany . . . He never thought of carrying out policies that would have forged bonds of solidarity between the occupied and the occupiers. . .
These failures lead me to suspect that the Germans’ political stupidity . . . owed something to fascism — that political and social system awkwardly situated between liberal democracy and Communist totalitarianism.
In the fascist system there was something of the “juste milieu” that could not but lead to the Germans’ miserable failure. [A French term meaning a "golden mean" or a "happy medium," "juste milieu" is historically associated with the moderate centrist politics (or anti-politics) of bourgeois constitutionalists -- first exemplified by France's July Monarchy (1830-48) and subsequently perfected in the American party system].
The Germans have no political tradition. For centuries, most of them inhabited small principalities or cities where larger political forces had no part to play. There was, however, Vienna and Berlin. In these two capitals, politics was the province of a small [aristocratic] caste. The events of 1918 [i.e., the liberal revolutions that led to the Weimar and Viennese republics] abruptly dislodged this caste, severing its ties from the new governing class.
Everything that has transpired in the last few years suggests that Germany remains what it was in the 18th century . . . a land unable to anchor its warrior virtues in politically sound principles . . .
[Part of this is due to the fact that] the German is no psychologist. He is too much a theoretician, too intellectually speculative, for that. He lacks psychology in the way a mathematician or metaphysician does. German literature is rarely psychological; it develops ideas, not characters. The sole German psychologist is Nietzsche [and] he was basically one of a kind. . . Politically, the Germans [like the French] are less subtle and plastic than the English or the Russian, who have the best psychological literature and hence the best diplomacy and politics.
Hitler’s behavior reflected the backward state of German, and beyond that, European attitudes. This son of an Austrian custom official inherited all the prejudices of his father’s generation (as had Napoleon). And like every German nationalist of Austrian extraction, he had an unshakable respect for the German Army and the Prussian aristocracy. Despite everything that disposed him against it, he remained the loyal Reichwehr agent he was in Munich [in 1919]. . . If he subsequently became a member of a socialist party [Anton Drexler's German Workers' Party] — of which he promptly became the leader — it was above all because this party was a nationalist one. Nationalism was always more important to him than socialism — even if his early years should have inclined him to think otherwise . . .
Like Mussolini, Hitler had no heartfelt commitment to socialism. [Drieu refers here not to the Semitic socialism of Marx, with its materialism, collectivism, and internationalism, but rather to the older European tradition of corporate socialism, which privileges the needs of family, community, and nation over those of the economy] . . . That’s why he so readily sacrificed the [socialist] dynamism of his movement for the sake of what the Wehrmacht aristocracy and the barons of heavy industry were willing to concede. He thought these alone would suffice in furnishing him with what was needed for his war of European conquest. . .
Fascism failed to organize Europe because it was essentially a system of the “juste milieu” — a system seeking a middle way between communism and capitalism. . .
Fascism failed because it did not become explicitly socialist. The narrowness of its nationalist base prevented it from becoming a European socialism . . . Action and reaction: On the one side, the weakness of Hitlerian and Mussolinian socialism prevented it from crossing national borders and becoming a European nationalism; on the other, the narrowness of Mussolinian and Hitlerian nationalism stifled its socialism, reducing it to a form of military statism. . .
Source: Pierre Drieu La Rochelle. Textes retrouvées.
Paris: Eds. du Rocher, 1992.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, national-socialisme, troisième reich, lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, france, europe, fascisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
È morto Giano Accame |
| ROMA (16 aprile) - Giano Accame si è spento a Roma. La notizia della morte dello storico, giornalista e scrittore nato a Stoccarda il 30 luglio del 1928 è stata data dal figlio Nicolò. La camera ardente, allestita presso la casa-studio di Accame in Lungotevere dei Mellini 10 a Roma, verrà aperta questo pomeriggio a partire dalle 15. I funerali si svolgeranno sabato prossimo alle 10.30 a Roma, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione al Foro romano. Accame, giornalista, studioso, direttore del Secolo d'Italia ìtra l'88 e il '91, è stato uno degli intellettuali di primo piano della destra italiana e avrebbe compiuto 81 anni il 30 luglio. Aveva un record unico tra i giovani di Salò: si arruolò la mattina del 25 aprile 1945: «la sera ero già in galera. Non ho mai fatto il miles gloriosus anche per questo. Avevo 16 anni», disse in una recente intervista. Accame, nato a Stoccarda ma cresciuto a Loano, ha avuto un percorso molto particolare nella destra. Fu tra i relatori al convegno sulla Guerra rivoluzionaria, nel '65, che gettò le base teoriche della strategia della tensione, dirigente del Movimento sociale italiano fino al '68, tra i più stretti collaboratori di Randolfo Pacciardi, padre del presidenzialismo italiano, nell'esperienza effimera dell'Unione democratica per la Nuova Repubblica, anticipatrice del dibattito sulla repubblica presidenziale. E' stato poi redattore delle più importante riviste della destra - da Il Borghese, al Fiorino e L'Italia settimanale - collaboratore de Il Sabato, Lo Stato, Pagine Libere, Letteratura. Durissima fu in principio la sua critica a Gianfranco Fini che parlava del fascismo come male assoluto ma Accame negli ultimi tempi leggeva gli avvenimenti politici e la confluenza con Forza Italia nel Pdl come un necessario fatto imposto dai tempi. Collocava dunque questa svolta nell'orizzonte del superamento delle ideologie, «oltre la destra, oltre la sinistra - disse ricordando lo slogan sempre caro alla destra sociale dell'Msi - il vero ambito in cui si muove questa fusione è quello della de-ideologizzazione, una scelta che è positiva ma che impone nuove analisi, nuovi modi di essere, nuove sfide. Lo globalizzazione non è stata quel fenomeno negativo che oggi si tende a raffigurare». «Per me è veramente una scomparsa gravissima, per me è stato un maestro», ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno. «Ho offerto alla famiglia di allestire la camera ardente in Campidoglio - ha detto Alemanno - loro però preferiscono tenerlo a casa». «È stato un intellettuale di grandissimo spessore - ha concluso - che ha attraversato tutta la storia del dopoguerra, con posizioni sempre molto ricche e significative. È stato uno dei grandi maestri della cultura di destra». |
00:48 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, italie, non conformisme, pensée rebelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Pensatore eretico della destra, fascista di sinistra, uno degli intellettuali storici della destra italiana, l'intellettuale che voleva unire destra e sinistra sull'idea di patria, il pioniere del dibattito sulla repubblica presidenziale, il primo intellettuale di destra ad avere posizioni filoisraeliane, pensatore "scomodo" grande studioso del poeta americano Ezra Pound: sono solo alcune delle definizioni date ad Giano Accame, il giornalista, saggista e scrittore scomparso a Roma a 81 anni.
Da vero "irregolare" del panorama politico e culturale di destra, Giano Accame ha ricoperto ruoli diversi nella sua lunga vita: dalla sua collaborazione con Tabula Rasa, fucina di pensatori della destra, a inviato del settimanale Il Borghese dal 1958 al 1968; per sedici anni direttore del settimanale Nuova Repubblica, che faceva capo al repubblicano Randolfo Pacciardi, e direttore del quotidiano Il Secolo d'Italia, organo del Msi, tra il 1988 e il '91. Ha pubblicato diversi libri che hanno sempre suscitato dibattito a destra e letti con attenzione a sinistra: Socialismo tricolore (1983) con Editoriale Nuova, poi con Settimo Sigillo Il fascismo immenso e rosso (1990), Ezra Pound economista, Contro l'usura (1995), La destra sociale (1996), Il potere del denaro svuota le democrazie (1998). Nel 2000 con Rizzoli Accame ha pubblicato Una storia della Repubblica: un'opera, avvertiva l'editore, non basata sul conformismo e sul politicamente corretto, ma raccontata con un'interpretazione fuori dai vecchi schemi, spesso critica ma sempre obiettiva e rigorosamente documentata. In pochi mesi il volume fu ristampato più volte e poi apparve anche in edizione tascabile Bur Rizzoli. Alla presentazione ufficiale del libro a Roma esponenti di destra e di sinistra cercarono di far "pace" sul dopoguerra: intervennero, tra gli altri, Gianni Borgna, Marco Minniti, Gianni Alemanno e Francesco Storace.
Giano Accame nasce a Stoccarda il 30 luglio 1928 da madre tedesca, Elisabeth von Hofenfels, mentre il padre e il nonno furono ammiragli e gli antenati piccoli armatori di Loano (Savona). Il 25 aprile 1945, giorno della Liberazione, ad appena 17 anni, Accame si arruolò nella marina militare della Repubblica sociale italiana, ammirando la Decima Mas. La sua adesione alla Rsi durò lo spazio di un mattino, perché alla sera fu catturato dai partigiani a Brescia. Nel 1946 si iscrisse a Genova al Fronte degli Italiani, organismo poi confluito nel Msi, di cui creò le prime sezioni nella riviera ligure ed è stato dirigente regionale e nazionale. Nel 1956 lasciò il Movimento sociale italiano, stanco di polemiche interne e per impegnarsi di più con il giornalismo, sua futura professione, nelle polemiche culturali.
Da qui la collaborazione, con altri intellettuali già stanchi del partito, con Tabula Rasa. Nel 1956 iniziò la professione come capo della redazione toscana del settimanale Cronaca italiana. Nel 1958 passò a Il Borghese, da cui si dimise nel 1968 per contrasti sulla contestazione giovanile. Segretario del Centro di vita italiana presiedutoda Ernesto De Marzio, organizzò a Roma due incontri internazionali di scrittori di destra. Nel1964 dirisse il settimanale Folla, poi, Nuova Repubblica, organo del movimento presidenzialista del repubblicano Randolfo Pacciardi, l'Unione democratica per la nuova Repubblica, di cui divenne segretario nazionale. Come stretto collaboratore di Pacciardi, Accame fu anticipatore, durante gli anni Sessanta, del dibattito sulla repubblica presidenziale.
Dal 1969, come inviato ed editorialista de Il Fiorino, Giano Accame si specializzò in giornalismo economico e collaborò agli Annali dell'economia italiana di Epicarmo Corbino. Tra la fine del 1988 e il 1991 ricoprì l'incarico di direttore del Secolo d'Italia. Ha collaborato con diverse riviste, tra le quali L'Italia settimanale, Il Sabato, Lo Stato, Pagine Libere, Letteratura - Tradizione, La Meta Sociale e Area, ma anche con diversi quotidiani come Il Tempo, Lo Specchio e Vita.
Giano Accame è stato considerato, insieme a Piero Buscaroli, Fausto Gianfranceschi, Franco Cardini, Gianfranco de Turris e Marcello Veneziani, uno degli intellettuali storici della destra italiana. Accame non si ritenne mai un "fascista di sinistra", come il suo grande amico Beppe Niccolai, né tantomeno un "Bertinotti della destra", come fu definito da alcuni giornali per le sue posizioni "eretiche" e "scomode", considerandolo una perniciosa macchietta. Accame ha sempre pensato che tradizione e patria non dovessero essere pretesti, ma ideali veri da rendere concreti con l'azione politica. Quando vennero fuori i documenti del "golpe bianco" del partigiano liberale Edgardo Sogno, alla metà degli anni Settanta, Accame risultava in predicato come ministro della Pubblica istruzione. "Vanterie di una persona anziana che voleva stupire. Sogno era intelligente, simpatico, coraggioso. Ma era il birichino di mamma"', dichiarò Accame nel 2004 in un'intervista a Claudio Sabelli Fioretti per Sette del Corriere della Sera. Allo stesso giornalista che gli ricordava le definizioni date di lui come "terzomondista, anticapitalista, antiamericano", Accame rispose: "Sono solo venature".
Il sindaco di Roma Alemanno:
''Per me è veramente una scomparsa gravissima perché è stato un maestro''. ''E' stato un intellettuale di grandissimo spessore che ha attraversato tutta la storia del dopoguerra con posizioni sempre molto ricche e significative, uno dei grandi maestri della cultura di destra''.
La camera ardente, allestita presso la sua casa-studio in Lungotevere dei Mellini 10 a Roma, verrà aperta questo pomeriggio a partire dalle 15. I funerali si svolgeranno sabato.
00:40 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, politique, politologie, sciences politiques, théorie politique, non conformisme, pensée rebelle, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Giano Accame, pensiero scomodo
14 maggio 2001
Puntata realizzata con gli studenti del Liceo Classico "Umberto I" di Napoli"
STUDENTESSA: Ringraziamo Giano Accame per essere qui con noi. Prima di dare avvio alla discussione guardiamo la scheda filmata.
Pensieri scomodi, pensieri inquietanti, pensieri di difficile collocazione, attraversano, come ombre, il corso del secolo che è appena trascorso. Un secolo dove la massa si è fatta protagonista e il conformismo, l'automatismo mentale, l'inerzia, il torpore, sono diventati condotta comune, norma di comportamento. Il secolo dei grandi totalitarismi sicuramente è anche il secolo dell'indottrinamento di massa, ma, paradossalmente, è anche il secolo degli antagonismi, delle ribellioni, è il secolo in cui scrittori e pensatori, spesso solitari, emarginati, talvolta sconfitti dalla storia, conducono "esperimenti temerari" o semplicemente portano il peso di una "intelligenza scomoda", refrattaria a ogni conformismo. È il caso, ad esempio, dello scrittore tedesco Ernst Junger, una delle grandi figure della letteratura del Novecento. In età più che matura, all'inizio degli anni Cinquanta, Junger teorizza il comportamento del ribelle, al quale, "per sapere che cosa sia giusto, non servono teorie o leggi escogitate da qualche giurista di partito". Il ribelle "attinge alle fonti della moralità ancora non disperse nei canali delle istituzioni". Il ribelle rifugge da ogni ordine costituito, non appartiene più a niente, ha varcato una volta per tutte il meridiano delle opinioni comuni. Pensatore scomodo è dunque Junger, come d'altra parte scrittore scomodo è stato Louis-Ferdinand Céline, definito "veggente del tramonto dell'Occidente". Poeta scomodo è Ezra Pound, una delle voci più alte della poesia del Novecento e uno dei critici più feroci della vita degradata, misurata dal denaro e dalla prestazione. E scrittore scomodo Yukio Mishima, la cui "intelligenza scomoda" si esprime nella ricerca della bellezza e nella fedeltà alla propria tradizione. Ma ogni ricerca ha il suo prezzo: Mishima muore suicida nel 1970.
STUDENTESSA: Possiamo arrivare a definire una "intelligenza scomoda"? Cioè quali sono i suoi tratti distintivi?
ACCAME: Questa espressione, "intelligenze scomode", viene da una trasmissione di Rai Educational dedicata a scrittori, intellettuali e artisti di destra, ma più che di destra, o fascisti, o accusati di fascismo, persone che sono state una parte ineliminabile, importante, del pensiero del Novecento; e che appartengono ormai non solo a una parte, ma al genere umano. Non si potrebbe fare a meno, nella letteratura italiana, di Gabriele D'Annunzio, anche se a Fiume ha creato la ritualità del fascismo, i saluti, il discorso dal balcone. La filosofia italiana non potrebbe fare a meno del più grande filosofo accademico del Novecento, Giovanni Gentile. L'arte italiana non potrebbe fare a meno del futurismo, anche se Marinetti è stato fascista. Il futurismo è stato, dopo il Barocco, la prima volta che l'arte italiana ha avuto di nuovo una dimensione universale. E così la cultura del mondo non potrebbe più rinunciare a Ezra Pound, che è stato il grande innovatore del modo di fare poesia in lingua inglese, o di Céline, che ha cambiato completamente, rinnovato, il modo di fare prosa narrativa, o di Carl Schmitt, che è stato il più grande politologo del secolo scorso.
STUDENTESSA: Secondo Lei, quali sono i rischi, i pericoli, che una "intelligenza scomoda" corre al giorno d'oggi, e quali sono stati quelli dell'anticonformismo nel secolo appena passato?
ACCAME: Ad esempio, tra i rischi dell'anticonformismo, è esemplare la vita tormentata di Ezra Pound, che per essere stato vicino al fascismo e soprattutto alla repubblica sociale italiana, fu poi chiuso dai suoi concittadini americani in una gabbia, come una bestia, in un campo di concentramento a Pisa e poi confinato per tredici anni in un manicomio criminale negli Stati Uniti. Questa idea di curare le dissidenze come una forma di disturbo mentale non è stata adottata prima nell'Unione Sovietica, ma per prima in America. Non accettandosi l'idea che il più grande poeta americano fosse simpatizzante del fascismo, lo si è fatto passare per matto.
STUDENTE: Al di là del nostro secolo, come può manifestarsi oggi una "intelligenza scomoda"? E cosa vuol dire, nella nostra società, andare contro l'opinione comune?
ACCAME: È sempre una posizione rischiosa e naturalmente scomoda. Non lo è stata nella prima metà del secolo, dove il pensiero fascista è stato dominante in quasi tutta l'Europa, ma nella seconda metà del secolo queste forme di cultura sono state emarginate e quindi, tra l'altro, si sono rarefatti gli intellettuali che vi hanno aderito. Il massimo della scomodità oggi è nel ribellarsi alla pretesa del denaro, dei poteri finanziari, e di porsi come elemento principale della scelta politica. Oggi viene teorizzato dalla migliore cultura economica, quella che viene dalla Banca d'Italia in Italia, la compresenza di due elettorati: uno siamo noi, sarete Voi, quando ci arrivate, a diciotto anni, il popolo sovrano, quello che vota per dei deputati e dei senatori, che contano sempre di meno. E l'altro invece è il grande elettorato del mercato finanziario, che, si dice, ormai vota tutti i giorni in casa nostra, facendo salire o scendere le quotazioni della lira e della borsa, a seconda che il Parlamento e i governi si comportino bene, cioè secondo le indicazioni del mercato finanziario, oppure si comportino male. Se spendono troppo per i pensionati o gli ammalati, la lira cade. Ecco, ribellarsi a questo grande potere internazionale è certamente scomodo, perché la maggior parte degli organi di informazione importanti sono nelle mai del potere finanziario, e quindi liberissimi nel criticare i poteri politici, molto meno nel criticare i poteri economici. I grandi giornali, le televisioni, sono un po' delle pistole puntate alla tempia dei poteri politici, che devono adeguarvisi.
STUDENTE: Non pensa che sia il pericolo ad impedire l'esercizio dell'anticonformismo? E ancora: è forse per paura che ci si adegua all'opinione comune?
ACCAME: Per la verità l'anticonformismo oggi non viene impedito. Viviamo in un periodo di piena libertà, soltanto che nessuno gli dà poi retta. Diceva Ezra Pound che la libertà di parola, senza la libertà di esprimersi via radio, non vale nulla. Questo lo diceva quando non esisteva ancora la televisione. Se uno scrive, ma non arriva a esprimersi attraverso il nuovo grande mezzo di comunicazione, parla a vuoto, o parla a delle piccole minoranze. Non credo che oggi vi siano motivi di paura. Il grande vantaggio di essere usciti dai due secoli di cultura delle rivoluzioni, con la caduta del Muro di Berlino, che nessuno ha più legittimo motivo di avere paura per la vita, per la libertà, per i beni, di fronte a qualunque scelta politica. Il potere non fa paura. Il potere però può emarginare, è naturale insomma. Quindi esiste, è legittimo, anche per gli intellettuali, il timore, la paura di essere isolati, di essere emarginati, di non contare niente, quindi di non guadagnare. Ecco, questo è. Ridimensionando il timore, è lì oggi il vero nemico dell'anticonformismo, quello che spesso vengono reclamizzate sono forme di anticonformismo banale, ma quello più serio viene ancora ghettizzato.
STUDENTESSA: Recentemente ho visto un film, L'ultimo bacio, di Gabriele Muccino, e uno dei personaggi dice: "La normalità è la vera rivoluzione". Lei cosa ne pensa?
ACCAME: La rivoluzione è cambiamento, mentre la normalità è stabilizzazione. La grossa difficoltà nel rapporto tra gli intellettuali e la politica è che, soprattutto in periodo democratico di elezioni, la politica si muove appunto sulla normalità. La politica deve usare argomenti accessibili al grande pubblico, quindi argomenti ormai banalizzati. Mentre il compito dell'intellettuale è quello di spingersi oltre, di dire delle novità; il compito più difficile, insomma. Ma la normalità non è la vera rivoluzione. La vera rivoluzione è il cambiamento. La vera rivoluzione è stata - adesso ormai questo periodo di due secoli è finito - l'ambizione delle filosofie a inverarsi nella storia. Un tempo ci si accontentava che le filosofie spiegassero il mondo. Da Marx a Gentile, che ha ripreso questa filosofia della prassi di Marx, invece si aggiunge o si era aggiunta una nuova pretesa, che la filosofia non solo spiegasse il mondo, ma che lo cambiasse. Ecco, la normalità non ha questa pretesa di cambiamento. La normalità di solito si adegua e non penso che possa essere rivoluzionaria.
STUDENTESSA: Nella scheda filmata abbiamo visto che gli scrittori e i pensatori citati sono tutti critici della democrazia occidentale. Ora l'atteggiamento antidemocratico può identificarsi con l'anticonformismo?
ACCAME: Certamente! Perché quelli anticonformisti sono atteggiamenti di minoranza, che quindi spesso si rivoltano, o si sono rivoltati in passato contro la democrazia. In realtà né Pound né Junger si sono particolarmente rivoltati contro la democrazia. Se mai solo Mishima, che è un curioso esempio di fascismo di ritorno, o di tradizionalismo di ritorno. Durante la guerra Mishima fu scartato alla leva e ne fu contentissimo perché si risparmiava la vita. Diventò lo scrittore giapponese più noto in Occidente, e di solito in Italia tutti i suoi primi libri sono stati pubblicati da Feltrinelli, quindi anche molto gradito alla sinistra. Omosessuale, o almeno bisessuale, quindi trasgressivo, su un piano che il pensiero conservatore è meno orientato a accettare. E tuttavia, dopo aver riscosso successo internazionale e in Giappone naturalmente, a un certo punto ha sentito la vanità di questo successo e ha avuto un ritorno di pensiero conservatore, tradizionale ed è ritornato all'antica etica dei Samurai, sino a compiere il sacrificio rituale in una caserma giapponese, per protestare contro l'occidentalizzazione del Giappone e soprattutto contro l'asservimento dell'attuale classe politica giapponese agli americani. Ecco, quindi è l'unico, se mai, che si è ribellato a quel tipo di democrazia asservita. In realtà tutti poi dopo hanno fatto riferimento al popolo. In particolare Ezra Pound era fortemente critico del sistema politico americano, ma non perché fosse antidemocratico. Lui seguiva le idee di Jefferson, che è tra i creatori della democrazia americana, ma accusava la classe dirigente democratica americana di essersi asservita ai banchieri, di essersi asservita al grande capitale finanziario e di aver quindi tradito la stessa Costituzione degli Stati Uniti, che riservava al Congresso la sovranità monetaria e invece questa sovranità era stata trasferita ai banchieri. Questo era più legato alla vera idea dei pionieri americani. Si considerava infatti un vero patriota americano, in rivolta contro il tradimento della democrazia fatta delegando troppi problemi e troppi poteri alla finanza.
STUDENTE: Non crede che l'anticonformismo sia possibile solo in democrazia, e che invece il totalitarismo non sopporti le intelligenze scomode?
ACCAME: Certamente è più facile in democrazia che nei totalitarismi. E tuttavia anche nei sistemi totalitari ci sono stati esempi di rivolta, di ribellione, che naturalmente sono costati di più. Io, come scrittore di destra, la libertà in questo mezzo secolo ho dovuto più faticosamente conquistarmela, giorno per giorno. A me non l'hanno regalata gli americani, insomma, non mi è stata importata. L'ho dovuta conquistare vincendo pregiudizi, difficoltà, tentativi di discriminazione. E quindi qualche difficoltà la si incontra anche in un sistema di piena libertà.
STUDENTE: Si può, paradossalmente, seguire la legge ed essere comunque scomodi? Pensavo, ad esempio, al Giudice Falcone.
ACCAME: Certamente! Ma il Giudice Falcone era scomodo per la delinquenza, per la grande criminalità organizzata. Non direi che sia un esempio di anticonformismo. È un esempio di eroismo, come quello del Giudice Borsellino, come quello delle forze dell'ordine quotidianamente impegnate nella difesa delle persone per bene, degli onesti, contro la grande criminalità. Ma non direi che questo sia un esempio di anticonformismo. Per quanto, lì dove la società è addormentata, dove esistono complicità tra poteri politici e grandi organizzazioni mafiose, anche questo, il coraggio di rivoltarsi, rischiando la pelle, può, a suo modo, essere interpretato come un anticonformismo. L'egoismo, il rischiare la vita, è sempre impresa di pochi. L'eroe è di per sé uno che si stacca dalla media, dalla normalità, e in questo si può considerare non perfettamente conformista. Non è uno che si fa i fatti suoi e pensa solo alla famiglia. Pensa alla Patria, alla generalità dei cittadini.
STUDENTESSA: Secondo Lei l'intelligenza scomoda è capace solo di demolire e criticare, o è in grado anche di costruire e affermare?
ACCAME: L'intelligenza scomoda vorrebbe anche costruire e affermare. In realtà, dalla lezione dei fascismi è venuto qualcosa che oggi, a livello debole, è estremamente diffuso. Cosa ha fatto il successo politico di Mussolini, ad esempio? È stato il ribellarsi a quella spaccatura, che è nel cuore dell'uomo e della società europea, che aveva provocato la presunzione illuministica, contrapponendo alla tradizione il progresso, contrapponendo alla fede la ragione e la scienza, e, poi il socialismo, contrapponendo alla aspirazione e alla giustizia sociale l'idea di Dio e della Patria. Il successo di Mussolini è stato quello di risaldare queste spaccature e legando e rendendo compatibile, con un'aspirazione alla giustizia sociale, l'idea di Dio e della Patria. Naturalmente poi gli errori hanno compromesso questo tentativo, che aveva suscitato tanti entusiasmi, aprendo nuovi conflitti: conflitto razziale, la discriminazione degli ebrei, e aprendo un conflitto sui temi della libertà. Ma questa idea di risaldare, di non spaccare le masse, sui temi di Dio e della Patria, e spingere il progresso delle masse, unificando questi sentimenti forti, oggi è condivisa da tutti. Nel socialismo italiano è stato Bettino Craxi che ha cercato di sanare queste imprudenti e stupide spaccature, queste fratture. Ha fatto un nuovo Concordato con la Chiesa, ha riscoperto il socialismo tricolore. Ma non c'è forza politica importante, sono solo marginali quelle che non abbiano il pieno rispetto del sentimento religioso e che rinneghino l'aspirazione, oggi più debole, all'identità nazionale. Questo è ormai da destra a sinistra. Tutte le volte che un'idea si affaccia, si affaccia di solito con violenza e con forza, mentre adesso, anche a livello di pensiero debole, tutti condividono questa aspirazione unificante di quelle che sono le grandi tendenze dell'uomo.
STUDENTESSA: Noi finora abbiamo parlato solo di anticonformismo. Ma cosa si intende e come si esprime il conformismo oggi?
ACCAME: Il conformismo, secondo me, si esprime soprattutto nell'economicismo, nell'assegnare, come obiettivo esistenziale e principale, l'idea dell'arricchimento. E questo porta a delle gare che possono essere addirittura distruttive per il genere umano, perché è probabile che l'assetto ecologico della terra non possa resistere a ulteriori progressi, a ulteriori escalation in questa ricerca del benessere e dello spreco. Un tempo ci si accontentava più facilmente della propria condizione economica e si cercava la gratificazione nel far bene certe cose. Il medico condotto non voleva arricchirsi, ma curare, il professore era completamente dedito al proprio lavoro di educatore e non era scontento, i servitori dello Stato e gli ufficiali peroravano la grandezza della nazione. E, comunque, chiunque faceva la propria professione, o il proprio lavoro, o il proprio mestiere di artigiano, di operaio, tendeva a trovare la gratificazione nell'esistenza e in altri valori oltre che quelli monetari. Oggi la ricerca dell'arricchimento, l'economicismo, spegnendo altre aspirazioni dell'uomo, altre tendenze, esprime una forma di conformismo che considero pericolosa.
STUDENTE: Non pensa che il prezzo da pagare all'anticonformismo sia l'individualismo?
ACCAME: No, se mai proprio il conformismo di oggi è l'individualismo. Ci si lamenta, dopo la caduta del Muro di Berlino, della affermazione planetaria della formazione di un pensiero unico, che è il pensiero liberale individualista. E c'è addirittura una forma quasi di intolleranza liberal-liberista. Se mai, l'anticonformismo oggi si dovrebbe manifestare in un ritorno al pensiero comunitario, all'idea di sentirsi insieme, all'idea della società a cui aderire e da servire.
STUDENTESSA: Secondo Lei, si può essere anticonformisti nel rispetto dell'opinione comune?
ACCAME: L'anticonformismo e l'opinione comune di solito sono in conflitto. L'anticonformista è proprio contro l'opinione comune. Però ci può essere una forma di anticonformismo del conformismo, nel senso che spesso gli intellettuali ostentano forme di disprezzo del senso comune. E allora aderire al senso comune rappresenta in qualche modo una forma di anticonformismo. Il coraggio di pensarla un po' come tutti, perché questo tipo di pensiero viene snobbato.
Puntata registrata il 21 febbraio 2001
00:35 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, droite, politique, politologie, sciences politiques, théorie politique, non conformisme, pensée rebelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Alors que les actes de piraterie maritime ne cessent de se multiplier dans le Golfe d’Aden, notre collaboratrice Michelle Favard-Jirard met en lumière certains aspects de ce phénomène jusque-là passé sous silence.
 Avec neuf millions d’habitants et une côte longue de 3 300 km, la Somalie est, depuis 1991, un patchwork formé au sud par la Somalie proprement dite, au nord-ouest par le Somaliland bordant le Golfe d’Aden et au nord-estpar le Puntland, région semi autonome perchée sur sa corne. Dans chaque zone, la situation diffère, le nord-est et le sud, étant les plus instables.
Avec neuf millions d’habitants et une côte longue de 3 300 km, la Somalie est, depuis 1991, un patchwork formé au sud par la Somalie proprement dite, au nord-ouest par le Somaliland bordant le Golfe d’Aden et au nord-estpar le Puntland, région semi autonome perchée sur sa corne. Dans chaque zone, la situation diffère, le nord-est et le sud, étant les plus instables.
Comme la majorité des pays africains décolonisés - dans les conditions lamentables que l’on sait – la Somalie a sombré dans le chaos puis la guerre civile. S’en est suivi une terrible famine et, en 1992, l’intervention, sous l’égide de l’ONU, d’une force militaire internationale à prépondérance américaine qui, se retrouvant en position d’échec, dut quitter les lieux en laissant le pays en proie à l’anarchie.
Des vérités pas très bonnes à révéler
C’est dans les années 80 qu’apparaît la piraterie, tout d’abord sous l’instigation de simples pêcheurs réagissant à l’incursion de navires étrangers pénétrant illégalement dans les eaux territoriales somaliennes. Malheureusement, ce système d’autodéfense se transforme peu à peu en un business lucratif et, suscitant des envies, dégénère en gangstérisme. Ce que réfute pourtant l’un des leaders des pirates, Sugule Ali qui affirme : « Nous ne nous considérons pas comme des bandits. Ceux qui sont des bandits, [sont] ceux qui pêchent dans nos mers et s’en servent comme dépotoirs ».
Un article paru voici quelques mois dans le journal londonien The Independant, fait écho à cette déclaration, affirmant que « dès la chute du gouvernement en 1991, de mystérieux bateaux européens ont fait leur apparition au large des côtes somaliennes, se délestant d’étranges cargaisons de barils. Peu après, la population a été prise de malaises divers : démangeaisons, nausées, etc. Suite au tsunami de 2005, l’échouage de quelques-uns de ces barils sur les plages, ayant bien entendu suscité curiosité et manipulation de la part des plus curieux, de graves signes de contamination radioactive se sont alors manifestés, entraînant le décès de quelques trois cents âmes. » Interrogés par Reuters, Ahmedou Ould-Abdallah, représentant de l’ONU en Somalie, devait confirmer « la présence de métaux lourds (plomb, cadmium, mercure) dans ces cargaisons provenant d’hôpitaux ou d’usines » et accuser « la mafia italienne (sic) de s’en être débarrassée à moindre frais ».
Déchets toxiques et piratage
D’autre part, à des centaines de kilomètres de là, un autre genre de rumeurs faisaient état de pillages des fonds marins, de surexploitation de fruits de mers - crevettes, langoustes et thons - par des chalutiers étrangers, évalués, pour la seule année 2008, à 300 millions de dollars.
Déplorant une pauvreté toujours croissante, le pêcheur Mohammed Hussein, résident de Marka, situé à une centaine de kilomètres de Mogadiscio, confiait à Reuters : « Si rien n’est fait, nous n’aurons bientôt plus de poisson au large de nos côtes ».
Comment, penseront d’aucuns, concilier dans une même région, le dumping de déchets toxiques et l’exploitation outrancière des ressources marines dès lors exposées à la contamination ? Vu la longueur du littoral somalien, sans garde-côte ni armée, commente un interlocuteur, « on peut par exemple imaginer combien il serait facile de voler du poisson en Floride et se lester en toute impunité de barils à contenance toxique en Californie. La distance séparant ces faits n’en annule pas pour autant, leur horrible commun effet : des indigènes meurent et la piraterie prospère… Il n’y a là aucune contradiction ».
Alors qu’attaques et kidnappings par les pirates se multiplient, la résolution du problème reste difficile. Interviewé le 14 avril dernier à Mogadiscio par Edmund Sanders du Los Angeles Times, le premier ministre somalien Omar Abdirashid Ali Sharmarke déclarait : « Nous ne sommes pas utilisés autant que nous le souhaitons… Il faut combattre les pirates sur la terre ferme. Nous avons des informations sur leur identité et leur fonctionnement… » Une intervention terrestre semble de même être favorisée par le représentant onusien Ahmedou Ould-Abdallah qui parle « d’encourager la paix sur la terre ferme afin de renforcer la sécurité sur mer ». Une chose est certaine, ce genre d’initiative de la part des seuls occidentaux ne pourrait qu’aggraver le conflit.
Aux dernières nouvelles, par une annonce de Sharmarke à l’Associated Press, on apprenait ce vendredi 17 avril, qu’une conférence sur la Somalie était organisée à Bruxelles la semaine prochaine, conduite par l’Union européenne et les Etats-Unis, à laquelle participeraient entre autre, le secrétaire général de l’ONU, le président somalien et des représentant de l’Union africaine en Somalie. Le pirate capturé dimanche dernier, Abdulwali Muse, 19 ans, devait être jugé à New York, alors que le porte-parole du quai d’Orsay, Frédéric Desagneaux, annonçait quant à lui, que la France proposait d’entraîner à Djibouti un bataillon somalien fort de 500 hommes.
Enjeux géopolitiques, véritable volonté de stabilisation ? L’ombre du Moyen-Orient pèse lourd sur cette région du monde…
Michelle Favard-Jirard pour Novopress France
[cc] Novopress.info, 2009, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine
[http://fr.novopress.info]
Article printed from :: Novopress.info France: http://fr.novopress.info
URL to article: http://fr.novopress.info/?p=16429
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : géopolitique, océan indien, afrique, marine, mers, océans, piraterie, somalie, corne de l'afrique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Geplaatst door yvespernet op 17 april 2009
Vandaag de dagen leven we in een liberale representatieve parlementaire democratie. Iedereen heeft een stem die via een evenredige verdeling zorgt voor een gelijke vertegenwoordiging van de politieke strekkingen in Vlaanderen. Iedereen heeft het recht op vrije meningsuiting, vrijheid van vergaderen, etc… We mogen dus zeggen en denken wat we willen, censuur is er niet meer. Althans, dat is toch de theorie.
Nieuw en oud totalitarisme
Wanneer men over totalitaire regimes spreekt, heeft men direct een beeld voor van regimes met soldaten in de straten, een zichtbare geheime dienst en met regelmatige verdwijningen van politieke tegenstanders. We kunnen echter ook stellen dat wij vandaag de dag in een totalitaire samenleving wonen. Alleen is het regime veel beter geworden in de schijn te bewaren van de vrije mens en worden er ook allerlei misleidende vormen van totalitarisme gebruikt om politieke oppositie tegen het systeem de kop in te drukken. Waar vroeger werd gewerkt met fysiek geweld om de oppositie aan te vallen, werkt men nu veel slimmer. In vroegere tijden werden opposanten nogal zichtbaar en fysiek uitgeschakeld. Ze verdwenen (waardoor iedereen wel kon raden wat ermee gebeurde) of werden gewoon vermoord. Betogingen en opstanden werden met de wapenstok, de bajonet of het geweer neergeslagen of uiteengeschoten.
Het ontstaan van de consumptiemaatschappij heeft het regime echter een machtig wapen gegeven. Door het voeden van het individualisme worden oude sociale verbanden en wordt het sociale middenveld ondermijnd. Mensen worden aangemoedigd om hun eigen belang na te streven, ook als dit ten koste gaat van anderen. En al juich ik uiteraard de materiële vooruitgang tegenover het begin van de 20ste eeuw toe, het materialisme heeft er ook voor gezorgd dat mensen een disproportioneel groot belang hechten aan hun bezittingen. De arbeiders hadden vroeger amper iets te verliezen bij het ondernemen van politieke actie, vandaar ook de term proletariërs.
Totalitarisme in de maatschappij
Een andere eigenschap van de totalitaire staat, althans toch volgens Hanna Arendt (die we niet echt van sympathie kunnen verdenken van radikaal-rechts gedachtegoed), is het ineenstorten van de klassen in de maatschappij. Iets dat we ook vertaald zien in de opbouw van totalitaire bewegingen. Daarin is iedereen gelijk buiten de leider die als een soort nieuwe absolute vorst boven zijn volgelingen zweeft. Ook deze afbraak van de klassen kunnen we herkennen in de huidige maatschappij. Om een totalitaire samenleving te creëeren, is de afbraak van overkoepelende structuren en groepsgevoel immers vitaal. Enkel het individu mag nog bestaan. Duizend individuen zijn immers makkelijker te controleren dan honderd georganiseerde militanten.
Bovenop de afbraak van de groepen en overkoepelende verbanden is er ook nog een andere belangrijke factor; sociale uitsluiting. Opstandelingen tegen het systeem moet men immers niet proberen neer te knuppelen wanneer men een machtig media-apparaat heeft dat het voor het regime doet. Ook fenomenen als “anti-fascisme” dienen enkel voor het overleven van de staat te waarborgen. De grootste successen tegen de oppositie zijn altijd geboekt geweest wanneer de controle van het regime het minst zichbare bleef. Zodra de bevolking zichzelf bespioneert en verdacht maakt, betekentdit voor de staat een enorme verlichting van hun taken.
Door de controle van de media en door de zelfspionage van de bevolking heeft de staat van na WOII ook voor de eerste keer, in een mate dat een dictatuur nooit heeft kunnen doen, zo een grote controle over de mensen. In alle lagen van de maatschappij; media, cultuur, samenleving, etc… wordt er nu gepleit voor een zo “pluralistisch” mogelijke samenstellingen. Buiten uiteraard de regimebedreigende krachten, die zijn naar het schijnt vanuit hun wezen vijandig naar de mens toe. Althans, dat wenst het regime ons wel wijs te maken.
Een nieuw volksfront
Wanneer de politieke klasse zich eensgezind, wat de verschillen onderling zijn wel zeer minimaal te noemen, tegen alle oppositie kant, is het nodig om een nieuwe weg in te slaan. De oppositie moet zich verenigen in een nieuw soort volksfront. Een identitair, anti-globalistisch, anti-kapitalistisch eenheidsfront tegen het cultuurvernietigende, globalistische en kapitalistische volksvijandige kamp. Eenheid tussen radikaal-links en radikaal-rechts. Maar dan moet radikaal-links ook eens gaan beseffen dat ze niet moeten streven naar dingen als meer migratie, aangezien dat net een wapen is van de neoliberale klasse. Die dienen immers om de lonen hier te drukken en het volk op te zetten tegen het grootkapitaal(1).
Maar totdat de radikaal-linkse kant (al zijn er uitzonderingen godzijdank) heeft geleerd dat het belangrijker is om te strijden tegen de volksvernielers en mensenhandelaars (want daar komt de huidige (economische) massamigratie op neer) dan te ijveren voor de emancipatie van zowat alles, zal het regime rustig verder doen met de demonisering van hun grootste bedreiging; de volksnationalisten en solidaristen.
(1) Het grootkapitaal is een kleine groep mensen die geen belang hecht aan het bestaan van naties, voelen zich met niemand buiten hun eigen sociale groep verbonden (en dan nog) en zullen enkel streven naar het eigen geldgewin. Zij zijn niet de burgerij die zich tenminste nog met een cultuur en volk verbond en zijn kapitaal ten minste ook nog gedeeltelijk ten dienste stelde van kunstenaars en musici. Dit grootkapitaal, dat zich steeds verder en verder op een globale schaal organiseert, wilt helemaal niet beperkt worden in hun doen en laten. Zij zullen dan ook altijd streven naar een verdere liberalisering van de economie. Het grootkapitaal produceert op geen enkele manier een meerwaarde aan de samenleving.
Als een parasiet teert het op de rijkdommen van de maatschappij. Rente en de handel in niet-bestaand geld op de beurzen maakt hen stinkend rijk. Wanneer we spreken over een “klassenstrijd” in solidaristische ogen is het beter om te spreken over de strijd tussen productieven en niet-productieven. Productieven zijn iedereen die bijdraagt door arbeid of investeringen aan de maatschappij in zijn geheel, ik heb het dan over veel meer dan pure economische factoren. Niet-productieven zoals het grootkapitaal teren op de maatschappij en haar verwezenlijkingen als een parasiet die zich volzuigt.
00:20 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, sciences politiques, démocratie, totalitarisme, contrôle, censure, actualité, liberté de pensée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

00:17 Publié dans Affiches | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, de gaulle, gaullisme, géopolitique, affaire chauprade, polémique, censure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
MISHIMA: L'HOMME, L'ŒUVRE, LA MORT
Dans son autobiographie Le Soleil et l'Acier, Kimitake Hiraoka, bien plus connu sous le pseudonyme qui le révèlera à l'humanité, Mishima Yukio, confessait son irréfragable désir d'assouvissement tragique par ces quelques mots, jetés en une fausse interrogation, et alors fort peu écoutés: «Qu'est-ce qui distingue une mort héroïque d'une mort décadente? (...) Résister à la mort et à l'oubli». Cette phrase, le 25 novembre 1970 consommé, personne ne devait plus l'oublier. De fait, pacte suicidaire du plus célèbre des auteurs japonais marque aujourd'hui encore les esprits à un point tel qu'elle recouvre d'ombre sa pourtant foisonnante et géniale œuvre littéraire. La biographie recomplétée de son ami journaliste Henry Scott-Stokes est éclairante en la matière, qui lui consacre près de 400 pages à décortiquer la troublante personnalité du dernier samouraï nippon, rejetant l'étude de ses textes à une simple énumération-explicitation insipide et sans profondeur aucune.
Etonnante inconséquence bien ancrée à “droite” également, pour qui le seppuku du Grand Quartier Général de Tokyo, plus coup d'éclat que coup d'état, est devenu un évènement prépondérant sa mythologie, qu'il est inutile ici d'évoquer à nouveau, tant il l'a déjà à maintes reprises été: «Yukio Mishima choisit d'être le dernier samourai. Sa sortie fulgurante hors d'un monde qu'il abhorrait se camoufle sous une tentative de putsch. Mais un putsch à la nippone, voué à l'échec, ayant pour seul dessein de mettre en scène un évènement inoubliable» (Jean Mabire). Pourtant, un rapide retour sur ses écrits jette un éclairage nouveau et bien plus instructif que tous les cours de psychologie ou études de philosophie orientale (sa vie durant, il restera sceptique à l'égard du bouddhisme et du shintoïsme institutionnels) que depuis vingt-sept ans littérateurs, critiques journalistiques ou prétendus exégètes nippophiles s'acharnent à plaquer sur la personne de Mishima pour en finir avec son geste fatal.
Tout dans ses romans, nouvelles, essais et recueils autobiographiques annonçaient par la plume ce que leur auteur allait bientôt sceller par le sang. L'idée précède l'action, l'action la complète. Le mot, trompeur, factice transposition scripturale du fatum humain, pallié, transcendé par l'action elle-même. Et si Mishima nous paraît si proche, c'est que derrière le vernis de l'artiste insulaire imprégné de culture sino-nippone se profile, tantôt en filigrane, tantôt frappant d'évidence, l'écrivain baigné de littérature européenne, de philosophie allemande, de mythologie hellénique. Ceux qui l'ont connu ou approché s'accordent tous à le reconnaître: sa maison, délirant bâtiment baroque mariant avec plus ou moins bon goût pilastres massifs, fioritures et plâtres moulés de statues de l'antiquité et de la renaissance, sa passion pour la Grèce, son culte de l'haltérophilie, son goût immodéré pour Thomas Mann et Friedrich Nietzsche, le philosophe au marteau, attestent de son regard tourné vers le berceau de la tragédie. «Il faut ne jamais s'être ménagé soi-même, il faut avoir fait de la dureté une habitude pour rester serein et de bonne humeur parmi de dures vérités», quelle meilleure traduction que cet aphorisme nietzschéen tiré d'Ecce Homo pourrait mieux percer à jour la complexité de Mishima, sa pensée profonde et la vision unique qui guida sa vie, son œuvre, et, point d'orgue terrible, sa mort par suicide.
Mishima, d'abord un écrivain européen? Perspective ambitieuse certes, mais qui s'appuie sur des faits et des écrits-mêmes de Mishima qu'il serait navrant de vouloir oblitérer, au titre fallacieux d'une compréhension plus aisée d'un auteur ultra-nationaliste et impérialiste en rupture de ban. En un dernier aveu au monde qu'il allait définitivement quitter, il laissait sur son bureau, accompagnant la dernière partie manuscrite de sa tetralogie La Mer de la Fertilité, ce billet, disant «La vie est brève, mais je voudrais vivre toujours». Espoir d'éternité concrétisé certes par sa postérite littéraire, que confirme la récente sortie dans la prestigieuse collection NRF-Gallimard du Pélerinage aux Trois Montagnes, mais qui, s'il n'avait été qu'un «quelconque» écrivain de talent, lui aurait au contraire évité sa mort volontaire et prématurée. Son acte, s'il reste nimbé de mystère, doit sa raison d'être à une toute autre inspiration, divine ou classique, indubitablement tragique, nourrie de références européennes, classiques grecs, littérature du «Grand Siècle» et bréviaires sils-mariens, juste retour des choses pour un Nietzsche volontiers «schopenhaueriennement» vulgarisateur du bouddhisme. Mishima, le plus occidental des écrivains asiatiques, tellement opposé au précepte Zen «Aller droit devant soi, sans se retourner et sans se poser aucune question».
*
«L'homme qui sait mourir ne sera jamais esclave» prêchait déjà Sénèque, conseiller de l'Empereur Néron et maître de la Rome stoïcienne, pour qui la vie, ascèse virile et souveraineté aristocratique sur ses pulsions tendues vers la LIBERTE absolue de l'Etre, trouvait sa conclusion la plus pure et olympienne dans son propre abandon volontaire. Mais se sacrifier sous le coup de la passion, preuve de son inaptitude à s'affirmer contre le monde, ne saurait mériter que mépris et déshonneur. Or, c'est bien dans ce sens qu'abonde Henry Scott-Stokes quand il affirme péremptoirement que le suicide de Mishima ne fut jamais que shinju, double suicide amoureux en compagnie de son prétendu amant et second au sein de la Tatenokai; Morita Masakatsu, connotant l'acte d'une homosexualité sado-masochiste honteuse qui ne résiste pas devant l'examen des faits. Quand meurt Mishima, il y a longtemps qu'il s'est défait de ses oripeaux romantiques. Son passage à la Bungei Bunka, association militariste de littérateurs nationalistes et son appartenance au mouvement Nippon Roman-Ha («les Romantiques japonais») regroupés derrière la figure du romancier Yasuda Yajura remonte aux dernières années du second conflit mondial.
Glorifiant la «guerre sainte» et prônant la valeur salvatrice du sacrifice et de l'autodestruction du peuple japonais guidé par l'infaillabilité de son Empereur-thaumaturge, seul aux yeux de ce cercle avait droit de cité l'exploit intrinsèque, la défaite et la mort, inéluctables, magnifiant comble du romantique la plus belle des victoires, d'ores et déjà acquise par le seul fait que le Japon, peuple à la supériorité divine, ait osé lever le sabre sur l'Asie et s'aliéner la haine de l'Occident. Profondément influencé en ses jeunes années par l'école néo-confucéenne Wang-Yang-Ming du Dr Inoue Tetsujuio («La mort du corps n'est rien face à la mort de l'esprit»), Mishima confiera bien plus tard, dans Le Soleil et l'Acier (1968), son progressif changement d'orientation: «L'élan romantique, à partir de l'adolescence, avait toujours été en moi une veine cachée, n'ayant de signification qu'en tant que destruction de la perfection classique (...) En l'espèce, je chérissais un élan romantique vers la mort, tout en exigeant en même temps comme véhicule un corps strictement classique (...). Me manquaient, en bref, les muscles qui convenaient à une mort tragique».
Le grand bouleversement de sa vie a lieu en 1952, lorsque Mishima, alors tout jeune romancier mondialement célébré pour Confession d'un Masque (1949) met le pied en Grèce. Lecteur assidu d'Homère, Eschyle et Sophocle, des classiques grecs et du «Grand Siècle», cas rarissime dans le Japon post-1945, il «tombe amoureux des mers bleues et des ciels vifs de cette terre classique» et echafaude une théorie pour sublimer son Voyage à Sparte: dans les temps anciens, la spiritualité («cette excroissance grotesque du christianisme»), inexistante, était palliée par un équilibre précaire entre le corps et l'esprit nécessitant un effort constant pour le préserver, que les Grecs sublimèrent dans la beauté et la tragédie, punition infligée aux hommes par les dieux pour leur arrogance. «Mon interprétation était peut-être fausse, mais telle était la Grèce dont j'avais besoin». Aristote ne disait-il pas qu'un «beau pied est l'indice d'une belle âme»?
A travers cette nouvelle grille de lecture éthique, le jeune et chétif écrivain désapprend la solitude, la haine de soi et découvre la beauté du corps travaillé, sculpté par l'exercice. A son retour au Japon, dégoûté du romantisme, «caractéristique typiquement bourgeoise (...) fadaises poétiques, héroïsmes mélodramatiques, pathétiques complications d'amour» (dixit Julius Evola), il décide que l'heure est venue pour lui désormais d'écrire des «œuvres classiques», et, en corollaire, autre lecon rapportée de l'Hellade, de s'adonner au culturisme. «Le bon endroit, c'est le corps, l'apparence physique, le régime, la physiologie -et le reste suit de lui-même (...) c'est pourquoi les Grecs constituent toujours le premier évènement capital de la culture de l'humanité. Ils savaient -et ils faisaient-, ce qu'il fallait». (Nietzsche in Crépuscule des Idoles).
La mort, qui jusque là n'était que trouble nihilisme destructeur, et attrait morbide pour la souffrance («Le penchant de mon cœur vers la mort, la nuit et le sang était indéniable» notera-t-il à l'occasion de la publication de Confession pour un Masque) se voit rehaussé au rang d'idéal, de suprême geste de domination, de puissance et de liberté. Patet Exitus: «Lorsque vous ne voulez plus combattre, il vous est toujours possible de vous retirer. Rien ne vous est plus facile que de mourir» (Sénèque). Chacune des œuvres qui paveront le panthéon de sa gloire littéraire sera dorénavant un pas supplémentaire dans son approche définitive du néant.
En 1951 puis 1953 paraissent deux versions de Couleurs Interdites, évocation de la société homosexuelle de Tokyo et des relations tumultueuses qui unissent le vieil écrivain Shinsuke et le bel éphèbe ingrat Yuichi, conclue par la mort par injection de drogue du vieillard, au terme d'un sermon inutile. Saisissante préfiguration de ce qui allait attendre Mishima... Cette même année 1953 sort La Mort en été, roman qui conte l'histoire d'une femme désespérée après la noyade accidentelle de ses deux enfants. Se profile à nouveau l'étude d'une âme en proie au chaos existentiel, qui lutte pour sa dignité dans le dépassement de ses sentiments. Définissant sa perception de la tragédie classique, Mishima écrit, toujours dans Le Soleil et l'Acier: «Selon ma définition de la tragédie, le pathos tragique naît lorsqu'une sensibilité parfaitement moyenne assume pour un temps une noblesse privilégiée qui tient les autres à distance, et non pas quand un type particulier de sensibilité émet des prétentions particulières (...). Pour que, parfois, un individu touche au divin, il faut dans des conditions normales, qu'il ne soit lui-même ni divin ni rien qui en approche. C'est seulement lorsque, à mon tour, je vis le ciel bleu, étrange et divin, uniquement perçu par ce type d'individu, qu'enfin j'eus confiance en l'universalité de ma propre sensibilité, que je pus étancher ma soif et que fut dissipée ma foi aveugle et maladive dans les mots. A cet instant, je participai à la tragédie de tout être».
La parution du Pavillon d'Or en 1956, qui confère définitivement à Mishima le rang d'écrivain à la renommée mondiale, entérine son rejet viscéral de la laideur physique et mentale, son mépris pour ce qu'incarne ici le personnage de Kashiwagi, être vil dont les pieds bots ne sont qu'extériorisation corporelle de sa bassesse intérieure, dans la formule toute kantienne «le beau est le symbole du bien moral»: «Il avait pour marque particulière deux pieds aussi bots que pieds peuvent l'être et une démarche extrêmement étudiée. Il avait toujours l'air de marcher dans la boue: lorsqu'une jambe parvenait, non sans peine, à s'extraire, l'autre au contraire paraissait s'engluer. En même temps, tout son corps s'agitait avec véhémence; sa démarche était une espèce de danse extraordinaire, aussi peu banale que possible». Autre approche de la mort avec Le Marin Rejeté par la Mer (1963), qui voit une bande d'adolescents nihilistes combattant leur sensibilité s'essayer à l'exercice macabre de la mise à mort de Ryuji, l'officier de marine marchande, amant de la mère de Noboru, membre du groupe, par l'ignoble sacrifice longuement détaillé par l'auteur d'un innocent chaton abandonné.
A cette époque Mishima a déjà pris conscience, au cours des évènements de 1960, de son intérêt pour la politique. Les émeutes qui émaillèrent le renouvellement de l'ANPO (traité de sécurité américano-japonais), humiliante charte imposée par Mac Arthur en 1945, agirent sur Mishima comme le révélateur d'un engagement à venir. C'est alors qu'il découvre la richesse de la tradition militariste nippone. A l'automne 1960, il termine la nouvelle Yûkoku (Patriotisme, aujourd'hui insérée dans le volume La Mort en été) qui traite à travers l'histoire d'un jeune officier, le lieutenant Takeyama Shinji, de l'affaire Ni Ni Roku, putsch entrepris le 26 février 1936 par la société secrète impérialiste Kodo-Ha. Tiraillé entre sa fidélité pour l'Empereur et celle pour la Kodo-Ha, Takeyama préfère se suicider en compagnie de son amie Reiko, shinju fort idéalisé et accompagné d'un véritable luxe de détails: «Il est difficile d'imaginer spectacle plus héroïque que le sursaut du lieutenant qui brusquement rassembla ses forces et releva la tête (...). Il y avait du sang partout. Le lieutenant baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé et sans force, une main sur le sol. Une odeur âcre emplissait la pièce. Le lieutenant, tête ballante, hoquetait sans fin et chaque hoquet ébranlait ses épaules. Il tenait toujours dans sa main droite la lame de son sabre, que repoussaient les intestins et dont on voyait la pointe».
A deux reprises, Mishima reprend ce thème, dans la pièce Toka no Kiku puis dans l'essai Eirei No Koe (La Voix des Morts héroïques, parue en 1966). De Patriotisme, il dira: «Ce n'est ni une comédie, ni une tragédie, mais simplement l'histoire d'un bonheur... Le douloureux suicide du soldat équivaut à une mort honorable sur le champ de bataille». De cette nouvelle devait être tiré un film éponyme en 1965, où Takeyama sera joué par... Mishima lui-même. On se souvient de la honte qui l'étouffa sa vie durant d'avoir triché au conseil de révision en 1945, alors que le Japon mobilisait ses dernières forces pour repousser l'hydre américaine. Dix ans après ce film, Mishima se rejouait la même scène, sans caméra cette fois.
Mais si Mishima manifeste un réel intérêt pour la politique, il reste un parfait apoliteia, seulement préoccupé par la figure de l'Empereur, à qui il reproche d'avoir trahi et sa charge divine et son peuple, sacrifié en son nom propre pendant huit ans de guerre. «Pourquoi fallait-il qu'il devienne un être humain...», écrira-t-il. La lecture de son roman Après le Banquet (1960) prouve quant à elle le profond mépris que ressentait Mishima pour la classe politique en général et le rôle prégnant qu'y tient l'argent. Le ridicule dont il affuble des personnages à l'identité réelle à peine voilée que manipule allègrement une sombre prostituée ne manqua pas de lui causer des déboires avec les milieux politiciens et certains groupes extrémistes.
Il s'initie aux règles du Bushido ainsi qu'aux arts martiaux (Kendo et Karaté), réédite le premier en 1967 le bréviaire du Samurai condamné par l'occupant en 1945, le Hagakuré, du guerrier Yamamoto Jocho (XVIIIième siècle), qu'il adapte aux conditions du XXième siècle et sous-titre Le Japon Moderne et l'Ethique Samourai: il en retient particulièrement quelques idées-clés, la soumission à son destin et à la mort, au relent fortement teinté de stoïcisme: «La mort recèle toujours un combat obscur entre la liberté de l'homme et un destin qui le dépasse». En introduction, il note: «Un homme d'action est destiné à subir une longue période de tension et de concentration jusqu'au dernier instant où il achève sa vie par son acte final: la mort —soit par causes naturelles, soit par seppuku» Si la mort l'obsède depuis son enfance, sa propre mort lui devient dès à présent prépondérante. «Aux abords de la quarantaine, l'âge commence à tracasser Mishima» remarque Scott-Stokes dans sa biographie. Toujours en excellente condition physique, ses muscles se font maintenant moins proéminents, ses contractions moins impressionnantes. Comment un homme si pétri d'esthétique classique pourrait s'en contenter, lui qui écrivait, toujours dans Le Soleil et l'Acier, qu'à un muscle dur correspond la force de caractère et «la sentimentalité à un ventre flasque».
Impossible d'accepter l'inéluctable décrépitude de l'âge, lui qui sait que la grande idée de l'art classique se trouve dans la commémoration dans le marbre de l'instant parfait où s'affirme la beauté ultime, l'extrême moment qui précède le déclin et derrière lui, la mort. C'est désormais à elle qu'il consacrera ses dernières années. Dans l'ouvrage Shobu No Kokoro (L'Ame des Guerriers), reprise d'un dialogue avec Murakami Ichiro, paru après son décès, il confie: «On doit assurer la responsabilité de ses paroles, une fois qu'on les a prononcées. Il en va de même du mot écrit. Si l'on écrit: Je mourrai en novembre, alors on doit mourir. Si l'on fait une fois bon marché des mots, on continuera de le faire». Sa tétralogie achevée, La Mer de la Fertilité, certainement le sommet de son écriture, et interrogation sur la réincarnation où s'exprime un bouddhisme plus universitaire que mystique, Mishima Yukio pourra se considérer enfin au bord de la falaise et rejoindre le héros qu'il vénère le plus, lui-même. «Le suicide est quelque chose qui s'organise dans le silence du cœur, comme une œuvre d'art» disait Albert Camus. Alors que persomne ne voulait voir en Mishima la réunion de la plume et de l'épée, il décidait de mourir fièrement, puisqu'il ne lui était plus permis de vivre avec fierté.
Dans son excellente biographie, Mishima ou la vision du vide, Marguerite Yourcenar devait écrire: «Il y a deux sortes d'êtres humains: ceux qui écartent la mort de leur pensée pour mieux et plus librement vivre, et ceux qui, au contraire, se sentent d'autant plus sagement et fortement exister qu'ils la guettent dans chacun des signaux qu'elle leur fait à travers les sensations de leur corps ou les hasards du monde extérieur. Ces deux sortes d'esprit ne s'amalgament pas. Ce que les uns appellent une manie morbide est pour les autres une héroïque discipline». Mishima aura vécu en artiste tragique, acceptant posément de se retirer en «joyeux pessimiste». Dyonisien aurait sans doute conclu Nietzsche.
*
Quand du haut du balcon du GQG des Jieitaï, ce 25 novembre fatidique de 1970, Mishima, revêtu de son uniforme moutarde, le front masqué par son hachi-maki, le poing tendu vers la foule qui le conspue, s'écrie «Au nom du passé, à bas l'avenir!», c'est d'abord et surtout à lui-même qu'il s'adresse, lui, subtile réunion d'irrationalisme nippon et d'universalisme européen, ayant décidé d'en finir avec une vie qui ne peut plus répondre à son idéal de beauté physique, de grandeur virile, de pureté olympienne. Sa résolution est prise, recouvrer sa liberté dans l'extase finale de la mortification purificatrice, à l'image de ce Saint Sébastien agonisant peint par Gueno Reni qu'il ne cessera jamais de révérer dans son martyre, allant jusqu'à l'imiter pour le photographe Shinoyama Kishi. Deux mois avant son seppuku, il posait encore pour un recueil de photos jamais publié et intitulé Otoko no Shi (La Mort d'un Homme). Sur certaines on le voit couvert de sang, sur d'autres mimant son seppuku. «Qu'est-ce que l'éternité», s'interrogeait Pierre Drieu la Rochelle. «Une minute excessivement intense». De son amour pour Saint Sébastien devait découler sa passion pour Gabriele d'Annunzio, dont il traduisit Le Martyre de Saint Sébastien et comme lui s'écriant: «J'ai tout risqué, j'ai tout donne, j'ai vaincu», il put lancer fièrement à la face de ce monde vieillot et assoupi, dernier acte d'insoumission à la fatalité, cet épitaphe: «La mort violente est l'ultime beauté, toujours, et surtout quand on est jeune».
Laurent SCHANG,
le 27 juin 1997.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres japonaises, littérature japonaise, japon, asie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ploutocratie : le couple Obama a déclaré deux millions d’euros de revenus en 2008
 20/04/2009 –19h00
20/04/2009 –19h00
WASHINGTON (NOVOpress) – Selon un communiqué de la Maison Blanche de la semaine dernière, le président américain et son épouse ont gagné 2,65 millions de dollars en 2008 soit environ deux millions d’euros.
L’essentiel de cette somme est dû aux droits d’auteur que le messie métis de l’Amérique perçoit pour ses livres Les Rêves de Mon Père et L’Audace d’Espérer. Le premier est resté 142 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times et le second, 67 semaines. Les droits d’auteur du nouveau Président américain se sont élevés à 2,5 millions de dollars (soit un peu moins de deux millions d’euros) en 2008 comme en 2007. En tant que sénateur de l’Illinois, Barack Obama a également touché une indemnité parlementaire de139 204 dollars (soit 105 454 euros).
Michelle Obama, Avocate de profession, a perçu pour sa part 62 709 dollars (47 492 euros) de salaire des hôpitaux de l’Université de Chicago, dont elle était l’une des directrices à mi-temps avant de devenir la première dame des Etats-Unis.
A titre de comparaison, le revenu médian des ménages américains - qui partage exactement en deux la population, une moitié disposant d’un revenu supérieur, l’autre moitié d’un revenu inférieur à celui-ci - est d’environ 38 000 euros par an. Obama s’était présenté durant la campagne comme le candidat des minorités ethniques, des pauvres et du changement. A l’instar de ses prédécesseurs, le nouveau président américain reste avant tout celui de l’argent.
[cc] Novopress.info, 2009, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine
[http://fr.novopress.info]
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : obama, etats-unis, amérique, ploutocratie, argent, crise, élections américaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Paul-François Paoli , Le Figaro, 29 janvier 2009
00:20 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, afrique, aficanisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
 Ex : Nieuwsbrief Deltastichting nr. 24 – April 2009
Ex : Nieuwsbrief Deltastichting nr. 24 – April 2009
De heidenen in de Lage Landen
Neen, dit is géén boek over heidense spiritualiteit of heidense religiositeit in 2009 in de Lage Landen. Ugo Janssens vertelt in dit boek wél de geschiedenis van het heidendom – in al zijn aspecten – in de Lage Landen. Van de oertijd (voor zover men al iets kan zeggen, natuurlijk) tot het christendom: het heidendom in de symboliek, in de riten, in de tempelbouw en in de verschillende momenten van het menselijk leven.
Alles startte met de jagers en de verzamelaars, die op het einde van de middensteentijd (van 11.500 tot 5.800 v.o.j.) overschakelden van de jacht naar een meer sedentair bestaan. Maar in de eerste hoofdstukken heeft auteur Janssens het eerst nog uitgebreid over die andere species, de Heidelbergmens, die nogal zwaar leken op de neanderthalmens (die van 800.000 tot 150.000 jaar geleden leefden). Europa werd immers minstens 500.000 jaar geleden al bewoond, zoveel is wel duidelijk geworden uit allerlei vondsten (bijvoorbeeld gevonden in Spanje). Deze soort en de neanderthalmens hadden een zeer sociaal gedrag, zij verzorgden hun zieken en gehandicapten, ze geloofden in een leven na de dood, en begroeven hun doden met allerlei riten en grafgiften.
Dan kwam inderdaad de ‘homo sapiens’, en het oudste Europees exemplaar werd in de Roemeense stad Pestera gevonden: zo’n 35.000 jaar oud. Net als bij vele andere natuurvolkeren in de wereld werden ook bij die eerste ‘homines’ sporen van sjamanisme ontdekt. In Europa doken bijvoorbeeld rots- en grotheiligdommen op. De mensen geloofden in reïncarnatie, en dus in het behoud van delen van het lichaam. Allerlei delen van het dode lichaam werden daarom bewaard: botten, huiden, schedels.
Voor de wetenschappers is de overgang van de oude naar de nieuwe steentijd (van 11.500 tot 7.800 v.o.j.) een duistere, geheimzinnige tijd. Zovele vragen blijven onopgelost. Zo bijvoorbeeld de vraag of de (vrij) plotse overgang veroorzaakt werd door wereldwijde overstromingen? Men heeft er het raden naar. De Vlaams-Nederlandse kustlijn bijvoorbeeld zou rond 6.000 jaar voor onze jaartelling gevormd zijn. En in Denemarken werd een vrij grote grafplaats gevonden, waarin heel wat mannen en vrouwen begraven waren. In ons land moesten wetenschappers genoegen nemen met artefacten. In de religieuze beleving was de vrouw – de Moeder – het middelpunt. De befaamde wetenschapster Marija Gimbutas heeft haar sporen verdiend in het (letterlijk soms) opspitten van deze ‘duistere’ prehistorie.
De overgang van jagers naar sedentaire gemeenschappen leidde tot een verruwing van de maatschappij, er ontstond wedijver, ambitie en agressie, en deze evolutie leidde uiteindelijk tot een degradatie van de vrouw tot slavin. Maar andere wetenschappers bijvoorbeeld denken dan weer dat allerlei patriarchaal gerichte ruitervolkeren vanuit Oost-Europa voor de grote omwenteling zorgden. Op vele plaatsen ontstond een soort mannelijke drievuldigheid, met als opperste god de Vader als hoogste leider.
Vele sacrale plaatsen uit het Neolithicum werden in Europa teruggevonden, ook in West-Europa. De oudste omwallingen zouden 4.400 tot 3.500 v.o.j. zijn opgericht. Vlaanderen, Nederland en Duitsland werden grotendeel agrarisch, onder de zogenaamde bandkeramiekers.
Ook over de stenen kolossen, dolmens, menhirs, en andere monumenten, die op het einde van het Neolithicum werden opgericht, blijven de grootste twijfels bestaan, en de auteur Ugo Janssens maakt er een erezaak van om alle mogelijke stellingen mooi op een rijtje te zetten (met weeral de naam Gimbutas prominent vernoemd). Voor wie er nog zou aan twijfelen: Stonehenge ontstond niet in dit Neolithicum, maar werd pas veel later opgericht, tijdens de bronstijd).
De zonnegod werd geboren en zou de Grote Moeder steeds vaker vervangen. De winterzonnewende werd ook steeds vaker als het begin van het jaar beschouwd. Zonnesymbolen verschenen op de rotswanden – ook het complex van Wéris in de Waalse Ardennen moet in dit tijdsgewricht worden gesitueerd. Grafheuvels werden opgericht als magisch en religieus cultusoord (er zijn er honderden van bekend in België en Nederland). De auteur gaat uitgebreid in hoe er werd begraven en wat de mogelijke verklaringen zouden kunnen zijn.
Tussen 5.000 en 3.000 voor onze jaartelling waaierden de Indo-Europeanen vanuit Azië uit over Europa – de kopertijd en de bronstijd braken aan. Men schakelde over van inhumatie naar crematie, alhoewel, zegt Ugo Janssens, de vraag waarom dit gebeurde, ook nu nog niet kan worden beantwoord. Er zijn gissingen, er zijn veronderstellingen, maar zekerheid hebben we niet. De eerste urnenvelden in de Lage Landen duiken op rond 1.100 voor onze jaartelling. Ook mensenoffers behoorden tot de religieuze tradities in die periode, en voor de eerste keer in dit boek duikt de naam over de Germaanse oppergod, Wodan, en van allerlei Keltische goden. Ook de zonnewagen kwam steeds vaker voor.
In onze contreien doken de eerste Keltische migranten wellicht op tussen 1.400 en 1.100 voor onze jaartelling, en dan vooral als een elite die de autochtone bevolking ging overheersen. De Keltische cultuur was het resultaat van een economisch en militair overwicht – de Hallstattcultuur (Oostenrijk). Germanen kunnen trouwens niet los worden gezien van Kelten, het waren in oorsprong ook Kelten, maar vermengden zich gaandeweg met Baltische stammen en met allerlei niet Indo-Europese gemeenschappen.
De Kelten geloofden in reïncarnatie, en geloofden daarenboven dat de verblijfplaats aan de overzijde van korte duur was. Hun riten waren er steeds op gericht de goden gunstig te stemmen, de natuur met andere woorden gunstig te stemmen. Tempels, ook openluchttempels (vooral van de Kelten in onze gebieden) werden opgericht ter ere van de goden. De goden werden niet in menselijke vorm afgebeeld – althans niet zolang de Romeinen nog niet in onze streken waren gelegerd). In Vlaanderen, aldus Janssens, zijn vele Keltische tempels gevonden, de grootste daarvan in Kontich.
Germanen en Kelten cultureel van elkaar onderscheiden, is eigenlijk onmogelijk. Maar de goden van de Germanen kon je wel onderscheiden van de Keltische, want naast de verpersoonlijking van de natuurelementen waren de Germaanse goden ook de goddelijke vertegenwoordigers van de verschillende sociomaatschappelijke lagen van de samenleving. En in tegenstelling tot de Keltische priesters waren de Germaanse niet georganiseerd.
Ugo Janssens gaat in op de verschillende scheppingsverhalen, het pantheon van de verschillende goden, en de rites bij overlijden en geboorte bij de componenten van de samenleving in de Lage Landen na de komst van de Romeinen: de (Gallo-)Romeinen, de Germanen en de Kelten.
Tenslotte, om dit boek over heidenen in de Lage Landen volledig te maken, is er een hoofdstukje over de Oosterse goden in onze gewesten. Met komst van de Romeinse soldaten en een Romeins toplaagje kwamen ook allerlei goden in Vlaanderen en Nederland: Isis, Serapis, Cybele, en Mythras. Met deze laatste werd de akker trouwens al aardig beploegd voor de (voorlopig) jongste goddelijke komst in onze landen: het monotheïsme, in de vorm van het christendom.
Een zeer interessante uitgave. Veel informatie. Maar ook vele onopgeloste vragen.
Titel: De heidenen: Riten, culten en religie in de Lage Landen. Van de oertijd tot het christendom
Auteur: Ugo Janssens
ISBN : 978-90-209-8321-0
Verkoopprijs : 19,95 EUR (richtprijs)
NUR-code : 683 Oudheid (tot 500)
Afwerking : Paperback
Aantal pagina's : 304
Uitgave : Uitgeverij Lannoo
(Peter Logghe)
00:15 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : préhistoire, archéologie, proto-histoire, tradition, traditionalisme, paganisme, celtisme, celtitude, celtes, germains, germanité, antiquité, nouvelles religiosités |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
L'éveil du traditionalisme en Allemagne
Le terme “traditionalisme” n'a pas de définition précise en langue allemande. Il peut s'appliquer au catholicisme pré-conciliaire ou, plus généralement, à des personnes ou à des mouvements qui persistent à défendre le point de vue d'une tradition qui leur a été léguée. Dans les pays de langues romanes, le “traditionalisme” est quelque chose de plus précis: les vocables “traditionnel” ou “traditionalisme” y détiennent un sens particulier, surtout lorsqu'ils se réfèrent au groupe des écrivains ou des philosophes de la religion qui entendent demeurer fidèles au “traditionalisme intégral”, c'est-à-dire à “un héritage non humain”, déterminé par un “absolu d'origine divine”. Ces formules, nous les devons à l'Italien Julius Evola qui, à côté du Français René Guénon, est l'une des principales figures de proue du Traditionalisme.
Depuis quelque temps, des ouvrages importants d'Evola ont été traduits en allemand, comme Revolte gegen die moderne Welt (chez Arun à Engerda), Das Mysterium des Grals (chez AAGW à Sinzheim) et Menschen inmitten der Ruinen (chez Hohenrain à Tübingen). Ces ouvrages abordent principalement la “théologie politique” d'Evola et moins l'autre aspect majeur de sa pensée, les doctrines ésotériques. Toutefois, en 1989 déjà, le livre Hermetische Tradition était paru chez Ansata à Interlaken et, dix ans auparavant, chez le même éditeur, Magie als Wissenschaft vom Ich, un livre qu'Evola avait cosigné avec le “Groupe d'Ur”. Ce recueil important ne nous livrait finalement qu'une esquisse; il vient toutefois d'être complété de son deuxième volume (Schritte zur Initiation, chez Scherz, une maison d'édition très importante, établie simultanément à Berne, Munich et Vienne). Ce nouveau volume compte près de 500 pages et contient, outre des écrits d'ordre hermétique dans une traduction nouvelle, de nombreux articles qui traitent pour l'essentiel de diverses questions de “pratique magnétique”, dans une acception assez inhabituelle du terme.
Si l'œuvre d'Evola se limite encore essentiellement à l'Italie et à la France, si, jusqu'ici, elle n'a soulevé que peu d'intérêt en Allemagne (à l'exception notoire de Hermann Hesse, Gottfried Benn, Edgar J. Jung et Ernst Jünger, plus récemment de Botho Strauss), les études traditionnelles font désormais lentement leur chemin en Allemagne. La preuve: la parution récente d'une nouvelle revue, Gnostika (c/o AAGW, Lothar-von-Kübel-Straße 1, D-76.547 Sinzheim; cette publication paraît quatre fois par an; l'abonnement coûte 40 DM). Le premier numéro est paru à l'automne dernier. Jusqu'ici trois livraisons ont été envoyées aux abonnés. L'éditeur est l'AAGW ou Archiv für Altes und Geheimes Wissen (= Archives pour le Savoir Ancien et Occulte). Cet éditeur offre également une édition bibliophilique du livre d'Evola Mysterium des Grals. Nous avons affaire ici à un organe très différent de toutes ces publications sans relief émanant de la sphère “New Age”: le niveau intellectuel en est très élevé, les auteurs traitent des matières ésotériques avec une grande compétence. Beaucoup de contributions de Gnostika n'éveilleront que l'attention des spécialistes, mais la présentation succincte de l'histoire de l'hermétisme, des travaux de Nicholas Goodrick-Clarke sur les rapports entre Rosicruciens et philosophie des Lumières, de même qu'un essai du Dr. H. Th. Hakl, publié en plusieurs parties, sur le national-socialisme et l'occultisme méritent d'être connus d'un public plus large.
Si en général l'on désigne aujourd'hui le traditionalisme comme un phénomène propre aux pays de langues romanes, il convient, me semble-t-il, de faire quelques exceptions. Surtout si l'on se souvient du poète et penseur religieux Leopold Ziegler. Après avoir connu une gloire beaucoup trop brève dans les années 20, cet Allemand a sombré dans l'oubli. Mais on vient de le réhabiliter. Une revue qui a l'habitude de nous surprendre, Tumult/Schriften zur Verkehrswissenschaft vient de consacrer son n°23 à Ziegler (Verlag Turia und Kant, Weinberggasse 17, A-1190 Wien; cette revue paraît deux fois par an; abonnement: 32 DM; prix au numéro: 26 DM; le n°16 avait été consacré à Ernst Kantorowicz; le n°18 à Georges Dumézil). Le n°23, consacré à Ziegler, présente cinq essais de cet auteur, dont le livre Überlieferung (= Tradition), paru en 1936, a joué un rôle essentiel et constitue très certainement la profession de foi traditionnelle la plus solide en Allemagne. Ziegler se réfère aux conceptions de Guénon, qu'il complète de ses propres réflexions, mûries au départ d'un livre de 1922, Gestaltwandel der Götter. Rappelons la phrase récente de Botho Strauss: “Eh oui, Leopold Ziegler fait bien partie de cette liste d'auteurs qu'il faut absolument redécouvrir”. Cette nécessité ne doit pas valoir pour Ziegler seul, elle doit s'étendre à tous les traditionalistes, qui représentent une branche injustement oubliée de la pensée européenne.
Karlheinz WEISSMANN.
(article paru dans Criticón, n°154/1997; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, evola, traditionalisme, allemagne, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Annonce de la prochaine conférence de Robert Steuckers sur l'"Eurasisme"
L'eurasisme? Nouvelle mouture du soviétisme ou innovation fondamentale qui reprend les règles du "Grand Jeu" qui avait opposé, au temps de Rudyard Kipling, la Russie des Tsars à l'Angleterre de la Reine Victoria, Impératrice des Indes?
Pour comprendre la dynamique pluriséculaire de la masse continentale eurasienne et de son centre géographique, fait de steppes semi-désertiques, entre l'Altai et la Volga, il faut remonter à la proto-histoire, quand les peuples cavaliers proto-iraniens se sont rendus maîtres de cet espace pour le céder, au fil de l'histoire, à leurs homologues huns, turcs et mongols, avant que les cosaques d'Ivan le Terrible et ses successeurs ne reprennent l'offensive.
Le géopolitologue britannique Halford John Mackinder disait: "Qui détient la Terre du Milieu (sibérienne), tient l'Ile du Monde et est donc maître de la planète". Or le pouvoir hégémonique des Britanniques hier et des Américains aujourd'hui ne vient pas de la maîtrise de ce vaste espace continental mais de celle de l'Océan Indien, Océan du Milieu, comme vient de l'expliquer dans les colonnes de "Foreign Affairs" l'essayiste américain Robert Kaplan.
L'histoire du monde serait-elle déterminée par la dialectique entre "Terre du Milieu" et de l'"Océan du Milieu"? N'est-ce pas la l'enjeu majeur des prochaines décennies du 21ème siècle? le nouveau "Grand Jeu" comme n'hésite pas à l'appeler Kaplan?
08:23 Publié dans Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : événement, eurasisme, eurasie, géopolitique, russie, empire britannique, proto-histoire, peuples cavaliers |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Rivarol, 17/4/2009 : "Sur son site où, sous le titre «Nouvelles concessions faites aux Turcs », il évoque l'ultimatum d'Obama sur l'adhésion d'Ankara à l'Union européenne, Jean-Gilles Malliarakis « approuve le président français Nicolas Sàrkozy d'avoir rejeté clairement, publiquement et immédiatement, dans deux interventions télévisées à Prague d'abord, puis sur TF1, le principe même d'une telle déclaration nord-américaine ».
Mais il ajoute : « On regrettera d'autant plus une autre concession faite de manière juridiquement souveraine par Paris et sans aucune relation avec la négociation du 4 avril ». Et "Mallia" d'expliciter : « En marge de la réunion de l'OTAN à Strasbourg, notre ministre des Affaires étrangères Kouchner rencontrait dès le 2 avril son homologue turc M. Ali Babacan. Le contexte explique en partie l'information qui va suivre. À ce jour, je n'en ai pas encore retrouvée la trace via aucune source habituelle de l'information parisienne mais seulement sur l'excellent site anglophone du quotidien conservateur de Turquie Zaman Today. En effet jusqu'ici la France bloquait l'entrée de la gendarmerie turque dans la Force de gendarmerie européenne (Eurogendfor ou FGE) créée en septembre 2004 et dont le siège est à Vicenza où, dirigée par le colonel Giovanni Truglio depuis juin 2007, elle est l'hôte de l'arme prestigieuse des Carabinieri italiens. Kouchner, au nom de la France, vient de donner le feu vert à l'entrée des Turcs dans cette communauté. On peut comprendre que la gendarmerie d'Ankara, dont les exploits de Sisirlik restent présents dans toutes les mémoires, l'impliquant dans la protection des trafics de drogue, illustrée dans le complot d'Eigenekon via son ancien patron le général Sener Eryugur, participe aux opérations d'Afghanistan au titre de l'OTAN puisqu'elle appartient à cette alliance. On comprend moins bien qu'elle puisse y figurer au titre de l'Europe. »
00:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, europe, union européenne, sarkozy, méditerranée, otan, mer noire, gendarmerie, affaires européennes, asie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Retrouvez cette chronique sur www.philipperanda.com
MODERNES INQUISITEURS
Chronique hebdomadaire de Philippe Randa
Nous vivons décidément une période où l’historiquement, le religieusement, le politiquement ou le médicalement correct est de plus en plus oppressant. Il n’y a sans doute pas pire dictature que celle qui entend modifier insidieusement non seulement notre vie quotidienne, mais également notre passé.
La dernière dinguerie en date, on la trouve du côté de la RATP et de Métrobus, sa régie publicitaire. Au nom de la loi Evin – lutte contre le tabac et l’alcool – elle a trouvé tout naturel d’amputer le célèbre personnage de M. Hulot de sa pipe sur les affiches de l’exposition de la Cinémathèque.
À censure ridicule, riposte de même : la cinémathèque a décidé de fournir à la RATP des affiches où la pipe est remplacée par un grotesque moulin à vent jaune. Après la cigarette d’André Malraux gommée du timbre à son effigie, le mégot de Jean-Paul Sartre supprimé sur les affiches d’une exposition qui lui était consacrée ou encore Lucky Luke obligé de mâchonner un brin d’herbe dans ses premières aventures « revues et corrigées », les talibans du médicalement correct ont donc encore frappé.
On s’est longtemps gaussé des communistes qui, ne cessant d’épurer leurs rangs de toutes les vipères lubriques de la réaction qu’ils y découvraient sans cesse, les effaçaient les unes après les autres sur les photos de leur rassemblement. Ils n’étaient en fait que des précurseurs.
Quelles seront les prochaines cibles de nos modernes inquisiteurs ? Ne peut-on craindre qu’ils s’en prennent aux monuments aux Morts de nos communes : chaque soldat arbore fièrement en bandoulière un fusil Lebel… Exposer ainsi une arme leur paraîtra sûrement inadmissible. Chaque monument sera-t-il alors resculpté pour que les fusils soit remplacé par des yo-yos ?
Pourquoi pas ! C’est impensable, vraiment ? « Les cons ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît », disait Michel Audiard.
00:35 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politiquement correct, censure, médias, totalitarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
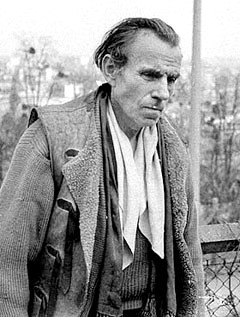
« Cette gaieté paradoxale et prodigieuse » [1957]
Nous avions exhumé l’article de Lucien Rebatet paru à la sortie de D’un château l’autre. Voici celui de Robert Poulet qui évoque, dans l’introduction, la polémique née au sein de la rédaction de l’hebdomadaire Rivarol.
Dans les circonstances difficiles, il vaut mieux être tout à fait clair et tout à fait franc. J’ai lu, comme tout le monde, l’interview que Louis-Ferdinand Céline a donnée à L’Express le mois dernier. J’y ai retrouvé, ni plus ni moins, le ton, l’humeur, les dispositions qui ont toujours distingué l’auteur du Voyage au bout de la nuit. Avec les mêmes facéties truculentes, les mêmes défis burlesques, la même affectation de platitude et de grossièreté, qu’il mettait déjà dans ses discours au temps glorieux de ses débuts, et qui comme alors enveloppent bel et bien une extraordinaire hardiesse de pensée et d’expression... En ayant l’air de se moquer de tout et de lui-même, Bardamu vient d’asséner à ses adversaires qui avaient pensé cette fois le prendre au piège, des vérités comme aucune oreille française n’en a encore entendu depuis dix ans. Et les artificieux propos de Mme Françoise Giroud ¹ ne parvenaient pas une seconde à couvrir cette voix qui porte, jusque dans le registre le plus contenu, quand Céline joue, avec des intonations redoutables, la scène de l’esclave rebelle et puni : du Plaute tranposé dans ce siècle sans élites ; un morceau plus que remarquable, et où l’on ne découvre, mon cher Pierre-Antoine Cousteau, pas un atome de reniement ².
À celui qui ne fut jamais d’aucun clan, et qui se définit justement par cette autonomie totale, qui va jusqu’à la manie, jusqu’à la furie, on ne saurait demander de respecter la « loi du clan » – à laquelle je ne crois pas, quant à moi. Je n’ai de considération que pour la probité individuelle, pour l’amitié, pour la solidarité du malheur, qui est une question de sentiment. Il ne me paraît pas du tout qu’en l’occurrence le persécuté Céline, le méconnu Céline ait enfreint ces règles de pure hygiène morale. Celles-ci ne sauraient exiger qu’un écrivain de vigoureux tempérament cesse de se manifester sous l’aspect qui répond en lui à des nécessités quasi constitutionnelles.
L’œuvre et l’outil
Depuis vingt-cinq ans tout juste, l’auteur de Normance a toujours réussi à conjuguer le profond sérieux, qui se dissimule dans son œuvre et dans sa vie, et qui s’y approfondit encore en pathétique, avec la nature orageuse et volcanique de son art ; et aussi avec l’impatience irritée, le besoin de scandale et de contradiction, qu’excite chez lui – c’est sa vocation particulière – la soif de vérité, de pureté, de justice. Dès le commencement, on a reconnu dans cet anarchiste aux visions obscènes, aux propos blasphématoires, un défenseur déçu et meurtri de la tradition. Cet iconoclaste garde en lui le regret des « bonnes façons de vivre ». Sa manière de servir le beau et le vrai, c’est de s’insurger aveuglément contre toutes les impostures qui en tiennent lieu, dans une société faussée à la base ; de s’insurger sans réserve, sans mesure, comme il convient à l’indignation et à la déréliction. Et, comme les choses qu’il faut bafouer ont pris l’aspect des usages et des lois, l’insurrection célinienne s’ouvre par une explosion de délire subversif.
Les révolutionnaires professionnels n’en sont pas encore revenus, d’avoir vu naguère cet isolé, ce vagabond de la pensée, battre une fois pour toutes les records de négation, de destruction, de malédiction qu’ils pensaient avoir établis depuis cent ans, et qui, par comparaison avec la terrible et naïve « table rase » où s’installe Bardamu, paraissent les fruits d’une timidité ridicule. Personne n’avait jamais poussé la dérision de tout aussi loin que le petit médecin de banlieue, mal embouché, sorti d’on ne sait quels remous coloniaux, maritimes, internationaux, populaires, et qui surgit un matin de 1931 sur la scène de Paris.
Dès ses premiers mots, il montra ce que peut être, réellement, un contempteur du monde moderne. Du coup on vit les mœurs, les usages, la sensibilité, le langage même, chanceler sur leurs bases. D’autant que le novateur s’était fabriqué l’outil qu’il fallait ; un style comme on n’en avait jamais vu nulle part, fait d’argot décanté, qu’entrecoupent des soupirs, des haussements d’épaules ; le mouvement d’un discoureur de bistrot qui crache de mépris entre deux onomatopées ou qui a des renvois de vin bourru ; rythme essentiellement vulgaire, qui soutient une émotion parfaitement indépendante, parfaitement aberrante, mais d’une secrète noblesse.
Le génie deux fois escamoté
Le miracle se reproduisit, en plus éclatant encore, avec Mort à crédit. Seulement, déjà la tourbe des imitateurs s’était jetée sur le pur produit du célinisme. Dès avant la guerre, les sous-Céline pullulaient ; et maintenant il en est qui n’ont jamais lu leur modèle, qui n’ont jamais entendu prononcer son nom, ayant trouvé leur provende chez des épigones et des caudataires qui l’avaient pesamment remâchée ; et prospérant en outre dans une atmosphère intellectuelle que régit la conspiration du silence, au détriment de « l’auteur le plus original qui soit apparu en Europe depuis un siècle » (dixit Middleton Murry) ³.
Que reprochent à Céline les critiques qui pendant deux lustres l’ont supprimé de l’histoire littéraire, exclu de la vie littéraire, jeté moralement dans des oubliettes aussi profondes que celles dans lesquelles le grand écrivain languit au Danemark, pour avoir « vendu les plans de la Ligne Maginot » (ô alliance de la méchanceté et de la sottise, dont Hamlet devait rire amèrement à Elseneur, distante d’une portée de mitraillette) ? Ils lui reprochent (au nom d’un principe né de la guerre) d’avoir écrit des pamphlets contre les Juifs avant la guerre.
L’extravagance furibarde de Bagatelles pour un massacre et des Beaux draps avait sa source – c’est visible pour qui étudie de sang-froid ces pages pleines de divagations, d’imprudences, de méprises monumentales, pêle-mêle avec quelques beautés sulfureuses – dans l’angoisse que la vue trop exacte des hécatombes imminentes, voulues par les uns, acceptées par les autres, inspirait à un homme dont la pensée première, la définition initiale est l’horreur des maux évitables, avec la rage de crier cette horreur, fût-ce dans la confusion extrême qui accompagne les grandes crises de prophétisme.
Quoi qu’il en soit, l’événement Céline, pour des motifs qui ne tenaient pas à la littérature, et même qui ne se rattachaient pas aux idées de résistance et de collaboration, étrangères à ce j’men-fichiste fabuleux, à ce parangon d’anarchie, disparut d’une époque qui, sans lui, se révélait inexplicable. La jeunesse française ignore le romancier contemporain dont l’attitude, l’esprit, le vocabulaire, répondent le mieux au chaos mental et moral dans lequel elle se complaît, se raccrochant à des interprètes beaucoup moins qualifiés, beaucoup moins expressifs – et surtout beaucoup moins libres.
Quelques petites choses
Aux hommes de lettres « engagés », auxquels la nouvelle génération a un moment prêté l’oreille, faute de mieux, la révélation célinienne oppose, au contraire, le spectacle d’une âme soucieuse de se dégager à fond, de se dégager de tout, pour avoir senti soudain que toutes les contraintes sociales, avec les doctrines et les institutions dont elles découlent, étaient en train d’appesantir sur l’Occidental du XXème siècle une énorme chape de mensonge, faits de la corruption et de la falsification du patrimoine humain. Procédant du même état d’âme, le Voyage fit le même bruit d’écroulement que le dernier effort de Samson. Si les jouisseurs du désordre, les adorateurs de l’absurde, étaient conséquents avec eux-mêmes, ils se tourneraient de ce côté, pour voir enfin sortir de la terre, au milieu des décombres que Louis-Ferdinand Céline remue avec de sanglants sarcasmes, la pousse verte du naturel, en attendant la fleur de la charité, que n’ont pas étouffée toute cette colère et toute cette haine.
S’il y a dans ce temps-ci un écrivain qui l’exprime en plein, et qui même anticipe sur le temps à venir, avec des mots que sans doute on ne comprendra tout à fait qu’au-delà des effondrements qui y conduisent, c’est bien celui-ci, dont pourtant la plupart de nos successeurs n’ont aucune idée par la faute des témoins prévenus et des serviteurs infidèles de la littérature.
Ils tablèrent d’abord sur l’absence du personnage, puis sur son affaiblissement. Depuis son retour en France, l’auteur de L’Église a publié trois livres, dont les deux premiers, malgré des passages étonnants, que lui seul pouvait écrire, avaient quelque chose de blessé, un souffle rauque de grabataire ; un creux s’ouvrait au cœur de cette élocution toujours abondante et puissante. Puis, il y eut les Entretiens avec le professeur Y, où s’étirait et se gonflait une pugnacité convalescente. Mais voici D’un château l’autre. Et nul ne peut nier que le grand Céline soit revenu.
C’est si vrai que les chevaliers de la distraction calculée, les spécialistes de la bouche en cul-de-poule et de la mine-de-rien ont compris qu’il fallait changer de tactique. Du moment qu’on renonçait à faire comme si l’homme et l’œuvre étaient morts ou mieux, n’avaient jamais existé, il n’y avait pas de moyen terme : il fallait se précipiter à leur rencontre. Ainsi s’explique le tumulte exceptionnel qui s’est élevé dans la presse depuis trois semaines. Tout d’un coup, le réprouvé, le maudit, l’intouchable, est devenu l’un des thèmes majeurs de la publicité journalistique, l’un des bouffons favoris que ses organisateurs proposent au public. Et ainsi, tout en jouant les Frontins et les Scapins, au commandement et conformément à sa pente, Céline a-t-il pu se débarrasser de deux ou trois petites choses qu’il avait sur le cœur...
Passons outre à ces numéros de cirque, mais d’un cirque sur lequel plane un drame. Et arrêtons-nous devant le livre qui a provoqué la rentrée du clown (voir les conséquences du fait dans un célèbre conte d’Edgar Poe 4 ).
On sait que les romans céliniens sont toujours tirés d’une réalité interprétée et transverbérée à laquelle s’applique le martèlement du verbe, dont les coups rapides et répétés finissent par forger une réalité seconde, chargée de poésie frénétique et sarcastique, avec une épouvante au bout. Cette fois, c’est sur ses souvenirs d’Allemagne – où il dut fuir en 1944, menacé de mort, sans nul motif – que l’auteur a travaillé. Il en résulte que, par exemple, on voit surgir à Sigmaringen une image du Maréchal Pétain, une image de Pierre Laval, et beaucoup d’autres images dont chacune a l’air d’être quelqu’un, de porter un nom. Purs cauchemars, où naturellement n’interviennent aucune des délicatesses ou des précautions que l’auteur a toujours instinctivement méprisées, à tort ou à raison, ne trouvant son maximum d’expressivité que dans l’irrespect intégral. Néanmoins, je défie bien les esprits les plus mal disposés de retirer d’un tel tableau une idée amoindrie des personnes qu’il met en scène.
Cela éclate surtout aux yeux de ceux qui prennent la peine de lire jusqu’au bout ces trois cent cinquante pages à la température d’ébullition. Il en sera récompensé par des plaisirs, par des surprises, dont les lecteurs des romans à la mode, si infirmes, si timorés sous leur masque de fausses audaces, ont perdu l’habitude. Il y a, notamment, une hallucination au bord de la Seine, qui rappelle dans le féerique et dans l’effrayant la fameuse « galère » du Voyage, et laisse loin derrière elle les plus échevelés pensums surréalistes. Il y a l’errance en chemin de fer. Il y a l’écriture, qui est encore plus divisée qu’avant ; ce n’est plus qu’un halètement musical, comme dans les premiers Stravinsky. Il y a cette gaieté paradoxale et prodigieuse, où entrent des éléments enfantins, des éléments jupitériens, à mi-chemin entre le petit garçon qui faisait des niches à ses copains en poussant dans Paris la voiture de sa mère dentellière, et le démiurge qui se moque de sa création au moment de la détruire.
En ce cas, le monde finirait par un cri de désespoir, qui ressemblerait furieusement à un cri de joie. C’est pourquoi l’on peut croire qu’au fin fond de la dissolution universelle à la Céline, il y a un noyau de santé. Puisse-t-il en tirer tout le suc, le cher homme !
En attendant, voici son bouquin. Le troisième de sa main qui ait chance de défier les siècles. Citez-moi seulement une dizaine de contemporains, dans les trois générations, qui puissent en dire autant !
Robert POULET
(Rivarol, 4 juillet 1957)
Notes
1. C’est François Giroud qui avait rédigé le chapeau rédactionnel de cette interview paru dans L’Express (14 juin 1957) sous le titre « Voyage au bout de la haine ».
2. Poulet répond ici à l’article de P.-A. Cousteau paru dans Lectures françaises (juillet-août 1957) sous le titre « Fantôme à vendre ».
3. John Middleton Murry (1889-1957), critique littéraire anglais, époux de Katherine Mansfield.
4. « La Barrique d’amontillado », avec son personnage tragique de Fortunato.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, belgique, lettres belges, littérature belge |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
L'OTAN et la Russie: entretien avec Nicolaï Sergueï Babourine, vice-président de la Douma
La visite récente qu'a apportée à Moscou Madeleine Albright, secrétaire des affaires étrangères des Etats-Unis, avait pour but de faire fléchir l'attitude négative des Russes face à l'extension vers l'Est de l'OTAN et à l'inclusion de la Pologne, de la Tchéquie et de la Hongrie dans le système de défense atlantique. La rencontre entre Madeleine Albright et les plus hauts dirigeants de la Russie n'a pas eu les résultats escomptés. (...). Fin janvier 1997, sous la direction du Vice-Président de la Douma, Sergueï Nicolaï Babourine, un nouveau groupe parlementaire voit le jour, le groupe “anti-OTAN”. Fin février, 110 parlementaires y adhéraient, principalement des députés de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite. Babourine, ancien recteur de la faculté de droit d'Omsk, la mégapole de Sibérie méridionale, est le plus farouche adversaire de l'élargissement de l'OTAN. Babourine a 38 ans, il est juriste et président de la “Fédération du Peuple Russe”, proche du PC de la Fédération de Russie. Il est un homme politique conservateur appartenant à la jeune génération. Il n'a pas été “mouillé” par le communisme, il a acquis sa maturité politique au début des années 90, après l'effondrement de l'Union Soviétique. «Babourine est l'un des rares, sinon le seul, parmi les hommes politiques nationalistes de gauche en Russie à manifester clairement son opposition à l'élargissement de l'OTAN à des pays ex-socialistes», nous a dit le chroniqueur parlementaire d'un journal moscovite à gros tirage.
Les adversaires de Babourine, les parlementaires qui ne partagent pas les mêmes opinions que lui dans la Douma, estiment qu'il est un homme politique clairvoyant. Plusieurs partis démocratiques cherchent à obtenir ses faveurs ou à l'attirer dans leurs rangs. Babourine est le plus jeune des hommes politiques russes à occuper d'aussi hautes fonctions, tout en étant membre d'une fraction parlementaire proche des communistes et dénommée “Le Pouvoir au Peuple” (Vlado VURUSIC, Zagreb).
VV: Quelle est la raison qui pousse la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie à adhérer à l'OTAN? Ces pays ont-ils peur de la Russie?
NSB: Je ne crois pas que les problèmes se trouvent dans les pays qui veulent adhérer à l'OTAN. A mon avis, il faut chercher la raison dans l'OTAN elle-même, qui, en principe, est un système de sécurité collective en Europe. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est conduit à une déstabilisation et contribuera à amener de nouveaux clivages et de nouvelles divisions en Europe. La question est la suivante: qui a besoin de ce système? De qui faut-il le protéger? De la Russie? Cela signifierait ipso facto que les relations entre l'Ouest et la Russie ne se sont pas modifiées d'un poil depuis la guerre froide? Absurde! Pour moi, la façon de procéder des pays membres de l'OTAN et des pays qui souhaitent y adhérer ou qui attendent d'en faire partie, est un acte de méfiance à l'égard de la Russie, quoi qu'ils veulent bien nous faire croire. Ce sentiment de méfiance est un danger pour la Russie.
VV: Pourquoi pensez-vous que l'OTAN est un danger pour la Russie? L'OTAN n'a-t-elle pas demandé à la Russie d'en faire partie elle aussi?
NSB: L'OTAN est un danger permanent pour notre sécurité. Elle possède un commandement unifié et constitue un système politique commun. Souvenons-nous des bombardements massifs subis par les Serbes en Bosnie et en Herzégovine. Qu'est-ce qui peut nous garantir qu'un jour nous ne subirons pas le même sort? Vous remarquez que l'OTAN a demandé à la Russie de faire partie de l'alliance, moi, je pense que cette proposition n'était pas honnête et sérieuse. Nous nous retrouverions dans une position subalterne, si nous demandions d'en faire partie, nous devrions faire la queue en attendant d'être acceptés et, finalement, nous risquerions d'être rejetés!
On nous dirait alors: “Les cartes d'entrée ont toutes été distribuées, vous avez attendu pour rien”. Pour nous, qui restons une grande puissance, ce serait une humiliation sans précédent. Ensuite, je me permettrais de vous rappeler qu'en son temps, l'URSS en la personne de Nikita Khrouchtchev, Secrétaire général du PCUS, avait demandé au Président américain Eisenhower notre adhésion à l'OTAN. Ils nous ont refusés. Après avoir rencontré des diplomates européens à Bruxelles et à Strasbourg ou en avoir reçus ici à Moscou, il me semble que les Européens conçoivent l'OTAN de la même façon que les Américains.
De toutes ces réunions, je suis revenu convaincu que les diplomates européens et américains conçoivent l'OTAN comme une forme de vie, comme un style de vie impassable. Cette façon de penser est profondément ancrée dans le subconscient de ces gens: il y a été enfoncé pendant toute la durée de la guerre froide. Ce subconscient, ils l'ont gardé jusqu'aujourd'hui, malgré le changement de donne. Pour eux, l'OTAN n'existe que contre la Russie. Or, s'ils voient les choses ainsi, il est tout naturel que nous, les Russes, nous nous montrions prudents. Pour ces diplomates, l'OTAN est l'élément principal dans l'architecture globale de la sécurité européenne.
C'est comme s'ils ne pouvaient pas comprendre que le Pacte de Varsovie n'existe plus, ce Pacte qui donnait a posteriori une raison d'être à l'OTAN. Ensuite, l'URSS, puissance nucléaire dont ils avaient peur, puissance qui était leur adversaire potentiel, n'existe plus non plus. Si l'on prend ces deux faits majeurs en considération, les efforts déployés par l'OTAN pour s'étendre vers l'Est menacent de fait la sécurité européenne dans son ensemble. Vu ainsi, cet élargissement en cours n'est pas seulement une reprise des hostilités à l'encontre de la Russie.
VV: Vous ne pensez donc pas que l'élargissement de l'OTAN soit une garantie pour la sécurité européenne, qu'elle soit une part du processus d'intégration qui anime l'Europe d'aujourd'hui et auquel la Russie est conviée?
NSB: Non. Pour moi, ce ne sont pas les garanties de sécurité qui constituent l'enjeu majeur; je crois qu'il s'agit en toute première instance de menacer la Russie. De plus, l'élargissement de l'OTAN vers l'Est pose problème pour l'avenir des accords et des traités signés jadis entre l'OTAN et la défunte URSS. De facto et de jure, ces accords et ces réglements, sur lesquels repose la sécurité européenne, ont été dénoncés unilatéralement par les membres européens et américains de l'OTAN.
En première instance, il s'agit des accords réglant la réduction des armes nucléaires. C'est justement l'OTAN, à ce niveau, qui menace la sécurité européenne dans ses fondements: même si l'OTAN n'acquiert qu'un seul nouveau membre, pour nous, cette situation crée une base juridique rendant caducs les accords du passé, par exemple ceux qui portent sur la limitation de l'emploi de missiles à courte et moyenne portée. C'est l'OTAN qui porte la responsabilité de la caducité de ces accords!
Car, enfin, osons poser la question: l'OTAN est-elle une alliance dirigée contre la Chine? Certes, les parties co-signatrices de ces accords devenus caducs par la volonté de l'OTAN, c'est-à-dire l'URSS et le Pacte de Varsovie, n'existent plus, mais il va tout de même de soi que c'est la Russie qui a hérité des obligations liées à ces accords.
Car on semble effectivement oublier que la Russie a repris à son compte les obligations liées à ces accords, signés par l'ex-URSS. Enfin, sur le plan juridique, si l'OTAN s'étend vers l'Est à des pays qui ont accepté eux aussi la teneur de ces accords au titre de membres du Pacte de Varsovie, alors la problématique peut être envisagée d'une toute autre façon. Quoi qu'il en soit, l'élargissement de l'OTAN vers l'Est constitue une entorse de taille aux accords passés qui avaient réglés les problèmes généraux de la sécurité européenne.
VV: Pourquoi affirmez-vous sans détours que l'OTAN menace la Russie?
NSB: La Russie et l'OTAN (du moins ses principaux membres) sont des puissances nucléaires. Ensuite, nous, les Russes, devons retirer tout notre potentiel nucléaire hors des pays qui faisaient jadis partie de l'URSS. Rien que la simple existence de l'OTAN est signe qu'il y a un ennemi, que cette alliance militaire existe contre quelqu'un. Si, finalement, la Russie vient à faire partie de l'OTAN, contre quel ennemi sera dirigée son adhésion? Sans doute contre notre plus gros voisin, la Chine, un pays de plus d'un milliard d'habitants? Ce pays considérera sans doute que notre adhésion à l'OTAN est un acte d'hostilité à son égard: avons-nous besoin de cela? Très logiquement, les Chinois se demanderaient si la Russie prépare la guerre contre eux. La Chine est un pays important, avec lequel nous entendons coopérer harmonieusement. Nous ne voulons pas le provoquer.
VV: La Russie prend-elle des mesures contre l'élargissement de l'OTAN vers l'Est?
NSB: Nous invitons toutes les forces de gauche en Europe à se mobiliser contre l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Nous avons déjà obtenu le soutien des représentants de la gauche dans le Conseil Européen. Ensuite, nous allons reprendre les meilleures relations possibles avec les pays non alignés.
L'OTAN est devenu une organisation qui n'a d'autre but que de se perpétuer. On peut se poser la question: l'OTAN existe-t-elle pour l'Europe, ou l'Europe existe-t-elle pour l'OTAN? Si les dirigeants européens l'avaient voulu, l'OTAN se serait auto-dissoute une semaine après l'auto-dissolution du Pacte de Varsovie voire même dès la dissolution de l'URSS. Dans les circonstances actuelles, je ne vois pas de raison objective pour que cette alliance atlantique se perpétue ou s'élargisse.
Je suis sûr que l'OTAN disparaîtra comme elle s'est jadis constituée. J'espère que dans quelques années, tout ce que je dis ici, ne sera plus qu'anecdotique, plus que matière pour les historiens et les chroniqueurs politiques et parlementaires.
VV: Mais pourquoi les Polonais, les Tchèques et les Hongrois veulent-ils intégrer l'OTAN?
Je vois et je comprends les motivations pour lesquelles des pays d'Europe orientale veulent adhérer à l'OTAN. Les Polonais et les Tchèques craignent surtout l'Allemagne réunifiée, ils craignent qu'elle ne réclame les territoires annexés en 1945. Si la Pologne et la Tchéquie deviennent membres de l'OTAN, elles obtiendront des garanties quant à leur sécurité mais aussi des garanties pour leurs frontières.
Lorsque l'on converse avec des hommes politiques est-européens, on perçoit chez eux une drôle de psychose, faite de tension et d'impatience. Ils parlent comme s'ils étaient agités par une fièvre et me disent: «Comprenez-vous? Tous autour de nous veulent entrer dans l'OTAN, alors pourquoi ne le ferions-nous pas?». J'interprète cela comme un phénomène psychologique, post-traumatique. Il y a quelques jours, j'étais en Bulgarie. Là-bas, les politiques m'ont dit souvent: «Pourquoi n'entrerions-nous pas dans l'OTAN, si tous les autres le font. Même si nous ne le souhaitons pas, nous devons y adhérer parce que tous nos voisins sont dans l'OTAN, nous ne pouvons pas rester en marge...».
VV: Manifestement, ni l'OTAN ni les pays est-européens ne sont en mesure de prendre leurs distances avec l'élargissement de l'alliance militaire atlantique...
NSB: Il faut que la Russie prenne des décisions claires, qui ne soient pas que paroles et qu'elle annonce aux Européens, qu'elle les convainc qu'un tel comportement induira des contre-mesures russes, par exemple, la reprise de la production de certains types d'armes, la remise en question de certains traités sur la réduction des armes nucléaires, de même que la reprise de tests ou l'adoption de nouveaux systèmes d'armes, ou encore la réactualisation de certains éléments de notre doctrine militaire, alors l'Ouest sera obligé de réfléchir... Justement, c'est dans le domaine de la doctrine militaire que je veux rester: une clause de cette doctrine est toujours théoriquement valable; elle dit que la Russie a le droit d'administrer la première frappe nucléaire. Le principe de la doctrine militaire soviétique, qui veut que la Russie garde pour elle le droit d'effectuer une première frappe, n'a pas été abandonné officiellement. La Russie peut donc conserver son droit de frapper la première.
Dès lors, la Russie a non seulement le droit de riposte mais aussi le droit d'initiative, si elle se sent menacée. Ce que pouvait la puissante URSS de jadis, la Russie affaiblie d'aujourd'hui le peut encore. Les dirigeants de l'OTAN devraient y penser. Ensuite, l'intégration de la Russie et de la Biélorussie progresse, bientôt ces deux pays seront à nouveau réunis. L'Occident doit aussi y réfléchir. La réunification russo-biélorusse sera un événement important, qui obligera l'OTAN à s'élargir encore davantage. De son côté, la Russie devra développer des processus d'intégration comparables avec les pays de l'ex-URSS. Ce sera sa réponse à l'OTAN et elle s'efforcera de créer en Europe un système efficace de sécurité collective, limité au territoire de l'ancienne URSS.
VV: Quelques pays de l'ancienne URSS se sont toutefois donné pour objectif de devenir eux aussi membres de l'OTAN...
NSB: Il n'en est pas question. Nous réclamerons le soutien du Conseil de l'Europe et nous ferons en sorte que l'Ukraine acquiert le statut d'un pays non aligné, qui, par sa propre volonté, renonce à l'arme nucléaire.
VV: Comment les futurs rapports entre la Russie et l'Europe évolueront-ils après l'adhésion des nouveaux membres de l'OTAN?
NSB: La Russie devra immédiatement réviser ses rapports avec les Etats qui viennent d'adhérer à l'OTAN et prendre toutes les mesures adéquates pour assurer la défense de ses frontières. On nous a dit assez souvent que la Fédération de Russie possédait une frontière commune avec la Pologne, en Prusse orientale. Nous allons devoir défendre nos frontières. L'élargissement de l'OTAN coûtera fort cher: aux nouveaux pays membres, à ceux qui les soutiennent et à la Russie. Toutes ces charges seront portées par nos contribuables. La Russie n'hésitera pas à défendre ses frontières: chaque région, chaque citoyen.
VV: Pouvez-vous nous dire quelles mesures la Russie compte-t-elle concrètement adopter après l'adhésion des nouveaux membres de l'OTAN?
NSB: La Russie prendre position face aux événements. Mais elle ne peut dévoiler ses cartes. Mais soyez-en sûrs, la Russie ne laissera pas l'élargissement de l'OTAN vers l'Est sans réponse.
(propos recueillis par Vlado Vurusic pour le journal Globus de Zagreb, le 28 février 1997. Trad. all.: Dr. Hrvoje Lorkovic; une version allemande écourtée est parue dans Junge Freiheit n°16/1997; trad. franç.: R. Steuckers).
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otan, atlantisme, russie, anti-atlantisme, défense, eurasie, eurasisme, europe, affaires européennes, asie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Nationalisme allemand 1850-1920
Le dernier numéro de la Revue d'Allemagne est consacré au «Nationalisme allemand 1850-1920». Dans sa contribution, L. Dupeux écrit à propos des deux conceptions —la "française et l'"allemande"— de la nation et du peuple: «...en fait, s'il est bien vrai que les deux conceptions-perceptions sont antagonistes, elles sont durcies et partiellement faussées dans le combat politique et idéologique. En premier lieu, il ne manque pas d'énoncés nuancés, surtout du côté français, mais ils sont souvent biaisés, voire tronqués, pour les besoins de la Cause. Ainsi de la fameuse définition avancée par Renan dans sa conférence en Sorbonne du 11 mars 1882: “Qu'est-ce qu'une Nation?”. L'auteur affirme, certes, et c'est resté célèbre, que l'existence d'une nation est “un plébiscite de tous les jours”; mais il fait aussi référence au passé, au “legs de souvenirs”, presque autant qu'au consentement actuel... En Allemagne, surtout après 1918 il est vrai, on verra des auteurs de premier rang comme Moeller van den Bruck, l'auteur du Droit des Peuples jeunes (1919), mais surtout du fameux Troisième Reich, évoquer la “volonté du peuple à devenir une nation”, solidaire face à l'Etranger, au “monde de Versailles”... Est-il par ailleurs nécessaire de rappeler que le nationalisme historisant existe aussi en France, surtout dans la nouvelle extrême-droite qui émerge après la crise boulangiste et celle de Panama, mais sans être absent au centre ni même toujours, quoi qu'on en dise (ou taise), à gauche? Qu'on songe au nationalisme barrésien, celui de “la terre et (des)morts”, ou au “nationalisme intégral” à références gréco-latines de Maurras; mais que l'on n'ignore pas par ailleurs le “patriotisme” et même le nationalisme “à la 93” —entre autres— qui parcourt même les rangs communistes à partir de 1935 — non plus que les appels du PCF au “front national”, à l'époque de la Résistance... En vérité, les deux nationalismes, français et allemand, ne font pas que s'opposer: ils se font écho, positif ou négatif, et quand ils sont de la même famille “sociétale”, ils s'empruntent jusqu'au va-et-vient: ainsi dans les années vingt de ce siècle pour l'ultranationalisme d'Ernst Jünger, qui n'est pas sans devoir à Barrès, étant clair que celui-ci doit pas mal à la pensée romantique allemande». Un intéressant numéro avec entre autres des contributions de C. Baechler («Le Reich allemand et les minorités nationales 1871-1918») et de J.-P. Bled («Les Allemands d'Autriche et la question nationale,1850-1918») (P. MONTHÉLIE).
La Revue d'Allemagne, Centre d'Etudes Germaniques, 8 rue des Ecrivains, F-67.081 Strasbourg Cedex . Abonnement annuel pour quatre numéros: 260 FF.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, livre, allemagne, nationalisme, histoire, histoire politique, idéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
La guerre, la violence et les gens au Moyen-âge
Le «Comité des Travaux Historiques et Scientifiques» édite en deux volumes les actes du 119ième Congrès des Sociétés Historiques et Scientifiques consacré en 1994 à «La Guerre, la violence et les gens au Moyen-Age». Le premier “apporte du nouveau sur le Languedoc au XIIIième siècle, sur les malheurs de la guerre en Italie, en Provence et en Normandie à la fin du Moyen Age, sur la mise en défense de plusieurs villes et territoires. Il s'intéresse à l'attitude des écrivains face à la guerre (Eustache Deschamps), traite des prisonniers et de leurs rançons, évoque le curieux recours au duel des princes, envisage enfin le thème de la paix. Ce panorama a le mérite, parmi d'autres, de reposer le plus souvent sur l'exploitation de sources inédites ou négligées. Le second volume “s'organise autour de trois grands thèmes. A propos des «Femmes en guerre», le rôle des régentes dans les royaumes de France et de Castille au XIIIième siècle est précisé, il est procédé à une réévaluation prudente de la personnalité d'Isabeau de Bavière et de sa mission pacificatrice, tandis qu'est mise en relief l'action des “viragos” dans l'Italie du Cinquecento. La section «Villes en guerre» fournit des exemples portant sur la fin du Moyen Age. On y trouve notamment un développement sur l'armement de la population “civile” à Troyes au temps de Louis XI. Quant à la dernière section, «Seigneuries et campagnes en guerre», elle traite aussi de la guerre de Cent ans: quelle fut l'attitude des populations normandes aussitôt après l'invasion de Henri V, de quelle manière les monastères réagirent-ils aux chevauchées et autres menaces, et surtout quelle place la guerre occupa-t-elle dans les violences de toutes sortes qui affectèrent Beauvais et le Bauvaisis lors de la domination anglaise» (Jean de BUSSAC).
La Guerre, la violence et les gens au Moyen Age, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (1 rue Descartes, F-75.005 Paris),1996, Tome I, Guerre et violence, 370 p., 190 FF. Tome II, La violence et les gens, 316 p.,190 FF.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, moyen âge, guerre, armées, militaria, violence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
“La gioventù francese che ieri viveva nelle tenebre, a cui mancava un ideale, che aveva perso la fede nei destini della patria, sarà abbagliata domani dal compito che l’attende: rifare l’Europa…” (1).
 Per la destra, per lo meno quella che non lo disprezza, Marc Augier detto Saint-Loup è il romanziere della civiltà minacciata e dell’Europa delle patrie carnali… Due temi che sono punto di riferimento dopo Solstice en Laponie, pubblicato nel 1939, dove l’autore espone già il suo timore per l’evangelizzazione e la colonizzazione delle popolazioni lapponi da parte dei mercanti della morale. Riflessione che prosegue sotto l’occupazione, soprattutto negli articoli sui Baschi ed i Bretoni dove Saint-Loup pone i primi fondamenti del “federalismo etnico” quale principio su cui vuole organizzare l’Europa (2). Sia detto tra parentesi, la difesa dei popoli minacciati non si limita nel suo spirito al solo territorio europeo giacché egli affermava nel 1941, in un articolo sull’avvenire dell’Impero francese: “Il nostro dovere in Africa è quello di ristabilire nel quadro storico e razziale una grande civilizzazione araba ed una grande civilizzazione nera (3)”.
Per la destra, per lo meno quella che non lo disprezza, Marc Augier detto Saint-Loup è il romanziere della civiltà minacciata e dell’Europa delle patrie carnali… Due temi che sono punto di riferimento dopo Solstice en Laponie, pubblicato nel 1939, dove l’autore espone già il suo timore per l’evangelizzazione e la colonizzazione delle popolazioni lapponi da parte dei mercanti della morale. Riflessione che prosegue sotto l’occupazione, soprattutto negli articoli sui Baschi ed i Bretoni dove Saint-Loup pone i primi fondamenti del “federalismo etnico” quale principio su cui vuole organizzare l’Europa (2). Sia detto tra parentesi, la difesa dei popoli minacciati non si limita nel suo spirito al solo territorio europeo giacché egli affermava nel 1941, in un articolo sull’avvenire dell’Impero francese: “Il nostro dovere in Africa è quello di ristabilire nel quadro storico e razziale una grande civilizzazione araba ed una grande civilizzazione nera (3)”.
Ed è sempre per l’Europa delle etnie che Saint-Loup ha seguito la fede gammata ed è andato a combattere sul Fronte dell’Est nel 1942. Egli era in effetti persuaso fin dal 1941 che la Germania preparasse una pace fondata su un federalismo etnico europeo. A questa convinzione si aggiunge ancora l’idea, diffusa precedentemente negli ambienti tedeschi rivoluzionari conservatori, che il futuro dell’Europa si trovi ad Est, in una Russia battuta dove si potranno attingere nuove forze: economiche, razziali, spirituali.
Dopo la sconfitta è difficile per molti comprendere come Saint-Loup abbia potuto interpretare – benché non sia stato il solo – il pangermanismo hitleriano come un tentativo di unione dell’Europa sulla base delle etnie che la compongono. Otto Strasser che manifestava negli anni trenta la medesima volontà, l’intenzione di riorganizzare l’Europa su basi etnico-linguistiche, entrerà presto in conflitto con i seguaci ortodossi di Hitler. Probabilmente questo atteggiamento era dovuto all’anticomunismo fanatico che Saint-Loup aveva sviluppato a causa del suo contatto con i militanti di sinistra nel periodo tra le due guerre mondiali (4). L’esperienza del fronte russo segna però un radicale cambiamento nell’atteggiamento di Marc Augier, che non si fa più illusioni sulle intenzioni tedesche. Questa tendenza è manifestata in alcuni articoli su “Combattant Européen” che oscillano tra la fedeltà completa ed una certa presa di distanza dalle posizioni ideologiche tedesche. Così scriveva a qualche mese di distanza “Hitler non è che un uomo (5)” mostrando così il suo rifiuto verso un’Europa a dominazione tedesca: “Non si tratta di fonderci in una specie di europeo. Non vogliamo essere germanofili o russofili. Vogliamo rimanere noi stessi, con la nostra eredità nazionale, pur adottando uno stile di vita moderno. E vogliamo arricchire questo stile con il genio francese che non è un mito (6)”.
La contraddizione apparente di questi due propositi deve essere compresa con lo iato tra un giuramento di fedeltà incondizionata e il pensiero proprio di Marc Augier. Questa confusione tra l’aspetto sentimentale e quello dottrinario che ha potuto, dopo il 1945, far passare Saint-Loup come un settario del Nazionalsocialismo proprio quando egli considerava lo stato nazione come un principio politico storicamente superato. Non è tuttavia errato osservare che questa contraddizione rimane in Saint-Loup per quelli che dopo la guerra hanno voluto far coincidere la sua esperienza nelle Waffen SS con la sua concezione del mondo. Nelle opere Götterdämmerung, Les Volontaires e Les Hérétiques, Saint-Loup, manifesta un viscerale attaccamento ai suoi camerati lasciando libero corso ai suoi fantasmi e concepisce l’esistenza di una frazione oppositrice federalista che avrebbe tentato di affermarsi all’interno del regime nazionalsocialista.
 Saint-Loup non ha mai deposto l’uniforme. Rifare l’Europa! Ma perché l’Europa delle etnie, delle patrie carnali? Perché nello spirito di Saint-Loup questa è la forma politica che più ha la forza di resistere alle ideologie massificanti - liberalismo, cristianesimo, comunismo - nascoste sotto la maschera dell’universalismo e dell’internazionalismo. Perché gli stati nazione hanno confini ideologici. Perché la patria carnale, terra dei padri, risponde ad una aspirazione di identità naturale. “L’Europa deve dunque essere riconsiderata a partire dalla nozione biologicamente fondata del sangue (…) e degli imperativi tellurici (…). Non può esistere che come somma di piccole patrie carnali nutrite di questa doppia forza. Infatti più lo spazio unificato si estende, più la realtà razziale si diluisce per mescolamento e più il territorio sfugge alla proprietà del singolo a profitto della massa (7)”. Saint-Loup fa della razza il motore della storia di un popolo e dell’ibridazione la principale minaccia che grava su una civiltà. Poiché l’omogeneità razziale è un elemento di stabilità.
Saint-Loup non ha mai deposto l’uniforme. Rifare l’Europa! Ma perché l’Europa delle etnie, delle patrie carnali? Perché nello spirito di Saint-Loup questa è la forma politica che più ha la forza di resistere alle ideologie massificanti - liberalismo, cristianesimo, comunismo - nascoste sotto la maschera dell’universalismo e dell’internazionalismo. Perché gli stati nazione hanno confini ideologici. Perché la patria carnale, terra dei padri, risponde ad una aspirazione di identità naturale. “L’Europa deve dunque essere riconsiderata a partire dalla nozione biologicamente fondata del sangue (…) e degli imperativi tellurici (…). Non può esistere che come somma di piccole patrie carnali nutrite di questa doppia forza. Infatti più lo spazio unificato si estende, più la realtà razziale si diluisce per mescolamento e più il territorio sfugge alla proprietà del singolo a profitto della massa (7)”. Saint-Loup fa della razza il motore della storia di un popolo e dell’ibridazione la principale minaccia che grava su una civiltà. Poiché l’omogeneità razziale è un elemento di stabilità.
La dottrina di Saint-Loup non si manifesta dunque sotto la forma di un nazionalismo aggressivo ma si avvicina maggiormente ad un differenzialismo etnico. In altre parole solo colui che ama e vuole difendere il suo popolo è capace di amare ed apprezzare i popoli stranieri. L’affermazione del diritto alla differenza si sostituisce all’imperialismo e Saint-Loup può stigmatizzare l’universalismo come ideologia razzista. E’ proprio quello che si vede in La Nuit commence au Cap Horn, eccellente libro con i caratteri dell’affresco epico: gli indiani della terra del fuoco sono vittime di un pericoloso progetto di un pastore evangelico pieno di buone intenzioni ma incapace di concepire un modo d’esistere diverso dal suo. Un popolo soccombe al colonialismo cristiano perché il cristianesimo è inadatto all’ambiente in cui questo popolo evolve. La morte di una civiltà attraverso l’arrivo di missionari, funzionari, commercianti. Questa tematica è anche quella di La peau de l’aurochs (8) pubblicato per la prima volta nel 1954 e finalmente ristampato. Anche in questo libro una civiltà è minacciata di scomparire; un’invasione dittatoriale, la conquista della meccanizzazione che si sostituisce poco a poco alla tradizione rurale e cattolica locale.
Nelle opere di Saint-Loup la patria carnale appare allo stesso tempo come un’alternativa politica, sociale e religiosa. Politica inizialmente, poiché rappresenta un rifugio contro l’imperialismo. Sociale in seguito, poiché mira a rafforzare il senso della comunità, che è istinto puramente etnico. Si basa su ciò che Saint-Loup chiama “socialismo dell’azione” che è destinato a diventare la pietra angolare della nuova Europa e che si definisce come un socialismo radicato, un atteggiamento del cuore, della volontà, di opposizione alla logica astratta del marxismo-leninismo. La patria carnale è infine un’alternativa religiosa che ci permette di ricollegarci alle nostre radici pagane. Ad una concezione eroica della vita che il giudeo-cristianesimo, religione salvifica, ha soffocato. La patria carnale deve concepirsi in un certo senso come un ritorno alle fonti spirituali e sensoriali dell’uomo. “Si tratta per l’individuo di attingere alle fonti di vita eroiche ed estetiche, di ricevere quindi l’insegnamento del combattimento naturale e di tutto ciò che implica: selezione delle aristocrazie con la lotta per la vita, nuova nozione del diritto che si stabilisce più con l’azione del forte e del migliore, infine ricerca ed applicazione della nozione estetica e della vera grandezza (9)”. Il federalismo etnico di Saint-Loup porta in realtà una nuova concezione della società. Un paganesimo eroico e popolare che rimanda ad un’immagine più accettabile della persona umana.
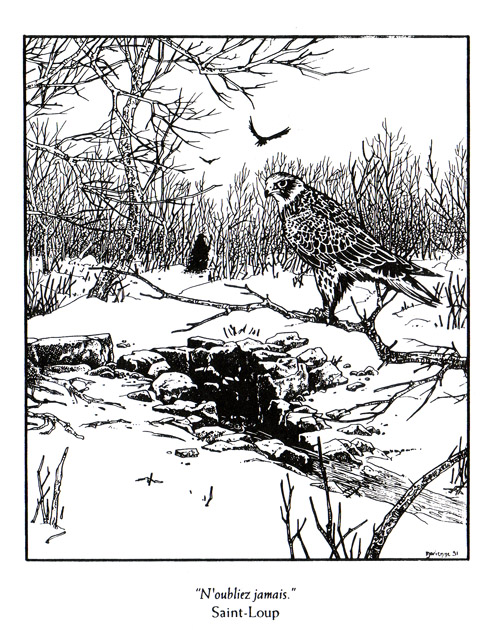 Nonostante le apparenti contraddizioni, l’itinerario politico di Saint-Loup obbedisce ad una logica perfettamente coerente, dove la volontà di affermarsi caccia le contrazioni ideologiche. Prende forma un mondo di grande salute fisica e morale dove tutti i popoli hanno il diritto di esistere, purché radicati nelle loro proprie culture. Nel tempo, Saint-Loup ha tessuto un opera sincera attraverso la quale si è espresso uno spirito libero, che ha pagato la sua libertà con la cospirazione del silenzio di cui si circonda il suo nome.
Nonostante le apparenti contraddizioni, l’itinerario politico di Saint-Loup obbedisce ad una logica perfettamente coerente, dove la volontà di affermarsi caccia le contrazioni ideologiche. Prende forma un mondo di grande salute fisica e morale dove tutti i popoli hanno il diritto di esistere, purché radicati nelle loro proprie culture. Nel tempo, Saint-Loup ha tessuto un opera sincera attraverso la quale si è espresso uno spirito libero, che ha pagato la sua libertà con la cospirazione del silenzio di cui si circonda il suo nome.
Note
1 Marc Augier, “Jeunesse d’Europe, unissez-vous!”, Conversazione del 17 maggio 1941 sotto gli auspici del Groupe Collaboration à la Maison de la Chimie - Paris.
2 Marc Augier, A la recherche des forces françaises, in La Gerbe, 4-9-1941 e 2-10-1941.
3 Marc Augier, La route de l’huile, in La Gerbe, 6-2-1941.
4 Occorre sempre avere lo spirito per comprendere l’itinerario politico di Saint-Loup, che ha fatto le sue prime esperienze politiche nell’ambito della sinistra “Fronte Popolare”. “Infatti Marc Augier fu uno dei principali animatori e ideologi del movimento Auberges de jeunesse (ostelli della gioventù, ajisme), fu redattore principale del periodico Cri des Auberges de Jeunesse (rivista del centro Laïc degli Auberges de Jeunesse), incaricato nel gabinetto di Léo Lagrange sotto governo del fronte popolare nel 1936 e vicino a Jean Giono, il suo riferimento ideale e maestro, con cui partecipò all’esperienza pacifista del Contadour. Per tutto questo periodo del dopo guerra, sono il pacifismo e volontà d’unire la gioventù europea che motivano il suo impegno. Rappresentante del CLAJ al Congresso Mondiale della gioventù che ebbe luogo negli Stati Uniti nel 1937, si rese tuttavia conto che i delegati comunisti si consegnavano ad una intensa propaganda bellicista contro la Germania e l’Italia. Da quella data manifesta i suoi primi sentimenti anticomunisti. Varie volte, dopo il 1941, Marc Augier considererà del resto la crociata europea contro il bolscevismo come il logico prolungamento della sua azione passata nell’ambito del movimento Ajiste.
5 Marc Augier, La fidélité des Nibelungen, in Le Combattant Européen, 30-9-1943.
6 Marc Augier, Ce siècle avait deux ans, in Le Combattant Européen, 15-6-1943.
7 Saint-Loup, Une Europe des patries charnelles?, in Défense de l’Occident, n°136, marzo 1976.
8 Saint-Loup, Peau de l’aurochs, Paris, Editions de l’Homme libre, 2000.
9 Marc Augier, Les Skieurs de la nuit, Paris, Stock, 1944, pp. 16-17.
In edizione italiana sono usciti presso l’editore Volpe e Sentinella d’Italia (via Buonarroti 4 – 34074 Monfalcone) le seguenti opere di Saint-Loup:
Saint-Loup, I volontari europei delle Waffen SS, Volpe, 1967 (curatore Adriano Romualdi).
Saint-Loup, Il sangue d’Israele, Sentinella d’Italia, 1975.
Saint-Loup, I velieri fantasma di Hitler, Sentinella d’Italia, 1978.
Saint-Loup, I volontari. Storia della LVF contro il bolscevismo, Sentinella d’Italia, 1983.
Saint-Loup, Gli eretici. Storia della Divisione SS “Charlemagne”, Sentinella d’Italia, 1985.
Saint-Loup, I nostalgici, Sentinella d’Italia, 1991.
Traduzione italiana di Harm Wulf.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, fédéralisme, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
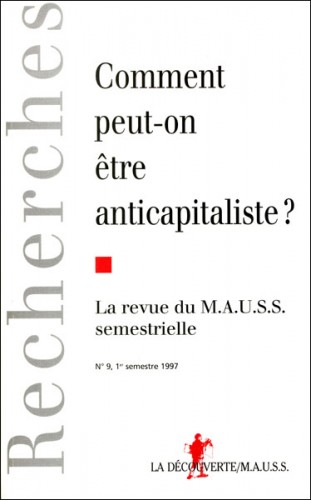
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Le M.A.U.S.S.: «Qu'est-ce que l'utilitarisme?»
La revue semestrielle du M.A.U.S.S. consacre son n°6 à «Qu'est-ce que l'utilitarisme? Une énigme dans l'histoire des idées». Elle le présente ainsi: «Depuis près de deux siècles, dans les pays de tradition anglo-saxonne, l'utilitarisme a constitué la philosophie morale et juridique de base. A ce titre, il a suscité de nombreux débats. Rien de tel en France où, depuis la grande thèse d'Elie Halévy, La Formation du radicalisme philosophique (1903), l'utilitarisme était oublié et ignoré. Toutefois, depuis quelques années, les philosophes et les chercheurs en sciences sociales relancent le débat sur l'utilitarisme. A en croire Halévy et la quasi-totalité des commentateurs de l'époque, le fondateur de l'utilitarisme est Jeremy Bentham (1748-1832): sa doctrine reposerait sur l'hypothèse que les sujets humains doivent être considérés comme des égoïstes calculateurs et rationnels. Pas du tout, rétorquent nombre d'interprètes contemporains: non seulement J. Bentham ne postule nullement le caractère dominant des motivations égoïstes, mais, en adoptant comme critère du juste et du bien la maximisation du bonheur du plus grand nombre, il plaide au contraire pour l'altruisme. On ne saurait rêver lectures plus radicalement opposées. Ce numéro de la Revue du M.A.U.S.S. semestrielle présente donc les diverses interprétations et suggère deux manières originales, et de surcroît probablement justes, de résoudre l'énigme. Pour la première, loin d'inventer l'utilitarisme, Bentham est celui qui achève une certaine tradition utilitariste vieille de plus de deux mille ans. Pour la seconde, cette tension insoluble entre égoïsme et altruisme est précisément ce qui caractérise l'utilitarisme moderne et post-benthamien amorcé par John Stuart Mill» (PM).
Editions La Découverte/La Revue du MAUSS, 9 bis rue Abel-Hovelacque, F-75.013 Paris, 290 p., 160 FF.
00:05 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, utilitarisme, anti-utilitarisme, économie, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
di Luca Leonello Rimbotti
Fonte: mirorenzaglia [scheda fonte]
Il vecchio storico inglese Thomas Carlyle insegnò con inclinazione romantica che l’eroismo ha molte facce, che quasi ogni aspetto della vita può essere interpretato come un momento in cui si può dispiegare una speciale attitudine verso l’ascesi di perfezione. Eroe è il Dio pagano che assomma su di sé tutte le qualità della stirpe, ma eroico può essere allo stesso modo lo spirito sacerdotale, ed eroi possono essere il profeta, il poeta, lo scrittore, il sovrano.
Era un gesuita, e dal gesuitismo imparò tutte quelle nozioni di affilata capacità di introspezione e di acuta conoscenza dei tempi e dei modi, che fecero di quell’ordine il tempio della dissimulazione e infine anche della sua degenerazione curiale, l’ipocrisia farisaica. In Gracián, tuttavia, si nota l’assoluta assenza di riferimenti ai dogmi cristiani: per questo, tenuto in sospetto dalla Compagnia di Gesù, fu prima ammonito, poi allontanato nel 1657 dalla cattedra e infine messo in condizione di non nuocere relegandolo presso un convento sperduto, con la tassativa proibizione di scrivere. Lo si accusava di aver intrapreso una precettistica del tutto profana sul saper vivere e, soprattutto, sul saper predominare sulle cose e sul mondo degli uomini, insomma di essere un laicissimo teorico di ciò che oggi chiameremmo una volontà di potenza in piena regola.
La recente pubblicazione de L’eroe (Bompiani), uno dei testi più celebri del trattatista aragonese, è l’occasione per verificare come il pensiero europeo si sia sempre misurato con queste categorie dell’essere e del mostrarsi, del fare e dell’avere ragione della realtà, in maniera che, dai sofisti e dagli stoici fino a Machiavelli, ai moralisti francesi o a Nietzsche e all’esistenzialismo, problema non da poco è sempre stato quello di avere a che fare col dispiegarsi dell’essere tra le penombre dell’apparire e del sembrare. Gracián insegnava la dissimulazione in quanto categoria dell’essere superiore e dell’innalzarsi al di là di se stessi, in un procedimento di continuo esercizio alla protezione dei propri fini. «Impedisca a tutti l’uomo colto di sondare il fondo della sua fonte, se da tutti vuole essere venerato…la metà è più del tutto, perché una metà ostentata e l’altra promessa, son più di un tutto dichiarato».
La velatezza dell’essere, in questo caso, non sarà un volgare atteggiamento di subdolo mascheramento volto all’inganno, ma, molto più sottilmente e nobilmente, lo strumento di una cerca dell’eccellenza, da ottenersi con il freno dei modi, la perfezione in ogni manifestazione di sé e un dosato ombreggiare i propri disegni. Qualcosa di propriamente “politico”, insomma: «Dissimulare una volontà sarà sovranità». In queste proposizioni sembra riecheggiare, in qualche modo, la dialettica heideggeriana circa il velamento della verità, secondo la struttura stessa della parola greca antica, che proponeva non a caso l’alfa privativo: a-lethéia, proprio nel senso che verità è essenzialmente un togliere veli per gradi. La dialettica sottile dell’apparire e del velarsi, lungi dall’essere solo un gioco femmineo di ritrosie seduttive, è in realtà, secondo la logica dell’etica tradizionale, il segreto della gloria. E la gloria, considerata dagli antichi l’unica e insieme la massima via all’eternità, è ugualmente per Gracián il premio al lavoro terreno dell’uomo di valore superiore.
In anni recenti è stato Emanuele Severino - il cui pensiero sappiamo essere sulla scia heideggeriana - a precisare i contorni del significato della gloria dal punto di vista esistenziale e tradizionale: «L’indefinita manifestazione dell’eterno, in cui la Gloria consiste e che indefinitamente si arricchisce, è il senso autentico della nostra destinazione per l’eternità». La gloria ha dunque a che fare col destino. E il destino ha a che fare con la fortuna e la fortuna con l’audacia, persino con l’azzardo. A patto che prima, dentro di sé, il temerario che si senta chiamato sulla via della gloria abbia percepito la concordanza della sua anima, tesa all’impossibile, con gli arcani segreti del fato. Difatti, in un passo de L’eroe si dice per l’appunto che la fortuna è «gran figlia della suprema provvidenza» e che «è regola da maestri compiuti nella politica discrezione notare la propria fortuna e quella dei propri sostenitori». Non diversamente la pensarono, a ben vedere, e magari senza aver letto un riga di Gracián, personaggi come Napoleone, che diceva di preferire generali fortunati a generali ben preparati, oppure come Hitler, che confessò più volte di aver giocato d’azzardo tutta la vita, sicuro di avere dalla sua parte la “provvidenza”. La fanatica fiducia in se stessi, quale suprema attitudine al comando in grado di piegare anche gli eventi sfavorevoli a proprio vantaggio, veniva da Gracián ricordata come dote dell’uomo di tempra superiore. E faceva l’esempio di Cesare, che al marinaio stanco e sfiduciato rivolse l’ammonimento: «Non dubitare, che offendi la fortuna di Cesare». Il dubbio interiore come ingiuria al destino. Quanto di meno cristiano e di più pagano si possa immaginare. Comprendiamo benissimo il motivo per cui lo scrittore venne messo al bando nella Spagna cattolicissima del gran secolo.
Tutto questo ha i contorni del tragico. Poiché in Gracián è ben vivo il senso di una lotta che l’eroe deve intraprendere prima di tutto su se stesso. Il controllo su ciò che appare e sulle occasioni che gli si presentano deve essere il frutto di un drammatico auto-controllo: questa volontà auto-imposta deve essere la sua signoria. Tanto che, se necessario, anche quando dentro l’uomo differenziato tutto lo sospingesse a dir di sì, la sua potenza e il suo comando interiore lo condurranno a un vittorioso dir di no. Questo si inserisce alla perfezione in quel dominio metafisico in cui si attua il contatto fra trascendenza e vita terrena. È ciò che gli antichi greci chiamavano kairòs, l’attimo fuggente, e i romantici tedeschi indicavano come der grosse Zufall, il grande caso fortunato. Saper cogliere il manifestarsi del momento in cui il destino si manifesta per cenni: la levigata sensibilità, quasi un istinto lungamente esercitato, saprà all’istante percepire questa epifania subitanea. Un evidenziarsi del sacro che indica il momento dell’agire. Poiché kairòs è suprema saggezza, è intima consonanza con gli interni voleri del fato, ma è anche sentimento di giustizia. Tradizionalmente, ciò che appare nel mondo, nell’immutabilità di ciò che è vero da sempre, oppure nell’improvviso irrompere dell’inatteso attraverso l’attimo, è anche ciò che è giusto: giusto è ciò che sa sopraggiungere al momento opportuno.
Una filosofia del rischio? Piuttosto, un’acuta capacità di percezione delle armonie e delle disarmonie del mondo. Nella sua introduzione a L’eroe, Antonio Allegra precisa che le sollecitazioni di Gracián verso l’affermazione di sé hanno il carattere di una libera alleanza col destino: «Occorre, in ogni caso, agire all’interno dello spazio della fortuna e del mondo: tutto sta nel potere ancora affermare un margine di libertà rispetto alla situazione integralmente mondana che si presenta, che va acutamente interpretata e colta nelle sue nascoste potenzialità». L’individuo differenziato, l’essere superiore costruito su un’elaborata e fanatica fiducia, si esprime attraverso la decrittazione dei segni lasciati cadere dal fato provvidenziale. Si tratta in fondo di un gioco: vince chi sa elaborare al massimo grado la dialettica tra il vivere all’occasione e l’essere uomo integro in grado di interpretare correttamente i segnali. L’individuo potenziato da questa superiore autocoscienza non è scelto dal caso, ma è lui stesso che sceglie l’attimo. Risolutezza e fulminea capacità di ricorrere alla decisione sono i sintomi dello spirito dominatore: «La prontezza fa da oracolo nei dubbi maggiori, sfinge negli enigmi, filo d’oro nei labirinti, e suole aver l’indole del leone, che riserva il massimo sforzo per quando ne ha più bisogno», scrive Gracián. Un manuale di politica: la golpe e il lione di Machiavelli, più un tocco di quel pessimismo barocco e manieristico che piacque tanto a Schopenhauer e che cercava di interpretare la complessità del mondo moderno allora già in agguato: L’eroe venne pubblicato nel 1637, l’anno di uscita del Discorso sul metodo di Cartesio. Ma anche una filosofia dell’intuito. Una vera mistica terrena dell’azione e del primato. In questo senso, la maschera che, secondo, Gracián, l’uomo superiore deve indossare per assicurarsi il dominio sul mondo non è un trucco plebeo, ma il necessario stigma della diversità: l’eroe gioca le sue maestrìe certo di non dover aprire a nessuno il suo cuore. Il mondo intriso di scaltrezze e di indegnità abbisogna di menti in grado di batterlo sul suo stesso terreno, mantenendo giusto il cuore. «Ti voglio singolare», suona l’esortazione con cui Gracián apre il suo pamphlet rivolgendosi al lettore, «qui avrai non una politica né un’economica, ma una ragion di stato di te stesso». La si direbbe una potente anticipazione di figure metapolitiche come l’Anarca jüngeriano oppure l’Autarca evoliano…
La fama di Gracián non si limitò alla sua epoca o ai momenti di insorgenza sovrumanista. In tempi recenti il suo nome ha riscosso un famigerato successo tra le turbe dei manager d’azienda…e il povero Gracián si è visto trascinare via dall’etica tradizionale aristocratica e dal suo stoicismo barocco, fin dentro le maleodoranti stanze dei consigli d’amministrazione, nei grattacieli americani: numerose edizioni dei suoi libri sono state vendute come il pane tra le schiere di yuppies alla ricerca del facile successo attraverso i manuali di auto-stima per piazzisti in carriera. I suoi libri hanno conosciuto l’onta di essere paragonati alle pubblicazioni a grande tiratura in uso sin dagli anni Cinquanta negli USA, ad esempio quelle a cura della Fondazione Carnegie: come vincere la paura degli altri, come avere successo nel lavoro…Noi aggiungiamo: come trascinare un filosofo del sovrumanismo europeo nel fango della morale da insetti tipica del liberalismo americano…
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, philosophie, 17ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

di Luca Leonello Rimbotti
Fonte: mirorenzaglia [scheda fonte]
Come sappiamo, nella cultura europea a cavallo tra Otto e Novecento - corrosa dal degrado positivista - D’Annunzio ha significato la rivolta romantica e dionisiaca del gesto audace, dell’istinto vittorioso, dell’immersione nella sensualità selvatica. Era la rivendicazione di un patrimonio di atavismi che il razionalismo moderno stava spegnendo con la sua violenta irruzione nei mondi della tradizione: di qui l’amore per la bellezza dorica - che l’Immaginifico assaporò nella sua crociera greca del 1895 -, per il lusso dell’estetica, per la volontà di potenza che crea il Superuomo.
In D’Annunzio c’è la sintesi del volontarismo di Nietzsche, dello slancio vitale di Bergson e della filosofia dell’azione di Blondel: in lui dunque si riassumono al meglio - nella poesia, nella narrativa, nella vita vissuta e poi nell’interventismo eroico del “poeta-soldato” - tutti i patrimoni culturali e ideologici che la vecchia Europa rilancerà in chiave tradizionale e anti-modernista. E con D’Annunzio, infatti, avremo il tipico rappresentante di quella figura di esteta armato che dominerà gli eventi a partire dalla guerra del 1914: da Jünger a Marinetti, da Soffici a Péguy ai vorticisti inglesi.
I messaggi di egualitarismo democratico e di individualismo borghese con cui il progressismo stava già allora sfibrando le radici europee, vennero rovesciati con una rivolta neo-pagana, nuova e antica, intesa a impugnare l’identità arcaica come un’arma estetica, letteraria e, infine, anche politica. Nel tardo Ottocento, D’Annunzio è già una guida per queste energie antagoniste, che saranno l’avanguardia europea delle future rivoluzioni nazionali del XX secolo.
Incastonato tra La Vergine delle rocce del 1895 e Il Fuoco del 1900, cioè i due bastioni del sovrumanismo nietzscheano rielaborato da D’Annunzio, c’è un piccolo capolavoro di solito trascurato dagli esegeti - forse perché al frivolo pubblico parigino dell’epoca non piacque il suo andamento sofoclèo e a quelli di oggi giunge estranea ogni forma di pensiero mitico -, ma che ben si inserisce nel filone neo-pagano, che è il fulcro di tutta l’opera dell’Inimitabile. Alludiamo al Sogno di un mattino di primavera, dramma “rinascimentale” buttato giù alla svelta nel 1897, nello spazio di pochi giorni, per placare il dispetto di Eleonora Duse [nel ritratto sotto a sinistra], cui pochi mesi prima era stata preferita Sarah Bernhardt nel ruolo di protagonista della Città morta.
In questo apice di vis tragica che è il Sogno, D’Annunzio dà fondo alla sua inesauribile vena visionaria. Del personaggio principale, Donna Isabella, la Demente, impazzita per essersi vista uccidere dal marito l’amante stretto tra le braccia, egli fa un’icona dell’uscita dalla normalità attraverso il più atroce dolore. E dell’ingresso in quell’arcano spazio aperto che è la follia, la grande follia. D’Annunzio scrisse il Sogno di un mattino di primavera in piena febbre nietzscheana: aveva da poco scoperto la grandezza recondita del Solitario, fu anzi tra i primi in Europa a capirne e divulgarne il genio rivoluzionario, ne rimase impregnato e ne impregnò molta parte della sua opera: pensiamo al Trionfo della morte, del 1894, in cui il “superuomo” Giorgio Aurispa esalta il «sentimento della potenza, l’istinto di lotta e di predominio, l’eccesso delle forze generatrici e fecondanti, tutte le virtù dell’uomo dionisiaco».
E proprio nel Sogno noi ritroviamo, schermati dietro il tragico destino individuale della pazza Isabella, questi stessi valori. Ciò che D’Annunzio definiva essenzialmente come la «giustizia dell’ineguaglianza». La Demente - creatura per definizione ineguale, inassimilabile alla normalità che appiattisce e livella - diventa il lato femminile e notturno del suprematismo virile e attivo proclamato da D’Annunzio. Chiusa in un micromondo claustrale, circondata dalle attenzioni cliniche dei “normali”, la pazza d’amore è lo specchio teatrale della follia vera in cui si rinchiuse Nietzsche. Ricordiamo che quando D’Annunzio scriveva questa sua prosa tragica, Nietzsche era ancora vivo, ma già da anni tutto avvolto da una pazzia inespressiva, che aveva ormai già dato tutto, e che era il prezzo che dovette pagare per aver troppo a lungo fissato le voragini della mente. Come l’Isabella di D’Annunzio, Nietzsche visse i suoi ultimi anni sorvegliato a vista dai “vivi”, per lo più ignari di quale profonda sapienza ci possa essere in simili fughe dalla “normalità”.
Bisogna tornare più spesso al D’Annunzio “minore”, a quello del Libro ascetico della Giovane Italia, dei Taccuini, della Vita di Cola di Rienzo… e a quello del Sogno di un mattino di primavera. Quando ripenso al D’Annunzio folgorale e insieme notturnale, alla sua capacità medianica di trasferire nei posteri i suoi mondi di apparizioni e di presenze arcane attraverso sedute di veri e propri transfert scenici, mi torna alla mente una rappresentazione del Sogno a cui ebbi modo di assistere anni fa, nel cortile del Palazzo del Bargello di Firenze. Qui prese corpo, dapprima lentamente, poi in maniera trascinante, la rarissima sintesi tra l’eloquenza traboccante della parola dannunziana e l’eloquenza muta dell’antica pietra squadrata: il Bargello, austero palazzo medievale. Questo prezioso vestigio della Firenze gotica e ghibellina, spazio di severità duecentesca un tempo sacrario del potere popolare, sede del Podestà e della Guardia del Capitano del Popolo, eretto da un Lapo Tedesco che fu forse il padre di Arnolfo di Cambio, è il luogo che meglio si prestava alla congiura dannunziana tra raffinatezza dei sensi e rigore della volontà politica. Qui D’Annunzio soleva venire e tornare, fermandosi davanti alle opere del Verrocchio, di Benedetto da Maiano, del Laurana…dai suoi Taccuini sappiamo che fu più volte al Bargello negli anni della sua residenza alla Capponcina di Firenze: aggirandosi tra quei capolavori, gli venne l’idea di fare una delle sue coltissime citazioni. E nel Sogno fa dire a Isabella di un busto di Desiderio da Settignano che lei teneva amorevolmente sulle ginocchia, consumandolo di pianto e di carezze.
Il Sogno di un mattino di primavera è un cammeo di prodigi. Qui D’Annunzio l’occulto, l’uomo d’arme che conosceva le tecniche dell’estasi, che invocava gli attimi visionari, che era sciamano, taumaturgo e profeta, ci mette a contatto con una creatura esiliata dalla vita, ma aperta a valori di eccezionale trascendenza. La Pazza si è fatta fare una veste verde, vuole diventare natura, vuole essere selva: «Ora potrò distendermi sotto gli alberi…non s’accorgeranno di me…sarò come l’erba umile ai loro piedi…vedo verde, come se le mie palpebre fossero due foglie trasparenti…io potrò dunque con gli alberi, con i cespugli, con l’erba essere una cosa sola…». E si fa guanti di rami, stringe ghirlande, si fascia di fili d’erba, aspetta di farsi bosco per rivivere in natura la natura selvaggia del suo amore. Impossibile non riandare, davanti a tali celebrazioni, a quella passione per la dimensione dionisiaca e panteista che, ad esempio, traspare in certe inquadrature del Trionfo della morte: l’epopea del «dominatore coronato da quella corona di rose ridenti di cui parla Zarathustra…». Qualcosa che ricorre di nuovo quando Giorgio Aurispa il solitario, nell’osservare il tramonto, sente pulsare gli annunci di Zarathustra nel trionfo di una natura esuberante, irta di colori che eccitano l’animo e fondono l’uomo con le più enigmatiche energie del creato. Perfetta creazione silvestre, simbolo compiuto di pagana immersione nella natura pànica, l’Isabella del Sogno reca anche archetipi di morte, di sangue e di scatenata sensualità.
Essa ci rimanda con naturale similitudine alla Wildfrau nordica, la “vergine selvatica” che percuote le notti durante la caccia selvaggia di Wotan, così come compare nel mito indoeuropeo della ridda, che accomuna mistero, magia e ancestrali terrori, giacenti nella sfera della natura barbarica e nel subconscio atavico dell’uomo: purissimo scrigno da cui sale - quando la si sa udire - la voce del sangue primordiale. Come spesso accade alla tregenda pagana, la morte e il dolore non sono tuttavia disgiunti da una sensualità istintuale. E, infatti, profondamente sensuale è il contatto di Isabella col corpo dell’amato morente, da cui sgorga sangue come da una fonte inesauribile. Il suo trauma si muta allora in una sorta di allucinazione orgasmica:
«…La sua bocca mi versava tutto il sangue del suo cuore, che mi soffocava; e i miei capelli n’erano intrisi; e il mio petto inondato; e tutta quanta io ero immersa in quel flutto…com’erano piene le sue vene e di che ardore! Tutto l’ho ricevuto sopra di me, fino all’ultima stilla; e gli urli selvaggi che mi salivano alla bocca io li ho rotti coi miei denti che stridevano, perché nessuno li udisse…».
In brani di rapimento erotico come questo - in cui, tra l’altro, non si è lontani neppure dagli estatici abbandoni alla voluttà del sangue presenti, ad esempio, nelle lettere di Santa Caterina da Siena: «Annegatevi nel sangue del Cristo crocifisso, bagnatevi nel sangue, saziatevi di sangue…» -, noi riconosciamo una miriade di rimandi alla sacralità pagana e neo-pagana del sangue, ai suoi occulti poteri fecondanti, alle sue qualità misteriche di infondere vita ulteriore, e proprio quando fuoriesce in fiotti, come seme di vita, da un corpo in travaglio di morte.

Basterà ricordare la libido di sangue ossessivamente presente nella tragedia greca, capace di celebrare l’amore di rango come una lotta spasmodica che non fa più differenza tra la vita e la morte, che riconosce nella carne viva, nel segno sensuale, un universo infinito, confine tra saggezza e follia scatenante: Pentesilea, ad esempio, di cui Kleist fece un superbo affresco del dramma romantico…ferro di lame e di scudi, ma anche di cuori. Tutto questo ebbe riverberi nella nostra poesia nazionalista dei poeti-soldati volontari nella Grande Guerra: amore e lotta celebrati in nozze mistiche di sangue. Ad esempio, in Vittorio Locchi o in Giosuè Borsi, il sangue dell’eroe caduto e riverso al suolo, con la bocca a toccare il terreno come in un bacio, diviene seme generatore, potenza che feconda la terra redenta, paragonata a una sposa che si lasci inondare il grembo dal flusso ancora caldo dello sposo morente. Nel poemetto di Locchi, un tempo famoso, intitolato La sagra di Santa Gorizia, la città da liberare attende il suo eroe come un’amante fremente: «Amore, amore dolce, mi vedi? Amore dolce, mi senti? - chiede l’amata - Quanti tormenti ancora, quanti tormenti prima degli sponsali?». È un misticismo di visionaria trance erotico-guerriera, che certo rinnova esplicitamente gli arcaici connubi di Eros e Thànatos. Ed è in un trionfo di celebrazioni al benigno destino, alla vita che vince la morte, alle armi che liberano lo spirito, che avviene alla fine l’apoteosi trasfiguratrice dell’unione tra la città-femmina, finalmente liberata, e il vittorioso eroe liberatore.
L’amore - ma non solo quello letterario, proprio quello vero…ma certo non quello “comune”…- è sempre a un passo dalla pazzia: c’è un frammento del Sogno, in cui Isabella viene assalita da gelido terrore nel vedere una coccinella posatasi sul suo candido braccio e da lei creduta una goccia di sangue: esatta trasposizione della demenza che impietrisce Parsifal nell’osservare la rossa goccia di sangue di un passero sulla neve immacolata…
Detto per inciso, sottesa al Sogno leggiamo una - certo non casuale - combinazione di fine simbolismo cromatico: il bianco dei lunghi capelli e dello spettrale volto di Isabella, il verde della sua mimesis selvatica e il rosso del sangue dell’amato: ed ecco qua i tre colori per i quali l’Orbo Veggente andrà a rischiare la vita, ormai anziano, sui fronti della Grande Guerra…È in situazioni come queste che noi, più che altrove, apprezziamo la fantastica capacità dannunziana di intrecciare una raffinata sensibilità con il primario istinto di vita. Se c’è un luogo in cui la follia diventa mistica percezione dell’Altrove, magia di poteri visionari, potenza che fonde in un unico rogo il dolore e la gioia, questo è l’amore pazzo e disperato: quello profondamente filosofico di Nietzsche, come quello semplicemente umano di Isabella. D’Annunzio, alla sua maniera di grande sensitivo, li visse e li rappresentò entrambi.
E li rappresentò anche nella vita vera vissuta, magari alla maniera di un sacerdote pagano che solennizzasse i riti della terra e del sangue. Tra i suoi amori folli, c’era infatti, e non minore, anche quello per l’Italia. Un suo legionario ricordò un giorno di come, già vecchio e cadente, al Vittoriale ogni tanto il Comandante amasse celebrare occulte comunioni insieme ai suoi fedelissimi: «sovente, la notte, adunato un piccolo numero di fedeli, alla rossastra luce fantastica di torce resinose, parla della nostra terra e della nostra stirpe, della nostra guerra e dei nostri Morti, dei nostri mari e delle nostre glorie; qui i compagni lo ritrovano, lo rivedono e lo risentono, come in trincea e come a Fiume». Una liturgia nibelungica per eredi della razza di Roma: esisteranno ancora da qualche parte, dispersi, solitari, silenziosi, uomini simili?
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres italiennes, littérature, littérature italienne, italie, paganisme, d'annunzio |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Manuel d'insurrection magique
Les éditions Hriliu publient sous le titre de Lettre du Commandant Marcos à son disciple sur les barricades un manuel d'insurrection magique qui se présente ainsi: «L'image médiatique, cette condensation matérielle des phantasmes de l'idéologie du capital, engendre désormais le monde. L'ère du Verseau n'est pas la paix; c'est la fin du monde objectif, et sa dévoration subjective par le capital. L'homme vit aujourd'hui dans les songes qui font les mondes, mais ces songes sont ceux des putains mercantiles, pas des dieux qui rêvent. Ce ne sont plus nos corps qui risquent la mort dans la minière comme du temps du prolétariat; ce sont nos âmes qui s'étiolent et s'éteignent dans les luisances de l'imaginaire planétaire marchand. La lutte des castes doit donc s'engager autour des moyens métaphysiques de production du réel. Or la Tradition a toujours affirmé qu'elle détenait ces moyens sous la forme de la Magie. Voici enfin les temps où la Magie doit imposer ses rêves et façonner les mondes». (Pierre MONTHÉLIE).
Hriliu c/o P. Pissier, Carrière Maïté, 17 rue Pellegri, F-46.000 Cahors,1996, 40 FF.
00:09 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, philosophie, livre, révolution, idéal révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook